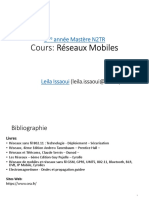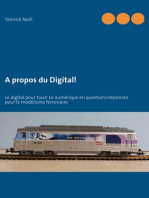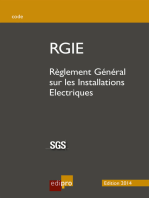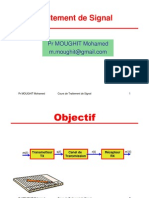Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
7480 Chap01 PDF
Transféré par
Zakaria KhatarTitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
7480 Chap01 PDF
Transféré par
Zakaria KhatarDroits d'auteur :
Formats disponibles
1
c
h
a
p
i
t
r
e
1
c
h
a
p
i
t
r
e
1
C
h
a
p
i
t
r
e
1
Les transmissions
et les supports
Un rseau suppose plusieurs quipements informatiques (ordinateurs xes ou portables,
divers quipements lectroniques, tlphones, assistants numriques personnels) situs
distance les uns des autres. La premire chose mettre en uvre pour constituer le rseau
est la transmission des informations dun quipement lautre : on utilise des supports de
transmission dont nous prsentons les caractristiques dans les deux premires sections.
chaque nature de support correspond une forme particulire du signal qui sy propage. Il
faut fabriquer les signaux, grce lquipement appel modem. Les techniques de transmis-
sion et linterface entre ordinateur et modem sont normalises pour assurer linteroprabi-
lit des quipements. Enn, nous dcrivons brivement le raccordement ADSL.
7480Book.indb 1 27/09/10 13:30
2010 Pearson France - Architecture des rseaux - Danile Dromard, Dominique Seret
A
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
d
e
s
r
s
e
a
u
x
2
1. Supports de transmission
Les supports de transmission sont nombreux. Parmi ceux-ci, on distingue : les supports
mtalliques, non mtalliques et immatriels. Les supports mtalliques, comme les paires
torsades et les cbles coaxiaux, sont les plus anciens et les plus largement utiliss ; ils
transportent des courants lectriques. Les supports de verre ou de plastique, comme les
fibres optiques, transmettent la lumire, tandis que les supports immatriels des com-
munications sans fil propagent des ondes lectromagntiques et sont en plein essor.
1.1. Paires torsades
Une paire torsade non blinde (UTP, Unshielded Twisted Pair) se compose de deux
conducteurs en cuivre, isols lun de lautre et enrouls de faon hlicodale autour de
laxe de symtrie longitudinal (voir figure 1.1).
Figure 1.1
Paire torsade.
2 conducteurs mtalliques
enrobs d'isolant et torsads
Lenroulement rduit les consquences des inductions lectromagntiques parasites
dues lenvironnement. Lutilisation courante de la paire torsade est le raccordement
des usagers au central tlphonique (la boucle locale ) ou la desserte des usagers de rseaux
privs. Son principal inconvnient est laffaiblissement des courants, dautant plus
important que le diamtre des conducteurs est faible. Les paires torsades contiennent,
intervalles rguliers, des rpteurs qui rgnrent les signaux. Quand plusieurs paires
sont rassembles dans un mme cble, les courants transports interfrent les uns avec
les autres. Ce phnomne est appel diaphonie.
La paire torsade suffit pour les rseaux locaux dentreprise o les distances se limitent
quelques kilomtres. Ses avantages sont nombreux : technique matrise, facilit de
connexion et dajout de nouveaux quipements, faible cot. Certains constructeurs pro-
posent des paires torsades blindes (STP, Shielded Twisted Pair) . Enrobes dun conduc-
teur cylindrique, elles sont mieux protges des rayonnements lectromagntiques
parasites. Une meilleure protection prvoit un blindage par paire.
1.2. Cbles coaxiaux
Pour viter les perturbations dues aux bruits externes, on utilise deux conducteurs
mtalliques cylindriques de mme axe spars par un isolant. Le tout forme un cble
coaxial (voir figure 1.2). Ce cble prsente de meilleures performances que la paire tor-
sade : affaiblissement moindre, transmission de signaux de frquences plus leves, etc.
La capacit de transmission dun cble coaxial dpend de sa longueur et des caractris-
tiques physiques des conducteurs et de lisolant. Sur 1 km, un dbit de plusieurs cen-
taines de Mbit/s peut tre atteint. Sur des distances suprieures 10 km, lattnuation
des signaux rduit considrablement les dbits possibles. Cest la raison pour laquelle on
utilise dsormais les fibres optiques sur les liaisons grandes distances.
S
Les supports
1.
7480Book.indb 2 27/09/10 13:30
2010 Pearson France - Architecture des rseaux - Danile Dromard, Dominique Seret
C
h
a
p
i
t
r
e
1
L
e
s
t
r
a
n
s
m
i
s
s
i
o
n
s
e
t
l
e
s
s
u
p
p
o
r
t
s
3
Figure 1.2
Cble coaxial.
2 conducteurs mtalliques
cylindriques de mme axe
spars par un isolant
Gaine extrieure isolante
(blinde ou non)
1.3. Fibre optique
Une fibre optique est constitue dun fil de verre trs fin. Elle comprend un cur, dans
lequel se propage la lumire mise par une diode lectroluminescente ou une source
laser (voir figure 1.3) et une gaine optique dont lindice de rfraction garantit que le
signal lumineux reste dans la fibre.
Figure 1.3
Fibre optique.
Gaine e xtr ieure isolant e
Un cur de fibre
Une gaine de fibre
avec un indice de
rfraction particulier
Les avantages de la fibre optique sont nombreux : diamtre extrieur de lordre de 0,1 mm,
poids de quelques grammes au kilomtre. Cette rduction de taille et de poids la rend facile
utiliser. En outre, sa trs grande capacit permet la transmission simultane de nombreux
canaux de tlvision, de tlphone Les points de rgnration des signaux sont plus loi-
gns (jusqu 200 km), du fait de lattnuation moindre de la lumire. Enfin, linsensibilit
des fibres aux parasites lectromagntiques est un avantage trs apprci, puisquune fibre
supporte sans difficult la proximit dmetteurs radiolectriques. On peut lutiliser dans
des environnements perturbs (avec de puissants champs lectromagntiques, par exemple).
Par ailleurs, elle rsiste bien aux carts de temprature. La fibre optique constitue la plupart
des artres des rseaux de tlcommunications et des rseaux locaux trs haut dbit.
Les premires fibres optiques employes dans les tlcommunications, apparues sur le
march partir des annes 1970, taient multimodes ( saut dindice ou gradient
dindice, selon que lindice de rfraction de la lumire varie de manire brutale ou
progressive entre le cur et la gaine de la fibre). Ces fibres taient rserves (et le sont
encore) aux dbits infrieurs au gigabit par seconde, sur des distances de lordre du
kilomtre. Plusieurs longueurs donde bien choisies se propagent simultanment en de
multiples trajets dans le cur de la fibre. Pour des dbits plus levs et des distances
plus longues, la fibre monomode, de fabrication plus rcente, plus fine, assure la pro-
pagation dune seule longueur donde dans son cur (quelques micromtres de dia-
mtre) et offre donc de meilleures performances.
1.4. Transmissions sans fil
Les ondes lectromagntiques se propagent dans latmosphre ou dans le vide (le terme
dther dsigne parfois ce type de support). Labsence de support matriel apporte une
certaine souplesse et convient aux applications comme la tlphonie ou les tlcommu-
nications mobiles, sans ncessiter la pose coteuse de cbles.
7480Book.indb 3 27/09/10 13:30
2010 Pearson France - Architecture des rseaux - Danile Dromard, Dominique Seret
A
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
d
e
s
r
s
e
a
u
x
4
Faisceaux hertziens
Les faisceaux hertziens reposent sur lutilisation de frquences trs leves (de 2 GHz
15 GHz et jusqu 40 GHz) et de faisceaux directifs produits par des antennes direction-
nelles mettant dans une direction donne. La propagation des ondes est limite lho-
rizon optique ; la transmission se fait entre des stations places en hauteur, par exemple
au sommet dune colline, pour viter les obstacles dus aux constructions. Les faisceaux
hertziens sutilisent pour la transmission par satellite, pour celle des chanes de tlvi-
sion ou pour constituer des artres de transmission longues distances dans les rseaux
tlphoniques.
Ondes radiolectriques
Les ondes radiolectriques correspondent des frquences comprises entre 10 kHz et
2 GHz. Un metteur diffuse ces ondes captes par des rcepteurs disperss gographi-
quement. Contrairement aux faisceaux hertziens, il nest pas ncessaire davoir une visi-
bilit directe entre metteur et rcepteur, car celui-ci utilise lensemble des ondes
rflchies et diffractes. En revanche, la qualit de la transmission est moindre car les
interfrences sont nombreuses et la puissance dmission est beaucoup plus faible.
Remarque
Lattribution des bandes de frquences varie selon les pays et fait lobjet daccords internatio-
naux. Le tableau1.1 donne les grandes lignes de la rpartition des ondes en France. On constate
que le dcoupage est complexe et quil reste peu de place pour de nouvelles applications.
Tableau 1.1 : Affectation des frquences en France
Gamme de frquences Type dutilisation
10 kHz 150 kHz Communications radiotlgraphiques
150 kHz 300 kHz Radiodiffusion (grandes ondes)
510 kHz 1 605 kHz Radiodiffusion (petites ondes)
6 MHz 20 MHz Radiodiffusion (ondes courtes)
29,7 MHz 41 MHz Radiotlphonie
47 MHz 68 MHz Tlvision
68 MHz 87,5 MHz Liaisons radio en modulation de frquence
87,5 MHz 108 MHz Radiodiffusion
108 MHz 162 MHz Radiotlphonie
162 MHz 216 MHz Tlvision
216 MHz 470 MHz Radiotlphonie
470 MHz 860 MHz Tlvision et radar
860 MHz 960 MHz Radiotlphonie
Autour de 1 800 MHz Radiotlphonie
Entre 6 et 30 GHz Services satellites en xe
7480Book.indb 4 27/09/10 13:30
2010 Pearson France - Architecture des rseaux - Danile Dromard, Dominique Seret
C
h
a
p
i
t
r
e
1
L
e
s
t
r
a
n
s
m
i
s
s
i
o
n
s
e
t
l
e
s
s
u
p
p
o
r
t
s
5
2. Caractristiques globales
des supports de transmission
Quelle que soit la nature du support, le signal dsigne le courant, la lumire ou londe
lectromagntique transmis. Certaines caractristiques des supports (bande passante,
sensibilit aux bruits, limites des dbits possibles) en perturbent la transmission. Leur
connaissance est ncessaire pour fabriquer de bons signaux, cest--dire les mieux
adapts aux supports utiliss.
2.1. Bande passante
Les supports ont une bande passante limite. Certains signaux sy propagent correcte-
ment (ils sont affaiblis mais reconnaissables lautre extrmit), alors que dautres ne les
traversent pas (ils sont tellement affaiblis ou dforms quon ne les reconnat plus la
sortie). Intuitivement, plus un support a une bande passante large, plus il transporte
dinformations par unit de temps.
Dfnition
La bande passante est la bande de frquences dans laquelle les signaux appliqus lentre du
support de transmission ont une puissance de sortie suprieure un seuil donn aprs traverse
du support. Le seuil fx correspond un rapport dtermin entre la puissance du signal dentre
et la puissance du signal trouv la sortie (voir fgure1.4). En gnral, on caractrise un support
par sa bande passante 3dB ( dcibels), cest--dire par la plage de frquences lintrieur de
laquelle la puissance de sortie est, au pire, divise par deux. Si on noteP
s
la puissance de sortie
etP
e
la puissance dentre, lafaiblissementA en dcibels est donn par la formule:
A=10 log
10
P
s
/P
e
; pour P
s
/P
e
=0,5, on trouve: 10 log
10
P
s
/P
e
=3dB
Figure 1.4
Notion de bande
passante.
Puissance du signal reu
Frquences
Ps
Pe
Pe
2
Bande passante 3 dB
Bande passante
C
d
2.
7480Book.indb 5 27/09/10 13:30
2010 Pearson France - Architecture des rseaux - Danile Dromard, Dominique Seret
A
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
d
e
s
r
s
e
a
u
x
6
2.2. Bruits et distorsions
Les supports de transmission dforment les signaux quils transportent, mme lorsque
leurs frquences sont adaptes, comme lillustre la figure 1.5. Diverses sources de bruit
perturbent les signaux : parasites, phnomnes de diaphonie Certaines perturbations
de lenvironnement introduisent galement des bruits (foudre, orages pour le milieu
arien, champs lectromagntiques dans des ateliers).
Par ailleurs, les supports affaiblissent et retardent les signaux. La distance est un facteur
daffaiblissement, trs important pour les liaisons par satellite. Ces dformations, appe-
les distorsions, sont gnantes pour la bonne reconnaissance des signaux en sortie, dau-
tant quelles varient avec la frquence et la phase des signaux mis.
Figure 1.5
Signal mis et exemple
de signaux reus.
Signal mis
Exemple de
signal reu
Mme lorsque les signaux sont adapts aux supports, on ne peut pas garantir leur rcep-
tion correcte 100 %. Le rcepteur dun signal doit prendre une dcision dans un laps
de temps trs court. De ce fait, cette dcision peut tre mauvaise. Par exemple, un sym-
bole 1 mis donne une dcision symbole 0 reu , ce qui constitue une erreur de trans-
mission. Les fibres optiques sont les meilleurs supports, car le taux derreur y est trs
faible : 10
12
(une mauvaise dcision pour 10
12
bits transmis). Les cbles et les supports
mtalliques prsentent des taux derreur moyens. Les liaisons sans fil ont un taux der-
reur variable, sensible aux conditions mtorologiques.
2.3. Capacit limite des supports de transmission
La capacit dun support de transmission mesure la quantit dinformations transporte
par unit de temps. Les caractristiques que nous venons de voir fait que la capacit dun
support est limite. Un thorme d Shannon
1
exprime, en bits par seconde, la borne
maximale de la capacit Cap
Max
dun support de transmission :
Cap
Max
= W log
2
(1 + S/B)
1. Claude Shannon (1916-2001), mathmaticien amricain qui a dvelopp la thorie de linformation.
7480Book.indb 6 27/09/10 13:30
2010 Pearson France - Architecture des rseaux - Danile Dromard, Dominique Seret
C
h
a
p
i
t
r
e
1
L
e
s
t
r
a
n
s
m
i
s
s
i
o
n
s
e
t
l
e
s
s
u
p
p
o
r
t
s
7
Dans cette formule, W est la largeur de la bande passante du support exprime en hertz,
S/B reprsente la valeur du rapport entre la puissance du signal (note S) et la puissance
du bruit (note B) ; la base 2 du logarithme sert exprimer la quantit dinformations
en bits (voir section 4.2).
Exemple
Sur une liaison tlphonique dont la bande passante a une largeur de 3100Hz et un rapportS/B
correspondant 32dB (valeurs courantes), on obtient:
10log
10
S/B=32, donc log
10
S/B=3,2 soit S/B=1585;
Cap
Max
=3100 log
2
(1+1585); comme 1586=210,63, Cap
Max
=3100 10,63=33000bit/s.
2.4. Qualit des cbles
La qualit dun cble de paires torsades est dfinie par sa catgorie : celle-ci correspond
des normes internationales (voir section 6). titre dexemple, le cble de catgorie 5
(norme de rfrence EIA/TIA 568A de 1994) contient quatre paires aux couleurs denro-
bage normalises (bleu, orange, vert et brun) avec une impdance de 100 dune lon-
gueur de 100 m, supportant une frquence maximale de 100 MHz, pour un dbit
infrieur 1 Gbit/s et des caractristiques prcises de diaphonie (27 dB), de pertes en
retour (8 dB) et daffaiblissement (24 dB par tranche de 90 m).
Un cble de catgorie suprieure, 5e par exemple, supporte jusqu 155 MHz avec de
meilleures caractristiques de diaphonie (30 dB) et de pertes en retour (10 dB). Le
connecteur de raccordement de ces cbles est la prise RJ45. Les normes spcifient aussi
le type disolation et de blindage utilis entre les diffrentes paires du cble.
Les rseaux voluant vers des dbits toujours plus levs, les instances de normalisation
ont travaill la dfinition de standards de cblage plus performants : catgorie 6 (fr-
quence maximale 250 MHz et dbit infrieur 10 Gbit/s), voire catgorie 7 qui utilise
une connectique diffrente et que lon rserve aux environnements o les exigences de
scurit et de performances sont trs leves.
Le choix dun support de transmission dpend de nombreux lments. Des considrations
conomiques (le prix de revient, le cot de sa maintenance, etc.) interviennent en plus des
facteurs techniques, de mme que la nature des signaux propags, puisque lquipement
de transmission de donnes contient une partie spcifique au support. Examinons main-
tenant les techniques de transmission du signal vhiculant les donnes sur le support.
3. Techniques de transmission
Selon les techniques de transmission, un quipement spcifique est plac chaque
extrmit du support : soit un modem (modulateur-dmodulateur), soit un codec
(codeur-dcodeur). Cet quipement, baptis modem dans la suite, fabrique, avec les
donnes binaires mettre, un signal dont les caractristiques sont adaptes au support
de transmission. Inversement, en rception, il extrait la suite des donnes binaires du
signal reu. Le support et les deux modems placs ses extrmits constituent le circuit
de donnes (voir figure 1.6).
T
Selon les tec
3.
7480Book.indb 7 27/09/10 13:30
2010 Pearson France - Architecture des rseaux - Danile Dromard, Dominique Seret
A
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
d
e
s
r
s
e
a
u
x
8
Dfnition
Le circuit de donnes est une entit capable denvoyer ou de recevoir une suite de donnes bi-
naires, un dbit donn, dans un dlai donn et avec un taux derreur dpendant du support
utilis.
Figure 1.6
quipements
constitutifs
dun circuit de
donnes.
DVD ROM
CDR-W ROM
HD
Power
Ordinateur
DVD ROM
CDR-W ROM
HD
Power
Ordinateur
Modem Modem Techniques de
transmission
Circuit de donnes
Historiquement, les modems taient des quipements matriels de taille moyenne puis
rduite, mais distincts des ordinateurs terminaux. Aujourdhui, ils sont souvent int-
grs dans une carte rseau lintrieur de lordinateur.
Lquipement metteur fournit au modem les donnes transmettre. Ce dernier les
met sous forme dun signal deux valeurs (correspondant 0 et 1), appel message de
donnes synchrone (voir figure 1.7). En effet, les intervalles de temps allous chaque
symbole sont gaux et concident avec les priodes successives dune base de temps (ou
horloge) indispensable linterprtation du message de donnes par le rcepteur.
Remarque
Lutilisation dun circuit de donnes dpend de la nature des modems situs aux extrmits du
support de transmission. La communication est en mode duplex intgral si la transmission simul-
tane est possible dans les deux sens. Si elle nest possible que dans un seul sens un moment
donn (transmission lalternat), le circuit est semi-duplex. Enfn, le circuit est simplex lorsque la
transmission ne se fait que dans un seul sens prdfni.
Figure 1.7
Message de donnes
synchrone.
0
1
0 1 1 1 0 0 0 1
T
Signal d'horloge
associ
Le message de donnes synchrone utilise une reprsentation conventionnelle de linfor-
mation. La plus habituelle est un signal binaire sans retour zro, dit NRZ (No Return
to Zero). Comme lillustre la figure 1.8, on utilise un niveau de tension +a pendant une
priode complte pour reprsenter la valeur 1 de 1 bit, et un niveau a pour sa valeur 0.
7480Book.indb 8 27/09/10 13:30
2010 Pearson France - Architecture des rseaux - Danile Dromard, Dominique Seret
C
h
a
p
i
t
r
e
1
L
e
s
t
r
a
n
s
m
i
s
s
i
o
n
s
e
t
l
e
s
s
u
p
p
o
r
t
s
9
Figure 1.8
Reprsentation dune
information en NRZ.
a
+a
0 1 1 1 0 0 0 1
Certains supports autorisent une transmission directe des signaux numriques appele
transmission en bande de base. Cette technique conduit des ralisations simples et co-
nomiques. Quand les frquences des signaux ne concident pas avec la bande passante
du support, des techniques de modulation sont indispensables. Nous dcrivons succinc-
tement les techniques de transmission en bande de base et par modulation.
3.1. Transmission en bande de base
Dans la transmission en bande de base, lquipement qui fabrique les signaux est un
codec. Il code le message de donnes synchrone en une suite de signaux compatibles
avec les caractristiques physiques du support (le codec effectue un simple transcodage
du signal que lui fournit lmetteur). Plusieurs facteurs expliquent les difficults ren-
contres dans la transmission en bande de base : la limitation de la bande passante dans
les basses comme dans les hautes frquences et le fait quil faille transfrer les donnes
quelle que soit leur valeur. Les longues suites de 0 ou de 1 engendrent des problmes la
rception.
Remarque
Le codec qui met en uvre une transmission en bande de base est parfois appel modem bande
de base par abus de langage, bien quil ne fasse pas de modulation.
Le codec rcepteur doit reconstituer le signal dhorloge associ aux donnes. Pour ce
faire, deux techniques de transmission de lhorloge sont envisageables : soit indpen-
damment du message de donnes (ce qui consomme une partie de la puissance dispo-
nible pour le signal), soit laide des transitions du signal cod (il faut que le signal
prsente suffisamment de transitions). Dans le cas o les donnes transmettre contien-
nent de longues suites de bits identiques, le signal NRZ reste la mme valeur long-
temps, provoquant ainsi une absence de repre temporel pour le codec rcepteur, do
un risque de perte de synchronisation. On ne transmet pas directement le signal en NRZ
mais sous une forme voisine, qui tient compte des contraintes prcdentes. Le code
biphase est un exemple trs connu de codage pour la transmission en bande de base.
Le code biphase, ou code Manchester (voir figure 1.9), utilise une reprsentation deux
niveaux : pendant chaque intervalle de temps correspondant un symbole binaire,
deux polarits opposes sont transmises. Selon la donne coder, on trouve un front
montant (transition vers le haut) ou un front descendant (transition vers le bas) au
milieu de lintervalle de temps significatif. Une transition du signal a lieu chaque
intervalle de temps, ce qui garantit une bonne synchronisation entre les deux codecs et
facilite le travail de dcision du rcepteur.
7480Book.indb 9 27/09/10 13:30
2010 Pearson France - Architecture des rseaux - Danile Dromard, Dominique Seret
A
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
d
e
s
r
s
e
a
u
x
10
Remarque
Le code Manchester est le code le plus frquemment employ dans les transmissions num-
riques. Il sutilise en particulier dans les rseaux locaux Ethernet.
Figure 1.9
Code biphase ou
Manchester.
a
+a
0 1 1 1 0 0 0 1
3.2. Transmission par modulation
La transmission par modulation consiste envoyer une onde sinusodale appele por-
teuse. En fonction de la donne transmettre, le modem modifie lun des paramtres de
la porteuse (frquence, phase ou amplitude). Soit a cos(2f
0
t + ) une porteuse de fr-
quence f
0
, et d(t) la suite des donnes binaires transmettre (le message de donnes
synchrone de la figure 1.7 par exemple). Appelons lintervalle de temps significatif
pendant lequel d(t) vaut 0 ou 1, cest--dire que d(t) est constant sur lintervalle [t, t + [.
Une modulation simple (voir figure 1.10) consiste modifier la porteuse et mettre le
signal produit pendant lintervalle (qui dpend du dbit binaire utilis). Sur cet inter-
valle, la donne transmettre peut prendre deux valeurs (0 ou 1), et le signal aura deux
valeurs (par exemple, les deux amplitudes a k et a + k).
En modulation damplitude simple, lamplitude du signal transmis change avec les donnes.
Ainsi, pendant lintervalle [t, t + [, le signal transmis vaudra : m(t) = (a k) cos(2f
0
t + )
si d(t) = 0 et m(t) = (a + k) cos(2f
0
t + ) si d(t) = 1. Dans ces expressions, k est une
constante. la rception, pendant lintervalle [t, t + [, le modem mesure lamplitude du
signal reu et en dduit la valeur de la donne d(t).
En modulation de frquence simple, la frquence du signal transmis change avec les don-
nes. Ainsi, pendant lintervalle [t, t + [, le signal transmis sera : m(t) = a cos(2(f
0
h)
t + ) si d(t) = 0 et m(t) = a cos(2(f
0
+ h)t + ) si d(t) = 1, expressions dans lesquelles h
est une constante. Pendant lintervalle [t, t + [, le modem mesure la frquence du
signal reu et en dduit la valeur de d(t).
En modulation de phase simple, la phase du signal transmis change avec les donnes.
Ainsi, pendant lintervalle [t, t + [, le signal transmis sera : m(t) = a cos(2f
0
t + ) si
d(t) = 0 et m(t) = a cos(2f
0
t + ( +)) si d(t) = 1. Pendant lintervalle [t, t + [, le
modem mesure la phase du signal reu et en dduit la valeur de d(t).
Pour atteindre des dbits levs, on peut rduire lintervalle . Si on remplace par /3,
linformation d(t) change chaque intervalle /3, de mme que le signal modul. Le
rcepteur na plus quun intervalle /3 pour effectuer ses mesures et prendre sa dcision.
Cette mthode devient peu fiable si on rduit trop lintervalle. On prfre dcoupler
lintervalle de variation des donnes, dsormais not , de lintervalle de variation du
signal modul, toujours not ; on parle alors de modulation complexe. Par exemple,
si vaut /3, les donnes contiennent 3 bits sur un intervalle (soit huit valeurs diff-
rentes) : le signal modul prend, pendant , une valeur parmi les huit possibles. Le
nombre de valeurs du signal, not V, sappelle la valence.
7480Book.indb 10 27/09/10 13:30
2010 Pearson France - Architecture des rseaux - Danile Dromard, Dominique Seret
C
h
a
p
i
t
r
e
1
L
e
s
t
r
a
n
s
m
i
s
s
i
o
n
s
e
t
l
e
s
s
u
p
p
o
r
t
s
11
Figure 1.10
Exemples de
modulations
simples.
0 1 1 1 0 0 0 1
Modulation
d'amplitude
Modulation
de frquence
Modulation
de phase
Lintrt dune modulation rside dans le choix de la frquence f
0
de la porteuse, afin que
le signal transmis trouve sa place dans la bande passante du support. Si cette dernire est
large, le signal ne loccupe pas entirement : il est possible dy juxtaposer plusieurs autres
signaux dont les frquences de porteuse f
i
sont choisies pour viter les interfrences ;
cette technique est appele multiplexage . Nous en verrons un premier exemple avec
lADSL plus loin et nous y reviendrons au chapitre 3. La garantie dune interoprabilit
maximale entre quipements de constructeurs diffrents repose sur des techniques de
transmission normalises lchelle internationale (voir section 6).
4. Circuit de donnes
Nous avons vu que lintroduction dune distance entre quipements informatiques
ncessite un support de transmission et que les modems cachent la nature relle du sup-
port lutilisateur (pour lequel elle est transparente). Du circuit de donnes, celui-ci ne
connat que le dbit binaire utilis pour la transmission.
4.1. Qualit du circuit de donnes
La qualit du circuit de donnes se mesure selon diffrents critres techniques :
Le taux derreurs est le rapport entre le nombre de bits errons, sur le nombre total de
bits transmis.
La disponibilit value la proportion de temps pendant lequel la transmission est pos-
sible (absence de panne ou de coupure).
C
Nous avons
4.
7480Book.indb 11 27/09/10 13:30
2010 Pearson France - Architecture des rseaux - Danile Dromard, Dominique Seret
A
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
d
e
s
r
s
e
a
u
x
12
Le dbit binaire D reprsente le nombre de bits transmis par seconde.
La rapidit de modulation R, exprime en bauds
2
, caractrise le rythme de travail du
modem et mesure le nombre dintervalles significatifs par unit de temps. Si repr-
sente la dure en secondes de lintervalle significatif, alors R = 1/ bauds. La formule
D = R log
2
V exprime la relation liant la rapidit de modulation au dbit binaire.
Le dlai de propagation dfinit le temps ncessaire au signal pour traverser le support. Par
exemple, il faut environ un quart de seconde un signal se propageant la vitesse de la
lumire pour parcourir une distance de 72 000 km (cas des satellites gostationnaires).
Remarques
1. Pour des modulations simples des signaux de valence2, chaque intervalle transporte
1bit. Les valeurs numriques du dbit binaire et de la rapidit de modulation sont gales.
Dans le langage courant, on ne fait pas la distinction entre ces deux notions: certains expri-
ment mme le dbit en bauds.
2. Pour un support de transmission, la rapidit de modulation maximale dpend de sa bande
passante ( critre de Nyquist). La rapidit de modulation maximale R
max
est gale au double
de la frquence la plus leve disponible sur le support: R
max
=2F
max
.
4.2. Interface ordinateur-modem externe
Depuis bientt 20 ans, on utilise le port srie USB (Universal Serial Bus) dont la version
la plus rapide supporte jusqu 480 Mbit/s pour raccorder un modem externe un
ordinateur. Celui-ci permet de brancher ou de dbrancher le modem chaud sans avoir
redmarrer lordinateur. Presque tous les appareils (scanners, imprimantes, appareils
photo) sont dots dun tel port, ce qui simplifie grandement la connectique. Le port
USB contient quatre circuits : un pour lalimentation, deux pour les donnes (un par
sens de transmission) et une terre de protection. Le dialogue de linterface se droule
directement sur les circuits de donnes, par des changes de messages cods, dans un
dialogue totalement contrl par lordinateur. Cette dernire caractristique prive le
modem dinitiative en cas de rception de donnes. Cest la raison pour laquelle on pr-
fre dsormais relier lordinateur au modem externe en considrant que ces deux qui-
pements sont relis par un rseau filaire ou sans fil. Les rseaux les plus utiliss cet effet
sont Ethernet et Wi-Fi
(que nous dtaillons au chapitre 4).
5. ADSL (Asymmetric Digital
Subscriber Line)
LADSL fait partie dune famille daccs haut dbit (le nom gnrique xDSL est donn
ces techniques de transmission), qui recourt aux lignes tlphoniques ordinaires comme
support de transmission. LADSL utilise la boucle locale raccordant chaque usager du tl-
phone au central tlphonique dont il dpend. LADSL fait cohabiter, sur la ligne de
labonn, les donnes numriques (provenant dun ordinateur par exemple) et le tlphone
vocal. Les deux quipements sutilisent ainsi simultanment sans interfrences.
2. Le mot baud vient dmile Baudot (1845-1903), ingnieur franais.
A 5.
7480Book.indb 12 27/09/10 13:30
2010 Pearson France - Architecture des rseaux - Danile Dromard, Dominique Seret
C
h
a
p
i
t
r
e
1
L
e
s
t
r
a
n
s
m
i
s
s
i
o
n
s
e
t
l
e
s
s
u
p
p
o
r
t
s
13
Une des caractristiques de lADSL tient dans son nom : le dbit est diffrent dans les
deux sens de transmission ; le sens le moins rapide possde un dbit environ 10 fois
infrieur lautre sens. Le dbit disponible dpend de la longueur et de ltat de la boucle
locale. Ces deux facteurs dterminent, linitialisation, le dbit maximal offert
labonn. Au dpart, lADSL permettait dmettre jusqu 8 Mbit/s dans le sens descen-
dant (du fournisseur vers lusager) et jusqu 800 kbit/s dans le sens montant (de lusager
vers le fournisseur). Les dernires versions offrent des dbits pouvant aller jusqu
50 Mbit/s. Les deux dbits sont diffrents car lADSL considre que lusager tlcharge
beaucoup plus dinformations, en particulier lorsquil visite des sites Web, quil nen
met lui-mme vers les sites distants.
Dans le central tlphonique, les deux types de systmes coexistent : le rseau de don-
nes (le rseau du fournisseur daccs) vient se greffer sur le rseau tlphonique clas-
sique, les deux rseaux utilisant la ligne de labonn (voir figure 1.11). Un quipement
appel rpartiteur (splitter) est responsable de lclatement et de la recombinaison des
deux types de signaux dans le central et chez labonn (indispensable chez ce dernier
uniquement lorsquil se sert dun tlphone numrique ; il faut sparer les canaux utili-
ss pour la tlphonie de ceux employs pour la transmission des donnes). Pour un
tlphone analogique, un simple filtre plac devant le tlphone de labonn suffit. Il
transmet le signal ADSL au modem qui extrait les informations numriques pour
lordinateur.
Figure 1.11
Raccordement
ADSL.
DVD ROM
CDR-W ROM
HD
Power
Super Modem X56
Commutateur
tlphonique
classique
Ligne
tlphonique
Tlphone
Rpartiteur
Sparation
voix-donnes
Vers un fournisseur
Modem
ADSL
Rpartiteur
Sparation
voix-donnes
La transmission des donnes de lADSL utilise une modulation particulire (DMT, Discrete
MultiTone) , spcifiquement adapte aux caractristiques physiques des lignes dabonns
sur une courte distance (gnralement moins de 3,5 km) et utilisant des dbits diffrents.
Cette modulation combine deux mthodes (modulation damplitude et modulation de
phase) avec une rapidit de modulation de 4 000 bauds sur chaque porteuse, sachant que
la bande passante est subdivise en 256 canaux sur un accs. Les frquences les plus basses
[4,3 64,7 kHz] sont disponibles pour la voie tlphonique classique ; la bande comprise
entre 69 et 133,7 kHz sert la transmission de lusager vers le rseau (sens montant). Enfin
la plus grande partie de la bande [138 1 099,7 kHz] est utilise pour la transmission du
rseau vers labonn ou sens descendant (voir figure 1.12).
7480Book.indb 13 27/09/10 13:30
2010 Pearson France - Architecture des rseaux - Danile Dromard, Dominique Seret
A
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
d
e
s
r
s
e
a
u
x
14
Figure 1.12
Partage de la
bande passante
dans un accs
ADSL.
Tlphonie
(4,3 64,7 kHz)
Liaison descendante
(138 1100 Hz)
Frquences (kHz)
de la ligne ADSL
Liaison montante
(69 133,7 kHz)
Chez labonn, linterface entre lordinateur et le modem ADSL peut utiliser soit un
cble et un port USB, soit un cble et un port Ethernet ou encore une liaison sans fil
(Wi-Fi). Si lusager a contract un abonnement supportant des communications tl-
phoniques, des programmes de tlvision et des donnes informatiques (offre triple
play), le modem est alors intgr dans un botier baptis box par les fournisseurs daccs.
Ce botier se raccorde au tlphone (prise RJ11) et au tlviseur (prise Pritel, par
exemple) et possde en plus un port Ethernet ou une liaison sans fil pour les ordinateurs
et autres quipements informatiques.
6. Normalisation
Dans des domaines techniques comme les rseaux et les tlcommunications, la norma-
lisation rpond aussi bien aux attentes des consommateurs quaux besoins des fabri-
cants. Dun ct, elle offre aux utilisateurs la garantie que deux produits aux fonctions
identiques mais de fabricants diffrents fonctionneront correctement ensemble. De
lautre, les industriels peuvent esprer toucher un plus grand nombre de clients grce
la normalisation. En effet, toute solution propritaire provoque la rticence des utilisa-
teurs et des entreprises dpendre dun seul fournisseur pour leur approvisionnement :
si certains quipements sont vitaux pour la survie mme de lentreprise, la continuit du
service impose de disposer de sources indpendantes dapprovisionnement.
Diffrents organismes de normalisation dictent des avis qui couvrent tous les aspects
dun quipement : aspects lectriques, mcaniques, connectique Les principaux orga-
nismes internationaux de normalisation regroupent des reprsentants des industriels,
des administrations, des utilisateurs : lISO
3
et lITU (International Telecommunications
Union)
4
.
On trouve galement divers groupements de constructeurs comme : lECMA (European
Computer Manufacturer), lEIA (Electronic Industries Association) Dans Internet,
lIAB (Internet Architecture Board) dfinit la politique du rseau long terme alors que
lIETF (Internet Engineering Task Force) soccupe de lhomognit des solutions et
publie les RFC (Request For Comments).
3. Le nom de lorganisation donnerait lieu des abrviations diffrentes selon les langues (IOS pour International
Organisation for Standardization, en anglais ; OIN pour Organisation internationale de normalisation, en fran-
ais). Il a t dcid demble dadopter un mot provenant du grec isos (gal), pour que la forme abrge du nom
de lorganisation soit toujours ISO.
4. Cette instance a remplac le CCITT (Comit consultatif international pour le tlgraphe et le tlphone) et le
CCIR (Comit consultatif international pour les radiocommunications).
q
N
Dans des dom
6.
7480Book.indb 14 27/09/10 13:30
2010 Pearson France - Architecture des rseaux - Danile Dromard, Dominique Seret
C
h
a
p
i
t
r
e
1
L
e
s
t
r
a
n
s
m
i
s
s
i
o
n
s
e
t
l
e
s
s
u
p
p
o
r
t
s
15
Une norme passe par plusieurs tapes : le rsultat des compromis entre les diffrentes
parties sexprime dans un document brouillon (draft) ; la forme stable est publie sous
forme de draft proposal. Le Draft International Standard est la forme quasiment dfini-
tive du document. Il constitue une base de travail pour les industriels. Enfin, lIS
(International Standard) est la forme dfinitive. Lorganisme considr publie cette der-
nire, en utilisant une rfrence qui dpend de son domaine dapplication.
Rsum
Pour relier deux quipements informatiques loigns lun de lautre, on utilise un circuit
de donnes constitu par un support de transmission, des modems et une interface de
raccordement quand les modems sont externes.
Les supports de transmission sont trs varis (paires mtalliques, cbles coaxiaux, fibre
optique, sans fil). La bande passante et le taux derreur sont les principales caractris-
tiques dun support. chaque extrmit, des modems (modulateurs-dmodulateurs de
signaux analogiques) ou des codecs (codeurs-dcodeurs de signaux numriques) trans-
mettent des signaux adapts la nature du support. Les techniques de transmission de
donnes (en bande de base ou par modulation) adaptent au mieux les signaux aux carac-
tristiques des supports. Une interface srie relie chaque modem lquipement infor-
matique qui envoie ou reoit des donnes. Les techniques et les interfaces sont
normalises au niveau international.
Le raccordement ADSL des usagers Internet est un exemple de transmission utilisant
la boucle locale tlphonique. Une liaison ADSL met en uvre une modulation spci-
fique pour transmettre simultanment voix et donnes. La connexion avec lordinateur
utilise soit un port USB, soit un port Ethernet soit une liaison sans fil.
7480Book.indb 15 27/09/10 13:30
2010 Pearson France - Architecture des rseaux - Danile Dromard, Dominique Seret
16
Problmes et exercices
Exercice 1 : notion de dcibel
Dans un environnement urbain, la puissance sonore produite par les nombreuses
sources de bruits est value en dcibels, en comparant la puissance sonore de la
source de bruit un niveau sonore de rfrence.
1. Si on value la puissance sonore S dune moto 87 dB, quelle est, en dcibels, la
puissance sonore produite par une bande de huit motards roulant sur des motos
identiques circulant la mme vitesse ?
2. Dterminez la puissance sonore rellement mise.
Exercice 2 : valuation dun rapport signal/bruit (S/B)
Sur un support de transmission, le rapport S/B vaut 400.
1. Quelle est la valeur de ce rapport en dcibels ?
2. Mme question avec un rapport S/B de 40 000.
3. Quelle est la valeur N en dcibels dun rapport S/B gal 500 000 ?
Exercice 3 : dbit binaire et rapidit de modulation
Soit un signal numrique dont la rapidit de modulation est quatre fois plus faible
que le dbit binaire.
1. Quelle est la valence du signal ?
2. Si la rapidit de modulation du signal vaut 2 400 bauds, quel est le dbit binaire
disponible ?
Exercice 4 : signaux transmis en bande de base et par modulation
Soit la suite dlments binaires 0 1 1 1 1 1 1 0.
1. Reprsentez les signaux transmis lorsquon transmet en bande de base avec les
codes NRZ et Manchester.
2. Reprsentez les signaux transmis lorsquon transmet les donnes avec une modu-
lation damplitude deux valeurs, une modulation de phase deux valeurs, une
modulation de frquence deux valeurs.
3. Si le dbit D est connu, quelle est la rapidit de modulation R ?
7480Book.indb 16 27/09/10 13:30
2010 Pearson France - Architecture des rseaux - Danile Dromard, Dominique Seret
17
Exercice 5 : code Manchester et autres codes
Le code Manchester a lintrt de possder au moins une transition du signal au milieu
de lintervalle pour une bonne synchronisation du rcepteur mais il prsente trop de
transitions, en particulier si la suite de donnes binaires contient une longue srie de 0.
1. Reprsentez le signal transmis avec le code Manchester pour les donnes
100000000001.
2. Le code de Miller offre une alternative intressante. Il consiste, partir du code
Manchester, supprimer une transition sur deux. Dessinez le signal transmis
pour les mmes donnes et montrez que le dcodage nest pas ambigu.
Exercice 6 : influence de la phase sur la rception
Dans la pratique, les signaux mis (et a fortiori reus) ne prsentent jamais de fronts
raides : il y a toujours un temps de monte, un temps pendant lequel le signal est
constant ou presque puis un temps de descente. Le rcepteur analyse le signal reu
et le compare une valeur seuil pour dcider de la valeur du symbole reu. Reprenons
lexemple de la figure 1.5. Un symbole 0 est cod par un signal ngatif dampli-
tude a, un symbole 1 se code par +a. La valeur seuil de dcision est donc 0.
Supposons qu la suite dun mauvais fonctionnement le codec du rcepteur se soit
synchronis avec un retard dun quart de priode dhorloge.
1. Sachant que les donnes mises sont 010110, quelles sont les donnes dcodes par
le rcepteur ?
2. Quelles sont les consquences de ce dphasage pour le rcepteur ?
Exercice 7 : formule de Shannon
Sans compression de donnes, une transmission de voix numrise ncessite un
dbit binaire de 64 kbit/s.
1. En supposant que la transmission se fasse par des signaux moduls de valence 32,
quelle est la bande passante disponible, sachant que celle-ci est gale la moiti
de la rapidit de modulation utilise ?
2. Quel doit tre le rapport S/B de la ligne de transmission offrant un dbit binaire
de 64 kbit/s et possdant une largeur de bande trouve dans la question prc-
dente ? On exprimera cette valeur en vraie grandeur et en dcibels.
Exercice 8 : caractristiques de ligne et tlchargement
Pour vous connecter Internet, vous avez reli votre ordinateur portable grce un
modem de type PCMCIA, raccord la ligne tlphonique de votre lieu de vacances. On
suppose que votre modem a un dbit maximal de 56 kbit/s et que la ligne tlphonique
possde une bande passante comprise entre 300 et 3 400 Hz. Pendant votre connexion,
vous constatez que la vitesse de transfert des donnes effective est 6 200 octet/s.
7480Book.indb 17 27/09/10 13:30
2010 Pearson France - Architecture des rseaux - Danile Dromard, Dominique Seret
18
1. Si la vitesse constate ne provient que dun mauvais rapport S/B de la ligne,
quelle est la valeur de ce rapport durant votre connexion ?
2. La vitesse de transmission est maintenant de 24 800 bit/s. Si la rapidit de modu-
lation est de 4 800 bauds, quelle est la valence du signal modul ?
3. On suppose que la ligne tlphonique rpond au critre de Nyquist et que la
rapidit de modulation vaut 4 800 bauds. Si on utilise la rapidit de modulation
maximale, quelle est la bande passante du support ?
4. Supposons que le dbit binaire indiqu reste constant et gal 49 600 bit/s pendant
toute la dure de la connexion. Combien de temps devrez-vous rester connect
pour tlcharger un fichier de 2 Mo (on pourra prendre ici 1 Mo = 10
6
octets) sur
votre portable ?
5. Vous utilisez dsormais une connexion 10 Mbit/s. Combien de temps resterez-
vous connect pour tlcharger le mme fichier ?
Exercice 9 : systme de radiomessagerie
Un systme de radiomessagerie de poche (un pager) rpondant la norme ERMES
(European Radio Message System) prsente les caractristiques techniques suivantes :
bande de frquences : 169,425 MHz 169,800 MHz ;
modulation de frquence quatre tats ;
rapidit de modulation : 3 125 bauds ;
rapport S/B dun rcepteur : 76 dB.
1. Quel est le dbit binaire rellement utilis dans cette radiomessagerie ?
2. En supposant quon transmette 1 octet par caractre, combien de temps
faut-il pour transmettre un message de 200 caractres sur un rcepteur de
radiomessagerie ?
3. Au lieu du dbit binaire trouv la question 1, quel dbit binaire pourrait-on
thoriquement obtenir en exploitant au mieux les caractristiques techniques de
la radiomessagerie ?
4. Pourquoi nest-ce pas utilis ?
Exercice 10 : principes de fonctionnement de lADSL
Dans la modulation DMT, la plage des frquences disponible sur la boucle locale est
divise en 256 canaux juxtaposs de 4 312,5 Hz chacun. Le canal 0 est utilis pour le
tlphone vocal, et les canaux 1 5 ne sont pas exploits pour viter les interfrences
entre la voix et les donnes. Parmi les canaux restants, deux sont rservs au contrle
des flux montant et descendant, le reste est utilis pour les donnes.
7480Book.indb 18 27/09/10 13:30
2010 Pearson France - Architecture des rseaux - Danile Dromard, Dominique Seret
19
1. Combien reste-t-il de canaux utiliser pour le transfert des donnes dans les
deux sens en modulation DMT ?
2. De quoi dpend le nombre de canaux affecter aux donnes de chaque sens ? Qui
se charge de laffectation des canaux ?
3. Que faudrait-il faire pour que les flux montant et descendant aient des dbits
identiques ?
4. Lutilisation la plus courante en ADSL consiste rserver 32 canaux pour le flux
montant et les canaux restants pour le flux descendant. Quel est le dbit tho-
rique que lon peut obtenir pour le flux montant si lon transmet des signaux
binaires sur chaque canal ?
5. Mme question pour le flux descendant.
6. Une autre technique de modulation utilise, pour le flux descendant, une rapidit
de modulation de 4 000 bauds et met 15 bits par signal transmis sur 224 canaux.
Quel dbit binaire peut-on obtenir avec cette technique ?
7480Book.indb 19 27/09/10 13:30
2010 Pearson France - Architecture des rseaux - Danile Dromard, Dominique Seret
Vous aimerez peut-être aussi
- 4transmision NumériqueDocument39 pages4transmision Numériqueنور الدينPas encore d'évaluation
- 00courstransmissionnumerique 220809171109 4ebbd423Document89 pages00courstransmissionnumerique 220809171109 4ebbd423AbdouMohamedPas encore d'évaluation
- Réseaux IDocument58 pagesRéseaux IVidal KenfackPas encore d'évaluation
- M1ig - Chapitre 1 - Reseaux Et ProtocolesDocument19 pagesM1ig - Chapitre 1 - Reseaux Et ProtocolesGuy Laurent TamouPas encore d'évaluation
- Réseaux OptiqueDocument92 pagesRéseaux OptiquedfdPas encore d'évaluation
- Base Optique L3Document51 pagesBase Optique L3dfdPas encore d'évaluation
- Chapitre 1Document8 pagesChapitre 1Adam LayefPas encore d'évaluation
- Supports de TransmissionDocument6 pagesSupports de Transmissionالنوري أيمن - NOURI AYMENPas encore d'évaluation
- Intro - Telecoms IDocument23 pagesIntro - Telecoms IJinette BaptistePas encore d'évaluation
- Chapitre1 CTCODocument21 pagesChapitre1 CTCOMe RePas encore d'évaluation
- Memoire de Fin D'étude Ingénieur Des Travaux TélécomsDocument25 pagesMemoire de Fin D'étude Ingénieur Des Travaux Télécomsmedoune diopPas encore d'évaluation
- CanauxDocument9 pagesCanauxABDELAZIZ AIT ABBOUPas encore d'évaluation
- Chap 5Document69 pagesChap 5oussamaPas encore d'évaluation
- I.1.1. Définition D'un Support de TransmissionDocument18 pagesI.1.1. Définition D'un Support de TransmissionChaima ChaimaPas encore d'évaluation
- ch12 Numerisation Et Transmission de L Info ElDocument9 pagesch12 Numerisation Et Transmission de L Info ElVoundai Mahamat ValamdouPas encore d'évaluation
- Chapitre1 RIL TLCDocument12 pagesChapitre1 RIL TLCTurbo DieselPas encore d'évaluation
- Cours Routage IpDocument15 pagesCours Routage IpNenissa AmazouzPas encore d'évaluation
- PDF Chapitre 5 Ccna 1Document22 pagesPDF Chapitre 5 Ccna 1Ledoux NgabaPas encore d'évaluation
- Master Fo 2022 AvrilDocument53 pagesMaster Fo 2022 Avrilibrahima yte colyPas encore d'évaluation
- Chapitre 5 Reseaux OptiquesDocument7 pagesChapitre 5 Reseaux OptiquesArsène Loïc MBANDA BIAMOUPas encore d'évaluation
- Procédés Physiques de Transmission de Données PDFDocument5 pagesProcédés Physiques de Transmission de Données PDFkimmikPas encore d'évaluation
- Fibre Optiques Master1Document14 pagesFibre Optiques Master1NasreddinePas encore d'évaluation
- Lignes de TransmissionDocument40 pagesLignes de TransmissionBéatrice Kamgang100% (2)
- Présentation1 1Document26 pagesPrésentation1 1Ramzi RamziPas encore d'évaluation
- Transmissiondata Chapitre1Document89 pagesTransmissiondata Chapitre1Faycel HamdiPas encore d'évaluation
- MemoiDocument7 pagesMemoimistersmile053Pas encore d'évaluation
- Chap 1Document13 pagesChap 1Amina NadiaPas encore d'évaluation
- Tech OptiqueDocument41 pagesTech Optiquenizar200Pas encore d'évaluation
- 2-Reseaux-Supports Et Interfaces de CommunicationDocument24 pages2-Reseaux-Supports Et Interfaces de Communicationfidele brouPas encore d'évaluation
- Communications Optiques Chap1et2 2022-2023Document59 pagesCommunications Optiques Chap1et2 2022-2023Yazid ZitouniPas encore d'évaluation
- Chap V Systeme de Transmission Part 2Document23 pagesChap V Systeme de Transmission Part 2zaza zaza1Pas encore d'évaluation
- Chapitre2 Téléphonie 091944 PDFDocument7 pagesChapitre2 Téléphonie 091944 PDFMarcus ArmstrongPas encore d'évaluation
- Fibre OptiqueDocument7 pagesFibre OptiqueYoussef GouaimaPas encore d'évaluation
- 01 - Generalites PDFDocument7 pages01 - Generalites PDFsedrick tchatchouangPas encore d'évaluation
- Chapitre II - Conception de Cablage Et Normes en VigueurDocument202 pagesChapitre II - Conception de Cablage Et Normes en VigueurAbdenour Mohandi100% (1)
- MR2WDM 2PDocument37 pagesMR2WDM 2PZied ZaghbiPas encore d'évaluation
- Cours FibreDocument57 pagesCours FibreIbrahim Tafsir DiagnePas encore d'évaluation
- TéléInformatiqueDocument32 pagesTéléInformatiqueArmosPas encore d'évaluation
- 1 - Chapitre 2 Les Supports de TransmissionDocument31 pages1 - Chapitre 2 Les Supports de TransmissionRayen Ghazouani100% (1)
- Chapitre 2-Réseaux Informatiques - La Couche Physique - MOUCHFIQ Nada-1Document54 pagesChapitre 2-Réseaux Informatiques - La Couche Physique - MOUCHFIQ Nada-1elhachchad002Pas encore d'évaluation
- La Fibre OptiqueDocument118 pagesLa Fibre OptiqueMoh TahaPas encore d'évaluation
- Telecom Par Fibre Optique PDFDocument19 pagesTelecom Par Fibre Optique PDFDankov2Pas encore d'évaluation
- Cours FO Chapitre 5Document5 pagesCours FO Chapitre 5Torkia HadjazPas encore d'évaluation
- Multiplexage en Longueur D'onde - WikipédiaDocument4 pagesMultiplexage en Longueur D'onde - WikipédiaBoudour BarkiaPas encore d'évaluation
- INTRODUCTION GENERALE ImeneDocument30 pagesINTRODUCTION GENERALE Imenezaoui100% (1)
- HTTPSFR - JF Parede - Ptwhat Is Transmission Media Computer Networks Its Types 2Document1 pageHTTPSFR - JF Parede - Ptwhat Is Transmission Media Computer Networks Its Types 2alcov603Pas encore d'évaluation
- 255Document7 pages255Bahi HolmesPas encore d'évaluation
- Presentaion3 - Chapitre2 ETUDE DE LA FIBRE OPTIQUEDocument76 pagesPresentaion3 - Chapitre2 ETUDE DE LA FIBRE OPTIQUEToudjani Anouar100% (4)
- Fibre OptiqueDocument20 pagesFibre OptiqueAouataf Djafarou100% (1)
- Système de Transmission Par Fibre OptiqueDocument15 pagesSystème de Transmission Par Fibre OptiqueWiss Al0% (1)
- Les Différents Types de CâblesDocument5 pagesLes Différents Types de Câblesbalha1985Pas encore d'évaluation
- Antennes Exercices 02 PDFDocument39 pagesAntennes Exercices 02 PDFmahmoud rimPas encore d'évaluation
- Théorie et conception des filtres analogiques, 2e édition: Avec MatlabD'EverandThéorie et conception des filtres analogiques, 2e édition: Avec MatlabPas encore d'évaluation
- A propos du Digital!: Le digital pour tous! Le numérique en questions/réponses pour le modélisme ferroviaireD'EverandA propos du Digital!: Le digital pour tous! Le numérique en questions/réponses pour le modélisme ferroviaireÉvaluation : 3.5 sur 5 étoiles3.5/5 (3)
- Réseaux mobiles et satellitaires: Principes, calculs et simulationsD'EverandRéseaux mobiles et satellitaires: Principes, calculs et simulationsPas encore d'évaluation
- La révolution technologique qui va bientôt nous surprendreD'EverandLa révolution technologique qui va bientôt nous surprendrePas encore d'évaluation
- Dispositif D'alerte Et de Déclaration Des Maladies InfectieusesDocument2 pagesDispositif D'alerte Et de Déclaration Des Maladies InfectieusesZakaria KhatarPas encore d'évaluation
- Amplification TRANSISTORDocument65 pagesAmplification TRANSISTORZakaria KhatarPas encore d'évaluation
- Traitement de SignalDocument87 pagesTraitement de Signalspindaar100% (3)
- Traitement de SignalDocument33 pagesTraitement de SignalTissir Ayoub100% (1)
- 400 Citations Pour Le Manager - Stagtéfie de ChurchillDocument125 pages400 Citations Pour Le Manager - Stagtéfie de ChurchillYouness BakkarPas encore d'évaluation
- Telechargement UML2 PDFDocument119 pagesTelechargement UML2 PDFKalaa SportPas encore d'évaluation
- Genielog Uml Diagrammes Slides PDFDocument86 pagesGenielog Uml Diagrammes Slides PDFbalzofayePas encore d'évaluation
- CM5 Tableaux 9ppDocument5 pagesCM5 Tableaux 9ppZakaria KhatarPas encore d'évaluation
- Uml Cours Slides PDFDocument365 pagesUml Cours Slides PDFSara ZizounePas encore d'évaluation
- La Santé en Afrique - Dynamiques Et Défis Socio-TerritoriauxDocument6 pagesLa Santé en Afrique - Dynamiques Et Défis Socio-TerritoriauxZakaria KhatarPas encore d'évaluation
- Bidani CoursDocument54 pagesBidani CoursZakaria KhatarPas encore d'évaluation
- 490DCADFd01Document71 pages490DCADFd01Marouane El KiassePas encore d'évaluation
- 01-Nombres Complexes, TrigonométrieDocument21 pages01-Nombres Complexes, TrigonométrieAnis MlkPas encore d'évaluation
- Algo DebutantDocument20 pagesAlgo DebutantIngenieur EnsaPas encore d'évaluation
- 5S MethodeDocument1 page5S MethodeZakaria KhatarPas encore d'évaluation
- Langage CDocument121 pagesLangage CMoz AsikPas encore d'évaluation
- Cours LangagecDocument259 pagesCours LangagecLounes MarmouchiPas encore d'évaluation
- Réalisation Application Gestion Maintenance Biomédicale ENSADocument2 pagesRéalisation Application Gestion Maintenance Biomédicale ENSAZakaria KhatarPas encore d'évaluation
- Langage CDocument47 pagesLangage CZoheir KhoumsiPas encore d'évaluation
- La Grippe, Maladie Épidémique Ubiquitaire Défiant Toutes PrévisionsDocument2 pagesLa Grippe, Maladie Épidémique Ubiquitaire Défiant Toutes PrévisionsZakaria KhatarPas encore d'évaluation
- Approche Globale Et Envt de L'eseDocument54 pagesApproche Globale Et Envt de L'eseapi-2642018494% (16)
- Dimensionner PABXDocument8 pagesDimensionner PABXAnwar El AlaouiPas encore d'évaluation
- Kls MartinDocument36 pagesKls MartinZakaria KhatarPas encore d'évaluation
- Crs 1Document62 pagesCrs 1Castro FidèlePas encore d'évaluation
- BISTOURI GIFE 09 Principes Electrocoagulation ERBE PDFDocument38 pagesBISTOURI GIFE 09 Principes Electrocoagulation ERBE PDFZakaria KhatarPas encore d'évaluation
- Pfeoussamafinal 140208090204 Phpapp02 PDFDocument91 pagesPfeoussamafinal 140208090204 Phpapp02 PDFkimo_antimo1993Pas encore d'évaluation
- Corrigc3a9s Des ExercicesDocument21 pagesCorrigc3a9s Des ExercicesMichel Duran100% (2)
- Réalisation Application Gestion Maintenance Biomédicale ENSADocument2 pagesRéalisation Application Gestion Maintenance Biomédicale ENSAZakaria KhatarPas encore d'évaluation
- Rapport SMDocument45 pagesRapport SMnaka2030Pas encore d'évaluation
- Traitement de SignalDocument28 pagesTraitement de SignalZakaria KhatarPas encore d'évaluation