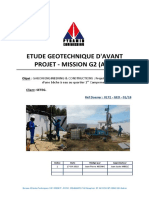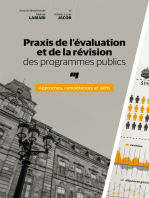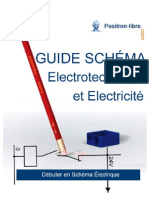Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Étude Formulation Et Mis en Oeuvre Des Enrobées
Transféré par
iftstpbdiroCopyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Étude Formulation Et Mis en Oeuvre Des Enrobées
Transféré par
iftstpbdiroDroits d'auteur :
Formats disponibles
Etude de formulation et de mise en
uvre des enrobs :
Cas des travaux de renforcement de la route
Ouaga-Sakoins
Mmoire pour lobtention du diplme de
MASTER EN INGENIERIE DE LEAU ET DE LENVIRONNEMENT
Option : Gnie-Civil
Prsent et soutenu publiquement par :
TAPSOBA Judical Honora
Travaux dirigs par :
Dr Ismala GUEYE
Responsable UTER ISM
Enseignant permanent au 2ie
M. Georges KORSAGA
Ingnieur BTP
COGEB BTP
Jury dvaluation :
Prsident :
Membres :
Promotion 2012
ETUDE DE FORMULATION ET DE MISE EN UVRE DES ENROBES :
cas du renforcement de la route Ouaga-Sakoins
Ddicace :
Ce mmoire est ddi ma trs
chre maman qui s'est battue
pour me voir arriver ce jour.
Merci pour tous les efforts que
tu as accomplie.
TAPSOBA J. Honora
Juin 2012
Page i
ETUDE DE FORMULATION ET DE MISE EN UVRE DES ENROBES :
cas du renforcement de la route Ouaga-Sakoins
REMERCIEMENTS :
Pour avoir particip la bonne tenue de ce stage, jadresse mes sincres remerciements
lentreprise COGEB et particulirement :
Mr KORSAGA Georges, Directeur COGEB de mavoir accueilli et permis
deffectuer mon stage dans de bonne conditions lors de ce projet de mmoire.
Mr TRAORE Oumar, Ingnieur des travaux, pour mavoir offert un suivi et une
assistance tout le long de mon stage.
Mr OUEDRAOGO Andr, Gotechnicien et chef laboratoire de COGEB pour le
suivi quil ma vou tout au long de mon stage
Tout le personnel de COGEB, tant en entreprise que sur le chantier pour mavoir
bien intgrer et offert un cadre de travail agrable.
Mes remerciements vont galement linstitut international dingnierie de leau et de
lenvironnement (2ie) et plus particulirement :
Mr GUEYE Ismala, mon Directeur de mmoire et responsable de lUTER ISM
2ie pour mavoir donn loccasion dtudier les structures et les matriaux de
chausse des projets routiers et aussi pour son aide et son soutien tout le long de
ltude.
Je ne saurai terminer sans adresser mes plus sincres remerciements ma famille pour son aide
tant sur le plan financier que moral quelle a su mapporter pendant toute la dure de mon stage.
TAPSOBA J. Honora
Juin 2012
Page ii
ETUDE DE FORMULATION ET DE MISE EN UVRE DES ENROBES :
cas du renforcement de la route Ouaga-Sakoins
Rsum :
Dans le cadre du programme de rhabilitation des routes nationales, il a t confi au
groupement dentreprise FADOUL-COGEB SA, lexcution des travaux. Les travaux mens
dans le cadre de ce mmoire ont permis premirement de faire une tude de dimensionnement de
la structure de la chausse et ce, afin de pouvoir analyser et discuter des rsultats obtenus. Ainsi,
il a t fait une tude pour dterminer la priode optimale pour faire un entretien progressif de la
chausse et aussi une tude pour caractriser limpact de linstallation de poste de pesage. Ces
deux tudes sont arrives la conclusion que la dure de service de la chausse peut tre
augmente de 22 ans si nous procdons un entretien aprs 5 ans de service et linstallation de
poste de pesage lentre et la sortie du tronon.
Par la suite il a t fait une tude de formulation sur les diffrents enrobs utiliser. Cette tude a
permis de dterminer en fonction des besoins de performance des couches, les diffrents niveaux
de formulation appliquer. Aussi elle a permis de faire une analyse des rsultats obtenus et est
arrive la conclusion que selon le besoin attendu la mthode PCG savre tre plus qualifie
que la mthode Marshall dont les rsultats sont nullement indicatifs de la prvision du
comportement du matriau.
En dernire partie, il a t fait une tude sur la mise en uvre des matriaux et le suivi de leur
excution. Cette tude a permis de pouvoir dterminer en fonction du type de central en place, le
calibrage des diffrentes caractristiques ncessaire la production des matriaux. Aussi elle a
permis darriver la conclusion quau niveau de la mise en place, lutilisation du PS500 est une
source de fragilit car elle sur-compacte la couche de surface entrainant ainsi lapparition
prmature des fissurations.
Mots cls :
1. Dimensionnement
2. Chausse
3. Enrobs
4. Formulation
5. Mise en uvre
TAPSOBA J. Honora
Juin 2012
Page iii
ETUDE DE FORMULATION ET DE MISE EN UVRE DES ENROBES :
cas du renforcement de la route Ouaga-Sakoins
Abstract :
Within the framework of rehabilitation program of the national road, the executions work has
been entrusted at the grouping company FADOUL-COGEB SA. Work carried out within the
framework of this memoir permitted firstly to make a study about the dimension of the structure
of the roadway, being so in order to be able to do an analysis and talk about result got. Thus after
analysis a discussion at the result pertinence of compared with the solution suggested by the
market has been did. On top of that it has been done at this level a study for to determine the
optimum period for to make a upkeep progressive of the roadway.
Afterwards it has been made a wording study at the different coat to use. This study permitted to
be able to determine according to the needs of performance of the coat, the different level of
wording to applied, besides it permitted to make a analysis of the result got and conclude that
according to the need waited out some method of wording are unsuited and besides that the
determination of some component didnt do at the optimum way.
At the last part it has been made a study at the implementing of the material and the sustained of
their execution. This study permitted of to be able to determine according to kind of station in
place, the style of caliber of the different characteristic necessary at the production of the
material. Besides it permitted to conclude that the level of start-up, the method who exist well
and who respond at the specific elements are in reality for some coat a spring of fragility.
Keywords :
1. sizing
2. roadway
3. coat
4. Formulation
5. Implmentation
TAPSOBA J. Honora
Juin 2012
Page iv
ETUDE DE FORMULATION ET DE MISE EN UVRE DES ENROBES :
cas du renforcement de la route Ouaga-Sakoins
LISTE DES ABRIEVIATIONS :
APD : Avant Projet Dtaill
BB
: Bton Bitumineux
: Compacit
CAM : Coefficient dAgressivit Moyen
CEBTP : Centre exprimental des Etudes du Btiment et des Travaux Publics
CST
: Cahier des Spcifications Techniques
EME
: Enrob Module Elev
GB
: Grave Bitume
GL
: Grave Latrite
GNT
: Grave Non Traite
LCPC : Laboratoire Central des Ponts et Chausses
LNBTP : Laboratoire National du Btiment et des Travaux Publics
MTLH : Matriau Trait au Liant Hydraulique
MVA : Masse Volumique Apparente
MVRe : Masse Volumique Relle des enrobs
NF
: Norme Franaise
OPM
: Optimum Proctor Modifi
PF
: Plate-Forme
PL
: Poids Lourds
TC
: Trafic Cumul
TL
: Teneur en Liant
TMJA : Trafic Moyen Journalier Annuel
VAM
: Vide inter granulaire
Vi
: Vides
VRB
: Vides Remplis par le Bitume
TAPSOBA J. Honora
Juin 2012
Page v
ETUDE DE FORMULATION ET DE MISE EN UVRE DES ENROBES :
cas du renforcement de la route Ouaga-Sakoins
LISTE DES TABLEAUX :
Tableau n1 : rcapitulatif des lots
Tableau n2 : rcapitulatif du trafic
Tableau n3 : classification du trafic
Tableau n4 : rsultats de la campagne de carottage
Tableau n5 : niveau de formulation
Tableau n6 : spcifications sur les granulats
Tableau n7 : spcification sur les liants
Tableau n8 : spcifications sur la GB
Tableau n9 : spcifications sur le BB
Tableau n10 : essai didentification du bitume pur pour la GB
Tableau n11 : rcapitulatif de la teneur en liant des diffrents mlanges
Tableau n12 : rcapitulatif des rsultats de stabilit et de fluage
Tableau n13 : rcapitulatif des caractristiques des briquettes
Tableau n14 : identification du bitume pur pour le BB
Tableau n15 : rcapitulatif des caractristiques de la carrire
Tableau n16 : classification des diamtres de tambour
Tableau n17 : proportion des composants du bitume fluidifi
Tableau n18 : rsultat du calibrage froid
Tableau n19 : rsultat de la planche dessai
Tableau n20 : comparaison des diffrentes structures
Tableau n21 : rsultat de lentretien progressif
TAPSOBA J. Honora
Juin 2012
Page vi
ETUDE DE FORMULATION ET DE MISE EN UVRE DES ENROBES :
cas du renforcement de la route Ouaga-Sakoins
LISTE DES FIGURES :
Figure n1: carte de localisation de la zone de projet
Figure n2 : chausse souple [LCPC, 1994]
Figure n3 : chausse paisse [LCPC, 1994]
Figure n4: chausse semi-rigide et rigide [LCPC, 1994]
Figure n5: chausse mixte [LCPC, 1994]
Figure n6 : chausse mixte [LCPC, 1994]
Figure n7 : phnomne de ressuage
Figure n8 : phnomne dornirage
Figure n9 : fissuration longitudinale
Figure n10 : schmatisation de la structure de lancienne chausse
Figure n 11: courbe de calage inverse
Figure n 12: organigramme de la dmarche de formulation
Figure n13 : courbe granulomtrique de la GB
Figure n14 : liste des graphiques de variation des caractristiques en fonction de TL
Figure n15 : graphique de synthse
Figure n16 : courbe granulomtrique du BB
Figure n17 : courbe de comparaison la masse volumique maximale
Figure n18 : courbe des variations de vides de lessai PCG
Figure n19 : courbe de lessai dornirage
Figure n20 : courbes de variation de la dure de vie selon lentretien
TAPSOBA J. Honora
Juin 2012
Page vii
ETUDE DE FORMULATION ET DE MISE EN UVRE DES ENROBES :
cas du renforcement de la route Ouaga-Sakoins
SOMMAIRE
DEDICACE...i
REMERCIEMENT .....ii
RESUME........iii
ABSTRACT.......iv
LISTE DES ABREVIATIONS....v
LISTE DES TABLEAUX..vi
LISTE DES FIGURES.....vii
I.
II.
INTRODUCTION GENERALE ................................................................................................... 1
I.1.
Problmatique et objectif de ltude ................................................................................... 2
I.2.
Rsultats attendus ..................................................................................................................... 2
I.3.
Contexte du projet ..................................................................................................................... 3
I.4.
Prsentation du projet ............................................................................................................. 3
I.5.
Mthodologie de ltude .......................................................................................................... 4
GENERALITES SUR LES CHAUSSEES .................................................................................... 6
II.1. Dfinition et constitution dune structure de chausse .............................................. 6
II.2. Matriaux de chausse : ........................................................................................................... 6
III.
IV.
Justification de la structure retenue .................................................................................. 8
III.1.
Modle de calcul mcanique du renforcement........................................................... 8
III.2.
Terme de rfrence ............................................................................................................... 9
III.3.
Etude du trafic existant........................................................................................................ 9
III.4.
Calcul et choix de la structure de renforcement ...................................................... 11
Etude de formulation............................................................................................................ 14
IV.1.
Etude thorique .................................................................................................................... 14
IV.2.
Mthodes de formulation.................................................................................................. 16
IV.3.
Essais de performance dans les tudes de formulation ........................................ 18
IV.4.
Niveaux de formulation ..................................................................................................... 20
TAPSOBA J. Honora
Juin 2012
Page viii
ETUDE DE FORMULATION ET DE MISE EN UVRE DES ENROBES :
cas du renforcement de la route Ouaga-Sakoins
V.
Application au cas de ltude de formulation des enrobs de la RN1 ................. 21
V.1. Spcifications sur les composants ..................................................................................... 21
V.2. Formulation de la GB .............................................................................................................. 23
V.3. Formulation du BB ................................................................................................................... 28
VI.
VII.
VIII.
Production en centrale ........................................................................................................ 32
VI.1.
Installations disponibles .................................................................................................. 32
VI.2.
Production des diffrents composants ....................................................................... 34
Mise en place sur chantier .................................................................................................. 35
VII.1.
Planche dessai ...................................................................................................................... 35
VII.2.
Mise en place des diffrents matriaux ....................................................................... 36
Essais de contrle .................................................................................................................. 39
VIII.1. Les essais de contrle sur la fabrication ..................................................................... 39
VIII.2. Les essais de contrle de la mise en uvre ............................................................... 40
IX.
X.
Analyses et Recommandations ......................................................................................... 41
IX.1.
Analyses et discussions ..................................................................................................... 41
IX.2.
Recommandations ............................................................................................................... 42
Conclusion gnrale.............................................................................................................. 45
TAPSOBA J. Honora
Juin 2012
Page ix
ETUDE DE FORMULATION ET DE MISE EN UVRE DES ENROBES :
cas du renforcement de la route Ouaga-Sakoins
I.
INTRODUCTION GENERALE
Dune manire gnrale, le rseau routier dun pays constitue lun des patrimoines qui revt
une importance capitale dans son dveloppement. En effet, la route assure le lien entre les
zones dconomie complmentaire, de production, dimportation, dexportation et de
consommation au sein des tats mais aussi entre les tats. Aussi, elle assure des liaisons
humaines et sociales dune importance inestimable car elle permet ltablissement dchanges
culturels, sociaux, politiques et administratifs qui savre aussi tre un des lments
promoteur tout dveloppement.
Malgr toute limportance quil revt, on remarque que le rseau routier de nos pays en
dveloppement est toujours au stade embryonnaire. Ainsi, particulirement au Burkina Faso,
en 2006, il a t recens : 15272 km de routes classes dont 2584 km sont bitumes. Cette
situation est principalement due lextrme pauvret de nos tats qui narrive assurer de
faon unilatrale, ni la construction dun rseau routier qui soit la hauteur de nos besoins ni
sa rhabilitation.
Cest fort de ce constat qua t initi le programme rgional de facilitation des transports et
du transit routiers en Afrique de louest de lUEMOA dont le but sera daccompagner les tats
de lunion dans leur qute au dveloppement travers la construction et la rhabilitation de
leurs rseaux routiers. Pour se faire, plusieurs projets de construction et de rhabilitation ont
t lancs partout dans la sous rgion dont celui du renforcement de la route Ouagadougou
Sakoins.
Le prsent mmoire subdivis en trois grandes parties se propose de prsenter lessentiel des
travaux effectus relatifs aux renforcements routiers. De ce fait une premire partie sera
destine la dfinition et au dimensionnement de renforcement, suivi dune seconde partie
destine ltude de formulation et de la mise en uvre. En dernire partie sera fait un
rsum des rsultats obtenus et une srie de recommandations destine optimiser les
performances de notre rseau routier.
TAPSOBA J. Honora
Juin 2012
Page 1
ETUDE DE FORMULATION ET DE MISE EN UVRE DES ENROBES :
cas du renforcement de la route Ouaga-Sakoins
I.1. Problmatique et objectif de ltude
Le besoin damliorer la durabilit des chausses tant lors de la conception de chausses
neuves que de la maintenance de chausses anciennes est un souci majeur des gestionnaires
routier. En effet, vu les sollicitations des surcharges leves des poids lourds que subissent
nos routes, son comportement est significativement drgl et on assiste de cet fait des
dgradations prmatures de nos chausse qui jusqu lors se comportaient normalement.
Cette situation est dautant plus accentue par la nouvelle configuration des charges des poids
lourds qui utilisent de plus en plus des pneumatiques super larges avec des pressions de
gonflage gnralement trs leves en remplacement des roues jumeles.
Sur la base de ces constatations, il est impratif dadapter nos mthodologies de
dimensionnement, de formulation et aussi de mise en uvre de nos enrobs afin de pouvoir
rpondre de faon efficiente aux nouvelles configurations.
Pour se faire, notre objectif tout au long de cette tude sera de :
rechercher amliorer la dure de vie de nos chausses travers une
optimisation des performances des matriaux utiliss
adapter au mieux les nouvelles configurations de charges aux modles de
dimensionnement existant
mieux adapter nos systmes de formulations et de mise en uvre aux
nouvelles conditions tout en tenant compte de nos limites tant sur le plan
technique que conomique.
I.2. Rsultats attendus
A lissue de ce stage, les rsultats attendus seront :
Des propositions afin damliorer la dure de vie de nos routes
Des recommandations sur des moyens de formulation et dvaluation des
performances
des
matriaux
ncessitant
des
moyens
techniques
et
conomiques faibles
Des propositions nouvelles sur les systmes de mise en uvre
TAPSOBA J. Honora
Juin 2012
Page 2
ETUDE DE FORMULATION ET DE MISE EN UVRE DES ENROBES :
cas du renforcement de la route Ouaga-Sakoins
I.3. Contexte du projet
Le tronon de route Ouagadougou Sakoins fait partie de la route RN 1 qui reprsente lun
des axes routiers principaux du Burkina Faso. Aussi dans le cadre des changes conomiques,
la RN 1 constitue lartre principale aussi bien sur le plan national que sur le plan de transit
car elle joue un rle trs important dans les changes entre les pays enclav (Burkina Faso,
Mali, Niger) et le littoral.
Cette configuration ajoute la dure de service de la route a eu pour consquence de
considrablement aggrav le niveau de dgradation de la route qui certains endroit savrait
tre impraticable impactant de ce fait sur les dures de trajet qui deviennent trs longs, le
confort et la scurit de conduite.
Cest ainsi que vu limportance que cette route revt pour nos pays dpourvu de dbouch
maritimes et vu les dgradations subit par la chausse, que la banque mondiale, travers le
programme rgional de facilitation des transports et du transit routiers en Afrique de louest
(PRFTTAO) a financ un projet de travaux de renforcement de la route nationale n1 entre
Ouagadougou et Sakoins. Pour se faire, les travaux ont t confis au groupement
dentreprise FADOUL-COGEB SA qui est charg de la ralisation de la chausse, de
lassainissement hydraulique et de lexcution des travaux damnagement.
I.4. Prsentation du projet
La zone de ralisation des travaux se situe dans la rgion du plateau central depuis la sortie
Ouest de la ville de Ouagadougou jusquau carrefour Ouaga-Koudougou-Bobo. Lensemble
du projet a t subdivis en 03 lots comme dfinit dans le tableau suivant :
Tableau n1 : rcapitulatif des lots
Lot n
Tronon
Longueur (Km)
Ouagadougou-Kokologo
32.700
Kokologo-Sakoins
17.586
Litinraire de la zone des travaux est prsent sur la carte ci-dessous :
TAPSOBA J. Honora
Juin 2012
Page 3
ETUDE DE FORMULATION ET DE MISE EN UVRE DES ENROBES :
cas du renforcement de la route Ouaga-Sakoins
Figure n1: carte de localisation de la zone de projet
I.5. Mthodologie de ltude
Dans le but datteindre les objectifs dfinis ci-dessus, la dmarche adopte se prsentera
comme suit :
Recherche documentaire
Cette partie t consacr la recherche de documents et de textes tudiant les principales
thmatiques tudies dans ce mmoire. Elle sest solde par lacquisition de documents
tudiant les diffrents types de renforcement de chausse, les diffrentes mthodes et
mthodologie de formulation et les rglementations sur la production et mise en uvre des
matriaux de chausse.
Collecte de donnes
A ce niveau, des recherches ont t menes afin de collecter les diffrentes donnes
directement lies au projet. Cette recherche a permis lobtention des donnes telles que :
TAPSOBA J. Honora
Les rsultats du comptage de trafic ralis
Les rsultats des campagnes de sondages et de dflexions ralises
Ltude gotechnique dAPD ralis
Ltude sur le renforcement prvu par le march
Juin 2012
Page 4
ETUDE DE FORMULATION ET DE MISE EN UVRE DES ENROBES :
cas du renforcement de la route Ouaga-Sakoins
Suivi de la mise en uvre et du contrle
Aprs la premire tape de notre tude qui a consist la recherche et collecte de donnes,
une partie du sjour t consacr au suivi sur le chantier et la carrire des diffrents
travaux de production et de mise en place mais aussi au suivi de la ralisation des essais de
contrle au niveau du laboratoire de lentreprise et avec les quipes du LNBTP.
Ralisation de ltude
Au terme de ces diffrentes tudes menes ci-dessus, la dernire partie du sjour a t
consacr ltude de :
TAPSOBA J. Honora
Dimensionnement de la structure de renforcement
La formulation des matriaux utiliss
La production, mise en uvre et contrle
Juin 2012
Page 5
ETUDE DE FORMULATION ET DE MISE EN UVRE DES ENROBES :
cas du renforcement de la route Ouaga-Sakoins
II.
GENERALITES SUR LES CHAUSSEES
II.1.
Dfinition et constitution dune structure de chausse
De faon gnrale, la chausse se dfinit comme tant une surface spcialement amnage sur
le sol ou sur un ouvrage, pour le stationnement ou la circulation des personnes et des
vhicules. Mais de faon approfondie la chausse peut se dfinir comme tant une
superposition de diffrentes couches que sont :
II.1.1. La couche de surface
Elle est constitue de la surface de roulement, qui est la face suprieure de la couche de
surface et de la couche de roulement, qui est la couche suprieure de la structure de la
chausse sur laquelle s'exercent directement les agressions conjugues du trafic et du climat.
Cette dernire assure une fonction dtanchit, de protection et influence les caractristique
de surface que sont : luni et ladhrence.
II.1.2. Le corps de chausse :
Il est constitu dune couche de base et ventuellement dune couche de fondation dont le
rle consiste rduire les contraintes transmises au sol support en assurant une diffusion et
une rsistance aux contraintes engendres par le trafic.
II.1.3. Le sol support :
Tout cet ensemble formant la chausse repose sur le sol support qui est lensemble constitu
par le terrain naturel et les remblais ou dans le cas chant, si la portance du terrain est faible,
il est ajout une couche de forme dont lpaisseur peut tre trs importante. Souvent pour
viter davoir une grande paisseur de la couche de forme, le sol en place est trait avec du
ciment ou de la chaux.
II.2.
Matriaux de chausse :
Les matriaux de chausse peuvent tre regroups en trois (03) grandes familles que sont :
II.2.1. Les matriaux naturels :
Il existe plusieurs types de matriaux granulaires composs de sols fins et des matriaux
granulaires que sont :
Les graveleux latritique (GL)
Les sables argileux
Les graves non traites (GNT)
TAPSOBA J. Honora
Juin 2012
Page 6
ETUDE DE FORMULATION ET DE MISE EN UVRE DES ENROBES :
cas du renforcement de la route Ouaga-Sakoins
II.2.2. Les matriaux traits au liant hydraulique :
On distingue plusieurs types de matriau trait au liant hydraulique. Ainsi, en fonction du
liant utilis, il y aura des matriaux traits au ciment, la chaux, au laitier ou aux cendres
volantes. Aussi en fonction de la granulomtrie du matriau et le dosage en liant hydraulique,
on distingue :
Les graves traits au liant hydraulique
Les sables traits au liant hydraulique
Les btons compacts
Les graves hydrauliques haute performances
Ces matriaux sont le plus souvent employs pour les chausses fort trafic car ils ont pour
avantages d :
Etre trs performant avec un module dlasticit lev
Etre trs rsistant en compression et en traction
Avoir une bonne tenue en fatigue avec une durabilit forte
Mais dans le mme temps, ceux-ci prsente un inconvnient
majeur du point de vue
pathologie de chausse car il se produit des fissurations lors du retrait du bton.
II.2.3. Les matriaux traits au liant hydrocarbon
De nos jours, concernant les matriaux traits au liant hydrocarbon, il nexiste plus quun
seul type que sont les enrobs bitumineux. En effet vu que le goudron a des proprits
cancrignes, son utilisation en tant que liant est dlaisse au profit du bitume. Aussi on
distingue en fonction de la granulomtrie, du degr de compactage, du grade et du dosage en
bitume diffrents types denrobs bitumineux qui sont :
La grave bitume (GB)
Le bton bitumineux (BB)
Lenrob module lev (EME)
Aussi travers le mode de production, on distingue deux types denrobs qui sont :
Les enrobs chaud
Les enrobs froid ou grave mulsion.
Les matriaux traits au liant hydrocarbons sont les plus utiliss pour les chausses et pour
tout trafic car ils ont pour avantages dassurer un bon compromis entre des performances
moyennes compar celle des matriaux traits au liant hydraulique et une capacit de
dformation sans fissures du support qui permet ainsi de supporter des dflexions trs leves.
TAPSOBA J. Honora
Juin 2012
Page 7
ETUDE DE FORMULATION ET DE MISE EN UVRE DES ENROBES :
cas du renforcement de la route Ouaga-Sakoins
III.
JUSTIFICATION DE LA STRUCTURE RETENUE
III.1. Modle de calcul mcanique du renforcement
Pour le renforcement des chausses, il existe plusieurs mthodes dont il ne sera prsent cidessous que la principale mthode applique aux chausses souples.
Cette mthode suppose dans un premier temps que le module du corps de chausse
(base+fondation) est gal 04 fois le module du sol support et que le module de lenrob
(couche de surface) est pris gal 1000 MPa, valeur relativement faible pour deux raisons :
Pour les calculs de renforcement lenrob est souvent dgrad
Pour une bonne mesure des dflexions (cas de la poutre de Benkelman), un
module faible donne des rsultats plus reprsentatifs.
enrob
corps de chausse
sol
1000 MPa
4ES
ES = 10-100 MPa
Figure n10 : schmatisation de la structure de lancienne chausse [LCPC, 1994]
La structure ainsi modlise, il est effectu le calcul du renforcement pour le trafic prvu. A
ce niveau le calcul se fait sur la base dun dimensionnement de chausse neuve. Pour se faire,
le logiciel ALIZE du LCPC dont le mode de calcul est bas sur le modle semi-analytique de
Burmister savre tre la rfrence. En effet, ce modle donne une modlisation plus adapte
avec plusieurs avantages que sont :
-
Un chargement circulaire qui rend le problme axisymtrique donc plus rapide
rsoudre
Une modlisation en plusieurs couches traduisant plus fidlement ltat de la
chausse
Des matriaux considrs comme tant des solides lastiques vitant ainsi le
problme des plaques
Des interfaces qui peuvent tre colles ou non.
TAPSOBA J. Honora
Juin 2012
Page 8
ETUDE DE FORMULATION ET DE MISE EN UVRE DES ENROBES :
cas du renforcement de la route Ouaga-Sakoins
III.2. Terme de rfrence
Aprs consultation des termes de rfrence du projet, les hypothses suivantes ont pu tre
tablies :
Dure de vie aprs renforcement
Vu quil est difficile voire impossible de prvoir long terme lvolution du trafic dans les
pays en voie de dveloppement, une dure de service de 15 ans est plus raliste.
Taux daccroissement du trafic
Aucune mthode ne permettant de calculer indpendamment le taux daccroissement du trafic
des poids lourds le TDR sest conform aux prescriptions du guide CEBTP pour pays
tropicaux qui recommande un taux daccroissement compris entre 4 et 15%. Par dfaut, pour
cette tude, il sera retenu un taux i = 4%.
Coefficient dagressivit (CAM)
Pour la dtermination du CAM, le TDR tenu compte de la mise en service des postes de
pesage de Dakola, Bittou, de linstallation imminente des postes de Yguresso et Haml et
aussi de lcrtage total de la surcharge sur la route Ouagadougou-P-frontire du Ghana pour
fixer le CAM une valeur plus raliste de 1,9.
Temprature de rfrence
La temprature fixe par le TDR est de 40 C la surface de la chausse au niveau de la
premire couche. Cette temprature dcroit mesure que lon descend les couches pour
atteindre 34 C au niveau de la seconde couche.
Charge de lessieu type
Le TDR adopte comme essieu de rfrence pour le dimensionnement de la structure de la
chausse, celui du LCPC qui est lessieu standard de 13 T. Cet essieu est aussi celui qui a t
adopt au sein de lUEMOA pour la prservation de notre patrimoine routier.
III.3. Etude du trafic existant
Il sagit ce niveau de dterminer premirement le trafic moyen journalier annuel (TMJA) de
poids lourds dans le sens le plus surcharg afin de calculer le trafic cumul (TC) puis de
dterminer en tenant compte du CAM, le nombre dessieu quivalent ce trafic.
Toutes ces donnes permettront de pouvoir dterminer la classe de trafic selon la
classification du CEBTP.
TAPSOBA J. Honora
Juin 2012
Page 9
ETUDE DE FORMULATION ET DE MISE EN UVRE DES ENROBES :
cas du renforcement de la route Ouaga-Sakoins
III.3.1. Trafic cumul
Les diffrentes campagnes dtudes de trafic effectues afin de dterminer le nombre de poids
lourds journaliers moyen annuel, ont donn le rsultat suivant :
712 PL pour les deux (02) sens daprs lAPD de 2007
Avec ce rsultat, le TMJA est pris comme gal 60% des 712 PL pour les chausses de
largeur suprieur 6 m. Soit TMJA = 428 PL. A travers ces donnes, le TC sera estim
partir de la formule suivante :
Avec : TMJA : 428 PL
n : 15 ans
TC = 2 999 400 PL
i : 4%
III.3.2. Nombre dessieu quivalent
Le nombre dessieu quivalent (NE) est le trafic prendre en compte dans les calculs du
dimensionnement. Il correspond au nombre cumul dessieux quivalents de 13 tonnes sur la
dure de vie considre.
Son calcul fait intervenir le CAM des PL et est donne par la formule suivante :
NE = TC x CAM ;
avec : CAM = 1.9
Do : NE = 5 696 900.
Toutes ces donnes sont rcapitules dans le tableau ci-dessous :
Tableau n2 : rcapitulatif du trafic
TMJA (PL)
Dure de vie (ans)
TC (PL)
CAM
NE
428
4%
15
2 999 400
1.9
5 698 900
Hypothse
III.3.3. Classe de trafic
Le trafic selon le guide pratique de dimensionnement des chausses dans les pays tropicaux
se divise en 05 classes qui sont fonction du nombre dessieu quivalent de 13 T et se dfinit
comme suit :
TAPSOBA J. Honora
Juin 2012
Page 10
ETUDE DE FORMULATION ET DE MISE EN UVRE DES ENROBES :
cas du renforcement de la route Ouaga-Sakoins
Tableau n3 : classification du trafic
Catgorie de trafic propos
Nombre cumul dessieux quivalent de 13 T
T1
1 x 105 T < 5 x 105
T2
5 x 105 T < 1,5 x 106
T3
1,5 x 106 T < 4 x 106
T4
4 x 106 T < 1 x 107
T5
1 x 107 T < 2 x 107
Avec un NE = 5 698 900, le trafic se retrouve dans la fourchette correspondant T4.
III.4. Calcul et choix de la structure de renforcement
III.4.1. Modlisation de la chausse existante
Selon le CST une dflexion caractristique de 80/100 mm sera considrer tout au long du
projet. Une campagne de dflexion t ralis sur tout le tronon et a fait ressortir que 24%
du tronon considr a une dflexion moyenne de 60/100 mm et se trouve donc dans la plage
de dflexion < 80/100 mm.
Aussi une campagne de carottage mene sur tout le tronon fait ressortir une structure qui
se prsente comme ci-dessous :
Tableau n4 : rsultats de la campagne de carottage
Couche de roulement
Couche de base
Couche de fondation
Couche de forme
Nature
BB
GL
GL
GL
Epaisseur
5 cm
20 cm
20 cm
25 cm
Module
1000 MPa
400 MPa
320 MPa
160 MPa
La dtermination du module du sol support existant sest fait par calage inverse. Pour se faire,
la structure existante a t modlise sur aliz puis en faisant varier le module du sol support,
on obtient le module correspondant la dflexion moyenne.
TAPSOBA J. Honora
Juin 2012
Page 11
ETUDE DE FORMULATION ET DE MISE EN UVRE DES ENROBES :
cas du renforcement de la route Ouaga-Sakoins
Figure n 11: courbe de calage inverse
A travers ce graphique, une dflexion de 60/100 mm correspond un module de sol
denvirons 80 MPa, qui, selon le guide pratique de dimensionnement pour les chausses
tropicaux, est de type S4.
III.4.2. Structure de renforcement
A ce niveau, il a t propos, pour les zones de dflexion bonne cest--dire < 80/100 mm, un
fraisage de la couche de BB + 5 cm de la couche de base puis une pose de :
20 cm de GNT + 12 cm de GB + 5 cm de BB
Pour les zones de dflexion >80/100 mm, il est propos un enlvement de la couche de BB,
de la couche de base, de la couche de fondation, de la couche de forme et si ncessaire un
traitement du sol support afin dobtenir un module de 80 MPa. Puis il est procd une par la
suite une reconstitution de la forme, la fondation et la base. Enfin il sera fait une pose de :
20 cm de GNT + 12 cm de GB + 5 cm de BB
III.4.3. Vrification de la structure
Calcul des dformations admissibles
On a :
zadm
= A x (NE)-0.222 avec A =12000 car NE > 25000
Zadm =
379.69 df
-
On a :
tadm
Dformation admissible verticale
6(10
TAPSOBA J. Honora
Dformation admissible transversale
; 25 Hz) x (
)b x
x Kc x Kr x Ks avec :
Juin 2012
Page 12
ETUDE DE FORMULATION ET DE MISE EN UVRE DES ENROBES :
cas du renforcement de la route Ouaga-Sakoins
Pour le BB
matriau
6(10
25 Hz)
100
BB
E(10)
MPa
E(40)
MPa
-1/b
Kc
1/Ks
R (%)
Kr
7200
1000
1.1
0.91
10
0.833
Kc
1/Ks
R (%)
Kr
1.3
0.91
10
0.794
Et pour la GB
matriau
GB
(10 ; E (10) E (34) -1/b
MPa
MPa
25 Hz)
90
12300
2020
5
6
Pour le BB :
tadm
= 157.8 df
Pour la GB :
tadm
= 147.1 df
Calcul des dformations
Aprs modlisation de notre structure de chausse dans le logiciel Aliz LCPC, on obtient les
rsultats suivant :
matriaux
BB
EpsT (df)
matriau
EpsZ (df)
38.6
GNT
GB
378
144.6
Ces rsultats compars aux dformations admissibles donnent :
t1 =
38.6 df <
tadm
= 157.8 df
t2 =
144.6 df <
tadm
= 147.1 df
zadm
= 379.69 df
z=
TAPSOBA J. Honora
378.0 df <
Juin 2012
dimensionnement OK.
Page 13
ETUDE DE FORMULATION ET DE MISE EN UVRE DES ENROBES :
cas du renforcement de la route Ouaga-Sakoins
IV.
ETUDE DE FORMULATION
IV.1. Etude thorique
IV.1.1. Gnralits
Dans un cadre gnral, une formulation se dfinit comme tant une mthode regroupant un
ensemble 03 lments ou piliers plus ou moins lis.
(Mth) = {P, E, V}
Avec :
P : ensemble des proprits physiques, chimiques et mcaniques
E : ensemble des essais utiliss pour mesurer ces proprits
V : ensemble des valeurs seuils respecter pour chaque proprits.
Dans ce contexte, une mthode de formulation nest recevable que lorsque :
P(E)
Cest--dire que les proprits mesures travers les essais raliss doivent tre incluses aux
valeurs seuils.
IV.1.2. Mthodologie de formulation
Lobjectif principal dune formulation est de dterminer une composition optimale de
granulats, de liants et aussi de vides afin datteindre les performances vises. En plus de cet
objectif, elle vise aussi assurer la fabrication de matriaux aptes :
-
Une mise en uvre correcte in situ
Satisfaire les exigences de durabilit structurelle
Satisfaire les exigences de qualit de la chausse.
Bien qu ce jour aucune mthode universelle de formulation na pu tre dicte, plusieurs
mthodes de formulation sont recommandes. Ces mthodes suivent une dmarche bien
prcise qui comporte 05 phases que sont :
Dfinition du besoin de performance
Elle consiste dfinir pour chaque couche les proprits recherches pour caractriser les
performances de la chausse. Ces caractristiques sont :
TAPSOBA J. Honora
le module complexe
la rsistance la fatigue mcanique
la rsistance aux dformations permanentes
la susceptibilit leau.
Juin 2012
Page 14
ETUDE DE FORMULATION ET DE MISE EN UVRE DES ENROBES :
cas du renforcement de la route Ouaga-Sakoins
Slection des composants
Cette tape consiste choisir les granulats, les liants et les ajouts utiliss lors de la fabrication
de lenrob en fonction des diffrentes caractristiques que sont :
le trafic
le climat
la structure de la chausse
les performances recherches de la couche de surface
Formulation volumique
A ce niveau, tout commence par la dfinition des critres de remplissage volumique suivi de
la dtermination de la composition du mlange qui se fait comme suit :
Evaluation de la teneur en vide du squelette minral
Dtermination du volume disponible pour le mlange liant-fillers
Dtermination de la composition du mastic
Vrification des critres de remplissage.
Optimalisation
Cette partie consiste fabriquer en plus de lenrob la teneur en liant initiale, 04 enrobs
diffrents de teneur en liant variant de 0.5%. Chaque type denrob est compact suivant la
procdure Marshall ou la PCG puis on choisit la teneur en liant donnant la compacit
optimale.
Vrification
Cette dernire tape consiste vrifier les performances de lenrob formul. A ce niveau, la
vrification se fait travers des essais de module, de fatigue, dornirage et de susceptibilit
leau. Les diffrents rsultats obtenus serviront valider la formule retenue au niveau de
loptimalisation.
Toute cette dmarche peut-tre matrialis comme suit dans un organigramme :
TAPSOBA J. Honora
Juin 2012
Page 15
ETUDE DE FORMULATION ET DE MISE EN UVRE DES ENROBES :
cas du renforcement de la route Ouaga-Sakoins
Figure n 12: organigramme de la dmarche de formulation
IV.2. Mthodes de formulation
Du point de vue du cadre gnral, il existe plusieurs types de mthode de formulation qui sont
fonction de lhistoire, du contexte technique et de la mthodologie de dimensionnement.
Dans ce contexte, il nen sera cit que les 02 plus utilises fonction de la technique et de la
mthode de dimensionnement disposes. Ces deux mthodes sont :
TAPSOBA J. Honora
Juin 2012
Page 16
ETUDE DE FORMULATION ET DE MISE EN UVRE DES ENROBES :
cas du renforcement de la route Ouaga-Sakoins
IV.2.1. Le Marshall mix design ou mthode Marshall
Cette mthode t dveloppe dans les annes 30 par Bruce Marshall. Elle vise choisir la
teneur en liant pour une certaine densit du mlange qui satisfait une stabilit minimale et
un fluage voluant dans un intervalle dacceptation.
La procdure de formulation se droule comme suit :
Choix des agrgats
Ce choix se fait en accord avec le CST du projet. Les matriaux doivent satisfaire les
proprits physico-chimiques fixes dans celui-ci. Aussi la combinaison des diffrentes tailles
dagrgats doit permettre dobtenir une courbe granulomtrique aussi proche que possible de
la courbe de rfrence.
Choix du liant
A ce niveau, il nexiste pas une procdure de slection et dvaluation normalise. Son choix
est alors laiss lingnieur qui devra raliser les essais quil juge ncessaire pour le guider.
La prparation des chantillons
Les chantillons sont fabriqus dans des moules normalises. Typiquement on prpare 03 ou
05 mlanges avec des teneurs en liant diffrentes, et pour chaque mlange, 03 chantillons.
Les chantillons sont ensuite compacts laide de la dame Marshall selon des rgles bien
prcises.
Dtermination de la stabilit et du fluage
Une fois compacts les chantillons sont soumis un essai de stabilit et fluage. La stabilit
est la force maximale
que peut supporter lchantillon et le fluage est la dformation
plastique qui sensuit. Ces deux valeurs sont en quelque sorte des mesures permettant de
prvoir la performance de lenrob.
Calcul de la densit et des vides
Cette tape sert dterminer les caractristiques du mlange que sont les densits et les vides.
Choix de la teneur en liant optimale
Il est fait a ce niveau, une reprsentation de lvolution du pourcentage de vides, de la densit,
du fluage, de la stabilit, des vides du squelette minral et des vides remplis par le bitume en
fonction de la teneur en liant. La teneur idale en liant est obtenue en faisant la moyenne des
teneurs en bitume qui ont donn la stabilit maximale, la masse volumique maximale et la
teneur en vides dsire. Tout cela se fait graphiquement laide des courbes issues des essais
raliss sur les chantillons.
TAPSOBA J. Honora
Juin 2012
Page 17
ETUDE DE FORMULATION ET DE MISE EN UVRE DES ENROBES :
cas du renforcement de la route Ouaga-Sakoins
IV.2.2. La mthode franaise
Cette mthode seffectue en deux tapes que sont :
Dtermination de la quantit minimale de liant
La quantit de liant se dtermine en fonction de la granulomtrie du mlange. En effet en se
basant sur lapproche codifie en France qui veut que pour toute composition
granulomtrique, on puisse dfinir une quantit minimale de liant ncessaire pour assurer sa
durabilit, une formule a pu tre tablie en fonction du module de richesse des grains. On
obtient :
TL = K x x
; avec =
; coefficient correcteur
La surface spcifique calcule avec la formule :
100
Avec les proportions massiques :
= 0.25G + 2.3S + 12s + 135 f
G, des lments suprieurs 6.3 mm
S, des lments compris entre 6.3 mm et 0.315 mm
s, des lments compris entre 0.315 mm et 0.08 mm
f, des lments infrieurs 0.08 mm.
Essai la presse cisaillement giratoire
Cet essai vise estimer le comportement lors du compactage du mlange prcdemment
dtermin. Pour se faire, une quantit prdtermine du mlange hydrocarbone, porte la
temprature usuelle de fabrication en centrale est place dans un moule cylindrique de 150
mm de diamtre. Le compactage sobtient par laction simultane dune :
-
Force de compression statique assez faible de 0.6 MPa
dune dformation de lprouvette laquelle on nimpose que son axe
longitudinal dcrive une surface conique de rvolution.
Linterprtation de lessai est faite en considrant les valeurs de pourcentages de vides
obtenues aprs 10 girations et aprs un nombre Ng girations dpendant de lenrob. Aprs les
Ng girations, il est spcifi une fourchette de valeur fonction des besoins en performance de
lenrob considr.
IV.3. Essais de performance dans les tudes de formulation
Pour la caractrisation de performances des enrobs formuls, il existe plusieurs types
dessais que sont :
TAPSOBA J. Honora
Juin 2012
Page 18
ETUDE DE FORMULATION ET DE MISE EN UVRE DES ENROBES :
cas du renforcement de la route Ouaga-Sakoins
IV.3.1. Essai Duriez ou essai de compression simple
Lessai Duriez ne permet pas davoir une proprit intrinsque du matriau mais juste un
moyen dapprciation de faon indirecte de la tenue leau. Pour cet essai, lnergie de
compactage utilise pour la confection des prouvettes est obtenue par une compression
double effet de lenrob lintrieur dun moule cylindrique. Les prouvettes ainsi
confectionnes sont conserves :
-
Les unes 18 C pendant 07 jours lair libre
Les autres 18 C pendant 07 jours dans leau
Au bout de ce dlai, les prouvettes sont crases une vitesse constante en compression
simple et lon obtient :
-
La rsistance des prouvettes conserves lair : R
La rsistance des prouvettes conserves dans leau : r
Le rapport r/R appel rapport dimmersion/compression traduit en quelque sorte la tenue
leau de lenrob.
IV.3.2. Essai dornirage
Lessai lornireur sert ltude des enrobs pour chausses trafic intense et trs lev. Il
permet dapprcier la rsistance lornirage des couches de roulement et des couches de
base destines notamment aux types de trafic prcits, et cela dans des conditions de nature
comparable celle rencontres sur les chausses.
Lessai est caractris par la dtermination de la profondeur dornire provoque par le
passage rpt dun pneumatique sur une plaque denrob 60 C pour les couche de surface
et 50 C pour les couches de base.
IV.3.3. Essai de module complexe
Cet essai caractrise le comportement viscolastique des enrobs en fonction de la frquence
et de la temprature. Lessai de module est effectuer sur une prouvette denrob de forme
trapzodale encastr sa base et sur lextrmit libre, on impose un dplacement sinusodale
trs faible damplitude constante crant une mise en flexion du corps dpreuve en simulant
leffet du trafic. A partir de la force rsultante, on calcul le module dans une gamme de
temprature allant de -10 40 C, et pour chaque temprature, quatre niveaux de frquence
qui sont : 1, 3, 10 et 30 Hz.
IV.3.4. Essai de fatigue
Cet essai consiste solliciter en flexion au travers de son bord libre une prouvette
trapzodale denrob encastr sa base. Cette sollicitation se fait en dplacement impos.
TAPSOBA J. Honora
Juin 2012
Page 19
ETUDE DE FORMULATION ET DE MISE EN UVRE DES ENROBES :
cas du renforcement de la route Ouaga-Sakoins
Cest--dire quon impose un dplacement sinusodal damplitude constante lextrmit de
lprouvette et on admet que la rupture est atteinte lorsque leffort ncessaire pour obtenir la
dformation est gal la moiti de leffort initial.
IV.4. Niveaux de formulation
Vu le cot lev des essais de formulation et vu que la pertinence de certains rsultats dessai
dpendent des conditions rencontrs, il existe plusieurs niveau dapplication des mthodes de
formulation en fonction de la nature des tudes. Ainsi, en fonction quon ait faire une
vrification de formule dj applique, adapter une formule un cas de changement dau
moins un des constituants ou dans le cas dune formule nouvelle, on aura quatre (04) niveaux
ou stratgies de formulation dtaill comme suit :
Tableau n5 : niveau de formulation
Niveau de formulation
Niveau 1
Niveau 2
Niveau 3
Niveau 4
Etapes de la formulation
Essai Marshall ou PCG + essai duriez
Essai Marshall ou PCG + essai duriez + ornireur Lcpc
Essai Marshall ou PCG + essai duriez + ornireur Lcpc + essai de
module complexe
Essai Marshall ou PCG + essai duriez + ornireur Lcpc + essai de
module complexe + essai de fatigue
Il est noter quau-del des niveaux de formulation, il existe en fonction des performances
atteintes aux essais, trois (03) classes de produits pour les enrobs.
TAPSOBA J. Honora
Juin 2012
Page 20
ETUDE DE FORMULATION ET DE MISE EN UVRE DES ENROBES :
cas du renforcement de la route Ouaga-Sakoins
APPLICATION AU CAS DE LETUDE DE FORMULATION DES
V.
ENROBES DE LA RN1
V.1.
Spcifications sur les composants
Les spcifications faites sont de diverses natures et concernent :
Les granulats
A ce niveau, il est noter que le bton bitumineux et la grave bitume appartiennent la mme
catgorie de granulat quest la catgorie C III dfinie par la norme NF P 18-586. Cette
catgorie requiert les spcifications rcapitules dans le tableau ci-dessous :
Tableau n6 : spcifications sur les granulats
Critres dacceptabilit
Caractristiques intrinsques :
Los Angeles (LA)
Micro-Deval humide (MDE)
(LA+MDE)
Caractristiques
de
fabrication
(granularit) :
Tamis (mm)
16
14
10
6.3
2
0.5
0.08
Norme
spcifications
Selon NF P 18-573 et
NF P 18-572
< 30
< 20
< 50
Selon NF P 18-560
Indice de plasticit IP
Equivalent de sable 10% de fines ES
Coefficient daplatissement
Pourcentage de refus D et d
BB
GB
100
100
95-100
65-72
38-46
20-27
6-9
100
100-92
100-71
79-51
45-23
25-10
8-3
NM
> 50
< 20
< 15
Les liants
Le liant retenu pour la formulation sera choisi parmi les deux grades de bitumes (50/70 et le
70/100) dont les spcifications sont ci-dessous:
TAPSOBA J. Honora
Juin 2012
Page 21
ETUDE DE FORMULATION ET DE MISE EN UVRE DES ENROBES :
cas du renforcement de la route Ouaga-Sakoins
Tableau n7 : spcification sur les liants
Classes
Caractristiques
50/70
70/100
Point de ramollissement bille et anneau (TBA) C
45/51
42/48
Pntrabilit 25 C, 100g, 5 s 1/10 mm
50/70
70/100
Densit relative 25 C
1/1.10
1/1.07
T bille et anneau aprs RTFOT C
TBA minimale aprs RTFOT C
47
44
Pntrabilit restante aprs RTFOT %
60
55
Point dclair C
230
230
Ductilit 25 C cm
80
100
Solubilit %
99.5
99.5
Teneur en paraffine
4.5
4.5
Les enrobs
Vu que les deux matriaux nont pas les mmes utilits dans la structure de la chausse, les
spcifications qui leur concernent sont diffrentes.
Pour la GB on a :
Tableau n8 : spcifications sur la GB
Spcifications pour GB 0/14
Essais
Module de richesse K
Essai Marshall
Compacit in situ en % du Marshall
Essai duriez 18 C
Rapport = r immersion / R sec
Couche daccrochage en bitume rsiduel en g/m
Mise en uvre conforme la norme NF P 98-150
Temprature minimale dpandage
Compacit de mise en uvre : C / MVRe
Epaisseur moyenne dutilisation en cm
TAPSOBA J. Honora
Juin 2012
Valeurs
2.5
> 97
0.65
350-400
130
C 89%
8-14
Page 22
ETUDE DE FORMULATION ET DE MISE EN UVRE DES ENROBES :
cas du renforcement de la route Ouaga-Sakoins
Pour le BB on a :
Tableau n9 : spcifications sur le BB
Spcifications pour BB 0/10
Essais
Valeurs
3.4
Module de richesse K
Essai Marshall
Compacit in situ en % du Marshall
> 97
Essai duriez 18 C
Rapport = r immersion / R sec
0.75
Essai de compactage la presse cisaillement giratoire
Pourcentage de vide compacit 10 girations
> 11
Pourcentage de vide compacit 60 girations
> 5-10<
Essai dornirage
- Profondeur dornire en % de lpaisseur (dalle de 10 cm 60
10
C) aprs 30 000 cycles pour % de vide compris entre 5 et 8%
- profondeur dornire pour le BB
7.5
Couche daccrochage en bitume rsiduel en g/m
250-300
Mise en uvre conforme la norme NF P 98-150
Temprature minimale dpandage
125
Compacit de mise en uvre : C / MVRe
92 < C < 96
Macro-texture hauteur au sable vraie en mm
0.4
Epaisseur moyenne dutilisation en cm
5-7
(*) essai rserv au cas o lon ne dispose pas de presse cisaillement giratoire
V.2.
Formulation de la GB
La GB retenue par le CST est de classe3. Pour sa formulation, il sera appliqu la mthode
Marshall pour une formulation de niveau1 :
V.2.1. Choix des granulats
La GB sera labore partir dune grave concasse approvisionne en quatre fraction que
sont : 0/4, 4/6, 6/10 et le 10/14. Ces chantillons ont fait lobjet didentification selon les
spcifications du CST. Un mlange blanc ralis lissue de ces essais a donn les rsultats
suivants :
TAPSOBA J. Honora
Juin 2012
Page 23
ETUDE DE FORMULATION ET DE MISE EN UVRE DES ENROBES :
cas du renforcement de la route Ouaga-Sakoins
120
100
Passant (%)
80
60
40
20
courbe
fuseau
100
0
0.01
0.1
Tamis (mm) 1
10
Figure n13 : courbe granulomtrique de la GB
On remarque que la courbe granulomtrique du mlange sintgre parfaitement dans le fuseau
granulomtrique du 0/14.
V.2.2. Choix du liant
Pour le choix de la teneur en liant, vu le niveau de trafic de la voie et vu les conditions
climatiques de la zone, le choix a t fait sur un bitume dont les essais didentification suivant
ont permis de conclure quil est de grade 50/70.
Tableau n10 : essai didentification du bitume pur
Densit relative
(NF T 66-007)
1.045
Pntrabilit 25 C
(NF T 66-004)
55.16
Point de ramollissement
(NF T 66-008)
48.00
V.2.3. Dtermination du taux minimal en liant
Le choix de la teneur en liant initiale sest fait pour un module de richesse minimale de 2.5
comme spcifi dans le CST.
Ce qui donne :
TLmin = K x x
; avec : =
= 0.996 et
= 1.525
TLmin = 3.84%
V.2.4. Prparation des briquettes
Il est ralis pour lessai, 03 groupes dprouvettes dont la teneur en liant varie de 0.45% par
rapport la teneur en liant initiale. Ces diffrentes teneurs sont rpertories dans le tableau cidessous :
TAPSOBA J. Honora
Juin 2012
Page 24
ETUDE DE FORMULATION ET DE MISE EN UVRE DES ENROBES :
cas du renforcement de la route Ouaga-Sakoins
Tableau n11 : rcapitulatif de la teneur en liant des diffrents mlanges
Mlange 1
Mlange 2
Mlange 3
2.50
2.89
3.19
TL
3.84
4.39
4.84
Pour chaque groupe dprouvette il est fabriqu 03 briquettes pour lessai. Les briquettes sont
ralises par compactage des chantillons laide de chocs provoqus par la chute dune
dame de poids et de hauteur normaliss sur les deux faces (50 coups de dame sur chaque
face). Cette opration se droule dans des moules normalises de 10.5 cm de diamtre. Elles
sont ensuite identifies puis dmouler aprs 12 heures la temprature ambiante.
V.2.5. Essai de stabilit et de fluage
A ce niveau, les briquettes sont trempes dans pendant 30 40 minutes dans un bain 60 C
puis sont places diamtralement entre les mchoires de la presse pour y subir un crasement
vitesse constantes. La presse est arrte lorsque les charges maximales sont atteintes. Les
valeurs de charge et de dformation obtenues sont rcapitules dans le tableau suivant :
Tableau n12 : rcapitulatif des rsultats de stabilit et de fluage
Mlange 1
Mlange 2
Mlange 3
Stabilit KN
1823.4
2029.66
2131.00
Fluage mm
2.037
2.233
2.433
V.2.6. Calcul des caractristiques requises pour les briquettes
Les principales caractristiques requises sont :
-
La masse volumique relle MVRe =
La masse volumique apparente MVA calcule aprs une pese en
immersion
Les pourcentages :
Vi
= (1-
) x 100
VAM
= (MVRg-MVRe) x
VRB
x 100
Le module de richesse K, tir de la formule TL = K x x
La compacit
TAPSOBA J. Honora
C=
Juin 2012
Page 25
ETUDE DE FORMULATION ET DE MISE EN UVRE DES ENROBES :
cas du renforcement de la route Ouaga-Sakoins
Toutes ces valeurs sont rcapitules dans le tableau suivant :
Tableau n13 : rcapitulatif des caractristiques des briquettes
MVRe
MVA
Vi
VAM
VRB
Mlange 1
2.520
2.22
11.83
13.62
14.18
2.53
88.17
Mlange 2
2.503
2.303
7.86
15.24
49.52
2.89
92.14
Mlange 3
2.486
2.343
5.70
16.83
66.46
3.19
94.3
V.2.7. Teneur en liant optimale
Cette teneur sobtient par la mise en graphique des diffrentes caractristiques (stabilit
Marshall, dformation, pourcentage de vide, masse volumique) en fonction de la teneur en
liant. Ces graphiques se prsentent comme suit :
STABILITE
2.2
FLUAGE
2.1
2.5
2.1
2.0
2.0
1.9
1.5
1.9
STABILITE
FLUAGE
1.8
1
3.5
4.5
MVA
2.36
3.5
VIDE
14.00
2.34
4.5
12.00
2.32
10.00
2.3
8.00
2.28
6.00
2.26
4.00
2.24
2.22
2.00
DENSITE
2.2
VIDE
0.00
3.5
TAPSOBA J. Honora
4.5
Juin 2012
3.5
4.5
Page 26
ETUDE DE FORMULATION ET DE MISE EN UVRE DES ENROBES :
cas du renforcement de la route Ouaga-Sakoins
VRB
70.00
3.50
60.00
3.25
50.00
3.00
40.00
2.75
30.00
2.50
20.00
10.00
2.25
0.00
2.00
3.5
4.5
3.5
4.5
Figure n14 : liste des graphiques de variation des caractristiques en fonction de TL
Au travers de ces diffrentes valeurs, la teneur en liant optimale sobtient en faisant la
moyenne des teneurs en liant qui ont donnes la stabilit maximale, la masse volumique
maximale et la teneur en vide dsire. Ce qui donne :
stabilit
Masse volumique max
% de vides
Valeur optimale
2131.00
2.343
7.5
TL
4.84
4.84
4.42
TL optimale
4.7
Cette teneur optimale a t cependant utilise pour vrifier sur les autres graphiques (VAM,
K, dformation) si elle permet de satisfaire aux exigences. Ce qui donne :
Fluage
VRB
4.7
TL retenue
Valeur lue
2.78
61
3.08
Exigences
2.00 4.00
85
2.5 3.5
A travers ce tableau, on constate que la valeur retenue rpond aux exigences formules, donc,
il sera retenu une TL = 4.7
V.2.8. Essai duriez
Lessai est ralis avec les prouvettes issues de lessai Marshall. Les rsultats obtenus suite
lcrasement des prouvettes aprs 7 jours de maturation ont donn pour :
-
Les prouvettes conserves lair libre, R = 5.18 MPa
TAPSOBA J. Honora
Juin 2012
Page 27
ETUDE DE FORMULATION ET DE MISE EN UVRE DES ENROBES :
cas du renforcement de la route Ouaga-Sakoins
Les prouvettes immerges dans leau, r = 3.92 MPa
Ce qui donne un rapport r/R = 0.76 conforme au CST qui exige un rapport 0.65
V.3.
Formulation du BB
Le BB retenue dans le CST est un BB semi-grenue de classe 2. De ce fait, vu ses besoins en
performance il est recommand une formulation de niveau 2 (PCG + essai dornirage). Pour
se faire, vu les moyens limits de nos laboratoires (formulation de niveau 1) ltude t
ralis par le laboratoire EIFFAGE puis t valide par le LNBTP. Cette formulation t
faite avec la mthode franaise qui consiste un :
V.3.1. Choix de la granulomtrie
Le BB sera labor partir dun grave concass approvisionn en trois fraction que sont : 0/4,
4/6, 6/10 et le 10/14 dont le combin granulomtrique ralis donn les rsultats suivants :
120
100
passant (%)
80
60
40
courbe
20
fuseau
0
0.01
0.1
1
tamis (mm)
10
100
Figure n16 : courbe granulomtrique du BB
A ce niveau on constate que la courbe granulomtrique sort de son fuseau de contrle, cet
cart est dautant plus marqu lorsquon essaie de la compare la courbe de masse
volumique maximale. En effet on remarque quau niveau du second point de contrle la
courbe sort compltement de sa zone de prescription :
TAPSOBA J. Honora
Juin 2012
Page 28
ETUDE DE FORMULATION ET DE MISE EN UVRE DES ENROBES :
cas du renforcement de la route Ouaga-Sakoins
120
100
passant (%)
80
60
40
COURBE
tmoin
point de contrle
20
0
0
0.5
1.5
2
tamis ^0.45
2.5
3.5
Figure n17 : courbe de comparaison la masse volumique maximale
V.3.2. Choix du liant et teneur en liant initiale
Le choix a t fait sur un bitume dont les essais didentification suivant ont permis de
conclure quil est de grade 50/70.
Tableau n14 : identification du bitume pur
Densit relative
(NF T 66-007)
1.045
Pntrabilit 25 C
(NF T 66-004)
51.00
Point de ramollissement
(NF T 66-008)
49.00
Le choix de la teneur en liant initiale sest fait pour un module de richesse minimale de 3.4
comme spcifi dans le CST.
TLmin = K x x
Ce qui donne :
; avec : =
= 1.01 et
= 1.514
TLmin = 5.2%
V.3.3. Dtermination de la densit maximale
Lessai de densit maximale permet dobtenir la densit maximale exprimentale de lenrob
ralise de faon ajuster plus prcisment la quantit de bitume insrer dans le mlange
destin lessai PCG. Elle est dtermine par pese hydrostatique ou lon dtermine les
masses suivantes :
-
Masse de lenrob lair libre A = 1230 g
Masse de lenrob dans leau E = 684 g
Avec ces donnes, on obtient la densit maximale travers la formule : dm =
Ce qui donne pour lessai un dm = 2253 Kg/m3
TAPSOBA J. Honora
Juin 2012
Page 29
ETUDE DE FORMULATION ET DE MISE EN UVRE DES ENROBES :
cas du renforcement de la route Ouaga-Sakoins
V.3.4. Essai PCG
En premier lieu il convient de dterminer la masse de lenrob utiliser qui est :
m = dm x eau x h(min) x
; o h(min) : hauteur de lprouvette 0% de vides
m = 4572.48 g
Lessai est alors effectuer et le pourcentage de vides est calcul en fonction de la hauteur
obtenue chaque niveau de giration donn. Elle est exprime par la formule :
; avec H(ng) : hauteur un nombre de giration donn (mm)
Vi =
Les diffrentes valeurs ainsi obtenues sont matrialises dans le graphique suivant :
25
% de vides
20
15
10
5
PCG
contrle
0
0
50
100
150
nombre de girations
200
250
Figure n18 : courbe des variations de vides de lessai PCG
Sur le graphique, on constate que la courbe est conforme aux prescriptions du CST qui
impose pour :
-
Lessai PCG, les valeurs suivantes :
Nombre de girations
10
60
200
% de vides
> 2%
> 5-10% <
> 2%
La formulation du BB : un pourcentage de vides compris entre 4 et 9% 60
girations pour les granulats 0/10.
V.3.5. Essai dornirage
Lessai est ralis sur des plaques de 10.04 cm dpaisseur avec un enrob de formulation
conforme aux rsultats donns par lessai PCG une temprature de 60 C. Par la suite, on
TAPSOBA J. Honora
Juin 2012
Page 30
ETUDE DE FORMULATION ET DE MISE EN UVRE DES ENROBES :
cas du renforcement de la route Ouaga-Sakoins
fait rouler un pneu lisse sur les prouvettes en de nombreux cycles. Les rsultats obtenus sont
matrialiss sur le graphique ci-dessous :
8
7
% ornire moyen
6
5
4
3
2
ornire
contle
0
20
200
2000
nombre de cycles
20000
Figure n19 : courbe de lessai dornirage
Ces rsultats permettent de conclure sur la conformit de lenrob utilis car ils rpondent
aux spcifications du CST qui impose pour :
-
La validation de lessai dornirage, un % dornire < 10% 30000 cycles
La validation de la formule denrob, un % dornire < 7.5% 30000 cycles
V.3.6. Essai duriez
Lessai est ralis avec les prouvettes issues de lessai PCG. Les rsultats obtenus suite
lcrasement des prouvettes aprs 7 jours de maturation ont donn pour :
-
Les prouvettes conserves lair libre, R = 4.43 MPa
Les prouvettes immerges dans leau, r = 7.13 MPa
Ce qui donne un rapport r/R = 1.6 conforme au CST qui exige un rapport 0.75
TAPSOBA J. Honora
Juin 2012
Page 31
ETUDE DE FORMULATION ET DE MISE EN UVRE DES ENROBES :
cas du renforcement de la route Ouaga-Sakoins
VI.
PRODUCTION EN CENTRALE
VI.1. Installations disponibles
Pour la production des diffrents enrobs, il est mis la disposition :
VI.1.1. Une carrire et une centrale de concassage
La carrire est situe dans la localit de Ramongo et assure une production en roche massive
dure assez leve pour assurer lapprovisionnement en roches ncessaire la production de
toute la quantit de granulat requise. Aussi elle assure la production de roches de qualit
conforme la qualit requise pour la production des diffrents matriaux. Ces caractristiques
sont dfinit dans le tableau suivant :
Tableau n15 : rcapitulatif des caractristiques de la carrire
Essais
Los Angeles (LA)
Micro-Deval humide (MDE)
(LA + MDE)
Rsultats
27
9.5
36.5
La centrale de concassage, situ juste ct de la carrire, assure la production des diffrentes
fractions granulaire suivante : 0/4, 4/6.3, 6.3/10, 10/14, 14/16, 16/20. Pour se faire, les roches
massives passent premirement dans une enceinte de pr-broyage puis suit une chaine
constitue de broyeur des diffrents calibres et de grille pour la sgrgation des lments
suivants leurs fractions granulaires.
VI.1.2. Une centrale denrobage
La centrale denrobage, assure la production des diffrents enrobs que sont : le BB et la GB.
Elle a une production maximale de 100 tonnes/h et est de type : tambour scheur-enrobeur
(TSE). Elle est compos de :
un pr doseur de granulats
Le pr doseur comporte plusieurs trmies doseuses divises en compartiments sparant les
diffrentes de classes et catgories de granulats. Les granulats sont stocks dans les trmies
puis entrains par un tapis roulant vers le scheur. Le dbit de chaque granulat sera rgl par
une trappe en position fixe et ceci pour avoir la quantit de granulat conforme a la portion
prescrit par le CST.
un scheur de granulats
Le scheur joue un double rle dans le processus qui est : celui de chauffer les granulats de
faon avoir une teneur en eau limite de 0.5% pour une bonne adhsivit liant-granulats mais
TAPSOBA J. Honora
Juin 2012
Page 32
ETUDE DE FORMULATION ET DE MISE EN UVRE DES ENROBES :
cas du renforcement de la route Ouaga-Sakoins
aussi il a pour rle dassurer la sortie du granulat une temprature constante afin dassurer
une bonne mouillabilit des granulats par le bitume. Pour se faire, les tapis roulants du pr
doseur doivent assurer une introduction des granulats dans le scheur de faon uniforme. La
temprature du granulat la sortie du scheur sera comprise entre les limites suivantes :
-
par temps chauds : 140 150 C
par temps
frais : 150 160 C
Toutes prcautions devront tre prisent pour que la temprature maximale ne soit pas
dpasse car cela entrainera un brulage du bitume. A cet effet, la centrale doit tre munie dun
appareil de mesure plac de telle sorte quil indique la temprature du granulat lentre du
malaxeur.
un dpoussireur
Le dpoussireur est un appareil incorpor au poste denrobage fonctionnant en permanence
lors de la prparation du granulat. Lorsquil nest pas prescrit, les poussires sont vacues au
niveau du scheur ; sinon, elles sont rcupres et rincorpores dans le mlange de faon
uniforme.
un silo de stockage de filler
Le filler est stock en silo dont la capacit correspond la consommation de deux journes de
fabrication, sa manutention est assurer par des vis et par des pompes. Les fillers sont ainsi
ajouts aux granulats dans les proportions fixes par un dispositif rglable.
une cuve de stockage et de chauffage du bitume
La cuve de stockage a une capacit totale suffisante pour assurer un fonctionnement continu
de la centrale et comporte une jauge pralablement talonne. Cette cuve est aussi dote dun
dispositif lui permettant de chauffer le liant entre 149 et 163 C tout en vitant une
surchauffe locale. Pour se faire, un thermomtre est plac sur la conduite dalimentation du
malaxeur de faon indiquer la temprature lentre de ce dernier.
un malaxeur
A ce niveau, la centrale tant de type TSE, le malaxeur est incorpor au scheur. Il doit tre
capable de produire des enrobs homognes. Pour se faire, il existe des critres de choix du
diamtre du malaxeur en fonction du dbit denrobs produire.
Tableau n16 : classification des diamtres de tambour
Production (T/h)
22
100
150
250
400
600
Diamtre tambour (mm)
0.8
1.3
1.5
1.7
2.1
2.5
TAPSOBA J. Honora
Juin 2012
Page 33
ETUDE DE FORMULATION ET DE MISE EN UVRE DES ENROBES :
cas du renforcement de la route Ouaga-Sakoins
En ce qui concerne la centrale en place elle a un malaxeur ayant un diamtre de 1.3 m. De
plus le malaxeur est dot dune plaque indiquant sa capacit volumtrique en fonction de la
hauteur de remplissage et le dbit dagrgats pour un rgime de production normale.
VI.2. Production des diffrents composants
VI.2.1. Production des bitumes fluidifis
Les bitumes fluidifis utiliss dans ce projet sont de deux catgories : le bitume 0/1 pour la
couche dimprgnation et le 400/600 pour la couche daccrochage. Leur production se fait
laide dune bouille lintrieur de laquelle des quantits de bitume pur et de fluidifiant sont
insres des proportions dfinit. A ce niveau pour la production, le fluidifiant utilis sera le
ptrole et les diffrentes proportions insrer sont dfinit dans le tableau suivant :
Tableau n17 : proportion des composants du bitume fluidifi
Proportion de bitume
Proportion de ptrole
Bitume 0/1
60
40
Bitume 400/600
85
15
VI.2.2. Production des enrobs
La production des enrobs se fait la centrale suivant les proportions dfinit par ltude de
formulation. Pour se faire, vu que la centrale en place est de type TSE o un tambour assure
la fois le schage et lenrobage des granulats, un dosage froid suffit. Ce dosage est fait au
travers dun calibrage froid de louverture des trmies pour une vitesse de rvolution
constante du tapis roulant. Aprs cette tape, le volume de bitume est dterminer laide
dune balance dynamique plac au niveau du tapis roulant qui mesure le poids des granulats
entrants dans le tambour et aprs un rapide calcul effectuer, lordinateur donne le dbit de la
pompe requis pour la formule. Ainsi pour une production maximale au niveau de la centrale
(100 t/h) les donnes de calibrage se prsentent comme suit :
Tableau n18 : rsultat du calibrage froid
Trmie 1
Trmie 2
Trmie 3
Trmie 4
Dbit bitume
(cm)
(cm)
(cm)
(cm)
(l/min)
GB
3.54
4.61
4.65
8.78
78.33
BB
4.18
5.00
7.60
94.56
TAPSOBA J. Honora
Juin 2012
Page 34
ETUDE DE FORMULATION ET DE MISE EN UVRE DES ENROBES :
cas du renforcement de la route Ouaga-Sakoins
VII.
MISE EN PLACE SUR CHANTIER
VII.1. Planche dessai
Avant la mise en place des enrobs, il est effectu des rglages de paramtres sur une planche
dessai. La longueur du tronon dessai prvu est de 300 ml pour une largeur quivalente
celle de la chausse. Elle est implante en alignement droit sur un support de portance
quivalente celle de la route.
Cette planche aura pour objet dans un premier temps, le choix des modalits dutilisation de
latelier adopt. Cest--dire :
Le calage des caractristiques du finisseur
Le plan de marche des engins (nombre de passe)
La vitesse de marche des engins
La pression de gonflage des pneumatiques des compacteurs
Le rglage de la hauteur de la table du finisseur.
Elle servira aussi dans un second temps vrifier les qualits exiges portant sur :
Les paisseurs avant et aprs compactage
La compacit en place
Pour se faire, quatre (04) mthodes de compactage ont t testes pour dterminer le nombre
de passes du compacteur pneumatiques lourds et celui du compacteur billes.
Au terme de cette planche dessai, les rsultats suivant ont t retenus :
Tableau n19 : rsultat de la planche dessai
Engins
Caractristiques
GNT
GB
BB
Epaisseur avant compactage (cm)
24
14
Epaisseur aprs compactage (cm)
20
12
Compacteur
Nombre de passes
billes
Vitesse (ml/s)
2.25
2.25
2.25
Nombre de passes
14
12
12
Vitesse (ml/s)
Pression des pneus
0.7
0.7
0.7
Finisseur
Compacteur
pneus lourds
TAPSOBA J. Honora
Juin 2012
Page 35
ETUDE DE FORMULATION ET DE MISE EN UVRE DES ENROBES :
cas du renforcement de la route Ouaga-Sakoins
VII.2. Mise en place des diffrents matriaux
VII.2.1. La grave non traite
La couche de base en GNT est excute sur toute la largeur de la plate-forme avec une
paisseur de 25 cm. Lors de sa mise en uvre un grand soin est pris pour viter la sgrgation
en ralisant lopration avec un finisseur. Au moment du compactage, la teneur en eau est
maintenue par arrosage 1% de lOPM.
Cette tape vrifie, on passe au compactage au moyen des compacteurs pneus lourds ayant
une charge de plus de trois (03) tonnes par roue et des compacteurs vibrants ayant une
rpartition de charge de 30 kg/cm. La mthode de compactage est celle dfinie par la planche
dessai avec un systme compos dun compacteur pneu lourd suivi dun compacteur
vibrant. Le nombre de passes se dfinit comme suit :
14 passes par voie pour le compacteur pneu
07 passes par voie pour le compacteur vibrant.
Il est rappeler que tout au long de la mise en uvre, il effectu tous les 250 m des contrles
sur lpaisseur. Ces essais sont valids avec une tolrance de 0.5 cm sur la moyenne de quatre
(04) mesures ralises aprs le passage du compacteur vibrant.
VII.2.2. La couche dimprgnation
Aprs excution de la couche de base, il est effectu une imprgnation au bitume fluidifi sur
toute la largeur de la chausse. Ce bitume, comme spcifi au niveau de la production est un
bitume fluidifi 0/1 dos 1.2 kg/m.
Limprgnation est ralise sur la GNT que trois jours au moins aprs rception de la couche
de base et condition quelle nest subie aucune dgradation.
Avant cette opration un balayage est pralablement ralis sur la couche de base au moyen
dune balayeuse mcanique pour tout matriau et poussire rsiduelle.
La chausse exempte de tout matriau roulant et poussire rsiduelle, on passe lpandage
du bitume fluidifi laide dune bouille au travers de la rampe et une temprature comprise
entre 60 et 80 C. lors de cette opration il est simultanment effectuer un contrle du dosage
en liant dont lcart autoris par rapport la dose fixe ne pourra excder un dixime de
kilogramme par mtre carr (0.1 kg/m).
Aprs cette tape, sil a lieu douvrir la zone imprgne la circulation, un sablage est
effectu sur la surface imprgne avec un dosage de sept (07) huit (08) litres de sable de
granulomtrie : 2/4 ou 4/6 par mtre carr. Cette opration est aussi excute en cas dexcs
de liant sur la zone dimprgnation.
TAPSOBA J. Honora
Juin 2012
Page 36
ETUDE DE FORMULATION ET DE MISE EN UVRE DES ENROBES :
cas du renforcement de la route Ouaga-Sakoins
VII.2.3. La couche daccrochage
Cette opration est ralise pralablement la mise en place de la grave bitume et du bton
bitumineux. Elle seffectue sur la chausse dj imprgne aprs un balayage effectu,
comme pour le cas de limprgnation, au moyen dune balayeuse mcanique de faon
liminer tous matriaux et poussires rsiduelles.
Pour se faire, un bitume fluidifi de type 400/600 est utilis. Pour le dosage, il est variant
selon la nature du support. Ce qui donne, pour :
La mise en uvre de la grave bitume sur la couche de base, un dosage de 400500 g/m de bitume rsiduel
La mise en uvre du bton bitumineux sur la couche de grave bitume, un
dosage de 300-400 g/m de bitume rsiduel.
La variation du dosage ne doit pas avoir un cart suprieur 100 g/cm.
A ce niveau lpandage se fait au travers dune lance pour assurer une pulvrisation uniforme
et respecter le dosage prescrit car avec la rampe il est impossible dpandre des quantits
infrieures 600 g/m.
Lpandage de la couche daccrochage se fait lavancement du finisseur avec une longueur
davance infrieur 50 ml. Un sablage la pelle est effectu sur laire dvolution des
camions au niveau de lpandage de la couche daccrochage pour la mise en place de la grave
bitume afin dviter que les pneumatiques des camions ne se colle et narrache
limprgnation.
VII.2.4. Les enrobs chaud
La mise en place de la GB et du BB est prcde dun balayage au moyen dune balayeuse
mcanique jusqu lobtention dun support propre.
Aprs cette tape seffectue la mise en place de lenrob au moyen dun finisseur afin
davoir : une rpartition sans sgrgation des granulats, un alignement, des profils avec les
diffrentes pentes, une paisseur fixe et une temprature correcte.
Cette temprature est fonction de la nature du bitume. Ce qui donne, pour le bitume 50/70
une temprature :
Temps trs chaud comprise entre 130 et 140 C
Temps frais et pluvieux comprise entre 135 et 145 C
Cette opration termine, on passe au compactage au moyen de compacteurs que sont : les
compacteurs pneus et les rouleaux tandem vibrant. La mthode de compactage utilise est
TAPSOBA J. Honora
Juin 2012
Page 37
ETUDE DE FORMULATION ET DE MISE EN UVRE DES ENROBES :
cas du renforcement de la route Ouaga-Sakoins
celle dite compacteur pneumatiques en tte dfinie par la planche dessai avec un
systme compos dun :
Compacteur pneus type P1 lests 3 tonnes/roue avec des pneumatiques
gonfls des pressions de lordre de 0.7 0.8 MPa pour le BB ou de type P2
lests 5 tonnes/roue avec des pneumatiques gonfls des pressions de
lordre de 0.6 0.7 MPa pour la GB
Compacteur rouleau tandem jantes mtalliques de type V0 ou V1.
Et un nombre de passe pour chaque engin dfinit comme suit :
12 passes sur la GB et la BB par voie pour le compacteur pneu
07 passes vibrants sur la GB par voie pour le compacteur vibrant
02 passes non-vibrants sur le BB le mme jour par voie pour le compacteur
pneu et 02 passes vibrants sur le BB le lendemain.
Lpandage des enrobs au finisseur tant ralis par demi-chausse de part et dautre de
laxe, il est ralis des joints longitudinaux de prfrence la mme journe afin de bnficier
de linertie de chute de temprature.
Pour la GB le joint est dcal de 15 cm de laxe avec une premire bande 15 cm plus large
que la deuxime bande, alors que pour le BB, le joint est recentr laxe.
Dans ces deux cas, le joint est lgrement compact au pneu puis le joint est ensuite pinc
par un rouleau tandem lisse en appui sur la premire bande.
Aussi des joints transversaux sont raliss chaque reprise de la mise en place. Pour se faire,
on dcoupe lextrmit de la bande ancienne la scie, puis on badigeonne la surface fraiche
juste avant la mise en uvre de la nouvelle bande. Cette nouvelle bande est mise en place en
tenant compte pour le joint transversale, dune surpaisseur dduite du contre-foisonnement
derrire la table du finisseur. A ce niveau le rglage se fait au moyen dun technicien et le
compactage se fait avec un rouleau tandem.
TAPSOBA J. Honora
Juin 2012
Page 38
ETUDE DE FORMULATION ET DE MISE EN UVRE DES ENROBES :
cas du renforcement de la route Ouaga-Sakoins
VIII. ESSAIS DE CONTROLE
Les essais de contrle raliss ont t scinds en deux grands groupes que sont :
VIII.1. Les essais de contrle sur la fabrication
A ce niveau, les essais sont raliss sur les diffrents composants et se prsente comme suit :
VIII.1.1. Essais sur les granulats
Vu que les granulats utiliss dans la production des enrobs seront de catgorie C III comme
dfinit dans le cahier des spcifications, il sera ralis des essais pour vrifier si les diffrentes
caractristiques retenues entrent dans les critres dacceptabilits du C III. Pour se faire, les
essais suivant ont t raliss :
le Los angeles (LA)
lanalyse granulomtrique
lquivalent de sable (ES)
coefficient daplatissement (A)
angularit (Rc)
VIII.1.2. Essais sur le bitume
Conformment au cahier des spcifications, le bitume retenu est le bitume pur de grade 50/70.
De ce fait, les essais suivant seront raliss pour une identification du bitume :
le point de ramollissement bille et anneau (TBA)
la pntrabilit
la densit relative
la pntrabilit rsiduelle aprs chauffage (RTFOT)
En plus de ces essais didentification du bitume, dautres essais sont raliss en vue
didentifier les bitumes fluidifis. Ces essais sont :
la pseudo viscosit
la pntrabilit sur liant rsiduel
VIII.1.3. Essais sur lenrob
Les enrobs, la sortie de la centrale devront respects les recommandations prescrites dans
les rsultats de formulation. Il sera de ce fait procd aux essais :
danalyses granulomtriques
de teneur en liant
de mesure de temprature la sortie du malaxeur
TAPSOBA J. Honora
Juin 2012
Page 39
ETUDE DE FORMULATION ET DE MISE EN UVRE DES ENROBES :
cas du renforcement de la route Ouaga-Sakoins
VIII.2. Les essais de contrle de la mise en uvre
La mise en uvre des enrobs doit respecter plusieurs critres dfinit dans les rsultats de la
formulation et dans les spcifications du CST. Pour se faire, plusieurs essais sont raliser
afin de vrifier les diffrents critres dfinit. De ce fait, il sera procd aux essais :
De temprature
De compacit en place
Dpaisseur
De dflexion
Duni
De nivellement
TAPSOBA J. Honora
Juin 2012
Page 40
ETUDE DE FORMULATION ET DE MISE EN UVRE DES ENROBES :
cas du renforcement de la route Ouaga-Sakoins
IX.
ANALYSES ET RECOMMANDATIONS
Les tudes ci-dessus ont mens des rsultats dont il sera fait dans ce chapitre : un rsum
suivi danalyses et des formulations de recommandations.
IX.1. Analyses et discussions
IX.1.1. Dimensionnement chausse
Ltude de dimensionnement du renforcement mene en premire partie est arrive la
conclusion que la structure propose (structure n1 : 20 cm GNT + 12 cm GB + 5 cm BB) est
apte couler le trafic prvu pour les 15 ans venir.
Une tude comparative de cette structure de chausse avec celle qui tait prvu par le march
(structure n2 : 5 cm BB + 17 cm GB sur chausse existante) t ralise afin de pouvoir
tirer des conclusions sur la pertinence du point de vue conomique et performantielle. Cette
tude fait ressortir les rsultats suivants :
Tableau n20 : comparaison des diffrentes structures
Dure de vie limite
Ecart
Structure n1
16 ans
5 658 436
Structure du n2
19 ans
FCFA
Vu comme tel, la structure n2 savre tre plus intressante mais de faon structurelle elle ne
sera pas adapte vu la grande faiblesse du BB existant qui se trouve mme tre certains
endroits, un enduit bicouche suite aux entretiens raliss. Aussi, au vu de ltat des
dgradations le recyclage de la couche de BB existant savre indispensable. Dans ce
contexte, la structure n1 savre tre une solution intressante.
Aussi il est noter que le modle de dimensionnement utilis nest pas adapt pour tous les
cas de renforcement. En effet, cette mthode surdimensionne la structure car elle ne tient pas
compte des dommages subits et des dommages rsiduels. Pour ce cas de renforcement il est
arriv que le dommage subit soit dj suprieur 1 ce qui signifie que la chausse avait dj
atteint sa dure de vie, ce qui a permis lutilisation de ce modle de calcul.
IX.1.2. Etude de formulation
Au niveau de ltude de formulation les rsultats obtenus sont du point de vue des
spcifications du CST satisfaisante, mais dautre part certaines rserves sont mettre.
En considrant ainsi les nouvelles configurations des charges des poids lourds sollicitant nos
chausses, certains essais actuellement utiliss ne sont plus adapter pour valuer les
TAPSOBA J. Honora
Juin 2012
Page 41
ETUDE DE FORMULATION ET DE MISE EN UVRE DES ENROBES :
cas du renforcement de la route Ouaga-Sakoins
performances des enrobs. En effet les valeurs indicative bas sur les performances
empiriques de lessai Marshall ne sont nullement prdictive de lvolution du comportement
des enrobs en place. Dautres essai telle lessai PCG savre actuellement tre plus adapter
vu lintensit du trafic actuel.
Aussi, pour la formulation du BB ralis travers lessai PCG, mme si les performances
requises par le CST ont t atteint, on a pu remarquer que la granulomtrie nest pas trs
adapte. Cette inadaptation est dautant plus flagrante lorsquon essai de comparer cette
courbe granulomtrique la courbe de densit maximale. A ce niveau, on note que la courbe
sort compltement de lintervalle des deux points de contrle intermdiaire. Ceci traduit le fait
que mme si lessai de PCG sest avr concluant, la formule retenue nest pas celle optimale
car avec cette granulomtrie, la densit maximale ncessaire lexcution dun essai PCG
optimale nest pas atteint. Cette situation pourra tre corrige travers une tude de combin
granulomtrique pour pouvoir trouver la composition granulomtrique optimale.
IX.1.3. Mise en uvre
Concernant la mise en uvre des matriaux sur le chantier, le compactage est assur
conformment aux essais raliss sur la planche dessai. Ces rsultats ont permis datteindre
les performances requises. Mais au niveau de la couche de BB, lutilisation des compacteurs
pneus lourds (PS 500) font lobjet de restriction dans certains pays car leur utilisation
engendre souvent des sur-compactages, ce qui va lencontre des besoins en performances de
ces couches. De ce fait il serait plus intressant dintgrer depuis ltape de la planche dessai
pour la couche de BB un atelier compos que de compacteur billes vibrants et non-vibrants.
IX.2. Recommandations
A ce niveau, on se rend compte quune excution optimale et efficiente dune chausse
intresse bien plusieurs acteurs que sont : le maitre douvrage qui souhaite prenniser son
ouvrage, le maitre duvre qui souhaite tre plus performants et aussi les entreprises et
laboratoire qui souhaite raliser des tudes comptitif et moindre cot. Pour se faire, nos
recommandations sadressent au :
IX.2.1. Maitre douvrage
Pour le maitre douvrage, nos recommandations sintressent plus la priode optimale pour
raliser un entretien afin de pouvoir accroitre la dure de vie. De ce fait, des suggestions
dentretien fait sur plusieurs annes de faon thorique permettent de pouvoir dterminer en
fonction du dommage subit, la dure de vie reporte. Pour se faire, il a t tudi lvolution
TAPSOBA J. Honora
Juin 2012
Page 42
ETUDE DE FORMULATION ET DE MISE EN UVRE DES ENROBES :
cas du renforcement de la route Ouaga-Sakoins
du dommage sur 40 ans avec un pas de 05 ans puis les diffrents rsultats obtenus ont t
reprsents sur le graphique suivant :
dommage
0
0
10
15
anne
20
25
30
35
40
Figure n20 : courbes de variation de la dure de vie selon lentretien
Au travers de ces rsultats obtenus, on obtient pour la suggestion dentretien :
Tableau n21 : rsultat de lentretien progressif
Entretien
Sans
5 ans
10 ans
15 ans
Dure de vie reporte (ans)
16
23
21
18
Il serait donc intressant de prvoir un entretien au plus tt pour plus prenniser la dure de
vie de la chausse.
Aussi toujours dans ce mme objectif, le maitre douvrage pourra sintress la cration de
poste de pesage supplmentaire afin de pouvoir diminu le CAM qui malgr ceux existants
savre toujours tre lev (1.9 en comparaison une moyenne de 0.8). Cette situation
impactera sur la dure de vie de la chausse car revenir un CAM de 0.8 reportera la dure de
vie limite de la chausse 31 ans soit une rallonge de 15 ans sur la dure de vie limite
initiale. Lapplication de ces 02 recommandations aura pour consquence de rallonger la
dure de vie de la chausse de 22 ans.
IX.2.2. Maitre duvre
A ce niveau, il sera intressant dintgrer lide de lexistence dautres mthodes de calcul
plus adaptes aux calculs de renforcement. Ces mthodes tiennent compte des dgradations,
des discontinuits de bord et des diffrentes configurations de charges. Des logiciels comme
TAPSOBA J. Honora
Juin 2012
Page 43
ETUDE DE FORMULATION ET DE MISE EN UVRE DES ENROBES :
cas du renforcement de la route Ouaga-Sakoins
ERASMUS permettent en fonction du diagnostic obtenu et du cahier des charges, de proposer
des solutions de travaux varies respectant les normes de lentretien et de la rhabilitation.
Aussi de nouveau modle de calcul bas sur les lments finis permettent dintgrer les
dgradations telles que les fissurations, les ornires et aussi dintgrer les limites de bord des
chausses.
Ces mthodes ont pour avantages de donner des rsultats plus ralistes compars aux
mthodes actuellement utilises. Ce qui permettra ainsi aux bureaux dtude dtre plus
performant et plus comptitif.
IX.2.3. Laboratoire et entreprise
Pour les laboratoires et entreprises il est recommand ladoption de la mthode PCG pour
loptimalisation de nos formules denrobs aux dpens de la mthode Marshall qui savre
tre de moins en moins efficace. En effet vu lintensit du trafic les chausse ont tendance
dvelopper un comportement viscolastique, et dans ce contexte les valeurs des essais
Marshall savrent inadaptes.
Aussi, il sera intressant dintgrer dans nos tudes de formulation une dimension de
vrification des performances (module complexe, fatigue et susceptibilit lornirage) de
nos matriaux. Bien sans ignorer les ralits conomiques qui limitent les capacits
dobtention du matriel ncessaire, ces essais seront possibles raliser aux moyens dtudes
thoriques et de logiciel tel que PRADO. En effet de nos jours des tudes ont permis de
dvelopper des bases thoriques de calcul du module complexe et aussi des mthodes
analytiques de prdiction de lornirage. Bien que thorique ces mthodes donnent des
rsultats qui dans des cadres bien dfinit sont sensiblement proche des rsultats obtenus de
faon exprimentale.
TAPSOBA J. Honora
Juin 2012
Page 44
ETUDE DE FORMULATION ET DE MISE EN UVRE DES ENROBES :
cas du renforcement de la route Ouaga-Sakoins
X.
CONCLUSION GENERALE
La route revt un caractre primordial tant sur le plan national que sur le plan rgional en
assurant les diffrents transit. Elle doit faire lobjet dune attention particulire car sa mise en
uvre demande souvent des investissements trs levs tel point que nos tats prtent des
fonds la plupart du temps aux institutions financires pour pouvoir la raliser. De ce fait, afin
davoir un retour sur investissement, des tudes srieuse devront tre menes depuis ltape
du dimensionnement jusqu celle de lentretien pour ainsi optimiser les capitaux investit.
Cela se fait travers le dimensionnement et la mise en uvre de chausse qui rpondront de
faon raliste aux sollicitations relles et aussi ltablissement dun programme dentretien
efficient afin de rallonger au maximum la dure de vie de la chausse.
Dans ce contexte, le cadre de notre tude sest intress trois points importants dans la
ralisation des projets de renforcement routiers qui sont ltude de :
Dimensionnement de la structure de renforcement
Formulation des diffrents matriaux
Mise en uvre
Au terme de cette tude, nous sommes arrivs la conclusion que ces projets ne sont pas
raliss de faon optimiser au maximum les capitaux investit. En effet, les mthodes de
dimensionnement utilises ne sont aptes assurer un dimensionnement raliste vis--vis des
relles sollicitations du trafic. Aussi les mthodes de formulation des matriaux actuellement
utilises sont devenues obsoltes vu le niveau de trafic couler. Enfin les mthodologies de
mise en uvre de certaines couches ne tendent pas prenniser la dure de vie de louvrage.
Non sans oublier les conditions conomiques limites disposs, plusieurs perspectives soffrent
nous travers lacquisition de logiciels plus pointus pour le dimensionnement, lintgration
des modles thoriques en complment des tudes de formulation ralises et enfin intgrer
ds le dbut de ltude un programme dentretien progressif qui pourra avoir pour finalit le
rallongement de la dure de vie de nos chausses.
Il serait aussi intressant dans les tudes venir dintgrer la mise en place de poste de
pages conformment a la rglementation de lUEMOA sur la norme des gabarits dans les
hypothses de dimensionnements car les cots levs de mise en uvre de nos routes
actuellement sont principalement dus aux surcharges des poids lourds qui entraine de ce fait
des CAM trs levs donc des trafics plus intense couler.
TAPSOBA J. Honora
Juin 2012
Page 45
ETUDE DE FORMULATION ET DE MISE EN UVRE DES ENROBES :
cas du renforcement de la route Ouaga-Sakoins
BIBLIOGRAPHIE
1. Andr LELIEVRE (mise jour 2002), Les enrobs bitumineux [livre], les ditions le
Griffon dargile, 410 p.
2. CEBTP (1980), Guide pratique de dimensionnement des chausses des pays tropicaux
[livre], Ministre de la coopration, 155 p.
3. Laurent POROT (nov. 2010), Structures de chausse souples [revue], renforcement des
chausses souples, eurovia-vinci, 23 p.
4. Jean-Pierre GRIMAUX, Paul-Claude GROZ et Monique HUET (oct.1996), guide
pratique de construction routire - premire partie [revue], les enrobs bitumineux, revue
gnrale des routes et des arodromes, 12 p.
5. Jean-Pierre GRIMAUX, Paul-Claude GROZ et Monique HUET (oct.1996), guide
pratique de construction routire - seconde partie [revue], les enrobs bitumineux, revue
gnrale des routes et des arodromes, 12 p.
6. Jean Maurice BALLAY (avr. 2010), Dimensionnement des chausses selon la mthode
rationnelle franaise [sminaire], Laboratoire Central des Ponts et Chausses (LCPC),
Institut des Sciences Et Techniques (ISET), 43 p.
7. Yves BROSSEAUD (avr. 2010), Fabrication, mise en uvre, contrle [sminaire],
Laboratoire Central des Ponts et Chausses (LCPC), Institut des Sciences Et Techniques
(ISET), 100 p.
8. JUNOD et A.G. DUMONT (Dc. 2004), Formulation et optimisation des formules
denrobs [mandat de recherche]- Ecole Polytechnique Fdrale de Lausanne (EPFL),
Laboratoire des Voies de Circulation (LAVOC), 89 p.
9. Quang Dat TRAN, modle simplifi pour les chausses fissures multicouches
[mmoire], Ecole Nationale des Ponts et Chausse (ENPC), sept. 2004 188 p.
10. Yann LEFEUVRE, Contribution ltude du comportement en fatigue des enrobs
bitumineux [mmoire], Ecole Nationale des Ponts et Chausse (ENPC), 2001 200 p.
11. Dr Ismala GUEYE, Cours de Gotechnique Routire [cours], Fondation 2ie, 2010,
61
p.
12. Dramane COULIBALY, Cours de pathologie et entretien des chausses [cours],
Fondation 2ie, 2010, 105 p.
13. Dr Paulin KOUASSI, Cours de dimensionnement des Chausses [cours], Fondation 2ie,
2009, 61 p.
TAPSOBA J. Honora
Juin 2012
Page 46
ETUDE DE FORMULATION ET DE MISE EN UVRE DES ENROBES :
cas du renforcement de la route Ouaga-Sakoins
ANNEXES
TAPSOBA J. Honora
Juin 2012
Page 47
ETUDE DE FORMULATION ET DE MISE EN UVRE DES ENROBES :
cas du renforcement de la route Ouaga-Sakoins
LISTES DES ANNEXES :
ANNEXE 1 : Dimensionnement Aliz ...50
ANNEXE 2 : Analyse des dflexions...52
ANNEXE 3 : Etudes sur lentretien 53
ANNEXE 4 : Tableau de comparaison des couts ..55
ANNEXE 5 : Calcul inverse de la dure de service pour CAM=0.857
ANNEXE 6 : Correction analyse granulomtrique du BB 59
ANNEXE 7 : Analyse granulomtrique de la GB 62
ANNEXE 8 : Rsultats des tudes de formulation 63
ANNEXE 9 : Tableau dexcution des essais de contrle 64
ANNEXE 10 : Calibrage de louverture des trmies68
ANNEXE 11 : Schma de la centrale denrobage .70
ANNEXE 12 : Dfinition des diffrents essais 71
ANNEXE 13 : Mthode thorique de prdiction de lornirage 78
TAPSOBA J. Honora
Juin 2012
Page 48
ETUDE DE FORMULATION ET DE MISE EN UVRE DES ENROBES :
cas du renforcement de la route Ouaga-Sakoins
ANNEXE 1 : DIMENSIONNEMENT ALIZE
Donnes Chargement :
jumelage standard de 65 KN
pression verticale : 0.6620 MPa
rayon de contact : 0.1250 m
entraxe jumelage : 0.3750 m
Units :
m, MN et MPa ; dformations en df ; dflexions en mm/100
Notations :
X=axe transversal
Y=axe longitudinal Z=axe vertical
R=axe vertical roue J=axe vertical entre-jumelage.
Tractions principales majeures dans le plan horizontal XoY et compressions principales
majeures selon la verticale ZZ ; dflexion maximale
Niveau
Calcul
EpsilonT
horizontale
SigmaT
horizontale
EpsilonZ
verticale
SigmaZ
verticale
------------------------------------------------------ surface (z=0.000) ---------------------------------------h= 0,050 m
0,000m
35,7 X-J
0,138 X-J
226,8 Z-R
0,660 Z-R
E= 1000,0 MPa
nu= 0,350
0,050m
38,6 X-R
0,153 Y-J
328,3 Z-R
0,618 Z-R
--------------------------------------------------- coll (z=0,050m) -------------------------------------------h= 0,120 m
0,050m
38,6 X-R
0,289 Y-J
134,0 Z-R
0,618 Z-R
0,170m
-144,6 Y-R
-0,282 Y-R
203,7 Z-R
0,239 Z-R
E= 2020,0 MPa
nu= 0,350
--------------------------------------------------- coll (z=0,170m) -------------------------------------------h= 0,200 m
0,170m
-144,6 Y-R
0,004 Y-J
378,0 Z-R
0,239 Z-R
0,370m
-114,1 Y-J
-0,049 Y-J
184,2 Z-J
0,084 Z-J
E= 600,0 MPa
nu= 0,350
--------------------------------------------------- coll (z=0,370m) -------------------------------------------h= 0,150 m
0,370m
-114,1 Y-J
-0,017 Y-J
227,8 Z-J
0,084 Z-J
E= 400,0 MPa
TAPSOBA J. Honora
Juin 2012
Page 49
ETUDE DE FORMULATION ET DE MISE EN UVRE DES ENROBES :
cas du renforcement de la route Ouaga-Sakoins
nu= 0,350
0,520m
-93,1 Y-J
-0,028 Y-J
163,6 Z-J
0,048 Z-J
--------------------------------------------------- coll (z=0,520m) -------------------------------------------h= 0,200 m
0,520m
-93,1 Y-J
0,720m
-89,4 Y-J
-0,017 Y-J
182,3 Z-J
0,048 Z-J
E= 320,0 MPa
nu= 0,350
-0,029 Y-J
137,6 Z-J
0,024 Z-J
--------------------------------------------------- coll (z=0,720m) -------------------------------------------h= 0,250 m
0,720m
-89,4 Y-J
-0,008 Y-J
185,1 Z-J
0,970m
-76,5 Y-J
-0,011 Y-J
133,0 Z-J
0,024 Z-J
E= 160,0 MPa
nu= 0,350
0,014 Z-J
--------------------------------------------------- coll (z=0,970m) -------------------------------------------h infini
0,970m
-76,5 Y-J
-0,002 Y-J
186,8 Z-J
0,014 Z-J
E= 80,0 MPa
nu= 0,350
Dflexion maximale = 39,1 mm/100 (entre-jumelage)
Rayon de courbure = 322,0 m (entre-jumelage)
TAPSOBA J. Honora
Juin 2012
Page 50
ETUDE DE FORMULATION ET DE MISE EN UVRE DES ENROBES :
cas du renforcement de la route Ouaga-Sakoins
ANNEXE 2 : ANALYSE DES DEFLEXION
PK
dflexion
PK
dflexion
PK
dflexion
PK
dflexion
1.175
64
12.925
72
24.675
60
36.425
63
2.35
59
14.1
58
25.85
76
37.6
59
3.525
62
15.275
60
27.025
58
38.775
48
4.7
50
16.45
76
28.2
61
39.95
57
5.875
54
17.625
58
29.375
62
41.125
63
7.05
48
18.8
62
30.55
66
42.3
69
8.225
46
19.975
60
31.725
60
43.475
46
9.4
58
21.15
62
32.9
49
46
70
10.575
52
22.325
44
34.075
57
11.75
45
23.5
63
35.25
61
140
120
dflexion
100
80
60
40
moy mobile sur 5 ans
20
moyenne arithmtique
47.00
44.65
42.30
39.95
37.60
35.25
32.90
30.55
28.20
25.85
23.50
21.15
18.80
16.45
14.10
11.75
9.40
7.05
4.70
2.35
0.00
PK
TAPSOBA J. Honora
Juin 2012
Page 51
ETUDE DE FORMULATION ET DE MISE EN UVRE DES ENROBES :
cas du renforcement de la route Ouaga-Sakoins
ANNEXE 3 : RESULTATS DES ETUDES SUR LENTRETIEN
Type dentretien prvu :
+ 5cm de BB sur la couche existante (projection 40 ans)
entretien aprs 05 ans :
Trafic coul NE1 = 1 602 821
Trafic restant NE2 = 19 531 179
NEadm1 = 6 510 580 (ancienne chausse)
Dommage subit par la chausse au moment de lentretien : D1 =
= 0.246
Dommage rsiduel : D2 = 1- D1 = 0.754
NEadm2 =
tadm = 203.4 df
= 25 903 420
Avant entretien, on a pour le BB, t1 = 38.6 df
Aprs entretien, on a : t2 = 15.1 df
1/b
Ce qui donne un dommage D1 =
Et un dommage D2 =
1/b
= 0.25 pour lanne dentretien
= 0.087 aprs 5 ans
Ce qui fait un dommage totale : D = 0.338 aprs 5 ans.
En recommenant lopration pour aprs 10, 15, , 40 ans, on obtient le tableau suivant :
ANNEE
5
10
15
20
25
30
35
40
NE1
1602821
3502500
5698900
8192200
10982000
14069000
17453000
21134000
TAPSOBA J. Honora
NE2
NE adm
19531179 25903420
17631500 23383952
15435100 20470955
12941800 17164191
10152000 13464191
7065000 9370026.5
3681000 4881962.9
0
0
Juin 2012
t adm
203.4
174
157.8
146.8
138.4
131.7
126.2
121.4
D2
0.25
0.0867816
0.1824724
0.2853334
0.3944374
0.509092
0.6287433
0.7531255
D
0.25
0.3367816
0.519254
0.8045874
1.1990248
1.7081168
2.3368601
3.0899856
Page 52
ETUDE DE FORMULATION ET DE MISE EN UVRE DES ENROBES :
cas du renforcement de la route Ouaga-Sakoins
entretien aprs 10 ans et 15 ans :
En recommenant les mmes oprations, on obtient :
entretien 10 ans
anne
D'
0.4867816
10
0.669254
15
0.9545874
20
1.3490248
25
1.8581168
30
2.4868601
35
3.2399856
40
TAPSOBA J. Honora
entretien 15 ans
anne
D'
15
20
25
30
35
40
Juin 2012
0.899254
1.1845874
1.5790248
2.0881168
2.7168601
3.4699856
Page 53
ETUDE DE FORMULATION ET DE MISE EN UVRE DES ENROBES :
cas du renforcement de la route Ouaga-Sakoins
ANNEXE 4 : TABLEAU DE COMPARAISON DES COUTS
N PRIX
DESIGNATION
200
201
202
203
204
205
206
TERRASSEMENTS
Dcapage de la terre vgtale
Purges
Dblais et mis en dpt
Dblais mis en remblai
Remblais provenant d'emprunt
Revtement des talus en terre
vgtale et vgtalisation
Mise en forme, Rglage et
compactage de la plate-forme
Couche de forme
Recyclage de la couche de base
existante
Fraisage et remise en dpt du BB
existant
Sous total Srie 200
207
208
209
210
300
301
302-1
CHAUSSEE
Couche de fondation en graveleux
latritiques
Couche de base en graveleux
TAPSOBA J. Honora
Juin 2012
Structure 1
Quantit
Montant
Structure 2
Quantit
Montant
Unit
Prix Unit
m
m3
m3
m3
m3
m
2632
10528
3948
4230
5264
1692
25436
8400
57571
5695
5000
46303
66947552
88435200
227290308
24089850
26320000
78344676
25436
8400
117450
51120
5000
46303
66947552
88435200
463692600
216237600
26320000
78344676
0
0
-236402292
-192147750
0
0
658
174140
114584120
330500
217469000
-102884880
m3
m3
6299
5076
39631
18968
249635669
96281568
82625
0
520454875
0
-270819206
96281568
m3
21056
3569
75148864
17850
375849600
-300700736
2053751103
1006673296
1047077807
Ecart
m3
7050
11480
80934000
66100
466005000
-385071000
m3
7482
27677
207079314
48000
359136000
-152056686
Page 54
ETUDE DE FORMULATION ET DE MISE EN UVRE DES ENROBES :
cas du renforcement de la route Ouaga-Sakoins
302-2
303
304
305
306
307
308
latritiques
Couche de base en grave concasse
0/20
Imprgnation au bitume fluidifi
couche d'accrochage au bitume
fluidifi
Grave-bitume 0/14
Bton bitumineux 0/10
Enduit superficiel bicouche
Enduit superficiel monocouche
Sous-total Srie 300
TOTAL GENERAL HTVA
TVA 18%
DROIT D'ENREGISTREMENT
3%
PATENTE 2%
MONTANT TOTAL TTC HORS
PROVISIONS
TAPSOBA J. Honora
Juin 2012
m3
41830
25688
1074529040
84000
3513720000
m
m
752
423
265848
1003427
199917696
424449621
553000
780000
415856000
329940000
m3
m3
m
m
97760
101520
3004
2444
84843
19517
155901
220349
8294251680
1981365840
468326604
538532956
13269386751
48000
19517
166315
0
2439190960
-215938304
94509621
4692480000 3601771680
1981365840
0
499610260
-31283656
0
538532956
12258113100 1011273651
14316464558
2576963620
429493936.7
14311864203
2576135557
429355926.1
4600355
828063.9
138010.65
286329291.2
17609251406
286237284.1
17603592970
92007.1
5658436.65
Page 55
ETUDE DE FORMULATION ET DE MISE EN UVRE DES ENROBES :
cas du renforcement de la route Ouaga-Sakoins
ANNEXE 5 : CALCUL INVERSE DE LA DUREE DE SERVICE POUR
CAM=0.8
Calcul du trafic
Avec : TMJA : 428 PL
n : 15 ans
TC = 2 999 400 PL
i : 4%
NE = TC x CAM ;
avec : CAM = 0.8
NE = 2 399 520
Toutes ces donnes sont rcapitules dans le tableau ci-dessous :
TMJA (PL)
Dure de vie (ans)
TC (PL)
CAM
NE
428
4%
15
2 999 400
0.8
2 399 520
Hypothse
Avec un trafic NE = 2 399 520, on se retrouve dans la fourchette de trafic correspondant T3.
Calcul des dformations
On a :
zadm
= A x (NE)-0.222 avec A =12000 car NE > 25000
Zadm =
460.037 df
-
On a :
tadm
Dformation admissible verticale
6(10
Dformation admissible transversale
; 25 Hz) x (
)b x
x Kc x Kr x Ks avec :
pour la GB
matriau
GB
6 (10
25 Hz)
90
TAPSOBA J. Honora
E (10)
MPa
12300
E (34)
MPa
2020
-1/b
Kc
1/Ks
R (%)
Kr
1.3
0.91
10
0.794
Juin 2012
Page 56
ETUDE DE FORMULATION ET DE MISE EN UVRE DES ENROBES :
cas du renforcement de la route Ouaga-Sakoins
Pour la GB :
tadm
= 174.9 df
Calcul des dformations sous essieu 13 t
Aprs modlisation de notre structure de chausse dans le logiciel Aliz LCPC, les rsultats
suivant ont t obtenus :
Calcul inverse
On obtient ainsi, t = 144.6 df pour des dformations admissibles
tadm
= 174.9 df.
Ceci donne par calcul inverse sur aliz, une dure de vie N = 31 ans, soit un accroissement
de 15 ans compar a celle de la chausse avec un CAM = 1.9
TAPSOBA J. Honora
Juin 2012
Page 57
ETUDE DE FORMULATION ET DE MISE EN UVRE DES ENROBES :
cas du renforcement de la route Ouaga-Sakoins
ANNEXE 6 : CORRECTION ANALYSE GRANULOMETRIQUE DU BB
Analyse des diffrents granulats :
Tamis
(mm)
14
12.5
11.2
10
8
6.3
5.6
4
2
1
0.5
0.25
0.125
0.08
0.063
0/4
100
100
100
100
100
99.9
99.7
97.6
80.8
64.4
47.2
29.3
16.1
10.5
8.5
Passants (%)
4/6
6/10
100
100
100
99.9
100
99.5
100
93.1
99.9
56.9
87
16.7
72.9
8.1
18.8
2
3.6
0.7
1.8
0.4
1.2
0.3
0.9
0.2
0.7
0.2
0.6
0.2
0.4
0.1
Filler
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
95
90
84
Correction de la courbe par tude du combin granulomtrique
TAPSOBA J. Honora
Juin 2012
Page 58
ETUDE DE FORMULATION ET DE MISE EN UVRE DES ENROBES :
cas du renforcement de la route Ouaga-Sakoins
Tamis (mm)
Spcifications
Limite suprieur
Limite infrieur
Granulomtrie vise
20
100
100
100
100
1
2
3
4
5
6
7
8
GRANULAT
Gros granulats
G1 10/14
G2 6/10
G3
Granulats fins
F1 4/6
F2 0/4
F3
Granulats trs fins
Filler
Calibre
%
Densit
G1
G2
36
2.600
G3
G4
F1
23.12
2.600
F2
37.08
2.620
F3
TF
3.8
2.700
COMBINE GRANULOMETRIQUE
TAPSOBA J. Honora
Juin 2012
14.00
10.00
100.00
100.00
100.00
95.00
100.00
97.50
89.00
71.00
Correction sur 10 mm
6.30
2.00
0.50
0.08
72.00
65.00
68.50
51.00
46.00
38.00
42.00
27.00
20.00
23.50
8.00
6.00
7.00
100
99.90
93.10
16.70
48.00
0.70
0.30
36.00
19.00
Correction sur 0.08 mm
3.60
1.20
80.80
47.20
0.20
2.10
100
100
100.00
100.00
100.00
100.00
87.00
99.90
100
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
90.00
36
35.96
33.52
6.01
0.25
0.11
0.07
23.12
37.08
23.12
37.08
23.12
37.08
20.11
37.04
0.83
29.96
0.28
17.50
0.14
3.89
3.8
100
3.80
99.96
3.80
97.52
3.80
66.97
3.80
34.84
3.80
21.69
3.42
7.52
0.60
10.50
Page 59
ETUDE DE FORMULATION ET DE MISE EN UVRE DES ENROBES :
cas du renforcement de la route Ouaga-Sakoins
Formule retenue :
Tamis (mm)
20
14
10
6.3
2
0.5
0.08
Passant (%)
100
99.96
97.52
66.97
34.84
21.69
7.52
Fuseau inf
100
100
95
65
38
20
6
Fuseau sup
100
100
100
72
46
27
8
Cette nouvelle formule donne le graphique suivant :
120
100
passant (%)
80
60
40
20
fuseau
0
0.01
0.1
10
100
tamis (mm)
TAPSOBA J. Honora
Juin 2012
Page 60
ETUDE DE FORMULATION ET DE MISE EN UVRE DES ENROBES :
cas du renforcement de la route Ouaga-Sakoins
ANNEXE 7 : ANALYSE GRANULOMETRIQUE DE LA GB
Analyse des diffrents granulats :
Tamis (mm)
16
14
12.5
10
8
6.3
4
2
1
0.5
0.25
0.125
0.08
0.063
Tamis
(mm)
16
12.5
10
8
6.3
5
4
3.15
2.5
2
1.6
1.25
Formule retenue :
Passant
Fuseau
(%)
inf
99.5
100
91
100
79.5
100
70
63
79
52.5
44.5
65
36.5
33
30
45
27
24
TAPSOBA J. Honora
Passants (%)
4/6
6/10
100
100
100
100
100
99.9
100
93.1
99.9
56.9
87
16.7
18.8
2
3.6
0.7
1.8
0.4
1.2
0.3
0.9
0.2
0.7
0.2
0.6
0.2
0.4
0.1
0/4
100
100
100
100
100
99.9
97.6
80.8
64.4
47.2
29.3
16.1
10.5
8.5
Fuseau
sup
100
83
71
51
35
23
Tamis
(mm)
1
0.8
0.63
0.5
0.4
0.315
0.25
0.2
0.16
0.125
0.1
0.08
Juin 2012
10/14
100
79
48
42
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
Passant
(%)
21.5
19
17.5
15.5
13
11
9.5
8
7
5.5
5
4.5
Fuseau
inf
Fuseau
sup
25
10
15
Page 61
ETUDE DE FORMULATION ET DE MISE EN UVRE DES ENROBES :
cas du renforcement de la route Ouaga-Sakoins
ANNEXE 8 : RESULTATS DES ETUDES DE FORMULATION
POUR LE BB
Constituant :
Constituants
Concass 6/10
Concass 4/6
Concass 0/4
Filler (calcaire bocahut)
Bitume pur 50/70
PCG
Nombre de giration
5
10
15
20
25
30
40
50
60
80
100
120
150
200
Dosage (%)
42.2
23.7
24.6
3.8
5.2
Ornirage
Nombre de cycles N
30
100
300
1000
3000
10000
30000
TAPSOBA J. Honora
% Vide
21
18
16.1
14.8
13.7
12.8
11.5
10.4
9.6
8.3
7.4
6.6
5.8
4.8
Catgorie
V min11
V min5
% Ornirage Moyen
1.6
2.1
2.5
2.9
3.6
4.7
6.9
Juin 2012
Vmax10
Catgorie
P7.5
Page 62
ETUDE DE FORMULATION ET DE MISE EN UVRE DES ENROBES :
cas du renforcement de la route Ouaga-Sakoins
ANNEXE 9 : TABLEAU DEXECUTION DES ESSAIS DE CONTROLE
Pour le BB :
MATERIAU
NATURE DES ESSAIS
NOM
PROCESSUS
Temprature de stockage du
liant
Thermomtre
145 155 C
Analyse granulomtrique
par tamisage
NF P 18-560
respect de la courbe de formulation
Teneur en eau des granulats
la sortie du scheur
NF P 18-555
w < 1%
Temprature du BB la
sortie du malaxeur
Thermomtre
fabrication entre 145/165 C
Essai Marshall
Bton bitumineux
(mise en uvre)
TAPSOBA J. Honora
respect des valeurs obtenues lors de
l'tude de formulation
respect du module de richesse rsultant
LCPC Rec. 2/3 XP T
de l'tude (considr comme valeur
66-041
plancher)
Pese de plaquettes 250 300 g/m (bitume rsiduel) 0.1
NF P 98-275-1
kg/m
au gr de l'ingnieur
2 analyses par jour
LCPC
Teneur en liant du BB
couche d'accrochage
NOMBRE
D'ESSAIS
92 C < 96
> 0.75
< 97
Compacit LCPC en %
Bton bitumineux
Rapport r/R
(tude de formulation)
Compacit Marshall
Bton bitumineux
(fabrication)
RESULTATS EXIGE
Dosage du liant
Vrification matriel
Juin 2012
Inspection visuelle
propret des bennes de camions, du
finisseur, des compacteurs
1 tous les 1500 m
au gr de l'ingnieur
Page 63
ETUDE DE FORMULATION ET DE MISE EN UVRE DES ENROBES :
cas du renforcement de la route Ouaga-Sakoins
Temprature du BB derrire
finisseur
Compacit en place
Compacit sur carotte
Rglage
Surfaage
TAPSOBA J. Honora
Thermomtre
140 160 C
Gamma densimtre
NF P 98-241-1
92% 100% des mesures 96%
LCPC
92% 100% des mesures 96%
Nivellement de
prcision
+ 1 cm et - 0.5 cm par rapport la
largeur thorique
Rgle de 3 m NF P
98-218-1
flche maximale 1 cm
Largeur
Chaine
Dvers
Rgle
1 carotte tous les 50 m
ct G-A-D
chaque profil en
travers (trois points
min)
entre 0 et 5 cm par rapport la largeur
thorique
0.5 %
chaque profil en
travers
Epaisseur
Carottage
contrle direct suprieur l'paisseur
prescrite - 0.5 cm
1 carotte tous les 50 m
ct G-A-D
Dflexion
Poutre de Benkelman
NF P 98-200-2
valeur informative sur portance
chausse finie
1 mesure tous les 50
en quinconce
Juin 2012
Page 64
ETUDE DE FORMULATION ET DE MISE EN UVRE DES ENROBES :
cas du renforcement de la route Ouaga-Sakoins
Pour la GB :
MATERIAU
NATURE DES ESSAIS
NOM
PROCESSUS
Temprature de stockage
du liant
Thermomtre
145 155 C
Analyse granulomtrique
par tamisage
NF P 18-560
respect de la courbe de formulation
Teneur en eau des
granulats la sortie du
scheur
NF P 18-555
w < 1%
Temprature du GB la
sortie du malaxeur
Thermomtre
fabrication entre 150/170 C
Essai Marshall
Grave bitume
(mise en uvre)
2 analyses par jour
respect des valeurs obtenues lors de l'tude
de formulation
LCPC Rec. 2/3 XP T respect du module de richesse rsultant de
66-041
l'tude (considr comme valeur plancher)
Dosage du liant
Pese de plaquettes
NF P 98-275-1
350 400 g/m (bitume rsiduel) 0.1
kg/m
Vrification matriel
Inspection visuelle
propret des bennes de camions, du
finisseur, des compacteurs
Temprature du GB
derrire finisseur
Thermomtre
Optimale de 140 150 C (Tmin=130 C)
Compacit en place
Gamma densimtre
NF P 98-241-1
100% des mesures > 89%
LCPC
100% des mesures > 89%
Compacit sur carotte
TAPSOBA J. Honora
au gr de l'ingnieur
LCPC
Teneur en liant du GB
couche d'accrochage
NOMBRE
D'ESSAIS
> 89%
> 0.65
Grave bitume 0/14 Compacit LCPC en %
(tude de formulation) Rapport r/R
Grave bitume
(fabrication)
RESULTATS EXIGE
Juin 2012
1 tous les 1500 m
au gr de l'ingnieur
1 carotte tous les 50
m ct G-A-D
Page 65
ETUDE DE FORMULATION ET DE MISE EN UVRE DES ENROBES :
cas du renforcement de la route Ouaga-Sakoins
Rglage
Surfaage
+ 1 cm et - 0.5 cm par rapport la largeur
thorique
Rgle de 3 m NF P
98-218-1
flche maximale 1 cm
Largeur
Chaine
Dvers
Rgle
entre 0 et 5 cm par rapport la largeur
thorique
0.5 %
contrle direct suprieur l'paisseur
prescrite - 0.5 cm
Calcul de dm, vrification compatibilit
Poutre de Benkelman
avec la rsistance la traction admissible
NF P 98-200-2
la base de la GB
Epaisseur
Carottage
Dflexion
TAPSOBA J. Honora
Nivellement de
prcision
Juin 2012
chaque profil en
travers (trois points
min)
chaque profil en
travers
1 carotte tous les 50
m ct G-A-D
1 mesure tous les 50
en quinconce
Page 66
ETUDE DE FORMULATION ET DE MISE EN UVRE DES ENROBES :
cas du renforcement de la route Ouaga-Sakoins
ANNEXE 10 : CALIBRAGE DE LOUVERTURE DES TREMIES
Donnes :
Capacit de la centrale
= 100 tonnes/h
Vitesse des courroies dalimentation = 20 rvolutions/minute
Dbit des trmies selon louverture :
nombre
Hauteur
Masse
Masse du
Masse
Masse par
Trmie
de
des portes
Totale
rcipient
Nette
rvolution
N
rvolution
(cm)
(Kg)
(Kg)
(Kg)
(Kg)
/mn
76.6
15.1
61.5
18.1
1
55.4
14.9
40.5
11.9
2
3
49.8
14.8
35
3.4
10.3
4
4
48.5
14.8
33.7
9.9
5
42.3
15.1
27.2
8.0
148.9
15.1
133.8
47.8
1
124.4
14.9
109.5
39.1
2
3
115.3
14.8
100.5
2.8
35.9
8
4
99.1
14.8
84.3
30.1
5
89
15.1
73.9
26.4
186.3
15.1
171.2
77.8
1
155.7
14.9
140.8
64.0
2
3
138.4
14.8
123.6
2.2
56.2
12
4
120.6
14.8
105.8
48.1
5
110.1
15.1
95
43.2
193.9
15.1
178.8
105.2
1
178.6
14.9
163.7
96.3
2
3
143
14.8
128.2
1.7
75.4
16
4
126.8
14.8
112
65.9
5
112.7
15.1
97.6
57.4
154.6
15.1
139.5
126.8
1
129.4
14.9
114.5
104.1
2
3
118.1
14.8
103.3
1.4
93.9
20
4
105.7
14.8
90.9
82.6
5
91.9
15.1
76.8
69.8
TAPSOBA J. Honora
Juin 2012
Page 67
ETUDE DE FORMULATION ET DE MISE EN UVRE DES ENROBES :
cas du renforcement de la route Ouaga-Sakoins
GB
BB
Quantit formul :
10/14
6/10
42
18
42.2
4/6
20
23.7
Calcul des diffrentes masses :
Masse (Kg/rv)
Totale
10/14
6/10
4/6
0/4
Bitume (Kg/mn)
Calibrage :
Trmie 1
0/4
20
24.6
Filler
3.8
GB
79.68
33.46
14.34
15.94
15.94
73.17
Bitume
4.39
5.3
BB
78.92
33.30
18.70
19.41
88.33
Trmie 2
Trmie 3
Trmie 4
Dbit bitume
(cm)
(cm)
(cm)
(cm)
(l/min)
GB
3.54
4.61
4.65
8.78
78.33
BB
4.18
5.00
7.60
94.56
TAPSOBA J. Honora
Juin 2012
Page 68
ETUDE DE FORMULATION ET DE MISE EN UVRE DES ENROBES :
cas du renforcement de la route Ouaga-Sakoins
ANNEXE 11 : SCHEMA DE LA CENTRALE DENROBAGE
TAPSOBA J. Honora
Juin 2012
Page 69
ETUDE DE FORMULATION ET DE MISE EN UVRE DES ENROBES :
cas du renforcement de la route Ouaga-Sakoins
ANNEXE 12 : DEFINITION DES DIFFERENTS ESSAIS
Analyse granulomtrique
La granulomtrie est la distribution dimensionnelle dun matriau donn. La mthode utilise
est celle par tamisage sec aprs lavage de la norme franaise NF P 94-056.
Principe
Lessai consiste tamiser au moyen dune srie de tamis normaliss mailles carres, un
chantillon reprsentatif dun matriau donn. Les masses des diffrents refus ou celles des
diffrents tamist sont rapportes la masse initiale du matriau, les pourcentages ainsi
obtenus sont exploits, soit sous leur forme numrique, soit sous une forme graphique (courbe
granulomtrique).
Mode opratoire
Lchantillon soumis lessai est pralablement sch ltuve pendant au moins quatre
heures 105 5C. Il est ensuite lav au tamis de 80m, qui reprsente le plus petit
diamtre des tamis. Le lavage est repris plusieurs fois, jusqu ce que leau de lavage
devienne claire. Ensuite le matriau humide est remis ltuve pour schage pendant au
moins vingt quatre heures 105 5C. Aprs cela, le matriau sec est pes laide dune
balance, afin dobtenir la masse de lchantillon sec note Ms. Le matriau est vers dans une
colonne de tamis constitue par lembotement de tamis mailles carres, classs de haut en
bas dans lordre de maille dcroissante. Cette colonne est agite manuellement ou
mcaniquement, puis les tamis sont repris un un en commenant par celui qui a le plus
grand diamtre. Le refus des tamis est pes de faon cumule, en commenant par celui ayant
le plus grand diamtre.
Los Angeles (LA)
Principe
Le principe de cet essai est la dtermination de la rsistance la fragmentation par chocs et
lusure par frottements rciproques. Il fait lobjet de la norme franaise NF P 18- 573. Le
coefficient Los Angeles est calcul partir du passant au tamis de 1,63mm, mesur en fin
dessai.
Excution de lessai
TAPSOBA J. Honora
Juin 2012
Page 70
ETUDE DE FORMULATION ET DE MISE EN UVRE DES ENROBES :
cas du renforcement de la route Ouaga-Sakoins
En fonction de la classe granulaire du matriau, on fait le choix dune classe granulaire
comprise dans la classe du matriau. On tamise le matriau entre les tamis correspondant la
classe granulaire choisie, et on prlve exactement une masse A= 5000 g de cette classe pour
lexcution de lessai. En fonction de la classe granulaire choisie, un abaque donne le nombre
de billes normalises utilises pour lessai. Introduire le matriau et les billes dans
lappareil. Aprs 500 tours soit 15mn on arrte lappareil et on retire le matriau. Celui-ci est
tamis au tamis de 1,63mm, lav, tuv puis pes. Soit B la masse du refus au tamis de
1,63mm.
Expression des rsultats
Le coefficient de Los Angeles exprim en pourcentage est obtenu par la formule suivante :
LA =
x 100
Equivalent de Sable (ES)
Principe
La propret superficielle est le coefficient pondral de particules infrieures 0,5 mm
contenues dan un chantillon de matriau. Il sagit donc, pour ce qui est du principe de lessai,
de sparer par lavage sur tamis de 0,5mm les particules infrieures cette dimension. La
norme de rfrence est la norme franaise NF P18-591.
Excution de lessai
Une masse dchantillon denviron 5 7 kg est prleve. Cette masse est pese au gramme
prs. On prpare deux chantillons partir de lchantillon pour laboratoire. Les deux
chantillons sont pess au gramme prs, et on obtient respectivement M1h pour le premier
chantillon et Mh pour le deuxime. Le premier chantillon est sch ltuve 105
5C jusqu masse constante au gramme prs. On le pse et on obtient une masse sche
M1s. Il est ensuite lav au tamis de 0,5mm, puis on sche le refus ltuve 105 5C
jusqu masse constante au gramme prs. On tamise le refus sch au tamis de 0,5mm
pendant une minute environ, et on le pse pour obtenir une masse sche m du refus.
Expression des rsultats
On calcule dabord la masse sche de lchantillon soumis lessai Ms partir de la
formule suivante :
TAPSOBA J. Honora
Ms(g) = Mh x
Juin 2012
Page 71
ETUDE DE FORMULATION ET DE MISE EN UVRE DES ENROBES :
cas du renforcement de la route Ouaga-Sakoins
Ensuite, on calcule la masse sche m des lments infrieurs 0,5mm par la formule
m(g) = Ms-m. La propret superficielle P est donne par la relation suivante :
P = 100 x
Coefficient dAplatissement (CA)
Principe
Le coefficient daplatissement caractrise la forme du granulat partir de sa plus grande
dimension et de son paisseur. Lessai consiste effectuer un double tamisage effectu selon
la norme franaise NF P 18-561:
Tamisage par voie sche sur tamis mailles carres pour la
dtermination des classes granulaires du matriau travers
lchantillon reprsentatif
Tamisage des diffrentes classes granulaires sur grilles fentes
parallles normalises.
Excution de lessai
On prlve un chantillon reprsentatif dont la masse est denviron 5 7 kg. Lchantillon est
lav et sch ltuve 105 5C pendant au moins 4 h. il
est ensuite crt au tamis
mailles carres de 4mm puis pes au gramme prs avant le dbut de lessai. Le premier
seffectue sur colonne de tamis mailles carres et on pse chaque classe granulaire
sparment. On procde au tamisage sur grille en fonction de la classe granulaire
correspondante, puis on pse au gramme prs le passant sur la grille correspondant chaque
classe granulaire.
Expressions des rsultats
Le coefficient daplatissement est calcul pour chaque classe granulaire selon la formule :
A classe = 100 x
, avec Me, la masse de chaque classe granulaire et Mg, la masse du refus
au tamis mailles carres de 4 mm pour chaque classe granulaire. Le coefficient
daplatissement global A est calcul partir de la formule : A = 100 x
, avec Me, la
masse totale de toutes les classes granulaires et Mg, la masse totale du refus au tamis
mailles carres de 4 mm.
TAPSOBA J. Honora
Juin 2012
Page 72
ETUDE DE FORMULATION ET DE MISE EN UVRE DES ENROBES :
cas du renforcement de la route Ouaga-Sakoins
L'essai de pntration (EN 1426)
Cet essai dtermine lenfoncement dune aiguille normalise de 1 mm de diamtre sur un
chantillon de bitume maintenu 25 C sous une charge de 100 g applique pendant 5
secondes. Cet essai est exprim en diximes de millimtre. Plus le bitume est mou plus la
valeur absolue de la pntrabilit est grande. Les bitumes sont dfinis par leur classe de
pntrabilit qui correspond sa borne infrieure et sa borne suprieure. (Exemple : 20/30
35/50 50/70 70/100 160/220)
Il est possible de tracer l'volution de la pntrabilit en fonction de la temprature et de
calculer un indice de pntrabilit trs utile pour apprcier la susceptibilit thermique du
bitume en faisant varier la temprature mais en gardant tous les autre paramtres.
Point de ramollissement bille et anneau (EN 1427)
Cet essai consiste donner une indication de la temprature laquelle le bitume acquiert une
plasticit donne. Les bitumes ne sont pas des corps purs et n'ont pas de point de fusion franc
et leur consistance volue avec la temprature. Cest pourquoi, pour chaque classe de bitume,
un intervalle de TBA de 8 C est impos, cest le repre de changement de consistance des
bitumes dans des conditions parfaitement dfinies. Une petite bille en acier de 3,5 g et de 9,5
mm de diamtre est pose sur un disque de bitume pralablement coul dans un anneau de
19,8 mm de diamtre intrieur, lui-mme plac sur un support normalis. Le tout est install
dans un bain d'eau dont la temprature initiale et stabilise est de 5 C. La face infrieure de
l'anneau de bitume se trouve 25,4 mm de la surface suprieure de la plaque du dessous du
TAPSOBA J. Honora
Juin 2012
Page 73
ETUDE DE FORMULATION ET DE MISE EN UVRE DES ENROBES :
cas du renforcement de la route Ouaga-Sakoins
support, ce qui correspond la distance de chute de la bille au cours de l'essai. Le bain est
chauff une vitesse constante de 5 C/min, sous agitation. Le point de ramollissement bille
et anneau (souvent not TBA) est la temprature laquelle la poche de bitume, forme
pendant la chute de la bille, touche la plaque de rfrence.
Dans cet essai, plus le point de ramollissement est lev plus le bitume est dur.
Dtermination de la rsistance au durcissement sous l'effet de la
chaleur et de l'air (EN 12607-1)
Le RTFOT (Rolling Thin Film Oven Test) est un essai dune dure de 75 minutes qui permet
de mesurer les effets combins de la chaleur et de l'air sur un mince film de bitume qui est
continuellement renouvel.
On coule une petite quantit de bitume dans un flacon ouverture rduite plac
horizontalement sur un disque rotatif dispos verticalement au fond d'une tuve ventile. La
temprature est rgule 163 oC et chaque tour (c..d. toutes les 4 secondes), l'ouverture du
flacon passe devant un jet d'air chaud.
Le point de rupture selon FRASS donne une indication sur le comportement du bitume
basse temprature.
TAPSOBA J. Honora
Juin 2012
Page 74
ETUDE DE FORMULATION ET DE MISE EN UVRE DES ENROBES :
cas du renforcement de la route Ouaga-Sakoins
XI.
DETERMINATION DE LA TENEUR EN BITUME :
Cet essai consiste dterminer le pourcentage de bitume d'un enrob selon la teneur en liant
de la formulation retenue au laboratoire. Cette procdure s'applique dans le laboratoire sur un
matriau d'origine naturelle, dans le domaine des routes.
Appareillage :
Centrifugeuse + filtre.
Solvant.
Srie de tamis (0/20 GB ou 0/14 BB)
Divers accessoires : spatule, plateau mtallique, paire de gant, petite pelle
TAPSOBA J. Honora
Juin 2012
Page 75
ETUDE DE FORMULATION ET DE MISE EN UVRE DES ENROBES :
cas du renforcement de la route Ouaga-Sakoins
Balance + tuve.
Mode opratoire :
Procder un prlvement au niveau de la station d'enrob ou aprs pandage.
passer l'chantillon l'tuve 150C pendant 1h environs.
Homogniser le matriau et faire un quartage.
Peser le matriau enrob puis l'introduire dans la centrifugeuse en ajoutant du
solvant.
Centrifuger jusqu' obtention d'une couleur claire de solvant.
Scher le matriau dsenrob et peser.
La diffrence de pese donne le poids du liant.
Laver le matriau dsenrob au tamis 0.080mm puis scher.
Faire une analyse granulomtrique suivant la norme N.F.P 18-560.
Expression des rsultats :
La teneur en liant est donne par la formule suivante :
Teneur en liant =
TAPSOBA J. Honora
x 100
Juin 2012
Page 76
ETUDE DE FORMULATION ET DE MISE EN UVRE DES ENROBES :
cas du renforcement de la route Ouaga-Sakoins
ANNEXE 13 : METHODE THEORIQUE DE PREDICTION DE
LORNIERAGE
Pour appliquer cette nouvelle procdure de prdiction il faut passer par les cinq tapes
dcrites ci-dessous.
Etape 1 :
Faire un essai dornirage laide de lornireur LPC du matriau et destin tre mis en
place (ou dj en place), puis dterminer les coefficients exprimentaux et .
Etape 2 :
Dterminer la charge de trafic quivalent total W, exprim en essieux quivalents [ESAL],
prvue durant toute la priode de service du tronon de chausse considr. Une fois que la
charge de trafic total est calcule, il faut lintgrer dans lquation dornirage en faisant
intervenir un coefficient de trafic Cw dont la valeur est constante :
Cw = 5.102 x 10-3
Etape 3 :
Dterminer la vitesse effective moyenne des vhicules lourds (>3.5t) prvue sur le tronon de
chausse considr. La vitesse doit tre lie lquation dornirage en introduisant un
coefficient de vitesse CV variable en fonction de la vitesse. Lorsque la vitesse moyenne est
connue ou estime, et pour connatre la valeur de CV, on introduit dans lquation :
Cv = 5 x 105 x V-2.5177
Etape 4 :
Dterminer la temprature maximale pour une priode de retour de 20 ans ou la temprature
des 4 jours les plus chauds issus des mesures des stations environnantes. Pour lier la
temprature lquation dornirage, il faut calculer un coefficient pour la temprature C,
variable en fonction de la temprature. Il est gal :
C =
Etape 5 :
Prdire lornirage laide de la formule : T = C x x (
TAPSOBA J. Honora
Juin 2012
) +
Page 77
Vous aimerez peut-être aussi
- RoutesDocument55 pagesRoutesSoumana Abdou100% (1)
- SUIVI GÉOTECHNIQUE DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION DE L'ARTЀRE PRINCIPALE DE LA COMMUNE DE MOANDApdfDocument61 pagesSUIVI GÉOTECHNIQUE DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION DE L'ARTЀRE PRINCIPALE DE LA COMMUNE DE MOANDApdfnourene100% (1)
- 2915-N1072-16b Campagne de Reconnaisances PDFDocument17 pages2915-N1072-16b Campagne de Reconnaisances PDFZANZANPas encore d'évaluation
- E07 Rapport GeotechDocument90 pagesE07 Rapport GeotechAnh Quan NGUYENPas encore d'évaluation
- BLPC SP Terrassements Routiers CompilDocument188 pagesBLPC SP Terrassements Routiers CompilSami SamiPas encore d'évaluation
- LBTP - Recommandation PR L'utilisation en Corps de Chaussée Des TVCDocument33 pagesLBTP - Recommandation PR L'utilisation en Corps de Chaussée Des TVCAbou Dramane TraorePas encore d'évaluation
- Travaux de Renforcement de La Route PDFDocument116 pagesTravaux de Renforcement de La Route PDFmohamedPas encore d'évaluation
- Cotita10 - Formation Labo Janv - Enrobes PDFDocument75 pagesCotita10 - Formation Labo Janv - Enrobes PDFsabrina sou100% (1)
- Annexe 9 - Etude Géotechnique PDFDocument87 pagesAnnexe 9 - Etude Géotechnique PDFMascariPas encore d'évaluation
- Etude Geotechnique D'avant ProjetDocument61 pagesEtude Geotechnique D'avant ProjetAbdou HababaPas encore d'évaluation
- 5 I-Reconnaissance Geotechnique 05Document34 pages5 I-Reconnaissance Geotechnique 05Mehdi KhouzaimiPas encore d'évaluation
- GUIDE Retraitement en Place LPEE-DRCRDocument36 pagesGUIDE Retraitement en Place LPEE-DRCRMohamedAhfourPas encore d'évaluation
- Rapport Etude Des Emprunts BotmakakDocument15 pagesRapport Etude Des Emprunts BotmakakLaboratoire Geotechnique100% (1)
- 1.4-Specifications Granulats. ChausseeDocument12 pages1.4-Specifications Granulats. ChausseeYassine HoumadinePas encore d'évaluation
- 1 P98-130 BBSG PDFDocument12 pages1 P98-130 BBSG PDFSoufiane LaghribiPas encore d'évaluation
- Cours 5 GNTDocument19 pagesCours 5 GNTMamadou SowPas encore d'évaluation
- Etude VoirieDocument12 pagesEtude VoirieErrmadiPas encore d'évaluation
- Recyclage de ChausseeDocument160 pagesRecyclage de ChausseeMourad TajPas encore d'évaluation
- Mur Souténement Rapport Etude GeotecDocument31 pagesMur Souténement Rapport Etude GeotecLahcen Lakdim100% (1)
- Propriété Exclusive IANOR: Décembre 2009Document18 pagesPropriété Exclusive IANOR: Décembre 2009mody100100% (1)
- Renforcement Et Entretien Des ChausséesDocument113 pagesRenforcement Et Entretien Des ChausséessalhiPas encore d'évaluation
- Dimensionnement D'une Structure de Corps de ChausséeDocument34 pagesDimensionnement D'une Structure de Corps de ChausséeHabibMoussaMohamedPas encore d'évaluation
- Tunisie Routes Non Revetues ZaidiMosbahDocument68 pagesTunisie Routes Non Revetues ZaidiMosbahAmoula AhmedPas encore d'évaluation
- Cours Geotechnique Routiere DR MezhoudDocument100 pagesCours Geotechnique Routiere DR MezhoudAbdoul Fatré Kienou100% (2)
- 3 11 DiagnosticGeotechnique SRDE ChamagneDocument54 pages3 11 DiagnosticGeotechnique SRDE ChamagneAbdelrahmanTahiriPas encore d'évaluation
- RAPPORT FORMULATION DE LA GRAVE CIMENT 0-25 mm-1 PDFDocument16 pagesRAPPORT FORMULATION DE LA GRAVE CIMENT 0-25 mm-1 PDFLaziz AtmaniPas encore d'évaluation
- Note de Calcul de La Structure de Chaussée Kumba Ekondo Titi IndbDocument10 pagesNote de Calcul de La Structure de Chaussée Kumba Ekondo Titi IndbSINGOPas encore d'évaluation
- Les Essais de Perméabilité Pour Étudier L Infiltrabilité PDFDocument15 pagesLes Essais de Perméabilité Pour Étudier L Infiltrabilité PDFZitoun38Pas encore d'évaluation
- TP2 - Caracteristiques Des Granulats PDFDocument8 pagesTP2 - Caracteristiques Des Granulats PDFNadjia baouchePas encore d'évaluation
- V3 1 - Guide IDRRIM MBCF - 130111 PDFDocument96 pagesV3 1 - Guide IDRRIM MBCF - 130111 PDFCorina AvramPas encore d'évaluation
- Terrassements Et Assises de ChausséesDocument148 pagesTerrassements Et Assises de ChausséesramdanedtfPas encore d'évaluation
- Dimensionnement Structures RoutesDocument6 pagesDimensionnement Structures Routeshsourou2Pas encore d'évaluation
- Cours Laboratoire 20-21Document73 pagesCours Laboratoire 20-21Paul StelmaszakPas encore d'évaluation
- NF en 12697-1 Extraction BitumeDocument47 pagesNF en 12697-1 Extraction BitumeAndo RandriaPas encore d'évaluation
- Guide TechniqueDocument42 pagesGuide TechniqueTawfik TalbawiPas encore d'évaluation
- Remblai Sur Zone Compressible 1 Cas de RDocument15 pagesRemblai Sur Zone Compressible 1 Cas de RAbdelkarim ELPas encore d'évaluation
- Aide Au Choix Des Techniques D'entretien Des Couches de SurfaceDocument28 pagesAide Au Choix Des Techniques D'entretien Des Couches de SurfaceBouba Maiga0% (1)
- Etude de Formulation Et de Mise en Œuvre Des Enrobés PDFDocument73 pagesEtude de Formulation Et de Mise en Œuvre Des Enrobés PDFlfpacheco100% (1)
- !!!M S GC Mokhtari+Hosni PDFDocument84 pages!!!M S GC Mokhtari+Hosni PDFZouhirPas encore d'évaluation
- Etude GéotechDocument33 pagesEtude GéotechCelio AbessPas encore d'évaluation
- Enrobés Hydrocarbonés Et Enduits PDFDocument78 pagesEnrobés Hydrocarbonés Et Enduits PDFraoufPas encore d'évaluation
- L'entretien Courant Des ChausséesDocument124 pagesL'entretien Courant Des Chausséesrami45Pas encore d'évaluation
- Classification GTRDocument12 pagesClassification GTRBalhaMontpelliérainPas encore d'évaluation
- Diagnostic Et Renforcement Des Chaussées PDFDocument123 pagesDiagnostic Et Renforcement Des Chaussées PDFRachida KrachaiPas encore d'évaluation
- 2 Essais Laboratoir Materiaux Routier PDFDocument84 pages2 Essais Laboratoir Materiaux Routier PDFZakaria AmraniPas encore d'évaluation
- Guide de Compactage Des Enrobés À Chaud - LCPCDocument81 pagesGuide de Compactage Des Enrobés À Chaud - LCPCMohamedAhfourPas encore d'évaluation
- Calcul de Renforcement de Chaussee Avec La Methode LCPC L PorotDocument23 pagesCalcul de Renforcement de Chaussee Avec La Methode LCPC L Porotkovary100% (1)
- Guide Technique - Valorisation Des Matériaux LocauxDocument42 pagesGuide Technique - Valorisation Des Matériaux LocauxOusseynou Ndiaye100% (2)
- Catalogue de Dimensionnement Des Chaussees Neuves (Fascicule3)Document78 pagesCatalogue de Dimensionnement Des Chaussees Neuves (Fascicule3)AdemNe100% (1)
- LCPC - Compactage Des Enrobes Hrydrocarbones A ChauxDocument81 pagesLCPC - Compactage Des Enrobes Hrydrocarbones A Chauxiftstpbdiro50% (2)
- Mémoire de Maxime-SAWADOGODocument82 pagesMémoire de Maxime-SAWADOGOAbou SoroPas encore d'évaluation
- Tindano Tilamanou VeroniqueDocument59 pagesTindano Tilamanou VeroniqueMouheb MaouiPas encore d'évaluation
- MEMOIRE FINAL DJADJOUKOA JacquesDocument110 pagesMEMOIRE FINAL DJADJOUKOA JacquesCabrel FankamPas encore d'évaluation
- OUEDRAOGO Abdoul RahimDocument98 pagesOUEDRAOGO Abdoul RahimRomdhane Ben KhalifaPas encore d'évaluation
- Mémoire M2 GC Thierry OUEDRAOGODocument63 pagesMémoire M2 GC Thierry OUEDRAOGOعثمان البريشي0% (1)
- Etude Technique Detaillee Des Travaux Route 5klmDocument164 pagesEtude Technique Detaillee Des Travaux Route 5klmyosriPas encore d'évaluation
- Projet de Fin D'etude: Ait Jeddi JamilaDocument182 pagesProjet de Fin D'etude: Ait Jeddi JamilahasnaPas encore d'évaluation
- NDOUMBE BATACKA Paul Alex PDFDocument60 pagesNDOUMBE BATACKA Paul Alex PDFimaPas encore d'évaluation
- Pfe GC 0085Document133 pagesPfe GC 0085gueyetapha77Pas encore d'évaluation
- Praxis de l'évaluation et de la révision des programmes publics: Approches, compétences et défisD'EverandPraxis de l'évaluation et de la révision des programmes publics: Approches, compétences et défisPas encore d'évaluation
- Conception Et Étude D'un Pont Biais Sur L'autotoute A42Document97 pagesConception Et Étude D'un Pont Biais Sur L'autotoute A42iftstpbdiroPas encore d'évaluation
- Le Mémento Du Conducteur Des TravauxDocument128 pagesLe Mémento Du Conducteur Des Travauxiftstpbdiro100% (10)
- Dimensionnement Terrain de FootDocument74 pagesDimensionnement Terrain de FootiftstpbdiroPas encore d'évaluation
- Constructions en Zone SismiqueDocument359 pagesConstructions en Zone SismiqueMiguel Teixeira Couteiro100% (1)
- D5Document17 pagesD5Rabai NoureddinePas encore d'évaluation
- LCPC - Compactage Des Enrobes Hrydrocarbones A ChauxDocument81 pagesLCPC - Compactage Des Enrobes Hrydrocarbones A Chauxiftstpbdiro50% (2)
- NBBVBVBVDocument42 pagesNBBVBVBVعثمان البريشيPas encore d'évaluation
- La Mise en Oeuvre Des EnrobésDocument114 pagesLa Mise en Oeuvre Des Enrobésiftstpbdiro100% (5)
- Morphometrie ArcGis SaidiDocument8 pagesMorphometrie ArcGis SaidiiftstpbdiroPas encore d'évaluation
- Capacité Du ReservoireDocument7 pagesCapacité Du ReservoireiftstpbdiroPas encore d'évaluation
- Haydraulique Calcul Débit EU EPDocument21 pagesHaydraulique Calcul Débit EU EPiftstpbdiro100% (1)
- Estimation Des Besoins en EauDocument13 pagesEstimation Des Besoins en Eauiftstpbdiro100% (1)
- Procedures de Suivie de ChantierDocument120 pagesProcedures de Suivie de Chantierachaass96% (26)
- Lamraoui RapportDocument196 pagesLamraoui RapportFifi VuvuzelaPas encore d'évaluation
- Notions GéologieDocument13 pagesNotions GéologieiftstpbdiroPas encore d'évaluation
- Mécanique Des Milieux ContinusDocument100 pagesMécanique Des Milieux ContinusiftstpbdiroPas encore d'évaluation
- Les Baragg Pdf2Document15 pagesLes Baragg Pdf2iftstpbdiroPas encore d'évaluation
- Justification de L Action SismiqueDocument8 pagesJustification de L Action SismiqueiftstpbdiroPas encore d'évaluation
- Formulation Des BetonsDocument17 pagesFormulation Des BetonsMajid BelkadiPas encore d'évaluation
- Dimensionnement Terrain de FootDocument74 pagesDimensionnement Terrain de FootiftstpbdiroPas encore d'évaluation
- PFE Conception Et Dimensionnement de La Construction Métallique D'un BâtimentDocument83 pagesPFE Conception Et Dimensionnement de La Construction Métallique D'un BâtimentChix Ch0% (1)
- Cours BA ST2 Chap 1Document15 pagesCours BA ST2 Chap 1philou6259100% (1)
- Morphometrie ArcGis SaidiDocument8 pagesMorphometrie ArcGis SaidiiftstpbdiroPas encore d'évaluation
- Calcul Des Ponts MetalliquesDocument92 pagesCalcul Des Ponts MetalliquesiftstpbdiroPas encore d'évaluation
- Notions GéologieDocument13 pagesNotions GéologieiftstpbdiroPas encore d'évaluation
- Radeema PDFDocument176 pagesRadeema PDFMed Ben-jahouPas encore d'évaluation
- Injection Des FondationsDocument43 pagesInjection Des FondationsBenlala Aghiles AzzedinePas encore d'évaluation
- Memo Schema ElectrotechniqueDocument29 pagesMemo Schema Electrotechniqueplaitil100% (1)
- 05.PDF Texte PDFDocument9 pages05.PDF Texte PDFcherifPas encore d'évaluation
- Partiel de Thermodynamique Du Juin 2017 Vers 2+corrigéDocument10 pagesPartiel de Thermodynamique Du Juin 2017 Vers 2+corrigédsiscnPas encore d'évaluation
- Dtu14 1-P2Document10 pagesDtu14 1-P2anhPas encore d'évaluation
- M02rm3ea 1Document4 pagesM02rm3ea 1ALI ALIPas encore d'évaluation
- Rapport AbaqusDocument6 pagesRapport AbaqusGeorges FarahPas encore d'évaluation
- Jean-Pierre Changeux, Alain Connes-Matière À Pensée-Odile Jacob (1989)Document265 pagesJean-Pierre Changeux, Alain Connes-Matière À Pensée-Odile Jacob (1989)Guillermo Benjamín Rojas Téllez100% (3)
- Calcul de La Somme Dune Serie AlterneeDocument2 pagesCalcul de La Somme Dune Serie Alterneeakaesaie9Pas encore d'évaluation
- RILEM TBS 3 - Essai de Chargement PDFDocument12 pagesRILEM TBS 3 - Essai de Chargement PDFIdriss Zaki100% (1)
- Distance Plus Court CheminDocument11 pagesDistance Plus Court CheminSamah Sam BouimaPas encore d'évaluation
- Aide-Mémoire WAISDocument11 pagesAide-Mémoire WAISScribdTranslationsPas encore d'évaluation
- Chapitre 2 Calcul de Probabilités PDFDocument33 pagesChapitre 2 Calcul de Probabilités PDFHajar El Alami100% (1)
- 2 - Prototypage Rapide PDFDocument27 pages2 - Prototypage Rapide PDFKh'adîijàDhPas encore d'évaluation
- Introduction ComsolDocument5 pagesIntroduction ComsolSmiley100% (2)
- Mémoire de StageDocument13 pagesMémoire de Stageapi-3707383100% (1)
- Dérivabilité Et Étude Des Fonction Série N°1Document2 pagesDérivabilité Et Étude Des Fonction Série N°1Mohamed LamriniPas encore d'évaluation
- Sulfonates Dans Les CosmétiquesDocument59 pagesSulfonates Dans Les Cosmétiquesjbonbs100% (1)
- Linopt PDFDocument121 pagesLinopt PDFAbdesselem BoulkrounePas encore d'évaluation
- TopVent® Manuel Technique PDFDocument176 pagesTopVent® Manuel Technique PDFAnonymous 4MLEo9TVQPas encore d'évaluation
- Foucault - 1966 - Les Mots Et Les Choses. Ed. GallimardDocument197 pagesFoucault - 1966 - Les Mots Et Les Choses. Ed. GallimardyotoulaPas encore d'évaluation
- Gas Calculations (Translated To French)Document12 pagesGas Calculations (Translated To French)Ilyas AissiPas encore d'évaluation
- Evaluation 2Document2 pagesEvaluation 2Yassine BarouniPas encore d'évaluation
- Cours Lycée Pilote - Sciences Physiques Spectre Atomique - Bac Sciences Exp (2010-2011) MR Sfaxi Salah - 2Document7 pagesCours Lycée Pilote - Sciences Physiques Spectre Atomique - Bac Sciences Exp (2010-2011) MR Sfaxi Salah - 2Tawfiq Weld EL ArbiPas encore d'évaluation
- Titrage Du Vinaigre CorrectionDocument4 pagesTitrage Du Vinaigre CorrectionOstensible50% (2)
- Ceinture Chauffante ELBHDocument4 pagesCeinture Chauffante ELBHprateek_chowdharyPas encore d'évaluation
- Notes de Cours Sur Les Suites Et Séries de FonctionsDocument6 pagesNotes de Cours Sur Les Suites Et Séries de FonctionsLilia LiliPas encore d'évaluation
- 04 Distributeur PVG 32Document76 pages04 Distributeur PVG 32Bruno Samaeian100% (2)
- Au Cours Du XIVe SiècleDocument10 pagesAu Cours Du XIVe SiècleCherif Cheikh Sidya Aidara100% (1)