Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Ethn 043 0407
Ethn 043 0407
Transféré par
nomkljhTitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Ethn 043 0407
Ethn 043 0407
Transféré par
nomkljhDroits d'auteur :
Formats disponibles
Cet article est disponible en ligne à l’adresse :
http://www.cairn.info/article.php?ID_REVUE=ETHN&ID_NUMPUBLIE=ETHN_043&ID_ARTICLE=ETHN_043_0407
Médicaments, drogues et poisons : ambivalences
par Jean-Pierre PETER
| Presses Universitaires de France | Ethnologie française
2004/2 - Tome XXXVII
ISSN 0046-2616 | ISBN 2-13-054556-4 | pages 407 à 409
Pour citer cet article :
— Peter J.-P., Médicaments, drogues et poisons : ambivalences, Ethnologie française 2004/2, Tome XXXVII, p. 407-
409.
Distribution électronique Cairn pour les Presses Universitaires de France.
© Presses Universitaires de France. Tous droits réservés pour tous pays.
La reproduction ou représentation de cet article, notamment par photocopie, n'est autorisée que dans les limites des
conditions générales d'utilisation du site ou, le cas échéant, des conditions générales de la licence souscrite par votre
établissement. Toute autre reproduction ou représentation, en tout ou partie, sous quelque forme et de quelque manière
que ce soit, est interdite sauf accord préalable et écrit de l'éditeur, en dehors des cas prévus par la législation en vigueur
en France. Il est précisé que son stockage dans une base de données est également interdit.
Dossier : Bembo f205735\pu181562\ Fichier : eth3-04 Date : 18/5/2007 Heure : 13 : 35 Page : 407
Note de recherche
Médicaments, drogues et poisons :
ambivalences
Jean-Pierre Peter
Centre de Recherches historiques, EHESS
Sur les drogues, remèdes et pharmacopées dans leur De surcroît, la médecine s’est enrichie des procédés chi-
histoire, sur les médecines et médications, douces ou miques (encore un temps entendus comme alchimiques),
amères, béchiques, diurétiques, apéritives ou astringen- qui ont extrait des minéraux d’efficaces mais dangereux
tes, sur les toxiques, les poisons et vénéneux divers, nous appoints à la pharmacopée : mercure, antimoine, sels
disposons de sources majestueuses, immenses biblio- divers. De profonds différends, de fortes controverses
graphies, études scientifiques et travaux historiques ont marqué leur introduction. On se retrouve ensuite,
approfondis. jusqu’au plein du XIXe siècle, dans un espace thérapeu-
Un point cependant pose encore question ou fait tique où se répondent, alternent et s’entrechoquent,
débat, et mérite une réflexion qu’esquisse le présent selon les cas, les écoles et les personnalités, tantôt pru-
numéro. Il s’agit de l’ambivalence propre à la nature dence vétilleuse voire abstentions systématiques, tantôt
même du médicament. Qu’elle relève du règne animal, démesure dans les emballements, envers l’administration
végétal ou animal, la matière active, par la puissance de de certaines matières suractives.
sa ressource, peut aussi bien réparer que détruire, rendre Reprenons. Voici, au XVIIe siècle, le grand rénovateur
à la vie ou donner la mort. Affaire de dose, infiniment de la médecine, l’Anglais Thomas Sydenham (1624-
délicate à décider. Les mots eux-mêmes l’indiquent : en 1689), clinicien, ennemi de tout système spéculatif. Il
grec, pharmakon désigne d’un même terme le médica- voit dans l’opium la ressource entre toutes, « un don du
ment et le poison. ciel », écrit-il, efficace en maints usages (spasmes, coli-
De là l’ensemble des précautions dont, depuis le socle ques, gastralgies, névralgies, paludismes, maladies ner-
hippocratique où elles s’expriment clairement, la méde- veuses), et surtout, par l’apaisement qu’il donne au
cine s’est entourée dans l’usage des drogues. Primum non malaise, à l’anxiété, au trouble général et diffus des mala-
nocere – c’est le précepte. « D’abord, ne pas nuire » ; mais des dans l’ébranlement dû aux excès violents de la fièvre,
user néanmoins de ce qui, foncièrement poison par son à l’étreinte du mal. Pour en sécuriser l’emploi, il l’atté-
excès d’activité, devient salutaire une fois cette activité nue par une solution d’extrait dans le vin. C’est le « lau-
restreinte dans des limites assez étroites pour que son danum liquide de Sydenham », qui eut d’ailleurs pour effet,
application à l’organisme vivant, cessant d’être perni- au long des temps, de charmer au-delà du raisonnable
cieuse, offre des avantages qu’aucun autre secours ne certains consommateurs qui, loin d’en obtenir aucun
saurait procurer. bienfait, y acquirent une dangereuse pathologie. La vie
Il reste que la gravité de ces enjeux n’a pas cessé de s’y perd. Médicament, poison, vie et mort.
produire des ambiguïtés, des réserves profondes, d’étran- En regard, la féconde école vitaliste issue de Mont-
ges paradoxes. Ainsi, dans la médecine monastique du pellier, très ouverte à l’esprit des Lumières (Barthez,
premier Moyen Âge chrétien, fut écarté l’usage des Bordeu, Pinel, Bichat) fait preuve d’une extrême réserve
grandes plantes actives (belladone, jusquiame, ciguë, envers la prescription des narcotiques. Ceux-ci affaiblis-
datura, suc de pavot – c’est l’opium), quelque précieuses sent, dans les tissus, les propriétés vitales et « perturbent
qu’elles fussent dans le traitement de certaines affections le ton des solides ». Il y a surtout qu’ils viennent, dans
graves et surtout, pour apaiser les douleurs extrêmes. l’appareil cérébral, pervertir l’influence que celui-ci
Leur pouvoir certain, mais secret, semblait relever d’une exerce, par les nerfs, sur l’ensemble des parties. Il en
sombre vertu païenne. C’est ainsi qu’elles furent laissées résulte des dérèglements dans toute l’économie du corps
à la secrète adhésion des campagnes, où ceux et celles et la manifestation de symptômes singuliers, inconstants,
qui prenaient renommée de guérir, et donc aussi de impossibles à démêler. L’estomac s’engourdit, la diges-
pouvoir nuire, ont entretenu connaissance et pratique tion est suspendue, le pouls « irrégulier, inégal, instable »
de ces plantes sorcières. s’accélère, puis se lâche par épuisement du cœur. Dès
Le grand mouvement d’avancée et de retours savants lors, la doctrine est de ne recourir aux opiacés qu’avec
propre à la Renaissance a fait revenir sur ces abandons. une extrême économie, pour calmer, en dernier
Ethnologie française, XXXIV, 2004, 3, p. 407-409
Dossier : Bembo f205735\pu181562\ Fichier : eth3-04 Date : 18/5/2007 Heure : 13 : 35 Page : 408
408 Jean-Pierre Peter
recours, une agitation pathologique, le mouvement trop (les progrès de l’infectiologie en ont depuis démenti la
désordonné d’un organe. Selon les catégories de la leçon) un médecin rédigeant l’article « venin » d’un
représentation vitaliste, si attentive aux fonctions de la grand dictionnaire de médecine, propose, en 1821, cette
sensibilité comme relais des rapports vitaux de l’esprit hypothèse : « La sécrétion du venin est une fonction naturelle ;
et du corps, tout ce qui mène à l’engourdissement et à peut-être que certaines maladies produisent un effet analogue
la torpeur s’oppose à la vie même. À l’horizon de cette dans le corps de l’homme. Telle est l’origine la plus vraisem-
réserve s’inscrivent pour des décennies deux postures blable des virus, qui sont de véritables venins. » [Monfalcon,
médicales problématiques. D’une part, une théorie de 1821].
la douleur utile, voire nécessaire, comme stratégie de sti- Voici Emma Bovary, conçue par un Flaubert qui se
mulation à engager ou préserver pour ranimer l’énergie pensait en elle. Lui fils et frère de médecins, elle-même
vitale restauratrice de la santé chez un malade qui man- épouse d’un praticien. Au terme d’un long parcours
que à guérir. De l’autre, le tacite interdit de toute nar- d’attente, d’égarements et de malheur, elle va chercher
cose préalable, dans les opérations chirurgicales. Opérer dans l’arrière-boutique de son voisin, l’apothicaire, la res-
à cru plutôt qu’endormir. source à trouver pour elle de sa libération dans la mort.
Passé ce stade, et passée la si tardive révolution de la Mais c’est Shakespeare qui dit le mieux cette oscilla-
pratique chirurgicale (1847-1848), l’usage opératoire de tion de la balance des choses, par la bouche du Frère
substances anesthésiques longtemps révoquées (éther Laurent, ami de Roméo et de Juliette, un savant en
sulfurique, protoxyde d’azote, chloroforme) et de dro- préparations somnifères. Il va sortir pour sa cueillette :
gues sédatives puissantes (morphine, puis héroïne) ouvre
le champ à une tentation collective d’explorer plus avant, Je dois emplir notre panier d’osier
en les éprouvant soi-même, les effets intéressants et D’herbes nocives et de fleurs au suc précieux.
magiques de ces drogues sur les degrés de la conscience. La terre, mère de la Nature, en est la tombe,
Mais ce sépulcre, c’est aussi sa matrice [...]
Voici la médecine confrontée à de nouveaux maux Oh ! grande est la grâce puissante que détiennent
– morphinomanie, éthéromanie –, qui prennent le Herbes, plantes, pierres et toutes leurs qualités,
relais, sans l’abolir en rien, d’un alcoolisme lui-même Car il n’est rien de si vil, ayant vie sur terre,
croissant (l’alcool, un remède et poison d’ancienne vertu Qui n’apporte à la terre quelque propre bienfait
curative...). Non rares, aux XIXe et XXe siècles, sont les Ni rien de si bon qui, détourné de son usage
médecins qui cèdent à la tentation d’affronter ces dan- N’inverse sa vertu native et n’achoppe sur l’abus [...]
Sous la fragile peau de cette fleur chétive
gers par eux-mêmes, comme expérimentalement, assu- Réside le poison et, pour la médecine, son pouvoir.
rés qu’ils sont, par grâce médicale, de les vaincre. Ils s’y La humer en cette intime part nous ravit de toutes parts
perdent. Ivresse du rapport de dialogue aux poisons. Y goûter anéantit tous nos sens et le cœur.
Singulière alliance, enfin, avec la radicalité du poison, Ainsi deux Rois ennemis, bienfaisance et nocivité,
dans la pratique contemporaine de la chimiothérapie des Dans la plante et dans l’homme ont établi leur camp.
cancers, pour tuer dans le vivant les cellules vivantes
anarchiquement multipliées. [Roméo et Juliette, Acte 2, Scène 3, traduction : J.-P. Peter]
Telle s’affirme cette proximité de toujours, qui conju-
gue en un corps matériel (végétal, minéral ou produc-
tion animale) les puissances alternes et opposées, parfois [Texte original]
coïncidentes, du salut et de la mort. Cette ambivalence
reste un point durable des sensibilités collectives dans [...]
leur rapport à la pharmacopée. D’ailleurs, l’histoire du I must up-fill this osier cage of ours,
droit, celle de la criminalité, l’histoire de la littérature With baleful weeds, and precious juiced flowers,
aussi bien, témoignent ensemble à cet égard d’une The earth that’s Nature’s mother is her tomb,
inquiétude qui lézarde l’action et la pensée. On perçoit What is her burying grave, that is her womb ; [...]
O mickle is the powerful grace that lies
bien cet arrière-plan, discret mais vivace, terrible à In plants, herbs, stones, and their true qualities ;
l’occasion, au cœur de tout ce numéro thématique de For nought so vile, that on the earth doth live,
la revue, adonné aux poisons. But to the earth some special good doth give ;
Plus encore pouvons-nous percevoir, inscrite en Nor aught so good but strain’d from that fair use,
nous-mêmes, une certaine appétence complice envers Revolts from true birth, stumbling on abuse [...]
cette intime ambiguïté du poison bienfaisant, de ses Within the infant rind of this weak flower
vivantes productions et transports pernicieux. Poison hath residence, and medicine power ;
For this being smelt with that part, cheers each part,
De cette conscience inquiète, de ces vertiges, voici Being tasted, slays all senses with the heart.
pour finir quelques illustrations probantes : dans un Two such opposed Kings encamp them still,
moment d’imagination scientifique créatrice mais fragile In man as well as herbs, grace and rude will [...] ■
Ethnologie française, XXXIV, 2004, 3
Dossier : Bembo f205735\pu181562\ Fichier : eth3-04 Date : 18/5/2007 Heure : 13 : 35 Page : 409
Médicaments, drogues et poisons : ambivalences 409
Références bibliographiques MONTFALCON Jean-Baptiste, 1821, Dictionnaire des Sciences Médi-
cales, article « Venin ».
ENCYCLOPÉDIE de Diderot et d’Alembert POUCHELLE Marie-Christine, 2003, « Effets iatrogènes du
Dictionnaire des Sciences médicales, Paris, Panckoucke, 60 vol., combat contre la maladie », L’Hôpital corps et âme. Essais d’anthro-
1812-1821. pologie hospitalière, Paris, Seli Arslan éd.
Pour ces deux dictionnaires, articles « Drogue », « Hypnotique », YVOREL Jean-Jacques, 1992, Les poisons de l’esprit. Drogues et
« Médicament », « Narcotique », « Opium », « Poison », « Séda-
tif », « Venin »). drogué au XIXe siècle, Paris, Quai Voltaire, coll. « Histoire ».
GARCIA-GUILLÉN Diego et al., 1984, Historia del Medicamento, PETER Jean-Pierre, 1993, De la douleur, Paris, Quai Voltaire, coll.
3 vols., Barcelona, Doyma. « Histoire ».
Ethnologie française, XXXIV, 2004, 3
Vous aimerez peut-être aussi
- Orgueil et Préjugés - Edition illustrée: Pride and PrejudiceD'EverandOrgueil et Préjugés - Edition illustrée: Pride and PrejudiceÉvaluation : 4.5 sur 5 étoiles4.5/5 (20391)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItD'EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItÉvaluation : 4.5 sur 5 étoiles4.5/5 (3310)
- Art of War: The Definitive Interpretation of Sun Tzu's Classic Book of StrategyD'EverandArt of War: The Definitive Interpretation of Sun Tzu's Classic Book of StrategyÉvaluation : 4 sur 5 étoiles4/5 (3321)
- The 7 Habits of Highly Effective People: The Infographics EditionD'EverandThe 7 Habits of Highly Effective People: The Infographics EditionÉvaluation : 4 sur 5 étoiles4/5 (2487)
- Learn German! Lerne Englisch! ALICE'S ADVENTURES IN WONDERLAND: In German and EnglishD'EverandLearn German! Lerne Englisch! ALICE'S ADVENTURES IN WONDERLAND: In German and EnglishÉvaluation : 3.5 sur 5 étoiles3.5/5 (5622)
- How To Win Friends And Influence PeopleD'EverandHow To Win Friends And Influence PeopleÉvaluation : 4.5 sur 5 étoiles4.5/5 (6538)
- The 7 Habits of Highly Effective PeopleD'EverandThe 7 Habits of Highly Effective PeopleÉvaluation : 4 sur 5 étoiles4/5 (2571)
- How to Win Friends and Influence People: Updated For the Next Generation of LeadersD'EverandHow to Win Friends and Influence People: Updated For the Next Generation of LeadersÉvaluation : 4 sur 5 étoiles4/5 (2327)
- Habit 6 Synergize: The Habit of Creative CooperationD'EverandHabit 6 Synergize: The Habit of Creative CooperationÉvaluation : 4 sur 5 étoiles4/5 (2499)
- Habit 1 Be Proactive: The Habit of ChoiceD'EverandHabit 1 Be Proactive: The Habit of ChoiceÉvaluation : 4 sur 5 étoiles4/5 (2559)
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeD'EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeÉvaluation : 4 sur 5 étoiles4/5 (5813)
- The Picture of Dorian Gray: Classic Tales EditionD'EverandThe Picture of Dorian Gray: Classic Tales EditionÉvaluation : 4 sur 5 étoiles4/5 (9763)
- Wuthering Heights (Seasons Edition -- Winter)D'EverandWuthering Heights (Seasons Edition -- Winter)Évaluation : 4 sur 5 étoiles4/5 (9974)
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeD'EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeÉvaluation : 4.5 sur 5 étoiles4.5/5 (20099)
- Habit 3 Put First Things First: The Habit of Integrity and ExecutionD'EverandHabit 3 Put First Things First: The Habit of Integrity and ExecutionÉvaluation : 4 sur 5 étoiles4/5 (2507)
- Anna Karenina: Bestsellers and famous BooksD'EverandAnna Karenina: Bestsellers and famous BooksÉvaluation : 4 sur 5 étoiles4/5 (7503)
- Alice in Wonderland: Down the Rabbit HoleD'EverandAlice in Wonderland: Down the Rabbit HoleÉvaluation : 4 sur 5 étoiles4/5 (4611)
- The Secret Garden: The 100th Anniversary Edition with Tasha Tudor Art and Bonus MaterialsD'EverandThe Secret Garden: The 100th Anniversary Edition with Tasha Tudor Art and Bonus MaterialsÉvaluation : 4 sur 5 étoiles4/5 (6840)
- The Illustrated Alice in Wonderland (The Golden Age of Illustration Series)D'EverandThe Illustrated Alice in Wonderland (The Golden Age of Illustration Series)Évaluation : 4 sur 5 étoiles4/5 (4347)
- Pride and Prejudice: Bestsellers and famous BooksD'EverandPride and Prejudice: Bestsellers and famous BooksÉvaluation : 4.5 sur 5 étoiles4.5/5 (20479)




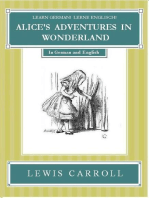

















![Don Quixote: [Complete & Illustrated]](https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/264046221/149x198/541f56cceb/1617238192?v=1)



