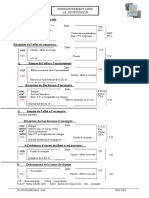Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
NV Nvelle Grammaire Tribune 120606 01
Transféré par
BruegelCopyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
NV Nvelle Grammaire Tribune 120606 01
Transféré par
BruegelDroits d'auteur :
Formats disponibles
La Tribune, 12 juin 2006
La Chronique de NICOLAS VÉRON
La nouvelle « grammaire des affaires »
Antoine Zacharias avait propulsé Vinci au premier rang mondial de sa
spécialité, et décuplé sa valeur en dix ans. Qu’un tel dirigeant puisse être
contraint de démissionner a de quoi faire réfléchir. Cette sortie sans gloire
n’est pourtant pas sans précédent, et fait notamment écho à celle de Maurice
« Hank » Greenberg, le charismatique octogénaire débarqué en mars 2005
de sa position apparemment imprenable à la tête d’AIG dont il avait fait en
quarante ans le géant incontesté de l’assurance outre-Atlantique.
Contrairement à d’autres comme Jean-Marie Messier ou Michel Bon, les
reproches adressés à Zacharias comme à Greenberg ne portaient pas sur la
stratégie ou les opérations, mais sur leurs indélicatesses quant au non-
respect de certaines règles : pour Zacharias, la modération dans l’auto-
attribution de primes diverses, et pour Greenberg, l’orthodoxie comptable. Nul
n’a contesté leurs qualités d’entrepreneurs, mais ils ont été écartés pour
n’avoir pas agi conformément à ce qu’on pourrait appeler, à la suite de
Thierry Breton, la « grammaire du monde des affaires ». La création de valeur
n’est plus le critère unique de jugement des marchés : le respect de cette
grammaire est également indispensable dans un monde financier où tous les
coups ne sont pas permis, même si les normes en question ne sont pas
forcément celles qu’avait en tête le ministre de l’économie en réagissant aux
annonces de Mittal Steel fin janvier dernier.
L’importance croissante de telles normes est liée à l’évolution du système
financier. Comme l’ont décrit les économistes Rajan et Zingales (Saving
Capitalism from the Capitalists, Crown Business Press, 2003), une des
conséquences de l’ouverture des frontières et des mutations technologiques
contemporaines est la perte relative d’influence du « capitalisme relationnel »
qui prévalait dans l’Europe d’après-guerre marquée par la pénurie de
ressources et la fragmentation des marchés, face à un « capitalisme
contractuel » fondé sur des liens moins personnels et plus anonymes entre
acteurs économiques, une standardisation des informations financières et non
financières, et une élaboration juridique sensiblement plus poussée.
Respect des règles. Au lieu d’être garantie par la connaissance réciproque
entre individus, la confiance est assurée par le respect des règles communes
et la sanction de leur violation. « Offenser la grammaire », comme disait
Molière, n’est plus seulement une faute de goût, c’est une faute tout court qui
peut se traduire par l’éviction rapide du système.
Quelles sont ces règles ? L’actualité récente en dessine quelques-unes en
négatif. D’abord bien sûr, ne pas insulter la discipline du capital : c’est parce
qu’Arcelor avait oublié d’être suffisamment « shareholder-friendly », comme
dit maintenant Guy Dollé, que Mittal a pu se porter acquéreur ; le sidérurgiste
luxembourgeois a ensuite fait un pari à très haut risque en donnant avec
l’opération Severstal le sentiment de court-circuiter les actionnaires.
Deuxièmement, faire preuve de prudence dans les relations avec les pouvoirs
publics, dont il serait téméraire d’attendre un soutien pérenne et univoque : en
témoigne la situation actuelle inconfortable de Suez, engagé dans la fusion
avec GDF mais dépendant d’une autorisation parlementaire qui tarde
beaucoup à venir. Troisièmement, éviter les tropismes nationaux trop
exclusifs : au moins jusqu’à la semaine dernière, Deutsche Börse s’était
laissée isoler faute d’avoir pu dépasser l’apparence d’un cadre analytique
germano-allemand dans la présentation de ses projets d’alliance.
Quatrièmement, accepter l’utilité des mécanismes d’intelligence collective, du
management participatif et de la collégialité des décisions : le « patron de
droit divin » (titre d’un livre de Roger Martin en 1984) n’existe plus, et Antoine
Zacharias a eu tort de penser pouvoir encore s’appliquer ce modèle. Un
attachement excessif au principe d’autorité est handicapant dans la
compétition pour les talents, et la qualité du management n’est pas en
général le point fort des entreprises hexagonales ; il est douloureux que cette
année encore, le classement des cent entreprises européennes où il fait bon
travailler (dans le Financial Times du 18 mai) ne mentionne aucune société
française, une lacune sans doute plus inquiétante pour la pérennité de nos «
champions nationaux » que la montée en puissance de l’actionnariat non
résident.
Cinquièmement bien sûr, éviter les fraudes, abus et comportements assimilés
tels que la créativité comptable et l’auto-gratification sans contrôle. Bien
d’autres règles pourraient être citées, qui ensemble composent une sorte de
Bescherelle du monde des affaires contemporain. Comme toute grammaire,
celle-ci s’apprend dans la rue mais aussi sur les bancs des écoles,
notamment dans les MBA et autres cycles internationaux de gestion que les
élites françaises gagneraient à considérer avec moins de condescendance.
L’exemple inachevé. Un hommage pour terminer. Edouard Michelin, disparu
tragiquement il y a deux semaines, était sans doute l’un des patrons français
qui avait le mieux compris ce changement de règles, et la nécessité pour nos
entreprises de se les approprier au plus vite pour défendre et renforcer leurs
positions dans la compétition mondiale. Souhaitons que son exemple
inachevé serve d’inspiration à ses pairs qui lui survivent.
(*) Nicolas Véron est research fellow au sein de Bruegel, centre indépendant
de recherche et de débats sur les politiques éconiques en Europe, et associé
de la société de conseil ECIF.
Vous aimerez peut-être aussi
- Decift A L AnglosaxonneDocument2 pagesDecift A L AnglosaxonneBruegelPas encore d'évaluation
- Figaro GreceDocument2 pagesFigaro GreceBruegelPas encore d'évaluation
- Finances Publiques JPFDocument2 pagesFinances Publiques JPFBruegelPas encore d'évaluation
- JPF RMB Telos 1007Document2 pagesJPF RMB Telos 1007BruegelPas encore d'évaluation
- JPF Entre PV Et Apparences Challenges 0906Document2 pagesJPF Entre PV Et Apparences Challenges 0906BruegelPas encore d'évaluation
- 20 Capitalisation Manuel Gestion Entrepreneuriale Des Coopératives MinDocument68 pages20 Capitalisation Manuel Gestion Entrepreneuriale Des Coopératives MinAnas Jalal100% (3)
- Article Cout Normal IFC Suite IFRIC - 5Document5 pagesArticle Cout Normal IFC Suite IFRIC - 5eric.maniablePas encore d'évaluation
- Démarche Audit Interne Agence BMCEDocument2 pagesDémarche Audit Interne Agence BMCERitaLm100% (1)
- Cadre Juridique de L EntrepriseDocument20 pagesCadre Juridique de L EntrepriseScribdTranslationsPas encore d'évaluation
- 004 Passage Résultat Comptable Au Fiscal - Cas Pratique # - 2Document3 pages004 Passage Résultat Comptable Au Fiscal - Cas Pratique # - 2hakim fayçalPas encore d'évaluation
- Bur Manag STMG Tle 01Document3 pagesBur Manag STMG Tle 01Lay.Pas encore d'évaluation
- Contrôle de GestionDocument2 pagesContrôle de GestionAzer AzePas encore d'évaluation
- Fr. Effets de CceDocument1 pageFr. Effets de CcemagicmagicmagicPas encore d'évaluation
- L'entrepreneuriat Social Et Solidaire - Son Importance Dans Le Monde Et Sa Place en AlgerieDocument10 pagesL'entrepreneuriat Social Et Solidaire - Son Importance Dans Le Monde Et Sa Place en AlgerieSalah OuakenouPas encore d'évaluation
- 5 Les Operations de Financement ProfesseurDocument17 pages5 Les Operations de Financement ProfesseurLamyae FlooPas encore d'évaluation
- Fiche de Poste Contrôleur de GestionDocument2 pagesFiche de Poste Contrôleur de GestionMouna Krafi100% (1)
- Corr Armor Lux2011Document13 pagesCorr Armor Lux2011gloPas encore d'évaluation
- Exposé GestionDocument10 pagesExposé GestionAdesanya LyPas encore d'évaluation
- 1 SOULIMANI SALOUA - pdf4Document1 page1 SOULIMANI SALOUA - pdf4FDPas encore d'évaluation
- Exportateur / Expéditeur Declaration #R. C Centre R. C ICEDocument1 pageExportateur / Expéditeur Declaration #R. C Centre R. C ICEbertrand.laugaPas encore d'évaluation
- Equilibre Du Producteur CPP Et MonopoleDocument1 pageEquilibre Du Producteur CPP Et MonopoleCHRAIHAPas encore d'évaluation
- SMQ ProjetDocument8 pagesSMQ ProjetChaimaa ElmtouguiPas encore d'évaluation
- Business Process Reengineering: Par: N. AlfathiDocument24 pagesBusiness Process Reengineering: Par: N. Alfathinajlae alfathiPas encore d'évaluation
- Document YZFDocument4 pagesDocument YZFRemy BourdonclePas encore d'évaluation
- Cours 4Document32 pagesCours 4Meriem Nait AttiaPas encore d'évaluation
- Fiche Situation Pro COMMUNICATION A Remplir (Annexe V. Circulaire 2021)Document2 pagesFiche Situation Pro COMMUNICATION A Remplir (Annexe V. Circulaire 2021)dessPas encore d'évaluation
- SEMINAIRE IFRS Part 1 PDF Mode de Compatibilité PDFDocument107 pagesSEMINAIRE IFRS Part 1 PDF Mode de Compatibilité PDFabdellahPas encore d'évaluation
- SC ZaraDocument9 pagesSC ZaraHicham ZahlouPas encore d'évaluation
- Bilan Financier Association Excel Gratuit AnnexeDocument4 pagesBilan Financier Association Excel Gratuit AnnexeMostafa KheddajPas encore d'évaluation
- Montage de Projet Et Création Dentreprise 2Document6 pagesMontage de Projet Et Création Dentreprise 2larra benmoulaPas encore d'évaluation
- 5.1 TS GE Passage Synthèse V1Document11 pages5.1 TS GE Passage Synthèse V1oussamaPas encore d'évaluation
- TDCDocument13 pagesTDCAbdelkarim MeskaouiPas encore d'évaluation
- Définition Et Typologie de L'entrepriseDocument5 pagesDéfinition Et Typologie de L'entrepriseJean Kerly Alcenat30Pas encore d'évaluation
- Entreprise PresentationDocument14 pagesEntreprise PresentationAbdourahmane BaPas encore d'évaluation
- 2 Contrat Dinsertion Par AnapecDocument2 pages2 Contrat Dinsertion Par Anapecsimo haloutPas encore d'évaluation