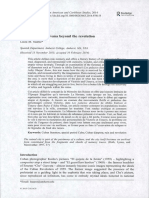Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Souvenirs de 40 Ans
Transféré par
Clea MounetteCopyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Souvenirs de 40 Ans
Transféré par
Clea MounetteDroits d'auteur :
Formats disponibles
Chapitre 1 C'est pour vous, mes enfants, que j'ai rassembl ces souvenirs qui, plus d'une fois,
ont rouvert dans mon cur de cruelles blessures. Je crois, en effet, comme mon fils l'a pens, qu'il est bon que dans chaque famille on prenne soin de redire ceux qui vous suivent les vnements auxquels on a pris part, ou mme qu'on a vus d'assez prs pour en pa rler avec l'autorit de tmoin oculaire. C'est au moyen de ces souvenirs que les traditions se continuent dans les familles . On aime conserver dans des galeries les portraits de ses aeux ; il semble plus naturel encore d'aimer connatre leurs tristesses et leurs joies, leurs motions, leur s preuves, en un mot leur vie ; et pour ceux qui se rapprochent du terme de leur existence, c'est une consolation que de penser qu'ils laisseront aprs eux comme une v ivante image d'eux-mmes, qui les rendra prsents l'esprit de leurs petits-enfants. Il ne fallait rien moins que ces considrations, mon cher fils, pour me dcider reve nir sur un pass qui me rappelle de bien pnibles motions, car, aprs tre ne au milieu de s splendeurs de l'ancienne socit franaise, je me suis trouve mle, pendant les premiers ours de ma jeunesse, aux catastrophes qui en ont marqu la fin. J'tais le cinquime enfant et la quatrime fille de la marquise de Tourzel, qui fut pou r moi la meilleure des mres. Tendrement leve par elle, entoure de surs chries, il ne m' st rest des jours riants de mon heureuse enfance qu'un seul souvenir douloureux, ce lui de la perte cruelle d'un pre pour qui nous avions la plus juste et la plus prof onde affection. Au mois de novembre 1786, mon pre, le marquis de Tourzel, chassant avec le Roi Lo uis XVI Fontainebleau, fut emport par son cheval dans la fort ; il se heurta la tte contre des branches d'arbre qui le blessrent mortellement. Aprs huit jours de souff rances, pendant lesquels il endura les traitements les plus douloureux, assist, s outenu par ma malheureuse mre, il mourut dans la cabane d'un garde o il avait d'abord t transport ; son tat tait si grave, que les mdecins avaient interdit tout dplacement. Le Roi, dans cette occasion, laissa voir toute la bont de son cur. Il veilla lui-mm e ce que tous les soins ncessaires fussent donns mon pre. Pendant sa maladie, il ne cessa d'exprimer les plus vives inquitudes, et, aprs sa mort, il tmoigna les plus do uloureux regrets : il sentait qu'il perdait en lui un sujet fidle, un ami dvou. Mais nous, nous perdions le plus tendre des pres, et tant d'annes coules depuis ce malheur n'ont pu diminuer nos regrets. Je ne vous dirai rien sur l'ancienne socit franaise, j'tais trop jeune pour avoir des id s faites sur un rgime qui finissait. Tout ce que je sais sur cette poque je le tie ns de ma mre. C'est elle que j'entendis parler des pieuses filles de Louis XV, les pr incesses Adlade et Sophie, qui, dans une cour frivole et lgre, donnrent l'exemple des v ertus qu'on ne trouve ordinairement que dans le clotre, et surtout de Madame Louise de France, qui mourut, en 1787, aux Carmlites de Saint-Denis. Louis XVI, Marie-A ntoinette et Madame lisabeth avaient un vritable culte pour leur sainte tante. Ils allaient souvent la visiter et se recueillir auprs d'elle. C'est ses prires que le Ro i et la Reine croyaient devoir la naissance du premier Dauphin, et le Roi, en al lant annoncer cet vnement la vnrable carmlite, exprima cette pense en lui disant : tante, je viens vous faire hommage d'un vnement qui fait aujourd'hui la joie de mon pe uple et la mienne, car je l'attribue vos prires. Quand Madame Royale eut quatre ans , la Reine se plut la conduire voir sa tante, et au retour de chaque visite on a vait quelque trait touchant ou intressant raconter. Ainsi une fois, c'tait en 1782, la Reine avait conduit la jeune princesse au monastre, et, comme elle tait la veil le d'tre inocule, on ne lui avait fait servir qu'une trs-lgre collation. Madame Royale, ui avait encore faim, ne fit aucune observation, et se contenta de ramasser jusq u'aux moindres miettes de pain. L'une des religieuses fit alors l'observation que la s oumission et la sobrit de la jeune princesse semblaient annoncer chez elle quelque vocation pour la vie des Carmlites, et elle demanda la Reine si, la chose tant, e lle en ressentirait quelque dplaisir. Loin de l, rpondit celle-ci, j'en serais au con traire trs-flatte. Marie-Antoinette, ayant dsir que toutes les religieuses vissent s a fille, demanda celle-ci, quand toute la communaut fut runie, si elle n'avait rien leur dire : Mesdames, rpondit la petite princesse, qui n'avait alors que quatre ans , priez pour moi la messe. Son bon ange lui disait-il ds lors combien elle aurait besoin du secours de Dieu pour traverser tant d'infortunes, caches encore dans les tnbres de l'avenir ?
Je consigne ici ce souvenir, parce qu'il se rapporte une princesse la destine de la quelle la mienne fut mle et pour laquelle je devais prouver une affection qui ne fi nira qu'avec ma vie. Mais, encore une fois, mes observations personnelles ne remon tent pas aussi haut ; mes jugements, mes impressions ne datent que des premires a nnes de la Rvolution. Je me souviens encore du mouvement qui agita tous les esprits au moment o les tats gnraux de 1789 s'ouvrirent ; un nouveau sujet de conversation, la politique, avait remplac tous les autres ; les socits se divisrent par nuance d'opinion ; et ceux qui n e pensaient pas de mme cessrent de se voir. Au fond les conversations taient devenu es des discussions, presque des disputes qui prludaient des luttes plus srieuses, et chaque salon devenait un camp. Les esprits taient si anims, qu'il n'tait pas possibl e qu'on n'en vnt pas bientt des chocs. C'est ainsi que se succdrent le serment du Jeu d aume, la sance royale du 23 juin, la runion et la confusion des trois ordres dans une assemble unique, les premiers troubles de Paris, le sige de la prison de l'Abbay e, fait par plusieurs milliers d'hommes qui voulaient dlivrer onze gardes franaises dtenus cette prison militaire pour dlit d'insubordination. Bientt aprs, le Roi voulut congdier Necker, dont la politique, toujours dispose aux concessions, lui paraissa it compromettre l'autorit royale. MM. de Montmorency, de la Luzerne et de Saint-Pri est reurent en mme temps leur dmission. Ce fut le signal de la journe du 14 juillet, qui se termina par la prise de la Bastille. Je me rappelle parfaitement un incident particulier de cette journe, qui est une des dates de la Rvolution. Les gardes franaises, travaills de longue main, vous le savez, firent dfection dans cette journe et mme aidrent prendre la Bastille. Charles de Sainte-Aldegonde, pour lequel ma mre avait beaucoup d'amiti, et qui tait o fficier dans ce corps, avait fait des efforts inutiles pour retenir sa compagnie ; au dsespoir de n'y avoir pu russir, il vint chez ma mre, et, dans son trouble, s'arm ant des pistolets qu'il portait, il allait se brler la cervelle en notre prsence : u ne impulsion dont je ne pus me rendre compte, une bonne pense qui me venait de Di eu, me prcipitrent sur lui ; je lui arrachai ses armes, et, sans trop savoir pourq uoi, je courus les cacher dans ma chambre : j'eus certainement le bonheur de lui s auver la vie. Chapitre 2 Vous savez avec quelle rapidit inoue la rvolution marcha aprs la journe du 14 juillet . Les personnes dsignes aux haines populaires n'taient plus en sret Paris ni en France ; le comte d'Artois partit ainsi que ses deux fils, le duc d'Angoulme et le duc de Be rry, qui migrrent sous la conduite du duc de Serent. Le prince de Cond, le duc de B ourbon et le duc d'Enghien, dsigns, comme le comte d'Artois, aux haines populaires, s'loi gnrent de Chantilly le 27 juillet 1789 ; les paysans des environs taient soulevs, e t heureusement que la voiture des princes avait dpass Pont-Saint-Maxence avant l'arr ive de la multitude, qui aurait pu se porter des violences. Les esprits taient cet te poque, dans presque toute la France, sous le coup d'une de ces paniques qui se c hangent facilement en fureur. Avec ces mots : Voici les brigands qui arrivent ! on avait mis la population tout entire sur pied. O taient-ils ? personne ne le sava it, et par cela mme on les voyait partout. D'o viendraient-ils ? on l'ignorait, et on les attendait par toutes les routes. Ces populations exaspres de peur et de colre s e livrrent aux plus grands excs. La guerre aux chteaux commena, surtout en Provence, en Alsace, en Franche-Comt, en Guyenne, en Normandie et en Bourgogne. On ajoutai t : Paix aux chaumires, mais la paix n'tait nulle part. C'est ainsi que l'migration comme na. Les premiers menacs quittrent la France les premiers. Il y eut plusieurs flots dans l'migration, parce qu'il y eut plusieurs phases dans la rvolution, qui finit par atteindre tout le monde. Madame de Polignac, que la Reine avait nomme gouvernante de ses enfants aprs la re traite de madame de Gumne, tait, ds 1789, au nombre des personnes en butte aux haines populaires. La Reine, qui avait pour elle des sentiments de vritable amiti, voyan t l'opinion se prononcer contre elle avec une si grande violence, crut devoir sacr ifier ses affections la sret de son amie et l'intrt du trne ; elle demanda madame lignac de s'loigner. Il fallut la remplacer auprs des enfants de France. Le choix tait difficile. Il im portait, en effet, de trouver une personne qui satisft aux exigences de l'opinion e
t qui en mme temps et toutes les qualits requises pour mriter qu'on lui confit un dpt prcieux. La Reine jeta les yeux sur ma mre[1], sur cette mre qui ne vivait que pour ses enf ants, qui ne donnait au monde que le peu d'instants que lui laissaient les devoirs qu'elle s'tait imposs et qu'elle remplissait avec tant de dvouement, qu'elle tait tout p nous, et que nous tions tout pour elle. Ce choix de la Reine, qui pour beaucoup d'autres et t une satisfaction d'amour-propre e t d'ambition, fut pour ma mre un coup accablant. Les devoirs de la mission laquelle elle tait appele, l'importance des fonctions qu'elle aurait remplir et que les circon stances rendaient si difficiles, lui apparurent ; en mme temps ses enfants qu'il fa udrait quitter... sa famille... laquelle il faudrait s'arracher, se prsentrent son e sprit. Elle ne pouvait se rsoudre accepter. Le combat entre ses affections particulires et le souvenir de la bont que le Roi e t la Reine lui avaient tmoigne, l'poque de la mort de mon pre, dura plusieurs jours. M ais le sentiment des malheurs de cette royale famille, le spectacle de l'abandon o beaucoup de ceux qui l'entouraient l'avaient laisse, l'emportrent. Elle se rsigna au sacr ifice qu'on lui demandait ; c'en tait un alors, et un bien grand : on pouvait dj prvoir quelques-uns des malheurs cachs dans l'avenir. Ma mre vit la Reine. Voici les premires paroles que celle-ci lui adressa : Madame, j'avais confi mes enfants l'amiti, aujourd'hui je les confie la vertu. Mes surs taient maries[2]. Reste seule prs de ma mre, je la suivis Versailles ; ma m prta entre les mains du Roi le serment de gouvernante des enfants de France et en tra en fonctions. L'appartement qu'elle occupait se trouvait entre l'appartement de M. le Dauphin et cel ui de Madame Royale[3]. Toutes les nuits, ma mre couchait dans la chambre de M. l e Dauphin et ne le quittait en aucun moment du jour. Je menai donc une vie un pe u triste et un peu solitaire dans le court espace qui spara notre installation Ve rsailles, au mois d'aot 1789, des journes des 5 et 6 octobre suivants. Loge dans un entre-sol donnant sur une petite cour intrieure fort obscure, ds deux heures de l'aprs-midi j'tais oblige d'avoir de la lumire ; ma chambre se trouvait prcis place sous le cabinet de la Reine, qui, malgr ses magnificences de dorures et des plus belles sculptures, n'avait vue, comme mon entre-sol, que sur cette cour. Un inconvnient grave, rsultant de la mauvaise distribution de cette partie du chtea u, excita chez moi des scrupules faciles comprendre, et ajoutait encore l'incommod it de ma sombre demeure : tout ce que la Reine disait dans son cabinet s'entendait distinctement dans ma chambre. Tous les jours, une heure, le Roi venait chez la Reine, et sa voix forte faisait arriver toutes ses paroles jusqu' moi. Ma mre crut d evoir en prvenir la Reine, en lui disant que j'avais le soin de tenir ma fentre habi tuellement ferme. Celle-ci, avec cette grce et cette bont qui se retrouvaient dans toutes ses actions et dans toutes ses paroles, lui rpondit : Qu'importe ? je n'ai rie n craindre, quand mes plus secrtes penses tomberaient dans le cur de notre chre Paul ine. Deux mois s'coulrent ainsi, et nous tions arrivs au mois d'octobre 1789. Les passions co ntinuaient fermenter. Une vague inquitude tenait le chteau en veil. Les rapports qu i arrivaient de Paris taient alarmants : on parlait de troubles, de projets de rvo lte ; une grande agitation rgnait la cour. Les personnes dvoues sentaient augmenter leur attachement, en raison mme des bruits qui devenaient plus menaants, et des pr ils croissants de la famille royale. Les gardes du corps, voulant donner un tmoignage clatant de leur fidlit, et en mme te mps sceller l'union des dfenseurs de la famille royale, eurent l'ide d'offrir un repas a ux officiers du rgiment de Flandre, qui venait d'tre appel Versailles. Rien de mieux motiv que l'arrive de ce rgiment. M. de la Fayette, qui n'a jamais pass pour alarmiste, avait crit M. de Saint-Priest, alors ministre de l'intrieur, pour l'avertir qu'il y avai t Paris de mauvais desseins, et qu'on cherchait rpandre dans la garde nationale par isienne l'ide d'aller Versailles. M. de Saint-Priest avait port la lettre au conseil, et propos de fortifier la garnison. Le ministre, suivant le loi nouvellement tablie , en avait rfr la municipalit, et c'tait celle-ci qui avait demand un renfort de trou . Tout s'tait donc pass selon les rgles, et la constitution avait t observe dans toutes ses prescriptions. Il n'y avait rien d'inconstitutionnel dans l'ide des gardes du corps d'offrir un dner leurs camarades du rgiment de Flandre, et les circonstances taient
assez difficiles, les menaces des ennemis de la royaut assez flagrantes, pour que l'utilit d'une pareille manifestation ft incontestable. Le repas eut lieu le 1er octo bre ; les gardes du corps y avaient invit non-seulement les officiers du rgiment d e Flandre, mais ceux des gardes suisses et de la garde nationale ; et, comme nul le part on n'avait pu trouver un local assez vaste pour une si nombreuse runion, le Roi fit mettre leur disposition la salle d'opra du chteau. On conseilla au Roi de p aratre cette fte, laquelle toutes les personnes de la cour, assises dans leurs log es, assistrent. Il tait impossible qu'il refust de se rendre au dsir de tant de braves gens prts mourir pour lui ; il s'y rendit. La Reine aussi parut ce repas avec ses enfants ; ma mre et moi, nous la suivmes. L a prsence de la Reine, qui tenait dans ses bras le second Dauphin, excita un vif enthousiasme. La musique joua l'air : Richard, mon roi ! qui tait malheureusement d e circonstance. Par un mouvement spontan, tous les convives se levrent, et, tirant leur pe, jurrent de verser pour la famille royale jusqu' la dernire goutte de leur san g. L'motion tait son comble, et tout le monde pleurait. Ce spectacle fit sur moi une impression que je ne peux rendre, et que rien n'a pu effacer. Je sentis que je m'unissais au serment de ces serviteurs fidles, de ces braves offi ciers, et mon cur se dvoua pour ma vie. Chapitre 3 Le moment arrivait o le dvouement devait tre mis l'preuve. Les bruits alarmants rpandus depuis quelques jours ne nous avaient pas tromps. Les agitateurs prparaient une journe Paris. La chert du pain favorisait leurs manuvres. Comme, tout en disputant au Roi jusqu' l'ombre de la puissance, on faisait remonter jusqu' lui la responsabilit de toute chose, on l'accusait aussi du renchrissement du bl. Il y a des circonstances o tout, jusqu'aux prcautions qu'on prend contre le danger, l'a ugmente. On exploita le banquet que les gardes du corps avaient donn aux officiers du rgime nt de Flandre. Les convives avaient seulement jur de dfendre le Roi et la famille royale, on prtendit qu'ils avaient jur d'attaquer le peuple et l'assemble, ce qui tait un affreuse calomnie et une infme machination. Le 5 octobre, les inquitudes se ralisent vers les dix heures du matin. On avait ap pris que la garde nationale solde et non solde partait de Paris avec du canon pour se rendre Versailles, et que la multitude habitue paratre dans les journes rvolutio nnaires la suivait. Il y avait eu dans le ministre quelque vellit d'arrter ce mouvemen t inconstitutionnel, en faisant occuper militairement les ponts de Svres et de Sa int-Cloud. Mais ce plan fut abandonn, sur l'observation de M. Necker que ce serait se prcipiter dans la guerre civile. Le Roi reculait toujours devant ce mot. On ne fit donc rien et on attendit. Ds le matin le chteau tait encombr de gentilshommes q ui venaient offrir leur pe au Roi. On m'a assur qu'ils taient au nombre de prs de sept c nts ; mais ils n'avaient que leur pe et ils taient en habit de cour. De quart d'heure e n quart d'heure on annonait l'approche des bandes parisiennes, et tout tait dans la pl us grande confusion dans la grande galerie et dans les autres salons. Ce ne fut que sur les six heures du soir que les premiers flots commencrent arriver, et M. de Lafayette n'entra Versailles, avec la garde nationale, qu' six heures du soir. Un billet crit par lui Auteuil annonait M. de Saint-Priest qu'il saurait maintenir l'ordr e et dfendre le Roi. Je ne vous redirai pas ici les dtails que vous trouverez partout ; je me borne vo us raconter ce que j'ai vu. Ma mre me fit coucher dans son appartement : vers cinq heures du matin j'entendis l es portes s'ouvrir vivement. La Reine parut. Elle tait peine habille et avait l'air trs -effray. Elle prit Madame, l'emmena, et demanda ma mre de monter, sans perte de temp s, monseigneur le Dauphin chez le Roi. Malgr son agitation, la Reine remarqua mon trouble ; bonne comme toujours, elle m e fit un geste de la main : N'ayez pas peur, Pauline, restez tranquille , me dit-el le. Je restai. Mais je ne pouvais me rendre compte du bruit qu'on faisait dans le chtea u : c'tait le retentissement de pas lointains, des portes ouvertes et fermes avec fr acas, des clameurs. Mon inquitude et mes anxits se prolongrent pendant plusieurs heu res, au bout desquelles j'appris les horreurs de cette nuit : le chteau forc, les ga
rdes du corps massacrs, les dangers qu'avait courus la Reine et ceux qui la menaaien t encore. Il avait fallu que trois gardes fidles, MM. Miomandre, de Varicour et d es Huttes, se fissent tuer leur poste pour donner la Reine le temps de descendre de son lit et de gagner peine vtue la chambre du Roi. Vers dix heures du matin, ma mre vint m'apprendre que le Roi permettait que je le s uivisse dans l'appartement o toute la famille royale tait rassemble. En passant prs des fentres, je vis avec horreur la cour de marbre remplie de figur es atroces ; c'tait une cohue d'hommes et de femmes arms de fourches, de faux, de piqu es, et vocifrant les plus horribles injures et les menaces les plus effrayantes, entremles des cris : Que le Roi paraisse ! que le Roi paraisse ! le Roi ! le Roi ! On reprsenta au Roi qu'il tait ncessaire qu'il se montrt ; il s'avana sur le balcon. Les cris Vive le Roi !... le Roi Paris ! le Roi Paris ! se firent entendre de to us cts. Cette clameur grandissait de moment en moment, et l'on n'entendit plus que ces mots : Paris ! Paris ! Le Roi se retira, et de nouveaux cris s'levrent : La Reine ! la Reine ! Cette exigence de la foule causa un grand effroi ceux qui taient auprs de la Reine , et plusieurs personnes la supplirent de ne point se montrer... Elle savait quel point on avait enflamm contre elle les haines populaires ; qui pouvait dire pour quoi on l'appelait sur le balcon ? Les hommes qui avaient assassin les gardes du co rps pendant la nuit ne reculeraient pas devant un plus grand crime. Rien n'obligea it la Reine courir au-devant d'un danger certain. ce mot de danger, la Reine leva la tte et dit avec fermet : Je paratrai !... Puis, saisissant ses enfants par la main, elle se prsenta sur le balcon entre M. le Dau phin et Madame Royale. La Reine seule ! s'cria une voix ; et bientt toutes les voix reprirent : La Reine se ule ! La Reine, par un mouvement plus prompt que la pense, repoussa ses enfants en arrir e et demeura seule sur le balcon, en face de la multitude. Ce courage imposa la haine elle-mme. On n'entendit plus que ces cris : Paris ! Paris ! et la Reine se retira aprs avoir c happ, je crois, un grand pril. Un morne silence rgnait dans l'appartement, on paraissait tre dans l'attente de ce qui allait arriver... Il y eut beaucoup d'alles et venues, et nous apprmes enfin que la famille royale partait pour Paris. Il est vraisemblable que le but de cette journe avait t d'arracher au Roi cette conce ssion. La populace de Versailles n'tait ni assez nombreuse ni assez audacieuse pour dominer la force militaire que le Roi pouvait lui opposer. Les meneurs des jour nes des 5 et 6 octobre calculaient sans doute qu'une fois Paris, o l'Assemble le suivra it naturellement, Louis XVI ne pourrait plus rsister l'Assemble, ni l'Assemble la Rvo ion, qui conduirait tout. deux heures, le Roi monta en voiture, ayant avec lui la Reine, M. le Dauphin, Ma dame Royale, Madame lisabeth et ma mre. Dans une seconde voiture montrent la princesse de Chimai, dame d'honneur, la duches se de Duras et madame la marquise de la Roche-Aimon, dames du palais, et moi. Plusieurs autres voitures suivaient. Il y en avait une o se trouvaient Mesdames de France, avec la duchesse de Narbonn e-Lara, madame de Chastellux, madame et mademoiselle de Donissan, qui fut plus t ard madame de Lescure puis madame de la Rochejacquelein. Mais Mesdames de France purent s'arrter Bellevue. Les voitures, qui marchaient au pas, taient entoures d'une multitude de brigands don t les cris affreux glaaient d'effroi. Des canons prcdaient le cortge : des hommes habi lls en femmes taient cheval sur ces canons, et les ttes des malheureux gardes du co rps massacrs, portes au bout des piques, servaient de bannires cette horde de sauva ges ; plusieurs fois on vint la portire du Roi prsenter ses regards ces ttes sangla ntes de ses malheureux serviteurs. Ce triste cortge marchait dans une confusion inexprimable et si lentement, qu'on mi t six heures faire les quatre lieues qui sparent Versailles de Paris. chaque inst ant on entendait tirer des coups de fusil, et la tte du Roi et celle de la Reine ne cessrent pas d'tre en danger pendant tout le trajet. Plusieurs coups de feu furen t tirs dans la direction de leur carrosse. Il y eut quelques personnes de tues.
Au moment du dpart, la plus grande partie des habitants de Versailles, aux fentres de leurs maisons, applaudissaient ce spectacle horrible, sans penser qu'ils appla udissaient leur propre ruine. Dans la voiture o j'tais, on garda pendant la route un profond silence : je tenais l es yeux baisss pour viter de voir ce qui se passait autour de nous. Cette marche c ruelle ne fut suspendue qu' la barrire de Paris, o M. Bailly, alors maire, vint prsent er au Roi les clefs de la ville, en lui disant : Sire, je remets Votre Majest les clefs de sa bonne ville de Paris. Le Roi rpondit : C'est toujours avec plaisir et confiance que je me vois au milieu des habitants de ma bonne ville de Paris. Bailly, rptant ces paroles ceux qui ne l es avaient pas entendues, pour qu'elles circulassent dans la foule, oublia le mot de confiance. Rptez avec confiance , dit la Reine. Hlas ! comment cette confiance de vait-elle tre justifie ? On arriva aux Tuileries huit heures du soir, aprs six heures d'un cruel supplice. Rien n'tait prpar pour l'arrive de la famille royale. Au milieu de cette immense confusi on, des ordres n'avaient pu tre que tardivement donns. Nous trouvmes les appartements sens dessus dessous, pleins d'ouvriers, et des chelles dresses de tous les cts. Le chteau des Tuileries tait rest inhabit presque sans interruption depuis 1665. Les meubles les plus ncessaires y manquaient ; ceux qu'on y trouvait taient dlabrs ; les tapisseries taient vieilles et fanes. Les appartements taient mal clairs au moment o n ous y entrmes. Tout y respirait un sentiment de tristesse en harmonie avec les im pressions que nous y apportions aprs cette douloureuse journe. La garde nationale s'tait empare des postes intrieurs et extrieurs du chteau. On ne savait pas encore o serait log M. le Dauphin, et, provisoirement, il fut tabl i dans une chambre du pavillon de Flore, au second ; ma mre resta prs de lui, et m oi je couchai sur un canap dans un salon ct. Chapitre 4 Quelques jours aprs l'arrive aux Tuileries, l'appartement destin ma mre tant prt, ell prit possession ; il tait au rez-de-chausse donnant sur la cour, et j'occupai les en tre-sol au-dessus. M. le Dauphin fut tabli au premier, prs de l'appartement du Roi ; un petit escalier noir servait de communication de l'appartement de M. le Dauphin celui de ma mre : l a Reine et ma mre, seules, avaient une clef de cet escalier. J'ai remarqu que dans les temps de rvolution il y avait toujours des moments de calm e aprs les grands orages, et c'est cela qui trompe ceux qui sont engags dans ces cri ses. Si elles se dveloppaient sans discontinuit, on se roidirait pour rsister, et p eut-tre finirait-on par en triompher. Mais, comme le courant se ralentit quand il a emport les premires digues, on se laisse aller l'espoir que tout est fini, et, da ns la crainte de troubler ce calme relatif dont on jouit dlicieusement, on omet d e prendre les prcautions ncessaires. Ce fut un peu ce qui arriva. Dans les premier s temps du sjour de la famille royale Paris, et aprs les journes des 5 et 6 octobre , et les troubles qui suivirent, et dans lesquels un boulanger nomm Franois fut pe ndu un rverbre comme suspect d'tre un aristocrate, il se fit un mouvement dans l'opinio n. L'Assemble proclama la loi martiale, et, craignant son tour de succomber devant l'anarchie de la rue attaquant son pouvoir, elle rsolut de donner au Roi un tmoignag e de sympathie et de respect. On la vit paratre spontanment au chteau des Tuileries , o elle n'tait pas attendue, et o elle fut conduite par M. Frteau, son prsident. Le Ro i se montra trs-sensible cette dmarche. En sortant de son appartement, l'Assemble se rendit dans celui de la Reine. Le prsident lui adressa un discours o respiraient l es sentiments de la vieille fidlit franaise, et qui se terminait par le vu de voir d ans ses bras le Dauphin, cet illustre enfant, rejeton de tant de rois chris de le urs peuples, hritier de Louis IX, de Henri IV et de celui dont les vertus taient l'e spoir de la France . La Reine, profondment touche de ces paroles, prit le Dauphin d ans ses bras et le prsenta l'Assemble, qui ne cessait de faire retentir les cris de Vive le Roi ! vive la Reine ! vive M. le Dauphin ! Je vous rappelle ces dtails parce qu'ils expliquent ce sentiment d'une scurit renaissan te qu'on a souvent reproch Louis XVI. Il se trompait sur la situation, a-t-on dit ; il serait plus exact de dire qu'on le trompait, par des manifestations du genre d e celle dont je viens de parler ; plus exact encore d'assurer que tout le monde se trompait, car je suis convaincue que l'Assemble ressentait, au moment o elle les ex
primait, les sentiments qu'elle manifestait. Mais la Rvolution tait comme un de ces grands courants qui entranent jusqu'aux barques qui essayent de jeter l'ancre. Tout m archait parce qu'elle marchait toujours. On s'habitua donc au sjour des Tuileries. Insensiblement on se fit des occupations et on se traa un plan de vie. La mienne tait assez douce. Des matres occupaient une partie de ma matine ; tous les jours, avec ma mre, j'accompagnais M. le Dauphin la promenade dans les Tuileries. Quelques gardes nationaux, sous les ordres d'un chef de bataillon, escortaient M. le Dauphin ; ils cartaient la foule qui se pressait sur son passage ; mais jamais nous n'emes nous en plaindre : on n'entendait que des exclamations sur la beaut du jeune prince, et nous tions heureuses de l'intrt qu'il insp irait. Ma mre sentit combien de pareilles promenades seraient peu profitables la sant d'un enfant, et, sur sa demande, le Roi fit arranger la ppinire du jardinier du palais, qui devint le jardin particulier de M. le Dauphin. Nous y passions trois heures tous les jours, et le jeune prince pouvait au moins prendre l'exercice ncessaire s on ge. Ce jardin tait l'extrmit de la terrasse du bord de l'eau, et de plain-pied avec le quai . Plus tard, sous l'Empire, il a t combl quand cette terrasse a t prolonge jusqu' la p Louis XV. Au bout de quelque temps, comme le calme paraissait renatre, hlas ! ce n'tait qu'un bie n court entr'acte au milieu des temptes, la Reine, dsirant donner quelques distracti ons ses enfants, dit ma mre qu'elle viendrait chez elle prendre du th de temps en te mps ; elle l'engagea inviter quelques personnes qui eussent des enfants de l'ge de Ma dame Royale. Ces runions taient faites pour plaire celle-ci, et pour mettre dans sa vie, qui de vait tre si triste, quelques lueurs de gaiet. On jouait de petits jeux : tous les appartements de ma mre, dont les portes battantes taient ouvertes, prsentaient un v aste champ l'activit de Madame Royale, et les parties de cache-cache qui avaient li eu alors laissrent dans son esprit de longs souvenirs que j'ai retrouvs plus tard da ns la mmoire de Madame la Dauphine. Pendant que la Reine, ma mre et les personnes invites taient dans le salon, j'tais ins titue la surveillante de la jeune princesse et de ses jeux. Mais les joies innocentes de Madame firent place bientt une occupation srieuse : i l s'agissait de l'acte le plus important de la vie. Elle venait d'atteindre sa douzime anne, il fut dcid qu'on lui ferait faire sa premire communion. Cette solennit eut lieu le 8 avril 1790, l'glise Saint-Germain-l'Auxerrois. Le matin de ce jour, la Reine conduisit la jeune princesse dans la chambre du Ro i, et lui dit : Ma fille, jetez-vous aux pieds de votre pre, et demandez-lui sa bnd iction. Madame se prosterna. Le Roi la bnit et la releva. Je rpte avec un pieux respect les paroles qu'il lui adressa : C'est du fond de mon cur, ma fille, que je vous bnis, en demandant au ciel qu'il vous fasse la grce de bien a pprcier la grande action que vous allez faire ; votre cur est innocent aux yeux de Dieu ; vos vux doivent lui tre agrables ; offrez-les-lui pour votre mre et pour moi ; demandez-lui qu'il m'accorde les grces ncessaires pour faire le bonheur de ceux sur lesquels il m'a donn l'empire et que je dois considrer comme mes enfants ; demandez-l ui qu'il daigne conserver dans le royaume la puret de la religion, et souvenez-vous bien, ma fille, que cette sainte religion est la source du bonheur et notre sou tien dans les adversits de la vie. Ne croyez pas que vous en soyez l'abri ; vous tes bien jeune, mais vous avez dj vu votre pre afflig plus d'une fois. Vous ne savez pas, ma fille, quoi la Providence vous destine, si vous resterez d ans ce royaume ou si vous irez en habiter un autre : dans quelque lieu o la main de Dieu vous pose, souvenez-vous que vous devez difier par vos exemples, faire le bien toutes les fois que vous en trouverez l'occasion ; mais surtout, mon enfant, soulagez les malheureux de tout votre pouvoir : Dieu ne vous a fait natre dans l e rang o nous sommes que pour travailler leur bonheur et les consoler dans les pe ines. Allez aux autels o vous tes attendue, et conjurez le Dieu de misricorde de ne vous laisser oublier jamais les avis d'un pre tendre. Il tait d'usage que les Filles de France reussent une parure en diamants le jour de leur premire communion ; Louis XVI, qui avait rsolu d'abolir cet usage dispendieux,
en avertit Madame Royale par ce peu de mots : Je vous sais trop raisonnable, ma fille, pour croire qu'au moment o vous devez tre entirement occupe du soin d'orner votre cur et d'en faire un sanctuaire digne de la divinit, vous attachiez un grand prix d es parures artificielles. D'ailleurs, mon enfant, la misre publique est extrme, les pauvres abondent, et assurment vous aimez mieux vous passer de pierreries que de savoir qu'ils se passent de pain. Chapitre 5 Le Roi, la Reine, ne sortaient pas de leur appartement : il n'y avait pour eux ni promenade ni exercice. Dans Paris on les regardait comme prisonniers ; on les pl aignait. Les meneurs, ne voulant pas que cette opinion s'accrditt et craignant l'intrt q ui commenait se porter sur Louis XVI et Marie-Antoinette, proposrent au Roi, vers le mois d'aot 1790, d'aller Saint-Cloud passer le reste de l't. Le Roi et la Reine accep ent cette ouverture avec empressement. Toute la famille royale quitta les Tuiler ies. M. le comte et madame la comtesse de Provence n'habitrent point le chteau de Sa int-Cloud ; ils avaient lou une maison prs du pont, mais chaque jour ils venaient souper chez le Roi et y passer avec lui la soire. C'tait un grand soulagement pour la famille royale et pour les personnes qui l'entour aient que de trouver la solitude et le repos loin des clameurs rvolutionnaires qu i les poursuivaient aux Tuileries, et d'tre l'abri des vocifrations des crieurs, qui, dans les derniers temps de notre sjour, ne se contentaient pas de se tenir aux po rtes du jardin, mais le parcouraient dans tous les sens en annonant toutes leurs mchantes nouvelles. Rien n'tait prpar Saint-Cloud pour l'arrive du Roi. Chacun provisoirement s'tablit com put. Madame, depuis sa premire communion, mangeait avec le Roi ; M. le Dauphin m angeait seul ; ma mre avait une table et recevait les personnes de service prs de la famille royale. Au bout de quelques jours, le Roi dcida que les personnes du voyage seraient admi ses sa table[1]. J'tais du voyage, mais j'tais bien jeune ; en outre, je n'tais pas prs , puisque je n'tais pas marie : je ne pouvais, d'aprs l'tiquette, tre admise la table i, je me trouvai donc dans la ncessit de dner seule. Le Roi daigna s'apercevoir de mon absence, et, avec cette bont qu'il montrait en tout e occasion, il pensa me tirer de ma solitude. C'tait chose assez difficile, car la cour l'tiquette faisait loi. Il en parla la Reine, et il fut convenu entre elle et le Roi que l'on consulterait Mesdames[2]. Il y avait de graves objections ; chose pareille ne s'tait pas encore faite ; on craignait de crer un prcdent dont d'autres pers onnes l'avenir pourraient se prvaloir... Mais le Roi leva toute objection en disant ma mre : Madame de Tourzel, de pareilles circonstances ne se rencontreront plus, je l'espre ; votre fille mrite bien une exception ; elle sera des ntres, amenez-nous -la. Le lendemain, sous la conduite de ma mre, je me rendis dans le salon du Roi l'heure du dner. Quand le Roi parut, ma mre me mena lui pour le remercier de sa bont ; il me dit quelques mots obligeants, mais la Reine me combla de tmoignages d'intrt et de bienveillance. dner, la place du Roi, celles de la Reine et de Madame lisabeth taient marques ; ils appelaient prs d'eux les personnes qu'il leur convenait de dsigner. Madame tait toujou rs ct de la Reine, et il y avait une place vide entre elle et ma mre. Pour mon dbut je fus appele prs de la jeune princesse. Quand M. le comte et madame la comtesse de Provence taient prsents, ils usaient au ssi du droit de se donner pour voisin qui leur convenait. Tous les jours, aprs dner, ma mre allait chercher M. le Dauphin, qui se runissait sa famille. Le Roi, la Reine, Madame lisabeth, jouaient au billard ; les autres per sonnes, disperses dans le salon, causaient ou regardaient jouer. Cette partie dur ait environ une heure, aprs quoi on montait en calche et l'on allait promener dans l es environs. Le Roi n'tait jamais de ces courses, sa promenade se bornait l'intrieur d es jardins. De retour de la promenade, on se retirait chez soi ; et moi, rentre dans mon intri eur, je reprenais mes occupations. l'heure du souper, ma mre, retenue prs de M. le D auphin, ne montait que lorsque l'on tait au moment de se mettre table ; mais, le Ro i et la Reine se rendant au salon avant le moment du souper pour y recevoir M. l e comte et madame la comtesse de Provence, il n'et point t convenable que j'arrivasse a
prs leur entre dans le salon ; ma mre me confiait alors ou la princesse de Chimai, ou la duchesse de Duras comme des mentors, et j'ai toujours eu me louer grandement de leurs bonts. Au souper, comme au dner, les princes appelaient prs d'eux la personne qu'ils voulaien t favoriser de cet honneur ; trs-souvent le Roi me donnait cette marque de bont : je ne me trouvais point embarrasse du tout prs de lui ; sa douce bont, sa simplicit, m'encourageaient. Il n'en tait pas de mme quand M. le comte de Provence me faisait l'honneur de me mettr e prs de lui ; il avait tant d'esprit, qu'il m'tait le peu que je pouvais avoir ; ses be lles phrases me rduisaient au silence ; je retrouvais l ma timidit tout entire. Mais, quand la comtesse de Provence m'avait fait signe de me placer ct d'elle, j'tais da s un vrai ravissement. Il est impossible d'tre plus gai, plus aimable que cette pri ncesse ; un grain de malice aiguisait ce charmant esprit, et le souper ne me par aissait jamais long. C'tait surtout le dimanche qu'il tait fort amusant de l'entendre : le public tait admis circuler autour de la table ; le plaisir de la comtesse de P rovence tait alors de deviner le caractre, les dispositions et la profession des i ndividus qui passaient sous ses yeux ; cette espce d'enqute divinatoire qu'elle faisai t en interrogeant les physionomies la conduisait quelquefois aux rsultats les plu s plaisants et les plus inattendus, et il fallait que j'eusse beaucoup d'empire sur moi pour garder le srieux convenable. Entr au salon aprs le souper, le Roi faisait une poule au billard avec sa famille, et admettait cette partie quelques-unes des personnes prsentes. Je suivais le jeu avec quelque intrt. Le Roi me dit un jour : Pauline, savez-vous jouer au billard ? Non, sire, rpondis -je. Ah ! ah ! il faut que vous sachiez jouer au billard ; je me charge de votre ducation, et je vous donnerai des leons. Effectivement le lendemain, aprs le dner, et la partie de la famille finie, il me donna la premire leon, et tous les jours il eut l'extrme bont de continuer ce qu'il avai t commenc. C'est donc lui que je dois de pouvoir vous battre aujourd'hui, mes chers a mis. Je profitai des leons d'un si bon matre, et, au bout de peu de temps, je fus admise la poule du soir : il m'arrivait quelquefois de tenir une des dernires. Une fois, r este seule avec M. le comte de Provence, aprs une lutte de quelques instants, il e ut la grce de jeter sa bille dans une blouse, et la poule m'appartint... J'eusse peut -tre dsir que sa perte et paru moins volontaire, mais la galanterie tait grande, et m on embarras presque aussi grand. Le temps du sjour Saint-Cloud fut calme ; on y jouissait d'une espce de libert. La ga iet du lieu, la beaut des promenades, l'loignement de Paris, cette fournaise o la Rvolu tion fourbissait ses armes, nous rendaient une sorte de tranquillit. On ne voyait plus les vnements qu'en perspective, au lieu de se trouver dans l'ardeur de la mle. J'y i t relativement heureuse. Admise dans l'intrieur de la famille royale, j'y avais trouv des jouissances de plus d'un genre. Les circonstances, en me rapprochant de Madame Royale, me firent connatre son excellent cur et ses prcieuses qualits ; et c'est de c e sjour Saint-Cloud que je peux dater le commencement de cette amiti et de ces bon ts dont elle m'a toujours donn depuis de si doux tmoignages. On revint Paris la fin du mois d'octobre 1790, et l on retrouva cette gne, cette con trainte, ce voisinage d'une population malveillante et bruyante, ces inquitudes que le sjour de Saint-Cloud paraissait avoir un peu allges. Je fis, cette poque, une absence de quelques jours. Mes surs m'emmenrent Gvres, chez e duc de Gvres[3], o il m'arriva quelque chose qui nous intrigua beaucoup. La poste m'apporta un jour une grande lettre avec enveloppe et timbre de Paris. mo i une si grande lettre !... Que pouvait-ce tre ? Je l'ouvre et n'y trouve autre chose qu'une feuille imprime, dtache du Mercure de France : nous lisons... c'tait un logogrip he ; on cherche... on devine... Le mot tait PAULINE. Sur ce mot les choses les pl us aimables, des choses beaucoup trop flatteuses taient adresses cette Pauline don t le nom avait inspir les vers du correspondant anonyme. Mais de qui venait cet envoi ? Le deviner semblait impossible... lorsqu'un trait d e lumire nous mit sur la voie : cette feuille du MERCURE tait de papier vlin ; la f amille royale seule recevait le Mercure imprim sur ce papier. C'tait donc un de ses membres qui avait bien voulu s'occuper de moi et me mnager cette surprise.
Je rapportai Paris la feuille mystrieuse, je la montrai ma mre, qui la montra la R eine, et la Reine laissa voir par un sourire qu'elle tait du secret, et nous smes qu e le Roi lui-mme m'avait donn cette marque touchante de son bienveillant souvenir. Chapitre 6 On tait entr dans l'anne 1791 ; la Rvolution marchait grands pas, et la position du Ro i et de la famille royale devenait de jour en jour difficile et plus critique, c elle des personnes qui les entouraient plus douloureuse. Necker, nagure l'idole du peuple, avait t dj depuis quelque temps forc de quitter le ministre, aprs avoir vu tom er en peu de mois cette popularit dont il tait si vain. La constitution civile du clerg avait t vote par l'Assemble, et le clerg franais, auquel on voulait l'imposer au de la loi, la repoussait au nom de sa conscience et de sa fidlit au chef de l'glise. Mirabeau, qui, aprs avoir fait tant de mal la monarchie, s'tait rapproch du Roi et av ait essay de soutenir le trne dans les derniers temps de sa vie, venait de mourir la fin de mars. Il y avait eu des rvoltes terribles dans les troupes, travailles par les rvolutionn aires, et M. de Bouill n'avait russi rprimer celle de Nancy qu'aprs un combat sanglant. Chaque jour, Paris tait troubl par des motions populaires dont le contre-coup reten tissait au chteau. Le Roi et la famille royale ne pouvaient plus sortir de la vil le, et c'est avec peine que, vers la fin du mois de fvrier, on avait laiss partir Me sdames de France ; nous apprmes mme qu'elles avaient t arrtes Arnay-le-Duc, parce qu' n'taient pas munies d'un passeport de l'Assemble. Le bref du Pape portant condamnation de la constitution civile du clerg rendait l a position du Roi encore plus difficile, car ce prince, catholique convaincu, s'tai t montr rsolu conformer sa conduite au dcret man du Saint-Sige. Or, ds le 10 juillet 90, le Pape avait crit au Roi : S'il tait votre disposition de renoncer mme des droi s inhrents la prrogative royale, vous n'avez pas le droit d'aliner en rien, ni d'abandon er ce qui est d Dieu et l'glise, dont vous tes le fils an. Cet avertissement avait 13 septembre de la mme anne ; et enfin, le 13 avril 1791, le Pape, dans un bref a ux cardinaux, avait qualifi de schisme le serment prt la constitution civile du cle rg. Dans la seconde quinzaine d'avril, le Roi ayant voulu se rendre Saint-Cloud, les j ournaux rvolutionnaires annoncrent que c'tait pour recevoir la communion d'un prtre non asserment. Ce soupon suffit pour amener une violente irritation dans les clubs et dans toutes les socits populaires. Il y eut un arrt du club des Cordeliers, affich au Palais-Royal, qui dclarait que, le premier fonctionnaire public de la nation sou ffrant et permettant que des prtres rfractaires se retirassent dans sa maison, et y exerassent, au grand scandale des Franais et de la loi, les fonctions publiques qui leur sont interdites par elle, la socit arrtait que ce premier fonctionnaire pu blic, ce premier sujet de la loi serait dnonc aux reprsentants de la Nation comme rf ractaire aux lois constitutionnelles qu'il a jur de maintenir . Le jour o le Roi deva it se rendre Saint-Cloud avait t publiquement annonc. Ds le matin, la gnrale battit, a place du Carrousel, la place Louis XV et le chemin de Saint-Cloud furent couve rts d'une grande foule. Lorsqu' midi le Roi sortit en voiture avec sa famille, cette foule se prcipita la tte des chevaux pour les arrter. Ce fut en vain que la Fayette et Bailly essayrent d'obtenir passage pour le Roi. La garde nationale leur dsobit et se mit avec la foule, en criant comme elle : Ne le laissez pas passer, il ne pa ssera pas. Le Roi renona se rendre ce jour-l Saint-Cloud, et, le lendemain, se prse ntant l'Assemble, il lui dit qu'il n'avait pas voulu faire cesser, la veille, par la fo rce la rsistance qu'on avait oppose son dpart pour Saint-Cloud, parce qu'il avait crain t de provoquer des actes de rigueur contre une multitude trompe, mais qu'il importa it de prouver la Nation qu'il tait libre pour l'autorit mme des sanctions et des accept ations qu'il avait donnes aux dcrets de l'Assemble. C'tait pour cela qu'il persistait dan de de se rendre Saint-Cloud. L'Assemble ne daigna mme pas ouvrir une dlibration sur la communication du Roi. Au milieu de ces perscutions cruelles, incessantes, et de ces alertes continuelle s, la Reine cessa de venir chez ma mre ; elle craignait de compromettre les perso nnes auxquelles elle aurait donn trop de marques d'affection ou de confiance. Les d istractions que l'on permettait Madame furent interrompues ; elle passait les soire s chez elle, et, frquemment, aprs le coucher de M. le Dauphin, je montais et j'assis tais au souper de Madame, aprs lequel nous faisions une partie de reversi.
Mais ma sant avait souffert de tant d'vnements dont j'avais t tmoin, de tant d'motions es qu'il fallait renfermer en moi. Ma mre jugea ncessaire de me distraire et de m'loigner pour quelque temps de ce thtre d e tant de maux. Elle exigea une sparation, la premire entre elle et moi ; elle me confia aux soins de ma sur, la duchesse de Charost ; nous partmes pour aller prs de Lille, chez mad ame de Sainte-Aldegonde, une autre de mes surs ; et l nous arrtmes un voyage en Zland e qui fut pour moi une vraie partie de plaisir. Mon oncle et ma tante de Montsoreau furent des ntres. Nous partmes tous les quatre ; nous vmes Tournai, Bruxelles ; nous nous embarqumes l'cluse pour Middelbourg. Nous vmes ces digues fameuses d'Ombourg et West-Capel. Et comme en ce moment une foire avait lieu Middelbourg, nous joumes du spectacle de la runion d'une infinit de costum es des environs, qui, tous, lgants et de la plus grande magnificence, formaient pa r leurs contrastes mmes un ensemble des plus attrayants. Nous revnmes par Flessingue l'cluse. Nous tions parties sans femmes de chambre, sans domestiques, voulant nous donner le plaisir de l'incognito ; chacun de nous portai t son petit paquet, qui, dans une seule occasion, nous parut lourd. Nous arrivmes l'cluse par un soleil du mois de juin ; nous gagnmes pied les portes de la ville, c omptant bien ne pas attendre longtemps un lieu de repos, mais il en fut autremen t. La ville tait une ville fortifie, elle avait un gouverneur ; et, pendant le dner de M. le gouverneur, les portes en taient soigneusement fermes. Quand nous nous prsentmes pour entrer et que nous demandmes le passage, on nous sig nifia que les portes ne seraient ouvertes que lorsque M. le gouverneur aurait dn. Force nous fut de rester en dehors, et, faute d'asile, il nous fallut demeurer au grand soleil, assis sur nos paquets. Le dner du gouverneur nous parut long, je l'av oue, et le repos que nous prmes devant cette porte nous mit en nage. Nous visitmes Ostende, Bruges, Gand, et vnmes Tournai, o nous devions sjourner. Ce voyage fut dlicieux pour moi : du mouvement, des choses nouvelles, des lieux n ouveaux, une grande varit d'impressions, une libert que je n'avais pas encore connue, t out fut jouissance et bonheur ; mais, hlas ! bonheur de bien courte dure. Tout coup, vers la fin du mois de juin 1791, nous apprenons que madame la comtes se de Provence[1] est arrive Tournai, se sauvant de Paris, et que le Roi aussi a quitt les Tuileries. Notre saisissement peut se concevoir. Nous courmes chez la pr incesse ; elle nous dit le dpart du Roi et de sa famille pour se rendre Montmdy, v ille forte situe prs de la frontire, et o commandait M. de Bouill ; ma mre les accompa gnait. Que d'inquitudes, de craintes, de tourments ! Ces craintes taient mles d'esprances. Le R i et la famille royale allaient peut-tre chapper cette demi-captivit dont j'avais t t n. tabli dans une place forte, au milieu d'une arme fidle, Louis XVI aurait un point d'appui pour traiter avec l'Assemble. Notre agitation nous porta partout o nous pouvions esprer quelques dtails, quelques renseignements. La nuit se passa dans de cruelles anxits. Le lendemain matin on v int nous apprendre l'arrestation du Roi Varennes et son retour forc sur Paris. La famille royale ! ma mre ! quel sort leur tait rserv ! l'attente des nouvelles tait u n supplice... Enfin, au bout de quelques jours mon frre arrive : il quittait ma mr e, il nous apportait de ses nouvelles. Elle tait aux Tuileries, en tat d'arrestation , dans l'appartement de M. le Dauphin, n'ayant pas mme la permission d'en sortir pour e ntrer chez elle ; un aide de camp de M. de la Fayette, charg de la surveiller dan s tous ses mouvements, couchait dans une chambre ct de la sienne ; du moins sa san t n'avait pas trop souffert. Elle nous faisait dire d'attendre, pour revenir Paris, d es ordres de sa part. Nous apprmes en mme temps les dtails de ce triste voyage de Varennes : ma mre portai t le nom de la baronne de Korf, dame russe qui avait mis son passe-port la dispo sition de la famille royale ; Madame Royale et le Dauphin, qu'on avait dguis en fill e, passaient pour ses enfants, sous les noms d'Amlie et d'Agla ; la Reine, sous le nom de madame Rocher, jouait le rle de gouvernante des enfants ; Madame lisabeth, dem oiselle de compagnie, sous le nom de Rosalie ; le Roi enfin, intendant de la bar onne russe, sous le nom de Durand. Deux gardes du corps, MM. de Maldent et de Mo ustier, passaient pour des domestiques ; un troisime garde du corps, M. de Valori , courait en avant pour faire prparer les chevaux. Tout avait t peu prs bien jusqu' Sa
nte-Menehould. Mais l le Roi avait t positivement reconnu au relais. C'est de l que le matre de poste, partant franc trier, tait arriv Varennes, o la municipalit avertie ait convoqu la garde nationale ; les populations de tous les environs, ameutes, s'tai ent leves en masse. Il n'avait pas t possible de surmonter cet obstacle. Aprs avoir en vain parlement, le Roi et la famille royale avaient t contraints d'obtemprer au dcret de l'Assemble apport par M. de Romeuf, aide de camp de M. de la Fayette, et qui pres crivait de ramener le Roi Paris, en quelque lieu qu'il ft atteint. Quel retour ! qu e de prils ! que d'outrages ! que de fatigues ! Un voyage fait au pas par des route s encombres d'une population hostile, sous les rayons d'un soleil brlant. La famille r oyale n'avait pas mme eu la consolation de pouvoir cacher ses souffrances ceux qui en taient les auteurs. Les trois commissaires de l'Assemble, Latour-Maubourg, Barnav e et Ption, avaient pris place dans cette voiture, o l'on touffait et o l'on tait si l , que Madame Royale avait d faire une partie du voyage assise sur les genoux de Pt ion. Ce n'tait que le 25 juin, sept heures du soir, qu'on tait entr Paris. Quelle morn et cruelle rception ! Je croyais voir le triste cortge traversant l'avenue des Cham ps-lyses, dont les alles taient remplies par trois cent mille spectateurs, dont aucu n ne donna la famille royale un tmoignage de respect, pas mme un signe de piti. La garde nationale, dont les armes taient renverses, pour qu'on vt qu'elle n'tait pas l pou endre les honneurs militaires au Roi, faisait la haie. Toutes les ttes taient couv ertes. Les gardes du corps assis sur le sige avaient t l'objet des insultes les plus grossires, et, peu de distance des Tuileries, il avait fallu l'intervention de la g arde nationale pour prserver leur vie. Enfin on tait entr dans le jardin par le pon t tournant, et le Roi avec toute sa famille tait devenu le prisonnier de M. de la Fayette, investi par un dcret de l'Assemble du gouvernement du chteau et de la garde de la famille royale. La rigueur de cette captivit avait t si grande, que par surc rot de prcaution on avait supprim la messe de la chapelle du chteau, parce qu'on trouv ait cette chapelle trop loigne des appartements, et qu'on craignait que, dans le tra jet, il n'y et quelque tentative d'vasion. On avait dress dans une pice contigu ces ap tements un autel de bois, et on en avait fait une chapelle provisoire o le Roi et sa famille entendaient la messe. La Reine, qui occupait l'appartement du rez-de-c hausse, montait-elle chez le Dauphin par l'escalier intrieur, elle trouvait toujours la porte ferme. Un des officiers frappait alors en disant : La Reine ! ce signal , deux des officiers qui gardaient pour ainsi dire vue ma mre ouvraient la porte. C'tait dj le rgime de la prison qui commenait aux Tuileries. Tant que ce rgime dura, ma mre nous prescrivit de rester o nous tions. Le temps pendant lequel nous attendmes notre rappel nous parut un sicle. Nous vivi ons en famille, mais toutes nos penses n'avaient qu'un mme objet, et l'inquitude de chacu n augmentait l'inquitude de tous. Enfin quand, au mois de septembre 1791, l'Assemble qui, pendant cette suspension de s pouvoirs du Roi, avait attir elle tout le gouvernement, eut termin la Constituti on, elle rendit au Roi, sinon la ralit, du moins l'apparence du pouvoir. Il y eut un e amnistie gnrale et toutes les consignes furent leves. Ma mre, aprs deux mois et dem i de captivit, libre des liens qui lui avaient t imposs, nous manda de revenir Paris . Je repris mon logement et me revis avec dlices prs de ma mre, de M. le Dauphin et d e Madame. On retrouva l'ancienne manire de vivre, avec cette diffrence que ce qui venait de se passer avait encore augment l'affection que le Roi et la famille royale avaient po ur nous et le besoin que nous avions de leur prouver notre tendre attachement. Chapitre 7 Ce fut le 4 septembre 1791 qu'une dputation de l'Assemble vint apporter au Roi l'acte co nstitutionnel. Thouret, rapporteur du comit de constitution, dit au Roi, en lui p rsentant cet acte : Sire, les reprsentants de la Nation viennent offrir l'acceptatio n de Votre Majest l'acte constitutionnel. Il consacre les droits imprescriptibles d u peuple franais, il rend au trne sa vraie dignit et organise le gouvernement de l'em pire. Le Roi rpondit qu'il allait examiner la Constitution, et qu'il rendrait sa rpons e dans le dlai le plus court possible, en faisant toutefois observer qu'un aussi gr ave sujet ncessitait un mr examen. Le 13 septembre, Louis XVI adressa l'Assemble son acceptation par l'intermdiaire du mi nistre de la justice.
Le Roi tait sincre : ceux qui le connaissaient comme nous ne pouvaient manquer d'en t re convaincus, et ceux qui n'ont pas connu cet excellent prince partageront cette conviction en lisant la lettre qu'il crivit cette poque Monsieur et au comte d'Artois pour leur expliquer l'adhsion qu'il venait de donner la Constitution. La Nation, disa it-il dans cette lettre, aime la Constitution parce que ce mot ne rappelle la cl asse infrieure du peuple que l'indpendance o il vit depuis deux ans, et la classe audessus l'galit. Ils blment volontiers tel ou tel dcret en particulier, mais ce n'est pas l ce qu'ils appellent la Constitution. Le bas peuple veut que l'on compte avec lui, le bourgeois ne voit rien au-dessus. L'amour-propre est satisfait, cette nouvelle jouissance a fait oublier toutes les autres. Ils n'attendaient que la fin de la Co nstitution pour tre parfaitement heureux ; la retarder tait leurs yeux le plus gra nd crime, parce que tous les bonheurs devaient arriver avec elle. Le temps leur apprendra combien ils se sont tromps ; mais leur erreur n'en est pas moins profonde . Si l'on entreprenait aujourd'hui de la renverser, ils n'en conserveraient l'ide que com me celle du plus grand moyen de bonheur, et, lorsque les troupes qui l'auraient re nverse seraient hors du royaume, on pourrait avec cette dernire les remuer sans ce sse, et le gouvernement se tiendrait dans un systme oppos l'esprit public et sans mo yen pour le contenir ; on ne gouverne jamais une nation contre ses habitudes ; c ette maxime est aussi vraie Constantinople que dans une rpublique. J'y ai bien pens, et j'ai vu que la guerre ne prsentait d'autres avantages que des horreurs et toujour s de la discorde. J'ai donc cru qu'il fallait loigner cette ide, et j'ai cru devoir essa yer encore les seuls moyens qui me restaient : la sanction de ma volont aux princ ipes de la Constitution. Je sens toutes les difficults de gouverner ainsi une gra nde nation, je dirai mme que j'en sens l'impossibilit ; mais l'obstacle que j'y aurais mis aurait port la guerre que je voulais viter, et aurait empch le peuple de juger cett e Constitution, parce qu'il n'y aurait vu que mon opposition constante. J'ai donc prfr la paix la guerre, parce qu'elle m'a paru la fois plus vertueuse et plus utile. Lorsque je relis, tant d'annes coules aprs l'vnement, le fragment de cette lettre alors crte, maintenant acquise l'histoire, je demeure frappe de la justesse de cette apprci ation. Il est impossible de mieux juger les difficults inextricables de la situat ion. Ceux qui ont voulu refuser Louis XVI l'intelligence des affaires et le discer nement politique auraient, ce me semble, bien de la peine expliquer cette lettre . Il y eut, aprs l'acceptation de la Constitution par le Roi, un moment de rpit. Le pe uple crut que tous les maux de la France allaient finir, et je ne sais si plusie urs personnes ne partagrent pas un moment au chteau cette illusion. Quant Madame li sabeth, elle prvoyait de nouveaux malheurs. Barnave, qui, depuis le retour de Var ennes, avait conquis la confiance du Roi par l'intrt respectueux qu'il avait tmoign la amille royale dans cette triste circonstance, venait secrtement aux Tuileries, et il donnait des conseils qui taient suivis. Le Roi, la Reine, et avec eux Madame l isabeth, allrent plusieurs fois au thtre, l'Opra, la Comdie-Franaise et la Comdi ne, et y furent accueillis par de grands applaudissements. On et pu croire que le Roi tait redevenu l'objet de l'adoration publique, comme au dbut de son rgne. On s'occupa activement de la cration de la garde constitutionnelle accorde au Roi, g arde qui eut une si courte existence, puisqu'elle fut licencie au mois d'avril 1792. Lorsqu'elle fut organise, elle fournit une escorte M. le Dauphin, qui allait tous l es jours au loin promener en voiture ; ma mre et moi nous l'accompagnions. Madame Royale, de son ct, sortait avec son escorte, et souvent on prenait rendez-v ous pour se rencontrer. Cette claircie dans notre ciel dura peu. L'Assemble constituante, qui se sentait use, n'aspirait plus qu' finir. La popularit dont elle avait fait un si terrible usage contre le Roi lui chappait. La majorit consti tutionnelle n'avait plus aucune force morale, elle dsesprait de son uvre, et le disco urs que pronona Malouet dans une des dernires sances de cette assemble donne la mesu re du dcouragement des esprits qui auraient voulu maintenir la Rvolution dans des limites modres : Voyez, disait-il, tous les principes de morale et de libert que vo us avez poss, accueillis avec des cris de joie et des serments redoubls, mais viols aussitt avec une audace et des fureurs inoues. C'est au moment o, pour me servir des expressions usites, la plus sainte et la plus libre des constitutions se proclam e, que les attentats les plus horribles contre la libert, que dis-je ? contre l'hum
anit et la conscience se multiplient et se prolongent. Comment ce contraste ne vo us effraye-t-il pas ? Je vais vous le dire. Tromps vous-mmes sur le mcanisme d'une so cit politique, vous en avez cherch la rgnration sans gard la dissolution ; vous avez nsidr comme obstacle le mcontentement des uns et l'exaltation des autres ; en ne croy ant donc vous roidir que contre les obstacles et favoriser les moyens, vous renv ersez journellement les principes, et vous apprenez au peuple les braver ; vous dtruisez constamment d'une main ce que vous difiez de l'autre ; c'est lever un difice en apant les fondements. Il faut terminer la Rvolution, c'est--dire commencer par ananti r toutes les dispositions, tous les actes contradictoires aux principes de la Co nstitution. Ainsi vos comits de recherches, vos lois sur les migrants, les serment s multiplis et les violences qui les suivent, la perscution des prtres, les empriso nnements arbitraires, les procdures continuelles contre des accuss sans preuves, l e fanatisme et la domination des clubs, tout cela doit disparatre la prsentation d e la Constitution si vous voulez qu'on l'accepte librement et qu'on l'excute. Mais ce n'est pas assez : la licence a fait tant de ravages... La lie de la nation bouillonne si violemment... L'insubordination effrayante des troupes, les troubles religieux , le mcontentement des colonies, qui retentit dj si lugubrement dans nos ports, l'inq uitude sur l'tat des finances, tels sont les motifs qui doivent dcider adopter des di spositions gnrales qui rendent le gouvernement aussi imposant qu'il l'est peu. Si vous ne contenez vos successeurs par des dispositions plus fortes que leurs volonts, que deviendra votre constitution ! Souvenez-vous de l'histoire des Grecs, et comme nt une premire rvolution non termine en produisit tant d'autres dans l'espace de cinqua nte ans. Ce discours de Malouet, dont je transcris un fragment sur un vieux numro du Monit eur que j'avais conserv, parce que cette harangue dsespre frappa tout le monde au chtea u, tait le testament politique de la Constituante et surtout des constitutionnels qui y avaient jou le principal rle. Aprs avoir fait moralement abdiquer le Roi, il s abdiquaient eux-mmes dans les mains d'hritiers plus ardents. Un simple rapprocheme nt peindra la situation : quand l'Assemble se retira, Robespierre sortit au milieu des acclamations de la foule, et Barnave fut poursuivi par les hues. Le 1er octobre 1791, la nouvelle assemble se runit sous le nom de Lgislative. Il y eut son dbut une certaine hsitation dans sa marche. Les constitutionnels y taient e ncore nombreux, et les centres, qui disposaient de la majorit, hsitaient entre eux et les Girondins, qui arrivaient avec une grande rputation d'exaltation et d'loquence . Ds les premiers jours de la runion de la Lgislative, on put voir que la violence rvolutionnaire dpasserait tout ce qu'on avait eu souffrir de la Constituante. Quelqu es dputs, au nombre desquels taient Couthon et Chabot, noms destins une sinistre clbr t, arrachrent la surprise de la majorit un dcret qui dcidait que l'Assemble pourrait eoir et se couvrir en prsence du Roi, et qu'on ne prparerait celui-ci, pour la sance royale, qu'un fauteuil pareil celui du prsident. La garde nationale, qui tait encore sous le coup du charme de la Constitution, et la bourgeoisie de Paris, qui part ageait ses illusions, s'indignrent contre cette tentative. Les reprsentants qui avai ent pris cette initiative furent menacs au sein mme de l'Assemble par des officiers d e la garde nationale. On crut alors qu'ils s'taient abuss sur la situation, et que la Rpublique, dont cette tentative annonait l'avnement, tait impossible en France ; ils s't ient seulement tromps d'heure. Bientt la Rvolution reprit sa marche, qu'on avait crue arrte, et qui n'tait que suspendu . Les troubles populaires recommencrent. Ption avait t nomm maire le 18 novembre 1791 et Manuel procureur-syndic de la commune. Ils n'taient pas hommes compromettre leu r popularit en s'opposant aux projets des agitateurs. Les factieux purent donc fair e tout ce qu'ils voulurent. La situation de la famille royale pendant ce triste hi ver de 1791 1792 se trouve exactement dcrite dans les lignes suivantes extraites d'une lettre crite par la Reine la duchesse de Polignac, la date du 7 janvier 1792 : Nous sommes sous scells comme des criminels, disait-elle, et, en vrit, cette cont rainte est horrible supporter. Avoir sans cesse craindre pour les siens, ne pas s'approcher d'une fentre sans tre abreuv d'insultes, ne pouvoir conduire l'air de pauvre nfants sans exposer ces chers innocents aux vocifrations, quelle position, mon ch er cur ! Encore, si l'on n'avait que ses propres peines ! mais trembler pour le Roi, pour ce qu'on a de plus cher au monde, pour les amies prsentes, pour les amies abse ntes, c'est un poids trop fort endurer.
Les personnes dvoues au Roi cherchaient, par des manifestations royalistes, consol er la famille royale et neutraliser l'effet des manifestations rvolutionnaires. Ain si, le 20 fvrier 1792, la Reine et ses enfants, qui avaient t la comdie, furent l'obje t d'une vritable ovation. Il y eut un tapage d'applaudissements rjouir tous les curs bi en placs, et Madame lisabeth disait ce sujet que la nation franaise avait de charma nts moments. On fit rpter quatre fois le duo du valet et de la femme de chambre de s vnements imprvus, o il est parl de l'amour que ces deux personnages ont pour leur mat e, et au moment o ils disent : Il faut les rendre heureux, une grande partie de l a salle s'cria : Oui ! oui !... Mais ces manifestations royalistes ne faisaient qu'ir riter la Rvolution, et lui dmontrer la ncessit d'enlever au Roi ses derniers appuis. Ds les premiers mois de 1792, le licenciement de la garde constitutionnelle du Ro i devint le but de toutes les motions dans les clubs. Quand on eut chauff les espr its, on porta la question devant l'Assemble ; Brissot russit, dans une sance de nuit, au commencement du mois de juin, faire porter un dcret d'accusation contre M. de B rissac, commandant de la garde constitutionnelle, et le dcret de licenciement, at tendu, disait-on, que l'esprit de cette garde tait mauvais, et que les chefs devaie nt en rpondre. M. de Brissac fut arrt dans les Tuileries sans qu'on et prvenu le Roi. L orsque celui-ci connut le dcret et le dessein qu'on avait de dsarmer sa garde, il pr it le parti de la suspendre et de la renvoyer l'cole militaire. La garde nationale l'y conduisit au milieu des cris de : Vive la Nation, sans vouloir souffrir qu'elle marcht le sabre la main. Elle tait prisonnire. Le licenciement de la garde constitutionnelle fut une vive affliction pour la fa mille royale : elle tait compose de gens si dvous ! son loignement prsageait de si gra nds malheurs ! De ce moment toute promenade, toute distraction cessrent, et l'intrieur du chteau pri t l'aspect de la plus douloureuse rsignation. On comprenait que ce n'tait pas sans des sein qu'on avait licenci la garde du Roi. En effet, trois semaines ne s'coulrent pas entre cette mesure et la journe du 20 juin . Elle tait prvue, elle tait annonce... Comment l'viter, comment s'y opposer ?... Vous connaissez tous les dtails de cette horrible journe : si elle ne mit pas fin aux malheurs et la vie du Roi par un crime, c'tait que la Providence lui rservait en core de plus grandes preuves. Le 20 juin au matin, le faubourg Saint-Antoine se mit en marche afin de porter u ne ptition la reprsentation nationale. Quinze cents hommes dfilrent devant l'Assemble il y avait peu de gardes nationaux, beaucoup d'hommes piques et de femmes des fau bourgs qui, dans toutes ces manifestations, se montraient les plus avances. Comme l'on prvoyait une journe, suivant le terme employ cette poque, la garde nationale ava it t convoque, et la cour et le jardin taient aussi remplis de troupes. Mais les ord res manquaient par suite du conflit soulev entre le dpartement, qui avait t d'avis de repousser la force par la force, et la municipalit, qui n'avait tenu aucun compte d e cette dlibration. la nouvelle que la populace se runissait dans les faubourgs et qu'il y aurait une t entative contre les Tuileries, ma mre alla s'tablir chez M. le Dauphin. Elle m'y emmen a avec elle. On entendit bientt rpter de tous cts : Ils arrivent !... ils arrivent !... Toute la famille royale tait rassemble dans la chambre du Roi ; la Reine fit ouvri r les communications de l'appartement du Roi avec celui de M. le Dauphin : on se p romenait avec une agitation extrme ; l'on n'avait rien opposer cette multitude, dont on entendait dj les clameurs... et l'on attendait avec angoisse. Tout coup les cours se trouvent remplies, les escaliers franchis, les appartemen ts envahis. Ils pntrent jusqu'au cabinet du Roi, dont les portes leur sont ouvertes. Nous entourions tous la famille royale. Le Roi, avec beaucoup de noblesse, se po rta en avant, en demandant ce qu'on voulait, ce qu'on prtendait faire. Il ne fut d'abord rpondu que par des cris confus : Vous n'tes pas un bon citoyen... vo us vouliez faire gorger le peuple par votre garde... Le Roi dit quelques mots qui ne furent point entendus ; mais une espce de chef, d'o rateur, prsentant au Roi un bonnet rouge, lui dit : Si tu es bon citoyen, mets-le sur la tte. Le Roi hsitait. Quelqu'un s'approcha et lui dit : La vie de votre famille en dpend.
Le Roi prit le bonnet, le mit sur sa tte. Quelques serviteurs fidles, M. le marchal de Mailly, MM. d'Hervilly et Acloque, et une douzaine de gardes nationaux entourre nt le Roi. En allant au-devant des meutiers, il tait sorti de son cabinet et il tai t pass dans sa premire antichambre. On approcha une chaise, et le Roi monta sur le s coffres qui taient dans l'embrasure des croises, pour tre vu de cette horde arme de fourches, de faux, de piques, et qui, dans son exaltation, tait parvenue monter d ans les appartements un canon charg. La mche tait prte, et apparemment, en cas de rsi stance, on aurait fait feu sur nous. Pendant que le Roi se dvouait au salut de sa famille, un bandit s'approcha du group e que nous formions dans un coin de l'appartement, et demanda d'une voix faire frmir : O est la Reine ?... laquelle est la Reine ?... Madame lisabeth, qui tait prs de la Reine, s'lanant en avant par un mouvement plein de grandeur, se mit devant elle, et, d'une voix forte, dit : Me voil !... La Reine, arrtant sa belle-sur, passa devant Madame lisabeth. C'est moi, dit-elle, qui suis la Reine. Ce combat de gnrosit, ou peut-tre l'incertitude o se trouva celui qui avait parl, lui i posa silence, et dans ce moment des gardes nationaux bien intentionns, qui s'taient mls parmi cette foule, se mirent crier : En voil assez... c'est bien... vive le Roi patriote !... Allons-nous-en... Ces cris rpts commencrent branler la multitude. Cette scne avait dj dur quatre heures. Pendant quatre heures nous avions entendu les mmes clameurs retentir : La sanction du dcret contre le clerg et le renvoi des min istres ! Plusieurs membres de l'Assemble, entre autres MM. Vergniaux et Isnard, taie nt venus haranguer la multitude, mais sans succs. Ils avaient eu beaucoup de pein e obtenir un peu de silence, et, ds leurs premires paroles, les cris recommencrent. Enfin Ption et plusieurs membres de la municipalit arrivrent. Ption harangua le peu ple, et, aprs avoir lou la dignit et l'ordre avec lequel il avait march, il l'engagea s retirer avec le mme calme, afin qu'on ne pt lui reprocher de s'tre livr aucun excs da une fte civique. Enfin le peuple commena s'couler. Le Roi, profitant du moment, se rapprocha de nous, et nous rentrmes dans sa chambre coucher. Cette malheureuse famille, si cruellement prouve, se jeta sur des siges et fondit e n larmes ; quelques instants aprs, le Roi embrassa ses enfants, la Reine en fit a utant et fit signe ma mre de les emmener. Il tait dix heures du soir. Nous passmes alors chez M. le Dauphin, et ma mre et moi nous fmes ce que nous pmes p our le distraire, ainsi que Madame, du souvenir du spectacle douloureux dont ils venaient d'tre tmoins. Nous n'tions gure en tat de leur donner des distractions : nos e forts cependant leur procurrent une nuit tranquille. La mienne ne le fut pas. J'emb rassai ma mre, qui couchait dans la chambre de M. le Dauphin, et je redescendis d ans ma chambre, le cur navr, glace d'effroi et livre seule, aprs cette journe tumultueu e, aux pnibles rflexions que pouvaient faire natre les scnes qui venaient de se pass er, et celles que l'on devait attendre de l'avenir. Chapitre 8 Vous pouvez imaginer dans quel tat d'esprit se trouvaient les tmoins de ces dplorable s scnes quand ils se revirent le lendemain de cette cruelle journe : la consternat ion tait peinte sur tous les visages ; la mort tait dans tous les curs ; c'tait le com mencement d'une agonie qui devait, chaque instant, devenir plus douloureuse. M. le Dauphin, malgr sa jeunesse, qui l'empchait de sentir toute l'horreur de la situa tion, tait touchant voir : ses yeux tonns se portaient sur ses parents ; il ne parl ait point ; il ne pouvait se rendre compte des motions dont il tait entour, de cell es qu'il ressentait ; mais par ses caresses au Roi, la Reine, il prouvait qu'il devi nait leur souffrance, qu'il cherchait les consoler. Madame, plus ge, sentait vivement les maux de sa famille. Pendant la journe du 20 j uin, un garde national avait dit la Reine, en lui montrant la jeune princesse : Quel ge a Mademoiselle ? La Reine rpondit, avec un accent que je crois entendre en core : Un ge o l'on ne sent que trop l'horreur de pareilles scnes. La Reine disait vra : Madame Royale avait t profondment frappe de ce qu'elle avait vu. Elle pouvait press entir les suites funestes de la situation o nous tions ; son caractre devint srieux
; elle perdit tout ce qui tenait l'enfance, et sembla ds lors associer son jeune co urage celui de sa mre. cette poque, madame de Tarente, qui fut depuis votre marraine, mon cher fils, cet te bonne princesse de Tarente[1], dont bientt tant de prils communs firent pour mo i une amie si prcieuse, tait dame du palais de la Reine. Elle tait si tendrement at tache cette princesse, qu'elle dsira ne plus s'loigner d'elle, et pria ma mre de lui pe ttre d'occuper une chambre de son appartement. Lies intimement comme nous l'tions, par tageant les mmes sentiments, appeles partager les mmes dangers, il nous tait doux de nous rapprocher dans ces terribles preuves. Ce fut aussi vers ce temps-l qu'il m'arriva une petite aventure fort maussade dont je veux vous dire un mot. Une de mes amies d'enfance, mademoiselle de Vintimille, qui venait d'pouser le prince de Belmont, m'crivit de Naples. Heureusement sa lettre ne contenait que des assuran ces d'amiti et d'intrt sur la position o nous nous trouvions. Je perdis cette lettre dan s les troubles du 20 juin ; mais, mon grand tonnement, mon grand chagrin, je la r etrouvai, vous ne devineriez jamais o : on la criait dans les feuilles du Pre Duchn e, infme journal de l'poque : Lettre de la princesse Vintimille de Belmont mademoisel le Pauline de Tourzel, et l'on induisait de la lettre que m'crivait mon amie qu'il y av ait une correspondance organise entre les migrs et le chteau des Tuileries. Heureuse ment qu'il ne rsulta de la dnonciation de ce grand complot que beaucoup d'embarras pou r moi et la douleur de savoir que mon nom figurait dans les feuilles infmes du Pre Duchne. Justement effray de ces troubles qui se renouvelaient sans cesse, le Roi exigea q ue la Reine, qui, seule, logeait au rez-de-chausse, vnt coucher dans l'appartement d e M. le Dauphin. La Reine prit le lit de ma mre, pour qui on dressa chaque soir u n lit de veille ; quant moi, l'on me fit coucher sur un canap dans un cabinet ct de l a chambre. Comme personne dans la maison ne se doutait que la Reine et chang d'appar tement pour la nuit, ma mre et moi nous prenions les prcautions de sret ; je me rele vais quand la Reine tait couche, et avec ma mre nous nous assurions de la fermeture des portes, et nous mettions les verrous intrieurs. Le cabinet que j'occupais servait de passage la famille royale quand elle allait s ouper. J'tais couche de bonne heure, souvent je feignais de dormir lors du passage d es princes, et je les voyais l'un aprs l'autre s'approcher de mon canap ; j'entendais quel ques mots de bont et d'intrt dont j'tais l'objet, et je remarquais leurs prcautions pour point troubler mon sommeil. Les circonstances devenaient de plus en plus menaantes, et l'on sentait que le dnomen t de l'agonie politique de la Royaut approchait. Ds le 10 juillet 1792, le ministre g irondin avait donn sa dmission. C'tait un symptme qui nous annonait l'approche de la cri e finale. La conduite des Girondins, depuis qu'ils taient dans l'Assemble, n'avait pas cess d'tre h ile au Roi. Comme chefs de l'opposition, ils avaient tout fait, au dbut de la Lgisla tive, pour placer le Roi dans l'impossibilit d'excuter la Constitution, en dterminant l'A ssemble voter deux dcrets, dont le premier violentait la conscience catholique de Louis XVI, et le second dchirait son me paternelle. Il s'agissait du dcret relatif au x prtres qui avaient refus le serment la constitution civile du clerg et qui, dclars suspects, taient privs de leur traitement et livrs la perscution. Le second dcret dcl rait passibles de la peine de mort les migrs qui, pass le 1er janvier 1792, demeure raient l'tranger. Les frres du Roi se trouvaient dans cette catgorie. Enfin les Giron dins ne cessaient de pousser la guerre, dont la perspective enflammait toutes le s passions rvolutionnaires. C'taient eux qui avaient demand la mise en accusation de Lessart, ministre des affaires trangres, qui avait la part principale la confiance du Roi, et Vergniaud, l'un de leurs chefs, avait attaqu la Reine elle-mme dans un d iscours clbre o il semblait dj la dcrter d'accusation. Je vois d'ici le palais, s't des conseillers pervers trompent le Roi que la Constitution nous donne, forgent des fers dont ils veulent nous enchaner, et ourdissent les trames qui doivent nou s livrer la maison d'Autriche. L'pouvante et la terreur sont souvent sorties, aux tem ps antiques, de ce palais du despotisme ; qu'elles y rentrent aujourd'hui au nom de la loi ; qu'elles y pntrent tous les curs ; que tous ceux qui l'habitent sachent que la Constitution ne promet l'inviolabilit qu'au Roi ; qu'ils apprennent que la loi y attei ndra tous les coupables, et qu'il n'y sera pas une seule tte convaincue d'tre criminelle
qui puisse chapper son glaive ! Ce fut cette harangue, dans laquelle on sentait dj le tranchant de la hache du 16 octobre, qui obligea le Roi de donner le ministre aux Girondins pour qu'ils ne le p rissent pas par une journe rvolutionnaire. Ministres, ils avaient continu leur guer re d'embches et de calomnies contre le Roi, et l'on put croire qu'ils n'taient entrs dans a place que pour en agrandir les brches. C'taient eux qui avaient fait licencier la garde constitutionnelle et fait dcrter d'accusation le duc de Brissac, qui la comman dait. Un d'entre eux, Servant, qu'ils avaient fait placer au ministre de la guerre, a vait propos l'Assemble, sans prendre l'avis du Roi, de placer un camp de vingt mille fd dans les environs de Paris : c'tait une force rvolutionnaire que les Girondins prpar aient l'Assemble pour abattre la Royaut quand le moment serait venu. Enfin, voyant q ue Louis XVI, rvolt par tant d'exigences et tant de perfidie, s'tait montr dcid rompr c eux, l'un des ministres, Roland, avait lu dans le conseil cette lettre pleine d'as tuce qu'il destinait ds lors la publicit et qui devait porter au Roi le coup mortel : Prenez garde, disait-il dans cette lettre, la dfiance n'est pas loin de la haine, et la haine ne recule pas devant le crime ; si vous ne donnez pas satisfaction la Rvolution, elle sera cimente par le sang ; ratifiez les mesures propres touffer le fanatisme des prtres ; sanctionnez les mesures qui appellent un camp de citoye ns sous les murs de Paris. Encore quelques dlais, et l'on verra en vous un conspira teur et un complice. Lire publiquement une pareille lettre l'Assemble, comme le fit Roland aprs sa sortie du ministre, c'tait dnoncer le Roi la vindicte populaire, c'tait le livrer la Rvolu Quand l'Assemble lgislative apprit que le ministre girondin se retirait, elle dclara l a patrie en danger, cause des menes des rois de Hongrie et de Prusse. On s'attendai t tout au chteau. On crut d'abord que le mouvement aurait lieu le 14 juillet, anniv ersaire de la Fdration ; mais la journe se passa sans trouble. On cria seulement be aucoup : Vivent les sans-culottes ! vive Ption ! Des voix plus insolentes ou plus franches ajoutaient : bas le Roi ! La famille royale, qui avait d se rendre au C hamp de Mars, put les entendre. mesure que nous approchions des derniers jours d e juillet, la violence des passions augmentait, et les manifestations devenaient plus menaantes. L'Assemble recevait tous les jours des ptitions demandant la plupart la suspension du Roi, plusieurs sa dchance, quelques-unes sa mise en accusation. Les sections de Paris demandrent, au nombre de quarante-six sur quarante-huit, qu'i l ft statu sur la dchance du Roi. Les ptitionnaires ouvraient la voie aux meutiers ; o n avait peu peu obtenu le dpart de la plus grande partie de la garnison pour les frontires ; la garde constitutionnelle tait dissoute, la Rvolution tait matresse. Ell e prludait par l'outrage aux derniers coups qu'elle avait frapper. La Reine fut oblige , la fin du mois de juillet, de renoncer toute promenade dans les Tuileries. Ell e tait alle prendre l'air avec Madame Royale dans le petit jardin du Dauphin, situ l'ex trmit des Tuileries, vers la place Louis XV. Elle fut grossirement insulte par des fdr . Quatre officiers suisses percrent la foule qui entourait la Reine, la placrent a u milieu d'eux ainsi que Madame Royale, et les ramenrent au chteau ; deux grenadiers suisses ouvraient la marche. Arrives dans les appartements, la Reine et Madame r emercirent leurs dfenseurs de la manire la plus expressive et la plus touchante, ma is la Reine renona ds ce jour-l sortir. Mais dans les derniers jours du mois il y eut des tentatives pour forcer la port e du chteau. Cette vie d'inquitudes et d'alertes dura jusqu'au moment de la terrible journe du 10 aot. Des processions d'hommes des faubourgs, d'hommes piques, comme on les appelait, prludr ent cette journe : ils se rendaient l'Assemble pour y faire ce que l'on appelait des m otions ; ils chantaient des paroles effroyables, et leurs promenades tumultueuse s autour du chteau y portaient la terreur. On et dit qu'ils venaient reconnatre les l ieux avant de les attaquer. Il tait vident que les rvolutionnaires de Paris attendaient des auxiliaires pour ag ir. Ces auxiliaires, c'taient les Marseillais. Ils arrivrent Paris dans les derniers jours de juillet, et les assassinats, prludes d'une lutte plus srieuse, commencrent. Santerre ayant annonc que les sans-culottes de Paris donneraient un banquet aux Marseillais dans le club des Jacobins, le bataillon des grenadiers des Filles-Sa int-Thomas, o les royalistes taient encore en majorit, se runit pour dner aux Champs-l yses. On voulait ainsi opposer une manifestation royaliste une manifestation rvolu
tionnaire. Les convives du banquet des Champs-lyses taient au nombre de cent cinqua nte. Trois cents Marseillais, qui l'on avait dit qu'il y avait aux Champs-lyses un ban quet d'aristocrates, se prsentrent en armes et engagrent le combat. Les gardes nation aux, surpris ou moins aguerris, se dfendirent mal ; la plupart se dispersrent ; qu elques hommes isols, ayant essay de se dfendre, furent gorgs. Chaque soir je descendais dans l'appartement de ma mre pour y souper ; je passais p ar l'escalier noir rserv la Reine et ma mre, de sorte que je voyais peu ce qui se pas sait dans le chteau hors de l'appartement. Le 9 aot, apparemment pour qu'en cas de pril rien ne pt indiquer cette communication secrte, ma mre ne m'en donna pas la clef, et je fus oblige de passer par le grand esc alier et par la cour. Aprs avoir soup avec madame de Tarente, et en retournant l'appartement de M. le Daup hin par la cour, je fus tonne et toute trouble de trouver cet escalier, que je vena is de descendre deux heures auparavant sans y avoir rencontr personne, couvert de gardes suisses assis, couchs sur toutes les marches. On avait des craintes. Elles taient malheureusement trop fondes : on tait prvenu que le chteau devait tre att aqu. Tout le monde veilla. Ds cinq heures du matin, nous entendmes sonner le tocsin et battre la gnrale. Quelqu es bataillons de gardes nationaux se rendirent au chteau pour repousser par la fo rce ceux qui s'taient annoncs comme devant l'assaillir. Vers sept heures du matin, le Roi passa dans les cours la revue des gardes suiss es et des gardes nationales. Le bataillon de la section des Filles-Saint-Thomas, presque entirement compos de g ens dvous, fut introduit dans l'intrieur du chteau. Runis dans la galerie de Diane, la Reine, M. le Dauphin, Madame et Madame lisabeth, accompagns de ma mre et de moi, se prsentrent eux et furent accueillis par les assurances du plus entier dvouement. L a Reine parla ces hommes de cur de la confiance qu'elle mettait en eux de manire red oubler leur enthousiasme. Au retour du Roi, toute sa famille et les personnes attaches la famille royale se trouvrent dans le cabinet du Roi. On savait que les faubourgs taient en marche ve rs le chteau. L'anxit tait son comble quand M. Rderer vint parler au Roi. Il l'engageait fortement quitter le chteau, se rendre l'Assemble : L seulement, di il, le Roi pouvait tre en sret lui et sa famille. Le Roi refusa longtemps d'obtemprer ce conseil : il ne voulait point abandonner tan t de gens qui s'taient rassembls dans le dessein de le dfendre... Rderer insista ; il parla du sang qui allait couler ; des dangers que courait la vie de la Reine, du Dauphin et de Madame Royale... Enfin le Roi cda. Chacun se disposait suivre le Roi, mais Rderer exigea que la famille royale seule se rendt l'Assemble. Ma mre accompagnait les enfants de France ; Rderer voulut s'y opposer ; mais le Roi insista en disant que, tant gouvernante de ses enfants, elle ne pouvait les quitt er. Je ne pus donc tre admise suivre ma mre. Le dpart fut si prcipit, qu'elle n'eut que le mps de m'embrasser et de me recommander aux soins de la princesse de Tarente. De la fentre de la chambre du Roi nous vmes passer ce triste cortge, pied, traversa nt le jardin des Tuileries, escort de quelques gardes nationaux, de quelques memb res de l'Assemble, et accueilli par le silence le plus profond. C'tait un spectacle se rrer le cur. L'ide d'un convoi funbre se prsenta mon esprit ; c'tait, en effet, le con e la Royaut. Pour ce qui m'arriva dans cette funeste journe et dans celles qui la suivirent je n e puis vous dire rien de plus complet et de plus prcis que ce que vous trouverez dans la lettre que je vais vous lire. Je l'crivis aprs ma sortie de prison ma sur, ma dame de Sainte-Aldegonde. Quand cette lettre fut crite, mes impressions avaient c onserv toute leur vivacit, mes souvenirs toute leur fracheur. J'tais comme un naufrag q ui, au sortir de la tourmente, raconte ce qu'il a vu, ce qu'il a souffert, ce qu'il a craint et comment il a t sauv.
Chapitre 9 Je n'ai eu hier que le temps de vous dire, ma chre Josphine, que ma mre et moi tions h ors de pril ; mais je veux vous raconter aujourd'hui comment nous avons chapp aux plu s affreux dangers. Une mort certaine m'en paraissait le moindre, tant la crainte d es horribles circonstances dont elle pouvait tre accompagne ajoutait mes frayeurs. Je reprendrai l'histoire d'un peu loin ; c'est--dire du moment o la prison a mis fin no re correspondance. Vous savez que, le 10 aot, ma mre, avec M. le Dauphin, accompagna le Roi l'Assemble n ationale. Moi, reste aux Tuileries dans l'appartement du Roi, je m'attachai la bonne princesse de Tarente, aux soins de qui ma mre m'avait recommande : nous nous prommes, quels que fussent les vnements, de ne jamais nous sparer. Le chteau tait investi de toutes parts. On s'occupa des moyens de salut : la fuite ta it impossible. Plusieurs personnes pensaient se retirer dans les combles : madam e de Tarente et moi nous pensmes qu'il fallait plutt nous rapprocher des portes de s ortie, afin de nous chapper s'il se prsentait quelque possibilit. La fusillade qui commena nous dcida. Pour nous mettre un peu l'abri, pour n'tre point u ct d'o l'on tirait, nous descendmes dans l'appartement de la Reine, au rez-de-chausse, r cet escalier noir qui servait de communication entre son appartement et celui de M. le Dauphin. Dans l'obscurit de ce passage, la lumire et le bruit d'un coup de canon vinrent nous g lacer d'effroi : toutes les dames qui taient dans l'appartement du Roi nous suivirent alors, et nous nous trouvmes runies. Le bruit de la fusillade, le bruit du canon, les fentres, les vitres qui se brisa ient, le sifflement des balles, tout cela faisait un vacarme effroyable. Nous fermmes les volets pour courir un peu moins de danger, et nous allummes la la mpe du passage une bougie pour n'tre point tout fait dans l'obscurit. Cette position me fit venir une ide qui fut sur-le-champ adopte : Allumons, dis-je , toutes les bougies du lustre, des candlabres, des flambeaux ; si les brigands d oivent forcer notre porte, l'tonnement que leur causera tant de lumires pourra nous sauver du premier coup et nous donner le temps de parler. Chacune de nous se mit alors en uvre. Et peine nos arrangements taient-ils finis, que nous entendmes, dans les chambres qui prcdaient celle o nous tions, des cris affreux et un cliquetis d'armes qui ne nous annona que trop que le chteau tait forc et qu'il fallait nous armer de courage. Ce fut l'affaire d'un moment. Les portes furent enfonces, et des hommes, le sabre la main, se prcipitrent dans le salon... Ils s'arrtrent l'instant... Une douzaine de femmes dans cette chambre... et ces lumires rptes dans les glaces faisaient, avec la clart du jour qu'ils quittaient, u n tel contraste, que les brigands restrent stupfaits. Nous tions runies avec plusieurs dames de la Reine, de Madame lisabeth et de madame de Lamballe. Plusieurs de ces dames se trouvrent mal. Madame de Genestou se jeta genoux ; elle avait tellement perdu la tte, qu'elle balb utiait des mots de pardon... Nous allmes elle, lui imposmes silence, et, pendant q ue je la rassurais, cette bonne madame de Tarente priait un Marseillais d'avoir pi ti de la faiblesse de la tte de cette dame et de la prendre sous sa protection. Ce t homme, aprs un moment d'hsitation, y consentit et la tira aussitt hors de la chambr e ; puis tout coup, revenant celle qui lui avait parl en faveur d'une autre,... fra pp apparemment d'une telle gnrosit dans cette circonstance... il dit madame de Tarente : Je sauverai cette dame, je vous sauverai aussi et votre compagne... Effective ment il remit madame de Genestou entre les mains d'un de ses camarades, puis, pren ant madame de Tarente sous un bras et moi sous l'autre, il nous entrana hors de l'app artement. En sortant du salon il nous fallut passer sur le corps d'un valet de pied de la Re ine et d'un de ses valets de chambre, qui, fidles leur poste, n'ayant pas voulu aband onner l'appartement de leur matresse, avaient t victimes de leur attachement. La vue de ces deux hommes morts nous serra le cur... Madame de Tarente et moi nou s nous regardmes... nous pensions que, peut-tre dans un instant, nous aurions le mm e sort.
Enfin, aprs beaucoup de peine, cet homme parvint nous faire sortir du chteau par u ne petite porte des souterrains. Nous nous trouvmes sur la terrasse prs la grille du Pont-Royal. L notre protecteur nous quitta, ayant, disait-il, rempli son engagement de nous conduire srement hor s des Tuileries. Je pris alors le bras de madame de Tarente, qui, croyant se soustraire aux regar ds de la multitude, voulut, pour retourner chez elle, descendre sur le bord de l a rivire. Nous marchions doucement et sans profrer une parole lorsque nous entendmes des cri s affreux derrire nous : en nous retournant nous apermes une foule de brigands qui couraient sur nous, le sabre la main ; l'instant il en parut autant devant nous, e t sur le quai, par-dessus le parapet, d'autres nous tenaient en joue, criant que n ous tions des chappes des Tuileries. Pour la premire fois j'prouvai une peur relle. Je crus bien que nous allions tre massa cres... Madame de Tarente parla... elle eut bien de la peine contenir la multitud e... Enfin nous obtnmes qu'une escorte nous conduirait au district. Il nous fallut traverser toute la place Louis XV au milieu des morts... Beaucoup de Suisses y avaient t massacrs et beaucoup d'autres personnes... Nous tions suivies d'un peuple immense qui nous accablait de toutes les injures imaginables. Nous fmes menes au district, rue Neuve-des-Capucines : l nous nous fmes connatre. La personne qui l'on nous remit tait un honnte homme ; il jugea notre position : elle lui inspi ra de l'intrt ; il donna reu de nos personnes, et, trs-haut, annona que nous serions co nduites en prison : il congdia ainsi ceux qui nous avaient amenes. Seul avec nous, il nous assura de tout son intrt, nous promettant que, la chute du jour, il nous ferait ramener chez nous. Sur les huit heures et demie du soir il nous donna deux personnes sres pour nous conduire, et nous fit sortir par une porte de derrire, afin d'viter les espions qui surveillaient sa maison. Nous arrivmes chez la duchesse de la Vallire, grand'mre de madame de Tarente et chez laquelle elle logeait. Aprs cette cruelle journe, vous pouvez vous figurer dans quel tat nous tions, notre fatigue, notre accablement : peine avions-nous la facult de penser... Je demandai cette bonne princesse de Tarente de ne la point quitter de toute la nuit ; je me couchai sur un canap dans sa chambre, et je ne dormis gure, comme vou s pouvez le penser. Chapitre 10 Le 11 aot, cinq heures du matin, madame de Tarente et moi, nous rappelions mutuel lement les terribles scnes de la veille, quand nous entendmes frapper la porte de notre chambre : c'tait mon frre... Il avait pass la nuit aux Feuillants prs du Roi, et venait nous en donner des nouv elles. Il nous apprit que la Reine avait demand ma mre que je vinsse la rejoindre, que le Roi en avait obtenu la permission de l'Assemble et que dans une heure il viendrait me chercher pour me conduire aux Feuillants. Cette nouvelle me fit un sensible plaisir : c'tait un vrai bonheur pour moi de retr ouver ma mre et de rejoindre la famille royale. Madame de Tarente questionna beaucoup mon frre sur ce qui tait arriv au Roi depuis son entre l'Assemble... Enfin je quittai mon excellente compagne ; nous nous fmes de tendres adieux ; nou s ne nous doutions pas cependant que ce ft pour si longtemps, et que je fusse des tine des preuves plus cruelles que celles auxquelles nous venions d'chapper ensemble. huit heures du matin j'arrivai aux Feuillants. Je ne puis assez vous dire la bont d u Roi et de la Reine quand ils me virent ; ils me firent bien des questions sur les personnes dont je pouvais leur donner des nouvelles. Madame et M. le Dauphin me reurent avec des tmoignages touchants d'amiti ; ils m'embrassrent, et Madame me dit : Ma chre Pauline, ne nous sparons plus. Quand la Reine entendit la dcision de l'Assemble qui ordonnait qu'elle et sa famille s eraient conduites au Temple, cette malheureuse princesse se tourna vers ma mre, p orta les mains sur ses yeux et dit : J'avais toujours demand au comte d'Artois de fai re abattre cette vilaine tour qu'il y a l ; elle m'a toujours fait horreur : je suis
sre que c'est l que nous serons enferms. Une demi-heure avant le dpart pour le Temple, Madame lisabeth m'appela, m'emmena dans un cabinet... Ma chre Pauline, me dit-elle, nous connaissons votre discrtion, votr e attachement pour nous ; j'ai une lettre de la plus grande importance dont je vou drais me dbarrasser avant de partir d'ici : comment la faire disparatre ? Il n'y avait ni feu ni lumire... Nous dchirmes cette lettre de huit pages, nous essaym es d'en broyer quelques morceaux dans nos doigts et sous nos pieds ; mais ce trava il tait long, elle craignait que son absence ne donnt des soupons... J'en mis des mor ceaux dans ma bouche, et je les avalai. Cette bonne Madame lisabeth voulut en fai re autant, mais son cur se souleva. Je m'emparai de ce qui en restait, je l'avalai en core, et bientt il n'en resta plus vestige. Nous rentrmes, et, l'heure du dpart pour le Temple tant arrive, la famille royale mont a dans une voiture dix places, compose de la manire suivante : Le Roi, la Reine et M. le Dauphin dans le fond ; Madame lisabeth, Madame et Manue l, procureur de la Commune, sur le devant ; madame la princesse de Lamballe et m a mre sur une banquette de portire, et moi avec un nomm Collonge, membre de la Comm une, sur la banquette en face. La voiture marchait au pas. On traversa la place Vendme ; l la voiture s'arrta, et Ma nuel, faisant remarquer la statue de Louis XIV, qui venait d'tre renverse, dit au Ro i : Voyez comme le peuple traite les rois... quoi le Roi, rouge d'indignation, mai s se modrant l'instant, rpondit avec calme : Il est heureux, monsieur, que sa rage n e se porte que sur des objets inanims. Le plus profond silence suivit cet change de paroles et dura tout le reste du che min. On prit les boulevards ; le jour commenait tomber lorsqu'on arriva au Temple. La cour, la maison, le jardin, taient illumins et avaient un air de fte qui contras tait horriblement avec la position o se trouvait la famille royale. Le Roi, la Reine, entrrent dans un fort beau salon, o nous les suivmes ; on y resta plus d'une heure sans pouvoir obtenir de rponse aux questions que l'on faisait pour savoir o taient les appartements. M. le Dauphin tombait de sommeil et demandait se coucher. On servit un grand souper, auquel on toucha peu ; ma mre pressant vivement pour s avoir o tait la chambre destine M. le Dauphin, on annona enfin que l'on allait l'y cond ire. On alluma des torches ; on nous fit traverser la cour, puis un souterrain ; enfi n on arriva cette tour que la Reine craignait tant, et nous y entrmes par une pet ite porte qui ressemblait fort un guichet de prison. La Reine et Madame furent tablies au premier, dans la mme chambre ; cette chambre t ait spare de celle destine M. le Dauphin et ma mre par une petite antichambre dans l aquelle devait coucher madame la princesse de Lamballe. Le Roi fut log au second, et Madame lisabeth, pour laquelle il n'y avait plus de cha mbre, fut tablie prs la chambre du Roi, dans une cuisine d'une salet pouvantable. Cette bonne princesse dit ma mre qu'elle se chargeait de moi ; elle fit mettre un l it de sangle prs du sien, et nous passmes ainsi la nuit sans dormir ; il nous et t di fficile de prendre quelque repos : la chambre qui prcdait cette cuisine servait de corps de garde, et vous pouvez vous douter du bruit qu'on y faisait. Le lendemain, huit heures, nous descendmes chez la Reine, qui dj tait leve, et dont a chambre devait servir de salon de runion. Depuis, on y passa les journes entires et l'on ne montait au second que pour se coucher. L'on ne fut jamais seul dans cette chambre de la Reine ; toujours un officier muni cipal tait prsent, mais chaque heure un nouveau municipal relevait celui qui avait fait son service. Tous nos effets avaient t pills dans notre appartement des Tuileries ; je ne possdai s absolument que la robe que j'avais sur le corps lors de ma sortie du chteau. Madame lisabeth, qui l'on venait d'envoyer quelques effets, me donna une de ses robes : elle ne pouvait aller ma taille ; nous nous occupmes de la dcoudre pour la refa ire ; tous les jours la Reine, Madame, Madame lisabeth, y travaillaient ; c'tait not re occupation ; mais on ne nous laissa pas le temps d'achever notre ouvrage. Chapitre 11 La nuit du 19 au 20 aot, il tait environ minuit, lorsque nous entendmes frapper.
travers la porte de notre chambre on nous signifia, de la part de la Commune de Paris, l'ordre qui venait d'tre donn d'enlever du Temple la princesse de Lamballe, ma mre et moi. Madame lisabeth se leva sur-le-champ ; elle-mme m'aida m'habiller, m'embrassa et me con uisit chez la Reine. Nous trouvmes tout le monde sur pied. Notre sparation d'avec la famille royale fut dchirante, et, quoique l'on nous assurt qu e nous reviendrions aprs avoir subi un interrogatoire, un sentiment secret nous d isait que nous la quittions pour longtemps. On nous fit traverser les souterrains aux flambeaux. la porte du Temple, nous en trmes dans un fiacre, et l'on nous conduisit l'Htel de Ville : un officier de gendarme rie tait avec nous dans la voiture. Arrives, on nous fit monter dans une grande salle, et l'on nous fit asseoir sur une banquette : pour nous empcher de causer ensemble, on nous avait spares en plaant en tre nous des officiers municipaux. Nous restmes assises sur cette banquette plus de deux heures. Enfin, vers les tro is heures du matin, on vint appeler la princesse de Lamballe pour l'interroger : c e fut l'affaire d'un quart d'heure, aprs lequel on appela ma mre ; je voulus la suivre, on s'y opposa en disant que j'aurais mon tour. Ma mre, en arrivant dans la salle d'interrogatoire, qui tait publique, demanda que j e fusse ramene auprs d'elle ; mais on le lui refusa trs-durement en lui disant que je ne courais aucun danger, tant sous la sauvegarde du peuple. On vint enfin me chercher et l'on me conduisit la salle d'interrogatoire ; l, monte su r une estrade, on tait en prsence d'une foule immense de peuple qui remplissait la s alle ; il y avait aussi des tribunes remplies d'hommes et de femmes. Billaud-Varenne, debout, faisait les questions, et un secrtaire crivait les rponses sur un grand registre. On me demanda mon nom, mon ge, et on me questionna beaucoup sur la journe du 10 aot , m'engageant dclarer ce que j'avais vu, ce que j'avais entendu dire au Roi et la famil le royale. Ils ne surent que ce que je voulus bien leur dire, car je n'avais nullement peur ; je me trouvais comme soutenue par une main invisible qui ne m'a jamais abandonne e t m'a fait toujours conserver ma tte et beaucoup de sang-froid. Je demandai trs-haut d'tre runie ma mre et de ne la plus quitter ; plusieurs voix s' t pour dire : Oui... Oui... d'autres murmurrent. On me fit descendre les marches du gradin sur lequel on tait lev, et, aprs avoir tra vers plusieurs corridors, je me vis ramene ma mre, que je trouvai bien inquite de mo i ; elle tait avec la princesse de Lamballe ; nous fmes toutes les trois runies. Nous tions dans le cabinet de Tallien et nous y restmes jusqu' midi. On vint alors nous chercher pour nous conduire la prison de la Force. On nous fi t monter dans un fiacre ; il tait entour de gendarmes, suivi d'un peuple immense. C'tai t un dimanche ; il y avait un officier de gendarmerie avec nous dans la voiture. Ce fut par le guichet donnant sur la rue des Balais, prs la rue Saint-Antoine, qu e nous entrmes dans cette triste prison. On nous fit d'abord passer dans le logement du concierge pour inscrire nos noms su r le registre. Je n'oublierai jamais que l un individu fort bien mis, s'approchant de moi, reste seul e dans la chambre, me dit : Mademoiselle, votre position m'intresse, je vous donne le conseil de quitter les airs de cour que vous avez, d'tre plus familire et plus af fable. Indigne de l'impertinence de ce monsieur, je le regardai fixement et lui rpondis que telle j'avais t, telle je serais toujours, que rien ne pourrait changer mon caractre , et que l'impression qu'il remarquait sur mon visage n'tait autre chose que l'image de c e qui se passait dans mon cur indign des horreurs que nous voyions. Il se tut et se retira, l'air fort mcontent. Ma mre, qui, pendant ce temps, tait dans une pice ct pour y signer le registre des us, rentra dans la chambre, mais, hlas ! ce ne fut pas pour longtemps. Madame de Lamballe, ma mre et moi, nous fmes spares : on nous conduisit dans des cac hots diffrents. Je suppliai qu'on me runt ma mre, mais on fut inexorable. Ainsi je me trouvai seule d ans cette infme demeure.
Peu de moments aprs, le guichetier entra pour m'apporter une cruche d'eau... Cet homm e tait un trs-bon homme... Voyant mes pleurs et mon dsespoir d'tre spare de ma mre, en dant mes supplications d'tre runie elle, il fut rellement touch, et, dans un excellent mouvement dont je garde une vraie reconnaissance, voulant me distraire de ma pe ine, il me dit : Je vais vous laisser mon chien ; surtout ne me trahissez pas ! j'aurai l'air de l'avoir oubli par mgarde. six heures du soir il revint : il m'apportait manger ; et, m'invitant prendre quelqu e chose : Mangez, mangez, me dit-il, cela vous donnera des forces. Je n'avais aucu ne disposition manger... coutez, me dit-il demi-voix, je vais vous confier un sec ret qui vous fera plaisir... Votre mre est dans le cabinet au-dessus du vtre ; ain si vous n'tes pas bien loin d'elle... D'ailleurs, ajouta-t-il, vous allez avoir dans un e heure la visite de Manuel, procureur de la Commune, qui viendra pour s'assurer s i tout est dans l'ordre : n'ayez pas l'air, je vous en prie, de savoir ce que je vous dis. Effectivement, quelque temps aprs, j'entendis tirer les verrous du cachot voisin, p uis ceux du mien : je vis entrer trois hommes, dont un, que je reconnus trs-bien t re Manuel, le mme qui avait conduit le Roi au Temple. Il trouva le cachot o j'tais trs-humide et parla de m'en faire changer. Je saisis cette occasion de lui dire que tout m'tait gal, que la seule grce que je so llicitais de lui particulirement tait d'tre runie ma mre... Je le lui demandai avec un grande vivacit, et je vis que ma prire le touchait... Il rflchit un moment, et me d it : Demain je dois revenir ici, et nous verrons ; je ne vous oublierai pas. Le pauvre guichetier, en fermant ma porte, me dit voix basse : Il est touch, je l ui ai vu les larmes dans les yeux ; ayez courage : demain ! Ce bon Franois, car c'tait le nom de ce guichetier, me donna de l'espoir et me fit un bien que je ne puis exprimer. Je me mis genoux ; je fis ma prire avec un calme et une tranquillit parfaite, je m e jetai tout habille sur l'horrible grabat qui servait de lit ; j'tais abme de douleur e t de fatigue ; je dormis jusqu'au jour. Le lendemain, sept heures du matin, ma porte s'ouvrit, et je vis entrer Manuel, qu i me dit : J'ai obtenu de la Commune la permission de vous runir votre mre ; suivezmoi. Nous montmes dans la chambre de ma mre ; je me jetai dans ses bras, croyant tous m es malheurs finis, puisque je me trouvais auprs d'elle... Elle remercia beaucoup Manuel ; elle lui demanda d'tre runies la princesse de Lambal le, puisque nous avions t transfres avec elle... Il hsita un instant, puis il dit : J e le veux bien : je prends cela sur moi. Il nous conduisit alors dans la chambre de madame de Lamballe, et huit heures du matin nous tions toutes les trois seule s ; nous prouvmes un moment de bonheur de pouvoir partager ensemble nos infortunes . Le lendemain matin, nous remes un paquet venant du Temple : c'taient nos effets que n ous renvoyait la Reine : elle-mme, avec cette bont qui ne se dmentit jamais, avait pris soin de les rassembler. Dans le paquet se trouvait cette robe de Madame lisa beth dont je vous ai parl plus haut ; elle devient pour moi un gage d'un ternel souv enir, d'un ternel attachement, et je la conserverai toute ma vie. L'incommodit de notre logement, l'horreur de la prison, le chagrin d'tre spares du Roi de sa famille, la svrit avec laquelle cette sparation semblait nous annoncer que nou s serions traites, tout cela m'attristait fort, je l'avoue, et effrayait extrmement ce tte malheureuse princesse de Lamballe. Quant ma mre, elle montrait cet admirable courage que vous lui avez vu dans de tr istes circonstances de sa vie ; ce courage qui, n'tant rien sa sensibilit, laisse ce pendant son me toute la tranquillit ncessaire pour que son bon esprit puisse lui tre d'usage. Elle travaillait, elle lisait, elle causait d'une manire aussi calme que si elle n'et rien craint : elle paraissait afflige, mais ne semblait pas mme inquite. Chapitre 12 Nous tions depuis prs de quinze jours dans ce triste sjour, lorsqu'une nuit, vers une heure du matin, tant toutes trois couches et endormies comme on dort dans une tel le prison, de ce sommeil qui laisse encore place l'inquitude, nous entendmes tirer l es verrous de notre porte ; elle s'ouvrit ; un homme parut et dit : Mademoiselle de Tourzel, levez-vous promptement et suivez-moi...
Je tremblais, je ne rpondais ni ne remuais... Que voulez-vous faire de ma fille ? dit ma mre cet homme. Que vous importe ? rpondit-il d'une manire qui me parut bien dure ; il faut qu'elle lve et qu'elle me suive. Levez-vous, Pauline, me dit ma mre, et suivez-le ; il n'y a rien faire ici que d'obir Je me levai lentement, et cet homme restait toujours dans la chambre. Dpchez-vous , dit-il deux ou trois fois. Dpchez-vous, Pauline , me dit aussi ma mre. J'tais habille, mais je n'avais pas chang de place ; j'allai alors son lit, je pris sa in pour la baiser ; mais cet homme s'approcha, me prit par le bras et m'entrana malgr moi. Adieu Pauline, Dieu vous bnisse et vous protge ! cria ma mre... Je ne pouvais lui rpondre... deux grosses portes taient dj entre elle et moi, et cet homme m'entranait toujours. Comme nous descendions l'escalier, il entendit du bruit... D'un air fort inquiet il me fit remonter quelques marches et me poussa prcipitamment dans un petit cachot, ferma la porte, prit la clef et disparut. Dans ce cachot brlait un reste de chandelle... En peu d'instants cette chandelle pr it fin... Je ne peux vous exprimer ce que je ressentais, ni les rflexions sinistr es que m'inspirait cette lueur tantt forte, tantt mourante... Elle me reprsentait une agonie et me disposait faire le sacrifice de ma vie mieux que n'auraient pu faire les discours les plus touchants... Elle s'teignit entirement... je restai alors dan s une profonde obscurit... Enfin j'entendis ouvrir doucement la porte ; on m'appela voix basse, et, la lueur d'un e petite lanterne qu'il portait, je reconnus l'homme qui m'avait enferme pour tre celui qui, dans la chambre du concierge, lors de mon entre la Force, avait voulu me don ner des conseils. Il me fit descendre petit bruit ; au bas de l'escalier il me fit entrer dans une c hambre, et, me montrant un paquet, il me dit de m'habiller avec ce que je trouvera is dedans. Il sortit, ferma la porte ; et je restai immobile, sans agir, sans pr esque penser. Je ne sais combien de temps je restai dans cet tat. J'en fus tire par le bruit de la porte qui se rouvrit, et le mme homme parut. Quoi ! vous n'tes point encore habille ! me dit-il d'un air inquiet... il y va de votr e vie si vous ne sortez promptement d'ici ! J'ouvris alors le paquet : il contenait des habits de paysanne ; ils me parurent a ssez larges pour aller sur les miens, je les eus passs dans un instant. Cet homme me prit par le bras, me fit sortir de la chambre ; je me laissai entran er sans faire aucune question, presque mme aucune rflexion ; je voyais peine ce qu i se passait autour de moi. Lorsque nous fmes sortis de la prison par la porte donnant sur la rue du Roi-de-S icile, j'aperus la clart du plus beau clair de lune une prodigieuse multitude de peu ple, et j'en fus entoure dans le moment. Tous ces hommes avaient l'air froce ; ils avaient le sabre nu la main, ils semblaie nt attendre quelque victime pour la sacrifier !... Voici un prisonnier que l'on sa uve ! crirent-ils tous la fois en me menaant de leurs sabres... L'homme qui me conduisait faisait l'impossible pour les carter de moi et pour se fair e entendre. Je vis alors qu'il portait la marque qui distinguait les membres de la Commune de Paris : cette marque lui donnait le droit de se faire couter : on le laissa parle r. Il dit que je n'tais pas prisonnire, qu'une circonstance particulire m'avait amene la e, qu'il m'en venait tirer par ordre suprieur, les innocents ne devant pas prir avec l es coupables... Cette phrase me fit frmir... ma mre tait reste enferme !... Abme dans ette affreuse pense, je n'entendis plus rien. Cependant ses paroles firent effet su r la multitude, et l'on allait enfin me laisser passer, lorsqu'un soldat en uniforme de la garde nationale cria au peuple qu'on le trompait, que j'tais mademoiselle Paul ine de Tourzel, qu'il me connaissait fort bien pour m'avoir vue aux Tuileries chez M . le Dauphin lorsqu'il y tait de garde, et que mon sort ne devait pas tre diffrent de
celui des autres prisonniers. La fureur redoubla alors tellement contre moi et contre mon protecteur, que je c rus bien certainement que le seul service qu'il me rendrait serait de me conduire la mort au lieu de me la laisser attendre. Enfin, ou son adresse, ou son loquence, ou mon bonheur, me tira encore de ce dang er, et nous nous trouvmes libres de poursuivre notre chemin. Nous pouvions cependant rencontrer bien d'autres obstacles ; nous avions traverser des rues dans lesquelles nous devions trouver beaucoup de peuple ; j'tais bien con nue et je pouvais encore tre arrte. Cette crainte dtermina mon librateur, car je comm enais voir que c'tait le rle que voulait remplir envers moi cet homme qui m'avait inspi r tant d'effroi et de terreur, cette crainte le dtermina me laisser dans une petite cour fort sombre qui n'avait pas d'issue, et il alla voir ce qui se passait aux envi rons. Il revint au bout d'une demi-heure : il me dit qu'il croyait prudent que je ch angeasse de costume ; il m'apportait un habit d'homme, un pantalon, une redingote, d ont il voulait que je me vtisse. Ce dguisement, qu'il pensait ncessaire, je le refusai avec obstination : j'avais horre ur de prir sous des habits qui ne devaient pas tre les miens... Je lui fis remarqu er qu'il n'avait apport ni chapeau, ni souliers : le dguisement devenait impossible ; je restai comme j'tais. Pour sortir d'o nous tions, il fallait repasser presque aux portes de la prison o taie nt les assassins, ou traverser une glise (le Petit-Saint-Antoine) dans laquelle s e tenait l'assemble de ceux qui donnaient l'impulsion aux massacres. L'un et l'autre chem in taient galement dangereux. Nous choismes celui de l'glise ; et je fus oblige de la traverser par un bas-ct, me tr ant presque terre, afin de n'tre point aperue de ceux qui formaient l'assemble. Mon con ducteur me fit entrer dans une petite chapelle latrale, et, me plaant derrire les db ris d'un autel renvers, me recommanda bien de ne pas remuer, quelque bruit que j'ente ndisse, et d'attendre son retour, qui serait le plus prompt qu'il pourrait... Je m'assis sur mes talons... Entendant beaucoup de bruit, des cris mme, je ne bouge ai pas, bien rsolue attendre l mon sort et remettant ma vie entre les mains de la Providence, laquelle je m'abandonnai avec confiance, rsigne recevoir la mort si tell e tait sa volont. Je fus trs-longtemps dans cette chapelle ; enfin, je vis arriver mon guide, et no us sortmes de l'glise avec les mmes prcautions que nous avions prises pour y entrer. Trs-peu loin de l, mon librateur s'arrta une maison qu'il me dit tre la sienne : nou tmes dans une chambre au premier, et, m'y ayant enferme, il me quitta sur-le-champ ; il tait environ neuf heures du matin. J'eus un moment de joie en me trouvant seule ; mais je n'en jouis pas longtemps : le souvenir des prils que j'avais courus ne me montrait que trop ceux auxquels ma mre t ait livre, et je restai tout entire mes craintes. Je m'y abandonnais depuis plus d'une heure lorsque M. Hardy, car il est temps que je vous nomme celui qui nous devon s la vie[1], revint et me parut plus effray que je ne l'avais vu encore. Vous tes connue, me dit-il ; on sait que je vous ai sauve, on veut vous ravoir ; o n croit que vous tes ici, on peut vous y venir prendre ; il en faut sortir tout d e suite, mais non pas avec moi : ce serait vous remettre dans un danger certain. Prenez ceci, me dit-il en me montrant un chapeau avec un voile et un mantelet n oir ; coutez bien tout ce que je vais vous dire ; surtout n'en oubliez pas la moind re chose. En sortant de la porte cochre, vous tournerez droite, puis vous prendrez la premir e rue gauche ; elle vous conduira sur une petite place dans laquelle donnent tro is rues ; vous prendrez celle du milieu, puis, auprs d'une fontaine, vous trouverez un passage qui vous conduira dans une grande rue ; vous y trouverez un fiacre p rs d'une alle ; cachez-vous dans cette alle, et vous n'y serez pas longtemps sans me vo ir paratre ; partez vite, et surtout, dit-il aprs me l'avoir encore rpt, tchez de n'oub r rien de tout ce que je viens de vous dire, car je ne saurais comment vous retr ouver, et alors que pourriez-vous devenir ? Je vis la crainte qu'il avait que je ne me souvinsse pas bien de tous les renseign ements qu'il m'avait donns ; cette crainte, en augmentant celle que j'avais moi-mme, me troubla tellement, que, en sortant de la maison, je savais peine si je devais to urner droite ou gauche ; comme il vit de la fentre que j'hsitais, il me fit un signe
, et je me souvins alors de tout ce qu'il m'avait dit. Mes deux habillements, l'un sur l'autre, me donnaient une figure trange : mon air inq uiet pouvait me faire paratre suspecte ; il me semblait que tout le monde me rega rdait avec tonnement. J'eus bien de la peine arriver jusqu' l'endroit o je devais trouver le fiacre ; les jam es commenaient me manquer. Mais enfin je l'aperus et je ne puis dire la joie que j'en ressentis ; je me crus pou r lors absolument sauve. Je me retirai dans l'alle, qui tait fort sombre, en attendant que M. Hardy part. Plus d'une heure s'tait coule, et il ne venait pas... Alors mes craintes recommencrent. Si j e restais plus longtemps dans cette alle, je craignais de paratre suspecte aux gen s du voisinage... mais comment en sortir ?... Je ne connaissais pas le quartier dans lequel je me trouvais : si je faisais la moindre question, je pouvais me me ttre dans un grand danger... Enfin, comme je mditais tristement sur le parti que je devais prendre, je vis ven ir M. Hardy ; il tait avec un autre homme. Ils me firent monter dans le fiacre et y montrent avec moi ; le nouveau venu se p laa sur le devant de la voiture et me demanda si je le reconnaissais. Parfaitement, lui dis-je ; vous tes monsieur Billaud-Varenne ; c'est vous qui m'avez interroge l'Htel de Ville. Il est vrai, dit-il ; je vais vous conduire chez Danton a fin de prendre ses ordres votre sujet. Arrivs la porte de Danton, ces messieurs descendirent de voiture, montrent chez lu i et revinrent peu aprs, me disant : Vous voil sauve !... Nous en avions assez... n ous sommes bien aises que cela soit fini. Il ne nous reste plus maintenant, me dirent-ils, qu' vous conduire dans un endroit o vous ne puissiez pas tre connue ; autrement vous seriez encore en danger. Je demandai tre mene chez la marquise de Lde, une de mes parentes : elle tait trs-g t je pensais que son grand ge loignerait d'elle les soupons. Billaud-Varenne s'y opposa, cause du nombre de ses domestiques, dont plusieurs, pe ut-tre, ne garderaient pas le secret de mon arrive dans la maison. Il me demanda d'i ndiquer une maison habite par une personne dont l'obscurit serait une sauvegarde pou r moi. Je me souvins alors de la bonne Babet, notre fille de garde-robe ; je pensai que je ne pouvais tre mieux que dans une maison pauvre et dans un quartier retir. Billaud-Varenne, car c'tait toujours lui qui entrait dans ce dtail, me demanda le no m de la rue pour l'indiquer au cocher. Je nommai... la rue du Spulcre. Ce nom, dans un moment comme celui o nous tions, lui fit une grande impression ; e t je vis sur son visage le sentiment d'horreur que lui inspirait le rapprochement de ce nom de mauvais augure avec les vnements qui se passaient. Il dit un mot tout bas M. Hardy, lui recommanda de me conduire l o je demandais aller, et disparut. Pendant le chemin je parlai de ma mre, je demandai si elle tait encore en prison : je voulais aller la rejoindre si elle y tait encore ; je voulais aller moi-mme pl aider son innocence... il me paraissait affreux que ma mre ft expose la mort laquel le on venait de m'arracher... Moi sauve... ma mre condamne prir... cette ide me mettai hors de moi. M. Hardy chercha me calmer ; il me dit que j'avais pu voir que depuis le moment o i l m'avait spare d'elle il n'avait t occup que du soin de me sauver ; qu'il y avait malhe ement employ beaucoup de temps, mais qu'il esprait qu'il lui en resterait encore assez pour sauver ma mre ; que ma prsence ne pourrait que nuire ses desseins ; qu'il alla it sur-le-champ retourner la prison et qu'il ne regarderait sa mission comme finie que lorsqu'il nous aurait runies ; qu'il me demandait du calme ; qu'il avait tout espo ir... Il me laissa remplie de reconnaissance pour le danger o il s'tait mis cause de moi, et avec l'esprance qu'il sauverait ma mre de tous les prils que je craignais pour elle. Adieu, ma chre Josphine ; je suis si fatigue, que je ne puis plus crire. D'ailleurs, m a mre dit qu'elle veut vous raconter elle-mme ce qui la regarde : elle vous crira dem ain. Cette lettre, un peu longue, ne parle que de moi, mes amis ; mais j'crivais ma sur :
le plus grand intrt pour elle tait ce qui regardait ma mre et moi dans ces journes ds astreuses. Je pourrai vous donner quelques autres dtails sur mon sjour au Temple, mais auparavant il faudra que vous lisiez la lettre de ma mre ma sur, elle complte l'histoire de notre captivit la Force, de ses dangers et de sa miraculeuse dlivrance . Chapitre 13 Pauline vous a racont les tristes preuves par lesquelles elle a pass ; mais ce qu'ell e a nglig de vous dire, c'est la manire dont elle les a soutenues. Elle a bien prouv q ue la patience et le courage ne sont incompatibles ni avec l'excessive jeunesse ni avec l'extrme douceur : elle n'a pas montr, m'a dit M. Hardy, un moment de faiblesse da ns ses dangers, et je ne lui ai point vu un instant d'humeur pendant notre prison. Elle a bien adouci mes peines, mais, en mme temps, elle a bien augment mes inquitu des. L'ide que je lui faisais partager des prils l'abri desquels son ge devait naturell ement la mettre me tourmentait sans cesse et m'empchait de jouir du bonheur de l'avoi r prs de moi. Elle vous a dit comme elle me fut enleve une nuit par un inconnu qui entra dans l a chambre o nous tions enfermes. Cette sparation me mit au dsespoir et comme hors de moi ; mais je plaai ma confiance en la bont du ciel, qui protge l'innocence. Un secre t pressentiment me disait qu'il veillerait sur elle et qu'il ne l'loignait de moi que p our la conserver. C'est ainsi que je me consolai de perdre ses soins si doux pour moi. Je ne souffris beaucoup que dans cet instant o, aprs qu'elle fut sortie de la c hambre, j'entendis refermer les verrous de notre porte, sans pouvoir la suivre de l'oreille ou des yeux, sans avoir aucun moyen de dcouvrir si on l'emmenait hors de la prison. Vous jugez bien que je ne dormis pas le reste de la nuit : mes inquitudes prenaie nt bien souvent le dessus sur ma confiance ; j'attendis avec bien de l'impatience qu e l'on entrt dans notre chambre l'heure o l'on apportait notre djeuner. Lorsque l'on vint, nous apprmes que les passions fermentaient dans Paris depuis la veille au soir, qu'on apprhendait des massacres, que les prisons taient menaces, et q ue plusieurs taient dj forces. C'est alors que je ne doutai plus que ce ft pour sauver Pauline qu'on me l'avait enleve, et il ne me resta plus que le regret de ne pas savoir dans quel lieu elle avait t mene. Je voyais clairement le sort qui tait rserv madame de Lamballe et moi. Je vous dirai pas que je le voyais sans frayeur, mais au moins je supportais cette ide avec rsignation. Il me sembla que, s'il y avait des moyens de me sauver des dang ers que je prvoyais, je ne les traverserais que par une grande prsence d'esprit, et je ne pensai plus rien qu' tcher de la conserver. Ce n'tait pas une chose facile, car l'extrme agitation de ma malheureuse compagne, les questions continuelles qu'elle m'adressait, ses conjectures effrayantes, me troubla ient beaucoup. Je tchai de la rassurer, de la calmer ; mais, voyant que je ne pouvais y russir, j e la priai de vouloir bien ne plus me parler. Nous ne faisions en effet qu'augment er nos craintes en les changeant. Je voulus essayer de lire : je pris un livre, p uis un autre ; rien ne pouvait me distraire ; j'en essayai plusieurs, mais je ne p ouvais fixer mon attention sur aucun. Je me souvins alors que j'avais remarqu mille fois qu'aucune occupation n'absorbait aut ant les ides que le travail des mains : je pris mon ouvrage. Je travaillai enviro n deux heures : au bout de ce temps, je me trouvai assez calme pour penser que, dans quelque situation que je me pusse trouver, j'aurais la tranquillit ncessaire po ur ne rien dire ou ne rien faire qui ft capable de me nuire. Vers l'heure du dner, on vint prendre ma compagne et moi ; on nous fit descendre da ns une petite cour dans laquelle je trouvai plusieurs autres prisonniers et un g rand nombre de gens mal mis qui avaient tous l'air froce ; la plupart taient ivres. Il n'y avait pas longtemps que j'tais dans cette cour lorsqu'il y entra un homme de bea ucoup moins mauvaise mine que ceux qui taient l ; sa figure paraissait sombre, mai s non pas cruelle. Il fit deux ou trois fois le tour de la cour. Au dernier tour , il passa fort prs de moi, et, sans tourner la tte de mon ct, il me dit : Votre fil le est sauve... Il continua son chemin et sortit de la cour. Heureusement l'tonnement, la joie, suspendirent un moment toutes mes facults, sans q uoi je n'aurais pu m'empcher de parler cet homme, et, peut-tre, de tomber ses pieds ;
mais, lorsque je recouvrai mes forces, je ne le vis plus : ainsi je n'eus pas cont enir l'expression de la reconnaissance qui dbordait de mon cur. La certitude que Pauline tait en sret me remplit d'un nouveau courage, et, me sentant sauve dans une aussi chre partie de moi-mme, il me sembla que je n'avais plus rien c raindre pour l'autre. Je commenai faire quelques questions aux gens qui taient auprs de moi : ils me rpond irent, m'interrogrent aussi leur tour ; ils me demandrent d'abord mon nom, que je leur appris : alors ils me dirent qu'ils me connaissaient bien, qu'ils avaient entendu p arler de moi, que je n'avais pas une trs-mauvaise rputation ; mais que j'avais accompa gn le Roi lorsqu'il avait voulu fuir du royaume, que cette action tait inexcusable, et qu'ils ne concevaient pas comment j'avais pu la faire. Je leur rpondis que je n'en avais cependant pas le moindre remords, parce que je n'av ais fait que mon devoir. Je leur demandai s'ils ne croyaient pas qu'on dt tre fidle son serment ; ils rpondirent tous unanimement qu'il fallait mourir plutt que d'y manquer. Eh bien, leur dis-je, j'ai pens de mme, voil ce que vous blmez : j'tais gouvernante d . le Dauphin, j'avais jur entre les mains du Roi de ne jamais le quitter, et je l'ai suivi dans ce voyage comme je l'aurais suivi partout ailleurs, quoi qu'il me dt arriv er. Elle ne pouvait vraiment pas faire autrement, dirent-ils tous ; mais c'est bien ma lheureux, ajoutrent quelques-uns, d'tre attach des gens qui font de mauvaises actions . Je parlai longtemps avec ces hommes ; ils me paraissaient frapps de tout ce qui ta it juste et raisonnable, et je ne pouvais m'empcher de m'tonner que des gens qui ne se mblaient pas avoir un mauvais naturel vinssent froidement commettre des crimes q ue l'intrt et la vengeance auraient pu peine expliquer. Pendant notre conversation, un de ces hommes aperut un anneau que je portais mon doigt et demanda ce qui tait crit autour : je le tirai, et le lui prsentai ; mais u n de ses compagnons, qui commenait, apparemment, s'intresser moi, et qui craignait q u'on ne dcouvrt sur cet anneau quelque signe de royalisme, s'en saisit et me le rendit en me disant de lire moi-mme ce qui tait crit, et que l'on me croirait ; alors je lu s : Domine salvum fac Regem et Reginam et Delphinum, cela veut dire en franais, a joutai-je : Dieu sauve le Roi, la Reine et le Dauphin. Un mouvement d'indignation saisit tous ceux qui m'entouraient, et je manquai perdre la bienveillance qu'ils commenaient me montrer. Jetez cet anneau terre, crirent-ils, foulez-le aux pieds ! C'est impossible, leur dis-je, tout ce que je puis faire, c'est de l'ter de mon doigt e t de le mettre dans ma poche, si vous tes fchs de le voir : je suis attache au Roi p arce qu'il est bon et que je connais particulirement sa bont ; je suis attache M. le Dauphin parce que, depuis plusieurs annes, je prends soin de lui, et je l'aime comm e mon enfant ; je porte dans mon cur le vu qui est exprim sur cet anneau ; je ne pu is le dmentir en faisant ce que vous me proposez : vous me mpriseriez, j'en suis sre, si j'y consentais, et je veux mriter votre estime ; ainsi je m'y refuse. Faites comm e vous voudrez , dirent quelques-uns. Et je mis l'anneau dans ma poche. Quelques gens d'aussi mauvaise mine que ceux qui m'entouraient arrivent alors de l'aut re ct de la cour pour me demander de venir au secours d'une femme qui se trouvait ma l. J'allai, et je vis une jeune et jolie personne absolument vanouie ; ceux qui la secouraient avaient essay en vain de la faire revenir, elle paraissait touffer : p our la mettre plus l'aise, ils avaient dtach sa robe, et, lorsque j'arrivai, l'un d'eux s disposait couper son lacet avec le bout de son sabre... Je frmis pour elle d'un te l secours et demandai qu'on me laisst le soin de la dlacer ; pendant que j'y travailla is, un des spectateurs aperut son cou un mdaillon dans lequel tait un portrait qu'il ne pensa pas pouvoir tre autre que celui du Roi ou de la Reine, et, s'approchant de moi, il me dit bien bas : Cachez ceci dans votre poche : si on le trouvait sur elle, cela pourrait lui nuire. Je ne pus m'empcher de rire de la sensibilit de cet homme, qui l'engageait me demander si vivement de prendre sur moi une chose qu'il pensait si dangereuse porter... et je m'tonnais chaque moment davantage de ce mlange de piti et de frocit que montraient ceux qui m'entouraient. Cette femme, qui tait celle du premier valet de chambre du Roi (madame de Septeuil), tant revenue elle, fut emmene hors de la cour. Il n'y rest ait plus que moi qu'on vint prendre peu de temps aprs. L'infortune princesse de Lambal
le avait disparu pendant que je rpondais aux questions des gens qui m'entouraient. Je savais par ces hommes que les prisonniers taient mens tour tour au peuple qui ta it attroup aux portes de la prison, et que, aprs avoir subi une espce de jugement, on tait absous ou massacr. Malgr cela, j'avais le pressentiment qu'il ne m'arriverait rien, et ma confiance fut bi en augmente lorsque j'aperus, la tte de ceux qui me venaient chercher, le mme homme qu i m'avait donn des nouvelles de Pauline. Je pensai que celui qui tait dj mon librateur, puisqu'il m'avait rassure sur le sort de mon enfant, ne pouvait devenir mon bourreau , et qu'il n'tait l que pour me protger. Cette ide ayant encore augment mon courage, je e prsentai tranquillement devant le tribunal. Je fus interroge pendant environ dix minutes, au bout desquelles des hommes figur es atroces s'emparrent de ma personne ; ils me firent passer le guichet de la priso n du ct de la rue des Balais, et je ne puis vous exprimer le trouble que j'prouvai l'ho rrible spectacle qui s'offrit moi. Une espce de montagne s'levait contre la muraille ; elle tait forme par les membres pa s et les vtements sanglants de ceux qui avaient t massacrs cette place ; une multitu de d'assassins entouraient ce monceau de cadavres ; deux hommes taient monts dessus ; ils taient arms de sabres et couverts de sang. C'taient eux qui excutaient les malheureux prisonniers qu'on amenait l l'un aprs l'autr On les faisait monter sur ce monceau de cadavres sous le prtexte de prter le serme nt de fidlit la nation ; mais, ds qu'ils y taient monts, ils taient frapps, massacr vrs au peuple ; leurs corps, jets sur les corps de ceux qui les avaient prcds, servai ent lever cette horrible montagne dont l'aspect me parut si effroyable. Lorsque je fus auprs, on voulut aussi m'y faire monter ; mais M. Hardy, qui me tena it par le bras, et huit ou dix hommes qui m'entouraient, prirent ma dfense. Ils ass urrent que j'avais dj prt le serment la nation, et, autant par force que par adresse, ls m'arrachrent des mains de ces furieux et m'entranrent hors de leur porte. quelque distance de l, nous rencontrmes un fiacre, on me mit dedans aprs en avoir f ait descendre la personne qui l'occupait. M. Hardy y monta avec moi ainsi que quat re des gens qui nous entouraient, deux autres montrent derrire, deux encore se pla crent auprs du cocher, qu'on fora d'aller trs-vite, et en peu de minutes je me trouvai l oin de la prison. Ds que je fus en tat de parler, ma premire parole fut pour m'informer de ma Pauline. M. Hardy me dit qu'elle tait en sret et qu'elle allait m'tre rendue. Je lui demandai alor des nouvelles de ma compagne de prison, la princesse de Lamballe ; mais, hlas ! son silence m'annona qu'elle n'existait plus... Il me dit qu'il aurait bien voulu la sauv er, mais qu'il n'avait pu en trouver le moyen. Pendant le chemin, je remarquai avec tonnement combien ces hommes qui taient dedan s et autour du fiacre taient anims du dsir de me sauver : ils pressaient sans cesse le cocher ; ils avaient l'air de craindre les passants ; enfin chacun d'eux paraiss ait tre personnellement intress ma conservation. Leur zle pensa mme coter la vie un cellent homme chez lequel votre frre tait cach ; Pauline vous contera cette histoir e, elle est vraiment touchante. J'arrivai enfin dans la maison de notre bonne parente, madame de Lde ; votre sur vin t m'y rejoindre, et, aprs avoir donn quelques moments au bonheur de l'avoir retrouve, j e pensai m'acquitter de ma reconnaissance envers les gens qui avaient aid me sauver . Ils paraissaient tous dans la misre et je ne pensais pas qu'ils pussent refuser d e l'argent ; mais, lorsque je voulus leur en donner, aucun d'eux n'en voulut recevoir : ils dirent qu'ils n'avaient voulu me sauver que parce qu'on leur avait bien prouv que j'tais innocente ; qu'ils se trouvaient bien heureux d'avoir russi et qu'ils ne voulaient pas tre pays pour avoir t justes. Enfin, quoi que j'aie pu leur dire, il me fut impos sible de leur faire rien accepter, et tout ce que je pus obtenir d'eux fut que cha cun me donnt son nom et son adresse. J'espre qu'un jour je trouverai les moyens de les rcompenser de ce qu'ils ont si gnreusement fait pour moi. Nous restmes fort tranquillement pendant deux jours chez madame de Lde ; le soir d u troisime jour, on vint me dire qu'un individu demandait me parler en particulier : je me rendis dans mon appartement, et je trouvai un homme de la plus effrayant e figure, trs-grand et avec une barbe norme. Cet homme me dit que je n'avais aucun risque courir Paris et que je pouvais y rest er, puisque j'avais t juge et innocente ; mais que ma fille, ayant t sauve de la priso
ans passer devant le tribunal, pouvait tre reprise d'un moment l'autre, et reconduite en prison ; qu'il me donnait le conseil de l'enlever de Paris, et le plus tt possibl e, de manire que personne ne pt dcouvrir le lieu de sa retraite. Cela dit, il sorti t de la chambre. Cet avertissement me jeta dans un trouble horrible. J'envoyai sur-le-champ cherche r M. Hardy, qui je racontai ce qui venait d'arriver. Il fut lui-mme tonn de cette mar que d'intrt ; mais il me dit qu'il ne fallait pas balancer un instant prendre un parti ; que le lendemain matin il viendrait de bonne heure confrer avec moi de l'arrange ment prendre pour le dpart, qu'il se chargeait de tout. Effectivement, le lendemain, M. Hardy arriva comme il l'avait promis. Il me dit qu'i l avait lou deux chambres Vincennes, que tout tait prt pour nous y recevoir, que pe rsonne, dans la maison que nous habiterions, ne nous connatrait. Nous partmes peu d'heures aprs avec M. Hardy, qui nous conduisit dans un fiacre, et nous arrivmes Vincennes non sans difficult, car la barrire on voulait absolument no us obliger prsenter des passe-ports. L'adresse et la prsence d'esprit de M. Hardy nous tirrent de ce pas difficile ; il russit nous faire passer, ainsi que ma femme de chambre et votre vieille bonne. Nous sommes tablies toutes les quatre ensemble, n'ayant pas la permission de sortir , ni mme de nous mettre la fentre de notre chambre. C'est de notre triste exil que nous vous crivons : je ne sais comment ni dans combi en de temps nous sortirons de la maison o nous sommes caches. Adieu, ma chre Josphine ; nous avons eu, avant de quitter Paris, le plaisir de voi r votre frre ; il est cach chez de bien bonnes gens, et j'espre qu'il ne sera pas dcouve rt. Pauline vous racontera son histoire, qui vous intressera srement, quoiqu'elle ne soit pas beaucoup prs aussi tragique que la ntre. Chapitre 14 Vous avez vu, mes chers enfants, que les dangers que j'ai courus sont peu de chose en comparaison de ceux auxquels ma mre a chapp. Elle dut son salut sa prsence d'espri t incroyable, cette noble et courageuse franchise qui frappa d'tonnement ceux qui s'a pprtaient devenir ses bourreaux. Ces cruelles preuves n'affaiblirent point son grand caractre, ne refroidirent pas l'at tachement qu'elle portait dans son cur ses matres malheureux ; dans la suite, vous l a reverrez la mme : la Reine s'tait confie sa vertu, sa vertu ne se dmentit pas. Ces lettres que vous avez lues, sont de bien vieille date ; elles furent crites p ar ma mre et par moi dans les premiers moments de repos que nous emes Vincennes. V ous sentez bien que nous n'en avions pas gard de copie, elles taient adresses ma sur, Bruxelles, et furent communiques ceux de notre famille qui, alors, taient l runis : beaucoup d'autres rfugis en eurent connaissance, des copies en coururent. Bien des annes aprs, M. de Barn, tant Riberpr chez M. d'Aubusson, trouva une de ces co ies entre les mains de ses filles : elles la tenaient de mademoiselle de Vitroll es. M. de Barn connut alors ces dtails, qu'il n'avait jamais pu obtenir de moi... J'ai longt emps prouv une rpugnance invincible ramener mes penses sur ces tristes temps ; ce n'es t que lorsqu'on est dans le port qu'on aime se rappeler les dangers de la mer. La lettre de ma mre et la mienne serviront vous expliquer l'tonnement que j'ai tmoign d vant tous, au sujet d'un passage des Mmoires de M. de Lavalette, celui dans lequel il s'exprime ainsi en rendant compte des journes des 2 et 3 septembre. Voici en eff et ce qu'il dit au tome Ier, page 92, que j'ai sous la main : Le bruit circula que l'on allait gorger tous les prisonniers. Je courus au chef-lie u de la section, j'y trouvai le greffier, M. du Tillet, qui me prit l'cart et me dit : Dans une heure les prisonniers de l'htel de la Force vont tre massacrs ; je viens d'o btenir de Tallien l'ordre de faire sortir madame de Tourzel et sa fille. Blve, le c apitaine des chasseurs, m'accompagne, il nous faut une troisime personne, me refuse rez-vous ? J'acceptai la proposition avec transport. Il fut convenu que du Tillet entrerait dans la prison, que Blve et lui se chargeraient de ces dames, que je le s accompagnerais, soit pour entretenir et distraire les importuns qui pourraient les arrter pendant la route, dans un quartier o ils taient si connus, soit pour co ntribuer les dfendre si on les attaquait. On ne fit aucune difficult pour faire so rtir ces dames. Nous descendmes la rue du Roi-de-Sicile, nous traversmes audacieus ement l'glise du Petit-Saint-Antoine, o se tenait l'assemble. La nuit, heureusement, co
mmenait nous protger ; on ne fit aucune attention nous, et mesdames de Tourzel tro uvrent dans la rue Saint-Antoine leurs amis, qui les mirent en sret. J'aimerais croire que M. de Lavalette ait contribu sauver ma mre et moi ; mais jamai s je n'avais entendu parler de lui ; les noms de M. du Tillet et de M. de Blve me s ont compltement inconnus, et, si M. de Lavalette a contribu notre dlivrance, j'ignore de quelle manire. Je sais bien, et l'on peut lire dans le Moniteur du temps, que Tallien, accus l'Assem ble d'tre l'auteur des massacres des 2 et 3 septembre, s'en dfendit et se fit un mrite d' ir donn l'ordre de sauver mademoiselle Pauline de Tourzel. M. Hardy, peut-tre, n'a-t-i l agi que par les ordres de Tallien, mais je n'ai vu que M. Hardy, et lui seul a t m on librateur. Du reste, ce que dit M. de Lavalette de la facilit avec laquelle ma mre et moi nou s sortmes de la Force prouve qu'il n'a point t tmoin de ce qui s'est pass dans cette cir stance. En lisant la lettre de ma mre et la mienne ma sur, madame de Sainte-Aldego nde, vous avez pu voir que cette vasion ne fut ni sans difficults ni sans prils. M. de Lavalette dit encore que nous trouvmes dans la rue Saint-Antoine nos amis, qui nous mirent en sret... Nos amis... ils ne pouvaient tre l dans ce terrible momen t : ils taient ou en prison, ou cachs, ou migrs. Les amis qui nous sauvrent furent ce ux de qui nous attendions la mort quelques moments auparavant. C'est M. Hardy seul que je dois ma dlivrance ; ma mre dut la sienne M. Hardy et ces huit hommes du peuple, un moment auparavant ouvriers de cette sanglante besogne, et qui, touchs de son courage, de sa franchise, devinrent ses protecteurs. Notre famille ne fut point ingrate envers ceux qui nous devions la vie : on fit beaucoup pour M. Hardy, et il y a peu d'annes encore que ma mre donnait des secours l'un des individus qui l'avaient ramene chez elle. En lisant ce passage de ma lettre ma sur dans lequel je rappelle de quelle manire t ait compose la voiture qui mena le Roi et sa famille au Temple, j'aurais d vous fair e remarquer que, des dix personnes qu'elle contenait, Madame la Dauphine, ma mre et moi, nous sommes les seules qui ayons chapp une mort violente : Le Roi !... La Reine !... Madame lisabeth !... M. le Dauphin !... madame de Lamba lle !... vous connaissez, hlas ! leur douloureuse destine. Quant Manuel et Collonge, ces monstres prirent du supplice qui avait frapp tant d'in nocents. Mes souvenirs me ramnent malgr moi ces trop courtes journes que nous passmes au Temp le auprs de nos princes prisonniers et malheureux. Avant de continuer mon rcit, je veux vous donner quelques dtails que ma mmoire me fournit et qui m'ont chapp quand je vous ai racont cette poque de ma vie. Le nombre des personnes qui avaient t enfermes au Temple avec le Roi tait considrable . Outre la princesse de Lamballe, ma mre et moi, il y avait MM. Hue et Chamitty, appartenant au Roi ; madame Thibaut, la Reine ; madame de Natam, femme de chambr e de Madame lisabeth ; madame de Saint-Brice, attache au service du Dauphin ; mada me Bazin, celui de Madame Royale ; enfin, trois hommes au Roi, Target, Chrtien et Marchant. Je vous ai dit que, au Temple, les journes entires se passaient chez la Reine, dan s sa chambre, qui servait de salon de runion ; mais la manire dont on y passait so n temps peut vous intresser : neuf heures et demie nous allions djeuner ; la pice q ui servait de salle manger tait assez loigne de la chambre de la Reine ; nous parti ons, mais escorts de quelques officiers municipaux : ces officiers municipaux nou s surveillaient pendant le repas, qui tait court et silencieux ; seulement, si pa rmi ces hommes il y en avait un d'une figure honnte, la Reine, Madame lisabeth, se h asardaient quelquefois lui adresser une question ; si la rponse n'tait pas brutale, si le son de la voix indiquait quelque intrt, c'tait un baume pour leur pauvre cur. En sortant de djeuner, on descendait prendre l'air dans une enceinte trs-restreinte, ferme de planches, et qu'on avait mnage dans le jardin du Temple pour servir aux pro menades des prisonniers. Toujours entours, toujours surveills, ils pouvaient, cepe ndant, plus aisment que dans la chambre de la Reine, changer quelques paroles. Les officiers municipaux se montraient trs-farouches et affectaient de ne tmoigner au cun respect au Roi. Remonts dans l'appartement, nous nous rangions autour d'une table ronde, et chacun se mettait l'ouvrage : on travaillait pour l'ordinaire cette robe que m'avait destine Mad
ame lisabeth, et l'on mettait cet ouvrage un intrt dont le souvenir me touche encore sensiblement. Mais, pendant ce temps-l, que faisait le Roi ?... Il avait pris son fils sur ses genoux, et, sur une table prs de nous, il lui donnait des notions de gographie ; c'ta it la Reine qui lui enseignait l'histoire et Madame lisabeth le calcul. Louis XVI a vait oubli qu'il tait roi, il se souvenait doublement qu'il tait pre. Il et t dsirer que la nation tout entire pt assister ces leons ; elle ft reste ne et mue de tout ce que ce bon Roi trouvait dire de sens, de cordial, de tendre, l a vue de la carte de France dploye devant lui et de la chronologie de ses prdcesseur s. Tout dans ses paroles dnotait l'amour qu'il portait ses sujets et combien son cur p aternel dsirait leur bonheur. Que de grandes, que d'utiles leons on et pu graver dans son cur en coutant ce roi captif instruisant cet enfant n pour le trne et condamn pa rtager la captivit de ses parents ! Ce Roi et son fils, cette Reine et sa fille, Madame lisabeth, les personnes dvoues qui les entouraient de leur respect et de leur amour, cet ensemble, ce tableau s i touchant, trouva un jour un cur sensible : un officier municipal ne put, cette vue, cacher son attendrissement. Peut-tre lui en fit-on un crime ; ce qu'il y a de sr, c'est que, pour viter les sductions que pouvait exercer la vertu, on dcida que, to utes les heures, le surveillant serait chang. Dans la journe, le Roi, qui heureusement avait trouv au Temple une bibliothque, don nait quelque temps la lecture dans un cabinet attenant la chambre, et, pendant s on absence, Madame lisait haute voix ; la Reine faisait de la tapisserie. Les distractions, comme vous le pensez bien, n'taient pas nombreuses ; j'en imaginai une pour M. le Dauphin. J'avais, par hard, un toton ; j'appris au jeune prince le fa ire tourner, et cet innocent plaisir prit une sorte d'importance par le parti qu'en sut tirer le gnie inventif des princesses. On tablit, comme pour amuser M. le Daup hin, des espces de joutes, en convenant que celui qui ferait tourner le toton plu s longtemps que les autres aurait gagn la partie. Cela donnait l'occasion aux joueu rs de s'approcher de la table et de se pencher pour jeter le toton prs des personne s assises, de manire pouvoir changer avec elles quelques paroles voix basse, ce qu i n'et pas t possible sans ce prtexte, car, lorsqu'on parlait bas, le municipal vous rap pelait que vous ne deviez parler que tout haut. L'histoire de ce toton n'est pas finie ; je le laissai lorsque nous fmes enleves du Te mple, et il fut de plus en plus employ mesure que les rigueurs augmentrent contre la famille royale : elle lui dut la possibilit de se faire de tristes confidences , et la Reine en garda un tel souvenir, que, au moment o on la spara de sa famille pour la conduire la Conciergerie, elle le remit Madame en lui recommandant de m e le rendre si jamais elle me revoyait. C'est au Temple, quand, aprs la mort de Robespierre et notre sortie de prison, il n ous fut permis d'y porter quelques consolations Madame, qu'elle me remit ce legs de sa malheureuse mre ; c'est une relique, je la conserve, elle me rappelle bien des s ouvenirs[1]. Je ne cherche point, vous le voyez, mes enfants, mettre dans ces souvenirs un or dre et une suite qu'ils ne comportent pas. Je dis les choses comme elles me vienne nt, retournant en arrire quand mes ides m'y entranent. C'est ainsi que je viens de vous ramener au Temple, aprs vous avoir dit comment nous en tions sorties. J'ai maintena nt quelques dtails ajouter ce que je vous ai dit sur les vnements qui suivirent ma sortie de la Force. En entrant dans la maison o il demeurait, M. Hardy, j'ai oubli de vous le dire, me c onduisit d'abord chez une dame qui, apparemment, tait prvenue de mon arrive. Elle vin t moi de la manire la plus obligeante, me fit offre de secours et de services. En vrit, je ne savais o j'en tais. Cette femme tait belle : son visage, plein de calme, r espirait la bont et la douceur. J'avais l'imagination encore frappe par l'aspect hideux des gorgeurs auxquels je venais d'chapper. Leurs figures atroces taient toujours deva nt moi. Ce contraste me troublait. Je croyais rver. Il me fallut quelques moments pour me remettre ; et combien me parurent douces ces prvenances, ces marques d'intrt , aprs tant d'horreurs dont je venais d'tre tmoin : je revoyais une femme, une femme co mpatissante ! Je croyais que c'tait prs d'elle que j'allais retrouver le calme dont j'avais si grand bes oin ; mais je ne fis qu'une apparition chez elle. L'appartement de M. Hardy tait sur
le mme palier que celui de cette femme dont la bienveillance me laissa une impres sion qui ne s'est jamais efface. Il me conduisit dans son appartement, comme je vou s l'ai dit, et c'est de l que je partis pour chercher, travers bien des dangers, cett e voiture qui devait me conduire dans un asile sr. Cette personne qui je dus ces premiers moments de consolation tait madame Carnot, belle-sur de celui qui fut directeur. Ce fut elle qui prta le chapeau, le voile e t le mantelet dont je me couvris lors de ma sortie de chez M. Hardy. Plus tard, ma mre et moi voulmes lui aller tmoigner notre reconnaissance. M. Hardy nous dit qu'elle n'habitait plus Paris, qu'elle tait retire la campagne. Toutes nos rech erches furent inutiles, et je ne revis jamais cette personne qui mon cur tait si r econnaissant de son gnreux accueil et du bien qu'elle m'avait fait. Chapitre 15 Je reprends maintenant, mes chers enfants, mon rcit au point o je l'avais laiss quand je suis retourne en arrire pour remplir des lacunes que j'avais laisses dans ce rcit. Vous vous souveniez que, trois jours aprs notre sortie de la Force, il nous fall ut fuir Paris, et que M. Hardy nous avait lou deux chambres Vincennes. Ma mre et m oi, sa femme de chambre et ma vieille bonne, nous nous clotrmes dans cette troite r etraite. Depuis ce triste sjour Vincennes, je tiens pour certain qu'on peut vivre et mme engr aisser, sans avoir besoin pour cela d'air ni d'exercice, encore moins de bonheur. Nous tions loges dans une rue carte et troite ; jamais nous n'ouvrions nos fentres ; no s ne mmes pas une seule fois le pied dehors. Nous renouvelions l'air de nos chambre s en ouvrant notre porte et en brlant des fagots dans la chemine. Aucun rapport n'eut lieu entre nous et nos htes, qui taient apparemment des gens la dvotion de M. Hardy. Ma bonne allait acheter nos modestes provisions ; elle faisa it notre petite cuisine, et ma plus grande distraction tait de l'aider dans cette f onction et dans les soins de notre petit mnage. Cette vie, qui dura prs de six mois, tait bien une vie de prison ; du moins notre prison tait tranquille et nous n'avions pas de geliers. Comment d'ailleurs songer nous au milieu de tant de calamits publiques ! Ce fut l que la nouvelle de la mort du Roi vint jeter le dsespoir dans nos curs. Bo n et malheureux prince ! qui, en butte tant de haines injustes, ne parvint har pe rsonne, qui avait des intentions si droites et si pures, un si grand amour pour la France, qu'il l'aima jusque sur l'chafaud ! Beaucoup l'ont pleur ; mais je vous laisse juger si beaucoup avaient autant de moti fs que nous de le pleurer. Nous vivions ignores du monde entier dans la retraite o nous tions comme ensevelies ; le seul moyen de vivre dans cette horrible poque, c'tait de se faire oublier. Nou s ne recevions ni lettres ni journaux. Une fois par dcade M. Hardy nous venait vo ir, et nous voyions aussi l'homme d'affaires de ma mre avec la permission de M. Hardy . Ils nous apprenaient une partie des atrocits qui se commettaient dans Paris. C'es t ainsi que nous passmes les plus mauvais temps de la Terreur. Quoique si prs de P aris, je ne puis dire que nous ayons assist aux horreurs dont ils furent marqus ; nous les avons sues par ou-dire. M. Hardy avait pris sur nous un empire absolu : nous ne nous permettions que ce qu'il nous permettait ; nous nous abstenions de tout ce qu'il nous interdisait. Enfin il crut que les dangers taient diminus pour nous, que notre rclusion pouvait recevoir quelque adoucissement. Il nous choisit un autre logement Vincennes, dan s une grande rue, en bon air, et il nous fut permis, la chute du jour, de nous p romener sur la grande route. Nos voiles et nos tournures modestes nous firent pr endre pour des religieuses ; ces religieuses prsumes ne furent inquites par personne . Nous arrivmes ainsi jusqu'au moment o M. Hardy ne vit plus d'inconvnient ce que nous allassions nous retirer la campagne. Nous traversmes Paris, et l nous emes la triste consolation de voir M. Edgeworth. I l nous parla des derniers moments du Roi, si courageux et si chrtien ; de cette m esse dite au Temple, de cette suprme communion, et puis de ce lugubre trajet jusq u' la place de l'chafaud. Nous versmes avec M. Edgeworth bien des larmes. Qu'elles taient belles, ces paroles que le saint prtre adressa au malheureux prince sur l'chafaud : FILS DE SAINT LOUIS, MONTEZ AU CIEL !
Qu'elles durent donner de courage celui qui dj tant de fois avait fait le sacrifice de sa vie ! Qu'elles durent lui donner de confiance, prononces par cet homme d'une fi gure si calme, si noble, et sur le front duquel le sceau de la prdestination semb lait crit ! Le Roi a pu croire avoir un ange ses cts. M. Edgeworth dit ma mre qu'il avait t charg par le Roi, dans ses derniers jours, de lu i dire que, dans la crainte de la compromettre, il n'avait pas voulu, dans son tes tament, lui tmoigner sa reconnaissance ; mais que cette reconnaissance tait grave d ans son cur. Nous prouvmes de bien douloureuses motions pendant le peu de moments que nous restme s Paris, et nous partmes pour rejoindre mon frre, qui tait retir chez lui, la campag ne. Nous tions dans la premire moiti de cette fatale anne 1793, qui vit tant de crim es et de malheurs. M. Hardy, dbarrass du soin de veiller sur nous, nous rendit encore un service. Ma sur, madame de Charost, tait alle conduire en Suisse une de ses amies, malade (la p rincesse de Talmont). Les vnements du 10 aot l'empchrent de revenir ; elle se trouvait igre sans le vouloir, et ne pouvait rentrer sans un grand danger. M. Hardy alla l a chercher et la ramena au milieu de nous. Tant d'vnements, tant de catastrophes s'taient succd depuis notre sparation ! Nous nous vmes avec bonheur. Nous passmes en famille et aussi tranquillement que cela se pou vait cette cruelle poque, c'est--dire sans tre inquites, l'hiver de 1793 1794, et le temps de cette dernire anne. Mais quel funeste vnement vint nous dchirer le cur : la m ort de la Reine ! Nous qui l'avions connue, aime, qu'elle avait aimes ; nous qui avion s vcu dans son intimit Versailles, aux Tuileries, au Temple, qui savions tout ce q ue son cur contenait de vertus royales et d'aimables qualits ! Nous tions avides de dt ails et, en mme temps, nous craignions d'en demander. Ces dtails taient si cruels et si navrants ! Jusqu'au dernier moment la haine rvolutionnaire avait suivi notre inf ortune Reine. Nous smes son attitude courageuse devant le tribunal rvolutionnaire, son appel tou tes les mres, sa sortie de la Conciergerie en dshabill blanc ; on n'avait pas mme voul u lui accorder pour aller l'chafaud le carrosse que la Convention envoya au Roi. C'es t dans une ignoble charrette que la Reine de France est alle l'chafaud, et les hurle ments des furies de la guillotine ont salu son supplice. Mais qu'importent ces inju res ! On n'a pu lui ter ce cur magnanime qui l'avait soutenue dans toutes ses preuves, et elle est morte comme elle avait vcu, en reine. C'est ainsi que l'admiration se mlai t la douleur que nous prouvions pendant qu'on nous racontait ces dtails. Mais la dou leur tait la plus forte. Ajoutez cela que nos craintes sur M. le Dauphin, ce noble et malheureux enfant l ivr aux mains les plus viles, nos inquitudes pour Madame et pour Madame lisabeth, r emplissaient nos curs d'amertume. Notre tranquillit personnelle prit fin au mois d'avril 1794. Je ne puis prciser la d ate du jour, mais je suis sre que nous tions entrs dans ce mois, lorsqu'un jour, vers les neuf heures du matin, un domestique en moi entra chez ma mre et lui apprit qu e des commissaires du Comit de sret gnrale demandaient lui parler. Aussitt averties, ous nous runissons autour de ma mre pour entendre la signification de l'ordre qu'ils a vaient de nous conduire dans les prisons de Paris : ma mre, mon frre, madame de Ch arost et moi. Ces commissaires taient au nombre de quatre. La signification faite , deux de ces commissaires nous quittrent pour aller au chteau de Courteille. Les deux autres procdrent, en notre prsence, l'apposition des scells dans chacune de nos c hambres, puis ils htrent le dpart. En moins de deux heures nous tions en route. Ils avaient une voiture de poste ; nous en prmes une seconde. Nous nous partagemes ent re ces deux voitures : mon frre et madame de Charost montrent dans la premire avec l'un des commissaires, ma mre et moi dans la seconde, avec l'autre. Chemin faisant, ma mre s'informa du lieu o l'on devait nous mener. On nous dit que nou s avions le choix de notre prison. Ma mre demanda tre conduite dans l'ancien couvent des Anglaises, situ rue Saint-Victor. Le commissaire rpta que nous tions libres de choisir, mais qu'il nous conseillait plutt les Bndictins anglais, comme la prison o l'on tait le plus tranquille. On nous conduisit donc aux Bndictins anglais, rue Saint-J acques. Nous n'avions gure eu le temps, ma mre et moi, de perdre l'habitude des prisons, car n otre sjour Vincennes pouvait tre regard comme une demi-captivit. Nous n'en tions pas m
ins affliges de perdre sitt cette libert si rcemment recouvre et ce bien-tre moral que nous avions retrouv dans la vie en famille. Mon frre et ma sur entraient en prison pour la premire fois. Tous quatre nous tions fort tristes. Pendant la formalit de l'crou, on nous fit entrer dans une grande salle qui avait t, dans un meilleur temps, le rfectoire des bndictins. Nous nous jetmes sur des chaises sans changer un seul mo t. Un homme petit, vieux, trs-maigre, vtu d'une camisole de nuit d'indienne, qui ne lui d escendait qu' mi-corps, couvert d'une coiffe de nuit, un balai la main, tait occup net oyer la salle. Il s'approcha de nous d'un air entre la goguenardise et l'intrt, et nous dit : Mesdames, il y a huit jours j'tais comme vous, triste et silencieux ; il parat que vous tes des ntres : dans huit jours vous aurez pris votre parti comme moi. I l reprit son balai et continua balayer. Cette apostrophe bizarre, la tournure, l'air de bonhomie de celui qui nous l'avait a dresse, nous arrachrent malgr nous un sourire. Ma mre entra en conversation avec cet homme, qui se trouva tre M. de Cassini, aimable, gai, instruit, et dont la socit n ous fut d'un grand secours pendant que nous fmes enfermes avec lui sous les mmes verr ous. Mon frre fut log dans la chambre de M. Parker, ancien suprieur de la maison. Cet ho nnte, aimable et respectable homme, prisonnier dans son propre couvent, resta not re ami tant qu'il vcut. Ma mre, ma sur et moi, nous fmes toutes trois mises dans une petite chambre au troi sime, sous les toits ; nos trois lits de sangle ne nous laissaient pas grand'place pour nous retourner, mais, grce l'lvation de la mansarde, nous avions beaucoup d'air et une vue tendue. Il est trs-utile de juger les choses par comparaison ; les souffrances passes font ainsi quelquefois paratre plus lgres les souffrances prsentes : les souvenirs du Te mple, de la Force, de Vincennes, nous firent trouver quelque agrment dans notre l ogement. Il y avait dj beaucoup de monde dans cette maison : hommes et femmes mangeaient en commun ; la nourriture n'avait rien de dlicat. On prenait dans ce qu'il y avait de p is, dans les rebuts des boucheries et des paniers lgumes ; on ajoutait cela du pa in de munition de la plus mauvaise qualit. Il tait vraiment difficile, malgr toute la sobrit possible, de se contenter d'un pareil menu. Heureusement, on nous permit d e faire venir du dehors quelques lgumes secs, du beurre et du lait ; on visitait ces provisions au greffe, aprs quoi nous les montions dans nos chambres. Je m'instituai cuisinire de ma chambre, et le repas du soir tait un festin de ma faon. Seulement l'heure de ce repas ne fut pas toujours la mme : il vint un moment o la l umire nous fut interdite, et je fus dans l'obligation d'allumer mon fourneau de terre assez temps pour que nous pussions souper au jour. On jouissait dans l'intrieur de la maison de la plus grande libert. C'tait, il est vrai , la libert en prison, mais du moins on pouvait se voir, se visiter. En vrit, le co mmissaire du Comit de sret gnrale nous avait rendu un grand service en nous conseilla nt cette prison de prfrence aux autres. Il y avait entre la plupart des prisonnier s une bienveillance, une union presque fraternelle. Cependant nous fmes avertis q ue nos paroles, nos soupirs, pouvaient trouver des surveillants et des interprtes dangereux ; il y avait dans la prison ce que l'on appelait des moutons ; c'taient de s espions chargs de recueillir les paroles imprudentes qui pouvaient compromettre les prisonniers. Leurs dnonciations taient par consquent fort craindre, car elles pouvaient devenir le point de dpart d'un acte d'accusation. Chacun, sur ses gardes, ne se livrait qu' bonnes enseignes. Du reste, notre vie tait si dcouvert, que l'on ne pouvait rien y trouver de suspect. M. de Cassini, dont je vous ai parl plus haut, s'tait fabriqu, au moyen d'un paravent, sur un palier de l'escalier, un petit rduit o il dessinait. Il dessinait trs-bien, on venait le voir ; bientt on lui demanda place prs de lui, et il se forma une petit e acadmie de dessin dont il tait le chef ; mon frre, ma sur et moi y fmes admis. Nous avions la jouissance d'un petit jardin. MM. Aynar, de Lyon, au moyen de deux cordes et d'une planche, avaient lev une escarpolette : j'tais jeune, j'en essayai, et ce petit exercice fut quelquefois une rcration pour moi. Le temps s'coulait assez doucement, mais bientt l'horizon se rembrunit encore. Depuis que nous tions renferms dans la prison de l'ancien couvent des Bndictins anglais, nous
y avions vu entrer beaucoup de monde ; nous tions plus de trois cents prisonnier s, et personne n'avait encore t appel devant le fatal tribunal. Mais on commena parler de complots ; le rgime de la prison devint plus rigoureux ; plusieurs d'entre nous furent enlevs et conduits l'chafaud... Nous apprmes que Madame lisabeth, cette prince sse d'une vertu anglique, venait d'y monter. Cette funeste nouvelle rouvrit dans nos curs la blessure qu'y avaient laisse la mort du Roi et celle de la Reine. On nous rpta ses dernires paroles au tribunal rvolutio nnaire ; elles nous firent verser bien des larmes : Toutes ces questions sont in utiles, vous voulez ma mort ; j'ai fait Dieu le sacrifice de ma vie, et je suis prt e mourir, heureuse d'aller rejoindre mes respectables parents que j'ai tant aims sur la terre. Dans la charrette, elle consola et exhorta la mort, avec une srnit d'me adm rable, les vingt-quatre personnes qu'on avait associes son supplice. On eut la crua ut de l'excuter la dernire. Ainsi tout ce qui tait entr au Temple semblait vou la mor chaque victime qui tait frappe, nous voyions avec une terreur croissante le glaiv e se rapprocher de la tte de Madame Royale, maintenant demeure seule dans cette pr ison o elle tait entre avec toute sa famille, car depuis longtemps le Dauphin tait sp ar d'elle. Auguste et malheureux enfant, quelle devait tre sa destine ! partir de ce moment, tout fut chang dans notre manire de vivre. L'inquitude remplaa la tranquillit, la terreur entra dans les curs. Nos craintes devinrent bien plus viv es encore quand on nous avertit que le nom de ma mre avait t prononc par une de ces bouches d'o sortaient les arrts de mort. Nous crmes notre dernier jour arriv ; nous nous prparions, nous nous encouragions ; nous allmes jusqu' chercher des renseignements sur la manire dont le supplice avait lieu. Rsignes notre sort, nous nous occupions, en l'attendant, prparer des vtements q i dispensassent le bourreau de mettre la main sur nous. Un jour, nous crmes que ces prparatifs allaient nous devenir utiles : la charrette couverte qui emmenait les victimes dsignes tait la porte de la maison ; la voix du guichetier nous appelle... nous emes un moment de grande terreur. Heureusement q ue bientt nous smes qu'il tait question seulement de transfrer ailleurs toutes les fem mes prisonnires dans la maison, et que nous faisions par consquent partie, ma mre, ma sur et moi, du convoi qui allait partir. Ainsi, aprs cinq mois de sjour, il nous fallut quitter cette prison. Nous ne nous en loignmes pas sans regret ; nous ne la quittions que pour passer dans une prison nouvelle ; notre captivit changeait de sjour sans finir, et par-dessus tout nous avions la douleur d'tre spares de mon frre, qui devait rester aux Bndictins anglais. Les motifs de cette translation nous taient inconnus : pourquoi nous enlever de l pour nous transfrer ailleurs ? L'incertitude de notre destination nous fit une tris te impression. On nous mena la prison nomme Port-Libre, nom drisoire quand on le r approche de l'usage auquel tait employ l'difice auquel on le donnait. Port-Libre tait l'a cien Port-Royal des Champs, rue de la Bourbe. Le premier spectacle qui s'offrit nos yeux en traversant la route de Port-Royal fu t le dpart d'une bande de malheureux condamns prir, et parmi lesquels nous reconnmes l e comte de Thiars, vieillard cheveux blancs, qui marchait d'un pas ferme et avec c ourage, mais dont la pleur indiquait que l'me faisait un violent effort pour surmont er la dfaillance du corps. Ils montrent pour aller au supplice dans cette mme voiture qui nous avait amenes, e t les chambres qui nous furent donnes taient celles qu'ils venaient de quitter !... Ces premiers moments ajoutrent beaucoup nos tristes penses ; bientt nous pmes compre ndre que, pour nous, le danger s'tait beaucoup rapproch. On tait au plus fort de la T erreur. La Commune de Paris tait matresse. L'chafaud, comme on l'a dit, tait en permanen ce, et le tribunal rvolutionnaire lui envoyait fourne sur fourne. Tous les jours un grand nombre des malheureux prisonniers taient enlevs : nous pensions que notre t our ne pouvait tarder. Nous l'attendions avec rsignation. Nous squestrant de la foul e de nos compagnons d'infortune, qui taient au nombre de plus de cinq cents, nous n'a vions de rapports qu'avec mesdames de Lambert et de la Rochefoucauld, et M. d'Aubuss on, dont la socit nous fut une consolation. Enfin, l'arrive imprvue d'un prisonnier dont le nom tait pour les honntes gens un sujet d'horreur et d'pouvante nous apprit que le moment du pril tait pass... Couthon, le fameu x Couthon, l'impitoyable Couthon, vient d'tre crou au Port-Libre, parmi nous... La nouv elle en circule bientt, tout le monde se hte, se presse pour s'assurer du fait. tait-
ce bien possible ? Couthon, le proscripteur de Lyon ! on ne pouvait y croire... Et pourtant rien n'tait plus vrai. Couthon tait prisonnier, et Robespierre avait tou rn contre lui-mme ses mains homicides. La Rvolution avait trop tendu le ressort de la Terreur, une raction tait invitable. On avait us le crime comme moyen de gouvernement, et, quoique les adversaires de Robespierre ne fussent gure plus humains que lui, et que leur principal motif pou r le tuer ft le dsir d'chapper la mort dont il les menaait, ils furent obligs d'adopte ne politique de clmence et d'humanit. La journe du 9 thermidor devait ouvrir les portes des prisons ; nous vmes sortir b eaucoup de monde avant qu'on nous apportt l'ordre de notre largissement. Enfin la libe rt nous fut rendue. Deux mois de prison la Bourbe ou Port-Libre, cinq mois de prison aux Bndictins ang lais, compltrent sept mois de prison ajouter ceux que nous avions dj subis. Mon frre recouvra en mme temps que nous la libert, et ma sur, madame de Charost, nou s recueillit dans sa maison. Chapitre 16 Au moment o j'achve le rcit de cette partie de ma vie, j'prouve comme un sentiment de dl vrance. Il m'a fallu, mon cher fils, toute la tendresse que je vous porte, pour me dcider recommencer par la pense ces tristes annes o mon cur a eu tant souffrir. Ces tristes annes sont cependant les six annes de ma premire jeunesse. Plaignez ceux qu i ont t jeunes de ce temps, ils n'ont jamais prouv cette confiance de cur et cette gaie t d'esprit qui sont le plus doux privilge du bel ge ; la Rvolution nous mrissait vite e t mettait des ombres sur nos fronts. Il n'y avait pas de jeunesse pour ceux qui s'at tendaient chaque matin mourir. Vous connaissez maintenant, mon enfant, la partie tragique de la vie de votre mre. La partie dont il me reste vous parler ne sera pas exempte de tribulations ; mais, avoir beaucoup souffert, on gagne de trouver supportable le temps o l'on souffre moins. Nous voil libres enfin. Le premier usage que nous fmes de notre libert fut de cherc her les moyens d'obtenir la permission d'aller au Temple porter Madame quelques cons olations. Elle tait seule : le Roi, la Reine, Madame lisabeth, tout avait pri autou r d'elle, tout avait disparu. Que de dmarches il nous fallut faire ! de combien de dgots nous fmes abreuves ! mais le motif qui nous guidait soutint notre courage. Aprs quinze jours de dmarches, d'in stances et de sollicitations, l'entre du Temple nous fut accorde, ma mre et moi, mais seulement deux fois par dcade. Je ne vous dirai pas avec quel bonheur nous revmes cette infortune princesse, et c ombien elle fut heureuse de nous revoir ! Nous ne savions pas, en nous rendant a u Temple, si Madame connaissait toutes les pertes qu'elle avait faites, et c'tait pou r nous le sujet d'une triste proccupation. tions-nous destines lui apprendre qu'aprs av ir perdu son pre elle avait perdu aussi la Reine, sa mre, et Madame lisabeth ? taien t-ce les premires paroles qu'il faudrait lui adresser en la revoyant aprs une si lon gue sparation ? Ma mre avait en vain demand Gauthier (de l'Ain), lorsqu'il nous remit l' utorisation d'entrer au Temple, si Madame savait qu'elle avait perdu tous ses parent s. Nous fmes reues en entrant par madame de Chantereine, laquelle ma mre renouvela cette question. Sa rponse nous soulagea le cur d'un grand poids. Madame connaissait tous ses malheurs et nous n'avions plus rien lui apprendre. Nous achevions d'changer ces paroles quand Madame vint notre rencontre : elle nous embrassa tendrement et nous conduisit dans sa chambre. Nous ne pmes d'abord que pleurer, et nous confondme s nos larmes en songeant tous ceux qu'elle avait perdus. Ce fut elle qui prit la p arole et nous raconta avec un accent dchirant les adieux de son pre la famille roy ale, quand il la vit pour la dernire fois, la veille du 21 janvier. Lorsque, remi ses de ces premiers moments, nous pmes considrer avec un peu d'attention Madame Roya le, nous fmes tonnes du changement qui s'tait opr dans sa personne. Quand nous l'avions itte au Temple, quelques jours aprs le 10 aot, nous l'avions laisse faible et dlicate, et aprs trois ans de malheurs inous, de mortelles douleurs et de captivit, nous la retrouvions belle, grande et forte, et portant dans tous ses traits ce grand air de noblesse qui est le caractre de sa physionomie. Je fus frappe, comme ma mre, de ce que sa figure offrait un mlange des traits du Roi, de la Reine et de Madame li sabeth. Madame nous parla de ses malheurs avec une douceur anglique, et, quelle q ue ft la profondeur de son affliction, nous ne surprmes pas un seul sentiment d'aigr
eur contre les auteurs de ses maux. Elle plaignait les Franais et elle aimait le pays o elle avait tant souffert. Ma mre lui ayant dit qu'elle dsirait sa sortie de Fr ance pour la voir dlivre de sa captivit, elle rpondit d'un ton pntr : J'prouve enco consolation en habitant un pays o reposent les cendres de ce que j'ai de plus cher au monde. Puis elle ajouta en fondant en larmes : J'aurais t plus heureuse de partag er le sort de mes parents que d'tre condamne les pleurer. Madame Royale nous parla aussi avec attendrissement du jeune Roi son frre et des mauvais traitements qu'il subissait journellement. Ma mre lui ayant demand comment, avec une me si affectueuse, elle avait pu supporter tant de malheurs dans une aus si affreuse solitude, voici quelle fut sa rponse : Sans la religion, c'et t impossible ; elle fut mon unique ressource et me procura les seules consolations que pt gote r mon cur. J'avais conserv les livres de pit de ma tante lisabeth ; je les lisais, je r epassais ses avis dans mon esprit, je cherchais ne pas m'en carter et les suivre ex actement. En m'embrassant pour la dernire fois et en m'excitant au courage et la rsign ation, elle me recommanda positivement de demander que l'on mt une femme auprs de mo i. Quoique je prfrasse infiniment ma solitude la compagne que l'on m'et donne dans un p reil moment, mon respect pour les volonts de ma tante ne me permit pas d'hsiter. On me refusa, et j'avoue que j'en fus bien aise. Ma tante ne prvoyait que trop le malheu r auquel j'tais destine, et elle m'avait accoutume me servir seule et n'avoir besoin d ersonne. Elle avait arrang ma vie de manire en employer toutes les heures. Le soin de ma chambre, la prire, la lecture, le travail, tout tait class. Elle m'avait habit ue faire mon lit seule, me coiffer, me lacer, m'habiller. Elle me faisait jeter de l'eau pour rafrachir l'air de ma chambre, et avait exig en outre que je marchasse avec une grande vitesse pendant une heure, la montre la main, afin de remplacer l'exer cice qui me manquait. Nous coutions Madame en pleurant et nous retrouvions dans son rcit Madame lisabeth telle que nous l'avions vue, avec cette prvoyance qui s'tendait tout et ce courage qu'au cun pril ne dconcertait. C'est en suivant les conseils que sa tante lui avait donns q ue Madame passa prs de quinze mois seule avec sa douleur, n'ayant d'autre livre de le cture que les Voyages de la Harpe, qu'elle relut plusieurs fois, manquant de tout et ne demandant rien, raccommodant elle-mme ses bas et jusqu' ses souliers. Visite qu elquefois par les commissaires de la Convention, entre autres par Robespierre, e lle mit tant de laconisme dans ses rponses qu'ils ne prolongrent pas leurs questions et ne renouvelrent pas leurs visites. Malgr tout son courage, Madame, elle nous l'a voua elle-mme, tait si fatigue de sa solitude, qu'elle se disait : Si on finit par me ttre auprs de moi une personne qui ne soit pas un monstre, je sens que je ne pour rai m'empcher de l'aimer. Ma mre lui demanda si elle n'avait jamais t malade pendant le mps de son isolement : Ma personne m'occupait si peu, rpondit-elle, que je n'y ai pas fait attention. Alors elle nous raconta un vanouissement qu'elle avait un jour prou v, en ajoutant, sur le peu de cas qu'elle faisait de la vie, des rflexions qui nous firent fondre en larmes. Nous nous retirmes de cette premire entrevue la fois heur euses et affliges, mais surtout pleines d'admiration pour cette jeune princesse qui , dans un ge si tendre, semblait avoir appris la rude cole de l'adversit toutes les v ertus que nous avions aimes et admires chez ses augustes parents. Ce fut dans cette premire entrevue que Madame s'acquitta de la commission que lui a vait donne la Reine et qu'elle me remit ce jouet, que j'avais laiss au Dauphin et qui aidait les membres de la famille royale, si troitement surveills, se communiquer l eurs penses. Lors de la seconde visite que je lui fis, elle me mit dans la main, au moment o j e lui disais adieu, un petit morceau de papier, en me disant : Vous le lirez. Arrive l'htel de Charost, j'ouvris ce petit papier ; il portait pour suscription : ma chre Pauline. Mon cher fils, j'ai lu bien souvent ce billet, et cependant, au moment de vous le relire, j'prouve presque autant d'motion qu'en le lisant pour la premire fois. Le voici ; coutez, et gardez-le, aprs moi, comme une prcieuse relique :
Ma chre Pauline, le plaisir que j'ai eu vous voir a beaucoup contribu soulager mes m aux. Tout le temps que j'ai t sans vous voir, j'ai beaucoup song vous. Malgr tout ce qu
j'ai eu souffrir, j'ai craint pour vous la Force : j'ai t tranquille en apprenant que ous tiez sauve et en esprant que vous n'y retourneriez plus. Mon esprance est due : on ous replonge dans un autre cachot, pour y passer bien plus de temps que dans le premier. Enfin vous en sortez heureusement. Je n'ai su votre seconde dtention que q uand vous tiez sortie de Port-Royal ; depuis ce temps vous tchez d'tre runie avec moi, ou du moins de me voir. Quand je ne vous aurais pas connue et aime comme je vous aimais, tant de preuves d'attachement, que vous avez donnes mes parents et moi, m'au raient attache vous pour la vie ; jugez par la tendresse avec laquelle je vous ai mais dj combien mon amour doit tre augment. Je vous aime, et vous aimerai toute ma v ie. la Tour du Temple, ce 6 septembre. Marie-Thrse-Charlotte.
Elle m'a toujours aime, cette grande et bonne princesse ; elle jugeait bien mon cur : elle avait confiance en moi, et savait qu'elle avait bien plac sa confiance. Nos visites de tous les cinq jours se continurent jusqu'au moment o Madame quitta le Temple pour aller Vienne. Nous arrivions vers midi, nous la quittions huit heur es du soir, et nous faisions pied, ma mre et moi, toutes seules, le trajet un peu long, surtout le soir, du Temple l'htel de Charost, rue de Lille. Ce fut alors que Madame me fit don du petit trictrac sur lequel jouait au Temple son infortun frre le jeune Dauphin ; on l'avait apport des Tuileries dans les premiers jours. Elle m e remit encore sa montre, cette montre en or, ambre et mail, ainsi que sa chane qu e je vous ai dj fait voir ; montre historique ayant appartenu la grande Marie-Thrse, qui la donna Marie-Antoinette lors de son dpart pour la France. Depuis, la Reine en avait fait prsent sa fille, Madame Royale, qui me demanda de l'accepter et de l a garder en souvenir de notre amiti[1]. Quand il fut question de faire sortir Madame de la prison du Temple, et de la re mettre l'empereur d'Allemagne, qui consentait rendre en change de sa cousine plusieur s prisonniers rpublicains, nous fmes averties que ma mre et moi nous tions dsignes pou r l'accompagner Vienne. Nous n'avions pas os l'esprer, mais nous avions t heureuses d'a er cet honneur ; une intrigue changea les dispositions : quelque temps avant le dpart de la jeune princesse, le 8 novembre, on vint arrter ma mre huit heures du ma tin. Elle n'tait point chez elle ; les deux commissaires attendirent dans sa chambr e jusqu' son retour. Ma mre, qui tait sortie de bon matin, fut avertie au moment o ell e rentrait, et la porte mme de l'htel, par la femme du suisse. Elle alla chez son ho mme d'affaires, qui demeurait rue des Baigneurs, pour se donner le temps de rflchir sur ce qu'exigeait la position. Elle savait qu'on avait arrt la personne qui avait la correspondance du Roi, et que cette personne avait dans ses papiers une lettre q ue ma mre crivait au Roi, en lui en envoyant une de Madame. Elle avait de plus che z elle le manuscrit de M. Hue, qui avait insist pour qu'elle en prt connaissance. El le demeurait donc incertaine de ce qu'elle avait faire, lorsque ma sur, madame de C harost, qui ma mre avait trouv moyen de faire savoir l'endroit o elle tait retire, la it avertir que le manuscrit tait en sret. Rassure sur ce point et ne voulant pas qu'on pt dire qu'elle s'tait cache au moment o elle devait accompagner Madame, elle revint ch ez elle, au risque de ce qui pourrait arriver. Ds qu'elle fut rentre, les commissair es de police firent l'inventaire de ses papiers. Elle dna trs-tranquillement avant d e se rendre l'htel de Brionne, o se tenait le Comit de salut public, qui ne s'ouvrait q u' six heures. Ma sur, madame de Charost, et moi, nous avions suivi ma mre ce Comit. O n nous fit attendre une grande heure dans la pice qui prcdait celle o l'on devait inte rroger ma mre ; on ne manqua pas de nous donner les dtails sur le supplice de M. L emaistre, condamn mort pour correspondance avec la maison de Bourbon, et l'on ajout a que dsormais on userait de la plus grande svrit avec les royalistes et mme les dame s chapeau. On fit subir ma mre un interrogatoire de plus de deux heures, et on la conduisit, onze heures du soir, au collge des Quatre-Nations, dont on avait fait une prison et o on la mit trois jours au secret. La prison du Temple me fut ds lo rs ferme, et Madame partit le 18 dcembre 1795, sans que je fusse admise lui faire mes adieux. Quant ma mre, elle ne nous fut rendue qu'aprs le dpart de Madame pour Vie nne. Depuis sa rentre en France, madame la Dauphine nous a dit que, sur toute la route et Vienne mme, elle avait trouv nos noms sur les logements qui lui avaient t assigns
. On a souvent rpt qu'un des motifs de la rigueur dont on avait us envers nous avait t e nous empcher de suivre la princesse Vienne, parce qu'on supposait que ma mre serai t favorable au dsir de l'empereur de mnager un mariage entre Madame et un archiduc, alliance apprhende par les chefs de la Rpublique franaise. L'hiver de 1795 1796 nous rendit ceux de nos amis et de nos parents qui avaient, c omme nous, chapp aux horreurs des annes prcdentes. Le mariage de mon frre vint porter un peu de joie et de bonheur dans notre intrieu r ; il nous donna une belle-sur aimable et charmante. Augustine de Pons vint habi ter avec nous et ajouter bien des charmes notre runion de famille. Deux annes aprs le mariage de mon frre, un vnement toujours bien grave dans la vie d'un e femme changea ma position ! Le 15 janvier 1797, j'ajoutai mon nom de Tourzel cel ui que M. de Barn me donna... Nous allmes passer une partie de l't qui suivit mon mariage avec M. et madame de Char ost, en Berri, dans leur chteau de Meillant, vrai chteau romantique, mais du roman tique le plus sombre. C'tait une des rares demeures fodales qui avaient chapp au marte au rvolutionnaire ; rien n'y manquait, ni la tour du nord, ni celle de l'ouest. Il tai t remarquable la fois par le caractre de son architecture et son tendue, qui ne co ntribuait pas peu lui donner un aspect imposant et terrible. L'appartement que j'occupais tait spar du salon par la grande salle du chteau, grande sa lle s'il en fut jamais. la nuit, il n'tait pas ncessaire d'y porter de lumire, un norme fourneau de forge se ch rgeant de l'clairer. On n'tait spar de ce fourneau que par une cour fort peu large, et l es forgerons, avec leurs grandes chemises noires, nous rappelaient assez l'atelier mythologique de Vulcain. Aussi quand il me fallait traverser cette salle la nui t, j'tais, je vous l'avoue, fort aise de n'tre pas seule. Le chteau, le fourneau, le pays, n'avaient rien de bien rjouissant, et notre vie se passait d'une manire fort monotone. Un incident vint cependant rompre pour un instant l'uniformit de notre vie. Un cour rier franc trier entre dans la cour : dans le temps o nous tions, c'tait chose peu ord inaire. Ce courrier tait envoy par M. le marquis de Saint-Simon, alors entrepreneur des vlo cifres, diligences d'un modle nouveau ; malheureusement ce ne fut pas la seule chose qu'il entreprit, et il a donn son nom une utopie dont il a voulu faire une religio n. M. de Saint-Simon nous annonait sa visite ; il venait pour tenter d'engager M. de C harost dans quelque affaire. Je ne vous parle de ce fait qu'en raison de la clbrit qu'ont acquise les adeptes de M. de Saint-Simon. Chapitre 17 Nous quittmes Meillant et revnmes Paris. Madame de Charost, si bonne, si tendre sur , tait devenue le centre autour duquel se runissait toute la famille. M. de Charos t, cet excellent homme qui avait pour la famille de sa femme les sentiments d'un f ils et d'un frre, avait recueilli dans sa maison sa belle-mre, ses beaux-frres et bel les-surs ; et cette maison offrait l'image de la plus tendre union. Nous tions heure ux de vivre ensemble, et notre bonheur et t sans mlange si les vnements politiques n't nt pas encore venus troubler notre repos. Une nuit, madame de Charost veille ouvrit un volet de sa chambre coucher, dont la vue donnait sur les Tuileries. Elle fut grandement surprise et effraye en apercev ant des troupes, des canons qui entraient dans le jardin. Elle fit appeler M. de Barn ; celui-ci fut d'avis qu'il fallait quitter immdiatement Paris, et se rendre Abo ndant, terre situe prs de Dreux, et appartenant mon frre, qui s'y trouvait dans ce mo ment avec sa femme. Cet avis fut adopt, mais l'excution tait difficile. Votre pre voulut que, sans paquets, en vitant tout ce qui pourrait indiquer un dpar t, nous quittassions sur-le-champ l'htel en lui donnant le bras. Il se chargeait de nous faire sortir de Paris. Hors les murs, nous prendrions une de ces petites v oitures publiques qui mnent volont, l'important tait de ne point perdre de temps ; le s barrires devaient probablement tre fermes, et les difficults crotraient ds que la no uvelle de ce qui se passait Paris se serait rpandue. Ma mre, ma sur et moi suivmes n otre guide, qui nous mena vers la barrire de Grenelle. Des bateaux conduisaient a
u bas de Passy, hors la barrire, de sorte que, embarqus dans Paris, nous devions db arquer hors Paris sans avoir eu rien dmler avec les gardiens des portes. Les choses se prsentaient merveille ; nous allions entrer dans le bateau, quand d es gardes de la barrire de Grenelle, qui nous aperurent, nous firent signe de nous arrter. La crainte de leurs fusils nous obligea leur obir, et il nous fut signifi que, les ordres tant donns de ne laisser sortir personne de Paris, on ne pouvait passer l'ea u cet endroit. Mon mari objecta qu'tranger Paris, venu de la veille et sans paquets, il voulait re tourner chez lui, et qu'il tait d'autant plus press de s'en aller que sa femme tait gross e, et qu'on paraissait craindre qu'il n'y et du dsordre dans la capitale. Il fallut assez longtemps prorer. Enfin, M. de Barn obtint qu'on nous laisserait pas ser, nous autres femmes ; quant lui, il dut renoncer nous accompagner. Nous nous embarqumes donc, et nous atteignmes l'autre rive, non sans prouver un vif r egret de laisser M. de Barn au milieu du dsordre que nous fuyions. Il nous vit mon ter dans une de ces voitures volont qui conduisent dans tous les environs de Pari s, et le lendemain il trouva le moyen de venir nous rejoindre. L'vnement qui troublant notre repos nous chassait ainsi de Paris, c'tait la journe du 18 fructidor, qui eut des suites si graves. La commotion passe, Paris nous rappela encore, mais nous ne tardmes pas avoir une nouvelle alerte. M. Boulay (de la Meurthe) avait propos l'Assemble une loi qui devai t chasser de France tous les nobles : on vint nous annoncer que la loi avait pas s. Votre pre, mon fils, prenant vite son parti, dcida sur-le-champ qu'il m'emmnerait le lendemain en Suisse pour y faire mes couches. Heureusement la nouvelle du succs d e la proposition de M. Boulay tait fausse, la loi avait t rejete. Nous restmes donc P aris, et le 25 dcembre 1797 Dieu m'envoya votre sur, cette Pauline que j'ai nourrie av ec tant de tendresse, qui nous donna tant d'inquitudes dans ses premires annes, et qu i nous cota tant de larmes quand nous la perdmes, douze ans et demi aprs sa naissan ce. Ma sant, qui s'tait trouve si forte pendant les temps d'preuves, devenait chancelante. L es eaux me furent ordonnes. Je fis deux annes de suite le voyage de Barges. J'emmenai vos deux surs, quand vous, mon cher enfant, encore trop jeune pour me suivre dan s ce long voyage, je vous laissai aux soins de ma mre. Au retour de mon second voyage, je m'tablis chez moi ; je pris mon mnage, et, entoure de mes enfants, j'oubliais bien des peines quand un grand chagrin vint m'assaillir. Ma mre, mon frre, mes surs, furent exils de Paris par ordre de l'Empereur... de l'Empere ur, car pendant que, tout entire aux devoirs et aux joies de la famille, je ne vi vais que pour mon intrieur, le Directoire avait succd la Convention, le Consulat au Directoire et l'Empire au Consulat. Vous jugez de mon dsespoir. Votre pre, que l'Empereur avait appel prs de lui, fit tout ce qui tait en lui pour obtenir le retrait de cette mesure si rigoureuse. Ses ef forts furent inutiles. Ma famille dut partir ; elle alla s'tablir la campagne, chez mon frre. Profondment afflige, je ne savais quel moyen employer pour obtenir le retour de ma famille. Le temps s'coulait ; l'absence de ces tres qui m'taient si chers se prolongeait ; je n'avais nglig aucunes dmarches, mais elles restaient toutes infructueuses. Il ta it cependant de mon devoir d'user de tous les moyens possibles pour ravoir ma mre e t ma famille. Je me dcidai demander une audience l'Empereur. J'eus peine obtenir cett e audience. Enfin elle me fut accorde. Aprs tant d'annes, je fus introduite dans ces Tuileries que j'avais quittes dans des ci rconstances si cruelles. Je ne pus les revoir sans que mille souvenirs du pass, m ille sensations douloureuses, vinssent me serrer le cur. J'tais certainement plus tr ouble, plus malheureuse, plus souffrante que le jour o je quittai le Chteau sous la protection de cet homme qui, le 10 aot 1792, m'en avait tire avec madame de Tarente . L'Empereur me reut avec un visage svre, dans lequel je crus dmler cependant un rayon de bienveillance ; mais, quelle que ft mon insistance, je ne pus obtenir la bonne p arole que j'tais venue chercher. Nous verrons cela plus tard , me dit-il au moment o je pris cong de lui. Ainsi cette dmarche qui m'avait tant cot avait chou, et je prvoyais qu'il faudrait la r
uveler plus d'une fois avant d'arriver au but auquel j'aspirais si ardemment. Cette pe nse n'avait rien qui pt ramener le calme dans mon pauvre cur. J'tais condamne subir lo emps encore cette douloureuse sparation. Cependant la vue de mon frre s'affaiblissait de jour en jour, et il tait menac de dev enir entirement aveugle. Cette circonstance ajoutait aux chagrins de ma famille e t aux miens. Je n'y pouvais plus tenir. Je me dcidai tenter, cote que cote, un nouvel effort. Je pars seule de Paris, j'arrive Compigne, o tait l'Empereur. Votre pre sollicite pour oi une audience ; il vient m'annoncer que dans la matine je serais reue. On me fait descendre dans le salon qui prcde le cabinet. J'attendis avec une anxit que vous pouve z comprendre, j'attendis... toute la journe, et j'attendis vainement ; la porte ne s'ou vrit pas pour moi. Je ne fus pas reue. Vous sentez tout ce que j'prouvai pendant cet te journe d'attente mortelle. N'importe ! mon parti tait pris. J'tais fille, j'tais sur, dcide aller jusqu'au bout. Le lendemain, on me donna le mme espoir que la veille. Je recommenai. Je descendis de nouveau, je fus introduite dans le mme salon, je m'tablis la mme place, je m'armai de patience, j'attendis. J'attendis encore toute la journe, et je ne fus pas plus reue que le premier jour. S'il s'tait agi de moi, je n'aurais pas re nouvel l'preuve, mais il s'agissait de ma mre, de mon frre, de ma sur. Je vins reprendre mon poste le troisime jour ; et je fus enfin admise prs de l'Empereur, dans ce cabin et que pendant les deux jours prcdents j'avais vu s'ouvrir tant de fois inutilement po ur moi. L'Empereur me fit une rception gracieuse ; mais, feignant d'ignorer le motif de ma dma rche, il me demanda quel tait l'objet de ma visite. J'exposai ce que je dsirais si viv ement et depuis si longtemps. Avec quelle anxit j'attendais la rponse ! Elle fut favorable. Il m'accordait le retour de ma mre, de ma famille. Mon cur se rouvrit au bonheur. Il est vrai que l'Empereur fit suivre les paroles consolantes qu'il venait de m'adresser d'un long sermon politiq ue sur la conduite tenir, sur la prudence observer. N'importe ! il me rendait ma mr e et ma famille. Je le quittai touche et reconnaissante. Aprs ces quatre ans d'exil qui nous avaient spars, nous nous retrouvmes donc encore un e fois tous Paris. Nous pmes avec scurit, avec tranquillit reprendre cette vie de fa mille qui tait pour nos curs d'un si grand prix, car le monde s'tait beaucoup rtrci pour nous. Passant l't la campagne, l'hiver Paris, nous vcmes ainsi, en trouvant le bonheu ans notre intrieur, jusqu' cette anne 1813 qui fut si dsastreuse pour les armes de la France. L'anne 1814 s'ouvrit sous des auspices plus menaants encore. La victoire abandonnait l es drapeaux de Napolon qu'elle avait si longtemps suivis. L'tranger avait pntr sur notre territoire, les armes coalises marchaient sur Paris ; le sort de cette grande vill e tait bien incertain. Nous quittmes Paris ; nous nous mmes en route pour la Rochebeaucourt ; nous emmenme s nos enfants, tout notre monde, dans un lieu inhabit depuis cinquante ans, dans un chteau sur lequel vingt ans de rvolutions avaient pass en laissant des traces de leur passage. Vous rappelez-vous que, pour nous rendre dans nos chambres nous t raversions les corridors un parapluie sur la tte ? Il me semble encore entendre v otre oncle nous raconter qu'il a t tourment toute la nuit par un cauchemar horrible, et qu'il a dcouvert le matin que ce cauchemar avait t caus par un filet d'eau qui, filtr ant travers le plafond de sa chambre, lui tait tomb goutte goutte sur le creux de l'estomac. Enfin, tout mal que nous fussions, nous pensions tre l'abri des dangers dont nous c royions Paris menac. Nous attendions les vnements sans pouvoir les prvoir. Cette imm ense fortune qui avait rempli le monde allait-elle tomber ? Chapitre 18 Bientt le bruit se rpandit que la famille royale rentrait en France, que Louis XVI II tait rappel au trne. Vous connaissez mon dvouement pour cette auguste et malheureuse famille. Ce retou r si longtemps inespr me semblait tenir du miracle. Je croyais tre le jouet d'un rve. J'allais donc revoir cette infortune princesse, dont j'avais t la compagne Versailles e t aux Tuileries, pendant son enfance, que j'avais suivie au Temple, que j'y avais re vue avant son dpart pour l'Allemagne, dont, pendant quinze ans, j'avais t spare, mais qu mon cur, accoutum souffrir de tout ce qu'elle souffrait, avait accompagne partout !
On m'crit de Paris que monsieur le duc et madame la duchesse d'Angoulme doivent dbarque r Bordeaux : il n'en fallut pas davantage ; sur-le-champ je pars pour Bordeaux. Madame la duchesse d'Angoulme n'tait point Bordeaux. Monsieur le duc d'Angoulme venait d arriver ; il m'apprend que sa femme vient d'Angleterre avec le Roi, et qu'elle se rend ra directement Paris. Il m'engage ne pas tarder l'aller rejoindre et me donne une le ttre pour elle. Des obstacles imprvus ayant ralenti mon voyage, je craignais d'arri ver trop tard pour tre des premires me jeter dans ses bras quand j'entrai Paris. Elle n'y tait point encore : mais on l'attendait Compigne, o elle devait arriver le len demain ; je partis aussitt pour Compigne. Le marquis de la Suze, mon vieil ami, ayant appris mon arrive, vint me voir aussi tt, et, me reconnaissant des droits tre loge au Chteau, il me fit, en sa qualit de gr and marchal des logis, donner un appartement. Le lendemain, toutes les personnes venues au-devant du Roi taient runies dans un d es grands salons. Les courriers se succdaient de quart d'heure en quart d'heure. Enfi n un dernier courrier annona que l'arrive tait prochaine. On se lve, on forme la haie. Vous savez que je ne me mets gure au premier rang. J'tais derrire, l'cart : mes jambes flchissaient sous moi, mon cur battait bien fort. Tout coup les portes s'ouvrent, un e voix retentissante jette ces mots qui depuis si longtemps n'ont pas t prononcs en F rance : Le Roi ! ces mots, je me sentis trouble jusqu'au fond de l'me. Tous les souven irs de ma jeunesse me refluaient la mmoire. Le pass redevenait l'avenir. Je ne voyai s plus, je n'entendais plus : cependant un cri : Ah ! c'est Pauline ! me rappelle mo i-mme : je me trouve dans les bras de cette chre princesse qui fondait en larmes ; les miennes coulaient en abondance ; la tte appuye sur mon paule, elle resta quelq ues moments sans parler : puis, me prenant par la main, elle me conduisit au Roi , qui tait assis au milieu du salon, et lui dit avec vivacit : Sire, voil Pauline ! Le Roi me prit la main, la posa sur son cur et me dit : Vous n'tes jamais sortie de l, ma chre Pauline, je vous revois avec grand plaisir. Rentre dans ses appartements, madame la duchesse d'Angoulme me fit appeler dans son cabinet : alors mille questions se succdrent sur moi, sur votre pre, sur vous, mes enfants... Quel touchant intrt, quelle aimable sollicitude elle me tmoigna ! Jamais princesse ne sut aimer avec plus de cur ceux qui lui taient dvous. Aprs avoir puis to tes les questions que sa bont et son amiti lui suggrrent sur tout ce qui m'intressait, elle me dit avec une motion extrme : Ma chre Pauline, vous me mnerez au tombeau de m on pre... Il faut que vous sachiez, mon enfant, que j'avais, une des premires, connu l'emplacem ent o avaient t dposs les restes du roi Louis XVI, qu'une des premires je l'avais visit ais mme cueilli sur le gazon qui le couvrait quelques fleurs que j'avais envoyes dan s une lettre madame la duchesse d'Angoulme, encore Mittau cette poque, en lui donnan t quelques dtails sur un objet si intressant pour elle. Avant d'aller plus avant, je veux mettre sous vos yeux un petit crit qui vous fera connatre l'ancien tat du terrain sur lequel s'lve aujourd'hui la chapelle expiatoire de l rue d'Anjou. Chapitre 19 Le petit crit dont je vous ai parl donne une ide parfaitement exacte de ce qui a ra pport la spulture du Roi et de la Reine ; le voici : Un respectable vieillard (M. Descloseaux), propritaire d'une maison contigu au cimet ire de la Madeleine, avait t tmoin oculaire de l'inhumation du Roi et de la Reine. Ce cimetire, dont tant d'excutions remplirent bientt toutes les places, fut d'abord int erdit : quelque temps aprs, la vente en fut ordonne. M. Descloseaux, guid par son attachement pour ceux qu'il y avait vu dposer, s'empressa d'acqurir le terrain qui renfermait leurs prcieuses dpouilles. Il fit entourer d'une haie vive le petit espace qui contenait ces restes prcieux. U n modeste tapis de gazon devint la pierre spulcrale de ce monument : deux saules pleureurs furent plants prs de chaque tombeau. Ds lors cet asile fut regard par le propritaire comme sacr ; il fut ferm tous les pr fanes. M. Descloseaux et ses deux estimables filles eurent seuls la clef de la porte qu i y communiquait. Les annes de troubles, de terreur, se passrent sans qu'on entendt parler de ce jardin .
Cependant les orages politiques s'apaisrent, on osa se rappeler les victimes de la Terreur et, surtout, les deux plus augustes. On se dit l'oreille que, dans le jardin d'un particulier, reposaient le Roi et la Re ine, on se montra de loin les peupliers qui servaient d'indice. On ne se hasarda point encore demander la grce de porter l un douloureux hommage, on ne savait point encore quel sentiment animait le propritaire, quel avait t son b ut, et s'il n'y aurait pas eu quelque danger lui faire connatre le motif d'une dmarche q ui pourrait lui paratre criminelle. Madame la comtesse de Barn (ne Pauline de Tourzel), et son amie la duchesse de la Trmoille (princesse de Tarente), eurent les premires la confiance de hasarder une demande : en 1803, elles allrent dans ce lieu prier et verser des larmes. Ces dames en conduisirent d'autres dont elles taient sres, mais toujours elles taient guides par le pre ou par l'une de ses deux filles. La famille Descloseaux ne voulai t cder personne le droit d'accompagner les visiteurs sur cette terre sacre. Ce fut vers cette poque que, par un bonheur qui ne s'effacera jamais de ma mmoire, j e fus introduit dans ce mystrieux asile : l'air vnrable du pre, l'air modeste de celle d e ses filles qui me conduisait m'inspirrent tout d'abord un profond respect, j'coutai av ec avidit jusqu'au moindre dtail. Je fatiguai mes guides de questions pour n'en ngliger aucune, et cependant j'tais impatient d'approcher de ces tombeaux sacrs. La porte s'ouvre ; j'entre, escort du pre et d'une de ses filles ; un saint respect me s aisit : je tremble de fouler aux pieds cette poussire, qui peut-tre est la cendre de ces augustes victimes. Je ne vous peindrai pas ce que j'ai prouv en me trouvant l, sur cette place, sur ce p etit coin de terre auquel se rattachent tant de sujets de douleur, tant de pnible s souvenirs, et o les grandes rflexions naissent d'elles-mmes. Le Roi et la Reine sont l ! me dit mon respectable guide... Le Roi a t dpos ici ; neu f mois aprs, la Reine, au moment o elle monta sur l'chafaud, demanda que son corps ft mis ct de celui du Roi ; cette grce lui fut accorde : un courrier nous arriva, porte ur de l'ordre de creuser sa fosse auprs de celle du Roi. Cette fosse fut, comme l'ava it t celle du Roi, creuse plus de dix pieds de profondeur. Alors on reconnut que les planches du cercueil du Roi taient encore apparentes. On plaa dans le fond de la fosse un lit de chaux, comme il avait t fait pour le Roi , puis le cercueil, puis un lit de chaux. De l'eau fut rpandue en abondance, le tou t fut recouvert de terre. J'ai t tmoin oculaire de tout ce que je vous raconte, j'tais a fentre et je suivais le travail des ouvriers. Mon gendre a t oblig d'assister cette triste crmonie comme garde national ; lui, mes deux filles et moi, voil quatre tmoin s existant dans ma maison... Vous voyez ici, ct, la place o ont t enterres les person es qui ont pri lors du mariage de Louis XVI. Un peu plus loin les Suisses, victim es du 10 aot, et quelques autres personnes attaches au Roi ; l-bas, au bout du jard in, sont les membres du Comit de salut public, et d'autres jacobins ple-mle avec eux. Ainsi les dcrets de la Providence avaient voulu que les victimes et les bourreaux fussent confondus dans le mme cimetire ! Je sortis mu jusqu'aux larmes ; je reviendrai souvent visiter ce tombeau : je revie ndrai y mditer ; que de sujets de mditation ! Ce rcit est d'un homme tendrement attach au Roi. Louis XVI avait une bont laquelle il tait difficile de rsister quand on approchait de sa personne. Barnave et Dumourie z l'aimrent ds qu'ils le connurent, et il y eut jusque dans la tour du Temple des muni cipaux qui se sentirent mus l'aspect de tant de patience, de douceur et de vertu. M. Descloseaux tait g de plus de quatre-vingts ans l'poque de la Restauration ; sa vie se prolongea assez pour qu'il pt remettre la famille royale le dpt sur lequel il ava it veill. Son jardin lui fut achet par Louis XVIII. Une pension lui fut donne, rvers ible sur la tte de ses filles. Il reut le cordon de Saint-Michel, et, en outre, il jouit, pendant quelques annes, des tmoignages d'estime si bien dus son attachement, son dvouement et sa noble conduite. Le lendemain de son arrive Paris, madame la duchesse d'Angoulme, par un petit billet , me manda de venir la voir avec votre pre et nos enfants. Vous vous souvenez de la bont touchante avec laquelle elle nous reut. Il est impossible de douter d'un intrt exprim avec tant d'abandon. Elle me rpta qu'elle dsirait que ce ft moi qui la menasse spulture de son pre. Le Roi, ajouta-t-elle, ne lui avait pas encore accord la perm ission d'y aller, apparemment parce qu'il voulait vrifier l'exactitude des dtails donns
e sujet. Ds que cette permission lui serait accorde, elle m'en prviendrait. Quelque temps aprs elle me manda que cette visite, objet si douloureux et cependa nt si ardemment dsir, aurait lieu le lendemain. Sur-le-champ je fis prvenir M. Descloseaux, afin que sa maison ne ft ouverte que p our Madame ; vous vous le rappelez, c'est vous, mon fils, qui avez rempli cette mi ssion. sept heures du matin, nous montmes avec Madame en voiture. La princesse n'avait auc une suite ; rien ne pouvait la faire reconnatre ni indiquer o elle allait. Nous nous rendmes rue d'Anjou, chez M. Descloseaux. Madame tait vtue d'une robe trs-simp le ; son chapeau tait couvert d'un grand voile. Elle gardait un morne silence. Je r espectai cette douleur muette. Nous fmes le trajet sans changer une parole. Je voy ais combien elle souffrait. Au moment o la voiture s'arrta, la petite porte de la maison s'ouvrit. Madame descendi t ; elle s'appuyait sur mon bras et sur le vtre, mon fils. Sur le seuil, nous trouvmes l'une des filles de M. Descloseaux. Par un signe de la main, elle nous indiqua le chemin prendre, mais pas une parole ne sortit de ses lvres ; aucun signe de respect n'annona qu'elle connaissait le nom de celle qui venait visiter la tombe de Louis XVI et celle de Marie-Antoinette. l'entre du jardin, la seconde fille de M. Descloseaux tait son poste. Elle tendit silencieusement le bra s, montra de quel ct il fallait tourner. Prs du tombeau se tenait le vnrable vieillar d, qui, dans un silence respectueux, l'indiqua Madame. Une croix de bois noir marquait la place. Madame s'en approche avec un tremblement qui agite tout son corps ; elle se jette genoux sur ce tombeau, se prosterne, e nfonce sa tte dans l'herbe qui le couvre et reste pendant quelque temps absorbe dans sa douleur. Je m'tais mise genoux. Je pleurais et je priais. Quand Madame releva la tte, je vis son visage inond de larmes ; les yeux au ciel, les mains jointes, elle fit cette prire, qui se grava dans mon cur et ne s'en effacera jamais : mon pre ! vous qui m'avez obtenu la premire grce que je vous aie demande, celle de re oir la France... obtenez que je la voie heureuse ! Ainsi la premire fois que la fille de Louis XVI s'agenouillait sur le tombeau de so n pre, elle remerciait Dieu d'avoir revu la France, et elle lui demandait de la voi r heureuse ! Aprs cette prire, elle baisa la place o reposaient son pre et sa mre, se releva et re prit d'un pas chancelant le chemin qui la ramenait sa voiture. En passant, elle saisit la main du bon vieillard et la serra affectueusement : e lle en fit autant chacune de ses filles quand elle passa prs d'elles ; mais pas un mot ne fut dit. Dans le lieu o reposaient ces vnrables reliques, la seule parole qu i pt tre prononce, c'tait une prire. La fille de Louis XVI agenouille ne pouvait parler qu' Dieu. Une fois monte en voiture, elle se jeta mon cou, me remercia du douloureux bonheu r que je lui avais procur par cette visite, qui avait fait tant de bien et tant d e mal son pauvre cur. Il ne me reste maintenant que bien peu de choses vous dire. Les temps les plus c almes et les plus heureux de la vie sont ceux qui passent le plus vite et fourni ssent le moins de souvenirs la mmoire, le moins de matire aux rcits. Les annes de la Restauration s'coulrent rapidement. Madame m'avait permis de la voir aussi souvent que je le voudrais ; je profitai av ec empressement de la permission, et j'allais de bonne heure chez elle, car elle ta it toujours leve de grand matin. L, de douces conversations me faisaient reconnatre le fond de son cur. Elle aimait tendrement la France, elle dsirait son bonheur. D auphine, elle fit tout le bien qu'elle put ; ses charits furent immenses ; elles al lrent chercher sans distinction d'opinion tous ceux qui souffraient ; Reine, elle a urait employ son influence de manire confondre ceux qui ont t si injustes son gard. a fille de Louis XVI n'a t mconnue que par ceux qui l'ont juge distance. Les princes, d t-on, n'ont point d'amis. Madame ferait donc parmi eux une exception ; elle avait de s amis sincres, dvous et dsintresss, parce qu'elle mritait d'en avoir. Quand elle quitta la France au mois d'avril 1815, aprs avoir montr Bordeaux qu'elle tai t la digne fille de la grande Marie-Thrse, j'tais la campagne, en Picardie. C'tait enco e un coup dont la Providence la frappait ; mais elle devait en recevoir un plus
terrible. Du moins aprs les Cent-Jours elle revint. Madame la duchesse d'Angoulme, lorsqu'elle avait form sa Maison, m'avait nomme l'une de se dames. Cette place, je ne l'avais pas ambitionne. Madame m'avait donn le titre de son amie, mon ambition et mon cur taient satisfaits. Je n'tais plus jeune : Madame menai t une vie bien active ; ma sant tait affaiblie, j'avais besoin de repos ; mais o est notre cur, l nous sommes tout entiers. Madame m'appelait : j'tais elle, je vins. Je fis avec elle quelques voyages : Bordeaux, aux eaux, dans les provinces, en V ende. Je montais cheval souvent avec elle ; elle tait pour moi toujours bonne, tou jours tendre. Au mariage d'Alix, ma fille, elle me donna une nouvelle marque de cette bont. Quoiq ue le nombre de ses dames ft fix et complet, elle donna une place ma fille. En m'ann onant cette grce, elle me dit que ma fille me supplerait toutes les fois que j'en sen tirais le besoin. Alix devint ma compagne. Je voudrais maintenant qu'elle la ft ici ; elle manque notre runion ; elle y porterait le charme et la gaiet de son caractr e ; mais, aprs s'tre concili l'estime de ceux qui l'ont connue la cour et ne s'y tre fa e des amis, la campagne, aujourd'hui, elle cherche faire des heureux. En 1823, pendant la guerre d'Espagne, que M. le duc d'Angoulme fit la tte de l'lite de l me franaise, madame la duchesse d'Angoulme vint s'tablir Bordeaux, afin d'tre plus p nouvelles. Vous vous souvenez, mon fils, avec quelle bont cette chre princesse vo ulut que nous vinssions, vous et moi, passer prs d'elle ces jours d'attente, et vous pouvez comme moi raconter avec quelle charmante affabilit elle accueillait succes sivement tous les jours sa table et dans ses salons les diffrents chefs des maiso ns de commerce de Bordeaux. Il tait touchant de voir la bont avec laquelle la princesse entrait avec chacun da ns des dtails qui ne pouvaient avoir d'intrt que pour les hommes initis la science du commerce ; mais Madame trouvait toujours interroger, couter et rendre heureux tou s ceux qui avaient l'honneur de l'approcher. Chapitre 20 Maintenant je n'ai plus vous parler, mon cher Hector, que d'un vnement que vous avez c onnu comme moi, triste dnoment sur lequel se fermeront ces Souvenirs. Le 3 aot 1830 , j'tais la campagne ; Madame la Dauphine arrivait d'un voyage pendant lequel de gran ds et terribles vnements s'taient accomplis. Une nouvelle rvolution tait sortie du sol de la France, min par tant de passions. La princesse tait Rambouillet, prte en part ir pour un nouvel exil. Je me rendis en toute hte Rambouillet. Je l'embrassai ; nos larmes se confondirent. Elle me remit alors comme dernier souvenir le cachet qu e sa mre, la Reine Marie-Antoinette, avait toujours port sur elle, appendu sa mont re, et que cette infortune Reine, en quittant le Temple, avait donn sa fille. En l'e mbrassant pour la dernire fois : Je n'ai rien de plus cher ni de plus prcieux, ma chr e Pauline, me dit cette bonne princesse ; je ne me serais spare de ce souvenir pou r personne au monde[1]. Mais vous avez t pour moi plus que personne... Adieu ; que lles que soient les nouvelles preuves que Dieu me rserve encore, nos curs se retrou veront toujours !... Nous nous sparmes alors, hlas ! peut-tre pour ne plus nous revoir. Toujours soumise la volont de Dieu, toujours forte, toujours rsigne, elle va o la Providence la mne, e n emportant dans son cur cet inpuisable amour pour la France qui a rsist tant d'preuve et tant d'exils. Elle s'en va en soutenant aux jours de sa maturit Charles X, comme aux jours de sa jeunesse elle a soutenu Louis XVIII. Grande princesse, sainte pr incesse, d'une me si haute, d'un caractre si ferme, d'un cur si bon ! C'est pour moi une c nsolation de lui rendre ce tmoignage devant ma famille runie, et, puisque vous ave z voulu, mon fils, que j'voquasse les souvenirs les plus chers de ma vie, c'est sur l e nom vnr de la fille de Louis XVI, dont l'amiti a fait le bonheur et la gloire de ma vie, que se fermera ce rcit. Ici se terminent les rcits obtenus de madame de Barn. Je n'y ai rien chang. Je n'oserai s y ajouter un seul mot. Si ces pages retracent de bien hautes et de bien touchantes infortunes, la vie d e madame de Barn, dans laquelle il m'a t donn de lire, m'a rvl bien des vertus. fin
Vous aimerez peut-être aussi
- La Révolution FrançaiseDocument761 pagesLa Révolution FrançaiseNicolas BecquetPas encore d'évaluation
- Wall Street Et La Révolution Bolchévique - Sutton Antony CyrilDocument130 pagesWall Street Et La Révolution Bolchévique - Sutton Antony CyrilvbeziauPas encore d'évaluation
- Contre Revolution BureaucratiqueDocument152 pagesContre Revolution BureaucratiqueNizar Ben HassenPas encore d'évaluation
- Hitler - L'irrésistible Ascension ?Document256 pagesHitler - L'irrésistible Ascension ?Guillaume Jutras-BergeronPas encore d'évaluation
- CatalogueDocument36 pagesCatalogueHenri JaffrezicPas encore d'évaluation
- Trotskisme Ou Leninisme Harpal BrarDocument613 pagesTrotskisme Ou Leninisme Harpal Brarsimon verdunPas encore d'évaluation
- 1944 1945 Le Tiomphe de La LiberteDocument379 pages1944 1945 Le Tiomphe de La LiberteClea Mounette100% (1)
- Enzo Traverso-De L'anticommunisme-L'histoire Du XXe Siècle Vue Par Nolte, Furet Et CourtoisDocument27 pagesEnzo Traverso-De L'anticommunisme-L'histoire Du XXe Siècle Vue Par Nolte, Furet Et CourtoisneirotsihPas encore d'évaluation
- Prevert Jacques ParolesDocument32 pagesPrevert Jacques ParolesНаташа ЛујићPas encore d'évaluation
- Les Illuminati PDFDocument7 pagesLes Illuminati PDFmipumoPas encore d'évaluation
- Jean Jacques Marie - Le Fils Oublié de TrotskyDocument192 pagesJean Jacques Marie - Le Fils Oublié de TrotskyJuan100% (1)
- De L'intérieur, Voyage Au Pays de La Désillusion PDFDocument93 pagesDe L'intérieur, Voyage Au Pays de La Désillusion PDFClea Mounette100% (1)
- Souvenirs de 40 AnsDocument47 pagesSouvenirs de 40 AnsClea MounettePas encore d'évaluation
- Les Guignols - L'agenda Secret de Jacques Chirac (1993) PDFDocument66 pagesLes Guignols - L'agenda Secret de Jacques Chirac (1993) PDFClea Mounette100% (1)
- Baro Politique HP JulDocument9 pagesBaro Politique HP JulClea MounettePas encore d'évaluation
- Pub Jean Giono Collection Monographique Rodopi en LittDocument156 pagesPub Jean Giono Collection Monographique Rodopi en LittIsa Doğan100% (1)
- 3C Etudes - Image de La Tunisie Post-Révolution en France Et Impact Sur Le Tourisme TunisienDocument4 pages3C Etudes - Image de La Tunisie Post-Révolution en France Et Impact Sur Le Tourisme TunisienSamia HasPas encore d'évaluation
- Le Monde DiplomaTiQue Octobre2011Document28 pagesLe Monde DiplomaTiQue Octobre2011Marc-Andre LavoiePas encore d'évaluation
- SUAREZ, Lucía M Ruin Memory Havana Beyond The RevolutionDocument19 pagesSUAREZ, Lucía M Ruin Memory Havana Beyond The RevolutioncarolillanesPas encore d'évaluation
- Metropoles 2562 3 La Ville Comme Machine A MobiliteDocument27 pagesMetropoles 2562 3 La Ville Comme Machine A MobiliteЕлена ТрубинаPas encore d'évaluation
- La Vie Et L'oeuvre Du Front de Libération Du QuebecDocument30 pagesLa Vie Et L'oeuvre Du Front de Libération Du QuebecPaula MPas encore d'évaluation
- M. Robespierre - Oeuvres Complètes (Tome VI) PDFDocument744 pagesM. Robespierre - Oeuvres Complètes (Tome VI) PDFArnOmkarPas encore d'évaluation
- Kali YugaDocument4 pagesKali YugacontrepoisonPas encore d'évaluation
- Devoir Histoire MR Markovic 4em2021 (1) (Récupération Automatique) Fini 5 Alma Lawson 4emDocument10 pagesDevoir Histoire MR Markovic 4em2021 (1) (Récupération Automatique) Fini 5 Alma Lawson 4emAlma LawsonPas encore d'évaluation
- Ch2 El Europe Restauration RévolutionDocument4 pagesCh2 El Europe Restauration RévolutionShirley HePas encore d'évaluation
- AH%Document1 pageAH%Lionel BoneuryoPas encore d'évaluation
- Oeuvres de Napoléon Bonaparte, Tome I. by Bonaparte, Napoléon, 1769-1821Document389 pagesOeuvres de Napoléon Bonaparte, Tome I. by Bonaparte, Napoléon, 1769-1821Gutenberg.org100% (1)
- Symboles de La Révolution FrançaiseDocument10 pagesSymboles de La Révolution FrançaiseMariePas encore d'évaluation
- Crise Haitiano Dominicaine Leslie ManigatDocument19 pagesCrise Haitiano Dominicaine Leslie Manigatjean_juniorjPas encore d'évaluation
- Nu Stiu BossDocument4 pagesNu Stiu BossariiscoolPas encore d'évaluation
- Special BouteflikaDocument31 pagesSpecial BouteflikaArref MichnyPas encore d'évaluation
- Les Symboles de La République FrançaiseDocument9 pagesLes Symboles de La République FrançaiseSebi MarișPas encore d'évaluation
- Alger Divise Le FLN: Liste Pour Les LégislativesDocument21 pagesAlger Divise Le FLN: Liste Pour Les LégislativesnaasnaasPas encore d'évaluation
- Maximilien ROBESPIERRE TomeVIII Discours-3ePartieDocument488 pagesMaximilien ROBESPIERRE TomeVIII Discours-3ePartieloggonPas encore d'évaluation
- Georg Lukacs. Sur La Question Du ParlementarismeDocument21 pagesGeorg Lukacs. Sur La Question Du ParlementarismeJean-Pierre Morbois100% (1)