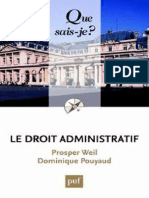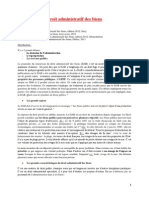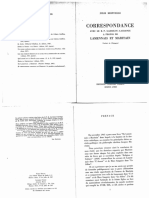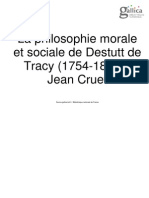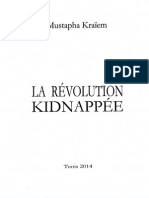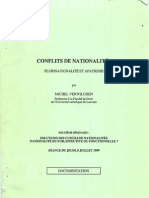Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Précis de Droit Administratif, Contenant Le Droit Public Et Le Droit Administratif, Par Maurice Hauriou
Transféré par
AthosBarbosaLimaTitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Précis de Droit Administratif, Contenant Le Droit Public Et Le Droit Administratif, Par Maurice Hauriou
Transféré par
AthosBarbosaLimaDroits d'auteur :
Formats disponibles
Prcis de droit administratif, contenant le droit public et le droit administratif, par Maurice Hauriou,...
Source gallica.bnf.fr / Bibliothque nationale de France
Hauriou, Maurice (1856-1929). Prcis de droit administratif, contenant le droit public et le droit administratif, par Maurice Hauriou,.... 1893.
1/ Les contenus accessibles sur le site Gallica sont pour la plupart des reproductions numriques d'oeuvres tombes dans le domaine public provenant des collections de la BnF.Leur rutilisation s'inscrit dans le cadre de la loi n78-753 du 17 juillet 1978 : *La rutilisation non commerciale de ces contenus est libre et gratuite dans le respect de la lgislation en vigueur et notamment du maintien de la mention de source. *La rutilisation commerciale de ces contenus est payante et fait l'objet d'une licence. Est entendue par rutilisation commerciale la revente de contenus sous forme de produits labors ou de fourniture de service. Cliquer ici pour accder aux tarifs et la licence
2/ Les contenus de Gallica sont la proprit de la BnF au sens de l'article L.2112-1 du code gnral de la proprit des personnes publiques. 3/ Quelques contenus sont soumis un rgime de rutilisation particulier. Il s'agit : *des reproductions de documents protgs par un droit d'auteur appartenant un tiers. Ces documents ne peuvent tre rutiliss, sauf dans le cadre de la copie prive, sans l'autorisation pralable du titulaire des droits. *des reproductions de documents conservs dans les bibliothques ou autres institutions partenaires. Ceux-ci sont signals par la mention Source gallica.BnF.fr / Bibliothque municipale de ... (ou autre partenaire). L'utilisateur est invit s'informer auprs de ces bibliothques de leurs conditions de rutilisation.
4/ Gallica constitue une base de donnes, dont la BnF est le producteur, protge au sens des articles L341-1 et suivants du code de la proprit intellectuelle. 5/ Les prsentes conditions d'utilisation des contenus de Gallica sont rgies par la loi franaise. En cas de rutilisation prvue dans un autre pays, il appartient chaque utilisateur de vrifier la conformit de son projet avec le droit de ce pays. 6/ L'utilisateur s'engage respecter les prsentes conditions d'utilisation ainsi que la lgislation en vigueur, notamment en matire de proprit intellectuelle. En cas de non respect de ces dispositions, il est notamment passible d'une amende prvue par la loi du 17 juillet 1978. 7/ Pour obtenir un document de Gallica en haute dfinition, contacter reutilisation@bnf.fr.
L'ARDOUIE 2009
PRCIS DE
DROIT
ADMINISTRATIF CONTENANT
LE
DROIT
PUBLIC
ET
LE
DROIT
ADMINISTRATIF
PAR MAURICE HAURIOU
ALAFACULT DETOULOUSE PROFESSEUR DEDROIT ADMINISTRATIF DEDROIT
DEUXIME DITION
PARIS LIBRAIRIE DU RECUEIL GNRAL DES LOIS ET ARRTS ETDUJOURNAL DUPALAIS L. LAROSE & FORCEL, DITEURS 22, RUE SOUFFLOT,22 1893 Tousdroitsrservs.
PRCIS DE
DROIT
ADMINISTRATIF
ANGERS, IMP. BURDIN ETCie,
4, RUE GARNIER
PRCIS DE
DROIT
ADMINISTRATIF CONTENANT
LE
DROIT
PUBLIC
ET
LE
DROIT
ADMINISTRATIF
PAR MAURICE HAURIOU
DETOULOUSE ALAFACULT DEDROIT PROFESSEUR DEDROIT ADMINISTRATIF
DEUXIME DITION
PARIS LIBRAIRIE DU RECUEIL GNRAL DES LOIS ET ARRTS ET DU JOURNAL DUPALAIS L. LAROSE & FORCEL, DITEURS 22, RUE SOUFFLOT,22 1893 Tousdroits rservs.
PRFACE
J'ai voulu faire une double entreprise : La premire est suffisamment expose au dbut de ma thorie de l'tat ; j'ai voulu tenter une tude de droit public o la conception juridique de l'tat, qui repose, ce que je crois, sur le postulat d'un concert de volonts libres, et la conception des sciences sociales, qui est au contraire dterministe et organique seraient utilises toutes les deux ; j'estime que pour se rendre compte de la ralit des rapports sociaux, il est ncessaire de se placer l'un et l'autre point de vue, et qu' adopter l'un des deux d'une manire exclusive, on risque de voir faux. La seconde entreprise demande tre explique plus londu droit administratif, guement. Dans l'exposition juridique j'ai voulu, mettant profit certains rsultats considrables du Conauxquels, dans ces dernires annes, la jurisprudence seil d'tat a abouti, reprendre une mthode inaugure il y a trente ans par Batbie et M. R. Dareste, et tenter d'organiser ce droit d'aprs la thorie de la personnalit. I. Voici, me semble-t-il, l'tat dans lequel la tentative de Batbie et de M. Dareste, aprs qu'elle et produit tout son effet, avait laiss la science. On reconnaissait l'exisdans le corps du droit administratif tence de trois groupes de rgles : 1 Le groupe des rgles de fond o dj tout gravitait autour de la thorie de la personnalit ; il comprenait les rgles sur l'organisation sur la constic'est--dire, administrative, tution mme des personnes administratives, tat, dparte-
II ments,
PRFACE
communes, etc. ; puis les rgles sur les droits de ces personnes morales, avec cette observation que ces droits ne dpassaient pas la notion du domaine priv, et que toute la puissance publique restait en dehors ; 2 Le groupe des rgles de procdure ou du contentieux, qui s'tait form l'occasion des litiges suscits par l'activit de et qui d'ailleurs, comme il arrive toujours l'administration, dans les droits nouveaux, contenait encore beaucoup de rgles de fond mlanges aux rgles de forme; 3 Le groupe des rgles sur l'administration et sur l'acte d'administration, qui s'tait constitu le dernier, qui devait son existence la pratique du recours pour excs de pouvoir diet qui rig contre les dcisions des autorits administratives, comprenait des rgles sur les conditions d'existence et de validit de ces dcisions. Or, de ces trois groupes de rgles, il y en avait un que l'on n'avait pas pu rattacher la thorie de la personnalit, c'tait le dernier. On n'avait pas vu tout de suite ce qu'est l'acte d'administration et o il peut tre class. Pendant longtemps on avait pris le parti de le rejeter dans le En effet, il y touche de trs prs contentieux. ; c'est par lui que les droits des particuliers sont viols ou leurs intrts froisss ; c'est, par suite, son occasion que le litige nat, une observation superficielle devait porter croire qu'il tait partie intgrante du litige. On assimilait donc les dcisions administratives des jugements, l'administrateur qui se prononait sur une question d'administration intressant un particulier, tait considr comme un juge tranchant un vritable dbat entre l'intrt gnral et l'intrt priv. Plus tard, si sa dcision tait attaque devant un tribunal, on estimait que le recours du particulier n'tait qu'un recours en appel. On appliquait surtout c'tait la docce raisonnement aux dcisions ministrielles, trine du ministre-juge. Cela ne satisfaisait point tous les esprits, cependant, on sentait qu'il y avait dans cette assimilation quelque chose de
PRFACE forc;
III
ne pouvait pas tre un juque l'acte d'administration gement terminant un litige, puisqu'au contraire c'tait lui qui sous peine de cond'autre ce et, que part, litige; provoquait ne pouvaient fondre toutes les notions, tous les administrateurs on s'attardait dans en transforms tre Cependant juges. pas cette erreur, au grand dtriment de la conception gnrale du droit administratif. Le Conseil d'tat est enfin sorti du cercle enchant en conen sparant l'adminisdamnant la doctrine du ministre-juge, en dclarant que l'acte d'administratration et la juridiction, mais une simple mation n'est point une dcision judiciaire, de cette volution nifestation de volont. Les consquences sont d'une trs grande porte. de jurisprudence La question se pose en effet tout de suite de savoir ce qu'est de volont renferme cette manifestation dans l'acte d'admine l'analyse plus en un jugement, et nistration, puisqu'on voici la seule rponse possible: Si l'on rflchit que derrire l'administrateur qui prend la dcision, il y a une personne adou commune, pour le compte ministrative, tat, dpartement de laquelle l'administrateur agit; que cette personne administrative. pour remplir sa mission qui est d'assurer le fonctionnement des services publics, a des droits exercer, on arrive facilement cette conclusion que l'acte d'administration est une dcision relative l'exercice des droits, et que d'une faon est l'exercice des droits des personnes gnrale, l'administration administratives. De fait, pour que cette vrit n'ait pas apparu plus tt, il faut qu'on ait prt peu d'attention ce qui se passe en droit priv. En droit priv aussi, il y a un exercice des droits et des individu Sans doute, lorsqu'un rgles sur l'administration. majeur et capable administre sa propre fortune, le droit n'intervient pas, car il respecte la libre initiative de l'individu ; mais ds qu'il s'agit de l'administration de la fortune d'autrui ou de celle d'un incapable, il intervient et pose des rgles d'administration. Faut-il rappeler en droit civil, les rgles de la tutelle, celles de l'administration des biens de la femme
IV
PRFACE
marie, des biens du mineur mancip? en droit commercial, les rgles sur l'administration des socits? A plus forte raison, devait-il tre pos des rgles en droit administratif, o il des intrts s'agit de l'administration, par des mandataires, de personnes purement fictives, alors surtout que ces intrts constituent au fond la fortune nationale, et qu'il ya ainsi, au de la fortune d'autrui. premier chef, administration Que si le droit priv, tout en traant des rgles sur l'administration et sur l'exercice des droits, n'a pas dtach et rglement part l'acte d'administration comme l'a fait le droit s'il n'a pas cr contre lui de recours, cela tient administratif, ce que ni chez les particuliers ni pour les socits commeravant d'tre ciales, la dcision ne se manifeste extrieurement tandis que dans l'administration excute; publique elle se manifeste et peut tre saisie avant son excution. Ds lors, les trois groupes de rgles que nous avons signals plus haut se relient l'un l'autre d'une faon logique dans l'ordre suivant: les rgles de fond sur les personnes administratives et sur leurs droits; les rgles sur l'administration ou sur l'exercice des droits; les rgles sur le contentieux ou sur les litiges qui peuvent tre provoqus par l'exercice des droits. Et le tout repose bien sur l'ide de personnalit juridique. Il subsiste toutefois une difficult: pour que l'administration tout entire soit ramene n'tre que l'exercice des droits, il faut que toutes les matires administratives puissent tre administrarduites en droits appartenant aux personnes ti ves ; or, si tout ce qui est gestion du domaine priv est depuis longtemps dj rattach des droits, il n'en est pas de mme de ce qui est opration de puissance publique, et notamment de ce qui est matire de police, sous le prtexte que dans ces matires les droits ne seraient plus comparables ceux des particuliers. Il y a l un pas qu'il faut franchir ; il faut reconnatre que la personnalit juridique dont sont doues les units administratives, n'est pas borne la jouissance des droits privs,
PRFACE mais qu'elle va au elle peut comporter droit commun; ou faut confesser que celle personnalit :
del, et que par une extension naturelle des droits administratifs exorbitants du si l'on prfre cette faon de s'exprimer, il ont une double les units administratives de personne prive qui leur donne la jouissance des droits pri vs, et celle de puissance publique qui leur confre la jouissance des droits de puissance, y compris les
droits de police. Il n'y a pas cela une grande hardiesse. Tous les droits ne sont pas des droits privs ; il y a longtemps que dans les relations internationales on reconnat l'tat des droits de souveune personnalit de puissance rainet, et, par consquent, publique. Cette conception, sur laquelle repose le droit international public, il suffit de la faire passer dans le droit national; l'ancien droit nous avait devancs dans cette voie en dterminant les droits rgaliens de l'tat; il suffit aussi de l'tendre aux personnes administratives secondaires membres de l'tat, l'ancien droit ne reconnaissait-il pas, certaines communes, des privilges seigneuriaux qui n'taient que des droits de police ? Il faut donc dire: le droit de domaine public, le droit d'imles droits de police, comme on pt, le droit d'expropriation, dit le droit de domaine priv, et classer dans le groupe des rgles de fond tout ce que l'on est convenu d'appeler matires administratives. Ou, si l'on veut, il faut que tout ce que l'on est habitu ranger parmi les attributions des autorits admiaux nistratives, apparaisse sous forme de droit appartenant personnes administratives. On doit tre d'autant plus dispos donner ce dveloppement la personnalit juridique en matire administrative, que toutes les rformes politiques accomplies en ce sicle au nom de la dcentralisation, ont eu pour rsultat de dgager de plus en plus cette personnalit. ont t se multiD'abord, les personnes administratives centralisatrice pliant. Au dbut du sicle, avec l'organisation de l'an VIII, l'administration tait l'uvre de l'tat seul; sans
VI
PRFACE
des communes tait admise, mais elle doute, la personnalit n'tait pas trs agissante; celle des dpartements sommeillait; les tablissements publics n'taient pas nettement distingus des tablissements d'utilit publique. A l'heure qu'il est, au tablissements contraire, communes, dpartements, publics ont une personnalit trs nette et trs agissante ; ils collaborent avec l'tat l'administration, et exercent certainement des droits de mme nature que les siens. Le droit administratif s'est donc peupl de personnes administratives. De plus, l'organisation dcentralisatrice, aux diverses circonscriptions ou units contribu beaucoup qui a t donne a administratives, mettre en vidence la
par elle-mme personnalit juridique qui se cache en elles. Le propre de cette organisation est d'avoir dot chaque unit administra-
ou commune, de deux organes: un organe tive, dpartement dlibrant constitu par une assemble issue du vote popuet un organe exlaire, conseil gnral ou conseil municipal, cutif, prfet ou maire; et chacun de ces deux organes a une valeur relle, tandis qu'avec l'organisation de l'an VIII, l'organe excutif, le prfet ou le maire, avait seul de l'im portance. Or, la remarque est peut-tre subtile, mais elle est fonde, la personnalit fictive des units administratives disparaissait facilement derrire l'action d'un organe unique, tandis fatalement au travers de l'action de deux qu'elle transparat le maire absororganes. Le prfet absorbait le dpartement, bait la commune; on pouvait ne pas faire attention que les attributions du prfet taient relatives l'exercice des droits du dpartement, du maire cachaient des que les attributions droits de la commune; on ne voyait que le prfet et ses attriA prsent, puisque le butions, le maire et ses attributions. conseil gnral et le prfet agissent chacun de son ct et qu'il y a cependant unit d'action, on est bien oblig de faire attention que cs deux organes agissent au nom d'une seule et mme personne fictive qui est le dpartement; de mme pour le conseil municipal et le maire. En d'autres termes, la a fait pntrer sparation des pouvoirs, que la dcentralisation
PRFACE
VII
et communale, dans l'organisation dgage la dpartementale a comme elle et de la du commune, dpartement personnalit dj dgag celle de l'tat. la table des matires, comII. On verra, en feuilletant ment j'ai mis profit ces rsultats acquis. Pour des raisons de commodit d'exposition, j'ai plac en la matire de l'administratte, dans un livre prliminaire, et du recours pour excs de tion, de l'acte d'administration pouvoir. Dans les livres I et II, j'ai plac ensuite la matire de l'organisation des personnes et de leurs droits. L administratives sont toutes les rgles de fond du droit, et toutes convergent vers l'ide de la personnalit juridique. rigoureusement Les droits sont diviss en droits de puissance publique et droits de personne prive, coup d'il les diffrences afin de faire apparatre au premier qui sparent les personnes administratives des personnes ordinaires. Cette disposition a l'avantage de prparer du mme coup pour le contentieux administratif, la solution de la difficile question du partage d'attribution entre les tribunaux judiciaires et les tribunaux ad ministratifs, car les oprations de puissance publique entranent en principe la comptence des tribunaux administratifs, tandis en principe que les oprations de personne prive entranent celle des tribunaux judiciaires. Entte des droits de puissance publique sont les droits de police. III. Je ne me dissimule pas les critiques que cet agencement rigoureux des matires est de nature soulever. On pourra objecter que c'est singulirement rapetisser l'administration que de ne plus la considrer en soi, de la regarder comme un simple exercice de droits et de la subordonner ce qu'il y a de ainsi, elle qui justement est trs extrieure, plus abstrait dans le corps du droit, la thorie de la personnalit. On se demandera avec quelque inquitude si la rubrique accoutume des attributions des diverses autorits administratives ne va pas trop perdre de son importance. On pourra objecter encore, qu'il ya quelque inconvnient
VIII
PRFACE
confondre sous la mme rubrique de droits des personnes administratives des matires aussi dissemblables que les droits de le domaine police, le droit de domaine public, l'expropriation, priv, etc. On s'apercevra cependant bien vite que ce sont des habitudes de langage qui sont heurtes beaucoup plus que des ides, et qu'en effet, le langage n'tait peut-tre plus bien en harmonie avec les ides courantes. Non seulement la conception du droit administratif que j'expose, et laquelle je ne fais que donner tout son dveloppement logique, a t accueillie avec faveur il y a trente ans, lorsque, pour la premire fois, elle s'est produite; mais elle se retrouve latente et comme prte jaillir dans tous les bons du Conseil ouvrages modernes et surtout dans lajurisprudence d'tat dont les meilleurs de ces ouvrages sont remplis. C'est le Conseil d'tat qui a fait le droit administratif franais. Or, il a eu ds le dbut et il a poursuivi avec une persvrance admirable cette conception que le droit administratif, tout en tant un droit spcial, se rattachait nanmoins l'ensemble du droit, et il s'est appliqu constamment en constituer la partie vraiment juridique. C'est lui qui a donn son achvement la thorie des personnes administratives en tablissant la distinction entre les tablissements publics qui sont membres de l'tat, et les tablissements d'utilit publique qui ne le sont pas, qui ne sont dj plus que des tablissements privs soumis une tutelle de l'tat, et en posant ainsi la barrire o s'arrte la personnalit publique. C'est lui qui, propos de la comptence des tribunaux a cr la distinction capitale des droits de administratifs, puissance publique et des droits de personne prive des personnes administratives, notammenten distinguant des contrats et qui, par l, a et des contrats ordinaires, administratifs ouvert la catgorie des droits de puissance publique o peuvent entrer la plupart des matires administratives.
PRFACE
IX
C'est lui, enfin, qui a cr toute la thorie de l'acte d'admi l'occasion du recours pour excs de pouvoir, qui nistration et a dgag peu peu l'a distingu des dcisions contentieuses de volont relative sa vritable nature de manifestation l'exercice des droits. de vrifier J'ai fait pour ma part cette exprience rassurante auxquelles ont est conduit dans que chacune des dductions est d'avance cette construction logique du droit administratif, consacre par quelqu'un des arrts du conseil. du Conseil d'tat il flotte dans l'atmosphre Il y a mieux: de ces maximes en forme de brocards qui expriment le plus profond du droit; ces maximes n'ont pas encore t complcites d'une faon elles sont simplement tement divulgues, courante dans les plaidoiries et les rapports ; je suis persuad attentif qui aurait particip depuis assez qu'un observateur dans le cadre longtemps aux travaux du Conseil, trouverait, une place approprie pour ainsi dress du droit administratif, chacune d'elles. Tout cela n'a rien de bien tonnant. Ceux qui ont fait des et de droit compar savent que tous les tudes d'histoire droits se ressemblent, ou, si l'on veut, que la trame du droit dans toutes ses branches, aussi bien en droit public qu'en droit priv, est forme des mmes lments. Or, il n'est pas difficile de s'assurer que le droit priv, notamment le droit est civil, dans sa partie gnrale et vraiment fondamentale, des trois lments que nous avons analyss constitu plus et leurs droits, l'exercice de haut: les personnes juridiques ces droits, les litiges soulevs par l'exercice des droits. Cela tient ce que partout des droits rglementer nir qu' des personnes. ciente le droit cre des pas de relles, ce qu'il matire administrative. le Droit est fait pour toujours et que les droits ne peuvent apparteDe l vient que d'une faon inconsfictives l o il n'en existe personnes a fait d'une faon si remarquable en et
J'ai voulu faire un livre d'tudiants,
parce que je crois pro-
PRFACE
fitable pour eux un procd d'exposition dont le propre est de mettre en relief les lments du droit administratif qui se la thorie gnrale du Droit, c'est--dire rattachent l'ensemble de leurs tudes. Mais les livres de cette espce ont leurs exigences : ils doivent la fois, raison des proccupaIl m'a fallu, tions de l'examen, tre brefs et encyclopdiques. d'une part, courter les thories, d'autre part reproduire des sans intrt scientifique. Je me dtails de rglementation suis rsign ces sacrifices pensant que si mon ouvrage du se trouvait ainsi rduit aux proportions d'un programme, une ide scientifique, qui, moins il y avait dans ce programme peut-tre, pourrait contribuer en susciter d'autres.
AVERTISSEMENT
Le droit public, entendu au sens large et comme terme oppos au droit priv, est cette partie du droit qui rgle les actions des hommes en tant qu'elles sont ncessites par l'existence de l'tat; il a pour objet, soit les droits de l'tat ou des diffrents organes de l'tat, soit les droits des individus vis--vis de l'tat. Le droit priv est au contraire cette partie du droit qui rgle les actions des hommes en tant qu'elles sont ncessites par les rapports d'individu individu ; il a pour objet les droits des individus vis--vis des autres individus. Ce sont les dfinitions romaines: Publicumjus est quodad statum rei publicae spectat, privatum quod ad singulorum utilitatem pertinet. (Inst. J. I, 4; l. 1. D. de Justitia et jure.) Il faut prendre garde dans cette dfinition du droit public ne pas substituer l'expression tat, cette autre expression intrt gnral. La notion de l'intrt gnral ne se confond pas avec celle de l'tat, elle est plus large. L'tat est organis, il est vrai, en vue de donner satisfaction aux intrts gnraux, mais il ne suffit pas la tche et il est oblig de solliciter ou de souffrir la collaboration des particuliers Des individualits isoles ou des associations travaillent ct de l'tat au bien gnral. Leur activit ne relve pas ncessairement du droit public, elle peut relever du droit priv. Il faut donc restreindre la notion du droit public celle de l'intrt gnral en tant qu'il est reprsent par l'tat, c'est--dire finalement la notion de l'tat. Le droit public et le droit priv constituent par leur ensemble le droit tout entier, car dans une socit organise il n'y a en prsence que l'individu et l'tat et tout ce qui n'est pas relatif l'un est relatif l'autre. Le droit public, qui forme ainsi lui seul une moiti du droit et non la moindre, se divise son tour : D'abord, en droit public international et en droit public national, selon qu'il s'agit des rapports de l'tat avec les tats voisins ou les nationaux de ces tats, ou bien de ses rapports avec ses propres nationaux ; Ensuite en branches multiples de ces deux troncs principaux. Nous n'avons pas nous proccuper ici des subdivisions du droit public international, mais seulement de celles du droit public national franais.
XII
AVERTISSEMENT
Ces subdivisions sont les suivantes : 1 Le Droit public stricto sensu, ensemble de rgles relatives aux droits des individus vis--vis de l'tat. Ces droits, que l'on appelle selon les cas droits publics des citoyens, droits individuels, liberts Individuelles, sont la base de notre tat social. Ce sont, par exemple, la libert de conscience, la sret personnelle, la proprit, le droit de suffrage, etc. 2 Le droit constitutionnel, ensemble de rgles relatives l'organisation et aux droits de l'tat envisags comme intressant la libert des citoyens. Le droit constitutionnel est un droit de garantie pour les liberts individuelles. 3 Le droit administratif, ensemble de rgles relatives l'organisation et aux droits de l'tat envisags comme intressant le fonctionnement des services publics. Les services publics sont tous les services que l'tat rend aux particuliers, comme le service de justice, de dfense militaire, de travaux publics, etc. Deces trois branches du droit public national, deux seulement font l'objet de ce livre, parce que seules elles sont dans le programme du deuxime examen de Licence, le droit public stricto sensu et le droit administratif. Le droit constitutionnel est laiss de ct. Il n'est pas pour cela sacrifi dans l'enseignement de la licence, puisqu'il fait l'objet d'un cours semestriel en premire anne. Les deux branches qui nous restent ont entre elles les rapports les plus troits et leur runion tait force. Le droit administratif et le droit public se supposent l'un l'autre. D'abord, l'organisation administrative de l'tat repose sur un droit individuel, le droit de suffrage; de plus, les droits de l'tat dans leur exercice se heurtent chaque instant aux droits des citoyens, soit la libert individuelle, soit la proprit, soit la libert du travail et de l'industrie, etc. Il est impossible de se rendre compte de la porte du droit administratif sans connatre l'tendue des droits du citoyen. Et l'inverse est tout aussi vrai, il est impossible de se faire une ide exacte des droits du citoyen, si l'on ne sait pas combien ils sont limits et battus en brche par l'action administrative. Une partie de l'ouvrage est consacre au droit public stricto sensu, une autre au droit administratif. Elles sont prcdes d'une partie intitule thoriede l'tat, o sont examins les problmes fondamentaux touchantl'tat, l'individu, les rapports de l'un avec l'autre. Elles sont suivies d'une partie consacre au contentieux administratif.
THORIE
DE
L'TAT
CHAPITRE
PRLIMINAIRE
ET LES SCIENCES SOCIALES LE DROIT
Il y a, entre le droit et les sciences sociales, un antagonisme qui parat irrductible : il se marque dans le but diffrent qu'ils poursuivent; dans la mthode qu'ils emploient, dans les postulats dont ils partent; il peut tre caractris d'un mot, comme tant une des manifestations de l'antagonisme de l'art et de la science. Les sciences sociales acceptent les phnomnes sociaux tels qu'ils se produisent naturellement; leur seul but est de dgager la loi de ce qui est. Le droit cherche ce qui doit tre; il a la prtention d'influer par ses rgles sur les phnomnes sociaux, de modifier ce qui est, et, par consquent, de crer. Les sciences sociales emploient la mthode d'observation, tout objective ; le droit emploie le procd de tous les arts, qui est de poursuivre la ralisation d'un certain idal subjectif, l'idal du juste. Enfin, les sciences sociales partent du postulat du dterminisme ; elles supposent les faits sociaux rgis par le mcanisme universel, car c'est la seule faon, semble-t-il, d'expliquer qu'ils soient soumis des lois naturelles. Le droit, au contraire, part du postulat de la libert. Il considre qu'il existe, en dehors du monde des phnomnes et transcendant par rapport lui, un certain ordre des choses auquel le monde doit se conformer et auquel il se conforme, en effet, par la libert. Des tendances aussi opposes ne peuvent qu'aboutir des conceptions opposes, et du droit lui-mme, et de la socit. Le droit, d'aprs les sciences sociales, et compltement engag dans les faits; c'est une rgle des phnomnes sociaux, mais qui n'est elle-mme qu'un phnomne semblable aux autres ; c'est la socit qui fait le droit, et, ce faisant, elle se rflchit elle-mme sans que rien de nouveau soit ajout son image. H. 1
THORIE DEL'TAT
Le droit, d'aprs la conception juridique, est suprieur aux faits et transcendant par rapport eux; le droit est justement cet ordre de choses suprieur au monde, auquel le monde doit se conformer. C'est le droit qui fait les socits ; il les modle d'aprs un type qui constamment les dpasse. Une socit, pour les sciences sociales, est un tre naturel et mme une sorte d'organisme vivant, car c'est un agrgat d'tres vivants qui sont entre eux dans des rapports mutuels de dpendance; ces rapports de dpendance sont imposs par des phnomnes inconscients de croissance, de dcroissance, de complication de structure dans les organes sociaux, trs analogues aux phnomnes biologiques. A ce titre, le corps social est soumis, dans son volution, des lois naturelles fatales dont la principale est la loi de la concurrence ou de la lutte pour la vie. Pour le droit, le corps social prend le nom d'tat. L'tat est un tre de raison, car les tres vivants dont il est compos sont des hommes, des tres raisonnables et libres qui ont ragi contre les rapports naturels auxquels ils taient soumis en crant entre eux de nouveaux rapports, volontaires cette fois, appels rapports juridiques. Ces hommes ont fait des lois, fond ou rform des institutions, et, pour ainsi dire, recr la socit. L'tat, loin d'tre soumis des lois fatales, est libre. En prsence de ces tendances et de ces conceptions si opposes, quelle doit tre l'attitude des jurisconsultes ? Il serait chimrique de croire que l'une des deux manires de voir dtruira l'autre. Le droit a combattu la constitution des sciences sociales; elles se sont constitues malgr lui. A leur tour, celles-ci ont essay de s'annexer le droit; elles n'y ont pas russi. D'ailleurs, la science, qui constate rellement une certaine rgularit dans les ; le phnomnes sociaux, ne peut pas renoncer cette constatation droit, qui a construit un difice imposant, ne peut pas renoncer au systme qui en fait la logique intime depuis des sicles. L'un et l'autre gardent donc leurs positions. Les j urisconsultes n'ont, ds lors, qu'un parti prendre. Accepter les deux conceptions, les tenir toutes les deux pour galement vraies, et, sans s'embarrasser de leur contradiction apparente, se servir alternativement de l'une et de l'autre. Aprs tout, pourquoi n'y aurait-il pas, dans l'homme, la fois du dterminisme et du libre arbitre, et, par suite, pourquoi n'y aurait-il pas, dans les socits, la fois des lois naturelles fatales et de la libert? Pourquoi le droit ne serait-il pas la fois engag dans les faits et suprieur aux faits? C'est le sens de la vieille distinction entre
LE DROIT ET LESSCIENCES SOCIALES
le droit positif et le droit idal. Pourquoi ne poudrait-on pas dire ? Pourla fois que la socit fait le droit et que le droit fait la socit quoi n'y aurait-il pas, dans la socit, la fois un organisme naturel et une organisation rationnelle? C'est affaire aux mtaphysiciens trouver, dans l'absolu, la conciliation de ces termes contradictoires. En attendant, les jurisconsultes, qui vivent dans le relatif, doivent se montrer pratiquement dualistes. Le droit et les sciences sociales doivent s'entr'aider, non pas prcisment en se compltant l'un l'autre, mais en se corrigeant l'un par l'autre. Les jurisconsultes ont besoin de ne pas oublier que le droit ne rgne pas sans conteste, qu'en dehors de lui il y a des forces brutales avec lesquelles il est perptuellement aux prises. Les sociologues ont besoin de savoir que la lutte pour la vie n'est pas tout, ni en conomie politique, ni en politique, que le droit est l pour la brider et en empcher les effets les plus dsastreux. En d'autres termes, il faut que les jurisconsultes soient en mme temps sociologues et inversement; et, soit dit en passant, c'est pour cela que les sciences sociales doivent tre enseignes dans les Facults de Droit. A vrai dire, nous croyons que, jusqu' notre poque, tous les grands jurisconsultes ont fait de la science sociale sans le savoir. La science sociale n'tait pas systmatise, ni rduite en formules, mais les observations fondamentales sur lesquelles elle repose taient connues, tant vieilles comme le monde. Les jurisconsultes romains taient des hommes politiques autant que des juristes, et, quant ceux du XVIesicle, leur ducation juridique tait fortement corrige par l'atmosphre naturaliste qu'avait cre la Renaissance et dans laquelle ils vivaient. C'est seulement au sicle dernier, alors que les sciences sociales ont voulu se constituer part, qu'un divorce malheureux s'est produit. Cela a abouti, d'une part, aux purilits d'un droit naturel compltement isol des faits, et, d'autre part, aux brutalits d'une science ddaigneuse des aspirations les plus sincres de l'humanit. Il est temps de faire cesser cette sparation; si nous voulons faire uvre fconde et organiser dans notre monde moderne quelque chose de durable, il nous faut oprer maintenant, d'une faon consciente et voulue, la synthse que nos devanciers faisaient d'une faon inconsciente parce qu'elle est dans la ralit vivante. Nous allons, pour notre part, essayer cette synthse dans une trs brve thorie de l'tat. Comme il n'est pas de procd d'exposition qui permette de se placer simultanment deux points de vue diffrents, et comme nous faisons surtout du droit, nous prenons position dans la conception juridique; mais, toutes les fois qu'il est possible, nous
THORIE DEL'TAT
tenons compte de la conception des sciences sociales et nous la faisons apparatre l'arrire plan. Par consquent, tout en faisant une thorie de l'tat, c'est--dire de l'organisation rationnelle des socits, nous n'oublions pas l'organisme naturel qui se trouve cach sous l'tat. On s'en apercevra propos du fait du pouvoir politique et de la thorie de la souverainet, et aussi lorsque nous mettrons l'tat en prsence de l'organisme national et de ce qu'on 'peut appeler ds maintenant l'organisme interne tional.
CHAPITRE PREMIER L'TAT
La notion de l'tat 1er. L'tat est une haute personnalit morale et juridique qui se cre au sein d'un groupe social et en assume la direction par l'exercice du pouvoir politique. Un groupe social, ou, si l'on veut, un organisme social, est un groupement d'hommes qui se meut avec une certaine unit sous la direction de ce que l'on appelle le pouvoir politique. Il porte, selon son importance, les noms de tribu, peuplade, peuple, nation. Dans son sein chaque homme mne sa vie particulire, et cependant, travers la succession des gnrations, le groupement conserve une individualit persistante grce un certain fonds d'ides communes cr et transmis par l'histoire. Les lments d'un organisme social sont donc: 1 une population; 2 un pouvoir politique auquel est soumise cette population; 3 un fond d'ides communes qui assure l'individualit et la permanence du groupe. On y ajoute, d'ordinaire, un certain territoire qui forme l'habitat du groupe ; mais cet lment est moins indispensable que les autres, car il existe des peuples nomades. L'tat est, pour ainsi dire, l'me de l'organisme social, et une me qui est arrive la conscience d'elle-mme. Tous les peuples ne parviennent pas raliser l'tat, la notion de l'tat ne se dgage qu' un certain moment de l'volution. Elle suppose que tous les membres du groupe sont arrivs la conscience des intrts gnraux du groupeet qu'ils ont une volont commune touchant les moyens d'y satisfaire. La personnalit de l'tat, en effet, tant purement fictive, ne peut avoir pour substratum que les volonts concordantes des hommes associs. I. Du pacte social qui est la base de l'tat. Ceci revient dire que l'tat suppose sa base un pacte social plus ou moins volontaire, un contrat, ou tout au moins un quasi-contrat.
THORIE DE L'TAT
Ainsi, d'une part, les hommes font partie, en vertu des fatalits de la naissance et de la vie, d'une faon involontaire, d'un certain organisme social ; mais, d'autre part, comme cet organisme il est venu se surajouter une association juridique qui est l'tat, de cette association l, ils sont censs faire partie volontairement. La thorie de Rousseau sur le contrat social, qui est inexacte si on l'applique aux socits en tant qu'elles se dveloppent la faon d'organismes naturels. abstraction faite de la raction produite par le droit et par la notion de l'tat, est, au contraire, tout fait exacte si on l'applique l'tat une fois organis, et c'est bien ainsi que lui-mme l'entend. Le pacte social a, dans une nation dtermine, exactement la mme tendue que l'activit de l'tat. Tout ce qui est donn l'tat lui est donn en vertu du pacte. Et, d'autre part, tant que le pacte ne s'est pas manifest d'une faon quelconque au sujet d'un service nouveau confier l'tat, ce service, fut-il trs voisin des services d'tat, ne lui appartient pas. Il en est ainsi des services rendus par ies tablissements d'utilit publique. Ces tablissements ne font pas partie de l'tat, parce que la volont de les y incorporer ne s'est pas manifeste. Les services qu'ils rendent peuvent tre d'intrt gnral, mais cela revient dire que la nation n'a pas encore suffisamment conscience de cet intrt. Quant la question de savoir si l'on doit tendre dvelopper le pacte, et, parsuite, l'activit de l'tat, c'est un point que noustraiterons au chapitre II, c'est la question du socialisme. Disons simplement ceci: 1 Il n'est pas ncessaire, contrairement l'opinion de Rousseau, que les hommes abandonnent tout l'tat par le pacte social, mme leur vie et leur libert. Rousseau croyait que l'tat avait besoin d'tre trs fort vis--vis de l'individu pour ne pas tomber en dissolution. Cette erreur tenait ce qu'il n'admettait pas la transcendance du droit qui, par elle-mme, impose l'homme la ncessit de l'tat. Le& hommes peuvent garder par devers eux des franchises, des liberts; et ce n'est pas l'tat qui les leur concde, elles leur appartiennent en propre. On peut exprimer la chose autrement en disant que l'tat n'absorbe pas ncessairement tout l'organisme national. 2 D'autre part, il y a un minimum que les hommes sont obligs de mettre dans le pacte social; c'est ce qui est ncessaire pour assurer la conservation d'un certain ensemble cr par l'histoire de murs communes d'ides communes et la possession d'un certain territoire; sans cela, l'tat serait incapable d'exercer la direction qu'il a assume. Ainsi entendu, le pacte social volontaire est incontestablement suppos par l'ensemble du droit: 1 Les lgislations positives de tous les pays admettent qu'on change
L'TAT
volontairement de patrie lgale, car elles admettent la naturalisation. A l'inverse, le droit international tend admettre de plus en plus, propos des annexions de territoires, que l'on ne change de nationalit que si on en manifeste la volont. 2 Le droit pnal tout entier suppose le contrat social ; si le droit de punir de la socit renferme quelque chose de plus que le fait de la dfense brutale, c'est qu'il suppose la responsabilit juridique du dlinquant; et cette responsabilit ne peut s'expliquer d'une faon satisfaisante que si l'on part de cette ide que le dlinquant, acceptant en somme l'tat lgal, est coupable de n'avoir pas accept celui-ci dans son entier et de ne s'tre pas soumis aux lois de police et de sret. II. Dupouvoir politique exerc par l'tat. Le pouvoir politique est un fait naturel qui existe indpendamment de l'tal.. Dans les organismes sociaux o la notion de l'tat ne s'est pas encore dgage, il existe dj un pouvoir politique. L'tat, une fois organis, s'empare de l'exercice de ce pouvoir pour le plus grand bien du groupe. Mais jamais il ne russit s'en emparer compltement. 1 Le gouvernement de l'homme par l'homme est un fait social fondamental. L o deux hommes agissent de concert, on peut affirmer que l'un des deux dirige l'autre; si c'est un groupe d'hommes qui se livre une action commune, on peut affirmer qu'il y a un meneur et que les autres obissent. Toute famille suppose un chef, toute quipe d'ouvriers suppose un contre-matre, tout parti politique suppose un comit. En d'autres termes, au point de vue naturel, la coopration apparat sous forme de subordination de volonts diriges des volonts dirigeantes, et non point sous forme d'union de volonts gales entre elles ; la coopration sur pied d'galit est une conqute de la raison sur la nature. Et remarquons bien que ce pouvoir de direction va jusqu' la contrainte physique, que c'est une manifestation de la force, que les volonts diriges n'acceptent pas toujours la direction, que souvent elles la subissent. Le pouvoir politique est une des manifestations de ce pouvoir de direction de l'homme sur l'homme. Dans le groupe social, une action commune est ncessaire pour la gestion des intrts gnraux ; cette action commune ne se produit ; il point naturellement sous forme de coopration sur pied d'galit se cre une classe de gouvernants et uneclasse de gouverns; les gouvernants dirigent les gouverns, se font obir d'eux par la persuasion ou par la force, exercent, en un mot, un pouvoir qui prend le nom de pouvoir politique. Ce sontles plus forts qui gouvernent ainsi les plusfaibles. Cetteforce,
THORIE DE L'TAT
les gouvernants la puisent dans leurs qualits physiques, intellectuelles ou morales. Et voil pourquoi le pouvoir a quelque chose de mystrieux dans ses origines, c'est parce qu'il est une des manifestations de la vitalit mme des tres. Suivant les poques, les moyens qu'ils emploient pour s'assurer la domination sur les autres hommes varient, c'est tantt l'habilet la guerre, tantt l'habilet amasser des richesses; mais toujours la raison profonde de leur succs, c'est leur force. On ne sait jamais l'avance o seront les gouvernants d'un pays; on appelle classes dirigeantes, les classes qui, d'ordinaire, les produisent; mais ils peuvent natre dans les classes les plus humbles. Combien de fois l'empire romain n'a-t-il pas t gouvern rellement par des affranchis? Ils ne forment donc point d'ordre apparent dans la nation, leur influence est souvent occulte; ils ne se connaissent pas toujours entre eux, mais ils agissent paralllement parce qu'ils ont un but commun. 2 Le gouvernement des plus faibles par les plus forts est un fait brutal, une des manifestations de la loi de nature de la lutte pour la vie; le droit a toujours essay de ragir contre ce fait et de crer des contrepoids. Sa plus belle cration ce point de vue est la notion de l'tat. Avant que la notion de l'tat n'apparaisse, on est sous ce que l'on peut appeler le rgime de la clientle; les gouvernants exercent leur pouvoir sur les gouverns directement d'homme homme, selon les rapports que nous connaissons entre patrons et clients. Sous ce rgime, outre que les intrts gnraux du groupe peuvent tre mal grs, confondus qu'ils sont avec les intrts particuliers du patron, le pouvoir exerc sur les gouverns est un despotisme absolu que temprent seules les croyances religieuses, les murs, les habitudes familiales transformes pour partie en coutumes. Apparat la notion de l'tat, immdiatement les choses changent. L'tat est une personnalit fictive qui incarne l'intrt gnral et en qui est cens rsider le pouvoir politique. Ds lors, la classe des gouvernants ne peut plus exercer le pouvoir qu'au nom de l'tat; ce n'est plus un pouvoir d'homme homme, il y a un intermdiaire et cet intermdiaire personnifie l'intrt gnral. Ce qu'il y a de vraiment admirable dans la conception de l'tat, c'est cet intrt gnral du groupe social tout entier rendu distinct des intrts particuliers de la classe dirigeante et mis au premier plan. Cela entrane une certaine indpendance pour les gouverns, parce que, ds lors, ceux-ci sont amens raisonner leur obissance et discuter ce qu'ils sentent n'tre pas utile l'intrt gnral. Ds lors,
L'TAT
en mme temps que les droits de l'Etat, se dfinissent les droits de l'individu. 3 Il ne faut pas croire que l'existence de l'tat fasse jamais compltement disparatre la division en gouvernants et gouverns. Il y aura toujours des gouvernants et peut-tre mme toujours des classes dirigeantes. Cela tient ce qu'il y aura toujours des ingalits physiques et morales entre les hommes. Il est mme trs probable que c'est unecondition de vie pour les socits. Seulement, plus le rgime d'tat se dveloppe, plus l'action des gouvernants est oblige de suivre la procdure des moyens constitutionnels. Cela l'affaiblit et la modre,cela cre un contrepoids, et c'est l la grande garantie des gouverns. III. De l'apparition de la notion de l'tat. Il est bien difficile de savoir o apparut pour la premire fois la notion de l'tat et comment elle apparut; il est probable que, comme toutes les grandes ides sociales, ce fut d'abord une ide religieuse et que des ncessits de dfense militaire la firent. se raliser. La seule donne historique que nous puissions saisir, c'est qu'il y a des priodes o la notion de l'tat s'affaiblit et d'autres o elle se renforce. Rien que dans l'histoire de la civilisation mditerranenne, qui certes n'est pas bien longue, par deux fois on a vu le rgime de l'tat se substituer au rgime de la clientle qui, entre les deux, avait fait un retour offensif. Les vieux patriciens romains, visiblement, sont des chefs de clan ou de tribu, qui tranent aprs eux une clientle. L'tat romain apparat trs clairement avec les rois. Il en avait t de mme pour la Grce. L'tat apparat avec le de l'poque homrique; l'poque homrique est l'poque de transition, on y distingue encore des patriarches chefs de clan. Mme histoire encore la fondation de l'tat juif. L'tat apparat avec le roi qui se superpose aux chefs de tribus ou Juges. Tous ces tats antiques, aprs une vie plus ou moins longue, viennent se fondre dans l'tat romain. Puis, du moins dans l'empire d'Occident, celui-ci se dissout avec les invasions des barbares ; on assiste une lente disparition de la notion de l'tat et une rsurrection du rgime de la clientle sous la forme fodale. La fodalit n'est pas autre chose, en effet, qu'un rgime de clientle compliqu de proprit foncire, tandis qu' l'poque patriarcale il y avait surtout une proprit mobilire. La fodalit dcline son tour, et nous assistons depuis quelques sicles l'organisation de l'tat moderne. La personnalit de l'tat est la fois morale et juridique, elle s'est cre l'image de la personnalit humaine. Ayant des intrts du mme ordre dfendre, il lui fallait les mmes attributions. L'tat
10
THORIE DEL'TAT
est donc considr comme un tre responsable et susceptible d'avoir des devoirs et des droits. Le langage populaire parle couramment de l'honneur de l'tat, des devoirs de l'tat, tandis que le langage juridique parle de ses droits. Cette personnalit a comptence universelle comme la personnalit humaine elle-mme. Aucun objet d'activit ne lui est tranger; elle a la jouissance de tous les droits. 2. La souverainet de l'tat La souverainet est le pouvoir politique en tant qu'il est exerc au nom de l'tat. Comme l'tat est une personne, on peut dire que la souverainet est la volont de l'tat en tant qu'elle exerce un empire. La souverainet ainsi entendue est la source des droits de l'tat, de mme que la volont individuelle est la source des droits de l'individu. I. Sphre d'action de la souverainet. La souverainet de l'tat s'exerce l'intrieur et l'extrieur. Elle s'exerce l'extrieur vis--vis des autres tats ; elle impose ceux-ci le respect de l'indpendance, de la dignit, des intrts matriels de l'tat. La souverainet des tats ainsi entendue est la base des relations internationales; c'est sur elle, notamment, que repose le principe de non-intervention. Elle s'exerce l'intrieur vis--vis des nationaux et elle impose ceux-ci l'obissance. Elle se manifeste aux deux points de vue suivants: 1 au point de vue de l'action que l'tat peut exercer sur lui-mme, sur les lments du corps social, sur la population, sur le territoire, l'organisation politique; elle se manifeste alors sous la forme constituante; 2 au point de vue de la gestion des intrts gnraux du pays, c'est--dire des services que l'tat rend aux individus, forme gouvernementale et administrative; elle mrite alors le nom de puissance publique. II. Des limites imposes la souverainet par le droit. Cette souverainet de l'tat, dont nous venons de mesurer la sphre d'activit au point de vue de l'tendue, n'est pas sans limites au point de vue de l'intensit; ce n'est pas de l'omnipotence. Il faut la considrer comme libre au mme sens que la volont de l'homme, uniquement dans le choix des moyens de se conformer au droit; elle a un but qui est la direction du corps social dans le sens de la justice. Cela lui impose le respect des droits d'autrui. Dans les relations internationales, elle est forcment limite par la souverainet gale des tats voisins. Dans
L'TAT
11
les relations intrieures, elle est limite par les franchises des citoyens, franchises que le progrs de la civilisation tend accroitre constamment (V. infr, chap. II et chap. m). III. Des trois pouvoirs, que renferme la souverainet. La souverainet de l'tat est aussi tendue que le pouvoir politique, car tout le pouvoir politique est cens appartenir l'tat. Or, si l'on se place au point de vue des actes par lesquels se manifeste le pouvoir politique, on en peroit trois espces diffrentes : 1 Dcisions soudaines prises par le gouvernement seul et dont le corps social n'a pas conscience, uvre du pouvoir excutif; 2 Dcisions rflchies et spares de l'excution dont le corps social peut prendre conscience, et parmi lesquelles figurent les lois, uvre du pouvoir lgislatif ou dlibrant; 3 Jugement des actes au point de vue du droit, uvre du pouvoir judiciaire. La souverainet apparait donc comme renfermant trois pouvoirs. Cette analyse que nous trouvons dans Aristote est prsente par lui comme connue depuis longtemps. Elle a t puise dans l'observation de la conduite des gouvernements, mais peut-tre aussi dans celle de la conduite des individus. Dans la volont agissante de l'individu, il y a aussi des dcisions soudaines, des dcisions rflchies et spares de l'action, enfin des jugements de la conscience morale sur la valeur morale des actes. Il faut viter ici deux erreurs : A. La premire consisterait identifier la souverainet avec le pouvoir de faire la loi, de telle sorte que le pouvoir de faire la loi appartiendrait seul l'tat. Le pouvoir excutif et le pouvoir judiciaire ne lui appartiendraient pas; ce seraient de pures forces sociales qu'il se contenterait de surveiller. Cette erreur a t commise par Rousseau. C'est une consquence logique de sa thorie sur la nature de la souverainet. Rousseau, n'admettant pas la transcendance du droit, n'admet pas que la souverainet soit limite par lui: il identifie souverainet et omnipotence. Comme, cependant, il faut bien qu'en fait cette souverainet se maintienne dans des bornes raisonnables, il en conclut que le souverain ne peut faire que des lois. Les carts du souverain ne sont pas craindre dans les lois, car le souverain, dans la thorie de Rousseau, c'est le peuple, et les lois, qui sont des dispositions gnrales, devant s'appliquer au peuple tout entier, il n'est pas craindre que le souverain fasse des lois mauvaises dont il serait le premier souffrir. Au contraire, les actes de pouvoir excutif et de pouvoir judiciaire,
12
THORIE DEL'TAT
que Rousseau appelle indistinctement actes de magistrature, tant de leur nature particuliers, il serait trop dangereux de confier au souverain le droit de les accomplir. Les constitutions modernes sont plus confiantes que Rousseau; elles supposent toutes que le pouvoir excutif et le pouvoir judiciaire appartiennent au souverain, comme le pouvoir lgislatif. Cela tient ce qu'elles admettent en mme temps, qu'au dessus de la souverainet, pour en rprimer les carts, il y a la garantie du droit. B. La seconde erreur consisterait croire qu'au lieu de trois pou: le pouvoir de faire voirs, la souverainet n'en renfermerait que deux la loi et celui de l'excuter. Cette opinion, que l'on appuie quelquefois sur un texte mal rdig de Montesquieu (Esprit des Lois, liv. XI, chap. VI), procde encore en ralit de Rousseau et provient de ce que celui-ci ne reconnat pas de droit idal au-dessus de la loi positive. Il n'y a, dit-on, que deux pouvoirs, le pouvoir lgislatif qui cre la loi, le pouvoir excutif qui l'applique. Le pouvoir excutif, il est vrai, se subdivise en deux branches: le pouvoir excutif proprement dit, qui applique la loi par des actes d'administration; le pouvoir judiciaire, qui l'applique par des jugements ; mais tout cela se ramne l'application de la loi, et, par consquent, est subordonn au mme titre la loi. D'abord, il est inexact de dire que le pouvoir excutif et le pouvoir judiciaire se bornent appliquer la loi; la vrit est que, dans la tche propre que chacun d'eux accomplit, ils sont tenus de ne pas la violer, ce qui n'est pas la mme chose. Ce que les deux pouvoirs s'efforcent de raliser, c'est le droit; mais ce serait singulirement rapetisser le droit que de l'enfermer dans la loi positive. La loi positive est ncessairement imparfaite et incomplte. La loi positive a une infirmit qui tient sa nature mme de rgle gnrale, elle ne peut s'appliquer directement aucun cas particulier; elle a t faite pour un cas abstrait qui n'existe pas dans la ralit des choses, de sorte qu'en ralit la loi ne s'applique pas; le juge et l'administrateur s'inspirent d'elle pour trouver, dans chaque cas particulier, la solution conforme au droit; ils doivent se laisser guider par elle, mais il y a un travail d'appropriation qui leur est propre, et c'est directement qu'ils ralisent le droit, car celui-ci doit se raliser dans la varit et la diversit infinie des cas particuliers. Et maintenant, si nous prenons chacun de ces deux pouvoirs et si nous comparons les actes qu'ils accomplissent, avons-nous besoin de dire qu'il n'y pas de ressemblance, que l'acte de juge diffre profondment de l'acte d'administration ?
L'TAT
13
L'acte d'administration est spontan, l'acte de juridiction suppose un conflit prexistant dont on saisit le juge. Le but de l'acte d'administration est un intrt de l'tat satisfaire, le but de l'acte de juge une pacification accomplir. Au fond, si la thorie des deux pouvoirs a t soutenue en ce sicle, c'est qu'on a t dupe de la prminence de fait qu'a prise, dans le rgime parlementaire, l'organe qui fait les lois. On a t conduit donner au pouvoir lgislatif et la loi une importance excessive. Les parlements sont tout puissants, beaucoup de lois ont t faites. Mais ce sont l des faits passagers, nouveaux tout au moins, et qui ne doivent pas influer sur une thorie qui doit tre vraie pour tous les temps. 3. L'organisation politique de l'tat
La souverainet, avons-nous dit, est le pouvoir politique en tant qu'il est exerc au nom de l'tat. Mais le pouvoir doit tre exerc par des hommes qui soient les organes de l'tat, car l'tat est une personne fictive qui ne peut agir que par reprsentant. On appelle organisation politique, la manire d'tre de l'tat en ce qui concerne l'exercice de la souverainet par des hommes. Il y a lieu de distinguer l'organe en qui rside la souverainet de l'tat et les organes qui l'exercice en est dlgu, car nous verrons que la dlgation de la souverainet est ncessaire. I. Organe en qui rside la souverainet. Les tats les plus diversement constitus peuvent tous, ce point de vue. tre ramens l'un des trois types suivants dfinis par Aristote : L'aristocratie, o la souverainet est cense rsider dans une minorit distingue; La monarchie absolue, o elle est cense rsider en la personne d'un seul homme; La dmocratie, o elle est cense rsider dans la nation tout entire. Chacune de ces formes politiques a eu sa thorie et ses croyants. Suivant les poques et les pays, des nations entires ont cru l'aristocratie, la monarchie absolue, la dmocratie. Sans prtendre faire la thorie mtaphysique de la dmocratie, nous pouvons observer que ce rgime est l'aboutissant naturel o doit conduire la notion juridique de l'tat. Notons qu'on n'a point la prtention d'expliquer ni de justifier en lui-mme le pouvoir. En tant que le pouvoir politique procde du fait naturel du gouvernement par les plus forts, il a quelque chose de mystrieux, comme toutes les forces naturelles. Il s'agit uniquement
14
THORIE DEL'TAT
de lgitimer le pouvoir en tant qu'il est exerc au nom de l'tat, considr comme une cration humaine. Or, du moment qu'au point de vue du droit, l'tat nous est apparu comme une association volontaire, c'est une consquence logique que la souverainet exerce par cette association soit considre comme lui tant donne par la volont de chacun des associs. Observons encore que si le rgime de l'tat, par lui-mme et quelle que soit l'organisation politique, a pour rsultat de crer un contrepoids l'action brutale des gouvernants, ce contrepoids est bien plus nergique avec l'organisation dmocratique qu'avec les autres. Il est port son maximum. En effet, par le jeu mme des institutions dmocratiques, par suite des choix du suffrage universel, la vritable classe dirigeante se trouve en partie exclue des organes de l'tat, notamment du Parlement. Lorsqu'elle veut exercer une action, elle trouve devant elle comme une masse rsistante qu'elle est oblige d'entraner, tout le corps lectoral; il faut crerdes mouvements d'opinion, obtenir des votes par la persuasion ou parla corruption, toutes choses qui demandent du temps, de l'argent, des efforts. Le danger de la dmocratie est peut-tre au contraire de trop nerver l'action de la classe dirigeante qui est ncessaire. Il faut, et c'est l le problme de l'organisation dmocratique, trouver des institutions assez bien calcules pour que cette action puisse s'exercer au travers du suffrage universel. Que celui-ci soit si l'on veut un instrument de direction, mais non pas de direction exclusive. II. De la ncessit de dlguer l'exercice de la souverainet. La souverainet peut tre retenue ou dlgue; retenue, c'est--dire qu'elle est exerce par le souverain lui-mme, l'organe en qui elle rside; dlgue, c'est--dire que l'exercice en est confi par l'organe souverain un autre organe. Des impossibilits pratiques s'opposent presque toujours la premire combinaison. Prenons pour exemple la forme dmocratique. Il est pratiquement impossible qu'une nation tout entire assemble en ses comices lgifre directement, juge directement, rende journellement les dcrets que ncessitent les affaires courantes. La raison en est dans l'ignorance o seraient les citoyens de la vritable porte des actes. Nous savons bien que la presse quotidienne et la rapidit des informations tlgraphiques tendent tablir, dans nos tats modernes, l'unit de conscience qui, dans les petites rpubliques antiques, tait ralise par l'assemble des citoyens sur l'agora ou le forum; que, par consquent, les citoyens connatraient assez rapidement les mesures prendre; mais le manque de loisirs de la plupart, et il faut bien le dire aussi, leur incapacit, les empcheraient de tran-
L'TAT
15
cher convenablement les questions complexes que soulve le gouvernement d'un grand pays. Tout au plus, des mesures particulirement simples et graves peuvent-elles tre exceptionnellement soumises au vote direct par la voie plbiscitaire, ainsi que cela se pratique en Suisse sous le nom de referendum. Les dmocraties sont obliges de dlguer presque compltement l'exercice de la souverainet. Elles donnent mandat d'agir des hommes qui savent ou qui seront en mesure de savoir ce qu'il faudra faire. La seule prrogativede l'individu souverain consiste alors en un acte minemment simple, la porte de tous, le choix des hommes qui sera confi l'exercice de la souverainet. Tout se ramne au bulletin de vote. III. Des organes qui est dlgu l'exercice de la souverainet. La constitution des organes chargs par dlgation d'exercer la souverainet de l'tat soulve les plus grosses questions, notamment la question de la sparation des pouvoirs, celle de la dcentralisation et celle des organes spciaux. A. Sparation des pouvoirs. L'exercice de la souverainet sera-t-il dlgu un organe unique ou bien sera-t-il partag entre un certain nombre d'organes? C'est l la question constitutionnelle dela sparation des pouvoirs. Nous avons vu que l'analyse de la nature intime de la souverainet rvlait en celle-ci trois pouvoirs distincts : excutif, lgislatif, judiciaire. Or, un des grands progrs de l'organisation politique a consist faire de cette vue de l'esprit une ralit objective et crer un organe spar pour chacun de ces trois pouvoirs. Aristote avait indiqu la division des pouvoirs comme une vue de l'esprit. C'est Montesquieu qui, le premier, parle de la sparation des pouvoirs ralise dans les organes de l'tat, et qui fait ressortir combien c'est une prcieuse garantie de libert parce que cela introduit la dlibration dans les actes de l'tat. Il faut, en effet, dsormais pour un acte de l'tat, l'accord entre plusieurs pouvoirs, c'est-dire plusieurs groupes d'hommes, ce qui est toujours une cause de ralentissement et de modration (Esprit des Lois, liv. XI, chap. VI). Bien entendu, Montesquieu n'a rien invent; il a seulement observ les faits qui s'taient produits, soit dj dans des tats antiques, soit surtout dans les tats chrtiens modernes. Aujourd'hui, on peut dire que le principe de la sparation des pouvoirs est acquis ; il faut un organe du pouvoir excutif, un du pouvoir lgislatif, un du pouvoir judiciaire. Ces organes doivent tre spars, c'est--dire indpendants les uns des autres, non pas sans communication, comme on l'avait imagin dans certaines constitutions qui n'ont pas fonctionn. Nous avons vu plus haut (p. 12) que la thorie des trois pouvoirs a t attaque; il faut la maintenir nergiquement et la raliser dans la cons-
16
THORIE DE L'TAT
titution. C'est un principe minemment tutlaire, et justement celui des trois pouvoirs que l'on semble le plus dispos sacrifier, le pouvoir judiciaire, serait, au contraire, celui que, dans une dmocratie, on devrait fortifier avec le plus de soin. Il n'est pas de rgime o la distribution chacun de la justice qui lui est due, soit plus ncessaire que celui o chaque individu, par son bulletin de vote, a action sur l'tat et, par son mcontentement, peut donner des secousses la machine gouvernementale. Pratiquement, d'ailleurs, dans notre constitution, bien que le pouvoir judiciaire ne soit pas assez fortement organis, la sparation des trois pouvoirs est ralise. Il ne faut pas s'arrter ce fait, que le chef du pouvoir excutif est nomm par le parlement et qu' son tour le chef du pouvoir excutif nomme les juges, de telle sorte qu'au point de vue de l'origine tout semble sortir du parlement, c'est--dire du pouvoir lgislatif. Sans doute, il paratrait plus logique que chacun des trois pouvoirs tirt directement son origine du vote populaire, chef du pouvoir excutif lu, magistrature lue; mais il y a cela des inconvnients constitutionnels. Ce dtail d'organisation est d'importance secondaire. L'essentiel, c'est que, dans l'exercice de leurs attributions, les trois organes, lgislatif, excutif, judiciaire, soient protgs contre les entreprises qu'ils pourraient tenter les uns sur les autres. A cet effet, des rgles constitutionnelles existent, et ces rgles, sur les rapports despouvoirs publics, forment l'objet le plus important du droit constitutionnel. Ce n'est pas ici le lieu de les dvelopper. Disons seulement un mot d'un point qui intresse particulirement le droit administratif. Il s'agit de la sparation du pouvoir excutif et du pouvoir judiciaire. Les lgislateurs de la Rvolution l'ont comprise en ce sens qu'il fallait protger le pouvoir excutif contre le pouvoir judiciaire, estimant que si le pouvoir judiciaire tait appel apprcier les actes de l'excutif, l'indpendance de celui-ci serait compromise. Dans la loi des 16-24 aot : Les fonctions judiciaires sont 1790, ils posrent le principe suivant distinctes et demeureront touj ours spares des fonctions administratives; les juges ne pourront, peine de forfaiture, troubler, de quelque manire que ce soit, les oprations des corps administratifs, ni citer devant eux les administrateurs pour raison de leurs fonctions (Tit. II, art 13). Et dans la loi du 16 fructidor an III : Dfenses itratives sont faites aux tribunaux de connatre des actes d'administration, de quelque espce qu'ils soient, aux peines de droit. Ainsi, d'une part, les actes d'administration ne peuvent pastre apprcis par les tribunaux judiciaires; d'autre part, les agents de l'administration ne peuvent pas tre poursuivis devant eux. Cette dernire rgle, que l'on appelait la garantie constitutionnelle des fonctionnaires, a disparu dans des conditions que nous aurons examiner (V. n 10). La premire a subsist ; elle a produit des consquences qui mritent d'tre signales tout de suite: 1 comme les actes d'administration ne pouvaient pas chapper compltement un juge, et comme, d'autre part,
L'TAT
17
ils ne pouvaient pas tre soumis au juge ordinaire, il a fallu crer une juridiction spciale, la juridiction administrative, qui, bien qu'tant une juridiction, fait partie du pouvoir excutif et non pas du pouvoir judiciaire. Il y a l videmment une anomalie qui s'explique par des raisons historiques, mais qui pourrait disparatre si le pouvoir judiciaire tait constitu d'une faon plus large qu'il ne l'est. 2 Il a fallu instituer une juridiction spciale, le tribunal des conflits, charge de dterminer les limites du domaine respectif de la juridiction administrative et du pouvoir judiciaire, et de juger les conflits d'attribution qui s'lvent entre ces deux pouvoirs. Observations. La sparation des pouvoirs appelle plusieurs observations complmentaires : a) Le fait de la division des organes de l'tat est tellement acquis aujourd'hui, qu'on a pris l'habitude d'envisager isolment l'organe en qui sige le pouvoir excutif et que l'on classe les tats selon la forme de cet organe. C'est un complment de la classification d'Aristote. Partant de ce fait que les tats civiliss actuels sont tous plus ou moins dmocratiques, c'est--dire que la souverainet rside dans la nation, nous les classons alors, au point de vue de la forme de l'organe excutif, en : 1 Monarchie constitutionnelle, excutif confi un roi hrditaire; 2 Rpublique, excutif confi un prsident lectif temporaire; 3 Empire, excutif confi un monarque avec combinaison d'hrdit et de sanction plbiscitaire1. On se proccupe aussi des rapports qui unissent l'excutif au lgislatif, et, ce point de vue, on distingue: 1 Les gouvernements parlementaires dans lesquels, en cas de conflit, le dernier mot reste au pouvoir lgislatif; 2 Les gouvernements de pouvoir personnel dans lesquels le dernier mot reste au reprsentant du pouvoir excutif; b) La division des organes de l'tat se poursuit dans le dtail l'intrieur de chacun des trois pouvoirs; ainsi, il semble acquis que le pouvoir lgislatif doit tre confi non pas un seul organe, mais deux, deux chambres. De mme, dans les organes chargs du pouvoir excutif, il y a subdivision, notamment pour les fonctions militaires et les fonctions civiles, l'lment militaire est soigneusement spar de l'lment civil et lui est subordonn. C'est une des plus prcieuses garanties des citoyens ; les Romains l'avaient dj organise, nous y tenons beaucoup, et nous l'appliquons mme dans les colonies aussitt que la priode aigu de la conqute est passe. c) La division des pouvoirs n'apparat pas seulement dans l'organisation de l'tat, mais encore dans l'organisation de ces membres de l'tat qui sont des rouages de gouvernement local, comme les dpartements, les communes. Il y a, dans les dpartements et les communes, un organe 1. Cette varit n'avait pas encore apparu l'poque de Montesquieu. II. 2
18
DEL'TAT THORIE
de pouvoir excutif, le prfet et le maire, et un organe de pouvoir dlibrant, le conseil gnral et le conseil municipal. Il n'y apparat pas d'organe de pouvoir judiciaire, mais, dans une constitution plus dcentralisatrice, on en pourrait imaginer. Certains tablissements publics ont, eux aussi, un organe de pouvoir excutif et un organe de pouvoir dlibrant. B. Dcentralisation. Position de la question. Pour comprendre la question de la dcentralisation, il faut connatre au pralable le fait de la ncessit du gouvernement local. Dans un tat de dimensions restreintes, on conoit qu'un mme organe de gouvernement central puisse pourvoir tous les besoins; ceux-ci sont peu prs uniformes et faciles connatre. Mais, ds que les dimensions territoriales de l'tat dpassent une certaine limite, on s'aperoit : 1 que les besoins cessent d'tre uniformes; 2 que le gouvernement central, par suite de son loignement, cesse d'y tre suffisamment sensible. Il devient ncessaire de crer des organes de gouvernement local, moins, ce qui arrive, qu'il ne s'en soit form spontanment. Dans nos tats modernes, le gouvernement local se compose de deux tages superposs de rouages locaux, le dpartement ou la province, et la commune. La question de savoir comment sont constitus les organes de gouvernementlocal et quels sont leurs rapports avec le gouvernement central se pose fatalement, et c'est ici qu'apparat le problme de la centralisation et de la dcentralisation. Il y a centralisation lorsque les autorits locales sont constitues par le pouvoir central; il y a dcentralisation lorsqu'elles sont lues par la population de la circonscription. En d'autres termes, la dcentralisation s'analyse en une mainmise plus directe du peuple souverain sur l'administration. L est l'essence de la dcentralisation; les autorits locales lues peuvent avoir plus ou moins d'attributions et plus ou moins de pouvoirs de dcision ; le pouvoir central peut conserver sur elles un pouvoir de tutelle : ce n'est plus qu'une question de degr dans la plus ou moins tendu dcentralisation. Historique. Nous marchons en France, depuis le commencement du sicle, vers la dcentralisation. Nous pourrons le constater quand nous tudierons l'histoire du dpartement et de la commune. A la fin de l'ancien rgime, sous l'action des intendants, la France tait centralise l'excs. Elle tenta, sous la Rvolution, un premier essai de dcentralisation qui ne russit pas, en partie parce qu'il fut trop brusque, en partie cause des malheurs des temps troubls au milieu desquels il se poursuivit. La loi du 28 pluvise an VIII, sous le Consulat, qui fut la grande charte administrative de la reconstitution de la France au sortir de la Rvolution, la fit retomber sous un rgime de centralisation absolue. Mais, presque tout de suite, un mouvement de raction, et, par consquent, de dcentralisation se produisit, qui, depuis, ne s'est pas arrt. D'aprs la loi du 28 pluvise an VIII, les administrations du dpartement et de la
L'TAT
19
commune taient constitues par de purs dlgus du pouvoir central, sans initiative, sans autonomie, les plus petites affaires de la plus petite commune se tranchaient dans les bureaux des ministres. A l'heure actuelle, dans les dpartements et dans les communes, il y a des conseils lus, les conseils gnraux et les conseils municipaux, qui ont la haute main sur les affaires de la circonscription. Ils se runissent spontanment si les besoins l'exigent, leurs sances sont publiques, ils peuvent en certain cas se concerter entre eux. Ils ont l'initiative des mesures et leurs dcisions sont en gnral excutoires par elles-mmes, sauf contrle postrieur du pouvoir central. Les conseils gnraux ont bien ct d'eux les prfets qui exercent dans le dpartement une autorit dlgue par le pouvoir central, mais les prfets sont obligs d'excuter leurs ordres. L'administration de la France n'est plus l'uvre exclusive de l'tat, elle est le rsultat d'une collaboration de l'tat, des dpartements et des communes qui ont conquis une personnalit indpendante de celle de l'tat. Valeur de la dcentralisation. La dcentralisation est une bonne chose tant au point de vue politique qu'au point de vue juridique. Au poin.t de vue politique, c'est un accroissement de vie publique, puisque c'est intresser aux affaires locales directement tous les lecteurs et des milliers de mandataires lus. Ce n'est pas prcisment que les intrts locaux soient mieux grs; on peut soutenir que de bons agents, choisis par le pouvoir central, seraient aussi bons administrateurs que les conseils lus ; mais l'tat tout entier profite de cette activit et de cet accroissement de vie, parce qu'il faut bien partir de ce postulat que la vie est bonne et que plus de vie vaut mieux que moins de vie. Spcialement, dans un pays o, comme dans la France dmocratique contemporaine, l'organisation du gouvernement central repose tout entire sur la prpondrance d'assembles lues au suffrage universel, il est indispensable pour le bien du pays qu'en vue de ces lections gnrales si graves, le suffrage fasse son ducation dans les lections locales; que les lecteurs, dont des couches nouvelles arrivent la vie publique tous les ans, y fassent l'apprentissage du vote et les lus celui de l'administration. Une constitution qui aurait organis dmocratiquement le gouvernement central, et qui aurait nglig d'organiser de mme le gouvernement local, aurait construit une machine dpourvue de rservoir de force. Mais il ne faudrait pas aller trop loin dans la dcentralisation au point de vue de la quantit et de l'importance des services confis aux organes locaux. D'abord,il semble bien que les tats trangers, qui possdent des immunits provinciales, ont une tendance se centraliser. De plus, on ne peut donner de grands pouvoirs un gouvernement local, qu' la condition que la circonscription soit trs tendue; le pouvoir n'est impartial que s'il vient de loin et s'il est tranger aux querelles de clocher; l est le grand avantage de la centralisation, on a pu dire d'elle qu'elle est impartiale commela loi. Or, il est douteux que la France soit assez grande pour tre
20
THORIE DE L'TAT
divise en grandes circonscriptions. Il faul songer qu'elle n'est gure plus grande que certains des tats des tats-Unis d'Amrique. Dans tous les cas, si l'tat abandonnait quelques-uns de ses services aux dpartements et aux communes, il serait logique de donner plus d'attributions aux dpartements qu'aux communes, parce que ce sont des circonscriptions plus tendues. Au point de vue juridique, la dcentralisation a eu le grand avantage de faire voir qu'on pouvait soumettre aux rgles du droit la plus grande partie de la puissance publique. Tant que l'administration entire tait aux mains de l'tat, on pouvait hsiter dterminer la limite des pou: l'tat est une trs haute personnalit voirs de celui-ci en administration revtue d'une certaine majest. Du jour o une partie de l'administration a t remise aux dpartements et aux communes, personnalits du mme ordre que l'tat, mais moinsimposantes, on a commenc de mesurerleurs pouvoirs, et par analogie ensuite on a appliqu la mesure aux pouvoirs de l'tat. C. Cration d'organesspciaux. Les organes de gouvernement que nous connaissons jusqu' prsent ont une comptence gnrale, c'est--dire ont pourvoir aux besoins les plus varis. Les services de l'tat, ceux des dpartements, ceux des communes, sont des services multiples, complexes. Eh bien! ceci se produit la longue; si on prend tel service dtermin, par exemple celui de la bienfaisance ou de l'hospitalisation, on s'aperoit qu'au lieu de le laisser grer par l'administration gnrale de l'tat, ou du dpartement, ou de la commune, il vaut mieux lui crer - un organe spcial dont ce sera la fonction unique. Le service sera mieux assur, il sera plus l'abri des perturbations politiques, il se crera des traditions dans le personnel, sans compter qu'il y aura aussi des avantages au point de vue budgtaire que nous verrons plus tard. Il se cre donc un organe spcial, le bureau de bienfaisance,un autre organe spcial, l'hpital, et ainsi de suite. Ces organes spciaux prennent le nom d'tablissements publics. Il y a tendance en crer beaucoup. L'tat, le dpartement, la commune se dchargent ainsi, sur des tablissements publics, de beaucoup de leurs services, de sorte qu'il y a des tablissements publics d'tat, des tablissements publics de dpartement, des tablissements publics communaux. Notez qu'au fond les services rendus sont des services d'tat, de dpartement, de commune, si bien que ce sont ces circonscriptions qui alimentent en grande partie parleurs ressources les budgets de leurs tablissements; si bien qu' la Rvolution, les anciens tablissements publics ayant t dtruits, tous leurs services avaient t confis la commune ou l'tat.
CHAPITRE II L'TATETL'ORGANISME NATIONAL
Lerle 1er.
de l'tat
Position du problme. C'est un fait que,dans les socits, l'tat et l'organisme national coexistent et ne se confondent pasentirement l'un avec l'autre. Il ya des rapportsentre les hommes qui ne dpendent pas de l'tat. Ces rapports sont innombrables, liens de parentou d'affection, relations purement mondaines, relations d'intrt; ils forment un tissu continu dans lequel tous les individus sont envelopps, et la direction en chappe l'tat. Il ne faut pas se laisser tromper par ce fait que l'tat a fait des lo is pour rglementer ces rapports. D'abord, ces lois ne rglementent pas tout; ensuite, elles se bornent le plus souvent interprter d'avance la volont probable des individus eux-mmes; elles tablissent quelques restrictions, quelques dfenses; mais cela ne peut pas tre assimil une direction. Ce n'est pas dire que, dans l'organisme national, en tant qu'il chappe la direction de l'tat, il n'y ait aucune coopration entre les individus.Il yen a,au contraire, beaucoup, les exemples abondent. C'est ainsi que l'alimentation quotidienne des villes est assure, sans que l'tat dirige en rien, par la collaboration consciente ou inconsciente de fournisseurs, de commerants, de convoyeurs, qui, avec une rgularit admirable, approvisionnent les marchs. Il ya donc de la coopration; seulement, trop souvent, elle se produit selon le mode naturel qui est la subordination des plus faibles aux plus forts la suite de la lutte et de la concurrence, ce qui entrane des souffrances individuelles et mme des sinistres collectifs. tant donn cette situation, les penseurs se demandent quel serait le rle de l'tat dans une socit vraiment organise, et jusqu' quel point il devrait imposer sa direction l'organisme national; les peuples aussi se le demandent quelquefois, lorsqu'ils se trouvent dans des priodes de malaise ou de souffrance. Lesocialisme et l'anarchisme. Au problme ainsi pos, il y a d'abord deux solutions radicales, opposes l'une l'autre: la solution
22
THORIE DEL'TAT
socialiste et la solution anarchiste. D'aprs le socialisme, l'tat devrait prendre la direction de toute la coopration entre les hommes ; il devrait, par consquent, absorber tout l'organisme national. Notons que le socialisme respecte tout ce qui est jouissance purement individuelle ; il ne veut pas restreindre les droits de l'individu en tant qu'ils ne sont pas oppresseurs d'autrui; ce qu'il veut, c'est subordonner la direction de l'tat tout ce qui est collaboration, afin de dtruire partout le pouvoir du fort sur le faible et de faire que tous les hommes soient gaux sous la houlette de l'tat. Dans la conception socialiste, ce que l'tat doit se subordonner, c'est donc beaucoup moins l'individu, comme on le dit trop souvent, que l'organisme national, c'est -dire la coopration organise d'une faon individuelle D'aprs l'anarchisme, au contraire, c'est l'existence de l'tat qui fait tout le mal. Si l'tat disparaissait avec sa lgislation, la coopration s'organiserait entre les hommes d'une faon naturelle, et le jeu des lois naturelles n'tant fauss par aucune cause accidentelle assurerait chacun une situation selon ses gots. Par consquent l'tat doit disparatre, et il ne doit subsister que l'organisme naturel. On voit que les deux solutions sont galement radicales; elles sont en mme temps galement fausses, par suite de la mme erreur qui est l'optimisme. Cela apparat clairement pour l'anarchisme; les partisansde ce systme croient la bont essentielle de la nature, c'est pour cela qu'il veulent laisser faire celle-ci et dtruire l'tat, qui est une raction de la raison de l'homme contre la nature; la nature est parfaite, c'est la raison de l'homme qui est mauvaise. Cela vient en droite ligne de Rousseau, bien que cela aboutisse des consquences diffrentes. Il n'est pas besoin d'une longue rfutation: c'est ici que les sciences naturelles sont utiles, en montrant que partout, dans la nature, rgne la loi cruelle de la lutte pour la vie, que, par consquent, la nature n'est pas essentiellement bonne. Le fond du socialisme est un optimisme analogue. Ici, c'est la raison de l'homme en qui on a une confiance absolue. La nature est mauvaise; tout ce qui, dans la socit. provient de l'organisation naturelle est irrmdiablement vici; il y faut substituer une organisation rationnelle et, par consquent, y faire pntrer le rgime de l'tat. On 1. Il en rsulte que le socialismene dtruit point les droits de l'individu en tant qu'ils garantissent une jouissancepurement individuelle; la proprit prive, par exemple, n'est pas attaque par les collectivistesen tant qu'elle est une forme de jouissance individuelle,mais en tant qu'elle devient un instrument de pouvoir dans la coopration sous forme de capital.
NATIONAL ETL'ORGANISME L'TAT
23
remarque, d'ailleurs, que jusqu'ici partout o l'tat a pris la direction de la coopration sociale, 'a t un bienfait; que, par exemple, c'est pour le grand soulagement des populations que l'tat a enlev aux barons fodaux et a pris pour lui les droits de guerre, de justice, de police, etc. H!as ! la raison humaine est aussi infirme que la nature est mauvaise. Et voil pourquoi l'tat, uvre de la raison, ne saurait tre charg de diriger toute la coopration humaine. La raison humaine, borne et sujette l'erreur, ne saurait construire qu'une organisation imparfaite, et, au nom d'une organisation qu'on sait d'avance devoir tre imparfaite, on n'a pas le droit de dtruire tout ce qui est. Les inconvnients de ce qui est sont connus, et d'ailleurs ils ont pour eux d'tre dans la nature ; les dangers de ce qu'on mettrait la place sont inconnus. La vraie rponse faire au socialisme, c'est donc que, pour un pareil rgime, la raison humaine n'est pas assez parfaite et qu'elle ne le sera jamais assez. Mais il y a des esprits qui croient au progrs indfini dela raison ; pour ceux-l, il n'est pas inutile de descendre un peu plus dans les faits et de leur faire toucher du doigt la difficult. Si l'tat prenait la direction de toute la coopration sociale, notamment de la coopration conomique, les luttes conomiques disparatraient; on ne verrait plus de faillites ni de grves, ni de scandales de Bourse ; seulement, toutes ces luttes seraient plutt transformes que supprimes, elles seraient transportes au cur de l'tat lui-mme; du dehors, elles passeraient au dedans et prendraient l'aspect de luttes politiques, c'est--dire de luttes pour la possession du pouvoir lgal. Certes, les luttes des partis politiques sont jusqu'ici moins meurtrires que les luttes conomiques ; mais il faut prendre garde, c'est par l que peut se produire la flure et la dsorganisation de la machine. Les luttes politiques n'ont qu'un inconvnient mdiocre lorsque le pouvoir de l'tat est modr ; mais que deviendraient-elles si ce pouvoir grandissait d'une faon dmesure? Or, il faut remarquer que si l'tat assumait la direction conomique, il hriterait de toutle pouvoir qui est maintenant dissmin et rparti entre les nombreux patrons et les nombreux capitalistes. Quelle course au pouvoir, ds lors, l'intrieur de l'tat ! Quelles batailles entre les partis, quel dveloppement du fonctionnarisme ! On touche du doigt le pril, c'est la corruption de l'tat par le pouvoir, consquence mme de son dveloppement. Une histoire bien instructive cet gard est celle de l'glise. L'Eglise, au moyen ge, tait un tat politique suprieurement organis; elle avait, pour assumer la direction de la socit humaine, des moyens
24
THORIE DEL'TAT
d'action que l'tat laque ne possde pas. A la contrainte matrielle, elle joignait la contrainte morale ; son personnel administratif tait innombrable et d'un grand zle ; elle avait sa disposition ce que l'tat n'a pas encore, un capital inpuisable reposant il est vrai sur la foi des fidles, un trsor de grces et d'indulgences qu'elle distribuait par ses sacrements. En dpit de ces avantages, elle a chou dans son rve thocratique de domination universelle. Elle est reste comme un noyau rsistant au milieu des contradictions de la librepense, mais elle n'a pas pu monopoliser la direction de la pense, et par l celle de la socit. Et la raison visible de son chec, c'est la corruption produite dans son sein par le pouvoir qu'elle avait dj conquis ; c'est la simonie, la dpravation du clerg, la lutte des papes et des antipapes, la banqueroute des indulgences, tous les scandales qui ont amen le grand schisme d'Occident et la Rforme. On a peine croire que l'tat laque soit plus heureux avec des moyens d'action moins puissants, et il est bien probable que sa destine lui aussi est de demeurer comme un noyau rsistant au milieu des contradictions de la lutte individuelle. L'individualisme et l'tatisme. Le socialisme et l'anarchisme,. ne pouvant pas se raliser compltement, se transforment en deux tendances qui luttent perptuellement l'une contre l'autre: la tendance dvelopper le rgime d'tat et la tendance le restreindre. Et, pour ceux qui se rendent compte de l'effet limit qu'elles peuvent produire, elles changent de nom : la premire prend le nom d'tatisme; d'interventionisme, de socialisme de la chaire; la seconde, le nom d'individualisme. Ces deux tendances se partagent les hommes suivant leurs intrts, leurs ides et leurs tempraments retravailles par la pense, elles ; aboutissent des systmes et des programmes qui varient suivant les circonstances. Ce ne sont pas, d'ailleurs, les systmes qui trouvent les solutions, ils ne font que les prparer. Les solutions sont trouves par la vie sociale sous la pression, d'une part, de l'intrt gnral vident, d'autre part de la justice vidente. Et comme la vie ne procdepas d'ordinaire par secousses, mais par volution, sauf des exemples trs rares de rvolutions o beaucoup de rformes se font la fois, l'habitude est qu'elles se ralisent lentement, une une. Les solutions sont tantt socialistes, tantt individualistes, souvent transactionnelles. Quelquefois on donne l'tat un monopole, maisen mme temps on accorde l'individu quelque nouvelle libert. La Rvolution franaisea certes fortifi l'tat; elle peut tre, certains gards, considre comme socialiste; mais c'est elle qui en mme temps a proclam les droits de l'homme. De nos jours, l'tat tend interve-
NATIONAL L'TATET L'ORGANISME
25
nir par sa lgislation dans le monde du travail, limiter la dure des heures de travail par exemple; mais, en mme temps, on a dcrt la libert des syndicats. On pourrait faire bien des rapprochements de ce genre. La vrit est qu'entre la coopration dirige par l'tat et celle qui reste libre il existe un certain tat d'quilibre. Seulement, chaque instant, l'quilibre est rompu, parce que la coopration, c'est--dire la solidarit entre les hommes, augmente d'une faon absolue par suite des progrs de la civilisation. Alors, pour rtablir l'quilibre, tantt il faut donner l'tat, tantt l'individu. Au fond, nous croyons que dans les priodes o la civilisation est ascendante, c'est--dire o la solidarit s'accrot, l'tat et l'individu voient tous les deux la fois s'augmenter leur domaine. Comme on l'a trs bien dit: Dans ce duel, la nature est la seule vaincue 1. 2. Le droit public national. Les droits individuels garanties constitutionnelles et leurs
Le droit domine la lutte entre l'tat et l'organisme national. Pour lui, l'organisme national se rsout en individus isols ou associs; le droit, en effet, ne se proccupe que des volonts, et il est facile de voir que, dans la mle sociale, il n'y a, en dehors de l'tat, que des volonts individuelles ou des volonts d'associations qui se comportent comme des individus. La lutte, au point de vue du droit, est donc engage entre l'tatd'une part et d'autre part l'individu. Le droit s'efforce de rgler cette lutte, 1.Cecin'est pas un paradoxe. IL est certain qu'un accroissement de solidarit entre les hommes accrot par lui-mme la richesse. En effet, il permet un nouveau dveloppement du crdit, qui n'est que de la solidarit humaine monnaye. Et, d'autre part, le crdit est un merveilleux multiplicateur de la richesse. L'tat peut donc devenir plus riche sans que, pour cela, l'individu soit appauvri ; ou, si l'on veut, la proprit collective peut se dvelopper sans que la propritprivediminue d'importance. Le tout,bien entendu, dans de certaines limites. L'examen des faits relatifs au crdit suggre mme l'ide que c'est de ce ct-l que l'tat pourrait le plus lgitimement chercher tendre son domaine. La direction du crdit est peut-tre la seule richesse collective qui puisse tre confie l'Etat. Cela aurait dj des inconvnients, mais, au moins, aurait l'avantage de ne demanderaucune expropriation. D'ailleurs, si l'on tudie l'glise comme institution politique, ne s'aperoit-on pas que tout le nerf de son pouvoir de direction repose sur la foi des fidles ? Pourquoi le crdit, qui est une forme de la confiance, ne pourrait-il pas devenir un des lments du pouvoir de direction de l'tat?
26
THORIE D L'TAT
et, pour cela, il dfinit les droits de l'tat et ceux de l'individu, et, selon sa proccupation constante, il s'efforce de maintenir l'galit entre eux. L'tat a des droits vis--vis des individus, par exemple il peut leur demander certains sacrifices, comme l'impt, le service militaire; il exerce sur eux une police de sret indispensable la scurit gnrale, etc. Ce sont des droits de puissance publique;leur rglementation forme une bonne partie du droit administratif. Les individus ont des droits vis--vis de l'tat, on les appelle des droits individuels. Il y en a trois principales espces : 1 des droits politiques, qui donnent l'individu une part d'action dans l'tat, par exemple le droit de suffrage; 2 des liberts individuelles qui reprsentent la part d'autonomie que l'individu garde en face de l'tat, par exemple la libert de conscience, la libert individuelle, la libert de la presse, etc. ; 3 des droits aux services de l'tat ou aux bnfices de la loi. La rglementation de ces droits forme l'objet du droit public proprement dit. Ces droits ont, de part et d'autre, besoin d'tre dfinis et garantis, car, de part et d'autre, des injustices peuvent tre commises. Il y a eu des poques o, l'tat tant moins fort, c'taient ses droits qui avaient besoin d'tre protgs. A l'poque actuelle, il semble bien que l'tat ait de la force en excdent, car toutes les constitutions s'appliquent, au contraire, garantir les droits des citoyens. C'est au droit constitutionnel surtout qu'appartient l'tude des moyens employer pour garantir les liberts individuelles, mais remarquons ici que les thories gnrales du droit public n'y sont pas indiffrentes. Il dpend des jurisconsultes d'amliorer la situation des individus vis--vis de l'tat, uniquement par la faon dont ils conoivent la personnalit de celui-ci. Il ne faut pas considrer cette personnalit comme tellement transcendante, qu'il n'y ait aucune commune mesure entre les droits de l'tat et ceux des individus; il faut considrer, au contraire, que c'est au fond une personnalit humaine, puisqu'elle procde de volonts humaines; que, par consquent, les droits de l'tat, tout en ayant plus d'amplitude, sont de la mme nature que les droits des individus, qu'ils peuvent tre soumis des rgles analogues, et que les actes par lesquels ils sont exercs peuvent tre apprcis des tribunaux, tout comme les actes des particuliers. En d'autres termes, il faut que l'action de l'tat soit soumise l'empire du droit, et non pas d'un droit quelconque, arbitraire, mais du seul qui existe, le droit quitable et contractuel.
CHAPITRE III L'TATET L'ORGANISME INTERNATIONAL
Les relations que les hommes nouent L'organisme international. entre eux, sans se proccuper de l'tat, ne s'arrtent pas aux frontires, elles les franchissent. Il y a entre nationaux des diffrents tats des relations de parent, d'affection, d'intrt, des communauts de croyance qui tablissent une vritable solidarit. A l'poque contemporaine, cette solidarit s'accrot avec rapidit. La facilit des communications, les chemins de fer et les tlgraphes, en ont t la cause immdiate; mais, si l'on voulait remonter dans l'histoire, on trouverait bien des vnement qui l'ont prpare, notamment les grandes guerres qui, en dpit d'animosits passagres, amnent le contact et le mlange des peuples. Outre l'organisme national, il existe donc un organisme international : en effet, ce tissu de relations cres entre nationaux des diffrents pays fait qu'en certaines occasions tous ces nationaux, secous par les mmes tressaillements, se sentent, dans une certaine mesure, sous la dpendance les uns des autres. La banque est internationale et les fluctuations des valeurs montaires se font sentir d'un bout du monde l'autre. La production conomique tout entire est internationale, car, si chaque tat n'tablissait pas sa frontire des barrires factices, la valeur de chaque produit serait chaque instant modifie par des faits conomiques survenus dans les parties du monde les plus lointaines. Cet organisme international a son me, l'ide internationale, et c'est ce qui fait sa force, car c'est l'ide qui agit. La religion est internationale, la science est internationale, l'art et la littrature le deviennent, l'ide dmocratique est internationale, il en est de mme de l'ide socialiste. Le rle del'tat vis--vis de l'organisme international. La concurrence et la lutte pour la vie rgnent, dans l'organisme international, d'une faon plus violente encore que dans l'organisme national. Le devoir de l'tat est de protger ses nationaux par sa diplomatie pendant la paix, et au besoin par la guerre. Ce n'est pas seulement l'organisme national, dont il a la direction,
28
THORIE DE L'TAT
que l'tat ale devoir de dfendre; il doit se dfendre lui-mme dans sa propre existence, et, pour ainsi dire, dans sa notion. Il ne faut pas se dissimuler, en effet, que, dans l'ide internationale, il y a un principe de dissolution des tats nationaux, tels qu'ils sorrt organiss. Toutes les fois que les groupes humains s'agrandissent, ils modifient leur type. La tribu est dj un autre type que la famille; la cit antique, un autre type que la tribu; l'tat moderne qui suppose un groupement plus nombreux, est un autre type que la cit antique. L'organisme international, encore l'tat rudimentaire, mais qui semble annoncer un groupement d'hommes encore plus nombreux, porte en gestation un type d'organisation sociale probablement trs diffrent de l'tat national moderne. L'tat doit donc se dfendre en mme temps qu'il dfend ces nationaux, car c'est encore indirectement protger ceux-ci. Il faut, si, dans des temps lointains, il se prpare un groupement nouveau, que les nationaux de chaque tat y aient la plac la meilleure possible. C'est l ce qui lgitime, au point de vue politique, non seulement la lutte d'tat tat, mais aussi les moyens de dfense que tous les tats emploient contre l'glise. Car l'glise, en tant qu'elle incarne l'ide internationale, est un dissolvant puissant des tats nationaux. Il pourrait se faire que, pour les mmes motifs, les tats eussent se dfendre un jour contre l'ide socialiste. Le droit international. Le droit domine la lutte internationale comme il domine la lutte nationale. Il rgle les rapports d'tat tat, soit dans la guerre, soit dans la paix. On l'appelle alors le droit international public. Il rgle aussi les rapports des nationaux appartenant des tats diffrents en donnant le moyen de rsoudre le conflit des : on l'appelle, dans cet office, le droit international lgislations diverses priv. L, comme partout, fidle son principe, le droit traite les tats et les individus comme des tres libres qui contractent sur pied d'galit. L'tat et les glises Les glises. Les glises sont des groupements d'hommes qui se rapprochent des tats plutt que des associations prives, en ce sens qu'ils se produisent la faon d'un phnomne naturel et que ceux qui en font partie y sont, pour la plupart, en vertu d'un quasi-contrat plutt que d'un contrat. Elles ont, d'ailleurs, une vritable organisation politique, un gouvernement centralis ou dcentralis, et, certaines poques, elles ont rendu des services qui semblaient rservs aux tats; tmoin, au moyen ge, l'extension aux matires civiles de la lgislation canonique.
INTERNATIONAL L'TATET L'ORGANISME
29
Elles ont certainement une personnalit morale et juridique, Lien que les tats ne la reconnaissent pas toujours et tous les points de vue. Les tats religieux ont forcles l'tat avec de glises. Rapports ment des rapports avec l'tat laque, parce qu'ils font sentir leur gouvernement sur le territoire et sur les nationaux de celui-ci. Et il serait puril de dire que les conflits sont impossibles parce que le but de l'action des glises est la prparation la vie future; la prparation la vie future se fait justement dans la vie terrestre, et c'est bien sur cette vie que les glises exercent leur action, tout comme les tats politiques. Il y a donc se proccuper dergler les rapports des deux pouvoirs en prsence. Deux systmes opposs se conoivent : ou bien l'tat politique juge propos de reconnatre le caractre d'tat religieux qu'ont les glises, c'est--dire le caractre social de la religion, et alors il s'tablit un modus vivendi entre les deux gouvernements; ou bien l'tat prfre ignorer les glises comme tats religieux, il considre le besoin religieux de ses nationaux comme individuel, et il les laisse libres d'y pourvoir par des moyens individuels. Le premier systme peut s'appeler celui de l'union de l'glise et de l'tat, le second s'appelle la sparation de l'glise et de l'tat. Les tatsont surtout jusqu'ici pratiqu le premier systme. L'union de l'glise et de l'tat a successivement revtu plusieurs formes. 'a t pendant longtemps un modus vivendi tabli sans contrat formel, ou du moins sans contrat solennel, et tantt, comme sous l'empire romain, l'tat a essay de dominer l'glise, tantt, comme au moyen ge, l'glise a essay de dominer l'tat. Actuellement, on en est gnralement l're des concordats, c'est--dire des contrats solennels, revtant, au moins avec l'glise romaine, la forme de traits diplomatiques et rglant expressment toutes les questions importantes. En France, le premier concordat a t sign par Franois Ier et Lon X (1516) et a rgl les rapports de la monarchie franaise et du saint-sige jusqu' la Rvolution. Le second date de 1801 (26 messidor an IX, complt par les articles organiques, L. 18 germinal an X) et nous rgit encore. Partant de ce principe que l'glise est une puissance trangre, qui exerce l'intrieur de l'tat une certaine autorit, il s'attache limiter son action. 1 Il surveille la lgislation, la mesure dans laquelle les ordonnances pontificales ou bulles peuvent tre promulgues dans l'intrieur de l'tat (Droit d'exequatur ou d'annexe,art. 1er, L. 18 germinal an X). 2 Il surveille le clerg, qui estle personnel administratif de l'glise, son recrutement et ses agissements. La grosse question est celle du
30
THORIE DEL'TAT
recrutement; on est arriv, par un systme trs rationnel, ce que, malgr le caractre cosmopolitede l'glise, malgr que le chef de cette glise rside l'tranger, le clerg soit national. Ce rsultat est obtenu au moyen de la distinction entre la nomination au poste et l'institution canonique; la premire appartient l'tat, an moins pour les vques et les curs de canton, la seconde l'glise. Ce systme force l'tat s'occuper de l'ducation et de la prparation des membres du clerg, faire ceux-ci une situation spciale si elle est ncessite par leur caractre, pourvoir leurs besoins, leur fournir les difices du culte, etc. Enfin, comme le concordat reconnat l'autorit de l'glise, il faut prvoir les conflits entre l'autorit ecclsiastique et l'autorit administrative. Ces conflits, d'une nature toute particulire, sont rgls par une institution d'ordre contentieux appele appel comme d'abus. Il sera trait de cette institution dans la partie du contentieux. (Pour les cultes protestants, V. L. 18 germinal an X, D. 26 mars 1852, L. 1er aot 1879. Pour le culte isralite, O. 25 mai 1844, D. 29 aot 1862, D. 11 novembre 1870.) On peut se demander si l're des concordats durera longtemps, ou si elle ne fera pas place la sparation de l'glise et de l'tat. Dans le cas o la sparation se raliserait, il faut bien entendre le rgime. Ce n'est pas : l'glise libre dans l'tat libre, comme on l'a dit, car l'tat ne pourrait pas reconnatre la personnalit de l'glise, ni des subdivisions administratives de celle-ci (diocses, paroisses, etc.). il reconnatrait L'tat ignorerait l'glise comme puissance, seulement des associations qui greraient les intrts religieux, titre purement individuel, fabriques, etc., en surveillant, bien entendu, les biens de mainmorte. Quant au recrutement nationalduclerg, le patriotisme des fidles suffirait sans doute l'assurer.
HISTOIRE DELA FORMATION DU DROIT ADMINISTRATIF
FRANAIS
DEPUIS L'AN VIII1
Comme toutes les crations sociales doues de vie, le droit administratif franais a t le produit de l'activit de beaucoup de volonts inconscientes. Nous entendons par l que parmi ceux qui J'ont fond au lendemain de la Rvolution, administrateurs, auditeurs, matres des requtes, conseillers d'tat, beaucoup, allant au plus press, se dcidaient d'aprs les besoins de l'administration et d'aprs un certain instinct; que quelques-uns seulement rflchissaient sur l'origine, la valeur, la porte des rgles qu'ils laboraient. Ce qui est vraiment frappant, c'est que, dans la pense de tous, ce droit tait compltement nouveau, qu'il ne procdait en rien de l'ancien rgime, et qu'il se dveloppait d'une faon tout originale. Cette opinion, qui, chez la plupart, tait latente, est exprime, ds le dbut, par de Grando, Cormenin, et plus tard par Boulatignier. On la formulait d'une faon trs plausible et qui devait lui donner beaucoup de crdit. On faisait remarquer que le droit administratif ne pouvait exister part et se distinguer du droit ordinaire, que si les juridictions charges de l'appliquer taient elles-mmes spares des juridictions ordinaires; en d'autres termes, qu'il ne pouvait y avoirde droit administratif sans sparation des pouvoirs. Or le principe de la sparation des ; le pouvoirs n'avait t introduit que par l'Assemble constituante 1. V. Boulatignier,Revuetrangre et franaise, anne 1839,De l'origine,des du droit administratif en France. DeCormenin, progrs et de l'enseignement Droit administratif, 5e dition, 1840,prface. R. de Mohl, Die Geschischte und Literatur der Staats wissenschaften,1858, 3e volume, p. 192-290. F. Laferrire, Del'enseignement administratif danslesFacultsde Droit etd'une cole spcialed'administration; Revuede Lgislation,t. XXXIV;Tablesde la Thmis,etc., prface, 1860. Ancoc,LeConseild'tat, 1876. E. Laferrire, Trait de la juridiction administrative,1887.
32
FORMATION DUDROIT ADMINISTRATIF
droit administratif ne pouvait donc pas remonter plus haut que le dbut dela Rvolution. Encore convenait-il de remarquer que, pendant toute la dure de la Rvolution, il n'avait pu exister qu'en germe, le contentieux tant confi aux corps administratifs eux-mmes, aux municipalits, aux directoires, au conseil des ministres, et le droit, dans ces conditions, ne pouvant pas aisment se dgager de l'administration. C'tait donc vraiment la rforme de pluvise et nivse an VIII qui, en organisant les conseils de prfecture et en transportant au conseil d'tat les attributions contentieuses des ministres, avait cr le contentieux administratif, et par suite le droit administratif. Ce qui frappait surtout dans l'ancien rgime, et ce qui faisait qu'on le voyait comme spar par un abme du nouvel tat de choses, c'tait la confusion qui y rgnait entre le pouvoir judiciaire et le pouvoir administratif : les parlements faisant des rglements de police et citant les administrateurs comparatre devant eux; le conseil d'tat cumulant la connaissance des affaires civiles et celle des affaires administratives: les justices locales ayant, presque partout la petite voirie; les juridictions incontestablement administratives, comme les tables de marbre, les cours de l'amiraut, des trsoriers de France, des aides, des comptes, organises tout comme les juridictions civiles1. Il y avait beaucoup de vrai dans cette manire devoir, et nous nous en rendrons mieux compte lafin de notre tude. Il est certain que la Rvolution et la sparation des pouvoirs ont produit quelque chose de nouveau, qui est le groupement des rgles administratives en un corps de droit distinct. Beaucoup de ces rgles existaient sous l'ancien rgime, mais elles taient parses et confondues avec les rgles du droit ordinaire. Leur agencement, leur coordination en un corps de droit unique, a t l'uvre des temps nouveanx. Quoi qu'il en soit, d'ailleurs, l'ide qu'on se fait des choses a plus d'action que la ralit vraie. Tout le monde a cru. a dit, que le droit administratif tait un droit nouveau, et il s'est comport comme tel. Il s'est dvelopp d'une faon exclusivement nationale, et il a pass curieux pour par toutes les phases d'un droit qui s'organise, spectacle un historien. A la vrit, il a parcouru ces phases avec une rapidit telle qu' l'heure actuelle, alors qu'un sicle n'est pas encore coul, son volution peut tre considre comme presque termine. Il y a eu des raccourcis. Cela tient ce que, si le droit tait jeune, le peuple au sein duquel il voluait n'tait rien moins que primitif. Ce ne sont pas 1. V. de Grando, Leond'ouverture, Thmis,I,67. Cormenin, prface, 2e partie. Boulatignier, article cit, Revuetrangre et franaise, 1839,p. 81. Bonnin, Principes d'administrationpublique, I, p. VII
DUDROIT ADMINISTRATIF FORMATION
33
des pontifes mystrieux, ni des prudents encore frustes, qui ont prsid son laboration premire, ce sont de vritables jurisconsultes. Le droit administratif a prsent, dans son volution, les phnomnes suivants: 1 Il s'est form surtout par le contentieux, c'est--dire par la jurisprudence du conseil d'tat. Le conseil d'tat s'est trouv dans une situation exceptionnelle ; juge dfinitif de tout le contentieux administratif grce l'appel et la cassation qui lui subordonnaient toutes les autres juridictions administratives, il tait en mme temps juge prtorien grce l'absence de codification. D'un autre ct, bien que ce ft un corps gouvernemental, heureusement pour lui peut-tre, il a t pendant plusieurs annes discut, critiqu, attaqu ; ces tribulations l'ont inclin au culte du droit plus que ne l'et fait sans doute si elleet dur, la faveur dont il jouissait sous le premier empire. Sauf de rares carts, sa jurisprudence s'est montre trs juridique, et l'on peut dire que la substance du droit administratif est sortie de ses arrts et de ses avis. 2 Le droit administratif a pass par les priodes suivantes: Une priode d'laboration secrte ; non pas que le secret ait t voulu ni jalousement gard comme celui des formules des actions de la loi Rome par le collge des pontifes ; mais, en fait, il y a eu un certain nombre d'annes pendant lesquelles ni les procds de l'administration ni les dcisions du conseil d'tat n'taient connues ; Une priode de divulgation; Une priode d'organisation. Il est difficile d'arrter par des dates ces diffrentes priodes, dans la vie, tout s'enchevtre, il ya eu, ds le dbut, un peu d'organisation; il y a encore actuellement une part de divulgation ; ces divisions ne doivent donc pas tre considres comme nettes et tranches; toutefois on peut fixer l'anne 1818 le commencement de la divulgation, et l'anne 1860 le dbut de l're d'organisation. a) Priode d'laboration secrte (1800-1818)
Aussitt que le conseil d'tat eut t rorganis par la constitution du 22 frimaire an VIII, art. 52, et que, par l'arrt du 5 nivse an VIII, il eut t charg des conflits et des affaires contentieuses dont la dcision tait prcdemment remise aux ministres, il commena d'y avoir une jurisprudence administrative. Toutefois, il faut remarquer qu'il n'y eut de suite dans cette jurisprudence et qu'il ne se cra des traditions qu' partir du dcret du 22 juillet 1806, qui organisa au sein du conseil d'Etat un comit spcial du contentieux et donna aux affaires contentieuses une procdure diffrente decelledes affaires administratives. H. 3
34
FORMATION DUDROIT ADMINISTRATIF
Mais, jusqu'en 1818, poque o Macarel publia ses Essais de jurisprudence administrative, cette jurisprudence ne fut pas connue. Non seulement elle tait ignore du grand public, mais elle l'tait de l'administration, des avocats au conseil et des conseillers d'tat eux-mmes, l'exception de quelques membres du comit du contentieux qui avaient fait un effort personnel pour se tenir au courant. La procdure, toute secrte, ne pouvait tre suivie que des parties. Les arrts s'entassaient dans les archives du conseil sans tre recueillis ni publis. D'ailleurs, cette jurisprudence inspirait quelque suspicion et l'on pouvait se demander si elle fondait un droit bien srieux. On voyait surtout dans le conseil d'tat un corps politique, et, dans les premires annes de la Restauration, ce fut un prtexte des attaques violentes contre sa juridiction1. Plusieurs des affaires dont il tait alors charg prsentaient, en effet, un caractre politique en mme temps que juridique; ce furent des contestations relatives aux domaines nationaux, des dchances imposes aux cranciers et fournisseurs de l'tat, l'indemnit des colons de Saint-Domingue; plus tard, aux fournitures faites pendant l'occupation militaire de 1814 et de 1815, la rintgration des migrs dans les biens non vendus, au milliard des migrs, aux majorats, etc., toutes choses qui irritaient et passionnaient dans des sens divers des intresss nombreux. De plus, le gouvernement de la Restauration, jusqu' l'ordonnance du 1er juin 1828, fit un abus du conflit, et, en voquant devant le conseil d'tat des affaires qui n'avaient rien d'administratif, lui donna quelques-unes des allures de l'ancien conseil du roi; de sorte que, bien que pardessous cette agitation superficielle il se crt des rgles de droit intressantes, pendant les premires annes personne ne fut tent d'aller leur recherche. Enfin, il faut bien le dire aussi, pour faire cette espce de dcouverte, il fallait des esprits suprieurs la moyenne ; or, soit pendant l'empire, soit pendant les annes d'invasion qui suivirent, tous les hommes de quelque valeur taient tourns vers l'action. Il a cependant t publi quelques ouvrages pendant cette priode; 1 mais. ou bien ce sont de pures compilations indigestes, ou bien des traits sans valeur2 1. V. dans Cormenin, Droit administratif, 5e dition, I, 216, la liste des brochures, pamphlets, discours auxquels a donnlieu la questiondu maintien ou de la suppression du conseil d'tat et de la juridiction administrative. la 2. Fleurigeon, Codeadministratif; la premire dition, antrieure 1812, Lalouette, dictionnaire. sortede 6 vol. 1817, Classificade in-8, 1820, seconde, Dupin, Loissur lois,1817,1vol.in-12. 1 vol. in-4. tiondes lais administratives,
ADMINISTRATIF DUDROIT FORMATION
35
Deux de ces traits sont particulirement fantaisistes, et ce sont pourtant les seuls qu'on puisse citer. C'est d'abord celui de Portiez de l'Oise, directeur de l'cole de Droit de Paris et charg du cours de droit administratif cr par la loi du 22 ventse an VIII, art. 21. Cet ouvrage porte le titre pompeux de Cours de lgislation administrative dansl'ordre correspondant l'harmonie du corps socials. : il envisage l'homme depuis sa L'auteur y adopte le plan suivant naissance jusqu' sa mort, en le faisant passer par tous les rapports qu'il peut avoir avec l'administration tant qu'il existe. Cela et pu faire un pamphlet spirituel, cela ne fait qu'un ouvrage bizarre. R. de Mohl, qui a eu le tort de le prendre au srieux, le dclare bien faible (sehr schwache 3). Le second trait, avec plus de prtentions, est tout aussi mauvais. Ce sont les Principes d'administration publique de Charles-Jean Bonnin 4 L'auteur est de l'espce redoutable des idologues qui rduisent tout en ides abstraites et mettent ces ides au service de la force pure. Pour lui, la Rvolution a fait table rase de tout. Le droit n'existe pas, il n'y a que la loi. On devrait dire non pas jurisconsulte, mais lgisconsulte. Tous les droits sont des facults de l'homme qui dcoulent de la loi. Quant la loi elle-mme, inutile d'ajouter qu'elle est l'uvre d'un gouvernement poigne. Il n'y a que trois pouvoirs dans la socit, le gouvernement d'abord, puis l'administration et la justice qui sont des formes du gouvernement. Montesquieu est arrang de la belle faon pour avoir pu imaginer qu'il y en et d'autres. Rousseau n'est pas mieux trait, ni les jurisconsultes du droit des gens,ni le droit romain. Avant Bonnin, d'ailleurs, il n'y a eu personne, si ce n'est Lavoisier qui a fond la science positive en mme temps que la chimie5! Presque point de dtails prcis dans le corps de l'ouvrage, ils sont noys dans le flot des ides gnrales. Pourtant, dans tout ce fatras, on peut relever une ide juste et qui servira plus tard, c'estque, en administration)l'tat doit tre considr comme une volont agissante6. Cela est important; plus tard, on s'apercevra qu'en effet l'acte d'administration doit tre considr comme une manifestation de volont. En somme, dans ces ouvrages, rien ou trs peu de chose; et il faut 1. Cecoursn'avait t organisqu' Paris et semblen'avoir t fait que pendant une anne. Thmis, I, 67. 2. Portiezde l'Oise,Cours delgislation administrative, etc. 2 vol. Paris, 1808. 3. Op. cil., III, p.219. 4. Bonnin, Principesd'administration. 3e dit., 1812. 5. Prface,pasiim. Si notre auteur tait plus srieux, on pourrait y voir, cause de ce dernier trait, un prcurseur d'Auguste Comte. 6. T. 1er,p. 86 et la note. I
36
DU DROIT FORMATION ADMINISTRATIF
bien croire que ce qui a manqu leurs auteurs, c'est d'tre soutenus par la jurisprudence, que c'est la jurisprudence qui est la grande rgulatrice de la doctrine par le sentiment qu'elle donne de la ralit des choses; car, jurisprudence mise part, ce ne sont pas les matriaux qui leur manquaient. Ils avaient leur disposition les lois et les dcrets ; le Bulletin des lois existait depuis l'an II, les actes du gouvernement, depuis 1789 jusqu' l'an II, avaient t l'objet d'une publication officielle en 1806, et il y avait d'autres collections prives. D'autre part, ils voyaient fonctionner sous leurs yeux l'organisation administrative simple et nette de l'an VIII; ils avaient leur disposition d'excellentes instructions comme celle adresse aux maires de Seine-et Marne par le prfet Lagarde, en 1808, qui est un vritable trait d'administration municipale. Ils n'ont tir de cela aucun parti. Il faut reconnatre, d'ailleurs, qu'ils ont t promptement oublis1. b) Priode de divulgation (1818-1860) I. Les annes 1818 et 1819 sont un moment intressant dans l'histoire du sicle. Il s'y est produit un rveil intellectuel. Le cauchemar de la domination impriale et celui de l'invasion viennent de disparatre, les armes des allis ont vacu le territoire le 10 dcembre 1818. Les jeunes hommes qui ont grandi dans ces annes troubles ont l'esprit ouvert et mri; ils sentent qu'il s'organise un monde nouveau et que c'est maintenant par la pense qu'il faut agir. Saint-Simon va commencer lancer ses brochures (1819), Lamartine va publier les premires Mditations (1820), et Victor Hugo les Odes et Ballades (1822). Victor Cousin et Guizot vont ouvrir leurs cours la Sorbonne, Thiers et Augustin Thierry entreprendre leurs travaux historiques (1822-1825). Dans l'ordre du droit, Jourdan fonde en 1819 la Thmis, vaillante revue qui ne devait vivre que dix ans, mais qui devait, par l'intermdiaire de l'Allemagne, nous faire retrouver la tradition de nos grands jurisconsultes du XVIesicle que nous avions perdue. La France, aprs avoir vcu pendant vingt-cinq annes au jour le jour, du spectacle des vnements vertigineux qu'elle crait, s'arrte, se recueille, regarde autour d'elle et chez elle. Trois hommes sont comme les anctres du droit administratif fran- ais, Macarel2, de Grando3, Cormenin4. Tous les trois avaient subi desautorits cons- 1. On peut citer encore,Jourdain, Codede la comptence litues de l'empire franais. 1811, 3 vol. in-8. 2. Louis-AntoineMacarel,n Orlans en 1790, mort en 1851. 3. Marie-Josephde Grando,n Lyon en 1772,mort en 1842. 4. Louis-Marie dela Haye, n Parisen 1788, mort en1868 vicomte deCormenin,
DUDROIT ADMINISTRATIF FORMATION
37
le contrecoup des commotions de la Rvolution et de l'Empire, et avaient t plus ou moins mls aux vnements. Macarel, qui d'Orlans avait t faire son droit Turin, avait t chef de cabinet de prfecture et contrleur des postes. De Grando avait fait la campagne d'Italie, il avait t membre de la junte administrative de Toscane en 1808 et intendant de Catalogne en 1812. De Cormenin, de race aristocratique, filleul de la princesse de Lamballe et du duc de Penthivre, avait t attach au conseil d'tat ds 1810. Tous les trois avaient le temprament du publiciste en mme temps que du jurisconsulte. De Grando est un philosophe, il a fait un Mmoire sur les signes de la pense, une Histoire compare des systmes de philosophie en huit volumes, un trait du Perfectionnement moral en deux volumes. DeCormenin estun pamphltaire, eta, sous le nom de Timon, cribl de brochures le gouvernement de Juillet aprs 1830. Macarel s'est plus exclusivement consacr au droit, mais il avait le mme esprit ouvert : c'est lui qui commence la srie des rvlations sur la jurisprudence du conseil d'tat, et qui fonde le recueil des arrts du conseil. A lui tout seul, il cre, en 1833, une petite cole des sciences politiques, et il fait, en 1838, sous le nom de Trait de la fortune publique en France le premier livre de science financire. Ils avaient donc tous des qualits d'initiateurs; ils se rattachaient assez l'ensemble des connaissances des hommes de leur temps pour leur rendre accessibles des connaissances nouvelles. Des trois, Macarel est certainement celui dont l'influence a t la plus fconde, bien que, dfinitivement, l'uvre de Cormenin soit demeure plus classique. C'est l'esprit le plus vari et celui qui a le plus d'initiative. Ila moins de largeur philosophique que de Grando, moins d'clat de style que Cormenin, mais il est le plus crateur 1. Coup sur coup, en trois annes, la divulgation se fait. Macarel dbute en 1818 par un livre qui eut un grand retentissement, Les lments de jurisprudence administrative. C'tait l'analyse de la jurisprudence du conseil d'tat depuis 1806, sur toutes les matires soumises ce conseil. Macarel avait lu tous les arrts, analys plus de quatremille dossiers; il avait extrait quelquesrgles gnraleset dgag 1.Liste des ouvragesde Macarel: Manuel des atevol. in-8. lments dejurisprudence administrative. 1818,2 vol.in-18.Destribunaux adliers dangereux, insalubres et incommodes. 1827,1 1 vol. in-8. lmentsde droit politique. 1833,1 vol. in12. Cours dedroit administratif. 1844,4 vol. in-8. Trait de la fortune publiqueen France, en collaborationavec Boulatiguier.1838,3 vol. in-8 inachevs. ministratifs.1828,
38
FORMATION DU DROIT ADMINISTRATIF
un commencement de jurisprudence. Tout cela tait encore un peu confus, les matires n'taient pas classs, elles taient groupes, suivantl'expression de Summer Maine en chefsde litige. Les quelques considrations gnrales mises en tte, sur l'administration et sur la juridiction administrative, aient pas grande valeur, mais le service norme rendu tait la publication de matriaux restsjnsque l secrets. On ne s'y trompa pas, et Isambert,en 18-0, apprciant dans la Thmis cet ouvrage, appelle Macarel le fondateur de la jurisprudence administrative 1. La mme anne, Sireypubliait le texte des arrts qu'avait analyss Macarel 2 et, pour qu' l'avenir la publication ft ininterrompue, Macarel tonnaitle projet de crerun bulletin ou recueil priodique o les arrts du conseil seraient insrs au fur et mesure3. Deux ans plus tard, en 1821, il ralisait son projet et fondait le Recueil des arrts du conseil d'tat, continu depuis jusqu' nos jours par MM. Lebon, Panhard, Hallays-Dabot, Grard. En mme temps, en 1819, M. de Grando inaugurait la Facult de Droit de Paris un cours de droit public et administratif cr, par ordonnance du 24 mars. Ce cours fut suivi avec le plus vif intrt. La Thmis nous en a conserv la premire leon, l'analyse de plusieurs autres et le plan 4.Il fut supprim en 1822. M. de Grando, qui tait un philosophe, ne chercha point son inspiration dans la jurisprudence du conseil d'tat, et il est remarquer mme que le contentieux ne figure pas dans son plan. Il apporta la science nouvelle quelques ides formatrices empruntes la philosophie, l'histoire, au droit naturel. Comme il fallait s'y attendre, il se plaa plutt au point de vue du but du droit administratif, qu'au point de vue de ses rgles intimes; mais, chemin faisant, il recueillit et classa des textes lgislatifs qu'il devaitplustard publierdans sesInstituteset qui taient pars dans le Bulletin des lois. Outre une action sur la mthode et l'organisation, il eut donc un rle important dans la divulgation. A la suite de ces premiers travaux sur la jurisprudence et sur les 1. Thmis , II, 123.Voicila liste des matiressur lesquellesla jurisprudence est analyse : Baux administratifs, bois communaux et domaniaux, communes, agents< comptables,conflits,contributionsdirectes ou indirectes,domainesengags,domaines nationaux, matires d'eau, migrs, tablissementsde charit, expropriation pour cause d'utilit publique, fabriques, halles, foires et marchs,li-quidation de la dette publique, manufactures et tablissements insalubres, marchs et fournitures, mines, rentes nationales, travaux publics et voirie.. d'tal. 5 vol. in-4, 1818. 2. Sirey, Jurisprudence du Conseil 3. Macarel,article de la Thmis.1819,I, p. 25. 4. Thmis, ; IV, 57. I, 67,150; II, 155,425
FORMATION DUDROITADMINISTRATIF
39
lois, il se cre un vritable mouvement dans les esprits vers le droit administratif, malgr la priode de raction politique qui commence avec les annes 1823 et 1824 (avnement de Charles X, milliard des migrs, etc.). La Thmis insre des articles de Macarel et de Cormenin; il se publie des recueils et quelques monographies1 La plus importante est celle de Cormenin, Questions de droit administratif (1822),o il reprend l'uvre accomplie par Macarel dans ses lments de jurisprudence, mais avec plus de dtails, plus de force dans l'analyse, plus d'clat de style, de sorte qu'il absorbe et fait disparatre le livre de Macarel et qu'en 1824 le sien en est dj la troisime dition. Cormenin classe les matires par ordre alphabtique, et chaque matire est traite suivant une mthode gomtrique, en un certain nombre de thormes d'o se dduisent des consquences numrotes. Ce procd, servi par un langage lapidaire, a produit beaucoup d'effet sur les contemporains; il avait le dfaut, cependant, de pousser l'absolu des principes qui rsultaient de lois trs transitoires et aujourd'hui beaucoup de ces prtendus thormes seraient faux2. Le vrai mrite de Cormenin a t dans le soin qu'il a mis 1. RECUEILS: Codeadministratif de Fleurigeon. 2e dit., 1820,6 vol. in-8. Lois administratives, Rondonneau. 1823,4 vol. in-8. Rpertoire de l'administration dpartementale, Pchard. 1823,1 vol. in-4. Lois sur la comptence, Dupin. 1825,4 vol. in-8. Lois des communes, Dupin. 1823,2 vol. in.8. MONOGRAPHIES: Alletz, Dictionnaire de la police moderne. 2e dit., 1823, 4 vol. in-8. Raynouard, Histoire du droit municipal. 1829,2 vol. in-8. Affre, Trait de l'administration temporelle des paroisses, 1827. Baudrillard, Trait gnral des eaux et forts. 1823,2 vol. in-4. Code de la pche, 1829. Davenne, Recueil mthodique des lois et rglements sur la voirie. 1824, 2 vol. in-8. Daviel, Pratique des cours d'eau. 1824, in-8. Henrion de Pansey, et de la police Des biens communaux rurale. 2dit., 1825. Isambert, Trait de la voirie, 1829, 3 vol in-8. Latruffe-Montmeylian, Des droits des communes sur les biens communaux. 1825, 2 vol. in-8. Locr, Lgislationsur les mineset sur les expropriationspour cause d'utilit publique. 1828,in-8. Macarel, Ateliers dangereux. 1828. Taillandier, id. 1827. De Lalleau, Trait de l'expropriation. 1828, 2 vol. Bavoux, Des conflits. 1828,in-4. 2. Quelquefoisils ont une allure quelque peu ridicule par la contradiction entre l'extrme gnralit du principe et la trs grande particularit des consquences. Exemple : v Commune.Du principe que les communes ont des droits propres dont l'exercice est attribu aux habitants qui occupent leur territoire et qu'il n'appartient qu' la loi de statuer dans toutes les questions qui touchent au droit civil, il suit qu'il n'appartient qu' la puissance lgislative, aprs enqute et sur l'avis des conseils municipaux, assists,des plus imposs, etc., de statuer sur les runions et distractions de communes qui modifieraientune circonscriptionde canton ou d'arrondissement.
40
FORMATION ADMINISTRATIF DUDROIT
runir les textes, dpouiller la jurisprudence, faire la bibliographie de chaque matire. Un bon travail sur la juridiction du conseil sert d'introduction. II. Un nouvel essort fut donn aux tudes par le mouvement libral de 1828 et la rvolution de 1830. C'est le moment o la gnration de jeunes hommes qui avait dpens ses premires ardeurs au dbut de la Restauration, mais que celle-ci avait comprime par la suite, triomphe. Guizot et Thiers arrivent aux affaires, le romantisme s'installe dans la littrature, un renouveau se produit dans toutes les branches du savoir. Les tudes de droit et spcialement de droit public en profitent. La Thmis a disparu, mais de nouveaux organes se fondent. En 1834, la Revue de lgislation franaise et trangre de Foelix apporte encore une fois un levain fcond d'Allemagne. L'change des ides se fait par la Facult de Strasbourg, o bientt apparatra un professeur de talent, Schutzemberger; en 1835, la Revue de lgislation de Wolowsky. De Grando reprend son cours en 1828, et des chaires de droit administratif sont organises (de 1829 1837) Aix, Caen, Dijon, Grenoble, Poitiers, Rennes, Strasbourg, Toulouse. Des professeurs jeunes et ardents se mettent l'uvre, de Serrigny Dijon, Foucard Poitiers, F. Laferrire Rennes; celui-ci fait, en 1838, un cours d'histoire des institutions politiques et administratives1. Toutes ces bonnes volonts vont avoir la fois plus de libert pour s'employer et des besognes nouvelles faire. La dcentralisation, les lois sur les lections des conseils gnraux et municipaux, sur leur attributions, introduisent l'norme matire des lections, en mme temps qu'elles troublent les anciennes notions sur l'administration dlibrative ; il va falloir classer, cataloguer les nouveaux pouvoirs. Les chemins vicinaux (1836), l'expropriation pour cause d'utilit publique (1841), les chemins de fer, le dveloppement brusque des travaux publics, tout cela sollicite les commentateurs de textes. En mme temps, il se trouve que la jurisprudence du conseil d'tat est fortifie, d'abord par l'ordonnance de 1828 qui restreint l'arbitraire en matire de conflit, ensuite par une srie d'ordonnances qui, vers 1830, rforment sa procdure, la rendent publique et orale en partie et instituent un ministre public. La divulgation de la jurisprudence continue, c'est Cormenin qui s'en charge. Son ouvrage qui a pris le nom de Trait de droit administratif, arrive sa cinquime dition en 1840. Chaque fois des matires 1. Premire et dernire leon, revue Wolowsky, t. VIII.
ADMINISTRATIF DUDROIT FORMATION
41
nouvelles y sont introduites; toujours le mme soin pour l'indication des sources lgislatives et des arrts. Les dcisions en elles-mmes continuent d'tre publies par le Recueil des arrts du conseil d'tat; mais, en mme temps, il se fonde une foule de bulletins ou d'annales destins aux diffrents services et portant la connaissance de chacun ce qui le concerne. L'administration active prend ainsi conscience du droit1. Les monographies se multiplient au point qu'on n'en peut plus citer que les principales2. En mme temps, apparaissent des ouvrages d'ensemble. Il y en a de deux espces bien diffrentes. Les uns sont des ouvrages de fond qui puisent directement dans les choses, o se continue la divulgation, soit des rouages de l'administration, soit des textes administratifs, soit des rgles. Les autres sont des uvres de vulgarisation et sont faits l'aide des premiers; en gnral, ils naissent des besoins de l'enseignement. 1 En tte des ouvrages de fond, il convient de placer les Institutes de M. de Grando (1829-1830, 5vol. in 8), vrai travail de bndictin, immense analyse de textes. Il faut songer que les textes applicables, dont nous avons l'heure actuelle la majeure partie dans des compilations faciles manier, taient enfouis dans le Bulletin des lois. Ce sont les travaux comme ceux de Grando qui ont permis d'en faire le triage. L'ouvrage est conu un peu suivant le procd gomtrique de Cormenin : une srie de rgles gnrales numrotes, sortes de thormes qui sont l'uvre de l'auteur et qui donnent une allure doctrinale; et, sous chaque rgle, une srie de consquences appuyes sur des analyses de textes avec renvoi au Bulletin des lois (1.404 rgles gnrales, 7.022 articles contenant des analyses de textes). Enmme temps (1830), parut un ouvrage de Bouchen-Lefer, matre des requtes au conseil d'tat, dont on adit que si le livre de Grando 1. Le Journal des Communes, recueil priodique desdcisions administratives L'coledes Communes, revue administrative l'usage des maires. 1828-1862. consacreaux travaux des maires et des conseils gnraux, o se trouvent de bons articles de Boulatignier(1830). Les Annales des Ponts et Chausses, 1831. Le Bulletin des contributions directes et du cadastre. 1832. Les Annalesdes contributionsindirectes, 1833. Le Journal des Conseillers muni Les Annales des cheminsvicinaux, 1845,etc. cipaux. 1833-1843. Une Revue administrative est cre en 1839et parat jusqu'en 1849, elle ne contient gure,que des documents, circulaires, rapports, etc., mais il en est d'intressants, des statistiques, des budgets. 2. Proud'hon, Trait du domaine public. 1833,9 vol. in-8. Cotelle, les des travaux Travaux publics. 1835, 2vol. Husson, Trait publics. 1841,2vol. in-8,etc. V. R. de Mohlpour une bibliographie plus complte.
42
FORMATION DUDROIT ADMINISTRATIF
tait les institutes du droit administratif, celui-ci en tait les pandectes1. C'tait, en quatre volumes in-8, sous le titre de Droit public et administratif franais, l'analyse et le rsultat des dispositions lgislatives et rglementaires publies ou non sur toutes les matires d'intrt public et de lgislation. Les matires y sont rparties suivant les branches des services publics, de sorte que l'ouvrage serait encore utile pour un cours d'administration. Macarel ne demeurait pas en resle. En 1828, il avait publi, sous le titre de Les tribunaux administratifs, un livre o il rvlait au public l'existence d'un certain nombre de juridictions. En 1838, en collaboration avec Boulatignier son lve, il commence, sous le nom de Tableau de la fortune publique en France, un vritable trait de lgislation financire qui malheureusement est rest inachev, mais o il met au jour les rgles de la comptabilit et du domaine 2. En 1844, il commence la publication de son Cours de droit administratif profess la Facult de Paris, o il avait remplac de Grando. L encore, dans la description de l'organisation administrative, il rvle un certain nombre de rouages, notamment l'existence des conseils administratifs, soit dans les ministres, soit auprs des prfets3. Vuillefroyet Monnier, l'un matre des requtes, l'autre auditeur au conseil d'tat, publient, en 1837, des Principes d'administration extrazts des avis du conseil d'tat et du comit de l'intrieur. C'taient les rgles suivies en matire d'administration dpartementale et communale, dont une bonne partie allait passer dans les lois de 1837 et 18381. Enfin, une place doit tre faite des ouvrages sur le contentieux administratif parce que ce n'est point l une matire spciale, c'est la source mme du droit administratif. De Serrigny, professeur Dijon, fit paratre en 1842 un Trait de l'organisation, de la comptence et de la procdure en matire contentieuse administrative, o il reprenait, avec plus de dveloppement et de mthode, les Tribunaux administratifs de Macarel5. Chauveau Adolphe avait publi dj en1841 des Principes de com1. Revue Foelix.1837. et Boulatignier.1838, 2. Tableau de la fortunepublique en France, Macarel 3 vol. 3. Coursde droit administratif, Macarel.1844,4 vol. inachev. 4. Il faut citer encore le Dictionnaire de droit public et administratif de Huart-Delamarreet Lerat de Magnitot.1836,2 vol. in-8 ; et le Trait gnral de droit administratif appliqude Dufour.1843,4 volumes, qui devait avoir successivementtrois ditions, et dont la troisime compte 8 volumes (1868). a t rdit en 1865 en 5. Le Trait de l'organisationet de la comptence trois volumes.
FORMATION DUDROITADMINISTRATIF
43
ptence administrative en trois volumes; mais, bien qu'il y et dans cet ouvrage des ides justes, elles taient dfigures par une terminologie tellement singulire qu'il eut peu d'influence scientifique'. Joints aux travaux de Vivien 2, ces ouvrages commencrent dterminer le contentieux administratif. Ils distingurent dans les matires administratives trois groupes: Le groupe des matires qui n'taient pas de la comptence desjuridictions administratives parce qu'elles taient de celle des juridictions ordinaires; Le groupe des matires qui taient dela comptence des juridictions administratives et o des recours contentieux taient ouverts aux parties; Le groupe des matires qui n'taient pas de la comptence des juridictions administratives, parce qu'elles restaient dans le domaine de l'administration discrtionnaire et qu'elles chappaient tout recours. Cette division ne serait pas compltement exacte aujourd'hui o les actes d'administration discrtionnaire n'chappent pas au recours pour excs de pouvoir. Les auteurs se plaaient uniquement au point de vue du contentieux de pleine juridiction; ils ne donnaient pas au contentieux de l'annulation la place qui lui revient. Mais il faut dire qu'en 1840 le recours pour excs de pouvoir n'avait encore eu que des applications timides et qu'il ne devait prendre tout son dveloppement que sous le second empire 3. En revanche, cette division avait le grand mrite d'affirmer qu'il y a des matires qui, par elles-mmes, sont contentieuses, c'est--dire susceptibles de donner lieu des recours contentieux toutes les fois que quelque droit y est viol, que, par consquent, il ya des actes de l'administration qui confrent aux particuliers des droits solides. C'tait un progrs, car, jusque-l, on s'tait content de cette ide superficielle qu'il y a contentieux quand, en fait, une contestation s'engage; sans doute, mais il s'agit de savoir dans quels cas elle doit s'engager. En d'autres termes, jusque-l on s'tait born constater que, dans certains cas, les recours taient reus par 1. La dfinition du contentieux tait particulirement obscure. Il y avait contentieux toutes les fois qu'un intrt spcial manant de l'intrt gnral se trouvait discut en contact arec un droit priv. Cela voulait dire : Toutesles fois que l'administration, par unacteparticulier,avait viol un droit priv, et c'tait la dfinitionde Serrigny et de Vivien. 2. tudes administratives. 1845. 3. Dans la seconde dition du trait de Serrigny, en 1865,le recours pour excs de pouvoir apparat encore comme une exception au principe que, dans les matires d'administration gracieuse, il n'y a pas de recours. Pour voir ce recours trait d'une faon principale et avec les dveloppementsqu'il mrite, il faut attendre jusqu'aux confrencesde M. Aucoc, en 1869.
44
FORMATION DUDROIT ADMINISTRATIF
le juge. Ce qu'ont fait nos auteurs de 1840, 'a t de dterminer les cas dans lesquels les recours devaient tre reus. Et l'on voit bien que la porte de ce progrs dpasse de beaucoup le contentieux, que cela va avoir de l'influence sur tout le droit administratif, provoquer un classement des matires, amener des distinctions entre les diverses dcisions administratives, c'est--dire entre les actes d'administration, suivant qu'elles confrent ou non des droits et par suite des recours contentieux. Tout cela sortait videmment dela jurisprudence du conseil d'tat, mais nos auteurs ont eu le mrite de le dgager. 2 Quant aux ouvrages de vulgarisation, ils apparaissent ds que l'enseignement du droit administratif est organis dans les Facults de province; Foucard, Poitiers, publie en 1834 des lments de droit publie et administratif; Chauveau, Toulouse, en 1838,un Programme d'un cours de droit administratif; Laferrire, Rennes, en 1839, un Cours de droit public et administratif; Trolley, Caen, en 1849, un Cours de droit administratif; Serrigny, Dijon, un Trait de droit public (2 vol., 1845). Foucard et Laferrire eurent le plus de succs. Le trait de Foucard est plus complet et plus proportionn, celui de Laferrire plus vivant et plus loquent. F. Laferrire, que l'histoire du droit avait dj attir et qui devait y retourner, qui avait sans doute suivi le cours de droit constitutionnel de Rossi, ouvert depuis 1834 la Facult de Paris, anime le droit administratif par beaucoup d'histoire et de droit public. Il y fait passer un peu de la chaleur communicative et de la sympathie dont il lait rempli1. Voil quelques-uns des documents dans lesquels on peut saisir le mouvement du droit administratif pendant cette priode fconde de 1818 1848. Les livres et l'cho des livres dans les comptes rendus des revues, c'est tout ce qui nous reste. Mais qui dira le travail cach, le plus fcond de tous peut-tre, qui s'est fait au conseil d'tat par de simples rapports de conseillers ou de matres des requtes tels que Cormenin, Macarel, Vivien, Bouchen-Lefer, Boulatignier, Vuillefroy, dans les bureaux des ministres, dans les cours oraux des Facults. De ce travail patent et de ce travail occulte, il tait rsult ceci, c'est qu'en trente ans une rvolution s'tait faite, et que le droit administratif, inconnu l'administration elle-mme, tait connu maintenant 1. Le livre de Foucard a eu quatre ditions. La quatrime,en 3 volumes,est de 1855-1857. On peut dire qu'il a fonden droit administratif une cole qui mrite le nom d'colede Poitiers,car M. Ducrocqen procde dans une certaine mesure. Cette cole se caractrise par un individualisme trs dcid. Le livre de F. Laferrire a eu cinq ditions, dont la dernire, en 2 volumes, est de 1860.
DUDROIT ADMINISTRATIF FORMATION
45
non-seulement des administrateurs mais des citoyens. Il tait encore confus, embrouill, mais enfin il tait connu. Aussi, aux approches de la rvolution de 1848, fiers des progrs raliss, songeait-on de nouveaux dveloppements. L'ide d'une cole des sciences politiques, lance par Macarel ds 1833, dans ses lmentsde droit politique,et qu'il avait ralise en partie avec Boula cette ide avait tignier dans des cours faits une mission gyptienne, t recueillie par une commission des tudes de droit qui fonctionna pendant plusieurs annes partir de 1838. Il avait t labor un projet en 1846. En 1848, on fut sur le point de crer une cole sur le modle de l'cole polytechnique, qui aurait form tous les administrateurs et fonctionnaires. On organisa, en effet, sur l'initiative d'Hippolyte Carnot, des cours qui fonctionnrent pendant un an au collge de France; Boulatignier et Blanche y enseignrent1 D'un autre ct, les Chambres, qui avaient discut longuement des projets de rforme du conseil d'tat et qui s'taient familiarises avec le droit administratif avaient, un moment, entrevu la possibilit de codifier le contentieux. III. La rvolution de 1848 et le cou p d'tat de 1852 ne furent pas des vnements heureux pour la science du droit. La rvolution de 1848 essaya de raliser des rformes intressantes, elle cra un tribunal des conflits, elle supprima pour le conseil d'Etat la fiction de la justice retenue (L. 3 mars 1849), mais ces rformes ne furent pas maintenues. Le coup d'tat survint; le conseil d'tat fut rorganis sur ses anciennes bases, et sa jurisprudence, sous un rgime de compression, devint tout fait timide. Les discussions parlementaires disparurent, les liberts dpartementales et communales furent restreintes. Le mouvement d'ides qui tait si bien lanc s'arrta brusquement; le cours de droit constitutionnel fut supprim, les professeurs de droit administratif furent invits se renfermer dans le commentaire des textes. Les deux revues, qui, depuis vingt ans, avaientservi d'organe tous les esprits chercheurs, qui avaient, on peut le dire, par leurs articles, par leurs comptes rendus d'ouvrages, dirig la science, disparurent l'une aprs l'autre, la revue Foelix en 1850, la revue Wolowsky en 1853. Elles tombrent en partie par suite des troubles, en partie par suite de l'avnement de ce que F. Laferrire 1. Il y eut, ce moment l, pour le dveloppementdes tudes de droit public, un mouvementcomparable a celui qui s'est produit dans ces dernires annes. V. Revuede lgislation,t. XXXIV, p. 104, art. F. Laferrire, De l'enseignement administratif dans les Facultsde Droit et d'une colespcialed'administration. Lenol, Des sciencespolitiques et administrativeset de leur 1865. enseignement.
46
FORMATION DUDROIT ADMINISTRATIF
appelle l'esprit positif, et qui est l'oppos de l'esprit scientifique1. Cette priode de strilit va se prolonger jusque vers 18602. c) Priode d'organisation (1860)
L'anne 1860 marque le point de dpart d'une priode nouvelle qui, travers les vnements de 1870, s'est poursuivie jusqu' nos jours. Le dcret du 24 novembre 1860, premire manifestation de ce que l'on a appel l'empire libral, rendit quelque libert aux dbats du corps lgislatif ; par une sorte de contrecoup, le conseil d'tat se montra plus accueillant pour les rclamations contre les actes de l'administration; bientt mme le gouvernement encouragea les recours pour excs de pouvoir en les dispensant, par le dcret du 2 novembre 1864, du ministre de l'avocat et des frais autres que ceux de timbre et d'enregistrement. C'est de ce moment que date la grande extension du recours pour excs de pouvoir. Les lois sur les conseils gnraux et sur les conseils municipaux de 1866 1867 allaient rentrer dans les voies de la dcentralisation et prparer les lois plus compltes de 1871 et de 1884. Bref, c'tait un rveil de l'esprit public, de l'administration elle-mme; le droit administratif ne devait pas manquer d'en profiter. I. Bien que le caractre de cette priode nouvelle soit, notre avis,. d'tre une priode de classement et d'organisation, cependant la divulgation de la science administrative s'y continue. Des collections prives de textes usuels sont faites qui mettent la porte de tous, dans des formais commodes, les lois administratives,. et qui permettent d'allger les ouvrages doctrinaux de toute citation. Les collections connues sous le noms de Codes contiennent maintenant ct des lois civiles, un choix de lois administratives ; une compilation spciale, malheureusement incomplte, a mme t faite par MM. Vuatrin et Batbie, en 1876, sous le nom de Lois administratives franaises. La jurisprudence administrative a continu d'tre recueillie non seulement dans le Recueil desarrts du conseil d'tal, mais dans les priodiques consacrs primitivement la seule jurisprudence civile, et qui, peu peu, lui ont ouvert leurs colonnes, Sirey, Dalloz, Journal du Palais, etc. Un Code des Lois administratives annotes a mme commenc de paratre en 1887 dans la srie des codes annots de Dalloz, et les dcisions de la jurisprudence y sont rparties par ordre de matires. 1. Tables de la Thmis,etc., p. xxx. le Dictionnaire gnral d'administration, de : 2. A signaler seulement Blanche,dont la premire dition est de 1848; le Dictionnaired'adminis-
DUDROIT ADMINISTRATIF FORMATION
47
Les dictionnaires d'administration ou de droit administratif, dont la priode prcdente offrait dj des exemples, et qui ont l'avantage de grouper dans un ordre propice aux recherches, textes, jurisprudence et doctrine, se sont multiplis. Le Dictionnaire de Blanche a t rdit ainsi que celui de M. Block, et une publication considrable a t entreprise en 1882 par MM. Bquet et Dupr sous le nom de Rpertoire du droit administratif. Cette publication, qui se poursuit actuellement sous la direction de M. E. Laferrire et qui ne comprendra pas moins de quinze grands volumes in-4, mritera tout fait son nom de rpertoire; l'administration y vide ses cartons et l'on y trouvera, sans parler de la valeur doctrinale des articles, les textes et les renseignements les plus spciaux. Les journaux ou revues spcialement consacrs au droit administratif ne font pas non plus dfaut. Le Journal du droit administratif et l'cole des communes ont continu leur publication. La Revue gnrale d'administration, cre en 1878 par M. Block et la maison Berger-Levrault, publie depuis le 1erjanvier 1879 sous les auspices du Ministre de l'Intrieur, a donn la science administrative un organe prcieux par ses articles de fond, par la revue de jurisprudence qu'y font MM. Le Vavasseur de Prcourt et Charreyre, par ses chroniques de l'administration franaise et des administrations trangres. La largeur du plan suivant lequel elle est conue appara: surtout lorsqu'onla compare son ane, la Revueadministrative de 1839. Ajoutons que d'autres revues de droit, comme la Revue critique, la Revue pratique, insrent des examens critiques de jurisprudence administrative et mme des articles de fond. L'enseignement du droit administratif, rgulirement donn dans toutes les Facults et dans quelques coles spciales comme celle des Ponts et Chausses, a t. en outre, complt par la cration d'une cole libre des sciencespolitiques et administratives raliseenfin en 1871 par M.Boutmy, et, tout rcemment, parcelle d'unecole coloniale, par l'organisation de cours complmentaires dans les Facults, matires administratives,lgislation financire, lgislation coloniale, etc. A cette divulgation incessante, les matriaux ont t fournis par l'activit du lgislateur sollicit par les vnements contemporains, les transformations politiques et sociales, l'expansion coloniale, par le travail silencieux des professeurs et des conseillers d'tat, matres des requtes, auditeurs. Les nom de Boulatignier et de Quentinles Rptitions tration, deBlock. 1855; critesde droitadministratif, de Cabantous. 1855; la fondationdu Journal de droit administratif, en 1858, par Chaude droit administratif. 1854. veau; les travaux de Serrigny, Questions
48
FORMATION DUDROIT ADMINISTRATIF
Bauchart mritent d'tre cits, pour ne parler que de ceux qui sont morts. La preuve de la diffusion croissante des connaissances administratives se trouve, d'une part, dans le nombre toujours plus grand des thses de doctorat soutenues annuellement sur des matires d'autre part, dans la quantit considrable des administratives; traits spciaux qui ont pour auteurs des membres de l'administration'. II. Toutefois, ce qu'il y a de vraiment nouveau dans notre priode, c'est le classement et l'organisation de la science administrative plus encore que sa diffusion. Il y avait bien eu dans la priode prcdente des tentatives d'organisation, mais on n'y attachait qu'une importance secondaire ; il s'agissait avant tout, ce moment l, de faire connatre n'importe comment et dans n'importe quel ordre des dtails ignors de tous. Chaque auteur a sa classification, et elle est base en gnral sur l'aspect extrieur des choses, c'est--dire sur l'organisation administrative ou sur les services publics. On prend l'administration comme objet direct d'tude, sans songer qu'elle n'est qu'un rsultat, que les oprations administratives ne sont intressantes pour le jurisconsulte qu'en tant qu'il les considre comme produites par l'exercice de certains droits ou de certains pouvoirs de l'Etat, et que le vritable objet du droit administratif, ce sont ces droits ou ces pouvoirs. C'est ainsi que l'objet du droit civil, ce ne sont point les oprations que fait un propritaire dans sa ferme ou un industriel dans son usine, mais les droits privs qui lui permettent d'accomplir ces oprations. Mais c'est l une vrit trop profonde et trop cache qu'on n'apercevra pas tout de suite. Pour le moment, on s'arrte l'piderme. Macarel et Bouchen-Lefer se bornaient dcrire l'organisation administrative. F. Laferrire, se plaant au point de vue des services publics et les envisageant en historien et en publiciste, les divisait en services qui ont pour but la conservation de la socit et services dont le but est le dveloppement de celle-ci. Au reste, il ne tenait pas du tout son systme ; dans plusieurs comptes rendus d'ouvrages, on le voit en accueillir d'autres avec la plus grande bienveillance2, et c'est lui qui, dans sa cinquime dition, donnera asile au plan de Batbie. Ce qui embarrassait le plus les auteurs et les professeurs, c'taient les rgles qu'on ne pouvait pas rattacher l'organisation administra1. Quelques-uns de ces traits ont acquis une vritable autorit, comme le de la loi municipale, de M.Morgand Commentaire ; le Commentairede la loi du recrutement, de M: Ch. Rabany. 2. V. Revuecritique. 1858, t. XII, p. 369.
DU DROITADMINISTRATIF FORMATION
49
tive, c'est--dire les rgles relatives aux rapports de l'administration avec les particuliers. Foucard avait inaugur ici une mthode qui fut reprise plus tard par M. Ducrocq, et que l'on peut donner comme la caractristique de l'cole de Poitiers; elle consistait rattacher le plus possible les rgles administratives l'tude des liberts individuelles en les considrant comme des restrictions de ces liberts.-Ainsi, par exemple, l'expropriation pour cause d'utilit publique, au lieu d'tre tudie en soi et comme opration administrative, tait tudie comme restriction au droit de proprit individuelle ou comme charge des biens1. Cela n'a l'air de rien, cela est gros de consquences cependant, cela indique des tendances nettement individualistes, le dsir de restreindre autant que possible les droits de l'tat, et cela se lie certainement aux thories conomiques de l'cole orthodoxe. L'cole de Paris, au contraire, qui reprsentait l'opinion moyenne, rangeait tout simplement ces rgles sous la rubrique matires administratives. Ce n'tait pas trs profond comme classification, mais cela avait, au moins, l'avantage de laisser planer l'ide de l'tat sur ces matires et de prparer les voies ceux qui y verraient des droits de l'tat. Au reste, voici quel tait le programme pour l'examen de droit administratif en 18602.
AUTORITS PREMIRE PARTIE. ADMINISTRATIVES I. Notions gnrales. Division des pouvoirs, conflits. Division en administration active, consultative et contenlieuse. II. Organisation et attribution des autorits administratives. III. Contentieux administratif. MATIRES DEUXIME PARTIE. ADMINISTRATIVES I. Fortune publique. Domaine, voirie, rgime des eaux, impts, etc. II. Travaux publics, expropriations, mines, desschement des marais. III. Industrie, ateliers dangereux, brevets d'invention.
1. Foucard, 3dit., t.Ier, p. 683.De mme pour le servicemilitaireconsidr comme une charge pour les personnes,au lieu d'tre considrcommeun droit de puissance ou de police de l'tat. 2. Ce programme est emprunt l'Introduction gnrale de Batbie. 1861. H. 4
50
DU DROITADMINISTRATIF FORMATION
Deux hommes ont eu l'honneur de trouver presque simultanment, sinon un plan d'organisation du droit administratif, du moins une ide organisatrice tire des entrailles du droit lui-mme: Batbie, dans son Introduction gnrale au droit public et administratif qui parut part en 1861, mais qui avait dj t insre dans la cinquime dition du trait de F. Laferrire en 1860, et M. R. Dareste, dans son livre sur La justice administrative en France qui parut en 1862, mais la Revue dontdes fragmentsavaienttinsrsdans historique, ds 1855. Cette ide, c'tait d'appliquer au droit administratif le plan des Institutes ainsi compris : les personnes, les choses, les modes d'acqurir1 : Ces trois lments sont de l'essence d'un droit quelconque, dit Balbie; ils se retrouvent ncessairement dans les matires administratives, moins que l'on ne refuse le nom de droit cette lgislation. Pourquoi, dit M. Dareste, ce systme que les Romains appliqurent au droit public comme au droit priv, ne pourrait-il pas tre suivi dans l'tude de notre droit administratif? . L'ide n'tait pas tout fait neuve. Balbie reconnat que Chauveau l'avait mise, ds 1838, dans son Programmed'un cours de droit administratif, et il et pu ajouter que Chauveau l'avait sans doute puise lui-mme dans le programme du cours de Grando publi par la Thmis en 18192, et qu'ainsi elle tait ne avec l'enseignement du droit administratif. D'ailleurs, cetteide tait suggre par les textes et par les vnements. La personnalit de l'tat, des communes, des tablissements publics, tait consacre par le Code civil. Le mouvement de dcentralisation de 1830-1838 avaitattir l'attention sur la personnalit de la commune et consacr celle du dpartement. Mais cette personnalit tait conue comme s'arrtant au domaine priv; il s'agissait de lui donner une extension nouvelle. Nos auteurs tudirent donc dans trois catgories : les personnes du droit administratif, les choses du droit administratif, les modesd'acqurir du droit administratif. Un premier rsultat de cette mthode fut d'isoler le contentieux et de le sparer des rgles de fond du droit. Jusqu'ici, on avait volontiers rapproch l'tude des juridictions de celle des autorits administratives (administration active, dlibrative, contentieuse); maintenant, comme on tudiait en soi les personnes du droit administratif, 1. La catgorie des modes d'acqurir est plutt suppose qu'exprime par les Institutes; elle a t dgage par les commentateurs.V. ce sujet, et notamment sur les obligations considres comme modes d'acqurir, une note sur l'influence des Institutes dans la classificationdu droit. Revue critique, 1887. 2. Thmis,I, 150.
DU DROITADMINISTRATIF FORMATION
51
on ne pouvait s'occuper que des autorits qui sont leurs organes ou leurs agents : les juridictions devaient tre relgues et avec elles le contentieux. C'tait l une sparation trs heureuse et, comme le remarque Batbie, analogue celle qui s'est produite entre le Code civil et le Code de procdure. Un second rsultat fut de donner une place convenable aux matires que, jusque l, on avait numres au hasard sous le nom de matires administratives. Presque toutes, en effet, expropriation, travaux publics, impts, etc., taient des modes d'acqurir. La nouvelle classification fut bien accueillie. On protesta bien un peu contre la catgorie des modes d'acqurir, pour les impts notamment : l'argent qui entre dans les caisses publiques en vertu de l'impt, disait-on, est d'avance destin au paiement des dpenses et n'entre que pour sortir, ce n'est pas une vritable acquisition; mais, en gnral, on approuva 1. On pouvait lui faire des critiques srieuses cependant, et M. Ducrocq n'avait pas tout fait tort lorsque, dans la premire dition de son cours, en 1861, il disait qu'il ne fallait pas se laisser sduire par des analogies spcieuses avec le droit civil. 1 Cette classification avait encore quelque chose d'extrieur, en ce sens que, dans les trois catgories formes, on juxtaposait des lments fort diffrents. Ainsi, dans la catgorie des personnes du droit administratif, sous prtexte que les tablissements d'utilit publique assujettis une tutelle administrative appartiennent par l, dans une certaine mesure, au droit administratif, on les faisait figurer ct des communes et des tablissements publics, qui sont membres de l'tat, tandis que les tablissements d'utilit publique ne le sont pas; dans la catgorie des choses du droit administratif, le domaine priv ctoyait le domaine public, alors qu'il est vident que ces deux espces de choses ne sontpas possdes par les personnes du droit administratif au mme titre; enfin, dans la catgoriedes modes d'acqurir, toutes les oprations taient places ple-mle, alors que les unes sont semblables aux oprations du droit priv, et que les autres supposent des droits de puissance publique. 1 Cette classification ne comprenait pas toutes les matires administratives; une bonne partie de ce que nous appellerions aujourd'hui la puissance publique, restait en dehors, notamment les matires de police. 1. V.article Reverchonsur Dareste.Revue critique,1862, t. XX,p. 354; art. Mimerelsur Batbie.Revue constate lui-mme plus et Bathie critique, t XXI; tardl'approbation de MM.Block,Aucoc, Serrigny, Valette, etc.
52
FORMATION DU DROITADMINISTRATIF
3 Enfin, dans le dtail, tout cela n'tait pas construit; les autorits administratives n'taient pas suffisamment rduites au rle d'organes de la volont des personnes administratives; les actes d'administration n'taient rattachs par aucun lien la thorie de la personnalit. C'est--dire que le mrite de cette classification tait d'attirer l'attention sur la notion de la personnalit administrative, de montrer que c'tait l l'ide centrale; que l'objet dudroit administratif, comme celui de toutes les autres branches du droit, devait tre de rglementer des droits; que ces droits ne pouvaient tre que ceux des personnes administratives; que, par consquent, la personnalit administrative devenait le pivot du droit administratif, comme la personnalit civile tait dj le pivot du droit civil. Mais cette notion n'avait pas t suffisamment creuse; on n'avait pas vu notamment qu'il y a, chez les personnes du droit administratif, deux personnalits, l'une de puissance publique, l'autre de personne prive, et qu'il faut soigneusement les sparer. Il faudra, pour raliser ce progrs, une plus longue habitude de la dcentralisation et un nouveau dveloppement du contentieux administratif. Telle qu'elle tait cependant, cette organisation systmatique du droit administratif tait bien suprieure l'anarchie de la priode prcdente; peu peu, elle pntra dans l'enseignement, et par l dans l'esprit des gnrations nouvelles. Batbie avait repris l'exposition du droit administratif dans un grand ouvrage conu avec beaucoup de largeur, contenant del'histoire et de la lgislation compare, et toujours d'aprs le mme plan. Mais il faut reconnatre que l'organisation n'y est pas plus pousse dans le dtail que dans le premier essai 1. Deux autres ouvrages, clbres tousles deux juste titre, et qui remplissent cette priode de 1860 jusqu' nos jours, le Cours de droit 2 et les Confrences de droit adminiadministratif de M. Ducrocq tratif deM. Aucoc3, contriburent d'une faon plus efficace quoique indirecte ses progrs. Ce n'est pas qu'ils adoptent ni l'un ni l'autre la division tripartite en personnes, choses, modes d'acqurir, et M. Ducrocq s'en dfend mme formellement; mais ils ontapport un tel soin dans l'tude de l'organisation dpartementale et communale, cataloguer les pouvoirs 1. Trait thorique et pratique du droitpublic et administratif. 1868,7 vol. in-8; 2e dit., 1885,8 vol. in-8. 2. Coursde droit administratif 1re dit., 1866; 6e dit.. 1881. 3. Confrences sur l'administration et ledroit administratif. 1re dit., 1869; 3e dit., 1885.
FORMATION DU DROITADMINISTRATIF
53
des conseils gnraux et des conseils municipaux, les classer en vue des intrts qu'ils dfendent par leurs dcisions diverses, qu'il apparat trs nettement: 1 que ces conseils, et par suite toutes les autorits administratives, ne sont que des reprsentants de personnes administratives caches derrire; 2 que leurs attributions consistent exercer des droits appartenant ces personnes administratives. En d'autres termes, l'tude approfondie qu'ils ont faite de l'organisation administrative, a eu pour rsultat de rattacher celle-ci la thorie de la personnalit. De plus, M. Aucoc a fait, pour la premire fois, un examen approfondi des actes, d'administration et de la thorie du recours pour excs de pouvoir. Cela lui tait d'autant plus facile que, depuis 1860 et surtout depuis le dcret du 2 novembre 1864, ce recours s'tait beaucoup dvelopp et que, personnellement, il avait contribu ce dveloppement. Le rsultat de cette tude a t de prparer les esprits voir, dans l'acte d'administration, une dcision, une manifestation de volont de la personne administrative. En effet, c'est une dcision excutoire prise par une autorit administrative au nom de la personne administrative qu'elle reprsente. Il restait seulement un nuage rsultant d'une confusion persistante entre l'acte d'administration et l'acte de juridiction, surtout en ce qui concernait les dcisions ministrielles, mais, partir de 1872, le conseil d'tat allait s'appliquer dissiper cette confusion et restituer aux dcisions ministrielles leur caractre de manifestation de volont 1. C'tait donc encore toute la matire des actes d'administration rattache la thorie de la personnalit. Le dernier des reproches que nous avons faits la classification de Batbie disparaissait ainsi, mais il subsistait les deux premiers : le mlange des matires qui supposent la puissance publique avec celles qui ne la supposent point ; le fait que certaines matires de police restaient en dehors. Un nouveau dveloppement du contentieux allait permettre de corriger ces imperfections, de complter et d'achever le systme. Depuis la loi du 24 mai 1872, qui a rorganis le conseil d'tat et qui lui a dfinitivement dlgu la justice administrative, ce grand corps a encore affermi sa jurisprudence, et l'on peut dire que, dans ces vingt dernires annes, il a dgag, en matire d'actes d'administration, en matire de recours et en matire de comptence, des rgles d'une importance capitale. Il a t second, d'ailleurs, par le tribunal des conflits rorganis par la mme loi de 1872. Cette ju1. V. M. E.Laferrire, Trait dela juridictionadministrative, I, p. 400 et suiv.
54
FORMATION DU DROITADMINISTRATIF
risprudence si pleine de choses a trouv un interprte digne d'elle. Le Trait de la juridiction administrative et des recours contentieux de M. E. Laferrire, dont le premier volume a paru en 1887 et le second en 1888, en contient en effet toute la substance. Ce trait, auquel dans le pass aucun n'est comparable est un vritable modle par la faon dont y sont utilises l'histoire et la lgislation compare, pour la conscience avec laquelle sont analyss les arrts, pour les vues synthtiques qu'il renferme et la largeur de touche avec laquelle il est rdig. Or il apparat, dans cette jurisprudence, que l'ide d'une double personnalit administrative, l'une de puissance publique, l'autre de personne prive, se dgage de plus en plus. Ce sont les questions de comptence et de conflit qui la rvlent. Et la cause de ce dualisme est le dsir trs louable des juridictions administratives d'abandonner aux tribunaux ordinaires tout ce qui peut leur tre abandonn, et de ne rserver aux tribunaux administratifs que les affaires o la puissance publique est engage Del, la distinction entre les oprations de puissance publique et celles qui n'ont pas ce caractre, entre les contrats administratifs notamment et les contrats ordinaires. Il apparat, en mme temps, que la personnalit administrative peut absorber toute la puissance publique, l'tat ou la commune agissant en leur qualit de personne, d'tre moral, non seulement quand ils font une opration pcuniaire de puissance publique, par exemple quand ils exproprient, mais quand ils font de la police; que la police peut se ramener des droits de police et tre rattache la personne; qu'il y a des droits sur les fonctionnaires, des droits de tutelle administrative, des droits de police administrative, etc. Ce qui fait apparatre cela, c'est que l'action de l'tat ou de la commune en ces matires commence tre rglementepar le droit, grce au dveloppement du recours pour excs de pouvoir contre des actes considrs comme discrtionnaires. C'est qu'on peut recourir contre l'arrt de police d'un maire; c'est qu'un conseil municipal peut recourir contre l'arrt d'un prfet qui annule une de ses dlibrations; c'est qu'un fonctionnaire simplement remplac dans ses fonctions, et non rvoqu, peut demander son admission la retraite (Cons. d't., 15 mars 1889), etc. Du moment que cette action de la puissance publique est rglemente, elle cesse d'tre une pure force qui chappe au droit, elle est elle-mme un droit. Arrive ce point, la thorie de la personnalit comprend tout, explique tout, organise tout. Tous les rouages de l'administration, tat, dpartements, communes, tablissements publics, colonies, sont des personnes administratives; elles ont des droits qu'elles exercent
DU DROIT ADMINISTRATIF FORMATION
55
par l'intermdiaire d'organes qui sont des autorits administratives. Les actes par lesquels ces droits sont exercs, et qui sont des dcisions excutoires, prennent le nom d'actes d'administration; et, en effet, l'administration, c'est--dire le fonctionnement des services publics en rsulte. Lespersonnes administratives ont des droitsde puissancepublique et des droits de personne prive qui ne doivent pastre confondus. Enfin, la comptence des juridictions administratives est entrane, soit par la nature spciale de l'acte d'administration, soit par la nature spciale des droits de puissance publique. Que l'on distribue, dans l'exposition, ces diffrentes matires comme on voudra, l'essentiel est qu'elles s'enchanent par une logique intime. Il est vrai, et il ne faut pas dissimuler ce rsultat, que cette organisation des matires administratives les fait apparatre sous l'aspect de droits de l'tat: l'tat a des droits de police, il a des modes d'acqurir de puissance publique, etc. Il y a donc l une mthode que l'on pourrait appeler tatiste; elle a, si l'on veut, quelque parent avec la doctrine conomique qui ne repousse pas systmatiquement l'intervention de l'tat, et on peut l'opposer la mthode individualiste que nous avons dit tre propre l'cole de Poitiers. Au lieu de considrer le service militaire comme une charge impose la personne, on le considrera comme un droit de l'tat; au lieu de considrer l'expropriation pour cause d'utilit publique comme une charge des biens on la considrera comme un droit de l'tat. Il est possible que cela pousse en certain cas dfinir des droits de l'tat, mais nous ne voyons pas l un danger srieux. L'tat, avec la masse norme d'impts qu'il lve sur nous tous les ans, commence nous intresser beaucoup ; nous commenons nous apercevoir que ses intrts sont un peu les ntres et que, comme contribuables, nous ne perdons rien ce que ses droits soient respects. Il ne s'agit pas d'ailleurs d'augmenter les droits de l'tat, mais de les reconnatre franchement l o ils existent. Conclusion Au point o en est arriv notre droit administratif, on peut se rendre compte d'une chose, c'est qu'il a fait un grand dtour pour en revenir au point o il tait dans le droit romain et dans notre ancien droit et o il n'a pas cess d'tre dans la plupart des lgislations trangres, savoir un droit trs voisin du droit priv. Du moment, en effet, que les rouages administratifs sont des individualits jouissant de droits plus ou moins exorbitants et que toute l'administration s'explique par le jeu de ces droits, le droit adminis-
56
FORMATION DU DROITADMINISTRATIF
tratif n'est pas beaucoup plus diffrent du droit civil que le droit commercial, par exemple, o les commerants sont envisags comme des individus exerant des droits exceptionnels et o le commerce s'explique par le jeu de ces droits. L'acte d'administration lui-mme n'est pas beaucoup plus diffrent de l'acte de la vie civile que l'acte de commerce. Il s'est produit pour le droit administratif, depuis la Rvolution, ce qui s'tait produit pour le droit commercial depuis la cration des juridictions consulaires au sortir du moyen ge, les rgles parses jusque-l et mles avec celles du droit civil dans chaque matire, se sont spares de celles-ci matriellement et ont form un systme. Cela est d uniquement l'tablissement des tribunaux administratifs. De mme que le droit commercial envisag comme corps de rgle est sorti des juridictions consulaires, de mme le droit administratif moderne est sorti de la juridiction administrative centralise par le conseil d'tat. Le droit romain et l'ancien droit n'eurent pas de corps de rgles administratives, parce qu'ils n'eurent que des juridictions administratives spciales isoles, sans lien entre elles; mais ils eurent des rgles administratives, et les ntres, malgr leur groupement part, ne sont pas plus loignes du droit commun que n'taient les leurs1. Est-ce dire que cette constitution d'un corps de droit administratif ait t inutile? Bien loin de l : elle prsente de grands avantages. D'abord, cela n'empche en rien la doctrine administrative de s'emparer de ceux des principes du droit priv qu'elle peut s'assimiler; les deux droits se dveloppant paralllement avec la mme ordonnance, les comparaisons sont faciles. En revanche, cela affranchit le droit administratif de la servitude des textes du droit civil, cela lui permet de se dvelopper librement. En matire de responsabilit du commettant, par exemple, cela l'a affranchi du texte de l'art. 1384 et lui a permis d'difier une thorie bien plus fine que celle du droit civil2 ; en matire de procdure aussi cela lui a permis de crer des 1. Arrivau terme de cet ouvrage,disait dj M.Daresteen 1862,il ne nous reste plus qu' en tirer la conclusion.Cette conclusionpeut s'exprimer d'un mot. C'estla tendance progressive et constante du droit administratif se rapprocher du droit commun, tendance qui se manifeste la fois et dans le fond du droit et dans la juridiction. Il y a cependant des diffrencesqu'on n'effacerapas, il y auratoujours des lois administrativescommeily a deslois commerciales et il sera toujours convenable d'en confier l'application des tribunaux spciaux (La justice administrative,conclusions). 2. Ce qu'il y a de plus fin dans la thorie du droit administratif,c'est que le commettantn'est responsable que lorsque le prpos reste dans l'esprit de sa fonction, tandis qu'en droit civil il est responsable tant que le prpos est
DU DROITADMINISTRATIF FORMATION
57
rgles bien plus souples que celles du Code de procdure civile, etc. Enfin, le fait que les rgles administratives sont groupes ensemble permet de les rapprocher les unes des autres, comparaisons, rapprochements fconds, trs difficiles dans les droits o ces rgles sont encore parses. Seulement, il y a un grand intrt se rendre compte que notre droit administratif, part le groupement qui est diffrent, ressemble singulirement au droit administratif de l'ancien rgime et celui des pays trangers. Cela doit nous pousser aux tudes d'histoire et de droit compar. Nous avons la conviction qu'il y aurait grand profit tirer des tudes de droit public parses dans les uvres de nos sicle, soit celles des romanistes dans les grands jurisconsultes du XVIe commentaires du Digeste et surtout du Code, soit celles des Loyseau, des Chopin, des Bacquet, et l'on constaterait avec une surprise bientt dissipe, que l'on parle le mme langage, car, eux, n'hsitaient pas rduire la puissance publique en droits (droits rgaliens, droits de seigneurie, de justice, etc.). Quant au profit que l'on peut retirer de la lgislation compare, nous n'avons pas y insister. D'tudes poursuivies en ce sens pendant un temps suffisant, pourrait peut-tre sortir ce Code administratif comprenant l'ossature vraiment permanente du droit, dgage de la partie mobile et purement rglementaire, dont tant d'esprits ont poursuivi l'ide, que l'on a fini par considrer comme chimrique, mais qui ne l'est point1. Il pourrait en sortir aussi un grand trait doctrinal de droit administratif, mais qui demanderait la collaboration de plusieurs hommes, car les proportions de la matire dpassent prsent les forces d'un seul. matriellementen fonction. Cela tient ce que les personnes administratives ne peuvent pas tre souponnes de donner des instructions mauvaises leurs prposs. 1. V. art. F. Laferrire sur un ouvrage de M. Mallein, professeur Grenoble. Revue critique, 1858,t. XII,p. 369.
LES
SOURCES
ET
LES DES
MONUMENTS
RGLES DU DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF FRANAIS1
Ier. Les sources Article Ier. Caractres gnraux des sources Le droit public jus scriptum . Les rgles du droit public et du droit administratif sont presque toutes contenues dans des lois. crites, la partde la coutume est trs faible. Apeine peut-on signaler, en droit administratif, la place faite aux usages locaux en matire de curage des cours d'eau non navigables ni flottables et en matire de pavage des rues des villes ; les assembles lues, conseils municipaux, conseils gnraux, chambres lgislatives, ont aussi quelques traditions au point de vue de la procdure de leurs dlibrations, mais on ne peut pas considrer encore que ces traditions aient forcede loi. Nous nous trouvons donc en prsence d'un droit qui est surtout jus scriptum. Le droit public jus novum . Un second caractre tout aussi saillant de ce droit, c'est qu'il est jus novum. Sauf quelques rares exceptions, les lois et rglements qui le renferment ne remontent pas, comme date, au del du 5 mai 1789. Ici, comme dans toutes les autres branches du droit, la Rvolution marque le point de dpart d'une entire refonte lgislative. Certes, il y a des institutions et des rgles du droit public de l'ancien rgime qui ont survcu et pass dans notre droit; plusieurs mme, travers l'ancien rgime, remontent jusqu'au droit romain; il suffit de citer le conseil d'tat, la plupart des rgles des impts; mais ces institutions et ces rgles ont t consacres par des textes nouveaux. 1. La lgislation sur ces diffrents points n'tant pas la mme dans la mtropole et dans les colonies,nous traitons d'abord de la lgislation de la mtropole, et renvoyons un appendice celle des colonies.
60
SOURCES DUDROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF
Par exception, cependant, quelques textes anciens antrieurs 1789, s'appliquent encore. On en rencontre surtout en matire de voirie, c'est--dire en matire de police des voies publiques. Il y a l divers actes qui ont t expressment confirms titre provisoire par la loi des 19-22juillet 1791, art. 29, tit. I, et qui n'ont pas encore t remplacs. (V. infr, nso 385 et s.; V. aussi art. 484 du Code pnal.) Article II. La loi et le rglement Il existe actuellement deux sources diffrentes des rgles du droit public et administratif crit, la loi et le rglement. La loi est une disposition gnrale, exprimant la volont de l'tat, et formule par l'organe du pouvoir lgislatif; elle constitue un acte de lgislation. On distingue d'aprs leur objet trois espces de lois: les lois constitutionnelles, qui ont pour objet les rapports des pouvoirs publics (les trois pouvoirs) : les lois organiques, qui ont pour objet l'organisation de tel ou tel grand corps faisant partie des pouvoirs publics, par exemple, le Snat ou la Chambre des dputs; les lois ordinaires, qui ont pour objet des matires quelconques de droit public ou priv. Au point de vue de la forme, les lois constitutionnelles diffrent presque toujours des autres lois. D'aprs la constitution de 1875, elles sont l'uvre de l'Assemble nationale runie en congrs Versailles, comprenant la Chambre des dputs et le Snat runis, tandis que les autres lois sont votes sparment par les deux Chambres. Sous le premier et le second Empire, les lois constitutionnelles normales taient des snatus-consultes; sous la Restauration, 'a t une charte octroye par le roi; en 1830, une charte vote par la Chambre des dputs et accepte par le roi. Le rglement est une disposition gnrale exprimant la volont de l'tat, ou bien de certains membres de l'tat tels que les communes, et formule par un organe de pouvoir excutif, en vertu de ce que l'on appelle le pouvoir rglementaire; il constitue un acte d'administration. Tous les rglements ne sont pas faits au nom de l'tat, il en est fait au nom de la commune par le maire, qui portent le nom de rglements municipaux, et qui constituent une bonne partie de la rglementation laquelle se trouvent soumis les citoyens. On peut se demander, il est vrai, si ce pouvoir rglementaire, qui semble appartenir la commune, lui appartient en propre, ou s'il ne lui est pas
ET ADMINISTRATIF PUBLIC DUDROIT SOURCES
61
plutt dlgu par l'tat. Sous un rgime de dcentralisation, il parat naturel que ce soit un pouvoir propre la commune. Il existe certainement un ordre public local maintenir. Pourquoi le pouvoir local n'auraitil pas la mission de le maintenir par des rglements de police au locaux? Aucune loi positive ne s'oppose cette interprtation; contraire, l'ensemble de la lgislation communale y est favorable, car elle reconnat l'existence d'une police municipale et d'une police rurale (art. 91, L. 5 avril 1884). Le pouvoir rglementaire exerc par le maire est surveill de trs prs par le prfet fonctionnaire de l'tat, mais cela doit tre considr comme une restriction impose dans un but d'intrt gnral un droit prexistant, et non pas comme une limitation d'un droit dlgu. (Cass. 3 nov. 1885.) On ne saurait, au contraire, reconnatre l'existence de rglements faits au nom du dpartement. Il est fait, dans le dpartement, des rglements par le prfet, mais il faut considrer que le prfet agit ici comme agent rgional de l'tat, et non point comme reprsentant du cela rsulte de ce fait, que la loi ne parle nulle part dpartement; d'une police dpartementale, et de cet autre fait, que d'aprs l'art. 3 de la loi du 10 aot 1871, le prfet ne reprsente le dpartement qu'en tant qu'il excute les dcisions du conseil gnral. L'tat fait donc les rglements pour le compte du dpartement, qui ce point de vue a moins d'autonomie que la commune. A. Rglements faits au nom de l'tat. Il faut distinguer les rglements gnraux faits pour tout le territoire, et les rglements locaux applicables une rgion, par exemple un dpartement ou une partie de dpartement. I. Rglements gnraux. a) Rglements faits par le chef de l'tat. Les rglements gnraux sont, en principe, l'uvre du chef de l'tat; ce sont, par consquent, des dcrets rglementaires, car tous les actes du chef de l'tat portent le nom gnrique de dcrets. Les dcrets rglementaires se divisent en deux classes: 1 Les rglements d'administration publique, pour lesquels la consultation du conseil d'tat est obligatoire en vertu d'une loi. (L. 24 mai 1872, art. 8, n 31.) 2 Les rglements ordinaires, pour lesquels cette consultation n'est 1. Il existe des dcrets dits : en forme de rglements d'administration publique, qu'il ne faut pas confondre avec les rglements d'administration publique. Ils doivent aussi tre rendus en conseil d'tat, mais ils ne sont pas des rglements, c'est--dire qu'ils ne contiennent pas de rgle gnrale.
62
DU DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF SOURCES
pas obligatoire; alors mme, qu'en fait elle aurait eu lieu, le rglement ne deviendrait pas pour cela d'administration publique. b) Rglements faits par les ministres. Trs exceptionnellement, en vertu d'une dlgation expresse de la loi, des rglements gnraux sont faits par des ministres; ils sont alors contenus dans des arrts rglementaires. L'exemple le plus remarquable d'une dlgation de cette espce se trouve dans l'art. 44 de l'ordonnance du 15 novembre 1846 sur les chemins de fer; le ministre des travaux publics est ; ces tarifs, charg par ce texte d'homologuer les tarifs de transport une fois homologus, deviennent de vritables rglements. Ce ne sont point des conventions passes entre la compagnie et le public pour la rmunration d'un louage de services, ce sont de petites lois. La jurisprudence a successivement dduit toutes les consquences de cette ide ; il en rsulte notamment qu'une fois les conditions de publicit remplies, nul n'est cens ignorer l'existence d'un tarif; que l'interprtation du tarif par le juge doit tre littrale; qu'on ne saurait par des conventions particulires droger un tarif, etc. Cette conception du tarif comme rglement a t fort critique; elle rpond bien pourtant la ralit des choses, car les prix du tarif contiennent pour partie une taxe publique de page, perue l'occasion d'un vritable travail public, ct du prix de transport proprement dit (art 42 du cahier des charges). Or, les taxes ne doivent tre tablies que par une loi ou un rglement. II. Rglements locaux. Ces rglements peuvent tre faits au nom de l'tat par les prfets dans des arrts rglementaires. Ils peuvent tre faits: 1 Pour tout le territoire d'un dpartement; 2 pour le territoire de plusieurs communes en cas d'inertie des maires (art. 99, 1. 5 avril 1884). Quant au cas o le prfet fait un rglement applicable une seule commune en se conformant aux formalits de l'art. 99 de la loi municipale du 5 avril 1884, c'est un cas o il fait un rglement au nom de la commune, non point au nom de l'tat, car il se substitue au maire. B. Rglements faits au nom de la commune. Ces rglements sont l'uvre du maire, ils sont contenus dans des arrts rglementaires. Exceptionnellement, ils peuvent tre faits par le prfet (art. 99 prcit). Domaine respectif de la loi et du rglement Une des difficults du droit administratif est de dterminer le domaine respectif de la loi et du rglement. C'est une question qui a une porte constitutionnelle, et qui se rattache aux rapports du pouvoir excutif avec le pouvoir lgislatif; il faut considrer que la loi
PUBLIC ET ADMINISTRATIF DUDROIT SOURCES
63
manant presque directement du peuple par l'intermdiaire du parlement, est protectrice des droits individuels, tandis que les rglements manant du gouvernement ont, au contraire, une tendance oppressive. Le domaine du rglement a t soigneusement dlimit. Dans sa mission gnrale, il doit seulement assurer l'application des lois. (L. 25 fvrier 1875, art. 3). Cela comporte les deux fonctions suivantes: 1 La publication du texte des lois. Cette publication, qui lgalement rsulte de l'insertion au Journal officiel ou au Bulletin des lois (dcret du 5 novembre 1870), en fait est ralise par des affichages ou des criages, que les prfets sont tenus de prescrire et de surveiller, et que les maires sont tenus de faire excuter dans chaque commune (art. 92 et 94,1. 5 avril 1884). Une loi dj publie, peut tre publie nouveau, si besoin est. 2 La prescription de mesures de dtail, destines assurer l'application des dispositions gnrales de la loi. La loi dispose toujours par voie de mesures trs gnrales; cela tient ce qu'elle est faite pour un grand territoire et pour une longue dure ; il faut que la rgle qu'elle pose soit, autant que possible, indpendante des circonstances de lieu et de temps. Mais alors, pour un lieu donn et une poque donne, il est ncessaire de la complter par des mesures de dtail, qui par rapport elle seront transitoires. Cette seconde fonction du rglement est beaucoup plus importante que la premire, et cela apparat dans les matires dites de police. La police administrative a ce but vague et complexe de veiller au maintien de l'ordre public, de surveiller constamment, de prvoir les faits fcheux qui peuvent se produire et de prendre des mesures en vue de les empcher. On comprend que c'est l une matire mouvante dans laquelle la loi ne peut point s'aventurer; les dangers qui menacent l'ordre public changent chaque instant de nature; le rglement seul est assez souple et assez rapide pour russir y parer. Aussi, en matire de police, les lois sont-elles rares et courtes. Il y en a sur des matires spciales d'assez importantes; par exemple, sur la police sanitaire, la police du roulage, etc.; mais sur la matire gnrale de la police elles sont d'une brivet digne des Douze Tables. Elles se bornent, en somme, indiquer les trois faits principaux qui constituent l'ordre public, la tranquillit publique, la scurit publique, la salubrit publique, et elles s'en remettent aux rglements du soin de prendre les mesures pour assurer le maintien de ces trois faits. (Voir la loi fondamentale des 22 dcembre 1789-janvier 1790, sect. III, art. 2, n 9.) Les rglements ont donc ici le champ libre, et non seulement les rglements faits au nom de l'tat par le chef de
64
SOURCES DUDROITPUBLIC ET ADMINISTRATIF
l'tat ou les prfets, mais ceux faits au nom de la commune par le maire, en matire de police municipale et rurale1. C'est ici surtout que les rglements sont menaants pour les droits individuels et qu'il y a lieu de poser des rgles, si la chose est possible, tant pour la sauvegarde des individus que pour la gouverne des autorits. Quelque dlicate que soit la matire, il semble qu'on puisse dgager les deux rgles suivantes: Premire rgle. Un rglement ne peut pas modifier les dispositions d'une loi2. Deuxime rgle. Un rglement ne peut pas violer les droits individuels reconnus par l'ensemble de la lgislation, en imposant des obligations prcises; spcialement il ne peut imposer la proprit d'obligations nouvelles, moins que le principe ne s'en trouve dans une loi. Cette dernire rgle doit s'interprter en ce sens que s'il n'y a pas de textes de lois spciaux en la matire, s'il n'y a que le texte gnral de la loi de 1790 prescrivant le maintien de la tranquillit, de la scurit, dela salubrit, un rglement ne peut que prescrire en termes trs gnraux la tranquillit, la salubrit, il ne peut pas imposer aux propritaires d'obligations spciales; par exemple, en matire de salubrit, en vue de l'assainissement d'un quartier d'une ville, un maire peut imposer aux propritaires l'obligation d'assainir leurs immeubles, il ne peut pas leur prescrire un mode particulier d'assainissement, tel que la destruction de puisards, ou le curage de fosses d'aisance qui ne seraient pas pleines. (Cassat., 26 nov. 1887.) Il faut reconnatre que ces deux rgles ne suffisent pas trancher toutes les questions, qu'il y a des cas d'absolue ncessit dans lesquels elles doivent flchir, et qu'une large libert d'apprciation est forcment laisse aux tribunaux dans ce conflit entre l'intrt public et l'intrt priv. Bien des dcisions contradictoires pourraient tre releves en jurisprudence. 1. Bien que la police municipale et la police rurale aient t l'objet de dispositions lgislatives assez dveloppes, il faut toujours en revenir la for; l. 6 oct.-28 sept. mule : tranquilit, scurit, salubrit (1. 5 avril 1884,art. 97 par 1. 5 avril 1884,art. 91,94,99; 1. 4 avril 1889; 1. 9 juillet 1791, modifie 1889; 1. 22 juin 1890). 2. On s'est demand cependant, si certaines dispositions purement rglementaires des lois, et qui auraient aussi bien pu trouver place dans des rglements, ne pourraient pas plus tard tre modifiespar des rglements, tout au moins par des dcrets rglementaires.Certains auteurs admettent l'affirmative. Nousnous refusons entrer dans cette voie dangereuse.
DU DROITPUBLICET ADMINISTRATIF SOURCES 65 Observationhistorique. Le domaine de la loi n'a pas toujours t respect par le rglement. 1 Il y a eu diverses reprises, sous les gouvernements autoritaires, empitement du pouvoir excutif sur le lgislatif, et des rglements sont intervenus, l o il aurait fallu des lois. Ces dcisions rglementaires ont t acceptes malgr tout, et tiennent encore la place de lois. Il faut les signaler. Nombre de ces dcisions sont l'uvre de Napolon Ier, qui avait t entran vers le pouvoir absolu (notamment, dcret du 16 dcembre 1811 sur les routes impriales, crant des servitudes pour les riverains). La lgalit de ces dcrets n'avait pas t conteste sous son rgne, elle le fut sous la Restauration; la cour de cassation les a maintenus, sous prtexte que le Snat, qui avait un dlai pour les casser pour inconstitution; des avis du conseil d'tat approuvs par l'emnalit, ne l'avait pas fait pereur et publis depuis le 16 septembre 1807 jusqu'en 1814, sont dans le mme cas. 2 A chaque changement de rgime, avant que les autorits nouvelles ne fussent rgulirement constitues, les gouvernements provisoires ont exerc la fois le pouvoir lgislatif et le pouvoir excutif et ont fait des dcrets-lois. Il y a eu de ces actes en 1830 et 1848, ils n'ont plus qu'un intrt historique ; mais il y en a eu en 1852 et 1870, qui sont encore en vigueur. Dcrets rendusparle prince-prsident depuis le 2 dcembre 1851, poque de la dissolution de l'Assemble nationale, jusqu'au 29 mars 1852, po: constitution du que de la runion des nouvelles chambres; notamment 14 janvier 1852, dcret du 25 mars 1852 dit de dconcentration. L'art. 58 de la constitution du 14 janvier 1852 dit formellement que tous les dcrets rendus pendant cette priode auront force de loi ; ce n'est pas exact, cela dpend de leur objet; il en est qui sont de simples dcrets, modifiables par dcrets. Dcrets rendus par le gouvernement de la dfense nationale ; dcret du 5 novembre 1870sur la publication des lois, etc. Domaine respectif des diffrents rglements Les diffrents rglements ont d'abord un domaine territorial, en ce sens qu'un prfet ne peut pas faire de rglements applicables hors de sa commune. Ils ont aussi un domaine au point de vue des matires rglementes, et cela en deux sens: 1 Certaines matires ne peuvent tre rglementes qu'au nom de l'tat, soit par le chef de l'tat, soit par les prfets, sans pouvoir l'tre au nom de la commune; en d'autres termes, il y a des matires qui relvent de la police de l'tat et non de la police communale. La 5 H.
66
SOURCES DU DROITPUBLICET ADMINISTRATIF
rciproque est vraie, il est des matires de police communale qui ne sont pas en mme temps matire de police d'tat; et lorsque le prfet se substitue au maire, en observant les formalits de l'art. 99, in fine, 1. 5 avril 1884, c'est la police communale qu'il exerce. De mme, parmi les matires de police d'tat, il en est qui doivent tre rgles par rglements d'administration publique, d'autres par rglements ordinaires, d'autres par arrts prfectoraux. On peut appeler cela le domaine de droit des rglements. 2 Il y a aussi un domaine de fait, c'est--dire que lorsqu'un rglement d'une certaine espce s'est empar d'une matire flottante qui aurait aussi bien pu tre saisie par un autre, ses dispositions ne peuvent plus tre modifies que par un rglement de mme espce, ou d'une espce plus haute. Ainsi, parmi les rglements faits au nom de l'tat, un dcret rglementaire ne peut jamais tre modifi par un arrt prfectoral. Une matire de police communale rgle une fois par arrt prfectoral en vertu de l'art. 99in fine, 1. 5 avril 1884, pourra cependant tre rgle nouveau par arrt du maire, puisque le prfet n'avait fait qu'exercer le pouvoir du maire; d'ailleurs, si la modification est intempestive, le prfet est arm, il peut suspendre ou annuler l'arrt du maire. Confection des lois et rglements La confection des lois et rglements est une opration en trois temps : 1 Rdaction de la formule de la loi ou du rglement par l'autorit comptente; aprs cela la loi est faite. 2 Promulgation ou ordre d'excution; aprs cela la loi est excutoire. 3 Publication destine faire connatre la loi; aprs cela la loi est obligatoire. Rdaction et promulgation. Les deux premiers temps ne sont distincts que pour les lois proprement dites; il y a : 1 rdaction du texte faite suivant une procdure qui met en mouvement l'organe lgislatif, et que nous verrons plus tard; 2 promulgation, acte par lequel le chef du pouvoir excutif atteste l'existence de la loi et la proclame excutoire : Le Snat et la Chambre des dputs ont adopt, le Prsident de la Rpublique promulgue la loi dont la teneur la prsente loi dlibre et adopte parle Snat et la Chambre suit. des dputs sera excute comme loi de l'tat. (Dcret du 6 avril la 16 1875, la loi du 7 de termes de l'article Aux juillet 1876.)
SOURCES DU DROITPUBLICET ADMINISTRATIF
67
promulgation doit intervenir dans le dlai d'un mois dater de la transmission au gouvernement et dans le dlai de trois jours en cas de dclaration d'urgence par les d(ux Chambres. Pour les rglements les deux oprations se confondent, parce qu'elles sont toutes les deux l'uvre du mme organe de pouvoir excutif. Rien d'essentiel dans la forme des dcrets et des arrts rglementaires, si ce n'est la signature et aussi la date, afin que l'on puisse vrifier la qualit du magistrat qui signe ; mais il y a une forme habituelle: 1 visa des textes, motifs sous formes de considrants; 2 dispositif par articles; 3 date et signature. De plus, les rglements d'administration publique qui sont dlibrs en assemble gnrale du conseil d'tat portent la mention de cette dlibration. Observation. Aprs la promulgation, les lois sont excutoires, il ne reste plus qu' les publier pour qu'elles deviennent obligatoires. Il en est de mme des dcrets rglementaires et des arrts des prfets. Mais il n'en est pas de mme des arrts des maires, du moins de ceux qui portent rglement permanent. Ils ne sont compltement excutoires qu'un mois aprs la remise de l'ampliation au prfet ou au sous-prfet, constate par certificat; nanmoins, en cas d'urgence, le prfet peut autoriser l'excution immdiate (art. 95, 1. 1884). Publication. C'est le fait qui porte la loi ou le rglement la connaissance des citoyens ou qui est cens l'y porter (divulgatio promulgationis). Publication des lois et des dcrets rglementaires. Les formalits de la publication pour les lois et dcrets rglementaires sont actuellement rgles par un dcret du 5 novembre 1870, qui a modifi l'ordonnance du 27 novembre 1816 en mme temps que l'article 1er du Code civil. La publication est cense faite lorsqu'un certain dlai s'est coul depuis l'insertion de la loi ou du dcret promulgu dans un recueil priodique, Journal officielon Bulletin des lois. 1 Insertion au Journal officiel. Toutes les lois et tous les dcrets rglementaires importants sont insrs au Journal officiel (art. 2, dcret 5 nov. 1870). Ils sont censs connus Paris un jour franc aprs celui de l'insertion au Journal officiel, c'est--dire le surlendemain. Partout ailleurs, dans l'tendue de chaque arrondissement, un jour franc aprs que le Journalofficiel qui contient l'insertion sera arriv au chef-lieu de l'arrondissement, c'est--dire encore le surlendemain. 2 Insertion au Bulletin des lois. Quant aux dcrets qui sont insrs seulement au Bulletin des lois, ils restent sous l'empire de l'ordonnance du27 novembre 1816.
68
SOURCES DU DROITPUBLICET ADMINISTRATIF
B.) Publication des arrts prfectoraux et municipaux. La cour de cassation admet ici que l'arrt est cens connu du jour mme de la publication. Quant au fait mme de la publication, pour les arrts prfectoraux, pas de rgles; pour les arrts municipaux (art. 96, 1. 5 avril 1884), publication et affichage, ces deux faits raliss conformment aux usages; seulement il faut que la date de la publication soit constate; aussi la loi du 5 avril 1884 a-t-elle exig que la publication ft certifie par une dclaration crite du maire, et pour plus de sret, mme, l'arrt doit tre transcrit en entier sur le registre de la mairie (art. 96 in fine), et tout habitant est autoris en prendre copie (art. 58) 1. Force obligatoire des lois et rglements A.) De la prsomption que nul n'est cens ignorer la loi ou de l'ignorance de droit. Deux principes communs avec les lois civiles s'appliquent ici: 1 Nul n'est cens ignorer les lois qui ont t rgulirement promulgues ; 2 les lois rgulirement promulgues sont obligatoires mme pour ceux qui de fait en ignorent les prescriptions. Donc on ne peut invoquer son ignorance de droit, ni pour chapper aux consquences de l'inaccomplissement d'une obligation lgale, ni pour se faire relever d'une dchance encourue. Cependant en matire administrative, remarquons des tempraments : 1 L'administration prend soin de rafrachir la mmoire aux citoyens en renouvelant en temps utile la publication de certaines lois, les lois de police notamment, et c'est un emploi trs important des rglements; 2 lorsque par suite de l'inaccomplissement d'une obligation, une amende a t encourue, il arrive que sur recours gracieux l'administration restitue l'amende si on fait preuve d'erreur; exemple, amendes en matire d'enregistrement; 3 enfin (dcret du 5 nov. 1870, art. 4), les tribunaux et les autorits administratives et militaires peuvent, selon les circonstances, accueillir l'exception d'ignorance allgue par les contrevenants, si la contravention a eu lieu dans le dlai de trois jours francs partir de la promulgation. B.) Evnements qui peuvent enlever leur force obligatoire aux lois et rglements. Ces vnements sont l'abrogation, la rtractation, l'annulation, l'illgalit. Le premier se produit galement pour les lois et les rglements, les trois autres seulement pour les rglements. 1. La publication ne rsulte pas de l'insertion dans un recueil prfectoralou municipal; on devrait dans une bonne lgislation cumuler tous les degrs l'affichage et l'insertion dans un recueil, le recueil restant comme monument (dj le dcret de 1870,art. 3, recommande l'affichagedes lois).
DU DROITPUBLICET ADMINISTRATIF SOURCES
69
a) L'abrogation. Cette cause de destitution de force se produit galement pour les lois et les rglements. Elle consiste en ce qu'une loi nouvelle succdant une loi ancienne sur une mme matire, la dtruit. Cette abrogation par le texte est la seule qui soit reconnue dans notre droit; il n'y a point d'abrogation par le non usage. Les lois et rglements sont perptuels moins d'abrogation par de nouveaux textes. Pour les rglements cependant, il faut distinguer entre les transitoires et les permanents ; il est bien clair que le rglement fait l'occasion d'une fte nationale est phmre. Le principe que les lois et rglements ne s'abrogent pas par dsutude est command par la constitution actuelle de l'tat et par la division des pouvoirs. La loi et le rglement sont l'uvre d'organes spciaux dans l'tat, il est naturel qu'ils ne puissent tre dfaits que par l'organe mme qui lesa faits. La dlgation de la souverainet doit tre la mme pour dfaire la loi que pour la faire. La dsutude ne se comprend que lorsque le souverain exerce lui-mme la souverainet (monarchie absolue, dmocratie directe1. L'abrogation est expresse ou tacite, elle est expresse lorsque la loi nouvelle prononce littralement l'abrogation de la loi ancienne. L'abrogation expresse est malheureusement trop rare en matire de droit public; on peut citer la loi sur la presse du 29 juillet 1881 et la loi municipale du 5 avril 1884, parmi celles qui ont abrog expressment et nommment les textes antrieurs. (V. l'art. 168 de la loi municipale. ) Elle est tacite lorsque la loi nouvelle contient des dispositions contraires celles de la loi ancienne. On trouve frquemment dans les lois administratives un article final qui prononce l'abrogation des lois anciennes en cequ'elles ontde contraire ; ce n'est que la conscration du principe de l'abrogation tacite. L'abrogation tacite soulve bien des difficults; il faut recourir aux rgles suivantes qui sont classiques : 1 Lorsque la contrarit porte sur le principe mme qui servait de base la loi ancienne, l'abrogation s'tend toutes les dispositions de cette loi indistinctement; 2 Lorsqu'elle ne porte que sur des dtails, ne sont abroges que 1. Lorsque les lois existantes contre les congrgationsnon autorises furent appliques parles dcrets du 27 mars 1880(1. 13 fvrier 1790 ; l. 28aot 1192; 1. 18 germinal an X; dcret du 3 messidor an XII), les dfenseurs des congrgations ne soutinrent pas qu'il y avait abrogation par le non usage ; tout leur effort porta sur ce point, qu'il y avait abrogation implicite rsultant d'autres textes.
70
SOURCES DU DROITPUBLICET ADMINISTRATIF
les rgles de dtail pour lesquelles il y a contrarit absolue : posteriores leges ad priores pertinent nisi contrari sint. 3 Legi speciali per generalem non derogatur; en principe, des lois spciales ne peuvent tre abroges que par des lois spciales nouvelles. Les lois ne peuvent tre abroges que par une loi, pas par un rglement 1. Les rglements peuvent tre abrogs par un rglement semblable, fait par la mme autorit. b) La rtractation. Les rglements peuvent tre rapports ou rtracts par l'autorit qui les a faits et par un acte dress en la mme forme. La rtractation diffre de l'abrogation, en ce sens que la disposition nouvelle se borne dtruire les dispositions anciennes sans rien y substituer. La rtractation, quoique possible pour les lois, est rarement usite. c) L'annulation. Tous les rglements peuvent tre annuls, soit par dcision administrative d'une autorit suprieure, soit par dcision judiciaire, d'aprs les rgles suivantes: 1Les arrts des maires peuvent tre annuls par le prfet, soit spontanment, soit sur recours gracieux des parties lses dans leurs intrts. Cette annulation peut intervenir un moment quelconque, alors mme que l'arrt est devenu excutoire, c'est--dire mme aprs l'expiration du dlai d'un mois depuis le dpt de l'ampliation; L'administration n'est pas lie par son silence, elle ne le serait mme pas par une approbation antrieure qui aurait t donne formellement. L'annulation doit tre prononce par arrt, elle peut tre motive par une simple inopportunit de l'acte. Les actes accomplis en excution de l'arrt municipal jusqu'au moment de l'annulation restent valables. Les mmes arrts peuvent tre annuls par le conseil d'tat la suite d'un recours pour excs de pouvoir, fond sur l'incomptence, la violation des formes ou de la loi, le dtournement de pouvoir, recours ouvert aux parties intresses en cas d'intrt froiss. 2 Les arrts des prfets peuvent tre annuls ou rforms par le ministre comptent, soit spontanment, soit sur le recours gracieux des parties intresses, pour simple inopportunit. Ils peuvent tre galement annuls par le conseil d'tat, la suite d'un recours pour excs de pouvoir. 1. Cependant, on peut soutenir que si une loi contient de ces mesures de dtail apurementrglementaires,qui rgulirement auraient d trouver place dans un dcret, ces mesures pourront tre abroges par dcret, mais la question est dlicateet nous avons dj dit (p. 64)que nous nous refusions entrer dans cette voie.
SOURCES DU DROITPUBLICET ADMINISTRATIF
71
3 Les dcrets rglementaires peuvent tre annuls pour excs de pouvoir. Les rglements, quels qu'ils soient, sont de d) L'illgalit. plein droit destitus de force s'ils sont illgaux; ils subsistent en apparence jusqu' ce qu'ils soient rapports ou annuls, mais les tribunaux doivent refuser de les appliquer. Ils sont illgaux : 1 Quand ils violent une loi formelle ou bien quelque droit individuel consacr par l'ensemble de la lgislation; 2 quand ils ont t rendus, non pas en vue de l'intrt gnral, mais en vue de favoriser un intrt particulier. Ceci est une cause frquente de dclaration d'illgalit pour les rglements municipaux. Rien de comparable pour les lois, elles ne sauraient tre illgales. Cependant on comprendrait qu'elles fussent inconstitutionnelles. Il y a eu, sous la constitution du premier Empire, droit du Snat de les casser dans ce cas. Aux tats-Unis, le pouvoir judiciaire a aussi le droit de refuser d'appliquer une loi qu'il juge inconstitutionnelle, il est ainsi le gardien de la constitution. 2. Les monuments du droit public On appelle monuments, les textes ou recueils de textes officiels dans lesquels se trouvent les lois et rglements. Une premire remarque faire, c'est qu'il n'y a pas de Code des lois administratives, c'est--dire de recueil mthodiquement ordonn, comme le Code civil, etc. Il y a simplement des recueils chronologiques dans lesquels on trouve leur place les diffrentes lois. Une seconde remarque, c'est qu'il n'y a de recueil officiel et par consquent de vritable monument du droit que pour les lois et les rglements mans du chef de l'tat (le Journal officiel et le Bulletin des lois sur lesquels nous allons revenir), mais qu'il n'y en a ni pour les rglements prfectoraux ni pour les rglements municipaux. Il existe bien dans chaque prfecture un recueil des actes administratifs, dont la publication a t prescrite par une circulaire du ministre de l'intrieur du 21 septembre 1815, et dont les exemplaires devaient tre envoys gratuitement aux communes, mais ces publications laissent beaucoup dsirer et n'ont rien d'officiel. De mme dans les mairies, la loi du 5 avril 1884 prescrit la tenue d'un registre de la mairie sur lequel les arrts doivent tre transcrits leur date (art. 96), mais ce n'est galement qu'une mesure d'ordre. Quelques grandes villes ont pris l'initiative de publier de petits codes de leurs rglements municipaux ; ces codes ne sont pas officiels, mais au moins sont-ils commodes pour les administrs.
72
SOURCES DU DROITPUBLICET ADMINISTRATIF
Bulletin des lois. Depuis la loi du 14 frimaire an II qui l'a cr, jusqu'au dcret du 5 novembre 1870 qui lui a substitu en partie le Journal officiel, le Bulletin des lois a t l'unique recueil officiel1. C'est un recueil priodique priodicit irrgulire, imprim et gr par l'Imprimerie nationale. Il parait par fascicules. Les actes insrs sont numrots, les fascicules le sont aussi. Le Bulletin des lois se divise en sries successives, suivant les gouvernements dont manent les actes : 1 Convention, 2 Directoire, 3 Consulat, 4 Empire, 5 Premire Restauration, 6 Cent-Jours, etc. De plus, depuis 1836, le Bulletin est divis en deux parties, une principale, l'autre supplmentaire pour les actes d'intrt local. La loi de 1837 avait oblig les communes s'y abonner; un dcret du 12 fvrier 1352 a restreint cette obligation aux chefs-lieux de canton, et cr pour les communes rurales le Bulletin des communes. Tout cela a t confirm par l'art. 136, n 2, 1. 1884. Le Bulletin des lois est une publication mal faite, Il et fallu s'astreindre insrer chaque loi la date de sa promulgation; quelquefois il y a des annes de retard, alors on ne sait o chercher. Journal officiel. Le Journal officiel n'est devenu un monument du droit que depuis le dcret du 5 novembre 1871, mais il existait depuis longlemps, et dj publiait les actes lgislatifs. Il commena de paratre le 5 mai 1789, jour de l'ouverture des tats gnraux, sous le nom de Moniteur universel ou Gazette nationale ; il devint officiel le 7 nivse an VIII. En 1869, il prit le nom de Journal officiel, fut in-folio jusqu'en avril 1871, poque o il est devenu in-4 Depuis le dcret du 5 novembre 1870, le Journal officiel est le recueil officiel de toutes les lois et de tous les rglements d'intrt gnral; il a le grand avantage sur le Bulletin des lois d'tre quotidien et beaucoup mieux tenu jour au point de vue chronologique, les lois tant publies trs peu aprs leur promulgation. Des tables annuelles facilitent les recherches. Observation. Les collections officielles, quelque bien ordonnes qu'elles soient, auront toujours l'inconvnient d'tre trop compltes et peu maniables. Il a t fait des compilations prives infiniment plus commodes. 1 Collection Duvergier, qui contient, en plus du texte, l'analyse des dbats parlementaires sur chaque loi et des confrences ; elle ne 1. Pour la priode de 1789 l'an II, il a t fait en 1806une publication officielle sous le nom de Loiset actes du Gouvernement.
DU DROITPUBLICET ADMINISTRATIF SOURCES
73
contient que les actes principaux, mais la fin de chaque volume il y a une table de tous les actes du Bulletin; 2 Collection Sirey et Dalloz et une infinit d'autres dans les journaux professionnels; 3 Codes ; 4 Lois administratives de Vuatrin et Batbie, trs bonne compilation sur: 1 l'organisation administrative; 2 les finances et les travaux publics, jusqu'en 1876 seulement. 3. Sanction des rgles du droit public Au point de vue de leur sanction les rgles du droit public se divisent en deux catgories: les rgles pnales et les rgles non pnales. A. Rgles pnales. Il y a des rgles pnales en droit public, tout comme en droit priv. On en trouve: 1 Dans le Code pnal. Tout le titre 1er du livre III de ce Code, de l'art. 75 l'art. 294, est consacr aux crimes et dlits contre la chose publique; les peines les plus diverses y sont prononces. Une bonne partie du livre IV sur les contraventions de simple police est aussi du droit public. 2 Dans des dispositions rglementaires de lois spciales, par exemple dans la loi sur la presse du 29 juillet 1881, dans la loi sur la police sanitaire du 21 juillet, mme anne; les peines y sont trs frquemment correctionnelles. 3 Dans les rglements faits par le chef de l'tat en vertu d'une loi qui en prescrit la rdaction; les peines sont ici indiques d'avance par la loi et peuvent tre correctionnelles. 4 Dans les rglements ordinaires du chef de l'tat, dans ceux des prfets et dans ceux des maires. Tous les rglements sont en principe des lois pnales, et une mme peine est attache toutes leurs dispositions, c'est une amende de simple police de un cinq francs (art. 471, n 15 C P. Disposition introduite en 1832). La sanction des rgles pnales est assure, soit par voie de mesure de police, soit par voie de rpression juridictionnelle. La mesure de police est un acte de force accompli par le pouvoir excutif veillant au maintien de l'ordre. Elle consiste, soit en voies de fait contre les personnes, prise au collet pour faire circuler, arrestation provisoire, conduite au poste de police, etc. ; soit en actes d'excution sur les choses, saisie de denres falsifies, visite de bagages en douane et aux octrois, mesures de dsinfection, arrachage de plans phylloxrs, enfouissements d'animaux morts, etc.; elleest accomplie par un per-
74
DU DROITPUBLICET ADMINISTRATIF SOURCES
sonnel spcial d'agents de police. La mesure de police est prventive, elle n'attend pas qu'un dsordre soit caus. La rpression juridictionnelle est un acte tranchant un conflit par l'application du droit. Elle aboutit, elle aussi, des mesures d'excution sur les personnes et sur les choses. Mais elle se distingue de la mesure de police : 1 en ce qu'elle est postrieure la violation dela loi; 2 en ce qu'elle ncessite l'intervention d'un juge qui s'interpose entre l'infraction et la punition; 3 en ce qu'il y a des formes de procdure qui sont une garantie pour l'individu. Sauf certains cas assez rares, o la mesure prventive de police est indispensable sous peine d'irrparables malheurs (tout ce qui touche l'hygine, inspection des viandes, quarantaines, etc.), la rpression juridictionnelle est infiniment suprieure, elle n'est ni vexatoire ni arbitraire. La rpression juridictionnelle en matire de rgles pnales de droit public est confie en principe aux tribunaux rpressifs ordinaires; on ne peut signaler titre d'exception que les contraventions de grande voirie qui sont de la comptence des conseils de prfecture. B. Rgles non pnales. La sanction des rgles du droit public non pnales est assure galement la fois par la voie administrative et par la voie juridictionnelle. Par la voie administrative, en ce sens que les actes de l'administration donnent lieu des recours purement administratifs, la suite desquels ils peuvent tre annuls ou rforms administrativement; par la voie juridictionnelle, en ce sens que trs souvent ils donnent lieu des recours contentieux ports devant de vritables juges et constituant litige. Ce qu'il y a de remarquable, c'est que, suivant les cas, des tribunaux de deux ordres diflrents peuvent tre appels connatre de ces litiges, les tribunaux ordinaires ou judiciaires et les tribunaux administratifs. Les rgles de comptence, grce auxquelles le partage s'opre entre ces deux ordres de tribunaux, sont trs dlicates. Elles seront tudies plus tard dans la partie du contentieux. Rappelons seulement ici qu'elles se rattachent au principe constitutionnel de la sparation des pouvoirs, et qu'on les a crues ncessaires pour protger l'indpendance du pouvoir excutif contre le pouvoir judiciaire (V. p. 16). Un tribunal spcial appel tribunal des conflits, et dont nous tudierons aussi plus fard l'organisation, est charg d'assurer le respect de ces rgles de comptence en tranchant les conflits qu'elles font natre. L'organisation des tribunaux administratifs sera tudie au contentieux. Notons seulement ici l'extrme importance de l'un d'eux,
PUBLICET ADMINISTRATIF SOURCES DU DROIT
75
le conseil d'tat, qui domine tous les autres, soit parce qu'il reoit leurs appels, soit parce qu'il est pour eux tribunal de cassation. La jurisprudence du conseil d'tat, juge souverain du fait et du droit, qui plus est, en certains cas juge prtorien, a certainement plus de poids en matire administrative que celle de la cour de cassation en matire civile. Nous aurons frquemment la citer ct de la jurisprudence du tribunal des conflits et de celle de la cour de cassation. Les arrts du conseil d'tat et ceux du tribunal des conflits se trouvent, accompagns d'ailleurs des arrts de la cour des comptes, dans un recueil intitul Recueil des arrts du conseil d'tat fond en 1821 par M. Macarel, et continu depuis par M. Lebon et par M. Panhard. Les arrts antrieurs 1821 se trouvent en partie dans un recueil de quatre volumes in-4 publis en 1818 par Sirey. Les sources, les monuments, les moyens de sanction des rgles du droit public et administratif en Algrie et dans les colonies. 1 Les sources Les sources du droit, aussi bien du droit priv que du droit public, ne sont pas les mmes dans les possessions coloniales que dans la mtropole. Il faut distinguer, pour se rendre un compte exact de la situation, la rglementation locale faite sur place par des autorits locales, et les rgles gnrales qui viennent de France. A. Rglementation locale. Les gouverneurs des colonies ont un pouvoir rglementaire qu'ils exercent en conseil priv. Les actes contenant rglement prennent le nom d'arrts rglementaires. Dans les colonies o des communes sont organises, les maires ont aussi le pouvoir rglementaire. En Algrie) la situation est un peu moins nette que dans les colonies. L'Algrie est moiti rattache la France, et outre le gouverneur gnral, il y a des prfets de dpartement. Ces prfets font des rglements comme les prfets du continent. Le gouverneur gnral fait-il en outre des rglements comme les gouverneurs des colonies? Depuis les dcrets de rattachement du 26 aot 1881, il semblerait qu'il ne dt pas en faire; le rsultat apparent de ces dcrets est, en effet, de faire du gouverneur, non plus le dlgu du chef de l'tat, mais celui des ministres; or les ministres n'ont pas le pouvoir rglementaire. En fait cependant le gouverneur d'Algrie continue de faire des rglements, c'est--dire que les dcrets de rattachement ont employ des expressions impropres, et doivent tre interprts en ce sens que, pour les matires
76
SOURCES DU DROITPUBLICET ADMINISTRATIF
o il est dlgu, le gouverneur est le dlgu du chef de l'tat, non des ministres. B. Rgles gnrales qui viennent de France. La France n'a pas fait systmatiquement une lgislation coloniale diffrente de la sienne. Au contraire, sauf de rares exceptions, c'est sa propre lgislation qu'elle tend ses possessions. Seulement, et c'est l ce qu'il ya de particulier, en principe, les lois et rglements dclars excutoires pour la mtropole, ne le sont pas de plein droit pour les possessions coloniales. On se trouve en prsence de races trangres plus ou moins disposes s'adapter notre civilisation; les mesures lgislatives qui s'appliquent sans difficult dans notre pays habitu la rglementation, doivent tre prsentes dans ces pays plus neufs avec beaucoup de prcautions. Aussi les possessions coloniales sont-elles, en principe, sous ce que l'on appelle le rgime du dcret, c'est--dire que le pouvoir excutif demeure charg d'y introduire, au moment qu'il juge opportun, les rgles de la lgislation franaise qu'il lui est d'ailleurs loisible de modifier, et cela par la voie du rglement. Et remarquons, que quand mme une loi franaise serait ainsi introduite dans une colonie par la voie du dcret, ce qui arrive frquemment, elle n'aurait qu'une valeur rglementaire, et pourrait tre modifie par simple dcret. L'ensemble de la lgislation franaise se retrouve donc dans les colonies, mais les textes y sont pour ainsi dire dmarqus et ont tous l'apparence de rglements. Cela souffre cependant des exceptions, et bon nombre de lois s'appliquent comme lois. Il y a lieu de distinguer l'Algrie des colonies proprement dites. Algrie. Au premier abord, l'Algrie semble soumise au rgime pur du dcret (ordonnance du 22 juillet 1834, art. 4). Tout est rgl par dcret et tout peut l'tre. Une loi franaise, pour tre rendue applicable en Algrie, doit l'tre par dcret. Ce dcret peut la modifier. Cela est arriv chaque instant. Des dcrets peuvent intervenir sur des matires entirement nouvelles. De plus les dcrets,, mme faits pour l'Algrie, ne deviennent obligatoires que lorsqu'ils ont t promulgus en Algrie par le gouverneur, et insrs au Bulletin officiel des actes du gouvernement. Voil la situation apparente. Au moins elle serait nette. La ralit en est bien loin, et par suite des rgles qui suivent, des quantits de lois de la mre-patrie s'appliquent directement en Algrie, sans passer par l'intermdiaire d'un dcret, et mme, le plus souvent, sans promulgation spciale; sont dans ce cas: 1 la plupart des lois franaises antrieures 1834, date de la prise de possession dfinitive de l'Algrie (la jurisprudence fait un triage dans ces lois, on ne sait trop
DU DROITPUBLIC ET ADMINITRATIF SOURCES
77
; ce qui compourquoi) ; 2 les lois modificatrices de ces lois anciennes prend presque toutes les lois nouvelles, car c'est bien miracle aujourd'hui si une loi nouvelle ne modifie pas quelque loi ancienne. La jurisprudence rcente de la cour de cassation est cependant contraire ce systme (C. cass. 5 nov. 1884) ; 3 les lois dites d'intrt gnral, formule encore des plus lastiques; 4 les lois, dcrets, etc., relatifs aux services rattachs par le dcret du 26 aot 1881, art. 2 du dcret; 5 les lois faites spcialement pour l'Algrie. On voit que la matire est fort embrouille. Colonies. Le rgime lgislatif des colonies est fix par le snatusconsulte du 3 mai 1854, qui les a divises en deux groupes: Premier groupe (Martinique, Guadeloupe, Runion). Il y a des matires rgles par des lois (autrefois snatus-consultes et lois), des matires rgles par des rglements d'administration publique, des matires rgles par simple dcret. Les matires rgles par des lois sont numres dans l'art. 3 (numration limitative). C'est la garantie des droits les plus importants, droits politiques, tat civil, distinction des biens et proprit, rgime des contrats, institution du jury, lgislation criminelle, etc. Les matires rgles par rglement d'administration publique sont numres dans l'art. 6, numration galement limitative. Deuxime groupe (Toutes les autres colonies). Elles sont soumises au rgime du dcret simple, art. 18, dcret de 1854. Cependant il y a certaines lois qu'on a formellement dclares applicables aux colonies : L. 9 aot 1849, tat de sige; L. 7 mai 1881, obligeant rgler en conseil d'tat le rgime douanier ; L. 29 juillet 1881 sur la presse; L. 27 mai 1885 sur les rcidivistes; L. 15 juillet 1889 sur le recrutement, titre IV, etc. Les rgles ainsi tablies une fois par des lois ne peuvent tre modifies que par des lois. Les lois et dcrets venant de la mtropole ne sont pas excutoires de plein droit l'arrive du Journal officiel dans la colonie, il faut une promulgation spciale faite par le gouverneur. Celui-ci n'est mme pas tenu de la faire dans un certain dlai, il n'est responsable que devant le ministre. Ce sont des arrts des gouverneurs qui fixent les formalits de la publication et les dlais aprs lesquels la loi est obligatoire. 2 Les monuments du droit et les moyens de sanction Il existe en Algrie et dans chaque colonie un Bulletin officiel des actes du gouvernement ou bien un Journal officiel (dc. 15 jan-
78
ET ADMINISTRATIF DU DROITPUBLIC SOURCES
vier 1853), o sont insrs tous les textes promulgus dans la possession coloniale par le gouverneur, soit qu'ils viennent de la mtropole, soit que ce soient les arrts du gouverneur lui-mme. Enfin il existe en Algrie et dans les colonies des tribunaux judiciaire et des tribunaux administratifs chargs de veiller l'application des lois. Les tribunaux judiciaires relvent de la cour de cassation.. les tribunaux administratifs, qui portent le nom de conseils du contentieux, relvent du conseil d'tat.
PREMIRE
PARTIE
LE
DROIT
PUBLIC
LIVRE
PREMIER
JOUISSANCE ET GARANTIE DES DROITS PUBLICS
CHAPITRE JOUISSANCE
PREMIER PUBLICS
DES DROITS
DES DROITS GNRAUX PUBLICS 1er. CARACTRES 1. Les droits publics sont les droits reconnus l'individu vis--vis de l'tat et garantis par l'ensemble de la Constitution. Leur nombre et leur qualit varient avec l'tat social. Nous n'avons nous occuper ici que de la lgislation franaise actuelle. Le nom des droits publics leur a t donn dans la charte de 1814, ils l'ont gard depuis; quant leur liste, on la trouve dans la clbre Dclaration des droits de l'homme des 3-14 septembre 1791. On peut dire que ce texte est encore en vigueur ; en effet, la constitution du 25 fvrier 1875 ne parle pas des droits publics; comme elle n'a certainement pas eu l'intention de les supprimer, il faut admettre qu'elle s'en rfre ici la constitution prcdente, celle du 14 janvier 1852, qui elle, dans son art. 1er, contient un renvoi formel la Dclaration de 1791. Nous donnerons plus tard la liste complte des droits publics, pour le moment, remarquons qu'on peut les diviser en trois groupes: 1 Le groupe des droits politiques ou civiques, qui donnent au ci-
80
LE DROITPUBLIC
toyen le droit de participer la constitution et au fonctionnement de l'tat lui-mme ; le principal de ces droits est le droit de suffrage; 2 Le groupe des liberts, qui donnent l'individu le droit d'exercer librement en tout sens sa propre activit, libert de conscience, libert du travail, libert de la proprit, etc.; 3 Le groupe des droits aux services de l'tat ou bien aux bnfices de la loi, dont les plus intressants par les questions qu'ils soulvent sont les droits l'assistance. 2. Harmonie entre les droits reconnus et publics tat social. Cette trinit de groupes de droits publics notre est en parfaite concordance logique avec notre dmocratie, la fois individualiste et tatiste. L'individu est souverain, par consquent il a des droits politiques, manifestation de sa souverainet; nous avons quantit d'institutions individualistes, l'individu a des liberts; mais nous avons aussi des institutions tatistes, il en rsulte que l'individu a de nombreux droits aux services de l'tat. Il est intressant de constater qu'il ya concordance aussi avec la clbre formule : libert, galit, fraternit, en qui se trouve pour ainsi dire rsum tout notre tat social. Sous le vocable de libert, il faut comprendre la fois les droits politiques, qui sont si l'on veut des liberts politiques, et les liberts individuelles; sous le vocable de fraternit, il faut comprendre les droits aux services de l'tat, car l'ide de fraternit, qui, en morale, se rapproche de l'ide de charit, sur le terrain du droit, se ramne simplement celle de service rendu l'individu par la collectivit. Reste le mot d'galit, sous lequel se cache une ide dont nous n'avons pas parl encore, mais qui se combine merveilleusement avec les deux autres, et qui est peut-tre le facteur his; cette ide, c'est que torique le plus efficace de leur ralisation Tous les hommes sont gaux devant la loi. (Art. 1er et art. 6, Dclaration des droits de l'homme.) En proclamant les hommes gaux devant la loi, le droit, la suite d'ailleurs des religions, a oppos la nature une contradiction hardie, car au point de vue de la nature, les hommes sont parfaitement ingaux, soit en force physique, soit en force intellectuelle, soit en valeur morale; mais on peut dire que cette ide audacieuse, qui depuis des sicles agit obstinment, a fait nos socits modernes. Elle se combine avec l'ide de libert, au point d'en paratre insparable, car, en effet, il n'y a point de degrs dans l'essence de la libert. Si tous les hommes sont libres, c'est qu'ils ont la mme libert, c'est qu'ils sont gaux; il n'y a d'ingalit que dans la servitude. L'ide de libert entraine donc l'ide d'galit, et l'inverse,
DES DROITSPUBLICS JOUISSANCE
81
historiquement, combien de liberts la passion de l'galit n'a-t-elle ? Tels ou tels individus dans la socit ont la libert pas fait conqurir de penser, d'crire, de travailler, de possder, pourquoi tous ne l'auraient-il pas? L'ide d'galit ne se combine pas moins bien avec celle de fraternit; d'une part, il est naturel que si l'tat rend des services, il les rende galement tous, c'est une grande simplification ; l'ide de fraternit conduit donc l'galit; d'autre part et surtout l'ide d'galit conduit la fraternit. Si tous les hommes sont gaux devant la loi, il faut que cette galit soit relle, sincre, et non point de pure apparence. Or, il faut bien le dire, dans notre tat social, les liberts sont galement offertes tous, mais leur usage rel n'est pas facilit tous. Le droit de proprit, par exemple, est offert tout le monde, il n'est pas ais de devenir propritaire. Pour la conqute de l'usage rel de beaucoup de liberts, il faut un effort et une lutte. Or, il y a bien des individus qui, par suite de maladie ou de misre, sont incapables de donner l'effort ncessaire. Il faut leur faciliter l'accs et l'usage des liberts, soit par une meilleure organisation sociale qui diminue l'pret de la lutte, soit par une assistance directe. L est le vrai sens de la fraternit. vritables. 3. Les droits sont des droits publics Les droits publics sont des droits vritables, bien qu'ils ne soient pas toujours sanctionns par une action; ils s'opposent naturellement tout ce qui est concession, permission, faveur de l'tat, l'une des notions est exclusive de l'autre. Tandis que les concessions, les permissions, les faveurs sont ingalement rparties, et peuventtre retires par l'tat aprs avoir t accordes, le droit public est au contraire reconnu tous et perptuit. Par suite, en matire de liberts, il ne faut point confondre le rgime de la permission administrative avec celui du droit. Ainsi, en matire de presse, avant les lois qui donnrent la libert, il y avait des journaux fonds, ils l'taient par permission administrative. La suppression de la ncessit de demander l'autorisation administrative pour faire un acte, est le signe que la libert existe, peu importe qu'elle soit troitement rglemente. Par suite encore, il faut bien se garder de confondre le droit politique avec la fonction publique, parce que la fonction publique est une concession de l'tat. Il ya ceci de commun dans les deux cas, c'est qu'un pouvoir est exerc dans l'tat par un individu, mais dans le cas de droit politique, l'individu exerce un pouvoir lui propre, dans le cas de fonction publique, un pouvoir lui dlgu par l'tat. Il peut y avoir hsitation en prH. 6
82
LE DROIT PUBLIC
sence-d'un pouvoir particulier, par exemple celui d'tre tmoin dans les actes ou celui d'tre jur, on peut ne pas savoir s'il faut le ranger dans la catgorie des droits politiques ou bien dans celle des fonctions publiques, mais la distinction des catgories est certaine. Les droits publics sont d'ailleurs opposables, non seulement l'tat, mais aussi aux particuliers, ils ont quelque chose d'absolu comme les droits rels. C'est ce titre que notre vie, notre libert, nos biens sont protgs dans le code pnal contre les crimes et dlits des particuliers. C'est ce titre encore, que l'esclave qui touche la terre de France et qui devient libre par le fait, peut invoquer sa libert contre son ancien matre. 4. Rapports des droits publics avec les droits privs. Les droits que les individus ont vis--vis de l'tat, et les droits qu'ils ont les uns vis--vis des autres, ne peuvent pas tre sans relation entre eux. Quand on essaie de prciser cette relation, on aperoit trs vite une grosse diffrence entre les deux catgories de droits, c'est que les droits privs sont dans le commerce et que les autres n'y sont pas. Il n'est certes pas permis de vendre son corps ni de vendre sa libert de conscience. Mais d'autre part, en rflchissant davantage, on aperoit quelque chose de tout aussi vrai et de bien surprenant, c'est que les droits privs ne sont pas autre chose que des droits qui rsultent de la mise dans le commerce d'une partie des droits publics. Les droits publics que les hommes ont conquis vis--vis de l'Etat, ils les mettent dans le commerce entre eux. Ils ont conquis la proprit, ils la mettent dans le commerce; ils ont conquis la libre activit, ils n'ont rien de plus press que de l'enchaner par des contrats de louage de services ou autres. Donc, premire constatation : L'existence des droits privs suppose rexistence des droits publics; Deuxime constatation : Les droits publics sont en partie hors du commerce, en partie dans le commerce, pour permettre l'dification des droits privs. La limite est mobile, elle est dtermine par ce que l'on appelle l'onze public1. avec les devoirs. des droits publics 5. Rapports 1 L'inobservation de certaines rgles morales fondamentales entrane privation de la jouissance ou de l'exercice de tout ou partie des droits publics. On peut dire ce point de vue que le droit est tout entier 1. L'ordre public, en ce sens, serait donc la limite l'action des transactions d'intrt priv, en tant qu'ellescompromettraientles droits-publics des la socitelle-mme. individus. Le tout, dans l'intrt de
DES DROITSPUBLICS JOUISSANCE
83
fond sur la morale, puisque la jouissance des droits suppose un minimum de moralit. Les peuples primitifs mettent hors la loi, c'est-dire hors du droit, les hommes qui ont commis certains crimes. Il n'y a pas encore un demi-sicle, dans notre lgislation, la mort civile venait enlever peu prs tous les droits du condamn qui avait encouru une peine capitale; nous avons nombre de peines dans notre code pnal actuel qui sont privatives de droits: privation du droit de disposer et recevoir titre gratuit, dgradation civique, interdiction civique. Enfin la peine de l'emprisonnement tous ses degrs prive de l'exercice d'un droit public, la libert d'aller et de venir. 2 Il ya des devoirs corrlatifs aux droits publics. Il y a des droits publics qui sont, en eux-mmes et par une certaine face, des devoirs. C'est ainsi que c'est la fois un droit et un devoird'tre soldat, d'tre jur, d'tre tmoin, et ici mme, le devoir moral est fortifi d'une obligation morale. Le droit de suffrage implique le devoir de voter, et l'abstention pourrait bien tre un jour punie d'une amende. La libert du travail implique le devoir de travailler, puisque le vagabondage est un dlit puni, etc. De plus, ce fait que nos droits publics pris dans leur ensemble sont garantis par la socit, entrane le devoir moral de contribuer sincrement chacun dans la mesure de nos forces aux charges sociales. Par suite, c'est un devoir moral de payer l'impt, et cela apparat nettement dans les lgislations o l'impt est assis sur une dclaration de revenus faite par le contribuable luimme. ET EXERCICE DESDROITSPUBLICS 2. JOUISSANCE On sait qu'il faut distinguer la jouissance et l'exercice d'un droit. Avoir la jouissance d'un droit, c'est avoir le droit lui-mme avoir ; l'exercice c'est avoir la possibilit juridique de l'exercer actuellement. On peut avoir la jouissance sans avoir l'exercice, on ne peut avoir l'exercice sans la jouissance. C'est ici que do6. Jouissance des droits publics. mine surtout l'ide d'galit; elle apparat comme constituant un vritable droit part appel l'galit civile, et figure dans la Dclaration des droits de l'homme sous plusieurs formes : la suppression des ordres, rangs, titres honorifiques, l'gale admission aux places et aux emplois, l'galit devant l'impt, l'galit de peine galit de dlit. L'esprit de la constitution est donc que la jouissance des droits publics soit galement tous, et non seulement tous les nationaux, mais mme aux trangers, car les droits proclams sont les droits de
84
LE DROITPUBLIC
l'homme sans acception de nationalit; aussi interprtons-nous le clbre article 11 du code civil en ce sens que les trangers doivent jouir de tous les droits qui ne leur sont pas expressment retirs. Cependant, il y a les droits de ce que la loi appelle le citoyen et qui ne sont accords qu' celui-l. Passons en revue les trois groupes de droits publics que nous connaissons. a) Droits politiques ou civiques. Ces droits, pour des raisons constitutionnelles ou de scurit nationale, sont de ceux qui n'appartiennent qu'au citoyen. Le citoyen est le sujet mle, franais par la race, le bnfice de la loi sur la nationalit ou la naturalisation1. Cela exclut : les trangers, les femmes franaises, les sujets franais qui ne sont pas de race franaise et ne sont pas naturaliss (indignes de certaines colonies et d'Algrie). Ainsi l'tranger, mme admis tablir son domicile en France, n'a pas le droit de suffrage, il n'est ni lecteur ni ligible ; il n'a pas l'aptitude aux fonctions publiques. Il n'est pas admis au service militaire, si ce n'est dans la lgion trangre. Quant aux sujets franais qui ne sont pas de race franaise et qui ne sont pas naturaliss franais, il faut distinguer entre ceux de l'Algrie et ceux des colonies. Algrie. Il n'y a plus lieu de s'occuper que des indignes musulmans, les indignes isralites ayant t naturaliss en masse par le dcret du 24 octobre 1870. Les indignes musulmans sont sujets franais, mais non de 1865, par consquent citoyens franais, aux termes du snatus-consulte ils n'ont pas en principe la jouissance des droits politiques. Cependant, il y a des exceptions : 1 l'indigne musulman peut servir dans les armes de terre et de mer (Sn-cons. 1865, art. 1er, 2, art. 2, 2); 2 il est admissible certains emplois civils en Algrie (Sn-cons. 1865, mmes articles); la nomenclature des emplois se trouve dans un tableau annex au dcret du 21 avril 1864; 3 il est lecteur et ligible aux fonctions municipales dans les communes de plein exercice, sous certaines conditions (D. 7 avril 1884). Colonies. Il n'y a point d'indignes dans toutes les colonies ; il faut noter, en effet, que les noirs affranchis en 1848 aux Antilles, la Runion et ailleurs sont devenus citoyens franais. En Ocanie (Tahiti), les indignes de l'ancien protectorat sont galement devenus citoyens. Il n'y a d'indignes que dans les colonies de conqute o la population qui avait la possession antrieure n'a pas compltement disparu : Inde, Cochinchine Nouvelle-Caldonie. Dans toutes ces colonies, l'exception de l'Inde, les indignes ne sont 1. Encore la naturalisation ne confre-t-ellel'ligibilit aux assembleslgislatives que dix ans aprs le dcret de naturalisation en principe (art. 3, L. 26juin1889).
JOUISSANCE DES DROITSPUBLICS
85
pas citoyens franais. Dans nos possessions de l'Inde, ils sont considrs comme citoyens; ils jouissent donc de plein droit des droits politiques; ils sont seulement, pour l'exercice du droit de vote, soumis des conditions particulires, inscrits sur des listes lectorales spciales, selon qu'ils sont renonants leur statut personnel ou bien non renonants. En principe, tous les tres humains b) Liberts individuelles. ont la jouissance des liberts, par consquent, les femmes aussi bien que les hommes, les trangers aussi bien que les nationaux, et sans distinguer selon qu'ils sont ou non admis tablir leur domicile en France. Il peut se faire, tout au plus, que l'exercice du droit soit rglement plus svrement pour l'tranger que pour le national; nous verrons au furet mesure ces questions de rglementation. Ainsi, l'tranger a la libert individuelle, avec cette restriction particulire qu'il peut tre expuls par mesure administrative. Il a la libert de conscience, le droit de publier sa pense par la presse ou par le livre, le droit de runion, d'association, etc. L'tranger n'a cependant ni le droit d'tre grant d'un journal (L. 29 juillet 1881, art. 7), ni le droit d'enseigner aucun degr, il peut seulement tre autoris par l'administration le faire (L. 15 mars 1850, art. 78, D. 5 dc. 1850; L. 12 juill. 1875, art. 9 sur l'enseignement suprieur; L. 30 oct. 1886, art. 4 sur l'enseignement primaire). Quant aux sujets franais qui ne sont pas citoyens, indignes de l'Algrie ou des colonies, ils ont eux aussi, en principe, la jouissance des liberts; seulement il faut tenir compte d'un certain nombre de faits : l'existence d'une sorte d'tat de sige dans les territoires militaires (Algrie), l'existence de la rpression administrative pour ce que l'on appelle les dlits d'indignat (Algrie, communes mixtes, et Cochinchine), qui diminuent leur sret personnelle ; enfin, le maintien de leur lgislation religieuse et prive (statut personnel) qui peut modifier la physionomie de leurs droits. c) Droits aux services de l'tat. Ces droits sont encore en principe de ceux qui appartiennent tous les hommes ; l'tat doit indiffremment ses services tous ceux qui se trouvent sur son territoire, mme accidentellement; il est naturel que dans tous les pays civiliss, un homme, quel qu'il soit, se sente protg par l'tat par consquent en principe ils appartiennent aux trangers. La question peut se poser pour toutes les formes d'assistance; il n'y a pas de doute dans deux cas, lorsqu'il y a trait diplomatique ou lorsque l'tranger est en tat d'autorisation de domicile (art. 13, C. civ.); il y en a hors de ces deux cas, mais il faut accorder le bnfice moins qu'il n'y ait un texte formel contraire. La ques-
86
LE DROITPUBLIC
tion s'est pose pour l'assistance judiciaire, bnfice introduit par la loi du 22 janvier 1851. Le bureau d'assistance de Paris se prononait en faveur de l'extension du bnfice aux trangers ds le 18 octobre 1855 (J. des Avous, t. LXXXI, p. 345), et depuis, nombre de dcisions judiciaires supposent qu'il a t en effet tendu. Observation. La jouissance des droits publics se perd, soit par suite de la perte de la qualit de Franais pour ceux o cette qualit est ncessaire, soit par suite de certaines condamnations pnales. L'exercice des droits. 7. Exercice des droits publics. publics peut rencontrer deux espces d'obstacles, des conditions remplir que l'on appelle conditions d'exercice, des incapacits qui suppriment compltement l'exercice. a) Conditions d'exercice. Beaucoup de droits publics sont soumis des conditions d'exercice, des formalits. C'est ainsi que le droit d'enseigner ne peut s'exercer qu'aprs certaine dclaration, de mme le droit de runion, le droit de fonder un journal, etc. Le droit de suffrage est soumis la rglementation de la liste lectorale, etc. b) Incapacits. Les incapacits rsultent de certains faits gnraux de nature affecter la personnalit intellectuelle ou morale del'individu: telles sont la minorit, l'interdiction, la demi-interdiction, certaines fonctions. Le rle des incapacits est trs important en matire de droit politique, surtout en matire de suffrage; il l'est beaucoup moins en matire de liberts. Beaucoup sont tellement primordiales, tellement indispensables, qu'il faut les accorder au mineur, l'interdit. Ainsi on ne peut songer refuser ces incapables l'exercice de libert de la conscience, de la sret personnelle, ce serait en mme temps leur en retirer la jouissance. Ce qu'on dira avec justeraison, c'est que si ces droits sont viols, l'action qui natra ne sera pas exerce par l'incapable, mais par son reprsentant lgal. Cependant il y a quelques droits dont l'exercice se comprend spar de la jouissance, le droit d'enseigner, le droit de grer un journal; pour ces deux droits, la minorit est une cause d'incapacit et sans doute aussi l'interdiction; le droit au travail pour le travail industriel, la loi du 19 mai 1874 vise des minorits de dix ans, douze ans, seize ans, selon certaines catgories.
CHAPITRE
II
GARANTIES DES DROITS PUBLICS
DES GARANTIES 1er. EXAMEN 8. Les droits publics des citoyens tant conquis sur l'arbitraire de l'tat, sont constamment menacs de retours offensifs. Les droits politiques et les liberts individuelles sont exposs tre viols par des actes positifs de l'administration. Les droits aux services de l'tat sont exposs l'tre par des refus de service, des ngligences ou des fautes dommageables dans l'accomplissement des services. Il fallait des garanties. Les garanties des droits publics sont de plusieurs sortes; il en est qui sont offertes par l'tat lui-mme, il en est d'autres qui sont la disposition de l'individu dont les droits ont t lss, mais qui demandent de sa part un effort. Les garanties que l'tat offre de lui-mme sont de deux espces : 1 Celles qui rsultent de la Constitution. Nous savons que le droit constitutionnel est tout entier un droit de garantie. Le principe dela sparation des trois pouvoirs, ainsi que nous l'avons dj fait remarquer, est une prcieuse garantie de libert individuelle, car il introduit la dlibration et par consquent une cause de ralenlissement, dans l'action gouvernementale. Il en est de mme du principe de la sparation du pouvoir militaire et du pouvoir civil, et de la subordination du premier au second en temps de paix ; enfin le droit de ptition ou de rclamation est largement reconnu tous. 2 Celles qui rsultent de l'organisation administrative et des prcautions qui y sont prises; les formes de procdure auxquelles est soumise l'action administrative; la surveillance que l'administration exerce sur elle-mme, grce au principe de l'autorit hirarchique; les poursuites que l'tat exerce contre les fonctionnaires prvaricateurs. C'est ainsi que les art. 114 117, 119,120, 122 duCode pnal punissent les actes attentatoires la libert individuelle ou aux droits civiques, commis par un fonctionnaire public, un agent ou un prpos du gouvernement ; que l'art. 174 punit le dlit de concussion, c'est--dire le fait de percevoir au del de ce qui est d par une taxe
88
LE DROITPUBLIC
(l'article final de la loi du budget rappelle tous les ans cette disposition, ainsi que l'existence d'une action civile en restitution qui dure trois ans) ; que les art. 177 et suivants punissent la corruption des fonctionnaires, l'art. 184 la violation de domicile, l'art. 185 le dni de justice des juges, l'art. 186 la violence contre les personnes. Toutes ces garanties offertes par l'tat lui-mme sont videmment prcieuses, mais elles ont surtout un effet prventif. Elles empchent une foule de violations du droit de se produire, mais lorsqu'en fait une violation s'est produite, elles sont d'un mdiocre secours. Sans doute, si le pouvoir excutif commet des actes abusifs, le pouvoir lgislatif peut employer des moyens constitutionnels pour intervenir, le parlement peut mettre en jeu la responsabilit ministrielle, mais c'est un bien gros mcanisme, il faut des circonstances politiques bien favorables ou unfait d'un arbitraire bien criant. Sansdoute aussi, le fonctionnaire coupable peut tre poursuivi au criminel, mais d'abord il peut se faire que l'acte qu'il a commis, tout en tant vexatoire, ne soit pas prvu par la loi pnale ; puis, il faut bien reconnaitre que le gouvernement y regarde plus d'une fois avant d'intenter une action publique contre un de ses propres agents. Pour toutes ces raisons, il est indispensable que l'individu ait luimme sa disposition des moyens de se protger. Ces moyens existent et constituent un prcieux ensemble de garanties individuelles. Ce sont des actions en justice. Il y en a de trois sortes, l'abus de pouvoir est saisi par elle de trois faons: 1" Dans l'acte administratif lui-mme, au moyen des recours contentieux; 2 Dans la personne des fonctionnaires, au moyen des poursuites diriges contre ceux-ci; 3 Dans la personne de l'tat ou des autres personnes administratives, au moyen d'actions en responsabilit directe. Nous allons passer en revue. administral'acte contentieux contre 9. Recours tif. Ces recours sont au nombre de deux, recours contentieux ordinaire, recours pour excs de pouvoirs; ils n'existent que contre les actes administratifs proprement dits, c'est--dire contre les dcisions excutoires prises au nom des personnes administratives en vue de produire un effet de droit ; ils sont enferms dans des dlais trs brefs, le recours pour excs de pouvoirs est, de plus, soumis des conditions de recevabilit trs troites. Il rsulte de tout cela que l'on n'a pas toujours la ressource de ces recours. L'acte dont on se plaint n'est peut-tre pas un acte d'administration, c'est--dire un acte juri-
GARANTIES DES DROITSPUBLICS
89
dique, c'est peut-tre un fait purement matriel, ou bien les dlais sont passs, ou bien l'on ne se trouve pas dans les conditions de recevabilit. Enfin, les recours contentieux, alors mme qu'ils russissent, n'aboutissent qu' l'annulation ou la rformation de l'acte, ils n'entranent jamais de condamnation dommages-intrts contre le fonctionnaire, ni d'ordinaire contre la personne administrative. Or, il est des cas o le prjudice caus par un acte administratif ne peut pas tre ; dans ce cas, le rerpar par l'annulation de l'acte, il est consomm cours ne donnerait qu'une satisfaction illusoire. Ga10. Poursuites contre les fonctionnaires. rantie administrative des fonctionnaires. La poursuite contre le fonctionnaire qui a commis un acte vexatoire est un mouvement naturel chez celui qui est ou se croit victime de l'acte ; tellement naturel, que les gouvernements ont toujours pris certaines prcautions pour protger leurs agents contre des poursuites engages ab irato; ces prcautions appeles garantie administrative sont lgitimes, condition de n'tre pas exagres et de ne pas aboutir la suppression des poursuites; la meilleure serait peut-tre de rendre par des moyens de procdure l'action periculosa1. Quoi qu'il en soit, il faut examiner la lgislation positive. Elle se rsume en ceci : certains fonctionnaires sont protgs en ce sens qu'ils ne sont responsables que de leur faute lourde et que c'est un tribunal gouvernemental, le tribunal des conflits, qui examine la question de savoir s'il y a eu faute lourde. La poursuite s'engage librement devant le tribunal ordinaire, mais elle peut tre arrte par un arrt de conflit du prfet dont le rsultat est de saisir le tribunal des conflits de la question de savoir s'il ya eu faute lourde. 1 Des fonctionnaires qui sont protgs. Le terme que l'on trouve dans les lois sur la matire est celui de agent du gouvernement (Dclaration desdroits, 3-14 septembre 1791, art. 15; Constitution de l'an VIII, art. 75). Est agent du gouvernement tout homme dpositaire d'une parcelle de la puissance publique, si petite soit-elle (Cass. 3 mai 1838). Il s'agit seulement de cette espce de puissance publique qui procde du pouvoir excutif, oppos aux deux autres pouvoirs, lgislatif et judiciaire; seulement il faut faire attention qu'il y a un pouvoir excutif, dans la commune et dans le dpartement, tout comme dans l'tat. Par consquent, rentrent dans la dfinition titre d'agents du 1. Le dcret du 19 septembre 1870avait indiqu cette voie.
90
LE DROITPUBLIC
pouvoir excutif, toutes les autorits administratives et tous les fonctionnaires qui exercent la puissance publique de l'tat, quels qu'ils soient; l'extrieur, ministres plnipotentiaires, agents diplomatiques, consuls; l'intrieur, prfets, sous-prfets, conseillers d'tat, conseillers de prfecture, commissaires de police, agents des rgies financires, etc. ; le maire de la commune, en tant que ses pouvoirs lui sont dlgus par le chef de l'tat. Il y a question pour les ministres du culte ; nous ne les ferions pas rentrer parmi les agents du gouvernement, parce qu'ils ne reoivent pas leur pouvoir du chef de l'tat, mais de leur glise. Il est remarquer que dans cette liste ne figurent, ni le chef de l'tat lui-mme, ni les ministres. Le chef de l'tat est irresponsable, sauf en cas de haute trahison ; les ministres ont t mis en dehors de la lgislation spciale la matire par l'art. 75 de la constitution de l'an VIII, mais, cet article ayant t abrog, ils doivent tre rintgrs. Rentrent encore dans la dfinition, le maire comme chef de la commune et les agents sous ses ordres. A l'inverse, les membres des assembles lectives, comme les chambres, les conseils gnraux, les conseils municipaux, qui reprsentent tous les degrs le pouvoir dlibrant, ne sont pas considrs ; 8 novembre comme agents du gouvernement (Cons. d't. 7 juin 1851 1854 : 6 mai 1863). Pour les membres du Parlement, ce que l'on appelle l'immunit parlementaire correspond en partie la garantie administrative. Quant aux reprsentants du pouvoir judiciaire, magistrats des cours et tribunaux, officiers de police judiciaire, il y a pour eux une lgislation spciale, celle de la prise partie, art. 505 du code de procdure civile, ou bien celle de l'art. 483 du code d'instruction criminelle, en cas de crime ou dlit. 2 Nature de la responsabilit des fonctionnaires. Le fonctionnaire qui dans l'exercice de sa fonction ou l'occasion de sa fonction, cause un tort autrui, est dans la mme situation qu'un particulier qui cause un tort, c'est--dire dans la situation de l'art. 1382 du code civil. Ce principe est accept, et en dehors de lui il n'y aurait point de justice. Seulement, la responsabilit de l'art. 1382 suppose qu'une faute dlictuelle ou quasi-dlictuelle a t commise, et c'est dans l'apprciation de cette faute que rside toute la difficult quand il s'agit du fonctionnaire. La difficult n'apparat pas quand il a commis une faute dlictuelle, quand il ya dlit prvu et puni ; mais seulement quand il y a faute quasi-dlictuelle. Dans ce cas, doit-on rendre le fonctionnaire responsable de la faute la plus lgre, comme on le ferait pour un particulier, ou doit-on ne le rendre responsable que
GARANTIES DES DROITSPUBLICS
91
de sa faute lourde? Ne faut-il pas laisser l'administrateur une certaine tolrance d'erreur ? D'aprs la jurisprudence du tribunal des conflits qui, pour des motifs que nous expliquerons plus loin, est souveraine en la question, il faudrait en effet distinguer entre une faute administrative qui ne pourrait entraner que des mesures disciplinaires, et une faute personnelle qui seule entranerait responsabilit. (Dcision du 25 dcembre 1877) : que l'illgalit ou excs de pouvoir n'aurait pas pour effet ncessaire de faire degnrer la faute ou l'erreur qui aurait t commise en une faute personnelle, de laquelle seule peut rsulter la responsabilit civile. Le tribunal des conflits estime que lorsqu'il y a faute lourde l'acte que fait le fonctionnaire n'est plus un acte administratif, le fonctionnaire fait l'acte sien dans le sens o l'on disait Rome du juge prvaricateur, litem suam fecit, c'est pourquoi la responsabilit est encourue. Cela suppose au fond que tant que l'acte reste administratif, malgr certains abus de pouvoir, il n'y a pas responsabilit pour le fonctionnaire Ce n'est donc qu'une faute trs lourde qui entrane responsabilit. Soit une ngligence : facteur qui donne une fausse direction une lettre, tlgraphiste qui transmet mal une dpche, sous-prfet qui rend nulles des oprations de tirage au sort en ngligeant une formalit, ingnieur des ponts et chausses qui par imprvoyance btit un pont qui s'croule, etc. Soit un abus de pouvoir: maire qui expulse lui-mme de la salle des sances un conseiller municipal qui avait manqu plusieurs convocations, au lieu de le faire dclarer dmissionnaire dans les formes (4 dcembre 1883), etc. On peut se demander en terminant si les agents d'ordre infrieur qui ne font qu'xcuter les ordres de leur suprieur, sont couverts au point de vue de la responsabilit. C'est la question de l'obissance passive. Les art. 114 et 190 du code pnal couvrent les agents infrieurs et punissent les chefs hirarchiques, mais il y a tendance restreindre ces articles, et notamment ne pas les appliquera la poursuite en dommages-intrts. (V. arrt trib. conflits, 15 fvrier 1890). 3 Formalits de la poursuite. Il ne suffit pas que la responsabilit du fonctionnaire soit reconnue en principe, il faut qu'elle puisse tre poursuivie devant les tribunaux. La lgislation actuelle sur ce point se rduit ces deux rgles: la poursuite peut librement tre intente; elle peut tre arrte par un arrt de conflit du prfet. a) La poursuite peut tre intente librement. Cette poursuite 1. Nousverrous plus loin un correctif; quand la faute est lgre, si l'on ne peut plus poursuivre le fonctionnaire, en revanche, on peut poursuivre l'tat en responsabilit civile.
92
LE DROITPUBLIC
sera, soit l'action civile en dommages-intrts, soit la poursuite au correctionnel en vertu du droit de citation directe qui appartient aux parties (art. 182 du code d'instruction criminelle). Ces actions peuvent tre de plano introduites devant le tribunal. Il n'ena pas toujours t ainsi; en mme temps que l'assemble constituante posait le principe que les fonctionnaires taient responsables, elle en posait un autre antagoniste, c'est que les tribunaux judiciaires ne pourraient tre saisis qu'aprs une autorisation de poursuivre donne par le gouvernement. Ce principe fut dfinitivement formul dans l'art. 75 de la constitution de l'an VIII, et il porta depuis le nom de garantie constitutionnelle. Les agents du gouvernement autres que les ministres ne peuvent tre poursuivis pour des faits relatifs leurs fonctions, qu'en vertu d'une dcision du conseil d'tat ; en ce cas, la poursuite a lieu devant les tribunaux ordinaires. On s'tait souvent lev contre cette ncessit de l'autorisation pralable, qui rendait le droit de poursuite illusoire parce que le conseil d'tat n'accordait que rarement l'autorisation. Un des premiers actes du gouvernement de la Dfense nationale fut d'abolir l'art. 75 (D. du 19 septembre 1870). Les auteurs du dcret de 1870 s'taient probablement flatts que dsormais les citoyens pourraient, sans entraves, poursuivre les fonctionnaires publics ; ils comptaient sans un artifice de procdure qui allait servir dresser un nouvel obstacle. b) La poursuite engage peuttre arrte par unarrt de conflit. L'examen de la cause va forcment amener le tribunal devant qui la poursuite est engage, apprcier des actes administratifs, pour savoir justement s'il y a eu faute l'occasion de ces actes. Mais ce tribunal est de l'ordre judiciaire, et il est de principe, en vertu de la sparation des pouvoirs, que les tribunaux de cet ordre ne doivent en aucun cas connatre des actes administratifs. Question embarrassante. Le dcret de 1870 avait-il eu l'intention de droger sur ce point au principe de la sparation des pouvoirs? entrainait-il attribution de comptence ? Il y eut d'abord hsitation. La cour de cassation se pronona pour la comptence des tribunaux judiciaires, mme quand il y avait apprcier des actes administratifs (Cass. 3 juin 1872) Le conseil d'tat faisant fonction de tribunal des conflits sembla aussi se rallier ce systme (Arr. 7 mai 1871) ; mais lorsque le tribunal des conflits fut rorganis la suite de la loi du 23 mai 1872, il se pronona immdiatement en sens oppos, et dclara que le principe de la sparation des pouvoirs n'avait point reu d'atteinte du dcret de1870, que par consquent le tribunal judiciaire devait tre
DES DROITSPUBLICS GARANTIES
93
dessaisi lorsqu'il y avait dans l'affaire un vritable acte administratif (Dc. 30 juillet 1873). Et, ds lors, il suffit que le prfet prtende que l'acte accompli par l'agent ne renferme pas une faute personnelle, mais est un acte administratif ordinaire renfermant tout au plus une faute administrative, pour qu'il puisse prendre un arrt de conflit. L'affaire est alors porte devant le tribunal des conflits qui dcide souverainement. Si l'acte administratif n'a pas t dnatur par une faute personnelle, le conflit est valid, le tribunal est dessaisi et il ne reste plus d'autre ressource que de poursuivre directement l'tat en responsabilit, si cela est possible. contre les personnes directes ad11. Poursuites Responsabilit civile de l'tat et ministratives. Les personnes administratives, notamment des communes. l'tat et les communes, peuvent tre poursuivies directement en responsabilit dans trois cas: 1 Lorsqu'un agent dans l'accomplissement d'un service a commis une faute prcise; 2 Lorsque sans faute prcise d'un agent dtermin, et par suite de la mauvaiseorganisation d'un service, un fait dommageable est survenu. Dans ces deux hypothses, d'aprs l'esprit de la lgislation actuelle, la nature de la responsabilit est la mme. C'est la responsabilit du commettant pour ses prposs, rsultant, soit du texte mme de l'art. 1384 du code civil, soit tout au moins du principe de justice sur lequel est fond cet article. Par consquent, c'est une responsabilit quasi-dlictuelle. Dans la premire hypothse, celle de la faute prcise commise par un agent dtermin, cette qualification est naturelle, Elle l'est moins dans la seconde lorsqu'il y a seulement mauvaise organisation gnrale d'un service. Pour trouver matire appliquer la responsabilit du commettant, il faut de toute ncessit qu'il y ait un prpos en faute ; or, ici nous le supposons, aucun agent subalterne n'est dans , ce cas, il faut donc remonter jusqu'au chef suprme du service, le maire pour la commune, le chef de l'tat pour l'tat, et par une vritable prsomption, supposer ce chef de service en faute. Il y aurait, semble-t-il, un bien meilleur fondement donner la responsabilit dans l'hypothse du service mal organis. Il faudrait reconnatre qu'elle est quasi-contractuelle. Les individus sont obligs juridiquement envers l'tat certaines prestations, l'tat est oblig juridiquement envers eux assurer certains services; obligation pour obligation. On est bien oblig d'en venir certains points de vue l'ide du
94
LE DROITPUBLIC
quasi-contrat, car si on n'admet pas la responsabilit pour tous les manquements de service, du moins l'inverse on n'admet la responsabilit en cas d'inaccomplissement d'un service qu' propos des services auxquels l'individu a vraiment droit. Ainsi, le droit l'assistance n'tant pas reconnu, un individu ne serait pas admis poursuivre l'tat ou la commune pour n'avoir pas t assist (V. infr, Droit aux services publics, n58). 3 Lorsqu'un droit de puissance publique tant exerc dans l'intrt de tous il en rsulte pour un particulier un dommage spcial qu'il serait injuste de lui faire supporter. Respon12. I. Poursuites directes contre l'tat. civile de l'tat. a) Cas de faute prcise d'un agent. sabilit La responsabilit de l'tat est admise, mais avec bien des tempraments; la jurisprudence se fonde non pas sur le texte de l'art. 1384 du Code civil, mais sur le principe de justice qui l'a inspir, et aussi sur certaines lois spciales en matire de douanes, de postes, de contributions indirectes. Ce fondement plus vague lui permet, d'abord, de dclarer que l'tat n'est pas responsable quand le fonctionnaire a commis une faute lourde personnelle, car, dans ce cas, le fonctionnaire s'est mis lui-mme hors de sa fonction, et n'est plus vraiment prpos de l'tat. Cette faon d'interprter le n 3 de l'art. 1384 du code civil qui exige, en effet, que la faute ait t commise dans l'exercice de la fonction, veut dire que l'tat ne rpond de son prpos que tant qu'il reste dans l'esprit de sa fonction, tandis que les commettants ordinaires rpondent des leurs, tant qu'ils sont matriellement en fonction1 (Conflits, 8 fvrier 1873; Cass. 19 novembre 1883). Ce fondement plus vague permet ensuite d'carter la comptence judiciaire. Dans tous les cas, l'action doit tre porte devant les tribunaux administratifs. Il n'y a mme pas distinguer entre les deux fautes, non seulement quand l'agent n'est coupable que de faute administrative, mais mme quand il est coupable de faute personnelle. De telle sorte que s'il y a la fois poursuite contre l'agent et poursuite contre l'tat, il faut disjoindre. La raison donne, c'est qu'il n'appartient qu' l'autorit administrative de se faire juge des relations qui existent entre l'tat et ses fonctionnaires, et par consquent du degr de responsabilit qu'il peut encourir. La formule gnrale semble tre b) Cas de service mal assur. 1. Si l'on combine cette jurisprudence sur la responsabilit civile de l'tat, avec celle sur la responsabilit des fonctionnaires que nous avons expose plus haut, on arrive cette conclusion, que la partie lse aura toujours quelqu'un poursuivre. Si la faute a t lourde, l'tat ne sera plus responsable,
DES DROITSPUBLICS GARANTIES
95
celle-ci : Plus le service rendu par l'tat l'individu est important, moins l'individu peut l'exiger . Ainsi il n'est gure de service plus important que celui de la dfense contre les faits de guerre. C'est peut-tre la ncessit de la dfense militaire qui a t la plus grande cause historique de la formation des tats. Et cependant l'individu n'a pas d'action juridique pour se faire protger par les armes. Il n'a pas non plus de moyens juridiques pour se faire indemniser des prjudices qu'il a soufferts, lorsqu'il n'a pas t dtendu soit dans sa personne, soit dans ses biens. Il ya eu des lois d'indemnit dans plusieurs hypothses, mais elles ont toujours protest que c'tait pure gracieuset de la part de l'tat. Au contraire, prenons un service important sans doute, mais enfin trs secondaire, celui des postes. Nul doute qu'on n'ait, dans de nombreux cas, le moyen de faire valoir son droit, il y a des textes. La formule donne, bien que d'apparence paradoxale, est donc exacte. Bien mieux, elle se justifie, non pas comme on l'a dit, parce que quand il s'agit de remplir les services trs importants, c'est la souverainet de l'tat qui est en jeu, ou tout au moins la puissance publique; ce sont un peu des mots; mais parce que l'tat ne peut pas toujours rendre ces services sans s'exposer lui-mme de grands prils extrieurs ou intrieurs, prils de guerre ou prils de politique Si l'existence, ou simplement la tranquillit de l'tat sont mises en jeu, on comprend que l'intrt particulier doive tre sacrifi. Dans ces limites la formule est juste, voyons comment elle est : lgislaapplique. L'tat rend aux individus trois grands services tion, justice, administration. Lgislation. Pas de moyen juridique pour les particuliers qui attendent une loi, rien que le droit de ptition; c'est raisonnable, la loi a une telle rpercussion sur le corps social tout entier, que l'tat doit tre matre de choisir son heure. Justice. Ici le droit des particuliers est en partie sauvegard. Toutes les fois que l'individu lui-mme peut introduire l'instance, mettre en mouvement l'action, le juge est oblig de juger sous peine de dni de justice. Mais quand l'action publique est rserve au ministre public, pas de moyen sr de le forcer agir, ce qui est regrettable. Quant aux erreurs judiciaires, pas de moyen de rparation, ce qui est galement trs regrettable. . Services de police. Dfense contre les Administration faits de guerre; nous avons dj vu la solution. mais l'agent le sera. Si la faute a t lgre, l'agent ne sera plus responsable, mais l'tat le sera. Seulement, jamais les deux ne seront responsables la fois.
96
LE DROITPUBLIC
Dfense contre les dangers intrieurs par les mesures de police. Mesures contre les attentats la personne, contre les attentats la proprit. Mesures d'hygine et de salubrit, etc. La rgle ici encore est l'irresponsabilit de l'tat. Les rglements de police peuvent tre insuffisants, imprudents, ne pas prvoir les accidents ou mme les provoquer. Les agents de la police peuvent refuser leur protection ou mme l'exercer d'une faon maladroite, la responsabilit de l'tat n'est pas engage. La lgislation n'est pas la mme pour les communes, nous allons le voir. On justifie cette irresponsabilit de l'tat en disant que les mesures de police sont des actes de la puissance publique. C'est une pure tautologie. Il faut dire plutt que l'ordre tant quelque chose de trs collectif, l'tat doit tre libre de le maintenir sa guise sur tel ou tel point. Cependant il n'est pas dmontr qu'il n'y ait pas de progrs accomplir du ct de la responsabilit. . Services domaniaux. Ce sont tous les services qui ont un contre-coup direct dans le patrimoine de l'tat, que l'tat accomplit en grant son propre patrimoine. Dans ces matires, la responsabilit est beaucoup plus largement admise. D'abord pour la gestion du patrimoine priv, ce qui va de soi, l'tat tant assimil alors un simple particulier; la rgle s'applique aux chemins de fer de l'tat (L. 15 juillet 1845, art. 22). Mme pour la gestion du patrimoine public, pour certaines matires o il y a des lois spciales. Ainsi pour les postes (L. 24 juillet 1793, art. 37; 5 nivse an V, art. 14 et 15). Pour les tlgraphes (L. 29 novembre 1850; 4 juillet 1868; dcret 25mai 1870). Tantt ces lois stipulentqu'il n'y a pas responsabilit du tout (lettres et tlgrammes ordinaires), tantt elles fixent forfait le montant de l'indemnit (lettres et objets recommands), tantt elles fixent l'indemnit au montant des valeurs perdues (valeurs dclares et mandats tlgraphiques), etc. En dehors des matires o il y a des textes, le conseil d'tat reconnat la responsabilit pcuniaire de l'tat, la condition toujours, qu'il n'y ait pas de fonctionnaire ayant commis de faute personnelle. Cette responsabilit a t applique en matire maritime en cas d'accidents arrivs par la faute d'officiers du port ; en matire d'exercices militaires mal rgls; en matire d'abordages causs par les navires de l'tat (l'art. 407 C. com. est applicable); d'accidents survenus dans les ateliers ou manufactures de l'tat; d'accidents occasionns aux personnes par des travaux publics. Dans ces matires, la juridiction comptente est tantt la juridiction ordinaire, tanttla juridiction administrative; notamment, dans la dernire hypothse, on assimile aux dommages causs aux proprits et on attribue comptence au conseil de prfecture.
PUBLICS GARANTIES DES DROITS
97
c) Dommages causs par l'exercice d'un droit de puissance publique. Renvoi au n 298. contre les communes. directes 13. II. Poursuites a) Cas de faute civile des communes. Responsabilit Ici le conseil d'tat, cartant les restrictions d'un agent. prcise qu'on accumule quand il s'agit de l'tat, dclare que l'art. 1384 du Codecivil est pleinement applicable (Arr. 7 mars 1874). Il en rsulte que la comptence judiciaire est de rgle moins qu'il n'y ait un acte administratif interprter. Il devrait en rsulter aussi la responsabilit pour les fautes personnelles de l'agent, aussi bien que pour ses fautes administratives, mais il y a tendance en ce point tablir la mme rgle que pour l'tat. b) Cas de service mal assur, dommages causs par les attroupements. La commune est responsable en principe lorsque ses services municipaux sont mal assurs par la faute de son maire et de son conseil municipal. Ainsi il a t dcid que les mesures de police prises au moment d'un incendie en vue d'organiser des secours engagent la responsabilit de la commune (Cass. 15 janvier 1866, 3 janvier 1883). De mme, le dfaut de barrires autour d'une tranche (Cass. 15 fvrier 1868). Le dfaut de prcautions propos d'un feu d'artifice (Paris, 15 juillet 1891). Le cas le plus saillant de responsabilit civile de la commune est celui qui est prvu par les art. 106 et suivants de la loi municipale substitus aux dispositions de la loi du 10 vendmiaire an IV, c'est la responsabilit en cas de dommages causs par des attroupements. Les communes sont civilement responsables des dgts et dommages rsultant des crimes et dlits commis force ouverte ou par violence sur leur territoire par des attroupements ou rassemblements arms ou non arms, soit envers les personnes, soit contre les proprits publiques ou prives. Les dommages, dont la commune est responsable, sont rpartis entre tous les habitants domicilis dans ladite commune, en vertu d'un rle spcial comprenant les quatre contributions directes (Art. 106. L. 5 avril 1884). ) Conditions de la responsabilit. 1 Dgts et dommages, mme moraux, pourvu qu'ils soient apprciables, envers les personnes ou les proprits publiques et prives, rsultant de crimes ou dlits commis force ouverte ou par violence ; 2 sur le territoire de la commune ; 3 par des attroupements ou rassemblements arms ou non arms. Il s'agit de dgts causs par des mouvements spontans de la population; si celle-ci -est dirige par les autorits, c'est uneautre question. Peu importe le motif du mouvement; aurait-il un motif politique, cela ne dcharge pas H. 7
98
LE DROITPUBLIC
la commune de sa responsabilit, et c'est le bon moyen d'arrter ds le dbut les meutes; 4 si les attroupements ou rassemblements ont t forms d'habitants de plusieurs communes, chacune d'elles est responsable des dgts et dommages causs, dans la proportion qui sera fixe parles tribunaux (art. 107). Dans ce cas, une commune peut tre responsable de dgts qui n'ont pas t commis sur son territoire. Il y a solidarit. ) Nature de la responsabilit. Responsabilit purement pcuniaire, fixe par les tribunaux, moins qu'il n'y ait transaction, car la transaction est reconnue possible par la majorit des auteurs. La somme est recouvre sur tous les habitants domicilis, en vertu d'un rle spcial comprenant les quatre contributions directes. Chaque cotisation est recouvrable en une fois. y) Dure de la responsabilit. L'action en responsabilit contre la commune est lie, quant sa dure, aux actions criminelles ou correctionnelles diriges contre les auteurs des crimes ou des dlits ; par consquent, prescription de trois ou de dix ans. ) Comptence. Les tribunaux civils sont comptents. e) Exception au principe de la responsabilit. Les dispositions des art. 106 et 107 ne sont pas applicables : 1 lorsque la commune peut prouver que toutes les mesures qui taient en son pouvoir ont t prises, l'effet de prvenir les attroupements ou rassemblements et d'en faire connatre les auteurs ; 2 dans les communes o la municipalit n'a pas la disposition de la police locale ou de la force arme 1 ; 3 lorsque les dommages causs sont le rsultat d'un fait de guerre (Art. 108). Ces trois exceptions sont fondes sur la mme ide que l o il n'y a pas faute dela commune, il ne saurait y avoir responsabilit. La commune dclare responsable peut exercer son recours contre les auteurs ou complices du dsordre (Art. 109). LES OU PARALYSENT QUI SUSPENDENT 2. DES VNEMENTS INDIVIDUELS GARANTIES DESDROITS Ces vnements sont au nombre de trois principaux d'une valeur bien ingale : 1 l'ouverture d'une instruction criminelle; 2 certaines ncessits de gouvernement; 3 l'tat de sige. criminelle. instruction 14. A. Ouverture d'une L'instruction prparatoire d'un crime ne peut pas tre faite sans que quelques liberts individuelles ne soient violes. Arrestation provisoire de la personne, violation du domicile, perquisitions, saisies, non seulement chez le dlinquant, mais chez des tiers, violation du secret 1. Paris et Lyon sont d'une faon permanente dans cette situation ; les autres communes peuvent s'y trouver temporairement en cas d'tat de sige.
GARANTIES DES DROITS PUBLICS
99
des lettres, toutes ces mesures deviennent lgitimes. Il faut bien s'y rsigner, mais la condition qu'elles se rattachent rellement une instruction ouverte, et qu'elles soient faites suivant les formes judiciaires. Ces conditions sont ralises, lorsque l'instruction est dirige selon la voie normale par le juge d'instruction sur la rquisition crite du ministre public. On est sr, ici, que l'acte violateur du droit se rattache une instruction, car on a la rquisition crite du procureur ncessairement antrieure en date. La division des pouvoirs entre les deux hommes est d'ailleurs une garantie srieuse. Malheureusement, il y a au Code d'instruction criminelle un certain article 10 qui, sous couvert d'instruction criminelle, permet l'arbitraire administratif de s'exercer. Le prfet de police Paris, et les prfets des dpartements peuvent, non seulement mettre en mouvement le juge d'instruction, mais se faire eux-mmes juges d'instruction, et cela spontanment, sans que rien vienne rvler l'examen quel moment, propos de quels crimes ils s'y sont rsolus (Arrt clbre de cass. 21 mars 1853). Ils peuvent donc procder par leurs agents, des arrestations, des perquisitions domiciliaires et des saisies de papiers, des violations de lettres, sauf plus tard, s'ils sont poursuivis pour ces faits, invoquer une instruction criminelle. C'est une tentation dangereuse. L'art. 10 devrait disparatre. Le projet de rforme de l'instruction criminelle en maintient la disposition uniquement pour le prfet de police, c'est encore beaucoup. 15. B. Certaines ncessits de gouvernement. Il ya un certain nombre d'actes Actes de gouvernement. qui peuvent entraner des violations de droits individuels, et qui ne donnent lieu aucun recours, parce qu'ils se justifient par la raison d'tat. La raison d'tat est assimilable ici un cas de force majeure, elle dtruit la responsabilit. Si des poursuites sont exerces ou des recours intents l'occasion de ces actes, ils seront arrts par la procdure du conflit. Et ici le conflit sera lev, chose remarquable, non seulement devant les tribunaux judiciaires, mais encore devant les tribunaux administratifs. L'acte doit toute juridiction. C'est cette chapper hypothse qu'estrelatif l'art. 26 de la loi du24 mai 1872: Les ministres ont le droit de revendiquer devant le tribunal des conflits les affaires portes la section du contentieux administratif, etc. (V. dj art. 47, L. 3 mars 1849). La liste des actes de gouvernement sera donne en droit administratif, propos des actes d'administration (V. infr, n 71).
100
LE DROIT PUBLIC
de sige. Une des plus grandes garanties des 16. C. L'tat liberts individuelles est la sparation du pouvoir militaire et du pouvoir civil, et la prpondrance donne ce dernier. Mais le rgime civil ne peut tre tabli ainsi sans inconvnient qu'en temps de paix. En temps de guerre avec l'tranger, ou bien en cas de troubles intrieurs, le salut de l'tat exige, au risque de diminuer momentanment les garanties des citoyens, que l'on tablisse, au contraire, le rgime militaire. Le rgime militaire peut tre tabli, soit pour le pays tout entier, soit pour une rgion dtermine. Il est essentiellement transitoire. On l'appelle tat de sige parce que le type est le rgime auquel est soumise une place rellement assige. On distingue: 1 L'tat de sige rel (L. 10 juil. 1791; D. 24 dcembre 1811 et 10 aot 1853); 2 l'tat de sige fictif ou politique (L. 9 aot 1849; 3 avril 1878). Effets. Les effets sont les mmes dans les deux cas. Les pouvoirs dont l'autorit civile tait revtue pour le maintien de l'ordre et de la police, passent l'autorit militaire, au moins ceux que celle-ci veut prendre: 1 Les tribunaux militaires peuvent tre saisis des crimes et des dlits contrela sret de la rpublique, contre la constitution, contre l'ordre et la paix publique ; 2 l'autorit militaire a le droit de faire des perquisitions de jour et de nuit dans le domicile des citoyens ; 3 elle a le droit d'interdire les publications et les runions qu'elle juge de nature causer des dsordres. Ainsi : sret individuelle, inviolabilit du domicile, libert de la presse, libert de runion sont suspendues. Dclaration et leve (art. 1er, L. 3 avril 1878). L'tat de sige fictif ne peut tre dclar qu'en cas de pril imminent rsultant d'une guerre trangre ou d'une insurrection main arme, une loi peut seule le dclarer. Cette loi dsigne les communes, les arrondissements ou dpartements auxquels il s'applique, elle fixe le temps de sa dure. A l'expiration de ce temps, l'tat de sige cesse de plein droit, moins qu'une nouvelle loi n'en prolonge les effets.. Suivent des rgles qui, en l'absence des chambres, permettent aut pouvoir excutif de dclarer l'tat de sige sous certaines conditions. Quant l'tat de sige rel, il rsulte des faits de guerre.
LIVRE
II
LES DROITS PUBLICS
CHAPITRE
LES DROITS POLITIQUES
LE DROITDE SUFFRAGE 17. Les droits politiques ou civiques sont les droits qui donnent l'individu une part d'action dans l'tat ou sur l'tat. Tels sont: le droit de suffrage, l'aptitude aux fonctions publiques, le droit de ptition, le droit d'tre jur, tmoin dans les actes, soldat. Nous ne nous occuperons ici directement que du premier de ces droits; les droits d'tre jur ou tmoin intressent surtout les matires civiles ou criminelles et sont traits cette occasion; le dioit d'tre soldat sera joint l'obligation d'tre soldat, c'est--dire au service militaire ; il sera dit un mot de l'aptitude aux fonctions publiques propos de la thorie dela fonction publique; quant au droit de ptition, il a surtout une importance constitutionnelle, il n'intresse le droit administratif que sous la forme de recours gracieux adress aux reprsentants du pouvoir excutif. Il en sera trait ce point de vue propos des actes d'administration (V. d'ailleurs L. 22 mai 1792, constitution du 22 frimaire an VIII, art. 89). Le droit de ptition est reconnu mme aux trangers. Le droit de suffrage est 18. Considrations gnrales. le droit qu'a l'individu de formuler sa volont imprieuse touchant la constitution et la direction politique de l'tat. C'est le mode sous lequel se manifeste la souverainet de l'individu. Si nous tions sous un rgime de souverainet directe, de plbiscite ou de referendum, le droit de suffrage apparatrait sous la forme d'une volont directement exprime sur telle ou telle mesure intressant l'tat. Mais nous
102
LESDROITS POLITIQUES
sommes sous un rgime de souverainet dlgue, exerce par reprsentation; le droit de suffrage apparat sous forme de deux droits corrlatifs l'un de l'autre, le droit de vote ou droit de nommer un reprsentant, le droit d'ligibilit ou droit d'tre nomm reprsentant, le tout parle moyen de l'opration que l'on appelle lection. Ces deux droits sont galement des manifestations de la souverainet individuelle, le premier parce qu'il sert dlguer la souverainet, le second parce qu'il sert exercer la souverainet reue par dlgation, et que le mandat impratif n'tant pas admis dans notre droit, le reprsentant lu introduit dans l'exercice qu'il fait de la souverainet une part de volont personnelle. Nous ne ferons pas l'histoire du droit de suffrage dans l'antiquit, ni au moyen ge ; par une tradition, qui ne parat interrompue que pour un observateur superficiel, il remonte aux poques les plus recules, mais il n'avait jamais eu une extension comparable celle dont nous sommes les tmoins. C'est sur le droit de suffrage que repose l'organisation politique de tous les tats modernes. Il faudrait, pour se rendre compte de l'tendue des pays o rgne le suffrage, prendre une mappemonde. On verrait alors que l'Europe, les deux Amriques, et l'Australie, c'est--dire la bonne moiti des continents habits, sont acquis au suffrage. La Russie, en Europe, fait exception; cependant elle est entre dans le mouvement, au moins au point de vue du gouvernement local. Restent seulement en dehors l'Afrique et l'Asie, un pays barbare et un pays immobile depuis des sicles; Partout ailleurs on vote, et si l'on pouvait tenir des phmrides exactes, on s'apercevrait qu'il n'y a pas de semaine o l'on ne scrutine quelque part dans le monde, et encore dans plusieurs endroits la fois. Mais, dans les diffrents pays, le suffrage n'a pas la mme valeur. Il faut se proccuper de bien des questions pour savoir quelle est la valeur du suffrage: 1 Quel est son emploi dans le gouvernement de l'tat? s'appliquet-il au gouvernement central et au gouvernement local, ou bien seulement l'un d'eux? Et, dans chacunedes circonscriptions, s'appliquet-il aux trois formes du pouvoir, lgislatif, excutif, judiciaire, ou seulement quelqu'une de ces formes? 2 Quelle est son extension aux individus? question du suffrage universel des hommes, question du vote des femmes, question des classes, systme d'aprs lequel tous les hommes votent, maisla classe des riches a l'avantage parce qu'elle forme un collge ayant le mme nombre de dputs que la classe pauvre, infiniment plus nombreuse cependant.
LE DROITDE SUFFRAGE
103
3 Quelle est son nergie? le suffrage est-il un seul degr ou plusieurs? les assembles lues ont-elles le droit de vrifier leurs pouvoirs? le renouvellement est-il intgral ou partiel? le mandat est-il gratuit ou salari? Voil une masse de questions. Nous ne pouvons pas les tudier en dtail, mais nous pouvons dire tout au moins que de l'tude compare des diverses lgislations sur le suffrage, quand on la fait porter sur un certain nombre d'annes, il se dgage l'impression d'une marche en avant. Partout la valeur du suffrage est croissante depuis le commencement du sicle, depuis vingt ans surtout. Il semble que les tats modernes voluent vers une constitution dmocratique o le suffrage aura son maximum de puissance. Pour la seule question du suffrage universel, c'est--dire de l'extension du suffrage tous les individus mles sans conditions de cens et sans distinction de classes, on peut voir combien la marche a t rapide. La France est l'initiatrice du mouvement, mais en France mme, le suffrage universel ne date que du dcret du 5 mars 1848. Le principe avait t pos en 1789, il n'avait pas jusque-l t compltement appliqu. On sait de quelle pidmie de rvolutions en Europe, fut le signal celle de 1848 faite sur une question de suffrage. Toutes amenrent une extension du suffrage. Les progrs ne furent pas maintenus partout, il y eut des ractions, mais ils s'accomplissent maintenant peu peu, et il est probable que le xxe sicle verra le triomphe complet du le suffrage universel. Ont dj le suffrage universel : l'Allemagne, Danemark, la Grce, le Portugal, l'Espagne, la Suisse, la Confdration Argentine, les tats-Unis. L'Italie en est trs prs, l'Angleterre et la Belgique y marchent rapidement. En France, au point de vue de la valeur du suffrage, voici la situation : 1 il a un emploi considrable; tout le gouvernement central repose sur lui, puisque le suffrage nomme le parlement, lequel nomme le chef du pouvoir excutif, lequel nomme les fonctionnaires; le suffrage s'exerce mme directement au point de vue de l'organisation de la justice, pour les juges consulaires et pour les conseils de prud'hommes. Il est galement la base du gouvernement local ; 2 il est trs tendu puisqu'il est universel; 3 il a beaucoup d'nergie, les lections sont un seul degr en gnral, les mandats sont relativement courts, et pour la Chambre des dputs et les conseils municipaux le renouvellement est intgral. Enfin, il a une grande valeur d'opinion. Le dveloppement progressif du suffrage est donc un fait historique qui s'impose, mais il n'est pas dfendu de chercher faire la thorie exacte de ce droit ; elleest d'ailleurs de nature dtruire bien des
104
LESDROITS POLITIQUES
prventions. Avec son bulletin de vote l'individu est souverain et tous les individus sont galement souverains, voil le rsultat du suffrage. Si l'on se trompe sur le sens de cette souverainet, si on la considre comme signifiant direction absolue du corps social, on arrive des rsultats qui paraissent bon droit choquants; on se heurte cette vrit naturelle que les intelligences et les caractres ne sont pas. ne sont pas gaux; on mconnat ce fait clatant que tous les hommes aptes au commandement et que tous n'en sont pas dignes. Mais il faut nous souvenir que la souverainet de l'individu n'est autre que celle de l'tat lui-mme, et que l'tat, quoique souverain, n'a point la direction absolue du corps social ; l'tat n'est qu'une organisation rationnelle destine rgulariser, temprer l'exercice du pouvoir naturel lequel appartient toujours une minorit de dirigeants. Il faut donc considrer que le bulletin de vote, tout en tant thoriquement un instrument de direction, pratiquement, par suite du jeu des forces antagonistes, n'aboutit gure qu' un contrle. Dans ces conditions, le suffrage individuelle plus tendu, et particulirement le suffrage universel, se justifie parfaitement. Tous les individus n'ont pas le droit de gouverner, parce que tous ne sont pas aptes, mais tous ont le droit de dfendre leur libert (V. Thorie de l'tat). On peut prsenter la chose autrement, et dire que la souverainet de l'individu exerce par le suffrage se ramne la souverainet du droit. Au milieu des actions et ractions qui constituent la vie des tats comme elles constituent celle des individus, il se cre des rapports permanents; ces rapports durables sont des rapports juridiques, car le droit c'est quelque chose qui demeure. Or, dans un systme individualiste, ces rapports de droit ne sont justes que s'ils sont accepts par tous ou du moins par la grande majorit. C'est donc pour l'acceptation deces rapports de droit, que doit intervenir le suffrage. Aussi, en fait, l'action la plus directe du suffrage se fait-elle sentir justement dans l'organisation du pouvoir lgislatif quia pour mission spciale de dfinirle droit. Et, vrai dire, il en a toujours t ainsi, le droit individualisteest toujours sorti des entrailles du peuple, c'est--dire des individus, par le consensus omnium. Seulement, autrefois il en sortait sous forme de coutume, avec quelque chose de vague, d'anonyme et sans date, aujourd'hui il en sort sous forme de loi avec une formule arrte, une date et un nom d'auteur; mais au fond, dans les deux cas il y a suffrage, lent dans un cas, rapide dans l'autre, insaisissable ou saisissable. Il est indispensable d'tudier sparment le droit de vote et le droit d'ligibilit.
LE DROITDE SUFFRAGE DE VOTE 1er. DUDROIT Article Ier. Jouissance du droit de vote.
105
19. Par suite des ncessits dela lgislation sur le fait trs concret du vote et des lections, la division suivante, bien qu'elle ne soit pas trs scientifique, s'impose: 1 de la jouissance du droit devote; 2 des incapacits lectorales, sujet comprenant la fois la privation de la jouissance et la privation de l'exercice du droit de vote; 3 des conditions d'exercice du droit de vote. Le droit de vote n'appartient qu'au citoyen franais, c'est--dire l'individu mle. Franais par l'origine, le bnfice de la loi ou la naturalisation. Il n'appartient par consquent, ni l'tranger1, ni la femme franaise, ni l'indigne des colonies et de l'Algrie non naturalis. L'exclusion de l'tranger se comprend. L'tat doit avoir une vie propre, il ne doit pas tre, mme pour une part minime, expos subir l'influence d'un membre d'un tat tranger. L'exclusion de la femme prte plus de discussions. Ce n'est pas que la femme ait jamais eu dans le pass le droit de suffrage, mais la question se pose pour l'avenir. C'est dans les pays o l'volution dmocratique est le plus avance, que les parlisans du suffrage des femmes sont les plus nombreux, notamment en Amrique. L'tat de Massachussets a admis en principe le vote des femmes (L. 16 mars 1886) ; la question a t discute en Angleterre, aux deux Chambres. Elle est de celles qui ne paraissent pas pouvoir tre tranches par des arguments priori, mais uniquement par l'exprience; il est souhaiter seulement qu'on fasse l'exprience avec prcaution, que l'extension soit essaye graduellement par les petits cts, par exemple pour l'lection des juges consulaires, il y a quelque chose de choquant ce qu'une femme bonne commerante, et il en est beaucoup, ne puisse pas choisir son juge; pour l'lection des prud'hommes; pour les lections municipales, etc. L'exclusion des indignes de l'Algrie et des colonies non naturaliss n'est pas absolue; il faut distinguer : 1 Les indignes isralites ayant t naturaliss cola) Algrie. lectivement par le dcret du 24 octobre 1870 jouissent du droit de suffrage ; 2 les indignes musulmans non naturaliss ne jouissent pas en principe du droit de suffrage. Cependant ils sont lecteurs et 1. Mme pour les lections consulairesou pour les lections au conseil des prud'hommes.
106
LES DROITS POLITIQUES
ligibles pour les lections municipales dans les communes de plein exercice. Les conditions pour tre lecteur sont : D'tre g 25 ans; d'avoir une rsidence de deux annes conscutives; de se trouver en outre dans l'une des conditions suivantes : tre propritaire foncier ou fermier d'une proprit rurale ; tre employ de l'tat, du dpartement ou de la commune ; tre membre de la Lgion d'honneur, dcore de la mdaille militaire, d'une mdaille d'honneur, d'une mdaille commmorative ou autorise par le gouvernement franais ou titulaire d'une pension de retraite. (Autrefois il y avait des patents, ce qui tait logique). Les conditions de : d'tre inscrit sur la liste des lecteurs municipaux (ce l'ligibilit sont qui suppose 25 ans) ; d'tre domicili dans la commune depuis trois ans au moins (D. 7 avril 1884). Les indignes musulmans avaient des reprsentants lus au conseil gnral du dpartement. L'lection a t supprime malencontreusement par un dcret du 28 dcembre 1870. Ils n'ont pas de reprsentants au conseil suprieur du gouvernement. b) Colonies. Dans l'Inde, les indignes sont unanimement considrs comme citoyens, mme les non-renonants; ils jouissent donc des droits politiques. Seulement, au moins pour les lections locales, ils sont inscrits sur des listes diffrentes selon qu'ils sont renonants ou non-renonants, et ils lisent des mandataires spars. Dans la Cochinchine, les indignes, quoique non citoyens, sont lecteurs et ligibles aux fonctions municipales des villages annamites, au conseil au conseil colonial. d'arrondissement, Ce suffrage est base censitaire. Les communes de Sagon et de Cholon sont organises d'une faon particulire.. Article II. Des incapacits lectorales. 20. La capacit lectorale qui entrane la qualit d'lecteur suppose la fois la jouissance et l'exercice du droit de vote; l'incapacit lectorale rsulte donc, soit de la privation de la jouissance du droit de vote, soit de la privation de l'exercice de ce droit. L'effet de l'incapacit est le mme dans les deux cas, il consiste en ce que l'incapable ne doit pas tre inscrit sur la liste lectorale ou doit tre ray s'il a t inscrit; ou s'il a t inscrit et s'il a vot, en ce que son vote doit tre dfalqu des suffrages exprims, ce qui, en modifiant la majorit, peut entraner aprs coup l'annulation de l'lection. 21. A. Incapacit lectorale rsultant de la privation
LE DROIT DE SUFFRAGE
107
de la jouissance du droit de vote. Il est des vnements qui font perdre la jouissance du droit de vote. Ces vnements sont des sentences judiciaires: 1 condamnations criminelles et certaines condamnations correctionnelles; 2 dclaration de faillite; 3 destitution d'emploi. En somme, des faits qui portent atteinte l'honorabilit de l'individu. Les droits publics, quels qu'ils soient, ne doivent appartenir qu' ceux qui ont un minimum de moralit, plus forte raison ce droit l qui est un pouvoir dans l'tat. Le texte fondamental en la matire est le dcret organique du 2 fvrier 1852 modifi par un certain nombre de lois postrieures, notamment les lois du 24janvier 1889, du 4 mars 1889 et du 15 juillet 1889; par sa nature mme, d'ailleurs, cette matire est expose des remaniements frquents. criminelles et correctionnelles. L'numration a) Condamnations de ces condamnations va trouver place dans un tableau, mais quelques observations pralables sont ncessaires: 1Les condamnations criminelles, quelles qu'elles soient, emportent privation du droit devote, quelles soient prononces pour crime politique ou pour crime de droit commun, par un tribunal d'exception ou par une juridiction ordinaire. Laprivation est toujours perptuelle. Il n'y a, au contraire, que certaines condamnations correctionnelles qui entranent perte du droit; tantt c'est raison de la nature du dlit quelle que soit la peine, tantt la gravit du dlit se mesure la peine. Enfin, bien qu'en principe la privation soit perptuelle,il est des cas o elle est temporaire et ne dure que cinq ans partir de l'expiration de la peine; ce dernier systme semble mme avoir une tendance se gnraliser. 2 Les complices sont frapps aussi bien que les auteurs; 3 Les condamnations encourues pendant la minorit enlvent le droit, les condamnations encourues l'tranger ne l'enlvent pas; 4 La rhabilitation et l'amnistie restituent le droit en principe; 5 Si le condamn ne subit pas la peine, la dchance commence du jour o il a acquis la prescription ou a t graci (Cass. 16 mai1865).
TABLEAU DES LECTORALES D'APRS LEDCRET INCAPACITS DU 2 FVRIER 1852 1 ORGANIQUE NOMENCLATURE NATURE ARTICLES DURE DES PEINES DURE dudcretorganiPAR OBD.E ALPHABTIQUE ET emportantl'excluque du2fv.1852 des dlits crimes, crimes, sionde la liste DE L'EXCLUSION qui prononcent ouautres causes lectorale. l'exclusion. d'incapacit. Abus de confiance. (Code pnal,art. 406 Emprisonnement, Perptuelle. Art.15,5. qu'elle qu'en 409.) soitla dure. Arbre sachant au- Emprisonnement, Idem Art.15, 10. abattu, qu'ilappartient detrois trui.(Code art.445.) mois au pnal, moins. ou corc, Arbre demanire Idem. /~e))!. Idem. mutil, c oup le faireprir,sachant qu'ilappartient autrui.(Code art.446.) pnal, contrela libert desctil-Quelle Art.15, &. quesoitla /~CM. publique Attaque dela libertet lesdroits peine. tes,le principe dela famille.(Loidu 11aot1848, article 3f. la loisur Emprisonnement L'exclusion dureArt.16. Attroupements (Dlits p rvus par de plus d'un cinqans daterles).(Loidu 7 juin1848.) de l'expiration mois. de la peine. Clubs Idem. T~en:. (Dlits prvus par la loisurles).(LoiZ~em du28juillet1848)3. laloisur Iden Idem. d'crits rde;,n Colportage (Infractions (Loi du 27 juillet 1849)4. le). condamnation Crimes suivis d'une des Quelle quesoitla Perptuelle Art.15,g lr. afflictives ou infamantes dure de la peines (travaux dtention ou rclu- peine. forcs,dportation, ou despeines infamantes seulesion), ment dgradation civique). (bannissement, art. 7 et 8.) (Code pnal, l'em-Idem. Art.15,g 3. Crimes suivisd'unecondamnation Ident en vertude prisonnement correctionnel, l'article 463duCodepnal. Art.15, Deniers /<~)K. publicssoustraits par les dposiEmprisonnement 5. tairesauxquels ils taient confis. (Code quellequ'en soitladure. pnal, art. 169 171.) Art.15,g 10, Destructions des registres, actesEmprisonnement Ident m inutes, de l'autorit mois au titres, detrois originaux publique, lettresde change, effets de com- moins. billets, t contenant I merce oudebanque, ouoprant oudcharge. obligation, disposition (Code pnal, art.439.) 7. Art. 15, g ajout, soustrait oualtr par dans un deplus detrois Art.35. I les personnes charges, oud- mois. o 1 scrutin, de recevoir, compter les lesbulletins contenant p pouiller descitoyens. suffrages H Emprisonnement Idem. autresqueceux ins-.MeM.Msm j Lecture denoms crits. Bulletin Idem Art.15,g 7. denoms/~CM. surle bulletin d'autrui Inscription Art.36. autresque ceux qu'ontait chargd'y inscrire. Art.15,g 7. dansun col-7<7<'7H. T~pM. lectoral. Collge (Irruption Art.42. consomme outenteavec lgelectoral, un choix). envued'empcher violence, Art.15, 7. obtenue laei?z. Listelectorale. sonsIrierti (Inscription Art.31. ou defauxnoms ou defausses qualits, endissimulant une incapacit prvue par laloi).
jI| I II I j1| j| jj I i 1 I [ j fi I| I I ? | t H H H fl
v 1.Cetableau, aucourant M atmis auBulletin du ministre del'Intrieur (1885,p. 288), emprunt de la lgislation. laloidu 29juillet1881 sur la presse. t 2. Abrog p ar e n seul reste les socits secrtes t3 dela loidu 28juillet1848 vigueur.j 3.L'article quiinterdit L.30juin1881.) 18a 22dela loi a t remplace du27juillet1849 4.La loisurle colportage par lesarticles surla presse du 29juillet (art.68). 1
LEDCRET 2 FVRIER D'APRS DU 185 2 INCAPACITS LECTORALES ORGANIQUE TABLEAU DES ARTICLES NATURE NOMENCLATURE DURE DES PEINES DURE du dcret orsraniPAR0B D R ALPHABTIQUEET emportant l'excluquedu2fv.1852 des crimes, dlits DE L'EXCLUSION sion delaliste quiprononcent lectorale. l'exclusion. ouautrescauses d'incapacit.
et Emprisonnement Listelectorale. rclame 7. Perptuelle. Art.15, (Inscription g de trois m. Art.31. obtenue surdeuxouplusieurs listes.) deplus /~em. Art.51,g 7. lectorales retardes ou empcMe":. Oprations Art.45. aumoyen Se voiesde fait oumenaches Bureau cespar deslecteurs. outrage ou dansl'un de ses dansson ensemble membres des lecteurs la p ar p endant Scrutin viol. runion. Art.15, 7. lectorales troubl-es - ., ..,.. /<2em Oprations par attrou-Idem Art.41. pements,clameursou dmonstrations Atteinte menaantes. porte l'exercice dudroitlectoral oula libert du vote. Art.15, 7. ouvaleurs T~OK. Idem g Suffrages. - Deniers quelconques Art.3S. oureus sous la condition donns, promis soitdedonner oude procurer un suffra Offre de s'abstenir ou devoter. ge, soit faite ouaccepte, sous lesmmes promesse ou privs. conditions, d'emplois publics Art.15, 7. ~ent. soit par voies de fait, .Mem. Suffrages influencs, Art.3'.. violences ou menaces contre un lecteur, enluifaisant craindre de perdre son ou d'exposer un dommage sa emploi, sa famille, ou sa fortune. personne, Abstention de voterdtermine les p ar mmes moyens. Art.15,g 7. l'aidede 7~m. T~ew Fuffrages surprisou dtourns Art.40. fausses bruitscalomnieux ou nouvelles, Absautresmanuvres frauduleuses. soit tention de voter dtermine les p ar mmes moyens. Art.15,g 7. Urnecontenant les suffrages miset non /e)H. Idem. Art.46. encore dpouills (Enlvement de l '). Art. 15, 7. Voteen vertud'uneinscriptionobtenue Ide,it Art.33. sousde fauxnomsou fausses qualits, une incapacit, I ouendissimulant ou en faussement lesnomset qualits prenant inscrit. I | d'unlecteur Art.15,g 7. Votemultiple, l'aide d'une inscription Icleni Ideitz Art.34. multiple. Art.15,g 10. de chevaux ou autresEmprisonnement Irlenz Empoisonnement au btes devoiture, demonture oudecharge, detrois mois debestiaux cornes, demoutons, chvres moins. ou de poissons ou porcs, danslestangs, viviers, ourservoirs.(Codepnal,art. 452.) i Escroquerie. Art.15,g 5. A~m. (Code pnal, art.405.) Emprisonnement cluellequ'en soitla dure. Art.10 du dcret Exclusion decinq Falsification deboissons et de d'un ans dater de de1852,mod. denres a limentaires ou mdicamenteuses (le plus de e par la loi du l'expiration destines a etrevendues. Vente oumise 1 janvier dud1889 la peine vente deces sachant denres, en sont falsifies 4, g a peme. A - Art. J 15, oucorrompues. (qu'elles. Loi, du g4,dudsub,stances ouf/Emprisonnement mod dLisonnement perptuelle cret de1852; par la]0i mofg 27 mars 1851, art. 1, et loi du 5 v mai mois. du24janv.l889. Art.15, 14,dFalsification de denres, boissons ou mar- Emprisonnement, /r/e;<:. cret de 1852, la quelle qu'en chandises nuisibles par desmixtions mod.par la loi soitla dure. sant.(Loidu 27mars1851, art. 2.) du24janv.1889. Art.15,g 10. troisMem. art. 447.) Emprison.de Greffe dtruite. (Code pnal, au moins. mois Laduredel'ex-Art.15, 3. dudroitdevote Interdiction correctionnelle clusion estfixe et d'lection. art. 42,86,89, p nal, (Code Art.3 et 6 dela loidu23janparlejugement 91,123. Art.6delaloi dater et court vier1873 sur l'ivresse. de l'expiration du7 juillet1874.) de la peine.
TABLEAU DES INCAPACITS LECTORALES D'APRS LE DCRET DU 2 FVRIER ORGANIQUE 1852 NOMENCLATURE PAR ORDRE ALPHABJE TIQUE descrimes, dlits ou autres causes d'incapacit. NATURE ARTICLES f ET DURE DES PRECIN.EUS A DURE dudcret crganiquedu2 fv.135 sion de la liste DE L'EXCLUSIO, quiprononcent lectorale. l'exclusion. emportant l'excluH jj !
Jeu de hasard(Maison la Perptuelle Art.15,3 1). Codepnal,Quelle quesoit de). art. 410.) peine. Loteries non autorisesi. (Loidu 21 mai 1836.) Marchandises oumatires servant la fabri-Emprisonnement 7~ent. Art.15S10 mois au volontairement. cation, gtes (Code P3- detrois moins. nal, art.443.) Mendicit. (Code pnal,art.274 279.) Quelle qae soit la /~e/H. Art.15,g 9. s peine. condamns au boulet ouauxtra- Quelle Militaires que soitla Perptuelle. Art.15,8 12. vauxpublics. dure de la peine. Murs (Attentats /</e?K. Art.15, 5. aux). Code pnal, art. 330Emprisonnement, qu'en et 334.) quelle soitla dure. D Officiers ministriels Idem Art. 8. 13, (avous, huissiers, gref destitus en vertude jufiers, notaires) oude dcisons gements judiciaires. la morale et re- Quelle quesoitla Ident Art.15. 6. Outrage public p ublique et aux bonnes murs. du peine. ligieu.se (Loi 17mai 1819, art.82. envers un jur raisonEmprisonnement L'exclusion dureArt.1G. Outrages publics desesfonctions ou envers un tmoin ans dater de plus d'un cinq raison de l'expiration desesdpositions. du 25mars mois. (Loi delapeine. 1822, art.6.) et violence envers Icleni les dpositaires llei,t idei2z Outrage de l'autoritou de la force publique. (Code pnal, a rt.nantissement 222 230.) Prts sur ou Quelle spitPerptuelle. Art.i5, g 11. gage (Maisons de) q u'en tablies ou tenues sans autorisation l- la peine. nontenus. gale.Registres pnal, (Code art. 411.) Rbellion envers les dpositaires del'autoL'exclusion dureArt.16. Emprisonnement de plus d'un cinqans darit oudela force Code publique. p nal, mois. ter de l'expiraart. 209 221.) tion delapein. Art.15, 10. Rcoltes pnal,art. Emprisonnement Perptuelle. (Dvastation de).(Code de trois mois 444.) au moins. Art.15, 13. de re- Emprisonnement /</e~ omissurlestableaux Jeunes g ens ouma- quelle qu'en censement par suitedefraudes nuvres. (Loidu 21mars1832,art. soitla dure. 38.- Loidu27juillet 1872, art. 60. art. 69.) du 15juillet1889, Jeunesgensappels fairepartiedu Ile,,2 Ide,,? Idem &< contingent deleur classe, quise sont auservice rendus militaire, impropres soitd'une manire soit t emporairement, g M dansle but de se souspermanente, Loi traireauxobligations imposes par la du21mars 1832, (Loi b<1 art. du27 Loi 41. 1872, juillet art.69et art. PS 63.Loidu15juillet1889, I Substitution 70-) effectu soitTc~e/H 7~e/;'.MeM ou remplacement la loi,soitau moyen encontravention fraudepices fausses oudemanuvres Complicit. du21mars deuses. (Loi art.43. loi 1832, Complicit.
t t t M
1 art.22. 1865, 1. Abrog par la loi du30novembre 2. Abrogparlaloidu29juilletl881 surlapresse, saufencequiconcerne l'outrage aux bonnes murs. l,
TABLEAU LE DU 2 FVRIER D'APRS ORGANIQUE LECTORALES 1852 TABLEAU DES INCAPACITS ] NATURE NOMENCLATURE ARTICLES ET DURE DES DES PEI~NES PEI>ES DURE , DUREE du dudcret oi, ganidcret orCga"n"i*PARORDRE ALPHABTIQUE emportant l'exclu" que du2fv.1852 descrimes, dlits sionde la liste DE L,EXCLUSION quiprononcent ou autrescauses lectorale. l'exclusion. d'incapacit.
ou officiersde Emprisonnement Perptuel!?. Art. 15,g 13. chirurgiens saut au qu'elle qu'en pourassister qui,djdsigns conseil dervision oudansla prvision soitla dure. E- decettedsignation, ontreudesdons ouagrdespromesses pourtrefavorablesaux jeunesgensqu'ils doivent ou qui ont reu des dons examiner, prononce. 'E2 pourunerforme justement art. 45.- Loi (Loi du21 mars1831i. art. 66. Loidu juillet1872, du 27 15juillet1889, art. 69 80.) L'excisiondure Art.12. Service militaire l'tranger prispar un sans autorisation du jusqu'ce que Franais majeur, la qualit de Mdecins, 1 aitt Franais recouvre. Gouvernement. s le titre desmatires d'orou Emprisonnement Tromperie Perptuelle. Art.15, 4. surla qualit d'unepierre fausse detroismois au d'argent, vendue pourfine,surla naturede toutes moins. marchandises. (Code pual,art. 423.) Exclusion de cinq Art. 10, modifi 1 de plus d'un ans daterde par la loi du 2 ou l'acheteur de janvier1880. Tromperie par le vendeur suri. mois. l'expiration la quantit desmarchandises la peine. livres. (Loi du27mars1851, art. 1ern3.) PerpctueUe. Art. 15, 4, moEmprisonnement deplusdetrois difiparlaloi du 1 f Emprisonnement mois. 24janvier 1889. Jsure. (Loisdu 3 septembre 1807et du Quelle que oit7'~!. Art.15, 5. 19dcembre la peine.' 1850.) art. 269 271.) Art.15.S 9. Vagabondage. (Code p nal, 7 ~/e~ 7~~ Vol.(Code Art.15, 5. pnal,art. 379, /~e~ 38S. 401.) Emprisounemeut soit quelle qu'en la dure. 1 b) Dclaration de faillite. L'aprs l'art. 15, n 17, du dcret du 2 fvrier 1852 modifi par la loi du 4 mars 1889, la dclaration de faillite n'entrane pas perte du droit de vote lorsqu'il y a eu concordat homologu ou excusabilit reconnue et que le droit de vote a t expressment conserv par jugement. Dans les autres cas, le droit devote est perdu. Par dispositions transitoires, la loi du 4 mars 1889 restitue le droit de vote aux faillis antrieurs sa promulgation qui sont concordataires ou qui ont t reconnus excusables. Quant la liquidation judiciaire, elle n'entrane pas perte du droit de vote. c) Destitution d'emploi (art. 15, n 18). Les notaires, greffiers et autres officiers ministriels destitus en vertu d'un jugement ou d'une dcision judiciaire perdent le droit de vote, et la cour de cassation admet que la destitution prononce par le chef de l'tat aprs et la suite de poursuites criminelles, correctionnelles ou discipli-
112
LES DROITS POLITIQUES
naires est une vritable dcision judiciaire (Cass. 19 avril 1880, Dall. 80. 1. 155)1. Mesure d'ordre. Un casier judiciaire spcial est tenu jour dans toutes les sous-prfectures pour les condamnations entranant perte du droit de vote pour tous les individus ns dans l'arrondissement. Les renseignements sont fournis par les ministres de la justice, de l'intrieur, de la guerre et de la marine. Les maires, pour l'tablissement de la liste lectorale, peuvent demander communication de ce casier. 22. B. Incapacits lectorales rsultant de la privation de l'exercice du droit de vote. Certains faits entranent privation de l'exercice du droit de vote et par consquent incapacit lectorale. Ce sont la minorit et l'interdiction : La majorit est de 21 ans pour les lections politiques; dans beaucoup de pays, elle est de 24 ou 25 ans, dans certains de 17. La majorit est encore de 21 ans pour les lections consulaires, elle est de 25 ans pour les lections au conseil des prud'hommes (L. 1er juin 1853). La minorit est bien une cause de privation d'exercice et non une cause de privation de jouissance. Il est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'intrt pratique la distinction, car le mineur ne peut pas exercer son droit par reprsentant. Cependant, une consquence admise est que les condamnations encourues pendant la minorit entranent perte du droit: c'est donc qu'il existe. Mmes rflexions propos de l'interdiction. Le dcret de 1852 la fait figurer parmi les faits qui privent du droit, mais ce n'est videmment qu'une cause de privation d'exercice. Ne devrait-on pas ajouter d'autres causes de privation d'exercice du droit de vote? 1 Le fait d'tre pourvu d'un conseil judiciaire. Celui qui ne sait pas diriger ses propres affaires ne doit pas tre admis diriger celles des autres. Dj la loi du 10 aot 1871 en fait une cause d'inligibilit, de mme la loi du 5 avril 1884; 2 Le fait d'tre indigent assist. Mme raison, n'a pas su faire ses affaires (Autriche-Prusse) ; 3 Le fait de ne pas savoir lire ou crire; prsomption d'ignorance. Dans quelques annes, cette incapacit paratra une consquence 1. Pour les lections consulaires (L. 8 dcembre 1883, art. 2) d'abord toute la liste prcdente, plus certaines condamnationspour d'autres dlits ; pour les lections au conseil des prud'hommes, mme liste absolument que pour les lections politiques (L. 1erjuin 1853,art. 6).
LE DROITDE SUFFRAGE
113
logique de l'obligation et de la gratuit de l'instruction primaire; en mme temps ce sera un stimulant; 4 Le fait d'tre au service d'autrui. Cette cause d'incapacit existe dans beaucoup de lgislations trangres. Article III. Des conditions d'exercice du droit de vote.
Le droit de vote s'exerce dans les lections; il ne suffit pas au citoyen pour voter d'avoir la capacit lectorale, il lui faut encore rem: la premire est positive, il faut tre plir au moins deux conditions inscrit sur la liste lectorale de la commune o l'on vote ; la seconde est ngative, il faut n'tre pas soldat prsent au corps, car il y a incompatibilit. Lgislasur la liste lectorale. 23. A. Inscription L'lection est une opration tion de la liste lectorale'. communale en principe. Les lections la Chambre des dputs, au conseil gnral, au conseil d'arrondissement se font par communes, celles au conseil municipal se font par communes ou par sections lectorales de communes. Cette opration importante a besoin d'tre conduite avec beaucoup de mthode. Une des premires mesures d'ordre prises a t la liste lectorale. La liste lectorale est le catalogue par ordre alphabtique des lecteurs d'une commune ou : 1 au moment o elle est dresse d'une section de commune. Elle sert ou revise, faire parmi les habitants de la commune le triage de ceux qui sont lecteurs et de ceux qui, pourune cause quelconque, ne le sont pas.Il y a l une sorte de censure qui s'exerce facilement l'intrieur de chaque commune par des relations de voisinage, et qui serait beaucoup plus difficile si la liste devait tre dresse pour une circonscription plus vaste que la commune; 2 au moment du scrutin, constater l'identit de l'individu qui se prsente pour voter; elle est en effet dpose sur le bureau et le nom de chaque votant est marg; 3 dterminer le nombre des lecteurs inscrits, ce qui est indispensable pour le calcul de la majorit au premier tour. Il faut, en effet, pour tre lu, que le candidat runisse les voix du quart des lecteurs inscrits. Il n'y a l'heure actuelle, depuis la loi du 5 avril 1884, qu'une 1. Il s'agit uniquement de la liste lectorale pour les lections politiqueset administratives; il y a des listes spciales pour les lections des juges consulaires et des membresdes conseilsde prud'hommes (V. L. 8 dcembre 1883 et L. 1erjuin 1853)pour celles des dlgus mineurs (L. 8 juillet 1890). H. 8
114
LES DROITSPOLITIQUES
seule liste lectorale dans chaque commune ou section lectorale de commune qui sert toutes les lections, politiques ou locales 1. Cette liste est permanente une fois dresse dans une commune ou une section lectorale de commune 2. Elle est soumise une revision annuelle. La liste revise sert de base aux lections depuis le 31 mars d'une anne jusqu'au 31 mars de l'anne suivante. Il y a lieu d'tudier: 1 les conditions requises pour tre inscrit sur la liste; 2 l'tablissement et la revision annuelle de la liste. 24. 1 Conditions tre inscrit sur la requises pour Ces conditions sont: liste lectorale d'une commune. 1 d'avoir la capacit lectorale, d'tre lecteur; c'est un dlit de rclamer son inscription en dissimulant une incapacit (art. 31 D. O. 2 fvrier 1852); 2 d'avoir une attache lgale avec la commune. L'attache lgale avec la commune rsulte indiffremment de l'un ou de l'autre des faits suivants (L. 5 avril 1884, art. 14) : a) Domicile rel tabli dans la commune avant le 31 mars. b) Rsidence de six mois accomplie dans la commune avant le 31 mars. c) Rsidence relle tablie avant le 31 mars des fonctionnaires publics et des ministres des cultes reconnus par l'tat, lorsque cette rsidence est obligatoire dans la commune. La rsidence est cense tablie du jour de la nomination. La qualification de fonctionnaire public comprend ici tous les citoyens investis d'un caractre public et chargs d'un service permanent d'utilit publique, qu'ils soient ou non rtribus sur les fonds de l'tat. La jurisprudence est trs large. d) Rsidence tablie dans la commune avant le 31 mars, d'un con1. Pendant une certaine priode, depuis la loi du 14 avril 1871jusqu' celle du 5 avril 1884,il y eut deux listes, une pour les lections lgislatives, l'autre pour les lections locales (conseil municipal, d'arrondissement, conseil 'gnral). La seconde liste exigeait des conditions plus svres de domicile. Ou tait parti pour tablir cette dualit d'une ide assez logique, c'est que quand il s'agit des affaires de la France, peu importe en somme qu'on soit depuis longtemps dans une commune dtermine, tandis que cela importe pour les affaires locales. Seulement, il faut se dfier de la logique dans les affaires humaines. Il est arriv que l'tablissement de ces deux listes crait de grands lecennuis aux municipalits, etune statistique a dmontr que sur10.171.000 teurs, elle n'cartait des lections locales que 257.566.Le besoin de simplicit, dont il faut tenir plus de compte que de la logique, fit supprimer la dualit de liste (L. 5 avril 1884). 2. Le principe de la liste permanente a t pos dans laloi du 2 juillet 1828; jusque-l les listes taient dresses l'occasion de chaque lection, ce qui donnait lieu aux plus grands abus. Le progrs de la permanence des listes n'est pas ralis encore dans tous les pays.
LE DROITDE SUFFRAGE
115
tribuable inscrit au rle de l'anne pour l'une des quatre contributions directes ou pour la prestation en nature, ou d'un habitant qui, sans tre inscrit personnellement au rle, compte dans la cote du chef de famille pour la prestation en nature, ou d'un habitant que son ge ou son tat de sant dispensent de la prestation en nature. e) Demande d'inscription sur la liste faite par un contribuable non rsidant, lorsqu'il est inscrit au rle de l'anne dans la commune pour l'une des quatre contributions directes ou pour la prestation en nature, ou demande faite par un membre de la famille qui compte dans la cote pour la prestation, sans tre inscrit personnellement au rle. Tous ces faits, d'o rsulte l'attache la commune, oprent de plein droit et doivent entraner l'inscription d'oftice, l'exception de celui indiqu sous la lettre e qui suppose une demande de l'intress. Lorsque ces faits sont connus ou prvus avant le 4 fvrier, poque o expire le dlai pour les rclamations contre l'opration de revision, l'inscription se fait normalement soit d'office, soit sur rclamation. Lorsque le fait se produit entre le 4 fvrier et le 31 mars, l'lecteur a encore le droit de se faire inscrire, l'art. 14 est formel ; bien que la commission municipale, qui seule peut faire l'inscription, ait termin sa tche, il doit s'adresser elle, car elle subsiste jusqu'au 31 mars; si elle refuse ou nglige de rpondre, il peut faire appel devant le juge de paix1. Il est facile de voir qu'un mme lecteur peut avoir une attache lgale avec plusieurs communes. Il peut avoir son domicile dans l'une, une rsidence de six mois dans une autre, payer des impts directs dans une troisime; il ne doit pas cependant exercer son droit de vote pour une mme lection dans plus d'une commune. Il y a lieu de poser les rgles suivantes : 1 C'est un dlit de rclamer son inscription dans plusieurs communes (D. 1852, art. 21), mais on peut se trouver inscrit d'office dans plusieurs; il suffit, pour pouvoir rclamer son inscription dans une nouvelle commune, de justifier que l'on a fait des diligences pour tre ray sur la liste de la commune o l'on tait prcdemment inscrit (Cass. 23 mai 1882; 26 mars 1890); 2 C'est un dlit de voter pour une mme lection dans plusieurs communes (D. 1852, art. 34); 3 On fixe son choix par le vote au premier tour, il n'est pas permis de voter dans une autre commune au second tour. 1. Le juge de paix est seulementjuge d'appel des dcisionsde la commission, mais on admet que l'omission de statuer mmeinvolontairede la commission quivaut dcisionde rejet et autorise l'appel (Cass.10 mai 1881).
116
LES DROITS POLITIQUES
25. 2 tablissement et revision annuelle de la liste L'tablissement pour la premire fois de la liste lectorale. lectorale dans une commune ou dans une section lectorale de commune, est un fait assez exceptionnel dsormais, on se reportera aux textes (L. 7 juillet 1874, art. 1er). Au contraire, la revision annuelle est un fait d'importance capitale qui demande des dveloppements. La revision de la liste lectorale commence dans chaque commune le 1er janvier de chaque anne et se termine le 31 mars. Elle passe par quatre phases : une opration administrative de revision accomplie par une commission; des rclamations formes par les intresss contre cette opration; le jugement des rclamations; la clture de la liste par la commission. a) Opration administrative de revision. Une commission dite administrative est organise dans chaque commune ou section lectorale de commune; elle est compose de trois membres : le maire, un dlgu du prfet, un dlgu du conseil municipal (pour une section lectorale, le maire peut tre remplac par un adjoint ou un conseiller municipal; pour Paris et Lyon, rgles spciales, L. 7 juillet 1874, art. 1er). Du 1er au 10 janvier, cette commission procde aux inscriptions et aux radiations d'office. Elle ajoute les lecteurs qui ont acquis ou qui acquerront les conditions requises avant le 31 mars, et retranche les dcds, les incapables, les indment inscrits; l'lecteur dont l'inscription a t discute est averti sans frais par le maire et convoqu pour prsenter ses observations. Un tableau indiquant les inscriptions et les retranchements oprs est dpos le 15 janvier au secrtariat de la mairie et affich le mme jour; il est transmis au prfet (art. 2 et 3, D. O. 1852). Si le prfet estime que les formalits et les dlais prescrits par la loi n'ont pas t observs, il devra, dans les deux jours de la rception du tableau, dfrer les oprations de la commissionadministrative au conseil de prfecture du dpartement, qui statuera dans les trois jours, et fixera, s'il y a lieu, le dlai dans lequel les oprations annules devront tre refaites (art. 4). Un dlai de vingt jours partir de l'affichage du tableau est ouvert pour les rclamations; ce dlai expire le 4 fvrier. Les rclamations peuvent tre faites, soit par b) Rclamations. l'lecteur intress, soit par des tiers lecteurs, soit par le prfet ou le sous-prfet (D. O. 1852, art. 19). Elles doivent tre formes dans les vingt jours compter de la publication des listes (D. R. 1852, art. 5; L. 7 juillet 1874, art. 2). La demande en inscription ou en radiation n'est soumise aucune forme parliculire, il suffit d'une lettre missive adresse au maire.
LE DROITDE SUFFRAGE
117
Celui-ci doit donner rcpiss. S'il s'y refusait, le rclamant ritrerait sa demande par exploit d'huissier. L'lecteur intress peut donner mandat un tiers de faire la rclamation en son nom, et il n'est point ncessaire que le mandataire soit lui-mme lecteur, ce peut tre une femme ou un mineur. Le contrle de la liste lectorale intresse l'ordre public, de l le droit du prfet former des rclamations, del aussi le droit des tiers lecteurs. Les tiers lecteurs sont tous les lecteurs inscrits sur l'une des listes de la circonscription lectorale, ce ne sont donc pas seulement les lecteurs de la mme commune, mais tous ceux qui ventuellement sont appels participer une mme lection, et il faut prendre la circonscription la plus grande; actuellement, elle se rencontre pour les lections lgislatives, c'est l'arrondissement; autrefois, avec le scrutin de liste, c'a t le dpartement. Il faut donc admettre qu'un lecteur inscrit sur une liste communale quelconque de l'arrondissement a le droit de contrler les autres listes : il y a l ce que quelques arrts appellent une action publique, plus exactement, c'est une action popularis. Le tiers lecteur qui a form une rclamation acquiert par l mme le droit de suivre l'affaire devant tous les degrs de juridiction; au contraire, le tiers lecteur qui n'a pas la qualit de rclamant ne .pourrait pas intervenir pour interjeter appel devant le juge de paix, ainsi que nous le verrons plus loin. En d'autres termes, c'est la rclamation forme dans les dlais, qui seule conserve le droit du tiers lecteur au contrle de la liste lectorale (Cass. 9 juin 1891). Il faut en dire autant du prfet. c) Jugement des rclamations. Le contentieux des rclamations est organis d'une faon judiciaire; il appartient en premier ressort une commissionmunicipale, et en appel au juge de paix avec possibilit de pourvoi la cour de cassation. Cela prouve que la rclamation est interprte non pas comme un moyen d'attaquer l'opration administrative de rvision de la liste lectorale, cette opration ne peut tre attaque que par le prfet et devant le conseil de prfecture un moyen de faire valoir le droit indi(V. p. 116) mais comme viduel de suffrage. Nous en effet, au contentieux que la protection des droits individuels, verrons, quand elle peut tre obtenue sans l'annulation d'un acte administratif entraine en principe la comptence judiciaire. Ce contentieux des rclamations est, en outre, organis de faon tre trs rapide et sans frais, les actes judiciaires sont dispenss du timbre et enregistrs gratis (D. O. 1852, art. 24). Nous verrons plus
118
LES DROITSPOLITIQUES
tard que le contentieux des lections est lui aussi jug rapidement et sans frais. De la commission municipale. La commission municipale est une vritable juridiction spciale et temporaire. Elle est compose: 1 des membres de la commission administrative qui a prpar la liste; 2 de deux autres dlgus du conseil municipal. A Paris et Lyon, ces dlgus sont remplacs par deux lecteurs, domicilis dans le quartier ou la section et dsigns par la commission administrative elle-mme (L. 7 juillet 1874, art. 2, 2 et 3). Cette commission se trouve donc compose de cinq membres, et de ce qu'elle est une vritable juridiction, la cour de cassation en a conclu qu'elle ne peut statuer valablement que si elle est au complet de ces cinq membres, la loi n'en ayant pas autrement ordonn (Cass. 11 avril 1888; 20 mai 1890). La loi du 15 mars 1849, art. 8, recommande de statuer dans un dlai de cinq jours. Ni la procdure, ni la forme des dcisions ne sont rgles par la loi, mais il faut autant que possible appliquer les rgles de la procdure judiciaire, par suite les dcisions doivent tre crites en minute et motives. Les dcisions doivent tre notifies dans les trois jours aux parties intresses, par crit et domicile, par les soins de l'administration municipale (L. 1874, art. 4, 2). De l'appel devant le juge de paix (D. O. 1852, art. 21; L. 1874, art. 4, 2). Appel peut tre form devant le juge de paix du canton, soit des dcisions de la commission municipale, soit des omissions de statuer qui rsultent du fait de l'administration et qui ds lors sont assimilables une dcision de rejet. L'appel doit tre form dans le dlai de cinq jours partir de la notification, il est form par simple dclaration au greffe. Le mot dclaration signifie que l'appelant doit comparatre en personne ou par un fond de pouvoir spcial, une lettre missive serait insuffisante. L'appel peut tre form, disent les textes, parles parties intresses. Ce sont : 1 L'lecteur dont l'inscription ou la radiation sont poursuivies, alors mme que la rclamation devant la commission municipale n'aurait pas t forme par lui; 2 Les tiers lecteurs de la mme circonscription lectorale condition qu'ils aient la qualit de rclamants; il n'est pas ncessaire qu'ils aient figur dans l'instance devant la commission municipale, mais il est ncessaire qu'ils aient form une rclamation pour conserver leur droit de contrle de la liste lectorale (Cass., 3 juin 1891) (V. p. 117).
LE DROITDE SUFFRAGE
119
Mme solution pour le prfet ou le sous-prfet1. Le juge de paix statuera dans les dix jours, sans frais ni formes de procdure, et sur simple avertissement donn trois jours l'avance toutes les parties intresses (D. O. 1852, art. 22). 11 faut entendre encore ici par parties intresses, d'une part, l'lecteur dont l'inscription ou la radiation sont demandes, d'autre part, les rclamants. Les questions d'tat, les questions d'interprtation d'actes administratifs, les questions subordonnes au rsultat de poursuites criminelles ou correctionnelles forment question prjudicielle devant le juge de paixet doivent tre renvoyes par lui devant l'autorit comptente si elles sont vraiment relatives l'affaire et susceptibles de donner lieu un dbat srieux. Lejuge de paix donnera avis des infirmations par lui prononces dans les trois jours de la dcision (D. R. 1852, art. 6). Du pourvoi en cassation. La dcision du juge de paix est en dernier ressort, mais elle peut tre dfre la cour de cassation. Le pourvoi n'est recevable que s'il est form dans les dix jours de la notification de la dcision, il n'est pas suspensif. Il est form, par simple requte dnonce aux dfendeurs dans les dix jours qui suivent. Il est dispens de l'intermdiaire d'un avocat la cour et jug d'urgence sans frais ni consignation d'amende. Les pices et mmoires fournis par les parties sont transmis sans frais par le greffier de la justice de paix au greffier de la cour de cassation; la chambre des requtes de la cour de cassation statue dfinitivement sur le pourvoi (D. O. 2 fvrier 1852, art. 23). Si la dcision du juge de paix est casse, l'affaire est renvoye devant le juge d'un autre canton. Peuvent former le pourvoi : 1 l'lecteur intress alors mme qu'il n'aurait pas t partie devant le juge de paix, alors mme qu'il n'aurait pas la qualit de rclamant ; 2 le tiers lecteur, le prfet et le sous-prfet lorsqu'ils ont la qualit de rclamant2. 1. Les rclamants qui veulent faire appel sans avoir figur, c'est--dire sans avoir t parties devant la commission municipale, ont besoin de connatre la dcision de cette commission; ils doivent la demander et elle ne peut pas leur tre refuse. En cas de relus, le dlai pour l'appel courrait du 31 mars. Pour viter toute difficult ce sujet, une circulaire ministrielle du 25 janvier 1888a invit les maires rendre publiques immdiatement les dcisions de la commission municipale. 2. La jurisprudence a exig pendant longtemps que les tiers lecteurs et le prfet eussent t parties devant le juge de paix pour pouvoir former le pourvoi. Maisellesemble s'loigner de cette formule et se rapprocher de celie que nous donnons. Un premier pas a t fait par un arrt du 4 avril 1883o la
120
LES DROITS POLITIQUES
Contre les dcisions du juge de paix rendues contradictoirement, il n'y a point d'autre voie de recours que le pourvoi en cassation. On s'accorde reconnatre que la tierce opposition et la requte civile sont impossibles. Que si la dcision dujuge de paix a t rendue par dfaut, les principes conduisent admettre la voie de l'opposition, et mme, dans ce cas, le pourvoi en cassation ne serait pas recevable. des listes lectorales. Le 31 mars de chaque d) Clture anne, la commission administrative opre toutes les rectifications rgulirement ordonnes et arrte dfinitivement la liste lectorale de la commune (D. R. 1852, art. 7; L. 7 juillet 1874, art. 1er). Rectifications au cours de l'anne. La liste lectorale reste jusqu'au 31 mars de l'anne suivante telle qu'elle a t arrte, sauf nanmoins les changements qui y auraient t ordonns par dcision du jugede paix1 et sauf aussi la radiation des noms des lecteurs dcds ou privs des droits civils ou politiques par jugement ayant force de chose juge (D. R. 1852, art. 8). TABLEAU RCAPITULATIF DES DLAIS2. OPRATIONS Opration de rectincation. Prparation du tableau rectificatif Publication de ce tableau Dlai ouvert aux rclamations pour dcision des commissionsmunicipales. - pour notificationdesdites. - appel devant le juge de paix. - pour dcisiondudit. pour notificationdu jugement dudit. - pour pourvoi en cassation. Clture dfinitive DES DLAIS TERME NOMBRE DE JOURS NORMAL 10 4 1 20 5 3 5 10 3 10 10 janvier 14 15 4 fvrier 9 12 17 27 2 mars ou lor 12 ou 11 31 mars
cour de cassationadmettait former pourvoi un tiers lecteur qui avait provoqu une radiation devant la commissionmunicipale, puis n'avait pas t partie en appel. Un second pas a t fait par l'arrt de cassation du 3 juin 1891,cit plus haut (p. 117),qui semblebien poser en principe que la qualit de rclamant une fois acquise, donne le droit d'intervenir tous les degrs de juridiction. 1. 11 s'agit des dcisions rendues tardivement par le juge de paix, mais dans les dlais (V.toutefoisp. 115, proposdes faits qui sur des appels forms surviennent entre le 4 fvrier et le 31 mars). 2. Bulletin du Ministre de l'Intrieur, 1885,p. 287. Les dlais imposs aux parties pour rclamation, appel, pourvoi en cassation, sont seuls prescrits peine de nullit; les dlais imposs aux autorits et juridictions sont pu-
LE DROITDE SUFFRAGE
121
Conservation et communication des listes lectorales. Les minutes des listes lectorales seront runies en un registre et conserves dans les archives de la commune. Tout lecteur pourra en prendre communication et copie (L. 7 juill. 1874, art. 4, 3). Copie est dpose au secrtariat gnral de la prfecture. rsultant de la qualit 26. B. Cause d'incompatibilit au corps (L. 15 juillet 1889, art. 9). de soldat prsent Les militaires et assimils de tous grades et de toutes armes des armes de terre et de mer, ne prennent part aucun vote quand ils sont prsents leur corps, leur poste ou dans l'exercice de leurs fonctions. Les assimils sont les non-combattants qui font cependant partie de l'arme: pour l'arme de terre, fonctionnaires de l'intendance, officiers d'administration, mdecins, pharmaciens et vtrinaires militaires, chefs de musique, adjoints du gnie et gardes d'artillerie, archivistes d'tat-major, interprtes militaires, etc.; pour l'arme de mer, corps du gnie maritime, ingnieurs hydrographes, corps du commissariat de la marine, etc. Ceux qui, au moment de l'lection, se trouventen rsidence libre 1, en non activit, ou en cong, les officiers et assimils qui sont en disponibilit ou dans le cadre de rserve peuvent voter dans la commune sur la liste de laquelle ils sont rgulirement inscrits. Le fait d'tre soldat prsent au corps n'empche pas en effet d'tre inscrit sur la liste; il empche de voter, quoique inscrit. Le motif de cette incompatibilit est facile dduire du caractre de la discipline militaire. D'une part, cette discipline serait compromise par l'introduction de la politique dans l'arme; d'autre part, elle compromettrait la libert du vote. Mais il est curieux de voir Combien, par notre conception moderne de la sparation de l'lment civil et de l'lment militaire, nous sommes loigns de la conception antique, o, au contraire, le peuple en armes constituait justement les comices (Constitution de Servius Tullius). 2. DROIT D'LIGIBILIT 1 Jouissance du droit d'ligibilit
27. D'ordinaire, on tudie le droit d'ligibilit propos de chaque rement rglementaires. S'ils ne sont pas observs, ils entranent des retards. Mais,dans tous les cas, la date de la clture est immuable, sauf rectification pour les solutionsretardes. 1. Cette situation est spcialeau corps de la marine.
122
LES DROITSPOLITIQUES
espce d'lection; sans renoncer cette mthode, nous ajoutons ici une tude d'ensemble; il est naturel qu'un droit individuel soit tudi propos de l'individu. Il y a lieu de se proccuper, pour le droit d'ligibilit, des trois mmes questions que pour le droit de vote : de la jouissance du droit, de l'incapacit ou inligibilit qui rsulte de la perte de la jouissance ou de l'exercice du droit, et des conditions d'exercice du droit. La jouissance du droit d'ligibilit appartient en principe tous ceux qui ont le droit de vote, l'un emporte l'autre; cependant, il faut signaler le cas de l'tranger naturalis qui acquiert immdiatement le droit de vote, et n'acquiert le droit d'ligibilit aux Chambres que dix ans aprs le dcret de naturalisation (L. 26 juin 1889). A partcette restriction, le droit d'ligibilit appartient tout individu mle, Franais d'origine, ou par le bnfice de la loi ou par naturalisation; ni les trangers ni les femmes franaises ne sont ligibles. Quant aux indignes d'Algrie et des colonies, ils sont ligibles dans la mesure o il sont lecteurs (V. plus haut p. 105). 2 De l'incapacit ou inligibilit 28. L'inligibilit provient soit de la perte de la jouissance, soit de la perte de l'exercice du droit. Dans les deux cas, elle produit le mme rsultat. Si la cause d'inligibilit existe au moment de l'lection, celle-ci doit tre annule. Si elle survient aprs l'lection, l'lu doit tre exclu de l'assemble dont il a t nomm membre (D. 2 fvrier 1852, art. 28; L. 10 aot 1871, art. 18; L. 5 avril 1884, art. 36). On comprendrait mal, en effet, que celui-l continut siger, qui, si l'lection tait faite au moment mme, serait inligible. Lorsque l'exclusion est motive par une condamnation entranant perte de la jouissance du droit, on dit qu'ilya indignit. de la de privation 29. A. Inligibilit suite par du droit. Ceci se rencontre dans le cas de conjouissance damnation criminelle ou correctionnelle, dclaration de faillite ou liquidation judiciaire, destitution d'emploi. Il faut se reporter ce qui a t dit du droit de vote (p. 111). En principe, tout jugement qui fait perdre le droit de vote fait perdre, et dans la mme proportion, le droit d'ligibilit. Il faut ajouter seulement l'indication de certains cas o le droit d'ligibilit est perdu, alors que le droit de vote ne l'est pas. Ainsi, depuis la loi du 4 mars 1889, les liquids judiciaires sont dclars inligibles alors qu'ils peuvent voter; de mme, les faillis concordataires ou dclars excusables sont dclars inligibles,
LE DROITDE SUFFRAGE
123
alors que le droit de vote peut leur tre conserv par jugement. Les membres des familles ayant rgn en France ont t frapps d'une inligibilit qui est galement une vritable privation de la jouissance du droit (V. L. 22 juin 1886). Enfin, sont inligibles au conseil gnral pendant trois ans, les conseillers gnraux condamns pour avoir pris part une runion illgale du conseil ou une confrence interdpartementale dissoute (L. 10 aot 1871, art. 34, 2, et 91, 2). De mme, est inligible au conseil gnral pendant un an, le conseiller gnral dclar dmissionnaire, pour avoir refus sans excuse valable de remplir une fonction qui lui avait t dvolue par la loi ; inligibilit de mme ordre pour le conseiller d'arrondissement et pour le conseiller municipal dans les mmes conditions (L. 7 juin 1873). 30. B. Inligibilit de l'exerpar suite de privation cice du droit. Les causes d'inligibilit sont ici les suivantes : minorit, interdiction, secours reus de l'assistance publique, fait d'tre domestique attach la personne, fait d'tre investi d'une fonction publique. Ces causes n'oprent pas toutes pour toutes les lections; les exceptions seront indiques. a) Minorit. Pour tous les mandats lectoraux, la majorit est en principe fixe 25 ans (Chambre des dputs, conseil gnral, conseil d'arrondissement, conseil municipal). Exceptionnellement, pour le Snat elle est fixe 40 ans. La majorit doit tre acquise au jour de l'lection. b) Interdiction. L'interdiction civile est certainement une cause d'inligibilit pour toutes les lections (Arg. D. 2 fvrier 1852, art. 15). c) Demi-interdiction. Cette cause d'inligibilit n'existe que pour le conseil gnral (art. 7, L. 10 aot 1871) et pour le conseil municipal (L. 5 avril 1884, art. 32) ; elle n'existe ni pourla Chambre des dputs et le Snat, ni pour le conseil d'arrondissement, et c'est fcheux. d) Assistance publique. Cette cause d'inligibilit n'existe que pour le conseil municipal (art. 32, L. 5 avril 1884). Il y a deux catgories : 1 ceux qui sont dispenss de subvenir aux charges communales. Il faut qu'il soit intervenu une dcision du conseil municipal tablissant la dispense (L. 21 avril 1832, art 18) ; en outre, il faut qu'il s'agisse de charges exclusivement communales, comme les prestations en nature. 2 Ceux qui sont secourus par les bureaux de bienfaisance ; il suffit que le secours existe au moment de l'lection. e) Fait d'tre domestique exclusivement attach la personne. Toutes nos lois municipales, depuis celle du 22 dcembre 1789, ont
124
LES DROITSPOLITIQUES
contenu une disposition analogue; mais celle du5 avril 1884, art. 32 l'a mieux prcise. Elle a ajout le mot : exclusivement. On n'a jamais considr comme inligibles les rgisseurs, intendants, contrematres, prcepteurs, secrtaires, etc. Cette cause d'inligibilit n'existe que pour les lections municipales. f) Fonctions publiques. L'inligibilit rsultant de la fonction peut tre de deux sortes: Elle peut tre absolue, c'est--dire rendre le fonctionnaire inligible dans toutes les circonscriptions; elle peut tre simplement relative, c'est--dire rendre le fonctionnaire inligible seulement dans la circonscription o il exerce sa fonction. I. Inligibilit absolue rsultant dela fonctionou qualit. Il n'y a qu'un cas d'inligibilit absolue de cette espce, c'est celle qui rsulte de la qualit de militaire en activit de service. Elle a pour but d'carter la politique de l'arme, elle est corrlative l'impossibilit de voter que nous avons vue plus haut(p. 121). Cette cause d'inligibilit existe actuellement pour toutes les lections : pour la Chambre des dputs (L. 30 novembre 1875, art. 7) ; pour le Snat (L. 9 dcembre 1884, art. 5), mmes dispositions, sauf que sont excepts les marchaux de France et les amiraux ; pour le conseil municipal (L. 5 avril 1884, art. 31). Parune vritable incohrence, la cause d'inligibilit n'existait pas pour les lections au conseil gnral et au conseil d'arrondissement, il n'existait qu'une inligibilit relative l'gard de certains officiers gnraux; mais l'inligibilit absolue a t introduite par une loi du 23 juillet 1891. L'incapacit ne frappe que les militaires en activit deservice; par consquent, elle ne frappe ni ceux qui sont dans la rserve ni ceux qui sont dans la territoriale. Elle ne frappe pas non plus les officiers placs dans la seconde section du cadre de l'tat-major gnral, ni ceux qui ont cess d'tre employs activement tout en tant maintenus dans la premire section ; ni les officiers renpour avoir command en chef devant l'ennemi voys dans leurs foyers en attendant la liquidation laquelle ils ont droit acquis. Elle frappe les militaires en disponibilit ou en non-activit. II. Inligibilit relative rsultant de la fonction ou qualit. Elle a pour raison d'tre la crainte des abus d'autorit qui pourraient vicier l'lection. Cette matire de l'inligibilit relative se trouve dissmi: Pour le Snat, loi du 2 aot 1875, art. ne dans les textes suivants 21; pour la Chambre des dputs, loi du 30 novembre 1875, art. 12; pour les conseils gnraux, loi du 10 aot 1871, art. 8; pour les conseils d'arrondissement, loi du 22 juin 1833, art. 5, et dcret du 9 juillet 1848 combins; pour les conseils municipaux, loi du5 avril 1884,
LE DROITDE SUFFRAGE
125
art. 33. Du rapprochement de ces textes qui, jusqu' prsent, semble m'avoir pas t fait, il rsulte des incohrences fcheuses; la loi du 23 juillet 1891 en a fait disparatre quelques-unes, mais seulement pour les lections au conseil gnral et au conseil d'arrondissement, et encore pas toutes; la matire aurait videmment besoin d'une refonte lgislative. En attendant, l'interprte est li par les textes, car les incapacits sont de droit troit. Il n'est cependant pas impossible d'indiquer quelques lignes gnrales. Il faut partir de cette ide trs simple qu'un fonctionnaire ne doit pas pouvoir tre lu dans une circonscription, lorsque sa fonction lui donne autorit sur les lecteurs de cette circonscription. Seulement on ne considre en gnral la fonction comme dangereuse que lorsqu'elle donne autorit sur tous les lecteurs de la circonscription lectorale, non pas lorsqu'elle donne autorit seulement sur une partie. Ainsi, les fonctionnaires chargs de services rgionaux ou dpartementaux sont inligibles dans les lections dont les dpartements et arrondissements de leur ressort constituent les circonscriptions lectorales; les fonctionnaires communaux sont inligibles dans la commune; mais les fonctionnaires communaux ne sont pas inligibles dans les lections dont le dpartement ou l'arrondissement sont les circonscriptions lectorales. On ne considre pas non plus la qualit du fonctionnaire comme dangereuse, lorsqu'un grand fonctionnaire se prsente une lection de petite importance comme une lection municipale ; nombre de fonctionnaires rgionaux ou dpartementaux ne sont pas inligibles au conseil municipal dans leur ressort. Enfin, il ya une diffrence noter entre l'effet de la fonction quand il s'agit d'lections la Chambre des dputs ou au Snat, et son effet dans les lections dpartementales ou communales. Dans le premier cas, l'inligibilit se prolonge pendant six mois au del de la cessation de la fonction (L. 2 aot 1875, art. 21 ; L. 30 novembre 1875, art. 12); dans le second cas, elle cesse avec la fonction. 1 Fonctionnaires rgionaux. Les fonctionnaires rgionaux sont ceux qui ont autorit sur plusieurs dpartements; il y en a aussi dans les colonies. Rigoureusement, ces fonctionnaires devraient tre inligibles toutes les lections, quelles qu'elles soient, faites dans la rgion; on verra qu'il y a quelques exceptions : Archevque : inligibilit universelle, except pour conseil d'arrondissement. Premier prsident de cour : d'appel, prsidents de chambres, membres des parquets des cours d'appel inligibilit universelle depuis la loi du 23 juillet 1891 ; avant, le premier prsident et les prsidents de chambre n'taient pas inligibles au conseil gnral ni au conseil d'arrondissement, et les membres du parquet
126
LES DROITS POLITIQUES
n'taient pas inligibles au conseil d'arrondissement. Recteurs d'acadmie : inligibilit universelle, sauf pour conseils d'arrondissement et conseils municipaux, car dans ce dernier cas on ne peut pas les comprendre sous l'expression instituteurs publics de l'art. 33, n 6, L. 5 avril : inligibilit universelle. 1884, Conservateurs et inspecteurs des forts Ingnieurs des mines : inligibles au conseil gnral seulement. 2 Fonctionnaires dpartementaux ou coloniaux. Prfets, sous-prfets, secrtaires gnraux, conseillers de prfectures ; gouverneurs, directeurs de l'intrieur et secrtaires gnraux des colonies : inligibilit universelle. Notez que les sous-prfets sont inligibles dans tout le dpartement, bien qu'ils n'exercent que dans un arrondissement, ils sont identifis avec le prfet. Les membres du conseil priv dans les colonies sont inligibles aux fonctions municipales. Inspecteurs d'acadmie : inligibilit universelle, sauf conseil d'arrondissement et conseil municipal. vques et vicaires gnraux : inligibilit absolue, sauf pour conseil d'arrondissement. Ingnieurs dpartementaux : inligibilit universelle. Agents : inligibles au Snat, la Chambre des dputs et au voyers en chef conseil municipal. Directeurs des contributions directes et indirectes, de l'enregistrement et des domaines, des postes, trsoriers-payeurs gnraux : inligibilit universelle, sauf lection municipale. Directeurs de : inligibles au conseil gnral. Employs de prmanufactures de tabac fecture et sous-prfecture : inligibles aux lections communales et au conseil d'arrondissement. 3 Fonctionnaires d'arrondissement. Les prsidents, vice-prsidents, juges titulaires, juges d'instruction et membres du parquet des tribunaux : inligibilit universelle, sauf pour le conseild'arronde premire instance dissement1. Les inspecteurs de l'enseignement primaire : inligibilit universelle, sauf pour conseil d'arrondissement et conseil municipal. Les Lesagents voyers: ingnieursd'arrondissement : inligibilit universelle. inligibilit universelle, sauf au conseil gnral et au conseil d'arrondissement. Receveurs particuliers des finances, agents de tous ordres employs l'assiette, la perception et au recouvrement des contributions directes ou indirectes et au paiement des dpenses publiques de toute nature : inligibilit universelle, sauf pour conseil municipal. Vrifica: inligibilit au conseil gnral seulement. teur des poids et mesures 4 Fonctionnaires cantonaux. En principe, il n'y a pour eux inligibilit ni la Chambre ni au Snat. Juges de paix (l'incapacit ne frappe pas les supplants) : inligibles seulement au conseil gnral et aux lections communales2. Commissaires de police et agents de police : ne sont inMinistres des difligibles qu'au conseil-gnral et au conseil municipal. : inligibles au conseil gnral seulement. Les agents frents cultes 1. Le projet de loi du 23 juillet 1891tablissait l'inligibilit. Cette disposition n'a pas t vote 2. Le projet de loi du 23 juillet1891 les rendait inligibles au conseild'arrondissement. Cette dispositionn'a pas t vote.
LE DROITDE SUFFRAGE
127
voyers : inligibles au conseil municipal seulement. Les agents des eaux Les agents d'assiet Le et forts : inligibles au conseil gnral seulement. de perception ou de recouvrement des impts directs ou indirects, per: inligibles au conseil cepteur, contrleur, employs des droits runis gnral et au conseil d'arrondissement seulement, avec cette observation que le percepteur est inligible au conseil municipal dans les communes o il fait fonction de receveur municipal. 5 Fonctionnaires communaux. Ils sont inligibles seulement aux lections communales. Ministres des cultes. Instituteurs publics. Comptables des deniers communaux. Agents salaris dela commune, parmi lesquels ne sont pas compris ceux qui, tant fonctionnaires publics ou exerant une profession indpendante, ne reoivent une indemnit de la commune qu' raison des services qu'ils lui rendent dans l'exercice de cette profession : mdecins, avous, avocats, architectes de la commune; il y avait discussion avant la loi de 1884 (Art. 33 in fine). Appendice. L'incompatibilit 31. L'incompatibilt doit tre rapproche de l'inligibilit. L'incompatibilit est l'incapacit, non pas d'tre lu, mais de consi une certaine situation de fait server le mandat aprsl'lection, est maintenue. C'est donc, en un certain sens, une incapacit par privation de l'exercice du droit, et ce point de vue il y a grande parent avec l'inligibilit. Cette parent est tellement grande que le mme fait est envisag par la loi tantt comme inligibilit, tantt comme incompatibilit; ainsi le fait d'tre employ salari de la commune, est considr comme une cause d'inligibilit par la loi municipale, tandis que le fait d'tre employ salari du dpartement n'est envisag par la loi dpartementale que comme une cause d'incompatibilit avec le mandat de conseiller gnral. Mais, en revanche, l'incompatibilit diffre de l'inligibilit : 1 en ce qu'elle n'opre qu'aprs l'lection; elle n'empche pas d'tre lu; 2 en ce que au moment o elle opre, elle ne fait pas perdre de plein droit le mandat lectoral, elle fait cesser une situation de fait fcheuse, mais pas ncessairement par la perte du mandat. Ainsi, dans le cas spcial o l'incompatibilit rsulte d'une fonction publique, son effet est de mettre le fonctionnaire lu dans l'obligation d'opter dans un certain dlai entre son mandat et sa fonction. Les causes d'incompatibilit sont les suivantes : cumul du mandat lectif avec une fonction publique ; rela; cumul de mandats lectifs tions de parent ou d'alliance entre plusieurs co-lus. 32. A. Cumul du mandat lectif avec une fonction
128
LES DROITSPOLITIQUES
On a vu plus haut que la fonction publique est parfois publique. une cause d'inligibilit. Dans le cas o le fonctionnaire n'est pas inligible, il peut se faire qu'une fois lu il ne puisse conserver la fois sa fonction et son mandat, qu'il y ait incompatibilit. L'incompatibilit entre la fonction publique et le mandat lectif parat fonde sur le manque d'indpendance du fonctionnaire. Il est remarquer en effet : 1 que l'incompatibilit n'existe que dans le cas de fonction salarie, non point dans celui de fonction gratuite, le salaire augmente la dpendance (L. 30 novembre 1875, art. 8; L. 10 aot 1871, art. 10) ; 2 que l'incompatibilit n'existe en principe qu'entre la fontion d'tat et le mandat aux assembles lectives d'tat, entre la fonction dpartementale et le mandat aux assembles lectives dpartementales (conseil gnral et d'arrondissement); parce qu'en effet la dpendance du fonctionnaire d'tat n'existe point hors de l'tat ni celle du fonctionnaire dpartemental hors du dpartement. Cependant, les prfets, sous-prfets, secrtaires gnraux, conseillers de prfecture, commissaires de police, agents de police, tant des fonctionnaires de l'tat particulirement dpendants, leur fonction est incompatible mme avec des mandats lectifs dpartementaux et 3 que, par exception, certaines fonctions sont compacommunaux ; tibles avec le mandat lectif parce qu'elles prsentent des garanties spciales d'indpendance (V. infr,art. 8 et 9, L. 30 novembre 1875). a) lections d'tat. Chambredes dputs. La matire est rgle par la loi du 30 novembre 1875, art. 8-11. Le principe est l'incompatibilit entre le mandat de dput et l'exercice de toute fonction publique rtribue sur les fonds de l'tat, mais il faut tenir compte des deux obser: vations suivantes 1 Par exception, il y a des fonctions compatibles,ce sont celles de : ministre, sous-secrtaire d'Etat, ambassadeur, ministre plni prfet de police, premier prsipotentiaire, prfet de la Seine, dent la cour de cassation, premier prsident de la cour des comptes, premier prsident de la cour d'appel de Paris, archevque et vque, pasteur prsident de consistoire dans les circonscriptions dont le chef-lieu compte deux pasteurs et au-dessus, grand rabbin du consistoire central, grand rabbin du consistoire de Paris, professeur titulaire de chaire donne au concours ou sur la prsentation des corps o la vacance s'est produite (art. 8 et 9, L. 30 novembre 1875). 2 Il ne faut pas confondre avec la fonction publique la mission temporaire mme rtribue; cette mission est compatible avec le mandat de (art. 9). dput, la condition cependant de ne pas dpasser six mois L'incompatibilit opre de deux faons diffrentes suivant qu'il s'agit d'un fonctionnaire qui devient dput, ou bien, au contraire, d'un dput qui devient fonctionnaire.
LE DROITDE SUFFRAGE
129
S'ils'agit d'un fonctionnaire qui devient dput, ce qui suppose qu'il tait ligible,l'lu doit faire connatre son option dans les huitjours qui suivent la vrification des pouvoirs. Sinon, il est prsum accepter le mandat lectoral et il est remplac dans sa fonction. La question de savoir comment il pourra tre remis en activit l'expiration de son mandat, et comment sont conservs ses droits la retraite, est rgle l'art. 10. S'il s'agit, au contraire, d'un dput nomm ou promu une fonction publique salarie, ce reprsentant cesse d'appartenir la Chambre du jour de son acceptation et cela est vrai alors mme que la fonction serait compatible. Seulement, dans ce dernier cas, le dput nomm fonctionnaire peut se reprsenter devant les lecteurs et tre valablement rlu (art. 11). Les dputs nomms ministres ou sous-secrtaires d'tat ne sont pas soumis la rlection (art. 11). Tout dput qui, au cours de son mandat, accepterait les fonctions d'administrateur d'une compagnie de chemin de fer, serait, par ce seul fait, considr comme dmissionnaire et soumis la rlection (L. 20 nov. 1883. Voyez aussi L. 25 juin 1883). Snat. La situation au Snat, au point de vue des incompatibilits, est depuis longtemps provisoire. On attend une loi gnrale sur les incompatibilits parlementaires. En attendant, aprs tre parti de l'ide que les incompatibilits devaient tre restreintes, on s'est rapproch du systme de la Chambre par des lois transitoires dont la dernire est en date du 26 dcembre 1887. Cette loi dclare applicables les articles 8 et 9 de la loi du 30 novembre 1875. Par consquent, la rgle est l'incompatibilit de toute fonction salarie sur les fonds de l'tat, et les exceptions sont indiques plus haut. Seulement, comme l'article 11 n'a pas t dclar applicable, il en faut conclure que lorsqu'un snateur est nomm une fonction compatible, il n'est pas, comme le dput, tenu de se reprsenter devant ses lecteurs. Les snateurs sont dans la mme situation que les dputs au sujet des fonctions d'administrateur d'une compagnie de chemin defer (L. 20nov. 1883), dmissionnaires et soumis rlection. aux assembleslocales. Il y a des incompatibilit absolues, b) lections c'est--dire s'appliquant toutes les circonscriptions de France, elles sont en principe les mmes pour le conseil gnral, le conseil d'arrondissement et le conseil municipal; elles concernent les fonctions de prfet, sous-prfet, secrtaire gnral, conseiller de prfecture, commissaire de police et agent de police. Il faut ajouter, au moins pour le conseil municipal, les fonctions de gouverneur, directeur de l'intrieur et membre du conseil priv des colonies (L. 10 aot1871, art. 9; L. 22 juin 1833, art. 5, et D. 3juillet 1848, art. 14; L. 5 avril 1884, art. 34). Il y a aussi des incompatibilits relatives, c'est--dire restreintes une seule circonscription, mais seulement en matire d'lection au conseil gnral dans le cas d'agents salaris ou subventionns sur les fonds dpartementaux et dans le cas d'entrepreneurs de services dpartementaux. H. 9
130
LES DROITS POLITIQUES
(L. 10 aot 1871, art. 10); et aussi en matire d'lection au conseil d'arrondissement en cas d'ingnieurs des ponts et chausses, d'architectes du dpartement, d'agents forestiers (L. 22 juin 1833, art. 5). Pour le conseil municipal, il n'y a point d'incompatibilit relative rsultant de fontions communales ou d'entreprises, pour la bonne raison que ces faits constituent des cas d'inligibilit (V. p. 127). Quant l'effet de l'incompatibilit dans les assembles locales, il faut distinguer: 1 S'il s'agit d'un fonctionnaire qui est lu, la loi municipale seule prvoit la solution : dans un dlai de 10 jours partir de la proclamation du rsultat de l'lection, l'lu doit faire son option. S'il garde le silence, par une prsomption inverse de celle qui existe pour la Chambre des d; il est alors puts, il est cns opter pour la conservation de son emploi dclar dmissionnaire de son mandat par le prfet (art. 34 et 36, L. 5 avril 1884). La loi du 10 aot 1871 ne prvoit pas de dlai d'option, ni d'autorit qui puisse dclarer l'lu dmissionnaire; en fait, il semble rsulter de plusieurs dcisions du conseil d'tat, que celui-ci est dispos lorsqu'il est saisi du contentieux d'une lection dpartementale considrer les cas d'incompatibilit comme des cas d'inligibilit viciant l'lection (Cons. d't., 3 dcembre 1886; 1er avril 1887). 2 S'il s'agit d'un conseiller gnral ou d'un conseiller municipal nomm : aprs son acceptation aprs coup une fonction publique incompatible il doit tre dclar dmissionnaire de son mandat, le conseiller gnral par le conseil gnral lui-mme (art. 18, L. 10 aot 1871), le conseiller municipal par le prfet, sauf recours (art. 36, L. 5 avril 1884). 33. B. Cumul de mandats lectifs. Le cumul des man: nul ne peut tre dats lectifs similaires est impossible. Ainsi membre de plusieurs conseils gnraux (L. 1871, art. 11) ; nul ne peut tre membre de plusieurs conseils d'arrondissement (L. 22 juin 1833, art. 14); nul ne peut tre membre de plusieurs conseils municipaux (L. 1884 art. 35). Il y a un dlai pour l'option. La raison, c'est que les sessions de tous ces conseils de mme ordre, sont simultanes et que le conseiller n'aurait pas le don d'ubiquit. Nul ne peut tre la fois snateur et dput. La raison ici est dans le principe constitutionnel de la dualit des chambres, il n'y aurait tait le des membres si le deux chambres ralit en personnel pas mme dans les deux. Mais le cumul des mandats lectifs non similaires est possible, sauf pour le conseil gnral et le conseil d'arrondissement (L. 12. munifois conseiller la on tre ainsi art. peut 1833, 14) ; juin cipal, conseiller gnral et dput. On a demand assez frquemment que des incompatibilits fussent cres, mais l personnel politique est assez nombreux.
LE DROIT DE SUFFRAGE
131
ou alliance entre plusieurs 34. Parent co-lus. Cette cause d'incompatibilit est spciale aux conseils municipaux, et encore elle ne s'applique que dans les communes de plus de cinq cents habitants. Les ascendants et les descendants, les frres et allis au mme degr, ne peuvent tre simultanment membres du mme conseil municipal. On procde l'limination d'aprs l'ordre du tableau art. 35 infine, L.5 avril 1884). 3 Conditions d'exercice du droit d'ligibilit. 35. Les conditions d'exercice du droit d'ligibilit s'apprcient, bien entendu, uniquement au moment de l'lection; leur absence entrane nullit de celle-ci. Pour le mandat de snateur, il n'y a pas de condition particulire d'ligibilit. Par cela seul qu'on a la jouissance du droit de suffrage, et qu'on n'est frapp d'aucune des incapacits que nous venons d'tudier, on est ligible. Pas n'est besoin, par exemple, d'tre inscrit sur une liste lectorale quelconque, ni d'avoir des attaches de domicile ou autres avec la circonscription. Le suffrage pour ces grandes lections va chercher son candidat o il lui plat. Il en est de mme, en principe, pour le mandat de dput ; cependant ici la loi du 17 juillet 1889 a introduit une condition d'exercice, la dclaration de candidature, dclaration qui doit tre faite le cinquime jour au plus tard avant le jour du scrutin, et qui ne peut valablement tre faite que dans une seule circonscription ; dfaut, les bulletins n'entrent pas en compte, par consquent l'lection est nulle. Nous tudierons la dclaration de candidature propos de l'lection(n 110). Pour les lections locales, la lgislation est plus svre, il y a quelques conditions d'ligibilit. Les conditions sont en principe les mmes pour le conseil gnral (L. 10 aot 1871, art. 6) et, pour le conseil d'arrondissement (D. juillet 1848, art. 14), il ya deux conditions cumules: 1 tre inscrit sur une liste d'lecteurs, n'importe o, ou justifier qu'on devait y tre inscrit avant le jour de l'lection; 2 Avoir une attache lgale avec le dpartement pour le conseil gnral, avec l'arrondissement pour le conseil d'arrondissement. Cette attache est tablie : soit par le domicile, soit par l'inscription au rle d'une des contributions directes au 1er janvier de l'anne dans laquelle se fait l'lection, ou justification qu'on devait y tre inscrit; soit par l'hritage depuis le 1erjanvier d'une proprit foncire dans le dpar-
132
LES DROITS POLITIQUES
tement (cette cause n'existe pas pour le conseil d'arrondissement). Toutefois, le nombre des conseillers gnraux non domicilis ne pourra pas dpasser le quart du nombre total dont le conseil doit tre compos, sinon limination par voie de tirage au sort. Cette dernire rgle n'existe pas pour le conseil d'arrondissement. Pour rgles; mune; conque le conseil municipal, il et t simple d'admettre les mmes cependant on n'exige plus que le fait de l'attache la compas n'est besoin d'tre inscrit sur une liste lectorale quel(art. 31, L. 1884, arg. mot citoyen, au lieu d'lecteur).
L'attache rsulte : soit du fait de l'inscription sur la liste lectorale; soit de l'inscription au rle d'une des quatre contributions directes, ou de la justification que cette inscription devait tre faite au 1er janvier de l'anne de l'lection. Rien pour l'hritage. Les conseillers non domicilis ne doivent pas dpasser le quart; l'limination se fait suivant l'ordre du tableau (art. 31, 2, et art. 49).
CHAPITRE LES LIBERTS
II
SECTIONPREMIRE.- LIBERTDE L'TRE LIBERTDE CONSCIENCE DE L'TREMORAL. 1er. LIBERT 36. La libert de conscience contient deux liberts, celle de la foi et celle de la science. La foi et la science tant les deux modes de la connaissance, c'est avec leur aide que l'homme travaille la constitution de son tre moral. On comprend, ds lors, l'importance, le prix inestimable de la libert de conscience. 37. Libert de la foi. La libert de lafoi a un sens double: un sens positif d'abord, on peut croire librement tel dogme dtermin, quel qu'il soit; puis, un sens ngatif, on peut ne croire aucun des dogmes connus. En somme, la loi protge impartialement la libre croyance et la libre pense. A. Libre croyance. Il s'agit de la croyance intime et non pas du culte public; nous rencontrerons plus loin la question de la libert du culte public: Nul ne peut tre inquit pour ses opinions mme religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public tabli par la loi , dit la dclaration des Droits de l'homme, art. 10. C'tait un progrs bien nouveau. Outre la suppression des perscutions proprement dites, cela a eu deux consquences: 1 L'galit de tous les religionnaires au point de vue des droits privs, et notamment au point de vue de l'tat civil, ce qui a entran la scularisation de l'tat civil et du mariage. (Constitution du 2 septembre 1791,titre II, art. 7). Un dit du 17 novembre 1787 avait dj restitu aux protestants l'tat civil que la rvocation de l'dit de Nantes leur avait enlev, mais cet dit laissait aux ministres du culte la tenue des registres de l'tat civil et conservait au mariage son caractre de sacrement, ce qui tait encore une source de difficults et de conflits; 2 L'galit de tous les religionnaires au point de vue des droits
134
LES LIBERTS
publics, l'gale admission aux emplois et aux fonctions publiques; l'dit de rparation de 1787 n'tait pas all jusque-l. B. Libre pense. On peut rattacher cette ide deux principes qui sont relativement rcents : 1 Le principe de l'instruction laque dans les coles de l'tat, par respect de la libert de ceux des enfants qui ne sont d'aucune confession (L. du 28 mars 1882, art. 1er : l'enseignement religieux n'est pas donn l'cole; L. du 30 octobre 1886, art. 17 : le personnel est laque); 2 Le principe de la libert des funrailles pos par la loi du 17 novembre 1887. On est libre de se faire faire les funrailles que l'on veut, civiles ou religieuses ; ds que l'on a la capacit de tester, on fait connatre sa volont cet gard en la forme testamentaire. Si des difficults sont souleves sur l'interprtation de cet acte de dernire volont, il est statu dans le jour par le juge de paix du lieu du dcs, sauf appel devant le prsident du tribunal civil qui doit statuer dans les vingt-quatre heures (le tout sans prjudice des attributions des maires en ce qui concerne les mesures prendre dans l'intrt de la salubrit publique). Toute personne qui violera la libert du dfunt sera punie des peines ; portes aux art. 199 et 200 du Code pnal ; pour la premire fois, amende en cas de rcidive, prison. Les honneurs funbres dus par l'autorit publique seront rendus, sans distinguer entre les funrailles civiles et les funrailles religieuses. On peut y rattacher aussi la loi du 12 juillet 1880 abrogeant la loi du 18 novembre 1814 surle respect du dimanche. Ici encore, de la science. 38. Libert il y a un sens positif et un sens ngatif. Il y a la libert d'apprendre ce que l'on veut, et il y a aussi la libert de ne pas apprendre. A. Libert de ne pas apprendre. Cette libert n'est pas complte. Il n'y a pas libert de l'ignorance cause de l'obligation de l'instruction primaire. L'obligation a t dictepar la loi du 28 mars 1882; les enfants de six ans rvolus treize ans rvolus, garons et filles, doivent ou frquenter une cole publique ou libre, ou recevoir l'enseignement chez leurs parents. Le pre, la mre, le tuteur, toute personne qui a la garde de l'enfant, sont tenus de dclarer si l'enfant recevra l'instruction domicile ou s'il frquentera une cole, et quelle cole. A dfaut de dclaration, le maire dsigne l'cole publique o l'enfant devra tre envoy. L'enfant lev domicile doit, aprs deux ans, subir un examen, et si
LIBERTDE CONSCIENCE
135
l'examen est insuffisant, il est d'office envoy dans une cole primaire publique. Quant ceux qui frquentent une cole, la loi n'exige point que leurs tudes soient couronnes par un examen ou un certificat, elle n'exige que la prsence assidue jusqu' l'ge rglementaire. Il existe cependant un certificat d'tudes primaires qui permet aux enfants qui l'obtiennent d'abrger le temps d'tude; les enfants peuvent se prsenter partir de onze ans. Il y a dans la loi toute une organisation de formalits et de pnalits pour assurer l'observation de la rgle de l'obligation. Il y a bien longtemps que l'obligation de l'instruction primaire tait demande. La Rvolution avait pos le principe (Const. de 1793, art. 22). L'instruction est le besoin de tous, la socit doit favoriser de tout son pouvoir les progrs de la raison publique et mettre l'intruction la porte de tous les citoyens. Cette ide se justifie par des considrations dcisives: 1 C'est l'intrt de l'tat lui-mme. Au point de vue de l'organisation politique, notre socit repose sur la souverainet de l'individu, il faut que cette souverainet soit claire. Seulement, on doit ajouter que l'intrt de l'tat exigerait une ducation morale et civique obtenue par une sage pdagogie tout autant que l'instruction; 2 C'est l'intrt de l'enfant, et l'tat doit intervenir pour l'assister en ce point. Notre socit laisse en effet subsister en grande partie la libre concurrence, la lutte pour la vie; au moins faut-il que, dans cette lutte, les individus soient galement arms. C'est de ce sentiment que procdent non seulement l'obligation, mais la gratuit de l'instruction qui est une forme d'assistance; de par la loi de 1882 l'instruction est obligatoire et gratuite en mme temps que laque. Bien que l'obligation de l'instruction primaire se justifie facilement, cela n'empche pas certains esprits de lui tre hostiles; la plus grave objection est qu'elle renferme une atteinte la libert du pre de famille. Le pre de famille n'est plus juge de la question de savoir si l'instruction convient son enfant. Seulement il faut remarquer que nous nous trouvons l en prsence de deux intrts opposs : l'intrt du pre maintenir son autorit, l'intrt de l'enfant tre instruit; il faut choisir entre le pre et l'enfant. Cela devient une question de haute politique que de savoir si l'tat doit intervenir et en quel sens. Les droits du pre de famille cadrent avec une constitution aristocratique. Ils cadrent trs mal avec une constitution dmocratique comme l'est la ntre; la logique de la dmocratie est de donner la prfrence aux droits qui profitent au plus grand nombre, or le nombre est du ct des enfants.
136
LES LIBERTS
B. Libert d'apprendre. Cette libert est complte en thorie, mais, en fait, elle est limite par les examens d'tat qui prcdent la collation des grades et qui entranent des programmes prcis. DEL'TRE 2. LIBERT PHYSIQUE Sous cette rubrique se rangent: la libert civile, la sret et la libert individuelles, l'inviolabilit du domicile. 39. Libert civile. C'est la libert dela personne physique vis--vis des autres individus, telle qu'elle rsulte de la suppression de l'esclavage et du servage. Les derniers serfs ont t affranchis dans la nuit du 4 aot ; quant aux anciens esclaves provenant de la socit antique, il n'en restait plus depuis le XIIesicle. Mais il y a un esclavage moderne; il y a eu des esclaves, mme aprs la Rvolution, dans certaines colonies franaises. Cet esclavage a t abolie par le dcret du 27 avril 1848. A citer encore : l'interdiction de toute servitude personnelle rappelant la fodalit (art. 686 et 1780 C. civ.); la suppression des vux religieux perptuels en tant qu'ils entranaient obligation civile. 40. Sret dela personne phyProtection individuelle. sique contre l'arbitraire administratif en matire pnale. Cette protection rside dans l'intervention de la justice. L'ide gnrale, c'est que personne ne peut tre arrt ni dtenu que par ordre de l'autorit judiciaire, la condition de passer en ju: 1 pas gement rgulier et de n'tre frapp que de peines lgales. Donc de dtention arbitraire ou administrative; 2 pas de jugement irrgulier; 3 pas de condamnation sans loi. Tous ces points sont du domaine de l'instruction criminelle. Le principe de la sret individuelle a t viol plusieurs fois en France depuis qu'il avait t inscrit dans la dclaration des Droits de l'homme. On peut dire que tous les rgimes politiques qui se sont succd, jusque et y compris le Second Empire, ont se reprocher des lois de sret gnrale, qui suspendaient la garantie de la sret personnelle pour des catgories trs vagues de suspects, et permettaient de les frapper de peines purement administratives. (D. 17 sept. 1793; D. 3 mars 1810; 1. 26 mars 1820; l. 27 juin 1848; commissions mixtes de 1852; 1. 27 fv. 1858.) d'aller et de venir. individu elle ou libert 41. Libert Cette libert, trs voisine de la prcdente, ne se confond pas ce-
LIBERTINDIVIDUELLE
137
pendant avec elle, en ce sens qu'elle est seulement une sauvegarde de la libert des mouvements, tandis que la sret personnelle peut tre une sauvegarde de la vie. Elle est consacre dans le titre Ier de la constitution des 3-14 septembre 1791. Elle reoit un certain nombre d'exceptions : A. Exceptions spciales aux trangers : 1 Obligation d'tre muni d'un passeport, manant de l'autorit trangre et vis par un agent diplomatique ou un consul franais (D. 23 messidor an III; 1. 28 vendmiaire an VI); de nombreux traits diplomatiques sont intervenus avec diffrents pays pour dispenser leurs nationaux de cette formalit, charge de rciprocit ; 2 Droit d'expulsion administrative; l'tranger peut tre expuls du territoire. Il ne faut pas confondre cela avec l'extradition ; la diffrence est que l'tranger n'est pas livr son gouvernement, comme dans l'extradition. L'arrt d'expulsion est pris par le ministre de l'intrieur, sauf dans les dpartements frontires o il peut tre pris par le prfet. Pour l'tranger admis tablir son domicile en France, aux termes de l'art. 13 du Code civil, l'expulsion ne produit son effet que pendant deux mois ; si l'on veut obtenir plus, il faut faire rvoquer l'autorisation en prenant l'avis du Conseil d'tat. B. Exceptions communes aux nationaux et aux trangers : 1 Passeport l'intrieur. Cette obligation, qui rsulte du dcret du 18 septembre 1807, n'est pas applique. Pour les militaires, le passeport est remplac par la feuille de route. Pour les ouvriers, il tait remplac par le livret qui vient d'tre aboli (L. 2juill. 1890); 2 Dfenses relatives au costume. Il est dfendu de porter publiquement un costume, un uniforme, une dcoration auxquels on n'a pas droit. (C. P., art. 259); 3 Dfense du port des armes caches ou secrtes. Dclaration du 3 mars 1728 qui limite le droit deport d'arme; 4 Quarantaine rsultant des lois sur la police sanitaire (1.3 mars 1822; D. 29 fvrier 1876) ; 5 Internement dans un asile d'alins. Cette grave atteinte la libert individuelle est actuellement rgle par la loi du 30 juin 1838, dont la modification a t souvent demande en vue d'augmenter les garanties contre les internements arbitraires. L'administration a le droit de procder l'internement d'office en cas de folie furieuse; cette disposition semble ncessaire et doit tre maintenue. Mais la famille a le droit de faire procder l'internement en cas de folie douce, en vertu d'une procdure tout administrative. C'est l qu'est le grand vice de la lgislation; l'internement pour folie douce ne devrait tre prononc qu'aprs un dbat judiciaire. L'intress ne peut se dfendre efficacement qu'avant l'internement; aprs, toutes ses protestations sont rendues suspectes par la redoutable prsomption de la folie (disposition adopte dans une loi des Pays-Bas de 1882);
138
LES LIBERTS
6 Les personnes condamnes pour mendicit dans un lieu o il y a un dpt de mendicit peuvent, aprs l'expiration de leur peine, tre conduites dans ce dpt. (C. P., art. 274; L. 30 mai 1790. D. 5 juillet 1808) ; 7o En vertu de la loi du 27 mai 1885 sur les rcidivistes (art. 19), des interdictions de sjour peuvent tre signifies aux condamns librs. La surveillance de la haute police est supprime, ainsi que les interdictions de sjour spciales au dpartement de la Seine et l'agglomration lyonnaise rsultant de la loi du 9 juillet 1852. 4. Inviolabilit du domicile (art. 76, Const. 22 frimairean VIII, C. P., art. 184.). La maison de toute personne habitant le territoire franais est un asile inviolable; c'est une consquence de la scurit et de la libert individuelle. a) Pendant la nuit, nul n'a le droit d'y entrer qu'en cas d'incendie, d'inondation ou de requte venant de l'intrieur. b) Pendant le jour, on peut entrer pour un objet spcial dtermin par une-loi ou par un ordre man d'une autorit publique. Voici les principaux de ces objets : 1 Pour l'excution des lois de police et de sret et pour prvenir les infractions (L. 19 juill. 1791, art. 8); 2 pour les actes relatifs la recherche des crimes et des dlits ; en gnral, ce droit de perquisition appartient seulement au juge d'instruction, art. 87 et 88 du Code d'instruction criminelle; il s'tend cependant dans certaines hypothses au procureur de la Rpublique (art. 36) et mme aux gardes champtres et gardes forestiers; 3 pour l'excution des jugements ou des condamnations (art. 587 Proc. civile; 4 pour l'excution des lois sur les contributions publiques (L. 19 juill. 1791, art. 8). Lorsqu'il y a tat de sige, l'inviolabilit du domicile est suspendue, l'autorit militaire a le droit defaire des perquisitions de jour et de nuit (1. 9 aot 1849, art. 9). Observation. Lorsque le domicile d'un citoyen est un tablissement ouvert au public, comme un dbit de boisson par exemple, les reprsentants de la force publique ont le droit d'y pntrer librement jusqu'au moment de la fermeture. SOCIALE 3. LIBERTDE LA PERSONNALIT 43. La personnalit sociale se compose de la filiation, du nom et des titres honorifiques. Les individus ont trs peu de libert ce point de vue. 1 Au point de vue de la filiation, l'absence de libert rsulte de la force des choses. La filiation est un fait brutal qu'on ne peut point
LIBERTDU TRAVAIL
139
changer. La socit pourrait ne pas le faire constater, mais elle le fait dans un but d'ordre et dans l'intrt des individus eux-mmes. 2 Le nom, qui se compose du nom proprement dit et du prnom, n'tant qu'un signe, on comprend qu'il soit possible thoriquement d'en changer ou d'en prendre sa fantaisie, en respectant bien entendu le nom d'autrui. Mais le nom est le signe de la filiation, c'est une raison pour que la socit intervienne. Aussi, le changement de nom est une faveur qu'il faut demander au gouvernement. (V. L. 11 germinal an XI). 3 Le titre nobiliaire, titre de duc, marquis, baron, qu'il ne faut pas confondre avec la particule, laquelle n'est qu'un nom, n'a plus de valeur lgale. Mais il a toujours une valeur sociale, et il est dfendu de s'en affubler sans droit (art. 259 C. P.). Cependant, il a t dpos des projets de loi rcents pour l'abolition de cette disposition. II. LIBRE ACTIVIT SECTION PARL'HOMME SUR LA NATURE,LIBERTDU EXERCE 1. ACTION ET DUCOMMERCE DE L'INDUSTRIE TRAVAIL, 44. Cette libert n'a t spcialement consacre par les lois rvolutionnaires qu' propos de l'activit industrielle, par l'abolition des matrises et jurandes, mais elle procde de la libert gnrale reconnue l'homme par la Dclaration des droits, art. 4, en ces termes : La libert consiste pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas autrui . Nous signalons simplement les dispositions lgislatives diverses qui apportent des restrictions cette libert. A. Agriculture. 1Lgislation sur la culture du tabac (D. 29 dcembre 1810; rgl. 12 janvier 1811; L. 28 avril 1816; L. 12 fvrier 1835 L. 21 dcembre 1872). 2 Sur le dfrichement des bois (art. 219 et suiv. C. forestier). 3 Sur le reboisement et le gazonnement des montagnes (L. 4 avril 1882). 4 Sur les bans de vendange dans les communes o ils auront t maintenus (L. 9 juillet 1889, art. 13). B. Industrie extractive. 1 Lgislation des mines (L. 21 avril 1810 revise par la L. 27 juillet 1880; L. 27 avril 1838). 2 Celle des carrires ou minires ciel ouvert (L. 27 juillet 1880; D. 12 fvrier 1892). 3 Celle des eaux minrales (L. 14 juillet 1856). 4 Celle de la chasse et de la pche. La chasse et la pche sont libres, sauf rglements de police et paie-
140
LES LIBERTS
ment d'un permis pour la chasse. Toutefois le prfet peut refuser les permis de chasse certains individus, ceux qui ont subi certaines condamnations et ceux qui ne sont point inscrits au rle des contributions. Il faut remarquer aussi, pour la pche, qu'elle n'est libre que sur les cours d'eau non navigables ni flottables ; sur les cours d'eau navigables ou flottables elle est afferme par l'tat, et sur mer, elle estle privilge des inscrits maritimes. (Chasse, L. 3 mai 1844, L. 22 janvier 1874; Pche fluviale, L. 15 avril 1829; Ordonn. 15 novembre 1830; L. 6 juin 1840; D. 10 aot 1875; D. 18 mai 1878.) C. Industrie commerciale. 1 Lgislation sur certains monopoles, tabacs, cartes jouer, allumettes chimiques, postes et tlgraphes, chemins de fer et tramways. 2 Lgislation exigeant l'autorisation administrative pour certains commerces, comme pour les bureaux de placement (D. 25 mars 1852), comme pour les dbits de boisson avant la loi du 17 juillet 1880. 3 Lgislation sur la taxe municipale du pain et de la viande. (L. 17-22 juillet 1791, tit. Ier, art. 30.) 4 Lgislation sur les marques de fabrique et de commerce, imposes certains produits. (L.23 juin 1857). E. Industrie manufacturire. C'est ici qu'il faut rappeler l'uvre de la Rvolution qui a aboli les matrises et jurandes o tait emmaillotte la libert du travail. Les matrises et jurandes taient des corporations d'artisans du mme mtier et de la mme ville. Il fallait distinguer dans les corporations le maitre ou patron, l'ouvrier ou compagnon, et enfin l'apprenti. 1 On n'tait pas libre de se faire patron ni ouvrier ni apprenti; il y avait des rgles sur la matrise, le compagnonnage, et l'apprentissage, il n'y avait qu'un certain nombre de matres, les annes d'apprentissage, le nombre des apprentis taient svrement fixs. 2 On n'tait pas libre dans les procds de travail; des rglements svres dcourageaient les perfectionnements et tuaient les inventions; il est vrai qu'ils taient une garantie pour la bonne qualit de la fabrication. 3 On n'tait pas libre non plus dans le dbat du salaire fix par la coutume, et d'ailleurs la matrise tait un vrai syndicat de patrons ; pour se dfendre les ouvriers avaient form des associations de compagnonnage. Turgot, dans son clbre dit de fvrier 1776, avait essay de dtruire ces redoutables matrises et jurandes. L'dit ne fut enregistr par le Parlement qu'aprs un lit de justice; il ne s'excuta pas, Turgot tombait et il tait rapport le 5 aot suivant. C'est la loi des 2-17 mars 1791 qui posa le principe de la libert en mme temps que celui de la patente. : Il y eut dsormais libert aux trois points de vue o il y avait servitude libert de s'installer au travail, libert dans les procds de travail, libert dans la fixation du salaire dans le contrat de louage. I. La libert pour l'installation au travail et pour les procds de fa-
LIBERTDU TRAVAIL
141
brication est demeure peu prs complte. On peut signaler seulement comme restrictions: 1 Les monopoles qui empchent les individus d'exercer certaines industries : tabacs, poudres, allumettes chimiques, papier timbr, etc. A noter les lois du 14 juillet 1860 et du 14 aot 1885 qui tablissent la libert de la fabrication et du commerce des armes de guerre, et celle du 8 mars 1875 qui permet la fabrication de la dynamite et de la nitroglycrine moyennant autorisation. 2 La lgislation sur les ateliers dangereux ; l'exploitation des ateliers dangereux, insalubres, ou incommodes est soumise la ncessit d'une autorisation et une rglementation svre (D. 15 oct. 1810). La fabrication, l'emmagasinage et la vente du ptrole et de ses drivs sont rglements aussi (D. 19 mai 1873). 3 La lgislation sur les machines vapeur. (Loi du22juill. 1856; Dcret du 25 janv. 1865; D. 30 avr. 1880.) 4 Les rglements de police auxquels sont assujettis certains mtiers, comme ceux d'armuriers, de fabricants d'objets d'or et d'argent, etc., par suite de la ncessit du poinonnage des produits par l'tat. La boucherie est libre depuis le dcret du 24 fvrier 1858, la boulangerie depuis le dcret du 22 janvier 1863. II. La libert dans le dbat du contrat de louage entre patrons et ouvriers a reu de plus graves atteintes, ou tout au moins de plus grandes modifications. : 1 On tait parti On avait t, la Rvolution, individualiste l'excs de cette ide que le. contrat de louage entrane un dbat purement individuel entre chaque patron et chaque ouvrier, et que les deux parties sont sur pied d'galit ; c'tait inexact, parce que le patron, arm de ses capitaux, possde lui tout seul autant de force que la masse de ses ouvriers; d'ailleurs, le dveloppement des socits anonymes devait bientt remplacer beaucoup de patrons par des compagnies. 2 On estimait en outre que l'ouvrier engage uniquement son travail, et que le patron lui doit uniquement le salaire dtermin par la loi de l'offre et de la demande; c'tait inexact, en ralit, raison du travail assujettissant et des risques de ce travail, l'ouvrier fait dpt entre les mains du patron de son corps et presque de son me, de telle sorte que cela impose au patron des obligations accessoires relatives aux accidents physiques et aux dsordres moraux. En vue d'assurer le respect de cette conception troite du contrat de louage industriel, et pour viter toute action collective des patrons ou des ouvriers, on avait inscrit dans le Code pnal deux prohibitions : celle de la coalition et de la grve (art. 414 et 415) et celle de l'association permanente entre patrons ou entre ouvriers (art. 416). Ce rgime fut vraiment dur pour l'ouvrier; protg autrefois tant bien que mal par les vieux usages de fraternit qui subsistaient dans les matrises et jurandes, il se trouva subitement isol et fut cras dans le contrat de louage. Cela concida justement avec la dcouverte de la ma-
142
LES LIBERTS
chine vapenr et le dveloppement de la grande industrie, qui des accumulations normes d'ouvriers sur les mmes points.amenrent Par une imprvoyance cruelle, les industriels laissrent ces hommes sans protection contre tous les vices qui naissent de la promiscuit, de l'extrme lassitude physique et de l'ignorance. Cela entrana la formation d'une ; classe que les souffrances aigrirent, et quis'appella elle-mme-quatrime tat. Depuis quelques annes dj, heureusement, on a pris conscience de ce qu'il y avait d'inj ustice dans cet tat de choses et on s'est efforc de ragir. D'abord des patrons nombreux se sont proccups spontanment du sort matriel et moral de leurs ouvriers; il a t organis des logements ouvriers, des caisses de retraite, des conomats, des coles d'enfants et d'adultes, des crches, etc. De plus, l'tat est intervenu par sa lgislation. On a commenc par abroger les dispositions pnales qui interdisaient la grve et l'association, de faon restituer au dbat du contrat de louage industriel son vrai caractre, qui est d'tre un dbat collectif (L. 25 mai 1864, libert de la grve; L. 21 mars 1884, libert des syndicats professionnels). Les ouvriers peuvent ainsi opposer la force du nombre celle des capitaux. On semble dispos aller plus loin et assister les ouvriers par des mesures lgislatives dans une interprtation de plus en plus large du contrat de louage. A cet ordre d'ides se rattachent: 1 La loi du 19 mai 1874 sur le travail des enfants et des filles mineures dans l'industrie, imposant une limitation des heures de travail. 2 La loi du 16 fvrier 1883 rappelant celle du 9 septembre 1848, qui limite la journe de travail des adultes douze heures. 3 La loi du 2 juillet 1890 abrogeant le livret d'ouvrier. 4 Les projets de loi sur la responsabilit des patrons en cas d'accident, qui devraient partir franchement de cette ide que la responsabilit du patron est contractuelle, et que par suite c'est lui prouver qu'il n'est pas en faute ; sur ; sur la caisse de retraite des invalides du travail les agents commissionns des chemins de fer, etc. SUR SES SEMBLABLES PAR L'HOMME EXERCE 2. ACTION 45. Un homme peut exercer une action sur d'autres hommes, et cela de diverses faons : par le simple ascendant moral, dans les relations de famille ou dans des runions ; par la clbration du culte en commun; par la manifestation de la pense opre par la parole ou par l'criture; par l'enseignement. Cette action est d'importance capitale et doit tre surveille par l'tat, car c'est l'impulsion donne la masse hsitante par quelques volonts plus nergiques qui dtermine les mouvements sociaux. Il ya lieu cepenla fait de du publicit. Importance dant de faire une distinction entre l'action exerce dans le cercle priv
LIBERT DU CERCLE PRIV
143
et celle exerce sur le public. L'tat est faiblement intress surveiller la premire, parce qu'elle n'est pas de nature provoquer de mouvements sociaux rvolutionnaires; il est, au contraire, intress surveiller la seconde. La distinction entre le cercle priv et le public n'est pas aise. La loi a sur ce point une thorie flottante. Il est certain que les lois sur la libert des cultes, sur celle de l'enseignement, sur celle de la presse, sur celle des runions, ne rglementent que le culte public, l'enseignement qui s'adresse au public, la pense rendue publique par un mode quelconque, la runion publique; que partout, par consquent, on rencontre comme lment essentiel motivant une rglementation spciale, le fait de la publicit. Mais, d'autre part, sur la question de savoir quand il ya public, la loi sur les runions publiques rpond : c'est quandles individus n'ont past runis par des invitations personnelles : c'est quand le cercle ; la loi sur la presse rpond des intimes est dpass; deux rponses videmment diffrentes, car les personnes runies par invitation personnelle ne sont pas ncessairement des intimes. De plus, la loi sur la presse voit encore un public dans une runion d'intimes groups en un endroit public. On ne peut que constater ces divergences et ajouter que la meilleure dfinition serait celle qui ferait de la publicit une question de fait. Article 1er. Action exerce par l'homme sur ses semblables dans le cercle priv. 46. Il faut mettre part, d'abord, l'action exerce dans le cercle de la famille, en vertu de cette autorit considre comme naturelle dans notre tat social qui appartient aux parents sur leurs enfants, au mari sur sa femme. A l'autorit du pre se rattachent ce que l'on appelle les droits du pre de famille, droits d'ducation et de correction rglements au Code civil au titre de la puissance paternelle et dont une loi rcente (L. 14 juillet 1889) prive certains indignes. Il a t dit un mot de ces droits propos du principe de l'obligation de l'instruction primaire qui y a port une lgre atteinte. Il faut encore citer le droit d'tre tuteur, que les Romains considraient, avec quelque raison, comme un munus publicum, et celui d'tre membre d'un conseil de famille. De plus, soit dans le cercle de la famille, soit dans le cercle priv des intimes, il faut reconnatre: 1 que la clbration de tous les cultes est libre, condition que l'assemble ne dpasse pas vingt personnes, au del, il y aurait association non autorise (art. 291 P.); 2 que l'enseignement est libre, qu'il soit donn par un prcepteur
144
LES LIBERTS
dans la famille, ou, au contraire, par un homme qui prend chez lui quelques enfants. Cependant, d'aprs la loi du 15 mars 1850, art. 66, les ministres des cultes ne peuvent donner l'instruction qu' quatre jeunes gens au plus destins aux coles ecclsiastiques, et condition d'en faire la dclaration au recteur; 3 que la manifestation de la pense par la parole, par l'imprim, par la gravure, par le chant, etc., est galement libre condition de ne pas constituer une injure au sens de l'art. 276 C. P; 4 que la runion prive est libre, condition qu'il y ait eu invitation personnelle. Article II. Action exerce par l'homme sur ses semblables en public. A cet ordre d'ides se rattachent la libert de l'exercice public des cultes, la libert de l'enseignement, la libert de la presse, la libert des runions publiques. de l'exercice des cultes. 47. A. Libert public Cette libert n'existe pas en principe. Le culte public doit tre autoris par le gouvernement. Cependant il faut distinguer entre ce que l'on appelle les cultes reconnus et les cultes non reconnus. 1 Pour les cultes dits reconnus, l'exercice public des cultes a t autoris une fois pour toutes par des lois. Ils sont au nombre de quatre: culte catholique (Concordat et loi du 18 germinal an X). Confessions luthrienne et calviniste (L. 18 germinal an X). Culte isralite (D. 17 mars 1808; D. 11 dcembre 1808 refondu depuis plusieurs fois, et notamment par dcret du 18 novembre 1870). Il n'y a donc pas ici d'arbitraire gouvernemental ; seulement, il faut observer que l'exercice n'est autoris que dans les difices rgulirement consacrs au culte, que, partout ailleurs, les manifestations du culte tomberaient sous le coup des articles qui punissent les associations illicites. Voir pour l'autorisation d'ouvrir une chapelle (L. 18 germinal an X. art. 44; D. 22 dc. 1812; D. 30 nov. 1807). 2 Pour les cultes non reconnus, l'autorisation est administrative, par consquent rvocable. V. D. 19 mars 1859. A dfaut d'autorisation, il y a association illicite (art. 291 P.). En Algrie et dans les colonies, les cultes indignes, musulman, brahmine, bouddhiste, etc., sont reconnus, en ce sens qu'ils sont tolrs sauf rglements de police. En Algrie, le culte musulman est de plus subventionn administrativement (Circul.17 mai 1856). 48. B. Libert d'enseignement. Cette libert ne figure
LIBERT D'ENSEIGNEMENT
145
on peut dire, au ; pas dans la Dclaration des droits de l'homme contraire, que la Rvolution a eu la pense, ralise par le Premier Empire par la cration de l'Universit, de faire de l'enseignement un monopole pour l'tat, ide qui se conoit chez des gens qui avaient la volont de faire une France nouvelle, et qui avaient dtruire dans les esprits autant d'ides d'ancien rgime qu'ils avaient dtruit d'institutions dans les lois. La Charte de 1830 est la premire qui ; partir de ce mopromette la libert d'enseignement (art. 69, n 8) : l'enseiment, en effet, cette libert fut graduellement accorde gnement primaire par la loi du 28 juin 1833; l'enseignement secondaire par la loi du 15 mars 1850; l'enseignement suprieur par la loi du 12 juillet 1875. Aujourd'hui donc il ya libert d'enseigner dans ces trois branches qui embrassent tout l'enseignement, c'est--dire droit sans autorisation administrative, pourvu que l'on remplisse certaines conditions. Mais, pour se rendre un compte exact de la situation de l'enseignement libre, il ne faut pas oublier deux observations: 1) A ct de l'enseignement libre, il existe un enseignement d'tat fortement organis; 2) l'tat s'est compltement rserv la collation des grades, et par l en fait impose en partie ses programmes l'enseignement libre. a) Enseignement primaire (L. 30 octobre 1886). 1) Le droit de tenir une cole primaire appartient tout Franais g de vingt et un ans accomplis s'il est muni d'un brevet de capacit (art. 4 et 7, L. 30 octobre 1886), pourvu qu'il ne soit dans aucun des cas d'incapacit prvus par l'article 5. L'art. 25, 2 de la loi du 15 mars 1850 admettait comme quivalents du brevet de capacit, un certificat de stage, le diplme de bachelier, un certificat constatant qu'on avait t admis dans une des coles spciales de l'tat, ou le titre de ministre non interdit ou rvoqu de l'un des cultes reconnus (lettres d'obdience pour les institutrices congrganistes, art. 49, L. 15 mars 1850). Mais ces quivalences ont t abroges par la loi du 16 juin 1881, art. 1er, qui exige le brevet de capacit pour les instituteurs ou les institutrices et pour les adjoints ou adjointes chargs d'une classe. On peut enseigner dans une cole partir de dix-huit ans pour les instituteurs, et de dix-sept pour les institutrices (art. 7, L. 30 octobre 1886). 2 Quiconque veut ouvrir une cole primaire, doit en faire la dclaration au maire de la commune o il a l'intention de s'tablir, lui indiquer lelocal o il veut l'ouvrir et donner des renseignements sur sa personne. Le maire peut faire opposition dans les huit jours au sujet du local. Mme dclaration au prfet, au ministre public, et l'inspecteur d'acadmie. Celui-ci a le droit de former, soit d'office, soit sur la dnonciation du ministre public, opposition l'ouverture de l'cole dans l'intrt des murs publiques ou de l'hygine. Cette opposition, qui doit tre forme 10 H.
146
LES LIBERTS
dans le mois qui suit la dclaration, est juge par le conseil dpartemental, sauf appel reu par l'inspecteur d'acadmie et jug par le conseil suprieur de l'instruction publique. A dfaut d'opposition, l'cole peut tre ouverte l'expiration du mois, sans autre formalit. 3 Tout instituteur priv pourra, sur la plainte de l'inspecteur d'acadmie, tre traduit pour cause de faute grave dans l'exercice de ses fonctions, d'inconduite ou d'immoralit, devant le conseil dpartemental; il peut y tre censur ou interdit de l'exercice de sa profession, soit dans la commune, soit dans le dpartement; il peut mme tre frapp d'interdiction absolue; dans ce dernier cas, il peut faire appel devant le conseil suprieur de l'instruction publique, l'appel n'est pas suspensif (art. 41, L. 1886). Pour la composition du conseil dpartemental, voyez art. 44. 4 Les instituteurs primaires libres sont matres de leur enseignement, de leur mthode, des ouvrages qu'ils emploient, l'exception de ceux qui seraient interdits par le conseil suprieur de l'instruction publique (art. 5, L. 27 fvrier 1880). 5 Ils sont soumis une inspection qui porte sur la moralit, l'hygine, la salubrit, et qui ne peut porter sur l'enseignement que pour vrifier s'il n'est pas contraire la morale, la constitution et aux lois. Pour le personnel d'inspection, voir art. 9, L. 30 octobre 1886. Pour les pensionnats primaires, les coles maternelles, classes enfantines, cours d'adultes, voir galement la loi. 1 L'art. 60 dtermine secondaire (L. 15 mars 1850). b) Enseignement le conditions auxquelles on peut ouvrir une institution. Il faut: tre Franais, g de vingt-cinq ans, faire une dclaration au recteur de la circonscription et dposer les pices suivantes : un certificat de stage constatant qu'on a rempli pendant cinq ans au moins les fonctions de professeur ou de surveillant dans un tablissement d'enseignement secondaire public ou libre ; le diplme de bachelier ou un brevet de capacit dlivr par un jury d'examen1; le plan du local et l'indication de l'objet de l'enseignement. Ces dclarations doivent tre communiques par le recteur au prfet et au ministre public. Toutes ces conditions sont de rigueur; le ministre peut cependant dispenser des cinq annes de stage sur la proposition du conseil acadmique et l'avis conforme du conseil suprieur de l'instruction publique, Dans le mois qui suit la dclaration, le prfet et le ministre public ont le droit de former opposition devant le conseil acadmique; celui-ci prononce sur la mainleve, sauf appel devant le conseil suprieur. Faute d'opposition, l'institution peut tre ouverte immdiatement aprs l'expiration du dlai, sans autre formalit. 2 L'enseignement secondaire libre est soumis l'inspection, suivant rglements dlibrs au conseil suprieur (art. 21, L. 15 mars 1850). 1. Un projet de loi est depuis longtemps en prparation pour exiger des conditions d'aptitude plus svres.
LIBERTDE LA PRESSE
147
Cette inspection porte sur la moralit, l'hygine et la salubrit ; elle ne peut porter sur l'enseignement que pour vrifier s'il n'est pas contraire la morale, la constitution et aux lois. Observation. Cette lgislation s'applique l'enseignement secondaire spcial aussi bien qu' l'enseignement classique. L'enseignement secondaire libre des jeunes filles ne se distingue pas de l'enseignement primaire. L'tat a organis des lyces, mais n'a pas encore rglement les pensionnats libres comme tablissements secondaires. c) Enseignement suprieur (L. 12juillet 1875; L. 18 mars 1880). Tout Franais g de vingt-cinq ans accomplis et les associations formes en vue de l'enseignement peuvent ouvrir des cours ou fonder des tablissements, condition d'en faire la dclaration pralable, sauf incapacit (voir art. 8). 1) Pour un cours isol, la dclaration est faite au recteur ou l'inspecteur d'acadmie; elle doit prcder de dix jours l'ouverture du cours. 2) Quant aux tablissements d'enseignement suprieur, la loi veut que la dclaration soit faite par trois administrateurs au moins. Si l'tablissement compte des professeurs ayant le titre de docteur en nombre gal celui de la Facult de l'tat qui en a le moins, il peut prendre le titre de Facult. Lorsque l'tablissement avait trois Facults au moins, la loi du 12juillet 1875 lui donnait le droit de prendre le nom d'Universit. La loi du 18 mars 1880 a retir cette concession. La loi de 1875 avait concd aussi aux Facults libres le droit de concourir la collation des grades ; un certain nombre de professeurs de ces Facults entraient dans la composition de jurys mixtes. Ces jurys ont t supprims. (L. 18 mars 1880.) 3) Les tablissements doivent prsenter certaines conditions d'installation garantissant le srieux des tudes : amphithtres, laboratoires, cliniques d'hpitaux, etc. (Art. 6, L. 1875.) 4) Inspection des dlgus du ministre de l'instruction publique ; la surveillance ne peut porter sur l'enseignement que pour vrifier s'il n'est pas contraire la morale, la constitution et aux lois. 49. C. Libert de la presse (L. 29 juillet 1881). Il s'agit ici au fond de la libert de la manifestation publique de la pense, sous toutes ses formes. On peut en distinguer trois: 1 manifestation ; 2 manifestation par l'crit parla parole, le discours, le cri, le chant ou l'imprim, le livre ou le journal, presse non priodique et presse priodique ; 3 manifestation par le thtre. La manifestation par le thtre n'est pas libre; l'ouverture d'un thtre est libre, mais la reprsentation d'une pice est soumise la censure, c'est--dire l'autorisation pralable, le texte fondamental est le dcret du 6 janvier 1864. Mais toutes les autres manifestations de la pense sont libres. Ce
148
LES LIBERTS
sont l des liberts prcieuses, surtout celle de la presse priodique. Cesont les manifestations publiques de la pense individuelle qui crent l'opinion publique, puissance indispensable dans les pays libres et c'est par la presse priodique que se produisent ces manifestations. La presse se charge par ses informations d'apprendre aux hommes tous les jours les faits politiques, en mme temps elle recueille leur opinion et lui donne une formule; elle est rellement l'organe au moyen duquel s'labore une sorte de conscience sociale. Cette fonction ne peut tre remplie avec toute son utilit que si la presse est libre; toute intervention de l'autorit aboutit au mensonge et fausse la conscience sociale. Il peut se faire qu'au dbut la presse abuse de la libert, mais comme toutes les grandes forces, elle se disciplinera elle-mme, elle se fera des habitudes de dignit et de modration; elle remplira ce moment le rle du censeur des socits antiques et, avec une bien autre autorit, elle sera la gardienne des murs et de la constitution. Histoire. L'histoire de la libert de la presse priodique est des plus mouvemente. Proclame dans la constitution de 1791, elle se maintient jusque sous le Directoire en l'an IV (1796); alors elle disparait graduellement; les lois de Serre en 1819 la rtablissent pour quelques mois peine; la loi Martignac du 18 juillet 1828 la rtablit une troisime fois; deux ans aprs, les ordonnances de 1830 la dtruisent; la Charte de 1820 la restaure une quatrime fois, mais la loi du 9 septembre 1805, la suite de l'attentat de Fieschi, la supprime aprs cinq ans. En 1848, dans la mme anne, quelques mois d'intervalle, elle est rtablie et dtruite. Elle ne reparat plus, aprs la priode draconienne du dcret du 17 fvrier 1852, qu' la fin du Second Empire par la loi du 11 mai 1868. Encore n'est ce qu'une restauration partielle, et il faut arriver pour la voir complte, aprs plusieurs lois successives, celle du 29 juillet 1881. En somme, jusqu' cette date, en 90 ans, treize ou quatorze annes de libert. Les rgimes de servitude ont vari pour la presse, mais prenons celui qui a t le plus complet, celui du dcret du 17 fvrier 1852; en voici les lments: 1 les professions d'imprimeur et de libraire ne sont pas libres, il faut autorisation du gouvernement, cela remontait au dcret du 5 fvrier 1810 ; 2 un impt trs lourd, le timbre de dimension frappe le journal, cela remontait la loi du 9 vendmiairean VI; 3 une autorisation est ncessaire pour fonderle journal; 4 il faut fournir un fort cautionnement; 5 les dlits de presse sont justiciables de la police correctionnelle et les auteurs sont tenus de signer les articles; 6 le gouvernement peut en certains cas suspendre le journal par voie administrative; 7 il peut le supprimer par
LIBERTDE LA PRESSE
149
dcret. Et encore ce rgime ne comprenait-il pas la censure pralable des articles qui avait exist d'autres poques. Le rgime de la libert est naturellement le contrepied : libert des professions d'imprimeur et de libraire; suppression de l'impt du timbre ; suppression de l'autorisation pralable et du cautionnement ; attribution des dlits de presse au jury; impossibilit pour le gouvernement de suspendre ou de supprimer administrativement le journal. Tous ces lments du rgime de libert se trouvent dans la loi du 29 juillet 1881. 50. Commentaire de la loi du 29 juillet 1881 1. La loi a deux objets distincts: 1 la rglementation spciale de la presse au point de vue de l'imprimerie, de la librairie, de l'affichage, du 2 les dlits qui peucolportage, de la grance des journaux, etc.; vent tre commis non seulement par la presse, mais par toute espce de manifestation publique de la pense. I. Rglementation spciale de la presse. Ily a des dispositions communes la presse priodique et la presse non priodique, d'autres qui sont spciales la presse priodique. 1 Rgles communes aux deux presses. Ces rgles sont relatives la librairie, l'imprimerie, l'affichage et au colportage. la librairie. La librairie est entirement libre (art. 1er). a) De b) De l'imprimerie. L'imprimerie est galement libre (art. 1er), mais au moment de la publication de tout imprims, deux obligations s'imposent l'imprimeur: de l'imprimeur; 1 L'imprim doit porter l'indication dunom etdu domicile, 2 Deux exemplaires de l'imprim doivent tre dposs entre les mains de l'autorit administrative ; ces exemplaires sont destins aux collections nationales. Ces deux obligations sont sanctionnes par des amendes. Certains imprims peu importants sont dispenss de ces formalits, ce sont des ouvrages dits de ville ou bilboquets (art. 2 et 3). b) De l'affichage. L'affichage est libre, saufla rpression appliquer dans le cas o l'affiche serait dlictueuse (art. 15 et 16). Un cas intressant de dlit se prsente lorsqu'il est contrevenu la loi sur les candidatures multiples; il est interdit sous peine d'une amende de 1,000 5,000 francs, de signer ou d'apposer des affiches, d'envoyer ou de distribuer des bulletins, circulaires ou professions de foi, dans l'intrt d'un candidat la dputation qui n'a pas fait de dclaration de candidature (art. 4 et 6, L. 17 juillet 1889). Non seulement l'affichage est libre, mais les affiches sont protges 1. Bibliographie,Fabreguettes, trait des infractions de la parole, de l'criture et de la presse, 1884; Barbier, loi sur la presse.
150
LES LIBERTS
par des dispositions pnales, au moins les affiches officiellesetles affiches lectorales; la destruction de ces affiches est un dlit (art. 17). c) Du colportage et de la vente sur la voiepublique. Le colportage est libre; toutefois il faut distinguer entre le colportage de profession et le colportage accidentel. Le colportage deprofession exige une dclaration faite l'autorit administrative, sous peine de constituer une contravention (art. 18-22). La distribution et le colportage accidentels ne sont assujettis aucune dclaration (art. 20). La loi du 19 mars 1889, relative aux annonces sur la voie publique, impose aux colporteurs l'obligation de ne crier que le titre des publications, le prix, l'indication de l'opinion et le nom de l'auteur. 2 Rgles spciales la presse priodique. Il y a des obligations qui incombent au priodique au moment de sa fondation, d'autres au moment de la publication de chaque numro. a) Fondation dupriodique. Le priodique raison de ce fait qu'il a une existence en soi caractrise par un certain nom, un certain format, une certaine opinion, une certaine clientle, est comme une sorte d'tre moral dou de la parole; la personnalit des rdacteurs disparat derrire la sienne, surtout maintenant qu'ils ne sont plus tenus de signer les articles. Cela entrane logiquementles consquences suivantes : 1la naissance du priodique doit tre officiellement constate, par consquent, avant la publication de tout journal ou crit priodique, il sera fait, au : le titre du journal ou crit prioparquet, une dclaration contenant dique et son mode de publication; le nom et la demeure du grant; l'indication de l'imprimerie o il doit tre imprim. Toute mutation dans les conditions ci-dessus numres sera dclare dans les cinqjours qui suivront (art. 8). et signes du Les dclarations seront faites par crit, sur papier timbr grant. Il en sera donn rcpiss (art. 8). 2 Le priodique doit avoir un reprsentant lgal qui puisse tre considr en cas de dlit comme le publicateur responsable. Par consquent, tout priodique aura un grant. Le grant doit tre Franais, majeur, avoir la jouissance de ses droits civils et n'tre priv de ses droits civiques par aucune condamnation judiciaire (art. 6). D'aprs ces dispositions rien n'empche une femme d'tre grante. L'article 9 contient la sanction des dispositions relatives la grance et la dclaration. b) Publication de chaque numro. Chaque numro du priodique est un imprim; par consquent, il est d'abord soumis aux obligations de l'imprim, c'est--dire au dpt administratifde deux exemplaires et l'impression du nom de l'imprimeur au bas de chaque exemplaire. Mais en outre, titre de priodique, chaque numro au moment de sa publication est astreint : 1 un second dpt de deux exemplaires destins au parquet ; 2 l'impression du nom du grant au bas de chaque exemplaire.
DE RUNION LIBERT
151
Tousles exemplaires dposs doivent tre signs du grant ; des amendes soit pour le grant, soit pour l'imprimeur sanctionnent ces diverses obligations (art. 10). Pour le droit de rectification qui appartient aux particuliers et aux dpositaires de l'autorit publique lorsque leur conduite a t inexactement apprcie dans un journal, v. art. 12 et 13. Pour la circulation des priodiques trangers qui est libre en principe, sauf droit pour le gouvernement de l'interdire par mesures spciales v. art. 14. II. Dlits de presse ou dlits commispar toute espce de manifestation publique de la pense. Cette matire est du ressort des tudes de droit criminel, nous y renvoyons. Il est bon de faire observer toutefois: 1 Que la publicit est un lment essentiel des dlits de presse. C'est la publicit qui fait le dlit, et lorsqu'il y a lieu de distinguer un auteur principal et des complices, c'est le puhlicateur qui est l'auteur principal. La thorie de la publicit, d'aprs laloi sur la presse, est donc d'importance majeure; elle se trouve dans les articles23 et 28 (v. p. 142). 2 Qu'il y a des dlits de presse caractriss, tels que l'outrage, la diffamation, les dlits contre le chef de l'tat, l'outrage aux bonnes murs1, etc., mais qu'il n'y a pas de dlit gnral d'opinion, c'est--dire qu'un journal ne peut pas tre poursuivi raison des opinions mises dans un article, quelque subversives qu'elles soient. Cependant : a) lorsqu'un article de journal et aussi un discours, un placard, etc., contient une provocation directe commettre une action qualifie crime ou dlit, et que la provocation a tsuivie d'effet, le publicateur de l'article est poursuivi comme complice du crime ou dlit (art. 23); b) ceux qui, parles moyens noncs, auront directement provoqu commettre les crimes de meurtre, de pillage et d'incendie, ou l'un des crimes contre la sret de l'tat prvus par les articles 75 et suivants, jusques et y compris l'article 101 du Code pnal, seront punis, dans le cas o cette provocation n'aurait pas t suivie d'effet, de trois mois deux ans d'emprisonnement et de 100 francs 3,000 francs d'amende; c) tous cris ou chants sditieux profrs dans des lieux ou runions publics seront punis d'un emprisonnement de six jours un mois et d'une amende de 16 francs 500 francs, ou de l'une de ces deux peines seulement (art. 24); d) toute provocation par l'un des moyens noncs en l'article 23, adresse des militaires des armes de terre et de mer, dans l but de les dtourner de leurs devoirs militaires et de l'obissance qu'ils doivent leurs chefs dans tout ce qu'ils commandent pour l'excution des lois et rglements militaires, sera punie d'un emprisonnement d'un mois six mois et d'une amende de16francs 100 francs (art. 25). 51. D. Libert de runion. La runion est un groupe
1. Pourl'outrage aux murs, les pnalits de la loi sur la presse ontt renforcespar la loi du 2 aot 1882.
152
LES LIBERTS
d'hommes qui se forme momentanment pour penser en commun, Elle diffre de l'association qui suppose des hommes groups d'une faon permanente pour agir en commun. Certes, la diffrence entre les deux notions est nette, cependant il s'est trouv des lgislations, notamment celle du Second Empire, pour les confondre dans un mme rgime rpressif. Le prtexte de cette assimilation c'est que les associations donnent lieu des runions. En effet, il y a forcment des runions d'associs ; il y a mme des espces particulires d'associations dont le but est d'organiser des runions priodiques, le club en est le type. La runion prive, o ne sont admises que les personnes munies d'une invitation personnelle et nominative, est et a toujours t libre; il n'y a se proccuper que de la runion publique. Histoire. Il y a l'heure actuelle, depuis la loi du 30 juin 1881, libert des runions publiques, mais l'histoire de l'tablissement de cette libert est aussi mouvemente que celle de la libert de la presse. La libert fut proclame par la Constitution des 3-14 septembre 1791, et en fait elle fut illimite pendant la Rvolution, mais, dans la Constitution du 5 fructidor an III, apparat un texte louche, l'art. 90 : les citoyens ne peuvent exercer leurs droits politiques que dans les assembles primaires. En fait, partir de ce moment-l jusqu'en 1848, bien qu'il y et libert thorique en ce sens qu'il n'y avait pas ncessit lgale de demander l'autorisation, le gouvernement estima pouvoir interdire les runions en vertu de ses pouvoirs gnraux de police et il ne s'en fit point faute. Le dcret du 28 juillet 1848 rtablit la libert. Mais, presque aussitt cause de l'agitation provoque par les clubs, il fallut la suspendre (L.19 juin 1849). Survint le coup d'tat; le dcret-loi du 25 mars 1852, supprima la distinction faite jusque-l entre les runions et les associations, et tendit les art. 291292 du Code pnal toutes les runions, quelles qu'elles fussent, de telle sorte qu'au dessus de vingt personnes il fallait demander l'autorisation. La loi du 6 juin 1868 commena cependant se dpartir de cette rigueur, au moins pour les runions qui n'avaient point pour but de traiter des matires politiques ou religieuses. Commentaire de la loi du 30 juin 1881. Lesrunions publiques sont libres en ce sens qu'elles peuvent avoir lieu sans autorisation pralable (art. 1er), mais l'autorit administrative doit tre avertie par une dclaration pralable, et d'autre part il y a certaines rgles observer pour la tenue de la runion. Toute runion publique sera prcde d'une 1 Dclaration pralable. dclaration indiquant le lieu, le jour, l'heure de la runion. Cette dclaration sera signe par deux personnes au moins, dont l'une domicilie
LIBERTDE RUNION
153
dans la commune o la runion doit avoir lieu. Les dclarants devront jouir de leurs droits civils et politiques, et la dclaration indiquera leurs noms, qualits et domiciles. Les dclarations sont faites: Paris, au prfet de police; dans les chefs-lieux de dpartement, au prfet; dans les chefs-lieux d'arrondissement, au sous-prfet, et dans les autres communes, au maire. Il sera donn immdiatement rcpiss de la dclaration. Dans le cas o le dclarant n'aurait pu obtenir de rcpiss, l'empchement ou le refus pourra tre constat par un acte extra-judiciaire ou par attestation signe de deux citoyens domicilis dans la commune. Le rcpiss, ou l'acte qui en tiendra lieu, constatera l'heure de la dclaration. La runion ne peut avoir lieu qu'aprs un dlai d'au moins vingt-quatre heures. (art. 2.) La dclaration fera connatre si la runion a pour but une confrence, une discussion politique, ou si elle doit constituer une runion lectorale (art. 4). Tenue des runions publiques. Les art. 6, 8 et 9 posent les rgles suivantes: 1 Les runions ne peuvent tre tenues sur la voix publique; 2 Elles ne peuvent se prolonger au del de onze heures du soir ; cependant, dans les localits o la fermeture des tablissements ouverts au public a lieu plus tard, elles pourront se prolonger jusqu' l'heure fixe pour la fermeture de ces tablissements. Il faut entendre ici par tablissements publics, les tablissements ouverts au public, tels que thtres, cafs, dbit de boisson, etc. ; 3 Chaque runion doit avoir un bureau compos de trois personnes au moins. Le bureau est charg de maintenir l'ordre, d'empcher toute infraction aux lois, de conserver la runion le caractre qui lui a t donn par la dclaration, d'interdire tout discours contraire l'ordre public et aux bonnes murs, ou contenant provocation un acte qualifi crime ou dlit. A dfaut de dsignation par les signataires de la dclaration, les membres du bureau et, jusqu' sa formation, les signataires de la dclaration, sont responsables des infractions aux prescriptions des articles 6, 7, 8 de la prsente loi (art. 8.). 4 Un fonctionnaire de l'ordre administratif ou judiciaire peut tre dlgu : Paris, par le prfet de police, et dans les dpartements, par le prfet, le sous-prfet ou le maire, pour assister la runion. Il choisit sa place. Il a le droit de dissoudre la runion conformment aux dispositions de l'art. 3 de la loi des 16-24 aot 1790, de l'art. 9 de la loi des 19-22juillet 1791 et des art. 9 et 15 de la loi du 18 juillet 1837. Toutefois, le droit de dissolution ne devra tre exerc par le reprsentant de l'autorit que s'il en est requis par le bureau, ou s'il se produit des collisions et voies de fait (art. 9.) Des runions lectorales. Les runions lectorales ne sont pas des runions publiques ordinaires : 1 le public n'y est pas admis mais seulement les lecteurs de la circonscription, les candidats et les mandataires de chacun des candidats; 2 elles ont un but spcial, le choix de candi-
154
LES LIBERTS
dats des mandats lectifs (art. 5); 3 elles ne peuvent tre tenues que pendant la priode lectorale, c'est--dire dans la priode comprise entre le dcret ou l'arrte portant convocation du collge lectoral,et le jour du scrulin exclusivement. Par exception cependant pour les lections au Snat, elles peuvent tre tenues le jour mme du scrutin (art. 3). L'inlrt qu'il y a mettre part les runions lectorales, c'est qu'elles jouissent d'un traitement de faveur. Non seulement elles sont aussi libres que les autres, mais elles peuvent tre tenues deux heures aprs la dclaration au lieu de vingt-quatre; et mme, immdiatement aprs la dclaration s'il s'agit de runions pour les lections au Snat, tenues le jour mme du scrutin (art. 3). Pour la police de la runion lectorale, mmes rgles que dessus. 52. Attroupements. (L. 7 juin 1848). Les attroupements sont des runions tumultueuses sur la voie publique. La loi distingue les attroupements arms et les attroupements non arms. : 1 quand plusieurs individus sont porteurs L'attroupement est arm d'armes apparentes ou caches ; 2 quand un seul individu, porteur d'armes apparentes, n'est pas spontanment expuls de l'attroupement. Les attroupements arms sont dfendus et doivent tre disperss par la force publique aprs deux sommations. Les attroupements non arms peuvent tre disperss s'ils mettent la tranquillit publique en danger ou seulement s'ils gnent la circu: exhortation, trois sommations, emploi lation; on procde alors ainsi de la force. Appendice aux 1 et 2. Le droit d'association et les associations
Le droit d'association se 53. Le droit d'association rattache intimement aux matires qui prcdent, car il est relatif un mode particulier d'activit, l'activit exerce en commun. Le droit d'association n'existe pas toujours, la libert n'est pas entire. Il y a lieu de faire des distinctions. Il faut carter d'abord des associationsqui ont t toujours permises et qui mritent d'ailleurs plutt le nom de socit que celui d'association. Ce sont les socits civiles et commerciales, associations intresses. Il faut carter en sens inverse des associations qui sont compltement interdites et dont le gouvernement ne pourrait mme : 1 les socits secrtes (L. 28 pas autoriser la formation, ce sont juillet 1848); 2 les associations internationales socialistes de travailleurs (L. 14 mars 1872); 3 les clubs (L. 30 juin 1881, art. 7). Restent trois groupes d'associations intressantes: les associations la ou congrgations religieuses; les associations de travailleurs;
DROITD'ASSOCIATION
155
masse des associations littraires, scientifiques, philanthropiques, politiques, etc. A. Associationslittraires, politiscientifiques, philanthtopiques, ques, etc. On peut considrer le rgime de ces associations comme tant celui du droit commun. Le voici : l'association peut se former [ librement sans autorisation toutes les fois qu'elle ne compte pas plus de vingt personnes; lorsqu'elle compte plus de vingt personnes, elle doit tre autorise, sinon elle est illicite et tombe sous le coup des art. 291 et suiv. du Code pnal; l'association autorise ne jouit pas par cela seul de la personnalit civile, il faut, pour obtenir cette personnalit qu'elle obtienne la dclaration d'utilit publique. Dans le chiffre de vingt personnes, ne sont pas comprises les personnes domicilies dans la maison o l'association se runit (art. 291 du Code pnal); mais, en revanche, alors mme que l'association serait divise en groupes moindres de vingt personnes, elle est illicite si le chiffre total des associs dpasse vingt (L. 20 avril 1834). Ce rgime est assurment peu libral et ne se maintient que parce que le gouvernement accorde largement les autorisations. La libert d'association avait t proclame par la loi des 13-19 novembre 1790 et elle exista en fait pendant la Rvolution, mais les excs des clubs la compromirent. La constitution du 5 fructidor an III, art. 360-364 ne reconnaissait plus que les associations qui ne sont pas contraires l'ordre public. Puis vint la lgislation du Code pnal et celle de la loi de 1834. En 1848, la libert d'association fut encore un instant reconnue; elle prit encore pour la mme raison, les excs des clubs; le dcret-loi du 25 mars 1852 retourna au Code pnal et la loi de 1834. Depuis, bien des projets de loi ont t prsents, aucun n'a abouti; la pierre d'achoppement pour l'tablissement d'un rgime libral n'est plus dans les clubs qui resteraient en tous cas interdits, mais bien plutt dans les congrgations religieuses, qui se sont trs fortement reconstitues depuis la Rvolution, qui sont actuellement sous un rgime d'exception, et pour lesquelles ce serait peut-tre l'occasion d'en sortir ; c'est du moins ce qu'on redoute. Ce sont les associations qui ont B. Congrgationsreligieuses. pour but de mener la vie religieuse en commun. Elles peuvent tre dans trois situations diffrentes: 1 autorises, elles sont alors licites mais n'ont pas la personnalit morale; 2 reconnues, alors non seulement elles sont licites, mais de plus elles reoivent la personnalit morale titre d'tablissements d'utilit publique; 3 non reconnues, leur existence est illgale et elles peuvent tre dissoutes par mesure de haute police, quel que soit le chiffre de leurs membres, - alors mme qu'il serait infrieur vingt.
156
LES LIBERTS
Cette situation des congrgations non reconnues qui a t rappele par les dcrets du 29 mars 1880, rsulte des lois suivantes : les dcrets du 13 fvrier 1790 et du 28 aot 1792, qui dclarent teintes et supprimes toutes les corporations religieuses et congrgations sculires d'hommes et de femmes, ecclsiastiques ou laques ; la loi du 18 germinal an X qui, aprs avoir autoris le rtablissement des chapitres et sminaires ajoute : . tous autres tablissements ecclsiastiques sont supprims. ; le dcret du 3 messidor an XII, qui dissout une congrgation qui avait tent de se reformer et tablit le principe de l'autorisation pralable du gouvernement. C. Associations de travailleurs. Syndicats professionnels. Les matrises et jurandes de l'ancien rgime avaient laiss un tel souvenir que, pendant longtemps, les associations de travailleurs de toute espce ont t prohibes comme portant atteinte la libert du travail, et cela quel que ft le nombre de leurs membres (L. 17 juin 1791; art. 416, C. P.). Cependant la force des choses avait amendepuis longtemps en fait la cration de chambres syndicales ou de syndicats, et le gouvernement les avaittolrs. Une loi du 21 mars 1884 est venue rgulariser cette situation. Cette loi dclare entirement libre la formation des syndicats professionnels sans limitation de chiffre pour les membres; par consquent, non seulement elle abroge les lois plus haut indiques, mais encore elle dclare inapplicables les art. 291 et suiv. du Code pnal et la loi du 10 avril 1834. Il y a syndicat professionnel aux deux conditions suivantes: 1 Lorsque les syndiqus exercent la mme profession, ou des mtiers similaires, ou des professions connexes concourant l'tablissement de produits dtermins. Bien que la loi ait t faite principalement en vue des corporations ouvrires, elle parait devoir tre tendue toutes les professions, mme celles dites librales1. Elle n'exclut que les fonctionnaires; les fonctionnaires ne peuvent point former de syndicat parce que la force qu'ils puiseraient dans ce groupement volontaire serait hostile la discipline et amnerait la dsorganisation de l'administration. Lorsque l'tat juge lui-mme qu'il a intrt grouper quelques-uns de ses fonctionnaires, il les 1. En ce sens, tribunal de la Seine, 10 mars 1890; Cour d'appel de Paris. 4 juillet 1890(syndicat de professeurs libres). La jurisprudence de la Cour de cassation est en sens contraire; elle ne considre comme licites que les syndicats se rattachant l'industrie, au commerce et l'agriculture (Cass.17 1885); mais il est prvoir qu'appele nouveau se prononcer, lorsque juin le temps coul aura fait perdre de leur actualit aux circonstances qui entour le vote de la loi, la cour suprme modifiera sa manire de voir. ont
LES ASSOCIATIONS
157
organise d'autorit en compagnies ou corporations dont il tablit les rglements (Facults de l'enseignement suprieur). 2 Lorsque le syndicat a pour objet l'tude et la dfense des intrts professionnels, c'est--dire des intrts conomiques ou techniques du groupe, qui peuvent prendre le caractre d'intrts industriels, commerciaux, agricoles ou tout autre (art. 2 et 3). Les syndicats professionnels ontla personnalit civile (art. 6 et 8) 1. Ils peuvent se concerter entre eux (art. 5). Les associations sont des individus 54. Les associations. fictifs qu'il faut ranger ct des individus rels, parce que l'activit qu'elles dploient n'est qu'un mode de l'activit prive. L'association est par essence un groupe d'hommes qui agissent en commun d'une faon permanente. L'action en commun prolonge fait le fond de l'association. L'association se forme par un fait volontaire, un contrat. Une fois forme, l'association se conduit comme un tre fictif. Il y a un lment spirituel dans cet tre, et c'est la volont des associs. Tous les associs mettent en commun une certaine volont, tous la mme; ce faisceau de volonts particulires, identiques entre elles, se comporte comme une volont unique, elle se dtache des associs et iwit de sa propre vie. Il y a aussi un lment matriel, le groupe mme des associs avec l'organisation qu'il a pu se donner. Il est naturel que cet tre fictif soit dou de personnalit juridique. L'tat ne reconnat pas toujours cette personnalit, ainsi que nous le verrons plus loin, mais quand il la reconnat, ce n'est pas une conression qu'il fait, c'est un fait existant qu'il constate. Les associations se classent, d'aprs leur but, en intresses et dLes associations intresses sont celles qui poursuivent intresses. : l'associaun but d'intrt priv, un bnfice pcuniaire; telles sont ition conjugale, les socits civiles, les socits commerciales. Les associations dsintresses sont celles qui poursuivent un but d'intrt gnral, sans pense de lucre; telles sont: les syndicats les socits de secours mutuels, les associations d'enprofessionnels, seignement, les socits savantes, les congrgations religieuses, etc. Les associations dsintresses sont des personnes morales prives tout comme celles qui sont intresses. C'est un point qui a t contest. Certains auteurs les appellent personnes morales publiques, 2. D'aprs un avisdu conseil d'tat du 30 juillet 1891,les droits confrs aux syndicats sont limitativement numrs par la loi du 21 mars 1884;par suite, ils n'ont pas le droit de recevoir des libralits.
158
LES LIBERTS
et veulent les transporter du ct de l'tat. C'est l une erreur ou une confusion de termes fcheuse; il n'y a et il ne peut y avoir d'autres personnes morales publiques que l'tat et les membres de l'tat: dpartements, communes, tablissements publics ; et cela pour une bonne raison, c'est que, par dfinition, l'activit publique, la vie" publique, le droit public, sont l'activit de l'tat, la vie de l'tat, le droit relatif l'tat; les termes chose publique et chose de l'tat sont synonymes. Que si on entend dire seulement par l que ces socits poursuivent des buts d'intrt gnral, on a tort de croire qu'elles cessent pour cela d'tre des personnes morales prives. Il est parfaitement loisible aux particuliers de se proccuper de l'intrt gnral. La charit prive s'en occupe assurment, et cependant elle s'appelle charit prive. Nous avons combattu dans notre thorie de l'tat cette ide que l'tat se confondrait avec l'intrt gnral; l'tat n'est qu'un des moyens de servir l'intrt gnral, le moyen politique, mais il y en a d'autres. L'tat se montre en des associations. 55. Condition gnral beaucoup moins libral envers les associations qu'envers les individus, il leur reconnat moins de droits. Comme leur action est plus puissante que celle des individus isols, cause surtout des richesses qu'elles accumulent, et que cependant elles poursuivent souvent des buts individuels, il redoute avec quelque raison qu'elles ne lui soient nuisibles. Il ne leur reconnat pas de droits politiques. On pourrait imaginer cependant telle constitution o les associations ou. corporations auraient des droits politiques. Sous l'ancien rgime, les corporations avaient des privilges, et dans quelques pays modernescertaines d'entre elles ont des droits lectoraux (Espagne, lection du: Snat). L'tat ne reconnat mme pas aux associations toutes les liberts qu'elles pourraient avoir, pas mme compltement la libert de l'tre. S'il reconnaissait ces liberts, voici en un tableau idal quelle serait la situation: 1 Les associations se formeraient librement; 2 Une fois formes, elles auraient de plein droit la personnalit civile et la jouissance de tous les droits qui peuvent leur tre nces saires pouratteindre leur but particulier; elles pourraient, par exemple au moins les socits dsintresses, acqurir librement titre gra tuit meubles et immeubles; 3 Comme, parmi les associations, il y en a qui poursuivent de buts d'intrt gnral et qui en cela travaillent dans le mme sens enque l'tat, quoique en dehors de lui, on comprendrait qu'une tente s'tablit entre les plus utiles de ces associations et l'tat. Une
LESASSOCIATIONS
159
sorte de trait d'alliance se conclurait qui, sans faire de l'association r une personne morale publique, c'est--dire un membre d'tat, la mettrait dans une situation intermdiaire en lui assurant des avantages particuliers. Cette situation serait celle qu'occupent dj la Banque de France, le Comptoir d'Escompte, le Crdit Foncier, qui tout en tant dans leur fond des socits prives et mme commerciales, sont cependant lies l'tat par des traits qui leur assurent elles des privilges, et assurent l'tat un contrle sur leur direction. Ces associations, intermdiaire ncessaire entre les personnes morales prives et les personnes morales publiques, seraient le signe de la collaboration qui doit exister entre l'tat et les particuliers dans l'uvre de l'intrt gnral. Elles seraient peut-tre destines devenir plus tard des tablissements publics; en attendant on les appellerait tablissements d'utilit publique. Cette lgislation idale est loin de la lgislation positive dont voici les principales dispositions: 1 Les associations ne se forment pas toutes librement. (V. supr , p. 154). 2 Une fois les associations formes,elles n'ont pas de plein droit la personnalit juridique. La loi a reconnu en bloc et d'avance la personnalit d'associations : socits commerciales, syndicats appartenant certaines catgories professionnels ; pour les autres, la reconnaissance de la personnalit rsulte d'un acte tout gracieux de la part de l'tat, qui intervient titre individuel, et qu'on appelle reconnaissance d'utilit publique. La jouissance des droits s'en suit normalement. 3 La clause des tablissements d'utilit publique existe bien, il ya mme beaucoup d'tablissements de ce genre, seulement la notion en a t fausse. Au lieu de comprendre toutes les associations qui rendent des services importants et de ne comprendre que celles-l, elle des associations dont les services sont minuscules, comme comprend certaines petites socits d'antiquaires, et l'inverse, elle ne comprend pas des tablissements de premire importance, comme la Banque de France ou le Crdit foncier. La raison de cette anomalie est que la classe des tablissements d'utilit publique comprend toutes les associations qui ont eu besoin, pour arriver la personnalit juridique, de demander la reconnaissance d'utilit publique, parce que c'tait le seul moyen, et qu'elle ne comprend que celles-l. Or, la Banque de France, le Crdit foncier, tant socits commerciales, avaient de plein droit la personnalit juridique. L'utilit publique, au grand dtriment de la mthode, est ainsi devenue une pure fiction destine faire acqurir la personnalit.
160
LES LIBERTS
Il est clair que dans ce systme actuel, dont on peut expliquer historiquement la formation, il y a quelque chose de boiteux, tant au point de vue de la concession de la personnalit juridique, qu'au point : 1 Pour la question de de vue de la formation mme des associations la personnalit, le droit romain et notre ancien droit taient plus logiques, ils n'admettaient pas la formation de l'association sans autorisation, mais une fois forme, ils reconnaissaient que la personnalit en dcoulait. Ce serait un progrs de revenir cette ide simple. La loi a toute intrt reconnatre ce qu'elle ne peut pas empcher. La suppression de la personnalit juridique n'a pas empch les associations de fonctionner ni d'amasser des richesses, elle n'a fait que crer des complications juridiques; 2 Non seulement il faut reconnatre la personnalit des associations formes, mais encore il faut les lasser librement se former ; ici encore la rpression est impuissante, l'association que l'on empche de se former au grand jour se forme secrtement. Le vrai pril des associations consistant dans l'accumulation en leurs mains de biens et de richesses, dans ce qu'on appelle les biens de mainmorte, la vraie mesure de prcaution pour l'tat est de prvenir cette accumulation, soit par des incapacit d'acqurir, soit par des droits fiscaux bien combins. III. LIBRE JOUISSANCE OU LIBRE PROPRIT SECTION INDIVIDUELLE. de la proprit mobilire et immo56. Inviolabilit Dclaration des droits de l'homme, art. 17 : La probilire. prit tant un droit inviolable et sacr, nul ne peut en tre priv, si ce n'est lorsque la ncessit publique lgalement constate l'exige videmment, et sous la condition d'une juste et pralable indemnit. Il s'agit de la proprit individuelle. Lorsque la Constituante la proclame un droit sacr, elle est dans le vrai au point de vue de l'volution historique. La proprit collective est une institution des temps primitifs; le progrs social est li l'extension de la proprit individuelle. Cela n'a rien de surprenant; le progrs social est dans le dveloppement de la solidarit mais de la solidarit d'tres libres, il suppose donc le dveloppement de l'autonomie de l'individu; or la proprit individuelle est la condition mme de cette autonomie. Le dsir de la proprit est le stimulant puissant de l'activit individuelle, la proprit acquise est la garantie de l'indpendance individuelle. Les rformes sociales devront toujours tenir compte de cette vrit
PROPRIT INDIVIDUELLE
161
d'exprience, sous peine d'tre un retour en arrire, elles devront d'une faon ou de l'autre s'accommoder de la proprit individuelle. La Dclaration des droits de l'homme proclame la proprit inviolable, cela vise surtout l'arbitraire administratif en matire d'expropriation et de servitude d'utilit publique. Une consquence intressante, c'est que toute question de proprit est de la comptence exclusive des tribunaux judiciaires, mme quand elle se soulve l'occasion d'un litige soumis un tribunal administratif. Elle constitue alors une question prjudicielle, principe reconnu par laloi du 16 septembre 1807, sur le desschement des marais (art. 47). Le droit de proprit n'est pas cependant sans rglementation ni restriction. L'art. 544 du Code civil le dfinit le droit de jouir et de disposer des choses de la manire la plus absolue. Mais il ajoute lui-mme : pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohib par les lois et rglements. Il faut citer parmi les obligations rsultant des lois et rglements : 1 l'obligation de subir les servitudes lgales et d'utilit publique (art. 649 et suiv. C. c.); 2 l'obligation de subir les rglements forestiers, ceux sur les marais, les mines, les carrires, le reboisement et le gazonnement des montagnes, etc. ; 3 l'obligation de subir les impts ; 4 l'obligation de subir l'expropriation force rsultant des voies d'excution sur les biens ; 5 l'obligation de subir l'expropriation force pour cause d'utilit publique, mais avec juste et pralable indemnit, etc., etc.
H.
11
CHAPITRE
III
LE DROIT AUX SERVICES PUBLICS. LES SERVICES D'ASSISTANCE
57. Le droit aux services La question de savoir publics. dans quelle mesure les individus ont droit ce que les services publics leur soient fournis est dlicate. Cependant, il nous semble que les rgles suivantes peuvent tre poses: 1 Les individus n'ont pas le droit d'exiger qu'un service public nouveau soit organis. L'tat organise ses services quand il lui plait, alors mme que le principe en a t inscrit dans une loi. Les dpartements et les communes peuvent tre tenus d'organiser certains services, mais c'est vis--vis de l'tat qu'ils y sont obligs, ce n'est pas vis--vis des individus ; l'tat est alors arm, en gnral, d'un moyen de contrainte qui consiste inscrire d'office la dpense ncessaire au service dans le budget dpartemental ou communal. Ce systme d'obligation administrative est un des avantages de la dcentralisation 2 Une fois qu'un service public est organis, les individus ont un vritable droit ce que ce service leur soit fourni. En effet, d'une part, la dpense de ce service est paye par eux sous forme d'impt, d'autre part, ils comptent sur le service public, et si leur confiance est trompe, cela peut entraner pour eux de grands dommages 1. Le droit de l'individu se traduira, en gnral, par un droit une indemnit s'il prouve un dommage par suite de l'inexcution d'un service public. Mais il est des cas o l'individu peut faire sommation par acte extrajudiciaire un fonctionnaire d'avoir lui fournir le service qui lui est d. C'est ainsi que l'on peut faire sommation un receveur des postes qui refuse de faire une expdition d'ailleurs conforme aux rglements. Seulement, il faut reconnatre que si en thorie le droit de l'indi1. Une communeest libre de ne pas organiser de service d'inspection des denres sur les marchs publics, mais, si en fait elle en a organis un, elle est responsable du mauvais fonctionnement du service; notamment, si par la faute de l'inspecteur, des champignons vnneuxont t vendus et ont ococt. 1890). casionnla mort du consommateur(Trib. Carcassonne,27
L'ASSISTANCE PUBLIQUE
163
vidu est certain, en pratique la possibilit juridique d'agir n'existe pas toujours, surtout quand il s'agit de services d'tat. L'tat ne peut pas tre poursuivi aussi facilement que la commune pour inexcution de ses services (V. supr, garanties des droits publics, p. 93 t s.), mais sur ce point la lgislation est susceptible de progrs. 3 Il est des services publics organiss auxquels, par exception, les individus n'ont pas droit, ce sont les services d'assistance. Ces services mritent un dveloppement. DES SERVICES D'ASSISTANCE Les observations de la de la question. 58. Position science contemporaine ont mis en lumire le grand fait social de la concurrence vitale, partout, dans tous les domaines, en politique et en conomie politique, les faibles sont vincs par les forts. Cette loi de la lutte pour la vie, que certains publicistes ont eu le tort de considrer comme un principe de droit, est au contraire une manifestation de la force brutale contre laquelle l'organisation sociale et le droit ont pour but de ragir en assistant les faibles. L'organisation des services d'tat notamment a sans qu'on le cherche directement, une vertu d'assistance, par cela seul que ces services sont dus galement tous, alors que tous ne les paient pas galement. Il faut donc avant tout se proccuper de l'organisation gnrale de la socit, c'est ce qu'on appelle la question sociale. Mais, jusqu' prsent, quelque perfectionnes que soient les organisations qu'on a trouves, on n'a pas russi supprimer compltement la lutte et la concurrence; il est probable que jamais on n'y parviendra. Ds lors, voici une question dont il faut se proccuper. tant donn la lutte, qui reste invitable dans un milieu social dtermin, il y a des tres qui, pour des raisons varies, sont incapables de faire l'effort ncessit par elle ; cela tient peut-tre leur ge, ce sont des enfants ou des vieillards, et ils n'ont'pas de famille qui puisse les secourir; cela tient peut-tre la maladie; cela tient peut-tre la misre, cet tat qui fait qu'un homme n'a mme plus assez de crdit pour acheter le morceau de pain qui lui donnerait la force. Que va-t-on faire pour ces tres? La vraie solution de la 59. Solution de la question. : l'tat a le devoir positif d'orquestion de l'assistance est celle-ci ganiserdes services d'assistance, mais ces servicesune fois organiss, tel ou tel individu n'a point le droit d'exiger que le service lui soit fourni.
164
LE DROIT AUX SERVICES PUBLICS
a) L'tat a le devoirpositif d'organiser des services d'assistance. L'assistance publique n'est donc point un don gratuit, mais l'accomplissement d'une vritable dette. La socit doit assister parce qu'au fond, c'est elle qui est en partie responsable. Si son organisation tait meilleure, il n'y aurait sans doute pas autant d'tres faibles. Si les services d'hygine taient mieux organiss, si la surveillance des logements ouvriers, par exemple, tait mieux exerce, il n'y aurait pas autant de malades. Si l'ducation publique tait mieux conue, il y aurait moins de ces vices qui engendrent la misre, l'alcoolisme, la dbauche, partant moins de misre 1. Le devoir d'assister est pour la socit la contre-partie et la ranon du droit qu'elle a de punir. La sbcit a le droit de punir parce que l'tat social est en partie volontaire, et que le dlinquant, en s'insurgeant contre lui, mrite une punition; mais elle a le devoir d'assister les malheureux, parce que ce mme tat social est en partie impos par la force, et qu'elle a le devoir de le rendre tolrable. Pour soutenir que l'assistance publique est un don gratuit, ce qui lui permet d'tre irrgulire et insuffisante, on ne peut mme pas s'appuyer sur la conception religieuse de la charit prive, car la charit prive d'aprs la pure doctrine, n'est pas facultative, elle est obligatoire. Il ne suffit pas pour que l'tat s'acquitte de son devoir d'assistance d'inscrire dans les lois le principe de l'obligation, il se trouve dans la Constitution des 3 et 14 septembre 1791, et il n'est pas encore ralis. Il faut l'organisation pratique d'un service public dou de ressources suffisantes. Sans doute, on et pu faire des services d'assistance des services d'tat. L'tat est honnte homme, il excute les lois et organise ses services du mieux qu'il peut; mais on a eu une ide meilleure, on a fait de l'assistance un service communal ou dpartemental. L'obligation reoit ainsi sa sanction sous une forme tangible; la commune ou le dpartement sont obligs vis--vis de l'tat, et celui-ci peut exercer une pression sur eux. Le droit de l'indigent se ralise ainsi par l'intermdiaire de l'tat. Ce systme est celui de l'Allemagne, non pas que l'obligation de l'assistance y soit communale, mais il a t cr des circonscriptions spciales appeles unions de pauvres, quisont obliges envers l'tat; 1. L o il apparat bien que l'assistance est ncessite par un vice d'organisation, c'est en matire d'assistance judiciaire. Si la justice tait vraiment gratuite, il n'y aurait pas besoin d'assistance.
L'ASSISTANCE PUBLIQUE
165
il tend s'tablir en France. La loi du 30juin 1838 avait dj oblig les dpartements se pourvoir d'un asile d'alins et avait mis leur charge, ainsi qu' celle des communes, les dpenses des alins indigents (art. 28). La loi du 5 mai 1869 met une partie des dpenses du service des enfants assists, qui, jusque-l, taient la charge des hospices et de l'tat, la charge des dpartements et des communes. La loi du 23 dcembre 1874, dite loi Roussel, sur la protection des enfants en bas ge et des nourrissons, met aussi moiti des dpenses du service la charge du dpartement. Mais ce sont l des applications timides du principe, et nombreuses sont les formes d'assistance qui ne sont pas encore obligatoires. En France, on est rest trop longtemps sous l'empire de cette ide que l'assistance tait un don gratuit. L'tablissement des hpitaux, celui des bureaux de bienfaisance, les secours mdicaux domicile ne constituent pas encore des services obligatoires. On semble cependant sur le point de raliser des progrs srieux. L'tat a commenc par rorganiser le service central de l'assistance publique qui doit tre un service de contrle destin donner l'impulsion aux dpartements et aux communes et surveiller leur action: cration au ministre de l'intrieur d'une direction de l'assistance publique (D.4 nov. 1888); rorganisation de l'inspection gnrale des services d'assistance publique (D. 18 oct. 1887); cration du conseil suprieur de l'assistance publique (D. 14 mai 1888). Ce conseil, qui se runit deux fois par an et pour lequel sont publis des fascicules forts intressants, a dj tudi la rorganisation de presque tous les services. On a pris une mesure pralable indispensable en autorisant les syndicats de communes (1. 22 mars 1890). Il y a, en effet, certains services, comme celui de l'hospitalisation, pour lesquels une commune isole est vraiment trop petite. Depuis, un projet trs tudi d'assistance mdicale domicile a t dpos par le ministre de l'intrieur sur le bureau de la Chambre dans la sance du 5 juin 1890. Il rend l'assistance mdicale obligatoire pour la commune, et pose nettement le principe de l'obligation mme pour les autres formes d'assistance. La commune ferait le plus fort de la dpense, sauf recevoir des contributions du dpartement. Le service serait organis sous la surveillance du dpartement. Les indigents seraient rattachs lgalement telle ou telle commune par l'institution d'un domicile de secours s'acqurant d'une faon particulire. Enfin, le projet cre dans chaque commune un bureau d'assistance, qui arriverait promptement centraliser tous les services d'assistance actuellement diviss d'une faon fcheuse, par exemple faire marcher d'accord hpitaux et bureaux de bienfaisance actuellement spars.
166
LE DROITAUX SERVICES PUBLICS
b) Une fois les services d'assistance organiss, on ne doit pas reconnatre l'individu le droit d'exiger qu'ils lui soient fournis. Cette solution ne semble pas logique ; d'ordinaire un devoir correspond un droit, si l'tat une dette d'assistance, l'individu doit avoir une crance. Pourquoi laisser l'tat distribuer arbitrairement l'assistance? Il y a cela de bonnes raisons : 1 Une raison pratique. Dans l'tat actuel des choses, les hommes ne sont pas suffisamment moraux pour qu'on puisse les croire sur parole lorsqu'ils viennent rclamer l'assistance; il n'y a pour s'en convaincre qu' consulter le chiffre norme des inscrits au bureau de bienfaisance dans les grandes villes. D'autre part, cependant, il serait trs prilleux de confier un juge la tche de dcider s'il y a lieu assistance ; la preuve de la misre, qui est la principale cause d'assistance, est difficile faire, la simulation est aise. Un seul pays au monde a reconnu, et pratiquement organis le droit l'assistance, c'est l'Angleterre. En Angleterre, un indigent a action contre sa paroisse pour se faire assister. Le rsultat est qu'en aucun pays l'assistance publique n'est plus dteste; elle est dteste du contribuable parce qu'elle cote fort cher, parce qu'il y a une taxe spciale des pauvres ; elle est dteste aussi des assists parce que, pour dcourager et dgoter les faux indigents, on l'a organise d'une faon extrmement dure. De plus, on a t amen prendre ce parti rigoureux d'carter des secours l'indigent valide, c'est--dire le simple misrable; on y tend de plus en plus. Une imprudence avait t commise, il a fallu la rparer en employant des procds fcheux. 2 Une raison thorique. L'originalit des services d'assistance publique est de remdier l'insuffisance de l'organisation sociale; ce titre, ils n'ont qu'une valeur de pis-aller provisoire. La socit doit constamment chercher amliorer le sort des dshrits par des rformes sociales. Sans doute il faudra toujours une assistance publique, mais elle est appele changer frquemmentde forme et d'objet. Ce serait lui faire perdre son caractre, relguer au second plan les rformes, immobiliserla socit que de donner aux individus un droit acquis. Ils se contenteraient de l'assistance et ne poursuivraient pas les rformes. Le panem et circenses est un des symptmes les plus srs de dcadence. Il ne doivent tre 60. Services d'assistance organiss. qui s'agit pas d'organiser tous les services qui pourraient tre imagins, mais ceux qu'une longue exprience a dmontrs vraiment utiles. L, comme ailleurs, il faut laisser l'initiative prive faire les expriences, l'tat recueillirles institutions dmontres viables. Cependant il y a un minimum
L'ASSISTANCE PUBLIQUE
167
vraiment indispensable, il faut assister, avons-nous dit, ceux qui sont hors d'tat de lutter par suite de l'ge, de la maladie, de la misre. a) L'ge. Il faut se proccuper la fois de l'enfance et de la vieillesse: I. L'enfance. 1 Enfants assists. Le service des enfants assists remonte au dcret de la Convention du 28 juin 1793 et la loi du 27 frimaire an V, il faut y ajouter l'arrt du 30 ventse an V, le dcret du 19 janvier 1811, la loi du 5 mai 1869,la loi du 24 juillet 1889 sur la protection des enfants maltraits et moralement abandonns. Il y a trois catgories d'enfants assists1 : 1 les enfants trouvs ou rellement abandonns par les parents. Jusqu'en 1860, cet abandon se faisait par le moyen des tours; ceux-ci ont t supprims en 1860 et il semble qu'il ne soit pas ncessaire de les rtablir; l'abandon se fait actuellement dans le bureau de l'administration, et le secret est assur, puisque le dposant ne rpond aux questions qu'on lui pose que s'il le veut bien; 2 les orphelins pauvres ; 3 les moralement abandonns. Cette catgorie, ajoute rcemment, comprend les enfants dont les parents existent, mais ngligent totalement leur devoir d'ducation. Bien que ce ne soient pas des nouveaux-ns, comme le sont en gnral les enfants des deux catgories prcdentes, la mme administration s'est charge de leur tutelle. La loi du 24 juillet 1889 est venue reodre lgale cette tutelle de l'assistance publique, proclamer la dchance de la puissance paternelle chez les parents et donner la dfinition des moralement abandonns. Aux termes des art. 1 et 2, il y a dchance de la puissance paternelle, par suite d'abandon moral, dans un certain nombre de cas de condamnations subies et, de plus, lorsque les pre et mre, par leur ivrognerie habituelle, leur inconduite notoire et scandaleuse, ou par de mauvais traitements, compromettent la sant, la scurit ou la moralit de leurs enfants. Les enfants assists sont gards et soigns l'hospice jusqu' leur majorit si leur sant est dlicate; sinon, ils doivent tre placs jusqu'au mme ge, par les soins de l'hospice, chez des cultivateurs ou des artisans. Les pres nourriciers reoivent une allocation dont l'importance dcrot mesure que l'enfant grandit. Pour restreindre le nombre des abandons d'enfants, il a t pris une excellente mesure prventive que, la loi du 5 mai 1869 a rendue obligatoire pour tous les dpartements. Ce sont les secours donns domicile aux filles-mres qui consentent garder chez elles leurs enfants. La dpense totale du service des enfants assists atteint actuellement 16.394.000 francs. Au 1er janvier 1888, 83.111 enfants taient assists, 41.806 taient secourus domicile; total 124.917. 2 Loi du 19 mai 1874. Travail des enfants dans les manufactures. Loi du 7 dcembre 1874relative la protection des enfants employs dans les professions ambulantes; loi du 23 dcembre 1874relative la protec1. Une classificationplus large a t propose par le conseil suprieur de l'assistancepublique, fascicule 31.
168
LE DROITAUXSERVICES PUBLICS
tiondes enfants du premier ge et en particulier des nourrissons. Toutes ces lois ont donn lieu des organisations d'inspection. Il a t beaucoup fait pourl'enfance; il resterait peut-tre faire, surtout dans les grandes villes. On ne saurait trop recommander les crches, les salles d'asiles, qui permettent aux mres de faire marcher de front le travail et les soins donns leurs enfants. II. Vieillesse. Il n'a malheureusement pas t fait autant pour la vieillesse. On peut dire que la vieillesse n'est pas secourue en elle-mme; elle se confond avec la misre ou avec la maladie ; cependant c'est bien en soi une cause d'assistance. Il existe quelques hospices pour les vieillards, mais trs clairsems. On a cherch un remde dans l'organisation de caisses de retraite. Une caisse de 'retraite a t cre par la loi du 18juin 1850; plusieurs lois sont intervenues depuis. Un projet de loi a t rcemment dpos encore par le gouvernement, mais ceci est de l'organisation sociale et dpasse les proportions de l'assistance. b) La maladie. La maladie peut donner lieu deux sortes d'assistance, l'hospitalisation, le secours domicile. I. Hospitalisation. L'institution des hpitaux est trs ancienne; on peut la faire remonter aux socits antiques; ils se multiplirent au moyen ge. La Rvolution les supprima en mme temps que les autres corps de main morte, et l'tat se chargea provisoirement du service. Mais ils furent reconstitus titre d'tablissements publics communaux parla loi du 16 vendmiaire an V, l'exception de certains hospices d'aveugles ou de sourds-muets qui restrent nationaux. Le devoir de l'hospitalisation est un service communal, seulement il n'est pas obligatoire. La loi du 7 aot 1851 autorise les hpitaux existants admettre les malades ayant leur domicile de secours dans d'autres communes, condition que celles-ci paient une pension fixepar le prfet. Les communes payantes peuvent recevoir une subvention, mais la dpense n'est pas obligatoire pour elles. Les malades des communes qui n'ont pas d'hpitaux ont donc peu de chances d'tre envoys dans un hpital. Or, sur 36.121 communes, il y en a 34.912 qui n'ont pas d'hpital. En revanche, en 1886, 15.000 lits d'hpital et 10.000 d'hospice sont demeurs vacants (il y en a perptuellement de 30 40 0/0). Le projet de loi sur l'assistance mdicale du 5 juin 1890 rend obligatoires pour les communes les dpenses d'infirmerie et d'hpital, et les syndicats de communes pourront btir les hpitaux ncessaires. II. Secours mdicaux domicile. La loi du 14 vendmiaire an Il avait pos le principe du secours mdical domicile en mme temps que celui de l'hospitalisation, mais sans plus de consquences pratiques. Le seul effort lgislatif qui ait t fait depuis se trouve dans la loi du 21 mai 1873, art. 7, qui autorise les hpitaux, dont les revenus sont en excdant, employer ces revenus jusqu' concurrence d'un tiers en secours domicile. Cette disposition n'a pas produit d'effet, parce que l'administration de l'hpital devait s'entendre avec celle du bureau de bienfaisance, et sque, par un vice de notre lgislation, ces deux administrations sont
L'ASSISTANCE PUBLIQUE
169
; certains pares. Ila t fait un effort administratif qui a mieux russi prfetsont pris l'initiative d'organiser l'assistance mdicale dans leurs dpartements. Le moyen employ a t l'offre d'une subvention faite par le dpartement aux communes qui voudraient crer ce service. L'uvre est dj commence depuis plus de trente ans. Actuellement, il y a 44 dpartements dots du service, ils comprennent 12.7000 communes affilies et unepopulation de 10 millions d'habitants, presque exclusivement rurale. Le nombre des personnes inscrites sur les listes d'assistance tait, en 1887, de 632,000. 233,000 ont t effectivement secourues. C'est ce service dpartem.ento-communal que le projet du 5 juin 1890 propose de gnraliser. La commune ferait la plus grande partie des frais, mais le dpartement aurait la haute main sur le service. Ce mode d'assistance suppose des consultations, des visites mdicales et la distribution gratuite de mdicaments. Plusieurs systmes sont employs,le meilleur semble tre le systme dit Landais ou Vosgien, qui assure la rtribution du mdecin tout en laissant au malade la libert du choix. Une liste des indigents est dresse annuellement. Les indigents inscrits peuvent faire appeler tout mdecin affili au service, ils doivent pour cela demander un billet la mairie. Avec le billet, le mdecin se fait ensuite rmunrer par le dpartement d'aprs un tarif1. c. La misre. L'assistance contre la misre est la plus dlicate de toutes, parce que le malqu'il s'agit de gurir est le plus difficile constater, la misre pouvant aisment tre simule. On peut concevoir ici : l'internement dans un refuge, l'assisencore deux modes d'assistance tance domicile. Le premier mode est applique n Angleterre dans les Workhouse, il n'a pas donn de bons rsultats. Cependant l'uvre de l'hospitalit de nuit a tir un bon parti de l'ide du refuge, mais en la restreignant singulirement. Le refuge n'est ouvert que la nuit, et au mme indigent trois nuits de suite seulement. Les grandes villes commencent organiser spontanment cette uvre excellente. Il est croire que dans quelque temps on pourrait la rendre obligatoire. Il existe aussi des dpts de mendicit o peuvent tre interns les mendiants par mesure administrative, mais ils fonctionnent mal et devront tre considrs des maisons pnitentiaires que comme des refuges d'assisplutt comme tance. Les secours domicile sont organiss peu prs dans tous les pays. En France, ils sont la spcialit d'tablissements publics communaux appels bureaux de bienfaisance. La dpense des bureaux de bienfaisance n'est pas obligatoire pour la commune, aussi n'en existe-t-il pas partout. Pour 36.121communes, il y a 14.500 bureaux; ces bureaux ont secouru, en 1886, 1.400.000 personnes et ont dpens 50 millions de francs. Mais ces dpenses sont ingalement rparties. De plus, le mode de distribution des secours est gnralement dfectueux. Il serait videmment dsi1. La Belgique a organis une assistance mdicale gratuite qui fonctionne depuis le 1er janvier 1892.
170
LE DROITAUX SERVICES PUBLICS
rable qu'il y et des bureaux de bienfaisance partout, surtout la campagne. Mais avant de rendre la dpense obligatoire, il faudra faire des tudes srieuses sur le meilleur mode de distribution. Il semble notamment que le systme des visites domicile par des visiteurs du bureau, soit bien suprieur la distribution faite au bureau. Il s'agit aussi de combiner les secours en argent, les secours en nature ou en bons, les secours destins au loyer, etc. On peut se proccuper de procurer du travail la faon des uvres de patronage, etc. On consulterait avec fruit sur tous ces points l'organisation de la ville d'Elberfeld dans la Prusse rhnane (Rev. d'con. polit. 1887, art. de M. Saint-Marc). Du domicile de secours (1. 24 vendmiaire, an II). Le domicile de secours est le lieu o l'homme ncessiteux a droit aux secours publics; le lieu de la naissance est le lieu naturel du domicile de secours ; le lieu de naissance pour les enfants est le domicile habituel de la mre au moment ou ils sont ns. Pour acqurir le domicile de secours dans une autre commune, il faut un sjour d'un an.
DEUXIME
PARTIE
LE
DROIT
ADMINISTRATIF
DFINITIONS La dfinition 61. Dfinition du droit administratif. du droit administratif demande certaines prcautions parce que c'est une matire o l'on a une grande tendance confondre le point de vue des sciences politiques, c'est- dire le point de vue du fait, avec celui du droit. Pour la science politique un grand fait domine tout, c'est l'existence et le fonctionnement dans un tat bien rgl de services publics, et le droit administratif n'est que l'ensembledes rgles qui prsident l'organisation et au fonctionnementdes services publics. Ce n'est pas l une dfinition juridique. Tout Droit a pour objet de rglementer des droits appartenant des personnes; or, dans cette premire dfinition, il n'apparat ni droits ni personnes qui soient sujets de ces droits: Voici la dfinition vraiment juridique: Le droit administratif est cette branche du droit public qui a pour objet l'organisation, les droits et l'exercice des droits des personnes administratives, en tant que cela intresse le fonctionnement des services publics. Il rsulte de cette dfinition: 1 que en droit administratif, comme dans toutes les branches du droit, il y a des sujets de droits; ces sujets de droits qui ne peuvent tre que des personnes sont les personnes administratives; 2 que en droit administratif comme dans toutes les branches du droit, il s'agit de rglementer des droits, ces droits sont ceux des personnes administratives; 3 enfin que le droit administratif a un but social comme toutes les branches du droit, ce but est d'assurer le fonctionnement des services publics; mais au lieu que la science politique se proccupe directement du service public, le droit administratif ne s'en proccupe qu'indirectement, il
172
LE DROIT ADMINISTRATIF
n'envisage les services publics qu'en tant qu'ils sont assurs par l'exercice des droits des personnes administratives. On a dj vu 62.I. Les personnes administratives. dans notre thorie de l'tat, que l'tat, pris au sens large, se rsolvait en un certain nombre de personnes morales publiques membres de l'tat. C'est le rsultat combin de la dcentralisation et du principe de la spcialisation des services. En ce sens, l'tat, au sens large, contient: 1 l'tat stricto sensu; 2 les dpartements; 3 les communes; 4 les colonies; 5 les tablissements publics. C'est surtout au point de vue de l'administration et du droit administratif, qu'il importe de considrer l'tat dcompos en ses lments, car chacun de ces lments gre des services publics diffrents, avec une certaine autonomie. Il n'est plus exact de dire, comme en l'an VIII, que l'administration est l'uvre de l'tat seul; il est plus exact de dire que l'administration est l'uvre commune de l'tat, des dpartements, des communes, des colonies, des tablissements publics. Seulement, cette numration des personnes morales publiques participant l'administration, est un peu longue et incommode pour le langage. On peut trouver une dsignation commune qui soit plus brve; nous proposons celle de personnes administratives. Certes, ces personnes administratives sont de valeur bien ingale. 1 Il y a une diffrence capitale entre l'tat, les dpartements, les communes, les colonies, d'une part, et d'autre part les tablissements publics. L'tat, les dpartements, les communes, les colonies ont une mission gnrale d'administration; ils pourvoient pour une circonscription donne aux besoins les plus varis, et ils ont pour cela des droits tendus, non seulement des droits domaniaux, mais des droits de police. Les tablissements publics, au contraire, ont une mission d'administration spciale, ils ne pourvoient qu' un seul besoin; aussi leurs droits sont-ils moins tendus et en gnral uniquement domaniaux. D'ailleurs, les tablissements publics sont simplement des services, soit de l'tat, soit des dpartements, soit des communes qui ont t personnifis; ils se rattachent comme des satellites ces grandes personnes morales publiques, ils sont comme des fondationsfaites par celles-ci. 2 L'tat occupe une place part. Il reprsente les intrts gnraux du pays, tandis que les dpartements, les communes, les colo; ce titre, il jouit de nies, ne reprsentent que des intrts locaux droits spciaux qui mritent le nom de droits rgaliens. Malgr ces diffrences considrables, il y a avantage pour le plan gnral d'une tude de droit administratif faire rentrer en principe, tablissements publics, colonies, tat, dpartements, communes,
DFINITIONS
173
dans une mme catgorie ; parce qu'il y a entre toutes ces personnes morales des ressmblances essentielles, parce que toutes ont une personnalit publique, que toutes ont des droits de puissance publique, et que pour les exercer toutes font des actes d'administration. et des personnes administratives 63. II. Les droits Les personnes administratives ont de ces droits. l'exercice une double personnalit et jouissent par consquent de deux espces dedroits: elles ont d'abord une personnalit de personne prive qui leur donne la jouissance des droits privs; elles ont en outre une personnalit de puissance publique qui leur donne la jouissance de droits exorbitants que l'on appelle droits de puissance publique. En vertu de la premire personnalit, elles administrent le domaine priv qu'elles possdent comme tout particulier; en vertu de la seconde, elles administrent leur domaine public, bnficient de modes d'acqurir exceptionnels, tels que les impts, l'expropriation, ou exercent de purs droits de police. Ces deux personnalits ne sont d'ailleurs distinctes qu' l'analyse juridique; aucun signe extrieur ne les rvle; les personnes administratives ont les mmes reprsentants, soit qu'elles agissent titre de puissance publique, soit qu'elles agissent titre de personne prive. La personnalit administrative ainsi comprise explique toute l'administration. L'administration entire rentre dans ce qu'on est convenu d'appeler les attributions des autorits administratives. On parle courammentpar exemple des attributions de police du maire ou du prfet aussi bien que de leurs attributions relatives la gestion du domaine. Or, il suffit de remarquer: 1 que les actes, que ces autorits administratives accomplissent en vertu de leurs attributions et qui sont des actes d'administration, sont, au fond, des actes par lesquels certains droits sont exercs ; quand un maire prend une mesure de police, il exerce un droit de police; quand il afferme un domaine communal, il exerce un droit de proprit; 2 que les droits ainsi exercs appartiennent aux personnes administratives que les autorits reprsentent, l'tat, la commune, etc. De telle sorte que, vue d'un certain ct, l'administration n'est que l'exercice des droits des personnesadministratives. Or il est clair que c'estl un point de vue juridique et c'est celui o doitse placer le droit administratif. Il y a longtemps d'ailleurs que l'onest habitu personnifier l'action administrative dans les actes o elle imite les particuliers, c'est la personnalit privequi apparat la premire et les droits privs sont reconnus d'abord. La personne de l'tat apparat avec le fisc ou do-
174
LE DROITADMINISTRATIF
maine priv. On est moins familiaris avec l'ide de personnifier la puissance publique. Il faut cependant y venir. Historiquement, la trantransition a t mnage par la fodalit qui avait transform en droits privs de vritables droits de puissance publique, tels que les droits de justice, les droits de police, le droit de battre monnaie, etc. Cela a fait apparatre leur caractre de droits et ce caractre leur est rest lorsque les lgistes les ont revendiqus pour le roi, c'est--dire pour l'tat sous le nom de droits rgaliens. Ajoutons enfin que, outre leurs droits, les personnes administratives ont encore des intrtset qu'il est dans les attributions des autorits qui les reprsentent de dfendre ces intrts, non plus par des dcisions, mais par des propositions, des vux ou des rclamations. Ainsi les conseils gnraux, outre qu'ils exercent les droits du dpartement par leurs dcisions, dfendent les intrts du mme dpartement dans les matires o il n'a pas de droits reconnus. C'est--dire que la personnalit administrative est aussi riche, aussi complexe, que la personnalit humaine. service public est une 64. III. Les services publics. Un cre une administrative en vue de la par personne organisation Cette organisation se compose satisfaction d'un besoin collectif. : des moyens matriels, btiments, moen gnral de trois lments ; un personnel de fonctionnaires ou employs avec des bilier, etc. rgles administratives pour ce personnel ; des moyens financiers pour subvenir aux dpenses du matriel et du personnel. Ainsi le service de l'instruction primaire suppose des maisons d'coles, un personnel d'instituteurs avec des programmes d'enseignement, des moyens financiers. Tout service qui fonctionne, raison de la fixit relative du personnel, et des traditions particulires d'administration qui se crent, a une tendance se comporter comme un organisme distinct. On s'habitue vite lui concder une sorte de personnalit. Les diffrents ministres semblent avoir une vie propre; mme des services ou administrations qui dpendent d'un mme ministre; ainsi en est-il de l'administration des contributions directes, de celle de l'enregistrement et des domaines, etc. Lorsque la personnalit juridique est rellement concde un service, il devient un tablissement publie. C'est vers le service public que service du public. A. Importance tout converge en administration et en droit administratif, parce qu'il est la raison d'tre de l'existence mme des personnes administratives. Sa notion se confond avec celle de l'utilit publique, car l'utilit publique, c'est l'intrt gnral, en tant qu'il y est donn satisfaction
DFINITIONS
175
par un service public. Or l'utilit publique apparat chaque instant en droit administatif, dans le domaine public, dans l'expropriation pour cause d'utilit publique, dans les travaux publics, etc. Il est des oprations administratives qui sont prcdes d'une dclaration formelled'utilit publique, nombre d'actes d'administration sont prcds d'une enqute destine constater l'utilit publique de la mesure prendre, etc. A son tour, l'utilit publique ncessite et justifie les droits de puissance publique dont disposent les personnes administratives. Il y a donc l trois ides dont nous constaterons chaque instant les relations troites, celle de service public, celle d'utilit publique, celle de droits de puissance publique. Mais si en droit administratif on ne doit jamais perdre de vue que le bon fonctionnement des services publics est l'objectif final, on ne duit pas oublier non plus que ce fonctionnement est le rsultat indirect de l'exercice de leurs droits fait par les personnes administratives, et que l'objectif immdiat ce sont ces droits. Prenons pour exemple la construction et l'entretien des chemins vicinaux ou service de la vieinalit, le droit administratif se proccupe non pas de ce service en soit, mais des droits exercs pour le faire fonctionner: droit d'expropriation exerc pour acqurir le terrain destin l'assiette du chemin, droit de travaux publics exerc pour assurer la construction du chemin ; impt des prestations recouvr pour payer la dpense, etc., etc. B. Modifications incessantes dans l'organisation des services publics. L'organisation des services publics varie constamment sous l'action de diverses causes. 1 A raison de la transformation des besoins. Les besoins collectifs se transforment, les uns lentement, les autres rapidement, aucun ne demeure immuable; il faut que les services publics se modifient au fur et mesure. Les services d'hygine et d'assistance publique sont visiblement en voie de dveloppement; les remaniements du service de la dfense nationale sont constants. Un bon exemple encore de transformation ncessaire est donne l'heure actuelle par le service vicinal dans les dpartements. Ce service, organis la suite de la loi de 1836, a eu pour but d'assurer la construction des chemins vicinaux; un personnel considrable d'agents voyers, de conducteurs, de cantonniers chefs, a t cr. Or, il arrive actuellement, aprs un demi-sicle, que les chemins sont peu prs partout construits et qu'il n'y a plus qu'les entretenir; il est clair qu'il faut un personnel moins nombreux pour entretenir que pour construire, et qu'une rorganisation du service s'impose, d'autant mieux que ce personnel absorbe une tonne moiti des ressources de la vici-
176
LE DROITADMINISTRATIF
nalit. La question est l'tude dans la plupart des dpartements. 2 A raison de la division du travail. La loi de la division du travail s'applique en administration comme dans tous les autres arts. En gnral, dans les organisations administratives rudimentaires, les services publics ne sont pas diffrencis ; un mme organe rend les ; c'est ainsi, par exemple, qu' l'poque fodale, servicesles plus divers dans les domaines royaux, le bailli lve les troupes, lve les impts, rend la justice; avec le temps, il se cre des organes spciaux et les services se sparent. Cette premire division du travail en entrane elle-mme une autre. Ds que les services publics sont spcialiss, ils ont une tendance sparatiste; il devient ncessaire de les relier les uns aux autres par des inspections et des contrles, afin de maintenir l'unit d'action. Ds lors, division entre les services d'administration proprement dite et les services de contrle. C'est ainsi que les prfets dans les dpartements sont chargs dela surveillance des agents rgionaux de l'tat les plus varis; c'est ainsi qu'au sein de presque toutes les rgies ou administrations spciales, il y a un corps de contrleurs ou d'inspecteurs. Enfin une troisime division du travail tend se produire, qui rsulte de diffrences dans la forme de l'action administrative. On verra qu'il y a des actes d'administration de deux espces, des actes d'autorit et des actes de gestion. Les premiers sont des actes qui ne supposent pas un dplacement de valeur pcuniaire dans le patrimoine des personnes administratives. Les seconds sont, au contraire, des actes qui en supposent un. Cette question d'argent, dont on verra plus loin toute l'importance, a eu son retentissement dans l'organisation des services. Il y a un service gnral de police et un service gnral de gestion. Le dpartement du ministre de l'intrieur n'est pas autre chose qu'un ministre de police gnrale d'tat, et sous le Premier Empire il en a port le nom. Il a la police sur les autres il etc. a la administratives, communes, ; dpartements, personnes police sur tous les fonctionnaires, mme ceux des autres ministres, grce ses prfets qui, dans chaque dpartement, sont en rapports avec tous les chefs de services, grce aussi la police politique; il a la police sur les individus, grce au service de la sret gnrale et la direction de l'assistance publique; il est le nerf de l'action policire. Le ministre des finances n'est pas autre chose qu'un service fourni s'exerce au de service de l'argent qui moyen gestion, gnral tous les autres services, car l'argent est le nerf de toutes les mesures, degestion; et au moyen de la surveillance exerce sur la comptabilit,
DFINITIONS
177
grce l'inspection gnrale des finances et la direction gnrale de la comptabilit. A ct de ces services gnraux qui rayonnent sur tous les autres, leur donnant l'impulsion au point de vue de la police et de la gestion financire et les surveillant, il y a des services spciaux qui sont dtermins uniquement par le besoin satisfaire et o les mesures de police et de gestion sont employes concurremment par les mmes administrateurs. 3 A raison des progrsde l'ide de justice. Les services publics sont dus galement tous les citoyens, et ceux-ci doivent contribuer les payer proportionnellement leurs facults. Or, il arrive souvent que l'organisation primitive d'un service cre des ingalits qui plus tard paraissent choquantes. Cela est arriv notamment pour les chemins vicinaux. Le principe encore en vigueur est que chaque commune construit et entretient ses chemins. Cela a paru juste pendant longtemps, tant que ces chemins inachevs ont servi aux petits parcours l'intrieur de la commune. Cela ne le parat plus, depuis que souds les uns aux autres, ils forment un rseau dpartemental servant de longs parcours. Ce ne sont plus seulement les habitants de la commune qui se servent de ses chemins. Ds lors, il faudrait faire contribuer la commune l'entretien, non plus raison de la longueur kilomtrique des chemins qui sont sur son territoire, mais raison des facults de ses habitants. c) Servicesobligatoires. Services facultatifs. Cette distinction n'existe pas pour les services d'tat, mais seulement pour les services dpartementaux, communaux ou coloniaux. L'tat n'est jamais que moralement oblig organiser un service, et, mme si une loi en prescrit l'organisation, c'est un ordre que l'tat se donne lui-mme et dont aucune autorit suprieure ne peut assurer l'excution. Il n'en est pas de mme des services des dpartements, des communes ou des colonies. L'organisation peut en tre obligatoire vis--vis de l'tat, et l'excution de l'obligation tre juridiquement assure; par exemple, si le service se traduit par une dpense, celle-ci peut tre inscrite d'office au budget du dpartement, de la commune ou de la colonie par les reprsentants de l'tat; ds lors, il y a lieu de distinguer entre les services obligatoires et les services facultatifs. (V. pour le dpartement, L. 10 aot 1871, art. 61,et pour la commune, 1.5 avril 1884, art. 136 et 149. ) d) Services d'tat, de dpartement, de commune, de colonie, d'tablissementpublic. Il ya des services d'tat, de dpartement, de commune, de colonie et d'tablissement public. On peut en faire le triage. Cependant, ce triage n'est pas ais,, sauf en ce qui concerne H. 12
178
LE DROITADMINISTRATIF
les tablissements publics, chargs chacun d'un seul service spcial Cela tient ce que rarement un service dtermin est la charge d'une seule personne administrative. Le plus souvent, il ya concours de personnes administratives diffrentes un mme service. Le concours un service se manifeste sous forme de mesures de police ou de mesures de gestion. Sous forme de mesure de police, c'est ainsi, par exemple, que la commune est charge de concourir au service del'tat-civil, au service des listes lectorales, la publication des lois et rglements qui constituent au fond des services d'tat. Sous forme de mesure de gestion, cela se produit souvent de ces deux faons : ou bien par l'apport d'un btiment destin loger le service (casernes, htels des postes, palais pour certains fonctionnaires fournis par les communes), ou bien par une contribution en argent. Le concours est obligatoire ou facultatif. Lorsqu'il est obligatoire, on emploie l'expression de contribution ou de contingent; c'est ainsi que les communes paient leur contingent aux dpenses du service vicinal, lequel est dpartemental. Lorsqu'il est facultatif, on emploie le mot de subvention. Il y a peu de services vraiment utiles qui ne reoivent des contingents ou des subventions. Ce concours presque constant des trois personnes administratives un mme service correspond une grande ralit; c'est que, malgr la dcentralisation, dpartements et communes sont toujours les membres d'un mme corps qui est l'tat; c'est que les besoins locaux sont gnraux en mme temps, les besoins gnraux locaux en mme temps. Malgr le concours des personnes administratives un mme service, il y a cependant intrt dsigner la personne administrative vraiment matresse. A notre avis, c'est celle qui vote lebudget gnral du service, parce que, par cette arme du budget, elle est matresse de l'organisation gnrale. Peu importe que la majeure partie des fonds qui alimentent ce budget soient fournis par d'autres personnes administratives ; peu importe que les fonctionnaires qui constituent le personnel du service soient nomms ou rvoqus par une autorit suprieure; peu importe que le btiment dans lequel est log le service appartienne une personne administrative diffrente; peu importe mme que le service consiste entretenir une dpendance du domaine public d'une personne administrative diffrente. Ainsi, le service vicinal charg de la construction et de l'entretien des chemins vicinaux de grande communication et d'intrt commun est certainement un service dpartemental, parce que c'est le conseil l peut modifier gnral qui rgle le budget de ce service, et qui par
DFINITIONS
179
le personnel et lui imprimer la direction; et cependant la majeure partie des fonds est fournie par la commune, et cependant les chemins qu'il s'agit d'entretenir sont ds dpendances du domaine public communal. Ainsi encore, le service de l'instruction primaire est un service d'tat, parce que l'tat rgle le budget de l'instruction primaire; et cependant les communes sont tenues de fournir la maison d'cole et de contribuer par une indemnit au traitement de l'instituteur; et cependant le dpartement est tenu de fournir le btiment pour les coles normales d'instituteurs et d'institutric s, et de supporter certaines autres dpenses. (V. art 2, 3 et 4, L. 19 juillet 1889.) Une description des services des diffrentes personnes administratives serait une chose vraiment instructive, mais pour laquelle la place nous manque. Quelques indications seulement: Services d'tat. Outre les services gnraux de police et de gestion dont nous avons signal l'existence et qui sont le ministre de l'intrieur et celui des finances, l'tat a des services spciaux que l'on peut classer ainsi: a) Services l'extrieur. 1 Relations extrieures: ministre des affaires trangres; 2 dfense nationale: ministres de la guerre et de la marine. b) Services l'intrieur. 1 Besoins moraux, service du droit: ministre de la justice; service de l'instruction publique, des beaux-arts, des cultes : ministre de l'instruction publique. 2 Besoins matriels: Services des travaux publics, de l'agriculture, du commerce et de l'industrie: autant de ministres spciaux. Services dpartementaux. Nous ne considrons comme vraiment dpartementaux que les services qui sont sous l'autorit du conseil gnral ou de la commission dpartementale. Sans doute, parmi ceux qui sont sous l'autorit du prfet seul, il en est qui, logiquement, devraient tre dpartementaux, mais, de par la loi, ce sont encore des services d'tat. Il n'y a pas dans le dpartement de service dpartemental de police, mais il y a un service gnral des finances. De plus, il y a des services spciaux dont les plus importants sont : : routes dpartementales, chemins vicinaux, de 1 le service de la voirie grande et de moyenne communication, chemins de fer dpartementaux, etc. ; 2 le service de l'assistance publique : alins, enfants assists, sans compter le service de l'assistance mdicale gratuite, l o elle est organise. Services communaux. Les services qui sont sous l'autorit du maire sont communaux, au mme titre que ceux qui sont sous l'autorit du conseil municipal. Il y a dans la commune un service gnral de police et un service gnral de gestion financire. Dans la grande majorit des communes il n'y
180
LE DROITADMINISTRATIF
a que trs peu de services spciaux. Le seul peut-tre qui se retrouve partout est celui de la voirie, qui comprend les chemins vicinaux ordinaires et les chemins ruraux ; il faut songer que l'instruction primaire et les cultes sont des services d'tat. Dans les grandes villes, il y a des services spciaux nombreux, tout fait facultatifs : services de l'eau, de l'clairage, du balayage, des halles et marchs couverts, etc. Services coloniaux. (Mmoire).
LIVRE
PRLIMINAIRE
L'ADMINISTRATION
65. L'administration du point de vue des envisage A ce point de vue, l'administration poursciences politiques. voit aux besoins des services publics et l'excution gnrale des lois1. Ainsi entendue, l'administration est la fois un art et une science; elle est un art car elle procde des crations, des organisations de services; elle est une science, car elle observe dans son action certaines rgles fournies par l'exprience. Elle suppose d'autre part la connaissance des hommes et de leurs besoins, par consquent, elle a besoin de sciences accessoires. Il faut l'administrateur beaucoup de psychologie et la connaissance de toutes les sciences sociales, conomie politique, science financire, politique, etc. A son tour l'administration peut devenir objet de science car il se cre de vritables rgles d'administration. C'est ainsi que le rapporteur de la loi du 28 pluvise an VIII a pu dire au nom de l'exprience que : administrer dans le sens d'excuter une mesure est le fait d'un seul, dlibrer est le fait de plusieurs : c'est ainsi qu'on peut affirmer que les administrateurs doivent tre responsables, qu'ils doivent tre astreints la rsidence dans un certain lieu, etc. L'organisation administrative surtout, la classification et la hirarchie des agents doivent beaucoup l'exprience, la faon dont les chefs doivent diriger leurs subordonns par des instructions ou circulaires, la faon dont le zle des fonctionnaires doit tre entretenu par la perspective de l'avancement, etc., etc. Jusqu' prsent, l'administration a t peu tudie ce point de vue. Il faudrait consulter les traditions des bureaux, compulser les volumineuses collections des circulaires ministrielles; quant aux principes les plus levs, on les trouverait dans les uvres politiques2. 1. Vivien,tudesadministratives, l. p. 2. 2. En fait d'tudes sur l'administration, on ne peut gure citer que les tudesadministratives de Vivien, 1845; quelques chapitres de Macarel dans ses tribunaux administratifs et dans son Droit politique, et le rapport sur la
182
L'ADMINISTRATION
66. L'administration du point de vue juenvisage doit tre dfinie l'exerridique. Ace point de vue, l'administration cicedes droits des personnes administratives en vue du fonctionnement des services publics, c'est--dire que l'administration est une procdure rglemente en partie par le droit, et c'est uniquement ce point de vue qu'elle doit tre tudie ici. Que l'adminstration publique soit un exercice de droits, il n'y a rien l qui puisse tonner. En droit priv aussi il y a une administration, et elle consiste dans l'exercice des droits: un pre de famille qui administre sa fortune est un pre de famille qui exerce ses droits; il n'est pas un acte de l'administration courante des fortunes prives qui ne soit l'exercice de quelque droit ; les baux ferme, les emprunts, les actes d'hypothque, les ventes de rcoltes sont l'exercice du droit de proprit ou de quelqu'un des modes d'acqurir. Que l'administration publique ait donn lieu des rgles de droit et qu'elle constitue une procdure rglemente, cela ne doit point surprendre non plus. Un particulier qui administre sa propre fortune exerce ou n'exerce pas ses droits, il les exerce de telle ou telle faon, c'est affaire de conscience pour lui, le droit n'a rien y voir. Il n'en est pas de mme pour les personnes administratives. D'abord on peut remarquer qu'en exerant leurs droits, au fond c'est la fortune d'autrui qu'elles administrent. C'est la fortune nationale, notre fortune tous. Cela dj les oblige exercer leurs droits correctement, et justifie l'intervention du Droit, car le droit rglemente en gnral l'administration de la fortune d'autrui. De plus, ce sont des personnes fictives qui n'agissent que par reprsentants. Ces reprsentants ont besoin d'tre surveills, ils ne peuvent l'tre par la personne morale qui est fictive, il faut donc que le droit intervienne, et les maintienne par des formalits et des rgles d'admistration. Les rgles sur l'administration ont une importance capitale en droit administratif: 1 il faut les connatre pour comprendre l'organisation administrative, parce que ce qu'il y a d'essentiel dans cette organisation ce sont les reprsentants qui ont les pouvoirs d'administration vritables, c'est--dire l'exercice des droits; 2 elles sont indispensables aussi l'intelligence des rgles du contentieux ; c'est en exerantleurs droits d'une faon plus ou moins correcte, que les personnes loi du 28 pluvise, an VIII. Toutefois,si on fait rentrer dans ces tudes la une littrature grande question de la centralisation administrative, en trouve l'tat et l'indiV. not. Trait; considrable : Cormenin, Dupont-White plus vidu, la centralisation; encore plus si on y fait rentrer la question de la juridiction administrative.
L'ADMINISTRATION
183
administratives sont exposes lser les droits et les intrts d'autrui et provoquer des litiges. C'est donc l'administration qui provoque le contentieux. Mais il faut bien se garder, comme on l'a fait trop souvent, de confondre l'administration avec le contentieux. Exercer ses droits, ce n'est pas toujours provoquer un procs, heureusement, et, mme quand on en provoque un, l'acte qui l'occasionne ne fait pas partie intgrante du litige. Il y a lieu de se proccuper propos de l'administration : 1 Des oprations administratives et des actes d'administration, actes par lesquels les droits des personnes administratives sont exercs ; 2 Des autorits administratives, reprsentants par lesquels ces droits sont exercs.
CHAPITRE
PREMIER ET LES ACTES D'AD-
LES OPRATIONS ADMINISTRATIVES MINISTRATION
SECTION I. LESOPRATIONS ADMINISTRATIVES 67. En vue du fonctionnement des services publics, et en exerant leurs droits, les personnes administratives font, soit des oprations administratives, soit des actes d'administration. L'opration administrative est constitue par un ensemble d'actes accomplis au nom d'une personne administrative par un reprsentant lgal, et concourant un mme but juridique. Par exemple, une expropriation pour cause d'utilit publique est une opration administrative, elle a un but juridique dtermin, l'acquisition d'un terrain, et elle se compose d'une quantit d'actes, enqutes, dclaration d'utilit publique, arrt de cessibilit du prfet, jugement, etc. De mme, une lection est une opration administrative, elle a un but juridiquedtermin, la nomination d'un reprsentant, et elle se compose d'une quantit d'actes, convocation des lecteurs, formalits du scrutin, recensement des votes, etc. L'opration administrative a de l'importance pour les raisons suivantes: 1 Parce qu'elle constitue uneinstitution juridique nomme et qu'au fond elle est l'exercice d'un droit qui appartient la personne administrative; beaucoup constituent des modes d'acqurir; ainsi en est-il de l'expropriation, des travaux publics, des impts qui sont la mise en exercice du droit d'exproprier, du droit de faire des travaux publics, du droit de lever l'impt, etc. 2 Parce que les textes lgislatifs sont en gnral conus en vue des oprations administratives. Il y a des lois sur l'expropriation, sur les impts, sur les lections, etc. 3 Parce que, au point de vue du contentieux, les rgles de comptence attribuent souvent la mme juridiction toutes les difficults qui peuvent tre souleves par une opration administrative dtermine. C'est ainsi que le contentieux des travaux publics est attribu aux conseils de prfecture, de mme le contentieux des lections municipales, de mme le contentieux des impts directs, etc. Il y a
LESACTES D'ADMINISTRATION
185
mme des cas, o il existe contre une opration administrative, prise dans son ensemble, un vritable recours contentieux, comme contre l'acte d'administration: exemple, recours contre une lection. Les oprations administratives doivent, surtout au point de vue du contentieux, tre classes en oprations de puissance publique et oprations de personne prive, suivant la qualit en laquelle agissentles personnes administratives. C'est ainsi que les lections, l'expropriation, les travaux publics, les impts directs, sont des oprations de puissance publique; que le bail d'une maison est une opration de personne prive. Pour les premires, la comptence administrative est de droit, tandis que, pour les secondes, elle est d'exception. 1 II. LESACTES SECTION D'ADMINISTRATION DESACTES NATURE CLASSIFICATION, 1er. DFINITION, D'ADMINISTRATION Article Ier. Dfinition. 68. L'acte d'administration est une dcision excutoire, prise au nom d'une personne administrative par un reprsentant lgal, en vue de produire un effet de droit et qui, par consquent, est relative l'exercice d'un droit. L'acte d'administration se rattache l'opration administrative comme la partie se rattache au tout, il en est un des lments; quelquefois aussi, c'est un acte isol qui se suffit lui-mme. Tous les lments de la dfinition sont importants: A. Dcision. L'acte d'administration est une dcision, c'est-dire une manifestation de volont positive. Il en rsulte que le silence gard par un administrateur auquel on demande d'accomplir un acte, n'est pas un acte d'administration qu'on puisse attaquer, du moins en principe (V. infr, n 87). Le silence n'est pas assimil en principe une dcision de rejet. Il y a l quelque chose de fcheux, car le silence gard par l'administration est en certains cas un vritable dni de justice. B. Dcision excutoire. Il n'y a acte d'administration que lorsque la dcision est excutoire. Elle peut l'tre dans deux sens diffrents : 1 Excutoire vis--vis des tiers, en ce sens qu'elle produira imm1. Bibliographie. E. Laferrire, Trait de la juridiction administrative et des recours contentieux, 2 vol. in-8.
186
L'ADMINISTRATION
diatement des effets vis--vis des tiers. Exemple arrt de police : d'un maire; 2 Excutoirevis--vis de la personne administrative elle-mme, en ce sens qu'mane de l'organe dlibrant qui reprsente la personne administrative, elle s'impose immdiatement l'organe excutif, qui reprsente la mme personne administrative, et qui devra prendre des mesures d'excution. Exemple : dlibration du conseil municipal enjoignant au maire de passer un march. De telle sorte que les lois d'affaire, les dcisions excutoires des conseils gnraux, de la commission dpartementale, des conseils municipaux, mme des commissions administratives d'tablissements publics, sont des actes d'administration au mme titre que les dcrets du chef de l'tat, les arrts des prfets et ceux des maires. Dans la conduite humaine, les dcisions que nous prenons l'avance nous obligent bien nous-mme excution, et par consquent sont des actes d'autorit vis--vis de nous-mme; seulement, le droit ne peut pas les saisir, tandis qu'il les saisit ici. Le seul point auquel il faille s'attacher, c'est donc que la dcision soit excutoire, c'est--dire tende l'excution par sa seule vertu. A ce point de vue, il faut remarquer que les dcisions prises au nom des personnes administratives dans des cas nombreux, ne sont pas excutoires raison de la tutelle laquelle celles-ci sont soumises. Il peut se faire que ces dcisions, bien qu'manant de leurs propres reprsentants, et tant par consquent la manifestation de leur propre volont, aient besoin de l'approbation expresse d'une autorit suprieure. La dcision dans ce premier cas ne devient excutoire, et par consquent n'est un acte d'administration, qu'aprs cette approbation. Mais s'il faut que la dcision soit excutoire, pas n'est besoin qu'elle soit excute; la question d'excution est indiffrente, elle se feraou ne se fera pas. Elle se fera par un acte de force pure ou un acte juridique, qui constituera peut-tre un second acte d'administration, peu importe. C. Dcisionprise au nom d'une personne administrative par un reprsentantlgal. Les personnes administratives nous sont connues. Quant aux reprsentants lgaux de ces personnes au point de vuedes dcisions prendre, et par consquent des actes d'administration accomplir, ils sont dtermins par les rgles sur l'organisation administrative; ce sont les autorits administratives dont il sera parl au chapitre suivant. Pour chaque personne administrative, il ya deux organes qui, chacun dans une sphre d'action dtermine, peuvent prendre des dcisions excutoires : l'organe de lgislation ou de dlibration, et l'organe excutif. Pour les tablissements publics il n'y a souvent qu'un seul organe.
LES ACTES D'ADMINISTRATION
187
On peut donc facilement dresser la liste approximative des actes d'administration : a) Au nom de l'tat: (Organe lgislatif). Lois d'affaires. (Organe excutif). Dcretsdu chef de l'tat, arrts ou dcisions ministrielles, arrts prfectoraux ou sous-prfectoraux. Il y a aussi des autorits administratives phmres dont les dcisions sont des actes d'administration. Les matires lectorales en fournissent beaucoup d'exemples: dcisionsdu bureau lectoral, de la commission de recensement, etc. b) Au nom du dpartement: (Organe dlibrant). Dcisions du conseil gnral et de la commission dpartementale. (Organe excutif). Arrts duprfet. : c) Au nom de la commune (Organe dlibrant). Dcisionsdu conseil municipal. (Organe excutif). Arrts du maire. : d) Au nom de la colonie (Organe dlibrant) Dcisions du conseil gnral. (Organe excutif). Arrts du gouverneur. e) Au nom des tablissements publics: (Organe de dlibration et d'excution confondus). Dcisionsde la commission administrative. D. Dcision en vue de produire un effet de droit. Il faut, pour qu'il y ait acte d'administration, que la dcision constitue l'exercice d'un droit, c'est--dire ait en vue la cration immdiate d'une nouvelle situation juridique, soit pour la personne administrative, soit pourun tiers. Cette rgle fait que nombre de dcisions prises par des administrateurs, ne constituent pas des actes d'administration. Sont dans cette catgorie,: 1 Les instructions donnes par des suprieurs hirarchiques leurs subordonns, en vue de leur faire prendre des dcisions dans un certain sens (16 janv. 1880, fabrique d'Astaffort); 2 Les mises en demeure qui prcdent et font pressentir des dci, sions excutoires, mais qui n'en sont pas encore (10 dc. 1875 5 avril 1884). Article II. Classification des actes d'administration. Les actes d'administration peuvent tre classs trois points de vue diffrents: 1 Au point de vue de l'effet de droit qu'ils produisent; ce point
L'ADMINISTRATION de vue, qui est le plus important, ils se divisent en actes d'autorit et en actes de gestion; 2 Au point vue de la qualit en laquelle les personnes administratives ont agi en les accomplissant, on les distingue alors en actes de puissance publique et en actes de personne prive; 3 Au point de vue du degr de responsabilit juridique avec lequel les personnes administratives les ont accomplis, on distingue alors, des actes de gouvernement, des actes d'administration discrtionnaire, des actes d'adminitration ordinaire. Les actes 69. Actes d'autorit, actes de gestion. d'administration se distinguenten actes d'autorit et actes de gestion. Les actes d'autorit sont ceux qui ne confrent pas aux tiers de droits acquis. Ainsi, l'arrt du prfet autorisant l'ouverture d'un tablissement insalubre est un acte d'autorit parce qu'il ne fait qu'une concession rvocable. Souvent mme les actes d'autorit ne concdent rien du tout, ils ne font qu'imposer des obligations : un rglement de police est un acte d'autorit; les dcisions des corps dlibrants sont en gnral des actes d'autorit, parce que leur seul effet de droit est d'obliger l'organe excutif excuter. Les actes de gestion sont ceux qui confrent aux tiers des droits acquis. Ainsi, la liquidation d'une dette de l'tat faite par dcision ministrielle est un acte de gestion, parce qu'elle constitue l'tat dbiteur vis--vis du fournisseur. De mme, les contrats passs pour assurer le fonctionnement des services publics sont, en principe, des actes de gestion, parce qu'ils sont commutatifs, marchs de travaux publics, marchs de fournitures, etc. Il y a un signe extrieur auquel on reconnat facilement l'acte de gestion et l'acte d'autorit, c'est que le premier entrane un dplacement de valeur pcuniaire dans le patrimoine de la personne administrative, que le second n'en entrane pas. En effet, du moment qu'une valeur pcuniaire a t dplace dans le patrimoine administratif, cela veut dire qu'un acte commutatif a t pass, qu'un tiers a acquis un des droits qui taient dans ce patrimoine, et que peut-tre il en a cd un autre en change. Il y a corrlation entre les deux choses. a) Diffrences entre l'acte d'autorit et l'acte de gestion. Dans l'acte d'autorit, la volont de la personne administrative reste indpendante et entire; n'ayant confr aucun droit contre soi, elle conserve son vrai caractre qui est d'tre imprieuse. Dans l'acte de gestion, elle est lie par le fait mme qu'elie a confr un droit un tiers; elle est diminue et abdique son caractre imprieux. L'acte
188
LES ACTESD'ADMINISTRATION
189
d'autorit est toujours un acte de puissance publique, tandis quel'acte de gestion peut tre un acte de personne prive. : Il s'ensuit que: 1 L'acte d'autorit est rvocable, l'acte de gestion ne l'est pas. L'acte d'autorit est rvocable quelque moment que ce soit, vingt, trente ans, cinquante ans plus tard, la condition qu'il n'ait pas servi d'appui un acte de gestion qui aurait confr des droits des tiers. L'acte d'autorit doit tre rapport par la mme autorit qui l'avait accompli et dans les mmes formes; 2 L'acte d'autorit est attaquable ensoi par le recours pour excs de pouvoir, voie de nullit fonde sur les vices intimes de la manifestation de volont. L'acte de gestion n'est pas attaquable par cette voie mais par un recours contentieux ordinaire fond sur la violation du droit qu'il a confr; il ne faut plus considrer la manifestation de volont en elle-mme, mais dans le droit qu'elle a confr; 3 Les tribunaux administratifs sont naturellement comptents pour l'apprciation de l'acte d'autorit, tandis que les tribunaux judiciaires sont naturellement comptents pour l'apprciation de l'acte de gestion. Cela tient ce droit acquis confr au tiers, qui rapproche l'acte de gestion des actes de la vie civile. Cependant, il est des actes de gestion qui, conservant le caractre d'actes de puissance publique, sont de la comptence des tribunaux administratifs. b) Hirarchie entre l'acte d'autorit et l'acte de gestion. Il n'y a pas seulement une diffrence entre l'acte d'autorit et l'acte de gestion, il y a une sorte de hirarchie. L'acte d'autorit est l'acte d'administration primordial, l'acte de gestion est un acte secondaire qui s'appuie toujours sur quelque acte d'autorit et lui sert de mode d'excution. Cela est vrai, non seulement quand l'organe excutif passe un contrat dtermin, ou fait quelque autre acte de gestion en vertu d'une dcision spciale de l'organe dlibrant, mais mme lorsque l'acte est pass en vertu de ses attributions propres. Mme dans ce cas, en effet, il y a un acte d'autorit pralable qui est le budget des dpenses, et tous les actes de gestion ne sont quel'excution du budget. tant donne cette importance de l'acte d'autorit, on conoit que certains auteurs l'appellent l'acte d'administration par excellence. Observation. Dans une mme opration administrative on trouve presque toujours accumuls des actes d'autorit et des actes de gestion. Ainsi dans une opration de travaux publics, l'acte dclaratif d'utilit-publique est un acte d'autorit, le march de travaux est un acte de gestion, la liquidation de la dpense est un acte de gestion, etc. 70. II. Actes de puissance publique, actes de per-
190
L'ADMINISTRATION
Les actes de sonne prive. puissance publique sont ceux que les personnes administratives ont accomplis en vertu de leur personnalit de puissance publique ; les actes de personne prive, ceux qu'elles ont accomplis en vertu de leur personnalit de personne prive. L'intrt pratique de la distinction est dans une question de comptence; les actes de puissance publique en principe ne peuvent tre apprcis que par les tribunaux administratifs, les actes de personne prive peuvent l'tre par les tribunaux ordinaires. Cette subdivision des actes d'administration se combine avec la prcdente de la faon suivante : 1 Les actes d'autorit sont toujours de puissance publique. Et cela, alors mme qu'ils seraient relatifs l'exercice d'un droit de personne prive. Ainsi une dcision du conseil municipal relative un bail d'un bien priv de la commune est un acte de puissance publique, parce que c'est un acte d'autorit1; 2 Pour les actes de gestion, il en est qui sont considrs comme actes de puissance publique, d'autres comme actes de personne prive. Au premier rang des actes de gestion de puissance publique, sont certaines oprations unilatrales o l'tat impose manifestement sa volont : les liquidations de dettes par lesquelles le ministre fixe lui seul le chiffre de la dette de l'tat envers un fournisseur; les arrts de dbet par lesquels le ministre fixe lui seul le chiffre de la crance de l'tat contre un comptable ou contre un fournisseur. De plus, certains contrats, malgr leur caractre bilatral, constituent des actes de gestion de puissance publique, parce que la personne administrative s'y rserve des droits exorbitants, on les appelle contrats administratifs : ce sont ceux qui sont passs pour le fonctionnement des services publics, marchs de travaux publics, marchs de fournitures de l'tat; des contrats analogues passs pour le service du domaine priv conservent le caractre priv Il faut considrer que le caractre d'acte de puissance publique est exceptionnel pour l'acte de gestion, et que celui-ci a une tendance naturelle tomber sous la juridiction ordinaire. 71. III. Actes de gouvernement, actes d'administration nistration, division est tire du degr de responsabilit actes ont t accomplis. Et la responsabilit en raison de la libert. Il est des cas o actes de pure admi Cette ordinaire. juridique avec lequel les juridique elle-mme est l'tat accomplit des actes
1. Ceci n'est vrai que si l dcision est examine en soi et avant d'tre incorpore au contrat qui s'ensuit; une fois le contrat pass, la dcision en fait partie intgrante.
LES ACTES D'ADMINISTRATION
191
pour lesquels il n'est pas entirement libre, pour lesquels les administrateurs ont la main force ; la contrainte provient des ncessits de la dfense extrieure ou de celles de la politique intrieure. Il est clair que si ces actes entranent des dommages, l'tat ne peut pas tre dclar juridiquement responsable, car il y a cas de force majeure. C'est donc au fond la question de savoir s'il y aura des recours ou s'il n'y en aura pas qui s'agite. Il y a trois catgories d'actes: 1 Actes de gouvernement. Ce sont des actes contre lesquels le recours contentieux n'est pas recevable, uniquement parce qu'ils ont t accomplis sous l'empire de la raison d'tat. Le Conseil d'tat saisi d'un recours doit se dclarer incomptent; s'il se dclarait comptent, le ministre lverait le conflit et la question serait porte au tribunal des conflits (L. 24 mai 1872, art. 26,1). Il a dj t parl de ces actes propos de la garantie des droits publics, car ils contiennent une menace pour ces droits,il peuvent servir de prtexte l'arbitraire. (V. p. 99.) La question intressante est celle de savoir quels sont ces actes et si on peut les numrer. Deux thories sont en prsence: a) La premire thorie que l'on peut qualifier de politique, est que' tous les actes d'administration, quels qu'ils soient, peuvent revtir accidentellement, grce aux circonstances politiques du moment, le caractre d'acte de gouvernement. C'est une question de mobile. Pas n'est besoin de faire remarquer tout ce que cette thorie a de dangereux. Tous les droits individuels seraient la merci de l'arbitraire gouvernemental; on pourrait aller jusqu' des confiscations de proprit. La situation des fonctionnaires inamovibles, des officiers propritaires de leur grade, etc., serait branle. On ne doit mme pas admettre qu'un acte d'administration, provoqu ou approuv par un ordre du jour des Chambres, prenne le caractre d'acte de gouvernement (Trib. confl.5 nov. 1880, dcrets contre les congrgations). b) La seconde thorie, plus juridique en ce sens qu'elle s'efforce de protger davantage les droits des particuliers, et de restreindre le domaine de la politique, admet qu'il y a une certaine liste d'actes que l'on peut dresser et qui par nature sont toujours des actes de gouvernement; mais que les autres actes ne sauraient revtir cette qualit. Cela semble tre jusqu' prsent la jurisprudence du Conseil d'tat (arrt 2 avril 1886, Fontenaud; 20 mai 1887, princes d'Orlans). C'est celle de la Cour de cassation (Crim. cass. 1er janv. 1885, d'Ornano). Quant au tribunal des conflits, il s'en rapproche, car il a dcid (arrt, 15 fvr. 1890) qu'un fait formellement interdit aux fonctionnaires
192
L'ADMINISTRATION
par une disposition de la loi pnale, ne saurait revtir le caractre d'un acte de gouvernement. Mais tout n'est pas dit sur cette thorie, car il s'agit d'tablir la liste. Faisons observer, d'abord, qu'il ne s'agit que d'actes accomplis au nom de l'tat, non point au nom du dpartement ou des communes, car il n'y a que pour l'tat que la raison d'tat se pose; en second lieu, qu'il ne s'agit que d actes accomplis par le pouvoir excutif, car les actes lgislatifs chappent par leur forme mme tout recours. Cela pos, il faut reconnatre qu'il n'y a point d'autre autorit pour dresser la liste que le Conseil d'tat et le tribunal des conflits; que ces deux autorits doivent employer tous leurs efforts raccourcir la liste, mais que cependant si des circonstances nouvelles rvlaient des actes nouveaux (par exemple en matire de protectorats), elles auraient le devoir de les inscrire1. La doctrine et la jurisprudence ne doivent pas oublier que l'idal du droit serait la suppression complte de la catgorie des actes de gouvernement; qu'on doit perptuellement y tendre, mais que cet idal ne sera jamais atteint cause de l'infirmit des socits humaines2. : 1 dcrets relatifs aux rapports Voici la liste gnralement admise du pouvoir excutif avec les Chambres, convocation, ajournement, dissolution des Chambres, promulgation des lois; 2 dcrets tablissant l'tat de sige; 3 dcrets rendus en matire de police sanitaire; 4 Les traits diplomatiques, les actes interprtant ces traits, les actes d'excution relatifs ces traits lorsque l'excution n'en est pas abandonne aux tribunaux, c'est--dire lorsqu'ils sont relatifs des questions de droil international public. Les ngociations par lesquelles le gouvernement intervient auprs des puissances trangres, pour ob1.Acepoint de vue, la dcisiondu Conseild'tat du 18dcembre 1891,dans l'affaire de la cessation du jeu des trente-six.btes au Cambodge,nous parait trs correcte. La pression exerce par le gouvernement franais sur le roi du Cambodge,souverain protg, en vue de l'amener faire cesser le jeu des trente-six btes, est une varit d'action diplomatique, et il appartenait bien au Conseild'tat de dclarer qu'il y avait l un acte de gouvernement non susceptible d'tre discut par voie contentieuse. 2. Des auteurs enseignent, en se plaant au point de vue du droit idal, que la catgorie des actes de gouvernementdoit tre supprime,et d'ailleurs, une savante analyse les conduit cette constatation que dans la plupart des cas elle est inutile, car pour d'autres raisons les recours n'aboutiraient pas (V. intressant article de M. Michoud,professeur de droit administratif la Facult de Droit de Grenoble, Annalesde Grenoble,t. I). Ils oublient qu'il s'agit justement de ne pas laisser s'engager la procdure sur ces recours et de les carter par une question pralable et, qu'en politique, la question pralable a une grosse importance.
D'ADMINISTRATION LES ACTES
193
tenir la rparation des dommages causs nos nationaux, sont des actes de gouvernement; 5 les faits de guerre rsultant de dcision prises pour la dfense nationale. Les faits de guerre ne donnent point droit une indemnit, sauf serrer de prs la notion du fait de guerre, et distinguer entre celui qui s'impose comme une ncessit immdiate de la lutte, et celui qui n'est qu'une mesure de prparation lointaine. 2 Actes discrtionnaires. Ce sont ceux pour lesquels le Conseil d'tat est lui-mme juge de la mesure dans laquelle il doit admettre le recours contentieux, raison des ncessits d'administration ou de politique intrieure; on les appelle aussi actes de pure administralion ou de haute administration. La liste n'en est pas trs arrte, mais aussi n'chappent-ils pas au recours confentieux aussi compltement que l'acte de gouvernement. La jurisprudence tend y tendre le recours pour excs de pouvoir. On peut dire qu'ils ne rpugnent vraiment ce recours que dans les cas o il est fond sur le chef de violation de la loiet des droits acquis parce qu'il est dans la nature des actes discrtionnaires de ne pas confrer de droits acquis; mais ils peuvent trs bien tre attaqus pour incomptence, ou vice de forme ou mme pour dtournement de pouvoir. Liste : 1 Rglements administratifs gnraux ; 2 mesures de police intressant la salubrit et la scurit publiques ; 3 actes de tutelle administrative, approbation ou annulation de dcisions ; 4 suspension ou dissolution de corps lectifs; 5 nomination et rvocation des fonctionnaires, lorsqu'il n'y a pas de loi fixant les droits de ceux-ci; 6 retrait de concession de mine, etc. 3 Actes d'administration ordinaires. Ce sont ceux contre lesquels le recours contentieux est normalement admis, sans qu'aucune fin de non-recevoir puisse tre tire des ncessits de l'administration. Il sont la rgle, il n'y a pas lieu de les numrer. Article III. Nature de l'acte d'administration. L'acte d'administration est une dcision, une manifestation de volonl; mais cette volont, on l'a dja vu, n'a pas le mme caractre dans l'acte d'autorit et dans l'acte de gestion. la 72. Nature de l'acte d'autorit. Dansl'acte d'autorit, personne administrative agissant . tftre de puissance publique, sa volont est imprieuse, elle ne traite pas d'gal gal,elle s'impose; suivant les cas, l'acte d'autorit se rapproche soit d'un acte de lgislateur, soit d'un acte de juge, sans tre jamais tout fait ni l'un ni l'autre. H. 13
194
L'ADMINISTRATION
a) Il se rapproche d'un acte de lgislateur: 1 quand il contient rglement gnral de police, obligatoire pour les particuliers ; 2 quand c'est une dcision de l'organe dlibrant, obligatoire pour l'organe excutif. b)Il se rapproche d'un acte de juge: 1 quand il contient une dcision applicable un particulier isol, comme l'arrt prfectoral qui autorise l'ouverture d'un tablissement dangereux, l'arrt de dlimitation du domaine public; 2 quand il contient un acte de tutelle vis--vis d'une personne administrative infrieure, par exemple l'arrt du prfet annulant la dcision d'un conseil municipal. La ressemblance avec un jugement est tellement grande dans quelques-unes deces hypothses, que quelques auteurs sont alls jusqu' l'identification. Et alors, pour ces auteurs, les dcisions des autorits administratives tant des jugements, les voies de recours qui sont diriges contre elles sont des voies d'appel. Il y a l une confusion regrettable qui, pendant longtemps, a encombr le droit administratif, mais dont on semble aujourd'hui compltement dgag. Il n'y a vritable jugement, que lorsqu'il y a litige organis suivant des rgles dont l'application serait impossible ici. Ainsi, il est de principe que le juge ne saurait tre juge et partie, l'adminis- trateur ne saurait donc tre un juge, caril est toujours partie. Quand il statue, il exerce toujours les droits de quelque personne administrative dont il est le reprsentant. Ainsi encore, le juge ne prononce pas d'office, l'administrateur agit souvent d'office, etc. (V. cependant au .contentieux, ce qui sera dit des dcisions sur recours administratifs, n 576.) Dans l'acte de gestion, 73. Nature de l'acte de gestion. en principe, la volont de la personne administrative se met de niveau avec la volont des particuliers, elle dpouille son aspect imprieux et revt l'apparence d'un consentement contractuel. Cela tient ce que cette volont est lie par les droits acquis que dans l'acte de gestion elle confre aux tiers. D'ailleurs, cela ne compromet en rien le caractre de la personne administrative, puisque l'acte de gestion suppose au pralable un acte d'autorit dont il n'est qu'un mode d'excution. Il ne faudrait pas croire que ce soit toujours un consentement vraiment contractuel. Il y a l un manque d'harmonie dans le droit administratif. Dans nombre d'actes de gestion, ceux qui sont en mme temps actes de puissance publique, la volont administrative garde un caractre imprieux. Dans les contrats administratifs, les personnes administratives ont toujours quelque privilge singulier qui empche
LES ACTESD'ADMINISTRATION
195
l'galit complte des parties; plus forte raison, dans les actes unilatraux. La liquidation de dettes et l'arrt de dbet, par exemple, sont des oprations qui ressemblent des actes de juge, qui mettent l'tat vis--vis du fournisseur ou du comptable, dans la mme situation avantageuse que s'il avait obtenu un premier jugement en sa faveur. L'arrt de dbet, mme, autorise le ministre des finances dcerner une contrainte qui entrane hypothque judiciaire. Il faut voir l des anomalies qui disparatront avec le temps. La logique finira par ramener tous les actes de gestion la pure notion contractuelle, et celle d'actes de personne prive. Article IV. Importance de l'acte d'administration.
74. Si l'on recherche pourquoi le Droit donne de l'importance l'acte d'administration, pourquoi il se proccupe ainsi d'une simple dcision qui n'est peut-tre pas encore excute, pourquoi il l'isole de l'opration dont elle fait partie, on s'aperoit que c'tait indispensable pour le contrle de l'action administrative. Si l'on et attendu qu'une opration administrative et t compltement excute pour en examiner la rgularit, on se ft presque toujours trouv en face de l'irrparable. On prvient bien des actes fcheux en saisissant l'action administrative dans son germe, dans la dcision qu'elle prend. Il y a l un examen de la volont, qui n'est pas possible chez les particuliers avant que cette volont n'ait t projete au dehors dans une opration juridique, parce que, jusque-l, tout se passe dans la conscience, mais qui est possible chez les tres fictifs dont les rouages sont apparents. Toute l'importance des actes d'administration est donc dans les conditions de validit qui leur sont imposes, dans le contrle et dans les recours dont ils sont l'objet; cela est surtout vrai pour l'acte d'autorit et apparatra par l'tude du recours pour excs de pouvoir. ET PROCDURE DEL'ACTE D'ADMINISTRATION 2. FORME Article I. Forme et procdure de l'acte d'autorit. L'acte d'administration est assujetti une forme, et mme assez souvent une succession de formes, qui constituent une vritable procdure. Il ne s'agit pas ici des formes intrinsques suivant lesquelles la dcision en elle-mme est prise, ces formes seront tudies propos de l'organisation des personnes administratives, mais des formes extrinsques qui accompagnent la dcision.
196
L'ADMINISTRATION
75. A. Formalits l'acte. Ces formalits antrieures ont toutes le mme but, clairer l'administration sur l'utilit publiqued'une mesure prendre. Elles constituent une sorte de procdured'instruction prparatoire; elles consistent dans des enqutes de commodo et incommodo, des dlais observer, des avis prendre. a) Enqute de commodo et incommodo. C'est une procdure administrative qui a pour but de constater l'opinion des tiers intresss sur des projets de l'administration. Elle consiste essentiellement dans l'envoi dans chaque commune intresse, d'un commissaire enquteur charg de rassembler des dpositions. Cet envoi du commissaire enquteur est prcd de mesures de publicit et du dpt la mairie de toutes les pices intressant le projet, de faon ce que le public puisse se renseigner. Le type de l'enqute decommodo et incommodo est celui qui est dcrit dans une circulaire du ministre de l'intrieur du 20 aot 1825 (Bull. officiel, V. p. 412); quoique spcial aux alinations communales, il doit tre considr comme devant tre employ toutes les fois qu'il n'y a pas de rgles particulires. L'enqute doit tre annonce huit jours l'avance son de trompe ou de tambour et par voies d'affiches placardes au lieu principal de runion publique, afin que les intresss ne puissent en ignorer, et parce que cette publicit autorise compter le silence des absents comme un vote affirmatif. L'annonce doit tre faite le dimanche. Il est bon aussi que l'enqute se fasse un dimanche. Le commissaire enquteur est dsign par le sous-prfet, qui choisit d'ordinaire le juge de paix du canton ou un maire d'une commune voisine. Au jour fix, le commissaire enquteur ouvre un procs-verbal. Le prambule de ce procs-verbal, dont il est donn communication aux dclarants, contient un expos exact de la nature, des motifs et des fias du projet annonc. Les dclarations sont individuelles et se font successivement; elles sont signes des dclarants, ou certifies conformes la dposition orale pour ceux qui ne savent pas crire, par la signature du commissaire enquteur. Lors mme que les dpositions sont identiques, chacune d'elles doit tre consigne. Les dclarations sont orales, en principe, mais elles peuvent tre crites. Tous les habitants sont admis sans distinction mettre leur avis, qu'ils soient ou nom domicilis, qu'ils soient ou non contribuables. C'est donc une enqute trs large, trs librale; il faut ajouter qu'elle est sans frais. C'est une premire diffrence avec les enqutes judiciaires; une autre diffrence est qu'on n'exige pas la qualit de tmoin, ni le serment. Bien qu'en gnral l'enqute ne dure qu'un jour, l'affiche peut annoncer plusieurs jours, et l'enqute n'est mme pas nulle si elle se prolonge au del du terme fix, par suite du grand nombre d'habitants qui se sont prsents.
LES ACTES D'ADMINISTRATION
197
Le procs-verbal dress par le commissaire enquteur est envoy au sous-prfet, qui y joint son avis et l'expdie qui de droit, suivant la matire qui en fait l'objet. Il y a des enqutes de commodoet incommodo spciales en matire d'expropriation pour cause d'utilit publique (Ord. 18 fvrier 1834,15 fvrier et 22 aot 1835, Ord. 7 septembre 1842); en matire d'tablissement d'association syndicale autorise (L. 21 juin 1865, art. 10, et D. 17 novembre 1865); en matire d'alination des chemins ruraux, rgles spciales de publication (L. 20 aot 1881, art. 16). L'enqute est en principe prescrite par le prfet, exceptionnellement par le ministre ou par le sousprfet. Il y a des cas o l'emploi de l'enqute est obligatoire, d'autres o il est facultatif. L'enqute est obligatoire notamment en matire d'acquisition et d'alination de biens communaux, en matire d'expropriation pour cause d'utilit publique, en matire d'autorisation d'tablissements insalubres de premire et de deuxime classe, en matire de changement aux circonscriptions territoriales d'une commune, en matire de sectionnement lectoral, etc. Dans les cas o l'enqute est obligatoire, elle l'est peine de nullit, et son absence est un vice de forme qui constitue ouverture recours pour excs du pouvoir. L'emploi de l'enqute facultative est une pratique recommandable, de plus en plus employe par l'administration. b) Dlais observer. On pourrait dire de l'acte d'administration l'inverse de ce que l'on dit pour l'acte de commerce. Ce qui en faitle propre, c'est la lenteur. On reproche souvent l'administration ses lenteurs ; condition de n'tre pas exagres, elles sont plutt bonnes que mauvaises; elles seules permettent aux administrateurs de se rendre un compte exact de la situation. Elles leur donnent le temps d'attendre de bonnes occasions pour s'informer, car il est toujours plus difficile de prendre conscience d'un besoin collectif, c'est--dire du besoin d'autrui, que d'un besoin personnel. Les dlais sont donc dans la pratique de l'administration. Il en est qui sont imposs par la loi. C'est ainsi que depuis l'art. 16 in fine de la loi du 20 aot 1881, dans la vente de partie de l'assiette d'un chemin rural dclass, l'autorisation de la vente ne peut tre donne qu'aprs un dlai de trois mois depuis l'enqute, dlai pendant lequel un syndicat peut se former et se charger de l'entretien de l'ancien chemin. c) Avis prendre, formalits diverses. Les cas sont nombreux dans lesquels les autorits, avant de prendre les dcisions, doivent s'entourer d'avis : 1 avis de conseils administratifs, les plus importants sont ceux que le chef de l'tat doit demander au Conseil d'tat avant de signer un dcret, et ceux que les prfets doivent demander aux conseils de prfecture; mais il est d'autres conseils plus techniques dont les avis doivent tre pris galement dans presque toutes les affaires. Les avis du comit des btimentscivils pour les btiments destins aux services publics, ceux
198
L'ADMINISTRATION
du conseil suprieur desponts et chaussespour les ponts et autres travaux d'arts, sont clbres par les formalits et les lenteurs qu'ils entranent1 ; 2 avis d'agents de l'administration, tels que l'ingnieur en chef, l'agent voyer;3 avis ou rapports d'experts nomms cet effet, etc. Dans la. grande majorit des cas, l'avis est obligatoire en ce sens qu'il doit tre pris, mais non pas en ce sens qu'il devrait tre suivi. Quelquefois, cependant, il doit tre suivi. 76. B. Formalits concomitantes l'acte. Les formalits ncessaires ne sont pas nombreuses. On ne peut pas dire que l'administration soit formaliste. Mais il y a cependant une forme qui s'impose la dcision, c'est la forme crite. Si la dcision mane de corps dlibrants, elle est consigne dans des procs-verbaux. Si elle mane d'administrateurs, elle est consigne dans des dcrets ou arrts, ou de simples dcisions, cartrs souvent les prfets prennent des dcisions par simple lettre. L'uvre personnelle de l'auteur ou des auteurs de la dcision dans l'criture, se rduit la signature; procs-verbaux ou arrts peuvent tre crits par des secrtaires ou tre imprims, mais ils doivent tre signs, soit par les membres du corps dlibrant ou les membres du bureau, soit par l'administrateur. Le plus souvent, la signature est accompagne d'un sceau, c'est--dire d'une empreinte obtenue l'aide d'une plaque de mtal sur laquelle sont gravs certains signes connus. Le sceau est indispensable sur toutes les dcisions qui contiennent des injonctions aux particuliers, pour attester l'authenticit de la signature. La date est essentielle au mme degr que la signature, afin qu'on puisse vrifier la comptence de l'autorit qui a sign. Quelquefois la loi exige que la dcision soit motive. L. 15 mai 1818, art. 80 : Tous les actes, Timbre et enregistrement arrts, dcisions des autorits administratives non dnomms dans l'art. 78 sont exempts de timbre sur la minute et de l'enregistrement, tant sur la minute que sur l'expdition. Toutefois, aucune expdition ne pourra tre dlivre aux parties que sur papier timbr, si ce n'est des individus indigents, la charged'en faire mention dans l'expdition. Les actes dnomms dans l'art. 78 sont des actes de gestion translatifs de droits rels; ils sont soumis au timbre et l'enregistrement. De mme, toutes 1. Les formalits remplir devant les conseils administratifs constituent toute une procdure que les particuliers intresss la dcision intervenir doivent suivreavec grand soin. La procdure devant les sections administratives du Conseil d'tat a fait l'objet d'un guide intressant de MM.Denis de Lagarde et Andr Godfernaud,Paris, 1891.
LES ACTESD'ADMINISTRATION
199
les demandes faites l'administration sont assujetties au timbre (L. 19 brumaire an VII), sauf les ptitions au corps lgislatif, demandes de secours, lettres de rappel, communications dans l'intrt de la chose publique. mesures depublicit, noti77. C. Formalits postrieures, Les actes d'administration, qui renferment des dcisions fication. excutoires vis--vis des tiers, doivent tre ports la connaissance de ceux-ci. Lorsque ce sont des rglements, ils doivent tre publis et affichs; nousavons vu cette matire (p. 66). Lorsque ce sont des actes individuels, ils doivent tre notifis. La notification peut tre faite par huissier en la forme ordinaire; mais elle peut aussi tre faite par la voie administrative, c'est--dire copie transmise par les soins du maire, par le garde champtre ou le commissaire de police. L'acte d'autorit, comme toute manifes78. Observation. tation de volont, peut tre soumis des modalits, terme ou condition. Il peut trs bien tre dcid que l'excution de la dcision sera suspendue jusqu' l'expiration d'un certain dlai. Il peut trs bien tre convenu que la dcision elle-mme est subordonne l'vnement d'une certaine condition. Les dcisions conditionnelles sont frquentes en administration. Les oprations administratives ncessitent souvent plusieurs dcisions prises par la mme autorit ou par des autorits diffrentes, entre lesquelles doivent se produire certains faits trangers. Jusqu' ce que ces faits se soient produits, la dcision est conditionnelle. Les dclarations d'utilit publique de travaux sont gnralement ad tempus. Les arrts dlivrant des alignements individuels sont valables pour un an, etc. Article II. Forme de l'acte de gestion. 79. Il faut faire attention d'abord ne pas confondre l'acte de gestion avec l'opration administrative. Pour peu que l'acte soit soumis une procdure dcompose en plusieurs phases, il devient une opration au cours de laquelle il y aura lieu de distinguer des actes d'autorit et des actes de gestion. Ainsi en est-il du march de travaux publics pass par adjudication. Ce contrat est devenu une opration, au cours de laquelle se glissent des actes d'autorit: par exemple, l'arrt prfectoral approuvant l'adjudication. (V. l'arrt du Conseil d'tat du 21 mars 1890 admettant le recours pour excs de
200
L'ADMINISTRATION
pouvoir contre cet arrt.) L'adjudication en elle-mme est le vritable acte de gestion. Il faut distinguer aussi entre les actes de gestion unilatraux et les contractuels. La liquidation d'une dette de l'tat, l'arrt de dbet revtent la forme des dcisions ou des arrts. Quant aux contrats, ils peuvent tre passs par adjudication ou de gr gr. On verra les formes de l'adjudication propos des marchs, marchs de travaux publics et autres (n 482). Forme dite administrative. Les contrats de gr gr peuvent tre passs dans la forme notarie ou dans la form dite administrative. La forme dite administrative confre l'authenticit sans qu'on ait besoin de recourir au ministre d'un notaire. Les actes sont simplement dresss sur papier libre ou sur un imprim, et signs par l'administrateur comptent et les parties, si elles savent le faire; si elles ne savent signer, il faut l'attestation de deux tmoins. La question de savoir si ces actes doivent tre ensuite timbrs et enregistrs est rgle par les art. 78 80, L. 15 mai 1818. Les actes portant transmission de proprit et d'usufruit, les adjudications ou marchs de toute relatifs ces actes, sont soumis l'enregistrenature,les cautionnements ment, etau timbre, les autres en sont dispenss. Passs au nom de l'tat et des dpartements, ces actes entranent excution pare; au nom des communes ils ont tous les caractres des actes authentiques, sauf l'excution pare (Cire. min. du 19 dcembre 1840, et jurisprudence); mme chose fortiori pour les tablissements publics1. Ils peuvent contenir constitution d'hypothque conventionnelle. DEL'ACTE D'ADMINISTRATION 3. LES VICES 80. Les actes d'administration sont des manifestations de volont des personnes administratives, mais il ne faut pas oublier que cette volont est formule par reprsentant. Si les personnes administratives pouvaient formuler elles-mmes leur volont, celle-ci serait toujours correcte et les actes d'administration seraient parfaits. Mais se sont des personnes fictives, elles ne vivent que par l'intermdiaire de leurs organes et ces organes peuvent parfois se montrer reprsentants infidles et traduire inexactement la volont administrative. L'acte d'administration peut donc tre vici du fait du reprsentant. D'une faon gnrale, on peut dire que l'acte d'administration 1. Un.dcret du 12 aot 1807recommandait aux hospices l'acte notari, mais des instructions rcentes leur recommandent l'acte en la forme administrative.
LES ACTESD'ADMINISTRATION
201
sera vici parce que l'autorit administrative qui l'aura fait aura mal us de ses pouvoirs. Le Droit devait intervenir et il est intervenu ; il a class les vices de l'acte d'administration et organis des moyens de les corriger. Il y a : 1 la voie administrative o les actes vicieux pour cela deux voies sont annuls ou rforms par des autorits administratives suprieures, o par consquent l'administration se rforme elle-mme; 2 la voie contentieuse o les actes vicieux sont annuls ou rforms par des tribunaux. Nous verrons au paragraphe suivant les voies d'annulation ou de rformation; pour le moment nous allons tudier les vices. On peut distinguer trois vices: 1 L'usurpation de pouvoir qui entrane l'inexistence de l'acte; 2 L'excs de pouvoir qui entrane l'annulabilit de l'acte; 3 L'inopportunit qui, sans entraner annulabilit de l'acte au point de vue contentieux, peut autoriser l'annulation ou la rformation par voie administrative. Il est remarquer que le plus souvent les annulations ou rformations d'acte fondes sur les vices profitent aux particuliers, parce que le plus souvent c'est au dtriment des particuliers que les administrateurs commettent des excs de pouvoir. Mais il peut trs bien arriver, et avec les autorits administratives lectives cela arrivera de plus en plus frquemment, que l'excs de pouvoirs soit nuisible la personne administrative elle-mme. La thorie des vices de l'acte d'administration pourra donc devenir protectrice des intrts de l'administration elle-mme. Il suffira, pour la pousser dans cette voie. de donner au recours pour excs de pou voir une extension que nous indiquerons plus loin : de reconnatre que tout contribuable est recevable l'intenter. (V. infr, nos90 et 91.) Article Ier. De l'usurpation de pouvoir.
81. Un seul vice entrane l'inexistence, c'est l'usurpation de pouvoir. Il y a usurpation de pouvoir dans deux cas : a) Lorsqu'il y a violation du principe de la sparation des pouvoirs; par exemple, un reprsentant du pouvoir excutif usurpe le pouvoir lgislatif ou le pouvoir judiciaire: un dcret qui dicterait des dispositions lgislatives, un arrt de prfet qui trancherait des questions de proprit ou d'usage dans un rglement d'eau. La plupart des attaques diriges contre les arrts des maires, le sont parce qu'on prtend que ceux-ci ont empit sur le pouvoir lgislatif, en imposant aux citoyens des obligations qui ne pouvaient tre cres que par le lgislateur.
202
L'ADMINISTRATION
b) Lorsqu'une dcision est prise par une personne dpourvue de toute autorit, soit parce qu'elle est place en dehors de la hirarchie administrative, soit parce qu'elle y remplit des fonctions qui nelui confrent aucun droit de dcision, soit parce que, en l'espce, elle n'a pas seule le droit de dcision (cas d'incapacit). C'est ce qui arrive lorsque les reprsentants d'une personne administrative en tutelle accomplissent seuls un acte pour lequel l'approbation d'une autorit suprieure est exige; exemple : droits d'octroi tablis par le conseil municipal seul et que le maire voudrait faire percevoir. Dans tous ces cas o l'acte est inexistant, la nullit est radicale, ne se couvre par aucun dlai. Les tribunaux peuvent refuser d'appliquer l'acte. Les tentatives d'excution devraient tre considres comme des voies de fait justiciables de la police correctionnelle. Article II. De l'excs de pouvoir. 82. Les vices portant atteinte la validit de l'acte d'administration proviennent tous d'un mme fait gnral reprochable au reprsentant, l'excs de pouvoir. On a successivement fait sortir de l'excs de pouvoir les quatre vices suivants : l'incomptence, la violation des formes, le dtournement de pouvoir, la violation de la loi et des droits acquis. Ces vices entranent une nullit relative de l'acte mise en uvre au moyen d'un recours spcial, le recours pour excs de pouvoir (V. infr, n 90); chacun d'eux constitue une ouverture recours pour excs de pouvoir. A. Incomptence. L'incomptence rsulte de l'empitement d'une autorit administrative sur une autre (diffrence avec l'usurpation de pouvoir). a) Il peut y avoir empitement d'une autorit infrieure sur une autorit suprieure, c'est assez rare; en gnral, quand un infrieur agira dans ces conditions, ce sera en vertu d'une dlgation; la question portera alors sur la porte de la dlgation. b) Il peut y avoir empitement d'une autorit suprieure sur une autorit intrieure : ministre qui voudrait se substituer au prfet dans le cas o celui-ci a reu un pouvoir propre de dcision; conseil gnral qui voudrait se substituer la commission dpartementale pour les attributions propres de celle-ci, par exemple en classant un chemin vicinal ordinaire. Il faut faire attention que, d'aprs la loi municipale nouvelle, le prfet peut, dans des cas nombreux, se substituer au maire (art. 85,. 98, 4, 99). c) Il peut y avoir enfin empitement entre autorits gales, questions
L'EXCS DE POUVOIR
203
de comptence territoriale, trs rares cause de la nettet de nos divisions administratives. Cependant elles peuvent se produire dans les communes suburbaines de Paris et de l'agglomration lyonnaise, pour les pouvoirs de police entre le prfet et le maire. B. Vice de forme. Il y a vice de forme, lorsqu'il y a omission complte ou partielle des formalits auxquelles un acte administratif est assujetti par les lois ou rglements, enqutes, etc. V. p. 195. Il est bon de distinguer entre l'omission complte et l'omission partielle. a) En cas d'omission complte d'une formalit prescrite, il y a nullit; il ne faut pas appliquer la rgle qui est en vigueur dans certaines matires de droit civil et de procdure, d'aprs laquelle les nullits ne se supplent pas et doivent tre expressment prononces par la loi. Jamais il n'y en aurait, les lois administratives ne se proccupent pas d'en prononcer. Il n'y a pas distinguer entre les formalits substantielles et celles qui ne le sont pas; toutes les formalits doivent tre prsumes subtantielles. L'urgence d'une dcision ne l'affranchit mme pas de la ncessit des formes. La loi tablit elle-mme, lorsqu'elle le croit ncessaire, r une procdure d'urgence. Cependant il faut observer que les magistrats publics peuvent trouver dans leur pouvoir de police, dans le cas o la scurit est menace, un biais pour agir. b) La simple irrgularit ou omission partielle entrane aussi en gnral la nullit. La jurisprudence se montre svre; cependant on pourrait peut-tre ici faire la distinction entre les formes substantielles ou non, notamment dans les dtails d'une enqute. C. Dtournement de pouvoir. C'est le fait d'un agent de l'administration qui, tout enfaisant un acte desa comptence et en suivant les formes prescrites, use de son pouvoir discrtionnaire pour des cas et pour des motifs autres que ceux en vue desquels ce pouvoir lui a t attribu. C'est--dire qui, tout en restant fidle la lettre, sort de [ l'esprit de sa fonction. L'esprit des fonctions administratives tant la satisfaction de l'intrt gnral, presque toujours le dtournement de pouvoir sera caractris parla poursuite d'intrts particuliers. La thorie du dtournement de pouvoir a t surtout applique en matire de police. Ainsi la police du domaine public appartient l'administration en vue de la conservation de ce domaine. On ne peut pas la taire servir aux intrts financiers de l'tat, ni constituer un monopole au profit d un particulier. Il en est de mme de la police de la voirie, de la police de la salubrit, de la police municipale.
204
L'ADMINISTRATION
Ainsi, on ne peut pas faire servir la police de la voirie, en rglementant d'une certaine faon la circulation et le stationnement de voitures, crer un monopole au profit d'une entreprise dtermine d'omnibus. D. Violation de la loi et des droits acquis. Il y a nullit dan cette hypothse, une double condition: 1 Qu'il y ait eu violation d'une loi ou d'un rglement d'administration publique. Un certain nombre de textes rcents ont ajout cett expression de rglement d'administration publique, par laquelle i faut entendre toute espce de rglement gnral (V. 1. 10 aot 1871 art. 47 et 88; loi municipale, art. 63). 2 Qu'il y ait eu un droit viol. La jurisprudence se montre trs prudente dans l'application de ce cas de nullit. C'est cependant pour elle un moyen de dfinir et de prciser progressivement les droits des particuliers en regard des droits de l'administration 1. Applications tires de la jurisprudence: Atteintes la proprit et aux droits qui en drivent par des arrts de dlimitation, par des retraits de concession de mines, par l'tablissementl de servitudes d'utilit publique en dehors des servitudes lgales, par des arrts prescrivant des travaux de salubrit en dehors des obligations lgales. Atteintes la libert du commerce et de l'industrie. Atteintes aux droits rsultant de fonctions, grades ou titres, inamovibilit des magistrats, proprit du grade pour les officiers, les droit acquis aux membres de la Lgion d'honneur. 1. La violation de la loi et des droits acquis n'est considre comme un varit d'excs de pouvoir et par consquent commeune ouverture recour pour excs de pouvoir,que depuis le dcret du 2 nov. 1864.Auparavant, elle donnait lieu un recours contentieux en annulation fond en somme sur ce principe que toute violation de droit doit donner lieu une action. Si le recours contentieux en annulation a t confondu avec le recour pour excs de pouvoir, c'est pour un motif d'utilit pratique, parce que le D 2 nov. 1864,avait dispens ce dernier du ministre de l'avocat et l'avait ain rendu moins coteux. Cette confusiona eu pour rsultat de modifier la notion du recours pour excs de pouvoir. On pouvait dire autrefois que ce recours tait fond sur un simple intrt froisset il s'opposaitainsi naturellementaux recours fonde sur des droits viols, c'tait l son originalit. On ne peut plus le dfinir ain aujourd'hui, puisqu'en certains cas il est fond sur des violations de droitli on est rduit le dfinir par son rsultat et en faire le recours en annulation par opposition aux recours ordinaires qui donnent au juge la pleine juridic tion, c'est--dire le pouvoir de rformation.(V. infr, nos 89 et 90.)
L EXCSDE POUVOIR
205
Retrait de dcisions ayant cre des droits; les dcisions adminisratives ne peuvent plus tre rapportes, non seulement quand elles ont ar elles-mmes cr des droits, mais encore lorsqu'elles ont autoris ou approuv des actes d'o ces droits sont rsults. Cela s'applique l'acte le tutelle qui devient par l irrvocable. Cela s'applique encore l'agrent donn certaines nominations que l'administration ne fait pas celles des curs, par exemple. Les dcisions par lesquelles une autorit refuse d'accomplir un fait obligatoire pour elle; refus de dlivrer un alignement; refus de dlivrer un permis de chasse, un brevet d'invention, etc.; refus de communicaion de pices, telles que les listes lectorales; refus de donner rcpiss le certaines dclarations. Article III. De l'inopportunit de l'acte.
83. Il ne suffit pas qu'un acte d'administration renferme toutes ses conditions de validit requises, qu'on ne puisse y relever ni un vice d'incomptence, ni une violation des formes, ni une violation de a loi et des droits acquis, ni un manquement l'esprit gnral de il est encore dsirer que l'acte d'administration soit administration; opportun. C'est --dire que l'administration ne doit pas se borner tre corecte et respectueuse de la lgalit, elle doit s'efforcer d'tre habile. La consquence est que des actes d'administration peuvent tre anrnuls ou rforms pour cause d'inopportunit. A la vrit, dans l'apprciation de l'opportunit et de l'habilet des actes il y a un lment discrtionnaire qui constitue un danger. Aussi : 1 l'apprciation discrtionnaire de l'opportunit des actes 'est-elle jamais confie aux tribunaux, ce serait leur donner une trop on ne peut donc jamais faire valoir grande prise sur l'administration; ce grief par la voie contentieuse; 2 mme par la voie administrative, l'annulation ou la rformation des actes, sans cause dtermine, c'est-dire pour simple inopportunit est renferme dans des bornes assez troites. (V. infr, nos 85 et s.) DEL'ACTED'ADMINISTRATION PARLA VOIE 4. CONTROLE ADMINISTRATIVE 84. Dans un but de bonne administration, l'tat exerce spontanment et par la voie administrative une surveillance constante, soit sur ses propres actes, soit sur ceux des autres personnes administratives.
206
L'ADMINISTRATION
Le contrle administratif s'exerce par la voie de la tutelle lorsque l'acte a t accompli au nom d'une personne administrative autre que l'tat, par une autorit autonome, un conseil gnral, un conseil municipal, le maire mme, en tant qu'il reprsente la commune; par la voie hirarchique, lorsque l'acte a t accompli par une autorit infrieure reprsentant l'tat lui-mme, le prfet, le sous-prfet, le maire en tant qu'il reprsente l'tat. La diffrence la plus sensible entre ces deux espces de contrle administratif, c'est que la tutelle donne seulement le droit d'annuler un acte, tandis que l'action hirarchique donne le pouvoir de l'annuler ou de le rformer, c'est--dire de substituer une autre dcision la place de la premire. Mais, sous cette diffrence, il s'en cache une autre plus profonde, c'est que l'action hirarchique est purement administrative, tandis que la tutelle a une tendance devenir une surveillance juridictionnelle. Article Ier. Contrle exerc par voiede tutelle. 85. Il est des cas o la dcision prise au nom d'une personne administrative infrieure, ne devient excutoire qu'aprs approbation expresse d'une autorit suprieure. C'est bien une forme nergique de contrle, seulement l'acte d'administration n'existe qu'aprs l'approbation et devient l'uvre de l'autorit suprieure. Le vrai cas de tutelle est celui o l'acte de l'autorit infrieure est excutoire par lui-mme, mais peut tre annul par une autorit suprieure. Il faut distinguer trois hypothses: 1 L'acte peut tre annul d'office sans cause dtermine. Par consquent il peut tre annul, non seulement parce qu'il renferme un des vices signals plus haut, mais simplement parce qu'il est jug inopportun. Sont dans ce cas, par exemple: Les arrts de police des maires (art. 95, L.5 avril 1884), qui peuvent tre en tout temps suspendus ou annuls par arrt du prfet. Les dcisions du conseil gnral sur les objets noncs l'art. 48, L. 10 aot 1871, qui peuvent tre suspendues par dcret motiv du chef de l'tat, mais condition que le dcret intervienne dans les trois mois partir de la clture de la session (art. 49). Les dcisions du conseil gnral sur les objets o le conseil tait incomptent; elles peuvent tre annules toute poque par dcret rendu en assemble gnrale du Conseil d'tat (art. 33).
LE RECOURS HIRARCHIQUE
207
2 L'acte peut tre annul d'office pour cause dtermine. Sont ans ce cas, par exemple: Les dcisions prises par les conseils gnraux dans une runion illgale ; elles peuvent tre toute poque annules par le prfet lui-mme art. 34). Les dcisions rglementaires des conseils municipaux, qui constituent le droit commun; elles peuvent tre annules toute poque par le prfet en conseil de prfecture dans le cas de runion illgale, d'incomptence, de violation de la loi ou d'un rglement (art 63,65). Les mmes dcisions peuvent tre annules de la mme manire, mais seulement dans un certain dlai, dans le cas des art. 64 et 66, loi municipale. 3 L'acte peut tre annul sur recours et pour cause dtermine. Sont dans ce cas, par exemple: Les dcisions des conseils gnraux sur les objets noncs dans les art. 42,43 et 46, L. du 10 aot.1871 qui peuvent tre annules pour excs bde pouvoir par dcret en Conseil d'tat sur un recours du prfet intent en la forme du recours pour excs de pouvoir dans les vingt jours partir bde la clture de la session (art. 47). Les dcisions des conseils municipaux, dans les cas des art. 64 et 66, L. 5 avril 1884, qui peuvent faire l'objet d'un recours form devant le prfet statuant en conseil de prfecture dans un dlai de quinzaine; la ) dcision du prfet pouvant ensuite tre attaque par toute partie intresse devant le Conseil d'tat par un recours en la forme du recours pour excs de pouvoir (art. 67). Dans ces hypothses o il y a des recours soumis des formes qui aboutissent en dfinitive au Conseil d'tat, bien que ces recours soient appels administratifs, il est bien difficile de ne pas avouer ; que c'est si l'on veut du contentieux qu'ils sont au fond contentieux de justice retenue, mais enfin du contentieux. (V. n 576.) C'est un point donc o le contrle administratif cde la place un contrle juridictionnel. Et d'ailleurs logiquement la dcentralisation doit aboutir ce rsultat, que dans certains cas, le contrle administratif de l'tat sur les actes des personnes administratives infrieures disparaisse pour ne plus laisser qu'une surveillance du juge; l'autonomie de ces personnes administratives le demande. Article II. Contrle exerc par voie hirarchique. 86. L'action hirarchique est celle qu'une autorit suprieure de l'tat exerce sur une autorit infrieure de l'tat, par exemple l'action que le ministre exerce sur le prfet ou sur le maire en tant que ceux-ci sont agents de l'tal. Cette action hirarchique, au point
208
L'ADMINISTRATION
de vue du contrle des actes d'administration, s'exerce de trois excutoire qu'aprs approbation a) L'acte d'administration n'est expresse de l'autorit suprieure. Avant l'approbation, il est ncessairement examin tous les points de vue. Mais l'acte devient alors faons plutt le fait de l'autorit suprieure. b) L'acte d'administration de l'autorit infrieure, excutoire par lui-mme, est annul ou rform d'office par l'autorit suprieure, mais seulement s'il est contraire aux lois et rglements. (D. 25 mars 1852; 13 avril 1861.) L'acte est port la connaissance de l'agent suprieur par l'agent infrieur lui-mme qui est oblig d'envoyer copie. Dans l'organisation coloniale il y a mme quelque chose de mieux. Un corps d'inspection coloniale a spcialement pour fonction, outre l'inspection de la gestion financire dans les colonies, de signaler au ministre les actes d'administration qui paraissent dfectueux. L'annulation d'office peut intervenir n'importe quel moment, tant qu'il n'y a pas droit acquis confr aux tiers par l'excution. c) L'acte d'administration de l'autorit infrieure, excutoire par lui mme, est annul ou rform sur le recours gracieux form par la partie lse. Cette hypothse, plus intressante que les autres, mrite des dveloppements. Le reou hirarchique. 87. Du recours gracieux cours gracieux ou hirarchique est un recours purement administratif, que la partie lse par une dcision d'une autorit infrieure de l'tat, peut porter devant une autorit suprieure de l'tat, et qui finalement aboutit au ministre. Histoire. Le recours hirarchique a t organis par la Constitution de 1791, et cette poque c'tait le seul qui existt, c'est--dire qu'il renfermait en germe tous les aulres. Il appartenait aux directoires de dpartement l'gard des directoires de district; au roi l'gard des directoires de dpartement (Const. 3 septembre 1791, t. III. ch. IV, sect. 2, art. 5 et 6). Les ministres se bornaient assister le roi, formant conseil. Ngligeons la Convention o il y a une organisation toute spciale. Sous le Directoire, les ministres deviennent les vritables dpositaires de l'autorit administrative avec la juridiction qui y est inhrente, et cela, non plus comme conseil, mais individuellement, chacun pour son dpartement. La Constitution de l'an VIII a conserv le mme principe, et, actuellement, il s'appuie sur les dcrets de dconcentration. (Dcret duJ 25 mars 1852, art. 6; du 13 avril 1861, art. 6.)
LE RECOURS HIRARCHIQUE
209
Nature juridique. Le recours hirarchique n'a rien de juridictionnel, c'est--dire de contentieux; il est purement administre tif et le suprieur, notamment le ministre, qui prend une dcision sur un pareil recours, ne prend point une dcision contentieuse, mais fait luimme un acle d'administration. Le pouvoir hirarchique qui s'exerce ainsi sur recours est le mme que celui qui s'exerce d'office, la faon dont il est mis en mouvement ne le fait pas changer de nature. Et ce recours hirarchique diffre du recours contentieux, alors mme qu'il porte sur un grief qui pourrait faire l'objet d'un recours telle sorte qu'aprs un recours hirarchique qui sera contentieux. De all jusqu'au ministre, et qui aura t rejet, la partie lse pourra former un recours contentieux si elle se trouve dans les dlais, et il ne faudra point considrer ce recours contentieux comme un appel de la dcision du ministre, mais comme une vritable action en premire instance. Le recours sera peut-tre dirig contre l'acte du ministre et non pas contre l'acte primitif du subordonn, mais uniquement parce que le ministre aura fait l'acte sien comme administrateur. Cette manire de voir n'est pas admise par tout le monde. Un certain nombre d'auteurs pensent, que lorsque le ministre statue sur un recours hirarchique form sur une matire contentieuse, il fait acte de jug au contentieux en premireinstance. Mais le Conseil d'tat tend de plus en plus s'loigner de toutes les doctrines qui confondent la mission d'administrateur avec celle de juge. (V. n 573.) Rgies du recours. 1 Contre quelles dcisions le recours peut-il tre form? Il peut tre form contre tous les actes des agents de l'tat qui font partie de la hirarchie. Le Conseil d'tat a toujours refus d'admettre qu'il pty avoir uneseuledeces autoritsaffranchie du contrleministriel. 2 Devant qui ? Devant l'autorit immdiatement suprieure, avec facult de remonter jusqu'au ministre. Ainsi, contre un acte du maire on recourt au prfet, et du prfet au ministre. Jamais ce recours n'est port devant le chef de l'tat, moins que ce ne soit contre un acte du chel de l'tat lui-mme. 3 Dans quel dlai? Il n'y a pas de dlai; ainsi qu'on l'a dit, un ministre d'aujourd'hui pourrait aussi bien rformer l'acte d'un prfet de l'an VIII que l'acte le plus rcent. Maisil y a un obslacle rsultant des droits acquis. 4 Pour quel motif? Pour simple intrt froiss. 5 Rgles de procdure. Aucune formalit, simple requte sur papier timbr; il est dlivr aux parties qui le demandent, un rcpiss constatant la date de la rception et l'enregistrement de la rclamation. Les ministres doivent statuer dans le dlai de quatre mois dater de la rception; dfaut, les parties peuvent considrer la rclamation comme rejetee et se pourvoir devant le Conseil d'tat. (Dc. 2 nov. 1864, art. 5, H.. 14
210
L'ADMINISTRATION
6, 7.) Lorsque l'affaire est susceptible de former un recours contentieux, le ministre doit statuer par dcision spciale 1, la dcision est notifie administrativement aux parties intresses. 6 Effets. Le recours gracieux aboutit l'annulation ou la rformation de l'acte incrimin, ou bien, au contraire, sa confirmation. Dans l'annulation il y a seulement anantissement de l'acte, dans la rformation il ya substitution d'une dcision nouvelle. La confirmation peut tre expresse; elle peut aussi tre tacite, elle rsulte alors du silence gard indfiniment par l'autorit devant laquelle on a port le recours. On a vu que, dans le cas spcial de recours devant le ministre, le silence gard durant quatre mois quivalait confirmation expresse. (Dcr. de 1864.) Dans le cas d'annulation ou de rformation, il y a une dcision de l'autorit suprieure qui dtruit l'acte primitif. On se trouve donc en prsence d'un nouvel acte d'administration qui peut son tour tre attaqu, soit encore par recours gracieux si on n'a pas puis la hirarchie, soit par recours contentieux. Dans le cas de confirmation expresse ou tacite, l'acte primitif demeure intact, la dcision confirmative, s'il en est survenu une, s'incorpore lui, et c'est cet acte primitif qu'il faudra maintenant attaquer parla voiedu recours contentieux, si l'on est encore dans les dlais. On verra tout l'heure la consquence. Le recours gracieux n'est pas suspensif de l'excution de la dcision attaque, au moins en principe. Les dcisions sur recours sont leur tour excutoires par provision, comme toutes les dcisions administratives. Enfin, tant que la dcision sur recours n'a pas cr de droits la partie, elle peut tre reprise et refaite. Rapports du recours gracieux avec le recours contentieux. Comme le mme acte peut donner naissance au recours gracieux et l'un des recours contentieux dont il sera trait au paragraphe suivant, des questions peuvent se soulever sur l'emploi successif ou simultan de ces recours. Deux rgles importantes : 1 Le recours gracieux n'est pas le pralable oblig du recours contentieux, soit du recours pour excs de pouvoir, soit du recours contentieux ordinaire. De telle sorte que l'on peut immdiatement former un recours pour excs de pouvoir contre l'acte d'une autorit infrieure, on n'est pas oblig de commencer par forcer le ministre se prononcer; on peut former dans les mmes conditions un recours contentieux ordinaire. C'est l le sens de la rgle que l'on peut recourir au Con-seil d'tat omisso medio. Ainsi, contre un arrt prfectoral fixant une pension d'agent communal, matire o le prfet a un pouvoir 1. Il y a discussion sur le point de savoir si cela veut dire dcisionmotive..
LES RECOURS CONTENTIEUX
211
propre, on peut recourir au Conseil d'tat pans avoir au pralable form recours gracieux devant le ministre. (Arrt Bougard, 24 juin 1881 Arrt Bansais, 13 avril 1882.) 2 Si cependant on emploie au pralable le recours gracieux, il faut bien faire attention ne pas perdre le droit au recours contentieux. par expiration des dlais. Le recours gracieux ne conserve le droit de former plus tard un recours contentieux, que s'il est intent dansles trois mois partir de la notification de l'acte, c'est--dire dans le dlai ole recours contentieux lui-mme devrait tre intent. Cette question, qui a t trs discute, est tranche en jurisprudence par deux arrts du Conseil d'tat,l' arrt Bansais du 13 avril 1882, et un arrt confirmatif du 14 janvier 18871. Il est donc toujours prudent, bien qu'en lui-mme le recours gracieux ne soit soumis aucun dlai, de l'intenter dans les trois mois, surtout pour le cas o il aboutirait une confirmation; sans cela, en effet, dans ce cas o il ne se produit pas de dcision nouvelle que l'on puisse attaquer, tout recours contentieux serait perdu. On voit par la combinaison de ces deux rgles que le recours gracieux est appel perdre beaucoup de son importance. DE L'ACTED'ADMINISTRATION PAR LA VOIECONTEN 5. CONTROLE TIEUSE. RECOURS CONTENTIEUX CONTRE L'ACTE. 88. Les actes d'administration tombent sous l'apprciation du juge de deux faons : par voie accessoire et par voie principale. Par voie accessoire, lorsqu'ils sont incorpors une opration administrative, dont tout le contentieux est attribu un tribunal dtermin. Ce tribunal a, par l mme, le pouvoir d'apprcier la validitde l'acte d'administration, mme de l'acte d'autorit. D'une faon principale, lorsqu'ils sont isols ou qu'on peut les isoler de l'opration administrative. Ils sont alors l'objet de recours contentieux spciaux que nous allons tudier. Ces recours sont dirigs par la partie lse contre l'acte, non point contre l'autorit qui l'a accompli ou contre la personne administrative au nom de laquelle il a t accompli. Cependant, au cours dela procdure, cette personne administrative est mise en cause. Il y en a de deux espces : le recours contentieux ordinaire et le recours pour excs de pouvoir; la diffrence fondamentale est que le 1. Ces arrts ne statuent expressment que pour le cas de recours pour excs de pouvoir, mais il ne sembe pas qu'il y ait lieu de faire de distinction.
212
L'ADMINISTRATION
recours contentieux ordinaire est une action confrant au juge un lui permettant de rformer l'acte, pouvoir de pleine juridiction, c'est--dire de substituer sa dcision celle de l'administrateur, tandis que le recours pour excs de pouvoir est une voie de nullit confrant au juge un simple pouvoir d'annulation. On a dit pendant longtemps que le recours contentieux s'appuyait sur un droit viol, tandis que le recours pour excs de pouvoir s'appuyait sur un simple intrt froiss. Ce critrium, qui prsentait de grands avantages, doit passer au second plan, depuis que le recours pour excs de pouvoir a t admis,lui aussi, pour violation de la loi et des droits acquis. (V. p. 204 et la note). Article Ier. Recours contentieux ordinaire. 89. Le recours contentieux ordinaire est une action confrant au juge le pouvoir de rformer un acte d'administration. Il toujours sur un droit viol. s'appuie 1 Contre quels actes existe ce recours! Ce recours existe normalement contre les actes de gestion, mme contre ceuxqui sontdes actes de puissance publique; c'est mme son domaine, car les actes de gestion accomplis titre de personne prive tombent sous le coup des actions judiciaires. Donc les liquidations de dettes, les oprations d'impt, les contrats administratifs, donneront lieu des recours contentieux ordinaires. Il existe aussi exceptionnellement contre certains actes d'autorit, par exemple contre l'arrt du prfet autorisant ou refusant d'autoriser un tablissement insaluble. Mais il faut un texte formel, car, en principe, l'acte d'autorit renfermant la volont indpendante de la personne administrative, on ne peut pas admettre que le juge ait le pouvoir de rformer, c'est--dire de substituer sa volont celle de l'administrateur1. 2 Au profit de qui? Ce recours existe au profit de toute partie dont un droit a t viol par l'acte, condition que ce droit soit reconnu par une loi ou par un rglement. 3 Dans quel dlai? Il y a des dlais variables, tous trs courts. Quand il n'y a pas de texte spcial, on applique le dcret du 22 juillet 1800 : dlai de trois mois compter de l'acte ou de la notification de l'acte. 4 Devant quelle juridiction? Suivant les cas, devant le Conseil 1. Le recours contentieux ordinaire peut exister aussi, non plus coutre un acte d'administration isol, mais contre une opration administrative : exemple, le recours contentieux contre une lection.
POUREXCSDE POUVOIR LE RECOURS
213
d'tat, le conseil de prfecture, le ministre. (Renvoi au contentieux.) 5 Effets du recours. Le recours donnant pleine juridiction au juge et pouvant aboutir la rformalion de l'acte, celui ci est apprci tous les points de vue, non seulement au point de vue des vices qui ont t signals au 3, mais encore au point de vue des erreurs de fait. L'effet de la dcision est limit aux parties en cause, suivant le principe de l'autorit de la chose juge. Article II. Recours pour excs de pouvoir. 90. Le recours pour excs de pouvoir est une voie de nullit spciale confrant au juge le pouvoir d'annuler un acte d'administration; il s'appuie d'ordinaire sur un simple intrt froiss. Ce recours est une cration trs originale de notre droit administratif moderne; il est particulirement l'uvre dela jurisprudence du Conseil d'tat. Son grand mrite est d'avoir soumis au droit les actes d'autorit, c'est--dire les vritables actes d'administration. Tous ces actes taient discrtionnaires au dbut, maintenant il y en a une grande quantit qui sont soumis aux conditions de validit numres au 3, conditions labores justement l'occasion de la thorie du recours pour excs de pouvoir. Les actes qui demeurent discrtionnaires eux-mmes sont entams, le recours pour excs de pouvoir tend s'y introduire et les rgulariser; il ne s'arrte que devant l'acte de gouvernement. La juridiction du recours pour excs de pouvoir est une vritable juridiction prtorienne qui cre le droit en le faisant pntrer dans des rgions nouvelles. Le recours pour excs de pouvoir est aujourd'hui Historique. fond sur la loi des 7-14 oct. 1790 ainsi conue : Les rclamations d'incomptence l'gard des corps administratifs ne sont en aucun cas du ressort des tribunaux, elles doivent tre portes au roi, chef de l'administration gnrale , et sur la loi du 24 mai 1872, art. 9; ce sont les deux textes viss dans les arrts. La vrit est cependant que jusqu'en 1830 aucun texte n'tait vis, le Conseil d'lat s'inspirait simplement des traditions de l'ancien conseil du roi et de l'esprit gnral de la lgislation de l'an VIII pour rgler les difficults qui s'levaient entre les autorits administratives, notamment pour la comptence. Dsle dbut, il admit ct du recours pour incomptence, le recours pour vices de formes, en assimilant l'acte d'administration un jugement et le recours pour excs de pouvoir un recours en cassation. Depuis le dcret du 2 novembre 1864 qui accorda au recours pour excs de pouvoir la dispense du ministre de l'avocat et le rendit
214
L'ADMINISTRATION
ainsi moins coteux, le Conseil d'tat l'a encore dvelopp et toujours dans le sens du recours en cassation judiciaire; il a admis deux nouvelles ouvertures fondes sur l'illgalit: la violation de la loi et des droits acquis, qui est une illgalit directe et pour laquelle d ailleurs il n'a fait que confondre avec le recours pour excs de pouvoir des recours contentieux en annulatio n qui exilaient dj (V. p. 204et la note); et le dtournement de pouvoir qui est une illgalit indirecte rsultant de ce que l'administrateur mconnait l'esprit gnral de l'administration. Depuis ce moment-l, aucune ouverture nouvelle recours n'a t admise par la jurisprudence du Conseil, bien qu'un fait nouveau se soit produit qui doit donner encore plus d'autorit cette jurisprudence. Ce fait, c'est l'attribution au Conseil d'tat par la loi du 24 mai 1872, art. 9, de la juridiction de l'excs de pouvoir titre de justice dlgue, alors qu'auparavant elle tait de justice retenue. (V. n 576.) Le Conseil d'tat s'est appliqu plutt depuis 1872 rduire le nombre des actes d'administiation qui chappaient au recours raison de leur nature discrtionnaire, et il a ralis des progrs de ce ct. Est-ce dire que la liste des ouvertures recours soit close? ne pourrait-on pas y ajouter le chef d'erreur du reprsentant ? il faudrait pour cela s'loigner du point de vue un peu troit qui fait du recours pour excs de pouvoir une imitation du recours en cassation des jugements, et songer que dans l'acte d'administrationil y a avant tout une manifestation de volont de la personne administrative traduite par un reprsentant. Le recours se rapprocherait alors de l'in integrum reslitutio (mais ce serait une grosse rforme). De plus, le recours, qui actuellement est accord un petit nombre d'intresss, pourrait bien devenir en certains cas une sorte d'action popularis. (V. infr, p. 216.) Il y a lieu d'tudier: 1 les conditions de recevabilit du recours; 2 les ouvertures recours; 3 la procdure, 4 la nature et les effets de la dcision. La recevabilit du re91. Recevabilit du recours. cours est l'objet de rgles trs prcises; il y a un certain nombre de fins de non-recevoir. Lorsque l'une de ces fins de non-recevoir est constate, le recours est rejet sans tre examin au fond; ces pr-cautions tiennent ce que, dans une matire o il cre le droit, le juge est tenu une extrme prudence. 1Fin de non-recevoir raison de la nature de l'acte. Le re-cours pour excs de pouvoir n'est recevable que contre un acte d'ad-ministration accompli par une autorit comprise dans la hirarchies
DE POUVOIR LE RECOURS POUREXCS
215
ou dans la tutelle administrative. Par consquent, chappent au recours pour excs de pouvoir: a) Les actes qui n'ont pas du tout le caractre d'actes d'administration, mme s'ils manent d'autorits comprises dans la hirarchie : actes d'instruction criminelle faits par le prfet en vertu de l'art 10. C. inst. crim.; actes faits par le maireen qualit d'officier de police judiciaire ou d'officier de l'tat civil, etc.. b) Les actes manant d'autorits qui ne sont pas comprises dans la hirarchie ou dans la tutelle administrative: actes du Parlement, lois administratives, dclarations d'utilit publique, autorisations et concessions de travaux publics, etc.; Dcisions prises par les assembles parlementaires, parleurs commissions ou par leurs bureaux l'gard des membres de ces assembles, de leurs auxiliaires ou mme des tiers; Actes d'administration accomplis par les autorits ecclsiastiques mme en vue du temporel des tablissements religieux. Ces autorits ne font, en effet, pas partie dela hirarchie administrative. (V. appel comme d'abus, n 577.) Premire observation. Mme pour les actes accomplis par une autorit comprise dans la hirarchie, il faut distinguer: les actes de gouvernement chappent totalement au recours, les actes discrtionnaires ne l'admettent que difficilement et pour certains griefs seulement. Cependant c'est ici que le Conseil d'tat fait uvre de prteur, il entreprend constamment sur les actes discrtionnaires. Les actes de gestion admettraient bien le recours mais presque toujours il y aura un recours parallle. (V. infr, p. 218.) Deuxime observation. Il faut que dans l'acte on retrouve la dcision excutoire qui fait le fond de tous les actes d'administration. Les instructions donnes par un suprieur ses subordonns ne sauraient tre attaques, parce qu'elles ne sont pas excutoires (V. p. 187). Le silence gard par une autorit administrative ne saurait une dcision tre, en principe et moins d'un texte de loi, assimil ngative et servir de fondement un recours. Il est clair cependant que ce silence peut avoir pour rsultat de lser un droit; par exemple, retard dans la liquidation d'une pension. C'est une lacune dans la loi. (V. p. 185.) 2 Fin de non-recevoir raison de la qualit de la partie. a) Il faut que la partie ait qualit. Il faut, d'abord, que le rclamant ait la capacit de droit commun pour ester en justice. Ont cette capacit sous certaines conditions: les particuliers, les personnes morales du droit priv, les personnes administratives. On admet mme en certains cas former recours pour excs de pouvoir les assembles
216
L'ADMINISTRATION
lectives prises en corps : conseils gnraux, conseils municipaux. b) Il faut, en second lieu, que la partie ait un intrt direct et personnel l'annulation. Il n'est pas ncessaire que l'acte attaqu ait viol un droit, il suffit qu'il ait froiss un intrt; c'est encore par l que la jurisprudence du recours pour excs de pouvoir est prtorienne, puisqu'elle protge les intrts qui ne sont pas encore des droits. Cependant, lorsque le recours est fond sur le moyen de violation de la loi et des droits acquis,il faut qu'il y ait un droit viol. Il faut que l'intrt soit direct, c'est--dire que le dommage rsulte immdiatement de l'acte attaqu. Il faut que l'intrt ait quelque chose de personnel au rclamant, c'est--dire que celui-ci ne le partage pas avec une trop grande quantit d'autres d'individus. Il y a l une question d'apprciation du juge. On n'exige pas que l'intrt soit exclusivement personnel, puisqu'on admet les membres de la minorit d'un conseil municipal attaquer la dcision prise par les membres de la majorit, ces membres sont plusieurs avoir le mme intrt. De mme on admet tous les propritaires de la commune touchs par un arrt de police illgal du maire former le recours. En revanche, on n'ad met pas en gnral que la qualit de contribuable d'une commune soit suffisamment personnelle pour permettre d'attaquer une dcision du conseil municipal qui engage les finances de la commune. Et cependant de la combinaison des art. 66 et 67 loi municipale, il rsulte que certaines dlibrations du conseil municipal, celles auxquelles ont particip des conseillers intresss l'affaire (art 64), peuvent tre attaques devant le prfet par tout contribuable de la commune, et qu'ensuite la dcision du prfet peut tre attaque devant le Conseil d'tat par tout intress, c'est--dire par le mme contribuable (Cons. d't. 22 janvier 1886) par un recours en forme du recours pour excs de pouvoir. La pente est glissante, sans doute plus tard la qualit de contribuable paratra suffisante, et notre recours deviendra une actio popularis. Nous n'y voyons pas d'inconvnient, au contraire, c'est le moyen de faire servir le recours pour excs de pouvoir la protection de la personne administrative elle-mme. 3 Finde non-recevoir raison des formes et dlais. Le recours pour excs de pouvoir n'est pas recevable s'il n'est pas introduit dans les formes et les dlais dter mins par la loi. Formes. Jusqu'au dcret du 2 novembre 1864, il fallait suivre les formes du recours ordinaire, c'est--dire employer le ministre d'un avocat au Conseil d'tat ; depuis ce dcret, il y a dispense du
POUREXCSDE POUVOIR LE RECOURS
217
ministre de l'avocat, la requte peut tre prsente directement par la partie; elle doit seulement tre sur timbre et enregistre (cot : 48 fr. 88 c.) Dans certains cas mme, il y a dispense du timbre etde l'enregistrement (art. 88, L. 10aot 1871 ; art. 58, L. 3 mai 1841). Dlai. Aucun texte spcial n'a dtermin le dlai dans lequel doit tre form le recours. A dfaut, on applique la rgle gnrale pose par l'art. 11 du dcret du 22 juillet 1806, trois mois compter du jour de la notification de la dcision. Il faut distinguer entre les actes qui sont susceptibles d'une notification individuelle, et ceux qui ne sont susceptibles que d'une publicit plus ou moins tendue, parce qu'ils s'adressent un ensemble d'intresss, comme par exemple les actes rglementaires; c'est donc soit partir de la notification, soit partir de la publication, suivant les cas. A dfaut de publication, la jurisprudence admet que le dlai court de l'excution de la dcision attaque, condition que cette excution ait atteint le requrant. Les trois mois sont compts de quantime quantime.On ne compte pas le dies a quo; on ne compte pas non plus celui de l'enregistrement du pourvoi, de sorte que, pour une dcision notifie le 15, le pourvoi peut tre reu jusqu'au 16 minuit. Lorsque le recours a t prcd d'un recours hirarchique au ministre, il y aune difficult spciale. (V. plus haut, Recours gracieux, p. 210.) Observation. Il peut se faire que l'acte soit devenu inattaquable et dfinitif avant le dlai de trois mois. Le cas se prsente lorsque l'acte d'autorit a t suivi d'actes de gestion qui ont cr des droits acquis, avec lesquels il s'est combin et uni, de telle sorte qu'on ne pourrait plus infirmer l'un sans porter atteinte aux autres. Ainsi une dlibration de conseil municipal relative une vente ou un bail de bien communal, si le bailou la vente sont raliss ; ainsi des actes de tutelle qui autorisent faire tel ou tel contrat, si ce contrat est pass; les actes dclaratifs d utilit publique, lorsque le jugement a t prononc et a cr des droits. A ce point de vue, les affaires de l'tat sont moins surveilles que celles du dpartement ou de la commune. Presque toutes les affaires du dpartement et de la commune, sont dcides par le conseil gnral ou le conseil municipal avant d'tre excutes par le prfet ou le maire, il y a place pour un recours. Pour le compte de l'tat, au contraire, les affaires sont traites directement par le ministre ou le prfet, et se prsentent du premier coup sous la forme d'actes de gestion, par consquent ne laissent pas place au recours pour excs de pouvoir. 4 Fin de non-recevoir rsultant de l'existence d'un recours paral-
218
L'ADMINISTRATION
lle. Le recours pour excs de pouvoir disparat devant tout recours parallle qui peut faire annuler ou rformer l'acte d'administration. Cela peut se produire en deux hypothses: 1 Dans le cas d'acte de gestion, parce que l'acte de gestion donne en gnral, naissance un recours contentieux ordinaire, 2 Dans le cas d'un acte d'autorit qui forme partie intgrante d'une opration administrative dont tout le contentieux est attribu un tribunal administratif dtermin. Par exemple, un acte relatif une opration de travaux publics dont tout le contentieux est attribu au Conseil de prfecture. Dans ces conditions, on ne peut pas porter la question de la nullit de l'acte d'une faon principale devant le conseil d'tat. Mais il faut que ce recours parallle soit une action, non une exception; il faut que l'individu ne soit pas oblig d'attendre une poursuite de l'administration. Ainsi dans l'hypothse d'un rglement de police illgal, sans doute le particulier pourrait commettre la contravention, attendre d'tre poursuivi et opposer l'exception d'illgalit, mais comme ce ne serait qu'une exception, le Conseil d'tat admet le recours pour excs de pouvoir contre le rglement. La jurisprudence du Conseil d'tat est motive parle dsir d'viter des contrarits de dcisions, et aussi par le dsir de ne pas se faire accuser de ressusciter les vocations de l'ancien rgime. On traduit cela d'ordinaire en disant que le recours pour excs de pouvoir est subsidiaire, c'est un point de ressemblance avec l'in integrum restitutio prtorienne. de pou recours excs 92. II. Ouvertures pour voir. Les ouvertures recours sont les moyens que l'on peut faire valoir pour obtenir l'annulation de l'acte. Ces moyens sont au nombre de quatre tirs des quatre vices qui peuvent affecter la validit de l'acte d'administration : l'incomptence, la violation des formes, la violation de la loi et des droits acquis, le dtournement de pouvoirs (renvoi au 3, p. 200 et s.) La requte introductive du recours peut viser plusieurs moyens la fois. Au sujet de l'ouverture recours qui consiste dans la violation de la loi et des droits acquis, V. l'observation faite p. 204 la note. du recours 93. III. Procdure pour excs de pouvoir. (D. 2 nov. 1864). On a vu comment s'introduit l'instance : une requte est dpose au secrtariat du Conseil d'tat, l'instruction est dirige par la section du contentieux, un rapporteur
POUREXCS DE POUVOIR LE RECOURS
219
est nomm et communication est immdiatement donne de la requteau ministre que la matire concerne. Un dlai lui est en mme temps indiqu pour produire sa rponse, ses observations, et toutes les pices ncessaires au jugement de l' affaire. Mais on prtend que l'administration ne tient pas compte du dlai qui lui a t assign, que trop souvent elle oppose la force d'inertie. Il y aurait l des rgles lgislatives poser. Il faut remarquer : 1 que c'est toujours un ministre que la communication est faite, de quelque autoril que l'acte attaqu mane; et il n'y a pas distinguer entre les autorits subordonnes, comme le prfet, et les autorits simplement soumises tutelle, conseil gnral ou conseil municipa l, parce qu'en effet c'est une affaire de surveillance; 2 que le ministre n'est pas vritable partie en cause; c'est une instance dans laquelle il n'y a pas de vritable dfendeur. C'est l'acte lui-mme qui est attaqu in rem. D'autres personnes peuvent tre appeles en cause d'ailleurs, si l'acte les intresse et si la section du contentieux le juge propos. Il peut aussi y avoir intervention spontane, et mme sont recevables intervenir ceux qui n'auraient pas un intrt, absolument direct et personnel. On reconnat plus facilement qualit pour intervenir que pour former le pourvoi Les autorits administratives ne peuvent pas intervenir, puisqu'elles sont reprsentes par le ministre. L'affaire est ensuite juge par l'assemble du Conseil d'tat statuant au contentieux. 1 La dcision 94. IV. Nature et effets de la dcision. ne peut que rejeter le recours ou prononcer l'annulation de l'acte attaqu. Elle ne peut ni rformer cet acte, ni ordonner aucune des mesures qui pourraient tre la consquence de l'annulation (art. 9, 1.24 mai 1872). a) Le Conseil d'tat ne peut ni modifier ni amender l'acte, car ce serait fai e un acte administratif nouveau; mais l'annula ion peut n'tre que partielle. Ainsi, dans un rglement de police, on peut n'annuler que certains articles , ou mme certaines prescriptions divisibles d un mme article. Il faut reconnatre que l'annulation partielle ressemble une rformation; il subsiste cette diffrence cependant, qu'il n'y pas d'lment nouveau introduit. b) Il n'appartient pas au Conseil d'tat de prescrire les mesures qui devront tre prises par l'administration comme consquence de l'annulation prononce : ordonner, par exemple, la rintgration de fonctionnaires indment rvoqus (16 janv. 1874) ; ordonner la des-
220
L'ADMINISTRATION
truction de travaux excuts en verlu d'une dcision reconnue illgale (20 avr. 1883). Il ne lui appartient pas non plus de statuer sur les rclamations pcuniaires que le demandeur joindrait son recours, soit qu'il rclame le remboursement de dpenses faites l'occasion de l'acte annul (28juill 1876; 30 avr. 1880); soit qu'il demande des dommages-intrts raison de tout autre prjudice (29 juin 1883). C'est une nouvelle question dbattre au contentieux ordinaire. 2 La dcision est soumise la rgle de l'autorit de la chose juge sous les distinctions suivantes : a) Si le recours est rejet il n'est pas drog aux rgles ordinaires de l'art. 1351. Le rejet ne fera donc obstacle une nouvelle demande que si celle-ci mane de la mme partie agissant dans la mme qualit, si la demande a le mme objet et si elle est fonde sur le mme moyen d'annulation. b) Si l'acte a t annul, l'annulation produit ses effets erga onmes, parce qu'elle fait disparatre l'acte aussi compltement que s'il tait rapport par son auteur. Si donc l'acte attaqu tait un rglementde police municipale, l'annulation profite tous les habitants de la commune, et mme toutes les poursuites engages pour contravention tombent de plein droit. (Cass. 25 mars 1882.)
CHAPITRE
II
LES AUTORITS ADMINISTRATIVES ET LES FONCTIONNAIRES
Si l'on tudie le personnel administratif en se plaant au point de vue du rle qu'il joue dans l'administration, c'est--dire dans l'exercice des droits des personnes administratives, on s'aperoit qu'il se divise en deux grandes catgories : les autorits administratives qui ont le droit de dcision, et les simples fonctionnaires qui ne l'ont pas. Les AUTORITS administratives. 95. Les autorits sont les reprsentants des personnes administratives ADMINISTRATIVES dans l'exercice des droits, par consquent qui ont le droit de DCISION D'ADMINISTRATION. le pouvoir de faire des ACTES Le principe de la sparation des pouvoirs s'est exerc dans l'organisation des autorits administratives, il a amen la distinction d'un organe excutif et d'un organe dlibrant. L'organe dlibrant prend des dcisions rflchies spares de leur excution ; l'organe excutif excute les dcisions de l'organe dlibrant et prend lui-mme des dcisions soudaines. Les affaires sont partages entre ces deux organes, suivant leur degr d'urgence ou leur degr d'importance et aussi suivant qu'elles peuvent tre tranches par voie de mesure gnrale ou par voie de dcision individuelle. On peut dire qu'il est de la nature de l'organe dlibrant de ne prendre que des dcisions gnrales, tandis qu'il est de la nature de l'organe excutif de prendre des dcisions individuelles. C'est--dire que le pouvoir dlibrant est voisin du pouvoir lgislatif; les dlibrations comme les lois doivent.avoir un objet gnral. Le pouvoir excutif au contraire, qui est un pouvoir de magistrature, est qualifi pour les dcisions individuelles. Ce principe tend s'affirmer par des dcisions positives rendues en matire d'administration dpartementale. L, en effet, le conseil gnrale et le prfet n'ayant pas la mme origine, il tait prvoir que des conflits se produiraient qui feraient prciser leurs pouvoirs. Il rsulte, par exemple, de nombreux dcrets d'annulation de dcisions
222
L'ADMINISTRATION
des conseils gnraux, que ceux-ci, s'ils peuvent vuter des fonds pour subvention, doiventrserver au prfet la rpartition individuelle; qu'en matire de pension, ils ne peuvent pas prendrede d cisionspciale un employdtermin, etc. (V.D Cons. d't. 15 mars 1843; 15 avril 1873; 8 novembre 1873; 18 mars1874, etc.; A. Cons. d't. 17 nov. 1891.) Le mme principe pourrait tre invoqu en cas de conflit entre le conseil municipal et le maire. D'aprs une axiome d en grande partie aux expriences faites sous la Rvolution, la dlibration est le fait de plusieurs, l'action est le fait d'un seul. Aussi jusqu'ici, les organes dlibrants sont des assembles, des agences collectives, tandis que les organes excutifs sont des hommes agissant seuls, le chef de l'tat, le prfet, le maire, etc. Il ne faudrait, cependant pas exagrer ce point de vue, il y a frquemmenten fait des assesseurs; ct du chef de l'tat, il ya le conseil des ministres; ct du prfet, la commission dpartementale; ct, du maire, dans les grandes villes, le bureau municipal. La sparation des pouvoirs n'est pas accomplie dans tous les tablissements publics; beaucoup ont une organisation plus rudimentaire, une seule agence collective qui dlibre et excute elle-mme. Les FONCTIONNAIRES sont les fonctionnaires. reprsentants des personnes administratives qui participent l'exeret par consquent cice des droits SANSAVOIRLE DROITDE DCISION sans faire d'actes d'administration. Les fonctionnaires constituent l'immense majorit du personnel administratif; ils sont les auxiliaires des autorits administratives; ils se divisent en employs de bureau qui prparent les dcisions; conseil administratifs qui donnent des avis sur les dcisions; agents d'excution qui excutent les dcisions. Les agents d'excution sont en rapport avec le public. Tous les agents de perception des impts sont des agents d'excution (ils peuvent avoir sous leurs ordres des employs de bureau). Une classe spciale d'agents d'excution est mise part par le droit administratif, ce sont les comptables, ceux qui ont le maniement des deniers publics1. 97. Observation. Cette classification des autorits administratives et des fonctionnaires repose, on le voit, sur la notion mme de l'acte d'administration et par consquent elle s'impose. Elle est 96. Les 1. Un mme agent de l'administration peut avoir la fois la qualit d'autorit administrative et celle de fouciiounaire, parce que tout en prenant luimme desdcisions excutoires, il peut tre appel excuter des dcisions du il en est autorit une ainsi, prfet qui, par exemple, suprieure; par prises tantt prend des dcisions, tantt excute les dcisions du ministre.
LES AUTORITS ADMINISTRATIVES
223
d'ailleurs textuellement indique dans la loi du 24 mai 1872, art. 9, propos du recours pour excs de pouvoir. Il a t propos une autre classification qui a eu une certaine fortune, celle en agentsdirects ou agents ayant autorit vis- vis du public, et agents auxiliaires ou agents n'ayant pas autorit sur le public. Cette classification est incomplte, elle ne tient compte que des agents du pouvoir excutif, elle ne met pas en ligne les assembles dlibrantes, conseils gnraux, conseils municipaux, qui sont cependant des autorits aussi importantes que le prfet ou le maire. Les actes de ces assembles n'ont pas en gnral d'autorit sur le public, mais ce n'en sont pas moins des actes d'administration, c'est-dire des dcisions excutoires. (V. p. 185 et 187.) Il faut remplacer la nolion d'agent ayant autorit sur le public par celle d'agent faisant des actes d'administration. Il suffit pour cela de renoncer d'anciennes habitudes d'esprit. Il n'y a pas longtemps encore, les assembles dlibrantes telles que les conseils gnraux, les conseils municipaux taient de simples conseils consultatifs qui n'avaient point de pouvoirs propres en adminislration. Tout cela est chang, ils ont reu, grce au mouvement de dcentralisation, des pouvoirs propres considrables, maison est rest pendant quelque temps sous l'empire de l'ancienne conception d'aprs laquelle le pouvoir excutif tait tout.
LIVRE LES PERSONNES
PREMIER ADMINISTRATIVES
TITRE
PREMIER
NUMRATIONDES PERSONNES ADMINISTRATIVES
Les personnes administratives sont des personnes morales publiques membres de l'tat, envisages en tant qu'elles assurent le fonctionnement des services publics par l'exercice de leurs droits. Nous avons dj donn une ide de leur personnalit juridique propos de la dfinition du droit administratif (p. 173), nous y reviendrons au livre II propos de la jouissance des droits (n 294). Ici nous passons simplement en revue ces personnes pour prparer l'tude de leur organisation administrative, et aussi pour tracer la ligne de dmarcation entre elles et les personnes morales du droit priv (V. infr, n 102). Ces personnes sont l'tat, les dpartements, les communes, les colonies et les tablissements publics. 98. tat. Dans notre droit public moderne la personnalit juridique de l'tat franais apparat toute forme. Elle remonte sans interruption celle de l'tat romain1. Les dpartements ont t crs comme 99. Dpartements. circonscriptions administratives et dots d'organes par la loi du 22 dcembre 1789-janvier 1790; mais leur personnalit morale n'a t reconnue que bien plus tard. Le Code civil ne les nomme pas 1.On pourrait faire l'histoire des modificationsde cette personnalit, notamment de la distinction entre l'tat et la Couronne, tant sous l'empire romain que sous l'ancien rgime, de la distinction entre l'tat et le fisc, etc. 15 H.
226
LES PERSONNES ADMINISTRATIVES
alors qu'il parle des communes et des tablissements publics (art. 2121, 2227). C'est qu'en effet ils n'avaient point encore de biens qui fussent clairement eux et que le premier signe de la personnalit, c'est le patrimoine. Des biens leur furent enfin donns par deux dcrets du 9 avril et du 16 dcembre 1811. Par le premier, l'tat leur fit cadeau de la pleine proprit des difices et btiments nationaux occups par le service des cours et tribunaux, la charge de supporter l'avenir les grosses et menues rparations. Par le second il leur abandonnait les routes nationales de dernire classe et constituait ainsi un domaine public dpartemental. Malgr cela il y eut encore des controverses et la personnalit morale des dpartements ne fut dfinitivement consacre que par la loi de 1838 sur les attributions des conseils gnraux qui visait formellement la gestion du patrimoine dpartemental. Le dpartement est subdivis en circonscriptions administratives, les arrondissements et les cantons qui, elles, n'ont pas de personnalit. Pour l'arrondissement, la question a pu paratre douteuse jusqu' la loi de 1838. Certains textes lui donnaient un patrimoine, la loi du 22 dcembre 1790 lui accordait un procureur syndic ; de plus, il avait et il a encore une reprsentation locale, le conseil d'arrondissement. La loi de 1838 a tranch la question, car deux articles du projet qui consacraient cette personnalit furent rejets. Quant au canton, la question ne saurait faire doute. Il eut un instant la personnalit sous la Rvolution, titre de grande commune, mais elle a disparu sans retour. Par intervalles on a propos de la faire revivre. Il est supposer que la cration rcente des syndicats de communes mettra fin ces tentatives, en permettant d'organiser trs simplement les quelques services que l'on et pu confier au canton, notamment les services intercommunaux d'assistance. La personnalit morale de la commune 100. Communes. remonte fort loin. Le droit romain reconnaissait la personnalit des municipes et des civitales, et au moyen ge, lorsque les communes se rorganisrent sous la forme de villes de consulats ou de communes proprement dites, partout o elles formrent corps, il fut admis qu'elles avaient une personnalit. Elles conservrent cette personnalit jusqu' la Rvolution. Mais il faut songer que les communes datant du moyen ge n'taient que des lots au milieu du territoire. Les communes rurales n'existaient pas, elles sont sorties lentement de la sicle. Sous le nom de communauts rurales, paroisse partir du XVIe elles aussi, la fin de l'ancien rgime, avaient conquis la personna-
NUMRATION
227
lit. On les admettait plaider par leurs syndics, on les rendait responsables de l'impt en la personne de leurs collecteurs, etc. La Rvolution ne toucha pas la personnalit morale des communes, qui perdirent seulement leur privilge fodaux dans la nuit du 4 aot, comme les autres seigneurs. La personnalit des colonies date des ordon101. Colonies. nances du 26 janvier 1825 et du 17 aot 1826 qui leur reconnurent un domaine. Il ya dans les colonies des communes et des tablissements publics. L'tablissement de l'Algrie ne constitue pas en lui-mme une personne administrative, bien qu'il y ait un budget local et unconseil, le conseil suprieur du gouvernement, form en partie par une dlgation des conseils gnraux des dpartements. Le budget de l'Algrie est rattach pour ordre au budget gnral de l'tat; il n'y a pas de domaine algrien ; enfin, surtout depuis les dcrets de 1881, la tendance est au rattachement, la fusion de l'Algrie avec la France. Mais il y a en Algrie: 1 Des provinces : Alger, Oran, Constantine, territoire civil et militaire; 2 Des dpartements qui sont forms du territoire civil des provinces ; 3 Des communes il y en a de trois espces qui toutes constituent ; des personnes administratives: communes de plein exercice, mixtes, indignes; 4 Des tablissements publics. L'tablissement public est 102. tablissements publics. une personne administrative qui gre un service public spcial. Si l'on recherche l'origine historique de la classe des tablissements publics considrs comme personnes morales, il faut remonter l'ancien rgime, o ils portaient le noms de corps et communauts ou de gens de mainmorte, au droit canonique et jusqu'au droit romain, o ils portaient le nom d'universitates. La Rvolution avait un instant supprim tous les tablissements publics (dcret du 14 dc. 1789, art. 50). Ils reparurent un un partir de l'an V, aprs avoir toutefois perdu leurs biens confisqus comme biens nationaux. Le Code civil, dans les art. 2121 et 2227, consacre nettement la classe des tablissements publics; le Code de procdure dans les art. 83, 398, 481. Mais la classe des tablissements publics n'est pas une classe ferme, elle compte dj plusieurs espces, hpitaux, bureaux de bienelle peut faisance, fabriques, associations syndicales, etc., etc.,
228
LES PERSONNES ADMINISTRATIVES
s'enrichir et s'enrichit en effet d'espces nouvelles. Il faut posercette rgle : une espce particulire d'tablissement public n'existe que lorsque l'un des deux faits suivants s'est produit: I. Lorsqu'un texte de loi luia confr directement cette qualit, ce que vient de faire la loi du 22 mars 1890 pour les syndicats de commune ; II. Ou bien lorsque l'ensemble de la lgislation lui reconnat directement ou indirectement la personnalit publique. En effet, si l'tablissement n'a pas la personnalit, bien qu'appartenant l'administration, ce n'est qu'un service rattach four ordre. S'il a la personnalit, mais que ce ne soit pas une personnalit publique, ce n'est qu'un tablissement d'utilit publique. Il est bon d'insister : a) Distinction des tablissements publics et des services rattachs Il ne suffit pas qu'un service parliculier d'une personne pourordre. administrative fonctionne avec une certaine autonomie, qu'il ait un budget dress part et rattach pour ordre, qu'il soit dirig par une commission sous la surveillance de l'autorit, etc., pour que ce service constitue un tablissement public, il faut que la personnalit lui ait t formellement confre; jusque-l il peut y avoir l'embryon d'un tablissement public, mais l'tablissement n'existe pas encore. Toutes les personnes administratives ont de ces services qui tendent plus ou moins vers l'tablissement public. Signalons particulirement les institutions d'assistance, et les caisses de retraite dpartementales, qui ont t cres en vertu de l'art. 46, nos 20 et 21, 1. 10 aot 1871. Des tablissements publics mme peuvent en avoir. Les syndicats de communes crs par la loi du 22 mars 1890,et qui sont des tablissements publics, peuvent organiser des institutions varies; ces institutions n'ont pas la personnalit (art. 176, Circul. Intr. 10 aot 1890); ce sont des services rattachs pour ordre. Il serait d'ailleurs inlgant d'admettre qu'elles pussent jamais devenir des tablissements publics; nous dirions volontiers tablissement public sur tablissement public ne vaut. b) Distinction des tablissements publics et des tablissements d'utilit publique. A l'inverse, il ne suffit pas, pour qu'il y ait tablis1. 11faut reconnatre d'ailleurs que la personnalit peut tre confrepar la loi indirectement,de sorte que la jurisprudence a un pouvoird'apprciation. Ainsi le tribunal des conflitsa t bien prs tout rcemment d'admettre que l'administration des cheminsdefer de l'tat constitueun tablissementpublic. (Arrt 22 juin 1889.) Le Conseil d'tat admet un conseil municipal former un recours pour excs de pouvoir, c'est--dire ester en justice, par argument de l'art. 67, loi municipale; c'esten faire une sorte d'tablissement public et celapourrait tre tendu toutes les assembles dlibrantes.
NUMRATION
229
sement public que l'on se trouve en prsence d'une personne morale, il faut encore que ce soit une personne morale publique, c'est--dire un membre de l'tat. Faute de faire cette prcision, on a confondu pendant assez longtemps l'tablissement public avec l'tablissement d'utilit publique. La cause de la confusion, c'est que l'tablissement d'utilit publique rend des services au public tout comme l'tablissement public; ajoutez que l'ancien droit ne distinguait pas. Aujourd'hui, et grce en grande partie au Conseil d'tat, la distinction est faite. On reconrait que les tablissements d'utilit publique sont des personnes morales prives. Elles rendent des services au public, mais ce ne sont pas des services publics, ce sont des services privs. L'tat n'a pas le monopole de la satisfaction des intrts gnraux. A la vrit, l'tablissement d'utilit publique est soumis certaines rgles qui lui sont communes avec l'tablissement public, par exemple, il est frapp de l'incapacit de recevoir sans autorisation de l'tat des donations et des legs (art. 910 et 937 C. civ.). Mais cela veut dire simplement que l'tat a un droit de tutelle sur lui, et rien n'empche l'tat d'avoir un droit de tutelle sur un tablissement priv; il en a bien, quoique d'une autre nature, sur la Banque de France, le Crdit foncier, le Comptoir d'escompte, qui sont des socits commerciales. A l'heure qu'il est, la distinction entre l'tablissement public et l'tablissement d'utilit publique est reconnue comme incontestable en doctrine et en jurisprudence, elle est aussi, accepte par la loi (1. 26 fvr. 1862 sur le Crdit foncier). Il serait sans intrt de reproduire des controverses qui paraissent mortes. Signalons seulement le langage inexact de certains auteurs qui persistent appeler les tablissements d'utilit publique, personnes morales publiques. Dans l'intrt de la clart et de la mthode, il faut absolument rserver cette expression aux personnes morales qui sont membres de l'tat. Mais il ne suffit pas d'tablir une distinction nette entre les deux classes d'tablissements, il faudrait aussi pouvoir trouver un critrium qui permt de dcider laquelle des deux classes appartient un tablissement dtermin. Il y a un certain nombre de cas douteux et il y en aura toujours. Il y a des tablissements qui ont t crs ds le dbut avec un caractre ambigu; il en est d'autres dont le caractre priv au dbut n'tait pas douteux, mais qui graduellement se modifient. Les tablissements d'utilit publique qui rendent au public des services vraiment utiles ont une tendance se transformer en tablissements publics. Par une sorte d'attraction, l'tat finit par
230
LES PERSONNES ADMINISTRATIVES
s'incorporer toute institution qui a un caractre de perptuit. Il y a une priode de transition pendant laquelle l'tablissement est de plus en plus asservi l'tat; quel moment prcis en devient-il membre? A notre avis, il n'y a qu'un seul signe: un tablissement est dans la classe des tablissements publics ou bien entre dans cette classe lorsqu'il se rattache d'une faon intime l'organisation administrative de la France (Cass., 28 oct. 1885;S. 86. I. 436). Par consquent: 1 Lorsque l'tablissement est fond par l'tat ou par un dpartementou par une commune1; 2 Lorsque pour un tablissement fond autrefois par l'initiative prive,la direction du service dans ses trois lments de moyens matriels, de personnel, de moyens financiers, passe l'administration, lorsque parmi les administrateurs il n'y a plus un seul particulier, lorsque le budget n'est plus aliment par des capitaux privs; question de fait. Tant que l'tat n'exerce pas ainsi une direction exclusive sur l'tablissement, celui-ci reste tablissement d'utilit publique; on ne peut pas admettre en effet que pour un de ses tablissements publics, l'tat partage la direction avec des particuliers. Par consquent on ne saurait considrer comme suffisants : ni le fait que l'tablissement est soumis des rgles de comptabilit et l'inspection des finances; ni le fait que dans son conseil d'administration on trouve des membres nomms par le prfet ou par des autorits municipales. Il y a l des faits de tutelle, qui constituent certainement une mainmise grave sur l'tablissement, mais qui n'entranent pas son absorption complte par l'tat. Aussi jusqu' nouvel ordre, faut-il se refuser qualifier d'tablissements publics, les caisses d'pargne. (En ce sens, Cass. Ch. req. 5 mars 1856; Ch. civ. 8 juillet 1856.) Mme s'il y a la tte de l'tablissement un directeur nomm par l'tat; mme si l'tablissement, au del 1. On doit considrer comme fondes par l'tat les associationssyndicales autorises dont le but est d'accomplir des travaux publics intressant tous les propritaires d'une rgion. L'initiative de l'association peut tre prise par la majorit des propritaires intresss, mais l'administration intervient ensuite pour contraindre la minorit entrer dans l'association. L'exercice de ce droit de contrainte qui ne peut appartenir qu' l'tat fait, qu'en somme, l'association syndicale est fonde par l'tat. Il en rsulte, bien que la question ait t controverse, que les associations syndicales autorises sont des tablissements publics. Elles semblent avoir pour but des travaux d'intrt priv, mais, par voie de consquence, ces travaux prennent le caractre de travaux publics; leur budget semble aliment par des cotisations prives, par voie de consquence, ces cotisations deviennent des taxes publiques. (V. infr, Travaux publics,n 499.)
NUMRATION
231
d'un certain chiffre, doit verser son boni dans les caisses publiques, cela ne suffit pas, ce sont encore des faits de tutelle. (Monts-de-pit.) On ne doit pas non plus attacher d'importance au fait que certains privilges, qui n'ont rien de commun avec la puissance publique, ont t concds certains tablissements, comme le privilge de verser des fonds en compte courant la caisse des dpts et consignations. (Caisses d'pargne, socits de secours mutuels.) Enfin, bien qu'il y ait l quelque chose de plus grave, on ne doit pas s'arrter ce fait, que des privilges qui procdent de la puissance publique ont t concds des tablissements. C'est ainsi que la Banque de France a reu le privilge de l'mission du papier-monnaie, qui est une sorte de privilge rgalien, et cependant n'est pas un tablissement public. C'est ainsi que de grandes compagnies de colonisation, si elles sont cres, recevront le privilge de lever des impts, de faire la guerre, etc., et cependant ne devront pas tre considres pour cela comme des tablissements publics. numration. Les tablissements publics remplissent des services d'tat, des services dpartementaux ou des services communaux. A. tablissements publics d'tat. Les principaux tablissements publics qui remplissent des services d'tat sont les suivants: 1 tablissements relatifs aux cultes: Fabriques, menses curiales, menses piscopales, sminaires diocsains et chapitres (Concordat art. 15. Dcr. 30 dcembre 1809; Dcr. 6 novembre 18131); les consistoires art. 9); les protestants (L. 18 germinal on X, art. 8 et 20; 0.2 avril 1817, consistoires isralites (0. 25 mai 1844). 2 tablissements hospitaliers relevant de l'tat (0. 21 fvrier 1841). 3 tablissements d'instruction publique (L. 10 mai 1806; D. 17 mars 1808; L. 7 aot 1850, art. 15). Rentrent dans cette catgorie l'institut et les diffrentes Acadmies qui le composent (L. 5 fructidor an III; L. 3 brumaire, 15 germinal an IV; L. 11 floral an X, etc.); l'Acadmie de mdecine (L. 14janvier 1821); le Collge de France, les Facults d'enseignement suprieur (D. 25 juillet 1885); les lyces et collges d'enseignement secondaire. 4 tablissements relatifs l'agriculture, au commerce et . l'industrie : 1. Le diocsene constitue pas un tablissementpublic (Avis du C. d'tat, avril 1880, conforme un avis du 21 dcembre 1842 avis contraire du 13 mai1874). anXIIIa constitu Raisons de douter : 1 undcretdu19thermidor un fonds de secours pour les ecclsiastiquesgs et infirmes et a confi l'vque l'administrationde ce fonds de secours. La seule consquence c'est que l'vque doit tre autoris accepter des dons et legs avec affectation; 2 un certain nombre de textes prennent le mot vch dans le sens de diocse, et l'ordonnance du 2 avril 1817autorise les vques accepter des libralits
232
LES PERSONNES ADMINISTRATIVES
Chambres consultatives d'agriculture (D. 25 mars 1852, art. 10); chambres de commerce (L. 28 ventse an IX ; Dcr. 23 septembre 1806; L. 23 juillet 1820, etc,); chambres consultatives des arts et manufactures (Arrt 10 thermidor an XI; O. 16 juin 1832). 5 tablissements relatifs aux travaux publics : Associations sydicales autorises. (L. 21 juin 1865; L. 15 dcembre 1888; L. 22 dcembre 1888.) 6 tablissements relatifs un service de banque et de grance. a) Caisse des dpts et consignations. (L. 28 avril 1816; O. 22mai 1816; L. 6 avril 18761.) b) Caisses administres par la caisse des dpts et consignations: Caisse des offrandes nationales en faveur des armes de terre et de mer (L. 27 novembre 1872; D. 9 janvier 1873); caisse des retraites pour la vieillesse (L. 18 juin 1850; L. 12 juin 1861; D. 27 juillet 1861); caisse d'assurance en cas de dcs, et caisse d'assurance en cas d'accidents rsultant des travaux agricoles et industriels (L. 11 juillet 1868.) c) Caisses qui doivent verser leurs fonds la caisse des dpts : Caisse d'pargne postale (L. 9 avril 1881. L. 29 juillet 1881, art. 34; L. 30 dcembre 1883). Caisse des chemins vicinaux reconstitue par 1. 30 dcembre 1890. d) Caisses indpendantes de celle des dpts et consignations : tablissement des Invalides de la marine, caisse des prises, caisse des gens de mer, caisse des Invalides de la marine. (L. 13 mai 1791 ; Ord. 12 mai et 17 juillet 1816.) 7 Ordre de la Lgion d'honneur. (L. 29 floral an X; arr. messidor anX.) 8 Les compagnies, ordres ou chambres d'officiers ministriels 2 : Notaires. (L. 25 ventse an XI; O. 4 janvier 1843.) faites leurs vchs. Rponse : le mol vch peut aussi bien s'entendre dans l'ordonnance de 1817de la mense piscopale. 1. La caisse des dpts et consignations est un tablissement d'une importance considrable. Elle fait valoir un capital de 4 milliards au moins qui lui est confi des titres divers : les dpts et consignations d'abord, ia cuisse est le seul dpositaire lgal; les cautionnements des fonctionnaires; les fonds des diverses caisses administres par elle; ceux de la cuisse d'pargne postale; ceux des dpartements, des communes et des tablissements publics; ceux mmes de certains tablissements d'utilit publique qui ont le privilge de verser, comme les caisses d'pargne prives, les socits de secours mutuel. Si la caisse des dpts n'tait pas rige en tablissement public, tons ces fonds seraient verss directement au Trsor, ce qui serait une source dangereuse de la dette flottante. La caisse est bien en compte courant avec le Trsor, mais le montant de ce compte a t progressivement restreint. Une autre consquence de la personnalit de la caisse, c'est qu'elle peut acheter de la rente franaise sans que la dette de l'tat soit teinte par confusion. Elle est le plus gros acheteur de rente franaise. 2. Ces chambres sont des tablissements publics, parce que les officiersministriels qu'elles reprsentent sont au fond des fonctionnaires salaris d'une
NUMRATION
233
Avous. (Arrt 13 frimaire an IX; Dcr. 19juillet 1810.) Huissiers et commissaires-priseurs. (L. 27 ventse an IX; arr. 29 germinal an IX ; Dcr. 14 juin 1813; 0. 26 juin 1816 et 26 juin 1822.) Agents de change. (Arrt 29 germinal an IX.) B. tablissementspublics dpartementaux. Le dpartement a peu d'tablissements publics. On ne peut gurelui attribuer que les asiles publics d'alins, l o le dpartement a un asile lui. L'asile public d'alins est, en effet, un tablissement public, cela rsulte nettement de l'art. 4, O. 18 dcembre 1839, qui parle de ses biens, des procs intenter en son nom, des acquisitions, des acceptations de legs ou donations, etc., toutes choses qui supposent un patrimoine, par consquent la personnalit (V. cependant av. Cons. d't., 8 avr. 1842). C'est de plus un tablissement public dpartemental, parce quele service desalins est dpartemental. La preuve en est que le conseil gnral rgle le budget (art. 46, n 17, L. 10 aot 1871). On sait que c'est l le signe. Il est vrai que le dpartement a peu de prise sur l'administration de cet tablissement; il est administr par un mdecin directeur, sous l'autorit du ministre de l'intrieur. Il existe une commission de surveillance, mais tous les membres y sont nomms par le prfet, qui n'est mme pas tenu d'en prendre un seul parmi les conseillers gnraux. Cela n'empche point que l'tablissement ne soit dpartemental, mais cela cre une iniquit. Le projet de loi sur les alins adopt par le Snat corrige en partie cette injustice en faisant entrer dans la commission deux membres lus par le conseil gnral. Il n'y a point d'autre tablissement public dpartemental. Tous les autres services qui paraissent en partie autonomes sont rattachs pour ordre; ainsi en est-il du service des enfants assists, de celui des dpts de mendicit, de celui des institutions d'assistance cres par le conseil gnral en vertu de l'art. 46, nos 20 et 21, L. 10 aot 1871. Cependant, administrativement, on semble considrer comme des tablissements publics, au moins les caisses de retraite. C. tablissements publics communaux. Ce sont: 1Les hpitaux et hospices. (L. 16 vend. an V; L. 4 vent. an IX; arr. 7 messidor an IX et 14 niv. an XI; L. 22 janvier, 8 avril, 7 aot 1851.) 2 Les bureaux de bienfaisance. (L. 7 frim. an V; 30 vent. an V; D. 17 juin 1852.) 3 La caisse des coles primaires. (L. 10 avril 1867, art. 15; L. 28 mars 1882, art. 17.) 4 La section de commune. (L. 10 juin 1793, art.1; Code forestier, art. 1 et 72; L. 18 juillet 1837, art. 3, 5, 6, 56 58.) 5 Les syndicats de commune. (L. 22 mars 1890.) faon spciale, ensuite parce qu'elles font vraiment partie de l'organisation administrative. Leurs dcisions peuvent tre frappes de recours, soit devant les ministres soit devant le Conseil d'tat. Pour les chambres des notaires, un recours pour excs de pouvoir peut tre port devant la Courde cassation.
234
LES PERSONNES ADMINISTRATIVES
Le syndicat de communes est un tablissement public intercommunal (art. 170), non pas une personne administrative qui s'interposerait entre la commune et le dpartement. Il est vrai que, en fait, il pourra tre form des syndicats de communes territoires contigus, ayant une cir: 1 le syndicat est consticonscription analogue celle du canton, mais tu dans ses organes par les communes (dlgus des conseils municipaux dont les pouvoirs tombent avec ceux de ces conseils, art. 171); 2 il est soumis la tutelle des communes pour son budget (art. 177) ; 3 il peut tre cr temps, il peut tre dissous ; 4 il peut tre form de communes non contigus, etc., etc. Seulement c'est un tablissement public d'un caractre nouveau et qui pourrait bien influer sur les autres; il n'est pas soumis la rgle admise jusqu'ici par la jurisprudence de la spcialit des services, au moins en ce sens qu'il peut cumuler plusieurs services.
TITRE
II
DES PERSONNES ADMINISTRATIVES ORGANISATION
CHAPITRE
PRLIMINAIRE
RGLES COMMUNES D'ORGANISATION
On a vu p. 221 que le personnel administratif se divisait en deux grandes classes d'agents: les autorits administratives qui ont le droit de dcision dans l'exercice des droits, et les fonctionnaires qui participent l'exercice des droits mais sans avoir le droit de dcision, et par consquent sans faire d'actes d'administration. Cette division fondamentale dans le personnel des agents s'applique toutes les personnes administratives; toutes ont la fois des autorits administratives et des fonctionnaires, et l'on peut dgager des rgles communes dans la constitution de ces divers organes. 1 Les autorits administratives et les fonctionnaires doivent tre considrs comme investis d'un certain pouvoir qu'ils exercent par dlgation et qui n'est autre que la volont mme de la personne administrative applique l'administration. Le pouvoir dont sont investies les autorits administratives mrite le nom de puissance publique, c'est la volont administrative dans sa plnitude et se manifestant par des dcisions excutoires. Le pouvoir dont sont investis les fonctionnaires mrite le nom de fonction publique, c'est un pouvoir beaucoup plus restreint puisqu'il ne va pas jusqu' prendre des dcisions excutoires, il est subordonn au prcdent, c'est une volont administrative limite, spcialise et rduite au rle d'auxiliaire. 2 Les pouvoirs de puissance publique et de fonction publique sont dlgus soit aux autorits administratives, soit aux fonctionnaires, par de vritables mandats qui sont des varits du mandat public. En consquence, ce qu'il convient d'tudier comme rgles gnrales d'organisation administrative, ce sont les rgles du mandat de puissance publique et celles du mandat de fonction publique.
236
RGLESCOMMUNES D'ORGANISATION
SECTIONIre. DU MANDATDE PUISSANCEPUBLIQUEPAR LEQUEL SONT DUMANDAT CONSTITUES ADMINISTRATIVES. LESAUTORITS LECTIF. La puissance publique 104. De la puissance publique. est le pouvoir d'exercer les droits des personnes administratives en vue des services publics en prenant des dcisions excutoires. La puissance publique est au fond une forme de la souverainet, c'est la souverainet applique l'administration, c'est--dire au fonctionnement des services publics. Il tait logique dans un rgime dmocratique o la souverainet est cense rsider dans la nation, que la puissance publique ft aussi cense y rsider. La puissance publique est donc cense rsider dans la nation et tre dlgue par celle-ci aux autorits administratives. Mais cette dlgation prend une ralit bien plus grande en ce qui concerne les administrations locales, lorsqu'il y a de la dcentralisation que lorsqu'il n'y en a pas. Lorsqu'il n'y a pas de dcentralisation, les autorits administratives du dpartement ou de la commune sont constitues par le pouvoir central. Sans doute le pouvoir central est lui-mme un dlgu de la souverainet nationale, mais l'action de cette volont nationale ne peut se faire sentir dans l'administration locale que d'une faon indirecte. Au contraire s'il y a dcentralisation, les autorits locales sont constitues par la population locale qui leur fait sentir directement sa volont. 105. Caractres du mandat de puissance gnraux I. La puissance publique doit toujours tre considre publique. comme confre directement ou indirectement par le souverain, c'est-dire par la nation, ou par une fraction du souverain, c'est--dire par la population d'une circonscription1. Directement, par la voie des lections. On se trouve alors en prsence du mandat lectif. Les organes dlibrants des grandes personnes administratives sont en gnral constitus de cette faon, les deux chambres, les conseils gnraux de dpartement, les conseils municipaux, les conseils gnraux des colonies; quelques organes 1. Il y a l, notre avis, une grande diffrenceavec le mandat de fonctionpublique. La fonction publique ne doit pas tre considre comme confre par le souverain, mais par la personne administrative une fois constitue (Y. infr, n 138.)
LE MANDAT DE PUISSANCE PUBLIQUE
237
d'tablissements publics galement, les chambres syndicales des associations syndicales autorises, les chambres de commerce, etc. Indirectement. Cela se produit de plusieurs faons: 1 L'organe dlibrant d'une personne administrative, une fois constitu, constitue son tour l'organe excutif ; par exemple, le Parlement runi en Congrs nomme le prsident de la Rpublique, le conseil municipal nomme le maire. 2 Une autorit administrative suprieure constitue les autoriss d'une personne administrative infrieure. Par exemple, le chef de l'tat nomme le prfet organe excutif du dpartement, le gouverneur organe excutif de la colonie. Les organes de presque tous les tablissements publics sont constitus par des autorits de l'tat agissant seules, ou bien concurremment avec des autorits du dpartement ou de la commune. Ainsi la commission administrative d'un hospice est constitue partie par le prfet, partie par le conseil municipal, etc. II. La puissance publique peut tre dlgue en certain cas par les autorits administratives des autorits secondaires. En gnral, les assembles dlibrantes ne peuvent pas dlguer leurs pouvoirs, il n'y a d'exception que pour le conseil gnral, qui peut dlguer des pouvoirs sa commission dpartementale. Les organes excutifs peuvent dlguer leurs pouvoirs dans la mesure fixe par les lois et rglements. Le chef de l'tat a des dlgus permanent qui sont, eux aussi, des autorits administratives, les ministres, les prfets, les gouverneurs de colonie, etc. Le maire peut dlguer de ses pouvoirs aux adjoints1. et aliena 1. Le mandat qui confre la puissance publique est un mandat sua gratia. Il est donn la fois en faveur du souverain ou de l'organe du souverain qui constitue, et en faveur de la personne administrativedont une autorit est constitue. Les dputs, par exemple,reprsentent la fois les collgeslectoraux qui les ont nomms et l'tat. Un maire reprsente la fois le conseil municipal qui l'a nomm et la commune, etc. La consquence,est que la responsabilit d'une autorit administrative constitue est ou peut tre double. Elle existe vis--vis de la personne administrative dont les droits ont t mal exercs. Elle existe aussi vis--vis de l'organe du souverain qui a constitu l'autorit. Il y a bien des caso cette responsabilit n'est pas juridiquement sanctionne, mais elle n'en existe pas moins au point de vue moral ou au point de vue politique. On peut citer l'exemple du maire. Un maire, qui a mal gr les intrts de la commune, peut tre dclar responsable juridiquement vis--vis de celle-ci considre comme personne morale, et il est politiquement responsable devant le conseil municipal. Le conseil, la vrit, n'a pas le droit de le rvoquer, ce droit appartient au chef de l'tat, mais en fait, il est suffisamment arm pour l'amener donner sa dmission.
238
RGLESCOMMUNES D'ORGANISATION
Nous nous Du mandatlectif. occuperons ici uniquement du caso la puissance publique est confre directement par le souverain, c'est--dire du mandat lectif. Il y a lieu d'tudier : 1 l'lection, fait par lequel le mandat lectif est confr; 2 l'exercice du mandat par la constitution et le fonctionnement des assembles dlibrantes; 3 les vnements qui mettent fin au mandat; 4 les caractres gnraux du mandat. DES LECTIONS. 1er. THORIEGNRALE Cette thorie gnrale des lections est 106. Observation. faite avec les rgles communes aux lections la Chambre des dputs, aux conseils gnraux, aux conseils d'arrondissement et aux conseils municipaux. Les lections aux Snat sont trop particulires pour y entrer. (L. 22 juin 1833; D. O. 2 fvrier 1852; D. R. 2 fvrier 1852; L. 5 mai 1855; L. 10 aot 1871; L. 17 juillet 1874; lois constitutionnelles de 1875; L. 2 aot 1875; L. 30 novembre 1875; L. 5 avril 1884; L. 14 aot 1884; L. 9 dcembre1884; L. 16 juin 1885; L. 13 fvrier 1889; L. 17 juillet 1889.) L'lection est une opration administrative, 107. Dfinition. par laquelle la majorit des lecteurs d'une circonscription formant collge lectoral, nomme un ou plusieurs reprsentants par la voie du scrutin. Les lecteurs sont les individus ayant la fois la jouissance et l'exercice du droit de vote, par consquent, inscrits sur une liste lectorale. (Renvoi au droit de suffrage, v. p. 106). La circonscription formant collge lectoral est un certain territoire dont tous les lecteurs sont appels faire un choix simultan. Le collge lectoral est l'assemble des lecteurs; ils sont tous attachs un certain territoire par le mcanisme de la liste lectorale. La circonscription est toujours une division administrative. Pour le Snat, le dpartement; pour la Chambre des dputs, l'arrondissement ou une section d'arrondissement; pour le conseil ; pour le conseil gnral et pour le conseil d'arrondissement, le canton municipal, la commune ou la section lectorale de commune. La circonscription lectorale ne se confond pas avec la circonscription de la personne administrative dont il s'agit de reprsenter les intrts, cette confusion n'existe en fait que pour la commune et encore pas toujours. Ainsi, pour le Snat et la Chambre des dputs, la circonscription dont il s'agit de reprsenter les intrts, c'est la France entire ; les reprsentants sont choisis par le dpartement ou
THORIE DES LECTIONS
239
par l'arrondissement. On a mis maintes fois le vu que les deux circonscriptions fussent confondues; que, par exemple, pour les lections lgislatives, la France formt un collge unique, c'est un souhait platonique de publiciste. La majorit qui nomme le reprsentant est une certaine quote-part des lecteurs de la circonscription, dtermine par les rgles qu'on verra plus loin; ce n'est pas l'unanimit. La chose tait impossible; ds qu'une association devient un peu considrable, et on s'en aperoit aussi bien pour les grandes socits commerciales que pour les associations politiques, l'unanimit de volont est irralisable, et comme il faut bien vivre, il faut se contenter de la majorit. Sans doute c'est une imperfection, une apparition de la force l o il serait dsirable de ne trouver que le libre consentement; sans doute il y aura une minorit opprime par la majorit; c'est une ncessit de la vie. Au reste, l'injustice est rarement persistante, grce cette loi bienfaisante que toute action amne une raction. Tout naturellement la minorit d'hier devient majorit d'aujourd'hui et chaque parti occupe le pouvoir son tour. Il est lgitime cependant de chercher corriger ce qu'il peut y avoir de trop brutal dans le rgime des majorits, et assurer un minimum de reprsentation aux minorits. Des systmes ingnieux ont t imagins cet effet, quelques-uns sont adopts par des lgislations trangres. Le plus simple est le systme inaugur en Espagne en 1876 pour les lections municipales, appliqu en 1878 aux lections lgislatives, et en 1882 aux lections provinciales ; c'est celui du scrutin de liste diminu. Un mme collge ayant lire la fois plusieurs reprsentants, chaque lecteur ne peut voter que pour les deux tiers ou les trois quarts de la liste. Si la minorit est discipline, elle fait fatalement passer ses candidats pour le tiers ou le quart restant de la liste. Le scrutin ou vote est une opration qui consiste essentiellement dans le dpt entre les mains de l'autorit, par les lecteurs, de bulletins crits contenant le nom ou les noms des reprsentants choisis. On distingue le scrutin de liste et le scrutin uninominal. Il ya scrutin de liste, lorsqu'un mme collge lectoral ayant choisir simultanment plusieurs reprsentants, le bulletin de chaque lecteur contient une liste de noms. Il y a scrutin uninominal, lorsque le collge lectoral n'ayant choisir qu'un seul reprsentant, le bulletin de chaque lecteur ne porte qu'un seul nom. Les lections communales se font actuellementau scrutin de liste. Les lections au conseil gnral et au conseil d'arrondissement se font au scrutin uninominal. Les lections la Chambre des dputs ont eu sur ce point des vicissitudes sans nombre ; elles ont t faites
240
RGLES COMMUNES D'ORGANISATION
tantt au scrutin de liste avec le dpartement pour circonscription, tantt au scrutin uninominal avec l'arrondissement pour circonscription. La question de savoir lequel est prfrable de ces deux modes de scrutin, relve du droit constitutionnel. Actuellement la Chambre est lue au scrutin uninominal. Il y a des lections gnrales et des lections partielles ou complmentaires. Il y a lection gnrale lorsque tous les membres qui composent une assemble sont soumis en mme temps l'lection, soit que l'assemble soit arrive la fin de son mandat, soit qu'il y ait eu dissolution. Si l'assemble ne se renouvelle pas intgralement, mais par sries, comme le conseil gnral par exemple, qui est renouvelable par moiti de trois en trois ans, l'lection d'une srie mrite encore le nom d'lection gnrale. Il y a lection partielle ou complmentaire, lorsqu'il s'agit uniquement de remplacer un ou plusieurs membres de l'assemble considrs individuellement. Article Ier. Oprations antrieures au scrutin. 1 de la dtermination de la cirIl y a lieu de se proccuper : conscription lectorale; 2 de la convocation des lecteurs; 3 de la priode lectorale et des vnements qui peuvent s'y produire. lectode la circonscription 108. A. Dtermination rale. Les circonscriptions lectorales sont en gnral dtermines par la loi d'une manire permanente. Cependant en matire d'lection lgislative, l'augmentation ou la diminution de la population d'un arrondissement peuvent amener des modifications qui sont faites par une loi spciale; et en matire d'lection communale, la circonscription normale, qui est la commune, peut tre modifie assez subitement au moyen de ce qu'on appelle le sectionnement lectoral. (Renvoi l'organisation communale, n 246.) Le scrutin doit 109. B. Convocation des lecteurs. avoir lieu un jour fix, et les lecteurs doivent en tre avertis. A cet effet, ils sont convoqus par un acte de l'autorit. Cet acte est un dcret pour les lections au Snat et la Chambre des dputs, au conseil gnral et au conseil d'arrondissement; un arrt du prfet pour les lections municipales, et mme, en cas de second tour de scrutin, un arrt du maire suffit pour les lections municipales (art. 30, L. 5 avril 1884).
DES LECTIONS THORIE
241
Mais il est clair que l'autorit qui fait la convocation est elle-mme astreinte par la loi la faire pour une date fixe, ou tout au moins pour une date comprise dans un certain intervalle de temps. Il n'y a qu'un seul cas o la loi dsigne une date fixe, c'est celui des lections municipales. Celles-ci devront avoir lieu perptuit le premier dimanche de mai, de quatre ans en quatre ans, partir de l'anne 1884, par consquent toutes les annes bissextiles, en 1888, 1892, 1896, etc. Et, alors mme que tous les conseils municipaux de France seraient dissous, cela ne porterait pas atteinte la priodicit. Les conseils lus aprs dissolution achveraient simplement la priode de quatre ans commence. Pour toutes les autres lections, la loi se borne dire que la convocation devra tre faite un certain laps de temps avant l'expiration des pouvoirs de l'assemble, ou bien, s'il y a eu dissolution, qu'elle devra tre faite dans un certain dlai aprs la dissolution. Dans le cas o l'assemble achve son mandat, il faut donc calculer la dure de ses pouvoirs pour savoir quand la convocation devra tre faite. On verra propos de chaque assemble quelles sont les rgles qui lui sont propres. Dans les limites o le pouvoir excutif peut se mouvoir, il est entirement libre,le dcret de convocation est un acte de gouvernement. Pour les lections partielles, il y a aussi des rgles particulires chaque assemble. et des vnements lectorale 110. C. De la priode La priode lectorale est le temps qui peuvent s'y produire. qui s'coule entre le jour de la publication de l'acte qui convoque les lecteurs et le jour du scrutin. La dure minimum est fixe par la loi ainsi qu'il suit : Snat, six semaines (l.2 aot 1875, art.1) ; Chambre des dputs, vingt jours (dcr. O. 1852, art. 4); Conseil gnral, quinze jours (1. 10 aot 1871, art. 12); Conseil d'arrondissement, quinze jours (1. 10 aot 1871, art. 12); Conseil mnnicipal, quinze jours (art. 15, l, 5 avril 1884). Les vnements qui peuvent se produire au cours de la priode lectorale s ont des candidatures, des faits de presse, des runions lectorales. 1 Des candidatures. Le candidat est un individu dsign aux suffrages des lecteurs avant le jour du scrutin. La canditature est le fait d'tre candidat. On comprend la ncessit des candidatures. D'une part, si les lecteurs ne sont pas sollicits porter leurs suffrages sur tel ou tel nom, les voix s'gareront sur une infinit de noms et il n'y aura pas d'lection ; d'autre part, les lecteurs nomment 16 H.
242
RGLESCOMMUNES D'ORGANISATION
un reprsentant en vue de faire prvaloir telle ou telle volont, ils ont besoin de savoir quels reprsentants sont en communion d'ides avec eux. La candidature est le seul moyen pratique de provoquer un change d'ides entre leur futur reprsentant et eux. De l, ces programmes et ces professions de foi par lesquels les candidats affirment leur candidature. Chose curieuse, la candidature, fait si ncessaire dans une lection, n'est pas rglemente en principe par le droit, except pour les lections la Chambre des dputs (1. 17 juillet 1889 dont il va tre parl). De sorte que pour toutes les autres lections: 1 Il peut n'y avoir pas de candidature. Les lecteurs peuvent voter spontanment pour tel ou tel nom. Le premier tour de scrutin dans ces conditions ne donnera probablement pas de rsultat, le second tour en donnera forcment. 2 La candidature, si elle se produit, n'est soumise aucune formalit, c'est un pur fait. Elle peut tre lance par le candidat lui-mme ou par un tiers; seulement le tiers doit s'assurer du consentement du candidat, il n'a pas le droit de disposer de son nom sans cela; le faire serait s'exposer l'application de l'art. 1382 C. civ., pour peu qu'il survint quelque dommage, quelque incident dsagrable pour le candidat. (Rouen, 27 dcembre 1878; Nevers,22 juin 1881.) Dclaration de candidature pour les lections lgislatives, loi du 1889. Exceptionnellement, pour les lections la 41 juillet Chambre des dputs, une dclaration de candidature est ncessaire. a) C'est un acte crit, sign ou vis par le candidat et dment lgalis, dpos la prfecture du dpartement intress. Cependant, on a admis le tlgramme en cas de force majeure. (Affaire Le Myre de Villers.) Le dpt doit tre fait le cinquime jour au plus tard avant le jour du scrutin. Il peut tre fait ds le premier jour de la priode lectorale; il est dlivr immdiatement un reu provisoire et dans les vingt-quatre heures un rcpiss dfinitif. Dans l'intervalle entre les deux rcpisss, la Cour de cassation admet qu'il peut tre fait acte de candidat, (Cass. 29 mars 1890.) b) Nul ne peut tre candidat dans plus d'une circonscription. Toute dclaration de candidature faite en violation de cette rgle est nulle et non avenue. Si plusieurs dclarations ont t faites, la premire en date est seule valable. Si elles portent la mme date, toutes sont nulles. c) Nul ne peut se porter candidat, s'il n'est citoyen, c'est--dire s'il n'a la jouissance du droit de suffrage. Cette solution est conteste, mais elle parat rsulter du texte de l'art. 2, qui dit, tout citoyen, etc. Elle rsulte aussi, il faut bien le dire, des principes du droit. Du mo-
THORIEDES LECTIONS
243
ment que la candidature devient un acte juridique, elle est soumise aux conditions de validit des actes juridiques. Or, il est conforme au droit, que celui-l qui ne pourrait pas tre lu ne puisse pas valablement faire acte de candidat. Toutefois, on ne peut pas admettre que le prfet devienne juge de la qualit de citoyen, dans les cas douteux. Nous admettrions donc que le prfet peut et doit refuser la dclaration de candidature d'une femme ou d'un individu qui a perdu par suite de condamnation la jouissance du droit de suffrage, mais qu'il ne peut pas refusercelle d'un candidat qu'il prtend tre tranger, parce que l il y a cas douteux et, qui plus est, question d'tat. d) Le rsultat de l'absence de dclaration de candidature, soit que la dclaration n'ait pas t faite, soit qu'elle n'ait pas t reue, soit qu'elle soit nulle par suite de la multiplicit, est la non-existence de l'lection, les bulletins n'entrent pas en compte dans le rsultat du dpouillement (art. 5). De plus, les affiches, placards, professions de foi, bulletins de vote, doivent tre enlevs et saisis1. e) Enfin, sera puni d'une amende de 10,000 francs le candidat qui contreviendra aux dispositions de la prsente loi, et d'une amende de 1,000 5,000 francs toute personne qui aura sign ou appos des affiches, envoy ou distribu des bulletins, circulaires ou professions de foi dans l'intrt du candidat. Cette loi est un peu de circonstance et renferme des parties caduques, notamment la partie pnale, mais il faut s'attendre en voir demeurer le fond; il est naturel que la candidature pose, qui est l'acceptation anticipe du mandat, devienne un acte juridique. En Angleterre, cela existe, et mme, quand il n'y a qu'une seule candidature l'lection devient inutile. Il pourrait mme se produire ce fait, que la loi du 17 juillet 1889 ft tendue d'autres lections. Son texte est gnral, si on la restreint actuellement aux lections lgislatives, c'est qu'on n'a vu encore que son caractre politique, non pas son caractre juridique. 2 Des faits depresse. Les candidatures sont lances d'ordinaire et discutes par des moyens qui constituent des faits de presse. Il y a quelques rgles destines faciliter les candidatures. Pour les formalits de l'impression, de l'affichage et du colportage des crits lectoraux, V. la loi du 29 juillet 1881 sur la libert de la presse. C'est le droit commun. 1. Les affiches, placards lectoraux,placs avant la priode lectorale, tombent aussi sous le coup de la loi, de sorte qu'il faut considrer que ces affiches, placards, sont soustraits par la loi nouvelle au droit commun de la loi sur la presse. (C. Chambry, 12dc. 1889.)
244
D'ORGANISATION RGLESCOMMUNES
Sont affranchies du timbre les affiches lectorales d'un candidat contenant sa profession de foi, une circulaire signe de lui, ou seulement son nom. (L. 11 mai 1868, art. 3, 3.) Il n'en serait pas de mme des affiches manes d'un tiers qui voudrait soutenir la candidature. Il est interdit tout agent de l'autorit publique ou municipale de distribuer des bulletins de vote, professions de foi et circulaires de candidats . (L. 30 nov. 1875, art. 3, 3.) 3 Des runions lectorales. Renvoi la matire des runions publiques. (V. p. 153.) Article 2. Oprations du scrutin. 111. Premier et second tour de scrutin, majorit Dans toute lection il peut y avoir deux tours de scrurequise. tin, et cela est li aux rgles sur la dtermination de la majorit. Il n'y a lection au premier tour de scrutin, que si un candidat a obtenu la majorit absolue des suffrages. Il y a majorit absolue aux deux conditions suivantes: 1 le nombre des suffrages exprims est gal au quart des lecteurs inscrits1; 2 le candidat a obtenu plus de la moiti des suffrages exprims. (Loi 30 nov. 1875, art. 18.) Lorsqu'il n'y a pas eu lection au premier tour de scrutin, il y a lieu un second tour. Il ya toujours lection au second tour pourvu qu'il y ait eu au moins un suffrage exprim. Il suffit en effet qu'un candidat ait obtenu la majorit relative, c'est--dire plus de voix que ses concurents, quel que soit le nombre des voix. En cas d'galit de suffrages, le plus g est lu. (L. 30 novembre 1875, art. 18; 1. 5 avr. 1884, art. 30.) Le second tour de scrutin est une opration distincte du premier tour. Il peut s'y produire des candidatures nouvelles. On l'appelle quelquefois scrutin de ballotage, par souvenir d'un temps o au contraire il ne pouvait y avoir de candidature nouvelle, et o il s'agissait de choisir entre les candidats du premier tour. Il y a cependant un certain rapport entre les deux scrutins; en cas d'lection lgislative, les candidats du premier tour ne sont point astreints faire une seconde dclaration de candidature au second tour. La raison d'tre des deux scrutins est de permettre aux lecteurs 1. Pour la question de savoir quand il y a suffrage exprim, voir infr, dpouillement du scrutin n 116.
THORIEDES LECTIONS
245
de mme opinion de se compter. Aussi sont-ils spars par un intervalle fix par la loi. Le second tour a lieu: Pour la Chambre des dputs, le second dimanche qui suit le jour de proclamation du rsultat du premier tour. (L. 30 novembre 1875, art. 4.) Pour le conseil gnralet le conseil d'arrondissement, le dimanche qui suit le dimanche du premier scrutin. (Art. 12, 2, 1. 1871.) Pour le conseil municipal, mme chose. (Art. 30, 1. 5 avril 1884.) Par exception, pour le Snat, il peut y avoir trois tours de scrutin le mme jour dans le collge runi au chef-lieu de dpartement, le premier de huit heures midi, le second de deux heures cinq heures, le troisime de sept heures dix heures. (Art. 14, 1. 2 aot 1875 modifie par 1. 9 dcembre 1884.) Chaque scrutin ne dure qu'un 112. Jour du scrutin. jour, ce jour doit tre un dimanche. Pour la Chambre des dputs ce n'est pas dit, sauf pour le second tour second dimanche qui suit .. (art 4, 1. 30 novembre 1875), mais on suit la disposition du dcret rglementaire de 1852 qui conseille de choisir le dimanche. Pour le conseil gnral, le conseil d'arrondissement, le conseil municipal, c'est une obligation lgale de choisir le dimanche. Pour la Chambre des dputs, le conseil gnral, le conseil d'arrondissement, le scrutin est clos six heures du soir. Il ouvre tantt huit heures, tantt sept heures du matin. Pour le conseil municipal, pas de fixation dans la loi, c'est l'arrt du prfet qui fixe, mais le scrutin ne peut tre ferm qu'aprs avoir t ouvert pendant six heures au moins. 113. Lieu du vote. Le vote, lieu au chef-lieu de la commune. Nanmoins chaque commune peuttre divise, par un arrt du prfet, en sections de vote en vue d'viter l'encombrement dans le lieu du scrutin. (L. 30 novembre 1875, art. 4; 1. 5 avril 1884, art. 13)1.
1. Il ne faut pas confondre la section de vote avec la section lectorale : la section de vote est une mesure d'ordre qui n'affecteque le scrutin ; pour tout le reste, elle n'empche pas l'opration lectorale de garder son unit dans la commune; la section lectorale, au contraire, qui d'ailleurs ne peut exister qu'au point de vue des lections municipales, affecte l'opration lectorale tout entire, elle fait qu'il y a plusieurs lections dans la commune, car chaque section lectorale est une circonscription qui lit sa liste de conseillers municipaux.
246
RGLESCOMMUNES D'ORGANISATION
C'est au maire qu'il appartient de dsigner des locaux, sauf pour les lections municipales o l'arrt de convocation du prfet fixe le local o le scrutin sera ouvert. (Art. 15, 1. 5 avril 1884.) L'autorit qui sont remis 114. Du bureau lectoral. les bulletins de vote porte le nom de bureau lectoral. C'est une vritable autorit administrative temporaire. Les dcisions qu'il prend sur les difficults qui s'lvent touchant les oprations du scrutin, sur la question de savoir qui doit voter, comment doivent tre compts les bulletins, etc., sont provisoirement excutoires, elles doivent d'ailleurs tre motives mais, d'autre part, le bureau lectoral, ; comme les commissions de recensement dont il sera parl plus loin, fonctionne uniquement pour assurer l'opration matrielle du scrutin, il n'est en aucun cas juge de l'ligibilit des candidats. (Cons. d't. 27 fvr. et 23 avr. 1882.) Le prsident du bureau a la police de l'assemble, et il l'a seul. Nulle force arme ne peut, sans son autorisation, tre place dans la salle des sances ni aux abords, les autorits militaires sont tenues de dfrer ses rquisitions. (D. R. 1852, art. 11 ; L. 5 avr. 1884, art. 18.) Le bureau de chaque section de vote est compos d'un prsident, de quatre assesseurs et d'un secrtaire. (D. R. 1852, art. 12.) Les bureaux de vote sont prsids par le maire, les adjoints, les conseillers municipaux, dans l'ordre du tableau ; et, en cas d'empchement, par des lecteurs dsigns parle maire. (L. 1884, art. 17, V. D. R. 1852, art. 13.) Les deux plus gs et les deux plus jeunes des lecteurs prsents l'ouverture de la sance, sachant lire et crire, remplissent les fonctions d'assesseurs . Le secrtaire est dsign par le prsident et par les assesseurs, dans les dlibrations du bureau, il n'a que voix consultatives. Trois membres du bureau au mons doivent tre prsents pendant tout le cours des oprations. (L. 1884, art. 19. V. D. R. 1852, art. 14 et 15.) 115. Du vote. a) Quipeut voter : Pendant toute la dure des oprations, une copie de la liste des lecteurs, certifie par le maire, contenant les nom, domicile, qualification de chacun des inscrits, reste dpose sur la table autour de laquelle sige le bureau. (L. 1884, art. 22; V. D. R., art. 17.) Nul ne peut tre admis voter s'il n'est inscrit sur cette liste.
DES LECTIONS THORIE
247
Toutefois, seront admis voter, quoique non inscrits, les lecteurs porteurs d'une dcision du juge de paix ordonnant leur inscription, ou d'un arrt de la cour de cassation annulant un jugement qui aurait prononc leur radiation. (L. 1884, art. 23; V. D. R. 1852, art. 19.) A l'inverse, tout individu inscrit sur la liste doit tre admis au : les dtenus vote l'exception des personnes suivantes ; les accuss contumaces; les personnes non interdites, mais retenues en vertu de la loi du 30 juin 1838, dans un tablissement public d'alins (D. R. 1 852, art. 18) ; les militaires et assimils de tous grades des armes de terre et de mer quand ils sont prsents au corps. (V. p. 121.) Si un individu inscrit sur la liste a subi depuis la clture de celleci une condamnation entranant dchance, et s'il n'a pas t ray ; mais, d'une part, en votant, il commet un dlit d'office, il peut voter (D. O. 1852, art. 32), d'autre part le juge du contentieux de l'lection pourra annuler son vote. b) Opration du vote. (D. R. 1852, art. 21 et 5. L. 1884, art. 25.) Elle consiste en ce que les lecteurs viennent un un apporter leur bulletin de vote au bureau. Comme le vote est secret ( 1. 30 nov. 1875, art. 5, 2) le bulletin doit avoir t prpar en dehors de l'assemble, le papier doit tre blanc et sans signes extrieurs; il doit tre pli. Le bulletin est remis au prsident; le prsident le dpose dans la bote du scrutin, laquelle doit avoir t ferme deux serrures dont les clefs restent, une clef entre les mains du prsident, l'autre entre celles du scrutateur le plus g. Au moment de son vote, le nom de chaque lecteur est marg sur une liste, appele liste d'margement. Ces listes seront ensuite dposes pendant huitaine la mairie et communiques tout lecteur requrant. Par un dernier souvenir des assembles primaires de la Rvolution, le dcret de 1852 prescrit un appel des lecteurs et un rappel. Ces formalits, qui supposeraient les lecteurs assembls, ne sont plus usisites ; les lecteurs viennent voter l'heure qu'il leur plait. Ils justifient de leur identit par une carte lectorale dlivre par la mairie ou par tout autre moyen. Nul lecteur ne peut entrer dans le lieu du scrutin s'il est porteur d'armes quelconques. (D. 1852, art. 27 ; 1. 116. Dpouillement du scrutin. municipale, art. 27.) En principe, le dpouillement du scrutin doit avoir lieu immdiatement; cependant, s'il y a impossibilit, on doit
248
RGLESCOMMUNES D'ORGANISATION
suivre les formalits de l'art. 41 de la loi du 5 mai 1855. Dans les sections o il s'est prsent moins de trois cents votants, les membres du bureau procdent eux-mmes au dpouillement. Dans celles o il s'en est prsent davantage, le bureau dsigne parmi les lecteurs prsents un certain nombre de scrutateurs sachant lire et crire qui se divisent par tables de quatre au moins. Les membres du bureau les surveillent et les tables sont disposes de telle sorte que les lecteurs puissent circuler l'entour. La bote du scrutin est ouverte et le nombre des bulletins vrifi. Si ce nombre est plus grand ou moindre que celui des votants, il en est fait mention au procs-verbal. Le prsident rpartit entre les diverses tables les bulletins vrifier; chaque table, l'un des scrutateurs lit chaque bulletin haute voix, un autre recueille les bulletins, les deux autres inscrivent les noms ports sur les bulletins sur des listes prpares cet effet. Les scrutateurs n'ont pas le droit de statuer sur les bulletins douteux, ce droit appartient au bureau et les scrutateurs n'ont que voix consultative; ils doivent donc provisoirement rserver ces bulletins, il sera statu aprs le dpouillement. Bulletins irrguliers, deux catgories : 10 Ceux qui n'entrent pas en compte pour le calcul des suffrages : les bulletins blancs ou illisibles; exprims; sont dans cette catgorie ceux ne contenant pas une dsignation suffisante ou dans lesquels les votants se font connatre ; pour les lections lgislatives, les bulletins portant le nom des candidats qui ne se sont pas conforms la loi sur les candidatures multiples (D. R. 1852, art. 30; L. 5 avril 1884, art. 28 ; L. 17 juillet 1889) ; 2 Ceux qui entrent en compte, mais ne sont y as attribus au candidat; sont dans cette catgorie, les bulletins sur papier de couleur ou portant des signes extrieurs. Tous ces bulletins doivent tre annexs au procs-verbal. Si un bulletin comprend plus de noms qu'il ne faut, les premiers seuls doivent tre compts. (L. municipale, art 28.) Immdiatement aprs le dpouille117. Proclamation. ment, le rsultat du scrutin est rendu public et les bulletins, autres que ceux qui doivent tre annexs au procs-verbal, sont brls en prsence des lecteurs. (D. R. 1852, art. 31; 1. 1884, art. 29.) Pour les collges diviss en plusieurs sections de vote, le dpouillement du scrutin se fait dans chaque section. Le rsultat est immdiatement arrt et sign par le bureau ; il est ensuite port par le prsident au bureau de la premire section, qui, en prsence des pr-
DES LECTIONS THORIE
249
sidents des autres sections, opre le recensement gnral des votes et en proclame le rsultat. (D. R. art. 32.) Pour les lections municipales, cette proclamation du rsultat est une dcision qui produit immdiatement son effet. Cet effet ne peut tre ananti que si l'opration est annule par la juridiction charge du contentieux de l'lection. Pour toutes les autres lections, le rsultat de chaque commune n'est qu'un lment de dcision pour la commission de recensement, qui proclamera le rsultat de toute la circonscription. des oprations lectorales. 118. Procs-verbaux Les procs-verbaux des oprations lectorales de chaque commune sont rdigs en double. L'un de ces doubles reste dpos au secrtariat de la mairie, l'autre double est transmis au sous-prfet de l'arrondissement qui le fait parvenir au prfet du dpartement. (D. R. art. 33.) L'administration se charge de faire prendre rapidement ces procs-verbaux pour les lections lgislatives et communales; par une anomalie, pour le conseil gnral et le conseil d'arrondissement, le procs-verbal doit tre port au chef-lieu du canton par deux membres du bureau (art. 13, 1. 1871). Les procs-verbaux font foi jusqu' preuve contraire. Le recense119. Recensement des votes. gnral ment gnral des votes est une opration qui s'impose dans toutes les lections autres que les lections communales. En effet, le scrutin tant une opration communale, toutes les fois que la circonscription lectorale comprend plusieurs communes, il faut bien centraliser les rsultats de toutes les communes de la circonscription. Pour les lections lgislatives ; le recensement gnral des votes pour chaque circonscription lectorale se fait au chef-lieu du dpartement en sance publique ; il est opr par une commission compose de trois membres du conseil gnral. A Paris le recensement est fait par une commission compose de trois membres du conseil gnral dsigns par le prfet de la Seine , art. 34. Le prsident de la commission proclame le dput lu. (D. R. 1852, art. 35.) Pour le conseil gnral et le conseil d'arrondissement, le recensement se fait immdiatement au chef-lieu de canton par le bureau de ce chef-lieu; le rsultat est proclam par le prsident de ce bureau. La commission de recensement qui fonctionne pour les lections
250
RGLESCOMMUNES D'ORGANISATION
lgislatives, le. bureau lectoral du chef-lieu de canton qui fait fonction de commission de recensement pour les lections au conseil gnral et au conseil d'arrondissement, sont des autorits administratives temporaires. La proclamation du rsultat faite par eux est une dcision qui s'excute provisoirement jusqu' ce que la juridiction comptente se soit prononce sur les rclamations formes contre l'lection. Si d'aprs cette proclamation le premier tour de scrutin n'a pas donn de rsultat, il y a lieu de procder un second tour, et on y procdera alors mme que, en fait, la commission se ft trompe dans ses calculs. A l'inverse, si la commission de recensement proclame lu un candidat, provisoirement ce candidat bnficiera dela situation, alors mme que, en fait, la commission se ft trompe dans ses calculs. Les pouvoirs de la commission de recensement en matire d'lection lgislative ne se bornent pas un calcul numrique des voix, ils vont jusqu' lui permettre de reviser l'attribution des bulletins irrguliers, qui ont d lui tre transmis annexs aux procs-verbaux de chaque commune. (Avis C. d't. 8 avril 1886.) Mais ils ne vont pas jusqu' la rendre juge de l'ligibilit du candidat, car il s'agit uniquement d'accomplir l'opration du calcul des voix. Le bureau du chef-lieu de canton, faisant fonction de commission de recensement pour les lections au conseil gnral et au conseil d'arrondissement, doit logiquement avoir les mmes pouvoirs, bien qu'une circulaire ministrielle ne lui reconnaisse que le droit de vrification numrique. (Cire. Int. 10 juillet 1886.)
Article III. Contentieux lectoral. des pouet vrification lectoral 120. Contentieux L'lection est une opration administrative dont la valivoirs. dit peut tre conteste. Seulement, selon les cas, cette validit sera apprcie par deux voies diffrentes, par la voie contentieuse ou par celle de la vrification des pouvoirs. La voie contentieuse est le mode ordinaire de contestation des oprations administratives. Il est form des rclamations ou recours devant un juge; d'une part, le juge n'examine que les lections qui ont t droule devant lui se l'affaire d'autre de rclamations; part, l'objet comme un vritable procs. Les lections d'assembles dlibrantes, celles des consont vritable un contentieux, lieu donnent ainsi qui des seils gnraux de dpartement, des conseils d'arrondissement, conseils municipaux, des conseils gnraux des colonies.
THORIEDES LECTIONS
251
La voie de la vrification des pouvoirs est rserve aux lections la Chambre des dputs et au Snat. Le droit de vrificalion des pouvoirs constitue une prrogative constitutionnelle des deux Chambres. Il consiste essentiellement en ceci, qu' l'intrieur de chaque Chambre les membres vrifient rciproquement leurs pouvoirs, c'est--dire apprcient rciproquement la validit de leurs lections. D'une part, toutes les lections doivent tre vrifies, mme celles qui n'ont t l'objet d'aucune protestation; la vrification est, en effet, une prcaution que prennent des mandataires qui vont traiter ensemble et qui examinent la valeur de leurs procurations; cela remonte historiquement aux runions des tats-Gnraux o les dputs arrivaient porteurs de vritables procurations. D'autre part, la vrification se fait non point en la forme d'un procs, mais suivant une procdure parlementaire tablie par le rglement intrieur de chaque Chambre. En fait, le systme de la vrification des pouvoirs tend se rapprocher de celui du contentieux, parce que les lections contestes sont seules examines. Pour celles qui n'ont t l'objet d'aucune contestation. la vrification est devenue une simple formalit. C'est un contentieux port devant un tribunal politique. Il est possible qu'au point de vue constitutionnel, le systme de la vrification des pouvoirs soit actuellement une ncessit. Nous ne possdons pas d'ailleurs, dans notre organisation judiciaire, de cour suprme assez haute pour qu'on lui confie le contentieux de l'lection des Chambres. Mais un moment viendra peut-tre o l'on organisera des juridictions plus indpendantes et ayant une porte constitutionnelle. Ce jour-l, le systme de la vrification des pouvoirs aura vcu, car, au point de vue du droit, il est infrieur celui du contentieux; il permet la majorit d'abuser de sa force au dtriment de la minorit. (L'Angleterre, certains tats d'Amrique ont dj renonc au systme de la vrification des pouvoirs.) En attendant: 1 il faut bien se garder d'tendre le systme de la vrification des pouvoirs aux assembles dlibrantes infrieures; la loi du 10 aot 1871 avait commis cette faute en accordant la vrification des pouvoirs aux conseils gnraux des dpartements; c'tait un recul au lieu d'un progrs, on s'en aperut bien vite ; la loi du 31 juillet 1875 rorganisa un contentieux qui fut confi au Conseil d'tat; 2 les Chambres ont le devoir de se considrer comme un vritable tribunal, d'assimiler autant que possible leur vrification des pouvoirs un contentieux, et, bien qu'elles soient souveraines, de se conformer aux rgles du droit. La thorie gnrale du contentieux lectoral que nous allons faire,
252
RGLESCOMMUNES D'ORGANISATION
s'appliquera ds lors aussi bien aux lections la Chambre des dputs et au Snat qu'aux autres lections. 121. Thorie du contentieux lectoral. gnrale Il y a lieu de se proccuper des vices qui peuvent entacher l'lection, des pouvoirs du juge, de la procdure. Il faut distinguer l'opration A. Des vices de l'lection. de l'lection et celle du calcul des voix. L'opration de l'lection comprend tout ce qui est relatif la manifestation de volont des lecteurs; l'opration du calcul des voix, tant postrieure l'lection, ne peut avoir aucune influence sur la volont des lecteurs. a) lection. L'opration de l'lection est un vritable contrat solennel, on y retrouve tous les lments des contrats de ce genre, la capacit des parties, le consentement, les formes. Dans l'apprciation des vices qui peuvent entacher l'un ou l'autre de ces lments du contrat, le juge a le devoir de tenir compte de tous les faits, mme des plus lointains, de telle sorte que le contentieux des lections est des plus comprhensifs. Ainsi propos d'lections municipales contestes, le juge a le devoir de tenir compte de ce fait qu'un sectionnement lectoral opr au pralable par le conseil gnral est dnonc comme illgal; cela peut entraner la nullit de l'lection. De mme, le juge a le devoir de tenir compte de la capacit des lecteurs inscrits sur la liste lectorale; il peut constater qu'un individu rgulirement inscrit sur la liste n'avait cependant pas le droit de voter, par exemple, parce que depuis il avait subi une condamnation. La jurisprudence parlementaire admet mme que la liste peut tre revise au point de vue des indment inscrits. 1 L'lment de capacit doit s'apprcier dans l'lu et dans les lecteurs. Dans l'lu, l'incapacit rsulte soit de l'inligibilit, soit de l'absence des conditions d'exercice du droit, telles que l'attache la circonscription par le domicile, ou par le paiement d'une contribution. (V. p. 131.) Dans les lecteurs, l'incapacit rsulte soit de la perte de la jouis- t sance du droit de vote, soit du fait qu'on n'est pas inscrit sur la liste, soit du fait que, tout en tant inscrit, on ne peut pas voter (militaires prsents au corps). Bien entendu, l'incapacit de tel ou tel votant n'a. d'intrt que si l'annulation du vote peut modifier la majorit, car il s'agit de savoir s'il y a une majoritde capables. 2 L'lment de consentement doit tre apprci au point de vue de la libert et de la sincrit du vote, de sorte que le juge doit tenir
THORIE DES LECTIONS
253
compte des faits de pression (violence), de manuvres lectorales (dol, terreur), de corruption. Il n'est pas ncessaire d'tablir que ces faits >ont en ralit dtermin des votes, la preuve serait difficile administrer, il suffit qu'ils aient t de nature en dterminer. D'autre part, il faut qu'ils aient t assez graves pour modifier la majorit. 3 L'lment de formes comprend une grande quantit d'actes, l'acte de convocation des lecteurs, la dure de la priode lectorale, la formation du bureau lectoral, l'ouverture et la fermeture du scrutin, etc., tous les actes qui, de prs ou de loin, servent pr parer ou raliser la manifestation de volont des lecteurs. Ces forces ne sont essentielles, qu'en tant qu'elles importent la libert et la sincrit du vote. Si l'on se montrait trop svre, peu d'lections chapperaient l'annulation. des voix. Tous les actes qui sont uniquement relatifs Calcul b) au calcul des voix, proclamation du bureau lectoral, proclamation de la commission de recensement, ne font plus proprement parler partie de l'lection; ils ne peuvent avoir une influence sur le vote puisque le vote est termin. Ils pourront tre annuls ou rforms, mais pour une toute autre raison, parce qu'ils sont matriellement inexacts. Cela a son importance au point de vue des pouvoirs du juge. du juge. Il faut distinguer, suivant 122. Des pouvoirs que les vices entachent l'opration de l'lection considre comme manifestation de la volont des lecteurs, ou seulement l'opration matrielle du calcul des voix. 1 Dans le premier cas, le juge n'a qu'un pouvoir d'annulation. Ainsi, s'il y a incapacit de l'lu ou bien faits de pression, le juge ne peut que casser l'lection, il ne pourrait point proclamer lu un autre candidat. 2 En ce qui concerne l'opration du calcul des voix, le juge a un pouvoir de rformation, en ce sens qu'il peut rformer les dcisions des autorits administratives qui ont proclam les rsultats du scrutin, si ces dcisions sont errones. Il faut cependant distinguer les hypothses : a) La commission du recensement avait proclam lu X , alors que, vrification faite, c'est Y qui a la majorit ; le juge rformera la dcision et proclamera lu Y. b) La commission de recensement avait dclar qu'il n'y avait pas lection au premier tour et fait procder un second tour, alors qu'en ralit il y avait lection au premier tour; le juge annulera le second tour de scrutin et pro-
254
RGLESCOMMUNES D'ORGANISATION
clamera lu le candidat qui avait obtenu la majorit au premier tour. c) La commission de recensement avait dclar tort qu'il y avait lection au premier tour; le juge annulera compltement l'lection, il ne se bornera pas prescrire un second tour; en effet, le second tour de scrutin n'a de sens que s'il suit une courte distance le premier tour, or ici, raison des lenteurs de la procdure, il s'est forcment coul un long intervalle. (Cons. d'tat, 25 octobre 1878 ; 9 novembre 1883.) Cette diffrence de pouvoirs, tantt d'annulation, tantt de rformation, s'explique facilement. Dans l'hypothse o l'opration du calcul des voix seule et vicie, la volont des lecteurs reste certaine, ce sont de pures oprations administratives qui avaient t mal faites, il est naturel qu'elles soient refaites. Au contraire, toutes les fois que le vice touche la manifestation mme du consentement des lecteurs, le juge ne peut substituer sa dcision celle du corps lectoral, il ne peut que provoquer une nouvelle consultation. On sait bien que la volont des lecteurs a t vicie, mais on ne sait pas ce qu'elle et t si elle n'et pas t vicie. Des rclamations doivent tre 123. C. De la procdure. formes, elles sont portes devant certaines juridictions et juges suivant certaines formes. a) Des rclamations lectorales. Le droit de former une rclamation appartient: 1 A tous les lecteurs de la circonscription; 2 aux candidats ; 3 aux membres de l'assemble lue, sauf pour les lections au conseil d'arrondissement; 4 au gouvernement reprsent par le prfet pour les lections des assembles dlibrantes infrieures, par un ministre ou un dlgu spcial pour les lections lgislatives. La rclamation gouvernementale ne peut s'appuyer que sur l'inobservation des formes et conditions lgales. Les rclamations ou protestations peuvent tre formes au moment mme du vote, et alors elles sont inscrites au procs-verbal du scrutin, Elles peuvent aussi tre formes aprs coup. Pour les lections lgislatives, il n'y a point de dlai, elles peuvent tre formes tant qu'il n'a pas t statu. Pour les lections au conseil gnral, dlai de dix jours; le prfet a un dlai de vingt jours depuis le moment o il a reu les procs-verbaux. Pour les lections au conseil d'arrondissement, dlai de cinq jours; le prfet a quinze jours depuis la rception des procs-verbaux- Pour les lections au conseil municipal, mmes dlais. Les rclamations sont affranchies du timbre de l'enregistrement,
THORIE DES ASSEMBLES DLIBRANTES
255
il n'y a aucune forme impose, elles doivent tre seulement signes, il n'est pas ncessaire que la signature soit lgalise. Pour les lections au conseil b) Des juridictions comptentes. gnral des dpartements, la juridiction comptente est le Conseil d'tat en premier et en dernier ressort (l. 31 juillet 1875). Pour les Slections au conseil d'arrondissement, c'est le conseil de prfecture avec appel au Conseil d'tat dans le dlai de deux mois (1. 22 juin 1833, art. 50-54; 1. 22 juillet 1889, art. 57). Pour les lections au conseil municipal, c'est galement le conseil de prfecture avec appel au Conseil d'tat dans le dlai d'un mois (1. 5 avril 1884, art. 37 et suiv.). Pour les lections aux conseils gnraux des colonies et aux )conseils municipaux des communes coloniales, c'est le conseil du contentieux de la colonie avec appel au Conseil d'tat. Formes de procdure. Pour les conseils gnraux, voir 1. 31 juil[let 1875. Pour les conseils d'arrondissement, voir 1. 22juin 1833, art. 50-54. Pour les lections municipales, voir 1. 5 avril 1884, art. 37 et suiv. Le caractre gnral de ces procdures est que l'affaire se juge d'urgence et sans frais. C'est un principe universellement admis 124. Observation. que l'exercice provisoire demeure ceux dont l'lection est attaque (1. 15-27 mars1792, art. 9). En consquence, les membres des assembles, dontl'lection est conteste, doivent tre convoqus aux sessions, prendre part aux dlibrations, toucher l'indemnit s'il y en a une. Cependant, la Chambre des dputs et au Snat, on suspend l'exercice du mandat pour les membres soumis une enqute, parce qu'il y a prsomption grave d'invalidation. (V. aussi Cassat. 10 avril 1847.) LECTIF.THORIEGNRALE DU MANDAT DES 2. EXERCICE DLIBRANTES ASSEMBLES
Les reprsentants investis d'un mandat lectif sont des membres d'assembles dlibrantes. L'exercice de leur mandat les a conduit constituer ces assembles et prendre part leurs travaux, c'est donc la thorie gnrale des assembles dlibrantes qui doit tre faite ici. Elle sera faite avec les rgles communes au Snat, la Chambre des dputs, aux conseils gnraux des dpartements, aux conseils
256 d'arrondissement, des colonies 1.
RGLESCOMMUNES D'ORGANISATION aux conseils municipaux, aux conseils gnraux
Caractres. Les assembles dlib125. Dfinition. rantes sont des AUTORITS ADMINISTRATIVES composes de plusieurs membres lus dont la fonction est de prendre des DLIBRATIONS la majorit des voix. Les asembles dlibrantes ont une sorte de personnalit morale. Les Chambres lgislatives ont leur budget, leur caisse, leurs comptables. Les conseils gnraux et les conseils municipaux sont admis ester en justice devant le Conseil d'tat. (Cons. d't. 8 aot 1872; art. 67, 1. 5 avril 1884.) Cette personnalit fait que les assembles dlibrantes sont considres comme tant en permanence; elles ne sigent point d'une faon permanente, mais, mme quand elles ne sont pas en session, l'administration quotidienne est faite sous leur influence. (Instr. de l'Ass. nat. 8 janv. 1790.) Cette personnalit est la consquence naturelle de ce fait, que les assembles dlibrantes ont une volont dtermine par la majorit des voix. Lorsque la majorit est forte et discipline, cette volont apparat avec des caractres particuliers trs marqus. 126. I. Organisation dlibdes assembles Le nombre des membres dont une assemble dlibrantes. rante doit tre compose est fix parla loi. En gnral, il est en rapport avec la population de la circonscription reprsente. Selon que les communes sont plus ou moins peuples, elles ont plus ou moins de conseillers municipaux. Il n'en est pas de mme pour les conseillers gnraux, leur nombre n'est pas directement en rapport avec le chiffre de la population du dpartement, il dpend du nombre des cantons ; chaque canton n'lit qu'un seul conseiller, quelle que soit sa population. Les assembles dlibrantes sont nommes pour un certain intervalle de temps, en gnral assez court, aprs lequel elles doivent tre renouveles. Les unes sont renouveles intgralement, comme la Chambre des dputs et les conseils municipaux ; les autres par sries, comme le Snat, o il y a trois sries renouvelables de trois en trois ans; comme les conseils gnraux et les conseils d'arrondissement, o il y a deux sries renouvelables galement de trois en trois ans. 1. Bien entendu, chaque assemble dlibrante sera tudie de nouveau sa place.
THORIEDES ASSEMBLES DLIBRANTES
257
Le renouvellement par srie assure davantage la permanence de l'assemble. On peut dire que le Snat est toujours le mme ou du moins se modifie trs lentement, tandis qu'une Chambre nouvellement lue peut ne pas ressembler sa devancire. Une rgle de procdure parlementaire traduit bien ce fait, c'est celle qui veut que, la Chambre, tous les projets de lois non vots tombent la fin de la lgislature; leur discussion n'est pas continue sous la lgislature nouvelle, moins qu'ils ne soient dposs nouveau. Les membres d'une assemble peuvent tre indfiniment rlus cette mme assemble. En principe, une assemble dlibrante doit toujours tre au complet. Si donc, il se produit quelque vide par suite du dcs ou de la dmission de quelque membre ou de quelque autre cause, il doit tre procd dans la circonscription dont le reprsentant a disparu, une lection complmentaire, moins que l'on ne soit la veille d'un renouvellement intgral ou du renouvellement d'une srie ( V. Rgles partie, chaque assemble). Par exception au principe, on ne procde des lections complmentaires pour le conseil municipal, que lorsqu'il manque le quart des conseillers, ou mme, si l'on se trouve dans les six mois qui prcdent le renouvellement intgral, lorsqu'il en manque plus de la moiti (art. 42, 1. 1884), moins qu'il n'y ait lire un maire ou un adjoint, etc. (V. n 245.) Toutes les assembles dlibrantes autres que le Snat peuvent tre dissoutes par le pouvoir excutif : la Chambre par un dcret appuy d'un vote du Snat; les conseils gnraux, les conseils d'arrondissement, les conseils municipaux par des dcrets rendus avec des formalits diverses. La loi prescrit des dlais pour les lections nouvelles. des assembles 127. II. Fonctionnement dlib Les assembles dlibrantes ont des A. DES SESSIONS. rantes. sessions, pendant lesquelles elles tiennent des sances, consacres la prparation et au vote de dlibrations. La session est un certain intervalle de temps pendant lequel une assemble peut lgalement tenir des sances. Toutes les assembles ont ainsi des sessions, attendu qu'aucune ne sige en permanence. (V. cep. n 214 pour la commission dpartementale.) On distingue des sessions ordinaires et des sessions extraordinaires. Les sessions ordinaires se reproduisent tous les ans des poques dtermines par la loi. La session ordinaire des Chambres commence le second mardi de janvier. Les conseils gnraux ont deux sessions ordinaires, l'une qui s'ouvre le premier lundi qui suit le 15 aot, l'autre le second lundi qui suit le jour de Pques ; les conseils H. 17
258
RGLESCOMMUNES D'ORGANISATION
d'arrondissement ont une session unique en aot. Les conseils municipauxont quatre sessions ordinaires, en fvrier, mai, aot, novembre. La dure de ces sessions ordinaires est en gnral fixe. Pour celle de la Chambre, il y a un minimum, cinq mois au moins; pour les autres assembles dlibrantes, un maximum ; pour le conseil gnral, la session d'aot ne doit pas excder un mois, la session d'avril quinze jours. Les sessions des conseils municipaux ne doivent pas non plus, en principe, excder quinze jours; exceptionnellement, la session o est discut le budget peut durer six semaines. Les objets qui doivent tre discuts dans ces sessions sont quelquefois fixs. Ainsi les conseils gnraux doivent discuter le budget et les comptes la session d'aot, les conseils municipaux la session de mai. Il peut y avoir autant de sessions extraordinaires que les besoins l'exigent. Ces sessions sont provoques par le gouvernement, ou bien dues l'initiative de l'assemble elle-mme. Les Chambres, les conseils gnraux et les conseils municipaux peuvent en effet se runir spontanment, sous certaines conditions fixes par la loi et avec obligation d'avertir le gouvernement. Par exception, les conseils d'arrondissement ne peuvent pas se runir spontanment. (L. 22 juin 1833, art. 27.) Lorsque l'ouverture de la session est fixe une date dtermine par la loi, il n'y a point d'acte de convocation. Il en est besoin lorsque la date n'est pas fixe, notamment pour les sessions extraordinaires. Les Chambres sont convoques par dcret, les conseils gnraux galement lorsque la convocation mane de l'initiative gouvernementale; les conseils d'arrondissement par arrt du prfet. Les conseils municipaux sont convoqus par le maire, mais non pas par arrt, par lettres individuelles adresses chaque conseiller, trois jours francs au moins avant celui de la runion. (Art. 48, loi municipale. ) La clture de la session des Chambres est prononce par dcret. Pour toutes les autres assembles, c'est le prsident de l'assemble qui la prononce. Le chef de l'tat peut ajourner les Chambres par dcret en cas de conflit; l'ajournement ne peut excder le terme d'un mois, ni avoir lieu plus de deux fois dans la mme session. (L. const. 16 juillet 1875, art. 2.) Cet ajournement interrompt la session et le temps de l'ajournement ne peut tre compt dans le minimum de cinq mois exig par la Constitution. Il ne faut pas confondre cet ajournement avec celui que les Chambres peuvent dcider elles-mmes, et qui ne consiste qu'en une interruption des sances. Un ajournement semblable est de tradition Pques,
DLIBRANTES THORIEDES ASSEMBLES
259
pendant la session des conseils gnraux. Comme la Chambre reste libre de se runir, la session n'est pas interrompue. Les autres assembles lectives ne sont pas ajournes par le gouvernement; celui-ci a un droit plus fort, il peut suspendre le corps lui-mme, ce qui entrane videmment ajournement de la session. Elles ont le droit d'ajourner leur sances l'intrieur de la session. Les sances sont les runions des 128. B. Des sances. membres de l'assemble tenues en vue de dlibrer. Elles doivent tre tenues en un certain lieu, il y faut la prsence d'un certain nombre de membres, un bureau qui dirige, l'observation d'une certaine procdure. 1 Lieu de la sance. Toutes les assembles dlibrantes ont un sige lgal. Depuis la loi du22 juillet 1879, le sige des deux Chambres est Paris. Le Palais-Bourbon est affect la Chambre des dputs, le Palais du Luxembourg au Snat; nanmoins chacune des deux Chambres demeurematresse de fixer, dans la ville deParis, le palais qu'elle veut occuper. Le sige du conseil gnral est une des salles de l'htel de la prfecture. Le sige du conseil d'arrondissement, une des salles de l'htel de la sous-prfecture. Lesige du conseil municipal, une des salles de la maison commune, ou tout au moins une chambre commune btie ou loue cet effet. Cependant la loi gardant le silence, la runion peut avoir lieu dans une maison particulire, s'il n'y a point de chambre commune. Mais il parait indispensable que ce soit au chef-lieu de la commune. 2 Du nombre de membres prsents, ncessaire pour qu'une assemble puisse valablement dlibrer. La rgle est peu prs la mme pour toutes les assembles; il doity avoir en sance plus de la moiti des membres. C'est ce qu'on appelle le quorum. Mais sur quel nombre total calcule-t-on cette majorit? Dans les deux Chambres, et pour les conseils gnraux et d'arrondissement, on prend pour point de dpart le nombre lgal des siges; peu importe que dans le moment il y ait des siges non pourvus. Pour les conseils municipaux, la rgle est diffrente; on calcule sur les membres en exercice (art. 50,1. 1884). Cette modification tait ncessaire; les conseils municipaux ne sont pas complts chaque vacance, il n'y a lieu lection complmentaire que lorsqu'il manque le quart des conseillers; dans ces conditions, un conseil rduit n'aurait pu que difficilement satisfaire la rgle telle qu'elle est pose pour les trs
260
RGLESCOMMUNES D'ORGANISATION
autres assembles. Il faut mme admettre qu'un conseil municipal peut valablement dlibrer, lorsqu'il y a en sance plus de la moiti des membres, alors mme que le conseil est rduit au-dessous des trois quarts ou de la moiti, suivant la distinction de l'art. 42, loi municipale. (Cons. d'tat, 31 dcembre 1878.) Il fallait prvoir le cas o, par ngligence ou par calcul de certains membres, les assembles ne se runiraient pas en nombre; leur travail devait il tre indfiniment empch? Des dispositions ont t prises pour la plupart des assembles: Pour la Chambre des dputs et pour le Snat, l'absence des membres en sance n'a pas souvent d'inconvnient, par suite de l'habitude qui s'est tablie et qui est considre comme un droit, de voter par mandataire. On ne s'aperoit que le quorum n'est pas atteint, que lorsqu'il y a demande de scrutin public la tribune par appel nominal. Alors, le lendemain, le vote est valable quel que soit le nombre des prsents. (R. ch. dp. art. 95.) Pour les conseils gnraux, une loi a t vote le 31 mars 1886 : 1 si, au jour fix par la loi ou le dcret de convocation, le conseil n'est pas en nombre, la session sera renvoye de plein droit au lundi suivant; une convocation spciale sera faite d'urgence par le prfet; la dure lgale de la session courra partir du jour fix pour la seconde runion. Les dlibrations alors seront valables, quel que soit le nombre des membres prsents ; 2 Lorsqu'en cours de session une sance, il n'y aura pas le quorum, la dlibration sera renvoye, quel que soit le nombre des votants. Dans les deux cas, les noms des absents seront inscrits au procs-verbal. Pour les conseils municipaux, l'art. 50 de la loi municipale dispose ainsi : quand, aprs deux convocations successives trois jours au moins d'intervalle et dment constates, le conseil municipal ne s'est pas runi en nombre suffisant, la dlibration prise aprs la troisime dlibration sera valable, quel que soit le nombre des membres prsents. Ces dispositions, prises pour assurer le quorum ou remdier son absence, sont de droit troit et ne sauraient tre tendues aux autres assembles. 3 Du bureau. Les assembles dlibrantes ont besoin d'un organe de direction. En principe, c'est un bureau compos d'un prsident, d'un ou plusieurs vices-prsidents, d'un ou plusieurs secrtaires, quelquefois de questeurs, comme la Chambre et au Snat. Ce bureau est lu par les assembles elles-mmes. Il est lu annuellement la premire sance de l'anne. A la Chambre des dputs et au Snat, le bureau est lu ds le dbut de la session ordinaire en janvier. Et mme, quand la suite
DES ASSEMBLES DLIBRANTES THORIE
261
de l'leclion d'une Chambre nouvelle il y a eu lection d'un bureau, celui-ci n'est que provisoire. Pour les conseils gnraux, c'est l'ouverture de la session d'aot, p qui est considre comme la premire session de l'anne. (Art. 25 l. 1871.) Pour les conseils d'arrondissement, au dbut de la session annuelle unique. (L. 27 juillet 1870.) Les conseils municipaux sont encore ici un peu part; ils ont un bureau compos d'un prsident et d'un ou plusieurs secrtaires, mais le prsident n'est pas lu, si ce n'est dans une hypothse trs exceptionnelle, dans les sances o les comptes d'administration du maire sont discuts (art. 52); l'ordinaire, le conseil municipal est prsid par le maire ou, son dfaut, par les adjoints dans l'ordre des nominations, et, dfaut d'adjoints, par les conseillers municipaux dans [ l'ordre du tableau (art. 52 et 84). La sance dans laquelle il est pro) cd l'lection du maire est prside par le plus g. Au dbut de ) chaque session et pour sa dure, le conseil municipal nomme un ou plusieurs de ses membres pour remplir les fonctions de secrtaire. Il peut leur adjoindre des auxiliaires pris en dehors de ses membres, qui assisteront aux sances, mais sans participer aux dlibrations (art. 53). Le prsident de l'assemble dirige les dbats, veille la police de la sance, la sret intrieure et extrieure de l'assemble. Les prsidents de la Chambre des dputs et du Snat ont le droit de rquisition directe de la force arme. (L. 22 juillet 1879, art. 5.) Le prsident du conseil gnralne l'a pas, il doit s'adresser au prfet. (Av. Cons. d't. 3 dcembre 1874.) Le maire l'a comme maire, mais non comme prsident du conseil municipal. 4 Ordre du tableau. Il n'y a pas d'ordre particulier tabli entre les membres d'une assemble en principe ; ils se classent d'aprs les partis politiques. Mais, pour le conseil municipal, il y a un ordre spcial, l'ordre du tableau, qui sert dans diverses circonstances. L'ordre du tableau est dtermin: 1 par la date la plus ancienne des nominations; 2 entre conseillers lus le mme jour, par le plus grand nombre de suffrages obtenus ; 3 galit de voix, par la priorit d'ge. 5 Procdure des sances. Rglement. La procdure des sances est en partie rgle par la loi, en partie par le rglement intrieur de chaque assemble. Toute assemble dlibrante a le droit de se faire un rglement intrieur. La Chambre des dputs et le Snat ont le eur (16 juin 1876 et 10 juin 1876). Les conseils gnraux doivent en avoir un (l. 10 aot 1871, art. 26). Il est facultatif pour les con-
262
RGLESCOMMUNES D'ORGANISATION
seils d'arrondissement (1. 22juillet 1870), et aussi certainement pour les conseils municipaux. 6 Publicit des sances. A l'exception des conseils d'arrondissement, les sances de toutes les assembles dlibrantes sont publiques. En certain cas le huis-clos peut tre prononc. Pour les chambres lgislatives, la publicit remonte la Rvolution. Pour les conseils gnraux, elle avait t tablie une premire fois par le dcret du 3 juillet 1848, puis supprime, elle a t rtablie par la loi de 1871, art. 28. Pour les conseils municipaux, elle a t tablie seulement par la loi de 1884. 7 Ordre dujour. L'ordre du jour est de tradition dans toutes les assembles dlibrantes. C'est la liste arrte l'avance des questions qui doivent tre traites dans une sance. L'ordre du jour est en gnral fix par l'assemble elle-mme. 8 Procs-verbal. Il doit tre dress procs-verbal de toute sance d'une assemble dlibrante. Ce procs-verbal est dress par les soins du bureau, il est adopt par l'assemble dans la sance suivante, avec des rectifications s'il y a lieu; il est sign du prsident et des secrtaires. Par exception, ceux du conseil municipal sont signs de tous les membres prsents la sance. Le procs-verbal est la disposition des lecteurs et contribuables qui peuvent en prendre connaissance sur place, en prendre copie et la publier. Les procsverbaux du conseil gnral sont publis en volumes. Ceux des conseils municipaux sont transcrits sur un registre de la mairie. De plus, des comptes rendus sont publis. Les comptes rendus inextenso des sances des Chambres sont publis au Journal officiel. Un compte rendu sommaire et officiel de chaque sance du conseil gnral est tenu la disposition des journaux du dpartement dans (art. 31, 1,l. 1871). Un compte rendu les quarante-huit-heures de chaque sance du conseil municipal est dans la huitaine affich par extraits la porte de la mairie (art. 56, 1. 1884). Les conseils d'arrondissement ne publient pas de compte rendu. Une dlibration est une 129. C. Des dlibrations. DE VOLONT OU D'OPINIONvote par une assemble MANIFESTATION dlibrante. Il ya lieu de se proccuper de la prparation des dlibrations, du vote des dlibrations, de leur caractre juridique. 1 De la prparation des dlibrations. Les affaires sur lesquelles il doit tre pris des dlibrations arrivent en gnral prpares aux assembles dlibrantes. L'instruction prparatoire appartient l'organe excutif. Mais il faut songer: 1 Qu'il ya des affairesqui sont soumises directement l'assemble
DLIBRANTES THORIEDES ASSEMBLES
263
par l'initiative de ses membres, et qui ne passent point par le prliminaire de l'instruction par l'organe excutif, moins que l'assemble ne les y renvoie par une dcision formelle. Les conseils gnraux seuls sont tenus de renvoyer au prfet pour l'instruction prparatoire de toutes les affaires; 2 Que, mme pour les affaires instruites, il faut une tude prparatoire au sein de l'assemble, ne fut-ce que pour prendre connaissance du dossier. Commissions d'tude. On s'est aperu depuis longtemps que l'tude prparatoire d'une affaire ne peut pas tre faite avec fruit par une assemble nombreuse. On ne peut pas commodment mettre les documents la disposition de tous les membres, la discussion devient confuse, etc. De l, l'ide trs ancienne dans le rgime parlementaire des commissions. Une commission est une petite assemble dlibrante, constitue au sein de la grande assemble, de membres lus par celle-ci. Le systme des commissions est aujourd'hui commun toutes les assembles dlibrantes, mme aux conseils municipaux (art. 59, 1. 5 avril 1884). On conoit deux espces de commissions: 1 Des commissions temporaires nommes pour une affaire dtermine; 2 Des commissions permanentes nommes avec comptence pour toute une catgorie d'affaires, commissions des travaux publics, des douanes, etc. Les assembles ont le choix. Aux chambres lgislatives, le systme adopt est celui des commissions temporaires, ce qui, au point de vue constitutionnel, semble prudent. Les assembles risqueraient en effet d'tre tyrannises par quelques-unes de leurs commissions, si celles-ci taient permanentes; l'exemple de la Convention est bon mditer. En principe, les commissions peuvent siger dans l'intervalle des sessions; il en est ainsi pour les Chambres lgislatives et pour les conseils municipaux (art. 59). On s'accorde gnralement reconnaitre qu'il n'en est pas de mme pour les commissions du conseil gnral, lequel est dj reprsent dans l'intersession par sa commission dpartementale. Division des Chambres en bureaux. Les commissions sont en gnral nommes directement par un vote de tous les membres de l'assemble dlibrante, mais la Chambre des dputs et au Snat il y a une organisation spciale. Les Chambres sont d'une faon permanente divises en bureaux, et ce sont ces bureaux qui nomment les commissions raison d'un, deux, trois, quatre ou cinq membres par bureau.
264
D'ORGANISATION RGLESCOMMUNES
La Chambre compte onze bureaux, le Snat neuf; ces bureaux sont tirs au sort par le prsident de chaque Chambre en sance publique, au commencement de la sance d'ouverture, et renouvels de la mme manire chaque mois. Les bureaux une fois constitus, nomment chacun leur prsident et leur secrtaire. L'existence des bureaux a une consquence trs importante, elle assure la participation de la minorit au travail d'examen pralable. Les bureaux tant composs au hasard du tirage, certains peuvent contenir en majorit des reprsentants de la minorit de l'assemble. L'organisation des bureaux pourrait certainement tre introduite dans les rglements des conseils gnraux et des conseils municipaux qui le jugeraient utile.. 2 Du vote des dlibrations. Le vote est prcd d'une discussion orale. On passe au vote lorsque la discussion est close. Il se fait sur des propositions de rsolution qui sont mises aux voix par le prsident. Les propositions de rsolution manent soit de l'organe excutif, soit de la commission qui a t charge d'tudier l'affaire, soit d'un membre de l'assemble. Les propositions mises aux voix doivent tre minemment simples, toutes les fois qu'une proposition est divisible la division est de droit. Les modifications la proposition se prsentent sous forme d'amendements crits dposs au bureau; tous les membres ont actuellement dans toutes les assembles le droit d'amendement. Les amendements sont mis aux voix avant la proposition principale. Le vote a lieu de trois faons : par assis et levs, au scrutin public, au scrutin secret, sauf la Chambre des dputs o le scrutin secret a t supprim par une rsolution du 2 fvrier 1885, et n'est plus employ que pour les nominations. Aux Chambres, le scrutin public se fait, en principe, par bulletin pris sur place; par bulletin la tribune avec appel nominal, lorsqu'un certain nombre de membres le demandent. Au conseil gnral, les votes sont recueillis au scrutin public, toutes les fois que le sixime des membres prsents le demande. Nanmoins, les votes sur les nominations ont toujours lieu au scrutin secret. (L. 1871, art. 80, 2 et 3.) Au conseil municipal, le vote a lieu au scrutin public sur la demande du quart des membres prsents; les noms des votants, avec la dsignation de leurs votes, sont insrs au procs-verbal. Il est vot au scrutin secret toutes les fois que le tiers des membres prsents le rclame, ou qu'il s'agit de procder une nomination ou prsentation. Dans ces derniers cas, aprs deux tours de scrutin secret, si aucun des candidats n'a obtenu la majorit absolue, il est procd un troisime tour de
DLIBRANTES THORIE DES ASSEMBLES
265
scrutin, et l'lection a lieu la majorit relative; galit de voix. ! l'lection est acquise au plus g (art. 51). Les dcisions sont prises dans toutes les assembles la majorit absolue des suffrages exprims, c'est--dire lorsqu'il y a dans un sens plus de la moiti des voix. Lorsqu'il y a pointage, et toutes les fois que le scrutin n'est pas secret, la voix du prsident est prpondrante. Les abstentions ne comptent pas comme suffrages exprims, de sorte qu'un vote peut tre dcid par un trs petit nombre de suffrages. Dans un conseil municipal, par exemple, il suffit de trois suffrages exprims, deux d'un ct, un de l'autre, la condition, bien entendu, que l'assemble soit malgr cela en nombre pour dlibrer1. Toute dlibration 3 Du caractre juridique des dlibrations. est un acte juridique. Ce n'est pas toujours un acte d'administration au sens prcis o nous avons pris ce mot, parce que la dlibration ne contient pas toujours une manifestation de volont, c'est--dire une dcision excutoire; elle peut contenir une simple manifestation d'opinion, un vu, une rclamation, un blme l'administration, etc. Quand la dlibration renferme une dcision excutoire, c'est--dire un acte d'administration, c'est en gnral un acte d'autorit; les assembles dlibrantes ne font pas l'ordinaire d'actes de gestion2. Les rgles des actes d'autorit s'appliquent, notamment le recours pour excs de pouvoir est admissible aux termes du droit commun. Mais mme dans les cas o elle ne contient pas de dcision excutoire, la dlibration tant un acte juridique, est soumise des conditions de fond et de forme. Il y aurait toute une thorie faire sur la validit des dlibrations et sur les voies de nullit qui peuvent tre diriges contre elles. Comment et jusqu' quel point sont sanctionnes les rgles sur les sessions, les sances, le quorum, les modes de scrutin? Jusqu' quel point est assur le respect des lois dans les dlib1. Il n'est pas ncessaire que le nombre des suffragesexprims soit gal au quart des membres. La notion de la majorit absolue est diffrente ici de ce qu'elle est pour les lections. 2. Certains conseils gnraux, s'appuyant sur l'art. 46, 21, 1. 1871, ont fait des rglements en vertu desquels ils liquident eux-mmes les pensions des employs dpartementaux; la liquidation d'une pension est bien d'ordinaire un acte de gestion. Cependant le Conseil d'tat s'est toujours refus admettre contre la dcisiondu conseil gnral dans ce cas un recours conten tieux ordinaire ; il n'admet que le recours pour excs de pouvoir, c'est--dire qu'il refuse la dcision le caractre d'acte de gestion. (C. d't., 8 aot 1873; 16juillet 1875.)
266
RGLESCOMMUNES D'ORGANISATION
rations? Cette thorie n'est encore qu'imparfaitement bauche dans la loi. La rgle est pose pour les dlibrations des conseils municipaux (1. 1884, art. 63-65). Toute dlibration prise en violation d'une loi ou d'un rglement d'administration publique est nulle, d'une nullit absolue, invocable et opposable par tout intress toute poque et une voie de nullit est organise. Mais cette rgle, trs rationnelle, ne parat pas pouvoir encore tre tendue aux dlibrations de toutes les assembles dlibrantes. Elle ne peut pas l'tre aux dlibrations des Chambres, parce que les Chambres sont souveraines. Elle ne peut pas l'tre non plus compltement aux dlibrations des conseils gnraux, notre avis. (V. infr, n 211.) 130. APPENDICE: Attributions des membres personnelles En dehors des fonctions qu'ils remdes assembles dlibrantes. plissent comme prenant part aux sessions des assembles lectorales dont ils sont membres, les reprsentants ont quelques attributions personnelles. Les dputs et snateurs ont le droit de prendre part aux lections snatoriales dans leur dpartement; ils ont l'aptitude tre nomms ministres ; ils peuvent faire partie de certaines commissions ou de certains comits de surveillance o leur prsence est exige par la loi: par exemple, la commission du contrle des ordonnateurs, la commission de surveillance de la Caisse des dpts et consignations, qui comprend deux snateurs et deux dputs lus par leurs collgues (L. 6 aot 1876), etc. Les conseillers gnraux ont le droit de prendre part aux lections snatoriales dans leur dpartement; ils peuvent tre appels suppler des conseillers de prfecture (Arr. 19 fructidor an IV), ou le sous-prfet Ord. 29 mars 1821) ; deux membres du conseil gnral doivent faire partie du conseil acadmique (L. 17 fvrier 1880, art. 9); quatre membres doivent faire partie du conseil dpartemental de l'instruction primaire (L. 30 octobre 1886, art. 44); un membre doit faire partie du conseil de revision dans chaque canton; deux membres font partie des comits dpartementaux relatifs la protection des enfants en bas ge (L. 23 dcembre 1874), etc., etc. Les conseillers d'arrondissement ont le droit de prendre part aux lections snatoriales; ils peuvent remplacer le sous-prfet (Ord. 29 mars 1821); un membre fait partie du conseil de rvision. Les conseillers municipaux peuvent faire partie des commissions administratives de certains tablissements publics, tels qu'hpitaux, hospices, bureaux de bienfaisance et des commissions de surveillance de certains tablissements d'utilit publique tels que les monts-de-pit; ils font partie des commissions administratives charges de reviser les listes lectorales; ils peuvent tre chargs de prsider un bureau de vote, etc.
LECTIF DU MANDAT CARACTRES GNRAUX LECTIF FIN AU MANDAT QUI METTENT 3. VNEMENTS
267
: la mort du reprsentant, l'expiration 131. Ces vnements sont de la dure normale du mandat, la dissolution de l'assemble, l'acceptation de fonctions incompatibles avec le mandat, la dchance, enfin la dmission volontaire ou force. Dmission volontaire. Tout reprsentant lu peut toujours donner sa dmission. A la Chambre des dputs et au Snat, les dmissions sont adresses au prsident. Au conseil gnral, elles sont adresses au prsident du conseil ou celui de la commission dpartementale, qui doit immdiatement avertir le prfet (art. 20, 1. 10 aot 1871). Au conseil municipal, elles sont adresses au sous-prfet. La dmission doit tre accepte par l'autorit qui elle est adresse; il peut se faire en effet qu'il yait lieu de la refuser, et de prononcer la place une dchance ou une invalidation. Les dmissions des conseillers municipaux sont cens acceptes lorsque le prfet a envoy un accus de rception, ou bien, dfaut, un mois aprs un nouvel envoi de la dmission constat par lettre recommande (art. 10, 1. 1884). Dmission force. La dmission force ne s'applique pas aux Chambres lgislatives (remplace par la dchance). Au conseil gnrai, elle est tantt un moyen de faire respecter les rgles sur l'inligibilit et sur les incompatibilits, alors elle est prononce par le conseil gnral lui-mme (art. 18, 1. 1871); tantt une sanction de l'obligation d'assister aux sances soit du conseil gnral, soit de la commission dpartementale, alors elle est dclare par le conseil ou la commission (art. 19 et 74); tantt une sanction du refus d'accomplir une fonction dvolue par la loi, alors elle est prononce parle Conseil d'tat (1. 7 juin 1873). Au conseil d'arrondissement elleest une sanction de l'obligation d'assister aux sances (art. 7, 1. 22 juin 1833, et une sanction du refus d'accomplir une fonction dvolue la loi, par dans ce cas elle est prononce par le Conseil d'tat (1. 7 juin 1873). Au conseil municipal, elle est une sanction des rgles sur l'exclusion et l'incompatibilit (art. 36), de l'obligation d'assister aux sances (art. 60), dans ces cas, elle est prononce par le prfet; et une sanction du refus d'accomplir une fonction dvolue par la loi, dans ce cas elle est prononce par le Conseil d'tat. (L. 7 juin 1873). GNRAUX DU MANDAT LECTIF. 4. CARACTRES 132. Prohibition du mandat impratif. Le mandat
268
RGLESCOMMUNES D'ORGANISATION
lectif doit tre considr comme un mandat cum liber administratione qui ne comporte pas de programme impratif. Tout le systme reprsentatif est fond sur cette prsomption, que le corps lectoral n'est ni suffisamment inform ni suffisamment prpar pour trancher par lui-mme les questions lgislatives. D'ailleurs le programme ne pourrait tre que celui impos par la majorit; or, la majorit est une ncessit de l'lection, mais il n'est pas dit que son influence doive s'tendre au del, 1lu doit s'inspirer des intrts de la circonscription tout entire. Aux termes de l'art. 13, 1. 30 novembre 1875, tout mandat impratif est nul et de nul effet. Cette rgle est dfaut cependant admettre comme pourvue de sanction juridique1. Il consquence que la dmission en blanc dpose par l'lu entre les mains des lecteurs au moment de l'lection, et envoye par ceux-ci au prsident de l'assemble sans le consentement de l'lu, ne doit pas tre accepte. En principe, la puis133. Impossibilit de dlguer. sance publique confre par le mandat lectif ne se dlgue pas. Individuellement le reprsentant lu ne dlgue pas l'exercice de son mandat; ce point de vue, l'habitude prise par les membres du Parlement de voter par mandataire doit tre blme. L'assemble dlibrante prise en corps, ne peut pas non plus dlguer son droit de dcision. La Chambre ne pourrait pas dlguer ses pouvoirs une commission parlementaire. Une seule exception existe ce point de vue au profit du conseil gnral qui peut, au contraire, dlguer des pouvoirs sa commission dpartementale. Indemnit parlementaire. 134. Gratuit du mandat. Le mandat lectif est naturellement gratuit. Pour les conseils gnraux, il n'a jamais t question, mme en 1871, de salarier les conseillers; il n'en a pas t de mme pour la commission dpartementale, le projet de la commission comportait une indemnit, en faisant observer qu'il y avait des dplacements frquents; malgr cela (art. 75), le principe de la gratuit l'emporta. Pour les conseils municipaux, ce fut assez vivement discut; mais ici encore le principe de la gratuit l'emporta, sauf l'exception de l'art. 74, loi 1884, pour les frais de missions spciales. 1. L'acceptation d'un mandat impratifpar le candidat ne vicie pas l'lection. (V. cepend. Cons. d't., 26 dec. 1891; mais il s'agit d'lections au conseil des prud'hommes, autorit juridictionnelle, l'acceptation par des juges d'un mandat impratif quivaut dni de justice.)
DU MANDAT LECTIF GNRAUX CARACTRES
269
A l'inverse, les membres de la Chambre des dputs et du Snat touchent une indemnit (loi 30 nov. 1875, art. 17; 1. 2 aot 1875, art. 26). Cette indemnit est rgle par les art. 96 et 97 de la loi du 15 mars 1849 et par les dispositions de la loi du 16 fvrier 1872 : L'indemnit est fixe 9,000 francs par an. Les reprsentants envoys des colonies reoivent, en outre, l'indemnit de passage pour l'aller et le retour. L'indemnit fixe pour les reprsentants pourra tre saisie mme en totalit. La loi du 16 fvrier 1872 rgle, au point de vue de l'indemnit, la situation des fonctionnaires nomms dputs, et vice versa. Il y a interdiction du cumul du traitement et de 1 indemnit; cette rgle ne s'applique pas au Snat. (C. d'tat, 26 janv. 1877.) des tiers. Immunit parlementaire. 135. Protection Les membres des assembles dlibrantes, en traitant les questions d'intrt gnral, sont appels formuler au sein mme de l'assemble, sur des tiers, des opinions qui peuvent tre juges injurieuses ou diffamatoires. La sance d'une assemble dlibrante, au moins quand elle est publique, ou bien quand le compte rendu est publi par les journaux, donne ces opinions exprimes, le caractre de publicit qui les fait tomber sous le coup de la loi sur la presse. Faut-il admettre que, dans l'intrt de la libert des discussions, et de la bonne gestion des intrts gnraux, il n'y aura pas dlit? Pour les assembles lgislatives, le principe est pos, il n'y a point Aucun membre dlit et cela constitue l'immunit parlementaire : des deux Chambres ne peut tre poursuivi et recherch l'occasion des opinions ou des votes mis par lui dans l'exercice de ses fonctions. (L. const. 16juill. 1875, art. 13.) Cette disposition est complte par l'art. 41 de la loi du 29 juillet 1881, qui dclare non susceptibles d'ouvrir une action en justice les discours tenus dans le sein des deux Chambres, ainsi que les rapports et toutes autres pices imprimes par l'ordre de l'une des deux Chambres. Mais ce principe ne s'tend pas aux autres assembles dlibrantes, Les membres des conseils gnraux , des conseils d'arrondissement, des conseils municipaux1 sont responsables de leurs propos et de leurs votes injurieux ou diffamatoires. Cette responsabilit est poursuivie devant les tribunaux judiciaires suivant le droit commun, et le conflit ne pourra mme pas tre lev par le prfet, parce que 1. Pour les membres des conseils municipaux, la question avait fait doute cause du recours spcial qui existe devant le prfet; elle est tranche aujourd'hui. (Cons. d'tat, 7 mai 1872; Trib. conflits, 28 dcembre 1878.)
270
RGLESCOMMUNES D'ORGANISATION
les membres des assembles dlibrantes ne sont pas des agents du gouvernement . (V. p. 90.) Pour les actes des conseillers municipaux, il existe en outre un recours devant le prfet aux termes de l'art. 60 de la loi du 14 dcembre 1789. Le prfet peut censurer la dlibration diffamatoire, prescrire une runion du conseil municipal o la censure sera lue, la faire inscrire en marge de la dlibration censure. Inviolabilit des reprsentants. 136. Protection parlementaire Les membres des assembles dlibrantes sont protgs dans l'exercice de leurs fonctions contre les outrages et les actes de violence, par les art. 224 230 du Code pnal ; contre la diffamation et l'injure par les art. 31 et 33 de la loi du 19 juillet 1881. Les membres des assembles lgislatives sont protgs en outre par le principe qui porte le nom d'inviolabilit parlementaire. 1 Aucun membre de l'une ou l'autre des deux Chambres ne peut tre poursuivi ou arrt, qu'avec l'autorisation de la Chambre dont il fait partie, lorsque les conditions suivantes sont runies: a) on se trouve pendant la dure d'une session ; b) il s'agit d'une poursuite criminelle ou correctionnelle; c) il n'y a pas eu flagrant dlit. (L. c. 16 juillet 1875, art. 14, 1er.) 2 Si la poursuite a t commence avant la session, si mme le reprsentant est dj incarcr prventivement, la dtention ou la poursuite est suspendue pendant la session si la Chambre le requiert. (L. 16 juillet 1875, art. 14, 2.) SECTION II. DU MANDAT DE FONCTION PUBLIQUE La fonction publique est De la fonction publique. l'exercice le pouvoir de participer l'administration, c'est--dire des droits des personnes administratives, sans droit de dcision. La fonction publique a pour objet la prparation ou l'excution des dcisions, elle contient un pouvoir trs limit confi aux agents auxiliaires ou fonctionnaires. (V. plus haut, p. 221 et 235.) La fonction publique doit tre tudie au point de vue du pouvoir qu'elle renferme et au point de vue des avantages personnels qu'elle confre au fonctionnaire. Il faut s'attacher a) De la fonction publique comme pouvoir. cette ide qu'au point de vue du droit, tout le pouvoir contenu dans une fonction publique est cens venir de l'tat, et que le fonctionnaire n'exerce ce pouvoir qu'en vertu d'un mandat. Au point de vue des sciences sociales, la conception est diffrente : il y a dans la fonction publique l'apparition d'une force naturelle, une 136
THORIEDE LA FONCTION PUBLIQUE
271
manifestation de la vie; une fonction publique dtermine est un organe particulier du grand organisme social. Mais nous avons dit une fois pour toutes dans notre thorie de l'tat, que, plac en prsence de la conception juridique et de la conception naturaliste des choses, vraies toutes les deux et cependant inconciliables, nous choisissions la conception juridique (V. p. 1-4). Or, au point de vue du droit, tout le pouvoir politique exerc dans l'tat est cens exerc au nom de l'tat, et c'est une des erreurs de Rousseau d'avoir cru que les actes de magistrature, c'est--dire justement les actes accomplis par les autorits administratives ou par les fonctionnaires, ne pouvaient pas tre considrs comme accomplis au nom de l'tat. (V. p. 11.) Certes, dans l'action rgulatrice que la Banque de France exerce sur le crdit, il ya un pouvoir naturel et qui n'est point cr par l'tat; mais si la Banque de France devenait banque d'tat, le droit serait oblig de conclure que le pouvoir contenu dans sa fonction rgulatrice lui est dlgu par l'tat. b) De la fonction publique au point de vue des avantages personnels qu'elle confre au fonctionnaire. La division du travail amne avec le temps une grande distinction des fonctions, de mme qu'elle amne une distinction des services. L'un est la consquence de l'autre, car les services publics sont accomplis grce aux fonctions publiques. Il rsulte de l, qu'une fonction dtermine devient une sorte de chose ayant une existence en soi, indpendante du fonctionnaire. Le fonctionnaire passe, la fonction demeure. Il faut, pour cela qu'elle prsente un certain caractre de permanence. Les fonctions transitoires, phmres, prennent le nom de les missions temporaires, d'emplois auxiliaires, et gnralement rgles des vritables fonctions publiques ne s'y appliquent pas. Par exemple, le mandat de dput est incompatible avec une fonction publique rtribue sur les fonds de l'tat, mais il n'est pas incompatible avec une mission temporaire. Ds qu'une fonction est distincte et permanente, peu importe le nom qu'on lui donne, qu'on l'appelle fonction ou emploi ; peu importe qu'elle absorbe compltement l'activit du fonctionnaire, ou qu'elle puisse tre cumule avec l'exercice d'une profession libre; peu importe qu'elle soit gratuite ou rtribue; qu'elle soit rtribue par un traitement ou par des remises sur le produit de certaines oprations; c'est une fonction publique. Un dbitant de tabacs, par exemple, rtribu par une remise sur la vente, et qui peut en mme temps exercer une profession libre, est un fonctionnaire ; un oficier ministriel, qui peroit directement du client des honoraires, est un fonctionnaire, etc.
272
RGLESCOMMUNES D'ORGANISATION
La tendance constante du fonctionnaire est de chercher faire de sa fonction un objet de proprit prive, transmissible hrditairement. Le droit combat cette tendance en considrant la fonction publique distincte et permanente, qui est devenue une chose en soi, comme une dpendance du domaine public, inalinable et imprescriptible. Le fonctionnaire est vis--vis d'elle dans la situation d'un concessionnaire qui n'a qu'une possession prcaire. Dans certains cas seulement, quelques-uns des avantages personnels que la fonction entraine pour lui sont dtachs de l'emploi proprement dit et deviennent l'objet soit d'une possession plus forte, soit d'un vritable droit de proprit. C'est ainsi que l'officier ministriel, le notaire ou l'avou, a un droit de proprit sur la finance de son office; c'est ainsi que l'officier a la proprit de son grade, le magistrat inamovible la proprit de son sige, le professeur de l'enseignement suprieur la proprit de sa chaire. (V. infr, n 302.) La 138. De la collation de la fonction publique. fonction publique est confre, non pas au nom du souverain, comme la puissance publique, mais au nom d'une personne administrative. On est fonctionnaire de l'tat, de la commune, etc., et le fonctionnaire de l'tat reprsente uniquement l'tat, le fonctionnaire de la commune reprsente uniquement la commune1. Le mandat est donc donn au nom d'une personne administrative, mais il peut l'tre de plusieurs faons : 1 c'est une autorit de la personne administrative que doit reprsenter le fonctionnaire qui nomme le fonctionnaire, par exemple le chef de l'tat nomme un fonctionnaire de l'tat, le maire nomme un fonctionnaire de la commune; 2 c'est une autorit d'une personne administrative suprieure qui nomme le fonctionnaire d'une personne administrative infrieure; par exemple, le prfet, autorit reprsentant l'tat, nomme certains fonctionnaires de la commune et des tablissements publics. Le mandat est rvoqu par des procds analogues. Tous aux fonctions 139. De l'aptitude publiques. 1. On doit voir l la diffrenceessentielle entre la fonction publique et le mandat de puissance publique, entre le fonctionnaire et l'autorit administrative. Il s'ensuit que toutes les autorits administratives,si la dcentralisationtait pousse dans ses dernires consquences,pourraient tre nommes l'lection, mais quejamais tre nomms l'lection. les vritablesfonctionnaires ne pouront Par suite, il faut refuser la qualit de fonctionnaire certains personnages lus, tels que les juges consulaires,les membres des conseilsde prud'hommes qui sont des autorits judiciaires, les dlgus mineurs institus par la loi du 8 juillet 1890,qui sont simplement des reprsentants des ouvriers mineurs.
DE LA FONCTION THORIE PUBLIQUE
273
les citoyens sont admissibles aux places et aux emplois. (C. 3-14 sept. 1791.) C'est un vritable droit individuel. En principe, ce droit est rserv aux citoyens, c'est--dire aux Franais mles, par consquent, les femmes et les trangers sont exclus; mais on tend se dpartir ) de cette rgle pour les femmes. Il y a dj beaucoup d'emplois et de fonctions qu'elles peuvent remplir; il existe, par exemple, des inspectrices des prisons, des inspectrices de l'enseignement primaire, des directrices de bureaux de poste, des tlgraphistes et tlphonistes, etc. Des textes prvoient ces drogations. Il y a pour tous les citoyens droit gal l'admission sans gard la naissance ni au rang social ou la confession religieuse. Seulement ce principe ne peut recevoir que trs difficilement une sanction juridique, car un refus de nomination n'est pas un acte juridique que l'on puisse attaquer. Il peut tre impos des conditions aux candidats aux fonctions, pourvu qu'elles ne soient pas fondes justement sur des distinctions sociales. Il y a des limites d'ge1, des grades et des diplmes exigs, etc. du mandat de fonction 140. De l'exercice publique. Le mandat de fonction pu Responsabilit des fonctionnaires. blique est impratif. Il y a pour chaque fonction ou catgorie de fonctions des rgles administratives tablies par la loi, par des circulaires ministrielles ou par des traditions, qui constituent pour le fonctionnaire des instructions et dont il ne doit pas s'carter. S'il s'en carte, il peut encourir des punitions disciplinaires. De plus, il y a des crimes et dlits spciaux dont le fonctionnaire peut se rendre coupable dans l'exercice de ses fonctions. (Soustraction commise par les dpositaires publics, art. 169 et suiv. C.P.; concussion, art. 174 et suiv. C. P.; fait de s'ingrer dans des afffaires ou commerces incompatibles avec sa fonction, art. 175 et suiv. C. P., etc., etc.) La question intressante est celle de savoir si, dans le cas o la faute commise par le fonctionnaire a entran un dommage pour la personne administrative, ce fonctionnaire peut tre poursuivi par elle en rparation pcuniaire. Il faut distinguer entre les comptables et les ordonnateurs. Les comptables peuvent certainement tre poursuivis, soit sur leur cautionnement, soit sur leurs biens, et les personnes administratives ont mme une hypothque lgale sur leurs immeubles. Pour les ordonnateurs, au point de vue thorique, la responsabilit 1 La majorit de vingt-un ans n'est pas toujours ncessaire ; par exemple, pour les fonctionsd'employ des contributions indirectes. 18 H.
274
RGLESCOMMUNES D'ORGANISATION
n'est pas douteuse, mais en pratique elle n'est gure poursuivie. La question s'est pose surtout l'gard des ministres, qui sontles suprieurs hirarchiques des fonctionnaires de l'tal, et qui remontela responsabilit de la plupart des actes. (V. infr, n 174.) Caractres du mandat de fonction gnraux I. Ce mandat est essentiellement rvocable; on ne publique. peut pas admettre que l'tat n'ait pas le droit de retirer son emploi un mauvais serviteur. Lorsqu'il arrive, comme au dbut de l'poque fodale, que la fonction cesse d'tre rvocable ad nutum, c'est qu'il y a un commencement de dmembrement de l'tat. Mme les fonctionnaires qui ont un droit sur leur grade, comme les officiers, peuvent se voir retirer leur emploi; ce que l'on ne peut pas leur retirer, ce sont les avantages pcuniaires ou autres attachs leur grade; mme les fonctionnaires inamovibles peuvent tre rvoqus avec certaines garanties, mme les officiers ministriels peuvent tre destitus, etc. (V. infr, n 302.) II. Ce mandat entrane certaines immunits : 141. 1 Les fonctionnaires sont protgs contre les poursuites intentes par les particuliers raison d'actes accomplis dans leur fonction, toutes les fois qu'ils n'ont pas commis de faute lourde. En effet, si le fonctionnaire est poursuivi devant un tribunaljudiciaire, le prfet lvera le conflit, le conflit sera maintenu, le tribunal judiciaire sera dessaisi, et aucun tribunal administratif ne pourra tre utilement saisi. (V. p. 89 ) 2 Les fonctionnaires sont protgs dans l'exercice de leur fonction contre l'outrage, la violence et la diffamation, par les art. 222 et suiv. C. P., et par l'art. 31, 1. 29juillet 1881. 3 Ils sont dispenss de certaines charges, par exemple de la tutelle, art. 427 et 428 C. civ.; du service militaire en certains cas. (V. L. 15 juillet 1889.) 4 Quelques-uns d'entre eux jouissent de privilges de juridiction. (Art. 479 et suiv. C. Instr. cr.; L. 20 avril 1810, art. 10.) 5 Leurs traitements sont insaisissables en tout ou en partie. (Arr. 18 niv. an XI; 15 germinal an XII; 1. 21 ventse an IX.) III. Ce mandat est gratuit ou salari. Observation. Pour tout ce qui a rapport la situation personnelle des fonctionnaires, les garanties contre la rvocation, les traitements, les pensions. (V. infr, police des fonctionnaires, n 301 et s.)
CHAPITRE ORGANISATION
PREMIER DE L'TAT
Ire. ORGANE SECTION EXCUTIF Il y a lieu de distinguer, dans l'organe excutif de l'tat, une organisation centrale et une organisation rgionale, que l'on appelle plutt pouvoir central et pouvoir rgional. Dans chacune de ces organisations, nous trouverons des autorits administratives et des fonctionnaires. CENTRAL 1er. POUVOIR Article Ier. Autorits administratives1. N 1. Le prsident de la Rpublique. Il y a un pr142. I. Organisation de la prsidence. sident dela Rpublique. Il n'y a pas de vice-prsident. On a considr que les intrigues possibles d'un vice-prsident constitueraient un danger. D'un autre ct, le congrs qui nomme le prsident tant facile runir, une vacance subite par suite de dcs n'aurait pas de graves inconvnients. D'ailleurs, en cas de vacance de la prsidence, dans l'intervalle, le conseil des ministres est provisoirement investi du pouvoir excutif. (L. const. 25 fvr. 1875, art. 7.) lection du prsident de la Rpublique. Le prsident de la Rpublique est lu par les deux Chambres runies en Assemble nationale. (L. const. 25 fvr. 1875, art. 2, 1.) L'Assemble se tient Versailles. (L. 22juill. 1879, art. 3.) Quant au moment o l'lection doit avoir lieu, l'art. 3, 1. const. 16 juill. 1875, la fixe en distinguant deux hypothses, le cas de terme lgal de pouvoirs et le cas de dcs ou de dmission: 1. Ces autoritsadministratives mritent aussi le nom d'autorits gouvernementales, parce que, ct des actes d'administration, ellesfont desactes de gouvernement.
276
ORGANISATION DE L'TAT
1 Un mois au moins avant le terme lgal des pouvoirs du prsident de la Rpublique, les Chambres devront tre runies en Assemble nationale pour procder l'lection du nouveau prsident. A dfaut de convocation, cette runion aura lieu de plein droit le quinzimejour avant l'expiration de ses pouvoirs. 2 En casde dcs ou de dmission du prsident de la Rpublique, les deux Chambres se runissent immdiatement et de plein droit. Dans le cas o, pour application de l'art. 5 de la loi du 25 fvr. 1875, la Chambre des dputs se trouverait dissoute au moment o la prsidence de la Rpublique deviendrait vacante, les collges lectoraux seraient aussitt convoqus et le Snat se runirait de plein droit. Tout citoyen est ligible l'exception des membres des familles ayant rgn sur la France. (L.14 aot 1884.) Dure du mandat du prsident de la Rpublique. Le prsident. de la Rpublique est nomm pour sept ans. Il est rligible. (L. c. 25 fvr. 1875, art. 2, 2.) Cette priode est personnelle chaque prsident, c'est--dire qu'il l'accomplit, alors mme que son prdcesseur ne serait pas all jusqu'au bout de la sienne par suite de dcs ou de dmission. Indemnit du prsident de la Rpublique. Le prsident de la Rpublique reoit une indemnit de six cent mille francs par an. L'lyse national est affect son logement. Il y a une responsabilit pnale du Responsabilit du prsident. prsident limite au cas de haute trahison. Dans ce cas unique, la Chambre des dputs accuse, le Snat juge. Il n'y a ni responsabilit civile, ni responsabilit politique. L'irresponsabilit politique du prsident sera tudie propos de la responsabilit ministrielle. 143. II. Attributions du prsident de la Rpublique. A. Attributions d'ordre lgislatif et judiciaire. Les attributions du chef de l'tat ne sont pas toutes d'ordre excutif, il en est qui le font participer au pouvoir lgislatif et au pouvoir judiciaire. a) Dans la lgislation, le chef de l'tat intervient: 1 par le droit d'initiative qu'il a concurremment avec les deux Chambres (l. const. 25 fvr. 1875, art. 3, 1); 2 par le droit de prendre part la discussion de la loi ; le chef de l'tat n'intervient pas en personne dans les dbats, mais il intervient par l'intermdiaire d'un ministre ou d'un commissaire du gouvernement nomm cet effet, ou par un message lu la tribune (1. c. 16 juill. 1875, art. 6); 3 par le drcit de demander une nouvelle dlibration en vue de retarder le vote d'une loi et de provoquer les Chambres rflchir; la demande doit tre faite dans le dlai fix pourla promulgation par message motiv
LE CHEF DE L'TAT
277
; 4 par la promulgation des lois (1. const. 16 juill. 1875, art. 7, 2) (V. plus haut, p. 66) ; 5 par les rglements d'administration publique qu'il fait par dlgation du pouvoir lgislatif. b) Dans l'ordre de la justice, le chef de l'tat intervient de deux faons : 1 pour rendre lui-mme avec un pouvoir propre certaines dcisions qui sont en forme contentieuse. On verra, en tudiant le contentieux (n 576), cette catgorie de dcisions qui rappellent la fictionde la justice retenue, par exemple : dcrets comme d'abus, dcisions sur les prises maritimes, certains dcrets d'annulation, etc. On peut rattacher cela des attributions qui sont de juridiction gracieuse, par exemple : le dcret accordant des lettres de naturalisation, le dcret accordant un changemeut de nom. On peut aussi y rattacher le droit de grce. (L. const. 25 fvrier 1875, art 3, 2.) 2 Pour participer l'exercice de la justice dlgue. En effet il nomme les juges, il fait excuter leurs jugements, il entretient auprs de toutes les juridictions un ministre public. Il y a lieu de 144. B. Attributions d'ordre excutif. mettre part quelques-unes de ces attributions qui ont une importance constitutionnelle. a) Attributions constitutionnelles. Deux principales : 1 Nomination des ministres. Le chef de l'tat nomme les ministres (l. 31 aot, 3 septembre 1791) et il peut de mme les rvoquer. Thoriquement il les choisit o il veut, mme en dehors du Parlement. Mais les traditions du rgime parlementaire, les rgles sur l'entre des ministres dans la salle des dlibrations des Chambres, le fait que les ministres sont responsables devant la majorit des Chambres et doivent se retirer devant un vote de blme, le forcent dans la pratique les prendre dans la majorit parlementaire. En fait, le chef de l'tat ne choisit personnellement que le prsident du Conseil, celui-ci choisit les autres ministres sauf agrment du chef de l'tat. 2 Droits du prsident de la Rpublique vis--vis des Chambres. Le prsident de la Rpublique convoque les Chambres et prononce la clture de leurs sesssions;il peut les ajourner; toutefois l'ajournement ne peut excder le terme d'un mois, ni avoir lieu plus de deux fois dans la mme session (1. c. 16 juill. art. 2, 2) ; il peut, sur l'avis conforme du Snat, dissoudre la Chambre des dputs avant l'expiration lgale de son mandat ; en ce cas, les collges lectoraux sont runis pour de nouvelles lections dans le dlai de deux mois et la Cham-
278
ORGANISATION DE L'TAT
bre dans les dix jours qui suivrontla clture des oprations lectorales. (Art. 5, 2, l. c. 25 fvr. 1875 modifie 1. c. 14 aot 1884.) b) Attributions gouvernementales et administratives. Le chef de l'tat, en sa qualit de chef du pouvoir excutif, est charg: I. De reprsenter l'tat dansles crmonies etsolennits publiques, tant au point de vue international qu'au point de vue national. Cette reprsentation est surtout importante au point de vue international, dans les relations entretenues au moyen des agents diplomatiques. C'est auprs de lui que sont accrdits les agents diplomatiques trangers et c'est en son nom que les agents diplomatiques franais sont envoys auprs des puissances trangres. II. D'exercer certains droits de l'tat par ses actes. Au point de vue international, le chef|de l'tat n'exerce pas le droit de dclarer la guerre, cela est rserv aux Chambres (1. const. 16 juillet 1875, art. 9), mais il a la direction.de la guerre si elle est dclare. Il a en principe le droit de conclure les traits, sauf en donner connaissance aux Chambres. Il est vrai qu' ce droit de conclure seul les traits, il y a des exceptions considrables: les traits de paix, de commerce, les traits qui engagent les finances de l'tat, ceux qui sont relatifs l'tat des personnes et aux droits de proprit des Franais l'tranger, ne sont dfinitifs qu'aprs avoir t vots par les deux Chambres. Nulle cession, nul change, nulle adjonction de territoire ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une loi. (L. const. 16 juillet 1875, art. 8.) Au point de vue de l'administration le chef intrieure, de l'tat exerce les droits suivants : 1 Desdroits de puissance publique. Il dispose de la force arme ou force publique (1. 25 fvrier 1875, art. 3, 3) pour assurer le maintien de l'ordre et l'excution des lois. Il exerce la police sur les autorits administratives infrieures de l'tat et sur les hauts fonctionnaires de l'tat, ce qui entrane la nomination et la rvocation. Il exerce certains droits de tutelle sur les personnes administratives autres que l'tat, ce qui entrane la nomination de certaines autorits, comme celle du prfet, autorit administrative du dpartement ; le droit de rvocation ou de dissolution de certaines autres autorits, rvocation du maire, dissolution du le droit d'annuler certains conseil gnral, du conseil municipal ; actes d'administration, suspension par dcret de certaines dcisions du conseil gnral; le droit d'en approuver d'autres, etc., etc., il exerce certains droits de police sur les individus. Cette police s'exerce par des mesures gnrales en vertu du pouvoir rglementaire dansdes rglements (v. plus haut p. 61) ou bien par des mesures individuelles.
LE CHEFDE L'TAT
279
Le chef de l'tat fait certains actes d'autorit intressant le domaine public de l'tat: dcrets de dlimitation du rivage de la mer, dcrets dclarant l'utilit publique d'un travail, etc. 2 Droits de personne prive. Certaines ventes des biens de l'tat, certaines concessions sur le domaine priv, sont, faites par dcret. 145. III. Nature voies et forme des actes, les dcrets, Les actes du chef de l'tat sont en principe des de recours. actes d'autorit, il fait peu d'actes de gestion, les actes de gestion intressant l'tat sont accomplis en gnral par les ministres ou les prfets. Cependant, il faut signaler les dcrets autorisant des ventes ou des concessions sur le domaine priv; les dcrets concdant des pensions des fonctionnaires, etc. A l'exception des messages, ils portent tous le nom de dcrets. Le dcret est un acte crit, qui comporte des considrants avec visa des textes, un dispositif gnralement par articles, la date et la signature du chef de l'tat toujours accompagne du contreseing d'un ministre. Le chef de l'tat, ne peut pas dlguer sa signature. Le dcret est insr au Journal officiel ou au Bulletin des Lois. Les dcrets se divisent en : dcrets rglementaires, qui contiennent des rglements, et en dcrets individuels. (Pour les dcrets rglementaires, voir plus haut, p: 61.) Les dcrets individuels sont rendus dans l'une des formes suivantes : 1 sur le rapport d'un ministre ; 2 en conseil des ministres; 3 en Conseil d'tat, alors ils s'appellent dcrets en forme de rglements d'administration publique. Voies de recours. On recourt contre les dcrets du chef de l'tat : 1 Par voie gracieuse au chef de l'tat lui-mme; 2 Par voie contentieuse: a) par recours pour excs de pouvoir contre tous dcrets, excepts ceux qui sont gouvernementaux, s'il ya une ouverture; b) par recours contentieux ordinaire devant le Conseil d'tat contre tous les dcrets dont il rsulte des droits acquis ; c) par un recours spcial en vertu de l'art. 40, D. 22 juillet 1806, contre les dcrets rendus en Conseil d'tat. Ces dcrets peuvent dj tre attaquspar le recours pour excs de pouvoir, mais le recours spcial a ceci de plus avantageux qu'il permet la rformation de l'acte. Ce recours n'est pas considr par tout le monde comme contentieux. (V. infr, contentieux, n 576.) N 2. Les ministres, les sous-secrtaires ministres. 146. Les ministres le conseil des
d'tat,
ont plusieurs attributions juridiques,
ainsi
280
ORGANISATION DE L'TAT
qu'on le verra plus loin. Au point de vue politique, ce sontles maires du Palais, c'est--dire que, adjoints au chef de l'tat, et thoriquement subordonns, en fait ils ont le pouvoir effectif. Le pouvoir effectif des ministres, combin avec leur responsabilit devant le Parlement et avec l'irresponsabilit du chef de l'tat, constitue le rgime parlementaire. Historiquement, les ministres procdent des conseillers du roi. Ce sont des conseillers imposs au chef de l'tat par la nation, et qui, par suite de cette origine, sont devenus les matres. Lorsque sous les rgimes de pouvoir personnel, les ministres sont choisis librement par le chef de l'tat, ils ne sont plus que des commis et mritent le nom de sous-secrtaires d'tat. Sous l'ancien rgime, il n'y avait que des sous-secrtaires d'tat. Ministres. On admet que 147.1. Rgles d'organisation. le nombre des ministres est rgl par dcret du chef de l'tat, sauf le contrle du Parlement qui peut s'exercer par voie budgtaire. En fait, le nombre en a souvent vari. Il n'avait t cr que six ministres par la Constituante: justice, intrieur, finances, guerre, marine, affaires trangres; il y en a maintenant dix, parceque du ministre de l'intrieur se sont dtachs le commerce, l'agriculture, les travaux publics, l'instruction publique. De plus, il peut y avoir des ministres sans portefeuille. Les ministres sont nomms par le chef de l'tat; ils peuvent tre rvoqus par lui, quoique, dans la pratique, il n'use pas de ce droit; ils donnent leur dmission, laquelle a besoin d'tre accepte; cette dmission peut tre individuelle ou collective. Ils touchent un traitement fixe de 60,000 francs, sans retenues (l.16 juin 1871, art. 26); ils sont logs et meubls aux frais de l'tat. (L. 10 vendmiaire an IV, art. 17.) Les sous-secrtaires d'tat sont adjoints Sous-secrtaires d'tat. aux ministres. Leur nombre n'est pas fix. Leur traitement n'est pas tabli par la loi; les lois de finances leur accordent 25,000 francs. Conseil des ministres. Les ministres forment un conseil o se font rgulirement des changes de vues sur les affaires politiques et les affaires administratives. Le conseil des ministres est, avant tout, un corps politique ; ce n'est pas une vritable assemble dlibrante, ni une autorit administrative, en ce sens qu'il ne prend pas en son propre nom des dcisions excutoires; mais certains dcrets du chef de l'tat doivent tre, de par la loi, dlibrs en Conseil des ministres
LES MINISTRES
281
et en porter la mention. Exceptionnellement, en cas de vacance de la prsidence, le conseil des ministres deviendrait une autorit administrative et rendrait de vritables dcrets (l. const. 25 fvrier 1875, art. 7). L'existence officielle du conseil des ministres a toujours t reconnue depuis la loi du 25 mai 1791 qui l'avait substitu l'ancien Conseil d'tat, sauf certaines poques de pouvoir personnel. C'est ainsi que depuis la Constitution de l'an III jusqu'en 1814, les ministres ont cess de former un conseil pour tre considrs comme des agents d'excution chacun dans son dpartement; il en a t de mme sous la Constitution de 1852 et jusqu'au snatus-consulte de 1869. En d'autres termes, sous les rgimes o les ministres ne sont considrs que comme des commis, il n'y a pas de conseil des ministres. Le conseil des ministres peut tre prsid soit par le chet de l'tat soit par le prsident du conseil qui est le ministre auquel le chef de l'tat a confi le soin de former le cabinet. Dans le premier cas on dit qu'il y a runion du conseil des ministres, dans le second qu'il y a conseil de cabinet. En principe, les sous-secrtaires d'tat n'ont pas entre au conseil. Responsabilit ministrielle. On appelle de ce nom la responsabilit politique que les ministres encourent raison de leurs actes. Cette responsabilit consiste en ce que un vote de blme de l'une des deux Chambres, surtout de la Chambre des dputs, peut les contraindre donner leur dmission. Lorsque l'acte est l'uvre d'un ministre isol, la responsabilit est individuelle; elle est collective, lorsque l'acte est l'uvre du cabinet tuut entier. Cette responsabilit des ministres, jointe l'irresponsabilit du chef de l'tat, est l'institution essentielle du rgime parlementaire. Il s'agissait de donner la haute main au Parlement dans la direction des affaires, d'tablir sa suprmatie sur le pouvoir excutif, sans toutefois affaiblir par trop ni dconsidrer celui-ci. Le rsultat est obtenu. En effet, le chef de l'tat, en qui est incarne la majest du pouvoir excutif, en luimme est inattaquable. Mais les ministres, en qui rside le pouvoir effectif, sont sous la dpendance du Parlement. Or, la responsabilit des ministres est engage pour le moindre acte du pouvoir excutif, grce la rgle qui veut que chacun des actes du prsident de la Rpublique soit contresign par un ministre. (L. 24 fvrier, art. 3, 6.) Les ministres peuvent tre mis en criminelle. Responsabilit accusation par la Chambre et jugs par le Snat en cas de crimes commis dans l'exercice de leurs fonctions. (L. const. 16 juillet 1875, art. 12, 2.) Responsabilit civile. En dehors de la responsabilit criminelle, les ministres n'ont-ils pas une responsabilit civile vis--vis de l'tat
282
ORGANISATION DE L'TAT
lorsque, par leurs actes, ils ont caus celuici un prjudice pcuniaire? Le principe de la responsabilit civile est pos, au moins dans le cas o le ministre a engag des dpenses en dehors des crdits ouverts par le budget, et s'il n'a pas t appliqu cela tient des difficults de procdure. Les lois de la Rvolution avaient dj vaguement parl de la responsabilit civile des ministres. La charte de 1814 avait, t plus explicite (art. 55 et 56). Elle avait rendu les ministres responsables des faits de concussion; la loi de finances de 1817, art. 91, en tira cette conclusion, que le ministre ne pouvait dpasser les crdits; la loi du 18 mai 1850, le dcret du 31 mai 1862, ont insist sur cette ide, mais la difficult est de trouver une juridiction. Les assembles politiques ne semblent comptentes que dans le cas de cause du principe de la sparation crimes; les tribunauxcivils, des pouvoirs, ne peuvent pas connatre des actes administratifs et il y en aurait forcment apprcier. Restent seulement le Conseil d'tat et la Cour des comptes. La Cour des comptes a juridiction sur les comptables et non pas sur les ordonnateurs. Quant au Conseil d'tat, il ne juge que les actes d'administration, non pas les administrateurs. En prsence de cette difficult, l'Assemble constituante de 1848 avait insr dans la Constitution un article 98 ainsi conu : Dans tous les cas de responsabilit des ministres, l'Assemble nationale peut, selon les circonstances, renvoyer le ministre inculp, soit devant la haute-cour de justice, soit devant les tribunaux ordinaires, pour la rparation civile. Dans la pense des rdacteurs de cet article, l'intervention pralable dela Chambre rpondait l'obj ection tire dela sparation des pouvoirs, puisque c'tait la Chambre elle-mme, corps administratif, qui chargeait le tribunal civil d'aprcier le dommage. On pourrait peut-tre soutenir que cette disposition dela Constitution de 1848 n'est pas abroge. Les ministres ont une triple quatit, 148. III. Attributions. ils sont la fois : 1 autorits administratives en tant qu'ils ont un pouvoir de dcision; 2 fonctionnaires en tant qu'ils excutent des dcisions prises par le chef de l'tat, avec le contreseing d'un de leurs collgues; 3 juges dans des cas exceptionnels. En tant que fonctionnaires, leurs attributions ne mritent pas qu'on s'y arrte ici, la seule chose intressante est la qualit mme que cela leur donne. Les ministres sont les premiers des fonctionnaires, ils font partie dela hirarchie, ils en forment le sommet.
LES MINISTRES
283
En tant que juges, nous les tudierons au contentieux (nos 573, 590). En tant qu'autorits administratives, les ministres ont des attributions considrables, le contreseing et des pouvoirs propres. A. Le contreseing. Le contreseing, que les ministres apposent sur les actes du chef de l'tat, les fait participer ces actes. Il a une double utilit: 1 il engage la responsabilit du ministre qui les signe ; 2 il certifie la signature du chef de l'tat et, en mme temps, il certifie que l'acte est conforme aux rgles d'administration du service affrent. A raison de cette seconde utilit, le contreseing a t maintenu sous des rgimes qui n'avaient rien de parlementaire, par exemple, sous le rgime de 1852. B. Les pouvoirs propres. Les ministres exercent les droits de l'tat avec un pouvoir propre de dcision dans les cas suivants: a) Droits de puissance publique. 1 Police des autorits administratives et des fonctionnaires de l'tat. Les ministres ont un droit de contrle sur les actes des prfets considrs comme autorits administratives rgionales de l'tat. En vertu de ce droit, tantt ils ont approuver formellement certains actes, tantt ils sont appels les annuler ou les rformer aprs coup. (V. dcrets de dconcentration, 25 mars 1852 et 13 avril 1861, art. 6.) Ils ont un droit analogue sur les actes des gouverneurs des colonies. Les ministres ont la nomimation et la rvocation de beaucoup de fonctionnaires; quelquefois ils ont la rvocation sans avoir la nomination. Ils ont la prsentation des fonctionnaires de leur dpartement nomms par le chef de l'tat. Dans l'arme, cette opration trs importante et trs rglemente prend le nom de classement. Ils ont un pouvoir disciplinaire. Ils sont les suprieurs hirarchiques de tous les fonctionnaires de leur dpartement; ce titre, ils reoivent leurs rapports et stimulent leur activit, leur donnent l'impulsion, le tout au moyen de ce qu'on appelle la correspondance. Les ministres envoient leurs subordonns des instructions qui prennent le nom de circulaires quand elles sont adresses toute une classe de fonctionnaires. Ces instructions, obligatoires pour les fonctionnaires, n'ont qu'une autorit doctrinale vis -vis des citoyens et des tribunaux. 2 Tutelle des personnes administratives infrieures. Le ministre tant le suprieur hirarchique du prfet, et le prfet ayant des droits de tutelle importants, soit sur le conseil gnral du dpartement, soit sur les autorits communales, il se trouve qu'indirectement et part ses instructions, le ministre a une part d'action trs grande dans la tutelle dpartementale ou commune. Aussi y a-t-il au ministre de l'intrieur une direction desaffaires dpartementales et communales.
284
DE L'TAT ORGANISATION
Le ministre de l'intrieur peut porter trois mois le temps de suspension des maires et adjoints, lorsqu'ils ont t suspendus par arrt du prfet (art. 86, l. 5 av. 1884). Le ministre a aussi la nomination et la rvocation de quelques fonctionnaires dpartementaux ou communaux. 3 Police des individus. Les ministres n'ont pas, en principe, le pouvoir rglementaire (V. Sources du Droit, p. 62), ils n'ont pas non plus la rquisition de la force arme, mais ils prennent quelques dcisions particulires opposables aux individus, exemple : autorisation d'agences d'migration. (L. 18juill. 1860.) En somme, au point de vue des droits de police, les ministres prennent par eux-mmes peu de dcisions. Leur rle est surtout de prparer les dcisions du chef de l'tat et de contrler celles des prfets. 4 Droits domaniaux de puissance publique. Au contraire, dans l'exercice des droits domaniaux de puissance publique, les ministres ont des attributions importantes. Ils sont, ce point de vue, les principaux reprsentants de l'tat, sauf en ce qui concerne le domaine public, auquel cas ce sont surtout les prfets. Les ministres sont les reprsentants lgaux de l'tat dans les contrats administratifs. Ils passent les marchs ou les traits avec les particuliers pour assurer les divers services compris dans leur dpartement. Ils font les liquidations et les rglements de compte qui terminent ces marchs. Ils ordonnancent les dpenses que l'tat doit faire pour la marche des services. Ils plaident au nom de l'tat, devant le Conseil d'tat seulement, chacun pour les affaires de son dpartement. b) Droits de personne prive. Les actes intressant le domaine privdel'tat sont passspar les prfets, mais l'administration dece domaine est dirige par une direction du ministre des finances, celle de l'enregistrement et des domaines. Observation. Les attributions des sous-secrtaires d'tat sont fixes par le dcret qui les institue. Il ne semble pas, cependant, que l'on puisse leur confrer le contreseing sans en faire de vritables ministres. Et, d'autre part, s'ils n'ont pas le contreseing, il n'y a pas pour eux de vritable responsabilit. Mais on leur dlgue la correspondance, et le droit de dcision dans les cas o le ministre peut dcider seul ; par consquent ce sont des autorits administratives. forme des actes, voies de recours. 149. III. Nature, Les ministres, considrs comme autorits administratives, font
D'TAT LE CONSEIL
285
des actes d'administration, tantt des actes d'autorit, tantt des actes de gestion. Ces actes affectent tantt la forme d'arrts, tantt celle de dcisions. Les dcisions sont de simples lettres missives. Les arrts comportent le visa des textes, des considrants, un dispositif par articles, la date et la signature. Les cas dans lesquels le ministre doit statuer par arrt ne semblent pas bien dfinis. Quelques auteurs disent que l'arrt seul est opposable un particulier. Ce n'est pas le sentiment de la jurisprudence, qui admet le recours contentieux aussi bien contre les simples dcisions que contre les arrts. Les recours contre les actes des ministres sont les suivants: 1 le recours gracieux au ministre lui-mme; 2 par la voie contentieuse, le recours contentieux ordinaire contre les actes ayant confr des droits acquis, le recours pour excs de pouvoir contre les actes n'en ayant point confr.
Article II. Fonctionnaires N 1. Conseils administratifs.
du pouvoir central. Le Conseil d'tat.
150. Le Conseil d'tat est le conseil administratif du chef del'tat. Il se distingue par l d'une foule d'autres conseils administratifs qui sont uniquement les conseils des ministres. (Conseil suprieur de la guerre, dela marine, des colonies, du travail, etc., etc.) Le Conseil d'tat est une institution ncessaire et d'ordre universel. Partout o il existe un tat et un chef de l'tat, il y a, sous une forme ou sous une autre, un Conseil d'tat, parce que partout le chef de l'tat a besoin de s'entourer d'avis. Notre Conseil d'tat actuel remonte visiblement celui des dernires annes de l'ancien rgime, et de l, sous des noms divers, au Conseil d'tat de l'empire romain. A toutes les poques, le Conseil d'tat prsente un caractre singulier, toujours le mme, qui est d'tre d'une trs grande plasticit: 1 le Conseil d'tat a eu toujours des attributions multiples; actuellement il est la fois conseil administratif et tribunal administratif. A la fin de l'ancien rgime, il tait tout cela et en plus il jouait le rle de conseil des ministres. Au XIIIesicle, il tait toute l'administration, et aussi toute la juridiction, puisque de son sein sont sortis la Cour des 2 le Conseil d'tat a toujours de Paris, etc.; comptes et le Parlement eu un personnel un peu flottant. Sous l'ancien rgime, il y a eu pendant longtemps un Conseil d'tat sans qu'il y et de conseillers attitrs ;
286
ORGANISATION DE L'TAT
et plus tard, outre les conseillers rguliers, il y a eu des personnages qui venaient siger extraordinairement. A l'inverse, les membres du Conseil d'tat taient dlgus dans des fonctions d'administration active. Les matres des requtes taient frquemment commissaires dpartis ou intendants. A l'heure actuelle la fixit dans le personnel tend s'tablir. Cependant il y a encore des conseillers en service extraordinaire, des personnages qui ont entre sans tre conseillers, et, en sens inverse, des conseillers en service ordinaire sont dtachs en mission ; 3 le Conseil d'tat fonctionne sous ce que nous appellerons les formations les plus diverses, tantt en sections, tantt en assemble gnrale, tantt en assemble dlibrant au contentieux, etc. Cette plasticit du Conseil d'tat est une ncessit de etc., gouvernement, elle rpond ce qu'il y a de vari, d'imprvu, de complexe dans l'administration quotidienne. Le Conseil d'tat, envisag comme conseil administratif, est un instrument indispensable au pouvoir excutif et il doit tre absolument dans sa main. Aussi faut-il considrer comme un vritable contresens constitutionnel les tentatives faites en 1848 et en 1872 pour donner au Parlement la nomination des conseillers d'tat. Le Conseil d'tat de l'ancien rgime avait t supprim pendant la Rvolution. Le Conseil d'tat moderne date de la Constitution du 12 frimaire an VIII, art. 52. Nous verrons dans la partie du contentieux quel fut son rle comme juridiction. Comme conseil administratif, son importance a vari avec les rgimes, elle a toujours t plus grande sous les rgimes de pouvoir personnel que sous les rgimes parlementaires. D'abord, les rgimes de pouvoir personnel donnent tous leurs soins l'administration. De plus, le gouvernement ayant seul l'initiative des lois, fait prparer celles-ci par le Conseil d'tat. Il serait souhaiter que sous le rgime parlementaire, on suivt sur ce point les mmes errements. d'tat du Conseil 151.I. Organisation (1. 24 mai 1872; 1. 13 juillet 1879: D. R. 2 aot 1879; 1. 1er juillet 1887). A. Organisation gnrale du personnel. Il faut distinguer l'organisation gnrale du personnel, et l'organisation en vue du travail, ce que nous appellerons les formations du conseil. Il y a un personnel flottant et un personnel fixe. 1 les ministres qui ont rang a) Font partie du personnel flottant: et sance au conseil des titres divers, notamment le ministre de la justice, garde des sceaux, qui a le titre de prsident du Conseil d'tat, et qui peut prsider effectivement en matire administrative; 2 des personnes ayant des connaissances spciales que le gouvernement peut
D'TAT LE CONSEIL
287
appeler prendre part aux sances avec voix consultative (1. 1872, art. 14) ; 3 les conseillers, matres des requtes, et auditeurs de 1re classe, actuellement dlgus dans des fonctions publiques aux termes de l'art. 3, 1. 13 juillet 1879, et qui ont cependant entre au conseil. (R. 2 aot 1879, art. 3.) : 1 un vice-prsident nomm par b) Le personnel fixe comprend dcret et choisi parmi les conseillers en service ordinaire; 2 un secrtaire gnral plac la tte des bureaux du conseil, ayant rang et titre de matre des requtes;-un secrtaire spcial attach au contentieux; 3 trois espces de membres du conseil: des conseillers d'tat, des matres des requtes, des auditeurs. Il faut observer que cette division des membres du conseil en classes, qui est d'ailleurs trs ancienne, correspond une division du travail. On peut dire sommairement que les conseillers d'tat formulentles dlibrations, tandis que les matres des requtes et les auditeurs prparent les affaires. Il faut observer en outre qu'il n'y a pas dans ces trois classes un avancement hirarchique rgulier. Le chef de l'tat n'est pas tenu de prendre les conseillers d'tat parmi les matres des requtes; il n'est tenu de prendre les matres des requtes parmi les auditeurs de premire classe que jusqu' concurrence d'un tiers des places. On saisit l la proccupation de conserver une certaine mobilit, mme au personnel fixe du conseil. Il y a : 1 trente-deux conseillers en service ordinaire; dix-huit conseillers en service extraordinaire; 2 trente matres des requtes; 3 douze auditeurs de premire classe et vingt quatre de seconde classe1. On distingue les conseillers d'tat en serConseillers d'tat. vice ordinaire et les conseillers en service extraordinaire. Les premiers n'ont pas d'autre fonction que celle de conseillers d'tat. Les seconds au contraire sont de hauts fonctionnaires de l'administration active dtachs temporairement au Conseil d'tat. Les conseillers d'tat en service ordinaire sont nomms et rvoqus par dcret rendu en conseil des ministres. Ils doivent avoir trente ans accomplis. Aucune autre condition de capacit. Les conseillers d'tat en service extraordinaire sont nomms par dcret simple ; ils perdent leur titre de plein droit, ds qu'ils cessent d'appartenir l'administration active. (L. 1872, art. 5, 1.) Matres des requtes. Les matres des requtes, le secrtaire 1. Un projet de loi, qui sera probablement adopt, porte le nombre des matres des requtes trente-deux; celui des auditeurs de premire classe, quinze; celui des auditeurs de seconde classe, vingt-cinq.
288
ORGANISATION DE L'TAT
gnral et le secrtaire spcial du contentieux, sont nomms par dcret du prsident de la Rpublique sur prsentation du vice-prsident et des prsidents de section, ils ne peuvent tre rvoqus que par un dcret individuel aprs avis des prsidents (Art. 5, 2,3 et 4.) Age minimum, vingt-sept ans. Auditeurs. Les auditeurs de premireclasse seront choisis parmi les auditeurs de seconde classe, ou parmi les anciens auditeurs sortis du conseil qui comptent quatre annes d'exercice, soit de leurs fonctions, soit des fonctions publiques auxquelles ils auraient t appels. Ils seront nomms par dcret du prsident de la Rpublique. Le viceprsident et les prsidents de section seront appels faire des prsentations (1. 13 juillet 1879, art. 2). Ils ne doivent avoir ni moins de vingt-cinq ans, ni plus de trente-trois ans au 1er janvier de l'anne de leur nomination. (L. 1er juillet 1887.) La dure de leurs fonctions n'est pas limite. Le tiers au moins des places de matres des requtes sera rserve aux auditeurs de premire classe. (L. 1872, art. 5, 10 et 11.) Les auditeurs de deuxime classe seront nomms au concoursdans les formes et aux conditions qui seront dtermines dans un rglement que le Conseil d'tat sera charg de faire. Nul ne peut tre nomm s'il a moins de vingt-un ans et plus de vingt-cinq. Ils ne restent en fonctions que pendant huit ans (1. 1er juillet 1887). Chaque anne, le gouvernement fera connatre par une dcision prise en conseil des ministres et insre au Journal officiel, les fonctions qui seront mises la disposition des auditeurs de deuxime classe qui auront au moins quatre ans de service. Ces fonctions seraient les suivantes: commissaire du gouvernement prs le conseil de prfecture de la Seine; secrtaire gnral d'une prfecture de premire ou de deuxime classe; sous-prfet de premire ou de deuxime classe; substitut dans un tribunal de deuxime classe. Les auditeurs, tant de seconde que de premire classe, ne peuvent tre rvoqus que pardesdcrets individuelset aprsavoir pris l'avis du vice-prsident du Conseil d'tat dlibrant avec les prsidents de section. (L. 1872, art. 5, 12.) Les fonctions de conseiller en service ordiIncompatibilits. naireet de matres des requtes sont incompatibles avec toute fonction publique salarie 1. Mais il y a deux sries d'exceptions en sens inverse. Les officiers gnraux ou suprieurs de l'arme de terre ou de mer, les inspecteurs 1. Et mmeavec certaines fonctions prives, telle que celles d'administateur de toute compagnieprivilgie ou subventionne. (L. 1872,art. 7, 3.)
LE CONSEIL D'TAT
289
et ingnieurs des ponts et chausses, des mines et de la marine, les professeurs de l'enseignement suprieur, peuvent tre dtachs au Conseil d'tat. Ils conservent, pendant la dure de leurs fonctions, les droits attribus leur position, sans pouvoir toutefois cumuler leur traitement avec celui de conseiller d'tat. (L. 1872, art. 7, 1 et 2.) En sens inverse, les conseillers d'tat en service ordinaire, matres des requtes et auditeurs de premire classe, aprs trois annes depuis leur entre au Conseil d'tat, pourront, sans perdre leur rang au Conseil, tre nomms des fonctions publiques pour une dure qui n'excdera pas trois ans. Le nombre des membres du Conseil, ainsi nomms des fonctions publiques, ne pourra excder le cinquime du nombre des conseillers, matres des requtes et auditeurs. Pendant ces trois annes ils ne seront pas remplacs. Les traitements ne pourront tre cumuls. (L. 13 juillet 1879, art. 3.) Traitements. Vice-prsident du Conseil d'tat, 25,000 francs prsidents de section, 18,000 francs conseillers d'tat, 16,000 francs matre des requtes 8,000 francs. (Lois de finances annuelles.) Auditeur de premire classe, traitement gal la moiti de celui desmaitres des requtes. (L. 24 mai 1872, art. 5, 10 auditeurs de deuxime classe, 2,000 francs. (L. 23 mars 1880, art. 4.) 152. B. Les diffrentes d'du Conseil formations tat. (L. 13 juillet 1879; D. R. 2 aot 1879.) Le Conseil d'tat est divis d'une faon permanente en sections; il peut en outre se former en sections runies, en assemble gnrale du Conseil d'tat, en assemble du Conseil d'tat statuant au contentieux. Le dernier mode de formation tant spcial la matire du contentieux, il ne sera traitici que des trois premiers. a) Formation du Conseil en sections. Depuis la loi du 13 juillet : une section du 1879, le conseil d'tat est divis en cinq sections contentieux et quatre sections administratives, o les affaires sont rparties par ministres, avec cette observationqu'il y a une section de lgislation, tandis qu'il n'y a pas de ministre de lgislation : 1 lgislation, justice et affaires trangres; 2 intrieur, cultes, instruction publique et beaux-arts; 3 finances, postes et tlgraphes, guerre, marine, colonies; 4 travaux publics, agriculture et commerce1. 1. Le projet de loi indiqu plus haut aurait pour rsultat, sans modifier [ le nombre total des sections, de crer une seconde section du contentieux ; c'est la section de lgislation qui disparatrait. H. 19
290
ORGANISATION DE L'TAT
Les sections sont composes de cinq conseillers d'tat en service ordinaire et d'un prsident, l'exception de la section du contentieux qui est compose de six conseillers en service ordinaire et d'un prsident. (L. 13 juillet 1879, art. 4, 2.) Les conseillers en service extraordinaire ne peuvent pas tre attachs la section du contentieux ; ils peuvent tre attachs toutes les autres sections. Le ministre de la justice a le droit de prsider toutes les sections l'exception de celle du contentieux. Les autres ministres n'ont pas entredans les sections. (L. 24mai 1872, art.10, 4.) Les matres des requtes et les auditeurs sont en outre rpartis entre les diverses sections. Tous les trois ans, il peut tre procd une nouvelle rpartition des conseillers d'tat et des matres des requtes entre les diverses sections ; tous les ans pour les auditeurs. Cette rpartition est faite par dcret en ce qui concerne les conseillers d'tat, et par arrt du ministre de la justice, en ce qui concerne les matres des requtes et les auditeurs. Les sections administratives ne peuvent dlibrer valablement que si trois conseillers en service ordinaire sont prsents. En cas de partage la voix du prsident est prpondrante. (L. 24 mai 1872, art. 12, 2.) Quelquefois les sections dlibrent dfinitivement, mais le plus souvent elles ne font qu'arrter un projet d'avis qui sera port l'assemble gnrale du Conseil d'tat. b) Formation en runion de sections. Certaines affaires peuvent concerner plusieurs sections, et il peut tre utile de les runir. Cela peut tre fait par le ministre de la justice ou le vice-prsident du Conseil d'tat. (R. 2 aot, 1879, art. 2.) Lorsque plusieurs sections sont runies, la prsidence appartient, en l'absence du ministre de la justice, au vice-prsident, ou celui des prsidents de ces sections qui est le premier dans l'ordre du tableau. Dans certains cas, les runions de sections dlibrent dfinitivement sur les affaires qui leur sont soumises, mais le plus souvent elles ne font qu'arrter un projet d'avis, et prparer un rapport qui sera port l'assemble gnrale du Conseil d'tat. Les dcrets rendus aprs dlibration d'une ou plusieurs sections mentionnent que ces sections ont t entendues. (L. 1872, art. 13, 2.) d'tat. L'asen assemble du Conseil Formation gnrale c) semble gnrale du Conseil d'tat se compose : du garde des sceaux, ministre de la justice, du vice-prsident, des ministres, des conseillers d'tat en service ordinaire, des conseillers d'tat en service
LE CONSEIL D'TAT
291
extraordinaire, des matres des requtes, des auditeurs et du secrtaire gnral. Elle est prside par le ministre de la justice, et, en son absence, par le vice-prsident du Conseil d'tat; en l'absence de l'un et de l'autre, parle plus ancien des prsidents de section en suivant l'ordre du tableau. (L. 24 mai 1872, art. 4.) Le Conseil d'tat en assemble gnrale ne peut dlibrer si seize au moins des conseillers en service ordinaire ne sont prsents. En cas de partage, la voix du prsidentest prpondrante. (L. 1879, art. 6.) Les dcrets rendus aprs dlibration de l'assemble gnrale mentionnent que le Conseil d'tat a t entendu et constituent toujours, soit des rglements d'administration publique, soit des dcrets en forme de rglements d'administration publique. (L. 1872. art. 13, 1er.) Des affaires portes l'assemble gnrale du Conseil d'tat. Certaines affaires sont ncessairement portes l'assemble gnrale, les autres n'y sont portes qu'autant que le renvoi cette assemble a t ordonn par les ministres ou par les prsidents de section. Il faut voir ce sujet le rglement du2 aot 1879, modifi par celui du 3 avril 1886. Parmi les affaires ncessairement portes figurent au premier rang les rglements d'administration publique1. 1. Nomenclature complte d'aprs le dcret 3 avril 1886: 1 les projets etles propositions de loi renvoys au Conseil d'tat; 2 les projets de rglement d'administration publique ; 3 l'enregistrement des bulles et autres actes du ; 5 les autorisations des congrgaSaint-Sige; 4 les recours pour abus tions religieuses et la vrification de leurs statuts ; 6 la cration des tablissements ecclsiastiquesou religieux ; 7 l'autorisation d'accepter des dons et legs excdant50,000francslorsqu'il y a opposition des hritiers ; 8l'annulation des dlibrations prises par les conseils gnraux du dpartement dans les cas prvus par les art. 33 et 47, L. 10 aot 1871; 9 les impositions d'office tablies sur les dpartements dans les cas prvus par l'art. 61, L. 10aot 1871; 10 les traits passs par la ville de Paris pour les objets numrs dans l'art. 16, L. 24 juillet 1867; 11 les changements apports la circonscription territoriale des communes; 12 la cration des octrois; 13 la cration des tribunaux de commerceet des conseils de prud'hommes; la cration ou la prorogation des Chambrestemporaires dans les cours ou tribunaux; 14 la cration des chambres de commerce; 15 la naturalisation des trangers accorde titre exceptionnel; 16 les prises maritimes; 17 la dlimitation des rivages de la mer; 18 les demandes en concessionde mines en France ou en Algrie; 19l'excution des travaux publics la charge de l'tat qui peuvent tre autoriss par dcret; 20 l'excution des tramvays; 21la concession de desschementde marais, les travaux d'endiguement et ceux de redressement des cours d'eau non navigables; 22 l'approbation des tarifs des ponts page; 23l'tablissement des droits de tonnage dans les ports maritimes; 24 l'autorisation des socits d'assurance sur la vie, des tontines.; 25la
292
DE L'TAT ORGANISATION
153. C. Rle des divers membres du Conseil d'tat. Garde des sceaux, ministre de la justice, prsidence facultative de l'assemble gnrale et des sections administratives, avec voix dlibrative. Ministres, autres que le garde des sceaux, voix dlibrative l'assemble gnrale, chacun pour les affaires de son dpartement; peuvent toujours faire venir une affaire en assemble gnrale. Conseillers en service ordinaire, voix dlibrative quelle que soit la formation du Conseil d'tat. Conseillers en service extraordinaire, n'ont entre qu' l'assemble gnrale et aux sections administratives ; voix dlibrative dans les affaires qui ressortent leur dpartement ministriel, voix consultative dans les autres. Matres des requtes, voix dlibrative dans les affaires dont ils ont fait le rapport, voix consultative dans les autres aussi bien l'assemble gnrale que dans les sections. Auditeurs, n'ont d'opinion mettre que sur les affaires dont ils ont fait le rapport, voix dlibrative dans leur section, consultative l'assemble gnrale. Le Conseil 154. II. Attributions du Conseil d'tat. d'tat a des attributions administratives et des attributions contentieuses. On dit quelquefois qu'il a aussi des attributions lgislatives. Il en a eu sous certains rgimes, mais il n'en a plus; son intervention dans la confection de la loi n'est plus ncessaire; quand il intervient en fait, c'est qu'il est consult titre administratif. Pour les attributions contentieuses, renvoi au contentieux. Quant aux attributions elles consistent uniquement administratives, mettre des avis dont le gouvernement reste libre de s'carter. L'intervention du Conseil d'tat est tantt facultative, tantt ncessaire. Elle est ncessaire quand la loi dit qu'il sera statu par rglement d'administration publique ou par dcret en forme de rglement d'administration publique. Dans ces cas, l'absence de l'avis du Conseil d'tat constituerait un vice de formes du dcret. Conseils administratifs 155. APPENDICE. pla Dans tous les ministres il ya cs auprs des ministres. des conseils ou comits dont les ministres prennent les avis; quelsuppression des tablissements dangereux, incommodes et insalubres dans les cas prvus par le D. 15 oct. 1810; 26 toutes les affaires non comprises dans cette nomenclature sur lesquelles il doit tre statu en vertu d'une disposition spciale par dcrets rendus en la forme des rglements d'administration publique; 27 enfin les affaires qui, raison de leur importance, sont renvoyes l'examen de l'assemble gnrale, soit parles ministres, soit par le prsident de la section, d'office ou sur la demande de la section.
LES BUREAUX
293
quefois ils sont tenus de prendre ces avis, quelquefois mme ils sont tenus de les suivre. Quelques-uns de ces conseils sont en mme temps des juridictions disciplinaires, par exemple le conseil suprieur de l'instruction publique. La liste de ces conseils ou comits est considrable, il y en a plusieurs par ministre, on la trouvera l'Almanach national. Un fait intressant signaler, c'est qu'il y a tendance changer le mode de recrutement de ces conseils. Autrefois ils avaient quelque chose d'immobile, ils taient composs uniquement de fonctionnaires de l'administration centrale qui y demeuraient longtemps. Actuellement, il y a tendance y introduire des fonctionnaires rgionaux assez frquemment renouvels, comme des personnes trangres l'administration. Ils ont des sessions priodiques qui deviennent ainsi plus vivantes (conseil suprieur du commerce, conseil suprieur de l'assistance publique, conseil suprieur du travail, etc., etc. Les conseils ou comits de la guerre ont t aussi trs renouvels). La plu; il part des membres de ces conseils sont nomms par les ministres est cependant des conseils o des membres sont lus par les intresss, par exemple le conseil suprieur de l'instruction publique (1. 27 fvr. 1880). Si ce mode de nomination se gnralisait, ces conseils deviendraient une sorte de reprsentation des intrts. N 2. Les bureaux. 156. Il y a des bureaux la prsidence, il y en a surtout dans chaque ministre. Ce sont des agglomrations d'employs, qui ont pour mission de prparer au ministre les lments de ses dcisions, et de dresser les actes pour la signature. Les bureaux sont l'appareil ils possdent la tradition, rgulateur de la machine administrative ; ils fonctionnent toujours la mme allure; aux poques o la direction politique manque, ils y supplent ; aux poques o elle se manifeste avec excs, ils la modrent. Depuis la loi du 29 dcembre 1882, art. 16, l'organisation centrale de chaque ministre est rgle par un dcret rendu dans la forme des rglements d'administration publique, insr au Journal officiel, et aucune modification ne pourrait y tre apporte que dans la mme forme et avec la mme publicit. Chaque administration centrale de ministre comprend la hirarchie suivante : directeurs gnraux, directeurs, chefs de division, chefs de bureau, sous-chefs, commis, expditionnaires. Les divisions et les bureaux donnent un dessin fidle des diffrents services publics groups dans un mme ministre.
294
ORGANISATION DE L'TAT N 3. Les agents d'excution du pouvoir central.
Les agents d'excution qui 157. Classification. dpendent du pouvoir central sont rattachs aux diffrents ministres. Ils sont extrmement nombreux et peuvent tre l'objet de classifications diverses. La classification la plus importante est celle en agents proprement dits et en inspecteurs. Les agents proprement dits font marcher les diffrents services. Les inspecteurs vont surveiller le fonctionnement de ces services, et par la seule ventualit de leur tourne d'inspection, tiennent constamment en haleine le personnel des agents. Il y a dans tous les ministres des inspecteurs, inspecteurs des services administratifs au ministre de l'intrieur, inspecteurs des finances au ministre des finances, inspecteurs de l'instruction publique, etc., etc. Dans la classe des agents proprement dits, il y a une catgorie qu'il faut mettre part raison des rgles spciales auxquelles elle est astreinte, c'est celle des agents comptables qui ont le maniement des deniers publics ou des matires soumises comptabilit. Les agents 158. Hirarchie et cadres rgionaux. proprement dits, bien que rattachs au pouvoir central, en ce sens qu'ils reoivent directement de lui l'impulsion, sont rpartis au point de vue de leur rsidence sur tout le territoire du pays. Il y a, en effet, des services d'tat qui doivent pntrer dans toutes les communes, par exemple le service de l'instruction primaire, la perception des impts directs, etc. Il faut bien que l'instituteur rside dans la commune, que le percepteur rside proximit de la commune. Beaucoup d'autres services doivent tre tout au moins porte des habitants de chaque commune, par consquent les agents doivent tre placs dans des centres bien choisis avec une circonscription dans laquelle ils auront comptence. C'est ainsi qu'il y a un tribunal de premire instance dans chaque arrondissement, etc. Ce n'est pas tout. Les agents qui sont rpartis sur le territoire et qui doivent recevoir l'impulsion du pouvoir central, ont besoin d'intermdiaires entre le ministre et eux. Le ministre ne peut pas corres: 1 parce pondre directement avec les agents tout fait subalternes que ces agents sont trop nombreux, que le ministre ne pourrait pas arriver les connatre individuellement et qu'il faut cependant qu'un subalterne soit connu individuellement de ses chefs ; 2 parce qu'il faudrait leur donner des instructions trs dtailles et que le ministre n'en aurait pas le loisir. De l la ncessit de la hirarchie et des cadres rgionaux. Entre les agents subalternes et le ministre s'ta-
LA HIRARCHIE
295
gentun certain nombre de fonctionnaires, qui encadrent les agents subalternes. Un premier fonctionnaire dirige tous les agents subalternes d'un mme service dans une mme rgion. Ce fonctionnaire, avec ses collgues du mme rang, est dirig son tour par un fonctionnaire suprieur, qui a comptence dans une rgion plus tendue. Et ainsi de suite, jusqu' ce qu'on arrive un fonctionnaire rgional, qui soit directement en rapport avec le ministre. C'est ainsi, par exemple, que dans l'instruction primaire, les instituteurs de tout un dpartement sont dirigs par l'inspecteur d'acadmie, que tous les inspecteurs de l'acadmie sont leur tour dirigs par le recteur, lequel est directement en rapport avec le ministre. Chacun des fonctionnaires interposs dans la hirarchie connat personnellement ses subordonns immdiats et leur dtaille les instructions; c'est un rservoir d'nergie qui permet l'impulsion gouvernementale d'arriver entire jusqu'en bas. Les fonctionnaires les plus intressants ce point de vue sont ceux qui, placs la tte des grands cadres rgionaux, sont directement en rapport avec le ministre; on les appelle les chefs de service. Quelquesuns de ces cadres rgionaux se confondent avec la circonscription du dpartement; par exemple, il y a dans chaque dpartement un directeur des contributions directes, un des contributions indirectes, et ces directeurs sont des chefs de service. Mais un certain nombre de ces cadres rgionaux sont bien plus vastes que le dpartement, et au contraire en contiennent plusieurs dans leur sein. Tels sont les ressorts des corps d'arme, des cours d'appel, des acadmies, des archevchs. Les commandants de corps d'arme, les prsidents de cours d'appel et les procureurs gnraux, les recteurs, les archevques sont de grands chefs de service. Si tous les grands cadres ou ressorts rgionaux concordaient entre eux, si le mme groupe de dpartements faisait partie la fois d'un mme corps d'arme, d'une mme cour d'appel, d'une mme acadmie, d'un mme archevch, tous les grands chefs de service, tant runis au mme chef-lieu, on arriverait bien vite la reconstitution des provinces; ce grand cadre commun pour les grands services publics crerait une vie commune. En fait, les grands ressorts rgionaux ne concordent pas; c'est en partie voulu, en partie d au hasard. Ils ne peuvent pas concorder, ils sont en nombre ingal. Il y a, dans la mtropole, dix-huit corps d'arme, vingt-cinq cours d'appel, seize acadmies, dix-sept archevchs. Un dpartement dpend, en gnral, d'une grande ville pour le corps d'arme, d'une autre pour la cour d'appel, d'une autre pour l'acadmie. Les grand chefs de service ont sur leurs subordonns des pouvoirs
296
DE LTAT ORGANISATION
de direction considrables en fait, bien qu'en thorie, les dcisions ! soient prises par le ministre. Exceptionnellement, la dcision directe peut leur tre dlgue. RGIONAL 2. LE POUVOIR L'organe ex159. Ncessit du pouvoir rgional. cutif de l'tat fait sentir au centre du pays son action directrice, grce aux autorits qui constituent le pouvoir central, chef de l'tat et ministres. Mais cette action s'affaiblit une certaine distance, et dans les rgions loignes, il est ncessaire que l'organe excutif soit reprsent avec son aspect de puissance publique par des autorits rgionales. L'ensemble de ces autorits rgionales, rparties sur le territoire, constitue ce qu'on peut appeler le pouvoir rgional. L'utilit du pouvoir rgional est double, elle existe : 1 vis--vis des personnes administratives infrieures et des citoyens; il est bon qu'une partie de l'autorit que le pouvoir excutif exerce sur eux, soit confi un organe trs rapproch; 2 vis--vis des fonctionnaires de l'tat lui-mme. On vient de voir que ces fonctionnaires sont diviss par ministres et par services, et qu'ils obissent des chefs rgionaux. La discorde et les comptitions sont craindre entre les diffrents chefs de service. Au centre, les dsordres de ce genre sont arrts par la prsence du chef de l'tat; au loin, il fallait qu'ils pussent l'tre par un reprsentant du chef de l'tat. Aussi le pouvoir rgional a-t-il comme mission trs importante, de surveiller tous les services rgionaux de l'tat pour y maintenir l'harmonie. Diffrence entre le pouvoir rgional de l'tat et les pouvoirs dcentraliss. Il ne faut pas confondre le pouvoir rgional exerc au -nom de l'tat avec les pouvoirs dcentraliss. Les pouvoirs dcentraliss ne sont pas exercs au nom de l'tat, mais au nom de personnes administratives, produit de la dcentralisation, telles qu'un dpartement ou une commune. La cause de confusion est que ces diffrents pouvoirs s'exercent concurremment sur le mme territoire; c'est aussi que les mmes autorits reprsentent la fois le pouvoir rgional de l'tat et le pouvoir dpartemental ou communal; en effet, le prfet, par exemple, est une autorit rgionale de l'tat et en mme temps une autorit dpartementale; le maire, qui est avant tout une autorit communale, est, certains gards, une autorit rgionale de l'tat. Ces causes de confusion sont faciles viter. Organisation du pouvoir rgional. De mme que le pouvoir central, le pouvoir rgional est compos d'autorits et de fonctionnaires.
LE PRFET
297
Article Ier. Autorits du pouvoir rgional. N1. L'lment fondamental du remplac les administrations qui reprsente le chef de l'tat rit sont les sous-prfets et les Le prfet. pouvoir rgional est le prfet, qui a dpartementales rvolutionnaires, et dans le dpartement. Sous son automaires.
Il y a un prfet dans chaque 160. Rgles d'organisation. dpartement (1. 28 pluvise an VIII, art. 2). Par exception, dans le dpartement dela Seine, il y en a deux qui se partagent les attributions, et qui cumulent d'ailleursla qualit de maire de Paris avec celle de prfet : le prfet de police et le prfet de la Seine. Toutes les rgles d'organisation que nous allons tudier sont inspires par une mme pense, faire que les prfets soient absolument dans la main du gouvernement et que, cependant, les avantages de leur situation soient assez grands pour attirer dans la carrire des hommes de valeur. I. Nomination. Les prfets sont nomms et rvoqus par dcrets du chef de l'tat, proposs et contresigns par le ministre de l'intrieur. La qualit de citoyen franais suffit, c'est--dire l'ge de vingt et un ans, et la jouissance des droits civils et politiques. II. Traitement, Combinaison des classes territoriales et personnelles. Il a t organis pour le traitement des prfets un systme que nous retrouverons pour les secrtaires gnraux, les conseillers de prfecture et les sous-prfets. Les prfectures sont divises en .trois classes territoriales raison de l'importance du dpartement : dans une prfecture de premire classe le traitement du prfet est de 35,000 francs, il est de 24,000 dans uneprfecture de seconde classe, et de 18,000 dans une prfecture de troisime classe. (D.28 octobre 1872) Mais ce systme de classes territoriales a un inconvnient, c'est qu'il faut dplacer un prfet pour lui donner de l'avancement et il peut tre trs utile de le laisser dans un dpartement o il a russi. On a donc eu l'ide de combiner, avec les classes territoriales, des classes dites personnelles, c'est -dire que les prfets peuvent avancer sur place. Ainsi, les prfets de deuxime et de troisime classe, aprs cinq ans de service dans le mme dpartement, peuvent obtenir une augmentation de traitement peu prs gale une demi-promotion de classe, etc. De plus, et afin de donner plus de latitude encore au gouvernement, les prfets qui ont un poste de premire ou de
298
ORGANISATION DE L'TAT
deuxime classe peuvent tre appels des prfectures d'une classe infrieure en conservant leur traitement. (D. 27 mars 1852; V. D. 7 octobre 1883.) III. Pension et traitement de non-activit. Les prfets ont droit une pension au bout de trente ans de services et soixante ans d'ge, mais comme ils peuvent tre rvoqus ad nutum, on ne leur fait pas subir de retenue sur le traitement (1. 22 aot 1790). De plus, toujours afin que le gouvernement puisse les rvoquer librement sans tre arrt par des considrations d'humanit, dans le cas o ils n'ont pas encore droit la retraite, ils peuvent recevoir un traitement de non-activit. Ce traitement (8,000 francs pour la premire classe, 6,000 pour la deuxime) ne constitue pas un droit, il ne peut tre accord qu' ceux qui avaient dj six ans de services rtribus par l'tat, il ne peut durer plus de six ans, et ne peut tre cumul avec aucun traitement ni aucune pension pays sur les fonds du Trsor, l'exception des pensions militaires. (D. 27 mars 1852; D. 15 avril 1877.) IV. Rsidence, remplacement temporaire. Le prfet doit rsider au chef-lieu de son dpartement, il ne peut s'absenter du dpartement sans la permissiondu ministre de l'intrieur (arrt 27 ventse an VIII). Le prfet peut dlguer ses fonctions un conseiller de prfecture ou au secrtaire gnral de la prfecture. La dlgation n'a pas besoin d'tre approuve par le ministre de l'intrieur, si le prfet ne sort pas du dpartement. (Ord. 29 mars 1821, art. 1.) En cas de vacance de la prfecture ou d'absence sans dlgation, le premier conseiller de prfecture dans l'ordre du tableau prend de droit l'administration du dpartement; toutefois si, avant la vacance dela prfecture, l'administration a t dlgue, celui qui a reu cette dlgation continue d'exercer jusqu' ce qu'il en soit autrement ordonn par le ministre de l'intrieur. (Eod., art. 2). 161. B. Attributions du prfet. Le prfet est avant tout reprsentant de l'tat, mais il est aussi reprsentant du dpartement. Il s'agit ici, uniquement, des attributions du prfet considr comme reprsentant de l'tat, nous verrons propos du dpartement, les attributions qu'il a comme reprsentant de cette personne administrative (n 197.) Le prfet a la double attribution de fonctionnaire et d'autorit administrative. de En qualit de fonctionnaire, le Qualit fonctionnaire. a) : 1 de l'excution des dcisions du chef de l'tat prfetest charg ou des ministres; 2 de la surveillance des services rgionauxen tant qu'ils fonctionnent dans son dpartement. Cette surveillance est faci-
LE PRFET
299
1lite par ce fait, qu'une bonne partie de la correspondance officielle des chefs de service avec leurs ministres respectifs, doit passer par 1les bureaux de la prfecture; mais pour les services o il y a de grands chefs dont le ressort est plus grand que le dpartement, la situation est assez dlicate ; 3 d'un service gnral d'informations au profit du pouvoir central, tant au point de vue de la statistique que de la police; 4 de la transmission des rclamations des particuliers au pour voir central. b) Qualit d'autorit administrative. En qualit d'autorit admile prfet prend des dcisions excutoires en exerant cernistrative, t tains droits de l'tat. I. Droits exercs par le prfet. 1 Droits de puissance publique. Le prfet a la direction des sous-prfets et des maires de son dpar tement, considrs comme autorits administratives rgionales de l'tat. Il a dans une certaine mesure, la police des fonctionnaires. Il exerce dans une certaine mesure la police ou tutelle sur les personnes Vis--vis du dpartement, il a le droit d'annuler administratives. en certains casles dlibrations du conseil gnral (1. 1871, art. 34). Vis--vis des communes, il a le droit de suspendre pendant un mois un conseil municipal (art. 43, 1. mun.), de suspendre pour le mme temps un maire ou un adjoint (art. 86, ibid.); il a le droit d'approuver certaines dlibrations du conseil municipal, le droit d'annuler leurs dlibrations rglementaires lorsqu'elles renferment quelque cause de nullit (art. 65 et 66) ; il a le droit d'annuler ou de suspendre les arrts des maires (art. 95); le droit, aprs avoir mis le maire en demeure, de substituer son action la sienne, aux termes des art. 85 et 99; il rvoque les gardes champtres (art. 102). Vis--vis des tablissements publics, il exerce des droits considrables ; pour les tablissements charitables, il nomme une partie des commissions administratives, il approuve les dlibrations de ces commissions, etc., etc. Enfin il exerce dans une certaire mesure la police sur les individus. D'abord, il a le pouvoir rglementaire. Ce pouvoir rglementaire, la jurisprudence le puise dans la loi des 22 dcembre 1789, janvier 1790, section III, art. 2, qui a constitu les administrations dpartementales; elle a tir notamment des 5, 6, 9 de cet article, le droit pour le prfet de faire des rglements relatifs la conservation des proprits publiques, celle des forts, rivires, chemins et autres choses communes, au maintien de la sret, de la salubrit et de la tranquilit publiques. De plus, des lois spciales ont reconnu au prfet le pouvoir rglementaire en matire de chasse (1. 3 mai 1844); en matire de pche
300
ORGANISATION DE L'TAT
(1. 5 avril 1829) ; en matire de chemins vicinaux (l. 21 mai 1836). Ce pouvoir rglementaire s'exerce par des arrts, qui doiventtre publis par voie d'affiche dans les communes o leur excution est rclame. (Avis du Conseil d'tat 25 prairial an XIII; Cassation 12 avril 1861.) En matire de sret gnrale, salubrit, tranquillit, les pouvoirs avec les duprfet entrent en conflitsurle territoire de chaque commune pouvoirs du maire. Nous examinerons ce conflit au n 332. De plus, le prfet a le droit de donner des autorisations individuelles, par exemple : l'autorisation d'ouvrir des tablissements insalubres de 1re et 2e classe, etc., etc. Le prfet participe la police du domaine public de l'tat, notamment celle des fleuves et rivires navigables et flottables. Il intervient dans la perception des impts directs en rendant excutoires les rles; il intervient dans l'expropriation d'utilit publique, soit dans les enqutes, soit par l'arrt de cessibilit; il autorise certaines adjudications de travaux publics; il liquide et ordonnance certaines dpenses, etc., etc. 2 Droits de personne prive. 1 Le prfet est le reprsentant de l'tat dans un certain nombre de contrats qui intressent le domaine priv, les alinations (sauf exceptions), les baux, etc. ; 2 il est reprsentant en justice de l'tat devant tous les tribunaux de son dpartement. II. Force excutoire des dcisions du prfet. Dcrets de dconcentration. En tant que le prfet est une autorit administrative, il s'agit de savoir jusqu' quel point il est indpendant des ministres, si ses actes ont force excutoire par eux-mmes, ou bien s'ils n'en ont que lorsqu'ils sont revtus de l'approbation ministrielle. De la loi des 22 dcembre 1789, janvier 1790, qui avait institu les directoires de dpartement auxquels les prfets ont succd en l'an VIII, il rsultait (section VIII)que sur tous les objets qui intressaient le rgime de l'administration gnrale du royaume ou sur des entreprises nouvelles et travaux extraordinaires , les arrts des administrations dpartementales devaient tre soumis l'approbation du roi; mais que sur les autres objets ils auraient force excutoire par euxmmes, sauf le droit du roide les annuler ou rformer. Il y avait donc des actes des directoires excutoires par eux-mmes. Le principe est rest le mme pour les prfets, l'art. 3 de la loi du 28 pluvise an VIII le prfet sera seul charg de l'administration n'a rien chang aux attributions; seulement, en fait, comme les expressions objets qui intressent le rgime de l'administration gnrale du royaume taient trs lastiques, la tendance centralisatrice en profita pour sou-
LE PRFET
301
mettre la ncessit de l'approbation ministrielle tous les actes des prfets, l'exception de quelques-uns nommment indiqus par la loi du 22 dcembre 1789, par exemple, les arrts rglementaires de police. Il rsultait de cette approbation ministrielle indispensable pour la plus petite affaire, une paperasserie et des lenteurs contre lesquelles les rclamations taient unanimes. Le gouvernement de 1852, qui se proposait d'tre avant tout un rgime administratif, donna satisfaction ces rclamations par les deux dcrets du 25 mars 1852 et du 13 avril 1861. Ces deux dcrets, sans toucher au principe tabli dans la loi du 22 dcembre 1789, contiennent, soit dans leurs articles, soit dans des tableaux annexs, la liste d'une foule de cas o dsormais les prfets pourront statuer sans l'approbation du ministre, sauf le pouvoir pour celui-ci d'annuler ou de rformer aprs coup leurs actes. En rsum, l'heure actuelle: : 1 en a) Les actes des prfets ont force excutoire par eux-mmes matire de rglement de police (1. 22 dc. 1789) ; 2 dans les matires contenues aux tableaux de 1852 et 1861, notamment en tout ce qui concerne la tutelle des dpartements et des communes (tableau A, n 55). Quelquefois le prfet est tenu de prendre l'avis du conseil de prfecture; quelquefois il est tenu de prendre celui de certains chefs de service. Ces actes peuvent tre rforms ou annuls par le ministre : 1 d'office, en cas de violation des lois et rglements; 2 sur recours des parties intresses, pour toute espce de motifs. b) Les actes des prfets sont soumis l'approbation ministrielle : 1 dans certains cas excepts par les dcrets de 1852 et 18G1 euxmmes; 2 dans les matires qui intressent l'administration gnrale du pays. Premire observation : Les tableaux des dcrets de 1852 et de 1861 doivent tre lus actuellement avec beaucoup de prcautions, parce qu'en vertu des lois du 10 aot 1871 et du 5 avril 1884, un certain nombre d'actes ne sont plus du tout dans les attributions du prfet, tant passes dans celles du conseil gnral ou de la commission dpartementale. Deuxime observation : Les dcrets de 1852 et de 1861 ont t appels, par le gouvernement imprial, dcrets de dcentralisation ; ils ne mritaient pas videmment ce nom, puisqu'ils faisaient passer des attributions du pouvoir central, non pas des autorits administratives dcentralises, dpartementales ou communales, mais des autorits rgionales de l'tat lui-mme; on les a appelsplus justement dcrets de dconcentration. Cependant, il est juste de reconnatre que si ces dcrets n'ont pas fait par eux-mmes de la dcentralisation, ils
302
ORGANISATION DE L'TAT
l'ont facilite pourplus tard. Il est plus facile d'enlever une attribution au prfet, pour la faire passer au conseil gnral du dpartement, que de l'enlever au ministre. Les dcrets de 1852 et 1861 ont rendu possible la loi du 10 aot 1871. 162. C. Nature et forme des actes. Voies de re En tant qu'il agit comme autorit administrative, le cours. prfet fait des actes d'administration lorsque ses dcisions sont excutoires par elles-mmes. Ce sont tantt des actes d'autorit, tantt des actes de gestion. La forme rgulire des actes d'autorit est l'arrt, mais il peut en tre fait par simple dcision sous forme de lettres (Pau, 9 fv. 1876). Dans tous les cas, il faut la signature du prfet. (Pour les arrts rglementaires, voir Sources du Droit, p. 68.) On peut recourir contre les actes des prfets: 1 par la voie gracieuse, devant le prfet lui-mme ou devant le ministre; 2 par la voie contentieuse, par recours pour excs de pouvoir contre les actes d'autorit s'il y a une ouverture, par recours contentieux ordinaire contre les actes de toute espce s'il y a un droit viol. N 2. Le sous-prfet. Il ya un sous-prfet dans 163. Rgles d'organisation. chaque arrondissement, except dans celui o est situ le chef-lieu du dpartement o le prfet en remplit les fonctions. (L. 28 pluvise an VIII, art. 8 et 11.) Les sous-prfets sont nomms et rvoqus par dcret. Aucune condition spciale de capacit; la qualit de citoyen suffit. Le traitement des sous-prfets est rgl d'aprs une combinaison de classes territoriales et de classes personnelles analogue celle qui existe pour les prfets et qui permet l'avancement sur place. Il est de 7,000francs pour la premire classe, de 6,500 pour la seconde, de 4,500 pour la troisime. (D. 23dc. 1872; D. 15 avr. 1877.) Il existe une pension sans retenue et un traitement d'inactivit. (V. p. 298.) Les sous-prfets ne doivent pas s'absenter sans cong accord par le prfet, moins de circonstances urgentes. Le prfet dsigne pour le remplacer soit un conseiller gnral, soit un conseiller d'arrondissement, soit un conseiller de prfecture. (Arrt 27 ventse an VIII, art 7; 0. 29 mars 1821, art. 3.) 164. Attributions. L'arrondissement n'tant pas une per-
LE SOUS-PRFET
303
sonne administrative, le sous-prfet n'a pas le reprsenter, il n'a donc pas, comme le prfet, un double caractre; il est uniquement reprsentant de l'tat. A ce titre, il a la double qualit de fonctionnaire et d'autorit administrative. a) En qualit de fonctionnaire, le sous-prfet est avant tout un agent de transmission, il fait parvenir aux municipalits les ordres du prfet et au prfet les rclamations que les municipalits adressent au nom des habitants, l'administration suprieure. Mais il s'y joint des pouvoirs d'information et de surveillance, car il doit surveiller l'excution des ordres du prfet et donner son avis sur les rclamations des habitants. b) Le sous-prfet est rarement une autorit administrative, c'est-dire qu'il a peu de pouvoirs de dcision. Cependant le D. du 13 avril 1861 a augment ses pouvoirs cet gard dans son art. 6. Nominationdes rpartiteurs des impts directs sur une liste dresse par le conseil municipal. Autorisation des tablissements insalubres de troisime classe. Dlivrance des permis de chasse. Nomination des prposs d'octroi, etc., etc. Force excutoire des dcisions des sous-prfets. Dans tous les cas o les sous-prfets ont le droit de dcision, leurs dcisions sont excutoires par elles-mmes, par consquent constituent des actes d'administration. Elles peuvent tre annules ou rformes par le prfet: 1d'office, pour violation de la loi ou des rglements; 2 sur recours de la partie lse pour toute espce de motifs. (D. 1861, art. 6.) et forme des actes, voies de recours. 165. Nature Les dcisions excutoires des sous-prfets sont des actes d'administration. Leur forme rgulire est celle de l'arrt. On peut recourir contre les actes des sous-prfets: 1 par la voie hirarchique devant le prfet avec la facult de remonter jusqu'au ministre; 2 par la voie contentieuse, par recours pour excs de pouvoirs, ou bien, s'il y a un droit viol, par recours contentieux ordinaire. N 3. Le maire. 166. Le maire est reprsentant de l'tat en mme temps que de la commune. Comme reprsentant de l'tat, le maire est charg, sous l'autorit du prfet: 1 de la publication et de l'excution des lois et rglements ; 2 de l'excution des mesures de sret gnrale; 3 des fonctions spciales qui lui sont attribues par les lois. (Art. 92,. loi 1884.)
304
ORGANISATION
DE L'TAT
Cela sera tudi propos de l'organisation municipale (n 233). Article II. Les fonctionnaires du pouvoir rgional.
N 1. Les secrtaires gnraux de prfecture. Il y a un secrtaire par Rgles d'organisation. dpartement ct du prfet. (L. 21 juin 1865, art. 5.) Les secrtaires gnraux ont t plusieurs fois supprims et rtablis depuis la loi du 28 pluvise an VIII, qui les avait institus. La raison d'tre de l'institution est double : le secrtaire gnral est l'aide et le confident du prfet, plus les conseils de prfecture voluent vers le contentieux, plus ce rle devient indispensable; de plus le secrtire gnral est un futur prfet qui fait un stage. Ils sont nomms et rvoqus par dcret. Aucune condition spciale exige, si ce n'est la qualit de citoyen. Pour eux comme pour les prfets existe la combinaison des classes territoriales et personnelles en vue de l'avancement sur place. Traitement de la premire classe, 7,000 francs, de la seconde, 6,000 francs, de la troisime, 4,500 francs. (D. 15 avril 1877, art. 2.) Ils ont une pension de retraite sans retenues, et peuvent obtenir un traitement de non activit (V. p. 298.) Le secrtaire gnral absent, empch ou charg par dlgation des fonctions de prfet, est remplac dans ses fonctions par le conseiller de prfecture le dernier dans l'ordre du tableau. 167. Le secrtaire gnral a des attributions 168. Attributions. administratives et des attributions contentieuses. Au point de vue contentieux, il joue le rle de commissaire du gouvernement devant le conseil de prfecture statuant au contentieux. Au point de vue administratif, il a en premier lieu cette fonction trs vague, mais trs importante, d'tre l'aide du prfet, son confident, celui qui peut le mieux tre dlgu en cas d'empchement; c'est un vice-prfet. De plus, il a la garde des papiers, la signature des expditions dlivres aux parties, la responsabilit des registres, des arrts et dcisions du prfet et des dlibrations du conseil de prfecture. (L28 pluvise an VIII, art. 7; O. 9 aot 1817.) N 2. Les conseils de prfecture. Les conseils de prfecture, de mme que le Conseil d'tat, sont
DE PRFECTURE LE CONSEIL
305
la fois des conseils administratifs et des tribunaux administratifs; on les tudiera ici uniquement comme conseils, tout en reconnaissant que leur qualit de tribunaux est celle qui prend le plus d'importance, et qui tend influer le plus sur leur organisation. (Renvoi au contentieux, n 588.) Les conseils de prfecture 169. Rgles d'organisation. ont t crs par la loi du 28 pluvise an VIII; depuis ils ont t remanis par la loi du 21 juin 1865, et l'on a constamment demande nombreux projets ont t dpod de nouveaux remaniements ; ss. Il y a un conseil de prfecture dans chaque dpartement ; il est compos du prfet prsident, et suivant l'importance du dpartement, de trois ou de quatre conseillers. Le conseil ne peut prendre aucune dlibration si les membres prsents ne sont au moins au nombre de trois. Le prfet, lorsqu'il assiste la sance, compte pour complter le nombre ncessaire. Il a voix prpondrante en cas de partage (arrt 19 fructidor an IX). La prsidence du prfet est trs critiquable, surtout au point de vue contentieux. En fait, le prfet prside rarement, et la loi du 21 juin 1865 consacre cet tat de fait, en dcidant que chaque anne un des conseillers est dsign par dcret pour prsider en l'absence du prfet. Mais le prfet continue pouvoir prsider. Il est fortement question de lui enlever ce droit, un projet est dpos en ce sens. Dans le dpartement de la Seine, le conseil de prfecture se compose de neuf membres, y compris le prsident. Les conseillers de prfecture sont nomms et rvoqus par dcret. Il y a depuis la loi du 21 juin 1865 quelques conditions de capacit. Nul ne peut tre nomm conseiller de prfecture s'il n'est g de vingt-cinq ans accomplis, s'il n'est, en outre, licenci en droit, ou s'il n'a rempli, pendant dix ans au moins, des fonctions rtribues dans l'ordre administratif ou judiciaire, ou bien s'il n'a t, pendant le mme espace de temps, membre d'un conseil gnral ou maire. (Art. 2.) Il y a aussi incompatibilit lgale entre les fonctions de conseiller de prfecture et tout autre emploi public ou l'exercice d'une profession. (Art. 3.) Pour les traitements, combinaison des classes territoriales et des classes personnelles afin de permettre l'avancement sur place : premire classe 4,000francs, seconde classe 3,000 francs, troisime classe 2,000 francs. (D. 23 dcembre 1872 ; D. 15 avril 1877.) Pension de retraite sans retenue ; traitement de non-activit. (V.p. 298.) 20 H.
306
DE L'TAT ORGANISATION
Le conseil de 170. Attributions administratives. prfecture, au point de vue administratif, n'a que des attributions consultatives.Il donne des avis au prfet, quelquefois mme au chefdel'tat. Le plus souvent ces avis sont facultatifs; quelquefois il sont obligatoires. Des lois assez nombreuses ont impos au prfet de statuer en conseil de prfecture, notamment en matire de tutelle dpartementale ou communale; mais, mme lorsque le prfet est tenu de prendre l'avis, il n'est pas tenu de le suivre. L'arrt mentionne que le prfet sigeait en conseil de prfecture, mais il est sign du prfet seul. N 3. Bureaux. 171. Il existe des bureaux la prfecture et la sous-prfecture; les employs y sont rpartis, comme dans les ministres, en divisions et en bureaux. Ils sont nomms et rvoqus par le prfet. II. ORGANE SECTION LGISLATIF. 172. L'organe dlibrant de l'tat porte le nom d'organe lgislatif, parce que sa principale fonction n'est point de dlibrer sur des mesures administratives, mais d'exercer le pouvoir lgislatif de l'tat. Cependant il dlibre aussi sur des mesures administratives lorsqu'il fait des lois d'affaires. Cet organe dlibrant porte encore le nom de parlement, qui rappelle plus particulirement le rle qu'il joue au point de vue constitutionnel dans ses rapports avec l'organe excutif. On sait que la prdominance du Parlement sur l'organe excutif, obtenue par la responsabilit ministrielle, constitue le rgime parlementaire. L'organe lgislatif est, 173. Dualit des Chambres. certains gards, un organe unique, et certains gards un organe double. Il est double car il est compos de deux assembles diffrentes, la Chambre des dputs et le Snat, qui n'ont pas le mme mode de recrutement et qui ne sigent pas ensemble. Il est unique, car ces deux assembles diffrentes, par suite de certaines rgles constitutionnelles, semblent bien tre les deux moitis d'un mme tout. En effet: 1 en certaines occasions, ces deux Chambres se fondent en une assemble unique qui prend le nom d'assemble nationale ou de ; 2 sauf congrs (revision de la Constitution, lection du prsident) trs rare exception, ces deux Chambres tiennent leurs sessions simultanment ; 3 elles participent toutes les deux la confection d'une
LES CHAMBRES
307
mme loi et en principe avec des droits gaux, de sorte qu'une loi est toujours l'oeuvre commune de la Chambre et du Snat. La dualit de l'organe lgislatif n'est donc pointaussi absolue qu'on se plat le dire en gnral; mais, telle qu'elle est ralise, il faut la considrer comme une des plus heureuses garanties constitutionnelles. Sous le rgime parlementaire, il faut craindre les abus de pouvoir du Parlement; il est clair que la division en deux Chambres gales est une cause de division et d'affaiblissement qui rendent ces abus de pouvoir moins redoutables. C'est dans le mme but qu' Rome, les plus hautes magistratures taient confies deux magistrats avec par majestas. On peut disserter perte de vue sur ce chapitre : dire avec Sieys, que la volont de la nation tant une, il ne doit y avoir faire remarquer avec Stuart-Mill, que la division ; qu'une Chambre en deux Chambres est un obstacle l'adoption des rformes les plus utiles, parce qu'une trs petite minorit suffit y faire chec. Toutes ces raisons a priori ne tiennent pas contre les leons de l'exprience. Or les faits sont crasants ; partout o le rgime reprsentatif est tabli, c'est--dire en Amrique, en Australie et dans l'Europe presque tout entire, partout il y a deux Chambres. Elles n'ont pas partout des pouvoirs gaux comme chez nous, c'est la seule diffrence. Plus gnralement, il y a une Chambre basse qui est l'agent du mouvement et un Snat modrateur. D'ORGANISATION 1er. RGLES Article Ier. Rgles gnrales de composition de la Chambres des dputs et du Snat. La Chambre des dputs et le Snat sont des assembles dlibrantes composes d'un certain nombre de reprsentants qui ont reu du souverain un mandat lectif. des dputs. 174. Composition de la Chambre (L. 30 nov. 1875, 1. 16 juin 1885, 1. 13 fvr. 1889.) Les reprsentants la Chambre des dputs sont lus au suffrage universel direct, et au scrutin uninominal ou individuel depuis la loi du 13 fvrier 1889. Chaque circonscription lectorale nomme un dput. Les circonscriptions lectorales sont dtermines en prenant comme base l'arrondissement administratif ( Paris, l'arrondissement municipal). Les arrondissements dont la population ne dpasse pas cent mille habitants nomment un dput. Les arrondissements dont la population dpasse cent mille habitants, nomment un dput de plus par cent mille ou
308
ORGANISATION DE L'TAT
fraction de cent mille. Dans ce cas, ils sont sectionns. Un tableau de ces sectionnements a t annex la loi du 13 fvrier 1889, et ne pourra tre modifi que par une loi. Il est attribu un dput au territoire de Belfort, six l'Algrie et dix aux colonies. Le nombre total actuel des dputs est de cinq cent soixante-seize. Beaucoup d'arrondissements ont t sectionns (cent quarante-quatre); quelques-uns d'entre eux ont fourni quatre et cinq circonscriptions. Il n'est donc pas trs exact de dire que les dputs sont lus au scrutin d'arrondissement. Renouvellement. La Chambre des dputs se renouvelle intgralement tous les quatre ans. Le mandat de quatre ans expire jour pour jour la date du second tour de scrutin qui avait constitu la Chambre. Exceptionnellement, la Chambre peut tre renouvele aprs une dissolution ; elle commence alors un mandat complet de quatre ans. lections partielles. La Chambre doit toujours treau complet. Si donc un dput disparait par suite d'invalidation, de dcs, de dmission, d'acceptation de fonctions publiques, il doit tre remplac. Cependant, dans les six mois qui prcdent le renouvellement intgral, il n'est plus procd aux lections complmentaires. du Snat. 175. Composition (L. const. 24 fvrier 1875, 1. 2 aot 1875, 1. 9 dcembre 1884.) La composition du Snat a t assez fortement modifie par la loi du 9 dcembre 1884, rendue aprs la revision constitutionnelle du 14 aot 1884, qui avait enlev leur caractre constitutionnel aux dispositions organiques sur le Snat. D'aprs la Constitution de 1875, le Snat se composait de trois cents membres, chiffre constitutionnel ; deux cent vingt-cinq taient lus parles dpartements et les colonies, et n'avaient qu'un mandat temporaire ; soixante-quinze taient nomms par le Snat lui-mme et recevaient un mandat vie, on les appelait snateurs inamovibles. Les snateurs nomms par les dpartements taient lus par des collges o dominait l'lment rural. Ce collge tait en effet compos en majeure partie de dlgus des conseils municipaux, raison de un dlgu par commune; une commune de cent mille habitants n'avait qu'un dlgu, tout comme une commune de cent habitants; les communes rurales, infiniment plus nombreuses que les communes urbaines, dcidaient de l'lection. La rforme de dcembre 1884 a laiss subsister le chiffre de trois cents membres, mais elle a eu un double objectif : 1 supprimer les snateurs inamovibles ; cet effet, la loi dcide qu' l'avenir tous les snateurs seront lus ; elle rpartit elle-mme dans son article 1 les
COMPOSITION DES CHAMBRES
309
trois cents membres entre les dpartements et les colonies. Les inamovibles existants conservent leur mandat, mais ils seront supprims par extinction. Leurs siges ont t d'avance attribus certains dpartements; lorsqu'il se produit une vacance parmi les snateurs inamovibles, il est, dans la huitaine, procd en sance publique un tirage au sort pour dterminer celui de ces dpartements qui sera appel lire en remplacement un snateur; 1 restituer de l'importance dans l'lection l'lment urbain. A cet effet, le nombre des dlgus de chaque conseil municipal a t rendu proportionnel au nombre des membres de ce conseil, c'est--dire parla indirectement, la population de la commune. Les snateurs sont lus au scrutin de liste, Modede scrutin. avec le dpartement comme circonscription lectorale. Ils sont lus au suffrage plusieurs degrs. Ils sont en effet nomms par un collge restreint compos : 1 des dputs, conseillers gnraux et conseillers d'arrondissement du dpartement, qui eux-mmes sont dj des lus, ci deux degrs 2 des dlgus lus par les conseillers ; municipaux, lesquels sont eux-mmes des lus, ci trois degrs. Renouvellement. Le Snat ne se renouvelle pas en entier, mais par tiers, de trois en trois ans, de sorte que le mandat de chaque snateur est de neuf ans. Au dbut, il a t form trois sries, A, B, C, entre lesquelles ont t rpartis les dpartements et les colonies par ordre alphabtique, savoir : la srie A, les trente premiers dpartements, de l'Ain au Gard inclusivement, et, de plus, le dpartement d'Alger, ainsi que les colonies de la Guadeloupe et de la Runion; la srie B, les vingt-neuf dpartements suivants, depuis la Garonne (Haute) jusqu' l'Oise inclusivement, et, en outre, le dpartement de Constantine et la Martinique; enfin la srie C, les vingt-huit derniers dpartements, de l'Orne l'Yonne, le dpartement d'Oran et les Indes franaises. Le tirage au sort des sries fut fait en sance publique du Snat, le 29 mars 1876; les sries sortirent dans l'ordre suivant : B, C, A. La premire srie ne devait avoir qu'un mandat de trois ans, la seconde un mandat de six ans, la troisime seule eut ds la premire fois un mandat de neuf ans. La srie B a t renouvele en janvier 1879, la srie C en janvier 1882, la srie A en janvier 1885, la srie B, en janvier 1888, la srie C en janvier 1891, etc., etc. lections partielles. Le Snat doit toujours tre au complet ; si donc un snateur disparat par suite d'invalidation, dcs, dmission, il doit y avoir lection partielle; toutefois, si la vacance survient dans les six mois qui prcdent le renouvellement triennal, il n'y est pourvu qu'au moment du renouvellement.
310
ORGANISATION DE L'TAT
Article II. Les lections la Chambre des dputs et au Snat. N 1. lections la Chambre des dputs. (L. 30 nov. 1875 ; l. 16 juin 1885; l. 13 fvr. 1889.) Sont lecteurs tous les ci176. lecteurs et ligibles toyens franais ayant la jouissance et l'exercice du droit de suffrage et inscrits sur une liste lectorale. (Renvoi au droit de suffrage, V. p. 113et s.) Sont ligibles tous les citoyens franais gs de vingt-cinqans, sans aucune condition particulire autre que celles qui ont t introduites par la loi du 17 juillet 1889 sur les candidatures multiples: 1 faire une dclaration de candidature; 2 n'tre candidat que dans une seule circonscription. (V. p. 242.) Il y a des causes d'inligibilit qui vicient l'lection. Il en est qui rsultent dela perte de la jouissance du droit desuffrage. (V. p. 122.) Il en est qui rsultent d'autres faits enlevant seulement l'exercice du droit, telle l'inligibilit absolue qui frappe les militaires en activit de service (1. 30 nov. 1875, art. 7), telle l'inligibilit relative qui frappe certains fonctionnaires. (L. 30 nov. 1875, art. 12; V. p. 124.) Il y a des causes d'incompatibilit qui empchent l'lu de conserver son mandat si une certaine situation de fait est maintenue. La principale de ces causes est le cumul d'une fonction publique rtribue sur les fonds de l'tat avec le mandat de dput. (L. 30 nov. 1875, art. 8-12; V. p. 127.) antrieures au scrutin. Convocation 177. Oprations des lecteurs. La convocation est faite par dcret; la date pour laquelle elle doit tre faite est fixe dans les diffrentes hypothses: 1 en cas de renouvellement par expiration normale des pouvoirs de la Chambre, l'lection doit avoir lieu dans les soixante jours qui prcdent l'expiration des pouvoirs (1. J6 juin 1885, art. 6); 2 en cas de renouvellement aprs dissolution, l'lection doit tre faite dans les deux mois (l. c. 14 aot 1884, art. 1er); 3 en cas d'lection partielle par suite de dcs, dmission ou autrement, l'lection doit avoir lieu dans le dlai d'un mois. (L. 30 nov. 1875, art. 16.) Comme dans tous ces cas, il faut laisser place pour une priode lectorale de vingt jours au moins entre le dcret de convocation et le jour de l'lection, le dcret de convocation doit paratre vingt jours au moins avant l'expiration deces diffrents dlais. Priode lectorale. La priode lectorale dure au moins vingt
LECTIONS A LA CHAMBRE DES DPUTS jours francs entre le dcret de O. 1852, art. 4.) Depuis la loi sairement se produire pendant candidature. (V. p. 242). Pour torales, V. p. 243.)
311
convocation et le jour du scrutin. (D. du17 juillet 1889, un fait doit ncescette priode, c'est la dclaration de les faits de presse et les runions lec-
Il peut y avoir deux tours de 178. Opration du scrutin. scrutin. Au premier tour, l'lection a lieu la majorit absolue, au second tour la majorit relative; le second tour de scrutin a lieu le second dimanche qui suit la proclamation du rsultat du premier tour. Le scrutin a lieu un dimanche (cependant ce n'est pas obligatoire pour le premier tour). Il est ouvert depuis huit heures du matin jusqu' six heures du soir. Dans les communes o cela paratrait ncessaire, les prfets pourront prendre des arrts pour devancer l'heure de l'ouverture. (Pour les formalits du scrutin et pour le recensement gnral des votes, Y. p. 244 et s.) La Chambre a le droit de 179. Contentieux lectoral. vrifier elle-mme les pouvoirs de ses membres, ce qui donne lieu la vrification des pouvoirs. (V. p. 250.) N 2. lections au Snat. (L. 24 fvr. 1875; l. 2 aot 1875; l. 9 dc. 1884; l. 26 dc. 1887.) Est ligible tout Franais g de quarante 180. ligibles. ans au moins et jouissant de ses droits civils et politiques. (L. 9 dc. 1884, art. 4.) Aucune condition spciale de domicile ou autre n.'est exige. Pas n'est besoin d'une dclaration de candidature. Il y a des inligibilits, les unes rsultant de la perte de la jouissance du droit de suffrage (v. p. 122), les autres de la perte de l'exercice de ce droit. Sont dans ce dernier cas: 1 l'inligibilit absolue qui ; mme lgislation que pour frappe les militaires en activit de service la Chambre des dputs, sauf que les amiraux et les marchaux de France sont ligibles au Snat sans l'tre la Chambre (V. p. 124); 2 les inligibilits relatives rsultant de certaines fonctions publiques. (L. 2 aot 1875, art. 21. V. p. 124.) Il y a des incompatibilits; en vertu de la loi du 26 dcembre 1887, provisoirement elles sont les mmes que pour la Chambre des dputs, (V. p. 127.) 181. lecteurs. Les snateurs sont lus au scrutin de liste
312
ORGANISATION DE L'TAT ou de la colonie et
par un collge runi au chef-lieu du dpartement compos.
1 Des dputs du dpartement; 2 Des conseillers gnraux du dpartement; 3 Des conseillers d'arrondissement du dpartement; 4 Des dlgus lus parmi les lecteurs de la commune par chaque conseil municipal du dpartement ; les conseils composs de dix membres liront un dlgu; les conseils composs de douze membres liront deux dlgus; ceux de dix-neuf, trois; ceux de vingt-un, six; ceux de vingttrois, neuf; ceux de vingt-sept, douze; ceux de trente, quinze ; ceux de trente-deux, dix-huit; ceux de trente-quatre, vingt-un : ceux de trentesix et au-dessus liront vingt-quatre dlgus. Le conseil municipal de Paris lira trente dlgus. (L. 9 dc. 1884, art. 6.) Les conseils qui ont un, deux ou trois dlgus nomment un supplant, ceux qui ont six ou neuf dlgus nomment deux supplants, ceux qui ont douze ou quinze dlgus nomment trois supplants, ceux qui ont dix-huit ou vingt-un dlgus nomment quatre supplants, le conseil municipal de Paris nomme huit supplants. Les supplants remplaceront les dlgus en cas de refus ou d'empchement, selon l'ordre fix par le nombre des suffrages obtenus par chacun d'eux. (Art. 8.) lection des dlgus par les conseils municipaux. (L. 2 aot 1875modifiepar loi 9 dc. 1884.) I. La date laquelle doit avoir lieu l'lection des dlgus est fixe par un dcret du chef de l'tat en mme temps que la date de l'lection snatoriale. Il doit y avoir un mois d'intervalle entre ces deux lections et, d'autre part, le dcret doit tre rendu cinq semaines avant l'lection snatoriale, il doit donc tre rendu peu prs douze jours avant l'lection des dlgus (1. 2 aot 1875, art. 1er). L'heure de la runion des conseils municipaux est fixe ensuite par arrt prfectoral. Le maire notifie par crit cet arrt chacun des conseillers, en indiquant le lieu de la runion. (D. 3 janv. 1876, art. 3.) II. L'lection se fait sans dbat au scrutin secret, et, le cas chant, au scrutin de liste, la majorit absolue des suffrages. Aprs deux tours de scrutin la majorit relative suffit, et, en cas d'galit de suffrages, le plus g est lu. Il est procd de mme et dans les mmes formes l'lection des supplants. Le choix des conseils municipaux ne peut porter ni sur un dput, ni sur un conseiller gnral, ni sur un conseiller d'ariondissement. Il peut porter sur tous les lecteurs de la commune, y compris les conseillers municipaux. Dans les communes o il existe une dlgation spciale institue en vertu de l'art. 44 de la loi du 5 avril 1884, les dlgus snatoriaux sont nomms par l'ancien conseil. (Art. 2 et 3, l. 1875.) III. Si les dlgus n'ont pas t prsents l'lection, notification leur en est faite dans les vingt-quatre heures par les soins du maire. Ils doivent faire parvenir au prfet dans les cinq jours l'avis de leur accep-
LECTIONS AU SNAT
313
tation. En cas de refus ou de silence, ils sont remplacs par les supplants, qui sont alors ports sur la liste comme dlgus de la commune; si leur tour ceux-ci refusent ou s'ils laissent passer le dlai de cinq jours sans envoyer l'avis de leur acceptation, le prfet doit prendre un arrt l'effet de convoquer le conseil municipal pour la dsignation de nouveaux dlgus. Si les dlgus sont membres du conseil municipal et assistent au vote, ils doivent faire connatre sance tenante leur acceptation ou leur refus qui est consign au procs-verbal. S'ils refusent, le conseil municipal doit pourvoir leur remplacement. (Art. 4.) IV. Le procs-verbal de l'lection des dlgus et des supplants est transmis immdiatement au prfet ; il mentionne l'acceptation ou le refus des dlgus et supplants, ainsi que les protestations leves contre la rgularit de l'lection par un ou plusieurs membres du conseil municipal. Une copie de ce procs-verbal est affiche la porte de la mairie. (Art. 5.) V. Un tableau des rsultats de l'lection des dlgus et des supplants est dress dans la huitaine par le prfet; ce tableau est communiqu tout requrant, il peut tre copi. Tout lecteur a de mme la facult de prendre dans les bureaux de la prfecture communication et copie de la liste, par commune, des conseillers municipaux du dpartement et, dans les bureaux des sous-prfectures, de la liste par commune des conseillers municipaux de l'arrondissement. (Art. 6.) VI. Des protestations peuvent tre formes contre l'lection des dlgus : 1 les conseillers municipaux peuvent protester au procs-verbal 2 tout lecteur de la commune peut, dans un dlai de trois jours, adresser directement au prfet une protestation contre la rgularit de l'lection ; 3 si le prfet estime que les oprations ont t irrgulires, il a le droit d'en demander l'annulation. (Art. 7.) Les protestations relatives l'lection des dlgus ou des supplants sont juges, sauf recours au Conseil d'tat, par le conseil de prfecture et dans les colonies par le conseil du contentieux. Le dlgu, dont l'lection est annule, est remplac par le supplant. En cas d'annulation de l'lection du dlgu et de celle du supplant, comme au cas de refus ou de dcs de l'un et de l'autre aprs leur acceptation, il est procd de nouvelles lections par le conseil municipal au jour fix par un arrt du prfet. (Art. 8.) Le dlai pour faire appel au Conseil d'tat de la dcision du conseil de prfecture est, depuis la loi du 22 juillet 1889, de deux mois. Ni la protestation devant le conseil de prfecture, ni le recours devant le Conseil d'tat n'ont d'effet suspensif, les dlgus conservent donc l'exercice de leur mandat jusqu' ce qu'il ait t annul, soit par le conseil de prfecture, soit par le Conseil d'tat. VII. Huit jours au plus tard avant l'lection des snateurs, le prfet et, dans les colonies, le directeur de l'intrieur, dresse la liste des lecteurs du dpartement par ordre alphabtique. La liste est communique
314
ORGANISATION DE L'TAT
tout requrant et peut tre copie et publie. Aucun lecteur ne peut avoir plus d'un suffrage. (Art. 9.) 1 Les dputs, les membres du conseil gnral ou des conseils d'arrondissement qui auraient t proclams par les commissions de rencensement, mais dont les pouvoirs n'auraient pas t vrifis, sont inscrits sur la liste des lecteurs et peuvent prendre part au vote. (Art. 10.) 182. lection des snateurs. (D. O. 2 fvr. 1852: D.R. 2 fvr. 1852; L. 2 aot1875modifie par l. 9 dc. 1884.) Convocationdu collgelectoral. Nous avons vu que le collge lectoral est convoqu par le mme dcret qui prescrit l'lection des dlgus municipaux. (V. p. prcd.) Priode lectorale. Runions. La priode lectorale s'ouvre ds le dcret de convocation, mais, par la force des choses, elle ne prend de l'importance qu' partir du jour de la nomination des dlgus, parce qu' partir de ce jour-l seulement il ya des lecteurs en nombre suffisant pour tenir des runions lectorales. On sait que, ici par exception, ces runions peuvent tre tenues le jour mme du scrutin. (L. 30 juin 1881, art. 3.) La dclaration de la runion sera faite par deux lecteurs au moins. Peuvent seuls assister la runion les candidats ou leurs mandataires et les lecteurs snatoriaux. L'autorit municipale veillera ce que nulle autre personne ne s'y introduise. Les dlgus et supplants justifieront de leur qualit par un certificat du maire de la commune, les candidats ou mandataires par un certificat du fonctionnaire qui aura reu la dclaration de la runion. Lieu du scrutin. Le prfet dsigne le local dans lequel doit se runir le collge lectoral et il prend les mesures ncessaires pour que cette dsignation soit connue des lecteurs. Bureau. Le collge lectoral est prsid parle prsident du tribunal civil du chef-lieu du dpartement ou de la colonie. Le prsident est assist des deux plus jeunes lecteurs prsents l'ouverture de la sance. Le bureau ainsi compos choisit un secrtaire parmi les lecteurs. Si le prsident du tribunal est empch, il est remplac par le vice-prsident et, son dfaut, par le juge le plus ancien. (L. 2 aot 1875, art. 12.) Le bureau rpartit les lecteurs, par ordre alphabtique, en sections de vote comprenant au moins cent lecteurs; il nomme les prsidents et scrutateurs de chacune des sections. Il statue sur les difficults et contestations qui peuvent s'lever au cours de l'lection, sans pouvoir toutefois s'carter des dcisions rendues en vertu de l'art. 8 de la loi et relatives l'lection des dlgus. (Art. 13.) Pour toute-s les autres attributions du bureau, voir ce qui a t dit cidessus propos des lections. (V. p. 244.) Dure du scrutin. Il y a trois tours de scrutin dans la mme journe. 1. C'est--dire qu'un dput, qui serait en mme temps conseillergnral, n'aurait qu'un seul suffrage.
DES CHAMBRES FONCTIONNEMENT
315
Le premier scrutin est ouvert huit heures du matin et ferm midi; le second est ouvert deux heures et ferm cinq heures ; le troisime est ouvert sept heures et ferm dix heures. Les rsultats des scrutins sont recenss par le bureau et proclams immdiatement par le prsident du collge lectoral. (Art. 14.) Pour la rception des votes et le dpouillement, rgles ordinaires. De mme pour les procs-verbaux sur lesquels des protestations peuvent tre immdiatement formules. Majorit requise. Nul n'est lu snateur l'un des deux premiers tours de scrutin s'il ne runit: 1 la majorit absolue des suffrages exprims; 2 un nombre de voix gal au quart des lecteurs inscrits. Au troisime tour de scrutin, la majorit relative suffit, et, en cas d'galit des suffrages, le plus g est lu. (Art. 15.) Indemnit des dlgus. Les dlgus qui auront pris part tous les scrutins recevront sur les fonds de l'tat, s'ils le requirent, sur la prsentation de leur lettre de convocation vise par le prsident du collge lectoral, une indemnit de dplacement qui leur sera paye sur les mmes bases et de la mme manire que celle accorde aux jurs par les art. 35,90 et suiv. du dcret du 18 juin 1811. (Art. 17. V. rglement du 26 dc. 1875.) Obligation du vote. A l'inverse, les lecteurs qui ne votent pas sont frapps d'une amende de 50 francs. (Art. 18.) Article III. Fonctionnement de la Chambredes dputs Snat. et du
La Chambre des dputs et le Snat suivent sur ce point les mmes rgles, qui sont celles de toutes les assembles dlibrantes. (V. p. 257 et s.) Elles ont des sessions pendant lesquelles elles tiennent des sances en vue de la prparation et du vote de dlibrations. Unit de la session parlementaire. 183. Des sessions. La premire rgle poser, c'est que les deux Chambres tiennent session en mme temps. (L. const., 16 juillet 1875, art. 1.) Il y a seulement deux cas o le Snat sige en l'absence de la Chambre des dputs: 1 Lorsque la Chambre des dputs tant dissoute, la prsidence de la Rpubliquedevient vacante. (L. const. 16juillet 1875, art. 3 4.) 2 Lorsqu'il sige comme haute-courde justice (L.const., 16juil. 1875, art. 12). En dehors de ces exceptions, toute assemble de l'une des deux Chambres qui serait tenue hors du temps de la session commune est illgale et nulle de plein droit. (L. 16 juillet 1875, art. 4.) Rglesdes sessions. Il y a une session ordinaire par an; elle
316
ORGANISATION DE L'TAT
s'ouvre de plein droit le second mardi de janvier sans convocation, elle doit durer au moins cinq mois, elle est clture par dcret. Il peut y avoir des sessions extraordinaires. Dans ce cas, les Chambres sont convoques par dcret. L'initiative de la convocation peut venir du gouvernement. Elle peut venir des Chambres elles-mmes. Lechef de l'tat est tenu de convoquer lorsque la majorit absolue des membres dans chaque Chambre le demande. Le chef de l'tat a le droit d'ajourner les Chambres pour une dure qui ne peut excder un mois, et il ne peut user de ce droit plus de deux fois en une session. Les deux Chambres sigent Paris (1. 184. Des sances. 22 juillet 1879), chacune d'elles est matresse de dsigner le palais qu'elle veut occuper. Le quorum, ou nombre de membres prsents ncessaires pour que les Chambres puissent dlibrer, est de la moiti plus un des siges que compte l'Assemble. Si ce nombre n'est pas atteint, le vote est renvoy au lendemain, et alors il est valable quel que soit le nombre des prsents. Les Chambres lisent chacune leurs bureaux compose d'un prsident, de plusieurs vice-prsidents, de secrtaires et de questeurs; le bureau est nomm pour un an, et doit tre lu ds le dbut de la session ordinaire. Le prsident dirige les dbats, veille la police de l'Assemble, il a la rquisition directe de la force arme. (L. 22 juillet 1879, art. 5.) Les sances sont publiques ; il doit y avoir des procs-verbaux et des comptes rendus. (V. p. 259 et s.) Pour et des votes. 185. Du travail prparatoire tout ce qui concerne la division des Chambres en bureaux, la nomination des commissions, les rgles du vote, voir la thorie gnrale des assembles dlibrantes. (P. 262 et s.) Art. IV. vnements qui mettent fin au mandat de snateur ou de dput. Ces vnements sont: 1 L'expiration normale des pouvoirs; 2 Pour les dputs seulement, la dissolution de la Chambre; 3 Le dcs; 4 La dmission volontaire. Cette dmission doit tre adresse au prsident, elle doit tre accepte par la Chambre;
FONCTIONNEMENT DES CHAMBRES
317
5 La dchance prononce. Sera dchu de la qualit de membre lgislatif tout dput qui, pendant la dure de son mandat, aura t frapp d'une condamnation emportant privation du droit d'tre lu la dchance sera prononce par le corps lgislatif sur le vu des pices lgislatives. Art. 28, D. O. janvier 1852. La dchance s'applique aux snateurs comme aux dputs. (L. 2 aot 1875, art. 27). 6 L'acceptation par un dput ou un snateur de fonctions publiques salaries incompatibles avec le mandat. (L. 30 novembre 1875, art. 8 et 11; L. 16 dcembre 1887. V. p. 128 et s.) Article V. Caractres gnraux du mandat de snateur et de dput. Pour cette matire, qui est relative la prohibition du mandat impratif, l'indemnit parlementaire, l'immunit parlementaire et l'inviolabilit parlementaire, voir Thorie du mandat lectif. (p. 267). DE L'ORGANE LGISLATIF 2. ATTRIBUTIONS Article Ier. Attributions constitutionnelles. Les Chambres ont des attributions constitutionnelles et des attributions administratives; en effet le Parlement est la fois un pouvoir et une autorit administrative. Nous ne faisons qu'indiquer les attributions constitutionnelles. 187. I. Les Chambres participent au pouvoir excutif en ce sens qu'elles surveillent l'organe excutif1. Il y a l une attribution essentielle dans le rgime parlementaire, car c'est la mise en jeu de la responsabilit ministrielle. Les moyens mis la disposition des Chambres pour l'exercice de ce contrle sont les suivants: 1 Des comptesrendus faits spontanment parles ministres, le plus connu est celui que fait priodiquement le ministre des affaires trangres sous le nom de livre jaune. 2 Des questions ou des interpellations faites aux ministres par les membres des Chambres, et destines provoquer des explications 1. Il estun cas o le Snat collabore encore plus intimement avec le pouvoir excutif, c'est quand il donne son avis conforme la dissolution de la Chambredes dputs. (L. c. 25 fvrier 1875,art. 5, 1er.)
318
ORGANISATION DE L'TAT
de la part des ministres. Il y a cette diffrence essentielle entre la question et l'interpellation que l'interpellation seule se termine par un ordre du jour de la Chambre. C'est--dire par une opinion formule par celle-ci sur la conduite du ministre. La Chambre peut voter un ordre du jour de confiance ou un ordre du jour de blme, ou bien l'ordre du jour pur et simple. L'ordre du jour pur et simple a toujours la priorit. Sa vritable signification est que la Chambre tient l'interpellation pour non-avenue, par consquent il a un sens favorable. Il y a entre la question et l'interpellation d'autres diffrences de pure forme: la question est pose verbalement condition que le ministre ait t prvenu avant la sance ; nul autre que l'auteur de la question ne peut intervenir dans la discussion ; l'auteur de la question peut toujours la transformer en interpellation. L'interpellation ncessite une demande crite adresse l'avance et sur laquelle la Chambre statue en fixant un jour pour l'interpellation. Les interpellations sur la politique intrieure ne peuvent tre renvoyes au del d'un mois. La Chambre peut d'ailleurs carter l'interpellation par la question pralable. Les interpellations donnent lieu une discussion gnrale. 3 Des enqutes parlementaires que chaque Chambre peut ordonner pour faire la lumire sur certains actes des ministres. 188. II. Les Chambres ont des attributions judiciaires. Le Snat est rig en haute cour de justice : 1 Pour juger le prsident dela Rpublique en cas de haute trahison; 2 Pour juger les ministres pour crimes commis dans l'exercice de leurs fonctions; 3 Pour juger toute personne prvenue d'attentat commis contre la sret de l'tat. Dans les deux premiers cas, le Snat est saisi par la Chambre des dputs qui joue le rle de Chambre de mises en accusation. Dans le dernier cas, il est saisi par dcret du chef de l'tat rendu en conseil des ministres; la Chambre ne joue aucun rle. (L. const., 16 juillet 1875, art. 11; 1. 10 avril 1889.) 189. III. Enfin les Chambres ont des attributions lgislatives qui sont les principales. Les Chambres ont pour mission de faire des lois sur toute espce d'objet, c'est--dire de dfinir le Droit en tablissant des rgles gnrales obligatoires pour les citoyens. Article II. Attributions administratives. 190. Les Chambres sont de vritables autorits administratives
DES CHAMBRES ATTRIBUTIONS
319
qui font nombre d'actes d'administration. La vritable nature de ces actes n'apparat pas au premier abord parce qu'ils sont faits en forme de lois; mais le langage traduit la ralit des choses en appelant ces actes des lois d'affaires ou d'intrt local, ou bien des actes lgislatifs, ou bien des actes parlementaires. 191. Actes faits les Chambres considres par 1 Actes de tutelle sur comme autorits administratives. les dpartements, communes, etc. La loi de finance fixe annuellement le maximum des centimes additionnels aux impts directs que le conseil gnral pourra voter. Une loi est ncessaire pour autoriser un emprunt dpartemental lorsque le remboursement doit demander plus de quinze ans (l.10 aot 1871, art. 41). Pour autoriser un emprunt communal dont la somme dpasse un million, soit en ellemme, soit runie aux chiffres d'autres emprunts non encore rembourss (1. 5 avril 1884, art. 143). Pour autoriser l'emprunt fait par un hospice ou tout autre tablissement charitable, lorsque le chiffre dpasse 500,000 francs en lui-mme ou runi aux chiffres d'autres emprunts non encore rembourss (1. 1884, art. 119). Pour prononcer la dclaration d'utilit publique de certains travaux dpartementaux ou communaux, tels que les chemins de fer d'intrt local, etc. 2 Loi du budget annuel de l'tat. Le budget des recettes est un acte d'autorit qui permet la perception des impts ; le budget des dpenses est un acte d'autorit qui sert d'appui tous les actes de gestion faits par les ministres pour l'accomplissement des services publics, si bien que ceux-ci ne font qu'excuter le budget. 3 Lois particulires, dclarant l'utilit publique de grands travaux, autorisant les alinations du domaine de l'tat, etc. Tous ces actes sont des actes d'autorit et ils ne sont susceptibles d'aucun recours raison de la forme lgislative qu'ils revtent ; mais les Chambres doivent observer spontanment certaines formalits, ainsi quelques-unes de ces lois doivent tre prcdes d'enqutes, de consultations des conseils gnraux, etc. , Article III. Nature et forme des actes. 192. Les actes des Chambres sont toujours des dlibrations, mais il y en a de diffrentes espces : il y a notamment des lois, des ordres dujour, des rsolutions. Un caractre commun ces dlibrations est qu'elles sont souveraines, et qu'aucun recours contentieux n'est possible contre elles,
320
DE L'TAT ORGANISATION
mme lorsqu'elles renferment de vritables actes d'administration, ainsi qu'il arrive pour les lois d'affaires 1. Elles diffrent par la forme. Les ordres dujour et les rsolutions sont soumis un seul vote et ne sont point promulgus; de plus, ils sont l'uvre d'une seule Chambre. Les lois sont soumises une procdure toute diffrente. 193. Confection de la loi. Les deux chambres ayant les mmes pouvoirs en matire de lgislation, et une mme loi devant tre vote il importe peu en principe qu'une loi soit vote pour les deux chambres, en premier lieu par la Chambre des dputs ou par le Snat. Il y a cependant une exception pour les lois de finances, elles doivent tre en premier lieu prsentes la Chambre des dputs et votes par elle. (L. const., 24 fvrier 1875, art. 8.) Cette disposition a donn lieu, une controverse clbre : lorsque le Snat est saisi en second lieu du projet de budget, peut-il y inscrire des crdits nouveaux ou y rtablir des crdits supprims par la Chambre, et celle-ci peut-elle ratifier ces modifications? L'argument pour soutenir la ngative, c'est que pour chaque crdit rtabli par le Snat, supposer que la Chambre accepte ensuite le crdit, le vote du Snat aurait prcd celui de la Chambre, alors que d'aprs la Constitution cela ne doit pas avoir lieu. Le Snat pourrait donc refuser des crdits, il ne pourrait pas en tablir. L'interprtation qui a prvalu est moins judaque. La loi de finances forme un tout ; c'est cette loi prise dans son ensemble qui doit tre prsente d'abord la Chambre, mais le Snat a le droit d'apporter des amendements. D'ailleurs si le conflit doit clater, il clatera toujours; le jour o on empcherait le Snat de rtablir un crdit ne pourrait-il pas rejeter en bloc le budget? La prrogative de la Chambre est dj assez grande, elle lui permet de prendre tout son temps pour l'examen du budget. et des de lois. On appelle projets de lois propositions desprojets Dpt de lois ceux qui manent du gouvernement ; les projets manant de l'initiative parlementaire prennent le nom de propositions de lois. Ily a entre ces deux formes de projets des diffrences plus apparentes que relles au point de vue du dpt. Les propositions de lois sont soumises l'examen d'une commissiond'initiative et un vote de la Chambre sur la prise en considration; les projets de lois sont dispenss de cette double formalit. Mais comme dans la pratique la prise en considration est presque toujours vote, cela ne cr pas une grande prrogative pour les projets de loi gouvernementaux. Projets et propositions de loi sont rdigs par crit et prcds d'un 1. Il y a eu parfois des commissionsparlementaires qui formulaient des dcisions opposables aux particuliers (revision des grades, revision des marchs de la dfense nationale). Ces dcisions participaient du caractre des actes parlementaires, elles n'taient susceptibles d'aucun recours.
ATTRIBUTIONS DES CHAMBRES
321
expos des motifs. Le prsident de la Chambre en ordonne l'impression, la distribution et le renvoi aux bureaux pour la nomination d'une commission d'tude. (V. p. 263.) Discussion et vote de la loi. Lorsque la commission d'tude a termin son travail d'examen, elle charge un de ses membres de rdiger un rapport. Dpt du rapport en sance publique, impression, distribution, fixation d'un jour pour la discussion. La discussion ne peut avoir lieu au plus tt que vingt-quatre heures aprs la distribution du rapport, moins qu'il n'y ait eu dclaration d'urgence. Le vote d'une loi donne lieu dans chaque Chambre deux dlibrations des intervalles de cinq jours au moins. Dans certains cas exceptionnels une dlibration suffit: 1 Quand l'urgence a t dclare; 2 Pour les lois du budget, les lois des comptes, les lois d'intrt local,c'est--dire presque toutes les lois d'affaires. Il est suivi dans les deux dlibrations une marche en sens inverse. La premire comporte : 1 une discussion gnrale; 2 la discussion des : 1 les articles sparment ; articles ; dans la seconde dlibration on vote 2 l'ensemble du projet. Dans la premire dlibration, le passage la discussion des articles, la question de savoir si l'on passera une seconde dlibration donnent lieu des consultations de la Chambre et des votes. laborationpar la seconde Chambre. Les projets de loi vots par une Chambre sont transmis l'autre, soit par le gouvernement, soit par le prsident de la Chambre lorsqu'ils manent de l'initiative parlementaire. Le dlai est d'un mois, il est rduit trois jours en cas de dclaration d'urgence. La seconde Chambre suit la mme procdure que la premire. Si elle adopte le projet dans les mmes termes, la loi est dfinitivement vote et il y a lieu de la transmettre au chef de l'tat en vue de la promulgation. (V. p. 66.) Si des modifications sont apportes par la seconde Chambre, le texte modifi est soumis la premire Chambre et ainsi de suite jusqu' accord complet. Les Chambres ont d'ailleurs la facult de nommer une commission d'tude commune qui tiendrades confrencesparlementaires, mais elles n'usent pas frquemment de cette facult. Les projets de loi vots par une Chambre et rejets par l'autre ne peuvent tre repris par l'initiative parlementaire avant le dlai de trois mois.
H.
21
CHAPITRE
II
ORGANISATION DU DPARTEMENT1
Il y a dans la 194. Renseignements statistiques. France continentale 86 dpartements, plus le territoire de Belfort. Ils contiennent 362 arrondissements et 2,870 cantons. Leur superficie moyenne est de 675,000hectares; leur population moyenne de 440,000 habitants, mais avec des carts considrables. Le total de leurs budgets s'levait, au 31 dcembre 1889, 258,000,000 de francs. Celui de leurs dettes 527,220,000 francs. Le revenu de leur domaine, qui est peu important, ne dpasse gure un million. Aux dpartementsde la France continentale, il faut ajouter les trois dpartements algriens. La division de la relatives au territoire. 195. Rgles France en dpartements, la subdivision des dpartements en districts, celle des districts en cantons, a t dcide, en principe, par la loi des 22 dcembre 1789-janvier 1790; elle a t excute par la loi des 15 janvier-16 fvrier 1790 qui contient un tableau annex; enfin, elle a t reproduite par la loi du 28 pluvise an VIII. Il y a eu quelques modifications la liste des Dpartements. dpartements, rsultant d'vnements purement intrieurs, sans parler de celles qui ont rsult d'annexions ou de cessions de territoire. C'est ainsi que le dpartement du Rhne et celui de la Loire, d'abord runis, furent diviss par la loi du 29 brumaire an II; que le dpartement de Tarn-et-Garonne fut form par un snatus-consulte du 4 novembre 1808 avec des cantons pris aux dpartements voisins. Actuellement, les circonscriptions des dpartements ne pourraient tre modifies que par une loi. Quant aux chefs-lieux, la loi de 1790 avait dcid que, dans un certain nombre de dpartements, il y aurait un alternat entre plusieurs villes; cette rgle, peu pratique, fut abroge, et une loi du 12 septembre 1791 fixa dfinitivement les 1. Sur l'origine de la personnalitadministrativedu dpartement.(V.p. 225.)
HISTOIRE
323
chefs-lieux. Il semblerait en rsulter qu' l'avenir les chefs-lieux ne ; cependant, sous le premier pourraient tre modifis que par une loi et le second empire, des changements ont t oprs par dcret. Le conseil gnral doit toujours tre appel donner son avis sur les modifications apporter la circonscription, ou sur le changement du chef-lieu. (L. 10 aot 1871, art. 50.) Les districts avaient t Arrondissements. supprims par la Constitution de l'an III, la loi de pluvise an VIII les a rtablis sous le nom d'arrondissements. La circonscription des arrondissements ne peut tre modifie que par une loi, mais, d'aprs une pratique constante, le chef-lieu peut tre dplac par dcret. Dans l'un ou l'autre cas, le conseil d'arrondissement et le conseil gnral du dpartement doivent tre consults. (L. 10 mai 1838, art. 41; 1. 10 aot 1871, art. 50.) Cantons. La circonscription des cantons ne peut tre modifie que ; le chef-lieu de canton peut tre dplac par dcret. Dans par une loi l'un ou l'autre cas, le conseil d'arrondissement et le conseil gnral doivent tre consults. (Eod.) de l'organisation 196. Histoire dpartementale. Ancien rgime. A la veille de la Rvolution, la France tait divise en trente quatre gnralits, dans chacune desquelles se trouvait un intendant. Dans les pays d'lection, la gnralit tait subdivise en lections o l'intendant avait un subdlgu. Dans les pays d'tat (six gnralits seulement), elle tait subdivise en baillages ou vigueries sous l'autorit des tats. Les intendants taient tout-puissants, mme dans les pays d'tat Sachez, dit Law d'Argenson, que le royaume de France est gouvern par trente intendants; que vous n'avez ni tat, ni parlement, ni gouverneurs, ce sont trente matres des requtes, commis aux provinces, de qui dpendent le malheur ou le bonheur de ces provinces, leur abondance ou leur strilit. L'intendant avait, en effet, beaucoup plus de pouvoirs que nos prfets d'aujourd'hui; il s'appelait intendant dejustice police et finance. Tout ce que le roi lui-mme avait le droit de faire, il le faisait par dlgation. C'tait la centralisation absolue, en ce sens qu'il n'y avait pas une autorit municipale, ni provinciale, susceptible d'une initiative particulire. En mme temps, au milieu de cette unit et de cette centralisation administrative extrme, il y avait une grande varit de murs et d'institutions secondaires, tenant la vieille division ethnique des provinces englobes dans les gnralits.
324
ORGANISATION DU DPARTEMENT
Organisation de 1790. L'Assemble nationale a certainement voulu dtruire la centralisation de l'ancien rgime. C'est pour cela qu'elle a supprim les gnralits et les intendants, procd une nouvelle division administrative, et donn aux dpartements une organisation qui, dans sa pense, devait rveiller la vie locale. Mais elle a voulu, du mme coup, dtruire les vieilles institutions particulires des provinces. Elle a voulu, en un mot, qu'il y et une vie locale, mais que partout cette vie locale ft mene par les mmes Franais, non pas par des Bretons l'ouest, des Provenaux aux midi, etc. C'est pour cela que les dpartements morclent les provinces, au lieu que les gnralits les runissaient. La premire organisation des dpartements date de 1790, dans la loi mme qui portait leur cration territoriale, elle est aussi loigne que possible de l'organisation des gnralits : 1 Le systme de la collgialit absolue est substitu au systme de l'unit absolue. Dans la gnralit, il y avait un intendant qui faisait tout ; dans le dpartement, il y aura un directoire, compos de plusieurs membres, qui fera tout. Dans l'lection il y avait un subdlgu, dans le district il y aura un directoire. 2 L'intendant et le subdlgu taient des agents du pouvoir central, sans aucune attache dans la rgion; les directoires de dpartement et de district seront lus par la circonscription. Ils sont d'ailleurs sous les ordres de conseils lus qui se runissent une fois par an, comme de petits tats, et dans le sein desquels ils rentrent momentanment, 3 Les directoires recueillent la plupart des attributions des intendants. Ils sont chargs : de l'impt; dela justice administrative (1. 11 septembre 1790, titre XIV), ils ont les attributions qui seront plus tard confies aux conseil de prfecture; de l'alination des biens nationaux; de la tutelle des communes, car le roi ne correspond pas directement avec les communes. Ils ont, sauf pour les objets les plus importants, un pouvoir de dcision propre; leurs dcisions peuvent bien tre annules par le roi, mais il n'y a auprs d'eux aucun reprsentant du roi pour faire respecter son autorit. Il n'y a qu'un procureur syndic, sorte de ministre public charg de faire respecter la loi, mais nomm comme eux l'lection. Ce fut bientt l'anarchie. Les vices de cette organisation taient : 1 L'excs du principe de la collgialit; il fallait, pour le moindre acte la signature de tous les membres prsents du directoire; 2 La complication des rouages cause des directoires de district;
HISTOIRE
325
3 L'absence de lien et d'articulation avec le pouvoir central. Organisation de l'an III. Dans l'organisation du 5 fructidor an III, la deuxime organisation rvolutionnaire qui ait fonctionn, on s'effora de faire disparatre les deux derniers inconvnients. 1 On supprima les directoires de district, et on tcha de faire l'conomie du rouage intermdiaire entre le dpartement et les communes, par une organisation toute spciale du canton. Il y avait dans chaque commune, deux officiers municipaux, et la runion au cheflieu de chaque canton de ces officiers des communes, formait la municipalit de canton qui grait les intrts communs de tout le canton. C'tait encore trop compliqu. 2 On tcha de relier davantage les administrations des dpartements au pouvoir central, par l'institution de commissaires nomms par le Directoire excutif auprs du directoire de dpartement et de la municipalit de canton. Ces commissaires n'avaient pas voix dlibrative, mais ils taient chargs de surveiller et de requrir l'excution des lois. On respecta le principe de la collgialit, et le principe de l'lection des membres des directoires et municipalits de canton. Seulement il est remarquer que les conseils adjoints aux directoires ont disparu. Organisation de l'an VIII. Avec l'organisation de l'an VIII, nous sommes rejets tout fait vers le systme des intendants : 1 action confie un seul homme, le prfet, suppression de la collgialit ce point de vue; 2 le prfet nomm par le pouvoir central et en correspondance constante avec lui; 3 suppression de toute lection locale. En mme temps, rtablissement du district sous le nom d'arrondissement, et suppression des municipalits de canton. Toutefois, l'influence de la collgialit ne devait pas compltement disparatre, on donnait comme auxiliaire au prfet, deux conseils: L'un, le conseil de prfecture, devait tre son auxiliaire dans l'intrt de l'tat, et recevait en mme temps les attributions judiciaires qui avaient appartenu aux directoires; l'autre, le conseil gnral, devait tre l'auxiliaire du prfet dans l'intrt du dpartement. Mais ce n'taient que des conseils non lus et sans pouvoir propre ; on peut dire qu'il n'y avait dans le dpartement qu'un seul organe, le prfet. Organisation actuelle, datant des lois du 22 juin 1833 et 10 mai 1838. Actuellement, il y a dans le dpartement deux organes : Le prfet, organe excutif nomm par l'tat; Le conseil gnral, organe dlibrant lu (complt depuis 1871
326
ORGANISATION DU DPARTEMENT
par une dlgation permanente appele commission dpartementale). 1 Cette organisation nouvelle est le rsultat d'une transaction entre le principe de la collgialit et celui de l'administrateur unique, analogue celle qui a triomph dans l'organisation de l'tat et dans celle de la commune. Les dcisions de principe doivent tre prises par une agence collective, mais l'excution doit tre confie un administrateur agissant seul. 2 Il y a dcentralisation, parce que le conseil gnral est lu par la population du dpartement. Historiquement, ce double rsultat provient d'une transformation du conseil gnral de l'an VIII. Ce conseil, qui n'tait au dbut qu'un auxiliaire du prfet, dont les membres taient dsigns par le pouvoir central et qui n'avait pas de pouvoirs propres, a t rendu lectif en 1833, et a reu en 1838 des pouvoirs de dlibrations. Ses attributions ont t encore augmentes par les lois de 1866 et de 1871, qui lui ont donn la dcision dans un grand nombre d'affaires. Ds lors, au lieu d'tre un auxiliaire, le conseil gnral est devenu une autorit parallle et mme, sous un certain sens, le suprieur du prfet. Les bienfaits de cette organisation nouvelle sont assezvidents pour frapper les esprits les plus prvenus. Depuis la loi du 10 aot 1871, grce surtout la cration de la commission dpartementale, la vie locale s'est merveilleusement veille dans le dpartement. Vingtannes de fonctionnement rgulier ont donn aux conseils gnraux le sentiment de leur pouvoir en mme temps que celui de leur responsabilit. Ils ont bien gr les services dpartementaux, ils ont fait des ils ont cr des chemins de crations et commenc des rformes., fer d'intrt local, des institutions d'assistance, l'enseignement agricole, etc. Partout ils ont mis l'tude l'importante question de la refonte de la voirie dpartementale. La lecture de leurs procs-verbaux qui sont publis tous les ans, ou simplement celle des Annales des assembles dpartementales, rsum de leurs travaux que M. de Crisenoy publie galement tous les ans depuis 1886, laisse une impression de satisfaction. C'tait prvoir d'ailleurs. Une assemble dpartementale est l'abri des grandes agitations de la politique, l'atmosphre y est plus calme qu'au Parlement; d'un autre ct il y a plus de lumires et moins d'esprit de coterie que dans un conseil municipal. On pourra tendre encore dans l'avenir les attributions des conseils gnraux et par consquent augmenter les droits du dpartement.
LE PRFET SECTION Ire. ORGANE EXCUTIF DU DPARTEMENT. LE L'organe excutif du dpartement est le est un fonctionnaire de l'tat, il y a l une l'tat sur le dpartement. Il n'y a pas lieu de revenir sur les rgles au prfet. (V. n 160.) Il faut se proccuper butions.
327 PRFET.
prfet. Comme le prfet mainmise nergique de d'organisation relatives seulement de ses attri-
du prfet 197. Attributions comme autorit admi Le prfet en cette qualit n'a nistrative dpartementale. que deux attributions : 1 la prparation des dcisions du conseil gnral et de la commission dpartementale; 2 l'excution de ces dcisions (loi 10 aot 1871, art. 3). En dehors de ces deux cas, mme quand, avec un pouvoir de dcision propre, il exerce quelque droit qui semble tre dpartemental, il est reprsentant du pouvoir excutif de l'tat. (V. nombreux exemples dans le dcret du 25 mars 1852, tableau A.) 1 Instruction pralable des affaires. Toutes les affaires soumises au conseil gnral ou la commission dpartementale doivent tre instruites par le prfet, c'est--dire que le prfet doit donner son avis; il y a l une rgle obligatoire, des dcisions de conseils gnraux ont t annules pour l'avoir mconnue. (D. 27 fvr. 1874, 2 juill. 1874.) Le prfet fait des rapports au conseil gnral qui sont imprims et distribus tous les membres huit jours au moins avant l'ouverture de la session; la session d'aot, il doit joindre au rapport sur les affaires spciales un rapport ou compte rendu complet sur la situation gnrale du dpartement. (L. 1871, art. 56). Cette prparation des affaires se fait dans les bureaux de la prfecture, aussi les conseils gnraux votent-ils des fonds pour contribuer, dans une certaine mesure, au traitement des employs. 2 Excution des dcisions. L'excution des dcisions du conseil gnral ou de la commission dpartementale peut tre obtenue par de simples mesures de fait, mais elle peut aussi demander des actes d'administration. Dans tous les cas c'est le prfet qui excute. a) Il fait les nominations aux emplois crs par le conseil gnral. b) Il passe les contrats et les marchs sur avis conforme de la commission dpartementale. (Art. 54.) c) Il reprsente le dpartement en justice, moins que le litige ne
328
ORGANISATION DU DPARTEMENT
se soit lev entre le dpartement et l'tat, auquel cas il reprsente l'tat, le dpartement tant alors reprsent par un membre de. la commission dpartementale dsign par celle-ci. Il intente les actions en vertu de la dcision du conseil gnral. Il dfend aux actions sur avis conforme de la commission dpartementale. Il fait seul tous actes conservatoires et interruptifs de dchance. Art. 54.) d) Il rpartit les crdits vots, toutes les fois que ce droit n'a pas t rserv la commission dpartementale par la loi1 et il a l'ordonnancement des dpenses. 198. Force excutoire des actes du prfet. Pour savoir quelle est la force excutoire des actes du prfet dans sa mission d'organe excutif du dpartement, il faut consulter les dcrets du 25 mars 1852 et du 13 avril 1861; en gnral il a des pouvoirs .propres. Il est surveill par le conseil gnral et surtout par la commission dpartementale. Mais ces assembles n'ont pas de pouvoir direct sur lui; elles peuvent seulement agir en adressant directement des rclamations au ministre, ou bien par des moyens politiques, par exemple en provoquant un conflit. SECTIONII. ORGANE DLIBRANT DUDPARTEMENT Conseil gnral et commissiondpartementale. GNRAL 1er. LE CONSEIL Article Ier. Rgles d'organisation. Il y a un con199. Rgles gnrales de composition. seil gnral par dpartement. Le conseil gnral est une assemble dlibrante compose de reprsentants lus au suffrage universel direct, raison de un par canton, quelle que soit la population du canton. Les conseils gnraux sont renouvelables par moiti de trois en trois ans, ce qui porte six ans la dure du mandat de chaque con1. V. sur ce point ce qui a t dit p. 221sur le partage des pouvoirs entre l'organe excutifet l'organe dlibrant.
ORGANISATION GNRAL DU CONSEIL
329
seiller. Le roulement rgulier des sries est tabli l'heure actuelle, mais il peut se faire qu'un conseil soit dissous ; la suite de la dissolution, il y a une lection intgrale. Alors, pour rtablir le roulement, la session qui suit cette lection, le conseil gnral divise les cantons en deux sries en rpartissant autant que possible dans une proportion gale les cantons de chaque arrondissement dans chacune des sries, et il procde un tirage au sort entre les deux sries pour rgler l'ordre du renouvellement; la premire srie sortante ne fait que trois ans. (Art. 21.) Le conseil gnral doit toujours tre au complet. Lorsqu'un membre disparat il y a lieu lection complmentaire. Toutefois, si le renouvellement lgal de la srie' laquelle appartient le sige vacant, doit avoir lieu avant la prochaine session ordinaire du conseil gnral, l'lection partielle se fera la mme poque. (Art. 22.) lecteurs. Ce 200. lections au conseil gnral. sont les lecteurs ordinaires. (V. p. 106.) ligibles. Sont ligibles tous les citoyens gs de vingt-cinq ans : 1 inscription accomplis qui runissent les deux conditions suivantes sur une liste lectorale quelconque, ou justification du droit tre inscrit avant le jour de l'lection ; 2 attache lgale avec le dpartement tablie par l'un ou l'autre des faits suivants: a) domicile; b) inscription au rle d'une des contributions directes au 1er janvier de l'anne dans laquelle se fait l'lection, ou justification du droit y tre inscrit; c) hritage d'une proprit froncire fait depuis le 1er janvier dans le dpartement. Toutefois, le nombre, des conseillers gnraux non domicilis ne pourra pas dpasser le quart du nombre total dont le conseil doit tre compos, sinon il y aura limination par voie de tirage au sort. (L. 1871, art. 6 et 17.) A. Il y a des inligibilits. I. Les unes rsultent de la privation de la jouissancedu droit par suites de certaines condamnations. (V. p. 122.) A signaler seulement certaines inligibilits temporaires : est inligible pendant trois ans le conseiller gnral condamn pour avoir pris part une runion illgale du conseil, ou une confrence interdpartementale dissoute (1.1871, art. 34 et 91). Est inligible pendant un an le conseiller dclar dmissionnaire pour refus d'accomplir une fonction lgale. (L. 7 juin 1873.) II. D'autres inligibilits rsultent de la privation de l'exercice du droit. Sont inligibles: a) les interdits (D. 1852); b) les demi-interdits (1. 1871, art. 7) ; c) les fonctionnaires numrs dans l'article 8 loi 1871 ; il est remarquer que toutes ces inligibilits de l'article 8 sont relatives, l'exception de celle qui frappe les militaires en activit de
330
ORGANISATION DU DPARTEMENT
service qui a t rendue absolue par uneloi du 23 juillet 1891. (V. p. 123.) B. Il y a des incompatibilits. I. Il y a des incompatibilits rsultant du cumul du mandat avec une fonction publique: 1 d'une faon absolue dans le cas de fonction de prfet, sous-prfet, secrtaire gnral, conseiller de prfecture, commissaire et agent de police; 2 d'une faon relative dans le cas d'agents salaris sur les fonds dpartementaux. (L. 1871, art. 9 et 10.) II. Il y a encore incompatibilit dans le cas de cumul de deux mandats de conseiller gnral (art. 11) et dans celui de cumul du mandat de conseiller gnral evec le mandat de conseiller d'arrondissement. (L. 22 juin 1833, art. 14.) Convocation des lecteurs. Les collges lectoraux sont convoqus par dcret (art. 12). Toutefois, le dcret est lanc pour le dpartement tout entier; les cantons o doit avoir lieu l'lection sont ensuite dsigns par arrt du prfet. S'il s'agit de fixer la date pour laquelle la convocation doit tre faite, il faut distinguer les hypothses: 1 en cas de renouvellement normal des sries, la seule rgle est celle qui rsulte de la dure du mandat de chaque srie. Le mandat ne doit pas durer plus de six ans, par consquent les lecteurs doivent tre convoqus avant l'expiration des six ans. Ils ne doivent pas non plus tre convoqus trop tt; le pouvoir excutif ne doit pas pouvoir abrger le mandat; cependant, cet gard, il n'y a pas de rgle et le chef de l'tat jouit d'une certaine latitude (art. 12) ; 2 en cas d'lection gnrale aprs dissolution, l'lection doit avoir lieu le quatrime dimanche qui suit le dcret de dissolution, moins qu'une loi ne soit intervenue pour fixer une autre date (art. 35-36) ; 3 en cas d'lection complmentaire par suite de dcs, option, dmission, vacance d'un sige ou pour toute autre cause, l'lection doit avoir lieu dans le dlai de trois mois. (Art. 22.) Priode lectorale. La dure de la priode lectorale est de quinze jours francs entre la date du dcret de convocation et le jour de l'lection. Pour les faits de presse et les runions lectorales, rgles ordinaires. (V. p. 243.) Scrutin. Il peut y avoir deux tours de scrutin. Le premier doit ; le second, s'il est ncessaire, a lieu toujours avoir lieu un dimanche le dimanche suivant (art. 12). Le scrutin est ouvert sept heures du matin et clos le mme jour six heures. et s.) Pour toute la procdure du scrutin, rgles ordinaires. (V. p. 244 Le recensement gnral des voix est fait par le bureau du chef-lieu de canton, auquel les procs-verbaux de chaque commune sont ports immdiatement par deux membres du bureau. (Art. 13.)
GNRAL ORGANISATION DU CONSEIL
331
Contentieux lectoral. Le contentieux des lections appartient au Conseil d'tat. Peuvent former des rclamations: 1 les lecteurs du canton, les candidats, les conseillers gnraux pour toute espce de motifs; 2 le prfet pour inobservation des conditions et formalits prescrites, mais ces expressions sont interprtes largement. Les rclamations des particuliers doivent tre formes dans les dix jours qui suivent l'lection. Pour le prfet, le dlai est de vingt jours, partir du jour de la rception des procs-verbaux des oprations lectorales. (Pour le surplus, voir p. 250 et s.) Les 201. Fonctionnement des conseils gnraux. conseils gnraux ont des sessions, pendant lesquelles ils tiennent des sances consacres la prparation et au vote de dlibrations. Sessions. Les conseils gnraux ont deux sessions ordinaires par an. L'une qui commence le premier lundi qui suit le 15 aot et qui ne peut excder un mois 1, l'autre qui commence le second lundi aprs le jour de Pques et qui ne peut excder quinze jours. Ils peuvent avoir des sessions extraordinaires : 1 sur convocation du chef de l'tat; 2 sur convocation du prfet, lorsque les deux tiers des membres ont adress une demande crite au prsident. La dure des sessions extraordinaires ne doit pas excder huit jours. (L. 1871, art. 23-24; l. 12 aot 1876.) Toute runion tenue par le conseil en dehors des sessions, ou dans une session prolonge au del de son terme est illgale: la dlibration est nulle, les membres du conseil sont passibles des peines de l'art. 258 C. P. (Art. 34.) Sances. Pour tout ce qui concerne les sances, le quorum ncessaire pour dlibrer, le bureau, la publicit des sances, etc., voir la thorie gnrale des assembles dlibrantes (p. 257 et s.). Il faut ajouter seulement que le prfet a entre au conseil, qu'il assiste aux dlibrations, qu'il est entendu quand il le demande; il se retire lorsqu'il s'agit de l'apurement de ses comptes. (Art. 2.) Prparation et vote des dlibrations. (V. galement p. 262.) Les conseils gnraux peuConfrences interdpartementales. vent correspondre entre eux et mme dbattre des intrts communs dans des confrences interdpartementales. Aces confrences, chaque conseil gnral est reprsent, soit par sa commission dpartementale, soit par une commission spciale. Les prfets peuvent toujours assister ces confrences, et ils devraient dissoudre la runion si des questions trangres au but taient mises en discussion. Les dcisions 1. Pour le conseil gnral de la Corse, cette session commencele deuxime lundi de septembre. (L. 31 juillet 1875.)
332
ORGANISATION DU DPARTEMENT
prises ne sont excutoires qu'aprs avoir t ratifies par tous le conseils gnraux intresss. (Art. 89-91.) Dissolution des conseils gnraux. Il est ncessaire que le che de l'tat ait le droit de dissoudre les conseils gnraux, mais il faut prendre garde qu'il n'en abuse. Ce droit est soigneusement rgle ment dans les art. 35 et 36. La premire rgle qui ressort de ce c'est les conseils textes, que gnraux ne peuvent pas tre dissou tous la fois par mesure gnrale. On a voulu viter le retour d'un mesure aussi regrettable que le fut le dcret du 26 dcembre 1870. Un conseil gnral peut tre dissous par mesure spciale. Si les Chambre sont en session, le chef de l'tat leur rend compte immdiatement, s elles ne sont pas en session, le dcret doit tre motiv et contenir en mme temps convocation des lecteurs. 202 vnements fin au mandat de con qui mettent Ces vnements sont: seiller gnral. 1 L'expiration des pouvoirs ou la dissolution de l'assemble; 2 Le dcs ; 3La dmission volontaire. Elle doit tre adresse au prsident du conseil gnral ou de la commission dpartementale, qui avertit le prfet (art. 20). Elle est accepte par le conseil gnral. 4 La dmission force, qui est tantt un moyen de sanction des rgles sur l'ingibilit et sur les incompatibilits, alors elle est prononce par le conseil gnral lui-mme (art. 18); tantt une sanction de l'obligation d'assister aux sances du conseil ou de la commission dpartementale, alors elle est prononce par le conseil ou la commission (art. 19 et 74); tantt enfin une sanction de l'obligation d'accomplir une fonction dvolue par la loi, alors elle est prononce! par le Conseil d'tat. (L. 7 juin 1873.) Sur la gradu mandat. 203. Caractres gnraux tuit du mandat, sur la protection du reprsentant, sur la protection des tiers contre les propos diffamatoires et le vote du reprsentant, voir p. 267 et s. Sur les fonctions individuelles que peuvent tre appels remplir les conseillers gnraux, voir p. 266. Article II. Attributions du conseil gnral.
204. Les conseils gnraux n'ont ni attributions lgislatives ni attibutions judiciaires, ils n'ont que des attributions d'ordre administratif. Il importe de signaler cependant une attribution exceptionnelle d'ordre constitutionnel. Aux termes de la loi du 15 fvrier 1872, si le Parlement tait illgalement dissous ou empch de se runir,
ATTRIBUTIONS DU CONSEIL GNRAL
333
ses conseils gnraux se runiraient de plein droit, pourvoiraient dans aque dpartement au maintien de l'ordre, et nommeraient chacun eux dlgus de faon reconstituer provisoirement une reprsentition nationale. (V. le texte.) Les attributions administratives sont au nombre de quatre: 1 Le onseil gnral prend des dcisions pour exercer les droits du dparementou, par dlgation, certains droits de l'tat; 2 il manifeste es opinions sous forme d'avis, de propositions, de vux, de rclaations au sujet des intrts du dpartement; 3 il procde certaines ominations, comme celle de la commission dpartementale; 4 il xerce un contrle soit sur les actes du prfet, soit sur ceux de la ommission dpartementale. 1 Les dcisions du conseil gnral. [ Le conseil gnral n'a pas eu ds le dbut des pouvoirs de dcion; la loi du10 mai 1838 ne lui avait donn que des pouvoirs de libration, c'est--dire que le pouvoir central ne pouvait dcider ertaines affaires dpartementales que sur avis conforme du conseil gnral. Celui-ci pouvait donc empcher certaines affaires d'aboutir, ais il ne pouvait rien raliser par lui-mme. La loi du 18 juillet 866 la premire lui donna des pouvoirs de dcision, et la loi du 0 aot 1871 augmente les pouvoirs de dcision au point d'en faire droit commun. Les dcisions des dcisions. 205.I. Force excutoire conseil gnral sont des manifestations de volont ; lorsqu'elles excutent, c'est la volont du conseil gnral qui se ralise, mais les n'ont pas toutes la mme force excutoire, c'est -dire qu'elles nt plus ou moins soumises au contrle de tutelle de l'tat; il y a, e point de vue, quatre catgories: a) Dcisions souveraines, excutoires immdiatement et sans aucun ontrle de tutelle. (Art. 37, 38, 1.1871.) b) Dcisions dfinitives, excutoires de plein droit vingt jours aprs clture de la session, si dans ce dlai le prfet n'en a pas demand annulation pour excs de pouvoir ou pour violation d'une disposition la loi ou d'un rglement. Le recours form par le prfet doit tre otifi au prsident du conseil gnral et celui de la commission partementale. Si dans le dlai de deux mois partir de la notificaon l'annulation n'a pas t prononce, la dlibration est excutoire. annulation ne peut tre prononce que par un dcret rendu en Conil d'tat dans la forme des rglements d'administration publique
334
ORGANISATION DU DPARTEMENT
(art. 47). Ces dlibrations sont celles numres aux art. 43-4 c) Dcisions ordinaires, excutoires de plein droit trois mois aprs la clture de la session, si dans ce dlai un dcret motiv, mais no rendu en Conseil d'Etat, n'en a pas suspendu l'excution. La suspen sion peut tre prononce pour simple inopportunit de la mesure. L suspension prononce dure indfiniment. (Art. 48-49.) d) Dcisions soumises approbation. Ces dcisions ne d viennent excutoires qu'aprs l'approbation d'une autorit suprieur cependant elles restent l'uvre du conseil gnral, parce qu'en prin cipe l'autorit qui approuve ne peut pas modifier. (Budgets, compte, certains emprunts.) 1re Observation. Ces diverses dcisions, une fois devenues ex cutoires, chacune suivant les rgles qui lui conviennent, constituen On verra plus loin les voies de recour des actes d'administration. ouvertes contre elles ce titre. 2e Observation. Parmi ces diverses catgories, il y en a une qu forme le droit commun des dlibrations du conseil gnral, c'est catgorie des dcisions soumises suspension pour simple inopportu nit. Cela rsulte de l'art. 48 qui dit, aprs avoir numr quelque hypothses, que ce sont lles pouvoirs du conseil gnral sur tou les autres objets sur lesquels il est appel dlibrer par les lois e rglements, et gnralement sur tous les objets d'intrt dpartemental dont il est saisi, soit par une proposition du prfet, soit par l'initiative d'un de ses membres . A ce point de vue, les conseils gnraux ont moins de pouvoirs que les conseils municipaux. En effet, le droit commun des dlibrations des conseils municipaux est la dlibration rglementaire, excutoire de plein droit un mois aprs rception de la copie la prfecture, moins que l'annulation n'en ait t prononce, et elle ne peut l'tre que pour-violation de certaines conditions lgales. (V. n 259.) Il est vrai que la catgorie des dcisions dfinitives, excutoires si l'annulation n'en a pas t demande dans les vingt jours, toute exceptionnelle qu'elle est, comprend cependant des attributions trs importantes pour les conseils gnraux. Mais ici encore il y a moins de pouvoir pour les conseils gnraux que pour les conseils municipaux, car ces dcisions peuvent tre annules pour excs de pouvoir ce qui est lastique, tandis que celles des conseils municipaux ne peuvent l'tre que pour violation de conditions lgales dtermines. de L'Etat exerce A. Droits 206.11. Objets des dcisions. Par dlgation de l'tat, le conseil gnral exerce dlgation. par certains droits relatifs aux contributions directes: 1 Il rpartit
DU CONSEIL GNRAL ATTRIBUTIONS
335
chaque anne dans sa session d'aot, entre les arrondissements, le contingent du dpartement dans les contributions directes de rpartition. (V. infr., n 409). Il statue sur les rclamations formes par les conseils d'arrondissement contre le contingent assign l'arrondissement, et sur les rclamations des communes contre le contingent assign la commune. Les dcisions du conseil gnral en cette matire sont souveraines, c'est--dire excutoires immdiatement, mais le conseil n'est pas libre de ne pas les prendre ; s'il refuse de procder la rpartition, celle-ci est opre d'office par le prfet d'aprs les bases de la rpartition prcdente. (Art. 37-39.) 2 Il fixe chaque anne dans la limite d'un maximum et d'un minimum le prix de la journe de travail qui sert de base la contribution personnelle (1. 22 juillet 1820). Ici encore dcision souveraine et qui peut tre supple d'office. B. Droits dpartementaux. Le conseil gnral a maintenant l'exercice de tous les droits dpartementaux, sauf respecter les attributions du prfet pour la prparation et l'excution des dcisions1. La loi du 10 mai 1838 et celle du 18 juillet 1866 ne l'appelaient dlibrer que sur les objets prvus par les lois et rglements, (art. 4, 1. 1838 : la loi du 10 aot 1871, art. 48 in fine l'appelle dlibrer sur tous les objets d'intrt dpartemental. Il y a l un progrs considrable accompli. Cela fait du conseil gnral le vrai reprsentant du dpartement. Seulement le conseil gnral ne peut dcider que l o le dpartement a des droits exercer ; l o il y a seulement des intrts, il met des opinions ou des vux. a) Droits de puissance publique. 1. Droits relatifs au budget. Le dpartement est tenu d'avoir un budget et des comptes. Il est intressant de savoir tout d'abord quels sont les pouvoirs du conseil gnral en ces matires, parce que de ces pouvoirs dpendent en un certain sens tous les autres, tout acte d'administration devant se traduire par une dpense et toute dpense devant figurer au budget. Le budjet dpartemental est dress tous les ans par les soins du prfet, vot par le conseil gnral dans sa session d'aot et rgl par dcret. Du moment que le budget est rgl par dcret, il rentre dans cette catgorie de dlibrations du conseil qui ont besoin de l'approbation du chef de l'tat, catgorie infrieure. Il semble donc que le conseil gnral n'ait qu'un faible pouvoir sur son budget, ce qui entranerait faible pouvoir pour tout le reste. Mais il faut faire attention que si l'approbation du chef de l'tat est ncessaire, d'un autre 1. V. ce qui a t dit p. 221 sur le partage des pouvoirs entre l'organe excutif et l'organe dlibrant.
336
ORGANISATION DU DPARTEMENT
ct celui-ci est oblig de la donner et qu'il ne peut pas rformer le budget. Il peut tout au plus y avoir un retard amenant des ngociations. L'examen auquel se livre le chef de l'tat n'a qu'un but, c'est de lui permettre de voir si un certain nombre de dpenses dclares par la loi obligatoires figurent au budget. Ces dpenses, qui taient autrefois beaucoup plus nombreuses, ont t rduites par la loi nouvelle quatre ou cinq. Il s'agit du loyer de certains btiments destins loger les services publics indispensables et des sommes ncessaires l'acquittement des dettes exigibles. (Art. 60, nos 1-4.) Si le conseil omet d'inscrire au budget quelqu'une de ces sommes, le budget n'en est pas moins approuv, seulement la dpense est inscrite d'office, et il yest pourvu au moyen d'une contribution spciale portant sur les quatre contributions directes, et tablie par un dcret ou par une loi, selon qu'on peut ou non se tenir dans les limites fixes annuellement par la loi de finances. Aucune autre dpense ne peut tre inscrite d'office dans le budget ordinaire et les allocations qui y sont portes ne peuvent tre ni changes ni modifies par le dcret qui rgle le budget (art. 60-61). Donc, en ralit, le conseil est matre de son budget, c'est lui qui fait la rpartition entre les sous-chapitres et les articles, c'est lui qui ouvre les crdits supplmentaires et fait les virements dans le crdit rectificatif. Toutefois le conseil gnral est gn : 1 par l'abus de principe de l'imputation des dpenses sur ressources spciales qui fait qu'il n'y a presque pas de fonds libres; 2 par ce fait que l'tat a le maniement de ses deniers, ce qui lui fait perdre le bnfice des intrts de ses fonds disponibles. Quant au compte d'excution du budget, c'est un compte rendu par le prfet, car celui-ci est l'ordonnateur des dpenses du dpartement; il est provisoirement arrt par le conseil gnral et rgl galement par dcret, aprs observations envoyes directement par le prsident du conseil au ministre de l'intrieur. II. Droits de police. Police des fonctionnaires dpartementaux. Le conseil a l'organisation gnrale des services qu'il cre avec des fonds dpartementaux, tels que : cole pratique d'agriculture, service des enfants assists, secours mdicaux domicile, institutions varies d'assistance. La nomination des fonctionnaires appartient au prfet, mais le conseil gnral fixe les cadres gnraux, les rgles du service, les conditions d'aptitude auxquelles les candidats doivent satisfaire. Il n'y a d'exception que pour les archivistes-palographes qui doivent tre choisis parmi les lves de l'cole des Chartes, si le conseil gn-
ATTRIBUTIONS DU CONSEIL GNRAL
337
ral dcide qu'il y aura un fonctionnaire de cet ordre dans le dpartement. (Art. 45.) Tutelle des communes. Le conseil gnral a, dans une certaine mesure, la tutelle des communes; il a sur ce point enlev au prfet quelques-unes de ses attributions. Il a mme t question en 1871 et en 1884 d'aller plus loin encore dans cette voie minemment dcentralisatrice. 1 Il arrte chaque anne sa session d'aot, dans les limites fixes annuellement par la loi de finances, le maximum des centimes extraordinaires que les conseils municipaux sont autoriss voter pour en affecter le produit des dpenses extraordinaires d'utilit communale. Si le conseil gnral se sparesans l'avoir arrt, le maximum fix pour l'anne prcdente est maintenu jusqu' la session d'aot de l'anne suivante. (Art. 42.) 2 Il statue dfinitivement sur les objets ci-aprs : Changements la circonscription des communes d'un [mme canton et dsignation de leurs chefs-lieux, lorsqu'il y a accord entre les conseils municipaux. (Art. 46, n 26.) Sectionnement lectoral des communes. (Art. 43; I.5 avr. 1884. art. 12.) tablissement, suppression ou changement de foires et marchs. (L. 16 septembre 1879; 1. 5 avril 1884 art. 68.) Chemins vicinaux de grande communication et d'intrt commun. Le conseil a ici de grands pouvoirs. D'abord il classe et dclasse les chemins, en dtermine la largeur, opre la reconnaissance des chemins anciens ; ensuite il en prescrit l'ouverture ou le redresse15 et 16 ment, dcisions qui produisent les effets spcifis auxart. l. 21 mai 1836, c'est--dire qui entrainent des attributions de proprit par voie d'alignement' : enfin il rgle les voies et moyens pour l'excution et l'entretien des chemins, il rpartit les subventions accordes sur fonds d'tat ou sur fonds dpartementaux, il dsigne les services auxquels sera confie l'excution des travaux, il fixe le prix des journes de prestation, etc. (Art. 46, nos 7 et 8,) 3 Le conseil gnral donne son avis sur l'application des dispositions de l'art. 90 du Code forestier relatives la soumission au rgime forestier des bois taillis ou futaies appartenant aux communes, et la conversion en bois de terrains en pturages ; sur les dlibrations 1. Ces dcisions que dans la pratique on appelle fixations de trac peuvent tre attaques par les communes si elles leur imposent des dpensesauxquelles elles n'ont pas consenti; quant aux dcisions de classement ou dclarations de vicinalit, ce sont des dcisionsde principe qui ne sont susceptiblesd'aucun recours. (C. d't., 11 dcembre 1891.) H. 22
338
ORGANISATION DU DPARTEMENT
des conseils municipaux relatives l'amnagement, au mode d'exploitation, l'alination et au dfrichement des bois communaux, (art. 50.) Il a aussi de nombreux avis donner en matire d'octrois municipaux. Sur ce point, les pouvoirs du conseil gnral ont t diminus par la loi du 5 avril 1884; il ne donne plus que des avis l o, d'aprs la loi de 1871, il avait un pouvoir de dcision (1. 1884, art. 137), etc., etc. Le conseil gnral n'a pas de droits de police sur les individus. III. Droits relatifs au domaine public dpartemental. Le domaine public inalinable des dpartements ne se compose gure, d'aprs l'opinion courante, que des routes dpartementales. Les conseils gnraux ont le droit de les classer et de les dclasser. (Art. 46, 6 et 8, dcisions dfinitives.) Jusqu' prsent, ils ont surtout us du droit de dclasser. A l'heure actuelle, quarante-cinq dpartements ont dclass leurs routes dpartementales pour en faire des chemins vicinaux de grande communication, et il est prvoir que les autres suivront l'exemple. Le but est l'unification du service de la voirie dpartementale, qui ne comprendra plus ainsi que des chemins vicinaux (de grande et de moyenne communication). Le rsultat est de faire passer ces routes dans le domaine public communal et d'en mettre l'entretien la charge de la commune traverse. Les communes intresses ont vivement rclam, des recours pour excs de pouvoir ont t forms par elles, mais ont t rejets par le Conseil d'Etat, la loi tant formelle. (10 nov. 1876, 27 avr. 1877.) Il faut placer ici la question de l'affectation aux services publics et de la dsaffectation des btiments dpartementaux. Ces btiments sont-ils ou ne sont-ils pas dpendances du domaine public? c'est un point contest, on le verra plus loin (n 370). Toujours est-il, que le conseil gnral statue dfinitivement sur les changements de destination des proprits et des difices dpartementaux, autres que les htels de prfecture et de sous-prfecture, les locaux affects aux cours d'assises, aux tribunaux, aux coles normales, au casernement de la gendarmerie et aux prisons. (Art. 46, n 4.) 1 Impts. Les seuls impts dparteIV. Modes d'acqurir. aux quatre mentaux qui existent sont les centimes additionnels grandes contributions directes de l'tat (impt foncier, cote personnelle-mobilire, portes et fentres, patentes). Un centime additionnel est la centime partie du principal d'un impt pay l'tat. On sait dans chaque dpartement la somme que produit un centime additionnel aux quatre contributions directes: on appelle cela la valeur du centime. Dans la Haute-Garonne, la valeur du centime est de quarante-neuf mille francs, pour le dpartement de la Seine, elle est de
GNRAL DUCONSEIL ATTRIBUTIONS
339
six cent trente-neuf mille francs. Il y a des centimes ordinaires et des centimes spciaux, dont le maximum est fix une fois pour toutes par la loi. Le conseil gnral les vote dans la limite du maximum. Il correspondant aux besoins y a aussi des centimes extraordinaires, nouveaux ou imprvus, dont le maximum est fix annuellement par la loi de finances; le conseil les vote dans la limite du maximum. Au-del il faut autorisation du Parlement. (Art. 40-41.) 2 Travaux publics dpartementaux. Le conseil gnral dcide en matire de travaux dpartementaux, car il statue dfinitivement sur les objets suivants : projets, plans et devis de tous autres travaux excuter sur les fonds dpartementaux et dsignation des services auxquels ces travaux seront confis; offres faites par les communes, les associationsou les particuliers pour concourir des dpenses d'intrt dpartemental; concessions des associations, des compagnies ou des particuliers de travaux d'intrt dpartemental; part contributive du dpartement aux dperses des travaux qui intressent la fois le dpartement et les communes (1.1871, art. 46, 9, 10, 11, 22). Mais lorsqu'il ya lieu de procder une expropriation pour cause d'utilit publique, ce n'est pas lui en principe qui dclare l'utilit publique du travail. b) Droits de personne prive. Pour la gestion du domaine priv du dpartement et l'exercice des droits qui s'y rattachent, le conseil gnral jouit de grands pouvoirs aux termes de l'art. 46 de la loi de 1871, le conseil gnral statue dfinitivement sur les objets ci-aprs : 1 acquisition, alination et change des proprits dsigns, savoir dpartementales, mobilires ou immobilires, quand ces proprits ne sont pas affectes l'un des services numrs au n 4 (htels de prfecture, sous-prfectures, palais de justice, etc.); 2 mode de gestion des proprits dpartementales; 3 baux de biens donns ou pris ferme ou loyer, quelle qu'en soit la dure ; 5 acceptation ou refus de dons et legs faits au dpartement, quand ils ne donnent lieu aucune 14 assurances des btiments dpartementaux; 15 rclamation.; action intenter ou soutenir au nom du dpartement, sauf les cas d'urgence dans lesquels la commission dpartementale pourra statuer; , 16 transaction concernant les droits du dpartement. Une mention spciale doit tre faite pour les emprunts. Les dpartements- comme les communes ne peuvent faire que des emprunts amortissables. Le conseil gnral statue dfinitivement sur les emprunts remboursables dans un dlai de 15 annes; au del de cette limite, il faut autorisation du Parlement. (Art. 40-41.)
340
DU DPARTEMENT ORGANISATION 2 Manifestations d'opinion, nominations, contrle.
207. Manifestations d'opinion. Les manifestations d'opinion sont des avis, des propositions, des rclamations et des vux; elles sont relatives de simples intrts dpartementaux. En principe, elles n'ont aucune force excutoire. Les rclamations et les vux ne sont pas ncessairement suivis d'effet. Les avis, le gouvernement est quelquefois tenu de les prendre, mais il n'est jamais tenu de les suivre. Il n'en est pas tout fait de mme des propositions ; parfois elles lient en un certain sens le gouvernement. Ainsi en est-il dans le cas de certains secours distribuer sur fonds d'tat, le gouvernement qui doit demander des propositions au conseil gnral n'est pas li quant au chiffre des sommes, mais quant l'ordre de distribution : Les secours pour les travaux concernant les glises et presbytres; les secours gnraux des tablissements et institutions de bienfaisance; les subventions aux communes pour acquisition, construction et rparation de maisons d'cole et de salles d'asile; les subventions aux comices et associations agricoles ne pourront tre allous par le ministre comptent, que sur la proposition du conseil gnral qui dressera un tableau collectif des propositions, en les classant par ordre d'urgence. (L. 1871, art. 68.) La plus importante des nominations 208. Nominations. auxquelles procde le conseil gnral est celle de la commission dpartementale (V. n 213). Mais il peut avoir aussi nommer une commission pour une confrence interdpartementale, dsigner des conseillers gnraux qui remplissent des fonctions individuelles, par exemple ceux qui sigent au conseil dpartemental et au conseil acadmique, etc. 1. Le contrle exerc parle conseil sur les actes 209. Contrle. de la commission dpartementale sera tudi propos de cette commission. Quant celui sur les actes du prfet, il est exerc au moyen des comptes rendus que le prfet est tenu de faire (V. p. 197) ; au moyen de renseignements demands aux chefs de service du dpartement (art. 52); enfin, au moyen d'enqutes que des membres du conseil gnral peuvent faire sur place (art. 51); tout cela est sanctionn par le droit qu'ont les conseils gnraux de correspondre directement 1. Les nominationsconstituent-elles des lections et y a-t-il lieu d'organiser un contentieux lectoral? Y. n 213et la note.
ATTRIBUTIONS DU CONSEIL GNRAL
341
avec le ministre par l'intermdiaire de leur prsident, et de lui adresser des rclamations. (Art. 51.) Article III. Nature et forme des actes, voies de recours.
210. Nature et forme des actes. Tous les actes du conseil gnral, assemble dlibrante, sont des dlibrations; celles de ces dlibrations, qui contiennent dcision excutoire, constituent en outre des actes d'administration. Les dlibrations sont soumises toutes les conditions de fond et de forme qui ont t tudies propos de la thorie des assembles dlibrantes. Elles doivent tre prises dans une session rgulire, dans une sance tenue d'une faon rgulire, avec le quorum ncessaire pour dlibrer, en observant les rgles du scrutin, et tre constates rgulirement au procs-verbal. 211. Recours Les dlibrations des et voies de nullit. conseils gnraux peuvent tre attaques deux titres diffrents : 1 A titre d'actes d'administration. Lorsqu'elles renferment une dcision et qu'elles sont devenues rellement excutoires, c'est--dire : si ce sont des dcisions dfinitives, lorsque le dlai de vingt jours est pass sans que le prfet en ait demand l'annulation; si ce sont des dcisions ordinaires, lorsque le dlai de trois mois est pass sans que le chef de l'tat les ait suspendues ; elles peuvent alors tre attaques par le recours pour excs de pouvoir aux termes du droit commun, ou mme en cas de violation d'un droit formel par un recours contentieux ordinaireport devant le Conseil d'tat. (C d't., 4juillet 1864.) 2 Simplement titre de dlibration, mme lorsqu'elles ne contiennent pas de dcision mais seulement un vu, une rclamation ou un blme l'administration ou une nomination. Dans ce second cas, y a-t-il quelque voie de nullit? Un point qui nous semble certain c'est qu'il n'y a pas devoie de nullit gnrale. La loi du 10 aot 1871 ne contient aucune disposition analogue celle de l'art. 63 de la loi municipale qui dclare frappes d'une nullit radicale, invocable toute poque et partout intress, les dlibrations des conseils municipaux qui sont prises en violation d'une loi ou d'un rglement d'administration publique, et les nullits ne se supplent pas. Il n'y a nullit que dans deux cas prvus aux art. 33 et 34 de la loi de 1871 : a) La dlibration a t prise en dehors des runions, c'est--dire des sessions rgulires. Elle est nulle de droit. Le prfet prononce cette nullit par arrt motiv (Art. 34.); b) La dlibration est relative un objet qui n'est pas de la com-
342
ORGANISATION DU DPARTEMENT
ptence du conseil; alors, sur la demande du prfet, elle est annule par dcret rendu en la forme des rglements d'administration publique, c'est--dire en assemble gnrale du Conseil d'tat (art. 33). Une application particulire de cette nullit est faite aux vux politiques interdits au Conseil par l'art. 51, 3. Dans ces deux cas, la nullit est absolue, peut tre dclare toute poque, et qu'elle ait t dclare ou non, est invocable par toute partie intresse. (Av. Cons. d'tat, 6 mars 1873.) La doctrine qui restreint ainsi les voies de nullit peut avoir des inconvnients pour les dlibrations contenant dcision si le prfet les laisse devenir excutoires en ngligeant de provoquer dans les dlais leur annulation ou leur suspension, et si les parties intresses laissent passer les dlais d'un recours pour excs de pouvoir. Cela est fcheux, mais la doctrine s'appuie sur l'art. 47 de la loi de 1871 par un argument a contrario. Du moment, en effet, que le prfet peut demander la nullit des dcisions dfinitives qui sont prises en violation d'une loi ou d'un rglement d'administration publique, dans un dlai de vingt jours, avant que la dcision ne soit excutoire, c'est qu'il ne le peut plus une fois que ce dlai est pass et que la dcision est devenue excutoire. Cet argument a conlrario, appuy sur le principe que les voies de nullit ne se supplent pas, est trs fort. On peut invoquer en ce sens un arrt du Conseil d'tat du 23 mars 18801. DPARTEMENTALE 2. DE LACOMMISSION 212. La commission dpartementale est une manation du conseil gnral charge de le suppler dans une certaine mesure dans l'intervalle des sessions. C'est donc encore un organe dlibrant. La commission dpartementale a t cre en 1871, mais l'ide n'en est pas neuve en France ; quelques-uns de nos anciens tats provinciaux avaient des dlgations, et les directoires de l'organisation rvolutionnaire n'taient autre chose qu'une dlgation permanente de conseils gnraux. A l'tranger, il existe dans l'organisation provinciale des comits permanents un peu partout, en Belgique, en Prusse, en Autriche-Hongrie, en Italie, en Espagne, etc. Article 1er. Organisation de la commission dpartementale. 213. Composition. La commission dpartementale est lue
1. Ceci ne s'applique qu'aux dcisions dfinitiveset aux dcisions soumises 38), on peut conve suspension. Quant aux dcisions dites souveraines(art. 37, nir en s'appuyant sur les mots conformmentaux rglestabliespar les lois de l'art. 37, qu'elles pourraient tre annules pour illgalit.
LA COMMISSION DPARTEMENTALE
343
par le conseil gnral chaque anne, la fin de la session d'aot; elle se compose de quatre membres au moins et de sept au plus et elle comprend un membre choisi autant que possible parmi les conseillers lus ou domicilis dans chaque arrondissement. Les membres de la commission sont indfiniment rligibles (art. 69). Les fonctions de membre de la commission dpartementale sont incompatibles avec celles de maire du chef-lieu du dpartement et avec le mandat de dput ou de snateur (art. 70, remani par l. 19 dcembre 1876). Le vote a lieu au scrutin secret. (Art. 30, 3.) Accidentellement, un conseil gnral peut avoir nommer sa commission dpartementale une autre poque : 1s'il a t dissous, aussitt aprs la rlection (art. 35-36) ; 2 s'il y a conflit entre la commission dpartementale et le prfet et que le conseiljuge propos de nommer une nouvelle commission. (Art. 85.) Les protestations contre l'lection ou la nomination des membres de la commission dpartementale sont actuellement sans juge, le Conseil d'tat s'tant dclar incomptent. (C. d't.,8 mai 1885)1. 214. Fonctionnement de la commission dparte La commission dpartementale est une assemble dmentale. librante, qui tient des sessions et des sances en vue de prendre des dlibrations. La commission dpartementale tient une session ordinaire par mois, elle fixe elle-mme l'poque et le nombre de jours2. Le prfet et le prsident de la commission peuvent la convoquer en session extraordinaire. (Art. 73). Rgles des sances. La commission dpartementale est prsi1. La question est de savoir si c'est une vritable lection ou bien une nomination. Si on considre que c'est une lection,le Conseild'tat est comptent pour le contentieux de cette lection parce qu'il est le juge de droit commun du contentieux administratif. Si on considre que ce n'est pas une lection, il ne subsiste alors contre la dlibration que les causes de nullit des art. 33 et 34. C'est sans doute ce systme que s'est ralli le Conseil d'tat ; bien que l'art. 69 emploie deux reprises le mot lection, il a considr que ce n'en tait pas une puisque la loi n'avait pas organis de contentieux. On comprend d'autant mieux qu'il hsite reconnatre le caractre d'lection, qu'il y a bien d'autres cas o le conseil gnral procde des nominations et qu'il faudrait y tendre la mme solution, nomination du bureau, nomination de commissions, dsignation de conseillers pour des fonctions individuelles, etc. 2. Ellene pourrait pas indirectement se constituer en permanence en dcidant que sa session durera tout le mois; ce serait contraire l'esprit de la loi, et mme au texte qui suppose des sessions extraordinaires et par consquent des intervalles entre les sessionsordinaires.
344
ORGANISATION DUDPARTEMENT
de par le plus g de ses membres. Elle lit son secrtaire, elle sige la prfecture et prend, sous l'approbation du conseil gnral et avec le concours du prfet, toutes les mesures ncessaires pour assurer son service. Tout membre de la commission dpartementale qui s'absente des sances pendant deux mois conscutifs, sans excuse lgitime admise par la commission, est rput dmissionnaire. Il est pourvu son remplacement la plus prochaine session du conseil gnral. (Art. 74.) Les membres de la commission dpartementale ne reoivent pas de traitement. (Art. 75.) Le prfet ou son reprsentant assistent aux sances de la commission ; ils sont entendus quand ils le demandent. (Art. 76, 1er.) La commission dpartementale ne Rgles des dlibrations. peut dlibrer si la majorit de ses membres n'est prsente. Les dcisions sont prises la majorit absolue des voix. En cas de partage, la voix du prsident est prpondrante. Il est tenu procs-verbal des dlibrations. Les procs-verbaux font mention du nom des membres prsents. (Art. 72.) Les procs-verbaux ne sont pas publis, ils peuvent seulement tre expdis sous pli cachet aux membres du conseil gnral. Instruction des affaires. La commission peut s'entourer de renseignements: Les chefs de service des administrations publiques dans le dpartement sont tenus de fournir, verbalement ou par crit, tous les renseignements qui lui seraient rclams par la commission sur les affaires places dans ses attributions. dpartementale (Art. 76, 2.) L'art. 84 ajoute : La commission dpartementale peut charger un ou plusieurs de ses membres d'une mission relative des objets compris dans ses attributions. Mais cela n'empche point que l'instruction pralable n'appartienne au prfet, c'est--dire que la commission ne peut statuer sans son avis. Article II. Attributions de la commission dpartementale.
N 1. Attributions dlgues. 215. La commission dpartementale a des attributions qui lui sont dlgues par le conseil gnral. Les conseils gnraux ne doivent pas abuser de cette facult de dlgation, car il est de principe notamment ils doivent ne se la dlgue pas, puissance publique que observer les rgles suivantes: 1 Ils ne doivent dlguer que pour des affaires spciales, non
LA COMMISSION DPARTEMENTALE
345
point pour des catgories d'affaires. Une circulaire ministrielle du 9 aot 1879 semblait admettre la dlgation par catgorie pour des affaires peu importantes, mais devant la rsistance du Conseil d'tat elle a t rapporte le 13 avril 1881. 2 Mme pour des affaires spciales, le conseil ne peut pas dlguer la dcision sa commission si l'affaire est trop importante Il y a ici une question d'apprciation. Ainsi il a t dcid que le conseil peut dlguer le droit de statuer sur le trac d'un chemin d'intrt commun (D. 27 dcembre 1878) sur une question de tramway (Avis minist. 17 aot 1886). Mais qu'il ne peut pas dlguer le droit de dresser les tableaux de proposition pour la rpartition des secours sur fonds d'tat. (Avis minist., 29 aot 1887.) Lorsque la commission dpartementale statue par dlgation, ses dcisions ont la force excutoire qu'auraient eue celles du conseil gnral lui-mme sur les mmes affaires; par suite, elles peuvent, suivant le cas, tre attaques directement devant le Conseil d'tat dans le dlai de vingt jours, ou suspendues par dcret dans le dlai de trois mois (D. Cons.d't.,7 mai 1875.) N2. Attributions propres.
La commission dpartementale a en outre des attributions propres, c'est--dire qui lui ont t donnes directement par la loi. La plupart ont t enleves au prfet. Ces attributions sont relatives des dcisions, desavis, des nominations, des actes de contrle. I. Force excutoire. Toutes les dci216. Dcisions. sions propres de la commission dpartementale sont de la mme ca; seutgorie, elles sont excutoires par elles-mmes immdiatement lement, c'est le prfet qui doit excuter, et il peut s'y refuser en formant devant le conseil gnral, aux termes de l'art. 85, un recours que nous tudierons plus loin n 221. II. Objets des dcisions. La commission dpartementale exerce par dlgation quelques droits de l'tat, par exemple, lors de la confection d'un cadastre, elle approuve le tarif des valuations cadastrales (art. 87, 1er); mais elle exerce surtout des droits dpartementaux. A. Droits de puissance publique. a) Droits de police. Tutelle des communes, hospices, etc. La commission dpartementale, aprs avoir entendu l'avis ou les propositions du prfet, rpartit les subventions diverses portes au budget dpartemental, et dont le conseil gnral ne s'est pas rserv la distribution, les fonds provenant des amendes de police correctionnelle et les fonds provenant du rachat
346
ORGANISATION DU DPARTEMENT
des prestations en nature sur les lignes que ces prestations concernent (art. 81). Elle prononce, sur l'avis des conseils municipaux, la dclaration de vicinalit, le classement, l'ouverture et le redressement des chemins vicinaux ordinaires, la fixation de la largeur et de la limite desdits. Elle exerce cet gard les pouvoirs confrs au prfet par les art. 15 et 16 de la loi du 21 mai 1836. Elle approuve les abonnements relatifs aux subventions spciales pour la dgradation des chemins vicinaux, conformment au dernier paragraphe de l'art. 14 de la mme loi. (L. 1871, art. 86.) Mmes attributions en matire de chemins ruraux. (L. 20 aot 1881, art. 4.) b) Droits domaniaux. La commission dpartementale dtermine l'ordre de priorit des travaux la charge du dpartement, lorsque cet ordre n'a pas t fix par le conseil gnral ; fixe l'poque et le mode d'adjudication ou de ralisation des emprunts dpartementaux lorsqu'ils n'ont pas t fixs par le conseil gnral ; fixe l'poque de l'adjudication des travaux d'utilit dpartementale (art. 81), etc. B. Droits de personne prive. La commission dpartementale autorise le prfet passer les contrats au nom du dpartement et dfendre aux actions. L'art. 54 dit en effet que le prfet doit faire ces deux espces d'actes de la viecivile du dpartement sur avis conforme. Un avis, auquel on est tenu de se conformer, quivaut une autorisation. 217. Nominations. La commission dpartementale assigne chaque membre du conseil gnral et du conseil d'arrondissement le canton pour lequel ils devront siger dans le conseil de rvision. (Art. 82.) Cette disposition se complte par celle de l'art. 18 de la loi du 15 juillet 1889, qui prescrit de choisir des membres autres que ceux qui sont lus dans le canton o la rvision a lieu. La commission dpartementale dsigne aussi les deux conseillers gnraux qui, aux termes de l'art. 34 de cette dernire loi, sont adjoints au conseil de rvision runi au chef-lieu du dpartement, pour prononcer sur les demandes de dispense pour soutien de famille et sur les demandes de sursis d'appel. Enfin, dans le cas ou le dpartement a subventionn une association syndicale, elle nomme des membres de la commission syndicale conformment l'art. 23, 1. 21 juin 1865. (Art. 87, 2.) 218. Avis. La commission dpartementale donne des avis au prfet, ils sont tantt facultatifs, tantt ncessaires (art. 77), mme quand le prfet est tenu de les prendre, en principe il n'est pas tenu
LA COMMISSION DPARTEMENTALE
347
de les suivre, en certains cas, cependant, il est oblig de s'y conformer, par exemple, en matire de dfense aux actions intentes contre le dpartement et de passation de contrats au nom du dpartement. (Art. 54). La commission dpartementale est charge 219. Contrle. de veiller ce que les lections complmentaires au conseil gnral soient faites dans les dlais fixs. (Art. 22, 3.) Le prfet est tenu d'adresser la commission dpartementale, au commencement de chaque mois, l'tat dtaill des ordonnances de dlgation qu'il a reues et des mandats de paiement qu'il a dlivrs pendant le mois prcdent concernant le budget dpartemental. La mme obligation existe pour les ingnieurs en chef, sous-ordonnateurs dlgus . (Art. 78.) A l'ouverture de chaque session ordinaire du conseil gnral, la commission lui fait un rapport sur l'ensemble de ses travaux et lui soumet toutes les propositions qu'elle croit utiles. A l'ouverture de la session d'aot, elle lui prsente dans un rapport sommaire ses observations sur le budget propos par le prfet. Ces rapports sont imprims et distribus, moins que la commission n'en dcide autrement . (Art. 79.) Chaque anne, la session d'aot, la commission dpartementale prsente au conseil gnral le relev de tous les emprunts communaux et de toutes les contributions extraordinaires communales qui ont t vots depuis la prcdente session d'aot, avec indication du chiffre total des centimes extraordinaires et des dettes dont chaque commune est greve (art. 80). La commission dpartementale vrifie l'tat des archives et celui du mobilier appartenant au dpartement (Art. 83.) Article III. Nature et forme des actes, voies de recours. 220. Les actes de la commission dpartementale sont des dlibrations soumises aux conditions ordinaires de forme et de fond. Quand elles contiennent dcision excutoire, ces dlibrations constituent en outre des actes d'administration. Elles sont susceptibles de recours sous les distinctions suivantes: a) Recours pour excs de pouvoir. Les dlibrations qui sont des actes d'administration sont susceptibles d'tre attaques par le recours pour excs de pouvoir selon le droit commun. Cependant, dans les cas des art. 86 et 87, le recours doit tre form dans un dlai de deux mois et il est suspensif de l'excution. b) Recours au conseil gnral dans le cas spcial des articles 86
348
DU DPARTEMENT ORGANISATION
et 87. Dans les cas prvus par les art. 86 et 87, c'est--dire en matire de dcision sur l'ouverture et le classement des chemins visur le tarif des valuations cadastrales, et en macinaux ordinaires, tire de nomination des membres des commissions syndicales, la dlibration peut tre frappe de recours au conseil gnral, par le prfet, par les conseils municipaux et par toute partie intresse. Ce recours est form pour cause d'inopportunit ou de fausse apprciation des faits. Il est notifi au prsident de la commission dans le dlai d'un mois partir de la communication de la dcision. Le conseil gnral statue dfinitivement sa plus prochaine session. Les mmes dlibrations peuvent tre attaques par le recours pour excs de pouvoir qui suit ici quelques rgles spciales. (V. plus haut.) En vue de faire courir les dlais de ces recours, les dcisions doivent tre communiques au prfet, aux conseils municipaux et aux autres parties intresses. (Art. 88.) c) Nullit rsultant des articles 33 et 34, l. 1871 .Le Conseil d'tat admet que les articles 33 et 34 s'appliquent la commission dpartementale aussi bien qu'au conseil gnral, par consquent: 1 les dlibrations prises par la commission irrgulirement runie sont annules par le prfet ; 2 les dlibrations portant sur des objets pour lesquels la commission est incomptente sont annules par dcret en Conseil d'tat sur la demande du prfet. (Avis 13 mars et 31 mai 1873.) Article IV. Du dsaccord et du conflit avec le prfet, du cas o la commission excde ses attributions. Contrle du conseil gnral. 221. Si la commission dpartementale et le prfet sont en dsaccord ou entrent en conflit, le conseil gnral peut tre saisi soit par le prfet soit par la commission. Dans le cas de simple dsaccord, l'affaire est renvoye la plus ; en attendant le prfet surseoit l'exprochaine session du conseil cution. Dans le cas de conflit le conseil doit tre convoqu extraordinairement. La discussion entre le dsaccord et le conflit est une question de fait. Dans le cas o la commission excde ses attributions, le prfet peut encore faire convoquer extraordinairement le conseil pour le saisir. Dans tous ces cas le conseil gnral n'a point annuler les actes de la commission, mais voir s'il doit rvoquer son mandat et en nommer une autre. (art. 85.)' les actes de 1. Il ne s'agit pas ici, croyons-nous, d'une voie de nullit contre
DE LA SEINE LE DPARTEMENT
349
La dlibration du conseil sur ce point est de la catgorie des dcisions dfinitives dont l'annulation peut tre demande dans les vingt jours. (D. Cons.d't. 9 juillet 1874.) Organisation spciale du dpartement de la Seine.
222. Le dpartement de la Seine est dans une situation tout fait particulire, raison de ce fait que la ville de Paris couvre presque en entier son territoire; ce qu'elle ne couvre pas, forme la banlieue. La consquence, c'est que les organes d'administration de la ville de Paris et ceux du dpartement de la Seine ont t en partie confondus. Il y a, dans le dpartement de la Seine, deux prfets: le prfet de police et le prfet de la Seine, l'un charg de la police, l'autre de la gestion domaniale. Ces deux prfets constituent l'organe excutif du dpartement, mais en mme temps, et surtout, ils constituent l'organe excutif de la ville et jouent le rle de maire. Il y a, dans le dpartement de la Seine, un conseil gnral, organe membres. Mais ce conseil dlibrant, compos de quatre-vingt-huit n'est autre que le conseil municipal de la ville de Paris, au nombre de quatre-vingts membres, auxquels viennent s'ajouter huit membres lus par la banlieue. Ce faible apport de l banlieue transforme peine le conseil. La loi du 10 aot 1871 ne s'est pas applique au conseil gnral de la Seine ; il en rsulte que ce conseil n'a pas de commission dpartementale. La loi du 16 septembre 1871, proroge depuis par diverses lois, et notamment par celle du 19 mars 1875, indique les textes qui sont applicables. Pour la nomination des huit conseillers de la banlieue, les rgles ordinaires sur l'lectorat, l'ligibilit et l'lection, sont applicables; les conseillers sont nomms pour trois ans, raison de un par canton, et renouvelables en mme temps. Ils ont t renouvels partir de novembre 1877. (L. 19 mars 1875.) Pour les sessions, le titre II, 1. 22 juin 1833, est applicable; il n'y a qu'une session ordinaire par an. Les attributions sont celles des lois du 10 mai 1838 et du 18 juillet 1866. Dans les arrondissements de Saint-Denis et Sceaux, il n'y a plus de sous-prfet, il y a des conseils d'arrondissement. la commission, comme dans le cas des art. 86 et 87,mais d'un moyen d'action sur la commission elle-mme. Que, si c'est un cas o la commission refuse de statuer, le conseil pourrait statuer sa place, la condition que ce ne ft pas dans une matire o elle a un pouvoir propre. (V.Av. minist., 24 mars 1883.)
350
ORGANISATION DU DPARTEMENT Dpartements algriens.
223. L'Algrie est divise en trois dpartements; ces dpartements sont forms du territoire civil des trois provinces d'Alger, Oran et Constantine; ils sont organiss comme les dpartements franais. 1 Ils sont diviss en arrondissements et en circonscriptions qui remplacent les cantons sans en porter le nom. 2 Il ya deux organes : le prfet, organe excutif; le conseil gnral, complt par une commission dpartementale, organe dlibrant. A. Le prfet est assist d'un secrtaire gnral et d'un conseil de prfecture. Il a les mmes attributions qu'un prfet de France. (D. 24 octobre 1870, art. 7.) B. Le conseil gnral est form de membres franais et de membres indignes. Les membres franais sont nomms au suffrage universel par les lecteurs franais, raison de un par circonscription cantonale. Les membres indignes sont dsigns par le gouverneur gnral. (Avant le dcret de 1870, ils taient lus.) Les conseillers sont nomms pour six ans et renouvelables par moiti. Le conseil a deux sessions ordinaires par an, en octobre et avril. Les attributions du conseil gnral, le degr d'autorit de ses dcisions, les objets dont il s'occupe sont les mmes qu'en France. La commission dpartementale suit aussi les mmes rgles qu'en France. (Il doit y avoir des assesseurs indignes qui ne peuvent tre d'ailleurs prsidents. Voir pour tous ces points, dcr. 23 septembre 1875, qui reproduit presque textuellement la loi de 1871.) Dans l'arrondissement, il y a un sous-prfet qui a des pouvoirs propres un peu plus tendus qu'en France. Il n'y a pas de conseil d'arrondissement. APPENDICE. Organisation de
L'arrondissement ne constitue pas une personne administrative. l'arrondissement. dont la personna(Voir p. 226.) Cependant dans cet arrondissement lit a disparu il subsiste des organes. Nous ne parlons pas du sousprfet qui est uniquement un agent de l'tat, mais du conseil d'arrondissement, assemble lue qui semble tre un organe dlibrant de l'arrondissement lui-mme. Il y a l une anomalie. En 1871 il a t question de supprimer ces conseils, et la loi du 10 aot ne les nomme pas. Ils sont demeurs; il faut en dire un mot en appendice l'organisation dpartementale.
L'ARRONDISSEMENT
351
Comme on ne 224. Conseils d'arrondissements. s'est pas occup d'eux en 1871, la lgislation n'est pas codifie, il faut remonter aux lois antrieures. (L. 28 pluv. an VIII, art 10, 11, 19; 1. 22 juin 1833. art. 20, 21, 24, 28; 1. 23 juillet 1870; 1.10 mai 1838, art. 29 47.) I. Organisation. Les conseils d'arrondissements sont composs d'autant de conseillers qu'il y a de cantons dans l'arrondissement, mais il ne peut y en avoir moins de neuf. Si ce chiffre n'est pas atteint, un dcret dsignera les cantons les plus peupls pour en nommer deux. Les membres du conseil d'arrondissement sont lus pour six ans et renouvels par moiti. Pour les conditions d'ligibilit et pour les lections, renvoi. (V. p. 121 et s. et 238 et s.) Le conseil d'arrondissement a une seule session annuelle partage en deux : moiti avant la session d'aot du conseil gnral, moiti aprs. Il lit son bureau Il peut faire un rglement intrieur, mais il n'y a pas publicit des sances ni des procs-verbaux. II. Attributions. La principale attribution du conseil d'arrondissement est relative l'exercice d'un droit de l'tat; il rpartit, pour les impts directs de rpartition, le contingent de l'arrondissement entre les communes, mais il a aussi des attributions relatives l'arrondissement. Si celui-ci n'a pas de personnalit et par suite pas de droits exercer, en revanche les populations de l'arrondissement peuvent avoir des intrts et le conseil d'arrondissement est charg de dfendre cesintrts en formulant des vux ou en mettant des avis. Rpartition des impts. Dans la premire partie de sa session, le conseil d'arrondissement dlibre sur les rclamations auxquelles Il dlidonnerait lieu la fixation du contingent de l'arrondissement. bre galement sur les demandes en rduction de contributions formes par les communes. (Art. 40, 1. 10 mai 1838.) Dans la seconde partie de sa session, le conseil d'arrondissement rpartit entre les communes les contributions directes (art. 45). Le conseil est tenu de se conformer, dans la rpartition de l'impt, aux dcisions rendues par le conseil gnral sur les rclamations des communes. Faute par le conseil d'arrondissement de s'y tre conform, le prfet, en conseil de prfecture, tablit la rpartition d'aprs lesdites dcisions. (Art. 46.) Si le conseil d'arrondissement ne se runissait pas, ou s'il se sparait sans avoir arrt la rpartition des contributions, les mandements des contingents assigns, chaque commune seraient dlivrs par le prfet, d'aprs les bases de la rpartition prcdente, sauf les modifications apporter dans les contingents en excution des lois. (Art. 47.) Dfense des intrts de l'arrondissement par des avis ou des vux.
352
ORGANISATION DU DPARTEMENT
L'administration peut demander l'avis du conseil d'arrondissement toutes les fois qu'elle le juge utile; dans certains cas elle est oblige de le demander. L'numration de ces cas se trouve dans l'art. 41, 1. 10 mai 1838 : 1 changements proposs la circonscription du territoire de l'arrondissement, des cantons et des communes, et la dsignation de leurs chefs-lieux; 2 classement et direction des chemins vicinaux de grande communication; 3 tablissement et suppression ou changement des foires et marchs; 4 rclamations leves au sujet de la part contributive des communes respectives dans les travaux intressant la fois plusieurs communes ou les communes et le dpartement, et gnralement tous les objets sur lesquels il est appel donner son avis en vertu des lois et rglements. De plus le conseil d'arrondissement peut donner spontanment son avis sur tous les objets d'ulilit publique intressant l'arrondissement, soit que la dcision doive tre prise par le conseil gnral, soit qu'elle doive l'tre par le pouvoir central : 1 sur les travaux de route, de navigation et autres objets d'utilit publique qui intressent l'arrondissement; 2 sur le classement et la direction des routes dpartementales qui intressent l'arrondissement; 3 sur les acquisitions, alinations, changes, constructions et reconstructions des difices et btiments destins la sous-prfecture, au tribunal de premire instance, la maison d'arrt ou d'autres services publics spciaux l'arrondissement, ainsi que sur les changements de destination de ces difices; 4 et gnralement sur tous les objets sur lesquels le conseil gnral est appel dlibrer, en tant qu'ils intressent l'arrondissement. (Art. 42.) Quant aux vux, aux termes de l'art. 44, le conseil d'arrondissement peut en formuler sur les besoins des diffrents services publics en ce qui touche l'arrondissement, ce qui exclut les vux sur l'administration dpartementale, sur l'administration gnrale et les vux politiques.
CHAPITRE
III
ORGANISATION DE LA COMMUNE1
La loi du 5 avril 1884 qui rgle actuellement l'organisation communale est un code complet. Elle a abrog expressment, dans son art. 168, toutes les lois antrieures. Il y a actuelle225 Renseignements de statistique. ment en France trente-six mille cent soixante-une communes. Leur superficie territoriale, leur population, leurs ressources sont trs ingales. Superficie. La superficie moyenne dans l'ensemble du pays est d' peu prs 1,462 hectares. Il y a des rgions entires o toutes les communes sont au-dessous de cette moyenne. La plus petite commune de France est celle de Vaud'herland, dans Seine-et-Oise, qui n'a que 9 hectares, la plus grande, celle d'Arles, qui en a 103,000. Paris a 7,802 hectares. Population. Le chiffre de la population des communes importe bien des gards : pour la fixation du nombre des conseillers municipaux; pour la question de savoir si des parents ou allis peuvent faire partie du mme conseil municipal, ils le peuvent dans les communes qui ont moins de cinq cents habitants; pour la question de savoir comment est rgle la police, dans les villes au-dessus de quarante mille habitants, elle est rgle par dcret du chef de l'tat. Cela importe aussi pour certains impts, notamment pour celui des patentes, etc. Tableau dress au point de vue du nombre des conseillers municipaux. Communesau-dessous de 500 habitants 17.219 10conseillersmunicipaux. de -14.321 12 500 1.500 de 2.724 16 1.501 2.500 de 2.501 3.500 872 21 de 784 23 3.501 10.000 de 10.001 30.000 163 27 de 30.001 6 30 40.000 de 40.001 50.000 13 32 de 50.001 7 34 60.000 au-dessus de 60.000 26 36 1. Pourla personnalit administrative de la commune, v. p. 226. H. 23
354
ORGANISATION DE LA COMMUNE
Dans ce tableau il faut surtout remarquer le nombre considrable des communes qui ont moins de cinq cents habitants. Plus de dix-sept mille sont dans ce cas. Il y en a mme plus de quatre mille qui ont moins de deux cents habitants. Ces communes n'ont videmment pas de ressources suffisantes pour une bonne administration. Dans quelques-unes, la valeur du centime est de 15 ou 20 francs. Ressources et situation financire. Les budgets des communes, Paris non compris, s'lvent 700 millions; celui de Paris 300millions. La dette de Paris atteint 2 milliards; il y a vingt mille autres communes endettes, dont les dettes montent ensemble prs de 1,500 millions. La moyenne des impts communaux connus sous le nom de centimes additionnels est de 55 centimes. Il y a quatre mille deux cent vingthuit communes o le chiffre de 100 centimes est dpass. Prs de douze mille communes possdent des bois titre de biens communaux. Ces bois couvrent plus de 2 millions d'hectares, le quart de la proprit boise. La des communes. 226. Du nom et du territoire Rvolution n'a point touch au nom ni au territoire des communes, elle les a respectes telles qu'elles avaient t lentement formes par l'histoire. Mais il faut prvoir des modifications volontaires, soit au nom, soit au territoire. A. Changement de nom. Le changement de nom d'une commune est dcid par dcret du prsident de la Rpublique, sur la demande du conseil municipal, le conseil gnral consult, et le Conseil d'tat entendu. (Art. 2.) B. Modifications au territoire. Ces modifications peuvent tre : fusion de plusieurs petites communes en de nature trs diffrente une seule; division d'une grande commune en plusieurs petites; rattachement d'une fraction de commune une autre commune; dplacement d'un chef-lieu. Ce que la loi voit avec le plus de faveur, c'est la fusion de plusieurs petites communes en une grande. Malheureusement l'attachement au clocher rend ce phnomne bien rare. Procdure suivre. Les autorits comptentes pour statuer varient suivant les cas. (Art. 5 et 6.) 1 Pour la cration de communes nouvelles et pour les autres modifications si elles entrainent changement la circonscription du dparment, d'un arrondissement ou d'un canton, il est statu par une loi, le conseil gnral et le Conseil d'tat entendus; 2 Pour les simples modifications, lorsque les communes sont situes dans le mme canton et que la modification projete runit, quant au
TERRITOIRE DE LA COMMUNE
355
fond et quant aux conditions de la ralisation, l'adhsion des conseils municipaux et des commissions syndicales intresses, il est statu dfinitivement par le conseil gnral si celui-ci approuve le projet. 3 Dans tous les autres cas il est statu par dcret en Conseil d'tat, le conseil gnral entendu. Avant que la question ne soit soumise la dcision des autorits comptentes, les formalits suivantes auront d tre remplies. (Art. 3 et 4.) 1 Enqute de commodo et incommodo prescrite par le prfet sur le projet de modification, soit d'office, soit sur la demande du conseil municipal de la commune, soit sur la demande du tiers des lecteurs inscrits de la commune ou de la fraction qui demande se sparer. 2 Toutes les fois que le projet intresse une fraction de commune, nomination d'une commission syndicale charge de donner son avis. Un arrt du prfet dcide la cration de cette commission, dtermine le nombre de ses membres et la date de l'lection; sont lecteurs seulement, les lecteurs domicilis dans la fraction de commune. L'lection se fait suivant les rgles des lections municipales. 3 Avis des conseils municipaux, des commissions syndicales et des conseils d'arrondissement. des Les modifications Consquences modificationsterritoriales. au territoire des communes entranent presque toujours des consquences pcuniaires ; en effet, les communes ont un patrimoine, les sections de commune aussi; bien que ces patrimoines appartiennent l'tre moral de la commune ou de la section de commune, les habitants y ont un certain droit, ils profitent de l'actif et souffrent des dettes; faire changer de commune les habitants d'un certain territoire c'est modifier leur situation ce point de vue, les priver de la jouissance de certains biens communaux, de certains difices publics, qu'ils ont contribu faire construire, etc. Les consquences de l'opration mritent d'tre rgles par un vritable trait, que l'on a quelquefois compar soit un contrat de mariage, soit une sparation de biens, mais qui prsente bien plus de rapports avec les traits internationaux contenant cession de territoire. L'art. 7 de la loi se proccupe de ces traits; de cet article, interprt par un important avis du Conseil d'tat du 5 juin 1891, rsultent les rgles suivantes: 1 Le trait rglant les consquences pcuniaires de l'opration, doit tre incorpor l'acte qui statue sur la modification ; 2 Un certain nombre de solutions sont indiques par la loi elle-mme et l'on ne pourrait y droger, ainsi : la commune, runie une autre
356
ORGANISATION DE LA COMMUNE
commune, conserve ( titre de section de commune) la proprit des biens qui lui appartenaient, l'exception des difices et autres immeubles servant un usage public qui deviennent la proprit de la nouvelle commune; il en est de mme pour les biens d'une section de commune runie une autre commune. Les habitants du territoire annex conservent la jouissance des biens communaux dont les fruits sont perus en nature, etc. 3 En dehors de ces solutions indiques par la loi, l'acte statue sur les questions quel'autorit a jug utile de trancher; il n'est pas dit que l'acte doive trancher toutes les questions qui peuvent tre souleves; 4 L o l'acte n'a pas dtermin de situation particulire, il faut appliquer les rgles des cessions de territoire en droit international, c'est-dire que, par une sorte de postliminium, les habitants du territoire rattach une commmune sont censs avoir toujours fait partie de cette commune, par consquent doivent immdiatement prendre leur part de ses charges, etc. Enfin une dernire consquence : dans tous les cas de runion ou de fractionnement de communes, les conseils municipaux sont dissous de plein droit. Il est procd immdiatement des lections nouvelles. Organisation d 227. Histoire de l'organisation. 1790. La commune, qui ia fin de l'ancien rgime n'avait plus de vie locale, a bnfici, comme le dpartement, du zle dcentralisateur de l'Assemble constituante. Il n'est que juste de dire, d'ailleurs, que dj l'dit de 1787 instituant les assembles provinciales avait ouvert la voie. Il organisait des municipalits, et remettait presque entirementla tutelle des communes aux assembles provinciales. Mais il y avait la plus grande bigarrure comme partout dans l'ancien rgime, villes, bourgs, paroisses ou communauts, ayant les organes et les privilges les plus divers. L'Assemble constituante fit une double besogne (l.14 dc. 1789) : elle ramena tous les types de communes l'unit, et elle donna la commune une organisation dcentralise, malheureusement un peu complique. Il y avait dans chaque commune trois organes : 1 le maire, qui pouvait tre seul ou assist d'un ou plusieurs assesseurs, suivant la population. Dans ce dernier cas, il y avait bureau municipal, agence collective; 2 un conseil municipal ; 3 un conseil gnral compos de notables en nombre double. Ce conseil gnral s'est en somme perptu jusqu'en 1882 dans l'adjonction des plus imposs. Tous les membres de ces conseils et le maire taient nomms directement l'lection par tous les citoyens actifs de la commune. La tutelle tait
HISTOIRE
357
confie au directoire du dpartement et au directoire du district. Il n'y avait pas de reprsentant du pouvoir central; des procureurs syndics taient bien chargs d'une mission de surveillance, mais ils taient lus, eux aussi, par les citoyens actifs de la commune. Les lois des 16 aot 1790 et 22 juillet 1791 confirent aux corps municipaux des pouvoirs de police et mme certains pouvoirs de juridiction. Le pays n'tait plus qu'une fdration de quarante mille communes. Ce fut bientt l'anarchie. Organisation de fructidor an III. L'anarchie fut un peu bride par l'nergie des reprsentants en mission envoys par la Convention, qui remplacrent les procureurs syndics par des agents nationaux sous leurs ordres. Cependant la Constitution de fructidor an III essaya d'en empcher lgalement le retour, en superposant aux communes rurales six mille municipalits de canton avec un commissaire du gouvernement ct. Mais ce rgime arbitraire, qui comprimait la commune rurale, ne pouvait durer. Organisation de l'an VIII. La Constitution de l'an VIII allait rtablir l'galit dans le rgime des communes en donnant partout l'administration au pouvoir central par un retour au rgime d'avant 1789. Il y a dans la commune un maire nomm tantt par le chef de l'tat, tantt par le prfet, assist d'un conseil municipal dont les membres sont choisis par le prfet et qui n'a aucune initiative. Ainsi, aprs dix ans d'agitations, on tait revenu au point de dpart. Non pas ici qu'on et abus de l'organisation collgiale, beaucoup de communes taient administres par le maire, magistrat unique, mais parce qu'on avait donn brusquement trop d'autonomie, et que le pouvoir modrateur de la tutelle avait t confi au directoire de dpartement, incapable ce moment de l'exercer. Il faut tenir compte aussi, des temps troubls au milieu desquels s'tait fait cet essai de libert, de la crise agraire des biens nationaux, de la proscription des ci-devant nobles, de la guerre civile, de la guerre trangre, des rquisitions continuelles du pouvoir central, de la dprciation du papier-monnaie. Pendant toute la Rvolution, on voit la plupart des petites municipalits uniquement occupes d'une chose, assurer la subsistance. L'essai avait t fait dans de mauvaises conditions, il tait recommencer. Malheureusement les communes avaient perdu dans la tourmente des richesses qu'elles ne devaient plus retrouver, leurs biens communaux, que les lois du 14 aot 1792 et du 10 juin 1793 prescrivaient de partager entre les citoyens (vente arrte seulement en l'an IV). Depuis 1830. Le dsir de rentrer dans la voie de la dcentralisa-
358
ORGANISATION DE LA COMMUNE
tion se manifesta ds la chute de l'Empire, et mme pendant les CentJours. Cependant la Restauration ne fit gure que prsenter des projets qui n'aboutirent pas ; le plus important fut le projet Martignac (9 fvrier 1829) dont le rejet entrana la chute du cabinet. C'est le gouvernement de Juillet qui devait ici encore donner satisfaction aux tendances dcentralisatrices par les lois du 21 mars 1831, et du 18 juillet 1837. Le mouvement, arrt un instant sous le second Empire par les lois du 7 juillet 1852 et du 5 mai 1855, reprend avec la loi du 14juillet 1867 pour aboutir un point trs satisfaisant avec la loi du 5 avril 8 84. a) Le premier point obtenu fut le retour l'lection pour la nomination du conseil municipal. Cela fut obtenu du premier coup, en 1831, il n'y eut de modification ultrieure que celle rsultant de l'tablissement du suffrage universel en 1848. Le maire et les adjoints devaient tre choisis par le chef de l'tat ou par le prfet dans l conseil municipal. C'tait une bonne solution. Depuis il y en a eu. : la nomination par le conseil municipal dans les pede trs varies tites communes et par le gouvernement dans les grandes; la nomination par le gouvernement dans toutes les communes d'un maire pris en dehors du conseil; enfin la nomination par le conseil municipal dans toutes les communes. Ce dernier mode, consacr pour la premire fois par la loi du 28 mars 1882, est maintenu par la loi de 1884. b) Le second point fut le pouvoir propre donn aux conseils municipaux; il y eut en 1837 quatre cas seulement o le conseil prenait des dcisions rglementaires. Ce nombre a t successivement augment jusqu' la loi de 1884, o la dcision rglementaire est devenue le droit commun. c) Enfin un troisime point fut de savoir qui, dans les cas o elle tait maintenue, on confierait la tutelle de la commune. En 1837, on la laissa au prfet reprsentant l'tat; mais depuis, l'opinion s'est dveloppe de la confier au conseil gnral, reprsentant le dpartement. En 1871, en 1884, cette opinion fut vigoureusement soutenue. Elle n'a pas triomph compltement, cependant il y a dj beaucoup de cas o le conseil gnral et la commission dpartementale sont appels donner des autorisations. Ainsi, par un progrs lent et mesur, on aura ralis les rformes que la Rvolution avait voulu faire brusquement; il est croire que cette fois ce sera durable. Observation. Il est une rforme que la Rvolution a accomplie du premier coup, c'est l'uniformit dans le rgime des communes. On peut se demander si elle est heureuse. Il est difficile d'organiser un rgime,.
HISTOIRE
359
qui aille la fois la taille des communes de trois cent mille habitants et de celle de trois cents. Dans la plupart des lgislations trangres on trouve la varit. En Angleterre, dans l'Amrique du Nord, en Allemagne, il y a une distinction fondamentale entre les communes urbaines et les communes rurales. Dans l'tat de Californie, une lgislation rcente (13 mars 1883) a mme distingu six classes de corporations municipales soumises, suivant le chiffre de la population, des rgimes diffrents; et ce qui est, au premier abord, tonnant pour nos habitudes franaises, ce sont les communes les plus populeuses qui ont le plus d'autonomie. Cependant l'uniformit de rgime est trop conforme notre caractre national pour qu'on puisse songer la dtruire. D'ailleurs elle n'est : peut-tre pas si mauvaise 1 C'est une simplification bien commode au point de vue du contrle administratif ; 2 En fait, les avantages et les inconvnients du chiffre de la population se balancent au point de vue administratif. Si la commune populeuse a plus de ressources et plus de lumires, et'par consquent si de ce chef elle mrite plus d'indpendance, en revanche elle a peut-tre moins de sagesse lectorale que la petite commune, par consquent elle est bien place dans la situation moyenne que lui a faite la loi. D'ailleurs, ct de la lgalit il y a les faits, la grosse situation du magistrat municipal d'une grande ville, aplanit devant celle-ci bien des obstacles administratifs. SECTION Ire. ORGANE EXCUTIF DE LA COMMUNE 228. L'organe excutif de la commune se compose : 1 D'une autorit administrative, le maire ; 2 d'un ou plusieurs assesseurs du maire, le ou les adjoints; 3 de fonctionnaires. Observation. Il y a lieu de runir pour l'tude le maire et les adjoints : 1 Les rgles d'organisation sont les mmes; 2 les adjoints n'ont pas d'attributions propres, leurs seules prrogatives sont : a) de remplacer provisoirement le maire en cas d'empchement (art. 84) ; b) d'avoir un droit de priorit lorsque le maire dlgue ses fonctions. (Art. 82.) En fait, dans les grandes communes, les adjoints exercent tous d'une faon continue des fonctions dlgues; deplus, les rsolutions importantes qui doivent tre prises sous la responsabilit du maire, sont arrtes en conseil par le maire et les adjoints d'un commun accord. La runion du maire et des adjoints forme alors ce qu'on peut appeler le bureau municipal, mais ce bureau municipal n'a pas d'existence lgale, ou tout au moins ne constitue pas une autorit administrative distincte. Le bureau municipal a eu une existence
360
ORGANISATION DE LA COMMUNE
lgale sous la loi du 14 septembre 1789, mais cette existence a disparu. ET LESADJOINTS 1er. LE MAIRE Article Ier. Rgles d'organisation. Le maire et les adjoints sont nomms l'lection par le conseil municipal et pris dans le sein de celui-ci. (L. 28 mars 1882, 1. 5 avr. 1884, art. 73.) 229. Nomination Nombre du maire et des adjoints. des adjoints. Il n'y a jamais qu'un maire dans une commune, mais le nombre des adjoints dpend de la population. Il est d'un dans les communes de deux mille cinq cents habitants et au-dessous, de deux dans celles de deux mille cinq cents dix mille. Dans les communes de population suprieure, il y aura un adjoint de plus par chaque excdent de vingtcinq mille, sans que le nombre des adjoints puisse dpasser douze, sauf en ce qui concerne la ville de Lyon, o le nombre sera port dix-sept. (Art. 73.) Rgle d'aprs laquelle le conseil municipaldoit tre au complet. Au moment o il procde l'lection du maire ou celle d'un adjoint, le conseil municipal doit tre au complet de ses membres. Par consquent, s'il s'est produit des vacances, il faut procder des lections complmentaires avant la nomination du maire et de l'adjoint (art. 77). Cette rgle est rendue ncessaire par ce fait que, en principe, les vacances ne sont pas combles au fur et mesure qu'elles se produisent, on attend que le conseil soit rduit aux trois quarts de ses membres (art. 42). La nomination d'un maire ou d'un adjoint est un acte trop grave pour qu'on le permette un conseil municipal incomplet. Il faut tout prvoir. Cette rgle trs raisonnable, que le conseil doit tre complt, pourrait servir d'arme un parti obstructionniste pour empcher l'lection d'un maire. Il suffirait qu' peine des lections complmentaires faites, des conseillers donnassent leur dmission, ce serait recommencer. Cette manuvre a t djoue par l'art. 77 : Si aprs les lections complmentaires, de nouvelles vacances se produisent, le conseil municipal procdera nanmoins l'lection du maire et des adjoints, moins qu'il ne soit rduit aux trois quarts de ses membres. En ce cas, il y aura lieu de recourir de nouvelles lections. Il y sera procd dans le dlai d'un mois dater de la dernire vacance. (Art. 77, 2 et 3.)
LE MAIRE
361
Mme solution si c'est aprs un renouvellement intgral du conseil que des vacances se produisent avant la nomination du maire et des adjoints. (C. d't. 2 fvr. 1885,15 mai 1885, etc.) Eligibilit. Tout conseiller municipal est ligible aux fonctions de maire ou d'adjoint, mais il y a des inligibilits : 1 Aux termes de l'art. 86 les maires et adjoints rvoqus sont inligibles pendant un an, moins qu'il ne soit procd auparavant au renouvellement gnral des conseils municipaux. Inligibilit temporaire. 2 Ne peuvent tre maires ou adjoints, ni en exercer mme temporairement les fonctions, les agents et employs des administrations financires, les trsoriers payeurs gnraux, les receveurs particuliers et les percepteurs, les agents des forts, ceux des postes et des tlgraphes, ainsi que les gardes des tablissements publics et des particuliers . (Art. 80.) 3 Les agents salaris du maire ne peuvent tre ses adjoints (art.80, 3). Cette disposition a surtout en vue les rgisseurs, intendants, secrtaires, chefs et contrematres de fabrique, employs de commerce, etc.; mais elle ne s'tend ni au fermier, qui est un vritable entrepreneur d'industrie, ni mme au colon partiaire. Date de l'lection. En cas de renouvellement gnral du conseil municipal, l'lection du maire et des adjoints a lieu la premire sance de la session aussitt aprs l'installation du conseil. (Cire. int. 10 avril 1884.) Lorsque l'lection est annule, ou que pour toute autre cause le maire ou les adjoints ont cess leurs fonctions, le conseil, s'il est au complet, est convoqu pour procder au remplacement dans le dlai de quinzaine. S'il y a lieu de complter le conseil, il sera procd aux lections complmentaires dans la quinzaine de la vacance, et le nouveau maire sera lu dans la quinzaine qui suivra. Si, aprs les lections complmentaires, de nouvelles vacances se produisent, l'art. 77 sera applicable. (Art. 79, 2 et 3.) Convocation du conseil. Pour toute lection du maire et des adjoints, les membres du conseil municipal sont convoqus dans les formes et dlais prvus par l'art. 48, trois jours francs au moins avant celui de la runion; la convocation contiendra la mention spciale de l'lection laquelle il devra tre procd. Aprs un renouvellement gnral et pour la premire runion, la convocation est faite par l'ancien maire qui n'a pas encore remis le service. Si le maire n'est pas lu la premire runion, la convocation sera faite ensuite par les conseillers dans l'ordre du tableau. (Art. 81.) On applique les rgles ordinaires sur le quorum ncessaire pour
362
DE LA COMMUNE ORGANISATION
dlibrer, la moiti plus un des membres en exercice; il peut y avoir lieu trois convocations successives aux termes de l'art. 50. Formes de l'lection. Le conseil municipal lit le maire et les adjoints au scrutin secret et la majorit absolue. Si aprs deux tours descrutin aucun candidatn'a obtenu la majorit absolue, il est procd un troisime tour de scrutin et l'lection a lieu la majorit relative. En cas d'galit de suffrages, le plus g est dclar lu. (Art. 76.) Ainsi, on procde d'abord l'lection du maire, puis celle de l'adjoint ou des adjoints. Lorsque la commune a droit plusieurs adjoints il n'y a pas scrutin de liste, chacun d'eux est nomm par un vote distinct; de sorte qu'il y a un premier adjoint, un second adjoint, etc. Ce rang entre les adjoints sert d'ailleurs dans diverses circonstances. La sance dans laquelle il est procd l'lection du maire est prside par le plus g des membres du conseil municipal (art. 77, 1) ; mais une fois lu, le maire prend la prsidence du conseil pour l'lection des adjoints. Les nominations sont rendues publiques dans les vingt-quatre heures de leur date, par voie d'affiche la porte de la mairie, elles sont dans le mme dlai notifies au sous-prfet. (Art, 78.) Rclamationscontre l'lection. Un contentieux est organis pour les lections du maire et des adjoints, il suit les rgles de celui des lections au conseil municipal. Peuvent former des rclamations: 1 tout conseiller municipal et tout lecteur de la commune dans un dlai de cinq jours qui commence courir vingt-quatre heures aprs l'lection; 2 le prfet dans le dlai de quinzaine dater de la rception du procs-verbal. et addes maires et rvocation 230. Suspension Les maires et adjoints peuvent tre suspendus par arjoints. rt du prfet pour un temps qui n'exde pas un mois, et qui peut tre port trois mois par le ministre de l'intrieur Dans les colonies rgies par la prsente loi, la suspension peut tre prononce par arrt du gouverneur pour une dure de trois mois. Cette dure ne peut tre prolonge par le ministre. Le gouverneur rend compte immdiatement de sa dcision au ministre de la marine et des colonies. (Art. 86, 1, 3 et 4.) Les maires et les adjoints ne peuvent tre rvoqus que par dcret; la rvocation emporte de plein droit l'inligibilit aux fonctions de maire et celles d'adjoint pendant une anne, moins qu'il ne soit procd au renouvellement gnral des conseils municipaux. (Art. 86, 2 et 3.)
LE MAIRE
363
1 En cas d'absence, de 231. Remplacement provisoire. suspension, de rvocation ou de tout autre empchement, le maire est provisoirement remplac dans la plnitude de ses fonctions par un adjoint dans l'ordre des nominations, et dfaut d'adjoints, par un conseiller municipal dsign par le conseil, sinon pris dans l'ordre du tableau. (Art. 84.) 2 Dans les cas o les intrts du maire se trouvent en opposition avec ceux de la commune, le conseil municipal dsigne un autre de ses membres pour reprsenter la commune, soit en justice, soit dans les contrats. (Art. 83.) Les vnements qui mettent fin 232. Dure du mandat. au mandat du maire et des adjoints sont les suivants : 1 Cessation des fonctions du conseil municipal par suite d'expiration normale des pouvoirs, dmission collective, dissolution ou annulation totale des oprations lectorales. Les pouvoirs du maire ne peuvent pas survivre en effet ceux du conseil qui l'a nomm. 2 Rvocation ou suspension (la suspension n'entraine qu'une interruption.) 3 Inligibilit ou indignit rsultant d'vnements postrieurs la nomination (art. 80). Les maires ou adjoints, qui tombent ainsi dans un cas d'exclusion ou d'incapacit, doivent tre dclars dmissionnaires, la loi ne dtermine pas les formes. Les prfets doivent appliquer par analogie les dispositions de l'art. 36 relatif aux conseillers municipaux qui se trouvent dans le mme cas. 4 Dmission. Les maires et adjoints peuvent donner leur dmission, elle doit tre adresse au prfet et elle n'est dfinitive que quand celui-ci l'a accepte. (Av. Cons. d't. 20 janvier 1885) 5 Annulation de l'lection. 6 Dcs. Remise du service. Autant que possible, il ne doit pas y avoir d'interruption dans l'exercice du pouvoir municipal. Aussi, en principe, les officiers municipaux conservent-ils l'exercice de leurs fonctions jusqu' l'installation de leurs successeurs (art. 81, 2). Cette rgle est traditionnelle depuis la loi du 14 dcembre 1789. Mais il y a tant d'exceptions que la rgle en est presque dtruite. En effet les magistrats municipaux cessent immdiatement leurs fonctions dans les cas suivants: 1 Lorsque, aprs sa nomination, un maire ou un adjoint at nomm une fonction ou un emploi que la loi dclare incompatible. (Art. 80-81.) 2 Lorsqu'ils sont suspendus ou rvoqus. (Art. 81-86.)
364
ORGANISATION DE LA COMMUNE
3 Lorsque le conseil municipal tant dissous ou dmissionnaire, il a t nomm une dlgation provisoire. (Art. 81-87.) 4 Lorsque l'lection du maire a t annule soit comme maire, soit comme conseiller municipal. (Arr. C. d't., 14 mars 1890.) Enfin, en cas de renouvellement intgral du conseil municipal, les maires et adjoints continuent leurs fonctions jusqu' l'installation du nouveau conseil, mais non pas jusqu' celle de leurs successeurs. (Art. 81.) Gratuit du mandat. Le mandat de maire ou adjoint est gratuit comme celui de conseiller municipal. A plusieurs reprises et notamment en 1884, la question de la rtribution a t agite, mais on a recul devant l'immense arme de fonctionnaires rtribus que cela et cr. Seulement il y a remboursement des frais ncessits par l'excution des mandats spciaux et de plus les conseils municipaux peuvent voter sur les ressources ordinaires de la commune, des indemnits au maire pour frais de reprsentation. (Art. 74.) Article II. Attributions du maire. N 1. Nature des attributions. Le maire a des attributions en vertu d'une double qualit, puisqu'il est la fois membre de l'organe excutif de l'tat titre d'autorit du pouvoir rgional, et chef de l'organe excutif de la commune. Il faut distinguer soigneusement ces deux qualits. comme agent 233. A. Attributions du maire considr En cette qualit le maire a les attributions les plus de l'tat. varies : 1 il a des attributions qui ne sont pas ou presque pas d'ordre administratif, ainsi il est officier de police judiciaire et officier de l'tat civil; 2 ses attributions d'ordre administratif font de lui, tantt une autorit administrative qui prend des dcisions, tantt une sorte de fonctionnaire qui excute les ordres de l'administration suprieure ou runit pour elle des lments d'information. Nous ne nous occuperons que des attributions d'ordre administratif. a) Le maire, autorit administrative de l'tat. Le maire exerce au nom de l'tat certains droits de police. Il est charg, aux termes de l'art. 92, d'assurer dans sa commune : 1 la publication des lois et rglements; 2 l'excution des lois et rglements; 3 l'excution des mesures de sret gnrale. Pour ces trois objets, le maire
DU MAIRE ATTRIBUTIONS
365
peut tre amen prendre des dcisions excutoires qui seront dans l'espce des arrts de police et user du droit de rquisition de la force arme. Il est charg en outre, et l il exerce le droit de certifier et d'authentiquer, qui est un droit de l'tat, de dlivrer une foule de certificats : certificats de bonne vie et murs, de bonne conduite, d'indigence, de d'une faon gnrale, tous les certificats destins rsidence, etc., attester la ralit d'un fait qui intresse un citoyen dans sa vie publique ou civile. b) Le maire, fonctionnaire de l'tat. Le maire joue dans une certaine mesure le rle d'un fonctionnaire : 1 il excute des dcisions prises par une autorit suprieure; ainsi il fait afficher le texte des lois, il notifie certaines dcisions aux particuliers, il dirige le recensement de la population dans sa commune (1. 29juill. 1792, art. 1); en matire militaire il dresse la liste des conscrits, il assiste au tirage au sort, etc., etc..; 2 il fournit des lments d'information aux autorits suprieures, une foulede renseignements statistiques lui sont demands; 3 il exerce une surveillance sur les prisons, sur les coles primaires, sur les tablissements privs d'alins, etc; 4 il est un agent de transmission entre l'autorit suprieure et certains fonctionnaires ou mme les particuliers. 234. B. Attributions considr du maire, comme En cette qualit le maire excutif de la commune. organe est une autorit administrative : 1 il exerce un pouvoir propre; 2 il excute les dcisions du conseil municipal. 235. I. Pouvoirs du maire agent de la compropres Le maire exerce, en prenant des dcisions excutoires, mune. un assez grand nombre de droits de la commune: a) Droits de puissance publique. Droits de police. 1 Le maire a la police des fonctionnaires de la commune. Le maire nomme tous les emplois communaux pour lesquels les lois, dcrets et ordonnances, actuellement en vigueur, ne fixent pas un mode spcial de nomination. Il suspend et rvoque les titulaires de ces emplois. Il peut faire assermenter et commissionner les agents nomms par lui, mais la condition qu'ils soient agrs parle prfet ou le sous-prfet. (Art. 88.) Les lois et rglements apportent dans un intrt gnral des restrictions au droit de nomination et surtout au droit de rvocation du maire. C'est ainsi que les agents de la police et le garde champtre peuvent bien tre nomms par le maire mais ne peuvent tre rvoqus que par le prfet. (Art. 102, 103.)
366
ORGANISATION DE LA COMMUNE
Le droit de nomination et de rvocation entrane forcment l'action disciplinaire. 1 Il exerce sur les citoyens les droits que comporte la police municipale et rurale. Nous verrons plus tard quels sont les objets prcis de ce double pouvoir de police appartenant la commune. (Livre II, n 332 et s.) Dans son objet gnral cette police a pour but d'assurer le maintien de l'ordre public, c'est--dire la tranquillit, la scurit et la salubrit, la ville et aux champs. (L. 22 juill. 1792, tit. I, art. 46; l. 16-24 aot 1790, tit. XI, art. 3 et 4; art. 97 99, 1. 1884.) Cela entrane, d'abord pour le maire, le droit de faire des rglements de police gnraux. Ces rglements ne sont valables que dans le territoire de la commune, et ils n'ont d'autre sanction que celle de l'art. 471, n 15 C. P., c'est--dire une amende de un cinq francs. Cela entrane, en outre, le droit de prendre des mesures de police individuelles en vue de tel ou tel particulier, pourvu que ce soit dans un intrt gnral; ces mesures sont des injonctions ou des dfenses ou des autorisations. Exemple : injonction de clore un terrain en bordure de la voie publique dfense d'tablir un dpt d'immondices, autorisation d'tablir une saillie, etc. Comme complment de tous ces pouvoirs de police, le maire a la rquisition de la force arme. 3 Le maire a la police du domaine public de la commune. C'est ainsi qu'il dlivre certains alignements le long des voies communales. C'est ainsi qu'il prend des arrts pour empcher que les difices communaux ne soient dtriors. Il a spcialement la police du cimetire (D. 23 prairial an XII). Les arrts qu'il prend en ces matires ne sont pas toujours sanctionns par l'amende de l'art. 471, n 15 C. P. Quelquefois ils ne donnent lieu qu' une action civile. (Cass. 23 mai 1846.) Le maire est charg, en vertu de b) Droits de personne prive. son pouvoir propre, et sans avoir besoin de faire intervenir le conseil municipal, de l'administration des biens du domaine priv de la commune dans la limite des actes conservatoires (art. 90, 1) ; spcialement, il peut, titre conservatoire, accepter provisoirement les dons et legs et former avant l'autorisation toute demande en dlivrance ; il peuL faire tous actes conservatoires ou interruptifs de (art. 113) dchance (art. 122), introduire une demande en rfr. (Paris, 27 juin 1864.) du condes dcisions excuteur 236. II. Le maire Le maire est charg d'excuter les dcisions seil municipal. du conseil municipal (ar. 90, n 10). Il est remarquerque la loi ne le
ATTRIBUTIONS DU MAIRE
367
charge pas d'une manire gnrale de la prparation des dcisions; elle ne parle que de la prparation du budget (art. 90 n 3). Il en rsulte que en toute autre matire, le conseil municipal peut dlibrer sans que l'affaire ait t tudie par le maire, la diffrence du conseil gnral, qui ne peut dlibrer que sur des affaires prpares par le prfet. En sa qualit d'excuteur des dcisions du conseil municipal, le maire a les attributions qui suivent: 1 Il excute le budget communal titre d'ordonnateur et il surveille la comptabilit. (Art. 90, nos 2 et 3.) 2 Il passe les marchs et les contrats (art. 90 nos 6 et 7). Pour les adjudications publiques, il lui est adjoint deux membres du conseil municipal dsigns par le conseil ou dfaut dsigns dans l'ordre du tableau, et le receveur municipal (art. 89); tous ces marchs ou contrats ont t au pralable dcids par le conseil municipal, ou sont aprs coup approuvs par lui. 3 Il reprsente la commune en justice, soit en demandant, soit en dfendant. Mais, en principe, toutes les dcisions sur la question de l'action intenter ou dfendre, sont prises par le conseil municipal. Dans le cas o les intrts du maire se trouvent en opposition avec ceux de la commune, le conseil municipal dsigne un autre de ses membres pour reprsenter la commune, soit en justice, soit dans les contrats. 4 Le maire dirige les travaux communaux, et il pourvoit aux mesures relatives la voirie municipale au point de vue de la viabilit des chemins. (Art. 90, nos4 et 5.) 5 Il organise tous les services dont la cration est dcide par le conseil municipal. 6 D'une faon gnrale il pourvoit aux mesures individuelles rendues ncessaires par les dcisions de principe du conseil municipal1. N 2. De la force excutoiredes actes du maire.
237. Toutes les fois que le maire prend une dcision en qualit d'autorit administrative, soit comme agent de l'tat, soit comme agent de la commune, cette dcision est excutoire par elle-mme. En principe elle est excutoire immdiatement, par exception les arrts rglementaires de police portant rglement permanent ne 1. V. ce qui a t dit p. 221sur le partage d'attributions entre l'organe excutif et l'organe dlibrant.
368
ORGANISATION DE LA COMMUNE
deviennent excutoires qu'un mois aprs que copie en a t envoye au prfet (art. 95). Les dcisions du maire peuvent aprs coup tre suspendues ou annules par le prfet ainsi que nous allons le voir, mais, elles n'ont pas besoin d'lre approuves par lui. (Art. 95.) Dans la pratique le prfet approuve quelquefois les contrats passs par le maire, mais c'est un visa de contrle qui n'est pas utile la perfection de l'acte. N 3. Nature et forme des actes du maire. 238. Les dcisions excutoires prises par le maire en sa qualit d'autorit administrative, soit comme agent de l'tat, soit comme agent de la commune, constituent des actes d'administration. Ce sont tantt des actes d'autorit, tantt des actes de gestion. La forme normale des actes d'autorit est l'arrt, cela rsulte de l'art. 94, mais comme la loi n'assujettit aucune formule obligatoire les arrts municipaux, il faut dcider qu'il suffit qu'ils soient crits, dats et signs. Les arrts du maire ne sont obligatoires qu'aprs avoir t ports la connaissance des intresss par voie de publication et d'affiches toutes les fois qu'ils contiennent des dispositions gnrales et dans les autres cas par voie de notification individuelle. La publication est constate par une dclaration certifie par le maire. La notification est tablie par le rcpiss de la partie intresse, ou son dfaut par l'original de la notification conserv dans les archives de la mairie. Les arrts, actes de publication et de notification sont inscrits leur date sur le registre de la mairie. (Art. 96.) Pour les actes de gestion, qui sont des contrats, ils sont passs d'ordinaire en la formeadministrative. (V. p. 200.) N 4. Du contrledes actes du maire par le prfet et le conseil municipal. Le maire est contrl dans son administration la fois par le prfet reprsentant l'tat, et par le conseil municipal reprsentant la commune. 239. Contrle du prfet. Lecontrle du prfet sur le maire, et sur ses actes, est la fois dans l'intrt de l'tat et dans l'intrt dei la commune, de sorte que c'est un contrle hirarchique en tant le maire est agent de l'tat, et un contrle de tutelle en tant qu'il est que
DU MAIRE ATTRIBUTIONS
369
agent de la commune. Au reste, cette distinction n'a pas d'influence sur les droits du prfet, ils sont les mmes dans les deux cas. Les art. 90 et 91 emploient, il est vrai, les mots contrle et surveillance pour caractriser l'action du prfet sur le maire agent de la commune, tandis que l'article 92 emploie le mot autorit pour caractriser cetfe action sur le maire agent de l'tat, mais quand on arrive au fait, contrle, surveillance, autorit aboutissent aux mmes rsultats. certains points de vue Le contrle est d'ailleurs trs nergique; il a t aggrav par la loi de 1884, et c'est un peu la consquence de ce que le maire n'est plus choisi par le gouvernement. Il faut bien assurer d'une faon ou de l'autre la subordination de la commune l'tat. 1" Suspension et rvocation du ma r Rappelons d'abord que le prfet peut suspendre le maire pendant un mois, et qu'il peut provoquer soit un arrt ministriel portant trois mois le temps de suspension, soit un dcret de rvocation. (Art. 86.) 2 Suspension et annulation des actes du maire. Le prfet peut en outre suspendre ou annuler les actes d'autorit du maire (l'art. 95 dit les arrts). Il ne peut pas les rformer. Cette mesure peut tre prise toute poque, mme contre les rglements permanents, alors que ces rglements sont devenus excutoires par l'expiration du dlai d'un mois. Le fait que le prfet aurait d'abord approuv l'acte ne l'empcherait pas de l'annuler par la suite. Le droit d'annulation ne disparat que lorsque l'acte d'autorit a servi d'appui un acte de gestion qui a confr des droits des tiers. (Art. 95.) Le prfet ne peut pas annuler les actes de gestion, c'est--dire les contrats passs par le maire. 3 Droits du prfet de substituer son action celle du maire. Il ne fallait pas prvoir seulement l'hypothse o le maire agirait incorrectement, mais aussi celle o il refuserait ou ngligerait d'agir. La loi a pourvu ce danger en permettant au prfet de substituer son action la sienne. Il faut distinguer deux hypothses : a) Le maire nglige de faire un rglement de police indispensable ; le prfet, aprs une mise en demeure, fera le rglement de police sa place. (Art. 99 in fine.) b) Le maire refuse ou nglige de faire un des actes qui lui sont prescrits par la loi; le prfet, aprs l'avoir requis, ce qui quivaut la mise en demeure de tout l'heure, y procde d'office par luimme ou par un dlgu spcial (art. 85). Le texte de l'art. 85 est trs gnral, il s'applique aussi bien aux actes que le maire accomplit sous la simple surveillance de l'administration, c'est--dire comme agent de la commune, qu' ceux qu'il accomplit sous l'autorit de H. 24
370
DE LA COMMUNE ORGANISATION
l'administration, c'est--dire comme agent de l'tat. Par consquent, il doit s'appliquer mme lorsque le maire refuse d'excuter une dcision du conseil municipal. La seule condition exige est que l'acte soit prescrit par la loi. Cette interprtation large s'appuie sur les observations suivantes : 1 l'art. 85 est plac en tte de tous les articles qui numrent les attributions du maire; 2 l'art. 152 applique la rgle au cas particulier o le maire est ordonnateur du conseil municipal ; 3 l'art. 98 in fine va jusqu' l'appliquer dans un cas o il s'agit d'un acte discrtionnaire de police municipale1. Ce contrle 240. Contrle du conseil municipal. s'exerce directement au point de vue financier, en ce sens que tous les ans avant le vote du budget, le maire doit prsenter son compte d'administration pour l'exercice clos ; le conseil municipal peut refuser de l'approuver (art. 151). Sur tous autres objets, le conseil municipal n'exerce qu'un contrle indirect, en ce sens qu'il ne peut agir que par des ordres du jour destins amener la dmission volontaire du maire, ou par des dmarches auprs du prfet. N 5. Voies de recours contre les actes du maire. 241. Les particuliers lss par un acte du maire peuvent user des recours suivants: 1 d'un recours adress au prfet, afin que celui-ci use de son pouvoir d'annulation2 ; 2 du recours pour excs de pouvoir aux termes du droit commun. Enfin, rappelons que les citoyens poursuivis devant l'autorit judiciaire pour infraction un rglement de police du maire, peuvent soutenir que ce rglement est illgal et par suite dpourvu de force obligatoire. (C. P. art. 471, n 15.) N 6. Dlgation de ses pouvoirs faite par le maire. 242. Le maire est seul charg de l'administration; mais il peut,
1. Il est vrai que l'art. 85 ne fait que reproduire l'art. 15de la loi de 1837, et que le Conseil d'tat, dans un arrt du 10avril 1883,avait dcid que ce texte ne s'appliquerait qu'aux actes accomplis sous l'autorit de l'administration. Celaveut dire simplementque la loi n'a pas confirmcettejurisprudence le Conseil et qu'elle devra tre abandonne; dj dans un arrtdu7juin 1889 d'tat, sans se prononcer catgoriquement,a opr un mouvementde recul. : 2. Ce recours ne peut pas tre qualifide hirarchique dans tous les cas dans les cas o le maire agit au nom de la commune, c'est un recours de tutelle.
DE LA COMMUNE LES FONCTIONNAIRES
371
sous sa surveillance et sa responsabilit, dlguer une partie de ses fonctions. Cette dlgation est soumise aux rgles suivantes : 1 Elle ne peut porter que sur une partie des fonctions; 2 Elle doit tre faite par arrt ; 3 Le maire doit choisir les dlgus dans l'ordre suivant: parmi les adjoints, puis parmi les conseillers municipaux, mais il n'est astreint suivre ni l'ordre de nomination des adjoints ni l'ordre du tableau; 4 La dlgation peut tre rapporte; elle subsiste jusqu' ce qu'elle ait t rapporte moins que le maire lui-mme ne cesse ses fonctions. (Art. 82.) DE LACOMMUNE. 2. LES FONCTIONNAIRES Les fonctionnaires de la commune peuvent tre: 1 des em; 23des agents d'excution d'espces trs varies, conploys de bureau ducteurs de travaux, employs de l'octroi, agents de police, etc. Tous les personnages rmunrs par la commune ne doivent pas d'ailleurs tre considrs comme fonctionnaire ou employs de la commune, l'art. 33, in fine, indique une exception relative ceux qui, tant fonctionnaires publics ou exerant une profession indpendante, ne reoivent une indemnit de la commune qu' raison des services qu'ils lui rendent dans l'exercice de cette profession . Cela est particulirement vrai de l'avocat de la ville ou du mdecin de la ville. 243. de la police. Ces agents sont : le garde cham244. Agents ptre, les agents de police, les commissaires de police. Gardes champtres. Toute commune peut avoir un ou plusieurs : 1 des officiers de gardes champtres. Les gardes champtres sont police judiciaire chargs de rechercher et de constater les dlits et contraventions en matire de police rurale et de police municipale. Ils dressent, pour constater ces contraventions, des procs-verbaux l. 1884) ; 2 ce qui font foi en justice. (C. I. C.,art. 9 et 16; art. 102, sont encore des agents de la police administrative, qui prennent sous les ordres du maire des mesures de prcaution ou d'excution. Les communes sont libres de dcider qu'elles auront ou n'auront pas un garde champtre, cette dcision appartient au conseil municipal. La nomination appartient ensuite au maire. Les gardes champtres doivent en outre tre agrs et commissionns par le sous-prfet, et celui-ci doit faire connatre son agrment ou son refus dans le dlai d'un mois. Les gardes champtres peuvent tre suspendus par le maire pour une dure qui ne peut excder un mois. Le prfet seul peut le rvoquer. (Art. 102.)
372
ORGANISATION DE LA COMMUNE
Agents de police (sergents de ville, gardiens de la paix). Ce sont seulement des agents de la police administrative, et non pas des officiers de police judiciaire. Ils concourent la constatation et la rpression des dlits, mais pas dela mme faon que les gardes champtres : leurs procs-verbaux ne font pas foi en justice, et ils ne peuvent agir spontanment, qu'en cas de flagrant dlit dans les mmes conditions qu'un citoyen ordinaire. Dans les autres cas, ils sont simplement la disposition des officiers de police judiciaire, commissaires de police, procureur de la Rpublique, etc. Dans les villes de plus de quarante mille mes, l'organisation de tout ce personnel de police est rgle sur l'avis du conseil municipal ; pour les villes ayant moins de quarante mille habitants, par dcret le systme est le mme que pour les gardes champtres (art. 103). Les agents de police sont embrigads, ils sont soumis une discipline, ils ont une tenue, etc. Commissaires de police. Les commissaires de police sont la fois des officiers de police judiciaire et des agents de la police administrative, comme les gardes champtres, avec cette diffrence que le commissaire de police a une plus haute situation comme officier de police judiciaire, qu'il a mission de constater tous les crimes et tous les dlits, et qu'il peut requrir les agents de la force publique. : comme agents de la police administrative, les Ce n'est pas tout commissaires de police ont un caractre mixte, ils sont la fois agents de l'tat et de la commune. Agents de l'tat. Ils sont nomms par l'tat, ils correspondent avec les prfets et sous-prfets, qui ils doivent faire des rapports sur les objets de police d'tat; ils ont autorit dans tout le canton. (Dcret 28 mars 1852.) Agents de la commune. Ils sont pays par la commune; leur traitement est une dpense obligatoire, au moins dans les communes de plus de cinq mille mes (art 136, n 6, combin avec loi 28 pluvisean VIII; Arrt. C. d't. 26 dc. 1885; 16 juill. 1886). Ils sont placs sous les ordres du maire et mis la tte du personnel de la police municipale. On peut mme dire qu'ils sont plutt agents de la commune que de l'tat. La loi du 28 pluvise an VIII a institu les commissaires de police, en mme temps que les magistrats municipaux (titre II, art. 12). Il y a un commissaire par ville de cinq mille dix mille habitants, un commissaire de plus pour chaque fraction en plus de dix mille habitants. Beaucoup de villes n'atteignant pas cinq mille habitants n'auraient pas de commissaire de police ce compte. Dans un certain nombre d'entre elles, le gouvernement en a placs dont le traitement est pay par l'tat.
LE CONSEIL MUNICIPAL
373
D'autres communes contribuent dans une certaine mesure (le dcret de 1852 avait rendu le traitement obligatoire). Dans les villes o il y a plusieurs commissaires de police, un dcret du 22 mars 1851 leur a donn un chef sous le nom de commissaire central. La nomination est rgie par le dcret du 28 mars 1852, art. 6: les commissaires de police des villes de six mille mes et au-dessous sont nomms parles prfets sur une liste de trois candidats arrte par l'inspecteur gnral du ministre de l'intrieur; la rvocation, pour tre dfinitive, doit tre approuve par le ministre; les commissaires de police des villes au-dessus de six mille mes sont nomms par le chef de l'tat sur la proposition du ministre de l'intrieur. LE CONSEIL II. ORGANE MUNICIPAL SECTION DLIBRANT. 1er. RGLES D'ORGANISATION. Rgles gnrales de composition1. 245. Il y a un conseil municipal dans chaque commune. Le conseil municipal est une assemble dlibrante compose de reprsentants lus au suffrage universel direct par les lecteurs de la commune. Le nombre des conseillers municipaux est en raison de la population de la commune. Il ne peut pas tre infrieur dix, ni suprieur trente-six, sauf pour la ville de Paris qui a un rgime spcial, et pour la ville de Lyon qui est divise en six mairies et, pour ce fait, a trois conseillers de plus pour chaque mairie, ce qui porte le chiffre cinquante-quatre. (Art. 10. V. le tableau des communes d'aprs leur population, n 225.) Les conseillers municipaux sont lus au scrutin de liste par la commune entire, qui, en principe, forme une seule circonscription. Cependant, exceptionnellement, la commune peut tre sectionne au point de vue des lections municipales. Chaque section forme alors une circonscription qui lit une liste de conseillers. Les conseils municipaux sont renouvels intgralement tous les quatre ans une date fixe, la mme pour toute la France, le premier dimanche du mois de mai, lors mme qu'ils ont t lus dans l'intervalle. (Art. 41.) A la diffrence des autres assembles dlibrantes, il n'est pas ncessaire que les conseils municipaux soient toujours au complet de leurs membres. Pour viter des lections trop multiplies, on a pos les rgles suivantes : 1 En temps ordinaire, il n'y a lieu des lections complmen1. V. thorie des assembles dlibrantes, p. 256et s.
374
ORGANISATION DE LA COMMUNE
taires que lorsque le conseil est rduit aux trois quarts de ses membres. 2 Dans les six mois qui prcdent le renouvellement intgral, il n'y a lieu des lections complmentaires que si le conseil est rduit au-dessous de moiti. 3 Dans les communes divises en sections, il ya toujours lieu des lections complmentaires lorsque la section a perdu la moiti de ses conseillers. (Art. 42.) Toutefois, nous savons que lorsqu'il y a lieu de procder la nomination d'un maire ou d'un adjoint, le conseil municipal doit au pralable tre complt. (Art. 77.) N 1. Les lections au conseil municipal. Le sectionnement 246. Du sectionnement lectoral. lectoral est une opration prparatoire aux lections municipales qui ne se produit pas dans toutes les communes, mais seulement dans celles o elle est demande. Cette opration a pour but de diviser la commune en deux ou plusieurs circonscriptions lectorales, dont chacune lit une partie des conseillers municipaux. Cela suppose que chacune des sections lectorales a des intrts distincts dfendre dans les conseils de la commune. Le sectionnement lectoral est en soi une chose excellente, mais dont il serait facile d'abuser dans un but politique; aussi la loi de 1884, plus prcise sur ce point que les lois antrieures, l'a-t-elle entour de prcautions minutieuses. Conditions du sectionnement. Le sectionnement ne peut avoir lieu que dans deux cas: 1 Quand la commune se compose de plusieurs agglomrations d'habitants distinctes et spares, dans ce cas, aucune section ne peut avoir moins de deux conseillers lire . 2 Quand la population agglomre de la commune est suprieure 10,000 habitants. Dans ce cas, la section ne peut tre forme de fractions de territoire appartenant des cantons ou des arrondissements municipaux diffrents. Les fractions du territoire, ayant des biens propres, ne peuvent tre divises en plusieurs sections lectorales1. Aucune de ces sections ne peut avoir moins de quatre conseillers lire . 1. Cette disposition s'applique aussi certainement dans le premier cas de sectionnement. Ces fractions de territoire ayant des biens propres sont des sectionsde communesqu'il ne faut pas confondreavec les sections lectorales, et qui constituent des tablissements publics, v. p. 233.
MUNICIPAL ORGANISATION DU CONSEIL
375
Dans tous les cas o le sectionnement est autoris, chaque section doit tre compose de territoires contigus . Chaque section lectorale lit un nombre de conseillers proportionnel au chiffre des lecteurs inscrits . (Art. 11.) Procdure du sectionnement. Le sectionnement est fait par le conseil gnral sur l'initiative soit de l'un de ses membres, soit du prfet, soit du conseil municipal ou d'lecteurs de la commune intresse . (Art. 12, 1.) Aucune dcision en matire de sectionnement ne peut tre prise qu'aprs avcir t demande avant la session d'avril, ou au cours de cette session au plus tard. Dans l'intervalle entre la session d'avril et la session d'aot, une enqute est ouverte la mairie de la commune intresse et le conseil municipal est consult par les soins du prfet . (Art. 12, 2.) Chaque anne ces formalits tant observes, le conseil gnral, dans sa session d'aot, prononce sur les projets dont il est saisi. Les sectionnements ainsi oprs subsistent jusqu' une nouvelle dcision. Le tableau de ces oprations est dress chaque anne par le conseil gnral dans sa session d'aot. Ce tableau sert pour les lections intgrales faire dans l'anne. Il est publi dans les communes intresses avant la convocation des lecteurs, par les soins du prfet, qui dtermine, d'aprs le chiffre des lecteurs inscrits dans chaque section, le nombre des conseillers que la loi lui attribue. Le sectionnement, adopt par le conseil gnral, sera reprsent par un plan dpos la prfecture et la mairie de la commune intresse. Tout lecteur pourra le consulter et en prendre copie. Avis de ce dernier dpt sera donn aux intresss par voie d'affiche la porte de la mairie. (Art. 12, 3-6.) Recours contre le sectionnement. Les dlibrations du conseil gnral relativesau sectionnement deviennent dfinitives si l'annulation n'en a pas t demande par le prfet dans les vingt jours de la clture de la session (art. 43 et 47, l. 1871). Le recours pour excs de pouvoir intent par les lecteurs n'est pas recevable, car tant qu'il n'y a pas d'lection, ils ne sont pas considrs comme ayant un intrt. Au moment des lections, le sectionnement irrgulier devient un vice de l'lection qui peut tre invoqu devant le conseil de prfecture. (C. d'tat, 6 fvrier 1885, 8 janvier 1885, 27 dcembre 1878.) 247. lecteurs. et suiv.) 248. ligibles. Ce sont les lecteurs ordinaires. (V. p. 106 Sont ligibles tous les citoyens gs de vingt-
376
ORGANISATION DE LA COMMUNE
cinq ans accomplis, qui ont avec la commune une attache lgale, ralise par l'un des deux faits suivants: 1 inscription sur la liste lectorale de la commune ou justification qu'on doit y tre inscrit; 2 inscription au rle des contributions directes au 1er janvier de l'anne de l'lection ou justification qu'on devait y tre inscrit (art. 31). Il n'y a pas de condition de rsidence dans la commune; toutefois, le nombre des conseillers qui ne rsident pas au moment de l'lection ne peut pas excder le quart des membres du conseil. S'il dpasse ce chiffre, les non-rsidents sont limins dans l'ordre du tableau. (Art 31.) A. Il ya desinligibilits. I. Les unes rsultent de la privation de la jouissance du droit par suite de condamnation (V. p. 122); signaler seulement l'inligibilit temporaire qui frappe le conseiller municipal dclar dmissionnaire par le Conseil d'tat pour avoir refus d'accomplir une fonction lgale, il est inligible pendant un an. (L. 7 juin 1873.) II. D'autres inligibilits rsultent de la privation de l'exercice du droit. Sont inligibles: a)les interdits (D. 1852) ; b) les demi-interdits (art. 33); c) ceux qui sont dispenss de subvenir aux charges communales et ceux qui sont secourus par les bureaux de bienfaisance attachs exclusivement la personne (ibid.); (ibid.); d) les domestiques e) certains fonctionnaires. Ici il faut distinguer entre une inligibilit absolue qui frappe les militaires et employs des armes de terre et de mer en activit de service (art. 31) et une inligible relative qui frappe certains autres fonctionnaires numrs dans l'art. 33 et qui les rend inligibles seulement dans le ressort o ils exercent leurs fonctions. (V. d'ailleurs p. 123.) B. Il ya des incompatibilits. I. Ne peuvent cumuler le mandat de conseiller municipal avec leurs fonctions, les prfets, sous-prfets, secrtaires gnraux de prfecture, commissaires et agents de police ; le gouverneur directeur de l'intrieur et les membres du conseil priv dans les colonies. Les fonctionnaires de cet ordre qui seraient lus membres d'un conseil municipal ont un dlai de dix jours pour opter. A dfaut de dclaration expresse, ils sont rputs avoir opt pour la conservation de leur emploi. (Art. 34.) II. Nul ne peut tre membre de plusieurs conseils municipaux. Un dlai de dix jours, partir de la proclamation des rsultats du scrutin, est accord au conseiller municipal nomm dans plusieurs communes pour faire sa dclaration d'option. Cette dclaration est adresse aux prfets des dpartements intresss. Si dans ce dlai le conseiller lu n'a pas fait connatre son option, il fait partie de droit du conseil de la commune o le nombre des lecteurs est le moins lev. (Art. 35.) III. Dans les communes de cinq cent un habitants et au-dessus, les
ORGANISATION DU CONSEIL MUNICIPAL
377
ascendants et descendants. les frres et les allis au mme degr ne peuvent tre simultanment membres du mme conseil municipal. Si des co lus se trouvent parents ou allis au degr prohib, on procde des liminations dans l'ordre du tableau. (Art. 35.) L'assemble des lec249. Convocation des lecteurs. teurs est convoque par arrt du prfet pour le premier tour du scrutin; le second tour ayant lieu de plein droit le dimanche suivant, il suffit d'une publication faite par le maire (art. 15 et 30) : 1 en cas de renouvellement normal des conseils municipaux, la date pour laquelle la convocation doit tre faite est fixe par la loi, c'est le premier dimanche de mai de quatre ans en quatre ans, partir de 1884; 2 au cas de dissolution ou de dmission collective d'un conseil municipal, ou lorsqu'il y a impossibilit de le constituer, ou lorsque les lections ont t annules en tout ou en partie, il doit y avoir rlection dans le dlai de deux mois partir de la dissolution ou de la dernire dmission, etc.,art. 45) ; 3 en cas d'lection complmentaire par suite de la ncessit de combler les vacances, le dlai est de deux mois partir de la dernire vacance (art. 42); 4 en cas d'lection complmentaire, par suite de la ncessit de complter le conseil avant l'lection du maire ou d'un adjoint, le dlai est de quinze jours depuis la vacance du poste de maire ou d'adjoint. (Art. 79.) Il doit y avoir quinze jours francs 250. Priode lectorale. entre la publication de l'arrt de convocation dans la commune et le jour du scrutin. Pour les faits de presse et les runions lectorales, v. p. 243. Il peut y avoir deux tours de scrutin. Le premier 251. Scrutin. a toujours lieu un dimanche et le second le dimanche suivant (art. 15 et 30). L'arrt de convocation fixe le local, l'heure de l'ouverture et celle de la fermeture (art. 15). Chaque scrutin ne doit durer qu'un jour (art. 20). Pour toute la procdure du scrutin, formation du bureau, rception des votes, dpouillement, recensement des voix, etc., v. p. 246 et s. Le contentieux des lections 252. Contentieux lectoral. appartient au conseil de prfecture en premire instance et au Conseil d'tat en appel. Peuvent former des rclamations : 1 tout lecteur et tout ligible pour toute espce de motif; les rclamations peuvent tre formules immdiatement et consignes au procs-verbal du scrutin, ou bien dposes dans les cinq jours qui suivent le jour de l'lection
378
ORGANISATION DE LA COMMUNE
au secrtariat de la mairie ou la sous-prfecture, ou la prfecture, peine de dchance; 2 le prfet, s'il estime que les conditions et les formes lgalement prescrites n'ont pas t remplies dans le dlai de quinzaine dater de la rception du procs-verbal (art. 37). Pour la procdure du contentieux, voir l'art. 37, in fine, et les art. 38 401. (V. aussi p. 250 et s.) N 2. Fonctionnement desconseils municipaux. Les conseils municipaux ont des sessions, pendant lesquelles ils tiennent des sances, consacres la prparation et au vote de dlibrations. Les conseils municipaux ont quatre sessions 253 Sessions. ordinaires par an : en fvrier, mai, aot et novembre. La dure de chaque session est de quinze jours; elle peut tre prolonge avec l'autorisation du sous- prfet. La session pendant laquelle le budget est discut peut durer six semaines. Pendant les sessions ordinaires, le conseil municipal peut s'occuper de toutes les questions qui rentrent dans ses attributions. (Art. 46.) Il peut y avoir des sessions extraordinaires : 1 sur l'ordre du prfet ou du sous-prfet ; 3 sur l'initiative des ; 2 sur l'initiative du maire membres du conseil, quand la demande motive en est faite par la majorit des membres en exercice (art. 47). Dans ces deux derniers cas, il n'y a point demander l'autorisation pralable au prfet. Le maire convoque purement et simplement. Il doit seulement, en mme temps, donner avis au prfet et au sous-prfet de la runion et des motifs qui la rendent ncessaire. (Art. 47.) Cette facult donne aux conseils municipaux de se runir spontanment est une des innovations les plus librales de la loi de 1884. 1. A signaler particulirement : 1 la disposition de l'art. 38 destine acclrer la procdure : le conseil de prfecture doit statuer dans le dlai de deux mois en cas de renouvellement gnral, dans le dlai d'un mois dans toutes les autres hypothses; faute pour le Conseild'avoir statu dans ces dlais, la rclamationest considre comme rejete; le prfet informe la partie intresse, qui n'a qu'un dlai de cinq jours pour former recours au Conseil d'tat, tandis qu'en cas de dcision du conseil de prfecture, le dlai est d'un mois; 2 la disposition finalede l'art. 40aux termes de laquelle les conseillers municipauxproclams restent en fonctionsjusqu' ce qu'il ait t dfinitivement statu sur les rclamations , c'est--dire jusqu' ce que le Conseil d'tat ait statu sur le pourvoi lorsque l'appel a t form. Cet effet suspensif du pourvoi a eu pour rsultat d'augmenter beaucoup le nombre des pourvois forms et n'est pas sans inconvnients.
MUNICIPAL ORGANISATION DU CONSEIL
379
En cas de session extraordinaire, la convocation contient l'indication des objets spciaux et dtermins pour lesquels le conseil doit s'assembler, et le conseil ne peut s'occuper que de ces objets. D'un autre ct, la session se prolonge jusqu' ce que l'ordre du jour soit puis. De la convocation. Toute convocation est faite par le maire. Elle est mentionne au registre des dlibrations, affiche la porte de la mairie, et adresse par crit et domicile trois jours francs au moins avant celui de la runion, En cas d'urgence, le dlai peut tre abrg par le sous-prfet. (Art. 48.) Il faut bien remarquer qu'il n'y a de convocation qu'au dbut des sessions ordinaires ou extraordinaires, il n'y en a point pour chacune des sances tenues l'intrieur de ces sessions ; lorsque le conseil doit tenir plusieurs sances, c'est lui qui s'ajourne. Il ne faut pas se laisser tromper par ce fait, trs frquent dans les petites communes, qu'il n'y a qu'une sance par session. Les conseillers municipaux prennent rang 254. Sances. la sance dans l'ordre du tableau. (Art. 49, v. p. 261.) Le conseil ne peut dlibrer que lorsque la majorit de ses membres en exercice assiste la sance. Quand, aprs deux convocations successives trois jours au moins d'intervalle et dment constates, le conseil ne s'est pas runi en nombre suffisant, la dlibration prise aprs la troisime convocation est valable, quel que soit le nombre des membres prsents (art. 50). Pour les autres rgles des sances, la prsidence, la publicit des sances, les comptes rendus, voir la thorie gnrale des Assembles dlibrantes, p. 259 et les art. 51-58. Pour la 255. Prparation et vote des dlibrations. formation des commissions d'tude, les rgles sur les votes, etc., voir galement p. 262et les art. 51 59. N 3. Suspensionet dissolution des conseils municipaux.
256. Un conseil municipal ne peut tre dissous que par dcret motiv du prsident de la Rpublique, rendu en conseil des ministres et publi au Journal officiel, et, dans les colonies rgies par la prsente loi, par arrt du gouvernement en conseil priv, insr au Journal officielde la colonie. S'il y a urgence, il peuttre suspendu par arrt motiv du prfet qui doit en rendre compte immdiatement au ministre de l'intrieur. La dure de la suspension ne peut excder un mois. Dans les colonies ci-dessus spcifies, le conseil municipal peut tre
380
ORGANISATION DE LA COMMUNE
suspendu par arrt motiv du gouverneur. La dure de la suspension ne peut excder un mois. Le gouverneur rend compte immdiatement de sa dcision au ministre de la marine et des colonies. (Art, 43.) Si les arrts ou les dcrets qui prononcent la suspension ou la dissolution n'taient pas motivs, il y aurait vice de forme et ouverture recours pour excs de pouvoir. En cas de dissolution 257. De la dlgation spciale. d'un conseil municipal ou de dmission de tous ses membres en exercice, et lorsqu'aucun conseil municipal ne peut tre constitu, une dlgation spciale en remplit les fonctions. Dans les huit jours qui suivent la dissolution ou l'acceptation de la dmission ou le second tour de scrutin rest sans rsultat, cette dlgation spciale est nomme par dcret du prsident de la Rpublique, et dans les colonies par arrt du gouverneur. Le nombre des membres qui la composent est fix trois dans les communes o la population ne dpasse pas trente-cinq mille habitants. Ce nombre peut tre port jusqu' sept dans les villes d'une population suprieure. Le dcret ou l'arrt qui l'institue en nomme le prsident et au besoin le vice-prsident. Les pouvoirs de cette dlgation spciale sont limits aux actes de pure administration conservatoire et urgente. En aucun cas, il ne lui est permis d'engager les finances municipales au deldes ressources disponibles de l'exercice courant. Elle ne peut ni prparer le budget communal, ni recevoir les comptes du maire ou du receveur, ni modifier le personnel ou le rgime de l'enseignement public. (Art. 44.) Toutes les fois que le conseil municipal a t dissous, ou que par application de l'article prcdent une dlgation spciale a t nomme, il est procd la rlection du conseil municipal dans les deux mois dater de la dissolution ou de la dernire dmission. Les fonctions de la dlgation spciale expirent de plein droit ds que le conseil municipal est reconstitu. (Art. 43.) N 4. vnements qui mettent fin au mandatde conseiller municipal. 258. Ces vnements sont: 1 Le dcs ; 2 L'expiration des pouvoirs ou la dissolution du conseil; 3 La dmission volontaire. Les dmissions sont adresses au sous-prfet; elles sont dfinitives partir de l'accus de rception, par le prfet et dfaut de cet accus de rception un mois aprs le nouvel envoi de la dmission constat par lettre recommande . (Art. 60, 2.)
ATTRIBUTIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
381
4 La dmission d'office. Cette dmission est dclare soit par le prfet, soit par le Conseil d'tat dans les hypothses suivantes : ; a) Tout conseiller municipal qui, pour une cause survenue postrieurement sa nomination, se trouve dans un cas d'exclusion ou d'incompatibilit prvu par la prsente loi, est immdiatement dclar dmissionnaire par le prfet, sauf rclamation au conseil de prfecture dans les dix jours de la notification et sauf recours au Conseil d'tat, conformment aux art. 38, 39 et 40. (Art. 36.) b) Tout membre du conseil municipal qui, sans motifs reconnus lgitimes par le conseil, a manqu trois convocations successives, peut tre, aprs avoir t admis fournir ses explications, dclar dmissionnaire par le prfet, sauf recours dans les dix jours de la notification devant le conseil de la prfecture . (Art. 60, 1er.) Les trois convocations successives doivent tre entendues de convocations des sessions diffrentes et non pas de convocations des sances d'une mme session. c) La dmission est dclare par le Conseil d'tat, quand, sans excuse valable, un conseiller municipal refuse de remplir une fonction qui lui est dvolue par la loi. (L. 7 juin 1873.) DU CONSEIL MUNICIPAL. 2. ATTRIBUTIONS Article 1er. Nature des attributions.
Le conseil municipal prend des dlibrations qui contiennent des dcisions, des manifestations d'opinion, des nominations, des actes de contrle. N 1. Dcisions du conseil municipal. Il n'y a que 259. A. Force excutoire des dcisions. deux catgories de dcisions du conseil municipal : les dcisions rglementaires que la loi appelle dlibrations rglementaires, et les dcisions soumises approbation. a) Dcisions rglementaires. Les dcisions rglementaires sont excutoires par elles-mmes, un mois aprs le dpt de la copie dela dlibration la prfecture ou la sous-prfecture. Cependant, lorsque quinze jours se sont couls, le prfet, par un arrt, peut dclarer qu'il ne s'oppose pas l'excution. (Art. 66 in fine, 68 in fine.) Pendant ce dlai, et avant, par consquent, que la dcision ne soit devenue excutoire:
382
ORGANISATION DE LA COMMUNE
1 La nullit peut en tre dclare par le prfet en conseil de prfecture, soit parce qu'elle a t prise hors d'une session lgale, soit parce qu'elle porte sur un objet tranger aux attributions du conseil, soit parce qu'elle est prise en violation d'une loi ou d'un rglement d'administration publique. (Art. 63-65.) 2 L'annulation peut en tre demande pour ce fait que des membres du conseil intresss l'affaire, soit en leur nompersonnel, soit comme mandataires, ont pris part la dlibration. (Art. 64.) L'annulation est prononce alors par le prfet en conseil de prfecture. Elle peut tre provoque d'office par le prfet dans un dlai de trente jours partir du dpt du procs-verbal de la dlibration la sous-prfecture ou la prfecture. Elle peut tre aussi demande par toute personne intresse et par tout contribuable de la commune. Dans ce dernier cas, la demande en annulation doit tre dpose, peine de dchance, la sous-prfecture ou la prfecture, dans un dlai de quinze jours partir de l'affichage la porte de la mairie; il en est donn rcpiss; le prfet statuera dans le dlai d'un mois; si, l'expiration du mois, le prfet n'a pas statu sur la demande en annulation, cette demande devra tre considre comme rejete, et ceux qui l'ont prsente auront le droit de se pourvoir ainsi que nous allons l'indiquer. (Art 66.) Dans les deux cas, en effet, qu'il s'agissede la nullit de l'art. 63 ou de l'annulabilit de l'art. 64, le conseil municipal, et en dehors du conseil, toute personne intresse peut se pourvoir contre l'arrt du prfet devant le Conseil d'tat. Le pourVoi est instruit et jug dans les formes du recours pour excs de pouvoir. (Art. 67.) En somme, ces dcisions rglementaires ne peuvent tre annules avant de devenir excutoires, que pour des causes trs dtermines, parmi lesquelles ne figurent mme pas l'excs de pouvoir, et leur annulation est entoure de garanties. Comme elles constituent le droit commun des dcisions des conseils municipaux, il en rsulte que ces conseils font excuter leur volont plus facilement que les conseils gnraux, car les dcisions dfinitives des conseils gnraux sont annulables pour excs de pouvoir, et leurs dcisions ordinaires peuvent tre suspendues pour simple inopportunit. Ces dlibrations, aujourb) Dcisions soumises approbation. d'hui l'exception, sont numres dans les art. 68, 115, 121 et s. et 140. Mais il faut dire qu'elles sont relatives aux actes les plus graves de la vie communale. (V. art. 68.) En principe l'approbation mane du prfet : Les dlibrations des conseils municipaux sur les objets noncs l'article prcdent sont excutoires sur l'approbation du prfet sauf les cas o l'appro-
ATTRIBUTIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
383
bation par le ministre comptent, par le conseil gnral, par la commission dpartementale, par un dcret ou par une loi est prescrite par des lois et rglements. Le prfet statue en conseil de prfecture dans les cas prescrits aux nos 1, 2, 4, 6 de l'article 68 (baux de plus de 18 ans, alinations ou changes de proprit communales, transactions, vaine pture). Lorsque le prfet refuse son approbation ou qu'il n'a pas fait connatre sa dcision dans le dlai d'un mois partir de la date du rcpiss, le conseil municipal peut se pourvoir devant le ministre de l'intrieur. (Art. 69), (simple recours hirarchique.) 260. Objets des dcisions. Le conseil municipal, par ses dcisions, exerce les droits de la commune dans la mesure suivante: a) Droits de puissance publique I. Droits en matire de budget, La commune est moins matresse de son budget que le dpartement; le conseil municipal a moins de pouvoir que le conseil gnral; voici, en effet, la situation : La dlibration du conseil sur le budget est soumise l'approbation tantt du prfet, tantt du chef de l'tat lorsque le revenu est de trois millions de francs au moins. La porte de cette approbation et par consquent les pouvoirs du conseil municipal seront prciss par les trois rgles suivantes : 1 Sont rtablis d'office, les crdits qui n'auraient pas t inscrits pour les dpenses obligatoires, opration prvue par l'art. 149. Notons que le conseil municipal est spcialement appel a dlibrer avant que le crdit ne soit rtabli. Jusqu'ici, rien que de conforme ce qui se passe pour le dpartement, en apparence au moins. Mais il faut noter que la liste des dpenses obligatoires est infiniment plus longue, elle comprend presque tous les actes de la vie communale ordinaire. (V. art. 136.) 2 Pour les dpenses facultatives, le conseil municipal n'a pleine libert qu' une double condition: Qu'il ait pourvu toutes les dpenses obligatoires; Qu'il n'ait employ pour les dpenses obligatoires ou facultatives, ordinaires ou extraordinaires, aucune ressource extraordinaire. (V. pour la distinction du budget ordinaire et extraordinaire, infr, n 284 et les art. 133 et 134.) Si l'une de ces deux conditions n'est pas remplie, et cela arrivera frquemment pour la seconde, l'autorit suprieure peut rejeter ou rduire la dpense, elle ne peut pas l'augmenter (art. 145, 2, et 148 combins). Le dpartement, lui, a pleine libert, pourvu bien entendu qu'il ait des ressources, mais ordinaires ou extraordinaires, on ne distingue pas.
384
DE LA COMMUNE ORGANISATION
3 Enfin les conseils municipaux peuvent porter au budget un crdit pour les dpenses imprvues. Mais cette somme peut tre rduite ou rejete si les revenus ordinaires, une fois les dpenses obligatoires payes, ne permettent pas d'y faire face (art. 147). Ce crdit est employ par le maire qui en rend compte. En somme, le droit du conseil municipal se borne tre matre de son budget pour les dpenses facultatives et pour les dpenses imprvues, dans la limite des ressources ordinaires. Il faudra tenir compte de ce correctif propos de toutes les mesures d'administration dont le conseil est matre. A un autre point de vue, le budget communal prsente beaucoup plus d'lasticit que le budget dpartemental: 1 parce que les ressources communales sont plus varies ; il y a beaucoup plus d'impts communaux que d'impts dpartementaux, il suffit de citer les octrois; 2 parce qu'il y a moins d'imputation des dpenses sur ressources spciales; 3 parce qu'il y a une varit de centimesqui n'existe pas pour le dpartement, les centimes pour insuffisance de revenu. II. Droits de police. Le conseil municipal exerce une tutelle sur un certain nombre d'tablissements publics, les fabriques, les bureaux de bienfaisance, les hpitaux et hospices, la caisse des coles primaires. Lorsqu'un hospice, un hpital ou un tablissement de bienfaisance, veut faire un emprunt dont la somme ne dpasse pas le chiffre de ses revenus ordinaires, et que le remboursement doit tre opr dans le dlai de douze annes, le conseil municipal donne son avis, auquel le prfet est oblig de se conformer, en ce sens qu'il ne peut pas autoriser si le conseil dsapprouve. (Art. 119, loi municipale.) : il Le conseil municipal exerce encore les droits de police suivants dcide l'tablissement des simples marchs d'approvisionnement, et il vote, sauf approbation, l'tablissement ou la suppression des autres marchs. (Art. 68, n 13.) III. Droits relatifs au domaine public. Le classement, le dclassement, le redressement ou le prolongement, l'largissement, la suppression, la dnomination des rues et des places publiques, la cration et la suppression de promenades, squares ou jardins publics, champs de foire, de tir ou de course, l'tablissement des plans d'alignement et de nivellement des voies publiques municipales, les modifications des plans d'alignement adopts, sont des dcisions du conseil municipal soumises approbation (art. 68, n 7). Il faut rapprocher de cette matire celle de l'affectation des btiments un service public. Le conseil municipal peut affecter librement les
MUNICIPAL ATTRIBUTIONS DU CONSEIL
3R5
proprits communales qui ne sont pas dj affectes. Il ne peut pas changer l'affectation, ni par consquent dsaffecter, sans l'autorisation de l'autorit suprieure. (Art. 68, n 5.) IV. Modes d'acqurir. Les impts communaux ) Impts. sont assez nombreux et les conseils municipaux ont pour les tablir d'assez grands pouvoirs: Centimesadditionnels. Les centimes additionnels sont les impts accessoires aux quatre grandes contributions directes perues au profit de l'tat. Un centime reprsente la centime partie du principal peru au profit deJ'tat. Les communes peuvent arriver s'imposer de 100 centimes et au del, de sorte que la somme paye par le contribuable la commune peut dpasser la somme paye l'tat. Nous savons qu'on appelle valeur du centime dans chaque commune, la somme fournie par un centime additionnel aux quatre contributions directes. Les conseils municipaux votent seuls dans la limite fixe annuellement par le conseil gnral, des centimes extraordinaires jusqu' concurrence de 5 centimes pendant cinq ans, pour les affecter des dpenses facultatives; ils votent galement d'autres centimes indiqus dans l'art. 141. Ils votent avec approbation du prfet les centimes extraordinaires audessus de cinq, tout en restant en dessous du maximum fix par le conseil gnral, et ce jusqu' trente ans. (Art. 142.) Au-dessus de ces limites, le conseil municipal dlibre, mais il faut, suivant les distinctions de l'art. 143, l'approbation tantt par dcret du chef de l'tat, tantt par dcret en Conseil d'tat, tantt par une loi. Impt des prestations affectspcialement la construction et l'entretien des chemins vicinaux. En matire de prestations, le conseil muni: 1 pour subvenir aux besoins de la vicinalit cipal a les droits suivants il peut opter entre| l'impt des prestations et des centimes additionnels spciaux; 2 si les ressources ordinaires suffisent, il peut refuser d'tablir ou supprimer l'impt des prestations; 3 il fixe le nombre des journes de prestation ncessaire jusqu' un maximum de trois et mme de quatre. (L. 21 mai 1836, art. 2; 1. 11 juillet 1868.) Autres taxes directes. Les taxes particulires dues par les propritaires ou habitants, en vertu d'une loi ou d'usages locaux, sont rparties par une dlibration du conseil municipal approuve parle prfet. (Pavage, balayage, etc., art. 140.) Octrois. Les octrois sont tablis sur l'initiative du conseil municipal par dcret en Conseil d'tat. Les conseils municipaux votent seuls la prorogation pour cinq ans des taxes existantes, ils peuvent mme augmenter pendant le mme temps les taxes, pourvu qu'ils restent dans les limites du tarif gnral. (Art. 139.) Ils peuvent, avec l'approbation du prfet et aprs avis de la commission dpartementale, voter la suppression ou la diminution des taxes (art 138). Pour tout le reste, tablissement premier de l'octroi, tablissement de taxes nouvelles, augmentation pour plus de cinq ans, modifications au H. 25
386
DE LA COMMUNE ORGANISATION
primtre, etc., etc., il faut l'intervention de l'tat par un dcret ou par une loi, aprs avis du conseil gnral ou de la commission dpartementale. (Art. 137.) Autres taxes indirectes. Les droits de place dans les halles, foires, marchs, abattoirs, etc., les permis de stationnements, les pages communaux, etc., sont perus en vertu de tarifs vots par le conseil municipal, sauf autorisation. (Art. 68, n 7.) Le conseil municipal dcide seul les tra) Travauxpublics. vaux publics, lorsque les dpenses totalises avec les dpenses de mme nature pendant l'exercice courant, ne dpassent pas la limite des ressources qu'il peut crer seul; au del, il faut autorisation, encore faut-il observer que si une expropriation est ncessaire, l'utilit publique du travail doit tre dclare par une autorit suprieure. Droits de Le conseil municipal peut faire b) personne prive. seul les actes de libre administration: baux jusqu' une dure de dix-huit ans, aussi bien comme bailleur que comme preneur (art. 68, n 1); acquisitions d'objets mobiliers (eod., nos 2 et 3); acquisitions d'immeubles, quand la dpense, totalise avec les dpenses de mme nature pendant l'exercice courant, ne dpasse pas les limites des ressources ordinaires et extraordinaires que les communes peuvent se crer sans autorisation spciale. Le conseil municipal ne peut pas dcider seul, il ne fait que dlibrer avec ncessit de l'approbation de l'autorit suprieure, dans les cas suivants : baux de plus de dix-huit ans ; alinationset changes des biens des communes (art. 68, n 2) ; acquisitions lorsque les dpenses dpassent les limites des ressources ordinaires et extraordinaires ; transactions, acceptations de dons ou legs lorsqu'il y a des charges, ou conditions, ou des difficults de la part des familles (art. 68, n 8); comparution en justice (autorisation du conseil de prfecture) Le conseil municipal rgle seul les emprunts remEmprunts. boursables sur les centimes qu'il peut voter seul, ou bien sur les ressources ordinaires; dans le premier cas, l'emprunt doit tre remboursable en cinq ans, dans le second en trente ans (art. 141). Pour les emprunts qui dpassent ces limites, voir art. 141-142. N 2. Manifestations d'opinion.
261. Le conseil municipal dfend les intrts de la commune par des vux qui doivent avoir pour objet l'intrt local. Art. 61, par des rclamations, par des avis et des propositions :
MUNICIPAL DU CONSEIL ATTRIBUTIONS
387
Avis. 1 Le prfet est toujours libre de consulter un conseil municipal; 2 Le conseil municipal est ncessairement appel donner son avis sur les objets suivants: 1 Les circonscriptions relatives aux cultes; 2 les circonscriptions relatives la distribution des secours publics; 3 les projets d'alignement et de nivellement de grande voirie dans l'intrieur des villes, bourgs et villages; 4 la cration des bureaux de bienfaisance; 5 les budgets et les comptes des hospices, hpitaux et autres tablissements de charit et de bienfaisance, des fabriques et autres administrations prposes aux cultes dont les ministres sont salaris parl'tat'; les autorisations d'acqurir, d'aliner, d'emprunter, d'changer, de plaider ou transiger, demandes par les mmes tablissements ; l'acceptation des dons el legs qui leur sont faits; 6 enfin tous les objets sur lesquels les conseillers municipaux sont appels par les lois et rglements donner leurs avis. (Art. 70. 3 En rgle gnrale ces avis sont purement consultatifs, cependant l'art. 119contient un cas o le prfetne peut agir sans l'avis conforme; 4 Lorsque le conseil municipal, rgulirement convoqu, refuse ou nglige de donner son avis, il peut tre pass outre. N 3. Actes de contrle. 262. Le conseil municipal dlibre sur les comptes d'administration qui lui sont annuellement prsents par le maire, conformment l'art. 151 de la prsente loi. Il entend, dbat et arrte les comptes de deniers des receveurs, sauf rglement dfinitif, conformment l'article 157 de la prsente loi. (Art. 71.) N 4. Nominations. 263. Le conseil municipal nommeou lit le maire, le ou les adjoints, les dlgus snatoriaux, certains membres des commissions administratives des hospices et des bureaux de bienfaisance, les membres des comits des syndicats des communes, etc. Article II. Nature, forme des actes, recours et voies de nullit. 264. Tous les actes du conseil municipal, assemble dlibrante,
1. Avant la loi du 5 avril 1884,les budgets de ces tablissements n'taient soumis l'examen du conseil municipal que si cestablissements demandaient des subventions la commune.
DE LA COMMUNE 388 ORGANISATION sont des dlibrations; celles des dlibrations qui contiennent dcision excutoire constituent en outre des actes d'administration. Les dlibrations sont soumises toutes les conditions de fond et de forme qui ont t tudies propos de la thorie des assembles dlibrantes. (V. p. 262 et s.) Les dlibrations des conseils municipaux peuvent tre attaques deux titres diffrents : 1 A titre d'acte d'administration, par le recours pour excs de pouvoir, lorsqu'elles renferment dcision excutoire et qu'elles sont devenues rellement excutoires, c'est--dire, si ce sont des dcisions rglementaires, lorsque le dlai de trente jours est coul. 2 Simplement titre de dlibration, qu'elles contiennent ou non dcision excutoire, mme si elles ne contiennent qu'une rclamation, un vu ou une nomination. Elles peuvent tre argues de nullit pour cause de violation de la loi ou d'un rglement, par consquent pour toute espce d'irrgularit, toute poque et par toute partie intresse. La nullit est dclare par le prfet en conseil de prfecture. (Art. 63-65.) Rgime spcial de Paris. 265. Nous savons dj 'qu' Paris il y a une confusion presque complte entre la ville de Paris et le dpartement de la Seine. Paris est un dpartement autant qu'une commune. A ce point de vue il a quelque ressemblance avec Londres, qui forme un comt1. Paris a deux organes municipaux un organe excutif et un dli: brant. L'organe excutif est constitu par deux prfets nomms par le chef de l'tat, le prfet de police et le prfet de la Seine. Ils jouent le rle de maire, et sont en mme temps organe excutif du dpartement de la Seine. Le partage des attributions est fait entre eux par un dcret du 10 octobre 1859. L'organe dlibrant est constitu par un conseil municipal, compos de quatre-vingts membres nomms au scrutin uninominal raison de un par quartier. Ce conseil municipal, lgrement modifi par l'adjonction de conseillers de la banlieue, devient le conseil gnral de la Seine. La loi du 5 avril 1884 ne s'est pas applique au conseil municipal de Paris; il faut se reporter, pour l'organisation, aux lois du 16 septembre 1871, 19 mars 1875; pour les attributions, la loi du 24 juillet 1867. La ville de Paris est en outre divise en vingt arrondissements municipaux, un d'ordre mesure cres pour par uniquement circonscriptions 1. Londres forme mme trois-comts concentriques ; 2la banlieue; : 1la cit 3 la ville entire. Chacun de ces comts est charg de services diffrents.
RGIME DE PARIS SPCIAL
389
Certain nombre de services. Dans ces arrondissements sont des maires et des adjoints nomms par le chef de l'tat, qui tiennent certains pouvoirs de la loi et des rglements. Le principal de ces pouvoirs est celui d'officier de l'tat civil. Le personnel des fonctionnaires subordonns se partage entre les deux prfets; celui de la police est, bien entendu, sous la direction de la prfecture de police. La situation ambigu de la ville de Paris tient non seulement son norme population, mais ce qu'elle est le sige du gouvernement et des principaux services publics. Le maintien de l'ordre n'y est pas seulement une question municipale, mais une question qui intresse la France entire ; de l, la mainmise de l'tat sur la mairie et sur la police municipale. Dans l'avenir, la situation de Paris pourra s'accentuer dans deux sens bien diffrents : ou bien, dans le sens municipal, il y aurait alors une mairie centrale ; ou bien, dans le sens dpartemental, Paris pour tous les services communs ne serait plus qu'un dpartement, il y aurait dans son sein plusieurs communes pour la gestion des services locaux : les arrondissements actuels formeraient l cadre de ces communes. Banlieue. Ajoutons que le prfet de police de Paris exerce une bonne partie de ses attributions de police municipale, toutes celles qui intressent la scurit: 1 Dans toutes les communes du dpartement dela Seine (1.10 juin 1853) ; 2 dans certaines communes du dpartement de Seine-etOise, Saint-Cloud, Meudon, Svres et Enghien (Arr. 3 brumaire an IX; 1. 14 aot 1850) ; en somme, dans toute la banlieue, laissant aux maires de ces communes le surplus de la police, c'est--dire les numros 1, 4, 5, 6, 7, 8, art. 97 de la loi du 5 avril 1884. Lyon et l'agglomration lyonnaise.
266. A raison de sa nombreuse population et pour des raisons politiques, la ville de Lyon a t diverses reprises soumise au mme que Paris, en ce sens que le prfet du Rhne devenait maire de Lyon. La dernire priode fut de la loi du 4 avril 1873 celle du 21 avril 1881. Depuis cette dernire date il y a un maire lu Lyon. Cependant il reste quelques traces du rgime prcdent. Le prfet du Rhne est encore investi dans la ville de Lyon et dans les communes de la banlieue, dont une du dpartement de l'Ain, d'une partie des pouvoirs de police municipale, laissant le reste aux maires. C'est le rgime des communes suburbaines de la Seine. (Art. 104, 1. 5 avril 1884.)
390
ORGANISATION DE LA COMMUNE
D'autres part, Lyon est divis, comme Paris, en arrondissements municipaux ; il y en a six, mais au lieu de maires fonctionnaires, ils sont administrs par des adjoints, deux par arrondissement. Ces adjoints sont chargs de la tenue des registres de l'tat civil et des autres attributions dtermines dans un rglement d'administration publique du 11 juin 18811. Les communes d'Algrie et des colonies. 267. Il existe en Algrie et dans plusieurs colonies trois catgories de communes qui toutes sont doues de la personnalit administrative, mais qui n'ont pas la mme organisation: 1 Les communes de plein exercice situes en territoire civil et o domine la population europenne ; 2 Les communes mixtes situes en territoire civil mais o la population est mlange. 3 Les communes indignes situes en territoire militaire Les communes mixtes et les communes indignes ne sont pas dcentralises, c'est--dire que les administrateurs y sont nomms par le gouverneur et qu'ils ont ct d'eux une commission administrative qui, suivant les cas, a voix dlibrative ou consultative et dont les membres sont dsigns par le gouverneur. Les communes de plein exercice de l'Algrie ont t soumises la loi du 5 avril 1884 par cette loi elle-mme, avec des rserves, art. 164. Les communes de la Martinique, de la Gouadeloupe et de la Runion qui sont toutes de plein exercice, ayant t soumises galement avec rserves. (V. art. 165.) Il existe aussi des groupements pour lesquels on a laiss aux indi; tels sont les douars d'Algrie administrs par une gnes leurs usages djemma (conseil) et par un cad; les douars doivent tre considrs comme des sections de communes; tels sont les villages annamites, etc. 1. Une application de ces rgles exceptionnelles avait t faite par la loi de sret gnrale du 5 mai 1855dans toutes les villes chefs-lieux du dpartement dont la population excdait 40,000mes. Le prfet tait charg d'une bonne partie de la police municipale, peu prs dans les conditions de communes suburbaines de la Seine. Ces dispositions ont t abroges par la loi du 24 juillet 1867,art. 23, il en reste ceci, c'est que dans les villes de plus de 40,000mes, l'organisation de la police est rgle parle chef de l'tat sur dlibration du conseilmunicipal et que la dpense en est obligatoire. (Art. 103de la loi du 5 avril 1884.) 2. Cette organisation a t tendue au Sngal par un dcret du 13 dcembre 1871.
CHAPITRE
IV
ORGANISATION DES COLONIES1
268. Nous avons vu, p. 227, que l'tablissement de l'Algrie, surtout depuis les dcrets de rattachement, ne constitue pas une personne administrative distincte de l'tat franais. Il n'y a donc point s'occuper ici de son organisation. Pour une raison diffrente, il n'y a pas s'occuper non plus des pays soumis uniquement notre protectorat. Ces pays ne sont pas membres de l'tat franais, ils constituent eux-mmes des tats soumis, il est vrai, notre influence, maisqui, thoriquement, conservent leur qualit d'tat. L'organisation des protectorats relve du droit public international, plutt que du droit public national. Enfin, il y a des rgimes mal dfinis : protectorats qui se transforment en colonie, par suites d'une lente annexion, possessions dans l'Afrique occidentale qui reposent la fois sur des conqutes et des traits de protectorat; tous ces rgimes provisoires doivent aussi tre laisss en dehors. Il s'agit uniquement des colonies proprement dites soumises une organisation peu prs uniforme. Ce qui distingu la colonie des autres possessions, ce n'est ni le fait qu'il y existe un conseil colonial autonome, car il peut n'y en pas avoir; ni le fait qu'il y a un budget local, car de simples possessions peuvent en avoir. C'est le fait que le pays est administr pour un fonctionnaire ayant rang de gouverneur. Les colonies ont en effetdroit un gouverneur, et mme un gouverneur d'une classe plus ou moins leve suivant le groupe auquel elles appartiennent. (D. 2 fvrier 1890.) Nos colonies 269. Renseignements de statistique. sont : la Cochinchine, l'Inde, Mayotte, Nossi-b, Sainte-Marie de Madagascar, la Nouvelle-Caldonie, Tati et ses dpendances, la Guine, le Sngal, la Guyane, Saint-Pierre et Miquelon, et enfin les trois plus avances au point de vue de l'assimilation la mre-patrie: la Guadeloupe, la Martinique et la Runion1. 1. Pour la personnalit administrative descolonies, v. p. 227.
392
ORGANISATION DES COLONIES
La superficie de ces colonies est approximativement de onze millions d'hectares, formant ainsi l'quivalent de quinze dpartements franais. La population est de prs de trois millions d'habitants, formant seulement l'quivalent de six dpartements. Les budgets locaux dpassent cinquante millions de francs, et il est remarquer que ce chiffre ne reprsente pas toutes les dpenses d'administration des colonies, chaque colonie, outre son budget local, ayant un budget mtropolitain aliment par les ressources de l'tat el rattach pour ordre au budget de l'tat. Nos colonies ont une certaine 270. Organisation gnrale. ressemblance avec les dpartements franais, et elles ont une tendance se transformer en dpartement. Leur ambition est l'assimilation progressive la mre-patrie et l'incorporation complte1. Notre systme colonial procde ainsi de la mthode romaine, la concession progressive, du droit de cit. Il est tout l'oppos du systme anglais qui consiste riger progressivement la colonie en tat indpendant. Le territoire de chaque colonie forme une seule circonscription. En gnral, il n'y a pas de subdivision en arrondissements. Il yen a cependant en Cochinchine et dans l'Inde. 1 le rgime civil est tabli aux colonies comme dans la mre-patrie; 2 il y a dans chaque colonie une administration locale doue d'autonomie, c'est--dire qu'il y a dcentralisation au point de vue colonial aussi bien qu'au point de vue dpartemental. Cette administration locale, depuis des dcrets relativement rcents qui ont organis partout des conseils coloniaux lectifs, est constitue d'un organe excutif, le ; gouverneur de la colonie, et d'un organe dlibrant, le conseil colonial 3 les organes de la colonie ont plus d'importance que ceux du dpartement. Ainsi le gouverneur a plus d'importance qu'un prfet; non seulement des pouvoirs plus considrables lui sont dlgus par le chef de l'tat, mais il est un peu lui-mme dans la situation d'un chef d'tat, en ce sens qu'il a sous ses ordres des sortes de sous-secrtaires d'tat qui sont des autorits administratives secondaires; ce sont les directeurs de l'Intrieur et autres. Le conseil colonial a galement plus d'importance que le conseil gnral d'un dpartement, parce que les droits de la colonie, qu'il exerce, sont plus tendus. Il se compose 271. A. Organe excutif. : 1 d'autorits administratives: le gouverneur et les directeurs de services ; 2 de 1. Projet de loi dpos par le gouvernement le 23 juin 1891pour assimiler les Antilleset la Runion des dpartements.
LE GOUVERNEUR ET LE CONSEIL COLONIAL
393
fonctionnaires: d'excution. Gouverneur. Le gouverneur est nomm par le chef de l'tat, aucune condition particulire n'est exige. Le dcret du 2 fvrier 1890 a tabli comme pour les prfets un systme de classes1 et une situation de disponibilit. Il a comme le prfet un double caractre, il est la fois agent du pouvoir rgional de l'tat et agent de la colonie. En sa qualit d'agent excutif de la colonie, il excute les dcisions du conseil colonial; comme agent-de l'tat, ses pouvoirs dpendent des dlgations qu'il a reues. Ils sont en gnral trs tendus, il a vis--vis du conseil colonial, et des conseils municipaux, des pouvoirs de dissolution qui dans la mtropole n'appartiennent qu'au chef de l'tat. Il a, bien entendu, un pouvoir rglementaire qu'il exerce par des arrts; il a mme quelquefois des pouvoirs diplomatiques. Directeurs. Les directeurs de service sont en nombre variable, les principaux sont: les directeurs de l'intrieur, de la justice, des forces militaires; ils ont des attributions qui rappellent celles des ministres: 1 ils contresignent les actes du gouverneur; 2 ils ont des attributions propres en vertu desquelles ils prennent des dcisions. Le directeur de l'Intrieur reprsente le gouverneur auprs du conseil colonial. Conseil priv. Le conseil priv est un corps purement consultatif, le gouverneur peut tre tenu de prendre son avis, non de le suivre. Il se compose du gouverneur, des chefs de services et de notables dsigns administrativement. Sa composition est d'ailleurs variable d'une colonie l'autre. Grce l'adjonction de quelques magistrats, ce conseil se transforme en tribunal administratif et prend alors le nom de conseil du contentieux. Conseils coloniaux. Les 272. B. Organe dlibrant. conseils coloniaux se rapprochentdes conseils gnraux de dpartement, ils sont complts comme ceux-ci par une commission coloniale tire de leur sein, et jouant le rle de la commission dpartementale. Dans les Antilles et la Runion, l'organisation du conseil colonial date du snatus-consulte du 4 juillet 18G6. Dans les autres colonies elle est plus rcente: Guyane (D. 23 sept. 1878); Sngal (D. 4 fvr., 1879); Inde (D. 25 janv. 1879); Cochin1. La combinaison des classes territoriales et des classes personnelles est peut-tre plus ingnieuse que pour les prfets. La base est la classe personnelle, seulement les colonies du premier groupe ont droit un gouverneur des trois premires classes.
le conseil priv qui assiste le gouverneur, et les agents
394
ORGANISATION DES COLONIES
chine (D. 8 fvr. 1880); Nouvelle-Caldonie (D. 2. avr. 1885); Saint-Pierre et Miquelon (D. 2 avril. 1385); Ocanie (D. 28 dc. 1885). La commission coloniale a t tablie dans les Antilles et la Runion par le dcret du 12 juin 1879; Saint-Pierre et Miquelon par le dcret qui a organis le conseil colonial ; la Guyane par le dcret du 28 avril 1882; au Sngal par le dcret du 12 aot 1885. Ces conseils sont lectifs ; dans les colonies o il ya des indignes, ceux-ci sont reprsents. Ainsi en est-il dans l'Inde et en Cochinchine. Partout on a dcoup dans le territoire des circonscriptions quivalentes au canton, et il y a un conseiller par circonscription. Partout le conseil est divis en deux sries et renouvelable par moiti; la dure du mandat est tantt de six ans, tantt de quatre. Partout on a organis le systme des sessions poque fixe, tantt deux, tantt une, la commission coloniale sigeant dans l'intervalle. Les attributions de ces conseils coloniaux sont les mmes en principe que celles des conseils gnraux. Au point de vue de l'autorit des dcisions, il en est de dfinitives, de soumises annulation par dcret suivant des formes et des dlais variables. Il est de simples dlibrations soumises approbation. Au point de vue des objets des dcisions : vote du budget et exercice des droits de la colonie; mais la colonie a plus de droits que le dpartement. Le budget de la colonie est plus important que celui du dpartement, par suite de ce fait que la colonie ne paie pas d'impts d'tat et qu'elle a tabli pour son compte presque tous les impts qui existent en France au profit de l'Etat. Le budget est dfinitivement rgl par arrt du gouverneur, mais celui-ci n'a pas plus de pouvoirs que le chef de l'Etat vis--vis des conseils gnraux, il se borne pourvoir aux dpenses obligatoires, il ne peut pas modifier les dpenses facultatives.
CHAPITRE
V PUBLICS1.
ORGANISATION DES TABLISSEMENTS
273. Ce qui mrite d'tre signal tout d'abord quand on aborde l'tude de l'organisation des tablissements publics, c'est que les uns sont dcentraliss, que les autres ne le sont pas. La dcentralisation a fait sentir son action sur quelques-uns d'entre eux mais pas sur tous. Nous entendons par organisation dcentralise une organisation fonde en tout ou en partie sur l'lection. Sont donc dcentraliss les tablissements publics dont les organes sont constitus en tout ou en partie par le suffrage des individus intresss au service ; sont centraliss au contraire ceux dont les organes sont constitus par le pouvoir central. Sont dcentraliss ce titre les tablissements suivants : fabriques (lection par cooptation) ; consistoires protestants et istralites (lection par les religionnaires), hospices et hpitaux, bureaux de bienfaisance (lection partielle par le conseil municipal) ; chambres de commerce, chambres consultatives des arts et manufactures (lection par commerants ou industriels); associations syndicales autorises (lection par les syndiqus); syndicats de communes (lection par les conseils municipaux) ; sections de commune (lection dans les cas o il est form des commissions syndicales). Ils est remarquer que pour tous les tablissements dcentraliss, la lgislation a une tendance se rapprocher de la lgislation communale pour les rgles des dlibrations des conseils, pour la force excutoire des dlibrations, pour l'organisation de la tutelle que conserve l'tat, pour les rgles de comptabilit, etc., etc. On peut faire d'autres remarques : il est des tablissements publics qui n'ont point proprement parler d'organisation administrative, ainsi les menses piscopales et curiales sont de purs patrimoines qui sont reprsents par des sortes d'usufruitiers, l'vque et 1. Pour la personnalit administrative des tablissements publics et leur distinction d'avec les tablissementsd'utilit publique, v. p.227 et s.
396
ORGANISATION DES TABLISSEMENTS PUBLICS
le cur ; il en est d'autres comme les sections de commune qui n'ont qu'une organisation intermittente, l'ordinaire, leurs intrts sont grs par le conseil municipal et le maire de la commune, ce n'est qu'en cas d'opposition d'intrts avec la commune qu'il est organis une commission syndicale ; il en est o l'on ne trouve qu'un seul organe, une agence collective qui cumule les fonctions dlibrantes et les excutives, ainsi en est-il des chambres de commerce, des chapitres de chanoines ; tandis que dans d'autres on trouve un organe excutif et un conseil dlibrant, ainsi en est-il dans les associations syndicales, dans les Facults d'enseignement suprieur, etc. Le manque d'espace ne nous permettant pas d'tudier l'organisation de tous les tablissements publics que nous avons numrs page 231, nous nous occuperons seulement des tablissements communaux de bienfaisance, hpitaux, hospices, bureau de bienfaisance, des fabriques et des syndicats de communes. A propos des travaux publics, n 499, il sera question des associations syndicales autorises. N 1. tablissements communaux de bienfaisance.
274. Il existait en 1886, en France, 1,657 hpitaux et hospices disposant de 150,000 lits de malades et d'un budget de 110 millions de francs, mais la moiti peu prs de cette somme fournie par des subventions de l'tat et des communes. A la mme poque, il y avait 14,944 bureaux de bienfaisance ayant secouru 1,440,000 indigents avec un budget de recettes de 52 millions, dont 12 millions fournis par des subventions des communes. L'organisation et le mode d'administration de ces divers tablissements sont trs voisins les uns des autres; tous sont administrs par un organe collectif unique qui porte le nom de commission administrative ( Paris tous ces services sont centraliss sous le nom d'assistance publique. V. pour l'organisation 1. 10 janvier 1849.) 275. tives administrades commissions Organisation (Lois du 21 mai 1873 et du 5 aot 1879.)
Les commissions administratives des hospices et des hpitaux et celles des bureaux de bienfaisance sont composes du maire et de six membres renouvelables. Deux des membres de chaque commission sont lus par le conseil municipal. Les quatre autres membres sont nomms par le prfet (L. 1879, art. 1er.) Le nombre des membres renouvelables peut, en raison de l'importance des tablissements et de circonstances locales, tre augment par un dcret spcial rendu sur l'avis du Conseil d'tat. Dans ce cas,
ET HOSPICES LES HOPITAUX
397
l'augmentation aura lieu par nombre pair, afin que le droit de nomi nation s'exerce, dans une proportion gale, par le conseil municipal et par le prfet. (Art. 2.) Les dlgus du conseil municipal suivent le sort de cette assemble quant la dure de leur mandat; mais, en cas de suspension ou de dissolution du conseil municipal, ce mandat est continu jusqu'au jour de la nomination des dlgus par le nouveau conseil municipal. Les autres membres renouvelables sont nomms pour quatre ans. Chaque anne, la commission se renouvelle par quart. Les membres sortants sont rligibles. Si le remplacement a lieu dans le cours d'une anne, les fonctions du nouveau membre expirent l'poque o auraient cess celles du membre qu'il a remplac. Ne sont pas li gibles ou sont rvoqus de plein droit les membres qui se trouveraient dans un des cas d'incapacit prvus par les lois lectorales. L'lec tion des dlgus du conseil municipal a lieu au scrutin secret, la majorit absolue des voix. Aprs deux tours de scrutin, la majorit re lative suffit, et, en cas de partage, le plus g des candidats est lu. (Art. 4.) La prsidence appartient au maire ou l'adjoint, ou au conseiller municipal remplissant dans leur plnitude les fonctions de maire Le prsident a voix prpondrante en cas de partage. Les commis sions nomment tous les ans un vice-prsident. En cas d'absence du maire et du vice-prsident, la prsidence appartient au plus ancien des membres prsents, et, dfaut d'anciennet, au plus g. Les fonc tions de membre des commissions sont gratuites. (L. 21 mai 1873, art. 3.) Les commissions peuvent tre dissoutes et leurs membres rvoqus par le ministre de l'intrieur. En cas de dissolutionou de rvocation la commission sera remplace ou complte dans le dlai d'un mois. Les dlgus des conseils municipaux ne pourront, s'ils sont rvo qus, tre rlus pendant une anne. En cas de renouvellement total ou de cration nouvelle, les membres que l'art. 1erlaisse la nomina tion du prfet seront, sur sa proposition, nomms par le ministre de l'intrieur. Le renouvellement par quart sera dtermin par le sort la premire sance d'installation. (Arl. 5, 1. 5 aot 1879.) Les receveurs des tablissements charitables sont nomms par les prfets sur la prsentation des commissions administratives. En cas de refus motiv par le prfet, les commissions sont tenues de prsenter d'autres candidats. Le receveur peut cumuler ses fonctions avec celles du secrtaire de la commission ; ils ne peuvent tre rvoqus que par le ministre de l'intrieur . (Art. 6, 1.1873.) 276. Attributions des commissions administratives. ; l. 5 avr. 1884, art. 119 et 120.) Les commissions (L. 22janv. 1851 administratives prennent des dlibrations qui contiennent soit des
398
ORGANISATION DES TABLISSEMENTS PUBLICS
dcisions relatives l'exercice des droits de l'tablissement, soit des nominations ou prsentations. Elles pourvoient aussi elles-mmes l'excution de leurs dcisions. Dcisions. Au point de vue de leur force excutoire, les dcisions des commissions administratives sont de deux classes comme celles des conseils municipaux : 1 dcisions rglementaires excutoires par elles-mmes si trente jours aprs la notification officielle le prfet ne les a pas annules, soit d'office pour violation de la loi ou d'un rglement d'administration publique, soit sur la rclamation de toute partie intresse (art. 8) 1. 2e Dcisions soumises approbation. L'approbation mane tantt du prfet, tantt du chef de l'tat, tantt du parlement; le plus souvent il faut aussi l'avis du conseil municipal. Au point de vue de l'objet des dcisions, la loi pose les rgles suivantes: La commission des hospices et hpitaux rgle par ses dlibrations les objets suivants : Le mode d'administration des biens et revenus des tablissements hospitaliers ; Les conditions des baux ferme de ces biens, lorsque leur dure n'excde pas dix-huit aus pour les biens ruraux et neuf ans pour les autres ; Le mode et les conditions des marchs pour fournitures et entretien dont la dure n'excde pas une anne, les travaux de toute nature dont la dpense ne dpasse pas 3,000 fr. La commission arrte, mais avec l'approbation du prfet, les rglements du service tant intrieur qu'extrieur et de sant, et les contrats passer pour le service avec les congrgations religieuses. (Art. 8.) La commission dlibre sur les objets suivants: Les budgets, comptes, et en gnral toutes les recettes et dpenses des tablisse ments ; Les acquisitions, changes, alinations des proprits de ces tablissements, leur affectation au service, et en gnral tout ce ; Les projets qui intresse leur conservation et leur amlioration des travaux pour construction, grosses rparations et dmolitions dont la valeur excde 3,000 fr ; Les conditions ou cahier des charges des adjudications de travaux et marchs pour fournitures ou entretien dont la dure excde une anne ; Les actions judiciaires et transactions; Les placements de fonds et emprunts ; Les acceptations des dons et legs. (Art. 9.) Les dlibrations comprises dans l'article prcdent sont soumises l' avis du conseil municipal, et suivent, quant aux autorisations, les 1 Dans le cas de rclamation de la partie intresse, l'annulation peut tre prononce pour toute espce de motif, mme pour inopportunit, diffrence avec les dcisions des conseils municipaux. (V. art. 63et 65, I. 1884.)
LES FABRIQUES
399
mmes rgles que les dlibrations de ce conseil. Nanmoins l'alina tion des biens immeubles formant la dotation des hospices et hpi taux ne peut avoir lieu que sur l'avis conforme du conseil municipal. (Art. 10). Les dlibrations des commissions administratives des hospices, hpitaux et autres tablissements charitables communaux concernant un emprunt, sont excutoires en vertu d'un arrt du prfet, sur avis conforme du conseil municipal, lorsque la somme emprunter ne d passe pas le chiffre des revenus ordinaires de l'tablissement et que le remboursement doit tre effectu dans un dlai de douze annes. Si la somme emprunter dpasse ledit chiffre ou si le dlai de rembour sement excde douze annes, l'emprunt ne peut tre autoris que par un dcret du prsident de la Rpublique. Le dcret est rendu en Conseil d'tat si l'avis du conseil municipal est contraire ou s'il s'agit d'un tablissement ayant plus de 100,000 francs de revenus. L'em prunt ne peut tre autoris que par une loi, lorsque la somme em prunter dpasse 500,000 francs ou lorsque ladite somme, runie au chiffre d'autres emprunts non rembourss, dpasse 500,000 francs. (L.5 avr. 1884, art. 119.) Pour les affectations des locaux, V. art. 120, 1. 1884. N 2. Fabriques. (D. 30 dc. 1809; O.12 janvier 1825.)
277. Les fabriques sont charges de veiller l'entretien et la conservation des difices consacrs au culte, d'administrer les fonds affects l'exercice du culte ; enfin d'assurer cet exercice et le maintien de sa dignit en rglant les dpenses ncessaires et les moyens d'y pourvoir. (D. 30 dc. 1809, art. 1er.) Les fabriques ne sont pas propritaires des glises ; aux termes de l'avis du Conseil d'tat du 2 pluvise an XIII, ce sont les communes; mais elles sont charges de l'entretien et des rparations l'glise. Les fabriques ne sont pas propritaires des presbytres, ce sont galement les communes; mais les fabriques sont-charges de l'entretien et des rparations au presbytre, ou bien elles sont tenues de fournir une indemnit de logement au desservant. Ces obligations de la fabrique peuvent subsidiairement tomber la charge de la commune dans la mesure suivante: 1 La commune est tenue des grosses rparations l'glise et au presbytre, lorsque les ressources disponibles de la fabrique sont insuffisantes (art. 136, n 11, 1. 1884) ; 2 elle est tenue dans le mme cas de payer une indemnit de logement au desservant s'il n'y a point de presbytre (art. 136, n 11, ibid.) Ce sont deux cas -de dpense obligatoire, mais depuis la loi de 1884, la commune n'est point tenue de contribuer aux autres frais du culte. Les fabriques, depuis la loi de 1884, n'ont plus la charge de l'entre-
400
DES TABLISSEMENTS ORGANISATION PUBLICS
tien des cimetires, cette charge est devenue exclusivement communale. (Art. 136, n 13.) Les fabriques sont reprsentes par deux organes : le conseil de fabrique et le bureau des marguilliers. Organisation. Le conseil 278. Conseils de fabrique. de fabrique est compos de membres de droit et de membres choisis par cooptation: Dans les paroisses o la population sera de cinq mille mes et audessus, le conseil sera compos de onze membres (neuf conseillers et deux membres de droit); dans toutes les autres, il devra l'tre de sept (cinq conseillers et deux membres de droit) . D. 30 dc. 1809, art. 3. Seront de droit membres du conseil : 1 le cur ou desservant, qui y aura la premire place et pourra se faire remplacer par un de ses vile maire de la commune du chef-lieu de lacure ou succursale caires ; 2 ; il pourra se faire remplacer par l'un de ses adjoints ; si le maire n'est pas catholique, il devra se substituer un adjoint qui le soit, ou dfaut un membre du conseil municipal catholique. (Art. 4.) Dans les villes o il y aura plusieurs paroisses ou succursales, le maire sera de droit membre de chaque conseil de fabrique. (Art. 5.) Dans les paroisses dans lesquelles le conseil de fabrique sera compos de neuf membres non compris les membres de droit, cinq des conseillers seront pour la premire fois la nomination de l'vque et quatre celle du prfet; dans celle o il ne sera compos que de cinq membres l'vque en nommera trois et le prfet deux. (Art. 6.) Le conseil de fabrique se renouvellera partiellement tous les trois ans, de faon tre compltement renouvel en deux fois. Par consquent, une fois sortiront cinq ou trois conseillers, la fois suivante quatre ou deux. (Art. 7.) Cette lection sefaitla session de Quasimodo. (0. 1825, art. 2.) Les conseillers qui devront remplacer les membres sortants seront lus par les membres restants. Les membres sortants pourront tre rlus. (Art.8.) Les conseillers doivent tre pris parmi les notables; ils doivent tre la paroisse. (Art. 3.) catholiques et domicilis dans Les conseils de fabrique peuvent tre dissous par arrt ministriel aux termes de l'ordonnance du 12 janvier 1825, art. 5. Il y a des sessions ordinaires et des sessions extraordinaires: Le conseil s'assemblera le dimanche de Quasimodo, le premier dimanche de juillet, d'octobre et de janvier, l'issue de la grand'messe ou des vpres, dans l'glise, dans un lieu attenant l'glise ou dans le presbytre. L'avertissement de chacune de ses sances sera publi le dimanche prcdent au prone de la grand'messe.
LES FABRIQUES
401
Le conseil pourra de plus s'assembler extraordinairement sur l'autorisation de l'vque ou du prfet. (D. 1809, art. 10; O. 1825, art. 2.) Le conseil nomme son prsident et son secrtaire; il sont renouvels chaque anne la session de Quasimodo (art. 9). Les membres de droit ne peuvent pas tre lus prsident. Attributions. Le conseil de fabrique dlibre sur les objets suivants : 1 le budget de la fabrique; 2 le compte annuel du trsorier; 3 l'emploi des fonds excdant les dpenses, du montant des legs et donations et le remploi des capitaux rembourss; 4 toutes les dpenses extraordinaires au dela de 50 francs, dans les paroisses audessous demille mes, et de 100 francs danses paroisses d'une plus grande population ; les procs entreprendre ou soutenir, les baux emphytotiques ou longues annes, les alinations ou changes et gnralement tous les objets excdant les bornes de l'administration ordinaire des biens des mineurs. (D. 1809, art. 12.) En principe, toutes ces dlibrations sont soumises approbation. Tantt c'est l'approbation de l'vque, notamment pour le budget, tantt c'est celle du prfet, notamment pour les travaux. Le bureau des marguil279. Bureau des marguilliers. liersse compose : 1 du cur ou desservant de la paroisse qui en est membre perptuel et de droit ; 2 de trois membres du conseil de fabrique. (Art. 13, D. 1809.) Ces trois membres sont lus par le conseilet renouvels raison de un par an, la session de Quasimodo (art. 15-16-17). Ne pourront en mme temps tre membres du bureau les parents ou allis jusque et y compris le degr d'oncle et de neveu (art. 14). Ils nomment entre eux un prsident, un secrtaire et un trsorier. (Art. 19.) Le bureau s'assemblera tous les mois. Il pourra tre convoqu extraordinairement par le prsident. Il dressera le budget de la fabrique, prparera les affaires qui doivent tre portes au conseil; il excutera les dcisions prises par celui-ci et sera charg des objets ordinaire des biens qui n'excdent pas les bornes de l'administration des mineurs. (Art. 12-24.) Quant au trsorier, il intervient en nom dans les oprations avec les tiers, il donne et retire les quittances, figure en justice, accepte les dons et legs. (Art. 34-35), etc., etc. N 3. Syndicats de communes.
280. Les syndicats des communes ont t crs par la loi du 22 mars H. 26
402
ORGANISATION DES TABLISSEMENTS PUBLICS
1890, en vue de permettre l'organisation de services intercommunaux et notamment de services d'assistance. Les dispositions de cette loi sur l'organisation des syndicats sont trs explicites, nous ne pourrions que les transcrire; nous y renvoyons purement et simplement. Notons seulement, que le syndicat est administr par un comit compos de dlgus nomms par les conseils municipaux intresss, raison de deux par commune, et qu'ils peuvent tre pris parmi tous les ligibles au conseil municipal. Le fonctionnement de ce comit est comparable celui du conseil municipal, la force excutoire et les conditions de validit de ses dcisions sont les mmes. Quant aux institutions d'assistance ou autres, que le syndicat pourra fonder, elles seront administres par des commissions de surveillance et des grants, que le comit choisira soit dans son sein, soit au dehors. Nous savons d'ailleurs, que ces institutions ne constitueront que des services rattachs pour ordre et non point des tablissements publics.
TITRE
III
OBLIGATIONDE LA COMPTABILIT
281. La comptabilit est l'art de rendre compte au jour le jour de la situation d'un patrimoine ; son objet est de saisir et de constater, au moment o elles s'accomplissent, toutes les oprations qui modifient les lments de celui-ci. Ce rsultat est obtenu au moyen d'critures. Toutes les personnes administratives sont astreintes certaines rgles de comptabilit qui constituent la comptabilit publique. On doit considrer cette obligation comme inhrente leur qualit, au mme titre que la tenue des livres est inhrente la qualit de commerant. L'tat s'y soumet volontairement et il y soumet juridiquement les autres personnes administratives. C'est un des points sur lesquels la tutelle administrative est la plus nergique. Il tend s'tablir des rgles uniformes, la comptabilit de l'tat prsente forcment des particularits, mais la comptabilitdes communes est devenue le type de celle de plusieurs tablissements publics, des tablissements de bienfaisance (D. 31 mai 1862, art. 547 et s.), des fabriques et consistoires. (Loi de finances 26 janvier 1891, art. 78.) Le rgime de la comptabilit publique s'tend mme quelques tablissements d'utilit publique. (Monts-de-pit, caisses d'pargne.) Le texte principal est le dcret du 31 mai 1862, complt par certains dcrets spciaux et dont on prpare dj le remaniement. Il faut distinguer la comptabilit et le contrle de la comptabilit. PUBLIQUE 1er. COMPTABILIT 282. La comptabilit comporte trois sries d'oprations : 1 le compte du patrimoine, ou inventaire des lments actifs et passifs du patrimoine, apprcis au point de vue de leur valeur en capital, compte des biens mobiliers ou immobiliers, compte de la dette ; 2 le budget, ou compte des dpenses et des revenus annuels; 3 les comptes de caisse, qui sont un moyen de vrification des deux autres espces d'oprations, parce qu'en effet toute opration, soit sur le capital, soit
404
OBLIGATION DE LA COMPTABILIT
sur les revenus, se traduit par une somme d'argent qui entre ou sort dela caisse. Une comptabilit idale serait celle qui, portant la fois sur ces trois espces d'oprations, par un artifice d'criture, pourrait prsenter quotidiennement, dans un tableau unique, tous les rsultats, en concordance les uns avec les autres. L'Italie, grce la mthode Cerboni, est arrive peu prs ce rsultat; on peut saisir au compte du patrimoine, et sous formed'acquisition faite par celui-ci, la trace d'une somme sortie de la caisse1. En France, tous ces lments de la comptabilit existent, mais ne sont pas suffisamment relis entre eux. N Le compte du patrimoine.
283. Le compte du patrimoine existe dans des documents spars. Ainsi pour l'tat il y a : 1 La comptabilit de la dette publique; 2 la comptabilit de tous les lments actifs et passifs susceptibles de dtriorations, tels que les approvisionnements des magasins et arsenaux ; on l'appelle comptabilit-matire (V. O. 16 aot 1844; D. 31 mai 1862) ; 3 des inventaires de mobilier dans les muses, palais nationaux, btiments affects aux services, etc. ; 4 des inventaires des proprits immobilires excuts en vertu d'une loi du 29 dcembre 1873 et dont le premier tableau a t arrt le 31 dcembre 1875. (V. comptes gnraux de l'administration des finances.) Pour les dpartements, les communes, les colonies et les tablissements publics, ces lments divers du compte du patrimoine existent aussi ou peuvent exister. C'est ainsi notamment qu'il y a une comptabilit-matire dans les hospices, dans les lyces, etc. N 2. Le budget. 284. Le budget est l'acte par lequelsont prvues et autorises les recettes et les dpensesannuelles d'une personne administrative. En ralit un budget se compose de deux tableaux, l'un de recettes, l'autre de dpenses; le total des recettes doit tre le mme que celui des dpenses, c'est ce qu'on appelle quilibrer le budget. L'opration du budget est annuelle parce qu'il s'agit de dpenses 1. Il ya cependant quelque chose de fictif;on ne sait pas si la valeur entre dans le patrimoine est rellement gale la somme sortie de la caisse. On de dperpeut mme affirmer qu'il n'en est rien et qu'il y aurait un coefficient dition dterminer.
LE BUDGET
405
qui doivent tre payes par les revenus de l'tat, c'est--dire en somme par les revenus des particuliers, et que ces revenus sont annuels. Cette opration est faite d'avance pour l'anne qui vient, dans une pense de prvision, afin que dans les dpenses engages au jour le jour on ne se laisse pas aller dpasser les revenus. Les budgets des recettes et des dpenses se distinguent en ordinaires et en extraordinaires, et cela pour toutes les personnes administratives, parce qu'en effet il ya des dpenses ordinaires et des dpenses extraordinaires, des recettes ordinaires et des recettes extraordinaires. La notion de la dpense extraordinaire est facile saisir, c'est toute dpense qui dpasse l'entretien, qui est de premier tablissement, l'acquisition d'un terrain, la construction d'un difice ou d'une voie publique, la construction d'un matriel de guerre, etc. La notion de la recette extraordinaire est corrlative. C'est en principe une recette qui est constitue par un capital plutt que par un revenu; c'est, par exemple, le produit de l'alination d'un immeuble ou d'une rente, le produit d'une coupe extraordinaire de bois , enfin et surtout le produit d'un emprunt. Il y a, au point de vue du budget extraordinaire, entre la situation de l'tat et celle des autres personnes administratives, une srie de diffrences, qui font que l'existence de ce budget cre un pril pour l'tat, alors qu'il n'en cre pas pour les autres: 1 les personnes administratives autres que l'tat alimentent surtout leur budget extraordinaire par des impts dits extraordinaires vots d'une faon temporaire. Cette faon de procder a l'avantage de ne pas augmenter le capital de la dette; l'tat ne l'emploie pas parce qu'il ne pratique pas le systme des impts temporaires. L'tat alimente son budget extraordinaire par des emprunts. 2 Lorsque les personnes administratives autres que l'tat sont obliges de recourir l'emprunt, celui-ci est court terme et l'amortissement en est soigneusement gag ; les emprunts auxquels l'tat recourt sont rarement court terme, et quand ils le sont le gage est insuffisant; l'tat compte, pour amortir, sur les ressources du budget ordinaire dont il anticipe ainsi les revenus ; mais les excdents de recette du budget ordinaire ne se produisent pas toujours ; la dette de l'tat arrive chance sans pouvoir tre paye, elle est alors exigible, et prend le nom de dette flottante. Elle pse bientt sur le crdit de l'tat et devient un danger. Il faut arriver au remde suprme qui est de faire un emprunt en rente perptuelle pour rembourser. Les budgets extraordinaires de l'tat aboutissent ainsi des liquidations priodiques qui se traduisent par une consolidation, c'est--dire par une augmentation dfinitive du capital de la dette perptuelle.
406
OBLIGATION DE LA COMPTABILIT
Ces inconvnients du budget extraordinaire de l'tat ont amen bien souvent sa suppression. Mais on aura beau faire, il renaitra toujours, parcequ'il correspond une ralit permanente : il y aura toujours des dpenses de premier tablissement qui se distinguent des dpenses de revenu. Il serait plus sage de chercher perfectionner les recettes extraordinaires, en gageant plus srieusement les emprunts court terme. Le budget est toujours vot 285. Vote du budget. par les assembles dlibrantes, c'est une de leurs prrogatives. Le budget de l'tat est vot par les Chambres, celui du dpartement est vot par le conseil gnral, sauf tre rgl par le chef de l'tat, etc. Ces assembles doivent observer un certain nombre de rgles: 1 Relativement la spcialit des crdits. On appelle crdit la somme qui est prvue au budget des dpenses pour une dpense dtermine, on alloue un crdit, on ouvre un crdit, etc. Il est clair que l'on peut plus ou moins dtailler les crdits; il est clair aussi que plus on dtaille les crdits, moins l'administrateur charg d'excuter les dpenses aura de latitude, moins il pourra modifier les lments de la dpense. Si, par exemple, on allouait un crdit en bloc pour le service des enfants assists, l'administrateur resterait libre d'employer telle partie de la somme l'hospitalisation des enfants, telle autre partie leur placement chez des cultivateurs; mais si on ouvre des crdits distincts pour ces deux oprations, l'administrateur sera li, car il lui est interdit de faire des virements, c'est dire d'employer un crdit une dpense autre que celle qui est prvue. Dans le budget de l'tat les crdits sont peu spcialiss, ils sont vots par chapitres, c'est--dire en somme par services, ce qui permet aux ministres des virements l'intrieur d'un mme chapitre entre les diffrentes branches d'un mme service. (L. 16 sept. 1871, art. 30 Dans les budgets des autres personnes administratives, ils sont plus spcialiss et sont vots par articles. 2 Relativement l'imputation des dpenses sur ressources spciales. Dans le budget de l'tat il ya ce point de vue une grande libert ; sauf pour les emprunts, aucune recette n'est affecte une dpense spciale ; dans les autres budgets, au contraire, beaucoup de recettes spciales, notamment des centimes spciaux, sont affectes des dpenses spciales : exemple, centimes pour les chemins vicinaux. Cette tendance l'imputation se trouve au dbut de l'histoire de tous les budgets, l'ancien rgime en faisait un abus. C'est une garantie aux poques o la comptabilit est imparfaite, mais cela devient vite une gne.
LE BUDGET
407
3 Relativement aux dpenses obligatoires. Il n'y a pas dans le budget de l'tat de dpenses particulirement obligatoires, elles le sont toutes galement; mais dans les autres budgets, on distingue, nous le savons, des dpenses obligatoires et des dpenses facultatives. L'obligation consiste en ce que, si le crdit n'a pas t inscrit volontairement, il sera rtabli d'office par les reprsentants de l'Etat. Le budget prvoit des redu budget 286. Excution cettes et des dpenses, il s'agit ensuite de les effectuer rellement, on appelle cela l'excution du budget. Il y a des rgles importantes: a) Rgles relatives l'exercice financier. Ces rgles ont pour but dehter l'excution des budgets et d'empcher qu'il ne s'tablisse un arrir. 1 L'excution du budget dress pour une anne dtermine, par exemple pour l'anne 1892, doit tre acheve dans un certain espace de temps que l'on appelle l'exercice L'exercice finanfinancier. cier de l'anne 1892 sera donc l'espace de temps dans lequel devra tre excut le budget de 1892. En principe, l'exercice financier dure un an, il commence et s'achve avec l'anne du budget dont il porte le millsime ; mais il y a des dlais de grce. On comprend, en effet, que pour certaines recettes dues des vnements qui se sont produits la fin de dcembre, l'encaissement ne se produise que le mois suivant ; on comprend encore mieux, que certaines dpenses engages par des marchs la fin de l'anne sur des crdits ouverts, ne soient payes qu'au commencement de l'anne suivante. Pour l'exercice financier de l'tat, les dlais de grce ont commenc par tre fort longs; rduits dj par le dcret du 31 mai 1862, ils l'ont t encore par la loi du 25 janvier 1889, ils durent: 1 Jusqu'au 31 janvier pourla rception du matriel, lorsque des causes de force majeure ont occasionn un retard; 2 Jusqu'au 31 mars pour la liquidation et l'ordonnancement des sommes dues aux cranciers; 3 Jusqu'au 30 avril pour le paiement des dpenses, la liquidation et le recouvrement des droits acquis l'tat pendant l'anne du budget. D'autres oprations se poursuivent jusqu'au 30 juin et jusqu'au 31 juillet dernier dlai. L'exercice financier du dpartement est clos dfinitivement le 30 avril, celui de la commune le 31 mars. 2 Lorsqu'un exercice est clos, tous les crdits sont annuls. Ceux qui n'ont pas t employs, c'est--dire en vertu desquels des dpenses n'ont pas t engages, demeurent dfiniment annuls. Ceux pour. lesquels des dpenses ont t engages, mais ne sont pas encore payes,
408
OBLIGATION DE LA COMPTABILIT
sont reports au budget de l'anne suivante dans un chapitre particulier o tous viennent se fondre ; ils peuvent ainsi tre reports de budget en budget, mais pas plus de quatre fois dans les budgets de l'tat et des colonies, ainsi que nous allons le voir. (L. 23 mai 1834 art. 8.) 3 Cinq ans aprs l'ouverture d'un exercice, cet exercice est prim, les crances qui s'y rattachent et qui n'ont pas t payes sont prescrites et teintes, on appelle cela la dchance quinquennale. Ainsi l'exercice 1892 sera prim le 1erjanvier 1897. La dchance quinquennale a t tablie au profit de l'tat par la loi du 29 janvier 1831, art. 9; au profit des colonies par le dcret du 20 novembre 1882, art. 94 ; elle n'existe pas au profit des dpartements (D. 31 mai 1862, art. 480), ni des communes, ni des tablissements publics, ce qui est une lacune fcheuse, car cela permet l'accumulation de l'arrir. b) Rgles relatives au paiement des dpenses. L'encaissement des recettes est rglement, mais le paiement des dpenses l'est encore plus. Il y a une rgle fondamentale qui est une des meilleures garanties de la comptabilit : la distinction des fonctions d'ordonnateur et de celles de comptable. L'ordonnateur donne l'ordre de payer, mais il n'a pas le maniement des deniers; le comptable a le maniement des deniers, mais ne peut pas payer sans ordre. (D. 1862, art. 17-19.) L'ordonnateur est presque toujours une autorit administrative: le ministre ou le prfet pour l'tat, le prfet pour le dpartement, le maire pour la commune, etc., trs rarement un fonctionnaire qui ce pouvoir a t dlgu, par exemple, un ingnieur des ponts et chausses. Le comptable est un simple fonctionnaire. Les ordres de paiement mis par le ministre, portent le nom d'ordonnances de paiement quand ils sont dlivrs directement au nom des cranciers de l'tat; ceux mis par les prfets et les maires portent le nom de mandats de paiement. Les ministres dlivrenten outre des ordonnances de dlgation par lesquelles ils autorisent les ordonnateurs secondaires (directeurs de service, prfets) disposer d'un crdit ou d'une portion de crdit par des mandats de paiement au profit de divers cranciers. Les ordonnances et les mandats, pour tre payables par les comptables, doivent tre appuys de pices constatant que la dette est rgulirement justifie, c'est--dire qu'il doit y avoir eu au pralable liquidation de la dette. (V. infr, dettes de l'tat, n 403.) c) Service de trsorerie. L'excution des diffrents budgets exige un perptuel mouvement de fonds; l'argent des recettes doit tre encaiss, l'argent des dpenses doit tre tenu disponible au lieu du
LE BUDGET
409
paiement. Ce service a t compltement centralis par l'tat qui prend ici le nom de trsor, et il est assur par une direction du ministre des finances, qui porte le nom de direction du mouvement gnral des fonds. Non seulement tous les fonds de l'tat sont centraliss au ministre des finances, mais encore ceux des autres personnes administratives. Ces fonds sont en effet verss au trsor, soit directement, soit par l'intermdiaire de la Caisse des dpts et consignations. Cette centralisation a l'avantage de crer au trsor des disponibilits, et de lui permettre de faire face aux grosses chances sans emprunter. Quelquefois cependant cela ne suffit pas, le trsor est oblig de faire des emprunts court terme, qu'on appelle des oprations de trsorerie; ou bien il met des bons du trsor, ou bien il se fait faire des avances par la Banque de France, etc. Les dpts que le trsor reoit des autres personnes administratives, ou les emprunts qu'il fait pour son service de trsorerie, vont se joindre aux emprunts court terme destins alimenter le budget extraordinaire, pour constituer la dette flottante. Le 287. Le budget considr comme acte juridique. budget n'est pas seulement une opration de comptabilit, c'est un acte juridique, il renferme une quantit d'actes d'administration de la catgorie des actes d'autorit. Il ne se borne pas prvoir, il autorise, (D. 1862,art. 5.) L'inscription d'un crdit au budget pour une affaire implique, en effet, dcision sur le fond de l'affaire ou tout au moins commencement de dcision. Il y a des cas, et cela est frquent surtout en matire d'administration de l'tat, o la dcision budgtaire est la seule que l'organe dlibrant, c'est--dire le Parlement, soit appel prendre. L'excution de la dcision budgtaire se fait ensuite par des actes de gestion de l'organe excutif, notamment par des marchs passs. Il faut donc considrer que les marchs passs par les ministres pour le compte de l'tat s'appuient sur les dcisions budgtaires, et qu'ils n'chappent pas la rgle gnrale d'aprs laquelle un acte de gestion doit toujours s'appuyer sur un acte d'autorit. (V. p. 189.) La consquence de cette doctrine est que les ministres, dans un exercice, ne doivent pas engager de dpenses par leurs marchs pour une somme suprieure aux crdits ouverts; et rigoureusement, dans la mesure o ils dpassent les crdits, les marchs devraient tre considrs comme irrguliers et annuls. Ce principe n'a pas encore t admis. On a cherch viter le danger des dpassements de crdits par d'autres moyens, par exemple en
410
OBLIGATION DE LA COMPTABILIT
proclamant la responsabilit personnelle du ministre envers l'tat, mais cette responsabilit n'a jamais t ramene effet. (V. p. 282.) Actuellement, la direction gnrale de comptabilit au ministre des finances cherche tablir un contrle sur les marchs, et la loi de finances du 26 dcembre 1890, art. 59, prescrit ceci : Dans chaque ministre il sera tenu une comptabilit des dpenses engages, les rsultats de cette comptabilit seront fournis mensuellement la direction gnrale de la comptabilit publique . 288. Crdits et extraordinaires. supplmentaires Le budget tant dress d'avance, au cours de l'anne o il s'excute, il peut se prsenter des causes de dpenses imprvues. Il ya lieu alors de demander immdiatement un crdit supplmentaire ou extraordinaire, sorte de petit budget spcial qui suit les rgles du budget ordinaire. N 3. La comptabilit de caisse. 289. On l'appelle aussi la comptabit-deniers. C'est la comptabilit par excellence, les agents auxquels ses rgles s'imposent portent le nom d'agents comptables : ce sont tous ceux qui ont le maniement des deniers publics, c'est--dire des deniers de l'tat, des dpartements, des communes, des colonies, des tablissements publics (D. 1861. art. 1er ; D. 20 nov. 1882), trsoriers-payeurs gnraux, receveurs particuliers, percepteurs, receveurs municipaux, etc. : 1 il y Le mcanisme de cette comptabilit tient dans deux ides a des rgles svres pour toutes les oprations que les comptables sont appels faire, encaissement de recettes ou paiement de dpenses, versements de fonds au trsor, etc.; 2 les comptables sont responsables de l'observation de ces rgles pendant leur gestion. Onappelle gestion l'ensemble des actes d'un comptable, soit pendant l'anne, soit pendant la dure de ses fonctions, si celles-ci n'ont pas dur une anne. Les comptables doivent donc rendre compte la fin de leur gestion, ils doivent compte des deniers qu'ils ont touchs, de ceux qu'ils auraient d toucher, de ceux qu'ils ont dpenss sans justification suffisante. Ils sont responsables sur leur cautionnement et sur leurs biens qui sont frapps d'une hypothque lgale (art. 2121 C. c.) (V. aussi Privilges du trsor, 1. 5 sept. 1807). DE LACOMPTABILIT 2. CONTROLE 290. Les oprations de comptabilitsont contrles, surtout celles
LA COURDES COMPTES
411
qui sont relatives l'excution du budget et aux oprations de caisse. Il y a deux procds de contrle diffrents. Le plus ancien consiste en des redditions de compte ; des comptes sont rendus annuellement par les ordonnateurs et par les comptables. Les comptables rendent compte de leur gestion d'une faon judiciaire, soit devant la Cour des comptes, soit devant le conseil de prfecture. Les ordonnateurs rendent compte de l'excution du budget devant l'assemble dlibrante qui a vot le budget. Ce contrle a l'inconvnient de porter la fois sur tout un exercice financier, et de plus, par suite de retards invitables, d'avoir lieu une poque loigne du moment o les faits se sont produits. Un procd plus rcent et qui tend se dvelopper de plus en plus, est celui du contrle administratif qui s'exerce d'une faon continue. Ce contrle est effectu, soit au moyen des inspections des inspecteurs des finances, qui se transportent chez les comptables et procdent des vrifications, soit au moyen des tats mensuels que les comptables et les ordonnateurs sont tenus de communiquer la direction gnrale de la comptabilit au ministre des finances. Cour 291. Reddition des comptables. de compte des comptes. (L. 16 sept. 1807 ; D. 31 mai 1862, art. 375 et suiv. ; D. 12 juill. 1887.) La Cour des comptes a t fcnde par Napolon en 1807 l'imitation des Chambres des comptes de l'ancienne monarchie. C'est une vraie cour de justice, qui a pour but de vrifier la gestion des comptables, de les dcharger de leur responsabilit en cas de gestion rgulire, ou de mettre leur charge les reliquats dont ils pourraient tre redevables pour fraude, imprudence ou infraction aux rglements. Elle est organise un peu comme le Conseil d'tat. Il y a : 1 un premier prsident, trois prsidents de chambre, dix-huit conseillers matres, seulement ces membres de la Cour des comptes sont inamovibles la diffrence des conseillers d'tat; 2 quatre-vingt-six conseillers rfrendaires, qui ressemblent aux matres des requtes, et vingt auditeurs ; 3 un greffe et un ministre public. La Cour des comptes juge en premire et en dernire instance les comptables de l'tat, en appel ceux des communes et des tablissements publics qui ressortissent en premier ressort aux conseils de prfecture, sauf pour les communes et tablissements publics dont le revenu annuel dpasse 30,000 francs qui ressortissent directement la Cour. La Cour tablit, par un arrt dfinitif1, si le comptable est quitte, 1. Quelquefoisla cour rend des arrts provisoirespour mettre le comptable en demeure de produire certaines justifications.
412
OBLIGATION DE LA COMPTABILIT
ou en avance ou en dbet. Dans les deux premiers cas, elle prononce sa dcharge dfinitive et ordonne la mainleve des oppositions et inscriptions hypothcaires mises sur ses biens, a raison de la gestion dont le compte est jug; dans le troisime cas, elle le condamne solder son dbet dans le dlai prescrit par la loi. (D. 1862, art. 419.) La Cour, nonobstant l'arrt qui aurait jug dfinitivement un compte, peut procder la revision de ses arrts, soit sur la demande du comptable, appuye de pices justificatives retrouves depuis l'arrt, soit d'office ou la rquisition du procureur gnral, pour erreur, omission, faux ou double emploi, reconnus par la vrification d'autres comptes. (Art. 420.) Enfin, ces arrts sont susceptibles d'un recours en cassation devant le Conseil d'tat. (Art. 423.) Attributions l'gard des ordonnateurs. La Cour des comptes n'a de juridiction que sur les comptables, non pas sur les ordonnateurs, c'est--dire qu'elle n'est pas juge de l'utilit d'une dpense rgulirement ordonnance; en d'autres termes, elle n'est pas juge du bon emploi des crdits. Elle est bien charge de constater que les comptes gnraux publis annuellement par le ministre des finances et par chaque ministre ordonnateur concordent avec le total des comptes individuels de comptables qu'elle a apurs, c'est--dire que le total des dpenses ordonnances est gal celui des dpenses payes ; et cela donne lieu une dclaration gnrale de conformit qui est communique au parlement avant le rglement dfinitif du budget ; mais cela ne donne encore aucun renseignement sur l'utilit de chaque dpense. L'obligation de rendre compte 292. Comptes du budget. de l'excution du budget l'assemble dlibrante qui l'a vot existe chez toutes les personnes administratives. Le prfet rend son compte d'administration au conseil gnral (art. 66, 1. 1871), le maire rend son compte d'administration au conseil municipal (art. 151 et suiv., l. 1884), le gouvernement rend son compte au Parlement, et partout les comptes doivent tre approuvs par l'assemble dlibrante. En ce qui concerne le budget de l'tat, aussitt aprs la clture de l'exercice, on procde dans les divers ministres l'tablissement des comptes. Il y a cet effet, dans chaque ministre, une division de comptabilit qui a pris note des oprations au fur et mesure. Le ministre des finances fait aussi le compte particulier de son administration, puis il centralise les comptes des autres ministres. En outre, il fait seul le compte gnral des recettes de l'exercice. Ces deux comptes constituent le budget dfinitif des dpenses et le budget dfinitif des recettes qui doivent tre prsents l'approbation des
DE FAIT COMPTABILIT
413
Chambres sous le nom de lois des comptes l'ouverture de la session ordinaire qui suit la clture de l'exercice (1. 25 janv, 1889, art. 6). Le contrle lgislatif ne peut porter que sur un point, la concordance : 1 il ne entre les sommes ordonnances et les crdits ouverts, donc porte que sur les ordonnateurs, pas sur les comptables; 2 on ne peut vrifier si les sommes ordonnances ont t rellement employes et correspondent un travail utile. A ce point de vue, les comptes du prfet, du maire, sont plus svrement examins parce que les rsultats rels sont plus faciles saisir. Appendice. Comptabilit de fait.
293. Il tait prvoir que nombre d'administrateurs essaieraient de se soustraire toutes ces obligations de la comptabilit. Cela est arriv, en effet, trs frquemment dans l'administration des communes, et danscelle des tablissements charitables. Il ya une tendance constante soustraire l'emploi de certaines ressources au contrle de l'administration suprieure. Ce n'est pas dans une pense de malver. sation, c'est pour avoir plus de libert dans l'emploi des fonds; c'est souvent aussi par suite de la crainte que l'affectation spciale, en vue de laquelle les fonds ont t recueillis, ne soit pas respecte, si ceuxci sont verss dans les caisses publiques titre de fonds disponibles. Quoi qu'il en soit, dans un intrt suprieur d'ordre, il a fallu se montrer svre pour ces irrgularits; la jurisprudence est parvenue organiser un systme de rpression efficace, tout simplement en considrant les administrateurs dans ce cas, comme des comptables de fait ou des comptables occultes, et en leur appliquant les mmes rgles qu'aux comptables rguliers. Par consquent, lorsqu'une gestion occulte est dcouverte, l'administrateur devient comptable, il doit rendre compte et restituer, il devient justiciable de la Cour des comptes, ses biens sont frapps d'une hypothque lgale, etc. La justification des dpenses faites par lui est examine svrement, on tient compte cependant de ce dont la commune ou l'tablissement public a rellement profit. (V. infr, gestion d'affaires, n 537.) C'est l toute une matire considrable.
LIVRE
II
LES DROITS DES PERSONNES ADMINISTRATIVES
CHAPITRE
PRLIMINAIRE DES DROITS
JOUISSANCE
et droits 294. A. Droits de puissance de publique Nous savons dj que les personnes admipersonne prive. nistratives ont la jouissance de deux catgories de droits fort diffrents : 1 les droits de puissance publique qui procdent de la souverainet de l'tat, qui se justifient par des considrations particulirement pressantes d'utilit publique, et qui ont pour caractristique d'imposer d'autorit, aux personnes des obligations, la proprit prive des servitudes exceptionnelles. Ces droits ne sont point semblables aux droits des particuliers, bien qu'ils ne soient pas sans commune mesure avec eux. Ce sont, par exemple, les droits de police, les droits relatifs au domaine public, les modes d'acqurir tels que l'expropriation, les impts, etc.; 2 les droits de personne prive, droits semblables ceux des particuliers, ceux que l'on trouve dans le Code civil ou mme dans le Code de commerce; ces droits s'exercent dans des matires o l'utilit publique n'est pas au mme degr en cause, et n'entranent que des obligations ordinaires; ce sont, par exemple, les droits relatifs au domaine priv, etles modes d'acqurir qui ne supposent pas la puissance publique, vente, change, dons ou legs, etc. (V. p. 173.) Il est conforme la tradition historique, et il est d'une bonne mthode d'tudier sparment ces deux espces de droits. Historiquement, ils ont toujours t spars depuis l'empire romain. Le fisc imprial n'tait pas autre chose que l'administration des biens de l'tat en tant que celui-ci tait considr comme une personne prive, et le jusfisci tait la lgislation applicable, qui, malgr des diffrences
416
LES DROITS DESPERSONNES ADMINISTRATIVES
de dtail, s'inspirait des principes du droit priv. Sous l'ancien rgime, le domaine du roi tait administr comme un domaine priv, et les villes, les corps et communauts avaient des syndics chargs de la gestion de leurs intrts privs. Aujourd'hui, l'tat seul a une administration spciale pour son domaine priv, celle des domaines. Pour les dpartements et les communes, les droits de personne prive sont exercs par les mmes organes que les droits de puissance publique. Mais il reste toujours cet intrt capital la distinction, que les rgles du droit dans cette matire se rapprochent bien plus des rgles du droit priv, de mme que pourle jus fisci romain; et que les contestations, s'il s'en lve, sont normalement de la comptence des tribunaux ordinaires. On ne sera donc pas tonn de nous voir grouper dans un titre premier tous les droits de puissance publique, et dans un titre second tous les droits de personne prive. Les personnes admi295. De la jouissance des droits. nistratives ont la jouissance de ces deux espces de droits, mais dans une mesure qui demande tre dtermine. a) Droits de personne prive. Pour ce qui est des droits de personne prive, on peut admettre que les personnes administratives en jouissent sans avoir besoin d'une concession de la part de l'tat. La jouissance de ces droits est implique par la notion mme de la personnalit juridique. Il faut mme aller jusqu' reconnatre que les personnes administratives peuvent faire des actes de commerce; l'tat est considr comme en accomplissant pour son administration des chemins de fer de l'tat. (Cass.8 juill. 1889.) Un seul droit priv est refus l'tat, c'est le droit de compromettre, de nommer des arbitres; l'tat peut bien se soumettre un arbitrage dans les litiges internationaux, mais non pas dans les litiges nationaux, car l il a des juges lui, et ce serait leur donner une preuve de dfiance. (C. d't. 23 dc. 1887, domaine d' Yseure.) Il ne semble pas que le droit de compromettre soit refus aux autres personnes administratives. Il y a notamment des exemples de compromis faits par des communes en matire de travaux publics. (Cons. d't. 29 juillet 1881, Rousseau; 16 mars 1870, Sagnot; 24 janvier 1872, Clet.) Pour les droits de puissance b) Droits de puissance publique. publique la question est plus dlicate. Faut-il considrer que les personnes administratives, tant au fond des membres de l'tat, ont de plein droit la jouissance des droits de puissance publique, l'exception de certains droits rgaliens qui seraient rservs l'tat? Faut-il
JOUISSANCE DES DROITS
417
faire une distinction entre les personnes administratives ayant des services multiples, ayant besoin par consquent de plus de droits, comme le dpartement ou la commune, et les tablissements publics qui ne grent qu'un seul service? Conviendrait-il defaire une autre distinction suivant que les personnes administratives sont ou non dcentralises, attendue qu'il est de la nature de la puissance publique d'tre dlgue directement par le souverain? Faut-il au contraire considrer que les droits de puissance publique sont une concession de l'tat, et que par consquent ils peuvent tre concds toutes les personnes administratives, mais ingalement? La discussion approfondiede cette question trs thorique serait dplace ici; bornons-nous constater que tout se passe pratiquement comme si ces droits taient une concession de l'tat. Il y a des droits qui, en fait, n'appartiennent qu' l'tat, tel le droit de disposer dela force arme. La commune a des droits de police sur les citoyens, le dpartement n'en a pas. Les tablissements publics ont tous le droit de faire des oprations de travaux publics, mais ils n'ont pas de domaine public, et, l'exception des associations syndicales, ils n'ont pas le droit d'exproprier. Il y a donc la plus grande bigarrure. Les des droits et de la capacit. 296. De l'exercice personnes administratives n'exercent pas librement les droits dont elles ont la jouissance; l'exception de l'tat, toutes sont des incapables. La situation de toutes ces personnes se rapproche de celle du mineur mancip. D'abord le rgime auquel elles sont soumises se rapproche de celui de la curatelle, bien qu'on l'appelle dans la pratique, tutelle administrative; en effet, les personnes administratives agissent par elles-mmes comme le mineur mancip, seulement elles ont besoin pour certains actes, de l'autorisation d'un curateur qui est le plus souvent l'tat. De plus, les actes, pour lesquels il leur faut l'autorisation, sont peu prs les mmes que pour le mineur mancip. Elles ne peuvent ni aliner leurs immeubles, ni emprunter, ni ester en justice sans autorisation, sautde rares exceptions; elles jouissent de plus de libert au point de vue des actes qui sont d'adminispure, ainsi le dparlement peut passer des baux d'une dure tration indtermine, la commune des baux de dix-huit ans, les hpitaux et hospices de mme ; mais elles disposent de leurs revenus avec moins d'indpendance que le mineur mancip, cause de la ncessit de pourvoir dans leur budget aux dpenses obligatoires. La thorie de l'incapacit en matire administrative est d'ailleurs difficile construire, parce qu'il y a des diffrences considrables H. 27
418
LES DROITSDES PERSONNES ADMINISTRATIVES
entre la capacit des dpartements, celle des communes et celle des diffrents tablissements publics. Pour ce qui est des dtails, ils ont t donns dans notre tude de l'organisation administrative, propos des attributions des diffrents organes, conseil gnral, conseil municipal, etc. Nous y reviendrons encore quelque peu, propos de la tutelle administrative considre comme droit de puissance chez celui qui l'exerce. (V.infr, n 318.) Il est lgitime d'tendre par analogie aux incapables du droit administratif, les rgles du Code civil sur les incapacits, mais il faut procder avec la plus grande circonspection. On ne saurait, par exemple, admettre au profit des dpartements ou des communes la rgle de l'art. 2252 sur la suspension de la prescription au profit des mineurs. La minorit des dpartements ou des communes durant perptuellement, cette suspension quivaudrait une suppression de la prescription. Or, l'art. 2227 soumet formellement les personnes administratives la prescription. On doit admettre, au contraire, que lorsqu'une personne administrative incapable a t engage en dehors des formes et des autorisations requises, il existe son profit une action en nullit, analogue celle de l'art. 1305. Alors, par analogie, : minor restituitur non trinquant on doit exiger la preuve de la lsion minor sed tanquam lsus. Rien ne s'oppose l'application de cette maxime trs sage. Mme, on applique la prescription de dix ans de l'art. 1304, mais on est oblig de modifier le point de dpart dudlai, le point de dpart est ici le jour de l'acte attaqu. (Bordeaux, 29 mars 1882; Cass. 12 janv. 1864; Cons. d't. 15 juin 1877.)
TITRE
PREMIER
LES DROITS DE PUISSANCE PUBLIQUE
CHAPITRE CARACTRES
PRLIMINAIRE
GNRAUX DES DROITS DE PUISSANCE PUBLIQUE
Les droits de puissance Dfinition et Division. publique sont ceux qui donnent aux personnes administratives des prrogatives exorbitantes du droit commun, et qui, par consquent, peuvent entraner des obligations pour les personnes et des charges pour la proprit galement exorbitantes. L'existence de ces droits se justifie par des considrations d'utilit publique particulirement pressantes. On peut les diviser en deux groupes, les droits de police et les droits domaniaux de puissance publique. 1 Droits de police. Ce sont ceux qui, tout en donnant aux personnes administratives autorit sur les personnes ou sur les biens, n'ont par eux-mmes aucune valeur pcuniaire, et n'entranent l'acquisition d'aucune valeur pcuniaire. Ainsi, le droit de service militaire est un pur droit de police; il donne autorit l'tat sur tout homme de vingt quarante-cinq ans, mais il n'a pour l'tat aucune valeur apprciable en argent, et il n'est pour l'tat la source d'aucune acquisition pcuniaire; la police des petits cours d'eau donne l'tat autorit sur les proprits riveraines de ces cours d'eau, elle entrane la charge de ces proprits la servitude de curage, mais il n'y a l non plus la source d'aucune acquisition pcuniaire. 2 Droits domaniaux de puissance publique. Ce sont ceux qui ont une valeur apprciable en argent, soit parce qu'ils sont des droits de proprit, soit parce qu'ils sont des modes d'acqurir et conduisent la proprit. Donc deux catgories: a) Le droit de domaine public : Nous verrons au n 362 que le droit 297.
420
LES DROITSDE PUISSANCE PUBLIQUE
de domaine public est un vritable droit de proprit, que l'tat par exemple est vraiment propritaire des chemins de fer, des canaux, des routes nationales, etc., comme d'autre part ce droit entrane des prrogatives exorbitantes du droit commun, c'est bien un droit domanial de puissance publique. : Ces modes d'acb) Les modes d'acqurir de puissance publique qurir sont, par exemple, l'expropriation pour cause d'utilit publique, les impts, les travaux publics, etc. Cette numration est significative par elle-mme ; il est clair que le droit d'exproprier, le droit de lever l'impt, le droit d'accomplir des travaux publics, sont des droits de puissance publique, et il est clair aussi que ce sont des modes d'acqurir qui conduisent la proprit soit directement, soit par l'intermdiaire d'obligations, et, parl, mritent d'tre qualifis de domaniaux. Observation. Il faut entendre cette division des droits de puissance publique en droits de police et droits domaniaux avec une certaine largeur; il est des droits de police dont l'exercice peut entraner accessoirement certaines consquences pcuniaires, il faut s'attacher l'objet direct et principal du droit. Pour ce qui est de comprendre parmi les droits domaniaux non seulement le domaine public, mais aussi les modes d'acqurir, cela est conforme la tradition de nos anciens auteurs. Ils rangeaient dans le domaine entendu largement, non seulement la proprit des objets corporels, mais aussi certains droits incorporels qui taient des modes d'acqurir, les droits d'aubaine et de btardise, d'amortissement, de franc-fief, le droit du roi sur les octrois des villes, etc. (V. les uvres de Chopin, Bacquet, Lefbre de la Planche.) de puissance des droits 298. De l'antagonisme pu Il y a un des citoyens. et des droits publics blique antagonisme naturel entre les droits de puissance publique des personnes administratives, et les droits publics des citoyens; les droits de puissance publique entranent des obligations pour les personnes, et des charges pour la proprit ou servitudes d'utilit publique, qui sont imposes et non pas librement consenties; cela quivaut, en dernire analyse, la violation de quelque libert individuelle, soit la libert d'aller et de venir, soit la libert de la proprit. Une des grandes proccupations du droit a toujours t de res-' treindre au minimum strictement exig par la ncessit publique, les atteintes portes aux liberts individuelles. Nous allons passer en revue quelques-unes des grandes thories auxquelles cette proccul'on remarquera une chose curieuse, c'est pation a donn naissance,et
LES DROITSDE PUISSANCE PUBLIQUE
421
que la protection est plus grande peut-tre pour la proprit que pour la personne. Cela tient ce que l'atteinte la proprit est bien plus facile saisir et rparer, parce qu'elle est d'ordre pcuniaire. Mais cela prouve une fois de plus, de quelle importance est la proprit pour l'individu, non seulement comme source de richesse, mais comme garantie d'indpendance. Les garanties pour les liberts individuelles ont t tires des deux principes suivants, qui en un certain sens sont constitutionnels: 1 pas de charge sans une loi ; 2 galit des charges pour tout le monde. 1 Pas de charge sans une loi. Ce principe est bien connu en matire d'impt ; mais il a d'autres cas d'application, sa porte est gnrale. Il prsente un intrt particulier en matire de police, en tant que les obligations manent de rglements. Il faut absolument que les rglements de police s'appuient sur des lois, et notamment aucune charge nouvelle ne peut tre impose la proprit sans une loi (v. p. 64). En matire de salubrit, c'est une grande gne pour les maires; en matire de police des cours d'eau, il est tels arrts des prfets qui, si l'on cherchait bien, malgr leur incontestable ncessit, devraient tre dclars illgaux. 2 galit des charges pour tout le monde. Ce principe est susceptibled'une application directeou indirecte. D'uneapplication directe, lorsque la charge est rellement susceptible d'tre impose tout le monde, comme en matire d'impt ou de service militaire L'galit, ralise pour l'impt depuis la Rvolution, nel'tait pas compltement, il y a peu de temps encore, en matire de service militaire. La loi du 15juillet 1889 l'a ralise autant qu'il est possible, soit en imposant tous le service effectif, soit en frappant d'une taxe compensatrice ceux qui n'accompliraient pas ce service effectif pour des causes dtermines. Mais il y a des cas nombreux o la charge, par sa nature mme, ne peut pas tre rpartie directement sur tout le monde, elle frappe au contraire une proprit dtermine ou une personne dtermine. C'est ainsi, par exemple, qu'on exproprie pour cause d'utilit publique des proprits dtermines; c'est ainsi que la servitude d'alignement est inflige des proprits dtermines le long des voies publiques, que la servitude de chemin de halage est inflige aussi des proprits dtermines le long des fleuves. Ici donc, l'galit devant la loi et devant les charges, ne peut tre rtablie qu'indirectement par le moyen d'une indemnit qui sera paye avec les deniers publics au propritaire frapp. De l le grand principe de l'indemnit pour les servitudes publiques imposes la proprit, principe qui a t proclam dans la Dclara-
422
LES DROITSDE PUISSANCE PUBLIQUE
tion des droits de l'homme propos de l'expropriation pour cause d'utilit publique, qui a t appliqu par la loi propos de diverses servitudes d'utilit publique, et qui a servi de point de dpart la jurisprudence du Conseil d'tat, pour difier sa trs belle thorie des dommages permanents causs par les travaux publics (V.infr, n 475). Ce principe n'est pas encore appliqu partout, et n'a certainement pas dit son dernier mot. Il est des cas o le principe de l'galit devant les charges se retourne contre certains particuliers, et aboutit leur faire supporter des charges exceptionnelles cela arrive lorsque les deniers publics ; ont servi payer des travaux, qui apportent certaines proprits des plus-values exceptionnelles; il parat juste qu'une contribution spciale soit leve sur cette plus-value. (V.infr. Travaux publics, n 478). 299. III. Des rgles de droit qui doivent tre appli Du moment de puissance ques aux droits publique. que les droits de puissance publique dpassent les droits privs par les effets exorbitants qu'il entranent, il est clair que les rgles du droit priv, et spcialement celles du Code civil, ne peuvent pas s'y appliquer de plano, puisque ces rgles sont faites la mesure des droits privs1. Il faut donc se dfier des tentatives d'assimilation entre les oprations de puissance publique et les oprations prives. En matire de contrats administratifs notamment, il faut se dfier de l'assimilation avec les contrats ordinaires. On a voulu, par exemple, bien des fois, dfinir la situation du fonctionnaire, en disant qu'il y avait contrat de mandat ordinaire, le rsultat est qu'on laisse dans l'ombre les droits de police considrables que l'administration a sur lui, et qui caractrisent vraiment sa situation. A ces droits spciaux il faut appliquer des rgles spciales, qui sont des rgles de droit public, et proprement des rgles de droit administratif. Mais il faut dire bien haut, que ces rgles spciales doivent s'inspirer du grand principe d'galit qui fait le fond de l'ide de justice dans tout le droit moderne. Tantt elles puisent ce principe dans les rgles constitutionnelles, nous venons d'en voir un exemple, tantt elles le puisent par analogie dans les rgles contractuelles du droit priv. Nous ne faisons d'ailleurs aucune difficult de reconnatre, que les droits de puissance publique ont une tendance s'attnuer d'une 1. On verra propos de la thorie des dommages permanents causs la proprits par les travaux publics,que les principes du Codecivil, s'ils eusseut t appliqus, eussent eu le rsultat dplorable de faireobstacle l'indemnit
LES DROITSDE PUISSANCE PUBLIQUE
423
; de telle sorte que sur une matire donne on peut faon constante assister un glissement vers les rgles du droit priv, sauf voir de nouveaux droits de puissance publique s'difier ct, car il en faut et il y en aura toujours. des droits de puissance 300. De la concession pu En principe, les droits de puissance publique ne doivent blique. tre exercs que par l'tat ou par les personnes administratives membres de l'tat. Il arrive cependant que l'exercice de quelqu'un de ces droits soit concd temporairement des particuliers. C'est ainsi que les compagnies de chemin de fer ont la concession d'une dpendance du domaine public, la voie ferre, et en outre celle du droit de lever une taxe sur le public ; c'est ainsi que la Banque de France a la concession du droit d mettre des billets de banque; c'est ainsi que les compagnies de colonisation, si elles sont constitues, auront la concession de divers droits, notamment le monopole de certains commerces ou de certaines industries, le droit d'tablir certains pages, d'organiser certaines forces de police, etc. C'est ainsi enfin que les communes concdent certains monopoles de canalisation des compagnies d'clairage au gaz ou autres. Nous reviendrons plus loin (n 396 400) sur les concessions faites sur les dpendances du domaine public et sur les monopoles de fait qu'elles entranent. Faisons remarquer seulement ici : 1 que les concessions de droits de puissance publique quelles qu'elles soient ne donnent jamais au concessionnaire le droit lui-mme, mais seulement l'exercice du droit, c'est--dire une possession prcaire. En ce sens on peut dire que tous les droits de puissance publique sont entre les mains de l'tat inalinables et imprescriptibles et que l'inalinabilit spciale des dpendances du domaine public est bien moins une ; 2 que, par suite, ces concesexception qu'une application de la rgle sions sont essentiellement rvocables ou rachetables, en tout cas temporaires.
CHAPITRE LES DROITS
PREMIER DE POLICE
SECTION Ire. LA POLICE DESFONCTIONNAIRES' 301. Le fonctionnaire est celui qui exerce une fonction publique; la fonction publique est tout mandat confr par une personne administrative, qui ne donne pas le droit de dcision, par consquent qui ne donne pas le pouvoir de faire des actes d'administration. (V. p. 270.) Il n'y a pas notre avis de distinction juridique faire entre la fonction publique et l'emploi, ni par consquent entre le fonctionnaire et l'employ. S'il existe une diffrence, elle est cre par les murs, et rside dans une dignit sociale plus ou moins leve2. Il y a au contraire une diffrence entre la fonction publique ou l'emploi qui ont quelque chose de stable ou de permanent et les missions temporaires ou provisoires; par consquent, il y a une diffrence entre les fonctionnaires en titre et les stagiaires, surnumraires chargs de mission, etc. Il ne sera trait ici que des fonctionnaires en titre. Il n'existe pas de statistique complte des fonctionnaires ou employs. Rien que pour les fonctionnaires de l'tat, les ministres interrogs en i886 ont dclar quatre cent soixante-deux mille, ce chiffre est certainement au-dessous de la vrit. Il est certain d'ailleurs qu'il ne comprend que les fonctionnaires directement salaris, car il est accompagn du chiffre des traitements, 510 millions. Il ne comprend pas, ds lors, les fonctionnaires rtribus par une remise sur le produit d'un objet de vente, comme les dbitants de tabac; or, en 1886, on en comptait plus de quarante-trois mille. Il ne comprend pas non plus les fonctionnaires rtribus directement par le public l'occasion des services qu'ils rendent, comme les officiers ministriels. 1. Bibliographie.Perriquet, tat des fonctionnaires, 1 vol., 1885. 2. D'aprs Loysean, Trait des offices,c.I : L'officeest dignit avec foncest administion publique. Cf. 1. 14, D. de Muner.et honor. L. 4 : Honor tratio reipublic cum dignitatis gradu .
POLICEDES FONCTIONNAIRES
425
Quant aux employs ou fonctionnaires des dpartements et des communes, il n'y a point de statistique. 302. Caractre de la situation du fonctiongnral Nous avons vu, en faisant la thorie de la fonction punaire. blique (p. 271),que le pouvoircontenu dans la fonction devaittre considr comme confi au fonctionnaire par un mandat. Certains auteurs en ont conclu qu'au point de vue de sa situation personnelle et des avantages pcuniaires ouautres rsultant de sa fonction, le fonctionnaire taitli la personne administrative parun contrat priv soit de mandat, soit de louage d'ouvrage; que par suite, en cas de contestation, la comptence devrait tre judiciaire, que le fonctionnaire arbitrairement rvoqu devrait obtenir des dommages-intrts, etc. Tout cela est exagr ; s'il y a mandat, c'est un mandat public et dont la notion doit tre restreinte la dlgation de pouvoirs. Les droits que la personne administrative a sur le fontionnaire participent beaucoup plus des droits de police que des droits contractuels. Non seulement, le fonctionnaire peut tre rvoqu ou dplac d'une faon intempestive pour lui, sans avoir droit aucune indemnit, mais encore, le traitement sur lequel il a pu compter, et qui lui tait assur au moment o il a accept la l'onction, par les lois et rglements en vigueur, peut tre rduit par des dispositions postrieures, qui rtroagissent contre lui parce qu'il n'est point considr comme ayant des droits acquis. De mme, son droit une pension de retraite est purement ventuel. Certains fonctionnaires, par exemple les inamovibles et les officiers, ont des garanties srieuses contre la rvocation et le dplacement arbitraires; mais, chose curieuse, ces garanties ne sont pas considres par le Droit comme ayant un caractre contractuel, on les explique plutt par la thorie des droits rels; la fonction est considre comme une chose, comme une dpendance du domaine public inalinable et imprescriptible en soi, mais sur laquelle le fonctionnaire peut avoir des droits de possession plus ou moins forts; quelquefois mme certains des avantages attachs la fonction sont rigs en objets de proprit. (V. infr, n 304). Cette thorie a l'avantage de donner de la scurit certains fonctionnaires sans lier l'tat vis--vis de tous. Il en rsulte que, en soi, et si l'on met part la question de proprit du grade, de l'office ou de la chaire, l'opration intervenue entre la personne administrative et le fonctionnaire est une opration de puissance publique qui entrane comptence des tribunaux administratifs. (Confl. 27 dc. 1879; 7 aot 1880;Cons.d't. 13 dcembre 1889.)
426
LES DROITSDE POLICE
L'emploi ou 303. Nomination ou collation d'emploi. fonction est confr par un acte unilatral, la nomination. Il ya ensuite acceptation du fonctionnaire ; souvent elle est constate solennellement par une prestation de serment professionnel ; quand il n'y a pas de serment, elle est tacite. Mais ce que le fonctionnaire accepte, c'est dans une formule vague, les devoirs et les avantages de sa charge, la situation telle que dans le moment mme, elle rsulte des lois et rglements. La nomination est un acte d'aministration discrtionnaire; elle ne peut que trs difficilement tre attaque par recours pour excs de pouvoir ; seulement en cas de violation des formes et des conditions exiges par la loi. Et encore faut-il avoir qualit, ce qui ne se prsente gure que pour les concurrents vincs aprs un concours irrgulier une cole du gouvernement. Le refus de nomination ne donne lieu aucun recours ; ainsi les candidats qui ont subi victorieusement un concours, n'ont pas droit tre nomms. Cependant d'aprs l'art. 84 de la loi du 15 juillet 1889 sur le recrutement, et d'aprs la loi du 18 mars 1889 sur le rengagement des sous-officiers, certains emplois de l'tat et du dpartement, qui seront dtermins par rglement, seront rservs aux hommes ayant cinq ans de service, dont deux ans de grade de caporal ou de sous-officier, et il a t entendu que la violation de cette rgle donnerait lieu recours pour excs de pouvoir 1. Une complication intressante peut se produire ; il peut y avoir une convention prive se rattachant une collation d'emploi;Il y a alors deux oprations distinctes: 1 la collation de l'emploi, qui est un acte de puissance publique essentiellement rvocable ; 2 le contrat pass, qui se rsoudra s'il y a lieu en dommages et intrts. On appelle tat des fonc304. tat des fonctionnaires. tionnaires, l'ensemble des garanties qui leur sont donnes au point de vue de l'action disciplinaire exerce sur eux, surtout au point de vue de la rvocation et du changement de rsidence. Les fonctionnaires qui ont un tat, sont ceux qui ont des garanties srieuses contre ces deux ventualits. Le principe est que les fonctionnaires sont rvocables volont et peuvent tre arbitrairement dplacs, soit par mesure disciplinaire, soit pour les besoins du service ; les fonctionnaires qui ont un tat sont donc une exception. Nous savons que le droit n'explique point les garanties dont jouissent les fonctionnaires par des engagements que l'tat aurait pris vis-1. Un rglement du 4 juillet 1890a dtermin ces emplois.
POLICEDES FONCTIONNAIRES
427
vis d'eux par contrat, mais par ce fait que le fonctionnaire aurait dans ces cas-l sur sa fonction une sorte de droit rel que l'tat serait oblig de respecter. En principe, ce droit rel n'est qu'un droit de possession plus ou moins fort; il ne doit pas aller jusqu' la proprit, car on ne peut pas admettre qu'un particulier ait vraiment la proprit d'une fonction publique avec les droits que cela entranerait, la perptuit, la mise dans le commerce, etc. ; ce serait le dmembrement de l'tat. Il y a cependant des cas o le fonctionnaire est propritaire sinon de sa fonction, du moins de quelque chose qui a t cr ct de la fonction et qui en reprsente l'molument. Ce systme est employ lorsqu'on veut donner au fonctionnaire des garanties considrables et il doit tre regard comme une limite extrme. C'est ainsi que pour les officiers ministriels on distingue entre l'office et la finance; l'office c'est la fonction publique, l'officier ministriel n'en est que le possesseur prcaire ; la finance c'est le droit de prsenter un successeur, l'office ministriel en est propritaire, elle ne saurait lui tre enleve, et il la cde moyennant argent. Nous allons retrouver quelque chose d'analogue pour les inamovibles et les officiers de l'arme. Si on laisse de ct les officiers ministriels, dont la situation, quoique trs intressante, mrite d'tre tudie propos du droit priv, on se trouve en prsence de deux catgories de fonctionnaires et les officiers. qui ont un tat, les inamovibles 305. a) tat des fonctionnaires inamovibles. Les inamovibles sont ceux qui ne peuvent tre ni rvoqus ni dplacs sans cause dtermine trs grave, et, en somm, aprs jugement de leurs pairs. Il ne faut pas confondre inamovibilit avec fonction vie. Actuellement, tous les inamovibles peuvent tre mis la retraite un certain ge. Les inamovibles sont: 1 Les magistrats de l'ordre judiciaire pourvus des fonctions de juge, ft-ce celles de juge supplant. Les juges de paix ne sont pas inamovibles; les magistrats des colonies non plus. Les magistrats inamovibles ont la proprit du sige, c'est--dire de la rsidence; la cour de cassation peut prononcer leur suspension temporaire ou leur dchance. 2 Les professeurs de l'enseignementpourvus de chaire. ) Enseignement suprieur. Les professeurs titulaires ont la proprit d'une chaire qu'ils conservent en certains cas tout en abandonnant leur emploi (lorsqu'ils acceptent des fonctions compatibles, par exemple). Cette chaire incarne certains avantages de traitement, de classement, le droit un certain enseignement et une certaine rsidence. La proprit de la chaire est protge de la faon suivante : les professeurs titulaires de
428
LES DROITSDE POLICE
l'enseignement suprieur ne peuvent tre rvoqus ou frapps de retrait d'emploi, que par jugement des conseils acadmiques avec appel au conseil suprieur de l'instruction publique. (L. 27 fvrier 1880, art. 7.) Ils peuvent tre frapps de mutation pour emploi infrieur par le ministre, aprs avis conforme du conseil suprieur (cod., art. 14); et de mutalion pour emploi quivalent par le ministre aprs avis conforme de la section permanente. (D. 28 dc. 1885, art. 34.) ) Enseignement secondaire. Mme chose que pour les prcdents, sauf que pour la mutation pour emploi infrieur, il suffit de l'avis de la section permanente, et que pour la mutation pour emploi quivalent aucune garantie ne parat exister. 306. b) tat des officiers. Il y a pour les officiers une distinction entre le grade et l'emploi. L'emploi est la fonction publique en elle-mme, les officiers n'ont sur lui qu'une possession prcaire, il peut leur tre retir, ils sont alors soit en disponibilit, soit en non-activit, soit en rforme. Mais en dehors de l'emploi, la loi du 19 mai 1834 a cr le grade qui est l'ensemble des avantages pcuniaires et honorifiques assurs l'officier; le grade est une sorte de proprit dont l'officier ne peut tre dpouill que pour des motifs dtermins et en suivant les formes lgales. Le grade n'est cependant pas une proprit aussi complte que la finance de l'officier ministriel en ce sens qu'il ne peut pas tre transmis moyennant argent. Le grade n'assure pas non plus l'officier l'inamovibilit que la chaire assure au professeur, l'officier peut toujours tre dplac. Il sert de garantie la solde, l'avancement, aux droits honorifiques. Les faits qui font perdre l'officier son grade sont ainsi numrs par l'art. 1er de la loi du 1834 1 dmission accepte par le chef de l'tat; 2 perte de la qualit de Franais prononce par jugement ; 3 condamnation une peine afflictive ou infamante; 4 condamnation une peine correctionnelle pour certains dlits; 5 condamnation une peine correctionnelle d'emprisonnement avec interdiction de droits civiques, civils et de famille ; 6 destitution prononce par jugement d'un conseil de guerre. tat des officiers de rserve et de territoriale. V. dcrets du 31 aot 1878 et du 3 fvrier 1880. tat des sous-officiers rengags ou commissionns. Ils ont eux aussi un tat. (V. 1. 18 mars 1889, art. 4.) Ils ne peuvent tre casss ou forcs de rtrograder, que par dcision du commandant de corps d'arme, aprs conseil d'enqute dont font partie deux sous-officiers. Dans tous les corps de 307. Classement et avancement. fonctionnaires qui ont une hirarchie, il y a un avancement qui peut tre prcd de classement. Dans les corps de fonctionnaires qui n'ont point de hirarchie, il y a un classement qui sert de base une augmentation de traitement.
POLICEDES FONCTIONNAIRES
429
L'avancement et le classement peuvent tre rgls par de simples traditions ou de simples circulaires ministrielles; ils peuvent aussi tre rgls par la loi ou par des actes rglementaires, auquel cas la violation des rgles peut donner lieu recours pour excs de pouvoir. Il ya ainsi des rgles lgales pour : 1 les officiers (1. 1834) ; 2 les membres de l'enseignement: enseignement suprieur (Dcr. 24 dc. 1881) ; enseignement secondaire (D. juin 1887) ; enseignement primaire (1. 19 juill. 1889. art. 6); 3 les auditeurs de deuxime classe au Conseil d'tat: le tiers des places de matre des requtes leur est rserv. (L. 1872, art. 5, 10 et 11), etc. Les traitements des fonctionnaires sont Traitements. pays par douzimes chus sur ordonnancement d'ordonnateurs varis; le retard ne donne point lieu rclamation. Les traitements des fonctionnaires de l'tat sont insaisissables dans une forte proportion. (V. arrts 18 nivse an XI, 15 germinal an XII, 1. 21 ventse an IX.) Les traitements sont fixs par la loi ou par des dispositions rglementaires; ils peuvent toujours tre modifis par des lois ou des dispositions subsquentes, la disposition nouvelle s'applique, le fonctionnaire n'a point droit acquis conserver l'ancien traitement. Cumul des traitements. En principe, les fonctions publiques peuvent tre cumules; les traitements aussi, mais pas en entier. Le principe a t pos en cette matire par la loi du 28 avril 1816, il a t repris et dvelopp par l'ordonnance du 31 mai 1838, art. 44: Il est interdit de cumuler en entier les traitements de plusieurs places, emplois ou commissions dans quelque partie que ce soit: en cas de cumul de deux traitements,le moindre est rduit de moiti; en cas de cumul de trois traitements, le troisime est en outre rduit au quart, et, ainsi de suite, en suivant cette proportion; mais cette rduction n'a pas lieu pour les traitements cumuls qui sont au-dessous de 3,000 francs, ni pour les traitements plus levs qui en sont dispenss par les lois. Par exception (art. 28, 1. 8 juillet 1852) : les professeurs, les savants, les gens de lettres et artistes peuvent remplir plusieurs fonctions et occuper plusieurs chaires rtribues sur les fonds du trsor public; mais le montant des traitements cumuls, tant fixes qu'ventuels, ne peut dpasser 20,000 francs. Il y a aussi des rgles sur le cumul des traitements avec l'indemnit de snateur ou de dput. (V. plus haut, p. 242.) Enfin il ya des rgles sur le cumul des traitements et des pensions de retraite. (V. pour pensions civiles, 1. 25 mai 1819 et 1. 7juin 1853; pour pensions militaires, 1. 26 dc. 1890, art. 31.) 308.
430
LES DROITSDE POLICE
Retenue des traitements. La retenue de traitement est un moyen d'action disciplinaire, que l'tat peut employer en principe vis--vis de tous ses fonctionnaires. Mais la question a t fort discute vis--vis des membres du clerg, soit parce qu'en effet, bien des gards, les membres du clerg ne sont pas des fonctionnaires ordinaires, soit parce que certains de ces traitements, tant concordataires, pourraient tre considrs comme tablis parun trait diplomatique. Le Conseil d'tat, dans un avis du 26 avril 1883, s'est prononc pour la possibilit de la retenue du traitement en se fondant sur des traditions antrieures au concordat ; celui-ci ayant d'ailleurs formellement reconnu au chef de l'tat les droits et prrogatives autrefois exercs par les rois de France. Il y a, dans la suspension de traitement, un acte discrtionnaire, mais soumis cependant des conditions de comptence et de forme. Le ministre seul peut prononcer une suspension de traitement de ministre du culte. (C. d't. 1er fvr. 1889.) Des pensions de retraite1. 309. La pensionest une rente viagre titre d'aliment, servie au fonctionnaire qui cesse d'tre en activit de service, lorsque certaines conditions sont runies. L'institution des pensions s'est tendue toutes les personnes administratives, les dpartements et les communes en servent leurs employs, mais ce sont les pensions de l'tat qui sont les plus importantes. Les pensions sont une lourde charge pour le budget : le total des arrrages des pensions civiles et militaires dpasse actuellement deux cent millions de francs. On s'est frquemment rcri contre cette ; mais charge toujours croissante, surtout contre les pensions civiles il ne semblepas qu'on puisse raisonnablement supprimer l'institution, ni mme la restreindre d'une faon sensible. La raison quia fait tablir le rgime des pensions subsiste toujours avec la mme gravit. D'une part, il est ncessaire qu'il y ait dans les fonctions de l'tat, une limite d'ge au del de laquelle le fonctionnaire puisse tre remerci ; sans cela on tomberait dans le grontisme. D'autre part, on hsitera toujours remercier, et par consquent priver de son traitement, un serviteur dont la vie ne serait pas assure. La pension de retraite est le seul moyen pratique d'obtenir le rajeunissement des cadres. 1. Bibliographie: Bavelier, Trait despensions, 2 vol. 1885. Ourry. Dictionnaire des pensions,1 vol. 1874.
DES FONCTIONNAIRES POLICE
431
A cette raison fondamentale viennent s'en joindre d'autres: 1 sup bref dlai, s'obliger les en ou tout en c'est, pensions, partie primer relever les traitements. Il est clair, en effet, que les serviteurs de l'tat font entrer l'ventualit de la pension dans les calculs qui dcident du choix de leur carrire, et qu'ils verraient au fond dans la restriction des pensions une diminution de traitement; 2 supprimer les pensions, c'est relcher d'une faon grave les liens qui attachent le fontionnaire l'tat. La pension attache le fonctionnaire, celui-ci prouve une rpugnance bien naturelle donner sa dmission, parce que la dmission lui ferait perdre les droits qu'il a dj acquis la pension. Elle impose aussi de la modration l'administration, qui hsite rvoquer le fonctionnaire dans des conditions qui lui feraient perdre ses droits la retraite. L'tat pourrait perdre ce que ces liens rciproques fussent briss Il faut chercher perfectionner le systme des pensions et non pas les supprimer. A. Des pensions civiles de l'tat. (L. 9 juin 1853.)
310. L'tat a successivement essay de plusieurs systmes en matire de pension ; il a fait d'abord de la pension une rcompense nationale (1. 3-22 aot 1790), mais c'tait pour un petit nombre d'agents, pour hs autres il avait pris le parti de forcer les diverses administrations constituer des caisses alimentes par des versements des enfin comme ces caisses avaient consfonctionnaires eux-mmes ; tamment besoin de subventions de l'tat, la loi du 9 juin 1853 les a supprimes, a rendu l'tat directement dbiteur des pensions mais en maintenant les versements des fonctionnaires. La loi de 1853 a ainsi combin les deux ides : l'ide de la caisse de retraites et l'ide dela rcompense donne par l'tat, car le chiffre des pensions servies dpasse de beaucoup celui des versements. Cette combinaison est assez heureuse, il est bon que le fonctionnaire sente qu'il contribue lui-mme, par ses versements, s'assurer sa pension. Le rgime de la loi du 9 juin 1853 forme le droit commun, on l'appelle le rgime du personnel soumis retenue. Mais il y a certains fonctionnaires tels que les ministres, les membres du Conseil d'tat, les prfets et sous-prfets qui ont droit pension sans verser de retenues: ils sont rests sous l'empire de la loi du 22 aot 1790 et cela tient l'instabilit particulire de leur situation. 311. I. Du droit pension. Nous employons cette expres-
432
LES DROITSDE POLICE
sion de droit pension, bien que, ainsi que nous le verrons chemin faisant, ce soit un droit singulirement ventuel et prcaire. 1 Fonctionnaires qui peuvent bnficier de la loi de 1853. Ce 1 les fonctionnaires ou employs directement rtribus par sont: l'tat (art. 3); 2 les fonctionnaires de l'enseignement rtribus en tout ou en partie sur les fonds dpartementaux ou communaux ou sur des ; 3 les foncpensions payes par les lves des lyces nationaux (art. 4) tionnaires ou employs qui, sans cesser d'apppartenir au cadre permanent d'une administration publique, et en conservant leurs droits l'avancement hirarchique, sont rtribus en tout ou en partie sur les fonds dpartementaux, sur les fonds des compagnies concessionnaires, et mme sur les remises et salaires pays par les particuliers. (Art. 4.) Cela s'applique notamment aux ingnieurs de l'tat dtachs au service des compagnies de chemin de fer. Pour les fonctionnaires coloniaux, voyez la loi de finances du 21 mars 1885, art. 9 et 10. 2 Versement des retenues. Les fonctionnaires ou employs. supportent indistinctement, sans pouvoir les rpter dans aucun cas, les retenues ci-aprs : 1 une retenue de 5 0/0 sur les sommes payes titre de paiement fixe ou ventuel, de prciput, de supplment de traitement, de remises proportionnelles, de salaires, ou constituant tout autre titre un molument personnel; 2 une retenue du douzime des mmes rtributions lors de la premire nomination ou dans le cas de rintgration, et du douzime de toute augmentation ultrieure; 3 les retenues pour cause de congs et d'absences, ou par mesure disciplinaire. Sont affranchies de ces retenues les commissions alloues en compte courant par le Trsor aux receveurs gnraux des finances. Les comptables, les receveurs particuliers et les percepteurs des contribu tions directes, ainsi que les agents ressortissant au ministre des finances, qui sont rtribus par des salaires ou remises variables, sup portent ces retenues sur les trois quarts seulement de leurs moluments de toute nature, le dernier quart tant considr comme indemnit de loyer et de frais de bureau. (Art. 3.) 3 Dure des services; ge requis. Le droit la pension de retraite est acquis par anciennet soixante ans d'ge et aprs trente ans de services. Il suffit de cinquante ans d'ge et de vingt-cinq ans de ser vices pour les fonctionnaires qui ont pass quinze ans dans la partie active. La partie active comprend les emplois et grades indiqus au ta bleau annex la loi sous le n 2 (douanes, contributions indirectes, forts et postes, enseignement primaire). Aucun autre emploi ne peut tre compris au service actif, ni assimil un emploi de ce service, qu'en vertu d'une loi. La limite d'ge fixe pour la mise la retraite des fonctionnaires civils et militaires par les dcret, arrts et dcisions actuellement en
POLICEDES FONCTIONNAIRES
433
vigueur, ne peut tre abaisse que par une loi. (L. 30 mars 1888, art. 22.) 4 tendue du droit. Bases de la pension. La pension est base sur la moyenne des traitements et moluments de toute nature soumis retenue, dont l'ayant-droit a joui pendant les six dernires annes d'exercice. Nanmoins, dans les cas prvus par l'art. 4,la moyenne ne peut excder celle des traitements et moluments dont le fonctionnaire aurait joui s'il et t rtribu directement par l'tat. (Art. 6.) La pension est rgle, pour chaque anne de services civils, un soixantime du traitement moyen; nanmoins, pour vingt-cinq ans de services entirement rendus dans la partie active, elle est de la moiti du traitement moyen, avec accroissement, pour chaque anne de ser vice en sus, d'un cinquantime du traitement. En aucun cas, elle ne peut excder, ni les trois quarts du traitement moyen, ni les maxima dtermins au tableau annex la loi sous le n 3 (Art. 7.) Pour le concours des services militaires et des services civils, v. art. 8. Observation. Les rgles gnrales sur le droit pension comportent des exceptions : 1 le fonctionnaire qui a le temps de service requis peut tre dispens par dcision ministrielle de la condition d'ge, s'il est exceptionnellement fatigu : 2 des pensions dites exceptionnellessont accordes quel que soit l'ge ou le temps de service, dans le cas d'acte de dvouement dans un intrt public, de lutte ou de combat soutenu dans l'exercice des fonctions, d'accident grave rsultant de l'exercice des fonctions, v. art. 11, 1 3; 3 des pensions proportionnelles l'ge et au temps de service peuvent galement tre accordes ceux qui ont contract des infirmits graves dans l'exercice de leurs fonctions. V.art. 11 , 4 et 5; 4 enfin il y a des droits pour la veuve et pour les orphelins. La veuve peut obtenir une pension soit titre de rversibilit de la pension acquise son mari (art. 13); soit en vertu d'un droit propre dans des hypothses exceptionnelles (art 14). Pour le droit des orphelins qui existe dans les mmes cas que celui de la veuve et lorsque celle-ci meurt ou est incapable de toucher. (V. art. 16.) 312. II. Dcision faire valoir l'intress qui admet Le fonctionnaire civil, quelque soit ses droits la pension. son ge et son temps de service, n'a pas droit acquis la pension tant qu'il n'est pas intervenu une dcision ministrielle l'admettant faire valoir ses droits la retraite. (Art. 19.) Il ne peut former jusque-l aucune rclamation contentieuse; sa dmission, s'il la donne et qu'elle soit accepte, lui fait perdre tous ses droits. Observons cependant que ds que le temps de service est accompli, le droit est acquis en ce sens, qu'en cas de dcs, le droit de reversibilit est acquis la veuve. (Art. 13.) La situation des militaires est moins mauvaise, ils ont droit acquis la retraite ds qu'ils ont l'ge et le temps requis. (V. infr, n316.) H. 28
434
LES DROITSDEPOLICE
La dcision ministrielle qui admet le fonctionnaire faire valoir ses droits la retraite est un acte d'administration discrtionnaire, de sorte que: 1 Le ministre peut retarder sa dcision tant qu'il lui plat, et retenir le fonctionnaire dans le service actif (C. d'tat, 17 janvier 1889), moins que la loi ne fixe imprativement une limite d'ge; 2 Au lieu d'admettre le fonctionnaire faire valoir ses droits la retraite, le ministre peut le rvoquer purement et simplement, ce qui lui fait perdre tout droit la pension. Dans ces deux cas aucun recours n'est possible. Le fonctionnaire qui n'est pas rvoqu, qui est simplement remplac dans ses fonctions, est cependant recevable intenter le recours pour excs de pouvoir. Le Conseil d'tat l'a dcid aprs hsitations et a annul la dcision ministrielle. (C.d't., 15 mars 1889.) L'admission faire valoir les droits la retraite est prononce d'office par le ministre, ou bien sur la demande de l'intress. Une fois l'admission de la pension. 313. III.Liquidation faire valoir ses droits la retraite prononce, le fonctionnaire a droit acquis la pension. Ce droit ne pourrait plus lui tre enlev que par son dcs, puisqu'il s'agit d'un droit viager, ou pour une des causes d'indignit qui font perdre mme la pension liquide (V. infr); mais reste faire liquider la pension, c'est--dire en faire le calcul et en fixer le montant. La liquidation est faite par dcret aprs accom Toute demande de pension plissement des formalits suivantes: est adresse au ministre du dpartement auquel appartient le fonctionnaire. Cette demande doit, peine de dchance, tre prsente, avec les pices l'appui, dans le dlai de cinq ans, partir, savoir : pour le titulaire, du jour o il aura t admis faire valoir ses droits la retraite, ou du jour de la cessation de ses fonctions, s'il a t autoris la continuer aprs cette admission; et, pour la veuve, du jour du dcs du fonctionnaire. Les demandes de secours annuels pour les orphelins doivent tre prsentes dans le mme dlai partir du jour du dcs de leur pre ou de celui de leur mre. (Art. 22. La liquidation est faite par le ministre comptent, qui la soumet l'examen du Conseil d'tat avec avis du ministre des finances. Le dcret de concession est rendu sur la proposition du ministre comptent. Il est contresign par lui et par le ministre des finances. Il est insr au Bulletin des lois. (Art. 24.) Comme le fonctionnaire a maintenant un droit acquis, des recours contentieux ordinaires lui sont ouverts contre tous les actes qui lseraient ses droits (refus de liquidation, calcul inexact, dcision
POLICEDES FONCTIONNAIRES
435
prononant la dchance ou la suspension du droit). Ces recours sont dispenss des frais et du ministre del'avocat. (D. 2 nov. 1864.) Caractre alimen314. IV. Jouissance de la pension. taire. La jouissance de la pension commence au lendemain du jour de la cessation de traitement ou du dcs du fonctionnaire. Les arrrages sont pays par trimestre (art. 30), sur production d'un certificat de vie dlivr par un notaire (D. 9 nov. t853, art. 46) aux dates des 1er mars, juin, septembre et dcembre. (L. 12 aot 1876, art. 13.) Lorsque trois ans se sont couls sans rclamation d'arrrages, la pension est raye des livres du Trsor, et son rtablissement ne peut donner lieu au rappel des arrrages antrieurs la rclamation (art. 30). Cette dchance triennale se distingue de la prescription quinquennale de l'art. 2257, en ce sens qu'elle frappe tous les arrrages dus depuis trois ans, et non pas seulement ceux dus depuis plus de trois ans. Cette dchance s'applique tout fait au dbut; bien qu'on ait cinq ans pour faire liquider la pension, on ne peut jamais rappeler plus de trois annes d'arrrages. Les pensions sont incessibles, elles ne peuvent tre mises en nantissement, elles sont insaisissables, sauf les exceptions de l'art. 26. Le fonctionnaire 315. Perte de la pension liquide. constitu en dficit pour dtournement de fonds ou de matires, ou convaincu de malversations, le fonctionnaire convaincu de s'tre dmis de son emploi prix d'argent, celui condamn une peine afflictive et infamante perd tout droit la pension. (Art. 27.) Il y a suspension de jouissance en cas de perte de la qualit de Franais (art. 29). Pour le cas de cumul de la pension avec un traitement ou de cumul avec deux pensions, voir art. 18 et 31. La perte du droit pension est prononce par un dcret rendu sur la proposition du ministre des finances, aprs avis du ministre liquidateur et de la section des finances du Conseil d'tat. (D. 9 nov. 1853, art. 43.) B. Pensions militaires. 316. Les textes lgislatifs qui rgissent mement nombreux. Il faut consulter, pour des 11 avril 1831, 26 avr. 1855, 25 juin aot 1879, 18 aot 1881, 22 mars 1885, ces pensions sont extrl'arme de terre, les lois 1861, 22 juin 1878, 18 15 avril 1885, 25 juillet
436
LES DROITS DE POLICE
1887; pour l'arme de mer, les lois des 18 avril 1831, 5 aot 1879, 16 avril 1881. 8 aot 1882, 22 mars 1885, 15 avril 1885, 26 janvier 1892, art. 49 et s. Le mcanisme en est analogue celui des pensions civiles. Il y a cependant une diffrence importante. Le militaire a droit acquis sa : il pension ds qu'il a satisfait aux conditions d'ge et de service peut donc en rclamer immdiatement la liquidation par recours contentieux; il n'y a pas pour lui cette dcision ministrielle sur l'admission la retraite qui, pour les pensions civiles, transforme le droit ventuel en droit acquis. Les pensions militaires peuvent tre cumules avec un traitement civil d'activit (1.15 mars 1817, art. 27 ; 1, 11avr. 1831, art. 4 et 17; 1.19 mai 1834) ; toutefois des limites ce cumul ont t poses par la loi du 26 dc. 1890, art. 31. C. Caisses dpartementales et communales de retraites.
317. Les dpartements et la plupart des grandes villes ont constitu des caisses de retraites pour leurs employs. C'est, en gnral, le dcret du 4 juillet 1806 qui est adopt comme type des rglements de ces diverses caisses, et le Conseil d'tat a dcid que, en l'absence d'un rglement particulier, il y avait lieu d'appliquer les dispositions de ce dcret pour la concession et la liquidation des pensions. La loi du 10 aot 1871 (art. 46, 21) donne aux conseils gnraux le pouvoir de statuer dfinitivement sur l'tablissement et l'organisation des caisses de retraites, ou de tout autre mode de rmunration en faveur des employs des prfectures et des sous-prfectures, ainsi que des autres agents salaris sur les fonds dpartementaux. Les conseils municipaux ont le mme pouvoir en ce qui concerne les caisses de retraites des employs communaux. Les fonds appartenant aux caisses dpartementales et communales de retraites sont gnralement centraliss la Caisse des dpts et consignations qui est charge de les administrer. Il y a lieu de distinguer ici aussi l'admission la retraite et la liquidation de la retraite. L'admission la retraite est dans les prrogatives de l'organe excutif, et notamment le prfet a le droit d'admettre un employ dpartemental faire valoir ses droits la retraite sans attendre que le conseil gnral ait au pralable vot un crdit. (D. en C. d't. 5 janv. 1892.) Quant la liquidation de la retraite, pour les pensions dpartementales elle est dans les attributions du conseil gnral, si celui-ci a voulu se la rserver, sinon elle est faite par dcret; pour les pen-
ADMINISTRATIVE TUTELLE
437
sions municipales, elle est dans les attributions du prfet. (D. 25 mars 1852, tableau A, n 38). SECTION II. LA TUTELLEADMINISTRATIVE EXERCE SURLES PERSONNES ADMINISTRATIVES 1er. TUTELLE 318. On appelle du nom de tutelle administrative, les pouvoirs de police exercs par certaines personnes administratives, et notamment par l'Etat, sur d'autres personnes administratives. On peut appeler du mme nom, les pouvoirs de police exercs par l'tat sur les tablissements d'utilit publique. Ila dj t parl de cette tutelle et de l'incapacit qu'elle entrane pour les personnes administratives (V. n 296). Ila t dit que le nom de curatelle serait mieux appropri que celui de tutelle, car le nom de tutelle veille, dans notre droit, l'ide d'un incapable qui n'agit pas du tout par lui-mme, pour le compte duquel agit un tuteur, ce qui, visiblement, est inexact quand il s'agit des personnes administratives. Ces personnes agissent par elles-mmes au moyen d'organes qui leur sont propres; seulement il leur faut, pour certains actes, l'autorisation d'un curateur. Malgr tout, le nom de tutelle tant consacr par l'usage, il est prfrable de le conserver. Nous ne pouvons pas entrer dans tous les dtails de la tutelle administrative, le rgime varie avec chaque espce de personne. Les dpartements ne sont pas soumis au mme rgimeque les communes, les colonies ne sont pas soumises au mme rgime que les dpartements, les tablissements publics ne sont mme pas soumis un rgime commun. Quelques-uns des dtails ont t donns dans notre tude de l'organisation administrative, propos des attributions des organes dlibrants ou excutifs de telle ou telle personne, des cas o leurs dcisions doivent tre approuves, des cas o elles peuvent tre annules, etc. Ici, nous n'allons faire que quelques observations trs gnrales. Premireobservation. La tutelle n'appartient pas exclusivement l'tat. Le dpartement a des droits importants detutelle sur la commune, qui sont exercs par le conseil gnral ou par la commission dpartementale. C'est ainsi, par exemple, que le conseil gnral fixe tous les ans un maximum de centimes extraordinaires dont les communes pourront s'imposer La commune, son tour, a des droits de tutelle sur certains tablissements publics, comme les hpitaux et hospices, les bureaux de bienfaisance; ainsi, certains emprunts de ces tablissements ne peuvent tre autoriss que sur avis conforme
438
LES DROITSDE POLICE
du conseil municipal, etc Il y a donc une certaine dcentralisation de la tutelle, et il a t maintes fois question d'accentuer cette dcentralisation, notamment d'augmenter les pouvoirs du dpartement sur la commune. Il y aurait une dcentralisation plus grande des avanil est certain, par exemple, que les fatages et des inconvnients ; briques, qui, comme tous les tablissements publics relatifs aux cultes, sont fortement rattaches l'tat, trouveraient des inconvnients tre rattaches la commune, qui ne mettrait peut-tre pas dans l'exercice de la tutelle la mme impartialit que l'tat. Deuxime observation. L'Etat, qui partage quelquefois la tutelle avec d'autres personnes administratives, ne l'abandonne jamais compltement. Il exerce toujours d'une faon immdiate une partie de la tutelle sur toutes les personnes administratives secondaires. Ainsi, les communes sont pour partie sous la tutelle du dpartement, mais elles sont aussi pour une partie plus importante sous la tutelle de l'tat. Il en est de mme des tablissements publics, mme de ceux qui sont communaux, comme les hpitaux, hospices, bureaux de bienfaisance, etc. : l'tat garde toujours une tutelle directe sur eux. En effet, toutes ces personnes sont membres de l'tat, il est naturel qu'il en garde la direction suprme. Troisime observation. Les pouvoirs contenus dans la tutelle confrent en gnral les droits suivants: 1 Le droit de participer la constitution des organes de la personne en tutelle. C'est ainsi que l'tat nomme le prfet du dpartement, le gouverneur dela colonie. C'est ainsi qu'il nomme en partie les membres de la commission administrative des hospices. C'est ainsi que la commune, par l'intermdiaire de son conseil municipal, nomme une autre partie des membres de cette mme commission administrative; 2 Le droit d'autoriser certains actes, en donnant une approbation ou un avis conforme aux dlibrations prises par les organes comptents de la personne en tutelle. C'est ainsi que l'tat approuve le budget des dpartements, communes, etc. C'est ainsi que la commune n'apapprouve certains emprunts des hpitaux, hospices, etc.; 3 Le droit d'annuler certains actes accomplis par la personne en tutelle dans la limite de sa capacit, mais qui sont contraires aux lois et rglements, ou bien simplement qui sont inopportuns. Ce dernier pouvoir, qui se rapproche singulirement du pouvoir juridictionnel, n'appartient jamais qu' l'tat (V. acte d'administration, p. 206); 4 Le droit de suspendre, rvoquer ou dissoudre les autorits administratives qui constituent les organes des personnes en tutelle. Ce droit est galement rserv l'tat. (Suspension et rvocation du maire, dissolution des conseils gnraux, des conseils municipaux, etc.,
TUTELLE ADMINISTRATIVE
439
319. Du droit de rgale exerc sur les menses pis Les menses piscopales sont soumises la tutelle de copales. l'tat dans des conditions trs particulires qui mritent d'tre signales. Les menses piscopales sont des tablissements publics qui n'ont pas, proprement parler, d'organisation administrative. Ce sont de purs fournir des revenus l'vque. L'vque est usupatrimoines destins fruitier de la mense, et en cette qualit l'administre. Les rgles de cette administration se trouvent dans un dcret du 6 novembre 1813. Tant que le sige piscopal est occup par un vque, la situation de la mense ne prsente rien d'anormal, l'vque administre, sauf pour certains actes, tels que l'alination, la constitution d'hypothques, etc., demander l'autorisation du gouvernement. Mais lorsque le sige piscopal devient vacant, l'tat use des droits de rgale et cela lui confre les pouvoirs suivants: 1 L'tat prend l'administration intrimaire de la mense; il est nomm un administrateur selon certaines formes; 2 Depuis la vacance du sige jusqu' la nomination du successeur, l'tat jouit des fruits et revenus de la mense ; 3 Pendant son administration intrimaire, l'tat a le droit de prendre toutes les mesures ncessaires pour que le patrimoine de la mense soit rendu sa vritable destination, qui est de fournir des revenus l'vque. Par suite, des alinations de biens-fonds peuvent tre autorises par dcret, pour le prix tre plac en rentes, si cela parat plus avantageux. Ce droit de rgale, avec ses effets originaux, a une origine fodale. Il fut, au dbut, la ranon d'une protection spciale accorde par le roi aux glises. Maintenu pendant tout l'ancien rgime, il fut ressuscit par l'art. 33 du dcret de 1813, en vertu de l'art. 16 du concordat, qui reconnat au chef du gouvernement les mmes droits et prrogatives que par le pass, et il produit encore tous les effets compatibles avec l'ordre de choses actuel. Sa raison d'tre, aujourd'hui, est qu'il procure le seul moyen de contrle efficace sur l'administration de l'vque. L'vque n'est astreint aucune comptabilit; il peut se faire qu'il jouisse de la mense pendant vingt ans, trente ans, sans rendre aucun compte. Il est indispensable que, d'une faon intermittente, l'tat prenne l'administration, afin de faire une sorte d'inventaire et de contrler la situation du patrimoine. Reconnaissons, cependant, que cela ne justifie pas l'attribution des fruits l'tat pendant l'intrim.
440
LES DROITS DE POLICE
EXERCE SURLESTABLISSEMENTS D'UTILIT 2. TUTELLE PUBLIQUE 320 On sait que les tablissements d'utilit publique ne sont point des membres de l'tat; que ce ne sont pas des personnes morales publiques, mais des personnes morales prives; que par l, ils se distinguent de toutes les personnes que nous avons tudiesjusqu'ici, notamment des tablissements publics. Mais comme ces tablissements collaborent plus ou moins avec l'tat au bien gnral, comme d'autre part, si l'tat ne leur en faisait pas la concession, ils n'auraient pas la personnalit civile, ces tablissements demandent l'tat la reconnaissance d'utilit publique, qui leur confre la personnalit et en mme temps les soumet une certaine tutelle. (V. p. 158.) Le nombre des tablissements d'utilit publique n'est pas aussi grand qu'on pourrait se le figurer. Si l'on dfalque les congrgations religieuses reconnues, les caisses d'pargne et les monts-de-pit, qui mritent d'tre compts part, une statistique, qui va jusqu'en 1890, accuse le chiffre de 756, dont 229 pour Paris, et 527 pour les dpartements. Il est bon d'ajouter, cependant, que dans les vingt dernires annes, la progression des reconnaissances d'utilit publique est sensiblement croissante. On trouve dans la catgorie des tablissements d'utilit publique 1 des institutions charitables, telles que les socitsde charit maternelle, les uvres du prt gratuit, des orphelinats, des asiles, etc. ; 2 des socits amicales, associations d'anciens lves de lyce, etc. ; 3 des socits savantes, acadmies, socits d'archologie, etc. ; 4 des ligues, comme la ligue de l'enseignement; de vritables tablissements d'enseignement, comme les facults libres, l'cole des hautes tudes, etc. 5 des comices agricoles, etc., et enfin les congrgations religieuses reconnues, les caisses d'pargne prives, les monts-de-pit, certaines socits de secours mutuels. Nous allons indiquer d'abord la condition gnrale des tablissements d'utilit publique, ensuite la condition plus particulire des congrgations religieuses reconnues, des caisses d'pargnes,des montsde-piti, des socits de secours mutuels. d'utilit 321. Condition des tablissements gnrale L'tablissement d'utilit publique est une association publique. qui la personnalit a t concde par un acte spcial de l'tat raison de l'utilit des services qu'elle rend au public. C'est une association de la catgorie des socits dsintresses, c'est- dire dans laquelle les associs ne cherchent point une occasion
TUTELLE ADMINISTRATIVE
441
de gain. Aussi les sommes verses par eux n'ont-elles point le caractre d'apports, et ne donnent-elles point droit au partage du fonds social si l'tablissement vient disparatre. Elles ont le caractre de chose donne ou abandonne par derelictio, et portent le nom de cotisation, de souscription, de fondation. Ce caractre dsintress n'empche point l'tablissement d'utilit publique d'tre personne prive, car l'activit prive n'est pas forcment intresse. De la reconnaissance d'utilit publique. La reconnaissance d'utilit publique est un acte gracieux de l'tat. En principe, elle est l'uvre du pouvoir excutif, elle rsulte d'un dcret rendu en Conseil d'tat, aprs une enqute srieuse portant sur l'utilit de l'uvre et sur ses chances de vitalit. Par exception, les tablissements libres d'enseignement suprieur ne peuvent tre dclars d'utilit publique que par une loi (l. 18 mars 1880, art. 7). La personnalit de l'tablissement nat du jour de la reconnaissance d'utilit publique. Capacit des tbalissements d'utilit publique. En principe, les tablissements d'utilit publique ne sont soumis aucune incapacit, si ce n'est celle de recevoir des donations et des legs, rsultant des art. 910 et 937 du Code civil. Nous tudierons cette incapacit propos des dons et legs. (V. infr, nos 526 et s. ) Par consquent, ils peuvent sans autorisation administrer leurs biens, acqurir titre onreux mme des immeubles, aliner, hypothquer, ester en justice, en un mot exercer librement les droits privs. Mais il faut faire attention que, n'tant pas personnes morales publiques, ils ne jouissent d'aucun droit de puissance publique; ils ne peuvent pas exproprier, ils n'ont le bnfice d'aucun impt, leurs travaux n'ont pas le caractre de travaux publics, ils n'ont pas d'hypothque lgale sur les biens de leurs comptables, etc. La capacit des tablissements d'utilit publique, qui est aujourd'hui de principe, n'a pas toujours paru aussi nette. Au dbut du sicle, alors qu'ils n'taient pas trs bien spars des tablissements publics, le Conseil d'tat admettait qu'ils pouvaient par leurs statuts se soumettre volontairement la condition des tablissements publics, et par consquent se rendre incapables d'aliner, hypothquer, ester en justice sans autorisation, etc. Cette jurisprudence a t abandonne avec juste raison, la capacit est d'ordre public, mme pour les associations. Suppression ou disparition de l'tablissement. L'tablissement disparait si l'association qui sert de support sa personnalit se dissout. De plus, l'tablissement peut tre supprim, c'est--dire que l'tat, qui avait accord la personnalit, peut la retirer. En principe,
442
LES DROITSDE POLICE
la personnalit peut tre retire par un acte de mme nature que celui qui l'avait concde , certains tablissements ont cette garantie que la personnalit ne peut leur tre retire que par une loi. Dans les deux cas, il s'agit de rgler la dvolution des biens. Le principe est que les associs n'ont aucun droit sur le fonds et que les biens appartiennent l'tat titre de biens vacants et sans matre (art. 713 et 539 C. civ.) ; mais un certain nombre de solutions de faveur sont admises dans la pratique, et ont t consacres par des textes pour des tablissements particuliers. Ainsi, si les membres actuellement associs ont vers des cotisations, on peut admettre qu'elles leur soient restitues. Si des donations ou des legs ont t recueillis, ils seront restitus aux donateurs ou testateurs ou leurs ayants cause. Enfin, pour le surplus des biens, les statuts de l'tablissement peuvent prvoir qu'ils seront distribus des tablissements similaires ; et, dans le silence des statuts, il sera convenable que l'tat procde une distribution de ce genre. (V.1. 15juill. 1850, art. 10, Socits de secours mutuels; l. 24 mai 1825, art. 7, Congrgations religieuses de femmes ; 1. 12 juill. 1875, art. 12, tablissements d'enseignement suprieur.) 322. Congrgations religieuses reconnues1. Nous savons que les congrgations religieuses peuvent se trouver dans trois situations diffrentes : 1 tre non-reconnues ou non-autorises, auquel cas elles sont illicites; 2 tre autorises; 3 tre reconnues d'utilit publique, auquel cas elles ont la personnalit civile. (V. p. 155.) Il n'y a que cinq congrgations d'hommes qui soient reconnues : les Lazaristes (D. 7 prairial an XII, 0. 3 fvr. 1816); les Missionstrangres (D. 2 germinal an XIII, 0. 2 mars 1815); la congrgation du Saint-Esprit ( l. (D. 2 germinal an XIII, 0. 3 fvr. 1816); les Prtres de Saint-Sulpice 3 avr. 1816); les Frres des coles chrtiennes (D. 17 mars 1808, art. 109, 0. 29 fvr. 1816), etc. La capacit de ces congrgations est dtermine par la loi du2 janvier 1817 : elles ne peuvent accepter des libralits, acqurir ou obtenir des immeubles ou des rentes qu'avec l'autorisation du gouvernement. Les congrgations de femmes reconnues sont plus nombreuses. Les formalits de la reconnaissance sont rgles par la loi du 24 mai 1825 et le dcret du 31 janvier 1852. En principe, un dcret suffit, uneloi serait ncessaire s'il s'agissait d'une association forme depuis 1825 et prsentant des statuts compltement nouveaux. Les statuts, pour tre approuvs, doivent se conformer la rgle qui prohibe les vux perptuels, et certaines conditions pour le noviciat, etc., etc. 1. Bibliographie. Calmette, Trait de l'administrationtemporelle desassociadudroit ecclsiastique. tionsreligieuses, 1878; mile Ollivier,Manuel
TUTELLE ADMINISTRATIVE
443
La capacit des congrgations est rgle par la loi de 1825 et le dcret de 1852. Les actes qui ne peuvent tre faits qu'aprs autorisation donne : les acceptations de dons ou legs, les alinations, les par dcret sont changes, les acquisitions, les achats et transferts d'inscriptions de rentes sur l'tat, les cessions ou transports, les constitutions de rentes sur particuliers, les transactions. 323. Caisses d'pargne prives. Les caisses d'pargne prives se distinguent de la caisse d'pargne postale, qui, elle, est un tablissement public ; leur qualit de simple tablissement d'utilit publique, qui avait t conteste, a t reconnue par un arrt de Cass. du 5 mars 1856 (S. 56. 1. 517) suivi de plusieurs autres. Il y a environ 550 caisses d'pargne en activit, ces caisses sont dpositaires de plus de cinq millions de livrets reprsentant prs de trois milliards de francs; le mouvement annuel des fonds est de 700 millions. Un pareil mouvement de fonds appartenant la petite pargne, justifie des mesures de prcaution et une tutelle srieuse de l'tat. Le texte fondamental est la loi du 5 juin 1835, puis sont intervenues des dispositions ultrieures, 1. 22 juin 1845, 1. 24 mai 1851, 1. 9 avril, 1881, 1. 26 dc. 1890, etc. Une loi nouvelle est en prparation. Les caisses d'pargne sont autorises par dcret en Conseil d'tat, la demande doit tre forme par les conseils municipaux et ceux-ci doivent dlibrer sur les statuts. La tutelle porte sur la gestion de la fortune personnelle de la caisse, mais elle a surtout pour objectif le contrle des oprations de dpt : 1 Le montant minimum des versements que peuvent faire les dposants est rgl par la loi. (L. 9 avr. 1881, art. 21.) 2 Les caisses d'pargne sont tenues de verser leurs fonds la Caisse des dpts et consignations, qui les administre sous la garantie du Trsor, et qui sert un intrt fix par la loi (1. 31 mars 1837). Cet intrt, primitivement de 4 0/0, a t abaiss 3,75 0/0 par la loi du 26 dcembre 1890. Les caisses d'pargne servent le mme intrt aux dposants, dduction faite d'un prlvement pour frais d'administration. 3 Elles sont soumises un rgime de comptabilit uniforme, la surveillance des receveurs des finances et aux inspections des inspecteurs des finances. (D. 15 avr. 1852). 324. Socits de secours mutuels 1. Les socits de secours mutuels se divisent en : 1 socits reconnues comme tablissements d'utilit publique; 2 socits approuves par les prfets. Il existe plus de 8,000 socits dont 6,000 reconnues, elles comptent plus de 1,300,000membres, paient annuellement prs de 5,000,000 journes de maladie et pourvoient aux frais funraires pour 18,000 dcs. 1. Bibliographie.Desmarets, Lgislation et organisation des socits de secoursmutuels,1881.
444
LES DROITS DE POLICE
Les textes fondamentaux sont la loi du 15 juillet 1850 et le dcret du 26 mars 1852. Une loi nouvelle est en prparation. Les socits reconnuesont la jouissance de tous les droits privs; elles en ont aussi l'exercice, sauf pour l'acceptation des dons ou legs pour laquelle il faut l'autorisation. Les socits approuves ont aussi une sorte de personnalit, mais incomplte ; elles n'ont pas la jouissance de tous les droits privs, notamment elles ne peuvent pas possder d'immeubles. (L. 16 pluvise, an XII; L. 8 mars, 24 juin 325. Monts-de-pit. 1851.) Les monts-de-pit ont pour spcialit le prt sur gage. Pendant longtemps ils n'opraient que sur les objets mobiliers; une loi du 25juillet 1891 a autoris le prt sur titres. Il y a en France quarante-deux mont-de-pit, y compris celui de Paris. Le mont-de-pit de Paris fait pour cinq millions de prts, ceux des dpartements de deux trois millions. Le texte fondemental est la loi du 24 juin 1851; sauf pour l'tablissement de Paris, qui a une organisation spciale. (Arr. 15 mars 1848.) Il sont administrs en gnral par un directeur nomm administrativement et qui peut tre rvoqu ; ce directeur est assist d'un conseil prsid par le maire et dont les membres sont nomms administrativement. Quant aux rgles de la comptabilit, ils sont assimils aux tablissements de bienfaisance. Les monts-de-pit sont donc soumis une forte tutelle, tellement qu'on voit difficilement comment ils se distinguent des tablisde sements publics. Cependant, il convient de n'y point voir des membres l'tat, mais de simples tablissements privs parce que leurs capitaux leur sont fournis non point par des deniers publics mais par des particuliers. (V. p. 230.) En consquence, l o il n'y'a pas de texte formel, il faut prsumer la capacit, notamment ils peuvent ester en justice sans autorisation. SECTIONIII. LES DROITSDE POLICE OU DE PUISSANCESUR LES CITOYENS Les droits de police ou de puissance sur 326. Observation. : il y a d'abord la les citoyens comprennent les droits les plus varis se police administrative qui a pour but le maintien de l'ordre, elle subdivise en police d'tat et en police communale, elle se subdivise aussi en police gnrale et en polices spciales; on peut y rattacher ensuite : 1 le droit qu'a l'tat d'authentiquer ou d'estampiller toutes choses : droit de battre monnaie, droit de poinonner les objets d'or et d'argent, droit de confrer l'authenticit aux actes, droit de certifier
POLICEADMINISTRATIVE
445
le savoir par la collation des grades, droit de certifier le mrite par les distinctions honorifiques, etc., etc.1; 2 le droit qui, en vue de la dfense du pays, permet l'tat d'exiger de tous les citoyens le service militaire personnel. Ces droits de police entranent en principe uniquement des obligations la charge des personnes, mais ils peuvent aussi entraner des obligations la charge des proprits qui prennent le caractre de servitudes d'utilit publique. C'est ainsi qu'il existe la charge des riverains des petits cours d'eau, une servitude de curage; c'est ainsi que, sur les terrains voisins des sources d'eau minrale, il est certains travaux qui ne peuvent pas tre accomplis, etc., etc. ; nous savons d'ailleurs dj que c'est le propre de tous les droits de puissance publique, d'imposer aux particuliers des obligations ou des servitudes d'utilit publique. Ier. LA POLICEADMINISTRATIVE ARTICLE 1er. La police gnrale de l'tat et de la commune. 327. La police administrative a pour but le maintien de l'ordre par des actes d'autorit qui imposent l'obissance aux citoyens. La police administrative poursuit d'une faon directe et en soi le maintient de l'ordre public ; elle se distingue par l de la police du domaine public que nous rencontrerons plus loin ; cette police a directement pour objet la conservation du domaine public, si elle concourt au maintien de l'ordre, c'est d'une faon indirecte La police administrative se subdivise en une police gnrale et un certain nombre de polices spciales. La police gnrale a pour objet le maintien de l'ordre pris dans son ensemble, dans ses trois lments de tranquillit publique, deset cela contre toutes les curit publique, de salubrit publique, causes de perturbation possibles, prvues ou imprvues. Les polices spciales ont pour objet le maintien de l'ordre contre certaines causes de perturbation prvues ou plus facile prvoir; 1. Le manque d'espace ne nous permettra pas de revenir sur ces droits rgaliens de l'tat, bien intressants pourtant, parce qu'ils marquent une mainmise de l'tat sur tout ce qui touche la confiancepublique et en un certain sens au crdit. (V. p. 25 et la note.) 2. Dans la police de la voirie, la police de la circulation, en tant qu'elle a pour but, Don pas la conservation de la voie, mais la scurit des voyageurs, est de la police administrative.
446
LES DROITS DE POLICE
ainsi en est-il dans la matire de la police des tablissements dangereux, insalubres et incommodes, dans celle de la police des cours d'eau, de la police de la chasse, etc. La police administrative n'appartient qu' deux personnes administratives, l'tat et la commune; ni les dpartements, ni les colonies ne sauraient tre considres comme ayant une police distincte de celle de l'tat. 328. Des droits la police administraque suppose tive. La police administrative, surtout sous sa forme la plus haute, qui est la police gnrale, suppose deux droits ou pouvoirs principaux: 1 Le pouvoir rglementaire, ou droit de faire des injonctions obligatoires, soit d'une faon collective, dans des rglements qui s'adressent tout un ensemble de citoyens, soit d'une faon individuelle dans des ordres qui s'adressent un citoyen dtermin. Ce pouvoir rglementaire, qui rappelle l'imperium romain, est exerc par des autorits administratives qui mriteraient cause de lui de porter le nom de magistrats publics. Nous avons vu, en tudiant l'organisation administrative, que pour l'tat ce droit est exerc surtout par le chef de l'tat et le prfet ; que pour la commune il est exerc par le maire. Le pouvoir rglementaire a t en outre tudi propos des rglements considrs comme sources du droit. (V. p. 60 et s.) 2 Le droit de disposer de la force publique. Il est des cas, o il est ncessaire d'imposer l'obissance aux injonctions par des mesures de force. L'tat et les communes ont tous les deux la disposition de la force publique ; mais il faut distinguer la force publique proprement dite et la force arme. a) Force publique proprement dite. Doivent tre considrs comme agents de la force publique proprement dite, les agents qui sont pourvus d'armes, mais qui en temps ordinaire ne font pas partie de l'arme; tels sont, pour l'tat, les agents des douanes et des forts; tels sont, pour les communes, les agents de police, et les gardes champtres. Il est noter d'ailleurs que les agents de police, soit par l'intermdiaire du maire, soit par l'intermdiaire du commissaire de police, sont rattachs la police d'tat. Les agents de la force publique sont la disposition en ce sens qu'il leur est donn des ordres. b) Force arme. Il n'en est pas de mme de la force arme, c'est-dire des troupes de l'arme de terre et de mer et de la gendarmerie; il ne leur est pas donn d'ordres, il leur est adress des rquisitions. Cela tient ce qu'il y a une sorte de sparation entre le pouvoir militaire et le pouvoir civil. Au reste, il ne faudrait pas croire qu'il n'y ait entre l'ordre et la rquisition qu'une diffrence de mots, l'ordre n'est soumis
POLICEADMINISTRATIVE
447
aucune condition de forme, tandis que la rquisition est astreinte des rgles svres. Voici ces rgles (L. 10 juillet 1791, art. 9, 13, 16, 17, 19; L. 3 aot 1791, art. 20, 22, 23; Rglement sur le service des places du 13 oct. 1863, art. 211, etc.; Cire. min. 4 dc. 1880) : 1 Nulle troupe ne doit agir que d'aprs les rquisitions crites des autorits qui en ont le droit. Cependant, en cas de flagrant dlit et d'urgence, on n'attendra pas pour agir d'avoir reu une rquisition crite ou d'avoir pu se concerter avec les officiers civils. Le commandant des troupes ou du dtachement prendra immdiatement les mesures qu'iljugera ncessaires pour disperser les rassemblements ou pour repousser l'agression dont il est l'objet. (Art. 25, 1. du 3 aot 1791; art. 87, 92, 211 et 212, rglement pour le service des places.) 2 Les autorits qui ont le droit de rquisition sont: le chef de l'tat, le prfet, le sous-prfet, le procureur de la Rpublique, les commissaires de police, les officiers et sous-officiers de gendarmerie, les maires ou adjoints; 3 La rquisition doit tre faite dans la forme indique l'art. 22, loi du 3 aot 1791 : Nous commandant, etc. requrons en vertu de la loi, M. de prter le secours des troupes de ligne ou de lagendarmerie nationale, ncessaire pour. Pour la garantie dudit commandant, nous apposons notre signature . 4 La rquisition doit indiquer clairement le but atteindre, mais elle doit laisser au chef militaire le choix des moyens pour y arriver, aprs s'tre concert autant que possible avec les officiers civils auteurs de la rquisition. 5 Le fonctionnaire civil responsable du maintien de l'ordre reste seul juge du moment o la force arme doit intervenir, mais l'autorit militaire ne doit pas tre prise l'improviste par une rquisition, elle doit autant que possible recevoir des avis pralables. (Circulaire 21 juin 1869.) 6 Nulle troupe, mme requise, ne doit sortir de sa division sans un ordre donn par le gnral commandant le corps d'arme, ou de son dpartement sans un ordre du gnral de division qui le pouvoir est dlgu. Nulle troupe, mme requise, ne doit quitter la ville o elle se trouve sans un ordre du gnral commandant la subdivision. Le pouvoir de rpondre aux rquisitions lgales pour agir en dehors de la ville o il sont tablis, peut tre dlgu aux commandants de garnison et de dtachement, par les gnraux commandant les divisions et subdivisions (circ. 15 mars 1848), mais sous la condition de rendre compte immdiatement. Dans les cas de flagrant dlit et d'urgence, une troupe peut toujours sortir de sa circonscription. Quant aux conditions dans lesquelles la troupe peut faire usage de ses armes. V. loi sur les attroupements du 7 juin 1848, et rglement sur le service des places.
448
LES DROITS DE POLICE
Observation. Les pouvoirs de police ne peuvent tre employs que dans l'intrt gnral, dtourns de leur but ils deviendraient trop dangereux. Spcialement c'est une cause d'annulation des arrts rglementaires de police, lorsqu'en fait il est tabli que l'arrt a t pris non pas dans l'intrt du public mais en vue de favoriser telle ou telle entreprise prive, par exemple un rglement refusant le droit de stationnement sur la voie publique toute voiture autre que celles d'un entrepreneur dtermin (Cons. d'tat, 2 aot 1870, Bouchardon). Il y a ouverture recours pour excs de pouvoir pour dtournement de pouvoir. N 1. Police gnrale de l'tat. 329. La police gnrale de l'tat a pour objet le maintien de la tranquillit, de la scurit, de la salubrit dans toute l'tendue du territoire, sauf l'gard de certains objets qui sont spcialement rservs la police communale. (V. infr, n 332 et s.) Il est impossible de donner mme une ide des mesures de police ou de la surveillance que ce triple objet ncessite. Nous pouvons seulement indiquer certains services qui ont t centraliss dans les ministres. Il existe au de la sret 330. A. Service gnrale. ministre de l'intrieur une direction de la sret gnrale. Son objectif gnral est le maintien de la tranquillit publique et de la sret individuelle. Voici le sommaire de ses attributions : Personnel des commissairesde police et des inspecteurs spciaux. Inspection gnrale de la gendarmerie et modifications l'assiette des brigades. Police des chemins de fer et des ports. Policedes trangers, demandes d'admission domicileou de naturalisation. Commerce des armes et poudres. Police administrative et librairie. Surveillance de l'migration, agences autorises, engagements d'migrants, renseignements, statistique. Police de la chasse et application de la loi Grammont. Police de la mendicit, qutes domicile, collectes, souscriptions. Vagabondage, professions ambulantes, bandes nomades, passeports. Jeux et marchands forains, jeux de hasard sur la voie publique, jeux de salon. Courses de chevaux, de taureaux. Police des cafs, cabarets et lieux publics. Police de la librairie, dpt lgal des ouvrages, protection de la proprit littraire. Police gnrale et associations (police politique). Affaires concernant la sret gnrale de l'tat et la dcouverte de manuvres qui.tendraient y porter atteinte. Surveillance des trangers dangereux. Subsistances. Grves, coalitions
POLICEADMINISTRATIVE DE L'TAT
449
Runions publiques, confrences, cours publics. Police des cultes, congrs, associations, plerinages, processions, ouvertures de chapelles. Bataillons scolaires. Associations. Socits de tir, de gymnastique, socits diverses, demandes en autorisation, en reconnaissance d'utilit publique. Ainsi la direction de la Sret gnrale n'est qu'une section du ministre de l'intrieur, et son chef, le directeur de la Sret gnrale, n'est qu'un collaborateur du ministre, agissant toujours par dlgation. L'action de la Sret gnrale s'exerce soit sur les agents spciaux de la police de l'tat, soit sur les agents de la police communale. Les a) Action sur les agents spciaux de la police d'tat. commissaires spciaux sont ceux qui sont entirement pays sur les fonds de l'tat : 1 les commissaires spciaux de police tablis sur les chemins de fer; 2 les commissaires spciaux des postes-frontires ; 3 les commissaires de police institus dans certaines localits pour lesquelles le traitement n'est pas obligatoire (parce qu'elles comptent moins de 5,000 habitants), mais o ils sont ncessits par des circonstances particulires. Les commissaires spciaux, chargs de la police des chemins de fer, ont pour mission les recherches dans les garnis et dbits connus sur les voies ferres, ou sur les territoires dpendant des lignes. Il ne faut pas confondre ces commissaires spciaux dela police des chemins de fer, relevant du ministre de l'intrieur, avec les commissaires de surveillance administrative, dpendant du ministre des travaux publics et qui ont pour mission de relever les infractions relatives l'exploitation de la ligne, commises par les compagnies. Les commissaires spciaux tablis aux frontires sont principalement chargs de la surveillance des voyageurs et de l'arrestation des criminels en fuite. b) Surveillance sur les polices communales. Le maire nomme, dans sa commune, les agents de police, le commissaire de police except. Le prfet n'exerce qu'un droit de veto, sous forme d'agrment la nomination. (L. 5 avr. 1884, art. 103.) La police locale est donc remise une infinit de directions. Ce serait une source perptuelle d'embarras, si le droit de surveillance de l'autorit suprieure, reconnu par l'art. 91 de la loi du 5 avril n'tait exerc par la Sret gnrale. 1883, Cette surveillance s'exerce sous trois formes : 1 par le rglement du nombre d'hommes affects au fonctionnement de la police, dans les villes de plus de 40,000 habitants; 2 par les prsentations des H. 29
450
LES DROITSDE POLICE
commissaires de police qui sont, les uns nomms par les prfets, les autres par le prsident de la Rpublique ; 3 par le rglement uniforme des questions de police communes toutes les villes. La police sanitaire, 331. B. Police sanitaire. qui vise le maintien de la salubrit publique, se subdivise en deux : la police contre les pidmies et la police contre les pizooties. a) Police sanitaire contre les pidmies et direction de l'hygine publique. La direction de l'hygine publique, qui dpendait autrefois du ministre du commerce, a t transfre au ministre de l'intrieur par dcret du 5 janvier 1889, et runie la direction de l'assistance publique, pour former une sorte de direction de la sant publique. La raison qui justifie le rattachement au ministre de l'intrieur, c'est que la principale proccupation actuellement, doit tre de combattre les pidmies l'intrieur par l'assainissement des villes, bien plus que de combattre l'invasion venant du dehors par l'organisation des quarantaines. Il est difficile d'arrter la contagion, il est plus facile de crer des milieux qui lui soient rfractaires. Il existe auprs du ministre de l'intrieur un comit consultatif de l'hygine publique, dans chaque dpartement, un conseil dpartemental d'hygine et de salubrit; il en existe un semblable dans chaque arrondissement et il peut tre cr dans certains cantons des commissions d'hygine publique. Ces conseils sont consults sur divers objets. (D. 18 dcembre 1848; arrt 15 fvrier 1849; D. 10 mars 1872, etc.) Mesures l'intrieur. Les mesures de salubrit et d'assainissement qui peuvent tre prises l'intrieur titre de prcaution, et alors qu'il n'y a pas actuellement d'pidmie, sont du ressort de la police municipale. Nous verrons d'ailleurs que le pouvoir municipal est trs limit en cette matire, parce qu'il ne peut pas porter atteinte la libert de la proprit. Cependant la loi du 16 septembre 1807, art. 35-37, donne au gouvernement le moyen d'intervenir: Tous les travaux de salubrit qui iptressent les villes et les communes seront ordonns par le gouvernement, et les dpenses supportes par les communes intresses, Cette disposition a t applique rcemment aux communes de Tourcoing et Roubaix, pour l'puration deseaux d'une rivire. Rien n'empche qu'elle ne soit applique d'autres oprations d'assainissement. En cas d'pidmie dclare ou de crainte imminente d'pidmie, la loi du 3 mars 1822 donne au chef de l'tat le droit de prendre par dcret des mesures extraordinaires, mme l'intrieur (art. 1er, n 3); mais les pnalits excessives de cette loi la rendent peu pratique. Mesures la frontire. Les mesures la frontire sont relatives aux
DE L'TAT POLICEADMINISTRATIVE
451
quarantaines que l'on fait observer dans les ports aux navires provenant de certains pays contamins, et a des mesures analogues qui pourraient tre prises sur les frontires de terre en cas d'pidmie. Le texte fondamental est la loi du 3 mars 1822, complte par un rglement du 22 fvrier 1876 : Le prsident de la Rpublique dtermine par dcret : 1 les pays dont les provenances doivent tre habituellement ou temporairement soumises au rgime sanitaire; 2 les mesures observer sur les ctes, dans les ports et rades, dans les lazarels et autres lieux rservs; 3 les mesures extraordinaires que l'invasion ou la crainte d'une maladie pestilentielle rendrait ncessaires sur les frontires de terre ou dans l'intrieur, etc. b) Police sanitaire contre les pizooties. (L. 21 juillet 1881.). Ce service dpend du ministre de l'agriculture. Il est institu un comit consultatif des pizooties auprs de ce ministre et dans chaque dpartement, il est organis un service des pizooties confi des mdecins-vtrinaires (dpense obligatoire pour le budget dpartemental. Mesures l'intrieur. La loi commence par numrer les maladies rputes contagieuses et les animaux dont les maladies sont surveilles en ajoutant que des dcrets rendus sur le rapport du ministre de l'agriculture aprs avis du comit consultatif des pizooties pourront venir ajouter ces nomenclatures. (Art. 1 et 2.) Puis elle impose l'obligation de dclarer la maladie contagieuse, au propritaire, toute personne ayant la garde de l'animal, du vtrinaire charg de le soigner. La dclaration est faite au maire qui prvient le prfet. (Art. 3 et 4.) Aprs la constatation de la maladie, le prfet statue sur les mesures mettre excution dans le cas particulier ; il prend, s'il est ncessaire, un arrt portant dclaration d'infection; cette dclaration peut entraner, dans les localits qu'elle dtermine, l'application des mesures suivantes: 1 l'isolement, la squestration, la visite, le recensement, et la marque des animaux et troupeaux dans les localits infectes; 2 l'interdiction de ces localits; 3 l'interdiction momentane ou la rglementation des foires et marchs, du transport et de la circulation du btail; 4 la dsinfection des curies, tables, etc. (Art. 5.) Il peut y avoir aussi des abatages d'animaux malades ou contamins prescrits tantt par le maire, tantt par le prfet ou par le ministre. (Art. 7 et 8.) Dans le cas de peste bovine ou de pripneumonie contagieuse il est allou aux propritaires des indemnits dont la gravit est rgle par l'art. 17; elles sont fixes par le ministre sauf recours au Conseil d'tat. (Art. 21.) On remarquera que la police des pizooties est plus srieusement organise que celle des pidmies, grce l'obligation de dclarer la maladie
452
LES DROITS DE POLICE
qui permet l'administration de prendre immdiatement des mesures prophylactiques. Mesures la frontire. Le gouvernement peut prohiber l'entre en France, ou ordonner la mise en quarantaine des animaux susceptibles de communiquer une maladie contagieuse ou de tous les objets pouvant prsenter le mme danger. Il peut, la frontire, prescrire l'abatage, sans indemnit, des animaux malades ou ayant t exposs la conles mesures que la crainte de l'invasion tagion, et, enfin, prendre toutes d'une maladie rendrait ncessaires. (Art. 26.) Les obligations imposes par cette loi sont sanctionnes par des peines correctionnelles, amendes leves et mme emprisonnement. (Art. 30-36.) N 2. Police communale, police municipale. 332. Il y a deux polices communales: 1 La police municipale qui a pour but le maintien de l'ordre dans les agglomrations bties; 2 La police rurale qui a pour but le maintien de l'ordre dans les champs. La police municipale a pour objet le maintien de l'ordre dans les agglomrations bties de la commune, et l'ordre se caractrise, ici comme partout, par ses trois lments : tranquillit, scurit, salubrit. Il semble qu'une numration des divers objets que cela comporte soit impossible et d'ailleurs inutile. Il en existe cependant une dans la loi. Elle se trouve dans les art. 97 et 98 de la loi du 5 avril 1884 et dans quelques autres dispositions. Cette numration est presque tout entire emprunte la loi des 16-24 aot 1790, tit. XI, art. 3. Voici en quel sens il faut en tenir compte. Cela ne veut pas dire que le maire ne puisse pas prendre des mesures de police pour des objets qui ne seraient pas prvus dans ces textes, mais cela veut dire que pour ces objets-l la police est exclusivement rserve au maire, qu'elle est exclusivement municipale. Ces textes ont pour but de faire le partage entre la police de la commune et celle de l'Etat, qui toutes deux ont le mme objectif, le maintien de l'ordre. Donc, pour les objets numrs en l'art. 97, le prfet ne peut pas prendre de mesure de police, si ce n'est dans les conditions prvues par l'art. 99 de la loi 1 il peut prendre des mesures de piano s'il les prendmunicipale: pour toutes les communes du dpartement ou pour plusieurs communes; 2 pour une seule commune il peut prendre des mesures, mais aprs une mise en demeure du maire reste sans rsultat. Police des rues et des places publiques. 333. A. Scurit. Le premier devoir de la police municipale est de procurer la sret
et
POLICEMUNICIPALE
453
la commodit du passage dans les rues, quais, places et voies publiques existant dans les agglomrations bties. (Art. 97-1,98, l. 5 av. 1884.) Peu importe que ces voies appartiennent la grande ou la petite voirie. Ce principe, discut sous l'ancienne lgislation, a t affirm par la loi de 1884 dans l'art. 98. (Cass. 8 janv. 1885.) Cet tat de choses est ncessaire pour assurer l'uniformit des rgles de police dans la mme ville, viter les conflits, etc., mais bien entendu la construction, la rparation, l'entretien des rues restent dans les attributions des autorits comptentes.. La police -des rues et places publiques est relative deux objets : diffrents : 1 l'tat matriel de la voie ; 2 la circulation sur la voie a) tat matriel de la voie. Cela comporte : 1 Le nettoiement, qui comprend le balayage, l'enlvement des boues et immondices, celui des neiges, celui des matriaux et fardeaux dposs et l'arrosement. Le balayage est une charge des propritaires riverains, une vritable servitude dont le maire se borne fixer le mode d'exercice ; il en est de mme, du reste, de la plupart de ces prescriptions de voirie. Lorsque la ville se charge du balayage, l'obligation du propritaire est convertie en une taxe qui se recouvre conformment l'art. 154 de la loi municipale sur destats dresss par le maire. 2 l'clairage. L'clairage comprend celui des rues et celui des dpts de matriaux et excavations. Le second est prvu parl'art. 471, n 4, in fine C.P. Le premier par le mme article 471, n 3. Il semble rsulter de ces articles que de simples citoyens peuvent tre tenus l'clairage des rues, ce qui n'est pas admis par un certain nombre d'auteurs. D'ordinaire, la ville se charge elle-mme de l'clairage des voies publiques ; elle passe un march avec un entrepreneur soit pour l'huile, soit pour le gaz, soit pour l'lectricit. C'est un march de travaux publics, et l'entrepreneur qui ne remplit pas ses obligations est tenu contractuellement des dommages-intrts prvus au cahier des charges. Mais ce qui est particulirement original, c'est que le maire peut ne pas se contenter de passer un march, il peut au pralable prendre un arrt de police rglant les conditions de l'clairage, et cet arrt de police s'impose l'entrepreneur ; il ajoute des obligations pnales aux obligations contractuelles. Ce cumul de la faute dlictuelle et de la faute contractuelle est parfaitement admis par la jurisprudence, et non seulement ici, mais dans d'autres cas (entreprise de balayage par exemple). En somme, il n'a rien d'extraordinaire, il existe bien aussi en matire civile. Il n'y a qu'une diffrence, c'est qu'en matire civile la loi pnale qui ctoie la lo civileest le Code pnal, c'est--dire
454
LES DROITS DE POLICE
une loi bien antrieure et que les contractants n'ont point faite, tandis qu'ici l'arrt du maire est instantan, et est l'oeuvre de l'un des contractants. L'clairage au gaz ou la lumire lectrique soulve des questions de canalisation dans le sol des voies publiques, qui ne sont pas du ressort de la police, qui sont domaniales ; aussi voit-on rentrer en scne le dpartement ou l'tat, pour les voies leur appartenant qui traversent la ville. 3 Enlvement des encombrements. Permissions de voirie. Les maires doivent veiller ce qu'aucun encombrement ne se produise sur la voie publique, l'art. 471, n 4, fait une contravention du fait d'avoir encombr la voie publique. Mais en dehors de cette contravention vise par la loi pnale et qui n'existe qu' de certaines conditions, les maires ont le pouvoir de prendre des arrts pour rgler certains encombrements ncessaires, notamment le dpt de matriaux en cas de construction. On peut permettre certains encombrements non ncessaires, tels que tables et chaises de cafs, talages des magasins. Ces permissions, dites de voirie, sont donnes moyennant redevance. Art. 98 in fine. Les permissions de voirie prsentant un intrt gnral, telles que celles qui sont ncessaires pour la pose des conduites d'eau, de gaz, peuvent, au refus du maire, tre accordes par le prfet. 4 Dmoliton et rparation des difices menaant ruine. Ce droit considrable n'appartient pas au maire seul ; il l'a le long de toutes les voies urbaines en cas d'urgence, en cas ordinaire, il le partage avec le prfet, et ne l'a que pour la petite voirie. (L. 19juill. 1791 reproduisant des ordonnances royales de 1729 et 1730, art. 471, n 5, C.P.) Le maire n'a pas besoin de requrir le concours de la justice pour prescrire la dmolition ou la rparation. Il procde par voie d'autorit, cela ne fait plus doute depuis un avis du Conseil d'tat du 27 avril 1818. Mais il doit suivre toute une procdure, qui est rgle encore aujourd'hui par les ordonnances de 1729 1730. Le point important de cette procdure, est qu'il doit tre fait une expertise contradictoire, qui doit porter tout la fois, et sur l'tat de la maison et sur l'importance des travaux de rparation qui pourraient tre ncessaires. Il faut en effet, protger l'intrt du propritaire. Dans le cas o l'difice menaant ruine est en reculement, le maire requiert la dmolition et non la rparation 1. 1. Dans le cas de pril imminent le maire peut prescrire la dmolition immdiate. (Trib. Rouen. 16juillet 1891.)
POLICEMUNICIPALE
455
Les auteurs spciaux posent quelques rgles qui permettent de savoir quand un difice menace ruine. 5 Dfense d'exposer ou jeter des substances de nature nuire. Cette matire peut tre rgle par arrt du maire. (Art. 97, 1er, nos 5 et 6.) Mais c'est presque inutile, attendu que l'art. 471, nos 6 et 12, punit dj les mmes faits de la mme amende et que les deux amendes ne peuvent tre cumules. Un arrt n'interviendra donc utilement que pour prescrire certains dtails ou pour rappeler l'observation de l'art. 471, ou pour permettre l'exposition de certains objets avec certaines prcautions. b) Circulation sur la voie publique. Le maire puise dans les pouvoirs de police que lui confrent l'art. 97, 1, et l'art. 98, 1 et 2, le droit de prendre des mesures pour rgler la circulation afin d'en assurer la scurit. Il peut notamment : 1 Interdire le stationnement sur les voies publiques et leurs dpendances, des voitures, des troupeaux, des btes de somme ou de trait. Le droit de rglementation du maire cet gard est trs tendu : il peut interdire le stationnement de voitures destines au transport des personnes en commun (omnibus), de toutes entreprise qui n'ont pas obtenu la permission. Cependant, le droit du maire ne va pas jusqu' lui permettre d'tablir indirectement un monopole au profit d'un seul entrepreneur. Son arrt serait entach d'excs de pouvoir. (Cons. d't. 2 aot 1870, Bouchardon.) Quant aux voitures de place ou de remise, le maire ne peut pas en interdire le stationnement, il peut seulement dterminer des stations; 2 Interdire la circulation dans certaines voies certaines heures; 3 Interdire certaines allures trop rapides; 4 Prescrire certaines prcautions destines avertir les passants: sonnettes, cornets des tramways, des vlocipdes, etc. La loi du 14 dcembre 1789 334. A. Tranquillit et sret. avait parl de la tranquillit publique sans essayer d'en analyser les lments. La loi de 1790, et aprs elle celle de 1884, ont essay une numration qui est incomplte et que la jurisprudence a t oblige d'allonger. On s'accorde faire rentrer dans la tranquillit publique: 1 Les rixes et attroupements ; 2 Les manifestations sur la voie publique, qui comprennent les processions. Faisons remarquer ici que les maires peuvent interdire les processions pour deux raisons: Parce qu'on se trouve dans une ville o il ya un temple consacr
456
DE POLICE LES DROITS
un autre culte que le culte catholique. (Art. 45, loi organique du 18 germinal an X.) Mais d'aprs l'interprtation qui fut donne par Portalis dans une instruction ministrielle et qui fut confirme en 1879, il faut combiner l'art. 45 avec l'art. 16 de la loi organique du culte protestant, et interprter le mot temple en ce sens qu'il dsigne une glise consistoriale, ce qui suppose six mille mes de la mme communion. Parce que la sortie de la procession pourrait porter atteinte la tranquillit publique, simple apprciation de fait qui est laisse la discrtion du maire. Les maires peuvent de la mme faon autoriser la sortie des processions. Lorsque le maire a autoris la sortie d'une procession, tout individu qui trouble l'ordre de celle-ci commet une contravention. 3 Le bruit et tapage; 4 La tranquillit de la circulation; 5 La rglementation des professions qui s'exercent dans les lieux publics, etc., etc. (V. art. 97.) Observation. Il est bon de faire remarquer, propos de la tranquillit publique, que la sonnerie des cloches est une matire distraite de la police municipale, car elle fait l'objet de rglements concerts entre le prfet et l'vque. Les cloches des glises sont spcialement affectes aux crmonies du culte. Nanmoins, elles peuvent tre employes dans les cas de pril commun qui exigent un prompt secours, et dans les circons tances o cet emploi est prescrit par des dispositions de lois ou r glements, ou autoris par les usages locaux. Les sonneries reli gieuses, comme les sonneries civiles, feront l'objet d'un rglement concert entre l'vque et le prfet et les consistoires, et arrt, en cas de dsaccord, parle ministre des cultes . (Art. 100.) Une clef du clocher sera dpose entre les mains des titulaires ecclsiastiques, une autre entre les mains du maire, qui ne pourra en faire usage que dans des circonstances prvues par les lois ou rglements. Si l'entre du clocher n'est pas indpendante de celle de l'glise, une clef de la porte de l'glise sera dpose entre les mains du maire. (Art. 101.) Les pouvoirs du maire en matire sani335. C. Salubrit. taire sont indiqus dans l'art. 97, n 6: prvenir ou faire cesser les maladies pidmiques ou contagieuses, les pizooties, etc., Malheureusement ces pouvoirs sont fortement limits par le respect du droit de proprit. Presque toutes les mesures d'assainissement touchent au droit de proprit ; elles sont relatives soit l'amene dans une mai-
POLICEMUNICIPALE
457
son d'eau potable, soit l'vacuationdes eaux contamines et des excrments. Or, la jurisprudence est ici que le maire: S'il peut, dans un intrt de salubrit publique, enjoindre aux propritaires de faire excuter des travaux d'assainissement, ne peut pas prescrire un moyen exclusivementobligatoire de faire disparatre les causes d'insalubrit. (Cassat. 27 juin 1879.) Ainsi est illgal l'arrt du maire ordonnant le curage d'une fosse qui n'est pas pleine (Cassat. 26 nov. 1887) ; est illgal l'arrt du maire ordonnant l'amene de l'eau dans la maison ; est illgal l'arrt du maire ordonnant de combler des puisards qui sont une cause d'infection. (Affaire des puisards de Caen. Cassat. 25 juill. 1885.) Si le maire se borne agir par simple arrt de police, il est donc peu prs dsarm. Mais pour les villes qui en ont la ferme volont, la lgislation fournit quand mme des moyens d'arriver l'assainissement. Ces moyens sontles suivants:1 le fonctionnement d'une commission des logements insalubres ; 2 des expropriations suivies d'oprations de voirie ; 3 des travaux d'assainissement excuts selon la procdure dela loidu 16 septembre 1807. 1 Commission des logements insalubres. (L 13 avril 1850 ; L. 25mai 1864.) Une commission municipale lue par le conseil municipal peut tre institue; elle a pour mission de visiter les logements insalubres lorsque des plaintes sont portes devant elle. Le rsultat de sa visite peut tre soit qu'il y a lieu des travaux d'assainissement, soit que le logement n'est pas susceptible d'assainissement. Dans le premier cas, le conseil municipal peut prescrire des travaux d'assainissement, dans le second cas interdire la location d'une faon temporaire. Un recours est ouvert aux intresss contre ces dcisions devant le conseil de prfecture dans le dlai d'un mois, dater de la notification de l'arrt municipal. Ce recours est suspensif. Conformment la rgle gnrale, l'arrt du conseil de prfecture peut tre dfr au Conseil d'tat. Si la dcision du conseil municipal n'a pas t annule ou rforme, le maire ordonne par mesure de police l'excution des travaux ncessaires. En pratique cette organisation fonctionne mal, soit parce que les commissions n'ont pas l'autorit ncessaire, soit parce que la jurisprudence du Conseil d'tat s'est montre trop difficile pour reconnatre les causes d'insalubrit. 2 Oprations de voirie accomplies par expropriation avec revente des terrains. Il peut se faire que l'insalubrit ne dpende pas seulement des maisons, mais de causes extrieures, comme le peu de largeur des rues, l'absence d'gout, etc.; il peut se faire aussi que
458
LES DROITS DE POLICE
toutes les maisons d'un mme quartier soient bties dans des conditions telles qu'une opration d'ensemble s'impose. Dansces conditions, la ville peut changer de tactique. Au lieu d'imposer des travaux aux propritaires par voie de police, elle peut se charger elle-mme de l'assainissement titre de travail public. La loi du 13 avril 1850, art. 13, lui en donne le moyen. Cet article autorise, en effet, l'expropriation de toutun quartier, l'effetde percerdes rues nouvelles, etc. et, non seulement il autorise l'expropriation, mais encore il donne la commune une facult qui seule rend l'opration possible, c'est la facult de revendre les terrains btir l'alignement des voies nouvelles. Cette facult est une exception intressante la rgle gnrale, qui ne permet pas d'exproprier pour revendre. Nous la retrouverons propos de l'expropriation (n 449). 3 Travaux d'assainissement selon la procdure de la loi du 16 septembre 1807. Les art. 35 37 de la loi du 16 septembre 1807 donnent au gouvernement le droit de contraindre les villes faire, leurs frais, des travaux d'assainissement. Il ya une dclaration d'utilit publique de travaux par dcret en Conseil dtat; si des expropriations sont ncessaires, elles sont faites d'aprs la procdure de la loi du 3 mai 1841 ; la dpense est obligatoire pour la commune; par consquent, il peut y tre pourvu au moyen d'une imposition d'office. Mais, ce qu'il y a de particulier, c'est que les proprits prives, qui profiteront directement des travaux accomplis, devront y contribuer au moyen d'une taxe spciale. C'est l'application d'un principe gnral pos par la loi du 16 septembre 1807, d'aprs lequel les proprits prives qui reoivent une plus value, l'occasion d'un travail public, doivent contribuer raison de cette plus-value. Les art. 35 37 ont t plusieurs fois appliqus; tout rcemment, ils ont t appliqus aux communes de Tourcoing et de Roubaix en vue de l'puration des eaux d'une rivire (D. 22 fvr. 1887). Sans nul doute, ils pourraient tre appliqus pour forcer les villes crer une distribution d'eau et construire des gouts, car il est prouv que ce sont l les deux grandes conditions de la salubrit; la loi de 1807 est absolument gnrale. Bien mieux, les villes auraient avantage se faire appliquer la loi, afin de bnficier de la taxe de plus-value leve sur les proprits prives. La ville de Marseille vient effectivement de faire une opration de ce genre1. N'oublions pas de signaler enfin, sur cette importante question de la salubrit, que depuis la loi du 22 dcembre 1888, les habitants des 1. Sur toutes ces questions, v. une intressante tude de M. Monod,Revue gnrale d'administration, 1889.
POLICERURALE
459
quartiers insalubres ont le droit de former une association syndicale autorise en vue des travaux d'assainissement (art. 1er, 6). Renvoi la matire des associations syndicales (n 498 et s.). La loi du 5 avril 336. Taxe du pain et de la viande. 1884 ne parle pas de cette taxe ; elle reste nanmoins dans les pouvoirs du maire en vertu de la loi des 19-22 juillet 1791. Rglementation trs troite relative au pesage, au dbit, la fixation du prix du pain et de la viande. La taxe implique d'ailleurs deux consquences: l'obligation, pour l'acheteur, de payer le prix fix, et l'obligation pour le marchand, de livrer la denre au consommateur qui lui offre ce mme prix. (Cassation 26 avr. 1861.) Police rurale. 337. La police rurale a pour objet la tranquillit, la salubrit et la sret des campagnes. Il faut dire tout de suite que le domaine de l'activit spontane du maire dans la police rurale est fort peu tendu, parce que la plupart des prescriptions relatives la tranquilit des campagnes, leur salubrit, leur sret, ont t prises par la loi elle-mme. La loi est ce point de vue pnale, elle a cr des dlits et des contraventions, et elle ne laisse gure place qu' une police judiciaire destine la recherche et la constatation de ces infractions. Le texte fondamental en matire de police rurale jusqu' l'entire confection d'un nouveau Code rural, est la loi du 6 octobre 1791 dont un certain nombre de dispositions ont pass dans le Code pnal. Seulement cette loi a dj t modifie dans quelques-unes de ses parties. par diverses lois rcentes qui sont des fragments du nouveau Code rural (l. 4 avril 1889; l. 9juill. 1889; 1. 18 juill. 1889). Deplus, la chasse et la pche sont matires de police d'tat, l'pizootie idem. (L. 21 juill. 1881.) Cependant il reste un certain domaine pour la police administrative du maire. C'est ainsi qu'aux termes de l'art. 9 du titre II de la loi de 1791, il doit faire une visite annuelle des fours et chemines de tout btiment loign de moins de cent toises des autres habitations, et qu'il peut ordonner des rparations et la dmolition des tres mal construits. Aux termes de l'art. 13, mme loi, le maire doit faire procder l'enfouissement des animaux morts si le propritaire nglige de le faire, sauf celui-ci payer les frais et une amende. Aux termes de la loi du 26 ventse an IV, art. 7, il fait procder d'office l'chenillage.
460
LES DROITS DE POLICE
Enfin, le maire a le droit de publier annuellement des bans de rcoltes, fauchaison, moisson, vendanges, dans les communes o ces bans sont d'un usage immmorial. Toutefois (loi sur le Code rural, 9 juillet 1889, art. 13), le ban de vendanges ne pourra tre tabli ou maintenu que dans les communes o le conseil municipal l'aura dcid avec approbation du conseil gnral ; une fois tabli ou maintenu, il est rgl chaque anne par arrt du maire. Il ne semble pas que dans le nouveau Code rural la tendence soit dvelopper les pouvoirs du maire ; la loi du 4 avril 1889 donne au prfet, aprs avis du conseil gnral, le pouvoir de rgler l'poque de l'ouverture et de la clture des colombiers, soit pour tout le dpartement la fois, soit, ce qui est plus grave, sparment pour chaque commune; elle lui donne dans les mmes conditions le pouvoir de rgler la distance observer entre les ruches d'abeilles et les proprits voisines ou la voie publique. (Art. 6 et 8.) Article II. Polices spciales de l'Etat. N 1. Police des cours d'eau non navigables ni flottables1. 338 A. Condition lgale des cours d'eau non navi Les cours d'eau navigables et flottables gables ni flottables. par trains ou radeaux sont des dpendances du domaine public de l'tat, ainsi que nous le verrons plus tard. Il n'en est pas de mme des cours d'eau non navigables ni flottables (art 538 C. civ., argument a contrario). Cela n'est vrai toutefois que dans la mtropole, car en Algrie et dans les colonies, il est admis au contraire que ces cours d'eau font partie du domaine public. Ds lors, la question se pose de savoirquelle est la condition juridique de ces cours d'eau, que l'on peut appeler les petits cours d'eau. L'opinion la plus gnralement suivie est qu'ils sont de ces choses dont parle l'art. 714 C. c. : Il est des choses qui n'appartiennent personne et dont l'usage est commun tous. Des lois de police rglent la manire d'en jouir. Et il n'y a pas lieu de distinguer entre le lit et l'eau courante. Il ne faut pas dire cependant que les petits cours d'eau sont des res nullius, car ils ne sont pas susceptibles d'occupation, ce sontdes res communes. (Cass,10 juin 1846: C. d'Et., 18 avr. 1866.) En consquence, un propritaire dont le fonds est travers par une rivire ne peut pas tablir de chanes chaque extrmit de son 1. Bibliographie. Picard Trait deseaux.
POLICEDES PETITS COURSD'EAU
461
tonds, pour empcher le passage des bateaux, moins d'y tre autoris par mesure de justice (Cass. 8 mars 1865, cour de Paris, 2 mars 1889). En consquence encore lorsqu'un cours d'eau non navigable le devient la suite de travaux de canalisation et tombe ainsi dans le domaine public, les riverains ne subissent aucune expropriation et n'ont droit aucune indemnit pour le lit de la rivire. Ils sont indemniss seulement pour la perte du droit de pche et d'irrigation 1. des cours d'eau non navigables ni 339. B. Police L'tat a la police des petits cours d'eaux et ce droit flottables. de police est exerc par les prfets. Il a un double objet: 1 assurer le libre coulement des eaux et prvenir ainsi ou faire cesser les causes d'insalubrit ou d'inondation 2 assurer la meilleure utilisation possible des eaux. I. Pour le premier objet, les prfets font des rglements de police : Les administrations de dpartement en vertu des textes suivants doivent rechercher et indiquer les moyens de procurer le libre cours des eaux ; d'empcher que les prairies ne soient submerges par la trop grande lvation des cluses des moulins et par les autres ouvrages d'art tablis sur les rivires. (L. 12-20 aot 1790, ch. VI.) Les propritaires ou fermiers des moulins et usines construits ou construire seront garants de tous dommages que les eaux pour raient causeraux chemins ou proprits voisines par la trop grande lvation du dversoir ou autrement. Ils seront forcs de tenir les eaux une hauteur qui ne nuise personne, et qui sera fixe par le directoire du dpartement d'aprs l'avis du directoire de district. (L. 6 octobre 1791, tit. II, art. 16.) Ces rglements qui s'appliquent un ou plusieurs cours d'eau sont relatifs l'obligation du curage qui incombe aux riverains, l'lvation des cluses, etc. Des difficults se sont frquemment leves sur l'tendue des pouvoirs des prfets en cette matire. Les prfets ont aussi, en vue de la conservation des cours d'eau, prendre des mesures individuelles. Ils donnent des permissions de 1. D'autres systmes ont t soutenus et notamment les deux suivants : 1 les riverains auraient la proprit du lit et de l'eau courante. Ce systme se heurte l'article 644du Code civil qui semble bien ne reconnatre aux riverains qu'un simple droit d'irrigation; et aussi l'article 563C. c., qui, en cas de dplacement du cours d'eau, accorde le lit abandonn titre d'indemnit aux propritaires des fonds nouvellement envahis ; c'est bien sans doute parce que le lit abandonn n'est personne; 2il faudrait distinguer entre le lit et l'eau courante : le lit appartiendrait aux riverains, l'eau courante serait une res communes.Ce systme se heurte encore l'art. 563 C. c.
462
LES DROITSDE POLICE
prise d'eau soit pour irrigation, soit pour force motrice. Ces permissions ne sont pas des concessions puisque les riverains ont droit l'eau, aussi n'y a-t-il point de redevance; mais c'est un moyen pour l'administration de s'assurer que la prise d'eau ne sera pas tablie dans des conditions qui puissent nuire au libre coulement des eaux. II. Pour le second objet, c'est--dire en vue d'assurer une meilleure utilisation de l'eau, les prfets sont amens faire entre les divers riverains ayant droit l'eau, des rglements qui prennent le nom de rglements d'eau: diriger enfin, autant qu'il sera possible, toutes les eaux de leur territoire vers un but d'utilit gnrale d'aprs les principes de l'irrigation (1. 12-20 aot 1790, ch. VI). En cette matire l'administration risque d'entrer en conflit avec l'autorit judiciaire, car les riverains peuvent avoir sur les eaux des droits d'usage placs sous la sauvegarde de cette dernire. Le conflit est vit lorsque le rglement d'eau est fait dans l'intrt collectif de tous les riverains, sauf ceux d'entre eux qui ont des droits particuliers rsultant de conventions ou de faits de possession les faire valoir contre les autres devant les tribunaux ordinaires. Les rglements d'eau ne sont d'ailleurs obligatoires qu'aprs approbation par dcret en forme de rglement d'administration publique. (Arr. C. d't. 2 nivse an XIV.) Droit de C. Droits et charges des riverains. Les propritaires riverains auront, chacun de son ct, le pche. droit de pche jusqu'au milieu du cours de l'eau, sans prjudice des droits contraires tablis par possession ou titres. (L. 15 avr. 1829, art. 2.) Ils doivent bien entendu respecter les arrts annuels du prfet sur la police de la pche. V. aussi 1. 31 mai 1865 pour des interdictions de pche qui peuvent tre prononces pendant toute l'anne sauf indemnit. Droit l'usage de l'eau. V. l'art. 644 C. civ., lois du 29 avril 1845 et du 11 juillet 1847. Les riverains des petits cours d'eau supou servitudes. Charges portent les charges ou servitudes suivantes : 1 L'obligation d'obtenir une permission administrative avant d'entreprendre tout ouvrage portant une modification au cours d'eau quelle qu'elle soit; 2 L'obligation de procder au curage des cours d'eau chacun en droit soi aux poques prescrites par le prfet. (L. 14 floral an XI.) Le maire ne peut pas prendre lui-mme d'arrt de curage, il ne extrme. en cas ou du d'urgence prfet, dlgation que par agir peut (Cass. 2 aot 1889.) 340.
DANGEREUX POLICE DES TABLISSEMENTS
463
Si les riverains mis en demeure de procder eux-mmes au curage ne l'ont pas fait, le prfet peut l'ordonner d'office. La dpense est recouvre sur les riverains comme en matire de contributions directes. Le curage entraine deux servitudes accessoires, la servitude de passage et celle de rejet des produits du curage. N 2. Police des tablissements dangereux, insalubres ou incommodes. 341. Les ateliers ou tablissements dangereux, insalubres ou incommodes, sont soustraits au principe de la libert du travail en ce sens qu'ils ne peuvent tre exploits qu'en vertu d'une permission administrative. Il ne faudrait pas voir cependant dans cette permission une concession de la part de l'tat, c'est une simple mesure de police prise l'occasion de l'exercice d'un droit. Le texte fondamental est le dcret-loi du 15 octobre 1810, qui a divis ces tablissements en trois classes, d'aprs les inconvnients qu'ils prsentent. et des tablissements non 342, I. Du classement Aux termes du dcret de 1810 (art. 10), il appartient classs. au gouvernement seul de dresser le tableau des tablissements dangereux, insalubres ou incommodes, et d'en faire la division en trois classes; ce classement ne peut tre effectu que par voie de dcret portant rglement d'administration publique. (D. rglem. 2 aot 1886, 26.) Des tableaux de classement avaient t annexs au dcret de 1810; d'autres leur avaient t substitus par une ordonnance du 14 janvier 1815; de nombreuses dispositions spciales taient intervenues; tous ces textes ont t remplacs par le dcret portant rglement d'administration publique du 31 dcembre 1866. Ce dcret, aujourd'hui fondamental, a tenu compte des progrs de l'industrie qui ont fait disparatre la nocuit de certains tablissements, qui ont provoqu la nocuit de certains autres. Il y a dj eu d'ailleurs des tableaux supplmentaires, D.D. 31 janv. 1872, 7 mai 1878, 22 avril 1879, sans compter des dcrets ajoutant des industries isoles. Les tablissements non encore classs peuvent tre crs sans autorisation. Mais le prfet peut en prononcer la suspension provisoire et par l'intermdiaire du ministre provoquer un dcret de classement. L'industriel qui cre un atelier rellement insalubre, quoique non encore class, court donc un assez gros risque. Il peut y chapper en demandant au prfet un classement provisoire. (0. 1815, art. 5, D. 25 mars 1852.)
464
DEPOLICE LESDROITS
des tablissements 343. II. De l'autorisation classs. 1 tablissements de la premire classe. Les tablisments de la premire classe doivent tre loigns des habitations particulires. Il n'y a pas de distance rglementaire, c'est une question de fait trancher pour chaque hypothse. (D. 1810, art. 1, 2.) L'autorisation est accorde par le prfet (D. 25 mars 1852, art. 2) aprs une enqute de commodo et incommodo ouverte dans toutes les communes 5 kilomtres de rayon. La demande est affiche dans le mme rayon pendant un mois. (D. 1810, art. 3; 0. 14 janv. 1815 art. 4.) S'il y a des oppositions, le conseil de prfecture donnera son avis. (D. 1810, art. 4.) classe. Cesont, d'aprsle texte : 2 tablissements de la deuxime les manufactures et ateliers dont l'loignement des habitations n'est pas rigoureusement ncessaire, mais dont il importe nan moins de ne permettre la formation, qu'aprs avoir acquis la certitude que les oprations qu'on y pratique sont excutes de manire ne pas incommoder les propritaires du voisinage ni leur causer des dommages. (D. 1810, art. 1er, 3.) La permission qu'exige la mise en activit des tablissements com pris dans la seconde classe est accorde par les prfets, sur l'avis des sous-prfets. (Art. 2, 2.) Les formalits sont les mmes que pour la premire classe, sauf qu'il n'y a pas apposition d'affiche et que l'avis du conseil de prfecture n'est pas exig. 3 Etablissements de la troisime classe. Dans la troisime classe sont placs les tablissements qui peuvent rester sans incon vnient auprs des habitations, mais doivent rester soumis la surveillance de la police. (D. 1810, art. 1er, 4.) L'autorit comptente pour dlivrer l'autorisation est le sous-prfet, aprs avis pralable du maire; l'enqute de commodo n'est pas indispensable. en matire d'autorisation d'ta344.III. Des recours Il faut considrer que la dcision de l'autorit, soit blissement. qu'elle autorise l'tablissement, soit qu'elle refuse l'autorisation, est de nature dans les deux cas porter atteinte des droits formellement acquis aux citoyens; soit la libert du travail de l'industriel, soit au droit de proprit des voisins. Il existe donc, soit au profit de l'un, soit au profit des autres, de vritables recours contentieux. Pour les tablissements de la troisime classe, le recours de l'industriel et ceux des voisins qui ont form opposition sont tous les deux ports devant le conseil de prfecture. (D. 1810, art. 8, 2.) Pour ceux de la premire et de la deuxime classe, afin de concilier
DANGEREUX POLICEDES TABLISSEMENTS
465
deux textes un peu contradictoires (D. 1810, art. 7, 1 et 2), il a t admis que le recours de l'industriel en cas de refus d'autorisation serait port au Conseil d'tat; tandis que celui des voisins, en cas d'autorisation accorde, serait port devant le conseil de prfecture. 345. IV. Dela police des tablissements autoriss. Les tablissements insalubres sont soumis un double pouvoir de police, celui du prfet et celui du maire. Le prfet puise dans ses pouvoirs gnraux de police le droit de faire fermer un tablissement ouvert sans autorisation, qu'il soit class ou non class, sauf s'il n'est pas class en provoquer le classement (v. n 342). Il a aussi notre avis, et bien que cela ait t discut, le droit de prescrire la fermeture d'un tablissement rgulirement autoris, si des inconvnients graves se rvlent. Il est de principe que les autorisations administratives sont rvocables. Mais si l'arrt du prfet n'tait pas motiv par des raisons de salubrit publique, il pourrait tre annul pour dtournement de pouvoir. (V. art. 11 et 12, D. 1810; D. 1852, art. 2.) Le maire a les pouvoirs que lui confre la police municipale. Il peut sans aucun doute prescrire la fermeture d'un tablissement non autoris; mais peut-il quelque chose vis--vis des tablissements autoriss, notamment peut-il leur imposer des conditions d'exploitation nouvelles? La jurisprudence admet qu'il ne le peut qu' la condition que ses prescriptions s'appliquent toutes les proprits de la commune et soient par consquent trs gnrales. 346. V. Dommages-intrts demands par les voisins. Un tablissement incommode rgulirement autoris peut, malgr toutes les prcautions prises, causer des dommages aux propritaires voisins, Il y a l une situation qui mrite d'appeler l'attention, car d'un ct, ces tablissements incommodes sont ncessaires au point de vue de l'intrt gnral, il faut bien qu'ils puissent tre crs quelque part; d'un autre ct, il n'est pas juste que les voisins supportent sans indemnit les ennuis que cela leur cause. Sans doute, ils peuvent demander l'autorit administrative la fermeture de l'tablissement, mais ce n'est pas l une solution satisfaisante au point de vue gnral ; il faut trouver un moyen de concilier l'existence de l'tablissement et l'intrt des voisins. Cette conciliation ne peut se trouver que dans le droit reconnu aux voisins, de demander une indemnit pour dommage permanent en se fondant sur l'art. 1382. Il y a toutefois une difficult: l'art. 1382 suppose qu'une faute a t commise; or, ici on peut soutenir que l'inH. 30
465
LES DROITSDE POLICE
dustriel n'est point en faute. L'industriel, peut-on dire, ou bien le propritaire qui lui a lou l'usine, ne font qu'user de leur droit de proprit, nemiuem ldit qui suo jure utitur. On peut rpondre cela que le droit de proprit n'est pas absolu, qu'il est soumis aux restrictions qui rsultent des lois et rglements (art. 545, C. civ.); et que justement, crer un atelier insalubre, c'est faire de sa chose un usage prohib par les rglements. Il est vrai qu'une autorisation administrative est intervenue, mais elle doit tre interprte en ce sens qu'elle rserve entirement les droits des tiers. Sans cela, l'autorisation crerait la charge des voisins une vritable servitude d'utilit publique, qui devrait alors tre accompagne d'indemnit au moment de sa cration. L'industriel n'est donc point dans son droit, par consquent l'art. 1382 s'applique. Ce systme est admis par la majorit des auteurs et par la jurisprudence. N 3. Police des sources minrales. (L. 14juill. 1856.)
347. Les sources minrales, qu'elles appartiennent des particuliers ou des personnes administratives (tat, dpartements, communes, etc.) sont soumises un rgime spcial: 1 Elles ne peuvent tre exploites qu'en vertu d'une autorisation administrative prcde d'une analyse chimique de l'eau; 2 Si la source est exploite d'une manire qui ne satisfait pas aux besoins de la sant publique, un dcret dlibr en Conseil d'tat peut en autoriser l'expropriation au profit de l'tat, dans les formes rgles par la loi du 3 mai 1841 ; 3 A condition d'avoir t au pralable dclare d'intrt public par un dcret en Conseil d'tat rendu aprs enqute, une source mme appartenant un particulier, bnficie de mesures de protection spciales qui entranent pour les proprits voisines de vritables ser1 certains travaux sont interdits aux vitudes d'utilit publique: voisins; 2 une sorte d'occupation temporaire est permise au contraire au propritaire de la source sur les terrains voisins: a) Un primtre de protection peut tre assign par un dcret rendu dans les formes tablies en l'article prcdent, une source dclare d'intrt public. Ce primtre peut tre modifi si de nouvelles circonstances en font reconnatre la ncessit. (Art. 2.) Aucun sondage, aucun travail souterrain ne peuvent tre pratiqus dans le primtre de protection d'une source minrale dclare d'intrt public, sans autorisation pralable. A l'gard des fouilles, tranches pour extraction de matriaux ou pour un autre objet, fondation de maisons, caves, on autres travaux ciel ouvert, le dcret qui fixe le primtre de
MINRALES POLICEDES SOURCES
467
protection peut exceptionnellement imposer aux propritaires l'obligation de faire, au moins un mois l'avance, une dclaration au prfet, qui en dlivre rcpiss. (Art. 3.) Les travaux noncs dans l'article prcdent et entrepris, soit en vertu d'une autorisation rgulire, soit aprs une dclaration pralable, peuvent, sur la demande du propritaire de la source, tre interdits par le prfet, si leur rsultat constat est d'altrer ou de diminuer la source. Le propritaire du terrain est pralablement entendu. L'arrt du prfet est excutoire par provision, sauf recours au conseil de prfecture et au Conseil d'tat par la voie contentieuse. (Art. 4). Lorsque, raison de sondages ou de travaux souterrains entrepris en dehors du primtre, et jugs de nature altrer ou diminuer une source minrale dclare d'intrt public, l'extension du primtre parait ncessaire, le prfet peut, sur la demande du propritaire de la source, ordonner provisoirement la suspension des travaux. Les travaux peuvent tre repris, si, dans le dlai de six mois, il n'a pas t statu sur l'extension du primtre. (Art. 5.) Les dispositions de l'article prcdent s'appliquent une source minrale dclare d'intrt public, laquelle aucun primtre n'a t assign. (Art. 6.) b) Dans l'intrieur du primtre de protection, le propritaire d'une source dclare d'intrt public a le droit de faire, dans le terrain d'autrui, l'exception des maisons d'habitation et des cours attenantes, tous les travaux de captage et d'amnagement ncessaires pour la conservation, la conduite et la distribution de cette source, lorsque ces travaux ont t autoriss par un arrt du ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics. Le propritaire du terrain est entendu dans l'instruction. (Art. 7.) L'occupation du terrain ne peut avoir lieu qu'en vertu d'un arrt du prfet qui en fixe la dure. Lorsque l'occupation prive le propritaire de la jouissance du revenu au del du temps d'une anne ou lorsqu'aprs les travaux le terrain n'est plus propre l'usage pour lequel il tait employ, le propritaire du terrain peut exiger du propritaire de la source l'acquisition du terrain. Dans ce cas l'indemnit est rgle suivant les formes de la loi du 3 mai 1841. Dans aucun cas l'expropriation ne peut tre provoque par le propritaire de la source. (Art. 9.)
N 4. Restauration 348.
des terrains en montagne. - On montagne. en grande partie du retiennent l'eau qui chapper que peu
I. Restauration des terrains en sait aujourd'hui que les inondations proviennent des montagnes; les terrains boiss dboisement provient de la fonte des neiges et ne la laissent
468
LES DROITSDE POLICE
peu, les terrains dboiss la laissent courir en torrent. De l songer au reboisement des montagnes pour prvenir les inondations, il n'y avait qu'un pas. Deux lois furent d'abord votes sans produire de rsullat utile, celle du 28 juillet 1860 sur le reboisement des montagnes, et celle du 8 juin 1864 sur le gazonnement. Une loi nouvelle du 4 avril 1882 a mieux russi. Elle prvoit: 1 Des travaux de restauration accomplis par l'tat sur des terrains acquis par lui dans les ravins, soit l'amiable, soit par expropriation, dans les articles 1 6. Les aprs de nombreuses formalits numres habitants du primtre peuvent aussi se constituer en association syndicale pour accomplir les mmes travaux; 2 Des mesures de protection qui consistent dans l'interdiction ou la rglementation des pturages dans certains primtres. L'interdiction du pturage qui porte le nom de mise en dfens est prononce par dcret rendu en Conseil d'tat aprs enqute ; elle entrane une indemnit pour les propritaires fixe par le conseil de prfecture en cas de dsaccord (Art. 7 11.) La fixation des dunes au bord de l'Ocan donne lieu une intervention analogue de l'administration. (V. D. 14 dc. 1810 ) N 5. Police des monuments historiques et des objets d'art (1. 20 mars 1887;D. 2 janvier 1889) 1. 349. Dans l'intrt de la formation du got public, le soin de conserver les belles choses appartient l'tat. Pour cela il lui faut des droits. Ces droits ont t pendant longtemps mal dfinis par des textes insuffisants (0. 19 fvrier 1829). La loi nouvelle, infiniment plus large, se proccupe: 1 Des monuments ayant un intrt historique, c'est--dire des immeubles; l'tat a le droit soit de les acqurir par expropriation, soit, tout en les laissant au propritaire, de les classer, le classement entranant une vritable servitude qui empche toute modification au btiment faite sans autorisation. (Art. 1 8.) 2 Des objets d'art, objets mobiliers appartenant des personnes administratives (la loi ne s'occupe pas des objets d'art appartenant des particuliers la diffrence de certaines lois trangres qui interdisent la vente hors du pays). Ces objets sont classs, et la consquence est qu'il ne peuvent tre ni alins ni rpars sans autorisation. 1. Bibliographie.Ducrocq, la loi du 20 mars 1887, Paris, Picard, 1889 ; Sap. 635. leille, loi du20 mars 1887, Revuebourguignonne,1891,
MILITAIRE LE SERVICE
469
Les objets classs appartenant l'tat deviennent mme inalinables et imprescriptibles; les objets des autres personnes administratives, s'ils sont alins irrgulirement, sont considrs comme vols ou adirs et peuvent tre revendiqus pendant trois ans conformment aux articles 2279 et 2280 C. c. (Art. 8-14.) 3 Des fouilles, en vue desquelles le droit d'expropriation est accord. (Art. 14-15.) 4 De la proprit des objets dcouverts en Algrie et dans les pays de protectorat, soit dans les terrains de l'Etat, soit dans les terrains concds par 1 tat, soit dans le domaine militaire. Cette proprit est attribue l'tat. (Art. 16-17.) N 6. Police des mines, minires, carrires. 350. Cette matire est renvoye au chapitre o nous traiterons des travaux publics, cause de la grande parent qu'il y a entre la concession des mines et la concession de travaux publics. (V. infr, n 503 et s.) MILITAIRE 2. LE SERVICE L'tat, qui a le devoir d'organiser la dfense militaire du pays, a le droit d'exiger de chaque individu le service militaire personnel. Le problme rsoudre dans 351. Aperu historique. l'organisation militaire d'un pays est d'obtenir le maximum de puissance offensive ou dfensive en cas de guerre, et, en temps de paix, d'avoir un effectif de troupes assez rduit pour n'puiser le pays ni en hommes ni en argent. Pendant longtemps on a cru pouvoir rsoudre ce problme, par l'organisation d'une arme peu nombreuse, compose de soldais qui faisaient du service militaire le mtier de toute leur vie et dont l'effectif tait le mme en temps de paix et en temps de guerre. Cette arme tait au fond compose de volontaires, soit d'engags comme sous l'ancien rgime, soit de rengags, comme l'arme de 1832. Que si les ncessits de la guerre l'exigeaient, on procdait des leves en masse d'hommes qui n'avaient nullement t exercs l'avance. Actuellement, cette conception est compltement abandonne. L'arme ne parait devoir tre suffisante en cas de guerre, que si elle est trs nombreuse et compose de troupes trs exerces. Elle doit reprsenter la leve en masse de la nation, mais une leve en masse savamment prpare de loin. Cela entraine les consquences sui-
470
LES DROITSDE POLICE
vantes : d'abord|l'arme ne sera pas compose de volontaires, le service militaire sera obligatoire pour tous. Ensuite il faudra distinguer profondment l'arme sur pied de paix et l'arme sur pied de guerre, Car on ne peut pas admettre que la nation entire reste arme pendant la paix. Il y aura donc deux tats diffrents, et l'on passera de l'un l'autre par une opration appele mobilisation. Le service militaire imposera chaque citoyen deux espces d'obligations : 1 l'obligation de servir dans l'arme en temps de paix pendant un certain temps, c'est ce qu'on appelle le service actif; 2 l'obligation de se tenir pendant un nouveau laps de temps la disposition de l'tat encas de mobilisation, et de faire des exercices prparatoires cette mobilisation. Cela constitue le service dans les rserves. Cette arme moderne n'a pas t cre d'une seule pice, il s'en : la loi du 19 fructidor faut, bien des lois se sont succdes en ce sicle an VI, celle du 10 mars 1818, celle du 21 mars 1832, celle du 1er fvrier 1868, celle du 27 juillet 1872 et enfin celle du 15 juillet 1889. Le principe du service militaire obligatoire pour tous a t proclam par l'Assemble constituante dans un dcret du 4 mars 1791, et de nouveau dans la loi du 19 fructidor an VI qui organisa la conscription, mais presque tout de suite on admit le tirage au sort qui dispensait certains conscrits de l'appel, et la facult de se faire remplacer pour ceux qui taient rellement appels. Cette organisation a dur jusqu'en 1872, avec des modifications de dtail, soit dans la faon d'appliquer le tirage au sort, soit dans la faon d'admettre le remplacement. La loi du 27juillet 1872 supprima le remplacement. Le service devint rellement obligatoire pour tous. Seulement, pour la partie aise de la nation, on organisa le volontariat d'un an qui tait une exonration partielle prix d'argent. Cette exception mme parut la longue fcheuse, et la loi du 15juillet 1889 l'a supprime. En principe, d'aprs cette loi, tout le monde fait le mme temps de service actif, c'est--dire trois ans ; le tirage au sort n'a presque plus de signification, il sert former une seconde partie du contingent qui peut tre renvoye dans ses foyers au bout d'un an, mais qui n'y a pas droit. Seuls, les jeunes gens qui poursuivent des tudes leves peuvent, en obtenant certains diplmes, rduire leur temps de service un an. Le principe de l'organisation des rserves apparat galement dans les lois rvolutionnaires, et des leves en masse furent faites par la Convention. Mais pour trouver un rudiment d'organisation relle, il faut venir la loi du 1er fvrier 1868 qui cra une rserve et une ; malheureusement, ces rserves ne furent pas garde nationale mobile exerces. La loi du 27 juillet 1872 refondit cette organisation. Elle
MILITAIRE LE SERVICE
471
cra une rserve de l'arme active, une arme territoriale et une rserve de l'arme territoriale. Le service dans ces rserves se prolon; la loi de 1889 l'a report jusqu' quageait jusqu' quarante ans rante-cinq ans. de la loi du 15 juillet 352. Dispositions gnrales 18891. 1 Le service militaire est gal pour tous. Tout Franais doit le service militaire. Pour la question de savoir qui est Franais, la loi, dans son art. 3, renvoie la loi du 26 juin 1889 sur la nationalit. Mais dans l'art. 11, elle pose des rgles qu'il faut combiner avec celles de la loi du 26 juin. Par une disposition en partie nouvelle, l'obligation du service est tendue aux Franais ou naturaliss Franais de l'Algrie et des colonies, sous les distinctions faites par l'art. 81. Les Franais de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de la Runion, sont soumis toutes les obligations de la loi. Ceux de l'Algrie et des autres colonies ne font, en principe, qu'une anne de service actif. Les dispenses de service qui existaient dans la lgislation antrieure, soit pour les membres du clerg, soit pour les membres de sont supprimes; seulement, par application de l'enseignement, l'art. 23, ces deux catgories de citoyens pourront ne faire qu'une anne de service actif. (V. infr, n 354.) 2 Le service militaire est un droit et un honneur en mme temps qu'une obligation. Les indignes doivent en tre privs. D'un autre ct, il ne faut pas que leur indignit les exonre d'une charge. La conclusion est qu'il ne feront pas leur service militaire dans l'arme ordinaire, mais qu'il le feront dans des corps spciaux et d'une faon plus dure (V. les art. 4, 5 et 6). Les uns sont mis la disposition du ministre de la marine, les autres sont incorpors dans les bataillons d'infanterie lgre d'Afrique. 3 Afin d'augmenter la solidit de l'arme, et surtout celle du cadre des sous-officiers, des rcompenses sont offertes ceux qui prolongent le temps de service requis par des engagements ou rengagements. Certains emplois salaris de l'tat ou des dpartements sont rservs ces rengags l'expiration du service. (V. art. 84). 4 Il n'y a qu'une arme, par consquent tout corps organis, quand il est sous les armes, fait partie de l'arme et est soumis aux lois militaires (art. 8). V. douaniers (D. 22 sept. 1882); chasseurs forestiers, idem; sapeurs-pompiers (D. 29 dc. 1875) ; socits de tir et de gymnastique (Dcis. 16 juin 1886) ; bataillons scolaires. (D. 6 juill. 1882.) 1. Bibliographie. Ch. Rabany, Loi sur le recrutement, 2 vol.
472
LE DROITDE POLICE Article Ier. Obligationsrsultant du service militaire.
N 1. Le service militaire. 353. Les obligations sont de deux sortes: 1 Le service militaire accompli rellement; 2 La taxe militaire la charge de ceux qui n'accomplissent pas compltement le service. Le service militaire a une dure de vingt-cinq annes. Il tient l'homme de vingt ans rvolus quarante-cinq ans rvolus. (Art. 2.) Tout Franais reconnu propre au service militaire fait partie successivement : de l'arme active pendant trois ans ; de la rserve de l'arme active pendant dix ans ; de l'arme territoriale pendant six ans ; de la rserve de l'arme territoriale pendant six ans. (Art. 37 modifi par 1. 19 juillet 1892.) L'art. 38 explique que le service est rgl par classes et prcise les classes qui font partie de l'arme active, de la rserve, etc. L'art. 40 fixe le point de dpart de la dure du service ; c'est le 1er novembre de l'anne de l'inscription sur les tableaux du recensement ; autrefois c'tait le 1er juillet. On appelle exempts ceux que leurs infirmits rendent impropres tout service. (V. art. 20.) Les Franais rsidant l'tranger sont exempts de service en temps de paix dans les conditions de l'art. 50. 354. II. Du service dans l'arme active. Le service se fait, soit dans l'arme de terre soit dans l'arme de mer. En effet, l'inscription maritime ne suffit pas fournir les quipages de la flotte, la rpartition se fait suivant les rgles de l'art. 43. Il y a aussi pourvoir les troupes coloniales. (Art. 44.) La rpartition entre les diffrentes armes est faite par le bureau de recrutement, administrativement, d'aprs les qualits physiques ou professionnelles de l'homme. La loi n'a pas prescrit le recrutement rgional, libert est laisse au ministre. Les hommes en service actif ne peuvent pas se marier sans autorisation. Exceptions au service actif de trois ans. Tous les hommes reconnus propres au service militaire ne font pas trois ans de service, et il y a des catgories nombreuses tablir: a) Les hommes classs dans les services auxiliaires raison de dfauts physiques. (Art. 20.)
LE SERVICE MILITAIRE
473
- Ceux-ci ne font pas du tout de service actif en temps de paix, ils sont astreints seulement des revues d'appel, ils ne sont appels qu'en temps de guerre. Ils peuvent se marier sans autorisation. b) Les hommes envoys en disponibilit aprs une anne de service comme faisant partie de la seconde portion du contingent, par suite de ncessits budgtaires. (Art. 39-46.) Ils peuvent se marier sans autorisation. c) Les hommes envoys en cong sur leur demande, aprs une anne de service, titre de dispenss, il y en a trois catgories: a) Les soutiens de famille lgaux : ART 21. En temps de paix, aprs un an de prsence sous les drapeaux, sont envoys en cong dans leurs foyers, sur leur demande, jusqu' la date de leur passage dans la rserve: 1 L'an d'orphelins de pre et de mre, ou l'an d'orphelins de mre dont le pre est lgalement dclar absent ou interdit; 2 Le fils unique ou l'an des fils, ou, dfaut de fils ou de gendre, le petit-fils unique ou l'an des petits-fils d'une femme actuellement veuve ou d'une femme dont le mari a t lgalement dclar absent ou interdit, ou d'un pre aveugle ou entr dans sa soixante-dixime anne; 3 Le fils unique ou l'an des fils d'une famille de sept enfants au moins; Dans les cas prvus par les trois paragraphes prcdents, le frre pun jouira de la dispense, si le frre an est aveugle ou atteint de toute autre infirmit incurable qui le rend impotent; 4 Le plus g des deux frres inscrits la mme anne sur les listes de recrutement cantonal; 5 Celui dont un frre sera prsent sous les drapeaux au moment de l'appel de la classe, soit comme officier, soit comme appel ou engag volontaire pour trois ans au moins, soit comme rengag, brevet ou commissionn aprs avoir accompli cette dure de service, soit enfin comme inscrit maritime lev d'office, lev sur sa demande, maintenu ou radmis au service quelle que,soit la classe de recrutement laquelle il appartient; Ces dispositions sont applicables aux frores des officiers mariniers des quipages de la flotte appartenant l'inscription maritime et servant en qualit d'officiers mariniers du cadre de la maistrance1; 6 Celui dont le frre sera mort en activit de service, ou aura t rform ou admis la retraite pour blessures reues dans un service com1. Pour le cas des 4 et 5 une modificationa t apporte par une loi du 6 nov. 1890dont le sens est celui-ci : Lorsque deux frres se suivent moins de trois annes d'intervalle, l'un des deux ne doit faire qu'une anne.
474
LES DROITS DE POLICE
mand, ou pour infirmits contractes dans les armes de terre ou de mer. La dispense accorde conformment aux 5 et 6 ci-dessus ne sera applique qu' un seul frre pour un mme cas, mais elle se rptera dans la mme famille autant de fois que les mmes droits s'y reproduiront. Les demandes accompagnes de documents authentiques justifiant de la situation des intresss seront adresses avant le tirage au sort au maire de la commune o les jeunes gens sont domicilis. Il en sera donn rcpiss. L'appel ou l'engag qui, postrieurement, soit la dcision du conseil de revision, soit son incorporation, entre dans l'une des catgories prvues ci-dessus, est, sur sa demande, et ds qu'il compte un an de prsence au corps, envoy en cong dans ses foyers jusqu' la date de son passage dans la rserve. Le jeune homme omis qui ne s'est pas prsent ou faitre prsenter par ses ayants cause devant le conseil de revision ne peut tre admis au bnfice des dispenses indiques par le prsent article, si les motifs de ces dispenses ne sont survenus que postrieurement la dcision de ce conseil. Le prsent article n'est applicable qu'aux enfants lgitimes. Les enfants naturels reconnus par le pre ou par la mre ne pourront jouir que de la dispense organise par l'article suivant et dans les conditions prvues par cet article. ) Les soutiens de famille effectifs: ART 22. En temps de paix, aprs un an de prsence sous les drapeaux, peuvent tre envoys en cong dans leurs foyers sur leur demande, jusqu' la date de leur passage dans la rserve, les jeunes gens qui remplissent effectivement les devoirs de soutiens indispensables de famille. Les demandes sont adresses, avant le tirage au sort, au maire de la commune o les jeunes gens sont domicilis. Il en sera donn rcpiss. Elles doivent comprendre l'appui: 1 Un relev des contributions payes par la famille et certifi par le percepteur; 2 Un avis motiv de trois pres de famille rsidant dans la commune et ayant un fils sous les drapeaux, ou, dfaut, dans la rserve de l'arme active, et jouissant de leurs droits civilset politiques. La liste de ces jeunes gens est prsente par le maire au conseil de revision, avec l'avis motiv du conseil municipal. Le nombre des jeunes gens dispenss par le conseil dpartemental de revision, titre de soutiens indispensables de famille, ne peut dpasser 5 pour 100 du contingent incorporer pour trois ans. Toutefois, le ministre de le guerre peut autoriser les chefs de corps dlivrer, en plus du chiffre fix ci-dessus, des congs titre de soutiens
LE SERVICEMILITAIRE
475
indispensables de famille aux militaires comptant un an et deux ans de prsence sous les drapeaux. Le nombre des congs accords en vertu du paragraphe prcdent ne pourra pas dpasser 1 pour 100 aprs la premire anne et 1 pour 100 aprs la seconde. Il sera calcul d'aprs l'effectif des hommes de la classe appartenant au corps. Les intresss devront produire les justifications mentionnes ci-dessus. Tous les ans, le maire de chaque commune prsente au conseil de revision, sigeant au chef-lieu du canton, une dlibration du conseil municipal faisant connatre la situation des jeunes gens qui ont t renvoys dans leurs foyers comme soutiens de famille. Il est tenu de signaler au conseil de revision les plaintes des personnes dans l'intrt desquelles l'envoi en cong a eu lieu en vertu du prsent article et de l'article prcdent. Le conseil dpartemental de revision dcide s'il ya lieu ou non de maintenir ces dispenses. Les jeunes gens dont le maintien en cong n'est pas admis sont soumis toutes les obligations de la classe laquelle ils appartiennent. y) Les dispenss conditionnellement raison d'tudes utiles la socit. La dispense est conditionnelle, en ce sens que si l'emploi ou le diplme vis n'est pas obtenu avant un certain dlai, la dispense disparat : ART.23. En temps de paix, aprs un an de prsence sous les drapeaux, sont envoys en cong dans leurs foyers, sur leur demande, jusqu' la date de leur passage dans la rserve: 1 Les jeunes gens qui contractent l'engagement de servir pendant dix ans dans les fonctions de l'instruction publique, dans les institutions nationales des sourds-muets ou de jeunes aveugles, dpendant du ministre de l'intrieur, et y rempliront effectivement un emploi de professeur, de matre rptiteur ou d'instituteur; Les instituteurs laques ainsi que les novices et membres des congrgations religieuses voues l'enseignement et reconnues d'utilit publique qui prennent l'engagement de servir pendant dix ans dans les coles franaises d'Orient et d'Afrique subventionnes par le gouvernement franais; 2 Les jeunes gens qui ont obtenu ou qui poursuivent leurs tudes en vue d'obtenir: Soit le diplme de licenci s lettres, s sciences, de docteur en droit de docteur en mdecine, de pharmacien de 1re classe, de vtrinaire, ou le titre d'interne des hpitaux nomms au concours dans une ville o il existe une facult de mdecine ; soit le diplme dlivr par l'cole des Chartes, l'cole des langues orientales vivantes et l'cole d'administration de la marine;
476
LES DROITS DE POLICE
Soit le diplme suprieur dlivr aux lves externes par l'cole des ponts et chausses, l'cole suprieure des mines, l'cole du gnie maritime ; Soit le diplme suprieur dlivr par l'Institut national agronomique ; l'cole des haras du Pin aux lves internes, les coles nationales d'agriculture de Grandjouan, de Grignon et de Montpellier; l'cole des Mines de Saint-tienne, les coles des matres ouvriers mineurs d'Alais et de Douai, les coles nationales des arts et mtiers d'Aix, d'Angers et de Chlons, l'cole des hautes tudes commerciales et les coles suprieures de commerce reconnues par l'tat; Soit l'un des prix de Rome, soit un prix ou mdaill d'tat dans les concours annuels de l'cole nationale des beaux-arts, du Conservatoire de musique et de l'cole nationale des arts dcoratifs; 3 Les jeunes gens exerant les industries d'art qui sont dsigns par un jury d'tat dpartemental form d'ouvriers et de patrons. Le nombre de ces jeunes gens ne pourra en aucun cas dpasser un demi pour 100 du contingent incorporer pour trois ans. 4 Les jeunes gens admis, titre d'lves ecclsiastiques, continuer leurs tudes en vue d'exercer le ministre dans l'un des cultes reconnus par l'tat. En cas de mobilisation, les tudiants en mdecine et en pharmacie et les lves ecclsiastiques sont verss dans le service de sant. Tous les jeunes gens numrs ci-dessus serontrappels pendant quatre semaines dans le cours de l'anne qui prcdera leur passage dans la rserve de l'arme active. Ils suivront ensuite le sort de la classe laquelle ils appartiennent. Des rglements d'administration publique dtermineront : les condiions dans lesquelles sera contract l'engagement dcennal vis au 1er; les justifications produire par les jeunes gens viss aux 2 et 4, soit au moment de leur demande, soit chaque anne pendant la dure de leurs tudes; la nomenclature des industries d'art qui donneront lieu la dispense prvue au 3, le mode de rpartition de ces dispenses entre les dpartements, le mode de constitution du jury d'tat pour les ouvriers d'art, ainsi que les justifications annuelles d'aptitude de travail et d'exercice rgulier de leur profession, que les jeunes gens dispenss sur la proposition du jury devront fournir jusqu' l'ge de vingt-six ans. Les mmes rglements fixeront le nombre des diplmes suprieurs dlivrer annuellement, en vue de la dispense du service militaire, par chacune des coles numres au troisime alina du 2, et dfiniront ceux de ces diplmes qui ne sont pas dfinis par la loi, ils fixeront galement le nombre des prix et des mdailles viss au quatrime alina du mme paragraphe. ART.24. Les jeunes gens viss au 1er de l'article prcdent qui, dans l'anne qui suivra leur anne de service, n'auraient pas obtenu un emploi de professeur, de matre rptiteur ou d'instituteur, ou qui cesseraient de le remplir avant l'expiration du dlai fix;
LE SERVICE MILITAIRE
477
Ceux qui n'auraient pas obtenu avant l'ge de vingt-six ans les diplmes ou les prix spcifis aux alinas du 2; Les jeunes gens viss au 3 qui ne fourniraient pas les justifications professionnelles prescrites; Les lves ecclsiastiques mentionns au 4, qui, l'ge de vingt-six ans, ne seraient pas pourvus d'un emploi de ministre de l'un des cultes reconnus par l'tat; Les jeunes gens viss par les art. 21, 22 et 23 qui n'auraient pas satisfait, dans le cours de leur anne de service, aux conditions de conduite et d'instruction militaire dtermines par le ministre de la guerre; Ceux qui ne poursuivraient pas rgulirement leurs tudes en vue desquelles la dispense a t accorde; Seront tenus d'accomplir les deux annes de service dont ils avaient t dispenss. En vertu del'art. 59 modifi parl. 11juillet 1892, tous les jeunes gens qui se trouvent dans le cas de l'art. 23 peuvent, lorsqu'ils sont gs de dix-huit ans accomplis, contracter l'engagement volontaire, tout en rclamant le bnfice de l'art. 23. Quand les causes de dispenses prvues aux art. 21, 22 et23 viennent cesser, les jeunes gens qui avaient obtenu ces dispenses sont soumis toutes les obligations de la classe laquelle ils appartiennent. Ils peuvent se marier sans autorisation. La liste des jeunes cens de chaque dpartement, dispenss en vertu des art. 21, 22, 23 et 50, sera publie au Bulletin administratif, et les noms des dispenss de chaque commune seront affichs dans leur commune, la porte de la mairie. En cas de guerre, ils sont appels et marchent avec les hommes de leur classe. Les dispositions de l'art. 55 ci-aprs leur sont applicables. d) Les ajourns pour faiblesse de complexion. (Art. 27.) Ils ne font que le reste du temps courir depuis le jour o ils sont incorpors; ils peuvent se marier. e) Les lves de certaines coles spciales font, sous certaines conditions, leur temps de service dans l'cole mme (art. 28) : cole polytechnique, cole forestire, cole centrale des arts et manufactures. f) Les hommes envoys en cong de maladie ou de convalescence. (Art. 45.) Ces congs sont dsormais les seuls possibles. Dans les r355. II. Du service dans les rserves. : 1 la mobilisation serves, les obligations sont relatives ; 2 aux priodes d'exercice ; 3 aux dclarations faire en cas de changement de rsidence.
478
LES DROITS DE POLICE
a) Mobilisation. Il peut y avoir mobilisation en temps de paix ou en temps de guerre; la rserve de l'arme territoriale ne peut tre appele qu'en cas de guerre. (Art. 48.) La mobilisation se fait autant que possible d'une faon rgionale. Il peut y avoir des mobilisations partielles : arme de terre ou arme de mer, un ou plusieurs corps d'arme, telle ou telle arme. Nul ne peut se prvaloir de la fonction ou de l'emploi pour se soustraire la mobilisation, sauf les exceptions indiques l'art. 51. Les hommes de la rserve de l'arme b) Priodes d'exercice. active sont assujettis pendant leur temps de service dans ladite rserve prendre part deux manuvres, chacune d'une dure de quatre semaines. Les hommes de l'arme territoriale une priode d'exercice d'une dure de deux semaines. (Art. 49.) Il peut tre accord des dispenses jusqu' concurrence de 60/0 suivant la procdure indique l'art 49. (Soutiens de famille effectifs.) c) Dclarations faire en cas de changement de rsidence. (V. art. 55.) Observation. Sous les drapeaux, les hommes de la rserve et de l'arme territoriale sont soumis toutes les obligations imposes aux militaires de l'arme active, par les lois et rglements en vigueur. Au point de vue spcial de la juridiction militaire: 1 Quand ils ne sont pas sous les drapeaux, ils ne sont soumis qu'aux juridictions du droit commun, saut' les exceptions des art. 52, 54 et 57. 2 Quand ils sont sous les drapeaux, ils passent entirement sous la juridiction militaire. (Art. 52.) 3 En ce qui concerne les contraventions militaires, ils sont soumis tout le temps la juridiction disciplinaire de l'arme. Les hommes de la rserve de l'arme active, et plus forte raison ceux de la territoriale, peuvent se marier sans autorisation. (Art. 58.) Les rservistes, pres de quatre enfants vivants, passent de droit dans l'arme territoriale. (Art. 58.) N 2. La taxe militaire. (Loi 15juill. D. 30dc. 1890.) 1889, art. 35;
356. Pour tudier cette obligation toute nouvelle, il y a lieu de distinguer : 1 l'assiette de la taxe; 2 les faits qui dterminent l'assujettissement la taxe et son montant; 3 le recouvrement; 4 la nonrtroactivit de la loi.
LE SERVICEMILITAIRE
479
I. Assiette de la taxe. La taxe militaire est une contribution : 1 un droit fixe de 6 fr. ; directe. Elle se compose de deux lments 2 un droit proportionnel compos lui-mme de deux chiffres. Un premier chiffre est gal au montant en principal de la cote personnelle et mobilire de l'assujetti. Un second chiffreest fourni par une quote part de la cote personnelle et mobilire de l'ascendant de l'assujetti qui est le plus impos, gale la part prsomptive de l'assujetli dans la succession. (Art. 35, 3, D. 30 dc. 1890, art. 6.) II. Assujettissement la taxe. a) Peuvent seuls tre assujettis la taxe ceux qui sont assujettis au service militaire; par consquent, jusqu' nouvel ordre, les trangers n'y sont point assujettis. b) Le fait qui dtermine l'assujettissement la taxe, est tout fait qui dispense du service actif de trois ans ou qui en rduit la dure; par consquent, l'exemption pour dfauts physiques, l'ajournement, le classement dans les services auxiliaires ou dans la seconde partie du contingent, toutes les dispenses qui rduisent le service un an, etc. c) Pour chaque assujetti, le montant de la taxe est proportionnel au temps de service qui n'a pas t accompli. Comme le service est de trente-six mois, la taxe complte est de 36/36e. Un trente-sixime est dduit pour chaque mois de service actif rellement effectu. Il n'est pas tenu compte des fractions de mois. (D., art. 3.) Ce calcul s'effectue sur le droit fixe comme sur le droit proportionnel. : 1 les hommes rforms ou admis d) Sont seuls dispenss de la taxe la retraite pour blessures reues dans un service command, ou pour infirmits contractes dans les armes de terre ou de mer ; 2 les contribuables se trouvant dans un tat d'indigence notoire. Les hommes exempts pour des infirmits entranant incapacit absolue du travail, ne doivent pas le droit fixe. Dure de l'assujettissement. Tout homme qui, au 1er janvier de l'une des trois annes o il doit le service, n'est pas prsent sous les drapeaux, commence tre assujetti la taxe. L'assujettissement durera jusqu'au 1er janvier qui suivra le passage de sa classe dans la rserve de l'arme territoriale, c'est--dire au maximum pendant seize ans. Exceptionnellement, l'assujettissement cessera si l'assujetti plus tard accomplit trois ans de prsence effective sous les drapeaux, soit 'par suite d'un engagement, soit parce qu'il perd le bnfice d'une dispense conditionnelle. D'autre part, il n'est plus tenu compte de la cote des ascendants, lorsque l'assujetti a atteint l'ge de trente ans rvolus et qu'il a un domicile distinct. III. Recouvrement de la taxe. La taxe est tablie au 1er janvier [pour l'anne entire. Tout mois commenc est exigible en entier.
480
LES DROITSDE POLICE
Elle est recouvre sur des rles dresss par les soins de l'administration des contributions directes, d'aprs des tats-matrices tablis par celle-ci dans chaque commune. Le rle est rendu excutoire par le prfet et recouvr par le percepteur. La taxe est due par l'assujetti; elle est exigible dans la commune o il a son domicile la date du 1er janvier. A dfaut de paiement constat par une sommation reste sans effet, elle est poursuivable contre celui des ascendants dont la cotisation a t prise pour lment du calcul de la taxe. De plus, en cas de retard de paiement de trois douzimes conscutifs constat par un commandement rest sans effet, il sera d une taxe double pour ces douzimes. Le paiement de la taxe est suspendu par l'engagement volontaire et par la mobilisation. Les rclamations sont formes, instruites et juges comme en matire de contribution personnelle-mobilire. IV. Non-rtroactivit de la loi. La disposition tablissant la taxe militaire n'a pas eu d'effet rtroactif. La premire classe assujettie cette taxe a t la classe 1889 soumise au recrutement en 1890, par consquent la taxe n'a pu commencer tre perue qu'en janvier 1891. Les hommes appartenant aux classes antrieures, quelle que soit leur situation, ne devront jamais cette taxe. Quant aux jeunes gens de la classe 1889, ou au del, qui auront pu devancer l'appel en contractant l'engagement conditionnel d'un an sous l'empire de la loi ancienne, ils ne devront pas non plus y tre soumis. Article II. Oprations du recrutement. N 1. Le recensement et le tirage au sort. Il y a, dans les oprations du recrutement, deux phases trs distinctes : 1 le recensement des conscrits dans chaque commune et leur rpartition en deux contingents opre par le tirage au sort au cheflieu de canton ; 2 la revision de ces oprations. Chaque anne, pour la formation de la 357. I. Recensement. classe, les tableaux de recensement des jeunes gens ayant atteint l'ge de vingt ans rvolus dans l'anne prcdente, et domicilis dans l'une de : communes du canton, sont dresss par les maires 1 Sur la dclaration laquelle sont tenus les jeunes gens, leurs parents ou leurs tuteurs; 2 D'office, d'aprs les registres de l'tat civil et tous autres documents et renseignements.
LE SERVICE MILITAIRE
481
Ces tableaux mentionnent la profession de chacun des jeunes gens inscrits. Ils sont publis et affichs dans chaque commune suivant les formes prescrites par les art. 63 et 64 du Code civil. La dernire publication doit avoir lieu au plus tard le 15 janvier. Un avis publi dans les mmes formes indique le lieu et le jour o il sera procd l'examen desdits tableaux, et la dsignation par le sort des numros assigns chaque jeune homme inscrit. Sont considrs comme lgalement domicilis dans le canton: 1 Les jeunes gens, mme mancips, engags, tablis au dehors, expatris, absents ou en tat d'emprisonnement, si, d'ailleurs, leur pre, leur mre ou leur tuteur est domicili dans une des communes du canton, ou si leur pre, expatri, avait son domicile dans une desdites communes; 2 Les jeunes gens maris dont le pre, ou la mre dfaut du pre, sont domicilis dans le canton, moins qu'ils ne justifient de leur domicile rel dans un autre canton; 3 Les jeunes gens maris et domicilis dans le canton, alors mme que leur pre ou leur mre n'y seraient pas domicilis; 4 Les jeunes gens ns et rsidant dans le canton qui n'auraient ni leur pre, ni leur mre, ni un tuteur; 5 Les jeunes gens rsidant dans le canton qui ne seraient dans aucun des cas prcdents et qui ne justifieraient pas de leur inscription dans un autre canton. Les jeunes gens rsidant, soit en Algrie, soit aux colonies, sont inscrits sur les tableaux de recensement du lieu de leur rsidence. Sur la justification de cette inscription, ils sont, en ce cas, rays des tableaux de recensement o ils auraient pu tre ports en France, par application des dispositions du prsent article. Sont, d'aprs la notorit publique, considrs comme ayant l'ge requis pour l'inscription sur les tableaux de recensement, les jeunes gens qui ne peuvent produire ou n'ont pas produit, avant la vrification des tableaux de recensement, un extrait des registres de l'tat civil constatant un ge diffrent, ou qui, dfaut des registres de l'tat civil, ne peuvent prouver ou n'ont pas prouv leur ge conformment l'art. 46 du Code civil. Si, dans les tableaux de recensement des annes prcdentes, des jeunes gens ont t omis, ils sont inscrits sur les tableaux de recensement de la classe qui est appele aprs la dcouverte de l'omission, sauf le cas prvu l'art. 69, moins qu'ils n'aient quarante-cinq ans accomplis l'poque de la clture des tableaux, et sont soumis toutes les obligations de cette classe. Toutefois, ils sont librs titre dfinitif l'ge de quarante-huit ans au plus tard. 358. II Tirage H. au sort. L'examen des tableaux de recensement et 31
482
LES DROITS DE POLICE
le tirage au sort sont faits au chef-lieu de canton, en sance publique, devant le sous-prfet assist des maires du canton. Dans les communes qui forment un ou plusieurs cantons, le sous-prfet est assist du maire et de ses adjoints. Dans les villes divises en plusieurs arrondissements, chaque arrondissement est reprsent par un officier municipal. Les tableaux de recensement de chaque commune sont lus haute voix. Les jeunes gens, les parents ou reprsentants sont entendus dans leurs observations. Les tableaux sont ensuite arrts et viss par le sous-prfet et par les maires. Dans les cantons composs de plusieurs communes, l'ordre dans lequel elles sont appeles pour le tirage est chaque fois indiqu par le sort. Le sous-prfet inscrit en tte de la liste du tirage: 1 Le nom des jeunes gens qui se trouvent dans l'un des cas prvus par l'art. 69 de la prsente loi; 2 Le nom de ceux qui se trouvent dans les cas prvus par l'art. 15. Les premiers numros leur sont attribus de droit. Ces numros sont, en consquence, extraits de l'urne avant l'opration du tirage. Avant de commencer les oprations du tirage, le sous-prfet compte publiquement les numros et les dpose dans l'urne, aprs s'tre assur que leur nombre est gal celui des jeunes gens appels y prendre part; il en fait la dclaration haute voix. Aussitt aprs, chacun des jeunes gens, appel dans l'ordre du tableau, prend dans l'urne un numro qui est immdiatement proclam. Pour les absents, le numro est tir par les parents o, dfaut, par le maire de la commune. L'opration du tirage continue sans interruption jusqu' ce que le dernier numro soit extrait de l'urne. Elle ne peut tre recommence dans aucun cas. Les jeunes gens qui ne se trouveraient pas pourvus de numros seront inscrits la suite des numros supplmentaires et tireront entre eux pour dterminer l'ordre suivant lequel ils seront inscrits. La liste du tirage est dresse mesure que les numros sont proclams. Elle est lue haute voix, puis arrte et signe de la mme manire au procsledit tableau avec annexe et de recensement le tableau que verbal des oprations. Elle est publie et affiche dans chaque commune du canton. N2. Larevision. La revision se dcompose elle-mme en deux phases. Il y a une premire revision qui se fait au chef-lieu de canton, et une seconde qui se
LE SERVICEMILITAIRE
483
fait au chef-lieu de dpartement. La revision est accomplie par un conseil de revision qui est en mme temps un conseil administratif et une juridiction, 359. I. Conseil de rvision cantonal. Les oprations du recrutement sont revues, les rclamations auxquelles ces oprations peuvent donner lieu sont entendues, les causes d'exemption et de dispenses prvues par les art. 20, 21, 22, 23 et 50, de la prsente loi, sont juges en sance publique par un conseil de revision, compos : Du prfet, prsident, son dfaut du secrtaire gnral, et, exceptionnellement, du vice-prsident du conseil de prfecture, ou d'un conseiller de prfecture dlgu par le prfet; D'un conseiller de prfecture dsign par le prfet; D'un membre du conseil gnral du dpartement autre que le reprsentant lu dans le canton o la revision a lieu, dsign par la commission dpartementale, conformment l'art. 82 de la loi du 10aot 1871; D'un membre du conseil d'arrondissement, autre que le reprsentant lu dans le canton o la revision a lieu, dsign comme ci-dessus et, dans le territoire de Belfort, d'un deuxime membre du conseil gnral; D'un officier gnral ou suprieur dsign par l'autorit militaire. Un sous-intendant militaire, le commandant de recrutement, un mdecin militaire, ou, dfaut, un mdecin civil dsign par l'autorit militaire, assistent aux oprations du conseil de revision. Le conseil ne peut statuer qu'aprs avoir entendu l'avis du mdecin. Cet avis est consign dans une colonne spciale, en face de chaque nom, sur les tableaux de recensement. Le sous-intendant militaire est entendu dans l'intrt de la loi toutes les fois qu'il le demande, et peut faire consigner ses observations au procs-verbal de la sance. Le sous-prfet de l'arrondissement et les maires des communes auxquelles appartiennent les jeunes gens appels devant le conseil de revision assistent aux sances. Ils ont le droit de prsenter des observations. En cas d'empchement des membres du conseil gnral ou du conseil d'arrondissement, le prfet les fait suppler d'office par des membres ; ces membres, dsigns d'ofappartenant la mme assemble que l'absent fice, ne peuvent tre les reprsentants lus de canton o la revision a lieu. Si, par suite d'une absence, le conseil de revision est rduit quatre membres, il peut nanmoins dlibrer lorsque le prsident, l'officier gnral ou suprieur et deux membres civils restent prsents la voix du prsident n'est pas prpondrante. La dcision ne peut tre prise qu' la majorit de trois voix En cas de partage, elle est ajourne. Dans les colonies, les attributions du prfet, des conseillers d'arrondissement sont dvolues aux directeurs de l'intrieur, aux conseillers privs, et aux conseillers gnraux. Dans les colonies o il n'existe ni conseil priv, ni conseils gnraux, des dcrets rgleront la composition des conseils de revision.
484
LES DROITS DE POLICE
Le conseil de revision se transporte dans les divers cantons. Toutefois, le prfet peut, exceptionnellement, runir plusieurs cantons et faire excuter les oprations dans un mme lieu. Les jeunes gens ports sur les tableaux de recensement, ainsi que ceux des classes prcdentes qui ont t ajourns, conformment l'art. 27 ci-aprs, sont convoqus, examins et entendus par le conseil de revision au lieu dsign. Ils peuvent faire connatre l'arme dans laquelle ils dsirent tre placs. S'ils ne se rendent pas la convocation, s'ils ne s'y font pas reprsenter, ou s'ils n'ont pas obtenu un dlai, il est procd comme s'ils taient prsents. Les dcisions du conseil de revision sont dfinitives. Elles peuvent, nanmoins, tre attaques devant le Conseil d'tat pour incomptence, excs de pouvoir ou violation de la loi. Le recours au Conseil d'tat n'aura pas d'effet suspensif, et il ne pourra en tre autrement ordonn. L'annulation prononce sur le recours du ministre de la guerre profite aux parties lses. Quand les listes 360. II. Conseil de revision dpartemental. de recrutement de tous les cantons du dpartement ont t arrtes, le conseil de revision, compos ainsi qu'il est dit l'art. 18 ci-dessus, mais auquel seront adjoints deux autres membres du conseil gnral, se runit au chef-lieu du dpartement et prononce, en sance publique, sur les demandes de dispenses titre de soutiens de famille, stipules l'art. 22. Les trois conseillers gnraux et le conseiller d'arrondissement sont spcialement dsigns cet effet par la commission dpartementale.
CHAPITRE
II PUBLIQUE
LES DROITS DOMANIAUX DE PUISSANCE
1re. LE DOMAINE SECTION PUBLIC 1er. Le droit de domaine public. 361. Le droit de domaine public est une sorte de proprit, comme d'ailleurs le nom l'indique (dominium publicum). C'est le droit de proprit appartenant une personne administrative et modifi dans seseffets par la destination d'utilit publique de la chose sur laquelle il porte. Ce droit de domaine public appartient toutes les personnes administratives l'exception des tablissements publics. Il y a donc un domaine public de l'tat, un domaine public dpartemental, un domaine public communal, un domaine public colonial. Les choses qui sont l'objet de ce droit de proprit spcial portent le nom de dpendances du domaine public. Citons tout de suite, titre d'exemple, comme dpendances incontestables du domaine public de l'tat, les routes nationales, les fleuves, les rivages de la mer (art. 538, C. civ.); comme dpendances du domaine public dpartemental, les routes dpartementales; comme dpendances du domaine public communal, les chemins vicinaux. Nous allons d'abord tablir que le droit de domaine public est bien un droit de proprit, ce qui est contest. Nous verrons ensuite, en quoi ce droit de proprit est modifi par la destination d'utilit publique de la chose. 362. A. Le droit est un droit de de domaine public Ceux qui ne veulent pas reconnatre dans le droit proprit. de domaine public un droit de proprit, y voient un droit de police ou de surintendance sur des choses qui par elles-mmes n'appartiendraient personne, qui seraient res nullius ou res communes. 1. Bibliographie : Gaudry, Trait du domaine; Proud'hon, Du domainepublic.
486
LES DROITSDOMANIAUX DE PUISSANCE PUBLIQUE
Les raisons qui nous dcident pour le droit de proprit sont les suivantes : 1 Dans la tradition historique, on voit cette ide apparatre ds l'poque classique romaine, et, malgr des contradictions, se montrer dominante. La majorit des dpendances du domaine public taient considres comme tant des res public, c'est--dire appartenant l'tat, ou bien des res univertaits, c'est--dire appartenant aux cits. taient considres comme res public, les voies publiques (1. 2, 22 et 23 : Ne quid inloc. public. D. XLIII, 8) ; les ports et certains fleuves. (Inst. J. 1. II, t. Ier De div. rer., 2.) taient considrs comme res universitatis les thtres, les sfades (Inst. J. eod., 6). Il est vrai que les rivages de la mer taient considrs par beaucoup de jurisconsultes comme faisant partie des res communes, parce qu'on y voyait un prolongement de la mer elle-mme ; mais deux jurisconsultes importants, Celsus et Neratius, les classaient dans le domaine public du peuple romain. (L. 14, 1, De acq. rer. dom. D. XLI. 1; l. 3, Ne quidin loc. publ., D. XLIII, 8.) Dans notreancien droit, la doctrine qui fait des dpendances du domaine public des res nullius ou des res communes, reprit quelque faveur; elle fut soutenue par Loyseau et par Domat (Droitpublic,l. I, tit. VI,sect. i, 7). Cette conception peut s'expliquer, soit par la difficult qu'il y avait cette poque, au lendemain de la fodalit, imaginer une proprit publique, soit par le dsir de mieux assurer la mise hors du commerce et l'inalinabilit de ces choses. On les proclamait hors du commerce par leur nature, estimant que cela tait plus sr que de les dclarer hors du commerce par suite de leur destination d'utilit publique. Quoi qu'il en soit, il y avait aussi des partisans de la domanialit des dpendances du domaine public et ils pouvaient s'appuyer sur des textes (Ord. aot 1669, t. XXVII, art. 41) : Dclarons la proprit de tous les fleuves et rivires portant bateaux sur leur fonds, etc. faire partie du domaine de noire couronne, etc. 2 Dans notre droit, l'ensemble des textes consacre srement l'ide de proprit. Les textes fondamentaux en matire de domaine public sont la loi des 22 novembre-1er dcembre 1790, art. 2, et les art. 538 et 540 du Code civil. Le premier de ces textes a t abrog par les seconds, qui le reproduisent presque fidlement, mais il est permis de rechercher la pense qui l'avait inspir. Or, le rapport d'Enjubault, sur la loi de 1790, dit formellement que cet art. 2 a eu pour but de mettre fin aux divergences des jurisconsultes, en tranchant une question de proprit, et en reconnaissant que les dpendances du domaine public qu'il numre sont la proprit de l'tat. Quant l'art. 538,
LE DROITDE DOMAINE PUBLIC
487
C. civ., il dclare que : les chemins, roules et rues la charge de l'tat, etc., et gnralement toutes les portions du territoire qui ne sont pas susceptibles d'une proprit prive, sont considrs comme des dpendances du domaine public. Qu'est-ce dire, sinon que l'expression domaine public, qui n'avait pas alors le sens prcis qu'elle a pris depuis, dsigne simplement la proprit de l'tat oppose la proprit prive? D'autant mieux que l'article attribue au domaine public de l'tat des biens, comme les successions vacantes, qui sont des proprits ordinaires entre les mains de l'tat. Outre ces textes fondamentaux, il y en a d'autres. Ainsi la loi des 22 dcembre 1789-8 janvier 1790, section III, art. 2, charge les administrations dpartementales de la conservation des proprits publiques; cela a toujours t entendu du domaine public, et notamment c'est sur ce texte que repose le droit du prfet de dlimiter les fleuves. De la loi du 3 frimaire an VII sur la contribution foncire, il rsulte que, sauf exception, les dpendances du domaine public productives de revenu sont cotises, et en effet cela a t appliqu aux canaux l. 5 floral an X) et aux chemins de fer, notamment aux chemins de fer exploits par l'tat (1. 18 mai 1878). Or, la contribution foncire frappe les proprits foncires. (L. 3 frimaire an VII, art. 2.) Citons encore l'art. 116 de la loi du 5 avril 1884, qui pose en principe que les biens des communes sont saisissables, mais qui en excepte ceux qui sont affects l'usage public, c'est--dire qui sont dpendances du domaine public; l'art. 7, mme loi, qui parle de la proprit des biens affects l'usage public ; toute la loi du 20 aot 1881 sur les chemins ruraux qui suppose que ces chemins appartiennent la commune, notamment art. 1 et 3, etc. Il est vrai que l'art. 714 du Code civil dit: Il y a des choses qui n'appartiennent personne et dont l'usage est commun tous. Des lois de police rglent la manire d'en jouir . Ce texte semble viser certaines dpendances du domaine public, comme les routes, les fleuves, etc Mais d'abord, il peut tout aussi bien viser des choses comme les petits cours d'eau, qui, dans l'opinion dela jurisprudence et de la majorit des auteurs, sont, eneffet, des res communes. De plus, l'expression choses qui n'appartiennent personne peut signifier simplement choses qui n'appartiennent pas aux particuliers. Il faut interprter l'art. 714 en le rapprochant de l'art. 538, qui place dans le domaine public gnralement toutes les portions du territoire franais, qui ne sont pas susceptibles d'une proprit prive , ce qui ne veut pas dire du tout qu'elles ne soient pas susceptibles d'une proprit publique.
488
DE PUISSANCE LES DROITS DOMANIAUX PUBLIQUE
3 Enfin, il y a des arguments de raison dcisifs. La qualit de dpendance du domaine public pourune chose dtermine n'est pas indlbile ; elle dure tant que dure l'affectation l'utilit publique ; elle apparat au moment de l'affectation, elle disparat au moment de la dsaffectation. Or, avant et aprs, quelle est la situation de la chose? Presque toujours, cette chose tait dj un objet de proprit pour la personne administrative, elle tait dj dans son domaine priv. Presque toujours, aprs, elle retombera dans le domaine priv de la : le personne administrative. Voici, par exemple, une route nationale terrain en a t acquis par l'tat par expropriation ; jusqu' l'achvement de la route, il a t dans le domaine priv de celui-ci, la route acheve et livre, il tombe dans le domaine public ; supposons que plus tard la route soit dclasse, le terrain retombera dans le domaine : la mer se dplace insensipriv de l'tat. Voici un rivage de la mer blement et se retire, l'ancien rivage devient un lai, il tombe dans le domaine priv de l'tat. Faut-il admettre que, selon les circonstances, la proprit apparatou disparat? N'est-il pas plus naturel d'admettre qu'elle existe toujours au fond, quoique modifie dans ses effets par l'utilit publique tant que dure l'affectation1? 1. Voir sur toute cette question, et en notre sens, un intressantarticle de M. Barckhausen, professeur de droit administratif la Facult de Droit de Bordeaux (Revuecritique de lgislation, anne 1884) Voir aussi deux re: marquables tudes deM. Saleille,professeur la Facult de Droit de Dijon 1 le Domainepublic Romeet son applicationenmatire artistique, nouvelle revue historique de Droit (anne 1888,p. 497et anne 1889,p. 457): 2 Loi du 30 mars 1887 sur la conservationdes monumentshistoriques,revue bourguignonne (1891,p. 635).Ces tudes trs analytiques et trs documentessont : si l'on veut tupleinement convaincantes.Nous ajouterons seulement ceci dier cette question compltement,il faut, comme toujours, se placer au point de vue de l'volution historique. Or au point de vue de l'volution historique il nous parat que les dpendances du domaine public apparaissentd'abord aux hommes avec le caractre de choses communes,jusqu' ce que se soit dveloppe une personnalit publique suffisante qui ils puissent en attribuer la proprit.Lesidesindustrielles,littraireset artistiqueslorsqu'elles ont cess d'appartenir l'inventeur, tombent dans le domaine public, c'est l'expression consacrepar le langage. A l'heure actuelle ce sont des res communes, elles sont dans le patrimoine communde tous les hommes, car elles ont incontestablementune porte internationale. S'il venait se crer une personnalit publique internationale, elles deviendraientla proprit de cette personnalit et tomberaient dans son domaine public. Un dveloppementanalogue s'est produit pour le domaine public de l'tat, et au fond ceux qui rsistent admettre que ce domaine soit la proprit de sont oude res communis, l'tat et qui en sont rests la notion de res nullius ceux qui n'admettent pas que la personnalit de l'tat puisse tre tendue jusqu'aux droits de puissance publique.
LE DOMAINE PUBLIC. DPENDANCES
489
B. Le droit de domaine 363. public est un droit de modifi dans ses effets pupar l'utilit proprit Lorsqu'une chose appartenant l'tat ou toute autre blique. personne administrative reoit uneaffectation d'utilit publique, il est clair que le droit de proprit portant sur cette chose est gravement modifi dans ses effets. Des trois attributs qui constituent le droit de proprit ordinaire, usus, fructus, abusus, il n'en est pas un seul qui reste intact: 1 L'abusus, ou droit de disposer, disparat presque entirement; cette chose ne peut tre ni aline ni modifie profondment dans sa substance, puisqu'il est d'utilit publique qu'elle demeure avec sa manire d'tre actuelle. Une roule nationale ne peut pas tre vendue aux riverains sous peine de perdre sa destination; elle ne peut pas davantage tre laboure ou transforme en prairie ; 2 l'usus disparat aussi, en ce sens que la chose ne peut pas tre affecte un usage autre que celui auquel elle est consacre par l'utilit publique; 3 enfin le fructus disparat, en ce sens que la chose ne peut plus produire de fruits qu'en tant que cela n'est pas nuisible sa destination. Une route nationale peut bien tre plante d'arbres, mais condition que la circulation n'en souffre pas. Toutes ces altrations du droit de proprit ne durent, bien entendu, que tant que la chose a une affectation d'utilit publique. L'affectation et la dsaffectation sont des vnements naturels ou des actes de l'autorit administrative que nous tudierons dans un paragraphe suivant. Lorsque la chose est dsaffecte, le droit de proprit recouvre sur elle tous ses effets, elle tombe alors dans le domaine priv de la personne administrative, c'est--dire dans son domaine ordinaire. La modification la plus intressante tudier est celle qui est apporte l'abusus et qu'on appelle d'ordinaire l'inalinabilit. Nous allons l'examiner, ainsi qu'on le fait d'ordinaire, propos des dpendances du domaine public. PUBLIC DUDOMAINE 2. LES DPENDANCES N 1. De l'inalinabilit des dpendances du domaine public. 364. Origine, de cette inalinabilit. sens et porte Les dpendances du domaine public sont inalinables, imprescriplibles, insaisissables raison de leur destination d'utilit publique. Cette inalinabilit existait dans notre ancien droit, mais elle pouvait une consquence du principe s'expliquer de deux faons : soit comme de l'inalinabilit du domaine de la couronne (dit de Moulins, fvrier
490
LES DROITS DOMANIAUX DE PUISSANCE PUBLIQUE
1566), soit comme consquence de ce fait que les dpendances du domaine public par leur nature mme rsistaient l'appropriation. Dans notre lgislation actuelle l'ensemble des textes consacre l'indisponibilit ou la mise hors du commerce des dpendances du domaine public par suite de leur destination d'utilit publique, il en dcoule naturellement l'inalinabilit, l'imprescriptibilit et l'insaisissabilit. La mise hors du commerce rsulte de l'art. 538 du Code civil qui dclare que les dpendances du domaine public ne sont pas susceptibles de proprit prive. Soustraire les dpendances du domaine public la proprit prive, c'est les mettre hors du commerce, car ce que le langage du droit appelle le commerce en ces matires, c'est l'ensemble des transactions qui conduisent la proprit prive. L'inalinabilit s'en suit immdiatement. Art. 1128 : Il n'y a que les choses qui sont dans le commerce qui puissent tre l'objet des conventions , et l'art. 1598 prcise : Tout ce qui est dans le commerce peut tre vendu . Par consquent, ce qui n'est pas dans le commerce ne peut pas l'tre. L'imprescriptibilit est prvue par l'art. 2226 : On ne peut prescrire le domaine des choses qui ne sont point dans le commerce. Quant l'insaisissabilit, elle rsulte indirectement de l'art. 1598, car la saisie n'ayant de sens que si elle aboutit une vente, les choses qui sont inalinables sont par l mme insaisissables. Nons verrons d'ailleurs plus tard, que mme les biens du domaine priv sont insaisissables; ceux de l'tat le sont compltement, ceux des autres personnes administratives ne deviennent saisissables qu'avec l'autorisation de l'tat. Nous allons insister sur l'inalinabilit proprement dite. Senset porte de cette inalinabilit. L'inalinabilit des dpendances du domaine public est fonde uniquement sur la destination d'utilit publique de la chose; elle n'est donc pas aussi absolue que si elle dcoulait de la nature mme de la chose et si celle-ci tait par elle-mme hors du commerce. Il en rsulte que cette inalinabilit doit tre un obstacle tous les actes qui porteraient atteinte la destination de la chose; mais qu'elle ne doit pas empcher les actes qui n'y porteraient aucune atteinte. Ceci doit tre examin divers points de vue: a) Auregard des alinations qui seraient consenties des particuliers. Ces alinations sont nettement prohibes, c'est l'effet direct de la mise hors du commerce. Mais, bien entendu, l'impossibilit d'aliner ne dure qu'autant que dure l'affectation de la chose l'utilit publique. Ainsi, lorsqu'une route est dclasse, le terrain
PUBLIC. DPENDANCES LE DOMAINE
491
peut en tre vendu parce qu'il cesse par l-mme d'tre dpendance du domaine public. Est impossible, non seulement l'alination totale, mais l'alination partielle. La doctrine et la jurisprudence tirent de l cette conclusion, que les btiments qui sont dpendances du domaine public ne sont pas soumis la servitude lgale de cession de mitoyennet telle qu'elle rsulte de l'art. 661 du Code civil (Cass. 5 dc. 1838, mur d'glise. Cass. 16 juin 1856, mur de soutnement d'une place publique). Cette solution parait correcte. On ne peut pas objecter que la cession de mitoyennet rsulte d'une de ces servitudes lgales qui forment le droit commun de la proprit. Il est bien clair, en effet, que les dpendances du domaine public sont soustraites au droit commun de la proprit, en tant que ce droit commun les mettrait dans le commerce. Est impossible, non seulement l'alination de la pleine proprit, mais toute alination d'un dmembrement de la proprit, par consquent toute constitution de servitudes. Il ne pourrait pas tre concd sur une dpendance du domaine public un droit de passage, une servitude de vue, etc., etc. Mais, de ce que des droits rels ne peuvent pas tre constitus sur les dpendances du domaine public, il ne s'ensuit pas que des concessions prcaires ne puissent pas tre faites sur ces mmes dpendances. Les concessions de ce genre sont d'une pratique constante. Elles ne confrent au concessionnaire aucun droit rel vritable, mais elles lui confrent l'exercice du droit rel, sa possession ou sa quasi possession vis--vis des tiers, si bien que le concessionnaire peut exercer vis--vis de ceux-ci l'action possessoire. C'est un vritable prcaire. Nous reviendrons plus tard sur ces concessions (n 396). b) Au regard des alinations forces qui ont un but d'utilit publique. Il y a des alinations forces qui ont un but d'utilit publique, comme, par exemple, celle qui rsulte d'une procdure d'expropriation pour cause d'utilit publique, ou celle qui rsulte d'une servitude d'alignement. Les dpendances du domaine public sont-elles exposes ces alinations? Il y a ici conflit de deux utilits publiques. La question a t tranche ngativement (Cass. 3 mars 1862), et une loi rcente, la loi sur les monuments historiques du 30 mars 1887, est venue dans son art. 4 apporter un argument de plus, en mettant les monuments classs hors du droit commun en ce qui concerne l'expropriation et l'alignement. Une dpendance du domaine public ne peut donc pas tre exproprie, elle n'est pas non plus soumise l'alignement1. 1. Il n'en est pas de mme de l'immeuble dotal que certains auteurs consi-
492
LES DROITS DOMANIAUX DE PUISSANCE PUBLIQUE
Au premier abord, cela parait un peu excessif, car l'expropriation est motive par l'utilit publique, il s'agit peut-tre d'accomplir un travail de premire ncessit. Il en est de mme de l'alignement, il peut tre trs utile, indispensable mme, d'largir une voie publique. Cela est vrai, mais il faut remarquer que sans recourir l'expropriation ou l'alignement, la question pourra presque toujours tre rgle l'amiable. Il s'agit d'une affaire qui se traite entre personnes administratives; c'est l'tat qui a besoin de faire passer un chemin de fer sur une place publique communale ; c'est, au contraire, une commune qui aurait besoin de btir sur une voie publique appartenant l'tat, etc. Quelquefois mme, l'affaire se traite entre services diffrents d'une mme personne administrative; c'est le service des ponts et chausses qui aurait besoin d'un terrain qui est sous la garde du service de la guerre ou inversement. Dans ces diffrents cas, il suffit d'obtenir la dsaffectation du terrain et de procder l'amiable des cessions ou des changes. Il est vrai que parfois, notamment pour le domaine militaire, la dsaffectation peut tre difficile obtenir. Notre doctrine pourrait prsenter des inconvnients en cas de travaux ncessits par la dfense militaire. Il faut admettre que dans ce cas elle flchit, et qu'un dcret ou une loi spciale peut dcider l'expropriation. (Art. 75, 1. 3 mai 1841.) c) Au regard des servitudes lgales qui constituent le droit commun de la proprit. De ce que les dpendances du domaine public sont hors du commerce, il ne s'ensuit nullement, notre avis, qu'elles soient soustraites en principe aux rgles qui constituent le droit commun de la proprit, car ce sont des objets de proprit. Elles sont donc soumises aux servitudes lgales : 1 quand ces servitudes n'ont pas pour effet d'entraner une mise dans le commerce, comme dans le cas de l'art. 661 du Code civil; 2 quand elles n'ont rien de directement contraire l'utilit publique. En consquence, les terrains, cours et jardins dpendant des btiments, peuvent tre considrs comme soumis l'obligation de clture (art. 663), aux rgles sur la distance exige pour certains travaux et certaines plantations, aux rgles sur les jours et vues et sur l'gout des toits. Les terrains du domaine public sont assujettis l'obligation de recevoir l'gout des terrains suprieurs. Les dpendances du domaine public doivent tre frappes par la contribution foncire lorsqu'elles sont productives de revenus ; c'est ainsi que les drent comme tant frapp lui aussi d'indisponibilit.La diffrencetient ce que la mise hors du commerce de l'immeuble dotal, supposer qu'elle ft relle, n'aurait jamais qu'un but d'intrt priv. Elle devrait disparatre en cas d'utilit publique.
PUBLIC. DPENDANCES LE DOMAINE
493
chemins de fer exploits par l'tat sont imposables comme les proprits des particuliers (1. 18 mai 1878), etc. Observation. Des droits d'accs et de vue des riverains des voies Les riverains des voies publiques et des places publiques publiques. ont sur ces voies le droit d'accs et le droit de vue. Il ne faut point considrer ces droits comme semblables des servitudes du droit priv qui pseraient sur la voie publique. Ces droits sont beaucoup plutt des bnfices dont profitent les riverains. Cependant ils ne peuvent pas tre retirs sans indemnit et par consquent constituent de vritables droits, non pas une simple jouissance prcaire. Ce sont des 1 si par droits administratifs d'un caractre assez indtermin : suite d'une opration de voirie le riverain perd son droit d'accs ou de vue, par exemple par l'excution d'un plan d'alignement qui rtrcit la voie publique, il peut y avoir indemnit fonde sur la thorie des dommages permanents rsultant des travaux publics (Cons. d't. ville de Chaumont, 17 dc. 1886); 2 pour pratiquer des accs ou des vues, le riverain n'est point tenu d'observer les art. 678 et 679 C. (Cass. c., il doit seulement observer les rglements administratifs 28oct. 1891.) utiles l'inalina365. Droits subsister que laisse Bien que les dpendances du domaine public soient inabilit. linables, le droit de proprit que les personnes administratives ont sur elles comporte encore des prrogatives importantes. Il entrane, en effet: 1 Le droit d'affecter ou de dsaffecter la chose l'utilit publique, par consquent le droit de lui donner ou de lui enlever son caractre; 2 Le droit d'en constater et d'en protger les limites par la dlimitation, l'alignement, etc. ; 3 Le droit de veiller sa conservation par des moyens de police ou des moyens judiciaires; 4 Le droit de retirer de la chose toute l'utilit qu'elle peut fournir sans que cela nuise sa destination, ce qui entrane le droit de percevoir les produits et de faire des concessions sr la chose. N2. Du critrium qui permet de dterminer domaine public. les dpendances du
366. Les dpendances du domaine public sont les choses sur lesquelles porte cette forme particulire de proprit publique, et qui, par consquent, doivent tre considres comme mises hors du commerce, inalinables et imprescriptibles.
494
LES DROITSDOMANIAUX DE PUISSANCE PUBLIQUE
Nous savons dj que le droit de domaine public n'appartient pas aux tablissements publics ; il ne faudra donc chercher de dpendances du domaine public que parmi les choses qui appartiennent l'tat, aux dpartements, aux communes, aux colonies. Il y aura lieu de procder des numrations et des descriptions; mais une question pralable se pose, c'est celle de savoir quel est le critrium l'aide duquel on reconnat qu'une chose ou une catgorie de choses sont des dpendances du domaine public. Il ya des textes de loi 367. Position de la question. qui numrent des dpendances du domaine public, les deux principaux sont les art. 538 et 540 du Code civil ; mais tout le monde reconnat que l'numration donne par ces textes n'est point limitative, qu'elle est purement nonciative, il s'agit donc de trouver un critrium qui permette de la complter. Le critrium doit tre cherch dans un caractre commun toutes les choses numres par la loi. Il est clair, en effet, que la raison qui fait ranger toutes ces choses parmi les dpendances du domaine public doit se trouver dans un caractre commun toutes. Ce caractre une fois dgag, partout o on le retrouvera dans unechose appartenant une personne administrative, il faudra dclarer que la chose est une dpendance du domaine public. est dans l'affectation de la chose 368. Le critrium Le seul caractre commun que l'on puisse l'utilit publique. dcouvrir dans toutes les dpendances du domaine public numres par la loi, c'est que toutes ont reu une affectation d'utilit publique; par consquent, le critrium est dans l'affectation de la chose l'utilit publique. Ce fait, qui dtermine dj les altrations que le droit de proprit subit dans le domaine public, qui explique dj l'indisponibilit des dpendances du domaine public, sert encore, comme on le voit, dterminer ces dpendances. Il faut entendre l'affectation l'utilit publique de la faon la plus large: 1 L'affectation l'utilit publique peut rsulter: soit de ce que la chose est affecte l'usage direct du public, comme les rivages de la mer, les chemins et routes la charge de l'tat que l'on rencontre dans l'numration de l'art. 538; soit de ce qu'elle est affects un service public, comme les murs et remparts des places de guerre qui sont indiqus dans l'art. 540, et qui sont affects au service de la tous du tout non du consquent, par l'usage public; point guerre, les btiments affects un service public devront, en principe, tre considrs comme des dpendances du domaine public.
PUBLIC. DPENDANCES LE DOMAINE
495
2 Il n'est pas ncessaire que l'affectation soit perptuelle, il suffit qu'elle soit actuellement ralise, soit par un fait naturel, soit par un acte de l'autorit administrative. au point de vue des choses mobi369. Consquences 1 Des choses mobilires peuvent, lires et incorporelles. aussi bien que des immeubles, tre considres comme dpendances du domaine public, si elles ont reu une affectation d'utilit publique. La jurisprudence a dcid que les collections des muses et les livres des bibliothques publiques devaient tre considrs comme inalinables et imprescriptibles, titre de dpendances du domaine public et il faut tendre cela tous les meubles affects d'une faon vidente, par la place mme qu'ils occupent, l'utilit publique (Cours de Paris, 3 janv. 1846, D. 46, 2, 212; 18 aot 1851,30 nov. 1860; Tribunal de de la Seine, 2 mai 1877). De plus, la loi du 30 mars 1887 sur les monuments historiques, dans son art. 10, dclare que les objets artistiques, appartenant l'tat et spcialement classs, sont inalinables et imprecriptibles1, et cela est vrai alors mme qu'ils ne seraient point dans un muse offerts aux yeux du public. Enfin, il est bien difficile de ne pas considrer comme inalinable et imprescriptible, tant qu'il n'est pas mis en rforme, tout le matriel de guerre, chevaux, canons, fusils, effets, etc. Pour ces objets mobiliers, il est vrai, l'inalinabilit et l'imprescriptibilit peuvent prendre un sens spcial. Dans le cas de l'art. 10, 1. 30 mars 1887, elles ont seulement pour effet de permettre l'action en revendication pendant trois ans, comme en cas de vol, mais pour les collections des muses et les livres des bibliothques, la jurisprudence admet l'imprescriptibilit perptuelle. 1 Des choses incorporelles peuvent, aussi bien que des choses corporelles, tre considres comme dpendances du domaine public, condition de pouvoir tre conues comme objets de proprit ou de possession. C'est ainsi que les fonctions publiques, lorsqu'elles ont une existence permanente, peuvent tre considres comme choses en soi, objets de possession pour le fonctionnaire, et alors objets de proprit pour l'tat titre de dpendances du domaine public inalinables et imprescriptibles. (V. nos 137 et 302.) 1. L'art. 11 semble carter cette consquence pour les objets classs qui appartiendraient aux dpartements ou aux communes. Sur toute cette question de la domanialit publique des objets mobiliers et sur les difficults que soulve la loi du 30 mars 1887,V. tude de M. Saleille, Revue bourguignonne, 1891,p. 635.
496
DE PUISSANCE LES DROITSDOMANIAUX PUBIQUE
Observation. Comme le rsultat du classement d'une chose dans le domaine public est sa mise hors du commerce, et en somme sa conservation indfinie en vue de l'usage qu'elle est destine procurer, il est des choses que l'on ne peut point y ranger, bien qu'en un certain sens elles aient une affectation d'utilit publique. Ainsi en est-il des deniers publics, parce que leur destination est d'tre alins. Cependant les deniers publics ont un caractre part, leur maniement est soumis une comptabilit svre, et le seul fait de les avoir manis, mme sans mandat, entraine l'application des rgles de la comptabilit. (V. Comptabilit de fait, p. 431.) Les approvisionnements de l'tat, soumis aux rgles de la comptabilit-matire, ne peuvent pas non plus tre classs dans le domaine public, parce que ce sont des choses qui se consomment par le premier usage. du systme, en ce qui concerne 370. Justification Cette faon affects un service les btiments public. large de concevoir le domaine public, en ramenant tout la seule question d'affectation de la chose l'utilit publique, n'est pas admise par tout le monde. Le point le plus contest est la situation faite aux btiments affects un service public. Tout le monde n'admet pas qu'ils soient rangs parmi les dpendances du domaine public. Beaucoup d'auteurs pensent au contraire que ces btiments restent dans le domaine priv. La doctrine est trs divise sur cette question1. La jurisprudence est presque muette2, elle n'a pas eu souvent l'occasion de se prononcer, parce que, ainsi que nous allons le voir, la question est trs thorique; raison de diverses circonstances, la situation des btiments affects est en fait peu prs la mme dans les deux systmes. La justification de notre manire de voir, en ce qui concerne les btiments affects un service public, aura pour consquence la justification du systme tout entier, et c'est pourquoi nous y insistons. 1. Le systme qui range les btiments affects aux services publics parmi les dpendances du domaine public, a pour partisans : MM. Toullier (III, 39), Mourlon (art. 538), Aubry et Rau (II, 169), G. Bressolles (Journal de droit adm., t. XI, p. 117),Troplong (art. 2226),Bourbeau (Trait desjustices depaix, p. 621), Dareste (La justice administrative, p. 253);Gaudry (Trait du domaine). Le systme qui les range parmi les dpendances du domaine priv a pour dfenseurs : MM.Delvincourt(1, p. 145); Macarelet Boulatigner(Trait de la public, II, n 334; Batbie; fortune publique, n 70); Proud'hon, 'Du domaine Adolphe Chauveau; Ducrocqet Aucoc. 2. La seule dcision intressante est celle de la Cour de Paris du 25fvrier 1854,qui refuse de ranger les htels de prfectures parmi les dpendances du domaine public.
LE DOMAINE PUBLIC. DPENDANCES
497
Intrt de la question. L'intrt pratique de la question est, nous l'avons dit, assez petit. Si les btiments affects un service publicsont des dpendances du domaine public, il s'ensuit qu'ils sont mis hors du commerce, que par consquent ils sont inalinables et imprescriptibles. Qu'ils soient imprescriptibles, cela ne peut vraiment paratre fcheux personne. La prescription acquisitive peut tre une ncessit sociale entre particuliers, mais, applique aux proprits publiques, ce qu'elle cache d'usurpation apparat immdiatement. D'ailleurs, la surveillance constante, qui est exerce sur les immeubles occups par des services publics, rend bien rares les faits de possession sur lesquels pourrait se fonder une prescription. Que ces immeubles soient inalinables, cela parat au premier abord plus fcheux. Les immeubles affects aux services publics sont nombreux et importants. Si l'on additionne tous les btiments de l'tat, palais, ministres, arsenaux, grandes coles, prisons, hpitaux, manutous ceux du dpartement: htels de prfecture et factures, etc.; de sous-prfecture, palais de justice, prisons, asiles d'alins, coles normales primaires, etc. ; tous ceux des communes : htels de ville, maisons d'cole, lyces, collges, facults, casernes, halles et marchs couverts, etc., etc., on arrive au chiffre de plusieurs milliards1. Et si l'on songe que cette masse norme de richesses est immobilise, retire du commerce, on voque l'ide de la mainmorte. A la rflexion, cependant, on ne tarde pas s'apercevoir qu'en fait, ce qui cre l'indisponibilit, c'est l'affectation; qu'un btiment affect ne peut pas tre vendu sans tre dsaffect, mme quand on le considre comme une dpendance du domaine priv ; que par consquent la thorie de l'inalinabilit ne change rien l'tat des choses, d'autant que cette inalinabilit elle-mme n'existe que pendant l'affectation; qu'il suffit de dsaffecter un btiment pour le faire rentrer dans le domaine priv et par consquent dans le commerce. : SupLe seul intrt pratique srieux qu'on ait signal est celui-ci posons un btiment affect un service public qui ne soit pas isol, qui soit immdiatement contigu un hritage voisin, s'il n'est pas dpendance du domaine public, le voisin pourra demander la cession de la mitoyennet du mur aux termes de l'art. 661, C. civ. ; si, au contraire, le btiment est dpendance du domaine public, le voisin ne pourra pas obtenir cette cession (V. n 364). On nous permettra de trouver que cette consquence n'est pas trs regrettable, il est certai1. Un tableau arrt par l'administration des domaines le 31 dcembre 1875, avant la construction des maisons d'coles, accuse le chiffre de 1,767millions. H. 32
498
LES DROITSDOMANIAUX DE PUISSANCE PUBLIQUE
nement bon, au point de vue des incendies, que les btiments affects aux services publics soient spars des maisons prives au moins par un double mur. Ce prtendu inconvnient devrait plutt tre considr comme un avantage, d'autant que cela n'empche point la mitoyennet pour les murs qui auraient t ds le dbut btis comme mitoyens. Nous ajouterons un autre intrt pratique. Si les btiments affects aux servises sont dpendances du domaine public, la conservation de ces btiments, la protection des limites et la protection contre les dgradations, peuvent tre obtenues non seulement par des moyens de droit civil, mais par des moyens de police, conformment la thorie gnrale de la police du domaine public. Les prfets et les maires peuvent donc prendre des arrts ce sujet. Discussion. L'opinion, qui exclut du domaine public les btiments affects un service public, a t prsente sous forme de syllogisme de la faon suivante, par son principal interprte1 : Une chose domaniale ne peut faire partie du domaine public, tre inalinable et imprescriptible, qu'en vertu d'un texte de loi gnral ou spcial. Or, il n'existe pas de texte gnral qui classe dans le domaine public ou frappe d'inalinabilit tous les btiments affects un service public. Donc il n'y a dans le domaine public que les btiments auxquels un texte spcial imprime ce caractre. A. Comme presque toujours, dans un syllogisme contestable, c'est la majeure qui contient l'erreur. O a-t-on vu qu'il faille un texte de loi pour classer une chose dans le domaine public? Si cette rgle a la valeur d'un principe absolu, comme on l'affirme avec quelque solennit, elle ne doit souffrir aucune exception. Or, comment se fait-il que tout le monde ait admis comme une chose toute naturelle, que les glises, btiments pour lesquels il n'y a aucun texte, sont des dpendances du domaine public? C'est un point d'histoire curieux auquel on n'a pas accord toute l'attention qu'il mrite. : Toutes les glises Le concordat, dans son art. 12, avait dit ceci mtropolitaines, cathdrales, paroissiales et autres, non alines, ncessaires au culte, seront remises la disposition des vques. Les art. 75 77 de la loi du 18 germinal an X avaient donn des instructions aux prfets pour oprer cette remise. Une fois la remise opre, on se demanda quelle tait la situation juridique des glises. D'abord qui elles appartenaient, si c'tait l'tat, aux fabriques ou 1. M. Ducrocq. Traitdesdificespublics, p. 47.
PUBLIC. DPENDANCES LE DOMAINE
499
finalement les communes l'emportrent (av. Cons. aux communes ; d't., 2 pluvise an XIII;arr. Cons. d't., 6 avr. 1854, 22dc. 1859). Ensuite si elles taient dpendances du domaine public. L, les dcisions judiciaires furent unanimes pour l'affirmative (Cass. 1er dc. 1823, S. VII, 1, 345; Cass. 19 avr. 1825, S. VIII, 106; Cass. 5 dc. 1838, S. 39, i, 33; Cass. 18 juill. 1838, S. 38, I, 198). Et quelles raisons donna-t-on? Nous les trouvons dans l'arrt du 5 dcembre 1838 : Avant le Code civil, il tait universellement admis en France, que les glises ou difices consacrs au culte n'taient pas suscep tibles de proprit prive, et ce principe d'ordre et de droit public n'a pas t dtruit ou modifi par le Code Napolon. Donc, ce n'est point parce qu'il y a un texte, et, de fait, ni l'art. 12 du concordat, ni les art. 75 et suivants de la loi du 18 germinal, ne s'occupent de la question de domanialit; ils prennent une pure mesure de police: les glises seront remises aux vques . C'est parce qu'il y a une tradition, et c'est aussi parce qu'il y a des prin: parce que la descipes suprieurs d'ordre et de droit public. Lisez tination d'utilit publique est tellement vidente, qu'elle impose l'indisponibilit ces difices. Voil donc une catgorie importante d'difices, les glises, qui sont considres comme dpendances du domaine public sans texte. Cette dispense de texte sera-t elle rserve aux glises? et le dveloppement croissant de l'importance des services d'tat, ne fera-t-il pas apparatre pour d'autres difices, ces mmes raisons suprieures d'ordre et de droit public? Voici, par exemple, les maisons d'cole avec chambre commune servant de mairie, que l'on vient d'difier grands frais dans toutes les communes rurales, pour lesquelles il a certainement t dpens plus d'un milliard, dont on a voulu faire une sorte de symbole du rgime de la dmocratie laque; ces mairiesmaisons d'cole, de mme que les htels de ville, ne devront-elles pas tre considres comme dpendances du domaine public de la commune, inalinables et imprescriptibles au mme titre que les glises? Des auteurs rcents reconnaissent qu'il y a l une ncessit qui s'impose, qu'il y a quelque chose de choquant considrer la maison commune comme dpendance du domaine priv au mme titre qu'un bois communal1. Mais qui ne voit combien toutes ces concessions de dtail sont fcheuses pour le principe qu'on prtend maintenir malgr tout? Combien il est plus simple de reconnatre qu'un texte n'est pas ncessaire pour faire rentrer une chose dans le domaine public, et qu'il y a des principes de Droit qui ne sont pas compltement enferms dans les textes ? 1. Rpertoire de Bequet, v Commune.
500
LES DROITSDOMANIAUX DE PUISSANCE PUBLIQUE
B. On a des textes d'ailleurs, il suffit de savoir les lire; ces textes nous donnent tout ce qu'ils peuvent nous donner, c'est--dire un critrium qui nous permette de reconnatre les dpendances du domaine public. Ce sont les art. 538 et 540 C. civ. Ils contiennent une numration nonciative o l'on trouve de tout, des choses affectes l'usage du public, comme les routes et les rivages de la mer, des btiments affects un service public, comme les portes, murs, remparts des places de guerre et forteresses. Nous en avons tir cette conclusion, que la seule condition exige tait l'affectation de la chose l'utilit publique, que cette chose ft un terrain affect un usage public, ou bien que ce ft un btiment affect un service public. Cette conclusion s'impose tous ceux qui reconnaissent, d'une part, que l'numration des art. 538 et 540 est purement nonciative, et, d'autre part, que tous les lments de cette numration ont une valeur gale. Or, que l'numration soit purement nonciative, cela tout le monde l'admet. Reste la question de savoir si tous les lments ont une valeur gale, si l'art. 540 a autant de valeur que l'art. 538. Rien, ni dans leur texte, ni dans l'histoire de leur rdaction, n'autorise faire une diffrence entre ces deux articles. C'est pourtant ce qu'on a fait, on a affirm sans preuve que l'art. 540 ne comptait pas, qu'il fallai chercher le critrium uniquement dans l'art. 538, et alors on s'est livr un curieux travail de dissection du texte de l'art. 538, pour y dcouvrir d'autres conditions que celle de l'affectation de la chose l'utilit publique ; on a cru y voir: 1 Que les dpendances du domaine public ne pouvaient tre en principe que des terrains non btis sous prtexte qu'il y a dans l'article ces mots : et gnralement toutes les portions du territoire franais, etc. Cet argument par trop subtil n'a pas eu beaucoup de succs. Et d'ailleurs tout le monde est bien forc d'admettre qu'il y a des constructions bties parmi les dpendances du domaine public, au moins lorsqu'elles sont titre d'accessoires sur des terrains, exemple: gares de chemins de fer; murs de soutnement, quais, etc. 2 Que les dpendances du domaine public ne pouvaient tre que des choses insusceptibles de proprit prive par leur nature mme, comme les rivages de la mer, les fleuves, etc, mais que les btiments publics ressemblaient trop des btiments privs, qu'on ne pouvait pas admettre qu'un pur acte administratif comme l'affectation changet leur caractre. Cette prtention est encore singulire. Voici par exemple un chemin rural. Rien ne ressemble un chemin priv comme un chemin rural, et cependant un arrt de reconnaissance de la commission dpartementale va le faire tomber dans le domaine public. (L. 20 aot 1881.)
DPENDANCES LE DOMAINE PUBLIC.
501
3 Que les dpendances du domaine public ne pouvaient tre que des choses consacres l'usage direct du public, et non pas des choses affectes un service public. On oublie toujours l'art. 540 qui nous donne l'exemple d'une chose affecte un service public. Et puis, quelle source de difficults inextricables que cette distinction. Un muse est affect un service public, n'est-il pas en mme temps affect l'usage du public, et le conoit-on sans cela? De mme une bibliothque, de mme un palais de justice, etc., etc. Ainsi on part d'une distinction arbitraire entre l'art. 538 et l'art. 540, et les consquences auxquelles on aboutit, en interprtant judaquement l'art. 538 pris isolment, se rfutent d'elles-mmes. Consquence : il faut prendre dans leur ensemble les art. 538 et 540, et les deux articles exigeant simplement l'affectation de la chose l'utilit publique, donnant d'ailleurs, propos des forteresses, un exemple de btiments affects un service public, suffisent montrer que la loi elle-mme a voulu faire entrer dans la catgorie des dpendances du domaine public, tous les btiments affects un service public. C. Le systme que nous soutenons rsiste donc facilement toutes les attaques. Il concorde avec l'ensemble des textes. Il a quelque chose d'minemment rationnel,car il est satisfaisant pourl'esprit que l'affectation d'une chose l'utilit publique produise toujours et partout les mmes rsultats. Il est simple. Enfin il n'entraine aucun inconvnient pratique. Comment se fait-il alors qu'il ne soit pas plus gnralement accept dans le monde administratif ? Cela tient, croyons-nous, deux raisons: 1 A ce que l'opinion, qui classe les dpendances du domaine public parmi les res nullius, est trs rpandue. Une erreur en entraine une autre. On rpugne dclarer que toute cette masse de btiments deviennent des res nullius. Si l'on admettait comme nous, que les dpendances du domaine public restent objets de proprit, on hsiterait moins augmenter la quantit de ces dpendances, et l'on comprendrait la porte du dcret du 24 mars 1852, qui dit que l'affectation d'un immeuble un service public n'altre en rien son caractre domanial. 2 A des habitudes d'esprit entretenues par la pratique administrative; l'administration des domaines, en effet, continue considrer les btiments de l'tat affects aux services, comme des dpendances du domaine priv. (Instr. du 1er avr. 1879, n 2618.) Limites du systme. Deux limites apparaissent immdiatement, au systme qui place dans le domaine public tout btiment affect un service public.
502
LES DROITS DOMANIAUX DE PUISSANCE PUBLIQUE
1 Il faut que le btiment soit vraiment affect un service public. a) Il faut qu'il soit affect par une dcision administrative, il nesuffirait pas qu'il ft utilis en fait; nous verrons plus loin les rgles de l'acte d'affectation; ) Il faut que ce soit un service public, par consquent un btiment dont la jouissance aurait t consacre un tablissement d'utilit publique ne remplirait pas les conditions. 2 Il faut que le btiment soit la proprit d'une personne administrative susceptible d'avoir un domaine public. S'il est la proprit d'un tablissement public, il ne sera pas dpendance du domaine public, car il n'est pas admis que les tablissements publics aient un domaine public. Il y a peut-tre l quelque chose d'arbitraire. La notion de l'tablissement public s'est certainement dveloppe depuis le Code, et cela pourrait entraner un dveloppement correspondant de la thorie du domaine public. La question n'a d'ailleurs pas beaucoup d'intrt pratique, parce que la plupart des difices, o sont logs les services des tablissements publics, appartiennent d'autres personnes administratives. Ainsi les hpitaux appartiennent en gnral aux communes, les asiles d'alins aux dpartements, etc. A plus forte raison, lorsqu'un service est log dans un btiment appartenant un particulier et lou par la personne administrative, ne peut-il pas tre question de domaine public. En dehors de ces deux limitations nous n'en voyons point d'autre, et notamment il n'y a pas de raison pour carter la domanialit publique, dans le cas trs frquent o un btiment est la proprit d'une personne administrative, et est affect aux services d'une autre. Beaucoup de services de l'tat sont ainsi logs. Les facults, les casernes, les htels des postes, sont en gnral des btiments municipaux et sont affects un service d'tat. Il en est de mme de toutes les maisons d'cole. Les palais de justice sont des btiments dpartementaux et sont affects un service d'tat, etc., etc. Ce serait se lancer dans des difficults inextricables, que de vouloir faire le triage des btiments qui sont ainsi fournis par une personne une autre. Certains auteurs ont mis cette restriction au systme, nous ne pouvons les approuver. Il suffit pour qu'il y ait domanialit publique : 1 qu'il y ait affectation un service public; 2 que le btiment soit la proprit d'une personne administrative susceptible d'avoir un domaine public. N 3. numration des principales dpendances du domainepublic. Le domaine public de l'tat. de 371. Domaine public l'tat est d'ordinaire divis, d'aprs les diverses administrations qui
DOMAINE PUBLICDEL'TAT
503
en ont la garde et la surveillance, en domaine public maritime, domaine public militaire, domainepublic des ponts et chausses ; il y faut ajouter un domainepublic monumental, puisque nous admettons que les btiments affects un service public en font partie. Cette expression, d'ailleurs, a dj t employe1. A cette division qui est tout fait administrative, nous en prfrons une autre plus juridique. Il y a des dpendances du domaine public de l'tat qui sont naturelles, en ce sens que l'homme n'intervient pas ncessairement pour les approprier l'usage auquel elles doivent servir. Tels sont les rivages de la mer, les fleuves. Il y a au contraire des dpendances du domaine public qui sont artificielles, en ce sens que c'est l'homme qui les cre ou qui les approprie, telles sont les routes, les canaux, les btiments. Parmi ces dpendances artificielles, il en est qui, par leur importance, mritent d'tre mises part, ce sont les voies de communication. En somme, il y a lieu de distinguer : 1 le domaine public naturel; 2 les voies de communication artificielles; 3 les btiments et les terrains affects un service public. Cette distinction est juridique, parce qu' elle se rattachent des rgles diffrentes dans la matire de l'affectation et de la dlimitation. A. Domaine public naturel de l'tat. 1 Lesrivages de la mer. Le rivage de la mer est la bande de terrain que la mer laisse dcouvert mare basse et qu'elle recouvre mare haute. Le rivage n'est pas dtermin de la mme faon le long de l'Ocan et le long de la Mditerrane. Pour l'Ocan, on applique l'ordonnance de 1681, tit. VII, art. 1er, livre IV : Tout ce que la mer couvre et dcouvre pendant les nou velleset pleines lunes, et jusqu'o le plus grand flot de mars se peut tendre sur la grve. Pour la Mditerrane, o il n'y a point de mares, on applique la loi 112 au D. de V. S. litus publicum est eatenus qu maxime fluctus exstuat. (V. aussi 1. 96 eod. titul.) La diffrence est donc, que pour l'Ocan, il faut combiner le plus grand flot de mars avec les mares des pleines et nouvelles lunes, tandis que pour la Mditerrane il faut tenir compte seulement du plus grand flot d'hiver. Le rivage de la mer est interrompu l'embouchure des fleuves ; il remonte un peu dans leur estuaire car la mer elle-mme y remonte, mais il arrive un point o la rive du fleuve doit succder au rivage. Ce point est assez dlicat fixeret cela constitue une difficult de la dlimitation des rivages que nous aurons examiner. 1. M. Gaudry. Trait du domaine, nos 267, 268,269.
504
DE PUISSANCE LES DROITS DOMANIAUX PUBLIQUE
Le rivage de la mer est interrompu encore par les ports, havres et rades. Mais ce sont tout simplement l des morceaux du rivage luimme, qui peuvent tre soumis un rgime diffrent selon qu'ils sont ports de guerre ou ports de commerce. Les premiers dpendent du ministre de la marine, les seconds du ministre des travaux publics. L'tendue du domaine public yest fixe d'aprs les mmes rgles que pour le rivage. Aux colonies, les rivages de la mer sont galement dpendance du domaine public de l'tat. Il y a en outre une bande de terrain superpose au rivage ; elle est large de cinquante pas quivalant 80 mtres, on l'appelle les cinquante pas du roi ou les cinquante pas gomtriques; elle tait primitivement destine faciliter la dfense des ctes des les. (V. D. 21 mars 1882.) Il ne faut pas confondre avec les rivages de la mer, leslais et relais qui sont des parties d'ancien rivage dclasses. La mer est toujours en mouvement et modifie le dessin de ses ctes constamment; l o elle ronge la cte, le rivage s'avance dans les terres, mordant sur la proprit prive et l'absorbant. L o elle se retire, le rivage se retire avec elle, mais les riverains ne s'emparent pas de l'ancien rivage, celui-ci tombe dans le domaine priv de l'tat sous le nom de lai ou relai, et il est en gnral vendu. L'art. 538 C. civ. a donc tort de ranger les lais et relais parmi les dpendances du domaine public, tout le monde reconnat que c'est une erreur. Les riverains dela mer sont moins bien traits que les riverains des fleuves; d'abord, leurs terrains ne vont pas jusqu' la mer, puisque le rivage est interpos, ensuite ils ne profitent pas des alluvions ni des dplacements lents de la mer, tandis que les riverains des fleuves profitent de ces phnomnes. (Art. 557. C. civ.) Les rivages de la mer se dveloppent sur les ctes de France sur une longueur de 2 500 kilomtres. 2 Fleuves et rivires navigables et flottables. La navigabilit n'est autre chose que l'aptitude physique et matrielle d'un cours d'eau la navigation, que cette aptitude soit naturelle ou artificielle. A la navigabilit, l'art. 538 C. civ. assimile le flottagepar trains ou radeaux, mais non le flottage bches perdues. (Avis Cons. d'tat 21 fvr. 1822, 1. 15avr. 1829.) Le fleuve fait partie du domaine public, pris comme fleuve, dans son ensemble d'eau courante et de lit Pour dterminer l'tendue du lit du fleuve, dfaut de texte, la jurisprudence a adopt la rgle du droit romain : ripa ea putatur esse qu plenissimum flumen continet, c'est--dire : tout le terrain que couvrent les eaux leur plus haut doint d'lvation dans l'habitude de leurs cours et sans dbordement.
DOMAINE PUBLICDE L'TAT
505
(Cass. 8 dc. 1863.) Nous verrons, propos de la dlimitation, que cela n'est pas toujours facile dterminer. Les les, lots, atterrissements qui se formentdans le lit des fleuves et rivires navigables et flottables, appartiennent aussi l'tat, mais tombent dans son domaine priv, par consquent sont alinables et prescriptibles. (Art. 560, C. civ.) La France possde environ 8,000 kilomtres de rivires navigables et 9,000 kilomtres de rivires flottables train et radeau. B. Voies de communication. 1 Les canaux de navigation, qui sont la proprit de l'tat, font partie de son domaine public. Ils en font partie avec leurs francs-bords, leurs chemins de halage, leurs cluses, les ponts qui servent les franchir, moins que ces ponts ne se trouvent dans le parcours des voies appartenant au domaine public dpartemental ou communal. La navigation sur les canaux est affranchie de toute taxe depuis la loi du 19 fvrier 1880 portant suppression des droits de navigation intrieure, moins que les canaux ne soient concds. La France possde environ 5,000 kilomtres de canaux. Les canaux d'irrigation et les canaux de desschement appartenant l'tat sont aussi considrs comme des dpendances du domaine public. 2 Les chemins, routes et rues la charge de l'tat. a) Cela comprend en premier lieu les routes nationales et les rues desvilles, bourgs ou villages qui leur font suite. Ces routes partent de Paris et se rendent, soil la frontire, soit un grand port maritime. Un dcret du 16 dcembre 1811 les divise en trois classes, mais il n'y a pas d'intrt juridique cette division. Ces routes ont un dveloppement de 38,000 kilomtres. On peut valuer leur prix de revient 1,300 millions, et leur entretien annuel 30 ou 40 millions. b) Cela comprend en second lieu les cheminsde fer d'intrt gnral, qu'ils soient construits et exploits par l'tat, ou bien qu'ils soient construits et exploits par des compagnies concessionnaires. Les compagnies n'ont que l'exercice d'un droit de jouissance sur la voie, une possession prcaire; elles n'ont pas un vritable droit rel. La domanialit publiquedes chemins de fer entrane, non seulement celle de la voie, mais aussi celle de tous les btiments qui servent l'exploitation; et cela, mme dans le systme des auteurs qui cartent en principe les btiments du domaine public. Cela tient ce qu'ici les btiments sont considrs comme l'accessoire du sol. Et il n'y a point de distinction faire entre les diffrents btiments, moins que l'on ne puisse estimer que la proprit en appartient plutt la compagnie qu' l'tat (ateliers d'ajustage, forces ou autres).
506
LES DROITSDOMANIAUX DE PUISSANCE PUBLIQUE
Le rseau des chemins de fer d'intrt gnral en exploitation atteint 33,000 kilomtres. Le cot peut en tre valu 12 milliard, les recettes nettes 500 millions. C. Les btiments et terrains affects aux services publics. Les citadelles, forteresses et fortifications sont ranges, par l'art. 540, dans le domaine public de l'tat. Elles y sont, avec toutes leurs dpendances, telles qu'elles sont numres dans la loi des 8-10 juillet 1791, titre Ier, art. 13, remparts, parapets, chemins couverts, fosss, glacis, etc. Les glises cathdrales et mtropolitaines, les palais nationaux, les ministres, les hpitaux nationaux, les grandes coles, les manufactures de l'tat et gnralement tous les btiments qui sont la proprit de l'tat, et qui sont en mme temps affects un service public, sont dpendances du domaine public de l'tat. Le domaine pu372. Domaine public dpartemental. blic dpartemental ne comprend que des dpendances artificielles et elles ne sont pas trs nombreuses : 1 Les routes dpartementales et les chemins de fer dpartementaux. Le premier fonds de ces routes a t constitu par le dcret du 16 dcembre 1811 qui a abandonn aux dpartements une partie des anciennes routes royales. Ce fonds s'est augment depuis. En 1882, on comptait 33,691 kilomtres de routes dpartementales; leur largeur moyenne est de 12 mtres; elles ont cot prs de700 millions et leur entretien cote 9 10 millions. L'histoire des routes dpartementales aura t assez curieuse en ceci, qu'aprs avoir t en 1811 donnes par l'tat aux dpartements, et avoir contribu ainsi faire admettre la personnalit morale de ceux-ci (V. p. 226), finalement elles seront repasses par les dpartements aux communes. Nous savons, en effet, qu'il y a actuellement un grand mouvement pour dclasser les routes dpartementales et les transformer en chemins vicinaux. Le dclassement a dj t opr par les conseils gnraux dans quarante-cinq dpartements et bientt sans doute les routes dpartementales auront disparu. Les routes dpartementales seront remplaces dans le domaine public des dpartements par les chemins de fer dpartementaux, chemins de fer voie troite en gnral, dont la cration a t dcide par beaucoup de dpartements en vertu de la loi du 11 juin 1880. (V. art. 11.) 2 Les btiments affects. Tous les btiments qui appartiennent au dpartement, et qui sont affects un service public, sont des dpendances du domaine public dpartemental. Sont dans cette catgorie, d'abord un certain nombre de btiments
DOMAINE PUBLICCOMMUNAL
507
lont l'tat avait fait cadeau au dpartement dans le dcret du 9 avril 811 : difices et btiments nationaux actuellement occups par e service de l'administration, des cours et tribunaux , donc, les tels des prfectures et sous-prfectures, les palais de justice. Enuite des btiments que les dpartements sont obligs de fournir, omme les vchs, les asiles d'alins, les coles normales primaires. Le domaine public communal. 373 Domaine public communal ne comprend, lui aussi, que des dpendances artificielles. 1 Chemins et voies de communication. Le domaine public communal peut comprendre de ce chef, des chemins vicinaux, des chemins ruraux, des rues, places et jardins de ville, avec tout ce qui fait corps,comme les colonnes, les grilles, les statues, les becs de gaz, etc. ; des chemins de fer, des canaux. Les chemins vicinaux et les chemins ruraux demandent des dveloppements particuliers. a) Chemins vicinaux. Les chemins vicinaux sont ceux qui font communiquer entre eux les chefs-lieux de communes et les gros hameaux. Juridiquement, ce sont ceux qui ont t classs comme tels (par les autorits comptentes. De plus, toute rue qui est reconnue Hans les formes lgales tre le prolongement d'un chemin vicinal, en sait partie intgrante (1. 8 juin 1864. Il y en a trois catgories : les chemins de grande communication, les chemins d'intrt commun et les chemins ordinaires. Suivant leur catgorie, ces chemins ont une sargeur diffrente qui est fixe dans chaque dpartement par le conseil gnral ou par la commission dpartementale. La cration du rseau des chemins vicinaux date de la loi du 21 mai 1836. La construction, activement pousse grce de larges subventions de l'tatet des dpartements, est actuellement presque achee, et c'est assurment une des uvres les plus utiles accomplies en ce sicle. On en compte 600,000 kilomtres. La dpense de premier tablissement doit tre value plus de trois milliards, l'entretien annuel absorbe une centaine de millions. Nous avons vu ailleurs (p. 178) que le service des chemins vicinaux de grande communication et d'intrt commun est dpartemental. Au point de vue juridique, les chemins vicinaux sont intressants cpar plusieurs particularits : D'abord, parce que, lorsqu'il s'agit de leur largissement, l'expropriation des terrains se fait d'une faon simple, par arrt du conseil gnral ou de la commission dpartementale. (Art. 15,1. 21 mai 1836.) De plus, parce qu'ils sont dots de ressources spciales, centimes sp-
508
LES DROITSDOMANIAUX DE PUISSANCE PUBLIQUE
ciaux et prestations, qui ont assur leur construction, mais qui deviennent moins utiles maintenant qu'il n'y a plus qu' les entretenir: (V.1. 21 mai 1836; 1. 24 juillet 1867 ;1. 11 juillet 1868, et pour l'impt des prestations n 441.) b) Chemins ruraux. Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affects l'usage du public et qui n'ont pas t classs comme chemins vicinaux. Ainsi les dfinit la loi du 20 aot 1881, qui est venuergler la situation de ces chemins jusquel un peu dlaisss. Au fond, il n'y a pas de diffrence de nature entre les chemins ruraux et les chemins vicinaux; seulement, comme ils paraissent moins indispensables que les autres, les communes n'ont pas engag les procdures ncessaires pour les faire classer comme vicinaux, et ne se sont pas procur les ressources ncessaires leur rfection. Avant la loi du 20 aot 1881, la condition juridique de ces chemins tait douteuse, on hsitait les faire tomber dans le domaine public de la commune. Cette loi a pos les rgles suivantes: Il y a deux catgories de chemins ruraux: 1 ceux qui ont t l'objet d'un arrt de reconnaissance pris par la commission dpartementale aprs les formalits de l'art. 4 et qui sont dpendance du domaine public (art. 6); 2 ceux qui, sans avoir t l'objet d'un arrt de reconnaissance, sont cependant certainement la proprit de la commune; ceux-l sont dans le domaine priv (art. 3 et 6). La question de proprit est tranche par les tribunaux ordinaires, mais il y a prsomption au profit de la commune lorsqu'il est constat administrativement que le chemin est affect l'usage du public. Cette constatation se fait en suivant les rgles de l'art. 2; il faut s'attacher la destination du chemin jointe l'un des deux faits suivants: le fait d'une circulation gnrale et continue, ou bien des actes ritrs de surveillance et de voirie de l'autorit municipale. La prsomption au profit de la commune admet, d'ailleurs, la preuve contraire. (Art. 3.) Ressources des chemins ruraux. La commune pourvoit l'entretien des chemins ruraux reconnus, dans la mesure des ressources dontelle peut disposer. En cas d'insuffisance des ressources ordinaires, les com munes sont autorises pourvoir aux dpenses des chemins ruraux reconnus, l'aide soit d'une journe de prestation, soit de centimes extraordinaires en addition au principal des quatre contributions di rectes. (Art. 10, 1 et 2. L. 1881; L.5 avril 1884, art. 141 et suiv.) Il peut aussi y avoir des subventions industrielles (art. 11) et des souscriptions volontaires (art. 12). Enfin, lorsque la commune n'excute pas des travaux rgulirement autoriss ou cesse d'entretenir le chemin, les
DOMAINE PUBLICCOMMUNAL
509
propritaires intresss peuvent se constituer en syndicats pour faire eux-mmes les travaux. (Art. 19 et s.) 1 Btiments affects. Le domaine public communal peut contenir de ce chef des objets nombreux. Dans les communes rurales, il y aura: a) l'glise, qui est bien une proprit communale, c'est aujourd'hui universellement admis (Av. Cons. d't., 2 pluvise an XIII), et qui est de plus une dpendance inconteste du domaine public; b) le presbytre, condition qu'il soit la proprit de la commune; ceci n'est pas gnralement admis, mais c'est une consquence de notre opinion sur les btiments affects; c) le cimetire; on range assez gnralement le cimetire dans les dpendances du domaine public. Quelques auteurs s'y refusent, cependant, sous le prtexte que dans le cimetire il est fait des concessions de terrain perptuelles qui constituent de vritables alinations, et que cela est incompatible avec la nature du domaine public inalinable. Nous verrons plus loin (n 399), propos des concessions sur le domaine public, que les concessions dans les cimetires n'ont pas la porte qu'on leur attribue1 ; d) la mairie et la maison d'cole, condition que ces btiments appartiennent la commune et ne soient point pris en location2 ; e) la halle ou le march couvert. Dans les villes, il y aura, en outre, ou pourra y avoir: a) Les casernes et tous les btiments affects l'instruction publique, facults, lyces, collges, etc., soit qu'ils aient t donns aux villes par l'tat (D. 9 avril 1811), soit qu'ils aient t btis depuis par les villes en vertu de conventions avec l'tat, de mme les htels des postes et tous les autres btiments fournis aux services d'tat. b) Les btiments fournis aux tablissements publics : hpitaux, hos1. Toute commune doit avoir un cimetire; il doit tre une certaine distance des maisons d'habitation (D. Le 23 prairial an XII; O. 6 dcembre 1843). prfet a le pouvoir d'ordonner la translation d'un cimetire trop rapproch deshabitations, aprs avoir pris l'avis du conseil municipal, mais sans tre oblig de s'y conformer.Ce pouvoir ne lui a pas t enlev par la loi du 5 avril 1884. (Arr. Cons. d't. 11 dcembre 1891.) 2. Toute commune doit avoir au moins une maison d'cole publique. Selon la population, cette coleest mixte, ou bien il ya cole spare pour les filles et les garons. De plus, une cole de hameau est obligatoire dans les centres d'habitations runissant au moins vingt enfants d'ge scolaire et distants d'au moins 3 kilomtres d'une autre cole. (L. 20 mars 1883, art. 8.) Enfin, mme en dehors des conditions prcdentes, le conseil dpartemental peut imposer une cole dans un hameau. (L. 30 octobre 1886,art. 13; Arr. Cons. d't. 11 dcembre 1891.)L'tat donne de fortes subventions pour la construction des maisons d'cole et gnralement aussi le dpartement.
510
DE PUISSANCE LES DROITSDOMANIAUX PUBLIQUE
pices, maisons de secours, condition qu'ils soient la proprit de la commune. c) Les btiments qui sont affects des services municipaux : thtres, casernes de sapeurs-pompiers, postes de police, muses, bibliothques, etc. d) Les eaux de la ville, toutes les conduites qui servent les amener, les aqueducs, chteaux d'eau, machines lvatoires, filtres, etc. Ce qu'il y a de trs particulier ici, c'est que le domaine public de la commune peut s'tendre hors du territoire de la commune; il arrive souvent, en effet, queles aqueducs vont chercher les eaux de trs grandes distances. Le domaine des Domaine colonial. public colonies, public et priv, a t constitu par les ordonnances du 26 janvier et du 17 aot 1825, qui concdaient aux colonies certaines proprits domaniales de l'tat. Les colonies, interprtant largement ces textes, ont continuellement empit sur le domaine de l'tat. Dans la plupart des colonies, il ne reste plus l'tat que certains objets formellement rservs par ces ordonnances, comme les fortifications, les btiments militaires et les cinquante pas du roi avec le rivage de la mer, de telle sorte que, outre le domaine artificiel, les voies de communication, les btiments affects aux services publics, etc., les colonies ont un domaine public naturel, les cours d'eau. Il n'y a mme point faire comme en France la distinction de ceux qui sont navigables ou de ceux qui ne le sont pas. Tous sont dpendance du domaine public.! 374. 3. LESDROITS LE DOMAINE PUBLIC QUECONTIENT dsaffectation. Classement, dclassement.
Art. 1er. Affectation,
375. L'affectation est l'vnement qui donne une chose appartenant une personne administrative la qualit de dpendance du domaine public; la dsaffectation est l'vnement qui fait perdre une chose la qualit de dpendance du domaine public, et la fait retomber dans le domaine priv. Ces vnements sont tantt des faits matriels, tantt des dcisions de l'autorit administrative. Il ya lieu d'ailleurs, ce pointde vue, de mettre part les dpendances naturelles du domaine public, et parmi les dpendances artificielles, de distinguer entre les voies de communication et les btiments. 376. A. Affectation et dsaffectation des rivages de
DOMAINE PUBLIC. AFFECTATION
511
Les rivages de la mer sont affects la mer et des fleuves. par le fait matriel que la mer les couvre et dcouvre alternativement. [Donc si la mer se dplace, un nouveau rivage est affect, et l'ancien rivage est dsaffect par le fait mme. Si la mer se dplace en se retirant des ctes, l'ancien rivage dsaftfect se trouve en terre ferme, nous savons qu'il tombe dans le domaine priv de l'tat sous le nom de lai ou relai; il est en gnral vendu soit l'amiable, soit par adjudication, et les riverains n'ont point de droit de premption. Si la mer se dplace en rongeant les ctes, le rivage s'enfonce dans les terres sans qu'il y ait droit aucune indemnit pour les riverains dpossds, l'ancien rivage dclass est alors couvert par les eaux. L'affectation ou la dsaffectation du rivage ne donnent lieu par ellesmmes aucun acte administratif; mais il y a lieu de constater les limites du rivage, telles que les faits matriels les ont dtermines, c'est l'objet de l'opration administrative de dlimitation. (N 379.) Les fleuves et rivires navigables et flottables sont galement affects par le fait matriel de la navigabilit ou du flottage. Peu importe que ce fait soit naturel ou qu'il soit la consquence de travaux publics entrepris pour amliorer le cours d'eau. La loi du 15 avril 1829 sur la pche fluviale, dans son art. 3, dispose que les cours d'eau navigables et flottables seront dtermins par des dclarations de navigabilit rendues par dcret aprs enqute. En effet, des dclarations de navigabilit ont t faites, mais il faut considrer que ces actes del'autorit administrative ne crent point la domanialit publique, ils ne font que la constater et leur utilit est de servir de point de dpart une vritable expropriation du droit de pche des riverains. Quant au lit du fleuve, il est affect au fleuve par le fait matriel du niveau des plus hautes eaux avant tout dbordement, sauf procder une dlimitation. (N 379.) Nous savons que les alluvions et les dplacements insensibles profitent aux riverains (art. 556 et 557 C. ci v.). Si le fleuve se forme un nouveau cours en abandonnant son ancien lit, les propritaires des fonds nouvellement occups prennent titre d'indemnit l'ancien lit abandonn, chacun dans la proportion du terrain qui lui a t enlev (l'art. 563); mais si partie du lit du fleuve est mise sec par des travaux publics, la proprit en reste l'tat et tombe dans le domaine priv. (Cass. 7 avril 1868.) 377. B. Classement et dclassement des voies de Pour les voies de communication. communication, l'affecta-
512
LES DROITS DOMANIAUX DE PUISSANCE PUBLIQUE
tion et la dsaffectation prennent le nom de classement et de dclassement. Le classement et le dclassement rsultent d'actes de l'autorit administrative. Nous verrons plus loin, pour chaque voie publique, quelles sont ces autorits. a) Effets du classement. Le classement peut intervenir dans : 1 La voie publiquen'existe pas encore, deux hypothses diffrentes il s'agit de la crer; l'acte de classement suivi du trac va servir de point de dpart aux procdures d'expropriation pour cause d'utilit publique, et aux oprations de travaux publics ncessaires la construction du chemin; l'affectation ne sera rellement effectue que lorsque le chemin sera construit et livr la circulation. Ici, un fait matriel vient se joindre la dcision administrative1. 1 La voie publique prexiste, c'est un chemin dj frquent par le public, mais qui n'a encore t plac dans aucune des catgories administratives; ou bien c'est un chemin dj class dans une catgorie infrieure, que l'on classe dans une catgorie suprieure, par exemple un chemin rural que l'on classe comme vicinal. Dans la premire hypothse, le classement a pour effet immdiat de faire tomber le chemin dans le domaine public; c'est ce qui arrive depuis la loi de 1881 pour le chemin rural qui est l'objet d'un arrt de reconnaissance. Dans la seconde hypothse, le chemin tant dj dans le domaine public, change seulement de catgorie. Le classement d'un chemin tant toujours accompagn d'un trac o est indique la direction du chemin et aussi sa largeur, lorsqu'il s'agit d'un chemin prexistant, le classement peut entraner soit un largissement du chemin, soit des redressements. En principe, ces largissements et ces redressements peuvent tre oprs par la voie de l'alignement dont il sera parl plus loin n 381, le trac du chemin constituant un vritable plan d'alignement. Ils peuvent aussi tre oprs par expropriation. Droits de premption. Le dclasdu dclassement. b) Effets sement d'une voie de communication peut tre total ou partiel. Le dclassement total est en gnral accompagn d'un reclassement dans une catgorie infrieure, c'est ainsi que les conseils gnraux dclassent en ce moment les routes dpartementales et les reclassent comme chemins vicinaux de grande communication. Un dclassement de ce genre peut tre accompagn, bien que ce ne soit pas ncessaire, d'un rtrcissement de la voie. La partie retranche tombe alors dans le 1. Le trac servira aussi de plan d'alignement pour toutes les constructions bties en bordure de la voie.
DOMAINE PUBLIC. CLASSEMENT
513
domaine priv et devient alinable. Le dclassement est partiel, lorsque, par suite d'une rectification du chemin, une section de l'ancienne voie est devenue inutile la circulation. La portion dclasse tombe alors galement dans le domaine priv. Dans tous ces cas o une portion de voie publique est dclasse, soit par suite d'un rtrcissement de la voie, soit par suite d'une rectification, la portion dclasse doit tre aline1. Au moment de l'alination se pose la question du droit de premption des riverains. Les riverains n'ont-ils pas le droit d'exiger que ce terrain leur soit vendu par prfrence tout autre? Les raisons d'quit ne manquent pas pour justifier ce droit de premption: 1 En supprimant la voie publique on supprime un droit d'accs qu'avaient les riverains, leurs fonds se trouvent maintenant isols, on leur doit une compensation ; 2 le sol de la voie avait probablement autrefois fait partie des fonds riverains, il est naturel qu'il y retourne; 3 au point de vue de la culture, il est mauvais de trop multiplier les parcelles, il vaut mieux runir les portions dclasses des fonds dj constitus, que d'en faire des parcelles nouvelles. Ces raisons d'quit n'auraient point suffi crer de toutes pices le droit de premption. Mais comme des textes l'ont tabli pour certaines voies publiques, elles peuvent servir l'tendre aux autres. Le droit de premption est tabli propos du dclassement des routes nationales par la loi du 24 mai 1842, propos du dclassement des chemins vicinaux par l'art. 19 de la loi du 21 mai 1836; propos des rues et places des villes, lorsque des terrains ont t retranchs en vertu de plans d'alignement rgulirement approuvs, 1. 16 sept. 1807, art. 53; propos du dclassement des chemins ruraux par la loi du 20 aot 1881, art. 17. Il est tendu sans difficult par la pratique administrative au dclassement des routes dpartementales. Il est tendu aussi aux portions retranches du lit des fleuves la suite de travaux publics. 1. Nous ne traitons pas la question de savoir au profit de quelle personne administrative est faite l'alination; certaines hypothses sont dlicates. Il y a des formalits pour ces alinations. A remarquer celle qui a t introduite dans la loi du 20 aot 1881sur les chemins ruraux. Lorsqu'un chemin rural est dclass, la loi tablit avant la vente certains dlais destins permettre la formation d'un syndicat de propritaires. Si ce syndicat se forme et se charge d'assurer l'entretien, le chemin est maintenu (art. 16). Faon originale d'organiser un contrle de l'administration municipale. H. 33
514
LES DROITS DOMANIAUX DE PUISSANCE PUBLIQUE
Mais le droit de premption n'est tendu, ni aux terrains retranchs des chemins de fer, ni ceux retranchs des canaux de navigation, parce que sur ces voies-l, les riverains n'avaient pas de droit d'accs, et que, par consquent, il n'y a pas lieu de les indemniser. On voit que l'administration se place uniquement au point de vue de la premire raison que nous avons donne pour justifier le droit de premption. Mais alors, pour tre logique, elle devrait admettre ce droit sur les lais et relais de la mer, car les riverains avaient bien un droit d'accs sur le rivage. La raison que l'on peut invoquer pour carter le droit de premption ici, c'est que les lais et relais sont parfois tropconsidrables, pour tre considrs comme un accessoire des fondsriverains. Pour les formalits de la premption, il faut voirles textes. Chacun des riverains prend le terrain en droit soi, c'est--dire dans une direction perpendiculaire l'axe de la route. a) Autorits qui procdentau classement et au dclassement. En principe, c'est la mme autorit qui procde au classement et au dclassement. Routesnationales. Elles sont classes et dclasses par un dcret en Conseil d'tat. (D. 16dc. 1811.) Par exception, lorsqu'il s'agit de la cration d'une route toute nouvelle, il faut une loi. (D. 1811, art, 4; loi 27 juill. 1870, art. 1er.) Routes dpartementales. Elles sont classes et dclasses par le conseil gnral du dpartement (art. 46, 6, 8, loi 10 aot 1871). Les dcisions du conseil gnral sur ce point sont de la catgorie desdcisions dfinitives. Elles sont prcdes d'une enqute en la forme de celle qui prcde la dclaration d'utilit publique en matire d'expropriation. (L. 20 mars 1835; D. 13 nov. 1878.) Chemins vicinaux, Le conseil gnral statue dfinitivement sur le classement et le dclassement des chemins vicinaux de grande communication et d'intrt commun; la commission dpartementale sur le classement des chemins vicinaux ordinaires (1. 10 aot 1871, art. 46-7 et 86.) Le tout aprs avis des conseils municipaux des comen outre, fixation de la lardcisions Ces intresses. portent, munes geur. ici le arrts de classement, portent qui Les ruraux. Chemins nom d'arrts de reconnaissance, sont pris par la commission dpardu conseil muniavis du sur la aprs prfet, tementale, proposition dans les mmes est dclassement Le opr et aprs enqutes. cipal formes. (L. 20 aot 1881, art. 4 et 16.) Rues et places. Le conseil municipal dlibre, sauf approbation le le redressement, le dclassement, le sur classement, prfectorale
PUBLIC. CLASSEMENT DOMAINE
515
prolongement, l'largissement, la suppression des rues et places publiques. (L. 5 avr. 1884, art. 68-7e.) Il convient d'ajouter que le caracttre des rues et places publiques peut se trouver tabli aussi par un usage prolong. (Cass. 13 juill. 1861.) des btiments et dsaffectation 378. C. Affectation Il y a lieu de poser I. aux services Affectation. publics. les rgles sui vantes: 1 L'affectation rsulte d'un acte de l'autorit administrative, mais rour entraner la domanialit publique, cet acte doit tre suivi d'une prise de possession effective par le service affectataire. 2 Lorsque l'difice est bti la suite d'une expropriation qui a ncessit une dclaration d'utilit publique, il n'est pas besoin d'un autre acte administratif pour entraner l'affectation. Celle-ci est dj implique en effet dans la dclaration d'utilit publique; on exproprie toujours pour un objet dtermin, pour btir un htel de ville, un march couvert, etc. 3 Lorsqu'il s'agit d'affecter un de ses propres services un difice qui est d'avance dans son domaine, et qui n'est encore affect aucun service, une personne administrative est gnralement capable. Ainsi peut faire la commune, par dcision rglementaire du conseil municipal; ainsi peut faire le dpartement, par dcision dfinitive du conseil gnral. Quant l'tat, ses immeubles sont en principe affects par dcret rendu aprs avis du ministre des finances. (0. 14 juin 1833; D. 24 mars 1852.) 4 Pour les btiments qu'une commune doit fournir un service d'tat en vertu d'une convention, comme les facults, les casernes, les htels des postes, l'affectation a lieu en gnral par dcret. II. Dsaffectation et changement d'affectation. 1 L'affectation tant un acte de puissance publique est toujours rvocable, mme lorsqu'elle a t effectue en excution d'un contrat ou d'une libralit. Si la dsaffectation prononce dans les formes requises, constitue la violation d'un contrat ou des conditions d'une libralit, la question se rglera par des indemnits ou des restitutions. 2 Les personnes administratives ont moins de capacit pour dsaffecter que pour affecter. Ainsi le conseil municipal ne peut prononcer une dsaffectation ou un changement d'affectation, mme pour un service communal, qu'avec l'autorisation du prfet (art. 68, n 5, .1. 5 avr. 1884). Spcialement pour les presbytres, si l'autorit ecclsiastique s'oppose la dsaffectation, il faut un dcret; si elle ne s'y oppose pas, une dlibration du conseil municipal, approuve par le prfet. suffit(O. 3 mars 1825; C. d't. 9 aot 1889). Le conseil gn-
516
LES DROITS DOMANIAUX DE PUISSANCE PUBLIQUE
ral peut prononcer par dcision dfinitive des changements d'affectation toutes les fois qu'il ne s'agit pas des htels de prfecture et de sous-prfecture, des palais de justice, des coles normales, des casernes de gendarmerie et des prisons (art. 46, n 4, l.10 aot 1871). Lorsqu'il s'agit de l'un de ces btiments, les dcisions sont soumises suspension. (Art. 48, n 2.) Bien entendu, si un btiment municipal a t affect par dcret un service d'Etat, il ne peut tre dsaffect que par dcret. 3 L'affectataire n'est qu'un dtenteur de la chose d'autrui; moins de stipulation contraire, il est non-recevable rclamer des indemnits pour impenses, amliorations ou constructions. (Cour de Paris, 23 avril 1891.) Observation. En dehors des btiments affects un service public, il peut y avoir des btiments affects un usage d'utilit publique et concds ainsi des tablissements privs ecclsiastiques ou civils ; par exemple, un btiment peut avoir t concd par une commune un tablissement des frres de la doctrine chrtienne. Ces affectations ne font point tomber l'difice dans le domaine public, elles constituent une forme de subvention; dans ce cas, au moins lorsqu'elle a t faite par une commune, l'affectation peut perdre son caractre de prcarit, et cesser d'tre un acte rvocable; elle peut tre interprte comme une attribution de jouissance faite en vertu d'un contrat, et l'interprtation de l'acte est de la comptence des tribunaux judiciaires (Trib. des confl. 27 dcembre 1879; 13 janvier 1883; 17 juin 1887; 12 juill. 189U). Si la dsaffectation peut tre prononce, elle doit l'tre dans la mme forme que l'affectation. (Art. 167,l. 1884.) Art. 2. Dlimitation No 1. Dlimitation et alignement.
des rivages de la mer et desfleuves.
Cette matire comprend la dtermination des limites des dpendances du domaine public, et la protection de ces limites. Il faut distinguer ici encore : 1 les rivages de la mer et les neuves navigables et flottables; 2 les voies de communication; 3 les btiments et terrains affects un service public. Aux premiers correspond la matire de la dlimitation proprement ; aux troisimes une sorte de dite ; aux seconds celle de l'alignement bornage. 379. A. Fixation des limites par la dlimitation.
DOMAINE PUBLIC.DLIMITATION
517
La dlimitation est la fixation des limites des rivages de la mer et des fleuves, telle qu'elle rsulte d'une dcision administrative rendue aprs oprations sur le terrain. L'acte de dlimitation n'est point attributif de proprit, il est purement dclaratif, il s'agit d'appliquer les rgles que nous avons vues au n 371 sur l'tendue des rivages de la mer et des rives des fleuves. La dlimitation ne peut pas par elle-mme empiter sur la proprit prive. Elle constate seulement que les mouvements de la mer ont empit En dehors des limites naturelles, il faut recourir l'expropriation, si l'on veut incorporer quelque parcelle de terrain au rivage ou au fleuve. a) Dlimitation des rivages de la mer. (Dcr.-loi 21 fvrier 1852.) Cette dlimitation donne lieu, aux termes de ce dcret, deux sortes d'actes administratifs diffrents: 1 Des dcrets de dlimitation rendus en forme de rglements d'administration publique; 2 Des arrts de domanialit pris, soit par les prfets maritimes, soit par les prfets de dpartement, et viss par le ministre de la marine. Tout de suite s'lve la question de savoir pourquoi il y a deux actes et quelle est l'utilit de chacun d'eux. L'opinion la plus sage est que les arrts de domanialit ne peuvent intervenir qu'aprs un dcret de dlimitationqui a eu pour objet toute une tendue de rivage, pour appliquer ce dcret telle ou telle parcelle riveraine. Les arrts de domanialit sont ainsi un moyen de faire connatre aux parties intresses la dlimitation telle qu'elle rsulte du dcret; ils ont une utilit comparable celle des alignements individuels, lorsque ceux-ci s'appuient sur un plan gnral d'alignement ou sur l'acte de classement d'un chemin. Un point particulirement dlicat, c'est la question de savoir o s'arrte le rivage de la mer l'embouchure des fleuves, pour faire place la rive du fleuve. Il y a des intrts pratiques : au point de vue de l'administration qui a la police, au point de vue de l'inscription maritime, de la libert de la pche, des alluvions, etc. Divers systmes ont t soutenus, notammerit celui qui fait remonter le rivage de la mer jusqu'au point o le flux se fait sentir dans le fleuve, ce qui est beaucoup trop haut. Le Conseil d'tat a adopt un systme complexe dans lequel on tient : le paralllisme des compte en les combinant des lments suivants rives, le degr de salure de l'eau, la nature fluviale de la vgtation et des atterrissements sur les bords. (Cons. d't. 4 mars 1875-6 mars 1882, baiede la Seine.) b) Dlimitation des fleuves. Les fleuves sont dlimits par ar-
518
LES DROITS DOMANIAUX DE PUISSANCE PUBLIQUE
rt prfectoral. Il n'existe pas de texte spcial, mais cela est par application de la loi des 22 dcembre 1789-8 janvier (Sect. III, art. 2), qui charge les administrations dpartementales d la conservation des proprits publiques. (Trib. confl, 3 juin 17 2850. admi Nous savons qu'on doit appliquer une rgle qui parat simple, attribuer au fleuve tout ce qui est couvert par le plan d'eau le plus lev avant toute inondation. Dans la pratique, la dtermination de et ce plan d'eau donne lieu des difficults cause de la pente du fleuve. On est oblig de procder par chelons, de diviser le fleuve en sections t de dterminer le plan d'eau en prenant le niveau des terrains les plus bas dans chaque section. La consquence de cette faon de procder est que presque jamais le lit du fleuve ne remonte jusqu' la crte des berges, que le plan inclin des berges est trs frquemment la proprit des riverains. (Cons. d't. 24 janv. 1890.) c) Des voies de recours contre les actes de dlimitation. Recours parallles. Il faut remarquer que la dlimitation est un bornage qui n'est pas opr d'une faon contradictoire. Un propritaire riverain peut s'apercevoir aprs coup que cette opration a t mal faite et qu'on a empit sur son terrain. Quelles voies de recours a-t-il sa disposition? Pendant longtemps il a t admis par le Conseil d'tat, que les actes de dlimitation taient des actes d'administration discrtionnaires, qui ne pouvaient point tre annuls sous le prtexte qu'ils empitaient sur la proprit prive. En prsence de cette jurisprudence du Conseil d'tat, la Cour de cassation admettait alors que si l'acte de dlimitation avait rellement empit, cela quivalait une expropriation, et que l'administration devait tre condamne payer une indemnit pour la valeur du terrain. (Cass. 23 mai 1849; 20 mai 1862, etc.) Actuellement, le Conseil d'tat, par un revirement complet, admet le recours pour excs de pouvoirs contre les actes de dlimitation, et il reconnatqu'ils doivent tre annuls lorsqu'ils ont empit sur la proprit prive; par consquent, il reconnat que ces actes ne peuvent ; point entraner d'expropriation indirecte. (Cons. d't. 23 mai 1861 27 mai 1863; 21 juill. 1870, etc.) En prsence de cette nouvelle jurisprudence du Conseil d'tat, il semble tout d'abord que la Cour de cassation et d cesser d'admettre l'action devant les tribunaux judiciaires, qui n'tait plus indispensable pour obtenir justice. Il n'en a rien t cependant, l'action a t maintenue, et mme le tribunal des conflits a approuv ce systme. (Cass., 6 nov. 1872; trib. confl. 11janv. 1873; 1er mars 1873). De telle sorte la devant s'ouvrent voies de recours deux que, actuellement, partie
DOMAINE PUBLIC. DLIMITATION
519
intresse: 1 le recours pour excs de pouvoir qui peut entraner annulation de l'acte et par consquent restitution du terrain; 2 l'action devant le tribunal civil, qui peut aboutir une indemnit paye par l'administration cause de l'emprise du terrain. Le systme de la Cour de cassation et du tribunal des conflits, que l'on peut appeler systme des recours parallles, ne peut plus s'appuyer sur l'ide d'une expropriation indirecte, puisque cette ide est condamne par la jurisprudence actuelle du Conseil d'tat; mais il lui reste une base excellente dans le principe de la sparation des pouvoirs sainement interprt. Les tribunaux judiciaires, en effet, sont gardiens de la proprit prive, au mme titre que les tribunaux administratifs sont gardiens de l'indpendance administrative. Il est vrai de dire qu'un tribunal judiciaire ne peut pas toucher un acte d'administration, mais il est aussi vrai de dire qu'un tribunal administratif ne peut pastre juge d'une question de proprit prive. Les deux tribunaux jugeront donc chacun de son ct; l'un fixera la limite de la proprit publique, l'autre la limite de la proprit prive. Si ces deux limites ne concordent pas, il faudra bien trancher la question par une indemnit pcuniaire. Il y a pour le riverain un avantage trs grand avoir sa disposition l'action civile, car elle ne se prescrit que par trente ans, tandis que le recours pour excs de pouvoir est non recevable au bout de trois mois. Ce systme de deux recours parallles, l'un devant les tribunaux administratifs, l'autre devant les tribunaux judiciaires, lorsqu'un acte administratif a port atteinte la proprit, a une porte trs haute; nous verrons toute sa signification dans la partie du contentieux. de la mer 380. B. Protection des limites des rivages Les entreprises faites sur les rivages de la et des fleuves. mer et sur le lit des fleuves constituent des contraventions de grande voirie. Ces contraventions sont de la comptence du conseil de prfecture. La contravention entrane: 1 le rtablissement des lieux dans l'tat primitif; 2 une amende variable, mais dont le minimum est de 16 francs et qui peut s'lever 50 et mme 300 francs. Donc les riverains doivent bien faire attention respecter la limite de ces dpendances du domaine public, soit qu'ils tablissent des constructions, soit qu'ils tablissent des cltures. Mais il faut bien noter qu'ils ne sont pas tenus demander autorisation pralable quand ils veulent faire des travaux de ce genre; en
520
LES DROITS DE PUISSANCE DOMANIAUX PUBLIQUE
d'autres termes, ils ne sont pas tenus demander alignement individuel. La servitude d'alignement n'existe que trs exceptionnellement le long de certains cours d'eaux. Ils agissent donc leurs risques et prils 1. Cependant, le long du rivage de la mer, il leur est loisible par mesure de prcaution de demander un arrt de domanialit au prfet. N 2. De l'alignement. L'alignement est la fixation des limites du domaine public, au droit des proprits riveraines des voies de communication. La lgislation de l'alignement fournit aussi les moyens de protger ces limites une fois qu'elles sont fixes. ). Des des limites par alignement. Il y a deux espces de plans d'alignement : d'alignement. plans 1 ceux qui existent pour les routes et chemins classs dans des catgories dtermines, tels que routes nationales, dpartementales, chemins vicinaux. Ces plans rsultent des actes portant fixation du trac de la voie, ou bien des actes relatifs l'largissement ou au redressement qui ont pu survenir; ils s'appliquent mme dans la traverse des champs, en dehors des agglomrations bties, par consquent aux maisons isoles2; 2 ceux qui sont dresss dans une ville, ou tout au moins dans une agglomration btie, titre d'opration municipale, dans un but de salubrit, de scurit pour la circulation, et d'embellissement pour la ville. Ces plans municipaux d'alignement peuvent porter sur toute espce de voies; non seulement sur les rues et places qui ne sont classes dans aucune catgorie, qui sont seulement affectes par l'usage, mais sur les voies classes, routes nationales, dpartementales, etc., dans leur traverse de la ville; ils ; ils constituent peuvent tre aussi particuliers telle ou telle voie une dpense obligatoire pour toutes les communes (art. 136, 14, 1. 1884); mais dans la pratique on ne les impose pas aux communes qui ne sont pas des villes. Les formalits sont les suivantes : 1 Ils sont dresss par le service charg de la voie. 381. Fixation 1. Cette doctrine qui rsulte des arrts du Conseil d'tat des 26 juin 1843, 28 juin 1844,19 dcembre 1848,avait t prcde de la doctrine contraire. 2. Il n'est pas admis qu'il y ait en ce sens de plan d'alignement pour les chemins ruraux. Mme depuis la loi du 20aot 1881,et alors mme que des la reconnaissancedu chemin, les limitesne peuplans ont t dresss lors de vent tre modifiesque par expropriation. Il n'y a ni occupationdes terrains nus, ni servitude de reculement.
DOMAINE PUBLIC. ALIGNEMENT
521
2 Le conseil municipal dlibre sur les plans d'alignement des voies municipales. (L. 5 avr. 1884, art. 68, 7.) Le conseil gnral donne son avis pour les traverses des routes dpartementales. (Av. Cons. d't. 15juill. 1879.) Le conseil des ponts et chausses donne son avis pour les traverses des routes nationales. (Circ. minist. 24 oct. 1845.) 3 Ils sont l'objet d'une enqute dans les conditions prescrites par le titre II de la loi du 3 mai 1841. 4 Ils sont homologus par un dcret en Conseil d'tat quand ils concernent les routes nationales et dpartementales, ainsi que les rues, des villes, bourgs et villages qui leur font suite, les rues de Paris et les chemins de fer. Par arrt prfectoral pour les rues des villes. Par dcision du conseil gnral pour les chemins vicinaux de grande communication et d'intrt commun (art. 44, 1. 1871). Par dcision de la commission dpartementale pour les chemins vicinaux ordinaires (art. 86, l. 1871), et pour les chemins ruraux (1. 20 aot 1881, art. 13). 5 Aprs l'homologation, dpt du plan d'alignement la mairie de la commune et publication de l'acte d'approbation. b) Effets des plans d'alignements. Servitudes d'alignement. Lorsque, par application d'un plan d'alignement, la voie publique se trouve largie : 1 Les terrains non btis inclus dans les limites fixes par le plan se trouvent ipso facto acquis la voie sans procdure d'ex propriation, mais moyennant indemnit ultrieure. 2 Les terrains btis sont grevs de la servitude de reculement. Il ne peut plus y tre fait de travaux confortatifs; le jour o ils seront dmolis ou tomberont de vtust, le sol sera runi la voie publique moyennant une indemnit qui ne reprsentera que la valeur du terrain nu. La notion des travaux confortatifs est une question de pratique administrative. Il est bon d'ajouter que par mesure de police, l'administration peut faire dmolir les difices qui menacent ruine. Dans ces deux cas, l'indemnit est rgle en principe par le jury d'expropriation, seulement le rglement est postrieur la prise de possession. (Av. Cons. d't. 1eravr. 1841.) Par exception, pour les chemins vicinaux, l'indemnit est rgle par le juge de paix du canton sur rapport d'experts. (L. 21 mai 1836, art. 15.) Lorsque, au contraire, par l'application d'un plan d'alignement, la voie publique est diminue de largeur, les propritaires riverains ont un droit de premption sur les terrains au droit de leurs proprits. (V. n 377.) Observation. Dans les villes o il n'y a pas de plan d'alignement
522
LES DROITSDOMANIAUX DE PUISSANCE PUBLIQUE
pour les rues ou places qui ne sont pas classes, on doit s'en tenir l'tat actuel des lieux. (Cons. d't. 5 avr. 1862.) 382. B. Protection des limites De par l'alignement. l'alignement individuel. Les autorits comptentes dlivrent la requte des riverains des arrts individuels d'alignement, qui indiquent, propos d'une parcelle dtermine de terrain, la ligne sparative de la voie publique telle qu'elle est fixe par les rgles prcdentes. C'est un simple renseignement pour le propritaire riverain, mais un renseignement qu'il est souvent oblig de demander. Les riverains sont tenus de demander un alignement individuel toutes les fois qu'ils veulent construire ou reconstruire un mur sur la ligne sparative de la voie publique. Ils y sont tenus, mme lorsqu'ils veulent construire en arrire de cette ligne au moins dans les villes. (Cass. 27 juill. 1876.) La jurisprudence du Conseil d'tat est contraire. (C. d't. 17 fvr. t859.) Les riverains sont tenus galement de demander une permission s'ils veulent simplement faire des travaux un mur de faade ; de mme, pour les saillies fixes, balcons, colonnes, marches, et les saillies mobiles, enseignes, devanture de magasin. Ces concessions sont rvocables. Les infractions ces prescriptions sont rprimes par le tribunal de simple police pour la petite voirie, par le conseil de prfecture pour la grande voirie; elles entranent une amende sans prjudice de la dmolition s'il y a lieu. Les autorits comptentes pour dlivrer les alignements individuels et les permissions de voirie sont: 1 Pour la grande voirie et les chemins vicinaux de grande communication ou d'intrt commun : le prfet. Dans les arrondissements autres que celui du chef-lieu, le prfet peut. tre remplac par le sousprfet lorsqu'il existe un plan d'alignement. Le maire doit tre consult. 2 Pour les rues, places, chemins vicinaux ordinaires et chemins ruraux: le maireN 3. Le bornage des btiments et terrains affects un service public. 383. Pour le domaine militaire les rgles du bornage se trouvent dans un dcret du 10 aot 1853. C'est une opration contradictoire. Lorsque le bornage est opr sur le terrain, procs-verbal en est dress. Ce procs-verbal est dpos la mairie, les intresss ont trois mois pour se pourvoir devant le conseil de prfecture. Ds qu'il a t
DOMAINE PUBLIC. VOIRIE
523
dfinitivement statu sur le recours, le procs-verbal est homologu par dcret. Pour les btiments affects aux services publics, l'administration pratique le bornage ordinaire avec action en justice, parce qu'elle considre que ces btiments ne sortent pas du domaine priv. La consquence logique de l'opinion qui fait tomber les btiments dans le domaine public, est que le bornage devient une mesure de police et doit tre fait par un arrt analogue aux arrts de dlimitation. ART.3. LA POLICE DU DOMAINE ETLES SERVITUDES D'UTILIT PUBLIC PUBLIQUE 384. Il s'agit ici de tout ce qui est police de conservation du domaine public, et en mme temps de tout ce qui est police de l'usage du public l o cet usage a lieu. Ces rgles de police entranent pour les citoyens des obligations ; elles peuvent entraner aussi pour les fonds riverains de vritables servitudes d'utilit publique. Nous en verrons de nombreux exemples. Ces servitudes dont quelques-unes sont fort lourdes ne donnent en principe lieu aucune indemnit au profit des riverains sur les fonds desquels elles psent. Nous verrons cependant quelques exceptions en matire de nouvel tablissement de chemin de halage, en matire de servitudes militaires. La police du domaine public ne forme pas un corps particulier de rgles pour toutes les dpendances du domaine public, mais seulement pour la voirie. La voirie est relative aux voies de communication et aux rivages de la mer, ainsi qu' certaines matires assimi les. Tout ce qui est btiment reste en dehors de cet ensemble de rgles. Cela tient en grande partie ce que jusqu'ici, grce la doctrine et la jurisprudence admises, il y a peu de btiments dans les dpendances du domaine public. Cependant il ya les glises et difices consacrs aux cultes et aussi les cimetires1. Il rsulte de cette situation que pour tout ce qui est btiment, la 1. La question de savoir si les cimetires sont ou non des dpendances du domaine public est discute (V n 399); ce qui est certain, c'est que le voisi, au moins lorsqu'il s'agit de ceux nage des cimetires entrane des servitudes qui ont t transfrs une certaine distance des habitations en vertu du dcret de prairial an XII : Naine peut,sans autorisation, lever aucune habitation, ni creuser aucun puits, moins de 100 mtres des nouveaux cimetires transfrs hors des communes en vertu des lois et rglements (D. 7 mars 1808).
524
DE PUISSANCE LES DROITS DOMANIAUX PUBLIQUE
: acprotection et la conservation s'obtient par les voies du droit civil tions civiles et possessoires. Cependant aucun obstacle ne s'opposerait, notre avis, ce qu'il ft pris des arrts de police par les autorits comptentes. Ainsi le maire peut prendre des arrts de police relatifs la conservation des btiments municipaux ou des cimetires. Il en prend bien relatifs la conservation des jardins et promenades publiques, qui ne font pas non plus partie de la voirie. Il en prend bien relatifs la conservation des bois communaux, des pturages communaux qui ne sont mme pas des dpendances du domaine public. Pour ce qui est du maintien de l'ordre l'intrieur des btiments affects aux services publics, c'est affaire de police administrative.. Police de la voirie et servitudes qui en dcoulent.
385. La police de la voirie est un ensemble de rgles relatives soit la conservation des rgles de communication, soit la circulation qui se produit sur ces voies de communication. On distingue la grande voirie et la petite voirie. L'intrt de la distinction est tir de ce que, dans certains cas, les infractions aux rgles de police de grande voirie constituent des contraventions de grandevoirie, qui sont de la comptence des conseils de prfecture, et qui sont punies d'amendes assez leves, tandis que les infractions aux rgles de la petite voirie sont toujours des contraventions de simple police justiciables des tribunaux de simple police et punies d'amendes lgres. De plus, les rgles de la grande voirie sont presque toutes contenues dans des rglements antrieurs 1789, qui ont t provisoirement confirms par loi des 19-22 juillet 1791 (tit. Ier, art. 29, 2), tandis que les rgles de la petite voirie sont toutes contenues dans des textes postrieurs 1789, arrts prfectoraux ou municipaux. Les voies de communication sont rparties dans la grande et la petite voirie raison de leur importance. Font partie de la grande voirie : 1 les routes nationales et dpartementales ; 2 toutes les rues de Paris; 3 les chemins de fer; 4 les fleuves et canaux ; 6 certaines matires ; 5 les rivages de la mer assimiles. Font partie de la petite voirie : 1 les chemins vicinaux ; 2 les chemins ruraux; 3 les rues et places des villes.
DOMAINE PUBLIC. LA VOIRIE N 1. Rglesde la grande voirie.
525
de grande 386. Des contraventions voirie. La contravention de grande voirie se caractrise par deux signes : 1 elle est de la comptence du conseil de prfecture. Cette comptence rsulte de la loi du 29floral an X (art. 1er et 4). Elle constitue ce qu'on appelle la comptence rpressive du conseil de prfecture, et c'est une exception aux principes gnraux, parce que d'ordinaire les juridictions administratives ne sont pas rpressives. Cette comptence est d'ailleurs limite aux amendes. Quelques-unes des contraventions de grande voirie entranent la peine de l'emprisonnement; mais la peine alors n'est pas applique par le tribunal administratif, l'affaire est renvoye devant le tribunal correctionnel. On estime que les tribunaux ordinaires sont gardiens de la libert individuelle au mme titre que de la proprit1. 2 Les amendes entranes par les contraventions de grande voirie sont plus lves que les amendes de simple police. Cela tient a ce qu'elles sont prononces par des textes de l'ancien rgime elles ont cependant t modres par une loi du 23 mars 1842. A dater de la promulgation dela prsente loi, les amendes fixes, tablies par les rglements de voirie antrieurs la loi des 19-22 juillet 1791, pourront tre modres, eu gard au degr d'im portance ou aux circonstances attnuantes des dlits, jusqu'au vingtime desdites amendes, sans toutefois que ce minimum puisse descendre au-dessous de 16 francs. A dater de la mme poque, les amendes dont le taux, d'aprs ces rglements, tait laiss l'arbitraire du juge, pourront varier entre un minimum de 16 francs et un maximum de 300 francs. Malgr le chiffre lev des amendes, les contraventions de grande voirie sont traites comme des contraventions et non comme des dlits; par consquent : 1 fait matriel punissable en dehors de toute intention de nuire ; 2 prescription d'une anne compter de l'infraction pour l'action publique ; de deux ans partir de la condamnation pour la peine. Quant la question de savoir quelles sont les rgles de la grande voirie qui sont sanctionnes par des contraventions de grande voirie, voici les observations que l'on peut formuler, mais il faut reconnatre que la matire est un peu confuse: 1. Rapprochezde ce qui a t dit pour la dlimitationn 379et v. au coutentieux,n 561.
526
LES DROITS DOMANIAUX DE PUISSANCE PUBLIQUE
1 Toutes les rgles de la grande voirie ne sont pas sanctionnes par des contraventions de grande voirie; 2 Les rglements antrieurs 1789 sont sanctionns par des contraventions de grande voirie; 3 Des rgles postrieures 1789, les unes sont sanctionnes par des contraventions de grande voirie (exemple : Police du roulage, l. 1851, art. 4 et 9), les autres pas; il faut, dans chaque matire spciale, se reporter aux textes. Il y 387.I. Routes nationales et dpartementales. a lieude distinguer la police de conservation des routes et la police de la circulation ou police du roulage. A. Police de conservation. La police de conservation des routes impose d'abord des obligations tout le monde, elle impose aussi aux riverains des obligations spciales qui mritent le nom de servitudes, en ce qu'elles sont dues par le fonds plutt que par le propritaire du fonds. Les contraventions en matire de a) Obligations de voirie. grande voirie, telles qu'anticipations, dpts de fumier ou d'autres objets, et toutes espces de dtriorations commises sur les grandes routes, sur les arbres qui les bordent, sur les fosss, ouvrages d'art et matriaux destins leur entretien, sur les canaux, fleuves et rivires navigables, leurs chemins de halage, francs-bords, fosss et ouvrages d'art seront constates, rprimes et poursuivies par voie administrative. (L. 29 flor. an X, art. 1er.) Cette loi, tablit, on le voit, pour tout le monde l'obligation de respecter la voie et pose le principe de la rparation de toute dgradation. Mais elle n'dicte aucune peine par elle-mme; l o il n'existe pas de rglements spciaux, le conseil de prfecture doit se borner condamner rparation. Les servitudes de voirie ressemblent de voirie. Servitudes b) aux servitudes du droit civil en ce qu'elles peuvent tre considres comme attaches la route comme fonds dominant, et comme portant sur les fonds riverains qui deviennent des fonds servants ; mais elles prsentent des singularits; elles consistent in faciendo aussi bien qu'in patiendo, de plus, elles sont sanctionnes par la contravention de grande voirie. Les principales sont les suivantes : 1 La servitude d'alignement, avec sa consquence la servitude de reculement. Ces servitudes ont pour but d'assurer la rectification et la protection des limites de la voie. (V. n 381.) 2 La servitude d'coulement des eaux.
LA VOIRIE PUBLIC. DOMAINE
527
3 Le rejet des fosss. Les propritaires riverains sont astreints recevoir sur leurs fonds, sans pouvoir rclamer d'indemnit, le rejet des terres provenant du curage des fosss. (Arrt du Conseil du 26 mai 1705 et du 3 mai 1720: 1. du 9 ventse an XIII; dcr. 16 dc. 1811, art. 109-110; 1. 12 mai 1825, art. 2; C. d't. 2 avr. 1849). 4 Les servitudes de plantations. Il existe des servitudes relatives des plantations d'arbres faire sur l'ordre de l'administration par les riverains, soit sur leur terrain une certaine distance, soit mme sur la route, mais ces servitudes ne sont plus pratiques, elles donnaient lieu trop de difficults. L'administration plante elle mme sur le terrain des routes toutes les fois qu'elle le peut. Mais il y a d'autres servitudes relatives aux plantations faites par les particuliers sur leur terrain, ces plantations ne peuvent en principe tre faites qu' 6 mtres au moins du bord de la route (1. 9 ventse an XIII, art. 5). Les haies vives peuvent cependant tre plantes deux mtres. Avec autorisation du prfet, toutes ces distances sont rduites. Enfin dans la traverse des forts il doit exister un espace libre de 20 mtres y compris la route. Cela constitue la servitude d'essartement. (0. 1669. T. XXVII, art. 2; Av. Cons. d't. 31 dc. 1849 ) 5 L'interdiction d'ouvrir des carrires et de pratiquer des fouilles une certaine distance de la voie. V. Dcrets du 12 fvrier 1892 sur l'exploitation des carrires dans chaque dpartement. B. Police du roulage. V. 1. 30 mai-8 juin 1851 et divers rglements d'administration publique rendus en excution, 10 aot 1852, 24 fvrier 1858, 29 aot 1869. Il s'agit de la longueur des essieux, de la largeur des bandes des roues, de la forme des clous, du chargement des voitures, etc. il ya des rgles spciales pour les voitures servant au transport des voyageurs, etc, etc. 1 que cette lgislation s'applique aux Il y a lieu de remarquer: chemins vicinaux de grande communication aussi bien qu'aux routes nationales et dpartementales; 2 que les contraventions qu'elle cre ne sont pas toutes de grande voirie et par consquent pas toutes de la comptence du conseil de prfecture, il faut ici se reporter l'art. 17 de la loi. 3 Que les mesures de police tablies par cette loi n'enlvent point aux prfets et aux maires le droit de faire des rglements pour assurer la scurit de la circulation. En tant que les prescriptions de ces rglements feraient double emploi avec celles de la loi, cela donnerait ouverture des poursuites pour un mme fait, l'une en vertu de la loi de 1851, l'autre devant le tribunal de simple police; mais le
528
DE PUISSANCE LES DROITSDOMANIAUX PUBLIQUE
mme dlinquant ne saurait tre condamn deux fois pour le mme fait, non bis in idem. Les rues de Paris, sans 388. II. Rues de Paris. exception, font partie de la grande voirie (D.27 oct. 1808, D. 26 mars 1852, art. 1er). Il faut faire cette observation cependant, que tout ce qui concerne uniquement la libert et la sret de la circulation fait partie, non pas prcisment, comme on le dit souvent, de la petite voirie, mais de la police municipale, de telle sorte que : 1 les rglements sur la libert et la sret de la circulation sont sanctionns par des amendes de simple police, rserve faite des rgles sur la police du roulage; ceci n'a rien de spcial Paris; 2 les permissions de saillie mobile dans toutes les rues donnent lieu au paiement de droits d'aprs un tarif particulier, dit tarif de petite voirie. Servitudes des riverains. (D. du 26 mars 1852.) Les charges des riverains des rues de Paris sont assez lourdes; elles ont t notablement aggraves par le dcret-loi du 26 mars 1852, rendu dans une pense d'assainissement et d'embellissement de la ville. Ce dcret a ceci de particulier qu'il peut tre tendu d'autres villes que Paris. Les villes doivent en faire la demande, le dcret de 1852 leur est alors appliqu par dcret spcial rendu en la forme d'un rglement d'administration publique. Cette opration a ceci d'intressant que des servitudes sont ainsi crespar simple dcret. Les dispositions de ce dcret sont relatives aux servitudes d'alignement et de nivellement ; l'coulement des eaux sur la voie publique, qui doit se faire dans des conditions particulires; la hauteur des maisons, au nettoiement de la faade une fois tous les dix ans; l'obligation du pavage, etc. Il contient aussi une disposition relative l'expropriation que nous retrouvons plus loin (n 449). de fer. On a d'abord appliqu aux che389. III. Chemins mins de fer les lois et rglements sur la grande voirie, comme aux routes (l. 15 juillet 1845, art. 2 et 3). De plus, des servitudes spciales ont t cres, distance pour les murs de clture, les excavations, les dpts de matriaux, etc. (V. 1. 15 juillet 1845, art. 5 10.) Pour la police de la circulation, v. 1. 15 juillet 1845, t. III et O. 15 nov. 1846. Observation. La loi du 15 juillet 1845 est en principe applicable aux chemins de fer d'intrt local; elle est galement applicable aux tramways, l'exception des articles 4 10 relatifs aux servitudes. (Art. 37, l. 11 juin 1880.)
LA VOIRIE DOMAINE PUBLIC.
529
- a) Voir, pour la police de conet canaux. 390. IV. Fleuves servation, arrt du conseil du 24juin 1777 et 1. 29 floral an X. Quant la policedela navigation, elle est rgle soit par d'anciens rglements, soit par des arrts prfectoraux, soit par des dcrets rendus en excution de la loi du 21 juillet 1856 pour la navigation vapeur. Servitudes de halage et de marchepied. La servitude de chemin de halage est due sur l'une des rives des fleuves ou rivires navigables, que la navigabilit soit naturelle ou qu'elle soit le rsultat de travaux artificiels. (0. aot 1669; D. 22 janv. 1808.) Le chemin de halage est large de vingt-quatre pieds au moins, au del desquels les riverains sont obligs de laisser encore six pieds s'ils veulent btir ou faire des plantations ou des cltures. L'administration peut rduire cette largeur si le service ne doit pas en souffrir. (D. 22 janv. 1808 art. 4.) La servitude de halage peut tre tablie sur les deux bords, mais il faut pour cela un dcret spcial du chef de l'tat (C. d'tat. 12 janvier 1878.) Toutes les fois que la servitude de halage est tablie sur une rive o elle n'existait pas anciennement, elle donne lieu une indemnit value conformment aux dispositions de la loi du 16 septembre 1807 , art, 57, c'est--dire rgle par le conseil de prfecture. (D. du 22 janvier 1808.) Le chemin de halage ne doit servir qu' la navigation. Si l'administration veut en faire une chausse laisser passer les voitures, elle doit recourir l'expropriation. Si la rivire cesse d'tre navigable, la servitude cesse. Sur les rivires navigables, la servitude de marchepied est due sur la rive oppose celle o se trouve le chemin de halage. Sur les rivires flottables, le marchepied est d sur l'une et l'autre rive. (Ord. 1669, l. 15 avr. 1829 sur la pche fluviale, art. 35.) Le marchepied est large d'au moins dix pieds. c) Police de la pche fluviale. (V. 1. 15 avr. 1829, 6 juin 1840, 31 mai 1865; D. 10 aot 1875; D. 18 mai 1878.) Canaux de navigation. Les canaux de navigation suivent les mmes rgles que les fleuves, avec cette diffrence que les servitudes de chemin de halage et de marchepied n'y existent pas. Les chemins de halage font partie du terrain du canal lui-mme. V. 391. V. Rivages de la mer, ports, havres, rades. Ord. de la marine aot 1681. Sur ce texte fondamental s'appuient des arrts prfectoraux. H. 34
530
LES DROITS DOMANIAUX DE PUISSANCE PUBLIQUE
392. VI. Matires assimiles la grande voirie. 1 Servitudes militaires. Ces servitudes consistent dans des restrictions au droit de btir dans une certaine zone autour des places fortes et des magasins poudre. Pour les places fortes, V. 1. 10 juillet 1791; 1. 17 juillet 1819 ; D. 10 aot 1853. Pour les magasins poudre, V. 1. 22juin 1854. Ces servitudes ne donnent lieu aucune indemnit lorsque, au moment ou la forteresse ou les magasins sont crs, il n'y a dans la zone aucun terrain bti. Si, a u moment de la cration, il se trouve dans la zone des constructions qu'il faille dmolir, ou des plantations qu'il faille arracher il y a indemnit. Dans le cas de construction, l'indemnit est rgle par le jury. Dans le cas de plantation, elle est rgle par le conseil de prfecture. 2) Servitudes de la zone frontire. (L. 7 avr. 1851.) Ces servitudes ont ceci de particulier qu'elles psent, non pas sur les particaliers, mais sur les personnes administratives, dpartements ou communes ; elles sont en effet relatives aux travaux publics accomplis dans une certaine zone avoisinant la frontire, tels que remblais, ponts et autres ouvrages d'art, chemins, routes, chemins de fer, canaux; elles ont pour but soit d'empcher que ces travaux ne compromettent la dfense, soit au contraire de les faire concourir la dfense. V. pour la dtermination des zones et l'numration des travaux la loi du 7 avril 1851 et les rglements du 16 aot 1853 et du 8 septembre 1878. Les travaux pour lesquels la servitude existe sont appels travaux mixtes, parce qu'ils sont soumis une commission mixte compose de membres civils et de membres militaires et qui relve du ministre de la guerre. 3 Lignes tlgraphiques et tlphoniques. Lorsque ces lignes sont tablies sur des voies publiques, elles sont dpendances du domaine public titre d'accessoires. Nous serions disposs admettre qu'elles ont encore ce caractre alors mme qu'elles sont tablies sur des terrains appartenant des particuliers. Ce sont en effet des objets de proprits affects l'utilit publique; leur caractre de chose mobilire n'est pas un obstacle. (V. n 369.) Quoi qu'il en soit de cette opinion, il est certain tout au moins que, au point de vue de leur conservation, elles bnficient du rgime de la grande voirie. (D. 27 dc. 1851 ; 1. 28 juill. 1885.) De plus, la loi du 28 juillet 1885, art. 9 et 10, a tabli la charge des riverains et au profit des deux espces de lignes une servitude d'appui qui peut donner lieu une indemnit rgle par le conseil de prfecture. 4 Desschements et endiguements. La conservation des tra-
PUBLIC. LA VOIRIE DOMAINE
531
vaux de desschement, celle des digues contre les torrents, rivires et fleuves, et sur les bords des lacs et de la mer, est commise l'administration publique. Toutes rparations et dommages seront poursuivis par voie administrative comme pour les objets de grande voirie. Les dlits seront poursuivis par les voies ordinaires, soit devant les tribunaux de police correctionnelle, soit devant les cours criminelles, en raison des cas. (L. 16 sept. 1807, art. 27.) 5 Mines. D'aprs la loi du 21 avril 1810, art. 50, les contraventions aux rglements miniers taient des contraventions de grande voirie. Cela a t modifi par la loi du 27 juillet 1880. Ce ne sont plus que des contraventions de simple police. N 2. Rgles de la petite voirie. La petite voirie comprend la voirie vicinale, la voirie urbaine, la voirie rurale. Ce 393. A. Des contraventions de petite voirie. sont en principe des contraventions de simple police, qui entranent comptence du tribunal de simple police et amende de 1 5 francs. (Art. 471, n 5, et n 15, C. P., art. 479, n 11 eod). Par exception, la loi du 30 mai 1851 sur la police du roulage s'applique aux chemins vicinaux de grande communication et donne lieu des contraventions de grande voirie. Par exception encore, toutes les fois qu'il y a usurpation du sol des chemins vicinaux, le conseil de prfecture est comptent, mais uniquement pour la restitution du sol, pas pour l'application de l'amende. (Combinaison de la loi du 9 ventse an XIII et de l'art. 479, n 11, C. P., qui a donn lieu difficult; conflits, 26 mars 1850, Cass. 19 juin 1852.) Quand il y a simple dgradation sans usurpation, le tribunal de simple police est comptent pour le tout. (Conflits, 17 mai 1873.) 394. B. Obligations et servitudes des riverains Elles sont en gnral de mme nature que celles de la grande voirie; seulement, elles rsultent d'arrts prfectoraux ou municipaux, au lieu de rsulter de lois, de dcrets ou d'anciens rglements. Il faut distinguer : a) Voirie vicinale. Les rgles relatives aux charges des riverains sont tablies par arrt prfectoral (1. 21 mai 1836, art. 21), elles peuvent donc varier d'un dpartement l'autre; mais des instructions gnrales du ministre de l'intrieur tendent tablir une certaine
532
LES DROITSDOMANIAUX DE PUISSANCE PUBLIQUE
uniformit. Ces rgles sont peu prs les mmes que celles que nous avons exposes propos des routes nationales et dpartementales. b) Voirie urbaine. La voirie urbaine comprend les rues et places des agglomrations bties, quelle que soit leur importance, mais non pas les jardins publics, promenades, squares, etc. S'appliquent la voirie urbaine les servitudes d'alignement, les autorisations de btir et les diverses permissions de voirie. Il y a de plus certaines servitudes spciales. Les maires ont le droit de fixer la hauteur des maisons par arrt de police. (L. 5 avril 1884, art. 97.) Ils peuvent tre tenus du pavage, de l'tablissement des trottoirs et du balayage des rues, s'il existe cet gard des rglements ou usages anciens. Et mme dans les traverses des routes qui dpendent de la grande voirie, il peut tre fait application des dispositions de la loi du 7 juin 1845 sur les trottoirs. Dans ce cas l'tablissement des trottoirs est l'objet d'une dclaration d'utilit publique sur l'initiative du conseil municipal. Il y a une enqute de commodo et incommodo. Il est statu par dcret sur l'utilit publique. Le conseil municipal donne un choix aux propritaires au point de vue des matriaux employer. La dpense est partage, la portion la charge de la commune ne peut tre moindre de la moiti. La portion de la dpense la charge des propritaires est recouvre dans la forme dtermine par l'art. 28 de la loi de finances du 25 juin 1841, c'est--dire comme taxe assimile aux contributions directes. Observation. Rappelons que les villes peuvent demander que le dcret du 26 mars 1852 leur soit appliqu, et qu'alors les riverains sont soumis aux mmes charges que les riverains des rues de Paris, sans que pour cela les rues de la ville entrent dans la grande voirie. Les riverains sont soumis notamment l'obligation de nettoyer les faades. (V. n 388). L'autorit municipale est charge de la porurale. Voirie c) lice et de la conservation des chemins ruraux (l. 20 aot 1881 art. 9). Donc rgles tablies par arrt municipal. DUDOMAINE PUBLIC PARLA DESDPENDANCES Art. 4. UTILISATION ET LACONCESSION DESPRODUITS PERCEPTION N 1. Perception des produits. 395. Les personnes administratives, qui sont au fond propritaires
DOMAINE PUBLIC. LES CONCESSIONS
533
des dpendances de leur domaine public, ont le droit de retirer de ces choses toute l'utilit qu'elles peuvent donner, tant que cela ne porte pas atteinte leur destination. Cette utilisation peut tre ralise de deux faons : 1 par la perception des produits; 2 par la concession. La perception des produits s'opre directement en rgie ou par bail ferme. Perception directe des produits. C'est ainsi que l'tat fait vendre par l'administration des domaines l'lagage des arbres plants sur les routes nationales, ou la coupe des arbres eux-mmes. C'est ainsi que les communes peuvent faire vendre aussi l'lagage des haies ou des arbres accrus sur les chemins vicinaux, de mme aussi la coupe de l'herbe sur les accotements. Dans la pratique, l'herbe n'est pas toujours vendue, souvent elle est abandonne en jouissance individuelle aux habitants de la commune pour leurs troupeaux, comme elle le serait dans un pturage communal. Baux fermes. Ferme de la pche sur les fleuves. C'est cette ide d'utilisation des dpendances du domaine public, qu'il faut rattacher le principe d'aprs lequel le droit de pche sur les fleuves et rivires navigables et flottables doit tre affermau profit de l'tat. L'tat a le droit de pche comme consquence de son droit de proprit. Ce droit pouvant tre productif sans que cela nuise en rien l'utilisation du fleuve, l'tat le rend productif en l'affermant. La matire est rgle par la loi du 15 avril 1829, modifie par celle du 6 juin 1840. L'art. 10 dispose : La pche au profit de l'tat sera exploite soit par voie d'adjudication publique, soit par concession de licences prix d'argent. Le mode de concession par licences ne sera employ que lorsque l'adjudication aura t tente sans succs . Les formalits de l'adjudication sont peu prs les mmes que celles des adjudications de coupes dans les forts. Les licences sont concdes par l'administration des forts. N 2. Concessions sur 396. A. Caractre gnraux le domainepublic1. de la concession. La
1. Nous ne traitons dans ce paragraphe que des concessionssur les dpendances immobilires du domaine public, mais il existedes concessionssur les dpendances mobiliresou sur les dpendances incorporelles.C'est ainsi que le privilge des reproductions photographiquesdes tableaux et des statues du Louvre a t concd pour trente ans. (Tribunalde la Seine, 15 janv. 1890.) C'est ainsi que les collations d'emplois publics ou de fonctions peuvent aussi s'analyser en concessionssur le domaine public. (V. n 137.)
534
LES DROITSDOMANIAUX DE PUISSANCE PUBLIQUE
concession sur le domaine public est la permission donne titre prcaire de retirer d'une dpendance du domaine public une certaine utilit. La concession peut tre faite par la personne administrative propritaire, soit un particulier, soit une autre personne administrative. Ainsi les plages de la mer sont en gnral concdes par l'tat aux communes riveraines, et celles-ci afferment ensuite leur privilge des industriels qui tablissent des cabines de bains. En, matire d'tablissement de tramways, l'tat, les dpartements, les communes peuvent se faire des concessions rciproques sur leurs routes respectives. (L. 11 juin 1880, art. 17 et 18.) La concession intervient dans deux hypothses bien diffrentes qui donnent lieu deux varits : 1 Il y a concession d'usage ou occupation temporaire du domaine, lorsque le concessionnaire est autoris utiliser une dpendance du domaine public dj cre; il en est ainsi des occupations du rivage de la mer : 2 il y a concession de travaux publics lorsque le concessionnaire est autoris utiliser une dpendance du domaine qu'il cre ou qu'il entretient lui-mme, l'occasion de laquelle il fait un travail public. La concession est lie au travail public en ce sens qu'elle en est la rmunration. Ainsi en est-il pour les concessions de chemins de fer, de tramways, de ponts page, faites des compagnies. La compagnie utilise la dpendance du domaine public en ce sens qu'elle prlve une certaine taxe sur le public l'occasion de l'usage de la chose, et cela l'indemnise des dpenses faites pour la construction et l'entretien de la chose. 397.1. Nature au regard du droit du concessionnaire de la chose. Le concessionnaire est un possesseur prcaire de la chose. 1 C'est un simple possesseur. Il n'a aucun droit rel sur la chose, par consquent son droit est purement mobilier et non susceptible d'hypothque, ce n'est mme pas un droit d'emphytose. Mais d'un autre ct, c'est un possesseur et non pas un simple dtenteur. A ce point de vue, sa situation est bien diffrente de celle d'un fermier. Il peut intenter les actions possessoires contre les tiers qui voudraient le troubler dans sa possession et qui ne se prvaudraient pas euxmme d'une concession. (V. Cass. 20nov. 1877, S. 78. I. 64; Ch. req. 6 mars 1878, S. 1879, I. 13. V. spcialement pour les compagnies concessionnaires de chemins de fer: Cassat. 15 mai 1861 ; 20 nov. 1865 ; C. d't. 5 nov. 1874.) 2 C'est un possesseur prcaire. Sa possession est entache du vice de prcarit au regard de la personne administrative concdante,
LES CONCESSIONS PUBLIC. DOMAINE
535
: a) s'il intente contre le concdant l'action possessoire, par consquent cette action se heurte l'exception de domanialit qui est infrangible; mais notons que cette exception ne peut tre invoque que par le domaine et en faveur du domaine ; b) jamais sa possession ne peut le conduire l'acquisition par usucapion d'un droit rel quelconque. Ces principes, tout fait conformes ceux du Droit romain sur la possession du prcariste, sont admis par une jurisprudence constante; ils sont admis notamment propos des concessions de chemins de fer. Nous verrons cependant une difficult spciale propos des concessions perptuelles dans les cimetires (infr, n 399). A l'tat de concession. 398.II. Nature de l'opration pur, l'acte de concession est un acte gracieux et unilatral de la personne administrative. Il peut tre fait titre gratuit ou moyennant redevance. C'est un acte de puissance publique rvocable volont et qui est de la comptence des tribunaux administratifs. Le concessionnaire se trouve alors non seulement vis--vis de la chose, mais aussi au regard du concdant, dans la situation du prcariste romain ; ainsi en est-il des concessions sur le rivage de la mer, des concessions d'eau de pluie faites sur les routes, etc. Mais il peut se faire que l'acte de concession soit accompagn d'une convention par laquelle la personne administrative s'interdit de rvoquer la concession pendant un certain temps, ou bien s'oblige, si elle rvoque, payer une indemnit; dans ce cas, la facult de rvoquer est transforme en facult de rachat. Des conventions de ce genre interviennent en gnral toutes les fois que pour utiliser la concession, des capitaux sont ncessaires, car ces capitaux exigent des garanties. Lorsque, par exemple, la concession est faite en vue de travaux publics accomplir, elle est toujours accompagne d'une convention. Il y a des conventions avec les compagnies de chemins de fer, avec les compagnies de tramways, avec les compagnies qui construisent des ponts page. Ces conventions ne crent entre les parties contractantes que des rapports purement personnels, elles n'empchent point que sur la chose la possession du concessionnaire ne soit toujours prcaire, mais dans ses rapports avec le concdant, la situation du concessionnaire s'loigne de celle du prcariste, car il a de vritables droits faire valoir contre le concdant. Observation. La concession sur le domaine public a toujours t pratique, mais son caractre juridique n'a pas toujours t bien compris et mme sa lgalit a t suspecte. Il ne pouvait pas y avoir de doutes pour le domaine public terrestre, car la loi du 12 frimaire an VII, t. I, art. 7, autorise expressment la location de places sur les
536
LES DROITS DOMANIAUX DE PUISSANCE PUBLIQUE
promenades publiques, etc.; mais on en souleva pour le domaine public maritime. Dans un arrt du 7 juillet 1869, la Cour de cassation fut prise d'un scrupule excessif; elle dclara que les rivages de la mer, tant hors du commerce, ne pouvaient faire l'objet d'aucune convention. Elle appliquait l'art. 1128, d'aprs lequel, en effet, il n'y a que les choses qui sont dans le commerce qui puissent tre l'objet de conventions . Il fallut que la loi de finances du 28 dcembre 1872 autorist au profit de l'tat, la perception de redevances titre d'occupation temporaire ou de location des plages et de toutes autres dpendances du domaine maritime, ce qui tait, par voie de consquence, autoriser les concessions. La Cour de cassation commettait une double erreur, d'abord en considrant le rivage de la mer comme une chose hors du commerce par sa propre nature au lieu d'y voir une proprit de l'tat frappe d'une certaine indisponibilit. Nous avons signal cette erreur qui consiste voir dans les dpennances du domaine public des res nullius (n 362) 1 ; ensuite en appliquant l'art. 1128. Dans les concessions sur le domaine public, la dpendance du domaine n'est pas, proprement parler, l'objet de la convention, attendu qu'aucun droit rel n'est constitu sur la chose; la dpendance du domaine n'est que l'occasion de la convention, et le vritable objet, c'est un pur fait que le concdant s'engage plus ou moins tolrer. Les con399. B. Examen de quelques concessions. cessions de travaux publics seront tudies plus loin propos des travaux publics. Nous allons passer en revue ici quelques concessions d'usage. sur de la mer. Concessions le On peut citer: a) rivage 1 Les concessions pour tablissement de cabines de bains, ces concessions sont d'ordinaire faites par l'tat aux communes riveraines, celles-ci exploitent directement ou afferment. 2 Les concessions faites sur les quais aux chambres de commerce pour tablissement d'appareils de chargement et de dchargement des navires; 3 Les concessions pour tablissement de pcheries. Les autorisations pour les occupations temporaires sont accordes soit par le ministre de la marine seul, comme pour les pcheries, soit par le ministre des travaux publics avec l'avis conforme du ministre de la marine. 1. Les dpendances du domainepublic ne sont hors du commerce que dans la mesure o cela est ncessitpar leur destination d'utilit publique.
LES CONCESSIONS DOMAINE PUBLIC.
537
Il ya des redevances fixes par le ministre des finances et revisables tous les cinq ans. Rvocation sans indemnit premire rquisition. et Les sur Concessions les cours d'eau flottables. navigables b) concessions sur les cours d'eau peuvent avoir pour objet soit des prises d'eau pour force motrice, soit des prises d'eau pour l'irrigation.. En principe, toutes ces concessions sont accordes par le chef de l'tat; par exception, par les prfets (arrt du 19 ventse an VI; D. du 25 mars 1852, tableau D, nos 1 et 2). Ces concessions donnent lieu des redevances (1. 16 juill. 1840). Elles sont rvocables sans indemnit en principe. Il y a cependant lieu indemnit lorsque l'usine se trouve dans l'un ou l'autre des cas suivants : 1 Lorsqu'elle existait avant 1566, poque o le domaine public est devenu inalinable; 2 lorsque l'usine a t l'objet d'une vente comme bien national aprs 1789; 3 lorsque la concession a t faite titre onreux, moyennant certains travaux ou certaines charges. c) Permissions de voirie. Les permissions de voirie sont relatives, soit l'occupation du dessus de la voie publique par des saillies des btiments ou le dpt temporaire d'objets mobiliers, soit l'occupation du dessous de la voie par des canalisations diverses, eau, gaz, etc. Les saillies des btiments se distinguent en saillies fixes, telles que balcons, piliers, marches d'escaliers, tuyaux de descente des eaux, corniches, etc. et en saillies mobiles telles que enseignes, devantures de boutique etc. La permission de voirie est donne ici par l'autorit comptente pour l'alignement. Il en est de mme pour les permissions qui concernent le dessous de la voie publique. Quant aux permissions de dpt d'objets mobiliers sur la voie comme talage, tables de caf, etc., elles sont dans les attributions du maire titre de matire de police municipale. (L. 1884, art. 98.) Toutes ces concessions sont en principe rvocables volont moins qu'elles ne soient accompagnes de conventions; seulement en certain cas les redevances perues doivent tre restitues en tout ou en partie. Ces permissions donnent en effet lieu des redevances perues au profit des communes sous le nom de droits de voirie et il n'y a pas lieu de faire de distinction entre les voies publiques qui sont traverses de routes et les voies urbaines. Les tarifs sont dlibrs par le conseil municipal et approuv par le prfet. (L. 21 avril 1832, art. 3; 1.5 avril 1884, art. 68). d) Concession des eaux de pluie qui tombent sur la voie publique.
538
LES DROITS DOMANIAUX DE PUISSANCE PUBLIQUE
Ces eaux ne sont pas, proprement parler, des dpendances du domaine public, ce sont des res nullius, elles sont au premier occupant. Mais c'est une occupation qui doit tre accomplie chaque fois. Le riverain n'acquiert pas par prescription vis--vis de l'administration le droit d'accaparer ces eaux de pluie. En ce sens, on dit que les eaux de pluie sont imprescriptibles 1. Ces eaux, quoique res nullius, peuvent tre concdes par l'administration. En effet, l'administration a le droit de tirer du domaine toute l'utilit qu'il peut fournir, tant que cela ne gne pas l'usage public. La concession peut tre formelle ou bien rsulter de l'autorisation d'tablir un aqueduc sous la voie. (Ch. req. 21 mars 1876, S. 76, I, 359.) Ds lors, les propritaires de fonds riverains suprieurs ne peuvent plus dtourner ces eaux de pluie, ou s'ils le font il y a lieu complainte; moins qu'eux aussi n'obtiennent une concession, car l'administration n'est point lie vis--vis du premier concessionnaire. e) Concessions dans les cimetires. Lorsque l'tendue des lieux consacrs aux inhumations le permettra, il pourra y tre fait des concessions de terrain aux personnes qui dsireront y possder une place distincte pour y fonder leur spulture et celle de leurs parents ou successeurs, et y construire des caveaux, monuments ou tom beaux. (D. 23 prairial, an XII, art. 10.) Les concessions de terrains dans les cimetires communaux, pour fondation de spultures prives, seront, l'avenir, divises en trois classes : 1 concessions perptuelles; 2 concessions trentenaires; 3 concessions temporaires. Les concessions trentenaires sont renouvelables indfiniment l'expiration de chaque priode de trente ans, moyennant une nouvelle redevance qui ne pourra dpasser le taux de la premire. Les concessions temporaires sont faites pour quinze ans au plus, et ne peuvent tre renouveles. (0.6 dc. 1843, art. 3.) Les concessions temporaires et les concessions trentenaires sont certainement de vritables concessions sur le domaine public; l'acte de concession est un acte de puissance publique, et il ne peut tre ; les concessionnaires interprt que par la juridiction administrative ne peuvent avoir au plus pour faire respecter leurs concessions que des actions possessoires, car ils n'ont qu'une possession temporaire. 1. Cependantles riverains peuvent faire des conventionsentre eux, ou tablir un tat des lieux tel que vis--vis de quelques-uns le droit d'occupation soit tabli par prescription.
LES CONCESSIONS DOMAINE PUBLIC.
539
En est-il de mme pour la concession perptuelle, et le concessionnaire n'acquiert-il pas ici un vritable droit de proprit ? Les consquences seraient les suivantes: 1 l'acte pourrait tre interprt par les tribunaux judiciaires; 2 contre les empitements des voisins le concessionnaire aurait l'action en revendication. L'opinion actuelle de la jurisprudence semble tre dans le sens du droit de proprit, malgr deux circulaires ministrielles des 20 juillet 1841 et 30 dcembre 1843. (V. Cons. d'tat 19 mars 1863, Cassat. 24aot 1864, 31 janv. 1870, 26 avril 1875; V. aussi conflits, 19 nov. 1875, 26 mars-1881, Cons. d'tat 10 janv. 1890.) Cette opinion est trs contestable, le droit du concessionnaire ne peut pas tre un vritable droit de proprit, car, malgr le nom de la concession, il n'est pas vritablement perptuel. En effet, en cas de translation du cimetire, le droit sur l'ancien terrain concd disparat et est remplac par un droit sur un nouveau terrain d'gale superficie. (O. 6 dc. 1843, art. 5.) La vrit est que la concession est ici accompagne d'une convention, qui donne au concessionnaire un droit personnel trs nergique contre la commune. La commune s'est interdit perptuit de rvoquer la concession. Rien n'empche que le concessionnaire ne transmette cause de mort ou entrevifs ce droit qu'il a contre la commune, en transmettant la concession. On arrivera ainsi au mme rsultat que s'il transmettait un droit de proprit; car le rsultat que l'on parat poursuivre surtout, c'est la transmissibilit des caveaux de famille. Dj les usiniers qui ont une prise d'eau sur un fleuve transmettent le droit la concession en cdant leur usine, bien qu'ici la concession soit essentiellement rvocable. Si, malgr tout, il faut adopter l'opinion de la jurisprudence, et admettre que la concession perptuelle est une concession en pleine proprit, comment concilier cela avec l'inalinabilit des dpendances du domaine public? Faut-il aller jusqu' dire, avec beaucoup d'auteurs, que les cimetires ne doivent pas tre rangs parmi les dpendances du domaine public justement cause de cette possibilit de concessions perptuelles? La consquence n'est pas force. Le cimetire n'est pas un objet indivisible, on peut admettre que son enceinte et les quartiers consacrs aux concessions temporaires sont des dpendances du domaine public, mais que les parties consacres aux concessions perptuelles ont t dsaffectes, sont retombes dans le domaine priv, et par consquent sont devenues alinables. 400. C. Des sur le domaine crs par les concessions monopoles Il arrive souvent public. que les concessions
540
LES DROITS DOMANIAUX DE PUISSANCE PUBLIQUE
sur le domaine public crent au profit du concessionnaire un monopole de fait. 11 est bien clair, par exemple, que les compagnies de chemin de fer ont un monopole pour les transports par voie ferre. Un monopole semblable peut tre cr pour une compagnie de tramways, si on accorde elle seule le droit de poser des rails sur les voies publiques. Enfin les permissions de canalisation dans le sol des rues peuvent encore tre une occasion de constituer un monopole, au profit d'une compagnie d'clairage par exemple. En cette matire, deux rgles doivent tre poses : 1 Toutes les fois que de la concession ou de la permission de voirie il rsulte un monopole, cette concession ou permission ne saurait tre accorde par l'organe excutif en vertu de ses pouvoirs de police; elle doit rsulter d'un trait pass par l'organe dlibrant et stipulant en retour des avantages pcuniaires. Ainsi un arrt de police d'un maire sur le stationnement des voitures d'o rsulterait un monopole de fait pour une certaine entreprise d'omnibus serait radicalement nul (Cons. d't., 15 fvrier 1864, Lesbats ; 1 aot 1870, Bouchardon) tandis que le trait pass par le conseil municipal et confrant indirectement le mme monopole sera valable. C'est que si on peut admettre qu'une personne administrative batte monnaie avec ses droits de police, au moins faut-il que sa caisse en profite et par l, indirectement, le public tout entier. 2 Les traits qui confrent ainsi des monopoles doivent sans doute, comme tous les contrats, tre interprts de bonne foi. Cependant, dans les cas o il y a doute, il nous parat qu'il faudrait plutt les interprter de faon restreindre autant que possible le monopole. La question s'est prsente sous une forme assez aigu pour les traits passs par les villes avec les compagnies d'clairage au gaz, et cela depuis qu'il s'est cr des compagnies d'clairage lectrique. Ces compagnies ont demand leur tour aux villes des permissions de voirie pour installer leur canalisation. Il s'agit de savoir jusqu' quel point les villes sont lies par le monopole concd aux compagnies d'clairage au gaz. Les traits ne sont pas conus tous dans les mmes termes; mais la rdaction la plus frquente et qui donne lieu aux plus grandes difficults est celle qui concde la compagnie le monopole pour l'clairage au gaz. Les conseils de prfecture se sont montrs un peu hsitants, cependant une jurisprudence tendait s'tablir dans le sens de l'interprtation restrictive du monopole, le monopole n'existant que pour le gaz, les villes auraient pu autoriser la canalisation de l'lectricit au profit des particuliers, et mme en user elles aussi, moins qu'elles n'eussent concd l'clairage public. (Conseil de prfecture de l'Orne, 13 fvrier 1891 ; id. Seine-et-Marne 10dc 1891.) Malheu-
DE PUISSANCE LES MODES PUBLIQUE D'ACQURIR
541
reusement deux arrts du Conseil d'tat du 26 dcembre 1891 (ville semblent condamner ce de Montluon et ville de Saint-tienne) principe d'interprtation; mais cette jurisprudence n'est peut tre pas encore bien assise. DE PUISSANCE II. - LES MODES SECTION D'ACQURIR PUBLIQUE Caractres gnraux de ces modes d'acqurir. modes 401.I. Des divers de puissance d'acqurir Les modes d'acqurir de puissance publique sont de publique. nature trs varie. Les uns se rattachent la loi, comme les impts; les autres sont une dcision judiciaire comme le jugement d'expropriation, les autres sont des contrats comme les marchs de travaux publics, les marchs de fournitures de l'tat, les contrats relatifs la dette de l'tat. De ces modes, les uns font acqurir la proprit directement, comme l'expropriation pour cause d'utilit publique, les autres la font acqurir par l'intermdiaire d'obligations. Caractre commun. Tous ces modes d'acqurir, envisags au point de vue de l'administration, constituent des oprations administatives, ce sont des oprations de puissance publique (v. p. 185). Leur caractre commun est de produire des effets exorbitants et d'tre employs dans des hypothses o l'utilit publique est particulirement vidente. Par consquent, ils font acqurir la proprit aux personnes administratives dans des cas o cette acquisition est particulirement utile. Il faut bien se garder cependant de voir un lien ncessaire entre les modes d'acqurir de puissance publique et le domaine public au sens troit, tel que nous l'avons tudi la section prcdente, et de croire que leur spcialit est d'alimenter ce domaine. Il n'en est rien. Les modes d'acqurir de puissance publique font bien acqurir la proprit et ce titre mritent d'tre classs parmi les droits domaniaux au sens large du mot comme nous l'avons fait p. 419, mais les choses acquises, grce eux, tombent toujours, momentanment au moins, dans le domaine priv. D'abord, beaucoup de ces oprations ont pour rsultat de faire ac: les impts, les contrats relatifs la dette publique, qurir des deniers notamment les emprunts, sont dans ce cas, or, les deniers publics ne sont point dpendances du domaine public. Mme les modes, comme l'expropriation, comme les marchs de travaux publics, qui font acqurir des objets susceptibles de devenir
542
LES DROITSDOMANIAUX DE PUISSANCE PUBLIQUE
des dpendances du domaine public, ne doivent pas tre considrs comme des modes d'acqurir de ce domaine. Sans doute, un terrain acquis par expropriation deviendra presque toujours une dpendance du domaine public, mais il ne le deviendra pas par le fait de l'expropriation, il faudra que l'affectation l'utilit publique soit ultrieurement ralise. Mme observation pour une construction accomplie au moyen d'une opration de travaux publics. Les personnes administratives ont des privilges exorbitants pour les crances et pour les dettes qui rsultent de ces modes d'acqu rir. 402. II. Privilges exorbitants des personnes administratives pour les crances qui naissent d'opra En gnral, les personnes tions de puissance publique. administratives pour ces crances-l, n'ont pas besoin de recourir aux tribunaux pour se procurer titre excutoire contre le dbiteur. La rgle s'applique compltement aux dpartements et aux communes, elle ne s'applique pas compltement l'tat, elle n'est pas formule pour les colonies ni pour les tablissements publics. a) Crances des dpartements et des communes. Pour les dpartements et les communes il y a des textes gnraux (1. 10 aot 1871, art. 64; 1. 5 avr. 1884, art. 154, 1er). Ces textes sont conus d'une faon analogue: toutes les recettes pour lesquelles les lois et rglements n'ont pas prescrit un mode spcial de recouvrement s'effectuent sur des tats dresss par l'organe excutif. Pour les dpartements, les tats sont dresss et rendus excutoires par le prfet ; pour les communes ils sont dresss par le maire et sont excutoires aprs qu'ils ont t viss parle prfet ou le sous-prfet. Cela appelle les observations suivantes: 1 Ces tats de recouvrement ne sont ncessaires que lorsqu'il n'y a pas d'autre mode de recouvrement, ce qui sera assez rare. Ainsi les impts directs ou indirects ont des modes spciaux de recouvrement que nous verrons plus tard, et qui d'ailleurs ne supposent pas l'intervention des tribunaux; les taxes municipales dues en vertu de lois ou d'usages, et rparties par le conseil municipal, sont recouvres comme les contributions directes (art. 140, l. 1884); les octrois, droits de place, etc., sont recouvrs dans la forme des contributions indirectes. D'un autre ct, quand les dpartements et les communes ont pass des contrats en la forme administrative, nous savons que l'acte forme titre excutoire. (V. p. 200.) On peut signaler, comme cas d'application, le recouvrement des subventions promises par des particuliers pour une opration de tra-
LES CRANCES ET LES DETTES MODES D'ACQURIR.
543
vaux publics ; celui des redevances pour concessions dans les cimetires. 2 Ces tats de recouvrement n'ont point d'autre effet que de former titre excutoire; par consquent ils n'entrainent point une hypothque' judiciaire analogue celle qu'entranent les contraintes au profit de l'tat (V.p. suiv.); ils n'entranent pas davantage attribution de comptence pour les tribunaux administratifs. Si la matire par elle mme est de la comptence des tribunaux ordinaires, elle ne cessera point d'en tre parce qu'un tat de recouvrement aura t dress (Caen, 12janv. 1881). Le visa du prfet ou du sous-prfet n'a que la valeur d'une formalit de procdure. (D. P. 82, 2, 57, note sur l'arrt prcit.) 3 La consquence de ce mode de poursuite est que le dbiteur qui veut contester sa dette est oblig de faire opposition. L'opposition au recouvrement sera forme devant les tribunaux administratifs ou devant les tribunaux ordinaires selon la matire; devant les tribunaux ordinaires elle sera juge comme affaire sommaire, et les communes pour y dfendre ne seront pas obliges de se faire autoriser par le conseil de prfecture (Art. 154.) b) Crances de l'Etat. Pour l'tat il n'y a point de texte gnral, aussi peut-il tre expos en certains cas demander aux tribunaux un titre excutoire, mais pour ses principales crances des textes spciaux lui donnent le droit de dcerner des contraintes dlivres par le ministre des finances, qui entranent l'excution pare et de plus une hypothque judiciaire. Les crances ainsi recouvrables sont: 1 Les dbets des comptables, entrepreneurs et fournisseurs (L. 12 vendmiaire et 13 frimaire an VIII, arrt du 18 ventse an VIII, arrt du 28 floral an XI et dcret du 12 janv. 1811.) Cette lgislation est applicable toute personne ayant eu le dpt, la garde, le maniement de deniers publics ou la disposition d'avances dont le Trsor a le droit de demander compte (Cons. d't. 10juill. 1874-6 juin 1879); mais elle ne s'tend pas plus loin; ainsi de nombreux arrts ont refus l'emploi de la contrainte pour le recouvrement du prix de la pension dans des coles de l'tat. Les arrts de dbet ne peuvent pas non plus tre pris contre les ordonnateurs pour dpenses inutiles, ni pour paiement de l'ind fait entre les mains des particuliers ; 2 Les crances de l'administration des douanes (1. 6-22 aot 1791, titre XIII, art. 31 et suiv. ; 1. 16 fructidor an III, art. 10; avis Cons. d't. 29 oct. 1811); celles de l'administration des contributions indirectes (1. 1er germinal an XIII art. 43 et suiv.); de l'administration
544
LES DROITSDOMANIAUX DE PUISSANCE PUBLIQUE
de l'enregistrement et des domaines (1. 19 aot 1791, art. 4; 22 frimaire an VII, art. 64). Nous ne faisons pas figurerles contraintes en matire de contributions directes, parce qu'elles ne prsentent pas le mme caractre que les autres, elles sont collectives et s'adressent plutt l'administration qu'aux contribuables. D'ailleurs le titre excutoire se trouve ici dans le rle des contributions. Les contraintes administratives entranent excution pare, c'esl-dire qu'elles autorisent: la saisie, la vente des meubles, l'inscription de l'hypothque judiciaire (av. cons. d't. 16 therm. anXII; av. 29 oct. 1811). Le recouvrement par contrainte repose sur une double prsomption de vracit de l'administration : vracit au point de vue de l'existence de la crance, vracit au point de vue du calcul du quantum. Cette prsomption tombe devant une opposition rgulirement forme et la question est porte devant le tribunal comptent. La contrainte administrative n'est point un acte de jugement, malgr qu'elle entraine l'hypothque judiciaire, c'est un acte d'autorit administrative. Elle est revtue de la formule excutoire, c'est vrai, comme les jugements, mais ceux-ci empruntent eux-mmes la formule excutoire la puissance excutive, et puis il y a d'autres actes qui en sont revtus, par exemple ceux des notaires. Elle fixe avec autorit le montant de la crance, mais ce n'est pas la faon d'un jugement, car ici le juge serait juge et partie. Nous reverrons la question au contentieux, car c'est un des cas o l'on a prtendu que les administrateurs agissaient comme juges. (V. n 573). administratives 403. III. Privilges des personnes de puissance rsultant des oprations pour les dettes Au regard des dettes, les privilges sontde deux ordres publique. diffrents: ils sont relatifs, soit la faon dont les dettes peuvent tre dclares ou constates, soit la faon dont le paiement peut en tre poursuivi. a) Comment les personnes administratives peuvent tre dclares dbitrices. Il existe ici au profit de l'tat un privilge qui lui est particulier: toutes les fois qu'il s'agit de dettes contractes en qualit de puissance publique, il ne peut tre dclar dbiteur que par les tribunaux administratifs, jamais par les tribunaux judiciaires. Ce principe signifie ceci, c'est que : aucune crance ne peut tre liquide la charge du Trsor que par l'un des ministres ou par ses dlgus ; que cette liquidation n'est pas seulement une opration prliminaire de comptabilit, consistant recevoir les titres de crance, vrifier les dchances qui leur seraient opposables, les crdits sur
LES CRANCES ET LES DETTES MODES D'ACQURIR.
545
lesquels leur paiement pourrait tre imput, mais qu'elle comporte en outre la reconnaissance dfinitive ou le rejet de la crance, que c'est un acte de gestion confrant vraiment le droit au crancier; que la dcision du ministre ne pouvant ensuite tre attaque que devant les tribunaux administratifs, en aucun cas les tribunaux ordinaires ne peuvent connatre des actions tendant faire dclarer l'tat dbiteur. Ce principe, qui remonte l'ancien rgime, a t consacr par les lois de la Rvolution (1. 17 juill. 1790, et 1. 26 sept. 1793), et est toujours en vigueur. Ce principe s'applique aux nombreuses crances provenant de contrats ou de quasi-contrats de l'tat : soldes, traitements, pensions, missions de rente, oprations de trsorerie, comptes courants des trsoriers-payeurs gnraux, marchs de fournitures, marchs de travaux publics, etc. Cette procdure est tellement rigoureuse que lorsque le Conseil d'tat condamne l'tat payer une indemnit un fournisseur, il ne liquide pas lui-mme, il renvoie devant le ministre pour la liquidation. Mais ce principe, comme toute rgle gnrale, comporte des exceptions. D'abord il ne s'applique pas aux actes que l'tat accomplit comme personne prive pour son domaine priv. En effet, c'est un privilge de puissance publique. En second lieu, mme pour les actes accomplis titre de puissance publique, il y a des exceptions rsultant de lois, mais il faut un texte. Il en existe en matire d'expropriation pour cause d'utilit publique, en matire de rquisitions militaires, etc. b) Comment le paiement des dettes est obtenu. Il existe ici un privilge commun toutes les personnes administratives, et ce privilge s'tend toute espce de dettes, non plus seulement celles qui supposent la puissance publique. Les cranciers ne peuvent pas employer les voies d'excution du droit commun. Par consquent ils ne peuvent faire ni saisie-immobilire ni saisie-excution, ni saisie-arrt sur les crances. (Av. Cons. d't., 12 aot 1807; Cours de Paris, 11 janv. 1889; spcialement pour les hpitaux, circ. 2 prairial an VII.) Contre l'tat il n'y a aucun moyen de contrainte, il paye toujours volontairement, d'ailleurs il est prsum solvable et honnte homme. Contre les autres personnes administratives, il existe un moyen de contrainte, mais il est la disposition de l'tat qui est toujours juge de la question de savoir s'il convient de l'employer. Ce moyen de contrainte consiste en ceci: que les dettes exigibles H. 35
546
LES DROITSDOMANIAUX DE PUISSANCE PUBLIQUE
constituent une dpense obligatoire du budjet, qui peut tre inscrite d'office et laquelle il peut tre pourvu par une imposition tablie d'office. (V. pour les dpartements, l. 10 aot 1871, art. 61 ; pourles communes, l. 5 avril 1884, art. 136, n 17 ; pour les colonies, les dcrets sur l'organisation des conseils coloniaux.) Vis--vis des communes, au lieu de prendre la voie de la contrainte budgtaire qui suppose une imposition d'office, l'tat peut prendre un autre moyen. Aux termes de l'art. 110, l. 1884, il peut autoriser la vente des biens autres que ceux qui servent un usage public ; la vente est autorise par un dcret qui en rgle les formes. Contre les tablissements publics, il faut admettre fortiori que l'tat peut employer la voie de la contrainte budgtaire; mais comme il ne peut pas tablir ici d'imposition d'office pour faire face la dpense, si l'tablissement n'a pas de ressources disponibles, il faut admettre qu'il peut autoriser la vente des biens. Dchance Rappelons enfin le principe de la c) quinquennale. dchance quinquennale qui existe au profit de l'tat et des colonies. (V. p. 408.) Cinq annes aprs l'ouverture de l'exercice financier pendant lequel la crance est ne, le crancier est dchu s'il ne s'est pas fait payer, moins que le retard ne provienne du fait de l'administration ou de pourvois forms devant le Conseil d'tat. Cette dchance existe pour toute espce de dettes de l'tat; elle frappe aussi bien celles qui ne sont pas liquides que celles qui le sont. Seulement elle doit tre formellement invoque par une dcision du ministre liquidateur, ou tout au moins dans un mmoire de procdure ; il ne suffit pas qu'elle soit invoque par l'avocat de l'tat. signe de lui La dchance peut tre invoque, mme quand l'tat a t condamn au fond. Le droit de l'invoquer ne disparat que quand un jugement pass en forme de chose juge statu, mme tort, sur la question mme de dchance et a dcid qu'elle ne pouvait pas tre invoque. La dcision du ministre est susceptible de recours contentieux aux Conseil d'tat. 1er LES IMPOTS Notions gnrales. 404. Le droit d'impt est, pour une personne administrative, le
i. Bibliographie.Fournier et Daveluy, Traitdescontributions directes,Lemercier de Jauvelle, Rpertoiredes contributionsdirectes.
LES IMPOTS MODES D'ACQURIR.
547
droit d'exiger d'un particulier une prestation en argent, raison de certains faits dtermins par la loi, et en vue d'alimenter son budget annuel. Les faits dtermins parla loi, raison desquels prend naissance la crance de l'impt, et qui sont des faits rvlateurs du revenu des d'assiette de l'impt. particuliers, portent le nom La prestation qui fait l'objet de l'impt aune tendance se rpter. Dans les impts directs, dont nous verrons plus bas la dfinition, cela tient ce que la prestation est due raison de certains faits qui sont par leur nature permanents, mais qui sont constats administrativement nouveau tous les ans; la prestation devient annuelle. Dans les impts indirects, la prestation est due raison de faits passagers, mais qui se reproduisent, et chaque fois qu'ils se reproduisent. Le droit d'impt procde de la loi, carc'est un principe constitutionnel que tout impt doit tre tabli par une loi. Comme la loi est faite par le Parlement, et que le Parlement reprsente la nation, on peut dire en un certain sens que les impts sont librement consentis par la nation. Il ne faut pas cependant exagrer ce point de vue, les impts ont un caractre de ncessit vident, ils ne pourraient cesser d'tre perus seulement pendant un mois sans que l'existence de toute la machine gouvernementale ne ft compromise; l'intervention du Parlementa surtout une valeur de contrle, soit pour empcher que le chiffre de l'impt ne soit inutilement augment, soint pour empcher des injustices dedtail dansl'assiette et dans la rpartition de l'impt. Le droit d'impt est un droit de crance, car il a pour objet une prestation en argent qui doit tre faite par un contribuable; cependant, dans l'impt foncier, le droit de crance est accompagn d'un droit rel portant sur l'immeuble; le dtenteur n'est tenu que propter rem, la preuve, c'est qu'il est dcharg en faisant dlaissement la commune. L'impt foncier a quelque analogie avec l'ancienne rente foncire. De plus, plusieurs impts sont garantis par des privilges ou des droits de gage que nous verrons plus tard. Le droit d'impt existe au profit de l'tat, des dpartements, des communes, des colonies, et de certains tablissements. 405. Importance Les impts sont peu prs des impts. l'unique source laquelle s'alimente le budget des personnes administratives. Ils prlvent actuellement tous les ans, sur le revenu des contribuables, plus de 3 milliards et demi, et ils sont sans cesse grandissants. L'tat prend 430 millions par les contributions directes, 2 milliards et demi par les contributions indirectes.
548
LES DROITS DOMANIAUX DE PUISSANCE PUBLIQUE
Les dpartements et les communes demandent prs de 400 millions aux contributions directes. Les communes prlvent en outre prs de 200 millions par les octrois et 60 millions par les prestations. Ce dveloppement continuel, la ncessit de chercher perfectionner l'assiette des taxes afin qu'elles psent d'un poids moins lourd, fait que la lgislation des impts est incessamment modifie. 406. Impts sur le revenu. sur le capital. Impts L'impt sur le capital peut tre conu de deux faons, ou bien c'est un impt calcul de telle sorte qu'il dpasse le prlvement raisonnable sur les revenus annuels des contribuables et aboutit ainsi confisquer indirectement, peu peu, le capital lui-mme; ou bien c'est un impt qui n'a pour but que de faire un prlvement sur les revenus, mais qui, au point de vue de son assiette, prend ses lments d'apprciation dans la valeur en capital. Le premier genre d'impt sur le capital est un procd socialiste, au premier chef, et il faut bien reconnatre qu'il ya le germe d'un impt pareil dans notre impt sur les successions, surtout en ligne collatrale, car les droits de mutation considrables qu'il comporte, dpassent frquemment les revenus de toute uns priode d'annes. En gnral cependant nos impts ne sont que des prlvements sur les revenus. Le second genre d'impt sur le capital, pratiquement, se ramne un impt sur le revenu, sauf de petites diffrences dans l'assiette, et il pourrait servir frapper les objets qui ont une grosse valeur en capital sans donner de revenu, par exemple les terrains btir dans les villes. Il y a des impts qui frappent des revenus spciaux comme l'impt foncier qui frappe le revenu de la terre, comme la patente, qui frappe le revenu du commerce ou de l'industrie; il y a aussi des impts qui frappent l'ensemble du revenu du contribuable tel qu'il est rvl par certains signes, comme la cote mobilire base sur la valeur du logement occup, comme la taxe des chevaux et voitures, etc. Le revenu du contribuable est donc frapp par des taxes multiples, assises soit sur des branches de revenu distincts, soit sur des signes rvlateurs du revenu total galement multiples. Il parat difficile de remplacer ces taxes multiples par un impt unique sur le revenu total du contribuable. La difficult est d'arriver connatre ce revenu total : demander au contribuable une dclaration volontaire et compter sur la sincrit ; de cette dclaration, serait trop prsumer de la moralit des hommes faire des enqutes et des recherches administratives portant sur l'en-
MODES D'ACQURIR. - LES IMPOTS
549
semble des affaires d'un contribuable, serait une inquisition intolrable. L'impt unique sur le revenu est donc peu praticable; de fait, il a t expriment plusieurs fois, notamment pendant la Rvolution, et il a donn de pitres rsultats. Il existe dans certains pays, mais d'abord ces pays lui demandent peu, et de plus en ralit il contient plusieurs cdules, c'est--dire plusieurs taxes. Il faut se rsigner la multiplicit des taxes. Il est clair que, quelques-unes sont mal assises; certains revenus ne sont pas frapps, d'autres le sont plusieurs fois; mais, d'abord, des perfectionnements de dtail sont-possibles ; ensuite, les particuliers s'arrangent entre eux pour corriger la rpartition ingale des impts. C'est ce qu'on appelle la rpercussion de l'impt. Si le propritaire d'une maison est surcharg, il fait payer une partie de l'impt par le locataire. Si le commerant a une patente trop lourde, il la fait payer en partie par l'acheteur, etc. 407. Impts proportionnels. Tarifs progressifs.Nos impts sont proportionnels, c'est--dire qu'ils sont tablis d'aprs cette ide que chacun doit contribuer aux charges publiques proportionnellement ses facults. C'est uneapplication du principe de l'galit devant la loi. L'ide est trs juste, mais il fautla bien comprendre.Il ne faut pas croire que la proportionnalit de l'impt exige toujours des tarifs proportionnels au revenu rvl, et s'oppose toute espce de tarif progressif. Il y a des cas o, tant donn le mcanisme de l'impt, le tarif progressif est le seul moyen de raliser sincrement la proportionnalit. Cela peut arriver pour les impts directs qui frappent un ensemble de revenus comme la cote mobilire, les portes et fentres, la patente. Il faut songer que ces impts frappent des revenus qui ne sont pas connus directement, qui sont prsums grce certains signes dont le plus important est la valeur du logement occup par le contribuable. Or, ce signe du loyer, qui est assez juste pour les fortunes moyennes, perd de sa justesse pour les grosses fortunes : on peut dire que la valeur du loyer, dans les gros chiffres, ne crot pas dans la mme proportion que les revenus, il 'crot moins vite. A ce point de vue, il n'est pas injuste d'appliquer un tarif progressif aux gros loyers. Il y a longtemps d'ailleurs que la lgislation applique instinctivement des tarifs progressifs. Dans l'impt des portes et fentres, les tarifs le sont sensiblement suivant la valeur des maisons. Dans beaucoup de grandes villes les petits loyers sont exempts de la cote mobilire. A Paris, les loyers au-dessous de 500 francs sont exempts de la cote mobilire, et pour les autres loyers le tarif est progressif. Pour l'im-
550
LES DROITSDOMANIAUX DE PUISSANCE PUBLIQUE
pt des patentes, le tarif du droit proportionnel est progressif, il varie du soixantime au huitime de la valeur locative. La taxe sur les cercles est progressive, etc. 408. Impts directs. indirects. Les impts diImpts rects sont perus directement sur le contribuable in personam, au moyen de rles nominatifs, l'occasion de certains faits qui rvlent le revenu total ou du moins une quote-part du revenu total du contribuable. Exemple : la cote personnelle et mobilire, assise sur le loyer, l'impt foncier assis sur la possession de la terre. Ces signes rvlateurs indiquent un revenu permanent. Ils sont constats administrativement tous les ans et donnent lieu une prestation annuelle. Les impts indirects sont perus l'occasion d'un fait qui suppose le dplacement d'une valeur certaine, une mutation de proprit, la circulation d'une richesse; ils sont perus pour ainsi dire in rem, la personne du contribuable devient indiffrente et si son revenu est atteint, c'est d'une faon indirecte. Exemple : droits de mutation entrevifs ou par dcs, droits de douane, droits sur les boissons, etc. Les faits qui donnent lieu la perception de ces impts sont passagers, mais ils sont de nature se reproduire, et chaque fois la taxe est due. Quelques-uns de ces faits se reproduisent ncessairement: les mutations de proprit par dcs, par exemple, la circulation des denres de premire ncessit. Quelques autres sont facultatifs, par exemple, la consommation du tabac, de l'alcool. Il ya entre ces deux espces d'impts des diffrences conomiques et des diffrences juridiques. a) Au point de vue conomique, il faut remarquer que les impts directs sont plus lourds pour le contribuable cause de leur annalit, mais que pour l'tat ils sont plus faciles percevoir, et que dans les moments de crise leur rendement flchit moins parce qu'ils ne dpendent pas de faits volontaires. Pour les impts indirects, il faut distinguer : il y en a de trs mauvais, ceux qui portent sur la consommation des objets de premire ncessit, ou ceux qui sont un obstacle aux transactions. Ceux qui portent sur des faits de consommation volontaire, comme l'imptsur le tabac ou sur l'alcool, sont au contraire excellents; le contribuable les paie sans ennui, puisqu'il les paie librement, ils peuvent mme devenir des auxiliaires de la morale et de l'hygine en restreignant la consommation de denres dangereuses. Mais cependant ils prsentent pour l'tat des inconvnients communs tous les impts indirects, la perception en est difficile et coteuse, de plus, dans les moments de crise, le rendement peut flchir parce que la consommation se restreint.
MODES LES IMPOTS D'ACQURIR.
551
Cela prouve que par mesure de prcaution il faut conserver les deux formes d'impt, demander la plus grosse somme aux impts indirects, surtout ceux qui sont facultatifs, et considrer l'impt direct comme un supplment et une rserve. Dj sur un budget de 3 milliards, les impts directs ne fournissent que 500 millions, les impts indirects fournissent 2 milliardset demi. b) Aupoint de vue juridique, il faut remarquer que les impts directs prsentent beaucoup plus que les impts indirects le caractre de droits de puissance publique. D'abord leur tablissement et leur perception supposent des oprations administratives recommences tous les ans, tandis que les impts indirects sont perus sim plement par application directe des lois. De plus, et c'est un peu une consquence, le contentieux des contributions directes est attribu aux tribunaux administratifs, tandis que celui des contributions indirectes est attribu aux tribunaux judiciaires. 409. Impts de quotit. de rpartition. Impts On appelle impt de quotit tout impt dans lequel la taxe payer par chaque contribuable est directement dtermine par la loi Tous les impts indirects sont des impts de quotit. Le contribuable qui achte une proprit, par exemple, connat par les tarifs des droits de mutation, directement, la taxe qu'il aura payer. On sait pour chaque marchandise qui passe en douane la taxe qu'elle aura payer, etc. Certains impts directs sont aussi des impts de quotit : la patente, par exemple, le patentable sait directement, au moyen des tarifs, tant donn la profession qu'il exerce, la population de la ville, le loyer qu'il occupe, quelle sera la taxe. Depuis la loi du 11 aot 1890, l'impt foncier sur la proprit btie est devenu aussi un impt de quotit. Chaque maison a t estime individuellement et frappe d'une taxe. On appelle, au contraire, impt de rpartition, des impts dans lesquels la taxe payer par chaque contribuable n'est pas directement dtermine par la loi. La loi se borne fixer le chiffre total pour lequel le produit de l'impt doit figurer au budget. Ce chiffre total est ensuite rparti entre les contribuables, au prorata du revenu imposable de chacun, au moyen d'une opration annuelle appele rpartition. La rpartition se fait quatre degrs. Au premier degr, somme totale rpartie entre les dpartements par le Parlement dans la loi du budget. Au second degr, contingent du dpartement rparti entre les arrondissements par le conseil gnral. Au troisime degr,
552
LES DROITSDOMANIAUX DE PUISSANCE PUBLIQUE
contingent de l'arrondissement rparti entre les communes parle conseil d'arrondissement. Au quatrime degr, contingent de la commune rparti entre les contribuables de la commune par une commission de 1 cinq contribuables de la commune rpartiteurs ainsi compose : choisis par le sous-prfet, dont deux au moins non domicilis dans la commune s'il s'en trouve de tels; 2 le maire et un adjoint. Dans les communes de cinq mille habitants, le sous-prfet peut dsigner la place deux conseillers municipaux. La commission ne peut dlibrer qu'avec cinq membres prsents au moins. (L. 3 frimaire an VII; 1. 19 floral an VIII, art. 4.) Il n'y a d'impts de rpartition que parmi les impts directs, et il n'y en a que trois: l'impt foncier sur la proprit non btie (depuis la loi du 11 aot 1890, l'impt foncier sur la proprit btie a cess d'tre un impt de rpartition); l'impt des portes et fentres; la cote personnelle-mobilire. Les impts de rpartition ne sont pas en faveur, et de fait, on peut se demander s'il n'y a pas en eux quelque chose de surann. Ils exigent une opration annuelle assez complique, qui gnralement est accomplie par les conseils locaux d'une faon mcanique, d'aprs le travail dress par l'administration, et dont par consquent l'utilit est contestable. Primitivement, l'impt a pris cette forme parce qu'il tait lev beaucoup plutt sur des collectivits que sur des individus ; la taille, d'o procde l'impt foncier, tait leve sur une province, sur une lection, sur une paroisse; c'tait la paroisse qui devait l'impt, sauf le recouvrer sur les habitants. Il est demeur quelque chose de ce rgime, puisque, aujourd'hui encore les contingents des dpartements, des arrondissements, des communes, doivent toujours tre fournis intgralement, et que ce qui n'a pas t peru pour cause de dcharge ou de rduction, doit tre rimpos sur les habitants. Il est certain qu'aujourd'hui, avec son administration perfectionne, l'tat peut renoncer cette garantie des collectivits, et percevoir directement l'impt sur l'individu. Si la rpartition est devenue inutile pour l'tat, prsente-t-elle quelque utilit pour le contribuable? On prtend que oui, qu'elle est un obstacle la fiscalit ; que le Parlement votant tous les ans le chiffre total de l'impt, ce chiffre n'est pas augment, tandis qu'avec des taxes de quotit, l'administration ferait rendre l'impt beaucoup plus. Avec la publicit donne au rendement des impts, et le contrle toujours en veil du Parlement, ce danger est devenu bien moins craindre qu'autrefois. la rpartition, c'est qu'elle assure Au fond, ce qu'il y a de bon dans l'intervention des conseils locaux dans l'tablissement de l'impt; le
LES IMPOTS MODES D'ACQURIR.
553
conseil gnral intervient dans la fixation de certains tarifs (journe de travail, cote personnelle, prestations); le conseil municipal dresse des listes d'indigents qui sont exempts ; la commission des rpartiteurs procde certaines valuations de matire imposables (cote mobilire, valeur locative). Tout cela pourrait facilement tre conserv, quand mme on supprimerait l'opration de la rpartition. Aux colonies il n'y a pas d'impt de rpartition. Article Ier. Les impts directs. Dispositions communes toutes les contributions directes. L'impt direct est celui qui est peru directement sur les contribuables in personam au moyen de rles nominatifs, l'occasion de certains faits qui rvlent un revenu. 410. Division et en centimes additionen principal nels. Le montant de chacune des contributions directes se divise gnralement en principal et en centimes. Les centimes sont des supplments perus en sus du principal et dont chacun quivaut un centime dece principal. Des centimes additionnels de ce genre, portant sur les quatre grandes contributions directes, peuvent tre perus au profit des dpartements et des communes, mais alors ils constituent des impts dpartementaux et communaux accols aux impts d'tat. Le vritable centime additionnel est celui qui est peru au profit de l'tat aussi bien que le principal. De ces centimes additionnels perus au nom de l'tat qui portent le nom de centimes gnraux, il en est qui sont sans affectation spciale, et qui constituent une simple aggravation d'impts : il y a ainsi dix-sept centimes sur la contribution personnelle-mobilire, quinze centimes sur celle des portes et des fentres, quatorze centimes sur la patente, outre des centimes extraordinaires; il n'y ena pas sur la contribution foncire depuis la loi du 7 aot 1850. Il est d'autres centimes gnraux qui ont une affectation; ainsi un centime sur la contribution foncire et un sur la cote personnelle-mobilire, sont affects la cration d'un , Enfin, pour presque fondsde secours en cas de grle, incendie, etc.. toutes les contributions directes, un ou plusieurs centimes sont affects la cration d'un fondsde non-valeur destin couvrir l'tat des cotes remises ou des cotes irrecouvrables. 411. Principe de l'annalit. Toute contribution directe
554
LES DROITSDOMANIAUX DE PUISSANCE PUBLIQUE
est une dette annuelle.1 Elle est due pour l'anne entire raison des faits existants au 1er janvier, et quels que soient les vnements survenus au cours de l'anne. Ainsi pour l'impt foncier, en cas de mutation de proprit, la mutation de cote ne compte que du 1er janvier qui suit la mutation faite; en cas de dmolition d'une maison, la dcharge ne peut tre demande qu' partir du 1er janvier suivant. Pour l'impt des portes et fentres en cas de dmolition de maison, mme solution. Pour la cote personnelle-mobilire en cas de mort du contribuable, les hritiers sont tenus de payer jusqu' la fin de l'anne. (Cons. d't. 20 avr. 1849.) Cependant pour la patente, en cas de mutation de cote ou de dcs, il y a des tempraments. (V. art. 28 1. 15 juill. 1880, avec l'addition des art 29 et 30, 1. 11 aot 1890.) Il y a aussi des tempraments pour quelques taxes assimiles. (V. les textes spciaux. ) 2 A l'inverse, lorsque la cause de l'impt n'existe pas au 1erjanvier, et survient au cours de l'anne, en principe l'impt n'est d qu' partir du 1er janvier suivant. Il y a exception en matire de patente (art. 28, 1.15juill. 1880), en matire detaxe des chevaux et voitures, etc. (V. textes spciaux.) 412. d'une matrice et d'un rle. tablissement Tout impt direct donne lieu l'tablissement: 1 d'une matrice ou registre permanent o sont inscrits nominativement les contribuables avec indication de leur cote; en principe, les matrices sont dresses par commune; sont tenues au courant des mutations elles annuelles survenues dans la matire imposable; 2 d'un rle qui n'est autre chose que la copie de la matrice. Cette copie faite annuellement, rendue excutoire par le prfet et publie dans chaque commune par le maire, sert de titre excutoire aux mains du percepteur. 1 Les contributions directes sont exi413. Exigibilit. gibles par douzimes. Il y a un certain nombre d'exceptions. Pour la patente, dans le cas de dmnagement hors de la perception, de vente volontaire ou force, la contribution de l'anne entire devient exigible. Mme chose pour la cote personnelle-mobilire; 2 Les contributions ne sont exigibles qu'aprs la publication du rle et l'envoi des avertissements. La date de la publication du rle est importante, parce que c'est elle qui fait courir le dlai de trois mois, pendant lequel peuvent tre formes les demandes en dcharge ou rduction. L'avertissement est une notification individuelle envoye chaque contribuable pour le prvenir que la contribution est exigible. L'aver-
LES IMPOTS MODES D'ACQURIR.
555
tissement porte l'indication du total de la contribution, de la part revenant l'tat et celle revenant au dpartement et la commune (1. 5 aot 1874, art. 6), et en outre des indications pratiques pour la facilit du paiement; 3 Les contributions sont qurables dans la commune, mais doivent tre portes au bureau que le percepteur y a tabli. Le contribuable qui, le 1er du mois 414. Poursuites. n'a pas pay le douzime chu exigible peut tre poursuivi. (V. cep. Patentes, art. 29, 1. 15 juillet 1880.) On distingue des poursuites administratives et des poursuites judiciaires; les unes et les autres sont faites par le ministre de porteurs de contraintes qui sont les huissiers spciaux des contributions directes et dont le tarif est moins lev que celui des huissiers officiers ministriels. A dfaut de porteurs de contraintes on peut employer ces derniers (arr. 16 therm. an VIII, art. 50). Les poursuites sont faites conformment un rglement du 21 dcembre 1839. a) Poursuites administratives. 1 Sommation sans frais, simple lettre missive, sans forme dtermine (Cass. 19 mai 1879. (Papier vert.) 2 Sommation avec frais (papier jaune, cot 0,20), nom nouveau donn l'ancienne garnison collective. D'aprs la loi du 17 brumaire an V, il y avait deux garnisons, l'une collective, purement fictive, l'autre individuelle o un garnisaire venait pendant plusieurs jours vivre aux dpens des contribuables. La garnison individuelle a t supprime par la loi du 9 fvrier 1877, et la garnison collective a reu le nom de sommation avec frais. Cette sommation est faite en vertu d'une contrainte dlivre par le receveur particulier pour toutes les communes o il y a des retardaires, vise et enregistre la sous-prfecture. Cette contrainte, n'tant pas adresse aux particuliers, ne rentre pas dans les termes de l'avis du Conseil d'tat des 16-26thermidor an XII et n'emporte pas hypothque judiciaire. b) Poursuites judiciaires. Si les poursuites administratives sont infructueuses, le percepteur passe aux poursuites de droit commun qui se composent de trois actes, le commandement, la saisie et la vente; ces poursuites judiciaires sont encore faites par les porteurs de contraintes. 1 Le commandement (papier bleu, cot 1 fr. 25) ne peut tre fait que trois jours aprs la sommation avec frais; il n'a lieu qu'en vertu d'une contrainte (la seconde) dcerne par le receveur particulier et vise par le sous-prfet. Cette contrainte ordonne de procder la vente des biens si le contribuable ne se libre pas dans les trois jours partir de la notification du commandement. Les formes du commandement sont celles que prescrit le Code de procdure civile. Cette contrainte n'emporte pas non plus hypothque judiciaire.
556
LES DROITS DOMANIAUX DE PUISSANCE PUBLIQUE
2 Trois jours aprs le commandement demeur sans effet et en vertu de la mme contrainte, le percepteur peut faire procder la saisie (papier rouge) des meubles du contribuable et celle des fruits pendants par branches et par racines. La saisie est faite dans la forme ordinaire. La liste des objets insaisissables rsulte des art. 592 C. pr. et 52 arrt du 16 themidor an VIII combins. (Art. 77, rglement 21 dc. 1839.) 3 La vente des meubles et des rcoltes ne peut tre faite que huit jours aprs le procs-verbal de saisie, en vertu de l'autorisation du sousprfet (celui-ci peut abrger le dlai). C'est sur le prix de ces ventes que s'appliquent les privilges du Trsor ; sur les rcoltes, pour la contribution foncire ; sur les meubles, pour les autres contributions directes. Le percepteur peut encore faire des saisies-arrts sans autorisation (mesure conservatoire). Enfin, dfaut d'autres moyens, le percepteur procde la saisie immobilire ou expropriation force des immeubles avec l'autorisation du ministre des finances. (L. 12 nov. 1808, art. 3.) Si le percepteur nglige de faire les poursuites pendant trois annes conscutives partir du moment o les rles lui sont remis, il y a prescription. Si des poursuites ont t commences, le dlai commencerait aprs le dernier acte de poursuite qui a prcd l'interruption. Cette prescription n'est pas fonde sur une prsomption de paiement, mais sur un motif d'ordre public; aussi les percepteurs ne pourraient-ils pas invoquer l'art. 2275 C. civ. Ces 415. Demandes en dcharge ou rduction. demandes sont des recours contentieux en matire de contributions directes; elles se fondent sur ce que le droit du contribuable a t viol; dans le cas de dcharge, le contribuable ne devait pas tre impos du tout; dans le cas de rduction, il avait t surtax. Ces demandes diffrent profondment des demandes en remise ou modration que nous verrons plus loin, et qui sont la sollicitation d'une remise totale ou partielle pour l'anne courante d'un impt parfaitement d. Les demandes en dcharge ou rduction sont donc l'exercice d'un droit, tandis que les demandes en remise ou modration sont la sollicitation d'une faveur. Les demandes en dcharge ou rduction suivent des rgles communes. Tout contribuable, qui se croit impos tort ou surtax, peut former une demande en dcharge ou rduction devant le conseil de prfecture, dans les trois mois partir de la publication du rle dans la commune; dans le cas de faux ou de double emploi, le dlai de trois mois ne commence courir que du jour o le contribuable a eu connaissance officielle des poursuites diriges contre lui pour le recouvrement (1. 29 dc. 1884). L'appel est port au Conseil d'tat. (Art. 6. 1. 28 pluvise an VIII; 1. 5 aot 1844, art. 8; 29 dc. 1884, art. 4.)
LES IMPOTS MODES D'ACQURIR.
557
Il a la facult de faire auparavant la mairie du lieude l'imposition, dans le mois qui suit la publication du rle, une dclaration. Cette dclaration sera reue sans frais ni formalits sur un registre tenu la mairie. Elle sera signe par le rclamant ou son mandataire. Elle sera examine sommairement par le contrleur des contributions directes. Dans le cas o la dclaration ne sera pas reconnue fonde, il en sera donn avis au contribuable, qui aura le droit de prsenter une demande en dgrvement dans les formes ordinaires, dans un dlai d'un mois partir de la date de la notification, sans prjudice dudlai de trois mois indiqu plus haut. Si, aprs avoir t reconnue fonde par le contrleur, la dclaration n'tait pas admise par le conseil de prfecture, le contribuable aurait encore un mois compter de la notification pour former sa demande en dcharge ou rduction. (L. 21 juill. 1887, art. 2.) Ainsi, depuis la loi de 1887, le contribuable a le choix, ou de saisir immdiatement le conseil de prfecture, ou de tenter au pralable un recours gracieux devant l'administration. On a eu le dsir par cette innovation de dsencombrer les conseils de prfecture et le Conseil d'tat. On peut en effet remarquer une lgre diminution dans les affaires soumises au conseil de prfecture: en 1888, 346,000, en 1889, 319,000, soit 27,000 en moins, presque un douzime. La demande porte devant le conseil de prfecture doit tre crite sur timbre, sauf si la cote pour laquelle on rclame est infrieure 30 francs. Elle doit tre accompagne de la quittance des douzimes chus. Les demandes en matire de patentes doivent tre communiques au maire (art. 27, loi 15juill. 1880); la demande est juge en la forme ordinaire par le conseil de prfecture. Les frais ne sont la charge du rclamant que lorsque sa demande est rejete pour le tout. Le vide cr par la dcharge ou rduction dans la caisse de l'tat est combl pour les impts de quotit l'aide du fonds de non valeur. Dans les contributions de rpartition on rimpose l'anne suivante sur la commune, et c'est justice: un contribuableavait t trop impos, cela prouve que les autres ne l'avaient pas t assez, la rpartition avait t mal faite. Cependant pour les portes et fentres, les dcharges et rductions sont imputes sur un fonds de non-valeur, form par l'addition de trois centimes au principal, cela tient ce que cet impt tait primitivement de quotit. Nous 416. Demandes en remise ou modration. savons que c'est la demande d'une remise totale ou partielle pour
558
LES DROITSDOMANIAUX DE PUISSANCE PUBLIQUE
l'anne courante de l'impt sollicite titre de faveur. Cette demande est adresse au prfet, non point au conseil de prfecture; et l'arrt par lequel le prfet statue n'est qu'un acte d'administration, alors mme qu'il serait pris en conseil de prfecture. C'est mme un acte de pure administration qui n'est susceptible d'aucun recours contentieux. Bien que ce soit une matire de pure faveur, la loi a indiqu elle-mme certaines causes de remise et certaines rgles. Ainsi pour l'impt foncier, le contribuable qui a prouv une perte totale ou partielle de matire imposable, par suite de vacance de maison, grle, incendie et autres sinistres, peut adresser au prfet du dpartement une demande en remise ou modration. La demande doit tre faite dans les quinze jours qui suivent l'vnement extraordinaire qui a caus la perte de rcolte ou de revenu (arrt du 24 floral an VIII); elle peut tre individuelle ou collective; dans ce cas elle est rdige par le maire au nom des contribuables de la commune. Le vide caus par les remises et modrations est combl par les fonds de non-valeur. Les grandes contributions N 1. Les imptsdirects de l'tat. directes. 1 Impt foncier sur la proprit non btie. (L. 22 nov. 1 790; l. 3 frimaire an VII.) L'impt foncier sur la proprit non btie est un impt direct de rpartition assis sur le revenu net imposable du sol. de l'impt foncier. 417. A. Assiette et rpartition Il faut distinguer profondment l'assiette et la rpartition en tant qu'elles conduisent la fixation du contingent communal, ou bien en tant qu'elles conduisent la fixation de la cote de chaque contribuable l'intrieur de la commune. L'impt foncier tant un a) Fixation du contingent communal. ; ce impt de rpartition, un contingent total est fix pour la France contingent, qui est tous les ans le mme, moins d'augmentations ou de dgrvements, a continuellement diminu depuis un sicle. En 1790, il tait de 200 millions, ressortant au taux de 460/0 du revenu imposable. En 1890, il n'tait plus que de 118 millions, ressortant au taux de 4,60 du revenu imposable. En 1891, il y a eu encore un dgrvement de plus de 15 millions, ce qui ramne le contingent total un peu plus de 103 millions. Ce contingent total est rparti en contingents dpartementaux,
LES IMPOTS MODES D'ACQURIR.
559
arrondissementaux, communaux, d'aprs des valuations du revenu imposable de ces diffrentes circonscriptions. Ces valuations doivent tre faites par l'administration au moyen de renseignements fournis par les actes de vente, les actes de partage, les baux ferme, les dclarations de succession, etc. En fait, une rpartition avait t faite sur ces bases en 1821, et depuis ce moment tait reste traditionnelle. Or, elle consacrait des rsultats d'une ingalit choquante, certains dpartements payaient beaucoup plus que d'autres. On demandait de tous cts l'galit de taux dans les contingents, c'est ce qu'on appelait la perquation de l'impt foncier. Celte opration a t enfin ralise par la loi du 11 aot 1890, la suite d'une nouvelle valuation faite par l'administration de 1879 1884. (Rapport, Journal officiel du 21 aot 1884). Elle a t ralise en ce sens que tous les dpartements qui payaient plus de 4,60 0/0 de leur revenu imposable, ont t ramens ce taux par un dgrvement ; mais les dpartements qui payaient moins de 4,60 0/0 n'ont point t surtaxs. C'est pour cette raison que l'opration a abouti un dgrvement dfinitif de 15 millions sur le contingent total de l'impt foncier partir de l'exercice 1892. b) Assiette et rpartition de l'impt dans la commune. Cadastre. Dans la commune, le contingent doit tre rparti entre les contribuables raison du revenu net imposable des parcelles de terre que chacun possde. Le revenu net imposable est d'abord un revenu dont on a dduit les frais de culture; c'est de plus un revenu moyen, il doit tre calcul sur une priode de quinze annes dont on dduit les deux plus mauvaises et les deux meilleures. La dtermination des parcelles, la fixation du revenu net imposable de chacune, l'indication de leurs propritaires, tous ces lments indispensables de la rpartition dans la commune sont fournis par le cadastre. L'importance du cadastre est donc trs grande dans la commune, mais il est bon de savoir que le cadastre n'a aucune influence sur la rpartition en dehors de la commune. Ducadastre. Le cadastre est le tableau de toutes les parcelles de proprit immobilire dress commune par commune avec valuation du revenu net imposable de chacune d'elles. L'utilit du cadastre n'est pas limite la rpartition de l'impt foncier, celui-ci pourrait devenir compltement un impt de quotit, sans que pour cela le cadastre ft aboli. D'abord c'est une source de renseignements prcieuse, au point de vue de l'arpentage des parcelles et de l'tat des lieux; de plus, on pourrait facilement en faire un registre destin constater les mutations de proprit.
560
LES DROITS DOMANIAUX DE PUISSANCE PUBLIQUE
Il avait exist un cadastre dans l'empire romain (capitastrum); dans l'organisation fodale lous les grands domaines taient galement cadastrs dans des terriers; la Rvolution, ces terriers furent presque tous brls. L'Assemble constituante avait dcrt l confection d'un cadastre gnral, mais cette opration ne reut un commencement d'excution on crut que sous le Consulat. On dbuta avec, beaucoup d'illusions, qu'il suffirait de cadastrer un cerlain nombre de communes qui serviraient de type, d'y valuer le revenu d'un hectare de chaque espce de culture et d'appliquer cela ensuite aux autres communes; c'est ce qu'on ; cela ne donna pas de rsultats, appelait le cadastre par masses de culture les comparaisons furent impossibles; il fallut en venirau cadastre parcellaire de chaque commune. Ce fut une opration trs longue, trs coteuse. Commence en 1807, elle fut termine en 1850 dans le dpartement du Cantal. Le cadastre se compose de trois lments: 1 Un plan gographique, contenant la carte de la commune dcoupe en sections et relevant toutes les parcelles, lesquelles sont numrotes dans chaque section; 2 Un registre appel tat des sections, contenant par ordre de sections et de numros, la liste de toutes les parcelles avec indication du nom des propritaires et du revenu imposable, dtaill, s'il le faut, pour les diffrentes parties d'une mme parcelle; 3 Deux registres appels matrices cadastrales, l'un pour la proprit btie, l'autre pour la proprit non btie, o sont ouverts des chapitres, au nom des propritaires, contenant la listes des parcelles que ceux-ci possdent, avec indication de la section, des numros et du revenu. (V. 1. 29 juill. 1881, art. 2.) Confection du cadastre. La confection du cadastre donne lieu deux ordres d'oprations de nature diffrente : 1 des oprations gomtriques; 2 des oprations administratives. 1 Oprations gomtriques. Elles ont pour but de dresser un tat descriptif exact des parcelles avec indication de la contenance. Ces oprations sont : la dlimitation de la commune, la division de la commune en sections, la triangulation, l'arpentage et la leve du plan parcellaire. 2 Oprations administratives. Elles ont pour but de dterminer le : la revenu imposable de chaque parcelle. Elles sont au nombre de trois classification, le classement, le tarif des valuations. La classification est l'indication du nombre de classes entre lesquelles devront tre rparties, suivant leur nature de culture, les diverses proprits de la commune et le choix du type de chaque classe. Le classementest l'indication de la classe dans laquelle est comprise chaque parcelle. Le tarif des valuations est l'estimation du revenu imposable de chaque classe. La classification et le classement sont oprs par les soins de cinq
LES IMPOTS MODES D'ACQURIR.
561
classificateurs choisis par le conseil municipal parmi les propritaires de la commune, dont deux, s'il est possible, doivent tre domicilis hors de la commune. Le tarif des valuations est arrt par le conseil municipal et approuv par la commissiondpartementale qui a t substitue au prfet par la loi du 10 aot 1871. (Art. 87, 1.) Pour avoir le revenu imposable de chaque parcelle, il suffit de multiplier la contenance de la pareelle par le revenu l'hectare de la classe dont elle fait partie. Toutes ces-oprations donnent lieu des recours. La classification et le tarif des valuations au recours pour excs de pouvoir; de plus en matire de tarif d'valuation, la dcision de la commission dpartementale peut tre attaque devant le conseil gnral (1. 10 aot 1871, art. 88). Enfin le classement peut donner lieu un recours devant le conseil de prfecture, car s'il est fautif il entrane une surtaxe et par consquent une demande en rduction. De la fixit cadastrale. Le revenu net imposable constat pour chaque parcelle de terre peut varier assez rapidement, la justice absolue demanderait une revision priodique des oprations cadastrales. Cela a. t jug impossible, d'abord cause des frais qu'et occasionn cette revision, ensuite, parce qu'on et risqu de dcourager les amliorations par la perspective d'une augmentation d'impt. On est parti de l'ide oppose : les valuations du cadastre sont permanentes. En principe, d'aprs la loi du 15 septembre 1807, art. 37, il ne pouvait tre demand de dgrvement que pour destruction totale de la proprit. (V. cep. O. 3 oct. 1821, art. 9 et R. 10 oct. 1821; 1. 2 mars 1874, art. 9 et 10). Il faut ajouler que le cadastre peut tre refait, mais il le sera rarement. Dans toute commune cadastre depuis trente ans au moins, il pourra tre procd la rvision et au renouvellement du cadastre sur la demande du conseil municipal de la commune et sur l'avis conforme du conseil gnral du dpartement, la charge par la commune de pourvoir aux frais des nouvelles oprations. (L. 7 aot 1850, art. 7.) la taxe. Toutes les portions 418. B. Assujettissement du sol qui sont objets de proprit sont frappes lorsqu'elles sont productrices de revenu. Le sol sur lequel est difi un btiment est cotis comme sol, indpendamment de la taxe que paie la proprit btie. Le sol des dpendances du domaine public des personnes administratives est soumis l'impt aussi bien que celui des dpendances de leur domaine priv, condition d'tre productif de revenu. Ainsi: les chemins de fer et les canaux sont imposs. Il ya intrt ce que les biens de l'tat et des communes soient imposs afin que, dans les communes o ils se trouvent, la rpartition soit quitable. H. 36
562
LES DROITSDOMANIAUX DE PUISSANCE PUBLIQUE
Exemptions. Il y a des exemptions. Les unes sont permanentes, les autres temporaires. Les forts de l'tat sont exemptes d'une faon permanente (1. 19 vent. an IX); mais cette exemption ne s'applique qu' l'impt foncier lev au profit de l'tat; elles sont soumises aux centimes additionnels dpartementaux et communaux. (L. 5 avr. 1884, art. 144.) Quant aux exemptions temporaires, elles ont pour but d'encourager les amliorations agricoles; on les trouve dans les art. 111 et suiv. de la loi du 3 frimaire an VII et dans divers autres textes, notamment loi 1er dcembre 1887 sur la reconstitution des vignes phylloxres. Qui doit l'impt? L'impt est d par le propritaire ou par celui qui a sur l'immeuble un droit de jouissance, comme l'usufruitier ou l'emphytote,il n'est pas d par le fermier. Le dbiteur de l'impt peut se librer en faisant abandon de l'immeuble la commune. Le Trsor a un privilge sur les rcoltes, fruits, loyers, revenus des biens soumis la contribution pour l'anne chue et l'anne courante. (L. 12 nov. 1808.) 2 Impt foncier sur la proprit l. 8 aot 1885;l. btie. (L. 3 frimaire an VII; 11 aot 1890.)
L'impt foncier surla proprit btie est un impt direct de quotit, assis sur la valeur locative de l'difice. Cet impt figure au budget de 1889 pour une somme de 62 millions en principal. L'assiette de cet impt a t 419. A Assiette de l'impt. compltement modifie par des lois nouvelles. Autrefois elle tait la mme que celle de l'impt sur la proprit non btie; l'impt tait de rpartition, il est devenu de quotit, c'est un certain tant pour cent de la valeur locative; il tait assis sur le revenu net imposable dtermin par le cadastre, il est assis sur la valeur locative dtermine par une valuation administrative qui n'a plus aucun rapport avec le cadastre. (L. 11 aot 1890, art. 4 et 5.) a) valuation de la valeur locative. La valeur locative imposable est la valeur locative relle, dduction faite d'un quart pour les maisons et d'un tiers pour les usines, en considration du dprissement, des frais d'entretien et de rparation. (Art. 5.) L'valuation de cette valeur locative est faite par l'administration : 1 pendant six mois dater de la pu(eod. ) Un recours est possible blication du premier rle dans lequel un immeuble est impos ; 2 pendant trois mois partir de la publication du rle suivant.
LES IMPOTS MODES D'ACQURIR. Il est France. 1885, a locative
563
procd en principe par valuations gnrales pour toute la Ce travail d'ensemble, accompli en vertu de la loi du 8 aot la valeur rvl l'existence de 9,051,542 proprits bties dont a t value 2 milliards et la valeur vnale 49 milliards. (Journal officiel, 7 juill. 1890.) L'valuation gnrale sera revise tous les dix ans. Pendant la priode dcennale, l'valuation ne sera pas modifie. Toutefois, si, par suite de circonstances exceptionnelles, il se produit une dprciation gnrale desproprits bties, soit de l'intgralit, soit d'une fraction notable d'une commune, le conseil municipal aura le droit de demander qu'il soit procd aux frais de la commune une nouvelle valuation. (Art. 8.) La fixit, pendant dix ans, de l'valuation n'empchera point les constructions nouvelles d'tre taxes. Les constructions nouvelles, les reconstructions et les additions de constructions seront imposes par comparaison avec les autres proprits bties dela commune o elles seront situes; sont considres comme constructions nouvelles la conversion d'un btiment rural en maison ou en usine, et l'affectation d'un terrain des usages commerciaux ou industriels (art. 9). Il y a exemption pendant deux ans. (V. infr.) La fixit de l'valuation n'empche pas non plus que les propritaires ne soient admis annuellement se pourvoir en dcharge ou rduction: 1 en cas de destruction totale ou partielle de leurs btiments; 2 en cas de conversion en btiment rural; 3 en cas de dprciation par suite de circonstances exceptionnelles. (L. 15 sept. 1807, art. 38; 1. 11 aot 1890, art. 7.) Ces mmes propritaires peuvent demander une remise ou modration dans le cas d'inhabitation totale ou partielle de leurs immeubles, pendant toute une anne. (L. 15 sept. 1807, art. 38; 1. 8 aot 1885, art. 35.) b). Fixation du taux de l'impt. Le taux de l'impt ou le tant pour cent payer sur la valeur locative, sera fix annuellement par la loi de finances. Pour les exercices 1892 et 1893, il a t fix 3,20 0/0. 420. B. Assujettissement la taxe. Sont frapps tous les difices productifs de revenu, mme les btiments dpendant du domaine public s'ils remplissent cette condition. Doivent tre frapps, par consquent, les thtres, les marchs couverts, les abattoirs. La loi du 18 juillet 1834, art. 2, a ajout aux difices les bains et moulins sur bateaux, les bacs-bateaux de blanchisseries et autres semblables, bien qu'ils ne soient retenus que par des amarres. La loi du
564
LES DROITSDOMANIAUX DE PUISSANCE PUBLIQUE
11 aot 1890, art. 9, a ajout les chantiers affects des usages commerciaux ou industriels. Il y en a de Exemptions. permanentes, c'est ainsi que la loi du 3 frimaire an VII, art. 85, a exempt tous les btiments d'exploitation agricole servant loger les rcoltes ou les bestiaux, et la loi du 11 aot 1890, art 5, ajoute le btiment qui sert loger le gardien des bestiaux. Il y en a de temporaires: les constructions nouvelles, reconstructions, etc., ne sont imposes que la troisime anne, condition que le propritaire fasse une dclaration la mairie dans les quatre mois de l'ouverture des travaux (l. 1890, art. 9). A dfaut de dclaration, la taxation se fait immdiatement, conformment l'art. 10. 3 Contribution personnelle-mobilire. (L. 18 fvr. an VII;l. 21 avr. 1832.) 1791 ; l. 3 nivse
Cette contribution est un impt direct de rpartition qui frappe l'ensemble du revenu du contribuable l'aide de deux droits: 1 la cote personnelle, droit fixe ou capitation assis sur le seul fait de l'existence personnelle indpendante; 2 la cote mobilire, droit proportionnel assis sur la valeur locative du logement. Cet impt figurait au budjet de 1889 pour la somme de 61 millions 698,000 francs au principal. a) Assiette du droit. 421. I. De la cote personnelle. La cote personnelle est une capitation, qui frappe tout habitant vivant de ses ressources propres et non rput indigent. Le montant de cette capitation quivaut trois journes de travail La valeur de la journe de travail est dtermine chaque anne pour chaque commune par le conseil gnral du dpartement, sans que nanmoins cette valeur puisse tre moindre de 0, fr. 50, ni suprieure 1 fr. 50. Ce qui est frapp par cet impt, c'est donc l'ensemble du revenu, et ce, raison du fait mme de l'existence indpendante du contribuable. Mais l'impt est trs lger, puisqu'il oscille entreun minimum de 1 fr. 50 et un maximum de 4 fr. 50. La cote personnelle est due par b) Assujettissement la taxe. tout habitant, sans distinction de nationalit, ni de sexe, ni d'ge, condition : 1 Que l'habitant ait des ressources propres. Par consquent, un mineur qui a des ressources personnelles doit tre impos. Une femme veuve, spare de corps ou divorce doit tre impose. A l'inverse, les garons et filles mmes majeurs, qui vivent avec leurs parents et
LES IMPOTS MODES D'ACQURIR.
565
n'ont pas de moyens d'existence personnels, ne doivent pas la taxe. Non plus la femme marie qui habite avec son mari. Les domestiques attachs la personne ne sont pas d'ordinaire imposs. 2 Que l'habitant ne soit pas rput indigent. Sont rputs indigents ceux qui ont t dsigns comme tels par le conseil municipal, qui les rpartiteurs soumettent leur travail cet effet. La taxe n'est jamais due qu'une fois au domicile rel, quel que soit le nombre des rsidences. (L. 1832, art. 13.) Les officiers avec Exemptions. troupe sont exempts de cet impt, de mme les sous-officiers ayant un logement en ville, de mme les pre et mre de sept enfants mineurs lorsque leur cote personnelle-mobilire serait gale ou infrieure 10 francs. (V. infr, Cote mobilire.) a) Assiette du droit. La 422. II. De la cote mobilire. cote mobilire est un droit proportionnel assis sur la valeur locative du logement habit par le contribuable. La cote mobilire est destine frapper l'ensemble du revenu du contribuable, mais il s'agit uniquement du revenu tel qu'il est rvl par la valeur du loyer. Il est interdit l'administration de tenir compte de tous autres renseignements. valuation de la valeur locative. L'valuation de la valeur locative est faite par les rpartiteurs de la commune assists du contrleur des contributions directes, d'aprs les rgles suivantes : 1 On ne doit tenir compte que de la partie des btiments consacre l'habitation personnelle avecles dpendances naturelles, curies, remises, etc. On ne tient pas compte des btiments d'exploitation agricole; non plus des locaux consacrs exclusivement au commerce et l'industrie, car ces derniers sont frapps par le droit proportionnel de la patente. 2 Les logements doivent tre valus vide, abstraction faite du mobilier. Cesvaluations sont consignes dans une matricerevise tous les ans. Il est clair que le travail d'valuation de la valeur locative de la proprit btie, accompli pour l'impt foncier, pourra exercer de l'influence sur l'valuation en vue de la cote mobilire; mais il y a une diffrence, c'est que les rpartiteurs interviennent pour la cote mobilire et qu'ils n'interviennent plus pour l'impt foncier sur la proprit btie. b) Assujettissement la taxe. Tout contribuable impos la cote personnelle est par l mme impos la cote mobilire. Il n'y a pas lieu de distinguer entre les locataires en garni, les locataires d'appartements vides, les propritaires qui habitent leur propre immeuble. Mme
566
LES DROITS DOMANIAUX DE PUISSANCE PUBLIQUE
les fonctionnaires qui habitent des btiments publics doivent l'impt. Un contribuable, ayant plusieurs rsidences, est impos pour chaque rsidence prte l'habitation. Exemptions. Sont exempts de la cote mobilire les officiers avec troupe; cependant, s'ils occupent un logement d'un loyer suprieur celui qu'ils occuperaient dans la caserne, ils paieront pour le surplus (Cons. d't. 23 nov.1883). Un dcret du 25 dcembre 1875 a numr les officiers sans troupe qui ne bnficient pas de l'exemption. Sont exempts dans les mmes conditions les sous-officiers ayant un logement en ville, lorsque la valeur du logement n'excde pas l'indemnit de logement accorde par la loi du 23 juillet 1881, c'est-dire 180 francs. (Cons. d't., 16 mars 1888.) Les sous-officiers de l'arme de mer sont assimils.(D. 13janv. 1885). Enfin aux termes des lois des 17 juillet 1889, art. 3, 3, et 11 aot 1890, art. 31, sont exempts les pre et mre de sept enfants vivants. mineurs, lgitimes ou reconnus, lorsque leur contribution personnelle-mobilire est gale ou infrieure 10 francs en principal. Ce n'est que grce la 423. III. Rpartition de l'impt. runion de ses deux lments, que la contribution personnelle-mobilire est un impt de rpartition. La cote personnelle elle toute seule serait un impt de quotit. Mais grce la runion des deux lments, voici ce qui se produit: un contingent unique est fix pour la commune ; on commence par dfalquer le chiffre produit par la cote personnelle; il reste un reliquat, variable tous les ans, qui doit tre fourni par la cote mobilire et qui est rparti au prorata de la valeur des loyers. Rien ne serait plus facile que de transformer ces deux lments en impts de quotit, si ce n'tait la peur d'en voir augmenter le poids; la tentative avait t faite par la loi du 26 mars 1831, elle souleva tant de rclamations qu'il fallut revenir la rpartition en 1832. Dans les communes ou il y de l'impt. 424. IV. Rachat a un octroi, le conseil municipal peut obtenir la conversion par dcret, de tout ou partie du contingent de la contribution personnelle et mobilire assign la commune, en une somme payable par la caisse municipale (art. 20, 1. 1832). La commune devient dbitrice la place des particuliers. 4 Impt des portes et fentres.(L. 4 frimaire an VII; l. 21 avr. 1832.) L'impt des portes et fentres est un impt direct de rpartition qui
LES IMPOTS MODES D'ACQURIR.
567
frappe le revenu du contribuable, rvl par le nombre et la qualit des ouvertures de son logement. Cet impt n'est visiblement qu'un complment de la cote mobilire. puisque, comme cette contribution, il frappe l'ensemble du revenu, grce une certaine manire d'tre du logement. Il figurait au budget de 1889 pour une somme de 41,464,000 francs en principal. Cet impt est trs critiqu parce qu'il s'oppose aux progrs de l'hygine. Dans beaucoup de rgions, en effet, il est un obstacle la multiplication des ouvertures qui feraient pntrer dans les maisons l'air et la lumire. Sa suppression ou sa transformation ont t bien souvent demandes. Le grand obstacle une rforme provient de ce que la diversit des usages locaux dans les locations met cet impt tantt la charge du propritaire, tantt la charge du locataire. La taxe est assise sur toute ou425. Assiette de l'impt. verture donnant accs dans un difice, du dehors au dedans, soit aux personnes, soit l'air et la lumire. Peu importe qu'une ouverture soit sur une rue, sur une cour intrieure ou sur un jardin, peu importe qu'elle soit sur le toit, un cielouvert est imposable. Sont seules hors de cause les ouvertures qui font communiquer entre eux l'intrieur les appartements ou les pices des appartements. Les ouvertures sont frappes en vertu d'un tarif fix par l'art. 24 de la loi du 21 avril 1832 et dress en tenant compte des trois lments suivants: 1 La population des communes; 2 le nombre des ouvertures des difices; 3 la qualit des ouvertures. Suivant le chiffre des habitants, les communes sont divises en six classes (5,000, 5,000 10,000, 10,000 25,000, etc.) Il y a des rgles pour dterminer la population. (Art. 24, 2, 1. 1832; 1. 30juill. 1885.) Au point de vue du nombre des ouvertures, les maisons sont galement divises en six classes: une ouverture, deux., etc., six ouvertures et au-dessus. Au point de vue de la qualit des ouvertures, la loi fait trois catgories, dont la premire comprend les portes cochres, charretires et de magasin ; la seconde, les fentres du rez-de-chausse et des tages infrieurs jusques et y compris le second ; la troisime, les fentres des tages suprieurs. Il est remarquer que le tarif ne tient pas compte de la diffrence de valeur des maisons suivant les quartiers; c'est une injustice. Aussi Paris, Lyon, Bordeaux, sont-ils rgis par des rgles spciales inaugu-
568
LES DROITSDOMANIAUX DE PUISSANCE PUBLIQUE
res par le dcret-loi du 17 mars 1852. Ces villes ont des tarifs spciaux dans lesquels il est tenu compte de l'importance du revenu cadastral. Toute maison et tout 426. Assujettissement l'impt. logement habitables doivent tre frapps de l'impt, alors mme qu'ils ne seraient pas actuellement habits. En effet, bien que l'impt soit destin frapper le revenu du locataire, dans un but de fiscalit la loi dclare qu'il est d par le propritaire ou l'usufruitier, sauf celui-ci le recouvrer sur le locataire. Si donc il n'y a pas actuellement de locataire, le propritaire ne peut point se pourvoir en dcharge ou rduction, il peut seulement former une demande en remise ou modration. Les maisons nouvellement construites sont soumises l'impt ds qu'elles sont habitables, tandis que pour l'impt foncier il y a exemption pendant deux ans. La taxation des ouvertures et le dnombrement des maisons taxer sont oprs par les rpartiteurs avec l'assistance du contrleur des contributions directes. Il y a une matrice revise annuellement. Il existe quelques exemptions: Exemption. Sont exemptes 1 les portes et fentres des btiments employs : un service public, alors mme qu'ils seraient productifs de revenu (1. 4 frimaire an VII, art. 5), diffrence avec l'impt foncier. Mais lorsque des fonctionnaires sont logs gratuitement dans ces btiments, ils payent la contribution pour les locaux qu'ils occupent. (Art. 27, 1. 1832.) 2 Dans l'intrt de l'agriculture, les portes et fentres servant clairer ou arer les granges, bergeries, tables, greniers, caves et autres locaux non destins l'habitation des hommes (1. 4 frimaire an VII, art. 5). De plus, dans les fermes et mtairies, il n'est compt qu'une seule porte cochre ou charretire, alors mme qu'il yen aurait plusieurs. (Art. 27, 1,1. 21 avr. 1832.) 3 Les propritaires des manufactures ne sont taxs que pour les fentres de leurs habitations personnelles et pour celles de leur prposs et commis. En cas de difficults sur ce que l'on doit entendre par manufactures, il y serastatu par le conseil de prfecture. (L. 4 germinal an XI, art. 19). On peut se demander 427. Rpartition de l'impt. comment il se fait que cet impt soit de rpartition, il prsente toutes les apparences d'un impt de quotit, chaque ouverture est taxe individuellement l'aide de tarifs applicables toute la France.
LES IMPOTS MODES D'ACQURIR.
569
Il avait t en effet cr impt de quotit, et il a t peru ainsi de l'an VII l'an X. Voici simplement comment il est procd la rpartition: on commence par appliquer les tarifs toutes les maisons de la commune, cela donne un certain chiffre. Ce chiffre est gnralement plus lev que le contingent mis la charge de la commune; le rle des rpartiteurs consiste alors rduire proportionnellement la cote de chaque contribuable, pour ramener le chiffre total au chiffre du contingent. 5 Impt des droits de patente. (L. 2-17 mars 1791 ; l. 1er brumaire an VII; l. 25avr. 1844;l. 15juill. 1880. actuellement fondamentale, V. Tableaux annexs, Journal officiel, 22 juill. 1880; modifications postrieures dedtail, l. 30juill. 1885;l. 17juill. 11 aot 1890, art. 28, 29, 30, 32, et tableaux 1889;l. annexs. ) L'impt des droits de patente est un impt direct de quotit qui frappe le revenu produit par le travail au moyen de deux droits: 1 un droit fixe assis sur la nature de la profession, la population de la commune o elle est exerce, etc. ; 2 un droit proportionnel assis sur la valeur locative du logement personnel et des locaux industriels. Cet impt produit environ 75,000,000 francs pour le compte de l'Etat, et 6,500,000 francs pour le compte des communes auxquelles est attribu un prlvement de 8 0/0. 428. I. Du droit fixe. a) Assiette de ce droit. Le droit fixe est rgl conformment aux tableaux ABC annexs la loi du 15 juillet 1880, sauf modifications de dtail ultrieures, et conformment au tableau D annex la loi du 11 aot 1890. Pour chacun de ces tableaux, l'assiette varie: Tableau A. Dans le tableau A, le droit est tabli d'aprs la nature de la profession et eu gard la population de la commune. Il comprend huit classes de professions et neuf classes de communes au point de vue de la population. L'lment de population est calcul d'aprs les rgles des art. 5 et 6. La ville de Paris forme, elle seule, la premire classe de population, la dernire est celle des villes de 2,000 habitants et au-dessous. Quant aux professions, ce sont celles des commerants, l'activit du commerce est, en effet, en rapport avec la population. Les premires classes sont occupes par le commerce de gros, puis vient le demi-gros, puis le dtail.
570
LES DROITS DOMANIAUX DE PUISSANCE PUBLIQUE
Le commerce de gros, d'aprs la loi de 1880, est celui qui fait princicipalement le gros, trs accessoirement le dtail. Le demi-gros fait la fois le gros et le dtail; le dtail ne fait pas du tout le commerce de gros. Ces appellations avaient vari sous les lois prcdentes. La plus grosse patente du tableau Aest de 400 francs; la plus petite de 2 francs. Il faut ajouter que des lois rcentes ont rduit les petites patentes, celles des 6e, 7e, 8e, classes dans les communes de moins de 2,000 habitants. Provisoirement, la dernire disposition est celle de la loi du 11 aot 1890, art. 32. Tableau B. Dans le tableau B, le droit est tabli eu gard la population et d'aprs un tarif exceptionnel spcial chaque profession. La population est calcule conformment aux rgles des art. 5 et 6 de la loi de 1880, avec cette observation que les villes de 30,000 mes et au-dessous qui ont un entrept rel, sont hausses d'une classe1. Pour la majeure partie des professions qui figurent dans le tableau B, on a tabli, en outre du droit fixe proprement dit, une taxe par employs en sus du nombre de cinq, dont la quotit suit la progression du droit fixe eu gard la population. Sont dans ce tableau les professions du haut commerce, agents de change, banquiers, commissionnaires, courtiers, grands ngociants. Les magasins de plusieurs marchandises (grands magasins) ont t frapps, par la loi du 11 aot 1890, d'un droit fixe plus lev et d'une taxe par employ, plus forte. Tableau C. Dans le tableau C, le droit est tabli sans avoir gard la population, mais en tenant compte du nombre d'ouvriers employs et de celui des machines ou instruments. Les individus au-dessous de seize ans et au-dessus de soixante-cinq ans ne seront compts dans les lments de cotisation que pour la moiti de leur nombre. (Art. 10; voir aussi art. 11.) Sont dans ce tableau les usines, fabriques, manufactures, dont les bnfices sont en effet indpendants de la population de la commune eL sont peut-tre mme en raison inverse. b) Assujettissement au droit. Les professions non dnommes dans les tableaux n'en sont pas moins assujetties la patente Il doit tre procd leur gard conformment aux rgles de l'art. 4 de la loi du 15 juillet 1880, c'est--dire qu'il y a fixation par analogie, par arrt du prfet. 1. Entrept, lieu o sont dposes les marchandises dont on ne paie pus immdiatement les droits de douane. L'entrept est rellorsqu'il est tabli dans un local gard par la douane il est fictif lorsqu'il est constitu dans des magasins du commerce sous des conditions dtermines. C'est videmment un signe d'activit commerciale.
LES IMPOTS MODES D'ACQURIR.
571
Le patentable, qui exerce la mme profession dans des tablissements diffrents, est passible d'autant de droits fixes qu'il a d'tablissements. (Art. 8 et 22, l.1880. V. 1. 4 juin 1858, art. 9; 1.29 mars 1872, art. 1er.) Le patentable qui exerce plusieurs professions dans le mme tablissement ne peut tre soumis qu' un seul droit fixe dtermin conformment aux rgles de l'art. 7. Mais, s'il a des tablissements diffrents, il est passible d'un droit fixe raison de chaque tablissement. (Art. 8 et 9.) a) Assiette du droit. 429. B. Du droit proportionnel. Le droit proportionnel est tabli sur la valeur locative, tant de la maison d'habitation que des magasins, boutiques, usines, ateliers, hangars, remises, chantiers et autres locaux servant l'exercice des professions imposables. (Art. 12, 1er.) Suivant les professions, le taux du droit proportionnel varie. Il est fix conformment au tableau D annex la loi du 15juillet 1880, art. 19, et modifi par la loi du 11 aot 1890; le tarif est progressif, il va du 60e au 8e de la valeur locative. Le droit proportionnel fait double emploi avec la cote mobilire, au moins pour l'habitation ; mais c'est que le logement est un indice prcieux du revenu. La valeur locative est dtermine, soit au moyen de baux authentiques ou de dclarations de locations verbales dment enregistres, soit par comparaison avec d'autres locaux dont le loyer aura t rgulirement constat ou sera notoirement connu et, dfaut de ces bases, par voie d'apprciation. Il s'agit d'obtenir la valeur locative relle, ce n'est pas comme pour la cote mobilire qui est impt de rpartition et o les rpartiteurs attnuent toujours la valeur locative relle. Le droit proportionnel pour les usines et tablissements industriels est calcul sur la valeur locative de ces tablissements pris dans leur ensemble et munis de tous leurs moyens matriels de production (art. 12, 2 et 3). L'ensemble des moyens de production comprend : 1 les btiments; 2 la force motrice naturelle ou artificielle; 3 l'outillage mobile ou fixe. b) Assujettissement au droit. Le patentable qui exerce la mme industrie dans des tablissements diffrents paie le droit proportionnel dans toutes les communes o sont situs les tablissements, magasins, boutiques, usines, ateliers, hangars, etc., conformment aux rgles de l'art. 14, l. de 1880. Ce droit proportionnel est tabli naturellement d'aprs la valeur
572
LES DROITSDOMANIAUX DE PUISSANCE PUBLIQUE
locative de tous les tablissements situs dans la mme commune. Exemple : gares de compagnie de chemin de fer. Le patentable qui exerce dans un mme local plusieurs industries ne paye qu'un droit, celui applicable la profession pour laquelle il est assujetti au droit fixe. S'il exerce des industries diffrentes dans des locaux diffrents, il paye un droit proportionnel pour chaque local (art. 25). V. art. 15 pour le droit qui frappe dans ce cas la maison d'habitation. Il y a des exemptions (art. 1er, 1. de C. Exemptions. 1880). Ces exemptions portent sur les deux droits la fois ou sur l'un d'eux seulement. I. Exemption du droit fixe au profit des patentables qui exercent des professions librales, comme celles d'avocat, mdecin, notaire, etc., numres au tableau D. Les professions librales sont soumises la patente depuis la loi du 18 mai 1850. Les axocats ne sont soumis la patente qu'autant qu'ils sont inscrits au tableau. Le stagiaire n'y est pas soumis. Le stagiaire qui a termin son stage, retir son certificat, et qui ne s'est ; que s'il donne des pas fait inscrire au tableau n'y est pas soumis consultations il pourra tre mis la patente comme agent d'affaires. II. Exemption du droit proportionnel au profit des patentables qui exercent des professions de la 7e et de la 8e classe du tableau A dans des communes dont la population est infrieure 20,000 habitants, (Arg. art. 16, 1. de 1880.) Il en est de mme des fabricants mtiers ayant moins de dix mtiers et ne travaillant qu' facon. III. Exemption totale des deux droits fixe et proportionnel au profit des professions et mtiers numrs dans l'art. 17, l,15 juill. 1880. Il y a exemption de moiti des droits fixe et proportionnel au profit des professions et mtiers numrs dans l'art. 18. Enfin il y a un certain nombre de cas o il est peru moins de droits de patente qu'il n'y a en apparence de patentables. (V. art. 19, 20,21, 22.) 430. 431. D. tablissement du rle. La made la matrice trice du rle des patentes est tablie, conformment aux rgles de l'art. 25 de la loi du 15juillet 1880, par l'administration des contributions directes sous la surveillance du maire. En cas de dsaccord, la difficult est soumise au prfet. Cette disposition est trs intressante, car elle pourrait servir de
LES IMPOTS MODES D'AQURIR.
573
modle au cas ou d'autres impts de rpartition deviendraient impts de quotit. Il est clair que le point important, c'est que le contribuable puisse surveiller l'administration dans la confection des matrices, pour que les valuations ne soient pas exagres, que les exemptions soient appliques, etc. Des formules de patente. Il est dlivr tout individu mis la patente une formule de patente qu'il doit reprsenter dans certaines occasions. (V. art. 31 35, l. 15juill. 1880.) du locateur. 432. E. Recouvrement, responsabilit Les locateurs de btiments occups par des patentables sont responsables du montant de la contribution en certains cas. (V. l. 15juill. 1880, art. 30, 2, 3, 4.) II. Les taxes assimiles aux contributions directes.
sur les socits, associations et per433. I. Taxes Une srie de taxes frappent le revenu des morales. sonnes socits, associations et personnes morales, elles ont des buts divers ; tantt elles ont pour but de rtablir l'quilibre au point de vue de la charge de l'impt entre les individus et les associations, quilibre rompu par ce fait que les biens possds par les associations paient moins de droits de mutation (cependant le droit d'accroissement tabli par la loi du 28 dcembre 1880, et qui est un droit de mutation, a diminu l'ingalit), et en mme temps d'empcher l'accumulation des biens de mainmorte, ainsi en est-il de la taxe des biens de mainmorte; tantt elles ont pour but d'atteindre indirectement certains revenus des actionnaires ou socitaires, ainsi en est-il de la taxe sur le revenu des valeurs mobilires et de la taxe sur les cercles. 1 Taxe des biens de mainmorte (1. 20 fvr. 1849; l. 30 mars 1872; 1. 12 dc. 1875). Cette taxe est une redevance annuelle tablie sur les immeubles passibles de la contribution foncire et calcule raison de 0,70 par franc du principal de cette contribution. Elle est due : 1 par les dpartements, les communes et les tablissements publics; 2 par les tablissements d'utilit publique, notamment par les congrgations religieuses qui ont cette qualit; 3 par les socits anonymes, sauf l'exception de la loi de 1875. L'numration qui se trouve dans l'art. 1er, l. 1849 doit tre considre comme limitative. 2 Taxe sur le revenu des valeurs mobilires. (L. 29 juin 1872,
574
LES DROITSDOMANIAUX DE PUISSANCE PUBLIQUE
1.21 juin 1875, l. 28 dcembre 1880). Cette loi frappe d'un prlvement de 3 0/0 les bnfices annuels que distribuent les socits intresses et ceux que distribuent ou pourraient distribuer les associations dsintresses et les personnes administratives. Elle frappe par consquent: 1 les actions, parts d'intrts, des socits civiles et commerciales, commandites, l'exception des socits coopratives entre artisans, et cela pour les socits trangres comme pour les socits franaises. 2 Les emprunts ou effets publics des dpartements, communes, tablissements publics franais, et des personnes administratives trangres autres que les tats. 3 Les bnfices non distribus, mais qui pourraient tre distribus si les statuts ne l'interdisaient pas, dans les associations dsintresses congrgations religieuses ou autres, reconnues ou non reconnues, socits rgulires ou socits de fait. Pour l'valuation des revenus, voir 1. 28dc. 1880, art. 3. Cette taxe, bien que leve nominativement sur les socits, et appele par la loi taxe directe, ne prsente pas tous les caractres des contributions directes. 3 Taxe des litres au porteur. Les titres au porteur sont assujettis un droit annuel de 0 fr. 20 0/0, pour remplacer les droits de mutation perus sur les titres dont la transmission peut tre officiellement constate. (L. 29 juin 1854.) 4 Taxe sur les cercles. (L. 16 sept. 1871; 1.11 aot 1890, art. 33.) Celte taxe est tablie sur les cercles, socits et lieux de runion o se payent des cotisations; c'est un droit proportionnel qui porte la fois sur le montant des cotisations, y compris les droits d'entre et sur la valeurlocative des btiments, locaux et emplacements. Lescercles sontdiviss en trois catgories et le tarif est progressif. 1 Conde la cote mobilire. 434 II. Taxes similaires tribution sur les voitures, chevaux, mulets. L.2 juill. 1862; 16 sept. 1872; 23 juill. 1872; 22 dc. 1879. 2 Taxe sur les billards publicset privs. 'L. 16 sept. 1871 ; 18 dc. 1872.) 1) Redevance des mines. (L. 435. III. Taxes diverses. 21 avr. 1810; D. 11 fv. 1874; L. 8juill. 1890, art. 16; l.11 aot 1890, art. 34.) 2) Droits de vrification des poids et mesures. (0. 17 avr. 1839; l. 24 juill. et 5 aot 1874; l. 28juill. 1883.) 3 Droits de visite chez les pharmaciens, droguistes et piciers.
LES IMPOTS MODES D'ACQURIR.
575
(L. 21 germinal an XI; arrt 25 thermidor an XI; D.22 mars 1859.) N2. Les impts directs dpartementaux. 436. Il n'existe au profit du dpartement que des impts directs. Ce sont des centimes additionnels aux grandes contributions directes de l'tat. Ces centimes se divisent en ordinaires et extraordinaires. Ils se subdivisent en centimes gnraux sans affectation spciale, et en centimes spciaux ayant une affectation. On peut citer, comme exemple de centimes spciaux ordinaires, ceux affects la confection du cadastre parla loi du 2 aot 18-9 et ceux affects aux chemins vicinaux par la loi du 21 mai 1836; il y avait aussi des centimes spciaux pour l'instruction primaire, ils ont t supprims par la loi du 19 juillet 1889. Ces centimes sont vots par le conseil gnral dans la limite d'un maximum fix annuellement par la loi de finances. Quelquefois le vote des centimes spciaux peut tre obligatoire ; ainsi en tait-il des centimes pour l'instruction primaire en vertu de la loi du 16juin 1881. Au point de vue de l'assiette, de la rpartition et du recouvrement, les impts dpartementaux sont lis aux impts similaires de l'tat; ils ont mme figur longtemps dans un chapitre du budget de l'tat, sous la rubrique budget sur ressources spciales. Leur produit atteint annuellement 175 millions de francs. N 35. Impts directs communaux. Il existe des centimes additionnels. 437. I. Centimes additionnels communaux qui prsentent les mmes caractres que ceux des dpartements. Il en est d'ordinaires et d'extraordinaires, et ils se subdivisent aussi en centimes gnraux et en centimes spciaux. Il y a des centimes spciaux ordinaires pour les chemins vicinaux; des centimes spciaux pour l'instruction primaire, qui taient obligatoires, ont t supprims par la loi du 19 juillet 1889. Il existe une catgorie de centimes gnraux trs avantageux pour le budget communal, ce sont les centimes pour insuffisance de revenu. Tous ces centimes sont vots par le conseil municipal, avec ou sans autorisation de l'autorit suprieure. Leur produit dpasse annuellement 200 millions de francs. 1 Pr438. II. Prlvement sur les impts d'tat. lvement de huit centimes par francs du principal dans l'impt des
576
LES DROITSDOMANIAUX DE PUISSANCE PUBLIQUE
patentes (1. 15juill. 1880, art. 36); 2 prlvement du vingtime de l'impt sur les chevaux et voitures. (L. 29 juill. 1872, art. 10.) 439.III. Taxe des chiens. (L. 2 mai 1855.)
440. IV. Taxes rparties par le conseil municipal. (L. 5 avr. 1884, art. 140.) Il s'agit de taxes particulires dues en vertu de lois ou d'usages locaux, et provenant en gnral du rachat de servitudes lgales, telles que taxes de balayage, de pavage, etc. des prestations. 441. V. Impts (L. 21 mai 1836.) L'impt des prestations est un impt direct de quotit qui frappe l'ensemble du revenu comme la contribution personnelle-mobilire, mais il n'est pas assis sur les mmes signes rvlateurs; il est assis sur des faits qui rvlent chez le contribuable la puissance de production. Caractres particuliers. Outre son assiette spciale sur laquelle nour allons revenir, cet impt prsente trois caractres particuliers : 1 Le produit en est spcialement affect aux dpenses des chemins vicinaux; 2 Il est, dans une certaine mesure, facultatif pour les communes; celles-ci peuvent se dispenser de l'tablir si leur ressources ordinaires suffisent aux dpenses des chemins vicinaux, ou bien elles peuvent lui prfrer des centimes additionnels spciaux (art. 2, 1.1836); 3 Bien qu'il soit en principe payable en argent, il y aune facultas solutionis qui permet au contribuable de s'acquitter en nature par des journes de travail. (Art. 4.) Assiette de l'impt. L'impt est assis sur des faits d'habitation et sur des faits de possession. 1 Est tax raison du fait d'habitation tout habitant de la commune, chef de famille, ou chef d'tablissement ,titre de propritaire, rgisseur, fermier ou colon partiaire, mle, valide, g de dix-huit soixante ans, inscrit au rle des contributions directes. La taxe est de trois journes de travail, dont la valeur est value en argent annuellement, pour chaque commune, par le conseil gnral, comme pour la cote personnelle, mais avec cette diffrence qu'ici il n'y a ni maximum ni minimum. On remarquera que, pour ce chef d'habitation, la taxe ressemble la cote personnelle, mais qu'elle exige des conditions plus troites et par consquent frappe moins de personnes. Notamment, elle ne frappe pas les femmes, mme chefs d'tablissement. A l'inverse, elle frappe tous les hommes mles, valides, etc., quelle que soit leur condition
LES IMPOTS MODES D'ACQURIR.
577
sociale, mme les ecclsiastiques. Sont seuls exempts les officiers avec troupes. 2 Est tax raison du fait de possession, alors mme qu'il ne se1 pour rait pas tax personnellement, tout chef d'tablissement: chaque individu mle, valide, g de dix-huit soixante ans, membre ou serviteur de la famille et rsidant dans la commune; 2 pour chacune des charrettes ou voitures atteles;3 pour chacune des btes de somme, de trait, de selle, au service de la famille ou de l'tablissement dans la commune (et non comprise dj dans les attelages). La taxe est de trois journes de travail pour chacun de ces lments; les journes des attelages, celles des btes de somme, sont values en argent par le conseil gnral, comme les journes des hommes. L'assiette de cet impt est trs critiquable, en ce qu'elle frappe lourdement les revenus qui s'emploient d'une faon productive, et trs lgrement ceux qui se dpensent en consommations improductives. Malgr cela, une loi du 11 juillet 1868 a autoris les communes s'imposer d'une quatrime journe de prestation, mais une rforme est prvoir, d'autant mieux que la priode de construction des chemins vicinaux touche sa fin. N 4. Impts directs coloniaux. 442. Il existe entre le territoire des colonies et les autres parties du territoire de l'tat franais, une diffrence capitale au point de vue de l'impt, c'est que les impts d'tat ne sont pas perus aux colonies. Il n'est peru d'impts qu'au profit des colonies elles-mmes ou bien au profit des communes qu'elles peuvent renfermer. Les colonies peroivent leur profit la plupart des impts qui, dans les autres parties du territoire, sont perus au profit de l'tat. Elles ont donc une grande varit d'impts. Tous ces impts sont vots par le conseil gnral de la colonie et en principe doivent tre approuvs par dcret. Il y a des impts directs et des impts indirects. Chacune de ces deux espces de contribution suit les mmes rgles qu'en France, notamment au point de vue du contentieux. Il est remarquer seulement que les impts directs y sont tous de quotit, les colonies donnent ici la mtropole l'exemple d'un progrs. Toutes les colonies n'ont pas les mmes impts. Les tableaux qui ont t dresss montrent que les plus frquents sont : parmi les impts directs, la contribution foncire et celle des patentes ; parmi les impts indirects, les droits sur les spiritueux, les droits de naviH. 37
578
LES DROITSDOMANIAUX DE PUISSANCE PUBLIQUE
gation, l'octroi de mer et les douanes, les droits d'enregistrement. Des arrangements sont pris pour que le personnel des administrations financires coloniales puisse, au bout d'un certain temps de service, rentrer dans les cadres de la mtropole. Comme l'tablissement de l'Algrie ne cons443. Algrie. titue pas une personne administrative, il n'est pas peru d'impts son profit. Il est peru en Algrie des impts d'tat, des impts dpartementaux et des impts communaux. Tous les impts d'tat perus en France ne sont pas perus en Algrie. Il faut distinguer entre la population europenne et la population arabe. Sur la population arabe, il est lev des contributions dites arabes qui se rapprochent de nos contributions directes. Sur la population europenne, il n'tait gure peru, en fait de contributions directes, que celle des patentes et quelques taxes assimiles. Une loi du 33 dcembre 1884 a tabli une contribution foncire sur la proprit btie, qui a t le premier essai du systme appliqu en France par la loi du 11 aot 1890 ; au dbut il y avait exemption du principal de la taxe, il n'tait peru que des centimes additionnels au profit des dpartements ou des communes, la loi du 20 juillet 1891'ordonne la perception du principal au profit de l'tat. Parmi les impts indirects sont organiss les droits de douanes, les droits d'enregistrement, et des droits sur les boissons qui portent le nom de droits de licence. N 5. Les impts au profit des tablissements publics. 444. Les principaux impts au profit des tablissements publics sont les suivants : 1 Au profit des Bourses et chambres de commerce, la taxe annexe la contribution des patentes et supporte par les catgories suprieures de patentables de la ville o sont tablies la Bourse et la chambre. (V. art. 38, l. 15 juill. 1880.) 2 Au profit des associations syndicales autorises, une taxe directe de quotit tablie sur les propritaires profitant des travaux, conformment aux art. 15 et 16 de la loi du 21 juin 1865. 3 Au profit des bureaux de bienfaisance et tablissements hospitaliers d'une commune, le droit des pauvres, sur tous les spectacles donns dans la commune.
LES IMPOTS MODES D'ACQURIR.
579
Sont soumis au paiement du quart de leur recette brute, les bals publics, les feux d'artifice, les exercices de chevaux, et gnralement tous les lieux de runion ou de fte o l'on est admis en payant. (L. 8 thermidor an V; 16 juill. 1840, art. 9; arr. C. d't. 12 fvr. 1817.) Sout soumis au paiement de 5 0/0 du maximum de leur recette brute, les concerts non quotidiens. (L. 3 aots 875, art. 23.) Sont soumis au prlvement du dixime en sus du prix du billet, tous les autres spectacles : Thtres (7 frimaire an V. 8 thermidor an V.) Panoramas (arr. 10 thermidor an XI). Concerts quotidiens l. 16 juill. 1840, art. 15), etc., etc. Le pari mutuel organis sur les champs de courses en vertu d'une autorisation, donnera lieu un prlvement fixe en faveur des uvres locales de bienfaisance. (L 2 juin 1891, art. 5). Ce droit des pauvres est une sorte de contribution directe qui ; au reste, il est frappe le revenu spcial de l'entreprise de spectacles peru soit en rgie, soit en ferme, soit par abonnement avec l'entrepreneur de spectacles. Le contentieux appartient au conseil de prfecture. L'attribution des droits perus entre les divers tablissements de la commune est fait par le prfet sur l'avis du sous-prfet. L'origine historique du droit est trs lointaine, elle remonte une ordonnance de Charles VI, avril 1407. Article II. Les impts indirects. 445. L'impt indirect est peru l'occasion d'un fait de consommation ou de circulation qui suppose le dplacement d'une valeur certaine. A la diffrence de l'impt direct, il n'est point peru l'aide de rles nominatifs car il est bien plutt d par les choses que par les personnes. Les impts indirects sont beaucoup moins intressants pour le droit administratif que les impts directs, pour les raisons suivantes : 1 Comme ils n'exigent pas la confection de rles nominatifs, il n'intervient pas leur sujet des oprations administratives annuelles comme il en intervient pour les impts directs; 2 Tandis que le contentieux des impts directs est de la comptence des tribunaux administratifs, celui des impts indirects, sauf exception trs rare, est de la comptence des tribunaux judiciaires, soit du tribunal d'arrondissement, soit mme du juge de paix, comme en matire de douanes et d'octrois. A la vrit, la procdure suivie est toute particulire et d'ailleurs un peu administrative, notamment l'affaire est juge sur
580
LES DROITSDOMANIAUX DE PUISSANCE PUBLIQUE
mmoires, mais il n'en reste pas moins que c'est l'autorit judiciaire qui en est charge. Cela s'explique, soit parce qu'il n'y pas d'actes administratifs interprter, mais seulement des lois appliquer; soit parce que, au sortir de la Rvolution, lorsqu'on a voulu rtablir les impts indirects qui taient trs mal vus, on a prouv le besoin de donner aux contribuables la garantie de la comptence judiciaire. Comme d'ailleurs la lgislation des impts indirects est une des plus compliques et une des plus mouvantes qu'il y ait, nous nous bornerons indiquer les impts sans entrer dans aucun dveloppement. a) Imptsindirects d'Etat. 1 Droits d'enregistrement. (L. 22 frimaire an VII; 1. 28 fvrier 1872.) Ces droits sont perus l'occasion de l'inscription des actes ou faits juridiques sur des registres tenus par l'administration de l'enregistrement; cette inscription ou insinuation est d'ailleurs obligatoire. On distingue des droits d'acte et des droits de mutation. La lgislation de l'enregistrement porte le nom de lgislation fiscale1. 2 Droits d'hypothque et de greffe. (L. 21 ventse an VII.) 3 Droit de timbre tabli sur tous les papiers destins aux actes civils et judiciaires. (1. 13 brumaire an VII; L. 23 aot 1871, art. 18.) 4 Droits de douane qui frappent les marchandises au passage la frontire. 5 Contributions indirectes. Droits sur les boissons, sur les sels, sur le papier, sur les voitures publiques; monopole du tabac, de la poudre, des allumettes chimiques, etc. b) Impts indirects communaux. Les impts indirects com: Droits de place aux halles, foires munaux peuvent tre trs varis et marchs; droits d'abatage; droits de stationnement et location sur la voie publique; pages communaux; droits de pesage, mesurage et jaugeage; concessions dans les cimetires; concessions d'eau; ; produit des expditions des actes de l'tat civil; droits de voirie prlvement sur le prix des permis de chasse, etc., etc., d'une faon gnrale toute taxe municipale qui ne peut pas tre peru l'aide d'un rle nominatif et qui, par consquent, ne peut pas tre rpartie par le conseil municipal aux termes de l'art. 140, 1. 5 avril 1884; enfin les octrois. Les octrois sont des droits de douanes intrieures perus sur cer1. Bibliographie raisonne des principes de l'enregis: G. Demante,Exposition trement, 3e dit., 2 vol. ; E. Naquet, Trait thorique et pratique des drozts d'enregistrement,1882,3 vol.; Garnier, Rpertoiregnral de l'enregistrement.
L'EXPROPRIATION MODES D'ACQURIR.
581
taines denres leur entre dans un primtre trac autour d'une ville. Les octrois sont de dtestables impts; ils sont une grande gne pour le commerce, la perception en est trs coteuse et trs vexatoire ; mais ils rapportent 300 millions aux 1,500 communes qui les ont et l'embarras est de trouver une taxe de remplacement. L'octroi est un impt facultatif pour les communes. Sous l'ancien rgime, il tait octroy par le roi, de l son nom. Actuellement il est tabli sur l'initiative du conseil municipal par dcret en conseil d'tat, aprs avis du conseil gnral ou de la commission dpartementale. D'ailleurs, les dlibrations du conseil municipal relatives aux octrois sont ranges dans quatre catgories diffrentes. C'est tantt une loi, tantt un dcret en Conseil d'tat, tantt un arrt prfectoral qui doivent les approuver et quelquefois elles sont excutoires par elles-mmes. (V. l. 5 avril 1884, art. 137 et suiv.) c) Impts indirects coloniaux. Les colonies ont tabli leur profit certains impts indirects semblables ceux de l'tat, droits d'enregistrement, droits sur les spiritueux, douanes; elles peuvent aussi tablir des droits de navigation. d) Impts indirects perus au profit des chambres de commerce. Les chambres de commerces peroivent dans les ports des droits de tonnage, ou bien des taxes l'occasion de l'usage d'appareils de chargement et de dchargement des navires; ces droits sont tablis par dcret. POURCAUSED'UTILIT PUBLIQUE 2. L'EXPROPRIATION 446. L'expropriation pour cause d'utilit publique est, pour les personnes administratives, un moyen d'acqurir la proprit des choses corporelles immobilires. Elles consiste essentiellement dans un transfert de proprit opr par autorit dejustice, et dans un envoi en possession prononc aprs le paiement pralable d'une indemnit rgler pas unjury de propritaires; le tout en cas d'utilit publique rgulirement constate par l'autorit administrative. Ce mode d'acqurir, qui entrane dpossession force, constitue videmment une atteinte grave la proprit prive, mais une atteinte ncessaire, car il ne peut pas dpendre du caprice de particuliers qui refuseraient de cder leur proprit l'amiable, d'empcher la ralisation d'entreprises utiles au bien de tous. C'est l'expropriation pour cause d'utilit publique qui permet de btir des forteresses, de cons1. Bibliographie : Aucoc, Confrencesde droit administratif.
582
LES DROITSDOMANIAUX DE PUISSANCE PUBLIQUE
truire des routes et des chemins de fer, d'assainir les villes, etc. C'est elle qui a permis d'accomplir l'norme masse de travaux publics qui ont t excuts en ce sicle. Toute la difficult, tant donn que le principe mme de l'expropriation n'est pas contestable, est de la rglementer de faon donner la proprit prive le plus de garanties possible. Notre lgislation actuelle est arrive sur ce point des rsultats peu prs satisfaisants, mais c'est aprs une longue srie de ttonnements. Histoire. Pendant longtemps, l'expropriation a t une sorte deconfiscation des terres suivie d'une indemnit problmatique pour laquelle il n'existait pas de garanties. A partir du XVIesicle notamment, poque o l'expropriation a t largement pratique cause desgrands travaux de routes et de canaux de navigation qui commenaient, l'indemnit tait rgle par les intendants, elle n'tait pas paye avant la prise de possession, elle ne l'tait que trs longtemps aprs, ou bien,. faute de fonds, elle ne l'tait pas du tout. Il parat, du reste, que le plus souvent on ne payait point les terres labourables, mais seulement la plus-value de celles qui taient en prs, vignes, bois ou jardins. Depuis la Rvolution, des progrs considrables ont t raliss. On peut distinguer trois phases : 1 Constitution du 3 septembre 1791 ; cette constitution a pos deux principes : Le premier, c'est que l'expropriation ne pouvait avoir lieu que pour une raison de ncessit publique. On a depuis substitu le mot utilit. Le second, c'est que l'indemnit devait tre pralable la dpossession, principe reproduit dans l'art. 545 C. civ. C'taient dj deux garanties prcieuses, mais l'indemnit tait rgle elle-mme, par le directoire du dpartement par l'administration (1. 7 sept. 1790, art. 4; 1. 28 pluvise an VIII; 1. 16 sept. 1807), et c'tait la mme administration qui opraitle transfert de proprit. Il y eut de vives rclamations. 2 Loi du 8 mars 1810, due l'initiative personnelle de Napolon, si l'on en croit du moins une note clbre date de Schnbrunn le29 septembre 1809. Cette loi donnait l'autorit judiciaire le droit d'oprer le transfert de proprit et celui de rgler l'indemnit. Pour le rglement de l'indemnit l'innovation n'tait pas heureuse.. On s'aperut, sous la Restauration, que cette fois l'intrt public tait sacrifi l'intrt priv; il y avait des longueurs infinies de procdure,. des appels, etc., et les juges s'en rapportaient des experts ne prsentant aucune garantie, qui exagraient outre mesure. 3 Loi du 7 juillet 1833 : apparition du jury d'expropriation pour le rglement de l'indemnit. Le jury permit d'abrger la procdure
L'EXPROPRIATION MODES D'ACQURIR.
583
parce que sa dcision est souveraine. On pensa aussi qu'il prsenterait plus de garanties que les experts, attendu que si les propritaires peuvent tre, comme propritaires, intresss lever les prix, comme contribuables ils sont intresss mnageries finances publiques. Sur ce dernier point il y a eu des mcomptes; plus propritaire que contribuable, le jury d'expropriation s'est montr trs variable et gnralement trs exagr dans ses valuations, il a cot fort cher l'tat. Cependant, malgr des vellits nombreuses de rformes, il a toujours t conserv. On peut dire que depuis la loi du 7 juillet 1833, le systme de l'expropriation pour cause d'utilit publique est cr dans ses grandes lignes. Cependant cette loi, en elle-mme, a disparu, elle a t remplace par deux autres qui fonctionnent simultanment : 1 La loi du 3 mai 1841 : expropriation normale avec le grand jury, qui n'est que la loi de 1833 simplifie au point de vue de la procdure; 2 La loi du 21 mai 1836, art. 16, qui a organis pour les chemins vicinaux un petit jury et dont la procdure a t tendue depuis un certain nombre d'hypothses. Article Ier. Dispositions gnrales. Les personnes administra447. I. Qui peut exproprier. tives seules peuvent exproprier, soit par elles-mmes, soit par l'intermdiaire de leurs concessionnaires de travaux publics (art. 63, 1. 1841)1. D'autre part, il faut remarquer que les tablissements publics, part une exception en faveur des associations syndicales autorises, n'ont pas le droit d'expropriation. Il y a l une rgle qui ne se justifie pas beaucoup; on a cherch l'expliquer en disant que le droit d'expropriation est un droit de puissance publique ; mais pourquoi les tablissements publics, qui sont membres de l'tat au mme titre que les autres personnes administratives, et qui grent des services publics, n'auraient-ils pas les droits de puissance publique qui leur sont utiles ? Il est admis par la jurisprudence que les tablissements publics peuvent recourir aux bons offices des communes pour faire faire par 1. Les concessionnaires de mines, simples particuliers, ont en certains cas le droit d'expropriation. (L. 27 juillet 1880,art. 44.) Nous verrons plus loin si cela ne doit pas contribuer les faire considrer comme des concessionnaires de travaux publics (n 504).
584
LES DROITSDOMANIAUX DE PUISSANCE PUBLIQUE
celles-ci une expropriation (Av. Cons. d't. 10 sept. 1850); il serait plus simple de leur donner le droit directement, l'administration serait toujours matresse de ne pas dclarer l'utilit publique de l'expropriation 1. 448. II. Quelles choses peuvent tre expropries. 1 La proprit des choses corporelles immobilires peut seule tre exproprie. Il rsulte de l'ensemble des dispositions lgislatives que l'expropriation n'est faite que pour les proprits foncires, non pas pour les meubles ni pour les droits incorporels. Pour les meubles, voir cependant, 1. 3juill. 1877, sur les rquisitions militaires. Pour les droits incorporels il a toujours t procd en vertu de lois spciales, notamment pour les rachats de concession. On peut citer les lois du 25 mai 1845,du 28 juillet 1860, etc., relatives au rachat de canaux de navigation concds des compagnies. 2 Tous les immeubles peuvent tre expropris, mme l'immeuble dotal (Arg. art. 13, l. 3 mai 1841); mme les immeubles dpendant du domaine priv des personnes administratives. Quant aux immeubles qui dpendent du domaine public, ils ne peuvent pas tre expropris tant qu'ils ne sont pas dsaffects. (V. p. 491.) 3 Le sous-sol d'un immeuble peut tre expropri indpendamment de la superficie (Cass. 1er avr. 1866; D. 66, I, 305). Cette dcision est trs importante pour les compagnies de chemins de fer cause des tunnels. 449. III. En vue de quels objets on peut exproprier. L'utilit publique qui justifie l'expropriation ne peut tre dfinie, c'est l'autorit administrative affirmer qu'elle existe dans chaque cas donn. Toutefois, on ne doit recourir l'expropriation qu'en vue d'un service public2. On ne doit y recourir en principe, ni en vue d'un embellissement, ni en vue d'acheter pour revendre. Pour ce qui est de l'embellissement, il faut remarquer cependant que les beaux-arts constituent eux-mmes un service public, et 1. Un dcret de 1873sur avis du Conseil d'tat avait autoris la fabrique d'Oullins (Rhne) poursuivre l'expropriation de terrains ncessaires la reconstruction de l'glise. 2. On exproprie en vued'un service public niais non pour faire tomberdans le domainepublic. L'immeuble tombe d'abord dans le domaine priv. Quelquefois il n'en sort pas; le plus souvent il tombe ensuite dans le domaine public, mais parce qu'il reoit une affectationet en vertu de cette affectation. Nous avons dj fait cette observation p. 541.
L'EXPROPRIATION MODES D'ACQURIR.
585
que la loi du 30 mars 1887 sur le classement des immeubles et monuments historiques autorise l'expropriation des btiments et des monuments mgalithiques prsentant de l'intrt, et des terrains o il peut tre fait des fouilles. (Art. 5 et 14.) Pour ce qui est d'acheter en vue de revendre, il y a des exceptions dans quelques cas o il est certain que l'opration n'est pas inspire par une pense de spculation: 1 Dcret du 26 mars 1852, applicable Paris et un certain nombre d'autres villes. On exproprie toute une maison dont partie seulement est comprise dans l'alignement d'une rue, lorsque la section restante serait trop petite pour tre salubre; on la joint des maisons voisines qu'on exproprie si cela est ncessaire et on revend le tout. (V. rglement du 14 juin 1876.) 2 Loi du 13 avril 1850, sur les logements insalubres. (V. p. 457.) 3 Loi du 14 juillet 1856 (art. 12). Il s'agit d'une source d'eau minrale exploite par le propritaire d'une manire qui ne satisfait pas aux besoins de la sant publique. 4 Reboisement et gazonnement des montagnes. (L. 4 avr. 1882.) Observation. Il peut se faire qu'un terrain ait t expropri en vue d'une certaine opration pour laquelle il y avait rellement utilit publique, mais laquelle on a renonc dans la suite. Dans cette hypothse, la personne administrative peut incontestablement revendre, mais les anciens propritaires ou leurs ayants-cause ont la facult de demander la rtrocession, conformment aux art. 60, 61 et 62 de la loi du 3 mai 1841. Cela constitue en leur faveur un droit de premption au cas o le terrain est mis en vente; cela ne leur donne point le droit de contraindre l'administration revendre. (Cons. d'Et. 6 mars 1872; Cass. 9 dc. 1861. En sens contraire, Paris, 29 avr. 1865.) Art. II. Expropriation par le grand jury. (L. 3 mai 1841.)
N 1. La dclaration
d'utilit publique.
450. La procdure d'expropriation se dcompose en quatre phases: la dclaration d'utilit publique, la dsignation des terrains, le transfert de proprit par jugement ou par cession amiable, le rglement de l'indemnit et l'envoi en possession. Toute procdure d'expropriation doit s'ouvrir par une dclaration d'utilit publique de l'opration. Les textes appellent cela une dclaration d'utilit publique des travaux, parce qu'ils se rfrent au plerumque fit; en gnral, en effet, des travaux publics seront excuts sur les terrains expropris, et la dclaration qui sert pour l'ex-
586
LES DROITSDOMANIAUX DE PUISSANCE PUBLIQUE
propriation servira en mme temps pour les travaux ; mais la dclaration d'utilit publique est ncessaire alors mme que des travaux ne devraient pas tre excuts. Nul doute, par exemple, que dans l'hypothse de la loi du 30 mars 1887, art. 5 (expropriation de monuments mgalithiques), il ne faille une dclaration d'utilit publique, bien qu'il ne doive s'ensuivre aucuns travaux. Pour savoir quelles sont les autorits qui prononcent la dclaration d'utilit publique et quelle est la procdure, il faut distinguer entre les diffrentes personnes administratives. I. Expropriations 451. au nom de poursuivies La loi du 27 juillet 1870, reproduisant l'art. 3 de la loi du l'tat. 3 mai 1841, tablit une distinction entre les grands travaux et les petits travaux. Pour les grands travaux, la dclaration d'utilit publique doit rsulter d'une loi, pour les petits travaux, elle rsulte d'un dcret en Conseil d'tat. Mais la distinction entre les grands travaux et les petits travaux est assez vague. La loi procde par numration ; elle considre comme petits travaux: les canaux et les chemins de fer d'embranchement de moins de 20 kilomtres de longueur, les lacunes et rectifications des routes nationales, les ponts et tous autres travaux de moindre importance. Comme la loi part videmment du point de vue financier, du dsir d'pargner les finances de l'tat, il faut l'interprter en ce sens que toute expropriation qui ne doit pas entraner pour l'tat plus de dpenses que ne le ferait la construction d'un tronon de chemin de fer ou de canal de 20 kilomtres, peut tre autorise par dcret ; que dans le cas contraire, il faut une loi, alors mme que la dpense devrait rsulter non pas de travaux, mais de l'indemnit d'achat (par exemple pour monuments historiques). Enqute pralable. L'acte dclaratif d'utilit publique, que ce soit une loi ou un dcret, est prcd d'une enqute destine constater l'utilit publique et rgle parles ordonnances du 18 fvrier 1834 et du 15 fvrier 1835. Nous reproduisons les dispositions de ces textes en faisant observer qu'ils se placent, tort, uniquement dans l'hypothse o il y a des travaux accomplir: Ordonnance du 18 fvrier 1834; l'enqute pourra s'ouvrir sur un avantprojet o l'on fera connatre le trac gnral de la ligne des travaux, les dispositions principales des ouvrages les plus importants et l'apprciation sommaire des dpenses. a l'avant-projet sera joint dans tous les cas un mmoire descriptif indiquant le but de l'entreprise et les avan-
L'EXPROPRIATION MODES D'ACQURIR.
587
tages qu'on peut s'en promettre; on y annexera le tarif des droits dont le produit serait destin couvrir les frais des travaux projets si ces travaux devaient devenir la matire d'une concession. Il sera form au chef-lieu de chacun des dpartements que la ligne des travaux devra traverser une commission de neuf membres au moins et de treize au plus, pris parmi les principaux propritaires deterres, de bois, demines, les ngociants, les armateurs et les chefs d'tablissements industriels les membres et le prsident de cette commission seront dsigns par le prfet ds l'ouverture de l'enqute. Des registres destins recevoir les observations, auxquelles pourra donner lieu l'entreprise projete, seront ouverts pendant un mois au moins et quatre mois au plus, au chef-lieu de chacun des dpartements et des arrondissements que la ligne des travaux devra traverser. Les pices qui, aux termes des art. 2 et 3, doivent servirde base l'enqute resteront disposes pendant le mme temps et aux mmes lieux la dure de l'ouverture des registres sera dtermine dans chaque cas particulier par l'administration suprme. Cette dure, ainsi que l'objet de l'enqute, sera annonce par des affiches'. A l'expiration du dlai, qui sera fix en vertu de l'article prcdent, la commission mentionne l'art. 4 se runira sur-le-champ : elle examinera les dclarations consignes aux registres de l'enqute; elle entendra les ingnieurs des ponts et chausses et des mines employs dans le dpartement, et aprs avoir recueilli auprs de toutes les personnes qu'elle jugerait utile de consulter les renseignements dont elle croira avoir besoin, elle donnera son avis motiv, tant sur l'utilit de l'entreprise que sur les diverses questions qui auront t poses par l'administration. Les diverses oprations dont elle dressera procs-verbal devront tre termines dans un nouveau dlai d'un mois. Le procs-verbal de la commission d'enqute sera clos immdiatement; le prsident de la commission le transmettra sans dlai, avec les registres et les autres pices au prfet qui l'adressera avec son avis l'administration suprieure dans les quinze jours qui suivront la clture du procsverbal. Les chambres de commerce et, au besoin, les chambres consultatives des arts et manufactures des villes intresses l'excution des travaux seront appeles et dlibrer et exprimer leur opinion sur l'utilit et la convenance de l'opration. Les procs-verbaux de leur dlibration devront tre remis au prfet avant l'expiration du dlai fix dans l'art. 6. Si la ligne des travaux n'excde pas les limites de l'arrondissement, le dlai de l'ouverture des registres et du dpt des pices sera fix au plus un mois et demi, et au moins vingt jours ; la commission d'enqute se runira au chef-lieu de l'arrondissement et le nombre de ses membres variera de cinq sept. 1. Pour les chemins vicinaux, au moins lorsqu'ils n'intressent que des communes d'un mme dpartement, la dure de l'enqute est maintenant fixe par le prfet. (D. 13 avril 1861.)
588
LES DROITS DOMANIAUX DE PUISSANCE PUBLIQUE
Ordonnance du 15 fvrier 1835. Lorsque la ligne des travaux relatifs une entreprise d'utilit publique devra s'tendre sur le territoire de plus de deux dpartements, les pices de l'avant-projet qui serviront de base l'enqute ne seront dposes qu'au chef-lieu de chacun des dpartements traverss. Des registres continueront d'tre ouverts tant au chef-lieu du dpartement qu'aux chefs-lieux d'arrondissement, pour recevoir les observations auxquelles pourra donner lieu l'entreprise projete. 452. II. Expropriations au nom des poursuivies des communes et des associations dpartements, Pour les dpartements, les communes, et il faut syndicales. ajouter aussi les associations syndicales, l'utilit publique est dclare en principe par un dcret rendu en forme de rglement d'administration publique. (Sn.-cons. 25 dc. 1852, art. 4.) Toutefois, pour les chemins de fer d'intrt local, elle est dclare par une loi; pour les tramways, par dcret en Conseil d'tat sur le rapport du ministre des Travaux publics, aprs avis du ministre de l'Intrieur. (L. 11 juin 1880, art. 2 et 29.) Pour les chemins vicinaux de grande communication et d'intrt commun, elle est dclare par le conseil gnral du dpartement; pour les chemins vicinaux ordinaires et les chemins ruraux, par la commissiondpartementale. (L. 10 aot 1871, art. 44 et 86; 1.20 aot 1881,art. 4.) Sauf toutefois dans les parties o lesdits chemins traversent des terrains btis ou enclos de murs, auquel cas un dcret du chef de l'tat est ncessaire. (L. 8 juin 1864, art. 2;1. 20 aot 1881, art. 13, 3.) Observation. Pour les chemins, il ne faut pas confondre l'opration du classement avec la dclaration d'utilit publique. Le classement ne suppose qu'un projet de chemin; il a pour but d'en dterminer la direction gnrale et de le classer au point de vue des diffrentes catgories de chemins. La dclaration d'utilit publique ne peut intervenir qu'aprs le classement et en vue de l'ouverture du chemin; elle n'intervient d'ailleurs que si des expropriations sont ncessaires. La dclaration d'utilit publique en faveur du dparEnqutes. tement est prcde d'une enqute administrative faite en les mmes formes que pour l'tat. La dclaration d'utilit publique en faveur d'une commune seule est prcde d'une enqute administrative dans les formes prescrites par l'ordonnance du 23 aot 1826. Si les travaux n'intressent pas la commune toute seule, l'enqute a lieu conformment l'ordonnance du 18 fvrier 1834. 453. Voies de recours. L'acte qui dclare l'utilit publique
L'EXPROPRIATION MODES D'ACQURIR.
589
peut tre attaqu par le recours pour excs de pouvoir toutes les fois que ce n'est pas un acte lgislatif, et pour les causes suivantes : 1 Parce que le travail projet n'a pas pour objet l'utilit d'un service public. 2 Pour inobservation des formes, notamment de celles de l'enqute. 3 Pour incomptence. En gnral le pourvoi n'est pas recevable aprs le jugement d'expropriation. (Ar. cons. d't. 22 nov. 1878,28 avr. 1882, etc.) N 2. La dsignation des terrains. La dsignation des terrains, quand il s'agit de grands travaux devant occuper des terrains trs nombreux, se fait d'aprs une mthode : la dsignation des territoires ou progressive par des actes successifs localits, et l'arrt de cessibilit du prfet. Cette dsignation des territoires. 454. Dsignation est celle des territoires et non pas encore des parcelles ; il s'agit de savoir o passera le chemin ou la route, quelles localits seront desservies, plutt que de savoir quelles parcelles devront tre expropries. Si la dsignation des territoires ou localits ne se trouve pas dans la loi ou le dcret qui dclarent l'utilit publique des travaux, elle doit tre faite par arrt prfectoral. (Art. 2, 1. 1841.) La dsignation des parcelles 455. Arrt de cessibilit. de terrains rsulte d'un arrt prfectoral dit arrt de cessibilit, rendu aprs une enqute dans laquelle les parties intresses ont t mises mme de fournir leurs contredits, le tout suivant les rgles poses par les art. 2, 4 11 de la loi du 3 mai 1841. L'arrt de cessibilit constitue une formalit essentielle de la procdure d'expropriation. Il sert de point de dpart au dlai d'un an, au bout duquel les propritaires des parcelles dsignes peuvent requrir l'expropriation (art. 14). Il ne produit d'ailleurs aucun effet au regard des par Il celles, et notamment il ne les frappe d'aucune indisponibilit. doit tre motiv et indiquer l'poque de la prise de possession. (Art. 11.) Enqute1. Les ingnieurs ou autres gens de l'art, chargs de l'excution des travaux, lvent, pour la partie qui s'tend sur chaque com1. Il ne faut pas confondre cette seconde enqute, avec la premire qui a prcd la dclarationd'utilit publique.
590
LES DROITS DOMANIAUX DE PUISSANCE PUBLIQUE
mune, le plan parcellaire des terrains ou des difices dont la cession leur parat ncessaire. Le plan desdites proprits particulires, indicatif des noms de chaque propritaire, tels qu'ils sont inscrits sur la matrice des rles, reste dpos pendant huit jours la mairie de la commune o les proprits sont situes, afin que chacun puisse en prendre connaissance. Le dlai fix l'article prcdent ne court qu' dater de l'avertissement qui est donn collectivement aux partie intresses, de prendre communication du plan dpos la mairie. Cet avertissement est publi son de trompe ou de caisse dans la commune et affich tant la principale porte de l'glise du lieu qu' celle de la maison commune. Il est, en outre, insr dans l'un des journaux publis dans l'arrondissement, ou, s'il n'en existe aucun, dans l'un des journaux du dpartement. Le maire certifie ces publications et affiches ; il mentionne, sur un procs-verbal qu'il ouvre cet effet, et que les parties qui comparaissent sont requises de signer, les dclarations et rclamations qui lui ont t faites verbalement, et y annexe celles qui lui sont transmises par crit. A l'expiration du dlai de huitaine prescrit par l'art. 5, une commission se runit au chef-lieu de la sous-prfecture. Cette commission, prside par le sous-prfet de l'arrondissement, sera compose de quatre membres du conseil gnral du dpartement ou du conseil de l'arrondissement dsign par le prfet, du maire de la commune o les proprits sont situes, et de l'un des ingnieurs chargs de l'excution des travaux. La commission ne peut dlibrer valablement qu'autant que cinq de ses membres, au moins, sont prsents. Dans le cas o le nombre des membres prsents serait de six, et o il y aurait partage d'opinion, la voix du prsident sera prpondrante. Les propritaires qu'il s'agit d'exproprier ne peuvent tre appels faire partie de la commission. La commission reoit pendant huit jours les observations des propritaires. Elle les appelle toutes les fois qu'elle le juge convenable. Elle donne son avis. Ses oprations doivent tre termines dans le dlai de dix jours ; aprs quoi le procs-verbal est adress immdiatement par le sous-prfet au prfet. Dans le cas o lesdites oprations n'auraient pas t mises fin dans le dlai ci-dessus, le sous-prfet devra, dans les trois jours, transmettre au prfet son procs-verbal et les documents recueillis. Si la commission propose quelque changement au trac indiqu par les ingnieurs, le sous-prfet devra, dans la forme indique par l'article 6, en donner immdiatement avisaux propritaires que les changements pourront intresser. Pendant huitaine, dater de cet avertissement, le procs-verbal et les pices resteront dposs la sous-prfecture; les parties intresses pourront en prendre communication sans dplacement et sans frais et fournir leurs observations crites. Dans les trois jours suivants, le sous-prfet transmettra toutes les pices la prfecture. Sur le vu du procs-verbal et des documents y annexs, le prfet dtermine, par un arrt motiv, les proprits qui doivent tre cdes et indique l'poque laquelle il sera ncessaire d'en prendre possession.
L'EXPROPRIATION MODES D'ACQURIR.
591
Toutefois, dans le cas o il rsulterait de l'avis de la commission qu'il y aurait lieu de modifier le trac, le prfet surseoira jusqu' ce qu'il ait t prononc par l'administration suprieure. (Art. 4-11.) Observation. Il y a modification de la procdure en cas d'expropriation d'intrt purement communal, et spcialement en matire d'ouverture et de redressement de chemins vicinaux, conformment l'art. 12 de la loi du 3 mai 1841 : commission d'enqute remplace par le conseil municipal, arrt de cessibilit pris par le prfet en conseil de prfecture pour compenser la garantie absente de la commission d'enqute. Voies de recours. L'arrt de cessibilit peut tre attaqu par le recours pour excs de pouvoir, tant que l'expropriation n'est pas consomme, et pourvu que le recours ne soit pas fond sur la violation des formalits prescrites par la loi. La dernire restriction se justifie par ce principe que le recours pour excs de pouvoir est subsidiaire et qu'il appartient l'autorit judiciaire de vrifier si les formalits ont t remplies. No 3. Le transfert de proprit. Le jugement d'expropriation.
Le transfert de proprit peut tre opr, soit par jugement d'expropriation du tribunal civil, soit par cession aimable. A 456. Procdure du jugement d'expropriation. dfaut de conventions amiables, soit avec les propritaires des terrains ou btiments dont la cession est reconnue ncessaire, soit avec ceux qui les reprsentent, le prfet transmet au procureur de la Rpublique, dans le ressort duquel les biens sont situs, la loi ou le dcret (ou la dcision du conseil gnral ou de la commission dpartementale) qui autorise l'excution des travaux, et l'arrt de cessibilit. (Art. 13 in fine.) Dans les trois jours, et sur la production des pices constatant que les formalits prescrites par l'art. 2 du titre Ieret par le litre II de la loi du 3 mai 1841 ont t remplies, le procureur de la Rpublique requiert et le tribunal prononce l'expropriation pour cause d'utilit publique des terrains ou btiments indiqus dans l'arrt du prfet. (Art. 14, 1er.) Si dans l'anne de l'arrt du prfet, l'administration n'a pas poursuivi l'expropriation, tout propritaire dont les terrains sont compris audit arrt peut prsenter requte au tribunal. Cette requte sera communique par le procureur de la Rpublique au prfet, qui devra,
592
LES DROITSDOMANIAUX DE PUISSANCE PUBLIQUE
dans le plus bref dlai, envoyer les pices, et le tribunal statuera dans les trois jours. (Art14, 2.) Ainsi, la procdure peut tre engage de deux faons, ou par l'administration, ou par les particuliers, prcieux droit pour ceux-ci, car le sort de leur proprit est dans une incertitude fcheuse. Les dlais, qui dans l'une et l'autre procdure sont indiqus, man; en matire de procdure, les nullits ne se supquent de sanction plent point. (Art. 1030, C. pr. civ.) Rle du tribunal. Il n'y a pas ici un vritable procs. Les propritaires ne sont pas parties en cause. Le tribunal, par un acte d'autorit opre le transfert de proprit; mais il a le devoir de vrifier si les formalits prescrites dans l'art. 2 du titre Ier et dans les articles du titre II dela loi du 3 mai 1841, en vue de protger la proprit, ont t accomplies. Toutefois, afin de respecter le principe de la sparation des pouvoirs, il est admis que le tribunal judiciaire est juge uniquement de l'existence matrielle ou lgale de ces actes, mais qu'il n'est pas juge de leur validit. (Art. 2 et 14, loi 1841, Jurispr. constante.) Par exemple, il est juge de la question de savoir si l'acte dclarant l'utilit publique du travail existe; mais, s'il existe, il n'est pas juge de la question de savoir s'il est entach d'un vice de forme. De mme pourl'arrt de cessibilit du prfet, le tribunal doit s'assurer de son existence, mais il n'est pas juge de la question de savoir sile dfaut de motifs ou le dfaut d'indication de la date de la prise de possession en entrane la nullit. Il doit encore vrifier l'existence de la seconde enqute, celle qui prcde l'arrt de cessibilit. Quant la premire, chose bizarre, elle ne se trouve pas dans les textes viss par l'art. 14 et le tribunal n'a point s'en occuper. Rdaction du jugement, mesures de publicit, voies de recours. Le jugement d'expropriation doit tre rdig suivant les rgles ordinaires, il doit en outre contenir la dsignation du magistrat-directeur du jury (art. 14, 3 et 4). Le jugement est publi et affich par extraits dans la commune dela situation des biens de la manire indique en l'art. 6. Il est en outre insr dans l'un des journaux publis dans l'arrondissement, ou, s'il n'en existe aucun, dans l'un de ceux du dpartement. (Art. 15, 1er.) Unextrait est en outre notifi chaque propritaire expropri conformment l'art 15, 2 et 3, et nous verrons que celui-ci son tour est tenu de faire connatre un certain nombre d'intresss, et, par suite, de leur faire connatre le jugement, usufruitiers, fermiers, locataires, cranciers hypothcaires, etc. (n 459).
L'EXPROPRIATION MODES D'ACQURIR.
593
Le jugement doit tre, immdiatement aprs l'accomplissement des formalits de publicit, transcrit au bureau de la conservation des conformment l'art. 2181 C. civ. hypothques de l'arrondissement, {Art. 16.) Le jugement ne pourra tre attaqu que par la voie du recours en cassation, seulement pour incomptence, excs de pouvoir, ou vices de forme (art. 20). Le pourvoi en cassation peut tre form non seulement contre le jugement qui exproprie, mais contre celui qui refuse d'exproprier. Il est form, soit par les propritaires intresss, soit au nom de la personne administrative expropriante. L'expropriation doit transfrer 457. Effets du jugement. l'expropriant la proprit pleine et entire de l'immeuble dgage de toute charge et de tout droit rel, sans cela elle n'atteindrait pas son but. Aussi le jugement d'expropriation produit-il les effets suivants : 1 Les droits rels, tels que usufruit, usage, habitation, servitudes qui grevaient ces immeubles, sont rsolus, et transforms en un droit sur l'indemnit. Les actions en rsolution, en revendication et toutes autres actions relles ne pourront arrter l'effet de l'expropriation, le droit des rclamants sera transport sur le prix. (Art. 18 et 21,l. 3 mai 1841.) Le droit du locataire est galement rsolu et transform en une crance d'indemnit. (Jurisprud. const.) Tous les personnages, atteints par cette rsolution des droits, sont invits faire valoir leurs droits avant le rglement de l'indemnit, suivant des voies et moyens que nous verrons plus tard. 2 Les privilges et hypothques inscrits sont virtuellement purgs et les cranciers sont pays par prfrence sur le prix. Les privilges et hypothques peuvent tre valablement inscrits pendant la quinzaine qui suit la transcription du jugement d'expropriation 1. La purge est un procd de suppression ou d'extinction des privilges et hypothques prvu au C. civ., art. 2181 et suiv., et qui peut tre pratiqu parle tiers dtenteur d'un immeuble grev. Il consiste essentiellement en ce que l'on offre aux cranciers un certain prix dont ils seront forcs de se contenter. Toutefois, lorsque la purge est pratique par un acqureur ordinaire, les cranciers ont une arme qui 1. On admet gnralement que ce dlai de quinzaine n'a point t supprim par la loi du 23 mars 1855sur la transcription, bien que cette loi dcide qu'en principe la transcription arrte le cours des inscriptions. Celatient ce que la loi du 3 mai 1841est une loi spciale, celle du 23 mars 1855une loi gnrale, et que legi speciali per generalem non derogatur. H. 38
594
LES DROITS DOMANIAUX DE PUISSANCE PUBLIQUE
leur permet d'obtenir la fixation d'un juste prix; ils ont le droit, en souscrivant une surenchre d'un dixime, d'exiger que l'immeuble soit mis aux enchres. Cette garantie ne pouvait pas tre donne aux cranciers en matire d'expropriation, car on ne pouvait pas admettre qu'un immeuble dont l'administration a absolument besoin, ft mis aux enchres et risqut ainsi de passer aux mains d'un tiers. On leur a donn une autre garantie, ils peuvent exiger que l'indemnit soit fixe parle jury (art. 17, 3). C'est qu'en effet, il faut savoir que mme aprs le jugement d'expropriation, une cession amiable pourrait intervenir entre l'administration et le propritaire pour la fixation de l'indemnit, et cette fixation pourrait lser les droits des cranciers. 3 Les privilges et hypothques sont galement teints, lorsque dans un dlai de quinzaine aprs la transcription du jugement d'expropriation, ils n'ont pas t inscrits. Cette hypothse est tout fait diffrente de la prcdente ; ici, les cranciers privilgis ou hypothcaires n'ont plus aucun droit sur le prix, ils ne seront pas pays. Exception est faite cependant pour certains cranciers hypothque lgale, les femmes, les mineurs, les interdits, qui peuvent tre colloqus sur le montant de l'indemnit tant qu'elle n'a pas t paye ou que l'ordre n'a pas t rgl dfinitivement entre les cranciers. (Art. 17, 1 et 2.) C'est un cas d'application de ce que l'on appelle la survie du droit de prfrence au droit de suite. De la cession amiable. 458. On considre souvent la cession amiable comme une vente volontaire qui intervient au cours de la procdure d'expropriation et qui opre le transfert de proprit au lieu et place du jugement du tribunal. Cette qualification n'est pas touj ours exacte. La cession amiable, que la loi appelle plutt convention amiable, peut intervenir avant ou aprs le jugement. Si elle intervient avant le jugement d'expropriation elle et peut comporter transfert de proprit et convention d'indemnit, alors c'est une sorte de vente ; mais elle peut aussi contenir transfert de proprit tout seul, et alors il faudra quand mme faire rgler l'indemnit par le jury. Si elle intervient aprs le jugement d'expropriation, elle ne peut avoir pour objet que de fixer le prix de l'indemnit la proprit tant dj transfre. La cession amiable est possible dsl'acte dclaratif d'utilit publique.
L'EXPROPRIATION MODES D'ACQURIR.
595
Les contrats de vente, quittances et autres actes relatifs la cession amiable peuvent tre passs dans la forme des actes administratifs, la minute restera dpose au secrtariat de la prfecture, expdition en sera transmise l'administration des domaines .(art. 56). La cession amiable est facilite en ce qui touche les biens appartenant des incapables par les rgles poses en l'art 13, 1 3 dela loi du 3 mai 1841, et en ce qui touche les biens appartenant des personnes morales par les rgles poses au mme article, 3 et 4. Depuis les nouvelles lois dpartementales et communales, ces dernires rgles ne font qu'appliquer le droit commun. La cession amiable est assujettie aux mmes formalits de publicit et de transcription que le jugement d'expropriation (art. 19, 1er), moyennant quoi elle produit les mmes effets au point de vue de la rsolution des droits rels, des actions relles et des droits du locataire. Elle produit aussi les mmes effets au point de vue des privilges et hypothques, en ce sens: 1 que lesdits privilges et hypothques doivent, pour produire effet, tre inscrits dans la quinzaine qui suit la transcription de la cession, sauf rserve du droit des femmes, mineurs, interdits, sur le montant de l'indemnit, tant qu'elle n'est pas paye; 2 qu'il y a purge virtuelle des privilges et hypothques ainsi inscrits, et que l'effet du droit de suite est rduit au droit de demander la fixation de l'indemnit par le jury. L'administration peut, sauf les droits des tiers, et sans accomplir les formalits ci-dessus traces, payer le prix des acquisitions dont la valeur ne s'lverait pas au-dessus de 500 francs. (Art. 19, 2.) N 4. Paiement de l'indemnit et prise de possession. a) Mesures prises pour 459. Mesures prparatoires. avertir les intresss. Il est clair que l'administration ne paiera pas deux fois l'indemnit et que les intresss qui n'auront pas fait valoir leurs droits temps seront forclos. Mais il est juste qu'ils soient avertis. Voici le systme suivi cet gard par la loi (art. 21). Les intresss sont diviss en trois catgories : 1 Le propritaire rel ou apparent qui a reu notification individuelle du jugement: celui-l est averti. 2 Les intresss que le propritaire doit faire connatre sous sa responsabilit : ce sont les fermiers, locataires, ceux qui ont des droits d'usufruit, d'usage et d'habitation ou des droits de servitudes rgls par le Code civil, et dont le propritaire peut connatre l'existence parce qu'il est intervenu dans les actes.
596
LES DROITS DOMANIAUX DE PUISSANCE PUBLIQUE
Si le propritaire n'a pas fait connatre les intresss, il demeure seul charg envers eux des indemnits auxquelles ils auraient droit. 3 Les intresss qui doivent se faire connatre eux-mmes; faute par eux de s'tre fait connaitre en temps utile, ceux-ci perdent tout droit tant contre l'administration que contre le propritaire, bien que celui-ci ait peut-tre reu une indemnit plus leve qu'il ne l'aurait reue; solution controverse par quelques auteurs, mais qui rsulte bien des termes de la loi. Ils sont suffisamment avertis par les formalits de l'art. 6. Sont parmi les intresss de la dernire catgorie : 1 les usagers dont les droits sont rgis par le Code forestier; 2 les titulaires de servitudes constitues par les anciens propritaires et non mentionnes dans les actes du propritaire actuel. En somme, le propritaire n'est tenu de faire connatre que les indemnitaires qu'il a pu connatre par lui-mme, par consquent il n'est pas tenu de faire connaitre un sous-locataire. de l'administration. L'administration notifie aux proOffres b) pritaires et tous autres intresss qui auront t dsigns ou qui seront intervenus dans le dlai fix par l'article prcdent, les sommes qu'elle offre pour indemnit. Ces offres sont en outre affiches et publies conformment l'art. 6 (art. 23). Elles peuvent tre modifies au cours de la procdure (Jurisprudence constante). Dans la quinzaine suivante, les propritaires et autres intresss sont tenus de dclarer leur acceptation, ou s'ils n'acceptent pas les offres qui leur sont faites, d'indiquer le montant de leurs prtentions. (Art. 24.) Des rgles spciales pour l'acceptation des offres faites aux femmes maries, aux tuteurs, aux envoys en possession provisoire des biens d'un absent, et autres personnes qui reprsentent des incapables ou des. personnes morales, sont traces dans les art. 25, 26 et 27. Dans le cas o les offres sont acceptes, il y a cession amiable pour la fixation du prix. totale. Dans le dlai de quinzaine c) Rquisition d'acquisition qui suit les offres de l'administration, le propritaire d'un btiment expropri pour partie peut requrir l'acquisition totale du btiment; il en sera de mme du propritaire d'un terrain expropri pour partie s'il se trouve dans le cas prvu l'art. 50 ; il faut pour cela la ru: 1 que le terrain se trouve rduit au quart; nion de trois conditions 2 que sa contenance soit infrieure 10 ares; 3 que le propritaire ne possde aucun autre terrain contigu. La partie de l'immeuble dont l'acquisition a t ainsi requise est trausfre l'administration, non pas titre d'expropriation, mais
L'EXPROPRIATION MODES D'ACQURIR.
597
: la titre de vente ordinaire, ce qui entrane les consquences suivantes ; le propritaire peut revendre jusqu' proprit est greve de charges la transcription; dans la purge, les cranciers hypothcaires peuvent requrir la mise aux enchres. Si les 460. Fixation de l'indemnit le jury. par offres de l'administration ne sont pas acceptes dans les dlais prescrits par les art. 24 et 27, l'administration citera tous les intresss devant le jury, conformment l'art. 28. a) Du grand jury d'expropriation. (L. 3 mai 1841 ; loi 3 juillet 1880. Le jury est compos d'un magistrat directeur dsign par le jugement d'expropriation, et de douze jurs choisis pour chaque affaire, suivant les rgles des art. 29 36 et de l'art. 47. Dans la pratique, il est tenu de vritables sessions du jury d'expropriation o il est jug plusieurs affaires, sessions analogues celles de la cour d'assises. Pour chaque affaire, l'intress a droit la constitution d'un jury spcial, mais les intresss peuvent aussi consentir ce que le mme jury juge plusieurs affaires. Diffrence avec le jury criminel. Les jurs sont choisis grce la formation annuelle de deux listes successives: 1 La liste d'arrondissement dresse par le conseil gnral dans sa session d'aot; elle contient trente-six noms au moins et soixantedouze au plus; par dcreten Conseil d'tat, si des circonstances exceptionnelles l'exigent, le chiffre peut tre port cent quarante-quatre; les noms sont choisis sur les listes lectorales ou sur la liste du jury criminel; 2 La liste de session compose de seize jurs et de quatre jurs supplmentaires : cette liste est dresse par l'autorit judiciaire, soit par la premire chambre de la cour d'appel, soit par la premire chambre du tribunal civil du chef-lieu du dpartement. On verra, la fin de l'art. 30, un certain nombre de cas d'exclusion, d'incompatibilit ou de dispense. Le nombre des jurs est rduit douze pour chaque affaire, soit par des rcusations, l'administration et la partie adverse ayant le droit d'exercer chacune deux rcusations premptoires, soit par le magistrat directeur qui retranche les derniers noms inscrits sur la liste. Il n'y a point tirage au sort. (Art. 34.) D'ailleurs le jury, qui n'est constitu que lorsque les douze jurs sont prsents, peut valablement dlibrer au nombre de neuf (art. 35). Il ya quelque chose de beaucoup moins rigoureux que pour le jury criminel.
598
DE PUISSANCE LES DROITS DOMANIAUX PUBLIQUE
b) Aspect gnral de la procdure. La procdure devant le jury d'expropriation a t visiblement calque sur la procdure devant le jury criminel, en ce sens qu'il ya une division radicale d'attributions entre le jury et le magistrat directeur. Le jury a pour attribution unique dergler l'indemnit; en cette matire, il a des pouvoirs souverains, sauf observer des rgles que nous allons voir. Le magistrat directeur a pour attribution unique de diriger les dbats pendant l'instruction en tranchant les incidents qui peuvent tre soulevs, et de donner force excutoire la dcision du jury. Mais il ne prend pas part la dlibration sur la fixation de l'indemnit; il n'y assiste mme pas, le jury se retirant en sa chambre et nommant un prsident du jury. Cette disposition de la loi de 1841 a t une des plus malheureuses; il est certain que la prsence d'un magistiat et fait reculer certains jurys devant des estimations scandaleuses. Une des meilleures dispositions de la procdure par le petit jury de la loi de 1836, c'est que l, au contraire, le magistrat directeur prend part aux dbats. Pour les dtails de la procdure, v. art. 36, 37, 38, 41. c) Rgles relatives la fixation de l'indemnit. Le jury fixe toujours le montant de l'indemnit. Il le fixe hypothtiquement dans le cas o il y a contestation soit sur le bien fond de l'indemnit, soit sur la question de savoir quel est l'ayant droit. Toutes les contestations sur le fond du droit sont renvoyes devant les tribunaux ordinaires, sans que le jury sursoie sa dcision. Il est juge de la sincrit de tous titres et de l'effet de tous actes dans la mesure o cela est ncessaire pour l'valuation de l'indemnit. (Art 48.) 1 Le jury prononce des indemnits distinctesen faveur des parties qui les rclament destitres diffrents, comme propritaires, fermiers, locataires, usagers et autres intresss dont il est parl l'art 21. Dans le cas d'usufruit, une seule indemnit est fixe par le jury, eu gard la valeur totale de l'immeuble; le nu-propritaire et l'usufruitier exercent leurs droits sur le montant de l'indemnit au lieu de les exercer sur la chose. L'usufruitier sera tenu de donner caution, les pre et mre ayant l'usufruit lgal des biens de leurs enfants en seront seuls dispenss. (Art. 39, 1, 2, 3, 1. 3 mai 1841.) 2 Sauf demande spciale de l'intress, l'indemnit doit consister en une somme d'argent. (Art. 38, 3.) Elle doit contenir rparation entire du dommage caus par l'expropriation. Toutefois les constructions, plantations et amliorations
L'EXPROPRIATION MODES D'ACQURIR.
599
ne donneront lieu aucune indemnit lorsque, raison de l'poque o elles auront t faites ou de toutes autres circonstances dont l'apprciation lui est abandonne, le jury acquiert la conviction qu'elles ont t faites dans la vue d'obtenir une indemnit plus leve. (Art. 52.) 3 Si l'excution des travaux doit procurer une augmentation de valeur immdiate et spciale au restant de la proprit, cette augmentation sera prise en considration dans l'valuation du montant de l'indemnit (art. 51). Si l'augmentation de valeurn'est pas immdiate, comment l'apprcier? Si elle n'est pas spciale l'immeuble expropri, comme les immeubles voisins ne contribuent pas, il ne serait pasjuste de faire contribuer l'immeuble expropri. Il doit toujours y avoir une indemnit, ft-elle fixe 1 franc. Au reste, la diminution de l'indemnit raison de la plus-value se combine parfaitement avec les taxes spciales leves sur les propritaires raison de plus-value directe ou indirecte. La lgislation de 1807 n'a point t abroge par celle de 1841. (V. infr, travaux puplics, n 478.) 4 L'indemnit allou par le jury ne peut, en aucun cas, tre infrieure aux offres de l'administration, ni suprieure la demande de la partie intresse (art. 39, 5). Si l'intress n'a formul aucune demande, l'indemnit ne doit pas tre suprieure aux offres de l'administration. La dcision 461. Paiement et prise de possession. du jury, signe des membres qui y ont concouru, est remise par le prsident au magistrat directeur qui la dclare excutoire, statue sur les dpens, conformment aux rgles poses par l'art. 40, et envoie l'administration en possession de l'immeuble, la charge par elle de se conformer aux dispositions des art. 53-54 et suivants, c'est--dire de payer ou de consigner le montant de l'indemnit. (Art. 41.) 462. Voies de recours. La dcision du jury et l'ordonnance du magistrat directeur ne peuvent tre attaques que par la voie du recours en cassation: 1 Pour incomptence et excs de pouvoir. (Jurisprudence.) 2 Pour violation de la loi, mais seulement pour violation de l'art. 30, 1er ; de l'art. 31 ; de l'art. 34, 2 et 4 ; des art. 35 40 de la loi du 3 mai 1841. (Art 42.) Les dlais et les effets du recours en cassation sont rgls par l'art. 42, in fine, et par l'art. 43 1. 1. Les difficults qui peuvent s'lever aprs coup, tant sur l'interprtation de
600
LES DROITS DOMANIAUX DE PUISSANCE PUBLIQUE
Toutes les significations et. 463. Dispositions diverses. notifications ncessites par la procdure sont faites la diligence du prfet du dpartement de la situation des biens, soit par huissier, soit par tout agent de l'administralion dont les procs-verbaux font foi en justice. (Art. 57.) Tous les actes sont viss pour timbre et enregists gratis; il n'est peru aucun droit pour la transcription des actes au bureau des hypothques. (Art. 58.) Procdures exceptionnelles par grand jury.
464. Il ya un certain nombre d'hypothses o la procdure de la loi dit 3 mai 1841 est modifie, bien que l'on conserve la fixation de l'indemnit par le grand jury qui est son caractre fondamental. 1 Procdure ordinaire enmatire de travaux militaires. Les formalits prescrites par les titres I et II de la loi, c'est--dire les formalits de dclaration d'utilit publique et d'enqute, sont supprimes, les terrains soumis expropriation sont directement dsigns par dcret. Cela tient ce qu'ici le gouvernement est seul juge de l'utilit publique, le public n'a pas besoin d'tre consult. Le reste de la procdure, comme l'ordinaire. 2 Procdure d'urgence en matire de travaux civils. Cette procdure prend une allure spciale aprs le jugement d'expropriation. Elle ne peut s'appliquer qu'aux terrains non btis. (Art. 65,1. 3 mai 1841.) L'urgence est dclare spcialement par un dcret du chef de l'tat, soit aprs le jugement, soit avant. Ce dcret est signifi, de mme quele jugement, aux propritaires et dtenteurs des terrains. Ceux-ci sont assigns devant le tribunal civil pour discuter l'offre faite par l'administration. Le tribunal fixe une indemnit provisoire qui doit tre dpose la Caisse des consignations. La consignation doit comprendre, outre le principal, la somme ncessaire pour assurer pendant deux ans le service des intrts 5 0/0. Sur le vu du procs-verbal de consignation, le prsident ordonne la prise de possession. Aprs la prise de possession, il est procd pour la fixation dfinitive de l'indemnit suivant la forme ordinaire devant le jury. Le tout conformment aux art. 65 74 de la loi du 3 mai 1841. 3 Procdure d'urgence en matire de travaux de forteresse. Cette procdure emprunte des caractres aux deux prcdentes : 1 c'est en matire militaire, donc il y a suppression de la dclaration d'utilit publique et des enqutes ; 2 c'est une procdure d'urgence; il y a, comme dans l'autre, fixation d'une indemnit provisoire par le tribunal, seulement, la dcision du jury que sur celle des cessions amiables, sont du ressort des tribunaux ordinaires. (Jurisprudence constante du Conseild'tat et de la Cour de cassation.)
L'EXPROPRIATION MODES D'ACQURIR.
601
cela s'applique aux terrains non btis et c'est le jugement d'expropriation qui statue en mme temps sur la somme consigner. (Art. 76, 1. 3 mai 1841.) Article III. Expropriation par le petit jury. art. 16.) (L. 21 mai 1836,
465. Dans la procdure d'expropriation par le petit jury, le jury spcial charg de rgler les indemnits n'est compos que de quatre jurs. Le tribunal d'arrondissement, en prononant l'expropriation, dsigne pour prsider et diriger le jury l'un de ses membres ou le juge de paix du canton. Ce magistrat a voix dlibrative en cas de partage. Le tribunal choisit sur la liste gnrale prescrite par l'art. 29 de la loi du 3 mai 1841, quatre personnes pour former le jury spcial et trois jurs supplmentaires. L'administration et la partie intresse ont respectivement le droit d'exercer une rcusation premptoire. Ainsi : 1 le nombre des jurs est moindre : quatre au lieu de douze ; 2 le rle du magistrat directeur est plus actif: il est prsident du jury et assiste aux dlibrations. En cas de partage, il vote. Cette organisation impose au jury une modration que n'a pas toujours eue le grand jury. Cette procdure est applique: 1 En cas d'ouverture et de redressement de chemins vicinaux. (L. du 21 mai 1836, art. 16.) 2 En cas de travaux accomplis par les associations syndicales, except ceux indiqus aux nos 6 et 7 de l'art. 1er de la loi du 22 dcembre 1888. 3 En cas d'accomplissement de travaux du mme genre par l'administration lorsqu'il ne se forme pas d'associations syndicales en vertu des lois du 16 septembre1807 et du 14 floral an XI. (L. 21 juin 1865, art. 27.) 4 En cas d'expropriation de terrain ncessaire pour l'tablissement d'un tramway sur une voie publique. (L. 11 juin 1880, art. 31.) 5 En cas d'ouverture ou largissement de chemins ruraux. (L. 20 aot 1881, art. 13.) 6 En cas d'tablissement d'une ligne tlgraphique ou tlphonique lorsqu'il y a lieu d'excuter des travaux qui entranent une dpossession dfinitive. (L. 28juill. 1885, art. 13.)
602
LES DROITSDOMANIAUX DE PUISSANCE PUBLIQUE Appendice. Matiresvoisines de l'expropriation.
Effet des plans d'alignement, 466. I. largissement Rappelons que les plans et redressement des chemins. d'alignement, dresss pour l'largissement ou le redressement des chemins ou des rues des villes, produisent en certains cas le mme effet que l'expropriation. Ils attribuent la voie publique certaines parties des terrains riverains, par consquent ils en font passer la proprit la personne administrative qui a la voie publique dans son domaine public. Ce transfert de proprit diffre de l'expropriation : d'abord en ce qu'il est opr non pas par autorit de justice, mais par de purs actes administratifs (plans d'alignement, trac de la voie); ensuite en ce que l'indemnit n'est pas pralable la prise de possession ; enfin en ce que l'indemnit n'est pas toujours rgle par le jury, en matire d'largissement de chemins vicinaux notamment, elle est rgle par le juge de paix du canton, sur rapport d'experts. (V. d'ailleurs, p. 521.) 467. II. Rquisitions militaires. (L. 3juill. 1877; 1. 5 mars 1890.) Les rquisitions militaires sont une sorte d'expropriation s'appliquant aux choses mobilires. Par certains cts, les rquisitions ressemblent une contribution directe de rpartition. En effet, la rquisition est adresse la commune et rpartie ensuite entre les habitants. Mais ce qui fait pencher la balance du ct de l'expropriation, c'est qu'il ya dpossession force et indemnit. Les objets qui peuvent tre rquisitionns sont numrs dans l'art. 5 de la loi, ce sont: des denres, des objets mobiliers, le logement des troupes, des services personnels. Les rquisitions sont possibles en cas de mobilisation totale ou partielle de l'arme, ou en cas de rassemblement de troupes ; elles peuvent tre faites autour des places fortes non seulement pour les besoins de la garnison, mais pour ceux de la population civile. (L. 5 mars 1890.) Il intervient une dcision du ministre de la guerre pour dclarer la priode des rquisitions ouverte. Ce sont en principe les autorits militaires qui oprent les rquisitions, mais pour le ravitaillement des places fortes elles peuvent dlguer leurs pouvoirs l'autorit administrative. Excution des rquisitions. Toute rquisition doit tre adresse la commune; elle est notifie au maire. Les rquisitions exerces sur une commune ne doivent porter que sur les ressources qui y existent, sans les absorber compltement . (Art. 19.) Le maire, assist, sauf le cas de force majeure ou d'extrme urgence,
LES TRAVAUX PUBLICS MODES D'ACQURIR.
603
de deux membres du conseil municipal appels dans l'ordre du tableau et de deux des habitants les plus imposs de la commune, rpartit les au lieu de prestations exiges entre les habitants et les contribuables. procder par voie de rpartition, le maire, assist comme il est dit cidessus, peut pourvoir directement, au compte de la commune, la fourniture des prestations requises ; les dpenses qu'entrane cette opration sont imputes sur les ressources gnrales du budget municipal, sans qu'il soit besoin d'autorisation spciale . (Art. 20.) 4 Rglementdes indemnits. Le ministre de la guerre nomme dans chaque dpartement, o peuvent tre exerces des rquisitions, une commission charge d'valuer les indemnits payer aux personnes et aux communes qui ont fourni des prestations. Un rglement d'administration publique dterminera la composition et le fonctionnement de cette commission qui devra comprendre des membres militaires et des membres civils, en assurant la majorit l'lment civil. (Art. 24.) D'ailleurs cette commission d'valuation ne fixe pas souverainement l'indemnit, elle ne fait que des propositions. Si ces propositions ne sont pas acceptes aprs toute une procdure rgle aux art. 25 28, le diffrend est tranch soit par le juge de paix, soit par le tribunal civil. Le paiement de l'indemnit est immdiat. aux chevaux, mulets 468. III. Dispositions relatives (V. sur la conscription des chevaux, mulets et et voitures. voitures, 1. 3juill. 1877, titre VIII, et R. 2 aot 1877.) 469. VI. Dispositions aux grandes maspciales Pour l'excution des grandes manuvres, il a t nuvres. ncessaire de permettre l'occupation des proprits prives, sauf l'allocation d'indemnits pour les dommages qui seraient causs. (V. 1. 3 juill. 1877, titre IX.) 1. PUBLICS 3. LESTRAVAUX Article 1er. Dfinition de l'opration de travaux publics. 470. L'opration de travaux publics est un mode d'acqurir qui suppose un travail excut pour le compte d'une personne administrative en vue d'un service public. Tous les lments de cette dfinition doivent tre srieusement tudis parce qu'il y a des intrts nombreux la question de savoir si dans un cas donn on se trouve ou non en prsence de l'opration 1. Bibliographie de droit administratif; Perriquet, Les : Aucoc, Confrences travaux publics; Albert Christophle, Traitsdes travaux publics, 2edition.
604
LES DROITSDOMANIAUX DE PUISSANCE PUBLIQUE
de travaux publics; le contentieux de l'opration de travaux publics est de la comptence du conseil de prfecture ; cette mme opration entraine en certains cas, pour les proprits voisines, des dommages graves, tels que l'occupation temporaire, etc., etc. La question de comptence est particulirement importante. La comptence des conseils de prfecture est tablie par l'art. 4 de la loi du 28 pluvise an VIII, et ce texte, quelque peu incomplet, est interprt par la jurisprudence administrative de faon rendre le contentieux des travaux publics extrmement comprhensif. Tout ce qui fait partie de l'opration telle qu'elle va tre dfinie ; tout ce qui en est une consquence, rentre dans la comptence du conseil de prfecture, condition d'intresser de prs ou de loin la personne administrative. La raison semble en tre que les travaux publics sont l'opration administrative la plus dangereuse pour les finances publiques et que le contrle doit en tre assur d'une faon particulirement svre. Faisons observer que la question de savoir s'il y a opration de travaux publics est compltement indpendante de celle de savoir par quels procds l'opration est ralise. Nous verrons plus loin que les travaux publics peuvent tre excuts par trois procds principaux : en rgie, par entreprise, par concession. Sous ces procds divers, c'est toujours la mme opration qui se retrouve. Cette opration est un mode d'acqurir, parce qu'en effet, elle fait entrer dans le patrimoine de la personne administrative un objet nouveau, l'objet cr par le travail public btiment, pont, route, chemin de fer, etc. : 1 un travail excut; L'opration est constitue par trois lments 2 une personne administrative pour le compte de laquelle le travail est excut; 3 un service public en vue duquel il est excut. Il faut qu'il y ait excution 471. I. Du travail excut. d'un travail pour le compte de la personne administrative et non pas livraison d'une chose fabrique d'avance. C'est--dire que si un contrat intervient avec un entrepreneur, il faut qu'il puisse s'analyser en un louage d'ouvrage et non pas en une vente ou fourniture. Il y a des cas douteux o les deux lments sont combins. Mais alors, si l'opration est indivisible, le caractre de travail public l'emporte, mme si l'lment de louage est moins important que celui de fourniture; c'est ainsi que les entreprises d'clairage au gaz sont considres comme des travaux publics; il y a fourniture pour le gaz, mais il y a travail excut pour la canalisation (C. d't. 28 nov. 1880). C'est ainsi que les entreprises de travail dans les prisons sont considres comme des travaux publics, parce que le cahier des charges
LES TRAVAUX PUBLICS MODES D'ACQURIR.
605
impose ordinairement l'adjudicataire certains travaux d'entretien des btiments. (C. d't. 23 dc. 1881.) Observation. La loi ne prcise nulle part la nature matrielle de l'objet qui doit tre cr par l'opration de travaux publics; mais il rsulte, soit de l'esprit des textes, notamment dela loi du 28 pluvise an VIII, art. 4, soit de la jurisprudence, soit de la pratique administrative, que l'opration de travaux publics aboutit toujours la cration ou l'entretien d'un immeuble. C'est une maison, un pont, une voie qui sont construits sur le sol et qui deviennent l'accessoire du sol. Des objets mobiliers entrent videmment dans la construction, mais il y a toujours un travail de pose qui les incorpore au sol1. Si un entrepreneur fournissait des matriaux destins la construction, mais s'il n'en oprait pas la pose, il y aurait fourniture et non pas travaux publics. (C. d't. 3 mars 1876, 7 mai 1881.) A plus forte raison, s'il s'agit de la cration d'objets mobiliers qui ne seront jamais incorpors au sol, n'y a-t-il point travaux publics; aussi la construction d'un navire par un entrepreneur priv, mme surveille par des agents de l'tat, n'aboutit-elle qu' un march de fourniture, de mme la fabrication d'armes de guerre par l'industrie prive. A plus forte raison encore, un simple service comme un service de transports maritimes accompli par une compagnie de navigation, mme si un monopole est concd, ne peut-il point tre considr comme un travail public, parce qu'il n'y a aucun immeuble de l'tat n cause. administrative le 472. II. De la personne pour Il est est excut. le travail de laquelle compte aujourd'hui admis que toutes les personnes administratives, y compris mme les tablissements publics, peuvent faire des oprations de travaux publics. Il n'y a jamais eu de difficult pourles dpartements; il y en a eu pour les communes, sous la Restauration, malgr l'art.30 de la loi du 16 septembre 1807 ; il y en a eu surtout pour les tablissements publics, mais aujourd'hui toutes les controverses sont abolies; la cration des associations syndicales autorises, dont les travaux sont formellement assimils aux travaux publics parla loi du 21 juin 1865, art. 16, a eu cet gard beaucoup d'influence. (V. Travaux publics d'hospice, C. d't. 27 fvr. 1847, 14 juill. 1876; Travaux 1. L'tablissement d'une ligne tlgraphique ou tlphonique est une opration de travaux publics, mais aussi c'est que les fils une fois poss sont attachs au sol et deviennent immeubles. (V. Cons. d't. 21 novembre 1890.)
606
LES DROITS DOMANIAUX DE PUISSANCE PUBLIQUE
publics de fabrique, C. d't. 14 nov. 1879 ; Trib. confl. 9dc. 1882.) Sont travaux publics non seulement ceux qui sont excuts sous la direction des personnes administratives en rgie ou par entreprise, mais encore ceux qui sont excuts pour leur compte par des concessionnaires. A l'inverse des travaux qui ne sont pas excuts pour le compte des personnes administratives, ne sont pas des travaux publics, mme s'ils sont excuts pour un tablissement d'utilit publique. (C. d't. 19 janv. 1860.) 473. III. Du service en vue duquel le travail public Il faut que le travail soit excut en vue d'un est excut. service public. Par consquent, tous les travaux entrepris par les personnes adminstratives n'ont pas le caractre de travaux publics, notamment ceux qu'elles font sur leur domaine priv et en vue de l'utilit particulire de ce domaine. Ainsi, les entreprises de routes faites par l'administration forestire pour l'exploitation des forts de l'tat ne doivent pas tre considres comme des travaux publics. Le Conseil d'tat s'est prononc plusieurs fois. (Arr. 2 mai 1873, 4 avril 1884.) De mme, les travaux faits pour des biens communaux. Mme si les travaux sont accomplis sur des dpendances du domaine public, ce ne sont pas des travaux publics s'ils sont faits en vertu d'une convention prive. (Confl. 18 mars 1881.) Mais les travaux de construction d'une manufacture de tabac, ceux d'un tablissement d'eaux thermales ont t considrs comme faits en vue d'un service public. De mme les travaux une maison que la commune loue au dpartement pour un service public, par exemple une gendarmerie. Il est des travaux que l'on appelle d'ordinaire travaux d'intrt collectif, qui ont pour but d'augmenter la valeur de certains terrains, par exemple, en desschant des marais, en oprant des drainages, etc. ; pour l'excution de ces travaux, il se constitue des associations syndicales de propritaires, qui, lorsquelles sont autorises par l'administration, deviennent des tablissements publics (V. n 499) ; ces travaux sont, eux aussi, faits en vue d'un service public, bien qu'ils doivent profiter un ensemble parfaitement dtermin de propritaires. En effet, puisqu'un tablissement public a t cr pour accomplir cette uvre, l'uvre est devenue un service public. Ce sont donc des travaux publics ordinaires, bien qu'ils entranent certaines consquences spciales au point de vue des plus-values, Comme toute opration, les travaux pu474. Observation. blics doivent tre dcids au nom de la personne administrative, par l'autorit administrative comptente. C'est ainsi que les travaux qui
LES TRAVAUX MODES PUBLICS D'ACQURIR.
607
doivent tre pays sur les fonds de l'tat, ne peuvent jamais tre entrepris que si une loi en autorise l'ouverture et alloue les crdits (1. 27 juill. 1870). Les travaux dpartementaux doivent tre dcids par le conseil gnral, les travaux communaux, par le conseil municipal. Les dlibrations de ces conseils locaux doivent tre approuves, en certain cas, par des autorits diverses 1. La question se pose de savoir s'il ya vraiment opration de travaux publics, et, par suite, comptence administrative, lorsque ces dcisions ncessaires n'ont pas t prises et que les travaux sont irrgulirement engags ; par exemple un maire engage seul des travaux qui auraient dtre vots par le conseil municipal. Sur cette question la jurisprudence se montre hsitante. Tantt, dans des affaires o le travail a t accompli par un particulier qui invoque ensuite contre une commune la gestion d'affaires pour se faire rembourser, le Conseil d'tat affirme que le conseil de prfecture est comptent et que l'inobservation des formalits ne fait pas disparatre le caractre de travail public (C. d't. 16 dc. 1881, 15 janv. 1881) ; tantt, quand il s'agit de dommages causs la proprit par des travaux d'une commune irrgulirement engags, il affirme que les tribunaux judiciaires sont comptents et qu'il n'y a pas travail public (C. d't. 25 nov. 1881). Mais il y a bien des chances pour que finalement la comptence administrative soit consacre. Et, en effet, cette comptence, en matire de travaux publics, a pour raison d'tre le dsir de protger les finances publiques; il faut reconnatre que ces finances sont tout aussi menaces par des oprations irrgulirement engages que par des oprations rgulires, sinon plus 2. 1. Nous ne parlons pas des dclarations d'utilit publique et des enqutes qui peuvent tre ncessaires, parce qu'elles sont ncessites, non pas directement par l'opration de travaux publics, mais plutt par d'autres raisons, par exemple parce qu'il faut au pralable procder une expropriation, ou bien parce qu'il faut crer une association syndicale (l. 22 dc. 1888,art. 3), ou bien parce qu'il y aura une taxe recouvrer sur des proprits (l. 7 juin 1845, sur l'tablissement des trottoirs). 2. Quant la question de savoir si celui qui a engag la dpense irrgulirement ne sera pas personnellement responsable. (V.infr, gestiond'affaires, n 537.)
608
LES DROITS DOMANIAUX DE PUISSANCE PUBLIQUE
Article II. Consquences de l'opration de travaux publics vis--vis des tiers. N 1. Thorie des dommages causs la proprit par l'opration de travaux publics. L'opration de travaux publics, par quelque mode qu'elle soit ralise, peut avoir vis--vis des proprits voisines des consquences : elle peut entraner des dommages graves en deux sens diffrents pour certaines proprits, elle peut apporter des plus-values certaines autres proprits. La justice exige que l'une et l'autre de ces consquences soient corriges ; de l deux thories, insparables de la matire des travaux publics, la thorie des dommages et celle des plus-values. 475. A. Thorie des dommages aux prognrale Deux espces de dommages peuvent tre causs la prits. proprit par l'excution des travaux publics: 1 des dommages varis qui sont causs par l'excution mme des travaux et que l'on groupe sous le nom d'occupation temporaire, notamment l'occupation d'un terrain pour y faire un dpt de matriaux, ou pour y procder l'extraction de matriaux ; ces dommages, qui d'ailleurs actuellement ne sont attachs qu'aux travaux de voirie,sont de leur nature passagers ; 2 des dommages permanents qui rsultent pour une proprit, du voisinage du travail excut, quel que soit cet ouvrage, pont, remblai, tunnel, btiment, etc., par exemple, parce que la proprit voisine a t rendue insalubre. Comme l'excution des travaux publics profite tous galement, il est juste que tous y contribuent galement; il ne serait pas juste, par suite, que les propritaires immdiatement voisins supportassent des dommages particuliers sans indemnit, car ce serait mettre leur charge une contribution exceptionnelle. Le principe de l'indemnit en matire de dommage caus par les travaux publics est donc de toute justice, mais il reste lui donner une base juridique prcise qui permette de dfinir les caractres du dommage. La thorie extrmement sage qui tend s'tablir, est que le droit l'indemnit rsulte d'une violation du droit de proprit prive analogue celle qui se produit dans l'expropriation. L'expropriation elle-mme, en un certain sens, peut tre range parmi les dom; elle est l'atteinte la plus mages qui rsultent des travaux publics
LES TRAVAUX PUBLICS MODES D'ACQURIR.
609
; les autres dommages y grave qui puisse tre porte la proprit apportent des atteintes moins graves, mais de mme nature. C'est--dire que le dommage rsulte del'exercice d'un droit de puissance publique suprieur au droit de proprit prive, devant lequel le droit de proprit doit cder, mais que l'quilibre doit tre rtabli par une indemnit. Le dommage, en un mot, rsulte du conflit d'un droit de puissance publique avec un droit de personne prive. (V. p. 420.) La chose est vidente quand il s'agit des dommages occasionns par l'occupation temporaire; mme, l'analogie avec l'expropriation s'impose; le terrain est occup, il est fouill, il y a dpossession vritable quoique temporaire, d'un autre ct l'administration agit en vertu d'un droit spcial reconnu par des textes formels. La situation est moins nette quand il s'agit de dommages permanents. D'une part, si le dommage est presque toujours vident., il n'apparait pas toujours avec la mme vidence qu'il soit le rsultat d'une atteinte porte au droit de proprit, carl il n'y a pas, en apparence du moins, dpossession du propritaire. Voici une hypothse curieuse. A la suite de travaux publics, un fort remblai est lev dans le voi vent ; ce remblai intercepte le vent rgnant dans sinage d'un moulin la contre et par consquent le moulin cesse de tourner, le dommage est vident. L'atteinte au droit de proprit l'est moins au premier , examen; en effet, il n'a pas t touch l'hritage o se trouve le moulin et qui est distant d'une dizaine de mtres. Cependant, la rflexion, on s'aperoit que le droit de proprit ne doit pas tre entendu d'une faon troite, qu'il ne donne pas seulement droit la jouissance du sol, mais aussi, au soleil, aux pluies, aux vents, toutes les circonstances atmosphriques qui constituent le climat normal de la rgion. Or, il y a eu modification dans ces circonstances atmosphriques, il y a donc eu atteinte la proprit. Mais, d'autre part, cette atteinte rsulte-t-elle bien de l'exercice d'un droit de puissance publique? ne pourrait-on pas dire que l'administration, qui est propritaire du terrain sur lequel elle accomplit le travail, ne fait en somme qu'exercer de son ct le droit de proprit ordinaire? car le droit de proprit, d'aprs le Code civil, permet de btir, comme bon il semble, de faire des fouilles dans son terrain comme bon il semble. Et ds lors, l'administration ne devrait aucune indemnit, pas plus qu'un particulier n'en devrait en pareille circonstance. A cela on a rpondu fort justement que le Code civil a t fait en vue des oprations ordinaires accomplies parles particuliers, mais H. 39
610
DE PUISSANCE LES DROITSDOMANIAUX PUBLIQUE
qu'il n'y a aucun rapport entre les petits travaux d'usage courant parmi les propritaires, et les normes travaux bouleversant le relief du sol accomplis par les administrations publiques, tranches, remblais, viaducs, tunnels, etc. ; que ces travaux, par consquent, ne peuvent pas tre considrs comme faits en vertu des privilges du droit de proprit prive, mais bien en vertu d'un droit de puissance publique. Cependant, cela appelle une distinction qui est de nature concilier bien des dcisions contradictoires du Conseil d'tat en matire de dommages permanents: les travaux ne doivent tre considrs comme accomplisen vertu d'un droit de puissance publique, et par consquent le dommage ne donne lieu indemnit, que si les travaux dpassent par leurs proportions ceux qui sont accomplis par les particuliers. Voici, par exemple, une source qui a t coupe. Si c'est en creusant un simple puits, il n'y a pas droit indemnit, car c'est un travail qu'un propritaire ordinaire et pu faire; si c'est en creusant un tunnel, il y aura droit indemnit. Toute cette thorie, trs quitable et trs lgante, se trouve consacre propos de l'hypothse du tunnel dans un arrt du Conseil d'tat du 11 mai 1883, rendu sur rapport de M. Le Vavasseur de Prcourt1. Cette matire est 476. B. De l'occupation temporaire. assez mal rglemente, elle s'appuie sur des textes antrieurs 1789, notamment sur des arrts du Conseil du 7 septembre 1755 et du 20 mars 1780, con firms par l'art. 28, tit. 1er, 1. 19-22 juill. 1791. Il a t plusieurs fois question de la remanier, plusieurs projets dposs n'ont pas abouti 2. 1 En quoi consiste l'occupation temporaire. Elle consiste dans le droit d'occuper les terrains des particuliers : 1 en vue du passage ou du dpt de matriaux; 2 en vue de pratiquer des fouilles et d'extraire les matriaux qui seraient utiles la construction. On conoit combien ces droits sont ncessaires pour l'excution de grands travaux, notamment pour les chemins de fer. 2 A l'occasion de quels travaux elle s'applique. L'occupation temporaire ne s'applique qu'aux travaux de voirie, c'est pour les 1. Il est peine besoin de faire observer qu'il serait absurbe de chercher la base du droit indemnit dans l'art. 1382. Cela supposerait que l'administration commet un quasi-dlit en excutant des travaux publics, alors que c'est non seulement son droit, mais son devoir d'en excuter.Mmesi l'ingnieur avait commis dans son plan des fautes videntes, cela neressemblerait encore en rien au quasi-dlit. 2. V. proposition Morel, Snat, 16 nov. 1891,Journal officiel23 fvrier 1892.
LES TRAVAUX PUBLICS MODES D'ACQURIR.
611
routes qu'elle a t cre par les anciens arrts et qu'elle a t consacre par le Code civil, dans l'art. 650 et par la loi du 16 septembre 1807, art. 55; elle a t tendue aux chemins vicinaux par la loi du 21 mai 1836, art. 17; aux chemins de fer par la loi du 15juillet 1845, art. 3, aux chemins ruraux par la loi du 20 aot 1881, art. 14. Elle s'applique aussi bien pour les travaux d'entretien que pour ceux de construction. Elle s'applique aussi aux travaux des fortifications (1. 31 mars 1832) et des casernes (pratique inconteste), mais elle ne s'applique pas aux travaux des btiments civils. 3 A quels terrains elle s'applique. A tous, sauf les exceptions. Sont exempts du droit d'occupation, l'habitation et ses dpendances, c'est--dire les cours, jardins, vergers, parcs, lorsqu'ils sont entours de vritables cltures en dfendant l'accs, alors mme qu'ils ne seraient pas compltement attenants la maison. C'est ainsi que le Conseil d'tat (arr. 21 mai 1867) interprte dfinitivement les arrts du Conseil du 7 septembre 1755 et du 20 mars 1780 dont les termes ne sont pas trs mesurs. 4 Par qui elle est exerce. Le droit d'occupation et d'extraction peut tre exerc directement par l'administration, par les entrepreneurs ou concessionnaires de travaux publics, et mme par de simples fournisseurs de matriaux. Ce dernier point a t longtemps contest, l'arrt du 7 septembre 1755 ne parlant que des entrepreneurs d'ouvrages. Le Conseil d'tat a rsist pendant longtemps. Cependant il s'est rendu la raison (9 mai 1867). Le dcret du 16dcembre 1811, art, 28, prescrivant l'administration de se faire fournir les matriaux pour l'entretien des routes, c'et t supprimer le droit d'occupation que d'en refuser l'exercice aux fournisseurs. 5 Suivant quelles formes. Les formes, suivant lesquelles doit s'effectuer l'occupation, sont regles par un dcret du 8 fvrier 1868 qui malheureusement ne s'applique qu'aux services relevant du ministre des travaux publics, sauf en ce qui concerne l'arrt du prfet toujours ncessaire : 1 Un arrt du prfet indiquant le nom de la commune ole terrain est situ, le numro des parcelles et le nom du propritaire, et visant les documents eu vertu desquels l'occupation est propose (devis ou rapport d'ingnieur). Ampliation de cet arrt est envoye l'ingnieur qui en remet une copie certifie l'entrepreneur et au maire, qui notifie l'arrt au propritaire du terrain ou son reprsentant. 2 Une tentative de l'entrepreneur afin d'arriver une entente amiable. 3 A dfaut d'entente amiable, une constatation de l'tat des lieux faite
612
LES DROITSDOMANIAUX DE PUISSANCE PUBLIQUE
contradictoirement par deux experts, conformment aux art. 4, 5 et 6 du dcret de 1868. 4 La prise de possession par l'entrepreneur, faite avec l'assistance du maire si le propritaire veut s'y opposer, sauf toutefois que l'entrepreneur est tenu de laisser subsister les arbresfruitiers ou de haute futaie jusqu' ce que l'estimation en ait t faite. Lorsque les entrepreneurs ne remplissent pas les formalit prescrites par le dcret du 8 fvrier 1868, ils sont responsables devant les tribunaux civils. (Conflits, 17 fvrier 1869; 19juillet 1872, 9 mai 1884.) S'il n'y a pas eu de dsignation du tout ou si elle est irrgulire, ou si l'entrepreneur est sorti des limites de l'arrt, les extractions non autorises constituent des voies de faitet sont passibles du tribunal correctionnel. (C. d't. Jurisprudence constante). L'arrt du prfet peut tre l'objet d'un recours gracieux devant le ministre des travaux publics en cas d'inopportunit, et d'un recours contentieux devant le conseil de prfecture, s'il y a violation des rgles sur les terrains qui ne doivent pas tre occups. 6 Comment est rgle l'indemnit. Aprs l'achvement des travaux, et s'ils doivent durer plusieurs annes, la fin de chaque campagne, il est fait une nouvelle constatation de l'tat des lieux. A dfaut d'accord entre l'entrepreneur et le propritaire pour l'valuation partielle ou totale de l'indemnit, il est procd conformment l'art. 56 de la loi du 16 septembre 1807, c'est--dire devant le conseil de prfecture. (D. 1868, art. 8.) Il y a toujours lieu d'indemniser pour l'occupation du sol, son bouleversement, le dgt aux rcoltes, etc. Pour ce qui est des matriaux extraits, on distingue deux hypothses: s'il n'y avait pas de carrire dj en exploitation, on ne doit rien au propritaire pour la valeur des matriaux extraits; s'il y avait une carrire dj en exploitation, on paye la valeur des matriaux. (L. 16 sept. 1807, art. 55.) Cette distinction peu justifiable est la disposition la plus critique; aussi, dans les projets de loi, indemnise-t-on toujours de la valeur des matriaux. En matire de chemins vicinaux, il y a prescription de deux ans pour l'indemnit. (Art. 18, loi 1836.) 7 De l'occupation dfinitive. L'occupation indfiniment prolonge quivaut expropriation, il doit tre procd la fixation de l'indemnit par le jury. La thorie des 477. C. Des dommages permanents. dommages permanents est beaucoup plus large que cellede l'occupation toute espce de de en ce sens propos qu'elle s'applique temporaire, travaux publics. Nous avons donn plus haut (p. 608) la notion de ces
LES TRAVAUX PUBLICS MODES D'ACQURIR.
613
dommages et le fondement juridique du droit indemnit; il nous reste ici indiquer les caractres prcis que doit prsenter le dommage pour que l'indemnit soit accorde, et les rgles de l'action en indemnit. Il faut pour qu'un dommage donne Caractres du a) dommage. lieu indemnit: 1 Qu'il soit direct et matriel. Direct, c'est--dire qu'il soit la con; des travaux de voirie excuts squence immdiate du travail excut ct d'une maison laissent cette maison en contre-bas de la voie, voil un dommage direct; des travaux de voirie excuts dans un quartier d'une ville appellent dans ce quartier le mouvement et le commerce, les immeubles des autres quartiers subissent une baisse; ce n'est pas un dommage direct. Matriel, c'est--dire que la proprit doit tre touche dans un de ses lments physiques; il faut qu'il y ait une sorte d'expropriation (v. p. 608). Le cas cit plus haut du moulin vent, pour lequel le rgime des vents a t modifi par un remblai, est un excellent exemple de dommage matriel, parce qu'il montre que cette condition est interprte trs largement. 2 Qu'il porte atteinte un droit et non une simple permission prcaire. Les permissions accordes sur les voies publiques ne donnent qu'une possession prcaire exclusive de toute ide d'indemnit en cas de dommages rsultant de travaux. Ainsi la construction d'un gout, par exemple, bouleverse les tuyaux de canalisation qu'une compagnie d'clairage au gaz avait placs sous le sol de la rue, aucune indemnit sauf convention contraire. Nous savons que la suppression de jours ou d'accs par des travaux de voirie, donne au contraire droit indemnit au profit des riverains de la voie publique, parce que le droit aux jours et l'accs sur la voie est plus qu'une possession prcaire. (V. p. 493.) 3 Qu'il rsulte d'un fait excdantl'exercice normal du droit de proprit ordinaire. Ce caractre a t expliqu par avance plus haut. (V. p. 610.) b) Rgles de l'action en indemnit. L'action en indemnit peut tre intente par toute personne qui a souffert un dommage rsultant de l'excution des travaux, non seulement le propritaire, l'usufruitier, l'usager, mais aussi le locataire, comme en matire d'expropriation. Pour savoir contre qui l'action peut tre intente, il faut voir si le dommage provient du plan de l'ouvrage ou de la faute de l'entrepreneur qui n'a pas observ le plan. Dans le premier cas elle doit toujours tre intente contre l'administration, soit que celle-ci dirige les travaux, soit qu'elle les ait donns l'entreprise, soit mme qu'elle les ait concds et bien que les
614
LES DROITS DOMANIAUX DE PUISSANCE PUBLIQUE
cahiers des charges mettent d'ordinaire la rparation des dommages la charge du concessionnaire. Lorsque le dommage rsulte du fait personnel de l'entrepreneur ou du concessionnaire, il ne peut tre poursuivi que contre lui; on s'appuie d'ailleurs, non plus sur ce que les travaux publics sont une opration de puissance publique, mais tout simplement sur l'article 1382. L'indemnit doit comprendre tous les lments du dommage, la perte subie et le gain manqu, damnumemergens et lucrum cessans, mais en revanche si une mme opration a la fois caus un dommage et apport une plus-value, la plus-value doit entrer en compensation. c) Comptence du conseil de prfecture. Le conseil de prfecture est comptent pour les dommages permanents en tant qu'ils rsultent de l'opration mme des travaux et que l'indemnit est rclame l'administration. Il est comptent aussi en tant qu'ils rsultent du fait de l'entrepreneur. N 2. Thorie des plus-values indirectes apportes la proprit par les oprations de travaux publics. 478. La loi du 16 septembre 1807, dont l'objet principal est le desschement des marais et quelques autres travaux d'intrt collectif, contient un certain nombre de dispositions d'une porte gnrale, qui lui ont valu une juste clbrit et le surnom de Code des travaux publics. L'une de ces dispositions gnrales, trop rares en droit administratif, est l'art. 30, qui pose en principe que lorsquedes proprits prives auront acquis, la suite de travaux publics excuts par l'tat, le dpartement ou la commune, une notable augmentation de valeur, elles pourront tre charges de payer une indemnit qui pourra s'lever jusqu' la valeur de la moiti des avantages qu'elles auront acquis. On appelle cette espce de plus-value, plus value indirecte, parce qu'elle n'a pas t le rsultat directement poursuivi par les travaux; et on l'oppose aux plus-values directes, qui rsultent de travaux spcialement entrepris pour amliorer un ensemble de terrains, travaux de desschement ou de drainage, que nous verrons plus loin propos des associations syndicales. Nous n'aimons pas beaucoup ces expressions qui ont le tort de n'tre pas claires, mais elles sont consacres par l'usage. et qui La plus-value indirecte qui nons occupe seule en ce moment rsulte de travaux publics quelconques, percements de rues, constructions de quais, de ponts, etc., est videmment un enrichissement
LES TRAVAUX PUBLICS MODES D'ACQURIR.
615
gratuit pour les proprits voisines. Les travaux tant pays sur les fonds d'tat ou sur les fonds dpartementaux ou communaux, tous les contribuables participent galement la dpense ; il n'est pas juste que quelques propritaires en profitent d'une faon exceptionnelle. L est le fondement de la disposition de l'art. 30 de la loi du 16 septembre 1807, il est bien inutile d'en chercher un autre. Dans l'hypothse des plus-values directes, au contraire, quand il s'agit de travaux entrepris spcialement pour amliorer des terrains , on peut dire qu'il y a eu gestion d'affaires au profit de tous les propritaires dont les terrains sont amliors, et la contribution demande sur la plus-value a le caractre d'un remboursement de frais. Le principe pos par l'art. 30, 1. 16 septembre 1807, a certainement inspir l'art. 51 de la loi du 3 mai 1841, en cas d'expropriation partielle: Si l'excution des travaux doit procurer une augmentation de valeur immdiate et spciale au restant de la proprit, cette augmentation sera prise en considration dans l'valuation de l'indemnit. Dans ce cas-l l'application du principe est facile, parce que la procdure est tout engage, que l'administration a la main garnie et qu'elle se paye en moins donnant. L'application du principe est beaucoup moins facile, lorsqu'il faut faire contribuer des propritaires qui ne sont pas touchs par l'expro; la procpriation et sur lesquels il faut directement lever des taxes dure organise par la loi de 1807 n'est pas trs heureuse, et il faut bien reconnatre qu'en fait l'application de l'art 30 est de plus en plus rare1. Il faut qu'un dcret rendu en Conseil d'tat intervienne et dcide, aprs avoir entendu les parties intresses, que dans un certain primtre il y a lieu faire contribuer la plus-value. Aprs cela, des commissions spciales sont nommes conformment l'art. 42, 1. 16 septembre 1807, pour estimer la plus-value; ce sont de vritables tribunaux temporaires et l'on peut recourir directement au Conseil d'tat contre leurs dcisions. Entin, divers modes de libration sont offerts aux propritaires par l'art. 31. Les recouvrements se font comme en matire de contributions directes. 1. On avait mme prtendu qu'il avait t abrog par l'art. 51, l. 3 mai 1841; il n'en est rien, il a t appliqu depuis, d'ailleurs les deux dispositions se concilient trs bien.
616
DE PUISSANCE LES DROITSDOMANIAUX PUBLIQUE
N 3. Des dommages causs aux personnes par les travaux publics. 479. Des dommages peuvent tre causs aux personnes par les travaux publics, soit dans la construction de l'ouvrage par suite d'accidents de chantier, soit par suite de l'croulement de l'ouvrage, soit dans l'usage mme de l'ouvrage par suite de dispositions vicieuses. Ces dommages doivent tre rpars soit par l'administration, soit par l'entrepreneur, mais la difficult est de savoir si le conseil de prfecture est encore com ptent. Les arguments pour dfendre sa comptence sont les suivants: 1 l'article 4, 1. 28 pluvise an VIII qui est le texte fondamental ne distingue pas entre les dommages aux proprits et les dommages aux personnes ; 2 la juridiction du conseil de prfecture est plus expditive, parce que s'il y a des actes administratifs interprter le conseil peut les interprter, tandis qu'un tribunal judiciaire serait oblig de surseoir et de renvoyer pour l'interprtation devant l'autorit comptente. Le Conseil d'tat, aprs certains revirements de jurisprudence est actuellement fix dans le sens de la comptence du conseil de prlecture sans aucune distinction (Cons. d't. 30 nov. 1877. Lefort). Le tribunal des conflits fait certaines distinctions et notamment pour d'ouvriers contre les entrepreneurs les demandes d'indemnit renvoie l'autorit judiciaire (Conflits 15 mai 1886, Bordelier). Il faut avouer qu'on se trouve l l'extrme limite de la notion de dommage caus par le travail public, et que la notion de faute soit de l'ingnieur, soit de l'entrepreneur, qui entranerait comptence judiciaire, parat s'imposer. Le dommage est survenu l'occasion du travail, mais la vritable cause est dans une faute dont on peut nommer l'auteur. Article III. Excution de l'opration de travaux publics. N 1. Excution en rgie Les travaux publics peuvent tre excuts de trois faons : en rgie, par entreprise ou march, par concession. Il y a l autant de contrats diffrents qui entranent des rapports entre la personne administrative qui fait excuter le travail, et les ouvriers, entrepreneurs, concessionnaires qui l'excutent. L'excution en rgie est celle qui est faite sous la direction de l'adcela ne comporte pas de grands dvelopministration elle-mme ; 480.
LES TRAVAUX PUBLICS MODES D'ACQURIR.
617
pements, le seul contrat qui intervienne est un contrat de louage d'ouvriers. On distingue: 1 l'excution la journe, comme pour l'empierrement des routes par un cantonnier; 2 la rgie simple, o il y a un directeur de travaux qui est un fonctionnaire, gnralement un conducteur des ponts et chausses ; 3 la rgie intresse, o le directeur des travaux n'est pas un agent de l'administration et est pay spcialement. Il ne faut pas confondre l'excution en rgie avec la mise en rgie, un incident qui peut survenir dans le march par entreprise. N 2. Excution par march ou entreprise. Les marchs de travaux publics. a) Forme des marchs. 481. L'entreprise ou march de travaux publics est un contrat par lequel un entrepreneur s'engage envers une personne administrative excuter l'ouvrage convenu, moyennant un prix que celle-ci doit lui payer d'aprs des bases dtermines. Le contrat peut se former de deux manires : par voie d'adjudication publique, ou par march de gr gr. L'adjudication est la rgle; les marchs de gr gr ne doivent avoir lieu que dans des cas exceptionnels. Ce principe, pos dj par l'ordonnance du 18 mars 1829 et celle du 4 dcembre 1833, est consacr nouveau pour les travaux de l'tat par le dcret du 18 novembre 1882 ; il s'applique de plein droit aux travaux des dpartements; il est pospourles travaux des communes et des tablissements de bienfaisance par l'ordonnance du 14 novembre 1837 ; il a t tendu aux colonies par des dcrets.Les cas dans lesquels, exceptionnellement, les marchs peuvent tre passs degr gr sont numrs pour l'tat et pour les dpartements dans le D. 18 nov. 1882, art. 18 ; pour les communes dans l'O. 14 nov. 1837, art. 1er. En dehors de ces hypothses exceptionnelles, tout march pass de gr gr alors qu'il et d tre pass par adjudication, est entach de nullit. Cette nullit, fonde sur l'incapacit, ne peut tre invoque que dans l'intrt de la personne administrative, l'entrepreneur ne saurait s'en prvaloir. 482. De l'adjudication. (D. 18 nov. 1882; D. 4 juin 1888; O. 14 nov. 1837 ; 1. 5 avril 1884, art. 89.) L'adjudication est un march pass avec publicit et concurrence.
618
LES DROITSDOMANIAUX DE PUISSANCE PUBLIQUE
Les formalits de l'adjudication consistent essentiellement en ce que, en une sance publique prside par une autorit administrative, il est procd une enchre pour arriver au plus fort rabais sur le devis dress par l'administration. Les rabais proposs par les entrepreneurs sont d'ailleurs contenus dans des soumissions crites et cachetes, et l'on se borne en la sance publique ouvrir les soumissions. Bien que l'adjudication doive tre faite avec le plus de concurrence possible, les concurrents ne sont admis que s'ils prsentent des garanties de capacit et des garanties de solvabilit, ces garanties sont apprcies par le bureau d'adjudication. Les associations ouvrires sont admises l'adjudication depuis un dcret du 4 juin 1888. Aussitt aprs l'adjudication, l'adjudicataire est li vis--vis de l'administration; l'administration ne l'est pas vis--vis de l'adjudicataire tant que l'adjudication n'a pas t approuve soit par le ministre comptent pour les travaux de l'tat, soit par le prfet pour les travaux des communes. L'adj udicataire doit fournir un cautionnement sauf exception. Pour les travaux de l'tat, il peut y avoir dispense du cautionnement; les associations ouvrires, notamment, sont dispenses lorsque le montant des travauxne dpasse pas50,000 les travaux des francs. (D. 4juin 1888.)Pour communes et des tablissements charitables, il y a touj ours cautionne.ment. En principe, le cautionnement consiste au choix de l'adjudicataire : 1 en numraire ; 2 en rentes sur l'tat et valeurs du Trsor au porteur; 3 en rentes sur l'tat, nominatives ou mixtes. Les valeurs du Trsor transmissibles par voie d'endossement, endosses en blanc, sont considres comme valeurs au porteur. (D. 18 nov. 1882, art. 5.) D'autres garanties peuvent tre exiges dans certains cas, telles que cautions personnelles et solidaires, affectations hypothcaires, dpts de matires dans les magasins de l'tat. (Art. 4.) Recours d'adjudicataires vincs. On reconnat aux entrepreneurs admis une adjudication le droit d'en contester la rgularit si tous les concurrents n'ont pas t, quant aux conditions remplir, placs sur pied d'galit. (V. arrt C. d't. 9 janv. 1868 et dj 28 janv. 1836 et 26 juill. 1851.) C'est un recours pour excs de pouvoir, formcontre l'arrt du prfet approuvant l'adjudication. Il est vrai que cet arrtest un acte approuvant un contrat. mais c'est un contrat administratif,il en serait autrement si c'tait un contrat judiciaire. (Arr. C.d't. 21 mars 1890.) Le cahier des charges. march. du b) Objet 483. Le march n'est pas, proprement parler, dbattu entre l'administration et l'entrepreneur; l'objet du march est dtaill dans un ensemble de pices qu'on appelle cahier des charges et qui a t dress
LES TRAVAUX PUBLICS MODES D'ACQURIR.
619
par l'administration; l'entrepreneur prend connaissance du cahier des charges avant le march, mais il l'tudie seul et sans explications. S'il y a des obscurits dans la rdaction et des malentendus, c'est aprs la conclusion du march que les difficults naissent. Le cahier des charges devient alors une pice capitale, car c'est lui qu'il faudra que le juge interprte et qu'il applique. Il importe donc de savoir de quoi se compose le cahier des charges; il se compose de trois ou de quatre lments : 1 les clauses et conditions gnrales ; 2 le devis ou cahier des charges spcial ; 3 le bordereau des prix d'application, 4 quelquefois l'avant-mtr. 484.1. Cahier des clauses et conditions gnrales. On entend par l le recueil des conditions communes tous les marchs passs par une personne administrative. Ce cahier comprend videmment les dispositions les plus gnrales des marchs. L'tat a plusieurs cahiers des clauses et conditions gnrales pour ses diffrents services Le plus clbre et le plus important est celui du service des ponts et chausses, dont l'embryon remonte jusqu' une dclaration royale du 7 fvrier 1608 et dont la dernire rdaction est du 16 novembre 1866. Ce cahier de 1866 ne s'applique point de plein droit aux travaux des autres personnes administratives, dpartements, communes, etc.; mais d'ordinaire les cahiers des charges de chaque entreprise s'y rfrent formellement, alors il s'applique. Rien ne s'opposerait ce qu'un dpartement ou une commune rdiget pour son propre usage uncahierdes clauses et conditions gnrales, sauf le faire approuver par les autorits comptentes; la ville de Paris en a rdig un. Cette 485. II. Devis ou cahier des charges spcial. pice indique l'objet du march, la nature du travail, les dlais de l'excution, la qualit et les provenances des matriaux employer, la manire de mesurer les ouvrages, etc. On ap486. III. Bordereau des prix d'application. pelle ainsi un bordereau qui contient le prix du mtre courant ou du mtre cube du travail fait, sans dtail; cependant on y ajoute le prix des transports et le prix pied d'oeuvre des matriaux dont l'emploi est prvu. (Cire. du 1er juin 1884.) Il existe un autre bordereau de prix sur cahier spar (Circ. 1884) qui contient le sous-dtail, savoir, pour un mtre cube de maonnerie, le prix de la pierre, du mortier, le salaire de ouvriers employs, le bnfice de l'entrepreneur, etc.
620
LES DROITS DOMANIAUX DE PUISSANCE PUBLIQUE
Autrefois on communiquait le sous-dtail aux entrepreneurs titre de renseignement, mais ils s'en autorisaient pour rclamer ds qu'un des lments avait enchri, prtendant qu'ils n'avaient consenti qu' cause de ce sous-dtail. Pour couper court, depuis 1884, on ne communique plus le sousdtail. Cette pice contient l'valuation 487. IV. Avant-mtr. des quantits mtriques d'ouvrage que l'administration se propose de faire excuter ; quelquefois le mesurage aprs coup tant difficile, le devis dcide qu'on s'en rapportera l'avant-mtr, alors cela devient une pice essentielle. Bien entendu, l'entrepreneur a droit une copie ou un exemplaire de toutes ces pices. c) Droits et obligations qui naissent du march. : le march forfait, sur 488. Il y a trois espces de marchs srie de prix, et l'unit de mesure. Dans le march forfait, l'administration fixe d'une maniere dfinitive l'ouvrage excuter ; l'entrepreneur s'engage l'excuter moyennant un prix qui sera invariable quelles que soient les circonstances qui surviennent, et sans qu'on ait faire de mesurage : c'est peuusit. Dans le march sur srie de prix, le devis indique le prix de chaque nature d'ouvrage : maonnerie, terrassement, etc., sans fixer le total auquel on devra s'arrter. Aprs achvement, on paye d'aprs le mtr des travaux excuts. Ce march est dangereux parce qu'il ne limite pasla dpense. Dans le march l'unit de mesure, le plus usit, on fixe d'une part la srie de prix de chaque ouvrage, d'autre part la quantit excuter, tout en rservant l'administration le droit d'augmenter dans une proportion donne la quantit des ouvrages. Il y a des dispositions communes tous ces marchs, ce sont celles qui se trouvent dans le cahier des clauses et conditions gnrales. De ces dispositions, les unes ne sont que l'application du droit commun, et pourraient trouver place dans des marchs passs entre particuliers (art. 1787 et s. C. civ. ); les autres sont exorbitantes du droit commun, et placent l'entrepreneur dans une situation plus mauvaise. Ces dispositions exorbitantes sont videmment plus intressantes, puisqu'en elles apparat le caractre de puissance publique de l'opration ; elles ont beaucoup diminu en ce sicle-ci. La rdaction du cahier des clauses et conditions gnrales de 1866 est moins draco-
LES TRAVAUX PUBLICS MODES D'ACQURIR
621
nienne pour l'entrepreneur que la prcdente qui datait de 1833 ; l'adminislration y a gagn, car les svrits injustes provoquaient les malfaons et les malversations. Notons que les droits singuliers consacrs par le cahier des clauses et conditions gnrales au profit de l'tat, existent apparemment, sauf modifications, au profit des dpartements et des communes, puisque ces personnes administratives peuvent adopter le cahier pour leurs travaux. Voici quelques-unes de ces dispositions exceptionnelles : L'adaux marchs. 489. I. Changements apports ministration se rserve le droit d'ordonner divers changements en cours d'entreprise. Elle peut prescrire des modifications dans les dtails d'excution, ordonner des ouvrages non prvus au devis, changer les lieux d'extraction des matriaux, enfin ordonner l'augmentation ou la diminution de la masse des travaux. Si l'entrepreneur veut qu'il lui soit tenu compte de ces changements, il doit exiger qu'ils soient prescrits par des ordres crits de l'ingnieur charg de la direction des travaux. Le prix des travaux faits la suite du changement est rgl d'aprs les lments de ceux de l'adjudication ou par assimilation aux ouvrages les plus analogues, ou si cette assimilation n'est pas possible, d'aprs les prix courants du pays. Les nouveaux prix sont dbattus ; en cas de dsaccord, il est statu par le conseil de prfecture. L'entrepreneur est tenu de subir ces changements sans pouvoir demander la rupture du march, toutes les fois qu'ils n'entranent pas augmentation ou diminution de plus d'un sixime dans la masse des travaux. (Art. 30, 31, 32, cahier.) au profit du march de la per490. II. Rsiliation La rsiliation est prononce au sonne administrative. profit de l'administration dans les cas suivants : 1 L'administration peut prononcer la rsiliation du march parce que l'entrepreneur n'excute pas, vis--vis d'elle, ses obligations. En ce cas, le droit de rsiliation se fonde sur l'art. 1184 et l'entrepreneur n'a droit aucune indemnit. En effet, il est en faute. L'administration peut mme procder une radjudication sa folle-enchre et il supportera la consquence de l'augmentation des dpenses si le rabais est infrieur. Ce qu'il ya de particulier, c'est que tout cela ce fait, non point par autorit de justice, selon le droit commun, mais par dcision administrative. 2 La rsiliation peut encore tre prononce par l'administration
622
DE PUISSANCE LES DROITS DOMANIAUX PUBLIQUE
dans son intrt, sans que l'entrepreneur soit en faute, mais moyennant indemnit. Cette rsiliation rsulte immdiatement d'un ordre de cessation absolue des travaux. Elle peut rsulter, si l'entrepreneur la demande, d'un ajournement des travaux dpassant une anne. Le droit de rsiliation de l'administration est puis ici dans l'art. 1794 du Code civil. Seulement les dispositions du cahier des clauses et conditions gnrales ont pour but d'ajouter quelques consquences celle de l'art. 1794 au point de vue de l'apprciation de l'indemnit. Quand on ne se trouve pas dans les cas prvus par le cahier, la rsiliation est valablement prononce, mais les consquences s'estiment d'aprs l'art. 1794. Dans les cas prvus au cahier des clauses et conditions, les consquences de la rsiliation s'apprcient selon les art. 34 et 43; il y a d'abord indemnit pour la perte subie et aussi pour le bnfice non ralis, mais en outre des rgles spciales sur l'acquisition par l'tat des outils et quipages de l'entrepreneur, des matriaux runis par lui sur le chantier, etc. 3 La rsiliation est opre de plein droit par la mort de l'entrepreneur (art. 1795), par sa faillite dclare. (Art. 37, cahier.) 491. III. Mise en rgie. Dans le cas o l'entrepreneur n'excute pas ses engagements, l'administration peut, au lieu de demander la rsiliation du march, organiser la mise en rgie. Elle substitue l'entrepreneur ngligent un rgisseur qui, avec le matriel, les ouvriers de l'entrepreneur, avec les matriaux approvisionns, et en y joignant au besoin d'autres moyens d'action, continue les travaux aux risques et prils dudit entrepreneur. Les dtails sont indiqus dans l'art. 25 du cahier des clauses et conditons gnrales. C'est une application de l'art. 1144 C. civ. ; mais il y a ceci de particulier qui en fait un droit exorbitant, c'est que la mise en rgie n'est pas prononce par autorit de justice, mais par dcision administrative. des de l'entrepreneur vis--vis 492. IV. Obligations L'entrepreneur doit payer ses ouvriers tous les mois, ouvriers. ou des poques plus rapproches si l'administration le juge ncessaire. En cas de retard rgulirement constat, l'administration a la facult de faire payer d'office les salaires arrirs sur les sommes dues l'entrepreneur, en se conformant la loi du 26 pluvise an II. Cette loi accorde aux ouvriers et fournisseurs de matriaux un privilge sur les sommes dues l'entrepreneur par l'tat; le privilge
LES TRAVAUX PUBLICS MODESD'ACQURIR.
623
n'a pas t tendu aux travaux faits par les dpartements, les communes, etc., mais un projet de loi est dpos en ce sens. L'entrepreneur doit supporter une retenue d'un centime, pour assurer sous le contrle de l'administration, des secours aux ouvriers atteints de blessures ou de maladies occasionnes par les travaux, aux veuves d'ouvriers et leurs enfants et pour subvenir aux dpenses du service mdical (art. 16, cahier). Le tout, si l'accident rsulte d'un cas fortuit. Sans prjudice d'une action contre l'entrepreneur fonde sur 1382 C. c., s'il ya faute imputable celui-ci. Il doit laisser aux ouvriers le repos du dimanche et des jours fris. (Art. 11, 2, cahier.) au profit de l'entrepreneur. 493. V. De la rsiliation La rsiliation peut tre prononce au profit de l'entrepreneur : 1 Si les conditions principales en vue desquelles a t contract le march sont modifies son gard. 2 Si l'administration augmente ou diminue de plus d'un sixime la masse des travaux. (Art. 30, 31, cahier.) 3 Si au cours de l'entreprise les prix subissent une augmentation telle, que la dpense totale des ouvrages restant excuter d'aprs le devis, se trouve augmente d'un sixime, comparativement aux estimations du projet. (Art. 33.) Il y a indemnit dans les deux premiers cas, pas dans le troisime. N 3. De la concession de travaux publics. 494. La concession de travaux publics est un contrat par lequel un entrepreneur s'engage, envers une personne administrative, excuter un travail public, moyennant la concession de l'exercice d'un droit de puissance publique qui est gnralement le droit de lever une taxe. Ce qui caractrise cette concession, c'est donc que la rmunration de l'entrepreneur est obtenue, non pas par le paiement d'une somme d'argent, mais par la concession de l'exercice d'un droit de puissance publique qui sera fructueux entre ses mains. C'est--dire que pour pargner ses finances, la personne administrative bat monnaie avec ses droits de puissance publique. C'est un procd prcieux en ce sens que, sans emprunter directement, la personne administrative peut ainsi associer son uvre des capitaux privs; mais c'est aussi un procd dangereux, car, d'abord, c'est toujours le public qui paye et il paye quelquefois plus que ne l'exigerait la juste rmunration des capitaux engags ; de plus, l'tat aline en partie sa libert d'action.
624
LES DROITSDOMANIAUX DE PUISSANCE PUBLIQUE
Il y a lieu de distinguer deux espces de concessions de travaux publics : 1 la concession de travaux accomplis sur une dpendance du domaine public, o il y a la fois concession d'une taxe et de la possession prcaire de la dpendance du domaine ; 2 la concession de travaux accomplis hors du domaine public, o il y a seulement concession d'une taxe, ainsi que cela arrive en matire de travaux concds aux associations syndicales. a) Concession de travaux publics sur les dp endances du public1. domaine
Tous les cas de 495. I. Des divers cas de concession. concession de travaux publics sur des dpendances du domaine public sont relatifs des voies de communication, chemins de fer, tramways, canaux, ponts, bacs, rampes rectifies sur les routes. 'a t un mode trs employ pour la construction de ces diffrents objets, mais l'avenir il ne le sera plus que pour les voies de communication dont le public ne peut pas faire usage directement, par consquent pour les cheminsde fer, les tramways et les bacs. La plupart , des canaux construits ont t rachets; pour les canaux construire, une loi du 5 aot 1879 a dcid qu'ils ne pourraient tre concds; quant aux ponts page, la loi du 31 juillet 1880 a prpar leur disparition prochaine; elle dcide qu' l'avenir il n'en sera plus construit sur les routes nationales et dpartementales, et sans interdire leur construction sur les chemins vicinaux, elle la dcourage en statuant ; en mme que l'tat ne fournira pas de subvention pour le rachat temps, elle facilite le rachat des ponts dj construits par une srie de mesures. Jusqu' la cration du rseau des chemins a) Chemins de fer. de fer de l'tat par la loi du 18 mai 1878, tous les chemins de fer d'intrt gnral avaient t concds pour l'exploitation des compagnies ; en dehors du rseau de l'tat, ils le sont encore. Mais depuis 1823, poque o les premiers essais furent faits, jusqu' nos jours, bien des combinaisons varies furent employes, bien des conventions furent passes entre l'tat et les compagnies. Tantt les compagnies ont construit en entier, tantt l'tat a construit en partie. Nous ne pouvons pas entrer dans l'examen de ces conventions, qui d'ailleurs prsentent surtout un intrt financier. Les dernires en date ont t approuves par une loi du 20 novembre 1883. En dehors des chemins de fer d'intrt gnral, il y a des chemins 1. Bibliographie : Picard, Lescheminsde fer.
LES TRAVAUX PUBLICS MODES D'ACQURIR.
625
de fer d'intrt local, qui appartiennent aux dpartements ou aux communes. A toute poque, une voie ferre peut tre distraite par une loi du rseau local et incorpore au rseau d'intrt gnral. Ces chemins de fer sont rgis actuellement par la loi du 11 juin 18801. Il y a d'abord dclaration d'utilit publique par une loi; puis ils doivent tre concds ; la concession est faite, au nom du'dpartement par le conseil gnral, au nom de la commune par le conseil munici; quant aux ressources appliques pal, avec approbation du prfet la construction, elles sont de nature varie ; un dtail intressant est que les communes peuvent appliquer la construction de chemins de fer locaux, les ressources de la vicinalit. (Art. 12.) b) Tramways. Les tramways tant tablis sur des routes dj construites, il va de soi que la concession doit tre faite par la personne administrative qui a la route dans son domaine public ; il s'ensuit des complications. Dans un rseau urbain, en effet, il y a des voies qui sont nationales, d'autres qui sont dpartementales, d'autres qui sont communales; on ne pouvait pourtant pas admettre que le concessionnaire eut affaire la fois l'tat, au dpartement et la commune. La loi du 11 juin 1880 a permis de trancher la difficult : l'tat et le dpartement feront la concession sur leurs voies au profit de la commune, et celle-ci rtrocdera cette concession au concessionnaire, en mme temps qu'elle fera la concession sur ses ; le concessionnaire n'aura ainsi de rapports qu'avec propres voies la commune. Si l'tat ou le dpartement voulaient constituer un rseau de tramways national ou dpartemental, il interviendrait des arrangements en sens inverse. c) Bacs et passages d'eau. Le privilge de concder les bacs tait primitivement, en vertu de souvenirs historiques, un droit rgalien rserv l'tat. Dans la loi du 10 aot 1871, art. 46, n 13, l'tat a abandonn son privilge au profit du dpartement pour les routes et chemins la charge des dpartements , cela s'entend des routes dpartementales et des chemins vicinaux de grande communication. Mais il n'a rien abandonn au profit des communes. De sorte que c'est l'Etat qui concde les bacs sur les chemins vicinaux ordinaires. (V. 1. 14 floral an XI.) La forme de 496. II. Formes de la concession. l'adjudication n'est pas impose pour la concession de travaux publics, elle n'est mme pas usite, les travaux concds tant en gnral trs 1. Cette loi, qui ne protge pas suffisammentles finances dpartementales, va tre remanie. H. 40
626
LES DROITS DOMANIAUX DE PUISSANCE PUBLIQUE
importants il ne pourrait se prsenter qu'un petit nombre de concurrents. La concession se fait donc par trait de gr gr. D'ailleurs au trait, qui renferme les clauses et conditions de l'opration, se joint un acte de puissance publique qui confre, proprement parler, au concessionnaire la possession de la dpendance du domaine public et le droit de percevoir la taxe. Cet acte de puissance publique fait corps avec le contrat et se prsente sous forme d'approbation du contrat. Loi ou dcret, suivant l'importance des travaux, pour les concessions faites par l'tat (L. 27 juill. 1870.); dcision du conseil gnral pour les concessions dpartementales (I. 10 aot 1871, art. 46, n 11); dcision du conseil municipal, sauf approbation, pour les concessions communales. (L. 5 avr. 1884, art. 115.) Toute concession de 497. III. Effets de la concession. travaux publics faite sur une dpendance du domaine public est essentiellement temporaire, elle ne saurait dpasser quatre-vingt-dixneuf ans. Elle est de plus essentiellement rachetable. Bien qu'elle renferme un acte de puissance publique, en soi c'est un contrat bilatral et, par suite, une source de droits et d'obligations pour les deux parties contractantes. 1 Droits du concessionnaire. Le concessionnaire a des droits de trois espces: a) Un droit sur la dpendance du domaine public dont il entreprend l'exploitation; ce droit. qui n'est qu'une possession prcaire et qui n'entrane point de vritable droit rel, a t tudi propos du domaine public. (V. p. 534.) b) Des droits contre la personne administrative concdante; ce sont en gnral des droits relatifs au concours financier qui a t promis pour la construction de l'ouvrage, et puis des garanties stipules en cas de rachat. Nous savons que toute concession sur le domaine public est rvocable; mais ici, comme des capitaux privs sont engags dans l'entreprise, des stipulations transforment la rvocation en rachat. Il est stipul d'abord que la rvocation ne pourra pas avoir lieu avant un certain nombre d'annes, en gnral quinze ans pour les concessions de chemin de fer, et mme aprs ce dlai, la rvocation ne pourra avoir lieu que moyennant une indemnit dont les bases sont tablies d'avance. c) Des droits vis--vis des tiers; le concessionnaire exerce, au lieu et place de la personne administrative concdante, un certain nombre de droits de puissance publique qui produisent leur effet vis--vis des tiers; d'abord il exproprie pour construire l'ouvrage, ensuite, une
LES TRAVAUX PUBLICS MODES D'ACQURIR.
627
fois l'ouvrage fait, il exerce pour sa conservation la police du domaine public. De plus, comme concessionnaire d'une taxe publique, il peroit sur le public un page. Il ne faut pas s'y tromper, en effet, le prix pay pour un transport en chemin de fer, en tramway, etc., reprsente bien pour partie le prix d'un service rendu, tel que ce prix pourrait tre dbattu dans des relations purement commerciales, mais pour partie aussi il reprsente une taxe publique, parce que par le fait de la concession, il a t constitu un monopole au profit du concessionnaire. Ce caractre de taxe publique que revtent les prix de transport donne naissance la question des tarifs. On comprend que l'tat intervienne dans leur fixation. Il intervient en effet par l'homologation. Cela est particulirement intressant pour les tarifs de chemin defer et surtout pour les tarifs de marchandises. Le pouvoir d'homologation est reconnu au ministre des travaux publics par l'O. 15 novembre 1846, art. 44. Ce pouvoir ne donne pas l'tat le droit d'imposer directement tel ou tel tarif, mais il empche les compagnies de faire sans approbation une modification quelconque, ft-ce un abaissement de tarif; et par consquent permet d'engager des ngociations avec elles. Ce caractre de l'homologation entranant la perception d'une taxe publique, fait que nous avons d ranger les tarifs homologus parmi les rglements. (V. p. 62.) 2 Obligations du concessionnaire; leur sanction. Les obligations du concessionnaire sont relatives l'excution des travaux et l'entretien des ouvrages ; elles sont consignes dans le cahier des charges spcial la concession. (V. cependant cahier des charges typepour les chemins de fer d'intrt local, 1. 11 juin 1880, art. 2). Il y a aussi des obligations en vue de la mobilisation de l'arme pour les compagnies de chemins de fer. Ce qu'il y a de plus intressan, ce sont les moyens de sanction qui sont la disposition de l'administration et qui sont: la saisie des revenus pour les employer l'entretien des ouvrages si le concessionnaire le nglige; le squestre qui ressemble la mise en rgie du march par entreprise; la dchance si le concessionnaire ne commence pas les travaux dans le dlai fix, ou s'il n'excute pas le cahier des charges, ou bien comme consquence du squestre, si dans les trois mois le concessionnaire n'est pas en mesure de reprendre l'exploitation. 3 Contrle de l'tat. L'tat exerce un contrle incessant, surtout en matire de chemins de fer, au point de vue de la bonne excution des travaux et de la conservation des ouvrages, au point de vue de la
628
LES DROITSDOMANIAUX DE PUISSANCE PUBLIQUE
scurit des voyageurs, au point de vue de l'exacte application des tarifs, au point de vue militaire, etc. b) Concessions de travaux publics hors des dpendances du domaine public. Associations syndicales autorises.
498. Il est des travaux d'intrt collectif qu'il est urgent d'accomplir, qui profiteront toute une contre, comme le desschement d'un marais, l'endiguement d'une rivire; mais les terrains sur lesquels ces travaux doivent tre excuts n'appartiennent pas l'tat, ils appartiennent des particuliers; d'ailleurs ils sont parfois tellement tendus qu'il serait impossible l'tat de les acqurir. Cependant ces travaux ne peuvent tre excuts que par une action collective, parce qu'il faut qu'ils portent la fois sur tout le primtre des terrains amliorer. Par quels procds raliser cette action collective? comment l'tat peut-il agir sur des terrains qui ne sont pas lui? Il existe trois procds qui tous reposent sur cette ide fondamentale, que ce sont les : 1 l'aspropritaires eux-mmes qui doivent accomplir les travaux sosiation syndicale force de tous les propritaires, organise par contrainte administrative; 2 l'association syndicale autorise de tous les propritaires, qui suppose libre initiative chez une certaine majorit de ces propritaires, mais contrainte administrative pour la minorit; 3 l'association syndicale libre de tous les propritaires. Historiquement, c'est l'association syndicale force qui est le procd le plus ancien, et il ne faut point s'en tonner avec les habitudes de centralisation du commencement du sicle; ces associations remon: c'est tent la loi du 14 floral an XI et celle du 16 septembre 1807 seulement dans la loi du 21 juin 1865 qu'apparaissent simultanment les associations syndicales autorises et les associations syndicales libres. Les associations syndicales autorises, qui constituent un type moyen, avec mlange de l'intervention gouvernementale et de l'initiative prive, semblent actuellement les mieux appropries notre tat social ; nous les tudierons en premire ligne et avec plus de dtails. L'assoautorises. 499.I. Associations syndicales ciation syndicale autoriseest un tablissement public constitu par un syndicat de propritaires form avec intervention de l'adminis-
LES TRAVAUX PUBLICS MODES D'ACQURIR.
629
tration et auquel un travail d'intrt collectif est concd titre de travail public. a) Les associations syndicales autorises sont des tablissements C'est un point qui a t longtemps contest ; et, en effet, publics. rien ne ressemble moins au premier abord un organe de l'tat, que cette association de propritaires qui vont accomplir des travaux dans leur propre intrt. Cependant le caractre d'tablissement public est certain; non pas parce que des droits de puissance publique sont concds ces associations, comme le droit d'expropriation, le droit de lever des taxes, nous savons que cela ne suffirait pas (v. p. 231); mais parce que ce qui anime l'association, ce n'est pas, malgr les apparences, l'esprit priv, mais bien l'esprit de l'tat. Cela rsulte de ce fait que l'association n'est pas compltement volontaire et contractuelle; une fois que la majorit des propritaires s'est prononce, l'administration contraint la minorit. Or, les associations purement prives sont toutes contractuelles, ce qui procde de la contrainte en pareille matire, ne peut qu'avoir un caractre public. Cette opinion est d'ailleurs gnralement admise aujourd'hui, si bien mme qu'on rapproche par analogie nos associations des communes, et qu'on les appelle des communes spciales 1. En effet, elles ont comme les communes un territoire, et sur ce territoire sont des propritaires dont les intrts sont communs. Remarquons que par cet artifice de la cration d'un tablissement public, l'tat s'installe au milieu des terrains, car si des parcelles sont acquises pour la construction d'ouvrages, digues ou canaux, elles appartiendront l'association syndicale membre de l'tat. Elles ne seront pas dpendances du domaine public, nanmoins, parce que les tablissements publics n'ont pas de domaine public. b) Travaux qui peuvent tre concds (1. 21 juin 1865. 1. 22 dc. 1888). Peuvent tre l'objet d'une concession, et par consquent peuvent motiver la formation d'une association syndicale entre propritaires intresss, l'excution et l'entretien des travaux: 1 De dfense contre la mer, les fleuves, les torrents et rivires navigables ou non navigables. 2 De curage, approfondissement, redressement et rgularisation des canaux et cours d'eau non navigables ni flottables et des canaux de desschement et d'irrigation. 3 De desschement des marais. 4 Des tiers (canaux d'amene de l'eau de mer dans les marais salants et ouvrages ncessaires l'exploitation des marais salants. 1. Le triomphe de cette ide est surtout d M. Aucoc. (Confrencesadministratives.)
630
DE PUISSANCE LES DROITS DOMANIAUX PUBLIQUE
5 D'assainissement des terres humides et insalubres. 6 D'assainissement dans les villes et faubourgs, bourgs, villages et hameaux. 7 D'ouverture, d'largissement, de prolongement et de pavage devoies publiques et de toute autre amlioration ayant un caractre d'intrt public dans lesvilles et faubourgs, bourgs, villageset hameaux. 8 D'irrigation et de colmatage. 9 De drainage. i0 De chemin d'exploitation et de toute autre amlioration agricole d'intrt collectif. Enfin la loi du 15 dcembre 1888 ajoute les travaux de dfense contre les vignes phylloxres, la loi du 4 avril 1882, les travaux de dfense des terrains en montagne. Cette numration des travaux d'intrt collectif qui peuvent tre concds est limitative notre avis. La concession entrane en effet, pour les propritaires du primtre, des charges qui sont de droit troit. Mais la loi de 1888 a employ des expressions si larges que la question ne se posera gure. Elle numre d'abord un certain nombre de travaux qui sont de dfense, au point de vue de la scurit ou de la salubrit. Mais ensuite elle prvoit les travaux de simple amlioration, et cela, soit dans les agglomrations bties (n 7), soit dans les champs (n 10). Observons cependant: 1 que dans le cas de ces simples amliorations, la concession n'aura lieu qu' la suite d'une dclaration d'utilit publique par dcret en Conseil d'tat, de sorte qu'en dernire analyse, c'est le gouvernement lui-mme qui interprtera la loi (art. 3, 1. 22 dc. 1888) ; 2 qu'il faut que ces travaux soient de nature apporter une plus-value aux proprits. (Art. 1er.) c) Constitution des associationsautorises. Les propritaires intresss peuvent tre runis, par arrt prfectoral, en association syndicale autorise, soit surla demande d'un ou de plusieurs d'entre eux, soit sur l'initiative du prfet ou du maire. (Art. 9.) Le prfet soumet une enqute administrative dont les formes seront dtermines par un rglement d'administration publique, les plans, avantprojets et devis des travaux, ainsi que le projet d'association. Le plan indique le primtre des terrains intresss et est accompagn de l'tat des propritaires de chaque parcelle. Le projet d'association spcifie le but de l'entreprise et dtermine les voies et moyens ncessaires pour subvenir la dpense. (Art. 10.) des Aprs l'enqute, les propritaires qui sont prsums devoir profiter travaux sont convoqus en assemble gnrale parle prfet, qui en nomme le prsident, sans tre tenu de le choisir parmi les membres de l'assem-
LES TRAVAUX PUBLICS MODES D'ACQURIR.
631
ble. Un procs-verbal constate la prsence des intresss et le rsultat de la dlibration. Il est sign par les membres prsents et mentionne l'adhsion de ceux qui ne savent pas signer. L'acte contenant le consentement par crit de ceux qui l'ont envoy en cette forme, est mentionn dans ce procs-verbal et y reste annex. Le procs-verbal est transmis au prfet. (Art. 11.) En principe, si la majorit des intresss, reprsentant au moins les deux tiers de la superficie des terrains, ou les deux tiers des intresss, reprsentantplus de la moiti de la superficie, ont donn leur adhsion, le prfet autorise, s'il y a lieu, l'association. Mais pour les travaux des nos 6 10, il faut les trois quarts des intresss reprsentant plus des deux tiers de la superficie et payant plus des deux tiers de l'impt foncier, ou bien les deux tiers des intresss reprsentant plus des trois quarts de la superficie et payant plus des trois quarts de l'impt. Le prfet prend ensuite son arrt. Pour les nos 7, 8, 9 et 10 : il doit tre prcd d'une dclaration d'utilit publique des travaux par dcret en Conseil d'tat. Un extrait de l'acte d'association et l'arrt du prfet, en cas d'autorisation, et, en cas de refus, l'arrt du prfet, sont affichs dans les communes de la situation des lieux et insrs dans le recueil des actes de la prfecture. (Art. 12.) L'arrt du prfet emporte la concession. Les propritaires intresss et les tiers peuvent dfrer cet arrt au ministre des travaux publics dans le dlai d'un mois partir de l'affiche. Le recours est dpos la prfecture et transmis, avec le dossier, au ministre dans le dlai de quinze jours. Il est statu par un dcret rendu en Conseil d'tat. (Art. 13.) S'il s'agit des travaux spcifis aux nos3 10 de l'art. 1er, les propritaires qui n'auront pas adhr au projet d'association pourront, dans le dlai d'un mois ci-dessus dtermin, dclarer la prfecture qu'ils entendent dlaisser, moyennant indemnit, les terrains leur appartenant et compris dans le primtre. Il leur sera donn rcpiss de la dclaration. L'indemnit la charge de l'association sera fixe conformment l'art. 16 de la loi du 21 mai 1836, pour les nos4, 5, 8, 9, 10, et conformment a loi de 1841 pour 6 et 7. (Art. 14.) Les biens des incapables peuvent tre dlaisss avec autorisation du tribunal. d) Administration des socits syndicales autorises. Les associations syndicales autorises sont des tablissements publics dous de trois organes : 1 L'assemble gnrale, qui nomme les syndics et laquelle on soumet les questions graves, comme celle d'un emprunt. 2 Le syndicat, organe la fois dlibrant et excutif, organe essentiel. 3 Le directeur, qui prside le syndicat et qui reprsente l'association en justice, mais qui a peu de pouvoirs. Pour la constitution de ces trois organes, quelques rgles sont poses par les art. 20 24 de la loi, mais il subsiste de graves lacunes qui sont combles en pratique parles statuts des associations, et comme l'autorit administrative a un pouvoir discr-
632
LES DROITSDOMANIAUX DE PUISSANCE PUBLIQUE
tionnaire en matire d'autorisation, elle est matresse d'imposer certaines clauses ncessaires et dont la plupart sont nonces dans des formules toutes prpares. Enfin un dcret du 7 avril 1886 a tranch un certain nombre de questions. A raison de l'analogie que nous avons signale entre les associations syndicales et les communes, on a puis dans la loi municipale des rgles relatives la convocation des membres du syndicat, au nombre des membres ncessaires pour les dlibrations, la formation de la majorit, etc. Le syndicat prend des dcisions pour les quatre ordres de faits suivants : 1Le personnel; 2 Les travaux; 3 Les finances (sauf approbation des emprunts par l'assemble gnrale) ; 4 Les procs. Les dcisions du syndicat sont des actes d'administration, et nul doute, lorsqu'ils sont dfinitifs, qu'ils ne puissent tre attaqus pour excs de pouvoir s'il n'y a pas de recours parallle. Il y a tutelle de l'tat, mais modre. Les projets de travaux doivent tre approuvs dans un certain nombre de cas. Le budget est simplement soumis aux ingnieurs sans approbation prfectorale, mais certaines dpenses peuvent tre inscrites d'office par arrt prfectoral. e) Droits de puissance publique accords aux associations syndicales autorises. Ces droits sont numrs dans les art. 15 19 de la loi du 21 juin 1865:1 les travaux entrepris sont des travaux publics, par consquent les contestations qui seront souleves seront de la comptence des conseils de prfecture ; 2 l'association a le droit d'exproprier; l'utilit publique est dclare par dcret en Conseil d'tat, aprs quoi il est procd l'expropriation par le petit jury, sauf pour les travaux des nos 6 et 7 pour lesquels on suit la procdure de la loi du 3 mai 1841 ; 3 l'association lve des taxes sur les propritaires raison de la plus-value que leurs terrains ont acquise ; ce dernier 1 point mrite quelques dveloppements : Taxes leves sur la plus-value. Plus-value directe. Nous savons dj qu'on appelle plus-value directe, celle qui rsulte de travaux publics lorsque ces travaux ont t entrepris justement pour la produire, 1. Les associations, le cas chant, ont droit aux servitudes d'irrigation et d'coulement des eaux, de la loi du 29 avril 1845et de celledu 10juin 1854; ici les contestations seront de la comptence du juge de paix.
LES TRAVAUX PUBLICS MODES D'ACQURIR.
633
tandis qu'on appelle plus-value indirecte, celle qui rsulte accessoirement de travaux dont le but principal n'tait point de la produire. (V. n 478.) En matire de travaux entrepris par association syndicale autorise, on se trouve forcment en prsence de plus-values directes. Il tait naturel de chercher des ressources l'entreprise dans ces plus-values et de les frapper d'une taxe annuelle, qui servirait gagerles emprunts que l'association serait oblige de contracter pour l'excution des travaux. La lgislation sur la matire est un peu confuse, parce qu'elle rsulte de plusieurs textes dont quelques-uns incomplets. (L. 14 floral an XI; 1. 16 sept. 1807; 1. 21 juin 18051.) L'ide essentielle est que chaque parcelle de proprit doit contribuer proportionnellement la plus-value. 1 Rigoureusement, pour dterminer la plus-value, il faudrait deux estimations de chaque parcelle, l'une avant les travaux, l'autre aprs. Cette procdure est en effet de rigueur en matire de desschement de marais, parce qu'elle est prvue in terminis par la loi de 1807 ; mais pour les autres hypothses, la jurisprudence admet que la plusvalue peut tre dtermine par une seule estimation faite avant le commencement des travaux. C'est qu'en effet, attendre dterminer la plus-value aprs l'achvement des travaux, c'est dire que les taxes ne pourront pas tre leves avant cet achvement ; or, les capitaux engags ne peuvent pas attendre aussi longtemps leur rmunration. L'estimation est faite par des commissions spciales composes administrativement de sept membres, aux termes de l'art. 43,1. 1807 ; des recours sont possibles et sont ports devant le conseil de prfecture (art. 26, 1. 21 juin 1865) ; la loi de 1865 a modifi en ce point celle de 1807, car primitivement les commissions spciales taient elles-mmes juges des recours. Il est admis dans la pratique administrative que par leurs statuts les associations peuvent attribuer le droit d'estimation leur propre syndicat, ce qui est une simplification. 2 La taxe est tablie sous forme de rente payable en argent sur le pied de 4 0/0 de la plus-value; d'autres modes de libration sont prvus en matire de desschement de marais par la loi de1807, mais n'ont pas t tendus aux autres travaux. Le recouvrement se fait comme en matire de contribution directe. 1. Avant la loi gnrale du 21 juin 1865,la loi du 16 septembre 1807,qui prvoyait le cas spcial du desschement des marais, avait en notre matire une importance qu'elle a un peu perdue.
634
LES DROITSDOMANIAUX DE PUISSANCE PUBLIQUE
Les asso400. II. Associations forces. syndicales ciations syndicales forces ne peuvent tre tablies que pour les travaux des nos 1, 2, 3 : travaux de dfense contre les eaux, de curage, de desschement des marais ; pour leur constitution, il faut se reporter aux lois du 14 floral an XI et du 16 septembre 1807, elles sont formes par dcret en Conseild'tat. Bien entendu et fortiori ce sont des tablissements publics. Pour la dtermination de la plusvalue et la taxe, il faut appliquer les dispositions que nous venons d'indiquer, savoir que la loi de 1807 a t modifieparcelle de 1865, en ce qui concerne la substitution du conseil de prfecture aux commissions spciales pour le jugement des recours. Ces asso401. III. Associations libres. syndicales ciations diffrent profondment des deux catgories prcdentes, en ce qu'elles sont purement prives, mais elles ont reu de la loi de 1865 la personnalit morale; ce sont donc des personnes morales prives. Il suit de l qu'elles ne peuvent tre formes que du consentement unanime de tous les intresss, que les travaux qu'elles accomplissent n'ont point le caractre de travaux publics, qu'elles n'ont ni le droit d'exproprier, ni celui de lever des taxes ; mais elles peuvent ester en justice par leurs syndics, acqurir, vendre, emprunter, hypothquer, etc. La loi du 22 dcembre 1888 statue que l'tat, les dpartements, les communes peuvent entrer dans ces associations libres, de sorte qu'on peut voir des personnes morales publiques faire partie d'une association prive. L'association se forme sans l'intervention de l'administration, mais il y a des formalits de dclaration l'administration et de publicit. (Art. 5 7, l. 1865.) Il ne faut pas confondre ces associations avec les syndicats professionnels; le critrium, c'est qu'il y a des travaux accomplir et des propritaires intresss ces travaux. No 4. Souscriptions volontaires et offres de concours.
402. La personne administrative qui fait excuter un travail public, reoit assez frquemment des offres de concours venant, soit de particuliers, soit d'autres personnes administratives. Ces offres de concours constituent des contrats sui generis, ds que l'offre est accepte, celui qui l'a faite est li et ne peut plus la retirer. Ce qu'il y a de particulier, c'est que toutes les contestations auxquelles peuvent donner lieu les offres de concours, fixation du chiffre
PUBLICS MODES LES TRAVAUX D'ACQURIR.
635
de la subvention, question de savoir si les conditions imposes l'administration ont t remplies, questions relatives au recouvrement, tout cela est de la comptence du conseil de prfecture. Cette solution a t admise par le Conseil d'tat d'abord, par une jurisprudence qui remonte 1840; puis, aprs quelques rsistances, par la Cour de cassation (20 avr. 1870, D. P. 1871. 1, 41), enfin par le tribunal des conflits (16 mai 1874). La raison est simplement que ces conventions sont intimement lies l'opration de travaux publics. La comptence du conseil de prfecture s'tend mme au cas o l'offre de concours consiste, non pas dans le paiement d'une somme d'argent, mais dans l'abandon gratuit d'un terrain sur lequel l'ouvrage sera difi; ainsi l'a dcid le tribunal des conflits (27 mai 1876, de Chargre). Toutefois le tribunal des conflits fait une distinction afin quele contentieux des travaux publics n'empite pas sur ce qui est du domaine lgitime de l'expropriation: si l'offre gratuite du terrain est postrieure la dclaration d'utilit publique du travail, c'est une cession amiable, par consquent un incident de la procdure d'expropriation rserv la comptence judiciaire; si elle est antrieure la dclaration d'utilit publique et destine amener l'administration entreprendre le travail, c'est une offre de concours. Cette jurisprudence est accepte par le Conseil d'tat. (Guillaumin, 30juil. 1887; Veil, 11 janv. 1890.) Les offres de concours des particuliers peuvent tre individuelles ou collectives, alors elles se prsentent sous forme de listes de souscription. Les offres de concours des personnes administratives se prsentent, soit sous la forme de subventions en argent, soit sous la forme de garanties d'intrt des capitaux engags dans l'entreprise, soit sous la forme d'avances remboursables. L'tat emploie frquemment cette dernire forme de concours pour venir en aide aux dpartements et aux communes : elle consiste en ce que l'tat facilite les emprunts, en chargeant soit des caisses spciales, soit la Caisse des dpts et consignations, de prter des conditions trs douces. C'est ainsi que la caisse des chemins vicinaux et la caisse des coles ont t cres, l'une pour faire des avances en vue de la construction des chemins, l'autre pour faire des avances en vue de la construction des maisons d'cole.
636
LES DROITSDOMANIAUX DE PUISSANCE PUBLIQUE Appendice aux travaux publics.
Les concessions de mines. Lgislation 1. 27 avr. 1838; 1. 27 juill, 1880.)
des mines. (L. 21 avr.1810;
503.I. Dfinition de la mine et du gisement minier. Il importe de ne pas confondre la mine avec le gisement minier. Gisement minier est une expression purement gologique qui indique un amas de minerai dans une rgion du sol. Les gisements peuvent tre immenses, tmoin les bassins houillers. Mine est une expression juridique qui indique que tout ou partie du gisement minier est considre comme objet de proprit, et forme un domaine. En effet, une mine est un domaine cr dans un gisement minier. Si bien que, dans un mme gisement, il peut y avoir quantit de mines. Ce domaine est cr par un acte de puissance publique, par une concession faite au nom de l'tat. Reste savoir quels sont les gisements miniers l'intrieur desquels il peut tre ainsi cr des mines. La loi est intervenue pour les dterminer. La loi du 21 avril 1810, fondamentale en la matire, distingue les gisements miniers, les minires et les carrires. L'exploitation deces trois sortes de gisements est soumise des condition diffrentes: Les gisements miniers ne peuvent tre exploits qu'en vertu d'une concession. Les minires en vertu d'une permission. (V.art. 57 et s.) Les carrires en vertu d'une simple dclaration au maire. (Art. 81.) Ces trois espces de gisements se distinguent au point de vue lgal, uniquement d'aprs la nature des matires qu'ils contiennent et qui sont indiques par la loi elle-mme. Il ne faut s'attacher aucun autre fait ; ainsi il ne faudrait pas s'attacher au fait que l'exploitation serait souterraine ou ciel ouvert. Une carrire peut tre exploite par galeries souterraines, cette particularit n'en fait point une mine, elle entrane seulement surveillance spciale de l'administration. Le gisement minier est un gisement des matires numres dans l'art. 2 de la loi du 21 avril 1810; ce sont ceux connus pour con tenir en filons, en couches ou en amas, de l'or, de l'argent, du pla tine, du mercure, du cuivre, del'tain, du zinc, de la calamine, du bismuth, du cobalt, de l'arsenic, du manganse, de l'antimoine, du molybdne, de la plombagine ou autres matires mtalliques, du soufre, du charbon de terre ou de pierre, du bois fossile, des bitumes, de l'alun, des sulfates base mtallique. D'ailleurs le
LES TRAVAUX PUBLICS MODES D'ACQUERIR.
637
Conseil d'tat estime que cette numration pourrait tre complte par dcret en forme de rglement d'administration publique. (Ar. 24 fvr. 1872.) A plus forte raison peut-elle l'tre par une loi. V. 1. du 17 juin 1840 qui a ajout les mines de sel et les sources d'eau sale. La minireest un gisement des matires numres dans l'art. 3, minerais de fer dits d'alluvion, terres pyriteuses renfermant du sulfate de fer, terres alumineuses et tourbes. La carrire (art. 4) est un gisement d'ardoises, grs, pierres btir, marbres, pierres pltres, terre poterie, etc. Le gisement minier est gnralement souterrain, il se trouve dans le trfonds du sol. Le trfonds du sol s'oppose la surface ou superficie, c'est une expression qui a t cre justement l'occasion des mines. du gisement minier et 504. II. Condition juridique de la mine. Cette question est clbre ; elle a donn lieu bien des discussions, faute d'avoir fait la distinction ncessaire entre le gisement minier et la mine. A. Condition juridique du gisement minier. Quelle est la condition juridique du gisement minier avant qu'aucune mine n'ait t cre en lui ? Trois opinions peuvent tre soutenues: a) Le gisement appartient aux propritaires de la surface; b) Il appartient l'tat; c) Il n'appartient personne, c'est une res nullius tant qu'il n'a pas t dcouvert, mais par occupation il devient la proprit de celui qui le dcouvre, d'o la consquence : la mine l'inventeur. De ces trois opinions, c'est la premire qui nous parait la plus conforme l'ensemble de la lgislation et aux textes spciaux, bien que la thorie de la loi de 1810 soit un peu indcise: 1 L'art. 552 C. civ. dit que la proprit du sol emporte celle du dessus et du dessous et en cela il est conforme la tradition romaine; il est vrai que la fin de l'article prvoit des restrictions provenant des rglements miniers, mais nous allons voir que cela vise une expropriation possible. 2 La loi de 1810 donne au propritaire du sol, une fois la mine concde, un droit de redevance immobilier susceptible d'hypothque ; c'est bien la reprsentation du droit que ce propritaire avait sur le trfonds. B. Condition juridique de la mine. Caractre de la concession. Le syslme organis par la loi du 21 avril 1810 et dvelopp par
638
DE PUISSANCE LES DROITSDOMANIAUX PUBLIQUE
la loi du 27 juillet 1880 peut tre formul dans les propositions suivantes: 1 Un domaine est cr au du sein gisement minier et prend le nom de mine. Cette cration d'un domaine particulier a lieu mme quand la mine est concde au propritaire de la surface. Ce domaine est un immeuble, et, sauf exception, le droit de proprit dont il est l'objet prsente tous les caractres de la proprit prive ordinaire. 2 Ce domaine est cr par l'tat au dtriment des propritaires du gisement minier qui sont en mme temps les propritaires de la surface, grce une expropriation. Cette expropriation est produite, d'ailleurs, en dehors des formes ordinaires par le dcret mme qui cela est si vrai que, aux termes de l'art. 17, ce concde la mine ; dcret purge tous les droits du propritaire de la surface. A titre d'indemnit, le propritaire de la surface reoit une redevance annuelle qui prsente un caractre immobilier. 3 La mine ainsi cre est concde, et cette concession prsente beaucoup d'analogie avec la concession de travaux publics. Cela ne ressemble pas la concession de travaux publics accomplir sur une dpendance du domaine public, car la mine n'est pas dans le domaine public de l'tat, ell e n'est mme pas dans son domaine priv ; mais cela ressemble la concession de travaux publics accomplis hors du domaine public, et par consquent la concession faite aux associations syndicales. Il faut en effet s'habituer cette ide que des travaux publics peuvent tre accomplis hors du domaine. Il est vrai que la concession se prsente sous l'apparence, non pas d'une concession de travaux publics, mais sous celle d'une concession de proprit ; mais le droit de proprit, qui est perptuel, est considr ici uniquement comme le moyen juridique permettant au concessionnaire d'accomplir un travail qui lui aussi de sa nature est perptuel. L'lment fondamental, c'est le travail accomplir. Cette interprtation de l'opration de la concession de mines est la plus conforme la ralit des choses. L'extraction des minerais, notamment celle de la houille, apparat de plus en plus comme une il est naturel que l'tat intervienne pour en ncessit publique; assurer la continuit; qu'on le veuille ou non, ds lors, l'opration devient plus ou moins publique; il y a tout avantage l'analyser en une simple concession de travaux publics, car autrement on serait conduit tt ou tard l'expliquer par la domanialit des mines et il parat fort inutile d'augmenter de ce nouvel lment le domaine de l'tat. C'est aussi le systme d'interprtation qui donne le sens le plus satisfaisant aux dispositions diverses de la loi. La thorie de la loi
PUBLICS MODES LES TRAVAUX D'ACQURIR.
639
de 1810 et de celles qui ont suivi est videmment indcise et flottante; mais voici des dispositions capitales qui s'expliquent trs bien par l'ide de la concession de travaux publics: 1 Ce qui montre bien que la concession de la proprit de la mine n'est au fond que la concession d'un travail public, c'est qu'il peut y avoir retrait de la concession s'il y a cessation de l'exploitation. Et ce retrait produit les mmes consquences que la dchance prononce contre le concessionnaire de travaux publics ordinaires. (L. 1810, art. 49;1. 1838, art. 6 et 10.) 2 De plus, la loi de 1810, remanie par celle du 27 juillet 1880, accorde au concessionnaire, au dtriment des propritaires de la superficie, un droit d'occupation temporaire assimil celui qui existe en matire de travaux de voirie et dont l'exercice ncessite un arrt du prfet, et mme, en certain cas, le droit d'expropriation. (Art. 43-44.) En revanche, il manque un des caractres importants de la concession de travaux publics : le contentieux auquel donne lieu l'exploitation des mines n'est point de la comptence du conseil de prfecture, mme pour l'occupation temporaire, il est dela comptence des tribunaux civils. Cependant, il faut remarquer que, en ce qui concerne l'occupation temporaire, la loi de 1810 attribuait comptence au conseil de prfecture, c'est la revision de 1880 qui a apport ici une modification ; que, de plus, il y a encore comptence du conseil de prfecture en quelques cas particuliers, par exemple en cas de difficults entre le concessionnaire et l'inventeur pour le remboursement des frais faits par celui-ci. (Art. 46.) 505. III. Lgislation des mines. A. Recherchedugisement minier. Il faut, avant tout, que l'existence des gisements miniers soit constate. Dans un intrt public la recherche en est facilite et encourage. D'abord le propritaire de la surface est libre de chercher dans son propre terrain, moins que des concessions n'y aient t dj faites. De plus, des tiers peuvent chercher soit avec le consentement du propritaire, soit avec un permis du gouvernement ; dans ce dernier cas, le permis est dlivr parle chef de l'tat. (0.19 aot 1832.) Le propritaire est entendu dans ses observations par le prfet, l'adminislration des mines est consulte, il doit y avoir paiement d'une indemnit pralable au propritaire, et il y a des restrictions au droit de recherche dans le voisinage des habitations (art. 11). Le permis ne dure en gnral que deux ans; l'acte de permission fixe le primtre. V. art. 43 modifi par la loi du 27 juillet 1880, pour les droits d'occupation du permissionnaire et la fixation de l'indemnit. La juridiction comptente en matire de contestation sur l'indemnit est le tribunal
640
DOMANIAUX DE PUISSANCE LES DROITS PUBLIQUE
civil. L'acte de permission est certainement attaquable par recours pour excs de pouvoir. A titre de rmunration, l'inventeur recevra une indemnit du concessionnaire dfinitif. B. Concessionde la mine. La mine ne peut tre exploite que si elle est concde par dcret en Conseil d'tat. Cette concession, dont nous avons vu plus haut les effets, qui purge les droits du propritaire de la surface et de l'inventeur, et par consquent produit une sorte d'expropriation, est prcde de toute une procdure: a) Demande faite au prfet, simple ptition, dont il est dlivr rcpiss et qui est enregistre sur un registre spcial. Le prfet ordonne dans les dix jours publication et affichage. b) Affichage pendant deux mois aux chefs-lieux du dpartement et de l'arrondissement o la mine est situe, dans toutes les communes sur lesquelles le primtre de la concession peut s'tendre, et dans la commune o est domicili le demandeur. Insertion deux reprises dans les journaux du dpartement et dans le Journal officiel. (Art. 23 modifi, loi 1880.) c) Demandes en opposition et en concurrence : l'une s'opposant simplement la demande, l'autre en contenant une rivale. Notifies la prfecture par acte extrajudiciaire avant l'expiration du dlai de deux mois, elles doivent tre inscrites sur le registre. Elles peuvent aussi tre formes aprs l'expiration de ce dlai, directement devant le ministre de l'intrieur ou devant le Conseil d'tat par requte, comme pour une affaire contentieuse. (Art. 28.) d) Rapport du prfet aprs avoir pris l'avis de l'ingnieur des mines. e) Dcision par dcret en Conseil d'tat. Le dcret de concession, tant un acte de puissance publique, est certainement inattaquable par recours contentieux ordinaire, mais rien n'empche le recours pour excs de pouvoir. (V. C. d'tat, 28mars 1879; Conflits, 28 fvr. 1880.) C. Obligations du concessionnaire. Le concessionnaire doit l'inventeur : 1 une indemnit pour rachat du droit de celui-ci sur la mine, cette indemnit est fixe d'une faon discrtionnaire par le dcret de concession; 2 le remboursement de ses dpenses ; en cas de contestation, comptence du conseil de prfecture. (Art. 46.) : 1 une redevance annuelle (art. 6 Il doit au propritaire de la surface et 42 modifis par 1. 1880); 2 des indemnits pour dommages dans le cas d'occupation de la surface. (V. art. 43 et 44 modifis par 1. 1880.) Il doit l'tat une redevance annuelle-quifigure au budget sous le nom de redevance des mines et qui est perue comme une contribution foncire; elle se compose d'un droit fixe de 10 francs par kilomlre carr et d'un droit proportionnel sur les produits fix annuellement par la loi de finances et qui ne doit pas dpasser 5 0/0 du produit net. Il doit concourir des travaux de dfense commune, lorsqu'un mme flau, par exemple l'inondation souterraine, menace plusieurs concessions
DE L'TAT LES MARCHS DE FOURNITURES
641
lui et que l'administration prescrit les mesures que la loi du 27 avril 1838 permet d'ordonner. Il doit subir la surveillance constante de l'administration, et depuis la loi du 8 juillet 1890 celle des dlgus mineurs exerce dans l'intrt de la production et dans celui de la scurit. (Art. 47 50, 1. 1810.) Enfin il ne doit ni restreindre ni suspendre l'exploitation sous peine de s'exposer au retrait dela concession. (L. 1810, art. 49 ; 1. 27 avril 1838 art. 10.) DEFOURNITURES DE L'TAT 4. LESMARCHS Les marchsde l'tat et des colonies sont seuls des oprations de puissance publique et par consquent des contrats administratifs ; ceux des dpartements, des communes, des tablissements publics sont des oprations de personne prive. Ils se passent, il est vrai, avec adjudication et cahier des charges, mais dans ces cahiers aucun droit exorbitant n'est stipul et la comptence est judiciaire. Nous nous occuperons ici uniquement des marchs de l'tat. On comprend, sous la 506. Dfinition et caractres. dnomination gnrale de marchs de fournitures, les contrats qui ont pour but de procurer l'tat, en vue d'un service public, des matires, des denres, des transports ou une main-d'uvre ; par consquent des contrats qui s'analysent en une vente, ou bien qui, lorsqu'ils s'analysent en un louage d'ouvrage, n'ont pas pour objet la cration d'un immeuble. C'est l ce qui les distingue du march de travaux publics. (V. p. 603 et s.; D. du 11 juin 1806, art. 13.) Il faut qu'il y ait contrat spcial avec cahier des charges. Un achat au comptant n'est pas un march de fournitures. Un transport excut par une compagnie de chemin de fer ou de paquebot, lorsque l'administration a us du moyen de transport dans les mmes conditions que le public, n'est pas un march de fournitures. Caractre de puissance publique. Le march de fournitures au profit de l'tat a un caractre dcid d'opration de puissance publique, surtout les marchs passs pour la guerre et la marine ; cela se traduit par des droits exorbitants au profit de l'administration et par la comptence d'un tribunal administratif, le Conseil d'tat. Encore le Conseil d'tat, saisi des recours du fournisseur, doit-il se renfermer dans un contentieux purement pcuniaire, c'est--dire qu'il ne doit pas en principe annuler les dcisions prises par l'administration, ou bien, l'inverse, prononcer la rsiliation au profit du fournisseur ; tout cela pourrait gner l'action administrative; il doit seulement accorder des indemnits au fournisseur. Il y a l une ncessit publique H. 41
642
DE PUISSANCE LES DROITS DOMANIAUX PUBLIQUE
il faut que certains marchs soient excuts rapidement; l'inverse, il faut que l'administration puisse rompre rapidement certains marchs. Il suit de l que le march de fournitures est un contrat spcial qui a ses rgles lui; qu'il doit s'inspirer des rgles gnrales des contrats, mais qu'il ne faut point lui tendre par analogie les rgles des contrats spciaux du Code civil ou du Code de commerce qui prsenteraient avec lui quelque parent. C'est d'ailleurs la rgle que nous avons pose pour tous les contrats administratifs. (V. p. 422.) Les marchs de fournitures 507. Rgles des marchs. sont soumis pour leur formation aux mmes rgles que les marchs de travaux publics, c'est--dire au principe de l'adjudication au rabais, sauf exception. (V. p. 617.) Obligations des fournisseurs. Ces obligations sont nonces dans des cahiers de clauses et conditions gnrales et dans des cahiers des charges spciaux. Ce qui est intressant, ce sont les sanctions. La sanction la plus importante est ce qu'on appelle le march par dfaut; elle correspond la mise en rgie dans les marchs de travaux publics. Si l'entrepreneur nglige de remplir ses engagements, l'administration, aprs une mise en demeure, peut faire excuter le march par un autre fournisseur aux risques et prils du premier. Le fournisseur vinc pourra recourir au Conseil d'tat, pour obtenir une indemnit, s'il tablit qu'il n'y a aucun retard lui reprocher. Une seconde sanction consiste dans la rsiliation du march prononce par l'administration, galement aprs une mise en demeure; la rsiliation est naturellement sans indemnit. Quelquefois des amendes en cas de retard sont stipules. Enfin, des sanctions pnales sont dictes notamment contre les fournisseurs des armes de terre et de mer qui, en temps de guerre, ont manqu le service, hors le cas de force majeure. (C. pn., art. 430 et suiv.) Rsiliation facultative pour l'administration. L'administration a toujours la facult de rsilier les marchs passs par elle, lorsque les besoins publics ont cess d'exister. Dans ce cas, la rsiliation ne peut tre prononce que moyennant indemnit. Pendant longtemps le Conseil d'tat a admis que l'indemnit devait comprendre le remboursement des impenses, mais non la privation du bnfice. On disait que l'entrepreneur, en passant le march, avait d prvoir le cas o les besoins du service public viendraient cesser. Cette jurisprudence est aujourd'hui abandonne. Liquidation des marchs. On distingue deux sortes de liquidations: 1 la liquidation provisoire qui est faite par un subordonn
DEL'TAT A LADETTE CONTRATS RELATIFS PUBLIQUE
643
du ministre, et qui sert pour la dlivrance d'acomptes; 2 la liquidation dfinitive qui ne peut tre arrte que par le ministre luimme. Cette seconde liquidation est un acte de gestion qui dtermine le montant de la dette de l'tat. Si le fournisseur en conteste l'exactitude, il doit se pourvoir devant le Conseil d'tat dans le dlai de trois mois compter de la notification. A LA DETTE DE L'TAT RELATIFS PUBLIQUE 5. CONTRATS 508. Tous les contrats relatifs la dette publique de l'tat, comme les emprunts, comme les cautionnements fournis par les fonctionnaires, qui sont un des lments de la dette parce que l'tat doit les rembourser, constituent des oprations de puissance publique; par consquent toutes les difficults souleves par ces oprations sont de la comptence de la juridiction administrative. Cette attribution de comptence s'appuie surla loi du 17 juillet 1790 et sur celle du 26 septembre 1793, c'est--dire sur les textes qui tablissent le principe gnral que toutes les crances sur l'tat sont rgles administrativement. Il tait naturel d'appliquer rigoureusement ce principe la dette publique, raison de son importance. Les dcisions du ministre des finances, qui en elles-mmes sont des actes de gestion, sont susceptibles de recours au Conseil d'tat. Cela s'applique aux contestations souleves pour l'mission et la rpartition des renies mises par souscription publique, la dlivrance deslitres, le paiement des arrrages, le remboursement des titres amortis, les transferts, mme quand ils sont oprs en vertu de conventions entre particuliers, ou quand un jugement du tribunal civil a statu sur l'attribution d'une rente, les oprations de conversion. Cela s'applique encore aux contestations souleves par les oprations de trsorerie, les missions de bons du trsor, et mme les traites que peut fournir le caissier payeur central du trsor, malgr que le dcret du 11 janvier 1808 assimile dans une certaine mesure ces traites des lettres de change. Enfin cela s'applique la restitution des cautionnements en argent fournis par les fonctionnaires. Observation. Les oprations relatives la dette des autres personnes administratives, par exemple les emprunts des dpartements, communes, etc., n'ont plus du tout le mme caractre et sont des oprations de personne prive.
TITRE
II
LES DROITS DE PERSONNE PRIVE
CHAPITRE CARACTRES
PRLIMINAIRE
GNRAUX DES DROITS DE PERSONNE PRIVE
Les droits de et subdivision. 509. I. Dfinition personne prive sont les droits des personnes admnistratives qui ne leur donnent pas de prrogatives exorbitantes du droit commun. Ce sont par consquent des droits semblables ceux qu'ont les particuliers dans leur patrimoine; ils n'entranent, ni pour les personnes, ni pour la proprit, de charges exceptionnelles. Premire observation. Il est bien entendu que les droits de personne prive peuvent servir, aussi bien que les droits de puissance publique, assurer le fonctionnement des services publics. Tous les droits des personnes administratives, directement ou indirectement, servent assurer le fonctionnement des services, mme le domaine priv qui constitue une sorte de rserve, et dont les revenus sont verss au budget. Lesdroits de puissance publique existent seulement dans des cas o il y a une ncessit particulirement urgente l'accomplissement du service. Les marchs de fournitures passs parles dpartements et les communes, les emprunts contracts par ces personnes administratives, servent certainement assurer leurs services, et cependant ce sont des oprations de personne prive. Deuxime observation. Il faut bien se garderde confondre le droit de personne prive, avec l'acte d'administration par lequel il est exerc. C'est qu'en effet, mme les droits de personne prive peuvent tre exercs par des actes de puissance publique. Ainsi une commune fait un bail de maison; c'est certainement une opration de personne
DESDROITS DE PERSONNE PRIVE GNRAUX CARACTRES
645
prive et l'exercice d'un droit de personne prive, les contestations, si l'excution du contrat en soulve, seront de la comptence des tribunaux ordinaires; mais la dlibration du conseil municipal qui contient la dcision de passer le bail est un acte d'autorit, et en tant que cette dlibration sera considre en elle-mme, elle pourra tre attaque par la voie du recours pour excs de pouvoir, tout comme si elle tait intervenue pour l'exercice d'un droit de puissance publique 1. Subdivision des droits de personne prive. Ces droits sont tous domaniaux; il n'y a point parmi eux de droit de police, moins qu'on ne veuille considrer comme tant un droit de police de personne prive, le pouvoir disciplinaire exerc dans les internats des lyces et collges, ce qui serait assez raisonnable, car l'tat n'est l que le reprsentant des pres de famille et ne doit par consquent exercer qu'un pouvoir familial. Les droits domaniaux de personne prive se divisent en deux grandes catgories: 1 Le domaine priv, qui n'est autre chose que le droit de proprit prive appartenant aux personnes administratives; 2 Les modes d'acqurir de personne prive, c'est--dire les modes d'acqurir qui ne supposent point la puissance publique. 510. II. Conflit entre les droits de personne pri Comme les droits de ve et les droits des particuliers. personne prive n'entranent aucune charge exceptionnelle ni pour les personnes, ni pour la proprit, ils n'entrent point en conflit avec les droits des particuliers. Il n'y a donc point se demander, comme il fallait le faire pour les droits de puissance publique, comment on rtablira l'galit entre l'administration et les citoyens, s'il n'y aura pas rgler des indemnits peur dommages, etc. Ici, il n'y a point de dommage rparer, il n'y a point rtablir l'galit parce qu'elle n'est pas rompue, administration et particuliers sont sur le mme pied et usent des mmes droits. III. Des rgles de droit applicables aux droits Nous avons vu que pour les droits de de personne prive. puissance publique il fallait appliquer des rgles spciales, qui ne se rattachent au reste du droit, que parce qu'elles s'inspirent des prin511. 1 Toutefois, lorsque le contrat aura t pass, la dlibrationdu conseil municipal y sera incorpore et les tribunaux judiciaires seront comptents pour l'interprter. (Conflits,12 juillet 1890,ville de Paris.)
646
LESDROITS DE PERSONNE PRIVE
cipes constitutionnels et des principes les plus gnraux des contrats. Pour les droits de personne prive, au contraire, il faut appliquer en principe, et sauf exception, les rgles du droit commun, soit du droit civil, soit du droit commercial; non seulement les rgles gnrales des contrats, mais les rgles spciales de chaque contrat; si l'on se trouve en prsence d'un bail de maison, par exemple, appliquer les rgles des baux; si l'on se trouve en prsence d'un march de travaux non publics, appliquer les rgles des art. 1787 et suiv. La prescription s'applique aux droits de personne prive dans les termes du droit commun, art. 2227, C. c. Les personnes administratives peuvent librement transiger sur ces droits, sauf les formalits spciales qui peuvent tre incorpores. De plus, en principe et sauf exception, les contestations qui s'lvent la suite de l'exercice des droits de personne prive, sont de la comptence des tribunaux ordinaires.
CHAPITRE
PREMIER
LE DOMAINE PRIV
512. Le domaine priv, dans le langage courant, dsigne le droit de proprit prive en tant qu'il appartient aux personnes administratives. Les choses sur lesquelles porte ce droit de proprit mritent le nom de dpendances du domaine priv. A la diffrence des dpendances du domaine public, les dpendances du domaine priv sont alinables et prescriptibles. Il subsiste cependant une diffrence entre elles et les biens des particuliers; elles sont insaisissables. Cela tient au principe gnral d'aprs lequel les engagements des personnes administratives, quels qu'ils soient, ne sont pas susceptibles d'excution force. (V. p. 545.) Toutes les personnes administratives ont un domaine priv, notamment les tablissements publics qui n'ont pas de domaine public, mais qui ont un domaine priv. On dit les biens des hospices, les biens des fabriques, les biens des sections de commune, comme on dit les biens des communes ou des dpartements. Observation. Bien que d'aprs le langage courant, le domaine priv ne comprenne que le droit de proprit prive, en ralit on y trouve aussi d'autres droits rels, tels que l'usufruit, l'usage, les servitudes, les privilges et les hypothques; nous nous occuperons de ces droits dans un appendice. PRIVDEL'TAT 1er. LE DOMAINE 513. Il n'y a actuellement qu'un seul domaine priv de l'tat, et toutes les dpendances de ce domaine forment, au point de vue juridique, une seule masse. On distinguait avant la Rvolution un grand et un petit domaine; depuis la Rvolution, il y a eu un domaineextraordinaire, produit de la conqute, servant notamment constituer des majorats; un domaine de la couronne ou des biens de la liste civile. Toutes ces distinctions du domaine et tous ces domaines particuliers sont aujourd'hui
648
LES DROITSDOMANIAUX DE PERSONNE PRIVE
abolis. Les dpendances du domaine priv de l'tat comprennent : des immeubles, comme les forts nationales, les lais et relais de la mer, lesfortifications des places de guerre dclasses, certaines sources minrales, salines, mines, etc. certains domaines; des meubles comme le mobilier des btiments affects aux services publics, comme le matriel de guerre, supposer que ces objets ne soient pas plutt des dpendances du domaine public (v. p. 495) ; enfin on y range souvent certains droits incorporels tels que le droit de chasse dans les fortsnationales et le droit de pche sur les fleuves, supposer qu'il y ait intrt sparer ces droits du droit de proprit. 514. Alinabilit et prescriptibilit du domaine. Toutes les dpendances du domaine priv sont alinables et prescriptibles; alinables, parce que les textes anciens qui les mettaient horsdu commeice sont abrogs; prescriptibles, parce que l'art. 2227 C. civ. soumet l'tat et les autres personnes administratives, aux mmes prescriptions que les particuliers. Sous l'ancien rgime, en vertu d'un principe qui remontetrs haut, et qui avait t consacr pour la dernire fois dans l'dit de Moulins de fvrier 1566, tous les biens du domaine de la couronne taient inalinables, sauf ce qu'on appelait le petit domaine, lais et relais de la mer, landes, marais, terres vagues. Le domaine de la couronne comprenait alors justement ce que nous appelons aujourd'hui le domaine priv. La loi du 22 novembre 1790 supprima le principe de l'inalinabilit, qui d'ailleurs avait toujours t fort mal respect par les rois. Ainsi qu'il est dit fort justement dans le prambule de cette loi, l'inalinabilit du domaine se comprenait lorsque ce domaine tait cens appartenir non pas la nation, mais au roi, chef de la nation; il y avait lieu de prendre des prcautions contre le roi; mais maintenant que la nation tait rentre en possession de son domaine et qu'elle tait matresse de ses destines, rien ne justifiait plus ce principe. La nation doit tre matresse d'aliner son domaine, et on est certain qu'elle ne l'alinera pas la lgre. L'inalinabilit des dpendances du domaine public se justifie parce qu'en fait, l'affectation l'utilit publique de ces choses les met hors du commerce; l'inalinabilit des dpendancesdu domaine priv serait sans motif. Cependant la loi de 1790 laissa subsister l'inalinabilit pour les grandes masses de forts, mais cette dernire exception fut elle-mme abolie par la loi du 25 mars 1817 qui affecta les forts de l'tat la dotation de la caisse d'amortissement. Par consquent, l'heure actuelle, les forts sont alinables et prescriptibles (Cass. 27 juin 1854,
LE DOMAINE PRIV
649
il faut une loi pour autoriser l'alination, S. 55.1. 497). Seulement de mme que pour autoriser l'alination des immeubles de plus d'un million (1. 1er juin 1864, art. 1er) 1. Bien qu'alinables et prescriptibles, les dpendances du domaine priv sont insaisissables. C'est le prfet qui passe les du domaine. 515. Gestion actes juridiques relatifs au domaine priv de l'tat, mais la gestion proprement dite, c'est--dire la direction conomique, appartient, soit l'administration de l'enregistrement, des domaines et du timbre sous l'autorit du ministre des finances, soit l'administration des forts qui dpend du ministre de l'agriculture; deplus, les biens affects un service public, que l'administration persiste considrer comme dpendances du domaine priv, et que nous avons considrs, nous, comme dpendances du domaine public, sont grs comme s'ils taient en effet dpendances du domaine public, c'est--dire sous l'autorit du ministre au service duquel ils sont affects. Les forts sont administres en rgie, et il y a tout un corps de rgles importantes que l'on appelle le rgime forestier. Les autres biens de l'tat, s'ils ne sont alins ou concds, ou affects un service public, doivent en principe tre afferms. (V. infr, n 535.) PRIVDU DPARTEMENT 2. LEDOMAINE 516. Nous ne le faisons gure figurer que pour ordre et pour mmoire, il est trs peu important; il est alinable, prescriptible et insaisissable; il est administr par le conseil gnral et le prfet. PRIVDELACOMMUNE 3. LE DOMAINE 517. Le domainepriv de la commune est plus important que celui du dpartement; cependant, pour ceux qui, comme nous, pensent que les btiments affects un service public sont des dpendances du domaine public, le domaine priv se trouve diminu d'autant. 1. Quelques auteurs voient dans cette ncessit d'une loi pour autoriser l'aliination,la preuve que les forts et les domaines de plus d'un million sont rests en principe inalinables et imprescriptibles, et ils en font un grand domaine qu'ils opposent au petit domaine qui seul serait alinable et prescriptible; ils ressuscitent ainsi l'ancienne distinction. Ils ne voient pas que la loi qui intervient ici n'est qu'un acte d'administration, analogue la loi qui dcide un emprunt ; que c'est la dcisionpar laquelle l'tat aline tel ou tel bien, et non point une loi qui le rend alinable.
650
LES DROITSDOMANIAUX DE PERSONNE PRIVE
Ce domaine est alinable, prescriptible et insaisissable; il est administr par le conseil municipal et par le maire; en principe, comme pour les biens de l'tat, les biens qui ne sont pas affects un service public doivent tre afferms. Les bois des communes, lorsqu'ils sont susceptibles d'tre amnags, sont soumis au rgime forestier. Il y a dans le domaine priv de la commune une catgorie de biens particulirement intressante, ce sont les biens communaux. Lesbiens communaux ont 518. Des biens communaux. une origine incertaine; ils peuvent tre un vestige de la coproprit de village et nous venir du droit germanique ; ils peuvent aussi nous venir, sinon de la lgislation romaine, tout au moins des traditions des grands propritaires fonciers romains, qui, dans leurs grands domaines cultivs par manses, laissaient certains terrains vagues communs entre les divers tenanciers. Ce qui est certain, c'est qu'ils reprsentent, ainsi qu'on va le voir, une forme de jouissance communiste. Trs considrables avant la Rvolution, ils ont t fortement diminus par les partages qu'on a laiss faire. On a beaucoup vant ces partages qui ont donn beaucoup de terres la culture. On s'aperoit que la culture a ses dceptions, et que dans les mauvaises aujourd'hui a nnes, il est bon que des bois ou des terres incultes soient la disposition des ncessiteux, pour leur fournir certaines ressources de premire importance. Les biens communaux sont affects l'usage des habitants ut singuli d'une ou de plusieurs communes,d'une ou de plusieurs sections de commune, d'un ou de plusieurs hameaux. Ils sont la proprit de la commune ou de la section de commune1. a) Condition juridique des biens communaux. Ils sont la proprit des communes et sections de commune, mais ils sont affects l'usage des habitants ut singuli des communes, sectionsde commune ou hameaux. Ce n'est pas un vritable droit d'usage, d'ailleurs, qu'ont les habitants, du moins il n'empche pas la commune ou la section de commune d'aliner son communal. 1 Les biens communaux sont alinables et prescriptibles. 2 Ils peuvent tre partags entre communes et sections de commune copropritaires. (L. 10 juin 1793.) 3 Ils ne peuvent pas tre l'objet d'un partage de proprit entre les habitants. Ce mode d'alination minemment dangereux est actuellement interdit. 1. L'art. 542 C. civ. donne des biens communaux une dfinition incorrecte, car elle supposerait que les habitants de la communeont un droit la proprit de ces biens, ce qui n'est pas.
LE DOMAINE PRIV
651
Il y a eu de ces partages sicle on avait dj fortement : au XVIIIe commenc; on partageait alors par feux. La loi du 14 aot 1792 ordonna le partage des terrains communaux, l'exception des bois. Enfin la clbre loi du 10 juin 1793 rendit le partage facultatif, mais il suffisait qu'il ft vot par le tiers des habitants de tout sexe; il avait lieu gratuitement et par tte; c'tait la spoliation des gnrations futures; on l'a appele une loi agraire. Trois ans aprs, la loi du 21 prairial, an IV venait suspendre la loi de 1793, puis la loi du 9 ventse an XII valida tous les partages excuts et fit remise aux communes de ce qui restait. Depuis lors, pas de doute, le partage est interdit. (AvisC. d't. 16 mars 1838.) 4 Il peut y avoir partage provisionnel d'usage entre les habitants. Ce partage est fait par le conseil municipal. b) numration des communaux. Doivent tre rangs parmi les biens communaux: 1 Les pturages communs et les forts affouagres dont les communauts rurales taient propritaires la date dela loi du28 aot 1792 2 Les forts affouagres en possession desquelles elles ont pu rentrer en vertu de l'art 1er de ladite loi. 3 Les terres vaines et vagues, dont les communauts avaient l'usage conjointement avec le seigneur, la mme date, ou dont elles ont pris possession dans les cinq ans, moins que ledit seigneur ou ses ayants cause ne puissent montrer un titre lgitime d'acquisition non entach de fodalit, ou justifier d'une prescription de droit commun. (L. 28 aot 1792, art. 1er et art. 9, et l. 10juin 1793, art. 1er.) 4 Le droit la rcolte du varech ou gomon de rive. 5 L'usage appartenant aux communes dans les forts de l'tat. (C. for. 61 85.) PRIVDESCOLONIES 4. LE DOMAINE 519. Le domaine priv des colonies comprend peu prs les mmes biens que celui de l'tat ; il a t constitu par les ordonnances du 26 janvier 1825 et du 17 aot 1826. Il est plac dans les attributions du directeur de l'intrieur et administr par le service du domaine. Les rgles d'alinabilit sont fixes par les dcrets constitutifs de chaque colonie. PRIVDESTABLISSEMENTS PUBLICS 5. LE DOMAINE 520 Le domaine priv des tablissements publics ne mrite au-
652
LES DROITSDOMANIAUX DE PERSONNE PRIVE
cune mention particulire; il est alinable et prescriptible, mais insaisissable, sa composition et son mode d'administration sont analogues ceux des biens du dpartement et des biens des communes. Lorsque les bois possds par des tablissements publics, notamment par des hospices, sont susceptibles d'tre amnags, ils sont soumis au rgime forestier. Appendice au domaine priv. Droits d'usufruit servitudes, privilges et hypothques. et d'usage,
521. Les personnes administratives, outre le droit de proprit prive, peuvent avoir galement titre priv d'autres droits rels. Les droits de servitudes ne mritent aucune observation. Les droits d'usufruit et d'usage soulvent la question de savoir si l'art. 619 C. civ. est applicable. Cet article statue que l'usufruit qui n'est pas accord aux particuliers ne dure que trente ans. Il ne faut tendre cette disposition aux droits d'usage appartenant aux personnes administratives qu'avec les plus grandes prcautions. Beaucoup de droits d'usage sont perptuels. Sans parler de la disposition de l'art. 643 C. civ. relative l'usage de l'eau d'une source acquis aux habitants d'un hameau, les droits d'usage des communes dans les forts de l'tat sont perptuels, sauf le droit de cantonnement (art. 61 85, C. for.) ; et beaucoup de droits d'usage sur des halles, ou champs de foire appartenant avant la Rvolution aux seigneurs, et dont les ayants-cause ont conserv la proprit, sont perptuels. (V. l. 28 mars 1790, t. II, art. 19, et 1. 20 aot 1790, c. III, art. 2.) Les privilges et hypothques mritent quelques dveloppements : I. Des privilges du trsor. 1 Letrsor jouit, vis--visdes comptables pour le paiement de leur dbet : a) d'un privilge gnral sur tous les biens meubles; b) d'un privilge spcial sur les immeubles acquispar eux postrieurement leur nomination. Ces privilges sont rglements par la loi du 5 septembre 1807. (Art. 2098. C. civ.) Ces privilges frappent les biens des percepteurs, la diffrence de l'hypothque lgale de l'art. 2121 C. c. (Trib. civ. Chambry, 25juill. 1889.) 2 Le trsorjouit vis--vis des condamns, pour le remboursement des frais dont la condamnation est prononce son profit, en matire criminelle, correctionnelle ou de simple police, d'un privilge qui frappe la gnralit des meubles et des immeubles des condamns. 11est rglement par une seconde loi du 5 septembre 1807. Ce privi-
LESPRIVILGES ET HYPOTHQUES
653
lge n'existe que pour les frais, non pour les amendes pour lesquelles il n'y a qu'une hypothque judiciaire. 3 Le Irsor jouit des privilges suivants en matire d'impts: a) En matire de contribution foncire, un privilge spcial sur les rcoltes, fruits, loyers et revenus des immeubles sujets la contribution; pour les autres contributions directes, un privilge gnral sur tous les meubles des contribuables. Ces deux privilges sont restreints ce qui est d pour l'anne chue et pour l'anne courante. (L. 12 nov. 1808, art. 1er. ) b) Au profit de la rgie des douanes, pour le recouvrement des droits dus, un privilge sur la gnralit des meubles et des effets mobiliers des redevables. (L. 6 aot 1791, titre XIII,art. 22; 4 germinal an II, VI, 4; loi de finances du 28 avril 1816. art. 58.) c) Au profit de la rgie de l'enregistrement pour le paiement des droits de mutation par dcs sur les revenus des biens dclarer. (L. 22 frimaire an VII, art. 32.) d) Au profit de la rgie des contributions indirectes pour le recouvrement des droits qui lui sont dus, un privilge sur tous les meubles et effets mobiliers des redevables. Il s'tend au mobilier des cautions. (Dcret du 1er germinal an XIII, art. 47.) Les personnes admiII. Des hypothques conventionnelles. nistratives, dans les contrats qu'elles passent, peuvent stipuler des hypothques conventionnelles. Ces hypothques sont rgies par le droit commun, sauf qu'elles peuvent tre stipules dans le contrat pass en la forme administrative par drogation l'art. 2127 C. civ. (Art. 14, titre II, 1. 28 oct. 1790 sur l'administration des biens nationaux,) III. De l'hypothque judiciaire. Les personnes administratives jouissent du bnfice de l'hypothque judiciaire rsultant soit des jugements des tribunaux ordinaires, soit des dcisions des juridictions administratives statuant au contentieux. Les contraintes dcernes par les autorits administratives dans les cas et pour les matires de leur comptence, sont assimiles ce point de vue des jugements de condamnation et emportent l'hypothque judiciaire au profit de l'tat. (Avis C. d't. des 16-25 thermidor an XII.) : un titre excuNous avons vu ce qu'est la contrainte administrative toire que l'administration se cre elle-mme. D'aprs l'opinion gnralement reue, ce titre entrane hypothque judiciaire, non seulement en matire de dbets, mais aussi en matire d'impts. (V. les textes cits, p. 543.) IV. De l'hypothque lgale. L'tat, les communes, les tablissements publics ont une hypothque lgale sur les biens des receveurs et administrateurs comptables (art. 2121, 3e alina, C. civ.). Elle prend rang au jour du commencement de la gestion, condition d'tre inscrite, car
654
LES DROITSDOMANIAUX DE PERSONNE PRIVE
elle n'est pas dispense d'inscription. Elle s'tend tous les biens prsents et venir des comptables, sauf en ce qui concerne les comptables de l'tat, dont elle ne frappe pas les immeubles acquis titre onreux postrieurement au jour de leur nomination (1. 5 sep. 1807, art. 4, 5, 6). Ces biens sont dj frapps du privilge spcial de la loi de 1807. Il y a question pour les dpartements. Le dcret de 1862 surla comptabilit (art. 29) se borne reproduire l'art.. 2121. Il y a aussi question pour certains tablissements publics dont les administrateurs ne sont pas comptables de derniers publics, notamment les chapitres, les fabriques. Les auteurs spciaux n'admettent pas l'hypothque. Enfin, c'est une question de savoir qui est comptable ; on n'applique l'hypothque qu'aux agents qui sont directement comptables,aux receveurs gnraux et particuliers, mais pas aux simples percepteurs.
CHAPITRE
II PRIVE
LES MODES D'ACQURIR DE PERSONNE
CARACTRES GNRAUXDE CES MODES SECTIONPRLIMINAIRE. D'ACQURIR a) Modes modes 522. I. Des diffrents d'acqurir. civils, modes commerciaux. A un premier point de vue, remarquons que les personnes administratives peuvent user des modes d'acqurir du droit commercial aussi bien que ceux du droit civil; en d'autres termes, elles peuvent pratiquer des contrats commerciaux. Les personnes administratives peuvent en effet faire des actes de commerce, et jusqu' un certain point tre considres comme commerants; nous disons jusqu' un certain point, car, raison du principe qu'il n'y a point d'excution force pour leurs dettes, les personnes administratives chapperaient la principale des consquences du commerant, qui est la mise en faillite. Il est reconnu notamment que l'administration des chemins de fer de l'tat, en exploitant les lignes de son rseau, et en tout ce qui concerne le contrat de transport, doit tre traite comme un commerant. (V. Cass., ch. req. 8juill. 1889.) b) Diffrentes causes d'acquisition. A un second point de vue, remarquons que ces modes d'acqurir se rattachent tous, soit la loi, comme l'attribution des biens sans matre ou la dshrence, soit la donation et au testament, comme les dons et legs, soit aux contrats, quasi-contrats et quasi-dlits. Il ne saurait tre question des dlits, car on ne saurait admettre que les personnes administratives en commettent. 523. II. Des droits et obligations de qui naissent a) Recouvrement des crances. ces modes d'acqurir. Les crances qui rsultent pour les personnes administratives des modes d'acqurir de personne prive, doivent tre recouvres en principe par les moyens ordinaires, c'est--dire que s'il n'y a pas de
656
LESDROITS DOMANIAUX DE PERSONNE PRIVE
titre excutoire, il faut en demander un aux tribunaux. Cependant il faut faire une exception pour les dpartements et pour les communes ; tous les recouvrements pour lesquels d'autres procds ne sont pas indiqus, doivent tre faits au moyen d'tats rendus excutoires par le prfet ou par le maire (art. 64, l. 10 aot 1871 ; art. 154, 1er, l. 5 avr. 1884). Ces textes sont trop gnraux pour qu'on fasse une distinction entre les crances qui proviennent d'oprations de puissance publique et celles qui proviennent d'oprations de personne prive. a) Paiement des dettes. Pour les dettes qui proviennent d'oprations de personne prive, toutes les personnes administratives, y compris l'tat lui-mme, peuvent tre condamnes au paiement par les tribunaux judiciaires. On se rappelle que lorsqu'il s'agit de dettes provenant d'oprations de puissance publique, l'tat, au contraire, ne peut tre dclar dbiteur que par la juridiction administrative ( v. p. 544). Ce privilge n'existe pas ici. En revanche, le privilge de la dchance quinquennale existe au profit de l'tat, aussi bien pour les dettes qui rsultent d'oprations de personne prive que pour celles qui rsultent d'oprations de puissance publique (v. p. 546). Ce privilge existe aussi pour les colonies, mais nous savons qu'il n'existe pas du tout pour les dpartements, les communes et les tablissements publics. Enfin, rappelons que mme lorsqu'elles sont condamnes payer, les personnes administratives ne peuvent pas tre contraintes le faire par les voies d'excution ordinaires; qu'elles ne peuvent l'tre que par l'tat et par des moyens spciaux. (V. p. 545). DE LA LOI. SECTIONIre. MODES D'ACQURIR QUI PROCDENT et sans des biens vacants 1. Attribution 524. Ce mode d'acqurir est particumatre 539 et 713 C. c.). (art. lier l'tat. Pratiquement il s'applique : Aux paves terrestres, choses dposes dans les greffes des tribunaux, dans les lazarets, dans les bureaux de douanes, sommes verses la poste, etc., lorsque ces choses n'ont pas t retires dans un certain dlai. Aux paves fluviales, objets trouvs sur les bords ou dans le lit des cours d'eaux navigables et flottables. Aux paves maritimes, objets provenant de jet, bris ou naufrage, choses du cru de la mer, herbes marines, ambre, corail, poissons lard, lorsque le tout est jet sur la grve. Aux successions vacantes, lorsque l'tat n'a pas voulu les recueil-
LES DONSET LEGS MODES D'ACQURIR.
657
lir par dshrence afin de n'tre pas trait comme successeur titre universel. Enfin, notre avis, aux biens laisss vacants, par la suppression de la personnalit des tablissements publics, des tablissements d'utilit publique, et de toutes les associations dsintresses qui constituent des personnes morales (syndicats professionnels, socits de secours mutuels autorises, etc., etc., v. p. 441). Le droit de dshrence appartient 525. II. Dshrence. l'tat et, dans des hypothses spciales, aux hospices, la caisse des invalides de l marine et la caisse des retraites pour la vieillesse. Le droit de dshrence de l'tat est rgl par les art. 723, 724, 767 772 du Code civil. Le droit de dshrence des hospices est rgl par la loi du 15 pluvise an XIII, art. 8, et l'avis du Conseil d'tat du 14 octobre 1809. Il porte : 1 sur la succession entire des enfants qui dcdent avant leur sortie de l'hospice, leur mancipation ou leur majorit, lorsqu'il ne se prsente aucun hritier pour la recueillir; 2 sur les effets mobiliers, meubles corporels, linges, vtements ou autres objets servant l'usage quotidien apporls par les malades dcds dans les hospices et qui y ont t traits gratuitement, l'exclusion des hritiers; 3 sur les effets mobiliers apports dans l'hospice par les malades payants, lorsque ceux-ci y sont dcds sans hritiers. Le droit de dshrence de la caisse des invalides de la marine est rgl par la loi du 30 avril 1791, art. 4, n 8. Il porte sur les deniers et effets non rclams dpendant de la succession des marins et autres personnes mortes en mer. Le droit de dshrence de la caisse des retraites pour la vieillesse est rgl par la loi du 20 juillet 1886, art. 18. Il porte sur les capitaux rservs dont la caisse et t dbitrice envers les hritiers ou lgataires du crdi-rentier s'ils se fussent prsents dans les trente ans. Pour les effets de la dshrence, renvoi au Code civil. II. LES DONSET LEGS1 SECTION 526. Les personnes administratives peuvent recevoir des donations et des legs, mais en gnral, l'tat intervient et il faut qu'il autorise l'acceptation. La lgislation est la mme pour les tablissements d'utilit publique, bien que ce. soient des tablissements privs. C'est un 1. Bibliographie : R. Tissier, desdons et legs, etc. H.
42
658
DE PERSONNE DOMANIAUX LES DROITS PRIVE
descas o ils sont soumis la tutelle de l'tat. (Art. 910 et 937 C. civ.) L'intervention de l'tat se justifie de diffrentes faons. Quand il s'agit de dons ou legs faits une personne administrative, il y a, d'une part, la proccupation de ne pas dpouiller la famille, d'autre part celle de surveiller les charges ou conditions mises la libralit, qui pourraient tre onreuses pour la personne administrative, ou la dtourner de son but. Quand il s'agit de dons ou legs faits un tablissement d'utilit publique, il y a la proccupation de l'intrt de la famille, et aussi celle de surveiller l'accroissement desbiensde mainmorte. La ncessit de l'autorisation de l'tat n'est pas la seule rgle exceptionnelle que le droit administratif ait introduite dans la matire des dons et legs, nous en rencontrerons quelques autres qui toutes sont plus souples que les rgles du droit civil; ainsi en est-il de la rgle qui permet aux tablissements de recevoir avant d'avoir la personnalit; de celle qui permet l'acceptation d'une donation aprs la mort du donateur; de celle qui autorise l'acceptation partielle d'un legs. En principe, malgr tout, il faut partir des rgles du droit civil, tant sur le fonds que sur la forme des libralits. a) Des 527. De la jouissance du droit de recevoir. tablissements dont l'existence n'est pas encore reconnue. Rigoureusement les tablissements qui, tout en ayant une existence de fait, n'ont pas encore la personnalit, ne devraient pas pouvoir recevoir; cependant la jurisprudence actuelle du Conseil d'tat les admet recevoir, leur appliquant par analogie l'art. 906 C. civ. qui admet l'enfant simplement conu; seulement, il faut : 1 que l'tablissement ait la personnalit au moment de l'acceptation; 2que les hritiers du testateur ou donateur ne se refusent pas l'excution. Les dcrets d'autorisation portent la mention que: l'tablissement est autoris accepter la libralit rsultant pour lui, tantdu testament ou de la donation que du consentement donn par les hritiers son excution. Il n'y a pas l une libralit nouvelle de la part des hritiers, mais une renonciation consentie par eux invoquer une exception existant leur profit. Pendant longtemps la jurisprudence du Conseil d'tat avait t diffrente; elle reposait sur un avis du 18 avril 1834, qui refusait l'autorisation, mme lorsque l'auteur de la libralit avait spcifi que la libralit tait subordonne la reconnaissance postrieure de l'tablissement. Dornavant les discussions ne seront plus possibles, car la loi municipale du 5 avr. 1884, art. 111, a consacr le principe nouveau au profit des hameaux qui ne sont pas encore rigs
LES DONSET LEGS MODES D'ACQURIR.
659
en sections de communes et qui, par suite, n'ont pas encore la personnalit. Les congrgations relib) Restrictions au droit de recevoir. gieuses reconnues ne peuvent recevoir que des legs titre particulier; elles ne peuvent recevoir d'un de leurs membres par donation entrevifs ou par testament que le quart des biens de celui-ci, moins que le don ou legs n'excde pas la valeur de 10,000 francs (1. 24 mai 1825, art. 4 et 5) ; elles ne peuvent recevoir de donations faites avec rserve d'usufruit au profit du donateur. (0. 14 janvier 1831, art. 4.) Les Petites Surs des pauvres ne peuvent possder ni rentes ni immeubles autres que ceux affects au logement des surs. (Statuts.) Les Socits de secours mutuels approuves ne peuvent possder d'immeubles. (Dc. 26 mars 1852, art. 8.) c) Restrictions rsultant de la spcialit des tablissements publics. Nous savons que les tablissements publics ont chacun leur spcialit; ils sont chargs d'un service dtermin, et un principe suprieur d'ordre exige qu'ils ne sortent pas de leur mission, sous prtexte que la condition d'une libralit qu'ils ont reue le leur imposerait. Ils ne doivent donc pas pouvoir recevoir les libralits, lorsque les conditions imposes les feraient sortir de leur spcialit. Ce principe a toujours t admis, mais il y a quelque difficult prciser la spcialit de certains tablissements publics. Il y a eu de nombreuses variations de jurisprudence relativement aux fabriques, curesetmensespiscopales, notammentpour la question de savoir si elles ne peuvent pas recevoir de legs pour les pauvres ou pour fonder des tablissements d'instruction. La spcialit des fabriques est de subvenir aux besoins du culte, mais il y a des traditions: autrefois les aumnes se distribuaient par l'glise et l'enseignement aussi. Jusqu'en 1873 on admit le systme de l'acceptation conjointe: l'tablissement gratifi recevait la libralit conjointement avec celui dont la spcialit tait d'en faire l'emploi. Ainsi dans l'hypothse d'un legs fait une fabrique charge d'aumnes, on adjoignait le bureau de bienfaisance la fabrique. Ce systme entranait beaucoup de complications parce qu'on ne savait qui tait la proprit. Des avis des 6 mars et 25 juillet 1873 autorisrent l'acceptation par la fabrique seule et cependant laissrent un certain droit de surveillance au bureau de bienfaisance. Enfin, partir de 1881, nouveau revirement, cette fois dans le sens de la svrit: refus complet d'autorisation, mme pas d'acceptation conjointe. (Av. 13juill. 1881,2 dc. 1881.)
660
DE PERSONNE LES DROITSDOMANIAUX PRIVE
de recevoir 528. De la capacit et de l'autorisation. En principe, les personnes administratives autres que l'lat sont incapables de recevoir sans autorisation. L'tat lui-mme, avant d'accepter, prend l'avis du Conseil d'tat. Mais ce n'est pas une autorisation qu'il demande, c'est une formalit qu'il s'impose. Par exception, le dpartement peut recevoir sans autorisation lorsqu'il n'y a pas de rclamation de la part des familles (1. 10 aot 1871, art. 46, n5). La commune aussi est capable, la double condition qu'il n'y ait pas de rclamation de la famille et pas de charges. (L. 5 avr. 1884, art. 68, n 8.) Les tablissements d'utilit publique sont toujours incapables de recevoir sans autorisation. Il en est de mme des tablissements publics ou d'utilit publique trangers. (Av. Cons. d't. 17 janv. 1823.) En a) Formes de l'autorisation. principe, l'autorisation doit tre donne par dcret rendu aprs avis du Conseil d'tat. Un arrt prfectoral suffit: 1 pour les communes quand il y a des charges, mais pas de rclamation des familles; 2 pour les hospices et bureaux de bienfaisance, lorsqu'il n'y a pas de rclamation; 3 pour les fabriques aprs avis pralable des vques, lorsque les libralits n'excdent pas 1,000 francs et ne sont greves d'autres charges que de l'acquit de fondations pieuses dans les glises paroissiales, et de dispositions au profit des communes, des hospices, des pauvres ou des bureaux de bienfaisance ; 4 toutes les fois que le don ou legs est d'une somme d'argent ou d'effets mobiliers n'excdant pas 300 francs. (O. du 2 avril 1817, art. 1er; D. du 25 mars 1852; loi dpartementale, loi municipale. ) En cas de libralit complexe ou connexe, l'autorisation a toujours lieu par dcret. Il y a libralit complexe lorsque plusieurs libralits des tablissements diffrents sont faites par le mme acte; il y a libralit connexe lorsqu'une libralit un second tablissement est crite comme charge d'une libralit un premier tablissement. En matire de donab) Autorisation d'acceptation partielle. tions, l'autorit administrative se borne autoriser ou ne pas autoriser l'acceptation; en matire de legs, elle peut en outre autoriser une acceptation partielle, la partie retranche faisant retour la succession ; la raisonde la diffrence est que la donation peut tre ritre, le legs ne le peut pas. En cas d'acceptation partielle de legs universel, les dettes sont rduites proportion. c) De l'autorisation d'office. Vis--vis des tablissements publics, l'autorit administrative peut donner une autorisation d'office et impo-
LES DONSET LEGS MODES D'ACQURIR.
661
ser l'acceptation. Vis--vis des autres personnes administratives et des tablissements d'utilit publique elle ne le peut pas1. d) Instruction de l'affaire. Il appartient au prfet de chaque dpartement de diriger l'instruction des affaires ayant pour objet des libralits faites au profit des tablissements publics. Il transmet le dossier l'administration centrale dans les cas o celle-ci doit statuer. Le dossier n'est complet qu'autant qu'il contient: Les dlibrations prises par les conseils administratifs de l'tablissement institu. L'avis duconseil municipal pour les libralits faites aux tablissements appels ventuellement recevoir des subventions. L'avis de l'vque pour les libralits faites aux tablissements ecclsiastiques. Un tat de l'actif et du passif de l'tablissement institu, certifi et vrifi par le prfet. S'il s'agit d'une donation, une expdition de l'acte de donation, le certificat de vie du donateur, une valuation de sa fortune et de celle de ses hritiers prsomptifs. S'il s'agit de dispositions testamentaires, une expdition du testament, le consentement ou l'opposition des hritiers et des lgataires universels ou bien les actes extrajudiciaires par lesquels ils ont t mis en demeure de consentir. Si les hritiers sont inconnus, les pices constatant que la disposition testamentaire a t affiche de huitaine en huitaine et trois reprises conscutives la mairie du domicile du testateur et insre dans le journal judiciaire du dpartement; une valuation des biens lgus et des renseignements sur la situation de fortune des hritiers. Le prfet joint son avis motiv. a) Par qui elle doit tre faite. 529. De l'acceptation. : pour le dpartement par le prfet, L'acceptation doit tre faite, savoir en vertu d'une dcision du conseil gnral ; pour les tablissements publics par les administrateurs, par les trsoriers des fabriques lorsque les donateurs ou testateurs ont dispos en faveur des fabriques ou pour l'entretien des glises et le service divin; par le suprieur des associations religieuses lorsqu'il s'agit de libralits faites au profit 1. On peut soutenir que la rgle a t modifiemme pour les tablissements publics par la loi du 5 avril 1884.En effet, le principe de l'autorisation d'office s'appuyait par argument a fortiori sur l'art. 48, 2 de la loi du 18 juillet 1837,qui autorisait le gouvernement passer outre malgr le refus d'un conseil municipal. Mais d'aprs l'article 112,1 de la loi de 1884,le conseil municipalest matre de refuser, il est simplementappel dlibrer deux fois; ds lors on peut conclure que l'autorisation d'office devenue impossible pour la commune,l'est devenue galement pour les tablissements publics.
662
LES DROITS DOMANIAUX DE PERSONNE PRIVE
de ces associations ; par les maires des communes lorsque les dons ou legs sont faits au profit de la gnralit des habitants, ou pour le soulagement et l'entretien des pauvres de la commune. (0. 2 avr. 1817, art. 3.) Le prfet accepte les libralits faites au profit des pauvres d'un canton, d'un arrondissement ou d'un dpartement. (Jurisprudence. ) b) De l'acceptation provisoire. L'acceptation ne peut avoir lieu en principe que lorsque l'autorisation administrative est intervenue (art. 937 C. civ.). Certaines personnes administratives sont admises faire une acceptation provisoire, et alors l'autorisation administrative. donne postrieurement rtroagit au jour de l'acceptation provisoire. Ce sont : les dpartements (1. 10 aot 1871, art. 53); les communes (1. 5 avr. 1884, art. 113); les hospices et hpitaux (1. 7 aot 1851, art. 11); les bureaux de bienfaisance. (Arr. Cassat. 11 nov. 1866.) Lorsqu'une donation a t faite un tablissement qui ne jouit pas du bnfice de l'acceptation provisoire, et que le donateur est dcd avant l'autorisation administrative, on autorise l'tablissement accepter la libralit rsultant pour lui tant de l'acte de donation entrevifs que du consentement donn par les hritiers son excution. (Cass. 5 mai 1862.) Produit des qutes, collectes, troncs. 530. Appendice. Ces produits sont des dons. Il est certain qu'il ne sont assujettis aucune des formalits des dons et legs. Mais une autre question s'est leve, celle de savoir si les bureaux de bienfaisance, tablissements publics, dont la spcialit est le soulagement de la misre, n'avaient pas un vritable monopole en matire de qute ou collecte pour les pauvres, et si le produit des qutes faites par des tiers, notamment par les curs dans leur glise, ne devait pas tre vers dans la caisse du bureau. Cette prtention tait excessive. Il est bien vrai que les textes reconnaissent au bureau de bienfaisance le droit de faire des qutes ou collectes dans les glises (Arrt 5 prairial an XI; D. 12 sept. 1806; D. 30dc. 1809, art. 75), mais ils ne parlent pas d'un droit exclusif. (Av. Cons. d't. 24 mars 1880.) SECTION III. LES CONTRATS 531. Les contrats que les personnes administratives peuvent passer titre de personne prive sont trs nombreux. Rappelions que les marchs de travaux passs pour le domaine priv sont des contrats du droit civil; qu'il en est de mme des marchs de fournitures passs
LES CONTRATS MODES D'ACQURIR.
663
par les dpartements, les communes, et les tablissements publics, et des emprunts contracts parles mmes personnes. Nous traiterons ici seulement des ventes, des concessions sur le domaine priv et des baux ferme. On remarquera pour tous ces contrats la mme rgle que pour les marchs de travaux publics et les marchs de fournitures, l'emploi de l'adjudication publique, qui est destin assurer la loyaut de la gestion des patrimoines administratifs. Remarquons aussi l'emploi au point de vue de la rdaction des actes, de la forme administrative qui donne au titre la vertu d'un titre excutoire. (V. p. 200.) N 1. Les ventes. a) Ventes d'immeu532 I. Ventes des biens de l'tat. bles. Les ventes d'immeubles appartenant l'tat ont t clbres sous la Rvolution et pendant tout le dbut du sicle, sous le nom de ventes de biens nationaux. Les biens nationaux taient en effet devenus biens de l'tat par la confiscation, et c'est en cette qualit qu'ils taient vendus. Les ventes de biens nationaux sont arrtes depuis longtemps, les rclamations et les procs sans nombre auxquels elles avaient donn lieu sont aujourd'hui tombs dans l'oubli; les ventes de biens de l'tat ne sont plus une opration politique, mais une opration d'administration courante, et par consquent une opration prive. Mais la lgislation n'a pas encore t mise en harmonie avec ce nouvel tat de choses. En l'an VIII, le contentieux des domaines nationaux avait t plac dans la comptence des conseils de prfecture. Cette attribution avait t ds le dbut considre comme exceptionnelle et restreinte l'alination des biens ; elle subsiste encore, alors qu'elle devrait avoir disparu. Autorits qui dcident la vente. D'une lgislation assez complique, il rsulte qu'il faut faire deux catgories de biens: 1 Ceux dont l'alination doit tre dcide par une loi, immeubles de plus d'un million (1. Ier juin 1864) et forts nationales. (L. 22 nov. 1er dc.1790, art. 8.) 2 Ceux dont l'alination doit tre dcide par dcret ; ce sont tous les autres immeubles (1. 15 et 16 floral an X) et parmi eux il convient de citer les lais et relais de la mer, les atterrissements des fleuves, les terrains retranchs de la voie publique par suite d'alignement. (L. 16 sept. 1807, art. 41 et 53.) Rgles de la vente, Le prfet est charg de procder la vente, mais l'administration des domaines doit intervenir l'acte.
664
LES DROITSDOMANIAUX DE PERSONNE PRIVE
La vente, sauf exception prvue par des textes, doit tre faite aux enchres avec publicit et concurrence sur une mise prix fixe par expert. Au point de vue de l'excution de la vente, l'tat a deux droits intresssants : d'abord la crance peut tre recouvre par contrainte (v. p. 544); de plus si, dans la quinzaine de la signification de la contrainte, le prix n'est pas pay, l'acqureur encourt la dchance qui n'est autre chose que la rsolution de la vente prononce par l'administration elle-mme; elle est prononce par le prfet, sauf recours au ministre et au Conseil d'tat. b) Ventes de meubles. La vente est faite aux enchres, avec les mmes formalits que la vente d'immeubles, sauf la mise prix par expert; adjudication prside par un receveur des domaines. Les ventes 533. II. Vente des biens des communes. des biens des communes, meubles ou immeubles, doivent tre faites par adjudication publique, v. art. 89, 1. 5 avril 1884. De plus, elles doivent tre prcdes d'une enqute de commodo et incommodo. Enfin, v. art. 1596 C. civ. pour une incapacit qui frappe les autorits municipales et les empche de se rendre adjudicataires. N 2. Les concessions sur le domaine priv. 534. Les concessions sur le domaine priv sont un mode d'alination ou tout au moins de constitution de droits rels, en quoi elles se distinguent des concessions sur le domaine public, qui ne donnent jamais au concessionnaire qu'un droit de possession prcaire. Elles se distinguent des ventes domaniales par des caractres variables selon les hypothses : tantt-parce qu'elles sont faites titre gratuit; tantt parce qu'elles concdent un droit de proprit simplement ventuel; tantt parce qu'elles concdent un droit charge d'un service remplir; tantt parce qu'elles chappent la rgle de l'adjudication pnblique et sont faites de gr gr, etc, etc. Toutes les personnes administratives peuvent faire des concessions. C'est ainsi que les communes peuvent concder des sources thermales leur appartenant, charge d'exploitation; de mme, les tablissements publics. Mais c'est l'tat surtout qui use des concessions. En Algrie, il y a tout un systme organis de concessions de terres domaniales faites en vue du peuplement, et qui entranent pour le concessionnaire l'obligation de rsider et de cultiver sous peine de dchance. En prin; cependant depuis quelques annes, cipe, ces concessions sont gratuites
LES CONTRATS MODES D'ACQURIR.
665
l'administration s'efforce d'introduire la pratique des concessions titre onreux par adjudication. (V. D. 30 sept. 1878.) Dans la mtropole, les concessions sont pratiques titre onreux en vertu de l'art. 41,1. 16 sept. 1807, pour les lais et relais de la mer, pour les marais qui appartiennent l'tat, pour les accrues et atterrissements des fleuves et rivires navigables et flottables, lorsque ces terrains se sont forms dans des conditions o ils n'accroissent pas aux riverains, notamment la suite de travaux publics; enfin pour les endiguements et les crments futurs. Dans ces deux derniers cas, il s'agit-de terrains qui seront repris sur les fleuves ou sur la mer la suite de travaux qu'accompliront les concessionnaires; ce que l'tat cde, c'est un droit de proprit ventuel; pour le moment, en effet, les terrains sont sous l'eau et font partie du domaine public, mais une fois les travaux effectus, ils seront ipso facto distraits du domaine public et saisis par le droit de proprit du concessionnaire. En la forme, ces concessions se prsentent en gnral comme des ventes, autant que possible, on les fait par la voie de l'adjudication; elles doivent tre approuves par dcret; le contentieux est, comme celui des ventes, de la comptence des tribunaux administratifs, mais pas toujours des conseils de prfecture. N 3. Les baux ferme. 535. Au sujet de baux ferme, deux rgles intressantes : Premire rgle, que nous avons dj rencontre plusieurs fois : les biens immeubles des personnes administratives, qui ne sont pas alins et qui ne sont pas affects un service public, doivent en principe tre afferms. (L. 19 aot-12 sept. 1791, art. 8, 2.) Deuxime rgle : La location des biens doit tre faite en principe par adjudication ; cette pratique, suivie par l'tat, est simplement recommande aux communes car les conseils municipaux sont matres de rgler les conditions des baux au-dessous de dix-huit ans. (Art. 68, n 1, 1. 5 avr. 1884.) Les baux ferme sont de la comptence des tribunaux judiciaires, mme les baux de chasse dans les forts de l'tat (Trib. confl. 21 mars 1891), mme les baux de droit de pche dans les cours d'eau navigables et flottables ; mais, par exception, les baux de sources minrales de l'tat sont de la comptence du conseil de prfecture. (Arrt 3 floral an VIII.)
666
LES DROITS DOMANIAUX DE PERSONNE PRIVE SECTION IV. LES QUASI-CONTRATS
536. Les personnes administratives peuvent tre obliges en vertu de quasi-contrats. Les deux seuls quasi-contrats dont il puisse tre question vis--vis d'elles, sont le paiement de l'ind et la gestion d'affaire. Le paiement de l'ind ne donne lieu aucune difficult srieuse. S'il y a eu trop peru au profit d'une personne administrative, soit dans le recouvrement de l'impt, soit dans toute autre occasion, il doit y avoir restitution, sauf formalits de comptabilit pour cette restitution. L'application du principe de la gestion d'affaire donne lieu des difficults plus grandes. Dans la gestion d'affaire, il 537. De la gestion d'affaire. y a un matre de la chose que nous supposons ici tre une personne administrative; il y aussi un tiers, qui, sans mandat et de sa propre initiative, accomplit une dpense pour la chose. La question est de savoir si la personne administrative sera oblige de tenir compte ce tiers des dpenses qu'il aura faites. Quelques exemples montreront combien cette matire de la gestion d'affaire est pratique et dans quelles hypothses varies la question peut se poser: 1 L'hypothse la plus simple est celle o un tiers, qui n'est en aucune faon une autorit administrative, fait une dpense qui sera utile une personne administrative et veut recouvrer sa dpense. Par exemple un usinier a fait construire ses frais un pont sur un chemin vicinal et actionne la commune en remboursement. 2 Une hypothse dj plus complique, est celle o une autorit administrative a engag seule une dpense qu'elle n'a pas le droit d'engager ; par exemple, un maire a pass seul un march pour lequel il et d y avoir dcision du conseil municipal. Le fournisseur ou l'entrepreneur du travail pourra-t-il se faire payer par la commune ? Ou bien s'il a poursuivi le maire, celui-ci, aprs avoir pay de ses deniers, pourra-t-il intenter une action rcursoire contre la commune? 3 Enfin, voici une hypothse plus complique encore, mais singulirement pratique un administrateur, un maire , par exemple, : ayant soustrait une certaine quantit de deniers la comptabilit de la caisse municipale, emploie cette somme d'une faon utile pour la nous savons qu'en sa gestion occulte est dcouverte ; commune ; vertu des principes sur la comptabilit de fait, il devient comptable
LES QUASI-CONTRATS MODES D'ACQURIR.
667
des deniers dissimuls, c'est--dire, qu'il doit rendre intgralement la somme. Ne peut-il pas invoquer, titre d'exception, la gestion d'affaire, et se faire dcharger de l'obligation de restituer dans la mesure o les deniers auront t utilement employs pour la commune? La doctrine est divise sur la question de savoir si le principe de la gestion d'affaire doit tre appliqu aux personnes administratives dans ces diverses hypothses. La jurisprudence est aussi un peu indcise ; cependant, dans ces dernires annes, elle semble s'tre oriente vers l'application du principe. On peut invoquer en ce sens des dcisions de toutes les juridictions intresses : de la Cour de cassation '(Cass., req. 15 juill. 1873, commune de Saint-Chinian, conclusions de M. Reverchon; Cass., req. 19 dc. 1877, commune de Bordeaux, conclusions de M. Dareste) ; du Conseil d'tat (16 mai 1879; 19 mai 1882 ; 8 dc. 1882; 6 fvr. 1883; 13 avr. 1883) ; enfin du tribunal des conflits (26 juin 1880; 25 janv. 1881 ; 11 dc. 1881). On ne peut que se fliciter de voir la jurisprudence s'engager dans cette voie. Le remboursement des dpenses accomplies par le grant d'affaires repose sur un principe de justice vident, d'autant mieux qu'il y presque toujours lieu d'appliquer un autre principe, celui de la restitution de l'enrichissement sans cause, autrement dit de l'action dein rem verso ; si la gestion de l'affaire a t utile, le maitre de la chose s'est enrichi, et il doit tre tenu d'indemniser, au moins dans la limite de son enrichissement. Il est de principe que les quasi-contrats obligent mme les incapables, pourquoi n'obligeraient-ils pas les personnes administratives? Il est vrai qu'il pourrait y avoir l une cause de dsorganisation pour les finances publiques, si la pratique des gestions d'affaire se gnralisait. Des dpenses considrables pourraient tre engages sans que les autorits, qui sont les reprsentants lgaux de la personne administrative, et qui seules ont le droit de formul er sa volont, fussent appeles se prononcer. Mais il est bien vident que l'application de la gestion d'affaire doit demeurer une exception en cette matire, comme elleest une exception dans les relations entre les particuliers. C'est aux tribunaux d'abord, l'administration ensuite, veiller ce qu'elle ne s'tende pas. Les tribunaux doivent se proccuper : 1 de la question de savoir si la dpense a t utile et dans quelle mesure1;2 de celle de savoir 1. Un arrt de la cour de Chambry du 13 aot 1891 fait une distinction trs judicieuse entre les dpenses utiles et les dpenses de luxe propos d'une dpense engage par un maire.
668
LES DROITS DOMANIAUX DE PERSONNE PRIVE
si la dpense n'a pas t engage malgr l'opposition des autorits rep rsentant la personne administrative, auquel cas il serait difficile de dire qu'il y a gestion d'affaire.. Quant l'administration, ainsi qu'on l'a remarqu, n'est-elle pas matresse, mme aprs la condamnation, de mettre l'excution du remboursement une telle lenteur que les grants d'affaire imprudents soient dcourags? L o il apparat qu'il serait inique et mme dangereux de refuser l'application du principe de la gestion d'affaire, c'est dans les moments de crise et de malheur public. Alors que dans une invasion, par exemple, les autorits communales sont dsorganises, pourquoi veuton dcourager par avance le citoyen dvou qui aura l'initiative de prendre quelques mesures indispensables ? Entre particuliers, la gestion d'affaire s'applique surtout aux affaires des absents; il y a des cas, malheureusement, o une personne administrative envisage dans ses autorits constitues, peut tre considre comme absente. SECTION V. LES QUASI-DLITS 538. Le quasi-dlit consiste dans un fait illicite el dommageable qu'une personne a accompli par sa faute, mais sans intention de nuire. Aux termes de l'art. 1382 C. civ., tout fait de ce genre entraine l'obligation de rparer le dommage; aux termes de l'art. 1384, on est responsable, non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est caus par le fait des personnes dont on doit rpondre, c'est--dire par le fait des prposs; cela s'appelle la responsabilit civile, ou la responsabilit du commettant. Cette responsabilit a elle-mme sa source dans un quasi-dlit spcial : la loi prsume que le commettant n'a pas choisi son prpos avec assez de soin ou ne l'a pas surveill avec assez d'attention, que par suite il est en faute. Ce quasi-dlit spcial est le seul que les personnes administratives puissent commettre. En effet, les personnes administratives, tres purement moraux, n'agissent point par elles-mmes, elles ne peuvent donc lser directement les tiers par leurs agissements; mais elles agissent par l'intermdiaire de leurs autorits administratives et de leurs fonctionnaires qui sont leurs prposs, elles doivent tre civilement responsables du fait de ces prposs. Nous avons tudi cette question propos de la garantie des droits publics, p. 93 et s. Nousavons vu alors que la jurisprudence reconnat pleinement l'application du principe de la responsabilit civile
MODES LESQUASI-DLITS D'ACQURIR.
669
pour les personnes administratives infrieures, notamment pour les communes, qu'elle leur applique l'art. 1384 et reconnat la comptence des tribunaux judiciaires; mais qu'au contraire, quand il s'agit de l'tat, comme celui ci, dans ses rapports avec ses fonctionnaires, agit titre de puissance publique, elle ne reconnat pas l'application directe de l'art. 1384, mais seulement celle du principe de justice sur lequel il repose, et qu'elle carte la comptence judiciaire.
LE
CONTENTIEUX
ADMINISTRATIF1
539. On entend par contentieux administratif l'ensemble des rgles relatives aux litiges que suscitel'activit des personnes administratives, en tant que ces rgles s'cartent du droit commun. Les personnes administratives, en agissant, c'est--dire en exerant leurs droits, sont exposes commettre des violations de droit ou froisser des intrts respectables. Sans doute, pour donner satisfaction aux rclamations qui s'lvent, l'administration pourrait se borner examiner elle-mme la plainte, et l'admettre ou la rejeter sans la soumettre un juge, c'est ce qui se passe en cas de recours gracieux. Mais il est facile de comprendre que cette faon de procder, dans le cas o la rclamation est rejete, ne donne pas satisfaction au plaignant, car celui-ci peut toujours objecter que dans cet examen de l'affaire fait par l'administrateur lui-mme, sans aucune des formes protectrices employes d'ordinaire par la justice, la vrit n'a pas pu se faire jour. L'administration a tout intrt, afin d'apaiser au plus vite les mcontentements, soumettre la rclamation un juge en suivant les formes ordinaires des litiges organiss; ces formes permettent au ; de l particulier ls de lutter pour faire triompher ses prtentions le nom de contentieux donn au dbat (contendere, lutter). La lutte judiciaire, avec ses pripties et ses formalits accoutumes, a le don d'apaiser les plaideurs, quelle qu'en soit l'issue. Ce n'est pas seulement d'ailleurs de l'intrt de l'administration qu'il s'agit, mais du triomphe du droit et de la justice Or, d'abord, il est clair que quelque bien dispos que soit un administrateur auquel on s'adresse par recours gracieux, il y a plus de garanties de justice dans l'intervention d'un juge, soit parce que ce juge est tranger la contestation, soit parce que les formes de la procdure qu'il emploie ont par elles-mmes une vertu. 1. Bibliographie : E. Laferrire. Trait de la juridiction administrative et des recours contentieux, 2 vol. in-8, 1887.
672
LE CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
De plus, le contentieux administratif a pour rsultat de dpouiller en partie l'tat de son aspect de puissance publique en l'amenant devant un juge; et ce fait est, au point de vue des progrs du droit., d'une trs grande valeur: il fait apparatre d'une faon sensible aux yeux de tous, que l'tat peut tre soumis des rgles de droit analogues celles auxquelles sont soumis les particuliers, puisqu'il est astreint comme eux un juge. Aussi est-ce par le contentieux que le droit administratif s'est form, et, plus que tous les autres droits, celuil sort-il de la procdure. Dans les pays o le contentieux administratif n'est pas dvelopp, il peut y avoir de bonnes pratiques d'administration, mais il n'y a pas de droit administratif. Le contentieux administratif remonte jusqu'au droit romain, et sous l'ancien rgime, la veille de la Rvolution, il tait trs considrable. L'tude du contentieux administratif doit logiquement comprendre les trois objets suivants : 1 Les actions ou recours; 2 les juridictions et la comptence; 3 la procdure.
CHAPITRE LES ACTIONS
PREMIER OU RECOURS
540. Le contentieux administratif doit se proccuper des actions ou recours intents par les particuliers contre les personnes administratives ou contre leurs actes, c'est--dire, des actions intentes par les particuliers titre de demandeur; mais il doit se proccuper aussi des actions intentes par les personnes administratives titre de demandeur, car les personnes administratives peuvent, elles aussi, avoir des droits faire valoir contre les particuliers, ou bien l'une contre l'autre. A la vrit, vis--visdes particuliers, les personnes administratives sont rarement demandeur; en gnral, c'est le particulier qui est oblig d'attaquer. Cela tient ce que les personnes administratives ont un certain nombre de droits de puissance publique, grce auxquels, dans la plupart des cas, elles ralisent leur droit extrajudiciairement jusqu' l'extrme limite, et mettent leur adversaire dans la ncessit d'attaquer. Il est clair, par exemple, que quand l'tat procde lui-mme la dlimitation de son domaine public, il met le voisin qui se croit ls dans l'obligation de prendre le rle de demandeur. De mme, quand l'tat liquide lui-mme ses dettes envers ses fournisseurs. Cela n'empche pas cependant, que quelquefois l'tat et les autres personnes administratives ne soient obligs de se porter demandeur. INTENTS PARLES PARTICULIERS OURECOURS 1. DES ACTIONS Des cas o le particulier peut attaquer.
Un par541. De la faon de crer le contentieux. ticulier ls par l'administration ne peut pas toujours attaquer, il faut qu'il y ait, suivant l'expression consacre, droit litigieux ou contentieux cr. Or, la question de savoir quand il ya contentieux cr est dlicate. Il faut distinguer suivant que la personne administrative a agi titre de puissance publique o titre de personne prive. H. 43
674
OU RECOURS LES ACTIONS
a) Cas o la personne administrative agit titre de puissance publique. Dans cette hypothse, il faut partir de cette ide fondamentale, que le particulier attaque beaucoup moins une personne administrative qu'un acte d'administration par lequel il a t ls. Ce qu'il intente, c'est un recours contre l'acte, bien plutt qu'une action contre la personne. Sans doute, en cours d'instance, la personne administrative sera mise en cause, mais au dbut, c'est l'acte lui-mme qui est poursuivi. On dirait que la personne administrative ne veut pas s'engager tout entire dans la dfensede son acte. La consquence est que toutes les fois qu'une personne administrativeagit titre de puissance publique, le contentieux, en principe, ne peut tre cr que par un acte d'administration. Il faut donc que le particulier puisse citer l'acte d'administration par lequel il a t ls, c'est--dire une dcision excutoire prise par une autorit administrative et lui opposable. Il est des cas o cet acte d'administration sera intervenu spontanment, sur l'initiative de l'administration elle-mme, par exemple, dans l'hypothse d'un dcret de dlimitation du domaine public, d'un dcret liquidant la pension d'un fonctionnaire, mais il est. d'autres cas o le particulier sera oblig de provoquer l'acte d'administration pour crer le contentieux. Cela peut arriver l'occasion de l'excution des oprations de puissance publique, notamment des marchs de travaux publics ou des marchs de fournitures de l'tat. L'entrepreneur ou le fournisseur peut s'apercevoir, en cours d'excution du march, qu'il est ls par les agissements d'un fonctionnaire infrieur sans pourvoirs propres, agissements qui ne constituent pas des actes d'administration au sens juridique du mot. Il est oblig alors de former devant le ministre un recours gracieux, afin de provoquer une dcision sur recours gracieux, qui, elle, sera un acte d'administration, et qui pourra tre attaque par la voie contentieuse. Il crera donc le contentieux en employant la voie pralable du recours gracieux 1. On pourrait voir une contradiction apparente entre la rgle que nous formulons ici, et d'o il rsulte que quelquefois le recours gracieux est le pralable oblig du recours contentieux, avecune autre rgle que nous avons formule, p. 210, et d'o il rsulte au contraire que le recours gracieuxn'est pas le pralable obligdu recours contentieux. : ici il n'y a pas de dcision Les hypothses sont compltementdiffrentes administrative et il s'agit d'en provoquer une, le recours gracieux est le seul moyen. A la page 210,nous nous placions dans l'hypothse o il y a dj une dcisiond'une autorit administrativeinfrieure, et la doctrine de l'arrt Bansais, que nous reproduisions, dcide qu'il n'y a pas lieu alors de passer
INTENTS PAR LES PARTICULIERS
675
Cette obligation se trouve inscrite dans le cahier des clauses et conditions gnrales des ponts et chausses, ait. 51. Elle est reproduite dans tous les autres cahiers pour tous les travaux publics de l'tat, et s'applique par consquent aux rclamations formules par l'entrepreneur. Il en est de mme pour les marchs de fournitures'de l'tat, les rclamations du fournisseur doivent tre d'abord soumises au ministre avant d'tre portes au Conseil d'tat. Il faut voir dans cette rgle un privilge de plus qui appartient aux personnes administratives agissant titre de puissance publique ; cette ncessit o la partie lse est de provoquer une dcision, permet l'administration suprieure d'tudier l'affaire, elle entrane des dlais et des lenteurs qui peuvent tre fort utiles. Pendant longtemps mme, il fut admis qu'il suffirait au ministre de ne pas rpondre au recours gracieux, pour emp cher indfiniment la partie de former son recours contentieux. Cet abus n'est plus possible depuis la disposition du dcret du 2 novembre 1864, qui assimile une dcision de rejet le silence gard par le ministre pendant quatre mois depuis la rception du recours. Il n'en est pas moins vrai qu'il ya l un privilge exorbitant du droit commun, qui doit tre restreint autant que possible. Dans les marchs de travaux publics, il s'impose aux entrepreneurs parce qu'il est expressment stipul au cahier des charges, mais on ne saurait admettre qu'il soit opposable aux tiers qui se trouveraient lss par une opration de travaux publics sans avoir trait avec l'administration. Par exemple, dans l'hypothse de dommages permanents causs la proprit, le propritaire ls peut de plano poursuivre la personne administrative devant le conseil de prfecture. b) Cas o la personne administrative agit titre de personne prive. Dans cette hypothse, la personne administrative peut tre actionne directement elle-mme ; ce n'est pas un recours contre l'acte qu'on intente, mais une action ordinaire contre la personne; il n'est donc point besoin de provoquer d'acte d'administration. Cela se prsente dans les contestations sur la proprit ou sur la possession, quand il s'agit du domaine priv. Cela se prsente aussi pour l'excution de ceux des contrats qui sont oprations de personne prive. Et cependant, mme dans ces cas, nous allons voir un peu plus loin que la personne administrative doit tre prvenue de l'action intente, par le dpt prable d'un mmoire. par l'intermdiaire d'une dcision ministrielle,puisqu'il y a dj une dcision. La conciliationest doncfacile.
676
OU RECOURS LES ACTIONS N 1. Des recours contentieux contre l'acte.
542. Ces recours sont au nombre de deux, le recours contentieux ordinaire, et le recours pour excs de pouvoir. a) Le recours contentieux ordinaire est une action qui donne au juge un pouvoir de pleine juridiction, qui lui soumet en entier la situation cre par la dcision incrimine, lui permet d'annuler ou rformer la dcision et de statuer sur les consquences, notamment de condamner des dommages-intrts. Le recours contentieux ordinaire rpond la situation suivante: un droit a t viol par l'administration, mais ce droit n'est pas quelconque, il avait t reconnu par la loi aux citoyens justement l'occasion de l'opration administrative au cours de laquelle il a t viol. Par exemple, en matire d'impts directs o il existe des recours contentieux, le droit reconnu aux citoyens par la loi et qui peut avoir t viol est le droit de n pas tre impos tort ni surtax ; en matire de pensions civiles o il y a galement des recours contentieux une fois que le fonctionnaire a t admis faire valoir ses droits la retraite, le droit reconnu au fonctionnaire est le droit une pension liquide suivant certaines rgles, etc. Il y a donc corrlation intime entre le droit viol et l'acte qui le viole. Aussi qualifie-t-on souvent de dcisions administratives contentieuses, les actes d'administration qui interviennent en de pareilles matires; ces dcisions sont contentieuses en ce sens qu'elles se heurtent srement des droits, qu'un contentieux peut srement en natre, que si le recours ne russit pas toujours, dans tous les cas il est toujours recevable. b) Le recours pour excs de pouvoir est une voie de nullit spciale qui donne seulement au juge un pouvoir d'annulation de l'acte, sans lui donner le pouvoir de rformer, ni de statuer sur les consquences de l'annulation. Le recours pour excs de pouvoir, qui, depuis le D. 2 nov. 1864, a absorb tout le contentieux de l'annulation, rpond deux situations. bien diffrentes de la prcdente et bien diffrentes entre elles: 1 Un droit reconnu par une loi ou un rglement a t viol, mais ce droit n'avait aucune corrlation avec l'acte d'administration par lequel il a t viol; c'est un droit individuel quelconque. Voici par exemple une opration de dlimitation du rivage de la mer; aucun texte de loi spcial n'a protg les riverains contre les emprises de terrain que le dcret de dlimitation peut entraner, aucun droit spcial ne leur est reconnu; par suite, aucun recours contentieux ordinaire contre le dcret; mais le droit de proprit d'une faon gnrale est
PAR LES PARTICULIERS INTENTS
677
protg par des dispositions lgislatives au Code civil et ailleurs; ds lors, s'il y a eu emprise de son terrain, le riverain pourra intenter le recours pour excs de pouvoirdu chef de violationde la loiet des droits acquis. C'est l'ancien recours en annulation contentieuse, et au fond c'est le droit gnral d'action qui doit exister toutes les fois qu'un droit est viol. (V. p. 204 et la note.) 2 Aucun droit n'a t viol, mais l'acte d'administration a froiss un intrt respectable et, de plus, il est entach d'un vice interne (incomptence, vice de forme, dtournement de pouvoir). c) Dans tous ces cas, il ya litige organis devant un vritable juge, et c'est ce qui fait que nos deux recours mritent le nom de recours contentieux et se distinguent du recours gracieux, qui n'est que la rclamation porte devant l'administrateur. Nousavons tudi les rgles de ces deux recours propos de l'acte d'administration (p. 211 et s.), nous avons tudi aussi, au mme endroit, les recours gracieux et ses rapports avec les recours contentieux (p. 208 et s.); nous n'avons pas revenir sur ces matires. N 2. Des actions contre la personne. 543. Lorsqu'un particulier peut intenter une action contre une personne administrative de piano, sans avoir provoquer au pralable de dcision administrative, il n'y a aucune rgle spciale suivre en principe. Le plus souvent, d'ailleurs, ce sera une action judiciaire porte devant les tribunaux ordinaires. Cependant, il peut se faire qu'il y ait obligation de dposer au pralable un mmoire entre les mains de l'autorit administrative. a) Obligation du dpt. 544. Dpt d'un mmoire. Un mmoire contenant les prtentions du demandeur avec les pices justificatives doit tre adress au prfet avant toute action judiciaire intente une personne administrative, sous le bnfice des distinctions suivantes: 1 Actions diriges contre l'tat t. III, art. (1. 28oct. 5 nov. 1790, 15). L'obligation existe pour les actions de toute nature. La prescription est interrompue par le dpt du mmoire. 2 Actions diriges contre le dpartement (1. 10 aot 1871, art. 55). L'obligation existe pour les actions ptitoires. L'action ne peut tre porte devant les tribunaux que deux mois aprs la date du rcpiss. Le dpt du mmoire interrompt toute prescription s'il est suivi dans les trois mois d'une demande en justice. 3 Actions diriges contre les communes (1. 5 avr. 1884, art. 124 et
678
LES ACTIONS OU RECOURS
suiv.). L'obligation existe pour les actions ptitoires. L'action ne peut tre porte devant les tribunaux que deux mois aprs la date du rcpiss. Ledpt du mmoire interrompt toute prescription, s'il est suivi dans les trois mois d'une demande en justice. b) Nature du mmoire. Au fond c'est un avertissement, il est remarquer que le dpt du mmoire se produit pour des actions judiciaires, c'est--dire dans des hypothses o il n'y a pas eu de recours gracieux qui ait averti l'administration. On a voulu y voir un essai de conciliation, cause de l'effet interruptif de prescription, mais les parties ne sont pas mises en prsence. On pourrait dire que c'est le reste affaibli d'une ncessit de demander l'autorisation d'attaquer. Ainsi les cranciers d'une commune, d'aprs l'arrt du 17 vendmiaire an X, renouvelant un dit d'aot 1683, ne pouvaient actionner la commune qu'aprs autorisation du conseil de prfecture. Cela a disparu depuis la loi du 18 juillet 1837. OU RECOURS INTENTS PAR LES PERSONNES 2 DESACTIONS ADMINISTRATIVES N 1. Des diffrentes actions que les personnes administratives peuvent avoir intenter. Les personnes administratives 545. Actions ordinaires. peuvent avoir intenter d'abord des actions ordinaires, soit pour leur domaine priv, soit pour leurs oprations de personne prive, et cela contre des particuliers ou contre d'autres personnes adminislratives. 546. Recours contre des actes d'administration. Elles peuvent aussi avoir former des recours contre des dcisions administratives. Ainsi, on peut trs bien voir une commune, propritaire de terrains au bord de la mer, former un recours pour excs de pouvoir contre un dcret de dlimitation. Quelquefois, elles forment des recours dits administratifs. C'est ainsi qu'aux termes de l'art. 67, loi municipale, le conseil municipal peut former un recours en la forme du recours pour excs de pouvoir contre l'arrt du prfet annulant une de ses dlibrations. Cette sorte d'ac547. Action publique rpressive. tion est rserve l'tat. C'est l'action publique par laquelle est poursuivie au nom de la socit la rpression des crimes et dlits nous n'en parlerions mme pas, si quelquefois cette action n'tait
ADMINISTRATIVES INTENTS PAR LES PERSONNES
679
porte devant des tribunaux administratifs. (Comptence rpressive des conseils de prfecture en matire de contraventions de grande voirie. ) dans l'intrt 548. Actions de la puissance publique. Un certain nombre d'actions ou recours sont intents au nom de l'tat dans l'intrt de la puissance publique; on peut citer: 1 Les oppositions ouverture d'coles libres. (V. p. 145.) 2 Les recours en annulation de dcisions de conseils gnraux forms par les prfets devant le Conseil d'tat, en vertu de l'art. 47, 1. 10 aot 1871; 3 Les recours en matire d'appel comme d'abus; 4 Les jugements des comptes des comptables, etc.; 5 Les lvations de conflit. (V. infr, n 570.) N 2. De la capacit des personnes administratives justice et du maniement de l'action. pour ester en
1 Capacit. L'tat a pleine capacit pour 549. L'tat. ester en justice. 2 Autorit qui prendla dcision. Ce sont les autorits du pouvoir excutif qui ont le droit de dcision pour intenter l'action, en principe ce sont les ministres. 3 Mandataire ad litern. Pour savoir qui est le reprsentant en justice il faut des distinctions : a) Domaine de l'tat. Toutes actions concernant le domaine de l'tat sont intentes et soutenues au nom du prfet du dpartement dans le ressort duquel se trouvent les objets contentieux. (Art. 69, 1, C. proc. civ.) Toutefois, l'administration des domaines a le droit d'exercer les actions qui ont pour objet de simples recouvrements de revenus, d'arrrages de rentes ou de crances, lorsque le fond du droit n'est pas contest. (L. 28oct.-5 nov. 1790, titre III, art. 14, et 19 aot-12 sept. 1791, art. 4 et 6.) Le prfet reprsente le domaine de l'tat mme contre le dpartement. Dans ce cas, le dpartement est reprsent par un membre de la commission dpartementale nomm par elle. (Art. 54, 1.10 aot 1871.) Le prfet reprsente le domaine de l'tat, non seulement devant les tribunaux judiciaires, mais aussi devant les juridictions administratives; mme devant le conseil de prfecture, bien qu'il en soit prsident; il se borne ne pas siger comme juge. Cependant, devant
680
OU RECOURS LES ACTIONS
le Conseil d'tat, c'est le ministre des finances qui reprsente le domaine de l'tat. b) Pour le domaine militaire, c'est le ministre de la guerre qui intente et dfend aux actions. (L. 10 juill. 1791, titre IV, art. 1 et 5.) c) Trsor public. Le trsor public procde en justice par le ministre d'un agent spcial, appel agent judicaire du trsor. (C. pro. civ., art. 69 et 70.) d) Pourtous les autres droits pcuniaires, l'tat est reprsent, soit par les ministres comptents, soit parles administrations qu'ils ontsous leurs ordres, et qui forment dans les ministres des directions ; ainsi les administrations de l'enregistrement, des contributions directes, des contributions indirectes, sont reprsentes par leurs directeurs. 1 550. Le dpartement. Capacit. Le dpartement a conquis peu peu la capacit d'ester en justice sans autorisation, en demandant comme en dfendant, pour toutes actions. Sous l'empire de la loi de 1838, il fallait l'autorisation du chef de l'tat; sous l'empire des dcrets de 1852, l'autorisation du prfet; depuis 1865, il y a capacit. C'est un des objets sur lesquels le conseil gnral statue dfinitivement. (L. 10 aot 1871, art. 46, 15.) 2 Autorit qui prend la dcision. Il faut distinguer: pour l'attaque, en principe, le conseil gnral ; dans les cas d'urgence, la commission dpartementale, qui a enlev ainsi en 1871 une attribution au prfet. (L. 1871, art. 46, n 15.) Pour la dfense : commission dpartementale. (Art. 54.) 3 Mandataire ad litem. Ce mandataire est le prfet, sauf dans le cas o il y a conflit avec l'tat, auquel cas la commission dpartementale dlgue un de ses membres. (Art. 54, 1. 1871.) 1 Capacit. Les communes sont 551. La commune. en principe incapables de plaider sans une autorisation donne par le conseil de prfecture. (Art. 121 et suiv., 1. 5 avr. 1884.) Cependant deux cas excepts: Actions possessoires et tous actes conservatoires. (Art. 122.) Difficults souleves par la perception des recettes municipales qui se recouvrent sur des tats dresss par le maire (art. 154). On admettait avant la loi de 1884, une troisime exception : celle du cas o la commune plaidait devant la juridiction administrative. Mais les termes de l'art. 121 ne permettent plus de l'admettre; il n'y a pas de raison d'ailleurs: la femme marie, elle aussi, est bien autorise par la juridiction devant laquelle elle doit plaider.
INTENTS PAR LES PERSONNES ADMINISTRATIVES
681
L'autorisation donne en premire instance doit tre renouvele en appel et pour le pourvoi en cassation, bien que le maire puisse seul interjeter l'appel ou former le pourvoi. (Art. 122.) Pour les formes de l'autorisation, v. art. 121 in fine, il y a autorisation tacite dfaut de dcision dans les deux mois. 2 Autorit qui prend la dcision. Le maire, sous le contrle du conseil municipal (art. 90, 8), c'est--dire qu'il doit tre autoris par une dlibration. Jurisprudence antrieure la loi de 1884.) 3 Mandataire ad litem. Le maire, sauf dans le cas o il a luimme dans l'affaire des intrts opposs ceux de la commune, auquel cas le conseil municipal dsigne un autre de ses membres. (Art. 83); Action exceptionnelle de l'art. 123. Les contribuables peuvent en certains cas exercer les actions de la commune. Cette disposition a t introduite par la loi de 1837. L'art. 123 est la reproduction exacte de l'art. 49 de la loi du 28 juillet 1837. Il ya quatre conditions : 1 L'action ne peut tre exerce que par des contribuables inscrits au rle; 2 L'action est exerce aux frais et risques du contribuable; 3 L'autorisation du conseil de prfecture est ncessaire; 4 La commune doit tre pralablement appele dlibrer. La disposition de l'art. 123 s'applique sans difficults lorsqu'il s'agit de dfendre une action, aussi bien que lorsqu'il s'agit de l'intenter. La commune est mise en cause. 552. Les tablissements publics. Capacit de plaider. Les tablissements publics sont soumis la ncessit de demander l'autorisation du conseil de prfecture; pour la plupart il y a des textes spciaux; il y en a pour les sections de commune, pour les hospices communaux, les bureaux de bienfaisance, les fabriques, les menses piscopales et curiales, les consistoires protestants et isralites. Pour les autres, il y a des textes trs gnraux, tel que l'art. 1032, C. proc. civ., et l'art. 3, 0. 1828 sur les conflits. De plus, on ne saurait admettre que les tablissements publics aient une capacit plus grande que les communes. Quant la question de savoir qui dcide et qui intente l'action, consulter l'organisation de chaque tablissement.
CHAPITRE LES JURIDICTIONS
II
ET LA COMPTENCE
SECTION Ire. DE LA PLACE OCCUPE PARLA JURIDICTION ADMINISTRATIVE DE LA JURIDICTION ET DE LA ADMINISTRATIVE 1er. SPARATION JURIDICTION ORDINAIRE Art. 1er. Raisons profondes de cette sparation. 553. Position de la question. Il existe des tribunaux administratifs distincts des tribunaux ordinaires, et une partie du contentieux administratif leur est rserve. Voil un fait considrable qui influe sur tout le contentieux administratif, parce qu'il fait natre pour chaque affaire la question de savoir si elle rentre dans les attributions du juge ordinaire, ou bien dans celles du juge administratif. Il s'ensuit: 1 la ncessit d'un tribunal spcial pour dpartager les deux ordres de juridictions et trancher les conflits d'atlribution qui s'lvent; ce tribunal existe en effet sous le nom de tribunal des conflits; 2 la ncessit de rgles d'attribution. En prsence de la gravit de ces consquences, on doit se demander s'il est vraiment indispensable qu'il y ait des juridictions administratives ct des tribunaux ordinaires. On peut poser la question de deux faons: 1 Au point de vue constitutionnel, en se demandant si l'indpendance du pouvoir excutif n'exige pas qu'on soustraye ses actes l'examen du pouvoir judiciaire; 2 A un point de vue purement rationnel, en se demandant si le contentieux administratif n'a pas un caractre spcial qui exige un juge spcial. Notre lgislation positive s'est place au point de vue constitutionnel, car elle fait du partage d'attribution entre les tribunaux administratifs et les tribunaux judiciaires une question de sparation des pouvoirs ; mais il faut bien dire que ce problme constitutionnel
DE L'EXISTENCE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS
683
prte la controverse, et qu'il est des pays o l'on n'a pas la mme dfiance du pouvoir judiciaire, o l'on admet trs bien qu'il ait une certaine prise sur les actes du pouvoir excutif (tats-Unis d'Amrique, par exemple). Il serait intressant, ds lors, de se placer l'autre point de vue, et de se demander si le contentieux administratif n'a pas un caractre spcial qui exige un juge spcial. Car si une juridiction distincte de la juridiction ordinaire parat ncessaire, il devient trs naturel que cette juridiction soit administrative, et le principe de la sparation des pouvoirs, tel que nous l'entendons en France, trouve des circonstances trs favorables sa justification. Nous allons essayer de nous placer ce second point de vue. A notre avis, il faut faire une de principe. 554. Solution distinction, dj faite bien des fois, entre la personnalit de puissance publique et la personnalit de personne prive. Lorsque l'acte des personnes administratives, qui cre le contentieux, est un de ceux o apparat leur caractre de personne prive, le contentieux ne prsente rien de particulier et ne ncessite nullement un juge spcial ; au reste, nous verrons que ce contentieux est presque tout entier abandonn au juge ordinaire. La situation est toute diffrente, lorsque, dans l'acte qui a cr le contentieux, apparatle caractre de puissance publique des personnes administratives; il y a ceci de particulier que les droits en prsence sont maldfinis, et que ds lors le juge doit avoir des pouvoirs prtoriens. Et cela arrive dans deux cas: 1 Toutes les fois que c'est l'acte d'administration en lui-mme qui est attaqu par un recours contre l'acte, parce que l'acte d'administration, ainsi que nous l'avons vu, renferme la volont mme de la personne administrative dans ce qu'elle a de libre et d'indtermin. (V. p. 193.) 2 Toutes les fois que des personnes administratives ont fait une opration de puissance publique, c'est- dire ont exerc un droit de puissance publique; ces droits, en effet, par cela seul qu'ils sont exorbitants du droit commun, sont difficiles dfinir; la loi serait impuissante poser des rgles en ces matires, le juge seul le peut mesure qu'il est amen dans chaque hypothse toucher la ralit. Il faut donc que le juge ait des pouvoirs prtoriens, qu'il puisse crer le droit. Et remarquons que jamais cette ncessit ne disparatra. Sans doute, il est des oprations dtermines qui finiront par perdre leur
684
LES JURIDICTIONS ET LA COMPTENCE
caractre de puissance publique, elles se seront tellement rptes, les droits des parties en prsence se seront tellement dfinis, qu'il n'y aura aucun inconvnient les faire passer dans la catgorie des oprations de personne prive soumises au juge ordinaire; mais de nouvelles oprations de puissance publique se rvleront. Si donc, dans un pays, le juge ordinaire n'a pas de pouvoirs prtoriens, on ne pourra pas lui confier la juridiction administrative, car elle est essentiellement prtorienne. La 555. Application l'organisation franaise. France est justement un pays o les tribunaux ordinaires n'ont pas de juridiction prtorienne; la Cour de cassation, qui est le rgulateur suprme de ces tribunaux, a seulement le pouvoir d'appliquer la loi, elle ne peut ni la dvelopper ni la modifier. La France donc, tant qu'elle conservera son organisation judiciaire gnrale, est condamne la ncessit d'une juridiction administrative spciale pour le contentieux provoqu par les actes et les oprations de puissance publique. Mais on peut se demander si tous les tribunaux administratifs qui existent actuellement sont bien indispensables pour exercer cette juridiction. Il y a deux catgories diffrentes de tribunaux administratifs, des tribunaux comptence large, comme le Conseil d'tat, les conseils de prfecture, les ministres; et des tribunaux comptence spciale, comme la Cour des comptes, les conseils de rvision, les conseils universitaires, etc. Il faut tout de suite carter du dbat les tribunaux spciaux. Il faut s'efforcer d'en diminuer le nombre, mais il en faudra toujours et il y en aura toujours. Restent les tribunaux comptence large, Conseil d'tat, conseils de prfecture, ministres. La comptence contentieuse des ministres doit tre restreinte autant que possible, tout le monde commence tre d'accord l-dessus, parce qu'il faut sparer les fonctions d'administrateur et celles de juge. (V.infr, n 573.) Restent finalement le Conseil d'tat et les conseils de prfecture. Et comme on ne saurait songer toucher au Conseil d'tat qui est dj le grand juge prtorien, tant le juge de l'excs de pouvoir, et qui prsente les plus hautes garanties possibles d'impartialit et de science, tout se rduit la question de savoir si l'on ne pourrait pas supprimer les conseils de prfecture. A notre avis, et si l'on se place uniquement au point de vue du
ADMINISTRATIFS DES TRIBUNAUX DE L'EXISTENCE
685
contentieux, laissant de ct toute proccupation gouvernementale, la rponse ne saurait tre douteuse, les conseils de prfecture pourraient tre supprims. 1 Plusieurs desaffaires dont ils sont actuellement chargs pourraient leur tre enleves pour tre donnes aux tribunaux ordinaires, notamment les affaires de contributions directes. Les conseils de prfecture jugent 460,000 affaires par an, mais, l-dessus, il ya prs de 400,000 affaires qui sont des rclamations en matire de contributions directes; or, d'abord, l'application de la loi du 21 juillet 1887 fera diminuer ce chiffre, parce que satisfaction sera donne beaucoup de rclamations par l'administration elle-mme; de plus, ces rclamations pourraient aussi bien tre portes devant le juge de paix. Il s'agit d'une opration de puissance publique, mais qui est trs rglemente par la loi, et o les droits des parties sont trs bien prciss. 2 Les affaires qui ne seraient pas donnes aux tribunaux ordinaires ressortiraient au Conseil d'tat. Au premier abord, on peut voir cela des inconvnients : Cela loignerait : il ya un conseil de prfecle tribunal du justiciable ture dans chaque dpartement, il n'y a qu'un Conseil d'tat pour toute la France. On peut rpondre que la facilit des communications et la souplesse de la procdure remdieraient cet tat de choses. La procdure qui est entirement crite, o tout se juge sur mmoires, n'exige en aucune faon la comparution des parties ni par consquent leur dplacement. Cela supprimerait la garantie des deux degrs de juridiction: lorsque le conseil de prfecture est saisi, ce n'est jamais qu'en premire instance, il y a toujours facult d'appel au Conseil d'Etat; saisir tout de suite le Conseil d'tat, c'est supprimer un degr de juridiction. Acela on peut rpondre que c'est le propre de la juridiction prtorienne de n'avoir qu'un degr de juridiction; le recours pour excs de pouvoir ne donne lieu qu' une seule instance. Dans notre pense, au point de vue de la mission gnrale du juge, le recours contentieux ordinaire ne s'loigne pas sensiblement du recours pour excs de pouvoir. Le seul inconvnient vraiment srieux serait dans la chert de la procdure devant le Conseil d'tat, mais on pourrait y remdier en multipliant les dispenses de frais et de ministre d'avocat. Donc la suppression des conseils de prfecture serait chose possible; : on conoit un prteur unique pour ce serait aussi chose dsirable toute la France, on ne conoit pas bien un prteur par dpartement. Cette suppression se fera probablement, mais ce serait mal connatre les habitudes des gouvernements que de supposer qu'elle aura lieu brusquement par une mesure de l'autorit. Elle sera longuement
686
ET LA COMPTENCE LES JURIDICTIONS
prpare par un certain nombre de faits dont il est dj facile de saisir l'action : 1 Un premier fait trs important, c'est que le Conseil d'tat, avec une remarquable intelligence de sa mission, tire lui, autant qu'il peut, le contentieux; il a depuis longtemps tabli, par sa jurisprudence,que les conseils de prfecture n'taient que des juges d'exception qui devaient tre renferms dans la comptence que leur assignent les textes; il vient d'tablir la mme rgle pour les ministres, de sorte que c'est lui, Conseil d'tat, qui est le juge de droit commun. (Arrt 13 dc. 1889, affaire Cadot.) (V. infr n 579). 2 Chaque fois que les conseils de prfecture sont attaqus, et ils le sont souvent, le gouvernement se proccupe, pour les fortifier, d'amliorer leur juridiction. Or, il se trouve que le seul moyen d'amliorer cette juridiction et de la rapprocher de celle des tribunaux ordinaires. Ces rformes successives fortifient peut-tre momentanment les conseils de prfecture, mais elles prparent fatalement leur disparition, parce qu'il viendra un moment o ils seront tellement semblables aux tribunaux ordinaires, qu'on se demandera s'ils ne font pas double emploi. Ce jour-l ils seront supprims ou bien on les fera fusionner avec les tribunaux ordinaires. Avant la loi du 21 juin 1865, les conseils de prfecture taient trs mal orgarniss. Ils taient prsids par le prfet, il n'y avait point de garanties pour le recrutement du personnel, il n'y avait pas de publicit des sances, pas de dbat oral, pas de ministre public. On pouvait considrer que c'tait le prfet, c'est--dire le reprsentant de l'administration active, qui jugeait. La loi de 1865 a opr une premire rforme qui a loign les conseils de prfecture de l'administration : le prfet ne practive, et les a rapprochs des tribunaux ordinaires side plus ncessairement, il ya un vice-prsident, quelques garanties de capacit ont t exiges, le dbat oral et la publicit des sances ont t introduits, un ministre public a t institu. Une nouvelle rforme est actuellement l'tude, d'aprs laquelle la prsidence serait compltement enleve au prfet, et des conditions seraient faites au personnel, suffisamment avantageuses pour lui donner une certaine indpendance. Il ne resterait plus vraiment qu'une dernire rforme accomplir pour rapprocher compltement les conseils de prfecture des tribunaux ordinaires, ce serait de dcrter l'inamovibilit des juges. Quant au Conseil d'tat, son existence comme juge administratif indpendant ne serait menace, que si notre organisation judiciaire tait tout entire modifie, et si une haute cour ayant des pouvoirs prtoriens absorbait en elle la Cour de cassation, le Conseil d'Etat,
DU PARTAGE D'ATTRIBUTION
687
: une semblable volution serait peut-tre dle tribunal des conflits sirable, mais jusqu' prsent rien ne la fait prvoir. Article II. Du fartage d'attribution entre les tribunaux nistratifs et les tribunaux judiciaires. admi-
N 1. Du principe constitutionnel sur lequel repose ce partage. 556. D'aprs la lgislation positive franaise, le partage d'attribution entre les tribunaux administratifs et les tribunaux judiciaires repose sur le principe constitutionnel de la sparation des pouvoirs. (V. p. 16.) Les tribunaux administratifs sont considrs comme faisant partie intgrante du pouvoir excutif, et la question de leurs rapports avec les tribunaux judiciaires devient une question de rapports du pouc'est--dire une question voir excutif avec le pouvoir judiciaire, constitutionnelle. Cela repose sur des textes de lois rvolutionnaires (1. 16-24 aot 1790 et 1. 16 fructidor an III), et, historiquement, cela s'explique par l'antagonisme qui existait avant la Rvolution entre les intendants reprsentant alors le pouvoir excutif, et les parlements reprsentant le pouvoir judiciaire. 11est bon de rappeler que, actuellement, on entend par tribunaux judiciaires, tous ceux qui sont sous la dpendance dela Cour de cassation : cours d'appel, tribunaux d'arrondissement, juges de paix, tribunaux de commerce, tribunaux criminels. Ces tribunaux ont en effet succd aux parlements et aux juridictions diverses qui dpendaient de ceux-ci. Les textes qui posrent les du principe. 557. Formule rgles des rapports entre les deux ordres de juridiction s'exprimaient de la faon suivante : Les juges ne pourront, peine de forfaiture, troubler de quelque manire que ce soit les oprations des corps administratifs. (L. 16 24 aot 1790, titre II, art. 13.) Dfenses itratives sont faites aux tribunaux de connatre des actes d'administration, de quelque espce qu'ils soient M. (L. 16 fructidor an III.) Ces expressions taient trs absolues; elles signifiaient que toutes les oprations administratives, de quelque nature qu'elles fussent, mme les oprations de personne prive, devaient tre soustraites
688
ET LA COMPTENCE LES JURIDICTIONS
la comptence des tribunaux judiciaires. Et en effet, jusqu' la rorganisation du Conseil d'tat, ce fut la jurisprudence applique. Mais il est vident qu'il y avait dans cette faon de comprendre la sparation des pouvoirs, quelque chose d'exagr et d'injuste qui ne pouvait s'expliquer que par le souvenir non encore effac de luttes politiques. On avait t proccup, visiblement, non pas de faire un partage gal entre les deux pouvoirs, mais de protger le pouvoir excutif contre le pouvoir judiciaire. On avait exagr les droits du pouvoir excutif, car ce pouvoir n'agit avec sa vritable essence, et n'a besoin d'indpendance que lorsqu'il agit titre de puissance publique. Lorsqu'il agit titre de personne prive, il n'y a pas de raison pour ne pas le soumettre au droit commun. D'autre part, on avait laiss dans l'ombre les droits du pouvoir judiciaire. Le pouvoir judiciaire a des attributions qui sont tout aussi fondamentales que celles du pouvoir excutif : le pouvoir judiciaire est le gardien des droits publics des citoyens, et notamment de ces liberts essentielles, la libert individuelle, l'tat des personnes, la proprit. Ce sont l des attributions qui sont consacres, non pas par tel ou tel texte, mais par l'ensemble des textes. Ce sera le trs grand honneur des juridictions administratives et notamment du Conseil d'tat, d'avoir compris qu'elles devaient d'elles-mmes renoncer profiter de textes excessifs, et qu'elles devaient les interprter avec souplesse l'aide du principe de la sparation des pouvoirs sainement entendu. Le Conseil d'tat entra dans cette voie ds qu'il fut rorganis et il y a toujours persvr, soit comme juge administratif, soit comme juge des conflits; le tribunal des conflits, ds qu'il fut organis part, y entra, lui aussi. Le rsultat d'un demi-sicle d'efforts accomplis ainsi dans le sens de l'abngation par les juridictions administratives elles-mmes, fait qu'aujourd'hui on peut formuler ainsi le principe: 1 Tout ce qui est apprciation des actes et des oprations de puissance publique doit tre de la comptence des tribunaux administratifs; 2 Tout ce qui n'est pas apprciation des actes et des oprations de puissance publique doit tre laiss aux tribunaux judiciaires. En d'autres termes, ce ne sont plus tous les actes de l'administration qui sont rservs aux tribunaux administratifs, mais seulement les actes de puissance publique. On remarquera que c'est justement la formule laquelle nous sommes arrivs au paragraphe prcdent, lorsque nous nous sommes
D'ATTRIBUTION DU PARTAGE
689
demand si des juridictions administratives taient ncessaires, abstraction faite du principe de la sparation des pouvoirs. C'est--dire que les proccupations constitutionnelles ont t progressivement ramenes de justes limites, grce aux ides purement rationnelles que nous avons exposes. N 2. 558. Des rgles d'attribution.
L'nonc du principe que nous venons de donner ne suffirait pas pour trancher les conflits d'attribution. Il faut en dduire des rgles plus prcises qui s'adaptent la varit des hypothses. Il y a lieu de distinguer quatre espces de contentieux : 1 Le contentieux de l'annulation. Il s'agit de faire annuler un acte d'administration, c'est le contentieux du recours pour excs de pouvoir. 2 Le contentieux de pleine juridiction. Il s'agit de saisir compltement un juge de toute une situation cre par un acte, soit par un recours contentieux ordinaire, soit par une action judiciaire. 3 Le contentieux de l'interprtation. Il s'agit, au cours d'un litige dont un tribunal judiciaire est saisi, de demander, titre de question prjudicielle, une autorit administrative l'interprtation d'un acte d'administration obscur, ou bien un juge administratif l'apprciation de la validit de cet acte. 4 Le contentieux de la rpression. Il s'agit des cas exceptionnels o les tribunaux administratifs sont comptents pour la rpression d'infractions. a) Contentieux de Vannulation. 559. Aucune difficult dans cette hypothse, puisque c'est celle du recours pour excs de pouvoir. Nous savons depuis longtemps que ce recours ne peut tre port que devant le Conseil d'tat (v. p. 213). Il s'agit de faire annuler un acte d'administration pris en luimme, isolde l'opration dont il fait partie. Dans cet acte, qui est toujours un acte d'autorit, apparat la volont mme de la personne administrative dans ce qu'elle a de plus indpendant et de moins facile dfinir l'avance; l'apprciation de la validit de cet acte ne pouvait tre soumise qu'au juge prtorien par excellence. Rappelons qu'il existe des recours administratifs en forme de recours pour excs de pouvoir, qui sont galement ports devant le Conseil d'tat. (L. 5 avr. 1884, art. 67.) H. 44
690
LES JURIDICTIONS ET LA COMPTENCE b) Contentieux de pleine juridiction.
560. C'est ici que se rencontrent les plus grandes difficults, parce qu'il s'agit de saisir un juge de toute une situation cre par un acte d'une personne administrative, et il peut surgir deux questions ; on peut se demander: 1 S'il faut saisir un juge administratif au moyen d'un recours contentieux ordinaire, ou s'il faut saisir un tribunal judiciaire au moyen d'une action ordinaire; 2 Si une fois l'un de ces juges saisi du fond de l'affaire, il ne se prsentera pas des questions prjudicielles dont il faudra renvoyer l'examen l'autre juge. Une srie de rgles vont tre donnes pour trancher ces deux questions ; on s'apercevra qu'elles sont inspires par l'interprtation librale du principe de la sparation des pouvoirs que nous avons signale plus haut, c'est--dire qu'elles consacrent non seulement l'indpendance du pouvoir excutif vis--vis du pouvoir judiciaire, mais aussi l'indpendance du pouvoir judiciaire vis--vis de l'excutif. 561. I. De la juridiction tre saisie de qui doit a) Rgles en faveur des juridictions administratives. l'affaire. 1 Les juridictions administratives doivent tre saisies du contentieux de pleine juridiction soulev par les ACTES DE PUISSANCE C'est ainsi que le recours contentieux contre un dcret du PUBLIQUE. chef de l'tat liquidant une pension, ne saurait tre port que devant un tribunal administratif; de mme le recours contre une dcision ministrielle liquidant une dette; de mme, les recours en matire d'tablissements dangereux (p. 464). Cette rgle est fondamentale, l'acte de puissance publique est trop indtermin pour tre soumis l'apprciation du juge ordinaire. Si elle n'est pas d'une application frquente, cela tient ce qu'il y a peu d'actes de puissance publique qui puissent tre attaqus par un recours contentieux ordinaire. 2 Les juridictions administratives doiventtre saisies galement du DE PUISSANCE contentieux soulev par les OPRATIONS PUBLIQUE, moinsd'exception consacre par un texte. La rgle se justifie par cette considration, que dans les oprations de puissance publique les personnes administratives exercent des droits de puissance publique. Mais on s'explique par l mme qu'il y ait des exceptions, car, avec le temps, quelques-uns de ces droits de puissance publique se dfinissent tellement qu'on peut en confier l'examen aux juges ordinaires;
D'ATTRIBUTION DU PARTAGE
691
ou bien, raison de leur caractre dangereux, c'est la loi qui les a elle-mme dfinis exactement ; c'est ce qui est arriv pour les impts indirects et pour l'expropriation pour cause d'utilit publique, ces oprations sont tellement rglementes par la loi qu'on a pu sans difficult en abandonner le contentieux aux tribunaux judiciaires. Au contraire, les oprations de travaux publics, les impts directs, les oprations lectorales, sont dans la rgle, le contentieux en est encore compltement administratif. Pour les travaux publics, cela est mme tout fait frappant, car des consquences accidentelles de l'opration, comme des dommages causs aux personnes, sont considres comme entranant la comptence administrative. (V. nos470, 479). 1 Les tribunaux b) Rgles en faveur des tribunaux judiciaires. judiciaires doivent tre saisis du contentieux de pleine juridiction DE PERSONNE soulev par les OPRATIONS PRIVE, moins d'exception consacre par un texte. Nous avons vu quelques-unes de ces exceptions : les ventes et les concessions du domaine priv de l'tat, par exemple, qui sont de la comptence des conseils de prfecture ; les baux des sources minrales appartenant l'tat. (V. nos 532, 535.) 2 Lorsqu'il s'agit de la protection des droits individuels, notamment du droit de proprit, les tribunaux judiciaires peuvent tre saisis de demandes tendant compenser, par une indemnit pcuniaire, le dommage caus par une opration de puissance publique. Un exemple nous a t donn propos de la dlimitation des rivages de la mer (p. 518), et si, en matire de dommages permanents causs la proprit par des travaux publics, les tribunaux judiciaires ne peuvent pas tre saisis, cela tient ce qu'un texte formel attribue aux conseils de prfecture tout le contentieux des travaux publics. 562. II. Des questions tre prjudicielles qui peuvent souleves dans l'un ou l'autre sens. a) Questions prjudicielles en faveur des tribunaux administratifs. Toutes les fois que dans un litige pour le fond duquel un tribunal judiciaire est comptent,il se rencontre un acte d'administration ne faisant pas corps avec un contrat judiciaire1, dontil faut apprcier la validit ou dont le sens est contest, l'apprciation de cet acte doit tre renvoye la juridiction administrative ou l'autorit administrative, et le tribunal doit surseoir. 1. Si l'acte fait corps avec un contrat judiciaire, le tribunal judiciaire est comptent pour l'interprter, par exemple une dlibrationdu conseil municipal qui a dcid le bail d'un immeuble communal, une fois le bail pass. (Conflits, 12 juillet 1890.)
692
LES JURIDICTIONS ET LA COMPTENCE
S'il ne s'agit que d'apprcier l'existence de l'acte et si le texte n'en est pas contest, le tribunal judiciaire est comptent. Le meilleur exemple nous est donn en matire d'expropriation, au sujet de l'apprciation de l'arrt de cessibilit du prfet (p. 592). b) Questions prjudicielles en faveurdes tribunaux judiciaires. Il y a question prjudicielle toutes les fois que devant un tribunal : 1 une question de proprit1; 2 une administratif il se soulve : l'examen de ces questions question d'tat, de capacit, de domicile doit tre renvoy devant un tribunal civil, et il faut surseoir. De plus, il est admis que la comptence rpressive des conseils de prfecture ne va pas jusqu' leur permettre de condamner l'emprisonnement ; il faut, le cas chant, saisir le tribunal correctionnel. Tout cela repose sur cette ide que les tribunaux judiciaires sont gardiens de la proprit, de l'tat des personnes et de leur libert. Observation. Il y aurait lieu de passer en revue les diverses matires administratives, afin d'appliquer les rgles que nous venons de formuler. Ce serait un excellent exercice pratique. L'espace nous ; mais il est rendu trs facile par cela seul que manque pour le faire les actes d'administration ont t tudis part dans un livre prliminaire, et par la faon dont tous les droits de puissance publique des personnes administratives et tous leurs droits de personne prive ont t groups en deux titres diffrents du livre II. c) Contentieux de Vinterprtation. 563. Il y a contentieux de l'interprtation dans les cas o, conformment aux rgles qui prcdent, l'existence d'un acte d'administration, dont le sens est obscur ou dont la validit est conteste, forme question prjudicielle devant un tribunal judiciaire saisi d'un litige. Il faut donc deux conditions : 1 Qu'il y ait un acte d'administration dont le sens soit obscur, ou dont la validit soit attaque; 2 Que la question soit souleve l'occasion d'un litige n et actuel. L'interprtation d'un acte administratif obscur ne pourrait pas tre demande d'une faon principale en dehors de tout litige actuel. Quant la validit d'un acte administratif, elle peutbien tre attaque d'une faon principale, mais alors c'est par le recours pour excs de pouvoir, dans les dlais et avec les formes de ce recours, et elle aboutit l'annulation de l'acte; tandis que par la voie de la question prjudi cielle, la validit de l'acte peut tre attaque pendant trente ans, par un recours contentieux ordinaire qui ne bnficie pas de la dispense 1. Il en serait de mme d'une question d'existence de privilege. (C. d't. 28nov.1890.)
DU PARTAGE D'ATTRIBUTION
693
d'avocat, et cela n'aboutit qu' une dclaration d'illgalit de l'acte qui peut avoir son influence dans le procs, mais qui n'anantit pas l'acte. (C. d't. 26 juin 1891.) Il faut ajouter que l'interprtation d'un acte ou l'apprciation de sa validit peuvent paratre ncessaires, parce que de l dpend une dcision administrative qui est sur le point d'tre rendue. Dans ce cas, le Conseil d'tat admet que l'interprtation peut tre demande, soit par les parties intresses, soit d'office par le ministre. On assimile ainsi l'instance purement administrative d'o doit rsulter une dcision, un litige pendant devant un tribunal. 11 y a lieu de distinguer l'interprtation du sens d'un acte obscur et l'apprciation de la validit de l'acte. La question 564.I. Interprtation du sens de l'acte. est de savoir par qui doit tre donne celte interprtation. Est-ce par l'autorit administrative qui a fait l'acte, par application de la maxime ej us est interpretari cujus est candere; est-ce au contraire par la juridiction administrative? La jurisprudence et la doctrine paraissent sur ce point assez indcises, et il est visible que le Conseil d'tat cherche s'attribuer toute la comptence. 1 Il est reu que pour tous les actes dont le conseil de prfecture a le contentieux, l'interprtation appartient au conseil de prfecture, avec appel au Conseil d'tat, par exemple, en matire de travaux publics. 2 Pour les actes du chef de l'tat et mme pour les actes d'administration accomplis par les Chambres, le Conseil d'tat s'attribue comptence en premier et en dernier ressort. Avant la loi du 24 mars 1872, l'interprtation tait donne par dcret en Conseil d'tat, le Conseil estime que c'est un des cas o la justice retenue a t transforme par ladite loi en justice dlgue. 3 Pour tous les autres actes, soit des maires, soit des prfets, soit des ministres, on applique la rgle ejus est interpretari, et on s'adresse l'autorit qui a fait l'acte ; lorsquec'est une autorit infrieure, on peut remonter par des recours successifs jusqu'au ministre, et la dcision du ministre peut tre porte devant le Conseil d'tat. Mais le Conseil d'tat, estimant que ces recours en interprtation devant les autorits administratives sont des recours hirarchiques et non point des recours contentieux, leur applique la doctrine de l'arrt Bansais (v. p. 210), et, dans un but de clrit, autorise le recours au Conseil d'tat omisso medio contre la dcision de l'autorit infrieure (Cons. d'tat., 21 nov. 1873; 9 mars 1877; 4 avr. 1884). On peut mme prvoir que, par une nouvelle volution, le Conseil d'tat se considrera comme directement saisi par le jugement qui constate la
694
ET LA COMPTENCE LES JURIDICTIONS
question prjudicielle; l'autorit qui a fait l'acte ne sera plus du tout consulte, l'interprtation sera devenue compltement l'affaire des tribunaux. Ce sera une simplification. de la validit de l'acte. Cette 565. II. Apprciation apprciation est l'affaire des tribunaux administratifs, et non point celle des autorits administratives. Dans le cas o le conseil de prfecture ou bien le ministre ne sont pas comptents en vertu des textes, c'est le Conseil d'tat en sa qualit de juge de droit commun. (Arrt 28avr. 1882.) d) Contentieux de la rpression. 566. Renvoi ce que nous avons dit de la comptence rpressive des conseils de prfecture en matire de contraventions de grande voirie (p. 525). 3. Des conflits d'attribution et du tribunal des conflits.
567. Le partage d'attribution entre les tribunaux administratifs et les tribunaux judiciaires entrane fatalement des conflits. On entend par conflit une lutte de comptence entre deux autorits. Dans le cas qui nous occupe, la lutte de comptence constitue un conflit d'attribution parce que les deux autorits qui luttent l'une contre l'autre appartiennent deux pouvoirs diffrents, le pouvoir excutif et le pouvoir judiciaire. Dans le cas o la lutte de comptence s'tablit entre deux autorits appartenant au mme pouvoir, par exemple entre deux tribunaux judiciaires ou entre deux autorits administratives, il y a conflit de juridiction. Nous n'avons pas nous occuper ici du conflit de juridiction. On distingue deux espces de conflits d'attribution : Le conflit positif, lorsque les deux autorits se disputent la connaissance d'un litige; le conflit ngatif, lorsqu'au contraire les deux autorits se dclarent incomptentes. Les conflits d'attribution sont tranchs d'une faon juridictionnelle et cela donne naissance un contentieux spcial. des con568. Caractres du contentieux gnraux flits. a) Caractre de justice dlgue. Pendant longtemps le contentieux des conflits a t aux mains du gouvernement lui-mme
DES CONFLITS D'ATTRIBUTION
695
(1. 7-14 oct. 1790; 1. 21 fructidor an III, art. 27). Lorsque le Conseil d'tat fut rorganis, on lui confia la mission d'examiner les conflits ; arr. 13 brumaire an X); mais la dcision tait (R. 5 nivse an VIII toujours signe du chef de l'tat, c'est--dire que c'tait un cas de justice retenue. La Constitution du 4 novembre 1848 fit une tentative pour organiser un tribunal des conflits indpendant ; il fut organis en effet (R. 28 oct. 1849; 1, 4 fvrier 1850) et il rendit quelques dcisions; mais la Constitution de 1852, presque tout de suite, le supprima et revint au systme ancien. C'est la loi du 24 mai 1872 qui a dfinitivement organis un tribunal des conflits indpendant, et qui a fait du contentieux des conflits une justice dlgue. b) Caractre constitutionnel. Le contentieux des conflits a un caractre constitutionnel et le tribunal des conflits est une juridiction constitutionnelle. En effet, il s'agit de rgler les rapports de deux pouvoirs publics, et tout ce qui est relatif aux rapports des pouvoirs publics est constitutionnel. Il faut distinguer cependant entre le conflit positif et le conflit ngatif. Le conflit ngatif ne porte aucune atteinte la sparation des pouvoirs, puisque justement les deux autorits refusent de se saisir de l'affaire; le dbat n'a donc point d'importance constitutionnelle, il n'y a en jeu que l'intrt du particulier qui veut trouver un juge. Aussi le conflit constitue t-il dans ce cas une affaire contentieuse ordinaire; l'tat n'y intervient pas, les parties peuvent prendre des conclusions; les jugements rendus donnent lieu la perception du droit d'enregistrement; ils peuvent contenir condamnation aux dpens. Le conflit positif, au contraire, soulve en plein la question de la sparation des pouvoirs, aussi le dbat ne constitue-t-il pas uneaffaire contentieuse ordinaire: 1 l'tat intervient, non pas comme plaideur, mais titre de puissance publique; 2 les parties prives, qui figurent dans le litige, ne sont pas vraiment parties en cause et elles ne seraient pas admises prendre des conclusions; 3 les dcisions ne sont pas des jugements passibles du droit d'enregistrement; 4 elles ne peuvent prononcer aucune condamnation; 5 elles ne sont pas susceptibles d'opposition. Le 569. Organisation du tribunal des conflits. tribunal des conflits se compose : 1 Du garde des sceaux, prsident; 2 de trois conseillers d'tat en service ordinaire lus par les conseillers d'tat en service ordinaire; 3 de trois conseillers la Cour de cassation nomms par leurs col-
696
LES JURIDICTIONS ET LA COMPTENCE
lgues; 4 de deux membres et deux supplants, qui seront lus par la majorit des autres juges dsigns aux paragraphes prcdents. Les membres du tribunal des conflits sont soumis la rlection tous les trois ans et indfiniment rligibles. Ils choisissent un vice-prsident au scrutin secret et la majorit absolue des voix. Ils ne pourront dlibrer valablement qu'au nombre de cinq membres prsents au moins. (L. 24 mai 1872, art. 251.) Les fonctions du ministre public seront remplies par deux commissaires du gouvernement, choisis tous les ans par le prsident de la Rpublique, l'un parmi les maitres des requtes au Conseil d'tat, l'autre dans le parquet de la Cour de cassation. Il sera adjoint chacun de ces commissaires un supplant choisi de la mme manire et pris dans les mmes rangs, pour le remplacer en cas d'empchement. Ces nominations doivent tre faites chaque anne, avant l'poque fixe pour la reprise des travaux du tribunal. (L. 4 fvr. 1850, art. 6.) Les dcisions du tribunal des conflits ne pourront tre rendues qu'aprs un rapport crit fait par l'un des membres du tribunal et sur les conclusions du ministre public. (L. 4 fvr. 1850, art. 4.) Dans aucune affaire, les fonctions de rapporteur et celles de ministre public ne pourront tre remplies par deux membres pris dans le mme corps. (L. 4 fvr. 1850, art. 7.) Les avocats au Conseil d'tat et la Cour de cassation peuvent tre chargs, par les parties intresses, de prsenter devant le tribunal des conflits des mmoires et des observations. (R. 1849, art. 4.) Les dcisions du tribunal des conflits portent en tte la mention le tribunal des conflits. Elles suivante : Aunomdu peuple franais, sont motives. Les noms des membres qui ont concouru la dcision y sont mentionns. La minute est signe par le prsident, le rapporteur et le secrtaire. (R. 28 oct. 1849, art. 9.) 570. Procdure du conflit positif d'attribution'.
1. On remarquera que, part les deux membres lus par les sept premiers juges, le tribunal des conflits est compos par gales parties de reprsentants du pouvoir judiciaire et de reprsentants de la juridiction administrative; le garde des sceauxlui-mme a un caractre mixte, puisqu'il est en mmetemps ministre de la justice, suprieur hirarchique des magistrats de l'ordre judiciaire, et prsident du Conseild'tat. Il tait impossible, en effet, de ne pas donner une reprsentation gale aux deux pouvoirs en prsence. Mais, d'un autre ct, il fallait bien les dpartager; c'est cette proccupation qu'on a obi en introduisant les deux membres lus par la majorit de leurs collgues. C'est un lment qui n'existait pas dans le tribunal des conflits de 1848. 2. Pour la procdure du conflit ngatif, v. R. 1849,art. 17 24.
D'ATTRIBUTION DES CONFLITS
697
Marche gnrale de la procdure du conflit. Il faut partir de cette ide que la procdure du conflit est destine protger surtout la comptence des tribunaux administratifs contreles empitements des tribunaux judiciaires; que, par consquent, l'hypothse pratique du conflit est celle o un tribunal judiciaire s'est saisi d'une question que le gouvernement estime tre de la comptence des tribunaux administratifs Ds lors on comprend qu'il y ait deux phases dans la procdure du conflit : 1 l'lvation du conflit qui a pour but de forcer le tribunal judiciaire surseoir, et qui porte la question d'attribution devant le tribunal des conflits; 2 le jugement du conflit devant le tribunal des conflits. D'ailleurs, le tribunal des conflits se renferme dans la question qui lui est pose : l'arrt de conflit lui pose la question de savoir si oui ou non les tribunaux ordinaires sont valablement saisis; le tribunal des conflits rpond affirmativement en annulant l'arrt de conflit, il rpond ngativement en validant l'arrt ; dans cette dernire hypothse le tribunal judiciaire est dessaisi, mais le tribunal des conflits n'indique jamais quelle est la juridiction comptente, c'est aux parties la rechercher. 1 lvation du conflit. (0. 1er juin 1828.) C'est le gouvernement reprsent par le prfet qui a la mission d'lever le conflit. Il agit l dans l'intrt de la puissance publique. Aussi peut-il lever le conflit, non seulement dans les instances o l'tat est partie en cause, mais aussi dans celles auquelles l'tat est compltement tranger. Dans les premires annes de la Restauration, il avait t fait un tel abus des conflits, que le gouvernement, pour donner une satisfaction l'opinion publique, fut oblig de restreindre lui-mme sa libert d'action. On ne put pas dterminer limitativement les cas de conflit, cela tait impossible faire d'une faon directe, pour la bonne raison que les actes de puissance publique qui doivent tre protgs par le conflit chappent toute numration ; maison tourna la difficult en indiquant certaines juridictions devant lesquelles le conflit ne pourrait pas tre lev, et en dterminant, une procdure rigoureuse. Ce fut l'objet de l'ordonnance du 1erjuin 1828. 2. L'art. 26, 1.24 mai 1812, donne bien aux ministres le droit d'lever le conflit devant la section du contentieux du Conseil d'tat, et, peut-tre, ce droit pourrait-il tre exerc par le ministre de la justice pour faire respecter la comptence des tribunaux judiciaires. Maisil faut remarquer : 1 que le conflit ne pourrait tre lev que devant la section du contentieux du Conseil d'tat et non point devant toutes les juridictions administratives; 2 que cette disposition a beaucoup plutt pour objet de soustraire certaines dcisions gouvernementales, mme l'apprciation du Conseil d'tat.
698
LES JURIDICTIONS ET LA COMPTENCE
a) Des juridictions devant lesquelles le conflit peut tre lev. Le texte de l'ordonnance carte un certain nombre de juridictions; de plus, la jurisprudence a admis que devant certaines autres le conflit ne pouvait pas tre lev raison de l'impossibilit d'accomplir certaines formalits de la procdure. En rsum, le conflit ne peut pas tre lev : 1 Devant les tribunaux criminels. (0. 1828, art. 1er.) Par consquent, alors mme qu'un acte administratif formerait l'un des lments d'un dbat criminel, il ne saurait y avoir lvation de conflit pour en renvoyer l'apprciation un tribunal administratif, titre de question prjudicielle. Mais cela ne s'applique qu'au cas o c'est l'action publique qui est porte devant la juridiction criminelle, non point au cas o ce serait une action civile. (Trib. confl., 22 dc. 1880.) 2 Devant les tribunaux correctionnels, le conflit ne peut tre lev que dans les deux cas suivants (art. 2) : 1er cas. Lorsque la rpression du dlit est attribue par une disposition lgislative l'autorit administrative, comme en matire de contravention de grande voirie ; 2e cas. Lorsque le jugement rendre par le tribunal dpend d'une question prjudicielle dont la connaissance appartient l'autorit administrative, en vertu d'une disposition lgislative. Dans ce cas, le conflit ne pourra tre lev que sur la question prjudicielle. 3 Devant les tribunaux de simple police, le conflit ne peut pas tre lev parce que le procureur de la Rpublique figure dans la procdure du conflit et que devant les tribunaux de simple police, il y a bien un ministre public, mais ce n'est pas le procureur de la Rpublique. 4 Devant les juges de paix et devant les tribunaux de commerce,mme raison. 5 Devant la Cour de cassation, le conflit ne peut pas tre lev, mais pour un autre motif, parce que tous les jugements dfrs la Cour de cassation sont des jugements en dernier ressort, et que le conflit ne saurait tre lev aprs des jugements en dernier ressort. (Art. 4.) Au contraire, le conflit peut tre lev devant les tribunaux d'arrondissement et devant les cours d'appel, c'est l son domaine. Il peut mme tre lev devant le prsident du tribunal civil statuant en rfr. (Trib. confl. 11 janv. 1873.) b) Moment o le conflitpeut tre lev. Hors le cas prvu ci-aprs par le dernier paragraphe de l'art. 8 de la prsente ordonnance (le cas o le jugement aurait t rendu avant l'expiration des dlais qu' l'adminis tration pour lever le conflit) il ne pourra jamais tre lev de conflit aprs des jugements rendus en dernier ressort ou acquiescs, ni aprs des arrts dfinitifs. Nanmoins, le conflit pourra tre lev en cause d'appel s'il ne l'a pas t en premire instance ou s'il l'a t irrgulirement. (Art. 4.) c) Autorit comptente pour lever le conflit. Nous savons que c'est le prfet.
DES CONFLITS D'ATTRIBUTION
699
d) Formes requisespourl'lvationduconflit. 1 Dclinatoire d'incomptence. Lorsqu'un prfet estimera que la connaissance d'une question porte devant un tribunal de premire instance est attribue par une disposition lgislative l'autorit administrative, il pourra, alors mme que l'administration ne serait pas en cause, demander le renvoi de l'affaire devant l'autorit comptente. Acet effet, le prfet adressera au procureur de la Rpublique un mmoire dans lequel sera rapporte la disposition lgislative qui attribue l'administration la connaissance du litige. Le procureur de la Rpublique fera connatre, dans tous les cas, au tribunal, la demande forme par le prfet, et requerra le renvoi si la revendication lui parat fonde. (0. 1828, art. 6.) Le tribunal rend un jugement sur le dclinatoire, pour l'accueillir, ou le rejeter. Si le dclinatoire est rejet, dans la quinzaine de cet envoi (du juge ment de rejet) pour tout dlai, le prfet du dpartement, s'il estime qu'il y ait lieu, pourra lever le conflit. (Art. 8 et 11.) 2 Arrt de conflit. Le conflit est lev par un arrt que prend le prfet et qu'il fait dposer au greffe du tribunal avec les pices l'appui : l'arrt devra viser le jugement intervenu et l'acte d'appel, s'il y a lieu ; la disposition lgislative qui attribue l'administration la connaissance du point litigieux, y sera textuellement insre. (Art. 9.) Si l'arrt a t dpos au greffe en temps utile, le greffier le re mettra immdiatement au procureur de la Rpublique, qui le commu niquera au tribunal runi dans la chambre du conseil, et requerra que, conformment l'art. 27 de la loi du 21 fructidor an III, il soit sursis toute procdure judiciaire. (Art. 12.) Cette procdure doit tre observe rigoureusement peine de non-recevabilit du conflit : notamment la formalit du dclinatoire d'incomptence est essentielle, et alors mme que les parties auraient propos elles-mmes une exception d'incomptence que le tribunal aurait rejete, le prfet doit proposer son dclinatoire ; en effet, le prfet agit au nom dela puissance publique, tandis que la partie agissait en son nom priv, et, au nom de la puissance publique, il convient que le tribunal soit invit reconnatre volontairement son incomptence. De mme, le dlai de quinzaine dans lequel doit tre pris l'arrt de conflit doit tre rigoureusement observ. 2 Jugement du conflit. (0.1828; 0.12 mars 1831; R. 28 oct. 1849). Aprs la communication ci-dessus, l'arrt du prfet et les pices seront rtablis au greffe, o ils resteront dposs pendant quinzejours. Le procu reur de la Rpublique en prviendra de suite les parties ou leurs avous, lesquels pourront en prendre communication sans dplacement, et re mettre, dans le mme dlai de quinzaine, au parquet du procureur de la Rpublique, leurs observations sur la question de comptence, avec tous les documents l'appui. (Art. 13. 0. 1828.) Le procureur de la Rpublique informera immdiatement le garde
700
LES JURIDICTIONS ET LA COMPTENCE
des sceaux, ministre de la justice, de l'accomplissement desdites forma lits, et lui transmettra en mme temps l'arrt du prfet, ses propres observations et celles des parties, s'il y a lieu, avec toutes les pices jointes. La date de l'envoi sera consigne sur un registre ce destin. (Art. 14.) . Transmission immdiate par le ministre au secrtaire du tribunal des conflits. Les rapporteurs sont dsigns par le ministre de la justice, immdiatement aprs l'enregistrement des pices au secrta riat du tribunal. (R. 1849, art. 6.) Dans les cinq jours de l'arrive, l'arrt de conflit et les pices sont communiqus au ministre dans les attributions duquel se trouve plac le service auquel se rapporte le conflit. La date de la communication est consigne sur un registre ce destin. Dans la quinzaine, le minis tre doit fournir les observations et les documents qu'il juge convenables sur la question de comptence. Dans tous les cas, les pices seront rta blies au tribunal des conflits dans le dlai prcit. (R. 1849. art. 12.) Les avocats des parties peuvent tre autoriss prendre communica tion des pices au secrtariat, sans dplacement. (R. art. 13.) Dans les vingt jours qui suivent la rentre des pices, le rapporteur fait au secrtariat le dpt de son rapport et des pices. (R., art. 14.) Le dossier est communiqu au commissaire du gouvernement. Le rapport est lu en sance publique ; immdiatement aprs le rapport, les avocats des parties peuvent prsenter des observations orales. Le commissaire du gouvernement est ensuite entendu dans ses conclusions. (R. 1819, art. 8.) Il sera statu sur le conflit dans le dlai de deux mois dater de la rception des pices au ministre de la justice. Si, un mois aprs l'expiration de ce dlai, le tribunal (primitivement saisi) n'a pas reu notification de la dcision, il pourra procder au jugement de l'affaire. (0. 12 mars 1831, art. 7.) ET DE DELA JURIDICTION ADMINISTRATIVE 2. SPARATION L'ADMINISTRATION ACTIVE Article Ier. Sparation des juges adminitrateurs. administratifs et des
571. Il est bon que pour le contentieux soulev par les actes et les oprations de puissance publique, il y ait une juridiction administrative, nous en avons donn plus haut les raisons ; mais il est nessaire que cette juridiction soit spare de l'administration active. Cela est ncessaire: 1 Dans l'intrt de la justice, il ne faut pas qu'un juge soit juge et partie; or, un administrateur qui prononcerait comme juge sur les litiges provoqus par une dcision administrative, serait forcment
DE L'ADMINISTRATION ET DE LA JURIDICTION701 SPARATION juge et partie, car cette dcision est son uvre, ou celle d'un infrieur hirarchique. 2 Dans l'intrt de la mthode et des progrs du droit: si le mme homme est la fois administrateur et juge, les dcisions qu'il prendra en ces deux qualits auront une tendance se confondre, les dcisions purement administratives prendront la couleur de jugements; or, cela est fcheux, car les dcisions administratives ne sont pas du tout des jugements, ce sont des manifestations de volont des personnes administratives, analogues aux volonts que les pirticuliers manifestent en exerant leurs droits (V. p. 185 et s.) On peut dire que cette ncessit de la sparation de la juridiction et de l'administration activeest aujourd'hui comprise de tout le monde. L'ide est accepte, en principe, par toute la doctrine et toute la jurisprudence contemporaines, mais ce progrs considrable est tout rcent. du principe de la sparation au 572. Application En Conseil d'tat et aux conseils de prfecture tant que la juridiction administrative est confie au Conseil d'tat ou aux conseils de prfecture, on voit tout de suite que la sparation est ralise; en effet, ces tribunaux ne sont point des autorits administratives. Ils participent, il est vrai, dans une certaine mesure l'administration active, puisque ce sont en mme temps des conseils administratifs dont les autorits administratives prennent les avis. Le Conseil d'tat peut avoir prpar titre consultatif le projet d'un dcret, et tre appel ensuite titre contentieux statuer sur les litiges soulevs par ce dcret. Le conseil de prfecture peut aussi avoir donn des avis au prfet dans des matires qui deviennent par la suite contentieuses. Il y a l un lger inconvnient. Mais d'une part, dans ces assembles, du moins au Conseil d'tat, des prcautions sont prises pour que les mmes conseillers n'aient pas statuer au contentieux, sur les consquences d'un acte sur lequel ils auraient mis un avis titre administratif. D'autre part, autre chose est avoir donn son avis pour une dcision prendre, autre chose est avoir pris la dcision soi-mme; le conseiller ne peut jamais avoir le mme amour-propre d'auteur que l'administrateur. Le lger inconvnient que prsente la confusion des attributions de juge et de conseiller administratif, est compens par un trs rel avantage. Du moment qu'il y a des tribunaux administratifs, il est naturel qu'ils soient composs d'hommes comptents; or, qui pourrait tre plus comptent que ces conseillers ordinaires des administrateurs
702
ET LA COMPTENCE LES JURIDICTIONS
qui, en vue des avis donner, sont obligs d'tudier toutes les affaires? A condition que ces corps soient srieusement constitus, que le personnel y ait des garanties d'indpendance, ce qui est dj ralis pour le Conseil d'tat, ce qui se ralisera pour les conseils de prfecture, cene sont pas les fonctions de conseiller administratif qui nuiront aux fonctions de juge; ce sont au contraire les fonctions de juge qui fortifieront celles de conseiller et qui donneront aux avis plus de poids. du principe 573. Application de la sparation aux Question administratives. autorits du ministrejuge. La consquence rigoureusedu principe de la sparation de l'administration active et de la juridiction, est que les autorits administratives proprement dites ne sauraient tre des juges. Donc, ni les ministres, ni les prfets, ni les maires, ni aucune des assembles dlibrantes, conseils gnraux, conseils municipaux, ne sauraient tre des juges. Une exception doit tre faite seulement pour le chef de l'tat dans les cas de justice retenue. (V. n 575.) 1 Cette doctrine n'a jamais prsent de difficult qu'en ce qui concerne les ministres. Les conseils municipaux, les conseils gnraux n'ont point d'attributions contentieuses; il est vrai que les conseils gnraux reoivent quelquefois des recours contre les dcisions de leur commission dpartementale (1. 1871, art. 86-88), mais ces recours ont toujours t considrs comme purement administratifs. Les prfets, les maires eux-mmes, ont bien quelques attributions contentieuses, mais elles rsultent de textes anciens et sont considres comme des anomalies. Pour les ministres, au contraire, les rsistances ont t trs grandes, et pendant longtemps, dans la plupartdes dcisions qu'ils rendaient, ils ont t considrs comme tant des juges, non point des administrateurs. Il en tait ainsi dans tous les cas o la dcision tait susceptible d'un recours contentieux au Conseil d'tat. On affirmait que cette dcision tait elle-mme un premier jugement, et que le recours au Conseil d'tat n'tait qu'un recours en appel. 1. Le chef de l'tat reprsente ici le pouvoir excutif dans ce qu'il a de plus lev, en tant qu'ilest la source historique du pouvoirjudiciaire, et mme du pouvoir lgislatif.
ET DE LA JURIDICTION 703 DE L'ADMINISTRATION SPARATION I. L'une des causes de cette erreur rsidait dans une locution que nous avons rapporte n 542; on avait pris l'habitude d'appeler dcision contentieuse une dcision administrative prise en une matire o il existait un recours contentieux au profit de la partie, et on en tait venu croire que la dcision tait contentieuse aussi en ce sens qu'elle quivalait elle-mme un jugement. II. Une autre cause d'erreur provenaitde ce que, par les circonstances dans lesquelles elle se produisent ou par leurs effets, quelques-unes des dcisions ministrielles rappellent des jugements; c'est surtout, en effet, dans les deux cas suivants, qu'on voulait y voir des jugements : 1 Dans le cas d'actes de gestion : dcision ministrielle liquidant une dette de l'tat, arrt de dbet mettant un dtenteur de deniers publics en demeure de restituer, etc. Dans ces hypothses, la dcision, qui est excutoire par elle-mme comme tout acte d'administration, devient dfinitive si l'on n'a pas form recours dans le dlai de trois mois, de mme qu'un jugement devient dfinitif par l'expiration des dlais d'appel. On oubliait que c'est la condition de tous les actes d'administration, les recours contre ces actes sont enferms dans des dlais trs courts, parce que sans cela la marche de l'administration serait entrave. L'administration agit beaucoup, il est ncessaire que les consquences de ses actes soient rapidement rgles. Contre le rle des contributions directes qui est rendu excutoire par arrt du prfet, le recours n'est possible galementque pendant trois mois. On n'a jamais prtendu, cependant, que cet arrt du prfet ft un jugement. Dans le cas d'arrt de dbet, cet arrt est suivi d'une contrainte dlivre par le ministre des finances, qui entrane hypothque judiciaire comme un jugement; on s'est beaucoup appuy sur cet argument, il est bien mauvais cependant : d'abord parce que ce n'est pas l'arrt de dbet lui-mme, qui est pourtant la vritable dcision, qui entrane l'hypothque, mais la contrainte qui n'est qu'une voie d'excution; ensuite, parce qu'il est tout naturel que le pouvoir excutif ait le droit d'employer des voies d'excution nergiques; n'est-ce point lui qui donne aux jugements eux-mmes leur force excutoire? Ce qui tranche la question, ce sont les observations suivantes: a) Il est de principe que le juge ne doit pas tre juge et partie; or, ici, le ministre est ncessairement partie dans l'acte comme ayant exerc les droits de l'tat, donc il ne peut pas tre juge. (2) Quand un jugement en premier ressort est frapp d'appel, le juge du premier ressort ne vient point lui-mme dfendre son jugele juge d'appel ment devant ; or, le ministre vient dfendre sa dcision
104
LES JURIDICTIONS ET LA COMPTENCE
devant le Conseil d'tat; cette dcision ne peut donc pas tre un vritable jugement. ) Quand une juridiction est soumise l'appel, ses jugements sont le mme juged'appel; or, les dcisionsdes ministres tous ports devant sont frapps de recours, tantt devant le Conseil d'tat et tantt devant les conseils de prfecture (en matire de travaux publics). Ces recours ne sont donc point des appels contre des jugements, mais des recours en premire instance contre des actes d'administration. 2 Dans le cas de dcision sur recours hirarchique. Dans cette hypothse, dit-on, le ministre statue bien la faon d'un juge, puisqu'il statue surune dcision quia dj le caractre d'un acte d'administration. Nous avons rpondu par avance cet argument lorsque nous nous sommes occups du recours hirarchique (v. p. 208). Ce recours a beau ressembler un recours contentieux, il est purement administratif, et la dcision ministrielle n'est qu'un second acte d'administration qui vient en annuler, en rformer ou en confirmer un premier. C'est l'action hirarchique qui s'exerce sollicite par un recours, mais qui pourrait aussi bien s'exercer d'office. Ellene ne change point de nature par ce seul fait qu'elle est sollicite. Ainsi qu'on l'a fait observer trs justement, il faudrait admettre alors que le prfet est un juge quand il annule l'acte d'un maire, que le conseil gnral est un juge quand il annule une dlibration de la commission dpartementale, si bien que dans la hirarchie administrative on chercherait vainement un administrateur, il n'y aurait plus que des juges 1. En rsum, sauf dans les hypothses exceptionnelles que nous numrerons plus loin, le ministre n'a pas de vritable juridiction; les dcisions qu'il prend sont des actes d'administration, soit des actes de gestion, soit des actes d'autorit, notamment dans le cas de dcision sur recours gracieux. Cela entrane quelques consquences: a) Une dcision ministrielle rendue par dfaut n'est pas susceptible ; 20 juill. 1877; d'opposition. (Cons. d't. 24 janv. 1872; 12 nov.1875 20fvr. 1880.) ) Une dcision ministrielle peut tre rapporte tant qu'elle n'a pas cr de droit acquis au profit d'un tiers. (Cons. d't. 19 aot 1867; 12 aot 1879.) ne sont ) Les dcisions ministrielles, n'tant pas des jugements, toute sentence la de droit soumises laquelle d'aprs rgle plein pas doit tre motive. (Cons. d't. 30avr. 1880; 2 juill. 1880.) 1. M. Laferriere, Trait de la juridiction administrative, J, p. 405.
DLGUE LA JUSTICE RETENUE ET LA JUSTICE
705
Article II. Limites des pouvoirs de la juridiction administrative sur les actes de l'administration active. 574. L'administration active, qui tend de plus en plus se sparer de la juridiction administrative, a quelque peu besoin, pour garder sa libert d'action, d'tre protge contre les entreprises de celle-ci. Elle est suffisamment protge par les rgles suivantes: 1 Il y a des actes qui, raison de leur forme ou de leur nature, chappent tout recours contentieux. a) Les actes du parlement, alors mme que dans le fond ce sont des il en actes d'administration, chappent tout recours contentieux ; est ainsi des lois d'affaires qui dcident des travaux ou qui sont des actes de tutelle pour les dpartements et les communes il en est ainsi mme des dcisions des commissions parlementaires mais l'inverse il n'est pas admis qu'un acte d'administration, approuv par un ordre du jour des Chambres, chappe par l au recours contentieux. (Cons. d't. 20 mai 1887.) b) Les lois, les dcrets-lois, les rglements d'administration publique rendus en excution d'une loi chappent tout recours contentieux. c) Les actes dits de gouvernement chappent aussi au recours contentieux (v. p. 191). Dans toutes ces hypothses, si le Conseil d'tat voulait indment examiner l'acte, le ministre pourrait lever le conflit devant la section du contentieux. (L. 24 mai 1872, art. 26.) 2 Comme toutes les juridictions, les juridictions administratives ne peuvent statuer que lorsqu'elles sont saisies par un recours rgulier. 3 En principe le recours form n'est pas suspensif de l'excution de l'acte administratif; cette suspension peut cependant tre ordonne par mesure spciale. 4 Lorsqu'un acte est annul, l'administration reste libre de le refaire comme elle l'entend, ou mme de ne pas le refaire. 5 A part les annulations ou les rformations d'actes, le contentieux est purement pcuniaire; c'est--dire que, mme dans le contentieux de pleine juridiction, l'administration ne peut jamais tre condamne qu' une somme d'argent, elle ne peut pas tre condamne une certaine prestation avec clause pnale pour chaque jour de retard. 6 Enfin comme il n'y a pas contre l'tat de voies d'excution, l'excution des condamnations est toujours volontaire de sa part. Article III. Des cas de juridiction gouvernementale.
575. Il existe un certain nombre de cas o de vritables dcisions H. 45
706
LES JURIDICTIONS ET LA COMPTENCE
juridictionnelles sont rendues par le gouvernement la suite de vritables recours, qui portent dans la pratique le nom de recours administratifs ou recours gouvernementaux : telles les dcisions en matire de prises maritimes, en matire de recours pour abus. Nous sommes trs dispos voir l des hypothses de justice retenue. On dit que 576. Justice retenue, justice dlgue. la justice est retenue, lorsque la dcision juridictionnelle est prise sous la signature du chef du pouvoir excutif, et par consquent sous sa responsabilit. On dit que la justice est dlgue, lorsque la dcision juridictionnelle est prise sous la signature d'autorits spciales constitues cet effet. Historiquement, pour un ordre de contestations dtermin, la justice commence presque toujours par tre retenue; puis plus tard elle est dlgue. De sorte que, d'une part, la justice actuellement dlgue a t auparavant de la justice retenue; et que, d'autre part, il y a toujours un peu de justice retenue, parce que des contestations nouvelles se rvlent continuellement pour lesquelles d'abord la justice est retenue. La vrit de ces observations est confirme par l'histoire du dveloppement de la juridiction administrative en ce sicle. I. Actuellement, la justice administrative est presque tout entire dlgue; mais elle a commenc par tre retenue. En effet, jusqu' la loi du 24 mai 1872, toutes les dcisions du Conseil d'tat en matire contentieuse taient prises sous la signature du chef de l'tat; sous l'empire, cela s'appelait des dcrets en Conseil d'tat, sous la monarchie, des ordonnances en Conseil d'tat, cela ne pouvait pas s'appeler des arrts du Conseil d'tat. Or, nous le verrons plus loin, le Conseil d'tat, par la cassation ou par l'appel, se subordonne toutes les juridictions administratives, de sorte que, par son intermdiaire, toute la justice administrative tait retenue. De plus, le Conseil d'tat tait juge des conflits, la juridiction des conflits tait donc encore de la justice retenue. Depuis la loi du 24 mai 1872, toutes ces justices sont, au contraire, dlgues. Cette loi donne en effet au Conseil d'tat un pouvoir propre en matire contentieuse, de telle sorte que ses dcisions ne sont plus signes du chef de l'tat, mais du vice-prsident du Conseil d'tat, et qu'elles mritent maintenant le nom d'arrts. De plus, la mme loi ayant organis un tribunal des conflits distinct, a galement donn au prsident de ce tribunal le droit de signer les arrts sur conflit.
DLGUE ET LA JUSTICE LA JUSTICERETENUE
707
La loi du 24 mai 1872 n'a fait d'ailleurs que consacrer lgislativement ce qui depuis longtemps tait pass dans les faits, savoir que la vritable autorit contentieuse rsidait dans le Conseil d'tat et que le visa du chef de l'tat n'tait qu'une formalit. II. Il subsiste, malgr tout une justice administrative retenue. Au lendemain de la loi du 24 mai 1872, on a t trs port croire que toute la justice administrative tait dlgue, qu'il ne subsistait plus du tout de justice retenue. Cependant, on se trouvait en prsence d'un certain nombre de recours qui aboutissaient des dcrets en Conseil d'tat, et qui ressemblaient par consquent beaucoupaux recours contentieux d'avant 1872; on se borna les appeler recours administratifs ou recours en annulation administrative, et on affirma que c'taient des recours administratifs, non point des recours contentieux. Mais quelques-uns de ces recours ont des formes consacres qui se ; il est mme un cas, celui du rerapprochent des formes contentieuses cours contre les dcisions du Conseil des prises maritimes, o le ministre des avocats au Conseil d'tat est obligatoire (Arr. 7 vent. an XII). Ce serait, croyons-nous, bien comprendre la marche de l'volution historique en ces matires, que de considrer la plupart de ces recours, comme tant de vritables recours contentieux pour lesquels la justice est retenue. La consquence serait que les dcisions sur ces recours seraient dfinitives et ne pourraient en aucun cas tre attaques, ni par un recours contentieux, ni par le recours de l'art. 40 du dcret de 1806 dont il va tre parl plus bas. Cette observation a un caractre trop scientifique pour que nous y insistions davantage. Disons seulement que nous sommes heureux de constater dans une tude toute rcente sur le contentieux administratif, la trace d'une opinion trs voisine de la ntre1. Les recours dits administratifs, qui tendent ainsi ds maintenant vers le recours contentieux, sont les suivants : 1 Les recours au Conseil d'tat contreles dcisions du conseil des prises en matire de prises maritimes; 2 Les recours en matire d'appel comme d'abus; 3 Les recours relatifs au privilge de la Banque de France2; 4 Les recours des prfets tendant l'annulation des dlibrations des conseils gnraux, en vertu des art. 33 et 47, l. 10 aot 1871 ; 1. Rpertoire de Bquel,v Contentieux,n 543, tude de M. Bquet. 2. Cestrois premiers recours sont signals par M. Bquet, loc. cit.
708
ET LA COMPTENCE LES JURIDICTIONS
5 Les recours forms en vertu de l'art. 13,l. 21 juin 1865, contre les arrts des prfets qui creraient des associations syndicales autorises en dehors des cas prvus par la loi ; 6 Les recours prvus par l'art. 40 du dcret du 22juillet 1806, qui tendent faire rapporter ou rformer par la voie administrative des dcrets rendus aprs dlibration du Conseil d'tat en matire non contentieuse. Ces recours ne font pas double emploi avec le recours pour excs de pouvoir, bien que le recours pour excs de pouvoir soit, lui aussi, actuellement admis contre les dcrets rendus en Conseil d'tat. Le recours du dcret de 1806est plus largeque le recours pourexcs de pouvoir, il peut atteindre mme des actes discrtionnaires et il peut aboutir la rformation de l'acte, non pas seulement son annulation1. 577. Du recours pour abus. Le recours pour abus tant l'un des plus importants de ces recours administratifs que l'on peut considrer comme contentieux en vertu d'une justice retenue, nous saisissons cette occasion de donner sur lui quelques dtails. On a vu, p. 28 et s., quels sont les rapports de l'tat avec l'glise ou avec les glises. L'autorit ecclsiastique est considre par le concordat et par les articles organiques, comme une autorit indpendante certains gards de l'autorit civile reprsente par le pouvoir excutif. Il ya entre l'autorit civile et l'autorit religieuse une sparation des pouvoirs, qui, par certains cts, est analogue la sparation constitutionnelle qui existe entre le pouvoir excutif, le pouvoir lgislatif et le pouvoir judiciaire. Entre ces deux autorits spares, mais agissant sur les mmes hommes, il fallait ncessairement prvoir des empitements et des conflits et trouver le moyen de les trancher. Les art. 6 et 7 de la loi du 18 germinal an X dclarent expressment maintenir, cet effet, l'antique institution de l'appel comme d'abus; l'art. 6 l'institue aussi pour le culte protestant, et l'art. 55, Ordonn. 25 mai 1844, pour le culte isralite. sicle; il servit d'aL'origine de l'appel comme d'abus remonte au XIVe bord la royaut restreindre la comptence des juridictions ecclsiassicle, il fut tendu non plus seulement aux dcitiques ; partir du XVIe sions desjuridictions ecclsiastiques, mais aux actes des autorits; il tait port devant les parlements. Actuellement, comme il n'y a plus de juridictions ecclsiastiques, il ne sert plus que contre les actes des autorits, et il mrite d'tre appel non plus appel comme d'abus, mais recours ; il est port au gouvernement statuant en Conseild'tat. pour abus 1. Nous devons reconnatre que, actuellement, le Conseil d'tat ne considre pas du tout ce recours comme conteutieux ; au contraire il est admis que la dcision sur ce recours pourrait, le cas chant, tre attaque au contentieux, ce qui fait un singulier chafaudagede recours.
LA JUSTICERETENUEET LA JUSTICEDLGUE
709
a) Dfinition. Le recours pour abus est un recours port devant le chef de l'tat statuant en son Conseil d'tat, l'effet d'obtenir la censure d'un acte de l'une ou de l'autre des autorits ecclsiatique ou civile violant les rapports tablis. Il faut donc faire attention: 1que le recours protge aussi bien l'autorit ecclsiastique que l'autorit civile; 2 que son rsultat est une censure purement doctrinale de l'acte, une dclarationd'abusqui peut tre insre au Bulletin des Lois ou mme affiche, mais qui n'entrane aucune autre consquence, pas mme l'annulation de l'acte. b) Des divers cas d'abus. I. De la part des autorits ecclsiastiques, les cas d'abus sont au nombre de cinq : 1 l'usurpation ou l'excs de pouvoir; 2 la contravention aux lois et rglements de la Rpu blique ; 3 l'infraction des rgles consacres par les canons reus en France ; 4 l'attentat aux liberts, franchises et coutumes de l'glise gallicane; 5 et toute entreprise ou tout procd qui, dans l'exercice du culte, peut compromettre l'honneur des citoyens, troubler arbitrairement leur conscience, dgnrer contre eux en oppression ou en injure ou en scandale public. (Art. 6, 1. 18 germ. an X.) II. De la part des autorits civiles, il y aura pareillement recours au Conseil d'tat, s'il est port atteinte l'exercice public du culte et la libert que les lois et rglements garantissent ses ministres. (Art. 7.) c) De l'exercice du recours. Le recours comptera toute personne intresse, dfaut de plainte particulire, il sera exerc d'office par les prfets. (Art. 8, 1er.) Il n'y aura de plainte particulire que dans le cinquime cas de recours pour abus contre une autorit ecclsiastique, et dans les cas de recours contre les autorits civiles. d) Du cas o l'acte qui provoque le recours pour abus constitue en mme temps une infraction la loi pnale. La question, dans cette hypothse, est de savoir si la dclaration d'abus n'est pas le prliminaire indispensable de la poursuite de l'ecclsiastique raison de l'infraction. Lorsque l'infraction n'a pas t commise dans l'exercice des fonctions sacerdotales, on s'accorde gnralement reconnatre que les tribunaux ordinaires peuvent tre saisis directement. Mais la question est plus dlicate lorsque l'infraction est commise dans l'exercice des fonctions sacerdotales, par exemple dans le cas d'expressions injurieuses employes en chaire. Avant le dcret du 19 septembre 1870, il existait, nous le savons, une garantie des fonctionnaires rsultant de l'art. 75 de la Constitution de l'an VIII, et qui consistait en ce qu'ils ne pouvaient pas tre poursuivis pour actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions sans l'autorisation du Conseil d'tat. Les ecclsiastiques n'taient point considrs comme fonctionnaires et par consquent n'taient pas protgs par l'art. 75, mais ils avaient une protection analogue, car on exigeait la dclaration d'abus pralable. Depuis le dcret du19 dcembre 1870, la garantie des fonctionnaires
710
LES JURIDICTIONS ET LA COMPTENCE
a disparu, et il parat conforme l'esprit gnral de la lgislation en ces matires de supprimer aussi le pralable de la dclaration comme d'abus. C'est ce que fait le Conseil d'tat depuis une dcision du 17 mars 1881; mais la Cour de cassation, fidle une distinction qu'elle avait pose dans un arrt du 10 aot 1861 entre l'action publique et l'action civile, continue d'exiger la dclaration d'abus pralable toutes les fois que l'action est intente par la partie civile. Le Conseil d'tat s'est pli de bonne grce cette jurisprudence par un dtour, en considrant les dclarations d'abus qu'on lui demande par jugement de sursis, comme une question prjudicielle dont on lui demande la solution. (D. sur abus, 7 juillet 1886, Gros; 20 janvier 1887, Meulin.) SECTION II ORGANISATION DE LAJURIDICTION ADMINISTRATIVE. DE LAJURIDICTION GNRALE ADMINISTRATIVE 1er. ORGANISATION 578. Cette organisation est trs particulire et trs diffrente de celle des tribunaux judiciaires. Il y a un tribunal administratif fondamental le Conseil d'tat. : Ce tribunal cumule toutes les juridictions. Il est le juge de droit commun en premier ressort, non seulement dans la matire du recours pour excs de pouvoir, mais aussi en matire de recours contentieux ordinaire ; par l, et surtout par le recours pour excs de pouvoir, il exerce une influence directe sur toutes les autorits administratives. Il est en mme temps juge d'appel et juge de cassation, et tous les autres tribunaux administratifs lui sont subordonns par l'une ou l'autre de ces voies. Les conseils de prfecture, et les ministres dans les cas exceptionnels o ceux-ci sont vritablement juges, lui sont subordonns par l'appel. Les tribunaux comptence spciale, srie qui comprend la Cour des comptes, les conseils de revision, les conseils de l'Instruction publique, qui a compris dans le pass, et qui pourra comprendre dans l'avenir, telle ou telle commission administrative plus ou moins phmre charge d'un contentieux particulier, lui sont subordonns par le recours en cassation. Ainsi, tandis que dans les juridictions civiles, le premier ressort, l'appel et la cassation sont nettement spars et confis des tribunaux diffrents, ici ils sont concentrs au profit d'un mme tribunal. Ce fait cre au Conseil d'tat une situation privilgie, et donne sa jurisprudence une autorit bien plus grande encore que n'a celle de la
EN PREMIER RESSORT LA JURIDICTION
711
Cour de cassation. Les principales dcisions du Conseil d'tat sont, en effet, des dcisions de juge de premier ressort ou de juge d'appel, qui statue la fois sur le fait et sur le droit. Ajoutez que toute cette jurisprudence est d'allure prtorienne, surtout dans la matire de l'excs de pouvoir. Le Conseil d'tat a conquis lentement cette haute situation. Le recours pour excs de pouvoir, bien qu'il trouve son germe dans une loi rvolutionnaire, est une cration de sa jurisprudence, et n'a pris tout son dveloppement que depuis un dcret du 2 novembre 1864. La doctrine d'aprs laquelle le Conseil d'tat est juge de droit commun en premier ressort pour les recours contentieux ordinaires, ne s'est tablie que trs pniblement, ainsi que nous le verrons, elle est mme encore conteste. Le Conseil d'tat a triomph de tous les obstacles par la conception nette de sa mission qu'il a eue ds le dbut, par son esprit de suite, par la haute valeur de sa jurisprudence. Les autres juridictions n'ont pas se plaindre d'tre ainsi subordonnes. Les membres de l'administration active, prfets et ministres, dont les actes peuvent tre annuls ou rforms par un tribunal aussi fortement organis, pourraient, jusqu' un certain point, s'alarmer de cette dpendance. Mais la dpendance n'est qu'apparente. Nous avons vu plus haut que l'administration active est suffisamment protge (n 574). De la juridiction en premier ressort.
579. Le Conseil d'tat est le juge de droit commun Le Conseil d'tat est juge en premier en premier ressort. ressort, dans la matire du recours pour excs de pouvoir, cela ne peut faire aucune difficult. (L. 24 mai 1872, art. 9.) Mais il faut admettre aussi qu'il est le juge de droit commun en premier ressort, dans la matire du recours contentieux ordinaire, c'est--dire qu'il est comptent lorsqu'un texte n'attribue pas comptence un autre tribunal administratif 1. Cette opinion, quoique trs raisonnable, ne s'est pas tablie sans difficult. On a longtemps cherch ailleurs le juge de droit commun, soit du ct des conseils de prfecture, soit du ct des ministres. Les conseils de prfecture auraient l'avantage d'tre proximit 1. Sauf pour le contentieux administratif des colonies qui appartient eu premier ressort au conseildu contentieuxde chaque colonie. (V.infr, n 589.
712
LES JURIDICTIONS ET LA COMPTENCE
des justiciables; mais, d'une part, le texte de l'art. 4, l. 28 pluvise an VIII,fsur lequel s'appuie leur comptence, contient une numration d'affaires qu'il est bien difficile de ne pas considrer commelimitative; d'autre part, si l'on part de cette ide que la juridiction administrative est essentiellement prtorienne, on comprendra qu'il ne saurait y avoir un prteur dans chaque dpartement. Le systme qui faisait des ministres les juges de droit commun en premier ressort, chacun dans son ministre, a eu beaucoup plus de partisans et pendant longtemps il a t accept par le Conseil d'tat lui-mme. Mais il est manifestement condamn aujourd'hui par la doctrine qui veut que le ministre ne soit pas juge du tout (v. n 573). Il est clair que s'il n'est pas juge, sauf dans des hypothses trs exceptionnelles, il ne saurait tre juge de droit commun. Reste donc seulement le Conseil d'tat, et il faut reconnatre que la doctrine qui en fait le juge de droit commun en premier ressort, cadre trs bien avec cette ide que la juridiction administrative est prtorienne: un seul prteur pour toute la France. Le seul inconvnient de cette doctrine est que la procdure devant le Conseil d'tat est coteuse, tandis que celle devant le ministre ne l'tait pas; mais des rformes seraient possibles. Nul doute que l'exemple du recours pour excs de pouvoir, n'ait t pour beaucoup dans le mouvement qui a pouss le Conseil d'tat revendiquer la juridiction de premier ressort en matire de recours contentieux ordinaire, surtout depuis que le recours pour excs de pouvoir est admis contre les dcisions des autorits administratives infrieures, omisso medio. (Arrt Bansais, 13 avril 1882, v. p. 210.) C'est d'abord dans les cas de recours en interprtation, la suite de questions prjudicielles souleves devant les tribunaux judiciaires, quil a affirm sa comptence. (Cons. d't. 28 avr. 1882.) Puis il l'a affirme franchement propos d'un recours contentieux contre un acte administratif port directement devant lui (Cons. d't. 13 dc. 1889, affaire Cadot). Un fonctionnaire communal rvoqu, le sieur Cadot, avait demand une indemnit; le conseil municipal avait rejet sa demande; le Conseil d'tat s'est dclar comptent pour le recours form contre cette dcision. (Arrt confirmatif28 mars 1890, Drancey.) Au point de vue des textes, cette doctrine s'appuie sur l'art. 52 de la Constitution du 22 frimaire an VIII et sur le rglement du 5 nivse an VIII. Le Conseil d'tat interprte ces textes comme ayant enlev son profit aux ministres, qui certainement les avaient eues pendant la Rvolution, la fois la juridiction d'appel et la juridiction de premier ressort.
L'APPELET LA CASSATION L'appel.
713
Il y a un certain nombre de tribunaux administratifs qui jugent en premier et en dernier ressort. Ainsi, lorsque le Conseil d'tat est juge en premier ressort il est en mme temps juge en dernier ressort. Il en est de mme de certains tribunaux spciaux, comme la Cour des comptes, les conseils de rvision. Cependant l'institution de l'appel existe pour certains autres tribunaux ; ainsi, tous les arrts des conseils de prfecture, toutes les dcisions des conseils du contentieux des colonies, toutes les dcisions contentieusesdes ministres sont susceptibles d'appel. Il faut faire quelques observations: 1 Les appels ne sont pas tous ports au mme tribunal, le Conseil d'Etat reoit les appels des conseils de prfecture et des ministres, mais la Cour des comptes reoit aussi les appels des conseils de prfecture lorsque ceux-ci jugent les comptes des comptables ; le conseil suprieur de l'instruction publique reoit les appels duconseil acadmique et du conseil dpartemental, etc. 2 L o l'appel existe, le recours en appel peut tre form, quelque minime que soit l'importance de l'affaire, parce qu'un intrt public est toujours prsum en jeu. 3 Le recours en appel devant le Conseil d'tat n'est pas suspensif de l'excution du jugement de premire instance, moins que le Conseil d'tat, par arrt spcial, n'accorde un sursis. (D. 22 juill. 1806, art. 3; l. 24 mai 1872. art. 24.) 4 Le dlai du recours en appel devant le Conseil d'tat est de trois mois pour les jugements des ministres et de deux mois pour les arrts des conseils de prfecture (1. 22 juill. 1889, art. 57). Pour les conseils du contentieux des colonies, il y a des rgles spciales. 580. La cassation. 581. Toutes les dcisions en dernier ressort des tribunaux administratifs qui ne relvent pas du Conseil d'tat par l'appel, peuvent tre attaques devant le mme Conseil d'tat par le recours en cassation. Par suite, les dcisions des conseils de prfecture, celles des conseils du contentieux des colonies, qui peuvent toujours tre frappes d'appel, ne peuvent pas tre l'objet d'un recours en cassation. D'ailleurs, par la voie de l'appel, on peut faire valoir contre ces dcisions des vices d'incomptence ou d'excs de pouvoir, tout comme on les ferait valoir par le recours en cassation.
714
LES JURIDICTIONS ET LA COMPTENCE
Au contraire, les arrts de la Cour des comptes, les dcisions des conseils de rvision, celles du conseil suprieur de l'instruction publique, peuvent tre attaques par le recours en cassation; il en est de mme des dcisions de toutes les commissions phmres charges d'un contentieux spcial, qui peuvent tre institues, comme celle, par exemple, qui fut charge de liquider les indemnits pour l'insurrection de 1871. (Cons. d't. 12 juin 1874.) Le recours en cassation est un recours en annulation ouvert pendant les trois mois qui suivent la notification de la dcision ; il diffre du recours en appel en ce qu'il est dispens du ministre d'un avocat. 582. Parent du recours en cassation et du recours Le recours en cassation et le repour excs de pouvoir. cours pour excs de pouvoir ont une grande parent: D'abord, ils trouvent tous les deux leur origine dans les mmes textes, la loi des 7-14 oct. 1790 et l'art. 9, l. 24 mai 1872 ; il est vrai que le recours en cassation s'appuie en certains cas sur des textes spciaux, sur l'art. 17, 2, 1. 16 sept. 1807 pour la Cour des comptes, sur l'art. 32, l. 15 juill. 1889 pour le conseil de rvision, mais on a besoin des textes gnraux prcits pour les cas o il n'y a pas de texte spcial. De plus, ce sont deux recours en annulation, tous les deux sont fonds sur l'excs de pouvoir, l'un du juge, l'autre de l'administrateur. Malgr cela, ces deux recours ne se confondent point, et il est prvoir que dans l'avenir ils iront se sparant toujours l'un de l'autre. Le recours pour excs de pouvoir est dirig contre des actes d'administration, le recours en cassation contre des jugements. On conoit qu'au dbut, alors que l'acte d'administration n'tait pas bien distingu de la dcision contentieuse, on ait presque identifi les deux recours ; mais maintenant, plus ira, plus la fonction d'administrateur sera spare de la fonction de juge, plus par consquent l'acte d'administration s'loignera du jugement. L'acte d'administration sera de plus en plus considr comme une manifestation de volont de la personne administrative, et par suite le recours pour excs de pouvoir sera considr comme une voie de nullit rsultant de vices du consentement. Il s'loignera du recours en cassation pour se rapprocher de l'in integrum restitutio. (V. p. 214.) Dj d'ailleurs il y a des diffrences graves entre les deux recours, ainsi qu'il va apparaitre : 583. Des ouvertures recours en cassation. Le
LE CONSEIL D'TAT
715
recours en cassation s'appuyant sur l'excs de pouvoir, il s'agit de savoir quand il ya excs de pouvoir: Le Conseil d'tat a, jusqu'ici, fait sortir de la notion de l'excs de pouvoir trois ouvertures recours: 1 L'incomptence; 2 la violation des formes; 3 quelquefois le dtournement de pouvoir. Chose remarquable, il n'admet pas le motif de violation de la loi, moins qu'il n'y ait un texte comme dans l'art. 32, l. 15juill. 1889. Cette ouverture recours existe au contraire dans le recours pour excs de pouvoir. On sait qu'elle existe aussi pour les pourvois la Cour de cassation, et on peut dire qu'elle est dans la logique de l'institution. 1 L'effet 584. Des effets du recours en cassation. de l'annulation du jugement est renferm interpartes, comme l'tait d'ailleurs l'effet du jugement lui-mme; au contraire, un acteadministratif annul la suite d'un recours pour excs de pouvoir est annul erg omnes. 2 Le tribunal dont le jugement est annul est oblig de refaire son jugement, car il faut que l'affaire soit juge; au contraire, une autorit administrative dont l'acte est annul n'est point tenue de refaire son acte. 585. Du pourvoi dans l'intrt de la loi. Les reprsentants de l'administration ont, aussi bien que les parties, le droit de former des recours en cassation ordinaires, mais les ministres peuvent en outre former des pourvois dans l'intrt dela loi, qui n'aboutissent qu' une censure purement doctrinale de la dcision sans infirmation de ses effets lgaux. Le pourvoi peut tre form mme contre une dcision qui n'est pas en dernier ressort; il en existe un semblable en matire judiciaire. DESDIVERSES JURIDICTIONS ET COMPTENCE 2. ORGANISATION N1. Le Conseil d'tat. 586. Organisation au du Conseil d'tat dlibrant Nous savons dj que le Conseil d'tatne se forme contentieux. pas de la mme manire, suivant qu'il dlibre en matire administrative ou en matire contentieuse ; on a vu quelles sont ses diverses formations en matire administrative (p. 289 et suiv.), le moment est venu d'tudier ses formations en matire contentieuse. Observons d'abord qu'il se forme de la mme faon quelle que soit
716
LES JURIDICTIONS ET LA COMPTENCE
la nature de sa juridiction, qu'il s'agisse du premierressort, de l'appel ou dela cassation. Cela dit, il faut savoir que le Conseil d'tat dlibrant en matire contentieuse est form, tantt en section du contentieux, tantt en assemble du Conseil d'tat statuant au contentieux,et quecela correspond la marche gnrale de la procdure, attendu qu'une affaire est en principe instruite par la section du contentieux, et juge par l'assemble du contentieux. I. De la section du contentieux. En principe, la section du contentieux est charge uniquement de diriger l'instruction crite et de prparer le rapportsur les affaires; exceptionnellement, elle peut retenir et juger les affaires pour lesquelles il n'y a pas de constitution d'avocat, moins que le renvoi l'assemble du contentieux ne soit demand par l'un des conseillers de la section ou par le commissaire du gouvernement. (L. 1872, art. 19.) Les affaires qui sont dispenses du ministre de l'avocat sont : 1le recours pour excs de pouvoir;2 le recours en cassation ; 3 les recours en matire lectorale ; 4 les recours en matire de contributions directes ou de taxes assimiles. Thoriquement donc, la section du contentieux pourrait statuer ellemme sur l'importante matire du recours pour excs de pouvoir. En fait il n'en est pas ainsi, la section ne retient que les matires lectorales et les recours en matire de contributions directes. Il n'y a actuellement qu'une section du contentieux, mais le nombre toujours croissant des recours a fait sentir la ncessit d'en crer une seconde ; une section temporaire a dj t organise spcialement pour les matireslectorales ; il est prvoir qu'on organisera prochainement une seconde section du contentieux ; un projet de loi est dpos en ce sens. La section du contentieux est compose de six conseillers d'tat en service ordinaire et d'un prsident ; les conseillers d'tat en service extraordinaire ne peuvent pas y tre attachs, le garde des sceaux qui a le droit de prsider les autres sections n'a pas le droit de prsider celle-ci. Il y a un ministre public compos de quatre matres des requtes qui prennent le nom de commissaires du gouvernement, plus des matres des requtes et des auditeurs chargs des rapports. La section du contentieux ne peut statuer que si cinq membres au moins ayant voixdlibrative sont prsents. En cas de partage, le prsident n'a pas voix prpondrante, et on appelle le plus ancien maitre des requtes prsent la sance. Il ya donc une srie de prcautions prises pour que la section du contentieux soit soustraite autant que possible l'influence administrative.
LE CONSEIL D'TAT
717
statuant au contentieux. II. De l'assemble du Conseil d'tat L'assemble du Conseil d'tat statuant au contentieux, qu'il ne faut : pas confondre avec l'assemble gnrale du Conseil d'tat, se compose 1 du vice-prsident du Conseil d'tat ou son dfaut du prsident de la section du contentieux; 2 des membres de la section du contententieux; 3 de huit conseillers en service ordinaire pris dans les autres sections et dsigns par le vice-prsident du Conseil, dlibrant avec les prsidents de section. Plus des matres des requtes, des auditeurs et un ministre public compos de quatre commissaires du gouvernement. Elle ne peut dlibrer valablement que si neuf membres au moins ayant voix dlibrative sont prsents. D'autre part, elle ne peut dlibrer qu'en nombre impair, de sorte que lorsque les membres prsents sont en nombrepair et suprieur neuf, le dernier conseiller dans l'ordre du tableau doit s'abstenir. Les membres du Conseil d'tat qui, dans les sectionsadministratives, ont particip la prparation d'une mesure, ne peuvent pas ensuite siger comme juges des recours forms contre cette mesure. en premier ressort du Conseil 587. Comptence Outre que le Conseil d'tat est le juge de droit commun d'tat. en premier ressort lorsqu'il n'y a pas de textes (v. n 579), il est juge en premier ressort dans un assez grand nombre de cas prvus par les textes. Sont ainsi de sa comptence: 1Le recours pour excs de pouvoir. (L. 24 mai 1872, art. 9.) 2 Les rclamations formes contre les dcisions ministrielles, ayant le caractre d'actes de gestion (auxquelles l'ancienne doctrine attribuait tort le caractre de jugements), lorsque ces actes de gestion ne relvent pas des tribunaux judiciaires, ou lorsqu'ils ne sont pas attribus exceptionnellement aux conseils de prfecture : ainsi, excution, rsiliation de marchs de fournitures de l'tat, liquidation et paiement des dettes de l'tat (sauf pour travaux publics), recouvrement de certaines crances de l'tat au moyen d'arrts de dbet, dcisions sur le droit la pension et liquidation de cette pension, etc. 3 Le contentieux des lections des conseils gnraux. (L. 31 j uill. 1875.) 4 Les dclarations de dmission prononces en la forme contentieuse la requte du ministre de l'intrieur contre les conseillers gnraux, d'arrondissement et municipaux, en vertu de la loi du 7 juin 1873. 5 Les recours forms par les industriels exploitant ou demandant exploiter des tablissements dangereux, insalubres ou incommodes de premire ou de seconde classe, contre les arrts des prfets qui refusent d'autoriser, ou retirent les autorisations donnes, ou imposent des con-
718
LES JURIDICTIONS ET LA COMPTENCE
ditions d'exploitation contestes par l'industriel. (D. 15 oct. 1810, art. 7.) 6 Les rclamations formes par les conseils municipaux ou par toute partie intresse contre les arrts des prfets prononant l'annulation des dlibrations de ces conseils, ou dclarant qu'elles sont nulles de plein droit, ou au contraire refusant d'annuler. (L. 5 avr. 1884, art. 66 et 67.) N 2. Les juges subordonns au Conseil d'tat par
l'appel.
Ces juges sont : les conseils de prfecture, les conseils du contentieux des colonies, les ministres. L'organisation des 588. I. Les conseils de prfecture. conseils de prfecture est la mme au contentieux qu'en matire administrative (v. p. 305). Faisons remarquer seulement que les secrtaires gnraux remplissent auprs d'eux les fonctions de commissaire du gouvernement, que les arrts doivent tre rendus par trois conseillers au moins, prsident compris; que dans tous les cas les conseillers doivent tre en nombre impair; que les arrts sont motivs, que les noms des membres qui ont concouru la dcision sont mentionns, etc. (L. 22juill. 1889, art. 47-48.) a) Caractres gnraux de la comptence. La comptence des conseils de prfecture prsente les caractres suivants: 1 Elle est exceptionnelle, c'est--dire que le conseil de prfecture est un juge d'exception, un peu comme le juge de paix en matire civile; elle repose en effet sur des textes qui contiennentdes numrations limitatives, notamment la loi du 28 pluvise an VIII, art. 4. 2 Elle est toujours en premier ressort. 3 Elle est territoriale ou ratione loci, non pas raison du domicile du dfendeur, mais raison du lieu o a t fait l'acte administratif attaqu. Ainsi les contestations relatives aux travaux publics sont portes non pas devant le conseil du domicile de l'entrepreneur, mais devant celui du lieu des travaux. Une exception cependant pour le cas o un mme travail public est excut par le mme entrepreneur dans plusieurs dpartements, surtout pour les concessions de chemins de fer qui couvrent de vastes territoires. On dtermine d'avance un seul conseil de prfecture qui sera comptent pour tous les dpartements; mais c'est une clause du cahier des charges qui n'a d'effet qu'entre le concessionnaire et l'administration, elle n'est pas opposable aux pro. pritaires qui rclament des indemnits pour dommages.
DE PRFECTURE LES CONSEILS
719
Le conseil de du conseil de diverses prfecture. b) Comptences prfecture a plusieurs comptences d'ordre diffrent : 1 Une comptence rpressive pour les contraventions de grande voirie. (L. 28 pluvise an VIII, art. 4; l. 29 floral an X.) 2 Une comptence comme juge des comptes pour les comptables des communes et des tablissements publics, lorsque le revenu annuel de ces personnes administratives ne dpasse pas 30,000 francs. (D. 31 mai 1862, art. 427.) L'appel est port dans ce cas la Cour des comptes. 3 Une comptence comme juge charg de donner les autorisations de plaider aux communes et aux tablissements publics. 4 Une comptence de pleine juridiction pour le contentieux auquel donnent lieu les oprations suivantes : ) Les lections au conseil d'arrondissement; toutes les lections municipales, c'est--dire celles qui concernent les conseils municipaux, les maires et adjoints et les dlgus snatoriaux. ) Les contributions directes (demandes en dcharge ou en rduction). y) Les oprations de travaux publics, non seulement pour les difficults qui s'lvent entre l'entrepreneur et l'administrateur, mais mme pour les actions en indemnit raison de dommages causs la proprit ou aux personnes et d'une faon gnrale pour toutes les consquences de l'opration qui sont de nature rflchir contre l'administration. (V. p. 604 et s.) ) Les ventes de domaines nationaux, etc., etc. 589. II. Les conseils des colonies. du contentieux Les conseils du contentieux existent dans toutes les colonies depuis le dcret du 7 septembre 1881, l'Algrie n'en a point parce qu'elle a des conseils de prfecture. Organisation. L'organisation en a t rgle nouveau, de mme que la procdure, par un dcret du 5 aot 1881. Ces conseils sont forms par le conseil priv, corps consultatif plac ct du gouverneur avec des attributions administratives, auquel viennent se joindre deux magistrats de l'ordre judiciaire dsigns chaque anne par le gouverneur. On voit donc ralise dans ces conseils, aux colonies, la fusion de l'lment judiciaire et de l'lment administratif si soigneusement spars dans la mtropole; seulement, ce qui vient diminuer la porte du fait, c'est que les magistrats coloniaux ne sont pas inamobiles. La prsidence appartient au gouverneur avec voix prpondrante, son dfaut, l'infrieur qui vient immdiatement aprs lui.
720
ET LA COMPTENCE LES JURIDICTIONS
Les fonctions du ministre public sont remplies par l'inspecteur des services administratifs. Le secrtaire du conseil priv fait office de greffier. Comptence. A la diffrence des conseils de prfecture, les conseils du contentieux ne sont point des juges d'exception, ils connaissent en gnral du contentieux administratif, disent les ordonnances du 21 aot 1825, art. 160, et du 9 fvrier 1827 (art. 76), confirrnes par le dcret du 5 aot 1881. Par consquent, ils sont juges de droit commun en premier ressort pour le contentieux administratif soulev dans les colonies; l la comptence en premier ressort du Conseil d'tat disparat, ce qui s'explique suffisamment par la distance. Cette comptence gnrale leur a fait attribuer le contentieux des contributions directes, celui du traitement des fonctionnaires, etc. Outre cela, une numration assez longue figure dans les textes: marchs de travaux publics, marchs de fournitures, voirie, etc. CeLte comptence est toujours en premier ressort. Comptence.Nous avons adopt 590. III. Les ministres. la doctrine qui veut que les ministres n'aient pasen principe d'attributions contentieuses, et qui considre comme des actes d'administration toutes leurs dcisions, soit les dcisions sur recours gracieux, soit les actes de gestion unilatraux, comme les liquidations de dettes (v. n 573). La consquence est que les attributions vraiment contentieuses des ministres sont trs rares. Le Conseil d'tat leur reconnat cependant comptence dans un certain nombre de cas de contentieux lectoral. Leur est ainsi attribu: Le contentieux des lections des chambres de commerce (ministre du commerce, arr.3 nivse an XI). Celui des lections au conseil suprieur de l'instruction publique et au conseil acadmique (ministre de l'instruction publique, D. 16 mars 1880, art. 12 et 13). Celui des lections des syndics dans les associations syndicales autorises (ministre des travaux publics). Un recours en appel peut tre port au Conseil d'tat. N 2. Les juges qui dpendent du Conseil d'tat par la cassation. 591. Les principales juridictions de cette espce sont la Cour des
LES JUGESSPCIAUX
721
comptes, les conseils de rvision, le conseil suprieur de l'instruction publique. Il a t dit un mot de la Cour des comptes propos de la comptabilit. (V. p. 411.) Il a t parl des conseils de revision propos du service militaire. (V. p. 483.) Pour le conseil suprieur de l'instruction publique, v. l. 27 fv. 1880 et D. 16 mars et 26 juin 1880.
II.
46
CHAPITRE
III
LA PROCDURE
1er. CARACTRES GNRAUX DE LA PROCDURE ADMINISTRATIVE 592. Existence de la procdure adindpendante Il existe une procdure administrative. A la ministrative. vrit, il en existe plusieurs, en ce sens qu'il y a une procdure suivre devant le Conseil d'tat, une autre devant les conseils de prfecture, une autre devant les ministres, sans parler des tribunaux spciaux ; mais toutes ces procdures, malgr des diffrences de dtails, prsentent des caractres communs, de telle sorte qu'on peut en extraire un corps de rgles gnrales. Cette procdure est distincte de la procdure civile, elle a son gnie propre et se dveloppe d'une faon indpendante. Lorsque les textes qui la rglementent sont insuffisants, il appartient au juge administratif lui-mme d'en formuler les rgles. C'est ainsi que le Conseil d'tat avait cr presque de toutes pices la procdure suivre devant les conseils de prfecture qui, jusqu' la loi du 22 juillet 1889, n'avait gure attir l'attention du lgislateur. Et si dans cette uvre prtorienne, le juge doit s'inspirer des principes d'quit sur lesquels reposent quelques-unes des dispositions du Code de procdure civile, il n'est point tenu d'appliquer textuellement ces dispositions, mme les plus gnrales, comme les art. 1029 et suivants. admide la procdure 593. Caractres gnraux Par ses caractres gnraux, la procdure adminisnistrative. trative se distingue profondment de la procdure civile ; elle appartient, de mme que notre procdure criminelle, au type de la procdure inquisitoriale o l'instruction de l'affaire est faite par le juge, tandis que la procdure civile se rattache au type de la procdure accusatoire, o l'instruction de l'affaire est faite par les parties ellesmmes en l'absence du juge. Le type de la procdure inquisitoriale est gnralement considr comme suprieur celui dela procdure accusatoire; la prsence d'un juge, qui dirige l'instruction, est en effet une garantie contre les sur-
ADMINISTRATIVE 723 DE LA PROCDURE GNRAUX CARACTRES prises d'audience et la multiplication des incidents, par consquent contre les lenteurs et les frais. Il est permis de penser ds lors, que la procdure administrative prsente quelques avantages sur la procdure civile et que celle-ci gagnerait s'en rapprocher. La procdure administrative prsente les trois grands caractres suivants: 1 L'instruction est dirige par le juge. Ds le dbut ce caractre apparat, car l'instance est introduite par une requte en demande adresse au juge, et non point par un ajournement adress directement au dfendeur. Le dfendeur est mis en cause par une ordonnance du juge, et la requte en dfense qu'il prsente est galement adresse au juge. De plus, tous les incidents donnent lieu une dcision du juge. Cette initiative donne au juge n'empche point que les parties n'aient un rle jouer, et qu'elles n'aient besoin dans une certaine mesure de conseils ou de reprsentants rompus aux affaires, comme les avous. Les parties ou leurs reprsentants stimuleront le juge, le juge surveillera les parties. Les choses ont t comprises ainsi ds le dbut au Conseil d'tat, puisqu'il a t cr, auprs de ce conseil, des avocats-avous dont le ministre est obligatoire sauf exception. Auprs des conseils de prfecture, la loi du 22 juillet 1889 a facilit l'accs des avous, en leur reconnaissant formellement le droit de reprsenter leurs clients sans procuration et en permettant en leur faveur le dplacement des pices. 2 La procdure est crite. Cela veut dire: 1 que le juge, charg de l'instruction, fait cette instruction sur des pices crites, qui doivent contenir non seulement les conclusions des parties, mais tous leurs moyens; un moyen nouveau ne peut pas tre produit pendant le dbat oral, ou bien alors il faut recommencer l'instruction; 2 que le juge charg du jugement, juge sur le rapport crit qui est rsult de l'instruction. En d'autres termes, en matire administrative toutes les affaires sont juges sur rapport, tandis que cette procdure est exceptionnelle en matire civile. Un dbat oral peut venir se joindre au rapportcrit pour les affaires juges en sance publique, mais il n'est jamais que le complment du rapport. 3 La procdure est en partie secrte. Pendant longtemps la procdure administrative a t compltement secrte, elle ne donnait lieu aucun dbat public et le jugement n'tait point rendu en public. Il a t introduit des sances publiques en 1830 au Conseil d'-
724
LA PROCDURE
tat et en 1862 au conseil de prfecture; mais on ne peut pas dire que la procdure soit compltement publique. D'abord les jugements sont lus l'audience publique, mais ils ne sont pas rendus en audience publique; ils sont tous rdigs dans la chambre du conseil. De plus, devant le Conseil d'tat, il est des affairesqui ne donnent lieu aucun dbat public, ce sont foutes celles qui sont retenues et juges par la section du contentieux. 594. Des privilges L'tat de lapuissance publique. plaidant devant la juridiction administrative jouit d'un certain nombre de privilges : 1 Devant le Conseil d'tat, les ministres ne sont pas tenus d'employer le minislre d'un avocat pour l'instruction crite, ils peuvent signer eux-mmes les pices; pour le dbat oral, il leur faut un avocat. 2 Soit devant le Conseil d'tat, soit devant les conseils de prfecture, les pices sont dplaces pour tre communiques l'administration, tandis que pour les parties prives, en principe la communication se fait au greffe sans dplacement. 3 L'tat ne peut pas tre condamn aux dpens, sauf quand il s'agit : a) des contestations relatives au domaine; b) des contestations relatives l'excution des marchs passs pour un service public, marchs de fournitures, ou marchs de travaux publics et de la rparation des dommages occasionns par les travaux publics. (D. 2 nov. 1864; l. 22 juill. 1839, art. 63.) 4 Nous savons dj qu'il n'y a pas d'excution force contre l'tat, par consquent l'tat excute volontairement les condamnations rsultant de jugements, comme il excute toutes ses obligations. Pour les autres personnes administratives, il ne peut y avoir qu'une excution par la voie administrative autorise par l'tat. (V. p. 545.) 595. Notification des pices par la voie adminis La procdure administrative prsente encore ceci de trative. particulier, que les dcisions et les pices sont trs rarement signifies par huissier; les pices sont communiques sans dplacement au greffe, les dcisions sont notifies par la voieadministrative, c'est--dire par les soins des prfets et des maires, ce qui constitue une grande conomie. Cette rgle s'applique surtout devant les conseils de prfecture.
D'TAT DEVANT LE CONSEIL PROCDURE PROCDURES 2. LESDIVERSES N 1. La procdure devant le Conseil d'tat.
725
(Dcret du22juillet 1806; D. 18janvier 1826 ; O.2 fv.; O.12 mars 1831; L. 11 juin 1859; D. 2 nov. 1864; D. 2 aot 1879; L. 22 juillet 1889 ) 596 Marche gnrale de la procdure devant le Conseil d'tat. Conformment aux caractres gnraux de la procdure administrative que nous avons indiqus n 593, la procdure devant le Conseil d'tat est inquisitoriale, c'est--dire dirige par le juge; crite, c'est--dire que les affaires sont juges sur rapport; secrte en partie, c'est--dire que l'arrt est toujours rdig hors de l'audience publique et qu'il n'y a mme pas de dbat oral pour les affaires juges par la section du contentieux ; il n'yen a quepour les affairesjuges en assemble du Conseil d'tat statuant au contentieux. Bien que la procdure soit dirige par le juge, cependant il y a auprs du Conseil d'tat des officiers ministriels qui portent le nom d'avocats au Conseil d'tat et la cour de cassation, et qui sont la fois avocats et avous. Ces officiers ministriels, crs par D. du 11juin 1806, ont un monopole; en principe, leur ministre est obligatoire, c'est--dire qu'ils ont seuls le droit de signer les requtes et mmoires prsents par les parties. Toutefois, dans le but de faciliter certains recours au Conseil d'tat, des dispenses de ministre d'avocats ont t tablies et ces dispenses sont intressantes connatre parce que, outre l'conomie qu'elles entranent, elles ont une autre consquence, elles permettent le section du contentieux de trancher elle-mme le litige sans renvoyer l'affaire l'assemble du contentieux. Nous avons dj numr au n 586 ces affaires dispen: les recours pour excs de pouvoir; les recours en cassation ses, ce sont ; les recours en matire lectorale, et les recours en matire de contributions directes ou de taxes assimiles. Les phases de la procdure sont: 1 L'introduction et l'instruction de l'affaire o il faut remarquer que toutes les pices de la procdure, les demandes et les dfenses, sont adresses au juge, au lieu d'tre adresses directement la partie adverse et prennent le nom de requtes en demande ou de requtes en dfense, il faut mme observer que la requte en demande n'est communique au dfendeur que sur une dcision prise par le prsident de la section, aprs examen sommaire de l'affaire, et qui porte le nom d'ordonnance de soit communiqu. 2 La rdaction du rapport et la communication au ministre public. Le rapport, qui est dress en ralit par un matre des requtes ou par un auditeur, est discut et arrt dansses termes par la section du contentieux, qui le fait sien et joue ainsi tout entire le rle de juridiction d'instruction. Tous ces rapports sont faits par crit.
726
LA PROCDURE
3 Le jugement de l'affaire, en sance non publique s'il est prononc par la section du contentieux elle-mme, en sance publique, s'il est prononc par l'assemble du contentieux. 4 Enfin il faut prvoir les voies de recours contre les dcisions, mais comme le Conseil d'tat est une juridiction souveraine, ce ne peuvent tre que des voies de rtractation. On en admet trois: l'opposition en cas de jugement par dfaut, la revision qui est une sorte de requte civile et la tierce opposition. 597. Nous reproduisons, pour le dtail de la procdure, le dcret du 22 juillet 1806 qui est rest le texte fondamental, tout en faisant observer que ce dcret ne prvoit ni la communication au ministre public, ni la procdure devant l'assemble du contentieux qui rsultent de rformes postrieures. (0. 1831 ; C. 1852.) DCRET DU 22 JUILLET 1806 Portant rglement sur les affaires contentieuses portes au Conseil d'tat. De l'introduction et de l'instruction des instances.
Des instances introduites au Conseild'tat, la requte des parties. Le recours des parties au Conseil d'tat, en matire ARTICLE PREMIER. contentieuse sera form par requte signe d'un avocat au Conseil; elle contiendra l'expos sommaire des faits et des moyens, les conclusions, les noms et demeures des parties, l'nonciationdes pices dont on entend se servir et qui y seront jointes. V. Dc.2nov. 1864,art. Ier. 2. Les requtes et en gnral toutes les productions des parties seART. ront dposesau secrtariat du Conseild'tat; elles y seront inscrites sur un registre suivant leur ordre de date, ainsi que la remise qui en sera faite l'auditeur nomm parle grand-juge pour prparer l'instruction. 3. Le recours au Conseild'tat n'aura pas d'effetsuspensif, s'il n'en ART. est autrement ordonn. Lorsque l'avis de la commissiontablie par notre dcret du 11 juin dernier sera d'accorder le sursis, il en sera fait rapport au Conseild'tat, qui prononcera. ART. 4. Lorsque la communicationaux parties intresses aura t ordonne par le grand-juge, elles seront tenues de rpondre et de fournir leurs : Dansquinzejours, si leur demeure est dfenses dans les dlais suivants Paris, ou n'en est pas loigne de plus de cinq myriamtres; Dans le mois, si elles demeurent une distance plus loigne dans le ressort de la cour d'appel de Paris, ou dans l'un des ressorts des cours d'appel d'Orlans, Rouen, Amiens, Douai, Nancy, Metz, Dijon et Bourges; Dans deux mois, pour les ressorts des autres cours d'appel en France; Et l'gard des colonies et des pays trangers, les dlais seront rgls ainsi qu'il appartiendra par l'ordonnance de soit communiqu. Ces dlais commenceront courir du jour de la significationde la requte personne ou domicilepar le ministre d'un huissier. Dans les matires provisoires ou urgentes, les dlais pourront tre abrgs par le grand-juge. V. L. 11 juin1859.
PROCDURE D'TAT DEVANT LE CONSEIL
727
ART. 5. La signature de l'avocat au pied de la requte, soit en demande, soit en dfense, vaudra constitution et lection de domicilechez lui. 6. Le demandeur pourra, dans la quinzaine aprs les dfenses fourART. nies, donner une seconde requte, et le dfendeur rpondre dans la quinzaine suivante. Il ne pourra y avoir plus de deux requtes de la part de chaque partie, y compris la requte introductive. ART. 7. Lorsque le jugement sera poursuivi contre plusieurs paTties dont les unes auraient fourni leurs dfenses, et les autres seraient en dfaut de les fournir, il sera statu l'gard de toutes par la mme dcision. ART.8. Les avocats des parties pourront prendre communication des productions de l'instance au secrtariat, sans frais. Les pices ne pourront en tre dplaces, si ce n'est qu'il n'yen ait minute, ou que la partie y consente. ART.9. Lorsqu'il y aura dplacement de pices, le rcpiss, sign de l'avocat, portera son obligation de les rendre dans un dlai qui ne pourra excder huit jours, et aprs ce dlai expir, le grand-juge pourra condamner personnellement l'avocat en 10 francs au moins de dommages et intrts par chaque jour de retard, et mme ordonner qu'il sera contraint par corps. ART.10. Dans aucun cas, les dlais pour fournir ou signifier requte ne seront prolongs par l'effet des communications. ART.11. Le recours au Conseil d'tat contre la dcision d'une autorit qui y ressortit, ne sera pas recevable aprs trois mois du jour o cette dcision aura t notifie. ART.12. Lorsque, sur un semblable pourvoi fait dans le dlai ci-dessus prescrit, il aura t rendu une ordonnance de soit communiqu,cette ordonnance devra tre signifie dans le dlai de trois mois, sous peine de dchance. V. Dc. 2 nov. 1864, art. 3. ART.13. Ceux qui demeureront hors de la France continentale, auront outre le dlai de trois mois nonc dans les deux articles ci-dessus, celui qui est rgl par l'art. 73 du Code de procdure civile. ART.14. Si, aprs l'examen d'une affaire, ily a lieu d'ordonner que des faits ou des critures soient vrifis, ou qu'une partie soit interroge, le grand-juge dsignera un matre des requtes, ou commettra sur les lieux: il rglera la forme dans laquelle il sera procd ces actes d'instruction. ART. 15. Dans tous les cas o les dlais ne sont pas fixs par le prsent dcret, ils seront dtermins par ordonnance du grand-juge. Dispositions introduites sur le particulires aux affaires contentieuses rapport d'un ministre. ART.16. Dans les affaires contentieuses introduites au conseil sur le rapport d'un ministre, il sera donn, dans la forme administrative ordinaire, avis la partie intresse de la remise faite au grand-juge des mmoires et pices fournis par les agents du gouvernement, afin qu'elle puisse prendre communication dans la forme prescrite aux art. 8 et 9, et fournir ses rponses dans le dlai du rglement. Le rapport du ministre ne sera pas communiqu. ART.18. Lorsque, dans les affaires o le gouvernement a des intrts opposs ceux d'une partie, l'instance est introduite la requte de cette partie, le dpt qui sera fait au secrtariat du conseil, de la requte et des
728
LA PROCDURE
pices, vaudra notification aux agents du gouvernement : il en sera de mme pour la suite de l'instruction. Des incidents qui peuvent survenir pendant l'instruction d'une affaire. Des demandes incidentes. ART. 18. Les demandes incidentes seront formes par une requte sommaire dpose au secrtariat du conseil : le grand-juge en ordonnera, s'il y a lieu, la communication la partie intresse, pour y rpondre dans lestrois jours de la signification, ou autre bref dlai qui sera dtermin. ART.19. Les demandes incidentes seront jointes au principal, pour y tre statu par la mme dcision. S'il y avait lieu nanmoins quelque disposition provisoire et urgente, le rapport en sera fait par l'auditeur la prochaine sance de la commission, pour y tre pourvu par le conseil, ainsi qu'il appartiendra. De l'inscription de faux. ART. 20. Dans le cas de demande en inscription de faux contre une pice produite, le grand-juge fixera le dlai dans lequel la partie qui l'a produite sera tenue de dclarer si elle entend s'en servir. Si la partie ne satisfait pas cette ordonnance, ou si elle dclare qu'elle n'entend pas se servir de la pice, cette pice sera rejete. Si la partie fait la dclaration qu'elle entend se servir de la pice, le Conseil d'tat statuera sur l'avis de la commission, soit en ordonnant qu'il sera sursis la dcision de l'instance principale jusqu'aprs le jugement du faux par le tribunal comptent, soit en prononant la dcision dfinitive, si elle ne dpend pas de la pice argue de faux. De l'intervention. ART.21. L'intervention sera forme par requte, le grand-juge ordonnera, s'il y a lieu, que cette requte soit communique aux parties pour y : nanmoins la dcision rpondre dans le dlai qui sera fix par l'ordonnance de l'affaire principale qui serait instruite, ne pourra tre retarde par une intervention. Des reprises d'instance, et constitution de nouvelavocat. ART.22. Dans les affaires qui ne seront point en tat d'tre juges, la procdure sera suspendue par la notification du dcs, de la dmission, de l'interdiction ou de la destitution de son avocat. Cette suspension durerajusqu' la miseen demeure pour reprendre l'instanceou constituer avocat. ART. 23. Dans aucun des cas noncs en l'article prcdent, la dcision d'une affaire en tat ne sera diffre. ART. 24. L'acte de rvocation d'un avocat par sa partie est sans effetpour la partie adverse s'il ne contient pas la constitution d'un autre avocat.
D'TAT DEVANT LE CONSEIL PROCDURE Dudsaveu.
729
ART. 25. Si une partie veut former un dsaveu relativement des actes ou procdures faits en son nom ailleurs qu'au Conseil d'tat, et qui peuvent influer sur la dcision de la cause qui y est porte, sa demande devra tre communique aux autres parties. Si le grand-juge estime que le dsaveu mrite d'tre instruit, il renverra l'instruction et le jugement devant les juges comptents, pour y tre statu dans le dlai qui y sera rgl. A l'expiration de ce dlai, il sera pass outre au rapport de l'affaire principale, sur le vu du jugement du dsaveu, ou faute de le rapporter. ART. 26. Si le dsaveu est relatif des actes ou procdures faits au Conseil d'tat, il sera procd contre l'avocat sommairement, et dans les dlais fixspar le grand-juge. Des dcisions du Conseild'tat. ART. 27. Les dcisions du Conseil contiendront les noms et qualits des parties, leurs conclusions, et le vu des pices principales. ART. 28. Elles ne seront mises excution contre une partie, qu'aprs avoir t pralablement signifies l'avocat au conseil qui aura occup pour elle. De l'oppositionaux dcisionsrendues par dfaut. 29. Les dcisionsdu Conseild'tat reudues par dfaut sont suscepART. tibles d'opposition. Cette opposition ne sera point suspensive, moins qu'il n'en soit autrement ordonn. Elle devra tre forme dans le dlaide trois : aprs ce mois, compter du jour o la dcision par dfaut aura t notifie dlai, l'opposition ne sera plus recevable. ART.30. Si la commission est d'avis que l'opposition doive tre reue, elle fera son rapport au conseil, qui remettra, s'il y a lieu, les parties dans le mme tat o elles taient auparavant. La dcision qui aura admis l'opposition, sera signifie dans la huitaine, compter du jour de cette dcision, l'avocat de l'autre partie. 31. L'opposition d'une partie dfaillante une dcision rendue conART. tradictoirement avec une autre partie ayant le mme intrt, ne sera pas recevable. Du recours contre les dcisions contradictoires. ART. 32. Dfensessont faites, sous peine d'amende, et mme, en cas de rcidive, sous peine de suspension ou de destitution, aux avocats en notre Conseil d'tat, de prsenter requte en recours coutre une dcision contracas: Si ellea t rendu sur pices fausses; dictoire, si ce n'est en deux Si la partie a t condamne faute de reprsenter une pice dcisive qui tait retenue par son adversaire. ART. 33. Cerecours devra tre form dans le mme dlai, et admis de la mme manire que l'opposition une dcision par dfaut.
730
LA PROCDURE
ART. 34. Lorsque le recours contre une dcision contradictoire aura t admis dans le cours de l'anne o elle avait t rendue, la communication serait faite, soit au dfendeur, soit au domicilede l'avocat qui a occuppour lui, et qui sera tenu d'occuper sur ce recours, sans qu'il soit besoin d'un nouveau pouvoir. 35. Si le recours n'a t admis qu'aprs l'anne depuis la dcision, ART. la communication sera faite aux parties personne ou domicile, pour y fournir rponse dans le dlai du rglement. 36. Lorsqu'il aura t statu sur un premier recours contre une ART. dcision contradictoire, un second recours contre la mme dcision ne sera pas recevable. L'avocat, qui aurait prsent la requte, sera puni de l'une des peines nonces en l'art. 32. De la tierce opposition. ART.37. Ceux qui voudront s'opposer des dcisions du Conseil d'tat rendues en matire contentieuse, et lors desquelles ni eux ni ceux qu'ils reprsentent n'ont t appels, ne pourront former leur opposition que par requte en la forme ordinaire; et sur le dpt qui en sera fait au secrtariat du Conseil, il sera procd conformmentaux dispositions du titre 1er. ART. 38. La partie, qui succombera dans sa tierce opposition, sera condamne en cent cinquante francs d'amende, sans prjudice des dommagesintrts de la partie, s'il y a lieu. ART. 39. Les art. 34et 35 ci-dessus, concernant les recours contre les dcisions contradictoires, sont communs la tierce opposition. ART. 40. Lorsqu'une partie se croiralse dans ses droits ou sa proprit par l'effet d'une dcisionde notre Conseil d'tat rendue en matire non contentieuse, elle pourra nous prsenter une requte pour, sur le rapport qui nous en sera fait, tre l'affaire renvoye, s'il y a lieu, soit une section du Conseil d'tat, soit une commission. Des dpens. ART. 41. En attendant qu'il soit fait un nouveau tarif des dpens, et statu sur la manire dont il sera procd leur liquidation, on suivra provisoirement les rglements antrieurs retatifs aux avocats au conseil, et qui sont applicables aux procdures ci-dessus. ART. 42. Il ne sera employ dans la liquidation des dpens aucuns frais de voyage, sjour ou retour des parties ; ni aucuns frais de voyage d'huissier au del d'une journe. ART. 43. La liquidation et la taxe des dpens seront faites la commission du contentieux par un matre des requtes, et sauf revision par le grandjuge. Des avocatsau Conseil. 44. Les avocats en notre Conseil d'tat auront, conformment ART. notre dcret du 11 juin dernier, le droit de faire tous actes d'instruction et de procdure devant la commission du contentieux.
DE PRFECTURE DEVANT LE CONSEIL PROCDURE
731
Les cri45. L'impression d'aucun mmoire ne passera en taxe. ART. tures seront rduites au nombre de rles qui sera rput suffisant pour l'instruction de l'instance. ART. 46. Les requtes et mmoires seront crits correctement et lisiblement en demi-grosse seulement; chaque rle contiendra au moins cinquante : sinon chaque rle, o il se lignes, et chaque ligne douze syllabes au moins trouvera moins de lignes et de syllabes, sera ray en entier ; et l'avocat sera tenu de restituer ce qui lui aurait t pay raison de ces rles. ART.47. Les copies signifies des requtes et mmoires, ou autres actes, seront crits lisiblement et correctement ; ellesseront conformesaux originaux, et l'avocat en sera responsable. ART. 48. Les critures des parties, signes par les avocats au Conseil, seront sur papier timbre. Les picespar elles produites ne seront point sujettes au droit d'enregistrement, l'exception des exploits d'huissier, pour chacun desquels il sera peru un droit fixe d'un franc. N'entendons nanmoins dispenser les pices produites devant notre Conseil d'tat, des droits d'enregistrement auxquels l'usage qui en serait fait ailleurs pourrait donner ouverture. N'entendons pareillement dispenser du droit d'enregistrement, les pices produites devant notre Conseil d'tat, qui, par leur nature, sont soumises l'enregistrement dans un dlai fixe. ART. 49. Les avocats au Conseil seront, suivant les circonstances, punis de l'une des peines ci-dessus, dans le cas de contravention aux rglements, et notamment s'ils prsentent comme contentieuses des affaires qui ne le seraient pas, ou s'ils portent en notre Conseil d'tat des affaires qui seraient de la comptence d'une autre autorit. ART.50. Les avocats au Conseil prteront serment entre les mains de notre grand-juge ministre dela justice. Des huissiers au Conseil. ART. 51. Les significations d'avocat avocat et celles aux parties ayant leur demeure Paris seront faites par des huissiers au Conseil. N 2. La procdure devant les conseilsde prfecture. 598. Cette procdure est rgie par une loi nouvelle, la loi du 22 juillet 1889. Cette loi, attendue et promise depuis longtemps, n'a gure fait que consacrer les rgles que le Conseil d'tat avait labores en se fondant sur le dcret de 1806, sur la loi du 21 juin 1865 et sur le dcret du 12 juillet mme anne. La procdure ressemble d'ailleurs beaucoup celle du Conseil d'tat, avec cette diffrence que l'instruction, au lieu d'tre dirige par une section du conseil, l'est par le conseil tout entier. I. Introduction de l'instance. La requte introductive d'instance doit tre dpose au greffe du conseil, le secrtaire-greffier dlivre aux parties qui en font la demande un rcpiss. Les parties peuvent aussi faire signifier leur requte augreffe par ex-
732
LA PROCDURE
ploit d'huissier, les frais de la signification n'entrent pas en taxe. Ceci est une disposition nouvelle. La requte doit contenir les nom, profession et domicile du demandeur, les nom et demeure du dfendeur, l'objet de la demande, l'nonciation des pices dont le requrant entend se servir et qui y sont jointes. La requte doit tre accompagne de copies certifies conformes par le requrant, destines tre notifies aux parties en cause. Ces copies ne sont pas assujetties au droit de timbre. Cette disposition nouvelle a pour but d'viter au dfendeur les frais d'un dplacement pour venir consulter au greffe la requte en demande. II. Instruction de l'affaire. Immdiatement aprs l'enregistrement au greffe des requtes introductives d'instance, le prsident du conseil de prfecture dsigne un rapporteur, auquel le dossier est transmis dans les vingt-quatre heures. Notification au dfendeur. Dans les huit jours qui suivent cette transmission, le conseil de prfecture runi en chambre du conseil, rgle, le rapporteur entendu, la notification aux parties dfenderesses des requtes en demande Il fixe le dlai pour fournir dfense. La notification a lieu par la voie administrative. Ainsi il n'y a pas, comme au Conseil d'tat, une ordonnance de suit communiqu signifie par huissier, c'est une conomie. Requte en dfense et rpliques. La requte en dfense et les rpliques sont dposes au greffe dans les mmes conditions que la requte en demande; le conseil en ordonne communication. Communicationaux parties. Les parties peuvent prendre connaissance des pices au greffe sans dplacement. Toutefois le dplacement est autoris au profit de l'administration et au profit des avocats et des avous mandataires des parties. Mesures d'instruction. Le conseil de prfecture a le droit d'ordonner les mesures qu'il jugepropres l'clairer, telles que: enqutes, expertises, auditions de tmoins, vrification d'critures, descentes sur les lieux. Ces diffrents moyens de vrification sont rglements dans le titre II de la loi du 22 juillet 1889. Incidents. Les incidents sont prvus au titre III (ibid.). III. Rdaction du rapport, communication au ministre public. Lorsque l'affaire est en tat d'tre juge, le rapporteur prpare un rapport. Ce rapport est remis au secrtaire-greffier qui le transmet immdiatement au commissaire du gouvernement. IV. Jugement des affaires. Le rle de chaque sance publique est arrt par le prsident du conseil et affich la porte de la salle d'audience. Toute partie doit tre avertie par une notification en la forme administrative, du jour o l'affaire est porte en sance publique.
DEVANT LE CONSEIL DE PRFECTURE PROCDURE
733
Aprs le rapport qui est fait sur chaque affaire par un des conseillers, les parties peuvent prsenter des observations orales l'appui de leurs conclusions crites, soit en personne, soit par mandataire. Le commissaire du gouvernement donne ses conclusions sur toutes les affaires. La dcision est prononce l'audience publique aprs dlibr hors la prsence des parties. V. Voies de recours. Elles sont au nombre de trois, l'opposition, l'appel et la tierce-opposition. L'opposition. L'opposition est dirige contre les dcisions par dfaut. Est par dfaut une dcision rendue alors que le dfendeur n'a pas fourni de requte en dfense, l'absence au dbat oral ne suffit pas pour constituer le dfaut. L'opposition doit tre forme dans le dlai d'un mois partir de la notification de l'arrt; elle est introduite en la forme ordinaire. L'opposition suspend l'excution moins qu'il n'en ait t autrement ordonn par la dcision qui a statu par dfaut. L'appel au Conseild'tat. Tout arrt du conseil de prfecture peut tre attaqu devant le Conseil d'tat dans le dlai de deux mois dater de la notification. Le dlai court contre l'tat ou les administrations reprsentes par le prfet, soit dater du jour o la notification de l'arrt a t faite par les parties au prfet, soit dater du jour o la notification a t faite aux parties par les soins du prfet. Ce dlai de deux mois est augment conformment l'art. 73 Code pr. civ. modifi par la loi du 9 mai 1862, lorsque le requrant est domiclii hors de la France continentale. La tierce opposition. Cette demande est forme au conseil de prfecture lui-mme, contre une dcision contradictoire, par un tiers auquel la dcision porte prjudice; elle suit les rgles ordinaires du recours. VI. Des procdures spciales. Il existe en matire de contributions directes une procdure spciale (1. 21 avr. 1832) ; il en est de mme en matire lectorale (1. 5 avr. 1884, art. 37 et s.). Il n'est rien innov en ces matires. (V. cependant l'art. 11, 1. 22 juillet 1889.) Pour les contraventions de grande voirie, v. l'art. 10. N 3. Laprocdure devant le ministre. 599. La procdure devant le ministre s'engage par le dpt d'un mmoire au ministre. Il est donn rcpiss si la partie le demande. Le ministre doit statuer par dcision spciale, mais cela ne veut pas dire dcision motive (D. 2 nov. 1864, art. 5 et seules formalits de cette procdure absolument sans 6). Cesotn les deux frais.
TABLE
ANALYTIQUE
DES
MATIRES
THORIE
DE
L'TAT
CHAPITREPRLIMINAIRE LE DROIT ET LES SCIENCESSOCIALES Ncessitde combinerles deux conceptions antagonistes CHAPITRE PREMIER L'TAT 1. La notion de l'tat. souverainet de l'Etat 10 2. La 3. L'organisation politique de l'Etat. Sparation des pouvoirs et dcentralisation. CHAPITREII L'TAT ET L'ORGANISME NATIONAL 1. Le rledel'Etat. Le socialisme. 2. Le droit public national. Les droits individuels et leurs garanties constitutionnelles. CHAPITREIII L'TAT ET L'ORGANISME INTERNATIONAL Rle de l'tat vis--vis de l'organisme international. L'tat et les glises 27 21 25 5 13 1
736
TABLEANALYTIQUE DES MATIRES
HISTOIREDE LA FORMATION DU DROIT ADMINISTRATIF FRANAIS, DEPUIS L'AN VIII.
AVERTISSEMENT a) priode d'laboration secrte (1800-1818) b) priodede divulgation (1818-1860) c) prioded'organisation (1860). Conclusion
31 33 36 46
LES SOURCESET LES MONUMENTS
DES RGLES DU DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF FRANAIS
1. Les sources. I. Caractresgni-aux ARTICLE dessoui-res.- Ledroit publicjus scriplvm, - le droit public jus ?!o~u?7. II. La loi el le rglement. Dfiuitions, rglements faits ARTICLE au nom de l'tat, rglements faits au nom de la commune, domaine respectif de la loi et du rglement, confection des lois et des rglements, force excutoire des lois et rglements, v: abronements qui peuvent leur enlever leur force excutoire , gation, annulation, illgalit g 2. Les monuments. Bulletin des lois et Journal officiel. 3. Les moyens de sanctioc. Sources,monuments,moyensde sanction des rgles du droit APPENDICE. public et administratif en Algrie et dans les colonies
59
60 71 73 75
TABLEANALYTIQUE DES MATIRES PREMIRE LE DROIT PARTIE PUBLIC
737
LIVRE JOUISSANCE
PREMIER DES DROITS PUBLICS
ET GARANTIE
CHAPITRE PREMIER JOUISSANCE DES DROITS PUBLICS 1. Caractres gnraux des droits publics. Harmonie entre les droits publics reconnus et notre tat social. Les droits publics sont des droits vritables, rapports des droits publics avec les droits privs, rapports des droits publics avec les devoirs. 2. Jouissance et exercice des droits publics. CHAPITRE II GARANTIESDES DROITS PUBLICS 1. Examen des garanties. Recours contentieux contre l'acte admi nistratif, poursuites contre les fonctionnaires, poursuites directes contre l'tat et les communes, Responsabilit civile des communes. 2. Des vnements qui suspendent ou paralysent les garanties des droits publics. L'ouverture d'une instruction criminelle, les actes de gouvernement, l'tat de sige.
79 83
87 98
LIVRE LES DROITS
II PUBLICS
CHAPITREPREMIER LES DROITS POLITIQUES DESUFFRAGE LEDROIT GNRALES 101 CONSIDRATIONS g 1. Du droit de vote. ARTICLE I. Jouissance du droit de vote 105 ARTICLE II. Des incapacits lectorales. Incapacit rsultant de la pri: tableau des condamnations emporvation de la jouissance du droit tant privation du droit de vote, incapacit rsultant de la priva106 tion del'exercice du droit. 47 H.
738
DES MATIRES TABLEANALYTIQUE
lIT. Des conditions d'exercicedu droit de vote. a) Lgislation ARTICLE de la liste lectorale, conditions requises pour tre inscrit sur la liste, - tablissement et rvision annuelle de la liste lectorale. bi Incompatibilitrsultant de la qualit de soldat prsent au corps. 2. Du droit d'ligibilit. ARTICLE I. Jouissancedu droit d'ligibilit II. De Vincapacilou inligibilit. a) Inligibilitpar suite de ARTICLE : condamnations b) Inligila privation de la jouissance du droit : inligibilitrsulbilit par suite de privation de l'exercice du droit tant de la fonction Appendice. L'incompatibilit. Cumul du mandat lectif avec une fonction publique, cumul de mandats lectifs, parent ou alliance entre plusieurs co-lus III. Conditions d'exercice du droit d'ligibilit. Conditions ARTICLE d'inscription sur une liste lectorale,ou d'attache avec la circonscription II CHAPITRE LES LIBERTS LIBRE PREMIRE. EXISTENCE SECTION
113 121
122 127 131
1. Libert de l'tre moral. Libert de conscience. a) Libert de la foi : libre croyance et libre pense ; libert des funrailles. : obligation de l'instruction primaire 133 b) Libert de la science 2. Libert de l'tre physique. Libert civile; Sret individuelle, libert individuelle, inviolabilitdu do?K?'c<7e. 136 3. Libert de la personnalit sociale. La filiation, le nom, les litres nobiliaires 138 II. LIBRE ACTIVIT SECTION 1. Action exerce par l'homme sur la nature. Libert du travail, de V indus trie et du commerce 139 2. Action exerce par l'homme sur ses semblables. 142 ARTICLE 1. Action exercedans le cercle priv II. Action exercepar l'hommesur ses semblablesen public, ARTICLE libert dela presse, libert du culte public, libert d'enseignement, libert de runion 144 APPENDICE AUX 1 ET2. Droit d'associationet conditiondes associations. Associationslittraires, scientifiques, etc. Congrgations 154' religieuses, - syndicats professionnels SECTION III. LIB::E JOI:IS=A\CE Libert et inviolabilitde la proprit III CHAPITRE LE DROIT AUX SERVICESPUBLICS L'assistanceest un devoir social, sanction DES SERVICES ^ASSISTANCE. juridique du devoir social, services d'assistance qui doivent tre 162 organiss 160
TABLEANALYTIQUE DES MATIRES
739
DEUXIME PARTIE LE DROIT ADMINISTRATIF
DFINITIONS 1 DFINITION DU DROIT ADMINISTRATIF 171 1 Les personnes administratives (tat, dpartements, communes, colonies, tablissements publics) 172 2 Les droits des personnes administratives et l'exercice de ces droits 173 174 30Les services publics
LIVRE
PRLIMINAIRE
L'ADMINISTRATION
ETDU L'ADMINISTRATION ENVISAGE DU POINT DEVUE DES SCIENCES POLITIQUES DEVUE 181 POINT JURIDIQUE. PREMIER [CHAPITRE LES OPRATIONS ADMINISTRATIVES ET LES ACTES D'ADMINISTRATION LESOPRATIONS SECTION ADMINISTRATIVES PREMIRE. DEL'OPRATION DFINITION ADMINISTRATIVE SECTION D'ADMINISTRATION II. LESACTES 1. Dfinition, classification, nature des actes d'administration. I. Dfinition. L'acte d'administration est une dcision exARTICLE 185 cutoire, etc II. Classification. Actes d'autorit, actes de gestion, actes ARTICLE de puissance publique, actes de personne prive, actes de gouvernement, actes de pure administration, actes d'administration ordi187 naire ARTICLE III. Nature de l'acte d'administration. Nature de l'acte d'autorit, ressemblance avecun jugement, nature de l'acte de gestion. 193 ARTICLE IV. Importance de l'acte d'adm:'KM<ra<OK. 195 2. Forme et procdure de l'acte d'administration. ARTICLE I. Forme et procdure de l'acte d'autorit, enqute de commodo et incommodo forme crite, etc 195 184
TABLE DES MATIRES ANALYTIQUE ARTICLE II. Forme de l'acte de gestion. Contrats passs en la forme administrative. 3. Les vices de l'acte d'administration. ARTICLE I. De l'usurpation depoM~o~ II. De l'excsde pouvoir. Vice d'incomptence, vice de ARTICLE formes, dtournement de pouvoir. Violation de la loi et des droits acquis. III. De l'inopportunit de l'acte ARTICLE 4. Contrle administratif de l'acte d'administration. 1. Contrleexerc par voie de ~e//e. ARTICLE II. Contrleexercpar voiehirarchique.Durecours gracieux ARTICLE ou hirarchique, ses rgles, ses rapports avecles recourscontentieux. 5. Les recours contentieux contre l'acte d'administration. ARTICLE I. Le re'coMr.9coM<eM~'eMj"ordt7ta!rp. II. Lerecours pour excs depouvoir. Sonhistoire, ses conARTICLE ditions de recevabilit, les ouvertures recours, la procdure, - les effets de la dcision CHAPITRE II
740
199 201 202 205 206 207 212 213
ET LES FONCTIONNAIRES LES AUTORITS ADMINISTRATIVES Autorits administratives. Reprsentants qui ont le pouvoir de faire 221 desactesd'administration. Fonctionnaires. Reprsentants qui n'ont pas le pouvoir de faire des actes d'administration 222
DES MATIRES TABLEANALYTIQUE LIVRE LES PERSONNES PREMIER ADMINISTRATIVES
741
TITRE numration
PREMIER administratives
des personnes
L'ETAT -25 LES DPARTEMENTS LES COMMUNES 22G LESCOLONIES 227 Distinction de l'tablissement public et de LESTABLISSEMENTS PUBLICS. l'tablissement d'utilit publique, numration des tablissements publics 227
225
TITRE Organisation
II administratives
des personnes
CHAPITRE PRLIMINAIRE RGLES COMMUNESD'ORGANISATION Du MANDAT SECTION PREMIRE. DEPUISSANCE PUBLIQUE. Du MANDAT LECTIF De la puissance publique. Caractres gnraux du mandat de puissance pubtique : 1er. Thorie gnrale des lections. Dfinition. a) Oprations antrieures au scrutin : priode lectorale, dclaration de candidature : le vote, le pour les lections lgislatives. h) Opration du scrutin dpouillement, le recensement gnral des voix. c) Le contentieux lectoral : la vrification des pouvoirs et le contentieux proprement dit, les vices de l'lection, les pouvoirs du juge, la procdure. 2. Thorie gnrale des assembles dlibrantes. a) Organisation des assembles. b) Leur fonctionnement, les sessions, les sances, les dlibrations. Attributions personnelles des membres des assembles dlibrantes.. S 3. Evnements qui mettent fin au mandat lectif. S 4. Caractres gnraux du mandat lectif. Prohibition du mandat impratif, gratuit du mandat, immunit et inviolabilit parlementaires. 230
238 255 266 267
267
742
TABLEANALYTIQUE DES MATIRES SECTION II. Du MANDAT OEFONCTION PCBLIQn:
De la fonction publique. Collation des fonctions publiques, aptitude aux fonctions publiques, caractres gnraux du mandat CHAPITREPREMIER ORGANISATION DE L'TAT ORGANE SECTION PREMIRE. EXCUTIF lor Le pouvoir central. I. Les autorits administratives du pouvoir central No1. Le ARTICLE prsident de la Rpublique, Organisation de la prsidence, attributions du prsident, nature et forme des actes, voies de recours. N 2. Les ministres, les sous-secrtaires d'Etat, le conseildes ministres. Organisation, attributions : le contre-seing, les pouvoirs propres. Nature et forme des actes, voies de recours. ARTICLE II. 'Les fonctionnaires du pouvoir central. N 1. Le Conseil d'tat. - Organisation,- attributions administratives. N 2. Les bureaux N 3. Les agents d'excution. La hirarchie et les cadres rgionaux. 2. Le pouvoir rgional. I. Lesautorits administratives du pouvoir rgional. N 1. Le ARTICLE prfet. - Organisation,- attributions, nature et forme des actes, voies de recours. N 2. Le sous-prfet N 3. Le M~-e. ARTICLE II. Les fonctionnairesdupouvo ir rgional. N 1. Lessecitaires gnraux de prfecture. N 2. Les conseilsde prfecture. N3. Les &M?'eaM~ SECTION II. ORGANE LGISLATIF lBr Rgles d'organisation. ARTICLE I. Rglesgnrales de composition de la Chambre des dputs et du Snat ARTICLE Il. Les lections la Chambredes dputs et au Snat. ARTICLE III. Fonctionnementde la Chambre des dputs et du Snat.. de snateuroude dput ARTICLE IV. vnementsqui mettent finau mandat Y. Caractres gnraux du mandat de snateur et de dput. ARTICLE 2. Attributions de l'organe lgislatif. I. Attributions coMs~<u~o?!~e//es. ARTICLE II. Attributions administratives. Lois d'affaires. ARTICLE III. Nature et forme des actes. Confectionde la loi, lois ARTICLE de finances.-'-CHAPITREII DU DPARTEMENT ORGANISATION Renseignements statistiques. Rglesrelatives au territoire. Histoire.
270
275 279 285 293 294
297 302 304
307 310 315 316 317 317 318 319
322
TABLEANALYTIQUE DES MATIRES ORGANE SECTION PREMIRE. EXCUTIF Le prefet. Attributions, force excutoire des actes. II. ORGANE SECTION DLIBRANT 1" Le conseil gnral. ARTICLE I. Rgles d'organisation.Rgles gnrales de composition lections, fonctionnement des conseils gnraux. ARTICLE 11. Attributionsdu cointil gnral. N 1. Les dcisionsdu conseil gnral, leur force excutoire, leur objet. N 2. Les manifestationsd'opinion,les nominations, le contrle ARTICLE III. Nature et forme' des actes, voie de ?~coMrs. 2. La commission dpartementale. ARTICLE I. Rgles~'or~a~M<2~o?. ARTICLE II. Attributions. N 1. Attributions N*2. Attribudlgues. tionspropres: Les dcisions, leur force excutoire et leur objet, les nominations, les avis, le contrle. ARTICLE III. Nature et forme des actes, voiesde recours ARTICLE IV. Du dsaccord et duconflit avec le prfet Organisation spciale du dpartement de la Seine. Dpartementsa/~r?'eMs APPENDICE. - RGANISATIO" DEL'ARRONDISSEMENT Leconseild'arrondissement CHAPITRE III DE LA COMMUNE ORGANISATION Renseignementsstatistiques. Nomet territoire. Histoire. ORGANE EXCUTIF SECTION PREMIRE.
743
327
328 332 340 341 342 344 347 3j8 349 350
351
353
1er Le maire et les adjoints. ARTICLE I. Rgls d'organisation. Nomination, suspension et rvo359 cation, remplacement provisoire, dure du mandat ARTICLE II. Attributionsdumaire. Nd 1. Nature des attributions, a) Le maire agent de l'tat. b) Le maire agent de la commune, ses l'excution des dcisions du conseil municipal 364 pouvoirs propres, N 2. Force excutoiredes actes du M~c 367 No 3. Nature et forme des actes 368 N 4. Contrledes actesdu maire 368 par le prfet etle conseilmunicipal. N 5. Voies 370 derecours contre les actes du maire N 6. Dlgationdeses pouvoirsfaite par le maire 370 2. Les fonctionnaires de la commune. Agentsde la police,garde 371 champtre, commissaire de police LECONSEIL II. ORGANE SECTION DLIBRANT. MUNICIPAL 1er Rgles d'organisation. Rglesgnralesde composition 373
744
DES MATIRES TABLEANALYTIQUE
? 1. lections auconseilmunicipal. Sectionnementlectoral, lec374 teurs, lig-ihles,- scrutin, etc. N 2. Fonctionnementdes conseilsmunicipaux. Sessions,sances, etc. 378 ? 3. Suspensionet dissolution. De la dlgation spciale. 319 4 vnementsqui mettent fin au mandat de conseillermunicipal 380 2. Attributions du conseil municipal. I. Nature des attributions. N 1. DcisionsduconseilmuniciARTICLE 381 pal. Force excutoire, objets de ces dcisions. N 2. Manifestationsd'opinion. Avis, propositions et vux. N 3. Actes de contrle. No4. A'b/M~~o~ 386 11.Nature et forme des actes. Recourset l'oiesde nullit ARTICLE 387 388 Rgime spcialde Paris et de ~o?:. Communes 390 d'Algrie et des co/c?!:~ CHAPITRE IV ORGANISATION DES COLONIES Legouverneur, les directeurs, le conseilpriv.. ORGANE EXCUTIF. Le conseilcolonial, la commission coloniale ORGANE DLIBRANT. CHAPITRE V DES TABLISSEMENTS ORGANISATION PUBLICS. de bienfaisance. Lescommissions 1'\01.Lestablissementscommunaux administratives 395 N 2. Les fabriques. Conseilsde fabrique 396 N 3. Les syndicats de communes 401 391 393
TITRE
III
Obligation de la comptabilit.
1er La comptabilit publique. N 1. Lecompte du p~</'<?Ko:'n<?. N 2. Le budget. Votedu budget, excution du budget, l'exercice financier, le budget considr comme acte juridique N 3. Lacomptabilit dcca<Me.*. 2. Le contrle de la comptabilit. Le contrle administratif, la Cour des comptes,les comptesdu budget. La comptabilitde /~</ APPENDICE.
403 404 410 410 413
DES MATIRES TABLEANALYTIQUE
745
LIVRE
II ADMINISTRATIVES
LES DROITS DES PERSONNES
TITRE
PRLIMINAIRE
JOUISSANCEDES DROITS Droits de puissance publique et droits de personne prive. Dela jouissance des droits, de l'exercice des droits et de la capacit. 415
TITRE
PREMIER
Les droits de puissance publique
CHAPITRE PRLIMINAIRE CARACTRES GNRAUX DES DROITS DE PUISSANCE PUBLIQUE Dfinition et division, antagonisme des droits de puissance publique et des droits publics des citoyens, des rgles de droit qui doivent tre appliques aux droits de puissance publique, de la concession des droits de puissance publique CHAPITRE PREMIER LES DROITSDE POLICE LAPOLICE SECTION PREMIRE. DES FONCTIONNAIRES Caractre gnral de la situation des fonctionnaires, nomination ou collation d'emploi, tat des fonctionnaires Des pensions de retraite civileset militaires SECTION II. LATUTELLE ADMINISTRATIVE 1er Tutelle exerce sur les personnes administratives. Du droit de rgale sur les menses piscopals 2. Tutelle exerce sur les tablissements d'utilit publique. Condition gnrale de ces tablissements, congrgations religieusesreconnues, caisses d'pargne prives,- socits de secours mutuels, monts de pit 424 430
419
437
440
746
TABLEANALYTIQUE DES MATIRES SECTION III. LAPOLICE DES CITOYENS
1er Police administrative. J ARTICLE I. Police gnrale de l'tat et de la commune. Des droits que suppose la police, le pouvoir rglementaire, le droit de disposer de la force publique N 1. Police gnrale de l'tat. Service de la sret gnrale, police sanitaire No 2. Police communale. a). Police municipale, police rurale ARTICLE II. Polices spciales de l'tat. - N 1. Police descours d'eau non navigables ni flottables. Condition lgale de ces cours d'eau, police et conservation, droits et charges des riverains No2. Police des tablissementsdangereux, insalubres et incommodes.. N 3. Police des sources minrales, No4. Restauration des terrains en montagne, fixatio?i desdunes N 5. Policedes monumentshistoriques et des objets d'art 2. Le service militaire. Aperu historique et dispositions gnrales de la loi du 15 juillet 1889. ARTICLE I. Obligations rsultant du servicemilitaire. No1.Leservicemilitaire N 2. La taxe m~t~aM'e. II. Oprationsdu recrutement. Le recrutement, la rvision, ARTICLE le conseil de revision CHAPITRE11 LES DROITSDOMANIAUX DE PUISSANCEPUBLIQUE LEDOMAINE PUBLIC SECTION PREMIRE. g 1er Le droit de domaine public. C'est un droit de proprit modifi dans ses effets par l'utilit publique 2. Les dpendances du domaine public. No 1. De l'inalinabilit desdpendancesdu domainepublic. Origine, sens et porte de cette inalinabilit ; droits utiles qu'elle laissesubsister. - N2.Du critrium qui permet de dterminer les dpendancesdu domaine public, ce critrium est dans l'affectation de la chose l'utilit publique, consquences au point de vue des choses mobilires et incorporelles, justification du systme en ce qui concerne les btiments affects un servicepubtic. - - N 3. numration des principales dpendancesdu domainepublic. : rivages dela Domainepublic de l'tat. a) Domaine public naturel mer; fleuveset rivires navigableset flottables. b)Voiesde communication : chemins, routes etrues la charge de l'tat; chemins de fer aux servicespud'intrt gnral. - c) Btiments et terrains affects blics : - - - - Domaine public dpartemental Domainepublic communal. Cheminsvicinaux, chemins ruraux. D'ow~<e/)M6/<cco/o~?'f</ - - - - -
445 448 452 460 463 466 467 468 469 472 47& 480
485
489
493
S02 507 510
TABLE
DES MATIRES ANALYTIQUE
747
1 3. Les droits que contient le droit de domaine public. I. L'affectation et la dsaffectation. Le classement et le d,vARTICLE. classement. 510 a) Affectationet dsaffectation des rivages de la mer et des tleuves.. : effets du 6) Classementet dclassement des voies de communication classement, effets du dclassement, droit de premption des riverains. 511 515 et dsaffectation des btiments aux services publics. c) Affectation Il. La dlimitation et l'alignement. ARTICLE. N 1. Dlimitationdes rivagesdela muetdes fleuves.- Voies de recours. 516 : No 2. De l'alignement. a) Fixation des limites par l'alignement, des plans d'alignement, servitudes d'alignement b) Protection des limites par l'alignement 520 No3. Bornage des btiments et terrains affects un service public. 522 ARTICLE. III. La police du domaine public. Policede la voirie. No 1. Rgles de la grande voirie. Contraventions de grande voirie, police des routes nationales et dpartementales, des rues de Paris, des chemins de fer, des fleuves et canaux, des rivages de la mer ; 525 matires assimiles la grande voirie. ? 2. Rgles de la petite voirie. Contraventions de petite voirie, 531 obligations et servitudes des riverains. ARTICLE IV. Utilisation des dpendancesdudomaine public par la perception desproduits et la concession. No 1. Perception des produits. Ferme de la pche des fleuves 532 N 2. Les concessionssur le domaine public. Caractres gnraux de la concession, nature du droit du concessionnaire, examen de : sur le rivage de la mer, sur les cours d'eau, quelques concessions dans les cimetires : permissions de voirie, etc. Des monopoles crs 533 par les concessions sur le domaine public SECTION DEPUISSANCE II. LES MODES PUBLIQUE D'ACQURIR Privilges exorbitants CARACTRES GNRAUX DECES MODES D'ACQURIR. des personnes administratives pour les crances et les dettes qui naissent d'oprations de puissance publique. Les arrts de dbet, comment l'tat peut tre dclar dbiteur. La dchanc e quiuquennale 1er Les impts. Dfinition. Importance des impts, impts NOTIONS GNRALES. sur le capital et sur le revenu, - impts proportionnels et tarifs progressifs, impts directs et indirects, impts de rpartition et de quotit. ARTICLE I. Les impts directs. Dispositionscommunes toutes les contributions directes, division en principal et en centimes additionnels, principe da l'annalit la matrice et le rle, -l'exigibilit, les poursuites, les demandes en dcharge ou rduction, les demandes en remise ou modration No 1. Les imptsdirects de l'tat. 1 L'impt foncier sur la proprit non btie, le cadastre 2 L'impt foncier sur la proprit btie. 3 La contribution personnelle-mobilire 4 L'impt des portes et fentres 5 L'impt des droits de patente
541
546
553 558 562 564 566 569
748
TABLEANALYTIQUE DES MATIRES 573 575 575 577 578 579 581 583 585 589 591 595 600 601 602
Les taxes assimiles aux contributions directes No 2. Les impts directs dpartementaux, les centimes additionnels. N 3. Les impts directs communaux, les centimes additionnels, les prestations. N 4. Les impts directs coloniaux No5. Les impdts au profit des tablissementspublics, le droit des pauvres ARTICLE II. Les impts indirects de l'tat, des communes, des colonies, des chambres de commerce. 2. L'expropriation pour cause d'utilit publique. DFINITION ETHISTOIRE ARTICLE I. Dispositions gnrales, Qui peut exproprier, quelles choses peuvent tre expropries, en vue de quels objets on peut exproprier ARTICLE II. L'expropriationpar le grand jury. o 1. La dclaration d'utilit publique .? 2. La dsignation des <e~ra~s N 3. Le transfert de proprit. Le jugement d'expropriation et ses effets, la cession amiable No 4. Le paiement de l'indemnit et la prise de possession, le grand jury d'expropriation Procdures exceptionnelles par le ~rc'M<~M)'!/ ARTICLE III. L'e~p?'opr!a<!OMp6[?'e~<yMr!/ Matires voisines de l'expropriation. L'effet des plans APPENDICE. d'alignement, les rquisitions militaires 3. Les travaux publics. ARTICLE I. Dfinition de l'opration de travaux publics. Du travail excut, de la personne administrative pour le compte de laquelle il est excut, du service public en vue duquel il est excut, des travaux irrgulirement engags ARTICLE II. Les consquencesdes travaux publics vis--vis des tiers. ? 1. Thorie des dommages causs la proprit. Thorie gnrale, l'occupation temporaire, les dommagespermanents. No 2. Thorie des plus-values indirectes apportes la proprit N 3. Des dommages causs aux personnes par les travaux publics.. ARTICLE III. L'excutiondes travaux publics. N1.L'excutionen rgie. No 2. L'excution par march ou entreprise, les marchs de travaux publics. a) Formes des marchs, de l'adjudication. b) Objet du march. Le cahier des charges, le cahier des clauses et conditions gnrales c) Les droits et obligations qui naissent du march. -- Droits exorbitants de l'administration. N 3. La concession de travaux publics. a) Concessionsde travaux publics sur des dpendancesdu domainepublic : chemins de fer, tramways, bacs et passages d'eau de travaux publics hors du domaine public. Les assob) Concessions ciations syndicales autorises, leur nature d'tablissement public, leur organisation, leurs prrogatives, les associations syndicales forces et les associations syndicales libres N 4. Les souscriptions, volontaires et les offres de co?!COM?'s Appendice aux travaux publics. Les concessions de mines. Dfi-
603 608 614 616 616 611 618 620 623
628 634
TABLEANALYTIQUE DES MATIRES nition de la mine et du gisement minier, condition juridique du gisement minier, il appartient au propritaire de la surface, condition juridique de la mine; caractre de la concession. Les analogies avec la concession de travaux publics faite hors du domaine Lgislationdes mines l'tat 4. Les marchs de fournitures de 5. Les contrats relatifs la dette publique de l'tat. Les emprunts et les cautionnements
749
636 639 641 643
TITRE
II
Les droits de personne prive
CHAPITRE PRLIMINAIRE DES DROITSDE PERSONNEPRIVE CARACTRES GNRAUX Dfinitiondes droits de personne prive, ils sont tous domaniaux. 64 4 Des rgles de droit quileur sont applicables CHAPITRE PREMIER LE DOMAINE PRIV 1er Le domaine priv de l'tat. Alinabilit et prescriptibilit du domaine, les dpendances du domaine priv, la gestion du domaine 2.Le domaineprivda dpartement. 3. Le domaine priv de la commune. Les bienscommunaux 4.LodomaineprivdeaooIoniea 5. Le domaine priv des tablissements publics Les droits d'usufruit, d'usage, de serviDOMAINE APPENDICE AU PRIV. tudes, deprtt;:~e~e</t?/po//:<yMM. CHAPITRE II DE PERSONNE D'ACQURIR PRIVE LES MODES CARACTRES DECES MODES SECTION PRLIMINAIRE. GNRAUX D'ACQURIR..655 MODES PROCDENT DE LA PREMIRE. SECTION LOI. a) AttriD'ACQURIR QUI bution des biensvacantset sans ~a!<rp. 656 657 b) La dshrence De la jouissance du droit de recevoir, II. LES DONS ETLEGS. SECTION de la capacit de recevoir et de l'autorisation, de l'acceptation. 657
647 649 649 651 651 652
750
TABLEANALYTIQUE DES MATIRES 662 663 664 665 666 668
Appendice. Produit des qutes, collectes,troues. N 1. Lesventes.Ventes des biens de SECTION III. LESCONTRATS. l'tat et des biens des communes No2. Lesconcessions sur le domainepriv N 3. Lesbaux /rme. La gestiond'affaires SECTION IV. LESQUSI-CONTRATS. La responsabilit civile de l'tat et SECTION V. LESQUASI-DLITS. des communes
DES MATIRES TABLEANALYTIQUE
751
LE
CONTENTIEUX
ADMINISTRATIF
Dmtion. PREMIER CHAPITRE LES ACTIONSOURECOURS 1er Les actions ou recours intents par les particuliers. Des cas oit le particulierpeut attaquer. De la faon de crer le contentieux J~<'l.DpsrecourscoK~eM<!eM;rcoM~e~'ac<e. N 2. Des actions contre la personne. Obligation de dposer un mmoire. 2. Les actions ou recours intents par les personnes administratives. No1. Des diffrentes actionsque les personnesadministratives : actions ordinaires, recours, actions dans peuvent avoir intenter l'intrt de la puissance publique N 2. De la capacit d'ester en justice et du maniement de l'action. De l'autorisation de plaider pour les communes et les tablissements publics II CHAPITRE ET LA COMPTENCE. LES JURIDICTIONS
671
673 676 677
678 679
DELAPLACE PAR LA ADMINISTRATIVE SECTION PREMIRE. OCCUPE JURIDICTION 1er Sparation de la juridiction administrative et de la juridiction ordinaire. ARTICLE 1ER, raisonsprofondes de cette sparation. 682 II. Partage d'attribution entre les tribunaux administratifs ARTICLE et les tribunaux judiciaires. N 1. Du principe constitutionnel sur lequel 687 repose ce partage o 2. Rglesd'attribution. a) Contentieux de l'annulation; b) contentieux de pleine juridiction; c) contentieux de l'interprtation; d) contentieux de la rpression 689 69* N 3. Des conflits et du tribunal des conflits | 2. Sparation de la juridiction administrative et de l'administration active. ARTICLE 1ER.Sparation des juges administratifs et 700 des administrateurs. Question du ministre-juge II. Limite des pouvoirs de la juridiction administrative sur les ARTICLE actes de l'administration active 705 III. Des cas de juridiction gouvernementale, justice retenue et ARTICLE justice dlgue, le recours pour abus. 705 II. ORGANISATION DE LAJURIDICTION ADMINISTRATIVE SECTION 1er Organisation gnrale de la juridiction administrative. La juridiction en premier ressort, le Conseil d'tat juge de droit
752
TABLEANALYTIQUE DES MATIRES 40 715 718 719 720 720
commun en premier ressort, l'appel, la cassation, parent du recours en cassation et du recours pour excs de pouvoir 2. Organisation et comptence des diverses juridictions. N 1. Le Conseil d'tat. Section du contentieux et assemble du contentieux N 2. Les juges subordonnsau Conseil d'tat par l'appel. a) Les conseils de prfecture. b) Les conseils du contentieux des colonies. c) Les ministres. No 2. Lesjuges subordonns au Conseild'tat par la cassation, Cour des comptes, conseils de revision, conseil suprieur de l'instruction publique, etc CHAPITRE III LA PROCDURE
10r Caractres gnraux de la procdure administrative. Existence indpendante de la procdure administrative, caractres gnraux de cette procdure, instruction dirige par le juge, procdure crite, procdure en partie secrte, les privilges de la puissance publique, la notification des pices par la voie administrative 722 2. Les diverses procdures. N 1. La procduredevant le Conseil d'tat 725 i31 La procdure devant le conseil de prfectuc^T N 2 733 N 3. . La procdure devant le ministre -" (,,,, ,^X.
TABLE
ALPHABTIQUE
DES
MATIRES
A Abus (recours pour), 708. Acte d'administration, acte d'autorit et acte de gestion, acte de puissance publique et acte de personne prive, nature et forme des actes, voies de recours, 185 et s. Acte de gouvernement, 191. Acte discrtionnaire, 193. Actions, ou recours intents par les particuliers ou par les personnes administratives, 673. Adjoints, 359et s. Adjudication, 617. Administration, 181. Affectation l'utilit publique, 494. Affectation des btiments aux services publics, 515; affectation de btiments des uvres prives, 516. Agents de police, 372. Algrie. Application des lois, 75; le droit de suffrage des indignes, 105; organisation, 227 ; dparments algriens, 350; communes d'Algrie,390; les impts, 578. Alignement, 520.. Annulation. Annulation des actes par voie administrative, 207. V. Prfet, Maire,Conseil gnral, Conseil municipal,etc. ; contentieux de l'. V. Contentieux. Appel, 713. Approbation. V. Autorisation. Arrt, une des formes de l'acte d'administration, 198; a. de dbet, 543; a. de cessibilit, 589. Arrondissement, 350. H.
Assainissement, 450,456. Assemblesdlibrantes (Thoriegnrale des),255 et s. Assistance publique, 163et s. Association (Les associations et le droit d'), 154. Associations syndicales autorises, 628; associations syndicales forces et libres, 634. Attributions des autorits administratives, sont relatives au pouvoir defaire des actes d'administration, 221. V. Prsident de la Rpublique,Ministres, Prfet, Maire, Conseil gnral, Conseilmunicipal, etc. Attribution contentieuse (Rgles d'), 689. V. Conflit. Attroupement, 154. V. Responsabilit des communes. Autorisations ou approbations, d'un acte par une autorit suprieure. 206, 438. V. Prfet, Maire, Conseil gnral, Conseil ; municipal,etc. de plaider par le conseil de prfecture, 681, d'accepter des dons et legs, 660. Autorits administratives, 221. Avis, 197. V. Conseil gnral, Conseil municipal, Conseild'tat, Conseil deprfecture. Avocats au Conseil d'Etat, 725; affaires dispenses du ministre d'avocat. les conseils de prAvous, devant fecture, 723. B Bacs, 625. 48
754
TABLE DES MATIRES ALPHABTIQUE
Classement, dclassement, 511. Cloches (sonnerie), 456. Colonies. Applicationdes lois, 75; suffrage, 106; organisation, 391; communesdes colonies, 390; domainepublic, 510; impts, 577,581. Commissairede police, 372. Commission administrative (hpitaux, hospices,bureaux de bienfaisance, 396. Commissioncoloniale, 393. Commissiondpartementale, 342. Commissionsd'tudes. V. Assemblesdlibrantes. Commune.Organisation,353et s. ; C police,452;domainepublic, 507 ; impts, 575; domaine priv, Cadastre, 559. 649; responsabilit civile, 97; gestion d'affaires,666. Cahier desclauses et conditions gnrales, 619. Comptence (destribunaux adminisCaisse des dpts et consignations, tratifs), 682et s. 232. Comptabilitpublique,403;compCaisses d'pargne prives, 443. tabilit de fait, 413. Caisses diverses. V.tablissements Comptes(Courdes), 411. Concession. C. des droits de puispublics, 232. sance publique, 423; c. sur le Canaux, 505. domainepublic, 533; c. dans les Candidature, et dclaration de cancimetires, 538; c. de travaux didature, 211. publics, 623; c. sur le domaine Capacit, des personnes administratives, 411; des individus pour priv, 664. les droits publics, 86. Concordat, 29. Conflit d'attribution; tribunal des Cassation, 713. conflits, 694. Cautionnement, des fonctionnaires, 442. Congrgations, 155, 643; c. des entrepreneurs et Conseils administratifs, 292. fournisseurs, 618. Conseil d'Etat, 285; Centimes additionnels, 553, 575. au contenCentralisation. V. Dcentralisatieux, 715. Conseils de prfecture, 304; au tion. Cessibilit (Arrt de), 589. contentieux,718. Conseilsducontentieux des colonies, Cession amiable, 594. 719. Chambres lgislatives, 306. Conseil priv. V. Colonies(orgaChambre de commerce, chambres consultatives diverses, 231. nisation) Conseilgnral de dpartement, 328. Chasse, 139,299. Conseil gnral de colonie, 393. Chemins de fer, 505,528,624. V. Conseil municipal, 373. Tarifs. Conseildes ministres.280. Chemins ruraux, 508. Conseil de revision, 721. Chemins vicinaux, 507. Contentieux administratif, 671et s. Cimetire, 509. Servitudesdes ciC. de l'annulation. 689; c. de metires,523. V. concessions.
Btiments affects un service publio, sont dpendance du domaine public, 496. Baux ferme, 665. Biens communaux, 650. Biens vacants et sans matre, 656. Budget, tude gnrale, 404; b. de l'tat, 320; b. du dpartement, 335; b. de la commune, 383. Bureau des assembles dlibrantes, 260. Bureau de bienfaisance, 169, 233, 396. Bureau lectoral. V. lections.
TABLEALPHABTIQUE DESMATIRES c. de l'inpleine juridiction,690; terprtation, 692; c. de la rpres; c. lectoral, 250. sion, 694 Contrainte administrative, 543, 703; porteurs de c., 555. Contrats. C. passs titre de puissance publique ou c. administratifs, 603 et s. V. Marchs; c. passs titre de personne prive, 662. Contravention de grande voirie, 525; c. de petite voirie, 531. Contreseing. V.Ministres. Contributions directes et indirectes. V. Impts. Contrle hirarchique ou par voie de tutelle, 205. V. Maire, Conseil gnral, Conseilmunicipal, etc. Cours d'eau non navigables ni flottables, 460. Cour des comptes. V. Comptes. Crances des personnes administratives titre de puissance publique, 542; titre de personne prive, 655. Crdits. V. Budget. Crment futur (Concession de), 665. Cumul. V. Traitements, incompatibilit. D Dbet (Arrts de), 543703. Dcentralisation, 18. Dcharge ourduction (Demandeen). V. Impts. Dchance quinquennale, 408546. Dcisions. V. Acted'administration, Dcrets,279. Dlgation. D. de la puissance publique, 237, 268. Dlgation spciale, 380. Dlibrations des assembles, 262. Dlimitation des rivages et des fleuves,516. Dmission, 267. Deniers publics, 410, 496. Dpartement. Organisation, 322; domaine public, 506; impts, 575. Dpens, 724.
755
Dpenses. Dpenses obligatoires. V. Budget ; paiement des dpenses,408. Dsaffectation. V. Affectation. Dshrence, 657. Dtournement de pouvoir.V. Excs de pouvoir. Dettes des personnes administratives, 544,656. Devis, 619. Diocse, 231. Dissolution. D. de la Chambre, 277; des conseils gnraux, 332; des conseils municipaux, 379. Domaine priv, 647. Domaine public, 485 et s. Domicile (Inviolabilit du), 138. domicile de secours, 170. Dommages rsultant des travaux publics, 608et s. Dons et legs, 657. Droit administratif, 171. Droits publics des citoyens, 79 et s. Droits de puissance publique, 415, 419 et s.; droits de personne prive, 415, 644 et s. Droit des pauvres, 579. E Ecole (maison d'), 509. Eglise. Les glises et leurs rap; domaniaports avec l'tat, 28 lit publique des btiments des glises, 498 ; rparations, 399. Elargissement. V.Alignement,Classement. Elections. Thorie gnrale, 238 et s. V.Snat, Chambre des dputs, Conseil gnral, Conseilmuniipal, etc. Electeurs, 106. Eligibilit. V.Inligibilit. Conditions d'ligibilit, 131. Endiguement (Concession d'), 665. Enfants assists, 167. Enqute de commodoet incommodo, 196. Etablissements dangereux, etc., 463. Etablissements d'utilit publique.
756
TABLE DESMATIRES ALPHABTIQUE H Halage (Cheminde), 529. Halles et marchs, 509, 652. Homologation. V. Tarifs. Hpitaux, Hospices, 168,233, 396. Hypothques, 653. I Immunit parlementaire, 269. Impts, notions gnrales, 546; impts directs, 553, dcharge ou rduction 556; remise ou modration, 557; impt foncier sur proprit non btie, 558; sur proprit btie, 562; contribution personnelle mobilire, 564; c. des portes et fentres, 566; patente, 569 ; taxes assimiles, 573; impts dpartementaux, 575; communaux, 575 ; prestations, 576; coloniaux,577; d'tablissement public, 578; imptsindirects, 579. Inalinabilit des dpendances du domainepublic, sens et porte,489. Incapacit. V. Capacit ; incapacits lectorales, 106; incapacit d'tre lu. V. Inligibilit. Incompatibilit, 127. Indemnit parlementaire. 268. Inligibilit, 122 et s. Insaisissabilit des biens des personnes administratives, 545. Instruction des affaires, 262. Interprtation des actes d'administration, 692. Inviolabilit parlementaire, 270. J Jouissance des droits (pour les 415. personnes administratives), Juge de droit commun, en premier ressort, 711. Juridiction. Existence d'une j administrative, son caractre prtorien, 682.
Distinctionde ces tablissements et des tablissements publics, 228; condition gnrale de ces tablissements, 440. Etablissements publics, 227, organisation, 395; impts, 578, 580; domaine priv, 651. Etat (Thorie gnrale de l'), 1; notion administrative de l'tat,172. Etat de sige, 100. Excs de pouvoir. Vice de l'acte d'administration, 202; recours 676. pour excs de pouvoir, 213, Exercice financier, 407. Expropriation pour cause d'utilit publique, 581. F Fabriques, 231, 399. Faits de guerre, 95, 193. Faute. F. administrative, f. personnelle du fonctionnaire, 90. Fleuves et rivires navigables et flottables, 504. V. Dlimitation. Fonctionnaire. 222. Conditiondes f.,424, et s. poursuites contre les f., 89 et s. Fonction publique, 270, 495. Force publique, 446. Forts de l'Etat, 648. Forme (Vicede). V.Excs de pouvoir. Forme administrative (Contrats en la), 200. Forteresses (Servitudes des), 530. Fouilles. V. Objetsd'art; occupalion temporaire. Fournitures (Marchde), 641. G Garanties constitutionnelles, 25. Garanties des droits publics, 87 ets. Garantie des fonctionnaires, 89. Garde champtre, 371. Gestion d'affaires, 666. Gouverneur. V. Colonies.
TABLE DESMATIRES ALPHABTIQUE Jury d'expropriation. V. Expropriation. Justice. J. retenue et j. dlgue, 706. L Lais et relais. 504. Legs. V. Donset legs. Liberts individuelles. V. droits publics, 79; libert de conscience, 133; 1. civile, sret individuelle 1. d'aller et de venir, ; 136 ; l. du nom et du titre, 138 1. du travail, de l'industrie et du commerce, 139; 1.des cultes, 144; 1. d'enseignement, 144; 1. de la presse, 147; 1. de runion, loi; D d'association, 154. Lignes tlgraphiques et tlphoniques (Servitudes), 530. Liquidation des dettes de l'Etat, 514. Liste lectorale, 113et s. Logementsinsalubres, 457. Loi. V. Sources du droit; confection des 1., 320. Lyon et l'agglomration lyonnaise, 389. M Maire, 360 et s. Majorit. Y. lections. mandat qui conMandat public, frela puissance publique, mandat lectif, 236; mandat qui confre la fonction publique, 270. Marais. V.Associations syndicales, plus-value directe. Marchs. V. Fournitures, travaux publics, Mmoire (Dpt d'un), 677. Mense, 231. V.Rgale. Mines, 636. Ministres, responsabilit civile des ministres, 279; question du ministre-j uge, 702. Ministres du culte. V.Abus. Modes d'acqurir, de puissance pu-
757
de personne priblique,541; ve, 655. Monopoles rsultant des concessions sur le domaine public, 539. Monuments du droit public, 71. Monuments historiques, 468. Monts de pit, 444. N Nom, titre, filiation,138. Nullit des dlibrations, 265; des dlibrations des conseils gnraux, 341; des conseils municipaux, 387. O Objets d'art, 468. Obligation administrative. V, Dcentralisation. Occupation temporaire, 610. Octrois, 579. Officesministriels, 427. Officiers (tat des), 428. V. Pensions. Offres de concours, 634. Oprations administratives, 184. Ordonnancement, ordonnateur, 408. Organisation administrative, 235et s. Organisation politique, 13. Organe. O. dlibrant, excutif221; o. spciaux, 20. P Paris (organisation municipale),388. Parlement. V.Chambres. Pavage,532. Pche, 139,299,462, 533. Pensions de retraite, 430; p. civiles, 431; p. militaires, 435. Caisses dpartementales et communales deretraite, 436. Priode lectorale, 213. Permissions devoirie, 537. Personnes administratives, 172, 225. V. Jouissancedes droits.
758
TABLEALPHABTIQUE DES MATIRES 213 ; r. gracieux ou hirarchique, 208; V. 676et s. Recrutement. V.Servicemilitaire. Redressement. V. Classement, Alignement. Rformation des actes. V. Annulation. Rgale (Droit de). 439. Rglement, 60 et s.; rglement d'eau, 462. Remise ou modration. V. Impts. Rquisitions militaires, 602. Rquisition de la force publique, 446. Responsabilit des personnes administratives, 93; V. Quasi-dlits; des fonctionnaires, 89. Runion (Droitde), 151; runions lectorales, eod. Rvocation. V. Fonctionnaires, Suspension. Ravage, 503, 516. Rle. V. Impts. Routes, nationales, 505; dpartementales, 506; Y. Classement, Alignement, Voirie. Rues, 507. V. Classement,Alignerues de Paris, 528. ment, Voirie; S Salubrit. V. Policeadministrative, Police municipale, Assainissement. Scrutin. V. lections. dlibrantes. SancesV.Assembles Secours mdicaux, 168. Secrtaire gnral de prfecture, 304. Section de commune, 233. Section lectorale de commune,374. Section de vote, 248. Seine (Dpartement de la), 349. Snat. V. Chambres. Sparation des pouvoirs. V. Pouvoirs. Sparation de l'administration et de la juridiction,700. Service militaire, 469. Services publics. 174. Droit aux services, 162.
Plus-values directes et indirectes, 614,632. Police. Droitsde p., 424et s. ; p. des fonctionnaires,424 ; p. administrative, 445et s.; p. de l'tat; p. de sret. p. sanitaire, 448; p. de la commune, municipale et rurale, 452.V. Cours d'eau non navigables, tablissements dangereux, sources minrales, terrains enmontagne, monuments historiques, servicemilitaire, etc. Ponts page, 624. Poursuites. V. Fonctionnaires, impts. Pourvois. V. Cassation. Pouvoirs. Les trois pouvoirs, sparation des p., 15; p. central et p. rgional, 248, 270; p. rglementaire, 60, 446. Premption (Droit de), 512, 521,585. Prfet, 297, 327. Presbytre, 399, 509. Prsident de la Rpublique, 275. Presse. V.Liberts. Prestations. V. Impts. Privilges. V. Hypothque. Procdure administrative, 722et s. Processions, 455. Proprit (Droit de), 160; protection de la p., 518, 692. Puissance publique, 236. Q Quasi-contrat, 666. Quasi-dlits, 668. Questions prjudicielles, 691. Qutes, 662. dlibrante. Quorum. V.Assemble R Recensement des voix. V. lections. Recrutement militaire. V.Service militaire. Recours. R. contentieux ordinaire, 212; r. pour excs de pouvoir,
TABLE DES MATIRES ALPHABTIQUE Servitudes d'utilit publique, 523. V. Voirie, Alignement, Travaux publics, Forteresses,Zone frontire, Halage,Lignestlgraphiques,Cimetire, etc. Sessions. V. Assembles dlibrantes. Socits de secours mutuels, 443. Sources du droit public, 59 et s. Sources minrales, 466. Souscriptions. V. Offres de concours. Sous-prfet, 302. Sous-secrtaire d'tat. V. Ministre. Souverainet, 10. Substitution du prfet au maire, 369. Suffrage (Droit de), 101 et s. Sret gnrale. V. Police. Suspension. S. des dlibrations des conseils gnraux, 334; s. des arrts du maire, 368 ; s. du maire, 362; s. du conseil municipal, 379. Syndicat de communes, 233. Syndicats professionnels, 156. T Tableau de dlais. V. Listelectorale, 120. Tableau des incapacits lectorales, 108. Tarifs de chemins de fer, 627. V. Rglements,62.
759
Taxe du pain, 459. Taxe militaire, 478. Terrains en montagne, 467. Traitements, 429. Tramways, 625. Travaux publics, 603et s. V. JuriTribunaux administratifs. diction. Tribunal des conflits. V. Conflits. Troncs. V. Qutes. Trottoirs, 532. Tutelle administrative. 437. V. 205. U Usage et Usufruit, 652. V Vente, 663. Vrification despouvoirs. V. contentieux lectoral. Vices de l'acte d'administration. V. Excs de pouvoir. Voies de nullit. V. Nullit, rccours. Voirie, 524 et s. Vote. Droitde v., 105. Opration du v. V. lections. Z Zone frontire 530. (Travaux mixtes),
IMP.A. BURDIN ETCie,RUE ANGERS, GARNIER, 4.
A LA MME
LIBRAIRIE
PRCIS DE DROITCIVIL, contenant: dans une premire partie, l'expos des principes, et, dam une deuxime, les questions de dtail .et les controveises, suivi d'une table des textes expliqus et d'une table analytique dveloppe,par G. BAUDRY-LACANTINERIE, doyen et professeur de droit civil la Facult de droit de Bordeaux, 4edition,1891-1893,3 vol. grand in-3 3f.fr. 50 Chaque volume sp-irment. 12fr. 50 LMENTS DE DROITADMINISTRATIF, l'usage des tudiants des facultsde droit, parJ. MARIE, avocat, professeur de droit administratif la Facultde llennes, 1890, 1 vol. iu-8 10 fr. v PRCISDE PROCDURE CIVILE, contenant les matires e}.l.{eii pour les examens de licence, par E. GARSOET, professeur la Facult de droitde Pari, 12 fr. . 1885,1 vol. in-8. PRCISDE DROITINTERNATIONAL PRIV. par Frantz DESPAG.NET, professeur1vol. iu-8 10 fr. adjointlaFacult.de droit de Uordeaux. 2edition, 1891', TRAITLMENTAIRE DE DROITINTERNATIONAL PRIV,par Andr WEISS, professeur agrg ia Facult de droit de Dijon, 2e dition, 1890, 1 vol.iu8" 12fr. PRCISDE DROITCRIMINEL, l'explication lmentairede la partie c omprenant gnrale du Code pnal, du Code d'instruction criminelle en entier et des lois qui ont modificps deux Codes, pnrR. GARRAUD, professeur de droit criminel la Facult de droit de Lyon, 4e dition, 1892,1 vol. in-8 10fr. LMENTS DE DROITROMAINr l'usage des tudiants des Facults de droit, par Gaston MAY, professeur de droit romain la Facult de droit de Nancy, 10 fr. 2dition, 1892,1 vol. in-8 DEDROITROMAIN, COURS LMENTAIRE contenant l'explication mthodique desINSTITUIEZ deJusiinien etdes principauxiqvtesclassiques, par DIDIEK-PAIUJ, 3o dition, revue et corrige professent la Facult de droit de par CharlesTAITAHI, professeur la mme Facult, 1887,2 vol. in-8 14 fr. & 7 fr. Chaque volume sparment. LMENTAIRE DEDROIT COURS contenant toutesles matiresdu COMMERCIAL, Code de commerceet des lois postrieures,exposesdans unordre mthodique, nar Auguste LAIJRIN, professeur dedroit commercial la Facultde droit d'Aix et la Facult des sciencesde Marseille,3e dition, 1890,1 vol. iu-8. 10 fr. PRCIS DE DROITMARITIME, rdig conformmentau nouveau programme des tudes de licence, par Auguste LALFRLN, prolesseur la Facult de droit d'Aix, 6fr. 1892, 1 vol. in-18 l'usage des tudiants des Facultsde droit, par PRINCIPES DE DROITROMAIN G. BRY, 6fr. >> professeur la Fa.cultde droit d'Aix, 1892,1 vol. in-18 PRCISLMENTAIRE DE DROITINTERNATIONAL PUBLIC, misau courant des progrs dela science et du droit positif contemporain, par Georges BRY, 1)fr. professeur la Facuit de droit d'Aix, 1891, 1 vol. in-H.. RSUMDE RPTITIONSCRITESSUR LE DROITADMINISTRATIF, par F. BOEUF, 6fr. rptiteur de droit, 14.dition, 1891,1vol. in-18 PRINCIPESD'CONOMIE POLITIQUE, par Charles GIDE,professeur d'conomie politique la Facult de droit de Montpellier,3edition, compltementrefondue, 6fr. 1891,1 vol.iu-18 LMENTS D'CONOMIE POLITIQUE,par P.-V. BEAUREGARD, professeur d'ileonomie politique la Facult de droit deParis, 1 voi. iu-12. 5 fr. , BURDIN ETCie, 4, RUE IMP. GARDER 4 ANGERS,
TABLE ANALYTIQUE DES MATIRES THORIE DE L'TAT CHAPITRE PRLIMINAIRE LE DROIT ET LES SCIENCES SOCIALES Ncessit de combiner les deux conceptions antagonistes CHAPITRE PREMIER L'TAT 1. La notion de l'tat 2. La souverainet de l'tat 3. L'organisation politique de l'Etat. Sparation des pouvoirs et dcentralisation CHAPITRE II L'TAT ET L'ORGANISME NATIONAL 1. Le rle de l'Etat. Le socialisme 2. Le droit public national. Les droits individuels et leurs garanties constitutionnelles CHAPITRE III L'ETAT ET L'ORGANISME INTERNATIONAL Rle de l'tat vis--vis de l'organisme international. - L'Etat et les glises HISTOIRE DE LA FORMATION DU DROIT ADMINISTRATIF FRANAIS, DEPUIS L'AN VIII. AVERTISSEMENT a) priode d'laboration secrte (1800-1818) b) priode de divulgation (1818-1860) c) priode d'organisation (1860) Conclusion LES SOURCES ET LES MONUMENTS DES RGLES DU DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF FRANAIS 1. Les sources. ARTICLE I. Caractres gnraux des sources. - Le droit public jus scriptum, - le droit public jus novum ARTICLE II. La loi el le rglement. - Dfinitions, - rglements faits au nom de l'tat, - rglements faits au nom de la commune, - domaine respectif de la loi et du rglement, - confection des lois et des rglements, - force excutoire des lois et rglements, - vnements qui peuvent leur enlever leur force excutoire: abrogation, annulation, illgalit, 2. Les monuments. - Bulletin des lois et Journal officiel. 3. Les moyens de sanction APPENDICE. - Sources, monuments, moyens de sanction des rgles du droit public et administratif en et dans les colonies PREMIERE PARTIE LE DROIT PUBLIC LIVRE PREMIER JOUISSANCE ET GARANTIE DES DROITS PUBLICS CHAPITRE PREMIER JOUISSANCE DES DROITS PUBLICS 1. Caractres gnraux des droits publics. - Harmonie entre les droits publics reconnus et notre tat social. - Les droits publics sont des droits vritables, rapports des droits publics avec les droits privs, - rapports des droits publics avec les devoirs 2. Jouissance et exercice des droits publics CHAPITRE II GARANTIES DES DROITS PUBLICS 1. Examen des garanties. - Recours contentieux contre l'acte administratif, - poursuites contre les fonctionnaires, - poursuites directes contre l'tat et les communes, - Responsabilit civile des communes 2. Des vnements qui suspendent ou paralysent les garanties des droits publics. - L'ouverture d'une instruction criminelle. - les actes de gouvernement, l'tat de sige LIVRE II LES DROITS PUBLICS CHAPITRE PREMIER LES DROITS POLITIQUES LE DROIT DE SUFFRAGE CONSIDRATIONS GNRALES 1. Du droit de vote. ARTICLE I. Jouissance du droit de vote ARTICLE II. Des incapacits lectorales. - Incapacit rsultant de la privation de la jouissance du droit: tableau des condamnations emportant privation du droit de vote, - incapacit rsultant de la privation de l'exercice du droit ARTICLE III. Des conditions d'exercice du droit de vote. - a) Lgislation de la liste lectorale, - conditions requises pour tre inscrit sur la liste, - tablissement et revision annuelle de la liste lectorale. - b) Incompatibilit rsultant de la qualit de soldat prsent au corps. 2. Du droit d'ligibilit. ARTICLE I. Jouissance du droit d'ligibilit ARTICLE II. De l'incapacit ou inligibilit. - a)Inligibilit par suite de la privation de la jouissance du droit: condamnations. - b) Inligibilit par suite de privation de l'exercice du droit: inligibilit rsultant de la fonction Appendice. - L'incompatibilit. - Cumul du mandat lectif avec une fonction publique, - cumul de mandats lectifs, - parent ou alliance entre plusieurs co-lus ARTICLE III. Conditions d'exercice du droit d'ligibilit. - Conditions d'inscription sur une liste lectorale, ou d'attache avec la circonscription CHAPITRE II LES LIBERTS SECTION PREMIRE. - LIBRE EXISTENCE 1. Libert de l'tre moral. - Libert de conscience. - a) Libert de la foi: libre croyance et libre pense; libert des funrailles. - b) Libert de la science: obligation de l'instruction primaire 2. Libert de l'tre physique. - Libert civile; Sret individuelle, - libert individuelle, - inviolabilit du domicile 3. Libert de la personnalit sociale. - La filiation, - le nom, - les litres nobiliaires SECTION II. - LIBRE ACTIVIT 1. Action exerce par l'homme sur la nature. - Libert du travail, de l'industrie et du commerce 2. Action exerce par l'homme sur ses semblables. ARTICLE I. Action exerce dans le cercle priv ARTICLE II. Action exerce par l'homme sur ses semblables en public, - libert du culte public, - libert d'enseignement, - libert de la presse, - libert de runion APPENDICE AUX 1 ET 2. - Droit d'association et condition des associations. - Associations littraires, scientifiques. etc - Congrgations religieuses, syndicats professionnels SECTION III. - LIBRE JOUISSANCE Libert et inviolabilit de la proprit CHAPITRE III LE DROIT AUX SERVICES PUBLICS DES SERVICES D'ASSISTANCE. - L'assistance est un devoir social, - sanction juridique du devoir social, - services d'assistance qui doivent tre organiss DEUXIEME PARTIE LE DROIT ADMINISTRATIF DEFINITIONS DFINITION DU DROIT ADMINISTRATIF 1 Les personnes administratives (tat, dpartements, communes, colonies, tablissements publics) 2 Les droits des personnes administratives et l'exercice de ces droits 3 Les services publics LIVRE PRLIMINAIRE L'ADMINISTRATION L'ADMINISTRATION ENVISAGE DU POINT DE VUE DES SCIENCES POLITIQUES ET DU POINT DE VUE JURIDIQUE [CHAPITRE PREMIER LES OPRATIONS ADMINISTRATIVES ET LES ACTES D'ADMINISTRATION SECTION PREMIRE. - LES OPRATIONS ADMINISTRATIVES DFINITION DE L'OPRATION ADMINISTRATIVE SECTION II. - LES ACTES D'ADMINISTRATION 1. Dfinition, classification, nature des actes d'administration. ARTICLE I. Dfinition. - L'acte d'administration est une dcision excutoire, etc ARTICLE II. Classification. - Actes d'autorit, actes de gestion, - actes de puissance publique, actes de personne prive, - actes de gouvernement, actes de pure administration, actes d'administration ordinaire ARTICLE III. Nature de l'acte d'administration. - Nature de l'acte d'autorit, ressemblance avec un jugement, - nature de l'acte de gestion. ARTICLE IV. Importance de l'acte d'administration 2. Forme et procdure de l'acte d'administration. ARTICLE I. Forme et procdure de l'acte d'autorit, enqute de commodo et incommodo - forme crite, etc. ARTICLE II. Forme de l'acte de gestion. - Contrats passs en la forme administrative 3. Les vices de l'acte d'administration. ARTICLE I. De l'usurpation de pouvoirs ARTICLE II. De l'excs de pouvoir. - Vice d'incomptence, - vice de formes, - dtournement de pouvoir. - Violation de la loi et des droits acquis ARTICLE III. De l'inopportunit de l'acte
4. Contrle administratif de l'acte d'administration. ARTICLE 1. Contrle exerc par voie de tutelle ARTICLE II. Contrle exerc par voie hirarchique. - Du recours gracieux ou hirarchique, ses rgles, ses rapports avec les recours contentieux. 5. Les recours contentieux contre l'acte d'administration. ARTICLE I. Le recours contentieux ordinaire ARTICLE II. Le recours pour excs de pouvoir. - Son histoire, - ses conditions de recevabilit, - les ouvertures recours, - la procdure, - les effets de la dcision CHAPITRE II LES AUTORITES ADMINISTRATIVES ET LES FONCTIONNAIRES Autorits administratives. - Reprsentants qui ont le pouvoir de faire des actes d'administration Fonctionnaires. - Reprsentants qui n'ont pas le pouvoir de faire des actes d'administration LIVRE PREMIER LES PERSONNES ADMINISTRATIVES TITRE PREMIER numration des personnes administratives L'TAT LES DPARTEMENTS LES COMMUNES LES COLONIES LES TABLISSEMENTS PUBLICS. - Distinction de l'tablissement public et de l'tablissement d'utilit publique, - numration des tablissements publics TITRE II Organisation des personnes administratives CHAPITRE PRLIMINAIRE RGLES COMMUNES D'ORGANISATION SECTION PREMIRE. - DU MANDAT DE PUISSANCE PUBLIQUE. - Du MANDAT LECTIF De la puissance publique. - Caractres gnraux du mandat de puissance publique 1er. Thorie gnrale des lections. - Dfinition. - a) Oprations antrieures au scrutin: priode lectorale, dclaration de candidature pour les lections lgislatives. - b) Opration du scrutin: le vote, le dpouillement, le recensement gnral des voix. - c) Le contentieux lectoral: la vrification des pouvoirs et le contentieux proprement dit, les vices de l'lection, les pouvoirs du juge, la procdure 2. Thorie gnrale des assembles dlibrantes. - a) Organisation des assembles. - b) Leur fonctionnement, les sessions, les sances, les dlibrations Attributions personnelles des membres des assembles dlibrantes 3. Evnements qui mettent fin au mandat lectif. 4. Caractres gnraux du mandat lectif. - Prohibition du mandat impratif, - gratuit du mandat, - immunit et inviolabilit parlementaires SECTION II. - Du MANDAT DE FONCTION PUBLIQUE De la fonction publique. - Collation des fonctions publiques, aptitude aux fonctions publiques, - caractres gnraux du mandat CHAPITRE PREMIER ORGANISATION DE L'TAT SECTION PREMIRE. - ORGANE EXCUTIF 1er Le pouvoir central. ARTICLE I. Les autorits administratives du pouvoir central - N 1. Le prsident de la Rpublique, - Organisation de la prsidence, - attributions du prsident, nature et forme des actes, voies de recours. N 2. Les ministres, les sous-secrtaires d'Etat, le conseil des ministres. - Organisation, - attributions: le contre-seing, les pouvoirs propres. - Nature et forme des actes, voies de recours ARTICLE II. Les fonctionnaires du pouvoir central. - N 1. Le Conseil d'tat. - Organisation, - attributions administratives N 2. Les bureaux N 3. Les agents d'excution. - La hirarchie et les cadres rgionaux. 2. Le pouvoir rgional. ARTICLE I. Les autorits administratives du pouvoir rgional. - N 1. Le prfet. - Organisation, - attributions, - nature et forme des actes, voies de recours N 2. Le sous-prfet - N 3. Le maire ARTICLE II. Les fonctionnaires du pouvoir rgional. - N 1. Les secrtaires gnraux de prfecture. - N 2. Les conseils de prfecture. - N 3. Les bureaux SECTION II. - ORGANE LGISLATIF 1er Rgles d'organisation. ARTICLE I. Rgles gnrales de composition de la Chambre des dputs et du Snat ARTICLE II. Les lections la Chambre des dputs et au Snat. ARTICLE III. Fonctionnement de la Chambre des dputs et du Snat ARTICLE IV. vnements qui mettent fin au mandat de snateur ou de dput ARTICLE Y. Caractres gnraux du mandat de snateur et de dput. 2. Attributions de l'organe lgislatif. ARTICLE I. Attributions constitutionnelles ARTICLE II. Attributions administratives. - Lois d'affaires ARTICLE ILL. Nature et forme des actes. - Confection de la loi, - lois de finances CHAPITRE II ORGANISATION DU DEPARTEMENT Renseignements statistiques. - Rgles relatives au territoire. Histoire. SECTION PREMIRE. - ORGANE EXCUTIF Le prefet. - Attributions, - force excutoire des actes SECTION II. - ORGANE DLIBRANT 1er Le conseil gnral. ARTICLE I. Rgles d'organisation. - Rgles gnrales de composition - lections, - fonctionnement des conseils gnraux ARTICLE II. Attributions du conseil gnral. - N 1. Les dcisions du conseil gnral, leur force excutoire, - leur objet N 2. Les manifestations d'opinion, les nominations, le contrle ARTICLE III. Nature et forme des actes, voie de recours 2. La commission dpartementale. ARTICLE I. Rgles d'organisation ARTICLE II. Attributions. - N 1. Attributions dlgues. - N 2. Attributions propres. - Les dcisions, leur force excutoire et leur objet, - les nominations, les avis, le contrle ARTICLE III. Nature et forme des actes, voies de recours ARTICLE IV. Du dsaccord et du conflit avec le prfet Organisation spciale du dpartement de la Seine. Dpartements algriens APPENDICE. - ORGANISATION DE L'ARRONDISSEMENT Le conseil d'arrondissement CHAPITRE III ORGANISATION DE LA COMMUNE Renseignements statistiques. - Nom et territoire. - Histoire SECTION PREMIRE. - ORGANE EXCUTIF 1er Le maire et les adjoints. ARTICLE I. Rgles d'organisation. - Nomination, - suspension et rvocation, - remplacement provisoire, - dure du mandat ARTICLE II. Attributions du maire. - N 1. Nature des attributions. a) Le maire agent de l'tat. - b) Le maire agent de la commune, - ses pouvoirs propres, l'excution des dcisions du conseil municipal. N 2. Force excutoire des actes du maire N 3. Nature et forme des actes N 4. Contrle des actes du maire par le prfet et le conseil municipal N 5. Voies de recours contre les actes du maire N 6. Dlgation de ses pouvoirs faite par le maire 2. Les fonctionnaires de la commune. - Agents de la police, garde champtre, commissaire de police SECTION II. - ORGANE DLIBRANT. - LE CONSEIL MUNICIPAL 1er Rgles d'organisation. Rgles gnrales de composition N 1. Elections au conseil municipal. - Sectionnement lectoral, - lecteurs, ligibles, - scrutin, etc N 2. Fonctionnement des conseils municipaux. - Sessions, sances, etc. N 3. Suspension et dissolution. - De la dlgation spciale N 4 vnements qui mettent fin au mandat de conseiller municipal 2. Attributions du conseil municipal. ARTICLE I. Nature des attributions. - N 1. Dcisions du conseil municipal. - Force excutoire, - objets de ces dcisions
N 2. Manifestations d'opinion. - Avis, propositions et voeux. - N 3. Actes de contrle. - N 4. Nominations ARTICLE II. Nature et forme des actes. Recours et roies de nullit Rgime spcial de Paris et de Lyon Communes d'Algrie et des colonies CHAPITRE IV ORGANISATION DES COLONIES ORGANE EXCUTIF. - Le gouverneur, - les directeurs, le conseil priv ORGANE DLIBRANT. - Le conseil colonial, - la commission coloniale. CHAPITRE V ORGANISATION DES ETABLISSEMENTS PUBLICS. N 1. Les tablissements communaux de bienfaisance. - Les commissions administratives N 2. Les fabriques. - Conseils de fabrique N 3. Les syndicats de communes TITRE III Obligation de la comptabilit. 1er La comptabilit publique. N 1. Le compte du patrimoine N 2. Le budget. - Vote du budget, - excution du budget, l'exercice financier, - le budget considr comme acte juridique N 3. La comptabilit de caisse 2. Le contrle de la comptabilit. - Le contrle administratif, - la Cour des comptes, - les comptes du budget APPENDICE. - La comptabilit de fait LIVRE II LES DROITS DES PERSONNES ADMINISTRATIVES TITRE PRLIMINAIRE JOUISSANCE DES DROITS Droits de puissance publique et droits de personne prive. - De la jouissance des droits, - de l'exercice des droits et de la capacit TITRE PREMIER Les droits de puissance publique CHAPITRE PRLIMINAIRE CARACTRES GNRAUX DES DROITS DE PUISSANCE PUBLIQUE Dfinition et division, - antagonisme des droits de puissance publique et des droits publics des citoyens, - des rgles de droit qui doivent tre appliques aux droits de puissance publique, - de la concession des droits de puissance publique CHAPITRE PREMIER LES DROITS DE POLICE SECTION PREMIRE. - LA POLICE DES FONCTIONNAIRES Caractre gnral de la situation des fonctionnaires, - nomination ou collation d'emploi, - tat des fonctionnaires Des pensions de retraite civiles et militaires SECTION II. - LA TUTELLE ADMINISTRATIVE 1er Tutelle exerce sur les personnes administratives. - Du droit de rgale sur les menses piscopales 2. Tutelle exerce sur les tablissements d'utilit publique. - Condition gnrale de ces tablissements, - congrgations religieuses reconnues, - caisses d'pargne prives, - socits de secours mutuels, monts de pit SECTION III. - LA POLICE DES CITOYENS 1er Police administrative. ARTICLE I. Police gnrale de l'tat et de la commune. - Des droits que suppose la police, - le pouvoir rglementaire, - le droit de disposer de la force publique N 1. Police gnrale de l'tat. - Service de la sret gnrale, - police sanitaire N 2. Police communale. - a). Police municipale, - police rurale. ARTICLE II. Polices spciales de l'tat. - N 1. Police des cours d'eau non navigables ni flottables. - Condition lgale de ces cours d'eau, - police et conservation, - droits et charges des riverains N 2. Police des tablissements dangereux, insalubres et incommodes. N 3. Police des sources minrales, N 4. Restauration des terrains en montagne, - fixation des dunes N 5. Police des monuments historiques et des objets d'art 2. Le service militaire. Aperu historique et dispositions gnrales de la loi du 15 juillet 1889. ARTICLE I. Obligations rsultant du service militaire. - N 1. Le service militaire N 2. La taxe militaire ARTICLE II. Oprations du recrutement. - Le recrutement, - la rvision, - le conseil de revision CHAPITRE 11 LES DROITS DOMANIAUX DE PUISSANCE PUBLIQUE SECTION PREMIRE. - LE DOMAINE PUBLIC 1er Le droit de domaine public. C'est un droit de proprit modifi dans ses effets par l'utilit publique 2. Les dpendances du domaine public. N 1. De l'inalinabilit des dpendances du domaine public. - Origine, sens et porte de cette inalinabilit; droits utiles qu'elle laisse subsister N 2. Du critrium qui permet de dterminer les dpendances du domaine public, - ce critrium est dans l'affectation de la chose l'utilit publique, consquences au point de vue des choses mobilires et incorporelles, - justification du systme en ce qui concerne les btiments affects un service public N 3. numration des principales dpendances du domaine public. - Domaine public de l'tat. - a) Domaine public naturel: rivages de la mer; fleuves et rivires navigables et flottables. - b) Voies de communication: chemins, routes et rues la charge de l'tat; chemins de fer d'intrt gnral. - c) Btiments et terrains affects aux services publics Domaine public dpartemental Domaine public communal. - Chemins vicinaux, chemins ruraux Domaine public colonial 3. Les droits que contient le droit de domaine public. ARTICLE. I. L'affectation et la dsaffectation. - Le classement et le dclassement. a) Affectation et dsaffectation des rivages de la mer et des fleuves b) Classement et dclassement des voies de communication: effets du classement, effets du dclassement, droit de premption des riverains. c) Affectation et dsaffectation des btiments aux services publics ARTICLE. II. La dlimitation et l'alignement. N 1. Dlimitation des rivages de la mer et des fleuves. - Voies de recours. N 2. De l'alignement. - a) Fixation des limites par l'alignement, - des plans d'alignement, - servitudes d'alignement - b) Protection des limites par l'alignement N 3. Bornage des btiments et terrains affects un service public ARTICLE. III. La police du domaine public. - Police de la voirie. N 1. Rgles de la grande voirie. - Contraventions de grande voirie, - police des routes nationales et dpartementales, des rues de Paris, des chemins de fer, des fleuves et canaux, des rivages de la mer; matires assimiles la grande voirie N 2. Rgles de la petite voirie. - Contraventions de petite voirie, - obligations et servitudes des riverains ARTICLE IV. Utilisation des dpendances du domaine public par la perception des produits et la concession. N 1. Perception des produits. - Ferme de la pche des fleuves N 2. Les concessions sur le domaine public. - Caractres gnraux de la concession, nature du droit du concessionnaire, - examen de quelques concessions: sur le rivage de la mer, sur les cours d'eau, dans les cimetires: permissions de voirie, etc. Des monopoles crs par les concessions sur le domaine public SECTION II. - LES MODES D'ACQURIR DE PUISSANCE PUBLIQUE CARACTRES GNRAUX DE CES MODES D'ACQURIR. - Privilges exorbitants des personnes administratives pour les crances et les dettes qui naissent d'oprations de puissance publique. - Les arrts de dbet, - comment l'tat peut tre dclar dbiteur. - La dchance quinquennale 1er Les impts. NOTIONS GNRALES. - Dfinition. - Importance des impts, - impts sur le capital et sur le revenu, - impts proportionnels et tarifs progressifs, - impts directs et indirects, - impts de rpartition et de quotit ARTICLE I. Les impts directs. - Dispositions communes toutes les contributions directes, - division en principal et en centimes additionnels, - principe de l'annalit - la matrice et le rle, - l'exigibilit, les poursuites, - les demandes en dcharge ou rduction, - les demandes en remise ou modration N 1. Les impts directs de l'tat. 1 L'impt foncier sur la proprit non btie, - le cadastre 2 L'impt foncier sur la proprit btie 3 La contribution personnelle-mobilire 4 L'impt des portes et fentres 5 L'impt des droits de patente Les taxes assimiles aux contributions directes N 2. Les impts directs dpartementaux, - les centimes additionnels. N 3. Les impts directs communaux, - les centimes additionnels, les prestations
N 4. Les impts directs coloniaux N 5. Les impts au profit des tablissements publics, - le droit des pauvres ARTICLE II. Les impts indirects de l'tat, des communes, des colonies, des chambres de commerce 2. L'expropriation pour cause d'utilit publique. DFINITION ET HISTOIRE ARTICLE I. Dispositions gnrales. - Qui peut exproprier, - quelles choses peuvent tre expropries, - en vue de quels objets on peut exproprier ARTICLE II. L'expropriation par le grand jury. - N 1. La dclaration d'utilit publique N 2. La dsignation des terrains N 3. Le transfert de proprit. - Le jugement d'expropriation et ses effets, - la cession amiable N 4. Le paiement de l'indemnit et la prise de possession, - le grand jury d'expropriation Procdures exceptionnelles par le grand jury ARTICLE III. L'expropriation par le petit jury APPENDICE. - Matires voisines de l'expropriation. - L'effet des plans d'alignement, - les rquisitions militaires 3. Les travaux publics. ARTICLE I. Dfinition de l'opration de travaux publics. - Du travail excut, - de la personne administrative pour le compte de laquelle il est excut, - du service public en vue duquel il est excut, - des travaux irrgulirement engags ARTICLE II. Les consquences des travaux publics vis--vis des tiers. - N 1. Thorie des dommages causs la proprit. - Thorie gnrale, - l'occupation temporaire, - les dommages permanents N 2. Thorie des plus-values indirectes apportes la proprit N 3. Des dommages causs aux personnes par les travaux publics ARTICLE III. L'excution des travaux publics. - N 1. L'excution en rgie. N 2. L'excution par march ou entreprise, - les marchs de travaux publics. - a) Formes des marchs, - de l'adjudication b) Objet du march. - Le cahier des charges, - le cahier des clauses et conditions gnrales c) Les droits et obligations qui naissent du march. - Droits exorbitants de l'administration N 3. La concession de travaux publics. - a) Concessions de travaux publics sur des dpendances du domaine public: chemins de fer, tramways, bacs et passages d'eau b) Concessions de travaux publics hors du domaine public. - Les associations syndicales autorises, - leur nature d'tablissement public, leur organisation, leurs prrogatives, - les associations syndicales forces et les associations syndicales libres N 4. Les souscriptions, volontaires et les offres de concours Appendice aux travaux publics. - Les concessions de mines. - Dfinition de la mine et du gisement minier, - condition juridique du gisement minier, il appartient au propritaire de la surface, - condition juridique de la mine; caractre de la concession. - Les analogies avec la concession de travaux publics faite hors du domaine Lgislation des mines 4. Les marchs de fournitures de l'tat 5. Les contrats relatifs la dette publique de l'tat. - Les emprunts et les cautionnements TITRE II Les droits de personne prive CHAPITRE PRLIMINAIRE CARACTRES GNRAUX DES DROITS DE PERSONNE PRIVE Dfinition des droits de personne prive, ils sont tous domaniaux. - Des rgles de droit qui leur sont applicables CHAPITRE PREMIER LE DOMAINE PRIV 1er Le domaine priv de l'tat. Alinabilit et prescriptibilit du domaine, - les dpendances du domaine priv, - la gestion du domaine 2. Le domaine priv du dpartement 3. Le domaine priv de la commune. - Les biens communaux 4. Le domaine priv des colonies 5. Le domaine priv des tablissements publics APPENDICE AU DOMAINE PRIV. - Les droits d'usufruit, d'usage, de servitudes, de privilges et hypothques CHAPITRE II LES MODES D'ACQURIR DE PERSONNE PRIVE SECTION PRLIMINAIRE. - CARACTRES GNRAUX DE CES MODES D'ACQURIR SECTION PREMIRE. - MODES D'ACQURIR QUI PROCDENT DE LA LOI. - a) Attribution des biens vacants et sans matre b) La dshrence SECTION II. - LES DONS ET LEGS. - De la jouissance du droit de recevoir, - de la capacit de recevoir et de l'autorisation, - de l'acceptation. Appendice. - Produit des qutes, collectes, troues SECTION III. - LES CONTRATS. - N 1. Les ventes. - Ventes des biens de l'tat et des biens des communes N 2. Les concessions sur le domaine priv N 3. Les baux ferme SECTION IV. - LES QUASI-CONTRATS. - La gestion d'affaires SECTION V. - LES QUASI-DLITS. - La responsabilit civile de l'tat et des communes LE CONTENTIEUX ADMINISTRATIF Dfinition CHAPITRE PREMIER LES ACTIONS OU RECOURS 1er Les actions ou recours intents par les particuliers. - Des cas o le particulier peut attaquer. - De la faon de crer le contentieux N 1. Des recours contentieux contre l'acte N 2. Des actions contre la personne. - Obligation de dposer un mmoire 2. Les actions ou recours intents par les personnes administratives. - N 1. Des diffrentes actions que les personnes administratives peuvent avoir intenter: actions ordinaires, recours, actions dans l'intrt de la puissance publique N 2. De la capacit d'ester en justice et du maniement de l'action. - De l'autorisation de plaider pour les communes et les tablissements publics CHAPITRE II LES JURIDICTIONS ET LA COMPTENCE. SECTION PRMIRE. - DE LA PLACE OCCUPE PAR LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE 1er Sparation de la juridiction administrative et de la juridiction ordinaire. - ARTICLE 1 er, raisons profondes de cette sparation. ARTICLE II. Partage d'attribution entre les tribunaux administratifs et les tribunaux judiciaires. - N 1. Du principe constitutionnel sur lequel repose ce partage N 2. Rgles d'attribution. - a) Contentieux de l'annulation; - b) contentieux de pleine juridiction; - c) contentieux de l'interprtation; - d) contentieux de la rpression N 3. Des conflits et du tribunal des conflits 2. Sparation de la juridiction administrative et de l'administration active. - ARTICLE 1er. Sparation des juges administratifs et des administrateurs. Question du ministre-juge ARTICLE II. Limite des pouvoirs de la juridiction administrative sur les actes de l'administration active ARTICLE III. Des cas de juridiction gouvernementale, justice retenue et justice dlgue, - le recours pour abus SECTION II. ORGANISATION DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE 1er Organisation gnrale de la juridiction administrative. - La juridiction en premier ressort, - le Conseil d'tat juge de droit commun en premier ressort, l'appel, - la cassation, - parent du recours en cassation et du recours pour excs de pouvoir 2. Organisation et comptence des diverses juridictions. - N 1. Le Conseil d'tat. - Section du contentieux et assemble du contentieux N 2. Les juges subordonns au Conseil d'tat par l'appel. - a) Les conseils de prfecture b) Les conseils du contentieux des colonies c) Les ministres N 2. Les juges subordonns au Conseil d'tat par la cassation, Cour des comptes, conseils de revision, conseil suprieur de l'instruction publique, etc CHAPITRE III LA PROCDURE 1er Caractres gnraux de la procdure administrative. - Existence indpendante de la procdure administrative, - caractres gnraux de cette procdure, instruction dirige par le juge, - procdure crite, - procdure en partie secrte, - les privilges de la puissance publique, - la notification des pices par la voie administrative 2. Les diverses procdures. - N 1. La procdure devant le Conseil d'tat N 2. La procdure devant le conseil de prfecture N 3. La procdure devant le ministre TABLE ALPHABTIQUE DES MATIRES A Abus (recours pour), Acte d'administration, acte d'autorit et acte de gestion, acte de puissance publique et acte de personne prive, - nature et forme des actes, - voies de recours, Acte de gouvernement, Acte discrtionnaire, Actions, ou recours intents par les particuliers ou par les personnes administratives,
Adjoints, Adjudication, Administration, Affectation l'utilit publique, Affectation des btiments aux services publics, Affectation des btiments aux services publics, affectation de btiments des oeuvres prives, Agents de police, . Application des lois, . le droit de suffrage des indignes, . organisation, . dparments algriens, . communes d'., . les impts, Alignement, Annulation. Annulation des actes par voie administrative, Prfet, Maire, Conseil gnral, Conseil municipal, etc.; - contentieux de l'. - V. Contentieux . Appel, Approbation. - V. Autorisation . Arrt, une des formes de l'acte d'administration, Arrt, a. de dbet, Arrt, a. de cessibilit, Arrondissement, Assainissement, Assembles dlibrantes (Thorie gnrale des), Assistance publique, Association (Les associations et le droit d'), Associations syndicales autorises, Associations syndicales autorises, associations syndicales forces et libres, Attributions des autorits administratives, sont relatives au pouvoir de faire des actes d'administration Prsident de la Rpublique, Ministres, Prfet, Maire, Conseil gnral, Conseil municipal, etc. Attribution contentieuse (Rgles d'), Conflit . Attroupement, Responsabilit des communes. Autorisations ou approbations, d'un acte par une autorit suprieure. Prfet, Maire, Conseil gnral, Conseil municipal, etc.; Autorisations ou approbations de plaider par le conseil de prfecture, Autorisations ou approbations d'accepter des dons et legs, Autorits administratives, Avis, Conseil gnral, Conseil municipal, Conseil d'tat, Conseil de prfecture. Avocats au Conseil d'Etat, Avocats au Conseil d'Etat, affaires dispenses du ministre d'avocat. Avous, devant les conseils de prfecture, B Bacs, Btiments affects un service public, sont dpendance du domaine public, Baux ferme, Biens communaux, Biens vacants et sans matre, Budget, tude gnrale, Budget, b. de l'Etat, Budget, b. du dpartement, Budget, b. de la commune, Bureau des assembles dlibrantes, Bureau de bienfaisance, Bureau lectoral. - V. lections . C Cadastre, Cahier des clauses et conditions gnrales, Caisse des dpts et consignations, Caisses d'pargne prives, Caisses diverses. - V. tablissements publics, Canaux, Candidature, et dclaration de candidature, Capacit, des personnes administratives, Capacit, des individus pour les droits publics, Cassation, Cautionnement, des fonctionnaires, Cautionnement, - c. des entrepreneurs et fournisseurs, Centimes additionnels, Centralisation. - V. Dcentralisation . Cessibilit (Arrt de), Cession amiable, Chambres lgislatives, Chambre de commerce, chambres consultatives diverses, Chasse, Chemins de fer, Tarifs . Chemins ruraux, Chemins vicinaux, Cimetire, Cimetire, - Servitudes des cimetires, Cimetire, - V. concessions. Classement, dclassement, Cloches (sonnerie), Colonies. - Application des lois, Colonies. - suffrage, Colonies. - organisation, Colonies. communes des colonies, Colonies. - domaine public, Colonies. - impts, Commissaire de police, Commission administrative (hpitaux, hospices, bureaux de bienfaisance, Commission coloniale, Commission dpartementale, Commissions d'tudes. - V. Assembles dlibrantes. Commune. - Organisation, Commune. police, Commune. domaine public, Commune. impts, Commune. domaine priv, Commune. responsabilit civile,
Commune. gestion d'affaires, Comptence (des tribunaux administratifs), Comptabilit publique, Comptabilit publique, comptabilit de fait, Comptes(Cour des), Concession. - C. des droits de puissance publique, Concession. - c. sur le domaine public, Concession. - c. dans les cimetires, Concession. - c. de travaux publics, Concession. - c. sur le domaine priv, Concordat, Conflit d'attribution; tribunal des conflits, Congrgations, Conseils administratifs, Conseil d'Etat, Conseil d'Etat, au contentieux, Conseils de prfecture, Conseils de prfecture au contentieux, Conseils du contentieux des colonies, Conseil priv. - V. Colonies (organisation). Conseil gnral de dpartement, Conseil gnral de colonie, Conseil municipal, Conseil des ministres. Conseil de revision, Contentieux administratif, Contentieux administratif, c. de l'annulation. Contentieux administratif, c. de pleine juridiction, Contentieux administratif, c. de l'interprtation, Contentieux administratif, c. de la rpression, Contentieux administratif, c. lectoral, Contrainte administrative, Contrainte administrative, porteurs de c., Contrats. C. passs titre de puissance publique ou c. administratifs, Contrats. V. Marchs; - c. passs titre de personne prive, Contravention de grande voirie, Contravention de grande voirie, c. de petite voirie, Contreseing. - V. Ministres . Contributions directes et indirectes . - V. Impts . Contrle hirarchique ou par voie de tutelle, Maire, Conseil gnral, Conseil municipal, etc. Cours d'eau non navigables ni flottables, Cour des comptes. - V. Comptes . Crances des personnes administratives titre de puissance publique, Crances des personnes administratives titre de personne prive, Crdits. - V. Budget . Crment futur (Concession de), Cumul. - V. Traitements, incompatibilit . D Dbet (Arrts de), Dcentralisation, Dcharge ou rduction (Demande en). - V. Impts. Dchance quinquennale, Dcisions. -V. Acte d'administration , Dcrets, Dlgation. - D. de la puissance publique, Dlgation spciale, Dlibrations des assembles, Dlimitation des rivages et des fleuves, Dmission, Deniers publics, Dpartement. - Organisation, Dpartement. - domaine public, Dpartement. - impts, Dpens, Dpenses. - Dpenses obligatoires. - V. Budget; - paiement des dpenses, Dsaffectation. - V. Affectation . Dshrence, Dtournement de pouvoir. - V. Excs de pouvoir. Dettes des personnes administratives, Devis, Diocse, Dissolution. - D. de la Chambre, Dissolution. - des conseils gnraux, Dissolution. - des conseils municipaux, Domaine priv, Domaine public, Domicile(Inviolabilit du), Domicile domicile de secours, Dommages rsultant des travaux publics, Dons et legs, Droit administratif, Droits publics des citoyens, Droits de puissance publique, Droits de puissance publique, droits de personne prive, Droit des pauvres, E Ecole (maison d), Eglise. - Les glises et leurs rapports avec l'tat, Eglise. - domanialit publique des btiments des glises, Eglise.- rparations, Elargissement. -V. Alignement, Classement . Elections. - Thorie gnrale, Snat, Chambre des dputs, Conseil gnral, Conseil municipal , etc. Electeurs, Eligibilit. - V. Inligibilit. - Conditions d'ligibilit, Endiguement (Concession d'), Enfants assists, Enqute de commodo et incommodo,
Etablissements dangereux, etc., Etablissements d'utilit publique. - Distinction de ces tablissements et des tablissements publics, Etablissements d'utilit publique. condition gnrale de ces tablissements, Etablissements publics, Etablissements publics, organisation, Etablissements publics, impts, Etablissements publics, domaine priv, Etat (Thorie gnrale de l'), Etatnotion administrative de l'tat, Etat de sige, Excs de pouvoir. - Vice de l'acte d'administration, Excs de pouvoir. - recours pour excs de pouvoir, Exercice financier, Expropriation pour cause d'utilit publique, F Fabriques, Faits de guerre, Faute. - F. administrative, f. personnelle du fonctionnaire, Fleuves et rivires navigables et flottables, Dlimitation . Fonctionnaire. Fonctionnaire. - Condition des f., Fonctionnaire. - poursuites contre les f., Fonction publique, Force publique, Forts de l'Etat, Forme (Vice de). - V. Excs de pouvoir . Forme administrative (Contrats en la), Forteresses (Servitudes des), Fouilles. - V. Objets d'art; occupation temporaire. Fournitures (March de), G Garanties constitutionnelles, Garanties des droits publics, Garantie des fonctionnaires, Garde champtre, Gestion d'affaires, Gouverneur. - V. Colonies . H Halage (Chemin de), Halles et marchs, Homologation. - V. Tarifs . Hpitaux, Hospices, Hypothques, I Immunit parlementaire, Impts, - notions gnrales, Impts, - impts directs, Impts, - dcharge ou rduction Impts, - remise ou modration, Impts, - impt foncier sur proprit non btie, Impts, - sur proprit btie, Impts, - contribution personnelle mobilire, Impts, - c. des portes et fentres, Impts, - patente, Impts, - taxes assimiles, Impts, - impts dpartementaux, Impts, - communaux, Impts, - prestations, Impts, - coloniaux, Impts, - d'tablissement public, Impts, - impts indirects, Inalinabilit des dpendances du domaine public, sens et porte, Incapacit. - V. Capacit; - incapacits lectorales, Incapacit. - incapacit d'tre lu. - V. Inligibilit . Incompatibilit, Indemnit parlementaire, Inligibilit, Insaisissabilit des biens des personnes administratives, Instruction des affaires, Interprtation des actes d'administration, Inviolabilit parlementaire, J Jouissance des droits (pour les personnes administratives), Juge de droit commun, - en premier ressort, Juridiction. - Existence d'une j. administrative, son caractre prtorien, Jury d'expropriation. - V. Expropriation . Justice. - J. retenue et j. dlgue, L Lais et relais. Legs. - V. Dons et legs. Liberts individuelles. - V. droits publics, Liberts individuelles. - V. droits publics - libert de conscience, Liberts individuelles. - V. droits publics l. civile, sret individuelle Liberts individuelles. - V. droits publics l. d'aller et de venir, Liberts individuelles. - V. droits publics l. du nom et du titre, Liberts individuelles. - V. droits publics l. du travail, de l'industrie et du commerce, Liberts individuelles. - V. droits publics l. des cultes, Liberts individuelles. - V. droits publics l. d'enseignement, Liberts individuelles. - V. droits publics l. de la presse, Liberts individuelles. - V. droits publics l. de runion, Liberts individuelles. - V. droits publics l. D. d'association, Lignes tlgraphiques et tlphoniques (Servitudes), Liquidation des dettes de l'Etat, Liste lectorale, Logements insalubres, Loi. - V. Sources du droit; - confection des l., Lyon et l'agglomration lyonnaise,
M Maire, Majorit. - V. lections . Mandat public, - mandat qui confre la puissance publique, - mandat lectif, Mandat public, - mandat qui confre la fonction publique, Marais. - V. Associations syndicales, plus-value directe. Marchs. - V. Fournitures, travaux publics. Mmoire (Dpt d'un), Mense, Rgale . Mines, Ministres, responsabilit civile des ministres, Ministres, question du ministre-juge, Ministres du culte. - V. Abus . Modes d'acqurir, de puissance publique, Modes d'acqurir de personne prive, Monopoles rsultant des concessions sur le domaine public, Monuments du droit public, Monuments historiques, Monts de pit, N Nom, titre, filiation, Nullit des dlibrations, Nullit des dlibrations des conseils gnraux, Nullit des conseils municipaux, O Objets d'art, Obligation administrative. - V, Dcentralisation . Occupation temporaire, Octrois, Offices ministriels, Officiers(tat des), Pensions . Offres de concours, Oprations administratives, Ordonnancement, ordonnateur, Organisation administrative, Organisation politique, Organe. - O. dlibrant, excutif. Organe. - o. spciaux, P Paris(organisation municipale), Parlement. - V. Chambres . Pavage, Pche, Pensions de retraite, Pensions de retraite, p. civiles, Pensions de retraite, p. militaires, Pensions de retraite, Caisses dpartementales et communales de retraite, Priode lectorale, Permissions de voirie, Personnes administratives, Jouissance des droits. Plus-values directes et indirectes, Police. - Droits de p., Police. p. des fonctionnaires, Police. p. administrative, Police. p. de l'tat; p. de sret. - p. sanitaire, Police. p. de la commune, municipale et rurale, Cours d'eau non navigables, tablissements dangereux, sources minrales, terrains en montagne, monuments historiques, service militaire, etc. Ponts page, Poursuites. - V. Fonctionnaires, impts . Pourvois. - V. Cassation . Pouvoirs. Les trois pouvoirs, sparation des p., Pouvoirs. p. central et p. rgional, Pouvoirs. p. rglementaire, Premption (Droit de), Prfet, Presbytre, Prsident de la Rpublique, Presse. - V. Liberts . Prestations. - V. Impts . Privilges . - V. Hypothque . Procdure administrative, Processions, Proprit (Droit de), Proprit protection de la p., Puissance publique, Q Quasi-contrat, Quasi-dlits, Questions prjudicielles, Qutes, Quorum. - V. Assemble dlibrante. R Recensement des voix. - V. lections . Recrutement militaire. - V. Service militaire. Recours. - R. contentieux ordinaire, Recours. - r. pour excs de pouvoir, Recours. - r. gracieux ou hirarchique, Recours. - V. Recrutement . - V. Service militaire . Redressement. - V. Classement, Alignement . Rformation des actes. - V. Annulation . Rgale (Droit de). Rglement, Rglement, rglement d'eau, Remise ou modration. - V. Impts . Rquisitions militaires, Rquisition de la force publique,
Responsabilit des personnes administratives, Responsabilit V. Quasi-dlits; - des fonctionnaires, Runion (Droit de), Runion runions lectorales, Rvocation. - V. Fonctionnaires, Suspension. Ravage, Rle. - V. Impts . Routes, nationales, Routes dpartementales, Routes V. Classement, Alignement, Voirie. Rues, Classement, Alignement, Voirie; Rues, rues de , S Salubrit. - V. Police administrative, Police municipale, Assainissement. Scrutin. - V. lections . Sances - V. Assembles dlibrantes. Secours mdicaux, Secrtaire gnral de prfecture, Section de commune, Section lectorale de commune, Section de vote, Seine (Dpartement de la), Snat. - V. Chambres . Sparation des pouvoirs. - V. Pouvoirs . Sparation de l'administration et de la juridiction, Service militaire, Services publics. Services publics. Droit aux services, Servitudes d'utilit publique, Servitudes d'utilit publique, V. Voirie, Alignement, Travaux publics, Forteresses, Zone frontire, Halage, Lignes tlgraphiques, Cimetire , etc. Sessions. - V. Assembles dlibrantes . Socits de secours mutuels, Sources du droit public, Sources minrales, Souscriptions. - V. Offres de concours . Sous-prfet, Sous-secrtaire d'tat. - V. Ministre . Souverainet, Substitution du prfet au maire, Suffrage(Droit de), Sret gnrale. - V. Police . Suspension. - S. des dlibrations des conseils gnraux, Suspension. - s. des arrts du maire, Suspension. - s. du maire, Suspension. - s. du conseil municipal, Syndicat de communes, Syndicats professionnels, T Tableau de dlais. - V. Liste lectorale, Tableau des incapacits lectorales, Tarifs de chemins de fer, Tarifs de chemins de fer, V. Rglements, Taxe du pain, Taxe militaire, Terrains en montagne, Traitements, Tramways, Travaux publics, Tribunaux administratifs. -V. Juridiction . Tribunal des conflits. - V. Conflits. Troncs. - V. Qutes . Trottoirs, Tutelle administrative. Tutelle administrative. V. U Usage et Usufruit, V Vente, Vrification des pouvoirs. -V. contentieux lectoral. Vices de l'acte d'administration. - V. Excs de pouvoir. Voies de nullit. - V. Nullit, recours . Voirie, Vote. - Droit de v., Vote. - Opration du v. - V. lections . Z Zone frontire (Travaux mixtes),
Vous aimerez peut-être aussi
- Droit Administratif 4e ÉdDocument81 pagesDroit Administratif 4e ÉdNajia PyarPas encore d'évaluation
- ESSENTIEL Feuillet 3 - Les Sources Non Écrites Du DroitDocument18 pagesESSENTIEL Feuillet 3 - Les Sources Non Écrites Du DroitNelsaPas encore d'évaluation
- Rapport Sercive PubliqueDocument54 pagesRapport Sercive PubliqueMike BurdickPas encore d'évaluation
- Introduction Historique Au Droit Administratif Depuis 1789 Gregoir BigotDocument22 pagesIntroduction Historique Au Droit Administratif Depuis 1789 Gregoir Bigotpolo007mxPas encore d'évaluation
- Chevallier L'ordre Juridique PDFDocument43 pagesChevallier L'ordre Juridique PDFFranciney Gomes Da SilvaPas encore d'évaluation
- Cours de Droit Civil Français (... ) Aubry CharlesDocument576 pagesCours de Droit Civil Français (... ) Aubry CharlesAlexandru DumitruPas encore d'évaluation
- Laurent Francois T1 Droit Civil 1878 PDFDocument591 pagesLaurent Francois T1 Droit Civil 1878 PDFlilyPas encore d'évaluation
- BRIMO Les Grands Courants de La Philosophie Du Droit Et de L'étatDocument440 pagesBRIMO Les Grands Courants de La Philosophie Du Droit Et de L'étatNélman Soulama100% (1)
- DROIT Admin - Dissertation Police AdministrativeDocument5 pagesDROIT Admin - Dissertation Police Administrativegaloixj.scpoPas encore d'évaluation
- León Duguit - Manuel de Droit Public Français - Droit Constitutionnel - Théorie Générale de L Etat - Organisation Politique (1907)Document1 126 pagesLeón Duguit - Manuel de Droit Public Français - Droit Constitutionnel - Théorie Générale de L Etat - Organisation Politique (1907)luciano melo francoPas encore d'évaluation
- Loïc Cadiet - Liberté Des Conventions Et Clauses Relatives Au Règlement Des LitigesDocument20 pagesLoïc Cadiet - Liberté Des Conventions Et Clauses Relatives Au Règlement Des LitigesGino Rivas Caso100% (1)
- Pouvoir Discrétionnaire en Droit Administratif (FR) - La GBD - 1624353709753Document8 pagesPouvoir Discrétionnaire en Droit Administratif (FR) - La GBD - 1624353709753Adama DiénePas encore d'évaluation
- Action AdmiveDocument19 pagesAction Admiveabdelouahed houssainiPas encore d'évaluation
- Delmas Marty - Le - Droit - Et - La - Complexité - PréfaceDocument5 pagesDelmas Marty - Le - Droit - Et - La - Complexité - PréfacejuaniwPas encore d'évaluation
- Code de Procédure Civile 1806Document16 pagesCode de Procédure Civile 1806EduardoHenrikAubertPas encore d'évaluation
- Comment Définir Le Service Public ...Document40 pagesComment Définir Le Service Public ...Yasmine ALIOUAPas encore d'évaluation
- La Voie de FaitDocument3 pagesLa Voie de FaitLaila BoujidaPas encore d'évaluation
- La loi, expression de la volonté générale: Étude sur le concept de la loi dans la constitution de 1875D'EverandLa loi, expression de la volonté générale: Étude sur le concept de la loi dans la constitution de 1875Pas encore d'évaluation
- Les Transformations Du Droit Public - Léon DuguitDocument330 pagesLes Transformations Du Droit Public - Léon DuguitEduardo LevinPas encore d'évaluation
- Arminjon P, Nolden B, Wolff M, Traité de Droit Comparé Tome I, 1950 PDFDocument525 pagesArminjon P, Nolden B, Wolff M, Traité de Droit Comparé Tome I, 1950 PDFandresabelr100% (1)
- Traité Élémentaire de Droit Civil (... ) Planiol Marcel Bpt6k1159982jDocument102 pagesTraité Élémentaire de Droit Civil (... ) Planiol Marcel Bpt6k1159982jseti2016Pas encore d'évaluation
- Paul Laband - Le Droit Public de L'Empire Allemand - T. IIDocument736 pagesPaul Laband - Le Droit Public de L'Empire Allemand - T. IIGaiden AshtarPas encore d'évaluation
- Droit Constitutionnel EsmeinDocument700 pagesDroit Constitutionnel EsmeinJesús María Alvarado Andrade33% (3)
- Cours de Droit Civil Français (... ) Aubry CharlesDocument802 pagesCours de Droit Civil Français (... ) Aubry CharlesAlexandru DumitruPas encore d'évaluation
- Jean Carbonnier - Droit PublicDocument9 pagesJean Carbonnier - Droit PublicPascal MbongoPas encore d'évaluation
- Paul Laband - Le Droit Public de L'Empire Allemand - T. IDocument568 pagesPaul Laband - Le Droit Public de L'Empire Allemand - T. IGaiden AshtarPas encore d'évaluation
- Traité de Droit Constitutionnel CongolaisDocument412 pagesTraité de Droit Constitutionnel CongolaisGlody mbembe100% (1)
- Cours de Droit AdministratifDocument67 pagesCours de Droit AdministratifKoffi Maxime Diby100% (1)
- PCP de LegaliteDocument13 pagesPCP de LegaliteMarie LobPas encore d'évaluation
- Droit Administratif Tous de Serge Velley.1Document16 pagesDroit Administratif Tous de Serge Velley.1ReĐønə Benz M-PsyPas encore d'évaluation
- Abus de Minorite - Ph. MerleDocument2 pagesAbus de Minorite - Ph. MerleNadim TarabayPas encore d'évaluation
- Résumé Contentieux Administratif Oral - OdtDocument2 pagesRésumé Contentieux Administratif Oral - OdtEtienne S. CotPas encore d'évaluation
- Schwarze - Droit Administratif - Européen - 1994 - Volume2Document944 pagesSchwarze - Droit Administratif - Européen - 1994 - Volume2fahhoudaPas encore d'évaluation
- JÈZE, Gaston. Les Principes Généraux Du Droit Administratif - Págs. 297-373Document79 pagesJÈZE, Gaston. Les Principes Généraux Du Droit Administratif - Págs. 297-373carlos alberto moraesPas encore d'évaluation
- Droit Constitutionnel 1-138Document138 pagesDroit Constitutionnel 1-138Hind BoujilaliPas encore d'évaluation
- VanRyn, Responsabilite Aquilienne-1936Document364 pagesVanRyn, Responsabilite Aquilienne-1936Natasha CardosoPas encore d'évaluation
- Jhering Rudolf (Von) - Études Complémentaires de L'esprit Du Droit Romain I (De La Faute en Droit Privé) PDFDocument92 pagesJhering Rudolf (Von) - Études Complémentaires de L'esprit Du Droit Romain I (De La Faute en Droit Privé) PDFArnOmkarPas encore d'évaluation
- Le Juge Administratif Rempart de ProtectionDocument35 pagesLe Juge Administratif Rempart de Protectionprosperazanman100% (3)
- Contentieux AdministratifDocument3 pagesContentieux AdministratifJu Drtz Dlb100% (2)
- Droit Constitutionnel Et Institutions Politiques 2017-2018 (29e Éd) by Philippe Ardant Bertrand Mathieu (Ardant, Philippe Mathieu, Bertrand)Document640 pagesDroit Constitutionnel Et Institutions Politiques 2017-2018 (29e Éd) by Philippe Ardant Bertrand Mathieu (Ardant, Philippe Mathieu, Bertrand)Kenza NafidPas encore d'évaluation
- (Jean Carbonnier) Flexible Droit Pour Une Sociol PDFDocument498 pages(Jean Carbonnier) Flexible Droit Pour Une Sociol PDFMichele Amaral Dill83% (6)
- Traité Des Obligations en Général Demogue RenéDocument624 pagesTraité Des Obligations en Général Demogue RenéAlexandru Dumitru50% (2)
- Droit Des Obligations, Les Groupes de ContratsDocument13 pagesDroit Des Obligations, Les Groupes de ContratsSophie100% (1)
- PDG Et PFRLRDocument5 pagesPDG Et PFRLRcicou770% (1)
- Gény F, Science Et Technique en Droit Privé Positif, Vol IV, 1924 PDFDocument310 pagesGény F, Science Et Technique en Droit Privé Positif, Vol IV, 1924 PDFandresabelr100% (1)
- Le Juge Administratif Et Le Contrôle de ConstitutionnalitéDocument3 pagesLe Juge Administratif Et Le Contrôle de ConstitutionnalitéPrinceleste MadzouPas encore d'évaluation
- Le Droit Administratif - Weil Prosper, Pouyaud DominiqueDocument108 pagesLe Droit Administratif - Weil Prosper, Pouyaud DominiqueTakeshi Kovach100% (2)
- La Responsabilité Pour Faute de L'administrationDocument10 pagesLa Responsabilité Pour Faute de L'administrationradoniainaPas encore d'évaluation
- Contentieux Constitutionnel Compare ExtraitDocument20 pagesContentieux Constitutionnel Compare ExtraitMichel Tolima kitokoPas encore d'évaluation
- Intervention CadietDocument31 pagesIntervention CadietARonaldo AssisPas encore d'évaluation
- Dissertation - Mariage HomosexuelDocument6 pagesDissertation - Mariage HomosexuelxlLovePas encore d'évaluation
- ARMINJON Pierre Et Al (1950) Traite de Droit Compare (Tome I)Document524 pagesARMINJON Pierre Et Al (1950) Traite de Droit Compare (Tome I)juan_de_heratPas encore d'évaluation
- Droit Administratif Des BiensDocument48 pagesDroit Administratif Des BiensTara0Dejane100% (3)
- Burgorgue-Larsen - Les Concepts de Liberté Publique Et de Droit Fondamental PDFDocument21 pagesBurgorgue-Larsen - Les Concepts de Liberté Publique Et de Droit Fondamental PDFVincentN'Gbesso0% (1)
- Manuel Élémentaire de Droit Civil - E. Colmet de SanterreDocument2 pagesManuel Élémentaire de Droit Civil - E. Colmet de SanterreJulioDanzigDravenPas encore d'évaluation
- Traité de Droit Constitutionnel La (... ) Duguit Léon Bpt6k5401497zDocument796 pagesTraité de Droit Constitutionnel La (... ) Duguit Léon Bpt6k5401497zEvariste MarekPas encore d'évaluation
- Roger BONNARD - Les Actes Constitutionnels de 1940Document183 pagesRoger BONNARD - Les Actes Constitutionnels de 1940JorgePas encore d'évaluation
- Contentieux Administratif (N. Jacquinot)Document2 pagesContentieux Administratif (N. Jacquinot)Salsabil SendidPas encore d'évaluation
- Droit ConstitutionnelDocument58 pagesDroit ConstitutionnelAlvaro MartinPas encore d'évaluation
- Songbook Lea FreireDocument81 pagesSongbook Lea FreireLucas Querini100% (1)
- Pascal Bernardin - Le Crucifiement de Saint PierreDocument309 pagesPascal Bernardin - Le Crucifiement de Saint PierreAthosBarbosaLimaPas encore d'évaluation
- JMcorrespondence Avec GarrigouDocument70 pagesJMcorrespondence Avec GarrigouAthosBarbosaLimaPas encore d'évaluation
- La Philosophie Morale Et Sociale de Destutt de TracyDocument186 pagesLa Philosophie Morale Et Sociale de Destutt de TracyAthosBarbosaLimaPas encore d'évaluation
- Étude Juridique de L'arbitraire Gouvernemental Et AdministratifDocument483 pagesÉtude Juridique de L'arbitraire Gouvernemental Et AdministratifAthosBarbosaLimaPas encore d'évaluation
- Iconographie ChrétienneDocument622 pagesIconographie ChrétienneAthosBarbosaLimaPas encore d'évaluation
- L'Histoire Externe Du Droit, Par Maurice HauriouDocument19 pagesL'Histoire Externe Du Droit, Par Maurice HauriouAthosBarbosaLimaPas encore d'évaluation
- Précis Élémentaire de Droit Constitutionnel (2e Ed.) Par Maurice HauriouDocument356 pagesPrécis Élémentaire de Droit Constitutionnel (2e Ed.) Par Maurice HauriouAthosBarbosaLimaPas encore d'évaluation
- Penser L'état. Rousseau Ou HegelDocument23 pagesPenser L'état. Rousseau Ou HegelDavo Lo SchiavoPas encore d'évaluation
- De La Souverainete Permanente de La R.D PDFDocument165 pagesDe La Souverainete Permanente de La R.D PDFKADOGO OLGPas encore d'évaluation
- ch03 076 ldp1Document10 pagesch03 076 ldp1DadouPas encore d'évaluation
- Joseph Dejacque La Question Revolutionnaire PDFDocument22 pagesJoseph Dejacque La Question Revolutionnaire PDFMichel FelipePas encore d'évaluation
- Théorie Générale de L'étatDocument15 pagesThéorie Générale de L'étatEl Jadou0% (1)
- Qui - Gouverne - Le - Monde Sous La Direction de - BADIEDocument336 pagesQui - Gouverne - Le - Monde Sous La Direction de - BADIEAbdelwahab El Hadiri100% (1)
- PLAF24Document96 pagesPLAF24sanand_1992Pas encore d'évaluation
- Cours 1 - L'EtatDocument74 pagesCours 1 - L'Etatsara benPas encore d'évaluation
- Sujets Complets D'éco de 2014 À 2022Document46 pagesSujets Complets D'éco de 2014 À 2022Ibrahim BahPas encore d'évaluation
- Les Acteurs Des Relations Internationales Cours RI PlateformeDocument9 pagesLes Acteurs Des Relations Internationales Cours RI PlateformeSalma AdraouiPas encore d'évaluation
- Chapitre 3 - L'exercice Du Pouvoir Politique.Document67 pagesChapitre 3 - L'exercice Du Pouvoir Politique.Tininha Atlan100% (1)
- Le Biopouvoir Chez Foucault Et AgambenDocument25 pagesLe Biopouvoir Chez Foucault Et Agambenusuariosdelserra1727Pas encore d'évaluation
- (Cours) LES FONDEMENTS DU DROITDocument37 pages(Cours) LES FONDEMENTS DU DROITJean-PaulPas encore d'évaluation
- Démocratie Et Citoyenneté Cairn - InfoDocument88 pagesDémocratie Et Citoyenneté Cairn - InfoChris IproPas encore d'évaluation
- La Révolution Kidnappée - Mustapha KraiemDocument539 pagesLa Révolution Kidnappée - Mustapha KraiemNabil DakhliPas encore d'évaluation
- Jalons Sur La Route de L IslamDocument24 pagesJalons Sur La Route de L IslamUshuaia DecoPas encore d'évaluation
- Théorie Générale de L'état - Chapitre 3. La Répartition Des Tâches Entre L'état Et La Société - Graduate Institute PublicationsDocument1 pageThéorie Générale de L'état - Chapitre 3. La Répartition Des Tâches Entre L'état Et La Société - Graduate Institute PublicationsSekou OuattaraPas encore d'évaluation
- Beetham MaxWeberet 1995Document13 pagesBeetham MaxWeberet 1995karagolbeyzanurPas encore d'évaluation
- Agamben Badiou Negri - Vie Multitude Evenement GiassiDocument81 pagesAgamben Badiou Negri - Vie Multitude Evenement GiassijfdelucheyPas encore d'évaluation
- Droit D'organisation Judiciaire Au MarocDocument251 pagesDroit D'organisation Judiciaire Au MarocMed Benali Balahcen75% (4)
- Comment L'obsession Sécuritaire Fait Muter La DémocratieDocument12 pagesComment L'obsession Sécuritaire Fait Muter La DémocratieTolle_Lege100% (1)
- IntroductionDocument10 pagesIntroductionHamza BarbachPas encore d'évaluation
- Sir Walter Scott - Vie de Napoleon Buonaparte (8) ADocument681 pagesSir Walter Scott - Vie de Napoleon Buonaparte (8) Aragod2Pas encore d'évaluation
- Droit International PublicDocument102 pagesDroit International Publicilya_novikov612Pas encore d'évaluation
- De La Nécessité D - Une Théorie Des Relations InternationalRDocument24 pagesDe La Nécessité D - Une Théorie Des Relations InternationalRdaniellogitecPas encore d'évaluation
- Petites Pensées Réduites À L'essentiel (MAJ Le 13.03.2013)Document1 461 pagesPetites Pensées Réduites À L'essentiel (MAJ Le 13.03.2013)eauregalePas encore d'évaluation
- Conflits de Nationalités Par Michel Verwilghen (1999)Document61 pagesConflits de Nationalités Par Michel Verwilghen (1999)punktlichPas encore d'évaluation
- Droit International Public - L3 DroitDocument81 pagesDroit International Public - L3 DroitSophie100% (1)
- L'exercice Du Metier Des Armes Dans L'armee de TerreDocument22 pagesL'exercice Du Metier Des Armes Dans L'armee de TerremmmaaarrriiieeePas encore d'évaluation
- Foucault1976 - Droit de Mort Et Pouvoir Sur La Vie PDFDocument4 pagesFoucault1976 - Droit de Mort Et Pouvoir Sur La Vie PDFmattdelezPas encore d'évaluation