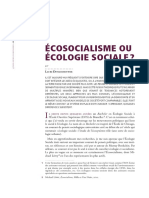Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Constructivisme Et Reflexitivité
Transféré par
Olga NancyCopyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Constructivisme Et Reflexitivité
Transféré par
Olga NancyDroits d'auteur :
Formats disponibles
CONSTRUCTIVISME ET REFLEXIVISME
EN THORIE DES RELATIONS INTERNATIONALES
par
Thierry BRASPENNING (*)
Prologue : positivisme
rflexivisme et constructivisme
Ltiolement des frontires de la discipline des Relations Internationales (1), ds le dbut de la seconde moiti des annes quatre-vingt, inaugure un nouveau sujet dvaluation : la discipline elle-mme (le troisime
dbat) (2). Cette auto-valuation, cette introspection, bref, cette rflexivit
ouvre la voie une laboration de typologies des diffrents paradigmes des
Relations Internationales, insistant de faon variable sur des distinctions
mthodologiques, ontologiques, axiologiques et pistmologiques. Le troisime dbat ne cherche pas dpartager deux approches opposes. Il sagit
plus de comparer que dexclure, de proposer et de complter que de vouer
les anciens paradigmes aux gmonies. L o les premier (3) et second (4)
dbats, engoncs respectivement dans les questions du sujet et de la mthodologie idoines des Relations Internationales, avaient propos successivement une thorie de ltre et du faire, le troisime dbat propose une thorie
de la connaissance socialement construite.
Cette sensibilit la construction sociale des disciplines est devenue lun
des critres rcurrents de la rflexivit, renforce par le rle de la perception
que le chercheur a de la thorie, et par la division positivisme/post-positivisme, ce qui constitue, plus dun titre, le principal legs du troisime
dbat. Pour la plupart des post-positivistes, la connaissance est socialement
construite et la thorie est intrinsquement rflexive. Le rflexivisme, qui
arbore une vision aux antipodes du positivisme, accepte les prsupposs suivants : il y a un foss entre les concepts et la ralit. On ne peut donc
connatre ou se reprsenter de manire directe la ralit parce que la
(*) Chercheur au Centre dtudes des crises et conflits internationaux (CECRI) de lUniverist catholique
de Louvain et au Centre dtudes internationales (Centre of International Studies) de lUniversit de Cambridge.
(1) Les majuscules dsignent la discipline alors que les minuscules renvoient au champ daction.
(2) Yosef Lapid, The Third Debate : On the Prospect of International Theory in a Post-positivist Era ,
International Studies Quarterly, vol. 33, n o 3, 1989, pp. 325-254 ; Kal J. Holsti, The Dividing Discipline :
Hegemony and Diversity in International Theory, Allen & Unwin, Boston, 1985, pp. 1-30.
(3) Ralisme versus Idalisme.
(4) Historicisme versus Bhaviorisme.
constructivisme et rflexivisme
315
connaissance du rel passe par la mdiation de notre conscience. Ce qui doit
animer la recherche, cest lhermneutique des cas uniques. Ce qui assoit la
mthode interprtative (5).
Les positivistes quant eux, soutiennent tout juste le contraire. Le positivisme est associ une ontologie tributaire du ralisme qui se concentre sur
la ralit des faits empiriques, indpendamment de notre conscience leur
sujet. Les concepts scientifiques correspondent des ralits factuelles. Le
but de lexplication en sciences sociales est identique celui poursuivi par
les sciences naturelles : rechercher des lois invariantes qui prennent en
compte les lments trouvs dans de nombreuses populations de cas individuels. Ces explications sont lies la dmarche exprimentale et lanalyse
quantitative avec des variables statistiquement dfinies.
Le positivisme soppose aussi au postmodernisme. En effet, selon le positivisme, le monde existe objectivement et les images dans lesprit de lhomme
reprsentent la ralit travers lobservation. Le postmodernisme rejette
cette conception des images comme rfrents rels. Le monde est textuel,
cr par un entrelacement du discours et du texte. Cela veut-il dire que le
postmodernisme rsorbe toutes les bances du positivisme ? Non, bien sr.
Il nest pas mieux inform pour offrir une analyse acceptable de la manire
dont les hommes construisent activement un pont entre le signe et le rfrent, entre la ralit et la thorie. Ce qui a pour consquence une oscillation
entre une multiplicit dagents et une diversit de structures. Ni le positivisme, ni le postmodernisme nessaient dtudier ou de dcrypter les luttes
humaines afin de construire leurs relations interactives dune part, et leurs
coexistences avec la nature dautre part, via la standardisation des signes,
des normes et des rgles. De tels manquements rendent difficile la thorisation, dans la vie humaine, des rgularits qui rsultent de lactivit de
lusage des rgles (6).
Le rflexivisme ouvre ainsi la voie une prolifration mtathorique, ce
qui pousse certains sociologues qui sen rclament rouvrir la voie pluraliste (7). Nanmoins, le pluralisme dont il est question ici nest pas celui
inhrent au second dbat. De fait, le pluralisme rflexif reste fidle sa
vocation dtre une mtathorie polyphonique et non pas une architecture
(5) Cf. Raymon A. Morrow/David D. Brown, Critical Theory and Methodology, Sage, Londres, 1994,
pp. 25-33.
(6) Les rcentes approches qui adoptent le structurationisme et le constructivisme permettent de sortir
de la double impasse positiviste et postmoderniste. Selon ces approches structurationistes, les rgles et les
normes peuvent tre des dterminants de laction. Les structures et les acteurs sont mutuellement constitus.
Le constructivisme libre ainsi les Relations Internationales du postmodernisme en ralliant les vues de ce
dernier au monde extra-textuel, un monde pleinement vivant, avec ses contingences, un monde cr par les
hommes pour leur propre ralisation. Cf. Nicholas G. Onuf, World of our Making. Rules and Rule in social
Theory and International Relations, University of South Carolina Press, Columbia, 1989, 327 pages ; Alexander Wendt, Levels of Analysis Vs Agents and Structures, Part III , Review of International Studies,
vol. 18, n o 2, 1992, pp. 235-270 ; David Dessler, What is at Stake in the Agent-Structure Debate ? , International Organization, vol. 43, n o 3, 1989, pp. 441-473.
(7) Par exemple, Yosef Lapid, The Third Debate : On the Prospects of International Theory in a PostPositivist Era , International Studies Quarterly, vol. 33, n o 3, 1989, pp. 235-254.
316
thierry braspenning
dont la prtention serait dlaborer un projet de recherche aux contours
clairs et distincts. Cela explique aussi son caractre relativement moins polmique puisque le pluralisme y est demble une vertu. Le troisime dbat
noffre pas une alternative thorique homogne aux autres paradigmes des
Relations Internationales. La seule bannire sous laquelle les diffrentes
interventions rflexives se retrouvent est celle dun anti-ralisme trs prononc. Voil pourquoi le rflexivisme apparat souvent comme une discussion quelque peu trique, reste simplement dans lantichambre de lantiralisme.
Outre cette perception qui sapparente un jugement de valeur ngatif
et qui en limite la porte, la critique rflexiviste du rationalisme thorique
cible le manque de dynamique endogne lidentit des acteurs. La
rflexion individuelle et sociale capable de provoquer des changements dans
les prfrences et les visions de la causalit est tout simplement ignore. Les
prfrences, dit-on, sont fixes une fois pour toutes. Or, cette prtention
doptions fixes exclut une meilleure comprhension des modifications
majeures lintrieur des institutions humaines. Les thories rationalistes
obscurcissent plus quelles nclairent les sources des choix politiques des
Etats. Le rsultat, selon Ashley, cest une attitude foncirement a-historique
du monde politique, qui a rifi les agencements politiques et culturels
contemporains en rejetant lhistoire comme processus et la signification historico-spatiale de la pratique (8). Le rationalisme ne nous apprend rien en
ce qui concerne les valeurs que promeuvent les institutions. Les variations
culturelles sont, pour elles, un domaine o la thorie se doit dtre aphone.
Le rflexivisme comme son nom lindique, se penche prioritairement sur le
reflet de soi, sur limage de soi laquelle on adhre, bref, sur lidentit. Justement, pour resituer la notion dimage et lui donner sa juste place afin de
redcouvrir la construction sociale de lacteur, Nicholas G. Onuf va parler,
pour la premire fois en Relations Internationales, du constructivisme (9).
Arms de tous ces prsupposs, cest ce constructivisme, ce socialconstructivisme, en somme, cette thorie sociale des Relations Internationales que cet article entend prsenter. Nous ne ferons pas cho aux
variantes post-modernistes du constructivisme, mais lcole reprsente
par Alexander Wendt, cest--dire, celle qui tente de rsorber lcart entre
rationalisme et rflexivisme. Le texte se dploie en trois grands axes : il
souvre par ltude des rapports entre le constructivisme et les thories noutilitaristes ; ensuite, il explore les lectures constructivistes des thmes traditionnels des Relations Internationales : intrt, structure, systme, institu(8) Richard K. Ashley, The Poverty of Neorealism , in Robert O. Keohane (dir.), Neorealism and Its
Critics, Columbia University Press, New York, 1986, 290 pages.
(9) Nicholas G. Onuf, World of our Making : Rules and Rule in Social Theory and International Relations,
University of South Carolina Press, Columbia, 1989, 327 pages.
constructivisme et rflexivisme
317
tions, anarchie, puissance ; larticle sachve sur une valuation du statut de
la rflexivit en Relations Internationales.
Au commencement tait la pratique...
Les constructivistes sappliquent combler le gouffre idel laiss bant
par les no-ralistes et les no-libraux rests no-utilitaristes (10) par
essence. La rampe de lancement de lapproche constructiviste est constitue
des omissions accumules par les thories existantes. La confrontation terminologique concerne surtout le degr dinfluence de lacteur sur la structure (lanarchie et la distribution de la puissance) par rapport au processus
(linteraction et lapprentissage) et aux institutions. Pour scruter la
construction sociale de la ralit internationale, le constructivisme avance
deux hypothses bien dveloppes par J. Checkel : lenvironnement dans
lequel les acteurs oprent est la fois social et matriel ; ce cadre peut
fournir aux acteurs lintelligibilit de leurs intrts (11).
Lapproche constructiviste repose sur la dimension intersubjective des
relations politiques en gnral. Les Etats sont des existants culturels
ayant la capacit et la volont dadopter des attitudes dlibres lgard
du monde et de lui donner sens. Cest cette capacit qui permet de donner
naissance aux faits sociaux, des faits qui dpendent de laccord des partenaires rationnels, dinstitutions humaines pour exister (12). Lidentit et
lintrt des acteurs sont socialement construits. Certes, le comportement
des acteurs subit des contraintes de divers ordres, mais on ne peut en faire
le sujet dtude exclusif de lentreprise des Relations Internationales comme
le font les no-utilitaristes.
Le no-utilitarisme
Le no-ralisme et le no-libralisme sont rationalistes. Ceux-ci parlent
des identits et des intrts comme des donnes exognes et se focalisent sur
la question du pourquoi . Pourquoi le comportement des acteurs gnret-il des actions de tel type, des actions prcises ? Cest donc une conception
comportementaliste des processus et des institutions. Lacteur peut changer
(10) Pour lesquels les interactions entre les Etats sont le rsultat de leurs calculs respectifs. John G. Ruggie, Constructing World Polity. Essays on International Institutionalization, Routledge, Londres, 1996,
312 pages.
(11) Jeffrey T. Checkel, The Constructivist Turn in International Relations , World Politics, vol. 50,
n o 2, 1998, pp. 324-348.
(12) Cf. John R. Searle, La Construction de la ralit sociale, Gallimard, Paris, 1998 (trad. Cl. Tiercelin), pp. 35-45.
318
thierry braspenning
de comportement mais pas didentit ni dintrt (13). Les no-utilitaristes
continuent de considrer que les acteurs centraux en relations internationales sont les Etats. La scurit y est dfinie en termes gostes. Le rationalisme rduit le processus relationnel aux dynamiques conflictuelles entre
acteurs extrieurement constitus. Cet individualisme ontologique contredit
lintersubjectivit ncessaire la pleine ralisation des phnomnes de la
thorie des rgimes. Autrement dit, les no-ralistes interprtent diffremment lanarchie internationale.
Que disent-ils ? Lanarchie est ncessairement inhrente au systme individualiste gnrant la dynamique comptitive du dilemme de la scurit et la
difficult de mener des actions conjointes. Etant donn que les Etats qui ne
peuvent se conformer cet individualisme ontologique seront balays ou
excommunis du systme, seuls lapprentissage et ladaptation comportementale sont possibles et salvateurs. Lapprentissage complexe quimplique
la redfinition de lintrt ne lest pas, le jeu savrant compltement
libre (14). Le no-libralisme concde au no-ralisme le principe de la puissance causale de la structure anarchique. Cependant, il affirme, en sens
contraire, que ce processus peut gnrer des attitudes coopratives dans un
jeu rglement.
Alexander Wendt, lun des prcurseurs du constructivisme, isole deux
genres de no-libralisme : le fort et le faible. Le no-libralisme faible soutient que lanarchie constitue des Etats avec des identits gostes extrieures la pratique ; il accepte la force causale de lanarchie de manire formelle et substantielle, et quelques ides rationalistes. Ce sont en fait prioritairement des ralistes avant dtre des libraux (15). Ils ne dpassent les
limites du ralisme que si les interactions internationales peuvent changer
la rigidit de la puissance et des intrts (16). Lautre courant, le no-libralisme fort, est plus proche du constructivisme. On y rencontre les notions
cardinales de lapproche constructiviste : lapprentissage complexe (17), le
(13) John Turner/Penelope Oakes, The Significance of Social Identity Concept for Social Psychology
with Reference to Individualism, Interactionism and Social Influence , British Journal of Social Psychology,
n o 25, 1986, pp. 237-252 ; John Turner/Richard Bourhis, Social Identity, Interdependance and the Social
Group : A Reply to Rabbie et al. , in Peter W. Robinson (dir.), Social Groups and Identities, Butterworth
Heineman, Oxford, 1996, pp. 25-63.
(14) Voyez la diffrence entre le jeu libre et le jeu rglement chez George H. Mead, LEsprit, le
soi et la socit, Presses Universitaires de France, Paris, 1963 (trad. J. Cazeneuve, E. Kallin et G. Thibault), pp. 130-139.
(15) Alexander Wendt, Anarchy is what States make of It : The Social Construction of Power Politics , International Organization, vol. 46, n o 2, 1992, pp. 391-425.
(16) Stephen Krasner, Regimes and the Limits of Realism : Regimes as Autonomous Variables , Idem,
International Regimes, Cornell University Press, Ithaca, 1983, pp. 355-368.
(17) Joseph S. Nye, Nuclear Learning and US Soviet Security regimes , International Organization,
vol. 41, n o 3, 1987, pp. 371-402.
constructivisme et rflexivisme
319
changement de la conception de soi et des intrts (18), et la conception
sociologique des intrts (19).
Les auteurs qui se rattachent cette variante ont une conception plus
forte du processus dinteraction et des institutions en relations internationales. Ils sont plus prudents sur le privilgement de la structure sur le
processus, dans la mesure o les mutations de lidentit et de lintrt travers le processus dchange sont aussi des transformations de la structure.
Lapport du no-libralisme fort par rapport la version faible, est daccorder une plus grande importance aux institutions internationales et aux
valeurs quelles essaient de vhiculer. La structure institutionnelle nest
modifie, repense, que par le biais de la transformation de lidentit et de
lintrt. Ds lors, la question de dpart dans cette toile constructiviste
revt une simplicit et une exigence de base : comment les pratiques bien
formes (lhabitus au sens de Bourdieu), construisent-elles une identit et un
intrt qui lui est consubstantiel ?
Les axiomes du constructivisme
Le constructivisme se penche sur la nature des acteurs (Etat, groupe et
individus) et sur leurs relations aux environnements structurels plus larges.
La philosophie est celle dune constitution mutuelle dans laquelle aucune
unit danalyse acteur/structure nest rduite lautre. Lintrt des
acteurs merge de et est endogne linteraction avec la structure au
premier niveau, et dautres acteurs, au second niveau, sans quaucun nait
la primaut analytique sur lautre. Tout se passe par le biais de la pratique
et des normes qui donnent sens laction. En labsence de ce cadre de pratique, de cette structure normative, les actions seraient dnues de sens. Ce
sont des normes de symboles constitutifs qui montent en pingle une identit accompagne toujours dun intrt et dactions spcifiques qui permettent aux autres de percevoir cette identit comme telle et dy rpondre par
une action approprie ou pas, en cas de mauvaise perception.
Les acteurs agissent lgard dobjets aussi bien que dautres acteurs, sur
la base du sens que ces objets et acteurs ont pour eux (20). Tel est le premier
axiome constructiviste (21). Le deuxime que nous pouvons mobiliser est le
suivant : le systme des Etats est enchss dans une socit dEtats qui
comprend un ensemble de rgles, de valeurs et dinstitutions communment
acceptes et rgulant la vie internationale. Le chemin est tout trac : concilier et dpasser lobjectivisme des structures du systme international ind(18) Robert Jervis, Realism, Game Theory, and Cooperation , in World Politics, vol. 40, n o 2, 1988,
pp. 317-349.
(19) Robert O. Keohane, International Liberalism Reconsidered , in J. Dunn (dir.), The Economics
Limits to Modern Politics, Cambridge University Press, Cambridge, 1990, pp. 165-194.
(20) Ami ennemi rival.
(21) Lide est dHerbert Blumer : cf. Symbolic Interactionism : Perspective and Method, Prentice-Hall,
Englehood Cliffs, 1969, pp. 18-19.
320
thierry braspenning
pendant de laction des acteurs et le subjectivisme de ces mmes acteurs,
cest--dire leurs modes de reprsentation et leurs actions.
Dans le cadre de l idalisme structurel (22) ainsi dfini, les contraintes
structurelles et les interactions des acteurs entretiennent une relation dialectique au cours de laquelle les contraintes structurelles ne sexercent pas
indpendamment des motifs et des raisons quont les acteurs de ce quils
font. Retour la pratique donc. Retour aussi, cela on lavait dj pressenti
et not, lanarchie, la coopration, la construction des identits,
linteraction. Mais aussi ouverture au rejointoignage des intrts et la
d-rification des structures.
La d-rification des structures, des identits et des intrts
Lidentit fournit une image de lautre en mme temps quelle projette le
soi. Par son identit, lacteur ouvre un espace de prdictibilit. Cest parce
que tel acteur a telle identit quil se comporte de telle faon et non de telle
autre (23). Un monde sans identit ou aux identits hypertrophies serait un
monde chaotique, imprdictible, vou aux angoisses de lincertitude. Lidentit remplit donc deux fonctions ncessaires : elle permet lego de savoir
qui est lalter et inversement ; elle prcise un stock dintrts et de prfrences eu gard aux choix daction dans un domaine particulier et aux
acteurs spcifiques (24). Un Etat ne comprend les autres que via les identits quil leur attribue. On nest donc pas forcment matre de son identit.
On peut mme en devenir esclave. Seule la pratique quotidienne peut donner lEtat loccasion de consolider ou de corriger son identit, son image :
la structure intersubjective est larbitre du sens. Linteraction permet aux
acteurs de tester des identits construites quils se sont mutuellement attribues.
A titre illustratif, durant la Guerre froide, les pays de lEurope de lEst
assimilaient lUnion sovitique la Russie, malgr les efforts de cette dernire pour viter une telle image. Lidentit russe tait donc prisonnire
des ides que se faisaient les Europens de lEst, mais aussi de la pratique
quotidienne qui impliquait, bien sr, le russe comme langue vhiculaire (25).
Lidentit est, du point de vue constructiviste, une question empirique,
qui doit nanmoins tre thorise dans un contexte historique. Les identits
sont variables, elles dpendent en grande partie des contextes historico-
(22) Alexander Wendt, Social Theory of International Politics, Cambridge University Press, Cambridge,
1999, p. 2.
(23) Cest aussi parce quil se comporte dune certaine faon quil a une identit prcise.
(24) Ted Hopf, The Promise of Constructivism in International Relations Theory , International Security, vol. 23, n o 1, 1998, pp. 171-200.
(25) Cet exemple est tir dAlexander Wendt, Anarchy is What State of It : The Social Construction
of Power Politics , International Organization, vol. 46, n o 2, 1992, pp. 391-425. Sur lidentit et lintercomprhension, cf. Roxanne L. Doty, Aporia : A Critical Exploration of the Agent-Structure Problematic in
International Relations Theory , European Journal of International Relations, n o 3, 1997, pp. 365-392.
constructivisme et rflexivisme
321
culturels et socio-politiques. Ces rflexions mnent loin. Lidentit de lacteur sinscrit dans une temporalit fondamentale. Elle est loin dtre
immuable. Cette variabilit est aussi la possibilit de dpassement du
modle de la prsomption de la souverainet de lacteur sur soi, de la fiert
de lacteur fort. Ainsi, le risque subjectif, cest que lEtat a perdu ses qualits classiques de sret, de matrise de soi et de son image, de soi et de son
destin. Lacteur acquiert un nouveau statut paradoxal : le maintien de soi
existe toujours dans le constructivisme, mais il se ralise de lextrieur,
comme disponibilit lentretien par lautre.
Vu sous langle no-raliste, les Etats, seuls acteurs des relations internationales, faut-il le rappeler, ont une identit unique, a-temporelle, invariable, rigide, donne ex ante une fois pour toutes. Cela est vrai si lon
dtache compltement les intrts des pratiques sociales qui constituent les
acteurs et les structures. La non-contextualisation des intrts et leur rification sont, comme le note Robert Keohane, des faiblesses majeures du
positivisme international (26). Cependant, puisque lintrt est le produit de
lidentit et que celle-ci se dmultiplie et se transfigure, le constructivisme
carte de son enqute des intrts qui prexisteraient ad vitam aeternam
laction et au comportement rels des acteurs concerns (27). Lapproche
sociale tudie lclosion ou non, la consolidation ou le dmantlement ventuel dune identit et dun intrt qui lui est concomitant. Lintrt ne survient que par la pratique sociale. Les pratiques sociales qui construisent une
identit ne peuvent que trs rarement entraner des identits qui seraient
non conformes aux pratiques et aux structures qui ont chafaud sa source
originelle : lidentit.
Identit et intentionnalit collective
De ce qui prcde, on retiendra que lidentit est relationnelle. Nous
allons nous y arrter. Il faut sy attarder car cest lun des picentres qui
devra encore mobiliser nos ressources intellectuelles pendant un certain
temps. Mais ne jetons pas lancre ici. Explorons lau-del de la surface afin
de quitter le terrain des truismes.
Et dabord, cette citation en guise douverture du rideau scnique dialogal : [L]identit, avec son attachement adquat de la ralit psychologique, est
toujours identit au sein dun monde spcifique socialement construit (28).
Chaque personne a plusieurs identits relies des rles institutionnels :
frre, sur, professeur, citoyen... De faon similaire, lEtat peut se prvaloir
de multiples identits : souverain, faible/fort, terroriste, puissance impriale/
(26) Robert O. Keohane, International Institutions : Two Approaches , International Studies Quarterly, vol. 32, n o 4, 1988, pp. 379-396.
(27) Jeffrey W. Legros, Culture and Preference in the International Cooperation Two-Steps , American Political Science Review, vol. 90, n o 1, 1996, pp. 118-137.
(28) Peter Berger, Identity as Problem in the Sociology of Knowledge , in European Journal of Sociology, vol. 7, n o 1, 1966, pp. 32-40.
322
thierry braspenning
civilisatrice... (29) Lattachement et la prvalence d une identit particulire varie, mais chaque identit est ontologiquement une dfinition
sociale de lacteur fonde sur les thories que les acteurs ont deux-mmes
et des autres.
Linstitutionnalisation de lidentit et de la menace apporte, paradoxalement, la scurit. Lorsque lobjet de la peur a t clairement identifi, on
sait mieux ce qui est menac et quelle attitude, quelle stratgie peut aider
sen prmunir. La survie est une question didentification. Elle est une
interrogation sur le qui , le quoi , le pourquoi et le comment . Qui
ou quest-ce qui est menac ? Par qui ou quoi ? Pourquoi ? Comment en sortir ? Ces interrogations assurent aussi le passage de langoisse du nimporte
quoi , du dsordre ontique sans objet, la peur de (30). Les reprsentations sociales que sont les institutions insrent la peur dans un cadre qui
scurise lenvironnement systmique.
Au sens large, linstitution est une structure didentits et dintrts qui
tend asymptotiquement vers la stabilit. Ces structures sont souvent
codifies dans des normes formelles et nont de force quen vertu de la socialisation des acteurs et de leur participation la connaissance collective. Les
institutions sont donc des entits cognitives qui nexistent pas en dehors
des ides des acteurs sur la faon dont le monde fonctionne. La souverainet, lgosme international, lEtat, lONU sont, chacun leur niveau, des
institutions. Leur existence dpend de rgles constitutives et rgulatrices.
Le no-ralisme de mme que le no-libralisme nont que des rgles rgulatrices dans leur thorie. Ils nont pas de thorie des rgles constitutives (31). La saisie de la distinction rgles constitutives rgles rgulatrices
remonte John Rawls (32). John Searle la reprend dans un ouvrage qui
marque son tournant constructiviste et le passage la philosophie
sociale (33). Certaines rgles ne font quharmoniser le dveloppement dune
activit. Elles peuvent apparatre avant, pendant ou aprs la cration dune
activit. Ce sont des rgles rgulatrices (34). Les rgles constitutives ont en
revanche un statut plus fondamental parce quelles sont endognes au
droulement de lactivit dsigne. Elles crent la possibilit mme de
lactivit. Exemple, le jeu dchecs. Pour quil y ait jeu dchecs, on a cre
les rgles en mme temps que le jeu : les deux sont lis. Si vous liminez
ces rgles, il ny a plus de jeu dchecs. Selon Searle, les faits institutionnels
(29) Cf. Kal Holsti, National Role Conception in the Study of Foreign Policy , International Studies
Quarterly, vol. 14, 1970, pp. 233-309.
(30) Cf. Thierry Braspenning, Group Identity and the Desintegration of the Modern Link between
Security and Fear , contribution prsente loccasion de la Graduate Conference in Political Theory lUniversit dEssex, 12-13 mai 2000, 12 pages.
(31) John G. Ruggie, What makes the World Hang Together ? Neo-utilitarism and the Social Constructivist Challenge , International Organization, vol. 52, n o 4, 1998, pp. 855-885.
(32) John R. Rawls, Two Concepts of Justice , Philosophical Review, vol. 64, n o 1, 1955, pp. 3-32.
(33) John R. Searle, La Construction sociale de la ralit, Gallimard, 1999 (trad. Cl. Tiercelin), pp. 2055.
(34) Ibid., p. 46.
constructivisme et rflexivisme
323
ne sont prsents qu lintrieur des rgles constitutives. Cest lensemble,
lossature, larsenal des rgles constitutives qui est la condition dexistence
des faits institutionnels (35). Les rgles constitutives sont la fondation institutionnelle de la vie sociale. Aucun pan de lactivit humaine ou autre
lexception de lactivit animale nest imaginable sans une gamme de
rgles rgulatrices.
Plusieurs institutions sont sdimentes au point quon en vient oublier
quelles sont le fait de rgles constitutives, que leur prennit dpend de lintentionnalit collective. Entendons-nous bien, lintentionnalit collective
est, dans ce cas prcis, le fait davoir en commun des tats dits intentionnels (36) : croyances, volont de puissance ou de coopration. Tout fait qui
implique une intentionnalit collective est un fait social (37). En outre, les
faits institutionnels nen sont quune sous-classe parmi dautres (38). Lintentionnalit collective cre du sens. Elle tablit le cadre de comprhension
intersubjective qui inclut un partage des conditions dmergence des institutions, les buts quelles servent, leurs grammaires ainsi que les critres
dadhsion, de suspension et dexclusion.
Lanarchie et la socit internationale
Si la structure est dnue de signification en dehors des normes et des pratiques intersubjectives, lanarchie, composante structurelle pose axiomatiquement par le no-ralisme (39), na pas de sens sans un minimum de rgles
dchanges. En effet, lanarchie ne peut socialiser les Etats aux desiderata de
la structure du systme international sil ny a pas des normes et des pratiques (40). Pour rendre cette assertion plus claire, reprenons une image qui
illustre bien propos lextrmisme structurel (41) :
Le scnario est celui dun incendie qui se dclare dans un thtre. En labsence de la connaissance des procdures sociales et des rgles constitutives,
les structures, mme dans des circonstances surdtermines, demeurent
indtermines. Imaginons, en effet, que ce soit un thtre avec une seule
issue de secours vers laquelle tous les spectateurs, devenus dramatiquement
acteurs, se ruent. Qui va y aller en premier ? Les plus forts ou les inaptes ?
Les femmes ou les enfants ? Ou est-ce une lutte du chacun pour soi ? Pour
(35) Ibid., p. 47. Le fait institutionnel saccompagne de lintentionnalit collective et de rgles agentives.
Par exemple, lONU a pour rgle agentive , la promotion de la paix. La rgle agentive est la fonction
essentielle attribue une entit.
(36) Ibid., pp. 40-44.
(37) Ibid., p. 45.
(38) Ibid., p. 44.
(39) Robert Jervis, Cooperation Under the Security Dilemma , World Politics, vol. 30, n o 2, 1978,
pp. 167-214.
(40) Ronald L. Jepperson/Alexander Wendt/Peter J. Katzenstein, Norms, Identity, and Culture in
National Security , in Peter J. Katzenstein (dir.), The Culture of National Security. Norms and Identity in
World Politics, Columbia University Press, New York, 1996, pp. 33-78.
(41) Ted Hopf, The Promise of Constructivism in International Relations Theory , International Security, vol. 23, n o 1, 1998, pp. 173 et s.
324
thierry braspenning
apporter un dbut de rponse ces questions, il faut connatre le contexte,
cerner la situation plus que la distribution de la puissance matrielle ou de
la structure dautorit. On doit aussi connatre la culture, les rgles, les institutions, les procdures et les jeux sociaux qui constituent aussi bien les
acteurs que la structure anarchique concerne. Comme la situation du
thtre en feu le montre, lanarchie reste indtermine lorsque des pratiques
et des normes sociales font dfaut. Chaque acteur a une manire de percevoir et de lire une situation anarchique. Prise isolment, cette lecture ne fait
sens que pour soi. Pour faire sens collectivement, il faut des rgles sociales.
Lanarchie nest pas a-temporelle, a-contextuelle, elle est ce que les acteurs
en font (42). Le pouvoir des jeux sociaux gt dans leur capacit reproduire
les significations intersubjectives qui forment les acteurs et les structures
sociales.
Un exemple, un seul : lintervention de la France au Rwanda en 1994
tait compatible avec un certain nombre didentits (dfenseur des droits de
lHomme et du droit dintervention humanitaire, mais aussi imprialiste,
alli du pouvoir en dliquescence). Mais une chose est dattribuer une identit, une autre est de la voir se confirmer dans la pratique. Ainsi, lidentit
garant de laide humanitaire sest-elle concrtise par la construction des
camps et la fourniture de laide alimentaire et sanitaire aux civils touchs
par le gnocide. Evidemment, pour dautres, lintervention ntait que lexpression dun attachement personnel au pouvoir en place, telle que le
confirme le rapatriement en premires urgences de la famille Habyarimana
ordonn, semble-t-il, par le Prsident Mitterrand lui-mme (43).
En ce sens, les pratiques sociales, non seulement reproduisent lacteur
travers son identit, mais aussi la structure sociale interactionnelle via la
perception sociale. Linteraction joue galement un rle de rducteur des
carts et des horizons dincertitude permettant ainsi la prdictibilit lintrieur dune communaut socialement structure. Nicholas Onuf parle
dauto-rgulation rflexive (reflexive self-regulation), ce qui parat plonastique en soi. La rflexivit renvoyant toujours au soi, que serait une autorgulation non rflexive ? (44) Le pouvoir de la pratique nest donc rien
dautre que celui de produire, de construire et de reconstruire un sens intersubjectif dans une structure sociale qui se mtamorphose au gr des mouvements actantiels (45). La pratique donne sens aux actions des membres
(42) Alexander Wendt, Anarchy is what States make of it : The Social Construction of Power Politics ,
International Organization, vol. 46, n o 2, 1992, pp. 391-425.
(43) Cf. Filip-X. Verschave, Connivences franaises au Rwanda , Le Monde diplomatique, mars 1995.
(44) Nicholas G. Onuf, World of our Making : Rules and Rule in Social Theory and International Relations, University of South Carolina Press, Columbia, 1989, p. 62.
(45) Des travaux constructivistes avant la lettre, nous pouvons citer : Robert Jervis, Perception and Misperception in International Politics, Princeton University Press, Princeton, 1976, 432 pages ; The Logic of
Image in International Relations, Princeton University Press, Princeton, 1970, 276 pages. Jervis reprend plusieurs lments cls dvelopps par Goffman, connu pour ses travaux sur la comparaison entre les scnes de
la vie quotidienne et le thtre. Voyez par exemple Erving Goffman, The Presentation of the Self in Everyday
Life, Penguin Books, Londres, 1990, 251 pages.
constructivisme et rflexivisme
325
dune communaut et aux xeno, aux trangers. On est, par la pratique,
ramen aux frontires de la signification et de la prdictibilit. Ce qui fait
croire, juste titre, que le constructivisme revient toujours, quoique provisoirement, au fixisme des thories traditionnelles de la discipline, tant
donn que les relations sociales disciplinent, forment les actions et les ractions, quelles ont le pouvoir de construire des communauts entires, y
compris la communaut internationale, en leur fournissant un panel didentits et dintrts bien reconnaissables.
Le changement didentit : dimensions systmiques et psychologiques
Lanarchie, rptons-le, est ce que les acteurs en font. Il y a plusieurs
visions de lanarchie internationale, ce qui signifie que les actions des Etats,
pour parler de cet acteur prcis, sont plus varies que le simple gosme dans
lequel le no-ralisme les avait figes. Cela nest que lobservation dun tat
des lieux, laffirmation sans gain dinformation dune vidence. En fait, le
problme nest pas la multiplicit de comprhension de lanarchie : cela,
la limite, nest pas dun grand secours. En revanche, dire que ces comprhensions sont profondment enracines dans des structures sociales, cela
devient plus pertinent parce quayant une consquence plus dcisive : les
diffrentes figures de lanarchie que lon trouve dans les structures sociales
sont soutenues par le pouvoir de la pratique sociale. Ce pouvoir consiste
reproduire, discipliner et contrler lordre et les sens tablis. Ds que le pouvoir de la pratique a sorti tous ses effets, la ralisation du changement
devient difficile, quoique possible. En effet, des acteurs alternatifs avec
dautres identits, dautres pratiques et des ressources suffisantes peuvent
provoquer la transformation de la scne internationale par le truchement
dinteractions denses.
Nous sommes ce point tents de formuler une thse, peut-tre minime,
mais non moins essentielle : ds quil y a diffrence, il y a possibilit de
changement. En revanche, ce nest pas parce que le monde est socialement
construit quil est mallable souhait. Deux raisons plaident en faveur de
cette position.
La premire est lide selon laquelle les systmes sociaux, ds quils sont
construits, font face chaque membre comme un fait social objectif qui renforce certains comportements et en dnonce dautres (Cf. Durkheim) : le
self-help tend rcompenser la comptition et punir laltruisme ; la probabilit du changement dpend des actions dviantes par rapport au scnario impos par les exigences de la comptition. Sil ny a pas de vide daction
326
thierry braspenning
dans le systme, sil ny a pas despaces de libert, le systme restera
intact (46).
FIGURE 1
Un pattern dinteractions intra-systmiques
(1) iinteraction normale ; (2) interaction biaise ; acteur dviant exclu du systme (47)
La deuxime raison, cest que les acteurs peuvent aussi sopposer aux
changements systmiques pour prserver leurs intrts personnels. Les identits sont sauvegardes dans le dsir de minimiser et de rduire lincertitude
et la peur, et dans la volont dviter les cots relatifs la rupture des engagements contracts lgard des autres parties prenantes danciennes interactions. Le niveau de rsistance quinduisent ces engagements dpend de
la pertinence et de lattachement de lacteur son rle (48). Un rle nest
pas gal un autre ; de mme, le degr dattachement une identit nest
que relatif. Les Etats-Unis peuvent, par exemple, renoncer aussi facilement
leur identit de promoteur des droits de lHomme, qu celle de premire
puissance militaire mondiale. Toutefois, pour la plupart des rles, les pratiques et les informations contraires peuvent crer des dissonances cognitives
et mme une perception de menace, ce qui peut causer des rsistances aux
mtamorphoses du soi et donc de la scne sociale.
Pour ces raisons systmiques et psychologiques, les intelligibilits et les
attentes mutuelles risquent davoir des effets conservateurs constituant des
voies de dpendance que des nouvelles ides propos de lun et de lautre
auraient pu dpasser. A travers lexercice, les acteurs sont constamment en
train de produire et de reproduire des identits et des intrts, de choisir
actuellement des prfrences quils pourront garder ou vacuer de leur
action plus tard.
(46) Cf. ce sujet, Howard Becker, Notes on the Concept of Commitment , American Journal of sociology, vol. 66, n o 1, 1960, pp. 32-40.
(47) Les cas de la Libye et de lIraq sont assez paradigmatiques.
(48) Cf. Howard Becker, Notes on the Concept of Commitment , American Journal of sociology,
vol. 66, n o 1 1960, pp. 32-40.
constructivisme et rflexivisme
327
Post-scriptum
Comparaison et dbat rflexif
Le monde vis par le constructivisme est doffice un monde intersubjectif
et interculturel parce quil nest pas uniquement celui dun acteur isol,
mais bien celui de tous les acteurs reconnus comme tels. En outre, il est fait
de significations dont la sdimentation sest ordonne au cours de lhistoire.
Il na y donc pas pure homognit ni du ct des acteurs, ni du ct du
systme social international. Les connaissances en prsence ne sont manifestement pas les mmes pour tous les diffrents acteurs : il y a comme une
distribution internationale de la connaissance elle-mme marque par la
situation biographiquement dtermine de chacun (49).
Faisons, par un mouvement rtroactif, un dernier pas au sein du troisime
dbat qualifi de rflexif, dans lequel nous avons situ le constructivisme.
Le dbat rflexif ne cherche pas trancher entre deux approches, mais
dcouvrir les lacunes des diffrents paradigmes internationaux. Afin de
mener bien cette tche, il va insister sur la possibilit de comparabilit de
ces cls hermneutiques . Cependant, les choses ne sont pas si simples. On
peut, en effet, dans la volont de diffrencier les paradigmes, adopter trois
positions (50). La premire correspond la tradition positiviste de la vritcorrespondance, selon laquelle les paradigmes sont commensurables et comparables : la comparaison est possible parce que les paradigmes peuvent tre
valus la lumire dun principe commun, celui de la correspondance avec
le monde rel. La deuxime position rompt, dit-elle, avec le positivisme,
tant donn quelle considre que ce qui constitue le savoir, ce sont des
constructions humaines et des conventions sociales : en vrit, cette attitude
renoue, malgr elle, avec le positivisme de la premire position, en particulier travers lide selon laquelle accepter lincommensurabilit implique
directement, sans faille, lincomparabilit des paradigmes. Enfin, les paradigmes rivaux sont incommensurables mais restent comparables : seule cette
approche est totalement rflexive, car elle reconnat le fait que les principes
de ce qui constituent un savoir fiable sont dpendants de la nature du
contexte et du vocabulaire usit par les diffrentes communauts scientifiques.
A la question quel est le meilleur paradigme ? , on peut substituer quel
est le programme social, le projet politique qui est appropri aux besoins de
la plante ? , quel programme se rfre telle thorie ? , quel programme
(49) Alfred Schtz, Le Chercheur et le quotidien, Mridiens-Klincksieck, Paris, 1987, pp. 14-15. Il faut distinguer le constructivisme de type phnomnologique de Schtz, qui part des individus et de leurs interactions, de celui de Bourdieu, qui part plutt des structures. Cf. cet effet Phlippe Corcuff, Les Nouvelles
Sociologies, Larousse, Paris, 1995, pp. 14-46.
(50) Mark Neufeld, Reflexivity and International Relations Theory , in W.S. Cox/Cl.T. Sjolander
(dir.), Beyond Positivism : Critical Reflections on International Relations, Lynne Rienner, Londres, 1994,
pp. 11-35.
328
thierry braspenning
politico-social, conomico-culturel, normatif, une thorie sert-elle ? (51).
Dans la mesure o les paradigmes se valident eux-mmes en termes dacteurs sociaux et de buts spcifiques, la question de lidentit et de lobjectif
politique poursuivi consciemment ou non par ceux qui constituent la communaut des chercheurs ne peut plus tre vite.
Dans cette perspective, adopter une position pleinement rflexive, cest
prendre conscience des caractres politico-normatifs inhrents une thorie
et considrer, dans son tude des faits, une mthode interprtative bien loigne du positivisme. Cest ici que semble se situer le vritable tournant du
rflexivisme : alors que le positivisme sidentifie, en sciences sociales, au
modle des sciences naturelles, qui est pour lui la meilleure mthode de
recherche pour lexplication des phnomnes, lantipositivisme rflexif considre que la diffrence entre les deux modes dapproche doit tre tenue. Ce
qui distingue les sciences sociales, cest la qute dun sens, dune subjectivit
opratoire. Il ny a donc rien de tel quune thorie qui soit spare dune
poque, dun espace et dun projet socio-politique. La tche du thoricien
est de prendre conscience de ces facteurs et de se faire rflexif sur le processus de thorisation en soi.
La comparaison entre des paradigmes et des approches incommensurables
est donc non seulement possible, mais aussi ncessaire ds lors que lon
tend le fondement de lvaluation aux dimensions politico-normatives des
entreprises thoriques rivales. Adopter une position pleinement rflexive,
cest accepter quen sinsrant dans un paradigme, une thorie, une
approche, on soutient peut-tre un projet politique spcifique. Cest aussi
reconnatre quen prenant par exemple lorientation du problem-solving, on
contribue consciemment ou non au maintien dun ordre global bien prcis.
Par suite, il est intellectuellement vital de cerner de manire critique, les
mrites relatifs des diffrents projets politiques et des ordres globaux en
comptition. Enfin, on accepte que les principes de dfinition de la connaissance ne sont pas neutres, mais ont un contenu politico-normatif indniable
quil faut valuer rationnellement dans nos explications de la politique
internationale.
Le tableau ci-dessous (figure 2) reprend une comparaison cible du ralisme et du constructivisme dans leur approche de la ralit internationale.
(51) Mark Neufeld, Reflectivity and International Relations Theory , in W.S. Cox/C.T. Sjolander,
Beyond Positivism : Critical Reflections on International Relations, Lynne Rienner, Londres, 1994, p. 33.
constructivisme et rflexivisme
329
FIGURE 2
Une comparaison Ralisme-Constructivisme (52)
Paradigmes (53)
Ralisme
Points
de comparaison
Constructivisme
Unit principale danalyse
tat fort
Individus (lites),
tat faible
groupes,
Mots cls
Puissance matrielle, expan- Identits, ides, valeurs, puission territoriale, intrt natio- sances matrielle et discursive
nal, scurit
Sources des paradigmes
Politique, histoire, conomie Politique, anthropologie struc(no-ralisme surtout) et phi- turale, sociologie et philosolosophie
phie (Libralisme)
Ethique et droit
Lthique est la base du Lthique et le droit peuvent
droit mais elle est inexistante tre des dterminants de lacsur le plan international
tion des acteurs sur le plan
externe
Propositions principales
Les Etats sont constamment
amens se battre pour
dfendre, promouvoir ou
consolider leurs intrts
Le systme des Etats est
enchss dans une socit
dEtats qui comprend un
ensemble de rgles, de valeurs
et dinstitutions communment acceptes et rgulant la
vie internationale
Probabilit de changement
Faible
Forte
Auteurs principaux
H. Morgenthau et K. Waltz
P. Katzenstein, N. G. Onuf, J.
G. Ruggie et A.. Wendt
Travaux reprsentatifs
H.J. Morgenthau, Politics
among Nations et K.N.
Waltz, Theory of International Politics
N.G. Onuf, World of our
Making; A. Wendt, Anarchy
is what State Make of it ; Idem,
Social Theory of International
Politics ; J.G. Ruggie ,
Constructing World Polity et
P. Katzenstein (dir.), The
Culture of National Security
(52) Ce schma est tir de Thierry Braspenning, Linteractionisme internationaliste : Constructivisme
et scurit globale , Studia Diplomatica, ( paratre).
(53) Le terme paradigme est usit ici dans un sens trs peu orthodoxe, car au sens classique, le paradigme dsigne un corpus de thories qui ont une perception similaire de ltre et du devoir-tre. Cf. KlausGerd Giesen, LEthique des relations internationales. Les thories anglo-amricaines contemporaines, Bruylant,
Bruxelles, 1992, pp. 2-17.
Vous aimerez peut-être aussi
- Devops Pour Les NulsDocument77 pagesDevops Pour Les NulsMǝhdi BorealisPas encore d'évaluation
- Topographie TPDocument18 pagesTopographie TPhammouche84% (38)
- Abderrazak & HadjiDocument110 pagesAbderrazak & HadjiSaifMaalemPas encore d'évaluation
- Groupe InconscientDocument350 pagesGroupe InconscientnaoufalstitouPas encore d'évaluation
- L’innéité aujourd’hui: Connaissances scientifiques et problèmes philosophiquesD'EverandL’innéité aujourd’hui: Connaissances scientifiques et problèmes philosophiquesPas encore d'évaluation
- Mœurs Et Histoire Des Peaux-Rouges PDFDocument302 pagesMœurs Et Histoire Des Peaux-Rouges PDFyahya333Pas encore d'évaluation
- Épistémologie et instrumentation en sciences humaines: Réflexions sur les méthodes à adopter dans l'étude de la psychologie socialeD'EverandÉpistémologie et instrumentation en sciences humaines: Réflexions sur les méthodes à adopter dans l'étude de la psychologie socialePas encore d'évaluation
- 1 - Introduction Aux Relations InternationalesDocument3 pages1 - Introduction Aux Relations Internationalesdahmani lotfiPas encore d'évaluation
- Dossier La Violence Et Le Sacré René GirardDocument7 pagesDossier La Violence Et Le Sacré René GirardRobert LamothePas encore d'évaluation
- Cours Microbiologie Alimentaire BOUBENDIR Abdelhafid CUM 2014 PDFDocument45 pagesCours Microbiologie Alimentaire BOUBENDIR Abdelhafid CUM 2014 PDFlara100% (8)
- Matériaux philosophiques et scientifiques pour un matérialisme contemporain: Volume 1D'EverandMatériaux philosophiques et scientifiques pour un matérialisme contemporain: Volume 1Pas encore d'évaluation
- La SociologieDocument26 pagesLa SociologieEL MOUHIB EL MAHDIPas encore d'évaluation
- Chapitre 1 - Implémentation Du Service D'annuaire Active DirectoryDocument106 pagesChapitre 1 - Implémentation Du Service D'annuaire Active DirectoryAbdenour Mohandi100% (1)
- Lien Social N°1216 - Intervenir À Domicile / Les Frontières de L'accompagnementDocument2 pagesLien Social N°1216 - Intervenir À Domicile / Les Frontières de L'accompagnementCéliaCarpaye100% (1)
- Individu Et CommunauteDocument11 pagesIndividu Et CommunautemokurenPas encore d'évaluation
- Musculation Rugby by MillerDocument59 pagesMusculation Rugby by MillersalvacorrePas encore d'évaluation
- Jean Hyppolite Entre Structure Et Existe PDFDocument29 pagesJean Hyppolite Entre Structure Et Existe PDFOlga NancyPas encore d'évaluation
- Gaston BachelardDocument2 pagesGaston BachelardRezzoug HamzaPas encore d'évaluation
- Retour Sur Les Institutions Du Sens de VDocument7 pagesRetour Sur Les Institutions Du Sens de VetiemblePas encore d'évaluation
- Chapitre 1Document23 pagesChapitre 1Cylia AmokranePas encore d'évaluation
- Le Constructivisme Dans La Théorie Des Relations InternationalesDocument12 pagesLe Constructivisme Dans La Théorie Des Relations InternationalesBejmanjinPas encore d'évaluation
- Hommes Domestiques, Hommes SauvagesDocument280 pagesHommes Domestiques, Hommes SauvagesNoël Pécout100% (1)
- HACKING Ian. Entre Science Et Réalité. La Construction Sociale de QuoiDocument7 pagesHACKING Ian. Entre Science Et Réalité. La Construction Sociale de QuoiLAFABREGUE100% (1)
- OLIVIER DE SARDAN La - Rigueur - Du - Qualitatif PDFDocument24 pagesOLIVIER DE SARDAN La - Rigueur - Du - Qualitatif PDFgil999999100% (1)
- Soyez Insatiables, Soyez Fous (Etc.)Document106 pagesSoyez Insatiables, Soyez Fous (Etc.)Herve Gerard NzameyoPas encore d'évaluation
- L'interactionnisme Symbolique - David Le BretonDocument229 pagesL'interactionnisme Symbolique - David Le BretonIsabel Carvalheira33% (3)
- Guide Des Etudes Philo 2023 2024Document192 pagesGuide Des Etudes Philo 2023 2024enzo.coubronne11Pas encore d'évaluation
- Desir MimetiqueDocument2 pagesDesir MimetiqueLoubna RiahiPas encore d'évaluation
- Managt - II.S2.2021 (1) - 3Document129 pagesManagt - II.S2.2021 (1) - 3minsu.yoonjiPas encore d'évaluation
- BOURDIEU - Une Classe Objet (Artigo)Document5 pagesBOURDIEU - Une Classe Objet (Artigo)ultimaflordolacio9019Pas encore d'évaluation
- Jodelet Psycho SocialeDocument436 pagesJodelet Psycho Socialehistoireg100% (1)
- Comprendreautrecultl PDFDocument5 pagesComprendreautrecultl PDFAriëlle RakotoarimananaPas encore d'évaluation
- Matériaux philosophiques et scientifiques pour un matérialisme contemporain: Volume 2D'EverandMatériaux philosophiques et scientifiques pour un matérialisme contemporain: Volume 2Pas encore d'évaluation
- Approche Critique Et ConstructivisteDocument13 pagesApproche Critique Et ConstructivisteSalih SaddekPas encore d'évaluation
- BOURDIEU. Domination Masculiner ResumeDocument11 pagesBOURDIEU. Domination Masculiner ResumefpadrianPas encore d'évaluation
- Judith Butler - Une Morale Pour Temps PrécairesDocument6 pagesJudith Butler - Une Morale Pour Temps PrécairesAntonio MemmioPas encore d'évaluation
- Fabbri, Paolo (2015) - Sémiotique, Stratégies, CamouflageDocument14 pagesFabbri, Paolo (2015) - Sémiotique, Stratégies, CamouflageEduardo Y. DongoPas encore d'évaluation
- Bourdieu, Boltansky, La Production de L'idéologie DominanteDocument46 pagesBourdieu, Boltansky, La Production de L'idéologie DominanteGabriella GiudiciPas encore d'évaluation
- MegeMorin - Ethique Et FiliationDocument39 pagesMegeMorin - Ethique Et FiliationaliodormanoleaPas encore d'évaluation
- Anthropologie de DeveloppementDocument2 pagesAnthropologie de DeveloppementRanto Andriampenitra RasoamanambolaPas encore d'évaluation
- Marxisme Et Sociologie de La ConnaissanceDocument30 pagesMarxisme Et Sociologie de La ConnaissanceLycophron100% (1)
- Cadrage TheoriqueDocument6 pagesCadrage TheoriquehadjarjijiPas encore d'évaluation
- Réponses À Badiou (2022)Document17 pagesRéponses À Badiou (2022)LIB TROPIQUESPas encore d'évaluation
- Alain Supiot, L'esprit de Philadelphie. La Justice Sociale Face Au Marché TotalDocument2 pagesAlain Supiot, L'esprit de Philadelphie. La Justice Sociale Face Au Marché TotalRémy Bres-FeuilletPas encore d'évaluation
- WebercoursDocument18 pagesWebercoursMme et Mr LafonPas encore d'évaluation
- Le Moigne (1990, 81-140)Document31 pagesLe Moigne (1990, 81-140)marcbonnemainsPas encore d'évaluation
- Le Paradigme de L'énaction Aujourd'huiDocument38 pagesLe Paradigme de L'énaction Aujourd'huiDavid Alcantara MirandaPas encore d'évaluation
- La Division de Travail Et Solidarité Sociale Pour DurkheimDocument4 pagesLa Division de Travail Et Solidarité Sociale Pour DurkheimWassime ElPas encore d'évaluation
- Communication 340 Vol 25 1 Jean Lohisse La Communication de La Transmission A La Relation Deuxieme Edition Revue Et Augmentee Par Annabelle KleinDocument5 pagesCommunication 340 Vol 25 1 Jean Lohisse La Communication de La Transmission A La Relation Deuxieme Edition Revue Et Augmentee Par Annabelle KleinCristina CurbătPas encore d'évaluation
- Bitbol ANTICIPER - LUNITE - Une - Methode - de - Connaiss PDFDocument34 pagesBitbol ANTICIPER - LUNITE - Une - Methode - de - Connaiss PDFAHC1952Pas encore d'évaluation
- Simone de Beauvoir, Le Deuxième SexeDocument20 pagesSimone de Beauvoir, Le Deuxième SexeAmos30Pas encore d'évaluation
- 1962 Nietzsche Et La PhilosophieDocument118 pages1962 Nietzsche Et La PhilosophieGeo BertazzoPas encore d'évaluation
- L'État-Nation Peut-Il Survivre À La Société de L'information ?Document87 pagesL'État-Nation Peut-Il Survivre À La Société de L'information ?gemini1096Pas encore d'évaluation
- (Dés)équilibres: L'informatisation du travail social en justiceD'Everand(Dés)équilibres: L'informatisation du travail social en justicePas encore d'évaluation
- Université D'été - Processus de Paix Et Justice TransitionnelleDocument17 pagesUniversité D'été - Processus de Paix Et Justice TransitionnelleMagalie BessePas encore d'évaluation
- Sens Valeur, Et Puissance Du Collectif - Entre Castoriadis Et Spinoza - Frederic LordonDocument12 pagesSens Valeur, Et Puissance Du Collectif - Entre Castoriadis Et Spinoza - Frederic LordonAnonymous ky2sK2IPas encore d'évaluation
- SARTRE L'amourDocument4 pagesSARTRE L'amourNinaPas encore d'évaluation
- Écosocialisme Ou Écologie SocialeDocument8 pagesÉcosocialisme Ou Écologie SocialePLX SteelFaktoryPas encore d'évaluation
- ARTICLE REVUE ELWAHATE Stratégies Argumentatives Dans Le Discours Rapporté Cas de L'argument Ad HominemDocument14 pagesARTICLE REVUE ELWAHATE Stratégies Argumentatives Dans Le Discours Rapporté Cas de L'argument Ad HominemRoubache Azzedine100% (1)
- Evelyne Pisier - Totalitarisme Et For IntérieurDocument12 pagesEvelyne Pisier - Totalitarisme Et For IntérieurgillesduteauPas encore d'évaluation
- La Justice Et Le DroitDocument4 pagesLa Justice Et Le DroitlefebvrePas encore d'évaluation
- Norbert Elias PDFDocument7 pagesNorbert Elias PDFDeroy GarryPas encore d'évaluation
- Un Entretien Avec Alain SupiotDocument6 pagesUn Entretien Avec Alain SupiotreatroiePas encore d'évaluation
- Françoise Choay - L'urbanisme en QuestionDocument2 pagesFrançoise Choay - L'urbanisme en QuestionAndreea AlexandraPas encore d'évaluation
- UN BON USAGE DE LA COMPASSION-Renaut PDFDocument13 pagesUN BON USAGE DE LA COMPASSION-Renaut PDFradioactPas encore d'évaluation
- La Nature, Entre Métaphysique Et ExistenceDocument21 pagesLa Nature, Entre Métaphysique Et ExistencemrotPas encore d'évaluation
- Henri Wallon Une Theorie Originale de LaDocument18 pagesHenri Wallon Une Theorie Originale de LaMARCEL SAHIPas encore d'évaluation
- Classes Préparatoires. La Fabrique D'une Jeunesse DominanteDocument3 pagesClasses Préparatoires. La Fabrique D'une Jeunesse DominanteAntonio Santos OrtegaPas encore d'évaluation
- Les Pricipales Critiques de La Théorie Du Choix Rationnel PDFDocument10 pagesLes Pricipales Critiques de La Théorie Du Choix Rationnel PDFSoukaina OuPas encore d'évaluation
- Sur L'Antropologie Economique de BourdieuDocument4 pagesSur L'Antropologie Economique de BourdieuOlga Nancy0% (1)
- Pratique Et Pouvoir Symbolique Chez BourdieuDocument17 pagesPratique Et Pouvoir Symbolique Chez BourdieuOlga NancyPas encore d'évaluation
- Qu Est Ce Qu Une EpoqueDocument20 pagesQu Est Ce Qu Une EpoqueOlga NancyPas encore d'évaluation
- La Fabrique Des Derniers Hommes - Cairn - Info Cap 1Document66 pagesLa Fabrique Des Derniers Hommes - Cairn - Info Cap 1Olga NancyPas encore d'évaluation
- Comment La Biologie Reponde A Question Sur Le VivantDocument8 pagesComment La Biologie Reponde A Question Sur Le VivantOlga NancyPas encore d'évaluation
- La Vocation Et Le Metier de Sociologue D PDFDocument21 pagesLa Vocation Et Le Metier de Sociologue D PDFOlga NancyPas encore d'évaluation
- A Propos Des Enjeux Struturalisme ContemporaineDocument13 pagesA Propos Des Enjeux Struturalisme ContemporaineOlga NancyPas encore d'évaluation
- La Logique Du PraticableDocument39 pagesLa Logique Du PraticableOlga NancyPas encore d'évaluation
- Le Fin de L'histoireDocument6 pagesLe Fin de L'histoireOlga NancyPas encore d'évaluation
- Boschetti, Anna. Les Transferts Théoriques Comme Ars InveniendiDocument15 pagesBoschetti, Anna. Les Transferts Théoriques Comme Ars InveniendiOlga NancyPas encore d'évaluation
- Au Siècle XX La Subjetivité Des SciencesDocument18 pagesAu Siècle XX La Subjetivité Des SciencesOlga NancyPas encore d'évaluation
- Désir Et TechnologiesDocument6 pagesDésir Et TechnologiesOlga NancyPas encore d'évaluation
- Une Nouvelle Approche de La Philosophie de CassirerDocument17 pagesUne Nouvelle Approche de La Philosophie de CassirerOlga NancyPas encore d'évaluation
- La Praxéologie PDFDocument20 pagesLa Praxéologie PDFOlga NancyPas encore d'évaluation
- La Praxéologie PDFDocument20 pagesLa Praxéologie PDFOlga NancyPas encore d'évaluation
- Raymond Aron Et La Philosophie Critique de L HistoireCANGUILHEMDocument8 pagesRaymond Aron Et La Philosophie Critique de L HistoireCANGUILHEMVanessa Nicola LabreaPas encore d'évaluation
- Sur La Violence SymboliqueDocument18 pagesSur La Violence SymboliqueOlga NancyPas encore d'évaluation
- Cpa9 4 RegnaultDocument29 pagesCpa9 4 RegnaultPtrc Lbr LpPas encore d'évaluation
- De Quelques Apports Piagétiens A Une Sociologie de La PratiqueDocument20 pagesDe Quelques Apports Piagétiens A Une Sociologie de La PratiqueOlga NancyPas encore d'évaluation
- Immigration Colonisation SayadDocument8 pagesImmigration Colonisation SayadOlga NancyPas encore d'évaluation
- Les Perspectives Constructivistes Et Consturctionnistes de L'identitéDocument15 pagesLes Perspectives Constructivistes Et Consturctionnistes de L'identitéOlga NancyPas encore d'évaluation
- Beethoven Surpasse Wagner Comme Kant Surpasse HegelDocument11 pagesBeethoven Surpasse Wagner Comme Kant Surpasse HegelOlga Nancy100% (1)
- Remise en Question Et Enquete Identitaire Dans L'ouevre Autobiographique D Annie ErnauxDocument19 pagesRemise en Question Et Enquete Identitaire Dans L'ouevre Autobiographique D Annie ErnauxOlga NancyPas encore d'évaluation
- Le Corps en Prise, Le Monde PhysiqueDocument23 pagesLe Corps en Prise, Le Monde PhysiqueOlga NancyPas encore d'évaluation
- Eléments D'une Philosophie de L'espace Chez Ernest CassirerDocument8 pagesEléments D'une Philosophie de L'espace Chez Ernest CassirerOlga NancyPas encore d'évaluation
- Agency and Speculative Realism Article of HarrmanDocument20 pagesAgency and Speculative Realism Article of HarrmanOlga NancyPas encore d'évaluation
- La Filosofia de La Diferencia Del Siglo XXDocument5 pagesLa Filosofia de La Diferencia Del Siglo XXOlga NancyPas encore d'évaluation
- Epistemologie HistoriqueDocument7 pagesEpistemologie HistoriqueOlga NancyPas encore d'évaluation
- Rolex Bloodhound Presskit FRDocument44 pagesRolex Bloodhound Presskit FRGregory PonsPas encore d'évaluation
- Decret Executif N 11-75 Du 13 Rabie El Aouel 1432 Correspondant Au 16 Février 2011 Fixant Les Attributions L Organisation Et Le Fonctionnement Des Services ExtérieursDocument4 pagesDecret Executif N 11-75 Du 13 Rabie El Aouel 1432 Correspondant Au 16 Février 2011 Fixant Les Attributions L Organisation Et Le Fonctionnement Des Services ExtérieurskikaPas encore d'évaluation
- Le Mali, 1960-1968. Manon TouronDocument13 pagesLe Mali, 1960-1968. Manon TouronWendel DamascenoPas encore d'évaluation
- Chapitre IiiDocument18 pagesChapitre IiihassanPas encore d'évaluation
- Chevallard 2009Document38 pagesChevallard 2009Katia Vigo IngarPas encore d'évaluation
- Calcul Des Dalles MixtesDocument7 pagesCalcul Des Dalles MixtesYounes TaoufikPas encore d'évaluation
- Fibres Optiques - BTS Bioanalyse Et Contrôles 2011Document1 pageFibres Optiques - BTS Bioanalyse Et Contrôles 2011Mohamed SyllaPas encore d'évaluation
- Déroule EntDocument5 pagesDéroule Entidrissa dembelePas encore d'évaluation
- Iso 30408 - 2016Document20 pagesIso 30408 - 2016Sonia zghal KallelPas encore d'évaluation
- Đề 2Document5 pagesĐề 2Thuy ChinhPas encore d'évaluation
- Limites Equivalents TDDocument12 pagesLimites Equivalents TDyouri GedeusPas encore d'évaluation
- Ajouter Ou Supprimer Un SignetDocument2 pagesAjouter Ou Supprimer Un SignetAmy PaynePas encore d'évaluation
- CV Kais Hermi Francais 2022Document5 pagesCV Kais Hermi Francais 2022ahmed chakrounPas encore d'évaluation
- DEVOIR SURVEILLE 3SE Débat D'idéesDocument2 pagesDEVOIR SURVEILLE 3SE Débat D'idéesNawel CheriguénePas encore d'évaluation
- Exemple de Lettre de Motivation Pour Un Stage de 3eDocument4 pagesExemple de Lettre de Motivation Pour Un Stage de 3eAnayaPas encore d'évaluation
- CNC 1988 MP PhysiqueDocument5 pagesCNC 1988 MP Physiqueanass griniPas encore d'évaluation
- EDM Support Cours - Traitement Des DonnéesDocument6 pagesEDM Support Cours - Traitement Des DonnéesYahya ElPas encore d'évaluation
- ATELIERDocument7 pagesATELIERsanae akherrazPas encore d'évaluation
- En 12390-4Document16 pagesEn 12390-4MOHAMMADPas encore d'évaluation
- Chapitre 8 - EquationsDocument2 pagesChapitre 8 - EquationsAhmed REGRAGUIPas encore d'évaluation
- Les Nouvelles TICDocument17 pagesLes Nouvelles TICzakiPas encore d'évaluation
- NODJS Formation Nodejs PDFDocument2 pagesNODJS Formation Nodejs PDFCertyouFormationPas encore d'évaluation
- Instrumentation Et Acquisition de Données MétéorologiquesDocument0 pageInstrumentation Et Acquisition de Données MétéorologiquesjboncoinPas encore d'évaluation