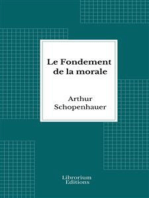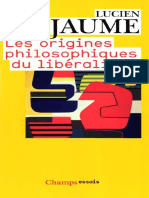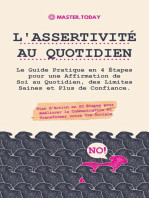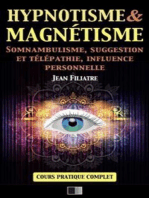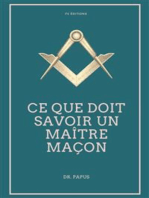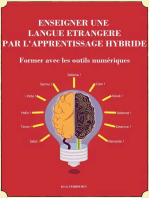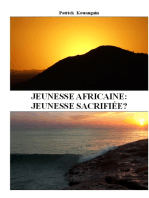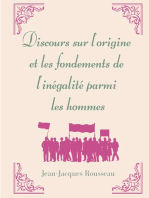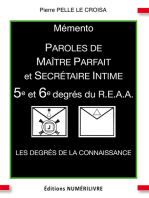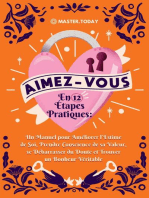Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
PDF Justice Rawls Dupond Cournarie
Transféré par
Khouloud AdouliCopyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
PDF Justice Rawls Dupond Cournarie
Transféré par
Khouloud AdouliDroits d'auteur :
Formats disponibles
La justic e
Introduction la Thorie de la justice de Rawls
Laurent Cour narie et Pascal Dupond
Philopsis : Revue numrique
http ://www.philopsis.fr
Les articles publis sur Philopsis sont protgs par le droit d'auteur. Toute
reproduction intgrale ou partielle doit faire l'objet d'une demande d'autorisation
auprs des diteurs et des auteurs. Vous pouvez citer librement cet article en en
mentionnant lauteur et la provenance.
Ce travail na pas dautre prtention que dtre une introduction la Thorie
de la justice1. On se propose dabord dexaminer les difficults, le but et lintrt
philosophique de cet ouvrage, ensuite danalyser sa partie thorique, cest--dire
principalement les sections 1, 2 et 3 de la premire partie, qui a t et qui demeure
aussi la plus discute Enfin, en conclusion, on tente de situer la Thorie de la
justice dans le dbat de la philosophie pratique contemporaine, en sinterrogeant
sur sa position par rapport lhritage kantien.
Abrg sous la forme TJ dans la suite de larticle.
www.philopsis.fr
Introduction la lecture de la Thorie de la justice
Les difficults de lecture : la situation franaise
Le lecteur franais peut avoir du mal entrer dans la lecture de la Thorie de
la justice et ne pas comprendre son intrt et la renomme dont elle jouit. La
premire difficult tient au fait quil aura fallu attendre seize ans pour que cet
ouvrage, capital dans la philosophie anglo-saxonne, soit traduit en franais2. Or
entre 1971, date de sa publication aux Etats-Unis et le moment de sa rception en
France, la Thorie de la justice a suscit un dbat intense dans la philosophie
anglo-saxonne, obligeant son auteur prciser et mme refondre sa thorie
travers de nombreux articles. On peut les lire runis, en franais, sous le titre
Justice et dmocratie, publi en 1993, la mme anne que Political Liberalism qui
constitue la reformulation densemble de ces mmes articles. La traduction de ce
deuxime ouvrage de Rawls est parue en France en 1995.
On se trouve donc dans cette situation singulire de disposer dans le mme
temps de la thorie de la justice et de ses rvisions successives. Le lecteur franais
doit paralllement dcouvrir et comprendre les thses de la Thorie de la justice et
les raisons de leur reformulation. Il se trouve presque condamn les interprter
la lumire de la discussion quelles ont engendre. Mais il ne peut comprendre ces
critiques quen se reportant dabord louvrage fondamental.
Deux questions se posent donc demble ensemble : quel est le but poursuivi
par Rawls dans la Thorie de la justice et ce but est-il encore maintenu partir des
annes 1980 ? Ce remaniement et cette autocritique modifient-elles ou non en
profondeur la thorie de la justice comme quit prsente dans la Thorie de la
justice3 ?
Mais louvrage princeps lui-mme est le fruit dune rflexion labore et
reprise sur plus de dix annes, partir dun essai programmatique, Justice as
Fairness paru en 1958 dans la Philosophical Review. Nous avons affaire une
manire de faire de la philosophie qui peut nous dsorienter : une uvre se
constitue partir de lensemble des rponses et des corrections quapporte lauteur
lensemble des critiques dont son premier texte est lobjet4. Mais cela correspond
assez bien au contexte analytique de la philosophie. Les dbats sont vifs, frquents,
par articles interposs, sur tel ou tel argument particulier. La Thorie de la justice
est donc un livre volumineux, indigeste, dont les analyses de dtail peuvent faire
Les premiers auteurs franais avoir attir lattention sur luvre de Rawls sont,
notre connaissance, Stoleru en 1974 (Vaincre la pauvret dans les pays riches,
Flammarion), Boudon en 1977 (Effets pervers et ordre social, PUF).
3
On a du mal se reprsenter lampleur des dbats autour de la Thorie de la
justice. La Thorie de la justice est aux Etats-Unis un vritable best-seller philosophique.
La Thorie de la justice est le trait philosophique le plus lu du XX s. Comparativement
Sein und Zeit passera pour un ouvrage confidentiel.
4
Mme si Rawls dment un peu cette interprtation, voir Libralisme politique,
PUF, 1995, p. 5, note, cit en abrg LP ans la suite de larticle
La justice Rawls
Philopsis Dupond Cournarie
www.philopsis.fr
perdre de vue le plan. On ne dmentira pas lauteur qui avoue que le livre est trs
long, et pas seulement par le nombre de pages 5.
Toutefois ldition franaise nest pas sans avantage. Dune part cest la
traduction dune version considrablement remanie en vue de la traduction
allemande de la Thorie de la justice en 1975. Ldition franaise possde donc
une valeur scientifique propre et suprieure ldition anglaise originale. Dautre
part Rawls rdige spcialement pour la traduction franaise une prface, reproduite
dans les autres ditions trangres, o il sexplique en partie sur son volution.
Voici, en rsum, la chronologie et lvolution de luvre de Rawls :
- 1957 : essai programmatique - Justice as Fairness - qui constitue la
premire partie de la Thorie de la justice.
- la Thorie de la justice dans son ensemble rsulte de leffort pour
rassembler sous forme cohrente les ides fondamentales de lessai de 1957 et
celles exposes dans des articles aprs 1957 : les ides principales sont donc
restes en grande partie les mmes, mais jai essay dliminer les incohrences et,
en de nombreux passages, de complter et damliorer largumentation 6. En
franais nous disposons de ldition remanie de 1975 ;
- la prface ldition franaise qui date de 1986, alors que Rawls a dj
rdig des articles importants, finalement runis en France sous le titre Justice et
dmocratie.
- Libralisme politique qui parait en 1993 comprend quelques textes indits
mais reprend surtout la formulation densemble de ces articles pour en rendre les
ides bien plus claires 7.
Ajoutons un troisime ordre de difficults. La Thorie de la justice nous
situe dans un paysage conceptuel qui nous est, pour lessentiel, tranger. Les
auteurs que cite Rawls sont soit connus mais leur uvre est introuvable ou nontraduite en France, soit inconnus pour les plus contemporains dentre eux.
Quel peut donc tre lintrt pour nous de cette lecture dont on vient
dvoquer les difficults toutes particulires ? Pour y rpondre, il faut chercher
savoir le but que Rawls poursuit dans la Thorie de la justice. Car la question de
savoir quel intrt philosophique prsente la Thorie de la justice et celle de savoir
dans quelle mesure Rawls est revenu sur ces positions initiales dans les ouvrages
plus rcents, ne peuvent trouver leur rponse que si lon saisit le but que poursuit
Rawls en laborant la Thorie de la justice.
But et mthode de la Thorie de la justice
Rawls le rpte de nombreuses reprises dans la Thorie de la justice. Il
sagit de proposer une alternative lutilitarisme aussi consistante que lui, une
thorie de rechange comme il lcrit souvent. Rawls est explicite ds la prface
de 1971 :
5
6
7
p. 20.
p. 19.
Libralisme politique, p. 1.
La justice Rawls
Philopsis Dupond Cournarie
www.philopsis.fr
La meilleure faon dexpliquer le but de ce livre est peut-tre la
suivante. Lutilitarisme, sous une forme ou une autre, a t la thorie
systmatique dominante de la philosophie morale moderne, du moins dune
partie dentre elle. Une des raisons en est quil a t adopt par une ligne
dcrivains brillants et ceux-ci ont labor un corps de doctrine tout fait
impressionnant par son tendue et sa subtilit. Nous avons tendance oublier
que les grand utilitaristes, Hume et Adam Smith, Bentham et Mill, taient
des thoriciens de la socit et des conomistes de premier ordre et que la
doctrine morale quils laboraient devait satisfaire leurs autres intrts et
constituer une conception globale. Leurs critiques, par contre, adoptaient des
points de vue beaucoup plus troits. Ils notaient les obscurits du principe
dutilit ainsi que les dsaccords apparents entre nombre de ses implications
et nos sentiments moraux. Mais je pense quils nont pas russi opposer
une conception morale systmatique et applicable. Le rsultat en est que nous
sommes souvent forcs, semble-t-il, de choisir entre lutilitarisme et
lintuitionnisme. Et, dans la plupart des cas, nous imposons les limites et les
restrictions ncessites par les contraintes de lintuitionnisme. Une telle
conception na rien dirrationnel et il ny a pas de garantie que nous
puissions faire mieux. Mais il ny a pas de raison, non plus, de ne pas
essayer 8.
Nous traiterons plus prcisment de lutilitarisme dans la deuxime partie.
Pour ce qui est de lintuitionnisme, Rawls sexplique sur le sens nonpistmologique quil donne cette notion au 79. Alors que lutilitarisme soutient
que le principe dutilit est le seul principe moral, et le seul efficace, les doctrines
intuitionnistes tiennent quil existe une pluralit de principes premiers,
ventuellement contradictoires, quil faut mettre en balance quand la situation se
prsente, sans que lon dispose dun critre de plus haut niveau pour hirarchiser
les principes et fonder son jugement : nous devons dcouvrir un quilibre par
intuition, daprs ce qui nous semble le plus proche du juste 10. Lintuitionnisme
est sans doute, pour Rawls, plus proche de nos intuitions morales profondes mais il
nest pas constructif comme lutilitarisme ; il ne permet pas de concevoir une
thorie des rgles fondamentales du fonctionnement des institutions sociales.
Donc de fait, on adopte une variante de lutilitarisme, un utilitarisme
pondr dintuitionnisme ( 7)11 et lutilitarisme triomphe faute dune thorie
concurrente consistante12. La thorie de la justice comme quit doit tre cette
conception systmatique substituable lutilitarisme.
Car en dpit de sa force dattraction, lutilitarisme souffre dune insuffisance
rdhibitoire pour Rawls. Il le prcise cette fois dans la prface franaise :
La raison principale en tait la faiblesse, selon moi, de lutilitarisme
comme base des institutions dune dmocratie constitutionnelle, que
lutilitarisme puisse fournir une analyse satisfaisante des droits et des liberts
8
pp. 19-20.
pp. 59-66.
10
p. 60.
11
p. 62.
12
Cest la mme prsentation des objectifs de la Thorie de la Justice que fait
Rawls au dbut de Libralisme politique, pp. 2-3.
9
La justice Rawls
Philopsis Dupond Cournarie
www.philopsis.fr
de base des citoyens en tant que personnes libres et gales, ce qui est
pourtant une exigence absolument prioritaire dune analyse des institutions
dmocratiques. Cest alors que lide du contrat social, mais rendue plus
gnrale et plus abstraite au moyen de lide de position originelle,
mapparut comme la solution. Le premier objectif de la thorie de la justice
comme quit tait donc de fournir une analyse convaincante des droits et
des liberts de base ainsi que de leur priorit. Le second objectif tait de
complter cette analyse par une conception de lgalit dmocratique, ce qui
ma conduit au principe de la juste galit des chances et au principes de
diffrence 13.
Nous laissons de ct provisoirement la fin de la citation qui anticipe sur les
concepts et les enjeux les plus thoriques exposs dans la premire partie de
louvrage. On sera plus attentif au fait que la critique de lutilitarisme sinscrit dans
le projet plus vaste de constituer la conception philosophique adquate une
dmocratie constitutionnelle.
La thorie de la justice a lutilitarisme pour adversaire dclar puisquelle a
pour but de prendre sa place dans la philosophie morale et politique. La thorie de
la justice comme quit se construit contre lutilitarisme. Mais cette rfutation
prend appui sur une conviction plus profonde : que la culture dmocratique porte
en elle une exigence fondamentale en direction des liberts et des droits de base
des citoyens, que cette exigence est absolument prioritaire, et quelle exprime notre
sens de la justice. Or lutilitarisme se trouve incapable de justifier cette exigence.
Autrement dit lutilitarisme, quelque soit sa consistance, son constructivisme, est
en contradiction avec la conscience moderne de la justice, ou comme il lcrit
encore plus prcisment en 1993 dans Libralisme politique, avec un fond
commun dides et de principes fondamentaux, qui implicitement, sont accepts ,
avec certaines ides fondamentales implicites dans la culture politique publique
dune socit dmocratique 14.
Mais quelle est pour ainsi dire la mthode ou loutil critique qui permet de
rfuter lutilitarisme partir de la conviction de la priorit des droits-liberts,
implicite la culture dmocratique ? Rawls le prcise la suite de la citation de la
prface ldition anglaise :
13
p. 10.
p. 32 et p. 38.Rawls considre que le pluralisme des conceptions du bien est
au fondement du libralisme et de nos socits modernes. Ce fait du pluralisme, y compris
ds ides librales, reprsente le contexte indpassable ou la contrainte spcifiquement
moderne de la pense. A ce titre, le projet rawlsien dune thorie simplement politique, et
finalement sociale, de la justice, situe, de fait, la Thorie de la justice du ct de ce quon
appelle la philosophie post-mtaphysique, qui a renonc toute espce de fondation
transcendante, ontologique ou thologique, des valeurs ou des normes. Et pourtant le pari
libral de Rawls est de croire quil est possible et raisonnable, malgr cette
incommensurabilit des conceptions du bien, qui laisse chacun libre de vivre en fonction
dune vision du monde particulire, condition de ne pas vouloir limposer aux autres, de
saccorder sur une conception du juste, des principes du droit juste, compatible avec la
plupart des intuitions morales partages. Sur ce point, voir Alain Boyer, Justice et
galit , Notions de philosophie, III, Folio, 1995, pp 53-54.
14
La justice Rawls
Philopsis Dupond Cournarie
www.philopsis.fr
Jai tent de gnraliser et de porter un plus haut degr dabstraction
la thorie traditionnelle du contrat social telle quelle se trouve chez Locke,
Rousseau et Kant. Jespre ainsi que cette thorie ne donnera plus prise aux
objections les plus videntes qui semblaient lui tre fatales. Mais, surtout,
cette thorie semble offrir comme solution de rechange une analyse
systmatique de la justice suprieure, selon moi, la tradition utilitariste,
pourtant dominante. La thorie que je propose est de nature profondment
kantienne et je ne prtends, pour les vues que javance, aucune originalit.
Les plus importantes sont classiques et bien connues. Mon intention a t de
les organiser en un systme gnral qui, grce certaines simplifications, en
fait voir toute la porte. Lambition de ce livre sera compltement satisfaite
si, grce lui, on parvient saisir plus clairement les principaux caractres
structuraux de cette conception de la justice, implicite dans la tradition du
contrat social, ainsi que les moyens de son laboration ultrieure. Parmi
toutes les conceptions traditionnelles, je crois que cest celle du contrat qui se
rapproche le mieux de nos jugements bien pess sur la justice et qui constitue
la base morale qui convient le mieux une socit dmocratique 15.
Lorientation de la Thorie de la justice nest pas en soi originale,
puisquelle reprend la philosophie contractualiste du XVIII sicle. Mais ce qui
lest, cest lusage quelle en fait, cest--dire linflchissement quelle fait subir
la thorie du contrat16. Cela apparatra mieux quand on explicitera la diffrence
entre les thories du contrat et la thorie de la justice comme quit partir de la
thorie contractualiste17. Mais dores et dj on voit comment la tradition du
contrat, qui est le moyen de la rfutation de lutilitarisme, est, la fois, la plus
conforme nos intuitions du juste, et insuffisante puisquelle demande tre
systmatise, leve un plus degr dabstraction pour justement en dgager des
15
p. 20.
Rawls parle de la thorie du contrat, comme sil ny avait pas de diffrence entre
Locke, Rousseau et Kant. Mais dune part Rawls rapportera par exemple Locke et
Rousseau deux traditions de la pense dmocratique en conflit : dune part la tradition
associe Locke qui donne plus de poids ce que Benjamin Constant appelait la libert
des Modernes, cest--dire la libert de pense et de conscience, certains droits de base de
la personne et le droit de proprit ainsi que lEtat de droit (rule of law ) et, dautre part, la
tradition associe Rousseau qui, elle, privilgie la libert des Anciens, lgalit des
liberts politiques et les valeurs de la vie publique. Cette distinction bien connue et
schmatique peut aider fixer les ides (pp. 28-29). Dautre part cette unification des
thories en une tradition homogne sexplique par lusage stratgique de rfutation de
lutilitarisme quen fait Rawls. Ce sont bien deux traditions qui saffrontent. Ainsi le jeune
Bentham, qui a vritablement fond lutilitarisme, a-t-il svrement critiqu les thories du
droit naturel et leurs prolongements politiques, enseigns par Blackstone, disciple de
Locke, Oxford (Principes de la morale et de la lgislation, ch. III - 1789)
17
On peut bien parler dune interprtation kantienne du contrat social ( la thorie
que je propose est de nature profondment kantienne dit notre texte ; voir aussi 24,
p. 171), cest--dire une interprtation procdurale de lautonomie dans le cadre dune
thorie empirique ( 40, pp. 292-293). Aussi est-ce la rfrence kantienne qui sert
dinstrument critique lgard des autres thories du contrat, notamment celle de Locke
(Libralisme Politique, pp. 341-342). Dans cet ouvrage la thorie de la justice comme
quit est explicitement dsigne comme version kantienne de la doctrine du contrat
social (p. 310).
16
La justice Rawls
Philopsis Dupond Cournarie
www.philopsis.fr
principes de justice quelle contient seulement implicitement. Autrement dit en
systmatisant la thorie du contrat, la thorie de la justice comme quit
systmatise et clarifie en mme temps les ides et les intuitions du juste dont la
thorie du contrat nest que lapproximation. On peut dire aussi bien que la
clarification de nos intuitions et de nos concepts moraux rencontre ncessairement
la thorie contractualiste, que la thorie du contrat reprsente la premire
systmatisation de ces ides. Rawls crit que tandis que la doctrine du contrat
accepte comme fondes, dans lensemble, nos convictions en faveur de la priorit
de la justice, lutilitarisme au contraire cherche en rendre compte comme si elles
taient une illusion socialement utile 18. On a donc dun ct lutilitarisme, de
lautre lensemble des intuitions bien peses du juste et la thorie du contrat que la
thorie de la justice comme quit cherche articuler et quilibrer. La thorie de
la justice comme quit est lune parmi les diffrentes thorie du contrat, mais son
interprtation de la situation initiale conduit une conception qui reprsente nos
jugements bien pess en quilibre rflchi ( 20)19.
La mthode est donc circulaire et cherche faire correspondre chaque
stade de son dveloppement les intuitions bien peses de la justice sociale et
llaboration thorique qui prend pour modle la tradition contractualiste. Voici
schmatiquement les tapes de la dmarche de Rawls dans la Thorie de la
justice : partant de la conscience de la justice propre la culture dmocratique et
dterminant les ides intuitives qui sy trouvent impliques, par un travail de
clarification et dexplicitation, Rawls aboutit la formulation de deux principes,
qui rsument lensemble de ces ides de base en une conception cohrente. Il se
rfre la thorie du contrat, travers lexprience abstraite de la position
originelle assortie de la condition du voile dignorance, qui sert dpreuve
argumentative la supriorit des deux principes sur toutes les autres conceptions
concurrentes de la justice sociale, notamment lutilitarisme. Enfin Rawls montre
quelles consquences on doit tirer de cet effort thorique pour llaboration des
institutions politiques et conomiques, tablissant en particulier quune socit
ainsi organise est stable, cest--dire tend se reproduire comme systme juste de
coopration. On est ici rendu la deuxime et la troisime parties de louvrage.
Dans la deuxime, Rawls entend montrer que les principes de la justice, qui,
jusquici, ont t tudis en faisant abstraction des institutions, constituent une
conception politique applicable et sont une approximation et une extension
raisonnables de nos jugements bien rflchis 20. Il sagit non seulement de
prouver que la thorie de la justice comme quit nest pas une utopie mais quelle
peut tre la base dinstitutions dune dmocratie constitutionnelle - ce qui
suppose une leve progressive et partielle du voile dignorance, en quatre tapes (
31) - mais encore de vrifier cet quilibre rflexif entre les principes tests21 par
la situation contractuelle et nos jugements intuitifs, par exemple propos de la
libert de conscience gale pour tous qui se dduit du premier principe de
justice et qui constitue en mme temps un des points fixes de nos jugements bien
18
19
20
21
p. 54.
p. 154.
p. 231.
p. 46.
La justice Rawls
Philopsis Dupond Cournarie
www.philopsis.fr
pess sur la justice ( 3322). Dans la troisime partie, Rawls tente de donner une
base psychologique sa thorie des biens premiers et lacquisition d un sens
de la justice , pour montrer comment les deux principes peuvent en eux-mmes
engendrer et dvelopper ce sens de la justice et produire, idalement, les conditions
dune socit stable.
Ainsi on peut dire, pour se limiter la premire partie o se concentrent tous
les enjeux de cette conception philosophique, que la thorie de la justice comme
quit tente de rendre compte de ces convictions du sens commun, concernant la
priorit de la justice 23. Mais la priorit de la justice correspond la priorit des
liberts de base et de droits qui ne sauraient tre soumis des marchandages
politiques ni des calculs dintrts sociaux 24. Cest cette priorit que la fiction
de la position originelle sous le voile dignorance, qui porte la thorie du contrat
social son plus haut degr dabstraction, met en vidence et fonde
argumentativement. Et lon peut galement prvoir que les principales objections
faites la Thorie de la justice iront la mthode qui fonde la justification des
principes par la thorie sur la justification des jugements moraux intuitifs et
rciproquement. Cette imperfection mthodologique, peut-tre inscrite au cur de
toute philosophie morale, comme le rappelle Ricur25, remet sans doute en cause
le projet mme de la Thorie de la justice, cest--dire comme Rawls le rappelle
encore au dbut de Justice et dmocratie : gnraliser et mener un plus degr
dabstraction la doctrine traditionnelle du contrat social 26. Si la rfrence la
thorie du contrat nest pas dmentie partir des annes 1980, du moins Rawls a-t-
22
p. 242.
p. 54.
24
Ibid..
25
La mthode de Rawls vise constituer une thorie normative de la justice sur
des bases contractualistes ou constructivistes (dduction des principes partir de la position
originelle). Mais la dmarche reste par ailleurs analytique, par le travail de clarification des
concepts et des intuitions. Mais, aprs tout, la philosophie morale peut-elle chapper cette
espce danalytique de lopinion qui engage la pense lucider rflexivement le
consensus sur les valeurs implicites de notre culture en les levant leur expression la plus
gnrale et la plus rigoureuse. Cest la suggestion faite par Ricur dans un article de 1988
Le cercle de la dmonstration : La philosophie morale ne fonde rien ex nihilo, mais
justifie aprs coup les convictions morales les plus communes. Ainsi Aristote part-il des
endoxa, cest--dire des ides admises sur les vertus, afin den dgager le noyau rationnel
dans une mise en tableau cohrente. En un sens voisin, Kant inaugure ses Fondements de la
mtaphysique des murs par laveu que, de tout ce que nous tenons pour bon, la bonne
volont est ce qui vaut sans restriction, partout et toujours ; et toute la thorie morale de
Kant se rsume en une mise lpreuve de cette conviction bien pese ; et quand il en vient
fonder le principe, il na mme rien dautre dire sinon que la nature raisonnable existe
en chacun comme immdiatement digne de respect. Or, exister signifie, dans ce contexte,
chapper toute production, toute manipulation. Quon ne doive pas traiter la personne
seulement comme un moyen, mais toujours aussi comme une fin, cela nous lavons
toujours su. Tout ce que nous y ajoutons ne relve-t-il pas alors de ce que Dworkin,
commentant la thorie de Rawls, appelle interprtation constructive ? (Lectures 1,
Seuil, 1991, p. 230)
26
p. 8.
23
La justice Rawls
Philopsis Dupond Cournarie
www.philopsis.fr
il peut-tre renonc vouloir la gnraliser comme si elle constituait un modle
universel et indpassable.
Lintrt philosophique de la Thorie de la justice
Quel est donc finalement lintrt de la Thorie de justice ? Ne constitue-telle quun pisode interne aux dbats de la philosophie anglo-saxonne, quon
pourrait rduire la critique de lutilitarisme, tradition anglo-saxonne sil en est, en
contexte analytique ?
Mais on a dj vu quel tournant reprsente la Thorie de la justice dans
la philosophie analytique. Par l-mme elle a une signification plus gnrale qui la
dcontextualise, puisque la rfrence insistante la tradition du contrat social
comme conception systmatique alternative lutilitarisme la situe de plain pied
dans la philosophie continentale. Rawls est peut-tre le plus continental des
philosophes anglo-saxons, de tradition analytique.
Ainsi ce qui est, pour nous, le plus significatif dans lhistoire de la
philosophie contemporaine, cest le retour de la question de la justice. De nouveau
il est possible et mme ncessaire de parler de justice en philosophie morale et
politique. Luvre de Rawls termine une assez longue priode deffacement de la
justice. Rawls labore une thorie de la justice, cest--dire quil considre que la
justice est la premire vertu des institutions sociales comme la vrit est celle des
systmes de pense (1 27). Si la justice est la vertu premire de la socit, la
question de la justice redevient une question premire en philosophie.
Lclipse de la justice tient sans doute des causes multiples qui ont affect
diversement lvolution des ides dans le contexte anglo-saxon ou continental. On
peut certainement voquer chez nous, dun ct la rduction de la philosophie
politique soit lanalyse des effets de pouvoirs soit la philosophie de lhistoire28,
de lautre linfluence du positivisme juridique qui soutient que lon ne peut
accorder de statut scientifique ltude du droit quen mettant entre parenthses le
problme de la justice29. La question du droit juste retrouve une actualit
conceptuelle. Il faut bien relever lambition du propos. Contre la philosophie du
droit lpoque moderne, et particulirement contre le positivisme juridique,
Rawls renouvelle le projet dune fondation du droit, en cherchant exhiber les
normes pures et universelles pour valuer rationnellement les institutions et les
pratiques de tout ordre social.
27
p. 29.
Voir Ricur, Le Juste, ditions Esprit, 1995, pp. 7-9. On se reportera galement
A. Renaut et L. Sosoe, Philosophie du droit, PUF, 1991, particulirement pp 13-40
29
Kelsen tente de constituer une Thorie pure du droit (1934, traduction franaise,
d. La Baconnire, 1953) qui a pour objet non pas de dterminer quelles rgles le droit doit
adopter ou tablir mais danalyser le droit tel quil est en fait , le droit positif tant
national quinternational . La thorie gnrale du droit naborde pas le droit en direction
de la justice, cest--dire de la norme, mais dans son fonctionnement strict, cest--dire
dans son existence. La question de la justice nest pas dnue de sens, mais elle relve de la
mtaphysique du droit et non dune science du droit.
28
La justice Rawls
Philopsis Dupond Cournarie
www.philopsis.fr
Mais Rawls relve un autre dfi. La thorie de la justice comme quit nest
pas une mtaphysique du droit30, mais bien une thorie de la justice sociale. La
justice, cest, si lon veut, le problme que la socit se pose ncessairement ellemme, en vertu de sa propre essence. La socit a besoin de justice parce quelle se
dploie comme ce problme. La justice nexiste pas en dehors du contexte ou de
lensemble des circonstances qui la dfinit. Ce sont ces circonstances qui rendent
en mme temps la justice possible et ncessaire. Ou plus prcisment le contexte
dapplication de la justice peut tre dfini comme lensemble des conditions
normales qui rendent la fois possible et ncessaire la coopration humaine. []
Les circonstances constituant le contexte de lapplication de la justice sont runies
chaque fois que des personnes avancent des revendications en conflit quant la
rpartition des avantages sociaux, dans des situations de relative raret des
ressources. En labsence de telles circonstances, il ny aurait pas doccasion pour la
vertu de justice. [] Mais une socit humaine est caractrise par le contexte
dapplication de la justice ( 23 31). Rawls le prcisait demble, en construisant
sa dfinition de la socit au dbut de louvrage :
Posons, pour fixer les ides, quune socit est une association, plus ou
moins autosuffisante, de personnes qui, dans leurs relations rciproques,
reconnaissent certaines rgles de conduite comme obligatoires, et qui, pour la
plupart, agissent en conformit avec elles. Supposons, de plus, que ces rgles
dterminent un systme de coopration visant favoriser le bien de ses
membres. Bien quune socit soit une tentative de coopration en vue de
lavantage mutuel, elle se caractrise donc la fois par un conflit dintrts et
par une identit dintrts. Il y a identit dintrts puisque la coopration
sociale procure tous une vie meilleure que celle que chacun aurait eue en
cherchant vivre seulement grce ses propres efforts. Il y a conflit
dintrts puisque les hommes ne sont pas indiffrents la faon dont sont
rpartis les fruits de leur collaboration, car, dans la poursuite de leurs
objectifs, ils prfrent tous une part plus grande de ces avantages une plus
petite. On a donc besoin dun ensemble de principes pour choisir entre les
diffrentes organisation sociales qui dterminent cette rpartition des
avantages et pour conclure un accord sur une distribution correcte des parts.
Ces principes sont ceux de la justice sociale : ils fournissent un moyen de
fixer les droits et les devoirs dans les institutions de base de la socit et ils
dfinissent la rpartition adquate des bnfices et des charges de la
coopration sociale 32.
On a reconnu sous le concept de justice sociale la notion de justice
distributive. La justice a pour objet et pour rle dattribuer chacun ce qui lui
revient. Mais ce qui est rpartir ne concerne pas seulement les biens, les charges
et les honneurs, dans une socit objectivement hirarchise comme chez Aristote,
mais aussi les liberts de base, les droits fondamentaux que la modernit a
30
Rawls est revenu sur cet cart, en particulier dans un article de 1985 : La
thorie de la justice comme quit : une thorie politique et non pas mtaphysique . Dans
Libralisme Politique, Rawls tente de dissiper la confusion entre thorie morale et thorie
politique de la Thorie de la Justice ( pp. 4 sq, et 2 pp. 35-40).
31
pp. 159-162.
32
pp. 30-31.
La justice Rawls
Philopsis Dupond Cournarie
0
10
www.philopsis.fr
reconnus galement tous les individus. Lhomme moderne ne dcouvre pas ses
fins mais les choisit.
Autrement dit il sagit pour Rawls de restaurer lide de justice, plus
exactement de construire une thorie de la justice distributive dans le cadre
idologique qui est celui de lindividualisme libral33. Comment fonder des critres
pour dcider ce qui revient chacun quand ce qui dfinit lindividu est sa capacit
et son droit fixer librement ses propres fins ? Rawls se mesure finalement
linterrogation suivante : une thorie moderne, cest--dire partir du libralisme,
de la justice distributive est-elle possible ?
Mais cette thorie moderne de la justice distributive doit articuler deux
valeurs fondamentales de la modernit politique, la libert et lgalit. Aristote
distinguait deux concepts du juste, irrductibles la mme espce de proportion. A
lintrieur de la justice-galit, elle-mme spare de la vertu de justice (justicelgalit), la justice distributive relve de la proportion gomtrique et la justice
corrective de la proportion arithmtique. La conscience moderne du juste hrite
elle de deux valeurs, la libert et lgalit, qui ont la mme prtention dfinir la
justice mais la mme incapacit lincarner de faon exclusive. La justice consiste
la fois dans un ensemble de liberts fondamentales, ce que lon appelle les droitsliberts, et dans des droits complmentaires que les individus peuvent exiger ou
revendiquer dobtenir au nom de lgalit des conditions (droits-crances). Peut-on
arbitrer entre ces deux valeurs ?
Trois solutions semblent offertes. On peut subordonner, voire sacrifier la
libert lgalit. Lexigence dgalit prcde celle de libert. Cette option est
reprsente par la tradition socialiste qui tend privilgier les droits-crances sur
les droits-liberts, qui dfend une galit des conditions matrielles. On connat la
critique que dveloppe Marx dans la Question juive des droits-liberts dont il
relve le caractre formel, au nom des droits rels ou matriels, cest--dire des
droits de crance.
On peut tout au contraire, pour lutter prcisment contre cette tendance
socialiste, sparer strictement les droits-liberts et les droits de crance et ainsi
disjoindre lide de justice de lexigence sociale. Cette perspective rpond un
libralisme radical dont il ny a pas dexemple chez les libraux classiques mais
qui se trouve thoris chez les nolibraux ou libertariens , chez Nozick et
surtout chez lconomiste autrichien Friedrich A. Hayek dont ils se rclament.
Ainsi Hayek dans Droit, lgislation et libert34 pousse la thse librale au bout de
sa logique : ou lon consent abandonner toute revendication dgalit des
33
Voir J-P. Dupuy, Les paradoxes de Thorie de la justice Introduction
luvre de J.ohn Rawls (Esprit, 1988, pp 72-84 ). Il nest pas facile de donner une
dfinition du libralisme. On pourrait dire que cest une forme de pense sociale et
politique qui lie laxiome individualiste (libralisme politique) lhypothse dune
autonomie fondatrice du march (libralisme conomique). Ce nest donc peut-tre pas tant
lindividualisme, la reconnaissance quil y a, selon lexpression de Constant une partie de
lexistence humaine qui, de ncessit, reste individuelle et indpendante (De la libert
chez les modernes, GF, p. 271), cest--dire finalement la thse dune stricte dlimitation
de la souverainet politique ( aucune autorit sur terre nest illimite (ibid p. 275), qui
dfinit le libralisme, que laffirmation du rle prioritaire et dterminant du march dans la
formation, lorganisation et lvolution des socits humaines.
34
1976, PUF,1995, Quadrige, t. 2.
La justice Rawls
Philopsis Dupond Cournarie
1
11
www.philopsis.fr
conditions matrielles ou bien on contribue instaurer un systme totalitaire qui
exclut la libert personnelle. Pour Hayek, lide de justice sociale ou justice
distributive est vide de sens dans une socit dhommes libres35. Juste est un
prdicat de laction humain, qui suppose intentionnalit et responsabilit. La
justice est un attribut de la conduite humaine 36. Il sappliquera videmment la
sphre judiciaire et au plan dlibr des institutions politiques 37 - Hayek fait ici
rfrence Rawls qui a consacr un ouvrage important ce problme, et avoue
ntre pas en dsaccord avec lui. Mais il regrette son usage prcisment de la
notion de justice sociale et cite plutt un article de 1961.
Mais le concept est dnu de sens quand il sapplique au procs
impersonnel du march qui confre aux individus la disposition de tels ou tels
biens ou services : il ny a rien qui puisse tre juste ou injuste parce quil sagit de
rsultats qui nont t ni voulus ni prvus, et qui dpendent dune multitude de
38
circonstances que personne ne connat en totalit . Dans ces conditions,
lexigence de justice sociale constitue un authentique pril pour les valeurs dune
civilisation de libert 39 et aussi longtemps que la croyance la justice sociale
rgira laction politique, le processus doit se rapprocher de plus en plus dun
40
systme totalitaire . Lintroduction de la justice sociale ne peut se faire quau
dtriment de la libert, cest--dire quau profit dun Etat toujours plus dirigiste.
La justice sociale ne peut avoir de signification que dans une conomie dirige
ou commande (par exemple une arme) o les individus se voient commander ce
quils ont faire ; et nimporte quelle variante de justice sociale ne pourrait tre
ralise que dans un tel systme dirig du centre 41.
35
Op. cit., pp. 82-83.
Cest le titre du chapitre 8.
37
Ch. 9, p. 120.
38
p. 85.
39
p. 81.
40
p. 82.
41
pp. 83-84. Cette dissociation de lide de justice et dexigence sociale ne peut se
comprendre qu partir de la thse gnrale dHayek sur lordre du march ou
catallaxie pour Hayek cest bien lordre conomique qui dtermine et cre en dernire
instance lordre social (conomisme) : les seuls liens qui maintiennent lensemble dune
Grande socit sont purement conomiques (plus prcisment : catallactiques) (p. 135).
Hayek substitue ce nologisme catallaxie (du grec katallattein, changer) au terme
traditionnel dconomie qui a le dsavantage de suggrer que le march serait organis
comme un agencement dlibr avec des moyens connus, alors que lordre du march est
engendr par lajustement mutuel de nombreuses conomies individuelles sur un march.
Une catallaxie est ainsi lespce particulire dordre spontan produit par le march
travers les actes de gens qui se conforment aux rgles juridiques concernant la proprit,
les dommages et les contrats (p. 131). Lordre du march, le kosmos du march
procde dun continuel change dinformations par lequel les objectifs des individus
sajustent spontanment les uns aux autres. Au sein du march, chacun poursuit ses
objectifs et ses intrts, en se contentant de respecter les rgles juridiques, qui nont pour
fonction que dautoriser lautodploiement des lois immanentes du march. Toute
intervention de lEtat dans le jeu catallactique (conomie mixte) introduirait du dsordre.
Donc non seulement le rle de lEtat est de crer et de maintenir le cadre juridique
qui rend possible la diffusion maximale de linformation, cest--dire le dveloppement
36
La justice Rawls
Philopsis Dupond Cournarie
2
12
www.philopsis.fr
Cest cette position extrme qui identifie Etat-Providence et Etat totalitaire
que diffusent les no- ou ultra-libraux, les libertariens. Ils se nomment euxmmes anarcho-capitalistes parce que mme lEtat minimal , lEtat veilleur
de nuit de la tradition librale, lEtat rduit la portion congrue, en tant quil
sapproprie le monopole de la protection par la force des individus, viole dj leurs
droits absolus, inviolables et inalinables.
Ou bien enfin on peut essayer darticuler la libert et lgalit dans une
thorie cohrente. Cest cette dernire voie difficile que Rawls tente de frayer dans
la Thorie de la justice qui constitue une forme de libralisme social ou de
libralisme modr. En cherchant dpasser ou surmonter cette opposition, il tente
une reprise philosophique de la modernit et de son histoire.
Pour terminer cette introduction la lecture de la Thorie de la justice, nous
reprendrons notre compte ces propos de J. Vuillemin, au dbut dun article
Remarques sur la convention de justice selon J. Rawls 42 :
Le livre, important et volumineux, de J. Rawls [] contient trois ides
principales dont chacune mrite examen. Il nous propose dabord une
dfinition nouvelle de la socit juste. Il dmontre ensuite que les hommes,
supposs raisonnables et soumis des conditions qui font de leur choix un
choix juste, choisiront unanimement cette socit. Enfin, le contrat de justice
pass, les institutions qui leur seront conformes faonneront leur tour les
hommes en sorte dassurer la stabilit de la socit juste quils auront
choisie .
autorgul du march qui conduit un accroissement du flux des biens et des chances
pour tous les participants de satisfaire leurs besoins (p. 139), soit la production dun solde
suprieur toute institution construite. LEtat doit se contenter de protger les liberts
individuelles. Dans lEtat libral, les seuls droits sont les liberts individuelles.
Aussi la rcrimination propos des rsultats du march, en termes dinjustices
relve du mirage ou du fantasme. A la question qui a donc t injuste ? , il ny a pas de
rponse. Lordre du march est sans sujet. Et vouloir maintenir tout prix lexigence de
justice sociale dans lordre spontan du march auquel se ramne lorganisation des
socits modernes, cest diviniser la socit, cder un anthropomorphisme social qui ne
peut sempcher de la transformer en instance mystrieuse laquelle on pourra adresser
plaintes et rclamations (p. 83). Nous ne faisons certes pas derreur en percevant que les
effets des processus dune socit libre, sur le sort respectif des divers individus, ne se
rpartissent pas selon un principe discernable de justice. O nous faisons fausse route, cest
en concluant de l que ces effets sont injustes et que quelquun doit en porter le blme.
Dans une socit libre o la position des divers individus et groupes ne dcoule pas du
dessein de qui que ce soit - ni ne peut, dans le cadre dune telle socit, tre modifie selon
un principe dapplication gnrale - les diffrences de rtribution ne peuvent tout
simplement pas tre qualifies raisonnablement de justes ou dinjustes (p. 84).
42
Lge de la science, p. 55.
La justice Rawls
Philopsis Dupond Cournarie
3
13
www.philopsis.fr
Analyse des principes de la thorie de la justice comme quit
La justice comme quit contre lutilitarisme
La justice comme quit
Cette thorie de la justice est souvent nomme par Rawls, conformment
la premire inspiration de son essai de 1958, thorie de la justice comme quit
(Justice as Fairness ). Comment peut-on comprendre cette expression ?
Il sagit de trouver un principe qui permette darbitrer des revendications
concurrentes lgitimes de la part des partenaires sociaux, de dterminer la
rpartition quitable des biens primaires que les hommes sefforcent datteindre ou
dviter, comme lcrit Rawls plus loin. La thorie de la justice se spcifie comme
quit en raison de cet arbitrage des biens, qui doit pouvoir rgler les conflits
venir entre les partenaires sociaux, partager les ingalits en liminant larbitraire43
Rawls indique que lquit constitue lessence de la justice : Dans cet
article, je souhaite montrer que dans le concept de justice, lide fondamentale est
celle dquit ; et je souhaite proposer une analyse du concept de justice de ce
point de vue. Afin de faire ressortir limpact de cette affirmation et de lanalyse qui
en dcoule, je soutiendrai que cest prcisment cet aspect de la justice dont
lutilitarisme, dans sa forme classique, est incapable de rendre compte, et qui est au
contraire exprim, mme si cest de manire errone, par lide de contrat
social 44.
Rawls entend se placer du point de vue de lquit pour laborer une thorie
de la justice, pour analyser le concept de justice comme dit notre paragraphe.
Et cest en se plaant ce point de vue que lanalyse de Rawls trouve son
originalit. Ou plutt, seule une approche qui sinspire de lide du contrat peut
rendre compte de laspect essentiel dquit de la justice. Autrement dit lquit
semble venir qualifier la thorie de la justice en totalit, puisque lhypothse du
contrat, qui sert de rfrence Rawls, est la seule exprimer quoique de manire
errone , la dtermination fondamentale dquit dans le concept de justice.
En effet lquit dsigne la procdure qui ralise laccord des partenaires sur
le choix des principes de justice. La thorie de la justice est une thorie de la
43
Llimination de larbitraire, la rduction de la contingence quelle soit naturelle
ou historique, voire sa correction, correspond bien une intuition du juste. (Voir le 12 de
la Thorie de la justice : Interprtations du second principe ). L o rgne larbitraire
rgne linjustice. Justitia et Fortuna sont des desses contraires. Il ne sagit pas de nier les
diffrences de capacits mais de faire travailler les contingences au bien des plus
dsavantags ( 17, p. 132). La rpartition naturelle nest ni injuste ni juste ; il nest pas
non plus injuste que certains naissent dans certaines positions sociales particulires. Il
sagit seulement de faits naturels. Ce qui est juste ou injuste par contre, cest la faon dont
les institutions traitent ces faits. [] Dans la thorie de la justice comme quit, les
hommes sont daccord pour ne se servir des accidents de la nature et du contexte social que
dans la perspective de lavantage commun. Les deux principes sont un moyen quitable
(fair) de faire face larbitraire du sort et les institutions qui les appliquent sont justes,
mme si elles sont sans doute imparfaites dautres points de vue (id., p. 133).
44
Id., p. 39.
La justice Rawls
Philopsis Dupond Cournarie
4
14
www.philopsis.fr
justice comme quit en tant quelle conoit les principes de justice comme tant
lobjet dun accord originel entre les partenaires sociaux, eux-mmes placs dans
une situation gale initiale. La position originelle est, pourrait-on dire, le statu
quo initial adquat et cest pourquoi les accords fondamentaux auxquels on
parvient dans cette situation initiale sont quitables. Tout ceci nous explique la
justesse de lexpression justice comme quit : elle transmet lide que les
principes de la justice sont issus dun accord conclu dans une situation initiale ellemme quitable. Mais cette expression ne signifie pas que les concepts de justice et
dquit soient identiques, pas plus que, par exemple, la formule la posie comme
mtaphore ne signifie que posie et mtaphore soient identiques ( 3 45).
Donc la thorie de la justice comme quit est, si lon veut, la thorie des
conditions quitables, puisquelles traitent les sujets moraux comme leur valeur
lexige46, qui rendent possible laccord originel sur les principes de justice ayant
pour objet les structures de base de la socit, et dont le second porte explicitement
sur la rpartition des ingalits.
La justice contre lutilit
On comprend par consquent l'opposition de la thorie de Rawls
l'utilitarisme. Cette thorie de la justice comme quit se construit contre le
principe d'utilit. Lutilitarisme nest pas pour nous une tradition forte de la
philosophie. Les uvres des philosophe de l'cole utilitariste sont introuvables ou
non-traduites, quelques rares exceptions prs. Et ce n'est pas le moindre mrite de
l'ouvrage de Rawls que d'avoir permis au lecteur franais de (re-)dcouvrir
l'importance de cette philosophie. Car la critique systmatique qu'il en fait est un
hommage indirect sa consistance47.
Lutilitarisme a t prfigur par Hume (1739), fond par Bentham (1789),
baptis et popularis par Mill (1861), et systmatis ou axiomatis par Sidgwick
(1874). Rawls se rfre de prfrence Sidgwick qui formule le plus clairement la
doctrine classique de l'utilitarisme48. Rawls prsente le livre de Henry Sidgwick,
The Methods of Ethics (Londres, 1907) comme rsum du dveloppement de la
thorie morale utilitariste 49. Sidgwick, contrairement Bentham, qui n'a jamais
jug ncessaire de prouver le principe d'utilit, s'est efforc de le dduire
logiquement. Rawls dsigne cette mthode axiomatique d' intuitionnisme
rationnel .
Rawls esquisse trs brivement dans une note une histoire de l'utilitarisme. Il
semble que Bentham ait commenc par reprendre l'expression, le principe
d'utilit (the principle of utility ) de Hume et d'Helvtius - dans De lEsprit, la loi
45
46
pp. 38-39.
Cette situation initiale est quitable lgard des sujets moraux, cest--dire
dtres rationnels ayant leurs propres systmes de fins et capables, selon moi de la justice
(p. 38).
47
Cest pourtant luvre en trois volumes dElie Halvy, La formation du
radicalisme philosophique (1901), qui a longtemps fait rfrence pour lhistoire de
lutilitarisme. Il vient dtre rdit au PUF, et on trouve dans la mme collection, une
anthologie de lutilitarisme par C. Audard, la traductrice de la Thorie de la justice.
48
p. 49.
49
p. 79.
La justice Rawls
Philopsis Dupond Cournarie
5
15
www.philopsis.fr
de lintrt est prsente comme lquivalent dans le monde moral des lois du
mouvement dans lunivers physique. Il adoptera finalement la formule : le plus
grand bonheur pour le plus grand nombre (the greatest happiness of the greatest
number ), dj employ par Beccaria et surtout par Hutcheson50.
L'utilitarisme pose que tout individu est anim exclusivement par la
considration de son utilit, cest--dire par la considration du plus grand bonheur
possible. Or ce qui vaut comme principe pour l'individu vaut aussi pour l'ensemble
de la socit : puisque le principe, pour un individu, est d'augmenter autant que
possible son propre bien-tre, son propre systme de dsirs, le principe pour la
socit est d'augmenter autant que possible le bien-tre du groupe, de raliser au
plus haut degr le systme complet du dsir auquel on parvient partir des dsirs
de ses membres 51. La justice sociale n'est que l'extension au bien-tre collectif du
principe de prudence rationnelle qui commande l'individu de promouvoir pour
lui-mme le plus grand bien possible en calculant ses pertes prsentes et futures
par rapport aux gains prsents et futurs. Ainsi la socit juste, du point de vue
utilitariste, est celle qui organise les institutions de manire augmenter le taux net
de satisfaction sociale, celle qui sait par consquent accrotre le plaisir net, la
somme algbrique des plaisirs et des peines de tous les individus concerns. Le
bien plus prcisment encore consiste dans la maximisation de l'utilit gnrale, ou
utilit publique (Bentham), obtenue par agrgation des utilits individuelles. Le
principe d'utilit devient effectivement normatif quand il prescrit le calcul du
bonheur ou du plaisir total - Bentham n'entend pas distinguer entre un bnfice,
un avantage, un plaisir, un bien ou le bonheur - et non pas ponctuel et immdiat.
Et de mme que ce qui compte, pour l'individu, c'est l'utilit globale, de mme
pour la socit, c'est l'utilit du plus grand nombre ou la somme la plus grande
d'utilits individuelles. Par principe d'utilit, crit Bentham, on entend le principe
qui approuve ou dsapprouve une action quelconque, selon la tendance qu'elle
parat avoir augmenter ou diminuer le bonheur de la partie intresse (the
happiness of the party whose interest is in question ) ; ou ce qui revient au mme,
favoriser ou contrarier ce bonheur. Si la partie intresse est la communaut en
gnral, alors il s'agit du bonheur de la communaut ; si c'est un individu
particulier, de son bonheur .
Ce qui signifie que la justice est soumise un principe d'efficacit dont elle
se distingue peine. L'utilitarisme relve en effet des thories thiques
tlologiques. Dans ces thories, le bien se trouve dfini antrieurement et
indpendamment du juste. Leur simplicit fait tout leur prestige. Le bien, ce qu'il
faut chercher, est clairement identifi, cest--dire indpendamment du juste. On
50
Recherche sur l'origine de nos ides de la beaut et de la vertu (1711),
Deuxime trait, Vrin (1991) p. 179 : lorsqu'un degr de bonheur gal est attendu en
rsultat d'une action, la vertu est proportionnelle au nombre de personnes auxquelles ce
bonheur s'tendra (et la dignit, ou l'importance morale des personnes peut ici compenser le
nombre) ; qu' nombres gaux, la vertu est gale la quantit de bonheur ou de bien
naturel ; ou encore que la vertu est en raison compose de la quantit de bien et du nombre
de ses bnficiaires. De mme, le mal moral, ou le vice, est fonction du degr de malheur et
du nombre de ceux qui en souffrent ; de sorte que l'action la meilleure est celle qui procure
le plus grand bonheur au plus grand nombre ; et la pire celle, de faon analogue,
occasionne le plus grand malheur .
51
Thorie de la justice, p. 49.
La justice Rawls
Philopsis Dupond Cournarie
6
16
www.philopsis.fr
dfinit seulement ensuite, mais aussi clairement, le juste comme ce qui maximise
le bien. Est juste ce qui permet d'obtenir le plus de bien possible. Autrement dit,
ces thories s'accordent naturellement avec notre conception habituelle de la
rationalit, en particulier dans le domaine conomique, comme maximisation. C'est
pourquoi elles semblent incarner l'ide de rationalit. Il est naturel de dfinir la
rationalit par la maximisation de quelque chose et, en morale, par la maximisation
du bien 52.
Si c'est l'excellence qui dfinit le bien, la thorie thique prend la forme du
perfectionnisme ; si c'est le bonheur, on a affaire l'eudmonisme Si le bien est
identifi la satisfaction du dsir rationnel, on obtient la forme utilitariste de la
doctrine tlologique : Quant au principe d'utilit, sous sa forme classique, je le
comprends comme dfinissant le bien par la satisfaction du dsir, ou mieux, peuttre, par la satisfaction d'un dsir rationnel. Ceci s'accorde avec tous les points
essentiels de la doctrine et en fournit, je crois, une interprtation correcte. Les
termes adquats de la coopration sociale sont fixs par ce qui, dans les
circonstances donnes, fournira la plus grande somme de satisfaction aux dsirs
rationnels des individus. Il est impossible de nier qu'initialement cette conception
parat plausible et attirante 53. L'utilitarisme est tellement satisfaisant qu'il est le
premier tre suffisamment formalisable pour tre trait mathmatiquement.
La critique rawlsienne de l'utilitarisme classique ainsi recompos porte
principalement sur trois points. D'abord en faisant de la justice le moyen de la
maximisation de la somme totale des satisfactions, l'utilitarisme passe indment du
plan individuel au plan social. Si l'on se reprsente que l'individu agit
rationnellement en nvitant pas une souffrance pour profiter d'une plus grande
satisfaction ensuite, on ne voit pas comment cette recherche de maximisation des
satisfactions peut tre extrapole au plan collectif. Ou alors on doit supposer un
spectateur impartial , sujet la sympathie , capable d'prouver les
satisfactions et les douleurs de la collectivit, comme si la socit ne faisait quun
seul individu. Or d'une part cette mdiation, sans laquelle l'extension sociale du
principe d'utilit n'est pas possible, est une pure fiction. D'autre part, et c'est la
deuxime critique, cette fiction fait fi de la pluralit des personnes, de la diversit
humaine, et du droit de chaque individu poursuivre et raliser son dsir
rationnel de vie. La dcision correcte [du spectateur impartial] est
essentiellement une question de gestion efficace. Cette conception de la
coopration sociale est le rsultat de lextension la socit du principe de choix
valable pour un individu et, ensuite, pour rendre efficace cette extension, on traite
toutes les personnes comme une seule, grce lactivit imaginaire du spectateur
impartial et capable de sympathie. La pluralit des personnes nest donc pas
vraiment prise au srieux par lutilitarisme 54. On pourrait dire que l'utilitarisme
nest quapparemment un individualisme 55.
52
p. 50.
p. 51.
54
p. 53.
55
p. 55. Rawls revient sur la fiction du spectateur impartial au 30, en la
comparant l'hypothse de la position originelle. Il ressort de cette analyse que si la justice
procde, dans la premire, de la sympathie, d'une information exhaustive (impossible) pour
dterminer le solde de satisfactions, donc d'une ngation du droit des individus choisir
53
La justice Rawls
Philopsis Dupond Cournarie
7
17
www.philopsis.fr
Enfin et surtout l'utilitarisme ne tient aucun compte de la faon dont la
somme totale des satisfaction est rpartie entre les individus 56. Seul importe le
solde net de satisfaction, comme il en va pour l'individu, et par rapport cette fin
normative, tous les moyens semblent adquats. Or si la rpartition des satisfactions
ne compte pas, rien nempche que les pertes de uns soient justifies par les gains
des autres, et, par exemple, que la violation de la libert dun petit nombre soit
justifi par un plus grand bonheur pour un grand nombre 57. Dans l'utilitarisme,
rien n'interdit par consquent qu'une socit esclavagiste puisse tre malgr tout
une socit juste si la justice nest rien dautre quune fonction de lutilit
collective. La logique de l'utilitarisme est, pour reprendre l'expression de J-P.
Dupuy 58, une logique sacrificielle . C'est l mme sa marque la plus distinctive,
et c'est pourquoi Rawls ne range pas Hume parmi les philosophes utilitaristes. Le
principe d'utilit renvoie chez lui quelque forme de bien commun et aucune
mention n'est faite de cette compensation entre les avantages de certains contre les
dsavantages d'autres, minoritaires 59.
videmment aucun utilitariste ne souscrirait cette hypothse d'une socit
esclavagiste mais juste. Et Rawls ne suggre pas l'absurdit selon laquelle les
utilitaristes classiques auraient approuv l'esclavage 60. Les utilitaristes ont de fait
dfendu la libert individuelle. Ils admettent que dans la plupart des cas, du moins
un stade avanc de civilisation, linjustice va lencontre de la plus grande
somme davantages et quelle est contraire au bien-tre social. Mais justement la
raison qui les fera dsapprouver l'esclavage reste le calcul des avantages et des
dsavantages. L'esclavage est injuste parce que les avantages des propritaires ne
contrebalancent pas, en fait et au total, les dsavantages des esclaves, et que, dans
ces conditions, le systme social du travail est plus inefficace qu'une socit non
esclavagiste61.
eux-mmes leur conception de la justice, confondant impartialit et impersonnalit, elle
drive, dans la seconde, du choix des acteurs sociaux en personne (p. 219), mutuellement
dsintresss et soumis au voile d'ignorance.
56
p. 51.
57
p. 52.
58
La thorie de la justice : Une machine anti-sacrificielle .
59
p. 58. On ne saurait s'en tonner puisque l'individu satisfait son dsir rationnel, en
consentant sacrifier un plaisir pour une peine, ou un plaisir faible pour un plaisir plus
intense. Et S. Mill ne s'en dfendait pas : La morale utilitariste reconnat l'tre humain
le pouvoir de faire, pour le bien des autres, les plus large sacrifice de son bien propre
(L'utilitarisme, p. 66, Champs-Flammarion).
60
La justice comme quit, p. 63.
61
A la suite de ce passage, Rawls crivait : La conception qui fait driver la
justice de l'efficacit implique que le jugement port sur une pratique est toujours, au moins
en principe, une affaire de calcul des avantages et des dsavantages, dots chacun d'une
valeur ou d'une absence de valeur en tant qu'il satisfont ou non des intrts, sans gard la
question de savoir si oui ou non ces intrts impliquent ncessairement que l'on acquiesce
des principes qui ne pourraient pas faire l'objet d'une reconnaissance mutuelle.
L'utilitarisme ne peut pas rendre compte du fait que l'esclavage est toujours injuste (p.
63). On se reportera sur cette question A. Renaut et L. Sosoe, op. cit., pp 449-455. Dans
un autre article ( Qu'est-ce que l'utilitarisme ? Revue Mauss n 6 1995), J-P. Dupuy cite
Helvtitus qui n'hsite pas faire appel explicitement cette logique sacrificielle : Cette
La justice Rawls
Philopsis Dupond Cournarie
8
18
www.philopsis.fr
Par consquent c'est parce que l'utilitarisme heurte directement nos
intuitions les plus profondes du juste, nos valeurs morales les plus fondamentales,
en procdant une rduction instrumentaliste et hdoniste du sujet humain, cest
parce que le droit de la personne ny est par affirm comme valable en soi, qu'il
faut reconstruire une autre thorie de la justice. Cette thorie a pour fonction d'tre
en accord avec ces valeurs et si possible de les fonder au niveau des principes.
Chaque personne possde une inviolabilit fonde sur la justice qui, mme au
nom du bien tre de l'ensemble de la socit, ne peut tre transgresse. Pour cette
raison, le justice interdit que la perte de libert de certains puisse tre justifie par
l'obtention, par d'autres, d'un plus grand bien ( 1 62). Or cest en renouvelant la
thorie contractualiste que Rawls rfute l'utilitarisme. Tandis que la doctrine du
contrat accepte comme fondes, dans lensemble, nos convictions en faveur de la
priorit de la justice, lutilitarisme, au contraire, cherche en rendre compte
comme si elles taient une illusion socialement utile ( 6 63)
Mais le contractualisme, dans linterprtation kantienne que Rawls entend
lui donner expressment, est bien singulier puisqu'il s'articule un empirisme de
type humien. Rawls, tout en se rclamant de Kant, abandonne la fondation
transcendantale de lthique, et fait au contraire explicitement rfrence Hume 64
utilit est le principe de toutes les vertus humaines, et le fondement de toutes les
lgislations. Elle doit inspirer le lgislateur, forcer les peuples se soumettre des lois ;
c'est enfin ce principe qu'il faut sacrifier tous ses sentiments, jusqu'au sentiment mme de
l'humanit. [] L'humanit publique est quelque fois impitoyable envers les particuliers.
Lorsqu'un vaisseau est surpris par de longs calmes, et que la famine a, d'une voix
imprieuse, command de tirer au sort la victime infortune qui doit servir de pture ses
compagnons, on l'gorge sans remords : le vaisseau est l'emblme de chaque nation ; tout
devient lgitime et mme vertueux pour le salut public (De l'Esprit, t. I ch. 6 discours 2).
62
pp. 29-30.
63
p. 54.
64
Voir le Trait de la nature humaine, L. III, 2me partie. La justice est une vertu
artificielle ou sociale, et ses rgles sont uniquement tablies par intrt. La justice nest pas
vraiment distincte de la rgle de proprit qui est une convention utile. La convention nest
pas naturelle mais ne correspond pas pour autant lide de contrat, car elle nest conclue
que par utilit. Hume le dit encore dans lEnqute sur les principes de la morale. Lutilit
publique est la seule origine de la justice. Nul besoin de justice, cette prudente et jalouse
vertu (p. 86 GF), nul intrt de partager les biens, de garantir la jouissance des biens
acquis par notre travail et notre bonne fortune (Trait de la nature humaine, II, p. 605
Aubier), avec la mme assurance que les biens tirs de lesprit ou les avantages du corps.
Cette ncessit elle-mme nexiste que par ltat relatif de raret o la nature a plac les
hommes.
Rawls semble entriner lanalyse de Hume en parlant lui aussi dun contexte de
justice, constitu par deux conditions : la raret relative des ressources (pour le contexte
objectif) et le conflit dintrts (pour le contexte subjectif) ( 22, p. 161) pourtant ce sont
deux versions du libralisme qui saffrontent daprs J. Bidet (J. Rawls et la thorie de la
justice, PUF, 1995, pp. 49-53). Autant la justice est chez Hume une convention tacite, entre
individus ingaux consentants, fonde sur la stricte utilit, autant elle est pour R.awls
lobjet dun choix suspendu une reconnaissance universelle par des personnes libres et
gales. Les circonstances de la vertu de justice, qui rappellent lutilitarisme, ne doivent pas
faire oublier lhorizon de normativit de la thorie de la justice. Hume est du ct de la
thorie raliste, Rawls du ct de laffirmation normative. Hume du ct de lconomique,
La justice Rawls
Philopsis Dupond Cournarie
9
19
www.philopsis.fr
travers le thme du contexte dapplication de la justice ( 2265). Le paradoxe
dune thorie distributive partir de prmisses librales se double du paradoxe
dune conception kantienne de la justice comme quit ( 2166) qui fait du
conflit dintrts le contexte subjectif de la justice. Comme le remarque JP. Dupuy : Tout en s'opposant l'utilitarisme, la philosophie rawlsienne conserve
des traits fondamentaux de celui-ci ; c'est, comme lui, une problmatique de
l'intrt 67.
Une thorie des principes de justice
Les principes de justice
Le but de la Thorie de justice est dexprimer de faon rationnelle, on la dit,
les intuitions majeures sur la justice qui ont cours dans une dmocratie librale et
de montrer comment elles peuvent devenir efficientes dans lorganisation sociale.
Il sagit donc dexposer une thorie des principes de justice.
Cette thorie sinspire du contractualisme de Locke, Rousseau et Kant 68.
Rawls imagine une pluralit de personnes dcides sengager dans une
coopration sociale ; ces personnes sont supposes tre raisonnables, au sens dune
rationalit instrumentale (elles ont la capacit discerner les moyens appropris
aux fins quelles se proposent) et avoir un sens de la justice.
Cette rfrence la justice - la conviction que chaque personne possde
une inviolabilit fonde sur la justice, qui, mme au nom du bien-tre de la socit
ne peut tre transgresse - nimplique pas que les personnes engages dans la
recherche des principes de justice aient se conduire comme des volonts
bonnes , au sens de Kant, ou aient agir comme des sujets moraux dans leur
choix des principes de justice. Le souci de Rawls est de requrir, pour la fondation
de la justice, un corps de prsuppositions minimales ; les partenaires sengageant
dans la coopration sociale discriminent le juste et linjuste, ce qui les situe
demble au-del dune pure raison instrumentale ; mais le pari de Rawls est de
montrer que la mise en uvre de cette discrimination, prsuppose la seule raison
instrumentale, non une raison pratique proprement dite (p. 40).
Ce systme de coopration, nous lavons soulign, comporte la fois
convergence et divergence dintrts. Convergence, puisque la coopration accrot
le volume global des biens disponibles, ce qui favorise lintrt de chacun ; mais
divergence aussi, dans la mesure o chacun souhaite recevoir la plus grande part
possible des fruits de la coopration. Cette situation (convergence-divergence)
exige la recherche de principes de justice dans la distribution, et, pour cette
recherche, la mise en uvre dune dlibration aboutissant un choix acceptable
par tous. Ainsi les cooprants sont appels choisir ensemble, par un seul acte
collectif, les principes qui doivent fixer les droits et les devoirs de base et
Rawls du ct du politique. Deux libralismes saffrontent : celui de lutilitarisme, et celui
des droits de lhomme (op. cit., p. 51)
65
p. 161.
66
p. 159.
67
Op. cit., p. 62.
68
p. 37
La justice Rawls
Philopsis Dupond Cournarie
0
20
www.philopsis.fr
dterminer la rpartition des avantages sociaux . Ils sont appels, non formuler,
mais choisir dans une liste doptions alternatives, leurs principes de justice. Cette
liste doptions alternatives est rgle au fond par lopposition cardinale de lutilit
(au sens de la maximisation du bien-tre du plus grand nombre) et de la justice
comme quit, entre lesquels interviennent un certain nombre de formes mixtes
(p.156). Rawls cherche, partir dune position originelle imagine et qui
correspond ce que les classiques appelaient tat de nature (p. 38), les rgles
fondamentales de justice capables dorganiser un systme coopratif consensuel.
On doit bien observer que la question de la justice concerne dabord ce que
Rawls appelle la structure de base : lobjet premier auquel sappliquent les
principes de la justice sociale est la structure de base de la socit, cest--dire
lorganisation des institutions sociales majeures en un seul systme de
coopration (85, voir aussi 33). La notion de structure de base renvoie celle
dinstitution. La structure de base est un systme dinstitutions organisant la
coopration. Et lide dinstitution renvoie, chez Rawls, lide de rgle publique :
une institution est un systme public de rgles qui dfinit des fonctions et des
positions avec leurs droits et leurs devoirs, leurs pouvoirs et leurs immunits et
ainsi de suite 69.
Si, dans la question de la justice, Rawls porte une attention prioritaire la
structure de base, cest sans doute parce que cest elle qui dtermine
fondamentalement les perspectives de vie des membres de la coopration sociale :
les institutions sociales favorisent certains points de dpart au dtriment dautres.
Il sagit l dingalits particulirement profondes (33). La structure de base est
le lieu fondamental o se jouent galit et ingalit, cest--dire la possibilit
mme de la justice. Rawls examine la question de la justice sous un angle limit,
mais qui est pour lui dcisif. Dans la suite de louvrage, Rawls traite aussi des
principes de justice qui sappliquent aux individus et leurs actions dans des
circonstances particulires (86), ce quon pourrait appeler la vertu de justice ;
mais la priorit revient aux principes de justice sappliquant aux institutions, car
cest delles quil dpend, au premier rang, que les membres de la coopration
sociale soient traits avec justice ou injustice (p. 33).
Ces individus, qui cherchent, en vue de leur propre intrt les principes de
justice organisant la structure de base de la socit, sont supposs placs dans une
situation dgalit. Dans le choix des principes de justice, tout ce qui diffrencie
les individus : dons de nature et avantages sociaux, doit tre exclu. Et on comprend
pourquoi : si dans la recherche des principes de justice, chacun prenait en compte
sa situation personnelle et ses variables individuelles, chacun chercherait ce qui lui
est favorable et utile (ce qui maximise son intrt personnel), et non des principes
de justice universels. Donc pour que lindividualit nintervienne pas, pour que
chacun puisse vritablement choisir des principes universels de justice, tout ce qui
69
p. 86. Lide de systme public de rgles est dj introduit dans larticle inaugural
la Justice comme quit pour donner son contenu spcifique la notion de pratique :
jutilise le mot pratique comme une sorte de terme technique qui signifie toute forme
dactivits spcifie par un systme de rgles qui dfinissent des fonctions, des rles, des
mouvements, des sanctions et des interdictions et qui donnent une structure lactivit en
question. A titre dexemple, on peut penser des jeux, des rituels, des procs, des
parlements, des marchs ou des systmes de proprit (39).
La justice Rawls
Philopsis Dupond Cournarie
1
21
www.philopsis.fr
concerne les diffrences individualisantes, naturelles ou acquises socialement, doit
tre mis hors jeu. Et cette mise hors jeu a lieu dans la fiction mthodologique du
voile dignorance (168). Personne ne connat sa place dans la socit ; et ainsi
les principes de justice sont le rsultat dun accord ou dune ngociation
quitables, o lintrt personnel qui entre en jeu est pour ainsi dire lintrt
personnel universel.
Selon Rawls, dans la position originelle ainsi dfinie, les partenaires
saccorderaient ncessairement sur un principe de justice qui exige une
rpartition gale pour tous , cest--dire un principe qui exige des liberts de base
gales pour tous ainsi quune juste galit des chances et un partage gal des
revenus et de la fortune (p. 182). Le principe de justice est donc initialement
unique. Mais il se ddouble quand les partenaires prennent en considration
lefficacit conomique et les exigences de lorganisation et de la technologie ,
puisque cette considration va susciter la distinction de deux domaines : celui o la
justice exige inconditionnellement lgalit (premier principe) et celui o elle ne
lexige que conditionnellement (second principe).
Le premier est le principe de libert gale. Il fonde le statut de la personne
ou du sujet de droit. En voici une premire formulation : Chaque personne doit
avoir un droit gal au systme le plus tendu de liberts de bases gales pour tous
qui soit compatible avec le mme systme pour les autres (p. 91). Egalit du droit
aux mmes liberts dites fondamentales, telles que libert dexpression, de
runion, libert de pense et de conscience, garantie de lintgrit de la personne,
droits politiques (vote et ligibilit).
On relvera limportance de lide de systme : il faut garder prsent
lesprit que les liberts de base doivent tre values comme un tout, comme un
seul systme. La valeur dune forme de libert normalement dpend de la
dfinition des autres liberts (p. 238). Rawls admet que dans des conditions
relativement favorables , un accord optimal des liberts de base peut tre ralis :
les partenaires doivent dcider de la meilleure manire de prciser les diverses
liberts de faon produire le meilleur systme total de liberts (p. 239).
On remarquera galement que pour rpondre aux critiques dorigine
marxiste sur le caractre formel des liberts de base, Rawls distingue libert et
valeur de la libert :
La libert et la valeur de libert sont distingues de la faon suivante :
la libert est reprsente par le systme complet des liberts incluses dans
lgalit des citoyens, tandis que la valeur des liberts pour les personnes et
les groupes, dpend de leur capacit favoriser leurs fins dans le cadre dfini
par le systme. La libert en tant qugale pour tous est la mme pour tous ;
et il nest pas question de donner une compensation pour une libert
moindre. Mais la valeur de libert nest pas la mme pour tous. Certains ont
plus dautorit et de fortune et donc des moyens plus importants pour mener
bien leurs objectifs (p. 240).
Est-il acceptable et, si oui, quest-ce qui rend acceptable, que certains aient
une libert de moindre valeur ? La rponse cette question nous fait anticiper le
second principe. Rawls poursuit ainsi :
La valeur moindre de la libert est, cependant, compense ; en effet la
capacit des moins avantags mener bien leurs objectifs serait encore
La justice Rawls
Philopsis Dupond Cournarie
2
22
www.philopsis.fr
diminue sils nacceptaient pas les ingalits existantes chaque fois que le
principe de diffrence est respect. Mais il ne faut pas confondre compenser
la valeur moindre de la libert et rparer une ingalit de libert. En prenant
en compte les deux principes la fois, la structure de base doit tre organise
de manire maximiser, pour les plus dsavantags, la valeur du systme
complet des liberts gales pour tous. Telle est la dfinition du but de la
justice sociale (p. 240).
Il ny a pas de compensation une ingalit de libert ; mais il peut y avoir
compensation une ingalit de valeur de libert ; et cette compensation consiste
dans la conviction rationnelle quaucune autre organisation sociale ne favoriserait
davantage la capacit des moins favoriss raliser leur ide du bien.
Cela conduit au second principe, qui concerne les rgles de la rpartition des
richesses ou des revenus et les conditions daccs aux fonctions dautorit et de
responsabilit. Il sarticule sur deux niveaux ou comprend deux volets : les
ingalits sociales et conomiques doivent tre organises de faon que, dune
part, on puisse raisonnablement sattendre quelles soient lavantage de chacun
(principe de diffrence) ; et quelles soient dautre part attaches des positions et
des fonctions ouvertes tous (principe dgalit des chances). Ce second principe
nonce les deux conditions qui doivent tre satisfaites pour que les ingalits
puissent tre acceptes par les partenaires de la coopration : les ingalits, si elles
existent, doivent tre lavantage de tous, c'est--dire profitables tous ; il faut
quon ne puisse pas imaginer un tat social qui, sans ces ingalits serait meilleur
pour chacun ; il faut que mme les plus dfavoriss puissent avoir la conviction
rationnelle quon ne peut pas concevoir un Etat social plus juste do ces ingalits
seraient absentes. En outre, elles doivent correspondre des fonctions en droit
ouvertes tous.
Rawls tablit une hirarchie entre les deux principes et au sein du second
principe. Cest ce quil appelle ordre lexicographique ou lexical , cest-dire lordre du dictionnaire : un mot commenant par la lettre A est toujours
antrieur un mot commenant par la lettre B, quelques soient les lettres qui
suivent la premire :
cest un ordre qui demande que lon satisfasse dabord le principe
class premier avant de passer au second, le second avant de considrer le
troisime, et ainsi de suite. On ne fait pas entrer en jeu un (nouveau) principe
avant que ceux qui le prcdent aient t entirement satisfaits ou bien
reconnus inapplicables. Un ordre lexical vite, donc, davoir jamais mettre
en balance des principes. Ceux qui se trouvent placs plus tt dans la srie
ont une valeur absolue, pour ainsi dire, par rapport ceux qui viennent aprs,
et nadmettent pas dexception ( 8, p. 68).
Le premier principe est lexicalement antrieur au second. Autrement dit on
sinterdit de pouvoir compenser des atteintes la libert (principe 1) par des
avantages conomiques plus grands (principe 2). La mme rgle vaut lintrieur
La justice Rawls
Philopsis Dupond Cournarie
3
23
www.philopsis.fr
du second principe : on ne doit pas restreindre lgalit des chances au profit de
lamlioration des conditions de vie de chacun 70.
On dira donc, comme le formule Alain Renaut, que le principe des droits
gaux et des liberts gales, c'est--dire le respect de la dmocratie formelle est
limpratif catgorique de tout ordre juste et que toutes les ingalits qui ne
peuvent pas tre justifies par le principe de diffrence sont inacceptables.
Aprs cette esquisse de lorientation de la Thorie de la justice, nous
tudierons quelques unes des questions quelle suscite concernant en particulier les
diffrentes formulations des principes de justice.
La rlaboration du concept de justice : justice et justice sociale
Pour quil y ait justice, il est ncessaire que les membres de la coopration
sociale parviennent un accord sur une distribution correcte des parts ou sur la
rpartition des bnfices et des charges de la coopration sociale. Cette
proccupation de la juste rpartition est dj au centre du concept aristotlicien de
justice distributive , mais tend disparatre du concept moderne du droit
(Rousseau) o laccent est mis sur lgalit formelle des citoyens intervenant dans
llaboration et le vote de la loi. Rawls revient lide de justice distributive, mais
cette fois au sens dune juste distribution des biens sociaux primaires .
Ces biens sociaux primaires (p. 93) ou principaux biens premiers la
disposition de la socit que Rawls distingue des biens naturels premiers ,
comme la sant et la vigueur, lintelligence et limagination - sont les
conditions et les moyens gnraux dont les individus sont censs avoir tous besoin
pour raliser leurs buts ; ils comprennent des droits, des liberts (dont traite le
premier principe) et des possibilits offertes lindividu, des revenus, la richesse
(dont traite le second principe). Cest un point fondamental : la question de la
70
Cette rgle de priorit est directement dirige contre lutilitarisme. On constate
en effet quil nest, dans les principes eux-mmes, jamais question dutilit ou de bien-tre,
mais seulement de ce que Rawls appelle les biens sociaux premiers ou principaux
biens premiers la disposition la socit , cest--dire des conditions et des moyens
gnraux dont les individus sont censs avoir tous besoin pour raliser leurs buts. Il les
distingue des biens naturels premiers, comme la sant et la vigueur, lintelligence et
limagination. Il sagit des droits, des liberts, dont traite le premier principe, et des
possibilits offertes lindividu, des revenus et de la richesse auxquels il adjoint le
respect de soi-mme , dont traite le second principe. Donc il nest plus question
dadditionner et donc de comparer des niveaux de bien-tre, mais de veiller que tous ont les
mmes liberts et les mmes chances et que les avantages socio-conomiques soient
distribus de telle sorte que ceux qui en ont le moins en aient plus que dans nimporte
quelle autre situation possible o liberts et chances seraient gales.
La priorit lexicale, lencontre de lutilitarisme qui soumet tout le champ social
la maximisation du bien-tre et rduit les droits de lindividu au rang de moyen de cette
maximisation, tablit leur caractre absolu et inviolable. Les droits-liberts ne peuvent tre
viols, mme au prix dune galisation des chances ou de lamlioration de a vie des plus
dfavoriss.
On peut schmatiser la priorit lexicale ainsi : principe dgale libert > principe
dgalit des chances > principe de diffrence. Donc principe dgale libert > principe
dgalit des chances > principe de diffrence (1> (2a>2b).
La justice Rawls
Philopsis Dupond Cournarie
4
24
www.philopsis.fr
justice ne concerne pas seulement les institutions politiques, mais aussi le systme
socio-conomique.
Ainsi lobjet de la justice sociale, ce sont, comme nous lavons vu, les
structures de base de la socit qui rpartissent les avantages tirs de la
coopration sociale (p. 33). Sous le voile dignorance, chacun ne peut
raisonnablement demander quun partage gal : le bon sens commande en
premier lieu dadmettre un principe de justice qui exige une rpartition gale pour
tous Ainsi les partenaires dbutent avec un principe qui exige des liberts de
base gales pour tous ainsi quune juste galit des chances et un partage gal des
revenus et des fortunes (p. 182). Mais cela ne veut pas dire que la justice
concide avec lgalit. Le projet de Rawls est de montrer quil ny a pas
dexigence de justice sans exigence dgalit, mais que cette exigence dgalit
doit tre trs prcisment dtermine. Ce qui nous reconduit aux rapports de la
justice et de lquit.
Lexigence dgalit inhrente la justice sexprime en premier lieu dans le
concept de justice comme quit . Lquit dsigne la situation des partenaires
choisissant, dans la position originelle, les principes de la justice rgissant la
structure de base du systme coopratif quils vont former. Cette position
originelle est une position initiale dgalit (p. 37) : il semble raisonnable de
penser que, dans la position originelle, les partenaires sont gaux (p. 46). Et
comme tous ont une situation comparable et quaucun ne peut proposer des
principes favorisant sa condition particulire, les principes de justice sont le
rsultat dun accord ou dune ngociation quitable (Id.) ; il semble raisonnable
de penser que, dans la position originelle, les partenaires sont gaux (46). On voit
ce qui distingue galit et quit. Lgalit qualifie la situation des partenaires ;
lquit qualifie la procdure de dlibration qui conduit au choix des principes de
justice et la justice dsigne le contenu des principes choisis. La justice comme
quit signifie par consquent quil ny a pas de justice si ce nest partir dun
accord quitable sur les principes, en situation dgalit. La justice dans la
situation de dlibration, cest--dire lquit, est cense se transfrer au rsultat
de la dlibration. Cest parce quil y a une juste procdure de dlibration que les
principes organisant la structure de base sont des principes de justice71. Mais parler
de justice comme quit ne signifie pas que la justice se rduise lquit.
Si, sous le voile dignorance, chacun ne peut raisonnablement demander
quun partage gal, pourquoi lingalit ? Il faut ici se souvenir que, nonobstant le
voile dignorance, les partenaires ont une connaissance de la psychologie gnrale
de lhumanit en ce qui concerne les passions et les motivations fondamentales ;
cette connaissance fait partie des prsuppositions accompagnant les conditions du
choix rationnel sous voile dignorance. Les partenaires savent ainsi que :
la socit doit prendre en considration lefficacit conomique et
les exigences de lorganisation et de la technologie. Sil y a des ingalits de
revenus et de fortune, des diffrences dautorit et des degrs de
71
A. Clair ( Laffirmation du droit : rflexions sur la Thorie de la justice de
Rawls , in Revista internazionale di Filosofia des Diritto, 1990, n 4) crit justement :
On peut mme se demander si ce concept <lquit> nest pas le seul pouvoir tre
qualifi de principe, en ceci que lquit caractrise la position originelle en fonction de
laquelle et partir de laquelle seraient choisis les principes de justice (p. 550).
La justice Rawls
Philopsis Dupond Cournarie
5
25
www.philopsis.fr
responsabilit qui tendent amliorer la situation de tous par rapport la
situation dgalit, pourquoi ne pas les autoriser ? Et Rawls continue :
Les partenaires ne refuseraient ces diffrences que si la simple
connaissance ou perception que dautres taient plus avantags les rendait
malheureux ; mais je suppose que leur dcision nest pas motive par lenvie.
Ainsi la structure de base devrait autoriser les ingalits aussi longtemps
quelles amliorent la situation de tous, y compris des plus dsavantags, et
condition quelles soient compatibles avec la libert gale pour tous et une
juste galit des chances (p.182)72.
On voit ainsi que, comme lutilitarisme, Rawls prend en compte la question
de lefficacit, tout en soutenant, contre lutilitarisme, que lefficacit doit tre
maintenue dans le cadre de la contractualit.
En outre les principes de justice dbordent la seule question de la fondation
de lEtat et intgrent la socit civile. Rawls propose donc un profond
renouvellement du schme contractualiste.
Traditionnellement, celui-ci a eu pour effet de soustraire la sphre
conomique la volont gnrale. Considrons par exemple le Contrat social de
Rousseau. Le contrat exige lalination de tous les droits naturels et de toutes les
forces des contractants. Parmi ces forces, il y a la proprit, et une proprit fort
ingalement rpartie, si lon en croit le Discours sur lorigine et les fondements de
lingalit parmi les hommes. Do la question : est-ce que lEtat, au moment o il
restitue leur possesseur les biens alines - qui deviennent, dans lEtat civil,
proprit garantie par la puissance publique -, exerce une redistribution rationnelle,
norme par une rgle de justice, ou entrine-t-il seulement la situation pr-civile
factuelle ? Le Discours sur lorigine et les fondements de lingalit parmi les
hommes parat aller dans le sens de la seconde rponse : le corps politique prend
les individus avec leurs possessions factuelles et, loin de redistribuer les biens
selon une rgle de justice, se contente de donner au statu quo valeur de droit. Do
une solution de continuit entre deux modes de lgitimation de la proprit : la
lgitimation prjuridique et matrielle par le travail et le besoin, et la lgitimation
juridique et formelle par la volont du souverain ;
72
Lide est reprise dans Justice et dmocratie (63) : Ds lors que les partenaires
se considrent comme des personnes de ce genre [libres et gales], il va de soi quils font
lhypothse de dpart que tous les biens premiers sociaux, y compris le revenu et la
richesse, doivent tre gaux, cest--dire que chacun doit en avoir une part gale.
Cependant ils doivent tenir compte dexigences organisationnelles et de lefficacit
conomique. Il nest donc pas raisonnable de sen tenir une rpartition gale. La structure
de base devrait autoriser les ingalits organisationnelles et conomiques, pour autant
quelles amliorent la situation de chacun, y compris celle des plus mal lotis et pourvu que
ces ingalit soient compatibles avec une libert gale pour tous et la juste galit des
chances (p. 63). Les ingalits sont admises sous la condition limitative du principe de
diffrence, parce que a/ les partenaires acceptent les relations dopposition entre les
hommes qui constituent le contexte de la justice et b/ leur dcision nest pas influence
par lenvie . Il est clair que la notion de contexte de justice , reprise de Hume, joue, en
cette problmatique, un rle capital. Les partenaires sont censs accepter les relations
dopposition, tout en tant mutuellement dsintresss. Do la mise hors jeu dune
certaine revendication dgalit conomique, au motif quelle relverait, non du sens de la
justice, mais de lenvie. Sur la question de lenvie, voir aussi TJ pp. 175-176 et 572-584.
La justice Rawls
Philopsis Dupond Cournarie
6
26
www.philopsis.fr
Ainsi lordre politique et lgalit de droit quil suppose perptuent une
ingalit conomique (issue, selon Rousseau, de ltat social pr-civil), dont on
peut craindre quelle ne pervertisse ou nannule lidentit de droit entre lintrt
particulier de chaque citoyen et lintrt gnral du corps politique. Lgalit des
contractants que postule lordre politique risque de rester lettre morte partir du
moment o lEtat civil retient en lui lingalit conomique dont les dangers
constituaient prcisment, selon le Discours sur lorigine et les fondements de
lingalit parmi les hommes, la raison de crer un ordre politique contractuel.
Rousseau est tout fait conscient de cette contradiction. Il observe que
laccumulation des richesses fait de la proprit prive une menace pour la libert.
Le Projet de constitution pour la Corse expose dailleurs un certain nombre de
mesures destines empcher une trop grande ingalit des fortunes73. Il sagit de
limiter le pouvoir politique de largent et dempcher que la dmocratie ne
dgnre en ploutocratie. Mais la prise en compte des facteurs conomiques ne fait
pas partie du contrat social lui-mme. Rawls met fin cette situation : les principes
de justice concernent quivalemment la sphre politique et la sphre conomique.
La rgle du maximin et les droits de crance
Rawls donne plusieurs formulations du second principe de justice. Ainsi au
3 de la Thorie de la justice (p. 41), le principe de diffrence nest pas
exactement formul comme il lest au 11 (p. 91). Selon ce dernier, les ingalits
ne sont justifiables que si elles sont lavantage de chacun , alors que le 3 met
laccent sur lintrt des plus dsavantags :
Le second, lui, pose que des ingalits socio-conomiques, prenons par
exemple des ingalits de richesse et dautorit sont justes si et seulement si
elles produisent, en compensation, des avantages pour chacun, et en
particulier pour les membres les plus dsavantags de la socit . Plus loin :
il ny a pas dinjustice dans le fait quun petit nombre obtienne des
avantages suprieurs la moyenne, condition que soit par l mme
amliore la situation des moins favoriss .
Au 46 (p. 341), cette orientation est encore plus nette :
Les ingalits conomiques et sociales doivent tre telles quelles soient
a) au plus grand bnfice des plus dsavantags dans la limite dun juste
principe dpargne et b) attaches des fonctions et des positions ouvertes
tous, conformment au principe de la juste galit des chances 74.
Sous quel angle la position des plus dfavoriss joue-t-elle le rle de
critre ? Dans la formulation de la page 41, les plus dfavoriss sont un cas
quelconque de tous : lingalit ne contrevient pas la justice si tous, y compris les
plus dfavoriss, y consentent pour un motif rationnel. Les rgles de la distribution
73
Impt progressif sur le revenu, taxe sur les objets de luxe, lois sur lhritage,
cration dun domaine public, lois agraires.
74
Formulation voisine dans Justice et dmocratie : les ingalits sociales et
conomiques doivent procurer le plus grand bnfice aux membres les plus dsavantags
de la socit (156).
La justice Rawls
Philopsis Dupond Cournarie
7
27
www.philopsis.fr
ne doivent pas exclure, sous peine dinjustice, les plus dfavoriss de lunanimit
du consensus. Dans le contexte dun concept procdural de la justice, la
coopration et la distribution des avantages de la coopration sont justes si chacun,
avantag ou non, peut y acquiescer librement.
Dans la formulation plus radicale de la page 341, laccord des plus
dfavoriss devient un vritable critre du juste. On peut donc parler dune sorte de
priorit lexicale du plus dfavoris, comme en tmoigne la rgle du maximin ou de
maximisation de la position des plus dfavoriss. Cette radicalisation permet
Rawls de montrer quil existe deux grandes catgories de principes de justice. La
premire correspond au principe dutilit, principe par excellence de lutilitarisme,
dont la rgle est celle de la maximisation du plus grand bien de lensemble. La
rgle dutilit peut exiger que certains, particulirement les plus dfavoriss,
renoncent aux avantages, au nom dun plus grand bien de lensemble (p. 208), ce
qui nest possible, prcise Rawls, que si ceux qui doivent faire des sacrifices
sidentifient fortement des intrts plus larges que les leurs . La seconde
correspond la rgle du maximin. Ici la sympathie ou lidentification un intrt
supra-personnel ne sont plus ncessaires ; la raison, au sens dune intelligence juste
de lintrt rciproque, suffit. Cest cette seconde rgle qui aura la prfrence des
partenaires choisissant les principes de justice sous voile dignorance. Quest-ce
qui justifie cette prfrence75 ? Plusieurs raisons interviennent.
La premire argument serait un argument moral : la rgle du maximin
organise les ingalits pour lavantage rciproque ; elle ne laisse pas jouer
librement les contingences naturelles et sociales qui rglent arbitrairement la
rpartition des responsabilits, des pouvoirs, des avantages sociaux. Elle favorise
donc le respect mutuel des personnes et le respect vis--vis delles-mmes 76. Elle
est prescrite par la rgle morale imposant aux hommes de se traiter les uns les
autres, non seulement comme moyens, mais toujours en mme temps comme fins :
dans la structure sociale, cela veut dire renoncer aux avantages qui ne contribuent
pas aux attentes de tous. Au contraire, traiter des personnes comme des moyens
veut dire quon est prt imposer ceux qui sont dj dfavoriss des perspectives
de vie encore plus limites au nom des attentes plus leves des autres (p. 103).
La seconde prend en compte les rgles de la dlibration rationnelle. Quand
nous avons choisir entre plusieurs options et en labsence de toute possibilit de
calculer des probabilits, il est rationnel de hirarchiser les diverses solutions en
fonction du plus mauvais rsultat possible : nous devons choisir la solution dont le
plus mauvais rsultat est suprieur chacun des plus mauvais rsultats des
autres solutions. On a comment cette situation en disant que la rgle du maximin
est celle que choisirait une personne pour planifier une socit dans laquelle son
ennemi lui assignerait sa place 77.
Un troisime argument concerne lexigence de stabilit : Quand nous
concluons un accord, nous devons tre capables de le raliser, mme si les pires
ventualits se ralisent - On ne peut pas se mettre daccord sur un principe sil
75
Voir en particulier p.184-187 et 206-214.
TJ pp. 208-209 : La reconnaissance publique des deux principes donne un plus
grand soutien au respect de soi-mme t ceci, son tour, augmente lefficacit de la
coopration sociale
77
C. Audard, Principes de justice et principes du libralisme : la neutralit de la
thorie de Rawls , in Individu et justice sociale. Autour de John Rawls, Seuil, p. 181.
76
La justice Rawls
Philopsis Dupond Cournarie
8
28
www.philopsis.fr
y a une possibilit relle quil ait un rsultat que lon ne pourra pas accepter (p.
214). Or il nest pas raisonnable desprer que les moins favoriss acceptent des
sacrifices au nom des avantages du grand nombre, comme le demande le principe
dutilit. Nous retrouvons l une ide centrale de Rawls : les partenaires faisant
choix des principes de justice sont mutuellement dsintresss (p. 40). Cela rpond
lexigence de rduire au minimum les prsuppositions. En lespce, on sabstient
de supposer quil y ait en eux une sympathie ou une bienveillance ou un sens du
sacrifice, en tant que condition de lordre social. Dire quils sont mutuellement
dsintresss ou mutuellement indiffrents, cest dire que lon renonce penser
que les contradictions sociales puissent tre netralises par la sympathie naturelle
(dont on peut par ailleurs reconnatre lexistence, mais sans soutenir que la justice
est fonde sur elle). Les partenaires, dans la position originelle, agissent seulement
en vue de leur avantage rciproque.
Selon ce troisime argument, donc, il est ainsi impossible dattendre une
stabilit de lordre social quand la rgle de lavantage rciproque nest pas
respecte (comme sous le rgne du principe dutilit o le dsavantage des uns est
compens par le plus grand avantage du plus grand nombre) moins que les
dfavoriss ne sidentifient lintrt du tout. Or on ne peut fonder aucun principe
de justice stable sur cette ventuelle identification des dfavoriss lintrt du
tout.
On comprend aussi par l que, selon la Thorie de la justice, la mise en
uvre dune exigence de justice ne prsuppose pas une raison pratique au sens de
Kant, mais puisse rsulter des simples principes dune dlibration rationnelle,
laquelle serait donc la condition suffisante du choix des principes de justice.
Le premier principe de justice comporte lui aussi plusieurs formulations.
Ainsi, dans Justice et dmocratie, Rawls ne parle plus du systme le plus tendu
des liberts , mais de systme pleinement adquat (p.156) de liberts. Cette
reformulation souligne que la libert se ralise seulement par un accord
raisonnable sur les restrictions qui doivent limiter les liberts de telle sorte que leur
exercice conjugu soit effectivement possible. Le systme adquat des liberts est
celui dans lequel les restrictions constitutionnelles ou lgales garantissent aux
individus une facult dagir conforme leur nature rationnelle. Do peuvent venir
ces restrictions ?
Elles viennent dabord du conflit des liberts. Les liberts de base sont en
conflit les uns avec les autres et se limitent rciproquement. Rawls parle ainsi
dune tension entre la libert des Anciens - reprsente par Rousseau qui accorde
la priorit aux liberts politiques gales pour tous et aux valeurs de la vie publique
et considre les liberts civiles comme subordonnes - et la libert des Modernes
- reprsente par Locke et qui met au premier plan la libert civile, en particulier la
libert de conscience et de pense, les droits de base de la personne, les droits de
proprit et dassociation78. Rawls admet une priorit de la libert des Modernes :
les liberts de pense et de conscience, la libert de la personne et les liberts
civiques ne doivent pas tre sacrifies la libert de participer, dans lgalit, aux
affaires politiques (TJ p.237)
78
TJ p. 260 et Justice et dmocratie, p. 79 et p. 197.
La justice Rawls
Philopsis Dupond Cournarie
9
29
www.philopsis.fr
Les restrictions viennent aussi de la ncessit de prendre en compte la notion
de valeur dune libert (TJ p. 240 ; JD p. 184) : la libert ne doit pas tre gale
seulement formellement, elle doit ltre, autant que possible rellement. Les
principes de justice autorisent cependant que certains aient une richesse plus
grande ou un revenu plus lev, cest--dire plus de moyens pour raliser leurs
fins, la condition cependant que le principe de diffrence soit respect : cette
moindre valeur de la libert est compense dans le sens suivant : les moyens
polyvalents disponibles afin que les membres les plus dsavantags de la socit
ralisent leurs fins seraient encore moindres si les ingalits sociales et
conomiques taient diffrentes de ce quelles sont. La structure de base de la
socit est organise de telle sorte quelle maximise les biens premiers disponibles
pour les moins avantags afin quils utilisent les liberts de base la disposition de
tous (TJ p. 184).
Le principe de diffrence stipule donc que la richesse et les revenus doivent
tre rpartis de telle sorte que le moins avantag obtienne le maximum de valeur
dusage de ces liberts galement rparties.
Le ddoublement des principes de justice (que Rawls dsigne comme
assez diffrents ) est destin permettre la priorit du premier sur le second.
Cette priorit signifie que jamais une restriction de la libert nest autorise par une
maximisation du bien-tre de tous ou par une rduction de lingalit
conomique79. La priorit du premier principe de justice sexplique parce quil
concerne les intrts de lordre le plus lev . Les partenaires de la position
originelle ignorent le contenu particulier de leurs intrts, ils savent seulement
quils ont des intrts et que les liberts de base sont les conditions qui protgent
leurs intrts (ainsi lintrt religieux est garanti par la libert de conscience gale
pour tous) ; dans la mesure o les liberts de base protgent les intrts, elles sont
elles-mmes des intrts de lordre le plus lev (au sens o ils conditionnent tous
les autres intrts).
Mais ce que prsuppose aussi cet ordre lexical, cest quil y ait une
opposition tendancielle entre libert et galit ou que trop accorder lexigence
dgalit soit un danger pour la libert. On reconnat l une dmarche dinspiration
librale80 Mais doit-on admettre le concept, hrit de la pense librale, dun
79
p. 239 : une libert de base dpendant du premier principe ne peut tre limite
quau nom de la libert elle-mme, cad seulement pour garantir que la mme libert de
base ou une autre est correctement protge et pour ajuster le systme unique de libert de
la meilleure manire . Voir aussi Justice et dmocratie, p. 160 : on ne peut pas refuser
certains groupes sociaux les liberts politiques gales sous prtexte que, sils les exeraient,
cela leur permettrait de bloquer des politiques essentielles lefficacit et la croissance
conomiques . On remarquera ainsi que la priorit lexicale de la libert vise assurer la
primaut de la libert sur lefficacit conomique, mais non la rigueur sur les droits de
crance. La pense rawlsienne veut manifestement chapper lopposition traditionnelle
entre droits-libert et droits-crances. Les principes de justice tablissent la fois les rgles
de la libert et de la plus haute valeur dusage pour chacun de la libert. La
revendication dgalit conomique est cense tre prise en compte dans le principe de
diffrence, qui maximise la valeur dusage de la libert.
80
F.A. Hayek soutient quil y antinomie entre justice sociale et libert et nous
place devant lalternative suivante : ou bien vous abandonnez toute revendication en vue de
La justice Rawls
Philopsis Dupond Cournarie
0
30
www.philopsis.fr
antagonisme entre la libert et lgalit de telle sorte quun choix entre elles serait
ncessaire ? Ces questions soulignent que la notion rawlsienne dordre lexical
admet certains prsupposs exigeant une discussion critique.
Le kantisme de Rawls
On peut se demander, pour conclure, quel est le sens de cette rfrence de
Rawls Kant dans cette thorie de la justice comme quit. cette rfrence peut
tre aborde sous deux points de vue, lun concernant le concept de justice, lautre
concernant le concept de raison.
Rawls distingue deux types de conceptions de la justice : les unes sont
dontologiques, les autres tlologiques.
La conception tlologique du juste fonde le juste sur une vise commune
du bien. Une telle orientation remonte Platon et Aristote. Dans lesprit de Rawls,
elle est exemplairement illustre par lutilitarisme : le bien y est dfini
indpendamment du juste et ensuite le juste est dfini comme ce qui maximise le
bien (TJ p.50). Rawls prcise que les thories tlologiques exercent une
attraction profonde sur lintuition puisquelles semblent incarner lide de
rationalit. Il est naturel de dfinir la rationalit par la maximisation et, en morale,
par la maximisation du bien . Quelles objections peut-on leur adresser ?
Certaines des objections que Rawls leur oppose sadressent lutilitarisme
et soulignent que lutilitarisme ne correspond pas notre intuition de la justice, en
ce quil est incapable de reconnatre le droit de la personne comme valable en soi
ou intrinsquement. Dautres objections, moins tournes vers lutilitarisme, font
valoir que les rgimes dmocratiques modernes, foncirement pluralistes quant aux
conceptions du bien, sont incapables de fonder sur une telle diversit un accord
rflchi entre les citoyens sur les rgles de justice. Il sagit donc de fonder des
rgles de justice partir dune poch frappant les conceptions du bien, ce qui est
lune des fonctions du voile dignorance.
La conception dontologique du juste est dinspiration kantienne. Elle
dfinit le juste indpendamment du bien et par lexigence rationnelle
duniversalisation de la maxime. En outre le juste est demble compris comme
une limite impose chacun dans la recherche de son bien : leurs dsirs et leurs
aspirations sont limites ds le dbut par les principes de justice qui dfinissent les
bornes que nos systmes de fins doivent respecter (TJ p. 58). Comprise dans
lorientation de la philosophie du contrat, lexigence duniversalisation de la
maxime signifie que le bien de la socit ne peut tre recherch que sous la
prsupposition dune dfinition contractuelle de lordre social et de la justice.
Lorientation de Rawls est dontologique en ce quelle affirme la priorit du
juste sur le bien : dans la thorie de la justice comme quit, le concept du juste
est antrieur celui du bien (TJ p. 57). Il est vrai que toute la Thorie de la
justice sordonne un concept du bien, au sens du bien que vise une personne, la
ralisation de son projet rationnel de vie fond sur ses aspirations, ses capacits et
la connaissance du milieu social o elle a agir, au sens aussi des biens sociaux
lgalisation des conditions sociales, ou bien vous allez vers un totalitarisme destructeur de
libert. Si lon refuse le totalitarisme, alors il faut, selon Hayek, revenir vers une
conception librale de lEtat. Celui-ci doit se contenter de crer la socit de droit qui
permet la loi immanente du march dexercer sa fonction rgulatrice.
La justice Rawls
Philopsis Dupond Cournarie
1
31
www.philopsis.fr
primaires , dont la distribution est lobjet des principes de justice. Mais ce
concept premier du bien est formalis : il ne suppose pas que les partenaires aient
certaines fins particulires, mais seulement quils dsirent certains biens premiers
(TJ p. 290), qui sont les conditions de lobtention de nimporte quel bien. Cette
formalisation assure la priorit du juste sur le bien puisque, en dcidant des
principes de justice, les partenaires ne sentendent pas sur une notion commune du
bien mais dterminent seulement la forme acceptable de rpartition des moyens,
partir desquels chacun pourra poursuivre son bien . Un ordre juste en gnral
dfinit les conditions de compatibilit et dacceptabilit universelle des projets de
vie.
De l limportance du concept de procdure. La fondation contractuelle des
principes de justice est, dclare Rawls, une thorie purement procdurale de la
justice ou une thorie de justice procdurale pure81. Une procdure de justice est
dite pure lorsquelle nest pas soumise la dfinition pralable dun critre du juste
et de linjuste, lorsque, en dautres termes le critre du juste et de linjuste, au lieu
de prcder et de fonder la procdure de mise en uvre, est cens rsulter
ncessairement de la forme mme de la procdure. Ainsi dans la choix des
principes de justice sous voile dignorance, on ne prsuppose pas une dfinition
matrielle du juste qui serait lobjet dune reconnaissance commune et dun
accord. Ce nest rien dautre que laccord unanime qui dsigne les principes de
justice comme principes de justice. Les rgles de justice ne sont rien dautre que ce
qui est dfini par laccord quitable entre les membres de la coopration sociale.
Do lexclusion de lide de droit naturel.
Cest ici que prend sens la rfrence Kant. Rawls crit : on peut
considrer la position originelle comme une interprtation procdurale de la
conception kantienne de lautonomie et de limpratif catgorique (TJ p. 293). a
lencontre de lutilitarisme, Rawls raffirme la signification morale de lexigence
de justice, comprise, kantiennement, comme exigence duniversalit82.
En outre la priorit du juste sur le bien prolonge la problmatique kantienne
du devoir et de la non primaut des fins du vouloir. Les principes de justice ne sont
pas des rgles matrielles mais des rgles dvaluation formelle dterminant si une
norme est quitable, quel que soit son contenu.
Larticulation avec Kant se fait encore par le concept de contrat. Rawls crit
que parmi toutes les conceptions traditionnelles, je crois que cest celle du
contrat qui se rapproche le mieux de nos jugements bien pess sur la justice et qui
constitue la base morale qui convient le mieux une socit dmocratique . La
fondation consensuelle des principes de justice sous voile dignorance peut ainsi
tre rapproche du contrat originaire kantien 83. Il sagit dans les deux cas dune
ide rgulatrice offrant une norme rationnelle aux principes de lordre politique..
81
TJ p. 118 : A loppos, la justice procdurale pure sexerce quand il ny a pas de
critre indpendant pour dterminer le rsultat correct ; au lieu de cela, cest une procdure
correcte ou quitable qui dtermine si un rsultat est galement correct ou quitable, quel
quen soit le contenu, pourvu que la procdure ait t correctement applique .
82
Est juste toute action qui permet ou dont la maxime permet la libert de
larbitre de tout un chacun de coexister avec la libert de tout autre selon une loi
universelle (Doctrine du Droit, C).
83
Doctrine du Droit, 47.
La justice Rawls
Philopsis Dupond Cournarie
2
32
www.philopsis.fr
Cependant, malgr cet hritage kantien, le concept rawlsien de raison nest
plus exactement celui de Kant ; alors que Kant exclut toute considration du
bonheur, de lamour de soi, de lintrt du champ de lautonomie, Rawls
prsuppose que les partenaires choisissant les principes de justice sous voile
dignorance sont des personnes libres et rationnelles, dsireuses de favoriser
leurs propres intrts et places dans une position initiale dgalit (TJ p. 34).
On peut exprimer cette distance autrement. Kant distingue rigoureusement
deux rgimes de la raison quil dsigne par les termes d humanit et de
personnalit , en soulignant que la premire nimplique pas la seconde84. Le
droit comme lthique ont pour prsupposition le concept de personnalit et non le
simple concept dhumanit. Or la fondation de la justice, chez Rawls parat bien
relever de ce que Kant appelle humanit puisque, nous dit-il, le concept de raison
oprant dans la fondation de la justice doit tre interprt, dans la mesure du
possible, au sens troit courant dans la thorie conomique, cest--dire comme la
capacit demployer les moyens les plus efficaces pour atteindre les fins dsires.
Relve du mme cart la mise hors jeu, dans la Thorie de la justice, de la
fondation transcendantale kantienne au profit dune fondation strictement
consensuelle85. paul Ricur prsente ainsi la Thorie de la justice comme une
dontologie sans fondation transcendantale en observant que, selon Rawls, la
fondation transcendantale implique des critres objectifs du juste, risquant de
rintroduire en dernier ressort des prsuppositions matrielles concernant le
bien.On peut aussi invoquer le niveau auquel se situe Rawls pour penser la justice,
cest--dire le niveau institutionnel. Ce qui carterait la fondation transcendantale
kantienne, ce serait aussi le projet daborder la question du juste sur le plan
institutionnel, et non par celui des individus et des rapports entre individus.
Mais le consensus, laccord quitable peuvent-ils tre vraiment considrs
comme des fondements suffisants de la justice ? On rappellera que ltablissement
84
La religion dans les limites de la simple raison, Vrin, p. 45 : De ce quun tre a
de la raison, il ne sensuit pas du tout que celle-ci contienne une facult pour dterminer
inconditionnellement le libre-arbitre par la simple reprsentation de la qualification de ses
maximes pour une lgislation universelle et par consquent pour tre en soi pratique .
85
Cette fondation commune parat commune Rawls et lthique de la
discussion. Alain Renaut ( Habermas ou Rawls , in Rseaux, n 60, juillet-aot 1993) a
trs justement montr que les divergences ne doivent pas dissimuler une orientation
commune dans la rception de lhritage kantien : a pragmatique universelle de Habermas
et Apel poursuit un but similaire celui du voile dignorance : reconstruire lespace formel
dune discussion argumente qui, sur la base dexigences de validit reconnues en
commun, aboutisse lexplicitation et la fondation consensuelle de principes de justice.
Chez Rawls comme dans lthique de la discussion, la fondation des normes universelles a
donc lieu partir de la dimension transactionnelle de la sphre pratique. Cest sur ce socle
commun que se dveloppe la diffrence. Avec son concept de voile dignorance, Rawls
aurait donn la norme une validit monologique. Habermas objecte que la discussion sert
rtablir un consensus qui a t troubl lors de conflits ns dans linteraction et qui ne
pourra tre rtabli que par le dgagement dune volont commune, obtenue dans une
discussion relle.
Voir aussi sur cette question J.F. Kervegan : Y a t-il une philosophie librale ?
Remarques sur les uvres de J. Rawls et de F. von Hayek , in Rue Descartes, n 3,
Citoyennet, dmocratie, rpublique , janvier 1992, pp. 51-77 ; voir aussi J.M. Ferry,
Philosophie de la communication, 2, Cerf, 1994.
La justice Rawls
Philopsis Dupond Cournarie
3
33
www.philopsis.fr
des principes de justice est guide par des convictions bien peses , au nombre
desquelles pourrait figurer la Rgle dOr ou une de ses variantes.
Do lambigut du statut des partenaires choisissant les principes de
justice. Rawls les prsente la fois comme des sujets strictement rationnels, au
sens de la rationalit instrumentale, et comme des sujets moraux, cest--dire des
tres rationnels ayant leur propre systme de fins et capables, selon moi, dun sens
de la justice (TJ p. 37). Rawls ne considre pas comme essentielle cette
diffrence puisque son propos est de fonder et de justifier par la seule puissance de
la dlibration rationnelle et de la raison instrumentale des principes de justice qui
pour nous ont une signification morale, mais qui ne sont pas adopts au motif de
leur caractre moralement obligatoire. Ainsi raison instrumentale et raison morale
pourraient-elles se rejoindre, au point que lexigence de la seconde soit
intgralement assume par la premire. Mais on peut alors se demander si la
dlibration rationnelle des partenaires choisissant les principes de justice nest pas
dentre de jeu et implicitement oriente par le caractre moral de lexigence de
justice, ce qui tmoignerait du caractre irrductible de notre pr-comprhension
du juste. On se demandera ainsi si la rgle du maximin que les partenaires
choisissent, au dtriment du principe dutilit, est vraiment la consquence de
lintelligence, en chacun, de son intrt bien compris, ou bien si elle nest pas
plutt une consquence de lobligation faite chacun de traiter lhumanit en sa
personne, comme en la personne de lautre, non seulement comme moyen, mais
toujours en mme temps comme fin. Cette question nous invite valuer le rle, en
thique, des arguments rationnels et de la dlibration, qui peuvent tre considrs
soit comme une vritable invention de la rgle pratique, soit comme le passage de
nos convictions antcdentes au crible de largumentation et de la libre
discussion86.
Laurent Cournarie
Pascal Dupond
86
Andr Clair (art. cit, p. 566) fait apparatre une dimension thique de la
rationalit fondatrice de la justice jusque dans la position originelle : Remarquons dj
que la construction de la position originelle nest pas aussi dgage de toute perspective
thique quil ny parat. En effet, le point essentiel, cest la stricte galit des partenaires
qui, exempts de toute dtermination particulire, partagent exactement les mmes
connaissances et les mmes ignorances. La prsentation de lhypothse est donc
implicitement la prsentation dun modle thique, celui prcisment de lquit. Ainsi,
dune certaine manire, on ne dduit lthique quen se la donnant initialement, en la
prsupposant .
La justice Rawls
Philopsis Dupond Cournarie
4
34
www.philopsis.fr
Bibliographie
Ouvrages principaux de Rawls
- Justice as Fairness , The philosophical Review, n 22, 1958, traduction
franaise de J.F. Spitz, La justice comme quit , Philosophie, n 14, 1984.
- A Theory of Justice, Harvard University Press, 1971, traduction franaise
de C. Audard, Thorie de la justice, Seuil, 1987.
- Justice et dmocratie (articles de 1978 1989), traduction sous la direction
de C. Audard, Seuil, 1993.
- Justice as Fairness, a Restatement, polycopi, Harvard University,
Cambridge, 1990.
- Political Liberalism, Columbia University Press, 1993, traduction franaise
de C. Audard, Libralisme politique, PUF, 1995.
- Dbat sur la justice politique, Cerf, 1997
Quelques ouvrages et articles consacrs Rawls
Ladrire J., Fondements dune thorie de la justice, Louvain-La-Neuve,
1984.
- Lge de la science n 1, Ethique et philosophie politique , mai 1988.
- Revue de mtaphysique et de morale, John Rawls, le politique n 1,
1988.
- Individu et justice sociale. Autour de John Rawls, Seuil, 1988.
- Critique, John Rawls. Justice et liberts , n 505-506, 1989.
Clair, A., Laffirmation du droit : rflexions sur la Thorie de la justice de
Rawls , Revista internazionale di Filosofia del Diritto, 1990, n 4.
- Renaut A. et Sosoe L., Philosophie du droit, PUF, 1991.
- Van Parijs P., Quest-ce quune socit juste ?, Seuil, 1991
- Kervegan J.F., Y a t-il une philosophie librale ? Remarques sur les
uvres de J. Rawls et F. von Hayek , Rue Descartes, n 3, Citoyennet,
dmocratie, rpublique , janvier 1992, pp. 51-77.
- Hffe O., Principes du droit, Cerf, 1993
- Renaut A., Habermas ou Rawls , Rseaux, n 60, juillet-aot 1993
- Ferry J.M., Philosophie de la communication, 2, Cerf, 1994
- Bidet J., John Rawls et la thorie de la justice, PUF, 1995.
- Boyer A., Justice et galit , Notions de philosophie, III, Folio, 1995
- Ricur P., Soi-mme comme un autre, Seuil, 1990 ; Lectures 1, Seuil,
1991 ; Le Juste, d. Esprit, 1995
La justice Rawls
Philopsis Dupond Cournarie
5
35
www.philopsis.fr
Table
Introduction la Thorie de la justice de Rawls ............................................................... 1
Introduction la lecture de la Thorie de la justice.................................................. 2
Les difficults de lecture : la situation franaise................................................... 2
But et mthode de la Thorie de la justice ............................................................ 3
Lintrt philosophique de la Thorie de la justice .............................................. 9
Analyse des principes de la thorie de la justice comme quit ............................ 14
La justice comme quit contre lutilitarisme..................................................... 14
La justice comme quit................................................................................... 14
La justice contre lutilit .................................................................................. 15
Une thorie des principes de justice .................................................................... 20
Les principes de justice .................................................................................... 20
La rlaboration du concept de justice : justice et justice sociale ................. 24
La rgle du maximin et les droits de crance.................................................. 27
Le kantisme de Rawls....................................................................................... 31
Bibliographie............................................................................................................. 35
Ouvrages principaux de Rawls ............................................................................ 35
Quelques ouvrages et articles consacrs Rawls ............................................... 35
Table .......................................................................................................................... 36
La justice Rawls
Philopsis Dupond Cournarie
6
36
Vous aimerez peut-être aussi
- Putnam (Hilary) - Philosophie de La Logique PDFDocument40 pagesPutnam (Hilary) - Philosophie de La Logique PDFArnOmkarPas encore d'évaluation
- Traité théologico-politique de Spinoza: Les Fiches de lecture d'UniversalisD'EverandTraité théologico-politique de Spinoza: Les Fiches de lecture d'UniversalisPas encore d'évaluation
- Althusser, Louis - Philosophie Et Philosophie Spontanée Des Savants-François Maspero (1974)Document162 pagesAlthusser, Louis - Philosophie Et Philosophie Spontanée Des Savants-François Maspero (1974)Rhapsode_00Pas encore d'évaluation
- Libertés et droits fondamentaux: Essai d'une théorie générale ouverte sur les expériences étrangèresD'EverandLibertés et droits fondamentaux: Essai d'une théorie générale ouverte sur les expériences étrangèresPas encore d'évaluation
- H - Putnam PhiloSophie de La Logique 1971 PDFDocument40 pagesH - Putnam PhiloSophie de La Logique 1971 PDFTasedlistPas encore d'évaluation
- Philosophie analytique: Les Grands Articles d'UniversalisD'EverandPhilosophie analytique: Les Grands Articles d'UniversalisPas encore d'évaluation
- Comprendre FoucaultDocument141 pagesComprendre Foucaultemremert100% (1)
- Fondements de la métaphysique des moeurs d'Emmanuel Kant: Les Fiches de lecture d'UniversalisD'EverandFondements de la métaphysique des moeurs d'Emmanuel Kant: Les Fiches de lecture d'UniversalisPas encore d'évaluation
- C. S. Peirce Et Le Pragmatisme - Claudine TiercelinDocument174 pagesC. S. Peirce Et Le Pragmatisme - Claudine TiercelinjeanlucboutinPas encore d'évaluation
- Théorie bidimensionnelle de l'argumentation juridiqueD'EverandThéorie bidimensionnelle de l'argumentation juridiquePas encore d'évaluation
- LLPHI133IntroductionlalogiquelogiquepropositionnelleB HalimiPremirepartie PDFDocument37 pagesLLPHI133IntroductionlalogiquelogiquepropositionnelleB HalimiPremirepartie PDFSouaïbou BabaPas encore d'évaluation
- Raymond Ruyer, Dumoncel (Commentaire)Document32 pagesRaymond Ruyer, Dumoncel (Commentaire)Juan CamiloPas encore d'évaluation
- Le Pragmatisme américain et anglais: Étude historique et critique suivie d'une bibliographie méthodiqueD'EverandLe Pragmatisme américain et anglais: Étude historique et critique suivie d'une bibliographie méthodiquePas encore d'évaluation
- 7.ap Int 11 07Document16 pages7.ap Int 11 07CarlosSánchezEchevarríaPas encore d'évaluation
- Politique des limites, limites de la politique: La place du droit dans la pensée de Hannah ArendtD'EverandPolitique des limites, limites de la politique: La place du droit dans la pensée de Hannah ArendtPas encore d'évaluation
- Philosophie Du DroitDocument6 pagesPhilosophie Du DroitMetouganaPas encore d'évaluation
- Le Droit Des Gens by Rawls, JohnDocument160 pagesLe Droit Des Gens by Rawls, JohnMhammed100% (1)
- Considerations Morales I.1Document11 pagesConsiderations Morales I.1Sébastian-Xavier Katz PinoPas encore d'évaluation
- Vincent Descombes Le Raisonnement de L'ours - Et Autres Essais de Philosophie Pratique 2007 PDFDocument458 pagesVincent Descombes Le Raisonnement de L'ours - Et Autres Essais de Philosophie Pratique 2007 PDFrolf100% (2)
- VIII. John Rawls, Une Théorie Politique de La JusticeDocument10 pagesVIII. John Rawls, Une Théorie Politique de La JusticerichardPas encore d'évaluation
- MEMOIRE Axiologie RUYERDocument74 pagesMEMOIRE Axiologie RUYERJean-Paul Oury100% (1)
- (Friedrich A. Hayek) Droit Legislation Et Liberte PDFDocument269 pages(Friedrich A. Hayek) Droit Legislation Et Liberte PDFnicoleta5aldeaPas encore d'évaluation
- Philosophie Du Droit USAKINDocument58 pagesPhilosophie Du Droit USAKINalfredPas encore d'évaluation
- Philosophie Et Theorie Du Droit Ou L Illusion ScientifiqueDocument32 pagesPhilosophie Et Theorie Du Droit Ou L Illusion ScientifiqueDelphin LindjiPas encore d'évaluation
- ÉthiqueDocument258 pagesÉthiqueparnouldPas encore d'évaluation
- De L'autonomie de La Volonté À La Justice Commutative. Du Mithe À La Réalité. ChénedéDocument28 pagesDe L'autonomie de La Volonté À La Justice Commutative. Du Mithe À La Réalité. ChénedéCésar E. Moreno MorePas encore d'évaluation
- Philosophie Analytique de La ReligionDocument23 pagesPhilosophie Analytique de La ReligionTCHEAKPONTE Anglele100% (1)
- Tiercelin - Peirce Et Le PragmatismeDocument82 pagesTiercelin - Peirce Et Le PragmatismeJuste BouvardPas encore d'évaluation
- Mérites Du Réalisme Dispositionnel Ou de Quelques Suggestions Pour Constituer La Métaphysique Comme ScienceDocument23 pagesMérites Du Réalisme Dispositionnel Ou de Quelques Suggestions Pour Constituer La Métaphysique Comme ScienceAsher GutkindPas encore d'évaluation
- La Sociologie Des Conventions. La Theorie Des Conventions, Element Central Des Nouvelles Sciences Sociales Francaises.Document13 pagesLa Sociologie Des Conventions. La Theorie Des Conventions, Element Central Des Nouvelles Sciences Sociales Francaises.Filip TrippPas encore d'évaluation
- Pouvoir Etre Soi RicoeurDocument40 pagesPouvoir Etre Soi RicoeurAurélia PeyricalPas encore d'évaluation
- Liberté Morale Et Causalité Chez Cudworth PDFDocument29 pagesLiberté Morale Et Causalité Chez Cudworth PDFsantseteshPas encore d'évaluation
- B. Russell - La Définition de " (La) Vérité" PDFDocument13 pagesB. Russell - La Définition de " (La) Vérité" PDFArnOmkar100% (1)
- Perelman - A Filosofia Do Raciocínio PDFDocument11 pagesPerelman - A Filosofia Do Raciocínio PDFJuan ErllePas encore d'évaluation
- 167 KanabusB TheorieDT RCritiqueDocument18 pages167 KanabusB TheorieDT RCritiqueFernando AmorimPas encore d'évaluation
- L'idée D'une Fondation Ultime de La Rationalité Philosophique Du Point de Vue de La Pragmatique TranscendantaleDocument7 pagesL'idée D'une Fondation Ultime de La Rationalité Philosophique Du Point de Vue de La Pragmatique Transcendantaleflore moussavoumPas encore d'évaluation
- Philosophie Et Theorie Du Droit Ou L Illusion ScientifiqueDocument32 pagesPhilosophie Et Theorie Du Droit Ou L Illusion ScientifiqueYuri SilvaPas encore d'évaluation
- I. Le Texte Et Ses ThématiquesDocument27 pagesI. Le Texte Et Ses ThématiquesPaulo AlvesPas encore d'évaluation
- Lucien Jaume-Les Origines Philosophiques Du Libéralisme-Flammarion (2009) PDFDocument392 pagesLucien Jaume-Les Origines Philosophiques Du Libéralisme-Flammarion (2009) PDFGeorgPas encore d'évaluation
- Corpus N°49Document383 pagesCorpus N°49awa soumarePas encore d'évaluation
- Philo Droit PDFDocument124 pagesPhilo Droit PDFAhmedCommunistePas encore d'évaluation
- Sophie LAVERAN. Le Problème de La Composition Politique Chez Spinoza Philonsorbonne-387Document24 pagesSophie LAVERAN. Le Problème de La Composition Politique Chez Spinoza Philonsorbonne-387Carlos PachecoPas encore d'évaluation
- Chaïm Perelman. de La Nouvelle Rhétorique À La Logique Juridique-2012Document277 pagesChaïm Perelman. de La Nouvelle Rhétorique À La Logique Juridique-2012Mounir100% (2)
- Balibar, E. - Spinoza Et La Politique PDFDocument127 pagesBalibar, E. - Spinoza Et La Politique PDFLuis Enrique CastroPas encore d'évaluation
- Boris Barraud, La Théorie Du DroitDocument24 pagesBoris Barraud, La Théorie Du DroitBen Younes ImenPas encore d'évaluation
- L'homme Du Possible PDFDocument427 pagesL'homme Du Possible PDFSalma EMPas encore d'évaluation
- 6Document23 pages6xgbhc100% (1)
- Ar 3elag Alse7r IbnbazDocument10 pagesAr 3elag Alse7r IbnbazhiuehfuehPas encore d'évaluation
- Paul Ricoeur PDFDocument418 pagesPaul Ricoeur PDFHans Bogaert100% (5)
- Foucault Hermeneutique Du SujetDocument19 pagesFoucault Hermeneutique Du SujetRosa O'Connor AcevedoPas encore d'évaluation
- La Pratique de La MoralitéDocument19 pagesLa Pratique de La MoralitéAfaf IsmailiPas encore d'évaluation
- Victor Delbos (1911), " Husserl. Sa Critique Du Psychologisme Et Sa Conception "Document14 pagesVictor Delbos (1911), " Husserl. Sa Critique Du Psychologisme Et Sa Conception "Thomas VongehrPas encore d'évaluation
- Introduction Cours DépistémologieDocument14 pagesIntroduction Cours DépistémologieChris JeanPas encore d'évaluation
- CoPhilo Du Droit Kinshasa Ucc 2020-2021A - 595241631Document51 pagesCoPhilo Du Droit Kinshasa Ucc 2020-2021A - 595241631JoelatitungPas encore d'évaluation
- Résumé de TexteDocument5 pagesRésumé de TexteWendinda BougmaPas encore d'évaluation
- Une Histoire de La RaisonDocument3 pagesUne Histoire de La RaisonLouis BergPas encore d'évaluation
- B. Barraud, Qu'est-Ce Que Le Droit Théorie Syncrétique Et Échelle de JuridicitéDocument223 pagesB. Barraud, Qu'est-Ce Que Le Droit Théorie Syncrétique Et Échelle de JuridicitéKosenot440Pas encore d'évaluation
- GILLES DELEUZE - Critique Et CliniqueDocument94 pagesGILLES DELEUZE - Critique Et CliniquePaolo Capelletti100% (6)
- Delbos Theorie Kantienne LiberteDocument25 pagesDelbos Theorie Kantienne Liberteachille7Pas encore d'évaluation
- And Raul T Bernad Vitalis MeDocument19 pagesAnd Raul T Bernad Vitalis MeKhouloud AdouliPas encore d'évaluation
- Introduction A La PhilosophieDocument186 pagesIntroduction A La PhilosophieKhouloud AdouliPas encore d'évaluation
- KantDocument17 pagesKantKhouloud AdouliPas encore d'évaluation
- Foucault Michel Dits Et Ecrits 3 1976-1979.Document420 pagesFoucault Michel Dits Et Ecrits 3 1976-1979.Zirtaeb Sadaseuq Rojas100% (1)
- Habermas L'intégration Répulicaine Compte RenduDocument7 pagesHabermas L'intégration Répulicaine Compte RenduKhouloud AdouliPas encore d'évaluation
- Citations de Spinoza Expliquées PDFDocument88 pagesCitations de Spinoza Expliquées PDFKhouloud AdouliPas encore d'évaluation
- Spinoza TTP ExplicationDocument4 pagesSpinoza TTP ExplicationKhouloud AdouliPas encore d'évaluation
- Pierre Macherey Querelles CartésiennesDocument49 pagesPierre Macherey Querelles CartésiennesKhouloud AdouliPas encore d'évaluation
- Querelles Cartésiennes Débat Entre Alquié Et Guéroult Adouli KhouloudDocument7 pagesQuerelles Cartésiennes Débat Entre Alquié Et Guéroult Adouli KhouloudKhouloud Adouli100% (1)
- 70 BeauvoirDocument30 pages70 BeauvoirMlle FrancaisePas encore d'évaluation
- Philosophie Et Histoire de La PhilosophiDocument16 pagesPhilosophie Et Histoire de La PhilosophiKhouloud AdouliPas encore d'évaluation
- Jacques Derrida L'Ecriture Et La DifferenceDocument437 pagesJacques Derrida L'Ecriture Et La DifferenceVeronica Olariu100% (9)
- 29 Juin 1955: (Davar) (Davar)Document20 pages29 Juin 1955: (Davar) (Davar)Nicolas GomesPas encore d'évaluation
- Explication de Texte Gorgias Sophie LaveranDocument5 pagesExplication de Texte Gorgias Sophie LaveranFrance Culture67% (9)
- Comment Vaincre La PeurDocument5 pagesComment Vaincre La Peurkendy GeorgesPas encore d'évaluation
- La Révolution À L'heure de L'islam Abdessalam YassineDocument242 pagesLa Révolution À L'heure de L'islam Abdessalam YassineMohamed Fadeli0% (1)
- Date Limite - 20 Juillet 2019, Tenons Bon !Document91 pagesDate Limite - 20 Juillet 2019, Tenons Bon !van deerben guyeenPas encore d'évaluation
- Pelagius - Anacrise Pour Avoir La Communication Avec Son Bon Ange GardienDocument21 pagesPelagius - Anacrise Pour Avoir La Communication Avec Son Bon Ange GardienMarkus MüllerPas encore d'évaluation
- Abrégé Du Traité de La Nature Humaine by Hume DavidDocument36 pagesAbrégé Du Traité de La Nature Humaine by Hume Davidzaim techPas encore d'évaluation
- La Réverbération Logique. La Phénoménologie Des Prolégomènes À La Logique Pure de Husserl PDFDocument30 pagesLa Réverbération Logique. La Phénoménologie Des Prolégomènes À La Logique Pure de Husserl PDFAnonymous PSO0vRfPas encore d'évaluation
- Reviser Bac Philo PDFDocument50 pagesReviser Bac Philo PDFziggy00zaggy88% (8)
- What Is The Holy GhostDocument44 pagesWhat Is The Holy GhostulrichPas encore d'évaluation
- Type D'Arguments - PDF - Argumentation - Induction (Logique)Document1 pageType D'Arguments - PDF - Argumentation - Induction (Logique)Olivier KridisPas encore d'évaluation
- Le Perfectionnement Des SaintsDocument61 pagesLe Perfectionnement Des Saintskyky1ivyPas encore d'évaluation
- Le Druidisme Et Ses SymbolesDocument20 pagesLe Druidisme Et Ses SymbolesBelloṷesus ĪsarnosPas encore d'évaluation
- L'Amour - Le Secret de Votre Succès - Gloria CopelandDocument14 pagesL'Amour - Le Secret de Votre Succès - Gloria CopelandGRACIENPas encore d'évaluation
- Nietzsche - Pourquoi J'écris de Si Bons LivresDocument53 pagesNietzsche - Pourquoi J'écris de Si Bons Livresscrazed100% (1)
- La Verite Sur Le MensongeDocument24 pagesLa Verite Sur Le MensongeCharly GANSOUPas encore d'évaluation
- Méthode DissertationDocument3 pagesMéthode Dissertation2pmmjqc7qcPas encore d'évaluation
- Nuh PDFDocument563 pagesNuh PDFMarcel RobertPas encore d'évaluation
- Histoire en CoursDocument2 pagesHistoire en CoursClaire DonneckePas encore d'évaluation
- SEANCE 3 SOFT SKILLS 5 (Assertivité)Document14 pagesSEANCE 3 SOFT SKILLS 5 (Assertivité)Lamia El FassiPas encore d'évaluation
- Maurice Blanchot - L'Echec de BaudelaireDocument19 pagesMaurice Blanchot - L'Echec de BaudelaireLazare FaustPas encore d'évaluation
- La Naissance de La PhilosophieDocument208 pagesLa Naissance de La PhilosophieFrédéric Dautremer0% (1)
- L'amour de Dieu. Martyn Lloyd-JonesDocument162 pagesL'amour de Dieu. Martyn Lloyd-JonesnixonkouassiPas encore d'évaluation
- AMORC - Harvey Spencer Lewis - L'Illumination Psychique - Texte OriginalDocument12 pagesAMORC - Harvey Spencer Lewis - L'Illumination Psychique - Texte OriginalSolipsist Ant100% (2)
- Jeff Foster Renonce À L'advaita VedantaDocument24 pagesJeff Foster Renonce À L'advaita VedantaNEMESIUSPas encore d'évaluation
- John Nelson DarbyDocument10 pagesJohn Nelson DarbyreussavelPas encore d'évaluation
- Département de Français Moderne de L'université de Genève - La Figuration de SoiDocument72 pagesDépartement de Français Moderne de L'université de Genève - La Figuration de SoiOblomov 2.0Pas encore d'évaluation
- Histoire de La Langue Roumaine (1901)Document556 pagesHistoire de La Langue Roumaine (1901)Jean-Noël Soissons100% (2)
- Force Mentale et Maîtrise de la Discipline: Renforcez votre Confiance en vous pour Débloquer votre Courage et votre Résilience ! (Comprend un Manuel Pratique en 10 Étapes et 15 Puissants Exercices)D'EverandForce Mentale et Maîtrise de la Discipline: Renforcez votre Confiance en vous pour Débloquer votre Courage et votre Résilience ! (Comprend un Manuel Pratique en 10 Étapes et 15 Puissants Exercices)Évaluation : 4.5 sur 5 étoiles4.5/5 (28)
- Introduction à la psychologie des émotions: De Darwin aux neurosciences: découvrir les émotions et leur mode de fonctionnementD'EverandIntroduction à la psychologie des émotions: De Darwin aux neurosciences: découvrir les émotions et leur mode de fonctionnementPas encore d'évaluation
- L'Assertivité au Quotidien: Le Guide Pratique en 4 Étapes pour une Affirmation de Soi au Quotidien, des Limites Saines et Plus de Confiance; Plan d'Action en 20 Étapes pour Améliorer la CommunicationD'EverandL'Assertivité au Quotidien: Le Guide Pratique en 4 Étapes pour une Affirmation de Soi au Quotidien, des Limites Saines et Plus de Confiance; Plan d'Action en 20 Étapes pour Améliorer la CommunicationÉvaluation : 5 sur 5 étoiles5/5 (7)
- Hypnotisme et Magnétisme, Somnambulisme, Suggestion et Télépathie, Influence personnelle: Cours Pratique completD'EverandHypnotisme et Magnétisme, Somnambulisme, Suggestion et Télépathie, Influence personnelle: Cours Pratique completÉvaluation : 4.5 sur 5 étoiles4.5/5 (8)
- 101 Choses À Savoir Sur Le Sexe Et Sa Vie Intime: Le Sexe Dont Vous Avez Toujours RêvéD'Everand101 Choses À Savoir Sur Le Sexe Et Sa Vie Intime: Le Sexe Dont Vous Avez Toujours RêvéPas encore d'évaluation
- Ce que doit savoir un Maître Maçon (Annoté): Les Rites, l'Origine des Grades, Légende d'HiramD'EverandCe que doit savoir un Maître Maçon (Annoté): Les Rites, l'Origine des Grades, Légende d'HiramÉvaluation : 5 sur 5 étoiles5/5 (4)
- Le livre de la mémoire libérée : Apprenez plus vite, retenez tout avec des techniques de mémorisation simples et puissantesD'EverandLe livre de la mémoire libérée : Apprenez plus vite, retenez tout avec des techniques de mémorisation simples et puissantesÉvaluation : 4 sur 5 étoiles4/5 (6)
- Enseigner une Langue Etrangère Par l’Apprentissage HybrideD'EverandEnseigner une Langue Etrangère Par l’Apprentissage HybridePas encore d'évaluation
- Anges & Jinn; Qui sont-ils?: Série sur les Connaissances Islamiques des EnfantsD'EverandAnges & Jinn; Qui sont-ils?: Série sur les Connaissances Islamiques des EnfantsPas encore d'évaluation
- La Pensée Positive en 30 Jours: Manuel Pratique pour Penser Positivement, Former votre Critique Intérieur, Arrêter la Réflexion Excessive et Changer votre État d'Esprit: Devenir une Personne Consciente et PositiveD'EverandLa Pensée Positive en 30 Jours: Manuel Pratique pour Penser Positivement, Former votre Critique Intérieur, Arrêter la Réflexion Excessive et Changer votre État d'Esprit: Devenir une Personne Consciente et PositiveÉvaluation : 4.5 sur 5 étoiles4.5/5 (12)
- Essai sur le libre arbitre: Premium EbookD'EverandEssai sur le libre arbitre: Premium EbookÉvaluation : 4 sur 5 étoiles4/5 (1)
- L'Interprétation des rêves de Sigmund Freud: Les Fiches de lecture d'UniversalisD'EverandL'Interprétation des rêves de Sigmund Freud: Les Fiches de lecture d'UniversalisPas encore d'évaluation
- Jeunesse africaine: jeunesse sacrifiée?D'EverandJeunesse africaine: jeunesse sacrifiée?Évaluation : 4 sur 5 étoiles4/5 (5)
- Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes: la matrice de l'oeuvre morale et politique de Jean-Jacques RousseauD'EverandDiscours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes: la matrice de l'oeuvre morale et politique de Jean-Jacques RousseauPas encore d'évaluation
- Dictionnaire de la Sociologie: Les Dictionnaires d'UniversalisD'EverandDictionnaire de la Sociologie: Les Dictionnaires d'UniversalisPas encore d'évaluation
- Mémento 5e et 6e degrés du R.E.A.A.: Paroles de Maître Parfait et Secrétaire IntimeD'EverandMémento 5e et 6e degrés du R.E.A.A.: Paroles de Maître Parfait et Secrétaire IntimeÉvaluation : 5 sur 5 étoiles5/5 (1)
- De la démocratie en Amérique - Édition intégraleD'EverandDe la démocratie en Amérique - Édition intégralePas encore d'évaluation
- Témoins de Jéhovah et Franc-Maçonnerie : l'enquête vérité: Inclus : l'histoire du nom JéhovahD'EverandTémoins de Jéhovah et Franc-Maçonnerie : l'enquête vérité: Inclus : l'histoire du nom JéhovahPas encore d'évaluation
- Le TDA/H chez l'adulte: Apprendre à vivre sereinement avec son trouble de l'attentionD'EverandLe TDA/H chez l'adulte: Apprendre à vivre sereinement avec son trouble de l'attentionPas encore d'évaluation
- Le B.A.-Ba de la communication: Comment convaincre, informer, séduire ?D'EverandLe B.A.-Ba de la communication: Comment convaincre, informer, séduire ?Évaluation : 3 sur 5 étoiles3/5 (1)
- Aimez-Vous en 12 Étapes Pratiques: Un Manuel pour Améliorer l'Estime de Soi, Prendre Conscience de sa Valeur, se Débarrasser du Doute et Trouver un Bonheur VéritableD'EverandAimez-Vous en 12 Étapes Pratiques: Un Manuel pour Améliorer l'Estime de Soi, Prendre Conscience de sa Valeur, se Débarrasser du Doute et Trouver un Bonheur VéritableÉvaluation : 5 sur 5 étoiles5/5 (4)
- Les cent faits divers les plus fous de 2017D'EverandLes cent faits divers les plus fous de 2017Évaluation : 4 sur 5 étoiles4/5 (1)
- Vaincre le Destin : l'Idéal, l'art de Réussir, le Bonheur.D'EverandVaincre le Destin : l'Idéal, l'art de Réussir, le Bonheur.Pas encore d'évaluation