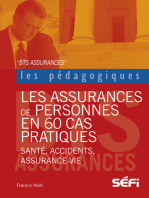Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
La Responsabilite Social de L'entreprise NOUVEAU
Transféré par
Nor Nor CHTitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
La Responsabilite Social de L'entreprise NOUVEAU
Transféré par
Nor Nor CHDroits d'auteur :
Formats disponibles
ECOLE MIAGE
Dédicace
Nous dédions ce travail à toutes les personnes ayant contribué
De près ou loin à la rédaction de ce projet.
Nous le dédions aussi à nos chers parents, nos frères, ainsi à
Toutes nos familles et nos amis.
Nous tenons aussi à le dédie à tous nos formateurs et
L’équipe administratives de l’Etablissement –MIAGE- salé, En
Tant que superviseur sur ce projet Pour leurs efforts, conseilles
Et motivations continus afin de nous préparer.
RESPONSABILITE SOCIALE D’ENTREPRISE 1 2016-2017
ECOLE MIAGE
Remerciement
Avant de commencer, je tiens a remercier Monsieur Nor-eddine CHTIOUI, notre
formateur et encadreur pour ce projet, qui grâce a ses efforts et ses conseils, je me
suis donner a fond dans ce projet de mémoire de fin d’étude .
Je voudrais remercier encours la directrice Mme HIDA Asmaa et tout le personnel
de l’école MIAGE-SALE pour leur sympathie et leur gentillesse ont contribuées
d’une façon ou d’une autre à la bonne réalisation de mémoire fin mes études.
RESPONSABILITE SOCIALE D’ENTREPRISE 2 2016-2017
ECOLE MIAGE
Introduction
Dans le cadre de fin de formation en filière management et gestion je choisi un sujet
pour applique tout les informations qu’on prend dans la période de mes étude ce
sujet il est une relation très important avec la gestion des ressource humain et le titre
de ce sujet :
La responsabilité sociétale (ou sociale) des entreprises (RSE) est la prise en compte
par celles-ci, sur une base volontaire, des préoccupations sociales et
environnementales dans leurs activités et dans leurs interactions avec les autres
acteurs, appelés "parties prenantes". Elle constitue une forme de prise en charge par
l'entreprise des préoccupations sociales, économiques et environnementales qui peut
être traduit en terme de développement durable appliqué aux entreprises qui signifie
une prise en compte par l'entreprise des questions sociales et environnementales tout
en les combinant avec ses préoccupations économiques et financières. Sur ce, il
s'avère impérieux pour toute entreprise qui œuvre dans n'importe quel domaine ou
secteur d'activité d'intégrer dans son portefeuille (ses activités) les préoccupations
sociales.
A l'heure actuelle du réchauffement climatique, des scandales financiers à répétition,
de controverse sur le comportement éthique des dirigeants et de la globalisation des
échanges, peu de personnes doutent encore du fait que l'entreprise, en tant qu'entité
organisée et localisée au cœur des changements économiques et sociaux
contemporains constitue une affaire sociale.
L'idée de la responsabilité sociale de l'entreprise, en sigle RSE, répond à cet enjeu,
proposant l'intégration des préoccupations sociales, environnementales et
économiques dans les activités des entreprises .Cela suppose que l'entreprise doit non
seulement rendre compte à ses actionnaires et maximiser son profit, mais aussi
RESPONSABILITE SOCIALE D’ENTREPRISE 3 2016-2017
ECOLE MIAGE
rendre compte à la société humaine des l'impact environnemental et social de ses
activités .
Le concept de la RSE, directement lié à la notion de développement durable dont la
réalisation des objectifs comporte une triple approche : celle de prendre en charge les
questions environnementales et sociales en les combinant avec les préoccupations
économiques et financières de l'entreprise
Notre travail s'efforcera de répondre aux préoccupations suivantes :
- De savoir ce qu'est la responsabilité sociale ?
- Envers qui et pour quel motif doit-on se sentir responsable ?
- L'entreprise doit-elle jamais se sentir responsable ? Pourquoi oui ou non ?
- Envers qui devrait-elle éventuellement se sentir responsable ?
- Quels serait la raison et le fondement d'une responsabilité éventuelle ?
RESPONSABILITE SOCIALE D’ENTREPRISE 4 2016-2017
ECOLE MIAGE
PARTIE N1 : LA GENERALITE SUR LA RESPONSABILITE
SOCIALE D’ENTREPRISE
RESPONSABILITE SOCIALE D’ENTREPRISE 5 2016-2017
ECOLE MIAGE
CH1 : PRESENTATION ET LES DIFFERENT TYPE DE L’ENTREPRISE
I- PRESENTATION DE L’ENTREPRISE
Entreprise désigne une unité institutionnelle créée dans la perspective de produire et
de fournir des biens et services à des personnes, physiques ou moral. Pour exister
légalement, une entreprise est tenue d'opter pour l'une des formes particulières .et
dans le but de vendue la maximisation de produit pour satisfaire les besoin du
consommateur.
II- les différents types D’entreprise :
Plusieurs éléments permettent de distinguer les différentes entreprises entre elles.
Leur taille d'abord, avec un classement qui comprend les catégories micro-
entreprise, TPE (très petite entreprise), PME (petite et moyenne entreprise),
jusqu'aux groupes d'entreprises et entreprises étendues. Et organisation ou une unité
institutionnelle, , en politiques et en plans d'action, dont le but est de produire et de
fournir des biens ou des services à destination d'un ensemble de clients ou usagers,
tout en réalisant un bénéfice. En plus Il existe une multitude d’entreprises qui
diffèrent selon leur forme, leur taille ou encore le secteur d’activité…
1. Les différentes formes des entreprises
a. Des différences selon la taille :
Les entreprises ont des tailles très différentes de l’entreprise individuelle au groupe
qui emploie.
des milliers de personnes dans le monde entier, on distingue en général :
• Les entreprises individuelles : une seule personne (le créateur) en fait partie.
• Les Très Petites Entreprises (TPE) qui comptent en général moins de 10 salariés.
Elles représentent néanmoins plus de 9 entreprises sur 10 en France.
• Les Petites et Moyennes Entreprises (PME) qui comptent moins de 500 salariés.
• Les grandes entreprises qui comptent plus de 500 salariés et sont souvent
internationalisées. Elles ne représentent que 0.1 % des entreprises françaises mais
emploient près d’un tiers des salariés.
RESPONSABILITE SOCIALE D’ENTREPRISE 6 2016-2017
ECOLE MIAGE
SECTION I : EMERGENCE ET LES CONCEPTS DE RESPONSABILITE
SOCIALE DE L’ENTREPRISE
I-HISTORIQUE DE LA RESPONSABILITE SOCIALE DE L’ENTREPRISE
La responsabilité sociale des entreprises (RSE) est une notion très en vogue et suscite
de nombreux débats tant chez les académiciens que les praticiens. Toutefois, le
vocabulaire généralement associé à la RSE - valeurs, éthique, développement
durable, etc. - indique une absence flagrante quant au sens et la portée de la RSE.
Ainsi, il apparait à notre sens pertinent de s’interroger sur l’histoire de la RSE afin
d’en cerner les fondements en stratégie et d’appréhender certains facteurs explicatifs
des débats contemporains autour de la RSE. C’est dans cet esprit que cette étude, en
proposant d’analyser les classiques en stratégies et d’en présenter les grandes lignes
en matière de RSE, s’inscrit dans une démarche visant à cerner la construction de la
notion de RSE et à reconstituer une partie de sa généalogie. Notre étude suggère trois
conclusions principales. Premièrement, la notion de parties prenantes et celle de
responsabilité sociale sont imbriquées et présentées comme complémentaires par la
littérature de base en stratégie. Deuxièmement, la responsabilité sociale des
entreprises et la réalisation de profits ne sont à priori pas antinomiques ; alors que les
profits représentent une nécessité de survie, la responsabilité sociale évoque quant à
elle une responsabilité morale des institutions. Troisièmement, les valeurs des
dirigeants influenceront généralement les pratiques des entreprises en termes de
degré de responsabilité sociale.
RESPONSABILITE SOCIALE D’ENTREPRISE 7 2016-2017
ECOLE MIAGE
II- EVALUATION DE LA RESPONSABILITE SOCIAL DE L’ENTREPRISE :
Il existe certains principes dans la réalité de travail qu'appliquent les gestionnaires
afin de reconnaître la conduite sociale appropriée. On peut les regrouper en trois
catégories, notamment :
- La responsabilité économique ;
- La responsabilité légale ;
- La responsabilité morale.
A-La responsabilité économique :
A un premier niveau, les gestionnaires ont la responsabilité de maximiser la richesse
(bénéfices) des actionnaires. Ce point de vue est depuis longtemps défendu .Il
implique simplement que la responsabilité première des dirigeants d'une entreprise
consiste à générer des bénéfices pour ses actionnaires. fut le premier à soutenir cette
doctrine en lui expliquant que les entreprises profitent à la société lorsqu'elles
peuvent améliorer le rendement et maximiser les bénéfices.
En effet, une entreprise à même d'enregistrer des bénéfices peut demeurer active et
employer des travailleurs.
Dans le cadre du cours de politique d'entreprise, la mission d'entreprise est de
produire les biens et/ou services et de les mettre à la disposition de la société
humaine, la maximisation de la richesse des actionnaires, n'est qu'objectif spécifique
parmi tant d'autres qui concourent à la réalisation de l'objectif ultime de l’entreprise.
B- La responsabilité légale :
A un deuxième niveau, les entreprises ont la responsabilité de se conformer aux
règles et aux règlements définis par les organismes gouvernementaux. Ces derniers
RESPONSABILITE SOCIALE D’ENTREPRISE 8 2016-2017
ECOLE MIAGE
établissent un processus de réglementation auquel tous les citoyens et les organismes
doivent se plier pour assurer le bon fonctionnement de la société. Les
réglementations gouvernementales existent à des fins économiques et sociales. Un
gouvernement peut aussi le faire pour éviter que les consommateurs n'achètent des
biens de mauvaise qualité et pour éliminer le plus possible la pollution de l'air et de
l’eau.
c-La responsabilité morale :
La responsabilité morale est la nécessité pour une personne de répondre de ses
intentions et de ses actes devant sa conscience.
La responsabilité morale est la responsabilité considérée en tant que valeur, d'un
point de vue éthique ou moral. C'est la capacité pour la personne de prendre une
décision en toute conscience, sans se référer préalablement à une autorité supérieure,
à pouvoir donner les motifs de ses actes, et à pouvoir être jugé sur eux.
Une autre caractéristique de la responsabilité morale est qu'il n'y a pas prescription.
Contrairement à la loi civile, La responsabilité morale survit perpétuellement à
l'action, pouvant prendre la forme de remords ou de contentement.
La principale condition de la responsabilité morale est la liberté, c'est-à-dire le fait de
pouvoir agir librement, d'être soi-même la cause de ses actions, sans quoi ce serait à
cette cause qu'incomberait la responsabilité. Cette question de la liberté d'action de
l'individu et de la responsabilité morale fait l'objet d'un débat philosophique pour
savoir si elle est compatible avec le déterminisme dans les actions humaines.
RESPONSABILITE SOCIALE D’ENTREPRISE 9 2016-2017
ECOLE MIAGE
II-EVALUATION DE LA RESPONSABILITE SOCIALE DE L’ENTREPRISE :
La plupart des dirigeants s’accordent aujourd’hui sur l’intérêt de renforcer la
performance de leur gestion des ressources humaines. Parallèlement, certains d’entre
eux – surtout dans les grandes entreprises – tentent de s’inscrire dans une démarche
de développement durable. Au croisement de ces deux notions, le premier
mouvement est de se centrer sur l’évaluation, ce qui ne va pas sans soulever bien des
difficultés. Il est tentant d’expliquer ces difficultés par la nouveauté du champ et la
rusticité des instruments de mesure. Un peu d’expérience et un savoir-faire technique
plus élaboré suffiraient à surmonter les obstacles. Et, bien sûr, il ne manque pas de
conseils pour prétendre qu’ils ont sur le sujet une certaine avance… A l’opposé de
cette orientation, les auteurs observent que la sophistication des instruments est sans
rapport avec les effets qu’ils produisent. Avant d’évaluer, il faut dire de quoi on
parle. Or les notions de performance de la GRH et de responsabilité sociale
d’entreprise sont loin d’être stabilisées. Leurs définitions sont elles-mêmes,
aujourd’hui encore, un enjeu de confrontations et de débats. Ils examinent ensuite le
caractère de nouveauté. S’il y a nouveauté, elle n’est pas là où on l’imagine : il y a
longtemps déjà que l’on a tenté d’évaluer le lien entre performance de la GRH et la
responsabilité sociale de l’entreprise. Pour ne prendre que cet exemple, l’idée qu’une
entreprise doit non seulement se soucier de sa rentabilité et de sa croissance, mais
aussi de ses impacts sociaux n’est-elle pas à la base du bilan social ? La nouveauté
réside davantage dans le réseau d’acteurs qui s’est mobilisé sur le sujet. Situé aux
frontières d’une entreprise désormais plus ouverte, il emprunte à la fois aux
organisations et à leur environnement. D’où l’intérêt d’identifier les acteurs
composant ce méso-système et de caractériser leurs liens. Pour terminer, les auteurs
s’interrogent sur la façon dont va se structurer le lien entre ces deux domaines. Ils
décrivent alors les deux grandes formes de régulation qui s’affrontent aujourd’hui
(régulation marchande vs régulation institutionnelle) pour tenter de (ré) concilier
l’économique et le social.
RESPONSABILITE SOCIALE D’ENTREPRISE 10 2016-2017
ECOLE MIAGE
Section II-LE ROLE DE LA RESPONSABILITE SOCIALE DE L’ENTREPRISE :
La notion de RSE est actuellement souvent évoquée dans une perspective de triple
résultats qui conduit à évaluer la performance de l’entreprise sous trois angles :
environnemental (compatibilité entre l’activité de l’entreprise et le maintien des
écosystèmes), social (conséquences sociales de l’activité de l’entreprise) et
économique (performance financière), tendance qui paraît résulter de divers facteurs
de contexte ayant significativement marqué ces dernières années - dont deux
essentiels : 1) la mondialisation des produits et des marques ; 2) l’accroissement des
écarts sociaux entre les populations et l’épuisement des ressources naturelles au
profit des pays riches. Les entreprises se voient de plus en plus obligées de remplir
leur rôle social et de combler les échecs du marché et des Etats dans la régulation des
droits sociaux.
I--LA RESPONSABILITE SOCIALE DE L’ENTREPRISE ET LE
DEVELLOPEMENT DURABLE.
Le développement durable est l’idée que les sociétés humaines doivent exister et
répondre à leurs besoins sans compromettre la capacité des générations futures à
répondre à leurs propres besoins.
Concrètement, cela signifie que l’humanité doit se développer en prenant en compte
les aspects économiques, mais aussi en respectant l’environnement, et en créant les
conditions d’une société juste et harmonieuse. Contrairement au développement
économique, le développement durable est un développement qui prend en compte
trois dimensions : économique, environnementale et sociale. Voici quelques
RESPONSABILITE SOCIALE D’ENTREPRISE 11 2016-2017
ECOLE MIAGE
exemples des crises économiques et sociales qui ont secoué le monde au XXème
siècle :
1907 : crise bancaire américaine
1923 : crise de l’hyperinflation américaine
1929 : la crise financière des années 1930 commence
1968 : mouvement social de mai 1968 en France et dans le monde
1973 et 1979 : chocs pétroliers
1982 : choc de la dette des pays en développement
Et quelques exemples de crises écologiques
1954 : retombées nucléaires de Rongelap
1956 : crise du mercure de Minamata
1957 : marée noire de Torrey Canyon
1976 : catastrophe Seveso
1984 : catastrophe de Bhopal
1986 : catastrophe nucléaire de Tchernobyl
1989 : marée noire de l’Exxon Valdez
1999 : catastrophe Erika
Plus les sociétés ont été confrontées à ces crises, plus la prise de conscience de la
nécessité d’un développement plus responsable a été forte.
II-L’ENTENDUE DE LA RESPONSABILITE SOCIALE DE L’ENTREPRISE :
Bien que l'on puisse expliquer souverainement ce qu'est la responsabilité sociale de
l'entreprise, les intervenants éprouvent la difficulté à s'entendre sur une définition. En
présence des questions sociales nombreuses et diverses, certains déclarent que les
entreprises sont tenues de résoudre l'ensemble des problèmes sociaux. Par contre,
RESPONSABILITE SOCIALE D’ENTREPRISE 12 2016-2017
ECOLE MIAGE
d'autres soutiennent que leur rôle en tant qu'agents sociaux devrait être plus limité.
Sur ce, il y a quatre modes de conduite (14(*)) que peuvent adopter les entreprises en
matière de la responsabilité sociale au sein de la société.
- Mode de conduite classique : l'entreprise cherche à savoir que dit la loi ?
- Mode de conduite réactif : quelle la réaction des intervenants ?
- Mode de conduite axé sur l'interaction avec les intervenants : quelles sont les
préoccupations et les priorités des intervenants ?
- Mode de conduite proactif : a-t-il intégré les préoccupations et priorités de la
société aux éléments prioritaires et aux plans stratégiques de l'entreprise ?
RESPONSABILITE SOCIALE D’ENTREPRISE 13 2016-2017
ECOLE MIAGE
CH2 : ENTREPRISE ET LE SYSTEME SOCIAL
SECTION 1 : Responsabilité sociale d’entreprise ET SANTE SECURITE DANS
LA VIE GENEREALE D’entreprise.
A l'heure actuelle, il n'y a pas à proprement parler de régulation sociale de la sous-
traitance en France, mais il existe plusieurs dispositions parcellaires:
- Une régulation économique de 1975, qui vise à protéger le sous-traitant des
difficultés économiques rencontrées par le donneur d'ordres et lui assurant une
garantie de paiement;
- Une loi sur le travail illégal, qui oblige tout donneur d'ordres à s'assurer - au-delà de
toute commande dépassant les 3000 € - du respect d'un certain nombre d'obligations
administratives, sociales et fiscales par le sous-traitant;
- Une série de dispositions sur le transfert d'entreprises (article L 122-12 du Code du
Travail), qui reprennent celles de la directive européenne sur le même thème;
- Une disposition de la loi de modernisation sociale (article L. 432-1-2 du Code du
Travail), qui impose à l'entreprise d'informer les sous-traitants des projets de
restructurations.
A ces dispositions visant explicitement la sous-traitance, il faut ajouter:
- Une réglementation en matière de santé-sécurité (1992) au travail sur les travaux
entrepris par une entreprise «extérieure» sur le site d'une autre entreprise.
- Une modification toute récente (2002) de la législation sur les comités d'hygiène,
de sécurité et de conditions de travail visant à étendre leur champ de compétences
aux entreprises sous-traitantes (suite notamment à l'accident industriel de l'usine
RESPONSABILITE SOCIALE D’ENTREPRISE 14 2016-2017
ECOLE MIAGE
Total Fina Elf de Toulouse qui a mis en cause le recours à la sous-traitance pour des
travaux à «risques»);
- Un principe général de responsabilité de l'employeur par rapport à tout ce qui se
passe sur le «site» de l'entreprise (y compris l'intervention de sous-traitants);
SECTION 1 : RESPONSABILITE SOCIALE DE L’ENTREPRISE ET SANTE
SECURITE DANS LA VIE GENEREALE D’ENTREPRISE :
A l'heure actuelle, il n'y a pas à proprement parler de régulation sociale de la sous-
traitance en France, mais il existe plusieurs dispositions parcellaires:
- Une régulation économique de 1975, qui vise à protéger le sous-traitant des
difficultés économiques rencontrées par le donneur d'ordres et lui assurant une
garantie de paiement;
- Une loi sur le travail illégal, qui oblige tout donneur d'ordres à s'assurer - au-delà de
toute commande dépassant les 3000 € - du respect d'un certain nombre d'obligations
administratives, sociales et fiscales par le sous-traitant;
- Une série de dispositions sur le transfert d'entreprises (article L 122-12 du Code du
Travail), qui reprennent celles de la directive européenne sur le même thème;
- Une disposition de la loi de modernisation sociale (article L. 432-1-2 du Code du
Travail), qui impose à l'entreprise d'informer les sous-traitants des projets de
restructurations.
A ces dispositions visant explicitement la sous-traitance, il faut ajouter:
- Une réglementation en matière de santé-sécurité (1992) au travail sur les travaux
entrepris par une entreprise «extérieure» sur le site d'une autre entreprise.
RESPONSABILITE SOCIALE D’ENTREPRISE 15 2016-2017
ECOLE MIAGE
- Une modification toute récente (2002) de la législation sur les comités d'hygiène,
de sécurité et de conditions de travail visant à étendre leur champ de compétences
aux entreprises sous-traitantes (suite notamment à l'accident industriel de l'usine
Total Fina Elf de Toulouse qui a mis en cause le recours à la sous-traitance pour des
travaux à «risques»);
- Un principe général de responsabilité de l'employeur par rapport à tout ce qui se
passe sur le «site» de l'entreprise (y compris l'intervention de sous-traitants);
I-LA genèse de la responsabilité sociale d’entreprise:
Une petite genèse de la responsabilité sociale d’entreprise permet de mieux
appréhender d’une doctrine de la responsabilité sociale d’entreprise encadrant les
pratique des hommes d’affaire américaine.
Durant la seconde révolution industrielle elle répond tout autant a une inspiration
religieuse protestante .le principe déminant de ce début de théorisation de la
responsabilité sociale d’entreprise.
Et pour Howard Bowen en la responsabilité social d’entreprise constitue une
troisième voie situe a mi chemin entre la régulation étatique et le pur laisse-faire
sorte d’autorégulation par les entreprise elle-même autrement dit la performance de
la responsabilité sociale d’entreprise évalue a sa capacité a générer un niveau de bien
être plus élève dans la société.
Comme le démontre l’ouvrage d’Howard Bowen la responsabilité sociale
d’entreprise puise ses fondements dans la religion ce livre fait partie d’une série de
six ouvrage consacre a l’application de la doctrine protestante au monde des affaire
et aux problèmes économique.
RESPONSABILITE SOCIALE D’ENTREPRISE 16 2016-2017
ECOLE MIAGE
II-LA LEGISALATION SUR LA RESPONSABILITE SOCIALE
D’ENTREPRISE :
A-LA LEGISLATION INTERNATIONALE :
L’ancien secrétaire général de l’ONU Koffi Annan est le moteur principal de la
résurgence de la responsabilité sociale d’entreprise.
Il invita les dirigeants des grand entreprise international .et pour les principe du pacte
mondial en matière de la responsabilité sociale d’entreprise que devient respecter les
entreprise sont deux principe aux droit de l’homme :
-promouvoir et respecter le droit international relatif au droit de l’homme.
-veiller a ce que leurs propres compagnies ne soient pas complices de violation des
droits de l’homme.
Et il y a quatre principes relatifs aux normes de travail :
-respecter la liberté d’association et reconnaitre le droit de négociation collective.
-élimination de tout les de travail force et obligatoire.
-abolition effective du travail des enfants.
-élimination de la discrimination en matière d’emploi et de profession.
RESPONSABILITE SOCIALE D’ENTREPRISE 17 2016-2017
ECOLE MIAGE
Section II : RECOUVRE ET LA CONCEPT DE RESPONSABILITE SOCIALE
D’ENTREPRISE :
I-RSE ET CREATION DE VALEUR UNE RELATION DEVOILEE :
A une époque où L'ancrage des activités RSE dans les attitudes managériales des
entreprises est de plus en plus perceptible, nombreux sont les auteurs qui s'intéressent
désormais au lien qui existerait entre RSE et création de richesse. Nous nous sommes
servis des écrits de ces auteurs pour parachever la première partie de ce travail de
recherche. Nous avons ainsi pu cerner les différents aspects de la relation qui
existerait entre responsabilité sociétale et création de valeur. Il en ressort une relation
tridimensionnelle : négative, neutre ou positive. Toutefois, ces différents aspects de
la relation entre RSE et création de valeur sont issus d'un construit uniquement
historique.
Cette partie, purement empirique, vise à présenter le lien entre politiques RSE et
création de valeur dans un contexte particulier. Pour y parvenir, nous avons mené
une étude expérimentale sur deux catégories de parties prenantes : les parties
prenantes internes (les salariés) et les parties prenantes externes (les sous-traitants,
clients, fournisseurs, ONG et l'ensemble de la société civile). L'objectif ici est de
savoir si la RSE comme levier de création de valeur, crée de la richesse uniquement
pour les actionnaires (valeur actionnariale) ou pour toutes les parties prenantes
(valeur partenariale). Cette partie, également divisée en deux chapitres, décrit
entièrement la démarche adoptée lors de la collecte, de l'analyse et de l'interprétation
des résultats (chapitre 3) ; puis, met en exergue la contribution de la RSE à la
création de valeur.
RESPONSABILITE SOCIALE D’ENTREPRISE 18 2016-2017
ECOLE MIAGE
II- Raison du choix des multinationales comme population de la recherche :
Trois principales raisons ont motivé le choix des multinationales comme population
appropriée pour ce travail de recherche : elles sont premièrement économiques,
sociétales et surtout pragmatiques.
S'agissant des raisons économiques, les multinationales sont très fortement
représentées dans l'économie camerounaise. En effet, en 2008, elles représentent
36% des entreprises installées au Cameroun28(*) . Elles sont en outre réparties dans
différents secteurs d'activité comme suit : les services (36%), l'industrie (25%), le
secteur primaire (18%), le commerce (15%), et le secteur du bâtiment et des travaux
publics (3%). Les secteurs des services et de l'industrie étant ceux qui semblent les
attirer le plus (de par leurs pourcentages élevés), nous avons retenu les entreprises
MTN, Orange, Nestlé, SCR Maya, SABC et Guinness comme champ d'investigation.
S'agissant des raisons sociétales, on peut noter que ces entreprises ont une culture
orientée vers des engagements sociaux et environnementaux remarquables. Aussi,
partant du fait que leurs filiales camerounaises subissent l'influence notoire des
sociétés-mères, ces activités extra-économiques font nécessairement partie de leur
quotidien. On a d'ailleurs remarqué qu'elles adaptent ces activités extra financières au
contexte camerounais marqué au départ par un taux de chômage élevé, une pollution
non négligeable de la couche d'ozone, en bref, par l'absence de véritables pratiques
responsables d'entreprises.
Enfin, les raisons pragmatiques concernent non seulement les actions RSE, mais
surtout, la notion de création de valeur. En effet, c'est une notion qu'on rencontre
dans les grandes entreprises cotées. Aussi, face à la situation actuelle du marché
financier camerounais qui tarde à prendre son véritable envol, la création de valeur
trouve place dans ces multinationales qui la conçoivent non pas comme une simple
performance financière, mais comme une véritable performance globale.
Performance qui inclus, non seulement les détenteurs des capitaux, ais également, les
RESPONSABILITE SOCIALE D’ENTREPRISE 19 2016-2017
ECOLE MIAGE
stakeholders qui contribuent directement ou indirectement à créer de la richesse pour
l'entreprise.
Les raisons du choix des multinationales comme population d'étude ayant été
données, il ne nous reste plus qu'à présenter les différents secteurs auxquels
appartiennent ces multinationales.
RESPONSABILITE SOCIALE D’ENTREPRISE 20 2016-2017
ECOLE MIAGE
PARTIE NII : L’ENTREPRISE ET LE SYSTEME SOCIALE.
CH1 : LA RESPONSABILITE SOCIALE ET LE DEVELOPEMENT DURABLE
Depuis plusieurs décennies, l'on aborde dans les rencontres internationales, des
questions d'environnement en essayant de démontrer que l'exploitation irrationnelle
des ressources naturelles pouvait freiner, voire compromettre la croissance
économique. Sur ce, les entreprises doivent produire des biens et/ou services tout
respectant l'environnement au sein dans lequel elle opère (éviter de dégrader la
qualité de l'environnement : pollution de l'eau, de l'air, etc.).
Dans le même ordre d'idées, les entreprises doivent s'approprier du développement
durable et surtout à le mettre en pratique, selon le principe de la triple approche :
celui de prendre en charge les questions environnementales et sociales, en les
combinant avec les préoccupations économiques et financières de l'entreprise
(12(*)). Cette intégration du développement durable permettra à l'entreprise
d'améliorer son rendement et sa survie qui contribuerait au bien-être social.
La responsabilité sociale de l'entreprise répond à cet enjeu proposant l'intégration des
préoccupations sociales, environnementales et économique dans le cadre des
activités de l'entreprises qui est un moyen pour cette dernière de participer à la
réalisation des objectifs de développement durable.
De nos jours, il ne suffit pas seulement d'avoir un taux de croissance annuel de 5%
du PIB (Produit Intérieur Brut) pour rattraper les pays dits développés. Le
développement n'est plus uniquement une affaire essentiellement économique.
Désormais pour accéder au développement durable, il faut qu'il y ait association de la
durabilité écologique, du développement économique et du développement social.
RESPONSABILITE SOCIALE D’ENTREPRISE 21 2016-2017
ECOLE MIAGE
SECTION I : L’ENTENDUE DE LA RESPONSABILITE SOCIALE
D’ENTREPRISE
Bien que l'on puisse expliquer souverainement ce qu'est la responsabilité sociale de
l'entreprise, les intervenants éprouvent la difficulté à s'entendre sur une définition. En
présence des questions sociales nombreuses et diverses, certains déclarent que les
entreprises sont tenues de résoudre l'ensemble des problèmes sociaux. Par contre,
d'autres soutiennent que leur rôle en tant qu'agents sociaux devrait être plus limité.
Sur ce, il y a quatre modes de conduite (14(*)) que peuvent adopter les entreprises en
matière de la responsabilité sociale au sein de la société.
- Mode de conduite classique : l'entreprise cherche à savoir que dit la loi ?
- Mode de conduite réactif : quelle la réaction des intervenants ?
- Mode de conduite axé sur l'interaction avec les intervenants : quelles sont les
préoccupations et les priorités des intervenants ?
- Mode de conduite proactif : a-t-il intégré les préoccupations et priorités de la
société aux éléments prioritaires et aux plans stratégiques de l'entreprise ?
I-LE MODE DE CONDUIT REACTIF :
Cette façon d'agir suppose que les gestionnaires jouent un double rôle, d'une part,
remplir leurs fonctions économiques et d'autre part, à se monter sensibles aux valeurs
et priorités sociales changeantes (telles la préservation de l'environnement, l'équité
en matière d'emploi et les attentes des consommateurs). Non seulement les
entreprises se plient alors aux normes et réglementations gouvernementales, mais
encore elles cèdent aux personnes de divers groupes intéressés.
II-LE MODE DE CONDUIT CLASSIQUE :
RESPONSABILITE SOCIALE D’ENTREPRISE 22 2016-2017
ECOLE MIAGE
Celui-ci repose sur l'idée que les dirigeants d'entreprise ont la responsabilité d'utiliser
les ressources de la société d'une manière économique, judicieuse et efficace au
moment de produire les biens et de fournir des services. Lorsqu'ils y parviennent,
tous les membres de la société y gagnent.
En effet, les actionnaires obtiennent des bénéfices raisonnables et les consommateurs
des produits et services de qualité. Le mode classique se fonde également sur l'idée
que les gouvernements et non l'entreprise est la plus apte à résoudre les problèmes
sociaux.
RESPONSABILITE SOCIALE D’ENTREPRISE 23 2016-2017
ECOLE MIAGE
CH2 : NECESSITE ET MISE EN ŒUVRE DE LA RSE
SECTION I : La responsabilité sociale de l'entreprise et ses parties prenantes.
La notion de partie prenante est née d'une exigence éthique de la société civile qui
demande que les entreprises rendent compte des conséquences sociales et
environnementales de leur activité. C'est dans ce sens que les parties prenantes de la
société ont des intérêts dans le bon fonctionnement de l'entreprise. On peut donc
distinguer, d'une part, les parties prenantes de premier rang c'est-à-dire celles dont
l'entreprise ne peut se passer sans remettre en cause son fonctionnement ou sa survie.
Il s'agit des actionnaires, dirigeants de l'entreprise, employés, syndicats, scientifiques
et spécialistes (chercheurs) et créanciers. D'autre part, les parties prenantes de second
rang c'est-à-dire celles qui ne sont pas essentielles pour le fonctionnement ou la
survie de l'entreprise. Il s'agit des communautés, organismes et réglementations,
groupes minoritaires, associations professionnelles, medias, organismes religieux,
etc.
I-COMMENT LA RESPONSABILITE SOCIALE D’ENTREPRISE
MATERIALISER T-ELLE DANS L’ENTREPRISE :
Mettre en pratique la RSE dans une entreprise c'est s'engager dans une ou des
démarches, suivant une ou plusieurs des dimensions environnementale, économique
ou sociale, auprès d'une ou plusieurs parties prenantes.
Une récente étude menée par l'Afnor et l'ORSE montre que les entreprises mettent au
premier rang des moyens à déployer la formation et la communication : la formation,
pour acquérir ou renforcer les compétences dans les différents domaines du la RSE,
la communication pour faire partager les valeurs fortes d'une entreprise socialement
responsable.
RESPONSABILITE SOCIALE D’ENTREPRISE 24 2016-2017
ECOLE MIAGE
Des actions semblent également incontournables :
- des relations renforcées avec l'ensemble des parties prenantes (de l'écoute active
des clients au mécénat),
- une attention forte portée à la satisfaction des collaborateurs au travers d'enquêtes et
de systèmes de suggestions,
- la mise en place progressive d'un système de reporting destiné à enrichir les
données économiques de l'entreprise par des données aussi bien quantitatives que
qualitatives portant sur les aspects sociaux et environnementaux de ses activités.
Chaque entreprise engagée dans une démarche de RSE, l'est cependant à sa manière,
suivant ses propres convictions.
` II-MISE EN ŒUVRE DE LA RESPONSABILITE SOCIALE DE
L’ENTREPRISE :
La mise en œuvre de la RSE implique, au-delà du respect des dispositions légales,
des conventions entre partenaires sociales et d'autres dispositions contractuelles, la
prise en compte des attentes de la société.
Pour aider les entreprises à assumer leur responsabilité, les organisations
internationales, les gouvernements, les associations d'entreprises et les organisations
non gouvernementales ont développé des normes, des codes de conduite et des labels
qui présentent le comportement attendu et favorisent la transparence. Parmi les
principaux instruments dans ce sens, citons les Principes directeurs de l'OCDE à
l'intention des entreprises multinationales, le Pacte mondial des Nations Unies
(Global Compact, UNGC), les Principes directeurs de l'ONU relatifs aux entreprises
et aux droits de l'homme, la norme ISO 26000 «Lignes directrices relatives à la
responsabilité sociétale» et la Global Reporting Initiative (GRI), des instructions
concernant l'établissement de rapports sur la durabilité. Dans la mesure du possible,
RESPONSABILITE SOCIALE D’ENTREPRISE 25 2016-2017
ECOLE MIAGE
la mise en œuvre doit couvrir toute l'étendue des effets de l'activité d'une entreprise
et prendre en considération les besoins de ses parties prenantes. Il faut également
tenir compte des circonstances et des possibilités spécifiques des entreprises,
notamment les PME. La transparence et la volonté de dialoguer sont des principes
fondamentaux de la RSE qui contribuent substantiellement à la réussite de sa mise en
œuvre.La mise en œuvre de la RSE implique, au-delà du respect des dispositions
légales, des conventions entre partenaires sociales et d'autres dispositions
contractuelles, la prise en compte des attentes de la société.
Pour aider les entreprises à assumer leur responsabilité, les organisations
internationales, les gouvernements, les associations d'entreprises et les organisations
non gouvernementales ont développé des normes, des codes de conduite et des labels
qui présentent le comportement attendu et favorisent la transparence. Parmi les
principaux instruments dans ce sens, citons les Principes directeurs de l'OCDE à
l'intention des entreprises multinationales, le Pacte mondial des Nations Unies
(Global Compact, UNGC), les Principes directeurs de l'ONU relatifs aux entreprises
et aux droits de l'homme, la norme ISO 26000 «Lignes directrices relatives à la
responsabilité sociétale» et la Global Reporting Initiative (GRI), des instructions
concernant l'établissement de rapports sur la durabilité.
Dans la mesure du possible, la mise en œuvre doit couvrir toute l'étendue des effets
de l'activité d'une entreprise et prendre en considération les besoins de ses parties
prenantes. Il faut également tenir compte des circonstances et des possibilités
spécifiques des entreprises, notamment les PME. La transparence et la volonté de
dialoguer sont des principes fondamentaux de la RSE qui contribuent
substantiellement à la réussite de sa mise en œuvre.
SECTION II : RSE LES AVANTAGE ET L’INCONVINIENT
I-AVNTAGE DE LA RESPONSABILITE SOCIALE D’ENTREPRISE :
RESPONSABILITE SOCIALE D’ENTREPRISE 26 2016-2017
ECOLE MIAGE
Les entreprises et acteurs de la RSE estiment qu’une démarche RSE favorise la
performance globale de l’entreprise notamment par :
Une anticipation et maîtrise des risques
Un regard nouveau porté sur l’activité de l’entreprise favorisant l’innovation et la
différenciation auprès des clients
Des économies notamment liés aux consommations d’eau, d’énergies et la
substitution progressive de matières non renouvelables dont les prix ont vocation à
augmenter
La motivation, l’implication et la fidélisation des salariés
L’accès à des marchés responsables (publics ou privés) qui sélectionnent les
entreprises et ou les produits sur des critères dits ESG (Environnement, Social (dont
société), Gouvernance)
Le développement d’une capitale confiance bénéfique à l’image de l’entreprise et à
sa valeur immatérielle
La fiabilisation des relations et des partenariats basés sur des valeurs
L’accès privilégié à des financements de la part d’organismes publics ou privés
La diversification enrichissante des profils de l’entreprise
Gagner en compétitivité
Accéder aux marchés responsables
S'engager / donner du sens
Se différencier, Innover
Accueillir, être solidaire
Fédérer les salariés, recruter
Maîtriser les risques.
RESPONSABILITE SOCIALE D’ENTREPRISE 27 2016-2017
ECOLE MIAGE
II-L’INCONVINIENT DE LA RESPONSABILITE SOCIALE D’ENTREPRISE :
La mise en œuvre de la responsabilité sociale d’entreprise mène à s’interroger sur
différentes questions de fond :
Au niveau de la communication : les entreprises peuvent être tentées d’adopter une
stratégie de communication superficielle et dans ce cas ne pas traiter les risques en
profondeur. Une communication sans structuration préalable des informations peut
discréditer l’entreprise;
Au niveau juridique et ethnique : la complexité du droit est une difficulté;
Au niveau macroéconomique et financier : la mise en œuvre de programme
transversaux dans l’ensemble des entreprises nécessite l’application de normes qui
touchent à la structure du droit, à la comptabilité nationale, à la finance, aux marchés
pouvant s’avérer complexe et ne dépendant pas exclusivement de l’entreprise;
Au niveau management : généralement les visions, les responsabilités et les actions
entre les qualiticiens, les responsables de la veille réglementaire, les responsables en
environnement, les juristes, et autres sont fragmentés, ce qui entraîne la complexité
d’organiser ce type de programme et suppose une coordination entre les parties;
Au niveau des risques : la perception de l’environnement et des risques peut être
entravée par le biais cognitifs, le biais culturel et autres.
Conclusion
RESPONSABILITE SOCIALE D’ENTREPRISE 28 2016-2017
ECOLE MIAGE
Dans le cadre de notre mémoire de fin d’étude, va prendre encore plus d’ampleur de
plus en plus De plus la RSE, va permettre de développer l’éthique dans l’entreprise.
La démarche volontaire de la RSE va mettre l’accent sur des sur des thématiques
spécifiques :
· Respect des droits de l’homme
· Conditions de travail
· Diminution des impacts environnementaux
· Autres…
Cette démarche de transparence et d’amélioration ne se fera pas sans difficulté :
· Volume de travail important pour obtenir des résultats représentatifs.
· Changement de la culture d’entreprise (longue et délicate) et stratégique.
Même si, à ce jour, la responsabilité sociale des entreprises est principalement
promue par de grandes sociétés ou des multinationales, elle représente une
importance dans tous les types d’entreprises et tous les secteurs d’activité, de la PME
à la multinationale. Il est capital qu’elle soit plus largement appliquée dans les PME
puisque ce sont elles qui contribuent le plus à l’économie et à l’emploi.
Pour conclure, la responsabilité sociale d’entreprise va devenir une démarche
essentielle dans le développement de l’entreprise. En effet, la prise en compte du
développement durable et de l’éthique devient un atout majeur dans la société
actuelle.
Et en fin je voudrais remercier a l’ensemble des personnel qu’on a participer pour la
réalisation de mémoire.
RESPONSABILITE SOCIALE D’ENTREPRISE 29 2016-2017
ECOLE MIAGE
Webliographie
RESPONSABILITE SOCIALE D’ENTREPRISE 30 2016-2017
ECOLE MIAGE
https://vertigo.revues.org/17715.
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Responsabilite_morale.htm.
https://www.agrh.fr/assets/actes/2005pigeyre-gilbert-charpentier0123.pdf.
https://e-rse.net/definitions/definition-developpement-durable/#gs.w8Trly8
https://memoires.sciencespo-
toulouse.fr/uploads/memoires/2010/memoire_JEANNE-FABIEN.pdf.
https://www.seco.admin.ch/seco/fr/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_
Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/Gesellschaftliche_Verantwortung_der_Unt
ernehmen/CSR/Umsetzung_CSR0.html.
http://www.rse-nantesmetropole.fr/interets-entreprise
http://alstom.e-monsite.com/pages/la-rse/avantages-et-inconvenients.html
RESPONSABILITE SOCIALE D’ENTREPRISE 31 2016-2017
ECOLE MIAGE
RESPONSABILITE SOCIALE D’ENTREPRISE 32 2016-2017
ECOLE MIAGE
RESPONSABILITE SOCIALE D’ENTREPRISE 33 2016-2017
ECOLE MIAGE
RESPONSABILITE SOCIALE D’ENTREPRISE 34 2016-2017
Vous aimerez peut-être aussi
- Cours Gestion BudgétaireDocument53 pagesCours Gestion BudgétaireNor Nor CH67% (6)
- RSEDocument18 pagesRSEMustaphaElHamdani50% (2)
- Rapport RSEDocument19 pagesRapport RSEMehdi67% (3)
- RSEDocument11 pagesRSEloffyPas encore d'évaluation
- La RSEDocument15 pagesLa RSERubs PastorePas encore d'évaluation
- La RSE RapportDocument20 pagesLa RSE RapportmouadPas encore d'évaluation
- Responsabilite Sociale Entreprises Sonatrach Partie PrenantesDocument337 pagesResponsabilite Sociale Entreprises Sonatrach Partie PrenantesdaelPas encore d'évaluation
- RSE FinalDocument18 pagesRSE FinalSiham BelkadiPas encore d'évaluation
- Mémoire RseDocument39 pagesMémoire RseAmine SaidiPas encore d'évaluation
- Chapitre RSEDocument19 pagesChapitre RSEpaganoussi100% (6)
- PFE 3 Audit SocialDocument106 pagesPFE 3 Audit SocialAyoub Haouas86% (7)
- Responsabilite Sociale Des EntreprisesDocument102 pagesResponsabilite Sociale Des EntreprisesKushinada100% (2)
- LA DEMARCHE RSE DANS LES PME CAS DES PME de LA WILLAYA DE BEJAIADocument111 pagesLA DEMARCHE RSE DANS LES PME CAS DES PME de LA WILLAYA DE BEJAIAChiheb DhibPas encore d'évaluation
- Historique RseDocument6 pagesHistorique Rsebarassa75% (4)
- RSEDocument48 pagesRSESara Labir100% (2)
- Rapport - MS & RSEDocument45 pagesRapport - MS & RSEIhssane Zahrane100% (2)
- Robert Mercier - Raisonnez Comme SherlockDocument75 pagesRobert Mercier - Raisonnez Comme SherlockIsaac CaradiPas encore d'évaluation
- Céline Alvarez, Une Pédagogie Business CompatibleDocument11 pagesCéline Alvarez, Une Pédagogie Business CompatibleCaptain TrroiePas encore d'évaluation
- La GRH Et La Rse Rapport FinalDocument36 pagesLa GRH Et La Rse Rapport FinalMed Amine Qsb100% (1)
- La gestion des entreprises sociales: Economie et objectifs sociaux dans les entreprises belgesD'EverandLa gestion des entreprises sociales: Economie et objectifs sociaux dans les entreprises belgesÉvaluation : 1 sur 5 étoiles1/5 (1)
- Je Me Souviens Detre PDFDocument157 pagesJe Me Souviens Detre PDFMaurice Lucien NaoussiPas encore d'évaluation
- Seduire Un HommeDocument17 pagesSeduire Un Hommecaro1302100% (1)
- La Responsabilité Sociale Des Entreprises TAFDocument14 pagesLa Responsabilité Sociale Des Entreprises TAFsosaiddPas encore d'évaluation
- Les Objectifs Et Les Enjeux de La RSE Atelier N°1 - 07/10/15Document5 pagesLes Objectifs Et Les Enjeux de La RSE Atelier N°1 - 07/10/15imane el baqqal100% (1)
- La Responsabilite Sociale de LentrepriseDocument68 pagesLa Responsabilite Sociale de LentrepriseNohaila ElPas encore d'évaluation
- La Responsabilite Sociale Des Entreprise 1Document21 pagesLa Responsabilite Sociale Des Entreprise 1GONNE JeromePas encore d'évaluation
- La - Responsabilite - Sociale - de - L - Entreprise !!!! PDFDocument26 pagesLa - Responsabilite - Sociale - de - L - Entreprise !!!! PDFMtibaa Hichem100% (2)
- La Responsabilité Sociale Des Entreprises Résumé (Khawla)Document5 pagesLa Responsabilité Sociale Des Entreprises Résumé (Khawla)Salma Hayek100% (1)
- CH6 La Rupture Du CTDocument9 pagesCH6 La Rupture Du CTNor Nor CHPas encore d'évaluation
- La RSEDocument12 pagesLa RSEAmine Ouakhsass100% (1)
- RSEDocument37 pagesRSEMtibaa HichemPas encore d'évaluation
- La RseDocument12 pagesLa Rsemmosny83Pas encore d'évaluation
- Responsabilité Sociétale Des EntreprisesDocument32 pagesResponsabilité Sociétale Des EntreprisesMounir mounirPas encore d'évaluation
- Présentation de La RSEDocument14 pagesPrésentation de La RSEGhassen JemaaPas encore d'évaluation
- Les Réferentiels RSE VFDocument35 pagesLes Réferentiels RSE VFait hamd-ouhsain fatima zahraPas encore d'évaluation
- Rapport Fraude FiscaleDocument20 pagesRapport Fraude FiscaleNor Nor CHPas encore d'évaluation
- Quel Lien Entre La RSE Et Les RHDocument4 pagesQuel Lien Entre La RSE Et Les RHaimad_btp0% (1)
- Responsabilité Sociale Des EntreprisesDocument70 pagesResponsabilité Sociale Des EntreprisesAmar Roustila100% (1)
- Rse Mémoire 1 PDFDocument28 pagesRse Mémoire 1 PDFyasser hanyPas encore d'évaluation
- Rse (1) (1077)Document16 pagesRse (1) (1077)yasser hanyPas encore d'évaluation
- Rapport RSEDocument37 pagesRapport RSESoukaina Tadlaoui50% (2)
- La Responsabilite Sociale Des Entreprises.Document19 pagesLa Responsabilite Sociale Des Entreprises.Younes Sitayeb100% (1)
- Année Universitaire: 2012/2013 Marketing Stratégique Et Management Commercial ApprofondiDocument28 pagesAnnée Universitaire: 2012/2013 Marketing Stratégique Et Management Commercial ApprofondiJamal Haj100% (1)
- Thèse Sur La Fonction RSEDocument108 pagesThèse Sur La Fonction RSEac_mrl100% (9)
- Fiche de RenseignementsDocument5 pagesFiche de RenseignementsMahdi LeebruPas encore d'évaluation
- Responsabilité Sociétale Des EntreprisesDocument52 pagesResponsabilité Sociétale Des EntreprisesRedEarl100% (2)
- Responsabilité Sociale Des EntréprisesDocument26 pagesResponsabilité Sociale Des EntréprisesNare Jonathan100% (1)
- La Responsabilité Sociale Des EntreprisesDocument36 pagesLa Responsabilité Sociale Des EntreprisesLys Flores100% (1)
- La GRH À Travers Les Compétences Pour Améliorer La Performance de L'entrepriseDocument219 pagesLa GRH À Travers Les Compétences Pour Améliorer La Performance de L'entrepriseNadjat Belghanami100% (1)
- RSE ET PERFORMANCE FINANCIÈRE Outre Les Études Sur Les Déterminants de La RSEDocument19 pagesRSE ET PERFORMANCE FINANCIÈRE Outre Les Études Sur Les Déterminants de La RSESoukaina’s LifePas encore d'évaluation
- RSE MarocDocument20 pagesRSE MarocLeila Amîne100% (2)
- RSE MarocDocument17 pagesRSE Marocnasrirachdi0% (1)
- PFE Soufiane Abderazzak RSEDocument38 pagesPFE Soufiane Abderazzak RSEnadaPas encore d'évaluation
- QCM GpecDocument2 pagesQCM GpecNor Nor CH67% (3)
- La Responsabilité Sociale de L'entreprise Et FinancementDocument43 pagesLa Responsabilité Sociale de L'entreprise Et FinancementHamza Rhiminate100% (2)
- La RSE Dans La PMEDocument55 pagesLa RSE Dans La PMEHANAN AIT TALEBPas encore d'évaluation
- RSE LaghzaouiDocument8 pagesRSE Laghzaouililly_kokoPas encore d'évaluation
- Pfe Rse 2016Document48 pagesPfe Rse 2016Radouane Jlaila100% (1)
- La Responsabilité Sociale Des Entreprises PDFDocument92 pagesLa Responsabilité Sociale Des Entreprises PDFMohammed Jabrane100% (1)
- RSE Et PF Version FinaleDocument11 pagesRSE Et PF Version FinaleCherradi ZakariaPas encore d'évaluation
- Responsabilit2 Social MarocDocument12 pagesResponsabilit2 Social MarocmissetafraoutPas encore d'évaluation
- RSE Et PEDocument37 pagesRSE Et PEAboud HichamPas encore d'évaluation
- BOUMAHDI Lobna - RSE Et DD Au Maroc - Mars 2015Document14 pagesBOUMAHDI Lobna - RSE Et DD Au Maroc - Mars 2015Ilyes Fattouh100% (1)
- These Sur RseDocument46 pagesThese Sur RseFOUDA WENCESLASPas encore d'évaluation
- Difficultes Rse MarocDocument14 pagesDifficultes Rse Marocmarouanesmaili100% (2)
- La Responsabilité Sociale Travail Final .Mme Debbagh2Document27 pagesLa Responsabilité Sociale Travail Final .Mme Debbagh2dinoPas encore d'évaluation
- Les Motivations Des PME Pour La RSE Au MarocDocument22 pagesLes Motivations Des PME Pour La RSE Au MarocIdriss DarkouchPas encore d'évaluation
- Quel demain pour quel Maroc ?: Réflexions sur le développementD'EverandQuel demain pour quel Maroc ?: Réflexions sur le développementPas encore d'évaluation
- Le contrat de travail : aspects théoriques et pratiquesD'EverandLe contrat de travail : aspects théoriques et pratiquesPas encore d'évaluation
- Les assurances de personnes en 60 cas pratiques: Ouvrage pédagogiqueD'EverandLes assurances de personnes en 60 cas pratiques: Ouvrage pédagogiquePas encore d'évaluation
- Exercice - Covariance Et Gestion Du Risque. Philippe Bernard Ingénierie Economique - Financière Université Paris-DauphineDocument5 pagesExercice - Covariance Et Gestion Du Risque. Philippe Bernard Ingénierie Economique - Financière Université Paris-DauphineNor Nor CHPas encore d'évaluation
- Feuilletage 180Document15 pagesFeuilletage 180Martin FreemanPas encore d'évaluation
- Fusions S2Document109 pagesFusions S2Nor Nor CHPas encore d'évaluation
- Un Droit Des Affaires Favorable Au Développement Économique Est Fondé Sur Une Structure Et Un Contenu Clairs Et PrévisiblesDocument1 pageUn Droit Des Affaires Favorable Au Développement Économique Est Fondé Sur Une Structure Et Un Contenu Clairs Et PrévisiblesNor Nor CHPas encore d'évaluation
- BancassuranceDocument6 pagesBancassuranceNor Nor CHPas encore d'évaluation
- Partie Du Contrat AssDocument8 pagesPartie Du Contrat AssNor Nor CHPas encore d'évaluation
- Historique de L - AssuranceDocument16 pagesHistorique de L - AssuranceNor Nor CHPas encore d'évaluation
- If Cours Et ApplicationDocument56 pagesIf Cours Et ApplicationNor Nor CHPas encore d'évaluation
- Benshmark GRC Ass - BqueDocument19 pagesBenshmark GRC Ass - BqueNor Nor CHPas encore d'évaluation
- Biadi InfoDocument9 pagesBiadi InfoNor Nor CHPas encore d'évaluation
- La Contribution de La Politique de RemunDocument112 pagesLa Contribution de La Politique de RemunNor Nor CHPas encore d'évaluation
- A Vers Une Nouvelle PB Intelligente Au Service de La Croissance Économique Et Du Développement Humain Au Maroc PDFDocument40 pagesA Vers Une Nouvelle PB Intelligente Au Service de La Croissance Économique Et Du Développement Humain Au Maroc PDFNor Nor CHPas encore d'évaluation
- Dépenses, Croissance Et Développement HumainDocument105 pagesDépenses, Croissance Et Développement HumainAbdelhakim QacharPas encore d'évaluation
- Evaluation Des Capitaux Propres Et Des Titres Des SocietesDocument6 pagesEvaluation Des Capitaux Propres Et Des Titres Des SocietesNor Nor CHPas encore d'évaluation
- CH1 Sources Droit TravailDocument2 pagesCH1 Sources Droit TravailNor Nor CHPas encore d'évaluation
- CH2 INSPECTION TravailDocument2 pagesCH2 INSPECTION TravailNor Nor CHPas encore d'évaluation
- Exemple Annonce RecrutementDocument3 pagesExemple Annonce RecrutementNor Nor CHPas encore d'évaluation
- Managerment de L'entreprise - Comptabilité - Analyse FinancièreDocument9 pagesManagerment de L'entreprise - Comptabilité - Analyse FinancièreMhaila ayoubPas encore d'évaluation
- La Proche Patrimonial PDFDocument14 pagesLa Proche Patrimonial PDFKhadija Khadija BouhkiPas encore d'évaluation
- CH3 Le Conseil de Prud'hommesDocument3 pagesCH3 Le Conseil de Prud'hommesNor Nor CHPas encore d'évaluation
- CH5 Contrat de TravailDocument13 pagesCH5 Contrat de TravailNor Nor CHPas encore d'évaluation
- Devoir À Rendre Statistique DescriptiveDocument2 pagesDevoir À Rendre Statistique DescriptiveNor Nor CHPas encore d'évaluation
- Bilan FONC COURSDocument4 pagesBilan FONC COURSNor Nor CHPas encore d'évaluation
- La Proche Patrimonial PDFDocument14 pagesLa Proche Patrimonial PDFKhadija Khadija BouhkiPas encore d'évaluation
- Notions Par Perspectives 2Document13 pagesNotions Par Perspectives 2Sarento MolkohPas encore d'évaluation
- Levinas Et DerridaDocument6 pagesLevinas Et DerridaAnonymous cfc0YgPas encore d'évaluation
- 2013-09-22 Bibliographie Du Profil Enseignement ESTDocument48 pages2013-09-22 Bibliographie Du Profil Enseignement ESTMariana CamarasanPas encore d'évaluation
- UPS - M2P INFORMATIQUE, Spécialité SYSTEMES DE TELECOMMUNICATIONS ET RESEAUX INFORMATIQUES (STRI)Document3 pagesUPS - M2P INFORMATIQUE, Spécialité SYSTEMES DE TELECOMMUNICATIONS ET RESEAUX INFORMATIQUES (STRI)OsAma AdDonPas encore d'évaluation
- Quelles Mixités Construire À L'écoleDocument118 pagesQuelles Mixités Construire À L'école31071978Pas encore d'évaluation
- Des Athlètes Sous Contrôle Mental (Extraits Du Livre L'amérique en Pleine Transe-Formation) - MK-PolisDocument14 pagesDes Athlètes Sous Contrôle Mental (Extraits Du Livre L'amérique en Pleine Transe-Formation) - MK-PolisWal WalterPas encore d'évaluation
- Lettre de L'imam Ali À Malick Al AchtarDocument11 pagesLettre de L'imam Ali À Malick Al AchtarsakhoibPas encore d'évaluation
- PallaviciniDocument5 pagesPallaviciniBelhamissi100% (1)