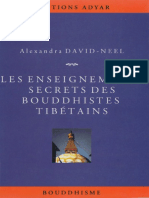Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
LaPenseeBouddhiste v2 Diversité Des Hommes PDF
Transféré par
Thierry FalissardTitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
LaPenseeBouddhiste v2 Diversité Des Hommes PDF
Transféré par
Thierry FalissardDroits d'auteur :
Formats disponibles
Extrait du livre « La pensée bouddhiste » (2e édition, à paraître)
Diversité des hommes
Nous étudions ici les différents stades de détachement et les différents types de personnes
ainsi « détachées ».
Le bouddhisme était à l’origine un élitisme monacal qui s’adressait à des ascètes éclairés et
motivés, soucieux de s’isoler des foules et des occupations vulgaires, car :
l’absence de stupidité et de bêtise est rare dans le monde. 1
Par la suite, avec la propagation d’une pratique ascétique au-delà du cercle de ce monachisme
strict, toutes sortes de motivations, d’implications, et d’étapes dans la « sagesse » sont
apparues chez les adeptes. Cette grande diversité de caractères sur la route de l’Eveil est
impossible à appréhender dans le détail2, mais on en trouve une classification dans le
Theravāda (le point de vue du Mahāyāna est différent, et sera examiné en fin de chapitre).
Le tableau suivant donne l’ensemble des « voies » possibles d’un point de vue bouddhiste.
Chacun des stades est détaillé plus loin.
Voie non
Theravāda Mahāyāna
bouddhique
bouddha parfait bouddha solitaire
libéré
éveillé (samyaksambuddha, (pratyekabuddha,
(arhat, arahant)
sammāsambuddha) paccekabuddha)
« sans-retour »
(anāgāmī)
ascète « une-fois-retournant »
bodhisattva
(sekha) (sakadāgāmin)
?
« entré dans le courant »
10 étapes (bhūmi)
(sotāpanna)
« auditeur »
disciple
(śrāvaka, sāvaka)
homme
être « non instruit » (pṛthagjana, puthujjana)
ordinaire
Degré zéro
Au niveau le plus bas est placé l’homme commun, ordinaire (pṛthagjana, puthujjana), qualifié
souvent dans le canon pāḷi de « non instruit » (assutavā)3. Il n’y a rien de honteux à cela,
puisque avant d’être instruit on est forcément ignorant, et même les plus éveillés sont passés
par là !
L’homme ordinaire est ignorant de tout ce qui a été exposé dans les deux premiers cercles,
1 Ajaḷatā anelamūgatā dullabhā lokasmiṃ. (Pātubhāva Sutta)
2 Selon le Migasālā Sutta, elle réclame une connaissance spéciale, « connaissance globale de la diversité des
hommes » (purisa-puggalā-paro-pariya-ñāṇa).
3 Il sera qualifié aussi d’indompté (adanta), incontrôlé (asaññata), inéduqué (avinīta), ignorant (akovida, ajānant),
peu éduqué (appassuta), intranquille (asanta), plongé dans l’aveuglement (avijjāgata), non éveillé (ananubodha),
ayant beaucoup de poussière dans les yeux (mahārajakkha), sot (asappurisa, maga), malavisé (moghapurisa), etc.
Selon le Mahāyāna (Mahāparinirvāṇa Sūtra), l’Eveil semble impossible pour certains êtres, on appelle ainsi
icchāntika (« plein de désirs ») celui qui est « irrécupérable », « incurable » (atekiccho en pāḷi).
© Thierry Falissard 1 La pensée bouddhiste
bien qu’il puisse être une personne morale et intelligente4. De par son ignorance
métaphysique, il voit le monde, son monde, et son « soi », comme absolument réels. Selon
l’hypothèse des renaissances, il est destiné à errer dans le saṃsāra, d’une naissance à l’autre,
jusqu’à ce qu’il rencontre une voie de détachement qui lui donnera une impulsion en direction
de la sortie du monde ; sinon, il subira indéfiniment les vicissitudes de l’existence :
Quand on vit dans le monde, avec l’acquisition (paṭilābho) d’une identité personnelle
(attabhāva), les huit conditions mondaines (lokadhammā5) tournent sans cesse dans ce monde
et ce monde tourne sans cesse autour d’elles : gain et perte, renommée et disgrâce, louange
et blâme, plaisir et souffrance.6
Parmi les hommes, bien peu sont ceux qui parviennent à l’autre rive (pāragāmin) ; les autres
restent plutôt sur cette berge, à s’agiter dans tous les sens (anudhāvati, à courir).7
Englouti dans l’obscurité (tamas) de volitions (saṃkalpa) très nombreuses,
Aussi inconstant qu’un éclair (taḍit) dans une forte tempête,
Submergé par la boue (mala) d’un irrésistible désir (rāga),
Un tel mental-cœur (citta) [s’identifie au] monde conditionné (saṃsāra), dit le sage (vajrin).8
L’homme commun (peu importe de ce point de vue que ce soit un parfait ignorant ou un grand
savant, au sens ordinaire du terme) a une vision profondément erronée de lui-même et du
monde. L’en faire sortir est une tâche quasiment impossible, d’autant plus que rien ne l’y incite
a priori, et qu’il se montrera rarement coopératif. L’ignorant est plein de certitudes, et « savoir
qu’on ne sait pas » est un luxe rare. Plus ou moins conscient malgré tout de la misère de la
condition humaine, il aura recours à des « solutions palliatives », principalement l’hédonisme
et le théisme, qui pour le bouddhisme sont des illusions :
Les êtres attachés aux choses (ālambana), et adhérant à différentes opinions (nānādṛṣṭi), après
avoir entendu l’enseignement de la vacuité (śūnyatādharma), finissent par le trouver trop abrupt
(prapāta : abyssal).9
Comment des hommes totalement « liés » par leur corps et leur psyché pourraient-ils trouver
dans ces liens une « liberté » : vaine recherche de ceux qui ne comprennent pas que cette
liberté ne peut se trouver que par la rupture des liens. C’est pour cette raison que le
bouddhisme, et particulièrement son expression gnostique, sont élitistes. Seules les âmes
fortes n’ayant pas besoin d’un protecteur y peuvent accéder.10
Chez l’homme commun, bien souvent, la religion (ou toute idéologie équivalente : morale,
politique, philosophique) n’est pas le moteur d’un « progrès spirituel » quelconque, car elle est
récupérée, phagocytée, envahie par l’illusion du soi, le plus souvent en lien avec une
appartenance sociale. La croyance, quelle qu’elle soit, n’est plus pour ses adeptes qu’une
source de réflexes identitaires, une affaire familiale, tribale, communautaire ou nationale, et
n’est jamais remise en question d’un point de vue philosophique parce qu’elle constitue une
part essentielle de l’identité de la personne (même chez les bouddhistes, qui devraient
pourtant se méfier de toute notion d’identité collective). Ainsi naissent les haines, les crimes,
les guerres et tous les malheurs d’un monde où règnent l’ignorance et le fanatisme.
Premier degré : il y a un début à tout !
Vient ensuite le disciple (śrāvaka, sāvaka), « auditeur », qui suit les enseignements
4 Il peut même avoir des pouvoirs psychiques étonnants (iddhi), comme Devadatta, le cousin du Bouddha, mais ce
ne sont que des pouvoirs communs (puthujjanika iddhi) qui ne permettent pas de transcender le monde.
5 Les Chinois, plus concrets, préfèrent parler des « huit vents » (八风).
6 Yathābhūte lokasannivāse yathābhūte attabhāvapaṭilābhe aṭṭha lokadhammā lokaṃ anuparivattanti, loko ca aṭṭha
lokadhamme anuparivattati : lābho ca alābho ca ayaso ca yaso ca nindā ca pasaṃsā ca sukhañca dukkhañcāti.
(Ṭhāna Sutta)
7 Appakā te manussesu ye janā pāragāmino | Athāyaṃ itarā pajā tīramevānudhāvati. (Orimatīra Sutta)
8
Analpa saṃkalpa tamas-abhibhūtaṃ | Prabhajjana-unmatta taḍic calaṃ, ca | Rāga-adidurvāra mala-avaliptaṃ |
cittaṃ, hi, saṃsāram, uvāca vajrī. (Prajñopāya Viniścaya Siddhi, IV-22)
9 Gaganagañjaparipṛcchā (Les questions de Gaganagañja), 205.
10 Prajñānanda, Bouddhisme gnostique, Archè, 1981.
© Thierry Falissard 2 La pensée bouddhiste
bouddhiques et entre dans la Voie11. Il a pu entendre la doctrine et se convaincre de sa validité,
ou tout du moins de l’intérêt de cet « éclairage » qu’elle donne sur l’existence :
C’est comme si l’on redressait ce qui était renversé, révélait ce qui était caché, montrait le
chemin à un égaré, allumait une lampe dans l’obscurité pour que ceux qui ont des yeux puissent
voir [des formes].12
Il est censé avoir « pris refuge13 » et respecter au minimum les cinq préceptes éthiques. Même
s’il ne vise pas le détachement complet, un certain nombre de recommandations d’ordre moral
lui sont destinées, notamment le comportement à tenir vis-à-vis de son entourage. La richesse
n’est pas condamnée, elle est même approuvée tant qu’elle est « acquise par l’activité et
l’énergie14 », obtenue moralement, « comme l’abeille butine la fleur sans l’abîmer »15 − une
explication « sociologique » à cette approbation de la richesse pourrait être que, dans le
bouddhisme primitif, et aujourd’hui encore dans le Theravāda, le disciple est censé subvenir
aux besoins de la communauté monastique, qui est entièrement dépendante des laïcs. La
richesse est cependant un bien à double tranchant, un avantage qui peut se transformer
facilement en problème :
Les possessions (upadhī) sont la jouissance des hommes. (…) Les possessions sont le
tourment des hommes.16
Quand le disciple obtient quelque réussite dans le détachement, il devient un ascète (sekha),
dans le sens étymologique du terme (ἀσκητής : celui qui s’exerce). Il y a évidemment
beaucoup moins d’ascètes que de disciples ! Mais ce n’est qu’une question de temps pour les
disciples opiniâtres :
Je suis devenu ascète (pravrajito) pour obtenir la maîtrise de soi, le calme de l’esprit (śamatha),
et la complète délivrance (parinirvāṇa).17
Conscient de la terreur (que provoquent) la vieillesse et la mort, j’ai adopté cette doctrine
(dharma) en vue de la délivrance.18
L’ascète (qui n’est pas forcément un moine) peut atteindre différents états d’Eveil, on en
répertorie quatre principaux dans le Theravāda. Ce ne sont pas des variétés d’Eveil
différentes, mais des étapes successives vers l’unique Eveil final.
Entrée dans la Voie
Le premier stade, capital puisqu’il signale l’entrée irréversible dans la Voie, est celui de l’être
entré dans le courant (sotāpanna)19. Le courant dont il est question n’est pas celui du devenir,
saṃsāra, mais celui qui mène, ultimement, à la fin du devenir, nirvāṇa − c’est donc un contre-
courant20, censé mener vers « l’autre rive » (pārimaṁ tīraṁ). Ce stade correspond à
1. l’élimination de la croyance en un soi permanent (âme ou équivalent), sakkāya-diṭṭhi ;
11 On rencontre aussi (Āhuneyya Sutta) le terme d’adepte, gotrabhū, celui est devenu (bhū) du lignage (gotra).
Outre le terme très général de dharmacārin (dhammacārin), « celui qui marche sur la Voie du Dharma », il y a aussi
celui d’upāsaka, disciple laïc, « celui qui est assis près » (d’un maître) et celui de « laïc vêtu de blanc » (gihī
odātavasanā) par opposition aux moines vêtus d’ocre à l’origine.
12 Seyyathāpi […] nikkujjitaṃ vā ukkujjeyya, paṭicchannaṃ vā vivareyya, mūḷhassa vā maggaṃ ācikkheyya,
andhakāre vā telapajjotaṃ dhāreyya, ‘cakkhumanto rūpāni dakkhantī’ti. (formule commune à de nombreux suttas)
13 Saraṇaṁ gacchati (prendre refuge) est mieux traduit par « aller vers [le Bouddha, le Dharma, le Sangha] comme
vers un refuge ». A l’époque du Bouddha, selon les textes, on « allait en refuge » auprès de l’ascète Gautama, de
sa doctrine et de la communauté monastique : esāhaṁ bhavantaṁ Gotamaṁ saraṇaṁ gacchāmi, dhammañ-ca
bhikkhu-saṅghañ-ca (voir par exemple l’Ālavaka Sutta). En hindi, sharan (शरण) est la protection, l’asile (politique).
14 Uṭṭhānaviriyādhigata (Pattakamma Sutta).
15 Sīgāla Sutta (ou Sigalovada Sutta).
16 Upadhī hi narassa nandanā (...) Upadhī hi narassa socanā. (Nandati Sutta)
17 C’est ce que, selon la légende, le premier ascète errant croisé par le futur Bouddha lui aurait dit : ātmadama-
śamatha-parinirvāṇārthaṃ pravrajito (Mahāvastu, 2.157).
18 Ahaṁ jarā-mṛtyu-bhayaṁ viditvā mumukṣayā dharmam imaṁ prapannaḥ. (Buddhacarita, 11.7)
19 On trouvera plus de détails sur l’entrée dans le courant dans le Manuel de méditation d’Ajahn Brahm (chap. 14),
Almora, 2011.
20 Dans le Sāriputta Sutta ce courant (soto) est défini comme l’octuple sentier (aṭṭhaṅgiko maggo) décrit plus haut
dans notre deuxième cercle : ariyo aṭṭhaṅgiko maggo soto.
© Thierry Falissard 3 La pensée bouddhiste
2. l’élimination de la croyance en l’efficacité métaphysique des règles éthiques et des rites
(sīlabbata-parāmāsa)21 ; et 3. l’absence de doute (vicikiccha) relativement à la validité de la
voie de détachement suivie.
Même si la vue (diṭṭhi), à ce stade, est devenue juste, l’éthique est loin d’être parfaite, et ce
n’est pas la fin totale de l’illusion du soi : celle-ci réapparaît fréquemment avec les affects
(désir, haine), car les pulsions de base (āsrāva) n’ont pas disparu. C’est uniquement cette vue
juste qui caractérise ce premier stade, et le distingue du stade précédent22 :
Quand le disciple ārya (ariyasāvako) voit dans leur réalité (yathābhūtaṃ pajānāti) l’apparition et
la disparition des cinq agrégats d’attachement, leur attrait (assāda), leur danger (ādīnava) et
leur émancipation (nissaraṇa), on l’appelle un disciple ārya "entré dans le courant" (sotāpanno),
délivré des mondes inférieurs (vinipāta), assuré (niyato) de l’Eveil final.23
Ils ont embrassé (ogādhappattā) la doctrine et la discipline, s’y sont fermement ancrés
(paṭigādha), y ont obtenu le réconfort (assāsa), ont surmonté (tiṇṇa) leurs doutes (vicikicchā),
dispersé leur perplexité (kathaṃkatā), gagné une confiance en eux-mêmes (vesārajja) et une
indépendance (aparappaccayā) relativement à l’enseignement d’un maître (satthusāsane).24
Par parenthèse, il se confirme ainsi que l’accomplissement de la voie bouddhique est, dès le
départ, une affaire de connaissance et d’expérience personnelle, et non de croyance, d’action
ou de « grâce ». Ce premier stade indique aussi sur quoi les efforts de l’adepte devraient porter
en priorité : il est moins important, à ce stade, d’avoir une éthique parfaite, une absence totale
de haine et de désir, que de comprendre la vacuité et l’absence de soi. Le détachement du
corps est d’une grande aide en ce sens, car c’est le premier coup fatal porté au vouloir-vivre,
et à l’attachement au monde matériel.
L’entrée dans le courant est un événement perçu plus ou moins clairement par l’ascète ; il sent
tout de même que quelque chose a changé dans sa perception des choses. Cela va au-delà
de cette simple vérité qui est que « nous allons tous mourir » − vérité à la fois si banale et si
refoulée qu’elle ne franchit pas la barrière de l’inconscient ! Il se produit « un fantastique
tremblement de terre dans l’esprit25 ». Un voile se déchire, la misère de notre condition
apparaît : le monde, auparavant plein d’attraits et de promesses séduisantes, ne semble plus
qu’un champ de ruines, un désert stérile. Mais une issue se dessine en même temps qu’une
clarté se précise26. On parle aussi de « l’ouverture de l’œil immaculé du Dhamma27 » :
l’existence est vue dans sa nature conditionnée (« tout ce qui est sujet à apparition est sujet à
cessation », ce qui met fin à la vue erronée d’un « soi » perdurant) et par opposition
l’inconditionné est vu aussi. C’est la fin d’une distorsion cognitive (qui affecte la quasi-totalité
de l’humanité), et c’est un détachement encore partiel du corps et de l’esprit, mais ce n’est pas
le bout de la route.
On compare parfois l’entrée dans le courant à la découverte d’un puits au milieu du désert, un
puits capable d’étancher la soif du voyageur, mais pour lequel on n’aurait ni corde ni seau pour
en tirer l’eau28 ; on la compare aussi au fait, pour un naufragé en mer, d’apercevoir la terre
21 Ce lien est souvent négligé et peut faire sourire le libre-penseur, pourtant il n’est que de voir combien dans
certaines religions le rite, les cérémonies, les « obligations religieuses » et les « interdits », le culte et d’autres
manifestations extérieures de la « croyance » sont jugées importants, au point que pour beaucoup de personnes
« avoir de la religion » se résume à cette orthopraxie individuelle ou sociale…
22 Comme expliqué dans l’Assāda Sutta, qui décrit en comparaison l’état de l’ignorant (avijjāgato).
23 Yato kho, bhikkhave, ariyasāvako imesaṃ pañcannaṃ upādāna-kkhandhānaṃ samudayañca atthaṅgamañca
assādañca ādīnavañca nissaraṇañca yathābhūtaṃ pajānāti, ayaṃ vuccati, bhikkhave, ariyasāvako sotāpanno
avinipātadhammo niyato sambodhiparāyano. (Sotāpanna Sutta)
24 Dhammavinaye ogādhappattā patigādhappattā assāsappattā tiṇṇavicikicchā vigatakathaṃkatā vesārajjappattā
aparappaccayā satthusāsane viharanti. (Nakulapitu Sutta)
25
Ajahn Brahm, Manuel de méditation (chap. 14).
26 Comme « un soleil qui se lève dans le ciel en automne » (saradasamaye), selon le Sarada Sutta.
27 La formulation canonique de l’ouverture de l’œil du Dharma est virajaṃ vītamalaṃ dhammacakkhuṃ udapādi
(mot à mot : « sans tache, immaculé, l’œil de la doctrine survient »). L’œil du Dharma (dhammacakkhuṃ) s’oppose
à l’œil de Māra (māracakkhuṃ), l’œil mondain, que l’Eveil détruit.
28 Kosambi Sutta.
© Thierry Falissard 4 La pensée bouddhiste
ferme au loin29. Ce bourreau qu’est la volonté est enfin vu clairement, mais on reste encore
très largement sous sa coupe. Sa contrepartie, la conscience, est, elle aussi, vue plus
nettement, tandis que les croyances éternalistes sont abandonnées, qu’il s’agisse de l’Être,
de la matière, de l’âme ou de la « vie éternelle ».
Le sotāpanna n’a pas fait disparaître le « soi ». Sa « réalisation » consiste à comprendre qu’il
n’existe pas de « soi », mais seulement un « sentiment du soi » (ahaṁkāra). C’est ce distinguo
qui caractérise ce stade. Ce qu’il prenait pour une réalité absolue disparaît pour laisser la place
à quelque chose de plus « léger » : un reste d’illusion, une croyance irrationnelle tenace, qui
résulte d’un conditionnement physique, psychique et social.
L’être non éveillé a une représentation de lui-même comme d’une entité monolithique, un
« bloc absolu » qui existerait en lui-même et par lui-même, par une sorte d’auto-génération ou
d’auto-suffisance. Avec le passage à l’étape de sotāpanna et la fin de la croyance en un soi
permanent, toutes les défenses, tous les refoulements et tous les faux-semblants tombent.
L’idée que l’on se fait de soi-même change du tout au tout, de façon catastrophique30 : elle ne
se résume plus qu’à une forme vide, une intrication empirique entre les cinq agrégats, un flux
d’éléments divers, dont l’apparente continuité s’explique causalement, avec une primauté de
la conscience, à quoi tout semble se réduire. L’introspection ne montre plus aucun « moi »,
mais seulement les cinq agrégats dans leur interaction. Il semble qu’une distance avec « soi-
même » soit ainsi posée de façon permanente et indéfinissable, une sorte de transcendance
de soi-même par rapport à soi-même, qui procure une forme de libération31. C’est un premier
pas dans le « monde » (non-monde) de la vacuité, un début parfois comparé à une éclosion32,
une vue claire qui développe chez l’ascète ainsi doté (diṭṭhi-sampanna) une connaissance
« non ordinaire » (asādhāraṇa-ñāṇa33) qui l’aide à se diriger correctement dans la Voie. Cette
compréhension de la vacuité n’est pas (ou pas uniquement) une compréhension intellectuelle,
c’est une compréhension existentielle qui finit par engager (ou dégager ?) l’être tout entier34.
L’ascète devient petit à petit un masque vide, un « homme sans qualité » : une simple
conscience d’exister, et non une conscience d’être ceci ou cela en particulier, égalité entre
« être pur » et « néant pur » (pour reprendre des termes hégéliens35).
L’étape de sotāpanna constitue le premier degré de « dépersonnalisation » du pratiquant, de
désengagement (visaṃyoga) de ses différentes identités ; c’est un but qui n’est pas hors de
portée et qui ne requiert pas de devenir moine, ni même de mener une ascèse sévère. Il est
probable d’ailleurs qu’il existe un certain nombre de non-bouddhistes qui sont sotāpanna (ou
en voie de l’être), sans le savoir... De notre point de vue, tout le monde (y compris un
mahayaniste qui se réclame de la voie du bodhisattva36), peut essayer d’atteindre ce stade
dans cette vie-même37. Seuls les « âmes faibles » et les esprits fragiles, dominés par leur
limbisme ou par d’autres pathologies, s’en tiendront écartés :
29 Udakūpama Sutta.
30 Le mot catastrophe vient du grec ancien renversement (καταστροφή), un tour (στροφή) de haut en bas (κατά).
L’équivalent en sanskrit serait parāvṛtti (révolution), le pāḷi *parāvaṭṭi n’est pas attesté, mais le terme viparāvatta
(renversé, changé) se rencontre. Inversement, on peut parler du saṃsāra comme d’une « catastrophe
phénoménale » (selon les mots de Prajñānanda).
31 Prajñānanda (op. cit.) parlait de « séparer le spectacle et le spectateur », comme le propose aussi le Vedānta.
32 Une sortie du poussin (kukkuṭa potakā) de son œuf (aṇḍa), selon le Cetokhila Sutta (Sutta des obstructions
mentales).
33 Ānisaṃsa Sutta. Cette connaissance est « non ordinaire » dans le sens où elle ne peut être partagée avec une
personne non éveillée.
34
Voir Yannick Gautier (De la conscience du souffle à la joie de l’abandon – Le Dharma du Bouddha : un
existentialisme métaphysique ?, Edilivre, 2017).
35 « Das reine Sein und das reine Nichts ist also dasselbe. » (Hegel, Wissenschaft der Logik, 1812)
36 Le stade de sotāpanna correspond à la première étape de la voie du bodhisattva (première bhūmi).
37 Le Mittāmacca Sutta invite d’ailleurs les moines à inciter (samādapeti) leurs proches (non moines) à devenir
sotāpanna.
© Thierry Falissard 5 La pensée bouddhiste
La doctrine [du bien] ultime (nai-śreyasa dharma) consiste en une vue (darśana) subtile et
profonde [de la réalité]. Les Eveillés (jinaiḥ, les victorieux) disent qu’elle est effrayante
(trāsakaro) pour les imbéciles (bālānāṃ) qui n’ont pas les oreilles [préparées à l’entendre].38
Ce premier éveil est tellement important (et bouleversant) que certaines traditions ou pratiques
« spirituelles » le prennent parfois pour le « vrai Eveil », pour un aboutissement39, alors que
ce n’est que le début du chemin final. Le disciple (sāvako), ainsi devenu ascète (sekha), entre
parmi les « nobles » (ariyasāvako) et quitte l’état commun (puthujjana). Sa position est
paradoxale, « décalée » : il a un pied dans le monde et un pied au-dehors ; sans être
complètement éveillé, il mesure les illusions qui emprisonnent l’esprit des gens, et celles qui
le tiennent lui-même encore captif. Il est déterminé à quitter cette maison de fous qu’est le
monde, sait que le détachement complet est la solution, mais n’a pas encore déployé
l’ensemble des moyens nécessaires pour y parvenir.
L’ascète comprend également que toutes les religions « positives », avec leur(s) dieu(x), leurs
croyances et leurs rites, leurs paradis et leurs enfers, toutes leurs mythologies, théories ou
pratiques « ésotériques » et « spirituelles », ne sont pas à prendre au sérieux, à croire à la
lettre : elles ne constituent qu’un moyen de pousser les gens vers un début de détachement,
ou à défaut de les orienter dans cette direction. Cet expédient, qui peut être un « moyen
habile » et efficace pour beaucoup de personnes, lui paraît à présent absurde et maladroit :
une béquille, une prothèse, pour des infirmes incapables de supporter la vacuité.
Malheureusement, les infirmes sont majoritaires dans le monde, et prétendent souvent détenir
seuls la « vérité » et imposer à tous leur point de vue !
Il y aurait, selon le Visuddhimagga, un stade moins avancé que celui de sotāpanna, celui de
cūḷa-sotāpanna (sotāpanna inférieur)40, caractérisé par un certain recul vis-à-vis des
phénomènes physiques et mentaux : l’ascète ne s’identifie plus constamment à l’activité du
corps et de l’esprit, il comprend plus ou moins bien qu’il n’y a pas de soi à y trouver. C’est le
début de la pureté de la vue (diṭṭhi visuddhi), qui doit conduire au stade de sotāpanna.
Selon l’école Theravāda, le sotāpanna n’aura à supporter qu’au plus six vies supplémentaires
(outre sa vie courante)41, et il ne peut renaître dans les mondes inférieurs (comme celui des
animaux) ; le cūḷa-sotāpanna est également assuré de ne pas renaître dans les mondes
inférieurs.
La progression irrésistible
Dans les deux stades suivants (« une-fois-retournant » et « sans-retour »), on s’attaque aux
désirs des sens (kāma-rāga) et à la haine (byāpāda), deux tendances très difficiles à déraciner,
car ancrées dans l’inconscient depuis des milliards de vies.
L’ascète est parfois présenté comme un guerrier42 qui lutte sans relâche contre un ennemi
intérieur : la sensualité, les pulsions. La croyance en un soi permanent était une construction
mentale, émanée des pulsions, une façon pour l’esprit de leur trouver une justification
consciente, tout en les tenant un peu à distance. Cette construction artificielle ayant été
détruite au stade précédent de sotāpanna, il y a un accès beaucoup plus direct à la soif
(deuxième vérité) sous ses différentes expressions d’attirance ou de répulsion à l’égard des
phénomènes, avec une relation à soi-même plus « authentique » et plus claire.
Selon le degré de détachement obtenu vis-à-vis de ces pulsions, on parvient au stade de
« une-fois-retournant » (sakadāgāmin) ou de « sans-retour » (anāgāmī), ainsi appelés parce
38 Naiḥ-śreyasaḥ punar dharmaḥ sūkṣmo gambhīra-darśanaḥ | bālānāṃ aśru[tima]tām uktas trāsakaro jinaiḥ.
(Ratnāvalī, 1-25)
39 Voir par exemple le « satori » dans le Zen.
40
Mentionné dans Visuddhimagga XIX, 27.
41 Selon le Sekhin Sutta, qui distingue trois types de sotāpanna : ceux destinés à vivre sept vies au plus
(sattakkhattuparama), ceux qui en vivront deux ou trois (kolaṅkola), et ceux qui n’en revivront qu’une (ekabījin). Les
commentateurs divergent sur le fait de savoir si, dans les « sept vies », la vie courante est comptée ou non.
42 Voir les « suttas du guerrier » (yodhājīva) : Paṭhamayodhājīvūpama Sutta, Dutiyayodhājīvūpama Sutta, de
l’Aṅguttara Nikāya.
© Thierry Falissard 6 La pensée bouddhiste
que dans un cas l’on est censé ne pas renaître plus d’une fois dans le monde humain et dans
l’autre ne plus y renaître du tout. Le désir, dans les aspects courants de la vie humaine, finit
par être complètement dépassé, et tout phénomène prend une saveur unique, que l’on pourrait
appeler : la « saveur du néant ». La haine (principalement de soi-même) finit aussi par
s’effacer, par compréhension de la non-dualité.
Le « sans-retour », appelé parfois « homme debout » (ṭhitatto puggalo43), renaît en théorie
dans un monde du pur esprit, un monde dévique appelé Suddhāvāsa (composé lui-même de
cinq mondes différents, pour compliquer encore la chose)...
Le bout du chemin
Ayant tranché cinq liens après avoir passé les trois stades précédents, devenu un « sans-
retour » affranchi du désir des sens et de la haine (ainsi que des affects associés, comme la
colère, le remords, la jalousie…), on pourrait penser être parvenu au bout du détachement,
mais il reste en réalité cinq autres liens très subtils à couper !
En effet, l’idée du « soi » n’a pas été complètement surmontée, elle demeure comme une
odeur résiduelle flotte dans l’air ou imprègne un tissu même quand la cause de cette odeur a
disparu44. Le vouloir-vivre ne cède pas aussi facilement, car après avoir dû abandonner le
grossier, il reste à l’ascète à abandonner le subtil, source d’attachements subtils eux aussi,
mais liants néanmoins :
soif d’existence dans le monde de l’esprit pur (rūpa-rāga) ;
soif d’existence dans le monde immatériel (arūpa-rāga) ;
orgueil (māna) ;
agitation (uddhacca) ;
ignorance (avijjā).
Les deux premiers liens sont un reste de vouloir-vivre. Les trois derniers liens sont très subtils :
il y a l’orgueil, dernier reste de l’illusion du soi, orgueil de savoir qu’on est parvenu au sommet
de l’existence, d’avoir dépassé les plus hauts états des mondes immatériels ; l’agitation, qui
n’est plus qu’un reste d’agitation, comme une ride sur un océan de l’esprit devenu presque
immobile (acala citta), agitation minime découlant non du désir mais d’un reste d’ignorance ;
et il y a enfin un reste epsilonesque d’ignorance, un dernier soubresaut de la volonté qui refuse
de se nier elle-même et de voir la vacuité ultime.
Le quatrième stade atteint, et les dix liens tranchés, on est un Eveillé (arhat, arahant) qui, selon
la formule canonique, « voit que la naissance a été abolie, que la vie de renonçant
(brahmacariya) a été vécue, que ce qui devait être fait a été fait, qu’il n’y a rien au-delà45 ».
Pleinement accompli (kevalin), passé sur l’autre rive (pāraṅgato), ayant traversé le flux
(oghatiṇṇo), affranchi de l’ignorance46, il ne produit plus de karma pour une nouvelle existence
(ahosi-kamma : karma ineffectif) mais peut encore subir l’influence d’un karma passé47.
Détaché d’absolument tout, cet être a mis fin à toute souffrance mentale (mais pas à la
souffrance physique), et il n’a plus peur de la mort :
Je ne me réjouis pas de la mort, je ne me réjouis pas de la vie, j’attends mon heure, en pleine
43 Voir l’Anusota Sutta et l’Udakūpamā Sutta. Il est « debout » parce qu’ayant abordé « l’autre rive », il a déjà pris
pied sur le rivage.
44 Voir le Khemaka Sutta à ce sujet.
45
Khīṇā jāti, vusitaṃ brahmacariyaṃ, kataṃ karaṇīyaṃ, nāparaṃ itthattāyāti pajānāti (formule propre à de
nombreux suttas). Nāparaṃ (na-aparaṃ) : « pas de suite, d’état futur », indique la fin du devenir (bhava-nirodho).
46 tamayogaṁ chinditvā, mot à mot : ayant tranché le joug de l’obscurité. On rencontre aussi l’expression
tamatagge : passé de l’obscurité à la clarté suprême (Mahāparinibbāna Sutta).
47 Les exemples sont nombreux : l’arhat Moggallāna, second des disciples du Bouddha, roué de coups par des
bandits, et le Bouddha lui-même (blessure causée par l’agression de Devadatta).
© Thierry Falissard 7 La pensée bouddhiste
conscience et pleine vigilance.48
Le passé est tari, le futur est sans promesse ; ne saisis rien du présent et va ton chemin
tranquillement.49
Avec la dissolution du mental-cœur (citta), le monde (loko) est mort (mato), telle est la [seule]
réalité ultime qui se conçoive.50
Le vouloir-vivre (bhava-netti) est éliminé, la racine du mal-être (dukkha) est annihilée, il n’y a
plus de renaissance à présent.51
Ces sages (dhīrā) s’effacent [de l’existence] comme [s’éteint] la flamme d’une lampe.52
Ayant vu les phénomènes (saṅkhāra) comme différents de moi (parato), nés de causes,
destinés à disparaître ; ayant abandonné toutes les pulsions (āsava), je suis apaisée (sītibhūtā)
et éteinte (nibbutā).53
Ayant mis fin aux pulsions, ayant expérimenté (sacchikatvā) ici et maintenant (diṭṭheva
dhamme) et par lui-même (sayaṃ abhiññā) la libération de l’esprit (cetovimutti), la libération par
la Connaissance (paññāvimutti), et l’ayant pénétrée (upasampajja), il y demeure (viharati).54
Passé sur l’autre rive (tiṇṇo), [il reste] dans le monde (loke) sans aucun attachement.55
Le surhomme bouddhiste, à l’encontre de celui de Nietzsche, n’a pas le « sens de la terre56 »,
car il a dépassé la terre57 ! Toutefois, le nirvāṇa n’est pas ce genre d’« espérance
supraterrestre » contre laquelle vitupérait Nietzsche, avec raison. L’Eveil ne donne pas accès
à une nouvelle dimension, à une éternité ou à un « être en soi » quelconque :
L’Eveil (bodhi) ne peut être conçu en relation avec l’être (sattva) ; comprendre l’absence d’être
(niḥsattva), c’est cela que l’on appelle l’Eveil.58
L’Eveil parfait n’est réalisé ni par le corps (kāya) ni par l’esprit (citta) ; c’est la cessation complète
(vyupaśama) de tous les phénomènes (nimitta). 59
L’arhat ne réside pas dans un monde supérieur ou dans une transcendance divine ; il mène
une vie humaine en apparence ordinaire et n’est d’ailleurs conscient d’être libéré des pulsions,
d’avoir définitivement « déposé le fardeau60 », que lorsqu’il tourne son esprit vers l’intérieur
48 Nābhinandāmi maraṇaṃ nābhinandāmi jīvitaṃ | Kālaṃ ca paṭikaṅkhāmi sampajāno patissato’ti.
(Saṅkiccattheragāthā). Les termes sampajāno (sam−pajañña : plein discernement, pleine connaissance) et
patissato (paṭi−sati : pleine vigilance, pleine conscience) sont souvent considérés comme synonymes, mais on
pourrait rattacher l’un à paññā et l’autre à sati, deux éléments de l’octuple sentier. Les deux termes se retrouvent
fréquemment associés dans l’expression sati-sampajāñña, vigilant et clairvoyant, alliant une compréhension
profonde à la vigilance, rappel constant des caractéristiques de l’existence (et non pas simplement mindfulness
and self-possession comme l’indique le Pali Text Society’s Pali-English Dictionary). Les deux qualités vont de pair,
paññā sans sati ne serait qu’une clairvoyance fugace, un éclair de lucidité, et sati sans paññā serait une attention
stérile, celle du chat qui guette la souris…
49 Yaṃ pubbe taṃ visosehi pacchā te māhu kiñcanaṃ, majjhe ce no gahessasi upasanto carissasi. (Attadaṇḍa
Sutta)
50 Cittabhaṅgā mato loko paññatti paramatthiyā. (Mahā Niddesa 1.42)
51 Bhavanetti samuhatā, ucchinnaṃ mūlaṃ dukkhassa, natthidāni punabbhavo. (Koṭigāma Sutta)
52 Nibbanti dhīrā yathāyampadīpo. (Ratana Sutta)
53 Saṅkhāre parato disvā, hetujāte palokite | Pahāsiṃ āsave sabbe sītibhūtāmhi nibbutā. (Therīgāthā 101)
54 Āsavānaṃ khayā anāsavaṃ cetovimuttiṃ paññāvimuttiṃ diṭṭheva dhamme sayaṃ abhiññā sacchikatvā
upasampajja viharati. (Nanda Sutta - Udāna 3.2)
55 Tiṇṇo loke visattikaṁ. (Ariyapariyesana Sutta)
56
Der Sinn der Erde (Ainsi parlait Zarathoustra, 1883).
57 Terre néanmoins « prise à témoin » par le Bouddha (bhūmisparśa) en preuve de ses efforts vers la vérité.
58 Na bodhiḥ sattvatayā prajñaptā | niḥsattvānubodho hi bodhirityucyate. (Suvikrāntavikrāmiparipṛcchā, I)
59 Na hi bodhiḥ kāyenābhisaṃbudhyate, na cittena | vyupaśamo bodhiḥ sarvanimittānām. (Vimalakīrti-nirdeśa
Sūtra, IV)
60 Voir le « Sutta du fardeau » (Bhāra Sutta).
© Thierry Falissard 8 La pensée bouddhiste
pour en mesurer la vacuité61. Peut-être est-ce ainsi qu’il faut comprendre l’égalité saṃsāra =
nirvāṇa qu’affirme le Mahāyāna62...
L’arhat jouit cependant d’une béatitude (ānanda) de l’esprit difficilement imaginable − ce qui
n’est pas incompatible avec la première vérité de la souffrance liée à l’existence (dukkha), qui
ne concerne que le conditionné (saṅkhāra), alors que l’arhat « a pris pied » dans
l’inconditionné (asaṅkhata). On peut spéculer à l’infini et écrire tous les livres que l’on veut sur
le sujet63, il sera toujours vain de chercher à expliquer cette situation paradoxale (car expliquer
c’est rester dans le conditionné), et également vain de prétendre la réfuter64.
La vie de l’Eveillé se poursuit jusqu’à son terme, malgré l’absence de tout vouloir-vivre, « tout
comme la roue du potier continue à tourner quand le pot est terminé, en raison de l’impulsion
initiale65 », ou comme une branche séparée de l’arbre, encore verte mais destinée à
disparaître, ou comme les dernières braises d’un feu qui s’est éteint. Le couple volonté /
conscience fonctionne « à vide », sans être soutenu par la soif. Dernier reste matériel du
vouloir-vivre, le corps persiste par inertie ; l’être qui « porte son dernier corps »
(sarīrantimadhārin) disparaît définitivement à sa mort (on parle de nirvāṇa sans reste,
anupādisesa-nibbāna) :
Avec la désintégration (bheda) du corps, après la mort, la vie ayant été épuisée, tout ressenti
sensoriel (vedayita) s’apaisera ici-même (deviendra « froid », sīta), n’étant plus objet de
jouissance (anababhinandita).66
Cela rappelle ce qu’écrivait le poète philosophe latin Lucrèce, dans un contexte différent :
Ainsi, quand nous ne serons plus, que le corps et l’âme seront séparés, rompant l’unité de notre
individu, rien ne pourra plus nous atteindre ni émouvoir nos sens, pour nous qui à ce moment-
là n’existerons plus.67
Dans l’hindouisme, l’équivalent de l’arhat serait le jīvan-mukta (« libéré vivant »), et sa
« réalisation » est comparable à celle de l’arhat :
Dans la demeure de la vacuité (śūnyāgāre) se tient l’ascète [nu], immergé (magna) dans la
pureté (śuddha), l’absence de passion (nirañjana) et l’équanimité (samarasa).68
Cette disparition définitive d’un Eveillé est évidemment un scandale pour les tenants des
théories éternalistes ou positivistes, qui ne connaissent que le paradigme binaire
« être/néant » et ne comprennent pas que la réussite dans une « voie spirituelle » puisse (et
doive) mener à la fin complète de l’individualité, ce que rappellent pourtant les grands
« mystiques »69 de tous horizons. Le paradigme indien traditionnel « manifesté/non-
manifesté », bien qu’ignoré par le bouddhisme, pourrait leur permettre de dépasser
l’opposition être/néant, qui n’est qu’un point de vue partiel et partial :
Pour ceux que la Volonté anime encore, ce qui reste après la suppression totale de la Volonté,
c’est effectivement le néant. Mais, à l’inverse, pour ceux qui ont converti et aboli la Volonté,
61 Selon le Sandaka Sutta, ce n’est qu’en tournant l’esprit vers l’absence de pulsions que l’arhat est conscient de
sa libération, tout comme celui qui a subi l’amputation d’un membre n’a pas constamment à l’esprit son infirmité.
62 Egalité qu’on pourrait trouver aussi dans le Theravāda, puisque le nirvāṇa est « sans opposé » (paṭibhāga), voir
le Cūḷavedalla Sutta.
63 Par exemple le volumineux Nirvana and other buddhist felicities (Utopias of the Pali imaginaire), Steven Collins,
Cambridge University press, 1998.
64 Voir The Doctrine of Nirvana in Buddhism (A brief overview), Morad Nazari, 2018 (notamment le paragraphe
Critics of the doctrine of Nirvana).
65 Cette comparaison n’est pas bouddhique, elle est mentionnée par Schopenhauer (Le Monde, vol. 1, livre IV), et
issue d’un texte hindouiste ancien, la Sāṃkhya Kārikā, verset 67: tisṭhati saṃskāra-vaśāc cakra-bhramivad dhrta-
śarīrah (« il reste, sous l’élan initial - tel la roue du potier - investi d’un corps »).
66
Kāyassa bhedā parammaraṇā uddhaṃ jīvitapariyādānā idheva sabbavedayitāni anababhinanditāni sītībhavissatī.
(Dhātuvibhaṅga Sutta ; voir aussi le Gelañña Sutta)
67 Sic, ubi non erimus, cum corporis, atque animai | Discidium fuerit, quibus e sumus uniter apti | Scilicet haud nobis
quicquam, qui non erimus tum | Accidere omnino poterit sensumque movere. (De natura rerum, III-838)
68 śūnyāgāre tiṣṭhati nagno śuddhanirañjanasamarasamagnaḥ. (Avadhuta Gita, VII)
69 Par exemple Maître Eckhart : « le détachement tend vers un pur néant ».
© Thierry Falissard 9 La pensée bouddhiste
c’est notre monde actuel, ce monde si réel avec tous ses soleils et toutes ses voies lactées, qui
est le néant.70
C’est une erreur constante des (nombreuses) doctrines à transcendance « positive » que de
croire en une « vie éternelle » de l’être empirique (ou au minimum de la conscience, sa part
jugée la plus noble), une fois l’Absolu « atteint ». Pour cette raison, elles considèrent souvent
le bouddhisme comme un simple nihilisme. Aveuglées par le vouloir-vivre, elles ne se rendent
même pas compte qu’elles exigent l’impossible.
Concédons, de façon plus positive (mais peut-être moins « bouddhiste »…), que l’on peut voir
aussi cette disparition de l’individualité comme l’accès à un aspect plus vaste de la
conscience :
[Quand on comprend la vérité,] la première chose qui se produit est la perte de l’individualité, et
tout ce qui survient ensuite est un fonctionnement [impersonnel] total : la compréhension de ce
fonctionnement total est indivisible. Ce n’est pas « moi » ni « vous » qui avez cette
compréhension : c’est une compréhension [pure]. Cette connaissance ne s’acquiert pas dans
les livres, car elle n’est pas d’ordre intellectuel. Bien que la conscience opère à travers des
millions de formes, c’est une seule et même conscience [qui est à l’œuvre].71
Récapitulation
Schématiquement, on peut dire que le sotāpanna a dépassé la condition humaine ordinaire, il
a fait sa seconde puberté (comme le disait si bien Prajñānanda) en voyant la vacuité et en
échappant aux illusions les plus courantes ; l’anāgāmī, lui, en ayant éradiqué le désir et la
haine, échappe complètement à la condition humaine ainsi qu’à la part animale qu’elle recèle ;
l’arhat, enfin, échappe à toutes les conditions, humaines ou surhumaines.
Le sotāpanna a compris l’essentiel ; cependant, même s’il est délivré d’une certaine anxiété
(vippaṭisāra) concernant les questions métaphysiques72, il lui reste encore un long « travail sur
soi-même » à entreprendre avant d’atteindre la paix de l’esprit de l’anāgāmī, le presque-éveillé
qui, lui, doit encore maîtriser quelques restes de l’illusion du « soi » et venir à bout de la peur
de la mort, pour parvenir au stade final de l’arhat.
Un « bouddha » a au minimum les mêmes qualités éthiques que l’arhat et le même Eveil, mais
n’a pas suivi le même parcours (décrit plus loin).
Conformément au relativisme bouddhique (exposé dans le premier cercle), il faut bien garder
à l’esprit que ce qui importe est moins l’adhésion (formelle ou réelle) à une doctrine étiquetée
« bouddhisme », ni même la pratique effective d’une telle doctrine, que le détachement obtenu
par l’érosion (partielle ou totale) du vouloir-vivre et la fin de la croyance en l’illusion du soi. Un
tel détachement peut exister en dehors du bouddhisme, même s’il est difficile de prime abord
d’évaluer l’état d’esprit, le niveau de conscience d’une personne, qui nous reste en grande
partie inconnu :
Ne soyez pas un mesureur (pamāṇikā) des individus, ne prenez pas la mesure (pamāṇaṃ) des
autres. Il court à sa perte (khaññati) celui qui prend la mesure des autres.73
Car le « fait métaphysique », c’est l’état de conscience intérieur résultant du détachement,
auprès de cela la doctrine invoquée est sans importance, elle reste de l’ordre du relatif. Pour
cette raison, il y a peut-être des ascètes, hindouistes, chrétiens, musulmans, athées, qui sont
bien plus « bouddhistes » que certains bouddhistes, même s’ils professent des opinions très
différentes ! Il y a cependant le risque pour eux de se trouver « coincés » à un certain stade à
cause de l’illusion du soi qui n’a pas été complètement surmontée (illusion augmentée avec la
croyance en l’immortalité de l’âme ou en une divinité salvatrice).
70
Schopenhauer, Le Monde, IV-71.
71 Nisargadatta Maharaj, Consciousness and the Absolute, 1994 (notre traduction).
72 Voir le Abyākatavatthu Sutta (ou Avyākata Sutta).
73 Mā puggalesu pamāṇikā ahuvattha, mā puggalesu pamāṇaṃ gaṇhittha, khaññatihānanda puggalo puggalesu
pamāṇaṃ gaṇhanto (Migasālā Sutta). Ṭhānissaro Bhikkhu précise qu’il ne s’agit pas pour autant de s’abstenir de
porter des jugements moraux.
© Thierry Falissard 10 La pensée bouddhiste
On pourrait affirmer que le véritable « noyau » d’une religion se découvre chez les ascètes ou
chez les mystiques, et qu’il diffère grandement de l’aspect extérieur, exotérique, de la religion,
qui ne serait qu’un « bricolage » dogmatique, rituel ou cultuel, hérité de l’histoire et des
interprétations humaines, et destiné à un public incapable d’aller plus en profondeur, tout juste
bon à accepter aveuglément des croyances ou à se soumettre à des règles sous une
contrainte sociale. Les religions sont extérieurement très différentes entre elles, mais
convergent probablement toutes vers un noyau commun où s’effacent leurs différences, mais
qui n’est accessible qu’aux ascètes éclairés qui ont su dépasser les apparences et les
traditions, avec toute leur pesanteur et leur emprise mentale.
S’il est difficile de décrire ce qu’est l’Eveil (même quand on est éveillé), car c’est « l’ultime
déception de l’ego74 », « une élimination plutôt qu’une illumination » (Ajahn Brahm), il est en
revanche facile d’indiquer des critères de non-Eveil (en sus des dix liens mentionnés plus
haut). Vous pouvez ainsi être certain de ne pas être éveillé (arhat) si, après introspection, vous
constatez les faits suivants :
votre esprit est assez fréquemment occupé par un monologue intérieur non maîtrisé
(prapañca, papañca : la « petite voix dans la tête ») ;
vous ressentez parfois (ou souvent) un « mal de vivre » incurable, un mal-être
fondamental, une insatisfaction durable, même dans des conditions de vie optimales ;
vous rêvez encore pendant votre sommeil.
L’atténuation de ces « symptômes »75 signale au contraire une progression dans la Voie, dans
le détachement, par affaiblissement des pulsions de vouloir-vivre et vouloir-désirer.
L’erreur du non-éveillé pourrait être décrite par la comparaison suivante : placé devant le
« miroir du monde » (le conditionné), l’être s’identifie par erreur à son reflet dans ce miroir
(l’individu empirique), et souffre en se croyant prisonnier d’une surface limitée, à deux
dimensions, celle du miroir, qui lui renvoie une image insaisissable de lui-même, objet d’un
fort attachement76. C’est en se détournant de ce reflet trompeur (par le renoncement) qu’il
obtient la délivrance (avec la fin de la dualité sujet-objet).
Les autres voies possibles
Les stades précédents relevaient de la voie du disciple, de l’auditeur (śrāvaka), celle de
l’octuple sentier, qui est la voie toute tracée dans le Theravāda. Il y a deux autres voies bien
plus spéciales.
Le bouddha solitaire (pratyekabuddha, paccekabuddha) a atteint l’Eveil sans enseignement,
par ses propres efforts, peut-être par des voies étranges ou des méthodes difficiles à expliquer.
Il vit probablement à une époque ou dans un monde où aucune voie de libération telle que le
bouddhisme n’est disponible, bien qu’il puisse avoir été un ascète bouddhique dans une vie
passée77. Il n’enseigne pas78, non par égoïsme, mais en raison de la difficulté à exprimer son
cheminement et sa réalisation : c’est un mystique de la vacuité qui a « tiré l’échelle » derrière
lui. L’existence de tels êtres prouve que l’on peut s’éveiller sans l’aide du bouddhisme !
Le bouddha parfait (samyaksambuddha, abhisambuddha, sammāsambuddha), cas de figure
le plus rare de tous, est un bouddha solitaire qui a suivi une voie particulière : celle du
bodhisattva. Il a, de par son karma, des qualités supérieures à celles des autres types
74 « Enlightenment is ego’s ultimate disappointment. » (Chögyam Trungpa)
75 Un « effet loupe » peut au contraire faire apparaître chez le méditant une aggravation temporaire de ces
symptômes (notamment le mal de vivre). C’est parce que l’attention soutenue semble accroître l’importance
d’imperfections qui en réalité peuvent être mineures.
76
Comparaison issue de l’Ānanda Sutta (Saṃyutta Nikāya, 22.83) : « C’est comme une jeune personne, coquette,
qui contemplerait son image dans un miroir (ādāse) : elle se regarderait avec un très fort attachement (upādāya no
anupādāya). »
77 D’après Nāgārjuna, Mahāprajñāpāramitāśāstra, XXX.
78 On trouve cependant dans le Saṅkhakathā (commentaire à Dhammapada 290) des paccekabuddha qui
enseignent…
© Thierry Falissard 11 La pensée bouddhiste
d’Eveillés, notamment la capacité à enseigner et, si l’on en croit les textes et la tradition,
l’omniscience et des pouvoirs psychiques exceptionnels. Il est le seul parmi les Eveillés qui
puisse affirmer :
Je demeure dans la sérénité, sans crainte, pleinement assuré de la perfection de mon Eveil. 79
Il nous faut donc expliquer ce qu’est un bodhisattva, puisque c’est l’étape qui précède celle de
bouddha.
Le terme de bodhisattva (bodhisatta), étymologiquement, est habituellement traduit par « être
d’Eveil », ou plus précisément « être engagé vers l’Eveil »80.
Le bodhisattva est un être qui a des ambitions particulières : il ne veut pas être un simple
auditeur, un élève-ascète destiné à quitter l’école après avoir suivi les « cours dharmiques »
et réussi l’examen du nirvāṇa, il veut avant tout devenir professeur pour enseigner à son tour !
Et c’est un parcours bien différent qui lui est dévolu, très spécial, car généralement peu
d’élèves cherchent à devenir professeur (bouddha), un métier difficile, peu gratifiant et qui
n’est pas de tout repos. Le type d’Eveil que le bodhisattva vise est supérieur à tous les autres :
selon l’expression consacrée, c’est le suprême et parfait Eveil (anuttarā samyak-saṃbodhi).
Le bodhisattva s’oblige à rester dans le monde, tout en cherchant à en sortir :
Il suit la voie du nirvāṇa, et cependant n’abandonne pas le cours (prabandha) du saṃsāra.81
Jusqu’ici nous avons assez peu parlé d’amour. Chaque ascète travaille à sa propre libération
dans son intérêt personnel. Ce n’est généralement pas un ermite, il fait partie d’une
communauté (saṅgha) avec laquelle il a des liens plus ou moins lâches. Il respecte son
prochain et peut même veiller à son bien-être, sans forcément l’inciter à entrer dans une voie
de libération dont il connaît les exigences et la difficulté. Il développe sa propre intuition
métaphysique, sa compréhension de la vacuité. Cette compréhension abolit peu à peu les
distances avec autrui, et suscite une compassion à l’égard des êtres non éveillés, voués
indéfiniment par leur propre faute et leur ignorance à la souffrance, à la maladie et à la mort,
au fardeau de l’existence. Si cette compassion est grande, il peut former la détermination
(praṇidhāna) de se consacrer à aider autrui, bien qu’il ne dispose d’aucune « grâce », d’aucun
moyen magique de le « sauver » ni de partager avec lui sa compréhension, sa vue de la
vacuité :
Cette « Vue » transcendante n’empêche pas, bien au contraire, d’agir avec amour, d’avoir
l’intention, autant qu’il est possible, de guérir du mal de vivre ceux qui peuvent l’être. Selon
nous, c’est ainsi qu’il convient de comprendre l’amour dharmique dont provient la
« détermination » du bodhisattva, l’existence d’Éveil. (…) au lieu de jouir sans attendre de la
béatitude du sans-moi et de la félicité que donne la Connaissance de l’Inconditionné, le
bodhisattva essaie de transmettre les moyens de détruire l’illusion du moi, c’est-à-dire l’accès
à l’Absolu, à ceux qui peuvent les recevoir parce que leur Connaissance transcendante s’est
éveillée.82
Cet altruisme requiert un certain degré de détachement, nécessaire à la fois pour enseigner
et pour avoir la motivation d’enseigner, qui peut aller jusqu’à une quasi-disparition du vouloir-
vivre, ce dernier n’étant plus « soutenu » que par la seule détermination altruiste, liée à l’esprit
79 Khemappatto abhayappatto vesārajjappatto viharāmi (Mahāsīhanāda Sutta). Vesārajja (assurance, confiance en
ses propres qualités) désigne les qualités propres à un bouddha.
80 Bhikkhu Bodhi remarque que le terme pāḷi de bodhisatta aurait dû être traduit par « bodhisakta » en sanskrit
(sakta = engagé, dirigé vers) au lieu de « bodhisattva », terme moins clair. Voir Arahants, Bodhisattvas, and
Buddhas, by Ven. Bhikkhu Bodhi, Access to Insight (Legacy Edition), 30 November 2013. En pāḷi, satta est le plus
souvent un être vivant (sans aspect essentialiste : l’emploi dans le sens d’âme ou de substance est rare), alors
qu’en sanskrit sattva a les divers sens d’être, créature, réalité, nature, essence (dans la philosophie Sāṃkhya, c’est
la pure essence de l’Être).
81 Nirvāṇagatiṃ ca gacchati, saṃsāraprabandhaṃ ca na jahāti. (Vimalakīrti-nirdeśa Sūtra, VII)
82 Prajñānanda, Exégèse du Sūtra cœur de la perfection de Connaissance transcendante, 1989.
© Thierry Falissard 12 La pensée bouddhiste
d’Eveil (bodhicitta)83. Le détachement s’accompagne d’une « connaissance transcendante »
(prajñā) plus ou moins développée, qui l’aide à mettre en œuvre des « moyens habiles »
(upāya) pour aider les êtres à se détacher eux-mêmes, selon sa détermination :
Aussi longtemps que je resterai dans le monde conditionné (que je "samsariserai"), j’amènerai
à maturité (paripācayati) les êtres.84
Quel que soit le nombre d’êtres (satva) compris dans la masse de tous les êtres (...) je les
conduirai tous vers l’extinction finale, dans l’élément (dhātu) de l’extinction sans reste.85
Comme le rappellent ces citations, on remarquera, s’il était nécessaire d’y insister, que ce
« sauveur » qu’est le bodhisattva ne conduit pas les êtres vers un paradis quelconque, mais
vers la « maturité » (la « seconde puberté », qui fait connaître la vacuité) et vers l’extinction
finale (parinirvāṇa). Ce n’est pas un « salut » positif qui sauvegarderait l’identité personnelle
en donnant accès à un monde transcendant quelconque. Car la tâche d’un bodhisattva, au-
delà de l’hagiographie « fleurie » très fournie qu’en offre habituellement le Mahāyāna, consiste
surtout à « déniaiser » les ignorants, et non pas à leur promettre des espoirs de survie dans
un hypothétique au-delà.
Là où l’on arrive vraiment dans l’indémontré, c’est quand on suppose que cette détermination
d’aider les êtres à se libérer peut subsister de vie en vie, que le bodhisattva ne va pas
« déchoir » de son statut de « grand être » (mahāsattva) destiné à un Eveil parfait, ni s’éveiller
comme un ascète ordinaire86, qu’il est engagé irréversiblement dans sa voie (avaivartika), et
qu’après avoir cultivé toutes les qualités spirituelles (pāramitā) pendant un nombre énorme de
vies il aboutira lors de sa dernière renaissance à un état de bouddha, avec toutes les qualités
qui l’accompagnent, son karma étant devenu tellement exceptionnel qu’aucun autre état dans
le monde ne lui conviendrait. Il lui faut à la fois une opiniâtreté et un « amor fati », une confiance
dans sa destinée, que n’ont pas les ascètes ordinaires, pour pouvoir conduire, selon son vœu,
un maximum d’êtres sensibles en route vers l’Eveil dans ce « grand véhicule » (sens
fréquemment associé au terme Mahāyāna, par contraste avec le prétendu « petit véhicule »
de l’ascète classique, monoplace ou à capacité de transport limitée).
Dans le Mahāyāna précisément, il semble que l’on forme un peu trop inconsidérément les
vœux de bodhisattva, sans avoir un degré d’Eveil et de détachement minimal. La compassion
du bodhisattva doit être éclairée par sa compréhension de la vacuité, de l’irréalité d’un monde
dans lequel « il se tient sans appui » (asthānayogena tiṣṭhati87), et même de l’irréalité du but
qui fait pourtant l’objet de tous ses efforts :
Il n’y a en réalité aucun être (satva) qui soit libéré (mocita) par l’Eveillé (Tathāgata). Si [de son
point de vue] un tel être existait, ce serait [de sa part] une saisie (grāha) d’un soi (ātman), d’une
existence (satva), d’une âme (jīva), d’une personne (pudgala).88
Il ne doit pas produire (utpādayati) un mental-cœur (cittam) fixé (pratiṣṭhita) sur quoi que ce soit
(kvacid).89
Dans ce qui est vu (dṛṣṭa), [les bodhisattvas] n’ont pas notion (samjñā) de quelque chose qui
serait vu ; dans ce qui est entendu (śruta), ils n’ont pas notion de quelque chose qui serait
entendu ; dans ce qui est senti (mata), ils n’ont pas notion de quelque chose qui serait senti ;
83 Cependant le Theravāda nie que l’on puisse devenir bodhisattva une fois obtenue l’une des trois premières
réalisations (sotāpanna, sakadāgāmin, anāgāmī) alors que le Mahāyāna affirme que c’est possible. Pour l’arhat,
complètement éteint, il est impossible de devenir bodhisattva.
84 Yathā yathā saṃsāriṣyāmi, tathā tathā sattvān paripācayiṣyāmi. (Upāya-kauśalya Sūtra)
85 Yāvaṃtaḥ satvāḥ satvasaṃgraheṇa saṃgṛhītāḥ (...) te mayā sarve anupadhiśeṣe nirvāṇadhātau
parinirvāpayitavyāḥ. (Vajracchedikā Prajñāpāramitā Sūtra, 3)
86 D’où souvent un refus du bodhisattva de suivre les enseignements bouddhiques classiques issus de ce qu’on
appelle le « bouddhisme primitif » (tels ceux du Theravāda) et l’affirmation d’une supériorité du bodhisattva sur tous
les autres types d’ascètes. Pourtant il est moins éveillé qu’un arhat, il peut même renaître comme animal
(cependant, sa dernière renaissance comme bouddha est forcément humaine).
87 Mahāprajñāpāramitāśāstra, chap. XVII.
88 Tat kasya hetoḥ na sa kaścit satvo ‘bhaviṣyad yas tathāgatena mocitaḥ sa eva tasyātmagrāho ‘bhaviṣyat
satvagrāho jīvagrāhaḥ pudgalagrāhaḥ. (Vajracchedikā Prajñāpāramitā Sūtra, 25)
89 Na kvacitpratiṣṭhitaṃ cittam utpādayitavyam. (Vajracchedikā Prajñāpāramitā Sūtra, 10)
© Thierry Falissard 13 La pensée bouddhiste
dans ce qui est connu (vijñāta), ils n’ont pas notion de quelque chose qui serait connu. 90
La voie du bodhisattva semble relever d’une ambition tellement exceptionnelle qu’elle n’est
pas décrite dans le bouddhisme primitif, et qu’elle n’est pas recommandée (bien que reconnue)
dans le Theravāda91. Les Mahāyānistes rétorqueront qu’au contraire la voie de l’arhat est la
plus élitiste et la plus fermée, alors que celle du bodhisattva est ouverte à « l’homme
commun », chaque être pouvant atteindre l’Eveil (en un temps certes plus ou moins long)
puisque chacun participe à la « nature de bouddha », qui est tout et qui est partout… Le
déterministe conclura que de toute façon l’on ne choisit pas, chacun entrant dans la voie qui
lui convient le mieux92.
Notons combien les deux conditions « choisies », celle d’ascète « normal » et celle de
bodhisattva, sont toutes deux insatisfaisantes et imparfaites93 : l’ascète finit par s’éveiller en
laissant derrière lui un monde non éveillé (renonçant au monde, il renonce aussi à améliorer
ou à changer le monde94), tandis que le bodhisattva s’oblige à rester non-éveillé le plus
longtemps possible, sans parvenir cependant à « éviter » l’Eveil final (contradiction suprême,
il s’efforce de ne renoncer ni au monde ni à l’Eveil) !
90 Na dṛṣṭe dṛṣṭisamjñāḥ, na śrute śrutasaṃjñāḥ, na mate matasaṃjñāḥ, na vijñāte vijñātasaṃjñāḥ bhavanti (Bajaur
Mahāyāna Sūtra - Bodhisattvaśikṣā : l’entraînement du bodhisattva). A comparer avec une citation du
Māluṅkyaputta Sutta qui dit le contraire !
91 Le Cariyāpiṭaka (« recueil de conduite ») du canon pāḷi (addition tardive ?) donne des récits de vies passées du
bodhisattva exerçant les pāramitā. Quelques maîtres theravādins se sont réclamés de la voie du bodhisattva (voir
The Bodhisattva Ideal of Theravāda, Shanta Ratnayaka, 1985).
92
On peut ébaucher des parallèles entre les deux types de voie, en comparant les différentes étapes entre elles.
Ainsi le stade de sotāpanna équivaut à la première terre du bodhisattva (pramuditā-bhūmi), celui d’anāgāmī à la
septième (dūraṃgamā-bhūmi), et celui d’arhat à la huitième (acalā-bhūmi).
93 Elles sont en outre très élitistes, chacune à sa façon : si tout le monde devenait ascète, l’humanité s’éteindrait
rapidement, et si tout le monde devenait bodhisattva, personne n’atteindrait l’Eveil…
94 Pour cette raison, l’arhat est parfois vu comme égoïste (ekasārīrika), ce que conteste le Saṅgārava Sutta.
© Thierry Falissard 14 La pensée bouddhiste
Vous aimerez peut-être aussi
- Bruno Bayle de Jessé - Initiation Tantrique (1991) PDFDocument335 pagesBruno Bayle de Jessé - Initiation Tantrique (1991) PDFbooksocialist100% (11)
- Le Point - de Véda À Gandhi - Sagesses de L'indeDocument132 pagesLe Point - de Véda À Gandhi - Sagesses de L'indeGina Filip100% (2)
- Daniélou Alain - Shiva Et DionysosDocument198 pagesDaniélou Alain - Shiva Et DionysosGeorgesLamargelle100% (1)
- Bruno Bayle de Jesse Initiation Tantrique 1991 PDFDocument335 pagesBruno Bayle de Jesse Initiation Tantrique 1991 PDFJakob RodrichsonPas encore d'évaluation
- Alexandra David-Neel - Les Enseignements Secrets Des Bouddhistes Tibétains - 1961 - HighlightedDocument66 pagesAlexandra David-Neel - Les Enseignements Secrets Des Bouddhistes Tibétains - 1961 - Highlightedkonepartners4479Pas encore d'évaluation
- Coeur PDFDocument10 pagesCoeur PDFOuattPas encore d'évaluation
- FM 2013Document19 pagesFM 2013Abou KouadioPas encore d'évaluation
- Yoga Sutras PatanjaliDocument240 pagesYoga Sutras PatanjaliLeandro Martínez100% (1)
- Kusen 2009-Les 12 Idees Contaignantes - Par Maître KeisenDocument61 pagesKusen 2009-Les 12 Idees Contaignantes - Par Maître KeisennicolasPas encore d'évaluation
- Tantra Pouvoirs Supra NormauxDocument16 pagesTantra Pouvoirs Supra NormauxRakotomananaPas encore d'évaluation
- Bouddhisme Vajrayāna PDFDocument8 pagesBouddhisme Vajrayāna PDFDeroy Garry100% (1)
- Formuler Objectif PedagogiqueDocument6 pagesFormuler Objectif PedagogiqueSbee100% (1)
- Santé Et Sécurité Au TravailDocument122 pagesSanté Et Sécurité Au TravailPierre Henri EPOUPas encore d'évaluation
- Shiva SamhitaDocument50 pagesShiva SamhitaDavid DumoutierPas encore d'évaluation
- Bouddhisme Et Franc MaconnerieDocument4 pagesBouddhisme Et Franc MaconnerieCody NguyenPas encore d'évaluation
- Les Quatre Nobles Vérités: Le Dhamma de La ForêtDocument50 pagesLes Quatre Nobles Vérités: Le Dhamma de La ForêtVeljko TomaševićPas encore d'évaluation
- Yun Hsi - Le Mental Cosmique PDFDocument50 pagesYun Hsi - Le Mental Cosmique PDFbigbigui100% (1)
- Advaita VedāntaDocument7 pagesAdvaita Vedāntachristellechilly100% (2)
- Agni Yoga - Helena RoerichDocument168 pagesAgni Yoga - Helena RoerichThechosen WolfPas encore d'évaluation
- Le Coeur Dans Le Shivaisme Tantrique Du Cachemire-Pierre FeugaDocument16 pagesLe Coeur Dans Le Shivaisme Tantrique Du Cachemire-Pierre Feugaitineo2012Pas encore d'évaluation
- Tantrisme Hindou Et Tantrisme BouddhiqueDocument13 pagesTantrisme Hindou Et Tantrisme BouddhiqueGabrielPas encore d'évaluation
- AUBERT, Laurent - Chamanisme, Possession Et MusiqueDocument10 pagesAUBERT, Laurent - Chamanisme, Possession Et MusiqueThiago De Menezes MachadoPas encore d'évaluation
- Vacuite DefinitionDocument8 pagesVacuite DefinitionThierryPenalba100% (1)
- Siddhārtha Gautama Dit Shākyamuni Ou Le Bouddha L'éveilléDocument15 pagesSiddhārtha Gautama Dit Shākyamuni Ou Le Bouddha L'éveillésamfabriPas encore d'évaluation
- Bodhicaryavatara de Shantideva (Louis de La Vallée Poussin 1907)Document168 pagesBodhicaryavatara de Shantideva (Louis de La Vallée Poussin 1907)MonkScribd100% (1)
- Dico Des Symboles Et DivinitésDocument10 pagesDico Des Symboles Et DivinitésNicolae Cuncea0% (1)
- La Roue de La VieDocument8 pagesLa Roue de La Vienicole_plante100% (1)
- 100 Citations Bouddhistes PDFDocument4 pages100 Citations Bouddhistes PDFAblayePas encore d'évaluation
- Dérivation Et FonctionDocument201 pagesDérivation Et FonctionThe Best Channel100% (1)
- PrajnaDocument28 pagesPrajnae.toile100% (1)
- Buddha - Sutras Essentiels, Vol.1Document346 pagesBuddha - Sutras Essentiels, Vol.1critiloPas encore d'évaluation
- 2 Visages de L EspritDocument76 pages2 Visages de L EspritSeraphin Miguel100% (1)
- ReconnaissanceDocument13 pagesReconnaissanceJulien FarachePas encore d'évaluation
- GFCF Outils Et Pilotage de Projets Taf Version FinaleDocument95 pagesGFCF Outils Et Pilotage de Projets Taf Version FinalefzelPas encore d'évaluation
- Résumé Graissage Et LubrificationDocument20 pagesRésumé Graissage Et LubrificationOliver Twiste50% (2)
- Cours Marketing DirectDocument45 pagesCours Marketing DirectMeryem IdbellaPas encore d'évaluation
- Renaître Dans Les Autres Mondes - Méditation Sur Les Conditions Posthumes Selon Guénon, Schuon, CoomaraswamyDocument20 pagesRenaître Dans Les Autres Mondes - Méditation Sur Les Conditions Posthumes Selon Guénon, Schuon, Coomaraswamypassmendjambe100% (2)
- Cahiers Du Yoga n02 p2Document3 pagesCahiers Du Yoga n02 p2Roberto TurciPas encore d'évaluation
- De La Vallee Poussin Musila Et Narada PDFDocument34 pagesDe La Vallee Poussin Musila Et Narada PDFDavid CarpenterPas encore d'évaluation
- Iso 4618 2014 en PDFDocument19 pagesIso 4618 2014 en PDFyassinPas encore d'évaluation
- SutrasDocument309 pagesSutrasnicole_plantePas encore d'évaluation
- La Voie Du Milieu - La VacuitéDocument32 pagesLa Voie Du Milieu - La VacuitéBenoit CHASSAINGPas encore d'évaluation
- Femmes Dans Le Bouddhisme GRFDocument12 pagesFemmes Dans Le Bouddhisme GRFRihab HamedPas encore d'évaluation
- Points Sagesses 299 Points Bouddha Vu Dinh Kim - Les Vies Antérieures Du Bouddha Au Travers Des Jātaka - 2014Document153 pagesPoints Sagesses 299 Points Bouddha Vu Dinh Kim - Les Vies Antérieures Du Bouddha Au Travers Des Jātaka - 2014SERGE MPas encore d'évaluation
- Expose de RelDocument11 pagesExpose de RelJojosPas encore d'évaluation
- Glossaire BouddhisteDocument10 pagesGlossaire BouddhistelirbaPas encore d'évaluation
- Le Sūtra Du CœurDocument3 pagesLe Sūtra Du CœurUsalama ShadariPas encore d'évaluation
- (Etienne Lamotte) Le Traite de La Grande Vertu de Sagesse de Nagarjuna Vol. II (1949)Document526 pages(Etienne Lamotte) Le Traite de La Grande Vertu de Sagesse de Nagarjuna Vol. II (1949)Marcel RobertPas encore d'évaluation
- Daniel Odier - La VoieDocument5 pagesDaniel Odier - La VoieDakkar de BundelkhandPas encore d'évaluation
- SHODOKADocument4 pagesSHODOKAJean-Paul LafittePas encore d'évaluation
- La6 Vertu de Perfection: La Sagesse Ou La Grande Sagesse: PrajnāpāramitāDocument16 pagesLa6 Vertu de Perfection: La Sagesse Ou La Grande Sagesse: Prajnāpāramitāyohan moukagaPas encore d'évaluation
- Mystique VajraynaDocument14 pagesMystique Vajraynanatacha deerPas encore d'évaluation
- GlossaireDocument2 pagesGlossaireJob YiwenPas encore d'évaluation
- La SagesseDocument3 pagesLa SagessePierre Frantz PetitPas encore d'évaluation
- Pensée Chinoise 05.12.13Document4 pagesPensée Chinoise 05.12.13Antoine ZmtPas encore d'évaluation
- Sutras Essentiels Du Canon BouddhiqueDocument346 pagesSutras Essentiels Du Canon BouddhiquethetchaboPas encore d'évaluation
- Advaïta VédantaDocument7 pagesAdvaïta VédantafzefzefPas encore d'évaluation
- Présentation Du TchanDocument9 pagesPrésentation Du TchanJoël BéartPas encore d'évaluation
- Largent de DieuDocument19 pagesLargent de DieuIng. Paul AndrePas encore d'évaluation
- L'ouverture Du Coeur - Tonglen - Maître AtishaDocument11 pagesL'ouverture Du Coeur - Tonglen - Maître AtishaPhil INCONNUPas encore d'évaluation
- Recension Critique Du Livre: La Liberté Naturelle de L'esprit, de LongchenpaDocument17 pagesRecension Critique Du Livre: La Liberté Naturelle de L'esprit, de LongchenpaRemus BabeuPas encore d'évaluation
- Discours de Sai Baba - 1960Document42 pagesDiscours de Sai Baba - 1960AppoloniusPas encore d'évaluation
- zfl2 Zhuan Falun 2Document60 pageszfl2 Zhuan Falun 2brigitte123456Pas encore d'évaluation
- Théorie Des Ensembles Appliquée Au Sudoku Et Algorithmique AssociéeDocument4 pagesThéorie Des Ensembles Appliquée Au Sudoku Et Algorithmique AssociéeThierry FalissardPas encore d'évaluation
- Les Lumieres Et Le Droit NaturelDocument11 pagesLes Lumieres Et Le Droit NaturelThierry FalissardPas encore d'évaluation
- Chap LiberteDocument21 pagesChap LiberteThierry FalissardPas encore d'évaluation
- La Catastrophe de Toulouse Arnaudiès-Nss5408Document5 pagesLa Catastrophe de Toulouse Arnaudiès-Nss5408Thierry FalissardPas encore d'évaluation
- NimittaDocument14 pagesNimittaThierry FalissardPas encore d'évaluation
- PrajnanandaDocument3 pagesPrajnanandaThierry FalissardPas encore d'évaluation
- Une Theorie LibertarienneDocument104 pagesUne Theorie LibertarienneThierry FalissardPas encore d'évaluation
- LINERDocument9 pagesLINERFa TehPas encore d'évaluation
- But de La ManipulationDocument9 pagesBut de La ManipulationBargui NadaPas encore d'évaluation
- Formation D'Equipier de Sapeur-Pompier: Livre 1 - TransverseDocument149 pagesFormation D'Equipier de Sapeur-Pompier: Livre 1 - TransverseMathis BENOISPas encore d'évaluation
- A I1108f PDFDocument79 pagesA I1108f PDFWafa AjiliPas encore d'évaluation
- Support n1 Apercu GeneralDocument33 pagesSupport n1 Apercu GeneralYAWOPas encore d'évaluation
- IPT MPSI DS4 CorrigeDocument12 pagesIPT MPSI DS4 CorrigeSwayziiPas encore d'évaluation
- TD No 2 de Tle D TOSDocument2 pagesTD No 2 de Tle D TOSBertino DidahPas encore d'évaluation
- Aspects Réglementaire BPF Et Organisationnel D'un Laboratoire de Contrôle de Qualité 1Document48 pagesAspects Réglementaire BPF Et Organisationnel D'un Laboratoire de Contrôle de Qualité 1lola benrPas encore d'évaluation
- Mémoire CorrigéDocument99 pagesMémoire CorrigéGUELLIL SidaliPas encore d'évaluation
- Calcul Chute de Tension V2Document5 pagesCalcul Chute de Tension V2aminePas encore d'évaluation
- Laghouasli Azrif 2019Document58 pagesLaghouasli Azrif 2019mohamedPas encore d'évaluation
- Série 01Document2 pagesSérie 01sdfgkePas encore d'évaluation
- Rapport Stage Version Finale - Mohamed HamdiDocument47 pagesRapport Stage Version Finale - Mohamed HamdiMohamed HAMDIPas encore d'évaluation
- TD N°1 Sciences Appliquées Bts 2 Les OndesDocument50 pagesTD N°1 Sciences Appliquées Bts 2 Les Ondesato ndongo fabricePas encore d'évaluation
- 1ére Année OrganisationDocument72 pages1ére Année OrganisationTaha CanPas encore d'évaluation
- CV TEBI Modif-1Document3 pagesCV TEBI Modif-1Eba Jean aymardPas encore d'évaluation
- REVENUS 2021: Investissements Outre-MerDocument8 pagesREVENUS 2021: Investissements Outre-Mer6edgeePas encore d'évaluation
- Devoir & Corrigé 1 Lycée de Moukoundzi NgouakaDocument4 pagesDevoir & Corrigé 1 Lycée de Moukoundzi NgouakagimeymouandaPas encore d'évaluation
- Plaquette CMC Conception Métallique ChaudronnerieDocument2 pagesPlaquette CMC Conception Métallique Chaudronneriendobra-1Pas encore d'évaluation
- Repertoire Milieux Septembre 2023Document162 pagesRepertoire Milieux Septembre 2023brandonssh91Pas encore d'évaluation
- ABHBC Etat de Qualite 2010-2011Document21 pagesABHBC Etat de Qualite 2010-2011Nahli Abdel MottalibPas encore d'évaluation
- Les Equations Algebriques - Aborder Les Inconnues-Par - (-WWW - Heights-Book - Blogspot.com-)Document164 pagesLes Equations Algebriques - Aborder Les Inconnues-Par - (-WWW - Heights-Book - Blogspot.com-)Houcinebeladjat BeladjatPas encore d'évaluation
- Raffaella TEDESCHI: La Critique Artistique D'octave Mirbeau, Lieu D'explorations Et de RéfractionsDocument6 pagesRaffaella TEDESCHI: La Critique Artistique D'octave Mirbeau, Lieu D'explorations Et de RéfractionsPierre MICHELPas encore d'évaluation