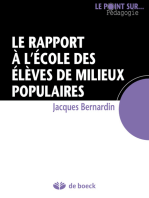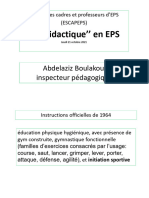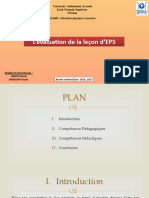Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Les Situations en EPS PDF
Transféré par
Rachid ZouhdyTitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Les Situations en EPS PDF
Transféré par
Rachid ZouhdyDroits d'auteur :
Formats disponibles
Les situations en EPS
A. Les différents types de situation.
1. Les situations de référence.
Elles donnent du sens aux situations d'apprentissage et permettent à l'élève de s'engager dans un projet d'action. Elles
sont souvent la situation d'entrée dans l'activité et la situation d'évaluation formative et sommative.
Elles permettent à l'enseignant de :
ꙭ déterminer les besoins d'apprentissage des élèves → évaluation diagnostique
ꙭ situer la progression de l'élève par rapport à un objectif donné → évaluation formative
ꙭ dresser le bilan des compétences de l'élève de manière cohérente → évaluation sommative
2. Les situations-problème.
P. MERIEU : « Dans une situation-problème, l'objectif principal de formation de trouve dans l'obstacle à franchir,
non dans la tâche à réaliser. »
Pour élaborer une situation-problème, il s'agit de proposer aux élèves de poursuivre une tâche ne pouvant être menée
à bien qu'après avoir surmonter un obstacle. Cet obstacle est alors véritable objectif d'acquisition du formateur.
3. Les situations d'apprentissage.
Elles permettent aux élèves d'apprendre, de progresser, de s'entraîner afin de transformer des acquis antérieurs,
d'acquérir un nouveau savoir ou une nouvelle habileté nécessaire à la résolution du problème posé.
J.P. FAMOSE définit 3 types de situations d'apprentissage :
La situation Pas de précision du but et des opérations.
non définie Ex : les élèves ont un ballon de baudruche chacun et aucune consigne n'est donnée (sauf celles de sécurité)
Précision du but, opération non prédéterminée.
La situation
semi-définie Ex : « vous devez aller marquer le plus de paniers possibles », « aller chercher un objet au fond de l'eau en vous aidant d'une
perche. »
Définition du but et des opérations.
La situation
définie Ex : « vous devez aller chercher un objet au fond de l'eau et pour cela vous prenez une inspiration maximale bloquée, vous
basculez la tête en premier, puis vous vous aidez de la perche pour descendre en faisant des mouvements amples. »
B. Les éléments constitutifs d'une situation.
Chaque élément de la situation doit être pensé et anticipé afin de favoriser les apprentissages et la participation
active de tous.
Didine et le CRPE (2015) -1- Didactique de l'EPS – Les situations en EPS
1. Le nom de la situation.
Il est conseillé de donné un nom à la situation. Ainsi les élèves pourront la reconnaître et la reproduire lors d'une
prochaine séance.
De plus, le nom de la situation permet d'aider l'élève à comprendre le sens de celle-ci et de le motiver.
2. Les objectifs ou compétences visées (par le maître).
Ce sont les intentions du maître en terme de progrès de l'élève. Les objectifs peuvent être l'acquisition d'habilités
motrices mais également des objectifs d'attitudes et de méthodes.
Il semble opportun de clarifier ces objectifs à travers l'énonciation de compétence : « Cette situation vise à ce que
l'élève soit capable de ... »
3. Le but (pour l'élève).
C'est ce que l'élève a à faire, ce qui le motive, le met en mouvement. Afin de permettre une mise en activité rapide et
motivée, le but énoncé doit :
ꙭ être concret, donc compréhensible par les élèves : « Tu dois refaire la même statue que ton partenaire »
ꙭ être adapté à leur niveau : en cycle 3, le but serait « Tu dois faire les mêmes mouvements que ton partenaire »
ꙭ permettre une évaluation. L'élève doit avoir une connaissance du résultat rapide et efficace : « Je dois mettre le
plus de paniers possible en 1 minute. Je marque un point par panier marqué »
ꙭ avoir du sens pour l'élève : « Je dois attraper le plus d'objets flottants possible et pour cela je ne pourrai pas toujours me tenir au bord »,
« Je dois trouver et reproduire 5 mouvements que je fais tous les jours en classe, ceux-ci me serviront dans une future chorégraphie »
4. Les critères de réussite.
Ils permettent à l'élève de connaître les résultats de son action . Ils sont indispensables si l'on veut que les élèves gèrent
leurs propres apprentissages.
Ils permettent aussi à l'enseignant de vérifier le niveau des élèves (et de réguler la situation si nécessaire) mais surtout de
mettre en projet les élèves. La comparaison des résultats permet ainsi d'identifier les effets de l'action et d'établir des
règles d’efficacité.
Ex : « J'ai attrapé un objet de plus lors de mon immersion »
« J'ai marqué 5 paniers en moins d'une minute »
« J'ai marqué 2 paniers de plus que la dernière fois »
Pour cela les critères de réussite doivent être concrets et laisser le moins de place possible à l'interprétation . Des critères
de réussite quantitatifs permettent une meilleure analyse du résultat que des critères qualitatifs souvent sujets à
caution.
Ex : « En athlétisme, j'ai atteint au moins la zone jaune »
« En danse, j'ai fini le mouvement en même temps que mon partenaire »
« En gymnastique, j'ai su reproduire deux fois le même parcours »
Didine et le CRPE (2015) -2- Didactique de l'EPS – Les situations en EPS
5. Le dispositif.
a. L'organisation matérielle.
L'enseignant doit penser à :
- sécurité passive (tapis, installation, …)
Assurer la - sécurité active (position de la parade, …)
sécurité - délimitation de l'espace
- être vu, entendu et compris de tous
- penser à l'espace relatif de chacun et à une quantité de matériel suffisante
Permettre - la liste du matériel nécessaire doit être anticipée afin de perdre un minimum de temps lors de la mise en œuvre. Son installation
se fait avant le cours (récréation) ou pendant le cours (souvent par les l'élèves)
une réelle
- dans un second cas une répartition des tâches est indispensables (qui installe ? Qui désinstalle ? Qui range?)
quantité - cette phase est un moment privilégié pour l'acquisition et l'évaluation des compétences du socle relatives à l'autonomie et à
d'activités l'initiative. Ex : est autonome, un élève sachant monter un atelier en respectant les critères d'efficacité et en partenariat avec
les autres
Faire évoluer - l'installation matérielle ne doit pas être « fermée » afin de faciliter l'introduction de variables et de pouvoir changer de
situation sans perdre de temps
l'espace
b. La durée.
La durée de la situation peut se définir en temps, en nombre d'essais ou en fin de situation → « Le jeu se termine au bout
d'une minute, quand chaque équipe a tiré 10 fois, dès qu'une équipe a marqué 6 paniers »
La durée est fonction de :
ꙭ l'évolution des élèves
ꙭ de leur degré de motivation
ꙭ de leur âge
ꙭ de l'intensité de l'activité
c. L'organisation humaine.
L'organisation humaine doit être toujours anticipée et construite afin d'assurer la sécurité (parade, aide, assurage, …) et
une quantité optimale de travail. Elle permet également le développement des compétences du socle (respecter tous
les autres, jouer avec tous les autres, …)
Forme Temps d'action et de
Intention pédagogique Limites
de travail récupération
- faire découvrir - tous les enfants sont en action en - observation difficile
- réinventer des acquis même temps - intervention individualisée de l'enseignant
Dispersion - travail d'une thématique (les sauts) ou de - chacun peut décider de s'arrêter, de
plusieurs thématiques combinées repartir, de faire à son rythme...
- faire respecter les règles de - régulé par le dispositif - attente souvent importante (éviter des
Vagues fonctionnement de la vague ou de la colonne - action effectifs trop chargés par colonne)
Colonnes - amener l'élève à connaître ses possibilités - retour - inadaptées en maternelle
- attente
- faire prendre conscience de sa place dans - régulé par le dispositif et les - l'enseignant ne peut observer qu'un seul
le groupe et accepter les contraintes rotations groupe
Ateliers - temps d'action important si beaucoup
d'ateliers
- faire l'inventaire des capacités - temps d'action peu important - attente longue
Circuits - réinvestir / évaluer des acquis - les élèves doivent enchaîner plusieurs - trop souvent un seul enfant en action
Parcours ateliers dans un ordre imposé - quantité d'actions à réaliser au détriment
de la qualité
Didine et le CRPE (2015) -3- Didactique de l'EPS – Les situations en EPS
Une fois la répartition humaine matériellement organisée, il est nécessaire de s'intéresser à la formation des groupes :
ꙭ Arbitraires ou Affinitaires ?
ꙭ Hétérogènes ou Homogènes ?
ꙭ Mixtes ou Non-mixtes ?
ꙭ Permanents ou Alternatifs ?
d. Le dispositif de communication.
Les consignes peuvent être transmises par la parole, l'écrit, une image (photo ou vidéo), un schéma ou une
démonstration (du professeur ou d'un élève).
Plus les élèves sont jeunes , plus on doit communiquer à l'aide de supports visuels et plus les consignes doivent être
brèves. Il ne faut pas minimiser la communication non verbale. Les démonstrations d'un élève permettent souvent de
mieux comprendre la consigne.
e. Les contraintes de réalisation.
Il s'agit des conditions à respecter pour exécuter ce qui est demandé. Elles sont en relation avec le règlement de
l'activité, la sécurité et le problème que l'on veut résoudre. Elles permettent une mise en action sécurisée mais surtout
efficace (les élèves ne doivent pas pouvoir contourné les problème posé).
Ex : Pour les élèves très jeunes, on demandera de transporter des ballons (plus encombrants que des balles) pour favoriser l'application de la règle
« transporter un seul objet à la fois »
f. La trame de variance (ou variables).
Les variables donnent des orientations afin de complexifier, simplifier, enrichir les situations. Elles sont présentent
dans la préparation de la séance, elles permettent d'anticiper pour relancer la situation (apprentissage, motivation...)
Objets, engins (ce qui sert à) :
• caractéristiques : taille, poids, forme, densité, nature
Matériel • positions : posée, tenu, mobile, au fond de l'eau
• nombre ...
Milieu Extérieur (cour, parc, stade...) / Intérieur (salle de motricité, gymnase...) ; Surface ; Limites ; Formes ; …
Coopérer / S'opposer
Faire avec (se suivre, se croiser, s'éviter...), faire comme / faire différent
Les autres Forme de groupements
Rôles (joueur, acteur, observateur, juge, arbitre, chorégraphe...)
Nombre, distance, répartition
Espace : Hauteur ; Distance ; Profondeur ; Plans ; Sens, directions ; Trajet ; Formes de déplacement (vague, dispersé) ...
Les composantes de
Organisation corporelle : Partie du corps, segments ; Latéralité ; Position du corps ; Actions ; Intensité ; Précision ...
l'acte moteur Temps : Durée ; Vitesse ; Rythme ; Régularité ; Énergie ; ...
Esthétique (faire plus beau, faire comme) Performance (faire mieux que)
Intentions Prise de risque ( faire plus difficile) Originalité (faire autrement) ...
g. Les comportements attendus.
On y distingue les comportements souhaités mais également les comportements typiques.
Ex : les élèves remplissent les caisses de manière aléatoire. On leur proposera de déplacer des objets de la même couleur que leur équipe pour les déposer
dans des caisses de même couleur.
Didine et le CRPE (2015) -4- Didactique de l'EPS – Les situations en EPS
Vous aimerez peut-être aussi
- PROJET Pedagogique Basket 2014 DefDocument36 pagesPROJET Pedagogique Basket 2014 DefJulien MunozPas encore d'évaluation
- Les NTIC Et Les Impacts Sur Les Missions Des Experts ComptablesDocument12 pagesLes NTIC Et Les Impacts Sur Les Missions Des Experts ComptablesBonnefoyPas encore d'évaluation
- #8 Pédagogie D IntégrationDocument60 pages#8 Pédagogie D Intégrationibtissam mouman100% (1)
- Eps S4Document69 pagesEps S4Mohammed JabranePas encore d'évaluation
- N Mas Cret Motivation e TepsDocument63 pagesN Mas Cret Motivation e TepsghzialePas encore d'évaluation
- L'echauffement en EpsDocument28 pagesL'echauffement en EpsHakim Kachach0% (1)
- Gestion Du Temps PDFDocument57 pagesGestion Du Temps PDFmounir100% (1)
- EPS 1 Didactique de L EPS Et Education A La SanteDocument12 pagesEPS 1 Didactique de L EPS Et Education A La Santelegobayou100% (1)
- Extrait ACCÈS EPS - Cycle 3Document22 pagesExtrait ACCÈS EPS - Cycle 35763ddfac5Pas encore d'évaluation
- APPRENDRE L'AthlétismeDocument109 pagesAPPRENDRE L'AthlétismeBeyaoui HachemPas encore d'évaluation
- Epreuve D'entretien CRPEDocument14 pagesEpreuve D'entretien CRPEVenuti AnnalisaPas encore d'évaluation
- 6 Lectorino LectorinetteDocument32 pages6 Lectorino LectorinetteAudrey BlanchetPas encore d'évaluation
- Accompagner les enseignants du maternel dans leurs missions: Guide pédagogiqueD'EverandAccompagner les enseignants du maternel dans leurs missions: Guide pédagogiquePas encore d'évaluation
- Vols D'aveugle Autour D'une LibrerieDocument14 pagesVols D'aveugle Autour D'une LibrerieMarcela Rivera HutinelPas encore d'évaluation
- Mdi Perfectionnement Au Calcul Cm1 Coloriages Cod - 233 - S - CompressedDocument55 pagesMdi Perfectionnement Au Calcul Cm1 Coloriages Cod - 233 - S - CompressedMohammed sefiani100% (1)
- Eps - Les Exemples de FichesDocument5 pagesEps - Les Exemples de FichesFousséni Koné100% (1)
- Oraux Français CRPEDocument57 pagesOraux Français CRPEVenuti AnnalisaPas encore d'évaluation
- Du Projet A La LeconDocument70 pagesDu Projet A La LeconĀbdél Elk100% (2)
- La Protection SocialeDocument2 pagesLa Protection Socialesoso sosoPas encore d'évaluation
- Didactique FrançaisDocument34 pagesDidactique FrançaisFabien NuryPas encore d'évaluation
- Sciences Expérimentales Et Technologie CE1 GuideDocument65 pagesSciences Expérimentales Et Technologie CE1 Guidekharbaoui100% (1)
- Didactique-Des-Sports-Collectif Basket-Ball, Handball, Football, Volley-Ball PDFDocument45 pagesDidactique-Des-Sports-Collectif Basket-Ball, Handball, Football, Volley-Ball PDFmokhtarkanPas encore d'évaluation
- Ordre Rosicrucien AMORC Vs - Imperator Gary L StewartDocument25 pagesOrdre Rosicrucien AMORC Vs - Imperator Gary L Stewartkaldeter50% (2)
- Resume DIDACTIQUEDocument52 pagesResume DIDACTIQUEyassine saoufiPas encore d'évaluation
- Saut Longueur Elan ReduitDocument6 pagesSaut Longueur Elan ReduitEl-Habti Zaid100% (1)
- Les premiers apprentissages scolaires à la loupe: Des liens entre énumération, oralité et littératieD'EverandLes premiers apprentissages scolaires à la loupe: Des liens entre énumération, oralité et littératiePas encore d'évaluation
- EPS-Acrosport-Enseigner L Acrosport Au Cycle 2 Et 3-2010-Ac. CaenDocument41 pagesEPS-Acrosport-Enseigner L Acrosport Au Cycle 2 Et 3-2010-Ac. Caenleefalk100% (1)
- Cahier #38: Jean RayDocument5 pagesCahier #38: Jean RayHerne EditionsPas encore d'évaluation
- Comment Organiser Une Seance D EPSDocument8 pagesComment Organiser Une Seance D EPSYazine ZeidPas encore d'évaluation
- Athletisme Cycle3Document21 pagesAthletisme Cycle3Mika KaPas encore d'évaluation
- Séquence Math Gs NombresDocument48 pagesSéquence Math Gs NombresjhjhjhsdihfosifoPas encore d'évaluation
- Projet EpsDocument48 pagesProjet EpsSaïf BenbrahimPas encore d'évaluation
- Le rapport à l'école des élèves de milieux populaires: Guide pédagogiqueD'EverandLe rapport à l'école des élèves de milieux populaires: Guide pédagogiquePas encore d'évaluation
- Analyse Didactique Et Traitement Didactique Du Basket BallDocument8 pagesAnalyse Didactique Et Traitement Didactique Du Basket BallYsf AfaPas encore d'évaluation
- 00 (Projet Prévisionnel)Document2 pages00 (Projet Prévisionnel)Mustapha Saidi100% (5)
- Séance5 (Volley-Ball)Document1 pageSéance5 (Volley-Ball)Cherradi eps100% (2)
- Exemple de Projet PedagogiqueDocument40 pagesExemple de Projet PedagogiqueJoao Gonzalez GracioPas encore d'évaluation
- Course de Vitesse PresentationDocument2 pagesCourse de Vitesse PresentationCRISPas encore d'évaluation
- 1 - Formation d'EPSDocument139 pages1 - Formation d'EPSFATIMA EZZAHRAE DRIOUECH100% (1)
- ATLETISMEDocument7 pagesATLETISMEHakim KachachPas encore d'évaluation
- Progressions EPS CP CE1Document10 pagesProgressions EPS CP CE1Pitou NatachaPas encore d'évaluation
- Analyse Et Traitement Didactique en EPS (Cours Enrichi)Document12 pagesAnalyse Et Traitement Didactique en EPS (Cours Enrichi)imad khamlichi100% (3)
- La Planification en EpsDocument10 pagesLa Planification en EpsBilbao AbdoPas encore d'évaluation
- Apprentissage MoteurDocument33 pagesApprentissage MoteurDylan QUINETPas encore d'évaluation
- La Didactique en EpsDocument27 pagesLa Didactique en EpskhadijaPas encore d'évaluation
- La LGDDocument29 pagesLa LGDMàlika IzegPas encore d'évaluation
- Corrosion TecsupDocument34 pagesCorrosion TecsupHebert Vizconde PoemapePas encore d'évaluation
- Situation Dapprentissage en EpsDocument2 pagesSituation Dapprentissage en EpsYel LowPas encore d'évaluation
- Evaluation de La Leçon d'EPSDocument22 pagesEvaluation de La Leçon d'EPSImad eddin El-atabyPas encore d'évaluation
- Projet de Cycle Course D'orientationDocument6 pagesProjet de Cycle Course D'orientationEpsWorkPas encore d'évaluation
- Module EPS - 2020 PDFDocument29 pagesModule EPS - 2020 PDFedane100% (1)
- Exemple Exposé EPS 1 - 1500 MDocument4 pagesExemple Exposé EPS 1 - 1500 Mapi-3802008100% (6)
- Gymnast I QueDocument15 pagesGymnast I QueEl-hany SimoPas encore d'évaluation
- Traitement Didactique de LDocument4 pagesTraitement Didactique de Lamassin chhaibiPas encore d'évaluation
- Fomration IA 2021 - Module EPSDocument55 pagesFomration IA 2021 - Module EPSNajimou Alade TidjaniPas encore d'évaluation
- Séance 1 (Gymnastique)Document1 pageSéance 1 (Gymnastique)Cherradi epsPas encore d'évaluation
- Séance2 (Volley-Ball)Document1 pageSéance2 (Volley-Ball)Cherradi epsPas encore d'évaluation
- Programmation Domaine 2 Petite Et Moyenne Section 2015 2016 GALMDocument2 pagesProgrammation Domaine 2 Petite Et Moyenne Section 2015 2016 GALMbadrPas encore d'évaluation
- Conduites Typiques Et Compétences Visées Volley-Ball PDFDocument1 pageConduites Typiques Et Compétences Visées Volley-Ball PDFyoussefbaqiPas encore d'évaluation
- Séquence SyllabesDocument13 pagesSéquence SyllabesLaetitia AngerPas encore d'évaluation
- Séance4 (Volley-Ball)Document1 pageSéance4 (Volley-Ball)Cherradi eps100% (1)
- Gere Ret PreparerDocument8 pagesGere Ret PreparerHassan AcharkiPas encore d'évaluation
- Unité D'apprentissage en EPSDocument5 pagesUnité D'apprentissage en EPSmielpopsPas encore d'évaluation
- Idees Activités PHONOLOGIE GSDocument8 pagesIdees Activités PHONOLOGIE GSLeón JeanPas encore d'évaluation
- Saut de Main1Document2 pagesSaut de Main1mokhtarkanPas encore d'évaluation
- Orientation Projet Cycle2Document17 pagesOrientation Projet Cycle2Directeur des Ecoles DELPONT VincentPas encore d'évaluation
- Situation-Problemes en EPSDocument15 pagesSituation-Problemes en EPSHoussine Errouifi100% (2)
- Unité 4, Nouveau Taxi 1Document3 pagesUnité 4, Nouveau Taxi 1corell90100% (1)
- Taguelmint Ikram (Développement D'une Application...Document64 pagesTaguelmint Ikram (Développement D'une Application...Fkaier AlaeddinePas encore d'évaluation
- Franchir Une Intersection 1.2Document22 pagesFranchir Une Intersection 1.2ArbnorPas encore d'évaluation
- Fiche Projet AftoutDocument13 pagesFiche Projet AftoutcissmarocPas encore d'évaluation
- DS 6 SupDocument2 pagesDS 6 SupSara MarouchePas encore d'évaluation
- Ce2 Evaluation PronomDocument2 pagesCe2 Evaluation PronomlawdepoliPas encore d'évaluation
- Asservissement de Vitesse D'une Charge Entrainée Par Un Moteur À Courant Continu, À Excitation Séparée ConstanteDocument24 pagesAsservissement de Vitesse D'une Charge Entrainée Par Un Moteur À Courant Continu, À Excitation Séparée ConstanteAlfredho ShactarPas encore d'évaluation
- L Histoire Des VoleursDocument5 pagesL Histoire Des VoleursMustapha Ben MansourPas encore d'évaluation
- AgitationDocument5 pagesAgitationMahefa Serge RakotozafyPas encore d'évaluation
- Traçage Des Données Mobiles Dans La Lutte Contre Le Covid-19 (Note Parlementaire)Document43 pagesTraçage Des Données Mobiles Dans La Lutte Contre Le Covid-19 (Note Parlementaire)l'Opinion100% (1)
- D Omraam Mikhaël Aïvanhov - PDFDocument1 pageD Omraam Mikhaël Aïvanhov - PDFadonis kria100% (2)
- Preconisation TechniqueDocument3 pagesPreconisation TechniquetéléPas encore d'évaluation
- PS42Document2 pagesPS42Franco GalvánPas encore d'évaluation
- Miele G 4991 ScviDocument96 pagesMiele G 4991 ScviAmine MedPas encore d'évaluation
- 2.cor 1fDocument8 pages2.cor 1fbulgo abelPas encore d'évaluation
- Sangalkam - SVT - 5ème - 2022Document2 pagesSangalkam - SVT - 5ème - 2022Kiiller Kiler0% (1)
- Advancing Women's Digital FinancialDocument69 pagesAdvancing Women's Digital FinancialMariem CherifPas encore d'évaluation
- 10 Cheville Et TarseDocument52 pages10 Cheville Et TarseefqsdfqsPas encore d'évaluation
- 4 Limites Continuité.1Document2 pages4 Limites Continuité.1Mohamed Hedi GhomrianiPas encore d'évaluation
- CMAP Health Economics Outline Revised July 2020 1Document26 pagesCMAP Health Economics Outline Revised July 2020 1nihad jessica AGOLIGANPas encore d'évaluation
- Résumé Philosophie de SpinozaDocument20 pagesRésumé Philosophie de SpinozaBerenice Vargas BravoPas encore d'évaluation