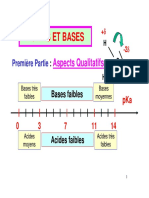Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Cours C5
Transféré par
Othman HabtiCopyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Cours C5
Transféré par
Othman HabtiDroits d'auteur :
Formats disponibles
Sciences-physiques BTS Bâtiment / BTS Travaux-publics
C5 : La corrosion des métaux
Les réactions d'oxydoréduction jouent un rôle important en chimie: combustions
(production d'énergie thermique) ; métallurgie (production des métaux) ;
électrochimie (piles, accumulateurs, électrolyse) ; corrosions des métaux.
I. ACTION DU FER SUR LES IONS CUIVRE
1) Manipulations
Expérience 1
clou
Si on dépose un clou en fer dans une solution de sulfate
dépôt
rouge de
cuivre
(CuSO4 ) aq
de cuivre, il apparaît au bout d’un certain temps un dépôt
Expérience n°1a
(NaOH)aq
de cuivre métallique sur le fer.
agitation
poudre précipité vert
de fer de Fe(OH) 2
qui brunit
(CuSO4 ) aq au contact
de l'air
Expérience n°1b
Expérience 2 fil de cuivre
cristaux
d'argent
(AgNO3 ) aq
Expérience n°2
Si on verse de la poudre de fer dans une solution de clou
dépôt
rouge de
sulfate de cuivre, après agitation, la couleur bleue du
cuivre
(CuSO 4 ) aq
Expérience n°1a
sulfate de cuivre disparaît et devient vert pâle. (NaOH) aq
Si on ajoute à cette dernière solution de la soude,
agitation
poudre précipité vert
de fer de Fe(OH) 2
on observe un précipité vert caractérisant la présence
qui brunit
(CuSO 4 ) aq au contact
de l'air
Expérience n°1b
des ions Fe2+. fil de cuivre
cristaux
d'argent
(AgNO3 ) aq
Expérience n°2
2) Interprétations
Expérience 1
Les ions cuivre (caractéristiques de la couleur bleue) de la solution de sulfate de cuivre se
sont transformés en cuivre métallique sur le clou en fer.
Pour que cette transformation soit possible, des électrons doivent intervenir :
Cu2+ + 2 e- Cu
Expérience 2
La disparition de la couleur bleue montre la disparition des ions cuivre ce qui confirme
l’expérience 1.
Le test caractéristique avec la soude montre que des ions fer II sont apparus dans la
solution. Ils proviennent donc du fer métal.
Pour que cette transformation soit possible, des électrons doivent intervenir :
Fe Fe2+ + 2 e-
Un transfert d’électrons a donc eu lieu entre le fer et le cuivre.
C5 : La corrosion des métaux 1
Sciences-physiques BTS Bâtiment / BTS Travaux-publics
II. DÉFINITIONS
1) Oxydant -réducteur
On appelle oxydant toute espèce chimique qui peut capter un ou plusieurs électrons au
cours d'une réaction chimique.
On appelle réducteur toute espèce chimique qui peut céder un ou plusieurs électrons au
cours d'une réaction chimique.
3) Demi-équation électronique
Un demi-équation électronique d’oxydo-réduction doit respecter a conservation des charges
et des éléments chimiques. Pour écrire la demi-équation électronique d’un couple
oxydant/réducteur, on pourra suivre la méthode ci-dessous.
La demi-équation sera du type :
Oxydant + ne- + kH+ = réducteur + mH2O
où k, m et n sont des entiers.
Les étapes 3 et 4 ne sont pas forcément nécessaire.
4) LE COUPLE REDOX
Un couple oxydant / réducteur est un ensemble d’un oxydant et d’un réducteur d’un même
élément chimique qui se transforment l’un en l’autre par transfert d’électrons.
Cela se traduit par une demi-équation électronique s’écrivant :
Oxydant + n e- = réducteur
C5 : La corrosion des métaux 2
Sciences-physiques BTS Bâtiment / BTS Travaux-publics
Le passage de l’oxydant au réducteur est une réduction :
Oxydant + n e- réducteur
Le passage du réducteur à l’oxydant est une oxydation :
Réducteur oxydant + n e-
5) Quelques exemples de couples redox
Couples redox Demi-équation
2+
Zn / Zn
Ag+ / Ag
Fe2+ /Fe
Fe3+ / Fe
Al3+ / Al
Cl2 / Cl-
H+ / H2
MnO4- / Mn2+
Cr2O72- / Cr3+
6) CLASSEMENT ÉLECTROCHIMIQUE DES COUPLES REDOX
Soient les 2 expériences suivantes :
Observations :
Dépôt de cuivre sur la lame de zinc
Apparition d’ions Zn2+ dans la solution et
appauvrissement en ions Cu2+
Aucune réaction ;
Bilan de la réaction 1 :
Cu2+ + Zn Cu + Zn2+
Oxydant réducteur
Conclusion:
On peut en déduire que l’oxydant Cu2+ est plus fort que l’oxydant Zn2+
ou bien le réducteur Zn est plus fort que le réducteur Cu
C5 : La corrosion des métaux 3
Sciences-physiques BTS Bâtiment / BTS Travaux-publics
A partir de là, on peut classer les 2 couples Cu 2+/Cu et Zn2+/Zn suivant leur pouvoir oxydant et
réducteur.
Dans un couple redox, plus l’oxydant est fort, plus le réducteur est faible (et inversement).
Une réaction d’oxydoréduction a lieu entre deux couples redox. La réaction d’oxydoréduction
a lieu entre l’oxydant le plus fort et le réducteur le plus fort.
La réaction a lieu suivant la règle du gamma.
Ox1 + Red2 Ox2 + Red1
III. POTENTIEL REDOX D’UN COUPLE
1) Description de la pile Daniell
Lorsqu’on réunit l’électrode de zinc à l’électrode de cuivre, il apparaît un courant dans le
circuit dans le sens indiqué (sens inverse du sens de circulation des électrons).
Le pôle + est donc le cuivre, et le pôle – le zinc.
Réaction au pôle - : Zn Zn2+ + 2 e-
Réaction au pôle + : Cu2+ + 2 e- Cu
Bilan
Zn + Cu2+ Zn2+ + Cu (la règle du gamma est bien respectée).
C5 : La corrosion des métaux 4
Sciences-physiques BTS Bâtiment / BTS Travaux-publics
IV. BILAN QUANTITATIF
1) Calcul de la quantité d’électricité Q produite par une pile
Il faut d’abord déterminer la quantité de matière d’électrons mise en jeu dans la réaction
d’oxydoréduction. On la note ne.
On a alors
Q = neF
F = nombre de Faraday, exprime la quantité d’électricité pour 1 mole d’électrons
F = 96500 c (coulomb)
Q s’exprime en coulomb.
7) Calcul de l’intensité du courant I
Q = It
I en A
t en s (durée de passage du courant ou durée de fonctionnement)
Exemple de calculs :
La concentration de chacune des solutions est de C = 0,1 mol/L, pour un volume de 100 mL.
La pile est reliée à une résistance R = 33 Ω.
L’intensité délivrée est de 33 mA.
La tension aux bornes de la pile est de 1,1 V
A la cathode, réduction, électrode positive.
A l’anode, oxydation, électrode négative.
Réactif limitant :
On suppose que les électrodes métalliques possèdent une grande quantité de matière. Les
ions cuivre sont consommés, donc constituent le réactif limitant.
n = C×V = 1,0×10-2 mol. C’est la quantité d’ions cuivre qui limitera la réaction.
Quantité d’électrons libérés
La réaction Cu2+ + 2e- = Cu montre qu’une mole de cuivre consomme 2 moles d’électrons.
Donc ne- = 2 × 1,0×10-2 = 2,0×10-2 mol d’électrons.
Quantité d’électricité :
Q = ne × F = 2,0×10-2 × 96500 = 1,9 × 103 C
On peut en déduire la durée de fonctionnement de la pile :
t = Q/I = 5,8×104 s soit environ 16 h.
Energie disponible :
W = Q×U = 2,1×103 J
ou
Q = I×t = 0,,33×16 = 0,53 Ah
W = Q×U = 0,53× 1,1 = 0,58 Wh
C5 : La corrosion des métaux 5
Sciences-physiques BTS Bâtiment / BTS Travaux-publics
V. CORROSION DES MÉTAUX
1) Corrosion du fer
La corrosion est l’ensemble des phénomènes par lesquels un métal ou un alliage métallique
tend à s’oxyder sous les conditions atmosphériques (problèmes économiques et industriels :
2 tonnes d’acier passent chaque seconde à l’état de rouille, à l’échelle mondiale). Le métal a
donc tendance à retrouver sa forme originelle dans les minerais.
La corrosion est une oxydation des métaux. Le fer peut être oxydé par
un oxydant plus fort, comme l’oxygène de l’air.
Fe Fe2+ + 2e- (oxydation)
O2 + 2 H2O + 4e- 4OH- (réduction)
Bilan :
2Fe + O2 + 2H2O 2Fe2+ + 4 OH-
Le fer s’oxyde donc en présence d’eau et de dioxygène. Les espèces formées vont subir
différentes transformations qui aboutiront à la formation de rouille (voir la vidéo sur la
corrosion du fer). Ce sont des oxydes de fer (oxydes métalliques).
La corrosion du fer est destructrice car la rouille formée va réagir avec le fer encore présent
et se propager à l’intérieur du métal.
Remarque : Le fer peut être oxydé par un métal plus oxydant que lui (comme le cuivre).
C’est se qui se passe si il y a des impuretés dans l’acier. Il se forme une pile de corrosion.
8) Protection du fer
Pour protéger le fer de la corrosion, il y a 2 possibilités :
- on favorise la réduction des ions Fe2+ (Protection cathodique)
- on sacrifie un autre métal (anode sacrificielle)
a. Anode sacrificielle
La structure métallique à protéger est reliée à un métal (anode) dont le
pouvoir réducteur est plus fort.
Le magnésium (Mg) ou le zinc (Zn) peuvent protéger le Fer. La protection
s’arrête quand l‘anode a été entièrement consommée (ou sacrifiée).
(ex : protection des canalisations, coques des navires)
C5 : La corrosion des métaux 6
Sciences-physiques BTS Bâtiment / BTS Travaux-publics
b. Protection cathodique
Afin d’éviter l’oxydation du fer, on peut
favoriser la réduction des ions Fe2+.
Une canalisation en Fer est reliée à un
générateur qui produit des électrons
(borne -).
L’autre borne est reliée à un autre métal
enterré. C’est le sol qui ferme le circuit.
9) Corrosion protectrice
Pour certains métaux comme le cuivre,
l’aluminium, le titane, la formation d’oxydes
métalliques va créer une couche imperméable
à l’oxygène de l’air qui va protéger le métal :
c’est la passivation.
(l’alumine se forme sur l’aluminium, le vert-de-
gris sur le cuivre, etc…)
Cette protection se fait naturellement, mais elle peut être accélérée en reliant le métal à un
générateur : c’est la protection anodique ou anodisation.
10) Protection physique
On dépose sur le métal à protéger une couche d’un autre métal résistant mieux à la
corrosion.
Le dépôt subit généralement un traitement contre la corrosion : passivation, chromage...
Exemples :
l’électrozingage ou galvanisation (dépôt de zinc par électrolyse) , puis passivation de la
couche de zinc
La parkérisation (ou phosphatation)
Une plaque d’acier trempée dans un mélange de phosphate de zinc, de manganèse et de
sodium à 100°C se recouvre d’une couche imperméable et insensible à la corrosion. Utilisée
dans l’industrie automobile.
Autre solution :
Une couche (de peinture, de plastique, de céramique...) non poreuse et isolante
électriquement protège les métaux de la corrosion.
C5 : La corrosion des métaux 7
Vous aimerez peut-être aussi
- Chapitre 3 THERMOCHIMIEDocument6 pagesChapitre 3 THERMOCHIMIEhmza14Pas encore d'évaluation
- CHAPITRE V Liaisons Chimiques Partie I Dec 2021Document11 pagesCHAPITRE V Liaisons Chimiques Partie I Dec 2021Monxef BlrPas encore d'évaluation
- Les Reaction Oxydo ReductionDocument21 pagesLes Reaction Oxydo ReductionmedPas encore d'évaluation
- L'apprentissage des sciences et des technologies par l'expérimentation – Module 4: Le magnétismeD'EverandL'apprentissage des sciences et des technologies par l'expérimentation – Module 4: Le magnétismePas encore d'évaluation
- Rapport de StageDocument55 pagesRapport de Stageouiameabdel50% (2)
- Chimie - Chimie Organique 02Document268 pagesChimie - Chimie Organique 02NAJIM ITTOBANEPas encore d'évaluation
- Révisions-Titrage ColorimétriqueDocument5 pagesRévisions-Titrage ColorimétriqueJayD 46Pas encore d'évaluation
- Chimie Supramoleculaire Bottom UpDocument46 pagesChimie Supramoleculaire Bottom UpOualid El HaddadePas encore d'évaluation
- Les Phenomenes Doxydoreduction - Theorie - 2020Document18 pagesLes Phenomenes Doxydoreduction - Theorie - 2020Lawrence Mundene-timotheePas encore d'évaluation
- 2nd C - C9 Tests Didentification de Quelques IonsDocument8 pages2nd C - C9 Tests Didentification de Quelques IonsSoroPas encore d'évaluation
- Chap7 BtsDocument16 pagesChap7 BtsImen HammoudaPas encore d'évaluation
- TitrageDocument2 pagesTitrageRebecca JacksonPas encore d'évaluation
- Serie1-Chimie Des Solutions-Ch5Document7 pagesSerie1-Chimie Des Solutions-Ch5KOUKI SOFIENPas encore d'évaluation
- OXYDOREDUCTION Le VigneronDocument5 pagesOXYDOREDUCTION Le Vigneronالغزيزال الحسن EL GHZIZAL HassanePas encore d'évaluation
- Les Reactions D'oxydo ReductionDocument6 pagesLes Reactions D'oxydo ReductionAntoine de BeughemPas encore d'évaluation
- 01 Vsepr PDFDocument6 pages01 Vsepr PDFhankoch0% (1)
- Chimie Des Solutions - Chapitre 1Document19 pagesChimie Des Solutions - Chapitre 1Aziz DahhaPas encore d'évaluation
- Dosage de Acide LactiqueDocument3 pagesDosage de Acide Lactiqueالغزيزال الحسن EL GHZIZAL HassanePas encore d'évaluation
- Réactions RedoxDocument4 pagesRéactions Redoxamaghchiche100% (1)
- Exercices Reaction Chimique Bep IndustrielDocument1 pageExercices Reaction Chimique Bep IndustrielhossamkamalPas encore d'évaluation
- Cours-Chimie Des Solutions-Chap I (EPST)Document8 pagesCours-Chimie Des Solutions-Chap I (EPST)Feriel0% (1)
- Electrolyse CoursDocument6 pagesElectrolyse CoursMehdi BnmssdPas encore d'évaluation
- Chapitre II Périodicité Et Étude Approfondie Des Propriétés Des ÉlémentsDocument14 pagesChapitre II Périodicité Et Étude Approfondie Des Propriétés Des ÉlémentsHaithem MouassaPas encore d'évaluation
- Acide BaseDocument35 pagesAcide BaseKhoudia Sy CamaraPas encore d'évaluation
- CH - Coord SMC6 2021 - 2022 AamiliDocument42 pagesCH - Coord SMC6 2021 - 2022 AamiliNabil mifdalPas encore d'évaluation
- DM Vendredi 27 MarsDocument6 pagesDM Vendredi 27 MarsEroline GuelciPas encore d'évaluation
- Chapitre 4CDocument7 pagesChapitre 4CIbrahim OuagaguePas encore d'évaluation
- Expansion de La Chimie Organique Cours 2Document5 pagesExpansion de La Chimie Organique Cours 2zakaria zakiPas encore d'évaluation
- Mines Ponts MP 2019 Chimie CorrigeDocument7 pagesMines Ponts MP 2019 Chimie CorrigeMajda hajjiPas encore d'évaluation
- Transformations Lentes Et RapidesDocument10 pagesTransformations Lentes Et RapidesJosé Ahanda NguiniPas encore d'évaluation
- Devoir de Contrôle N°1 (AVec Correction) - Physique - 2ème TI (2010-2011) MR Abdessatar PDFDocument4 pagesDevoir de Contrôle N°1 (AVec Correction) - Physique - 2ème TI (2010-2011) MR Abdessatar PDFفيديو بالعربيPas encore d'évaluation
- Série5 Liqvap 2022 PC2Document4 pagesSérie5 Liqvap 2022 PC2Aymen GharbiPas encore d'évaluation
- Théorie Des BandesDocument3 pagesThéorie Des BandessoumiaPas encore d'évaluation
- TD Cinetique 2021 LSLL WahabDiopDocument2 pagesTD Cinetique 2021 LSLL WahabDiopNajimou Alade TidjaniPas encore d'évaluation
- 05 Exo Chroma ToDocument1 page05 Exo Chroma TodinaPas encore d'évaluation
- Chap 2 AlcènesDocument43 pagesChap 2 AlcènesWahab Houbad100% (1)
- C1Chim Transformations Lentes Rapides Exercices PDFDocument6 pagesC1Chim Transformations Lentes Rapides Exercices PDFAzizElheniPas encore d'évaluation
- Liste de Réactions en Chimie Organique PCSIDocument3 pagesListe de Réactions en Chimie Organique PCSIlebananistPas encore d'évaluation
- Chapitre 2CDocument15 pagesChapitre 2CIbrahim Ouagague100% (2)
- Ch4 Ds Atome Structure Electronique 28Document2 pagesCh4 Ds Atome Structure Electronique 28Molka HamdiPas encore d'évaluation
- TD Thermochimie IIDocument2 pagesTD Thermochimie IIZougmoréPas encore d'évaluation
- C9Chim Transformations Forcees PDFDocument2 pagesC9Chim Transformations Forcees PDFAzizElheni100% (1)
- SPECTRE DE l'HYDROGENE - Modèle de BOHRDocument4 pagesSPECTRE DE l'HYDROGENE - Modèle de BOHRoussama LabiodPas encore d'évaluation
- ChmTheo S5 Chapitre 7Document32 pagesChmTheo S5 Chapitre 7Abdelhakim BailalPas encore d'évaluation
- Spe Physique Chimie 2021 Zero 1 CorrigeDocument8 pagesSpe Physique Chimie 2021 Zero 1 CorrigeChahid OUAAZIZIPas encore d'évaluation
- Développent Historique Du Concept de L'atomeDocument32 pagesDéveloppent Historique Du Concept de L'atomefad hmaPas encore d'évaluation
- Liaisons ChimiquesDocument42 pagesLiaisons ChimiquesOumar Sall100% (1)
- Exercice Chimie 05Document2 pagesExercice Chimie 05Amine van DreedPas encore d'évaluation
- VotampéroDocument4 pagesVotampéroNada MerzougPas encore d'évaluation
- Methode GranDocument29 pagesMethode GranASMAA KherrazPas encore d'évaluation
- Chimie PDFDocument94 pagesChimie PDFDON DEVATTIPas encore d'évaluation
- S6 Chapitre 7 Interactions Electriques CondensateurDocument10 pagesS6 Chapitre 7 Interactions Electriques CondensateurDaboPas encore d'évaluation
- Chim Orga 2 (Suite Du Dernier Chapitre)Document24 pagesChim Orga 2 (Suite Du Dernier Chapitre)Hk Eh100% (1)
- Examen 24 Mai 2017 Questions Et ReponsesDocument8 pagesExamen 24 Mai 2017 Questions Et Reponseshéma tologiePas encore d'évaluation
- C25 - Courbes Intensite Potentiel PDFDocument8 pagesC25 - Courbes Intensite Potentiel PDFAbdelhakim BailalPas encore d'évaluation
- TD de Thermodynamique Série 3: Université Ibn Zohr Ecole Nationale Des Sciences Appliquées Agadir BTP3: 2018/2019Document5 pagesTD de Thermodynamique Série 3: Université Ibn Zohr Ecole Nationale Des Sciences Appliquées Agadir BTP3: 2018/2019PFEPas encore d'évaluation
- C Ex23 Cin Ca PDFDocument4 pagesC Ex23 Cin Ca PDFعادل الحمديPas encore d'évaluation
- Corrige DM5 PDFDocument15 pagesCorrige DM5 PDFBrandy OdonnellPas encore d'évaluation
- TP de Module ElectrochimieDocument16 pagesTP de Module ElectrochimiefatimazahragramziPas encore d'évaluation
- 04 SeriesDocument14 pages04 SeriesProfchaari SciencesPas encore d'évaluation
- Examen National Physique Chimie 2 Bac SVT 2017 Normale Sujet 2Document6 pagesExamen National Physique Chimie 2 Bac SVT 2017 Normale Sujet 2Othman HabtiPas encore d'évaluation
- Cor Exercices NathanDocument4 pagesCor Exercices NathanOthman HabtiPas encore d'évaluation
- Exos CorrosionDocument4 pagesExos CorrosionOthman HabtiPas encore d'évaluation
- Cor Exercices NathanDocument4 pagesCor Exercices NathanOthman HabtiPas encore d'évaluation
- Sujet PDFDocument1 pageSujet PDFOthman HabtiPas encore d'évaluation
- Batiment PDFDocument92 pagesBatiment PDFHamza Chf100% (1)
- Batiment PDFDocument92 pagesBatiment PDFHamza Chf100% (1)
- ETUDE COMPARATIVE ENTRE TROIS - BENHADDOU Izlane - 1548Document57 pagesETUDE COMPARATIVE ENTRE TROIS - BENHADDOU Izlane - 1548Allaa BoukhelfPas encore d'évaluation
- Exercice SolutionDocument2 pagesExercice SolutionMeryem Chakri0% (1)
- Introduction Et Objet Du Test MatérielDocument44 pagesIntroduction Et Objet Du Test MatérielKevin Jose Gonzalez MoreloPas encore d'évaluation
- TD #2 L2 S.AlimentaireDocument31 pagesTD #2 L2 S.AlimentaireSagacious IvejutenPas encore d'évaluation
- INTRODUCTION Le Sol, Formation Meuble Constituée D'unDocument6 pagesINTRODUCTION Le Sol, Formation Meuble Constituée D'unjaizozPas encore d'évaluation
- PhisiqueDocument8 pagesPhisiquejessee-petit-4524Pas encore d'évaluation
- La FluorineDocument7 pagesLa FluorineMohamed AzPas encore d'évaluation
- Expose en SolDocument1 pageExpose en SolMahdy Legend100% (1)
- La Synthèse D'un Inhibiteur De...Document72 pagesLa Synthèse D'un Inhibiteur De...Monsef EnnajihPas encore d'évaluation
- Roches MagmatiqueDocument3 pagesRoches MagmatiqueSabri NaPas encore d'évaluation
- Parasitologie IspitsDocument116 pagesParasitologie IspitsHindPas encore d'évaluation
- Compte Rendu de Manipulation NDocument6 pagesCompte Rendu de Manipulation NMolka MrabetPas encore d'évaluation
- Université Kasdi Merbah Ouargla 99Document68 pagesUniversité Kasdi Merbah Ouargla 99أميےنة الداہےشPas encore d'évaluation
- TH 2015 Scala Bri No GabrielleDocument255 pagesTH 2015 Scala Bri No Gabrielleنور الزهراءPas encore d'évaluation
- Effet de L'ajout de La Cendre Issue de La CombustionDocument86 pagesEffet de L'ajout de La Cendre Issue de La Combustionr;rPas encore d'évaluation
- Intermédiares Réactionnels en Chimie OrganiqueDocument9 pagesIntermédiares Réactionnels en Chimie Organiqueadnan aitlahcPas encore d'évaluation
- HadjSalah Nadjet 2012 ArchivageDocument175 pagesHadjSalah Nadjet 2012 ArchivagekaltoumPas encore d'évaluation
- Chapitre 4 Les AdjuvantsDocument4 pagesChapitre 4 Les Adjuvantsfarid chalal100% (1)
- 2 - Les Acides Et Les BasesDocument21 pages2 - Les Acides Et Les BasesAmine CompanPas encore d'évaluation
- TP AciditetotalevinDocument2 pagesTP AciditetotalevinNassimaPas encore d'évaluation
- 3 Les Restaurations Par StratificationDocument13 pages3 Les Restaurations Par StratificationPedroPas encore d'évaluation
- Série 4Document2 pagesSérie 4saidPas encore d'évaluation
- Traitement D'eau de ChaudièreDocument6 pagesTraitement D'eau de ChaudièreMust Boujaata100% (1)
- AcidebaseDocument3 pagesAcidebaseabdelkrim salemPas encore d'évaluation
- Évaluation Analytique Pour Le Dosage Du Mercure Dans L'eau PDFDocument6 pagesÉvaluation Analytique Pour Le Dosage Du Mercure Dans L'eau PDFash600Pas encore d'évaluation
- Boughaba WalidDocument68 pagesBoughaba WalidDr. Rachid djoudjouPas encore d'évaluation
- Initiation A La Toxicologie V2 PDFDocument91 pagesInitiation A La Toxicologie V2 PDFFtPas encore d'évaluation
- L'oxydation Catalytique Des Composés Organique Des Composés Organiques Volatils Par Des CatalyseuDocument62 pagesL'oxydation Catalytique Des Composés Organique Des Composés Organiques Volatils Par Des CatalyseuKevin RavelondrambalaPas encore d'évaluation