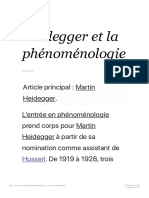Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Philo Morale Et Politique
Transféré par
LOLA LIZOTTitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Philo Morale Et Politique
Transféré par
LOLA LIZOTDroits d'auteur :
Formats disponibles
Philosophie Morale et Politique
INTRO : La figure de Sartre
Image de Sartre dans la doxa (d’aujourd’hui) : Un homme qui se serait toujours trompé sur ce qui
touche à l’histoire et à la philosophie. Mais on lui reconnait son talent d’écrivain.
Sartre : figure écrasante dans l’espace de l’intellectualité de l’après guerre. = immense echo du
courant existentialiste.
C’est sûrement la dominance de sa philo qui fait de sa disqualifiquation une rupture brutale.
= émergence du structuralisme.
Existence libre VS Structure determinante/conditionnante
Structuralisme = Machine de guerre anti pensée Sartrienne.
Déclare la péremption de la “conscience et liberté” considéré comme une illusion forgée tout
au long de l’humanité.
Notoriété de Sartre (omniprésente au XXe s.) = plus populaire qu’universitaire.
1964 = S. reffuse prix Nobel car : “C’est au gens de juger son oeuvre, pas a une institution”
S. a commencé par être un important disciple de Husserl et Heideger. Pour Deuleuze : S. occupe une
position de relai vers une nouvelle forme de la phénoménologie.
Cette omniprésence lié à son engagement. -> écriture Sartrienne semble soumise à un régime
d’interventions permanantes. S. n’a jamais desolidarisé son travail théotique des enjeux politique,
sociaux et historiques de son époque.
Théorisation de l’engagement :
Engagement tente de résourdre pratiquement les difficultés de nature conceptuelles. L’engagement
survient au point de défaillance de la théorie.
Engagement = indice de l’inévidence entre théorie et pratique.
2 magnières de voir l’engagement :
- Dimension critique : s’engager contre qqch
- Dimension prospective : s’engager pour qqch
Engagement = une intervention addressée (pas d’engagement en général). Penser l’engagement
c’est penser le rapport temps/actions et moyen/fins.
Paradoxe -> S’engager c’est être déjà engagé
C’est prendre conscience qu’on est déjà engagé. En s’engageant, le sujet organise la reprise
de son passé pour tracer l’avenir.
Engagement = lieu où la pensée s’efface au profit de l’action.
Premier éclairage sur la conscience :
S. est LE penseur de la liberté = obsession Sartrienne.
Problème de l’étude de la liberté comme concept -> nous sommes à la fois le sujet connaissant et le
sujet à connaître.
Paradoxe = Pour parler de la Liberté on ne peux pas partir de la liberté
Partisants du libre arbitre VS déterminisme rend débat stérile.
Dans la IV partie de l’être et le néant : S. cherche à démonter cette opposition. Pour S. le moyen de
neutraliser ce débat stérile -> réfléchir sur la notion d’Action.
La Transcendence de l’égo amène la voie de l’être et le Néant à travers = Conscience et Liberté
Thèse Être et le Néant -> Il appartient à la conscience d’être libre.
Pourquoi lien avec la conscience ? Par ce que pr S. reflexion sur la liberté = reflexion sur notre liberté.
2 acceptions du terme conscience :
- Une faculté de représentation
- Une instance morale
En philosophie on fait de la conscience le lieu de la raison = donc propre à l’humain.
Conscience = origine des actes et de la connaissance -> On appelle ça un Sujet
2 orientations possible de la réflexion sur le sujet :
- Sujet de la connaissance (piste Carthésienne)
- Sujet morale (piste Rousseauïste)
Chez S. la conscience n’est pas l’origine de la connaissance et il n’y a pas de principe iné de la morale
dans la conscience. (contrairement à Rousseau à travres l’empathie)
Chez S. la morale est entièrement à faire.
Transcendance de l’égo = conception Sartienne de la conscience (+ amorce d’une critique de Husserl)
Sa thèse est la suivante : il faut distinguer entre la conscience et l’égo.
Chez S. : “égo” = “Moi” + “Je” (-> qui est la face active du “Moi”) p.19
Pour S. la conscience ne se réduit pas à l’égo. L’égo est en fait un produit dérivé de la conscience.
Le point de départ de l’essai est une citation de Kant : “Le “je pense” doit pouvoir accompagner
toutes mes représenations.” = Notion de transcendental
Kant : “J’appelle transcendental toute connaissance qui s’occupe non pas tant d’objets aue de notre
mode de connaissance des objets en tant qu’il est possible en général.”
Est transcendental toute enquête qui pose la possibilité de la réfléxion/connaissance
Pour Kant : Les objets (phénomènes) nous sont donnés par la sensibilité.
Connaître c’est appliquer des catégories sur des phénomènes donnés par des sensations.
Le “je pense” pour K. permet que nos représentations ne soient pas chaotiques. Il permet par
exemple que je vois une table (=catégorie du phénomène) comme une unité.
Pour S. l’égo n’est pas coextensif à la conscience. Les deux termes ne se regroupent pas.
S. veut arracher l’égo à la conscience, car l’idée d’intentionnalité rend inutile le recours au “moi”
pour charactériser la conscience.
Intentionnalité : principe qui viens de Husserl -> Toute conscience = conscience de quelque chose.
S. rajoute : “… qui n’est pas elle”. Toute conscience est tourné vers l’exterieur.
Sa structure est d’être en dehors de soi = transcendentale. C’est pourquoi elle ne peut pas être
définie par l’égo.
Pour S. la conscience transcendentale ou conscience premiere = plus originelle que la conscience
interne ou conscience réflechie car on a besoin de la conscience pour dire “moi je” mais on a pas
besoin de l’égo pour penser à un objet.
S. n’entend pas récuser complétement l’égo, mais il le déplace à un autre niveau : celui de la
conscience réflechie. L’égo n’est pas dans la conscience, il est quelque chose pour la conscience. (->
en tant qu’objet)
Lorsque nous parlons de nous même, nous aprlons toujours de quelqun d’autre, d’exterrieur en tant
qu’observateur. Idée chez S. qu’autruit me connait aussi peu/bien aue moi même.
Lorsque S. parle de la conscience de soi transcendentale/irréflechie, il ne prend pas la conscience
comme objet (=paradoxe). Cette conscience émerge simultanément à la conscience d’un objet
transcendental.
Conscience de soi = Conscience d’être conscience de l’objet transcendental.
Ce type de conscience, c’est ce que S. apelle “exister” donc exister = être autre que soi même.
Donc la thèse de S. s’articule en 3 aspects :
- La Simultanéïté de la conscience de soi et de la conscience de l’objet.
- La loi de l’existence de la conscience : Toute conscience est conscience d’être conscience.
- La conscience de soi n’est pas positionnelle d’elle même en tant qu’objet (mais en tant que
conscience de l’objet)
Dans l’Être et le néant, S. désigne cette conscience de soi comme “la présence à soi”.
Domaine de l’irréfléchit = nerf de la transcendence de l’égo
S. critique Husserl en retournant sa propre thèse de l’intentionnalité contre lui. Pour S. le partage du
réflechit et de l’irréflechit est la conséquence néssessaire de la structure intentionnelle de la
conscience.
S. reprochge à Husserl d’avoie été inconséquent vis à vis de sa propre découverte -> faire de l’égo un
concept introuvable dans la conscience. Pour S. l’intentionnalité correctement comprise dyscalifie
d’avance toute référence à l’égo.
Pour S. l’intentionnalité entraine une mutation de l’idée même de l’interiorité. Car tout l’être de la
conscienc est d’être en dehors d’elle.
La conscience irréfléchit se passe donc sur un plan impersonnel ou pré-personnel donc , le “moi” ne
désigne plus une interriorité obsucure et profonde, précisément par ce qu’elle n’est plus dans la
conscience.
L’égo n’est donc qu’un dérivé, une fixation partielle et segondaire de la conscience. -> donc il y a une
vie de la conscience pure que les instances personnelles sont incapables de restituer présisemment
par ce qu’elles en proviennent.
C’est pourquoi parfois on se redécouvre ou on ne se reconnaît pas.
“Tout est dehors, tout jusqu’à nous même : dehors, dans le monde, parmis les autres, voilà où est la
conscience.”
Vous aimerez peut-être aussi
- Aubay PDFDocument22 pagesAubay PDFElchoPas encore d'évaluation
- Dastur, Fran+žoise - D+ęconstruction Et Ph+ęnom+ęnologieDocument245 pagesDastur, Fran+žoise - D+ęconstruction Et Ph+ęnom+ęnologiefelipekaiserf100% (2)
- Conscience Et InconscientDocument6 pagesConscience Et InconscientMamadou Moustapha SarrPas encore d'évaluation
- La Distanciation Positive Chez Ricoeur.Document22 pagesLa Distanciation Positive Chez Ricoeur.Salifou BoubéPas encore d'évaluation
- Reviser Son Bac Avec Le Monde PhilosophieDocument114 pagesReviser Son Bac Avec Le Monde PhilosophieGunnar Calvert100% (3)
- Problématique 1 Problème 1Document20 pagesProblématique 1 Problème 1SARAHPas encore d'évaluation
- Langage, Conscience, Rationalité: Une Philosophie Naturelle, Entretien Avec John SEARLEDocument14 pagesLangage, Conscience, Rationalité: Une Philosophie Naturelle, Entretien Avec John SEARLEYhjfgeriuguiPas encore d'évaluation
- Reviser Son Bac Avec Le Monde PHILOSOPHIEDocument95 pagesReviser Son Bac Avec Le Monde PHILOSOPHIEprofaudaPas encore d'évaluation
- Le Facteur Humain - Christophe DejoursDocument121 pagesLe Facteur Humain - Christophe DejoursMaurício TombiniPas encore d'évaluation
- Marc Richir - Synthèse Passive Et Temporalisation - SpatialisationDocument19 pagesMarc Richir - Synthèse Passive Et Temporalisation - SpatialisationFilippo NobiliPas encore d'évaluation
- 1 L'intentionnalité PulsionnelleDocument13 pages1 L'intentionnalité PulsionnelleMaurizio BadanaiPas encore d'évaluation
- Philosophie Cours Quest-Ce - Que - La - Conscience by Philosophie Cours Quest-Ce - Que - La - ConscienceDocument32 pagesPhilosophie Cours Quest-Ce - Que - La - Conscience by Philosophie Cours Quest-Ce - Que - La - ConscienceElvis Wilfried PossiPas encore d'évaluation
- FormeDocument48 pagesFormeTheLastArchivistPas encore d'évaluation
- Giova 2017 PDFDocument145 pagesGiova 2017 PDFJosé Carlos Cardoso100% (1)
- Le Désir de Merleau-PontyDocument24 pagesLe Désir de Merleau-Pontyrockman22100% (1)
- Intentionnalité Et Intentionnalisme Chez Brentano, La Structure Métaphysique de La Référence IntentionnelleDocument26 pagesIntentionnalité Et Intentionnalisme Chez Brentano, La Structure Métaphysique de La Référence IntentionnelleGKF1789Pas encore d'évaluation
- Quatre Principes de La PhénoménologieDocument25 pagesQuatre Principes de La PhénoménologieLandry SEKI100% (1)
- Heidegger Et La Phénoménologie WikipédiaDocument127 pagesHeidegger Et La Phénoménologie WikipédiaQuoi? Quoi?Pas encore d'évaluation
- Normes Et Contexts I (Maesschalck, Marc)Document40 pagesNormes Et Contexts I (Maesschalck, Marc)Cristián Valdés NorambuenaPas encore d'évaluation
- L'Attention - VermerschDocument39 pagesL'Attention - VermerschEstêvão FreixoPas encore d'évaluation
- La Transcendance Des Signification Dans L'idéalisme Transcenda, Ntal de HusserlDocument27 pagesLa Transcendance Des Signification Dans L'idéalisme Transcenda, Ntal de HusserlGKF1789Pas encore d'évaluation
- Denis Seron-Ce Que Voir Veut Dire-Essai Sur La Perception-JerichoDocument315 pagesDenis Seron-Ce Que Voir Veut Dire-Essai Sur La Perception-JerichoAMINEPas encore d'évaluation