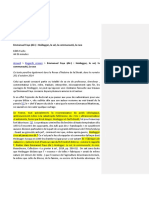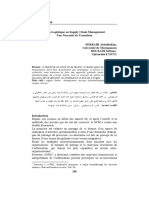Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
B. Dreveton, La Crise Sanitaire Vue Par Les Managers Publics Cairn - Info
Transféré par
GONNE JeromeTitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
B. Dreveton, La Crise Sanitaire Vue Par Les Managers Publics Cairn - Info
Transféré par
GONNE JeromeDroits d'auteur :
Formats disponibles
La crise sanitaire vue par les managers publics | Cairn.
info 31/03/2021 17(47
La crise sanitaire vue par les managers publics
Une hybridation de la performance publique ?
Benjamin Dreveton
Dans Revue française de gestion 2020/8 (N° 293), pages
139 à 149
Article
« J’en ai la conviction profonde : l’organisation de l’État et de notre action
doit profondément changer (…) Face à l’épidémie, les citoyens, les
entreprises, les syndicats, les associations, les collectivités locales, les agents
de l’État dans les territoires ont su faire preuve d’ingéniosité, d’efficacité, de
solidarité. »
.
— intervention du Président Emmanuel Macron, 14 juin 2020
C omme l’indiquent ces propos, la crise sanitaire replace sur le devant de
la scène les organisations publiques. Ces structures (hôpitaux,
collectivités locales, lycées, universités, commissariats de police, etc.) se
1
retrouvent au centre de toutes les attentions. Si les réformes ayant rythmé les
récentes transformations de ces organisations ont conduit à initier une
culture de la performance, leur gestion de la crise sanitaire constitue une
https://www-cairn-info.ressources.univ-poitiers.fr/revue-francaise-de-gestion-2020-8-page-139.htm Page 1 sur 18
La crise sanitaire vue par les managers publics | Cairn.info 31/03/2021 17(47
opportunité pour repenser l’évaluation de leur performance. Elle permet de
nourrir une réflexion sur le sens accordé par les managers à la notion de
performance lorsque celle-ci est qualifiée de « publique ». Ainsi, cette
recherche explore la problématique suivante : Quelles sont les conséquences
de la crise sanitaire sur les représentations de la performance des managers
publics ?
Les travaux de recherche sur le New Public Management et leurs 2
prolongements sur le concept de performance constituent l’ancrage
théorique et conceptuel de la recherche. Au niveau méthodologique, l’étude
s’appuie sur l’analyse secondaire d’une recherche menée au sein d’une
collectivité locale. Cet article défend l’idée suivante : en fragilisant les
fondamentaux premiers de ce concept, la crise sanitaire engendre le
déploiement d’une vision hybride de la performance pour les managers
publics.
L’article est structuré en trois parties. La première expose les fondements de 3
la recherche. La deuxième présente la méthodologie de l’étude. La dernière
partie décrit les modalités d’hybridation du concept de performance.
I – Crise sanitaire, organisations publiques et
performance
Historiquement, de nombreuses crises ont rythmé l’évolution des 4
organisations publiques. Toutefois, si la crise de l’État-providence a permis
d’institutionnaliser le concept de performance, la crise sanitaire de la Covid-
19 semble, a contrario, le déstabiliser fortement.
1. La crise de l’État-providence ou
l’institutionnalisation de la notion de performance
publique
Le déploiement de la notion de performance peut être appréhendé comme 5
une conséquence première des difficultés de l’État-providence. Au cours des
années 1970, l’État est soumis à une triple crise : de financement, de
https://www-cairn-info.ressources.univ-poitiers.fr/revue-francaise-de-gestion-2020-8-page-139.htm Page 2 sur 18
La crise sanitaire vue par les managers publics | Cairn.info 31/03/2021 17(47
légitimité mais aussi d’efficacité et d’efficience (Rosanvallon, 1981). Cette
dernière crise entraîne l’implantation progressif du New Public Management
et, avec lui, celui du concept de performance au sein de ces organisations.
Le New Public Management est défini par Hood (1991) comme « l’ensemble des 6
doctrines administratives sensiblement similaires qui a dominé le
programme de réforme bureaucratique dans de nombreux pays membres de
l’OCDE depuis les années 1970 ». Il se fonde sur un principe central : la
modernisation de la gestion des organisations publiques repose sur
l’application des pratiques et des outils traditionnellement mobilisés par les
entreprises du secteur privé (Ittner et Larcker, 1998). Ainsi, il institue une
nouvelle vision du management qui positionne la performance au cœur de
l’action publique. Cette orientation convoque une conception traditionnelle
de la performance. Celle-ci se fonde sur le triptyque « Moyen-Objectif-
Résultat » et vise à maîtriser l’efficacité et l’efficience des actions engagées.
Comme le résume Mathiasen (1996), le New Public Management entraîne une
focalisation de la gestion publique sur la notion de résultat à travers le prisme
de l’efficacité et de l’efficience. Les modèles traditionnels de la performance
sont alors adaptés aux spécificités des organisations publiques. Dupuis (1981)
replace l’usager au cœur de ce modèle et souligne l’importance d’évaluer leurs
attentes et leur satisfaction. Gibert (1986) décrit la « double fonction de
production » de ces organisations et propose de mesurer le résultat de
l’action mais aussi ses conséquences pour la société. Plus récemment,
Bouckaert et Halligan (2008) réaffirment l’importance de cette notion en
présentant une typologie des usages de la performance. À l’aube du 21e siècle,
les réformes de l’action publique s’appuient sur cette vision de la
performance. De la loi organique relative à la loi finance (LOLF) en 2001 au
Programme action publique de 2022 en passant par la modernisation de
l’action publique en 2012 et la révision générale des politiques publiques
en 2007, l’État engage de nombreuses réformes visant à moderniser sa
gestion et donc à rendre plus performante son action. Cette volonté s’étend à
l’ensemble de ses domaines d’intervention. En 2007, avec le volet de la loi
relative aux Libertés et Responsabilités des universités portant sur les RCE
(responsabilités et compétences élargies), les universités doivent faire face à
ce nouvel enjeu et rendre plus autonome la gestion budgétaire de leur masse
https://www-cairn-info.ressources.univ-poitiers.fr/revue-francaise-de-gestion-2020-8-page-139.htm Page 3 sur 18
La crise sanitaire vue par les managers publics | Cairn.info 31/03/2021 17(47
salariale. De la même façon, la mise en place progressive depuis 2004 de la
« tarification à l’activité » conduit les hôpitaux à changer leur mode de
financement, dorénavant l’enveloppe financière globale est définie suivant le
niveau d’activités et non suivant le montant du budget de l’année précédente.
En synthèse, cette évolution se traduit par un mouvement de 7
managérialisation des pratiques de l’organisation publique (Kurunmakï,
2009).
2. La crise sanitaire : un vecteur de déstabilisation de
la performance publique ?
La nature et l’ampleur de la crise sanitaire de la Covid-19 fragilisent la notion 8
de performance. Une double déstabilisation est observée.
La première concerne les fondements de la notion de performance. Les 9
systèmes traditionnels de mesure de la performance reposent sur une mise
sous tension des ressources et notamment des ressources financières. Or,
depuis le début de la crise sanitaire, ces moyens sont écartés des réflexions.
Par exemple, au cours du premier confinement, l’État décide d’augmenter le
budget de la recherche de 25 milliards. De la même façon, alors que le coût
des agences d’État est régulièrement débattu, le Centre national
d’enseignement à distance met à disposition gratuitement ses services et ses
produits afin d’assurer une continuité pédagogique. Dans le même temps, la
notion de résultat peut, elle aussi, être questionnée. À titre d’exemple, il a été
demandé aux policiers de sanctionner les citoyens qui ne respecteraient pas
les modalités du confinement. Comment évaluer la performance de ces
agents ? En chiffrant le nombre de contraventions dressées ? Ou en essayant
de qualifier les conséquences de leurs actions sur la propagation du virus ? La
notion de résultat se transforme : d’une logique de quantification de l’action
à court terme, elle s’oriente vers une logique d’évaluation des effets de l’action
à moyen et long-terme. Enfin, la gestion de la crise sanitaire engendre aussi
un renouvellement de la notion d’objectif. Notion centrale des modèles de
performance, l’objectif doit être fixé en amont de l’action afin de vérifier sa
réalisation dans le futur. Or, la crise sanitaire signale la difficulté de figer ces
objectifs a priori et donc d’évaluer les résultats ex-post. Afin d’illustrer ce
https://www-cairn-info.ressources.univ-poitiers.fr/revue-francaise-de-gestion-2020-8-page-139.htm Page 4 sur 18
La crise sanitaire vue par les managers publics | Cairn.info 31/03/2021 17(47
propos, comment définir une valeur cible à l’objectif « nombre de malades
guéris de la Covid-19 » alors que, dans le même temps, il est impossible de
prévoir la propagation du virus ? Si les notions de moyen, de résultat et
d’objectif sont détournées de leur sens initial, les mesures qui s’attacheraient
à évaluer l’efficience et l’efficacité de l’action publique s’avèrent délicates à
mettre en œuvre.
La seconde déstabilisation est conceptuelle : les finalités classiques de la 10
notion de performance sont fragilisées. La performance se trouve confrontée
à un contexte nouveau qui ne lui permet plus de juger de l’action publique et
de ses effets. La conception défendue par les tenants du New Public
Management montre ses limites : avec la crise sanitaire, l’utilisation des
mesures de performance ne peut se cantonner uniquement à vérifier
l’efficacité et l’efficience de actions. La finalité des systèmes de pilotage de
performance se déplace. Il ne s’agit plus tant de mesurer un résultat que
d’essayer de comprendre comment celui-ci s’est formé. Ce constat fait écho
aux travaux de Bourguignon (1997) qui soulignent la polysémie de cette
terminologie. Si la performance est souvent associée à l’idée d’un succès, elle
peut aussi prendre la forme d’un résultat (sans que celui-ci soit synonyme de
succès) ou, plus simplement, du pilotage d’une action. La crise sanitaire
semble avoir recentrée les évaluations de la performance sur cette dernière
intention. Ainsi, si les hôpitaux peuvent difficilement définir un objectif de
nombre de malades guéris, ils peuvent agir sur les modalités de leur
organisation afin de les accueillir et de les soigner. Cette logique, fondée sur
le pilotage de l’action, se retrouve au sein des universités lorsque celles-ci
décident d’investir fortement en matériel informatique afin d’assurer la
réalisation des enseignements à distance et donc la continuité des cursus
universitaires. À la suite de ces deux constats, cette recherche étudie la
manière dont les managers envisagent les répercussions de la crise sanitaire
sur l’évaluation de la performance. Notre problématique est la suivante :
Quelles sont les conséquences de la crise sanitaire sur les représentations de
la performance des managers publics ?
II – Méthodologie de la recherche
https://www-cairn-info.ressources.univ-poitiers.fr/revue-francaise-de-gestion-2020-8-page-139.htm Page 5 sur 18
La crise sanitaire vue par les managers publics | Cairn.info 31/03/2021 17(47
La recherche relatée repose sur une analyse secondaire. Cette méthodologie 11
« consiste dans le réexamen d’un ou plusieurs ensembles de données
qualitatives dans l’optique de poursuivre des questions de recherche qui sont
distinctes de celles de l’enquête initiale » (Thorne, 2004, p.1006). Heaton
(2004) présente une typologie des recherches mobilisant l’analyse secondaire
de données qualitatives :
1. La supra-analyse se consacre à de nouvelles questions non abordées lors 12
de l’analyse primaire.
2. L’analyse supplémentaire aborde une question qui a émergé lors de
l’analyse primaire mais qui n’a pas pu être considérée.
3. La ré-analyse remobilise des données pour vérifier les analyses
primaires.
4. L’analyse amplifiée regroupe plusieurs recherches afin de mener des
comparaisons.
5. L’analyse assortie combine des données issues de recherches
secondaires avec une étude reposant sur des données primaires. La
méthodologie de cette recherche est assimilable à une « analyse
assortie ». Elle se décompose en deux temps. Le premier s’est
matérialisé par une recherche-intervention menée dans une collectivité
locale de 2016 à 2017. Le second a consisté à réinvestir ce terrain de
recherche en 2020.
Le premier temps de la recherche correspond à la première phase d’une 13
recherche-intervention. Elle repose sur la réalisation de seize entretiens
semi-directifs menés de juin à septembre 2016 (tableau 1). Ces derniers
permettent de définir les représentations des acteurs sur les enjeux de la
création d’un nouvel outil de pilotage de la performance. L’ensemble de ces
données a été étudié par une analyse thématique (Bardin, 2013). Quatre
thèmes sont utilisés pour analyser les représentations des acteurs : le
contexte de gestion de la direction/du service, les outils utilisés, les besoins
en termes d’outil de pilotage de performance et les enjeux du projet
d’implantation d’un tableau de bord visant à piloter la performance.
https://www-cairn-info.ressources.univ-poitiers.fr/revue-francaise-de-gestion-2020-8-page-139.htm Page 6 sur 18
La crise sanitaire vue par les managers publics | Cairn.info 31/03/2021 17(47
Ce terrain de recherche a été de nouveau sollicité au cours de la période de 14
déconfinement. Lors de ce second temps de la recherche, les managers ont
été de réinterrogés. Douze entretiens semi-directifs ont pu être menés de
mai et juin 2020 (tableau 2). Le mode de recueil des données a été adapté au
contexte de l’étude : entretien à distance, entretien téléphonique et
administration d’un questionnaire.
Ces entretiens visent à comprendre les conséquences de la crise sanitaire sur 15
les représentations des acteurs. La grille d’analyse étudie la vision des
managers sur l’outil de gestion créé trois ans auparavant. Trois thématiques
sont définies : l’évolution des représentations sur l’outil (contenu et finalités),
sur ses usages et sur les nouveaux besoins des acteurs en termes de pilotage
de la performance.
Au cours de ces deux phases de recherche, l’ensemble des entretiens a fait 16
l’objet de retranscriptions validées par les acteurs. Enfin, l’analyse de ces
données a été complétée par une étude des documents internes (document
de présentation du projet, compte-rendu de réunions, rapports d’activités
des services).
III – La crise sanitaire : quelles conséquences sur les
représentations de la performance ?
Après avoir présenté la vision de la performance développée par les managers 17
de la collectivité au cours du projet de création d’un outil de pilotage, cette
troisième partie explore les changements de représentations liés à la crise
sanitaire.
Tableau 1 : Entretiens menés au cours de la première
phase de recherche
Entretien Fonction Durée de l’entretien
1 Directeur général adjoint 1 h 30
2 Chargé de mission 1 h 15
https://www-cairn-info.ressources.univ-poitiers.fr/revue-francaise-de-gestion-2020-8-page-139.htm Page 7 sur 18
La crise sanitaire vue par les managers publics | Cairn.info 31/03/2021 17(47
3 Directeur 1 h 05
4 Élu 35 min
5 Directeur 1 h 00
6 Responsable de service 45 min
7 Responsable de service 50 min
8 Responsable de service 1 h 10
9 Technicien 40 min
10 Directeur 45 min
11 Élu 30 min
12 Responsable de service 1 h 00
13 Responsable de service 50 min
14 Responsable de service 1 h 00
15 Technicien 40 min
16 Responsable de service 1 h 00
1. Un projet qui véhicule une représentation
traditionnelle de la notion de performance
En 2017, la collectivité locale partenaire de la recherche s’engage dans la 18
création d’une intercommunalité. Parmi les arguments justifiant sa
transformation en communauté urbaine, l’utilisation plus efficace et plus
efficiente des moyens est clairement affichée : « La mutualisation humaine et
financière, induite par ce regroupement, entraînera à moyen et long terme la
réduction des coûts pour tous. L’élargissement du périmètre permettra de les
rationaliser » (site internet de la nouvelle intercommunalité).
La recherche étudie la situation de la direction Voirie de cette organisation. 19
Avec le déploiement de la nouvelle intercommunalité, cette direction voit ses
effectifs augmenter de 65 %. Son périmètre d’intervention passe d’une seule
https://www-cairn-info.ressources.univ-poitiers.fr/revue-francaise-de-gestion-2020-8-page-139.htm Page 8 sur 18
La crise sanitaire vue par les managers publics | Cairn.info 31/03/2021 17(47
commune à 40, de 400 km à 2 000 km de voies, les 5 000 actes administratifs
comme les 4 000 signalements de problèmes doublent. Ces changements
questionnent les modalités de la gestion des activités de cette direction :
Comment continuer à maîtriser la qualité du service public sur le nouveau
territoire ? Face à cet enjeu, la direction entreprend un projet visant à
implanter un nouveau système de pilotage de ses activités. Comme l’indique
le document de présentation du projet, l’objectif de performance est
clairement identifié : « À la suite de plusieurs rencontres (…), ce document
présente les modalités d’une démarche de mise en œuvre d’un système
d’indicateurs de la performance pour la direction » ; « Afin de mettre en place
un système de pilotage de la performance, quatre étapes structurent la
progression du projet ».
Tableau 2 : Entretiens menés au cours de la seconde
phase de recherche
Entretien Fonction Durée Mode d’administration
1 Directeur général adjoint 42 min Entretien à distance
2 Chargé de mission 1h Entretien à distance
3 Directeur 30 min Entretien à distance
4 Responsable de service 30 min Entretien téléphonique
5 Directeur – Questionnaire
6 Responsable de service 45 min Entretien à distance
7 Responsable de service 20 min Entretien téléphonique
8 Responsable de service 40 min Entretien téléphonique
9 Responsable de service – Questionnaire
10 Responsable de service – Questionnaire
11 Responsable de service – Questionnaire
12 Technicien – Questionnaire
https://www-cairn-info.ressources.univ-poitiers.fr/revue-francaise-de-gestion-2020-8-page-139.htm Page 9 sur 18
La crise sanitaire vue par les managers publics | Cairn.info 31/03/2021 17(47
L’analyse des entretiens révèle la volonté des managers de perfectionner le 20
pilotage interne de leurs activités. Un directeur déclare : « Nous devons être
plus fin dans l’analyse du fonctionnement du service. Les indicateurs que
nous allons créer doivent nous permettre de juger de l’efficacité de nos
actions ». Cette idée est relayée par les responsables de services : « Les
indicateurs doivent aider au pilotage de l’activité » ; « L’outil devrait nous
permettre d’organiser un suivi plus précis des budgets et des coûts de nos
activités » ; « Il faut montrer aux collègues que les indicateurs peuvent les
aider à mieux faire avec les mêmes ressources ! » Toutefois, le pilotage de la
performance ne se limite pas à la seule évaluation de l’efficience et de
l’efficacité des actions. Les managers ont aussi conscience que cet outil
pourrait servir des opérations de communication menées auprès des élus et
des usagers. Comme l’indique un responsable de service : « Cet outil est aussi
un outil de communication vis à vis de l’extérieur. Un outil de
communication pour légitimer la décision car les usagers sont en droit de
demander des explications » ; « Les nouveaux indicateurs devraient
perfectionner notre communication externe vis à vis des élus mais aussi des
habitants ». Le directeur général adjoint le confirme : « Les indicateurs ont
aussi un rôle politique, ils devraient nous permettre d’améliorer le dialogue
avec nos élus ».
En synthèse, les acteurs véhiculent une vision classique de la performance. Ils 21
envisagent le futur outil comme un moyen d’améliorer le pilotage de leurs
actions et le reporting externe de la collectivité. Cette représentation nourrit la
progression du projet pour aboutir à la création, en juin 2017, d’un système
de pilotage composé de trois tableaux de bord regroupant 46 indicateurs.
2. La crise sanitaire : un renouvellement de la vision de
la performance
Face à la crise sanitaire, les managers de la collectivité réaffirment 22
l’importance de l’outil : « Le contexte sanitaire ne remet pas en cause les
tableaux de bord » ; « Mon service aura besoin des informations remontées
par les indicateurs pour ajuster nos plans d’actions ». Toutefois, ils soulignent
aussi le besoin de repenser les pratiques d’évaluation : « Oui, la crise sanitaire
https://www-cairn-info.ressources.univ-poitiers.fr/revue-francaise-de-gestion-2020-8-page-139.htm Page 10 sur 18
La crise sanitaire vue par les managers publics | Cairn.info 31/03/2021 17(47
impose un changement de regard sur la manière dont sont évalués les
résultats de notre activité » ; « En situation de crise, nous portons un regard
différent sur l’évaluation de l’activité de l’équipe, et je pense que ce regard
devra perdurer ». Plus précisément, trois évolutions sont envisagées :
enrichir l’outil, le compléter et recentrer son ambition première.
Dans un premier temps, les managers désirent d’une part, renforcer les 23
indicateurs relevant de leur mission de service public et, d’autre part,
implanter des nouveaux indicateurs. Sur le premier point, une responsable
de service signale le besoin de porter un regard plus attentif aux attentes des
citoyens : « Avec la crise, je pense que l’indicateur Pourcentage des jardins
accessibles aux citoyens sera plus important que celui relatif au suivi du
budget ». De manière générale, les indicateurs relevant de la notion de
service public sont sollicités : « Le service au public doit redevenir la priorité
des modèles et des outils d’évaluation » ; « Cette crise a montré l’importance
de nos missions à tous les niveaux d’une collectivité territoriale… Il est donc
essentiel de centrer nos évaluations sur les missions de service public ». Sur le
second point, les nouvelles conditions de travail amènent les acteurs
rencontrés à envisager l’implantation de nouveaux indicateurs. Ces derniers
devraient permettre d’évaluer le management humain de la direction. Un
technicien déclare : « Le télétravail n’a pas été un choix mais une nécessité
pour maintenir l’activité du service. Il faudrait mettre en place des
indicateurs qui permettent d’évaluer ces nouvelles modalités de travail. » Un
autre technicien rejoint ce constat : « Je pense que le tableau de bord
perdurera. Toutefois, il faudra le faire évoluer car l’on va devoir tenir un peu
plus compte de la dimension RH, du bien-être des agents. » Dans un second
temps, les acteurs indiquent que si les tableaux de bord jouent un rôle
essentiel, ils ne peuvent pas, à eux seuls, évaluer la performance. Aussi, ils
proposent de leurs adjoindre de nouveaux dispositifs de pilotage. Le premier
repose sur l’autocontrôle : « le déploiement du télétravail, notamment pour
les responsables, montre les limites de l’outil. Il nous oblige à favoriser un
autocontrôle des activités » ; « Dans notre situation, l’évaluation se porte sur
des mécanismes nouveaux… l’auto-évaluation par les managers doit prendre
une place centrale ». Le second dispositif est fondé sur la confiance. Pour un
technicien, il faut « faire confiance, accompagner sans exclure le contrôle afin
https://www-cairn-info.ressources.univ-poitiers.fr/revue-francaise-de-gestion-2020-8-page-139.htm Page 11 sur 18
La crise sanitaire vue par les managers publics | Cairn.info 31/03/2021 17(47
d’atteindre les objectifs fixés dans la temporalité et la qualité ». De la même
façon, des responsables de service affirment : « les tableaux de bord ne
peuvent pas tout, on doit encore plus qu’auparavant travailler en confiance
afin de laisser un maximum d’initiatives à nos collaborateurs » ; « Ma
hiérarchie m’a demandé d’avoir une posture de confiance, rassurante et
bienveillante ». Indirectement, les acteurs soulignent l’importance de
compléter l’usage des tableaux de bord par des pratiques moins formelles et
capables d’intégrer les conséquences de la crise sanitaire sur les modalités de
réalisation de leurs activités.
Dans un troisième temps, les acteurs envisagent un recentrage des objectifs 24
associés à l’utilisation des tableaux de bord. Face à l’ampleur de la crise
sanitaire, ils insistent sur la nécessité de posséder des indicateurs qui
mesurent les modalités de leurs actions : « Pour moi, l’indicateur qui
permettra de piloter mon action est le “Pourcentage du parc lumineux
défectueux”. Les indicateurs sur le coût ou encore sur les économies réalisées
grâce aux LED vont perdre de l’importance ». Un directeur insiste sur la
nécessité de maîtriser la réalisation des activités : « Avec la crise sanitaire, je
serai moins vigilant sur l’atteinte des objectifs (…) Concernant l’évaluation de
mes collaborateurs, je me concentrerai sur la manière dont ils mènent leurs
activités ». Pour un autre directeur : « il s’agit de mesurer la performance sur
la capacité d’adaptation des process (…) Je vais demander de décrire avec plus
de détails la façon dont les dossiers du service sont gérés ».
En synthèse, l’analyse décrit un changement de regard des managers publics 25
sur l’outil de pilotage. Tout en indiquant la nécessité d’évaluer la
performance, les acteurs soulignent les incidences de la crise sanitaire sur
l’outil, son contenu et les finalités de son utilisation.
Conclusion : vers une hybridation du concept de
performance publique
Les résultats de cette recherche mettent en évidence une des conséquences 26
de la crise sanitaire pour les organisations publiques : l’hybridation du
concept de performance. Besharov et Smith (2014) définissent l’hybridation
https://www-cairn-info.ressources.univ-poitiers.fr/revue-francaise-de-gestion-2020-8-page-139.htm Page 12 sur 18
La crise sanitaire vue par les managers publics | Cairn.info 31/03/2021 17(47
comme l’imposition par l’environnement institutionnel d’une nouvelle
logique a priori contradictoire avec la logique préexistante. Dans la discipline
du management public, de nombreuses recherches décrivent l’hybridation de
l’organisation (Emery et Giauque, 2014) ou encore de l’activité des managers
(Bachir et al., 2015 ; Banoun et Rochette, 2017). Les outils de gestion sont plus
rarement étudiés (Marchand et Brunet, 2019). Notre recherche s’inscrit dans
ce dernier courant. Elle indique que la crise sanitaire transforme la notion de
performance publique en s’appuyant sur un double processus d’hybridation.
En réponse à la crise sanitaire de la Covid- 19, le concept de performance 27
publique s’enrichit. Il se transforme. La philosophie managériale initiale de
l’outil, mesurer l’efficience et l’efficacité des actions publiques, reste présente.
Toutefois, avec la crise sanitaire, elle perd de son importance. Pour les
managers, il ne s’agit plus seulement d’atteindre l’objectif mais de se focaliser
sur les modalités de réalisation de leurs actions. Un glissement sémantique
est constaté. La performance retrouve ses racines latines : « Per-formare »,
action de donner une forme. En ce sens, la performance publique ambitionne
d’évaluer un processus en cours de formation et non uniquement les
conséquences de ce dernier. Ce glissement sémantique rejaillit sur les outils
chargés de piloter la performance. La crise sanitaire les amène à intégrer des
valeurs différentes et parfois opposées (la performance mais aussi le service
public, la confiance, la responsabilité). Comme l’indiquent les résultats de
cette recherche, l’hybridation instrumentale se fonde sur l’introduction de
nouveaux outils de gestion capables d’intégrer des nouvelles valeurs toutefois
elle peut aussi se résoudre au sein du même outil de gestion. Face à la crise
sanitaire, les instruments de gestion chargés de piloter la performance
évoluent pour introduire ou renforcer de nouvelles valeurs et surtout
maintenir ces valeurs en tension afin d’organiser une nouvelle vision du
pilotage de la performance de l’action publique.
Résumé
https://www-cairn-info.ressources.univ-poitiers.fr/revue-francaise-de-gestion-2020-8-page-139.htm Page 13 sur 18
La crise sanitaire vue par les managers publics | Cairn.info 31/03/2021 17(47
La crise sanitaire de la Covid-19 rappelle les enjeux de l’action publique pour
les diverses composantes de notre société. Le pilotage de la crise par ces
organisations constitue une opportunité pour revisiter la notion de
performance publique. Cette recherche étudie l’évolution des représentations
des managers publics sur l’évaluation de la performance de leurs activités.
Elle souligne que si la crise déstabilise les fondements conceptuels de la
performance publique elle favorise aussi une nouvelle appréhension par les
managers de cette notion.
The health crisis seen by public managers: A hybridisation of public
performance?
The health crisis of Covid-19 contributes to highlight the stakes of public
management for the entities of our society. More precisely, the management
of the crisis by these organisations constitutes an opportunity to revisit the
notion of public performance. This research proposes a study on the
evolution of the representations of public managers on the evaluation of the
performance of their activities. It underlines that if the crisis destabilises the
conceptual foundations of public performance, it also encourages a new
understanding of this notion by managers.
Plan
I – Crise sanitaire, organisations publiques et performance
1. La crise de l’État-providence ou l’institutionnalisation de la notion de
performance publique
https://www-cairn-info.ressources.univ-poitiers.fr/revue-francaise-de-gestion-2020-8-page-139.htm Page 14 sur 18
La crise sanitaire vue par les managers publics | Cairn.info 31/03/2021 17(47
2. La crise sanitaire : un vecteur de déstabilisation de la performance publique ?
II – Méthodologie de la recherche
III – La crise sanitaire : quelles conséquences sur les représentations de la
performance ?
1. Un projet qui véhicule une représentation traditionnelle de la notion de
performance
2. La crise sanitaire : un renouvellement de la vision de la performance
Conclusion : vers une hybridation du concept de performance publique
Bibliographie
Bachir M., Rousseau A. et Sponem S. (2015). « Les gestionnaires publics à
l’épreuve des résultats », Revue française de gestion, vol. 41, no 251, p. 89-95.
Banoun A. et Rochette C. (2017). « Le gestionnaire public au cœur de logiques
contradictoires. Le cas des centres de services partagés », Revue française de
gestion, vol. 43, no 266, p. 11-30.
Bardin L. (2013). L’analyse de contenu, Paris, Presses universitaires de France.
Besharov M.L. et Smith W.K. (2014). “Multiple institutional logics in
organizations : Explaining their varied nature and implications”, Academy of
Management review, vol. 39, no 3, p. 364-381.
Bouckaert G. et Halligan J. (2008). Managing Performance. International
Comparisons, Routledge, London.
Bourguignon A. (1997). « Sous les pavés la plage... ou les multiples fonctions
du vocabulaire comptable : l’exemple de la performance », Comptabilité
o
https://www-cairn-info.ressources.univ-poitiers.fr/revue-francaise-de-gestion-2020-8-page-139.htm Page 15 sur 18
La crise sanitaire vue par les managers publics | Cairn.info 31/03/2021 17(47
Contrôle Audit, vol. 3, no 1, p. 89-101.
Emery G. et Giauque D. (2014). « L’univers hybride de l’administration au
XXIe siècle », Revue internationale des sciences administratives, vol. 1, no 80, p. 25-
34.
Hood C. (1991). “A public management for all seasons”, Public Administration
Review, vol. 69, no 1, p. 3-19.
Ittner C. et Larcker D. (1998). “Innovations in performance measurement :
Trends and research implications”, Journal of Management Accounting Research,
vol. 10, no 5, p. 205-237.
Gibert P. (1986). « Management public, management de la puissance
publique », Politiques et management public, vol. 4, no 2, p. 89-124.
Heaton J. (2004). Reworking Qualitative Data, London, Sage.
Kurunmakï L. (2009). “Management accounting, economic reasoning and the
new public management reforms”, Handbook of Management Accounting
Research, C. Chapman, A. Hopwood and M. Schields (Eds.), p. 1371-1383.
Mathiasen D.G. (1996). “The new public management and its critics”,
Conference on The New Public Management in International Perspective, Institute
of Public Finance and Fiscal Law, St Gallen, Switzerland.
Marchand J.S. et Brunet M. (2019). « L’émergence des initiatives post-NMP :
l’évaluation d’impact intégrée comme un outil hybride d’aide à la prise de
décision », Revue Internationale des Sciences Administatives, vol. 85, no 2, p. 331-
347.
Rosanvallon P. (1981). La crise de l’État-providence, Paris, Seuil.
Thorne S. (2004). “Qualitative secondary analysis”, The SAGE Encyclopedia of
Social Science Research Methods, S. Lewis-Beck, A. E. Bryman, T. F. Liao, vol. III,
London, Sage.
https://www-cairn-info.ressources.univ-poitiers.fr/revue-francaise-de-gestion-2020-8-page-139.htm Page 16 sur 18
La crise sanitaire vue par les managers publics | Cairn.info 31/03/2021 17(47
Auteur
Benjamin Dreveton
professeur à l’IAE de Poitiers. Il dirige le Centre de recherche en gestion (CEREGE). Ses
travaux se situent à l’intersection du contrôle de gestion et du management public. Plus
précisément, ses publications se concentrent sur le processus d’implantation des outils de
pilotage de la performance au sein de la sphère publique (collectivité locale, État, hôpital,
université, etc). Il préside l’association nationale des masters Contrôle de gestion et audit
organisationnel.
Mis en ligne sur Cairn.info le 31/03/2021
https://doi-org.ressources.univ-poitiers.fr/10.3166/rfg.2020.00492
Article suivant
Pour citer cet article
Distribution électronique Cairn.info pour Lavoisier © Lavoisier. Tous droits réservés
pour tous pays. Il est interdit, sauf accord préalable et écrit de l’éditeur, de reproduire
(notamment par photocopie) partiellement ou totalement le présent article, de le
stocker dans une banque de données ou de le communiquer au public sous quelque
forme et de quelque manière que ce soit.
https://www-cairn-info.ressources.univ-poitiers.fr/revue-francaise-de-gestion-2020-8-page-139.htm Page 17 sur 18
La crise sanitaire vue par les managers publics | Cairn.info 31/03/2021 17(47
Cairn.info | Accès via Université de Poitiers
https://www-cairn-info.ressources.univ-poitiers.fr/revue-francaise-de-gestion-2020-8-page-139.htm Page 18 sur 18
Vous aimerez peut-être aussi
- 1 s2.0 S2214423418300668 MainDocument14 pages1 s2.0 S2214423418300668 MainGONNE JeromePas encore d'évaluation
- 1 s2.0 S2214423417301254 MainDocument15 pages1 s2.0 S2214423417301254 MainGONNE JeromePas encore d'évaluation
- 1 s2.0 S2214423417301126 MainDocument13 pages1 s2.0 S2214423417301126 MainGONNE JeromePas encore d'évaluation
- Rampa Et Agogué, Lorsque Les Démarches D'exploration Nécessitent de L'innovation Collective Cairn - InfoDocument39 pagesRampa Et Agogué, Lorsque Les Démarches D'exploration Nécessitent de L'innovation Collective Cairn - InfoGONNE JeromePas encore d'évaluation
- Tchangam Et Tchankam, Les Antécédents Sociodémographiques de L'intention Entrepreneuriale Des Étudiants - Le Rôle Médiateur de L'auto-EfficaDocument21 pagesTchangam Et Tchankam, Les Antécédents Sociodémographiques de L'intention Entrepreneuriale Des Étudiants - Le Rôle Médiateur de L'auto-EfficaGONNE JeromePas encore d'évaluation
- 1 s2.0 S2214423418300073 MainDocument17 pages1 s2.0 S2214423418300073 MainGONNE JeromePas encore d'évaluation
- 1 s2.0 S221442341830019X MainDocument8 pages1 s2.0 S221442341830019X MainGONNE JeromePas encore d'évaluation
- Restrepo Amariles, Van Waeyenberge, Responsabilité Sociale Des EntreprisesDocument19 pagesRestrepo Amariles, Van Waeyenberge, Responsabilité Sociale Des EntreprisesGONNE JeromePas encore d'évaluation
- RSG - 299 - 0027-2-1 BELLO Et FeudjoDocument16 pagesRSG - 299 - 0027-2-1 BELLO Et FeudjoGONNE JeromePas encore d'évaluation
- Sampieri-Teissier, Camman Et Livolsi, La Supply Chain Santé Est Aussi Une Affaire D'état ! Cairn - InfoDocument18 pagesSampieri-Teissier, Camman Et Livolsi, La Supply Chain Santé Est Aussi Une Affaire D'état ! Cairn - InfoGONNE JeromePas encore d'évaluation
- Souleymanou Et Hikkerova, Les Défaillances de Communication Financière Des Entreprises CamerounaisesDocument21 pagesSouleymanou Et Hikkerova, Les Défaillances de Communication Financière Des Entreprises CamerounaisesGONNE JeromePas encore d'évaluation
- Véry Et Cailluet, Intelligence Artificielle Et Recherche en GestionDocument17 pagesVéry Et Cailluet, Intelligence Artificielle Et Recherche en GestionGONNE JeromePas encore d'évaluation
- Chatelain-Ponroy Et Deville, Crise Sanitaire Et Technocratie Cairn - InfoDocument13 pagesChatelain-Ponroy Et Deville, Crise Sanitaire Et Technocratie Cairn - InfoGONNE JeromePas encore d'évaluation
- Deville Et Riva, Innovation Financière Et Recherche en FinanceDocument19 pagesDeville Et Riva, Innovation Financière Et Recherche en FinanceGONNE JeromePas encore d'évaluation
- Silberzahn Et Riot, Face À L'effondrement Du Cahmp, La Stratégie Comme Manière de VivreDocument12 pagesSilberzahn Et Riot, Face À L'effondrement Du Cahmp, La Stratégie Comme Manière de VivreGONNE JeromePas encore d'évaluation
- Aggeri Et Saussois, La Puissance Des Grandes Entreprises Mondialisées À L'épreuve Du JudiciaireDocument17 pagesAggeri Et Saussois, La Puissance Des Grandes Entreprises Mondialisées À L'épreuve Du JudiciaireGONNE JeromePas encore d'évaluation
- Article: Covid-19, Inspirons-Nous de L'open Source Pour Manager Les Activités Collaboratives À DistanceDocument17 pagesArticle: Covid-19, Inspirons-Nous de L'open Source Pour Manager Les Activités Collaboratives À DistanceGONNE JeromePas encore d'évaluation
- Chekkar Et Renault, Le Crowdfunding Solidaire en Contexte D'urgence Cairn - InfoDocument24 pagesChekkar Et Renault, Le Crowdfunding Solidaire en Contexte D'urgence Cairn - InfoGONNE JeromePas encore d'évaluation
- Bréchet Et Desreumaux, Une Théorie Englobante de L'entreprise Pour Une Fécondité InterprétativeDocument14 pagesBréchet Et Desreumaux, Une Théorie Englobante de L'entreprise Pour Une Fécondité InterprétativeGONNE JeromePas encore d'évaluation
- De Becdelièvre Et Grima, La Covid-19, Un Choc de Carrière Restructurant Le Sens Du Travail Cairn - InfoDocument17 pagesDe Becdelièvre Et Grima, La Covid-19, Un Choc de Carrière Restructurant Le Sens Du Travail Cairn - InfoGONNE JeromePas encore d'évaluation
- Brunat Et Fontanel, La Science Économique Comme Idélogie. La Science de Gestion Comme Viatique de L'actionnaireDocument20 pagesBrunat Et Fontanel, La Science Économique Comme Idélogie. La Science de Gestion Comme Viatique de L'actionnaireGONNE JeromePas encore d'évaluation
- Coussi Et Moinet, Extension Du Domaine de La Prédation Cairn - InfoDocument33 pagesCoussi Et Moinet, Extension Du Domaine de La Prédation Cairn - InfoGONNE JeromePas encore d'évaluation
- Bouillon Et Praschiv, Le Coaching, Un Vecteur de Changement Au Sein Des Organisations Cairn - InfoDocument25 pagesBouillon Et Praschiv, Le Coaching, Un Vecteur de Changement Au Sein Des Organisations Cairn - InfoGONNE JeromePas encore d'évaluation
- Bartoli Et Hermel, La Science, Le Politique Et Le Citoyen, Des Relations Revisitées À La Faveur de La CriseDocument17 pagesBartoli Et Hermel, La Science, Le Politique Et Le Citoyen, Des Relations Revisitées À La Faveur de La CriseGONNE JeromePas encore d'évaluation
- Branellec Et Onnée, L'essor Du Crowdfunding ImmobilierDocument15 pagesBranellec Et Onnée, L'essor Du Crowdfunding ImmobilierGONNE JeromePas encore d'évaluation
- Béjean Et Drai, Innovation, Collaboration Et DroitDocument15 pagesBéjean Et Drai, Innovation, Collaboration Et DroitGONNE JeromePas encore d'évaluation
- Biaz Et Brasseur, L'impact de La Digitalisation Des Organisations Sur Le Rapport Au Travail - Entre Aliénation Et ÉmancipationDocument16 pagesBiaz Et Brasseur, L'impact de La Digitalisation Des Organisations Sur Le Rapport Au Travail - Entre Aliénation Et ÉmancipationGONNE JeromePas encore d'évaluation
- Ayerbe, Azzam Et Pénin, Crise Du Covid-19, Une Nouvelle Génération de Trolling de Brevets Contaminant Démasquée Cairn - InfoDocument23 pagesAyerbe, Azzam Et Pénin, Crise Du Covid-19, Une Nouvelle Génération de Trolling de Brevets Contaminant Démasquée Cairn - InfoGONNE JeromePas encore d'évaluation
- A. François-Lecompte Et Alli, Confinement Et Comportements Alimentaires Cairn - InfoDocument28 pagesA. François-Lecompte Et Alli, Confinement Et Comportements Alimentaires Cairn - InfoGONNE JeromePas encore d'évaluation
- Financement ParticipatifDocument14 pagesFinancement ParticipatifKarima Jaffali50% (2)
- Heidegger Le Sol La RaceDocument21 pagesHeidegger Le Sol La RacebrandonbenqPas encore d'évaluation
- LettreDocument6 pagesLettreBotezatu DorinaPas encore d'évaluation
- Andriamananjaraantsa ECO M2 11Document72 pagesAndriamananjaraantsa ECO M2 11RASOANOMEJANAHARY Marie OliviaPas encore d'évaluation
- L'eurocentrisme - Samir Amin PDFDocument80 pagesL'eurocentrisme - Samir Amin PDFAgnus LaurianoPas encore d'évaluation
- Des QCM de L'evaluation Échelle 11Document3 pagesDes QCM de L'evaluation Échelle 11Soufiane Harachi100% (1)
- P RAYMOND BTS MAI Les API PDFDocument43 pagesP RAYMOND BTS MAI Les API PDFNils BickelPas encore d'évaluation
- Chapitre 10 - Les Risques OpérationnelsDocument9 pagesChapitre 10 - Les Risques Opérationnelswilliams rodrigue kodebri njambePas encore d'évaluation
- Emergence Du Management InterculturelDocument4 pagesEmergence Du Management InterculturelelkouchePas encore d'évaluation
- Les SlidesDocument2 pagesLes SlidesSouFiane SafouanPas encore d'évaluation
- Idvol98n28p86 91Document6 pagesIdvol98n28p86 91Maxime IannottaPas encore d'évaluation
- Gestion Du TransportDocument279 pagesGestion Du Transportbzouzouko@gmail.com75% (4)
- FO037 - BRC Self Assessment Tool (French)Document59 pagesFO037 - BRC Self Assessment Tool (French)Il Principio CarinoPas encore d'évaluation
- Technologia Catalogue 76 PagesDocument76 pagesTechnologia Catalogue 76 PagesjcdoyonPas encore d'évaluation
- 20 Questions Que Les Administrateurs Dorganismes Sans But Lucratif Devraient Poser - 50011 PDFDocument48 pages20 Questions Que Les Administrateurs Dorganismes Sans But Lucratif Devraient Poser - 50011 PDFDotou TankpinouPas encore d'évaluation
- Le Testament Esthétique de Marcuse: Pierre-Yvan LarocheDocument3 pagesLe Testament Esthétique de Marcuse: Pierre-Yvan LarocheRougah Na Allah Abdoul KarimPas encore d'évaluation
- Plantes Génétiquement Modifiées, Controverse, Communication Et IdéologieDocument501 pagesPlantes Génétiquement Modifiées, Controverse, Communication Et IdéologieJean-Paul OuryPas encore d'évaluation
- Sujets Bac SES ES Spé G1Document13 pagesSujets Bac SES ES Spé G1Anonymous pt601aHPas encore d'évaluation
- Mémoire de Fin D'études Paul BataillardDocument45 pagesMémoire de Fin D'études Paul BataillardPaul ßataillardPas encore d'évaluation
- 816 Belec Colloque Aqpc 2017Document62 pages816 Belec Colloque Aqpc 2017Jérôme StédilePas encore d'évaluation
- Module Français S2Document8 pagesModule Français S2Hammadi HabadPas encore d'évaluation
- TD1 PDFDocument2 pagesTD1 PDFHatim EzzaoufiPas encore d'évaluation
- Book de L'eco-ConstructionDocument52 pagesBook de L'eco-ConstructionCci du MorbihanPas encore d'évaluation
- FadimanDocument33 pagesFadimantest1234Pas encore d'évaluation
- Decret 20 342 Modifiant 15 19Document9 pagesDecret 20 342 Modifiant 15 19Mahmoud Nait HaddadPas encore d'évaluation
- Incoterms Et AssuranceDocument2 pagesIncoterms Et AssuranceKawtar IdemPas encore d'évaluation
- De La Logistique Au Supply Chain Management Une Nécessité de TransitionDocument13 pagesDe La Logistique Au Supply Chain Management Une Nécessité de TransitionFe DwāPas encore d'évaluation
- Rapport Sur Le Diagnostic Stratégique de Facebook (1) yDocument15 pagesRapport Sur Le Diagnostic Stratégique de Facebook (1) yZerrouqui MaryamPas encore d'évaluation
- Annonce Responsable en Cedre 220214Document3 pagesAnnonce Responsable en Cedre 220214Hajar LemtoubiPas encore d'évaluation
- Histoire de La Violence PDFDocument267 pagesHistoire de La Violence PDFiveliosdu12Pas encore d'évaluation