Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Que Reste T Il Du Cinema
Transféré par
holaTitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Que Reste T Il Du Cinema
Transféré par
holaDroits d'auteur :
Formats disponibles
Que reste-t-il
du cinéma ?
par Jacques Aumont
E
n 1971, Jean Eustache réalise Numéro zéro. C’est l’enregistrement brut d’une
conversation entre sa grand-mère, Odette, et lui – ou plutôt, d’un long mono‑
logue de la grand-mère devant le petit-fils. Dix bobines de film, tournées
à deux caméras et montées en alternance, afin de ne pas interrompre le flux de la
parole. Les cent dix minutes du film sont l’empreinte exacte de cent dix minutes de
temps passé, y compris les accidents, par exemple un téléphone qui sonne, ou les claps
ponctuant les changements de bobine. Ce film, produit par le Service de la Recherche
de la télévision française, est resté longtemps ignoré, jusqu’à sa redécouverte en 2003,
plus de vingt ans après la mort du cinéaste 1. Le titre renvoie à la « copie zéro » qui est
le premier état du montage, mais le fait que le film soit si peu monté suggère aussi ce
degré zéro du cinéma dont Bazin disait qu’il « embaume le temps ». Un temps concret,
pas la pure expérience de la durée sans contenu vécu de l’Empire de Warhol (1963), pas
le temps dramatisé des plans-séquences de Welles ou Wyler autour de 1950.
Presque au même moment, Jean-Luc Godard commençait une longue série de travaux
en vidéo, avec toutes les générations successives de matériel. Trente ans plus tard
exactement, en 2001, il réalise Éloge de l’amour, une œuvre hybride, mêlant des scènes
en noir et blanc et en 35 mm, et d’autres avec des couleurs au contraire extrêmement
saturées, tournées en vidéo et reportées sur film pour la projection. Éloge de l’amour
est un éloge, peut-être paradoxal, du cinéma, car seule la projection en salle, sur un
grand écran et à partir d’une copie sur pellicule, permet de constater l’abîme visuel
entre le 35 mm noir et blanc et la vidéo, avec ses couleurs archifausses.
Dix ans encore ont passé depuis ce film, et désormais la vidéo règne, sous les
espèces de ce qu’on appelle le numérique. Au congrès de la Fédération internationale
des archives du film (FIAF), en 2006, une projection fut organisée, où l’on compara la
technique pelliculaire à la technique numérique : dès cette date, il fut clair pour tous
– non sans quelques frémissements d’horreur ou de mélancolie chez les plus âgés –
1. Il en existe une version de 54 minutes pour la télévision, intitulée Odette Robert. 1
Aumont.indd 1 21/05/11 14:53:58
que la projection numérique à haute résolution était de qualité égale à celle de la
pellicule. Ce public, composé de professionnels de la préservation des films, fut parfois
même, dit-on, incapable de distinguer l’une de l’autre.
Je pourrais continuer, car depuis quarante ans que les premières machines vidéo
à bandes ont fait leur apparition, le cinéma ne cesse de tracer ses frontières et de les
défendre, parfois de manière étrangement passéiste, comme dans la cérémonie quasi
funéraire de « The Last Nitrate Picture Show ». Mais aujourd’hui, celui qui veut avoir
une certitude sur ce qu’on lui projette n’a guère qu’une solution : il lui faut guetter,
sur l’écran, la trace d’une poussière ou d’une tache sur la pellicule, que la projection
numérique a rendues impossibles. L’amoureux de la pellicule en vient à aimer jusqu’à
ses défauts (en bon fétichiste). Quant à la production de films, elle reste provisoire‑
ment partagée entre des enregistrements sur pellicule, de plus en plus rares, et les
gros bataillons de l’enregistrement numérique.
Se demander « ce qui reste » du cinéma, c’est aussi se demander ce qui a disparu.
Le cinéma, lui, n’a pas disparu. On continue d’« aller au cinéma », c’est-à-dire de voir
des œuvres d’image mouvante, la plupart du temps narratives, dans des salles spécia‑
lisées, en payant son billet. L’industrie du cinéma existe toujours, elle produit autant
de films qu’il y a cinquante ans, et même, avec la diffusion de copies des films sur
dvd puis en vod, elle a trouvé de nouveaux débouchés ; au passage, la culture ciné‑
matographique est devenue une partie banale de la culture tout court. Pourtant, les
choses ont changé, dans deux domaines au moins.
D’abord, le cinéma n’a plus l’exclusivité des images en mouvement. Déjà la télévision
l’avait concurrencé sur ce terrain – mais avec elle un modus vivendi était facile à trouver.
En s’appropriant la fiction, la tv au fond a consacré la victoire du modèle cinémato‑
graphique, car les feuilletons et séries télévisées sont le dernier avatar du cinéma
classique. Au reste, depuis dix ans, la télévision est devenue dans les pays riches un
médium du passé, et le site le plus copieux de diffusion d’images en mouvement, c’est
désormais le web – source continue, indéfinie, illimitée, et qui, elle, ne peut pas copier
le cinéma. Sur l’autre bord, celui de la culture intello, il faut maintenant compter avec
le musée d’art contemporain. Depuis que les artistes plasticiens ont inventé l’art vidéo
à la fin des années 1960, l’image mouvante est devenue une possibilité parmi d’autres,
de plus en plus utilisée, entre autres dans des installations.
D’autre part, la diffusion, devenue hégémonie, de l’image numérique a engagé un
gigantesque retour du cinéma – dans sa définition sociale majoritaire – dans la « voie
Méliès », celle du trucage, de la maîtrise, du dessin. Cela est évident des films pour
« adulescents » réalisés en images de synthèse, mais c’est aussi le cas, désormais, de
n’importe quel film : l’enregistrement numérique n’est pas une empreinte intouchable,
mais un codage, sur lequel il est loisible d’intervenir autant qu’on veut et comme on
2 veut. Pour les très jeunes gens, qui n’ont guère connu l’époque « argentique », c’est
Aumont.indd 2 21/05/11 14:53:58
avant tout une libération : enfin, le cinéaste peut bénéficier du droit au repentir et à
la retouche, jusque-là réservés au peintre. Mais le prix à payer est, symboliquement
et esthétiquement, assez lourd : il s’agit de rien de moins que de renoncer à une
ontologie, celle de l’empreinte, donc de la rencontre et de la révélation du réel.
Que reste-t-il du cinéma ? la question est donc double. C’est d’abord une question
de vécu : que reste-t-il de l’expérience de la vision esseulée d’une grande image
mouvante dans le noir, s’imposant à nous sans que nous puissions agir sur elle ?
voir un film sur un petit écran mobile, est-ce voir du cinéma ? dans l’exposition de
films au musée d’art contemporain, ce qu’on voit est-il du cinéma ? Et puis, c’est une
question d’ontologie : que reste-t-il de la relation d’immédiateté, fût-elle fantasmée,
qui unissait le film au réel ? peut-on croire que certaines formes prises par les
images mouvantes pourront encore être dites « filmiques » ? les « nouvelles images »
et les nouvelles techniques d’image laissent-elles une place à ce qui a fait le prix,
esthétique et idéel, du cinéma : le respect de la réalité ?
L’évolution des techniques et des dispositifs est indiscutable. Cependant, sur ce
terrain, on a trop raisonné à partir d’un a priori hégélien, qui veut qu’un dispositif
ne puisse appartenir qu’à une époque, et doive obligatoirement être dépassé par une
autre époque qui ne peut plus s’y reconnaître. C’est ce qui me retient d’adhérer à
l’idée, éloquemment proposée depuis une dizaine d’années, que le cinéma aujour‑
d’hui ne se trouve plus seulement dans les salles de cinéma, mais un peu partout,
notamment au musée d’art contemporain 1. On a connu cela avec la peinture : en juin
1989, au colloque « Cinéma et peinture » du Louvre, Christian Boltanski déclarait,
en se frappant comiquement le crâne : « Si je dis que c’est de la peinture, ce sera de la
peinture ! » Hélas, ce n’en est toujours pas : peindre, c’est peindre. Idem, à mes yeux,
pour le cinéma : ce qu’on voit au musée, en général, non, ce n’en est pas.
Une intéressante variante de cette nouvelle vulgate s’efforce d’identifier la situation
présente avec celle d’il y a un peu plus d’un siècle, lorsque le cinéma a dû se dégager
du cinématographe ou du kinétoscope et inventer à la fois son dispositif propre et son
langage. Dans un article récent, Tom Gunning nous rappelle que, autour de 1900, les
« films » étaient surtout destinés à la démonstration et à la promotion d’appareils, de
techniques et de dispositifs 2. Cela devrait nous dire quelque chose : les productions
1. Représentatifs de cette nouvelle vulgate, qui se répand à la vitesse de l’éclair dans l’université, les
travaux du groupe agrégé autour des « Spring schools » et « Summer schools » animées par les infatigables
Philippe Dubois et Leonardo Quaresima. Voir Ph. Dubois et al., Oui, c’est du cinéma / Yes, it’s cinema
(2009) et Extended cinema. Le cinéma gagne du terrain (2010), tous deux chez Campanotto editore, à
Pasian di Prato ; voir aussi plusieurs numéros de la revue Cinema & Cie, notamment le n° 11 (« Relocation »,
dirigé par Francesco Casetti) et le n° 12 (« Cinéma et art contemporain III », dirigé par Ph. Dubois).
2. Tom Gunning, « Introduction », in André Gaudreault, ed., American Cinema 1890-1909. Themes
and Variations, New Brunswick, N.J., Rutgers University Press, 2009. 3
Aumont.indd 3 21/05/11 14:53:58
d’images mouvantes, aujourd’hui, n’ont-elles pas souvent pour finalité de nous
convaincre que c’est formidable d’avoir un petit écran en permanence dans sa valise,
voire un très petit écran dans sa poche ? Comme en 1900, l’accent n’est-il pas mis
constamment sur la technique et sur les dispositifs, au détriment des contenus (voir
la présentation promotionnelle de l’iPad, fin 2009) ?
Certains voient même dans cette prolifération des petites images nomades la
revanche d’Edison sur Lumière : « Ironiquement, alors même que le système qui fut
introduit par Edison en 1894 est menacé, son insistance sur le visionnement individuel
est devenue plus valide. Avec la banalisation des machines pluri-format et tenant
dans la main, les très petites images qui semblaient si inadéquates en 1895 deviennent
acceptables au xxie siècle 1. » Le parallèle est sans doute trop précis. On voit mal par
exemple en quoi le « système introduit par Edison en 1894 » est menacé : ce n’est pas
lui qui a inventé le spectacle cinématographique, auquel il a résisté de toute sa force,
et ses « petites images » étaient tout sauf nomades. Mais surtout, ce parallèle minore
par trop les différences, à commencer par celle-ci : lorsque sont apparues les premières
technologies de l’image mouvante, entre 1890 et 1900, on n’avait encore jamais rien vu
de comparable. Aucune des inventions techniques des vingt dernières années n’a cette
portée, aucune ne nous apporte une nouveauté aussi essentielle. On a pu ontologiser
l’image en mouvement, on ne peut rien faire de semblable avec l’image numérique. Le
mouvement est une perception, élémentaire, fondamentale ; le pixel n’en est pas une,
quoi que prétendent certains critiques obnubilés par le nouveau en tant que tel. A
fortiori, le digit, sur lequel repose toute la technologie numérique, n’est pas perceptible,
il est le pur instrument abstrait d’un calcul caché et destiné à le demeurer. (Ce
pourquoi, je le note au passage, on n’aura jamais en numérique des effets de matière
d’image égaux à ceux que permettait le grain de la pellicule argentique.)
Si le dispositif cinéma a réussi (contre Edison et sa visionneuse), c’est qu’il était plus
fort que les autres, et non, comme on a tendance à le dire dans une approche hyper‑
relativiste, parce qu’il a eu de la chance 2. Le mot de Raymond Bellour, « le cinéma est
un dispositif qui a particulièrement bien réussi 3 », copie avec justesse un mot célèbre
à propos du christianisme : dans un cas comme dans l’autre, on peut être étonné du
succès mondial obtenu historiquement, mais ce succès tient moins au hasard qu’à
certaines qualités propres. En termes anthropologiques, l’image mouvante reste
l’invention d’image majeure du xx e siècle (la peinture abstraite, ou le collage, c’est
autre chose). Sensation neuve, domaine neuf.
De ce point de vue, l’invention la plus significative de la fin du xxe, ce n’est ni l’image
numérique – qui laisse intact le dispositif – ni l’écran mobile – qui casse le lien social
autour de l’image projetée pour en établir un autre, c’est vrai, mais ne touche pas au
1. Paul C. Spehr, « Movies and the Kinetoscope », ibid. (ma traduction).
2. Une tentation sensible dans l’intéressant livre de Luc Vancheri, Cinémas contemporains : du film à
l’installation, Lyon, Aléas, 2009.
3. Raymond Bellour, « “Le cinéma, seul” / Multiples “cinémas” », in Jacques Aumont, dir., Le Septième
4 Art, éd. Léo Scheer, 2003, p. 258.
Aumont.indd 4 21/05/11 14:53:58
mouvement de l’image mouvante. L’invention la plus importante, en tout cas du point
de vue esthétique, c’est la touche « pause », parce qu’elle produit une image d’une
nature nouvelle : une image arrêtée – c’est-à-dire autre chose qu’une image en mouve‑
ment, mais aussi autre chose qu’une image fixe ; une image hybride, dont ce n’est pas
un hasard qu’elle ait tellement fasciné les théoriciens du cinéma, à une époque où la
pellicule ne permettait pas de la produire commodément. C’est à partir de cette extrac‑
tion contre nature que l’on peut se rendre compte que cette image immobile contient
du mouvement 1. L’image arrêtée rompt le flux, donc aussi la fascination, l’absorption
du spectateur. Elle représente exactement une transgression (ce qui va contre la règle,
sans l’abolir). C’est un geste d’emblée théorique, et cependant pleinement sensoriel,
auquel je ne vois pas d’équivalent dans les diverses manipulations que permettent
la vidéo et le numérique. Par exemple, l’incrustation telle que Godard en joue dans
Numéro deux est saisissante, sensationnelle si l’on veut ; le long récit de viol conjugal
accompagné du gros plan de la petite fille est extraordinairement expressif, mais il dit
– avec de tout autres moyens formels – la même chose qu’une surimpression, procédé
qui touche au filmique sans toutefois le mettre en jeu comme l’arrêt-image 2.
Dernière remarque : si le cinéma – dispositif, industrie et le reste – a eu tant de
succès, c’est aussi à la diffusion de certains contenus qu’il le doit. Il y a eu, il y a encore,
une industrie de la fiction, et, inséparablement quoique toujours minoritaire, une
industrie de l’art visuel. Le cinéma n’a pas eu l’apanage de la fiction ; depuis l’arrivée
de la télévision dans les années 1950-1960, il y a même eu un déplacement massif sur
ce plan, et aujourd’hui la majorité des fictions en image est produite pour la télé. De
même, l’art visuel n’est pas réservé au cinéma ; il a sa place, toute désignée, au musée.
Il n’est jusqu’à la cérémonie socialisante qui n’ait d’autres lieux, dont certains sont
presque aussi industrialisés que le cinéma (la pop, le rock). Mais par rapport à toutes
ces institutions – télévision, musée, musique populaire –, ce qui continue de bénéficier
au cinéma, et fait qu’il perdure, c’est l’alliance originale d’une fiction, d’une émotion
visuelle, et de conditions de réception propices à la captation psychique sur un mode à
la fois individuel et collectif – ce qu’aucun autre dispositif n’a accompli au même point.
En 2007, D.N. Rodowick écrivait : « Le cinéma n’est plus un médium moderne ; il
est complètement historique 3 . » Je n’entre pas dans une discussion sur la modernité
1. La position la plus nette en ce sens reste celle de Sylvie Pierre, « Éléments pour une théorie du
photogramme », Cahiers du cinéma, n° 226-227, janvier-février 1971, mais c’est Raymond Bellour qui,
dans ses travaux fondateurs sur l’analyse textuelle, est revenu le plus souvent sur cette question (voir,
au moins, L’Analyse du film, 1978, rééd. Calmann-Lévy, 1995, passim).
2. Sur la surimpression, je me permets de renvoyer à mon texte « Clair et confus », Matière d’images,
redux, La Différence, 2009.
3. D.N. Rodowick, The Virtual Life of Film, Cambridge, Mass., Harvard University Press, 2007, p. 93
(ma traduction). 5
Aumont.indd 5 21/05/11 14:53:58
– concept flou, qui a lui-même son histoire et ne cesse d’hésiter entre la désignation
du moment présent et celle d’une époque du passé 1. On pourrait aussi bien dire qu’au
contraire le cinéma est attaché au moment moderne, et que c’est justement pour cela
qu’il n’est pas « contemporain ». Mais qu’importe. M’intéresse davantage l’assertion
selon laquelle le cinéma est « complètement historique ». J’observe d’abord que ce
sentiment n’est pas nouveau. Rappelons-nous, il y a un quart de siècle, l’épisode de
l’histoire de la critique du cinéma qui a tourné autour de l’idée que le cinéma était
mort. Le double livre de Deleuze venait de paraître, donnant sur le coup l’impression
d’avoir fait le tour du cinéma et de ne dessiner aucune issue nouvelle. La critique
se sentait démunie, après la fin des grandes théories. L’époque était à la nostalgie,
et ce n’est pas par hasard que se produisit alors un symptôme intéressant, avec la
tentative de trouver à tout prix une filiation entre le cinéma et la peinture 2. C’était
aussi le moment où – autre symptôme, plus idiosyncrasique mais capital – Godard
entamait sa grande entreprise mélancolique des Histoire(s) du cinéma.
Cette idée de la « mort du cinéma » est typique de l’histoire d’un art moderne ;
l’histoire de la peinture est ponctuée de moments où on l’a décrétée morte, pour s’en
affliger (la grande plainte régressive du xixe) ou pour s’en réjouir – voir le sympto‑
matique Dernier Tableau de Taraboukine (1923). Or, malgré sa « disparition », la
peinture continue de jouir d’une image (si l’on peut dire) très favorable, liée à une
qualité intrinsèque insurpassable : elle résulte d’un geste délibéré mais arbitraire, et
d’une intervention directe, corporelle, sur la matière. Quoi qu’on fasse, l’infographie ne
sera jamais de la peinture. Au fond, mon opinion sur le cinéma est du même ordre :
il n’est plus ce qu’il était, il n’a plus le prestige d’être le seul art d’image mouvante,
mais il continue d’être la référence positive et dernière (pour d’autres raisons que la
peinture). Pourquoi ? J’en donnerai trois raisons, qui sont aussi trois vertus propres du
cinéma, et qui sont à mes yeux l’essentiel de ce qu’il en reste (et en restera).
Exaltation du regard
Le dispositif cinématographique est battu en brèche par d’autres dispositifs, mais il
fait tout de même encore partie de « ce qui reste ». Or, si je cherche les traits essentiels
de ce dispositif, j’en trouve trois : la salle obscure, la projection et la matérialité
paradoxale de l’image. La salle obscure est un lieu collectif entièrement dévolu au
cinéma. Nous ne croyons plus qu’elle est un avatar de la caverne platonicienne,
comme on l’a dit avec insistance voici quarante ans, mais enfin, c’est un endroit où
1. Jacques Aumont, Moderne ? comment le cinéma est devenu le plus singulier des arts, Cahiers du
cinéma, 2007.
2. Je n’y ai pas échappé, cf. L’Œil interminable (3e édition, La Différence, 2007, mais écrit en 1986-
6 1987).
Aumont.indd 6 21/05/11 14:53:58
on ne peut rien faire d’autre que regarder un film. Dans ce lieu, l’image n’advient
pas toute seule, elle provient d’une source de lumière, le plus souvent située derrière
les spectateurs ; elle est projetée, ce qui l’insère dans la longue série culturelle des
projections, et surtout lui confère un caractère d’apparition. Enfin, l’image filmique
ne se touche pas, mais, dans sa version pellicule, le spectateur sait que, quelque part,
il existe un support matériel, d’ailleurs par lui-même invisible durant la séance ;
ce point est le seul qui ait changé avec la disparition de la pellicule (et du féti‑
chisme de la bobine), mais pour l’instant il reste latent, aidé par la disposition de
l’ensemble, car l’écran semble toujours recueillir un dépôt matériel (c’est et cela a
toujours été un fantasme, mais vivace).
Ce dispositif canonique a une première conséquence, qui est de nous convier à
l’expérience d’une unité insécable, l’œuvre filmique. Un film est un morceau de temps
mis en forme – comme la musique mais avec d’autres moyens. Ce que nous propose
la séance de cinéma, c’est l’expérience de ce temps, sans moyen d’y échapper. C’est
aujourd’hui un point crucial, car toutes les autres présentations de films nous
laissent, au contraire, libres d’interrompre ou de moduler cette expérience. La vision
privée était déjà devenue plus active avec la reproduction vhs, mais avec le dvd
elle est devenue proprement analytique, donnant d’emblée la possibilité de prendre le
film comme somme d’un nombre indéterminé de fragments. Il est donc important de
noter tout ce qui contribue à conserver, voire à renforcer, la croyance dans l’œuvre en
tant qu’entité, fût-ce de manière contradictoire.
Le passage au musée, par exemple, a des effets ambigus sur ce point. Le film y
est visible dans des conditions souvent difficiles, pourtant des films y circulent,
présentés les uns à côté des autres et même parfois transformés. Un exemple devenu
banal, mais très parlant, est celui de la réfection de films connus à laquelle s’est
livré naguère Douglas Gordon, notamment son 24 Hr Psycho. Le remake de Gus Van
Sant a pu être projeté côte à côte avec l’original de Hitchcock, et la confrontation
mettait en évidence des différences, toujours de l’ordre du détail. L’œuvre de Gordon
appartient à un autre régime de vision, et personne ne restera vingt-quatre heures
devant elle pour la voir. Cependant elle est bel et bien un exercice de modulation
du temps, une création de temps propre (dont on peut faire l’expérience même si on
n’en voit qu’une partie), et ainsi, comme plusieurs autres œuvres du même artiste,
elle garde quelque chose de cinématographique. D’ailleurs bien des cinéastes ont
investi, parfois de manière inventive, les espaces muséaux, en gardant certaines
propriétés du dispositif cinéma (mais presque jamais toutes). Pour prendre un seul
exemple – intéressant parce qu’il a été tourné en vidéo, pas en pellicule –, le premier
épisode des Voix spirituelles de Sokourov (1991) consiste en une variation continue,
trois quarts d’heure durant, de la lumière sur un même paysage sibérien. Or il a été
projeté aussi bien dans des salles de cinéma (dans une copie reportée sur pellicule)
qu’au musée (entre autres à Beaubourg 1).
1. Par Chris Dercon, dans la section 1980-1996 de « Face à l’histoire », en 1996. 7
Aumont.indd 7 21/05/11 14:53:58
C’est que, au fond, la question essentielle n’est pas la nature de ce qui est montré.
Voyant un film au musée, au cinéma, sur un écran portatif, il s’agit moins de savoir
si le film est respecté en tant qu’œuvre, que de savoir si on conserve un résultat
essentiel du dispositif canonique : la production d’un regard. C’est le problème des
machines en tout genre. Le rapport à un film vu sur un téléphone portable ne peut
être que distrait, à cause de la taille minuscule de l’image, mais surtout parce
qu’il y succède indifféremment à des jeux, à la gestion de mon compte en banque,
à des sms, etc. Pour le dire lapidairement, le dispositif cinématographique, c’est
le dispositif dans lequel on regarde ce qu’on voit, et en ce sens il s’oppose à tous les
autres dispositifs d’image mouvante, dont aucun ne programme la tenue d’un regard.
C’est le côté profondément classique du cinéma, celui qui fait qu’il a pu tenir la
comparaison avec la musique (celle qui s’écoute, pas celle qu’on vaporise dans le salon
ou qu’on injecte par voie intra-auriculaire). Ou avec la lecture – laquelle a jusqu’ici
résisté à toutes les déstructurations et imposé son régime à tous les changements
techniques, tablettes incluses.
Le musée ne favorise pas non plus le regard (ce serait pourtant sa mission
sociale et esthétique). En tout cas, pas pour ce qui est des images mouvantes (je ne
me prononcerai pas sur la peinture). Je souscris sans peine à ce constat de Didier
Semin : « Il existe quelques cas où la présentation de films ou de vidéogrammes dans
la même condition que des tableaux est légitime. Mais ces quelques catégories singu‑
lières ne représentent aujourd’hui qu’une part infime du flot d’images animées dont les
grandes expositions internationales et les musées infligent à leurs visiteurs la vision
debout – visiteurs qui s’abstiennent de protester, contents peut-être qu’on n’exige pas
d’eux qu’ils se tiennent au surplus en équilibre sur un seul pied 1. » Pour ne prendre
qu’un exemple, l’exposition « Dans la nuit, des images » (Paris, décembre 2008)
juxtaposait, dans un vaste espace instructuré, plus de cent projections concomitantes
d’œuvres de diverses origines, films d’auteur ou films de fin d’études, documentaires
ou fictions. Il est clair que le type de regard convoqué par ce qui était, au fond, une
seule et gigantesque installation (signée Alain Fleischer) n’est pas le regard (ni
l’écoute) que suppose le dispositif canonique du cinéma.
Inversement, une installation comme celle d’Agnès Varda, Les Veuves de Noir‑
moutier (2005), démontre qu’on peut produire un regard cinématographique dans un
dispositif qui ressortit au musée : des spectateurs en petit nombre – quatorze, autant
que d’écrans –, chacun n’entendant que le son d’un seul des quatorze écrans mais
pouvant voir les treize autres, assis, dans le noir. Exemplaire exercice d’une cinéaste
faisant autre chose que du cinéma, mais en cherchant à placer ses spectateurs dans
une relation au temps et au regard qui reste celle du cinéma.
8 1. Didier Semin, L’Atlantique à la rame, Genève, Les Presses du réel, 2008.
Aumont.indd 8 21/05/11 14:53:59
Le contenu du cinéma, c’est le temps
Le cinéma commençant n’a cessé de s’éloigner du théâtre, qui a été son principal
ennemi esthétique. Pourtant, très vite, le film a été voué à proposer un morceau de
fiction. Sans doute, comme le note Gunning, une des raisons du développement rapide
du film de fiction est que, contrairement aux films tournés sur le vif, sa production
« pouvait être organisée à l’avance 1 ». J’ajoute qu’elle était maîtrisable, et que produire
un film de fiction, c’est toujours une entreprise dont on possède les clefs, esthétiques
et sémantiques : on peut signifier ce qu’on veut, dans les formes qu’on aura choisies.
Le meilleur moyen de s’en convaincre, c’est de comparer, à n’importe quelle fiction
même rudimentaire (disons, l’un des courts métrages de Griffith pour la Biograph),
un film des premiers temps qui n’obéisse pas à cette logique narrative, tel le fameux
The Kiss (1896), qui nous semble seulement être une expérimentation sur le gros
plan, et nous étonne par son obscénité. Or, il était tiré d’une pièce bien connue, The
Widow Jones, dont c’était le happy ending, signifiant la promesse de mariage des deux
protagonistes ; c’était donc, pour ses spectateurs, un spectacle moral, un good old
American kiss : seulement, il faut le savoir, et cela ne se voit pas dans les images.
Au contraire, n’importe quel film de fiction, surtout classique, est aisément compré‑
hensible et appropriable, parce qu’il ressemble à notre appréhension de la vie elle-
même. Stanley Cavell a remarqué 2 que le film de fiction a le grand avantage d’être
autocompréhensible : il ne nécessite pas de mode d’emploi, il ne demande aucun
savoir préalable (du moins, pour un sujet humain qui a un peu l’habitude de la
mise en forme dramatique). La question est intéressante par rapport aux nouveaux
supports et aux nouveaux réseaux de l’image en mouvement. Y a-t-il vraiment là un
type de production qui puisse être « organisé à l’avance » ? La plupart de ces contenus
ne sont pas produits ad hoc, ils sont la reproduction de contenus élaborés ailleurs,
dans d’autres dispositifs et pour d’autres publics. Des sites comme YouTube sont de
grands fourre-tout où chacun peut mettre un petit morceau de quelque chose, selon
la logique générale d’internet.
Le cinéma continue donc de se distinguer par la sérieuse mise en forme de
ses contenus. On le voit bien dans le cas, récent, du webdocumentaire, qui offre,
sur un site dédié, ce que d’habitude le cinéaste est le seul à voir dans la salle de
montage ; tout au plus élimine-t-on certains plans qui font double emploi. On joue
donc sur l’ambiguïté entre cinéma et internet en proposant quelque chose comme un
film, puisqu’il y a eu un tournage dont on voit le résultat – mais pas vraiment
un film, puisqu’on ne donne que ces éléments bruts, sans véritable montage. Pour le
spectateur, cela revient à voir une version beaucoup plus longue, mais surtout plus
diffuse. Le point de vue, dans un film, passe en effet prioritairement par le montage
et les choix qu’il suppose : choix négatifs (élimination de ce qui ne fait pas sens ou fait
1. Tom Gunning, « Introduction », op. cit.
2. Stanley Cavell, The World Viewed, 2nd edition, Cambridge/Londres, Harvard University Press, 1979. 9
Aumont.indd 9 21/05/11 14:53:59
trop sens), choix positifs (l’ordre, le rythme). Ce n’est pas hasard si Pasolini, reprenant
une des idées-forces de la phénoménologie heideggérienne, a pu affirmer que « la mort
est le fulgurant montage de notre vie, qui lui donne son sens 1 ». Le webdocumentaire
ne meurt jamais : donc sa vie est dépourvue de sens. Les choix y sont renvoyés
sur le spectateur lui-même ; inutile de dire que, comme quasi tous les usages de
l’interactivité, celui-ci favorise les parcours sémiotiques les plus consensuels et les
plus pauvres. En tout cas, ce qui disparaît, c’est l’idée même d’un rythme, d’une
forme dans le temps : de ce point de vue, il ne s’agit plus du tout d’un film.
Le temps est essentiel au film parce qu’il gère l’exercice du regard ; il fait partie du
substrat formel du film. C’est un postulat esthétique et critique : quelle que soit la
conception qu’on peut avoir du cadrage, du montage, du type de récit, un bon film est
un film qui sait maîtriser la production du temps. Telle est la leçon paradoxale de ce
secteur du cinéma qu’on a appelé « expérimental », « underground » ou « poétique ».
Souvent ces films insistent sur leur visualité, sur la profusion de la sensation visuelle
qu’ils produisent – mais un visuel toujours inscrit dans le temps, comme on le voit
bien dans les plus extrêmes d’entre eux, ceux qui travaillent des formes « abstraites »,
par exemple certains films peints de Brakhage. Le contenu essentiel du cinéma, ce
n’est donc pas le drame : c’est le temps mis en forme.
La rencontre
« Sartre pensait […] que tout récit introduit dans la réalité un ordre fallacieux ;
même si le conteur s’applique à l’incohérence, s’il s’efforce de ressaisir l’expérience toute
crue, dans son éparpillement et sa contingence, il n’en produit qu’une imitation où
s’inscrit la nécessité. Mais Sartre trouvait oiseux de déplorer cet écart entre le mot et
la chose, entre l’œuvre créée et le monde donné : il y voyait au contraire la condition
même de la littérature et sa raison d’être ; l’écrivain doit en jouer, non rêver de l’abolir :
ses réussites sont dans cet échec assumé. […] C’est en regardant passer des images sur
un écran qu’il avait eu la révélation de la nécessité de l’art et qu’il avait découvert, par
contraste, la déplorable contingence des choses données 2. »
Sartre allait au cinéma dans la même disposition d’esprit qu’en allant au théâtre
ou en lisant un roman : pour chercher une mise en ordre expresse de la réalité. Mais
il avait compris que le charme propre du cinéma, c’est que, tout en proposant des
histoires composées, mises en forme, il fait semblant de les découvrir en même temps
que nous, par la force suggestive de sa monstration. Devant un film, je sais bien que
tout est écrit d’avance avant qu’on me raconte l’histoire dans la salle, mais je tiens à
1. Pier Paolo Pasolini, « Observations sur le plan-séquence » (1967), in L’Expérience hérétique, trad.
Anna Rocchi-Pullberg, Payot, 1976.
10 2. Simone de Beauvoir, La Force de l’âge (1960), Gallimard, coll. « Folio », p. 50 et p. 59.
Aumont.indd 10 21/05/11 14:53:59
garder l’impression qu’elle n’est pas encore advenue, que « tout peut arriver ». Pour
en finir avec Sartre, on sait que c’est le reproche qu’il fit à Citizen Kane, où il trouvait
que tout était joué d’avance, et qu’on ne pouvait donc plus avoir la moindre croyance
envers cette histoire 1. Ce n’était pas une critique très raisonnable (difficile de récuser
pareille mise en ordre), mais cela montre bien que, même pour un tenant de la
vertu créative du cinéma, capable de substituer à la réalité un monde imaginaire
cohérent, cela n’est supportable qu’à condition que ce monde imaginaire rencontre
la réalité.
Le thème de la rencontre est au cœur d’une esthétique assez singulière du cinéma,
mais qui a eu un énorme retentissement. L’idée que le cinéma est voué à rencontrer
le réel est née, grosso modo, après la Seconde Guerre mondiale, dans la critique
européenne et surtout française. On la trouve, sous des formes à peine différentes,
sous la plume d’André Bazin, de Jacques Rivette, plus tard de Robert Bresson – et
jusqu’à l’énigmatique formule de Godard dans ses Histoire(s) du cinéma : le cinéma
n’est « pas un art, pas une technique, mais un mystère ». On la trouve aussi, et cela
n’a pas été sans importance, dans les commentaires d’Henri Langlois sur les vues
Lumière : à ses yeux, elles ont capté un instant singulier, dans son insignifiance, et
l’ont préservé tel quel, sans l’interpréter, sans même laisser penser qu’il y a quelque
chose à comprendre (alors que les vues d’Edison dans la Black Maria étaient des
mises en scène lourdement appuyées). On la trouve même, exportée hors d’Europe,
dans la tardive méditation de Kracauer 2.
Ce n’est évidemment pas la seule esthétique possible du cinéma ; les avant-gardes
en ont proposé au moins une autre, tout aussi importante dans l’histoire des films,
fondée sur la maîtrise et la manipulation. Toutefois, si je dois évaluer ce qui, aujour‑
d’hui, « reste » du cinéma, je me poserai moins la question du montage que celle de la
rencontre. Si la rencontre est ce hasard sans hasard qui fait qu’une image touche au
réel, elle n’est pas l’exclusivité du cinéma. La photographie, à tout le moins, pourrait y
prétendre (voir les réflexions de Barthes sur le « ça a été » comme noème de la photo‑
graphie) : dès qu’il y a automatisme de la production d’image, on peut escompter
une certaine part du hasard, donc une certaine présence (ce sur quoi comptaient
les surréalistes avec leur culte de l’« automatique »). Mais il y a des formes qui la
suscitent davantage et mieux que d’autres, et au premier chef des formes fondées sur
la durée, parce que la durée non truquée est un fragment d’expérience filmique qui
reproduit un aspect de l’expérience du monde, la contemplation (attitude elle-même
propice à un certain type de rencontre du réel). Par exemple, le journal filmé de Jonas
Mekas, qui n’est cependant qu’une série de rencontres (avec des gens, des paysages,
des faits divers), ne relève pas, pour moi, de cet idéal : c’est le côté trop concerté de
l’idée même de journal filmé qui empêche la rencontre ; celle-ci en effet n’est pas la
1. Voir le commentaire de Dominique Chateau, Sartre et le cinéma, Séguier, 2005.
2. Théorie du film : la rédemption de la réalité matérielle – de 1960, mais traduite en français l’an
dernier seulement (chez Flammarion). 11
Aumont.indd 11 21/05/11 14:53:59
contingence pure et conservée – encore moins la reproduction de l’accidentel – mais
un sentiment de l’essentiel dans le contingent.
Il n’est pas étonnant que Bazin et ses disciples aient chéri les plans longs. On se
souvient de l’analyse du plan de la cuisine dans The Magnificent Ambersons, mettant
en évidence un processus d’accumulation et de décharge d’énergie – dramatique mais
aussi psychologique. Mais ce plan était encore très structuré, le dialogue et le jeu des
acteurs y jouaient un rôle essentiel. L’idéal de la rencontre se trouve à l’état plus pur
dans des pratiques du plan long qui le tirent, comme je le disais, vers l’insignifiance.
Or de ce point de vue, je ne vois pas de différence entre le cinéma des années 2000
et celui des années 1960, 70, 80, 90. Là encore, j’ai du mal à suivre les critiques
essentialistes pour qui quelque chose s’est perdu avec l’apparition du numérique, telle
Babette Mangolte se demandant : « Pourquoi est-il difficile pour l’image numérique de
communiquer la durée ? 1 » J’avoue ne pas comprendre cette plainte, quand je pense à
Sokourov, à Nobuhiro Suwa, à Gus Van Sant, à Apichatpong Weerasethakul, à Carlos
Reygadas, à Lisandro Alonso, à Jeon Soo-il, à tant d’autres qui jouent précisément
sur cette arme absolue du filmique, le plan long et « vide » : qu’ils soient tournés
ou non sur pellicule, j’éprouve la même sensation, le même sentiment de mystère du
monde et du temps, devant ces plans qui insistent à me montrer la réalité lors même
qu’elle a épuisé toute signification.
Les choses vont encore changer, cela est certain. Peut-être les prophéties méca‑
niques des thuriféraires de la nouveauté qua talis s’avéreront-elles ; peut-être le
cinéma, comme industrie et commerce, est-il voué à une disparition plus ou moins
rapide, au bénéfice d’une autre configuration des techniques et des médias. Mais je
ne vois pas comment pourraient disparaître, par elles-mêmes, les sensations et les
espèces d’émotions inventées par un siècle de films – ces valeurs propres du cinéma
que je viens de décrire : le regard attentif, la captation imaginaire, l’absorption, la
fiction autocompréhensible, la rencontre. Sans doute devons-nous nous préparer à
n’avoir plus toutes ces valeurs à la fois, dans une même œuvre et dans un même
médium – un peu comme, de l’icône byzantine, nous avons gardé bien des valeurs,
mais jamais ensemble 2. Mais ce n’est pas pour aujourd’hui, et il sera alors temps de
se redemander, autrement, « ce qui reste » du cinéma.
1. Babette Mangolte, « Une histoire de temps. Analogique contre numérique, l’éternelle question du
changement de technologie et de ses implications sur l’odyssée d’un réalisateur expérimental », Trafic,
n° 50, mai 2004.
2. C’est une des thèses centrales du monumental Image et culte de Hans Belting (1990), trad. Franck
12 Muller, éd. du Cerf, 1998.
Aumont.indd 12 21/05/11 14:53:59
Vous aimerez peut-être aussi
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeD'EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeÉvaluation : 4 sur 5 étoiles4/5 (5794)
- The 7 Habits of Highly Effective PeopleD'EverandThe 7 Habits of Highly Effective PeopleÉvaluation : 4 sur 5 étoiles4/5 (353)
- The Perfect Marriage: A Completely Gripping Psychological SuspenseD'EverandThe Perfect Marriage: A Completely Gripping Psychological SuspenseÉvaluation : 4 sur 5 étoiles4/5 (1107)
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeD'EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeÉvaluation : 4.5 sur 5 étoiles4.5/5 (20018)
- Pride and Prejudice: Bestsellers and famous BooksD'EverandPride and Prejudice: Bestsellers and famous BooksÉvaluation : 4.5 sur 5 étoiles4.5/5 (19653)
- Art of War: The Definitive Interpretation of Sun Tzu's Classic Book of StrategyD'EverandArt of War: The Definitive Interpretation of Sun Tzu's Classic Book of StrategyÉvaluation : 4 sur 5 étoiles4/5 (3321)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItD'EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItÉvaluation : 4.5 sur 5 étoiles4.5/5 (3275)
- The 7 Habits of Highly Effective People: The Infographics EditionD'EverandThe 7 Habits of Highly Effective People: The Infographics EditionÉvaluation : 4 sur 5 étoiles4/5 (2475)
- Habit 1 Be Proactive: The Habit of ChoiceD'EverandHabit 1 Be Proactive: The Habit of ChoiceÉvaluation : 4 sur 5 étoiles4/5 (2556)
- Habit 3 Put First Things First: The Habit of Integrity and ExecutionD'EverandHabit 3 Put First Things First: The Habit of Integrity and ExecutionÉvaluation : 4 sur 5 étoiles4/5 (2507)
- Orgueil et Préjugés - Edition illustrée: Pride and PrejudiceD'EverandOrgueil et Préjugés - Edition illustrée: Pride and PrejudiceÉvaluation : 4.5 sur 5 étoiles4.5/5 (20260)
- American Gods: The Tenth Anniversary EditionD'EverandAmerican Gods: The Tenth Anniversary EditionÉvaluation : 4 sur 5 étoiles4/5 (12945)
- The 7 Habits of Highly Effective PeopleD'EverandThe 7 Habits of Highly Effective PeopleÉvaluation : 4 sur 5 étoiles4/5 (2566)
- How To Win Friends And Influence PeopleD'EverandHow To Win Friends And Influence PeopleÉvaluation : 4.5 sur 5 étoiles4.5/5 (6520)
- Habit 6 Synergize: The Habit of Creative CooperationD'EverandHabit 6 Synergize: The Habit of Creative CooperationÉvaluation : 4 sur 5 étoiles4/5 (2499)
- Wuthering Heights (Seasons Edition -- Winter)D'EverandWuthering Heights (Seasons Edition -- Winter)Évaluation : 4 sur 5 étoiles4/5 (9486)
- The Iliad: A New Translation by Caroline AlexanderD'EverandThe Iliad: A New Translation by Caroline AlexanderÉvaluation : 4 sur 5 étoiles4/5 (5718)

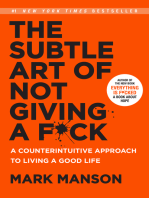










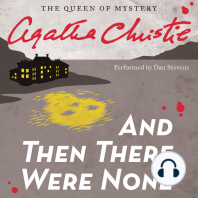



![American Gods [TV Tie-In]: A Novel](https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/audiobook_square_badge/626321117/198x198/22ab6b48b6/1712683119?v=1)









