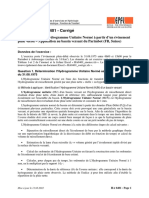Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Cours Bassin Versant
Cours Bassin Versant
Transféré par
mia orned0 évaluation0% ont trouvé ce document utile (0 vote)
18 vues12 pagesTitre original
COURS BASSIN VERSANT
Copyright
© © All Rights Reserved
Formats disponibles
PDF ou lisez en ligne sur Scribd
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
© All Rights Reserved
Formats disponibles
Téléchargez comme PDF ou lisez en ligne sur Scribd
0 évaluation0% ont trouvé ce document utile (0 vote)
18 vues12 pagesCours Bassin Versant
Cours Bassin Versant
Transféré par
mia ornedDroits d'auteur :
© All Rights Reserved
Formats disponibles
Téléchargez comme PDF ou lisez en ligne sur Scribd
Vous êtes sur la page 1sur 12
svm2, 9:20 6M ‘COURS BASSIN VERSANT
1
LE BASSIN VERSANT
1.1, LE CYCLE DE L'EAU
Une parte de Teau précipitée retoume vers fatmosphore, par évapotranspiration (fig. 1.1)
Le terme dévaporation désigne les pertes en eau des nappes d'eau libres sous forme de vapeur (lacs, retenues, mares); alors que
Vévapotranspiration regroupe les pertes du sol: absorption de Feau par le couvert végétal ou animal, et restituion & fatmosphare par
transpiration
LVévapotranspiration est lige @ un certain nombre de paramatres clmatiques tels que température, vent, humidté, rayonnement etc
{eau non restiuée & fatmosphére migre sous forme :
= dlécoulements de surface rapids (rvidres, ravines.) transitant parfols par des zones de stockaye naturel (étangs, mares...) ou
artical (retenves..)
+ dlécoulements souterrains intervenant aprés inflation; ces eaux sont souvent stockées en profondeur dans des réservoirs constilués
do roches porouses ot porméables formant les aquiféres.
Sielles ne sont pas utlisées par "homme, les eaux souterraines parviennent fnalement a la mer.
Le cycle de Teau se poursult c'est le milieu marin qui, par évaporation, humic les masses dair véhiculées par Valizé
Par condensation, ily a formation de nuages, et éventuelement précipitation.
Etablirle bilan en eau c'une région sur une période donnée, c'est chifrer les quantilés d'eau qui entrent et sortent des diférents bassins
versants qui la composent (lo bassin versant dune rvidre est la zone a Fintérieur de laquelle Teau précipitée s'écaule et converge vers la
fiviere),
Le bilan hydrologique d'un bassin versant peut s'exprimer schématiquement par la formule suivante:
Ps
+QH1+U4AR,
P- précioitation,
E + évaporation + évapotranspiration,
rmodhyeos mplisivenisetamyarDrabovtCchim
ne
‘une, 920M ‘COURS BASSIN VERSANT
LE CYCLE HYDROLOGIQUE
u
Précipttation
Evaporation et i
evapotransprration |
continentales
Evaporation
océanique
Fig. 1.1. Le cycle hydrologique.
Q - écoulement;
1 inftration;
U- utilisation bumaine;
AR - stockage.
‘Chacun des termes du bilan hydrologique est naturellement pondéré par divers paramatres climatiques st géographiques. Par exemple, la
{température est fun des facteurs principaux du pouvoir évaporant de Taimosphére, le relief condilionne les préciptations des masses
nuageuses, et la nature de la couverture végetale influs sur les phénoménes dinterception et de transpiration.
Les durées de séjour de eau dans les différents compartiments du cycle sont tr variables. En moyenne, elles sont de ordre de la semaine
{dans fatmosphére, de plusieurs jours & plusieurs années dans les rviéres selon Is taille des bassins versants, des siécles & des millénaires
dans las grands aquiféres du sous-sol, dune trentaine de siécles dans les océans.
1.2, DEFINITIONS,
‘On appelie bassin versant dune riviére considérée en un point donné de son cours, "aire limitée parle contour &Tintérieur duquel eau
récipiée so dirige vers ca point de la rividre.
Lexutoice dun bassin est le point le plus en aval du réseau hydrographique par lequel passent toutes les eaux de ruissellement drainées par
le bassin. La ligne de créte d'un bassin versant est la ligne de partage des eaux. La ligne ainsi définie, limite les bassins versants
topographiques adjacents
‘Cependant, le cours d'eau c'un bassin versant donné peut-ére alimenté par les eaux précipitées sur un bassin topographiquement adjacent.
Gest le cas provoqué parla présence dun horizon imperméable ou d'coulements souterrains complexes comme dans les terrains
kerstiques,
En fait, a figure 1.2 montre quien cas d'averse abondante, les eaux ruisselées pourraient rejoindre le cours d'eau du bassin adjacent tandis.
‘que les eaux infl’ées se drigeraient vers le bassin principal
rmodhyeos mplisivenisetamyarDrabovtCchim ana
svm2, 9:20 6M ‘COURS BASSIN VERSANT
Le tracé de la ligne de créte est une opération délicate qui se fait su la carte topographique de la région concemée. Généralement, on utlise
une carte & Péchelle 1/200 000. Sil s'agit d'un petit bassin versant, de lordre de quelques ‘S%”, on préférera des cartes topogrephiques au
1180000, voire au 1/25000, ot, si cos documents existont, la couverture de photos aériennes, quien vision stéréoscopique, resitue et permet
un tracé beaucoup plus précis. Une vérité terrain est toujours indispensable.
ly
Ey
3
Limite dy bassin
‘Limite du bassin
Fig. 1.2. Bassin versant topographique et bassin versant hydrogéologique,
1.3. CARACTERISTIQUES GEOMETRIQUES
1.3.1. AIRE ET PERIMETRE
LLare esta portion plan délimitée parla igne de Be, ou contour du bassin, Sa mesure est fate sot & Taide dun planimdte, soit parla
méthode des petits carrés, et est généralement exprmée en kan?
Le pénmétre est la longueur, généralement exprimée en km, dela ligne de contour du bassin; sa mesure est faite Taide dun curvimatre.
Pour certaines applications on trace le périmetre stylsé du bassin en issant son contour,
1.3.2. INDICE DE COMPACITE
LLincice acimis par les nydrologues pour caractéiser la forme un bassin versant est lindice de compacité de GRAVELIUS qui est le rapport
du pérmétra du bassin & celul dun corcle de méme surface.
x,
SiA esta surface du bassin an!" et Pson périmétre en km, e coetfcient Se est égal &
Pp
28.
ong
aA
VA
Le coefficient “ est supérieur a 1 et dautant plus voisin de cotte valour que le bassin est compact.
4.3.3, LE RECTANGLE EQUIVALENT
Cotte nation a été introduite pour pouvoir comparer des bassins entre eux du point de vue de
‘geometriques sur "écoulement.
Nnfluence de leurs caractéristiques
Soit Let
la longueur et la largeur du rectangle, et Pet A le périmétre et sire du bassin versant
one:
rmodhyeos mplisivenisetamyarDrabovtCchim ana
swe, 920° ‘COURS BASSIN VERSANT
kal, f(uzy
m2
1.4. CARACTERISTIQUES TOPOGRAPHIQUES:
out
1.4.4, LE RELIEF
Le relief c'un bassin est souvent caractérisé parla courbe de sa réparttion hypsométrique.
Elle est tracée surla figure 1.3 en reportant en ordonnée latitude ¥, et, en abscisse le pourcentage de la surface du bassin dont Falitude est
2 supérieure ou égale 2 Y, rapportée a a surface totale du bassin. La répartition hypsométrique est donnée parle pourcentage dela surface
‘comprise entre les différentes courbes de niveau a la surface totale (tab, 1.1),
+
on mo 0 oO % 8 0 1 ne
Fig, 1.3. Courbe hypsométique.
Tableau 1.1 Exomplo do courbe hypsomaitrque
Elévaton || Supericie | Pourcentage | Pourcentage au-
courbede || entwles | dutotal | dessus dea limite
niveau (m) || courbes (m=) inféreure
170-300 500 24 100.0
300- 400 1700 82 976
‘400 - 500 1900 92 894
500-600 2400 118 802
eau 1.1 (suite)
Elévaton || Supericie | Pourceniage | Pourcentage au-
couroede || ontwlos | autotal |, dossus dea limite
niveau (m)__|| courbes (me) inéreure
600-700 3000 145 08.6
redhyeos mplistvenisetamyarDrabovtCchim ana
svm2, 9:20 6M ‘COURS BASSIN VERSANT
700- 800 2970 143 544
800-900 2270 110 39,8
900 - 1000 2180 105 288
+1000 - 1100 1500 72 183
+100 - 1200 640 34 4
+1200. 1300 610 30 80
+1300 1400 410 20 50
1800 620 30 30
1.4.2. LES PENTES
On peut distinguer 4 types de pentes:
la ponte orographique,
* la pente topographique;
* la pente hycrograph que;
la pante stratigraphique.
Les indices de pentes permettent, comme pour certaines caractérstiques géométrques, de comparer les bassins versants entre eux.
1.4.2.1. Pente orographique. La pente orographique caractérise le rele. Ele favorise Félévation des masses dair en mouvernent au dessus
des ralies et provoque la condensation de Thumidilé qu‘elles conliennent
1.4.2.2. La pente topographiquo. C'est la pente qui influence 'écoulement superficiel des eaux: ruissellement de surface et écoulement
hypodermique, Elle accélére le ruisselement sur les versants et détermine en parte le temps de réponse du cours d'eau aux impulsions
pluviometriques.
La pente topographique se it et se mesure sur a carte topographique a grande échelle ( >1/100000) ou a aide de M.N.T.
1.4.2.3, La pente hydrographique. La pente hydrographique, ou profi en long du cours d'eau, peut-étre déterminée sur la carte ou mesurée
sur le terrain par un nivellement de précision. Cette pente exprimée généralement en mikm concitionne:
* la vitesse de l'eau dans le chenal
* Ia vitesse de onde do crus:
+ le trant d'eau de la rividre: pour un méme débit et une méme largeur une rviére plus pentue a une vitesse d'écoulement plus grande et
onc, généralement, une profondeur ols fable.
La pente hydrographique varie plus ou moins irrégullérement pour un méme cours d'eau selon les structures géologiques traversées ot
diminue en général c'amont en aval (forme concave des profis en long) (ig. 1.4),
2
La pente dun cours d'eau varie beaucoup d'un type de cours dleau a un autre: supérieurs & 10° mim pourles torrents fortement pentus &
107? km pour les grands fleuves. Ella conditionne la forme des hydrogrammes de crue, comme le monire la igure 1.5
rmodhyeos mplisivenisetamyarDrabovtCchim sna
svm2, 9:20 6M ‘COURS BASSIN VERSANT
vm ite
i
fomuss iam, 42.0 pe
8
Fig. 1.4, Profis en long de tHérault et dea Vis.
1.4.24, La pente stratigraphique, Elle contréle le chemin des eaux inflirées qui alimentent les aquiféres. Elle détermine la direction de
écoulement des eaux souterraines.
hydragramme fortes pentas
ntrogramme ties penis
Fig. 1.5. Role de la pente sur la forme de Ihydrogramme,
1.4.25. Les indices de pente
* Lindice de pente Roche. indice de pente de Roche caractévise la pente globale du bassin versant Il e'exprime pa
0 bea
1: Longueur du rectangle équivalent,
(03. représenie la fraction en % de la surface A comprise ene deux courbes de niveau voisines disiantes de
* indice global de pente. Surlacourbe hypsométrique, on prend les points tls que la surface supérieure ou infériaure sok gale & 5%
Ge A. On en déduit es alitudes 5 et 795 entre lesqueles sinscrt 90% de Faire du bassin et la dénivelée 0 = #5705
Lindi global et egal
2.
Z
rmodhyeos mplisivenisetamyarDrabovtCchim ane
svm2, 9:20 6M ‘COURS BASSIN VERSANT
‘Los madéles numériques de terrain. Le modéle numérique de terrain est abil partir des courbes de niveau numérisées du bassin.
Los altitudes sont calculées aux points dune grile dont la taille dune maille élémentaire détermine le pas du modele. Ditférents
paramétras sont calculés pour chacune des maillos:altiude moyenne, direction de drainage, ponte moyenne, exposition, concavit,
Convexité etc. Le moddle numérique de terrain permet c'avoir une représentation en 3 dimensions du bassin versant. Il permet surtout
@'éludior la distibulion des paramatres précédents, de tracer automaliquement le réseau de drainage et de disposer de données
escritives quantifies et précises pour réalser une modélisation des éeoulements distlouge dans espace,
1.5. LES CARACTERISTIQUES DU RESEAU HYDROGRAPHIQUES
Le réseau hydrographique est ensemble des chenaux qui drainant les eaux de surface vers Fexutoie du bassin versant.
Un chenal pout-6tre défini comme Inscription permanente dans espace d'un écoulement concentré plus ou moins permanent. A amont de
tout chenal ls processus hydrologiques sont aréolaires, spatiaux, Cest-é-dire quilsintéressent une surface et non une ligne; dans le chenal
ils covennent linéaires.
Dans un bassin versant les chenaux sont organisés, hiérarchisés en un réseau qui concentre los eaux des rus dans les ruisseaux, cellos dos
ruisseaux dans les rivigres, celles des rvigres dans ies leuves.
Un réseau hydrographique est done ensemble des cours d'eau, alfluents et sous-afluents d'une rvidre ou d'un méme fleuve. A Pétat naturel
tous les réseaux sont hidrarchisés, de nombroux autours ont proposé dos classifications do cos réseaux.
1.5.1. CLASSIFICATION DE HORTON
‘Tout cours d'eau sans affluent est dordre 1, tout cours d'eau ayant un affluent dordre x est ordre x + 1, et garde cet ordre sur toute sa
longueur. A ls confluence de deux talwogs dimportance égale, on donne ordre supérieur au plus long,
1.5.2. CLASSIFICATION DE SCHUNM (fig. 1.6)
Est ordre x + 1 tout trongon de rviére formé par la réunion de deux cours d'eau c'ordre x
Fig. 1.6. Bassin versant a orcre 4 (classification de SCHUMM),
1.5.3. RAPPORT DE CONFLUENCE
Le rapport de contuence *r ast égal au quotient du nombre de talvags d'ordre x par celui des talwags dordre supérieur (x +1)
Les réseaux hydrographiques sont toujours dendrtiques,cest-4-dre ramifés comme les branches tun arbre. Certains auteurs ditinguent 3
Principaux types de réseaux:
‘+ chéno: a ramification est bien développée avec un espacement réguler dos confluences. Le rapport * est infénour€ 5 (exemple
Amazone)
* pouplior: le bassin versant nettement plus long que large, présente de nombreux affuents parallles et un rapport de confluence élevé,
superiour a 10,
* pin: le bassin so caractérise par une concentration des confluences dans le secteur amont g'ol sort un trone qui ne regoit plus
affluents importants, Le rapport
cet fainle (exemple le Nil.
rmodhyeos mplisivenisetamyarDrabovtCchim ma
svm2, 9:20 6M ‘COURS BASSIN VERSANT
Cette organisation est trés importante pour la formation des crues du cours d'eau principal. Selon le type de géométie du réseau, les crues
dos différents affluents confluent plus ou moins rapidement dans espace ot dans le tamps. Elles se suporposont plus ou moins los unes sur
les autres, ou au contraire se succédent les unes aprés les autres. Les risques de superposition croissent du type peuplier au type pin
parasol. Ceci est vrai pour les bassins qui sont globalement afectés par un événement pluvieux,
Les trois types présentés dans la figure 1.7 sont des types simples organisation de réseaux hydrographiques. Lhistoie géomorphologique
tla structure géologique sont a Forgine de réseaux organisation plus complexe.
a) ») a
Type pn pignan
Fig. 1.7. Types de bassins versants.
1.5.4. LA DENSITE DE DRAINAGE
Crest le quotient de la somme des longueurs de tous les cours d'eau >” & la superficie du bassin drain
eae
Bang
La determination de la densité de drainage suppose d'adopter certaines conventions quant la défintion des chenaux de drainage:
+ talwegs nettement marqués et empruntés par des écoulements temporaires sur es riviéres non pérennes;
‘ou ruisseaux toujours en eau des grands bassins versants,
1.5.5. ENDOREISME
I s'agit une forme spéciale du bassin versant dans laquelle eau est concentrée en un point cu bassin luiméme, soit sous forme de lac ou
{de mate, solt par accumulation souterraie.
On peut distinguer deux types d'endoréisme:
++ rendoréisme de ruissellement: les apports des différents éléments du réseau se concentrent la limite du bassin,
ccneminer encore longtemps dans le sol pour éventuellement se méler aux nappes provenant d'autres bassin;
*rendoréisme total: les appors se concenirent en un point situé a intérieur du bassin ou quelquefois & sa périphérie; ils forment en
général un lac ou une mare permanente ou temporaire, sans initration notable vers 'extérieur du bassin. Dans ce cas, tous les apports
sont consommeés sur place par évapatranspiraton
infltrent et peuvent
LVendoréigme peut étre plus ou moins généralisé: bassins de quelques kllomatres carrés ou de plusieurs milirs de klomatves carrés, Il est
rare que dans ce dernier cas fendoréisme soit total. Le bassin du lac Tchad peut cependant étre considéré comme totalement endoréique,
‘mais quand on atteint de telles superficies de drainage, la notion dendorsisme est toute relative: le lac Tchad jous en fat leréle dune mer
intérieure, Signalons enfin, que Fendoréisme est généralement caractéistique des zones arides et souvent présent dans les régions
karstiques.
1.6. LE TERRAIN
Le terrain est au contact terre/atmasphére; on peut donc le schématiser par trois types de matériaux:
* le sol qui fixe et nourrt les plantes,
+ le manteau de dépéts superfciels plus ou moins épais (altéites, colluvions,alluvions.,.)
rodhyeos molisenisetamyaDrabovtChim ane
svm2, 9:20 6M ‘COURS BASSIN VERSANT
‘le substratum ou roche en place, structure géologique supérieure du bassin versant
Ce demier est toujours présent, alors que le sol et le manteau peuvent ne pas exister.
LUnydrologue siintéresse & ces trois types de matériaux dans leur rapport avec le déroulement du cycle de 'eau. Nous ne traterons pas du
‘substratum, traté en hydrogéologi.
Le sol et le manteau exercont vis @ vis de Peau deux réles prine/paux:
* un r6le de stockage => porosité;
* un Ole de transfer => perméailté
1
1, LES SOLS.
Le sol agit de citférentes maniéres sur le régime d'une rivére, Se nature et surtout sa couleur interviennent dans le bilan thermique. Par son
influence sur le développement et la nature de la végétation, il agi indirectement sur 'évapotranspiration. Ce sont surtout les propriélés
mécaniques du sol qui intéressent les nydrologues,
Un sol peut-étre compact (roche) et est généralement imperméable, saut en cas de fissures, diaclases ete. Il peut étre meuble, et ilest alors
nécessaire de 'analyser pour connaftre en particulier les propartions d’éléments plus ou moins fins ou grossiers qui le composent. En effet, la
dimension des particules constituant le matériau est le facteur déterminant des phénoménes dinfitration,
En schématisant on dira que plus les particules seront dune tale importante, plus le terain sera perméable, cest-d-dre favorable &
Ninfitration. On acopte généralement la classification suivante:
Diamétre des particule:
Gravier> 2 mm:
Sable grossier 2 80.2 mm:
Sable fin 0,28 0,02 mm:
Limon 0,02 & 0,002 mm
Agi < 0,002 mm.
Ceci nous améne & défnir quelques termes couramment ulisés
Porméabilté: propité dun milieu solide poreux de se laisser traverser par Tea.
Infiltration: passage d'un tude de extérieur vers Nntéisur un milieu poreux. Pour quily atinfitration ne suft pas que le mile soit
perméable, faut que la surface qui le sépare de Fextérieur le soit aussi En Hydrologi, celle remarque est lrés importante comple tenu du
Tle ous par état de la surface du sol dans le processus du ruissellement,
Absorption: en hydrologie, processus général de rétention de 'eau précipitée sur un bassin versant, lorsque cette eau est défnitivement
‘soustraite au ruissellement. Ele comprend entre autres infiltration.
Le sol parle biais de sa capacté de rétention capiliaie et de sa perméabilté joue un role de fre entre Tatmosphare et le sous-sol. ll va
partager les quantités o'eau précpitées entre ruissellement, stockage, st inflation,
Le sol se recharge parla pluie et se vidange par ressuyage et par évapotranspiration.
Le manteau, surtout caractérisé par sa macro-porosité, se recharge par les apports dus au ressuyage du sol, et se vidange par écoulement
‘ravitaie vers les nappes ou vers le bas du versant, Cette vidange est plus ou moins rapide en fonction de la perméabilié des matériaux.
On peut dire que sol et manteau représentent deux réservoirs qui contiennent plus ou moins eau,
Un meme épisode pluvieux survenant sur ces réservoirs& des états dlférents de saluration va avoir des conséquences hydrologiques tres
siférentes.
Enfin, lo sol et le manteau sont soumis aux aléas météorologiques saisonniers:
= gel imperméablisation du bassin versant
=> immobilisation de eau
= dégel => destockage des eaux gelées
rmodhyeos mplisivenisetamyarDrabovtCchim ane
svm2, 9:20 6M ‘COURS BASSIN VERSANT
=> sécheresse dessiccation du sol
=> dans certains cas déshysratation et
contraction des argiles (fentes de retralt des vertisols)
1.6.2. LA COUVERTURE VEGETALE
La couverture végétale dun bassin versant joue un role primordial dans le déroulement du cycle de 'eau, souvent complexe el contradictore.
La notion fondamentale est ci celle de couverture, plus ou moins continue, plus ou moins épaisse, plus ou moins efficace hydrologiquement,
La couverture végétale agit sur le cycle de eau par:
‘sa biomasse aérienne qui
* Intercepte une plus ou moins grande partie des précipitalions, et toute pluie faible en général
+ capte plus ou moins broullard et rosée:
*protige plus ou moins efficacement le Sol contre insolation done 'évaporation et contre férosion pluvial,
+ sa biomasse souterrsine qui
*pénéire la rhizosphére et structure celle-c
+ pompe l'eau du sol et des nappes quelle peut ateindre
‘+ sa vie propre qui commande sa transpiration, proportionnelle & la biomass totale
' ses propres déchets enfin, para litiére produite, devenant humus et mati organique. Une abondante tire annuelle ameubli les
sols lourds, donne du corps aux sols trop légers, parce qu'elle accrott leur teneur en matiére organique et avec elle leur capacité de
rétention capiliaire et leur macro-porosité
Mais cette action se diférencle selon les formations et les associations végétales et selon intervention des agrueurs. Lihydrologie des pays:
foresters differ de celle des pays de prairie, et plus encore des pays sleppiques ou désertiques; et celle des bassins versants defrichés et
cullvés differe de celle des bassins versans nalurels, toules choses égales par ailleurs.
(On peut distinguer cing principaux types de couverture vagstale:
© la Foret:
© la praine;
os cultures
* es tourbieres:
* a végétation désertique.
La carte de la couverture végétale du bassin versant constitu donc un document essentiel pour thydrologue.
Celui-ci se montre soucioux moins des types de végétalion dstingués par les botanistes que:
‘os types de couvertures vagétales;
* do Feffcacité de colles-c face aux aléas météorologiques;
‘de lour comportement hydrologique propre;
‘de lour extension spatiale ete
1.6.2.1. Comportement hydrologique de fa forét. La forét est c'abord une formation végétale, généralement muti-trate (arbres, arbustes,
arbrisseaux, herbe, mousse etc.) occupant une surface plus ou moins étendue de maniére continus.
La fort accrot les précipitations annuelles de 5 & 6% dans les pays tempérés ocbaniaues:
+ par effet topographique en pays plat;
* par effet thermique:
* par effet d'écran sur les broullards;
+ par sa masse méme et sa puissance évaporatoire dans les grandes cuvettes forestiéres équatoriales,
La forétdiminue les précipitations réeles au so:
* par interception dune parte de la pluie, tranche de 1 & § mm qui se réévapore le jour méme,
rmodhyeos mplisivenisetamyarDrabovtCchim rove
svm2, 9:20 6M ‘COURS BASSIN VERSANT
‘par sublimation de la neige retenue sur le houppier des arbres;
© par rétention dela hire
La foret accrottles capacités dlemmagasinement des bassins versants:
* par accroissement de la capacité de rétention du sol avec la Iitiére devenant humus;
+ par diminution de Fvaporation au sol;
+ par une meilloure répartition de la couverture nivale au so
* par réduction de Ia sublimation de la neige tombée au so
+ par une meilleure percolation des eaux gravifques 4 travers les sols mieux aérés, rendus plus macroporeux par les conduits racinaires,
une rhizosphere généralement épaisse.
Finalement, les sos foresters qui recolvent moins de pluie et de neige que les sols découverts,recoivent plus d'eau slockable que les
‘espaces voisins découverts, mais la forét accrot les portes des bassins versants par sa transpiration, surtout si les racines atteignent la
{range de capillarté dela nappe phréatique
| faut nuancer ces appréciations selon le type de fort, mais dans tensemble an paut dre que:
+ la forét diminue la tame d'eau écoulée sous les cima pluviaux
* a fort accrot la lame d'eau écoulée sous las climate nivaux
* céboiser ou reboiser perturbe toujours la structure hydrologique initial.
On peut citer le cas de la for8t (plantée) des Landes de Gascogne, ol! une coupe de pinéde (coupe toujours & blanc), fait remonter le niveau
de la nappe phréatique de 0,6 3 1 mare, assez pour que le marécage rbapparaisse partis.
La fordtrégularise le régime dos cours d'eau on jouant un rl éerétour de crues. Surtout pour les couvertures forestires denses, couvrantes,
protectrices de leur propre sol par lour sous-bois et Ie tapis herbacé sous fort, Letficaité des grands reboisements‘rangais dans les Alpes
du Sud, les Pyrénées Centrales et Orientals, le massif de FAigoual (dont les sédiments se retrouvaient dans le port de Bordeaux et
contribuaient pour une trés large part a son envasement) le prouve
1.6.2.2. Comportement hydrologique de (a prairie. Un tapis herbacé bien enraciné brise aussi 'énergie pluviale, blaque Férosion ruisselante et
Fempéche de devenir ravinante
Lu aussi joue un rdlerégulateur quoique moindre que celui de la forét
* son ombre est moindre;
*+ son horizon racinairs moins épals;
‘+ mais faccumulation dThumus et de matiére organique quil engendre accrolt beaucoup la capacité de rétention du Sol, Cette matiére
lrganique ne s'accumule pas sur le sol comme la lire forestiére mais dans fe sal, cffuse dans tout [horizon racinaire parce que de
ombreuses herbes sont des plantes annuelles dont les racines pourissent dans le sol, et parce que la biomasse racinaire temporte
sur la biomasse aérienne ala différence dela frat
1.6.2.3. Comportement hysrologique des cultures. Les cultures ont un réle hydrologique certain, important, complexe at diférencié an
fonction:
* cu travail cameublissement du sol plus ou moins poussé, plus ou moins frequent, plus ou moins profond,
* ola méthode de travall du sol: la hous, par traction animale, avoc un matériel loutd, en suivant les isohypsos ou non;
* do la protection plus ou moins eticace des plantas culties mais < blé < fourrage;
* cu stade vagétati de la plante au moment dos fortes pluies;
* do la structure agraira
‘+ méga-parcelle englobant tout un versant, voire plusieurs;
‘+ mini-parcelles morcelant un méme versant avec rideaux,
En bassin Aquitan, la culture du mais et du sorgho aggrave érosion et crues inondantes parce que les sols sont travallés et nus au
printomps, saison des pluies les plus abondantes; a culluro on tras grandes parcellas aggrave encore lo danger.
1.6.2.4. Comportement hydrologique des fourbiéres: La tourbe, veritable formation éponge, peut contenitjusqu’a 80% de son volume en eau.
Eile se comporte comme une éponge naturelle ou un spontex, gonffant en présence d'eau, an retenant une partie par capllaé, tandis que sa
macro-porosité se sature avec la pluie tse vidange ensuite assez vite
Parla, les tourbigres, plus manteau que couverture végétale parle comportement, écrétent les crues mais ne sauraient par elles-mémes
relover les diages,
rmodhyeos mplisivenisetamyarDrabovtCchim swe
‘un, 920M ‘COURS BASSIN VERSANT
Elles jouent un Ble hydrologique important dans les pays froids et humides, elles y surélavent les veux, tapissent les versants.
1.6.28. Déserts climatiques ou “déserts anthropiques”. Dans les régions désertiques, souls la localisation du substratum, a structure des sols
ct Forganisation des differents types de pentes déterminent la distribution de eau dans les civers compartiments:
* os calcaires ot autres roaches compactes donnent des surfaces rocheuses structurales lavées & chaque rare plu
' los sables donnent des dunes ot des ergs modelds par le vent st absorbant toute pluie: cl stobsorve Farsisme absolu (privé
‘écoulement réguler):
+ os argiles et mames sont ravinées en bad-lands, ou nivelées en glacis.
Le missellemant supertcil direct sur substratum est partout la procassus dominant,
rmodhyeos mplisivenisetamyarDrabovtCchim nae
Vous aimerez peut-être aussi
- SQL 3Document31 pagesSQL 3mia ornedPas encore d'évaluation
- Eeee Eeeeee 1Document646 pagesEeee Eeeeee 1mia ornedPas encore d'évaluation
- Progrès Du Secteur Transports Et La Réduction Des Gaz À Effet de SerreDocument8 pagesProgrès Du Secteur Transports Et La Réduction Des Gaz À Effet de Serremia ornedPas encore d'évaluation
- M1info Lgreq td05Document3 pagesM1info Lgreq td05mia ornedPas encore d'évaluation
- HA0401 CorrigeDocument4 pagesHA0401 Corrigemia ornedPas encore d'évaluation
- Sig I-6Document29 pagesSig I-6mia ornedPas encore d'évaluation
- 1-Intro SigDocument27 pages1-Intro Sigmia ornedPas encore d'évaluation