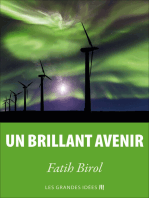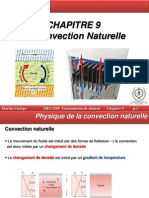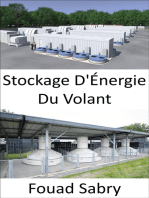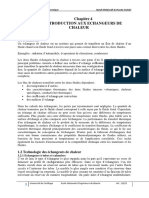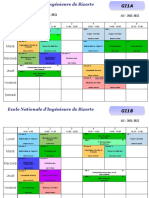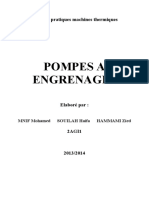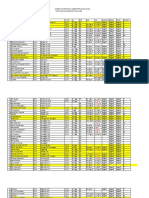Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Chapitre III Audit TD
Transféré par
Achref MraihiaCopyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Chapitre III Audit TD
Transféré par
Achref MraihiaDroits d'auteur :
Formats disponibles
Chapitre 3 : Audit énergétique des installations de chauffage
Chapitre 3 : Audit énergétique des
installations de chauffage
3.1 Introduction
L'objectif de ce cours est de montrer les principes de base de l’énergie thermique et ses applications
industrielles. Le focus est sur la chaufferie composée essentiellement de chaudières de différents
types et produisant de la vapeur.
Avec une bonne connaissance de la combustion, des combustibles utilisés, ainsi que des
équipements (brûleur et chaudière), le personnel impliqué dans une centrale électrique ou une usine
aura un outil pour prendre les bonnes décisions concernant l'optimisation des coûts d'opération, la
planification des arrêts et la fourniture non interrompue des services énergétiques requis par le
procédé.
3.2 Généralités
3.2.1 Eléments nécessaire à la combustion
La réaction chimique de combustion ne peut se produire que si l'on réunit trois éléments :
• Un combustible
• Un comburant
• Une énergie d'activation en quantités suffisantes.
La combustion cesse dès qu'un élément du triangle suivant est enlevé
ENIB - Enseignante : Fathia Chaibina -1-
Chapitre 3 : Audit énergétique des installations de chauffage
Le combustible peut être
• un solide formant des braises (bois, papier, carton, …)
• un liquide ou solide liquéfiable (Fuel, gasoil, huile, …)
• un gaz (butane, propane, méthane, dihydrogène, …)
• un métal (fer, aluminium, sodium, magnésium, …)
Le comburant
La plupart du temps, il s’agit de l’air ambiant, et plus particulièrement de l’un de ses composants
principaux, le dioxygène.
La source de chaleur
Le plus souvent, la réaction est déclenchée par une énergie d’activation. Il s’agit généralement
de chaleur.
3.2.2 Les types de combustion
Il y a quatre types de combustion :
Combustion STOECHIOMETRIQUE ou neutre, qui est la référence : elle n'est que
théorique (le vœux pieux), toutes les techniques évoluées tentent de s'en approcher.
Combustion COMPLETE par EXCES D'AIR ou oxydante, c'est à dire sans imbrûlé, ni
solide ni gazeux, c'est la seule envisageable pour des brûleurs performant, c'est aussi
l'objectif à atteindre dans le domaine du chauffage.
Combustion INCOMPLETE avec EXCES D'AIR (semi-oxydante)
Combustion INCOMPLETE en DÉFAUT D'AIR (semi-réductrice).
ENIB - Enseignante : Fathia Chaibina -2-
Chapitre 3 : Audit énergétique des installations de chauffage
3.2.3 Les conditions de la combustion
Pour obtenir et entretenir une combustion il faut :
- Un combustible sous forme gazeuse (pour les liquides : ils seront pulvérisés ou vaporisés et
pour les solides, ils seront chauffés très fortement pour en extraire les gaz).
- Un comburant en suffisance : d’où la nécessité de bonnes ventilations d’air.
- Combustible et comburant seront mélangés.
- Une vitesse d'écoulement stable (10 à 40 m/s) généralement en régime turbulent.
3.2.4 Excès d’air
La différence de la quantité d’air utilisée et la valeur stœchiométrique, exprimée en pourcentage
de celle-ci, est appelée « EXCES D’AIR ».
La formule de définition de l’excès d’air est donc :
Volume d 'air utilisé − Volume d 'air théorique
EXCES D ' AIR (E) =
Volume d 'air théorique
O2
e (%) = x100
21 − O2
Le réglage d’excès d’air a pour objectif de trouver la quantité d’air optimale pour laquelle la
somme des pertes par imbrûlés et des pertes par la chaleur sensible des fumées, dues à l’excès
d’air, est minimale.
L’excès d’air dépend de plusieurs facteurs dont :
Le type de brûleur
Le type de combustible
Le taux de charge de la chaudière
ENIB - Enseignante : Fathia Chaibina -3-
Chapitre 3 : Audit énergétique des installations de chauffage
3.2.5 Energie dégagée et pouvoir calorifique
La quantité d’énergie produite par la combustion est exprimée en joules (J) ; il s'agit de
l'enthalpie de réaction.
Le pouvoir calorifique est l'enthalpie de réaction par unité de masse de combustible ou l'énergie
obtenue par la combustion d'un kilogramme de combustible, exprimée en général kJ/kg et l'on
définit :
le pouvoir calorifique supérieur (PCS) : « Quantité d'énergie dégagée par la combustion
complète d'une unité de combustible, la vapeur d'eau étant supposée condensée et la
chaleur récupérée ».
le pouvoir calorifique inférieur (PCI) : « Quantité de chaleur dégagée par la combustion
complète d'une unité de combustible, la vapeur d'eau étant supposée non condensée et la
chaleur non récupérée ».
La différence entre le PCI et le PCS est la chaleur latente de vaporisation de l’eau (Lv)
multipliée par la quantité de vapeur produite (m), qui vaut à peu-près 2 250 kJ/kg (cette dernière
valeur dépend de la pression et de la température).
PCS = PCI + m.Lv
ENIB - Enseignante : Fathia Chaibina -4-
Chapitre 3 : Audit énergétique des installations de chauffage
3.2.6 Les propriétés des combustibles
3.3 La Chaufferie
• Les chaudières
• Les bilans d’une chaufferie
• Les rendements de chaudières
• Le traitement des eaux et les purge
ENIB - Enseignante : Fathia Chaibina -5-
Chapitre 3 : Audit énergétique des installations de chauffage
3.3.1 Les chaudières
3.3.1.1 CLASSIFICATION DES CHAUDIERES
On peut classer les chaudières en fonction de
a/- La puissance thermique
Si l’on se réfère au critère le plus simple qui est sans doute la puissance thermique ou production
de vapeur, on peut constater de façon très globale que :
Au-dessous de 20 t/h de production de vapeur, il existe une très grande variété de modèles
de chaudières, construction à tubes de fumées presque exclusivement, à circulation
naturelle ou forcée. Ces chaudières sont standardisées, monobloc et transportable.
Construites en atelier et livrées sur un châssis supportant également tous les équipements
annexes : ventilateur, pompe alimentaire, armoire électrique de commande et de
contrôle, etc.
Applications : usines Textiles, Unité de production pharmaceutique, Agro-alimentaire,
hôtelleries, hôpitaux, cliniques, bâtiments administratifs, etc.
Entre 20 et 140 t/h de production de vapeur, ce sont principalement des chaudières «
monoblocs » ou « transportables », également construites en atelier et expédiées d’un
seul bloc, mais cette fois sans leurs équipements annexes, lesquels sont rapportés sur le
site. Ce sont aussi des chaudières dont le gabarit exclut déjà le transport monobloc et qui
sont construites sur le site à partir d’éléments préfabriqués plus ou moins importants. Il
s’agit très généralement de chaudières à tubes d’eau et à circulation naturelle, équipées
d’une surchauffeur lorsque la vaporisation excède l’ordre de grandeur de 30 à 50 t / h.
Note : entre 20 et 40 t/h il y a quelquefois le choix entre construction à tubes de fumées
ou tubes d’eau. La gamme de pression s’étend jusqu’à environ 120 bars.
Ces chaudières sont généralement mixtes, c'est-à-dire production d’électricité et de
vapeur pour les processus de fabrication des usines.
Applications : Industrie lourde : Chimie, Pétrochimie, Raffinage, Sidérurgie,
Cimenterie, etc.
ENIB - Enseignante : Fathia Chaibina -6-
Chapitre 3 : Audit énergétique des installations de chauffage
Au-delà de 140 t /h et jusqu’à la limite variable des chaudières industrielles que nous
avons située au voisinage de 3 à 400 t/ h de production de vapeur, ce sont des chaudières
construites à l’unité, entièrement assemblées sur le site, le plus souvent à circulation
naturelle, et équipées d’une surchauffeur. Ces chaudières sont également mixtes (vapeur
et électricité).
Applications : Elles sont globalement les mêmes que pour les chaudières de 20à140t/h.
Qualités demandées à une chaudière industrielle :
• Souplesse de marche, réponse rapide aux variations brusque de forte amplitude.
• Qualité et stabilité de la vapeur en Pression et Température.
• Bon rendement à la mise en service, mais surtout durant toute la durée
d’utilisation, en général 15 à 30 ans et même plus, suivant la taille et l’entretien.
Au-delà de 400t/h (120 M/W) et jusqu’à 1300 M/W ces puissances sont le domaine
réservé des centrales de production d’électricité au charbon ou nucléaire. Pour fixer les
idées à STEG Sousse ou Rades la chaudière d’une tranche thermique (au Gaz naturel) est
de 150MW correspond à 515t/h et (144bar et 540°C).
b/- La conception
La distinction la plus nette du point de vue conception est celle qui apparaît entre :
• Les chaudières à tubes de fumées parcourus intérieurement par les gaz de combustion
La vapeur est générée en chauffant un important volume d’eau, au moyen de fumées
produites par combustion de gaz ou fioul et circulant dans des tubes immergés. C’est la
technique la plus classique pour la production de vapeur saturée, d’eau ou de vapeur
surchauffée pour une gamme de débits de 160 à 50 000 kg/h (112 à 34 000 kW).
ENIB - Enseignante : Fathia Chaibina -7-
Chapitre 3 : Audit énergétique des installations de chauffage
• Les chaudières à tubes d’eau parcourus intérieurement par l’eau et l’émulsion eau vapeur,
représente : La grande majorité des chaudières en service, la gamme de vaporisation de
20/40 t/h à 400 t/ h et la réduction importante du volume d’eau contenu dans les tubes
par rapport au débit de vapeur produite, le réservoir ayant la dimension juste nécessaire à
la séparation eau-vapeur.
Ce type de chaudière possède deux réservoirs appelés ballon distributeur (en partie
inférieure) et ballon collecteur (ou encore ballon de vaporisation, en partie supérieure),
reliés par un faisceau de tubes vaporisateurs, dans cet ensemble circule l’eau qui se
transforme en vapeur.
Les gaz chauds produits par le brûleur sont directement en contact avec les tubes
vaporisateurs, à l’intérieur de ceux-ci se produit la vaporisation. La vapeur ainsi générée
est collectée dans le ballon supérieur, l’eau excédentaire est ramenée vers le ballon
inférieur par des tubes de chute non soumis à la chaleur. Dans le domaine des hautes
pressions, une pompe peut être installée pour faciliter cette circulation du haut vers le
bas.
• Les Chaudières à eau chaude
Ces chaudières sont conçues selon les principes de robustesse des chaudières
industrielles.
Applications :
ENIB - Enseignante : Fathia Chaibina -8-
Chapitre 3 : Audit énergétique des installations de chauffage
Elles répondent à tous les besoins de chauffage des collectivités, ensemble commerciaux
et résidentiels, ensembles scolaires et universitaires, centres sportifs, piscines, hôpitaux,
usines, serres de culture, etc...
• Les Chaudières à fluide caloporteur
Le fluide caloporteur circule dans un serpentin chauffé par la flamme du brûleur et par
les fumées. Il est ensuite distribué à faible pression (quelques bars) au travers d'un réseau
fermé vers les différentes applications. Sur le retour un dégazeur, atmosphérique ou
inerté à l'azote, permet d’éliminer les traces de gaz avant injection dans la boucle de
circulation.
3.3.1.2 BILAN D’UNE CHAUDIERE
Les bilans énergétiques :
• Calcul de la puissance utile
• Estimation du rendement attendu
• Calcul de la puissance à introduire dans la chaudière sous forme de combustible
• Calcul du débit massique (ou volumique) de combustible
Le bilan matière :
• Estimation de l’excès d’air nécessaire à l’obtention d’une combustion correcte (fonction de la
nature du combustible),
• Calcul du débit d’air nécessaire à la combustion,
• Calcul du débit (massique et volumique) des fumées engendrées par la combustion, et
éventuellement de la quantité de cendres produites.
ENIB - Enseignante : Fathia Chaibina -9-
Chapitre 3 : Audit énergétique des installations de chauffage
3.3.1.3 RENDEMENT DES CHAUDIERES
La chaleur apportée par un combustible qui brûle n’est pas totalement récupérée par le fluide que
l’on veut chauffer. On en perd toujours une partie par différents mécanismes. La chaleur totale
apportée par la combustion d’une unité de masse ou de volume est égale au pouvoir calorifique du
combustible. La partie de cette chaleur qui sert effectivement à chauffer le fluide est appelée «
énergie ou chaleur utile ». La partie perdue, qui est égale à la différence entre l’énergie totale et
l’énergie utile, est appelée « pertes ».
Les pertes, qui sont de différentes natures, ne peuvent pas être complètement éliminées.
Cependant, les règles de conduite et d’entretien permettent de réduire ces pertes au minimum et
d’augmenter l’efficacité de l’installation.
L’efficacité ou la performance d’une installation est exprimée par le rapport entre l’énergie utile et
l’énergie totale apportée par le combustible, encore appelé « rendement ».
a/- Pertes et leur évaluation
Les pertes représentent la différence entre la chaleur totale apportée par le combustible et la chaleur
effectivement reçue par le fluide à chauffer. Ces pertes sont de natures et d’importances différentes.
Parmi les pertes les plus typiques d’une chaudière on distingue :
• Les pertes par les fumées
• Les pertes par imbrûlés
• Les pertes par purge
Le rôle de l’opérateur de la chaudière est de faire fonctionner son installation de façon à réduire le
plus possible ces pertes.
ENIB - Enseignante : Fathia Chaibina - 10 -
Chapitre 3 : Audit énergétique des installations de chauffage
* Pertes par chaleur sensible des fumées
Ces pertes sont les plus importantes. Elles représentent la chaleur emportée par les gaz chauds
sortant de la cheminée. Cette quantité de chaleur est proportionnelle au volume des fumées et à leur
température. Le coefficient de proportionnalité dépend de la composition des gaz.
Une augmentation de ces pertes peut provenir d’un excès d’air excessif qui peut être dû à :
• Un mauvais réglage
• Des problèmes d’entretien tels que des entrées d’air parasite, une mauvaise pulvérisation du
combustible ou une mauvaise distribution de l’air.
Une augmentation des pertes par les fumées peut également provenir d’un accroissement de la
température de sortie des fumées dû à :
• Une diminution de l’excès d’air
• Une chaudière encrassée : les dépôts internes (tartre) et externes (suies) limitent le transfert
de chaleur entre la vapeur et les fumées. Celles-ci doivent donc être plus chaudes pour
assurer les mêmes températures d’eau ou de vapeur.
Les pertes par chaleur sensible des fumées en pourcentage du PCI peuvent être estimées par
l’utilisation de la forme suivante :
Tf − Ta
Pertes (en% du PCI) = k *
CO2
Où :
Tf : température des fumées
Ta : température de l’air comburant
CO2 : teneur en CO2 des fumées (en %)
K : 0,6 pour les fiouls
Pour les différents combustibles, ces pertes sont évaluées en fonction de la différence de la
température des fumées et la température ambiante et de l’un des paramètres suivants : L’excès
d’air, la teneur en CO2 ou la teneur en O2 des fumées.
* Pertes par chaleur sensible des scories
Ces pertes, normalement inférieures à 0,5%, n’existent que pour des combustibles solides. Elles
proviennent de la chaleur emportée par les scories évacuées du foyer.
* Pertes par les parois de la chaudière
ENIB - Enseignante : Fathia Chaibina - 11 -
Chapitre 3 : Audit énergétique des installations de chauffage
Ces pertes, de l’ordre de 0,5% de la puissance nominale de la chaudière, proviennent des échanges
de chaleur par convection et rayonnement entre les parois chaudes de la chaudière et l’air ambiant.
Ces pertes dépendent surtout des dimensions géométriques et la nature des matériaux des parois de
la chaudière. Un bon calorifugeage de la chaudière permet de réduire notablement ces pertes. Pour
une telle chaudière elles peuvent être évaluées approximativement par :
0,5 x puissance nominale
Pertes par les parois (%) =
Puissance actuelle ou moyenne
Ainsi, pour une chaudière bien calorifugée et opérant à pleine charge les pertes par les parois sont
de l’ordre de 0,5%. Ce pourcentage augmente lorsque la charge diminue.
* Pertes par purges
Ces pertes proviennent de la chaleur sensible des purges. Elles peuvent être réduites par un
traitement adéquat de l’eau d’alimentation et un bon système de retour de condensas. Ces pertes
dépendent de la température et du taux de purge. Le calcul de ce taux peut être déduit des bilans
matières et des mesures des taux de salinité de l’eau d’alimentation de la chaudière et de l’eau de la
purge :
Débit de la purge A
Taux de purge (%) = = x100
Débit de la vapeur P−A
A : taux de salinité de l’eau d’alimentation
P : taux de salinité de la purge
b/ Calcul du rendements des chaudières
En général, le rendement est par définition le rapport de l’énergie utile à l’énergie totale apportée
par le combustible
Energie Totale - Pertes
Rendement (%) = x100
Energie Totale
Méthodes de calcul du rendement
Une méthode rapide d’estimation du rendement de la chaudière consiste à calculer les pertes par les
fumées à partir de la température et la composition en O2 ou en CO2 des gaz de combustion, et
d’utiliser des estimations des pourcentages par rapport à l’énergie totale mise en jeu pour les autres
pertes c’est la méthode des pertes.
Exemple de calcul de rendement
Combustible utilisé : Fuel lourd N°2
ENIB - Enseignante : Fathia Chaibina - 12 -
Chapitre 3 : Audit énergétique des installations de chauffage
Température des fumées : 285°C
Température ambiante : 30°C
Composition de CO2 sur la base des fumées sèches : 11,5%
Pertes par parois et purge : 6%
D’après la formule, les pertes par les fumées sont évaluées à :
285 - 30
Pertes par les fumée (%PCI) = 0.6* = 13.3%
11.5
Rendement de combustion (%PCI) = 100% - 13,3% = 86,6%
Rendement de la chaudière (%PCI) = 100% - 13,3% - 6% = 80,6%
Les méthodes présentées donnent les pertes en pourcentage de la chaleur totale apportée par le
combustible. Cette chaleur totale est exprimée en utilisant le PCI du combustible. Il faut préciser
que les références anglo-saxonnes calculent le rendement par rapport au PCS. Il faut toujours
préciser lequel des deux pouvoirs calorifiques est utilisé car les valeurs obtenues du rendement sont
différentes. Il y a cependant une relation simple entre ces deux rendements :
Rendement (%PCI) = Rendement (%PCS) x R
R est le rapport du PCI et PCS, il ne dépend que du combustible. Pour le fuel lourd n°2 R = 0,94. Il
convient de préciser que certains analyseurs de fumées calculent automatiquement le rendement.
Pour les analyseurs d’origine anglo-saxonne, le calcul du rendement est basé sur le PCS. Il y a lieu
donc de faire la conversion.
ENIB - Enseignante : Fathia Chaibina - 13 -
Chapitre 3 : Audit énergétique des installations de chauffage
Il existe deux méthodes pour calculer le rendement d'une chaudière :
Le bilan massique, plus complexe mais plus sûre
Le bilan par les pertes, la plus courante mais en réalité la plus délicate.
Bilan massique
On calcule d'un côté l ' énergie entrante, c'est à dire celle du combustible (débit x PCI) et celle de
l'eau d'alimentation, de l'autre l'énergie utile sortante, c'est à dire celle de la vapeur produite.
Le rapport de la seconde à la première fournit le rendement massique, qui n'est pas contestable.
Bilan thermique
Plus simple en apparence. Cette méthode, on le sait, consiste à additionner toutes les pertes.La
somme de ces pertes, retranchée à 100%, fournit le rendement de la chaudière, mais pas l'énergie
produite. Pour accéder à cette donnée tout aussi importante, il faut en outre déterminer soit l'énergie
entrante, soit évidemment l'énergie sortante.
La détermination précise et fiable du rendement de combustion d'une chaudière n'est donc pas une
tâche simple, à confier à n'importe qui. Le rendement calculé est un "rendement sur les fumées" et
la détermination du vrai rendement de la chaudière implique de prendre en compte aussi les pertes
par les parois et les imbrûlés, ainsi que le PCI du combustible, avec toutes difficultés déjà
évoquées. La seule solution vraiment rigoureuse est de brancher tous les capteurs nécessaires, de
centraliser leurs données sur un ordinateur équipé d'un logiciel adapté, qui établit la chimie des gaz
et de calculer le rendement en temps réel à toutes les allures de chauffe.
ENIB - Enseignante : Fathia Chaibina - 14 -
Chapitre 3 : Audit énergétique des installations de chauffage
ENONCÉ EXERCICE 1 :
Une chaudière débite 12 tonnes de vapeur par heure.
Sachant qu’elle fonctionne 8 000 heures par an et qu’elle consomme
85 Nm3 de gaz naturel/Tonne de vapeur.
PCI de gaz naturel : 9 Th/Nm3
1. Calculer la production annuelle de vapeur ?
2. La consommation annuelle de gaz en TEP ?
3. Les dépenses annuelles en DT sur la base de 180 DT/TEP ?
4. Les émissions de CO2 sur la base de 2,349 Tonnes de CO2 pour 1 TEP ?
Exercice 2
Soit une usine textile, exploitant une chaudière, année 2005 de puissance nominal 12T/h de
vapeur, timbre à 15 bars.
Température moyenne de la chaufferie 31,4°C.
Il s’agit de déterminer le rendement de cette chaudière à l’aide des méthodes du bilan thermique
et bilan massique.
Les valeurs suivantes ont été relevées :
• Pression vapeur : 11,5bar
• Température vapeur : 190°C
• Débit vapeur : 8277 Kg/h
• Débit gaz naturel : 466 Kg/h
• PCI gaz naturel : 9 Th/Nm3
• Débit d’eau d’alimentation : 8880 Kg/h
• Température d’alimentation : 69°C
• Température des fumées : 238,7°C
ENIB - Enseignante : Fathia Chaibina - 15 -
Chapitre 3 : Audit énergétique des installations de chauffage
• CO2 en % : 6,4
• O2 en % : 9,6
On note pour le gaz naturel K = 0,47
Question :
1 : Calculer l’excès d’air.
2 : Calculer les pertes par les fumées.
3 : Calculer le rendement de combustion de la chaudière.
4 : On donne
ENIB - Enseignante : Fathia Chaibina - 16 -
Chapitre 3 : Audit énergétique des installations de chauffage
• Calculer les déperditions surfaciques Pparoi .
• Calculer les pertes par les purges
ENIB - Enseignante : Fathia Chaibina - 17 -
Chapitre 3 : Audit énergétique des installations de chauffage
Bilan massique et thermique :
Comptage gaz naturel sur la chaudière :
• Jour 1 à 9h00 : 0 Nm3
• Jour 2 à 9h30 : 19555 Nm3
• Jour 3 à 8h30 : 33715,5 Nm3
PCI = 9 Th/Nm3
Densité = 0,656 Kg/Nm3.
Eau alimentaire :
• Jour 1 à 9h00 : 0 m3
• Jour 2 à 9h30 : 235,47 m3
• Jour 3 à 8h30 : 405,98 m3
Température de l’eau alimentaire à l’entrée de la chaudière : 70°C
Air de combustion :
Vitesse moyenne : 56,53 m/s
Section : 0,1 m²
Température : 31,4 °C
Vapeur à la sortie : Pas de moyen pour mesurer le débit de vapeur.
Question :
Calculer la consommation horaire moyenne de combustible pour la chaudière
Calculer la consommation horaire moyenne en eau pour la chaudière
Calculer la production de vapeur d la chaudière sachant que l’eau utilisée est une eau osmose.
Calculer le débit d’air de combustion.
Calculer le débit des fumées.
Faire le bilan massique de la chaudière.
Rappel : Débit massique air = Vitesse * Section * 3600 * Densité de l’air en Kg/h.
Avec densité air = 1,293 * 273/(273+Tair).
ENIB - Enseignante : Fathia Chaibina - 18 -
Chapitre 3 : Audit énergétique des installations de chauffage
Avec débit des fumées = Débit gaz nat + Débit air de combustion Débit vapeur = débit eau
d’alimentation car l’eau est osmose.
ENIB - Enseignante : Fathia Chaibina - 19 -
Chapitre 3 : Audit énergétique des installations de chauffage
Bilan thermique
Comptage gaz naturel sur la chaudière :
Jour 1 à 9h00 : 0 Nm3
Jour 2 à 9h30 : 19555 Nm3
Jour 3 à 8h30 : 33715,5 Nm3
PCI = 9 Th/Nm3
Eau alimentaire :
Jour 1 à 9h00 : 0 m3
Jour 2 à 9h30 : 235,47 m3
Jour 3 à 8h30 : 405,98 m3
Température de l’eau alimentaire à l’entrée de la chaudière : 70°C
Vapeur :
La pression absolue vapeur est 11,5 bars
Enthalpie vapeur à 11,5 bars absolue : 2783,3 Kj/Kg
Question :
Calculer la chaleur apportée par le combustible.
Calculer la chaleur apportée par l’eau d’alimentation.
Calculer la chaleur emportée par la vapeur.
Calculer la chaleur emportée par les fumées.
Faire le bilan thermique total de la chaudière.
Calculer le rendement thermique total de la chaudière
ENIB - Enseignante : Fathia Chaibina - 20 -
Chapitre 3 : Audit énergétique des installations de chauffage
ENIB - Enseignante : Fathia Chaibina - 21 -
Vous aimerez peut-être aussi
- TP 2Document3 pagesTP 2Achref Mraihia100% (1)
- Conversion De L'Énergie Thermique Des Océans: Des différences de température entre les eaux de surface et les eaux profondes de l'océanD'EverandConversion De L'Énergie Thermique Des Océans: Des différences de température entre les eaux de surface et les eaux profondes de l'océanPas encore d'évaluation
- Chaudiere À Vapeur - 3Document19 pagesChaudiere À Vapeur - 3Ayoub Azhoum50% (2)
- Rendement CombustionDocument15 pagesRendement CombustionSABAPas encore d'évaluation
- Chaudiere 1Document17 pagesChaudiere 1ikram kbibouPas encore d'évaluation
- Chauffage de L'eauDocument15 pagesChauffage de L'eaurpercorPas encore d'évaluation
- Formation Efficacité Énergétique Dans L'industrie PDFDocument168 pagesFormation Efficacité Énergétique Dans L'industrie PDFArih Fadi100% (2)
- Poly de Cours TF06Document99 pagesPoly de Cours TF06REISPas encore d'évaluation
- Fiche de Poste SoudeurDocument1 pageFiche de Poste Soudeurdelpeche porquet TafinPas encore d'évaluation
- Transfert Thermique 1Document38 pagesTransfert Thermique 1ZiadiPas encore d'évaluation
- Pompes À Chaleur en Habitat Collectif Et Tertiaire, Installation Et Mise en ServiceDocument95 pagesPompes À Chaleur en Habitat Collectif Et Tertiaire, Installation Et Mise en ServiceLahouari FatahPas encore d'évaluation
- Bâtiment Zéro Énergie: L'énergie totale consommée par les services publics est égale à l'énergie renouvelable totale produiteD'EverandBâtiment Zéro Énergie: L'énergie totale consommée par les services publics est égale à l'énergie renouvelable totale produitePas encore d'évaluation
- Rendement D'une ChaudièreDocument8 pagesRendement D'une ChaudièreJUST LEARNPas encore d'évaluation
- Cours Carbon EmprienteDocument52 pagesCours Carbon EmprienteChaimae BOUTALEBPas encore d'évaluation
- Techno Gaz 10-Gaz Distrib, Combust, ResHPDocument45 pagesTechno Gaz 10-Gaz Distrib, Combust, ResHPSaiah Vs AbdoPas encore d'évaluation
- 02 - Guide Diagnostic Energetique - 60 PagesDocument60 pages02 - Guide Diagnostic Energetique - 60 PagesMouhamadou ThiamPas encore d'évaluation
- Afpac Guide Technique 2 Pompe A Chaleur Air Eau Plancher Chauffant Et Chauffant RafraichissantDocument81 pagesAfpac Guide Technique 2 Pompe A Chaleur Air Eau Plancher Chauffant Et Chauffant Rafraichissantአመርም አርኤኤምአርPas encore d'évaluation
- Type de PurgeDocument2 pagesType de PurgeMayssam DalhoumiPas encore d'évaluation
- Combustion Turbuulente PDFDocument55 pagesCombustion Turbuulente PDFKawtar Belrhiti AlaouiPas encore d'évaluation
- Chapitre 1 GeneralitesDocument9 pagesChapitre 1 GeneralitesجعدبندرهمPas encore d'évaluation
- Seq 4 ExercicesDocument3 pagesSeq 4 ExercicesTøtï SïgníngPas encore d'évaluation
- Chaudière À Tubes D'eauDocument2 pagesChaudière À Tubes D'eauChouYa OsPas encore d'évaluation
- Chap 1Document24 pagesChap 1Heni Bouâfia100% (5)
- Séminaire Fours & Chaudieres (2006)Document79 pagesSéminaire Fours & Chaudieres (2006)Sarra BÉCHIRI100% (1)
- A3-BTP-P3-2023 SAM 1 Reglementations Thermiques Et Environnementales RessourceDocument115 pagesA3-BTP-P3-2023 SAM 1 Reglementations Thermiques Et Environnementales Ressourceathem boukhmayerPas encore d'évaluation
- Transfert de ChaleurDocument7 pagesTransfert de ChaleurMike Kalala NKPas encore d'évaluation
- Les Types de ChaudieresDocument2 pagesLes Types de ChaudieresBasma IssaouiPas encore d'évaluation
- Mise en Œuvre de La Combustion Dans Les Fours Et Chaudières: - 3 Matériel ThermiqueDocument24 pagesMise en Œuvre de La Combustion Dans Les Fours Et Chaudières: - 3 Matériel ThermiqueMediterranei ExypniPas encore d'évaluation
- Devoir SDocument3 pagesDevoir SMourad MatmourPas encore d'évaluation
- Chap1 Rappels de ThermodynamiqueDocument20 pagesChap1 Rappels de Thermodynamiquesino spagoPas encore d'évaluation
- Dimensionnement ECSDocument33 pagesDimensionnement ECSFRANCONPas encore d'évaluation
- M1 Energétique Cours Energies Renouvelables Chap 1 Chap 2 Chap 3 Chap 4 2021Document26 pagesM1 Energétique Cours Energies Renouvelables Chap 1 Chap 2 Chap 3 Chap 4 2021CHEMS EDDINEPas encore d'évaluation
- Chaudières Industrielles MI GChimique Mai 2018Document60 pagesChaudières Industrielles MI GChimique Mai 2018Amine RedouanePas encore d'évaluation
- Cours Echangeurs Et Applications19Document87 pagesCours Echangeurs Et Applications19Móhäm MêdPas encore d'évaluation
- Bilan Energetique D'un BatimentDocument32 pagesBilan Energetique D'un BatimentAHLAM ETTOUHAMI100% (1)
- 7 Hvac Ene6510 H17Document47 pages7 Hvac Ene6510 H17Emanuel Maracajá50% (2)
- Échangeur de ChaleurDocument12 pagesÉchangeur de ChaleurBertin KamsipaPas encore d'évaluation
- Cours de ThermodynamiqueDocument34 pagesCours de ThermodynamiquemeriemPas encore d'évaluation
- TP Ndeg 1. Determination Du Point Eclair Et La Temperature Dinflammabilite Du Gaz-OilDocument6 pagesTP Ndeg 1. Determination Du Point Eclair Et La Temperature Dinflammabilite Du Gaz-OilJa3far Lilou0% (1)
- Rendement D'un Four1Document2 pagesRendement D'un Four1Hamza OuniPas encore d'évaluation
- page de gardefinalpdf-مدمجDocument114 pagespage de gardefinalpdf-مدمجhana tiPas encore d'évaluation
- Optimisation de La Consommation EnergétiqueDocument42 pagesOptimisation de La Consommation Energétiquedallagi mohamedPas encore d'évaluation
- Acoustique AerauliqueDocument33 pagesAcoustique AerauliqueAnonymous 73gEYyEtLPas encore d'évaluation
- Cours - Les Distillateurs SolairesDocument11 pagesCours - Les Distillateurs SolairesDieudonné Joseph Bathiebo100% (2)
- Pompe 2STMDocument10 pagesPompe 2STMyoussefPas encore d'évaluation
- Exo Transfert Thermique-ConvertiDocument5 pagesExo Transfert Thermique-ConvertiFerahtia HindPas encore d'évaluation
- Chauffage CentralDocument8 pagesChauffage CentralingcciPas encore d'évaluation
- Eree Cours EcsDocument126 pagesEree Cours EcsAyoub OukhalekPas encore d'évaluation
- Examen 2017OU2Document3 pagesExamen 2017OU2koltaPas encore d'évaluation
- Transmission de Chaleur PDFDocument285 pagesTransmission de Chaleur PDF2ste3100% (1)
- Calcul Hauteur CheminéeDocument9 pagesCalcul Hauteur CheminéePavel KamtoPas encore d'évaluation
- Cours de Combustion 2eme PartieDocument25 pagesCours de Combustion 2eme PartiethdrsvgPas encore d'évaluation
- Corr Therm BtsDocument8 pagesCorr Therm BtsmicropechPas encore d'évaluation
- 01 Audits Energetiques Analyses Critiques 2020Document70 pages01 Audits Energetiques Analyses Critiques 2020moradePas encore d'évaluation
- TD 7 Combustion PDFDocument3 pagesTD 7 Combustion PDFAbdulwahab MayasPas encore d'évaluation
- CHAP 9 Martin Gariepy 2013Document15 pagesCHAP 9 Martin Gariepy 2013sb aliPas encore d'évaluation
- ET - Problemes Échangeur ThermiqueDocument73 pagesET - Problemes Échangeur Thermiquemguisse100% (1)
- Stockage D'Énergie Du Volant: Augmenter ou diminuer la vitesse, pour ajouter ou extraire de la puissanceD'EverandStockage D'Énergie Du Volant: Augmenter ou diminuer la vitesse, pour ajouter ou extraire de la puissancePas encore d'évaluation
- CR4 Ali Mtibaa Et Ahmed Khemakhem Base de DonnéeDocument3 pagesCR4 Ali Mtibaa Et Ahmed Khemakhem Base de DonnéeAchref MraihiaPas encore d'évaluation
- TP Ogi2019Document38 pagesTP Ogi2019Achref MraihiaPas encore d'évaluation
- S3 Logistique Et Transport 2019 Partie 1Document52 pagesS3 Logistique Et Transport 2019 Partie 1Achref MraihiaPas encore d'évaluation
- Compte Rendu tp1 Ali Mtibaa Et Ahmed KhemakhemDocument9 pagesCompte Rendu tp1 Ali Mtibaa Et Ahmed KhemakhemAchref MraihiaPas encore d'évaluation
- S1 Logistique Et TransportDocument43 pagesS1 Logistique Et TransportAchref MraihiaPas encore d'évaluation
- DM2 2020Document2 pagesDM2 2020Achref MraihiaPas encore d'évaluation
- Chapitre III - Audit-FathiaDocument14 pagesChapitre III - Audit-FathiaAchref MraihiaPas encore d'évaluation
- CHAP1Document100 pagesCHAP1Achref MraihiaPas encore d'évaluation
- C9 - Transformateur Mono PDFDocument9 pagesC9 - Transformateur Mono PDFKIDS APP100% (1)
- S2 Logistique Et TransportDocument36 pagesS2 Logistique Et TransportAchref MraihiaPas encore d'évaluation
- Application Bernouilli GazDocument1 pageApplication Bernouilli GazAchref MraihiaPas encore d'évaluation
- Chapitre3 Transfert ThermiqueDocument27 pagesChapitre3 Transfert ThermiqueAchref MraihiaPas encore d'évaluation
- Chapitre 4 Transfert ThermiqueDocument40 pagesChapitre 4 Transfert ThermiqueAchref MraihiaPas encore d'évaluation
- Chapitre3 Transfert ThermiqueDocument27 pagesChapitre3 Transfert ThermiqueAchref MraihiaPas encore d'évaluation
- Travaux Dirigés ConvectionDocument3 pagesTravaux Dirigés ConvectionAchref MraihiaPas encore d'évaluation
- Chapitre 4 Transfert ThermiqueDocument40 pagesChapitre 4 Transfert ThermiqueAchref MraihiaPas encore d'évaluation
- Calendrier Des EX1 2020-2021 VFDocument1 pageCalendrier Des EX1 2020-2021 VFAchref MraihiaPas encore d'évaluation
- Chapitre 4 Transfert ThermiqueDocument40 pagesChapitre 4 Transfert ThermiqueAchref MraihiaPas encore d'évaluation
- Emploi S11 (22-11-2021) ClassesDocument12 pagesEmploi S11 (22-11-2021) ClassesAchref MraihiaPas encore d'évaluation
- Travaux Dirigés ConvectionDocument3 pagesTravaux Dirigés ConvectionAchref MraihiaPas encore d'évaluation
- Chapitre 4 Transfert ThermiqueDocument40 pagesChapitre 4 Transfert ThermiqueAchref MraihiaPas encore d'évaluation
- Emploi S11 (22-11-2021) ClassesDocument12 pagesEmploi S11 (22-11-2021) ClassesAchref MraihiaPas encore d'évaluation
- Emploi S11 (22-11-2021) ClassesDocument12 pagesEmploi S11 (22-11-2021) ClassesAchref MraihiaPas encore d'évaluation
- Capteurs ThermiquesDocument19 pagesCapteurs ThermiquesAmira WarhéniPas encore d'évaluation
- DTP 411.1Document5 pagesDTP 411.1JI MIPas encore d'évaluation
- Master-Electronique Energie Electrique Automatique PT Energie Electrique NancyDocument5 pagesMaster-Electronique Energie Electrique Automatique PT Energie Electrique NancyMordji Kalida TchanigaPas encore d'évaluation
- 5 - Les Roches CarbonéesDocument14 pages5 - Les Roches CarbonéesJiji MadridistaPas encore d'évaluation
- Ms GM AzzouzDocument80 pagesMs GM AzzouzAmel AlidraPas encore d'évaluation
- RelaisDocument24 pagesRelaismadasaPas encore d'évaluation
- ELCIN - 40 Montage A Resistance NegativeDocument3 pagesELCIN - 40 Montage A Resistance Negativesih emPas encore d'évaluation
- Planning Des TravauxDocument7 pagesPlanning Des TravauxWalid Ben DaoudPas encore d'évaluation
- TP Pompe À EngrenageDocument8 pagesTP Pompe À EngrenagehoussemPas encore d'évaluation
- LYCÉE DE MBALLA II EVALUATION NtroisDocument3 pagesLYCÉE DE MBALLA II EVALUATION NtroisSerges AbologoPas encore d'évaluation
- AutomaDocument33 pagesAutomaBELLILI BouchraPas encore d'évaluation
- PCT Bepc Blanc Mai 2020Document3 pagesPCT Bepc Blanc Mai 2020TCHEUTCHOUA Leonel SergioPas encore d'évaluation
- Energie HydrauliqueDocument12 pagesEnergie HydrauliqueLekane nelsonPas encore d'évaluation
- Programme - Mathématiques - Physique - EAC INGDocument6 pagesProgramme - Mathématiques - Physique - EAC INGsagesse MoukakouPas encore d'évaluation
- Présentation Chapitre 02Document24 pagesPrésentation Chapitre 02Anes KassoulPas encore d'évaluation
- Etoile TriangleDocument2 pagesEtoile TrianglekamalPas encore d'évaluation
- Techno Des Équipts Et Instal Élec 3 Doc - ProfDocument26 pagesTechno Des Équipts Et Instal Élec 3 Doc - ProfGilles Franck EtouaPas encore d'évaluation
- Ecodan Ehst17dvm2dDocument35 pagesEcodan Ehst17dvm2dmonnomPas encore d'évaluation
- TRIACDocument13 pagesTRIACDixdox DixPas encore d'évaluation
- Evaluation Formative: Mécanique Des FluidesDocument6 pagesEvaluation Formative: Mécanique Des FluidesAyman MachkourPas encore d'évaluation
- MecaniqueDocument20 pagesMecaniquehamzaPas encore d'évaluation
- Etudier Et Mettre en Œuvre Un Variateur de Vitesse. Banc Variation de Vitesse Altivar 71 Avec Frein À PoudreDocument23 pagesEtudier Et Mettre en Œuvre Un Variateur de Vitesse. Banc Variation de Vitesse Altivar 71 Avec Frein À PoudreNour ouzeriPas encore d'évaluation
- CV KHEYI Dihya 1703277234Document2 pagesCV KHEYI Dihya 1703277234Achraf SOUNNIPas encore d'évaluation
- VanneDocument32 pagesVannejack sakoPas encore d'évaluation
- Laborat Ibu Hamil Nop 2022Document49 pagesLaborat Ibu Hamil Nop 2022BERGASPUSKESMASPas encore d'évaluation
- DT - Audi V8 4.2l ARS (FR)Document25 pagesDT - Audi V8 4.2l ARS (FR)Benjamin GrjnPas encore d'évaluation
- Exploration Et Production Du PetroleDocument10 pagesExploration Et Production Du Petroleits.nathanPas encore d'évaluation
- Projet N°4: Construction Du Centre de Secours Du Pays RochoisDocument49 pagesProjet N°4: Construction Du Centre de Secours Du Pays Rochoisfoudil kelianPas encore d'évaluation
- Presentation iNCUB-ETHiC Energie 716152Document13 pagesPresentation iNCUB-ETHiC Energie 716152Carlo FavrettoPas encore d'évaluation