Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Logistique Verte PFE
Logistique Verte PFE
Transféré par
Anas0 évaluation0% ont trouvé ce document utile (0 vote)
377 vues62 pagesASZZEFRGFR
Copyright
© © All Rights Reserved
Formats disponibles
PDF ou lisez en ligne sur Scribd
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentASZZEFRGFR
Droits d'auteur :
© All Rights Reserved
Formats disponibles
Téléchargez comme PDF ou lisez en ligne sur Scribd
0 évaluation0% ont trouvé ce document utile (0 vote)
377 vues62 pagesLogistique Verte PFE
Logistique Verte PFE
Transféré par
AnasASZZEFRGFR
Droits d'auteur :
© All Rights Reserved
Formats disponibles
Téléchargez comme PDF ou lisez en ligne sur Scribd
Vous êtes sur la page 1sur 62
EC
oka yl tae
Tora cant ara
Projet de fin d’étude en vue
d’obtention de la licence fondamentale
La logistique Verte au Maroc
Encadré par :
OUNIR Abdessamad
Présenté par :
LAAROUSSI Najoua
Année Universitaire : 2018 - 2019
Remerciement :
En préambule de ce mémoire ; Je souhaite adresser mes remerciement tout d’abord et tout
particulizrement & mon dieu qui nous comble A tout moment de son aide ; sa bénédiction ; et
ses bienfaits
Etje tiens Aexprimer mma profonde gratitude Amon encadrant monsicur Ounir Abdessamad
pour son aide ; ses conseils ; ct ses orkntations tout au long de la période d’élaboration ce
travail, que je hi espére plus de prospérité dans son parcours scientifique
‘Mes remerciements vont également a administration au corps professoral, et au personne! de
la faculté pour les efforts qu’ils déploient en fiveur des étudiants
je remercie mes tis chers parents Mohamed et Fatihaa, qui ont toujours été la pour moi, Je
remereie mes soeurs Khadija et Fatima, et mon fitre Abdelouahed, pour leurs
‘encouragements.
Enfin, je remercis mes amies Iham , Souad Noubaila et Amine qui ont toujours été ld pour
moi. Leur soutien inconditionne! et leurs encouragements ont été d'une grande aide,
A tous ces intervenamts, je présente mes remerciements, mon respect et ma gratitude
Table de matires
Introduction :
Chapitre 1: La logistique verte
1-1-La logistique au sein de l'entreprise :
1+ 1-1-La logistique et son historique
1- 1-2-La supply chain management
1-1-3-muri, mura, mada et eur traduetion dans la vie de Pentreprise
1-1-4-Processus générique : Barrre-Collecte-Tri-Traitement
2-2-Le développement durable au coeur des preoccupations de l’entreprise :
2-1-I-Lachaine bgistique durable
2-1-2-Lesquatres kviers de be logistique durable:
2-1-3. Le volet environnemental de la logistique durable
De la logistique durable & la logistique verte :
3-1-1 Une chaine logistique verte
3-1-2-'éeo-conception
3-1-3-Probisme de conception et de modétisation de réseaux logistiques
3-1-4-De la quéte du « zéro déchet » A Papprentissage de nouveaux pratique
organisationnelles
Chapitre 2; une comparaison entre la logistique marocaine et saoudienne
2-1-La logistique au maroc :
2-1-ILe climat actuel de la logistique marocaine
2-1-2: les opportunités offerte
maroc
2
3 Les handicaps de ka logitique
2-1-4 Pistes d’amélioration pour ke développement d'une logistique
2-2La logistique de Varabie saoudite
2-241-Le transport saoudienne
2-2-2. Les atouts de la logistique saoudienne
Introduction génér ale
Les questions environnementales sont devenues
ka une dans tous Jes débats politiques,
économiques, sociaks voire méme entreprencuriales. Ainsi Tenvironnement, qui n’était pas
une priorté majeure jusqu’d récemment, prend de l'ampleur au niveau de lintérét et de la
phnification stratégique, ce qui va révolutionner les sysitmes industrielles et logistiques.
La quasi-totalité des socigtés, notamment dans cette période de difficultés économiques
majeure, ménent une guerre sans cesse, contre toutes les sources de gaspillige.et privilé gient
toutes sources «optimisation de cofits dans une logique continuelle damélioration, Cest
ainsi la logistique «verte» tente d’atteindre les plas hautes sphéres de la direction des
entreprises.
Cet état de chose impose une intégration phss soutenue d’actions axées sur la protection de
environnement sur tous ks niveaux de Management d’entreprie (Stratégique, tactique et
‘opérationnelle). De ce fait, la gestion de la Supply Chain qui constitue Les 7 muda
Les muda décrivent une classification des pertes de Porganisation industrielle. Une remarque
préalable est nécessaire : cette classification ne prétend pas a 'exhaustivité, Les frontigres
centre les mula sont parfois floues. II peut exister d'autres pertes que kes 7 muda habituel-
lement déerites Iorsqu’on parle du systéme de production Toyota
Toutefois, méme si la Inte est imparfaite, les praticiens du lean ont pris Phabitude de utiliser
comme gril de kcture pour organiser les analyses et comme trame pédagogique pour « faire
changer de lunettes » aux managers opérationnels,
Tl faut aussi noter que ks 7 muda sont toutes des causes dallongement du temps de passage.
En pratique, il est presque toujours équivalent de chercher & réduire le temps de passage que
de chercher A néduire les pertes, C’est pour cette raison que lorsque nous parlons de
programme d'amétionition kan, nous préférons souvent en axer ka communication sur cette
réduction du kad time plut6t que sur la réduction des gaspillages ou Pamélioration de la
productivité, qui constituent des sources de sbgans peut-@tre moins fédérateurs et plus
restrictifS quant aux gains recherchés.
+ Surproduetion
On considére comme perdues toutes les ressources qui ont été affectées & une production non
vendue. La matitre, la main-d'ceuvre, Tusure des équipements, Pénergie et es consommnb ks
ne doivent pas étre engagés pour autre chose que ce que le client est prét A acheter, Tout ce
qui est produit en avance constitue un gaspilage. On peut d’aillews mesurer conerétement
cette perte par ke BFR (besoin en fonds de roukement), puisqu‘elle fait appel A la tésorerie de
Tentreprise en avance de phase sur ce que ie client va payer.
Cette notion de suproduction, lorsqu’on ft prend en compte pour kes caleuls
ordomancement, met & mal les pratiques classiques de dimensionnement des lots par la tres
académique « formule de Wikon »
Celle-ci permet d’estimer une quantité de ncement dite « économique » en cherchant
Téquilibre entre les cotts de lancement du lot et les coats de stockage. Cette formule pose
deux probk:mes principaux au lbgisticien et a Pordonnanceur :
+ Dune part, la notion de cotit de stockage n’est juste que si on prend en compte un ensemble
de dépenses indirectes diffciles 4 évaluer (obsolescence, le cott suppkimentaire de
traitement de la non-qualité dans des grands lots, les cofits de manutention issus des surs-
tockages, le cout financier de la trésorerie mobilisée pour stocker).Les hubitués de ces caleuls
complts prennent souvent un « forfait ». pour tous ces éléments et considérent que ke stock
cofite chaque un tiers de sa valeur.
+ D’autre part, la formule de Wilson ne tient compte que des coits...et améne done a définir
des bots s
ins tenir compte de ki demande et done a tenir des stocks et en-cours avals
suppKimentaires pour synchroniser Tusine et son clint
Nous reviendrons plus Join sur fa logique SMED et sur la réduction des tales de lots, qui est
la réponse « dynamique » a perte par surproduction
Mairiser kk surproduction commence par le choix des bons indicateurs de productivité. Si
Vindicateur d'efficacité de la main-d’ceuvre prend en compte kes quantités produites au-dela
du besoin du client, i induit alors une mauvaise comprehension de ce qu'est la performance
de Pentreprise, puisqu'il va pousser 4 produire trop pour mieux occuper kt main-d’wuvre,
+ Non-qualité
Les rebuts font bien entendu partie de la non-qualité, mais aussi les retouches, ainsi que
Lensemble des activités de traitement des réclamations, comme celles d’analyse et de
traitement des défauts interes
La non-qualité peut étre considérée comme fa plus grave de toutes
ss pentes :
au minimum, ele double ke cott de la pidce (a pitce jetée doit ée remplucée) ;
8
—elle dégrade image de entreprise chez. le client ;
—elle détourne les équipes de techniciens des activités de développement sur des activités: de
«eéparation ».
“Transports :
On considére comme une perte Pensemble des mouvements intemes 4 Tusine, entre les postes
de travail ou entre ks différents ateliers. Lors d°un chantier damélioration lean, les distances
seront done un indicateur spécifique a mettre en pkce pour évaluer les différentes. solutions
De mime, on s’attachera 4 réduire le nombre de fois ot Popérateur « prend » ou « pose » une
pice, qui sont autant de gestes sans vakeur ajoutée pour bk main-d’auvre directe.
+ Mouvements imutiles
‘Les mouvements jinutiles sont dela méme nature que es transports : ik trahissent une
mauvaise organisation du poste de travail. On classe dans cette catégorie tous Jes mouvements
et les gestes de lopérateur sur son poste. De méme, on peut considérer comme mouvements
inutiles tous kes déplicements excessifi dela machine (courses (approche, vilesses, trop
lentes, et
). La distinction entre les pertes par transports et les pertes par mouvements inutiles
cest parfois difficile a faire. Tout dépend de la « loupe » choisie pour analyser les activités. De
fagon générale, sion cherche A réduire des temps indirects ou des en-cours intermédiaires,
on se focaksera sur kes transports entre postes ; sien revanche on cherche a réduire des temps
de main-d'ceuvre directe, on décortiquera les mouvements. de Popérateur pour y chasser les
‘mouvement inutiles.
Les techniques classiques des méthodistes pour déterminer les temps standard (en particulier
Je MOST) sont bien adaptées & la réduction des mouvements inutiles.
Chacun de ces mouvements peut tre analysé et traité par Vamélioration de ergonomic des
Posies : mouvements des yeux (chercher des pitces), mouvements des jambes par le
rapprochement des machines,ete.
+ Process et méthodes inadaptés :
Réduire cette perte des process et méthodes inadaptés fait appel aux techniques classiques de
Tingénieur des méthodes industrielles : analyse de k vakeur et adaptation de la gamme de
fabrication, réduction des cots de transformation, etc. Toutefois, dans ke cadre d’un projet
Jean, on appuiera tout particulgrement. sur la notion de standardisation des opérations.
Lorsque ki « bonne » méthode utilisant la technologie A jour et adaptée & Vopération ou au
colit attendu est déterminge, i faut faire un effort suppkimentaire de description du geste de
Vopérateur et de formation, qui permette d’assurer que tout le monde pratique de la méme
fagon
* Stocks :
Les stocks apparaissent dans la liste des pertes, non pour signifier que tous les en-cours et
stocks de produits finis doivent tendre vers aéro quelque soit le type d’industrie, mass bien
our rappeler que chaque en cours et chaque stock doivent répondre Aides conditions strictes =
d'une part, définis par une quantité minimum, une quantité maximum, ainsi que des rgles de
déclenchement et de révision systématique régulgre et d°autre part, faisant Fobjet d’un plan
daction de réduction a trater parmi les sujets d’améloration continue.
Un stock a une fonction de lissage des aléas de fabrication ou de consommation (variabilité de
Ja demande, pannes machine, indisponibilié des pitces de rechange...), ou encore une
fonction de gestion dune complexité de fabrication (temps de changement de série, difficulté
dappairage de deux pigces dans un montage, ete.). Inserire la réduction des stocks dans les
objecti8s d’améioration continue, c’est se forcer & travailler sur les causes de
dysfonctionnement et sur les difficultés elles-mémes, plutot que de ks couvrir par des
inmobilisations de tésorerie
Une autre munigre de voir le stock est de considérer qu'il masque systématiquement une autre
nature de perte. Par exemple, un stock de pitces faites positionnées apres une machine peu
fiable en couvte les pannes, et donc, cache kes effets d'un manque de maintenance, ou dun
manque de maitrise de Péquipement par léquipe d’exploitation.
Le parti pris managérial d’une usine Jean doit étre d’exposer les pertes pour les résoudre et
donc, souvent, de diminuer arbitrairement ks stocks pour mettre en évidence kes vraies causes
de pertes et forcer Pusine a les trater durablement
+ Attentes
Les actions sur les stocks et en-cours répondent déja au probeme des pitces qui attendent leur
tour devant fa machine ou sur k quai dexpédition... Les pertes d’« attente » sont done
destinges a identifier les gaspilliges de main-d’wuvre (lorsque Mopérateur attend) et les
dysfonctionnements des équipements (panne machine). Les causes dattente des opérateurs
peuvent @tre dues Ades défauts d’organisation et en particulier & des manques de
synchronisation entre la gestion de production et Pencadrement de terrain, qui provoquent des
erreurs de phnification des ressources et des ordres de fabrication, De plus, si on observe les
activités des opérateurs en train de produire, il peut exister des micro-attentes, qui sont elles
liées &1la synchronisation des téiches.
Les solutions ces micro-attentes se trouvent dans ks techniques dӎquilibrage de la ligne.
10
Pour mesurer les attentes, il faut s
taller um outil analytique de décompositinn des causes
de pertes de rendement, comme ke TRS ou Peffivience de la main-d’ceuvre, soi pratiquer des
mesures focalisées, en particulier par le biais d’observations.instantanges,
Quelques exemples pour illustrer ces concepts
+ Mura : Firégubrité des ventes d'une référence autre, c’est-i-dite a variabilité des
consommations au sein d'un catabgue, suscite de vraies difficultés pour stabiliser
production, Elle tend provoquer la surproduction, les stocks, les attentes..
réelles dans annonce des dékis, soit des
+ Muri: Fabsence de prise en compte des capaci
personnes, soit des équipements, provoque des retards, et de kr non-qualité, Cela s’applique
aux dossiers R&D comme aux ordres de fabrication !
+ Muri forsque fa pénibiité (au sens de Pergonomie) d’une tiche n’est pas prise en compte,
on peut s'attendre aun manque de fiabilité dans son exécution, et & devoir organiser une
rotation des opérateurs défavorable la bonne maitrise du procédé.
1-1-4-Processus générique
L-Barrigre :
L’étape dela barritre consiste 4 filer les retours vers lentreprise. Rogers et Tibben-Lembke
(1998) la définissent comme étant bk décision de quels produits som permis dans ke systme
de logistique inverse. Ainsi, elle cherche a éviter que des produits ne lui appartenant pas ou
envers lesquek elle n'a pas d'obligation contractuelle ou kyale lui soit retournée.
Normalement, cette étape conduit 4 Pacceptation du retour et est suivie deb collecte. De
information sur le retour doit étre foumie brs d'une demande d"autorisation de retour,
Celle-ci varie en fonction du type de retour et des contrats qui lent Tentreprise a ses
différents. clients, Par exemple pour un retour commercial, Pinformation foumie est le numéro
du produit, la quantité et le numéro de facture, Dans le cas du retour d’un produit déféctueux,
Ventreprise peut demander le numéro de série, ke modék, ke numéro de facture (si acheté
directement de entreprise) ou une copie de la facture pour connaitre la date d’achat et ainsi
déterminer si le produit est toujours sous garantie, ete, L’entreprise dome en retour un
numéro d'autorksation au client pour ke retour ct information recueillie est entrée dans le
systéme de Pentreprise pour étre utilisée dans les étapes subséquentes, Il se peut que le client
se voir refiwser le retour. Les raisons peuvent étre variges, contracwelles, ou encore par ce que
Je client ne peut fournir Finformation demandée, ete. lei, le client peut foreer bi barrigre en.
décidant dexpédier le produit méme s'il n’a pas obtenu Tautorisation. L’entreprise doit done
prévorr un mécanisme pour traiter c
S quelques exceptions dans le processus. Dépen
ct
des politiques de Ventreprise et du type de retour, il se peut qu'une compensation soit donnée
immédiatement au client aprés avoir obtenu Pautorisation de retour, Souvent dans ce cas,
Temballage du produit d°échange est réutilisé pour expédier le retour et kes détails
d’expédition sont fournis par la méme occasion.
Etape 2 : Collecte
La collecte est définie par Rogers et Tibben-Lembke (1998) comme étant le iit de réunir ks
me de logistique inverse. Cette étape comporte deux volets
produits pour le s
Yenlévement et le transport du retour
2.1Enlevement d°un retour
L'enkvement consiste a reprendre du client Ie produit devant étre retoumé. La méthode de
reprise peut étre tres varige. Le client peut ramener ke bien A retourner au point de vente ou &
un centre autorisé, Tenvoyer par kt poste, ou encore une personne auto
chercher le bien directement chez k client.
peut aller
2.2 Transport des retours :
Dépendamment de la complexité du réseau de distribution inverse, Ventreprise doit faire le tri
et la consolidation des retours avant de les acheminer vers leurs destinations finales. Les
produits retournés.prennent différentes directions selon la raison du retour ou leur état comme
Vindique Rogers et Tiben-Lembke (1998). Dans certains cas, il n’est pas souhakable de
transporter ke produit plis loin compte tenu de son état ou de sa nature ct il est recycks
immédiatement, Puisqu'il y a phsieurs activités associées Ala logistique inverse, Fentreprise
peut avoir plusicurs centres de traitement pour desservir Fensemble des termtoires ou un
tertitoire spécifique. Lorsque ke produit retoumé atteint sa destination, il est mis en attente
pour l'étape suivante, le tri
Etape 3: Tri
L’étape du ti permet de décider de ce qui est fit avec chacun des produits, comme le
mentionnent Rogers et Tibben-Lembke (1998). Cette étape comporte plisicurs activités
2
La premigre consiste & faire la réception du produit retourné. I faut ensuite sassurer que le
produit retoumé corresponde a fa demande (produit, quantité, numéro d’autorisation, état
visuel, ete.). L'entreprise doit communiquer avec fe clent lorsqu’il y a divergence entre fa
demande de retour et ke produit retourns. Des ajustements &h demande doivent étre faits pour
pemmettre Vacceptation du produit retourns. Dans le cas contraire, ke produit peut étre refisé
et retoumé au client, Souvent, c’est 4 cette étape qu'un produit de remplacement est expédi¢
au client ou qu’un crédit est donné au client. Une fois triés, les produits peuvent étre
consolidés et ensuite expédigs vers le traitement appropris. La complexité de cette étape
dépend de Pétendue du réseau de Ventreprise. Dans ke cas d’un seul centre de traitement,
Pétape sert aprés acceptation a trier, consolider et acheminer vers les traitements a Pintérieur
du méme site, Si ke réseau est complexe, ka gestion des stocks en transit et ke transport entre
les différents. sites deviennent alors des activités importantes. & cette étape.
Etape 4: Traitement
La quatrtme étape de Rogers et Tibben-Lembke (1998) est la décision de disposition, c’est-
a-dire Penvoi du produit vers la destination désirée. Done, a cette étape, il faut décider du type
de tatement. les trois activités de Pétape du traitement des retours. La premiére activité
consiste 2 faire une inspection détailke du produit retourné afin de s‘assurer que Je produit
soit dirigé vers le taitement approprié. Un choix préliminaire de traitement a été fait
précédemment a l'étape du tri, Ce choix de traitement n'est pas final et peut encore étre
changé cette étape-ci. C’est Ace moment que a condition du produit est évaluge en
profondeur et que ki décision est prise, La gestion des stocks est la deuxtme activité de cette
étape. Son but est de confirmer que le produit peut entrer dans le traitement choisi
Finakment, la dernitre activité est celle du traitement 2 faire. Les choix de traitements
possbles sont réemballer
2-1-1-Une chaine logistique durable
La mie en place dune logistique durable constitue aujourd'hui un enjeu reconnu
comme essentiel par la majorité des entreprises. La notion n'est cependant pas clairement
définie, et recouvre des pratiques nombreuses. et disparates. L’objet de ce billet est de faire le
point sur la notion et ks pratiques de logistique durable, en s‘appuyant sur ks résultats d°un
travail de recherche intitulé « Veille Logistique Durable » (VLD), mené dans le cadre du
programme Predit et financé par!’Ademe tavailler sur la VLD supposait au préalable de
B
clarifier la notion de logistique durable et d’étudier es pratiques qui y étaient assocites. Pour
cel, nous avons réalisé une reve de la Htérature académique existante, puis conduit des
centretiens approfondis avec plus de 40 professionnels intéressés_par ces sujets, dont les
discours ont ensuite été analysés pardeux méthodes différentes.
‘Une notion académique complexe :
La littérature
académique, notamment anglosaxonne, offre de nombreuses définitions du
SSCM (Sustainable Supply Chain Management). Celles-ci permettent de définir bk logistique
durable comme une logistique qui
m= s‘inscrit dans la durée (perspective de long terme),
= prend en compte ke développement durable dans décisions et ses choix,
= S‘appuie sur un ensemble de pratiques/actions inter-organisationnelies et inter
fonctionnelles, coordonnées voire collaboratives, en lien avec la gestion des flux/des
processusides chaines de vakurs,
= combine des objectifs ifs aux trois pilirs du développement durabk,
= ct améliore kt performance logistique dela conception ala fin de vie des produits et
services.
Les travaux académiques révelent par ailleurs une prééminence de la réflexion
environnementale sur kes aspects sociaux et sociétaux, Péconomique étant implicitement et
obligatoirement_pris en compte : pour durer, il fiut d’abord étre économiquement viable |
‘Une notion difficile & opérationnal
Les praticiens ont du mal & défnir spontanément a logistique durable, mais sont en revanche
us demandeurs dune définition claire et pouvant guider leur action, L’analyse de leurs
discours montre néanmoins que kes éléments de définition parcellaires qu’ils donnent
convergent avec ceux de la litérature, L’analyse des discours sur la bogistique durable insiste
parailleurs sur la problématique de son opérationnalisation dans ks contextes spécifiques de
chaque secteur dactivité et de chaque chaine Ingistique, Elle renvoie aussi ht complexité de
Ja logistique durable qui ne peut se mettre en acte sans impliquer de nombreuses. parties
prenantes (entreprises des chaines Iogistiques, institutions, groupes de pression, etc.) qui
doivent construire ensemble les solutions logstiques durablesjalors qu’'elkes poursuivent des
finalités parfois contradictoires ! De ce fait, les praticiens soulignent la nécessité, mais aussi ka
difficulté, de préciser quels doivent Gtre kes objectifs vsés et de défnir ky mesures de
performance associées & bi logistique durable. Un point sur kquel ka recherche en logistique
14
durabk est attendue par les profe
nels !Cette complexité percue par les professionnels
confirme qu’au-debt des opérations, la logistique durable s‘inscrit bien dans la fabrication des
stratégies dentreprises contemporaire
2-1-2-Les quatres leviers de la logistique durable :
La logistique s'étend de bout en bout de la chaine de valeur of son réle consiste a relier les
deux poles de économie en synchronisant efficacement et aux meilleures conditions
économiques la chaine de offre avec bk demande réelle des consommateurs, aussi complexe,
incertaine et fuctuante soit-elle. Alignée sur la stratégie de Fentreprise, bien orchestrée et
intégrée, elle permet selon ka devise de Christopher (2005) de faire « mieux, plus vite, moins
cher et plus proche » pour l'obtention d’avantages coneurentiel :
+ micux, en livrant des commandes parftites ;
+ plus vite, en réduisant les déhis et en éliminant les activités inutiles qui entravent la
circulation des flux ;
+ moins cher, en réduisant kes stocks, les coiits d’exploitation et ks cofts de structure
4
+ phis proche, en fidélisant kes clients & tmvers otlfe de services valeur ajoutée tels
dourdissent fa chatine logistique ;
que personalisation des produits, la réactivité la demande, la tragabilité des fux, ke
suivi de commande via Intemet, etc.
Cette vision séduisante est cependant difficile A atteindre. Elle demande une démarche
progressive etde longue hakine, et dépend surtout de la capacité des entreprises & modemiser
leurs méthodes de travail, & intégrer le processus logistique, Acomprimer ks coiits et kes
délas, & mesurer les performances, & automatis.
les changes d'information (Echanges de
Données Informatisés (EDI) et interlagage des ERP (progiciels de gestion intégrés)),
coordonner les activités et & partager des informations, des ressources et des moyens entre
partenaires.
L'intégration du développement durable fait émerger deux nouvelles. dimensions — sociake et
environnementale. Celles-ci s’ajoutent au défi économique des supply chain managers. qui,
notons-le, ne disposent pas encore dune logistique compétitive — notamment dans les petites
‘et moyennes entreprises — qu’ik doivent maintenant intégrer de nouvelles. exigences
environnementales et sociales. Par chance, les ttois axes & concilier ne sont pas antinomiques
15
—T'économique allant dans le sens de lenvironnemental et du social —bien que cette
affirmation reste & démontrer.
‘Nous introduisons ici la notion de levers logistiques faisant le lien entre la supply chain et les
objecti8s de développement durable. Ces keviers "action sont alignés sur la finalité de bt
logstique définie par Hesket (1977) : « Répondre a la demande a un niveau de service fixé a
moindre coftt » et recoupent également k deve de Christopher. Au nombre de quatre, kes
leviers de la logistique durable se répartissent comme suit
+ a fiabilité logistique ;
+ Pefficience logistique :
© a réactivité logistique ;
+ Péco-logistique
Loin d’avoir une action limitée, la logistique offie quatre Feviers au service du développement
durable, Dans les sections suivantes, nous allons tenter de montrer comment 1a logistique peut
concilier kes attentes des actionnaires, des clents, du personnel, des citoyens et de
environnement en étant plus fable, efficiente, réactive ct soucieuse dela préservation de
environnement.
4.1. La fiabilité logistique
Une organisation est dite fiable lorsque la probabilté de remplir sa mission sur une durée
éiinie comespond A celle spécifiée dans ke contrat ou k cahier des charges. Dans ke cas de la
logstique, la fiabilité se traduit parla capacité & livrer des commandes parhates
conformément aux attentes des clients. Symbolisée par un levier a Péquilibre, b fiabilité
logstique recouvre les notions de respect des engagements de moyen et de résuitat par rapport
aux spécifications et aux objectifs prédéfinis, Elle nécessite des ressources, des compétences
et des connaissances fiables et pi
ises tout au long de la chaine logistique en adéquation avec
les compétences requises. De méme, Tinformation doi étre symétrique aux produits, Par
exemple, les fiches-produits doivent corresponklre aux produits, ainsi que les stocks
informatiques doivent refiter kes inventaires. physiques,
L’application de procédures et l'utilisation d’équipements et de conditionnements conformes
ah réglmentation evou aux bonnes pratiques pour kt manutention et ke transport sécurisés
des produits contribuent également & respecter la quallié et Pintégrité des marchandises
16
comme d’en imiter les impacts sur environnement. Le langage gbbal utilisé par kes acteurs
dela supply chai
A savoir les standards intemationaux de codification et de marquage des
produits et des unités logistiques, ainsi que les messages EDI, sont également un moyen de
produire et d°échanger des informations fables, précises et compktes. Pour contrer kes
risques d'incident et de crise, d’erreur de saisie, d'erreur de réception, d’étiquetage, de
préparation, d'expédition, de ficturation, mai aussi les retards de livraison, les malveillances
de tracabilité, des outils de suivi en temps réel des stocks et des flux, des technologies
utilisant bi radiofiéquence pour la localisation des produits (RFID) et la géo-localisation des
véhicules, ainsi que des systémes: de Supply Chain Evem Management (SCEM) et de
mutualisation des risques sont déja & Paeuvre
Les mesures de fiabilité logistique aux différents stades de la supply chain portent
principalement sur ke taux de service client, le taux de service des prestataires bgistiques et le
taux de service foumisseur, ainsi que sur la qualité des fiches-produits, la précision des stocks,
des nomenclatures et des gammes, Ie taux de non-conformité, le taux obsolescence, fa
fiabilité des prévisions de vente, le taux de respect des plannings de production, le taux de
respect des procédures, le taux d'incident, le taux d’absentéisme, la formation du personnel,
certification des compétences, le nombre de contrats d’assurance, etc. Les enjews pour les
parties prenantes se chiflrent en économies financiéres, de temps, de ressources et en qualité
dimage. La stricte application des procédures et des régements. permet de réduire es risques
de défaillance pouvant étre préjudiciables notamment dans le cas du stockage, de la
manutention, du transport et de Putilisation de matisres périssables et/ou dangereuses. «
Liver le bon produit au bon endroit au bon moment du premier coup dans le respect des
wsi de réduire ks st
spécilications » perme au retard ov
s et les pollutions Bs
redoublement des livraisons. Aucune étude chiffrant le codt de la non-fiabilité dans b supply
chain rexiste & ce jour, mais nous pouvons dores et deja affirmer que celui-ci est
considérable. Enfin, la fiabili
colits ot des nuisances ; elle représente aussi un lever d’accroissement du volume d'affaires
des opérations ne se limite pas aun levier de réduction des
lig Ala satisfaction et la fidélisation des clients. Ce point est particulitrement important dans
un contexte Geonomique marqué par la crise du pouvoir d’achat et hyper concurrence.
7
4.2. Lrefficience logistique
Lefficience est le rapport « Efficacité / Cott ». He désigne le fait de réaliser un objectif avec
le minimum de moyens engagés possibles. Elle ne doit pas se confondre avee Fefficacité qui
‘ne mesure que Patteinte d’un objectif sans précision des moyens utilsés. Les principes de
Tefficience industrielle ct logistique font appel aux économies d’échelk, & la standardisation
des produits et des process, i Pautomatisation des opérations, & Pamélioration de la visibilité,
4 Torganisation en fhux, aux systémes tirés par ka demande, & optimisation des ressources, 8
la mutualisation de moyens logstiques et d’applications informatiques, a la mise en commun
d'une fonction d'entreprise (par exemple : gestion des commundes, élaboration des prévisions
de vente, pilotage des flux, etc.) et 4h collaboration interentreprises. Ils recourent également
aux techniques de Qualité Totale pour la rationalisation des produits et des processus, la
réduction des coats et I’élimination systématique des gaspillages dans une démarche
damélioration continue (démarche lean, kaizen, etc.). On représente Pefficience logistique
parun bras de kvier démutiptiant effort foumi pour obtention d'un résultat optimal,
Bre efficient, c'est étre efficace en faisant une bonne utilisation des ressources (humaines,
informationnelles, matériell
, finaneitres, etc.) avec un impact positif sur la rentabilité et la
trésorerie des entreprises et sur environnement des brs que la consommation des ressources
est minimisée
43. La
tivité logistique =
Une entreprise réuctive est dotée de moyens flexibles qui, s'ik sont assez Kegers, lui
pemmettent d’étre agile. La réactivité est la capacité d’adapter rapidement les volumes de
production et fa variété des produits aux fluctuations de la demande, ainsi que d'accéKrer la
mie sur ke marché ¢’un nouveau produit, Dans une optique d'agilté, c'est lr flexibilité et
Tadaptabilité des processus, des ressources, des organisations et des chaines logistiques qui
sont recherchées pour faire face & des environnements instables, turbulents, incertains et
risqués, ainsi qu’a des opportunités de marché. L’une des cts de la rtactivité est a reduction
systématique des délais de conception, d'approvisionnement, de fabrication, de changement
de série (SMED) et de distribution face aux évolutions de lt demande. Pour les produits
hybrides (mi-génériques, mi-personnalisés), la différenciation retardée est ume autre technique
qui permet a personalisation de masse en offrant plus de variété au client pour un coftt total
inférieur. Cette stratégie consiste a profiter des avantages de la standardisation en termes de
18
réduction des cotits (production & bas coit des composants et des modules génériques, stocks
génériques. plus flxibles, pré
sions génériques plus fiables) tout en maximisant Pofiie
commerciale parka personalisation des produits sur ke marché local, Les indieateurs de
réactivité font typiquement référence au time-to-market, au time-to-volume, la rotation des
stocks, a la vitesse d’
oulement des produits, au ratio de tension des flux, aux temps de
cycle, de transit, dattente, d’indisponibilité, etc., aux tales de bt, au cycle order-to-cash, au
cycle cash-to-cash, etc. Les différentes stratégies basées sur le temps ofirent également des
perspectives de développement durable en permettant aux industries bneales d’étre plus
réactives tout en maintenant moins de stock pour satisfaire une demande plus difficile
prévor. En répondant mieux, pls vite et moins cher a la demande, le chiffre d'affaires, la
rentabilité et le fonds de roulement augmentent tandis que les impacts. sur Penvironnement
Sven trouvent diminués, notamment au niveau des surstocks et des produits obsoktes 4
recycler. Pour ifustrer la réactivité logistique, nous représentons un vier flexible capable de
répondre aux-’-coups de la demande,
4.4, L'éco-logistique :
Selon Martinet et Reynaud (2000), « les entreprises sont amenées a internaliser une pan des
coitts d ‘environnement et des cotits
sociaux qu’elles auraient [auparavant] rejetés &
Vextérieur. La prise en compte du développement durable devient alors un élément de
différenciation »1
Aujourd’hui, application de plusieurs programmes de dévebppement dumble est possible
tek que ka certification ISO 14001 concermant le management environnemental, utilisation
dénergies renouvelables, la réduction de la consommation d’eau, le tri et le recyclage des
cemballages (programme Eco-Emballages), faménagement du territoire grace notamment au
développement des produits du terir, le développement du commerce équitable,
Tintégration de travailleurs sociaux, etc. Mais ces projets doivent étre équilbrés avec fa
recherche de performances économiques et financitres pour perdurer et se développer.
‘Au phn de la logstique durable, les programmes concement plus spécifiquement la formation
des chaufieurs A Péco-conduite, utilisation de modes de propubion hybrides, la
mutualisation des entrepéts et du transport ou le développement du transport multimodal
combinant fa route, le fer, le fuvial, Paérien et le maritime pour réduire lt consommation
énergétique, les émissions de gaz a effet de serre et la congestion des axes routiers, La
19
limitation des emballages et faugmentation du taux de recyclabilité des produits représentent
également des mesures conerétes pour réduire empreinte environnementale des
marchandises. A ce titre, la logistique inverse permet k collecte, ie tri, k démantékement et
récupération de valeur des produits usagés. D'autres axes concement la certifeation pltes-
formes et des batiments logitiques selon la démarche HQE (Haute Quaité
Environnementale) promue par association AFILOG en France, Existant sous d”autres
formes dans différents pays d’Europe, cette norme passe en rewe difigrents crittres tls que
impact des flux sur Fenvironnement immédiat, le recours au transport combing,
consommation d’énergie des bureaux et des entrepdis, la gestion de eau (réduction de
Vimperméabilisation de la parvelle, traitement paysager des bassins, économie d'eau pour les
systémes d’extinction incendie, ete.), ke traitement des matigres dangereuses, Ia qualité
sanitaire de Tair et kes conditions de travail, Enfin, les mitiers: deh logistique offient un
gisement d’empbi important. Selon une étude du Centre d’analyse stratégique, ft profession
dans son ensemble proposerait quelque 700.000 nouveaux postes entre 2005 and 2015 sur un
total de 2 millions d’emplois dédiés aux activités de ba logistique en Frances
2-1-3- Le volet « environnemental » de la logistique durable
Sion en croit Srivastava (2007), c’est dés 1989 que des travaux scientifiques se sont
intéressés 4 Taspect environnemental de la logistique. Mais, c’est surtout 4 compter des
années 2003 qu’émergent de plus en phis de travaux sur le Green SCM (Fahimnia et al,
2014), Ainsi, si le Green SCM émerge la méme époque que kes écrits en SCM (Christopher,
1992), son évolution ne suit pas le méme rythme et peut-étre expliquer -toutes choses égales
parailleurs- que ke volt économique via k SCM n'est pas toujours chirement associé une
logtique durable ; alors que le Green SCM y aurait trouvé plus facilement sa place (pour
rappel, kes études de terrain considére le facteur environnemental comme lk facteur
prépondérant dune bgistique durabk).
La raréfaction des matigres premiéres, Pobligation de répondre a des décrets
environnementaux ou encore Paceroissement des taxes écologiques sont autant de facteurs. qui
rendent e Green SCM important dans les discours et les pratiques actuels, Au sein de cette
logstique environnementale/verte, il est possible de considérer trois axes principaux
[1 les operations vertes qui se rapportent :
0 Ala gestion des déchets avec pour but une limitation des déchets ultimes, ceux qui font
objet d'un enfouissement. Ontrouvera ici, par exemple, ks directives sur la gestion des
20
déchets des équipements électriques et électroniques (directive 2002/95/CE-ROHS du 27
Janvier 2008 et directive 2002/96/CE-DEEE. du 27 janvier 2003) ou encore T'éco-contribution
des
\Se A financer la collecte et le recyclage des meubles mis en plice en mai 2013 ;
© Alt gestion des retours : invendus, réparations
©Aka production et reproduction verte dans optique d"utiliser le moins de mati¢res dans le
processus de fabrication ou de redonner une seconde vie aux machines.
a conception verte qui touche autant le produit (par des raisonnements en éco-conception
dés br rétlexion en Recherche & Développement) que ke bitiment (construction ou rénovation
en Batiment Basse Consommation ou en Haute Qualité Environnementale) ;
Ile transport vert recherche la multimodalité par utilisation de plusieurs moyens de
transport moins pollants (maritime, ferré, fluvial) ou des tansports moins chronophage en
carburant (GPL, hybride, électrique, biogaz, nouvelle génération de moteur). Ces choix sont
dautant plus importants du fait de existence d’écotaxes poids-lourds ou de contraintes,
régkmentaires (ivraisons en centre-ville limitées & tels types de véhicules, selon teks horakes,
ete).
3-1-1 Ch
logistique verte
La littérature contient de nombreuses définitions de « la gestion de la chaine logistique verte».
Ces definitions varient d'un achat vert jusqu’a une chaine logistique intéerée en bouck fermée.
‘Wu et Dunn (1995) mentionnent que la logistique verte, c'
phis que la logistique inverse car
celle cherche a économiser kes ressources, a éliminer kes déchets et &.améliorer ka productivite
Hart (1997) indique que la bgistique verte doit avoir la plus petite empreinte
environne mentale.
Beamon (1999) a défini la chatine logistiyue verte comme étant Textension de la chine
logstique traditionnelle pour y inclure des activités qui cherchent &minimiser les impacts
environnementaux d'un produit tout au long de son cyck de vie, tels que Ico conception,
Téconomie des ressources, la réduction des matires dangereuses, la réutiisation et le
recyclage des produits.
Selon Hervan, Helms et Sarkis (2005), la chaine logistique verte comprend Lachat vert,
1a fabrication écologique, bh distribution/marketing verte et la kogistique inverse
Srivastava (2007) définit la gestion de la chaine Ingistique verte comme Tintégation deb
pensée environnementale dans la gestion de kt chane gistique, y compris la conception des
21
Produits, Tapprovisionnement en matériaux, la sélection des procédés de fabrication, la
livraison du produit final aux consommateurs ainsi que lt gestion de produit apres sa fin de
vie util. Sarkis et al. (2011) la définissent comme étant Tintégration des considérations
écologiques dans les pratiyues inter organisationnelles de la gestion de i chaine logistique, y
compris ka logistique inverse.
Pour Ahy et Searcy (2013), la chaine loghtique verte fait référence une entreprise focal: qui
colabore avec ses foumisseurs pour amélorer la performance environnementale,
application d'une démarche de la chaine logistique verte peut conduire & des avantages en
termes de réduction des coiits, d'efficacité et d'innovation (Kumar, Teichman et Timpernagel,
2012). Cependant, une nouvelle mesure de performance a été développée qui engbbe Ak fois
Jes considérations environne mentales et Gconomiques : léco-efficience. Cet indicate ur
informe sur la consilération conjointe de la performance économique et la performance
environnementale (Govindan, Sarkis, Jabbour, Zhu et Geng, 2014).
Ainsi, il apparait de ces définitions que la chaine Ingistique verte référe 2 un systéme en
boucke fermée intégrant la logistique inverse et la chaine logistique classique
14 Différences entre la chaine logistique traditionnelle et la chaine logistique verte
Malré les liens dinterdépendance entre la chaine Iogistique classique et bt chaine logistique
verte, il existe des diflérences 4 plusieurs égards entre Jes deux chaines. La chaine logistiy uc
verte implique Textension de la chaine logistique négulidre pour y intégrer ka Jogistique
inverse. Van Hoek (1999) discute Jes défis de réduction de Tempreinte écologique des chaines
logstiques en améliorant impact des pratiques commerciales sur lenvironnement, L'auteur
concht que Iétude de lt logistique inverse est insuffisante et faccent devrait étre mis
davantage sur la compréhension de toute ki chatine logistique intégrant la logistique inverse a
la chaine logistique traditionnelle.
Seuring (2004) compare ki chatne logistique verte et la chine logistique traditionnelle
en utilisant cing critéres: la base physique, la base conceptuelle, les acteurs, la coopération et
Tobjectif. Liauteur constate des points de similitude et de difigrence entre Jes deux chaines. Il
cexplique ce constat par la différence exitante entre ke principe du cycle de vie et ke principe
dela chute Jogistique traditionnelle ainsi que la nature de coopération enire les acteurs.
Ho, Shalishali, Tseng et Ang (2009) comparent la chaine lgistique traditionnelle et ka
22
cchaine logistique verte en ce qui conceme Fobjectif, Ioptimisation écologique, la sélection des
fourisseurs, ke cott et hr réactivité/flexibilité. La gestion de la chaine Jogistique verte
implique un changement de structure physique de kt chaine logistique traditionnelk: et Tajout
de nouveaux objectifS environnementaux (Neto, Walter, Bloembof, Van Nunen et Spengler,
2010) ainsi que des flax de matigre et d'information associés aux activités de la logistique
inverse. . Objectif. La chathe logistique traditionnelle vise des objectifs économiques tels que
Je cofit/profit, la satisfaction de client, la réactivité et la flexibilité (Gopal et Thakkar, 2012).
En revanche, la chaine Jogistique verte cherche un compromis entre ks objectifs économiques
lervani_ et al, 2005; El
classiques et les objectifs environnementaux (Beamon, 199!
Saadany, Jaber et Bonney, 2011 Structure, La chaine logistique traditionnelle posséde une
structure linéaire dont les flux de matigre et d'information entre les partenaires dl’ affaires: sont
¢ accordée aux
Uunidirectionnels. Considérations environnementales. import
considérations écologiques par la chatine Iogistique classique est souvent seconklaire par
rapport aux facteurs économiques. Albrs que pour kt chaine logistique verte, cette importance
est équilibrée avec a fnalité économique commune des entreprises constituant réseau
logstique.
Collaboration, La nature de collaboration entre les partenaires de la chaine logistique indique
le degré a! intégration des unités d'affaires ete degré de partage de Tinfonnation pertinente
centre ces demitres. Dans la chaine traditionnelle, la collaboration porte générakment sur les
transactions commerciales et parfois a fassistance technique. Tandis que dans la chatne
logitique verte, le partage d’ infonnation est un facteur cié dans Tamélioration des
2010),
performances économiques et écologiques de la chaine logistique (Faisa
Conception du produit. La conception du produit pennet a Tentreprise de répondre
eficacement 4 la dynamique du marché et d'améliorer sa perfonnance économique.
Dans un contexte de chine logistiyue verte, les crittres écologiques sont ajoutés au processus
de conception.
Sélection des foumisseurs. Dans bi chaine logistique classique, la sélection des fournisseurs
est basée principalement sur ke prix et sur une collaboration & des valeurs économiques et
‘guidé par un contrat & court terme. Chaque membre de la chaine s'occupe de son propre
impact enviromemental direct til peut collaborer attentivement avec d'autres membres de la
cchaine, mais indépendamment de impact global de la chane logistique. Alors que dans la
chaine logistique verte, la sélection des fournisseurs prend en compte ks critéres économiques
23
et écologiques et la coopération est forte et nécessite un partenariat & long terme, basé sur la
confiance mutuelle entre les partenaires. Ce type de partenariat permet aux partenaires
d'échanger [ks informations et les compétences en matitre de conception et de développement
du produ, de réduction des émissions de carbone, des emballages et des déchets. Le plein
potentiel d'une chaine logistique verte ne peut étre obtenu qulavee un partenariat & long terme
entre les fournisseurs et kurs fournsseurs, les clients et leurs clients (Vachon et Klassen,
2006).
Les processus de gestion de la chaine logistique verte :
Dans la chaine Iogistique verte, phisieurs processus se combinent et se completent afin
d'assurer la raison du produit au consommateur final ainsi que son retour aprés utilisation.
Ces processus varient selon kes secteurs d'activité de Fentreprise et mettent en relation un
maillon ayec un autre ou avec plusieurs maillons du réseau,
Studtler (2002) subdivise la gestion de kt chatne logistique en deux parties: Tintégration du
réseau et la coordination des différents flux. Liintégration porte sur le choix des partenaires,
Torganisation, la colboration et le pilotage du réseau. La coordination constitu Tensemble
des processus de planification et de controle de la chaine ainsi que les processus de partage
d'information et les technologies utilisées & cet effet. Lambert et Cooper (2000) déerivent les
différents processus définissant ba gestion d'une chaine logistique. Les fonctions transversales
pemmettant la gestion des flux et lintégration des fonctions de base d'une entreprise dans une
chaine logistique sont :
la gestion de la relation client;
la gestion du service aux clients;
Ja gestion de fa demande;
lh gestion des commanles;
la gestion des flux de production;
lh gestion des relations fournisseurs;
le développement du produit et sa commercialisation;
la gestion des flux inverses (recyclage, service aprés-vente).
Llapprovisionnement vert
a double objecti; augmenter e taux de remplissage des véhicules et réduire ks
‘émissions_de C02 (Pan et al. ,2011). La réduction de lempreinte carbone de la
24
ote du transport dépend fortement du modéle de production adopté. Par exemple, kes
systémes de production en flix tendus ont démontré: Feurs avantages
économiques mais en contrepartic, i favorisent Taugmentation des émissions de C02 Du fait
de sa positon en amont au sem de kr chine logistique, le processus «s! approvisionner» joue
un rOke stratégique essentil; il est en mesure de prévenir, lors de la sSlection des foumisseurs
et des prestataires, le transfert des risques environnementaux des matires premitres et des
produits acquis.
Le processus de sélection des fournisseurs doit inclure, en plus des erittres économiques et
des critres environnementaux teks que I' existence d'un systtme de gestion de
Tenvironne ment certifié ISO 14001 , fabsence de substances nocives dans les produits.
T tend également a sélectionner
S produits présentant une forte proportion de matidres
recyclables et de composants réutilisables, la diminution des emballages (Hamner, 2006)
Face a une concurrence économique intense, la mise en place d'une telle démarche est
difficile et nécessite une révision de b stratégie globale d'achat de Tentreprise et
Tétabissement d'un partenariat durable avec les foumisseurs
La fabrication verte :
Le processus « fabriquer» englobe kes opérations de transformation des mati
celles
es premitres et
semblage du produit, Pour assurer une fabrication verte, ks entreprises devraient
améliorer Jeurs processus de fabrication en agssant sure triangle constitué de trois éléments
clés: la technologie, Ténergie et les matériaux
Deif (2011) ajoute que la néduction de Timpact du processus de fabrication sur
Tenvironnement peut tre atteinte parle bon choix de technologies en concertation avec la
conception du produit.
Leacquisition des technologies écobgiques qui consomment moins de matibres et dénergic et
émettent moins de dioxyde de carbone et de déchets;
La réingénierie des technologies exitantes via la substitution des intrants toxiques par ceux
non-toxiques, non-recyclables par ceux recyclables, bt réutilisation des extrants valorisables. et
la réduction des exirants indésirables
La distribution verte
Le processus « livrer» inclut deux sous-processus: le stockage et Ie transport,
Le stockage vert. Les bitiments Iogistiques jouent un rble essentiel dans lt gestion des flux en
amont et en aval de la chine logistique, is assurent k stockage ainsi que d'autres opérations
de finition dela commande (emballage, étiquetage, etc.). La démarche de stockage vert a pour
objectif la conception des batiments logitiques en respectant des normes de Téco construction
25,
(p.ex., nome NF EN 15643-1) qui permettent de réduire impact environnemental. Les
centrep6ts peuvent étre batis en utiisant des matériaux comme le bois et peuvent fonctionner
avec des Energies alternatives et renouvelables elles que les énergics Solaire et éobenne,
Le transport vert
Le transport assure le mouvement des flux de matitres & travers la chaine Jogistique.
Cependant, ce secteur a un grand impact sur Fenvironnent : le transport des marchandises
représente environ 14 % des émissions totals européemmes (EEA, 20 ID), La démarche du
transport vert consiste a chercher des solutions akematives écologiques par:
+ Tadoption de solutions moins polluantes (elles que ke mode fluvial ou maritime ferroviaire
ou k combing rail-route, assurant ainsi un meilleur rendement écologique, Toptimisation des
toumées des véhicukes afin de réduire les émissions de dioxyte de carbone;
+ Tutilsation des véhicules moins polluants (hybrides, électriques, utilisant des biocarburants
ou du gaz nature);
+ la muualisation des moyens de transport entre plusieurs chaines Iogistiques pour un double
objectif: augmenter k taux de remplissage des véhicules et réduire les émissions de C02 (Pan
etal, , 2011). La réduction de Lempreinte carbone de la flotte du transport dépend fortement
du modéle de production adopté. Par exemple, les sysitmes de production en fax tendus ont
démontré leurs avantages économiques mas en contrepartz, ils favorisent laugmentation des
émssions de C02
3-1-2 l’éco conception
L’6co-conception, ou Papproche produit de fenvironnement constitue aujourd’hui un théme
incontournable des politiques de développement durabk: des entreprises, et méme pour
certaines d’entre elles un thime de communication et un champ d'innovation priviligits (ex.
1a conception de véhicukss hybrides chez Toyota, Vofite de produits durables chez Monoprix,
les stratégies d’imovation pour le marché de li Haute qualité environnementake chez
Lafarge), Lintérét croissant pour !éco-conception depuis Jes années 1990 s‘explique par la
recherche de solutions de rupture pour freiner la dégradation continue de nombreux
indicateurs environnementaux (croissance de la production des déchets, émissions de CO2,
épuisement accéléré des ressources, perte de biodiversité etc.) et pour rendre soutenabk
TaceéKration du développement économique de grands pays comme ['Inde et b Chine, Pour
limter Tépuisement des ressources naturelles et le réchauffement clinstique, condition d'un
développement durable, certains experts invoquent un facteur 4 voire un facteur 10, soit une
réduction par 4 d'ici 2050 et par 10 & Thorizon 2100 des impacts environnementaux de nos
26
activités économiques. Pour atteindre un tel niveau de performance, différentes démarches
sont envisageables — « dématérialisation » de Téconomie, réutilsation et recyckige des
produits, batiments & énergie passent, notamment, par la combinaison dinitiatives locales,
comme Féco-conception des produits et services, et d’impulsions publiques fortes par ke biais
d'nstruments économiques et de politiques appropriges. A cette aune, ka ligne d'horizon de
Téco-conception est I « économie de fonctionnalité », fortement démutérialisée, od les
servi
ont remphcé es produits et oii la réutilisation et k recyclage des produits et des
matériaux dans de nouveaux cycles de production permetient de réduire drastiquement la
consommation de matires premidres et les émissions de polhunts, Or, ks conditions de
gestion de I'éco-conception est loin dialer de soi car, d'une part, les résultats sont souvent 118s
en deg des objectifs visés parles entweprises, d'autre part, les entreprises rencontrent des
difficultés & conduire des projets d'éco-innovation qui sortent des trajectoires: technologiq ues
cexistantes (dominant design). Ainsi se posent de plas en plus la question des conditions de
pibtage d'une éco-conception innovante. positive, véhicules 4 ues fable consommation.
3-1-3Probléme de conception et de Modélisation de réseaux logistiques :
Le probléme de conception de réseau est Tun des problémes de décision stratégiques les plus
complets qui doivent étre optimisés pour un fonctionnement efficace Along terme de la chaine
logstique entiere. Il détermine le nombre, Femphicement, la capacité et le type dusines,
in
talations, des entrepéts et des centres de distribution a utiliser-II établit également des
canaux de distribution, et la quantité de matériaux et éKments a consommer et 4 produite, et 2
transporter depuis les foumisseurs jusqu'aux clents.Les problémes de conception de réseaux
Jogistiques couvrent une large gamme de formulations depuis un simple et seul type de
produit jusquaux plus complexe muiti-produits, et de modéles déterministes lingaires juscu'a
ceux beaucoup phis complexe stochastiques et non lingaires. Dans ka litérature, il existe
différentes études portant sur le probk:me de conception des réseaux logistiques nous pouvons
citer [15] [3]{16}, [17], et [18].
Au cours des dernigres années, de nombreux chercheurs ont proposé des modbles
mathématiques pour résoudre des problémes en tenant compte des effets envronnementaux.
une des premidres ceuvres était par Zhou et al, [19], qui a proposé
un modék: de programmation par but (goal programming) pour caluler la durabilité des
processus continus dans une chaine logistique Guillen-Gosalbez et Grossmann[20Jont aussi
abordé ka conception et b planification de la chaine dapprovisionnement, et ont proposé
7
modele bi-objectif bistochastique non-lingaire mixte en nombres emtiers qui tente de
minimiser simultangment s cofts et limpact environnemental au niveau d'une chaine
dapprovisionnement de matériel liquide
Loptimisation nuiki-objectif de la chaine logistique a été abordées par de nombreux
chercheurs dans la littérature. Par exemple, Paksoy et al. [21], ont modé
é une chaine
dapprovisionnement afin de minimiser le cott total, prévenir les émissions de CO2 et
choix muiples
de transport différents entre les échelons, en fonction des émissions de CO2. Mincirardi et
encourager les clients & utiliser des produits recyclables. Is ont proposé
al[22Jont proposé modéle muki-objectif pour réduire les déchets solides dans une chatne
dapprovisionnement. Akada-Almeila et al ont dressé une approche de programmation
moki-objectif capable d'ide:
des installations
1 bes lieux et les capac inération de
matiéres: dangereus
et équilirrer les impacts socitux, économiques et environnementaux.
‘Wang etal. [24], ont abordé un modéle d'optimisation mul
jectif qui capte Ie compromis,
entre ke coat total et impact. sur environnement.
Sabri et Beamon [25], ont développé un modele intégré de chaine logistique mulki-objectif
pour la plinification statégique et opérationnelle, sous incertiudes d'approvisionnement de
produit, de livraison et de la demande.
‘Chan et Chung [26] ont proposé une procédure d'optimisation génétique muki-objectif pour le
probRme de la distribution dans un SCN guidé parka demande. Is ont considéré la
minimisation du coft total du syst#me, nombre total de jours de prestation et Péquité du taux
utilisation des capacités pour les fabricants comme objectif
Erol et Ferrel [27] ont proposé un modéle daffectation des fournisseurs aux entrepdts et des
entrepots aux clients. Ths ont utilisé un cadre de modélisation dePoptimisation nuiti-objectif
pour minimiser Jes coats et maximiser la satisfaction du client,
Guillen, Mele, Bagajewiez, Espuna, et Puigianer formu le probkme de conception SCN
comme un modal multi-objectif stochastique mixte de programmation linéaire en nombres
enters , quia été résola parla méthode e-contrainte, et la techniques branch and bound. Les
‘objects étaient le profit et la satisfaction client,
3-1-4— DE LA QUETE DU « ZERODECHET » A L’APPRENTISSAGE DE NOUVELLES
PRATIQUES ORGANISATIONNELLES =
Depuis kes anges 1990, l'écologie industrielle connait un développement rapide,tant sur ke
plan institutionne! que conceptuel. La mise en oeuvre de cette démarche intéresse de
nombreux acteurs Economiques et politiques, en particulier dans les pays les plas
industrialists. L'imphatation des pares éco-industriels sur le mod? de Kalundborg, une
28
municipalité danoise ayant mis en oeuvre ce type de parc en collaboration avec diverses
entreprises (notamment une usine électrique, une raffinerie, une fibrique de placoplatre et une
centreprise biotechnologique), a fait Pobjet de nombreuses recherches (brahimi et al.,1997;
Ehvenfeld et Gertler, 1997; Grann,1997). Ce modéle européen, devenu une référence
incontestable, a inspiré d'autres expériences, notamment aux Etats-Unis (& Brownsville,
Texas, Baltimore, Maryland, & Cape Charkss, Virginie et 4 Chattanooga, Temnessee), au
‘Canada ( Bumside, Nouvelle-Ecosse) ou encore au Japon (C6té et Smoknaars, 1997 ; Cor
et Cohen Rosenthal, 1998), Bien que Pexpérience de Kalundborg se déroule dans un contexte
trés précis qu'il semble difficile de transplanter ailleurs (Erkman, 1998 ; Desrochers 2001;
Lifset et Graedel, 2002), il a montré la pertinence opérationnelle des principaux concepts et
outils
aujourd*hui dans Jes travaux sur écologie industrielle.
Ces outils se confondent souvent avec la recherche du « zéro déchet », qui apparait comme
une sorte de quéte & jamais inachevée, dont kes principes d’écologie industrielle s'attachent a
définir les principaux paramitres. A Timage du « zéro défaut » dans le domaine de bk qualité
totak, cette quéte est, par nature, insatiable et illimitée puisqu'elle représente un absohi qui ne
peut se satisfaire de demi-mesures ou de résultats imparfaits. Cependant, st pertinence sociale
et son caracttre mobilisateur en ont fait un des leitmotive des promoteurs de Pécologie
industrielle. Comme le déclare Hawken, un des principaux auteurs dans ce domaine : « Nous
devons nous soumettre 4 Pidée que les déchets sont des ressources et Eliminer b notion de
déchet de notre syste de production industrielle» (Hawken,1993, p. 209). D’autres
associent Pécologie industrielle & une démarche plus générale de mise en oeuvre du principe
de développement durable (Lowe et Evans, 1995; Keoleian et Gamer, 1994 ; EhrenfeKl,
1997). Ainsi, scbn Boiral et Croteau, kes principes de Técologie industrielle représentent
application la phis coneréte et ht phis complete du concept de développement durable. Dans
cette perspective, Técologie industrielle peut se défnir comme «une approche intégrée
‘ant Aambliorer 'éco-e!
analyse et de réduction des fhix de matidre et d’énergie nce
des mStabolismes industriels par la promotion de technologies, de valeurs et de pratiques
destinges 2 assurer la protection, la durabilté ainsi que ke renouvellement des ressources
nécessaites au développement» (Boinal et Croteau, 2001b, p. 17).
L’écologie industrielle se traduit done par une recherche d’optimisation de Pusige des
ressources qui vise, d'une part, la réduction de la quantité de déchets dans les systtmes
de production et de consommation et, dautre part, leur utilisation comme matigres.premitres
dans différents procédés industriel. Un systéme dit « éco industriel», en phis de réduite la
production des déchets, s‘attache A maximiser I'usage des matires résiduelles ou des produits
29
ab fin de leurs vies uties en les réinroduisant, lorsque c’est possible, comme matitres
premigres dans d'autres procédés de production, La revalorisation et by transformation
des déchets industriels peuvent déboucher sur des opportunités d'affaires pour les entreprises.
Ainsi, les déchets industriels et ménagers sont récupérés comme mutitres premitres,
revalorisés ef transformés en produits & valeur ajoutée pour des marchés diflgrents, ou encore
utiisés comme sources alternatives d°Gnergie en substitution des combustibles
conventionnels.
Cependant, dans le développement actue! du domaine, kes méthodolo gies et les outils
de mise en oeuvre de Pécologic industrielle s’apparenient souvent Ades principes généraux
que les industries sont conviées A appliquer de fagon plus ou moins dogmatique. Ainsi, des
concepts tels que le « 2610 déchet » ou encore kk « dématérialisation de Péconomie »
apparaisemt comme des idéaux qui risquent, s'ils sont appliqués aa lettre, de dgboucher sur
une quéte d’absokt plus que sur des solutions réalistes.
Cette vision trop souvent monolithique de 'écolbgie industrielle tend a ignorer les
conditions concrétes d’application ct es détis organisationnels que soulbvent la mise en
oeuvre de principes généralement définis partir dune perspective encore relativement
spéculttive. Du point de vue industriel, ces principes semblemt pourtant s*apparenter, dans une
large mesure, une logique pragmatique de réduction du gaspillage avers une meilleure
utilisation des matigres et de l'énergie, et done d’une meilleure productivité1
Siellke ne semble pas, en soi, nowvell
a mise en oeuvre d’une tele logique ne saurait reposer
sur des ajustements. sporadiques et édukorés, en continuité avec les opérations habituelles des
entreprises. Elle suppose au contraire la mobilisation de savoirs tec!
icques,
opérationnels,juritiques ou encoremarketing afin de repenser Pactivité de Pentreprise en
fonction des possibilités de valorisation intemes ou extemes des résidus industriels. Ces
changements appellent générale ment une transformation assez radicake des activités
hubituelles. Ainsi Interface, une entreprise américaine spécialisée dans la fabrication de tapis
ct de produits textiles, a recentré ses activités et ses méthodes de production autour de
pratiques directement inspirées de Pécologie industrielle (Johansen, 1998), Pour favoriser
engagement des quelques 6 300 employés dans cette démarche audacieuse, des groupes de
travail, appes « QUEST » (Quality Utilizing Employee Suggestions and Teamwork) ont 6té
créés dans Tensenble de Fentreprise. L’objectif de ces groupes était de sollciter Pimplication
des travailleurs dans la réduetion des déchets, du gaspillage et dans Pamélioration de
Tefficience des procédés. Un programme ambitieux de formation, One World Learning,
également été mis en oeuvre pour promouvoir Vesprit d’équipe et ke partage des
30
connaissances dans Je développement de pratiques d’écologie industrielle. Enfin, plusieurs
environnementalistes, comme D. Brower, ancien président du Sierra Club, ou encore P.
Hawken, auteur dun lie & succés sur Pécologie industrielle (Hawken, 1993)2, ont été
régulsrement invités comme conférenciers et comme conseillers de Péquipe de direction
d'Interfice. Ces initiatives pour promowoir Fapprentssage de nouvelles valeurs etde
nouveaux. comportements verts sont au centre de la vision de 'entreprise, qui sattache
désormais &« permettre A chaque personne de continuellement apprendre et A se développer »
et A.« devenir k premier nom dans le domaine de lécologie industrielle »3. Depuis 1994, kes
efforts pour mettre en oeuvre cette vision ont permis d’économiser prés de 80 millions de
dollars et @augmenter es revenus de 20 % tout en restreignant de fagon tres significative les
déchets et la consommation de matiéres. premires.
Les connaissances et les changements qui ont permis & une entreprise comme Interface de
diminuer les pertes et le gaspillage associés aux déchets ne sauraient se réduire a des mesures;
d'ingénierie cnvironnementale placées sous a seule responsabilité de services techniques.
L’ampleur des changements réalisés montre, au contraire, le développement "une véritable
logque dapprentissage s‘articulant autour d'une redéfinition des compétences-clés de
Ventreprise etreposant sur une large particpation des employés. Quintas, Lettere et Jones
éfinissent ka gestion des connaissances et Papprentissage orgunisationne! comme « le
processus continu de management des savoirs de tout ordre afin de répondre aux besoins
exist
is et émergents, d’identifier et exploiter actif de connaissance acquis et développer de
nouvelles opportunités » (Quintas er al., 1997,p. 387). Compris comme étant k processus
dacquisition, de diffusion et de production de connaissances permettant & une organisation de
s‘adapter collectivement aux changements de environnement et de promouvoir de nouvelles
pratiques (Senge,1990; Garvin, 1991; Argyris, 1999; Quintas et al., 1997), le management des
savoirs semble inhérent aux mesures de réduction et de valorisation des résidus industries.
En effet, comme le montrent ks exemples d'Interfice ou de Kabndborg, Pécologie
industrielle appelle des changements profonds dans les modes de production industrielle
Ces changements se!
Sctuent A travers des processus de transformation, de réinvention et
(imovation continuels (Drejer, 2002), L’inovation technologique et la mise en oeuvre de
nouveaux équipements sont souvent indispensables pour transformer et valoriser les déchets
générés « in situ » ou par d’autres organisations.
Dans la déconstruction et la reconstruction de nouvelles ilées qui caractérisent ce processus
d'imovation, les résultats attendus dépendent de la capacité de Pentreprise a s'adapter & un
eavironnement de plus en plus instabke (Lowe, 1995). Cette capacité d’adaptation ne repose
31
pas seulement sur la mobilisation de connaissances explicites, mais aussi sur des savor-fuire
implicites et des informations circonstancizlles likes 4 Vexpérience de travail des employes,
cen particulier kes opérateurs de procédé
n effet, parce quriks font corps avec Toutil de
production, les opérateurs sont souvent les micux placés pour en comprendre ks aléas et
trouver des solutions visant a réduire les rejets & la source, contribuant ainsi au « bouckage des
systémes producti » (Boiral, 2002). Comme le dit Hart & propos du développement des
habiktés nécessain
Aula mise en ocuvre d'une stratégic de réduction des rejets lt source, «
la nature décentralsée et tacite de cette capacité la rend difficile & observer en pratique (ses
‘causes sont ambigués) et, par conséquent, difficile a dupliquer rapidement » (Hart, 1995,
p. 999). Par kur spécificité, leur caractére plus ou moins tacite et donc difficile a imiter, par
les économies qu’elles peuvent apporter, les connaissances associes aux pratiques d’écologie
industrielle peuvent étre considérées comms un « noyau de compétences » (core
competences) susceptible de déboucher sur des avantages compétitifS durables. En effet, selon
approche des ressources de la stratégie (Wemerfelt, 1984; Prahalad et Hamel, 1990), les
savoirfaire organisationnek représentent une des principakes sources de difigrenciation et
d’avantages compétitifs, L’approche des ressourves propose done de centrer Panalyse
stratégique sur les savoirs tangibles ct intangibles (informations, connaissances, méthodes de
travail, technologies, ete.) développés par lentreprise et qui b distinguent de ses concurrents,
Parce qu’elkes résultent d’un apprentissage collect
f de nouveaux comportement et de
nouvelles technologies, qu’elles reposent sur mobilisation de conn
ances. spécifiques
relatives aux procédés, aux matigres résiduclies et aux différentes. fagons de les valoriver, kes
pratiques d’écologie industrielle sont susceptibles de constituer des compétences clés
pour les organisations, Cependant, quelle est la nature précise de ces compétences ? Comment
les pratiques d’écologie industrielle sont-elles percues et intégrées Titéricur des
organisations ? Quels sont ks défis et les difficultés que ces pratiques soulbvent, en particulier
en matitre de management des savois
‘est pour tenter de répondre & ces questions, pour le
moment dludées dans bb litérature sur ce théme, qu'une étude a été réalisée auprés d'une
tuentaine de responsables environnement et de gestionnaires canadiens ayant mis en oeuvre
une démarche d’écolog: industrielle.
Chapitre 2 : une comparaison entre la logistique marocaine et saoudienne
2-1- La logistique au maroc
Introduction générale :
32
Le secteur du transport et de la logitique est un secteur porteur pour économie nationale
avec 100.000 emplois directs et une contribution de 5% au PIB pour Tensemble deb filére
logistique dont 3% pour fe changement et le transport. L’importance du secteur du transport et
dela logistique se mesure également par son impact direct sur la compétitivité du tissu
économique aussi bien en termes d’export que d’import. Selon le ministére de ! Equipement
cet du Transport, le coft bgistique intégré représente au Maroc 20% du PIB, taux supérieur
cohii d'autres pays émergents comme le Brésil, le Mexique et ht Chine oit ce ratio varie entre
15% et 17%. C’est la maison pour quelle, ce secteur figure parmi kes principales priorités du
gouvemement. Cedemier engage tous ses efforts afin de réaliser une infrastructure de base
moderne, facilitant les échanges locaux, régionaux et intermationaux et assurant la Muidité, le
confort et la sécurité des déplacements des biens et des personnes. Pour accompagner ke
développement du secteur, plusieurs instituts publies dédis aux formations dans les domaines
du transport et de fa logistique ont été eréés au Maroc, notamment par Office de ba
Formation Professionnelle et dela Promotion du Travail (OFPPT - www.ofpptima), Aussi, les
écoles supéricures privées ont intégré dans leur offte de formation des cycles de formation et
des spécialsations dans ces fiitres. Aujourd’hui, Jes métiers du transport et de la bgistique
présentent de trés belles perspectives professionnelles. Les possibilités de carrre sont tts
diversifi¢es (transit et douane, transport routier, maritime, aérien, Rrroviaire...). Toutelbis,
phisiewrs analystes reconnaissent quaujourd’hui bi performance du secteur dans son
ensemble reste Aun stade intermédiaire (Le Maroc a été classé 50@me mondial en 2012 sur la
base de Tindice de performance logstique (LPI) publié par la Banque Mondiale, au fiew du
94¥me rang en 2007), caractéristique des pays émergents. Mais le Maroc présente un fort
potentiel de développement par rapport aux pays qui ont réussi eur mutation logistique: une
offie de services encore inggak (coit, qualité, déla), une demande en moyenne peu
sophistiquée ct un manque d'infastructures spécialisées sur certains flu. Par conséquent, afin
de paller les diverses carences, un contrat-programme portant sur la période 2010-2015 a été
décrété, En effet, les acteurs sectoriels et ks pouvoirs publics ont conscience de Venjeu, Pour
ccux, il va sans dire que la compétitivité logistique constitue un levier important dans
Tamtlioration de la compétitivité des métiers mondiaux du Royaume, dans le cadre du Pacte
National pour Emergence Industrielle, dans l'amélioration de la compétitivite des filigres
agricoles exportatrices du Phin Maroc Vert ou encore dans la compétitivité des produits
marocains sur le terrtoire national (distribution locake, préservation du pouvoir d’achat,
sécurité, hygigne notamment pour les produits fia, transparence sur les prix...). De méme, la
sécurkation et Poptimisation des coits d’importation des matigres premigres énergétiques
33,
représentent un enjeu majeur dans le cadre de la nouvelle stratégie énergétique du Royaume.
Tis'agt done de soutenir dans la durée des efforts importants déja consents & Tégard du
secteur bgitique, et de lancer Jes chantiers stratégiques d'amélioration de sa compétitivité. sur
Tensembk des modes et Tensemble des fix, en commengant par ceux qui impactent le plus
économie du pays tout en impliquant activement les opérateurs privés dans cette nouvelle
phase.
Un ensemble d'atouts font de la logistique au Maroc un s
cteur prometteur et en pleine
évolution, aussi, b position gographique du Maroc au carrefour des échanges entre le Nord
et le Sud, PEst et [Ouest renforce sa vocation logistique. Ce fort potentiel de développement
du secteur, sera davantage mis a profit par une stratégie nationale a horizon 2030 qui est en
cours de mise en euvre pour Pamélioration deb compétit
& bgistique
2-1-1-Le climat actuel de la logistique marocaine
Du c6té de Pentreprise :
Aujourd’hui, avec Touverture progressive des frontiéres et Farrivée en masse de la
concurrence étrangtre, I's entreprises marocaines se retrouvent dans deux situations:
* Certaines ont compris que Cappel a des prestataires de services logistiques. pouvait
constituer un levier d’amiloration de la performance, mnis également une manidre de se
concentrer sur des axes de différenciation par rapport aux concurrents, par exemple en
s de activité,
transformant leurs anciennes aynes de stockage enespaces consacrés 4 des pi
ou Ades bboratoires de recherche.ete.
*D'autres hésitent a extemaliser cette activité du fait de certaines résistances intemes ou
encore apprehensions quant a Timplication d’un fournisseur exteme dans les activités de
Tentreprise. Mais en général, la distribution devient problématique dans un environnement ol
le temps est de largent, et oi1 le point crucial est d’optimiser ses coits pour étre rentable.
Confer sa distribution & un foumisseur exteme permet aussi de profiter de Texpertise
de professionnels dans Je domaine, afin de trouver ba stratégic adéquate au réseau de
distribution de fentreprise par exemple
Sans oublier Tapport en
solutions pour des produits problématiques, tes que les
produits frais (hitiers, égumes, produits de la p@che) qui dans un contexte de
développement touristique, doivent bénéficier "une distribution respectant la chaine
du froid et doivent étre entreposés dans des conditions. strictes pour étre disponibles. en.
cas de besoin,
‘Du coté de I'Etat:
Conscient des enjeux de 1a ghbalisation et Fouverture des frontitres pour ke climat d'affaires
au Maroc. il multiplie es efforts pour contribuer 4 développer le secteur de la Logistique
Libéralisation des transports. publies.routiers
Lancement des travaux pour la construction d'une plate-forme logistique Comme moyen
privikégié pour le développement du tansport combine rail route
Aménagement de 44 wagons pts pour Je transport ferroviaire des conteneurs
Développement de Fotite du Royaume en terme de surfaces exploitables par Paménagement
de zones industrielles répanies sur tout ke temitoire
Aides linvestissement par Toctroi d'autorisations spéciaks A ce tire le CRI se charge de
Vintermédiation entre Tinvestisseur et [Etat et de la négociation de certaines aides au
francement de activité ou du foncier
B. La logistique au Maroc
La logistique constitue un enjeu de premier plan pour le développement économique du
Maroc.La logistique est done un secteur intéressant pour kk Maroc pour diverses raisons
© Métier nécessitant des techniques pointues et rigoureuses : source de professionnalisme et
de modemité
© Créateur d’empbos.
© Levier 4 Pamtlioration de la compétitivité et des performances. des entreprises :
contribuer 2 la réussite dela mise 2 niveau des entreprises marocaines. face A kurs
concurrentes étrangéres dans le cadre de Pouverture des frontiéres
# Source d’attraction des capitaux étrangers et véhiculew d’image : une capitale logistique se
positionne systématiquement comme un carrefour d’échanges, une porte ouverte sur ie
monde.
Le Marve n’en est qu’ ses premiers balbutiements en matiére de Logistique et pourrait étre
une plate-forme d'accueil des intervenants internationaux au sein d’un marché quasi-vierge et
riche en promesses
Voie maritime :
Le transport et la logistique constituent des enjeux de premier pln pour le développement
‘économique des pays partenaires méditerranéens (pays MEDA) qui sont des partenaires de
premier plan de PUnion Européenne.Parmi ces pays, le Maroc est une yéritable ile,
économiquement parlant, puisque 98% de ses échanges extérieurs. s'effectuent par voie
maritime. Le Royaume dispose d'un littoral long de 3.500 Km et d’une infrastructure portuaire
tres développée =
+ Plus de 1 210 ha de bassins
35,
+ Plus de 32.000 m lingaires de quais et appontements
+ Plus de 46 000 m fingaires de jetées et digues
+ 13 installations de réparation navale
+8 termnaux spéciaisés (vracs minéraliers, hydrocarbures, céréales,
+4 gares maritimes
+5 docks silos
‘Trafic commercial global portuaire:
* Le port de Casablanca:
deuxitme port du Maghreb, regroupe a lui seul 70% des échanges. Elaboré juste avant la
premigre guerre mondiale, le projet portuaire de Casablanca offie exemple dun port
modulable, c'est a dire ouvert & tout aménagement qui serait rendu nécessaire par
Tacerossement des trafies ou par des innovations techniques,
* Le port de Mohammedia:
ke portde réception du pétroke brut et lorgane de népartition des produits raffings.Situé dans
Ja zone urbaine dela vill, relif aux axes principaux de circulation et embranché sur la voie
femée principale Casablanca — Rabat, il met & la disposition des usagers des équipements
modemes adaptés aux techniques ks phis récentes.
* Le port de Jorf Lasfar:
Opérationnel depuis 1982, ke port de Jorf Lasfar constitue un point supplémentaire
d’évacuation du phosphate brut et un point spécialsé pour Papprovisionnement du complexe
industriel mis en place pour la transformation des phosphates
Casa-Rabat
Port tanger med
Ce port répond 2a volonté du Maroc de construire un énorme port industriel sur la rive du
détoit ainsi quiun réseau logistique intégré au commerce mondial afin de devenir une
Inauguré en 2007, il sert de base aux principales compagnies maritimes internationales. Il
accueil: des lignes de passagers depuis 2010.
Treste actuellement en construction en raison dela mie en cure de ce grand projet destine
A alkger Je trafic de marchandises. du port de Tanger et agrandir ses instalkitions
Voie aérienne
36
Le Maroc compte 20 aéroports. A hui seul, 'aéroport Mohamed V de Casablanca assure 80%
de Pactivité fret échelle nationale, Desservi par 29 compagnies
1,52% de son trafic fret, dépassant ainsi la croissance nationale qui était de 0,34%en 2003.Son
activité a enregistré une croissance de 88% entre 1991 et 2003. 260.000 avions transitent
annuellement par Tespace aérien national, ce qui incite fortement TONDA a mettre en place
une stratégic A terme visunt & accompagner le développement et la modemisation de ce
secteur par un ensemble d’investissements, tels que lt construction d’un deuxigme terminal &
Vaéroport Mohamed 5
2-1-2-Les opportunités offertes au maroc :
la logistique dans tous ses états, prise comme étant Ie syst2me nerveux de la globalisation
actuelle, qui change rapidement et continuellement. En effet, le monde de la logistique est
passé trés rapidement dune logistique glbake aux logistiques intéerées, fragment
urbaines, intelligentes, vertes ..., autormatisées et robotisées... On parle actuellement d'une
quatritme révolution logistique, appelée révolution logistique 4.0, en paralltle avec a
quatritme révolution industrielle, appele elle aussi industrie 4.0.
En matiére d'industrie, malgré la succession de stratégies volontaristes depuis 2005, toutes les
politiques sectorielles, les contrats-programmes et autres dispositifs mis en marche n'ont pu
sortir Pindustrie marocaine de son marasme et aceéder le Maroc au rang d’économie
industrielle émergente. Ni le plan émergence, ni le Pacte National pour I’Emergence
Industrelle de 2009, ni le Plan d’Accélération Industrielle 2014-2020, ni la stratégie
Jogistique ne parlent de ka 48 révolution industrialo-logistique. C'est seulement a partir de
2017 qu’on commence a parler de cette révolution, Nous donnons des exemples : Le 13 Avril
2017, PAssociation des utilisateurs des systémes informations au Maroc (AUSIM) a organisé
a Casablanca, une conférence sur Ie theme «L’Usine 4.0 : La de révolution industrielle ou
comment accompagner k plan d'accékration de Tindustrie marocaine », En conchision de
cette conférence : Au Marve, la dimension numérique n’exste pas encore dans le plan
daccélération industriclle, mais Pamonce révente de la création d’une Agence de
développement de Iéconomique numérique pourrait contribuer la transition vers ke
numérique des enireprises industrielles marocaines du textie. En effet, rimportance du
secteur textile marocain oblige a se réorganiser et s’investir dans cette nouvelle révolution
industrielle. Tl doit surtout s'y préparer s'il veut survivre et étre compétitif dans la chaine de
valeur mondiale. Le 6 Décembre 2017, le Magazine industris du Maroc a organisé les
canatinges de Tindustrie» & Casablanca, sous le theme de Pindustrie 4.0, réunissant Tes
principaux intervenants dans kb numérique, pour échanger des idées d’imtérét commun dans le
37
domaine, avoir des pistes d’évolution et chercher de nouvelles niches de marché, mais aussi
pour identifier des opportunités d'affaires (B to B ) en abordant des questions techniques,
juridiques, commerciales de cette nouvelle révolution.
Pari ks conclusions :
- Chez la grande majo:
4.0 ne sont pas présentes. - Pour le ministre El Ferdaous, « ke Marve n’entrera. pas dans le
des employés industriels, les compétences requises pour l'industrie
XXle sick tant que Pon n’aura pas une souveraineté sur nos donntes», a ajouté ; «Nous ne
pouvons indéfiniment héberger nos données sur des servewrs étrangers». - Afin damorcer le
Virage 4.0, les PMI (petites et moyennes industries) doivent faire d’importants
investissements, allint de 789% de kur chife d’afhires, pour intégrer de nouvelles
technologies. numériques.
laboration d’une stratégie Industrie 4.0» et d’un plan mun
que sont incontournab les
au sein des PME qui veulent prendre les meilleures déciions en matisre d"investissements
pour acquisition et Vintégration de nouvelles technologies. - Une usine pilote verra le jour au
“Maroc. Son inauguration est programmée pour le premier semestre 2018, alors qu'en Europe,
cen 2020, quatre entreprises sur cing auront numérisé leurs industries en 2020, selon les
prévisions de Bruxells
opportunité pour Féconomie nationale, Elle permettra de drainer davantage d’investissements
- Pour 'beure, la 4 éme révolution industrielle reste encore une
Gtrangers et de créer des milliers demplois. Mais retarder s
mn intégration dans notre plan
daccélération industrielle risquerat de plomber notre industrie et de détoumer dmportants
investisseurs vers d'autres pays. Selon conseil économique, social et environnemental
(CESE), dans son rapport de 2016 (172 pages), qui résume les résultats des Plans Emergence
2009-2015 et d'aceération industriel 2014-2020, ke risque pour le Maroc de rater ke train
d'une nouvelle révolution industrielle ct décrit comment le Royaume pourrait monter & bord.
Pari ks recommandations du CESE :
- L’appel aun changement de paradigme dans la conception des strat
s de développement
au Maroc et une rupture totale par rapport au passé. - Alors que Tactuel Pkn d'accélération
industrielle mise sur les avantages comparatifs en termes de codts de production pour attirer
des industriels étrangers et ainsi atteindre ses objectifs de création de 500.000 emplois
industriels et de porter ke PIB industriel 23 % dei fin 2020, il nin@gre pas la nouvelle
révolution industrielle, usine 4.0,
-La digitalisation, la robotisation, es objets comnectés, Timpression 3D, n'ont pas encore fait
leur véritable entrée dans Tindustrie marocaine et les projections actuelles ne donnent pas de
visibilité quant A une probabk: inversion de tendance & court terme, comme si k Maroc
38
regardait Je train pass
= Il faut revoir tout ke systme du avail : de Féducation et la
recherche 2h formation professionnelle, en passant park statul des organisations syndicales
et la réglementation du travail qui doit étre complement dépoussignée, - Pour sadapter
rapidement & ces changements, le CESE préconse notamment la eréation d'un Conseil
national de 1!
lustrie, qui sera une sorte de centre de réflexion et de pilotage de la politique
industrielle. Des missions qui ne doivent plus relever du seul ministére de Industrie, mais qui
doivent incomber directement au chef du gouvemement, Enfin, nous terminons_par les
Discoury de SM le Roi qui chaque fois insistent sur ks déséquilibres qui entravent k bonne
marche du Marve et pronent un changement du modéle de dévebppement. En voici exemple
du discours du 13 Octobre 2017 4 Foccasion de louverture de la premigre session de la
deuxitme année Kgislative de la 10e Kgistature
«...Le Maroc a réalisé des progrés maniféstes, mondialement reconnus, le modéle de
développement national, en revanche, s’avére aujourd’hui inapte a satisfaire les demandes
pressantes et kes besoins croissants des citoyens, A réduire les disparités catégorielles et es
carts terrtoriaux et & réaliser ba justice sociale. A cet égard, Nous invitons ke gouvemement,
e parlement et les diliéremtes institutions ou instances concemées, chacun dans son domaine
de compétence, A reconsidérer notre mod? de développement pour le mettre en phase avec
Jes évolutions que connat le pays. Nous formons le souhait que soit éluborée une conception,
intégrée de ce mode, propre 2 hi insuffler un nouveau dynamisme, a dépasser les obstacks
qui freinent son évolution et 4 apporter des remédes aux faible
set autres
dysfonctionnements névélés par kes Evaluations menées sur le terra
2-1-3- Les handicaps de la logistique au maroc :
Pour les entreprises marocaines, la bogistique est encore a I'état embryonnaire. Les
entraves sont multiples et complexes. Elles sont d’ordre instiutionnel, organisationne! et
structurel, Les entreprises ont des structures inadaptées la logique logistique (structures
pymmidales, cloisonnement des fonctions, rétention de information, etc.), L’infiastructure
au sens logistique est défalllante. Les régles de ka circulation physique ne sont pas a
Wlaptées, ni
respectées. Le temps variabk, déterminant dans la logistique, a malheureusement une
signification sociale non adaptée & la rationalité de la perception bgistique, méme classique.
La logitique est un défi pour le Maroc. On peut done fster les contraintes ges & by logistique
marocaine dela manitre suivante
1) Les problémes de la logistique interne au Maroc :
-Les insuffisances du transport inteme : Le transport inteme est conitonté principalement
39
au probme du transport routier de marchandise qui ne permet pas aujourd’hui de garantir
une offe de qualité. Le faible développement du transport intermodal contribue aussi a kt
fablesse du secteur.
Au Maroc, k transport routier de marchandises se caractérise par un faible rapport
qualté/prix. Pour de nombreuses entreprises marocaines, le transport routier n'est pas
un probime dans ki mesure oil il est peu onéreux. Il est vrai que ka fabilité et la vitesse
ne sont pas aujourdhui des impératif pour de nombreuses entreprises marocaines non
cexportatrices
Pourtant, la situation devrait assez rapidement changer. En effet, avec la lbéralisation
de Péconomie et Parrivée sur le marché des grands distributeurs. européens, ces
impératifs de qualité et de vitesse devraient émerger.
La demande de transport devrait évoluer & terme vers phis de qualité et de vitesse.
[offre de transport routier marocaine est dans son ensemble abondante mais te
transport routier de qualité ou spé
6 fait crvellement défaut,
Diaprés les professionnels interviewés parla Banque Mondiale et le Ministére de
Péquipement ct du transport, les principaux obstacks la modemisation du transport
routier de marchandises sont kes suivants :
la difficuké d'aceés au financement ;
Jes surcodits, notamment pour le transport international,
Acause des probkimes de
sécurité, notamment aux ports (avec absence de parkings sécurisés dans les zones
dattente) ;
Ja concurrence débyale du transport informe! (pour k transport interme) confortée par
absence de prix de références depuis la dispariion de TONT (Office National des
Transports)
+e manque de contréle pour ks contrevenants aux régles ;
absence de respect strict des
es d'aceds & kh profession
- La mmultiplicité des obstacles au développement d'une logistique moderne au
Maroc
Le développement des prestataires Iogitiques est fieiné pour les raisons suivantes :
coft élevé du foncier pour le développement de phtes-formes. logistiques (notamment 2
Casablanca),ka_méfiance des chargeurs marocains pour communiquer es stocks, es
cadences de production etc...., lt petite taille de nombreux chargeurs qui ne peuvent
supporter le coiit de Pextemalisation, b fablesse de br main d'oeuvre compétente dans
ce domaine. Tous ces é&ments sont interdépendants et, sans une stratégie globale, la
40
logstique au Maroc aura du mal 4 émerger dans un avenir proche. Liofite de
prestations logistiques est faible et peu diversifige au Maroc.
Premirement, kes entreprises qui offrent une palette importante de services Iogistiques
’ne sur tout Ie territoire. marocain.
sont peu nombreuses : moins d'une
Deuxdmement, les cntreprises qui offrent une palette compltte de services Iogistiques
sont quasiment exclusivement des filiales de groupes européens et ont, le plus souvent,
comme clients des entreprises: muitinationales.
Exel et Geodis sont ks deux logisticiens, d’envergure mondiale, qui ont pris pied assez
réc
mment sur le marché marocain de ka iogistique. Ils sont implantés & Casablanca (et
‘Tanger dans Je cas de Géodis). Géodis offre une gamme compBte de services.
Pourtant, ce marché est bipolaire : kes prestations logistiques. sont exchusivement
demandées par des entreprises étrangéres tandis que ks compagnies marocaines
ont recours qu’au transport ou bien au stockage.
La messagerie se développe mais, comme dans les autres domaines, ce secteur de la
logitique reste dominé par les filales d’entreprises multinationals comme DHL,
CHRONOPOST, UPS, FEDEX ou TNT. Contrairement ce qui se passe en Europe, ces
entreprises de messagerie acheminent non seulement du courrier mais aussi des
produits qui requirent une expédition fiable et rapide. Le développement rapide de
cette activité est le symptéme de probkmes de distribution interne au Maroc.
Dans la logstique, les entreprises marocaines se concentrent sur la commervialisation
de solutions de transport plus ou moins complexes. De méme, ke conseil en logitique
est une activité quasiment inexistante au Maroc. Exel est entré sur ce marché mais la
demande reste faible, Les professionnels du métier reRvent que la méfiance des
chargeurs marocains pour une transparence sur leurs stocks, kurs cadences de production
etc....est un ficin important au développement des services logistiques. De
. la petite taille de nombreux chargeurs explique pourquoi I'extema lisation
logstique peine A émerger. La réduction des coats est un des avantages recherchés
‘mais il est compris dans un ensemble d’autres justifications comme lamélioration du
service, la flexibilité ou le recentrage sur les compétences-clés (Van Laarhoven et al.
2000). La réduction des coits est visible a partir du moment oii Pentreprise a une idée
exacte de ces cofits cachés. Pour la majorité des entreprises. marocaines, cette
information n'est pas disponible et ks impératifs de flexibilité et d'améfioration du
service ne sont pas intégerés,
La fablesse des servic
connexes la logistique est patente. Ce fait est comoboré par
41
la fable activité dans ce domaine. Cela a des conséquences importantes pour Je
développement de ce qui fait partie intégrante d'une Iogistique modeme, ke
développement de plates-formes logistiques
Le manque de ressources pour le développement de la logistique : un exemple,
les insuffisances de la formation professionnelle et continue
‘Une logitique performante doit s'appuyer sur quatre niveaux de métiers
Vous aimerez peut-être aussi
- Orgueil et Préjugés - Edition illustrée: Pride and PrejudiceD'EverandOrgueil et Préjugés - Edition illustrée: Pride and PrejudiceÉvaluation : 4.5 sur 5 étoiles4.5/5 (20391)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItD'EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItÉvaluation : 4.5 sur 5 étoiles4.5/5 (3310)
- Art of War: The Definitive Interpretation of Sun Tzu's Classic Book of StrategyD'EverandArt of War: The Definitive Interpretation of Sun Tzu's Classic Book of StrategyÉvaluation : 4 sur 5 étoiles4/5 (3321)
- The 7 Habits of Highly Effective People: The Infographics EditionD'EverandThe 7 Habits of Highly Effective People: The Infographics EditionÉvaluation : 4 sur 5 étoiles4/5 (2487)
- Learn German! Lerne Englisch! ALICE'S ADVENTURES IN WONDERLAND: In German and EnglishD'EverandLearn German! Lerne Englisch! ALICE'S ADVENTURES IN WONDERLAND: In German and EnglishÉvaluation : 3.5 sur 5 étoiles3.5/5 (5622)
- How To Win Friends And Influence PeopleD'EverandHow To Win Friends And Influence PeopleÉvaluation : 4.5 sur 5 étoiles4.5/5 (6538)
- The 7 Habits of Highly Effective PeopleD'EverandThe 7 Habits of Highly Effective PeopleÉvaluation : 4 sur 5 étoiles4/5 (2571)
- How to Win Friends and Influence People: Updated For the Next Generation of LeadersD'EverandHow to Win Friends and Influence People: Updated For the Next Generation of LeadersÉvaluation : 4 sur 5 étoiles4/5 (2327)
- Habit 6 Synergize: The Habit of Creative CooperationD'EverandHabit 6 Synergize: The Habit of Creative CooperationÉvaluation : 4 sur 5 étoiles4/5 (2499)
- Habit 1 Be Proactive: The Habit of ChoiceD'EverandHabit 1 Be Proactive: The Habit of ChoiceÉvaluation : 4 sur 5 étoiles4/5 (2559)
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeD'EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeÉvaluation : 4 sur 5 étoiles4/5 (5814)
- The Picture of Dorian Gray: Classic Tales EditionD'EverandThe Picture of Dorian Gray: Classic Tales EditionÉvaluation : 4 sur 5 étoiles4/5 (9764)
- Wuthering Heights (Seasons Edition -- Winter)D'EverandWuthering Heights (Seasons Edition -- Winter)Évaluation : 4 sur 5 étoiles4/5 (9974)
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeD'EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeÉvaluation : 4.5 sur 5 étoiles4.5/5 (20099)
- Habit 3 Put First Things First: The Habit of Integrity and ExecutionD'EverandHabit 3 Put First Things First: The Habit of Integrity and ExecutionÉvaluation : 4 sur 5 étoiles4/5 (2507)
- Anna Karenina: Bestsellers and famous BooksD'EverandAnna Karenina: Bestsellers and famous BooksÉvaluation : 4 sur 5 étoiles4/5 (7503)
- Alice in Wonderland: Down the Rabbit HoleD'EverandAlice in Wonderland: Down the Rabbit HoleÉvaluation : 4 sur 5 étoiles4/5 (4611)
- The Secret Garden: The 100th Anniversary Edition with Tasha Tudor Art and Bonus MaterialsD'EverandThe Secret Garden: The 100th Anniversary Edition with Tasha Tudor Art and Bonus MaterialsÉvaluation : 4 sur 5 étoiles4/5 (6840)
- The Illustrated Alice in Wonderland (The Golden Age of Illustration Series)D'EverandThe Illustrated Alice in Wonderland (The Golden Age of Illustration Series)Évaluation : 4 sur 5 étoiles4/5 (4347)
- Pride and Prejudice: Bestsellers and famous BooksD'EverandPride and Prejudice: Bestsellers and famous BooksÉvaluation : 4.5 sur 5 étoiles4.5/5 (20479)




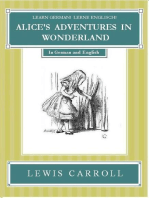

















![Don Quixote: [Complete & Illustrated]](https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/264046221/149x198/541f56cceb/1617238192?v=1)



