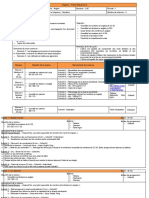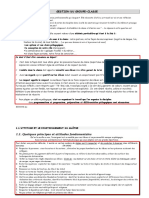Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Guide - Didactique de La Fondation Miro
Transféré par
Pascale GirardTitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Guide - Didactique de La Fondation Miro
Transféré par
Pascale GirardDroits d'auteur :
Formats disponibles
Guide didactique
Fundació Joan Miró
INDEX
0. PRÉSENTATION
I. ALPHABET:
1. Rayures et ronds
2. Pinceau magique
3. Lignes et plans
II. TECHNIQUES:
1. Empreintes et coulures
2. Contre la toile
3. Improvisations sur el mur
III. COULEUR:
1. Eaux de couleurs
2. Mélodies peintes
3. Palette d’émotions
IV. TEXTURE:
1. Chemins en bronze
2. Frottage
3. Incisions
V. FORME:
1. Plein et vide
2. Collage de formes
3. Abstractions
VI. VOLUME:
1. Rencontre d’objets
2. Projet pour un monument
3. L’objet invisible
VII. SYMBOLOGIE:
1. Transformations
2. Bestiaire de signes
3. En affiche
VIII. COMPOSITION:
1. Mosaïque de rythmes
2. Symétries
3. Entre les lignes
IX. SONS:
1. Le tableau sonore
2. Atelier de sons
3. Agenda sonore
X. IMPRESSIONS EN RELIEF
- Guide didactique - Fundació Joan Miró
PRESENTATION
Le projet comprend 30 activités réparties en 10 sections. Chaque section est divisée
en trois niveaux de difficulté, et chaque niveau en deux phases : la première, d’observation
et la seconde, de création. Dès le tout début, le projet a pris en compte toute une diversité
d’utilisateurs (individuel, en milieu familial ou scolaire), avec des inquiétudes, intérêts ou
besoins éducatifs concrets, ainsi que les capacités psychomotrices limitées des premières
années et les ressources à la portée des personnes atteintes de handicaps visuels et auditifs.
Même s’il est possible d’établir une relation entre les niveaux et les âges des utilisateurs,
il faudrait préalablement considérer certains facteurs d’importance potentielle. À titre
d’orientation, nous indiquons que le niveau le plus élémentaire est spécialement adapté aux
utilisateurs dont l’âge est compris entre 3 et 6 ans ; le niveau intermédiaire aux utilisateurs
entre 7 et 12 ans et le niveau supérieur pour le reste. Néanmoins, il serait erroné d’appliquer
ces considérations de manière trop restrictive. De fait, un utilisateur appartenant à la troisième
catégorie peut trouver attrayantes les propositions du niveau élémentaire, tirer profit de
l’expérience et obtenir des résultats forts élaborés.
En ce qui concerne la mise en œuvre du projet dans le milieu éducatif, nous nous sommes
efforcés d’offrir un support structuré, tout à la fois flexible et rigoureux, qui fournira aux
éducateurs des ressources de travail motivantes mais également des informations spécifiques
et des idées pratiques pour développer les contenus à l’école.
est, avant tout, un ensemble. Tel que le démontre ce Guide didactique, les activités
ne sont pas indépendantes de la trame théorique du projet. Leurs destinataires naturels (mais
pas uniques) sont les éducateurs, qui y trouveront des informations supplémentaires et des
propositions complémentaires.
Le guide comprend 27 fiches. Chaque activité dispose d’une fiche didactique, à l’exception
de la dernière section, qui est un questionnaire évaluant les connaissances acquises avec les
vidéos.
Chaque fiche contient une introduction, une explication du fonctionnement de l’activité (En
quoi cela consiste ?), des objectifs didactiques (Où voulons-nous en venir ?), le contenu
éducatif (Qu’apprenons-nous ?), des suggestions pour approfondir le sujet traité (Pour en
savoir plus...), une proposition plastique et une proposition accessible (Avec les yeux fermés).
L’extension tout comme le contenu de l’introduction varient en fonction du niveau : plus
accessibles au niveau 1, et de plus en plus spécialisés à mesure que le niveau monte.
L’introduction apporte des précisions sur le concept générique auquel l’activité est liée, sur le
titre, sur les artistes ou les œuvres sélectionnées dans la première phase.
- Guide didactique - Fundació Joan Miró
Pour en savoir plus... appréhende l’activité d’un point de vue global, faisant partie d’un
ensemble comprenant également les vidéos et une navigation libre, et indique d’éventuelles
concomitances.
Proposition plastique et Avec les yeux fermés se fondent sur l’idée de base de l’activité et
proposent deux options alternatives : travailler dans la salle de classe ou à la maison, non
pas de manière virtuelle mais avec du matériel physique, et travailler avec une perspective
sensorielle plus vaste, abandonnant le sens de la vue pour se concentrer sur la richesse
perceptive du tact, de l’ouïe ou du goût.
Comme complément aux activités, ce Guide didactique vous fournit des schémas pour
imprimer. Il s’agit d’images pdf déchargeables pour rendre accessibles quelques œuvres de
Miró aux personnes aveugles et malvoyantes. Pour obtenir des reliefs tactiles thermogonflés,
il faut du papier multicouche et un four « fuse » spécifique.
- Guide didactique - Fundació Joan Miró
Alphabet niveau 1. Rayures et ronds
RAYURES ET RONDS
INTRODUCTION
Le point et la ligne sont des éléments de base du langage plastique. Ces éléments apparaissent
couramment, sous forme de nombreuses variations, dans la création de Joan Miró.
On trouve notamment des ronds noirs, souvent reliés par des lignes, qui nous rappellent des
planètes ou des constellations. Des taches de couleurs pures estompées nous font penser à
des astres en suspens dans l’espace.
EN QUOI CELA CONSISTE ?
La première phase consiste à observer trois peintures de Miró. Nous isolerons ensuite les
points et lignes afin de les classer.
La deuxième phase consiste à réaliser une création avec les points et les lignes que nous
aurons classés. Ces éléments n’apparaissent jamais de manière individuelle mais en série
et sont distribués sans ordre apparent. On pourra tenter de les organiser ou créer une
composition aléatoire.
OÙ VOULONS-NOUS EN VENIR ?
• Observer les points et lignes dans l’œuvre de Miró
• Identifier les éléments de base de l’alphabet visuel : le point et la ligne
• Différencier leurs caractéristiques
• Classer les points et les lignes
QU’APPRENONS-NOUS ?
• Le point et la ligne
• Miró utilise les points et les lignes dans certaines de ses œuvres
• Le point et la ligne peuvent avoir divers attributs (taille, couleur, épaisseur, définition)
POUR EN SAVOIR PLUS...
Nous recommandons de combiner cette activité avec CHEMINS EN BRONZE (Texture,
niveau 1) pour étudier le rapport entre le point et la ligne et pour concevoir la ligne comme
une succession de points ou comme un point en mouvement.
- Guide didactique - Fundació Joan Miró
Alphabet niveau 1. Rayures et ronds
PROPOSITION PLASTIQUE : Collage recyclé
En premier lieu nous devrons rassembler divers matériaux que nous pourrons représenter
comme points et lignes (bouchons, confettis de perforatrice de papier, boutons, capsules de
café, ficelle, laine, rubans, papier toilette ou journal, câbles…).
Puis nous répartirons abondamment de la colle blanche sur un support rigide. Nous créerons
sur ce dernier notre composition avec les matériaux dont nous disposons. Nous pouvons
réaliser une création préméditée ou, suivant l’exemple de l’activité en ligne, nous pouvons
laisser tomber les composants, les lancer ou les disposer au hasard.
Dès que le collage sera sec, nous pouvons le peindre avec de la peinture acrylique ou de la
détrempe mélangée à de la colle. On pourra utiliser une seule couleur si l’on souhaite mettre
le contraste des points et des lignes en valeur, ou différentes couleurs si l’on désire faire
ressortir certains éléments par rapport à d’autres.
AVEC LES YEUX FERMÉS : Glane et grappille
Avec certains types de papier fins (papier de soie, papier aluminium, etc.), nous pouvons
modeler des boulettes et des rondins fins et allongés, comme avec de la pâte à modeler.
Nous mélangeons le tout dans un sac.
Avec les yeux fermés, nous tirerons les formes du sac et les classerons par rapport à l’épaisseur
et à la longueur.
Nous pourrons ensuite réaliser une composition libre en combinant les formes.
Il est primordial d’effectuer toute l’activité sans regarder afin de stimuler la reconnaissance
des formes uniquement avec le toucher.
- Guide didactique - Fundació Joan Miró
Alphabet niveau 2. Pinceau magique
PINCEAU MAGIQUE
INTRODUCTION
La tache est l’empreinte laissée par le pinceau au contact avec une toile ou toute autre
surface. C’est un point ou une ligne faits spontanément, sans peaufiner. Il peut s’agir d’une
simple tâche, d’un coup de pinceau ou s’étendre au-delà de cela.
Suivant le mode d’application, les coups de pinceau peuvent être visibles ou non. En ce qui
concerne Miró, les coups de pinceau sont généralement perceptibles, qu’ils remplissent le
fond ou qu’ils apparaissent au premier plan.
EN QUOI CELA CONSISTE ?
Cette activité nous permet d’observer certaines peintures de Miró de près.
La première phase consiste à localiser dans le tableau une paire de fragments décontextualisés
où l’on distingue les taches.
Lors de la seconde phase, tu disposes d’un pinceau imaginaire qui réalise des taches
de diverses formes et couleurs. L’apparition des taches est imprévisible, de sorte que la
réalisation dépendra à tout moment de ta capacité d’adaptation et de savoir tirer profit des
possibilités créatives du hasard.
OÙ VOULONS-NOUS EN VENIR ?
• Observer les œuvres de Miró dans le détail
• Identifier les taches dans les œuvres observées
• Utiliser la tache comme ressource plastique pour créer des compositions libres
QU’APPRENONS-NOUS ?
• Miró se sert de la tache dans ses œuvres
• La tache est un élément de base du langage visuel
• La tache peut avoir divers attributs (taille, forme, couleur, régularité)
POUR EN SAVOIR PLUS...
Nous recommandons de combiner cette activité avec RAYURES ET RONDS (Alphabet, niveau
1) pour travailler les éléments de base du langage visuel.
Nous recommandons de combiner cette activité avec BESTIAIRE DE SIGNES (Symbologie,
niveau 2) par rapport aux attributs de la tache et au fait que celle-ci évoque souvent l’ustensile
qui l’a généré.
- Guide didactique - Fundació Joan Miró
Alphabet niveau 2. Pinceau magique
PROPOSITION PLASTIQUE : Collection de taches
Nous confectionnons un inventaire de taches faites avec des substances et dans des
contextes divers.
Nous découpons quelques feuilles de papier de différentes qualités et couleurs, mais avec la
même mesure ; ces formes nous serviront de base pour les échantillons. Une fois une tache
obtenue, nous annoterons la substance et l’ustensile employés, le lieu et la date d’obtention
(ex. : « Confiture de fraise. Cuillère en bois. Cuisine de grand-mère, août 2010 »).
Pour éviter la dispersion des échantillons et maintenir l’ordre de la collection, il faudra établir
un système de stockage.
Nous pourrons composer notre collection avec celle de nos compagnons. D’autre part, ce
recueil peut nous être utile pour obtenir certains résultats dans de futures créations.
AVEC LES YEUX FERMÉS : Pluie de couleurs
Il nous faudra de la peinture légèrement liquide et des brosses à dents, un papier de grand
format et divers objets.
Nous plaçons les objets sur le papier. Puis nous trempons la brosse dans la peinture et
faisons passer le doigt sur les poils de la brosse en direction des objets. De petites taches
de couleur éclaboussent aléatoirement les objets et le papier. Finalement, nous retirons les
objets et il ne restera que la silhouette des objets en négatif.
- Guide didactique - Fundació Joan Miró
Alphabet niveau 3. Lignes et plans
LIGNES ET PLANS
INTRODUCTION
Vassily Kandinsky établit le point, la ligne et le plan comme les éléments de base rendant
une composition visuelle possible. La ligne est perçue par Kandinsky comme le tracé que
décrit un point en se déplaçant ; le plan, quant à lui, est vu comme une surface résultant du
croisement de diverses lignes.
Les compositions abstraites de Piet Mondrian se basent sur l’organisation sur une surface
blanche de lignes verticales et horizontales qui se coupent perpendiculairement. Cela
engendre la création de plans de couleur blanche, noire, jaune, rouge et bleue.
La ligne et le plan constituent également le fondement des créations de Victor Vasarely. Un
patron géométrique répété et modifié produit un effet optique de volume et de mouvement.
En 1929, Miró réalise plusieurs collages avec des papiers d’usage courant. Les lignes, très
délicates, contrastent avec les plans aux couleurs très austères intentionnellement mal
découpés.
Les intersections de formes générant des plans aux couleurs pures constituent une singularité
du style de Miró. Ces entrecoupements présentent souvent un aspect de mosaïque ou
d’échiquier.
Dans les années soixante, la gestualité domine une grande partie de l’œuvre de Miró. Les
lignes (auparavant fines et bien définies) sont à présent le résultat d’un tracé épais et spontané.
EN QUOI CELA CONSISTE ?
La première phase consiste à choisir une image, à l’observer avec attention et à identifier une
suite de plans et de lignes.
La seconde phase consiste à réaliser une composition à partir de l’usage de différents types
de plans et lignes. Tu pourras les utiliser librement et autant de fois que tu voudras et en
modifier les dimensions et la position.
OÙ VOULONS-NOUS EN VENIR ?
• Observer avec attention les œuvres d’art de différents artistes
• Identifier les lignes et plans dans diverses œuvres d’art
• Créer une œuvre plastique à partir de l’usage de lignes et de plans
QU’APPRENONS-NOUS ?
• Éléments du langage visuel : Lignes et plans
• Observation de l’usage que font divers artistes des lignes et des plans
• Création d’œuvres plastiques à partir de lignes et de plans
- Guide didactique - Fundació Joan Miró
Alphabet niveau 3. Lignes et plans
POUR EN SAVOIR PLUS...…
Pour approfondir le travail sur le plan, nous recommandons de combiner cette activité avec
MÉLODIES PEINTES (Couleur, niveau 2) et avec COLLAGE DE FORMES (Forme, niveau 2).
Nous recommandons de combiner cette activité avec ENTRE LES LIGNES (Composition,
niveau 3) pour un usage plus conceptuel de la ligne.
PROPOSITION PLASTIQUE : Collage dadaïste
Il nous faudra du carton à découper, une feuille de bristol ou une planche fine de contre-plaqué
comme support, du cirage à chaussures de couleur noire et une brosse pour l’appliquer,
de la ficelle, de la colle, un pinceau et des ciseaux. En premier lieu, découpe le carton en
réalisant des formes géométriques régulières ou irrégulières, puis coupe la ficelle en bout de
différentes longueurs.
L’activité est inspirée d’un procédé de travail dadaïste : éparpille les différents plans de carton
découpé et colle ceux qui se projettent sur la planche de support dans la position où le hasard
les aura distribués. Puis fais de même avec les lignes de ficelle coupée. Une fois la phase de
collage dadaïste terminée, complète le travail avec des taches de couleur, en appliquant le
cirage à l’aide de la brosse.
AVEC LES YEUX FERMÉS : Téléphone tactile
L’activité est inspirée du jeu du téléphone et requiert un nombre minimum de participants.
Ceux-ci se placeront en file, l’un derrière l’autre. La personne située à la fin de la file fait un
dessin assez simple sur du papier. Elle peut le faire en traçant des lignes indépendantes,
des points organisés rappelant une figure, des formes fermées (plans) ou en combinant des
points et des lignes. Il reproduit ensuite ce même dessin sur le dos de son compagnon, en y
faisant pression avec son doigt. L’opération est répétée successivement, d’un participant à
l’autre, jusqu’à parvenir au chef de file. Le dernier participant transfère l’information qui lui est
parvenue sur le papier. Compare alors le résultat final avec l’idée originale. Au lieu de faire un
dessin, tu peux utiliser de la pâte à modeler sur un support rigide.
- Guide didactique - Fundació Joan Miró
Techniques niveau 1. Empreintes et coulures
EMPREINTES ET COULURES
INTRODUCTION
Miró a commencé à peindre en utilisant les procédés et les ustensiles conventionnels d’un
peintre : le crayon, le pinceau, la toile, des tubes de peinture....
Par la suite, il utilise des pots de peinture et des brosses, mais il appliquera également la
couleur avec les doigts, avec les mains et avec les pieds, éclabousse la toile ou y verse
directement la peinture avec un récipient.
EN QUOI CELA CONSISTE ?
La première phase consiste à compléter une peinture de Miró en insérant les fragments qui
y manquent. Chaque fragment révèle un aspect de la solution technique employée par Miró.
La seconde phase consiste à réaliser une création libre à partir de deux ressources plastiques
que nous avons observées dans l’œuvre de Miró : la coulure et l’empreinte. Tu disposes
d’un pinceau pour faire des coulures et d’une chaussure et d’une main pour réaliser des
empreintes. À chaque fois que tu sélectionnes l’un de ces éléments, le curseur agit comme
ce dernier. Dans le cas du pinceau, en déplaçant le curseur petit à petit la quantité de peinture
appliquée sera plus importante tandis que si le mouvement est rapide, la coulure sera plus
fine. Tout comme cela arrive dans la réalité, de temps en temps la peinture se termine et il
faut à nouveau tremper le pinceau. Cependant, la couleur ne sera pas la même. La main et la
chaussure aussi doivent être à nouveau imprégnées de couleur après quelques estampages.
OÙ VOULONS-NOUS EN VENIR ?
• Observer avec attention certaines ressources plastiques (coulure, éclaboussure et empreinte)
dans l’œuvre de Miró
• Découvrir différentes façons d’appliquer la peinture
• Utiliser les ressources observées pour réaliser des productions personnelles
QU’APPRENONS-NOUS ?
• Ressources plastiques que l’on peut apprécier dans l’œuvre de Miró
• Ressources plastiques d’avant-garde (coulure, éclaboussure et empreinte)
POUR EN SAVOIR PLUS...
Nous recommandons de combiner cette activité avec BESTIAIRE DE SIGNES (Symbologie,
niveau 2) pour étudier les possibilités plastiques de l’empreinte.
Nous recommandons de combiner cette activité avec CHEMINS EN BRONZE (Texture, niveau
1) pour étudier le mouvement comme élément générateur d’images.
- Guide didactique - Fundació Joan Miró
Techniques niveau 1. Empreintes et coulures
PROPOSITION PLASTIQUE : Coulures inventées
Sur un support absorbant (papier d’aquarelle, papier de cuisine, carton épais...) nous tentons
d’obtenir des effets surprenants avec de la peinture très liquide (il peut s’agir de détrempe
dissoute dans l’eau, d’encre de chine, de café, de jus, etc.).
Certains ustensiles employés offriront des résultats similaires à ceux de l’activité en ligne,
tandis que d’autres seront le fruit de l’expérimentation. Nous pouvons utiliser des ustensiles
que nous trouverons à la maison, qui se remplissent et se vident, tels des seringues médicales,
des compte-gouttes, des brosses à dents ou des pulvérisateurs de parfum. Nous pouvons
appliquer la peinture avec le support en position horizontale ou verticale. Nous pouvons
également verser la peinture légèrement liquide et incliner le support d’un côté et de l’autre
pour que la peinture coule et ouvre des chemins dans diverses directions.
AVEC LES YEUX FERMÉS : Laisser sa marque
L’expérience consistant à peindre avec les mains et les pieds s’avère également intéressante
à réaliser avec les yeux fermés. Le résultat nous surprendra sans le moindre doute.
Il nous faudra de la peinture pour mains, des plateaux pour y verser la peinture et un grand
morceau de papier d’emballage.
Nous trempons les mains ou les pieds dans les plateaux de peinture de différentes couleurs
puis nous déplaçons librement sur le papier en y laissant des empreintes. Sans même nous
en rendre compte, nous réaliserons une composition avec les traces des empreintes de pied
et de main. Une fois terminé, nous ôtons le bandage de nos yeux pour découvrir notre œuvre
sur le papier.
- Guide didactique - Fundació Joan Miró
Techniques niveau 2. Contre la toile
CONTRE LA TOILE
INTRODUCTION
Le contact de Miró avec les artistes de sa génération et avec les avant-gardes artistiques
qu’il rencontre à Paris le font remettre en question l’usage des matériaux traditionnels. Les
cubistes et les futuristes sont les premiers à intégrer la technique du collage à leur travail. À
la fin des années vingt, Miró commence à l’utiliser à son tour.
La remise en question de la valeur de l’œuvre d’art soulevée par les dadaïstes et les surréalistes
est évoquée des années plus tard par Miró avec les Toiles brûlées. Miró les entaille, les piétine,
les brûle.
EN QUOI CELA CONSISTE ?
La première phase consiste à observer trois œuvres. Nous en sélectionnons une. Nous mettons
en rapport une suite d’ustensiles avec les divers effets plastiques que présente l’œuvre.
Pour la seconde phase nous disposons d’une toile et de quelques ustensiles à expérimenter.
Tu peux lui appliquer de la peinture, déchirer la toile ou la brûler partiellement.
OÙ VOULONS-NOUS EN VENIR ?
• Découvrir les ressources qui amplifient les possibilités plastiques au-delà des techniques
académiques classiques
• Identifier certains ustensiles avec lesquels les effets plastiques observés peuvent s’obtenir
• Simuler un travail plastique dans lequel les ressources observées sont utilisées
QU’APPRENONS-NOUS ?
• Les ressources plastiques d’avant-garde (coulure, entaille, éclaboussure, empreinte)
• L’expérimentation et la recherche de nouvelles ressources créatives dans l’œuvre de Miró
POUR EN SAVOIR PLUS...
Nous recommandons de visionner la vidéo LES DERNIÈRES ANNÉES.
- Guide didactique - Fundació Joan Miró
Techniques niveau 2. Contre la toile
PROPOSITION PLASTIQUE : Contre le carton
Nous pouvons dessiner sur un carton d’emballage en utilisant des techniques atypiques telles
que nous servir d’incisions produites par une fourchette en forçant légèrement sur le carton.
Nous pouvons ensuite compléter le dessin ou les formes élaborées à partir de la séquence de
petits trous avec quelques touches de couleur. Nous pouvons également obscurcir le carton
en faisant dégouliner de l’huile avec un huilier, en vaporisant du vinaigre ou en appliquant du
cirage à chaussure avec une brosse, un chiffon ou l’éponge de l’applicateur.
AVEC LES YEUX FERMÉS : Silhouettes poinçonnées
Il nous faudra un carton d’emballage, un poinçon et un coussinet ou une base moelleuse.
Nous disposons le carton sur la base et le poinçonnons pour réaliser la forme souhaitée.
Une fois terminé, nous retournons le carton de sorte que les formes soient perceptibles au
toucher. Nous pouvons également appliquer différentes techniques de texture telles que la
cire, la peinture, les crayons de couleur, le vernis... Si l’activité est réalisée en groupe, nous
pouvons tenter de reconnaître les formes créées par les autres compagnons avec les yeux
fermés.
- Guide didactique - Fundació Joan Miró
Techniques niveau 3. Improvisations sur le mur
IMPROVISATIONS SUR LE MUR
INTRODUCTION
Les dernières années de sa vie, Miró exécute un grand nombre de peintures de grandes
dimensions. En termes de dimensions comme pour les procédés employés (brosses,
empreintes, mouvements du corps, amples coups de pinceau), ces œuvres nous rappellent
souvent le concept de fresque murale.
De nombreux artistes, contemporains de Miró mais aussi ultérieurs, se sont intéressés aux
grands formats et ont choisi des techniques expressives et l’incorporation de matériaux.
Dans les années soixante du XXe siècle, le recours au mur comme support de l’œuvre d’art
se popularise.
EN QUOI CELA CONSISTE ?
La première phase consiste à choisir une œuvre parmi les trois qui sont proposées. Nous
mettons en rapport les ustensiles utilisés pour obtenir différents effets plastiques.
La seconde phase consiste à réaliser une activité plastique en simulant le travail sur un mur.
OÙ VOULONS-NOUS EN VENIR ?
• Découvrir les ressources qui amplifient les possibilités plastiques au-delà des techniques
académiques classiques
• Identifier certains ustensiles avec lesquels les effets plastiques observés peuvent s’obtenir
• Simuler un travail plastique de grand format dans lequel les ressources observées sont
utilisées
QU’APPRENONS-NOUS ?
• Ressources plastiques (collage, coulure, éclaboussure)
• L’expérimentation et la recherche de nouvelles ressources plastiques dans l’œuvre de Miró
• Le grand format
POUR EN SAVOIR PLUS...
Nous recommandons de visionner la vidéo LES DERNIÈRES ANNÉES.
- Guide didactique - Fundació Joan Miró
Techniques niveau 3. Improvisations sur le mur
PROPOSITION PLASTIQUE : Image finie
Nous pouvons expérimenter la sensation du travail en grand format lors d’une sortie à la
plage. Il suffit de délimiter un espace sur le sable dans lequel nous procéderons au travail
plastique. Puis nous sélectionnons comme matériau de travail les ressources naturelles
propres au contexte (algues, coquillages, pierres, bois, branches, eau de mer). Avec le
matériau trouvé, nous réalisons une composition en agissant avec agressivité et laissons
le hasard produire des effets esthétiques sur la parcelle de sable délimitée. Nous pouvons
compléter le travail avec une certaine préméditation en calculant la disposition de certains
éléments. Nous pouvons également utiliser des ustensiles pour dessiner des traits, faire des
coulures de sable mélangé à l’eau, inclure des empreintes de chaussure ou d’autres objets.
Il s’agit d’une création éphémère de sorte que si nous voulons conserver un souvenir de
l’expérience, il faudra photographier le résultat.
AVEC LES YEUX FERMÉS : Composition éphémère
Il s’agit de réaliser une composition éphémère de grand format. En premier lieu, nous
délimitons un espace dans une salle. Cela constitue notre support. Nous déterminons un
nombre d’éléments (chaises, livres, crayons, corbeilles à papier...) pour chaque participant.
Les objets perdent leur usage habituel et se transforment en composantes d’un ensemble
esthétique.
Successivement, chaque participant dispose ses éléments, mais sans regarder. Une fois
l’œuvre terminée, nous nous y déplaçons et l’explorons. Nous pouvons réfléchir à ce que
nous croyons que cette distribution inhabituelle nous transmet. Puis nous la démonterons et
chaque objet reprendra sa fonction ; tout redevient comme avant.
- Guide didactique - Fundació Joan Miró
Couleur niveau 1. Eaux de couleurs
EAUX DE COULEURS
INTRODUCTION
Au début, Miró utilise une gamme de couleurs très ample. Mais au fil du temps, sa palette se
réduit aux couleurs primaires, secondaires, au noir et au blanc. La couleur blanche est souvent
celle de la toile, que Miró ne recouvre pas complètement. Les couleurs sont généralement
uniformes, sans nuances.
Les trois œuvres choisies pour cette activité sont uniquement composées des couleurs
primaires, du noir et du blanc.
EN QUOI CELA CONSISTE ?
La première phase consiste à observer trois tableaux de Miró et d’en choisir un. Remplis trois
récipients avec les couleurs primaires qui apparaissent, un pour chaque couleur.
Pour la seconde phase, tu as besoin d’une série de verres que tu rempliras avec les couleurs
obtenues lors de la première phase. Tu pourras les remplir à moitié, complètement, y mélanger
deux couleurs ou les laisser vides. Tu peux également les changer de place. Un son est
associé à chaque couleur ; il s’écoute à chaque fois que la couleur est introduite dans le verre.
Grâce à ces sons isolés, tu pourras à tout moment écouter la mélodie créée et la modifier
indéfiniment.
OÙ VOULONS-NOUS EN VENIR ?
• Observer l’usage que fait Miró de la couleur dans certains de ses tableaux
• Identifier les couleurs primaires
• Mélanger les couleurs primaires et découvrir les couleurs secondaires obtenues
QU’APPRENONS-NOUS ?
• Couleurs primaires et secondaires
• Usage que fait Miró des couleurs dans ses œuvres
POUR EN SAVOIR PLUS...
Pour approfondir le travail sur le mélange des couleurs, nous recommandons de combiner
cette activité avec MÉLODIES PEINTES (Couleur, niveau 2).
- Guide didactique - Fundació Joan Miró
Couleur niveau 1. Eaux de couleurs
PROPOSITION PLASTIQUE : Lumière de couleur
Rassemble des bouteilles d’eau ou des pots de conserve transparents pouvant se fermer, en
plastique ou en verre.
Dans des récipients bien différenciés, prépare des eaux de couleurs à l’aide de cotons de
vieux marqueurs ou avec de la teinture pour habits dissoute dans l’eau (il est recommandé
d’utiliser des gants).
Prépare d’abord les trois couleurs primaires. À l’aide d’un entonnoir, remplis les bouteilles ou
les pots transparents avec ces eaux de couleurs. Puis combine les couleurs primaires suivant
diverses proportions pour obtenir des variations de ton et remplis des bouteilles ou des pots
avec ces mélanges.
Place alors les récipients avec les eaux de couleurs devant une fenêtre. La lumière produit
un effet similaire à celui des vitraux : les pots projettent des reflets de couleur dans l’espace.
AVEC LES YEUX FERMÉS : Couleurs aromatiques
Pour un enfant aveugle, il est très difficile d’identifier les couleurs. Un moyen facile de créer
avec des « couleurs » consiste alors à utiliser des marqueurs avec des odeurs. Chaque
couleur est associée à un arôme caractéristique, tel que le citron, la fraise ou le chocolat.
Pour intensifier la perception « olfactive » des couleurs, réalise l’activité avec les yeux bandés.
Tu pourras ensuite comparer les résultats avec tes compagnons.
Si tu n’as pas de marqueurs à odeur, tu peux également réaliser l’activité avec des essences
aromatiques mélangées à de la peinture à doigts. Il est néanmoins important de respecter un
lien analogique entre les couleurs et les essences sélectionnées.
- Guide didactique - Fundació Joan Miró
Couleur niveau 2. Mélodies peintes
MÉLODIES PEINTES
INTRODUCTION
Au fil du temps, Miró simplifie les figures et limite les couleurs. Dès la fin des années trente,
sa palette se réduit aux couleurs primaires, secondaires, au noir et au blanc. De même, il opte
pour des couleurs uniformes et renonce aux ombres.
EN QUOI CELA CONSISTE ?
La première phase consiste à observer trois tableaux de Miró et d’en choisir un. Extrais ensuite
les couleurs primaires et secondaires du tableau et remplis le récipient.
Lors de la seconde phase, réalise une création avec des formes géométriques. Tu peux
choisir la même forme ou des formes différentes, les disposer de manière isolée ou les faire
s’entrecouper. Tu peux également appliquer de la couleur sur le fond et sur les figures.
En outre, tu peux écouter la mélodie obtenue. Conformément aux affirmations de Vassily
Kandinsky relatives à la musique et à la peinture, chaque couleur est associée à un instrument
différent. Les formes déterminent l’acuité ou la gravité du son tandis que leurs dimensions
affectent son intensité. Le rythme de la mélodie dépend de la couleur de fond.
OÙ VOULONS-NOUS EN VENIR ?
• Observer les œuvres de Miró et en apprécier la variété chromatique
• Identifier les couleurs primaires et secondaires
• Utiliser les couleurs primaires et secondaires pour réaliser des compositions libres
QU’APPRENONS-NOUS ?
• Les couleurs primaires et secondaires
• Miró utilise les couleurs primaires et secondaires dans ses œuvres
POUR EN SAVOIR PLUS...
Pour approfondir le travail sur le mélange des couleurs, nous recommandons de combiner
cette activité avec EAUX DE COULEURS (Couleur, niveau 1).
Pour étudier l’usage et la valeur expressive de la couleur, nous recommandons de combiner
cette activité avec PALETTE D’ÉMOTIONS (Couleur, niveau 3).
Pour approfondir le travail sur les formes géométriques et organiques, nous recommandons
de combiner cette activité avec COLLAGE DE FORMES (Forme, niveau 2).
Nous recommandons également de visionner la vidéo LES COULEURS DE MONT-ROIG.
- Guide didactique - Fundació Joan Miró
Couleur niveau 2. Mélodies peintes
PROPOSITION PLASTIQUE : Couleurs découpées
Rassemble du papier journal et du papier usagé. Avec ces papiers et de la détrempe de
couleurs primaires, confectionne artisanalement du papier de couleurs. Tu peux appliquer les
couleurs à l’état pur pour obtenir du papier aux couleurs primaires ou associer deux couleurs
pour obtenir des couleurs secondaires.
Une fois la peinture sèche, crée une composition en découpant directement les formes. Colle
celles-ci sur un support. Tu pourras les disposer de manière isolée ou les superposer.
AVEC LES YEUX FERMÉS : La saveur des couleurs
Cherche des bonbons de couleur aux saveurs caractéristiques : le rouge (fraise), le jaune
(citron) et le bleu (anis) pour les couleurs primaires ; l’orange, le vert (menthe), le violet (mûre)
pour les couleurs secondaires ; blanc (vanille) et noire (réglisse). Puis broie-les et combine-
les par paires élémentaires afin de constituer des mélanges de saveurs et de couleurs.
L’équivalent de la gamme de nuances qu’offre une quelconque couleur s’obtient ici aussi en
variant les proportions du mélange. Tu pourras ensuite tenter d’obtenir des combinaisons
plus complexes, avec base de trois ou quatre saveurs. Prépare les combinaisons avec soin,
en tentant d’ajuster les mesures par moitiés ou par quarts.
L’activité consiste à identifier, avec les yeux bandés, les combinaisons élaborées par un
compagnon et à s’aventurer à deviner les pourcentages de couleur de la préparation. Chaque
création est, naturellement, éphémère.
- Guide didactique - Fundació Joan Miró
Couleur niveau 3. Palette d’émotions
PALETTE D’ÉMOTIONS
INTRODUCTION
Certains artistes ont spécialement accentué la capacité expressive de la couleur afin de
transmettre certains états d’esprit ou pour éveiller des émotions concrètes chez le spectateur.
William Turner a étudié les effets de la lumière sur le paysage à partir des théories de couleurs
de son époque. Il peignait des scènes de brouillard, de fumée, de tempête ou dans lesquelles
les motifs apparaissaient diffus.
Les expressionnistes allemands faisaient un usage arbitraire de la couleur car ils ne peignaient
pas ce qu’ils voyaient mais cherchaient à refléter le sentiment intérieur que leur suscitait le
sujet.
Peu avant la guerre civile espagnole, Miró réalise une série de peintures qu’il appelle
« sauvages ». La couleur y est appliquée de manière subjective, avec des intentions de
dramatisation.
Les peintures les plus caractéristiques de Mark Rothko sont abstraites et symétriques ; elles
invitent à la méditation. Elles sont composées de bandes de couleurs intenses aux limites
diffuses sur le contour de la toile.
Andy Warhol a introduit la sérigraphie dans l’art. Ce système permettant de réaliser des
reproductions multiples d’un même thème était très courant dans le domaine de la publicité.
En toute cohérence, il appliquait des couleurs uniformes, industrielles et criardes.
Les Portraits imaginaires d’Antonio Saura présentent une gamme limitée de couleurs (gris,
ocres, terres, noir et blanc). L’absence de tons vifs, la spontanéité et la rondeur des coups de
pinceau transmettent une sensation d’angoisse.
EN QUOI CELA CONSISTE ?
La première phase consiste à choisir une émotion parmi les douze options possibles. En
fonction de cela, choisis l’une des peintures proposées et extrais-en quelques couleurs.
La seconde phase consiste à choisir une photographique. Avec la palette de couleurs de la
phase précédente, essaie d’exprimer l’émotion de référence ou des sensations qui y sont
associées.
Tu pourras finalement comparer ta création avec une peinture de Miró sur le même motif de
la photographie.
OÙ VOULONS-NOUS EN VENIR ?
• Utiliser une couleur comme moyen d’expression
- Guide didactique - Fundació Joan Miró
Couleur niveau 3. Palette d’émotions
QU’APPRENONS-NOUS ?
• La couleur évoque des émotions et constitue un moyen d’expression plastique
• Miró utilise dans certaines de ses œuvres la couleur comme une importante ressource
d’expression
POUR EN SAVOIR PLUS...
Pour observer l’usage que fait Miró de la couleur en tant que moyen d’expression, nous
recommandons de visionner les vidéos PEINTURES SAUVAGES et NATURE MORTE AU
VIEUX SOULIER.
PROPOSITION PLASTIQUE : Portraits émotionnels
Fais des photographies de tes camarades de classe, amis ou des membres de ta famille.
Propose à la personne dont tu as fait le portrait d’exagérer le geste pour exprimer l’un de ses
traits de caractère ou une quelconque émotion. Fais une photocopie en noir et blanc de la
photographie et agrandis-la au format DIN A4 (le fais qu’il s’agisse d’une photocopie garantit
que l’encre ne se dissoudra pas dans l’eau).
Avec des aquarelles ou de la détrempe diluée, tu pourras travailler librement la couleur sur la
photocopie, en essayant d’accentuer l’expression dépeinte.
AVEC LES YEUX FERMÉS : Écouter les couleurs
Il te faudra un ordinateur avec accès Internet.
La musique peut transmettre des émotions à travers les notes, mais également à travers
les paroles des chansons. Chaque groupe devra chercher sur Internet des chansons faisant
référence aux couleurs ou aux émotions associées aux couleurs.
Exemples : La chanson Yellow submarine fait référence à une couleur, même si celle-ci ne
transmet aucune émotion concrète. Le blues fait référence à la couleur bleue (blue en anglais)
comme synonyme de tristesse et mélancolie.
- Guide didactique - Fundació Joan Miró
Texture niveau 1. Chemins en bronze
CHEMINS EN BRONZE
INTRODUCTION
Dans plusieurs sculptures de Miró, on reconnaîtra des objets. Pour la plupart, il s’agit de
trouvailles dues au hasard. En les associant, Miró ne tient pas compte de l’utilité ni du lien
existant entre ces objets dans la vie quotidienne. Ce qui l’intéresse, ce sont leur forme, leur
texture ou encore le dialogue qui peut s’établir entre eux.
Pour unifier l’ensemble, Miró fond la pièce en bronze afin de la rendre plus résistante et d’en
rallonger la vie. La technique utilisée (cire perdue) reproduit avec la plus grande fidélité la
texture originale des objets.
EN QUOI CELA CONSISTE ?
La première phase consiste à classer l’image d’une sculpture en bronze réalisée par Miró. La
sculpture présente diverses textures, ce qui facilite la tâche.
La seconde phase consiste à jouer avec une sphère mobile qui laisse la trace d’une texture sur
le fond blanc. Le contact de la sphère avec les marges provoque un changement de texture,
de couleur et de largeur de la trace. Le résultat est une composition assez imprévisible et
éphémère.
OÙ VOULONS-NOUS EN VENIR ?
• Observer les textures des œuvres d’art
• Apprécier la diversité des textures
• Utiliser les textures avec une finalité créative
QU’APPRENONS-NOUS ?
• Les textures peuvent être tactiles ou visuelles
• Les textures constituent un élément présent dans le langage artistique
POUR EN SAVOIR PLUS...
Nous recommandons de combiner cette activité avec FROTTAGE (Texture, niveau 2) pour
étudier l’effet des textures réelles sur le papier.
Nous recommandons de visionner la vidéo SCULPTURES EN BRONZE.
- Guide didactique - Fundació Joan Miró
Texture niveau 1. Chemins en bronze
PROPOSITION PLASTIQUE : Marcher sur la Lune
Les motifs des semelles des chaussures varient grandement : ils peuvent être lisses, sans
le moindre dessin, ou avoir un dessin en relief. Ce sont des textures que l’on peut regarder
et toucher. Chez toi, cherche des chaussures aux semelles les plus originales possibles ;
rassemble autant de paires que tu peux. Répands du cirage liquide sur une semelle et
imprime-la sur une grande feuille de papier. C’est une empreinte dans un espace vierge, qui
peut évoquer le premier pas de l’homme sur la surface de la Lune.
Chaque texture imprimée peut être à l’origine d’un personnage ou d’un objet fantastique. Tu
peux définir cet habitant imaginaire de l’espace avec un gros marqueur ou à la cire.
AVEC LES YEUX FERMÉS : À la découverte de textures
Tu auras besoin de suffisamment de pâte à modeler pour faire plusieurs couches rectangulaires
fines. Cherche ensuite des objets ou un matériau dont la texture est spéciale ou caractéristique
(papier de verre, toile de jute, de carton ondulé, de la maille de fer, des pommes de pin, des
coquillages, etc.) et enfonce-les dans la pâte à modeler afin d’y fixer leur empreinte.
Tu pourras ensuite comparer les résultats avec tes compagnons. Avec les yeux bandés et en
travaillant uniquement au toucher, essaie d’associer les textures imprimées avec les objets et
les matériaux employés.
- Guide didactique - Fundació Joan Miró
Texture niveau 2. Frottage
FROTTAGE
INTRODUCTION
Joan Miró a toujours eu un vif intérêt pour l’expérimentation. Il a travaillé avec des supports
communs dans l’art tels que la toile ou le papier mais aussi sur du bois, du carton, du papier
de verre, de la toile de jute ou du cuivre.
Le support représentait pour Miró un stimulus qui l’incitait à créer ou qui exigeait d’autres
matériaux, d’autres textures.
EN QUOI CELA CONSISTE ?
La première phase consiste à classer des œuvres de Miró en fonction de la variété des textures
caractéristiques des matériaux employés.
La seconde phase consiste à réaliser une composition dans un espace quadrillé. Si tu le
souhaites, tu peux modifier les coordonnées prédéterminées. Remplis ensuite les espaces
disponibles avec des fragments de textures extraites des murs et du sol de la Fundació Joan
Miró. Enfin, superpose une feuille de papier et frotte-la avec une barre de couleur pour y
transférer les textures réelles.
OÙ VOULONS-NOUS EN VENIR ?
• Identifier les textures des œuvres d’art
• Apprécier les qualités tactiles des objets et matériaux
QU’APPRENONS-NOUS ?
• La texture en tant que ressource plastique
• Les types de textures : réelles ou calquées
POUR EN SAVOIR PLUS...
L’activité PROJET POUR UN MONUMENT (Volume, niveau 2) nous permet d’observer
comment le fait d’altérer le matériau d’un objet déterminé influe sur notre perception.
Nous recommandons de visionner la vidéo L’ASSASSINAT DE LA PEINTURE.
- Guide didactique - Fundació Joan Miró
Texture niveau 2. Frottage
PROPOSITION PLASTIQUE : À la pêche de textures
Il te faudra une feuille de papier dont les dimensions et la couleur peuvent varier et une barre
de couleur (cire, fusain, craie, graphite).
Tu peux pêcher des textures à la maison, à l’école, dans la rue, au parc... Pour pêcher des
textures, il faut être un bon observateur. Si tu y prêtes attention, tu te rendras compte de
la variété infinie des textures qui nous entoure. Chaque fois que tu trouves une texture
intéressante, pose le papier dessus et frotte fort avec la barre plate. Dès que tu en auras un
certain nombre, découpe les feuilles en formes d’animaux marins ou inventées. Colle-les
ensuite sur un papier ou une feuille de bristol de couleur bleue et organise la composition
comme s’il s’agissait d’un aquarium, d’un lac ou de fonds marins.
AVEC LES YEUX FERMÉS : Paires tactiles
Tu auras besoin de quelques objets qui aient un peu de relief sans être trop gros ni grands (tels
qu’une pièce de monnaie ou une clé). D’une part tu obtiendras des empreintes d’objets en
les pressant sur une surface molle de terre ou de pâte à modeler. D’autre part, tu obtiendras
des impressions par frottage, en dessinant fort au crayon sur un papier posé sur l’objet. Plus
le nombre d’objets sera élevé, plus l’activité sera intéressante. L’étape suivante consiste à
trouver les correspondances entre l’objet de référence, son empreinte et la gravure (frottage),
si possible avec les yeux bandés.
- Guide didactique - Fundació Joan Miró
Texture niveau 3. Incisions
INCISIONS
INTRODUCTION
Le peintre cubiste Louis Marcoussis a initié Miró à la technique de la pointe sèche. En 1938
les deux artistes décident de faire ensemble un portrait de Joan Miró. Marcoussis dessine
le visage, l’apparence de Miró. Miró donne libre cours à son inconscient en révélant tout un
monde intérieur et en envahissant l’espace avec des personnages, signes, astres, flammes et
oiseaux qui se confondent avec les tracés reproduisant les traits de son visage et ses mains.
Pour graver sur une planche de cuivre, un quelconque ustensile avec une pointe affilée
convient : par exemple, un burin, une aiguille en acier, un couteau ou un clou. Suivant l’ustensile
utilisé, le sillon sera plus ou moins profond. Les ombres et les effets de tons s’obtiennent en
gravant des lignes consécutives rapprochées ou en créant une trame de lignes croisées. Un
fois la planche gravée et teintée, l’image est imprimée sur un papier. L’image gravée et l’image
imprimée sont spéculaires.
EN QUOI CELA CONSISTE ?
La première phase consiste à observer une matrice de gravure travaillée par Miró montrant
les incisions caractéristiques. Ci-dessous tu trouveras six épreuves d’artiste correspondant à
divers stades du processus créatif que tu dois classer dans l’ordre.
La seconde phase t’invite à agir sur une planche de cuivre, avec une simulation du processus
de gravure chalcographique. Tu peux également dessiner des formes et ajouter des trames
visuelles préétablies pour créer des ombres. Une fois la composition prête, choisis une couleur
pour appliquer l’encre. L’écran montre alors l’impression sur papier.
OÙ VOULONS-NOUS EN VENIR ?
• Observer les incisions sur une matrice de gravure chalcographique
• Observer l’usage de trames visuelles en tant que ressource plastique
• Utiliser les trames en tant que ressource plastique
QU’APPRENONS-NOUS ?
• Les trames en tant que textures visuelles
• Les trames en tant que ressource plastique
• Introduction au processus de travail chalcographique
• Miró a également travaillé la technique de la gravure
POUR EN SAVOIR PLUS...
Nous recommandons de visionner les vidéos LE TRIOMPHE DU SIGNE et POÉSIE ET LIVRES.
- Guide didactique - Fundació Joan Miró
Texture niveau 3. Incisions
PROPOSITION PLASTIQUE : Modélographie
Il te faut de la pâte à modeler, des cure-dents ou autres ustensiles pointus, de la détrempe, un
pinceau ou un rouleau et du papier. Étale la pâte à modeler pour obtenir une surface homogène
d’environ 5 mm d’épaisseur qui nous servira de matrice. Dessine dessus en creusant des
sillons avec un cure-dent, une aiguille ou un quelconque ustensile pointu. Tu peux également
faire des tracés courts et répétés, séparés ou croisés, ou des regroupements de points à la
manière d’une trame pour créer des effets d’ombres. Lorsque tu as fini, laisse durcir un peu la
pâte à modeler et peins-la. Avec un pinceau, une éponge ou un rouleau, applique avec soin
une fine couche de détrempe, en évitant les excès de peinture qui pourraient boucher les
incisions. Pose une feuille de papier au contact de la partie peinte encore humide. Puis exerce
une légère pression pour que la peinture s’imprime sur le papier sans déformer la matrice.
AVEC LES YEUX FERMÉS : À propos de gravure
La technique de la gravure est difficile à comprendre si on ne peut voir le résultat final. Il
te faudra une feuille d’acétate (cela peut également être une feuille de papier), une base
moelleuse et des ustensiles pointus (stylo, crayon, fourchette, cuillère, trombone, etc.). Place
l’acétate sur la base moelleuse. Avec les ustensiles sélectionnés, exerce une pression sur la
feuille d’acétate afin d’obtenir des trames : groupes de points, série de rayures, succession
de courbes, grillages… Il ne s’agit pas de faire des trous mais de laisser une marque profonde
sur le support. Ce qui nous intéresse est, en fait, l’envers en relief de l’acétate qui montre
l’effet en négatif de l’opération préalable. Cette gravure en négatif est comparable à l’écriture
et la lecture manuelle en système braille : les points sont pratiqués sur une face et lus sur
l’autre.
- Guide didactique - Fundació Joan Miró
Forme niveau 1. Plein et vide
PLEIN ET VIDE
INTRODUCTION
Les formes organiques prédominent dans les peintures de Miró. Ces formes sont, parfois,
bien délimitées et constituent des variations libres de figures géométriques, comme par
exemple des ronds, des ovales ou des carrés ; d’autres fois, il s’agit simplement de tracés
plus ou moins compacts évoquant la calligraphie.
Le fond sur lequel ces formes se trouvent peut suggérer un intérieur comme un paysage ou
un espace indéterminé.
EN QUOI CELA CONSISTE ?
La première phase consiste à compléter une peinture de Miró en insérant les formes qui
manquent.
Pour la seconde phase, tu disposes d’un espace distribué en six zones, chacune d’une
couleur ainsi que de quatre figures géométriques de base. Celles-ci extraient du fond une
pièce avec une forme équivalente en y laissant un espace vide. L’activité consiste à réaliser
une composition en extrayant des formes et en les replaçant.
OÙ VOULONS-NOUS EN VENIR ?
• Différencier la forme et le fond dans certaines œuvres de Miró
• Réaliser une composition avec des formes sur un fond
QU’APPRENONS-NOUS ?
• Les concepts de forme et de fond
POUR EN SAVOIR PLUS...
Pour approfondir le travail sur les formes géométriques de base, nous recommandons de
combiner cette activité avec MÉLODIES PEINTES (Couleur, niveau 2).
Pour approfondir le travail sur les formes géométriques et organiques, nous recommandons
de combiner cette activité avec COLLAGE DE FORMES (Forme, niveau 2).
Pour approfondir le travail sur le plein et le vide, nous recommandons de combiner cette
activité avec SYMÉTRIES (Composition, niveau 2).
- Guide didactique - Fundació Joan Miró
Forme niveau 1. Plein et vide
PROPOSITION PLASTIQUE : Construire un dessin
Il te faut un carton de format DIN A4 qui servira de support pour notre travail. Il te faut également
de la colle blanche, de la peinture de couleur et des pinceaux. Tu peux utiliser les pièces d’un
vieux jeu de construction en bois ou fabriquer des formes avec du carton découpé.
Pour commencer, prépare le fond avec de la peinture. Une fois sec, distribues-y les pièces en
bois ou en carton jusqu’à obtenir une composition qui te plaise. Ensuite colle-les et peins-les.
(Si la peinture n’adhère pas bien sur les pièces en bois, tu peux mélanger la peinture avec un
peu de colle blanche).
AVEC LES YEUX FERMÉS : Formes poinçonnées
Il te faudra une feuille de bristol, un poinçon et une base moelleuse. Mets la base moelleuse
en place et pose la feuille de bristol dessus. Crée des formes en perforant la feuille de bristol
avec le poinçon, jusqu’à ce que la forme se détache. La feuille de bristol constitue la toile
et les formes poinçonnées sont les éléments de la composition. Lorsque tu as fini, tu peux
proposer à tes compagnons d’essayer d’identifier les formes évidées au toucher.
- Guide didactique - Fundació Joan Miró
Forme niveau 2. Collage de formes
COLLAGE DE FORMES
INTRODUCTION
Fernand Léger a essayé d’harmoniser l’homme avec la machine, qu’il considérait comme son
modèle. Son œuvre se base sur le contraste : des lignes droites et des courbes, horizontales
et verticales, des couleurs vives et des tons neutres, des formes planes et modelées, des
formes organiques et géométriques.
Avec La famille, Miró convertit une scène quotidienne en univers délirant, où les personnages
ont l’aspect d’automates ou de plantes, et où les figures géométriques côtoient, en toute
normalité, les éléments organiques.
La création de Paul Klee intègre des concepts contraires tels que la linéarité et le colorisme,
l’analyse et la spontanéité, l’organicisme et la géométrie ou la figuration et l’abstraction.
EN QUOI CELA CONSISTE ?
La première phase consiste à choisir une œuvre et classer les formes qui y sont mises en
valeur. Pour la classification, on distingue les formes organiques des formes géométriques.
La sélection s’effectue en faisant glisser les concepts « organique » ou « géométrique » sur
l’image.
Pour la seconde phase, tu dois réaliser une composition libre avec des formes organiques
et / ou géométriques. Pour les formes organiques, tu disposes d’une série de formes
préétablies que tu peux transposer sur le fond de couleur de l’écran. En contact avec le fond,
extrais une portion équivalente qui laissera à découvert une couche d’une autre couleur, et
ainsi de suite. Pour les formes géométriques, utilise l’outil « lasso polygonal » qui permet de
dessiner des lignes droites. Chaque fois que tu fermes une forme, extrais-la du fond et tu
pourras la déplacer dans un autre endroit.
OÙ VOULONS-NOUS EN VENIR ?
• Identifier des formes organiques et géométriques dans les œuvres d’art
• Différencier les formes organiques des formes géométriques
• Utiliser les formes organiques et géométriques pour réaliser une composition personnelle
QU’APPRENONS-NOUS ?
• Les types de textures : organiques et géométriques
- Guide didactique - Fundació Joan Miró
Forme niveau 2. Collage de formes
POUR EN SAVOIR PLUS...
Pour approfondir le travail sur les formes géométriques de base, nous recommandons
de combiner cette activité avec PLEIN ET VIDE (Forme, niveau 1) et MÉLODIES PEINTES
(Couleur, niveau 2).
Pour étudier le collage en tant que photomontage, nous recommandons de combiner cette
activité avec ENTRE LES LIGNES (Composition, niveau 3).
Nous recommandons également de visionner les vidéos LE PARIS SURRÉALISTE,
L’ASSASSINAT DE LA PEINTURE et COLLAGE.
PROPOSITION PLASTIQUE : Des formes qui peignent
Tu auras besoin de peinture de plusieurs couleurs, de pinceaux, de pâte à modeler, de matériel
de récupération et d’une feuille de papier (ou d’une feuille de bristol) qui te servira de support.
Pour commencer, rassemble du matériel de récupération aux formes géométriques, comme
par exemple des pots de yaourt, des bouchons de bouteille, d’anneaux, de boîtes ou
d’emballages de médicaments… Tu utiliseras ce matériel, en le trempant dans la peinture
à la manière de tampons, pour estamper le support. Quant aux formes organiques, tu les
obtiendras à partir de pâte à modeler.
AVEC LES YEUX FERMÉS : Identités occultes
Rassemble plusieurs objets, certains aux formes organiques (courbes, ondulations) et d’autres
aux formes inorganiques ou géométriques (droits, angulaires). Sur une feuille de bristol ou un
carton, trace le contour des objets choisis puis découpe les formes. Fixe-les ensuite sur un
support plat et confectionne une composition tactile. Une fois terminée, montre ta composition
à un compagnon et demande-lui d’essayer d’identifier les éléments d’origine.
- Guide didactique - Fundació Joan Miró
Forme niveau 3. Abstractions
ABSTRACTIONS
INTRODUCTION
La trajectoire artistique de Joan Miró se compose d’étapes très différentes. Au début, il avait
pour principal intérêt d’observer soigneusement la réalité et d’en faire une représentation
fidèle au modèle, qu’il s’agisse d’un portrait, d’un paysage ou d’une nature morte. Par la suite,
il a soumis ses sujets à une transformation subjective, voire à une déformation expressive.
Finalement, il a converti certains éléments en signes qu’il utilise de manière continue.
Certaines œuvres des dernières années font preuve d’un dépouillement extrême frisant
l’abstraction. Néanmoins, Miró à toujours nié être un artiste abstrait : « Pour moi, disait-il,
une forme n’est jamais quelque chose d’abstrait ; elle est toujours le signe de quelque chose.
C’est toujours un homme, un oiseau ou quelque chose d’autre. »
EN QUOI CELA CONSISTE ?
La première phase consiste à classer une série de représentations d’un même motif, du plus
figuratif au plus abstrait.
Lors de la seconde phase, tu devras réaliser une composition abstraite. Le point de départ
est une image photographique. Calques-en certaines parties, en simplifiant ou en mettant
en évidence ce que tu crois approprié. Tu peux également suggérer un effet d’ombre ou de
relief en y appliquant divers tons de gris. Le dessin implique déjà une altération de l’image
initiale, un premier degré d’abstraction ; mais tu disposes en outre de fonctions spécifiques
de transformation : zoom ou échelle avec déplacement ; blur ou flou ; altération chromatique ;
pixelement et style de raccord avec coin.
OÙ VOULONS-NOUS EN VENIR ?
• Observer diverses manières de représenter la réalité
• Définir des degrés dans les concepts de figuration et d’abstraction
• Comprendre que les formes abstraites peuvent avoir un rapport avec la réalité
• Entreprendre des processus de transformation de la réalité destinés à créer des formes
abstraites
QU’APPRENONS-NOUS ?
• Les types de textures : figuratives et abstraites
• Les processus d’abstraction de la forme
- Guide didactique - Fundació Joan Miró
Forme niveau 3. Abstractions
POUR EN SAVOIR PLUS...
L’activité BESTIAIRE DE SIGNES (Symbologie, niveau 2) permet d’étudier le processus dans
le sens inverse : de l’abstraction à la figuration.
Les vidéos INTÉRIEUR HOLLANDAIS I et PORTRAITS IMAGINAIRES apportent de plus
amples informations sur les transformations formelles. La vidéo LE TRIOMPHE DU SIGNE
incite à la réflexion sur le concept de l’abstraction. La vidéo AUTOPORTRAIT présente le
concept de l’abstraction comme un procédé de schématisation et de synthèse.
Nous recommandons également de naviguer dans les modules d’EXPLORATION.
PROPOSITION PLASTIQUE : Portrait total
Tu auras besoin d’un appareil photo, d’une imprimante, de ciseaux, de feuilles blanches
de papier, d’acétate transparent, de bâton de colle, d’un marqueur indélébile, de peintures
acryliques (ou de détrempe mélangée à de la colle) et de pinceaux.
Choisis un modèle et fais-en le portrait sous différents angles, à différentes distances et,
si possible, à divers moments ou sur plusieurs jours. Imprime les photographies en noir et
blanc, au format DIN A4. Découpe les images en essayant d’isoler les divers organes et
parties du visage. Puis fais un photomontage à partir d’une sélection des fragments. Essaie
de reconstruire une vision cohérente du visage et de mettre en évidence la pluralité de l’étude
réalisée. (Il ne s’agit pas de viser la concordance ni le réalisme, mais de regrouper diverses
facettes de la personne photographiée).
Avec le marqueur, calque le photomontage sur la feuille d’acétate. Essaie de synthétiser les
formes et, au besoin, de les géométriser. Tu peux colorier le portrait final avec de la peinture
acrylique, en utilisant la couleur de manière libre et expressive.
AVEC LES YEUX FERMÉS : Personnage fortuit
Chaque participant doit penser à trois concepts et les écrire sur des bouts de papier individuels.
Les concepts doivent tenir compte des catégories suivantes : animaux, plantes ou fruits,
minéraux, objets, univers. Introduis les bouts de papier dans une boîte et mélange le tout.
Chacun son tour, les participants prennent trois bouts de papier : le premier correspondra
à la tête d’un personnage imaginaire, le second à son corps, et le troisième à ses jambes.
Ils devront ensuite dessiner ou décrire verbalement leur personnage avec un maximum de
détails.
- Guide didactique - Fundació Joan Miró
Volume niveau 1. Rencontre d’objets
RENCONTRE D’OBJETS
INTRODUCTION
L’objet est le point de départ de la plupart des sculptures de Miró. Des objets quotidiens, des
outils, des fruits et des déchets que Miró ramasse sur le chemin ou la plage de Mont-roig, qu’il
trouve chez lui ou qu’il achète parfois. Il les associe, en fait un assemblage. Généralement, le
processus s’achève avec la fonte de l’ensemble en bronze.
Au cours des dernières années de sa vie, Miró réalise des sculptures en bronze qu’il peint
avec des couleurs élémentaires.
EN QUOI CELA CONSISTE ?
Lors de la première phase tu découvres une sculpture de Miró. L’œuvre est le résultat d’une
combinaison d’objets transformés en bronze et différenciés par la couleur. Tu verras la
silhouette de la sculpture et des objets similaires à ceux que Miró a utilisés pour réaliser
l’œuvre. Tu dois faire glisser chaque composant à sa place jusqu’à ce que la pièce entière soit
reconstruite. C’est alors que tu pourras faire tourner la sculpture et la voir sous divers angles.
Pour la seconde phase, réalise une sculpture en combinant des objets sur un socle. Tu peux
également peindre les éléments de la composition.
OÙ VOULONS-NOUS EN VENIR ?
• Observer en détail les sculptures de Miró
• Se rapprocher de la tridimensionnalité de la sculpture
• Créer des sculptures en combinant des objets quotidiens
QU’APPRENONS-NOUS ?
• Miró a également fait des sculptures
• Une sculpture est une œuvre artistique qui a du volume
• La sculpture peut être observée sous divers angles
• La combinaison d’objets est un moyen de réaliser des sculptures
POUR EN SAVOIR PLUS...
Pour étudier la relation entre la sculpture et son contexte, nous recommandons l’activité
PROJET POUR UN MONUMENT (Volume, niveau 2).
Nous recommandons de visionner la vidéo LA SCULPTURE ET L’OBJET.
- Guide didactique - Fundació Joan Miró
Volume niveau 1. Rencontre d’objets
PROPOSITION PLASTIQUE : Entre plats et marmites
Cette activité se déroulera dans la cuisine. Rassemble de petits objets que tu y trouveras,
comme par exemple des petites cuillères, des cure-dents, des baguettes chinoises, des
anneaux de boîtes de conserve ou de rafraichissements, des bouchons de bouteille, etc.
Prépare une pâte à modeler à base de farine, de sel et d’eau (2 verres de farine, 1 verre de
sel et 1 verre d’eau).
Travaille sur une assiette pour ne rien salir. L’assiette peut également représenter le socle de
ta sculpture. Avec la pâte, modèle une forme à ton goût ; tu pourras ensuite y incruster des
objets. Il convient de faire tourner l’assiette de temps en temps et d’observer le processus sous
d’autres angles, comme si tu contemplais une sculpture. Si tu souhaites unifier l’ensemble, tu
peux le peindre avec de la détrempe mélangée à de la colle blanche.
AVEC LES YEUX FERMÉS : Naissance d’une sculpture
Tout au long de la journée, rassemble des objets qu’en temps normal tu jetterais à la poubelle
ou que tu trouveras : des bouchons de bouteille, des Tétra briks de lait, une serviette en
papier, une enveloppe, une image, des tubes en carton, une pierre... Essaie de composer une
figure avec ce matériel. Le processus de réalisation doit tenir en compte du fait que la figure a
du volume et doit s’avérer intéressant sous divers angles. Il est également important que les
éléments aient un rapport avec ce qu’ils représentent, que ce soit au niveau de la forme ou
de la fonction qu’ils remplissaient avant d’être recyclés. Tu obtiendras finalement une série de
personnages aux diverses caractéristiques physiques. Tu peux essayer d’imaginer comment
ils se comporteraient les uns avec les autres ou les regrouper en fonction de ce que tu crois
qu’ils ont en commun.
- Guide didactique - Fundació Joan Miró
Volume niveau 2. Projet pour un monument
PROJET POUR UN MONUMENT
INTRODUCTION
La première sculpture de Miró (Personnage, 1931) est le fruit de l’assemblage d’objets réels.
Vingt ans plus tard, il réalise une série de petits projets pour des monuments où il combine
des objets réels sur une base de ciment, de pierre ou de bois.
Néanmoins, le matériau le plus fréquent dans les sculptures de Miró est le bronze, qui donne
leur homogénéité aux œuvres.
Dans les années soixante, Miró réalise plusieurs sculptures destinées à des emplacements
en plein air. L’échelle des œuvres augmente alors et, même s’il continue à travailler avec le
bronze, il réalise également des sculptures en marbre, en béton et en résine de polyester.
De par le passé, les matériaux sculpturaux devaient être « nobles et résistants » (bronze,
marbre). La sculpture actuelle incorpore de nouveaux concepts (elle peut être éphémère, par
exemple), ainsi que de nouveaux matériaux.
EN QUOI CELA CONSISTE ?
Lors de la première phase, observe trois sculptures, chacune d’un artiste et d’un matériau
différent. Après avoir identifié les matériaux, associe-les aux sculptures correspondantes.
Pour la seconde phase, conçois un projet de sculpture. En premier lieu, choisis le lieu où
tu voudras installer la sculpture. Réalise ton projet sur un papier superposé à l’image. Tu
disposes d’un échantillonnage d’objets pour choisir les éléments qui constitueront l’œuvre.
Tu les assembleras pour la confectionner. Finalement, tu pourras décider du matériel et y
incorporer des annotations ou dessiner dessus.
OÙ VOULONS-NOUS EN VENIR ?
• Connaître et identifier les matériaux sculpturaux d’œuvres de divers artistes
• Créer une sculpture en pensant à l’environnement dans lequel elle doit être placée et aux
matériaux
QU’APPRENONS-NOUS ?
• Il existe divers matériaux sculpturaux
• Les sculptures peuvent être installées dans divers endroits
• Les sculptures peuvent être munies d’un socle ou non
• L’altération de l’échelle en tant que ressource sculpturale
- Guide didactique - Fundació Joan Miró
Volume niveau 2. Projet pour un monument
POUR EN SAVOIR PLUS...
Pour approfondir la relation de la sculpture avec l’espace, nous recommandons l’activité
L’OBJET INVISIBLE (Volume, niveau 3).
Pour approfondir le travail de composition, nous recommandons de combiner l’activité avec
ENTRE LES LIGNES (Composition, niveau 3).
Nous recommandons également de visionner les vidéos LA SCULPTURE ET L’OBJET,
SCULPTURES EN BRONZE et SCULPTURE PUBLIQUE.
PROPOSITION PLASTIQUE : La rue de l’Art
Construis la maquette d’une ville imaginaire, avec une place, de larges trottoirs et une zone
piétonne. Pour cela, des boîtes en carton d’aliments ou de médicaments, des emballages
vides divers ou des tubes en carton peuvent t’être utiles. En fonction de leurs caractéristiques
spécifiques, attribue-leur un rôle ou un autre. Pour renforcer ce rôle, peins-les avec de la
peinture acrylique ou de la détrempe mélangée à de la colle et colle-les sur une base rigide.
Tu peux créer d’autres détails (bancs, poubelles, lampadaires, clôtures, végétation, feux
tricolores) avec de la pâte à modeler peinte, des cure-dents collés ou du carton découpé.
Tu peux également utiliser des jouets dont l’échelle correspond à celle de la maquette
(voiturettes, personnages, animaux). Confectionne ensuite quelques sculptures et place-les
dans des endroits appropriés, avec ou sans socle.
Tu peux modeler les sculptures avec de l’argile ou de la pâte à modeler et les peindre par
la suite ; tu peux également réaliser des constructions avec du matériel de récupération ou
encore utiliser directement des objets réels dont les dimensions attirent l’attention.
AVEC LES YEUX FERMÉS : Étude de terrain
Choisis des sculptures publiques ou commémoratives de ta ville. Localise leurs coordonnées
avec un GPS ou sur Internet. Rends-toi ensuite sur les lieux et réalise un recueil de
données incluant le matériau avec lequel les œuvres sont conçues, leur échelle et leurs
caractéristiques physiques. Ces données doivent être recueillies de manière empirique,
in situ. Il est particulièrement intéressant d’indiquer ce que les œuvres te communiquent
directement, au-delà des prétentions de l’artiste ou de l’importance et de la signification
de l’œuvre dans le contexte de l’Histoire de l’Art. Prends note des formes, mais également
des qualités de matériaux (dureté, texture, température) ; indique comment l’environnement
influe sur l’œuvre ; si celle-ci à suffisamment d’espace pour « respirer » ou si elle est enserrée
parmi d’autres éléments ; s’il y a du mobilier urbain à proximité ; si l’endroit est silencieux ou
bruyant ; s’il permet une proximité ou s’il marque une distance avec les piétons ; constate
les proportions de l’œuvre par rapport aux bâtiments; l’aspect des pavés... Ensuite on pourra
évaluer les sculptures d’un point de vue sensoriel, plus qu’intellectuel.
- Guide didactique - Fundació Joan Miró
Volume niveau 3. L’objet invisible
L’OBJET INVISIBLE
INTRODUCTION
Le titre d’une œuvre d’art répond à divers critères.
Il arrive qu’il vienne renforcer ce qui semble évident. À titre d’exemple, l’intervention de Robert
Smithson au Great Salt Lake, en Utah. Le titre, Jetée spirale, corrobore tant la fonction que la
forme de son travail.
À d’autres occasions, l’artiste renonce à intituler son œuvre pour en affirmer le caractère
autonome ou pour éviter une quelconque implication émotionnelle.
Le titre peut, d’autre part, avoir une influence décisive dans l’appréciation du sens d’une
œuvre. Le fait d’appeler Fontaine ce qui objectivement n’est autre qu’un urinoir, comme l’a
fait Marcel Duchamp, marque une distance ironique entre l’auteur et son œuvre et force le
spectateur à accepter de nouvelles règles de jeu.
Cela peut également renvoyer au monde symbolique particulier à l’auteur, comme c’est le cas
pour les sculptures Femme, monument, L’oiseau se niche sur les doigts en fleurs et Femme
assise et enfant, dans lesquelles on retrouve la femme et l’oiseau, des motifs récurrents chez
Miró.
Transparent, le paysage nous indique que ce qui attire l’attention de l’artiste (Pep Duran) ne
sont pas seulement les éléments physiques qui composent la pièce, mais également le jardin
qui l’entoure et qui s’y reflète. La pièce apparaît ainsi reliée à l’environnement et ne pourrait
pas exister sans ce dernier.
Le peigne du vent XV, d’Eduardo Chillida, installé à une extrémité de la baie de La Concha, à
Saint-Sébastien, est une autre œuvre indissociable de son contexte. Les pièces en acier sont
incrustées dans les rochers du littoral, mais n’opposent aucune résistance aux assauts de la
mer. Le titre précise la nature poétique de cette relation.
Une chambre où il pleut toujours, de Juan Muñoz, constitue un autre exemple d’installation.
L’œuvre est inachevée, ce qui confère une aura mystérieuse au titre. La cage qui contient la
scène délimite la pièce, camouflée sous des arbres. Les ouvertures entre les grilles incitent
à regarder, de sorte que le rapport avec le spectateur devient plus intime, plus existentielle.
EN QUOI CELA CONSISTE ?
La première phase consiste à déduire les titres des sculptures proposées.
La seconde phase consiste à créer une installation dans une salle de la Fundació Joan Miró. Tu
disposes de divers modèles de cage que tu dois suspendre au plafond et éclairer frontalement
ou latéralement. Une fois éclairée, la pièce disparait et il ne reste plus que l’ombre projetée
sur l’un des murs.
OÙ VOULONS-NOUS EN VENIR ?
• Observer les sculptures d’artistes différents
• Conclure le titre de certaines sculptures éloignées d’une représentation réaliste
• Créer une installation virtuelle et éphémère
- Guide didactique - Fundació Joan Miró
Volume niveau 3. L’objet invisible
QU’APPRENONS-NOUS ?
• Les sculptures peuvent être figuratives, abstraites ou conceptuelles
• Les titres des œuvres peuvent fournir des pistes sur le message que l’artiste a voulu
transmettre
• La sculpture intègre également la notion d’espace environnant
• Certaines sculptures ont été conçues pour des endroits concrets et ont pour objectif
d’impliquer le spectateur
POUR EN SAVOIR PLUS...
Nous recommandons de visionner la vidéo PROJET POUR UN MONUMENT.
PROPOSITION PLASTIQUE : Le chasseur d’ombres (entre installation et happening)
Il te faut du papier d’emballage noir, une lampe à pied avec une ampoule puissante, des craies,
un petit groupe de personnes et, si possible, une caméra vidéo ou un appareil photographique
ainsi qu’un trépied.
Dans un espace fermé, exempt d’objets et de meubles, recouvre de papier un ou plusieurs murs
ainsi qu’une partie du sol. Le groupe de personnes constituera les éléments d’une installation
vivante. Elles doivent se placer dans un endroit et une position déterminée. Situe la source de
lumière de sorte que l’ombre du groupe ou d’une personne se projette sur le papier. Trace le
contour de l’ombre avec une craie. Modifie de temps à autre la position de la source lumineuse
et substitue le chasseur d’ombres avec l’un des modèles. Si tu disposes d’une caméra, tu
peux enregistrer le processus ; tu peux également photographier totalement ou partiellement
le résultat.
AVEC LES YEUX FERMÉS : Mémoire des mains
Chaque participant doit modeler une forme en argile, avec les yeux bandés. Même si la forme
doit être d’une certaine complexité, il est préférable que la confection ne se prolonge pas
trop longtemps : elle peut évoquer une figure ou objet quelconques, mais il faut éviter que la
représentation soit trop facilement identifiable. Place-là ensuite dans une boîte (que tu identifies
avec ton nom ou une marque) et attends quelque temps. Au cours de ce laps de temps, l’argile
durcira tandis que le souvenir de ta création deviendra de plus en plus vague. Après quelques
jours, tente de produire la même forme, sans la regarder ni la toucher, en t’efforçant de te
remémorer son aspect, ses dimensions, son volume. Dès lors que tu penses y être parvenu
ou lorsque tu es incapable de te rappeler plus de détails, ouvre la boîte où tu gardais la
première version et compare-les. Remets la pièce originale dans la boîte et donne-la à un autre
participant. Il ne doit pas la regarder et peut seulement la toucher. Dès lors qu’il pense qu’il
l’imagine suffisamment, il la remet dans la boîte et dois tenter de la reproduire avec de l’argile.
En dernier lieu, on comparera la pièce originale, la copie faite de mémoire par son auteur ainsi
que la réplique réalisée par l’autre participant. Qui est le plus fidèle à la pièce d’origine ?
- Guide didactique - Fundació Joan Miró
Symbologie niveau 1. Transformations
TRANSFORMATIONS
INTRODUCTION
Au fil des années, le langage de Miró s’est réduit à quelques motifs. La présence de ces
motifs qui, tout au long de sa production, apparaissent avec diverses morphologies, deviendra
particulièrement importante à partir de 1940. Il s’agit d’éléments liés à la terre ou au ciel,
toujours plus stylisés et que Miró peindra dans les couleurs élémentaires. Les plus habituels
sont l’œil, les cheveux, le sexe, les oiseaux, les étoiles, les constellations, le soleil et la lune.
EN QUOI CELA CONSISTE ?
La première phase consiste à choisir une œuvre. Celle-ci entame une séquence ayant pour fil
conducteur un motif récurrent dans l’œuvre de Miró. Il suffit pour cela d’identifier ce motif et
de cliquer dessus pour avancer.
La seconde phase consiste à créer un personnage imaginaire de l’espace. Tu te baseras sur
une série de figures réalisées par d’autres enfants. Ces figures présentent trois sections (tête,
thorax et membres inférieurs) que tu peux combiner.
OÙ VOULONS-NOUS EN VENIR ?
• Observer certains éléments de la symbologie de Miró
• Observer les transformations des formes réelles qu’un artiste peut réaliser
• Créer des formes symboliques personnelles
QU’APPRENONS-NOUS ?
• Miró utilise certains éléments de manière récurrente
• Les éléments de la réalité peuvent se représenter de différentes façons
• Les formes peuvent expliquer des choses
POUR EN SAVOIR PLUS...
Pour étudier plus en détails le langage de signes de Miró, nous recommandons de visionner
la vidéo LE TRIOMPHE DU SIGNE. Nous recommandons également de naviguer dans les
modules d’EXPLORATION (ASTRES et PARTIES DU CORPS).
Pour approfondir le concept de transformation, nous recommandons de visionner la vidéo
PORTRAITS IMAGINAIRES.
- Guide didactique - Fundació Joan Miró
Symbologie niveau 1. Transformations
PROPOSITION PLASTIQUE : Changement d’image
Il te faut : des images de magazines, découpées et collées sur une feuille blanche ou du
bristol blanc de format DIN A3 ; des marqueurs de couleur ; des pastels à l’huile ; du papier
de qualité et couleurs différentes ; des ciseaux et un bâton de colle. Il te faudra également une
série de cartons avec chacun un attribut inscrit (content, fatigué, calme, malade, aventurier,
etc.) Tu peux travailler tout seul ou avec une autre personne. Distribue une image (bouteille,
maison, femme, chaussure, lunettes, vélo, etc.) et un attribut à chaque participant ou paire
de participants. Il s’agit de transformer l’image en essayant d’exprimer l’attribut. Tu peux la
peindre, la dessiner ou coller des formes en papier découpé.
AVEC LES YEUX FERMÉS : Les sens des objets
L’idée est de travailler les sens et de stimuler l’imagination. Pour commencer, il te faut
quelques objets. Chaque groupe est formé de cinq participants : un sens est assigné à
chaque participant. Un objet quelconque est remis au groupe. Comme chaque participant
représente un sens, il ne pourra définir l’objet qu’avec une qualité lié à son sens (vue : une
image associée ou un personnage ; ouïe : un son ; odorat : une odeur ; goût : une saveur ;
toucher : une texture ou une forme).
Afin que l’activité soit intéressante, il convient de ne pas utiliser des objets trop évidents tels
qu’une orange dont chacun connaît le goût, l’odeur et la forme. En revanche, devoir imaginer
le goût d’une boîte ou d’un livre peut s’avérer plus intéressant.
- Guide didactique - Fundació Joan Miró
Symbologie niveau 2. Bestiaire de signes
BESTIAIRE DE SIGNES
INTRODUCTION
Dans l’art, nous comprenons comme signe la représentation, généralement simple et directe,
d’un concept déterminé.
Le style caractéristique de Miró comprend un ensemble de signes liés à la terre et au ciel.
Ses personnages proviennent de la terre (notamment la femme) et certains animaux, comme
le serpent ou le lézard. Les insectes tels que l’araignée, la libellule et le papillon sont aussi
très fréquents. Les yeux, les dents, les cheveux, les antennes et le sexe répondent à des
configurations très concrètes que Miró utilise tout le temps.
En ce qui concerne le ciel, un cercle rouge représente le soleil, la lune est généralement
représentée sous la forme d’un quart croissant ou décroissant, les étoiles ont cinq branches
ou sont radiales et des points estompés de couleur pures ou des ronds noirs au tracé net
évoquent les astres ou les planètes.
Les oiseaux et l’échelle, que Miró nomme « échelle de l’évasion », font office de médiateurs
entre la terre et le ciel.
EN QUOI CELA CONSISTE ?
Le premier écran affiche trois tableaux de Miró représentatifs de son langage de signes
particulier. Clique sur l’une des œuvres pour l’agrandir momentanément. L’écran suivant
montre quatre colonnes mobiles : la première servant de référence aux autres se compose
de signes extraits des tableaux précédents ; la deuxième contient des photographies ; la
troisième, des mots, et la quatrième, des icônes. Tu dois trouver l’équivalence entre les quatre
éléments (signe, photographie, mot et icône) pour chaque concept. Les commandes en
forme de flèche dans la partie inférieure permettent de stopper le mouvement des colonnes
respectives.
La seconde phase consiste à créer un pictogramme représentant un animal. Sélectionne
l’un des objets situés dans la partie inférieure. Tu peux l’agrandir ou le réduire ou encore le
faire tourner. L’empreinte de cet objet sera le point de départ d’une figure que nous devrons
compléter à l’aide d’un tracé de craie variable.
OÙ VOULONS-NOUS EN VENIR ?
• Observer certains éléments de l’iconographie de Miró et connaître leurs significations
• Observer et mettre des signes dessinés, des photographies, des mots et des icônes en rapport
• Créer des pictogrammes représentant des animaux
QU’APPRENONS-NOUS ?
• Concepts : image réelle, symbole, icône
• Création de symboles
- Guide didactique - Fundació Joan Miró
Symbologie niveau 2. Bestiaire de signes
POUR EN SAVOIR PLUS...
Pour étudier plus en détail le langage de signes de Miró, nous recommandons de visionner la
vidéo LE TRIOMPHE DU SIGNE. La vidéo OISEAUX se concentre sur l’un des motifs les plus
caractéristiques de l’artiste.
Nous recommandons également de naviguer dans les modules d’EXPLORATION.
PROPOSITION PLASTIQUE : Dictionnaire secret
Il te faut un carnet, un marqueur noir et un crayon. L’activité est individuelle. Élabore un
registre des émotions, sensations, expériences ou états d’esprit que tu vis pendant une
semaine. Une page correspond à chaque jour. Les éléments de ce registre seront un dessin
très simple réalisé au crayon et repassé au marqueur, dont tu indiqueras la signification en
l’écrivant à côté.
À la fin de la semaine tu auras un dictionnaire graphique d’émotions secrètes que tu pourras
partager avec tes amis et compagnons.
AVEC LES YEUX FERMÉS : Chaîne d’idées
Formez des groupes de quatre ou cinq personnes. Dans chaque groupe, deux personnes
pensent à un mot : l’une d’entre elles commencera le jeu et l’autre l’achèvera. Établissez
l’ordre d’intervention des participants. Il s’agit de générer une séquence de mots enchaînés.
Suivant l’ordre établi, chaque participant pense et dit un mot. Chaque mot doit avoir un
rapport avec le précédent, mais l’objectif est toujours d’arriver au mot final. Il faudra déceler
un sens et une logique au hasard et chercher des stratégies qui amèneront au mot final.
- Guide didactique - Fundació Joan Miró
Symbologie niveau 3. En affiche
EN AFFICHE
INTRODUCTION
La fonction d’une affiche peut être diverse : elle peut informer, faire la publicité d’un produit
ou contribuer à une prise de conscience. Au fil des années, l’affiche est devenue un des
instruments de propagande le plus populaire et efficace.
En raison de la Guerre Civile Espagnole, Miró conçoit un timbre-poste destiné à rassembler
des fonds pour les républicains. Celui-ci représentait un paysan avec une barretina (coiffe
traditionnelle catalane) levant le poing. Finalement, il servit d’affiche. Le slogan appelait à la
solidarité avec le peuple espagnol. Au cours de sa trajectoire, Miró a réalisé plus d’une centaine
d’affiches (notamment à partir des années soixante), certaines à tournure revendicative, mais
c’est notamment celle-ci celle qui démontrait explicitement ses convictions politiques.
En 1950, Paul Rand conçoit une affiche de grandes dimensions pour annoncer le film No Way
Out, du réalisateur nord-américain Joseph L. Mankiewicz. La combinaison des photographies
et des couleurs emblématiques du constructivisme russe, la clarté formelle et les fractures
constantes des plans donnent lieu à une composition à fort impact visuel.
La politique de ségrégation raciale en Afrique du Sud est le thème de l’affiche réalisée par
les hollandais Dienstenbonden. La force de communication est fondée sur la simplicité ; une
simplicité extrême : zones blanches et zones noires, et le mot apartheid.
EN QUOI CELA CONSISTE ?
La première phase consiste à choisir une affiche. Une liste de concepts apparaît à l’écran.
Détermine lequel de ces messages est transmis.
La seconde phase consiste à créer une affiche. Pour cela, tu disposes de plusieurs slogans,
typographies, fonds et pictogrammes.
OÙ VOULONS-NOUS EN VENIR ?
• Découvrir l’affiche comme une autre des facettes de l’œuvre de Miró
• Observer avec attention une affiche et en déduire les valeurs expressive et symbolique
• Aborder le monde du graphisme et concevoir une affiche
• Utiliser les ressources expressives et symboliques propres à la conception des affiches
QU’APPRENONS-NOUS ?
• Miró, affichiste
• La valeur expressive de l’affiche
• L’usage expressif et symbolique des éléments du langage plastique
- Guide didactique - Fundació Joan Miró
Symbologie niveau 3. En affiche
POUR EN SAVOIR PLUS...
Pour initier à la diversité des façons de représenter un concept, nous recommandons de
combiner cette activité avec BESTIAIRE DE SIGNES (Symbologie, niveau 2).
Au sujet du langage de signes de Miró, nous recommandons les vidéos LE TRIOMPHE DU
SIGNE et RETOUR À BARCELONE.
Concernant l’importance de la figure du paysan dans l’œuvre de Miró, nous recommandons
la vidéo PAYSAN CATALAN AU CLAIR DE LUNE.
Concernant l’implication politique de Joan Miró, nous recommandons les vidéos LES ANNÉES
DE GUERRE et LES DERNIÈRES ANNÉES.
PROPOSITION PLASTIQUE : Affiche audio
Il te faut des affiches publicitaires ou annonces de revues, un appareil pour enregistrer et
reproduire des sons, des éléments et des matériaux pour créer des sons, de la musique, etc.
L’activité peut se réaliser individuellement, à deux ou en petits groupes.
Elle consiste à confectionner une affiche sonore à partir d’un modèle graphique. Pour cela, il est
important d’observer et d’analyser avec attention les éléments visuels du modèle de référence
et d’identifier l’intention expressive et symbolique (formes, couleurs, composition, textes…).
Puis tu tenteras d’extrapoler tout cela au niveau acoustique. Avec l’aide de la musique, des bruits
et autres effets sonores, développe une version sonore de l’affiche ou de l’annonce. Tu peux te
servir de la voix, mais sans utiliser de mots. Finalement on mettra toutes les images en commun.
Si les autres compagnons sont capables d’établir un rapport entre ta composition sonore et
l’image correspondante, cela signifie que tu as réussi à donner une bonne interprétation.
AVEC LES YEUX FERMÉS : Publicité avec message
Répartissez-vous en groupes de quatre ou cinq personnes. Chaque groupe concentrera son
travail sur un sujet à tournure sociale et revendicative : la durabilité, le changement climatique,
la discrimination raciale ou liée au genre, l’élimination des barrières architectoniques,
l’intégration des personnes handicapées, l’alphabétisation, etc. L’activité consiste à créer
un spot publicitaire radiophonique. On pourra soit laisser choisir librement un sujet à chaque
groupe ou leur demander de travailler ensemble pour une campagne de sensibilisation sur un
sujet concret.
Il faudra d’abord penser au message clé que l’on voudra transmettre (le slogan) puis
sélectionner les ressources qui en garantiront l’efficacité : mots, intonation, musique, effets
sonores…
La publicité devra, comme il se doit, durer vingt secondes. Il faut par conséquent utiliser
des concepts très concis et directs afin que les auditeurs potentiels captent rapidement la
substance.
Une fois le scénario rédigé, vous l’enregistrerez avec un magnétophone, un téléphone portable
ou un ordinateur.
- Guide didactique - Fundació Joan Miró
Composition niveau 1. Mosaïque de rythmes
MOSAÏQUE DE RYTHMES
INTRODUCTION
Dans les arts plastiques, le rythme est une répétition ordonnée de motifs visuels : lignes,
formes, couleurs, dimensions, espace... Ces répétitions offrent des solutions diverses : elles
peuvent être continues, alternées, progressives, symétriques, radiales, etc.
Le rythme est un recours très employé par Miró. Cependant, il ne calcule pas ses rythmes de
manière mathématique. Parfois il oppose des lignes fines et des lignes épaisses ou joue avec
les possibilités combinatoires de points et de lignes (droites, courbes, en zigzag, en spirale) ;
d’autres fois il peint des corrélations de points ou les dissémine sur la surface. Il lui arrive
également de distribuer des figures, des étoiles ou des éclaboussures.
EN QUOI CELA CONSISTE ?
Pour commencer, choisis une œuvre de Miró. Écoute ensuite un rythme musical que tu devras
mettre en rapport avec un secteur de l’œuvre. Le rythme se répète jusqu’à ce que tu identifies
le fragment qui lui correspond.
La seconde phase consiste à élaborer un rythme musical avec des éclats de céramique. À
titre de support, tu disposes d’une séquence de six carreaux. Tu peux distribuer librement
les éclats, les utiliser autant de fois que tu veux et travailler sur le carreau de ton choix, sans
distinction. Cependant, la mise en place d’une pièce déterminée sur un carreau entraîne
l’apparition automatique de la même pièce sur les autres carreaux. Tu peux à tout moment
modifier le dessin de l’ensemble en cliquant sur un ou plusieurs carreaux, et en les faisant
tourner dans le sens des aiguilles d’une montre.
OÙ VOULONS-NOUS EN VENIR ?
• Introduire le concept de rythme visuel
• Identifier les rythmes visuels suivant le parallélisme établi avec les rythmes musicaux.
• Créer des rythmes visuels
QU’APPRENONS-NOUS ?
• Le rythme comme moyen de répétition et d’alternance d’éléments du langage plastique
• Le rythme comme méthode pour placer les éléments plastiques d’une composition
• Création de rythmes visuels basés sur la répétition d’éléments visuels
- Guide didactique - Fundació Joan Miró
Composition niveau 1. Mosaïque de rythmes
POUR EN SAVOIR PLUS...
Pour étudier le rythme d’un point de vue formel, nous recommandons de combiner cette
activité avec RAYURES ET RONDS (Alphabet, niveau 1) et avec LIGNES ET PLANS (Alphabet,
niveau 3).
Pour étudier le rythme d’un point de vue musical, nous recommandons de combiner cette
activité avec EAUX DE COULEURS (Couleur, niveau 1) et avec MÉLODIES PEINTES (Couleur,
niveau 2). Pour un travail avec du matériel sonore réel, nous suggérons l’activité LE TABLEAU
SONORE (Sons, niveau 1).
Nous recommandons également de visionner la vidéo CÉRAMIQUE.
PROPOSITION PLASTIQUE : Partition peinte
Il te faut des objets qui puissent produire des sons et des instruments de musique à percussion,
de la peinture de couleurs, des pinceaux de différentes épaisseurs et du papier (DIN A3)
blanc ou noir. Formez deux sous-groupes : l’un réalisera une composition sonore et l’autre
interprètera cette dernière d’un point de vue plastique.
Le groupe de musiciens doit prêter attention au rythme. Il ne s’agit pas de produire des sons
sans sens ; il faut essayer et répéter divers rythmes et les utiliser dans une composition
collective. Le groupe d’artistes s’assoit par terre autour des musiciens, avec les peintures
et les ustensiles préparés. Chaque auditeur devra faire une traduction personnelle de la
composition sonore, en tentant de trouver une graphie appropriée aux rythmes sonores. Il en
résultera une partition plastique.
AVEC LES YEUX FERMÉS : Soupe de rythmes
Il vous faudra divers types de pâtes pour la soupe : des macaronis, des spaghettis, des
nouilles, des fusillis, des coquillettes... Il vous faudra aussi de la peinture plastique ou acrylique,
un pinceau, de la colle blanche et un carton de dimension DIN A4. Il s’agit de réaliser une
mosaïque en sélectionnant et en peignant divers types de pâtes que vous organiserez et
fixerez ensuite sur le support en carton en accord avec les rythmes déterminés : continu,
répétitif, intermittent, alterné, vertical, horizontal... Ces rythmes peuvent se lire avec les doigts.
Finalement, vous échangerez les collages rythmiques et essayerez de les identifier au moyen
du toucher.
- Guide didactique - Fundació Joan Miró
Composition niveau 2. Symétries
SYMÉTRIES
INTRODUCTION
Une composition peut être symétrique ou asymétrique. Une composition symétrique présente
un équilibre axial : à chaque élément situé d’un côté de l’axe central (qu’il soit vertical ou
horizontal) correspond un élément identique de l’autre côté. Une composition de ce type
s’avère généralement statique et même ennuyeuse. C’est pourquoi les artistes et les designers
préfèrent des variantes plus élaborées et attractives, dans lesquelles ils tentent de compenser
le poids de chaque composant.
Peu d’œuvres de Miró sont réellement symétriques. Certains portraits et autoportraits frontaux
le sont, à cause de la symétrie bilatérale propre au visage humain. Certains des paysages et
natures mortes de sa première époque suivent une symétrie apparente.
EN QUOI CELA CONSISTE ?
La première phase consiste à contempler un tableau réalisé par Miró. Il s’agit du buste d’une
figure en position frontale. Tu vois uniquement une moitié et devras trouver l’autre parmi les
quatre options possibles. Les variations entre ces options sont minimes, de sorte que tu seras
obligé de les observer avec précision.
La seconde phase consiste à choisir un fond qui servira de support. Tu ne pourras travailler
que sur la moitié du support. Tu peux le perforer et dessiner dessus. Finalement, tu peux
déplier le support. La vision entière du support révèlera un dessin symétrique.
OÙ VOULONS-NOUS EN VENIR ?
• Apprécier la symétrie comme trait caractéristique de certaines compositions plastiques
• Créer des compositions plastiques symétriques
QU’APPRENONS-NOUS ?
• Axe de symétrie
• Compositions symétriques
• Création de compositions symétriques
POUR EN SAVOIR PLUS...
Pour approfondir le travail sur les compositions symétriques et asymétriques, nous
recommandons de combiner l’activité avec ENTRE LES LIGNES (Composition, niveau 3).
Nous recommandons également de visionner les vidéos DÉTAILLISME, PORTRAITS
IMAGINAIRES et AUTOPORTRAIT.
- Guide didactique - Fundació Joan Miró
Composition niveau 2. Symétries
PROPOSITION PLASTIQUE : Monotypes
Il te faut des peintures, des pinceaux et du papier de taille moyenne. L’activité est individuelle
et expérimentale. Tu devras d’abord plier horizontalement, verticalement ou en diagonale les
bouts de papiers en deux parties égales. Les feuilles ne doivent se plier qu’une seule fois,
et ce pli constituera l’axe de symétrie. Tu travailleras sur l’une des moitiés, avec le pinceau
chargé de peinture ou en faisant couler la peinture directement du pot. Tandis que la peinture
est humide, replie une partie sur l’autre. Une extension uniforme de la peinture se produira au
contact des deux faces. Tu obtiendras à nouveau une composition symétrique en les dépliant.
AVEC LES YEUX FERMÉS : Axes symétriques
Il te faut une feuille de papier et des ciseaux. Avec les yeux bandés, plie la feuille en accordéon
en essayant de maintenir une largeur constante pour tous les soufflets. Tu obtiendras une
bande de papier d’une certaine épaisseur. Découpe ensuite de petites formes géométriques
ou organiques dans les marges. Puis déplie la feuille. Suivant que tu aies fait beaucoup ou
peu de perforations, l’ensemble aura l’aspect d’une frise ou d’une création modulaire. Les plis
préliminaires montreront clairement la symétrie des formes obtenues.
- Guide didactique - Fundació Joan Miró
Composition niveau 3. Entre les lignes
ENTRE LES LIGNES
INTRODUCTION
En règle générale les éléments formant un tableau s’adaptent à un schéma linéaire invisible.
Ce schéma régit la composition.
Hokusai est l’un des maîtres de l’estampe japonaise. Ce genre, qui a influencé divers artistes
occidentaux à la fin du XIXe siècle et au début du XXe, se caractérise, entre autre, par le
recours à une perspective en diagonale et par des compositions asymétriques.
Dans Nature morte avec figure, de Cézanne, la statue de craie regroupe et harmonise les
plans principaux (la table, le sol, la toile). Ce qui importe véritablement est l’ensemble ainsi
que les rapports entre les composants du tableau. Cela justifie certaines déformations et
combinaisons de points de vue.
Dans Autoportrait avec portrait d’Émile Bernard, Paul Gauguin se représente comme
l’incarnation du personnage des Misérables de Victor Hugo. Le visage est décentré, légèrement
coupé par la marge, comme dans certains cadres photo. À l’angle opposé se trouve le visage
de Bernard en profil. Entre les deux, un fond décoré de fleurs, d’inspiration japonaise.
Van Gogh utilisait un instrument pour étudier les proportions et la perspective. Celui-
ci consistait en un cadre muni de ficelles mobiles qu’il plaçait devant son sujet. Cela lui
permettait de mieux comprendre les lignes de l’espace, de sorte que chacun de ses tableaux
révèle une expérience personnelle unique et intense au-delà de tout calcul.
Les figures d’Egon Schiele traduisent l’angoisse existentielle de l’auteur. Malgré leur distorsion
et son insistance à les présenter adoptant des postures forcées, le dessin compositionnel est
souvent conventionnel.
Les genres traditionnels (le paysage, la nature morte et le portrait) sont à l’origine des recherches
cubistes. Braque et Picasso offrent une représentation à la fois multiple et simultanée du
motif. Il en résulte des œuvres d’une grande complexité constructive, sur plusieurs plans, aux
tons sobres et de lecture difficile.
Au début, la peinture de Miró s’incorpore tout à fait aux genres traditionnels. De nombreuses
œuvres de sa dernière époque peuvent elles aussi intégrer une notion générale de paysage ;
tout comme sa dernière nature morte, de 1937, intitulée Nature morte au vieux soulier. La
plupart de ses œuvres dérivent d’annotations et d’études préliminaires, et il a toujours tenu
compte des lois de composition.
- Guide didactique - Fundació Joan Miró
Composition niveau 3. Entre les lignes
EN QUOI CELA CONSISTE ?
L’activité permet d’apprécier l’existence de lignes de composition qui structurent et organisent
certaines œuvres d’art.
La première phase consiste à observer les œuvres de Miró et d’autres artistes. Tu disposes
ensuite d’une série de lignes qu’il te suffit de placer dans l’œuvre sélectionnée et qui, bien
situées, nous en révèleront la structure.
La seconde phase consiste à proposer une création personnelle utilisant la technique du
photomontage et suivant la structure de composition de l’œuvre analysée lors de la phase
précédente.
OÙ VOULONS-NOUS EN VENIR ?
• Identifier la structure de composition d’une œuvre
• Recourir à une structure de composition pour créer un photomontage
QU’APPRENONS-NOUS ?
• La ligne (explicite ou implicite) est un élément de base du langage visuel
• Miró utilise parfois une structure de composition préliminaire
POUR EN SAVOIR PLUS...
Pour approfondir le travail sur les compositions d’un point de vue formel, nous recommandons
de combiner cette activité avec LIGNES ET PLANS (Alphabet, niveau 3). Pour approfondir le
travail sur les compositions d’un point de vue plus conceptuel, nous recommandons l’activité
EN AFFICHE (Symbologie, niveau 3).
Les vidéos CARNAVAL D’ARLEQUIN et CONSTELLATIONS mettent en évidence deux
approches compositionnelles différentes. Dans NATURE MORTE AU VIEUX SOULIER, Miró
jette les bases de cette peinture.
- Guide didactique - Fundació Joan Miró
Composition niveau 3. Entre les lignes
PROPOSITION PLASTIQUE : Réorganisation
Imprime quelques unes des œuvres que tu as observées lors de la première phase de l’activité
en ligne. Identifie ensuite les lignes de composition et trace-les au marqueur. Découpe
l’impression suivant les lignes tracées et tu obtiendras une série de formes polygonales qui
rappellent les pièces du jeu de Tangram.
Sur une grande feuille de papier (de format DIN A3, par exemple), colle les pièces en
cherchant une nouvelle structure de composition, un nouvel ordre totalement libre. L’idée
consiste à décomposer l’œuvre de référence et de créer une nouvelle œuvre à partir des
pièces découpées qui en résultent, tout en lui conférant un aspect et une signification tous
deux nouveaux.
Pour finir, remplis les espaces blancs entre les pièces en te conformant à une idée d’ensemble.
Tu peux utiliser des marqueurs de couleur pour compléter les espaces qui sont restés blancs,
en essayant de maintenir la cohérence chromatique.
AVEC LES YEUX FERMÉS : Actualité informative
Sélectionne une nouvelle d’un programme d’informations ou journal numérique, qu’importe
l’ordre (politique, économique, technologique, culturel, sportif, loisir).
Décortique la nouvelle et synthétise-la au maximum pour la réduire en un schéma. Ce schéma
constituera la base du travail postérieur.
Cherche ensuite une autre nouvelle relevant, elle, d’un autre ordre. Rédige à nouveau cette
nouvelle en suivant le scénario structurel de la nouvelle précédente.
Un exemple :
Nouvelle 1 (Une manifestation de protestation violemment réprimée) – Ordre ; titre ; date et
heure ; lieu ; motif (de la protestation) ; nombre d’assistants ; victimes ; auteur (de la répression) ;
phrase d’intérêt liée à la nouvelle et à son auteur : « Ceux qui doivent théoriquement protéger
le peuple n’ont pas hésité à le massacrer » (M.V., assistant à la manifestation).
Nouvelle 2 (un match de football) – Ordre ; titre ; date et heure ; lieu ; motif (championnat) ;
nombre d’assistants ; victime (équipe perdante) ; auteur (équipe gagnante) ; phrase d’intérêt
liée à la nouvelle et à son auteur : « Ceci n’est pas une déroute ; c’est une humiliation » (R.H.,
supporter).
Lorsque le champ à remplir ne soit pas complètement adapté, tu as deux options : chercher
les données manquantes dans d’autres sources ou les inventer. Cet exercice peut introduire
une réflexion sur la décontextualisation, l’objectivité informative et la rigueur ou la banalisation
dans les moyens de communication.
- Guide didactique - Fundació Joan Miró
Sons niveau 1. Le tableau sonore
LE TABLEAU SONORE
INTRODUCTION
La ferme tout comme Paysage catalan (Le chasseur) et Intérieur hollandais I sont des œuvres
élaborées aux éléments abondants et à l’exécution minutieuse. Tandis que dans La ferme
Miró enregistre tous les composants avec une grande fidélité et le plus grand souci du détail,
les deux autres tableaux révèlent une transformation subjective de ces composants.
Des carnets de notes et des lettres de Miró font référence à une hypothétique représentation
plastique des sons : les bruits de l’eau, du vent ou d’une roue de charrue, le chant des
oiseaux… Dans certains dessins préparatoires, des onomatopées sont associées aux
personnages, animaux ou même objets (OLEEE !, AH !! OOOH !, RR, BOUB BOUB, TIC TIC).
EN QUOI CELA CONSISTE ?
Après avoir choisi un tableau de Miró, on commence une exploration ayant pour objectif de
mettre à jour certains de ses éléments. Tu peux te déplacer dans le tableau à l’aide des flèches
du clavier. La localisation de chaque élément déclenche un son réel associé à cet élément.
La seconde phase consiste à réaliser une composition sonore. Tu disposes d’une bibliothèque
de sons classés par dossier thématique que tu peux combiner en toute liberté. Pour finir,
écoute le résultat.
Il est important de prêter attention aux indications des énoncés pour réussir le défi.
OÙ VOULONS-NOUS EN VENIR ?
• Fournir une expérience sensorielle à partir d’une œuvre d’art
• Connaître certains composants et détails de trois œuvres de Miró
• Réaliser une composition artistique sonore
QU’APPRENONS-NOUS ?
• Éléments présents dans certaines œuvres de Miró
• Procédés de travail artistique sonore
POUR EN SAVOIR PLUS...
Cette activité a été spécialement conçue pour les utilisateurs aveugles ou malvoyants. Pour
les autres utilisateurs, il peut-être intéressant de se plonger dans le module EXPLORATION,
bien qu’il faille trouver la route pour arriver aux tableaux sélectionnés dans cette activité. À titre
d’orientation, La ferme se trouve dans ANIMAUX ; Paysage catalan (Le chasseur) apparaît sous
ASTRES, PARTIES DU CORPS et ANIMAUX et Intérieur hollandais I apparaît sous ANIMAUX.
Nous recommandons les vidéos LA FERME et INTÉRIEUR HOLLANDAIS I à tous les utilisateurs.
- Guide didactique - Fundació Joan Miró
Sons niveau 2. Atelier de sons
ATELIER DE SONS
INTRODUCTION
En 1915, à Barcelone, Miró partage son atelier avec un ami peintre. Plus tard, à Paris, il vit
et travaille dans un appartement de la rue Blomet. De retour à Barcelone, il travaille dans la
maison même où il est né, dans le Passatge del Crèdit.
À Mont-roig, en revanche, Miró dispose de beaucoup d’espace. Pendant ses séjours estivaux,
outre peindre et dessiner, il réunit le matériel dont il se servira pour ses sculptures.
Dans les années cinquante, Josep Lluís Sert lui dessine un atelier à Palma de Mallorca. Le
nouvel espace est ample et lumineux, et Miró commence à produire des œuvres de grandes
dimensions et à travailler d’une manière plus gestuelle. Plus tard, il achète Son Boter, un mas
situé à côté de l’atelier dont il habilite une partie pour exercer la gravure.
Au cours de toutes ces années, le papier est probablement le matériau que Miró utilise de
manière plus vive et constante. Il s’intéresse beaucoup à ce matériau et à toutes ses qualités :
papier de verre, carton, papier journal, cartes postales…
D’un point de vue expressif, sa création sur toile offre, à partir des années cinquante, des
résultats très vigoureux. La prédilection de Miró pour les grands formats y est pour beaucoup.
Le rapport avec la toile devient plus corporel et abonde en effets témoignant d’une spontanéité
ou d’une exploitation de l’hasard amplifiées (empreintes, éclaboussures, coulures).
Les sculptures en bronze de Miró proviennent de l’assemblage de divers objets. Le processus
de transformation est mené à terme dans une fonderie. Miró a recours à la technique de
la cire perdue, dont l’emploi remonte à l’antiquité. En premier lieu, on réalise un moule en
caoutchouc qui capte la forme de la pièce que l’on souhaite convertir en bronze. Ce moule
est rempli de cire. On le revêt ensuite d’un matériau réfractaire capable de supporter les
températures élevées, on fait fondre la cire (d’où le nom du procédé) et on le rempli à nouveau
avec le bronze fondu. Une fois le métal solidifié, le moule réfractaire est retiré, la pièce polie
et une patine appliquée.
EN QUOI CELA CONSISTE ?
La première phase consiste à choisir une œuvre de Miró. Écoute ensuite de courts échantillons
sonores correspondants aux matériaux utilisés ou à l’action effectuée.
Pour la seconde phase, tu disposes d’un clavier avec quelques-uns des échantillons sonores
précédents. Tu peux créer une composition musicale ou ambiante et l’enregistrer.
Il est primordial de suivre les consignes orales pour te déplacer avec aisance.
- Guide didactique - Fundació Joan Miró
Sons niveau 2. Atelier de sons
OÙ VOULONS-NOUS EN VENIR ?
• Connaître certains procédés mis en œuvre par Miró
• Réaliser une composition à partir de l’évocation sonore de certaines techniques artistiques
QU’APPRENONS-NOUS ?
• Certains procédés artistiques : techniques et matériaux
• Création d’un travail artistique sonore
POUR EN SAVOIR PLUS...
Cette activité a été spécialement conçue pour les utilisateurs aveugles ou malvoyants.
Nous recommandons en outre aux autres utilisateurs qui veulent approfondir le travail des
techniques artistiques, les activités EMPREINTES ET COULURES (Techniques, niveau 1),
CONTRE LA TOILE (Techniques, niveau 2) et IMPROVISATIONS SUR LE MUR (Techniques,
niveau 3).
Les vidéos SCULPTURES EN BRONZE et LES DERNIÈRES ANNÉES traitent également des
techniques et procédés.
Pour approfondir les informations relatives aux ateliers successifs de l’artiste, nous
recommandons les vidéos LA RUE BLOMET, RETOUR À BARCELONE et L’ATELIER DE
PALMA.
- Guide didactique - Fundació Joan Miró
Sons niveau 3. Agenda sonore
AGENDA SONORE
INTRODUCTION
Joan Miró était structuré et méthodique, dans ses habitudes tout comme dans son travail. En
1967, le journaliste et essayiste Lluís Permanyer lui formule le « Questionnaire Proust ». Les
allusions au travail y sont constantes. Voici ses réponses :
Le principal trait de mon caractère ?
-En me jugeant moi-même, il me faudrait beaucoup de rigueur pour le savoir.
La qualité que je préfère chez un homme ?
-La noblesse.
La qualité que je préfère chez une femme ?
-La dignité d’un arbre planté sous le ciel de Tarragone.
Ce que j’apprécie le plus chez mes amis ?
-La noblesse et la correction.
Mon principal défaut ?
-Ils sont nombreux ; je ne saurais préciser lequel est le principal.
Mon occupation préférée ?
-Mon travail.
Mon rêve de bonheur ?
-Être suffisamment fort pour passer inaperçu.
Quel serait mon plus grand malheur ?
-Ne plus pouvoir travailler, de manière active ni passive.
Ce que je voudrais être ?
-Ce que je suis.
Le pays où je désirerais vivre ?
-Là d’où je viens, Tarragone et Majorque. À Barcelone, à Paris et des déplacements dans les
endroits où un objectif de travail concret m’appelle, où que ce soit.
La couleur que je préfère ?
-Le blanc immaculé d’un mur de chaux où l’on puisse peindre un bleu rêve ou un rouge
passion.
La fleur que j’aime ?
-Je ne peux le préciser.
L’oiseau que je préfère ?
-Celui qui décrit le plus beau graphisme dans l’espace.
Mes auteurs favoris en prose ?
-Cela dépend de mon état d’esprit. Actuellement je relis Le journal intime de Baudelaire.
Mes poètes préférés ?
-En fonction du moment. Toujours ceux qui m’aident à conserver une tension d’esprit pour
mon travail. J’ai à porté de la main Solitudes de Góngora et d’anciennes poésies chinoises.
- Guide didactique - Fundació Joan Miró
Sons niveau 3. Agenda sonore
Mes héros dans la fiction ?
-Je n’ai pas eu le temps d’y penser.
Mes héroïnes favorites dans la fiction ?
-Je n’ai pas eu le temps d’y penser.
Mes compositeurs préférés ?
-Lorsque je me trouve dans une grande nef gothique catalane, je pense à Bach. Lorsque je
suis devant une surface blanche qu’il faut remplir, avec des espaces vides, des intervalles,
des silences et des signes aigus à y marquer, je pense à Stockhausen. Lorsque je me promène
dans la campagne, dans mes moments de repos, je pense à Vivaldi. Lorsque je parcours une
grande ville, je pense à Varèse. Lorsque je me promène dans les rues de cette grande ville, je
pense souvent à John Cage.
Mes peintres favoris ?
-Nos peintres romans. Le coq qui, les pattes imprégnées d’encre noire, se promène fièrement
sur une grande soie déployée et dont Hokusai signa ensuite les empreintes devant l’Empereur.
Mes héros dans la vie réelle ?
-Les héros anonymes et humbles.
Mes héroïnes dans l’histoire ?
-Anonymes et humbles.
Mes noms favoris ?
-Les prénoms austères de chez moi, sans la moindre ombre de poésie ni le moindre
symbolisme.
Ce que je déteste par-dessus tout ?
-La vanité et le mensonge.
Personnages historiques que je méprise le plus ?
-Celui qui tente d’étouffer la libre irradiation de l’esprit et la dignité de l’homme.
Le fait militaire que j’admire le plus ?
-Le fait militaire le plus antimilitariste.
La réforme que j’estime le plus ?
-Celle qui défend les valeurs universelles et immuables.
Le don de la nature que je voudrais avoir ?
-Il faudrait que j’effectue une autocritique très dure et intransigeante pour m’en rendre compte.
Comment j’aimerais mourir ?
-Parfaitement lucide, et avec l’immense désir de déranger le moins possible ceux qui
m’entourent.
État présent de mon esprit ?
-Serein et plein d’espoir dans le monde futur qui est en train de se façonner.
Fautes qui m’inspirent le plus d’indulgence ?
-Les fautes sentimentales.
Ma devise ?
-Vivre et travailler avec le sens de la dignité.
(Lluís Permanyer, 43 réponses catalanes au questionnaire Proust, Barcelone, Éditions Proa, Col. La
mirada, 1967.)
- Guide didactique - Fundació Joan Miró
Sons niveau 3. Agenda sonore
EN QUOI CELA CONSISTE ?
La première phase consiste à écouter et se remémorer la distribution d’une journée ordinaire
de Miró. Essaie ensuite de la reconstruire de mémoire tout en ordonnant de petits échantillons
sonores liés aux actions mentionnées.
La seconde phase consiste à confectionner un agenda hebdomadaire personnel à base de
sons qui puissent nous suggérer des choses à faire.
Il est important de prêter attention aux indications verbales pour réussir le défi.
OÙ VOULONS-NOUS EN VENIR ?
• Se rapprocher de l’environnement le plus intime de l’artiste
• Établir des parallélismes entre notre quotidien et celui de Miró.
QU’APPRENONS-NOUS ?
• Détails de la vie de Joan Miró
POUR EN SAVOIR PLUS...
Nous recommandons de compléter cette activité avec ATELIER DE SONS (Sons, niveau 2).
- Guide didactique - Fundació Joan Miró
Impressions en relief
IMPRESSIONS EN RELIEF
1. « Le placeur du music-hall », 1925. Diagramme
Diagramme 1
La peinture originale de Joan Miró apparaît dans la vidéo PEINTURES DE RÊVE.
2. « Série Barcelone (22) », 1944
Diagramme 1
Diagramme 2
Diagramme 3
Diagramme 4
La « Série Barcelone » est spécifiquement traitée dans la vidéo RETOUR À BARCELONE.
3. « L’œil-oiseau ». Étude d’éléments scénographiques, 1968
Diagramme 1
Diagramme 2
Diagramme 3
Diagramme 4
L’étude d’éléments scénographiques originale de Miró apparait dans la vidéo LE
TRIOMPHE DU SIGNE.
4. « Paysan catalan au clair de lune », 1968. Diagramme
Diagramme 1
La peinture originale de Joan Miró apparaît dans la vidéo PAYSAN CATALAN AU CLAIR DE
LUNE.
- Guide didactique - Fundació Joan Miró
Vous aimerez peut-être aussi
- Condt Serie3Document2 pagesCondt Serie3PROF PROFPas encore d'évaluation
- Ai 4Document11 pagesAi 4Nana ReinePas encore d'évaluation
- Microsoft Word - Conseils Rapport de Stage Lic.2007 - 3Document5 pagesMicrosoft Word - Conseils Rapport de Stage Lic.2007 - 3ayoub2012Pas encore d'évaluation
- AFSC Fiches Peda Les Fiches MemoDocument12 pagesAFSC Fiches Peda Les Fiches MemoJeanPas encore d'évaluation
- 33232dix20 NDocument14 pages33232dix20 NJava FikaPas encore d'évaluation
- Journal ScolaireDocument1 pageJournal ScolairemoicmathPas encore d'évaluation
- Module 1 Précis Du Programme RénovéDocument37 pagesModule 1 Précis Du Programme Rénovéyahayarakia36100% (1)
- 2018 2019 Feuille de Route PDFDocument4 pages2018 2019 Feuille de Route PDFAnonymous EXVt1PTdPas encore d'évaluation
- Fiche de Preparation Modele Vierge Cycle 3 Nc2b06 Programme de 2020Document2 pagesFiche de Preparation Modele Vierge Cycle 3 Nc2b06 Programme de 2020Yelena SemedoPas encore d'évaluation
- Fiches Brevet TechnologieDocument10 pagesFiches Brevet TechnologieFu TsutsuPas encore d'évaluation
- CP - Tableau SyllabiquesDocument9 pagesCP - Tableau SyllabiquesMwandu KasongoPas encore d'évaluation
- Module 2 A Instruments Et Outils de Gestion Des Classes Spéciales-ConvertiDocument3 pagesModule 2 A Instruments Et Outils de Gestion Des Classes Spéciales-ConvertiSaloly SYLLAPas encore d'évaluation
- Séquence 2-Les NombresDocument9 pagesSéquence 2-Les NombresElisaM98Pas encore d'évaluation
- Exercices Observation Cp2Document75 pagesExercices Observation Cp2Modeste DegboeviPas encore d'évaluation
- Géographie Cm2 Programmation AnnuelleDocument1 pageGéographie Cm2 Programmation AnnuelleLéonor DelvignePas encore d'évaluation
- 23122Document190 pages23122InèsPas encore d'évaluation
- Microsoft Word - Evaluations CE1 Periode 3 Calculs Jocatop BDGDocument16 pagesMicrosoft Word - Evaluations CE1 Periode 3 Calculs Jocatop BDGasdsdPas encore d'évaluation
- Méthodologie Française MBROUK MOBARIK 1234Document21 pagesMéthodologie Française MBROUK MOBARIK 1234hammouda100% (1)
- Cond CoursDocument2 pagesCond CoursPROF PROFPas encore d'évaluation
- Communication Orale123Document4 pagesCommunication Orale123LaminePas encore d'évaluation
- A Annualisation Temps TravailDocument16 pagesA Annualisation Temps Travailmohammed-aminePas encore d'évaluation
- CP Exercices Utiliser Regle 2Document2 pagesCP Exercices Utiliser Regle 2nouriaPas encore d'évaluation
- École Et Decentralisation: Le Cas de La Guinée - Djénabou Baldé & Outros - IIEP UnescoDocument192 pagesÉcole Et Decentralisation: Le Cas de La Guinée - Djénabou Baldé & Outros - IIEP UnescoLuís Leandro DinisPas encore d'évaluation
- Synthèse de Cours - 20Document6 pagesSynthèse de Cours - 20Venuti Annalisa100% (1)
- Charte de Vie Scolaire 085833500 0821 12072016Document6 pagesCharte de Vie Scolaire 085833500 0821 12072016hamidPas encore d'évaluation
- Module Francais Ci CP Ce1 Contenu ValidéDocument69 pagesModule Francais Ci CP Ce1 Contenu ValidéNana Mariama KailouPas encore d'évaluation
- Révolution - Fiche Prep s4 Et 5Document3 pagesRévolution - Fiche Prep s4 Et 5Jean-Philippe Solanet-Moulin100% (2)
- 7 Gestion Du GroupeDocument8 pages7 Gestion Du GroupeМедина ГусейноваPas encore d'évaluation
- Ref 1740-DPAE FormulaireDocument1 pageRef 1740-DPAE Formulairejoao85Pas encore d'évaluation
- Fiches UD3 Loasis Des Mots 3AEPDocument20 pagesFiches UD3 Loasis Des Mots 3AEPMouaad AlaouiPas encore d'évaluation
- Contenu Du Module 3Document3 pagesContenu Du Module 3222222222-3228Pas encore d'évaluation
- La Nouvelle cm2Document2 pagesLa Nouvelle cm2lordkhe100% (1)
- Lexique EmploiDocument7 pagesLexique EmploiCamilla CorrêaPas encore d'évaluation
- Programme Éducatif Maths 6è 2020Document29 pagesProgramme Éducatif Maths 6è 2020Sandon Davy100% (1)
- Production D'ecritsDocument37 pagesProduction D'ecritsNoel GomesPas encore d'évaluation
- Les Fractions Fractions Et Droites GradueesDocument30 pagesLes Fractions Fractions Et Droites GradueesalainestorPas encore d'évaluation
- Ofppt Module 10Document30 pagesOfppt Module 10سيدي الله يطول فعمروPas encore d'évaluation
- 2 - Communication InterpersonnelleDocument47 pages2 - Communication Interpersonnellelahlou LhPas encore d'évaluation
- Eveil ScientifiqueDocument3 pagesEveil ScientifiqueSemmach mustafa0% (1)
- Un Poirier LivretDocument20 pagesUn Poirier LivretSarah FalaquePas encore d'évaluation
- Manuel Didactikos CP (LFA)Document55 pagesManuel Didactikos CP (LFA)mbegteimiPas encore d'évaluation
- Nombres DecimauxDocument6 pagesNombres DecimauxMbolafabPas encore d'évaluation
- CH 21 Gestion Des Agendas CORRIGEDocument10 pagesCH 21 Gestion Des Agendas CORRIGEIsmael ZouhriPas encore d'évaluation
- Guide Rentrée Scolaire GS FRDocument64 pagesGuide Rentrée Scolaire GS FRElaassemy SalahPas encore d'évaluation
- Lettre Motivation SidibeDocument1 pageLettre Motivation SidibeAnonymous ARuWglPas encore d'évaluation
- Progression Sequences Traits VerticauxDocument3 pagesProgression Sequences Traits VerticauxEcole Actuelle BilinguePas encore d'évaluation
- MES 0709-Education Des Jeunes Enfants N5 APPDocument62 pagesMES 0709-Education Des Jeunes Enfants N5 APPnadjet horchPas encore d'évaluation
- L'ecole A L'ere Du Numerique Entre Ethique Et EnjeuxDocument12 pagesL'ecole A L'ere Du Numerique Entre Ethique Et EnjeuxRosa LinePas encore d'évaluation
- Le Poeme MagicienDocument52 pagesLe Poeme MagicienSandrine GallardPas encore d'évaluation
- Fondamentaux APCDocument13 pagesFondamentaux APCObed KleinPas encore d'évaluation
- Professeur Des Écoles: OffertDocument37 pagesProfesseur Des Écoles: Offertsouleymanecongo80Pas encore d'évaluation
- Arts PlastiquesDocument8 pagesArts PlastiquesStella ArnauldPas encore d'évaluation
- Dossier Pédagogique Carnaval - CalameoDocument44 pagesDossier Pédagogique Carnaval - CalameoValérie PALACIOS100% (1)
- Les QUADRILATERESDocument3 pagesLes QUADRILATERESSABATOUPas encore d'évaluation
- Didactique Robotique Leila LaghliouDocument14 pagesDidactique Robotique Leila LaghlioulayloutaPas encore d'évaluation
- 1AEP+CC1+Graphisme++SEMESTREمدونة العبقريDocument2 pages1AEP+CC1+Graphisme++SEMESTREمدونة العبقريkhalil AZZOUZIPas encore d'évaluation
- ÉvaluationDocument84 pagesÉvaluationAboukikiss KikissPas encore d'évaluation
- G-Dire Faire AgirDocument152 pagesG-Dire Faire Agirfadel rifiPas encore d'évaluation
- Apprendre et enseigner sur le Web: quelle ingénierie pédagogique?D'EverandApprendre et enseigner sur le Web: quelle ingénierie pédagogique?Pas encore d'évaluation
- Et Ciboria Relation Entre Les Ateliers Coptes de Peinture D'icônes Et L'iconographie Du Mobilier Liturgique en BoisDocument21 pagesEt Ciboria Relation Entre Les Ateliers Coptes de Peinture D'icônes Et L'iconographie Du Mobilier Liturgique en BoisJacopo Zar'a Ya'eqob GnisciPas encore d'évaluation
- Directeur Artistique ZIKDocument2 pagesDirecteur Artistique ZIKebogus225Pas encore d'évaluation
- Musique À VoirDocument36 pagesMusique À VoirGilles MalatrayPas encore d'évaluation
- Philo TLE - A1 - A2Document27 pagesPhilo TLE - A1 - A2Koffi Fortune BEYLLAHPas encore d'évaluation
- CalligraphieDocument6 pagesCalligraphiedavid.zitta368Pas encore d'évaluation
- Casedas, C. La Conservation-Restauration en Spectacle. 2010Document14 pagesCasedas, C. La Conservation-Restauration en Spectacle. 2010Trinidad Pasíes Arqueología-ConservaciónPas encore d'évaluation
- AP 3ème - L8 - ART NEGRE ET CUBISMEDocument3 pagesAP 3ème - L8 - ART NEGRE ET CUBISMEKouassi Jean marc YebouaPas encore d'évaluation
- Clément D'alexandrieDocument205 pagesClément D'alexandrieBFLPas encore d'évaluation
- Dossier Vie de Joseph RoulinDocument10 pagesDossier Vie de Joseph RoulinJING HONGPas encore d'évaluation
- Baudelaire Et Le Mythe Du ProgrèsDocument5 pagesBaudelaire Et Le Mythe Du ProgrèsMargaux AnaïsPas encore d'évaluation
- Anthropologie de L'art Regards CroisésDocument55 pagesAnthropologie de L'art Regards CroisésStellina ZolaPas encore d'évaluation
- Jean Dethier - Habiter La TerreDocument53 pagesJean Dethier - Habiter La TerreGhazi Ben IsmaïlPas encore d'évaluation
- Spécial: PhilosophieDocument33 pagesSpécial: Philosophienakechakal01Pas encore d'évaluation
- Andy Warhol Dollar SignDocument3 pagesAndy Warhol Dollar Signcdi_lavoisier0% (1)
- Arnaud Vareille, Préface Des "21 Jours D'un Neurasthénique"Document7 pagesArnaud Vareille, Préface Des "21 Jours D'un Neurasthénique"Anonymous 5r2Qv8aonfPas encore d'évaluation
- Ob - D595ab - Philosophie de L Art de Jean LacosteDocument16 pagesOb - D595ab - Philosophie de L Art de Jean LacosteMarco BowaoPas encore d'évaluation
- Arts Plastiques: Les Fabrications Et La Relation Entre L'objet Et L'espaceDocument3 pagesArts Plastiques: Les Fabrications Et La Relation Entre L'objet Et L'espaceJean reynaudPas encore d'évaluation
- Lecolebelgedepei 00 LemoDocument470 pagesLecolebelgedepei 00 LemoFrank ToddPas encore d'évaluation
- La Confiance en SoiDocument162 pagesLa Confiance en Soiezekielassogbavi4Pas encore d'évaluation
- Cours PhiloDocument101 pagesCours Philobbabaca100% (1)