Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Helene Clastres - La Terre Sans Mal - Compressed
Helene Clastres - La Terre Sans Mal - Compressed
Transféré par
Luis Manuel0 évaluation0% ont trouvé ce document utile (0 vote)
40 vues79 pagesTitre original
Helene Clastres- La Terre Sans Mal _compressed
Copyright
© © All Rights Reserved
Formats disponibles
PDF ou lisez en ligne sur Scribd
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
© All Rights Reserved
Formats disponibles
Téléchargez comme PDF ou lisez en ligne sur Scribd
0 évaluation0% ont trouvé ce document utile (0 vote)
40 vues79 pagesHelene Clastres - La Terre Sans Mal - Compressed
Helene Clastres - La Terre Sans Mal - Compressed
Transféré par
Luis ManuelDroits d'auteur :
© All Rights Reserved
Formats disponibles
Téléchargez comme PDF ou lisez en ligne sur Scribd
Vous êtes sur la page 1sur 79
Héléne Clastres
La terre sans mal
le prophétisme tupi-guarani
| Recherches anthropologiques
sous la direction de Remo Guidieri
aux Editions du Seuil; Paris
| S1¢ BIS
Ses,
HELENE CLASTRES ce)
Gene
a GS
LA TERRE
SANS MAL
LE PROPHETISME
TUPI-GUARANI
MH ABES 2A 44 SHOU I
EDITIONS DU SEUIL
21, rue Jacob, Paris VIP
(CE LIVRE EST PUBLIE DANS LA COLLECTION
RECHERCHES ANTHROPOLOGIQUES
DIRIGEE PAR REMO GUIDIERI
© Editions de Seuil, 1975,
er Ou dt es ape ban, eS Bite cons te entre
Toon sanction rls aie #28 et suivants ds Coe peal.
I
Introduction
Gens sans foi, dirent des Tupi leurs premiers observateurs.
« Théologiens de 'Amétique du Sud », écrivait-on récemment
des Guarani. Entre ces deux jugements contraires, quatre siécles
histoire : la Conquéte et, pour les Guarani, cent cinquante ans
de vie dans les « réductions » des jésuites. Aucune commune
mesure, semble-t-il, entre les peuples si peu soucieux du sacré que
nous ont décrits les chroniqueurs et les mystiques que sont aujour-
‘hui les Guarani. A envisager chacun pour soi ces deux moments
de son histoire, le contraste semble si marqué que I'on pourrait
presque se demander s'il s'agit de la méme culture. Est-ce & dire
que la Conquéte et Ia christianisation qui la suivit ont introduit
une cassure définitive, telle qu’il soit désormais impossible, pour
comprendre ce que disent aujourd'hui les Guarani, de renouer les
fils de leur tradition?
Au_xvi® siécle, les Tupi-Guarani se distribuaient sur une aire
géographique trés vaste. Les Tupi occupaient la partie moyenne et
inférieure da bassin de I'Amazone et des principaux affluents de
Ja rive droite. Ils maitrisaient une grande partie du littoral atlan-
‘tique depuis l'embouchure de !’Amazone jusqu’ Cananea. Les
Guarani occupaient la portion du littoral comprise entre Cananea
‘et Rio Grande do Sul; de la ils s‘étendaient vers I'intérieur jus-
qu'aux fleuves Parana, Uruguay et Paraguay. Du confluent duu
Paraguay et du Parana, les villages indiens se distribuaient tout
Te long de la rive orientale du Paraguay et sur les deux rives du
Parana, Leur tecritoire était limité au nord par le fleuve Tiet® ot
7
a Di a a
.
LA TERRE SANS MAL
4A louest par Ie Paraguay. Au-dela, séparé de ce bloc par le Chaco,
vvivait un autre peuple Guarani, les Chiriguano, installé aux fron-
‘idtes de I'Empire inca
De toutes ces sociétés, celles du littoral sont de beaucoup les
mieux connues, Au xvi* sigcle voyageurs et missionnaires, (moins
d'une culture alors intacte, en laissérent des descriptions — quel-
‘ques-unes remarquables. Ainsi celle de Jean de Léry : c’est en 1555
que le disciple de Calvin fait le voyage au Brésil. A cette date un
chevalier de Malte, Villegaignon, avait fondé, dans la baie de Rio de
Janeiro, une modeste colonic : il avait attiré dans la « France
antarctique » des pasteurs huguenots et Léry (alors étudiant en
théologie), par la promesse que le culte réformé pourrait y éire
pratiqué librement. On sait ce qu'il en fut. C’est un an avant Léry
‘que le cosmographe du roi André Thevet, ancien moine cordelier,
se rend chez les Tupinamba. 1! séjourne Ini aussi dans la région
de Rio, puis, soit dans le mme voyage, soit au cours d'un second
voyage, il visite également des tribus tupi situes beaucoup plus
au nord. Dix ans auparavant, en 1545, c'est encore cher les Tupi-
namba de la région de Rio qu’un aventurier allemand, Hans
Staten, avait séjourné plusieurs mois, contre son gré, Iui, puisque
prisonnier des Indiens. La Véritable Histoire de son aventure,
pleine d'observations naives sur les coutumes des Tupinamba,
est un document précieux. Aux relations de tous ces voysgeurs,
s'ajoutent celles des missionnaires. Les premiers jésuites arrivent
au Brésil en 1549. Leur but éant d’évangéliser ils se déplacent
constamment : leurs témoignages portent done sur tous les grou
pes du littoral alors accessibles.
En contact les premiéres avec les Européens, les sociéiés du
littoral disparaissent aussi les premiéres : au tout début du
lene il ne subsiste plus une seule tribu tupi sur toute la
cétiére,
} ‘Le destin des Guarani est quelque peu différent. La pénétra-
tion européenne dans leur région commence dans le premicr tiers
du xvi sitele, trés locale et trés inceriaine durant les premieres
décades. Asuncién, fondée en 1537, n'est qu'un petit fortin. Les
premiers jésuites arrivent & Asuncién en 1588 et visitent la pro-
vince du Guaira : & cette époque, |'évangélisation se réduit & sa
8
INTRODUCTION
plus simple expression. Les missionnaires ne se soucient pas de
demeurer parmi les Indiens: ils se contentent de traverser les
villages, baptisant en toute hite des milliers de gens. C'est scule-
ment au début du xvu® sigcle que les missions commencent
s'implanter. En 1609, le roi d’Espagne, & la demande de Hernan-
darias de Saavedra alors gouverncur du Paraguay, accorde & la
Compagnie de Jésus le droit d'entreprendre la. conquéte spiri-
tuelle des cent cinquante mille Guarani du Guaira. L’année sui-
vante deux jésuites, les péres José Cataldino ct Simon Maceta,
parviennent a rassembler quelques centaines de « Sauvages » dans
la premigre « réfuction ». Le pére Antonio Ruiz de Montoya,
Je plus illastre évangélisateur des Guarani, fondera onze réductions
entre 1622 et 1629. C'est ainsi que s‘inaugura une réalisetion
orinante ? ce qu'on allait appeler le « royaume de Dieu sur terre »,
Is « république communiste catholique » ou, plus simplement
1’ « Brat jésuite du Paraguay », Pendant plus dun siécle et demi
(jusqu’en 1768, date d’expulsion des jésuites), les trente cités
de cet Etat prospere et & peu pres autonome (seuls le pape et le
roi d’Espagne y avaient droit de regard) allaient isoler les Guarani
(plus de deux cent mille Indiens) du monde colonial espagnol. Les
Jésuites partis, ts direction des missions échut aux franciscains
contrdtés par des administrateurs : les anciennes réductions furent
aussit6t envahies par les colons et il ne fallut pas longtemps pour
que le systéme économique collectiviste établi par les jésuites s¢
transformat en un impitoyable systéme d’exploitation. Par milliers,
es Guarani abandonnérent ‘alors les réductions, le plus souvent
pour s‘instalier dans des villages espagnols. ‘Trente ans aprés
Vexpulsion, moins de la moitié des Indiens vivaient encore dans
kes réductions. Par la suite, plusieurs guerres achevérent de ruiner
‘ce qui restait des cités. Ceux des Guarani qui n'y furent pas massa-
cerés s'installérent dans de petits villages, dans le Guaira, non loin
de I'emplacement des ancieanes réductions. Mais en 1848, le
dictateur Carlos Antonio Lopez contraignit ces Indiens (six mille
environ) A abandonner leurs villages pour aller vivre dans
ceux des Paraguayens. Telle fut, résumée dans ses grandes
lignes, histoire post-colombieune des Guarani ; soustraits
Pendant plus de cent cinquante ans & la domination des colons,
9
LA TERRE SANS MAL
ils se fondirent ensuite peu & peu dans I population para-
‘guayenne,
Un certain nombre de tribus guarani avaicnt. pourtant éhappé
aux jéuites et aux colons et avaient pu conserver leur autonomie
our s'étre établies dans un territoire resté longtemps inaccessible :
de 1A appellation de Caaigua on Caingua (— gens de la forts)
qui leur fut donnée. Vers 1800, les Caingua habitaient aux sources
du fleuve Iguatemi, s'étendant vers le Nord jusqu’a la cordillére
‘de San José, prés des sources de I"Ypané. Des Caingua descendent
yraisemblablement les trois groupes guarani — Mbya, Chiripa
et Pa’i — qui vivent aujourd'hui au Paraguay. Leur nombre, au
tolal, nexcdde sans doute pas trois mille. Les Mbya vivent, dissé-
minés en petits villages, dans l'actuel département du Guaira,
centre Yuty au sud et San Joaquin au nord. Les Chiripa ont établi
leurs villages au nord de San Joaquin; les Pa’i encore plus au
nord, prés du Parana, sont plus éloignés. Au début de ce siécle,
ils occupaient une région plus vaste; on trouvait également plu-
sicurs groupes de Caingua au Brésil, dont les Apapokuva étudiés
par Nimuendgju. Si, en 1912, Nimuendaju estimait a trois mille
Fensemble des Caingva brésiliens, ils ont aujourd'hui presque
dispar.
‘Chacune de maniére inégale, mais toutes inéluctablement, les
trois communautés guarani du Paraguay se désagrégent ; elles
‘ont perdu leur autonomie politique (outre le « dirigeant religieux »
elles ont ii leur téte un capitan le plus souvent imposé par les auto-
rités paraguayennes) et économique (sans doute les Guarani culti-
Yent-ils encore leurs propres brilis & proximité de leurs villages,
mais nombreux sont ceux qui travaillent chez les Paraguayens).
SSi les Mbya ont conservé leur langue, les Chiripa ne parleat plus
‘que le guarani paraguayen. Bref, les communautés guarani sont
condamnées a bréve échéance : Jusque-Ii, pourtant, toutes ont
conservé une tradition religicuse originale, qu’elles ont maintenue
autant micux qu’en elle seule elles ont trouvé tout ensemble le.
‘moyen et le but de leur résistance au monde des Blancs. Tous les
‘ethnologues qui, depais Nimucndaju, ont éudié les Guarani,
n'ont pu que souligner l'importance que ces Indiens accordent &
leur vie feligieuse, Voici, par exemple, ce qu’éerit A ce propos
10
INTRODUCTION
Egon Schaden : « Il n’existe sur terre aucun peuple, aucune tribu,
qui s‘applique, mieux qu’aux Guarani, la parole évangstique :
Mon régne n'est pas de ce monde, Toute la vie mentale du Guarani
gst tournée vers I'Au-dela. » Des « théologiens » done. Voila
le probléme. Comment concilier ces observations récentes — et
certes, indiscutables — avec le tableau que nous ont laissé des
Guarani et des Tupi les chroniqueurs?
Une explication semble s'imposer : I'influence du christianisme
serait & Vorigine de cet épanouissement de la vie religieuse, que
cette influence date du temps des « réductions » ou qu’elle soit posté
Fieure. Ainsi, J. Vellard, lorsqu'il commente des priéres mbya 2,
‘opére-t-il une discrimination entre celles qui, selon Ini, sont de
toute évidence indiennes — pour étre pauvres et stéréotypées — et
celles quil juge belles et d'une plus haute spiritualité, dues par
‘conséquent aux jésuites et que la tradition orale des Mbya aurait
‘conservées. Passons sur le parti pris pour ne considérer que l’hypo-
‘thése qu'il met en jew : les Mbya seraient done les descendants des
Guarani qui vécurent jadis dans lef réductions. Rien n’est moins
sir et tel n’est pas, par exemple, avis de L. Cadogan : aprés de
Jongues recherches, ce dernier découvrit que les Mbya descenden)
des « sauvages » du Mba’e Vera dont parle Dobrizhoffer dans son
Historia de Abiponibus, et qui, d’aprés le témoignage du Pére, en
bbatte aux persécutions des Espagnols, venaient justement de
demander aide et protection aux jésuites lorsque ceux-ci furent
expulsés §; de sorte que les Mbya n’eurent guére la possibilité de
vivre dans les missions. On sait, du reste, & peu prés, ce qu’il advint
de Ia plupart des Guarani qui vivaient dans les réductions : ils
se trouvérent mélés & la population des colons qui n’attendaient
que le départ des jésuites pour s'emparer du Guaira. A la rigueur
pourrait-on admettre que quelques groupes aient pu reprendre
leur ancien mode de vie — et encore, a condition de.supposer que
~~. E, Sehadeo, « 0 estudio do Indio Brasileiro... », in America Indien,
vol. XIV, 1954.
2. « Texies Mbiwha recueilis en Paraguay », JSAP, 1937.
3 L. Cadogan, « Ywyra fe'ery , in Sipplemente Antropokseice dele Revisit
del ‘Ateneo paragiyo.
u
LA TERRE SANS MAL
‘ces groupes problématiques aient, de leur propre mouvement,
rejoint les missions peu de temps avant leur destruction, On oublic
trop souvent en effet quel bouleversement radical de la société
traditionnelle supposait le nouvel ordre imposé par les jésuites :
la forme du village et des maisons, les activités quotidicnnes,
Véconomie, le sysiéme de parenté, les relations inter-tribales...
tout fut transformé. Une société d'un tout autre type s*édifia sur
les ruines de Vancicnne et qui fut & peu prés en place vers 1660,
La question tant débattue de savoir si les Peres firent des Guarani
de vrais chrétiens ou s'ils n’obtinrent qu’une conversion superfi-
cielle devient secondaire : ils leur avaient imposé des conditions
existence telles qu'il est bien difficile de eroire que les Guarani
aient pu, aprés un sigcle, retourner tout simplement dans la forét.
Crest pourtant ce qu’affirme E. Schaden, qui se préoceupe surtout
de décsler dans le discours des Guarani d’aujourd’hui la marque
du christianisme : « Déja, en vertu de différenciations antérieures
4 Varrivée des Européens, la culture guarani, & cause de lisolement
des divers sous-groupes, ne possédait qu’une uniformité trés rela-
tive quant & la langue, la religion, la tradition mythique et les
‘auires secteurs de la culture. La différenciation ne fit que s'accen-
tuer T’époque coloniale, lorsqu'une partie des populations fut
soumise durant plus d’un sitcle la tutelle des jésuites, et retourna,
‘aprés expulsion des missionnaires, & ses conditions d’existence
primitives. »
La seconde partie de cette assertion ne va pas sans poser quel-
ques problémes. Mais que penser de la premigre? Et pourquoi
‘Schaden a--il besoin d'alléguer, contre tous Jes anciens témoigna-
5, des différenciations antérieares & la Conquéte? Peut-étre pour
‘mieux asscoir (en faisant de I'aptitude au changement une dim
sion de fa culture guarani) les explieations par le synerétisme qu'il
donne de la religion actuelle; ou pour rendre compte de I'écart
qu'il établit entre les Mbya da Paraguay qui, dit-il, « semblent
avoir conservé leurs traditions dans leur pureté originelle » et
tous les autres groupes guarani pour lesquels « l'examen Te plus
superficiel montre qu’ils ont assimilé une série d’éléments chré-
= 1. B. Schaden, Aspectos Fundamenais de cultura guarani, p. 18.
2
INTRODUCTION
tiens 1». Pourtant les différences culturelles entre les sous-groupes
guarani étudiés depuis te début de ce sidcle ne paraissent pas si
grandes : que l'on compare par exemple, les danses, les rites
attribution du nom, Je grand mythe des jumeaux... chez les
Chiripa, les Mbya et les Apapokuva. Ils sont au contraire remar-
quablement homogénes. La différence alléguée réside-t-elle alors
dans la plus ou moins grande assimilation éléments chrétiens?
‘Mais il n'est pas toujours aisé de déceler de tels éléments, et il
faut en tout cas une analyse moins superficielle pour en évaluer
‘importance et la signification : Nimuendaju remarquait, par
exemple, que le « christianisme » des Apapokuva n’était que de
facade. Comment trancher? Synerétisme, ou « pureté originelle »?
A priori, ni lun ni l'autre ne nous paraissent convaincants, pour
les présupposés théoriques qu’ils mettent en jeu : le premier, parce
qu'il suppose que la pensée religieuse des Indiens offre assez peu
de cohérence pour pouvoir admettre n‘importe quels éléments
Girangers; l'autre parce qu'il suppose que le discours religieux
(iscours sur l'homme et le monde, et aussi discours d'une société
sur elle-méme) peut demeurer immuable quand la société a change.
Enfin, lune et l'autre procédent d'une méme maniére d’envisager
histoire de ces cultures : & I'envers, en reconstruisant le passé des
‘Tupi-Guarani partir de ce que I'on sait, ou de ce que I’on croit
savoir aujourd'hui de leur religion.
Poser le probléme en ces termes revient plut6t & l’esquiver puis-
‘que c'est préjuger déja de la solution. Il faut par conséquent chan-
‘ger d’optique : nous avons pris le parti inverse, et choisi de repren-
dre histoire a ses débuts. Nous avions, pour le faire, un fil conduc-
teur : les Guarani aujourd’hui parlent de la « Terre sans Mal »,
or c'est 18 un théme trés ancien, attesté au xvi* siécle chez tous les
‘Tupi-Guarani, Notre premiére tiche est par conséquent de cher~
cher & comprendre la signification qu'il avait 4 ce moment-la,
dans un contexte historique et culturel qui n°était pas celui de
maintenant, Alors, les sociétés tupi-guarani étaient libres et fories;
aujourd’bui elles meurent ; nous le savons bien; mais les Indiens
‘eux aussi le savent, et ils le disent, Mais auparavant, quel pouvait
1, E. Schaden, préface au livre de Cadogan, Ayru Rapyta,
3B
TA TERRE SANS MAL
ure leur discours? C’est ce qu'il faut tenter de découvrir : et
peut-étre pourra-t-on entendre autrement les belles paroles que
les Guarani disent axjourd’hui, savoir si le discours qu’ils tiennent
est ou nest pas le leur, s'il a changé et de quelle maniére. Rien ne
‘nous oblige, aprés tout, & reprendre & notre compie les affirmations
des anciens chroniqueurs et & accorder 4 leurs opinions le méme
‘Grédit qu’a leurs informations : on verra, a les relire, qu’ils nous
‘ont livré, & leur insu, lessentiel de Ia religion indienne.
cuAPrTRE 1
Des peuples sans superstitions
Quand on se reporte au témoignage des chroniqueurs sur les
‘croyances des anciens Tupi-Guarani, on est frappé par la conver-
gence de leurs dires, sur ce point précis unanimes : les Gentils
de « paredeld » n’avaient pas de « superstitions ». Les premitres
relations & nous offrir sur ces nations amérindiennes des docu-
ments tant soit peu détaillés, celles des jésuites, tOt venus sur la
terre brésilienne pour y établir leurs missions, nous disent des
Tusk quills Galt gene ipnorants de tote viii avalaraat
idole, ne reconnaissant en rien la dimension du sacré,
i campmor paral giabsiniewtbre or
rituelle me vienne ordonner leur activité quotidienne et rythmer
leur temps. « Ce sont des gens (les Tupi da Nord) qui n’ont aucune
connaissance de Dieu, n'ont aucune idole’, » Sans doute ce
jugement du pére Manuel Nébrega est-il pour le moins hitif : il
ny avait guére plus d'une quinzaine de jours que le missionnaire
Gtait arrivé chez les Tupi lorsqu’l I’écrivit. Mais quatre mois plus
tard son opinion est & peine modifige : « Ces gens-la (il s’agit
cette fois des Tupinamba) n’adorent pas Ia moindre chose, ‘ils
ne connaissent pas Dieu; toutefois, ils nomment le tonnerre
tupana, et cela signifie chose divine *. » La différence est minime,
tout au plus leur accorde-til maintenant une vague notion du
‘Chez les Tupi, par conséquent, ni croyances ni pratiques
uses; ni foi, ni loi, strictement.
1. Lettre au pére Simo Rodriguez, 10 avril 1549, in. Leite, Cartas dos
Jesultas do Brasil, vol. bp. 111.
‘Xinformagio das terras do Brasil, 200t 1549, 1, p. 150.
15
LA TERRE SANS MAL
A lasuite du pre Manuel Nébrega et des premiers missionnaires,
tous les voyageurs qui se rendirent chez les Indiens font écho &
‘cette affirmation : non seulement ils n’avaient aucune connais-
‘Sance du vrai dieu ce qui, s’agissant de sauvages, n’était guére
fait pour les surprendre, mais ils n’avaient pas davantage de
« fausses croyances », Ce trait remarquable des nations tupi-
‘guarani les étonne — méme s‘ils s'en félicitent, les missionnaires
du moins : leur tiche d°évangtlisation se voyant simplifiée de
n'avoir pas A combatire de croyances déja établies. Rebelles &
Vidée que l'on se faisait de ce que devaient tre des patens —
adorateurs de divinités multiples et pratiquants de cultes idol-
tres — ces Indiens, eux, ne croyaient & rien, n'adorant astres, ni
animaux, ni plantes, ne possédant ni prétres, ni lieux sacrés.
Sans « superstitions » précisément : sans rien of s’avérit un quel-
congue souci du surnaturel, Bref, ils étaient en deca méme du
paganisme et la dimension religieuse semblait faire totalement
défaut & leur culture. Le fait, sans nul doute, avait de quoi sur-
prendre, Au reste, avec les Guarani, les chrétiens n’en étaient plus
4 un sujet d’étonnement pris : comment pouvaient-ils comprendre
fen effet que des gens possessours d'une langue dont tous admi
raient sans réserve la richesse, I'harmonie et la complexité, doués
d'assez de raison naturelle pour avoir établi un ordre social ott
les nobles étaiont soigneusement distingués des roturicrs? aicnt
pu en méme temps vivre sans foi aucune, pratiquer la polygamie,
guerroyer sans arrét et, pour comble, s’entremanger?
Citons ici quelques textes, Sur les Tupinamba : « Combien que
este sentence de Ciceron, assavoir qu'il n'y a peuple si brutal,
ny nation si barbare et sauvage, qui n’ait sentiment qu’ll y a quel-
que divinité, soit recedic et tenue d'un chacun pour maxime indu-
bitable : tant y a néantmoins que quand je considére de prés
‘nos Totloupinambsoults de I'Amérique, je me trouve aucunement
empesché touchant application d’icelle a leur endroit. Car en
premier lieu, outre qu’ils n'ont nulle cognoissance du vray Dieu,
‘encores en sont-ils Ia, que, nonobstant la coustume de tous les
1. Montoya, « tenian sus caciques, en quien todos reconocen nobleza here
dada de sus astepasados, fundada en que habian tenido yasallo y gobernado
Pueblo », in Conquista Espiritual.. p. 49.
16
DES PEUPLES SANS SUPERSTITIONS
anciens payens, lesquels ont eu la pluralité des dieux : et ce que
font encore les idolatres daujourd’hui, mesmes les Indions da
Péru... ils ne confessent, ny n’adorent aucuns dicux celestes ny
terrestres : et par conséquent n’ayans aucun formulaire, ny lieu
député pour s'assembler, & fin de faire quelque service ordinaire,
ils ne prient par forme de religion, ny en public ny en particulier
chose quelle qu’elle soit. » Et auteur de plsindre quelques
pages plus loin ces « pauvres gens » qui vivent « comme bestes
brutes » sans la moindre foi. Si nous avons choisi de citer d’abord
ct assez longuement Jean de Léry c'est qu'il exprime admirable-
ment le sentiment général. Léry, pourtant, serait difficilement
‘soupconné d’ethnocentrisme. Sa relation est formelle : nulle trace
‘chez les Tupinamba de croyances & de quelconques divinités, nul
indice conctet, geste, objet ow rituel, qui laissGt. supposer l'exis-
tence de préoccupations religieuses si minimes fussent-elles.
Bien miewx, & ce que semble vouloir suggérer I'auteur : de tels
sujets étaient si profondément éirangers aux Indiens que lors-
qu'ils écoutaient les Blanes exposer leur théologie, ils ne savaient
‘exprimer que la plus profonde stupéfaction : attitude révdlatrice,
donne-t-on a entendre, de ce que rien ne se trouvait dans leur propre
culture qui piit faire écho A un semblable discours. Les chroni-
‘queurs avaient Ii de bonnes raisons de se montrer surpris : quelle
culture peut étre assez peu inquiete d'elle-méme pour n'inclure
pas cette dimension de négativité que traduit une religion? Mais
‘Poursuivons leur lecture : Claude d’Abbeville * : « Encore que les
Indiens Topinamba soyent d'un jugement naturel assez beau,
siest-ce que jamais il ne s'est trouvé nation si déraisonnable qu’eux
au service de Dieu. Quel peuple se trouve-t-il si sauvage soubs
le ciel et quelle nation il y a si barbare qu’elle n’aye ev, sinon
la vraye religion, au moins quelque vaine superstition soubs
Vombre d’icelle?... Je n’estime pas qu'il y ait aucune nation au
‘monde laquelle ait esté sans quelque espéce de religion, sinon tes
Indiens Topinamba lesquels n’ont cy devant adoré aucun Dieu,
ny Coeleste ny terrestre, ny d'or, ny d'argent, ny de pierre, ny
4 ean ery Hao wt vovae fet nl ered Bly. Al. 0,
~ 2. GL d' Abbeville, Histoire de lo Mision des péres capucins... p. SH, 322.
a
il
LA TERRE SANS MAL
de bois, ny autre chose que ce soit.
fonnement que chez Léry: des gens pas meme palens: Eeyptiens,
Perses, Grecs, Romains, etc., tous euret
care dans toute histoire une seule |
i i i ‘Unique excep
ration & qui la religion fit complétement défaut. |
tion A cette régle générale, les Tupi, qui, nous dit-on, ne procé |
dieux; on chercherait
daient & aucun sacrifice,
jgnoraient ce que pouvaient étre une
ea vain
» Méme observation et méme
‘avaient ni prétres, ni autels, ni temples,
prigre ou un office divin,
ff pour qui tous les jours s'équivalaient, ni plus ni moins solen’ |
nels les uns que les autres.
Pourtant, ajoute l'auteur,
dieu véritable, qu’ils nomment
cord : en effet, quant
Iui-méme et ses compagnons,
que manif
ils ont quelque connaissance d'un
upd. Notons ici un premier désac-
cette derniére alfirmation, le témoignage
de Léry est bien différent qui nous déctare que ce fureat les Blancs
qui, prenant prétexte de Ia crainte
“ent les Tupinamba A oul le tonnerre — upd —
prétendirent que ¢’étut li Te dieu dont ils eur parlaient. «.. Quand
iis entendent le tonnerre, qu'ils n
‘dement effrayez : si nous acc
de Ia particuligrement occasion
ponse a cela estoyent, que puis
fagon, qu'il ne valoit
aux Frangois » aient
antérieurs au voyage
‘dgji mention. Ainsi la lettre
‘nomment le toanerre
‘accomm
jomment Toupan, ils sont gran
jodans de Jeur rudesse, preaions
de leur dire, que c'estoit le Dieu
Gont nous leur parlions, lequel pour montrer sa grandeur et puis-
dont areal ainsi trembler ciel et terre : Jeur résolution et res
isqu'il les espouvantoit de telle
done rien*. » Que es habitants de I" « Isle
4&8 les premiers & promouvoir ceite accep-
jon du terme indigtne tupd est certainement inexact : des textes
aascas ae ce compagnons de Villegaignon en font
déji citée du P, Nobrega : « .. ils
tupana, et cela signif chose divine. Aussi
‘de terme plus approprié, pour leur
nous autres n’avions-nous pas
pparler de Dieu, que celui de Pére Tuy
pana * ». Tel fut le sort qui
Zohut A Tupd : on sait comment les missionnaires l'utilisérent
dans leurs catéchismes pou
{i ta longue, il prit pour les
Ja méme époque que
1. Ley, op. cit tT
2 Informagonns OP.
ir désigner le diew chrétien et comment,
Indiens eux-mémes ce detnier sens. A
Léry, un texte de Thevet semble confirmer
6.
ry B. 180.
18
DES PEUPLES SANS SUPERSTITIONS.
| que Toupan fut une invention chrétienne, et que Jes Tupi ne Je
confondaient pas avec leur propre notion de tupd (tonnerre) =
« faut done scavoir qu’ils confessent qu’il y a un Diew da ciel.
Is ne le prient, ny honnorent en aucane fagon et disent estre le
Dieu des Chrectiens, et qu’il fait bien aux Chrestiens, et non &
eux. Ils appellent Dieu Toupan, et ne croyent point qu'il aye puis
sance de faire plevoir tonner ou donner beau temps, ny mesmes
Jeur faire venir aucun fruit! ». Néanmoins quelques auteurs, &)
Vinstar de Nébrega — et a l'encontre de Léry — laissent entendre
que Tupi était 4a” pour les Indiens une divinité, voire le diew
unique; dont les Tupi auraient ew-par conséquent quelque lumigre
naturelle encore qu'is ne lui rendissent aucun culte.
~Ainsi Yves d’Evreux parle+-il de « la croyance naturelle quills (
font toujours euc de Dieu, des Esprits et de Mmmortalité de
V’Ame® », Précisons toutefois que son affirmation se fonde davans
{age sur la preuve cosmologique de V'existence de Dieu et sur
les éerits des Grecs ou des Latins que sur observation des
sauvages, Et précisons encore que les voyages des péres capucins
Cl. d’Abbeville et Y, d’Evreux sont postérieurs d’un demi-siécle
Acelui de Léry, de plus de soixante ans & celui de Ndbrega et des
premiers jésuites : I'enseignement des Blancs avait eu le temps
de faire son chemin, Il n’est qu’ lite, pour s'en convaincre,
telle discussion sur la nature de Dieu * of ’argumentation prétée
par Yves d’Evreux A son interlocuteur indigéne est d'un homme
que Ton dirait presque rompu aux débats théologiques : Tupa
ne saurait étre homme, tant partout ata fois; Tupi ne saurait
Gire homme, ayant tout créé : s'il était homme, il faudrait qu'un
autre homme V'eit engendré; Tupi est invisible, etc. Voila de
quoi nous laisser perplexe quant & Vorigine « naturelle » — in-
diene — d’une pareille croyance. Nous reviendrons sur la ques-
tion de Tup& que, d’un commun accord, les ethnologues (ainsi
Métraux) ont peut-éire trop vite relégué & un rang secondaire,
eddant sans doute & l'impression que Icissent des témoignages
1. A-ThenetoMitoire de dee Voyausy Les Franca on Aig P26.
2: oor d Evreux, Voyage dans le nerd de Brat, . 27. Me
19
| LA TERRE SANS MAL
|aussi_contradictoires que ceux que nous venons de citer.
IY. d'fivreux, pour sa part, conclut de la facon suivante : « Voila
|la croyance de Dieu que ces Sauvages ont toujours eue emprainte
|naturellement-en leur esprit sans le recognoisire -par.aucune
\sorte de prigres ou de sacrifices, » Lui aussi, par conséquent,
“emarque l'absence de toute pratique religieuse chez les Indiens,
leur insouciance a 'eadroit de la divinité, Enfin, pour en terminer
vee les Tupinamba, citons un dernier écrit, celui du mission
naire jésuite Ferndo Cardim : « Ce peuple n'a pas connaissance
de son Créateur, ni des choses du Ciel, ni de ce quia trait ala peine
‘ou a la gloire aprés cette vie. Partant, il n’adore rien, ne pratique
‘aucune cérémonie, aucun culte divin. Toutefois, les Indiens savent
quills ont une me, et qui ne meurt pas... Ils ont aussi grand
peur du démon qu’ils nomment Curupira, mais ils ne l'adorent
pas plus qu'une quelconque autre créature. Ils ne possédent pas
non plus d’idole de quelque sorte que ce soit®, » On pourrait
encore multiplier les citations : toutes. sont.en accord. Les plus
radicales font des Indiens de parfaits athées. Les autres, qui con-
sentent a les eréditer de quelque connaissance du sacré, voient
cen eux Fimage de I'innocence : s'est le bon sauvage, au jugement
, A la suite d’une violente
querelle « Tamendonare... frappa si rudement la terre, que de 18
sourdit une grande source d'eau, si hault, que en peu de temps
elle attaignoit par-dessus es collines et costeaux, et sembloit
ssurpasser la haulteur des nues, et laquelle persevera jusques &
‘ce que Ia terre en fust toute couverte. Ce que voyans les deux
fréres et soigneux de se sauver, montdrent sur des montaignes les
plus haultes de tout le pals : Et taschoient se sauver contremont
les arbres avec leurs femmes. Ce qu’ils feirent aussi, sgavoir est
‘Temendonare monta sur un arbre, nommé Pindona y tirant avec
ui une de ses femmes : et Ariconte monta avec se femme sur
‘un autre arbre, nommé Genipar®... ». Lors de ce cataclysme tous
Jes hommes et tovs les animaux périrent, & V'exception des deux
1. Thevet, op. elt p. 29.
2. Ibid, p. 3.
30
DES PEUPLES SANS SUPERSTITIONS
couples fot naqurent deux peoples ennemis: es Tupinama et
ls Tamcio.
Comme on peut le voir d'aprés les citations faites plus haut
est ce deuxidme mythe qui a été seul retenu, Tl est difficile de
suivre Métraux lorsqu’il suggére que ces deux versions du déiuge
font double emploi, En effet, le premier déluge est df 4 une eau
céleste, le second & une eau chtonienne; le premier s’articule &
une diversité naturelle, gfographique : duniforme qu'elle était,
plate et sans eau, la terre prend du relief et les iéments s'y mélent;
le second s'articule & la diversité des sociétés humaines. Et l'ordre
des mythes suggére que la diversité des cultures ne pouvait advenir
‘que comme conséquence de la diversité des milieux naturels,
La premitre humanité, aussi plate et uniforme que la terre elle-
meme, n'est Id que comme le gage de I'avénement de la seule
humanité réelle, qui se définit par la multiplicité des socigtés.
Quoi qu'il en soit, on retrouve ces deux mythes (incendie et
<éétuge) dans la plupart des tribus Tupi et Guarani d’aujourd’hul,
Tupa, Ana, Giropari,
‘Au mime souci de repérer chez les Indiens quelques traces de
Ja vraie religion, i faut attribuer assimilation de Tupa au diew
Chrétien, d’Afd et de Giropari au démon. Afi, Aignan, pour
Jes Guarani et les Tupinamba, Giropari (ou Jurupari) pour les
‘Tupi du Nord sont en effet les plus éminents de ces Esprits pervers
qui peuplent fa forét et dont la seule raison dexister est de persé-
cater les Indiens et de vouer a I’échec leurs entreprises. Ce sont
‘eux que l'on rend responsables tant de Vissue malheureuse d'une
expédition guerriére, de l'insuffisance dune récolte, que des mésa~
ventures individuetles. Aussi présents et vivants dans la vie quoti-
dienne des Indiens que le diable dans celle des. missionnaires,
capables de tromper jusqu'aux chamanes et les porter & faire de
fausses prédictions, ils sont bion d'une certaine fagon des répliques
‘du Malin et I'assimilation était facile.
1, Métraux, op. cit, p. 44,
31
LA TERRE SANS MAL,
La question de Tupa, en revanche, mérite un examen plus atten-
tif, non seulement parce que les ethnologues (Métraux, Schaden),
n'y ont vu finalement qu’ane invention de missionnaires, mais
parce que, pour les Indiens eux-mémes, contraints désormais & se
penser par opposition aux chrétiens, Tupi en est yenu a signifier
Dieu; de sorte que, méme s'il n’a point perdu ses anciens attri
buts (on le situe & Vouest til est lid au tonnerre et aux tempetes),
ii n’en est pas moins pensé parfois comme un élément étranger
la culture guarani.
De fait, il est évident que les missionnaires avaient besoin pour
leurs prédications d’un terme qui fat apte a ex
Dieu et que leur premier souci devait étre de le rechercher dans
Ja langue indigéne. On a vu comment Nébrega justifiait le choix
de Tupi; Vasconcellos et d’auires sont du méme avis. Que Tupi
ait 6té pour les Indiens « chose divine », sacrée, et que Nobrega
ait donné la véritable acception du terme, rien ne permet d’en
outer @ priori. Et V'analyse de sa fonction viendra le confirmer.
Nul doute non plus qu’ faire de Tupa un équivalent de Dieu,
‘on lui donna une signification qu'il n’avait certainement pas. Ce
qui est ici en question c'est de savoir s'il existait, dans le panthéon
‘guarani, une autre figure mieux apte & remplir ce role. Tel est bien
Te sentiment dA. Métraux lorsqu’il tente de découvrir les raisons
d'un choix qu’il juge peu pertinent. Sa réticence se justfic en réfe-
ence & la mythologie : dans le grand mythe d'origine Tupinamba,
dont nous avons rappelé plus haut quelques thémes, Tupi en effet
n’apparait pratiquement pas. Ni ctéateur du monde, ni transfor-
mateur ou héros culturel, aucun fait, geste ou invention ne lui est
expressément attribué. Voici le texte de Thevet : « La premiére
cognoissance donc que ces Sauvages ont de ce qui surpasse la
terre ct dun qu’ils appellent Moran, ... lequel a créé le ciel, la
terre, et les oyseaux et animaux qui sont en cux, sans toutefois
faire mention de la mer ne d’Aman Attoupaye qui sont les nuées
d'eau 3... » Si « Aman Attoupave » peut s'interpréter comme une
transcription un peu fautive de and ha tupdve (= ta pluie et le
tonnerre), Tupa n’est ici mentionné que pour n‘avoir pas é1é eréé.
1, Thevet, op. cit. p. 38.
32
i
DES PEUPLES SANS SUPERSTITIONS
Le second passage du mythe of il apparait est I’épisode de Ia mort
de Maira-Monan, lequel périt sur un bicher dressé par les
hommes : « ... la teste lui fendi, avec une si grande impétuosité
ct bruit si hideux, que le son monta jusques-au ciel et & Toupan :
ct de la disent que s'engendrent les tonnerres 8s le commence-
ment, et que I’éclair qui préséde I’esclat du tonnerre, n’est que la
signification du feu par lequel ce Maire fut consommé? ». C'est
tout; nulle part ensuite il n'est plus question de Tupi. Le mythe,
on Va vu, relate la eréation et la destruction de la terre par Monan,
les aventures des « jumeaux », et comment Sommay (doublet de
‘Monan, selon Métraux) enseigna aux hommes les arts de la civili-
sation. Il est certain que dans ce contexte de la eréation, le role de
Tupi est nul. C'est ce qui a conduit Métraux A voir en Monan la
figure centrale de la religion Tupinamba, et & attribuer a la caté-
chisation importance accordée a Tupd. E. Schaden et L. Cadogan
sont du méme avis. Et, de fait, dans les textes Mbya-Guarani
récemment publiés par Cadogan’, c'est Namandu le personnage
premier, celui qui apparalt seul au milieu des ténébres originelles,
le cxéateur. Dans ces textes mbya cependant, le réle de Tupi est
loin d’étre négligeable puisque c'est lui qui eréera la « terre impar-
faite » aprés la destruction de la premitre terre.
Pour en revenir aux chroniqueurs et A notre probléme, nous
voudrions faire plusicurs remarques. Tout d’abord, et si l'on s'en
tient strictement & ce que l'on peut savoir des Tupi-Guarani par
les auteurs du xvi sitcle, il n'y a aucune raison de préférer Monan
& Tupi ou le second au premier, dans la mesure ot les Indicns
ne se souciaient d’honorer ni I’un ni autre : il n’existait aucun
culte rendu & une quelconque divinité, tous les auteurs nous le
disent assez. En second ficu, s'il est vrai que Tupi n'est rien dans
Ja création du monde, il est en revanche étroitement associé aux
grands cataclysmes qu'il personnifie. Si Monan est le Dieu créa-
tcur, Tupai ext le dieu destructeur. Maitre de la pluie, du tonnerre
et de ta foudre, il est la cause directe de la destruction de Ia terre
par Vincendie et le déluge
1. Thevet, op. elt, p. 43.
2. Ayn Rapyta.
33
EA TERRE SANS MAL
doute, cest « le feu du ciel » qui consuma la premiére terre, ct
une cau céleste qui engendra le premier déluge. Que cet épisode
du mythe ne fasse pas intervenir nommément Tupi et aitribue &
tune autre volonté que la sienne la décision de détruire la terre ne
change rien : pluie, tonnerre et foudre sont Tes attributs: spéci-
fiques et exclusifs de Tupa. Que l'on se reporte a lépisode de ta
mort de Maira-Monan : tonnerte et éclairs y sont explicitement
ligs A Tupa. Et puisque les Indiens voyaient dans les tempétes
réelles Ia manifestation tangible de cette puissance den haut,
comment n’auraientils pas pergu comme un effet de cette meme
puissance la destruction mythique de la terse par le feu et l'eau
célestes? 7
‘Une autre raison nous porterait & admettre que Tupi n’était
pas cette figure secondaire qu'on s'est plu ay voir; elle nous est
fournie par la référence & une autre culture guarani : celle des
Guayaki, La comparaison peut étre ici élairante (quoiqa’elle
rhe s‘appuie que sur une observation récente de ces Indiens) car
les Guayaki n'ont jamais été en contact avec les Blanes : l'unique
tentative, eflectuée au xvut siécle, pour les amener dans les réduc-
tions jéstites se solda par un échec : sur une vingtaine de Guayaki
capturés, la plupart parvinrent a s'enfuir aussit6t et & regagner
Ja forét, les autres moururent. Or dans les croyances: Guayaki,
Chono, le tonnerre, est Je personage le plus important, celui qui
pris la mort a charge des mes. L’association du tonnerre et des
mes des morts n’était pas non plus étrangére aux Tupinambs.
Citons encore Thevet ; «Ces Sauvages estans sur "eau, s'il s"esmeut
(comme souvent il advient) quelque orage ou tempeste, ils pen-
sent que ce soient les Ames de leurs parents et amis qui ainsi les
inquiétent... Toutefois ne sont-ils si grossiers, que pour apaiser
{elle tourmente, ils ne jettent quelque chose en l'eau, comme luy
en faisant don et présent d’hommage, estimant que par ce moyen
Ja furie des orages puisse estre appaisée *. » fc
Enfin, un dernier argument pour souligner l'importance de
‘Tupa en tant qu'il personnifie 1a destruction ; la croyance gua-
‘rani en la destruction future de la terre. Cette vision apocalyptique
1, Thevet, op. city p. 96.
PEUPLES SANS SUPERSTITIONS
est au eur de la pensée des Guarani d’aujourd’hui : les mémes
cataclysmes déja advenus sont promis a la terre; comme la pre-
miére terre, la « terre imparfaite » sera détruite. De cette croyance
on ne trouve guére mention chez les chroniqueurs. Un court pas-
sage de Thevet y fait pourtant allusion : & propos de ces picrres
gui étaient supposées conserver les traces de pas de Sommay,
il écrit : « Et sont ces pauvres Sauvages en ceste folle créance, que
si la pierre leur estoit dérobée, ou qu’elle fust rompue, ce scroit
Ja ruyne et anichilation de toute leur contrée !. » C’est pour éviter
Je cataclysme — par conséquent promis — que les hommes se sont
instaarés gardiens de ces pierres marquées d'empreintes sacrées,
gages du passage des Dieux dans le monde des hommes. Ces
métonymies de la divinité ont ainsi une double signification :
cles attestent qu'il n'est point d'ordre culture! qui ne se pense
‘comme un ordre (ranscendant. Lorsqu’on passe de l’ordre naturel
4 ordre de la culture, on passe d'un type de nécessité & un auire :
Ja premitre, universelle, est immanente, W'autre, parce qu'elle
instaure la particularité ne peut étre que transcendante. Entre la
nature et la culture ily a la place du surnaturel. La seconde signi-
fication des pierres sacrées dont les hommes ont la garde est dés
lors évidente : elles témoignent que les diewx sont encore parmi
les hommes, et que le monde (la société) durera aussi longtemps
qu'il en ira ainsi.
Sans doute cette information de Thevet est-elle peu de chose
cn regard de l'importance qu’a prise chez les Guarani la croyance
‘en la destruction de la terre. Encore faut-il remarquer que cette
croyance se traduit non pas en mythes (il n’existe aucun récit du
cataclysme) mais en prophéties — et ceci peut expliquer que Ia
notation de Thevet soit si bréve. Elle serait pourtant insuffisante
pour nous permettre d’affirmer que Ia méme croyance existait
chez les anciens Tupi-Guarani, si on ne pouvait la mettre en
relation avec le contexte dans lequel elle prend place, notamment
avec la quéte de la Terre sans Mal dont on sait qu'elle préoccupait
les Indiens dés avant la Conquéte. Or, la quite de la Terre sans
‘Mal est essentiellement liée & 1a conviction que ta terre sera a |
1. Thevet, op. cit, p. 60,
35
LA TERRE SANS MAL
nouveau détruite. Nous reviendrons la-dessus, Ajoutons seule-
‘ment, pour conclute, que si, comme nous tenterons de le démon-
trer, la pratique religieuse des Tupi-Guarani s'est toujours inscrite
dans cette quéte de Ia Terre sans Mal A quoi les poussait la certi-
tude d'un cataclysme imminent, on peut comprendre que Tupd
{ft pour eux chose sacrée entre toutes : comme artisan de ces des-
tructions, il était le maitre véritable de leur destin.
Sur importance de Tupi, les missionnaires ne se sont donc
pas trompés + Ia figure du destructeur commande la religion gua~
rani, non celle du créateur. Is se sont trompés sur sa signification :
rrien ‘de plus opposé, dans ce symbole indigéne, a V'idée chrétienne
‘du créateur. A ct égard, A. Métraux commet l'erreur inverse
Jorsqu'll fait de Monan le dieu central de la religion Tupi : Monan
est bien le eréateur, son nom méme I'indique*. Métraux ne se
trompe pas sur sa signification, mais sur son importance. Cela
evient dire que missionnaires et ethnologues ont été victimes
du méme préjugé : I’idée que la religion devait se définir en rapport
A une divinité eréatrice. Allons plus loin, et demandons-nous si
C'est bien dans ces termes qu'il faut poser Je probléme. Autrement
dit, nous suffit-il de rechercher des priorités dans Vensemble des
figures mythiques guarani, d’établir la hiérarchie des « dieux »
de leur « panthéon »; en serons-nous quittes pour dire qu’ll existe
tune divinité centrale, Tupi, laquelle figure In destruction et des
divinités secondaires, dont Monan le Créateur? Ce ne serait
guére plus satisfaisant. En premier lieu, se limiter & cela, c'est
‘encore poser le méme a priori que nous dénoncions : V'idée que
par essence une religion se définit dans une relation A des divinités,
qu'elle procéde d'une disjonction irréductible qui met d'un cbté
ies dieux, de M'autre les hommes. Mais surtout, on néglige ainsi le
fait, pourtant digne d’attention, qu’aucun culte n’était rendu &
tune queleonque « divinité », pour s'enfermer dans le paradoxe
— qui laissait fort justement perplexes les premiers observateurs —
une religion réduite & un savoir vague et inutile puisque sans
1. De mofd, qui signife enzendrer. $i on s'en tient & Vtymologe, il faut
réctisee afirmation de Métraux que le dieu tupi est pas us eréateurex-ninilo,
fais plut6t un transformateur.
36
DES FEUPLES SANS SUPERSTITIONS
effets. Il faut, par conséquent, changer radicalement de perspec-
tive : sugaérons que ce qui fait Noriginalité de la religion Tupi-
Guarani c'est qu'elle ne se déploie pas dans I’ « élément » de la
théologie, du savoir des dicux. Et s'il est vrai, comme Wécrit
Dumézil, que la religion soit toujours « chose actuelle et active,
demandons-nous quelle était 1a pratique religieuse des Indiens.
En reprenant ainsi la question par autre bout, peut-étre compren-
drons-nous mieux leurs croyances.
La Terre sans Mal.
‘Nous venons de faire allusion 4 cette croyance. La Terre sans
Mal est ce lieu privilégié, indestructible, oi 1a terre produit d’etle~
méme ses fruits et of on ne meurt pas.
Les chroniqueurs n'y font que de bréves allusions, et encore
la réduisent-ils & des ‘proportions compréhensibles pour eux :
‘un « au-deld » of vont les fimes aprés la mort. On pourrait s’atten-
dre ce que, comme il en alla du reste, ce thime ait été assimilé
au théme chrétien du paradis, Curieusement il n’en fut rien.
F. Cardim nous assure que les Tupi ne se souciaient point de savoir
s'il existait aprés la vie résompense ou chitiment '. Pourtant, dit-
il, ils croient & limmortalité des fimes, lesquelles sont supposées
se rendre « en des champs pleins de fruits prés d’une belle rividre
‘oi toutes ensemble elles ne font rien d’autre que danser *», Selon
Léry, ce lieu de délices loin d’étre accessible & tous était la récom-
pense promise aux meilleurs : « ... ils croyent l'immortalité des
‘Ames, mais aussi ils tiennent fermement qu’aprés la mort des comps,
celles de ceux qui ont vertueusement vécu, c’est-a-dire selon eux,
qui se sont bien vengez et ont beaucoup mangé de leurs ennemis,
s’en Yont derriére les hautes montagnes ol elles dansent dans de
‘beaux jardins avec celles de leurs grands-péres® ». Méme informa~
tion chez Cl. d’Abbeville et Y. d’Evreux : accéder & la terre de
1. F, Cardim, op. cit, p. 161, p. 162.
2 hid.
3, Lary, op. elt tI, p, 62.
37
LA TERRE SANS MAL
« par-dela les montagnes »
cannibales ?. ° est réservé aux plus féroces
_Pour tous les chroniqueurs, en tout cas, laTe A es
rien que de paien, c’est «les ofiaings-lyséems des os Maln’éyo
quoi les chrétiens ne se sont-ils pas emparés aus eS Poétes », Po U
et pourquoi, plus généralement, ont-ils mei de cette croyanee,
One vsue d peut supposer de prime abord, que vou elle sj bee
- dune vie future toute faite de dan ette conceptig
deval paraitre impie aux Blancs. Choquante, a et de bewveries
pl en rate esto lo
Ee . Tupi-Guarant situaient la Terre sans aphique pré.
Pp éel, tantot a lest, tantot a Douest. Le plus ns Mal dans leur
ent a Pouest,
* semble-t-i i i
t-il, au moins pour les Tupi du littoral : les inf
* ies Intormatio
ns
données par Y. d’ ss
Thevet, dati ee et Cl. d’Abbeville confirment
« par-dela les monta a les montagnes » (d’Evreux pré Celles de
de l’espace telle Mee es des Andes »), donc’ dans ane di, méme
Aucune infiniti io préservée l’idée d’un lieu “ction
peut-étre les migrations qui T mhent. les anciens Guar. mine
pieds des Andes étaient-elles en arte liées i le ee ang
erche de la
Terre sans :
Mal; le nom, Kandire, qu’ils donnérent 4
5 .
nt a l’Empire.
i 2 ege i i > e€ pe 1t-ét
inca le suggere “. Quoi qu il en soit il exist etre
une raison i : y
: plus profonde au curieux dédain pour cette cro ance
ppe er qu elle fut singuliérement aplatie. d
dont il faut Ta 1 , re uite
1. D’Abbeville apport ‘
en tupi : « oudioupi eune précision supplémentaire : .
Parmi les em ms Etait-e2 la le mot qui designate i oe lieu est appelé
tenme tpi pour la Tene sans Mal On 1 consultés, aucun ‘autre. ne “d = mea
ographié di . On trouv onne |
quelque peu ciyetsenet chez plusieurs sake on oe le mot oudioupia,
chamanes étaient ap “16 insi dans le Tesoro de Mo at —_ avec une acception
guayupia). Montoya, malheure aie gavigia naan = 2 apprend que les
terme. Le Vocabulario tale SInerK, te done a i pans - yara - du
deste (0 feiticeiro bom) se tae brasilica dit, 4 I’a ible Fe Pomeleeis de ce
es « Esprit par lequel ils apr e goajupia. Le « Houiousii iceiro : O spirito
ss probablement le mém lee cherenee devinent ce » de Thevet, qui
Raia par coerce et faut, mal transcrit. Ces ‘ros v est venir »,
on doit conclure que d’Abbe faute depouvoir établir l’étym ee oe.
; it, jusque sur le plan lin ville s’est trompé. Son err ymologie de guayupia,
. Sur la significati guistique, la Terre s eur est révélatrice : il
ion du mot kandire, cf. “ee a un séjour des esprits.
38
~~
s SUPERSTIT TONS
mes apres la mott. séjour a
3 Mal était aussi un. lieu accessible
ans passer pat yépreuve de la
tention, les
DES PEUPLES SAN:
des ancé-
u’elle était a un séjour des 4
la Terre san
re —_ ou lon pouvait « Ss
x vivants
an rendre corps et ame. rder leur at ;
s d’apercevolr que la terre e « par-
i tu la terre
e meurt pas, que les pro-
étaient une seule et méme chose.
ce qui n’efit pu leur apparaitre
réhensible folie : une reli-
t de devenir pareils aux
hétes promettaient ;
été confrontés alors a
me un scandale ou une incomp
‘| les hommes eux-mémes s’efforcen
ortels comme eux. ; ;
signifient Vinquiétude qui poussait les Tupi-Guaran!
Vespoir afiirrmé que l’on peut sans mourir accéder
sinon énoncer la question de la possibilité (ou de
>impossibilité) pour les hommes d’étre a eux-mémes leurs propres
dieux. A quelle pensée renvoie une telle pratique, sinon au refus
de la théologie : hommes et dieux y sont deux poles que l’on veut
penser autrement que sous les espéces de la disjonction. Voir dans
cette religion un discours sur les dieux est non seulement la réduire
a son expression la moins significative, mais la distordre par
imposition d'une logique qui n’est peut-étre pas la sienne. C’est
pourquoi on peut affirmer que débattre des dieux est, en l’occur-
rence, d’importance secondaire.
dieux, imm
Car que
a pareille quéte,
a jimmortalité,
A travers cette lecture rapide des anciens témoignages, nous
avons tenté de comprendre pourquoi les Tupi-Guarani ont pu
apparaitre aux premiers observateurs comme des gens « sans super-
oe », alana sans rites religieux, et esquissé la perspective
OF ae a ons poursulyi - youés quils étaient a la recherche
n impossible — et pressenti
e telle —, les Gu i
Oss s arani
ont forset une ee athée. De 1a l’absence de culte ou de
e, mais non de pratique; de 14 Voriginalité
a ; a Poriginalité de se é
ne on } s « prétres »
n peut considérer qu’elle en avait en la personne des ‘Karai
cuarree 1
Pagés et Caraibes
Le chamanisme offre semble-t-il, dans toute |"Amérique une
remarquable homogénéité. Comme beaucoup d'autres popula-
tions amérindiennes, les Tupi-Guarani possédaient de ces per-
sonnages prestigieux, médiateurs entre le monde surnaturel et les
‘humains que leurs dons particuliers rendaient aptes & remplir des
fonctions fort diverses : guérir les malades, prédire Pavenir,
maitriser la pluie ou le beau temps...
‘Ave les Guarani, pourtant, le chamanisme est plus et autre
chose que cela; il s’accroit d'une dimension nouvelle et acquiert
‘une signification et une portée particuliéres — d’ordre religieux
et non plus seulement magique — qui le différencient sensible-
ment de ce qu'il est ailleurs.
‘Chez les Apapokuva-Guarani parmi lesquels i vécut au début
de ce sidcle, Nimuendaju! observa Il'existence d'une sorte de
higrarchie lige au chamanisme : les Indiens se répartissent en
quatre catégories en fonction de leurs dons chamanistiques. La
premigre, négative, groupe ceux qui n’ont aucun chant, c’est-i-
dire ceux qui n'ont pas ou pas encore resu d'inspiration; A cette
eatégorie appartiennent ta majorité des adolescents et quelques
rares adultes décidément réfractaires au commerce avec les esprits :
‘ceux ne pourront jamais diriger les danses. La deuxiéme caté-
gorie réunit tous ceux qui, hommes et femmes, possédent un ou
plusieurs chants — preuve qu’ils ont un esprit auxiliaire — sans
pourtant étre dotés d’un pouvoir susceptible d’étre utilisé & des
fins collectives. Certains d’entre eux (ceux qui se rapprochent de
1, Nimuendajo, Leyenda de a ereacion y Juicio final del Mundo, p. 41 s.
40
PAGES EY CARATBES
la troisiéme catégorie) peuvent diriger certaines danses. La plu-
part des adultes des deux sexes en font partic. La troisi¢me caté-
gorie est celle des chamanes proprement dits, les paje : cupables
de guérir, de prévoir, de découvrir le nom des nouveau-nés, etc,
Hommes et femmes y parviennent et ont droit au titre de « Nan-
deru » ou « Nandesy » (notre pére, notre mére). Seuls les hommes
peuvent accéder a la quatritme catégorie, celle des grands cha-
anes, dont le prestige dépasse largement les limites de la com-
munauté. Couxla deviennent fréquemment les dirigeants poli-
tiques.du.groupe. Eux seuls peuvent conduire la grande danse du
Nimongarai, la plus importante féte Apapokuva. Cette féte se
célébrait chaque année, entre janvier et mars, & l'époque oit le
mais commencait A mart, et était destinée, entre autres choses, &
garantir hommes, animaux et plantes des influences mauvaises
susceptibles d'advenir durant I'année. Comme toute grande
cérémonie, le Nimongarai exigeait de longs préparatifs, devant
offrir & profusion boisson et nourriture & de trés nombreux parti-
cipants : toute Ia tribu en effet s'y rassemblait (et c’était l'unique
occurrence) car non seulement on invitait tous les villages voisins,
mais de surcroit des individus ou des familles qui avaicnt depuis
longtemps renoncé au mode de vie traditionnel pour aller travailler
dans les fazendas brésiliennes, rejoignaient alors, pour quelques
Jours, leur communauté, Féte de prémices, le Nimongarai avait
aussi tine signification politique et religicuse A Ia fois, ainsi qu'il
ressort du rituel de cldture ot les deux aspects étaient entremélés,
Apriés quatre nuits de danses ininterrompues, 4 I'aube du cin-
quiéme jour, se déroulait une cérémonie qui reproduisait le rituel
du baptéme, a ceci prés qu'on n'y donnait point de nom ; lun
aprés T'autre tous les assistants sc présentaient devant le paje,
chacun accompagné d'un « parrain » et d'une « marraine! »,
La finalité de ce dernier rite était de sceller Ialliance politique, ~
symbolisée par la relation de ¢yrasa, de compérage, ainsi établie
entre tous les membres de ta tribu ®
1, Etymologiquement,nimongarai = se fare chamane (ne ~ $0 : mo mf
soos
2. CF. Susi, in Qhirguanor ; rien ne peut remplacee « fe sentiment de
smoope ot Fexpresion Ge Momopente tral asset nation
4
LA TERRE SANS MAL
La bréve évocation de ces fétes aujourd'hui disparues (Nimuen-
daju assista aux dernitres) permet de mettre en lumitre le role
‘Véritable de ces grands chamanes — les karai — guérisseurs sans
doute, mais avant tout dirigeants religieux et souvent politiques
des villages.
L'immense prestige dont jouissaient les chamanes avait frappé
les premiers voyageurs, et tous ont é1é fascinés par ces person-
rages qui suscitérent en eux des sentiments bien divers, souvent
ambigus, mais ne les lnissérent pas indiflérents. Ce qui nous
vvaut sans doute les excellentes descriptions qu’ils en laissérent.
Quant aux missionnaires, ils pouvaient dautant moins s’en désin-
téresser que c’est en eux que, de leur propre aveu, ils rencontrérent
Jes plus sérieux obstacles & la christianisation : « ces pagés ou
Barbiers, qui tiennent parmi les Sauvages le rang de Médiateurs
centre les esprits et le reste du peuple, et sont ceux qui ont plus
‘grande authorité acquise par leurs fraudes, subtilisez et abus, et
ont détenu ces gens plus fortement soubs le royaume de l'ennemy
de Salut... » Imposteurs peut-8tre, mais doués de génie — de
‘matin génie — ot avec qui il fallait bien compter — Nébrega,
Montoya, Lozano, Y. d’Evreux... tous, avec une belle unanimité,
dénoncérent les chamanes comme leurs pires ennemis; et des
ennemis d'autant plus redoutables gu’ils leur reconnaissaient
— A P'instar des Indiens — un obscur mais trés réel pouvoir : en
somme, les authentiques suppdts de Satan, Tout le récit de la
‘« Conquéte spirituelle » de Montoya est celui dune constante
lutte de Dieu contre Satan, inspirateurs respectivement des Péres
‘et des chamanes, Car de railler la erédulité des sauvages n’empéche
rnullement les Blancs d’en montrer & leur tour : pour eux, il ne
fait aucun doute que les chamanes ont commerce avec le diable
et que sils ont du pouvoir, c'est de Iui qu’ils le tiennent.
une chicha de mats», En 1758, un chef Chiriguano se déclarait prét & servir
{coi et 8 pactiser avec es Expagnols. Mais, disai-l & un jésaite, jamais il
iaccepterat Pétablissement d'une mission au moyen de « azotes ¥ que
‘raduras de cantaros de chicha ».
1. ¥. d'Bvreux, op. ell, p. 285,
42
PAGES EP CARALBES
Y. d’Evreux, qui pourtant impate au hasard d'une prédiction
réalisée la notoriété acquise par tel ou tel chamane, consacre plu-
siours pages (aprés que l'un d’eux Tui eut fait sur des événements
de France une prédiction qui se révéla exacte) & ce point de
théologie : Satan peut-il connaitre fe futur; concluant son argu-
mentation par I’aflirmative, il explique du méme coup le savoir et
Je pouvoir des « barbiers ». On pourrait citer maints autres exem-
ples. Pourtant, derrigre indignation que provoguaient coux
qu'on voulait ne considérer que comme des imposteurs, pointe
une secréte admiration : on blame, certes, violemment leurs
«ruses » et leurs « abus », mais en méme temps on reconnat et
fon souligne leur habileté, lear éoquence, leur étonnant pouvoir
de séduction. « Le Diable, explique Y. d’Evreux, esprit superbe;
ne se communique fas indifféremment & tous les Barbicrs + mais
il choisit les plus beaux esprits d’entre iceux, et lors il mesle ses
inventions avec leurs subtilitez?, » C'est & la méme explication
{que recourt Lozano pour rendre compte du fait que les chamanes
se recrutent toujours parmi les esprits les plus subtils.
Tels apparurent aux Européens les chamanes. Reste & voir, par
dela tes croyances de ces derniers, ce qu’ils représentaient pour
les Indiens. Les récits de leurs faits, gestes et dits sont nombreux
et souvent précis; c'est sans doute & Y. d’Evreux qu'on doit les
meilleurs : pour s‘étre vite convaincu de-ta profonde influence
des chamanes sur les autres Indiens, ce missionnaire s'était attaché
presque exclusivement i a conversion de ceux-ci et s'était lié avec
plusieurs dentre eux.
La hiérarchie des chamanes.
Les villages tupi et guarani étaient composés de plusieurs mai-
sons collectives (quatre, le plus souvent, parfois huit) disposées
autour d'un espace central. D’aprés Y. d’Evreux deux personnes
‘avaient Je pouveir dans chaque village + un mburuvicha (= chef)
1, Y¥. Evreux, op. cit
4B
LA TERRE SANS MAL
et un pagy owassou (= grand chamane). Ces grands chamanes
étaient ceux qui portaient le titre de Karat (caraiva, caratbes, selon
les graphies). Tous les paje en effet ne jouissaient pas d’un égal
prestige et Y. d’Evreux pour sa part en distingue trois catégories.
« Vous en trouvez de bien petits, et n’en faict-on pas grand estat,
ct si on ne les eraint guére et leur métier ne leur vaut beaucoup.
Ty en a d'autres un petit plus ssavants et médiocres, entre les
peiits et les grands : Et ceuxda d’ordinaire levent leur boutique
fen chaque village qu’ils s'attribuent... ayans soin des danses et
d’autres choses qui dépendent de leur office. » Viennent enfin les
grands; ils « sont les plus prisez aprés les Principaux, voire les
‘Principaux leur parlent avec révérence ! ». Leur notoriéié dépassait
trés largement le village : « Si ces petits et médiocres Barbiers ont
de lauthorité entre les leurs, beaucoup plus en ont ceux qui pro-
prement sont appelez Pagy-Ouassou, grands Rarbiers : ear ceux-li
sont comme les Souverains d’une Province, crains et redoutez
grandement, et sont parvenus a telle authorité par beaucoup de
subtilitez * »
‘Une autre tripartition avait cours chez les Guarani, si I’on en
croit Lozano §, qui s’attache en outre & préciser le role dévolu a
chaque catégoric : « La premifre était l'art de sucer... : celui qui
se disait suceur, pour gagner sa vie et acquérir de a renommée
parmi les siens, feignait de posséder le pouvoir de guérir les mala-
dies en sugant les régions malades... » I s’agit done de guérisseurs
proprement dits; l'auteur explique ensuite comment se déroule
Ja cure qui s‘inaugure, dans la maison du malade, par des danses
— une série de « gesticulations ridicules », dit Montoya. Ensuite
Je chamane suce Ia partie atteinte afin d’en extraire l'objet patho-
‘gine, « épine, fragment d'os on ver qu’il portait cachés sous la
langue », et Je montrer & Vassistance, C’est, om le voit, a technique
de cure la plus couranie de toute I'Amérique du Sud. La deuxiéme
sorte de sorcellerie, dit-il ensuite, est plus pernicieuse, car ceux
‘qui Wexercent sont familiers du démon, lequel leur apparait cou-
‘ramment sous la forme dun « négrillon », accompagné d'un bruit
44
PAGES ET CARATBES
épowvantable et dans la plus grande confusion, Is consultent
cette apparition chaque fois qu’ils veulent ensorceler quelqu'un;
ils recherchent, pour ce faire, divers objets susceptibles de provoquer
Je mal, tels que « charbons trés secs, pour susciter la fiévre ou la
toux; 08, épines, objets pointus, pour transpercer le corps de dou-
leurs...»». Ce sont des jeteurs de sorts et Lozano précise bien qu’ils
nemploient leurs talents qu’a susciter maladies et mort.
‘Avant de passer a la troisitme eatégorie, arrétons-nous un ins-
tant sur la premiére distinction qu’opérent les deux auteurs auxquels
‘on vient de se référer. Elle n'a pas le méme contenu dans les deux
cas, En suivant Y. d'Evreux on peut dire que la différence entre
ceux qu'il appelle les petits et les moyens chamanes n'est que de
degré : c'est seulement par l'inégale étendue de leur renom qu’ils
se distinguent, Autrement dit il n'y a pas lieu de conserver la tri-
partition qu’ suggére et la vraie différence est entre pagé et
‘pagy-ouassou. En revancke, la distinction opérée par Lozano peut
‘paraitre plus pertinente ; guérisseurs et jeteurs de sorts sont radi-
calement opposés. Mais elle n'est pas sans poser un probléme,
Chez tous les Tupi, en effet (comme en bien d’autres cultures
amétindiennes), si lune des fonctions essentielles des chamanes
‘est celle de guérisseurs, les hommes-médecine sont toujours ambi-
valents. A. Métraux *I’a fort bien démontré : maitres de la maladie,
les chamanes peuvent & leur gré la conjurer ou l'infiger. Le
pouvoir surnaturel dont ils sont porteurs — de par leur faculté
entrer en communication avec les esprits — provient de ce qu'ils
font accés a un savoir fermé aux autres hommes : ils connaissent la
dimension cachée des choses. Par essence le pouvoir né d’un tel
savoir est indéterming, non orienté vers des fins spécifiques, De
1a 1a multiplicité des fonctions chamanistiques, que l'on ne trouve
point, généralement, & l'état séparé, distribués dans des individus
différents. On aura remarqué que les techniques, décrites par
Lozano, qu‘utilisent guérisseurs ct ensorceleurs sont exactement
les mémes, mais inversées, comme est inversé leur but : ce qui
tend indiquer qu'on n’a affaire en réalité qu'aux deux faces
une méme pratique. On pourrait alors en conclure qu'il existait
1, Métraux, Religions et Magies indienes "Amérique chu Sud.
43
LA TERRE SANS MAL
chez les Guarani, & lintérieur de la catégorie paje une répartition
des activités correspondant & une sorte de division du travail
Par conséquent la encore il n'y a pas lieu de retenit Ia distinction
(du moins dans la perspective qui est la nétre. Car pour une étude
du chamanisme elle ne serait certainement pas dénuée dintéré!),
‘Ce que nous voudrions mieux établir ici c'est ce qui différenciait
les paje, les chamanes proprement dits (i. e. les deux premiéres
catégories de Lozano et Y. d'Evreux) de la troisiéme catégoric,
les Karai, que quelques chroniqueurs ont fort & propos nommés
« prophétes ».
Notons d’abord que quelques auteurs anciens font explicite-
ment la distinction entre paje et karai. Léry~: « {l faut scavoir
qu'ils ont entre eux certains faux prophétes qu’ils nomment
Caraibes, lesquels allans et venans de village en village, comme
les porteurs de rogatons en In papauté, leur font-accroire que
‘communiquans avec les esprits ils peuvent non seulement par ce
moyen donner force & qui leur plsist, pour vaincre et surmonter
les ennemis, quand on va 4 Ia guerre, mais aussi que ce sont eux
‘qui font croistre les grosses racines et les fruicts, tels que j'ai dit
ailleurs que ceite terre du Brésil les produit. » Et il prend soin de
préciser qu'il ne faut pas confondre les caralbes avec « ... une
maniére d’abuseurs qu’ils ont entre eux nommez Pagés, qui est
4 dire Barbier ou médecin, lesquels leur font accroire qu’ils leur
arrachent Ia doulear, mais aussi qu’ils leur prolongent la vie ® ».
Le terme paje, par conséquent se référe & ce qu'on entend tradi-
tionnellement par chamane : celui chargé de guérir le mal ou, &
Voceasion, de linfliger et qui, du seul fait de l'ambiguité de ses
dons, est un homme toujours craint et respecté, sachant fort bien
au demeurant faire rémunérer ses services. Cardim fait la méme
distinction et ajoute que les Indiens ne croient pas spécialement
‘aux chamanes; simplement ils les jugent capables de guérir. 11
‘veut dire qu’on ne les considére pas comme des étres surnaturels,
qui seraient honorés comme tels; ceci n'est le eas que pour quel-
1, B, Susaik, op. ei, a remarqué chez les Chiriguano de Bolivie une sem
‘lable division’: les paje s'y répartissent en « faiseurs de pluie», guérisseurs,
censorceleurs, etc,
2, Lity, ep. cl, Il, p. 67 et p. 116,
46
Pats ET CARAIBES
‘ques-uns d’entre eux : ceux qui portent Je titre de caraiba, c'est-
dire, selon Cardim, saint ou sainteté. A propos de cette traduc-
tion, on peut faire plusieurs remarques. « Santo », « sanctitad »
sont les termes les plus ftéquents qu’emploient aussi les premicrs
jfsuites (Nébrega, Correia, etc.). Thevet, qui par ailleurs emploie
toujours indifféremment les termes de pagé et de caralbe, attribue
toujours le titre de caralbe aucx héros culturels des mythes. Le
Tesoro de Montoya rappelle que carat était le titre donné aux
grands chamanes et le nom qui fut donné aux Espagnols, et il
propose I’étymologie suivante : le mot serait formé par aggluti-
nation de cara (— habileté, adresse) et y qui indique la persévé-
ance. Faute d’en pouvoir proposer une meilleure, acceptons
celle-ci. Tout indique en tout cas que les karai étaient bien plus
‘que des chamanes; seuls quelques rares paje parvenaient i devenit
des karai, et leur fonction dés lors n’était plus de soigner les
malades.
Revenons au texte de Lozano : « La troisiéme sorte de sorcelle-
rie faisait autorité beaucoup plus que toutes les autres, car il
s‘agissait d'un art particulier que trés peu détenaient, Ceux-la,
les plus audacioux et les plus hardis, essayaient de persuader la
populace qu'ls étaient fils de la vertu supréme, sans pére terrestre,
quoiqu’ils admissent étre nés d'une femme... Ils passaient pour
authentiques prophétes aux yeux de la populace qui voyait
parfois s’accomplir queiques-unes de leurs prédictions. On les
tenait pour des saints, obéis et vénérés comme des dieux '. » Leur
renommée sStendait trds loin dans la région, et ils pouvaient se
rendre @ leur gré od ils voulaient, assurés d"étre partout eraints
‘et respectés. Les jésuites eux-mémes leur prétaient un pouvoir
‘exorbitant; non seulement ils assurent avoir été témoing & maintes
reprises de la véracité de leurs prédictions, mais ils les croient
capables d’opérer de démoniaques miracles : assécher subitement
une rivigre ou un étang, ou au contraire faire brusquement gonfler
les eaux et provoquer de catastrophiques inondations... De la
nature de leurs prophéties, de ce qui se disait dans leurs discours
(car l'éloquence était leur grande qualité) Lozano malheurvuse-
1, Lozano, op. cit, vol. I, p. 403.
a7
TA TERRE SANS MAL
ment ne dit mot. Tl ajoute deux précisions concernant leur mode
de vie ; ils affeciaient d'aimer Ia solitude et s'infligeaient fré-
quemment des jetines rigoureux jusqu’d perdre connaissance.
Le statut des karai.
On sait en effet que les karai vivaient retirés,& I'éeart des villages
et ne demeuraient point avec les autres (chefs y compris) dans leg
grandes maisons collectives, différents en cela des chamanes.
4 Vous les voyez monstrer une gravité extérieure, ct parlent pew,
aymans 1a solitude, et évitent le plus qu’ls peuvent les compa-
nies... Et pour se conserver en tel honneur, ils dressent leurs
loges & part, esloignez de voisins * », éorit Yves d’Evreux qui, lors
de Ia premiére entrevue qu'il eut avec Pacamont « Grand Barbier
et Principal » de Comma, s'entendit dire ceci : « Il ya plusieurs
lunes que j‘ay le désir de te venir voir, et les autres Pals (= Péres),
mais ty seays toy qui parles & Dieu, que nous autres qui sommes
estimez converser avec les Esprits, qu'il n'est pas bon, ni expédient
lestze legers et faciles, et aux premiéres nouvelles s'émouvoir ct
‘mettre en chemin : parce que nous sommes regardez de nos sem-
blables et se rangent & ce que nous faisons. La puissance que nous
avons obienue sur nos gens se conserve par une gravité que nous
leur monstrons en nos gestes et en nos paroles. Les volages et ceux
‘qui au premier bruit apprestent leurs canots, s’emplument et
Vont voir hativement ce qui est arrivé du nouyeas, sont peu
estimez et ne deviennent grands principaux ®, » Cette belle lecon
du savoir-vivre des grands de ce monde se passe de commentaires
et valait d’étre rapportée, Ainsi, leur comportement, leur mode de
vie, tout les désigne comme des personnages. exceptionnels.
‘Plus encore qu'une attitude destinée seulement & souligner leur
importance, cet isolement voulu était une fagon de marquer qu’ils
J avaient un statut & part; qu’en fait, ils n’appartenaient pas vrai-
ment & une communauté, qu’ils n’étaient de nulle part. Non seule-
‘ment, en effet, ils vivaient a I'écartdans une demeure faite leurseul
1, Lozano, op. it, p. 287 et p. 327.
2 Ibid.
48
PAGES ET CARATBES
usage, mais ils restaient peu de temps dans le méme village. Is
se déplagaient coastamment, a parcourir des provinces entiéres.
‘Tous les auteurs insistent sur leur vie errante et Thevet, par exem-
ple, en parle comme de « vagabonds ». Encore un trait qui les
oppose aux chamanes, si l'on se souvient de ce que disait
Y. d’'Evreux de ces derniers. Tis évitaient de se méler aux autres,
de participer aux conversations et moins encore aux divers tra-
vaux, jeQnaient, refusant parfois ostensiblement la nourriture
qu'on venait leur offrir, et prétextant qu’ils n'avaient nul besoin
aliments. Mais & certains moments de la journée, ils sadressaient
‘au village rassemblé en des discours souvent fort longs. Sur
Vobjet de leurs pérégrinations, nous reviendrons bient6t; il faut
pour I'instant préciser que non seulement ils pouvaient parcourir
ainsi tous les villages d'une « province », mais encore qu‘ils
Pouvaient se rendre dans des villages ennemis. Ce qu’ils étaient
seuls A pouvoir faire = tout autre qui s'y ft risqué eft été fait
prisonnier ct mis & mort, Dans plusieurs de feurs lettres, les
jésuites signalent cette liberté dont les prophétes jouissaient seuls
‘et qui leur permettait de circuler & leur guise entre les provinces
ennemies. Et Soares de Souza donne une curicuse information
qu'il est peut-8tre possible d’interpréter dans le méme sens :
«Ce peuple a la plus grande estime pour les chanteurs; oi qu’ils
aillent, ceux-ci sont toujours trés bien accucillis, et plusieurs
d’entre eux sont déji allés dans le territoire de leurs ennemis,
‘sans qu’on leur fasse le moindre mal*. » Le méme auteur dit
encore que les Tupi renongaient parfois @ manger un prisonnier
de guerre, s'il était bon chanteur. On a déja signalé "importance
du chant dans le chamanisme et nous aurons l'occasion d'y revenir.
‘Mais tre trés bon chanteur ne signifiait pas seulement, pour les
Indiens, étre capable de moduler d’agréables mélodies (encore que
Jear sensiblité musicale ait été soulignée par de nombreux observa~
teurs), cela signifiait pouvoir chanter longtemps, et en énongant
des poroles. Le chant était un discours, ponctné, entrecoupé de
1. Ce que Jes chroniqueurs appelient une « province » c'est ensemble des
Villages allis, Les alliances politiques groupaient par conséquent les com>
unautés tupi et guarani en plusicurs pr ‘ennemies ene elles,
2 Soares de Souza, Tratado deseritivo do Brasil em 1387, p. 316.
49
LA TERRE SANS MAL
mélodies non parlées (Léry en donne une assez bonne description).
Si les Tupi, donc, épargnaient ces chanteurs exeeptionnels c'est
‘qu'ils devaient reconnaitre en eux des caratbes, On sait que ces
derniers pouvaient accompagner les expéditions guerriéres, ils
pouvaient par conséquent, méme s’ils ne se battaient pas cux-
‘mémes, étre faits prisonniers.
Cette double liberté par rapport a Vespace quiavaient les
‘karai — extérieurs au village et extérieurs a la « province » —
cst le signe dun statut doublement marginal, Au moins idéale-
‘ment, leur statut les faisaient extérieurs aux alliances politiques,
ct extérieurs la parenté, Car étre hors de la communauté ne
Signifie pas seulement demeurer & l'écart; plutot, cette mise &
Vécart n'est elle-méme i que pour manifester une extériorité
plus profonde : celle qui situe le prophéte en dehors, socialement
{et pas seulement spatialement), de ce qui précisément constitue
tune communauté : le réseau de parenté. L’impression que l'on
retire de la lecture de tous les témoignages, c'est qu’on ne sait
jamais dpi.viennent les Karai : ni de quel lieu de espace, ni
‘par conséquent de quel point de la généalogie. Allant et venant
Constamment, done sans résidence, ils sont partout et done nulle
part, Rappelons ce qu’en dit Lozano : qu’ils afirmaient volon-
tiers n’étre point nés de pére, mais seulement de mére. On pourrait
yoir Id et on n'a pas manqué de le faire, du syncrétisme, une
séminiscence de la. Vicrge Marie; ils se seraient emparis de ce
théme_pour-justifier leur
Texte capital puisque, on le voit, y sont évoqués les thémes
essentiels des discours des prophétes. Ii confirme aussi ce que nous
disions plus haut du prestige des karai, des pouvoirs qu'on leur
aitribuait, Surtout, il ne laisse aucun doute sur fa teneur de leurs
1, Léty, op. city tM, 9. 67
z 3. Informagiae. in Leite, op. et, vol I, p. 150,
7
LA TERRE SANS MAE
discours ; c'est de la Terre sans Mal qu'il est question. La terre
‘8 tont est produit d'abondance sans qu'il soit besoin de travailler
‘od Ton jouit d'une perpétuelle jeunesse, etc. voild ce dont ils
promettent Mavénement. Ts sont les garants de co quelle est
accessible ici et maintenant puisqu’ils peuvent s'engager 2 y
‘conduire les autres. Sans doute n’est-il pas question, dans ce
texte, de migration; on n'incite pas les gens A abandonner les
villages et & se mettre en chemin yers la Terre sans Mal. Mais
Gest bien de cette terre que les carafbes sont les maitres et
Welle quills annoncent 1a réalisation possible ici-bas = pour cela
il ne tient qu’aux autres de se conformer a des régles de vie spéci-
fiques, de s‘imposer les exercices nécessaires de esprit ou du
corps, Le savoir des prophates consiste en ceci qu’ils détiennent
la clé de ce nouveau séjour ils connaissent le chemin de la Terre
‘sans Mal, non pas tant sa localisation dans espace réel, que les
regles éthiques par lesquelles seules on peut y accéder. On peut
comprendre, dans cette optique, le sens des « confessions » publi-
‘ques des femmes (dont Métraux disait que Jeur but nous restait
inconnu) : elles pourraient n’étre qu'un préhide aux divers exer-
ices qui accompagnaient toujours 1a quéte de Ia Terre sans Mal
et qui en conditionnaient le succes.
Le caractire négateur des discours prophétiques resort &
Vévidence : pour aceéder & cette terre promise non seulement on
‘engage les Indiens a cesser de chasser et de cultiver (done & renon-
‘er Ace qui constitue Ia trame de leur existence quotidienne) mais
‘encore on leur conseille de faire fi des régles de mariage. Qu'ils
donnent leurs filles qui ils veulent : c'est tout Jordre social qui
fest mis en question. Et ce n'est pas pat hasard si les seuls éléments
qui n’en soient pas niés sont la guerre de vengeance et Je canni-
balisme + ils représentent, sous la forme institutionnalisée et
par conséquent contrOlée du rituel, la négation des régles
liance *,
‘Avant de compléter ces informations par celles que donne
Léry, il faut dire quelques mots des maraca. L’existence de cale-
asses tuillées en forme de visage humain est attestée par de
1, On donmait toujours une épouse aux prisonniers de guerre : ceux que
ron tuait pour les dévorer étaient par coaséquent des beaur-fréres.
8
PAGES EY CARATBES
nombreux observateurs; on a vu que Staden les considérait comme
les seules divinités indigénes. Les maraca étaient utilisées par les
prophétes lorsqu'ils allaient rendre leurs prédictions, et on n’entre-
prenait jamais d'expédition guerriére sans les avoir auparavant
consultées. « Quelques sorciers usent d'une calebasse qui a l'aspect
dune te humaine, avec ses cheveux, ses oreilles, son nez, ses
yeux, sa bouche; elle repose sur une fiche qui tient liew de cou,
et lorsqu’ils veulent rendre leur oracle, ils font de la fumée dans
‘ete calebasse avec des feuilles séches de tabsc qu’ils brileat
st aspirent par le nez la fumée qui sort par les yeux, les oreitles
et Ia bouche de Ia téte artificielle jusqu’a ce qu’ils finissent par en
tre troublés et ivres comme s’ils avaient bu. » On les consi-
Aérait, en ees occasions, comme les réceptacles des esprits, et
lorsque le prophéte « change sa voix en une voix d’enfant » c'est
le signe que, dés lors, un esprit parle ou, pour mieux dire, que le
dieu parle en lui. Faut-il voir dans les maraca des idoles? Leur
aspect anthropomorphique pourrait y inciter, mais, outre le fait
qu’elles n’étaient pas toujours modelées de la sorte, dautres
Aléments interdisent, nous semble-t-il, cette interprétation. Tout
@’abord la maraca n’était pas V'attribut spécifique des paje ou des
caraibes; chaque homme en possédait et elle faisait partie du
mobilier des familles tupinamba (cf. Thevet), coaservée, par
conséquent, avec les autres biens, dans la maison collective.
‘Avant tout, c'est un instrument de musique destiné & accompagner
et & rythmer les danses et les chants. La maraca, comme le remar-
que Métraux, n’était done pas chose sacrée en elle-méme et
n'était Fobjet d’aucun culte. En de rares occasions — lors, pré-
cisément, des visites des karai — les esprits s'y manifestaient +
lorsque, grace i la fumée de tabac qu’ils y expiraient, les grands
paje les imprégnaient du pouvoir dont ils étaient seuls déten-
teurs. « Is (les pae) parcourent une fois par an le pays et entrent
dans toutes les maisons; ils font croire qu'un esprit vena de
1, Vasconcellos, cité par Métraux, La Religion... p. 73.
2, S'il était permis de considérer ies dessins des chroniqueurs comme des
« informations», a mmere ae eur un, ein de Std
fe suggestions : la maraca qu'il représente (p. 129) est dotée se
«une « bouche » et cele-ci ressemble & s'y méprendre & un croissant de |
9
Hi
LA TERRE SANS MAL
régions lointaines et étrangéres est avec eux ct leur a donné le
pouvoir de faire parler toutes les tamaraca'. » Chacun alors
peignait en rouge sa maraca, V'ornait de nouvelles plumes et la
présentait au karai qui, lorsqu’il les avait toutes réunies souffiait
de la fumée de tabac pour leur donner un peu de son pouvoir,
et y faire parler les esprits (selon une information de Theyet,
les esprits des ancétres). [1 ne s‘agit pas ici d'idoles; la maraca
c'est Caccessoire principal du prophite, le médiateur tangible
par quoi nécessairement doit passer toute communication avec le
surnaturel.
Revenons maintenant & ces grandes cérémonies auxquelles
participaient plusieurs grands karai. Celle a laquelle assista Léry
‘réunissait « dix ou douze des meilleurs Caraibes ». Nous ne nous
Giendrons pas sur Ia réception fastueuse qui leur fut faite : Léry
ne nous apprend rien IA que nous ne sachions par ailleurs, sinon
que tous les villages environnants vinrent y assister de sorte qu'il
sly trouvait cing ou six cents hommes adultes. Sit6t arrivés au
village, les Indiens se séparérent en trois groupes : les hommes
dans une maison a part, les femmes dans une autre, les enfants
dans une troisiéme, Interdiction fut faite aux femmes et aux
enfants de sortir. Réunis autour des caraTbes les hommes se mirent
‘Achanter, les femmes répondant de leur c5té par des cris rythmés,
Tancés par intermittence. D'abord ce fut un chant épouvantable
et discordant, rapporte Vauteur, qui saisissait de frayeur et dura
Vespace d’un quart d’heure. Ensuite les hommes se remirent &
chanter, en parfait accord cette fois, ce qui incita Léry (qu'on
avait relégué dans la maison des femmes) a aller voir de plus prés.
Il se rendit donc, sa frayeur passte, dans la maison des hommes,
ot ceux-ci éiaient en train de chanter et de danser. « Tout prés
4 prés l'un de l'autre, sans se tenir par la main ni sans se bouger
d'une place, ains estans arrangez en rond, courbez. sur le devant,
guindans un peu le corps, remuant seulement la jambe et le pied
droit, chacun ayant aussi la main dextre sur ses fesses et le bras
‘ét la main gauche pendant, chantoyent et dansoyent de ceste
facon. Et au surplus, parce qu’ cause de 1 multitude il y avait
1, Staden, op. city p. 129.
PAGS ET CARATBES
trois rondeaux, y ayant au milieu d’un chacun trois ou quatre
de ces Caraibes, richement parés de robes, bonnets et bracelets
faits de belles plumes naturelles... : tenans au reste en chacune
de leurs mains un Maraca... ils les faisoyent sonner & toute reste...
Outre plus, ces Caratbes en s'avangans et sautans en devant,
puis reculans en erriére, ne se tenoyent pas tousjours en une place
comme faisoyent les autres : mesme j'observay qu'eux prenans
souvent ne canne de bois, longue de quatre & cing pieds, au bout
de laquelle il y avait de I'herbe de Perun seiche et allumée; en le
tovrans et souiflans de toutes parts la fumée d’icelle sur les
autres sauvages, ils leur disoyent; A fin que vous surmontiez
vos ennemis, recevez tous lesprit de force*...» La description
de Léry est trop longue pour que nous puissions la citer en entier;
mais elle est trés belle et d'une grande précision = il suffit, pour
cn juger, de comparer sa description de la danse avee celle que
fera beaucoup plus tard Nimuendaju de la danse apapokuv:
ce sont, i trds peu prés, les mémes gestes. La danse se poursuiv
sans interruption, prés de deux heures, puis vinrent des chants
entrecoupés de discours. Quatre grands thémes furent évoqués
dans ces discours, d’aprés le truchement de Léry : le premier
consacré aux morts et aux ancétres; ensuite on dit Ia certitude
aller les retrouver « derriére les hautes montagnes » pour danser
et se réoulr avec eux; le troisiéme point concerne les menaees
faites aux ennemis; enfin on raconta le mythe du déluge. Bien
centendu, on ne saurait de 1A tirer des conclusions définitives sur
les discours des karai; il est fort possible que le « truchement »
de Léry n’ait point résumé tout ce qui avait été dit et n’ait retenu
que quelques-uns des thémes évoqués. Néanmoins, et cette réserve
faite, il est intéressant de remarquer que le seul mythe raconté
cen pareille circonstance soit précisément celui du déluge, et que,
par conséquent, le théme de la destruction de la terre yienne
svarticuler 4 Ia promesse de la Terre sans Mal. Tout 0 passe
comme si le rappel de cx cataclysme passé n’était IA que pour
confirmer Vimminence dune catastrophe & venir, & laquelle il
‘est impossible d’échapper autrement qu’en aceédant & la Terre
1, Léty, op. cit, t. Il, p. 70-71,
a
TA TERRE SANS MAL
sans Mal. C'est la on Te verra, le théme majeur des réflexions des
Guarani modernes; et les parcelles «informations que nous avons
voulu rassembler ici donneat a penser qu'il n’était pas non plus
Stranger a leurs lointains ancétres.
1Les_ chroniqueursne-disent pas Ia signification qu’avaient
pour les Tupi-Guarani, chants, danses_et fumée de tabac. Du
moins nous apprennent jours_associés_
ccérémonies que présidaient les Kari, dont ils constituaient méme
Ja plus grande part: on peut par conséquent leur attribuer une
Fonction éminemment religicuse. En somme chants, danses,
absorption de tabac étaient leurs gestes de pigtt, les éléments de
\Jeur pratique religicuse. Si l'on y joint les confessions de femmes,
les jeGnes, on percoit tout un ensemble de pratiques qui indiquent
(gue lorsqu’on recevait un karai, on se préparait, esprit et corps,
réaliser Vavénement de ces temps nouveaux dont on savait
i'l était, lui, le messager.
La fonction de la fumée de tabac comme moyen de commuri-
tion avec le surnaturel est trop connue pour qu'on n'y insiste
s ici, Elle m’est pas, du reste, propre aux Tup-Guarani : le
bac, quoique diversement préparé et consommé, joue un role
jquivalent pour la plupart des tribus qui le cultivent,
Les chants, mélodies entrecoupées de phrases non chantées,
Gaient Moccasin de dire les récits mythiques, ordre du monde
‘et la promesse de la nouvelle terre. Quant & la danse, elle est,
pour les Guarani d’aujourd’hui, l'une des techniques qui permet-
tent d'alléger le corps et de rendre plus aisée son accession & la
Terre sans Mal. Le lien entre chant et danse apparalt bien chez
les Chiripa ot ceux qui dirigent les danses sont les oporaiva, ceux
‘qui chantent (porai = chant), entendons ceux qui savent dire
les paroles sactées. La encore la continuité peut s’iablir & travers
les sidcles, Du reste les jésuites qui fondérent les premiéres réduc-
tions paraguayennes avaient si bien vu la valeur sacrée qu’avaient
pour les Guarani les chants et les danses qu’ils n’hésitérent point
leur accorder une large place dans-le nouveau culte qu’ils ten-
taient de leur imposer.
oa
a
Pacts ET CARAIBES
Le chapitre préeédent voulsit expliquer Ia vision européenne
du monde indien et montrait comment la plupart des croyances:
favaient été isolées de four contexte et transposées en un autre,
& exception, disions-nous, de la Terre sans Mal. Puisque les
rapports entre deux cultures doivent pouvoir se lire en deux sens,
ton peut tenter de faire I'inverse : imaginer comment les Indiens:
ont pu, dans les termes de leur propre culture, interpréter & leur
tour le religion des nouveaux yenus. L'idée de Dieu qu’on tentait
de leur inculquer ne pouvait que les laisser indifférents. On peut
deviner, d’aprés les témoignages des Peres, qu’ils essayérent
@abord de Iassimiler & leurs karai ou bien aux missionnaires
‘cux-mémes. Leurs questions l'attestent : Tup’ avait-il beaucoup
de femmes, pour étre si puissant, ou bien avait-il comme les
Péres fait voeu de chasteté; portait-il une soutane, etc. Si I'idée
de résurrection ne faisait pour eux nulle difficulté — leurs korai
en pouvaient faite antant — ils avaient en revanche quelque
ptine A comprendre les mystéres de Ia passion : si Tupi était,
comme on le prétendait, le plus puissant de tous, comment s*était-i]
Jaissé vainere et mettre en croix par ses ennemis; et pourquoi
‘se punir lui-méme, plutot que les hommes, des fuutes commises
par ces dorniers? Toutes questions propres a irriter les Péres et
entamer parfois leur confiance en la possibilité de faire entendre
daussi grandes vérités & des Sauvages. A lire les. innombrables
tt Fastidieux sécits de « conversions », tne chose au moins appa
rait : parmi les thémes de prédication des missionnaires, il en est
‘un seul qui trouva chez les Indiens un écho immédiat, Ja promesse
d'une vie sans fin aprés la mort. A T'inverse de ce qui ‘était
passé chez les Européens, ils ont cru y reconnaltre leur propre
Imythe de la Terre sans Mal. On comprend alors qu'ils aient pu voir
dans les missionnaires d’authentiques karai (rappelons que tel
fut le titre dont ils les honorérent), plus puissants encore que les,
leurs — de 1a supériorité technique des Blanes —, et qui, de sur-
croit ne courraient guére le risque de les décevoir puisque la
‘Terre sans Mal qu’ils promettaient n°était point & chercher ici
bas, La est peut-ttre Ia clé de l’extraordinaire réussite des jésuites
chez les Guarani.
6
LA TERRE SANS MAL
Tupi et Guarani n’étaient done pas ces gens sans foi que tous
Jes chroniqueurs se sont plu & voir en eux : leurs temoignages
mémes sont li pour nous enseigner le contraire. Touts la pensée
ct la pratique religicuses des Indiens gravitaient autour de la
‘Terre sans Mal. Une religion que I’on peut dire prophétique. Dés
Je début de la Conquite (rappelons que Nébrega éerit en 1549)
tout le contexte, tous les éléments du prophétisme sont en place :
les personages des karai, avec leur position d’extériorité spatiale
ct généalogique; le thime de la Terre sans Mal; le mythe de la
destruction de la premiére terre et Ia croyance en un cateclysme
futur. C'est dire qu’il ne s’agit pas du tout ici d'un « messianisme »
qui se serait produit par réaction & la colonisation. Tl se peut que,
par a suite, la Conquéte ait radicatisé le prophétisme. Mais
réduire, comme on a voulu le faire, cette religion & une réponse
ae gens opprimés & une situation d’oppression, c'est s'interdire
de Ia comprendre. C’est du sein méme de la culture indienne,
‘comme une dimension originale de leur société, qu'il faut tenter
de Mexpliquer.
(CHAPITRE IL
Le discours des prophetes
et ses effets
Tusque-1a, nous cherchions a isoler le domaine du religieux
chez les anciens Tupi-Guarani, puisqu’il fallait tenter de le saisit
dans sa spécificité, Démarche imposte par la contradiction
centre l'ensemble des témoignages anciens d'une part et les obser-
vations faites depuis le début de ce siécle (depuis Nimuendaju)
d’autre part sur les Tupi-Guarani : comme si un incompréhen-
sible changement s'était produit dans histoire de cette culture,
qui aurait fait mystiques des gens auparavant dénués de préocc
pation: religiouses. Qu’aucune mutation de cette sorte ne soit
intervene, c'est ce que nous avons voulu établir : en dépit du
bouleversement provoqué par la conquéte européenne, on déeele
au contraire une remarquable continuité
La religion n’est qu’un élément dans un ensemble plus vaste,
Ja socigté. C'est dire qu’elle est toujours susceptible de deux
lectures : T'une, que I'on peut dire philosophique, Mabstrait de
cet ensemble et la prend comme un systéme de pensée apte i
ire Etudié pour Iui-méme. Lautre, sociologique, nous convic
{la replacer dans cet ensemble et & nous interroger sur ses impli-
cations. C'est & quoi nous allons nous attacher maintenant ; tenter
de superposer oes deux lectures pour comprendre dans sa diffé-
rence une religion que T’on a, bien & tort, assimilée & un messiae
nisme. a
Les études faites sur les mouvements messianigues en diff
rents points du monde tendent a faire ressortir V'existence d'une
cause commune a Iéclosion de ces mouvements : un état de
65
LA TERRE SANS MAL
crise, ou de profond malaise social. Ils surgissent et se multiplient
cn situation coloniale, en des sociétés qui se voient vouces a dis-
paraitre de par l'impact de la civilisation blanche. La Ghost-
Dance ou ie culte du Peyotl des Indiens nord-américains, Tes
ccargo-cults océaniens sont des mouvements de ce type. Ils sont
tout a la fois expression du désespoir de sociétés qui se savent
menacées dans leur existence méme, et une tentative pour inter-
rompre le processus de désorganisation, en réaffirmant les valeurs
traditionnelles : de 18 les termes de « revivalisme » ou « nati-
visme » dont on les désigne, de li aussi leur caractére religieux
et politique & la fois. Tis représentent par conséquent, en réaction
une menace externe, des forces de cohésion nouvelles. Réponses
‘opprimés & des situations d’oppressions.
Que ce schéma classique ne s’applique pas aux Tupi-Guarani,
‘A. Métraux l'avait déji remarqué : « Le mythe de la Terre sans
Mal a été & Vorigine de plusieurs migrations qui s’échelonnent
du xvi au xx¢ sidele, et dont les premiéres. remontent peut-étre
4 la période pré-européenne. Ce sont bien. des mouverents-messia=
niques, mais ils différent de la plupart de ceux que nous connais-
sons par -leur-caraclére purement indigéne. Ils se réclament de
mythes tribaux et en apparence du moins, ne doivent rien & la
‘culture européenne}. » C'est 4 Métraux également que l'on doit
les études les plus précises sur ces migrations, dont fl découvrit
‘que certaines s'étaient produites en des régions oi les Indicns
vivaient libres et loin de tout contact avec les envahisscurs®.
Diaccord avec Métraux quant au caractére purement indigtne
des croyances et des personnages ligs au messianisme, E. Schaden
stoppose Iui pour affirmer que d'autres conditions sont néces~
saires & I'éclosion de mouyements messianiques. Deux autres,
selon lui, sont essentielles : la premigre est le développement
d'un mysticisme trés accentué, lié a la mythologie aborigéne
Cela implique, écrit-il, « que le messianisme — quoi qu'il ne
puisse se développer que dans une atmosphéxe d'inquiétude
sociale — ne remonte pas nécessairement & un état de désorgani-
1. A. Métraux, Religions et Megies indiennes... p. 13
2, A Métraus, Les Hommes.Diewx chez les Chirieuano, v.66.
66
LE DISCOURS DES PROPHETES ET SES EFFETS
sation? ». Jusque-li son interprétation concorde avec celle de
Métraux. Mais il ajoute qu’on ne peut pas néanmoins affirmer
que le messianisme soit dO uniquement & des phénomeues inter-
nes : il faut aussi — et c'est pour lui la deuxiéme condition — une
raison extérieure. C’est pourquoi, ditil, « nous sommes en désac-
cord avec Métraux lorsqu'il invoque Ie caractére anti-chrétien et
anti-européen des mouvements mystiques provoqués par les
messies, comme argument en faveur de l’origine purement indigéne
de ces derniers, A notre avis, les manifestations xénophobes
— qui sont un aspect quasi général du messianisme — sont dues
essenticllement 4 une situation de déséquilibre provoguée par
le contact avec la civilisation blanche * », Sans doute largumen-
tation de Schaden serait-elle digne d’attention, si le « messianisme»
tupi se définissait par son caractére « xénophobe », « anti-chrétien »
et « antieeuropéen ». Mais était-ce le cas? Le messianisme ne
s‘expliquerait pas par un « état de désorganisation » mais suppo-
serait malgré tout un certain « déséquilibre » et un « mysticisme
accentué », Voili qui demeure assez imprécis et quelque peu
confus. Pour résumer son point de vue, deux facteurs rendent
compte du messianisme tupi-guarani :’un facteur interne, le
rmysticiame exacerbé de cos Indiens, et un facteur externe, l'état
de déséquilibre df & Varrivée des Européens. Le cas tupi-guarani
siniggre alors parfaitement au modéle général rappelé plus
haut, Avant de proposer une autre interprétation, nous remst-
querons qu'il y aurait beaucoup & dire sur cette catégorie —
somme toute plutot vague — de « mysticisme » dont on qualiie
la religion indienne, Et que signifie un mysticisme « exacerbé »,
ou, que dire d'une société de mystiques? A tout Iz moins pourrait-
fon soupgonner ld un indice interne de déséquilibre social. Si,
slobalement, Jes Tupi-Guarani étaient vraiment ces _mystiques
que l'on se plait & voir en cux — non sans raison peut-Btre —
‘on peut diffcilement se contenter de I"évidence du fait : on a li
lune donnée intrinséque qui fait probléme et dont il faut com-
prendee les rlsnaa st pourquoi on ne peut pas éluder une
ture sociologique des faits religicux. En second lieu, que connote
1, Sehaden, 4 mitolopia herofca de tribes tndigenax de Ball, ps St.
2 Schuden, op. cits p. 58.
7
Vous aimerez peut-être aussi
- Orgueil et Préjugés - Edition illustrée: Pride and PrejudiceD'EverandOrgueil et Préjugés - Edition illustrée: Pride and PrejudiceÉvaluation : 4.5 sur 5 étoiles4.5/5 (20391)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItD'EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItÉvaluation : 4.5 sur 5 étoiles4.5/5 (3310)
- Art of War: The Definitive Interpretation of Sun Tzu's Classic Book of StrategyD'EverandArt of War: The Definitive Interpretation of Sun Tzu's Classic Book of StrategyÉvaluation : 4 sur 5 étoiles4/5 (3321)
- The 7 Habits of Highly Effective People: The Infographics EditionD'EverandThe 7 Habits of Highly Effective People: The Infographics EditionÉvaluation : 4 sur 5 étoiles4/5 (2487)
- Learn German! Lerne Englisch! ALICE'S ADVENTURES IN WONDERLAND: In German and EnglishD'EverandLearn German! Lerne Englisch! ALICE'S ADVENTURES IN WONDERLAND: In German and EnglishÉvaluation : 3.5 sur 5 étoiles3.5/5 (5622)
- How To Win Friends And Influence PeopleD'EverandHow To Win Friends And Influence PeopleÉvaluation : 4.5 sur 5 étoiles4.5/5 (6538)
- The 7 Habits of Highly Effective PeopleD'EverandThe 7 Habits of Highly Effective PeopleÉvaluation : 4 sur 5 étoiles4/5 (2571)
- How to Win Friends and Influence People: Updated For the Next Generation of LeadersD'EverandHow to Win Friends and Influence People: Updated For the Next Generation of LeadersÉvaluation : 4 sur 5 étoiles4/5 (2327)
- Habit 6 Synergize: The Habit of Creative CooperationD'EverandHabit 6 Synergize: The Habit of Creative CooperationÉvaluation : 4 sur 5 étoiles4/5 (2499)
- Habit 1 Be Proactive: The Habit of ChoiceD'EverandHabit 1 Be Proactive: The Habit of ChoiceÉvaluation : 4 sur 5 étoiles4/5 (2559)
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeD'EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeÉvaluation : 4 sur 5 étoiles4/5 (5813)
- The Picture of Dorian Gray: Classic Tales EditionD'EverandThe Picture of Dorian Gray: Classic Tales EditionÉvaluation : 4 sur 5 étoiles4/5 (9763)
- Wuthering Heights (Seasons Edition -- Winter)D'EverandWuthering Heights (Seasons Edition -- Winter)Évaluation : 4 sur 5 étoiles4/5 (9974)
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeD'EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeÉvaluation : 4.5 sur 5 étoiles4.5/5 (20099)
- Habit 3 Put First Things First: The Habit of Integrity and ExecutionD'EverandHabit 3 Put First Things First: The Habit of Integrity and ExecutionÉvaluation : 4 sur 5 étoiles4/5 (2507)
- Anna Karenina: Bestsellers and famous BooksD'EverandAnna Karenina: Bestsellers and famous BooksÉvaluation : 4 sur 5 étoiles4/5 (7503)
- Alice in Wonderland: Down the Rabbit HoleD'EverandAlice in Wonderland: Down the Rabbit HoleÉvaluation : 4 sur 5 étoiles4/5 (4611)
- The Secret Garden: The 100th Anniversary Edition with Tasha Tudor Art and Bonus MaterialsD'EverandThe Secret Garden: The 100th Anniversary Edition with Tasha Tudor Art and Bonus MaterialsÉvaluation : 4 sur 5 étoiles4/5 (6840)
- The Illustrated Alice in Wonderland (The Golden Age of Illustration Series)D'EverandThe Illustrated Alice in Wonderland (The Golden Age of Illustration Series)Évaluation : 4 sur 5 étoiles4/5 (4347)
- Pride and Prejudice: Bestsellers and famous BooksD'EverandPride and Prejudice: Bestsellers and famous BooksÉvaluation : 4.5 sur 5 étoiles4.5/5 (20479)




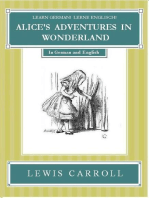

















![Don Quixote: [Complete & Illustrated]](https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/264046221/149x198/541f56cceb/1617238192?v=1)



