Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Groupe 2
Groupe 2
Transféré par
Kere SamirahTitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Groupe 2
Groupe 2
Transféré par
Kere SamirahDroits d'auteur :
Formats disponibles
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, BURKINA FASO
DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE ************
L'INNOVATION (MESRSI) Unité – Progrès - Justice
------------------
SECRETARIAT GENERAL
------------------
DIRECTION GENERALE DE L’ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR
------------------
DIRECTION DES INSTITUTIONS PRIVEES
D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
------------------
UNIVERSITE DE L’UNITE AFRICAINE
(Ex IAM OUAGA)
RAPPORT DE FIN DE CYCLE
POUR L’OBTENTION DU DIPLOME DE LA LICENCE
EN RESEAUX ET TELECOMMUNICATION
THEME :
« Etude du principe de traitement des signaux TV en transmission numérique: cas de la SBT »
PRESENTE PAR : Judicaël Rayiimwende TAPSOBA
Période de stage : du 04 avril au 03 juin 2022
Sous la direction de
Maitre de stage : Professeur de suivi :
Clément ILBOUDO Guy Edouard BOUDA
Technicien en Informatique Enseignant à l’Université de l’Unité
Africaine
Année académique : 2021-2022
DEDICACE
A mon père Abel TAPSOBA pour tous les sacrifices consentis, son soutien permanent et
ses précieux conseils qui m’ont été d’un apport inestimable ;
A ma mère Helene TAPSOBA/NANA qui n’a cessé de m’encourager et de prendre soin
de moi depuis ma tendre enfance jusqu’à cette période de présentation du document. Son
amour et son soutien moral ont toujours été ma force ;
A mes frères, mes sœurs et tous les membres de ma famille pour leurs soutiens
multiformes.
Année académique : 2021-2022 ii
REMERCIEMENTS
Avant de commencer la présentation de ce rapport, nous profitons de l’occasion pour rendre
grâce à Dieu le Tout Puissant créateur de l’univers pour le souffle de vie et la santé de fer qu’il
m’accorde chaque jour pour accomplir ses œuvres. Mes remerciements à tous ceux qui ont œuvré
de près ou de loin à l’élaboration et à la réussite de ce document :
➢ A Mon Professeur de suivi, Monsieur Guy Edouard BOUDA qui tout au long de ma
rédaction n’a cessé de me conseiller et m’orienter ;
➢ A mon Maître de stage, Monsieur Clément ILBOUDO qui, malgré toutes ses multiples
tâches, n’a cessé de me soutenir et me guider dans la réalisation de ce travail ;
➢ A l’ensemble du corps professoral de l’Université de l’Unité Africaine (ex IAM-Ouaga)
pour ces trois (3) années d’instruction et d’apprentissage ;
➢ A tout le personnel de la SBT, pour son accueil, sa considération, ses conseils et son
accompagnement tout au long de la durée de notre stage ;
➢ A toute ma famille, mes amis (es), ma promotion pour leurs soutiens inconditionnels et
toutes les personnes qui m’ont aidé d’une manière ou d’une autre.
Année académique : 2021-2022 iii
LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS
Tableau 1 : Listes des sigles et abréviations
ATSC Advanced Television Systems Committee
BCH Bose Chaudhuri Hocquenghem
BNC Bayonet Neill-Concelman Connector
CAMES Conseil Africain et Malgache pour l’Enseignement Supérieur
CDN Centre de Distribution Numérique
CNA Convertisseur Numérique-Analogique
DVB Digital Video Broadcast
DVB-S Digital Video Broadcasting-satellite
DVB-T Digital Vidéo Broadcasting Terrestrial
DTH Direct To Home
ES Elementary Stream
FEC Forward Error Corrector
FH Faisceau Hertzien
HD Haute Définition
HDTV Ultra Haute Définition Télévision
IDU Indoor Unit
IAM Institut Africaine de Management
IP Internet Protocol
ISDB-T Integrated Services Digital Broadcasting-Terrestrial
LDPC Low Density Parity Code
MPEG Moving Pictures Expert Group
MPTS Multi program Transport Stream
OFDM Orthogonal Frequency-Division Multiplexing
PES Packet Elementary Stream
PID Program Identifier
PLP Physical Layer Pipe
PS Program Stream
QAM Quadrature Amplitude Modulation
QPSK Quadrature Phase Shift Keying
RS Reed Solomon
SBT Société Burkinabè de Télédiffusion
Année académique : 2021-2022 iv
SD Simple Définition
SDI Serial Digital Interface
SPTS Single Program Transport Stream
TNT Télévision Numérique Terrestre
TS Transport Stream
TV Télévision
T2-MI Modulator Interface for a second generation
UA Université l’Unité Africaine
UHF Ultra High Frequency
UIT Union Internationale des Télécommunications
Année académique : 2021-2022 v
LISTE DES FIGURES
Figure 1 : Organigramme de la SBT……………………………………………………………………………3
Figure 2 : Organigramme de la Direction Technique…………………...……………….…………..6
Figure 3 : Etat de déploiement du réseau de diffusion de la SBT……………………………..14
Figure 4 : Architecture du réseau de la SBT……………………………………………….….…………15
Figure 5 : Câble coaxiale BNC…………………………………………………………………………..………18
Figure 6 Mesure C/N sur un analyseur de spectre……………………………………………………21
Figure 7 : Chaine de démodulation………………………………………………………………………….21
Figure 8 : Mesure graphique Eb/No…………………………………………………………………………22
Figure 9 : Schéma d'un IDU………………………………………………………………………………………24
Figure 10 : Création d'un TS…………………………………………………………………………………….26
Figure 11 : Exemple de multiplexage de chaine dans un seul canal…………………….……27
Figure 12 : Image montrant le processus de traitement de signal…………………………...28
Figure 13 : Chaine de traitement numérique……………………………………………………………31
Figure 14 : Acheminement du contenu national du CDN aux stations régionales.……32
Figure 15 : Schéma de la structure d'un émetteur……………………………………………………34
Figure 16 : Architecture d'un émetteur……………………………………………………………………35
Année académique : 2021-2022 vi
LISTE DES TABLEAUX
Tableau 1 : Liste des sigles et abréviations………………………………………………………………..iv
Tableau 2 : Le réseau de diffusion des 12 régions……………………………………………………13
Tableau 3 : Débit et formats vidéo………………………………………………………….……………….17
Année académique : 2021-2022 vii
AVANT PROPOS
L’Université de l’Unité Africaine (UA) est née en 2020 de la mutation de l’Institut Africain de
Management (IAM-OUAGA) créé en 2007. L’université place au cœur de ses missions la diffusion
de la culture scientifique et technique. La réalisation de cette mission principale exige l’adoption
d’un certain nombre de valeurs et de règles de conduite.
Ces valeurs au centre du projet éducatif sont notamment : l’humanisme, le courage, l’ouverture sur
le monde, le non conformisme.
En respectant ces valeurs, l’UA place au cœur de ses priorités la formation de l’Homme au plan
scientifique, social et culturel.
L’UA est composée de deux Unités de Formation et de Recherche (UFR) : Sciences Juridiques,
Politiques et Administratives (SJPA), Sciences Economiques et Gestion (SEG) ; et de l’Institut
Africain de Management (IAM-OUAGA). En SJPA et en SEG, la première année de Licence est
pluridisciplinaire et donne aux étudiants les moyens de construire leur projet de formation. Elle
ouvre sur un large choix de parcours en 3eme année de Licence qui permettent de se spécialiser et
de s’orienter vers un master.
L’Institut Africain de Mangement (IAM-OUAGA) permet aux étudiants d’acquérir des
compétences hautement professionnelles avec des programmes de formation qui alternent
l’enseignement théorique et l’expérience en entreprise à travers des stages suivis et dirigés.
Le corps professoral est de qualité et est composé d’enseignants locaux et étrangers, des
professionnels d’entreprise pétris d’expériences de terrain.
Le Conseil Scientifique, dirigé par un professeur de rang A, a comme membres des enseignants de
haut niveau et des chefs d’entreprise. Le Conseil Scientifique se réunit en sessions régulières et
veille à la qualité scientifique et pédagogique de l’offre de formation. Il veille aussi à la bonne
image et au positionnement de l’université dans l’enseignement supérieur privé.
A cela, il faut ajouter la qualité de vie et de travail sur le campus, les partenariats avec les
établissements d’enseignement supérieur publics et privés nationaux, internationaux et les
entreprises.
Dans le cadre de sa démarche qualité et de l’amélioration continue de ses offres de formation,
vingt-cinq diplômes de l’UA sont accrédités par la CAMES.
Année académique : 2021-2022 viii
SOMMAIRE
DEDICACE…………………………………………………………………………………………………………………………………………………ii
REMERCIEMENTS…………………………………………………………………………………………………………………………………….iii
LISTES DES SIGLES ET D'ABREVIATION……………………………………………………………………………………………………..iv
LISTES DES FIGURES…………………………………………………………………………………………………………………………………vi
LISTES DES TABLEAUX……………………………………………………………………………………………………………………………..vii
AVANT PROPOS……………………………………………………………………………………………………………………………………..viii
SOMMAIRE……………………………………………………………………………………………………………………………………………..ix
INTRODUCTION GENERALE………………………………………………………………………………………………………………………1
CHAPITRE 1 : PRESENTATION DE LA SOCIETE BURKINABE DE LA TELEDIFFUSION……………………………………..2
I. DISPOSITION GENERALE…………………………………………………………………………………………………………………..…2
II. LES DIRECTION ET SERVIVES……………………………………………………………………………………………………………….2
III. ORGANIGRAMME DE LA SBT…………………………………………………………………………………………….………………3
VI. DIRECTION TECHNIQUE…………………………………………………………………………………………………………....………4
CHAPITRE 2 : ARCHITECTURE GENERALE DU RESEAU DE LA SBT……………………………………………………………….7
I. LES TETES DE RESEAU………………………………………………………………………………………………………………………….7
II. LE RESEAU DE TRANSMISSION…………………………………………………………………………………………………………10
III. LE RESEAU DE DIFFUSION……………………………………………………………………………………………………………….13
CHAPITRE 3 : LES CONCEPTS TECHNIQUES DE LA CHAINE DE TRAITEMENT DE SIGNAUX…………………………16
I. ELABORATION DU FLUX VIDEO………………………………………………………………………………………………………….16
II. LA TRANSMISSION NUMERIQUE……………………………………………………………………………………………………….19
CHAPITRE 4 : LA DIFFUSION NUMERIQUE……………………………………………………………………………………………….29
I. LA DIFFUSION NUMERIQUE TERRESTRE…………………………………………………………………………………………….29
II. EMETTEUR……………………………………………………………………………………………………………………………………….33
CHAPITRE 5 : BILAN DU STAGE……………………………………………………………………………………………………………….37
CONCLUSION GENERALE…………………………………………………………………………………………………………………………40
BIBLIOGRAPHIE ET WEBOGRAPHIE ................................................................................................................ x
TABLE DES MATIERES ................................................................................................................................... xii
Année académique : 2021-2022 ix
INTRODUCTION GENERALE
Essentielle et devenue un élément de vie quotidienne, la « télévision » a toujours été un
élément indispensable pour une nation car elle est aussi bien une source d’information (à travers le
journal télévisé, les différents reportages) que de divertissements (musique, cinéma, sport, etc…).
C’est un puissant canal que les médias utilisent pour véhiculer différentes informations audio-
visuelles en temps réel. La diffusion de ces informations qui depuis belle lurette était analogique
est passée au numérique grâce à la Télévision Numérique Terrestre (TNT).
Par conséquent, tous les pays doivent donc basculer dans la TNT, au Burkina Faso la
Société Burkinabé de Télédiffusion (SBT) en est l’opérateur public de télédiffusion. Elle a pour
objectif d’assurer la diffusion des programmes télévisuels par voie hertzienne terrestre en mode
numérique. Elle dispose d’un vaste réseau permettant d’assurer la diffusion des programmes de
toutes les chaines des éditeurs de service sur toute l’étendue du territoire national. Le réseau TNT
de la SBT est constitué tout d’abord par le transport des signaux des éditeurs (chaines de télévision)
jusqu’au centre de distribution numérique (CDN), ensuite nous avons le transport par satellite du
multiplex national sur tout le territoire national. Enfin nous avons le transport du multiplex complet
(national et régional) des têtes de réseaux secondaires vers les stations de diffusions rattachées.
De nos jours, la TNT offre aux usagers une haute définition de l’image et une qualité
sonore optimale ainsi que la diversité en termes de station ou de chaîne. De ce fait, nous nous
sommes focalisés sur le thème suivant : « Etude du principe de traitement des signaux TV en
transmission numérique : cas de la SBT ».
Pour cela, le plan décrit ci-dessous sera adopté en cinq chapitre. Le premier
chapitre décrit la présentation de la structure d’accueil, ensuite, le second chapitre parlera de
l’architecture général du réseau de la SBT. Dans le troisième chapitre, nous verrons le concept
technique de chaine de traitement des signaux, en quatrième chapitre, nous nous consacrerons
sur le processus de la diffusion numérique. En dernier chapitre nous aborderons le bilan du stage
offert par la SBT.
ANNÉE ACADÉMIQUE : 2021-2022 1
CHAPITRE 1 : PRESENTATION DE LA SOCIETE BURKINABE DE
TELEDIFFUSION (SBT)
Dans ce chapitre nous ferons une présentation de notre structure d’accueil, la SBT avec ses
différents services et directions sans oublier la présentation de son réseau.
I. DISPOSITION GENERALE
La Société Burkinabè de Télédiffusion a été créée par le décret n°2013-
3/PRES/PM/MICA/MC/MDEMP/MEF du 09 juillet 2013 en application de la Loi n°022-2013/AN
du 22 mai 2013 portant règlementation de la Radiodiffusion sonore et télévisuelle. La Société
Burkinabé de Télédiffusion (SBT) est une société d’État, dotée de la personnalité juridique et de
l’autonomie financière. Elle a pour objet d’assurer la diffusion des programmes radiophoniques et
télévisuels par voie hertzienne terrestre en mode numérique.
Pour mener à bien ses missions, la Société Burkinabè de Télédiffusion sera structurée sous
une forme hiérarchico-fonctionnelle avec un Conseil d’Administration. L’organigramme a été
élaboré de manière opérationnelle et fonctionnelle, par rapport aux grandes activités techniques et
de gestion en renforçant la séparation des tâches pour prévenir les incompatibilités dans les rôles.
II. LES DIRECTIONS ET SERVICES
Le projet d’organigramme ainsi élaboré propose une direction générale, quatre (4) directions et
onze (11) services. Les directions et les services sont :
La direction générale
❖ Le service Audit et Contrôle de Gestion ;
❖ Le service Juridique.
La direction technique
❖ Service de la diffusion et de la transmission ;
❖ Service de l'exploitation et de contrôle des réseaux ;
❖ Service de l'ingénierie, de la maintenance audiovisuelle et de l'informatique ;
❖ Service de l'énergie et du froid.
ANNÉE ACADÉMIQUE : 2021-2022 2
La direction commerciale
❖ Service Commercial et Marketing ;
❖ Service de la Communication.
La direction des finances et de la comptabilité
❖ Service des Finances et du budget ;
❖ Service de la Comptabilité ;
❖ Service des marchés et du patrimoine.
La direction des resources humaines
❖ Service administration du Personnel ;
❖ Service Formation et Perfectionnement.
III. ORGANIGRAMME DE LA SBT
L’organigramme de la SBT se présente comme suit :
Figure 1 : Organigramme de la SBT
(Source SBT)
ANNÉE ACADÉMIQUE : 2021-2022 3
IV. DIRECTION TECHNIQUE
Elle a en charge les principales missions ci-après :
• Installer, exploiter, et assurer la maintenance du réseau de diffusion et de transmission ;
• Garantir le respect des normes techniques de diffusion et de transmission ;
• Assurer la veille technologique ;
• Élaborer les projets techniques conceptuels, pour l'acquisition des équipements et pièces
de rechanges ;
• Assurer la gestion et la maintenance des équipements audiovisuels, des installations
informatiques et électriques, de la climatisation et des groupes électrogènes.
La Direction Technique est subdivisée en plusieurs services que sont :
• Le secrétariat ;
• Le service de la diffusion et de la transmission ;
• Le service de l'exploitation et de contrôle des réseaux ;
• Le service de l'ingénierie, de la maintenance audiovisuelle et de l'informatique ;
• Le service de l'énergie et du froid.
1. Le secretariat
Le Secrétariat a pour attributions de :
• Organiser le travail quotidien de la Direction ;
• Exécuter les travaux de secrétariat ;
• Rédiger les rapports et comptes rendus de réunion.
2. Le service de la diffusion et de la transmission
Il a en charge les principales missions ci-après :
• Assurer le fonctionnement du réseau de transmission et de diffusion ;
• Assurer la collecte et l'analyse des rapports périodiques de fonctionnement des
équipements de diffusion et de transmission ;
• Mener les opérations de mesures de champs magnétiques des émetteurs ;
• Exploiter les équipements de transmission terrestre et satellitaire.
ANNÉE ACADÉMIQUE : 2021-2022 4
3. Le service de l’ingénierie, de la maintenance audiovisuelle et de
l’informatique
Il a en charge les principales missions ci-après :
• Proposer à la Direction Technique les plans stratégiques et opérationnels pour le
développement de la SBT ;
• Élaborer des fiches de projet pour la recherche de financement ;
• Rédiger les cahiers de charge des projets ;
• Assurer l’exercice de la veille technologique ;
• Assurer la gestion et la maintenance des équipements audiovisuels et informatiques sur
l'ensemble du territoire.
4. Le service d’exploitation et de contrôle des réseaux
Il a en charge les principales missions ci-après :
• Contrôler, configurer et régler les équipements des têtes de réseau primaire et secondaire ;
• Gérer les flux audio et vidéo entrant et sortant en local et à distance ;
• Assurer le bon fonctionnement des installations de réception, de contrôle et de
distribution ;
• Établir les rapports journaliers sur l'état de fonctionnement du réseau.
5. Le service de l’énergie et du froid
Il a en charge les principales missions ci-après :
• Exploiter les installations électriques et électrotechniques ;
• Assurer et veiller au respect des normes techniques d'alimentation, de protection, et de
sécurité des installations électriques et énergétiques ;
• Assurer l'entretien et la maintenance des circuits électriques, des climatiseurs et des
groupes électrogènes ;
• Tenir à jour les mesures de terre, les dispositifs de protection des bâtiments, des pylônes,
des émetteurs et des groupes électrogènes.
L’organigramme de la Direction Technique se présente comme l’indique la figure suivante.
ANNÉE ACADÉMIQUE : 2021-2022 5
Direction Technique
Secrétariat de
Direction
Service de la Service de Service de l Ingénierie, de la
Service de l Energie
Diffusion et de la l Exploitation et de Maintenance audiovisuelle et
et du Froid
Transmission Contrôle des Réseaux de l Informatique
Figure 2 : Organigramme de la Direction Technique
(Source SBT)
La SBT est constituée d’une direction Générale, de quatre (4) directions et de onze (11) services.
ANNÉE ACADÉMIQUE : 2021-2022 6
CHAPITRE 2 : ARCHITECTURE GENERALE DU RESEAU DE LA SBT
Au Burkina Faso, le réseau TNT est composé d’un centre de distribution nationale appelé
CDN, de 35 stations de diffusion équipées d’émetteurs DVB-T2 et d’une dizaine de sites relais
pour l’acheminement des signaux via des faisceaux hertziens. Ces stations sont disposées
stratégiquement pour offrir une couverture totale du pays. Comme complément de réseau de
diffusion, il y a une série d’équipement dont la fonction est d’adapter les contenus à la technologie
DVB-T2 et être capable de les transporter jusqu’aux stations afin d’être diffusés.
Dans ce chapitre nous allons structurer l’architecture générale du réseau de la SBT.
I. LES TETES DE RESEAU
Les têtes de réseau ont accueilli l’équipement nécessaire pour :
✓ Créer les multiplex des services à partir des contenus reçus des divers éditeurs
✓ Donner un format à ces multiplex afin de les adapter à la technologie DVB-T2.
En ce qui concerne les têtes de réseau, nous avons celle nationale et celle régionale.
1. La tête de réseau national
Il faut souligner qu’initialement il était prévu d’avoir du contenu régional dans la capitale, mais
finalement il est décidé de distribuer tout le contenu des éditeurs de Ouagadougou à l’échelle
nationale. Cela signifie qu’actuellement il n’y a aucun contenu régional ou dans le PLP2 (Physical
Layer Pipe 2) à Ouagadougou, mais la conception offre cette possibilité.
Plusieurs éléments sont utilisés dont nous pouvons les citer et en même temps donner leurs
fonctions :
✓ Chez les éditeurs nous avons :
- Studio Encoders : Ils compressent le signal vidéo et audio d’entrée (SDI) en utilisant
le format H.264/MPEG-4 AVC et l’envoient sous format TS ou IP via Multicast à
travers la liaison radio.
- IDU (1) : c’est un modulateur qui convertit le signal bande de base en un signal FI
(Fréquence Intermédiaire) à l’émission et inversement à la réception. Il adapte le
contenu pour sa distribution via liaison radio.
✓ Au CDN, nous avons:
ANNÉE ACADÉMIQUE : 2021-2022 7
- MUX (A/B) : Il unifie tous les SPTS (Single-program transport stream) en un seul
MPTS (Multi-program transport stream) et génère les tableaux correspondants
(PSI/SI)
- IP Guard National/Régional : En cas de défaillance dans l’entrée sélectionnée, il
commute automatiquement l’entrée redondante.
- T2 Gateway DTH National (A/B) : Il adapte le TS national au format DTH pour sa
distribution via satellite.
- T2 Edge DTH National (A/B) : Il adapte le MPTS national sous format DTH au
format T2-MI pour sa transmission et distribution régionale.
- T2 Edge Nat + Reg (A/B) : Il combine les deux PLP en un Stream (flux) MPLP
unique pour sa distribution régionale.
- IDU (2) : qui joue le rôle de démodulateur. Il convertit le signal FI en un signal de
bande de base.
- Uplink contenu national
Tel qu’indiqué au préalable, la distribution du contenu national se fait par satellite. C’est pourquoi
un système a été installé dans le CDN qui offre un haut degré de redondance. Ce système se
compose :
- Modulateurs DVB-S2 (A/B) : Module le MPTS (Multi-program transport stream) du
contenu national sous format DVB-S2 pour sa distribution via satellite.
- RF Splitter : Il divise l’entrée de signal RF en plusieurs sorties.
- BUC (A/B) : Il amplifie le signal et élève sa fréquence de la bande L (UHF) à la bande C
(SHF) pour sa distribution via satellite.
- Waveguide + Load : Il transmet le signal à travers le guide d’ondes et offre une charge pour
la dissipation du signal du BUC redondant.
A la réception satellitaire, nous avons les équipements suivants pour la supervision :
- LNA (Low Noise Amplifier) : Il amplifie le signal reçu par la parabole pour garantir un
niveau optimum de réception.
- Down Converter : Il diminue la fréquence du signal de bande C en bande L, ce qui facilite
son transport et sa réception.
ANNÉE ACADÉMIQUE : 2021-2022 8
- IRD (A/B) : Ils reçoivent le signal satellite en bande L et le démodulent, en extrayant le
MPTS du contenu national pour son analyse postérieure.
- Spectrum analyser : Équipement professionnel de mesure qui offre une analyse détaillée du
signal RF à transmettre.
Pour faciliter la surveillance des équipements, un système a été conçu. De cette façon, nous avons
la possibilité de visualiser sur deux écrans de ‘’60" pousse aussi bien le contenu généré par l’éditeur
(avant de multiplexer) que celui transmis par satellite ou son centre émetteur régional.
Le CDN comprend une fonction de surveillance de TS sur les points suivants :
- Contributions des éditeurs.
- Sortie des deux multiplexeurs.
- Contenu National avant la montée satellite.
- Contenu National descente satellite.
- Contenu émis par l’émetteur régional de Ouagadougou (Kamboinsin).
Tous ces points peuvent être sélectionnés pour être surveillés à travers le système multi-écrans et
un analyseur de TS, les installer et les configurer dans le CDN.
2. Les têtes de réseau régional
Sa conception présente un haut degré de redondance en dupliquant divers de ses éléments. La
fonction de chaque élément est la suivante :
✓ IRD (A/B) : Ils reçoivent le signal satellite depuis la parabole et la démodulent en extrayant
le MPTS du contenu national.
✓ IDU (A/B) : Ils reçoivent le signal de l’ODU et le démodule, en extrayant le SPTS du
contenu régional généré dans chaque studio.
✓ T2 Edge DTH (A/B) : Il adapte le TS national sous format DTH au format T2-MI pour sa
transmission et distribution régionale.
✓ MUX Régional : Il unifie les deux SPTS régionaux en un seul MPTS et génère les tableaux
correspondants (PSI/SI).
✓ T2 Gateway : Il adapte le TS régional au format T2-MI pour sa transmission et distribution
régionale.
ANNÉE ACADÉMIQUE : 2021-2022 9
✓ T2 Edge (A/B) : Il combine les deux PLP en un Stream MPLP unique pour sa distribution
régionale.
✓ IP Guard : En cas de défaillance dans l’entrée sélectionnée, il commute automatiquement
l’entrée redondante.
II. LE RESEAU DE TRANSMISSION
Le but de la transmission est de transmettre des informations d’un émetteur à un récepteur à travers
un canal de transmission. Au niveau de la SBT, elle se fait par faisceau hertzien ou par satellite.
✓ Transmission par faisceau hertzien:
Un faisceau hertzien est un système de transmission de signaux, aujourd'hui principalement
numériques, monodirectionnel ou bidirectionnel et généralement permanent, entre deux sites
géographiques fixes. Il exploite le support d'ondes radioélectriques, par des fréquences porteuses
allant de 1 à 86 GHz (gamme des micro-ondes), focalisées et concentrées grâce à des antennes
directives.
Ces émissions sont notamment sensibles aux obstacles et masquages (relief, végétation, bâtiments,
etc.), aux précipitations, aux conditions de réfractivité de l'atmosphère, aux perturbations
électromagnétiques et présentent une sensibilité assez forte aux phénomènes de réflexion pour les
signaux analogiques mais la modulation numérique peut, au moins en partie, compenser le taux
d'erreur de transmission dû à ces nuisances.
✓ Transmission par satellite:
Un réseau de télécommunication par satellite se compose d’un satellite et d’un ensemble de stations
terriennes.
Le satellite est la partie centrale du réseau. Il est maintenant de types actifs : il se comporte comme
un véritable relais dans le ciel. Il est constitué d’un véhicule sur lequel sont installés les
équipements de télécommunications et les antennes tels que : l’alimentation en énergie, le contrôle
d’altitude, le contrôle d’orbite, le contrôle thermique des équipements, la télécommande et la
télémesure.
ANNÉE ACADÉMIQUE : 2021-2022 10
Dans le satellite, les répéteurs sont essentiels; ce sont des équipements de télécommunication
assurant les mêmes fonctions qu’un relais, c’est à dire, ils reçoivent les émissions provenant de la
terre et les retransmettent vers la terre après amplification et transposition en fréquence. Un satellite
comporte donc plusieurs répéteurs et par conséquent la largeur de bande qui est assignée pour le
trajet montant est subdivisé par ces répéteurs.
La station terrienne constitue le terminal d’émission et de réception d’une liaison de
télécommunication par satellite. Compte tenu de l’affaiblissement en espace libre très important
subi par les ondes radioélectriques porteuses dans leur trajet entre la station et le satellite (35786km
environ), la qualité de fonctionnement des sous-ensembles principaux d’une station terrienne devra
être très enlevée.
Le réseau de transmission se compose de réseau de contribution et de réseau de distribution.
1. Le réseau de contribution
Le réseau de contribution sert à amener les signaux depuis leur source jusqu’au point de diffusion.
Au Burkina Faso, le réseau de contribution représente le réseau qui existe entre les éditeurs de
service et le CDN et aussi les têtes de réseau chefs-lieux des régions. Concernant le réseau de
contribution, nous avons celui national et celui régional.
✓ Réseau de contribution nationale
Nous avons un réseau de contribution national qui permet la codification H264-SD de programmes
dans les éditeurs de services nationaux et le transport de ceux-ci, au moyen de faisceaux hertziens
urbains, au CDN.
✓ Réseau de contribution régionale
Nous avons 12 réseaux de contribution régionale qui permettent la codification H264-SD de
programmes dans les éditeurs de services régionaux et le transport de ceux-ci, au moyen de
faisceaux hertziens urbains, aux têtes de réseau chefs-lieux des régions correspondantes.
2. Le réseau de distribution
Dans cette partie du réseau nous avons 2 types :
✓ Le réseau de distribution nationale
ANNÉE ACADÉMIQUE : 2021-2022 11
Nous avons un réseau de distribution nationale. Il permet le transport du multiplex national (T2-
MI avec le PLP1) crée dans le CDN. Il permet également la transmission via satellite aux 11 têtes
de réseaux du centre régionale et aux 35 stations du réseau de diffusion.
✓ Le réseau de distribution régionale
Au total nous avons 12 réseaux qui transportent au moyen de faisceaux hertziens interurbains du
T2-MI complet généré dans la tête de réseau chefs-lieux de régions jusqu’à chacune des stations
du réseau de diffusion appartenant à la région.
ANNÉE ACADÉMIQUE : 2021-2022 12
III. LE RESEAU DE DIFFUSION
Le réseau de diffusion est structuré sur 12 régions qui est détaillé dans le tableau ci-dessous.
Tableau 2 : Le réseau de diffusion des 12 régions
Numéro Région Chef-lieu Emetteur
01 Centre Ouagadougou Ouagadougou
02 Haut Bassins Bobo Dioulasso Bobo Dioulasso
Houndé
Orodara
03 Cascades Banfora Banfora
Niangoloko
Mangodara
04 Boucle du Mouhoun Dédougou Dédougou
Nouna
Tougan
Boromo
Solenzo
05 Centre Ouest Koudougou Koudougou
Léo
06 Centre Nord Kaya Kaya
Boulsa
Kongoussi
07 Nord Ouahigouya Ouahigouya
Yako
08 Centre Est Tenkodogo Tenkodogo
Koupéla
09 Sahel Dori Dori
Djibo
Arbinda
Sebba
10 Est Fada N’Gourma Fada N’Gourma
Bogandé
Diapaga
Kompienga
Gayéri
11 Centre Sud Manga Manga
Pô
12 Sud-Ouest Gaoua Gaoua
Batié
Diébougou
ANNÉE ACADÉMIQUE : 2021-2022 13
Les 35 stations de diffusion numérique déployées et fonctionnelles.
Figure 3 : Etat de déploiement du réseau de diffusion de la SBT
Les contenus sont organisés en deux PLPs, le PLP1 à caractère national composé de 17 chaînes et
le PLP2 à caractère régional.
Au Burkina Faso la diffusion des programmes jusqu’aux téléspectateurs se fait à partir de 35
stations d’émission disséminées sur le territoire national, et se fait sur la bande UHF de 474 à 678
Mhz. Le DVB-T2 utilise la modulation COFDM et offre les mêmes modes que le DVB-T avec un
mode supplémentaire, le 256 QAM ou le 64 QAM : la transmission peut alors être faite sur 8 bits
par symbole au lieu de 2, 4 ou 6 pour le DVB-T ; il en résulte un accroissement de la force du
signal mais qui est en partie compensée par l'évolution des corrections d'erreurs. Cela permet donc
au final une réduction de la force du signal pour une réception correcte sans erreur.
ANNÉE ACADÉMIQUE : 2021-2022 14
En résumé, nous pouvons structurer l’architecture du réseau de la SBT en schéma comme suite :
Editeur Editeur Editeur Editeur Editeur
Editeur
National National Régional Régional Régional
National
Réseau de contribution National Réseaux de Contribution Régional
(Faisceaux Hertziens Urbains) (Faisceaux Hertziens Urbains)
Tête de Réseau National
(CDN) Tête de Réseau chef lieux de
région
Réseau de Distribution National
(Via Satellite) Réseau de Distribution Régional (Faisceaux
Hertziens Urbains)
Station de Station de Station de
Diffusion Diffusion Diffusion
Figure 4 : Architecture du réseau de la SBT
(Source BTESA)
ANNÉE ACADÉMIQUE : 2021-2022 15
CHAPITRE 3 : LES CONCEPTS TECHNIQUES DE LA CHAINE DE TRAITEMENT
DES SIGNAUX
La télévision est en pleine essor sur le plan technologique. Ainsi, le passage de la
télévision analogique à la numérique entraine la convergence du secteur de l’audiovisuel, de
télécommunications et de l’informatique à de nouveaux processus adaptés à cette technologie.
La TNT est alors un mode de diffusion numérique qui joue sur des techniques de compression
des signaux (après numérisation), utilisant le principe classique de diffusion dans les bandes
VHF/UHF et s’appuie sur la technique de multiplexage des canaux de transmission ainsi que sur
la modulation appelée OFDM.
I. ELABORATION DU FLUX VIDEO
1. Les formats vidéos numériques
Le format de base (Format SD) simple définition pour l’image numérique est réalisé sous la base
du sous-échantillonnage 4 : 2 : 2, (4 échantillons de Y contre 2 pour les composantes rouge et Bleu
caractérisés par :
➢ Fréquence de l’image : 25 images/s de 625 lignes, dont 576 affichées
➢ Signal de luminance Y(t) échantillonné à la fréquence Fe = 13,5 MHz avec une Fmax = 6
MHz (Loi de Shannon et de Nyquist Fe ≥2*Fmax)
➢ Signaux de chrominance Cr(t) et Cb(t) échantillonnés à Fe = 6,75 MHz, (Fmax = 3,335
MHz)
➢ Echantillons codés sur 10 bits (chaque valeur d’échantillon est d’écrit sur 10 bits = Taux de
numérisation)
Calcul du débit de numérisation :
D = 13,5.106 x10bits + 2 x 6,75.106 x10bits = 270 Mbits/s
Pour les deux composantes de chrominance
Un canal de télévision selon la norme a une Bande passante de largeur 8Mhz.
La contrainte de débit du canal TV en mode Télédiffusion Numérique Terrestre, le débit binaire
maximum du Multiplexeur est limité à 40 Mbits/s.
ANNÉE ACADÉMIQUE : 2021-2022 16
Alors il est impossible de transmettre un signal vidéo numérisé et sous échantillonné en 4:2:2 dans
un canal de 8 MHz de large ; parce que ce format a un débit D= 270Mbps.
Tableau 3 : Débit et formats vidéo
chaînes TV Chaînes TV chaînes HD
numériques numériques améliorées
Définition SD (720 x 576) SD (720 x 576) HD (1920 x 1080)
Vidéo MPEG2 4 Mbits/s MPEG4 AVC MPEG4 AVC
2 Mbits/s 8 Mbits/s
MP3 100 kbits/s
Audio Dolby AC3 192 kbits/s MPEG4 AAC MPEG4 AAC
Dolby 5.1 384 kbit/s
Stéréo 128 Kbit/s
2. Les signaux vidéos numériques
BNC : Bayonet Neill-Concelman Connector est utilisé sur les câbles coaxiaux vidéo de source.
Son impédance est de 75 Ohm.
ANNÉE ACADÉMIQUE : 2021-2022 17
Figure 5 : Câble coaxial BNC
L'interface numérique série ou Serial Digital Interface (SDI), est un protocole de transport de
signaux numériques vidéo et audio à l’état non compressé, il est obtenu après la numérisation à la
production. Il existe différents signaux de source au format SDI :
• HD-SDI (1,485 Gbit/s), liaison entre équipements à haut débit ;
• 3G-SDI (2,970 Gbit/s), liaison entre équipements à haut débit ;
• SDI Embedded ce dernier encapsule l’audio et la vidéo sur le seul câble coaxial vidéo, (pas
besoin de câble audio à part et vidéo à part) ;
• ASI : Asynchronous Serial Interface : c’est un format de signal que l’on obtient en sortie
du multiplexeur, il contient un ensemble de programmes assemblés en des paquets ainsi
que les informations sur chaque programme, l’ensemble des paquets forme un signal appelé
TS (Transport Stream) ;
• UHD-SDI pour définir des protocoles adaptés à des débits binaires plus importants pour
les transmissions de vidéos haute définition (HDTV), ultra haute définition (UHDTV1 et
UHDTV2) ou pour le cinéma numérique (2K, 4K, 8K).
Les données du signal vidéo ne sont pas compressées.
La quantification est effectuée sur 8, 10 ou 12 bits, et la structure de sous-échantillonnage utilisée
est souvent de type 4:2:2, bien que les normes les plus récentes autorisent une structure 4:4:4 ou
4:4:4:4. Le signal peut être transmis sous forme électrique, via un ou plusieurs câbles
coaxiaux d'impédance caractéristique 75 Ω muni de connecteurs BNC, ou par fibre optique.
ANNÉE ACADÉMIQUE : 2021-2022 18
II. LA TRANSMISSION NUMERIQUE
Les systèmes de transmission numériques avec ou sans fil, véhiculent à haut débit
l’information entre une source et un destinataire, en utilisant un support physique comme par
exemple le câble vidéo numérique, la F.O ou encore la propagation sur un canal radioélectrique
(FH) : propagation dans l’espace (air) sans fil. Tous ces supports physiques constituent ce que l’on
appelle le canal de transmission.
1. Le canal de transmission
a. Le codage source
Le codage source est le traitement qui permet de réduire la taille d’un signal, sa principale opération
est la compression. La compression consiste à supprimer les données redondantes dans le signal et
a pour but de réduire la quantité d’information à transmettre. Le codage de la vidéo et de l’audio
se font séparément. La TNT utilise la norme MPEG (Motion Picture Expert Group). A la SBT on
utilise le format H264/MPEG-4 AVC (Advanced Video Coding).
b. le codage canal
Lors du transport du signal audio-vidéo sur les différents supports de transmission il y’a des pertes
de données et des erreurs de transmission. Il faut donc une solution pour éviter le moins de perte
possible. Le codage canal a pour but d’adapter le signal à son canal de transmission. Il comprend
principalement le brassage, le codage correcteur d’erreurs et l’entrelacement.
La protection des données avant leur transmission dans un canal donné, met en œuvre 2 techniques
complexes de codage de canal.
➢ LE CODE REED SOLOMON (code RS)
Le code RS ajoute à chaque paquet de 188 Octets (symboles de 8bits),
16 octets (16 symboles faits de 8 bits chacun) c’est-à-dire 16 octets/byte de parité, pour la correction
d’erreur, ce qui n’est pas sans conséquent sur le débit final ainsi que la bande passante à occuper
parce qu’en sortie on 188 + 16 = 204 Octets ou 204 symboles de 8bits ! RS (204, 188, 2T=16) ;
soit alors T= 8 octets qui seront correctibles.
ANNÉE ACADÉMIQUE : 2021-2022 19
Par exemple si le débit total à la sortie d’un multiplex de 6 Chaines à raison de 4 Mbps par chaine
on a 24 Mbps, le débit final sera :
24 X 204 / 188= 26 Mbps ou 204 / 188 est le rendement du code
RS (204,188, 2T).
Au codage RS s’ajoute l’effet du codage convolutif qui double à sa sortie le nombre de bit à son
entrée ; pour un FEC de 2/3 on aura un rendement final de
26 X 2/3 = 39 Mbps
➢ Code LDPC-BCH
Dans le souci de corriger les limites du code RS, un code plus performant de codage de canal a été
mis en place : le code LDPC- BCH (Low Density Parity Check code) et celui de Bose-Chaudhuri-
Hocquenghem (BCH) code. Ce sont des groupes de code de parité beaucoup plus performants dont
le principe est basé sur la correction d’erreur par blocs et sont de technologie linéaire. Ils sont
réalisés en cascade et en série.
Avec comme code extérieur le code BCH et le code intérieur le LDPC. La combinaison de ces
deux codes a pour but de parfaire la correction des erreurs de transmission dans les communications
de la norme DVB.
c. La capacité du canal
Dans la transmission des données binaires, il est important de connaître la capacité du support de
transmission appelé aussi capacité du canal.
En effet, celle-ci représente le débit utile, c’est à dire le nombre de bits à transmettre par seconde
sans erreur et sans les bits redondants (Sans la correction du canal).
D = W. Log2 (1+S/N) bits/s
W: la bande passante
Le rapport signal sur bruit : C/N (exprimé dB).
D : la capacité du canal.
ANNÉE ACADÉMIQUE : 2021-2022 20
Exemple de mesure de C/N sur un analyseur de spectre :
Figure 6 : Mesure de C/N sur un analyseur de spectre
Exemple: Si C/N = (−32.5 dBm) − (−48 dBm) = 15.5 dBm
Plus C/N ≥10dB le signal à la réception est meilleur
La figure ci-dessous décrit de façon très simplifiée la chaîne de démodulation. L'objectif
est de permettre de localiser dans cette chaine de réception, les points où sont mesurés les grandeurs
permettant de caractériser et apprécier la qualité du signal, à savoir : la puissance du signal reçu, le
rapport porteur sur bruit (S/N), le taux d'erreur de modulation (MER), le taux d'erreur avant
correction (CBER) et le taux d'erreur après correction (VBER)
Figure 7 : Chaine de démodulation
ANNÉE ACADÉMIQUE : 2021-2022 21
Energie par bit sur la densité spectrale Eb/No
P (W)
C: carrier power 101001110001010 stream of bits
N: noise power
1Hz f (Hz)
Total bandwidth (B)
Figure 8 : Eb/No mesure graphique
➢ N0 = Densité spectrale de bruit blanc (White Gaussian Nosie =WGN) contenu dans une
largeur de bande de 1Hz et vaut
No = N/B exprimé en W/Hz
2. La modulation
Pour des raisons techniques ou de rentabilité, l’acheminement d’une information numérique, ne
peut pas toujours se faire en bande de base. L’utilisation d’une fréquence porteuse est alors
nécessaire. La modulation est l’opération qui fait correspondre à chaque niveau du signal
numérique, un état d’amplitude, de fréquence ou de phase d’une onde porteuse. Le choix d’une
modulation numérique dépend de l’occupation spectrale, la résistance aux distorsions et aux
diverses perturbations, la simplicité de réalisation des systèmes de modulation et de démodulation
Les principaux types de modulation sont les suivantes : la modulation d’amplitude, la modulation
de fréquence, et la modulation de phase.
La modulation a pour rôle d’adapter le spectre du signal au canal de transmission, c’est à
dire le milieu physique sur lequel il sera émis.
ANNÉE ACADÉMIQUE : 2021-2022 22
Elle consiste à faire varier un des paramètres (phase, amplitude, fréquence) du signal porteur par
le signal modulant (signal de base)
Pour cela, il existe différentes catégories de modulations numériques que sont :
a. La modulation numérique terrestre
La Modulation d’Amplitude en Quadrature (QAM) est le type de modulation adaptée en terrestre
en raison du haut débit que requièrent les transmissions sans fil et également en raison des
nombreux obstacles au sol.
La modulation numérique la plus utilisée en transmission terrestre, (TNT, MMDS, WIMAX GSM
etc.) est le QAM.
Elle est une combinaison de modulation à la fois de phase et d’amplitude contrairement au QPSK
ou l’amplitude est constante.
Il existe une variété de modulation QAM avec des états constellations allant de 16 QAM, 32QAM,
64QAM, 128QAM 256QAM.
L’on retient que plus la taille de la constellation est grande, plus le débit de transmission est élevé
mieux cela vaut pour la qualité des images, mais en revanche le signal est moins robuste donc plus
fragile devant les perturbations dues au canal de transmission.
Pour le cas de la SBT, les liaisons FH ont été réalisé avec des modulations 64QAM, par contre le
PLP1 a été réalisé avec une modulation de 64 QAM et le PLP2 avec 256 QAM.
La fragilité du signal réalisé en 256 et 64 QAM est compensé par ledit Codage de canal : qui
consiste à prendre des dispositions techniques permettant de reconstruire les informations qui
pourraient être détériorer lors du transport, ou de la diffusion.
• IDU : il adapte le signal au canal de transmission. L'opération de modulation transforme le
signal, à l'origine en bande de base en signal à bande étroite (FI), dont le spectre se situe à
l'intérieur de la bande passante du canal. A la réception l’IDU fait l’opération inverse c’est-
à-dire l’opération de démodulation.
ANNÉE ACADÉMIQUE : 2021-2022 23
Figure 9 : Schéma d’un IDU
(Source BTESA)
b. La modulation pour les transmissions par satellite
Le QPSK (Quadrature Phase Shift Keying) ou modulation en quadrature à saut d’états de
phases (français) comporte quatre (04) états de phases différentes mais d’amplitudes constantes et
est utilisée pour les transmissions par satellite. La SBT utilise le QPSK pour la modulation
satellitaire.
En QPSK, une information (symbole) est représentée par 2bits ce qui donne une combinaison
possible de 4 états :
• Le nombre d’états possibles est déterminé par la relation 2n ou n–représente le nombre de
bits pour un symbole.
• La représentation dans un repère de nombres complexes que sont : (1, 𝑗, −1, −𝑗) des 4 états
possibles sont respectivement constitués des bits suivants :(00 ; 01 ; 10 ; 11).
• Le nombre de combinaison d’états de phases possibles avec une amplitude constante des
phases est ; π/4 soit (45°), 3π/4 soit (135°), 5π/4 soit (225°) et 7π/4 soit (315°).
𝑗Ԧ
01 00
pi/
−1 1
10 11
−𝑗Ԧ
Constellation en QPSK
ANNÉE ACADÉMIQUE : 2021-2022 24
Dans ce cas de figure une information représente un symbole et est représentée par 2bits.
➢ Le QPSK est utilisé en modulation des informations à transmettre par satellite.
Généralement la compression équivalente est le MPEG2 et correspondant ainsi à la norme
DVB-S. La SBT utilise la norme de compression DVB-S2 2ieme génération.
3. Le multiplexage
La vidéo et l’audio étant codées séparément on se retrouve avec deux signaux, il faut alors effectuer
un multiplexage. Le multiplexage consiste à regrouper plusieurs signaux à l’entrée de telle sorte à
avoir un seul signal à la sortie.
Pour ce faire les flux audio (ES audio), les flux vidéo (ES vidéo) et les autres données sont d’abord
multiplexés. A la sortie du multiplexeur, on obtient un flux unique contenant les données de tous
les signaux, appelé Program Stream (PS). Chaque programme a un numéro qui permet de le
retrouver, ce numéro est appelé Program Identifier (PID). Ce premier multiplexage est appelé
multiplexage de données. Le PS contient les programmes de l’éditeur. Les différents programmes
des éditeurs (PS) sont ensuite multiplexés. Ce deuxième multiplexage est appelé multiplexage des
programmes ou multiplexage des chaînes. A la sortie du multiplexeur, on obtient un flux découpé
en paquets de longueurs fixes appelés Transport Stream (TS). Le TS est un flux de paquets de taille
fixe de 188 octets qui est obtenu à la suite du multiplexage des programmes des différents éditeurs
de service. Toutes les fonctions jusqu’à la mise en paquets, sont effectuées dans l’encodeur
(codeur).
Une horloge de synchronisation détermine le temps de prélèvement des PES venant de chaque
chaine de télévision.
ANNÉE ACADÉMIQUE : 2021-2022 25
Les figures suivantes représentent successivement les étapes de création d’un TS et le schéma d’un
TS :
Figure 10 : Création d’un TS
(Source BTESA)
a. Le multiplexage temporel des signaux de la télévision
C’est celui utilisé en DVB-T2 pour occuper moins de place par n – programmes de chaines
différentes. En plus du format de compression le multiplexage temporel est la technique du DVB-
T2 qui permet de faire passer beaucoup de chaines TV dans un même canal. C’est une technique
de transmission qui consiste à fractionner le canal en différents sous-canaux indépendants pour la
transmission de flux d’information. Ce multiplexage est caractérisé par son dimensionnement,
c'est-à-dire suivant le temps, la fréquence ou l’espace.
ANNÉE ACADÉMIQUE : 2021-2022 26
Canal E1
MUX Canal S
Canal E2
Canal E3
Figure 11 : Exemple de multiplexage des chaînes dans un seul canal
En TNT, un canal peut supporter jusqu’à 3 chaînes en HD ou plus de 6 chaînes en SD en fonction
de sa capacité dans un même multiplexe.
b. Le multiplexage au niveau du centre de diffusion numérique
Au niveau du CDN les signaux sont repartis sur deux multiplex selon leurs zones de couverture.
-Les signaux qui doivent être diffusés sur tout le territoire sont multiplexés pour former le multiplex
national encore appelé PLP1.
-Les signaux qui doivent être diffusés sur la région du centre sont multiplexés pour donner le
multiplex régional appelé PLP2.
Le multiplex national est ensuite envoyé vers un équipement appelé le Gateway DTH. Le Gateway
DTH transforme ce signal en un signal qu’un satellite sera capable de transporter et appeler signal
DTH. Le signal DTH est transmis dans un premier temps à la station terrienne puis sur satellite.
Le multiplex régional quant à lui, il est envoyé vers un équipement appelé le Gateway-T2
qui le transforme en signal T2-MI et l’envoie sur l’inserteur.
L’inserteur associe les deux multiplex, et on obtient le multiplex complet en T2-MI.
ANNÉE ACADÉMIQUE : 2021-2022 27
Figure 12: Image montrant le processus du traitement du signal
(Source BTESA)
La nouvelle technique d’émission de télévision offre de nombreux avantages par rapport
à son prédécesseur. Ainsi, cette technologie permet une nette amélioration de la qualité sonore
et vidéo en production jusqu’à la réception. En effet, de nombreuses ressources sont mises en
considération pour la qualité de la transmission et de l’information. La TNT, une norme
révolutionnaire, qui optimise cette qualité recherchée, en s’appuyant sur la numérisation des
signaux audiovisuels. Grâce à ces recherches incessantes, on tend de plus en plus vers le « tout
numérique ». Alors, le système analogique se dégrade pour laisser place à cette innovation.
ANNÉE ACADÉMIQUE : 2021-2022 28
CHAPITRE 4 : LA DIFFUSION NUMERIQUE
La télévision numérique terrestre est une évolution technique en matière de télédiffusion,
fondée sur la diffusion de signaux de télévision numérique par un réseau d’émetteurs et réémetteurs
hertziens terrestres. C’est un système de télédistribution numérique via des ondes terrestres. C’est
une technologie récente de diffusion des séquences audiovisuelles numériques, appelées
programmes de télévision, par des émetteurs télé numériques, installés au sol : d’où le qualificatif
de télévision terrestre.
I. LA DIFFUSION NUMERIQUE TERRESTRE
Les émissions de la TNT se font pour l’essentiel dans la bande UHF qui va de 470 à 862
MHz. Cette bande a été divisée en canaux de largeur 8 MHz pour la TV analogique, numérotés de
21 à 69. La TNT a repris les mêmes canaux ce qui donne 48 Canaux disponibles.
Mais l’UIT, dans le souci de faire libérer assez de fréquences UHF à réduit cette bande pour la
TNT de 470-694 Mhz et affecter le reste de 694-862 à la téléphonie mobile.
Formule de calcul de la fréquence : F MHz = 306 + 8 * numéro du canal
Exemple: le canal 21 correspond à une fréquence
F = 306 + 21 x 8 = 474 MHz
Soit la longueur d’onde λ= 63 cm
1. La norme de DVB T/T2
Digital Video Broadcasting abrégé en DVB, est un ensemble de normes de télévision numérique
qui a été conçu par le consortium européen appelé DVB, et utilisé dans un grand nombre de pays.
Il est associé au format de compression MPEG-2 et sa particularité est de transmettre par paquets
les données informatiques compressées.
Le DVB-T (Digital Vidéo Brodcasting – Terrestriel) est l’application de la norme DVB aux
transmissions numériques terrestres et audiovisuelles.
ANNÉE ACADÉMIQUE : 2021-2022 29
Le DVB-T utilise la modulation multi-porteuse COFDM associée à la modulation d’amplitude
QAM. Cette norme s’appuie sur les caractéristiques d’une transmission hertzienne, avec une bande
passante réduite à 8 Mhz. Il est à noter que les bruits peuvent être issus des bruits impulsifs (dû aux
équipements électriques...).
La norme DVB-T permet non seulement de mettre en place des réseaux multifréquences mais aussi
des réseaux mono fréquences, ce qui permet d’économiser les fréquences en utilisant la même
fréquence pour des émetteurs qui couvrent des zones adjacentes.
Le DVB-T2 est la 2ième génération de la norme DVB-T de base. Elle s’appuie essentiellement sur
la compression de données avec le format MPEG-4. Elle est plus performante dans son mode de
diffusion. Le DVB-T2 accroit la bande passante numérique vidéo de chaque canal (32 Mbit/s,
contre 24 Mbit/s). Dans les mêmes conditions d’émission et de réception, le DVB-T2 permet
d’augmenter la capacité spectrale de 30% à 50% avec la même puissance des émetteurs. Ainsi cette
norme permet le développement de la télévision haute définition (HD). Elle permet également
d’améliorer la réception de type portable sans augmenter la puissance des émetteurs ni densifier le
réseau de diffusion. Elle a été officiellement approuvée en juin 2008. Elle est compatible avec le
DVB-T. c’est à dire qu’un démodulateur (récepteur décodeur) DVB-T2 est compatible avec les
signaux de la norme DVB-T. Cependant l’inverse n’est pas possible. Le DVB-T2 utilise aussi la
modulation OFDM mais avec d’autres codes correcteurs et a la possibilité d’utiliser les modes 1k,
2k, 4k, 8k, 16k et 32k contrairement au DVB-T qui n’utilise que les modes 2k et 8k. La SBT utilise
le DVB-T2 avec le réseau multifréquence, les fréquences ne peuvent être réutilisées que lorsque
les sites d'utilisation sont suffisamment séparés les uns des autres de façon à réduire au maximum
l'interférence entre les émetteurs. C’est un réseau dans lequel plusieurs radiofréquences ou canaux
RF sont utilisées pour transmettre du contenu multimédia.
Ses principales concurrentes sont les normes ATSC : American Television system committee
(utilisées aux États-Unis et au Canada) et les normes ISDB : Integrated Service Digital
Broadcasting (utilisées au Japon et au Brésil). DMB : Digital MultiMedia Broadcasting. (Chine et
Corée du nord).
ANNÉE ACADÉMIQUE : 2021-2022 30
2. Les paramètres de la diffusion en DVB T2
a. Structure de la chaine de traitement des signaux : TS, MPTS, T2-MI
Illustration schématique du processus de traitement des signaux télédiffusés
Figure 13 : chaine de traitement numérique
(Source BTESA)
La figure ci-dessus met en évidence les principales fonctions de la chaîne de traitement et
de transport du contenu audiovisuel issu, par exemple, des capteurs et des microphones d’une
caméra numérique.
Les signaux vidéo RVB sont matricés (codés) et numérisés dans des « CAN, Convertisseur
Analogique/Numérique ».
Les données Y, Cb, Cr obtenues sont digitalisées puis compressées en MPEG pour générer ensuite
les flux ES (Elementary Stream) qui seront mis en paquets de façon à constituer un flux PES vidéo
(Packetized Elementary Stream) dans l’encodeur.
De même, les signaux audio voie gauche (AF-G) et voie droite (AF-D) sont numérisés. Les
données audios sont ensuite compressées en MP3 ou AAC (standard MPEG) ou AC3 (Dolby).
Ces données audionumériques sont ensuite réparties dans les paquets PES audio.
ANNÉE ACADÉMIQUE : 2021-2022 31
b. Acheminement du contenu national du CDN aux stations régionales
satellite
Antenne de transmission
satellitaire
Switch Switch Modulateur
A
Mux A
IDU 1
Modulateur B
Mux B
IDU 2 antenne de réception
satellitaire
IP guard
Mux
Diffusion
au niveau
T2
régional
Gateway
DTH A
IDU 17 T2
Gateway
DTH B
T2 Edge
DTH
TD Edge
national et
régional
Centre de
Supervision diffusion
Transmission et Réception par faisceau
Kamboinssin
Figure 14 : Acheminement du contenu national du CDN aux stations régionales
ANNÉE ACADÉMIQUE : 2021-2022 32
Comme nous les avons définis plus haut, le premier rack contient les différents IDU qui sont
interconnectés à un switch. Ces IDU reçoivent les différents contenus des éditeurs de services qui
à leur tour adapte le signal à transmettre au canal de propagation.
Le deuxième rack contient aussi un switch connecté au switch du premier rack par lequel les
équipements sont interconnectés. Ces équipements sont :
Les multiplex A/B qui unifie les différents signaux des éditeurs en plusieurs entrées et les transmet
en une seule sortie sur un seul canal.
IP Guard du multiplex qui sert de commutateur automatique de l’entrée redondante en cas de
défaillance dans l’entrée sélectionner.
T2 Gateway DTH A/B qui adapte le TS national au format DTH pour sa distribution via satellite
en passant par l’encodeur dans le troisième rack. Ce signal sera diffusé au niveau national tout
comme régional à travers l’antenne satellitaire.
T2 Edge DTH qui adapte le MPTS national sous format DTH au format T2-MI pour sa transmission
et distribution régionale.
T2 Edge national/régional : combine les deux PLPs en un Stream (flux) MPLP unique pour sa
distribution régionale. C’est de ces équipements qui nous pouvons avoir une supervision sur
l’ensemble des signaux à diffuser après multiplexage, ce qui nous permettra de savoir si le signal
est bon ou pas. Lorsque le signal est bon, il est envoyé par faisceau sur l’émetteur à Kamboinsin
qui sera ensuite diffusé sur le territoire national.
II. EMETTEUR
1. Definition
Un émetteur est un équipement de télécommunications capable de transposer la fréquence
d’un signal de source en une fréquence plus élevée, qui soit adaptée au canal de transmission puis
de l’amplifier et de le transmettre à distance.
Selon le canal d’émission le signal à émettre peut-être une onde radioélectrique (Hertzienne) onde
Optique (photonique).
ANNÉE ACADÉMIQUE : 2021-2022 33
Figure 15 : Schéma de la structure d’un émetteur
ANNÉE ACADÉMIQUE : 2021-2022 34
2. Structure d’un Emetteur DVB-T2
Présentation d’un émetteur DVB-T2
Commutateur Exciteurs
Exciteurs
Logique de Contrôle
Amplificateurs
Contrôle Périphérique
Distributeur Energie
Figure 16: Architecture d’émetteur
(Source BTESA)
Emetteurs TX (A/B):
Il représente les équipements transmetteurs muni d’un oscillateur local et transpose la fréquence FI
en RF en émission et fait l’opération inverse en réception.
La mission de l'émetteur DVB-T2 est de moduler selon le standard DVB-T2 le signal T2MI
provenant de l´En-Tête et aussi d’amplifier le signal modulé jusqu´à un niveau de puissance
nominal. Ci-après sont décrits les principaux éléments de l´émetteur :
ANNÉE ACADÉMIQUE : 2021-2022 35
➢ Exciteurs DVB-T2
On installe deux Exciteurs DVB-T2 qui incorporent chacun :
✓ Modulateur Digital DVB-T2 avec entrées ASI et entrées Top (Entrées externes de référence
1 PPS et 10 MHz);
✓ Correcteur Adaptatif pour corrections linéaires et non linéaires;
✓ Circuit de Contrôle Automatique de Puissance pour stabiliser la puissance de sortie;
✓ Amplificateur intégré jusqu´à 30 dBm.
➢ Amplificateurs de Puissance:
En dépendant de la puissance nominal, l'émetteur aura un nombre d'amplificateurs de puissance
combinés en parallèle. Chacun d´eux incorporent :
✓ Entrée tri phasique à 3x380 ou 3x220 (avec protection magnétothermique chaque
amplificateur)
✓ Sources d’alimentation de 3kW et 94% d´efficience (Facteur de puissance>0.95)
✓ Circuit d´entrée de Phase et Gain pour accoupler en combinaison
✓ Circuit de Protections individuelles de surexcitation et VSWR
✓ Circuit de Contrôle Microtraité et détecteurs digitaux incorporés
✓ Amplification basée en Technologie Doherty de Bande Large et haute efficience. 6 palets
(12 transitoirs) de puissance par amplificateur.
✓ Module de haut gain grâce à l´incorporation de deux étapes de drivers avant les palets de
puissance.
➢ Link Distribution: Il adapte le contenu pour sa distribution via liaison radio.
On a également un réseau de centre secondaire qui utilise la plupart de ces équipements cités ci-
dessus. Ces équipements sont : IRD, IDU, T2 Edge DTH, IP Guard qui a une entrée prioritaire qui
est celle de la distribution car elle possède les deux PLPs, TX (A/B) qui représentent les
équipements transmetteurs.
ANNÉE ACADÉMIQUE : 2021-2022 36
CHAPITRE 5 : BILAN DU STAGE
Notre séjour à la SBT nous a permis de mettre en pratique les connaissances de base que nous
avons reçues au cours de notre formation dans l’Université de l’Unité Africaine (ex IAM) en réseau
et télécommunication. Nous avons appris tant sur le plan relationnel que sur le plan technique, en
observant et en faisant participer chaque jour certaines activités nous ont été bénéfiques. Nous
sommes satisfaits de ce stage de fin de cycle, car l’enrichissement en termes de connaissance, que
nous avons acquis dépasse de loin nos attentes.
I. APPORT DU STAGE
Au cours de ce stage, nous avons pu approfondir nos connaissances et de comprendre les
réalités sur le terrain. Ainsi nous avons eu à participer aux différentes sortes d’activités menées :
✓ Sur le plan professionnel, nous avons appris l’organisation du travail au sein d’une structure
de télédiffusion.
✓ La télégestion qui est chargée de suivre le système de communication et de s’occuper de la
gestion et le contrôle à distance nos installations techniques réparties dans le pays.
✓ La participation aux différentes tâches de la SBT au niveau de la direction technique et des
sorties effectuées ;
✓ Ce stage a été pour nous l’occasion de nous familiariser avec les équipements de production
audiovisuelle, de multiplexage, de transmission et de diffusion à travers les opérations de
maintenances au centre de distribution numérique (CDN) ;
✓ Par ailleurs, les relations humaines, la collaboration et le soutien entre les différents
techniciens, indépendamment de l’activité exercée par chacun d’eux, nous ont appris sur le
comportement à avoir dans un travail en équipe.
II. CRITIQUES
Durant nos deux (02) mois de stage à la SBT nous avons remarqué des aspects positifs qui ont
retenus notre attention, on peut citer entre autres :
ANNÉE ACADÉMIQUE : 2021-2022 37
✓ L’esprit d’équipe : nous avons remarqué une réelle collaboration et un respect mutuel entre
les agents de la SBT et une bonne coordination de leurs activités ;
✓ La disponibilité, l’écoute et l’accompagnement des travailleurs vis-à-vis des stagiaires sont
à noter dans le fait que nos questions et préoccupations y ont toujours trouvé satisfactions ;
✓ Le dévouement au travail des agents qui travaillent le plus souvent au-delà des heures
règlementaires ;
Malgré ces aspects positifs que présente la SBT, nous notons également qu’il y a des points à
améliorer dont nous avons observé :
✓ La non-participation des stagiaires aux missions hors de Ouagadougou ;
✓ Les têtes de réseaux reçoivent les signaux venant des éditeurs par des liaisons FH
uniquement donc pas de redondance ;
✓ Les têtes de réseaux régionales reçoivent le multiplex national envoyé du CDN par satellite
uniquement donc pas de redondance.
III. SUGGESTIONS
Au regard de toutes ces critiques, il nous vient donc à l’idée et très humblement de proposer
des éléments qui pourraient profiter aux acteurs de l’entreprise, mais également qui pourraient
procurer un meilleur rendement pour l’entreprise elle-même.
✓ Utiliser de la fibre optique en plus du faisceau hertzien pour le transport des signaux venant
des éditeurs ;
✓ Utiliser la fibre optique en plus du satellite pour le transport du multiplex national vers les
têtes de réseaux régionales ;
✓ La SBT dispose son propre réseau de transport du multiplex national avec une autonomie
de gestion. Ce réseau est plus stable et peut être mailler sur tout le contenu du territoire
national, en revanche avec le FH la probabilité qu’un incident puisse affecter tout le
multiplex national est très faible.
✓ Innover dans les services et recruter des nouveaux clients : En effet de par sa grande
capacité (146Mbits/s), la SBT peut créer plusieurs multiplex pour le transport des services
à valeur ajoutée à savoir la fourniture à accès internet et la création d’un bouquet payant.
ANNÉE ACADÉMIQUE : 2021-2022 38
✓ IP (Internet Protocole) : La transmission sur IP est une possibilité de transport de données
audio, vidéos et de métadonnées multiplexées, alors nous pouvons mettre en place une
plateforme IPTV. Cette plateforme permettra non seulement à la diaspora d’avoir accès aux
programmes audiovisuels mais aussi permettra à la SBT de fournir à ces clients beaucoup
plus de services. Ainsi, les données numérisées sont plutôt transmises par paquets sur un
réseau orienté paquet à l’instar du DVB-T2.
ANNÉE ACADÉMIQUE : 2021-2022 39
CONCLUSION GENERALE
Dans le cadre de notre stage de fin de cycle, nous avons été accueillis au sein de la direction
technique de la Société Burkinabè de Télédiffusion (SBT). Ce stage nous a permis, en tant que
stagiaire d’avoir une expérience dans le domaine des technologies des réseaux et systèmes de
télécommunications durant ces deux (02) mois effectuer à la SBT. Nous avons eu l’occasion
d’imprégner les réalités sur le terrain, de se familiariser et de bénéficier des connaissances pratiques
importantes. Nous avons eu a travaillé sur notre thème portant sur l’étude du principe de traitement
des signaux TV en transmission numérique.
Le choix de notre thème a été d'un très grand intérêt car il nous a permis de découvrir que
le réseau de la SBT est constitué de trois (3) principaux segments, le réseau de contribution, le
réseau de distribution et le réseau de diffusion. L’influence de la technologie sur les procédés et les
équipements ne cesse de s’accroitre ; ainsi que les concepts techniques de traitement du signal
d’une chaîne de transmission bénéficie de nombreux atouts qu’apporte l’avancée technologique
qui est la télévision numérique terrestre (TNT). En terme de diffusion numérique, des technologies
en vogue de nos jours qui tend de plus en plus vers le tout numérique présente de nombreux
avantages en termes de qualité de l’image et du son.
Malgré quelques soucis techniques telles les pertes de connexions sur certains sites, la SBT travaille
à garantir la diffusion partout dans le pays.
Les recherches sur l’amélioration du mode de transmission sont toujours en exergue pour
une diminution des coûts des équipements, pour aboutir à une très haute qualité des multimédias
transmis et pour une cohabitation avec d’autres technologies comme les smartphones.
ANNÉE ACADÉMIQUE : 2021-2022 40
BIBLIOGRAPHIE ET WEBOGRAPHIE
Bibliographie
Document de formation BTESA << Enensys DVB-T>>
SAWADOGO Richard. Processus d’intégration d’une chaine de télévision dans le multiplex de la
SBT : cas de la télévision privée ‘‘ La Chaine d’Afrique : LCA’’. Licence. Ouagadougou: ISIG,
2018.
NANAN Jean Charles. Processus d’intégration des services audio visuels d’un éditeur dans le
multiplex de la Société Burkinabè de Télédiffusion (SBT). Licence. Ouagadougou : ESMT, 2018
Webographie
Sites internet
https://docplayer.fr/12703152-La-tnt-a-principes-generaux-la-television-numerique.html,le 18/05/
2022 à 14h15
https://fr.wikipedia.org/wiki/Modulation_du_signal, le 18/05/ 2022 à 14h15
https://www.academia.edu, le 18/05/ 2022 à 14h15
https://fr.wikipedia.org/wiki/Multiplexage, le 18/05/ 2022 à 14h15
https://stringfixer.com/fr/DVB-T, le 18/05/ 2022 à 14h15
https://foad-mooc.auf.org/IMG/pdf/5_Cours_TVNUM_IQ.pdf, le 21/05/2022 à 17h05
http://biblio.univ-antananarivo.mg/pdfs/rakotoarisoaLanjaF_ESPA_LIC_14.pdf, le 28/05/2022 à
13h23
https://fr.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9l%C3%A9vision_num%C3%A9rique_terrestre,le
28/05/2022 à 13h23
ANNÉE ACADÉMIQUE : 2021-2022 x
https://foad-mooc.auf.org/IMG/pdf/3_Cours_TN_CS.pdf, le 05/06/2022 à16h43
https://www.claude-gimenes.fr/signal/communications-numeriques/-iv-modulation-damplitude-
en-quadrature-maq-qam, le 14/06/2022 à 12h20
ANNÉE ACADÉMIQUE : 2021-2022 xi
TABLE DES MATIERES
DEDICACE…………………………………………………………………………………………………………………………………………………ii
REMERCIEMENTS…………………………………………………………………………………………………………………………………….iii
LISTES DES SIGLES ET D'ABREVIATION……………………………………………………………………………………………………..iv
LISTES DES FIGURES…………………………………………………………………………………………………………………………………vi
LISTES DES TABLEAUX……………………………………………………………………………………………………………………………..vii
AVANT PROPOS……………………………………………………………………………………………………………………………………..viii
SOMMAIRE………………………………………………………………………………………………………………………………………………ix
INTRODUCTION GENERALE………………………………………………………………………………………………………………………1
CHAPITRE 1 : PRESENTATION DE LA SOCIETE BURKINABE DE LA TELEDIFFUSION……………………………………..2
I. DISPOSITION GENERALE……………………………………………………………………………………………………………………..2
II. LES DIRECTION ET SERVIVES……………………………………………………………………………………………………………….2
III. ORGANIGRAMME DE LA SBT…………………………………………………………………………………………….………………3
VI. DIRECTION TECHNIQUE…………………………………………………………………………………………………………....………4
CHAPITRE 2 : ARCHITECTURE GENERALE DU RESEAU DE LA SBT……………………………………………………………….7
I. LES TETES DE RESEAU………………………………………………………………………………………………………………………….7
1. Les tetes de réseaux national…………………………………………………………………………………………………..7
2. Les tetes de réseau regionales…………………………………………………………………………………………………9
II. LE RESEAU DE TRANSMISSION…………………………………………………………………………………………………………10
1. Le réseau de comtribution………………………………………………………………………………………………………11
2. Le réseau de distribution……………………………………………………………………………………………………….11
III. LE RESEAU DE DIFFUSION……………………………………………………………………………………………………………….13
CHAPITRE 3 : LES CONCEPTS TECHNIQUES DE LA CHAINE DE TRAITEMENT DES SIGNAUX…………………………16
I. ELABORATION DU FLUX VIDEO………………………………………………………………………………………………………….16
1. Les formats des videos numériques………………………………………………………………………………………..16
2. Les signaux des videos numériques………………………………………………………………………………………..17
II. LA TRANSMISSION NUMERIQUE……………………………………………………………………………………………………….19
1. Le canal de transmission………………………………………………………………………………………………………..19
a. Le codage source………………………………………………………………………………………………………………..19
ANNÉE ACADÉMIQUE : 2021-2022 xii
b. Le codage canal………………………………………………………………………………………………………………….19
c. La capacité du canal……………………………………………………………………………………………………………20
2. La modulation………………………………………………………………………………………………………………………..22
a. La modulation numérique terrestre……………………………………………………………………………………23
b. La modulation pour la transmission par sattellite………………………………………………………………24
3. Le multiplexage………………………………………………………………………………………………………………………25
a. Le multiplexage temporel des signaux de la television……………………………………………………….26
b. Le multiplexage au niveau du centre de diffusion numérique……………………………………………..27
CHAPITRE 4 : LA DIFFUSION NUMERIQUE……………………………………………………………………………………………….29
I. LA DIFFUSION NUMERIQUE TERRESTRE…………………………………………………………………………………………….29
1. La norme DVB T/T2…………………………………………………………………………………………………………………29
2. Les paramètres de la diffusion en DVB T2………………………………………………………………………………..31
a. Structure de la chaine de traitement des signaux: TS, MPTS, T2-MI……………………………………..31
b. Acheminement du contenu national du CDN aux stations régionales ………….…………..32
II. EMETTEUR……………………………………………………………………………………………………………………………………….33
1. Définition……………………………………………………………………………………………………………………………….33
2. Structure d'un émetteur en DVB-T2………….……………………………………………………………………………35
CHAPITRE 5 : BILAN DU STAGE……………………………………………………………………………………………………………….37
I. Apports du stage……………………………………………………………………………………………………………………………….37
II. Critiques…………………………………………………………………………………………………………………………………………..37
III.Suggestions……………………………………………………………………………………………………………………………………..38
CONCLUSION GENERALE………………………………………………………………………………………………………………………..40
BIBLIOGRAPHIE ET WEBOGRAPHIE ................................................................................................................ x
TABLES DES MATIERES…………………………………………………………………………………………………………………………….xii
ANNÉE ACADÉMIQUE : 2021-2022 xiii
Vous aimerez peut-être aussi
- Orgueil et Préjugés - Edition illustrée: Pride and PrejudiceD'EverandOrgueil et Préjugés - Edition illustrée: Pride and PrejudiceÉvaluation : 4.5 sur 5 étoiles4.5/5 (20391)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItD'EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItÉvaluation : 4.5 sur 5 étoiles4.5/5 (3310)
- Art of War: The Definitive Interpretation of Sun Tzu's Classic Book of StrategyD'EverandArt of War: The Definitive Interpretation of Sun Tzu's Classic Book of StrategyÉvaluation : 4 sur 5 étoiles4/5 (3321)
- The 7 Habits of Highly Effective People: The Infographics EditionD'EverandThe 7 Habits of Highly Effective People: The Infographics EditionÉvaluation : 4 sur 5 étoiles4/5 (2487)
- Learn German! Lerne Englisch! ALICE'S ADVENTURES IN WONDERLAND: In German and EnglishD'EverandLearn German! Lerne Englisch! ALICE'S ADVENTURES IN WONDERLAND: In German and EnglishÉvaluation : 3.5 sur 5 étoiles3.5/5 (5622)
- How To Win Friends And Influence PeopleD'EverandHow To Win Friends And Influence PeopleÉvaluation : 4.5 sur 5 étoiles4.5/5 (6538)
- The 7 Habits of Highly Effective PeopleD'EverandThe 7 Habits of Highly Effective PeopleÉvaluation : 4 sur 5 étoiles4/5 (2571)
- How to Win Friends and Influence People: Updated For the Next Generation of LeadersD'EverandHow to Win Friends and Influence People: Updated For the Next Generation of LeadersÉvaluation : 4 sur 5 étoiles4/5 (2327)
- Habit 6 Synergize: The Habit of Creative CooperationD'EverandHabit 6 Synergize: The Habit of Creative CooperationÉvaluation : 4 sur 5 étoiles4/5 (2499)
- Habit 1 Be Proactive: The Habit of ChoiceD'EverandHabit 1 Be Proactive: The Habit of ChoiceÉvaluation : 4 sur 5 étoiles4/5 (2559)
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeD'EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeÉvaluation : 4 sur 5 étoiles4/5 (5813)
- The Picture of Dorian Gray: Classic Tales EditionD'EverandThe Picture of Dorian Gray: Classic Tales EditionÉvaluation : 4 sur 5 étoiles4/5 (9763)
- Wuthering Heights (Seasons Edition -- Winter)D'EverandWuthering Heights (Seasons Edition -- Winter)Évaluation : 4 sur 5 étoiles4/5 (9974)
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeD'EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeÉvaluation : 4.5 sur 5 étoiles4.5/5 (20099)
- Habit 3 Put First Things First: The Habit of Integrity and ExecutionD'EverandHabit 3 Put First Things First: The Habit of Integrity and ExecutionÉvaluation : 4 sur 5 étoiles4/5 (2507)
- Anna Karenina: Bestsellers and famous BooksD'EverandAnna Karenina: Bestsellers and famous BooksÉvaluation : 4 sur 5 étoiles4/5 (7503)
- Alice in Wonderland: Down the Rabbit HoleD'EverandAlice in Wonderland: Down the Rabbit HoleÉvaluation : 4 sur 5 étoiles4/5 (4611)
- The Secret Garden: The 100th Anniversary Edition with Tasha Tudor Art and Bonus MaterialsD'EverandThe Secret Garden: The 100th Anniversary Edition with Tasha Tudor Art and Bonus MaterialsÉvaluation : 4 sur 5 étoiles4/5 (6840)
- The Illustrated Alice in Wonderland (The Golden Age of Illustration Series)D'EverandThe Illustrated Alice in Wonderland (The Golden Age of Illustration Series)Évaluation : 4 sur 5 étoiles4/5 (4347)
- Pride and Prejudice: Bestsellers and famous BooksD'EverandPride and Prejudice: Bestsellers and famous BooksÉvaluation : 4.5 sur 5 étoiles4.5/5 (20479)




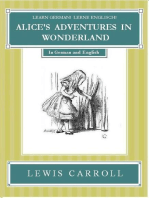

















![Don Quixote: [Complete & Illustrated]](https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/264046221/149x198/541f56cceb/1617238192?v=1)



