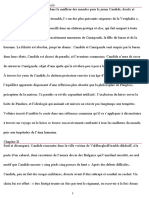Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Términologie Linguistique
Términologie Linguistique
Transféré par
Abdellah Ouarich0 évaluation0% ont trouvé ce document utile (0 vote)
10 vues2 pagesterminologie linguistique
Titre original
términologie linguistique
Copyright
© © All Rights Reserved
Formats disponibles
DOCX, PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentterminologie linguistique
Droits d'auteur :
© All Rights Reserved
Formats disponibles
Téléchargez comme DOCX, PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
0 évaluation0% ont trouvé ce document utile (0 vote)
10 vues2 pagesTérminologie Linguistique
Términologie Linguistique
Transféré par
Abdellah Ouarichterminologie linguistique
Droits d'auteur :
© All Rights Reserved
Formats disponibles
Téléchargez comme DOCX, PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
Vous êtes sur la page 1sur 2
1.
Langue / Parole : La distinction entre la "langue", qui représente le système de règles et de
structures linguistiques abstraites, et la "parole", qui correspond à l'utilisation concrète et
individuelle de la langue par les locuteurs.
2. Phonologie : L'étude des sons de la langue et de la façon dont ils fonctionnent ensemble pour
former des systèmes distinctifs.
3. Morphologie : L'étude des unités minimales de sens, appelées morphèmes, et de la façon dont
ils sont combinés pour former des mots.
4. Syntaxe : L'étude de la structure grammaticale des phrases et de la manière dont les mots sont
ordonnés pour créer des significations.
5. Sémantique : L'étude de la signification des mots, des phrases et des énoncés.
6. Pragmatique : L'étude de l'utilisation du langage dans le contexte et de la manière dont le sens
est influencé par le contexte de communication.
7. Sociolinguistique : L'étude de la variation linguistique en fonction de facteurs sociaux tels que la
classe sociale, l'âge, le sexe, etc.
8. Psycholinguistique : L'étude des mécanismes mentaux impliqués dans la production, la
compréhension et l'acquisition du langage.
9. Diachronie vs. Synchronie : La distinction entre l'étude du langage à travers le temps
(diachronie) et l'étude du langage à un moment donné (synchronie).
10. Langue naturelle vs. Langage formel : La distinction entre les langues humaines telles qu'elles
sont utilisées dans la communication quotidienne et les langages formels utilisés en
mathématiques, en logique, etc.
11. Grammaire générative : Une approche de la linguistique développée par Noam Chomsky, qui
postule l'existence d'une grammaire universelle innée à l'humain et cherche à décrire la structure
profonde des langues.
12. Structuralisme : Une approche qui met l'accent sur l'analyse des structures formelles du langage,
en se concentrant sur les relations entre les éléments linguistiques.
13. Fonctionnalisme : Une approche qui met l'accent sur le rôle et la fonction du langage dans la
communication humaine.
14. Signifiant vs. Signifié : La distinction sémiotique entre le "signifiant", qui est le support physique
ou acoustique d'un mot, et le "signifié", qui est la représentation mentale de sa signification.
15. Dénotation vs. Connotation : La distinction entre le sens littéral et objectif d'un mot
(dénotation) et les associations émotionnelles ou culturelles qui y sont attachées (connotation).
16. Analyse distributionnelle : L'approche qui étudie les propriétés d'un mot en examinant les
contextes dans lesquels il apparaît.
17. Métaphore : Une figure de style qui consiste à transférer le sens d'un mot à un autre sur la base
d'une relation analogique.
18. Métonymie : Une figure de style où un élément est utilisé pour représenter quelque chose de
plus large ou avec lequel il est lié par une relation spécifique.
19. Analyse contrastive : La comparaison systématique de deux langues pour identifier les similarités
et les différences au niveau grammatical, phonologique, lexical, etc.
20. Analyse morphologique : L'analyse des morphèmes qui composent un mot et de la manière
dont ils s'organisent.
21. Inventaire phonétique : L'ensemble des sons distinctifs d'une langue, généralement représentés
par des symboles phonétiques.
22. Transcription phonétique : La représentation écrite des sons d'une langue à l'aide de symboles
phonétiques.
23. Analyse morphosyntaxique : L'étude de la façon dont la morphologie (formation des mots) et la
syntaxe (structure des phrases) interagissent dans une langue.
24. Déclinaison et conjugaison : Les variations morphologiques que subissent les noms (déclinaison)
et les verbes (conjugaison) pour indiquer des relations grammaticales telles que le cas, le genre, le
nombre, le temps, etc.
25. Marqueur de cas : Un élément morphologique (préfixe, suffixe, etc.) qui indique le rôle
grammatical d'un nom ou d'un pronom dans une phrase.
26. Grammaire transformationnelle : Un modèle linguistique qui décrit les règles de transformation
permettant de passer de la structure profonde à la structure de surface des phrases.
27. Théorie de l'acte de parole : L'approche qui considère le langage comme un moyen d'accomplir
des actes et des intentions, allant au-delà de la simple transmission d'informations.
28. Mot fonctionnel vs. Mot lexical : La distinction entre les mots qui ont principalement une
fonction grammaticale (articles, prépositions, etc.) et ceux qui portent un sens lexical (noms,
verbes, adjectifs, etc.).
29. Autonomie du signe linguistique : Le concept selon lequel le lien entre le signifiant et le signifié
d'un mot est arbitraire et conventionnel.
30. Marquage du genre grammatical : La distinction entre les genres grammaticaux (masculin,
féminin, neutre, etc.) qui peuvent être attribués aux noms et aux adjectifs dans certaines langues.
31. Synthèse vs. Analyse : Les processus morphologiques de construction de mots à partir de
morphèmes (synthèse) ou de décomposition de mots en morphèmes (analyse).
32. Métalangage : Un langage utilisé pour parler du langage lui-même, souvent utilisé dans les
descriptions grammaticales et linguistiques.
33. Homonymie vs. Poly sémie : L'homonymie se produit lorsque deux mots distincts ont la même
forme, tandis que la polysémie se produit lorsque un seul mot a plusieurs sens liés.
34. Phonème vs. Allophone : Les phonèmes sont les unités distinctives de sons dans une langue,
tandis que les allophones sont les variantes phonétiques d'un phonème qui peuvent se produire
en fonction du contexte.
35. Accent tonique : L'accent mis sur une syllabe particulière d'un mot, qui peut avoir des
implications sur la signification ou la structure grammaticale.
36. Déviation phonologique : Les variations dans la prononciation des sons d'une langue, souvent
observées dans les dialectes et les variations régionales.
37. Universaux linguistiques : Les traits linguistiques communs à toutes les langues ou à la plupart
d'entre elles, étudiés pour comprendre les caractéristiques fondamentales du langage humain.
38. Hypothèse de la fenêtre critique : L'idée que l'acquisition optimale d'une langue se produit
pendant une période de développement spécifique, après quoi il devient plus difficile d'atteindre
une maîtrise native.
39. Langue véhiculaire : Une langue utilisée comme moyen de communication entre des locuteurs
de langues maternelles différentes.
40. Agrammatisme : Une condition linguistique résultant de lésions cérébrales où la production de
structures grammaticales complexes est altérée.
Vous aimerez peut-être aussi
- Dialogue LectureDocument1 pageDialogue LectureAbdellah Ouarich100% (2)
- OFPPTDocument1 pageOFPPTAbdellah OuarichPas encore d'évaluation
- Condide Résumé Par ChapitreDocument15 pagesCondide Résumé Par ChapitreAbdellah OuarichPas encore d'évaluation
- 100 Adjectifs de FrancaisDocument1 page100 Adjectifs de FrancaisAbdellah Ouarich100% (1)