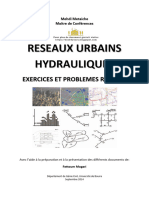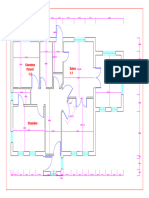Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Essai Sur Les Matériaux
Essai Sur Les Matériaux
Transféré par
hadroug mouhamed ali0 évaluation0% ont trouvé ce document utile (0 vote)
47 vues239 pagesTitre original
essai sur les matériaux
Copyright
© © All Rights Reserved
Formats disponibles
PDF ou lisez en ligne sur Scribd
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
© All Rights Reserved
Formats disponibles
Téléchargez comme PDF ou lisez en ligne sur Scribd
0 évaluation0% ont trouvé ce document utile (0 vote)
47 vues239 pagesEssai Sur Les Matériaux
Essai Sur Les Matériaux
Transféré par
hadroug mouhamed aliDroits d'auteur :
© All Rights Reserved
Formats disponibles
Téléchargez comme PDF ou lisez en ligne sur Scribd
Vous êtes sur la page 1sur 239
A. Capliez
“seducalivre
CASTEILLA
Preracr
PREFACE
Pendant longtemps la chimie a été considérée comme une technique. Elle
est devenue une science grace aux mesures et essais qui ont permis d’en
définir les lois fondamentales.
C’est ce qui se passera, un jour, pour la technologie lorsqu’il sera pos-
sible de mieux connaitre la frange d’incertitude qui entoure encore ses
phénomenes. Ainsi, grdce A des observations rigoureuses, 4 des mesures
précises et des essais de comportement structurés, il est d’ ores et déja pos-
sible de diminuer, dans une trés large mesure, cette frange dincertitude.
Cela se vérifie notamment dans le domaine du génie civil ot la mise en
ceuvre des matériaux requiert qualité et régularité des performances. Ici,
comme dans les autres domaines technologiques, les essais constituent
le moyen privilégié de parvenir au contréle du comportement des maté-
riaux utilisés : granulats, sols, ciments et bétons.
est ce qu’ont fort bien compris Raymond Dupain, docteur en génie civil
et maitre de conférence a I'IUT de Saint-Nazaire, René Lanchon, ingé-
nicur et professeur technique honoraire, Jean-Claude Saint-Arroman, ingé-
nieur INSA et enseignant 4 TUT de Saint-Nazaire, lorsqu’ils ont rédi-
g€ cet ouvrage, né de la volonté de René Lanchon d’ actualiser son «Cours
de laboratoire» (premizre édition 1978).
Les auteurs, dont les qualités pédagogiques et professionnelles sont lar-
gement reconnues, ont avec beaucoup de méthode, de clarté et de préci-
sion, mis I’ accent sur la description des essais de laboratoire, permettant
ainsi de micux comprendre le comportement des divers matériaux.
Remercions-les vivement pour l’exceptionnelle qualité de leur travail et
Vapport important qu’ ils font ainsi & la bibliographic de l’enseignement
technologique secondaire et supérieur.
A.Capliez
Directeur de la collection
Les auteurs tiennent a remercier les sociétés SCREG-Ouest et Controlab.
Photo de couverture : René a Saint-
Nazaire.
Frémondiére ~ Enrochements de pieds de fal
Courrier électronique des auteurs
raymond. dupain@ wanadoo.fr
aude. saint-arroman@ iutsn.univ-nantes.fr
jean-
© Casteilla, 2004
ISBN : 2-7135-2632-9
Tous droits de traduction, de reproduction et d’adaptation réservés pour tous pays.
Nouvelle Imprimerie Laballery, 58500 Clamcey ~Dépét legal : aot 2004 — N° 407176 ~ Imprimé en France
SOMMAIRE
Cet ouvrage est né de la volonté de R. Lanchon d’actualiser son Cours
de laboratoire, qui traitait des granulats, béions et sols (1"@ édition 1978) ;
R. Dupain s‘esi chargé de la partie concernant les granulats et les sols ;
J.-C. Saint Arroman a traité la partie concernant les ciments et bétons.
Premiére partie - Granulats
1 - Présentation générale ..... 3
2- Echantillonnage s
3- Analyse granulométrique.... ee 8
Analyse granulométrique par voie s¢che 8
Granulats impropres au séchage en étuve 14
4- Coefficient d’aplatissement des granulats 16
5 - Mesure de la propreté des granulats 0.0.0.0... ae 20
Essai d’équivalent de sable 50
Essai d’€quivalent de sable a 10% de x 20
Essai au bleu de méthyléne 22
6 - Détermination de la masse volumique absolue d’un sable ou dun gravier 26
7 - Coefficient d’absorption des granu 29
8- Essais de résistance 4 Pusure et au choc des granulats 30
9 - Spécifications minimales des granulats 3
Deuxiéme partie - Sols
1 - Présentation générale 7
2- Paramitres de nature du sol... P ‘ 39
Paraméires de granularité coke 39
Limites d’ Atterberg et indice de plAstiCtE .n..eorr : . 39
Essai au bleu de méthyléne dit essai A la tache. 46
Equivalent de sable 50
3 - Paramttres détat : tencur en eau du sol, compactage, portance. 54
Détermination de la teneur en eau d°un sol 34
Fsai Proctor > compactage des sols 55
Essai C.B.R, : détermination de la portance du so] compact€... 62
4- Analyse granulométrique par sédimentométrie 69
Troisiéme partie - Ciments et bétons
1 - Constituants des bétons. 79
Bétons, mortiers et piles pures 79
Ciments ee - siesta + ae
mulats. 82
auiviwos
SOMMAIRE
Vv
4 - Essais
Adjuvants. 83
Eau... 85
2 - Particularités des essais concernant les liants hydrauliques. 89
3- Essais sur le ciment anhydre...... 2
Masse volumique absolue ol
Mesure de la finesse 95
sur la pate de 99
Essais de consistance. 9
Essai de prise 108
Détermination de la stabilit 113
Bilans volumiques de li réaction d'hydratation, ls
5 - Essais sur les mortiers so 122
Mortier normal ee hae
Mesure de la consistance des mortiers 123
Mesure du temps de prise sur mortier ‘ 126
Mesure des résistances a 1a compression et i la traction . 126
Durcissement 129
Porosité et résistance .. 133
Evaluation de 1a masse volumique des éprouvettes de mortier
par pesée hydrostatique..
Retraits et gonflements..... 136
6 - Classification des ciments - 146
Classification des ciments en fonction de lear composition 146
Classification des ciments en fonction de leur résistance normal: 147
Désignation normalisée des ciment 148.
Autres liants hydrauliques. 148.
iments présentant des spécifications particuliéres 150
7- Essais sur les bétons.. 151
Ist
152
Résistance... 160,
Déformation des bétons. 169,
Egsais pouvant étre pratiqués sur le béton de Vouvrage .... 178,
8 - Durabilité des bétons 182
Résistance aux agents agressif’s 182
Résistance aux ambiances hivernale: ss i 186,
Aleali-réaction ~~ 190
Prescriptions normalisées concernant la durabil 192
- Formulation des bétons 196
Objectifs dune formulation 196
Lexique.
Index
Paramétres influant sur la résistance 196
Moyens de diminuer la porosité de la pate liante & consistance maintenue 200
Composition du squelette granulaire 205
Bétons optimisés 210
Méthode de formulation des bétons opt 212
Exemples de formulation . wasihcoiacs ae
Vérification et ajustement des formulations par les essais 224
Sensibilité dune formulation aux variations de dosage. 230
Premiére partie
GRANULATS
| + PRESENTATION GENERALE
Les granulats utilisés dans les travaux de batiment et de génie civil doi
vent répondre a des impératifs de qualité et & des caractéristiques propres
chaque usage. Les granulats étant d’origines diverses - naturelle, allu-
vionnaire, calcaire, éruptive, voire artificielle ou provenant de sous-pro-
duits industriels - il est nécessaire d’en établir les caractéristiques par dif
férents essais de laboratoire. Il existe six classes granulaires principales
caractérisées par les dimensions extrémes d et D des granulats rencontrés
(norme XP P 18-540, octobre 1997) :
— les fillers 0/D avec D <2 mmet au moins
70 % de passant a 0,063 mm,
— les sablons. 0/D avec D <1 mm, et moins
de 70 % de passant 4 0,063 mm,
— les sables. 0/D avec 1 6,3 mm,
~ les gravillons dD avecd> | mmet D = 125 mm,
— les ballasts dD avecd > 25 mmet D <= 50 mm.
La teneur en fines d’un granulat est définie par le passant ou tamisat (cf.
Ire partie § 3.1) 4 0,063 mm.
Certaines propriétés des granulats sont directement liées aux caractéristiques
intrins®ques des roches originelles. C'est le cas de la masse volumique ré
le, de absorption d'eau, mais aussi de la résistance mécanique qui peut
s‘exprimer par les résistances A la fragmentation, & l'usure et au polissage
D’autres caractéristiques dérivent du mode d’élaboration des granulats, que
ce soit apré’s extraction alluvionnaire, ou par concassage de roches massives
cn cartitres. II s’agit principalement des paramétres liés a la distribution
dimensionnelle des grains ou granularité. Ceci est complété par des carac-
téristiques liées 2 la propreté des matériaux obtenues en évaluant le pour-
centage des fines ainsi que leur degré de pollution par les minéraux argi-
Jeux qui sont néfastes a la fabrication de bétons de qualité. A ces parametres
s'ajoutent des caractéristiques liées a I angularité et la forme des grains
ainsi qu’A leur sensibilité au gel, leur porosité et leur réactivité chimique.
Ten résulte une dispersion sur les caractéristiques finales du matériau éla-
boré, ce qui oblige les producteurs & une grande rigueur dans la spécifi-
cation des produits.
Tableau 1.1 :
Paranée
ristigues
des granulats
Ceci s’applique tout particulitrement au fuseau granulométrique de
fabrication sur lequel sengage le producteur de granulats. I correspond
aux limites en dimension et en fréquence des granulats constituant les six
principales classes granulaires et ceci en fonction de l'usage envisagé
(assises de chaussées, couches de roulement, chaussées en béton, bétons
hydrauliques). C’est ainsi que les caractéristiques du fuseau de fabrica-
tion des granulats sont bornées par des valeurs spécifices inféricure (Vz)
et supérieure (V,.) servant & quantifier les limites acceptables pour
chaque caractéristique du matériau apres fabrication.
La spécification d’un gravillon d/ D, par exemple, est ainsi précisée dans
la norme XP P 18-540 par :
— des pourcentages de passant, Vs (valeur de spécification inférieure), &
0,63d, et Ves (valeur de spécification supérieure), & 1,58D et 2D, qui don-
nent les limites du fuseau de régularité sur lequel s’ engage le producteur.
Les granulats d/D peuvent avoir des dimensions comprises entre les
extrémes 0,63d et 2D,
— des valeurs limites inférieures L), et supérieures L,, pour les pourcen-
tages de passants aD, a(d + D)/2 etad.
Le tableau ci-dessous résume les caractéristiques recherchées pour les gra
nulats, que ce soit pour un usage routier ou pour la fabrication de béton:
Granulats Granulats pour bétons
pour usages routiers
Mise Comportement Comportement & la mise
enuyre | a court terme: en quyre :
~ granulométrie — granulométrie
—angularité —angularité
— propreté —teneur en eau
— teneur en eau
f — masse volumique
Niveau Evolution long terme Résistances mécaniques
de service | et niveau d’usage : et évolution a long terme :
— résistance mécanique: | — affinité aux ciments
* fragmentation — résistance mécanique
+ usure ~ gélivité
* polissage —aleali réaction
—affinité aux liants —teneur en chlorure
~ gélivité ct sulfates
—angularité
4+ ECHANTILLONNAGE
9-1, But et principe de l’echantillonnage
Les essais effectués en laboratoire portent nécessairement sur des quan-
tités réduites de matériaux, celles-ci devant permettre de mesurer des para-
metres caractéristiques de l'ensemble du matériau dans Iequel on a fait
le prélévement. II faut que I’échantillon utilisé au laboratoire soit repré-
sentatif de l’ensemble. Ce probléme est complexe a résoudre mais il condi-
tionne en grande partie la fiabilité des résultats obtenus au cours des essais
de laboratoire.
Le prél&vement d’é
‘hantillons se fait en deux temps
1. Prélévement sur le chantier, la carrigre ou 'usine d’ une quantité de maté-
riaux nettement plus grande que celle qui sera utilisée pour l’essai pro-
prement dit
2. Au Laboratoire, prélévement de la quantité nécessaire 4 I’e!
soit également représentative de l’échantillon de départ.
i et qui
9-9, Prélevement sur le tas (sables et graviers)
Lorsque un matériau granulaire est mis en stock, les gros éléments ont ten-
dance a rouler en bas du tas tandis que le haut est plus riche en éléments
de faibles diamétres. On prélévera donc les matériaux en haut, en bas, au
milieu et 4 l’intérieur du tas de granulats, afin d’avoir un échantillon aussi
représentatif que possible de l’ensemble. Ces diverses fractions seront
mélangées avec soin.
Dans le cas des matériaux de cartiére, il faudra également prendre en comp-
te ’hétérogénéité des différents bancs rocheux exploités.
a
BcHanti
Fig. 2.1: Opération
de quariage
Fig 22
échantillennewr
pour graviers
Ph Gauche?
Deni: SCREG-Onet
9-3, Echantillonnage en laboratoire
Le passage de I’échantillon total prélevé sur le tas A l’échantillon réduit,
nécessaire a l'essai, peut se faire par quartage ou a l'aide d’un échan-
lonneur.
ntillon doit etre séché 1’ étuve a 105 °C sil est exempt de miné-
raux argileux, ce qui est rare, ou A 60 °C dans le cas contraire.
2-3.1 Quartage
L’échantillon est divisé en quatre parties égales dont on ne retient que la
moitié en réunissant deux quarts opposés. Cette sélection est homogénéisée
et un nouveau quartage est effectué, Il’ opération pouvant se répéter trois
ou quatre fois. On obtient ainsi un échantillon représentatif du matériau
initial (voir fig. 2.1)
| 143 6x8 |
Echantillon de départ Echantillon d'essai |
2-3.2 Echantillonneur
Cet appareil de Laboratoire
permet de diviser facilement
en deux parties représenta-
tives la totalité d’un échan-
tillon initial, chaque moitié
6tant recueillie dans un bac
de maniére séparée.
La répétition en cascade de
cette opération, en retenant
a chaque opération le conte-
nu de l'un des baes, permet
dobtenir, aprés trois ou
quatre opérations identiques,
la quantité de matériaux
représentative et nécessaire
a lessai envisage (fig. 2.2
ci-contre).
Le procédé peut étre résumé par la figure 2.3 ci-dessous. Celle
de sélectionner une masse m a partir d’un prélévement de mass
permet
3m.
15m 03m
3m 1 07m a
15m 2 03m
i —<$<$=$$_—-»>| a
9-4, Choix du procede
Ces deux procédés peuvent étre utilisés séparément ou conjointement, en
fonction de la quantité nécessaire a l’essai et de la grosseur maximale des
grains. Si l’échantillon de départ est d'un volume trés important, une ou
deux opérations de quartage permettent de diminuer rapidement le volu-
me des matériaux traités ensuite a l'aide de l’échantillonneur. Celui-ci sera
choisi de telle maniére que son ouverture soit de dimension compatible
avec celle des plus gros grains du matériau traité.
Nota : La norme EN 932-1 (aotit 1996) présente de maniére détaillée les
différents aspects des problémes posés par I’échantillonnage.
Fig. 2.3:
Schéma d'une opération
de quartage
~
Cisco
ANALYSE GRANULOMETRIQUE
3 - ANALYSE GRANULOMETRIQUE
(EN 933+1 et EN 933-2)
3-1, Analyse granulometrique par voie seche
3-1.1 But de l’essai
v
cent
nalyse granulométrique permet de déterminer la grosseur et les pour-
pondéraux respectifs des différentes familles de grains consti-
tuant l’échantillon. Elle s’applique & tous les granulats de dimension nomi-
nale inférieure ou égale 4.63 mm, a l’exclusion des fillers
A noter qu’il faut éviter la confusion entre la granulométrie qui s’in
resse 2 la détermination de la dimension des grains et la granularité qui
conceme la distribution dimensionnelle des grains d’un granulat.
3-1.2 Principe de |’essai
Leessai consiste & classer les différents grains constituant I’ échantillon en
utilisant une série de tamis, emboités les uns sur les autres, dont les dimen-
sions des ouvertures sont décroissantes du haut vers le bas. Le matériau
tudi€ est placé en partie supérieure des tamis et le classement des grains
sobtient par vibration de la colonne de tamis
Avant I’ opération de tamisage, |’échantillon est lavé au dessus d’un tamis
de 0,063 mm afin d’éliminer les fines et éviter ainsi l'agglomération des
grains, ceci pouvant fausser les résultats de lanalyse. L’ analyse granu-
lométrique est conduite sur la fraction refusée par le tamis de 0,063 mm.
3-1.3 Equipement nécessaire
varrés
Ce sont des tamis (fig. 3.1) dont les ouverture: de dimensions
normalisées, sont réalisées soit A partir d'un maillage métallique, soit par
pergage d'une tOle. Les passoires, qui comportent des trous ronds per-
cés dans une tole, ne sont plus utilisées actuellement, Pour un travail aisé
et aux résultats reproductibles, il est conseillé d'utiliser une machine
tamiser électrique qui imprime un mouvement vibratoire horizontal, ainsi
que des secousses verticales, 2 1a colonne de tamis.
La dimension nominale des tamis est donnée par l'ouverture de la maille,
Cest-a-dire par la grandeur de louverture carrée. Ces dimensions sont telles
qu'elles se suivent dans une progression géométrique de raison 'Y/10 ,
depuis le tamis 0,063 mm jusqu’au tamis 125 mm, Pour des ouvertures
inférieures 4 0,063 mm, l'analyse granulométrique n'est pas adaptée et l'on
peut procéder par sédimentométrie (cf. 2¢ partie chapitre 4).
Lexistence de passoires (trous ronds) a conduit, dans le passé, 4 une double
classification des tamis et des passoires, tout en conservant pour chaque
famille d’ appareils, la méme progression géométrique des ouvertures. Afin
d'éviter toute ambiguité, un tamis et une passoire Equivalents étaient alors
désignés par un méme numéro de module. Le tableau 3.1 présente la clas-
sification des tamis selon l’ancienne norme NF P 18-560 :
Modules. 20 jar 23 |24 |25 |26 |27 Jas |29 }30
(Tamis (mm) |0,08 |0,100]0,125]0,160|0,200} 0,250} 0,315] 0,40 | 0,50 | 0,63 10,80
|Modules 31 |32 |33 |34 |35 |36 |37 |38 |39 |40 |41
/Tamis (mm)
1,60 |2,00 |2,50 |3,15 |4,00 }5,00]63 |8 [10
Modules 42 |43 |44 |4s Jae [47 |48 |49 |50
ltamis(mm) |12.5|10 |20 |25 |315|40 |s0 jos | so
La norme actuelle EN 933-2 (mai 1996) préconise, pour |’analyse gr
nulométrique, la série de tamis soulignés en gras dans la progression sui-
vante (tableau 3
Mamis (mm)|0 | 0,063 0.08 0.1 |0,125|0,160|0,2 {0,25 |0.315)0,4 | 0,5
‘tami (mm) 0,63 [0.8 1 125 [lo j2 25 [31s ]4 [5
MMamis(mm)|8 |10 12,5 [14 |16 20 j25 [31,5 |40 |50 | 63
Ffamis (mm)|80 | 100 2s |
Fig. 3.1
Tamis d mailles carrée
Docanens CONTROLAB
Tableau 3.1:
Dimensions
‘nomineles des tamis
selon rorme
NEP 18-560
(antérieure @ 1996)
Tableau 3.2:
Dimensions
nominales des tamis
selon norme EN 933.2
ran
>MeTRIOUE
ANALYSE ORANU
10
3-1.4 Conduite de I’essai
La prise d’essai est séchée a (110 + 5) °C jusqu’d masse constante puis
pesée (masse M1)
On réalise ensuite un tamisage par lavage afin de séparer les éléments de
dimension inférieure & 0,063 mm du reste de |’échantillon. Cette mani-
pulation est réalisée aprés une période de trempage de 24 heures afin de
favoriser la séparation de l'ensemble des grains. Un dispersant peut étre
éventuellement utilisé pour faciliter cette opération. Au cours du lavage,
il y a licu de protéger le tamis de 0,063 mm par un ou deux tamis d’ou-
verture plus grande (1 ou 2 mm par exemple) placés au-dessus. Le lava-
ge est poursuivi jusqu’a ce que I’eau passant au travers du tamis de
0,063 mm soit claire. Si on souhaite étudier plus particulitrement les é1é-
ments fins (voir essai de sédimentométrie dans le chapitre 2), il y a lieu
rver le filtrat obtenu et de séparer les éléments fins par décan-
tation puis séchage.
L’échantillon ainsi préparé est alors séché & (110 + 5) °C, Aprés refroi-
dissement il est pesé jusqu'a masse constante (masse M2). Le tamisage
a sec peut alors étre réalisé.
© Dimensions des tamis utilisés
En fonction des dimensions d/D des matériaux analysés, on utilisera la
série de tamis préconisée par la norme EN 933-2 (cf. tableau 3.2) ainsi
que tous les tamis nécessaires & la couverture des dimensions comprises
entre 0,063 mm et 2 mm pour les fillers, entre 0,08 mm et 2D pour les
sablons et les sables, et entre 0,63d et 2D pour les gravillons (norme
XP P 18-540).
© Préparation de |’échantillon
La quantité a utiliser doit répondre a différents impératifs qui sont contra-
dictoires :
~ il faut une quantité
tatif,
ssez grande pour que I’échantillon soit représen-
~ il faut une quantité assez faible pour que la durée de l’essai soit accep-
table et que les tamis ne soient pas saturés et donc inopérants.
Dans la pratique, la masse utilisée sera telle que: M 2 0,2D avec M,
masse de I’échantillon en kg et D diamétre du plus gros granulat expri-
mé en mm
© Description de l’essai
Le matériau séché, de masse M3, est versé sur une série de tamis choisis
de telle manitre que la progression des ouvertures soit croissante du bas
de la colonne vers le haut. En
partie inférieure, on dispose un
tamis de 0,063 mm surmontant un
fond étanche afin de récupérer les
éléments fins qui n’auraient pas
été entrainés par le lavage initial.
Un couvercle est également dis
posé en haut de la colonne afin
d'interdire toute perte de matériau
pendant le tamisage.
4mm
2mm
Imm
0,500 mm,
0,250 mm.
On appellera tamisat le poids de
matériau passant a travers un tamis.
domné et refus le poids de maté-
riau retenu par ce méme tamis.
0,125 mm
0,053 mm
fond étanche
Le matériau étudié est versé en
haut de la colonne de tamis et
celle-ci est vibrée A l'aide de la
tamiseuse électrique. Le temps de
tamisage varie avec le type de
machine utilisé, mais dépend éga-
lement de la charge de matériau
présente sur le tamis et de son
ouverture. Un étalonnage de la
machine est donc nécessaire.
On considére que le tamisage est
terminé lorsque les refus ne varient
pas de plus de | % entre deux
séquences de vibrations de la tami-
seuse.
Le refus du tamis ayant la plus
grande maille est pesé. Soit Ry la
masse de ce refus.
Le refus du tamis immédiatement inférieur est pesé. Soit Ry la masse du
deuxiéme refus. La somme Ry + Rp représente le refus cumulé sur le
deuxidme tamis,
Cette opération est poursuivie pour tous les tamis pris dans l'ordre des
ouvertures décroissantes. Ceci permet de connaitre la masse des refus
cumulés Rn aux différents niveaux de la colonne de tamis. Le tamisat pré-
nt sur le fond de la colonne de tamis est également pesé, Soit P sa masse.
La somme des refus cumulés mesurés sur les différents tamis et du tami-
sat sur le fond (fillers) doit coineider avec le poids de l’échantillon intro-
duit en téte de colonne. La perte éventuelle de matériaux pendant I’ opé-
ration de tamisage ne doit pas exeéder plus de 2 % du poids total de
Péchantillon de départ
Fig. 425
Colonne de tamis
Tamiseuse électrique
Ph, Gausherem jou
SCREG- Ouest
sayaaxvap
x
7
.
z
Z
<
12
Tableau 3.3:
Exemple de cateal
Les résultats des refus sont exprimés en pourcentage de la masse stche
M, ce départ. Is peuvent étre présentés selon ’exemple suivant :
‘Tamis
enmm
4 41 41 2,05 97,95
2 162 203 10,15 89,85
L 494 697 34,87 65,13
0,500 705 1 402 70,14 29,86,
0,250 396 1798 89,95 10,05
0,125 159 1957 97,90 2,10
0,063 25 1 982 99,15 0,85
fond 4 1999 100,00 0,00
Le pourcentage de fines (f) passant a travers le tamis de 0,063 mm est
P; masse du tamisat restant dans le fond, en kg.
3-1.5 Expression des résultats :
courbe granulométrique
Les pourcentages des refus cumulés, ou ceux des tamisats cumulés, sont
représentés sous la forme d’une courbe granulométrique en portant les
ouvertures des tamis en abscisse, sur une échelle logarithmique, et les pour-
centages en ordonnée, sur une échelle arithmétique. La courbe est tracée
de manitre continue et peut ne pas passer rigoureusement par tous les points.
La représentation graphique de I’analyse granulométrique du tableau 3.2
est donnée par la figure 3.4.
Remarques :
. Les courbes granulométriques peuvent étre considérées comme conti-
nues si tous les tamis enregistrent un refus. Elles peuvent étre consi-
dérées comme discontinues lorsque plus de trois tamis consécutifs ne
gardent pas de refus.
ie)
La forme de la courbe granulométrique peut conduire A des interpré-
tations rapides. La figure 3.5 présente différentes possibilités dans le
cas d'un sable :
ANALYSE GRANULOMETRIQUE (XP F 18 540)
Sie a eae rtr al
Saar am 020 00, ont 100 ie 38 60) G4 S| ewes
i 308 tS 08 aan as Maa 4 Mad a san a on
—courbe | ; granulats riches en éléments fins,
~courbe 2 : courbe granulométrique discontinue. II manque les gra-
nulats de diamétres compris entre 0,25 mm et 1 mm,
— courbe 3 : courbe granulométrique courante,
— courbe 4: granulats pauvres en éléments fins
3, Le caractére plus ou moins fin d'un sable peut étre quantifié par le cal-
cul du module de finesse MF. Celui-ci correspond la somme des pour-
centages des refus cumulés, ramenés a I'unité, pour les tamis d’ ouverture
(exprimée en mm) 0,16 - 0,315 - 0,63 - 1,25 - 2,5 - 5. Ce paramétre
esi en particulier utilisé dans les ealeuls de composition des bétons.
I ANALYSE GRANULOMETRIQUE (XP F 18 540)
rc
Spee esueeus °3¢
ssssssss
|
[Oo oie ait aa 0m 00 1m iam 380 0) GOSS ew
88 eas ah a 0m 128 M0 1d oo 6 ase so * 0"
Fig 34:
Courbe
‘granulométrique
dun sable
Fig. 35:
Courke
‘granulométrique
dans différents cas
13
SavtANVAD
Zz
&
AN
14
Tableau 3.4 :
Modules de finesses
des sables
de la figure 3.5
Dans le cas de la courbe granulométrique série 3 de la figure 3.5, celui-
ci est égal a
MF = (95,5 + 84,5 + 58 + 26 +7 + 1,5) / 100 = 2,73
Le module de finesse représente, en quelque sorte, et de manigre appro-
chée, la surface comprise entre la courbe granulométrique et I'axe hori-
zontal supérieur du graphique, celui-ci correspondant & un refus cumu-
1é nul (tamisat cumulé = 100 %). Plus son module est faible et plus le
sable est riche en éléments fins.
Dans le cas de la figure 3.5, les modules de finesse sont les suivants :
Série Module de finesse
1 1,47
Nn
nN
3-2, Cas des granulats impropres
au sechage en étuve
Certains matériaux naturels sont dégradés par un passage A1’étuve a 110°C
et on ne peut donc appliquer le protocole d’essai précédent, sauf a ris-
quer d’altérer la qualité des résultats obtenus.
Dans ce cas, on utilise deux prises d’essai du méme matériau. Sur l'un
des échantillons, on détermine la teneur en eau du matériau par séchage
Al’étuye A 110 °C. On procéde a I'analyse granulométrique par la métho
de de lavage et de tamisage sur la deuxidme prise d’essai (masse M”,).
Sa masse seche M, est déterminée & partir de la masse humide M”) et de
la teneur en cau w (cf. deuxidme partie) déterminée sur la premiere prise
dessai.
La masse Mj s’exprime par la relation suivante :
Mj
M\= T00-+w
Modéle de feuille de calculs
Date : Chantier
Nature de I’échantillon : Demandeur :
Procédé utilisé : lavage et tamisage / tamisage par voie séche**
Masse stche My = ‘ou masse humide M? =
Masse séche apres lavage M=
Masse sche des fines retirées par lavage My —-M2=
Ouverture Masse Masse Pourcentage | Pourcentage
des tamis des refus des refus des refus | des tamisats
(mm) Ri (a) cumulés, cumulés, cumulés,
Ry (g) (Rn/My) 100 | 100 - (Ra/My. 100)
Fond
Pourcentage de tamisat de fines (/) sur le tamis 0,063 mm :
(M-M)+P 4)
ipa
(résultat exprimé a la décimale la plus proche).
DR+P=
M,-(Z Ri +P) 2
Vous aimerez peut-être aussi
- DocdDocument2 pagesDocdhadroug mouhamed aliPas encore d'évaluation
- Manoeuvre en Batiment: Ma RechercheDocument2 pagesManoeuvre en Batiment: Ma Recherchehadroug mouhamed aliPas encore d'évaluation
- Étancheur Couvreur: Ma RechercheDocument1 pageÉtancheur Couvreur: Ma Recherchehadroug mouhamed aliPas encore d'évaluation
- Cours Conduite Dun Chantier BTPDocument206 pagesCours Conduite Dun Chantier BTPhadroug mouhamed aliPas encore d'évaluation
- Travaux Pratiques de Materiaux de ConstructionsDocument40 pagesTravaux Pratiques de Materiaux de Constructionshadroug mouhamed aliPas encore d'évaluation
- Réseau Urbain HydroliqueDocument115 pagesRéseau Urbain Hydroliquehadroug mouhamed aliPas encore d'évaluation
- Maison Youtube-Présentation1Document1 pageMaison Youtube-Présentation1hadroug mouhamed aliPas encore d'évaluation
- Livre C3D18.FR00.00 - JAN21Document440 pagesLivre C3D18.FR00.00 - JAN21hadroug mouhamed aliPas encore d'évaluation