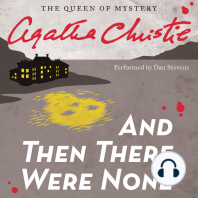Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
KERSBERG, Pierre - La Science Dans Le Monde de La Vie
Transféré par
Laura Soledad Romero0 évaluation0% ont trouvé ce document utile (0 vote)
43 vues149 pagesPierre Kersberg. La Science dans le Monde.
Titre original
KERSBERG, Pierre - La Science dans le Monde de la Vie
Copyright
© © All Rights Reserved
Formats disponibles
PDF ou lisez en ligne sur Scribd
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentPierre Kersberg. La Science dans le Monde.
Droits d'auteur :
© All Rights Reserved
Formats disponibles
Téléchargez comme PDF ou lisez en ligne sur Scribd
0 évaluation0% ont trouvé ce document utile (0 vote)
43 vues149 pagesKERSBERG, Pierre - La Science Dans Le Monde de La Vie
Transféré par
Laura Soledad RomeroPierre Kersberg. La Science dans le Monde.
Droits d'auteur :
© All Rights Reserved
Formats disponibles
Téléchargez comme PDF ou lisez en ligne sur Scribd
Vous êtes sur la page 1sur 149
Mu ANE
2044 7
yowi lerre Kerszberg
La Science
dans le Monde
de la Vie
8
COLLECTION KRisIs
dirigée par Marc Richir
Du méme auteur :
The Invented Universe, Oxford, Clarendon Press, 1989
Critique and Totality, State University of New York Press, 1997
Kant et la Nature, Paris, Les Belles Lettres, 1999
L'Ombre de la Nature, Paris, Editions du Cerf, 2009
© Editions Jéréme Millon ~ 2012
Marie-Claude Carrara et Jéréme Millon
3, place Vaucanson
F-38000 Grenoble
ISBN : 978-2-84137-277-5
Catalogue sur demande
www.millon.com
Pierre Kerszberg
La Science
dans le Monde de la Vie
MILLON
INTRODUCTION
Une interrogation qui ne va pas de soi
«La nature ... mais nous ne la comprenons pas, et c'est d’elle que
nous persistons & attendre quelque chose ».
Ivan Tourgueniey, 4 Ia veille.
A la suite des révolutions les plus brutales que la science a accomplies au
tournant du vingtiéme siécle, le monde naturel est devenu déconcertant. Les
matériaux sur lesquels s’appuie le physicien pour en faire la théorie, il ne les
emprunte plus, comme c’ était encore Je cas auparavant, au témoignage d'un
monde qui s’ouvre directement 4 nous. Newton placait encore sa confiance
dans les phénoménes décrits par des lois empiriques, jusqu’a déduire tout le
systéme de la science 4 partir d’eux ; ainsi les forces de la nature sont
déduites des phénoménes du mouvement, et ensuite les autres phénoménes
sont démontrés a partir de ces forces. Pour ce qui est de la cause de ces forces,
Newton avoue que la déduction s’arréte devant des raisons encore inconnues.
Par crainte de tomber dans |’ illusion métaphysique, il refuse d’imaginer des
hypothéses tant qu’elles ne serviront qu’a élever des objections a l’encontre
des lois expérimentales solidement établies. Mais depuis l’avénement des
théories de la relativité et de la mécanique quantique, les hypothéses revien-
nent sous la forme de ces fictions délibérées dont Newton voulait se débar-
rasser. Les principes de la science ne sont plus tout simplement des
systématisations de l’expérience. Comme |’ont souligné Einstein et d’autres,
dés le début les concepts sont des libres créations de l’esprit humain ; la
science aurait définitivement rompu avec la naiveté d’une premiére expé-
rience incontestable dont tout dépendrait. Comment se fait-il que les créa-
tions libres ne tombent pas tout simplement dans le vide ? qu’elles sont,
comme disait Einstein dans une formule célébre, tout aussi peu indépen-
dantes des expériences que les habits ne le sont du corps humain ? qu’en plus
de s’organiser selon leur logique propre certaines d’entre elles accrochent &
quelque chose qu’il faut bien appeler le « réel » ?
Suivons les pas d’Eddington, l'un de ces extraordinaires savants qui au
début du vingtiéme siécle a accompagné la formation de ces théories. Faisons
6 LA SCIENCE DANS LE MONDE DE LA VIE.
comme lui, oublions pour un instant l’impact des théories de plus en plus abs-
traites de la nature, et plagons-nous en toute bonne foi dans une situation frai-
chement naive!
Le monde familier de l’expérience quotidienne est celui qui apparait
spontanément devant moi lorsque j’ouvre les yeux. Je voudrais le décrire.
Que vois-je ? Je vois cette table, et concentrant mon attention sur sa surface,
je découvre vite que ma description est entrainée dans un monde de signifi-
cations qui sont loin d’étre claires. La table posséde de toute évidence un
certain nombre de propriétés facilement discernables comme la grandeur, la
couleur, une relative stabilité, une certaine rugosité. Mais ce qui est facile-
ment discerné est-il si indiscutable qu’on puisse le prendre pour une caracté-
ristique objective ? Eddington dit tout de suite qu’il ne va pas examiner plus
avant la question de savoir comment départager ce qui reléve de l’ objectif de
ce qui reléve du subjectif. En effet la question s’avére vite inextricable. La
table n’est pas seulement la devant moi, comme si elle n’avait rien a cacher,
et comme s’il me suffisait de décrire ce que je vois pour comprendre ce
qu’elle est. Elle vient aussi a moi sous la forme d’une certaine image men-
tale. En outre elle était certainement 1a avant que mon regard se pose sur
elle, d’oi les préjugés hérités de mon histoire passée et de la culture ot je
vis, qui me font ajouter a cette table des valeurs que je confonds peut-étre
avec des propriétés objectives. Evidemment dans le cas d’une table on a vite
fait le tour de ses caractéres qui pourraient étre autant de préjugés : elle est
faite d’un certain matériau comme le bois ou le métal, mais que sa place soit
dans la cuisine ou dans le bureau, qu’elle soit faite pour soutenir d’autres
choses (comme par exemple le fait de m’appuyer dessus), ce sont 1a autant
@ images informées par certaines valeurs. Si j’éloigne de la table tout ce qui
reléve de mes préoccupations, je retiens ce qui est effectivement devant
moi: la table est une chose, point c’est tout. En tant que chose et rien que
chose, rien ne vient la brouiller et elle est au moins une table sans que je
m’en méle. Or en disant qu’une table est une table, on a déja dépassé le
cadre d’une simple description ; on a exigé un effort pour ignorer ce dont on
se préoccupe. A vrai dire cet effort semble encore une fois bien simple dans
Je cas présent : je comprends ou je crois comprendre ce qu’il en est d’une
table ordinaire, simplement parce que cette table ordinaire ressemble 4 une
autre table ordinaire ; de plus, je comprends ou je crois comprendre qu’il en
1, AS. Eddington, The Nature of the Physical World, Cambridge University Press, 1928,
pp. xi-xix. Voir également C, Hempel, Philosophy of Natural Science, Englewood Cliffs,
Prentice-Hall, 1966, pp. 77-78, et J. Bouveresse, Langage, perception et réalité, tome 2,
‘Nimes, J. Chambon, 2004, p. 22 sq.
INTRODUCTION 7
va de méme pour tout un chacun. II doit y avoir dans la table qui est devant
moi quelque chose comme une solidité & toute épreuve, grace & laquelle,
bien loin de perdre en choséité lorsqu’elle se compare a d’autres qui lui res-
semblent, elle en gagne. Ce quelque chose d’absolument résistant, a défaut
de savoir ce que c’est, il faut le baptiser d’un grand mot : la « substance ».
La substance est la plus éminente de toutes les propriétés de chose en tant
que chose et rien que chose, peut-étre est-elle méme porteuse de toutes les
autres propriétés qui viennent a se manifester lorsque la chose est sollicitée
par une préoccupation. Bien qu’elle parait s’en approcher, la substance n’est
pas la matiére, dont je sais que je ne la comprends pas tout de suite en tant
que matidre et rien que matiére. Je le sais, parce que parmi mes préoccupa-
tions, mon éducation scientifique m’a appris qu’il faut explorer la matiére et
la manipuler en tous sens au moyen d’instruments de plus en plus sophisti-
qués, de théories de plus en plus abstraites, faute de quoi la matiére n’est
qu’un autre mot pour la substance. Pour expliquer ce que je comprends ou
crois comprendre depuis toujours, je ne peux qu’invoquer un grand mot.
Comme chose, la substance est un X, quelque chose de complétement
inconnu et peut-étre inconnaissable ; comme nom, elle désigne pourtant la
chose la plus connue — une table ordinaire,
Or, parmi toutes les préoccupations vis-d-vis de la chose, la préoccupation
scientifique n’est-elle pas justement celle qui va permettre de venir a bout de
la substance : expliquer le comment et le pourquoi de la chose, qui dans la vie
quotidienne se présente dans l’insouciance de ce qui va de soi ? Dans sa ver-
sion la plus récente, la science trouve que la table est constituée d’atomes et
de champs électriques, enfouis dans des profondeurs telles qu’en réalité elle
est faite de beaucoup plus de vide que de matiére. La table qui est devant moi
n’est pas tout d’abord cette chose grossi¢re que me révélent mes impressions
sensibles, mais plutdt un ensemble d’atomes et de molécules religes par cer-
taines forces dont les grandeurs et les interactions sont en principe calcu-
lables selon les lois de la mécanique. Dans la vie pratique, les deux tables se
différencient finalement fort peu l’une de l’autre. Par exemple, la résistance
effectivement éprouvée en réponse a une pression exercée par mon coude sur
la table équivaut a celle qu’on calcule au moyen de la valeur des champs élec-
triques. Cet X qu’est la substance semble finalement condamné a disparaitre
au profit d’une description scientifique de la table.
La science procéde du moins bien connu au mieux connu, et elle ne s’em-
barrasse pas de ce qui est inconnaissable par principe. Brisant cette table
familiére pour découvrir ses constituants, la science découvre des électrons
ou d’autres particules dites « élémentaires », qu’on peut apprendre a
connaitre suivant la méme curiosité qui pousse par exemple a bricoler une
8 LA SCIENCE DANS LE MONDE DE LA VIE
table. L’électron n’est pas présent comme une table est présente dans I’ expé-
rience ordinaire, et pourtant il a une présence qui compte pour la théorie
scientifique. Présence certes troublante, puisque 1’électron doit sa présence
aux bons soins d’un appareillage complexe, qui pour sa part est encore une
«chose » analogue a une table dans la premiére impression. L’appareillage
s’efface-t-il au profit de !’électron, la substance de la premiére impression
disparait-elle, place est faite une présence qui n’est pas A proprement parler
une présence de « chose». Or, A présence nouvelle, énigme nouvelle. La
table scientifique, dit Eddington, « est la seule qui soit réellement la — ob que
puisse étre ‘1d’». Etre « ld » ne signifie justement pas étre « n’importe ot» :
yoila l’énigme. Ne pas pouvoir situer une chose qui est réellement la, cela ne
revient-il pas simplement a croire qu’elle est réellement la ? cela n’est-il pas
la caractéristique d’un étre fantomatique ? Sans le soutien de la substance,
avoue Eddington, on est obligé de dire : « le fantéme de mon coude repose
sur le fantéme de table ... ». Pour la substance de 1a table ordinaire il n’y
aurait pas de doute : elle est 1a oit elle est ; tout ce qu’elle a de réel, c'est
méme peut-étre d’étre 1a plutét qu’ailleurs.
La science connait d’autres tours pour bousculer cette assurance. Il
existe en effet une nouvelle menace sur l’intégrité de la chose, beaucoup
plus sérieuse et compromettante que la fragmentation pour aller voir sa
« substance » de plus prés. Sous ’action du feu ma table est transformée en
fumée. Lors de cette métamorphose parfaitement naturelle, la table scienti-
fique est devenue fumée scientifique. Il y a un milieu dans lequel les choses
scientifiques évoluent pour passer d’un état a un autre, et ce milieu est
encore une chose scientifique. Mais pour l’expérience familiére, cette cir-
constance de la combustion est extraordinaire : 4 quelle métamorphose
miraculeuse attribuer la disparition de cette table ordinaire lorsqu’elle brile
sous mes yeux ? A force de multiplier les choses autant que les chemins qui
meénent des unes aux autres, la science fait perdre a la substance sa derniére
raison d’étre : il n’y a pas de relations entre substances comme il y a des
relations entre choses. Apparemment c’en est fini de la substance : est-ce la
le dernier mot a son affaire ?
Avant de les rejeter dans la poubelles des fantasmes, la science moderne a
pourtant connu ses propres substances, comme par exemple un fluide calo-
ique qui fut pour un temps une substance invoquée par la science pour expli-
quer la combustion. Mais la science a fini par résoudre I’équation « substance
= X» en identifiant le X 4 une multiplicité de choses et de relations entre
choses, Comme Mach |’a bien résumé a la fin du dix-neuviéme siécle, la par-
ticularité du concept scientifique de substance est de renoncer & la constance
absolue d’une chose et d’installer des dépendances fonctionnelles entre élé-
INTRODUCTION 9
ments du réel. L’influence d’une métaphysique hors de propos fait ses
ravages quand on parle de chose absolument invariable dans la nature. Parmi
toutes les dépendances observées et observables, il se fait que celles qui sont
constantes font plus grosse impression et dépassent largement en nombre
celles qui ne le sont pas. La métaphysique de la substance tombe de haut.
Ala suite de abandon de la substance, Eddington aurait pu s’abstenir de
troquer une énigme pour une autre. Peut-étre aurait-il méme dd le faire d’em-
blée. Hempel proteste que ce n’est ni le but ni l’effet des explications théo-
riques de montrer que les choses et événements de notre expérience
quotidienne ne sont pas « réellement 1a ». La théorie atomique de la matiére
cherche plutét 4 montrer quels sont les aspects des processus microphysiques
sous-jacents d’aprés lesquels une table réellement existante déploie telles ou
telles caractéristiques macrophysiques. Les processus microphysiques ne
renvoient pas a une énigmatique présence qui contaminerait la présence bien
connue des choses ; ils sont simplement une partie du monde oi! nous vivons
en relation & une autre partie de ce méme monde. En derniére analyse, la
théorie ne touche pas au fait qu’il y a des événements macroscopiques parfai-
tement conformes a la vie ordinaire ; elle les prend comme allant de soi,
méme si la théorie peut évidemment étre amenée a corriger telle ou telle
notion familigre que nous avions d’une chose avant d’entreprendre la
recherche scientifique. L’erreur d’Eddington serait de transposer a la table
scientifique un besoin de représentation emprunté 4 la table ordinaire, faisant
de la table scientifique une « construction étrange », comme il est lui-méme
contraint de l’appeler : pourquoi exiger d’un fantéme qu’il « repose » sur un.
autre a la maniére d’une chose ordinaire sur une autre ? Mais n’est-il pas tout
aussi étrange qu’une théorie atomique de la matiére comme la mécanique
quantique aboutisse finalement quelque chose de bien plus fort qu’une
simple correction du familier : une transformation en quelque chose dont on
est néanmoins pratiquement sir qu’il n’apparaitra jamais ? Jouant avec la
dimension du monde globalement continu et déterministe de notre monde
familier, la théorie prévoit des sursauts aléatoires et discontinus d’autant
moins improbables que la dimension se fait petite, sans empécher compléte-
ment qu’ils se manifestent un jour a I’échelle familigre. Ces sursauts signa-
lent-ils une double présence dans un méme monde, ou une présence dans
deux mondes différents ? En cherchant & voir émerger quelque chose qui res-
semble au monde ordinaire effectivement pergu a partir de structures ott l’ex-
périence ordinaire n’a plus cours, la mécanique quantique est confrontée &
2. Voir R. Musil, Pour une évaluation des doctrines de Mach, éd. P.-L. Assoun, trad.
M.F. Demet, Paris, PUE, 1985, pp. 116-117.
10 LA SCIENCE DANS LE MONDE DE LA VIE
Pénigme désormais universelle de la présence de n’importe quoi. De cette
énigme sortent des interprétations du formalisme de Ia théorie qui vont du
rejet total du réalisme a son acceptation sous certaines conditions.
Pourtant rien ne parait plus simple que désamorcer |’étrangeté de la table
scientifique. Il suffirait de refuser de la traiter comme le fantéme d’une chose
ordinaire, Les outils conceptuels ne manquent pas pour y parvenir. Une table
ordinaire qui se trouve « 1a » se tient devant mon regard, elle est vue depuis
une certaine perspective qui est mon « ici », c’est-A-dire qu’ entre elle et moi
ily a déja un réseau de relations sans qu’ il soit question de « substance ». De
la sorte, la table ordinaire ne peut-elle pas elle aussi prétendre étre « réelle-
ment 14 » en conformité avec la préoccupation scientifique ? Mon regard est
celui d’un observateur au sens de la théorie, c’est-a-dire un systéme de réfé-
rence parmi d’autres, de sorte que grace a l’opération de mesure le systéme
de référence transforme n’importe quel « la » en un « ici », La mesure quali-
fie le « réellement 14 » en « od que puisse étre ‘1a’», et elle s’applique aussi
bien a un objet ordinaire qu’A un champ magnétique. Dés que le « 14 » de cet
objet ou de ce champ est effectivement n’importe ow, la « substance » n’a
plus d’effet et n’est plus la cause de rien du tout.
Pourtant Eddington insiste. Dés l’instant o0 la substance d’une chose indi-
viduelle est abandonnée, et ot tout ce dont il est question est affaire de
mesure, il n’y a plus aucune raison de penser la nature en compartimentant
les catégories sous lesquelles elle apparait : des choses, des relations, mais
aussi des formes, etc. A toutes ces catégories se substitue ce que Eddington
appelle un « arriére-fond commun de toute l’expérience ». Celui-ci se veut
certes différent d’un arriére-monde qui hanterait le nétre par sa présence
énigmatique : en effet, la mesure le rend justement accessible. Mais comment
s’en différencie-t-il au juste ? Ici apparait pleinement la signification de la
substance comme maniére de désigner la solidité de toute expérience.
Eddington insiste sur une « alchimie » propre 4 l’esprit humain, par laquelle
les choses mesurées, bien qu’ayant perdu leur dimension fantomatique, sont
néanmoins repeintes en choses ordinaires avant que la science ne décrive la
transformation du niveau quantique en niveau ordinaire. I] est insupportable a
notre esprit de considérer que le « od que puisse étre ‘1a’» ne soit pas aussi un
«étre 1» purement et simplement. Il ne nous viendrait jamais a l’idée de
nous aventurer dans le monde de la table scientifique si, écrit-il, « les noyaux
de force électrique dispersés de fagon parcimonieuse » ne devenaient pas
d’une certaine fagon un solide tangible ; si, derechef, leur agitation incessante
ne devenait pas d’une autre fagon encore « la chaleur de I’été » ; et ainsi de
suite en progressant vers des attributs de plus en plus subjectifs au fur et
mesure de l’approfondissement des structures dites objectives.
!
i
i
INTRODUCTION 1
L’importance attribuée a cette imagerie a été vivement contestée, bien au-
dela du contexte particulier ott elle se présente chez Eddington. Ainsi
Poincaré admet que des analogies entre une explication scientifique du
monde et des phénoménes de la vie ordinaire sont monnaie courante dans la
pratique de la science. Si ces analogies aident 4 la compréhension, tant
mieux ; en tout cas elles se prétent a la vérification. Mais au-dela de la seule
veérification, une confusion s’installe vite sur le sens des analogies : celles-ci
passent pour I’explication au lieu de la soutenir ; elles utilisent l’expérience
ordinaire comme une indication de ce qu’est le phénoméne en soi, parce qu’il
nous semble comprendre cette expérience depuis toujours?, Poincaré ne veut
pas interdire ce genre d’hypothéses, qui ont l’avantage de satisfaire I’esprit
dans sa recherche d’un accord avec le monde ; mais il prévient qu’il faut
s’entendre sur Icur sens purement métaphorique. Duhem va plus loin encore,
et taxe toute tentative de passer du visible au caché par I’intermédiaire d’ana-
logies empruntées & notre vie de manceuvre sinon frauduleuse, du moins
impraticable. L’histoire de la physique enseignerait que cet X caché, lorsqu’il
est imaging, ne joue aucun réle dans le développement d’une théorie.
Or, Pimagerie d’Eddington n’engage ni une logique de la découverte ni
une logique de la justification. Elle signale plutét que la construction scienti-
fique de chose ne viendra jamais 4 bout de son étrangeté en refusant pure-
ment et simplement d’y voir les reliquats fantomatiques de l’expérience
familiére. La chose ordinaire qualifie la chose scientifique comme une enve-
loppe dont elle ne peut se défaire ; un voile qui, bien qu’inapproprié a ce qui
est « réellement », en est inséparable. La chose scientifique est comme une
substance vidée de son mystérieux noyau qui traditionnellement en fait une
substance, mais une substance quand méme. Cette alchimie est encore plus
magique que la disparition d’une chose dans l’expérience ordinaire. En effet,
si l’arriére-fond commun de l’expérience est capable de distiller une telle
alchimie, n’est-il pas finalement une sorte de substance généralisée, d’une
finesse extraordinaire ? Tout se passe comme si le voile de chaque chose au
premier contact, sans lequel le contact avec la chose n’aurait pas méme lieu
pour commencer, était étiré sur le monde dans l’ensemble de toutes ses
dimensions. C’est pourquoi l’arriére-fond est plus mystérieux et insondable
encore que l’ancienne substance dont nous sommes partis. Plus rien ne certi-
fie qu’il renvoie au monde supposé réel, quand bien méme la science y trouve
« son »> monde. I] induit au moins une hésitation sur le monde auquel l’expé-
rience scientifique a affaire. Eddington écrit 4 bon escient que le monde
scientifique n’est pas un monde extérieur en face et face 4 nous simplement
3. H. Poincaré, La Science et I’hypothése, Paris, Flammarion, 1968, p. 176.
12 LA SCIENCE DANS LE MONDE DE LA VIE
parce qu’il est construit avec l’intention de I’étre, comme s°il suffisait de dire
que le monde qui est réellement li est le monde de la science : il est possible
qu'il soit I’un ow l’autre (« is, or is intended to be, a wholly external world »).
Il est possible que le monde objectif visé par la science s’épuise dans cette
visée au lieu de ’épuiser. Cette possibilité est plus profonde que la transfor-
mation du monde ott nous vivons en monde possible selon les lois générales
de nature. La science n’est plus dépositaire d’une théorie de la connaissance
pour venir a bout de ta présence lancinante de l’expérience préscientifique.
*
La science a développé ses propres techniques d’auto-validation et de
contréle de ses énoncés. Elle puise dans deux sources, son formalisme qui
évolue selon des exigences internes de cohérence, mais aussi I’expérience
intuitive préscientifique ancrée dans. des capacités d’analyse qui demeurent
fondamentalement plus ou moins les mémes. Si les limites du formalisme ont
pu étre établies par des méthodes intemes & la science, il n’en va pas de méme
pour le monde ou prévaut |’intuition. Einstein abolit le temps absolu et l’es-
pace absolu au profit de régles et d’horloges fabriquées conformément a cer-
taines normes, afin d’assurer la mesure des événements et construire une
représentation du monde qui n’excéde pas les moyens de la mesure. Or, l’ex-
périence intuitive veut que la régle se rapporte malgré tout 4 quelque chose
comme « l’espace », et que l’horloge indique malgré tout quelque chose
comme « le temps ». L’horloge ne fera sans doute jamais le travail qu’on lui
demande de faire dans la théorie si le devenir effectivement vécu était une
simple illusion a surmonter, a ranger aux cétés de ces habitudes ancestrales
que la science aurait enfin dépassées.
Depuis Eddington, une idée générale de correspondance entre le monde
quantique et le monde de la logique commune s’est assez bien imposée. Bien
au-dela de la causalité, la physique a emprunté au sens commun une vaste
palette de concepts, comme la séparabilité ou la localité, pour buter sur des
oppositions qui ont fini par n’apparaitre irréductibles qu’en apparence. Tout
le poids de la correspondance pése du cété quantique : le monde quantique
est la norme pour un sens commun qui se plie a elle. La norme est inspire
par le langage mathématique qui est plus qu’un outil : en physique quantique,
les choses sont congues dans leur étre comme des opérateurs mathématiques.
Le monde dans lequel nous vivons effectivement est un monde possible vis-
a-vis du monde qui se comporte en profondeur comme une structure mathé-
matique. La théorie prévoit une multitude de formes que peuvent prendre
dans la réalité sensible les multiples fonctions d’onde possibles associées &
INTRODUCTION 13
un méme systéme de particules élémentaires, Le monde ordinaire n’« est »
pas comme on I’a toujours cru naivement en se fiant a une logique commune,
mais on peut le retrouver dans sa naiveté premiére en le déduisant a partir de
certaines quantités microphysiques qui auraient la vocation a se rassembler
pour devenir des propriétés macroscopiques. Ainsi le déterminisme globale-
ment vérifié 4 I’échelle de l’expérience ordinaire tolére des fluctuations inat-
tendues lorsque 1’échelle d’observation est suffisamment petite ; entre des
probabilités d’existence extrémement petites et d’autres qui choquent le sens
commun, la théorie assure un passage continu. D’ou vient que le sens com-
mun soit tenu d’étre révisé a l’aune des lois atomiques ? Comme le sens com-
mun est incapable de savoir comment il peut se limiter ou s’amender
lui-méme, il revient 4 la physique quantique de lui apprendre comment faire.
Réviser le sens commun est une opération qui n’a de sens qu’en lui attribuant
dabord un pouvoir d’autant plus exorbitant qu’il est incompris.
Deux tables, deux mondes : méme si les deux mondes ne sont finale-
ment que les aspects différenciés d’un seul monde, il reste que chacun pose
une énigme A l’autre précisément parce que chacun de son cété pense que
des passages doivent étre aménagés de l’un a I’autre, sans qu’on puisse
avoir l’assurance que ces deux maniéres de penser se rencontreront dans un
schéma unique par un simple changement de point de vue. Pour le sens
commun, méme éduqué et rééduqué par la science, une fluctuation quan-
tique est 4 proprement parler un miracle, parce que cet événement déroge &
la structure globalement habituelle du monde. La science apprivoise le
miracle pour en faire un événement simplement inhabituel et tout au plus
extraordinaire, mais elle veut en outre que l’inhabituel devienne la norme
d'une nouvelle habitualité. Déja 4 l’époque de la premiére fondation de la
science a l’époque moderne, Galilée n’a rien a redire au miracle de Josué
qui aurait permis d’allonger exceptionnellement la durée d’une journée,
bien qu’il y trouve une occasion de tester I’hypothése héliocentrique de
Copernic et d’affermir sa validité : Dieu aurait mieux fait d’étre coperni-
cien pour réaliser ce miracle. Aprés tout, comme l’avait déja remarqué
Hume, quand la température de |’eau se refroidit et qu’elle passe d’un coup
de la complete liquidité 4 la parfaite solidité, il y a 14 quelque chose d’ex-
traordinaire que la science nous a appris 4 considérer comme ordinaire*.
Mais pour celui qui vit dans des contrées ott I’eau ne géle jamais, s’il était
@un coup transporté chez nous il ne pourrait s’empécher de voir un miracle
dans cet événement. La mondialisation de l’expérience en aura-t-elle
4, D. Hume, Enguéte sur lentendement humain, X, trad. M. Malherbe, Paris, J. Vrin,
2008, pp. 291-293, note.
14 LA SCIENCE DANS LE MONDE DE LA VIE
jamais fini avec les miracles ? Le penchant a la vérité prendra-t-il jamais le
dessus sur le penchant a I"émerveillement ? Méme le sage sceptique ne le
croit pas. Désormais, dans 1’ arriére-fond commun de toute l’expérience que
la science heurte de plus en plus profondément, ce qui est étrange n’est plus
Parriére-fond en tant que tel mais le fait qu’il soit commun.
La science légue ainsi a la philosophie une tache qui lui revient de droit
comme philosophie. Il y a des raisons de penser que cette tache est méme la
plus importante qui nous échoit aujourd’hui. Toujours dans le sillage des
théories scientifiques révolutionnaires du début du vingtiéme siécle,
Husserl écrit :
« Le paradoxe du rattachement mutuel d’un ‘monde objectivement vrai’ et
dun ‘monde de la vie’ rend le mode d’étre de tous deux énigmatique. Donc le
vrai monde en quelque sens que ce soit, y compris par conséquent notre propre
étre, devient une énigme quant au sens méme de cet étre. Dans les tentatives
pour parvenir la clarté nous devenons conscients d’un seul coup — mis en pré-
sence des paradoxes qui viennent d’apparaitre — de l’absence de terrain de toute
la facon de philosopher qui a été jusqu’ici la nétre. Comment pouvons-nous
devenir maintenant vraiment des philosophes ? »5
Depuis la révolution scientifique du dix-septi¢me siécle, les théories
mathématiques de la nature construisent 4 cété de la nature qui nous est
donnée depuis toujours une seconde nature, ot régnent des lois qui pour-
raient fort bien exister sans que nous existions. Les théories conférent a ce
monde une réalité ontologique qui peut valoir autrement qu’elle vaut pour
moi, ou méme avoir une signification sans moi. Monde en soi absolument
positif, il advient pour ainsi dire sans sujet de soi-méme. C’est pourquoi, si
la science attribue encore au monde profond qu’elle comprend 1a vocation
de se manifester dans l’expérience ordinaire comme sa possibilité la plus
éminente, cette vocation trouve sa justification ultime dans l’idée méme de
monde possible qui précéde tous les mondes & comprendre comme autant
de possibilités. Ce monde possible en idée est celui dont ni la science ni
V’expérience intuitive ne parlent jamais, et qui pourtant est toujours déja 1a
comme un étre d’autant plus « premier » qu’il est commun 4 tous et qu’il
est réfractaire aux prises de la pensée sur lui: le « monde de la vie »
(Lebenswelt). Avant tous les miracles qui seront apprivoisés, le monde de la
vie suscite pour nous aujourd’hui cet étonnement devant notre propre nai-
veté, étonnement que Platon avait identifié en son temps a l’origine de la
5. E.Husserl, La Crise des sciences européennes et la phénoménologie transcendantale,
§ 34e, trad, G. Granel, Paris, Gallimard, 1976, p. 149. Cité ci-aprés KR,
INTRODUCTION 15
philosophic. Mais la naiveté a son histoire. Comme dit encore Husserl, une
théorie comme celle de la relativité d’Einstein ne toucherait pas du tout a
espace et au temps dans lesquels nous vivons, parce que le changement
apporté par cette théorie concerne des formules appliquées 4 une nature
déja idéalisée et naivement objectivée depuis Galilée. L’idée n’est-elle pas
ce qu’on attend d’elle si elle est le sommet de la pensée libérée de sa pre-
miére naiveté ? Comment a-t-elle pu tomber dans une naiveté qui lui serait
propre ? Il y a fort a parier que les théories atomiques contemporaines se
sont engouffrées dans cette naiveté pour la préciser derechef, et cette opéra-
tion s’est avérée si extraordinaire que les sujets qui y vivent en toute tran-
quillité sont pour ainsi dire des miraculés.
Vaste machine dont l’existence vaut en principe par soi, affranchie de la
vie des sujets qui s’efforcent de la comprendre, la nature mathématisée a
aboli tous les anciens priviléges d’une puissance hi¢rarchisée : le mouvement
d’un corps céleste ou sa composition chimique n’ont a priori rien d’excep-
tionnel vis-a-vis des corps ordinaires de mon environnement immédiat. Face
A cette indifférence, mon étre est double : d’une part il n’est pas différent de
tous les autres corps du monde, puisque le corps dans sa fonction physico-
chimique ne déroge pas en principe aux lois de la physique et de la chimie
connues par ailleurs ; mais d’autre part en tant que psyche il est capable de
poser librement des fins pour lui-méme, comme la maitrise de la nature. La
maniére scientifique de penser suggére que ce double caractére de 1’étre que
nous sommes n’est pas si génant qu’il y parait. Comme le disait Francis
Bacon dés l’aube de la révolution scientifique, la connaissance humaine et la
puissance humaine sont deux objets jumeaux qui ne demandent qu’a se réunir
en une seule chose. Or, pour arriver a cette unité qui justifie en derniére ana-
lyse l’indifférence de toutes les choses naturelles vis-a-vis d’une échelle de
valeurs, le sujet humain conserve paradoxalement une singularité que la
science ne saurait lui retirer : 4 savoir que tous les objets étant équivalents les
‘uns aux autres du point de vue ontologique, ils sont tous privés de finalité
propre, c’est-d-dire qu’ils sont infra-humains®. Une étoile est composée des
mémes éléments chimiques que moi, mais son étre manque de direction vis-
a-vis de fins que seul mon étre posséde. Si l’homme et sa psyché deviennent
A leur tour l’objet d’une exploration scientifique, comme dans la psychologie,
celle-ci en fait derechef un homme réduit en chose infra-humaine ; il en va de
méme si nétre étre est le produit d’une longue évolution naturelle qui l’a pré-
cédé. Dans tous les cas, qu’il s’agisse de physique, de psychologic ou de bio-
6. Voir H. Jonas, « The Practical Uses of Theory », The Phenomenon of Life, New York,
Harper & Row, 1966, pp. 188-210.
16 LA SCIENCE DANS LE MONDE DE LA VIE.
logie évolutionniste, la réduction du monde a l’infra~-humain est intenable dés
instant od la fin la plus éminente que l’homme se donne 4 lui-méme est jus-
tement l’intention de connaitre ce monde.
Si la science est un ensemble de techniques de calcul appliquées a la
nature pour en tirer la promesse d’une maitrise, elle asservit la nature a des
fins extérieures a elle, bien qu’en soi elle est pensée comme indifférente 4
toute fin. Elle n’est donc plus au clair sur ce qu’elle veut : un monde. sans
nous ou avec nous ? La science s’enorgueillit de découvrir un monde profond
d’oit l’expérience ordinaire jaillit comme une de ses manifestations possibles,
mais c’est une manifestation qui aurait pu ne pas étre. Le propre de cette
manifestation est donc d’entrer en concurrence avec d’autres dont nous
n’ayons et ne pouvons avoir aucune idée. C’est pourquoi, si pour des raisons
inhérentes sa méthode la science proclame la parfaite insignifiance de notre
atre propre au regard du monde qui l’intéresse, elle en est en méme temps
totalement dépendante quant a son sens. Que la vie en général puisse ne pas
tre, n’est-ce pas aussi une caractéristique de chaque vie que nous autres mor-
tels éprouvons trop bien ? La science n’a-t-elle pas transposé dans un monde
oi la singularité de la vie est insignifiante une dimension de ’existence qui
est parfaitement familiére ?
S’il en est ainsi, et méme s’il est construit pour prouver le contraire, le
monde objectivement vrai visé par la science n’est pas étranger au « monde
de la vie » dans lequel nous sommes depuis toujours. Au regard de ce que la
science veut effectivement, c’est ce monde de la vie qu’il s’agit d’interro-
ger. Au lieu de poursuivre une tache épistémologique dans le sillage de la
science, il s’agit méme de V’interroger pour la premiére fois, puisque c’est
le développement interne de la science qui l’a conduite 4 ne plus étre au
clair sur soi, C’est une tache a laquelle Husserl, le fondateur de la phéno-
ménologie transcendantale, s’est attelé avec acharnement dans sa derniére
grande période créatrice. Tache a reprendre aujourd’hui avec une vigueur
renouvelée par suite de l’obnubilation persistante de la science 4 se mettre
en régle vis-a-vis de ses droits et de ses devoirs.
Depuis le renversement copernicien, les sciences sont suffisamment
assurées dans leur visée de sens. Mon étre double est déja dédoublé dans sa
seule composante corporelle, puisqu’il suppose un sujet décentré du sol sur
lequel il vit. Au regard de ce transfert, le dédoublement de mon étre en
corps et psyché ne compte pas en soi, ou il compte seulement comme un
phénoméne parmi d’autres. A cette insignifiance, la phénoménologie
‘oppose un renversement copernicien qui n’ engage cette fois-ci que la philo-
sophie dans son cheminement propre : un renversement qui vis-a-vis des
sciences « ne change rien au contenu de ses résultats, mais en dégage le
INTRODUCTION 17
sens ultime »?. Mais comment un sens ultime pourrait-il valoir pour un
contenu essentiellement changeant en proportion du progrés dans les
connaissances ? Autre chose est la condition de vérification des énoncés
scientifiques dans des mondes que je pense mais oi je ne vis pas nécessaire-
ment, autre chose leur légitimation dans les possibilités du seul monde ot je
vis effectivement, sans réussir A les penser autrement que sur le mode de
L'imagination libre.
7, E, Husserl, Méditations cartésiennes, § 61, trad. G, Peiffer et E, Levinas, Paris,
J. Vrin, 1969, p. 126. Cité ci-aprés MC. Lorsqu’on a affaire & l'oeuvre d’un grand philo-
sophe, il est inutile, et c’est méme un pidge a éviter, d’étre obsédé par la chronologie et le
développement historique de sa pensée. Cette recommandation s’applique incontestable-
ment a l’ceuvre de Husserl qui va désormais nous servir de point d’appui pour comprendre la
seience dans le monde de la vie, méme et surtout lorsque nous serons portés au-dela de son
cuvre telle qu’elle nous est parvenue. Cette ceuvre est en effet traversée par des tendances
qui parfois se contrarient d’une maniére assez déconcertante. Mais c’est justement le propre
d'une grande euvre de se préter a des interprétations qui ne la circonscriront jamais. En ce
qui conceme plus particuliérement le monde de la vie et la science dans ce monde, elles
témoignent de sa capacité A confronter la science sur laquelle elle n’est pas en prise directe
au sens épistémologique habituel.
CHAPITRE 1
Grandeur et misére de l’épistémologie
EN AMONT DE LA THEORIE ET DE L’EXPERIENCE
Dans la science qui est advenue jusqu’d nous a la suite de la révolution
scientifique du dix-septiéme siécle, les conjectures théoriques prétendent étre
plus que de simples compte rendus de ce qui est directement et empirique-
ment vérifiable. Ces conjectures consistent 4 poser un certain nombre de
régularités dans les phénoménes, en méme temps qu’une série de processus
micro- et macroscopiques censés « expliquer » ces régularités. Mais ces
explications sont, dans le meilleur des cas, testables indirectement et donc
incomplétement. Qu’est-ce qui permet néanmoins de considérer les théories
de ce genre comme appropriées, ou capables d’expliquer ? bref de maintenir
ces explications comme des explications valables ? Les théories qui passent
le test expérimental avec succés sont considérées comme consistantes, com-
préhensives, systématiques, et méme souvent simples en tant que systéma-
tiques ; en outre elles fournissent une application empirique large et en
principe agrandissable au-dela de ce qui a été effectivement testé. Bref, si
elles passent le test, les théories sont considérées comme empiriquement adé-
quates. Cela reste vrai indépendamment de leur idéal d’explication : le critére
de V’adéquation empirique dépasse les modifications que les théories font
subir a cet idéal, comme par exemple la question de savoir si l’action phy-
sique est ultimement de type « corpuscule » ou « champ ». Mais si elles sont
empiriquement adéquates, c’est surtout parce qu’elles posent au moins l’exis-
tence d’une certaine structure causale, telle que les qualités éprouvées du
monde physique en sont un effet. L’explication qui porte sur une entité théo-
rique, aussi abstraite fit-elle, reste une explication causale pour laquelle
Vexistence de la chose invoquée théoriquement est une caractéristique
interne et inéliminable de la théorie. On peut parler de |’électron selon la
théorie de Bohr, selon celle de Rutherford, ou encore selon celle de Lorentz.
Reste toujours |’Electron, pour lequel il existe certes un grand nombre de
théories incomplétes et souvent en conflit les unes avec les autres. Si donc
certaines théories sont considérées comme empiriquement adéquates, cela
20 LA SCIENCE DANS LE MONDE DE LA VIE
tient finalement au fait qu’elles recélent en plus quelque vérité 4 propos du
monde naturel. Qu’est-ce qui justifie ce dernier saut de la puissance explica-
tive a la vérité ? Evidemment il est toujours possible de nier que le saut soit
une nécessité imposée par quelque relation intime avec la nature : ’adéqua-
tion entre un modéle et le réel pourrait se révéler fructueuse par pure coinci-
dence, A la suite d’un accident inexplicable qui s’insinuerait d’une maniére
mystérieuse et incontrélable dans Vintention d’expliquer. Différentes
réponses a cette question ont été suggérées, selon que la question est considé-
rée comme empirique, comme une question de langage, ou encore comme
une question pragmatique.
De nos jours le langage a pris le relais de la mesure pour définir la réalité
mathématisée comme une réalité linguistique : par exemple une chaise peut
étre n’importe quoi, comme en témoigne le design contemporain qui nous
met parfois en peine pour reconnaitre une chaise, mais elle est néanmoins
quelque chose qui « est » une chaise si dans l'usage que je fais du mot
« chaise » je réussis a me faire comprendre. En physique nous n’avons plus
affaire 4 des événements aussi clairement repérables, mais le réel ne serait
rien d’autre que le résultat d’une communication synchronisée a propos de
n’importe quel genre d’influence ou d’interaction attestée dans I’expérimen-
tation. Un mot vient-il 4 me manquer, alors qu’il existe pour une autre per-
sonne, l’existence du réel indiqué par ce mot s’en trouve relativisée mais non
supprimée!, Des deux tables d’Eddington qui menagaient de constituer deux
mondes séparés, et dont seul un mystérieux arriére-fond commun de toute
Vexpérience pouvait assurer le lien, il suffisait d’en parler pour que l’arriére-
fond passe a l’avant-plan et efface les traces de son mystére.
Aujourd’hui nous sommes si bien familiarisés avec des étres symbo-
liques comme les électrons qu’un physicien comme Penrose est loin des
scrupules d’Eddington et les range dans une méme catégorie ; le monde
physique, qui comprend tout aussi bien les électrons que les tables réelles?.
En avons-nous fini avec le spectre des deux mondes ? Pas du tout, et la
situation a méme empiré. Le monde physique est débordé de tous cétés, en
amont par les perceptions conscientes qui ont affaire 4 lui (le monde men-
tal), en aval par les formes astraites qui jouent un réle crucial dans son com-
portement (le monde mathématique). D’aprés Penrose, les perceptions
1, Telles sont les spéculations de S. Majid, “Quantum Spacetime and Physical Reality”,
On Space and Time, 64. 8. Majid, Cambridge, Cambridge University Press, 2008, pp. 137-138.
2, R. Penrose, Shadows of the Mind, Oxford, Oxford University Press, 1994, pp. 412-
414, Voir également la découverte des lois de I’univers, ttad. C. Laroche, Paris, O. Jacob,
2007, pp. 16-21 et 989-991
GRANDEUR ET MISERE DE L’EPISTEMOLOGIE 21
conscientes et les formes mathématiques constituent deux mondes a part
entiére, enchdssés autour d’un X qui serait le monde physique en tant que
tel. Trois mondes, autant de mystéres : comment se fait-il que les formes
mathématiques sont en rapport si étroit avec le monde physique ? comment
les tres percevants que nous sommes peuvent-ils sortir du monde physique
pour constituer un monde propre ? comment |’esprit imagine-t-il des
formes mathématiques abstraites ? comment ces formes relévent-elles du
monde physique ?
Penrose organise les relations mystérieuses entre les trois mondes selon
un ordre qui est lui-méme mystérieux, mais dont il ne parle pas comme un
mystére : la totalité (ou une partie) du monde mathématique régit le monde
physique ; le monde mental prend sa source (totalement ou en partie) dans
le monde physique ; la totalité (ou une partie) du monde mathématique est
du ressort du monde mental. Les trois mondes (mathématique, physique,
mental) suivent un cycle of chacun prend ses racines dans celui qui pré-
céde. Le cycle a sa raison dans le monde mathématique qui, a la différence
des deux autres, est caractérisé par l’idéal de vérité. Penrose garde une
confiance si forte dans la mathématique comme détentrice de l’idéal du vrai
qu’il est prét 4 admettre des notions mathématiques en physique qui a I’ave-
nir ne seront méme plus des équations au sens ot nous l’entendons encore
aujourd’hui. A cet égard, Penrose est un lointain héritier de cette démarche
épistémologique qui, 4 la suite de Hempel et surtout Carnap, a consisté &
envisager la structure de la science par analogie avec la structure d’un sys-
téme logique — une logique idéale de la croyance et de |’explication. Des
critéres normatifs ont été formulés, grace auxquels l’adéquation formelle et
la garantie rationnelle seraient assurées pour les propositions qui visent la
connaissance d’un phénoméne naturel ou leur capacité théorique a les
expliquer. Or, bien vite, cette démarche s’est heurtée a I’étonnante flexibi-
lité de la pratique scientifique ; lorsqu’elle réussit, celle-ci se démarque
souvent des canons de la procédure rationnelle, non seulement en ce qui
concerne le contexte de la découverte, mais aussi, ce qui est plus sérieux, en
ce qui concerne le contexte de la justification. L’histoire des sciences a eu
t6t fait d’exposer de plein fouet les critéres pour le moins versatiles et chan-
geants de ce qui est digne d’étre expliqué, de ce qu’est une bonne explica-
tion, et de ce qui compte comme preuve pour accepter une explication.
Feyerabend en a tiré la conclusion radicale que la science est fonci¢rement
irrationnelle, qu’elle ne se laisse pas du tout circonscrire dans un quel-
conque cadre normatif. A tout le moins, s’il est encore loisible de parler
d'une logique de la science, celle-ci sera pragmatique, opportuniste ; en
tout cas historiquement relative.
22 LA SCIENCE DANS LE MONDE DE LA VIE
Lirrationalité fait surgir le spectre de critéres extra-scientifiques au cceur
de la science, de sorte que par sa rigueur exemplaire la science n’aurait plus
que l’apparence de se distinguer d'autres domaines. C’est ainsi qu’une autre
démarche s’est proposé de construire la science de la nature comme une
forme de vie : une variété de techniques destinée 4 résoudre des problémes
d’ordre empirique ou conceptuel. Dans son association étroite avec 1’inter-
vention et le contréle expérimental, la science révéle le contexte pratique de
son investigation de la nature. Pratiquement elle s’accommode ainsi d’idéaux
changeants d’explication, souvent en conflit les uns avec les autres.
Comment rendre compte fidélement de la riche variété des problémes et des
multiples configurations adoptées pour résoudre les problémes ? Kuhn a
montré comment la science progresse en un sens historique. Elle élargit ses
techniques expérimentales et théoriques pour résoudre des problémes en sus-
pens, pour en poser et résoudre de nouveaux. De ce point de vue, la science
rest plus le paradigme d’une poursuite rationnelle de la vérité. Elle reste une
activité rationnelle, mais au sens d’une technique capable d’amélioration pro-
gressive simplement en tant que technique. Bref, comme l’a remarqué
Laudan, la science est une activité rationnelle qui ne préjuge cependant pas
de la vérité des théories que nous jugeons rationnelles ou irrationnelles. De
méme, développant une version purement instrumentaliste de la science qui a
été mise en ceuvre au début du vingtiéme siécle par Duhem, I’empirisme
constructif d’un van Fraassen se refuse 4 considérer les théories scientifiques
comme étant vraies dans un sens « profond » ; notre appréciation de leur
valeur est confinée a leur précision empirique.
Le passage du critére d’adéquation au critére de vérité se préte a une diffi-
culté de principe, souvent contournée ou prétendument résolue, mais en tout
cas jamais éliminée. En tant que critique exemplaire du réalisme scientifique,
V’épistémologie de Duhem en est certainement la plus représentative et la
phus significative. D’aprés son schéma, le prototype de I’explication valable
serait fourni par l’exemple des théories acoustiques, dans la mesure oi le réel
qui y est décrit théoriquement (un mouvement périodique trés petit et trés
rapide) est lui-méme accessible a l’observation3. Mais dans le cas plus géné-
ral (comme I’éther en optique) une explication se congoit comme un moyen
pour traverser les apparences et dépasser les données sensibles de l’observa-
tion ou de I’expérimentation pour accéder a un autre ordre des choses. Quand
une théorie réussit 4 « sauver les phénoménes », le réaliste est prét a en infé-
rer que les lois de cette théorie sont vraies (ou presque vraies) et que les enti-
3. P, Duhem, La Théorie physique. Son objet et sa structure, 2° édition, Paris, J. Vrin,
1989, p. 5
GRANDEUR ET MISERE DE L’EPISTEMOLOGIE 23
tés auxquelles elle se référe existent vraiment ; mais le succés de la théorie se
limite précisément a ne croire que cela et rien que cela, a savoir qu’elle sauve
Jes phénoménes. Affirmer que la théorie est vraie est une hypothése addition-
nelle mais gratuite. Duhem n’a donc rien 4 opposer aux lois phénoménolo-
giques qui peuvent étre confirmées par des méthodes inductives. Il s’oppose
plutét aux lois théoriques dans la mesure ot elles seraient fondées sur leur
capacité 4 inférer des explications meilleures que d’autres. Son argument
contre ce type d’inférence arréte la science devant le mur de l’explication :
pour un ensemble donné de phénoménes organisé d’une certaine maniére, il y
aura en principe toujours plus qu’une explication également satisfaisante, et
quelques-unes au moins parmi ces explications seront incompatibles entre
elles. Comme elles ne peuvent pas étre vraies toutes ensemble, la vérité, si
elle existe, est indépendante de l’explication — aussi « satisfaisante » que soit
cette explication,
La multiplicité des explications plausibles 4 propos d’un ensemble orga-
nisé de phénoménes les frappe toutes de nullité comme explications, parce
qu’elles se heurtent a la multiplicité irréductible du sens qui touche déja la
simple organisation des phénoménes avant qu’il soit question d’ explication.
Un exemple discuté par Duhem est le passage inductif des lois de Kepler a la
théorie de la gravitation newtonienne. La gravitation universelle n’est pas
une généralisation des lois de Kepler. Au contraire elle est incompatible avec
ces lois. Les propositions de Newton ne peuvent étre comprises comme des
conclusions inférées de lois expérimentales. Plus précisément : si Newton a
(pense avoir) effectué une généralisation A partir des lois de Kepler, c’est
quwil a traduit ces lois dans son langage : « Pour qu’elles acquiérent cette
fécondité, i] faut qu’elles soient transformées »*. Une fois utilisées ou tra-
duites symboliquement dans le cadre conceptuel de Newton, les lois de
Kepler acquiérent une nouvelle signification. C’est l’adhésion 4 un nouveau
cadre théorique qui pour Duhem donne un nouveau sens aux mots de la loi :
«La traduction des lois de Kepler en lois symboliques supposait l’adhésion
préalable du physicien & tout un ensemble d’hypothéses »°. L’avénement
d'une nouvelle théorie équivaut 4 un changement dans I’usage et la significa-
tion des mots, ainsi que la traduction des lois et des faits précédemment
admis dans ce nouveau langage. Et Duhem de préciser : « Les lois de Kepler,
transportées dans le cadre de la mécanique newtonienne, c’est-d-dire dans un
contexte dominé par les notions de force et de masse, prennent un sens tota-
lement différent ». Dés lors, la question devient pressante de savoir si effecti-
4, bid, p.278.
5. Ibid.,p. 296.
24 LA SCIENCE DANS LE MONDE DE LA VIE
vement la totalité du sens accordée au monde physique est touchée chaque
fois @ la suite d’un recadrage théorique. En principe elle devrait I’étre en
vertu de ce que signifie une rencontre entre la théorie et l’expérience : la
théorie ne touche effectivement que le phénoméne et le monde phénoménal
dans lequel il s’inscrit, sans prétention & l’explication de ses causes cachées,
car c’est toute la masse théorique (optique, dynamique, thermodynamique,
etc.) qui est déja convoquée 4 l’occasion de la mise en question d’un seul
phénoméne. Le sens est-il bouleversé au point d’engager aussi loin que tout
un monde, de sorte que Kepler et Newton n’habitaient pas le méme monde,
comme |’a suggéré Kuhn en radicalisant la these de Duhem ?
Le couple indissociable constitué par la théorie et l’expérience se recon-
nait dans plusieurs mondes de sens différents les uns des autres, et pourtant il
n’y aqu’un monde naturel qui intéresse la conscience scientifique. La ques-
tion du sens ne peut donc éviter la question de savoir ce qui se trouve chaque
fois en amont du couple, qui soit-susceptible de mettre en mouvement la
conscience scientifique. A ce niveau, est-il encore admissible que la vérité
soit un ingrédient extérieur l’explication ? En amont du couple Duhem
trouve tout simplement le bon sens, ou le sens commun. La constatation de
bon sens peut-elle rivaliser avec l’exigence du sens ? Par un pressentiment
qui la guide souterrainement, la physique évoluerait progressivement et tou-
jours dans la méme direction comme se développe une unité dans une univer-
salité de plus en plus étendue. Le bon sens prend ainsi la place dévolue jadis
des premiers principes de style métaphysique d’ov sortent les prétentions
illusoires a l’explication. Si Duhem rabaisse le besoin d’explication @ un
moment finalement inutile dans la constitution d’une théorie, le bon sens
répond 4 un autre besoin, a savoir une « aspiration impossible étouffer », ou
encore « un sentiment surgi en nous avec une force invincible »®, Mais le
besoin d’explication n’est-il pas tout aussi bien l’habit du bon sens sous ses
meilleurs atours, la seule force qui soit au diapason d’une force invincible
située en amont de la théorie et de l’expérience ?
Lattitude phénoménaliste ou phénoméniste de Duhem n’est pas étran-
gére A une sorte de positivisme méthodique, particuliérement en vogue dans
la deuxiéme moitié du dix-neuviéme siécle A propos de la question de
savoir si les atomes existent réellement comme constituants ultimes de la
matiére. Kirchhoff demandait ainsi A la physique de se limiter a indiquer
quels sont les phénoménes qui se produisent effectivement dans la nature,
sans aller aussi loin que découvrir leurs causes. Mais nonobstant l’agnosti-
6. Ibid., pp. 148-154.
GRANDEUR ET MISERE DE L’EPISTEMOLOGIE 25
cisme sur les causes, Boltzmann a bien vu que la théorie physique se définit
par sa capacité 4 suppléer 1 o& précisément les phénomenes sont man-
quants ; I’ignorance des causes ne lui permet pas de se fier & un tissu des
phénoménes qui parlerait de Iui-méme. A la suite de Maxwell et Hertz,
Boltzmann s’appuie sur la notion métathéorique d’image (Bild), ou modéle,
pour montrer que des constructions mentales fournissent les outils qui per-
mettent de compléter la connaissance glanée par des moyens empiriques.
Vopération mentale de construction par images finit par transcender |’ex-
périence : elle consiste en effet ajouter quelque chose a l’expérience et
oréer quelque chose qui n’est pas l’expérience, de sorte qu’elle peut repré-
senter plusieurs expériences et les organiser d’une certaine maniére. Le rai-
sonnement de Duhem porte plutét sur la multiplication anarchique des
interprétations des lois aprés que les phénoménes aient déja été organisés
d’une certaine maniére, sans voir que cette premiére organisation est déja
une interprétation.
Certes Duhem concéde que le physicien ne se prive pas d’imaginer des
modéles empruntés A l’imagination sensible pour simuler les propriétés du
réel grace 4 un ensemble de phénoménes concrets. Mais au-dela de la
construction utilitaire de modéles, le véritable but de l’opération serait la
découverte d’analogies entre classes distinctes de phénoménes qui consti-
tuent la nature. Un modéle glisse sur le phénoméne pour le pénétrer par le
biais d’un phénoméne qui lui serait « naturellement » associ
Aujourd’hui le besoin d’explication des réalités objectives s’est avéré
d’autant plus invincible qu’il est devenu inséparable d’un autre genre de réa-
lité, a savoir celle du sujet connaissant, En effet, a chaque échelle ot se porte
Vobservation, nos capacités d’analyse demeurent plus ou moins identiques.
Pourtant la réalité ne cesse de gagner en complexité au fur et 4 mesure qu’on
s’efforce de la reconstruire a différentes échelles selon un schéma déductif.
D’oti la nécessité de procéder a des simplifications drastiques du réel chaque
fois qu’un niveau organisation complexe impose sa propre légitimité7.
Léchelle d’observation produit des cassures dans l’ordre de I’analyse la ot
Duhem tablait encore sur une analogie universelle.
Ce hiatus entre les capacités du sujet et la complexité du monde naturel
qui s’impose relance la question de savoir si la science progresse encore en
tant que connaissance naturelle. La tentation est grande de s’en remettre a
un regard purement anthropologique sur la maniére par laquelle la science
procéde effectivement : la science cultive ses pratiques en les validant dans
7. Voir O. Rey, Itinéraire de I’égarement. Du réle de la science dans I’absurdité contem-
poraine, Paris, Le Seuil, 2003, pp. 228 sq.
26 LA SCIENCE DANS LE MONDE DE LA VIE
le cadre de systémes de représentation légués par une tradition, et ces sys-
témes fonctionnent comme un tribunal qui accorde ou refuse la validation
des pratiques®.
OU EST PASSEE LA NATURE ?
La grande analogie universelle de la nature n’est pas absolument fiable.
Newton en a déja fait une régle pour I’étude de la nature : il n’y a pas de
garantie métaphysique contre les exceptions. Méme un principe trés général
et trés clair induit A partir des phénoménes, sans y ajouter des hypotheses
simplement « révées » ou fabriquées pour les besoins d'une cause, ne sera
jamais absolument certain ; une vérification expérimentale constante est exi-
gée pour voir si le principe n’est pas malgré tout sujet 4 des exceptions, qui
pourraient s’avérer fatales. La science s’accommode ainsi de ses échecs
annoncés au point d’y trouver sa plus puissante justification : la faillite
annoncée d’une théorie considérée comme « vraie » est garante de sa fiabi-
lité. Comme I’a dit Popper, une théorie finit par s’imposer au détriment d’une
autre lorsque son pouvoir falsificateur est plus grand que sa concurrente.
Pour s’y conformer, le praticien de la science est celui qui essaie et imagine
les hypothéses les plus audacieuses, parce que les plus improbables, pour leur
faire passer le test de l’expérience. La science serait constamment extra-ordi-
naire, au sens littéral : au bord de la rupture. Une hypothése ne sera jamais
confirmée, mais au moins corroborée pour un temps si elle résiste a un
nombre croissant de tests les plus sévéres. La science consiste a élaborer des
hypothéses dont le contenu empirique augmente en proportion de leur impro-
babilité. Elle est quand méme un pari pour le meilleur, car selon une observa-
tion pertinente de Lakatos, la falsification d’une théorie existante n’a aucun
sens si une théorie meilleure n’a pas déja émergé auparavant pour la mettre
en question.
Dans ces conditions, aussi utiles et éclairantes que soient chacune des
démarches épistémologiques, tant pour la pratique de la science que pour ses
visées théoriques, on s’apergoit tout a coup que le souci de la science envers
le monde naturel devient une sorte d’anomalie. Rien dans les démarches épis-
témologiques, si révolutionnaires soient-elles, ne permet plus de rendre
compte de ce souci. La science progresse-t-elle encore en tant que connais-
sance naturelle ? Non seulement cette question tombe dans le vide, son oubli
8. Voir P. Jorion, Comment la vérité et la réalité furent inventées, Paris, Gallimard, 2009,
p. 328.
GRANDEUR ET MISERE DE L’EPISTEMOLOGIE 27
est méme devenu critére du progrés scientifique. Loin de tenir dans le simple
combat d’une théorie contre une autre, avec la promesse d’une victoire de
Lune sur l’autre, le progrés du discours scientifique est mesuré par des séries
de théories qui s’emboitent les unes dans les autres selon ce que Lakatos
appelle une « heuristique positive »?. Chaque série est incamée dans un pro-
gramme de recherche, construit autour d’un « noyau dur » qui constitue le
fond de sa représentation du monde. A toute époque, divers programmes sont
en conflit les uns avec les autres, parce qu’il n’y a jamais de test expérimen-
tal absolument décisif pour les départager. Comment expliquer que certains
programmes paraissent progressifs, alors que d’autres sont plutét considérés
comme dégénératifs ? Chaque programme se fabrique une ceinture de protec-
tion autour de son noyau dur, ce qui est toujours permis puisque ce noyau
reste impossible a frapper directement : cette ceinture consiste 4 suggérer des
faits nouveaux, en principe vérifiables, tels que le noyau soit préservé. Mais
pour chaque série de théories, cette stratégie est soit progressive soit dégéné-
rative : progressive si la série se distingue par sa capacité A produire effecti-
vement des faits nouveaux, dégénérative si la protection est purement
défensive et met en place des hypothéses ad hoc incapables de prédire
quelque chose d’effectivement nouveau. Les deux types de séries ne sont pas
complétement étanches les uns vis-a-vis des autres ; ainsi une série dégénéra-
tive peut resurgir comme progressive si a son tour elle prédit des faits nou-
veaux, par exemple au moyen d’hypothéses auxiliaires. Dans tous les cas, un
fait nouveau est typiquement un produit théorique, relatif 4 une théorie don-
née, a propos duquel il n’y a plus de sens a se demander s’il est une donnée
proprement naturelle. La réponse a la question de savoir s’il est une donnée
naturelle exigerait de posséder d’avance une théorie meilleure que n’importe
quelle théorie existante ou a venir. Pourtant, l’intention primordiale de la
science n’est-elle pas toujours de comprendre le monde naturel en tant que
tel, de se tenir 4 son écoute avant que la théorie ne s’en méle ?
LE NATURALISME PRIS AU PIEGE
La discipline naturaliste de la physique a fini par nous donner une image
du monde ou non seulement la vie consciente, mais aussi toute vie quelle
qu’elle soit, apparait d’une maniére contingente aprés un certain temps de
9. 1. Lakatos, « Falsification and the Methodology of Scientific Research Programmes »,
1. Lakatos et A. Musgrave (éds), Criticism and the Growth of Knowledge, Cambridge
University Press, 1970,
28 LA SCIENCE DANS LE MONDE DE LA VIE
Vhistoire cosmique : une nébuleuse originelle, suivie de la formation des
étoiles et des systémes planétaires, la réunion imprévisible des conditions
favorables a la vie sur l’une des planétes du systéme solaire, "histoire des
espéces, jusqu’a l’apparition de la vie consciente d’elle-méme chez les indi-
vidus que nous sommes!®. Cela revient 4 ouvrir une constellation de pos-
sibles qui rivalisent en images plus ou moins fantastiques et inquiétantes :
une nature entiérement privée d’organismes, d’animaux, d’étres humains ;
une disparition pure et simple de toute trace de vie ; ou encore sa perpétuation
suivant des formes totalement inconnues pour répondre aux défis biologiques
a venir. Cette hypothése jette-t-elle une lumiére sur les faits naturels tels que
nous en faisons l’expérience ? Si I’existence autre que celle qui est donnée
est en effet un genre d’hypothése dont la science a déja fait de multiples pro-
fits depuis la révolution copernicienne (les théories réellement fécondes
ront-elles pas été précédées d’« expériences mentales », comme les appelait
Mach, oi les traits essentiels de la nature qui prétendent a la légalité se déga-
gent des autres par une libre variation des facteurs concourant 4 un résultat,
conférant une détermination 4 des objets ou des événements seulement pos-
sibles ?), la possibilité de la non-existence d’une vie, ou méme de toute vie,
ne rend-elle pas d’avance vaine toute projection des catégories humaines sur
une nature décidément jalouse des regards posés sur elle ? Le naturalisme,
quand il devient conscient de soi en tant qu’attitude avant de se poser en doc-
trine, démontre ici la précarité de sa propre raison d’étre. Le moment ou la
causalité physique devient inefficace quant a l’émergence de la vie elle-
méme n’est-il pas fatal 4 toute la maniére naturaliste de penser ?
Inversement, l’anthropologie qui explore l’existence humaine au moyen
de catégories naturelles aboutit a retirer 4 celles-ci la puissance qu’on leur
préte pour commencer!!, Ce que la nature dépose en l’homme n’a rien a voir
avec les déterminations anthropologiques sur lesquelles repose le style pro-
prement humain d’existence. Au contraire, ces déterminations s’ouvrent
comme possibilités insignes par suite du retrait des déterminations naturelles,
c’est-a-dire la mise 4 distance des formules fonctionnelles du vivant qui
enferment dans la répétition et la dépendance aux régulations propres 4
Pordre biologique. L’espace libre ainsi ouvert par le retrait des contraintes
biologiques dévoile les capacités de réflexion dont une conscience est
10. Voir l’essai de H. Jonas, « Matiére, esprit et création. Constat cosmologique et hypo-
thése cosmogonique », Evolution et liberté, trad. S, Comille et P. Ivernel, Paris, Rivages, 2000,
pp. 193-260,
11, Voir A. Leroi-Gourhan, Le geste et la parole. Technique et langage, Paris, A. Michel,
1964,
GRANDEUR ET MISERE DE L'EPISTEMOLOGIE 29
capable. Si la naturalisation de existence humaine fait peser sur celle-ci une
menace oii il y va de sa possibilité, ’humanisation du matériau naturel qui
fait I’étoffe du vivant dénaturalise ce matériau.
Entre les exigences de la nature, que l’existence humaine repousse pour
s’affirmer comme essentiellement humaine, et les exigences de l’humain, que
Ja nature peut encore annuler, la place d’une science de la nature vis-a-vis de
notre vie est de moins en moins claire.
Au minimum il existe une correspondance apparemment indéniable entre
certains événements du monde physique et certains états des parties de notre
corps que nous appelons « mentaux ». De cette correspondance Mach tirait
déja le projet d’une physique au sens élargi. La physique au sens élargi inclut
le corps et son fonctionnement dans une physiologie des sens qui, au lieu de
constituer un autre domaine de I’expérience, élargit celui de la physique en lui
assignant de nouveaux buts. Par exemple la couleur est un objet physique au
sens étroit lorsqu’ elle est étudiée dans sa dépendance causale et fonctionnelle
vis-d-vis des sources lumineuses, mais en rapport aux propriétés physiques de
ceil et du systéme nerveux central elle est objet physique au sens élargi.
Pourtant, l’abime qui continue a séparer la chose naturelle de sa représentation
mentale familiére est signalé par l’expérience irréductible de l’intériorité
qu’un sujet conscient a de lui-méme. Ici, rien de plus difficile a penser qu'une
causalité qui s*annule, comme la vie qui aurait pu ne pas advenir. Rien de plus
obscur que la capacité qu’a un sujet, avant de se poser la question de sa propre
vie et ensuite celle de la vie, de vivre sa propre auto-détermination, peut-étre 4
contre-courant de la chaine des événements naturels. Or, au démenti insistant
opposé par l’intériorité a sa représentation physicaliste, ne faut-il pas en outre
que I’ expérience de I’extériorité oppose A son tour une résistance a la maniére
par laquelle l’intériorité se prend pour un moment absolu ? Le sujet qui
découvre son intériorité sans fond est le méme que celui qui établit les lois de
Ja nature par-dela l’opacité apparente des choses. La profondeur de 1’expé-
rience intérieure pourra étre minimisée tant qu’on voudra, quelque chose de
cette intériorité se répercutera toujours sur la maniére par laquelle le monde
extérieur est rendu intelligible. L’idéologie scientifique concéde assez facile-
ment que par principe la conscience n’est pas un moment de la nature compa-
rable 4 n’importe quel autre. La perception intérieure n’est-elle pas cependant
un simple épiphénoméne, dont I’épaisseur ne menacerait l’idéal objectiviste
que pour un sujet qui réfléchissant sur lui-méme se prendrait pour un moment
absolu ? Moyennant un effort d’humilité, l’expérience apparemment irréduc-
tible qu’un sujet a de son petit monde intérieur ne devrait pas entraver sa
réflexion tournée vers le monde extérieur. A Ja limite, de la méme maniére que
la matiére et tous les phénoménes naturels paraissent fractionnables a volonté,
30 LA SCIENCE DANS LE MONDE DE LA VIE
le phénoméne de conscience serait ainsi indéfiniment réductible a zéro, s’effa-
gant pour permettre aux autres phénoménes de s’étaler en vraie grandeur.
Or, si les lois de la nature sont conformes au naturalisme évolutionniste, la
correspondance entre le physique et le mental doit étre évaluée comme une
sorte de balance qui fait la part des choses. Imaginons d’abord que la balance
penche du cété mental. Dans ce cas, avant que la conscience existe, le monde
physique n’existait pas ou existait d’une maniére totalement déstructurée.
Cette interprétation est suggérée par la découverte des constantes fondamen-
tales de l’univers, qui semblent si étroitement ajustées les unes aux autres que
le plus petit changement empécherait l’apparition ou I’évolution de la vie et
donc aussi de la conscience. Cela revient a faire confiance 4 un miracle en soi
incompréhensible qui nous tombe pour ainsi dire dessus, sans lequel aucune
compréhension ne serait pourtant possible. Pour rendre compte de cette situa-
tion au moyen d’hypothéses scientifiques plausibles, il faudrait remonter &
des conditions initiales qui prévalaient avant I’émergence de la conscience,
c’est-a-dire en un temps ou l’univers n’existait pas ou existait sans aucune
structure. N’est-il pas plus conforme 4 une expérience mentale comme la
compréhension de penser qu’elle travaille elle-méme a élaborer des théories
inintelligibles pour la conscience commune afin de venir 4 bout de l’entéte-
ment de certains faits irréductibles ? Une théorie comme la mécanique quan-
tique se heurte 4 des obstacles si extraordinaires, elle est si étrangére au
monde dont nous faisons effectivement l’expérience, qu’il parait « naturel »
de renvoyer ces obstacles 4 une réalité indépendante de toute conscience.
Mais que signifie alors, pour une conscience, de se rapporter a quelque
chose qui est indépendant de la conscience ? La question est aussi ancienne
que l’idée méme de science, dont la science mathématique de la nature est la
derniére mouture.
UN MONDE DE QUALITES
Galilée a formulé avec insistance l’idéal mécaniste de la science, lorsqu’il a
pris la décision que certaines qualités attribuées aux corps, comme la couleur,
le son ou l’odeur, ne contraignent pas la raison : ces qualités dites « secondes »
résident essentiellement dans le corps vivant qui les pergoit par l’intermédiaire
de certaines sensations, « de sorte qu’une fois l’animal supprimé, [ces sensa-
tions] se retrouveraient elles-mémes supprimées et annihilées »!2, Un corps
12. Galilée, L’Essayeur, trad. M. Clavelin, La Philosophie naturelle de Galilée, Paris,
A. Colin, 1968, p. 438.
GRANDEUR ET MISERE DE L’EPISTEMOLOGIE Sil
vivant est un certain corps matériel, et il subsiste comme n’importe quel corps
matériel si la vie lui en est retirée. C’est pourquoi, dés que je me représente un
corps matériel, ma raison est amenée A lui attribuer des déterminations que le
plus gros effort d’imagination ne pourrait lui enlever : telles sont les qualités
dites « premiéres », mathématisables, comme le fait de circonscrire un certain
espace et d’avoir unc certaine forme, d’étre en mouvement, etc. Les qualités
premiéres nous apparaissent comme elles sont réellement : des objets ronds
nous apparaissent ronds simplement parce qu’ils sont ronds. Par contre la fagon
dont les qualités secondes nous apparaissent ne ressemble en rien aux objets
qui causent ces apparences : des objets rouges apparaissent rouges en raison de
Ja maniére par laquelle leurs atomes de surface absorbent et réfléchissent la
lumiére : cette cause n’a aucun rapport intelligible avec I’apparence qui est
pourtant son effet. Considérées comme causes, les qualités premiéres ne sont
méme plus tenues d’apparaitre : les qualités secondes sont pergues par I’inter-
médiaire de certaines sensations causées par contact avec des corpuscules trés
petits mais néanmoins doués de forme et de grandeur déterminées.
Imbue de son idéal objectiviste, la science demande de croire que la
lumiére qui baigne ma chambre n’est pas ce jeu d’ombre et de clarté que je
vois avec mes propres yeux, mais plutét un ensemble de longueurs d’onde
organisées selon les lois de I’électromagnétisme : & telle couleur que je per-
ois correspond une certaine fréquence de l’onde. Or la fréquence elle-méme
ignore tout de ce qu’est une couleur percue, une longueur d’onde n’est pas
colorée et ne sait rien de l’expérience vécue d’une couleur telle qu’elle se
produit aprés son passage et son filtrage dans notre équipement sensoriel. Cet
écart souléve la question de savoir ce que réalise effectivement la correspon-
dance. En quoi désigne-t-elle une causalité ? A cette énigme, la science
rétorque qu’elle ne vaut que pour un sens commun mal informé. Les lois
électromagnétiques ne sont pas des lois de la matiére, mais du champ.
D’aprés ces lois il existe un champ d’ondes entre une source de lumiére et
une surface éclairée, et ce champ existe en dépit des apparences qui ne mon-
trent rien de tel, puisqu’il nous semble voir les objets directement. Nos
organes sensoriels ne détectent pas la lumiére comme une onde ; l’onde est
une construction théorique, alors méme que la lumiére étant réfléchie par les
objets, nous ne voyons en fait que le champ et non les objets directement. La
correspondance entre une valeur numérique et une perception n’établit pas un
lien objectif, car pour prouver ce lien il nous faudrait faire I’expérience d’un
« fait théorique » qui se substitue au « fait sensible ». Cette circonstance
démontre que pour les qualités premiéres, en plus de ne pas apparaitre du tout
ou d’apparaitre comme elles sont, il y a une maniére spécifique de ne pas
apparaitre alors qu’elles devraient apparaitre.
32 LA SCIENCE DANS LE MONDE DE LA VIE
Comme l’avait déja remarqué Duhem & propos du principe d’explica-
tion, la perception du son ne cadre pas avec celle de la couleur. La percep-
tion d’un son distingue entre des sons simples et des sons composés.
Chaque son simple posséde une hauteur définie, et les hauteurs se distri-
buent selon une échelle unidimensionnelle de bas en haut. Il est actuelle-
ment établi que cette échelle traduit une échelle unidimensionnelle des
longueurs d’onde des ondes sonores extérieures a nous, étant entendu que
la premiére ne couvre qu’une partie de la deuxiéme puisqu’elle exclut des
sons trop hauts ou trop bas pour étre audibles par nous. Par contre, notre
perception des couleurs n’admet aucune distinction entre des couleurs
simples et des couleurs complexes. Les couleurs différent entre elles par
leurs nuances, mais la variété des nuances n’est pas répercutée dans une
échelle unidimensionnelle. Leurs relations sont représentées convention-
nellement dans une carte 4 deux dimensions dont la topologie est la surface
d'une sphére. Cette maniére d’ordonner les nuances ne traduit aucun fait
relatif aux longueurs d’onde des ondes de lumiére qui en sont la cause pré-
sumée. II n’existe pas de relation simple entre les différentes nuances et les
différentes combinaisons d’ondes lumineuses qui frappent 1’ceil ; de fait,
plusieurs combinaisons différentes produiront la méme nuance. Pour étre
plus complexe qu’il y paraissait d’abord, I’expérience vécue d’une couleur
est mise en question quant a une causalité objective qui lui correspondrait.
Mais n’est-il pas ridicule de mettre en doute le procédé scientifique de
recherche des causes objectives qui a déja fait ses preuves en d’innom-
brables occasions ? Pour assurer a coup stir l’efficacité de l’opération
contre les protestations de l’expérience sensible, il faut, comme |’a bien vu
Descartes dans la premiére de ses Méditations, que je puisse me croire tou-
jours attaché 4 ma propre pensée lorsque « je me considérerai moi-méme
comme n’ayant point de mains, point d’yeux, point de chair, point de sang,
comme n’ayant aucun sens », C’est bien entendu une croyance fausse de se
considérer ainsi, d’od la question de savoir ce que je crois en effet lorsque
je me crois encore attaché 4 ma pensée en mutilant mon corps. Ai-je en moi
le pouvoir de croire a ce qui est faux, afin de me mettre ainsi en connais-
sance de cause au service de ce qui est vrai, ou bien suis-je victime d’un
malin génie, « non moins rusé et trompeur que puissant, qui a employé
toute son industrie a me tromper » ?
GRANDEUR ET MISERE DE L’EPISTEMOLOGIE 33
HUMILIANTE HUMILITE
La volonté de vérité propre 4 la science moderne est tout entiére traversée
par le souci de ne pas se laisser tromper, que ce soit par une puissance malé-
fique ou par des apparences superficielles qui nous feraient voir ce qui n’est
pas. Elle est donc tout aussi bien désir de se rendre fidéle 4 un « autre
monde » qui se tient derriére ou au-dela, en tout cas un monde de substitution
al’écart de tout ce que nous voyons avec nos propres yeux ; ne pas se laisser
tromper par ce que je crois connaitre dans ce monde-ci, c’est, dit Nietzsche,
volonté de ne pas tromper ce qui reste A connaitre dans ce monde-la.
Souvenons-nous du respect total de Newton envers l’exception.
Comme |’a bien compris Nietzsche, dés lors que le malin génie est avec
nous, on ne peut plus jamais vraiment se débarrasser de lui, et sa présence
persistante finit par inquiéter sans espoir de rémission. La puissance malé-
fique qui guette procure une raison d’étre constamment renouvelée a toutes
les victoires remportées sur elle. A force de vérifier et d’abandonner des
hypothéses provisoires, la discipline scientifique voudrait s’interdire toute
conviction péremptoire, en quoi la volonté de vérité, incapable de s’assumer
elle-méme comme conviction, s’aveugle sur son propre compte et dévoile au
grand jour une fatale ambiguité sur son sens. Victime d’un étrange dédouble-
ment de la personnalité, le praticien de la science se croit maitre du malin
génie qui est sa créature, et pourtant il tombe sous la coupe de ce démon
chaque fois qu’il croit déjouer ses tours perfides au nom de la réalisation pro-
chaine de son but. La sacro-sainte volonté de vérité est finalement travaillée a
son insu par le souci d’une dépossession de soi — une souterraine, irréductible
volonté de mort!3,
Le destin de la discipline scientifique moderne est un raccourci du destin
qui affecte toute la culture. Si en effet le plus durable mensonge sur soi est la
croyance que la vérité est vérité divine, et si « Dieu est mort » a force de
suivre l’idéal du vrai d’une manitre de plus en plus rigoureuse!4, la science
ne peut que constater qu’un dieu de la modernité comme Galilée est, lui
aussi, mort. L’homme qui a porté a bout de bras tout le poids de la révolution
scientifique est un étre qui, au nom du Livre de la Nature qu’il est toujours
plus urgent de déchiffrer, a sacrifié le besoin de se comprendre lui-méme — il
a renoncé a la valeur de son intériorité vivante. Au contact des « Grandes
13. F, Nietzsche, Le Gai Savoir, § 344.
14, Ibid., § 125 et § 357.
34 LA SCIENCE DANS LE MONDE DE LA VIE
Choses », comme dit Musil, l’intériorité personnelle se fait d’autant plus insi-
gnifiante que les choses sont grandes!5,
Mais plus la conscience s’efface pour se mettre au service de la Nature,
d’autant moins peut-elle éviter de se mettre en question comme conscience
purement rationnelle. Par la bouche de Sagredo, dans un texte célébre, Galilée
évoque le sculpteur qui a transformé un bloc de marbre en un Hercule ou un
Jupiter si admirable de force et de vie, que V’artiste en est venu a éprouver la
peur de le retoucher ou méme de le regarder!®, De méme, la science n’a-t-elle
pas fagonné la matiére autour de nous en une image inquictante de nous-méme,
une puissance qui inspire de la terreur A force de se rendre intouchable ?
Etrange ironie de Vhistoire. Kepler avait donné le ton en comparant le
désir du savoir pour le savoir a la jouissance jamais repue procurée par une
nourriture toujours abondante ; celui qui n’est pas porté par le désir frén
tique et constamment renouvelé du savoir resemble plus 4 un mort qu’a un
vivant. Mais chez Galilée pointe-déja l’inquiétude, certes encore masquée par
un franc enthousiasme et un refus de la volonté déraisonnable de vivre.
Galilée était convaincu que la physique mathématique moderne allait ouvrir
espace d’une extraordinaire réconciliation entre "homme et la nature. II
attribue 4 tous les corps célestes cette altérabilité et corruptibilité qui sont
Vapanage de la condition terrestre, et cette transposition confére aux cieux
Vauthentique noblesse et la dignité que les Aristotéliciens avaient cherchées
en vain dans la soi-disant immuable perfection céleste. L’enthousiasme de
Galilée pour ce renouvellement universel de l’imparfait et du transitoire le
conduit 4 mépriser les limites naturelles de la vie : « Ceux qui placent si haut
Vincorruptibilité, l’inaltérabilité, etc., en arrivent, je crois, 4 dire cela parce
qu’ils souhaitent vivre encore longtemps ; ils ont peur de la mort »!7. La
sagesse de Galilée devant la mort ne va pas sans rappeler la résolution des
atomistes de l’Antiquité : seule la mort est éternelle. Mais cette sagesse est-
elle compatible avec la science moderne, la physique est-elle restée ce qu’elle
était pour eux, a savoir une éthique de la mesure avec l’ordre cosmique ?
Lincorruptibilité et ’inaltérabilité dont Galilée se méfie, il les transpose
dans les lois mathématiques de la nature. D’oi ce paradoxe : l’esprit projette
sur la nature 4 la fois l’immutabilité des lois mathématiques et la fragilité de
la vie qui soutient cet esprit. C’est pourquoi l’idéal du progrés indéfini de la
15, R. Musil, L homme sans qualités, § 88.
16. Galilée, Dialogue sur les deux grands systémes du monde, trad. R. Fréreux et F. de
Gandt, Paris, Le Seuil, 1992, p. 137. Dans sa nouvelle La Vénus d'Tile, Mérimée a mis cette
situation en scéne d’une maniére remarquable,
17. Galilée, Dialogue sur les dewx grands 3
:mes du monde, op. cit., p. 91.
GRANDEUR ET MISERE DE L'EPISTEMOLOGIE, 35
connaissance a fini par montrer ses limites : 4 force de ne se fier qu’a elle-
méme, la science tourne finalement en rond, comme dans la métaphore
jnventée par Heisenberg du bateau dont le compas ne s’oriente plus que vers
Ja masse devenue colossale du bateau!8, La mécanique quantique, dont
Heisenberg est un des pionniers, est particuliérement qualifiée pour montrer
les limites intrinséques de la connaissance dans le fait que l’observateur
devient partie prenante de ce qui est observé. Des lors, suivant Heisenberg, si
la connaissance n’est pas condamnée comme connaissance authentique de la
nature, il lui incombe de se laisser réanimer par le désir de ne pas tourner en
rond. La physique dans le sillage de Galilée n’aurait été qu’une étape, une
forme transitoire de développement propre a la vie humaine, qui finit par se
complaire dans les limites indéfiniment reculées qu’elle se donne 4 elle-
méme ; mais la prise de conscience des limites intrinséques du savoir relan-
cerait les forces sans limite de la vie en méme temps que l’idée méme de
science. Au nom d’une pensée qui se prétend maitre de la vie qui lui est
impartie, la science de la nature affiche aujourd’hui sa volonté de vérité en
s’accrochant a une force de vie qui pour Iheure est encore surhumaine, En
quoi elle s’empétre peut-étre toujours plus dans horizon de la mort.
UNE REFORME DE L’IDEALISME.
Parce qu’il est dépassé par la vie qui le soutient, le praticien de la science
profére un discours qui ne se tient pas de part en part. De ce qui pourrait
apparaitre comme un simple accident du discours, Husserl fait le point de
départ d’une évaluation critique fondamentale de la science : « Ce n’est pas
toujours la science de la nature qui parle, quand les savants parlent »!9. La
science de la nature a du mal a dire absolument ce qu’elle a a dire ; le dis-
cours scientifique est toujours exposé au risque de perdre sa scientificité lors-
qu'il parle de lui-méme. En tout cas la science ne peut placer une confiance
illimitée dans son porte-parole qui en est pourtant son plus fidéle serviteur. Il
se pourrait que le savant parle d’autre chose que de la science de la nature
lorsqu’il croit en parler, Aucune autorité n’est en mesure d’assurer que la
18, Voir W. Heisenberg, La nature dans la physique contemporaine, trad. A.E.Leroy, Paris,
Gallimard, 2000, pp. 143-144.
19, E, Husserl, Idées directrices pour une phénoménologie et une philosophie phénoméno-
logique pures, livre 1, Introduction générale a une phénoménologie pure, § 20, trad. P. Ricoeur,
Paris, Gallimard, 1950, pp. 69-70. Cité ci-aprés IDI
36 LA SCIENCE DANS LE MONDE DE LA VIE
science de la nature est toujours conforme a son but, qui est de comprendre en
toute chose l’essence d’un étant naturel. C’est pourquoi le savant refuse
écouter une part de lui-méme lorsqu’il « ne voit rien qui ne soit 4 ses yeux
nature et avant tout nature physique », Il y a un philosophe qui lui implore
de persévérer dans cette obnubilation, c’est le philosophe naturaliste. Celui-ci
aun programme : réduire toute la conscience et toutes les idées a des faits de
nature qui en sont la cause, et A partir de 1a justifier la validité des théories de
la nature que la science construit pour son propre compte. Mais ce pro-
gramme, il n’apergoit pas qu’il le soutient déja au moyen d’une pensée théo-
rique dont il est rien moins que sir qu’elle soit justiciable de ces théories : il
pose justement en Idée qu’une connaissance vraie de la nature est accessible
par ce moyen, C’est, poursuit Husserl, I’Idée selon laquelle la nature a « le
sens d’une unité de l’étre spatio-temporel, unité qui obéit 4 des lois exactes ».
S°il écoutait le philosophe naturaliste jusqu’au bout, le savant ne déchiffrerait
pas simplement la nature, il la réformerait selon cette Idée. Le philosophe
naturaliste s’accroche méme 4 I’exclusivité de cette Idée au détriment de
toutes les autres. Autrement dit, son Idée est a la fois pure et pratique, alors
méme qu’il la voulait absolument désintéressée au profit de la seule Nature.
La contradiction est intenable : « Les sujets ne sauraient s’épuiser dans le fait
d’étre nature, puisque, alors, manquerait ce qui donne sens a la nature »21, Le
naturaliste, qu’il soit savant ou philosophe, est non seulement un idéaliste qui
s’ignore, mais en outre son idéalisme est incohérent. C’est une pensée qui
affirme qu’elle ne peut échapper aux causes naturelles, done qui s’affirme
victime des causes qui la jetteraient dans la nécessité de produire ce qu’elle
pense, sans pouvoir décider de la vérité ou de la fausseté de ce qui est proféré
par elle. Cet idéalisme, il s’agit de le réformer.
Si la science est point de départ pour la philosophie, ce point de départ
n’est pas simplement le fait de la science qui va de soi en son progrés infini.
Si le savoir scientifique se met finalement en question comme savoir, c’est
que plus profondément et depuis toujours le fait de la science ne va pas de
soi. Avant de se poser en garante de 1’ objectivité, le savoir scientifique s’im-
pose comme la pointe culminante du désir de connaitre en ce qu’il a de plus
ancien et de plus irrépressible. L’activité scientifique qui alimente en sous-
main le fait de la science en est le témoignage le plus probant. Contrairement
20. E, Husserl, La philosophie comme science rigoureuse, trad. M. de Launay, Paris, PUF,
1989, p. 19. Cité ci-aprés PSR.
21. E, Husserl, Idées directrices pour une phénoménologie et une philosophie phénoméno-
Jogique pures, livre Il, Recherches phénoménologiques pour la constitution, § 64, trad.
E. Escoubas, Paris, PUF, 1982, pp. 399-400. Cité ci-aprés 1D2
GRANDEUR ET MISERE DE L’'EPISTEMOLOGIE 37
aux théories qu’elle construit, cette activité est enti¢rement au diapason de la
conscience qui l’exécute. Comme dit Husserl, « rien ne saurait nous empé-
cher de ‘vivre’ (einzuleben) les tendances et l’activité scientifiques »22, de
nous en pénétrer d’une maniére concréte au lieu d’en théoriser les résultats
pour y déméler aprés coup le vrai du faux, ou le bon du mauvais. Ce vivre,
nous pouvons le capter directement 4 méme « l’immense diversité de la vie
concréte se déroulant dans I’homme de science au cours de son activité de
pensée (Denkarbeit) », la diversité des processus dans lesquels « il vit ... sans
les voir eux-mémes »?3, Que faire avec une vie qui ne s’apercoit pas ?
Essayer de la vivre d’une maniére concréte, qu’est-ce que cela signifie, sinon
parasiter l’activité qui va toujours de l’avant ? Le praticien de la science
pourrait certes s’y intéresser 4 l’occasion, comme par inadvertance. Mais ce
vivre s’atteste profondément dans le fait qu’il y a des raisons logiques pour
lesquelles les théories dans les sciences de la nature sont essentiellement pro-
visoires. La probabilité pour les théories d’étre vraies, dans un contexte
donné, éblouit au point de passer pour une « probabilité évidente »24, Mais
comment 1’évidence admettrait-elle la probabilité comme un critére d’évi-
dence ? Le praticien de la science vit et se voit vivre dans le processus intel-
lectuel ot « les seuls modes de pensée et les seules évidences qui entrent
alors en jeu sont ceux qui sont absolument nécessaires a une technique »25,
savoir la technique de calcul qui chemine aveuglément vers un but circonserit
d’avance. Mais il n’y aurait méme pas de technique pour commencer si les
intéréts supérieurs de la raison ne commandaient pas chacun des buts qu’elle
se fixe dans une technique. Méme si elle ne s’y voit pas vivre, la science
n’ignore pas ces intéréts supérieurs, ou une connaissance probable du réel est
fondée a priori.
Husserl assigne a une logique comme science de toutes les sciences (dési-
gnée « logique pure ») la tache d’explorer la nature des actes de conscience
qui rendent compte de ce 4 quoi les sciences tendent effectivement dans leur
activité. Elles tendent 4 faire du monde réel un monde réel en soi, c’est-a-dire
un objet de pensée tel que son étre ne dépend justement pas de la conscience
et de la pensée (une théorie inintelligible et pourtant absolument respectueuse
des faits en est le parfait exemple). Avant d’étre traduit en savoir disponible
dans une théorie, I’idéal de la science est de révéler ce que la pensée peut
22. MC § 4, p. 8.
23. E, Husserl, Philosophie premiare, I, trad. A. Kelkel, Paris, PUF, 1970, p. 57.
24, E. Husserl, Recherches logiques, I, § 72, trad. H. Elie, A. Kelkel et R, Schérer, Patis,
PUE, 1969, p, 282. Cité ci-aprés RL1.
25. KR § 9g, p. 54.
Vous aimerez peut-être aussi
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeD'EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeÉvaluation : 4.5 sur 5 étoiles4.5/5 (20018)
- Art of War: The Definitive Interpretation of Sun Tzu's Classic Book of StrategyD'EverandArt of War: The Definitive Interpretation of Sun Tzu's Classic Book of StrategyÉvaluation : 4 sur 5 étoiles4/5 (3321)
- The 7 Habits of Highly Effective People: The Infographics EditionD'EverandThe 7 Habits of Highly Effective People: The Infographics EditionÉvaluation : 4 sur 5 étoiles4/5 (2475)
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeD'EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeÉvaluation : 4 sur 5 étoiles4/5 (5794)
- The 7 Habits of Highly Effective PeopleD'EverandThe 7 Habits of Highly Effective PeopleÉvaluation : 4 sur 5 étoiles4/5 (353)
- Pride and Prejudice: Bestsellers and famous BooksD'EverandPride and Prejudice: Bestsellers and famous BooksÉvaluation : 4.5 sur 5 étoiles4.5/5 (19653)
- Habit 1 Be Proactive: The Habit of ChoiceD'EverandHabit 1 Be Proactive: The Habit of ChoiceÉvaluation : 4 sur 5 étoiles4/5 (2556)
- Habit 3 Put First Things First: The Habit of Integrity and ExecutionD'EverandHabit 3 Put First Things First: The Habit of Integrity and ExecutionÉvaluation : 4 sur 5 étoiles4/5 (2507)
- Orgueil et Préjugés - Edition illustrée: Pride and PrejudiceD'EverandOrgueil et Préjugés - Edition illustrée: Pride and PrejudiceÉvaluation : 4.5 sur 5 étoiles4.5/5 (20260)
- American Gods: The Tenth Anniversary EditionD'EverandAmerican Gods: The Tenth Anniversary EditionÉvaluation : 4 sur 5 étoiles4/5 (12945)
- The 7 Habits of Highly Effective PeopleD'EverandThe 7 Habits of Highly Effective PeopleÉvaluation : 4 sur 5 étoiles4/5 (2566)
- How To Win Friends And Influence PeopleD'EverandHow To Win Friends And Influence PeopleÉvaluation : 4.5 sur 5 étoiles4.5/5 (6520)
- Habit 6 Synergize: The Habit of Creative CooperationD'EverandHabit 6 Synergize: The Habit of Creative CooperationÉvaluation : 4 sur 5 étoiles4/5 (2499)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItD'EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItÉvaluation : 4.5 sur 5 étoiles4.5/5 (3275)
- The Perfect Marriage: A Completely Gripping Psychological SuspenseD'EverandThe Perfect Marriage: A Completely Gripping Psychological SuspenseÉvaluation : 4 sur 5 étoiles4/5 (1107)
- Wuthering Heights (Seasons Edition -- Winter)D'EverandWuthering Heights (Seasons Edition -- Winter)Évaluation : 4 sur 5 étoiles4/5 (9486)
- The Iliad: A New Translation by Caroline AlexanderD'EverandThe Iliad: A New Translation by Caroline AlexanderÉvaluation : 4 sur 5 étoiles4/5 (5718)








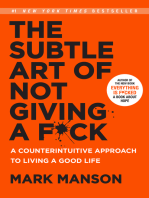

![American Gods [TV Tie-In]: A Novel](https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/audiobook_square_badge/626321117/198x198/22ab6b48b6/1712683119?v=1)