Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Les Droit Des Traités
Les Droit Des Traités
Transféré par
Marcos Aurelio0 évaluation0% ont trouvé ce document utile (0 vote)
2 vues63 pagesDroit des traités Droit International
Titre original
les droit des traités
Copyright
© © All Rights Reserved
Formats disponibles
PDF ou lisez en ligne sur Scribd
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroit des traités Droit International
Droits d'auteur :
© All Rights Reserved
Formats disponibles
Téléchargez comme PDF ou lisez en ligne sur Scribd
0 évaluation0% ont trouvé ce document utile (0 vote)
2 vues63 pagesLes Droit Des Traités
Les Droit Des Traités
Transféré par
Marcos AurelioDroit des traités Droit International
Droits d'auteur :
© All Rights Reserved
Formats disponibles
Téléchargez comme PDF ou lisez en ligne sur Scribd
Vous êtes sur la page 1sur 63
QUE SATS=} ER
Le droit des traités
JEAN COMBACAU
Professeur A |’Université Panthéon-Assas
INTRODUCTION
1. Un droit sans loi. — Le droit international est un
systéme juridique anarchique. On veut dire quil
ignore, dans sa production comme dans sa réalisation,
Je phénoméne du pouvoir iégal grace auquel, dans
ordre interne, Etat, sujet éminent et dispensateur
initial de tout droit, produit des normes opposables 4
une collectivité d’assujettis, au nom de la supériorité
de Vintérét général qu’il prétend représenter sur la
multitude de leurs intéréts particuliers. Dans ce milieu,
la loi, ou toute autre variété d’acte juridique unilatéral
reproduisant le modéle du « droit objectif » qu'elle
porte a sa perfection, est le mode caractéristique de
normalisation des relations sociales par la voie du
droit. Il n’est pas le seul cependant ; les sujets conser-
vent des pouvoirs légaux, c’est-d-dire une aptitude 4
voir leurs comportements produire des effets de droit,
notamment ceux qu’ils attendent de leurs « actes juri-
diques » : actes unilatéraux (comme le testament), bi-
ou plurilatéraux — I’acte collectif, la convention et, au
premier rang de ses espéces, le contrat. Mais ces actes
ne tirent leurs effets, et en définitive leur qualité juridi-
que dactes, que d’une régle de droit objectif qui
attache aux intentions des sujets, et aux comporte-
ments qui leur donnent corps, les conséquences qu’elle
ordonne.
Rien de tel en droit international, of aucun étre ne
joue par rapport aux Etats-sujets internationaux le
réle qu’assume I’Etat-sujet interne par rapport 4 ses
3
»~-—--propres- assujettis.-Pas..de-super-Etat-pour-représenter
Lintérét général d’une « communauté internationale »,
dont les aspirations supposées ne trouvent pas
d’organe apte a les exprimer et 4 vouloir légalement
, pour elle ; et pas de « loi » internationale pour enca-
drer les actes de sujets que nul n’assujettit, éperdument
attachés qu’ils sont a leur puissance de vouloir. Pas de
loi : est-ce 4 dire pas de droit, et une parfaite anomie
des comportements dans un état de nature ot chaque
acteur déterminerait sa conduite en fonction des cir-
constances concrétes, une fois ainsi, une fois autre-
ment, selon les intéréts du moment, sans obéir a des
régles qui viendraient la « normaliser » ? La réalité est
plus originale : le systéme international est a la fois
organisé légalement et anarchique : organisé selon un
mode légal en ce que le comportement individuel des
sujets obéit 4 des régles qui le déterminent au moins
partiellement ; anarchique en ce que les Etats, égaux
(comme le sont entre eux les sujets internes) mais sou-
verains (c’est-d-dire soustraits 4 toute autorité supé-
rieure, qualité dont l’existence méme de l’Etat et du
droit objectif prive les sujets internes), ne tolérent ce
mode légal, distingué de sa variété « législative », qu’a
Ja condition qu’aucun d’eux ne se voie opposer un élé-
ment quelconque du systéme juridique international
s'il n’a pas consenti 4 la production de ses effets
légaux. Dans un tel contexte, l’'acte conventionnel se
voit assigner une place encore plus éminente que dans
Yordre juridique interne, mais il y change de significa-
tion, par la disparition de la loi.
D’abord rien ne valide plus les actes, ni ne déter-
mine plus leurs effets, sinon d’autres régles qui, éma-
nant elles aussi de l'accord des Etats entre eux, ne sont
pas supérieures aux actes qu’elles prétendraient régir ;
Pédifice conventionnel juxtapose des conventions
égales émanant d’Etats égaux, et nulle clef de votite ne
4
vient plus en réunir les éléments, sinon ce seul prin-
cipe : Pacta sunt servanda, « on doit observer ce dont
on est convenu », principe métajuridique plus que
régle de droit, axiome de base sans quoi aucun énoncé
légal ne peut étre pris au sérieux, et qui impose aux
sujets de tenir pour du droit ce qu’ils ont dit étre tel.
Privée du support et de la couverture d’une loi expri-
mant le droit objectif, la convention entre Etats est
ainsi portée au premier rang des modes de formation
du droit, avec la coutume qui, par des voies différentes,
exprime aussi leur accord, et chargée des fonctions que
se répartissent en droit interne la loi de l’Htat et les
conventions entre ses sujets. A celles-ci répondent les
accords bilatéraux ou plurilatéraux restreints par les-
quels les Etats aménagent leurs rapports comme le font
en droit interne les particuliers, posant des régles, ins-
tituant des situations légales, etc., faites pour valoir
dans le cercle étroit qwils forment pour la durée de
cette opération. A celles-la correspondent les conven-
tions multilatérales larges d’ot résultent les régles qui
ont vocation a régir un grand nombre d’Etats et, plus
ambitieuses encore, celles qui visent 4 se rapprocher de
Puniversalité et constituent, avec les régles coutumiéres
elles-mémes a vocation universelle, le « droit interna-
tional général » : général par le nombre d’Etats qu'il
lie et par objet sur lequel il porte.
Ensuite si rien n’occupe dans le droit international
la place de la loi, rien n’y vient établir existence des
Stres légaux au regard de V'universalité des sujets. La
ou le droit interne, et le mode législatif qu’il comporte,
permettent de rendre « absolument » opposables a
tous ceux qu’ils désignent I’existence d’une norme,
dune institution, d’une situation légale, le droit inter-
national est sans pouvoir pour le faire : ici comme
ailleurs, la convention ne fait droit qu’entre les parties
et, on le verra, ce qu’elle énonce n’est réputé vrai que
5
ement; dans les relations qu’elies entretiennent.
Aussi, par son mode d’étre méme, le droit internatio-
nal. impose-t-il de distinguer toujours deux paliers
d’existence des étres légaux qu'il accueille. D’une part
“chacun apparait objectivement, par le jeu des régles
qui régissent sa production ; pour s’en tenir a ce type
d’étres, une régle se forme par la voie conventionnelle
et existe dés lors en soi avec l'ensemble des attributs
inhérents 4 sa nature normative : apte 4 produire des
droits, des pouvoirs et des obligations dans le chef de
ses destinataires. Mais apte en puissance seulement
d’autre part, tant que des destinataires actuels ne sont
pas venus réaliser cette potentialité normative par des
actes leur rendant la régle opposable, la faisant exister
pour eux en ce qu’ils entrent effectivement dans la caté-
gorie de ses destinataires. Dans ce mécanisme qui
consiste pour un sujet international a se mettre en rela-
tion avec un étre légal extérieur en s’accrochant indivi-
duellement a lui, on identifie sans mal la forme, essen-
tiellement caractéristique du droit international, de la
« reconnaissance », acte par lequel un sujet atteste
Pexistence 4 son égard d’un étre légal et s’engage a
tirer d’elle les conséquences que le droit y attache.
Dans le monde artificiel du droit, ou rien n’existe natu-
rellement et ou tout, y compris les faits — grace a la
qualification qu’il leur impose —, est également insti-
tué, dans un monde ou en outre aucune autorité supé-
rieure aux Etats également souverains n’a le pouvoir
Wattester Pexistence légale de ce qu’aurait produit le
droit, Pobjectivité virtuelle des étres légaux ne peut étre
consacrée que par un acte subjectif établissant leur
existence seulement relative, aux yeux de ceux qui
acceptent de se les voir opposer. Ainsi la convention,
virtuellement porteuse d’effets de droit, n’est rien de
plus qu’un texte tant quw’ils n’ont pas été pris en charge
par des Etats individuels ; c’est par ia reconnaissance
6
de ces effets, et entre ceux-la sculs qui y procédent, que
ses virtualités (la production de normes, la détermina-
tion d’un statut, la fondation d’une institution) se
réalisent légalement.
Le traité — ou la convention, les deux mots sont a peu
prés interchangeables — peut donc se définir comme un
ensemble d’énoncés établi de fagon concertée, destiné a
produire les effets de droit international qu’en attendent
ses auteurs, dans les relations entre sujets internatio-
naux qui se le sont reconnu opposable. C’est a cet objet
qu’est consacré ce petit essai, que le lecteur voudra bien
prendre pour ce qu’il est : quand le moins ambitieux des
manuels de droit international consacre au droit des
traités plus d’espace que ne lui en laisse le format de la
collection qui l’accueilic, on n’y trouvera évidemment
pas exposé systématique d’une réglementation
complexe, mais une présentation théorique des prin-
cipes qui en ordonnent les éléments a premiére vue dis-
parates et, espére-t-on, une introduction 4 l’esprit du
droit international dans son ensemble.
2. Le droit des traités, — Les mécanismes qui prési-
dent a la confection des traités et 4 la détermination de
leur signification (chap. 1), a la facon dont les sujets se
les rendent opposables (chap. II) et aux effets qui en
résultent pour eux (chap. IID), aux événements enfin
qui jalonnent leur existence (chap. IV) constituent le
« droit des traités ». Ce singulier recouvre en réalité
une pluralité de corps de régles, ressortissant respecti-
vement au droit international et aux droits internes des
Etats ; chacun a sa facon, ceux-ci comblent certaines
des lacunes que celui-la laisse volontairement subsister
dans la mesure de l’autonomie qu’ils se reconnaissent
mais, si l’on n’a pas cru devoir borner ici I’étude du
droit des traités 4 sa face internationale, c’est malgré
tout 4 elle que I’on s’attachera pour I’essentiel.
tumiére, et résulte de la pratique suivie par les Etats
et. plus. réecemment par les organisations internatio-
““nales. Vers 1950, elle a paru suffisamment cohérente
et homogene pour se préter a une codification ; vingt
ans d’efforts de la Commission du droit international
puis de la Conférence des Nations Unies convoquée a
cette fin ont abouti le 23 mai 1969 a la conclusion de
la convention de Vienne sur le droit des traités (citée
ci-aprés « CV »), applicable aux traités conclus entre
Etats’. L’existence et le statut de ce « Traité des trai-
tés » appellent deux remarques.
En premier lieu il est techniquement paradoxal
dincorporer dans un traité les régles qui sont appelées
a régir tous les autres, mais c’est la conséquence inévi-
table de Pindisponibilité du mode législatif en droit in-
ternational (supra). De méme que, dans le droit
interne d’un Etat qui réduit sa constitution matérielle a
des « lois constitutionnelles », d’autres lois peuvent les
modifier ou les écarter selon la procédure legislative
ordinaire, de méme les régles du droit des traités ne
régissent la passation et les effets d’un traité particulier
que si les Etats qui le concluent conviennent entre eux
qwelles constituent un modéle satisfaisant et ne les
mettent pas 4 Pécart en incluant dans ses clauses pro-
pres des mécanismes différents. En d’autres termes la
convention de Vienne constitue un ensemble de droit
supplétif (ou dispositif) : ses régles s'imposent a un
Etat agissant individuellement, mais ne 8’opposent pas
a ce que des Etats y dérogent de concert 3 nombre de
ses articles (« sauf disposition contraire du traité », «a
moins que le traité n’en dispose autrement »,..) rappel-
1. A part de rapides allusions aux traités conclus entre Etats et organi-
sations internationales ou entre organisations ¢lles-mémes (une conven-
tion du 20 mars 1986 transpose pour lessentiel les régles de la convention
de 1969 a leur cas particulier), eux seuls retiendront notre attention.
8
lent d’ailleurs le rdle subsidiaire dans lequel sa qualité
de traité cantonne la Convention par rapport a toute
disposition conventionnelle contraire.
En second lieu les régles énoncées dans la Conven-
tion obéissent elles-mémes a un des principes essentiels
qu'elle proclame, celui de l’effet relatif des traités : cles
ne valent comme régles conventionnelles que dans les
relations entre Etats qui y sont parties (leur nombre
saccroit réguliérement)', Pour eux les énoncés qu'elle
inclut font droit, et se substituent a toutes autres for-
mulations des régles qui les liaient coutumiérement et
qui, du fait de leur commune appartenance au cercle
des parties, se voient désormais préférer la formulation
conventionnelle de la coutume ; dans la mesure ou,
comme toute convention dite de codification, elle fait
en outre une place a des régles nouvelles introduites 4
Yoceasion du recensement de la coutume applicable,
ces régles font droit elles aussi, mais comme purement
conventionnelles, dans les rapports entre eux. En
revanche, dans les relations entre Etats qui ne sont
pas, ou pas tous, parties 4 la Convention, son texte
cesse d’étre applicable en tant que tel puisqu’ils ne se le
sont pas également reconnu opposable ; ce n’est pas a
dire bien sir que les régles coutumiéres du droit des
traités soient devenues caduques dans leurs relations 3
elles continuent a faire droit en cette qualité, et rien ne
Soppose d’ailleurs a ce qu’un Etat tiers se juge tenu
par une régle dans l’énoncé méme qu’en donne la
Convention s’il Pestime fidéle 4 ce qu’elle prétend codi-
fier ; mais d’une part il lui est toujours loisible de nier
la conformité de la formulation conventionnelle a la
régle coutumiére qu’on lui oppose ou que lui-méme
1, V. Pétat et les modalités de la participation dans le recueil annuel
des Nations Unies, Traités multilatéraux pour lesquels le Secrétaire géné-
ral exerce les fonctions de dépositaire (5t/L#G/SER.D/...).
invoque ; d’autré “part, la” possible “présomption “de
conformité que vaut 4 la plupart des dispositions de la
Convention le sérieux des travaux qui ont conduit a
son adoption ne s’étend évidemment pas aux disposi-
tions dont le caractére novateur est généralement
_ attesté. Il importe donc, ici comme dans tout exposé
des régles qui composent le droit des traités, de ne
s’appuyer sur la convention de Vienne que dans la
mesure ou elle se présente comme le recensement fidéle
du droit coutumier, et de tenir compte de celui-ci pour
le reste, chaque fois notamment qu’une de ses régles
met en cause la situation d’un Etat qui, comme c’est le
cas en particulier de la France, a refusé la qualité de
partie qui aurait permis de lui en opposer les termes.
10
Chapitre I
LE TRAITE
COMME TEXTE LEGAL
Oublions, le temps d’un chapitre, quels effets
légaux un traité produira sur les parties entre qui va
s’établir bient6t un lien conventionnel, et envisa-
geons-le pour ce qu’il est tant que ce lien n’est pas
formé : un texte légal. Un texte d’abord, mais écrit a
plusieurs, et en cela sa qualité de traité le rapproche
d’autres actes dont les énoncés sont dus 4 une plura-
lité d’auteurs : la convention (notamment le contrat),
Lacte collectif... Un texte légal ensuite, dont la signifi-
cation s’apprécie par référence 4 un code de déchiffre-
ment particulier, celui-la méme qu’ont utilisé ses
auteurs ; ils n’ont pas voulu faire ceuvre littéraire —
le texte ne s’apprécie pas en termes de beauté — ni
scientifique — il n’entend pas décrire ou expliquer le
vrai — ni morale — il n’a pas pour objet de prescrire
le bien —- mais produire des effets de droit, ceux que
le systéme juridique dans son ensemble attache a un
texte auquel il reconnait la qualité de traité; c’est
done par référence aux catégories du droit, et en par-
ticulier du droit international des traités, que ce texte
prend un sens : celui que lui attribuent ses auteurs et
celui que lui reconnait le droit objectif. On étudiera
U
‘Ye traité dans cette perspective; et’on se demandera
comment le texte lKégal est établi et quelle est sa
signification.
I. — Etablissement du traité
1, Participation 4 lopération.
A) Sujets participants. — Avant toute détermination
de Paptitude d’un sujet particulier a participer 4 un ré-
gime conventionnel individualisé (infra, p. 44), une
question préalable doit étre résolue, celle de la « capa-
cité de traiter » et de ses titulaires. Envisagée comme
une aptitude abstraite, en elle-méme sans intérét tant
que d’autres sujets ne lui donnent pas corps en
acceptant d’entrer en relations conventionnelles avec
tre qui en est investi, l’aptitude a traiter est un attri-
but fondamental de tout sujet de droit international, et
méme ce a quoi se reconnait sa personnalité. Dans la
mesure ot imputation d’un acte juridique a un étre
plutét qu’a la multiplicité des étres dont il se compose
ou. 4 l’étre qu’il compose avec d’autres est ce qui fait de
lui un « sujet » du systéme de droit auquel se rattache
Pacte juridique dont il s’agit, la capacité de produire
un tel acte est ’exigence minimum de lattribution de
la personnalité ; peu importe pour le reste que le sujet
ne puisse pas entrer dans n’importe quelle relation
conventionnelle, ni avec n’importe qui : sa person-
nalité ne dépend que de son aptitude abstraite 4 nouer
une telle relation. La possibilité de la transformer en
aptitude concréte résulte de son habileté 4 trouver au
moins un autre sujet disposé a le considérer comme tel
{a le « reconnaitre » comme sujet) et 4 entrer en rela-
tion conventionnelle avec lui, A permettre en somme, si
lon veut reprendre ici une distinction contestable,
Pexercice d’une prérogative dont le droit international
12
“ne lui accorde automatiquement que Ia jouissance.
Toute question de reconnaissance étant ainsi hors de
cause, il devient relativement aisé de dresser la liste des
étres ayant la capacité de traiter, confondue avec la
liste des sujets de droit international.
Tous les Etats en sont dotés (CV, 6), du moment
quwils ont cette qualité au regard du droit interna-
tional. La capacité des collectivités composantes des
Etats fédératifs et des autres formations infra-étatiques
comme celle des étres « préétatiques » (les mouve-
ments de libération nationale) est plus douteuse : n’en-
trant pas dans les attributs de ces étres au statut incer-
tain, elle suit le sort de la décision concernant leur
personnalité ; et comme celle-ci dépend largement de
leur reconnaissance, par tel partenaire dans une rela-
tion bilatérale ou par une organisation internationale
exergant une fonction de légitimation collective, la
question de la capacité de traiter cesse de se régler
objectivement comme elle le fait pour Etat, sur la
base d’une personnalité opposable 4 tous, pour étre
résolue cas par cas au gré des relations qui s’établissent
entre l’étre dont il s’agit et les autres sujets, selon qu’ils
sont ou non disposés a entrer en relations convention-
nelles avec lui; on évite généralement de parler de
« traités » pour désigner ces accords dont il n’est pas
sir quils lient des parties ayant également un statut de
sujet international.
Pour les organisations internationales au contraire, Paffirma-
tion par la convention de 1986 d’une capacité régie Par les régles
propres 4 chacune d’elles implique l’assertion de son existence,
au moins dans les rapports entre l’organisation ct ses membres ;
mais ses « régles propres » étant inopposables aux Etats tiers et
aux autres organisations, la capacité pour ceux-ci et pour celle-ld
@entrer en relations conventionnelles suppose une reconnais-
sance mutuelle de I’existence méme de lorganisation en cause,
substituée comme sujet 4 la collectivité de ses membres : 4 nou-
veau la capacité de conclure cesse d’étre un attribut objectif d'un
13
sujet. existant objectivement pour étre “associée 4” Pattestation
subjective de son existence par le sujet qui souhaite entrer en
relations conventionnelles avec lui.
B) Individus ayant qualité pour représenter les sujets
~ participants.
a) Recensement. — L’ensemble de V’opération de
conclusion, qu’on traite ici pour n’y plus revenir, est
mené pour le compte de l’Etat ou de l’organisation
internationale par un ou plusieurs de ses organes, de
ses agents, ou des agents de ses organes. Deux caté-
gories d’organes et d’agents doivent étre distinguées.
Les uns ont ex officio qualité pour représenter l’Etat
auquel ils ressortissent (CV, 7 — il n’existe pas de for-
mule homologue pour les organisations internatio-
nales). Il s’agit d’une part des organes auxquels est
reconnue l’aptitude légale 4 le représenter dans ses
relations internationales : chefs de ’Etat, du gouverne-
ment, de la diplomatie (ministre des Affaires étran-
géres) qui constituent les seuls canaux officiels par les-
quels elles transitent en l’absence de rapport spécial
daccréditation, et les seules autorités centrales de
Etat que les autres Etats aient 4 connaitre ; d’autre
part des chefs de mission diplomatique et des représen-
tants de I’Etat aux conférences et auprés des organisa-
tions internationales, mais seulement pour la conclu-
sion des traités que l’Etat accréditant négocie avec
YEtat accréditaire ou qui se négocient au sein de la
conférence ou de l’organisation.
Les autres doivent justifier auprés des participants 4
la fois de leur qualité d’agents de la personne morale
qwils prétendent représenter et de la compétence que
leur reconnait cette derniére pour mener en son nom
les opérations conventionnelles, compétence qu'elle
peut d’ailleurs assortir de conditions restrictives, par
exemple en ne les habilitant qu’a signer le traité ad re-
Jerendum, assurant ainsi aux organes centraux une
4
miaitrise complete sur les agissements du réprésentant.
Cette habilitation résulte soit des « pleins pouvoirs »
(définition dans CV, 2/1 c), soit de comportements des
organes centraux ou de documents émanant d’eux qui
attestent sans équivoque leur intention et celle des au-
tres participants 4 lopération conventionnelle de ne
pas requérir la production de ces documents formels.
Dans Ie cas de la France, et pour s’en tenir a ses institutions
actuelles, le pouvoir de traiter n’est constitutionnellement attri-
bué qu’au président de la République, mais dans des termes qui
impliquent un partage avec d’autres autorités, que l'article 52 de
la Constitution omet de préciser. Le clivage binaire qu'il opére
entre le « traité », que le chef de Etat est chargé de négocier
(généralement par l'intermédiaire d’un plénipotentiaire) et de
ratifier, et I’ « accord international non soumis 4 ratification »,
de la négociation duquel il est simplement informé, ne corres-
pond ni a la pratique ni méme a d’autres dispositions constitu-
tionnelles concernant les relations conventionnelles de la France,
et on verra le peu de cas qui en est fait (infra, p. 46). En réalité la
grande majorité des conventions internationales sont conclues
par des agents de l’Exécutif autres que le président de la Répu-
blique, dont beaucoup appartiennent 4 des administrations qui
ne sont soumises hiérarchiquement ni au chef du gouvernement
ni au premier responsable de la diplomatic.
5) Statut. — Quelle que soit la modalité retenue, ’agent ou
Porgane de l’Etat ou de l’organisation agit en tant que « repré-
sentant » : ses actes et ses comportements sont automatiquement
imputés 4 la personne morale dont il est censé exprimer la vo-
lonté, et on verra les conséquences de cette attribution lorsqu’on
examinera les conditions de validité des engagements (infra,
p. I11). Il en résulte nécessairement un contréle étroit des auto-
rités supérieures du sujet représenté sur les agissements des repré-
sentants, dont les exigences s’accentuent 4 mesure que s’accroit
la distance qui les sépare de lautorité de qui émane lhabilita-
tion ; si le représentant est lui-méme un organe de 1’Etat, tirant
sa compétence de sa fonction constitutionnelle (chef d’Etat ou de
gouvernement ct, dans les cas ot il agit de facon autonome,
ministre des Affaires étrangéres), il exprime « immédiatement »
la volonté de celui-ci ; si au contraire il n’en est qu’un agent, sou-
mis au pouvoir hiérarchique, sa compétence se mesure a la délé-
gation qui lui en est faite par l’organe ou méme par l’agent pri-
maire qui lui délivre ses pouvoirs, de qui il exprime la volonté et
1S
ir _les:«. instructions.» de-qui-il-agit; selon un-ra) port de repré-
sentation qui peut étre ainsi plusieurs fois médiatisé,
2, Consistance de opération.
de conelure, la nature des agents appelés 4 Participer 4 sa mise
au point, etc., et ne suivent d’autres régles que celles qui résul-
tent de Pégalité des Etats ct, si la négociation passe par les repré-
sentants de chacun d’eux sur Je territoire des autres, celles que
comporte le droit diplomatique. Plus organisées sont les négo-
actes qu’on examinera tout 4 Pheure, résulte d'un réglement
adopté par les participants dés Pabord , dans le second elle obéit
aux régles Propres de organisation : tantét, parce que celle-ci
compte parmi ses fonctions principales celle délaborer des trai-
tes O.1.7., UNESCO...), l’acte constitutif comporte des dispositions
regissant la fagon dont elle s’en acquitte ; tantét c'est la pratique
des Organes compétents qui en organise les modalités (voir p. ex.
les multiples procédures de négociation de conventions interna-
elles, si Je cadre de Popération conventionnelic leur en laisse la
latitude, avant de passer 4 la négociation sur Je fond et en ayant
sn vue les positions qu’ils entendent tenir au cours de cette future
Stape,
2) Au Premier rang des questions de procédure
figure ailleurs celle de Vadoption du texte (CV, 9),
négociation, et dont la fonction est dy mettre un
terme ; dés le moment ow le projet de traité est adopté,
Son existence objective comme traité est établie, avec
les conséquences légales qui s’attachent 4 cette qualifi-
16
cation : c’est un étre juridique parfait, se prétant au jeu
des actes unilatéraux par lesquels les Etats se situeront
désormais par rapport 4 lui. Du point de vue de la
politique juridique, la technique dadoption joue un
role déterminant puisque cest d’elle surtout que
dépend la possibilité pour un Etat participant a la né-
gociation de maintenir sur ses pairs une pression suffi-
sante pour qu’ils acceptent ses exigences individuelles :
selon que la participation d’un Etat ou d’un groupe
@Etats minoritaires 4 !' adoption parait ou non néces-
saire au succés du futur régime conventionnel, les Etats
de la majorité introduiront ou non telle clause, la
feront ou non disparaitre, en modifieront ou non la ré-
daction... ; le choix d’un mode d@ adoption permettant
a la minorité de bloquer l’opération en refusant dy
contribuer renforce évidemment sa main en lui don-
nant les moyens de contraindre la majorité, a peine
d’échec, 4 poursuivre indéfiniment la négociation. Le
choix dépend de ce dont les participants 4 la négocia-
tion sont convenus : si Yadoption est nécessairement
un acte unanime quand il s’agit d’un traité bilatéral
ou, le plus souvent, d’un traité restreint, ce mode n’est
plus acceptable quand le texte est négocié entre un
nombre important d’Etats, dont chacun disposerait
sinon d’un veto inconditionné ; le réglement de procé-
dure de la conférence ou de Porgane de négociation
prévoit alors un vote a la majorité qualifiée des partici-
pants, qui est souvent (c’est d’ailleurs la régle que
retient a titre supplétif la Convention) fixée aux deux
tiers des suffrages exprimés.
3) A la différence de l’adoption, Pauthentification du
texte (CV, 10) est normalement un acte individuel, et
elle émane de certains seulement des sujets qui ont par-
ticipé a la négociation. En droit strict, elle a en effet
pour fonction d’arréter le texte comme « authenti-
que », c’est-a-dire de reconnaftre dans Pinstrumentum
17
‘ou il est consigné le reflet fidéle du negotium sur lequel
a porté l’acte collectif d’adoption ; il s'agit donc néces-
sairement d’un acte individuel, par lequel chaque Etat
n’engage que lui, s’interdisant en particulier de remet-
tre en cause le contenu du texte sur lequel accord a
été obtenu.
Cette fonction de forclusion explique le glissement
qui peut s’opérer entre ’effet légal d’authentification et
un effet politique oblique. Certes, en apposant sa
signature au bas du ou des instruments qui constituent
le traité ou de lacte final de la conférence dans lequel
il se trouve inclus —. c’est ainsi que s’opére tradition-
nellement l’authentification — le représentant ne rend
pas normalement opposables 4 son Etat national les
dispositions substantielles qui constituent son texte :
en régle générale, nous le verrons (infra, p. 38), la si-
gnature n’a pas pour fonction d’exprimer le consente-
ment de I’Etat a étre lié et ne fait pas de I’ « Etat ayant
participé 4 la négociation » qu’il est encore un « Etat
contractant », et moins encore un « Etat partie » (sur
ces expressions, v. CV, 2/1 fet 8). Il n’en reste pas
moins que, dans la pratique d’un Etat, faire signer un
traité par son représentant signifie souvent manifester
approbation de son contenu, et constitue alors
annonce implicite d’une intention dy devenir partie
ultéricurement, méme si on ne doit pas attacher une
importance excessive 4 cette signification, que la prati-
que contemporaine a considérablement brouillée et qui
est de toute fagon sans portée légale. L’usage, aujour-
hui fréquent, qui consiste a faire authentifier par le
président de la conférence ou de Porgane international
au sein duquel s’est faite adoption une convention
dont le texte prévoit en outre quelle sera ouverte 4 la
signature —— fit-elle « différée » — des Etats qui ont
participé 4 la négociation, redonne a ce dernier acte
une fonction autonome et, de ce moment situé a la
18
charniére entre l’opération d’établissement du texte et
Vopération de formation de l’engagement individuel,
tend déja a faire un premier élément de la seconde ;
c'est ce qui explique les précautions dont les Etats
entourent des actes d’authentification (la signature
_ peut par exemple n’étre donnée qu’ad referendum, ou
se déclasser en un simple paraphe : CV, 10 b), qui
auraient peu de sens s’ils n’ouvraient la voie a ’expres-
sion d’une volonté de se rendre opposable le fond du
traité,
3. Statut du texte 4 Pissue de Popération d’établisse-
ment, — II reste que, a ce stade, le traité n’est qu’un
texte et qu’il ne produit aucun des effets que son objet
est de lui faire produire ; lactualisation de ses effets
potentiels (instituer une norme applicable entre des
sujets internationaux ou un étre légal existant comme
tel a leurs yeux) dépend d’actes unilatéraux des futurs
participants au régime conventionnel, qui n’ont pas été
encore accomplis. Mais, si l’on envisage la conclusion
des traités comme une opération complexe, chaine
dactes juridiques dont seul le dernier, rendu possible
par la succession des chainons antérieurs, produit
Veffet conventionnel, aucun de ces actes n’est légale-
mentindifférent ; l’établissement du texte rend possible
le déroulement des opérations ultérieures mais il pro-
duit en outre des effets propres tenant a sa seule exis-
tence objective en tant que texte, hors de tout effet de
ses clauses substantielles.
1) Les dispositions non substantielles du traité entrent
en vigueur immédiatement, ce qui se comprend sans
peine si l’on se contente de justifications pratiques.
— Les clauses finales (ou « articles finals ») du traité
sont celles qui concernent sa technique de conclusion
et d’entrée en vigueur, le mode d’acquisition de la qua-
lité de partie et la possibilité d’y apporter des réserves,
19
les conditions dé modification et d’extinction des enga-
gements, etc. : bref; toute la logistique conventionnelle
du « droit des traités », étrangére pour I’essentiel a la
teneur de Ia convention dont le texte vient d’étre mis
sau point.
Lentrée en vigueur immédiate de certaines de ces dispositions
est nécessaire, celles dont l'objet est précisément d’ordonner les
opérations antérieures 4 entrée en vigueur des clauses substan-
tielles du traité; elles sont donc par nature détachables de
Tensemble du texte et opérent hors de toute logique convention-
nelle puisque c’est de leur jeu que résulteront ultérieurement les
effets conventionnels du traité. Analyser ce mécanisme comme
une entrée en vigueur anticipée mais partielle, résultant de la
seule adoption du texte (en ce sens CY, 24/4), ne résout nulle-
ment la question théorique des origines de ces effets : puisqu’ils
ne découlent pas du traité, ils ne peuvent trouver leur base légale
que dans le droit international général, dont Vadoption du texte,
opérant a la maniére d’un acte-condition, déclencherait Je jeu:
mais alors il faut supposer l’existence d’une régle coutumiére ren-
voyant 4 la collectivité des Etats participant a la négociation de
n’importe quel traité, la compétence pour déterminer, par
adoption des clauses finales, les régles relatives 4 la formation
du lien conventionnel entre les futures Parties et donnant a ces
regles un effet Jégal. La méme explication pourrait rendre compte
en théorie de la possibilité d’une application Provisoire, totale ou
partielle, d’un traité non encore entré en vigueur (CV, 25), hors
de tout accord conclu en ce sens par les Etats participant a la
négociation et sur la base d’une disposition du traité.
— Parmi les dispositions non substantielles qui
entrent ainsi en vigueur immédiatement, celle qui
concerne l’éventuel dépét du traité a une importance
particulicre. Le dépét (CV, 76-77) est Vopération qui
consiste 4 confier 4 une personne, morale (Etat ou
organisation internationale) ou physique (organe de
Tun ou de lautre), les fonctions d’administration
d'un traité multilatéral ; comme, a défaut de déposi-
taire, les actes individuels des sujets ayant participé a
la négociation (actes ayant pour objet d’acquérir la
qualité de partie ou de la perdre, réserves et objec-
20
~ tions,
5 examinera dans les chapitre
yants) doivent étre soit « échangés » entre eux (ins-
truments de ratification) soit « notifiés » unilatérale-
ment a chacun, tout traité associant un nombre
important de sujets ferait Pobjet d’un nombre consi-
dérable de communications entre chacun d’eux et
chacun des autres ; le dépositaire, constitué en inter-
médiaire unique de toutes ces communications, regoit
les actes de chaque Etat ou organisation et les réper-
cute lui-méme auprés de tous les autres. II s’agit 1a
d'une fonction délicate car le dépositaire peut étre
amené a prendre dans l'exercice d’une mission qui
parait d’abord purement technique des initiatives que
contesteront certains de ceux de qui il tient ses pou-
voirs; c’est ce qui explique l’accent mis par la
Convention sur le « caractére international » de ses
fonctions et sur l’impartialité avec laquelle il doit s’en
acquitter (CV, 76).
2) Dispositions substantielles. — L’existence méme du texte
est par ailleurs opposable aux Etats ayant participé 4 la négo-
ciation, qui doivent « s’abstenir d’actes qui priveraient [le]
traité de son objet ou de son but », dés le moment ov ils ont
pris 4 son sujet une position individuelle qui, sans aller jusqu’a
Jeur en rendre Ja substance opposable, dépasse la scule partici-
pation 4 V’opération collective d’adoption (CV, 18). Il ne s’agit
certes pas pour I’Etat de respecter des prescriptions qui ne sont
encore que virtuellement enfermées dans le texte, mais de se
conduire de facon telle que, si le traité vient ultérieurement 4
entrer en vigueur pour lui, les conditions d’exécution de ses
engagements n’aient pas été altérées entre-temps de son propre
fait et que les autres Etats qui Pont conclu avec lui en fonction
des circonstances qui prévalaient lors de la négociation ne
jugent pas modifiées les conditions au vu desquelles ils se sont
eux-mémes engagés. Ainsi serait inacceptable l’attitude d'un
Etat qui, ayant signé mais non encore ratifié une convention
comportant une réduction échelonnée des droits de douane sur
un produit, procéderait avant qu’elle n’entre en vigueur 4 une
augmentation du taux sur la base duquel devra étre ensuite cal-
culé V’abaissement du tarif douanier. Il n’y a la rien d’autre
qu’une application du principe de bonne foi qui, on le répéte,
21
international général, sans rapport avec Je contenu du traité
proprement dit et sans base conventionnelle.
IL. — Signification du traité
Un traité, on I’a dit, est un acte juridique écrit. En
tant qu’acte juridique il vise 4 produire un effet de
droit, c’est la son « objet », au sens ot I’on entend ce
mot dans la théorie des actes : l’effet de droit que
recherche son auteur; parler de la signification du
traité, c’est donc d’abord envisager l’objet de cet acte,
chercher l’effet de droit que ses auteurs en attendent,
s'interroger en somme sur ce qu'il veut faire (la
recherche de ce qu’il fait effectivement, c’est-a-dire de
sa signification objective telle qu’elle résulte des régles
qui lui sont extérieures, ressortit quant a elle 4 l’étude
des effets du traité, infra, chap. III). Mais pour agir
ainsi légalement sur la réalité, les auteurs du traité ont
emprunté la voie du langage : en tant qu’acte écrit, le
traité est un assemblage de mots et de phrases articulé
en un discours ; s‘interroger sur la signification du
traité, c’est done aussi déterminer le sens du texte par
lequel, et pas toujours de facon claire et univoque, les
auteurs de l’acte ont matérialisé Paccord qui les a
réunis sur l’objet vers lequel ils tendaient : c’est se de-
mander ce que le traité veut dire. Pragmatique et
sémantique se conjuguent ainsi dans la recherche de la
signification du traité. :
1. Ce que le traité veut faire : objet de Pacte, — L’effet
de droit visé par les auteurs du traité — son « objet » —
peut étre de deux sortes, et des dispositions du méme
traité peuvent se cétoyer qui appartiennent a l’une et 2
Pautre.
22
"impose" que des obligations “dé” comportément tirées du droit ©
~ A) Dispositions normatives. : - mo
a ) Notion. — L’objet le plus fréquent des traités est
de régir (norm-aliser) des conduites. Le texte énonce
: conventionnellement des normes légales, dont le traité
prétend opérer soit la création soit (traités de codifica-
tion du droit coutumier) la révélation. Tl ne s’agit pas
pour Tinstant de déterminer 4 qui ces normes seront
opposables (infra, chap. II) ; ce qui doit nous retenir,
crest le fait qu’un texte énonce collectivement des pro-
positions normatives ; que ces propositions sollicitent
le destinataire de faire ou de ne pas faire quelque chose
(et quelque force quil y emploie : invitation ou pres
cription) ou qu’elles l’autorisent a faire ou ne pas are
quelque chose (habilitation)..., toutes ont pour o jet
de déterminer pour l’avenir la conduite du destinataire
de 1a norme, et de poser un modéle auquel cette
conduite pourra étre confrontée ; chacune des normes
en cause s’articulant par ailleurs 4 d’autres a I intérieur
d'un systéme juridique, il s’en trouvera parmt elles qui
attachent des conséquences différentes a la conduite
des destinataires de la premiére selon qu’elle a été ou
non conforme au modéle qu'elle définit. En somme, ce
qui caractérise une proposition normative, ¢ est qu’elle
sadresse 4 quelqu’un, pour définir 4 son usage un
éle de comportement. oe
me) Varibids L rogles et normes individuelles. — AYinté-
rieur du genre que constituent les propositions nor-
matives, les traités — comme les actes juridiques
internes — offrent une multiplicité d’especes, dont quel-
ques-unes peuvent étre signalées sans glisser de la théo-
tie des traités dans la théorie des normes convention-
nelles et en s’en tenant a celles qui permettent des
qualifications pertinentes au regard du droit des traités.
ié jstinction tient 4 la généralité de la norme
conventionaelle. que doit eappréeier en Fonction de son mode
Wopération. Tantét elle gouverne le comportement de ses desti-
23
‘4
nataires (dé “quelque maniéré” qu’ils’ soient determinés) dans une
situation individualisée, concréte ct insusceptible de reproduc-
tion, en sorte que, une fois qu’ils ont agi dans le sens prescrit,
Ja norme a épuisé ses effets et que les droits et obligations qui
en résultaient sont éteints du fait de son exécution ; tantét elle
n’opére que dans les situations qu’elleeméme caractérise en
termes abstraits, de fagon telle que V’hypothése retenue comme
condition d’opération de la norme puisse se reproduire indéfi-
niment aussi longtemps que celle-ci reste en vigueur, la mettant
a méme d’opérer chaque fois que Thypothése se réalise. On
peut ainsi opposer normes 4 structure catégorique, déterminant
la conduite de leurs destinataires en fonction d’une condition
déja_supposée réalisée effectivement par la norme, fic et nunc,
et normes 4 structure hypothétique qui, sans étre moins obliga-
toires, ne déclenchent réellement le jeu de lobligation que si
une condition se réalise mais le déclenchent aussi souvent
quelle se réalise; par exemple un traité par lequel un Etat
sengage a fournir une prestation déterminée 4 un autre en
échange d’une contrepartie monétaire apparticnt au premier
type normatif, et un traité par lequel le méme Etat svengage a
préter une assistance militaire 4 son cocontractant si («a
condition et chaque fois que ») celui-ci est Pobjet d’une agres-
sion reléve du second. On le notera 4 ce propos, une norme ne
perd pas son caractére de régle par le fait que ses assujettis
sont individualisés (comme c’est le cas ici, s’agissant du traité
bilatérat ou moltilatéral restreint) : la qualité de régle d'une
norme ne tient pas au caractére indéfini du nombre de ses des.
tinataires mais 4 celui du nombre des applications qui peuvent
en étre faites,
¢) Suite ; traités-contrats et traités-lois. — Cette
remarque nous met sur la voie d’une nouvelle distinc-
tion entre les traités, trés discutée en doctrine, selon
quwils sont de nature contractuelle ou législative. Les
premiers (« traités-contrats ») auraient pour objet
exclusif l’institution entre les parties d’un rapport de
créancier 4 débiteur (et d’un rapport réciproque si le
traité est synallagmatique) ; des normes quils posent
résulteraient des droits et des obligations pour chaque
partie dans ses relations avec l’autre (ou chacune des
autres), comme ils le font en droit interne d’une norme
contractuelle, génératrice de relations juridiques pure-
24
ment intersubjective entre des personnes ne poursui-
vant pas le méme but. Dans les seconds au contraire
(« traités-lois ») les parties auraient pour but commun
de poser des normes d’ou résultent objectivement des
droits et des obligations au profit et a la charge de cha-
cune d’elles ; 4 ces droits correspondent certes les obli-
gations réflexes des autres, et a ces obligations des
droits, mais la relation intersubjective entre parties se
dissoudrait, chacun des Etats se trouvant a Pégard des
normes posées par le traité dans une situation | juridi-
que statutaire analogue 4 celle que fait le droit interne
aux personnes assujetties 4 une loi; Ja relation
commutative entre parties, fondée sur l’échange des
prestations, s’estomperait ainsi au profit de leur
commune soumission a la convention, d’ot elles tire-
raient directement leurs obligations et leurs droits. Les
traités-lois, qui ont toujours pour contenu des. régles
(et non des normes individuelles), devraient a leurs
caractéristiques un régime juridique partiellement
différent du droit commun des traités ; ainsi la dispari-
tion de ’élément de réciprocité exclurait la possibilité
pour un Etat d’invoquer la non-exécution de son enga-
gement par l’autre partie comme motif pour ne pas
exécuter le sien, et surtout favoriserait Pidée que les
Etats dont l’accord a permis la conclusion du traité
n’en sont pas les principaux destinataires, ou en tout
cas pas les seuls : agissant collectivement comme légis-
lateur conjoint et non individuellement comme
contractants, ils produiraient des conventions dont les
normes s’adressent a leurs sujets internes autant ou
plus qu’a eux-mémes, et affectent directement la situa-
tion juridique de ceux-ci (infra, chap. III, sur le pro-
bléme de |’ « immédiateté »).
Il est d’usage de dire que la distinction des traités-contrats et
des traités-lois est sans portée positive, et certes elle a un carac-
tére doctrinal et n’est pas reprise en termes exprés dans la
25
Vous aimerez peut-être aussi
- Orgueil et Préjugés - Edition illustrée: Pride and PrejudiceD'EverandOrgueil et Préjugés - Edition illustrée: Pride and PrejudiceÉvaluation : 4.5 sur 5 étoiles4.5/5 (20391)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItD'EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItÉvaluation : 4.5 sur 5 étoiles4.5/5 (3310)
- Art of War: The Definitive Interpretation of Sun Tzu's Classic Book of StrategyD'EverandArt of War: The Definitive Interpretation of Sun Tzu's Classic Book of StrategyÉvaluation : 4 sur 5 étoiles4/5 (3321)
- The 7 Habits of Highly Effective People: The Infographics EditionD'EverandThe 7 Habits of Highly Effective People: The Infographics EditionÉvaluation : 4 sur 5 étoiles4/5 (2487)
- Learn German! Lerne Englisch! ALICE'S ADVENTURES IN WONDERLAND: In German and EnglishD'EverandLearn German! Lerne Englisch! ALICE'S ADVENTURES IN WONDERLAND: In German and EnglishÉvaluation : 3.5 sur 5 étoiles3.5/5 (5622)
- How To Win Friends And Influence PeopleD'EverandHow To Win Friends And Influence PeopleÉvaluation : 4.5 sur 5 étoiles4.5/5 (6538)
- The 7 Habits of Highly Effective PeopleD'EverandThe 7 Habits of Highly Effective PeopleÉvaluation : 4 sur 5 étoiles4/5 (2571)
- How to Win Friends and Influence People: Updated For the Next Generation of LeadersD'EverandHow to Win Friends and Influence People: Updated For the Next Generation of LeadersÉvaluation : 4 sur 5 étoiles4/5 (2327)
- Habit 6 Synergize: The Habit of Creative CooperationD'EverandHabit 6 Synergize: The Habit of Creative CooperationÉvaluation : 4 sur 5 étoiles4/5 (2499)
- Habit 1 Be Proactive: The Habit of ChoiceD'EverandHabit 1 Be Proactive: The Habit of ChoiceÉvaluation : 4 sur 5 étoiles4/5 (2559)
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeD'EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeÉvaluation : 4 sur 5 étoiles4/5 (5814)
- The Picture of Dorian Gray: Classic Tales EditionD'EverandThe Picture of Dorian Gray: Classic Tales EditionÉvaluation : 4 sur 5 étoiles4/5 (9764)
- Wuthering Heights (Seasons Edition -- Winter)D'EverandWuthering Heights (Seasons Edition -- Winter)Évaluation : 4 sur 5 étoiles4/5 (9974)
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeD'EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeÉvaluation : 4.5 sur 5 étoiles4.5/5 (20099)
- Habit 3 Put First Things First: The Habit of Integrity and ExecutionD'EverandHabit 3 Put First Things First: The Habit of Integrity and ExecutionÉvaluation : 4 sur 5 étoiles4/5 (2507)
- Anna Karenina: Bestsellers and famous BooksD'EverandAnna Karenina: Bestsellers and famous BooksÉvaluation : 4 sur 5 étoiles4/5 (7503)
- Alice in Wonderland: Down the Rabbit HoleD'EverandAlice in Wonderland: Down the Rabbit HoleÉvaluation : 4 sur 5 étoiles4/5 (4611)
- The Secret Garden: The 100th Anniversary Edition with Tasha Tudor Art and Bonus MaterialsD'EverandThe Secret Garden: The 100th Anniversary Edition with Tasha Tudor Art and Bonus MaterialsÉvaluation : 4 sur 5 étoiles4/5 (6840)
- The Illustrated Alice in Wonderland (The Golden Age of Illustration Series)D'EverandThe Illustrated Alice in Wonderland (The Golden Age of Illustration Series)Évaluation : 4 sur 5 étoiles4/5 (4347)
- Pride and Prejudice: Bestsellers and famous BooksD'EverandPride and Prejudice: Bestsellers and famous BooksÉvaluation : 4.5 sur 5 étoiles4.5/5 (20479)




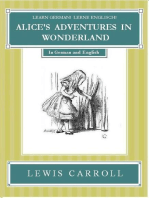

















![Don Quixote: [Complete & Illustrated]](https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/264046221/149x198/541f56cceb/1617238192?v=1)



