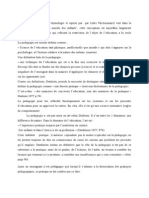Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Le Bon, Gustave - L'homme Et Les Sociétés, Leurs Origines Et Leur Histoire - II (Uqac)
Le Bon, Gustave - L'homme Et Les Sociétés, Leurs Origines Et Leur Histoire - II (Uqac)
Transféré par
SugarplantationTitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Le Bon, Gustave - L'homme Et Les Sociétés, Leurs Origines Et Leur Histoire - II (Uqac)
Le Bon, Gustave - L'homme Et Les Sociétés, Leurs Origines Et Leur Histoire - II (Uqac)
Transféré par
SugarplantationDroits d'auteur :
Formats disponibles
Gustave Le Bon (1841-1931)
Sociologue franais
(1881)
Lhomme et les socits
Leurs origines et leur histoire
DEUXIME PARTIE
LES SOCITS
Leurs origines et leur dveloppement
Un document produit en version numrique par Rjeanne Toussaint, bnvole,
Courriel: rtoussaint@aei.ca
Dans le cadre de la collection: "Les classiques des sciences sociales"
Site web: http://www.uqac.ca/Classiques_des_sciences_sociales/
Une collection dveloppe en collaboration avec la Bibliothque
Paul-mile-Boulet de l'Universit du Qubec Chicoutimi
Site web: http://bibliotheque.uqac.ca/
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
Cette dition lectronique a t ralise par Madame Rjeanne Toussaint, bnvole, Chomedey, Ville de
Laval, Qubec.
partir du livre de :
Gustave Le Bon
[sociologue franais, 1841-1931],
L'homme et les socits. Leurs origines et leur dveloppement.
Deuxime partie: Les socits Leurs origines et leur
dveloppement.
Ouvrage orn de 90 gravures. Rimpression de l'dition J. Rothschild de 1881.
Paris: rimpression, ditions Jean-Michel Place, 1987, 432 pages. Collection: Les
Cahiers du GrandHiva, no 5.
Polices de caractres utilise :
Pour le texte: Times New Roman, 14 points.
Pour les citations : Times New Roman 12 points.
Pour les notes de bas de page : Times New Roman 10 points.
dition lectronique ralise avec le traitement de textes Microsoft Word 2004 pour Macintosh.
Mise en page sur papier format
LETTRE (US letter), 8.5 x 11)
dition complte le 5 aot 2005 Chicoutimi, Ville de Saguenay, province de Qubec.
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
Gustave Le Bon
[sociologue franais, 1841-1931]
(1881)
Lhomme et les socits.
Leurs origines et leur dveloppement.
Deuxime partie:
Les socits. Leurs origines et leur dveloppement
Ouvrage orn de 90 gravures. Rimpression de l'dition J. Rothschild de 1881.
Paris: rimpression, ditions Jean-Michel Place, 1987, 432 pages. Collection: Les
Cahiers du GrandHiva, no 5.
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
Table des matires
Deuxime partie
Livre premier : La science sociale.
Chapitre premier. - La science sociale et ses limites.
I. L'existence d'une science sociale. - Hypothses qu'on peut invoquer pour expliquer
l'volution des socits. - Rles attribus la providence, au hasard, aux caprices des
hommes. - Minime dveloppement du sentiment de la causalit Chez la plupart des
hommes. - Insuffisance des explications dont se contente ordinairement le plus grand
nombre. - Les socits obissent dans leur volution des lois invariables. - Preuves de
l'existence de ces lois. - Possibilit de prdire avec prcision pour un pays donn le nombre
des naissances, des mariages, des crimes, des dcs, etc. - II. Limites de la science sociale. Les donnes tires de la statistique fournissent les preuves de l'existence de lois sociales,
mais ne nous les font pas connatre. - Limites de nos prvisions. - Pourquoi les prvisions
des astronomes semblent avoir une prcision que ne sauraient comporter celles des
phnomnes sociaux. - En quoi leurs prvisions ne sont galement qu'approximatives.
Chapitre II. - Utilit de la science sociale.
Ignorance gnrale de l'existence d'une science sociale. - Dangers de cette ignorance. Exemples fournis par l'histoire - de. divers peuples. Rvolutions et guerres produites par
l'ignorance des lois sociales. - Exemples fournis par les rcentes tentatives de civilisation du
Japon.
Chapitre III. - Mthodes de la science sociale.
L'tude des phnomnes historiques et sociaux passe aujourd'hui aux mains des savants. tendue des connaissances scientifiques que cette tude exige. - Ressources fournies par les
diverses sciences. - Mthode d'tude des phnomnes sociaux. - Ils doivent tre
dcomposs dans leurs lments constituants. -Un phnomne social ou religieux doit tre
tudi comme un phnomne physique quelconque.
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
Livre II. Les facteurs de l'volution sociale.
Chapitre I. - Les socits animales et les socits humaines primitives. - Existence des premiers
hommes.
I. Anciennes croyances relatives l'tat des premiers hommes. - Conception que se faisaient
de l'homme primitif les philosophes du dernier sicle. - Ides qu'ils se formaient de l'tat
intellectuel, moral et social de nos premiers pres. - Comment on supposait alors que se
fonde une socit. - Influence politique immense que ces conceptions ont eue. II. Les
socits animales. - Les socits animales se sont formes sous l'empire des mmes
ncessits que les socits humaines. - On y retrouve les mmes lments. - Murs, usages,
travaux de diverses socits animales infrieures. - Faits dmontrant que les sentiments
sociaux et la moralit des animaux ne sont pas infrieurs ceux des sauvages. - Socits de
singes et de castors. - Ce qui dtermine l'tat de sociabilit ou d'isolement des diverses
espces animales. - III. Formation des socits humaines primitives. - Les dbris laisss par
nos premiers aeux nous rvlent leur infriorit primitive et leurs conditions d'existence
misrables. - Ncessits qui ont dtermin la formation des premires agglomrations
humaines. - Pourquoi, pendant de longues sries de sicles, ces agglomrations ne purent
jamais tre bien nombreuses. - IV. Existence des premiers hommes. - Leur tat physique et
intellectuel. - Preuves de leur frocit et de leurs habitudes d'anthropophagie. - L'tude des
sauvages modernes permet de complter l'ide que nous pouvons nous former de nos
premiers anctres d'aprs leurs dbris. - Opinion des voyageurs les plus rcents sur la
frocit, l'absence de morale et les sentiments infrieurs des sauvages. - Leur habitude de
tuer et de manger leurs parents gs. - Comment ils traitent leurs femmes. - Habitude des
Australiens de manger les vieilles femmes. - En quoi consistent les ides religieuses des
sauvages. - Pourquoi leurs murs et leur genre de vie varient sur les diffrents points du
globe. - Preuves que nos premiers aeux ressemblaient aux sauvages les plus infrieurs. Leurs conditions d'existence ne semblent misrables que parce que nous les comparons aux
ntres. - Leurs ides et leurs besoins taient adapts leurs conditions d'existence. - Les
sauvages les plus misrables sont satisfaits de leur tat et n'en veulent pas changer. Conclusion.
Chapitre II. - Influence des milieux.
I. Conditions d'adaptation des individus leurs milieux. -L'adaptation n'est possible qu' la
condition de se faire lentement. - Erreurs gnralement professes sur l'acclimatement. Preuves fournies par l'histoire de l'gypte et de certaines parties de l'Afrique, de l'incapacit
de l'homme s'adapter brusquement certains changements de milieux. - II. Influence des
milieux. - Cette influence devient profonde quand elle a t accumule, pendant plusieurs
sicles, par l'hrdit. -Transformations sabies par les mmes races en changeant de milieu.
- Les Anglais, en Amrique, tendent retourner au type Peau-Rouge. - Influence des divers
lments : climat, chaleur, lumire, composition du sol, etc., qui constituent les milieux. Influence du milieu intellectuel et moral.
Chapitre III. - Influence de l'intelligence et des sentiments.
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
I. Influence de l'intelligence. - Importance exagre gnralement attribue l'intelligence
dans l'volution des socits. - Ce sont les sentiments et non l'intelligence qui conduisent le
monde. - Preuves fournies par le caractre des personnages ayant jou les plus grands rles
dans l'histoire. -L'ingalit du dveloppement des sentiments explique pourquoi les mmes
institutions ne conviennent pas des peuples d'intelligence gale. - II. Influence des
sentiments. - Rle des divers sentiments. - Leurs transformations. - La civilisation ne
progresse qu'avec ces transformations. - Erreurs de quelques philosophes sur l'invariabilit
des sentiments moraux. - Comment la ncessit transforme les sentiments.
Chapitre IV. - Influence de l'acquisition du langage, des relations commerciales et des progrs de
l'industrie, de la littrature et des arts.
I. Influence de l'acquisition du langage. - Existence d'un langage chez tous les tres vivants.
- L'homme ne commena a progresser que quand le langage fut suffisamment dvelopp. La langue d'un peuple est l'image de sa civilisation. - II. Influence des relations
commerciales. - Elles ont t un lment actif des progrs social. - III. Influence des
progrs de l'industrie. - Progrs raliss par la division croissante du travail. - Les progrs
industriels ont eu pour rsultat de soustraire de plus en plus l'homme l'influence des agents
extrieurs. - Importance des progrs de l'industrie moderne. - Ils ont eu plus ; d'action sur le
dveloppement social de l'homme que les plus grandes rvolutions. - Nombre considrable
d'ouvriers reprsents par la consommation de la houille dans les machines vapeur. - Les
progrs de l'industrie ont-ils augment le bonheur de l'homme ? - IV. Influence des arts et
de la littrature. - Les arts et la littrature d'un peuple reprsentent des effets et non des
causes ; ils constituent l'image exacte de la civilisation qui les a produits. - Limites de leur
influence.
Chapitre V. - Influence de la lutte pour l'existence et du dveloppement des institutions militaires.
I. Gnralit de la lutte pour l'existence dans l'espce humaine. - La guerre a toujours t
une des principales occupations de l'homme. - La civilisation ne fait que la rendre plus
meurtrire et plus coteuse. - Ce que cotent les guerres modernes. - La guerre n'est pas
toujours la forme la plus meurtrire de la lutte pour l'existence. - Sentiments de frocit
engendrs chez l'homme par l perptuit de la lutte pour l'existence. - La civilisation ne fait
que les masquer. - Frocit native de l'enfant. II. Influence de la lutte pour l'existence sur
rvolution des socits humaines. - Importance de cette lutte. - La civilisation ne progresse
que dans les pays o la lutte est violente. - Le degr de civilisation d'un peuple peut se
mesurer. la perfection de son armement militaire. - Qualits diverses discipline, mulation,
courage, etc., cres par la lutte pour l'existence.
Chapitre VI. - Influence de la connaissance de l'agriculture et du dveloppement de la population.
I. Influence de l'agriculture. - Impossibilit pour les individus vivant uniquement du produit
de leur chasse de se runir en socits nombreuses. - Importance des progrs dont
l'agriculture a t l'origine. - Le chiffre de la population d'un pays est en rapport exact avec
ses ressources agricoles. - II. Influence du mouvement de la population. - Dangers d'une
multiplication trop rapide de la population quand les ressources agricoles n'augmentent pas.
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
- Ce que cote un adulte produire. - Dficit actuel des nations europennes au point de vue
agricole. - Documents statistiques relatifs la production et la consommation en France. L'augmentation de la population se fait gnralement dans les classes les plus pauvres. L'accroissement de l'aisance et de l'instruction rduit le chiffre de la population. Documents statistiques relatifs aux naissances, migrations, mouvements de la population,
etc. - Pourquoi certaines contres, telles que l'Allemagne et l'Angleterre, peuvent supporter
une augmentation progressive de leur population. - Avenir de l'migration allemande en
Amrique.
Chapitre VII. - Influence de la stabilit et de l'aptitude varier.
I. Influence de la stabilit. - Importance pour les socits primitives de pouvoir se plier au
joug de rgles et de coutumes. -Supriorit que leur acquisition procure. - Trs-difficile
tablir d'abord, la coutume devient bientt toute-puissante. - Sa tyrannie chez certains,
peuples de l'antiquit tels que les Grecs. - Puissance absorbante de l'tat. - L'individu lui
appartenait tout entier. - Ncessit d'un tel rgime. - Pourquoi la libre pense ne pouvait tre
supporte dans les temps antiques. - Rle puissant de la tradition et des coutumes chez les
nations modernes. - II. Influence de la variabilit. - Aprs avoir t une condition du
progrs, la fixit des coutumes devient sa principale entrave. - Peu de socits primitives
ayant russi se soustraire au joug de la coutume, un trs petit nombre ont progress. Conditions diverses qui favorisent les transformations des coutumes. - La guerre et les
relations commerciales sont les principaux facteurs de ces transformations. - Ce que
deviennent les nations qui ne peuvent se soustraire au joug de la coutume. - Exemples de
l'Inde et de la Chine. - Conclusion.
Chapitre VIII. - Influence des grands hommes et de l'action individuelle.
Importance considrable gnralement attribue aux grands hommes par les historiens. Origine de cette croyance. - En quoi elle est errone. - Le rle des grands hommes est
beaucoup moindre qu'on ne le suppose gnralement. - troites limites de leur action. Leur apport reprsente l'hritage d'un long pass lentement labor avant eux. - Preuves
fournies par l'histoire des principales inventions. - Machine vapeur. - Poudre canon. Imprimerie. - En quoi la supriorit des grands hommes est plus grande dans le domaine
scientifique que dans le domaine politique.
Chapitre IX. - Influence de la race.
I. Diversit du caractre des races. Importance de cette tude. - L'ide que l'homme est le
mme dans tous les pays a t longtemps gnrale. - Erreur de cette conception. - Diversit
du caractre des races. - Anciennet de la formation de leurs caractres. - Leur permanence.
- Le rle historique de chaque race dpend de son caractre. - II. Composition des races qui
constituent les nations modernes. - Influence des croisements sur la formation des
caractres nationaux. - Toutes les nations modernes sont formes par des mlanges de races
diffrentes. - Exemples fournis par les Franais, les Allemands, les Juifs, etc. - III. Influence
des lments qui entrent dans la constitution d'un peuple sur son volution sociale. Variation des rsultats suivant les lments mis en prsence. - Leur influence sur la forme
des gouvernements. - Dangers de croiser des races trop diffrentes. - Ces dangers ont t
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
mconnus par des nations modernes. - La communaut des sentiments est beaucoup plus
importante pour un peuple que celle du langage. - Rsultats produits par le contact de races
trs diffrentes. - Exemples fournis par les Anglais, les Irlandais, les Ngres, les Indous, les
Chinois et les Amricains. - Envahissement prochain de la race jaune. - IV. Nature des
diffrences existant entre les diverses races et entre les individus d'une mme race. - Les
diffrences de sentiment et d'intelligence existant entre les hommes tendent-elles s'effacer
ou s'accrotre ? - Recherches anatomiques de l'auteur pour rsoudre cette question. V.
Accroissement des diffrences existant entre la femme et l'homme dans les races
suprieures. L'ingalit entre les races diffrentes et entre individus d'une mme race
s'accentue de plus en plus avec le dveloppement de la civilisation. - VI. Accroissement des
diffrences existant entre l'homme et la femme dans les races suprieures. - Explication
psychologique du fait anatomique que dans les races suprieures l'homme et la femme
tendent se diffrencier de plus en plus. - Nature des diffrences intellectuelles et morales
existant entre les deux sexes. - Incapacit de la femme raisonner ou se laisser influencer
par un raisonnement. - Son habitude de se laisser guider par l'instinct du moment. Exagration de ses sentiments. - Elle est plus rapproche de l'enfant et du sauvage que de
l'homme. - Inconvnients de lui donner la mme ducation qu' l'homme.
Chapitre X. - Influence du pass et de lhrdit .
I. Les faits de l'hrdit. - L'hrdit s'tend toutes les modifications organiques et
mentales. - Les instincts qu'elle transmet sont parfois assez puissants pour l'emporter sur le
sentiment de la conservation lui-mme. - Hrdit de la constitution mentale. - Hrdit du
penchant au crime. -Difficult de transformer les penchants hrditaires. - Les qualits
acquises par les parents ne se fixent dans la race qu'aprs avoir t accumules par l'hrdit
pendant plusieurs gnrations. - II. Les divers modes de l'hrdit. - Influence d'un seul
parent ou de deux parents. - Accumulation des qualits ou des dfauts dans les croisements
entre parents. - Influence des parents loigns. - Exemples divers d'influences ataviques. Comment peuvent se manifester chez les descendants des aptitudes que n'ont jamais
possdes aucuns de leurs ascendants. - Influence de l'tat des parents au moment de la
conception. - Influence de l'tat de la mre pendant les premiers temps de la conception. Explication des phnomnes de l'hrdit. - Elle peut tre considre comme un mode de
croissance du mme individu. - III. Les consquences de l'hrdit. - Consquences
relatives la transformation des espces. - Consquences relatives la transmission des
vertus ou des vices. - Dangers pour une socit de la reproduction d'lments infrieurs mal
adaptes. - Erreurs de la philanthropie. - Imperfection de la lgislation relative aux criminels,
- Consquences de l'hrdit au point de vue de la transmission des aptitudes intellectuelles
et mentales. - Consquences politiques de l'hrdit. - Castes et noblesse. - Influence de
l'hrdit sur nos conceptions morales, religieuses et sociales. - Notre morale est cre par
notre pass. - Les gnrations qui nous ont prcds vivent toujours en nous. - Puissante
influence des morts.
Chapitre XI. - Influence des illusions et des croyances religieuses.
1. Influence des illusions. - Rle important qu'elles exercent sur l'volution de l'homme. Sous le nom d'idals, elles constituent le but que pour suivent tous les hommes. - Leur
ncessit et leur puissance. - Danger de les dtruire. - L'homme ne peut s'en passer. - II.
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
Influence des croyances religieuses. - Les religions reprsentent les illusions formules en
doctrines. - Idale divers qu'elles ont proposs l'homme. - Toute-puissance des religions
sur les mes dans l'antiquit classique. - Le droit et les institutions politiques reposaient sur
elles. - Tous les dtails de la vie taient rgle par la religion. - Disparition des religions
antiques. - Nouvel idal cr par le christianisme. - Rle considrable qu'il a jou dans le
monde. - Idal des religions de l'Inde. - Leur influence. - Influence de la religion sur la
conduite.
Chapitre XII. - Influence des institutions politiques et de l'action des gouvernements.
I. Relations entre les institutions d'un peuple et sa constitution mentale. - Anciennes ides
sur l'influence des institutions et des gouvernements. - Comment elles se sont modifies. Ides actuelles sur l'enchanement des faits historiques. - Les institutions politiques ne sont
pas luvre de la volont des hommes. - On les subit et on ne les choisit pas. - Preuves
historiques. - Gense de quelques institutions. - Esclavage, fodalit, royaut, etc. Formation de la constitution anglaise. -Valeur relative des institutions politiques. Difficult de les transplanter. - Erreurs des rformateurs politiques et sociaux. - II.
Influence des gouvernements. - Conditions qui rendent avantageuse ou nuisible leur
intervention. - Cette intervention doit tre porte son maximum ou, au contraire, rduite
son minimum, suivant la race, les habitudes, les conditions d'existence, les sentiments, etc. Exemples divers.
Chapitre XIII. - Influence de l'instruction et de l'ducation.
I. Limites de la puissance de l'ducation. - Elle est un des rares facteurs dont l'homme
dispose. - Sa puissance est trs grande, mais gnralement exagre. - Son action ne se fait
sentir que lorsqu'elle s'est exerce pendant plusieurs gnrations. - C'est surtout sur les
sentiments que sa puissance est faible. - II. L'enseignement primaire. - Bases sur lesquelles
il doit reposer. -Notions qui doivent entrer dans l'enseignement primaire. - Comment ces
notions doivent tre enseignes. - Enseignement des sciences. - ducation morale. Enseignement professionnel. - Mauvais rsultats de notre enseignement primaire. Difficult de le transformer. - III. L'ducation des femmes. - Importance de cette ducation.
- Ce qu'elle est dans divers pays. - Pourquoi la femme ne doit pas recevoir une instruction
semblable celle de l'homme. - Mme dans les races infrieures, la femme peut, aussi bien
que l'homme, acqurir l'instruction classiques. Pourquoi la possibilit de cette acquisition ne
prouve rien en faveur de l'utilit pour elle de cet enseignement. - Au point de vue
intellectuel, l'homme et la femme ne se diffrencient profondment qu' l'ge adulte. - La
femme conserve toujours la constitution mentale de l'enfant. - Ses aptitudes. - Elle est trsapte l'ducation de l'enfance. - IV. L'Enseignement secondaire. - Bases de cet
enseignement. - Ce qu'il importerait d'apprendre. - Rle funeste jou par le grec et le latin
dans l'enseignement. - La mme ducation ne saurait convenir toutes les intelligences. Rsultats dsastreux produits sur l'intelligence et les sentiments par notre ducation
classique. - V. L'enseignement suprieur. - Diversit des mthodes. d'enseignement
suprieur dans plusieurs pays. - Rsultats malheureux produits par nos mthodes
d'enseignement suprieur. - Comment se forment nos professeurs. - Profonde dcadence de
notre enseignement suprieur. - Consquences sociales de l'ducation.
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
10
Livre III. Dveloppement des socits.
Chapitre I. - Dveloppement du langage.
I. Origine et formes diverses du langage. - Formes diverses du langage. - Il n'est pas une
facult spciale l'homme. - Tous les animaux ont un langage. - On peut passer par
transitions insensibles du langage des animaux celui de l'homme. - II. Langage des
premiers hommes. - Moyens de le reconstituer. - Comment il se rattache celui des autres
vertbrs. - Naissance du langage articul. - Il se composa d'abord de cris, d'interjections et
de sons imitative. - Imperfection du langage des races humaines infrieures. - Ncessit
pour elles de complter leur langage par des gestes. - Importance du langage par gestes chez
beaucoup de peuples actuels. - III. Lois du dveloppement du langage. - Formation et
dveloppement des premires racines des langues. - Formes que les langues ont
ncessairement revtues dans leur dveloppement. - Monosyllabisme, agglutination et
flexion. - Ncessit pour les langues suprieures de traverser d'abord des formes intrieures.
-Transformations continuelles des langues. - Elles sont l'image de l'tat intellectuel et social
des peuples, qui les parlent. - IV. Comment les peuples transforment leurs langues. - Un
peuple peut adopter la langue d'un autre peuple, mais il lui fait subir rapidement des
modifications en rapport avec son tat de civilisation. - Exemples des transformations
prouves par le latin en Italie, en Espagne et en Gaule. - Comment s'est form le franais. Mcanisme de la transformation des langues. - Il varie suivant le gnie de chaque peuple. Exemples fournis par la langue anglaise. - V. Formation et dveloppement du langage crit.
- Origines de l'criture. - Elle drive de la reprsentation directe des objets. - Ce mode de
reprsentation se retrouve encore chez beaucoup de peuples. - Sa prcision. - C'est de la
reprsentation des objets que drivent les hiroglyphes. - Comment l'criture reprsentant
les objets eux-mmes s'est transforme en signes indiquant le son des mots par lesquels on
dsigne ces objets, - Exemples fournis par l'criture en gypte. - Comment ces signes ont
donn naissance aux divers systmes d'criture employs plus tard. - Rsum.
Chapitre II. - Dveloppement de la famille.
I. Erreurs des anciennes conceptions relatives l'tat primitif de la famille. - La famille n'a
pas dbut par l'tat patriarcal. - Mthodes qui permettent de reconstituer son tat primitif.
II. Les communauts primitives. - La parent maternelle. - Les socits primitives ont pass
par des formes o les femmes taient possdes en commun. - Ces formes ne sont pas
primitives. - Usages religieux et sociaux drivs de la communaut fminine primitive. Estime dans laquelle la prostitution a t tenue elles un grand nombre de peuples. -Parent
par les femmes. - Les enfants n'ont port pendant longtemps que le nom de leurs mres. III. Constitution de la parent paternelle. - Restriction des droits de la communaut. - La
communaut des femmes finit par se rduire la communaut d'une seule entre parents. Persistance de cet usage chez divers peuples. - Comment le nom du pre a fini par se
substituer celui de la mre. - IV. Condition des femmes et des enfants dans les socits
primitives. - La femme a toujours t considre comme une esclave par tous les anciens
peuples. - Les codes anciens et modernes l'ont toujours envisage comme une crature trs
infrieure. - Sort des enfants dans les socits primitives. - Gnralit de l'infanticide. - V.
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
11
Constitution de la famille dans l'antiquit historique. - Puissance de son organisation. - Elle
avait pour chef le pre de famille. - Il tait le seul juge lgal de la famille. - L'unit sociale
des ges antiques tait la famille et non l'individu. Transformations de la famille dans les
temps modernes. - Sa dissociation progressive.
Chapitre III. - Dveloppement de la proprit.
I. Les formes primitives de la proprit. - La proprit n'a pas toujours exist sous ses
formes actuelles. - L'ide de la proprit individuelle du sol ne pouvait natre que trs-tard. Formes de la proprit chez les peuples primitifs. - La proprit chez les peuples chasseurs,
pasteurs et agriculteurs. - La proprit du sol en commun. - La redistribution poques
priodiques aux divers membres de la communaut. - Description du Mir en Russie.
-Communaut des villages dans bride, Java, etc. - Ces formes de la proprit
correspondent certaines priodes de l'volution par laquelle tous les peuples ont d
successivement passer. - Rsultats que la communaut des terres a engendrs. - II.
vo1ution de la proprit depuis qu'elle est devenue individuelle. - tat de la proprit chez
les Grecs et les Romains. - Apparition du droit de tester. - Il n'est pas primitif. - L'origine de
la proprit chez les Grecs et les Romains ne drive pas des coutumes religieuses. - Elle
n'est pas non plus celle qu'indiquent les lgistes. - Transformations de la proprit. L'emphytose. - Les bnfices. - Le fermage. - Les baux long terme. - Comment dans les
temps modernes la petite proprit tend disparatre et redevenir collective. - Avenir de la
proprit.
Chapitre IV. - Dveloppement des croyances religieuses.
I. Formation des croyances religieuses. - Sentiment religieux chez l'animal. - Gense des
croyances religieuses. - lments dont se compose le sentiment religieux chez l'homme. Ses transformations. - II. volution des religions. - Ancienne division des cultes en
ftichisme, monothisme et polythisme. - Minime valeur de ce classement. - En quoi
consiste rellement l'volution des religions. - Les cultes primitifs. - Toutes les choses de la
nature ont t successivement adores. - Adoration des animaux, des astres, etc. - Culte des
morts. - Sa gnralit. -Origine des sacrifices. - Leur gnralit dans les religions. - Culte
des grands hommes. - Prtendue origine des dieux antiques suivant les linguistes. - Les
grands cultes dites monothistes. - Le judasme, le brahmanisme, le bouddhisme, le
christianisme. -Tous ces cultes ont t en ralit polythistes. - III. Comment les peuples
transforment leurs religions. - De mme que le langage, chaque culte se transforme suivant
la constitution mentale du peuple qui le reoit. - Comment le mme culte peut-tre
ftichiste, polythiste et monothiste, suivant les individus qui l'ont adopt. - Exemples
fournis par le bouddhisme et le christianisme transplants en divers pays. - Formation de
l'islamisme et du protestantisme. - IV. Les religions de l'avenir. - Les vieilles croyances ne
sont plus en rapport avec la conception du monde rsultant des dcouvertes de la science
moderne. - Disparition de la croyance dans l'ide de divinit. - Les anciennes croyances
s'vanouissent, mais le sentiment religieux reste vivant dans les mes. - Formation d'un
idal nouveau et de croyances nouvelles. - Les religions en voie de formation seront-elles
meilleures que celles qui les ont prcdes ?
Chapitre V. - Dveloppement de la morale.
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
12
I. Variabilit de la morale. - Origine de la morale. - Hypothses errones sur son
invariabilit. - Preuves de sa transformation. - II. Morale des animaux. - Dveloppement
des qualits morales chez l'animal. - Impossibilit d'tablir une sparation entre le sens
moral de l'homme et celui des animaux. - III. Morale des tres humains infrieurs :
sauvages, femmes et enfants. - tat barbare de la morale des sauvages. - Absence d'ides de
justice et de bienveillance. - Pourquoi la morale de quelques tribus sauvages est assez
dveloppe. - La morale de l'enfant de l'homme civilis se rapproche de celle du sauvage. tat infrieur du dveloppement moral de la femme. - IV. Les facteurs de la morale. - Il n'y
a point de principes absolus d'o on puisse dduire la morale, mais il exist des facteurs
nombreux, variables suivant les temps, qui la dterminent. - Influence de ces divers
facteurs. - L'utilit. - L'opinion. - Le milieu. - La slection. - La coutume. - La religion. L'ducation. - Les lois. - L'intelligence et la raison. - V. volution future de la morale. L'tat moral d'un peuple a gnralement plus d'influence sur sa destine que l'tat de son
intelligence. - Influence de l'abaissement de la moralit romaine sur la dcadence de Rome.
- La morale actuelle s'appuie sur des croyances en voie de disparatre. - Formation de la
morale de l'avenir.
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
13
Chapitre VI. - Dveloppement du droit.
I. Les origines du droit. - Erreurs des anciennes conceptions relatives l'tat primitif du
droit. - Gense de ces conceptions. - Elles drivent des thories des lgistes romains. Comment l'ide du droit naturel naquit l'poque romaine. - Bases relles du droit. - On ne
peut le dduire de principes absolus antrieure l'existence des socits. Il rsulte des
conditions mmes d'existence de chaque peuple et varie avec ces conditions. - Influence de
l'opinion sur sa formation. - Des peuples diffrents possdent forcment des codes
diffrents. - Le droit ne peut se maintenir qu'entre individus de forces gales. - Pourquoi les
rgles des droits entre individus ne sont jamais observes dans les relations entre peuples
diffrents. - Ncessits qui conduiront un jour les observer. II. volution du droit. - Les
codes n'ont jamais t crs par des lgislateurs et reprsentent des ncessits indpendantes
d'eux. - Applications de la mthode l'histoire de l'volution du droit en ce qui concerne les
dlits et les peines. - Formes primitives du droit de punir. - Exerc uniquement d'abord par
l'offens ou par ses parents, il apparat primitivement sous forme de peine du talion. Substitution graduelle de la compensation la peine du talion. - Comment l'ide de
dshonneur, accompagnant le crime, remplace, celle de simple dommage rparer. Pourquoi la socit arriva se substituer l'individu dans la rpression des dlits et des
peines. - Conception du droit de punir dans les codes modernes. - En quoi le but qu'ils se
proposent n'est nullement atteint. - Comment il pourrait l'tre. - Documents statistiques
relatifs a l'influence de nos codes en matire de crimes et de rpression.
Chapitre VII. - Dveloppement de l'industrie et de l'conomie sociale.
I. Formes primitives de l'industrie. - Elle est contemporaine des premiers hommes. - Son
existence chez les animaux. -L'ancienne industrie ne connaissait que la force musculaire
comme puissance motrice. - Dans l'antiquit classique, le travail tait exclusivement
l'apanage des esclaves. - II. Nouvelle organisation de l'industrie aprs la disparition de
lesclavage et du servage. - Constitution de chaque industrie en corporation. - Rigueur des
rgles qu'elles imposaient. - En quoi elles taient adaptes aux besoins des temps o elles
prirent naissance. - III. L'industrie moderne. - Comment l'antique rgime des corporations
disparut. - Influence des voies de communication nouvelles et des dbouchs nouveaux. Naissance de l'industrie libre. - Influence des machines. - Influence de la dcouverte de la
houille comme force motrice et de l'emploi de la machine vapeur. - Influence considrable
du progrs des sciences. - La civilisation moderne est fonde sur elles. - Rsultats
avantageux de l'industrie moderne. - Comparaison entre l'aisance actuelle et ce qu'elle tait
il y a quelques sicles. - Rsultats dsavantageux de l'industrie. - Influence des tendances
utilitaires. - Accroissement des diffrences entre individus de diverses classes. - Lutte entre
le capital et le travail. - Dgnrescence intellectuelle et morale des classes infrieures
produite par les conditions actuelles de l'industrie. - Comment on pourrait y remdier. - IV.
volution actuelle de l'industrie et de l'conomie sociale. - Tendance actuelle de la
proprit industrielle prendre la forme collective. - Mcanisme de l'association. - Formes
diverses d'associations ouvrires. - Leur avenir. - Importance de faire acqurir l'ouvrier un
petit capital. - Comment on pourrait y arriver. - Infriorit des conceptions des socialistes
modernes. - Elles nous ramneraient des formes d'volution intrieures depuis longtemps
dpasses. - Pourquoi, malgr leur valeur nulle, ces conceptions sont peut-tre appeles
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
14
jouer un rle trs grand. - Les rvolutions scientifiques et industrielles ont une importance
beaucoup plus grande que les rvolutions politiques. - Les premires seules exercent une
action durable dans l'existence des hommes.
Rsum.
Fin de l'ouvrage (deuxime partie).
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
Retour la table des matires
15
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
16
L'homme et les socits.
LEURS ORIGINES ET LEUR HISTOIRE.
Deuxime partie
LES SOCITS
Leurs origines et leur dveloppement
Livre I.
La science sociale
Retour la table des matires
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
17
Deuxime partie
LES SOCITS
Leurs origines et leur dveloppement
livre I : La science sociale
Chapitre I.
La science sociale et ses limites.
Retour la table des matires; retour au dbut du chapitre
1. Existence d'une science sociale. - Hypothses qu'on peut invoquer pour expliquer
l'volution des socits. - Rles attribus la providence, au hasard, aux caprices des hommes. Minime dveloppement du sentiment de la causalit chez la plupart des hommes. - Insuffisance
des explications dont se contente ordinairement le plus grand nombre. - Les socits obissent
dans leur volution des lois invariables. - Preuves de l'existence de ces lois. - Possibilit de
prdire avec prcision pour un pays donn le nombre des naissances, des mariages, des crimes,
des dcs, etc. - II. Limites de la science sociale. -Les donnes tires de la statistique fournissent
les preuves de l'existence de lois sociales, mais ne nous les font pas connatre. - Limites de nos
prvisions. - Pourquoi les prvisions des astronomes semblent avoir une prcision que ne
sauraient comporter celles des phnomnes sociaux. - En quoi leurs prvisions ne sont galement
qu'approximatives.
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
18
I. - Existence d'une Science sociale.
Retour la table des matires; retour au dbut du chapitre
Les diverses thories proposes jusqu'ici pour expliquer l'volution des
vnements dont l'histoire enregistre le cours peuvent se ramener en dernire
analyse aux hypothses suivantes : 1 une puissance suprieure, nomme Dieu ou
providence, guide son gr les actions des hommes ; 2 les vnements sont le
rsultat du hasard ; 3 les vnements sont la consquence des volonts humaines ;
4 les vnements reprsentent une chane de ncessits troitement lies, et portent
en eux les causes de leur volution fatale.
Il serait sans intrt, je crois, pour les lecteurs de cet ouvrage, de discuter la
premire des hypothses qui viennent d'tre numres, que les vnements
seraient le rsultat de l'intervention d'une providence. Ne une poque o les
sciences n'existaient pas, et conserve par la puissante influence de l'hrdit, elle
est devenue, chez un grand nombre d'hommes, un de ces sentiments inconscients
sur lesquels la raison ne saurait avoir de prise. Une telle croyance est fille des
temps o Jupiter lanait la foudre, o Phoebus guidait le soleil, o Crs faisait
mrir les moissons. La discuter ici, aprs tant de chapitres consacrs montrer les
lois du dveloppement des choses, serait inutile.
Malgr les progrs des sciences modernes, la croyance au rle d'une providence
sera longtemps encore sans doute invoque. Des diverses faons d'expliquer les
vnements, elle est la plus simple que l'on puisse imaginer. Elle donne rponse
tout et n'exige aucun effort intellectuel de ceux qui l'admettent. La recherche
approfondie des causes est, au contraire, ce qu'il y a de plus fatigant pour l'esprit.
Dans cette recherche, la plupart des hommes ne diffrent gure des enfants, dont le
perptuel pourquoi est satisfait par les explications les plus futiles. Ils ressemblent
ces habitants du Sahara, dont parle un voyageur, pour lesquels il n'y a pas de
causes, dans le sens que nous attribuons ce mot. Chaque phnomne est d, pour
eux, une puissance mystrieuse dont l'intervention suffit tout expliquer. Dans
l'opration de l'ingnieur qui fait sortir de l'eau de leur dsert en y creusant un puits,
ils voient un miracle. Une telle explication nous parat purile ; elle a pourtant
exactement la mme valeur que celle du croyant qui invoque l'action de la
providence pour faire mrir les moissons et diriger le cours des choses.
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
19
Ce ne sont pas seulement, du reste, les enfants, les sauvages et les peuples
demi civiliss dont la curiosit est satisfaite par les explications les plus
insuffisantes. Mme chez des hommes fort instruits, mais dont l'ducation a t
surtout littraire, le sentiment de la causalit est extrmement peu dvelopp et se
satisfait trs facilement. L o le sauvage met la volont d'une divinit, ils mettent
un mot : l'lectricit, la chaleur, ou le nom d'une force quelconque ; mais, pas plus
que le sauvage, ils n'ont jamais tch de comprendre comment la cause invoque
par eux pouvait produire l'effet observ. Parmi les milliers d'hommes qui voient
natre et mourir les tres, la nuit succder au jour, et le jour la nuit, la graine
grandir et se transformer en arbre, combien seulement se sont demand le pourquoi
de tels phnomnes ; et parmi ceux qui se sont pos de semblables questions
combien en est-il pour lesquels l'explication la plus superficielle n'ait pas t juge
suffisante ?
La deuxime des hypothses que nous avons nonces, que les vnements se
produiraient au hasard, nous semble galement inutile discuter. Dans l'tude du
dveloppement de l'univers et de l'homme, laquelle a t consacre toute la
premire partie de cet ouvrage, nous avons trouv la ncessit partout et le hasard
nulle part.
Il ne nous reste donc examiner que les deux dernires des hypothses
prcdemment numres, c'est--dire que les vnements seraient la consquence
de la volont raisonne des hommes, ou le rsultat de ncessits fatales. Cette
dernire conception est celle que nous avons d adopter dans tous les chapitres qui
prcdent, et celle que nous continuerons adopter encore. Nous essaierons donc
de montrer que ce qui est vrai pour l'univers et les tres qui l'habitent, est vrai
galement pour les socits ; que dans leur volution les secondes obissent,
comme les premiers, des lois rigoureuses ; que les vnements humains forment
une trame de ncessits dont chaque anneau est aussi troitement li ceux qui le
prcdent qu' ceux qui le suivent ; que les socits actuelles sont les rsultats
ncessaires d'un pass d'une immense longueur, et portent en elles le germe de
toutes les transformations qu'elles sont fatalement destines subir encore.
Les socits humaines seraient donc, d'aprs cette thorie, rgies dans leur
dveloppement par des lois aussi immuables que celles qui obligent les plantes
dcrire dans l'espace leurs ellipses invariables ; et, soit que nous remontions par la
pense vers ces ges lointains o vcurent les premiers hommes, soit que nous
plongions dans l'avenir sans fin o se droulent les choses, nous ne pouvons
concevoir dans l'immense univers, depuis les mouvements d'un grain de sable
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
20
jusqu'aux volutions les plus hautes des socits humaines, aucun phnomne qui
ne soit pas l'expression de lois inflexibles auxquelles aucun tre ne saurait se
soustraire.
Avant d'aborder la dmonstration de cette hypothse, il n'est pas inutile peut-tre
de rpter ce que nous avons dit dj, que ce terme de lois naturelles que nous
sommes oblig d'employer souvent pour la commodit du langage, ne doit tre
considr que comme une formule abrge destine exprimer l'ordre constant que
prsente un groupe dtermin de phnomnes. La loi d'un phnomne n'est en
aucune faon la puissance qui le produit, mais seulement la formule indiquant
comment agit toujours cette puissance. Le type le plus parfait de ces lois, celles qui
rgissent la marche des astres dans l'espace, rsument uniquement la srie des
mouvements que doivent toujours accomplir des corps d'un volume dtermin
lorsqu'ils sont placs dans des conditions donnes ; mais, de la cause de ces
mouvements, elles ne sauraient rien dire. Dans l'tat actuel des sciences, rien ne
nous autorise esprer que les causes premires d'un phnomne quelconque
puissent jamais tre pressenties.
Les preuves dmontrant que les socits obissent dans leur volution des
ncessits rigoureuses, seront successivement fournies dans les diverses parties de
cet ouvrage o nous examinerons la transformation des lments varis : famille,
religion, proprit, morale, institutions, croyances, qui entrent dans la constitution
des socits humaines. Oblig de nous limiter ici un point de vue gnral, et de
n'embrasser par consquent qu'un seul ct de la question, nous allons simplement
montrer comment les recherches de divers mathmaticiens modernes ont prouv
que les phnomnes qui semblent le plus dpendre de la volont des hommes,
comme les mariages, les crimes et les suicides, sont ce point le rsultat ncessaire
des circonstances qui les ont prcds, que nous pouvons en prdire d'avance avec
certitude le retour. Nous pouvons dire aujourd'hui, pour un pays et pour une anne
donns, le nombre de mariages de veufs ou de garons, celui des crimes, la nature
de ces crimes et les instruments qui serviront les commettre, combien d'individus
seront accuss, combien condamns et combien acquitts.
Dans tout ce qui se rapporte aux crimes, crit l'auteur qui a le plus approfondi cette
question, le savant mathmaticien Qutelet, les mmes nombres se reproduisent avec une
constance telle, qu'il serait impossible de la mconnatre, mme pour ceux des crimes qui
sembleraient devoir chapper le plus toute prvision humaine.... L'exprience prouve que non
seulement les meurtres sont peu prs annuellement en mme nombre, mais encore que les
instruments qui servent les commettre sont employs dans les mmes proportions. Nous
pouvons numrer d'avance combien d'individus souilleront leurs mains du sang de leurs
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
21
semblables, combien seront faussaires, combien seront empoisonneurs, peu prs comme on peut
numrer d'avance les naissances et les dcs qui doivent se succder.
La socit renferme en elle les germes de tous les crimes qui vont se commettre. C'est elle
en quelque sorte qui les prpare, et le coupable n'est que l'instrument qui les excute. Tout tat
social suppose donc un certain nombre et un certain ordre de crimes qui rsultent comme
consquence ncessaire de son organisation....
Cette observation ne nous prsente au fond que l'existence de la loi bien comme de tous les
philosophes qui se sont occups de la socit sous le rapport physique : c'est que, tant que les
mmes causes subsistent, on doit s'attendre au retour des mmes effets. Ce qui pouvait faire
croire qu'il n'en tait pas ainsi des phnomnes moraux, c'est l'influence trop grande qu'on avait
gnralement suppose l'homme dans tout ce qui se rapporte ses actions.
Parmi les faits sociaux, il n'en est pas de plus important et qui suppose plus l'intervention du
libre arbitre de l'homme que le mariage. Cette circonstance, et la considration que les mariages
sont des lments comparables et compltement connus dans les pays civiliss, ont d nous porter
choisir cette classe de faits pour juger de l'influence que le libre arbitre peut exercer sur l'tat
social... Les mariages considrs sous ce point de vue gnral procdent avec une rgularit telle,
qu'il est permis de croire qu'ils sont uniquement soumis l'influence de causes places en dehors
de la sphre d'action des individus. Il y a plus, les mariages, qui sont censs prsenter les traces
des caprices et des fluctuations des hommes, se succdent avec plus de rgularit que les dcs.
Cependant l'homme ne se consulte pas pour mourir comme il le fait pour se marier.
-- Des diffrentes recherches auxquelles je me suis livr, j'ai cru pouvoir dduire comme
principe fondamental que le libre arbitre de l'homme s'efface et demeure sans effet sensible,
quand les observations s'tendent sur un grand nombre d'individus. (Physique sociale, 2e dit.
1869, t. I, p. 95 et t. Il, p. 319.)
Pour justifier ce qui prcde, j'emprunte aux statistiques officielles les plus
rcentes des chiffres qui prouvent avec quelle rgularit se reproduisent la plupart
des phnomnes sociaux :
Crimes contre les personnes et les proprits.
Annes
Nombre des accuss
Nombre des acquitts
1874
1873
1872
5228
5284
5498
1056
1049
1305
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
22
Il arrive souvent que les mmes chiffres se reproduisent d'une faon presque
identique d'une anne l'autre. Il y a eu, par exemple, 4069 accusations pour
crimes en 1873 et 4072 en 1872 : diffrence, 3 seulement.
Le tableau qui prcde montre galement que le rapport entre le nombre des
accuss et celui des condamns varie fort peu. D'aprs les trois annes que j'ai
donnes , sur 100 accuss, il y en a en moyenne 21 d'acquitts.
Je n'ai pas sous la main les chiffres les plus rcents des jugements infirms en
matire civile, mais je trouve dans le Trait de la thorie des chances et
probabilits, de Cournot, le calcul effectu par lui pour les dix annes comprises
entre 1830 et 1840. Le nombre des jugements infirms par les cours d'appel a t en
moyenne de 31,8 pour cent, avec des carts qui ne se sont levs qu'une seule fois
plus de 3 units au-dessus de la moyenne.
Si nous entrons dans le dtail des crimes et des dlits, nous trouverons pour la
plupart une rgularit analogue. Le tableau suivant le montre clairement. On y voit
notamment que les dlits qui semblent le plus le rsultat du hasard, tels que les
blessures involontaires, sont au contraire ceux qui offrent la rgularit la plus
constante.
Rgularit des crimes et dlits.
Annes
Blessures
involontaires
Assassinats
Empoisonnements
Mendicit
Escroquerie
Abus de
confiance
1875
1874
1873
1872
1092
1095
1097
1128
243
233
259
251
20
23
26
25
7152
7753
7064
7437
3424
3760
3582
3215
3464
3556
3793
3465
Les suicides et les faillites prsentent, comme les crimes, une rgularit
constante. Les chiffres suivants en sont la preuve :
Suicides et faillites.
Annes
Nombre de suicides
Nombre de faillites
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
1875
1874
1873
1872
5472
5617
5525
5275
23
5361
5596
5508
5306
Quelquefois, sous l'influence de causes gnrales, changements des moeurs,
etc., les chiffres se modifient ; mais alors c'est toujours fort lentement. Les
demandes en sparation de corps, par exemple, prennent d'une anne l'autre un
accroissement continu, mais lent, comme le montrent les chiffres que voici, que
j'emprunte, de mme que les prcdents, aux publications officielles :
Demandes en sparation de corps.
Annes
Demandes effectues
Demandes accueillies
1872
1873
1874
1875
2793
2850
2884
2997
2150
2166
2242
2292
Pour les mariages, naissances d'enfants naturels et lgitimes, les chiffres ne sont
pas moins constants. On sait, par exemple, qu'il y a en France 300,400 mariages par
an, 884,000 naissances d'enfants lgitimes, 67,000 d'enfants naturels, 44,000 mortsns, 845,000 dcs. Ces chiffres, qui sont ceux de l'anne 1875, dernire statistique
publie, se rptent chaque anne avec de trs lgres variantes.
La rgularit que nous venons de constater est beaucoup plus grande encore
qu'elle ne le parat, car elle ne porte pas seulement sur le total des chiffres, mais sur
les groupes qui les composent. Certains phnomnes, tels que la taille, le poids des
diffrents habitants d'un pays, ne se groupent pas au hasard, mais suivant des lois
mathmatiques permettant, quand on connat quelques-uns des termes de la srie,
de dterminer les autres. Connaissant, par exemple, la taille d'un certain nombre
d'individus d'un pays, dterminer celle de tous les autres habitants.
Qutelet est le premier qui ait effectu cette dmonstration, et il y attachait avec
raison une importance trs haute. Il a prouv que certaines grandeurs, qui
semblaient au premier abord n'avoir aucun lien entre elles, telles que les tailles et
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
24
les poids des habitants d'un pays, les erreurs qu'on commet en tirant un grand
nombre de fois la cible, se rangent d'aprs l'ordre des ordonnes de la formule, du
binme de Newton, et, avec ces nombres, il a pu construire des courbes assez
rgulires, dites binomiales, dont la forme rappelle un A sommet convexe dont les
deux extrmits infrieures seraient latralement prolonges.
Ces courbes ne sont applicables qu' l'expression d'un petit nombre de
phnomnes, et les calculs qu'elles permettent s'cartent assez souvent des chiffres
donns par l'observation.
Fig.1
Nouvellemthoded'expressiongraphique
desdiversphnomnesstatistiques.
Courbe no 1. - Distribution par ge de la population franaise d'aprs les chiffre publis par
l'Annuaire du Bureau des longitudes, anne 1858.
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
25
Courbe no 2. - Penchant au crime suivant les ges, d'aprs les chiffres donns par Qutelet dans
son Anthropomtrie, suivant les comptes rendus officiels du ministre de la justice, de 1826
1844.
Courbe no 3. - Taille des nouveau-ns
Courbe no 4. - Poids des nouveau-ns
d'aprs les chiffres publis en 1878
dans Les Annales de Dmographie,
par le directeur de l'hospice des
enfants assists de la Seine.
Courbe no 5. - Taille des adultes en France, d'aprs les chiffres donns par Bertillon dans la
dernire dition du Dictionnaire de Nysten.
Courbe no 6. - Taille des adultes en Italie, d'aprs les chiffres officiels du gouvernement italien (la
Dmographie italienne, Rome, 1878).
La premire chelle du ct gauche (en dehors) est l'chelle des conscrits de 135 190
centimtres. Dans cette chelle, 2 millimtres = 1 centimtre.
La deuxime chelle du ct gauche est l'chelle des annes pour la distribution de la
population et le penchant au crime. Elle va de 0 100 ans. - 1 millimtre = 1 anne.
La premire chelle du ct droit (en dedans) est l'chelle de la taille des nouveau-ns de 36
56 centimtres. - 1 millimtre = 1 centimtre.
La deuxime chelle du ct droit est l'chelle du poids des nouveau-ns en kilogrammes et
hectogrammes de 1k 3 4k 6. -3 millimtres = 100 grammes.
L'cartement des ordonnes tant proportionnel dans nos courbes aux variations du
phnomne observ, il suffit pour savoir combien il y a, par exemple, sur 100 nouveau-ns, de
sujets d'une taille donne, de compter le nombre de millimtres horizontalement compris entre les
points o la courbe coupe les lignes horizontales correspondant aux chiffres de l'chelle indiquant
la taille donne. Soit, je suppose, rechercher combien il y a, sur 100 nouveau-ns, de sujets de
51 52 centimtres de taille ; il suffit de compter combien il y a horizontalement de millimtres
entre les points o la courbe coupe les lignes horizontales correspondant aux chiffres 51 et 52.
Les 6 millimtres existant entre les deux points reprsentent le chiffre cherch. Sur 100 nouveauns, il y en a donc 6 dont la taille est comprise entre 51 et 52 centimtres.
La ligne verticale marque en noir exactement au milieu de la planche et sur laquelle est crit
axe des moyennes coupe chaque courbe en un point qui jouit de la proprit de reprsenter
exactement la moyenne des chiffres dont chaque courbe donne le dtail, la simple condition que
la srie sur laquelle on opre soit suffisamment nombreuse. Le chiffre donn, par exemple, pour
la taille moyenne en France et en Italie, d'aprs les documents statistiques, est de 164 centimtres
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
26
pour le premier pays et 162 centimtres pour le second. C'est prcisment celui qu'indiquent nos
courbes avec une erreur d'environ 2 millimtres, c'est--dire ngligeable entirement.
En recherchant une mthode mathmatique pour exprimer facilement des
valeurs possdant entre elles des relations dont la loi n'est pas connue, j'ai russi,
par un procd diffrent de celui de Qutelet, montrer que les phnomnes tudis
par lui, et d'autres qui avaient chapp son analyse, pouvaient tre exprims par
des courbes trs rgulires. J'indiquerai dans un autre chapitre le moyen de les
construire, et je me bornerai ici en reproduire quelques-unes, en indiquant
seulement pour les gomtres que les abscisses y s'ont quidistantes, et que les
ordonnes expriment par leur hauteur les valeurs dont il s'agit de peindre les
variations, et par leur cartement le tant pour cent de ces variations.
Un grand nombre de phnomnes, qui semblent au premier abord indpendants
de toutes lois, tels que les variations d'ge, de poids, de taille, de volume ou de
circonfrence du crne, etc., que peut prsenter un groupe considrable d'individus,
obissent, au contraire, comme le montre l'aspect de mes courbes, des lois trs
rgulires. L'quation analytique de quelques-unes d'entre elles est mme trs
simple. Celle qui reprsente la distribution de la population franaise est, entre 0 et
90 ans, une parabole dont le paramtre = 0, m 040. L'quation analytique de cette
courbe
2
x y
2x40
m'a permis de calculer, indpendamment d'aucun lment statistique, le nombre
1
d'individus qui existaient en
France l'poque pour laquelle elle a t construite .
Dans cette quation si simple se trouve exprim combien il y a d'individus de tous
les ges possibles dans un immense pays comme la France.
1
On trouvera tous ces chiffres dans mon mmoire : Recherches anatomiques et mathmatiques sur les
variations de volume du crne.
J'en extrais quelques-uns :
Population de chaque age en France sur cent individus :AgeNombre d'individus de chaque ge donn par les tables
de statistique pour 1858Nombre d'individus de chaque ge calcul d'aprs la formule de la courbeDe 0 5
ans10,9910,94De 5 109,8010,31De.10 159,379,69De 15 209,029,36De 20 258,548,44De 25 307,887,81De
30 357,227,19De 35 406,626,56De 40 456,035,94De 45 505,455,31De 50 554,844,69De 55 604,194,06De
60 653,513,44De 65 702,752,81
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
27
II. - Limites de la Science sociale.
Retour la table des matires; retour au dbut du chapitre
Les prvisions fondes sur l'tude des phnomnes statistiques n'ont de valeur
que lorsqu'elles reposent sur des chiffres nombreux. Pour les cas isols, elles ne
sont d'aucune utilit. La raison en est sans doute qu'un grand nombre de causes
pouvant produire un phnomne, la mort d'un individu, par exemple, nous ignorons
quel sera le groupe de causes agissantes dans une circonstance donne. Lorsqu'on
opre sur un grand nombre de faits se rptant intervalles priodiques, il n'en est
plus de mme, parce que, le nombre des causes n'tant pas infini, les mmes
groupements de causes doivent forcment la longue se rpter et engendrer les
mmes effets. Nous savons, avec une exactitude suffisante pour que les
compagnies d'assurances ne commettent aucune erreur dans leurs prvisions,
combien, sur 100,000 individus d'un ge donn, il en meurt notre poque dans un
temps donn. Nous savons, par exemple, que sur 50,000 enfants qui viennent de
natre, il en mourra un tiers avant l'ge de 14 ans, et qu'il n'en restera que la moiti
de vivants l'ge de 42 ans. Nous savons cela avec certitude, parce que nous
oprons sur un grand nombre de cas ; mais, si nous voulions n'oprer que sur un
petit nombre, il n'y aurait pas de prvision possible. Si, prenant pour base les
chiffres qui prcdent, on affirmait que sur 6 enfants ns le mme jour, 2 seront
morts avant l'ge de 14 ans et qu'il n'en restera que 3 de vivants l'ge de 42 ans,
on s'exposerait se tromper grossirement. On s'exposerait des erreurs bien
moindres si, au lieu d'oprer sur 6 enfants, on oprait sur 100. En oprant sur des
nombres de plus en plus grands, 1,000, 10,000, 100,000, etc., les chances d'erreurs
se rduisent de plus en plus, et, arriv un certain chiffre, on approche d'une
certitude presque absolue.
Mais, quelle que soit la prcision des prdictions tires de l'tude statistique des
vnements, il est impossible d'en rien dduire relativement leurs causes. Ce n'est
mme que parce que nous ne connaissons pas ces causes que les prdictions pour
les cas isols nous sont impossibles. Si nous les connaissions, le mot hasard n'aurait
plus aucun sens. Il n'exprime, en effet, que notre ignorance de l'enchanement des
causes qui produisent les vnements. Laplace fait justement remarquer que, pour
une intelligence suffisante connaissant toutes les causes et sachant les soumettre au
calcul, la science des probabilits s'vanouirait faute d'objet. Une telle intelligence
saurait tout prvoir et ne se tromperait jamais. Elle dirait avec certitude, quand nous
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
28
mettons la main dans une urne contenant des boules de diverses couleurs, de quelle
couleur sera la boule retire, et, quand un enfant vient de natre, l'heure o il devra
mourir.
Entre les prvisions bases sur les rsultats empiriques fournis par la statistique
et celles qui reposent sur la connaissance des causes dterminantes des
phnomnes, il y a la mme diffrence que celle existant entre la prdiction des
clipses par les anciens astronomes et cette prdiction par les savants modernes.
Des observations nombreuses avaient montr aux Chaldens qu'il existait certains
intervalles de temps au bout desquels les clipses se reproduisaient peu prs dans
le mme ordre. Grce la constatation de ce fait, ils pouvaient, malgr leur
ignorance des causes de ces phnomnes, et bien que tout fait incapables
d'excuter les calculs ncessaires pour en prvoir le retour, prdire, pour les lieux
o ils se trouvaient, quelles poques elles devaient se reproduire. L'astronome
moderne, qui connat les lois de la marche des astres et par consquent les causes
des clipses, peut sans aucune donne statistique dterminer d'une faon rigoureuse
quelle seconde elles se produiront pour un point quelconque du globe. Du fond de
son cabinet, il peut plusieurs annes d'avance dire, sans crainte d'erreur, quelle
minute un astre passera devant un autre pour un observateur plac sur un point
quelconque de notre plante.
Les prdictions tires de l'tude de la statistique ne nous fournissent pas plus
d'indications sur les causes des phnomnes sociaux, que le retour priodique des
clipses ne pouvait fournir aux Chaldens d'indications exactes sur leurs causes. Du
retour rgulier des phnomnes nous pouvons tirer seulement la conclusion qu'ils
sont rgis par des lois constantes. C'est la recherche de ces lois que la science
sociale doit tre consacre.
Une seule voie s'offre nous pour dcouvrir les causes des phnomnes dont la
statistique nous dmontre la rgularit constante : c'est d'tudier sparment, de
faon bien apprcier la valeur de chacun d'eux, les divers facteurs : besoins,
milieu, ducation, hrdit, croyances, etc., dont l'ensemble dtermine leur
volution.
Sans doute il serait autant au-dessus de notre pouvoir de dterminer l'action
produite par ces divers facteurs quand ils agissent simultanment, qu'il serait audessus des ressources de l'astronome de dterminer exactement la trajectoire d'un
corps soumis l'action d'un grand nombre d'autres corps. Cependant, comme
certains de ces facteurs ont une action trs grande, alors que d'autres ont, au
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
29
contraire, une action trs petite, nous pouvons souvent pressentir d'une manire
gnrale leur influence 2.
En raison du grand nombre de facteurs qui entrent en jeu pour produire le
moindre effet, nous ne pouvons esprer que la science sociale approchera jamais
dans ses prvisions de la prcision des astronomes. Ces derniers du reste sont bien
obligs de se contenter d'approximations souvent grossires, et leur prcision n'est
le plus souvent qu'apparente. Bien que le nombre des facteurs dont ils ont
dterminer l'action rciproque soit trs peu lev, il l'est cependant encore trop pour
pouvoir tre soumis leurs calculs. Ce n'est qu' des circonstances particulires qui
auraient pu ne pas se produire, et qui dans d'autres systmes solaires que le ntre
n'existent pas peut-tre, que leurs prvisions doivent l'exactitude qu'elles semblent
avoir. Si les plantes, dans leur trajectoire elliptique autour du soleil, n'obissaient
qu' l'action de cet astre, il serait facile de connatre rigoureusement leur marche,
parce que les lments agissant les uns sur les autres seraient peu nombreux. Mais
les plantes, qui agissent sur le soleil, agissent aussi les unes sur les autres, et ces
influences rciproques viennent modifier leur course. Dterminer la rsultante de
l'action rciproque de tous ces corps, mme sans compter l'action de ceux situs en
dehors du systme solaire, dpasserait de beaucoup les ressources actuelles de
l'analyse mathmatique 3. Heureusement pour les astronomes, les masses des
plantes sont trs petites devant celle du soleil, les excentricits et les inclinaisons
mutuelles de leurs orbites trs faibles, et, grce ces circonstances, les
approximations dont ils sont obligs de se contenter sont suffisantes pour que,
l'gard des units de temps et d'espace dont nous disposons, les rsultats de leurs
calculs paraissent possder une prcision qu'ils sont loin d'avoir rellement. On
comprendra combien leurs approximations et mme leurs moyens d'observation
sont grossiers, en se rappelant que des toiles comme Sirius, qui roulent dans
l'espace avec une vitesse de plusieurs centaines de milliers de lieues par jour, ont pu
tre considres pendant deux mille ans comme absolument immobiles.
2
Les causes d'un vnement quelconque sont fort nombreuses, car aux facteurs prsents s'ajoutent toujours
les facteurs passs qui l'ont engendr ; mais mme lorsque le nombre des facteurs est rduit quelques units, et
dans les cas en apparence les plus simples, par exemple, la dtermination de la trajectoire que suivrait dans
l'espace un corps soumis aux influences d'un petit nombre d'autres, la prvision est absolument au-dessus des
ressources actuelles de l'analyse mathmatique la plus savante. L'association des causes entre elles finit par
former des combinaisons dont le nombre crot avec une rapidit excessive pendant que le nombre des choses
combiner augmente fort lentement. Dix personnes assises autour d'une table peuvent tre places de 3,628,000
faons diffrentes sans rpter une seule fois la mme combinaison. Si, au lieu de dix personnes, il y en avait
douze, au lieu de trois millions et demi de combinaisons il y en aurait prs de 500 millions. En travaillant sans
relche depuis Jsus-Christ, raison de douze heures par jour et de une minute par dplacement effectuer
toutes ces combinaisons, on ne les aurait pas encore termines aujourd'hui.
Je mentionnerai, pour donner une ide de la complication de ces calculs, que la seule thorie du soleil par Le
Verrier comprend 12 volumes in-folio de calculs.
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
30
L'expos qui prcde nous a prouv que les phnomnes sociaux obissent dans
leur volution un enchanement de causes rigoureuses, dont nous pouvons dans
des circonstances donnes prvoir l'action, bien qu'il ne nous soit pas possible de
remonter jusqu' elles. Conclurons-nous de la fatalit de ces causes, de la difficult
extrme de dterminer le rle individuel de chacune d'elles, que la science sociale
ne prsente aucune utilit pratique ? Quand bien mme il en serait ainsi, cela
n'terait rien l'intrt qu'elle offrirait au philosophe ; mais, en dehors de l'intrt
que prsente l'observateur l'tude des lois qui prsident aux transformations des
socits, la science sociale possde une utilit pratique considrable. Nous allons le
prouver en montrant combien nous payons souvent chrement notre ignorance des
lois de l'volution des choses.
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
31
Deuxime partie
LES SOCITS
Leurs origines et leur dveloppement
livre I : La science sociale
Chapitre II.
Utilit de la science sociale.
Ignorance gnrale de l'existence d'une science sociale. - Dangers de cette ignorance. Exemples fournis par l'histoire de divers peuples. - Rvolutions et guerres produites par
l'ignorance des lois sociales. - Exemples fournis par les rcentes tentatives de civilisation du
Japon.
Retour la table des matires; retour au dbut du chapitre
Les rares savants qui se sont adonns l'tude des lois de l'volution des
socits ont gnralement t frapps de ce fait, que la difficult d'une science si
abstraite et qui implique la connaissance de tant d'lments soit habituellement si
ignore. Alors qu'on ne voit gure une personne ne connaissant pas l'astronomie ou
l'algbre essayer de rsoudre des problmes exigeant la connaissance de ces
sciences, on rencontre chaque jour des individus parfaitement ignorants se croire
tout fait aptes conseiller un gouvernement telle ou telle loi, tel ou tel trait, et
cela sans avoir l'ide la plus lgre des effets que sont destines produire un jour
les mesures lgislatives ou commerciales recommandes par eux.
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
32
Il est vident que c'est seulement parce que les difficults des problmes sociaux
ne sont pas apparentes que chacun se croit mme de les trancher sans aucune
tude spciale, et est convaincu que diriger les affaires d'un pays est une question
de simple bon sens. Qu'on transporte bord d'un navire un individu qui rsout si
hardiment de telles questions, et que, lui mettant dans les mains un sextant, la
Connaissance des temps, une table de logarithmes et un chronomtre, on le prie de
vouloir bien dterminer la longitude et la latitude du navire, partant la direction
qu'il faut lui donner pour arriver au port, on le verra immdiatement, s'il n'est marin
ou astronome, se reconnatre tout fait incapable de rsoudre le problme qu'on lui
pose, et par suite de hasarder le moindre conseil sur la direction donner au
vaisseau.
Dans le cas que je viens de supposer, comme dans tous les cas analogues, on
voit les difficults, alors qu'elles chappent entirement l'observateur peu attentif,
quand il s'agit de problmes sociaux. Ne les souponnant pas, on agit alors comme
l'ignorant qui conseille un remde contre une maladie parce qu'il ne se rend pas
compte de la difficult de faire une prescription utile. Qu'on propose au mme
donneur de conseils de pratiquer une rsection, de rduire une luxation ou de lier
une artre, il s'y refusera sans hsiter, parce qu'alors il verra la difficult qui lui
chappait prcdemment.
Les exemples qui prouvent les dangers de vouloir rsoudre les problmes
sociaux sans aucune connaissance de leurs divers facteurs remplissent l'histoire. Il
nous suffira de rsumer ici rapidement quelques-uns des principes que nous avons
prouvs ou que nous aurons occasion de dmontrer, pour faire pressentir quelles
lueurs la connaissance des lois rgissant l'volution des lments divers des
socits pourrait jeter sur les questions qui dans les temps modernes ont le plus
passionn les esprits.
Les tudes auxquelles va tre consacre la deuxime partie de cet ouvrage nous
montreront que les lments dont la runion constitue une socit obissent, dans
leur volution, aux lois auxquelles sont soumis tous les tres ; que, pas plus qu'un
individu, une socit ne peut atteindre un tat dtermin de dveloppement sans
avoir pass par les phases infrieures qui l'en sparent. Nous verrons galement que
les formes politiques, religieuses et sociales dans lesquelles une nation peut entrer
ne dpendent nullement de sa volont, mais sont le rsultat de sentiments, d'ides,
d'habitudes rigoureusement dtermins eux-mmes par son pass ; qu' chaque
priode de la vie d'un peuple, il y a un mode de penser et de sentir, une morale et
des croyances qui exigent certaines institutions et n'en comportent pas d'autres ;
qu'il y eut, par exemple, un ge o le rgime fodal fut le meilleur, un autre o ce
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
33
fut le rgime dmocratique, un autre encore o ce fut le rgime monarchique ; que
si les institutions libres sont les meilleures qui puissent convenir certains peuples,
un rgime tyrannique est le seul qui convienne d'autres ; que vouloir imposer
une nation des institutions auxquelles elle n'est pas adapte, quelque parfaites
qu'elles puissent tre ; imposer, par exemple, une civilisation suprieure un peuple
qui n'a pas dpass certaines formes d'volution infrieure, fut toujours une
tentative aussi vaine que celle qui consisterait vouloir modifier son pass ou
obliger un amphibie respirer l'air avant d'avoir perdu ses branchies.
Ces principes, que nous aurons souvent l'occasion de dmontrer, tant bien
compris, nous voyous immdiatement de quelle erreur sont victimes les
rformateurs qui croient qu'une socit peut secouer volont le joug de son pass,
et qu'il est possible un gouvernement de la rformer son gr sur un plan
prconu ; que des nations monarchiques et superstitieuses, comme l'Espagne ou la
Russie, par exemple, pourraient tre transformes facilement en rpubliques ; et
que ce n'est qu'aux vices d'institutions faciles changer qu'il faut s'en prendre des
bouleversements et des maux dont se plaignent les nations modernes.
C'est de cette croyance errone, si gnrale encore, surtout chez les nations
latines, que le progrs a principalement pour causes des changements dans les
institutions, et qu'on peut trouver dans ces changements une panace pour chaque
plaie sociale, qu'est ne cette tendance gnrale rclamer ce progrs des chefs des
socits, au lieu de l'attendre des transformations des individus qui les composent.
Faire rgner par la force ces institutions si dsires, et qui doivent remdier tant
de maux, est le rve commun des croyants convaincus de tous les partis. Pour le
philosophe pntr des lois de l'volution sociale, on doit ranger dans la mme
famille le conservateur rvant la restauration du pass, le rvolutionnaire souhaitant
la destruction du prsent, le croyant regrettant les tenailles et les bchers avec
lesquels l'Inquisition convertissait les infidles, et qui, n'ayant plus ni tenailles ni
bchers, voue les ennemis de sa foi aux flammes ternelles. Tous sont dupes d'une
mme erreur.
L'histoire nous dit ce que de telles erreurs ont cot de maux l'humanit, et il
n'est pas besoin d'tre un prophte bien clairvoyant pour pressentir ce qu'il faudra
encore de bouleversements politiques, de guerres sociales, de misres entasses, de
larmes et de sang verss, avant que des expriences, rptes des milliers de fois,
aient dissip les illusions profondes qui rgnent si gnralement relativement aux
lois du dveloppement des choses, et montr clairement aux hommes les
consquences funestes dont sont invariablement victimes ceux qui mconnaissent
ces lois.
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
34
Les exemples prouvant combien les peuples expient chrement l'ignorance des
lois de l'volution remplissent, comme je l'ai dit, l'histoire, et, si je n'tais oblig de
me borner ici des considrations gnrales, il me serait facile d'crire avec ces
exemples un volume. Que de guerres, par exemple, ont rsult de l'ignorance des
principes de l'conomie politique relatifs aux changes commerciaux ! Autrefois les
hommes d'tat considraient comme une chose vidente qu'il tait de l'intrt d'une
nation d'amoindrir sa voisine pour s'enrichir, sans se douter qu'en agissant de cette
faon, ils imitaient le marchand qui chercherait ruiner ses clients. Le jour o les
principes si longtemps ignors de l'conomie politique furent connus, on observa ce
fait qui a tant frapp plusieurs penseurs anglais minents, que l'esprit commercial,
qui fut autrefois une des principales causes de guerre, est devenu aujourd'hui un de
ses plus srieux obstacles. Cet obstacle est mme maintenant si puissant en
Angleterre, qu'il faut les circonstances les plus graves pour la dcider prendre les
armes. Elle s'est corrige temps pour sa future grandeur ; mais d'autres peuples,
comme l'Espagne, ont pay de leur dcadence leur ignorance des mmes lois.
C'est naturellement dans les classes peu instruites que cette ignorance est plus
profonde. On ne saurait prvoir ce qu'il faudra encore de sicles de misres, de
privations, de rpressions sans piti, pour convaincre les classes ouvrires que
l'organisation industrielle du travail dont elles se plaignent, parce qu'elles en
souffrent, est exactement en rapport avec leur degr actuel de prvoyance,
d'instruction, d'ducation, de moralit et d'intelligence ; que cette organisation ne
peut tre change graduellement qu' mesure qu'elles se transformeront ellesmmes, et que les rorganisations chimriques rves par elles rendraient leur
condition mille fois pire que l'esclavage.
Bien que je n'aie pas l'intention d'insister sur les exemples particuliers qui
dmontrent les dangers de l'ignorance des lois de l'volution des socits, il en est
un que je veux citer en passant, parce qu'il est tout rcent et vient justifier ce que
j'ai dj rpt plusieurs fois dans cet ouvrage, que la civilisation qu'un peuple
possde est l'expression de ses besoins, et qu'il est aussi impossible de lui imposer
une civilisation suprieure que d'obliger un enfant arriver l'ge mr sans passer
par la jeunesse.
Il y a quelques annes, le Japon se trouvait, comme il se trouve en ralit du
reste encore, une priode de dveloppement correspondant peu prs aux temps
de la fodalit en Europe. merveill par la vue de nos bateaux vapeur, de nos
armes et de divers produits de notre civilisation europenne, le souverain et
quelques ministres japonais rsolurent de dcrter la civilisation immdiate de leur
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
35
empire. On fit venir d'Europe des professeurs, des ingnieurs, des savants, des
instruments, des machines, et on se mit civiliser avec ardeur. Comme il fallait
cet tat nouveau des institutions nouvelles, et qu'on supposait n'avoir qu' choisir,
on choisit naturellement celles qui semblaient les plus parfaites, et le code
Napolon fut immdiatement adopt. En consquence, un professeur de droit de la
facult de Paris fut charg d'aller enseigner et appliquer aux Japonais les futures
institutions qui devaient les rgir.
Qu'un professeur de droit puisse accepter une telle tche, et ignorer par
consquent que les institutions tant l'expression des besoins d'un peuple, et non un
moyen de le transformer, celles qui sont adaptes aux besoins des uns ne le sont
nullement aux besoins des autres, cela n'tonnerait que si on ne savait quel point
les notions relatives l'origine et aux transformations du droit et des institutions
sont ignores dans nos coles. Pour un observateur ayant une claire notion des lois
du dveloppement des choses, vouloir imposer le code Napolon un peuple en
plein moyen ge, est une tentative analogue celle par laquelle on voudrait obliger
un poisson respirer dans l'air, sous prtexte que tous les animaux suprieurs
respirent de cette faon, et que cela est trs avantageux pour eux.
Quoi qu'il en soit, cette singulire mission fut accepte, et, dans le courant de
l'anne 1872, le futur lgislateur du Japon arrivait dans sa nouvelle patrie et se
mettait immdiatement luvre. Elle ne dura pas longtemps. Comme il tait
intelligent et savait profiter des leons de l'exprience, il ne tarda pas comprendre
l'absurdit de la tche qu'il avait entreprise et reconnatre et signaler l'inanit de
luvre prcipite qu'on voulait entreprendre . Au bout de quelques annes, le
jeune lgislateur revenait en Europe entirement dsillusionn.
Ce qui advint et adviendra de la tentative de civilisation du Japon, le lecteur de
cet ouvrage le devine facilement. Toutes les fois que l'homme veut troubler
l'volution naturelle des choses, de telles tentatives s'expient chrement.
Entirement dsorganis aujourd'hui, le Japon en fait la cruelle exprience. Dans un
travail qu'il a publi sur ce pays, le professeur auquel nous venons de faire allusion
s'exprime de la faon suivante : En rsum, le Japon est en face d'une tche
extraordinaire au cours de laquelle il ne peut plus s'arrter sous peine de dcadence
et de perturbation ; elle consiste dans le changement radical d'un rgime politique,
conomique et industriel voisin du moyen ge contre les conditions de la vie
moderne des peuples europens. Il possdait une civilisation propre complte et
mme avance la faon orientale : il a port lgrement la pioche dans ce champ
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
36
cultiv, comme on fait dans une terre en friche ; il doit maintenant achever son
oeuvre et planter aprs avoir arrach 4.
Je crois qu'en crivant ce qui prcde l'auteur tait encore sous l'empire de
l'illusion qui lui faisait consentir accepter la tche de doter de nos institutions
juridiques le Japon. Ce qui serait la dcadence assure pour cet empire, ce serait,
non de s'arrter dans son oeuvre, mais de la continuer, ce qui, heureusement pour
lui, sera impossible, une rvolution tant toujours chose phmre. Comment
l'auteur, qui vante lui-mme l'existence heureuse de l'habitant du Japon, qui
reconnat que sa condition est cent fois prfrable celle du travailleur
besogneux, haletant, surmen, qui gagne pniblement sa vie dans les ateliers, ne
comprend-il pas que ce peuple n'a que faire d'une civilisation adapte des ides,
des sentiments, des besoins qui ne sont pas les siens, et qui n'a eu jusqu' prsent
d'autres rsultats que d'accrotre ses impts et de commencer rendre difficile son
existence autrefois si prospre! Le jour n'est pas loin o, ruin et rendu misrable
par ses tentatives de civilisation et les besoins nouveaux qu'elles lui ont crs, le
Japon comprendra quel point fut profondment sage le lgislateur antique qui
avait rigoureusement ferm ses portes aux trangers.
[NOTE :
Je recommande aux personnes dsireuses de connatre l'opinion des Orientaux les plus
instruits sur l'utilit de notre civilisation et les moyens que nous employons pour la propager, la
lecture d'un article sur le Japon publi en 1878 dans une revue franaise (la Revue scientifique),
par un Japonais distingu, Masana Maeda, commissaire gnral du Japon l'Exposition de Paris.
Bien qu'oblig par sa position et le milieu o il crivait voiler sa pense, l'auteur justifie fort
bien l'opposition que faisait aux trangers le parti le plus sage du Japon : Les nobles, en effet,
qui les choses de la Chine, mme moderne, n'ont jamais t trangres, venaient d'avoir sous les
yeux la triste conduite des Anglais vis--vis des Chinois. Les Anglais, en effet, avaient cherch,
par l'introduction de l'opium, abtardir ce peuple, dont la civilisation est depuis plus de deux
mille ans en dcadence ou tout au moins stationnaire, et tout cela au profit de leur commerce, tout
cela pour accumuler des richesses aux dpens des peuples de l'extrme Orient. Ces tristes effets
de la politique goste de l'Angleterre, ou, pour tre plus vrai, de la cupidit des commerants
anglais, avaient eu une consquence on ne peut plus funeste : elle avait donn lieu la triste et
terrible guerre connue sous le nom de guerre de l'opium. Les nobles japonais craignaient, au
souvenir de semblables vnements, que les trangers ne profitassent de leur permission d'entrer
au Japon et de faire le commerce avec notre pays, pour y introduire des denres du genre de
l'opium, denres funestes qui tuent un peuple en le dmoralisant. C'est donc dans une pense de
patriotisme, irrflchie, si l'on veut, et trop troite, mais nanmoins dans une relle pense de
4
Le Japon contemporain. - Revue des Deux-Mondes, octobre 1876.
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
37
patriotisme, de conservation et de salut pour leur pays que les nobles prirent le parti de rsister.
L'introduction des trangers au Japon tait pour eux, dans leur conviction personnelle, dans leur
pense intime, une question de vie ou de mort pour le Japon. Ils s'imaginaient que la paix
profonde et pleine de prosprit qui rgnait depuis trois cents ans dans leur pays allait tre
trouble par l'arrive des trangers, comme elle l'avait t une premire fois au XVIe sicle. et
comme elle venait de l'tre tout rcemment dans un pays voisin du leur, l'empire chinois.
Parlant ensuite de la conduite des trangers au Japon, l'auteur ajoute .... Les trangers, soit
la ville, soit la campagne, n'ont aucun respect pour tout ce qui les environne, et ne se font pas
scrupule de ravager et dvaster la proprit d'autrui... Ils ne font pas plus de cas des lois que des
murs. Ils professent le plus large mpris pour la lgislation japonaise, et ne se font pas faute de
violer journellement les dispositions de nos lois. En vain le gouvernement fait-il remettre les
coupables entre les mains des consuls de leurs pays en rclamant leur punition, ces consuls
n'appliquent jamais la peine que le coupable devrait subir, et aucun chtiment ne vient fltrir la
conduite de ceux qui ont mpris et viol les lois japonaises.
Il serait vraiment intressant d'avoir l'histoire des tentatives europennes de la civilisation en
Chine, aux Indes, en Ocanie, etc., crite par les habitants de ces pays ; nous nous tonnerions
moins peut-tre alors de la haine profonde que tous ces peuples ont pour les Occidentaux et de
leur excessif mpris pour notre morale : nous comprendrions mieux surtout ce fait qui a tant
frapp les conomistes, que le contact de notre civilisation a pour rsultat fatal de dsorganiser
d'abord, d'anantir plus tard tous les peuples infrieurs qu'elle touche. Continuons, tant que nous
le pourrons, pressurer, piller et dtruire toutes ces races infrieures, puisque nous sommes
encore les plus forts, mais ne poussons pas l'hypocrisie jusqu' prtendre que nous les civilisons.
Songeons aussi, tout en les exploitant, qu'il existe des pays comme l'Inde, qui ont deux cents
millions d'habitants, abhorrant profondment leurs matres ; qu'il en est d'autres, comme la Chine,
comptant plus de quatre cents millions d'hommes, qui n'ont oubli ni nos guerres si injustes, ni le
pillage et l'incendie de leurs palais. Assez sages pour refuser d'accepter une civilisation non
adapte leurs besoins, ces derniers ont compris cependant qu'il fallait lui emprunter ses armes.
La Chine traduit aujourd'hui nos ouvrages de tactique, et dans sa rcente campagne en Turkestan
elle faisait usage de canons Krupp et de carabines tir rapide.
Nous voici donc conduits cette conclusion importante, que les lments dont
l'ensemble constitue une socit obissent dans leurs transformations des lois
rigoureuses, et que ce n'est qu'au prix des plus dangereuses catastrophes que
l'homme peut momentanment russir les entraver. Les rformateurs qui se
croient les mdecins du corps social lui sont aussi nuisibles que l'taient autrefois
aux malades les remdes actifs dont la mdecine faisait alors usage. Quand on se
trouvait en prsence d'un malade atteint d'une fluxion de poitrine, on le saignait
nergiquement et on le bourrait de mdicaments. Trente pour cent succombaient
la maladie, complique du traitement. Aujourd'hui qu'on laisse le malade tranquille,
qu'on se borne soutenir ses forces par un rgime convenable, on n'en perd plus
que trois sur cent. Aucun mdecin moderne ne s'imagine maintenant qu'il puisse
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
38
arrter par ses remdes une affection marche constante, comme la scarlatine, la
rougeole, la fivre typhode, etc. Il se borne quelques soins hyginiques, des
prescriptions propres calmer l'esprit du malade, et laisse en dfinitive la maladie
suivre son volution naturelle. Lui reprochera-t-on une abstention grce laquelle
il perd dix fois moins de malades qu' l'poque o une intervention active tait de
rigueur ?
L'influence de l'homme sur l'volution des choses est comparable celle du
mdecin sur la marche des maladies. Bien que fort minime, l'utilit de l'un et de
l'autre n'est pas contestable, mais le bien qu'ils peuvent faire est infiniment petit si
on le compare la grandeur du mal que leur ignorance peut produire.
Si les principes exposs dans ce chapitre taient gnralement compris, une des
principales causes des rvolutions sanglantes que nous avons dj subies, et de
celles probablement beaucoup plus sanglantes que nous sommes destins subir
encore, aurait disparu. Comprenant la vanit de leurs efforts, les rformateurs ne
songeraient plus imposer par la force un peuple des institutions que les sicles
ont condamnes prir, ou qui ne pourraient prosprer que dans des temps qui ne
sont pas ns encore.
Je ne me suis pas proccup dans ce qui prcde des objections que l'on fait
habituellement aux thories qui semblent dpouiller l'homme de la libert qu'il croit
possder et dont il est si fier. Les littrateurs et les orateurs trouveront l pendant
longtemps une source inpuisable de tirades, loquentes peut-tre, mais qui ne
changeront rien la ralit des choses. Il est intressant cependant d'observer que
les revendications les plus sonores de la libert humaine ont gnralement pour
auteurs des crivains religieux qui proclament bien haut la toute-puissance de la
Providence. L'homme s'agite et Dieu le mne, nous disent Fnelon et la plupart des
historiens. J'avoue me sentir impuissant saisir en quoi je serai moins libre en
subissant l'engrenage de fatalits qui nous entourent, qu'en obissant aux caprices
de divinits irascibles dont il faut journellement calmer les fureurs par des supplications et des prsents. Les deux doctrines nous rendent galement esclaves, mais
l'une enseigne l'homme la rsignation et la tolrance, l'autre le rend servile.
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
39
Deuxime partie
LES SOCITS
Leurs origines et leur dveloppement
livre I : La science sociale
Chapitre III.
Mthodes de la science sociale.
L'tude des phnomnes historiques et sociaux passe aujourd'hui aux mains des savants. tendue des connaissances scientifiques que cette tude exige. - Ressources fournies par les
diverses sciences. - Mthode d'tude des phnomnes sociaux. - Ils doivent tre dcomposs dans
leurs lments constituants. - Un phnomne social ou religieux doit tre tudi comme un
phnomne physique quelconque.
Retour la table des matires; retour au dbut du chapitre
Les crivains de l'avenir qui tudieront le mouvement scientifique et littraire de
notre poque envisageront certainement comme un fait caractristique que l'tude
des phnomnes psychologiques, historiques et sociaux, jusqu'alors l'apanage
exclusif des philosophes, des historiens et des littrateurs, soit graduellement
devenu celui des savants ; et, comparant le nombre immense de faits dcouverts par
les derniers en quelques annes au minime bagage de vrits mises en vidence par
les premiers pendant des sicles, ils regretteront srement qu'une semblable
transformation ne se soit pas plus tt accomplie.
Rien n'est plus lgitime que cette substitution, laquelle nous assistons chaque
jour, de l'lment scientifique ce que l'on pourrait nommer l'lment littraire. Ce
n'est en effet que grce aux dcouvertes scientifiques effectues depuis quelques
annes qu'il est devenu possible de remplacer par des ides nettes les
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
40
gnralisations htives, les systmes priori dont on s'est content pendant si
longtemps. La gologie, la palontologie, la zoologie, ont permis de retracer
l'histoire des anctres de l'homme ; l'archologie prhistorique nous a redit les
phases de son pass. De patientes recherches sur les origines de la famille, de la
proprit, des religions, ont jet les lueurs les plus vives sur les phases ncessaires
par lesquelles elles doivent toujours passer. L'anthropologie a entrepris l'histoire
physique, intellectuelle et morale de l'homme, et, substituant aux descriptions
vagues et purement littraires des mthodes prcises 5, elle a runi une somme de
matriaux de l'tude desquels le lgislateur, l'historien, le philosophe, l'conomiste
ne sauraient se passer.
L'importance de toutes ces sciences n'tait mme pas souponne il y a quelques
annes. Pour crire sur la civilisation, la politique et l'histoire, il suffisait alors
d'tre un littrateur habile ; aucune connaissance scientifique n'tait juge utile. On
est en droit d'exiger aujourd'hui de ceux qui crivent sur de telles questions qu'ils
aient tudi profondment les sciences physiques et naturelles, la gologie, la
biologie, l'anthropologie, la psychologie humaine et compare, l'conomie
politique, la statistique, etc. ; qu'ils aient appris observer la nature dans les
laboratoires ; qu'ils n'aient pas tudi l'homme seulement dans les livres, mais en
ayant visit des peuples divers et parl leurs langues.
La mthode que nous adopterons pour l'tude des phnomnes sociaux est celle
laquelle nous avons eu jusqu'ici recours. Utilisant toutes les ressources des
sciences que nous venons de mentionner, nous examinerons d'abord le rle des
divers facteurs qui dterminent l'volution sociale ; puis, dcomposant les socits
dans les lments qui les constituent : famille, proprit, droit, morale, etc., nous
tracerons l'histoire de leurs transformations. Connaissant les causes de l'volution
de ces lments et la srie de transformations qu'ils ont subies, nous pourrons alors
remonter jusqu' l'histoire des socits elles-mmes. Seules ces investigations
patientes nous permettront de comprendre l'enchanement des vnements de
l'histoire, les hommes et les mobiles de leurs actions, l'influence du pass et celle
du prsent, et de dcouvrir sous ce tourbillon d'vnements qui semblent le produit
du hasard l'action de lois fatales guidant le cours des choses.
Je recommande aux personnes dsireuses de comparer les mthodes actuelles avec celles des psychologistes
et des historiens, de parcourir le questionnaire de psychologie rdig par un savant distingu, M. le docteur
Letourneau au nom de la Commission d'anthropologie de Florence. Il n'a que quelques pages, mais le voyageur
qui y aurait rpondu pour un peuple aurait fourni plus de renseignements sur l'tat intellectuel, moral, politique
et social de ce peuple, qu'on ne pourrait en puiser sur les nations les plus connues dans les meilleurs livres
d'histoire.
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
41
Les sciences diverses qui seront nos instruments d'tude ont t suffisamment
utilises jusqu'ici pour qu'il soit inutile d'insister sur leur importance. Il en est une
cependant dont nous n'avons encore qu'exceptionnellement eu occasion de faire
usage et laquelle nous devons consacrer quelques pages, en raison de l'emploi que
nous en ferons dsormais : je veux parler de la statistique.
Chacun sait que l'on donne le nom de statistique la science qui a pour but
d'exprimer par des chiffres les variations de groupes de faits semblables. Utilise
avec discernement, elle fournit sur l'tat social, industriel et politique d'un pays des
documents que rien ne saurait remplacer. Quatre pages de chiffres bien choisis
fournissent beaucoup plus de renseignements sur l'tat d'un pays que cinq cents
pages des plus loquentes dissertations, et leur runion exige souvent du reste
beaucoup plus de temps et de science que la rdaction de ces cinq cents pages. Un
tableau bien clair de statistique compare m'en dira plus certainement sur l'avenir
des tats-Unis, par exemple , que les plus brillants discours. J'y verrai en effet que
leur importation a graduellement diminu d'anne en anne au point de devenir
nulle pour certains articles importants, - les rails de chemin de fer, par exemple, alors que leur exportation a toujours grandi, et en est arrive au point qu'ils
envoient maintenant en Europe des objets dont cette dernire semblait avoir le
monopole exclusif, les articles d'horlogerie notamment. J'y verrai encore qu'ils ont
130,000 kilomtres de chemins de fer, alors que la France, dont la population est
presque gale, n'en a que 27,000 ; qu'ils renferment 7,200,000 propritaires, alors
que le sol de l'Angleterre est possd par 200,000 personnes, dont 2,000 dtiennent
plus de la moiti de la surface du royaume ; que le nombre de ses habitants, qui
tait de 13,000,000 d'individus il y a 50 ans, dpasse 40,000,000 aujourd'hui, et que
cet accroissement peut devenir beaucoup plus considrable, puisque le chiffre de la
population n'y est que de 4 individus seulement par kilomtre carr, alors qu'en
Angleterre, o le sol n'est pas plus fertile, il est 25 fois plus lev. Il est facile de
prvoir que dans les livres d'histoire de l'avenir, des documents semblables, si
ngligs aujourd'hui, occuperont une place prpondrante, et qu'un crivain ne
prendra pas alors la plume sans les avoir tudis longuement.
Les statistiques sont malheureusement rdiges dans la plupart des tats par des
agents subalternes dpourvus de toute mthode critique ; aussi les documents
publis sont gnralement trs insuffisants, remplis de contradictions et d'erreurs, et
ne peuvent tre utiliss qu'avec une grande rserve et aprs les corrections que
ncessite l'association des lments, gnralement fort htrognes, qui les
composent.
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
42
Parmi les mthodes statistiques les plus usites aujourd'hui, il en est une
notamment que je ne saurais trop combattre, parce qu'elle conduit aux conclusions
les plus errones : je veux parler de la mthode dite des moyennes. Elle consiste,
comme on sait, runir ensemble une certaine quantit d'observations et diviser
leur somme par leur nombre. On l'emploie pour comparer l'ge, la taille, la
richesse, la consommation individuelle, etc., de groupes d'individus diffrents. Ce
sont les moyennes ainsi obtenues et qui reprsentent une sorte de valeur
intermdiaire entre toutes celles qui ont servi les former, que l'on compare ensuite
entre elles. Plus le nombre des sujets entrant dans chaque groupe est grand, plus les
moyennes obtenues sont considres comme exprimant compltement l'tat de ces
diffrents groupes.
Utile quand elle se borne prendre la moyenne d'un groupe de valeurs peu
diffrentes, comme, par exemple, des observations d'un mme phnomne
astronomique, cette mthode devient entirement illusoire quand il s'agit de
comparer des valeurs trs diffrentes. Les chiffres donns pour reprsenter la dure
moyenne de la vie, la taille moyenne, etc., d'un grand nombre de sujets d'ge et de
taille divers, sont des valeurs artificielles qui semblent devoir reprsenter les
chiffres qu'on observe le plus frquemment et qui reprsentent au contraire ceux
qui s'observent le plus rarement. Quand on dit, par exemple, que la dure de la vie
moyenne dans un pays est, je suppose, de quarante ans, il semble immdiatement
que c'est cette poque de la vie que la grande majorit des individus doit mourir :
or, l'observation dmontre que c'est, au contraire, la minorit qui meurt cet ge.
C'est dans l'extrme enfance et dans la vieillesse que se rencontre la plus grande
mortalit et nullement l'poque indique par la moyenne. De mme pour la taille :
le chiffre de 164 centimtres, donn comme reprsentant la taille moyenne en
France, est une valeur au-dessus ou au-dessous de laquelle se trouve la taille de la
presque totalit de la population.
La plupart des moyennes fournissent des rsultats aussi trompeurs. Le chiffre
donn pour la consommation individuelle de la viande en France, par exemple, est
obtenu en runissant, comme dans les cas prcdents, des sujets tout fait
diffrents, ceux des classes riches qui mangent beaucoup de viande, ceux des
classes peu aises qui n'en mangent gure, et les habitants de certaines campagnes
qui n'en mangent pas du tout. Le rsultat est naturellement un chiffre absurde.
Ces moyennes gnrales, qui confondent entre eux des lments tout fait
dissemblables : sujets grands et petits, riches et pauvres, individus d'ge, de
condition, de sexe, de genre de vie diffrents, peuvent tre utiles pour indiquer en
bloc les variations que peuvent produire sur une masse considrable d'individus
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
43
l'tat de la civilisation, l'influence du milieu, etc. ; mais elles sont impuissantes
nous fournir les plus lgers renseignements sur les diverses variations qui se
produisent dans les groupes qui constituent cette masse. Or, ce sont prcisment ces
renseignements que le plus souvent il importe d'obtenir. Les moyennes des
statisticiens sont gnralement aussi inutiles l'conomiste ou au philosophe que
pourrait l'tre un chapelier la connaissance de la moyenne des mesures de tous les
chapeaux vendus par lui. S'il prenait cette moyenne pour guide lorsqu'il veut
renouveler son approvisionnement, les chapeaux fabriqus d'aprs cette indication
ne pourraient servir qu' un nombre d'individus tout fait restreint.
La critique que je viens de formuler contre le procd des moyennes en gnral
est applicable galement la plupart des moyennes anthropologiques. Je puis bien
admettre, l'extrme rigueur, l'homme moyen d'un groupe form de sujets d'origine
semblable, vivant dans un milieu semblable, et partant plus ou moins homogne. Je
ne saurais admettre l'homme moyen d'une race, comme l'tre hybride cr par
Qutelet. Avec ses qualits moyennes, il reprsente une sorte de type effac, dont
on ne retrouverait peut-tre pas un reprsentant sur la surface du globe. Il n'y a pas
plus de moyenne prendre entre des sujets dont le crne possde une capacit de
1,200 centimtres cubes et ceux chez lesquels le mme organe atteint 1,900, qu'il
n'en existe entre l'intelligence d'un Cuvier et celle de son porteur d'eau. Rien n'est
plus chimrique que de vouloir tablir une moyenne entre la petitesse et la
grandeur, entre la science et l'ignorance, c'est--dire entre des lments
dissemblables qui ne sauraient tre compars entre eux.
Supposons maintenant qu'au lieu de comparer ces valeurs si fictives qu'on
nomme des moyennes, nous divisions par groupes ne contenant chacun que des
valeurs trs rapproches les lments qui ont servi les former, et que, au lieu de
faire porter nos comparaisons sur les moyennes, nous les fassions porter sur ces
groupes, nous arriverons alors des rsultats fort diffrents. Soit, par exemple,
comparer la capacit du crne des diverses races. Au lieu de runir les grands
crnes et les petits crnes que chaque race contient, puis de les additionner et d'en
prendre la moyenne, nous les classerons par groupes de capacits dtermines, et
rechercherons ensuite combien il existe dans cette race de crnes de chaque groupe.
Mettant ensemble, par exemple, les crnes de 1,300 1,400 centimtres cubes,
ceux de 1,400 1,500 centimtres cubes, etc., et prenant ensuite le total de chacun
de ces groupes, nous saurons combien de crnes de telle ou telle dimension une
race contient. N'y et-il parmi les sujets examins qu'un nombre tout fait restreint
de grands crnes ou de petits crnes, ce nombre sera mis immdiatement en
vidence, alors que, dans le procd des moyennes, il et t effac entirement.
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
44
Le seul inconvnient du groupement par sries, c'est qu'il prsente, en dernire
analyse, plusieurs chiffres au lieu d'un seul, comme le font les moyennes. Or, quand
il s'agit de comparer un certain nombre d'lments diffrents, l'tude simultane de
plusieurs chiffres devient parfois difficile. Grce l'emploi des courbes que j'ai
imagines, et dont j'ai parl dans un prcdent chapitre, cet inconvnient disparat
entirement. Elles expriment trs clairement en effet le tant pour cent d'objets
classs suivant une certaine variable. Leur simple aspect indique immdiatement la
composition des lments qu'elles sont charges d'exprimer, et permet de comparer
ensemble des groupes diffrents, tels que la taille, l'ge, etc., de diverses races. La
figure ci-dessus fait connatre, par exemple, la capacit du crne dans un certain
nombre de races et montre clairement en quoi les unes l'emportent sur les autres.
[NOTE :
Pour bien faire comprendre la construction de mes courbes, je choisirai un
exemple. Soit traduire par cette mthode, en langage graphique, les variations
qu'on observe dans le volume des crnes masculins des Parisiens modernes. Ces
variations sont exprimes numriquement par le tableau suivant :
Capacit crnienne
De 1,300 1,400 centimtres cubes
De 1,400 1,500 centimtres cubes
De 1,500 1,600 centimtres cubes
De 1,600 1,700 centimtres cubes
De 1,700 1,800 centimtres cubes
De 1,800 1,900 centimtres cubes
Tant pour cent de chaque capacit
10,4
14,3
46,7
16,9
6,5
5,2
100,0
L'axe des abscisses est d'abord divis en cent parties, divisions qui se trouvent toutes faites en
employant du papier quadrill au millimtre, qu'on trouve partout ; l'axe des ordonnes est divis
galement en parties quidistantes assez nombreuses pour comprendre toutes les variations
observes, soit, dans le cas prcdent, de 1,300 1,900 centimtres cubes.
Les ordonnes qu'on lve sur l'axe des abscisses doivent, comme je l'ai dj dit en
dfinissant ces courbes, exprimer, par leur hauteur, les valeurs dont il s'agit de peindre les
variations, et, par leur cart, la proportion centsimale de ces variations. En d'autres termes, les
ordonnes doivent correspondre, par leur hauteur, aux chiffres de la premire colonne du tableau
ci-dessus, et, par leur cartement, ceux de la dernire. Dans l'exemple qui prcde, la premire
ordonne se trouvera donc 10mm 4 du 0, la deuxime 14mm 3 de la prcdente, et par
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
45
consquent 10,4 + 14,3 =24mm 7 du 0 ; la troisime 46mm 7 de la prcdente, c'est--dire
10,4 + 14,3 + 46,7 = 71mm 4 du 0, etc. La position de chaque ordonne dpend donc, comme on
le voit, de celle qui la prcde, et toutes les ordonnes ont, par consquent, une troite
dpendance entre elles. Leur hauteur est naturellement limite par les abscisses tires au niveau
des chiffres crits sur l'axe vertical. Les trois prcdentes s'arrteront donc au niveau des lignes
horizontales qui partent des chiffres 1,300, 1,400 et 1,500. En faisant usage de papier quadrill au
millimtre, les ordonnes et les abscisses se trouvent toutes traces d'avance. L'opration se borne
donc marquer l'encre, sur l'axe des abscisses, le nombre de millimtres qui doit exister entre
chaque ordonne, et pointer sur l'ordonne qui se trouve au-dessus de cette marque sa hauteur.
Les points sont ensuite runis par une ligne continue et l'opration est termine.
Les autres courbes traces sur le mme tableau, c'est--dire les volumes du crne des
Parisiens du XIIe sicle, des anciens gyptiens, des ngres, etc., ont t traces suivant les
mmes principes. Elles permettent, comme j'aurai occasion de le montrer, des comparaisons qui
ne seraient possibles par aucune autre mthode.
Les ordonnes semblent, au premier abord, quidistantes sur les figures, parce qu'on s'est
servi, pour simplifier leur construction, de papier quadrill ; mais il suffit d'un instant d'attention
pour reconnatre que leur cart rel est, au contraire, trs variable. Ce n'est mme que cet cart
qui fait connatre la proportion centsimale du phnomne. Il suffit, par exemple, de compter
combien de millimtres se trouvent horizontalement entre les points o la courbe coupe les
abscisses correspondant aux crnes de 15 1600 centimtres cubes de capacit, pour savoir
combien, sur cent crnes, il y en a possdant ce volume. Il est vident que plus ce nombre de
millimtres est grand, plus la courbe tend devenir horizontale ; plus ce nombre est petit, au
contraire, plus elle tend devenir verticale. La courbe comprise entre deux ordonnes forme, en
effet, l'hypotnuse d'un triangle dont le ct vertical a, comme on le voit facilement, une hauteur
constante, et le ct horizontal une longueur d'autant plus grande que les ordonnes sont plus
cartes. En examinant les courbes dans les points o elles expriment des groupes trs petits, par
exemple, la proportion centsimale d'individus de tailles ou de crnes trs grands ou trs petits,
on les voit devenir presque verticales.
On remarquera que les courbes de la figure qui prcde ont un aspect anguleux que n'ont pas
celles que j'ai donnes dans un prcdent chapitre. Cela tient ce que pour la taille, la mortalit,
etc., on oprait sur un nombre d'individus considrable, et qu'alors le module de groupement
(quelques centimtres pour la taille, un petit nombre d'annes pour la population), pouvait tre
fort petit, tandis que pour les crnes, leur nombre tant relativement restreint, il fallait que le
module de groupement choisi (100 centimtres cubes) ft assez grand pour que chaque groupe se
trouvt compos d'un nombre suffisant d'observations. Si, possdant nombre de crnes beaucoup
plus grand, on avait pu constituer des groupes ne diffrant que par 50 ou mme 25 centimtres
cubes de capacit, les cts de la courbe eussent t plus nombreux et l'aspect anguleux et
disparu, de mme qu'en multipliant suffisamment le nombre des cts d'un polygone inscrit dans
un cercle, les contours de ce polygone s'arrondissent et finissent par diffrer trs peu de celui de
la circonfrence.
Qu'il s'agisse de volumes de crnes, de tailles, de mortalit, etc., la construction des courbes
est identique. Sur l'axe des ordonnes, on crit les chiffres correspondant aux volumes, tailles,
ges qu'il s'agit d'exprimer ; l'axe des abscisses est toujours divis en 100 parties, et les ordonnes
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
46
ont un cart proportionnel l'importance du groupe qu'elles reprsentent, c'est--dire au chiffre
indiquant en centimes dans quelle proportion entre dans le total le groupe dont la valeur doit tre
exprime. La figure 1 donne plusieurs exemples de l'application de cette mthode l'expression
de divers phnomnes statistiques.
Les courbes dont je viens de parler ont un autre avantage sur lequel je dois
insister : c'est de prsenter immdiatement l'il des relations que les chiffres dont
elles sont la traduction ne laissent souvent apercevoir qu'avec peine. C'est grce
elles que j'ai pu dterminer les lois des variations du volume du crne dans les races
humaines, dont je parlerai dans un autre chapitre, et dont l'importance sociale est
trop considrable pour que j'aie regretter le temps fort long que j'y ai consacr.
J'ai pu galement dterminer par cette mthode certains rapports mathmatiques,
tels que les relations entre le poids du cerveau, le volume et la circonfrence du
crne, etc.
La rgularit des courbes prcdentes ne se manifeste que lors qu'on opre sur
des lments de mme origine ; on peut mme de leur irrgularit dduire le
mlange d'lments htrognes, par exemple, un mlange accidentel de crnes de
races diverses. J'ai pu ainsi reconnatre dans une srie de crnes que je n'avais pas
sous les yeux que des crnes d'hommes et de femmes avaient t confondus. Ce
rsultat curieux montre le degr de prcision de la mthode.
Grce aux ressources que fournissent les sciences diverses numres dans ce
chapitre, il est possible aujourd'hui d'aborder l'tude des phnomnes historiques et
sociaux comme on aborde celle d'un phnomne naturel quelconque : les
contractions musculaires de la patte d'une grenouille, les proprits d'une
combinaison chimique, les perturbations d'une plante. Les mthodes scientifiques
seules nous permettent de nous soustraire tous ces prjugs divers que font peser
sur nous notre milieu, notre ducation, notre pass, et de rechercher dans cette
tude autre chose que des armes pour combattre ou dfendre telle ou telle croyance.
Que les rsultats constats soient favorables ou non une opinion politique ou
religieuse quelconque, qu'importe ? Qu'ils dtruisent des illusions que nous tions
habitus considrer comme les bases les plus inbranlables et les plus sacres de
nos croyances, qu'importe encore ? Un phnomne quelconque, physique, religieux
ou social, est une rsultante dont nous devons tudier les causes avec un esprit aussi
libre de prjugs que peut l'tre celui du physicien la recherche des lois de la
propagation d'un courant lectrique. Une telle indpendance n'est pas facile sans
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
47
doute acqurir ; ou y arrive surtout en se rappelant que, s'il est toujours
indispensable d'avoir une mthode, il est souvent funeste d'avoir une doctrine.
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
48
L'homme et les socits.
LEURS ORIGINES ET LEUR HISTOIRE.
Deuxime partie
LES SOCITS
Leurs origines et leur dveloppement
Livre II.
Les facteurs de l'volution
sociale
Retour la table des matires
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
49
Deuxime partie
LES SOCITS
Leurs origines et leur dveloppement
livre II : Les facteurs de lvolution sociale
Chapitre I.
Les socits animales et
les socits humaines primitives.
Existence des premiers hommes.
Retour la table des matires; retour au dbut du chapitre
I. Anciennes croyances relatives l'tat des premiers hommes. -Conception que se faisaient
de l'homme primitif les philosophes du dernier sicle. - Ide qu'ils se formaient de l'tat
intellectuel, moral et social de nos premiers pres. - Comment on supposait alors que se fonde
une socit. - Influence politique immense que ces conceptions ont eue. - II. Les socits
animales. - Les socits animales se sont formes sous l'empire des mmes ncessits que les
socits humaines. - On y retrouve les mmes lments. - Murs, usages, travaux de diverses
socits animales infrieures. - Faits dmontrant que les sentiments sociaux et la moralit des
animaux ne sont pas infrieurs ceux des sauvages. - Socits de singes et de castors. - Ce qui
dtermine l'tat de sociabilit ou d'isolement des diverses espces animales. - III. Formation des
socits humaines primitives. - Les dbris laisss par nos premiers aeux nous rvlent leur
infriorit primitive et leurs conditions d'existence misrables. -- Ncessits qui ont dtermin la
formation des premires agglomrations humaines. - Pourquoi, pendant de longues sries de
sicles, ces agglomrations ne purent jamais tre bien nombreuses. - IV. Existence des premiers
hommes. - Leur tat physique et intellectuel. - Preuves de leur frocit et de leurs habitudes
d'anthropophagie. - L'tude des sauvages modernes permet de complter l'ide que nous pouvons
nous former de nos premiers anctres d'aprs leurs dbris. - Opinion des voyageurs les plus
rcents sur la frocit, l'absence de morale et les sentiments infrieurs des sauvages. - Leur
habitude de tuer et de manger leurs parents gs. - Comment ils traitent leurs femmes. - Habitude
des Australiens de manger les vieilles femmes. - En quoi consistent les ides religieuses des
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
50
sauvages. - Pourquoi leurs murs et leur genre de vie varient sur les diffrents points du globe. Preuves que nos premiers aeux ressemblaient aux sauvages les plus infrieurs. - Leurs conditions
d'existence ne semblent misrables que parce que nous les comparons aux ntres. - Leurs ides et
leurs besoins taient adapts leurs conditions d'existence. - Les sauvages les plus misrables
sont satisfaits de leur tat et n'en veulent pas changer. - Conclusion.
1. - Anciennes croyances relatives
l'tat primitif de l'homme.
Retour la table des matires; retour au dbut du chapitre
Avant d'aborder l'tude des facteurs ayant dtermin l'volution des divers
lments dont l'ensemble constitue une socit, nous allons jeter un coup dil
rapide sur les conditions d'existence de nos premiers anctres. Avec ce point de
dpart pour base, nous pourrons plus facilement nous rendre compte ensuite de
l'importance des progrs que les socits humaines ont graduellement accomplis.
Plusieurs chapitres de la premire partie de cet ouvrage ont t consacrs
dmontrer comment il est possible de reconstituer l'tat physique et intellectuel de
nos premiers pres. Dans les chapitres qui vont suivre, nous ferons voir comment
nous pouvons nous faire une ide suffisamment nette des diverses phases par
lesquelles ont pass les lments nombreux qui entrent dans la constitution d'une
socit humaine. En runissant ces divers matriaux, il est facile de nous rendre
compte de ce que dut tre la primitive existence de l'homme.
Cette vue d'ensemble, laquelle le prsent chapitre va tre consacr, nous
montrera que l'homme rel des premiers temps n'eut rien de commun avec les
heureux anctres dont d'antiques lgendes nous retracent l'image, et, qu'aux
lumires de la science moderne, la priode fortune nomme l'ge d'or, place par
toutes les traditions au berceau de l'histoire des peuples, doit s'vanouir.
Ce n'est pas seulement un sentiment de curiosit pure qui doit nous conduire
rechercher les conditions d'existence de nos premiers anctres, leur genre de vie,
leurs croyances et leurs murs. Il y a dj un sicle, une cole philosophique dont
bien des doctrines sont vivantes encore, s'tait galement demand ce que
l'existence de nos premiers pres avait pu tre. La rponse qu'elle fit cette
question, et que la science moderne a condamne, eut des consquences pratiques
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
51
considrables, puisque c'est d'aprs ces thories que furent difies les institutions
politiques de la rvolution qui, la fin du sicle dernier, a fait subir aux socits
une agitation si profonde.
L'homme primitif, suivant ces thories, serait un tre naturellement bon,
aimant la justice et l'ordre ; les socits seules l'auraient dprav. Cet tat primitif
admis, on en dduisit immdiatement qu'il fallait rformer les socits auxquelles
l'humanit devait tous ses maux, s'affranchir de ces institutions du pass, qui
n'taient qu'un tissu de calamits et d'erreurs, et refaire un systme social adapt
aux besoins de l'homme l'tat de nature, tel que le concevaient les philosophes.
Personne ne doutait alors de la possibilit d'une telle tche. Elle fut tente avec
une persvrance, une loyaut d'intention et une nergie qui peuvent lgitimer
l'admiration et la sympathie, mais aussi avec une ignorance tellement profonde de
la nature humaine, qu'un observateur instruit aurait peine la concevoir, s'il n'tait
pas oblig de reconnatre qu'aprs un sicle de progrs scientifiques immenses,
cette mme ignorance est aujourd'hui aussi gnrale encore.
C'est surtout dans les oeuvres des philosophes dont l'influence fut prpondrante
alors, J.-J. Rousseau notamment 6, qu'on peut voir un expos fidle des ides
6
Influence des ides des philosophes sur la Rvolution. -L'influence des ides des philosophes, notamment de
Rousseau, sur la Rvolution, fut beaucoup plus profonde encore que ne le croient la plupart des historiens.
Comme le dit trs justement Edgar Quinet : Rousseau rgna dans la Lgislative, et la Convention, mesure
que la Rvolution se dveloppe, elle semble une incarnation de J.-J. Rousseau.
Cette Il faut se reporter aux mmoires du temps pour comprendre l'influence immense qu'exera alors ce
philosophe. Le Contrat social, crit un tmoin oculaire, Mallet-Dupan, fut le Coran des discoureurs de 1789,
des Jacobins de 1790, des rpublicains de 1791 et des forcens les plus atroces. J'ai entendu Marat, en 1788, lire
et commenter le Contrat social dans les promenades publiques, aux applaudissements d'un auditoire
enthousiaste. influence de Rousseau et des thories des philosophes de cette poque a t parfaitement
apprcie par un profond penseur anglais, Summer Maine. Le lecteur lira certainement avec intrt l'opinion de
cet auteur sur ce point :
Nous n'avons pas vu de notre temps, crit ce savant, et le monde n'a vu qu'une fois ou deux, dans le cours
des temps historiques, des travaux littraires exercer une aussi prodigieuse influence sur l'esprit des hommes de
tout caractre et de toute nuance intellectuelle que ceux que publia Rousseau de 1749 1762. Ce fut la premire
tentative faite pour reconstruire l'difice de la croyance humaine, aprs les travaux de dmolition commencs
par Bayle et par Locke, achevs par Voltaire ; et outre la supriorit que toute tentative de construction a
toujours sur les oeuvres purement destructives, les travaux de Rousseau eurent l'immense avantage de paratre
dans un temps o tout le monde, ou peu prs, doutait de l'exactitude de la science du pass en matire
spculative. Dans toutes les spculations de Rousseau, le personnage central, soit qu'il signe le contrat social,
soit qu'il paraisse nu et dpouill de toutes ses qualits historiques, est constamment l'homme dans l'tat suppos
de nature. Toute loi, toute institution qui ne convient pas cet tre imaginaire et dans ces conditions idales, doit
tre condamne comme une dchance de la perfection originelle ; toute transformation qui pourra faire
ressembler davantage la socit au monde sur lequel rgnait l'enfant de la nature, est admirable et doit tre
ralise cote que cote.
Si la philosophie fonde sur 1'hypothse de l'tat de nature est tombe dans le discrdit devant l'opinion
sous ses formes les plus palpables et les plus grossires, elle n'a pas perdu pour cela, dans ses dguisements plus
subtils, sa plausibilit, sa popularit et sa puissance. Je crois, comme je l'ai dit, qu'elle est encore le grand
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
52
tranges qu'on se faisait, il y a un sicle, sur l'tat intellectuel, moral et social de
nos premiers pres :
Le principe fondamental de toute morale sur lequel j'ai raisonn dans mes
crits, dit le philosophe que je viens de nommer, est que l'homme est un tre
naturellement bon, aimant la justice et l'ordre... La nature a fait l'homme heureux et
bon, la socit le dprave et le rend misrable.
Des tres bons, doux, bienfaisants, vivant de fruits, se dsaltrant l'ombre des
arbres, et se distrayant dans leurs loisirs par des dissertations philosophiques : telle
tait peu prs l'ide que l'on se faisait alors de nos primitifs aeux l'tat de
nature. Il faut lire Buffon, Diderot, Bernardin de Saint-Pierre, pour voir les
raisonnements subtils que ces savants illustres prtent aux sauvages et nos
premiers pres. Rsumant la littrature philosophique de l'poque, M. Taine trace
de la faon suivante la fondation d'une socit humaine, suivant la croyance du
dernier sicle :
On imaginait vaguement une scne demi-bucolique, demi-thtrale, peu prs
semblable celle qu'on voyait sur le frontispice des livres illustrs de morale et de
politique. Des hommes, demi-nus ou vtus de peaux de btes, sont assembls sous un
grand chne ; au milieu d'eux, un vieillard vnrable se lve et leur parle le langage de
la nature et de la raison ; il leur propose de s'unir et leur explique quoi ils s'obligent
par cet engagement mutuel ; il leur montre l'accord de l'intrt public et de l'intrt priv,
et finit en leur faisant sentir les beauts de la vertu. Tous aussitt poussent des cris d'allgresse, s'embrassent, s'empressent autour de lui et le choisissent pour magistrat. De toutes
parts on danse sous les ormeaux, et la flicit, dsormais, est tablie sur la terre.
Pour Rousseau, l'origine des socits et de tous les maux qu'elles produisent est
chose plus simple encore :
Le premier qui, ayant enclos un terrain, s'avisa de dire : ceci est moi, et trouva des
gens assez simples pour le croire, fut le vrai fondateur de la socit civile. Que de crimes,
de guerres, de meurtres, que de misres et d'horreurs n'et point pargns au genre humain
celui qui, arrachant les pieux et comblant le foss, et cri ses semblables : Gardezvous d'couter cet imposteur ; vous tes perdus si vous oubliez que les fruits sont tous et
que la terre n'est personne.
Telle fut la fiction. Nous allons montrer bientt ce que la ralit dut tre.
antagoniste de la mthode historique ; et chaque fois, -toute objection religieuse part, - qu'on voit une personne
rsister cette mthode ou la ddaigner, on trouve que c'est sous l'influence de prjugs qui se rattachent la
croyance, consciente ou inconsciente, qu'il existe un tat naturel et non historique de la socit ou des individus.
Toutefois, c'est principalement en s'alliant aux tendances politiques et sociales que les doctrines de l'tat de
nature et du droit naturel ont conserv leur nergie.
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
53
II. - Les Socits animales.
Retour la table des matires; retour au dbut du chapitre
L'homme et les espces animales dont il drive s'tant forms sous l'influence
des mmes besoins, et obissant aux mmes lois. nous devons retrouver dans les
socits animales les lments fondamentaux qui entrent dans la constitution des
socits humaines. Nous verrons, en effet, en tudiant les facteurs de l'volution
sociale, que les ncessits qui ont dtermin la formation et l'accroissement des
unes, ont prsid galement la naissance et au dveloppement des autres.
Nous pourrions remonter ces tres infrieurs dont les demeures nommes
polypiers forment des constructions gigantesques qui ont modifi sur plusieurs
points la surface du globe, pour trouver les premiers germes des socits ; mais, en
ralit, tous ces tres sont des dpendances d'un mme organisme, comparables aux
cellules qui constituent le corps des animaux suprieurs.
Il ne faut pas s'lever, cependant, beaucoup dans l'chelle des tres pour voir
apparatre des socits semblables celles formes par les animaux suprieurs et
par l'homme. Beaucoup d'espces d'insectes forment des socits o existe la
division du travail, et dont les membres oprent dans un but commun. Telles sont,
par exemple, les socits d'abeilles et de fourmis. Ces dernires construisent des
routes et des demeures, attaquent mthodiquement leurs ennemis, font des
prisonniers qu'elles utilisent ensuite comme esclaves, lvent avec tendresse leurs
petits, se sacrifient pour le bien de la communaut, et possdent, enfin, des
aptitudes qui pourraient sembler l'observateur peu attentif le privilge exclusif des
socits suprieures.
Lorsqu'on arrive aux vertbrs suprieurs, on constate chez eux l'existence de
socits dont l'organisation est trs comparable celle des tribus humaines
infrieures. En tudiant les sentiments, nous avons montr qu'il existe de grandes
analogies entre les sentiments des animaux et ceux des sauvages, et reconnu chez
les premiers l'existence des qualits les plus ncessaires la vie sociale :
dvouement rciproque des poux, tendre affection pour leurs petits, respect de
l'autorit des chefs de la communaut, sacrifice de l'individu pour le bien collectif,
etc.
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
54
Bien des espces animales ont mme des sentiments sociaux et une morale trs
suprieurs ceux de beaucoup de sauvages. Alors, en effet, qu'il est d'un usage
gnral chez certaines tribus humaines de massacrer les parents gs, de traiter les
femmes comme des btes de somme et de les tuer pour les manger aussitt qu'elles
commencent vieillir, on voit le mle et la femelle des espces dont nous parlons
avoir l'un pour l'autre une affection quelquefois si profonde, que la mort de l'un est
bientt suivie du trpas de l'autre. Il n'y a gure, du reste, je crois, que chez les
araignes et chez l'homme o l'on voit des individus de sexe diffrent se dvorer.
Beaucoup d'oiseaux nourrissent, comme on le voit dans des exemples cits par
Darwin, leurs compagnons devenus vieux et aveugles, et on en a vu pousser la
bienveillance jusqu'au point d'adopter et d'lever de jeunes oiseaux abandonns,
mme quand ils appartenaient une espce diffrente.
C'est surtout chez les vertbrs les plus voisins de l'homme, comme les singes,
que s'observent les socits animales prsentant les analogies les plus grandes avec
les socits humaines. Quelques espces de singes, telles que les gorilles, vivent
isoles, mais la plupart se runissent en socits nombreuses. Les cynocphales
hamadryas vivent par bandes de cent cinquante individus, contenant, au dire de
Brehm, une quinzaine de mles, le double de femelles et des jeunes singes en
nombre variable. Ces socits sont aussi bien organises que beaucoup de tribus de
sauvages. Leurs membres obissent l'autorit d'un ou de plusieurs chefs, se
communiquent leurs penses par gestes et par cris plus ou moins conventionnels, se
concertent pour aborder un ennemi ou un jardin qu'ils dsirent piller, envoient des
reconnaissances examiner les endroits qu'ils veulent attaquer, posent des sentinelles
destines prvenir la troupe des dangers qui pourraient surgir, se dvouent pour
protger les individus trop faibles de la communaut, etc.
D'autres vertbrs, vivant en socits, se construisent de vritables villages.
Tels sont, par exemple, les castors. Leurs villages sont forms par la runion sur le
bord de l'eau de huttes de 2 3 mtres de hauteur sur 3 4 mtres de largeur,
destines les abriter et recevoir leurs provisions. Ces huttes exigent pour leur
construction le concours d'individus nombreux et se comprenant parfaitement. Il
leur serait tout fait impossible autrement d'excuter des travaux aussi compliqus
que l'tablissement de digues de 3 4 mtres de largeur leur base, destines
maintenir l'eau un certain niveau, et dont la forme varie suivant la force du
courant et les ncessits locales. Bien des sauvages seraient absolument incapables
de tels travaux et des raisonnements que leur excution ncessite.
Les conditions de milieu dans lesquelles se trouvent les divers tres vivants
tant trs variables, nous devons nous attendre rencontrer des modes d'existence
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
55
trs diffrents chez les diverses espces animales mme quand ces espces sont trs
voisines ; il ne faut donc pas s'tonner de voir les unes rester spares, les autres se
runir ou avoir des habitudes en partie solitaires et en partie sociales, suivant
l'poque de l'anne. Les individus qui appartiennent des espces vivant de proies
et qui peuvent facilement et sans secours mettre mort leurs victimes, comme les
aigles, les faucons, les chouettes, etc., ont intrt vivre seuls, et vivent seuls, en
effet. Loin de leur procurer aucun avantage, la runion en socits ne ferait que leur
rendre la vie plus difficile, les animaux qui leur servent de proie devant naturellement apercevoir plus facilement des ennemis en bande que des individus isols.
Ceux qui, comme les loups, s'attaquent souvent de grosses proies qu'ils ne
pourraient russir seuls vaincre, ont intrt, au contraire, former des associations
temporaires ou permanentes. Ceux qui vivent de vgtaux ont galement intrt
s'unir afin de se protger rciproquement et de mieux djouer les embches que
peuvent leur tendre leurs ennemis. Il en est qui se runissent en bandes une partie
de l'anne, mais se sparent pendant la saison des amours. D'autres , comme les
castors, vivent par couples isols dans les pays o ils sont trop poursuivis par
l'homme, et en socits construisant des villages dans les pays o il leur est
possible d'chapper ses embches.
L'intrt de l'espce dtermine, comme on le voit, son degr plus ou moins
grand de sociabilit. Lorsque cet intrt a amen les individus se tenir runis
pendant un certain nombre de gnrations, le dsir de vivre ensemble finit par
devenir un instinct hrditaire qui persiste mme quand l'intrt qui les a
primitivement conduits se former en socit a disparu.
Nous ne saurions prtendre exposer, dans ce trs rapide aperu, les diffrences
que dterminent dans l'tat social des diverses espces animales leurs conditions
d'existence ; nous nous bornerons dire, d'une faon gnrale, que la sociabilit est
dveloppe surtout chez les animaux se nourrissant de vgtaux et se procurant leur
nourriture facilement ; que les instincts sociaux sont peu vivaces et les instincts
froces trs dvelopps, au contraire, chez les individus qui se nourrissent de proies
vivantes.
Les dbris laisss par les premiers hommes nous montrent que, pendant de
longues priodes de sicles, l'homme ignora l'agriculture et ne connut pas d'autre
nourriture que la nourriture animale. Cette indication seule suffirait, dfaut
d'autres preuves, pour nous faire supposer qu'il fut d'abord un animal peu sociable
et froce.
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
56
III. - Formation des Socits
humaines primitives.
Retour la table des matires; retour au dbut du chapitre
Pour nous faire une ide suffisante de ce que les premires socits humaines
durent tre, nous devons nous rappeler que les dbris laisss par elles prouvent que,
pendant de longs sicles, nos primitifs anctres se trouvrent dans des conditions
d'existence qu'on ne rencontre aujourd'hui que chez les sauvages les plus infrieurs,
ignorant entirement l'agriculture, l'art de rendre les animaux domestiques, de se
tisser des vtements, de construire des maisons et de travailler les mtaux, habitant
des cavernes et vivant uniquement du produit de leur pche et de leur chasse. La
vie de pasteur et d'agriculteur n'apparat qu' cet ge de la pierre polie o l'humanit
tait dj bien vieille.
Deux ncessits imprieuses ont d tre, l'aurore de l'humanit, les principaux
mobiles des hommes : celle de se nourrir et celle de se protger contre les ennemis
qui les entouraient de toute part. La premire a conduit aux perfectionnements
industriels qui se sont succd ; la seconde, l'organisation constamment
progressive des ressources militaires dont l'homme pouvait disposer.
Ce ne fut pas seulement contre les animaux qui lui servaient de nourriture ou par
lesquels il tait poursuivi, que l'homme se trouva tout d'abord en guerre. Oblig de
disputer ses semblables une proie peu abondante, trouvant souvent dans ces
derniers, quand ils taient moins forts que lui, une proie plus facile chasser que
des animaux puissamment arms, il dut se trouver bientt en guerre implacable
avec eux.
Malgr la frocit naturelle que rvle, par ses dbris, sa primitive existence,
l'homme dut rapidement reconnatre la ncessit de l'association pour se protger
contre ses ennemis ou les attaquer plus facilement ; mais ce n'est pas sans doute
dans ces ncessits seules qu'il faut chercher le germe des socits primitives. Chez
tous les mammifres, qu'ils soient sociables ou non, les premiers liens qui
runissent des tres vivants sont les liens de famille. Le plus grand nombre des
socits ne se composent d'abord que de la runion des membres d'une mme
famille, dont l'union, passagre le plus souvent, dure au moins le temps ncessaire
pour que les jeunes animaux qui en sont issus soient devenus assez grands pour
savoir se nourrir.
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
57
en juger par ceux des sauvages modernes qui ressemblent le plus par leur
industrie aux premiers hommes, les premires hordes humaines ne durent gure se
composer que des individus d'une mme famille ou tout au plus de la runion d'un
trs petit nombre de familles. Nous voyons encore beaucoup de sauvages vivre par
tribus composes d'un nombre trs restreint d'individus et qui ne peuvent dpasser
jamais un certain chiffre, parce que, aussitt que ce chiffre est atteint, ils sont trop
nombreux pour trouver dans une mme localit des moyens de subsistance, et par
suite sont obligs de se sparer. Les Fugiens vivent par bandes de quinze ou
vingt ; les Australiens, par groupes de trente cinquante forms d'un trs petit
nombre de familles et dont l'organisation n'est gure suprieure celle des socits
de singes dont nous avons parl plus haut. Les Turcomans nomades vivent par
campements qu'aucun lien politique ne rattache et composs d'un nombre restreint
de familles dont le pre est le chef.
Des usages qui ont persist jusque dans les temps historiques nous montrent que
ce ne fut pas seulement dans les temps primitifs que la famille forma l'unit relle
et la base de toute socit. C'est de l'agrgation des petites tribus primitives formes
de la runion de quelques familles et conservant leur autonomie que les socits
civilises devaient un jour sortir. Jusqu' la conqute romaine, la Grce offrit des
traces de ces confdrations primitives, qu'on peut suivre du reste jusqu'aux temps
modernes dans les clans de l'cosse.
Pendant l'immense dure de l'ge de la pierre taille, l'organisation des socits
humaines dut tre des plus rudimentaires et comparable celle des plus misrables
sauvages actuels. Ce n'est que lorsque la dcouverte de l'agriculture et de l'art de
rendre les animaux domestiques eut permis l'homme de se contenter, pour vivre,
d'une surface de territoire peu tendue, que des socits nombreuses et fortement
organises purent se constituer et que l'ge de la civilisation commena natre.
IV. - Existence des premiers Hommes.
Retour la table des matires; retour au dbut du chapitre
Le travail de reconstitution auquel nous nous sommes livr dans une autre partie
de cet ouvrage a dj donn une ide nette de l'tat physique et intellectuel de nos
primitifs aeux.
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
58
Les tudiant d'abord au point de vue physique, nous avons montr que les
premiers animaux qui peuvent mriter le nom d'hommes durent tre caractriss
par un crne troit et fuyant, des arcades sourcilires prominentes, une mchoire
projete en avant, un aspect bestial et froce, une stature demi-verticale, les genoux
fortement flchis.
Nous avons vu que la seule langue qu'ils aient pu possder d'abord devait tre
constitue par des hurlements et des cris ; que pendant des milliers d'annes ils
ignorrent absolument l'agriculture, l'art de travailler les mtaux, de rendre les
animaux domestiques, de se tisser des vtements, de construire des demeures ;
qu'ils vivaient au fond des cavernes, n'ayant gure d'autre industrie que de tailler
grossirement les pierres qu'ils employaient comme armes.
Les tudiant ensuite au point de vue intellectuel, nous avons montr qu'ils
taient incapables des combinaisons les plus simples et des calculs les plus
lmentaires, incapables de songer autre chose qu' l'heure prsente et d'avoir
aucune prvoyance. Nous avons montr que leurs passions taient trs fortes et leur
raison trs faible, et que l'instinct du moment tait leur seul guide ; qu'ils taient
indiffrents tous les phnomnes de la nature, incapables de distinguer la vrit
de l'erreur, de souponner l'existence de choses surnaturelles, et qu'aucune question
relative l'origine des choses ne les proccupa jamais.
L'tude des vestiges qu'ils nous ont laisss et l'examen des couches gologiques
o ces vestiges ont t retrouvs, nous ont prouv que cet tat primitif se continua,
avec des progrs bien faibles, durant des priodes de sicles qu'on ne peut chiffrer
que par centaines de milliers d'annes ; car, pendant toute la dure de ces temps
primitifs, la flore, la faune, l'aspect du globe eurent le temps de changer
entirement.
L'tude de ces mmes dbris nous a montr l'excessive frocit des murs de
nos premiers pres. La trace laisse par eux sur des ossements humains nous a fait
connatre que, comme les sauvages modernes, ils dvoraient leurs prisonniers, et
que les femmes et les enfants eux-mmes leur servaient de pture 7.
7
Commenc une poque fort rcente, le travail de reconstitution du pass de l'homme fait chaque jour de
nouveaux progrs. Pour montrer combien il est possible d'aller loin dans cette voie, je citerai un travail rcent
(Die geschichtliche Entwickelung des Farbensinnes, Leipzig, 1877), dans lequel le docteur Hugo Magnus,
professeur d'ophthalmologie l'Universit de Breslau, a cherch montrer, en s'appuyant surtout sur des
donnes philologiques, qu'aux premiers temps de l'histoire, nos anctres ne distinguaient pas la plupart des
couleurs et voyaient, par consquent, tous les objets avec cette teinte grise qu'ils nous prsentent le soir, lorsque
le jour vient tomber, ou quand on les regarde dans un paysage dessin la mine de plomb. Les auteurs des Rig
Vedas semblent n'avoir connu que le noir et le blanc, c'est--dire l'obscur et le clair. Ils commenaient pourtant
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
59
Avec de tels documents, nous pouvons pressentir facilement ce que l'existence
des hommes primitifs put tre. Pour complter ce tableau et vrifier l'opinion que
nous pourrions dduire des indications qui prcdent, relativement leur genre de
vie, leurs croyances, leur morale et leurs murs, nous devons tudier les sauvages
modernes, dont un grand nombre, ainsi que nous le savons, en sont rests un
degr de dveloppement peu prs analogue celui des premiers hommes. C'est
surtout en les examinant avec soin que nous pourrons nous faire une ide de
l'homme naturellement bon des philosophes, auquel nous avons fait allusion
plus haut, de cet tat de nature qui leur paraissait si charmant.
Malheureusement pour la vracit de tableaux que l'imagination seule avait
crs, les voyageurs modernes ayant observ d'un peu prs les sauvages ont d
reconnatre que cet tat de nature tait une fort vilaine chose, l'homme non civilis
un trs mchant animal. Leurs tmoignages se ressemblant gnralement sur ce
point, je me bornerai en citer quelques-uns. Ils montreront que, part un nombre
fort restreint d'exceptions dont j'indiquerai les causes, les sauvages dont l'industrie
et le genre de vie paraissent se rapprocher le plus de ceux de l'homme primitif
vivent dans un tat qu'on ne peut gure comparer qu' celui des btes froces :
ignorant entirement l'existence du bien et du mal, ne reconnaissant d'autre loi que
la force, tuant et pillant ceux dont ils n'ont rien craindre, se dbarrassant de leurs
parents gs en les massacrant, considrant les femmes comme de simples btes de
somme, uniquement bonnes tre tues et le plus souvent manges quand l'ge
commence affaiblir leurs forces.
Je voudrais que les ngrophiles de l'Angleterre, dit Samuel Baker dans son livre sur
l'Albert Nyanza, pussent voir comme moi le cur de l'Afrique ; leurs sympathies
distinguer la plus lumineuse des couleurs, le rouge ; mais il semble rsulter de leurs descriptions qu'ils le
confondaient souvent avec le blanc. A l'poque d'Homre, le nombre des couleurs connues tait encore fort
restreint. Achille et Ulysse confondent le vert avec le jaune, le bleu avec le noir. C'est ce qui explique qu'Homre
donne Ulysse des cheveux de couleur hyacinthe, que Pindare parle de tresses de couleur violette. Fort riche en
pithtes pour peindre l'clat lumineux des objets, Homre en a trs peu pour dcrire leur coloration.
On peut suivre, d'aprs le docteur Magnus, chez les auteurs grecs antrieurs Jsus-Christ, le progrs
graduel de l'acquisition du sens des couleurs, dans la prcision de plus en plus grande des mots destins
dsigner les objets colors. L'ordre de cette acquisition se fit de la couleur la plus lumineuse, qui est le rouge,
la moins lumineuse, qui est le violet, et suivant l'ordre dans lequel elles sont places dans le spectre.
On a fortement combattu les opinions du docteur Magnus. Il me semble que ce qu'on peut lui reprocher
surtout, c'est de ne pas avoir vrifi sa thorie sur des sauvages et des enfants, ce qui et t trs facile en
recherchant, au moyen de bandes de papier de couleurs diffrentes, quelles sont celles qu'ils peuvent
diffrencier. L'homme rptant, en se dveloppant, les phases par lesquelles ont pass ses aeux, il est probable
que si nos premiers anctres n'ont pas peru les couleurs, l'enfant doit rester longtemps sans savoir les distinguer.
Mes observations personnelles ont confirm entirement cette conjecture. Les enfants confondent entre elles la
plupart des couleurs ; ils ne voient ni le bleu du ciel ni le vert des arbres ; ils ne reconnaissent d'abord que la
couleur rouge.
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
60
disparatraient. La nature humaine, vue dans son tat primitif chez les sauvages de ce
continent, ne s'lve pas au-dessus du niveau de la brute et ne peut se comparer avec la
noblesse du chien. Ces ngres ne savent pas ce que c'est que la reconnaissance, la piti,
l'amour, le dvouement ; ils n'ont aucune ide de devoir ou de religion ; l'avarice,
l'ingratitude, l'gosme et la cruaut sont leurs qualits distinctives. Ils sont tous voleurs,
paresseux, envieux et prts piller leurs voisins plus faibles qu'eux ou les rduire en
esclavage.
Quand nous pntrmes dans les bois, dit le P. Salvado dans ses Mmoires sur
l'Australie, nous ne trouvmes que des cratures qui tenaient bien moins de l'homme que
de la bte : des sauvages qui se tuaient pour se dvorer les uns les autres, qui dterraient
leurs morts, mme aprs trois jours de spulture, pour s'en nourrir dans les cas extrmes ;
des maris qui, pour un rien, tuaient leurs femmes ; des mres qui donnaient la mort leur
troisime fille, allguant pour raison unique le grand nombre de femmes ; des sauvages
qui n'adoraient aucune divinit, ni vraie ni fausse.
L'absence presque complte d'organisation sociale chez les populations les plus
infrieures a t note par plusieurs observateurs.
Parlant des sauvages de l'intrieur de Borno, M. Dalton, cit par Lubbock, dit :
Ils vivent absolument dans l'tat de nature, ne cultivant pas la terre et n'habitant pas
dans les cabanes ; ne mangeant ni riz ni sel ; ne s'associant pas entre eux, mais errant dans
les bois comme les btes froces, et s'accouplant dans les jungles. Lorsque les enfants sont
assez grands pour se tirer d'affaire seuls, ils se sparent de leurs parents pour toujours. La
nuit, ils dorment sous des arbres, autour desquels ils font du feu pour loigner les serpents
et les btes froces. Leur vtement consiste en un morceau d'corce.
L'auteur d'un voyage rcent, M. Raffray, charg d'une mission par le ministre
de l'instruction publique, s'exprime ainsi au sujet des Papous :
Comme on doit s'y attendre chez des peuples aussi primitifs, l'organisation sociale
est encore dans la priode embryonnaire. Pas de gouvernement, pas de lois, pas de
coutumes, pas de prtres, pas d'autorit obie et respecte. Ce n'est qu'un ensemble
d'individualits absolument libres et indpendantes, qui ne sont lies entre elles qu'autant
que leur intrt l'exige, et qui, cependant, chose curieuse, sont toutes solidaires les unes
des autres.
La frocit des populations primitives est gnralement trs grande ; elle semble
chose si naturelle aux habitants de l'Afrique, qu'ils trouvent fort simple d'en tre
victimes, et il faut qu'elle soit pousse bien loin envers eux pour qu'ils finissent par
protester. J'emprunterai, ce sujet, deux citations au rcent voyage de Cameron en
Afrique :
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
61
Je fus surpris, dit le clbre voyageur en parlant du chef Kassango, de voir parmi ses
compagnons un aussi grand nombre de mutils, et plus encore d'apprendre que beaucoup
de ces mutilations avaient t faites par simple caprice du matre, ou pour tmoigner de
son pouvoir. Le fidle Achate du potentat avait perdu les mains, le nez, les oreilles et les
lvres par suite d'accs de colre de son noble ami. Malgr ces cruauts, le malheureux
semblait adorer jusqu' la trace des pas de son bourreau ; et cette adoration se manifestait
galement chez d'autres qui n'avaient pas moins se plaindre de l'objet de leur culte.
Parlant d'un autre chef, le mme voyageur dit :
Faire couper des nez, des lvres, des oreilles ne suffisait pas ce misrable ; il avait
voulu tendre ses vivisections une femme qui allait devenir mre et la faire ouvrir pour
satisfaire une curiosit monstrueuse. Sa sur, qui tait aussi sa premire pouse, s'tait
oppose cette fantaisie royale, et, pensant qu'un jour ou l'autre elle pourrait tre choisie
comme sujet anatomique, elle avait runi un parti nombreux qui devait surprendre le chef
pendant la nuit et le mettre mort.
Sans doute, la ncessit oblige les sauvages se respecter entre eux et ne faire
tomber leurs instincts de pillage et de meurtre que sur les individus trangers leur
tribu, ou seulement sur ceux de cette tribu dont ils n'ont rien craindre, mais la
ncessit seule les oblige agir ainsi. On comprend que, du jour o commena se
former une socit, la ncessit s'imposa tous ses membres de se mnager rciproquement pour s'viter des reprsailles. Aussi les sauvages les plus froces et les
plus pillards respectent gnralement les personnes et les biens de leur tribu. Il en
est chez lesquels la simple clture d'une proprit par un fil suffit la protger, et
pour lesquels une parole donne est chose beaucoup plus sacre qu'elle ne l'est pour
les hommes civiliss. Mais cette ncessit, bien vite dmontre par l'exprience, de
se mnager et de s'entr'aider, va rarement jusqu' secourir les membres de la tribu
dont on n'a plus esprer de services, ni craindre de reprsailles. Aussi voit-on la
plupart des sauvages massacrer et fort souvent manger ensuite leurs parents,
lorsque ces derniers sont devenus vieux et infirmes.
Ce n'est pas seulement, du reste, chez les sauvages de l'Afrique ou de l'Ocanie,
ou chez certains peuples de l'antiquit, qu'tait rpandu l'usage de manger les
parents gs. Le clbre voyageur Marco Polo dit dans son livre des Diversits et
merveilles du monde, crit la fin du XIIIe sicle, que quand un habitant du
royaume d'Angrinam, dans l'Inde, est malade, les gens du pays envoient chercher
leurs devins pour savoir si le malade doit gurir. Si les sorciers dclarent qu'il doit
mourir, on l'touffe immdiatement et les parents du mort s'assemblent et le
mangent. Et je vous dis, ajoute Marco Polo, qu'ils sucent les os si bien, qu'il n'y
reste pas un grain de moelle dedans.
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
62
Un voyageur peine antrieur Marco Polo, le moine Rubruquis, envoy par
saint Louis en mission chez les Tartares, signale la mme coutume chez les
Thibtains ; les enfants y considrent, suivant lui, comme un devoir de manger les
cadavres de leurs pres et mres afin de leur procurer une spulture honorable.
Les sauvages grossiers, qui vivent absolument au jour le jour, dit B. Tylor, trouvent
bientt trop pnibles les soins qu'exigent des infirmits incurables et jugent qu'il vaut
mieux, sous tous les rapports, renoncer prolonger des existences inutiles ou
douloureuses. Ainsi, les tribus des forts de l'Amrique du Sud en taient venues
considrer comme un devoir pieux le meurtre des malades et des vieillards ; dans certains
cas, ils les mangeaient tout bonnement. Bien des voyageurs ont d tre tmoins, dans le
dsert, de scnes aussi dchirantes que celle laquelle assista Catlin, lorsqu'il dit adieu au
vieux chef Puncab, presque aveugle, dcharn, grelottant auprs d'un maigre feu, et
n'ayant, pour toute provision, qu'une cuelle pleine d'eau et quelques os demi rongs. Ce
pauvre vieillard, qui avait t autrefois un guerrier redoutable, fut abandonn, sur sa
propre demande, lorsque sa tribu fut force d'aller chercher d'autres territoires de chasse,
de mme que, lui aussi, avait, bien des annes auparavant, laiss son vieux pre mourir
tout seul, lorsqu'il ne fut plus bon rien. D'aprs les auteurs anciens, plusieurs peuples
barbares de l'Asie et de l'Europe conservrent cet usage cruel jusque dans les temps
historiques. Ainsi Hrodote nous apprend que, chez les Massagtes, quand un homme
tait arriv une extrme vieillesse, tous ses proches s'assemblaient, le tuaient et faisaient
bouillir son corps avec d'autres viandes pour un grand festin. Selon les ides de ces
peuples, c'tait la mort la plus heureuse.
Elien nous dit qu'en Sardaigne, la loi commandait aux fils de tuer leurs pres
coups de massue lorsqu'ils taient trop vieux, parce qu'aux yeux de ces peuples, la
dcrpitude tait une honte.... Mme aprs leur conversion au christianisme ; les Slaves
ont continu mettre mort les vieillards et les infirmes. On dit que 1es Wendes, de
mme que les Massagtes, les faisaient cuire et les dvoraient. Une ancienne tradition
scandinave nous parle de guerriers devenus infirmes, qui partaient pour le Walhalla en
sautant dut haut de l'Atternis stapi, ou rocher de la famille ; et en Sude, jusqu' l'an 1600,
on garda dans les familles d'normes massues appeles Atta-Klubbor, c'est--dire massues
de famille, avec lesquelles les vieillards et les incurables taient autrefois solennellement
tus par leurs proches.
Naturellement, le cannibalisme des sauvages ne s'exerce pas uniquement sur les
parents gs. Tous les prisonniers qui leur tombent sous la main leur servent de
pture. L'anthropophagie, comme je l'ai dj montr dans un autre chapitre, est d'un
usage gnral chez presque tous les sauvages de l'Ocanie et de l'Afrique. Suivant
plusieurs auteurs, il existait, il y a peu d'annes encore, aux les Fidji des
boucheries publiques de chair humaine et des abattoirs spciaux pour les victimes
humaines. En 1873, le capitaine Hurt et sa femme ont t dvors, aux les
Marquises, par les habitants. Lorsque les marins de la rcente expdition du
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
63
Challenger visitrent les les de l'Amiraut, ils y constatrent le got passionn des
habitants pour la chair humaine. Comme les cabanes taient pleines d'ossements
humains, et que, nulle part, on ne voyait de traces de spultures, ils en conclurent
que les indignes, non contents de dvorer les vivants qu'ils pouvaient attraper,
mangeaient aussi leurs morts.
L'habitude de manger les morts, que plusieurs auteurs ont signale chez divers
peuples de l'antiquit, parat trs rpandue encore en Afrique. Au tmoignage du
docteur Schweinfurth, que j'ai dj cit dans une autre partie de cet ouvrage, je puis
encore ajouter celui du commandant Cameron. Dans sa rcente relation de son
voyage en Afrique, le clbre explorateur, parlant des indignes du Manyema,
s'exprime de la faon suivante :
lci, les habitants semblent s'aimer beaucoup entre eux, et sont dcidment plus
prolifiques que tous les Africains d'autres races que j'ai eu occasion de voir ; mais, si
nombreuses que soient leurs qualits, ils n'en sont pas moins anthropophages, et d'une
anthropophagie dgotante. Ils ne mangent pas seulement les hommes tus dans le
combat, mais ceux qui meurent de maladie. Ils font macrer leurs cadavres dans l'eau
courante, jusqu' ce que les chairs soient presque putrfies, et les dvorent sans plus de
prparation.
La faon dont les sauvages traitent habituellement leurs femmes vaut, au point
de vue moral, celle dont ils traitent leurs parents gs. S'ils sont obligs de se
respecter entre eux, crainte de reprsailles, rien ne les oblige user de la mme
rserve l'gard de leurs femmes ; aussi ces dernires sont-elles pour eux, comme
je le disais plus haut, de simples btes de somme, qu'ils traitent absolument comme
nous le faisons de nos animaux domestiques, dont nous exigeons tout le travail
possible et que nous tuons pour les manger, quand l'ge ou les infirmits les
empchent de travailler plus longtemps. Chez les Australiens, lorsque les femmes
commencent vieillir, on s'empresse de les massacrer pour les dvorer avant
qu'elles aient trop perdu de leurs qualits nutritives.
Parlant des Australiennes, M. Olfield, cit par Lubbock, dit que peu d'entre
elles sont assez heureuses pour mourir d'une mort naturelle. On les dpche,
gnralement, avant qu'elles soient vieilles et maigres, de peur de laisser perdre tant
de bonne nourriture.
propos de la faon dont les sauvages traitent leurs femmes, je ferai remarquer
que ce ne fut sans doute que quand l'homme commena vivre en socits un peu
nombreuses que les femmes subirent un sort si dur. L'homme tout fait primitif
avait d conserver l'instinct de ses anctres ; et, parmi les animaux actuels qui
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
64
reprsentent le mieux ces anctres, nous voyons les mles protger leurs femelles,
aller la chasse pour elles, les nourrir quand elles allaitent leurs petits et ne les
maltraiter que fort rarement.
Contrairement un prjug trs rpandu encore, l'ide d'une divinit est
absolument inconnue beaucoup de sauvages. Je n'insisterai pas davantage
maintenant sur cette question, me proposant d'y revenir ailleurs. Pour le moment, je
me bornerai dire que les conceptions religieuses des sauvages sont des plus
grossires, et se ramnent gnralement la crainte de tout ce qu'ils croient pouvoir
leur nuire. Le plus souvent, ces conceptions sont fondes sur ces associations
d'ides bizarres dont nous avons dj parl. Une expdition a russi, par exemple,
la suite de la rencontre d'un serpent, ils en concluent que le serpent porte bonheur et
doit tre ador. C'est ainsi, du reste, que se forment la plupart des croyances des
peuples primitifs. Ce sont des associations d'ides de cette sorte qui font que les
sauvages du Sngal attachent une patte de livre la cuisse des femmes sur le
point d'accoucher, dans le but de communiquer l'enfant la clrit de l'animal dont
cette patte provient. Dans les cas pareils, les Peaux-Rouges prfrent administrer
une infusion de queues de serpents sonnettes, afin que l'enfant, effray par le bruit
que doivent produire les serpents, se hte de sortir du sein maternel pour leur
chapper.
Les croyances religieuses des sauvages n'ont du reste aucun rapport avec leur
morale. Nous verrons que ce ne fut qu' une poque bien avance dans l'histoire du
dveloppement de l'homme que la morale et la religion, d'abord entirement
distinctes, finirent par prendre l'une sur l'autre un naturel appui. Les croyances
religieuses qu'ils possdent n'ont d'autres rsultats que de rendre leur existence un
peu plus misrable qu'elle ne le serait sans elles, les craintes imaginaires qu'elles
leur inspirent venant s'ajouter aux craintes trop relles que doivent provoquer les
tres qui les entourent.
Par le fait mme que l'homme est esclave de son milieu et des ncessits qui
l'entourent, il est vident que son existence doit varier plus que ce milieu lui-mme
vient varier. C'est pour cette raison que les murs des sauvages ne sont pas
uniformes dans tous les pays. On comprend, par exemple, que dans les contres
chaudes et tempres, o la nourriture est abondante, et o partant l'existence est
facile, le cannibalisme soit inutile et que les murs soient plus douces que dans les
climats froids, o la nourriture tant difficile se procurer, l'anthropophagie et le
massacre des bouches inutiles s'imposent comme des ncessits fatales.
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
65
Les dbris laisss par nos premiers anctres, et l'tude gologique du sol o ces
dbris se sont trouvs, nous montrent que nos primitifs aeux ne se trouvrent pas
dans les conditions d'existence qui adouci sent les murs parce qu'elles rendent la
vie facile. Ils prouvent au contraire que ces conditions d'existence furent trs
misrables, beaucoup plus misrables mme que celles des sauvages dont nous
parlions plus haut. Les pays dans lesquels ces derniers vivent ne sont plus habits,
en effet, comme aux temps gologiques, par des monstres formidables contre
lesquels devaient constamment se dfendre nos misrables anctres, quand la faim
les chassait des obscures cavernes qui leur servaient de repaires. Lorsqu'ils en
sortaient pour tcher de trouver un animal facile tuer, ou dfaut d'une telle proie
un autre sauvage moins fort ou moins bien arm qu'ils ne l'taient eux-mmes,
c'tait toujours avec la perspective de subir le sort qu'ils leur rservaient. La libert
rgnait alors sans entraves, et il n'y avait d'autres droits que ceux du plus fort. Tuer
les plus faibles en attendant d'tre tus par des ennemis plus forts, tait la destine
commune. Tout individu devenu faible, malade, impotent, n'avait plus qu' mourir.
Telles furent les conditions d'existence, la morale et les murs du temps que les
potes ont nomm l'ge d'or. Loin de retrouver dans un tel tableau l'homme
naturellement bon, aimant la justice et l'ordre des philosophes du dernier sicle,
nous y voyons au contraire que l'tat de nature fut pour l'homme un tat de
frocit pure, o ne rgnait d'autre loi que celle du plus fort.
Avec cette reconstitution sous les yeux, nous comprenons que ce ne sont pas les
temps passs qui doivent nous servir de modles, et que si, l'homme est trop
souvent un tre pervers, ce ne sont pas les socits qui l'ont perverti.
Quand nous examinons, avec nos ides modernes, l'existence de nos premiers
pres ou des sauvages que l'on trouve encore sur divers points du globe, elle peut
paratre fort dure ; mais il ne faut pas oublier que ceux qui vcurent d'une existence
semblable eurent des modes de penser et de sentir entirement diffrents des ntres.
Du reste, leur imagination reprsentative peu dveloppe ne leur permettait pas
plus de faire des rflexions sur la duret de leur sort, que n'en fait l'animal qui fuit
devant le chasseur. La parfaite insouciance des sauvages, leur complte
imprvoyance, les empchent de songer autre chose qu' l'heure prsente et
d'avoir des soucis pour l'avenir. La perspective d'tre tus et dvors aussitt que
l'ge a affaibli leurs forces ne les influence pas plus que la perspective d'une
vieillesse remplie d'infirmits et termine par les planches d'un cercueil n'influence
l'homme civilis. De nos jours encore, il existe des pays, comme le Montenegro, o
l'on ne trouve pas de meilleur souhait faire, la naissance d'un enfant, que celui
de ne pas mourir dans son lit.
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
66
Les sauvages sont aussi accoutums leur existence que nous sommes
accoutums la ntre ; ils ont des ides en rapport avec leur faon de vivre et
refuseraient assurment pour la plupart de changer avec nous. Bien des voyageurs
ont not comme un fait qui leur paraissait trange, mais que nous considrons, au
contraire, comme fort simple, que des sauvages, amens dans nos villes et ayant
bnfici pendant plusieurs annes de notre civilisation, retournent vivre l'tat
sauvage aussitt qu'ils le peuvent. Les Indiens, auxquels les Amricains offrent
gratuitement des territoires, des habitations, de la nourriture, prfrent la vie errante
avec ses privations et ses dangers.
La conclusion essentielle qu'il importe de dgager de tout ce qui prcde, c'est
que, relativement nos ides modernes, les conditions d'existence de nos premiers
pres furent des plus misrables, leur morale et leurs murs des plus barbares, et
que, s'il fallait crer des institutions politiques et sociales pour de tels hommes, ce
ne sont pas les institutions des philosophes qui pourraient leur convenir, mais
seulement ces lois de fer ignorant la piti qui, dans toutes les socits naissantes,
furent les lois des premiers ges.
Ce fut pourtant de ces populations sauvages, ne connaissant ni les mtaux, ni
l'agriculture, ni l'art de rendre les animaux domestiques et de se construire des
demeures, o l'on massacrait sans piti les parents gs et o l'on n'pargnait jamais
le plus faible, que devaient sortir par de lentes transformations successives ces
nations polices qui amenrent les lettres, les sciences et les arts au degr lev o
ils sont aujourd'hui.
Comment de telles transformations purent-elles s'accomplir ; comment
naquirent et se dvelopprent l'industrie et les sciences, le droit et la morale, les
institutions et les croyances ? C'est ce problme que nous allons aborder
maintenant, en recherchant l'influence des divers facteurs qui ont agi sur l'homme
pendant le cours des ges.
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
67
Deuxime partie
LES SOCITS
Leurs origines et leur dveloppement
livre II : Les facteurs de lvolution sociale
Chapitre II.
Influence des milieux.
1. Conditions d'adaptation des individus leurs milieux. -L'adaptation n'est possible qu' la
condition de la faire lentement. - Erreurs gnralement professes sur l'acclimatement. - Preuves
fournies par l'histoire de l'gypte et de certaines parties de l'Afrique, de l'incapacit de l'homme
s'adapter brusquement certains changements de milieux. - II. Influence des milieux. - Cette
influence devient profonde quand elle a t accumule, pendant plusieurs sicles, par l'hrdit. Transformations subies par les mmes races en changeant de milieu. - Les Anglais, en Amrique,
tendent retourner au type Peau-Rouge. - Influence des divers lments : climat, chaleur,
lumire, composition du sol, etc., qui constituent les milieux. - Influence du milieu intellectuel et
moral.
Retour la table des matires; retour au dbut du chapitre
L'existence d'une science de l'volution sociale et son utilit tant dmontres,
l'tat d'infriorit des premires agglomrations humaines mis en vidence, nous
pouvons aborder maintenant l'tude des facteurs qui ont dtermin la naissance et
le dveloppement des divers lments dont l'ensemble constitue une socit. Ces
facteurs sont beaucoup plus nombreux que ne le supposent gnralement les
historiens et les crivains qui se sont occups de leur influence. Suivant leurs
tudes antrieures, leur temprament, leur faon de penser, ils ont attribu
gnralement quelques-uns d'entre eux un rle exclusif, et c'est ainsi que nous
voyons les causes de l'volution des socits successivement cherches dans
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
68
l'action d'une providence, dans le climat, dans la race, dans les institutions
politiques, dans la religion, dans le dveloppement de l'intelligence.
Rien n'est plus difficile, du reste, que de reconnatre l'action souvent cache des
divers facteurs de l'volution sociale, et de russir dterminer exactement leurs
rles. Cette tude, toute nouvelle encore, forme les limites extrmes de la science
laquelle ce livre est consacr, et nous aurons plus d'une fois parcourir des rgions
o nul sentier n'avait encore t trac.
I. - Conditions de l'adaptation
des Individus leurs Milieux.
Retour la table des matires; retour au dbut du chapitre
Sous ce terme de milieu on comprend deux lments d'une nature diffrente : le
milieu physique et le milieu intellectuel et moral.
Le milieu physique comprend des lments nombreux, tels que le sol ,
l'atmosphre, la flore, la faune, le climat, tout ce qui en un mot peut modifier les
conditions d'existence de l'individu. Le milieu moral et intellectuel constitu par
les ides, sentiments, traditions, moeurs, genre de vie de ceux qui nous entourent
embrasse galement des lments trs varis.
En recherchant les causes des transformations des tres, nous avons vu que la
mtamorphose progressive des espces n'a t possible qu'en raison de leur aptitude
a subir les modifications ncessaires pour s'adapter leurs changements de milieu.
Ce n'est que quand ces changements sont trop brusques que cette adaptation est
impossible. Le poisson qu'on retire de l'eau, c'est--dire qu'on change instantanment de milieu meurt rapidement : et pourtant l'embryologie dmontre que par de
lentes transformations les poissons anctres des vertbrs, ont fini par acqurir une
respiration arienne.
L'adaptation des tres leur milieu ne pouvant se faire que d'une faon fort
lente, il est facile de comprendre que les tres adapts un climat ne peuvent sans
transition graduelle arriver en supporter un autre. Si au contraire ce changement
se fait lentement, ils modifient leur structure de faon s'accoutumer leurs
nouvelles conditions d'existence. Vouloir acclimater dans un pays froid les plantes
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
69
ou les animaux des pays chauds, comme on l'a souvent tent, est une chimre. S'ils
chappent la mort, ce n'est qu'en prouvant les modifications ncessaires pour
s'adapter leur nouveau milieu, modifications qui leur font perdre prcisment les
qualits pour lesquelles on avait voulu les acclimater.
Pas plus que les autres tres, l'homme lui-mme ne peut s'adapter
immdiatement 8. aux divers milieux, et vivre par consquent sous des climats
diffrents. J'ai dj indiqu, dans un passage d'un autre ouvrage que je vais
reproduire ici, les preuves historiques dmontrant qu'un acclimatement rapide est
aussi impossible pour lui que pour les autres animaux :
On rpte gnralement dans les ouvrages classiques que l'homme, suprieur en
cela aux animaux, peut vivre indiffremment sous tous les climats : mais c'est une
erreur profonde : l'histoire nous prouve, au contraire, qu'il ne peut facilement
supporter les changements de milieu considrables. Les migrations rapides n'ont
jamais form des colonies durables. Ce n'est que par des migrations marche
sculaire, comme celles des anciens, et surtout par des croisements avec la race
indigne que les diffrents peuples, notamment ceux qui migrent dans les pays
plus chauds que ceux d'o ils viennent, russissent se propager et encore
l'acclimatement n'est-il possible qu'entre peuples voisins, ou entre peuples loigns,
mais vivant sous des climats diffrents.
Le ciel du Midi a toujours t impitoyable pour les hommes du Nord. Les
Barbares qui la chute de l'empire romain, quittrent leurs contres glaces pour
aller s'tablir dans les parties les plus fertiles et les plus chaudes du monde ancien
furent vite dtruits. Moins d'un sicle aprs l'invasion on ne trouvait pas un seul
Goth en Italie. L'gypte asservie par vingt peuples divers, fut toujours leur
tombeau. Sa population actuelle, pure de tout mlange, est reste la vivante image
des types gravs sur ses spulcres il y a cinquante sicles. D'aprs le docteur
Schnepp, on ne pourrait pas citer une seule famille trangre qui se soit propage
dans ce pays pendant plusieurs gnrations. Ni l'Europen, ni le Turc, ni le ngre, ni
le juif lui-mme, malgr son tonnante facilit d'acclimatement, ne peuvent y
lever leurs enfants. Ce n'est qu'en se renouvelant constamment que la population
trangre s'y maintient.
8
L'homme supporte beaucoup plus aisment des transitions de temprature brusques, mais peu prolonges
que des changements peu tendus en apparence, mais dont l'action se fait longuement sentir. J'ai pu, au
Hammam de Paris, un jour o l'tuve air sec avait une temprature de 100 environ, y sjourner quelques
minutes, puis me placer dans une piscine dont l'eau marquait l0, sans prouver aucune incommodit de cette
diffrence instantane de 90. La sensation du froid tait mme beaucoup moins dsagrable que lorsque, par un
temps froid et pluvieux on prend une douche d'eau a 15 ou 20. sans que le corps ait t chauff par l'exercice
ou par un sjour dans une atmosphre fortement chauffe.
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
70
De mme en Afrique. Alors que les Romains russissaient romaniser la Gaule
et l'Espagne au point de les rendre compltement latines, ils furent impuissants,
malgr sept sicles d'occupation, coloniser les chaudes contres o domina
Carthage. Nous rencontrons en Algrie les mmes obstacles que ceux dont la
persvrance romaine ne put triompher jadis. Les enfants des Europens,
l'exception de ceux des nations voisines de l'Afrique, comme les Espagnols et les
Maltais, y meurent ds leurs premires annes, et, moins d'imiter les Anglais dans
l'Inde, qui envoient lever leurs fils en Europe, la race conqurante sera fatalement
dtruite par le sol envahi par elle.
Ce n'est, en ralit, que dans les contres plus froides que celle d'o elle migre,
qu'une nation peut s'acclimater facilement. Les peuples qui s'avancent vers le Nord,
et l'histoire du mouvement colonisateur des Romains en est la preuve frappante,
russissent s'y perptuer, alors que ceux qui marchent vers le Midi disparaissent
rapidement 9.
II. - Influence gnrale des Milieux.
Retour la table des matires; retour au dbut du chapitre
Les changements que dterminent les milieux, lorsque leur influence s'est
produite graduellement et a pu s'accumuler pendant plusieurs gnrations, sont des
plus profonds. Nous avons fait voir qu'ils avaient fini par transformer entirement
les espces. C'est surtout leur action que sont dues les diffrences si grandes
existant entre la faune et la flore de divers climats, et qui frappent l'observateur le
moins attentif.
Cette influence des milieux n'est pas moins profonde sur l'homme que sur les
autres tres vivants. Nous en avons la prouve en voyant combien des individus
d'une mme race ont fini par se transformer dans le cours des sicles lorsqu'ils ont
chang de milieu. Si rellement, comme cela est admis par plusieurs savants
aujourd'hui, des peuples aussi diffrents que les Grecs, les Latins, les Slaves, les
Germains, proviennent d'une mme race, les Aryens, quels changements profonds
9
Gustave Le Bon : Trait de physiologie.
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
71
les milieux ne leur ont-ils pas fait subir ! Quelques milliers d'Anglais ont russi
conqurir dans l'Inde, et maintenir sous le joug, deux cents millions d'habitants
appartenant la mme race que celle dont ils sont issus.
Si, refusant d'admettre, avec plusieurs anthropologistes, que les diverses races
de l'Europe descendent des primitifs habitants de l'Inde, on croit que ces derniers
n'ont fait qu'apporter dans leurs invasions en Occident leur influence civilisatrice, et
notamment leur connaissance des mtaux et leur langue, il ne manque pas d'autres
exemples pour dmontrer l'influence du milieu. Elle apparat vidente quand nous
comparons les habitants des contres froides, brumeuses et sombres du nord de
l'Europe avec ceux des rives fertiles de la Mditerrane. Cette mme influence se
montre plus vidente encore quand on voit combien furent profondes les
modifications que subirent certains peuples en changeant de pays. Lorsque les
Arabes, qui vivaient presque l'tat sauvage, sortirent de leurs rudes contres pour
conqurir le monde, ils devinrent, sous le ciel lumineux de l'Espagne, une des
nations les plus polices qu'ait connues l'histoire, une de celles o les lettres, les
sciences et les arts furent cultivs avec le plus vif clat.
Les transformations que subissent actuellement les Anglais en Amrique, et qui
tendent les rapprocher des Peaux-Rouges, constituent un des plus intressants
exemples de l'influence des milieux. Voici comment un anthropologiste distingu,
M. le professeur de Quatrefages, rsume l'opinion des divers observateurs qui ont
t le mieux mme de constater cette transformation :
L'Anglo-Saxon Amricain prsente ds la seconde gnration des traits du
type indien qui le rapprochent des Leni-Lennapes, des Iroquois, des Cherokees. Le
systme glandulaire se restreint au minimum de son dveloppement normal ; la
peau devient sche comme du cuir ; elle perd la chaleur du teint et la rougeur des
joues, qui sont remplaces chez l'homme par un coloris de limon et chez la femme
par une pleur fade. La tte se rapetisse et s'arrondit ou devient pointue. Elle se
couvre d'une chevelure lisse et fonce en couleur ; le cou s'allonge. On observe un
grand dveloppement des os zygomatiques et des masseters. Les fosses temporales
sont profondes, les mchoires massives. Les yeux sont enfoncs dans des cavits
trs profondes et assez rapprochs l'un de l'autre. L'iris est fonc, le regard perant
et sauvage. Le corps des os longs s'allonge, principalement l'extrmit
suprieure.- La France et l'Angleterre fabriquent, en consquence, pour
l'exportation dans l'Amrique du Nord, des gants part dont les doigts sont
particulirement allongs. - Les cavits des os sont trs rtrcies. Les ongles
prennent facilement une forme allonge et pointue. Le larynx est grand, la voix
rauque et criarde. Le bassin de la femme se rapproche dans les extrmes de celui du
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
72
singe. - Un autre correspondant se contente de dire qu'il rappelle celui de l'homme.
Le mme ajoute un dtail remarquable : le langage tend se rapprocher du
polysynthtisme des langues des Peaux-Rouges par les standard phrases (formules).
Il signale enfin comme trait de murs l'exclusion de la lumire dans les
appartements, l'amour des couleurs criantes dans les vtements. Or vous savez que
le got auquel il est fait allusion en dernier lieu est propre toutes les populations
sauvages 10.
Sans doute, on peut citer des faits qui prouvent que certaines contres, comme
l'Assyrie, la Phnicie, l'Espagne, etc., ont t habites par des races diverses qui,
malgr des sicles de sjour, n'y ont subi aucune transformation ; mais cela
dmontre seulement que tous les milieux n'ont pas une action gale, ou que
certaines races sont plus rsistantes que d'autres. Il est probable que lorsqu'une race
est fort ancienne, et que l'hrdit y a accumul et fix depuis longtemps certains
caractres, elle est beaucoup plus rfractaire l'action du milieu que des races en
voie de formation ne possdant pas encore d'aptitudes bien tranches.
Parmi les facteurs qui entrent dans la constitution du milieu, le climat a toujours
t cit comme un des plus importants et son importance a toujours t plutt
exagre qu'attnue. Il y a plus de trois mille ans qu'Hippocrate, dans son livre des
Airs, des Eaux et des Lieux, dcrivait son rle dans des pages que Montesquieu n'a
fait que rsumer dans le quatorzime livre de son Esprit des Lois, et auxquelles on
n'a gure ajout depuis. Suivant Hippocrate, c'est dans le climat et la marche des
saisons qu'il faut chercher la cause de ce fait, que les Asiatiques sont mous, sans
activit, pusillanimes et de murs plus douces que les Europens. Le mme auteur
s'tend longuement sur les diffrences que produit dans les murs le sjour dans
des pays plats ou montagneux. Adoptant les opinions d'Hippocrate, l'illustre auteur
de l'Esprit des Lois attribue au climat l'tat plus ou moins dvelopp de la morale.
Vous trouverez, dit-il, dans les climats du nord des peuples qui ont peu de vices,
assez de vertus, beaucoup de sincrit et de franchise. Approchez des pays du midi,
vous croirez vous loigner de la morale mme ; des passions plus vives
multiplieront les crimes. Chacun cherche prendre sur les autres tous les avantages
qui peuvent favoriser ces mmes passions. Dans les pays temprs, vous verrez des
peuples inconstants dans leurs manires, dans leurs vices mme et dans leurs
vertus. Le climat n'y a pas une qualit assez dtermine pour les fixer euxmmes 11.
10
De Quatrefages : Cours d'anthropologie du Museum. - Formation des races humaines. Revue scientifique,
1868, p. 728.
11
Montesquieu : Esprit des Lois, liv. XIV, ch. II. [Texte disponible dans Les Classiques des sciences sociales.
JMT.]
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
73
Par climat, nous devons entendre non seulement la temprature d'un pays, mais
encore l'ensemble des variations atmosphriques, lumire, humidit, scheresse,
vents, etc., qui peuvent affecter nos organes. Ainsi envisag, son influence sur tous
les tres est vidente. Examinons rapidement en quelques lignes ce que nous savons
de l'action de chacun des lments qui contribuent le former.
La temprature habituelle d'une contre a une action certaine sur les tres qui
l'habitent. La flore et la faune des pays froids diffrent entirement comme aspect
de celles des pays chauds. Chacun sait qu'elles sont bien plus puissantes dans les
seconds que dans les premiers. Quand la temprature dpasse un certain degr, elle
a une influence fcheuse sur l'homme ; elle diminue ses forces et puise rapidement
son nergie et son initiative. Sans vouloir assurment attribuer une seule cause ce
qui est l'effet de plusieurs, on peut faire remarquer que c'est surtout dans les pays
chauds que se trouvent les peuples qui supportent le plus facilement la main d'un
matre.
La lumire a galement une action puissante sur tous les tres, les vgtaux
surtout. La plante qu'on met dans l'obscurit blanchit et dprit rapidement.
Ramene au soleil, elle reprend sa vigueur. Le ngre transport en Europe plit et
n'a plus cette teinte d'bne qu'il possde en Afrique. D'un autre ct, le blanc qui
va dans les pays chauds voit sa peau se foncer. M. Pruner-Bey rapporte que le
voyageur Antoine d'Abbadie revint d'Abyssinie color en bronze fonc. D'aprs le
docteur Rolle, cit par Darwin, la plupart des familles allemandes tablies en
Gorgie ont acquis dans le cours de deux gnrations des cheveux et des yeux
noirs.
Il nous semble dmontr que c'est la lumire, beaucoup plus que la temprature,
qui produit cette coloration. Dans des excursions sur des glaciers o la temprature
est trs basse, mais o l'action du soleil, rflchie par la neige, est trs intense, j'ai
vu mes mains, habituellement blanches, devenir rapidement d'un brun rougetre.
C'est peut-tre pour cette raison, mais faute de preuves suffisantes je n'insisterai pas
sur cette hypothse, que les habitants des contres les plus froides du globe, les
Esquimaux et les Lapons, ont les cheveux trs noirs et la peau trs basane. Audessous d'eux se trouvent les habitants de la Scandinavie, qui sont, parmi tous les
peuples, ceux dont les cheveux, la peau et les yeux sont les plus clairs. Mais en
Scandinavie les neiges et la glace ne sont pas, comme en Laponie, ternelles.
Je considre comme probable du reste que d'autres causes mal connues ont pu
dterminer ces diffrences de coloration. Il est facile de reconnatre, en effet, que
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
74
les divers lments qui peuvent agir dans le climat nous chappent, en observant
que des contres ayant des climats en apparence identiques, telles que Borno et la
Nouvelle-Guine, par exemple, ou encore les Moluques et les Philippines,
possdent des faunes trs diffrentes.
Aprs la chaleur et la lumire, on peut faire figurer, parmi les lments les plus
actifs d'un climat, l'tat de l'atmosphre, notamment son degr d'humidit plus ou
moins grand. Personne n'ignore que l'air sec, et chaud rend le corps plus actif et
plus nergique que l'air froid et humide. On a remarqu avec raison que les
civilisations primitives, comme celles de l'gypte, de la Babylonie, de l'Assyrie, de
la Phnicie, sont nes dans des rgions sches et chaudes.
La richesse plus ou moins grande de l'atmosphre en oxygne, et surtout en
oxygne sous cet tat particulier auquel on a donn le nom d'ozone, doit avoir une
influence considrable sur les tres qui vivent dans une contre. J'ai eu trop
frquemment occasion d'observer l'action de l'air des montagnes en Suisse et dans
les Carpathes, pour ne pas tre profondment convaincu de son influence.
Malheureusement il n'est pas encore possible de dire, dans l'tat actuel de la
science, quel lment il faut attribuer cette influence.
Parmi les lments varis qui constituent le milieu, il en est, tels que la
configuration du sol, par exemple, qui ont sur l'homme une influence presque aussi
marque que le climat lui-mme.
Suivant qu'un peuple vit dans des plaines fertiles, comme les habitants de
l'Italie, dans des dserts, comme l'Arabe vagabond, dans des montagnes, comme les
populations indpendantes de l'Helvtie, de l'cosse et du Caucase, sur les bords de
la mer, comme les industrieux et commerants Hollandais, les habitudes, les ides,
les murs, et par suite le rgime politique et social diffrent. Ainsi que le fait
justement remarquer Grote, les anciens philosophes et lgislateurs avaient bien
compris cette influence et observ le contraste existant entre les populations des
villes de l'intrieur et celles des cits maritimes. Dans les premires, la vie est
simple et uniforme, les habitants tiennent leurs anciennes coutumes et sont
hostiles tout changement. Dans les villes maritimes, au contraire, la vie est
beaucoup plus varie, l'imagination plus vive, l'activit plus grande. Loin de
repousser les nouveauts apportes par les trangers, on les adopte avec
empressement.
Ce n'est pas seulement par sa configuration, mais encore par sa composition,
que le sol a une influence considrable sur les tres vivant sa surface. C'est de sa
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
75
composition que dpendent surtout les matires alimentaires qu'il fournit. Quand
elle le rend impropre toute production, comme dans les dserts de l'Afrique, la vie
est naturellement impossible. Plus il est fcond et mieux il est cultiv, plus les
socits vivant sa surface peuvent tre nombreuses. Nous verrons, en tudiant
l'influence du progrs de l'agriculture, qu'aucun peuple n'a pu arriver la
civilisation avant que l'art d'ensemencer le sol et celui de rendre les animaux
domestiques aient t connus.
La composition du sol a une influence d'un autre ordre que celle qui vient d'tre
indique, mais galement trs considrable. Je veux parler de l'influence que les
matires diverses qu'il contient, telles que les mtaux , la houille, etc., peuvent
avoir sur l'tat de civilisation des habitants vivant sa surface. C'est surtout depuis
l'exploitation de ses mines de houille que l'Angleterre a acquis son prodigieux
dveloppement commercial.
Parmi les influences qu'exerce le sol sur les habitants, nous ne devons pas
omettre de mentionner encore celle qui tient l'aspect gnral de la contre
rsultant la fois de la nature du sol et du climat. Pour ne s'tre produite sans doute
qu' une poque dj avance de l'histoire de l'homme, cette action n'en est pas
moins relle. L'influence, inconsciente le plus souvent, profonde toujours,
qu'exerce l'aspect des choses sur nos ides ne doit pas tre mconnue. Les images
qui remplissaient le cerveau d'un barbare des froides contres du nord, coutant
dans sa cabane la pluie ruisselant toujours, ne pouvaient tre celles d'un homme du
midi ne voyant autour de lui qu'un ciel toujours bleu, une mer toujours tranquille un
sol toujours verdoyant. J'ai eu bien des fois occasion de constater dans mes voyages
combien les ides qui naissent spontanment en nous varient avec l'aspect extrieur
des choses. A Londres, sur les bords brumeux mais si vivants de la Tamise,
Venise, sur les lagunes aux horizons fantastiques, Florence, devant les chefsduvre de la nature et de l'art, en Suisse, sur les cimes arides des glaciers ternels,
en Allemagne, sur les rives de ce vieux Rhin peuples d'antiques chteaux et de
vieilles lgendes, Moscou, sur les bords du fleuve que le Kremlin domine et enfin
dans toutes les capitales o les hasards m'ont conduit, le monde d'ides voques
par ces milieux changeants prsentait la mme diversit, que ces milieux mmes.
L'action du moral sur le physique est trop profonde pour que l'influence sur
l'homme des ides produites par les milieux puisse tre nglige. L'habitude, sans
doute, l'mousse, mais elle ne saurait l'annuler entirement. Qui voudrait soutenir,
en supposant mme toutes les autres conditions gales, que si les Grecs eussent
vcu au milieu des steppes monotones de la Russie, ils eussent t, dans la
philosophie, dans les lettres et dans les arts, tout ce qu'ils furent ?
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
76
On a laiss de ct dans ce qui prcde l'tude de l'influence du milieu
intellectuel et moral. J'ai mentionn dj ailleurs cette influence et montr combien
elle est profonde bien qu'inconsciente et quel point l'individu reflte quoi qu'il
fasse l'image des milieux o il a vcu. Il leur emprunte tout murs, croyances,
penses, opinions, et jusqu' ses vices et ses vertus. Devant bientt revenir encore
sur cette influence, je me bornerai pour le moment faire pressentir l'importance de
son rle sur l'volution sociale, en rappelant d'une part ce que j'tablirai ailleurs que
la variabilit de ce milieu est une condition essentielle pour le dveloppement
d'une socit et en montrant d'autre part combien le milieu o grandit l'homme
moderne est diffrent de celui ou vivaient ses premiers pres.
Le milieu intellectuel de 1'homme primitif et du sauvage moderne est constitue
par le petit nombre d'expriences de traditions et de croyances de la tribu o il vit.
Le milieu d'un homme moderne est constitu par les traditions et l'exprience de
tous les peuples prsents et passs, depuis l'ge o l'criture a t connue. Des
progrs raliss sur un point quelconque du globe, il profite aussitt. Cette
complication graduelle du milieu intellectuel, et l'adaptation force des individus
ce milieu sont assurment une des causes les plus actives du progrs social.
Nous voyons, par tout ce qui prcde, quel point l'homme et partant les
socits formes par les agglomrations humaines, dpendent des milieux o ils
vivent. Ces milieux ont cr leurs ides et leurs besoins, et furent les causes
premires des civilisations diverses qui se sont dveloppes la surface de notre
plante. Leur influence a vari suivant les poques o elle s'est manifeste. Elle
s'est montre d'autant plus puissante que l'homme pouvait moins s'y soustraire, et il
put d'autant moins s'y soustraire qu'il fut moins lev sur l'chelle de la civilisation.
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
77
Deuxime partie
LES SOCITS
Leurs origines et leur dveloppement
livre II : Les facteurs de lvolution sociale
Chapitre III.
Influence de l'intelligence
et des sentiments.
1. Influence de l'intelligence. - Importance exagre gnralement attribue l'intelligence
dans l'volution des socits. - Ce sont les sentiments et non l'intelligence qui conduisent le
monde. - Preuves fournies par le caractre des personnages ayant jou les plus grands rles dans
l'histoire. - L'ingalit du dveloppement des sentiments explique pourquoi les mmes institutions
ne conviennent pas des peuples d'intelligence gale. - II. Influence des sentiments. - Rle des
divers sentiments ; leur transformation. - La civilisation ne progresse qu'avec ces transformations.
- Erreurs de quelques philosophes sur l'invariabilit des sentiments moraux. -Comment la
ncessit transforme les sentiments.
I. - Influence de l'Intelligence.
Retour la table des matires; retour au dbut du chapitre
Lorsqu'on envisage l'importance des rsultats fournis par les dcouvertes
scientifiques, et leur influence sur la civilisation, on comprend facilement
qu'blouis par eux, les rares auteurs qui se sont occups des causes de l'volution
sociale, Auguste Comte et Buckle notamment, aient vu dans le dveloppement de
l'intelligence la cause principale et mme la cause unique des progrs de
l'humanit.
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
78
Les progrs que l'Europe a faits depuis l'tat de barbarie jusqu' la
civilisation, dit Buckle 12, sont entirement dus son activit intellectuelle. On
ne saurait hsiter, crit A. Comte 13, placer en premire ligne l'volution
intellectuelle comme le principe ncessairement prpondrant de l'ensemble de
l'volution de l'humanit.
Les citations qui prcdent montrent quel point des penseurs aussi minents
que ceux que je viens de citer ont pu s'illusionner sur l'importance des divers
facteurs dont l'ensemble dtermine l'volution des socits. Le rle des facteurs
l'tude desquels ont t consacrs les chapitres qui prcdent et ceux qui vont
suivre n'a mme pas t souponn par eux. Suivant en cela la tradition commune,
ils ont attribu une seule cause ce qui est l'effet d'un grand nombre.
En ce qui concerne l'intelligence, je ne nierai assurment pas son influence, mais
je me refuse entirement admettre, avec Buckle et Comte, que cette influence soit
prpondrante. D'une part, en effet, le dveloppement de l'intelligence est un effet
et non une cause, et, lorsque cet effet devient cause son tour, il est loin d'avoir sur
le dveloppement des socits une importance de premier ordre. S'il en tait ainsi,
nous verrions des peuples de mme intelligence, galement civiliss, ce qui n'est
pas.
Il ne faut pas oublier, en effet, et j'ai suffisamment insist dj sur ce point dans
le chapitre consacr l'tude des sentiments, que ce n'est pas l'intelligence qui sert
de guide l'homme, mais ces associations hrditaires, dont l'ensemble constitue le
caractre instincts, besoins, passions, etc., auxquelles on donne le nom gnral de
sentiments. Les dcouvertes scientifiques et industrielles, fruits de l'intelligence,
peuvent, par suite des changements qu'elles apportent dans les conditions
d'existence de l'homme, le modifier la longue : mais ce n'est que quand ces
modifications ont t accumules par l'hrdit pendant des sicles que les
sentiments arrivent se transformer et que l'on peut dire que l'intelligence a t la
cause indirecte de ces transformations.
Il suffit de jeter un coup dil sur 1'histoire pour tre pntr de la vrit de ce
qui prcde. C'est bien plus par l'nergie des sentiments que par la profondeur de
l'intelligence qu'ont brill la plupart des hommes qui ont jou nu rle actif sur la
scne du monde. Ce n'est pas avec la raison qu'ils ont fond des religions et conquis
des empires. Les individualits vigoureuses qui ont cre la puissance de Rome et
dompt l'univers, se sont beaucoup plus distingues par leur vaillance, leur
12
13
Civilisation anglaise, tr. fr., t. 1, p. 251.
Philosophie positive, t. 4, p. 459. [Texte disponible dans Les Classiques des sciences sociales. JMT.]
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
79
persvrance, l'nergie et l'troitesse de leur patriotisme, que par leurs aptitudes
intellectuelles. Quand l'empire se dissocia, les Romains taient plus instruits, plus
civiliss et plus intelligents qu'ils ne le furent aucune poque ; mais ils ne
possdaient plus les qualits de caractre qui avaient assur leur grandeur.
Ce n'est que parce que les sentiments sont les rgulateurs de la conduite et que
ces sentiments sont ingalement dvelopps dans les diverses races humaines, que
l'on peut comprendre pourquoi, - mme en supposant aux divers peuples une
intelligence gale et des conditions d'existence gales, - leur tat social ne saurait
tre le mme et pourquoi des institutions semblables ne sauraient leur convenir.
C'est seulement quand on a bien compris cette vrit, qu'on conoit pourquoi
des institutions qui ont rendu les plus grands services certains peuples, ont t
absolument funestes d'autres. Les rpubliques espagnoles de l'Amrique ont
emprunt aux tats-Unis leur constitution et leurs lois, mais elles n'ont pu leur
emprunter les sentiments d'nergie, d'initiative individuelle, du respect de la loi et
du devoir, que la plupart des sujets de la grande rpublique possdent, et, alors que
ces derniers sont arrivs au sommet de la prosprit, les rpubliques espagnoles
vgtent dans la plus misrable anarchie. Lorsqu'un peuple n'a pas les sentiments
que je viens de mentionner, il n'y a d'autres institutions possibles pour le sauver de
la dcadence que des lois de fer et la dure main d'un matre. L'ducation,
l'instruction moins encore, n'y pourraient rien.
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
80
II. - Influence des Sentiments.
Retour la table des matires; retour au dbut du chapitre
Nous avons montr que les dispositions hrditaires diverses : besoins, passions,
caractres, etc., que nous avons d ranger sous le nom de sentiments, sont les
principaux mobiles de l'activit humaine, et que certains d'entre eux, comme la
faim et le besoin de se reproduire, jouent un rle prpondrant dans l'existence de
tout ce qui vit la surface du globe.
Chez tous les tres, depuis la monade jusqu' l'homme civilis, le souci le plus
grand, l'occupation la plus absorbante, celle laquelle est consacre la presque
totalit du temps que n'exige pas le repos, est de trouver le moyen de se nourrir et
de se reproduire ; la faim et l'amour ont t jusqu'ici les grands rgulateurs du
monde. C'est du second de ces besoins que la famille et toutes les socits
humaines drivent. Sans l'aiguillon du premier, l'homme n'et jamais connu
l'agriculture, l'art de travailler la pierre et les mtaux, et les diverses industries sans
lesquelles aucune civilisation n'aurait jamais pris naissance. C'est une vrit si
triviale qu'on ose peine l'noncer, dit trs justement Liebig, que si l'homme
pouvait vivre d'air et d'eau, les ides de matre et de serviteur, de prince et de
peuple, d'ami et d'ennemi, d'amiti et de haine, de vertu et de vice, de bien et de
mal, etc., n'existeraient mme pas. L'organisation des tats, la vie sociale et de
famille, les rapports mutuels des hommes, les nations, l'industrie, l'art et la science,
bref, tout ce qui fait l'homme ce qu'il est, sont dus uniquement cette circonstance
qu'il possde un estomac, et qu'il est soumis une loi naturelle qui l'oblige
consommer journellement une certaine quantit de nourriture qu'il doit soutirer la
terre par son activit et son habilet, attendu que la nature ne la lui offre qu'en
quantit tout fait insuffisante 14.
Des deux sentiments que nous venons d'numrer, et d'un petit nombre d'autres,
comme l'ambition, l'intrt, etc., rsultent en dfinitive tous les vnements dont
s'occupe l'histoire.
Ces sentiments si puissants aujourd'hui encore, puisqu'aucun tre vivant ne
saurait se soustraire leur empire, le furent bien davantage aux premiers ges des
14
Les lois naturelles de l'agriculture
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
81
socits humaines, alors que l'homme obissait toujours aux impulsions du moment
et n'avait que ses aveugles instincts pour guide. Il a fallu de longues priodes de
sicles pour que, sous l'influence des ncessits cres par la complexit toujours
croissante du milieu, il ait acquis des sentiments assez puissants pour faire quilibre
ces impulsions du moment auxquelles il obissait tout d'abord.
Les sentiments sont assurment ce qui se transforme le plus difficilement, et j'ai
prouv par de nombreux exemples que, chez l'homme civilis lui-mme, ils sont
souvent peine plus dvelopps que chez l'animal ; mais nous possdons des faits
qui montrent que, sous l'influence de variations lgres accumules pendant des
sicles, plusieurs d'entre eux ont fini par se transformer entirement. Il suffit mme
de remonter d'un millier d'annes en arrire pour trouver des anctres dont les
sentiments diffrent en bien des points de ceux des hommes d'aujourd'hui. Les
rudes compagnons de Guillaume le Normand, les fiers barons du Moyen Age,
seraient impuissants, si on les faisait revivre, comprendre nos sentiments
modernes. Chez l'homme primitif ou simplement chez un sauvage, cette
impuissance serait bien plus grande encore.
Nous avons vu que les vestiges de nos premiers pres dmontrent qu'ils furent
semblables ces sauvages qui massacrent leurs parents gs, tuent leurs femmes
pour les manger quand elles commencent vieillir et exterminent sans piti tout
individu moins fort qu'eux, tranger leur tribu. Entre les sentiments qui poussaient
nos aeux de tels actes, et ceux de l'homme moderne qui les lui font considrer
avec horreur, il y a aujourd'hui un abme ; mais ce n'est que graduellement que cet
abme a pu se creuser, et nous aurons plus d'une fois montrer dans cet ouvrage
que l'histoire conserve la trace des transformations qu'ont d subir les sentiments de
l'homme primitif pour devenir ce qu'ils sont aujourd'hui.
Ces transformations de sentiments s'effectuent toujours avec une grande lenteur.
Cette lenteur est mme telle qu'on peut considrer ces transformations comme
nulles quand on envisage seulement la courte dure de l'existence des individus,
mais elles apparaissent nettement quand on compare entre elles des priodes
suffisamment lointaines. Je ne saurais donc, malgr l'autorit trs grande de
penseurs tels que Condorcet, Kant, Buckle, etc., croire qu'il y a des sentiments,
comme les sentiments moraux, par exemple, qui n'aient subi aucun changement et
soient rests les mmes chez tous les peuples depuis l'antiquit la plus haute. Sans
conteste, dit Buckle, l'on ne trouvera rien au monde qui ait subi aussi peu de
changements que ces grands dogmes qui composent le systme moral, faire du bien
autrui, sacrifier son prochain ses propres volonts, l'aimer comme soi-mme,
pardonner ses ennemis, contenir ses passions, honorer ses parents, etc.
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
82
Renversant la proposition qui prcde, je dirai que, sans conteste, au contraire,
on ne trouvera rien au monde qui ait subi autant de changements que les grands
dogmes auxquels fait allusion l'illustre auteur que je viens de citer. Dans le chapitre
consacr l'volution de la morale, je montrerai combien les sentiments moraux
ont chang suivant les ges, et quelles ncessits imprieuses ont prsid leurs
transformations. Si, l'aurore de son histoire, l'homme avait fait du bien a autrui,
et sacrifi son prochain ses propres volonts, s'il avait mnag les vaincus,
pargn les bouches inutiles et connu la piti, il ne ft jamais sorti de la barbarie
primitive. Nos premiers pres eurent une morale fille de la ncessit, comme la
ntre, mais ses prescriptions taient absolument diffrentes de celles de la morale
moderne. L'amour du prochain, le respect des vieillards y taient parfaitement
inconnus. Elle leur disait de traiter en ennemi, c'est--dire de tuer et de piller, tout
individu tranger leur tribu, de massacrer leurs parents gs quand ils ne
pouvaient plus se suffire, et de ne jamais pargner un vaincu.
Les sentiments moraux n'ont donc pas chapp a la loi commune qui oblige
chaque chose se transformer ; et, de toutes les transformations que l'homme a d
subir pour arriver a l'tat civilis, la transformation de ses sentiments a t la plus
profonde et la plus difficile acqurir. On le voit bien quand un peuple civilis
essaie d'imposer sa civilisation une race infrieure. On peut transformer les
conditions d'existence de cette dernire, mais changer ses sentiments et par suite
l'tat social qui en est la consquence est une oeuvre que les sicles seuls peuvent
accomplir.
Les changements qu'ont prouvs les sentiments de l'homme et qui ont eu une si
profonde influence sur l'tat des socits humaines, sont ncessairement destins
se continuer encore, et, en jetant les yeux sur l'avenir, nous pouvons prvoir qu'il
arrivera un jour o notre morale actuelle, qui ne se soutient que par la perspective
de rcompenses ou de peines excessives, paratra aussi barbare que peuvent le
sembler l'homme civilis moderne les sentiments des sauvages que nous citions
l'instant. Sans doute alors on considrera du mme oeil celui qui fait le bien par
espoir d'une rcompense et celui qui vite le mal par crainte d'un chtiment. A cet
ge, encore bien lointain, l'hrdit aura fini peut-tre par crer chez l'homme des
sentiments tels, que l'ide du mal voquera autant de rpulsion en lui qu'en
voquerait dans l'esprit d'un Europen moderne l'ide de tuer une vieille femme
pour la manger, comme le fait aujourd'hui l'Australien, ou comme le faisaient
l'ge de la pierre taille nos pres. Pour le sauvage, la double perspective d'un tel
repas et du dbarras d'une bouche inutile, constitue une tentation laquelle il ne
sait pas rsister. Dans le cerveau de l'Europen, si dgrad qu'on le suppose, de
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
83
telles tentations ne surgissent mme pas, et cela nous montre combien ses
sentiments primitifs se sont transforms.
Parmi les faits qui montrent d'une part la transformation graduelle de certains
sentiments, et de l'autre l'influence norme de ces transformations sur l'volution
des socits, il en est plusieurs dont l'histoire serait des plus intressantes tracer,
tels, par exemple, que la gense du sentiment de la libert individuelle, qui
n'apparat que dans des temps presque modernes et fut tout fait inconnue dans
l'antiquit grecque et latine, o l'individu vivait uniquement pour l'tat, alors que
c'est le contraire qui a lieu aujourd'hui ; mais, oblig de me limiter aux points les
plus essentiels de mon sujet, je me bornerai montrer la naissance et le
dveloppement du sentiment qui a le plus d'influence sur les conditions d'existence
des socits humaines : je veux parler de ce sentiment fort peu naturel qui conduit
l'homme respecter ses semblables, quel que soit le pays auquel ils appartiennent.
Des faits sur lesquels nous aurons revenir ailleurs dmontrent que les tribus
sauvages, et naturellement aussi l'homme primitif qui leur ressemblait, vivent dans
un tel sentiment d'hostilit contre tout tranger leur tribu, qu'on y considre
comme un ennemi qu'il est mritoire de piller et tuer tout individu n'en faisant pas
partie.
On conoit facilement comment ce sentiment d'hostilit gnrale a pu natre et
se maintenir pendant la primitive priode d'existence de l'homme et sans doute
pendant la plus grande dure de l'ge de la pierre taille, en se rappelant qu'ignorant
l'agriculture, vivant exclusivement du produit de leur chasse, nos premiers pres
devaient forcment considrer comme des rivaux dangereux les individus des tribus
voisines qui venaient sur leurs territoires de chasse leur disputer une proie
forcment toujours trop rare, car, pour nourrir l'individu vivant exclusivement du
produit de sa chasse, il faut une surface de terre considrable.
Lorsqu'au contraire l'agriculture fut connue, que le travail commena se
spcialiser, que l'industrie et le commerce prirent naissance, et que les individus
d'une tribu devinrent forcment dpendants des individus d'autres tribus plus riches
en certains articles de consommation n'existant pas partout, on sentit vite le besoin
d'agir sur ses semblables plus par la persuasion que par la force et de respecter leur
vie et leur proprit afin d'obtenir le mme respect pour soi. L'hostilit primitive
diminua donc forcment, et les sentiments altruistes purent prendre naissance.
Alors seulement des socits, qui n'avaient d'abord eu pour units que la famille,
puis la tribu, se formrent par l'agglomration de tribus plus ou moins nombreuses
qui constiturent des tats. Les sentiments d'gosme localiss primitivement la
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
84
famille, puis la tribu, s'tendirent l'tat et devinrent le sentiment nomm
patriotisme. Avec les progrs des relations, la rapidit des moyens de
communication, avec la dpendance de plus en plus croissante des peuples les uns
l'gard des autres, par suite de la diversit des produits que chacun possde, ce
sentiment tend, dans les temps modernes, se gnraliser encore et devenir ce
que l'on a nomm le cosmopolitisme, et nous pouvons prvoir le jour o la patrie de
l'homme, qui tait d'abord sa famille, puis sa tribu, puis l'tat, sera l'univers.
Il n'est pas ncessaire d'approfondir longuement l'histoire pour comprendre
combien les sentiments altruistes ont cot acqurir l'homme, malgr les leons
de la ncessit et l'appui des religions. Ce n'est pas sans peine, en effet, qu'un
sentiment nouveau se substitue des sentiments anciens. Sous l'influence puissante
de l'hrdit, les premiers tendent pendant longtemps reparatre, et des exemples
qui se reproduisent frquemment chez les peuples les plus civiliss dmontrent qu'il
ne faut pas gratter trop longtemps notre vernis de civilisation pour voir renatre
sous leur forme la plus sombre les instincts de frocit primitive.
La rapide esquisse qui prcde est suffisante pour montrer l'influence immense
que les sentiments de l'homme et leurs transformations ont eue sur l'volution des
socits humaines. Le philosophe qui veut pressentir les destines d'un peuple doit
examiner surtout l'tat de ses sentiments. Ce ne sont pas les institutions politiques,
comme le croient les hommes d'tat, ni les ides, comme le soutiennent certains
penseurs, qui gouvernent le monde. C'est aux sentiments qu'appartient ce rle.
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
85
Deuxime partie
LES SOCITS
Leurs origines et leur dveloppement
livre II : Les facteurs de lvolution sociale
Chapitre IV.
Influence de l'acquisition du langage, des
relations commerciales
et des progrs de l'industrie
de la littrature et des arts.
Retour la table des matires; retour au dbut du chapitre
1. Influence de l'acquisition du langage. - Existence d'un langage chez tous les tres vivants. L'homme ne commena progresser que quand le langage fut suffisamment dvelopp. - La
langue d'un peuple est l'image de sa civilisation. - II. Influence des relations commerciales. - Elles
ont t un lment actif de progrs social. - III. Influence des progrs de l'industrie. - Progrs
raliss par la division croissante du travail. - Les progrs industriels ont eu pour rsultat de
soustraire de plus en plus l'homme l'influence des agents extrieurs. - Importance des progrs de
l'industrie moderne. - Ils ont eu plus d'action sur le dveloppement social de l'homme que les plus
grandes rvolutions. - Nombre considrable d'ouvriers reprsents par la consommation de la
houille dans les machines vapeur. - Les progrs de l'industrie ont-ils augment le bonheur de
l'homme ? - IV. Influence des arts et de la littrature. - Les arts et la littrature d'un peuple
reprsentent des effets et non des causes ; ils constituent l'image exacte de la civilisation qui les a
produits. - Limites de leur influence.
I. - Influence de l'Acquisition du Langage.
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
86
Retour la table des matires; retour au dbut du chapitre
Tous les tres vivant en socit possdent un langage qui leur permet de se
communiquer leurs besoins et de se concerter dans un but commun. Moins l'animal
est lev dans la srie zoologique, plus ce langage est simple ; mais, chez tous les
animaux qui se groupent en socit, il existe toujours.
J'aurai traiter dans un prochain chapitre l'histoire du dveloppement du
langage. N'ayant pas m'en occuper ici, je me bornerai indiquer rapidement
l'importance considrable que son acquisition a exerce sur le dveloppement
intellectuel et social de l'homme.
L'acquisition d'un langage prcis peut tre considre comme une des plus
importantes conqutes, celle qui devait exercer la plus grande influence sur le
dveloppement intellectuel et social de l'humanit. Du jour o l'homme possda un
langage conventionnel, si restreint que ft le vocabulaire qui le constituait, il avait
entre les mains un outil merveilleux qui devait tre l'origine de tous ses futurs
progrs. Ces progrs devinrent bien plus rapides encore quand, au moyen de
dessins imitatifs, puis de ces dessins abrgs d'o drivent les hiroglyphes et
l'criture, il put conserver le souvenir du pass, et partant lguer ses descendants
les acquisitions qu'il possdait. C'est de ce jour seulement que les civilisations
purent natre. L'histoire ne nous a pas conserv la trace d'un seul peuple civilis o
l'criture n'ait pas t connue. Ce n'est que grce elle que chaque tre pouvait tre
mme de profiter du trsor d'expriences ralis par sa longue srie d'anctres.
C'est dater du jour o l'criture fut connue que l'on peut dire que toute la suite des
hommes qui se succdent doit tre considre comme le mme homme qui
vieillirait en apprenant toujours. Le trsor d'expriences et de dcouvertes que le
langage crit nous a lgu est si grand qu'il n'est pas aujourd'hui un seul homme
la surface du globe dont le cerveau serait assez puissant pour le contenir.
L'importance de la connaissance du langage est telle que la langue d'un peuple
est le miroir exact de sa civilisation. Nous avons dj vu que, s'il ne restait d'une
nation que le dictionnaire de sa langue, il serait facile de reconstituer avec
exactitude le tableau fidle de ce que cette nation a pu tre.
Insister davantage sur l'importance de l'acquisition du langage crit et parl
serait, je pense, inutile. On peut rsumer son influence en disant que sans cette
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
87
acquisition aucun progrs social n'tait possible, et que ce n'est que grce elle que
l'homme peut profiter des connaissances des innombrables gnrations qui l'ont
prcd.
II. - Influence des Relations commerciales.
Retour la table des matires; retour au dbut du chapitre
Lorsque l'homme possda les rudiments d'un langage, les premires relations
commerciales purent s'tablir. Les vestiges de l'ge de la pierre taille nous ont
montr cet ge recul l'existence de leurs premires traces. Leur rsultat a d tre
d'adoucir les moeurs et de crer des rudiments de morale, en obligeant l'homme
respecter ses engagements et la vie de son prochain, respect sans lequel les rapports
commerciaux fussent bientt devenus impossibles. Elles ont cr par l'appt du
gain l'esprit d'aventure qui devait conduire l'homme la dcouverte de rgions
inconnues, donn ceux qui les pratiquaient le got des choses nouvelles,
l'habitude de profiter des inventions des autres peuples et enfin la richesse, qui
permet les loisirs, sans lesquels aucune culture intellectuelle n'tait possible. Nous
ne devons donc pas tre surpris de voir les peuples dont les relations commerciales
taient tendues acqurir gnralement un assez haut degr de culture et le perdre
lorsque ces relations ont cess. Le jour o le commerce de Venise fut dtruit, la
ville des palais fantastiques, que le monde ne devait pas se lasser de venir admirer
plus tard, tait destine mourir. Une simple dcouverte scientifique, en
transportant vers d'autres rivages le commerce de la merveilleuse cit, devait y
arrter la vie artistique en mme temps que la vie commerciale. En contemplant
aujourd'hui sa lagune dserte que ne traverse plus aucune voile, ses trsors
d'architecture et d'art que le temps a pargns, on comprend quel point des causes
en apparence petites peuvent avoir, dans la vie des peuples, des consquences
profondes.
III. - Influence des Progrs de l'Industrie.
Retour la table des matires; retour au dbut du chapitre
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
88
Parmi les divers facteurs du dveloppement des socits que nous avons
numrs, et parmi ceux que nous sommes appel numrer encore, il en est qui,
aprs n'avoir t que de simples effets, sont devenus causes leur tour. Dans leur
nombre se trouve celui que je viens de mentionner en tte de ce paragraphe.
L'origine de tous les progrs industriels a t la division du travail. Mais la
division du travail ne pouvait apparatre elle-mme que dans des tribus assez
nombreuses pour que chacun de leurs membres et intrt excuter des travaux
diffrents. C'est avec raison qu'on a dit que le point de dpart des socits humaines
tait une tribu dont les membres accomplissaient tous les mmes actions chacun
pour soi, et leur point d'arrive, une communaut dont les membres accomplissaient chacun les uns pour les autres des actions diffrentes.
Tant que les hommes vcurent par petites familles isoles, chacun devait savoir
suffire ses besoins, fabriquer ses armes, ses instruments de chasse, ses vtements,
construire sa demeure, et naturellement l'aptitude pour ces divers travaux tait
d'autant moindre qu'elle s'exerait sur des sujets plus nombreux. Aussitt que des
agglomrations humaines ayant quelque cohsion se formrent, la division du
travail, avec ses consquences, se manifesta et alla en s'accroissant toujours.
Suivant leurs dispositions, les uns s'adonnrent la chasse et la pche, d'autres
la construction des habitations ou des armes ; et, mesure que la division du travail
augmenta, la perfection des oeuvres excutes s'accrut.
Aussi le progrs industriel est-il marqu, dans toutes les civilisations, par une
division et une spcialisation croissantes du travail. Elles sont devenues telles, dans
l'industrie moderne, que l'objet le plus simple, une pingle, par exemple, passe dans
les mains de nombreux ouvriers avant de pouvoir tre termin.
Une des principales influences exerces par les progrs industriels sur l'homme,
a t de le soustraire de plus en plus la dpendance de la nature, dont il tait
primitivement l'esclave, alors qu'il vivait exclusivement du produit de sa chasse. Se
construire des abris, se fabriquer des vtements et des armes, c'tait se crer de
l'indpendance.
Mais c'est surtout quand on considre les progrs de l'industrie moderne, que
l'on comprend le rle fondamental qu'elle joue dans la vie des peuples. Si
d'anciennes inventions, comme la boussole, la poudre canon, l'imprimerie, inventions que je qualifie d'industrielles, parce que la science pure n'eut que peu de
part leur dcouverte, - ont eu une si profonde influence sur la marche du monde,
les progrs de l'industrie moderne en ont une bien plus considrable encore. La
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
89
seule application de la vapeur a apport, dans les conditions d'existence des
peuples, plus de changements que n'en avaient produit toutes les guerres et les
rvolutions politiques qui l'ont prcde. Un physicien distingu, M. Radau, a
calcul que si le tiers seulement des trois cent millions de tonnes de houille que
l'Angleterre extrait annuellement de ses mines, est consomm par la machine
vapeur, cela reprsente le travail annuel de deux cents millions d'ouvriers 15. C'est
donc absolument comme si elle avait acquis deux cents millions d'esclaves
infatigables et dociles, c'est--dire une puissance que Rome ne connut pas, mme
aprs avoir asservi le monde. Lorsque, dans deux ou trois sicles, l'Angleterre aura,
suivant les calculs des gologues, brl son dernier morceau de houille, ce sera
comme si elle avait perdu ces deux cents millions d'esclaves, et on conoit
qu'aucune rvolution politique ou sociale ne saurait produire sur elle des
transformations aussi profondes que celles qui rsulteront d'une telle perte.
Ce sont galement les progrs de l'industrie, et nullement les thories
humanitaires, qui ont tu l'esclavage, cette institution dont Aristote disait avec une
sagesse profonde, qu'elle tait la condition ncessaire de toute civilisation, et qui
s'est maintenue jusqu' nos jours dans les pays, comme le Brsil, o l'industrie n'est
pas suffisamment dveloppe.
Dans l'examen rapide que nous venons de faire de l'influence de l'industrie sur
les socits, nous avons entirement laiss de ct l'effet qu'elle peut avoir sur le
bonheur de l'homme. Le bonheur est chose si subjective, et varie tellement suivant
le point de vue personnel, qu'une discussion semblable serait tout fait oiseuse.
Ceux qui pensent que les progrs industriels augmentent la somme du bonheur
montrent volontiers les villes plus riches et plus populeuses, les salaires plus levs,
l'pargne plus grande, la vie plus facile qu'autrefois. Ceux qui professent une
opinion contraire font voir combien est misrable la vie de l'ouvrier, passant son
existence au fond d'une mine ou d'une usine, dans un travail abrutissant qui lui
rapporte juste de quoi se procurer les forces ncessaires pour recommencer le
lendemain, en attendant l'hpital et la fosse commune. Le comparant ensuite au
sauvage insouciant vivant au grand air, ils dclarent prfrable l'existence de ce
dernier. On pourrait discuter fort longtemps sur cette question, mais de telles
discussions sont inutiles, puisqu'il n'est pas au pouvoir de l'homme que les choses
soient autrement qu'elles ne sont actuellement. Si j'tais oblig de donner mon
opinion, je me rangerais cet avis du savant conomiste Bagehot, que nous ne
savons pas si toutes les machines et les inventions de l'espce humaine ont encore
allg le travail quotidien d'un seul tre humain. Elles ont permis un plus grand
15
La force des machines vapeur existant en France reprsente 4,500,000 chevaux vapeur, soit le travail
d'environ 31,590,000 hommes.
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
90
nombre d'hommes de vivre, mais ces hommes se livrent un travail aussi pnible,
mnent une vie aussi abjecte, aussi misrable que ceux qui vivaient autrefois en
moins grand nombre.
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
91
IV. - Influence des Arts
et de la Littrature.
Retour la table des matires; retour au dbut du chapitre
Les arts et la littrature d'un peuple sont les vestiges les plus importants qu'il
puisse nous laisser, ceux qui nous permettent de mieux juger du degr de
dveloppement qu'il a atteint ; mais ils reprsentent des effets et non des causes, et,
quand ils agissent comme causes, c'est d'une faon gnralement trop minime
comparativement aux facteurs tudis jusqu'ici, pour que nous puissions leur
attribuer une influence bien grande.
Les arts et la littrature d'un peuple sont en effet le simple reflet de ses ides, de
sa culture et de l'influence des divers milieux qui agissent ou ont agi sur lui. Nous
retrouvons le moyen ge tout entier dans sa peinture nave, ses sombres lgendes,
ses gigantesques cathdrales, qu'il mettait des sicles construire, et que les
gnrations qui les commenaient et y engloutissaient leurs trsors ne voyaient pas
finir. L'Orient se reflte dans sa littrature image et son architecture tourmente ;
les temps modernes, avec leurs tendances positives et leur dsir de jouir de l'heure
prsente, dans leur architecture confortable, mais sans caractre ni dure, dans leur
littrature prcise poussant le ralisme aussi loin qu'elle peut.
Ce n'est que d'une faon tout fait exceptionnelle qu'on voit les arts et la
littrature d'un peuple influer sensiblement sur son volution et d'effets devenir
causes leur tour. Sans doute nous avons vu au sicle dernier quelques crivains
avoir une influence incontestable sur la gense de la Rvolution franaise ; mais le
fait est bien exceptionnel, et ce sont les ides philosophiques, bien plus que la
littrature proprement dite, qui ont jou alors le plus grand rle.
Ce n'est, en ralit, que quand un peuple essaie pendant une longue suite de
sicles de s'assimiler les arts et la littrature d'un autre peuple, que l'on peut dire
que ces manifestations de l'intelligence humaine ont eu une action efficace sur son
volution. Les littratures grecque et latine, qui forment les bases actuelles de notre
ducation et que nous tudions depuis tant de sicles, ont eu assurment une
influence considrable, accumule par l'hrdit, sur notre faon de penser. Nous
aurons rechercher les limites de cette influence, quand nous tudierons le rle de
l'ducation sur l'volution intellectuelle et morale de l'homme.
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
92
En dehors de ces cas exceptionnels, les arts et la littrature d'un peuple ne sont,
je le rpte, que le simple reflet des ides et des sentiments de ce peuple, la
photographie d'une poque, et je trouve que l'minent auteur de l'Histoire de la
civilisation anglaise, Buckle, exprime une pense trs-juste quand, parlant de
l'influence des livres, il dit que le seul service qu'ils rendent, c'est de servir de
dpts dans lesquels les trsors de l'intelligence sont en sret et o on peut les
retrouver facilement.
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
93
Deuxime partie
LES SOCITS
Leurs origines et leur dveloppement
livre II : Les facteurs de lvolution sociale
Chapitre V.
Influence de la lutte pour
l'existence et du dveloppement
des institutions militaires.
1. Gnralit de la lutte pour l'existence dans l'espce humaine. - La guerre a toujours t une
des principales occupations de l'homme. - La civilisation ne fait que la rendre plus meurtrire et
plus coteuse. - Ce que cotent les guerres modernes. - La guerre n'est pas toujours la forme la
plus meurtrire de la lutte pour l'existence. - Sentiments de frocit engendrs chez l'homme par
la perptuit de la lutte pour l'existence. - La civilisation ne fait que les masquer. - Frocit native
de l'enfant. - II. Influence de la lutte pour l'existence sur l'volution des socits humaines. Importance de cette lutte. -La civilisation ne progresse que dans les pays o la lutte est violente. Le degr de civilisation d'un peuple peut se mesurer la perfection de son armement militaire. Qualits diverses : discipline, mulation, courage, etc., cres par la lutte pour l'existence.
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
94
I. - Gnralit de la Lutte pour l'Existence
dans l'Espce humaine.
Retour la table des matires; retour au dbut du chapitre
Un chapitre entier de la premire partie de cet ouvrage a t consacr tudier
la lutte pour l'existence qui s'observe chez tous les tres, et son importance
fondamentale. Il a t montr que cette lutte avait pour rsultat une sorte de triage,
chaque gnration, des individus les mieux dous, et, partant, la transformation
progressive des espces.
Cette lutte universelle, que nous avons constate chez toutes les espces
vivantes et qui fait de la vie un ternel combat o ne peuvent triompher que les plus
forts, est plus intense encore chez l'homme que chez l'animal. Ce dernier mnage
gnralement, en effet, ses semblables alors que l'homme ne les pargne gure.
L'tat d'hostilit des hommes entre eux s'observe depuis le jour o les premiers
hommes connurent leurs premiers frres, et il est impossible d'entrevoir l'poque o
il pourra finir.
Si loin que nous remontions dans l'histoire des tres humains, nous voyons que
la guerre a toujours t une de leurs principales occupations, et qu' mesure que la
civilisation a progress, la destruction de l'homme par ses semblables a
constamment suivi une progression parallle. On pourrait mme, comme nous le
verrons bientt, mesurer le dveloppement de la civilisation d'un peuple la
perfection de son armement militaire, c'est--dire la facilit avec laquelle il peut
tuer le plus grand nombre d'individus possible dans un espace de temps donn.
C'est l une vrit irrfragablement prouve par l'histoire, et contre laquelle les
puriles dclamations des philanthropes, des optimistes et des rveurs de paix
perptuelle ne sauraient prvaloir. Aussi bien pour le sauvage que pour l'homme
civilis, l'tat de guerre contre ses semblables est l'tat naturel, et la lutte est
d'autant plus cruelle, par le nombre de victimes qu'elle entrane, par le prix qu'elle
cote, que le peuple chez lequel elle svit a atteint un degr de civilisation plus
haut. Les progrs de la civilisation tendent seulement rendre les guerres de plus
en plus courtes en raison de leur caractre de plus en plus destructif, et de la
complexit des intrts qui y sont engags.
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
95
A aucune poque de l'humanit la guerre n'absorba autant de ressources en
hommes et en argent qu'elle le fait aujourd'hui, et jamais elle ne fit autant de
victimes qu'elle en a fait depuis un sicle 16. En France seulement, prs de trois
millions d'hommes ont t tus par leurs semblables depuis un sicle. Aujourd'hui
les plus grandes nations civilises en sont rduites maintenir sous les armes un
grand nombre de leurs membres, et consacrer souvent jusqu'au quart de leurs
revenus annuels des dpenses militaires pour se prserver des attaques des autres
peuples civiliss. Une telle ncessit peut paratre humiliante, elle est imprieuse.
Une socit incapable de se dfendre serait bien vite dtruite aujourd'hui par ses
voisines, sous un prtexte quelconque, ou mme sans prtexte.
Pour bien comprendre toute l'tendue de la lutte pour l'existence dans l'espce
humaine, il faut bien se rappeler que, de mme que chez l'animal, ce n'est pas
seulement sous forme de combat sanglant qu'elle se manifeste, mais sous des
formes trs varies : concurrence commerciale ou industrielle, notamment. Que la
lutte ait lieu main arme, ou par les procds, en apparence plus pacifiques, que je
viens de nommer, le rsultat est toujours le mme, l'crasement du plus faible.
La guerre n'est donc pas toujours la forme de destruction la plus terrible et la
plus efficace entre nations rivales ou entre individus rivaux. On a fait remarquer
avec raison que cette destruction n'est rien auprs de la mortalit qui frappe des
milliers d'hommes quand l'industrie et le commerce d'un pays sont atteints par la
concurrence d'un pays voisin. La disparition observe en Ocanie, en Amrique,
des races infrieures en prsence des races suprieures, est le rsultat, non pas
simplement de l'gorgement systmatique du plus faible par le plus fort, mais
surtout de la suppression graduelle des ressources qui les faisaient vivre.
16
Ce que cotent les guerres modernes. - Ce n'est que depuis une poque bien rcente qu'on possde des
chiffres exacts sur les pertes des armes en temps de guerre, par suite de blessures ou de maladies. C'est surtout
pour la guerre de Crime, la guerre de la scession et la guerre franco-allemande, que nous possdons des
documents exacts. Le lecteur, que ces questions intressent, devra se reporter, pour les pertes des armes
franaises, aux statistiques du docteur Chenu, pour les pertes des Amricains pendant la guerre de la scession,
au livre du docteur Barnes [The Medical and surgical history of the war of the rebellion, Washington, 1870) ; et
enfin pour les pertes des Allemands, dans leur dernire guerre, l'ouvrage du docteur Engel (Die Verluste der
deutschen Armeen im Kriege gegen Frankreich. Berlin, 1 872).
Les pertes des Franais, pendant les guerres de la Rpublique et des deux Empires, sont d'environ 2,700,000
hommes. J'obtiens ce chiffre en ajoutant le total des morts de la dernire guerre ceux tus de 1791 1865. On
en trouve le dtail dans plusieurs documents, et notamment dans une statistique non conteste donne dans un
discours prononc au corps lgislatif, l'occasion de la loi militaire, le 21 dcembre 1867. Les chiffres prsents
alors ont t obtenus en retranchant du nombre d'hommes appels sous les drapeaux dans la priode 1791-1863,
le nombre d'hommes rentrs dans leurs foyers et de ceux qui auraient d succomber d'aprs les lois de la
mortalit ordinaire. Quant au nombre d'hommes extermins en Europe par les guerres de la Rvolution et du
premier Empire, il n'est pas exactement connu ; mais plusieurs auteurs le considrent comme suprieur 5
millions. Les guerres modernes deviennent chaque jour plus meurtrires. Au mois d'aot 1870. les Allemands,
malgr la supriorit de leur armement, ont eu devant Metz 40,000 hommes tus en trois jours.
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
96
Cet tat de guerre permanent des hommes entre eux, qui a commenc avec nos
premiers anctres et ne finira sans doute qu'avec les derniers de nos descendants, a
eu pour rsultat, indpendamment des consquences sociales que nous tudierons
plus loin, la formation de sentiments de frocit et de cruaut qui aujourd'hui
sommeillent plus ou moins au fond de nous, mais que la moindre tincelle rveille.
Grce aux changements survenus dans les conditions de l'existence humaine,
l'aptitude se reprsenter vivement dans l'esprit les douleurs que nous
prouverions, si on nous faisait souffrir ce que nous sommes tents de faire souffrir
d'autres, s'est dveloppe, et le sentiment de la piti, si profondment inconnu
nos premiers anctres, a fini par se manifester ; mais ce sentiment a une origine
trop rcente, et celui de la cruaut une origine au contraire trop ancienne, pour que,
lorsqu'il y a lutte entre eux, ce ne soit pas habituellement ce dernier qui l'emporte.
Ce n'est gnralement que lorsque nos instincts de frocit sont satisfaits, que nos
sentiments de piti cherchent se satisfaire galement. C'est ainsi, par exemple,
qu'aprs avoir tu et estropi le plus d'individus possible sur un champ de bataille,
nous cherchons ensuite secourir les blesss au lieu de les achever comme le
faisaient nos pres.
Les sentiments d'hostilit et de frocit primitifs ont t tellement fixs en nous
par l'hrdit, que tous les efforts de la civilisation ont t radicalement impuissants
les draciner. L'histoire nous montre qu'il existe bien peu de nations capables de
laisser couler quelques annes sans prouver le besoin de se prcipiter sur leurs
voisins, pour tcher de les dtruire, ou, si elles sentent leurs voisins trop forts, sur
les habitants des contres loignes pour les tuer et les piller sous prtexte de les
civiliser.
Ce besoin de destruction que nous ont lgu nos anctres ne serait pas
suffisamment assouvi par les guerres qui svissent de temps autre. Ne pouvant
toujours l'exercer sur nos semblables, qui, naturellement, usent de reprsailles
quand ils sont assez forts, nous l'exerons sur les animaux. Ce qu'on appelle le
plaisir de la chasse, c'est--dire le plaisir de se runir en bande pour aller, par pure
distraction, gorger un cerf inoffensif ou tout autre animal aussi peu nuisible, est
considr comme une des plus nobles distractions, une de celles qu'il faut le plus
encourager chez la jeunesse. Pour le philosophe, le plaisir qu'prouve le chasseur
en tuant un animal, qui n'est en aucune faon destin satisfaire sa faim, celui
qu'prouve l'Espagnol en assistant des combats de tauraux, sont simplement la
satisfaction des sentiments de frocit que l'hrdit a maintenus en eux, et qui, ne
pouvant plus facilement s'exercer sur les hommes, s'exercent sur les btes. Le
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
97
chasseur qui passe une journe faire souffrir un cerf par ses chiens avant de
l'gorger, l'individu qui contemple les souffrances du taureau, que le torador a soin
de cribler de blessures, avant de lui donner le coup mortel, ne diffrent nullement,
mes yeux, du sauvage qui torture un prisonnier attach un poteau ; et je ne vois
mme pas en quoi le plaisir du dernier serait moins noble que celui des premiers,
car, pour s'emparer de son prisonnier, le sauvage a couru quelques risques inconnus
du chasseur et dut spectateur que je viens de mentionner. L'homme peut cacher
sous des mots sonores ses instincts sanguinaires ; mais, quoi qu'il fasse, ces
instincts sont terriblement vivaces encore.
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
98
[NOTE :
Sur le sentiment de la cruaut dans l'espce humaine. - L'instinct de cruaut que je viens de
signaler dans l'espce humaine, et que je considre comme la consquence du long pass que
l'homme a derrire lui, se retrouve chez tous les peuples et dans tous les temps, depuis les plus
reculs jusqu'aux plus rcents de notre histoire. Les plus anciens monuments crits de l'humanit
sont aussi remplis que les livres modernes des preuves de la frocit des hommes. Il suffit
d'ouvrir la Bible au hasard pour en avoir la preuve. Parlant, par exemple, de la ville de Rabbath,
que David parvint prendre, le narrateur ajoute, comme consquence toute simple : Et ayant
fait sortir les habitants, il les coupa avec des scies, fit passer sur eux des chariots avec des roues
de fer, les tailla en pices avec des couteaux et les jeta dans des fourneaux o l'on cuit la brique.
C'est ainsi qu'il traita toutes les villes des Ammonites. (Rois, liv. Il, ch. XII. v. 31 .)
Les actes de frocit dont est remplie la Bible ne sont pas tout fait spciaux aux Juifs,
comme on l'a prtendu, car on les trouve chez la plupart des peuples. Il n'aurait pas de notre
espce une opinion trs leve, l'habitant d'une autre plante qui lirait, par exemple, le rcit de la
conqute du Mexique par les Espagnols, des atrocits commises par le clerg pendant
l'Inquisition ou par les foules pendant les soulvements populaires.
Quand l'homme peut donner libre cours ses instincts, on ne peut vraiment trouver de btes
assez malfaisantes pour lui tre compares. J'ai parl, dans un autre chapitre, de la frocit des
sauvages : celle des blancs livrs eux-mmes lui est au moins gale. Les voyageurs qui ont
parcouru rcemment l'Afrique dans un but scientifique sont unanimes dans leur opinion sur ce
point. Parlant des actes de cruaut commis en Afrique par les Portugais sur les femmes et les
enfants qu'ils gorgent sans piti pendant leurs chasses aux esclaves, le commandant Cameron
s'exprime ainsi :
J'arrivai exaspr du traitement que, pendant toute la course, j'avais vu infliger aux
malheureux esclaves. Les pires des Arabes, je n'hsite pas l'affirmer, sont, cet gard, des anges
de douceur en comparaison des Portugais et de leurs agents. Si je ne l'avais pas vu, je ne pourrais
jamais croire qu'il pt exister des hommes aussi brutalement cruels et de gaiet de cur.
Les actes qui ont justement mu Cameron s'observent dans tous les pays o l'homme vulgaire
est livr lui-mme. Ceux qui ont vu de prs les foules pendant les guerres civiles savent
parfaitement quoi s'en tenir sur ce point. Pour ne parler que des faits analogues ceux de
Cameron, c'est--dire de la conduite du blanc civilis chez le sauvage quand il peut agir sans
frein, il faut bien reconnatre qu'on les a observs partout. Parlant, d'aprs des tmoins oculaires,
des moyens employs habituellement par des capitaines de navires anglais pour se procurer des
ouvriers papous, et qui consistent simplement attraper des naturels par surprise et leur couper
immdiatement le cou avec un couteau pour ngocier leurs ttes, le savant naturaliste de
Quatrefages s'exprime de la faon suivante :
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
99
Tous les moyens paraissaient bons aux kidnappers pour se procurer rien ne cote leur
cargaison humaine. Je pourrais emprunter ici bien d'horribles dtails M. Markham. Je ne citerai
qu'un seul fait :
A Florida, une des les Salomon, un brick vint s'arrter quelque distance de la cte. Un
canot charg de naturels s'en tant approch, une manoeuvre, en apparence accidentelle, le fit
chavirer. Les chaloupes furent immdiatement mises la mer comme pour porter secours aux
naufrags ; mais les spectateurs placs sur les rcifs ou sur d'autres canots virent les matelots
europens saisir ces malheureux et leur couper la tte avec un long couteau sur le plat-bord des
chaloupes. L'oeuvre accomplie, celles-ci retournrent au brick, qui prit immdiatement le large.
Les ttes ainsi recueillies taient destines payer l'engagement d'un certain nombre de
travailleurs. Dans plusieurs de ces les mlansiennes, le guerrier vainqueur dcapite le vaincu et
emporte la tte ; il est d'autant plus respect qu'il possde un plus grand nombre de ces trophes.
Eh bien! il avait t convenu entre quelques chets et quelques commandants de navires que ces
derniers se procureraient des ttes et recevraient, en change, un certain nombre d'individus
vivants engags pour un ou deux ans.
Il va sans dire que, le terme de l'engagement arriv, la plupart de ces malheureux Papous ne
retrouvaient pas pour cela leur libert. En 1867, par exemple, on eut la preuve que, sur 382
insulaires engags pour trois ans, et qui auraient d tre rapatris, 78 seulement avaient t
ramens chez eux. (L'Espce humaine, in-8, 1877, p. 342.)
Ces faits et beaucoup d'autres, reproduits par l'minent professeur que je viens de citer, l'ont
conduit aux conclusions suivantes, que j'adopte entirement et reproduis avec d'autant plus
d'empressement, qu'elles proviennent d'un savant qui n'a jamais t tax de pessimisme :
Au point de vue du respect de la vie humaine, la race blanche europenne n'a rien
reprocher aux plus barbares. Qu'elle fasse un retour sur sa propre histoire et se souvienne de
quelques-unes de ces guerres, de ces journes crites en lettres de sang dans ses propres annales.
Qu'elle n'oublie pas, surtout, sa conduite envers ses soeurs infrieures. La dpopulation marque
chacun de ses pas autour du monde ; les massacres commis de sang-froid et souvent comme un
jeu ; les chasses l'homme organises la faon des chasses la bte fauve ; les populations
entires extermines pour faire place des colons europens ; et il faudra bien qu'elle avoue que
si le respect de la vie humaine est une loi morale et universelle, aucune race ne l'a viole plus
souvent et d'une plus effroyable faon qu'elle-mme. (L'Espce humaine, p. 347.)
Chez l'enfant qui rpte, comme nous l'avons dit, pendant son dveloppement,
les phases diverses par lesquelles ont pass ses primitifs anctres, et qui ne se
trouve pas, au point de vue de l'intelligence et des sentiments, au-dessus de ses
lointains aeux, la piti est un sentiment absolument inconnu, et la crainte seule des
chtiments l'oblige cacher ses sentiments de cruaut. Ils sont cependant tellement
puissants, qu'il n'y a pas de perspective de punition qui puisse contre-balancer le
plaisir qu'il prouve commettre un acte de cruaut quelconque, comme noyer un
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
100
chien, touffer une niche de petits oiseaux, estropier un animal, rouer de coups un
camarade plus faible, etc.
L'instinct de destructivit, dit un auteur qui a consacr un ouvrage spcial la
description des premires annes de l'enfant, et celui de combativit se montrent de bonne
heure chez tous les jeunes enfants, comme chez tous les jeunes animaux. Dchirer,
craser, dfaire, dranger, est une de leurs joies quotidiennes ; c'est un des modes
d'exercice de leur imagination. Mais ils sont essentiellement batteurs. Les plus doux sont
ports battre les personnes qu'ils aiment le plus, pour peu qu'on les laisse faire : les
nourrices et les mres en savent quelque chose. J'ai vu un enfant de huit mois donner une
tape sur le visage d'une personne qui voulait l'embrasser. Mettez deux enfants n'ayant pas
dix mois jouer sur le parquet ou sur le sol : il ne se passera pas un quart d'heure que l'un
aura gratign l'autre, l'aura frapp avec la main ou avec un jouet, ou l'aura tir, soit par la
robe, soit par le bras, soit par le cou. Quand ils marchent, c'est bien autre chose ; j'en
connais un fort bien lev (deux ans), et qui ne bat chez lui ni les personnes ni les objets ;
mais, quand ses amis viennent le voir, ou qu'il est amen chez eux, les jeux bruyants qu'il
dirige, parce qu'il est le plus intelligent, tournent tous les quarts d'heure, et de son fait, en
rixes des plus srieuses. Mais il a trouv qui lui rpond : une jeune enfant, ge de trois
ans, et fort robuste, lui donne des tapes fort bien appliques, dont il crie comme un
corch, quand il ne s'en venge pas sur les autres enfants plus faibles que lui 17.
Dans tous ces actes de frocit enfantine, que les parents trouvent parfois si
charmants, ou considrent comme des lgrets sans consquence, le philosophe,
qui voit plus loin, retrouve des traces de ce que furent nos anctres pendant les
temps qui prcdent l'histoire, et reconnat qu'alors, aussi bien qu'aujourd'hui
encore, hlas ! parmi les animaux les plus cruels, le plus cruel est l'homme.
II. - Influence de la Lutte pour l'Existence
dans l'volution des Socits humaines.
Retour la table des matires; retour au dbut du chapitre
La lutte pour l'existence, qui est si universelle chez tous les tres, et les a si
profondment transforms, a eu une influence considrable sur l'volution des
socits humaines. Les peuples ne progressent gure que quand leur puissance
militaire progresse. Aussitt que cette puissance reste stationnaire ou dcrot, les
nations restent elles-mmes stationnaires ou dcroissent. C'est dans les rgions o
les barrires naturelles empchent l'incursion des voisins, et o la douceur des
17
G. Prez. Les premires annes de l'enfant.
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
101
lments et l'abondance des ressources alimentaires rendent la comptition peu
intense que les civilisations se sont le moins dveloppes. Le Mexique, le Prou, la
Chine, l'Afrique, l'Ocanie peuvent tre invoqus comme exemples. Dans les
contres o la lutte a t ardente, comme en Europe, la civilisation s'est au contraire
rapidement dveloppe. Que les peuples en aient tir avantage ou non, c'est une
question que je n'ai pas examiner ici.
L'histoire nous montre qu'une lutte continuelle, et toutes les misres qu'elle
entrane, sont pour les nations une condition de progrs. Tant que Rome eut lutter,
elle fut oblige de se perfectionner constamment, et resta matresse du monde.
Aussitt que, par suite de la pacification universelle, elle n'eut plus qu' songer
jouir de son oeuvre, elle tomba en dcadence et devint incapable de rsister au flot
des envahisseurs, jadis si mpriss et si facilement vaincus par elle. On citerait bien
difficilement, je crois, un peuple qui ait progress sans que sa puissance militaire
ait progress galement.
L'armement des guerriers d'Homre tait trs-suprieur celui des hommes de
l'ge de la pierre polie. Les Romains eussent t vaincus sans peine par les armes
du moyen ge ; les preux du temps de Roland et de Charlemagne n'eussent pas tenu
un instant contre les soldats de Louis XIV ; et toutes les armes runies du grand
roi eussent fait triste figure contre la plus faible des armes modernes munie de ses
engins de destruction longue porte.
En recherchant les causes de cette puissance toujours croissante du pouvoir
militaire des peuples qui progressent, on reconnat immdiatement qu'elle est la
consquence de cette loi inflexible qui donne toujours le pouvoir aux plus forts.
Dans les premiers temps de l'humanit, alors qu'il n'y avait ni commerce ni
industrie, les seuls progrs ralisables taient les progrs militaires. Le moindre
perfectionnement obtenu dans le travail d'une arme ou dans la tactique pour
attaquer son ennemi, donnait ceux qui en faisaient usage une supriorit vidente,
qui provoquait l'mulation de rivaux pour lesquels cette supriorit tait une
question de vie ou de mort. L'histoire des peuples n'est, en ralit, que le rcit des
faits rsultant de leurs efforts pour dpasser leurs voisins en puissance militaire.
Mais ce n'est pas seulement en obligeant les peuples se perfectionner, que les
guerres auxquelles ils n'ont cess de se livrer ont exerc une influence profonde sur
leur volution. Elles ont cr, en effet, et seules elles pouvaient crer, certaines
qualits telles que la valeur, la fermet, l'esprit d'obissance et de discipline qui sont
indispensables au maintien d'une socit. La guerre seule pouvait tablir entre les
membres d'une tribu cette solidarit, ces habitudes d'ordre et de respect de l'autorit
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
102
sans lesquelles aucune socit n'est possible. On comprend l'importance de
l'acquisition de qualits semblables quand on voit ce que deviennent les nations
chez lesquelles elles se sont affaiblies ou ont disparu.
Outre l'mulation constante qu'elles craient entre les diverses nations et la
formation des qualits que je viens d'numrer, les guerres ont eu pour rsultat la
survivance des plus forts et l'limination graduelle des moins bien adapts. Ce fut
surtout aux premiers ges de l'humanit, alors que chacun n'avait compter que sur
soi, que cet effet se produisit. La concurrence sous ses diverses formes, qui rendait
de plus en plus misrable l'existence des membres les plus faibles, dtermina leur
limination.
Dans les temps modernes, les efforts de la philanthropie ont considrablement
restreint cette slection, et il en rsulte que chaque socit contient aujourd'hui un
nombre parfois considrable d'individus non adapts ses conditions d'existence,
incapables de pourvoir leurs besoins 18, et qui ne peuvent naturellement rver que
de la dtruire. Dans le chapitre consacr la lutte pour l'existence, j'ai montr
quel point les plus grands penseurs modernes sont unanimes signaler les dangers
rsultant des efforts que nous faisons pour favoriser la reproduction de ces lments
infrieurs. En se multipliant dans le sein d'une nation, ils y propagent les plus
redoutables germes de ruine et de dcadence et prparent nos descendants de
terribles soucis. Une socit serait vite dtruite par la multiplication de ces lments
infrieurs, si la force des choses, plus puissante que la philanthropie, ne restreignait
pas leur nombre par suite de la mortalit leve qui les frappe. Si les tats-Unis
sont arrivs si rapidement au degr de prosprit qui les caractrise, c'est qu'ils se
sont forms par la runion des hommes les plus nergiques, les plus entreprenants
et les plus vigoureux de l'Europe, et que tout individu ne possdant pas ces qualits
disparaissait fatalement, et ne pouvait par consquent altrer la race par ses
descendants.
Le rle exerc sur l'volution sociale par la lutte ternelle des tres entre eux
nous apparat clairement maintenant. Cette lutte sans merci, o ne triomphent que
les plus forts et o le repos est la mort, a t un des plus actifs facteurs de
l'volution des socits humaines. Sans mconnatre la grandeur des rsultats
obtenus par elle, on ne peut s'empcher d'tre saisi de piti et d'horreur en voyant
combien sont cruels les moyens que la nature emploie pour faire progresser les
tres qui vivent sous ses lois, et de songer cette dfinition de la vie du philosophe
Schopenhauser, qui peut tre donne comme consquence de tout ce qui prcde :
18
L'Angleterre seule compte actuellement 750,000 individus incapables de se suffire et qu'il faut nourrir
chaque jour. Elle est oblige de consacrer annuellement prs de 200 millions leur entretien.
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
103
La vie est une chasse incessante o, tantt chasseurs et tantt chasss, les tres
se disputent les lambeaux d'une horrible cure ; une guerre de tous contre tous, une
sorte d'histoire naturelle de la douleur.
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
104
Deuxime partie
LES SOCITS
Leurs origines et leur dveloppement
livre II : Les facteurs de lvolution sociale
Chapitre VI.
Influence de la connaissance
de l'agriculture et du dveloppement
de la population.
Retour la table des matires; retour au dbut du chapitre
1. Influence de l'agriculture. - Impossibilit pour les individus vivant uniquement du produit
de leur chasse de se runir en socits nombreuses. - Importance des progrs dont l'agriculture a
t l'origine. - Le chiffre de la population d'un pays est en rapport exact avec les ressources
agricoles. - II. Influence du mouvement de la population. - Dangers d'une multiplication trop
rapide de la population quand les ressources agricoles n'augmentent pas. - Ce que cote un adulte
produire. - Dficit actuel des nations europennes au point de vue agricole. - Documents
statistiques relatifs la production et la consommation en France. - L'augmentation de la
population se fait gnralement dans les classes les plus pauvres. - L'accroissement de l'aisance et
de l'instruction rduit le chiffre de la population. - Documents statistiques relatifs aux naissances,
migrations, mouvements de la population, etc. - Pourquoi certaines contres, telles que
l'Allemagne et l'Angleterre, peuvent supporter une augmentation progressive de leur population. Avenir de l'migration allemande en Amrique.
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
105
I. - Influence de l'Agriculture.
Retour la table des matires; retour au dbut du chapitre
Pour comprendre l'importance que la connaissance de l'agriculture devait avoir
sur la formation des socits et leur volution future, il faut se rappeler que, tant
qu'elle fut ignore, c'est--dire pendant les centaines de milliers d'annes que dura
l'ge de la pierre taille, l'homme ne sortit pas de la barbarie primitive. Tant qu'il
vcut uniquement du produit de sa chasse, aucune civilisation ne pouvait natre. La
runion d'un certain nombre d'individus sur un mme territoire tait impossible, car
tout le gibier et t rapidement dtruit. On a dit avec raison que le sauvage qui se
nourrit exclusivement de chasse a besoin pour subsister d'un espace de terre qui,
dans une contre agricole, suffirait mille individus pour vivre.
Lorsque nos premiers pres connurent l'agriculture, ils renoncrent forcment
la vie nomade, et des socits nombreuses commencrent se former ; le travail se
divisa, les villages devinrent graduellement des villes, et la civilisation put natre.
De tous les progrs raliss par l'homme depuis l'poque o il se spara des
espces anthropodes qui l'avaient prcd, la connaissance de l'agriculture fut un
des plus importants. C'est du sol, en effet, qu'il tire toute sa subsistance et celle des
animaux domestiques dont il se nourrit, et il ne faut pas oublier que, pour
l'immense majorit des tres, le problme le plus important, celui auquel est
consacre la presque totalit de leurs efforts, est celui de se nourrir. Procurer
chacun sa nourriture journalire, c'est cela que se rduisent au fond tous les
problmes sociaux. Aucune civilisation n'a pu natre avant que l'homme et sa
subsistance assure ; aucune ne pourrait continuer vivre si les moyens de
subsistance faisaient dfaut.
Ce n'est pas seulement dans les premiers ges de l'humanit que l'agriculture a
jou un rle fondamental : l'importance de ce rle s'est continue travers les ges
et se continue encore. Elle forme le principal moyen d'existence des nations, leur
occupation la plus imprieuse 19. Son degr de prosprit est intimement li leur
tat de grandeur ou de dcadence. Elle dtermine rigoureusement le nombre des
19
D'aprs le recensement de 1876, une quotit de 53 % de la population franaise est exclusivement consacre
l'agriculture, 26 % seulement l'industrie.
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
106
habitants d'un pays, et ce point que le chiffre des mariages et des naissances d'une
anne permettrait lui seul de dire ce qu'a t la production agricole de cette anne.
Les guerres les plus meurtrires n'ont jamais fait prir autant d'hommes, ni
provoqu tant de ruines, qu'une diminution accidentelle dans la production agricole
d'un pays 20. Je ne crois pas qu'on puisse attribuer uniquement, avec Liebig,
l'appauvrissement de son sol la dcadence de l'Espagne, si prospre sous les
Romains et sous les Musulmans, alors que l'on voyait des villes comme Tarragone,
qui comptent 15,000 habitants aujourd'hui, et qui en possdaient un million alors.
Mais, si l'puisement du sol n'a pas t la cause unique de cette immense
dcadence, il a d y contribuer nanmoins pour une forte part.
L'tat de l'agriculture d'un peuple a, sur le dveloppement de sa population et
sur son tat social, une importance fondamentale et trop souvent mconnue. Par les
aliments qu'elle fournit l'homme, elle a aussi sur sa destine une influence qu'il
serait trop long d'tudier en dtail ici, mais que je ne dois pas omettre cependant de
mentionner en passant.
Les peuples dont la nourriture est exclusivement vgtale sont gnralement
pusillanimes, sans nergie et peu aptes au travail. Ce n'est pas sans raison que
Geoffroy Saint-Hilaire disait que plusieurs centaines de millions d'Hindous, qui se
nourrissent presque exclusivement de riz, n'obiraient pas aux quelques milliers
d'Anglais qui les exploitent, s'ils se nourrissaient comme eux. C'est un fait bien
connu que les carnivores qu'on nourrit exclusivement de vgtaux perdent leur
humeur froce et la reprennent quand leur nourriture redevient animale. J'ai
possd un chien dont je changeais ainsi l'humeur mon gr.
II. - Influence du Mouvement
de la Population.
Retour la table des matires; retour au dbut du chapitre
20
La superficie des vignes dtruites en France par le phylloxera ou atteintes par lui, et devant prochainement
disparatre, est, au moment o j'cris ce livre, de 616,000 hectares, soit plus du quart de la totalit des terres
plantes en vignes qui existaient il y a vingt ans. Chaque hectare produisant une moyenne annuelle de 33
hectolitres environ, il est facile de calculer qu'il y a peu de guerres qui aient cot autant la France que les
ravages de ce misrable petit insecte. S'il n'arrte pas ses dvastations, il aura bientt tari une de nos plus
puissantes sources de richesse nationale, celle qui formait avec les tissus notre principal objet d'exportation. La
valeur des vins et eaux-de-vie exports s'lve, en effet, pour 1876, la dernire des annes pour laquelle on
possde des documents, 317 millions.
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
107
Le chiffre de la population tant li la quantit de ses subsistances, et ces
dernires tant peu prs exclusivement fournies par l'agriculture, on comprend
qu'il est impossible que la population s'accroisse sans que les ressources agricoles
subissent une augmentation correspondante. Aux ges prhistoriques ou au temps
o les ressources fournies par le sol taient considrables relativement au nombre
de ses habitants, l'homme pouvait se multiplier sans inconvnient, et cette
multiplication tait un avantage manifeste pour les socits naissantes.
Tant que l'tendue du sol exploitable est suffisante, la population peut
augmenter, et elle augmente en effet. Le jour o il y a quilibre entre les
subsistances et la population, cette dernire doit rester stationnaire, et, comme l'a
montr Malthus, toutes les fois qu'un excdant de la population vient rompre
l'quilibre, une ruine gnrale succde la prosprit jusqu'au jour o les guerres,
les famines, les pidmies rtablissent l'quilibre. Ce n'est que lorsque, par suite de
l'application de procds scientifiques nouveaux, les ressources agricoles viennent
augmenter, que la population peut elle-mme s'accrotre.
De telles vrits devraient tre banales ; elles sont cependant mconnues d'un
grand nombre d'crivains qui ne cessent de demander qu'on favorise par tous les
moyens possibles le dveloppement de la population, et de se lamenter sur le sort
des pays comme la France, o la population tend devenir stationnaire. Depuis
qu'il est bien constat que la population franaise ne s'accrot presque plus, chaque
anne voit clore de nouvelles lamentations et de nouvelles propositions de
remdes cet tat de choses.
Les erreurs gnralement professes sur cette question en France sont assez bien
reprsentes par l'assertion suivante, mise en 1868, par M. Jules Simon, ancien
ministre de l'instruction publique, devant l'Institut : Celui qui ajouterait, dit-il, un
million au chiffre de notre population ferait bien plus pour la prosprit et la
prpondrance du pays que celui qui, au prix du sang, nous donnerait un terrain de
quelques lieues.
Rien n'est plus dangereusement erron que la proposition qui prcde. Celui qui
nous donnerait un terrain de quelques lieues augmenterait nos ressources et rendrait
certain un accroissement de la population en rapport avec cette augmentation de
ressources. Celui qui augmenterait au contraire la population d'un million
d'habitants, sans nous donner le territoire ncessaire pour les nourrir, ne ferait que
donner au pays un million de mcontents destins augmenter ses charges, et qui
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
108
finiraient par lui coter plus cher que ne pourrait le faire la guerre la plus
sanglante 21.
Si les vux et les rcriminations que nous entendons de tous cts n'avaient pas
sur le mouvement de la population une influence peu prs gale celle que
produirait sur la marche d'un astre les souhaits d'un astronome, nous assisterions
bien vite aux plus terribles catastrophes.
Ceux qui poussent la multiplication de la population sans comprendre qu'il y a
un rapport fatal, dmontr depuis longtemps, entre les ressources agricoles d'un
pays et le nombre de ses habitants, et que, si leurs souhaits taient exaucs, ils
prpareraient aux nations qui les auraient couts les plus sanglants cataclysmes,
devraient mditer les paroles du savant qui a possd en matire d'agriculture la
plus haute autorit en Europe ; je veux parler de l'illustre Liebig. Voici ses paroles :
Un concours de circonstances a, dans tous les tats de l'Europe, augment la
population dans une proportion qui n'est pas en rapport avec le produit de son sol,
et qui par consquent n'est pas naturelle.
. Dans peu d'annes, les provisions de guano seront puises, et il ne faudra
plus alors de dmonstrations scientifiques ou thoriques pour prouver l'existence de
la loi naturelle qui commande aux hommes de veiller au maintien des conditions de
leur existence et qui chtie cruellement quand on la transgresse. Les peuples seront
forcs, dans l'intrt de leur propre conservation , de se dtruire et de se dchirer
mutuellement pour rtablir l'quilibre, et si, ce qu' Dieu ne plaise, les deux annes
nfastes de 1816 et 1817 venaient se reproduire, on verrait des centaines de
milliers de personnes mourir dans les rues. Que la guerre vienne s'ajouter cette
dsolation, et l'on verra les mres, comme dans la guerre de Trente ans, emporter
les cadavres pour calmer avec cette chair la faim de leurs enfants.
21
Il est impossible d'valuer tous les maux que peut occasionner une nation un excdant de population ; mais
il est possible d'apprcier pcuniairement ce que lui cote cet excdant, lorsque, au moyen d'migrations, elle
arrive s'en dbarrasser. Partant de ce fait, que l'Allemagne lve un excdant de 560,000 enfants sur ce qu'elle
lverait si les naissances, chiffre gal de population, n'taient pas plus nombreuses qu'en France, et
considrant que la plupart des statisticiens valuent 4,000 francs la valeur d'un adulte de vingt ans, le docteur
Bertillon arrive par une simple multiplication cette conclusion, que l'Allemagne dpense annuellement 1
milliard 240 millions pour lever un excdant de population qu'on ne peut considrer comme productif pour
l'avenir, puisqu'il migre en partie. Si notre natalit devenait aussi leve qu'en Allemagne, il nous faudrait
augmenter nos dpenses annuelles de cette somme norme qui reprsente peu prs la moiti du budget de notre
pays. Une notable partie de cet excdant de population se dirigeant vers l'Amrique, c'est en ralit un tribut
annuel fort lev, - on l'value un demi-milliard, - que l'Allemagne paie rgulirement ainsi aux tats-Unis.
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
109
Ce ne sont pas de vaines prophties ni des rves d'une imagination malade, car
la science ne prophtise pas, elle calcule. Ce n'est pas le si, c'est le quand ? qui est
incertain.
Tout homme qui rflchit et qui examine mrement les conditions poses par
les lois de la nature, se convaincra que l'avenir des tats europens n'a pas une base
solide et large, mais qu'il repose sur la pointe d'une aiguille 22.
Je ne crois pas qu'avec les moyens de transport que nous possdons aujourd'hui
les prdictions de Liebig soient prs de se raliser ; elles mritent cependant d'tre
mdites profondment. Presque partout en Europe, en France et en Angleterre
surtout, la consommation dpasse de beaucoup la production, et nous devenons de
plus en plus tributaires de l'Amrique.
Depuis 1826, crit M. Georges Ville, professeur au Museum, nous ne
produisons pas assez pour notre subsistance. Divisez cette priode de 46 ans en
quatre priodes dcennales, mettez en regard pour chacune ce qu'elle a produit et ce
qu'elle a consomm, et vous verrez s'ouvrir devant vous le gouffre bant des
dficits. Suivez, pesez et mditez la gravit de cette progression :
DFICIT ANNUEL EN FRANCS
1827 1836
1836 1846
1846 1856
1856 1868
23,000,000
26,000,000
76,000,000
224,000,000
Et ne le perdez pas de vue ce dficit : je le restreins aux denres agricoles les
plus essentielles. Si l'on allait au del, si on y comprenait le bois de construction et
la laine, on atteindrait le chiffre de 500 millions. C'est celui affirm par M. PouyerQuertier. Au taux de 5 pour cent, l'intrt de 10 milliards 23 .
Depuis que M. Georges Ville a crit ces lignes, le dficit annuel n'a fait
qu'augmenter 24. Tant qu'il ne portait que sur les crales, on pouvait la rigueur, et
22
23
24
Liebig. Die Naturgesetze der Landwirthschaft. Tr. Scheler, tome 1er.
Confrences au champ d'expriences de Vincennes. Revue Scientifique, 1872, p. 735.
En additionnant d'aprs les donnes de l'Annuaire statistique de la France la valeur de tous les objets
d'alimentation imports en 1876, on trouve qu'elle s'lve 745 millions. Dans cette somme les crales figurent
pour 207 millions, les bestiaux pour 179 millions, les viandes fraches ou sales pour 43 millions, etc.
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
110
en ne songeant qu'au prsent, s'en consoler, car plusieurs pays produisent des
excdants dont le transport est facile ; mais, maintenant que le dficit porte sur la
viande, qui de toutes les denres est la moins transportable, la chose est plus grave.
Sa consommation crot depuis quelques annes, en France, avec une rapidit trs
grande, alors que sa production diminue en mme temps trs vite 25, et il en est de
mme, du moins au point de vue de la diminution de la production, dans la plupart
des pays de l'Europe. Jusqu' prsent, ce double mouvement, de consommation
croissante d'une part et de production dcroissante de l'autre, ne s'est encore
manifest que par une augmentation supportable du prix de la viande, parce que
nous empruntons le btail qui nous manque aux nations voisines 26 ; mais ces
nations ne sont pas plus riches en viande que nous. Jusqu'ici elles ont conserv
l'habitude, qu'avait autrefois la majorit de la population en France, de manger trs
peu de viande ; mais, le jour o elles commenceront en consommer autant que
nous, elles se refuseront l'exporter, ou, si elles l'exportent, elles ne le feront que
devant la perspective d'un gain qui en fera hausser le prix un chiffre non
souponn aujourd'hui.
Du chiffre de la production et de la consommation actuelles des denres en
Europe, il est permis de conclure que la population est arrive un chiffre que, sous
peine des plus graves dangers, elle ne saurait dpasser.
Il est possible d'objecter tout ce qui prcde qu'un accroissement de la
population pourrait, condition bien entendu qu'il ne ft pas trop rapide, avoir pour
rsultat de stimuler l'activit et de pousser les habitants d'un pays mieux utiliser
leurs ressources actuelles ou s'en crer de nouvelles. Cela serait vrai dans
L'exportation d'articles similaires ne permet pas naturellement de considrer la valeur totale des objets imports
comme reprsentant un dficit.
25
Voici l'appui les chiffres de la consommation croissante et de la production dcroissante de la viande
depuis vingt ans. J'emprunte les chiffres de la production M. J. Callot, ceux de la consommation M. Block.
1 poids en kilogrammes de btail existant en
France :AnnesKilogrammes18524,994,465,00018624,590,580,00018724,094,726,000
On voit par ces chiffres que nous possdons environ 900 millions de kilogrammes de btail de moins qu'il y
a vingt ans. Voici maintenant le chiffre moyen de la consommation annuelle :
2: Consommation moyenne individuelle de la viande
dans les villes de 10,000 habitants et au-dessus..AnnesQuantit consomme par
individu183948k 6184450k 1185453k 4186256k 6186757k 5187259k 0
Pour les villes de 40,000 habitants et au-dessus, la consommation est de quelques kilogrammes suprieure.
Pour la campagne les chiffres sont peu prs moiti moindres que ceux qui prcdent ; cependant l'usage de la
viande tend galement s'y rpandre de plus en plus.
26
D'aprs la statistique du ministre du commerce, nous avons import en 1876 pour 156 millions de bestiaux.
En 1875, le chiffre de l'importation ne s'tait lev qu' 112 millions.
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
111
certaines limites si l'accroissement portait sur les individus les plus intelligents ;
mais la statistique dmontre que c'est au contraire sur les membres les plus
incapables et les plus misrables que porte gnralement cet accroissement.
L'augmentation de leur nombre n'a par suite d'autre rsultat que d'accrotre les
charges publiques.
Quand on consulte les tables statistiques, on voit que ce sont les contres les
plus pauvres, comme la Bretagne, o la population se multiplie le plus vite, et les
pays les plus riches, comme la Normandie, la Champagne, la Charente, o elle reste
presque stationnaire. Ayant class les dpartements suivant le nombre de
propritaires qu'ils contiennent, M. Bertillon a vu, conformment la thorie, que
ce sont ceux o les propritaires sont le moins nombreux qui possdent le plus
d'enfants.
La mme relation entre la pauvret des habitants et le nombre des enfants
s'observe partout. L'Irlandais ignorant, imprvoyant, vivant dans la misre, pullule
comme le lapin et fournit l'migration anglaise les trois quarts de son contingent,
alors que son voisin l'cossais, instruit, sage et prvoyant, s'accrot lentement. On a
dit avec raison que, dans un pays peupl de mille Saxons et de mille Celtes, les cinq
siximes de la population seront Celtes aprs une douzaine de gnrations ; mais
que le sixime restant, compos de Saxons, possdera les cinq siximes des biens,
du pouvoir et de l'intelligence. Bien qu'tant les moins nombreux, ils deviendront et
resteront les matres, et cela malgr toutes les rvolutions de ceux que, grce leur
intelligence et leur prvoyance, ils auront asservis. Ce n'est pas le nombre, mais la
qualit des habitants d'une contre qui en fait la valeur. Par-del les mers, des
centaines de millions d'Hindous sont mens par quelques milliers d'Anglais.
Favoriser la multiplication des lments infrieurs d'une socit, c'est entretenir
dans cette socit des germes de ruine qui tt ou tard chercheront la dtruire. Il
n'y a point de solution au problme consistant faire vivre dans une civilisation
suprieure des tres qui par leur infriorit et l'incapacit hrditaire n'y sont pas
adapts.
D'o viennent ces malheureux qui forment la lie des grandes villes, remplissent
les prisons et les bagnes et forment une arme chaque jour plus nombreuse, que
chaque rvolution, quel que soit le prtendant soutenir, trouve prte la
dfendre ? De parents que la pauvret a rendus insouciants et qui n'ont pu donner
ces produits inconscients de la misre ni l'ducation qui rprime les instincts
pervers, ni l'instruction qui permet l'homme de gagner sa vie. Dans un pays riche
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
112
ou superstitieux, les pauvres, comme l'a dit Montesquieu, se multiplient parce qu'ils
n'ont pas les charges de la socit, mais sont eux-mmes les charges de la socit.
Un tel danger devait frapper quelques penseurs minents, et il les a frapps. Il en
est mme qui, malgr leurs opinions librales, ont considr comme ncessaire de
restreindre par la force cette multiplication dangereuse des tres infrieurs. Voici
comment le clbre conomiste Stuart Mill s'exprime sur ce point :
Tout homme a droit de vivre, soit ; mais personne n'a le droit de mettre au monde des
tres destins rester la charge d'autrui. Quiconque prtend soutenir le premier de ces
droits doit renoncer au second. Si un homme ne peut vivre que par le secours d'autrui, on
a le droit de lui dire qu'on n'est pas tenu de nourrir tous ceux qu'il lui plaira d'appeler au
monde. Cependant il existe un grand nombre d'crivains et d'orateurs qui, avec des
prtentions normes aux sentiments levs, considrent la vie un point de vue tellement
brutal qu'ils trouvent dur d'empcher les indigents d'engendrer des indigents mme dans la
maison de travail et de refuge. La postrit se demandera quelque jour avec tonnement
dans quelle espce de peuple de tels prdicateurs pouvaient trouver des proslytes.
L'tat pourrait assurer de l'emploi et un ample salaire tous ceux qui sont ns. Mais,
s'il prend cette charge, il est tenu par la ncessit de dfendre son existence et la socit
pour la conservation de laquelle il est institu, en pourvoyant ce que personne ne vienne
au monde sans son consentement. Si les motifs ordinaires et spontans de continence sont
supprims, il faut leur en substituer d'autres. Il serait indispensable en ce cas de mettre
obstacle aux mariages au moins autant qu'en Allemagne, ou de porter des peines contre
ceux qui auraient des enfants lorsqu'ils sont hors d'tat de les nourrir. La socit peut
nourrir les ncessiteux. Si elle est charge de leur multiplication ou si elle est prive de
sentiment pour les pauvres enfants, elle laissera la multiplication des pauvres leur
discrtion et abandonnera le soin de les faire vivre. Mais elle ne peut impunment se
charger de les faire vivre et cependant les laisser se multiplier librement. (Principes
d'conomie politique, 2e d. t. 1, p. 407.)
Je partage entirement, en principe, l'opinion de Mill ; mais je ne crois pas du
tout l'efficacit des moyens de limiter la population qu'il propose. Aucune peine
ne peut effrayer celui qui n'a rien perdre, et pour qui la prison est simplement un
lieu de refuge o il trouve un gte et une nourriture assurs. On avait imagin dans
certaines parties de l'Allemagne d'empcher ceux qui sont sans ressources de se
marier ; mais cela n'a nullement restreint le nombre des enfants. Au lieu d'tre
lgitimes, ils taient naturels.
Un seul moyen, qui n'est gure la porte d'aucun gouvernement, s'est montr
efficace pour limiter le mouvement de la population : c'est l'accroissement de
l'aisance et de l'instruction. Elles provoquent la prvoyance et rendent les mariages
moins prcoces et moins fconds. A mesure que l'aisance et l'instruction se
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
113
rpandent dans un pays, on voit l'accroissement de la population se ralentir, et cette
loi est si gnrale, que l'on pourrait dire que le meilleur moyen de faire baisser le
chiffre des habitants d'un pays est de lui donner de l'instruction et de l'aisance.
La statistique prouve que cette tendance n'avoir qu'un nombre limit
d'enfants, afin de pouvoir leur assurer tout le bien-tre possible, produit les
meilleurs rsultats. Les tableaux dresss par M. Legoyt, ancien chef de statistique
au ministre de l'intrieur, montrent que le plus grand nombre de survivants vingt
ans et la plus longue vie moyenne se rencontrent dans les dpartements o la
fcondit est la moindre.
Le ralentissement constat de l'accroissement de la population en France 1
s'accompagne du reste de l'accroissement du chiffre moyen de la fortune. Suivant
M. Block, la moyenne des successions, qui, dans la priode de 1826-1830, tait de
1,674 fr., est devenue, dans la priode de 1861-1865, de 3,129 fr. Ces successions
sont constitues pour la plupart par des parcelles de terres.
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
114
[NOTE :
Documents statistiques relatifs la population de divers pays. Je runis ici sous forme de
tableaux que je me suis efforc de rendre le plus clairs possible plusieurs documents statistiques
dissmins dans diverses sources et que je n'ai pas voulu introduire dans le texte pour ne pas trop
le charger de chiffres.
1 Accroissement de la population dans les principaux tats depuis quarante ans et nombre
d'habitants par chaque kilomtre carr dans chaque tat.
tats-Unis
Saxe
Angleterre et pays de Galles
Ensemble du Royaume-Uni
Russie d'Europe
Espagne
Prusse
Empire allemand
Autriche
Italie
France
Population
en 1831.
Population
en 1871.
12,886,000
1,402,000
13,896,000
24,392,000
48,381,000
11,207,000
13,038,000
27,270,000
35,087,000
22,369,000
32,569,000
39,925,000
2,556,000
22,712,000
31,845,000
78,308,000
16,900,000
24,639,000
41,058,000
36,155,000
26,801,000
35,970,000
Temps
ncessaire
pour doubler
la population
d'aprs
M.Loua
ans
49
63
72
76
79
81
83
135
202
263
Nombre
d'habitants par
kilom. carr,
(d'aprs l'Ann.
du Bureau des
longitudes pour
1879.)
4
184
101
101
13
33
74
79
68
91
70
Voici, comme complment de ces renseignements, la population par kilomtre carr de
quelques tats non mentionns dans ce tableau : Saxe 184, Belgique 181, Hollande 109, Chine
102 (400 dans certaines provinces), Japon 83, Suisse 65, Indes 60, Hongrie 48, Portugal 44,
Danemark 14, gypte 10 (dans les parties cultivables, comme la valle du Nil, la population
s'lve 170 hab. par kil. carr), Sude 10, Norvge 6, Finlande 4, Brsil 1, Nubie 1, Australie
0,5, Sibrie 0,4, Canada 0,4 (l'accroissement de la population, si lent en France, est d'une rapidit
excessive au Canada o la place ne manque pas.)
Bien que la France soit le pays o la population s'accrot le plus lentement, comme le
montrent les chiffres prcdents, il s'en faut de beaucoup qu'elle soit reste stationnaire. Depuis le
commencement du dernier sicle, elle a en effet presque doubl. En 1700, la population s'levait
en France 19,600,000 ; en 1801, 27,450 ; en 1871, 36,000,000.
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
115
L'accroissement de la population des villes est beaucoup plus rapide que celui de la
population des campagnes. La proportion de la population urbaine, qui tait en France de 25,52
%, en 1851, a t de 32,44 % au dernier recensement de 1876. Voici, d'aprs les donnes de la
statistique municipale, le tableau de l'accroissement de la population parisienne par priode de
dix annes (sauf pour la dernire) depuis le commencement de ce sicle. On manque de
documents bien prcis pour les poques antrieures ; cependant on admet gnralement que Paris
comptait 210,000 habitants seulement il y a trois sicles.
2 Accroissement de la population parisienne
depuis le commencement de ce sicle
Annes
Population.
1801
1811
1831
1841
1851
1876
546,000
622,000
785,000
935,000
1,053,000
1,989,000
Le tableau suivant, dont j'emprunte les chiffres un travail de M. T. Lona sur l'migration
europenne, complte utilement les renseignements qui prcdent, en montrant la ncessit dans
laquelle se trouvent les pays trop populeux d'envoyer dans les pays trangers l'excdant de leur
population.
3 Nombre des migrants anglais et allemands
Priodes
migrants Anglais
et Irlandais
migrants Allemands
1815-1820
1820-1830
1830-1840
1840-1850
1850-1860
1860-1870
1870-1875 (5 annes)
97,799
216,114
669,314
1,494,786
2,439,585
1,859,099
1,530,023
20,000
49,600
220,900
661,223
1,017,022
1,345,904
749,602
Totaux.
8,306,720
4,064,251
Les derniers chiffres de ce tableau ne comprennent, comme on le voit, que 5 annes. Si
l'migration continue dans la mme proportion pour les annes suivantes, elle aura t en
Angleterre, pour la priode de 1870-1880, de 3,060,046, dont prs des trois quarts Irlandais, et en
Allemagne de 1,499,204, chiffres trs suprieurs ceux de toutes les priodes prcdentes. La
plupart de ces migrants se dirigent, sans esprit de retour, vers l'Amrique et sont perdus pour le
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
116
pays qui les a vus natre. De 1790 1875 les tats-Unis ont reu 9,554,000 migrants. Quant au
nombre des migrants Franais, il est presque nul. En 10 ans, en effet, il ne s'est lev qu'
72,000, soit 7,000 seulement par an.
Le nombre des mariages dans divers pays de l'Europe, et des naissances par mariage, est
donn par le tableau suivant, dont j'emprunte les lments M. Loua, chef de la statistique au
ministre du commerce.
4 Nombre de mariages et de naissances dans divers pays.
Priodes
Russie
Hongrie
Allemagne
Autriche
Italie
Angleterre
Belgique
Norvge
Sude
Suisse
France
Nombre de naissances
annuelles par 100 habitants
Nombre de mariages
annuels par 100 habitants
4,72
4,14
3,97
3,93
3,67
3,57
3,25
3,10
3,05
3,04
2,70
1,00
1,08
0,97
0,90
0,79
0,86
0,76
0,78
0,71
0,82
0,88
Ces chiffres varient gnralement peu d'une anne l'autre. Le docteur Bertillon a cependant
montr que, pour la Sude, un des pays les plus instruits de l'Europe, le nombre des mariages
dcroissait rgulirement d'anne en anne, depuis cinquante ans.
Le tableau suivant, dont les lments se trouvent dans l'Annuaire du bureau des Longitudes
pour 1879, montre que ce n'est pas la diminution du nombre d'individus qui se marient, mais
la rduction du nombre d'enfants par mariage, qu'est d l'tat stationnaire de notre population
franaise.
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
117
5 Diminution progressive du nombre d'enfants par mariage en France
depuis le commencement de ce sicle.
Priodes
Nombre de naissances par mariage
Nombre de mariages
annuels par 1,000 habitants
1801
1811
1821
1831
1841
1851
1861
1871
4,2
4,0
3,7
3,3
3,2
3,0
3,0
2,7
7,6
7,9
7,8
8,0
8,0
7,9
8,0
8,0
Je terminerai l'ensemble des documents qui prcdent par le tableau de la dcomposition de la
population franaise selon l'tat civil des habitants, d'aprs le recensement officiel de 1876.
6 Composition de la population franaise selon l'tat civil des habitants.
Clibataires adultes (de 18 ans et audessus pour les hommes, de 15 ans et
au-dessus pour les femmes)
Maris
Veufs
Enfants
Totaux
Sexe
masculin
Sexe
fminin
Totaux
3,752,242
3,999,976
7,752,218
7,588,929
986,129
6,046,339
18,373,639
7,567,241
2,021,065
4,943,867
18,532,44
9
15,156,170
3,007,194
10,990,206
36,905,788
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
118
Cet accroissement gnral de l'aisance est la consquence toute naturelle de la
diminution du nombre des enfants de chaque famille, diminution d'o rsulte l'tat
stationnaire de la population sur lequel se lamentent tant les ignorants. Leur
nombre, qui s'levait au chiffre de 4,2 par mariage au commencement de ce sicle,
n'atteint plus que le chiffre moyen de 2,7 aujourd'hui, ainsi qu'on le voit dans un
des tableaux que j'ai reproduits en renvoi.
L'argumentation qui prcde n'est applicable naturellement qu'aux pays o il y a
quilibre entre l'tat des subsistances et le chiffre de la population. Lorsque les
habitants d'un pays peuvent migrer dans des colonies fertiles et non encore
peuples, sa population peut augmenter sans inconvnient ; tel est le cas de
l'Angleterre et de l'Allemagne, par exemple. Les chiffres que j'ai donns montrent
que, d'aprs l'accroissement annuel actuel, la population ne doublerait en France
qu'en 263 ans, alors qu'elle doublerait en 98 ans en Allemagne et en 63 ans en
Angleterre.
Grce ses colonies, l'Angleterre peut supporter cet excdent, qui ne laisse pas
que d'inquiter profondment au surplus les conomistes prvoyants. L'Allemagne
pourra le supporter aussi jusqu'au jour, qui semble peu loign, o les tats-Unis,
effrays devant le flot envahissant des Germains - ils sont six millions dj -,
chercheront par tous les moyens possibles supprimer leur invasion.
[Note :
L'migration allemande, trs favorise autrefois aux tats-Unis, est considre aujourd'hui
comme une calamit publique. La grande rpublique compte maintenant dans son sein six
millions d'Allemands, la plupart socialistes, qui lui font par leurs grves, leurs journaux et leurs
votes, une guerre redoutable et devant laquelle elle est dsarme. Les lignes suivantes, extraites
d'une des plus importantes revues de l'Amrique, le North American Review (mars 1879), feuille
dont le ton est habituellement celui de la Revue des Deux Mondes, montre quel point
l'exaspration est violente aujourd'hui contre eux :
Abject dans l'adversit, servile quand il est en minorit, l'Allemand devient agressif quand il
a pour lui la fortune et le nombre. Tels nous les avons vus en Europe et ici ......M. H. Seward avait
raison de redouter ces Allemands, qui, au nombre de six millions, forment aujourd'hui une
importante partie de notre population.... Nous discutons perte de vue sur la question de savoir si
le ngre est mr pour la vie politique ; une autre question, bien autrement grave, s'impose nous :
un nouvel ennemi surgit et nous menace d'un conflit prochain entre le capital et le travail, conflit
plus terrible que celui de la guerre de scession et qui soumettra une plus redoutable preuve les
rouages d'un gouvernement trop faible pour y rsister... Nous demandons une rvision complte
des lois relatives l'immigration. Non seulement la population primitive d'origine anglaise ne
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
119
figure plus que pour une moiti sur notre sol, mais l'autre moiti se compose du rebut des autres
nations.
Vux superflus ! la grande rpublique n'a reconnu, jusqu'ici, que la loi du nombre, et elle
devra en subir tous les effets. L'heure n'est pas loin o, presse entre l'immigration chinoise et
l'immigration allemande, elle aura soutenir une des luttes les plus gigantesques dont parlera
l'histoire.
Nous voyons par tout ce qui prcde quel rle important joue dans la vie des
peuples le mouvement de leur population. Aucune tude n'est plus digne de fixer
les mditations des philosophes, des conomistes et des historiens.
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
120
Deuxime partie
LES SOCITS
Leurs origines et leur dveloppement
livre II : Les facteurs de lvolution sociale
Chapitre VII.
Influence de la stabilit
et de l'aptitude varier.
Retour la table des matires; retour au dbut du chapitre
1. Influence de la stabilit. - Importance pour les socits primitives de pouvoir se plier au
joug de rgles et de coutumes. - Supriorit que leur acquisition procure. - Trs difficile tablir
d'abord, la coutume devient bientt toute-puissante. - Sa tyrannie chez certains peuples de
l'antiquit tels que les Grecs. -Puissance absorbante de l'tat. - L'individu lui appartenait tout
entier. - Ncessit d'un tel rgime. - Pourquoi la libre-pense ne pouvait tre supporte dans les
temps antiques. - Rle puissant de la tradition et des coutumes chez les nations modernes. - II.
Influence de la variabilit. - Aprs avoir t une condition du progrs, la fixit des coutumes
devient sa principale entrave. - Peu de socits primitives ayant russi se soustraire au joug de
la coutume, un trs petit nombre ont progress. - Conditions diverses qui favorisent les
transformations des coutumes. - La guerre et les relations commerciales sont les principaux
facteurs de ces transformations. - Ce que deviennent les nations qui ne peuvent se soustraire au
joug de la coutume. - Exemples de l'Inde et de la Chine. - Conclusion.
La premire des conditions de l'volution des tres numres dans notre tude
de la transformation des espces a t leur aptitude varier, c'est--dire s'adapter
aux conditions extrieures. Nous avons montr que plus cette adaptation se faisait
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
121
facilement, c'est--dire plus la race tait apte changer, plus son perfectionnement
tait rapide.
Ce qui est vrai pour les diverses espces vivantes l'est-il galement pour
l'homme, et surtout pour l'homme en socit ? Les socits humaines sont-elles, en
d'autres termes, d'autant plus susceptibles de perfectionnement qu'elles sont plus
aptes varier, ou, au contraire, cette variabilit est-elle un obstacle au progrs ?
C'est ce problme que nous allons chercher lucider maintenant.
I. - Influence de la Stabilit.
Retour la table des matires; retour au dbut du chapitre
Quand nous examinons les populations sauvages qui peuplent encore diverses
parties du globe, nous voyons que les plus infrieures d'entre elles n'ont pour ainsi
dire pas de lois ou de coutumes et ressemblent ces socits dont parle Homre
dans l'Odysse, qui n'avaient point d'assembles pour dlibrer, point de lois, o
chacun commandait ses femmes et ses enfants, et ne s'inquitaient pas les unes
des autres.
Il est facile de comprendre que, dans la comptition universelle qui dut se
manifester aux premiers ges des socits humaines, les groupes qui purent
acqurir quelques traces de discipline, c'est--dire se plier au joug d'une rgle,
obtinrent sur leurs rivaux un immense avantage. Les communauts dans lesquelles
l'autorit des chefs tait assez solidement tablie pour obliger tous les membres
agir simultanment sous une impulsion unique, devaient avoir une supriorit
certaine sur les communauts n'ayant pas le sentiment de la responsabilit
collective, o chacun agissait sa guise et ne se concertait pas avec ses semblables
pour se dfendre contre ses ennemis ou les attaquer.
Ce que nous avons dit de l'tat intellectuel des premiers hommes, qui, de mme
que les sauvages modernes, taient violents et imprvoyants et n'obissaient qu'aux
impulsions du moment, nous permet de pressentir ce qu'il a fallu de sicles et
d'efforts aux socits primitives pour obliger leurs membres obir des coutumes
tablies. Celles-l seules qui y russirent, et ce ne fut pas le plus grand nombre,
sortirent de l'tat sauvage.
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
122
L'tablissement de coutumes fixes auxquelles chacun devait se soumettre donna
aux premiers groupes humains qui purent l'acqurir une supriorit tellement
immense sur les communauts qui ne le possdaient pas, que tous les efforts se
runirent pour conserver l'avantage ainsi acquis. Les rgles tablies eurent bientt
des sanctions religieuses ou pnales si terribles, que chacun redouta de les
enfreindre.
Lorsque l'esprit des premiers hommes fut assez disciplin pour russir se plier
au joug d'une rgle, il leur devint relativement facile de se plier au joug de plusieurs
autres. De nouvelles coutumes s'ajoutrent lentement aux anciennes, et, s'appuyant
les unes sur les autres, elles finirent par former un rseau que tous les efforts des
chefs et des prtres tendirent de plus en plus fortifier. Les mmes influences
continuant agir pendant un grand nombre de gnrations ; la coutume devint si
puissante, que toute la communaut se levait contre quiconque songeait la
transgresser. Quand quelque rare esprit indpendant le tentait, il tait aussitt
limin par une svre slection.
Que cette tyrannie de la loi et de la coutume ft un bien pour les socits
primitives, nous n'en pouvons douter. Elle seule pouvait assouplir les passions
violentes, plier les hommes aux ncessits sociales, les forcer agir dans un but
commun et se respecter entre eux.
Pour comprendre ce que put tre aux temps primitifs le joug de la coutume,
nous n'avons qu' nous reporter aux poques relativement peu loignes o elle
rgnait encore. Il faut avoir aussi peu pntr dans les choses de l'histoire que le
font habituellement les historiens pour croire la libert de la Grce antique et la
vanter. Jamais divinit tyrannique ne tint ses adorateurs plus profondment plis
sous son joug que le furent les peuples les plus civiliss de l'antiquit grecque et
latine sous la main de fer de la coutume. L'tat, c'est--dire le faisceau de lois, de
traditions et d'usages dont il tait le gardien, tait tout et l'individu rien. Aucune
puissance n'et pu sauver celui qui et essay de toucher ce dpt sacr. Et-il eu
la sagesse de Socrate, le peuple entier se ft dress immdiatement devant lui.
L'empire des morts sur les vivants tait alors tout-puissant. De ce que nous
nommons la libert, l'homme n'avait pas mme l'ide. Que les gouvernements
s'appelassent aristocratie, monarchie, dmocratie, aucun d'eux ne tolrait la libert
individuelle, et il est facile de comprendre qu'avec l'troite solidarit ncessaire aux
nations qui voulaient rester puissantes, aucun ne pouvait la tolrer. L'antiquit
grecque ne connut ni la libert politique, ni la libert religieuse, ni la libert de la
vie prive, ni celle des opinions, ni celle de l'ducation, ni enfin nulle libert
d'aucune sorte. Rien dans l'homme, ni le corps ni l'me, n'tait indpendant ; il
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
123
appartenait tout entier l'tat, qui pouvait toujours disposer de sa personne et de
ses biens son gr. ces ges antiques, qu'on nous offre encore, pour modles, il
n'tait pas permis au pre d'avoir un enfant difforme ; et, s'il lui en naissait un
contrefait, cet enfant devait mourir. Sparte, l'tat dirigeait l'ducation, sur
laquelle le pre n'avait aucun droit. La loi athnienne ne permettait pas au citoyen
de vivre l'cart des assembles et de ne pas tre magistrat son tour. Je ne parle
pas de la tyrannie religieuse. Il ne fut mme pas venu un Athnien l'ide de ne pas
croire aux dieux de la cit. Socrate paya de sa vie un tel doute. La loi punissait
svrement quiconque se ft abstenu de clbrer religieusement une fte nationale.
L'tat ne permettait mme pas l'homme les sentiments les plus naturels, et
n'autorisait chez lui qu'une sorte d'immense gosme collectif. Les Spartiates ayant
prouv une dfaite Leuctres, les mres des morts durent se montrer en public
avec un visage gai et remercier les dieux, alors que les mres des vivants devaient
montrer de l'affliction. Quand Rousseau admire ce trait, il montre quel point il
ignorait ce que fut dans l'antiquit la tyrannie de l'tat. La prtendue libert
antique, dont les disciples de ce philosophe ont fait la base de leur systme
politique, n'tait que l'assujettissement absolu des citoyens. L'inquisition, avec ses
bchers, ne me paratrait pas un rgime plus dur.
Mais, si dur que ce rgime puisse nous sembler aujourd'hui, il tait alors une
condition essentielle d'existence, et, avec les ides de ces temps loigns, il ne
paraissait pas dur. A ces poques primitives, si la discussion avait pu tre tolre, si
les bases sur lesquelles la vie sociale reposait avaient pu tre branles, les socits
se seraient rapidement dissoutes. Un agrgat social dans lequel les membres
eussent possd la libert de penser et d'agir, n'et pas subsist longtemps dans
l'tat de guerre gnrale o les socits vivaient alors. Quelques chances qu'ont
les tats libres d'tre dtruits par des forces extrieures, dit justement Bagehot, ils
sont plus exposs encore prir par leurs propres forces.
Il ne faut pas oublier de remarquer, d'ailleurs, que lorsque les traditions et les
coutumes sous le joug desquelles est pli un peuple existent depuis longtemps, ce
joug est accept sans aucune difficult. On considre mme alors comme un
ennemi quiconque cherche s'y soustraire. Il suffit pour le comprendre de voir de
puis combien peu de temps, et avec quelles restrictions, la libert de penser est
tolre dans les pays les plus civiliss, et combien est rare le nombre d'hommes
capables de se soustraire l'influence inconsciente du pass. Des savants de
premier ordre, des hommes politiques minents, habitus ne rien accepter sans
dmonstration, tout soumettre l'analyse et au calcul, professent sur des questions
de morale et de religion des superstitions aussi grossires que celles des plus
misrables sauvages. Si on leur parle des croyances de ces derniers, ils en sourient
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
124
avec piti, sans songer que sur bien des points elles sont identiques aux leurs. Le
pass, qui pse inconsciemment sur eux, est si puissant, que la discussion leur en
est impossible. Mme chez l'homme qui a russi s'y soustraire, l'action de ce
pass est si nergique, qu' son heure dernire elle le ramne souvent aux
superstitions qui pendant tant de sicles furent celles de ses pres.
Quand nous voyons quel point est puissant chez les esprits les plus distingus
l'empire de la tradition et de la coutume, nous comprenons comment l'esprit
d'originalit et de libre pense peut tre si difficilement support. Tolrer des ides
originales, c'est--dire en opposition avec tout ce que nous avons reu de cette
tradition qui fait en quelque sorte partie de nous-mmes, est ce qu'il y a de plus
difficile. Mme dans les temps modernes, o les mthodes critiques sont si
dveloppes, un novateur est plus ou moins un ennemi. On a remarqu depuis
longtemps dj qu'on citerait difficilement une grande dcouverte qui soit sortie du
sein des corporations savantes, et plus difficilement encore quelque grand principe
nouveau qui n'ait pas t perscut par elles.
Ce n'est pas seulement l'influence du pass qui fait que les esprits rellement
originaux sont si profondment rares. Semblable aux autres animaux, l'homme est
naturellement imitatif. L'imitation est un besoin pour lui, condition bien entendu
que cette imitation soit tout fait facile. C'est ce besoin qui rend si puissante
l'influence de ce que nous appelons la mode. Qu'il s'agisse d'opinions, d'ides, de
choses littraires ou simplement de costumes, combien osent se soustraire son
empire ? Ce n'est pas avec des arguments, mais avec des modles, qu'on guide les
foules. A chaque poque, il y a un petit nombre d'individualits qui impriment leur
action et que la masse inconsciente imite. Il ne faudrait pas cependant que ces
individualits s'cartassent par trop des ides reues. L'imitation serait alors trop
difficile et leur influence nulle. C'est prcisment pour cette raison que les hommes
trop suprieurs leur poque n'ont gnralement aucune influence sur elle. L'cart
est trop grand. C'est pour la mme raison que les Europens, avec tous les
avantages de leur civilisation, ont une influence si nulle sur les peuples de l'Orient ;
ils en diffrent trop.
Cette double influence du pass et de l'imitation rciproque finit par rendre tous
les hommes d'un mme pays et d'une mme poque ce point semblables que
mme chez ceux qui sembleraient devoir le plus se soustraire son action,
philosophes, savants et littrateurs, la pense et le style ont un air de famille qui fait
immdiatement reconnatre le temps auquel ils appartiennent. Il ne faut pas causer
longtemps avec un individu pour connatre fond ses lectures, ses occupations
habituelles et le milieu o il vit ; mme dans les grandes capitales, o le milieu est
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
125
si variable, la chose n'est pas trs difficile. Elle est des plus faciles l'gard des
habitants des petites villes de province, o le dfaut de variabilit du milieu
empche l'imitation de s'exercer sur des sujets diffrents. Radicaux et libres
penseurs dans une ville, les habitants sont conservateurs et religieux dans une autre,
suivant les modles qui leur sont le plus souvent offerts. La plus forte raison qu'ont
les hommes d'adhrer une croyance, et il est fort rare que cette raison ne soit pas
la seule, c'est, d'une part, que cette croyance a t celle de leurs anctres, et, de
l'autre, qu'elle est celle de leur entourage. Les croyances peuvent changer parfois de
nom, mais sous leur changeante apparence le philosophe sait reconnatre leur fond
identique. Il considre, par exemple, comme proches parents les socialistes, avec
leurs thories galitaires, les dvots, avec leurs bchers, les rvolutionnaires, avec
leurs guillotine.
Plus nous descendons dans l'chelle des races, plus l'originalit est rare et plus
l'influence de l'imitation est grande. C'est pour cette raison que tous les sauvages
d'une tribu semblent identiques, et que, quand on en connat un, on les connat tous.
L'habitude de se copier exactement les a rendus semblables. Bagehot rapporte,
d'aprs le capitaine Palmer, qu'un chef des les Fiji suivait un sentier de montagne
escort par une longue file d'hommes de sa peuplade, quand il lui arriva par hasard
de faire un faux pas et de tomber ; tous les autres en firent immdiatement autant,
l'exception d'un seul sur lequel les autres se jetrent aussitt pour savoir s'il croyait
mieux valoir que leur chef. Une bande de singes se ft sans doute montre moins
svre pour ce faible indice d'indpendance ; mais il est vraisemblable que dans
une circonstance analogue l'imitation et t identique.
II. - Influence de la Variabilit.
Retour la table des matires; retour au dbut du chapitre
Nous venons de montrer la rigidit des liens qui pendant tant de sicles ont t
l'homme toute libert de penser ou d'agir, et combien cette rigidit avait t
ncessaire. Une telle fixit tant oppose la variabilit, et l'aptitude varier tant
prcisment une condition essentielle de progrs, nous nous trouvons en prsence
du problme suivant : Comment les socits primitives, aprs avoir russi se plier
au joug de la coutume, arrivrent-elles s'y soustraire ? En fait, fort peu y
russirent ; si nous considrons, en effet, l'tat stationnaire de la plupart des nations
qui couvrent la surface du globe, nous devons reconnatre qu'un nombre fort
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
126
restreint d'entre elles ont pu dpasser certaines formes de dveloppement. Nous
pouvons donc dj prvoir qu'indpendamment des raisons de races, de milieux,
etc., que nous n'avons pas examiner maintenant, les conditions qui permettent
un peuple de varier assez pour pouvoir progresser sont d'une ralisation fort
difficile.
Parmi ces conditions, une de celles qui me semblent les plus importantes est la
variabilit du milieu. Il est facile de concevoir que dans un milieu trop homogne
aucun motif de changement ne peut se produire. Nous comprenons aisment, au
contraire, que lorsqu'un peuple intelligent comme les Romains, par exemple, se
trouve ds le dbut de son histoire en lutte avec des nations fort diverses, et,
partant, dans des conditions de milieu fort diffrentes, il est conduit emprunter
chacune d'elles ce qu'elle a d'utile et abandonner ceux de ses usages qui lui ont
donn une infriorit quelconque dans la lutte. Les guerres, les colonisations, les
relations commerciales, tout ce qui, en un mot, tablit entre des hommes d'ides, de
croyances, de costumes et de genres de vie divers un contact plus ou moins
immdiat, et accrot par consquent l'htrognit du milieu, est une cause
permanente de transformation.
Mais, pour qu'une telle cause puisse agir, il faut qu'elle se manifeste une
poque o l'antiquit des coutumes n'est pas telle que toute aptitude varier n'a pas
encore t perdue. Un grand nombre de peuples fort intelligents, Chinois, Hindous,
etc., sont arrivs un certain degr de civilisation, puis se sont arrts et se sont
tellement laiss envelopper par la chane de la coutume, qu'aujourd'hui il semble
que toute volution progressive leur soit impossible, La plupart de ces peuples sont
assez intelligents pour comprendre les avantages de la civilisation europenne, avec
laquelle ils se trouvent parfois en contact, mais il est trop tard maintenant pour
qu'ils puissent se transformer.
On comprend trs bien pourquoi ces peuples ont atteint une certaine phase de
dveloppement et ne l'ont pas dpasse, en admettant que la progression a cess le
jour o, n'ayant plus de guerre soutenir avec leurs voisins, ni de relations
commerciales avec eux, leur milieu est rest le mme. Pendant une certaine priode
de leur existence, des causes diverses, telles que la ncessit pour eux de
perfectionner leurs ressources agricoles, industrielles, commerciales et guerrires
pour lutter contre les difficults de l'existence et l'hostilit de leurs voisins, les ont
forcs subir des modifications plus ou moins profondes. La destruction ou la
soumission des voisins moins forts ayant rendu la lutte inutile, les moyens
d'existence tant devenus suffisants, les relations commerciales ayant cess,
l'organisation agricole, religieuse, industrielle et guerrire n'avait plus de raison de
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
127
changer, et elle n'a plus chang. Le lien des traditions s'est alors appesanti sur eux,
son poids s'est accru chaque gnration, et aujourd'hui il ne peut plus tre bris.
Pour nous, Europens, il ne faut pas nous en plaindre. Ceux qui ont vu Paris, en
1878, la merveilleuse exposition des objets rapports de l'Inde par l'hritier de la
couronne d'Angleterre, ont pu se demander comment deux cents millions d'hommes
chez lesquels les arts et l'industrie ont atteint depuis bien des sicles un tel degr de
dveloppement, peuvent tre asservis par quelques milliers d'Anglais. C'est qu'en
ralit ce n'est pas une poigne de soldats qui les mnent, mais bien leur long pass.
Lui seul est leur matre. Pour un Hindou, renoncer des ides, des murs, des
usages, des habitudes qui taient ceux de ses pres, est impossible. S'ils pouvaient y
renoncer, ils seraient bientt aussi civiliss que leurs vainqueurs, et, grce leur
nombre, en deviendraient les matres.
Tous les peuples qui ont atteint un haut degr de dveloppement dans l'histoire,
comme, par exemple, les Romains dans les temps anciens, et les Vnitiens dans des
temps plus modernes, se sont toujours trouvs, pour des raisons militaires ou
commerciales, en contact avec des peuples divers dont l'influence les a lentement
transforms.
Certes les Romains vivaient sous le joug de coutumes rigides ; mais, obligs de
lutter sans cesse avant de devenir les matres du monde, la ncessit leur avait
montr bien vite l'intrt qu'il y avait pour eux emprunter aux vaincus ce qui
pouvait leur tre utile. Ce ne sont pas seulement leurs armes et leur industrie qu'ils
empruntrent aux autres peuples, mais encore leurs coutumes et parfois leurs dieux.
Les Romains variaient en ralit fort peu, mais cependant ils changeaient ; et,
accumuls par l'hrdit, ces petits changements finirent la longue par tre trs
profonds. Quand Rome devint plus tard la matresse du monde et que la lutte cessa,
elle s'immobilisa, et ce fut l une des causes de sa dcadence.
Nous voyons l'intrt qu'il y a pour un peuple avoir, au dbut de son existence,
une coutume rigide, mais cependant pas assez rigide pour l'empcher de se
transformer d'une faon insensible. Lorsqu'il a laiss des coutumes se fixer pendant
plusieurs gnrations, il ne peut plus changer et devient par suite incapable de
perfectionnement. Il est dans un tat stationnaire auquel les rvolutions les plus
sanglantes ne sauraient rien changer. Elles peuvent briser la chane, mais il arrive
alors ou que les fragments se ressoudent et que le pass reprend son empire, ou que
ces fragments restent disperss, et dans ce cas la dcadence succde bientt
l'anarchie.
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
128
Cette double difficult de possder un faisceau de traditions rigides, mais
cependant assez souple pour pouvoir se transformer, est considrable. L'histoire est
jonche des dbris des peuples qui n'ont pu la rsoudre. Le nombre de ceux, tels
que les Romains dans l'antiquit, les Anglais dans les temps modernes, qui ont pu
maintenir entre ces conditions contraires un juste quilibre, est infiniment petit.
Malgr sa grandeur, cette difficult ne fut mme pas souponne des auteurs de
notre grande rvolution, qui croyaient possible pour un peuple de briser sans retour
avec son pass.
Nous avons dj montr plusieurs fois dans cet ouvrage quel point le pass de
l'homme pse sur lui ; nous venons de voir de nouveau combien cette influence est
lourde, et nous aurons le montrer bien des fois encore. L'homme croit agir comme
il veut, mais dans ce milieu inconscient qu'il ne souponne mme pas, et o
s'laborent les causes de ses actions, toutes les gnrations qui l'ont prcd ont
dpos leurs traces. En vain voudrait-il s'y soustraire, les limites dans lesquelles il
peut s'en carter sont des plus restreintes.
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
129
Deuxime partie
LES SOCITS
Leurs origines et leur dveloppement
livre II : Les facteurs de lvolution sociale
Chapitre VIII.
Influence des grands hommes
et de l'action individuelle
Importance considrable gnralement attribue aux grands hommes par les historiens. Origine de cette croyance. - En quoi elle est errone. - Le rle des grands hommes est beaucoup
moindre qu'on ne le suppose gnralement. -troites limites de leur action. - Leur apport
reprsente l'hritage d'un long pass lentement labor avant eux. - Preuves fournies par l'histoire
des principales inventions. - Machine vapeur. - Poudre canon. - Imprimerie. - En quoi la
supriorit des grands hommes est plus grande dans le domaine scientifique que dans le domaine
politique.
Retour la table des matires; retour au dbut du chapitre
Lorsqu'on ouvre la plupart des livres d'histoire et qu'on recherche les motifs que
les historiens attribuent aux vnements, on y trouve invoqus deux facteurs
principaux, les grands hommes, ceux surtout placs la tte des nations, et la
Providence. L'immense majorit de leurs ouvrages n'est gure compose que de
biographies de rois, de gnraux et d'hommes d'tat. Ce qui est considr
aujourd'hui, par les esprits pntrs des mthodes scientifiques, comme les causes
relles des vnements : milieux, races, croyances, pass, etc., n'y semble mme
pas souponn.
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
130
Les philosophes eux-mmes, du reste, sont venus encourager les historiens dans
ces croyances. Un des plus illustres d'entre eux, Hegel, considre les grands
hommes comme des sortes de demi-dieux dont la puissance cre les tats, et qui
ont transform le monde. Un crivain autrefois clbre, Cousin, fit de leur influence
la base de ses tudes, et comme il fallait un caractre pour reconnatre les grands
hommes, il crut dcouvrir ce caractre dans le succs. Pour lui, le grand homme
tait celui qui triomphait. Le vaincu avait toujours tort. Il faut tre du parti du
vainqueur, crivait-il ; c'est celui de la meilleure cause. Pour Carlyle, imbu
galement des ides de Hegel, le grand homme est un messager du ciel et toutes les
religions doivent s'appuyer sur son culte. Des thories semblables, professes par
d'aussi minents esprits, montrent quel point la servilit est un besoin imprieux
chez l'homme.
Ce n'est qu' une poque rcente que quelques historiens ont commenc
entrevoir que les causes des vnements n'taient pas aussi simples qu'ils l'avaient
suppos jusqu'alors, et que ces vnements avaient des facteurs loigns fort
diffrents de ceux qui leur taient attribus gnralement ; que les grands hommes
taient eux-mmes la rsultante de toute une volution antrieure, et que leur action
et t nulle si elle se ft manifeste une poque autre que celle laquelle elle
s'est prcisment produite ; qu'en un mot ce ne sont pas les hommes qui font les
vnements, mais les vnements qui font au contraire les hommes.
On ne saurait nier sans doute que les grands hommes n'aient une action sur les
vnements. Un homme de guerre peut bien troubler l'volution d'une socit aussi
facilement que nous pouvons, en brisant un oeuf ou une graine, empcher leur
dveloppement, mais il n'a nullement le pouvoir d'en rgler le cours. Trouble au
prix des plus violents efforts, l'volution naturelle des choses reprend bientt sa
marche. Changer sa direction est impossible. Le pouvoir d'un Cromwell et celui
d'un Napolon se sont montrs impuissants accomplir une telle tche. Les grands
hommes qui ont eu un rle durable dans l'histoire sont ceux, comme Csar et
Richelieu, par exemple, qui ont dirig leurs efforts dans le sens des besoins du
moment. Si le rgime inaugur par Csar se perptua pendant des sicles, malgr le
meurtre de son fondateur et de la plupart de ses successeurs, c'est videmment qu'il
tait ncessaire. Quelques sicles plus tt il et t impossible, et si, par un violent
effort, un homme de gnie et t assez puissant pour le fonder, il et bientt
disparu.
Pressentir la direction des vnements et y pousser les peuples, est le seul rle
rel des grands hommes. L'importance d'un tel rle est assez grande pour qu'il soit
inutile de l'exagrer encore.
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
131
Qu'il s'agisse de politique, de science ou d'industrie, l'apport qu'une individualit
puissante fait son poque est toujours en ralit fort petit si on compare ce qu'il
lui donne, ses ides, ce qu'il lui emprunte, c'est--dire l'hritage de toute
l'exprience accumule par les sicles qui l'ont prcd.
Il peut sembler, au premier abord, facile de rpondre une telle assertion en
montrant les rsultats gigantesques de certaines inventions, telles que la vapeur, les
chemins de fer, la tlgraphie lectrique, etc. ; mais l'ide qu'on se fait
gnralement de la gense de ces inventions est habituellement trs fausse. Une
grande dcouverte n'est jamais sortie de toutes pices du cerveau d'un seul homme,
elle est la consquence d'autres recherches accumules pendant des sicles. Quand
ces matriaux ainsi accumuls sont assez nombreux, il se trouve un homme
suprieur qui les runit et apporte l'tincelle qui en fait jaillir la lumire. Sur ces
fondations lentement construites la dcouverte apparat alors tout coup. Sans ces
fondations, elle tait impossible.
Ce n'est pas ainsi, sans doute, que le vulgaire comprend les grandes inventions
et tous les progrs accomplis dans les diverses branches des connaissances
humaines. Leur appliquant la thorie si simple du grand homme en histoire, il croit
que chaque invention est luvre d'un seul homme, et devant chacune d'elles il veut
mettre un nom d'inventeur. Les thories sur lesquelles elles reposent, les
expriences dont elles sont le rsultat ont exig des sicles pour tre tablies, mais
de ces thories, de ces fondements, hritage d'un long pass, il n'aperoit que le
couronnement. La thorie, il l'ignore ou la ddaigne tant qu'elle n'a pas produit un
rsultat pratique bien visible pour lui. Il et ddaign les observations de Galile
sur l'isochronisme des oscillations d'une lampe suspendue, sans se douter que de ce
fait thorique devait rsulter l'art de mesurer le temps et tous les perfectionnements
de l'horlogerie moderne qui permettent au navigateur de dterminer avec exactitude
sa position sur l'Ocan. Il et ddaign aussi cette observation d'Oerstedt qu'un
courant lectrique qui parcourt un fil de cuivre plac au-dessus de l'aiguille d'une
boussole la dvie, sans se douter qu'elle devait provoquer toute une srie de
recherches d'o le tlgraphe lectrique devait natre un jour.
Pour comprendre l'absurdit des ides qui ont gnralement cours sur les
inventions, il faudrait examiner successivement chacune d'elles et tracer l'histoire
de leurs origines. Une telle tche tant impossible dans cet ouvrage, je me bornerai
indiquer la gense de quelques-unes des plus importantes.
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
132
Prenons la machine vapeur, par exemple. Elle se compose d'lments trs
divers ayant exig chacun des recherches considrables. A cette question : qui l'a
invente ? on peut rpondre qu'il n'a jamais exist la surface de notre plante un
cerveau humain capable lui seul d'une telle conception. Pour que la machine
vapeur ft possible, il fallait savoir extraire le fer, le forger, le transformer en
plaques de tle, savoir alser les cylindres, connatre les proprits de la vapeur
d'eau, trouver le moyen de la faire arriver tantt sur une des faces du piston, tantt
sur l'autre, savoir s'en dbarrasser immdiatement quand elle a cess d'agir, etc.,
srie de dcouvertes capitales qui ont exig d'innombrables recherches.
De mme pour toutes les dcouvertes les plus importantes, la poudre canon et
l'imprimerie, par exemple. De telles inventions sont galement trop complexes pour
avoir pu sortir du cerveau d'un seul homme. Ce ne fut pas plus Roger Bacon qui
inventa l'une que ce ne fut Gutenberg qui cra l'autre. La poudre canon sortit, par
une srie de transformations graduelles, de ces mlanges combustibles connus sous
le nom de feu grgeois et qui n'taient autre chose que des poudres trs imparfaites.
On remplaa le naphte par du charbon, on y ajouta du salptre, on modifia les
anciennes proportions, et finalement la poudre, avec ses proprits explosibles, se
trouva cre.
De mme encore pour l'imprimerie. Son ide premire est d'une antiquit bien
haute, car, ds le temps des Grecs et des Romains, l'impression avec des planches
de bois portant des caractres sculpts en relief tait connue. Au moyen ge, on s'en
servait pour imprimer sur des cartes jouer des dessins et mme de l'criture. Les
lettres mobiles elles-mmes taient connues, puisqu'elles servaient pour apprendre
lire aux enfants et pour marquer le front des esclaves ; mais on ne songea pas
les utiliser la reproduction des manuscrits, pour cette excellente raison surtout que
le besoin ne s'en faisait nullement sentir. Le nombre des lettrs tait petit et les
copistes suffisaient largement tous les besoins. Le moment n'tait pas venu.
Lorsque parut Gutenberg, il en tait tout autrement. Les lettrs se multipliaient
tellement que le nombre des copistes tait devenu insuffisant. L'attention tant
attire sur les moyens de reproduire facilement des copies d'un mme livre,
Gutenberg s'occupa du problme, perfectionna les caractres mobiles, remplaa les
lettres de bois par des lettres de mtal et rendit leur impression facile ; mais il ne fit
en ralit que transformer des procds connus. Il est parfaitement absurde, comme
le fait remarquer un auteur fort comptent en ces matires, M. Firmin-Didot,
d'admettre qu'un homme ait pu trouver du premier coup cette srie d'oprations
compliques qui constituent l'art du typographe.
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
133
Des dcouvertes capitales comme l'imprimerie, la machine vapeur, la
tlgraphie lectrique, ne sont donc, je le rpte, que la consquence dernire d'une
srie d'anciennes dcouvertes, et ne peuvent se faire que lorsque ces dcouvertes
prparatoires ont t accomplies. Il faut, en outre, qu'elles apparaissent un
moment o elles peuvent tre utilises. De quel usage et t l'imprimerie une
poque o l'immense majorit des hommes ne savait pas lire ? la poudre canon,
aux ges o on n'aurait pas su fabriquer les tubes mtalliques qui doivent la
contenir ? le tlgraphe lectrique, quand les communications entre les peuples
taient rares ou n'existaient pas, et lorsque du reste les connaissances techniques
taient trop peu dveloppes pour permettre de fabriquer les matriaux divers dont
cet instrument se compose ?
C'est donc une erreur laquelle nous devons entirement nous soustraire, que de
prtendre que les progrs politiques, industriels ou sociaux sont luvre de
quelques hommes suprieurs. Il ne sont en ralit que la consquence de la lente
accumulation de recherches nombreuses.
Ce serait tirer de ce qui prcde des conclusions trs fausses que de vouloir ter
aux grands hommes leur mrite et tenter de les rabaisser au niveau de la multitude.
La nature a fait les hommes profondment ingaux, et ce n'est pas un
physiologiste le mconnatre. Pour tre autre que ce qu'on le croit gnralement,
le rle des hommes suprieurs est cependant trs rel. De ce que leur emprunt au
pass soit immense et leur apport petit, il n'en est pas moins vident que les
services qu'ils rendent sont trs grands, et qu'il leur faut une intelligence de
beaucoup au-dessus de celle de leurs contemporains pour voir des consquences
qui avaient chapp leurs devanciers et secouer les prjugs du pass. Quand on
sait de quel poids ce pass pse dans les mobiles de nos actions, il faut reconnatre
que les hommes capables de s'y soustraire, tels que Christophe Colomb, par
exemple, sont aussi suprieurs la moyenne des hommes de leur temps que cette
moyenne peut l'tre celle des derniers sauvages.
Dans le domaine politique, la supriorit des grands hommes, quoique
infiniment moindre que dans le domaine scientifique, est galement relle. Il faut
videmment un jugement trs sr pour deviner le sens de l'volution d'une poque.
Il ne faut pas pourtant que leur supriorit intellectuelle sur la foule soit trop
grande, sous peine de perdre toute influence sur elle. Les conditions qui les font
russir rsident surtout, du reste, dans le dveloppement de leur caractre. Ce n'est
pas avec le langage de la raison, mais avec celui du sentiment, qu'on se fait couter
des hommes.
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
134
On conoit facilement qu'en ce qui concerne les dcouvertes scientifiques,
mres des perfectionnements industriels et de toutes les transformations sociales
qui en sont la consquence, la supriorit des grands hommes doit tre intellectuelle
au contraire. Leur action directe sur la foule est nulle. Ils s'en cartent trop et n'ont
pas de points communs avec elle. Cela importe peu, car les vrits qu'ils mettent en
lumire, qu'elles aient leur application aujourd'hui ou dans cent ans, ne seront pas
perdues. Et quand on considre combien sont profondes les transformations opres
dans l'existence des hommes par l'application de quelques principes scientifiques,
on ne peut s'empcher de reconnatre que cette petite phalange de chercheurs que
chaque nation renferme et ne protge gure constitue cependant son plus sr trsor.
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
135
Deuxime partie
LES SOCITS
Leurs origines et leur dveloppement
livre II : Les facteurs de lvolution sociale
Chapitre IX.
Influence de la race.
Retour la table des matires; retour au dbut du chapitre
1. Diversit du caractre des races. Importance de cette tude. -L'ide que l'homme est le
mme dans tous les pays a t longtemps gnrale. - Erreur de cette conception. - Diversit du
caractre des races. - Anciennet de la formation de leurs caractres. - Leur permanence. - Le rle
historique de chaque race dpend de son caractre. - II. Composition des races qui constituent les
nations modernes. - Influence des croisements sur la formation des caractres nationaux. - Toutes
les nations modernes sont formes par des mlanges de races diffrentes. - Exemples fournis par
les Franais, les Allemands, les Juifs, etc. - III. Influence des lments qui entrent dans la
constitution d'un peuple sur son volution sociale. - Variation des rsultats suivant les lments
mis en prsence. - Leur influence sur la forme des gouvernements. - Dangers de croiser des races
trop diffrentes. Ces dangers ont t mconnus par des nations modernes. - La communaut des
sentiments est beaucoup plus importante pour un peuple que celle du langage. - Rsultats produits
par le contact de races trs diffrentes. - Exemples fournis par les Anglais, les Irlandais, les
Ngres, les Indous, les Chinois et les Amricains. - Envahissement prochain de la race jaune. IV. Nature des diffrences existant entre les diverses races et entre les individus d'une mme
race. - Les diffrences de sentiment et d'intelligence existant entre les hommes tendent-elles
s'effacer ou s'accrotre ? - Recherches anatomiques de l'auteur pour rsoudre cette question.
V. Accroissement des diffrences existant entre la femme et l'homme dans les races suprieures.
L'ingalit entre les races diffrentes et entre individus d'une mme race s'accentue de plus en
plus avec le dveloppement de la civilisation. - VI. Accroissement des diffrences existant entre
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
136
l'homme et la femme dans les races suprieures. - Explication psychologique du fait anatomique
que dans les races suprieures l'homme et la femme tendent se diffrencier de plus en plus. Nature des diffrences intellectuelles et morales existant entre les deux sexes. - Incapacit de la
femme raisonner ou se laisser influencer par un raisonnement. - Son habitude de se laisser
guider par l'instinct du moment. - Exagration de ses sentiments. - Elle est plus rapproche de
l'enfant et du sauvage que de l'homme. - Inconvnients de lui donner la mme ducation qu'
l'homme.
I. - Diversit du caractre des races.
- Importance de cette tude.
Retour la table des matires; retour au dbut du chapitre
Les observateurs qui ont tudi la nature humaine ailleurs que dans les livres
sont toujours frapps, en parcourant les ouvrages des historiens et des
psychologistes, d'y voir l'homme reprsent comme identique partout lui-mme,
quels que soient les temps ou les lieux qui l'ont vu natre. Qu'il s'agisse d'un hros
de la Grce ou de Rome, d'un sauvage, d'un Turc, d'un Byzantin, d'un Hindou ou
d'un seigneur de la cour de Louis XIV, tous pensent, agissent, raisonnent comme
auraient pu raisonner en semblable circonstance les contemporains de l'auteur qui
les met en scne. Les personnages des tragdies de Corneille et de Racine n'ont
jamais appartenu aux ges bibliques ou l'antiquit latine. Ils ont vcu en ralit
aux temps des potes qui les ont fait agir. Leur idal de la vertu et des devoirs de
l'homme est celui de l'auteur qui les fait parler. Les sauvages de Rousseau sont des
philosophes raisonneurs remplis des abstractions de l'poque. Voulez-vous
connatre les Grecs et les Romains, disait Hume, tudiez les Anglais et les
Franais ; les hommes dcrits par Tacite et Polybe ressemblent aux habitants qui
nous entourent.
Cette conception si errone de la nature humaine est encore celle de la plupart
des historiens, celle surtout des psychologistes. Bien peu comprennent que des
races diverses puissent avoir des modes de penser, de sentir absolument diffrents,
et par suite ne pas tre influences par les mmes motifs, avoir des idals de morale
et de croyances entirement opposs ; que les institutions, les murs d'un peuple, le
rle grand ou petit qu'il joue dans le monde sont le rsultat de son caractre, c'est-dire de cet ensemble de sentiments que chaque homme apporte en naissant,
ensemble variable suivant les lieux, plus ou moins diffrent dans chaque race, et
qui dtermine sa faon de sentir et de ragir.
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
137
C'est cette communaut de sentiments dans les mmes circonstances chez la
plupart des individus d'une mme race qui constitue le caractre national. Il est
form dj chez l'individu qui vient de natre et reprsente l'hritage d'un pass
d'une immense longueur que chacun de ses anctres a contribu former. La part
qu'il reoit du pass en naissant est infiniment grande, si on la compare celle qu'il
recevra de son milieu intellectuel et moral, et c'est pour cela que chez les peuples
comme chez les individus rien n'est plus difficilement modifiable que le caractre.
Ce n'est pas le prsent qu'il faut tudier quand nous voulons comprendre l'volution
d'un peuple, c'est son pass surtout. Ces morts qui dorment depuis des sicles au
fond de leurs tombeaux ont sur nous une influence telle, que nous n'essayons mme
pas de nous y soustraire. C'est dans ce pass inconscient que nous apportons en
naissant, que s'laborent les motifs de nos actions.
Si loin que nous puissions remonter dans l'histoire, nous trouvons dj les
caractres des peuples tout tracs. Les ncessits qui les ont engendrs ont agi sans
doute pendant des priodes de temps fort longues avant de les dterminer ; mais,
une fois fixs, ils ne se modifient plus qu'avec une extrme lenteur. Rien n'est plus
permanent que le caractre national d'un peuple. Il y a dix-huit cents ans que Csar
dpeignait le caractre de nos pres sous des traits auxquels il y aurait aujourd'hui
bien peu changer : Les Gaulois, dit-il, ont l'amour des rvolutions ; un revers les
abat ; ils sont aussi prompts entreprendre des guerres sans motifs que mous et
sans nergie l'heure des dsastres. Le Grec de nos jours, comme le faisait
remarquer Ampre, a encore tous les dfauts et les qualits d'autrefois. Le Byzantin
du moyen ge avait tous les caractres de ses anctres. Quand on s'enfonce, crit
M. Ribot, dans les in-folio peu frquents de l'histoire du Bas-Empire, on est
tonn de voir combien ce peuple, qui s'appelait romain, malgr ses traditions
latines, son fonctionnarisme imprial, ses moeurs importes d'Orient (les eunuques,
le souverain par et ador comme une idole) et son christianisme troit, est rest
grec au fond. Il y a l une curieuse tude de psychologie historique. Le Byzantin a
gard du Grec, outre la langue et les traditions littraires, une finesse qui, n'ayant
plus de force pour soutien, dgnra en ruse mesquine. L'amour du Grec pour le
beau langage et les discussions brillantes devint le bavardage byzantin ; la subtilit
sophistique des philosophes, la scolastique vide des thologiens ; et la souplesse du
Graeculus, la diplomatie perfide des empereurs. C'est le Grec de Pricls, mais
dessch et l'tat snile.
Il en est de mme pour les Germains d'aujourd'hui ; ils sont rests ceux de
Tacite : De grands corps blancs, flegmatiques, avec des yeux bleus farouches et
les cheveux d'un blond rougetre ; des estomacs voraces, repus de viande et de
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
138
fromage, rchauffs par des liqueurs fortes ; un temprament froid, tardif pour
l'amour, le got du foyer domestique, le penchant l'ivrognerie brutale : ce sont l
encore aujourd'hui, crit M. Taine, les traits que l'hrdit et le climat maintiennent
dans la race, et ce sont ceux que les historiens romains leur dcouvrent, d'abord,
dans leur premier pays.
mesure qu'on pntre plus profondment dans l'tude de l'histoire, on
reconnat bientt que c'est surtout l'tat de son caractre qu'est d le rle que joue
telle ou telle race dans le monde. J'ai dj cit, en les comparant, les tats-Unis et
les rpubliques espagnoles de l'Amrique, et dit que les causes de la grandeur des
uns et de l'tat de misrable anarchie des autres, bien que leurs institutions soient
semblables, doivent tre recherches principalement dans les diffrences de leurs
caractres.
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
139
II. - Composition des races qui constituent
les nations modernes.
Retour la table des matires; retour au dbut du chapitre
Malgr leur persistance, les caractres nationaux ne sont pas toujours
invariables. Certaines ncessits les ont crs, d'autres ncessits peuvent les
transformer, et l'on soutiendrait difficilement, je crois, qu'un Romain de la
Rpublique avait le mme caractre que son descendant du temps de Caracalla et
d'Hliogabale. Nous avons assist de nos jours la formation de caractres
nationaux nouveaux, ceux des habitants des tats-Unis d'Amrique, assez diffrents
de ceux de la race anglaise, d'o ils proviennent. Des ncessits diffrentes, des
conditions nouvelles d'existence ont suffi dterminer rapidement cette
transformation.
Parmi les agents de transformation du caractre national, le plus puissant, et
vrai dire le seul rapidement puissant, est constitu par les croisements. Chacun des
lments en prsence apportant le caractre propre que lui a lgu son pass, il peut
rsulter de cette association, si ces lments ne sont pas trop divergents, la
formation de nouveaux caractres. C'est surtout ces croisements qu'est due la
formation des caractres des nations modernes.
Il n'existe gure aujourd'hui, en effet, de races homognes ; on ne les rencontre
plus que chez quelques populations infrieures dont tous les individus sont
tellement semblables, que quand on en a vu un, on connat tous les autres. En
Europe, nous n'avons que des mlanges, et, sans vouloir entrer dans des dtails qui
m'entraneraient trop loin, je rappellerai succinctement ce que l'anthropologie nous
a appris sur ce point.
En ce qui concerne la France, par exemple, que l'on dit nation latine, on peut
affirmer que, si elle tient des Romains sa langue et bien des ides, elle ne se
rattache en aucune faon eux par le sang. Les anthropologistes sont tous d'accord
sur ce point :
Quoique, dit M. Lagneau, les Romains aient eu longtemps dans les Gaules de
nombreuses armes, une administration considrable ; quoique leur commerce y ft trs
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
140
tendu ; quoiqu'ils aient impos aux habitants non seulement leurs institutions, mais voire
mme en partie leur langue, leurs caractres graphiques, surtout dans les villes et les
rgions mditerranenne et rhodanienne ; bien qu'ainsi que les Grecs, leurs prdcesseurs,
ils aient fait adopter plus ou moins leur religion en assimilant les divinits gauloises aux
dieux du paganisme par eux adors, l'influence anthropologique des Romains sur notre
population parat avoir t minime, soit par suite de leur dissmination extrme au milieu
des nombreuses populations des vastes contres qui composaient leur empire, soit aussi
par la diversit des lments ethniques de ce peuple dominateur, mlange de Pelages, de
Sicules, d'trusques, de Ligures, de Grecs, d'Ombres, etc.
En France, crit un autre savant anthropologiste, le Dr Topinard, il y a des Franais,
mais pas de races franaises. On y dcouvre : au nord, les descendants des Belges. des
Wallons et autres Kymri ; l'est, ceux des Germains et des Burgondes ; l'ouest, des
Normands ; au centre, des Celtes qui, l'poque mme o leur nom prit naissance, taient
forms d'trangers d'origines diverses et d'autochthones ; au midi enfin, des anciens
Aquitains et des Basques, sans parler d'une foule de colonies, comme les Sarrasins qu'on
retrouve et l, les Tectosages qui ont laiss Toulouse l'usage des dformations
crniennes et les trafiquants qui passrent par la ville phocenne de Marseille.
De mme pour les Anglais, composs d'un croisement de la population primitive
du sol avec des Saxons, des Danois, des Angles. etc., lments du reste assez
homognes. Le fond germain y a domin, et c'est lui videmment que reviennent
l'esprit srieux, le got de la famille, le sentiment du devoir, la patience et la
persvrance qui contrastent avec l'impressionnabilit, la lgret et l'insouciance
de l'Irlandais d'origine celte.
L'Allemagne, aussi, est constitue par des mlanges assez variables, suivant ses
provinces. L'influence slave, finnoise, celte y est trs manifeste, ainsi que celle du
sang mongol. C'est peut-tre ce dernier qu'est d le ct dur, goste et brutal du
caractre allemand, trs frappant pour l'observateur dans certaines provinces.
Si nous passons maintenant au sud de l'Europe, nous ne rencontrons galement
que des nations constitues par des mlanges. Les Espagnols, par exemple, sont
forms par la fusion d'lments beaucoup plus dissemblables encore que ceux que
nous avons eu l'occasion de mentionner. C'est d'une part, la race primitive du sol et
de 1'autre diverses populations europennes (Celtes et Romains) et africaines.
L'Espagne fut, comme on le sait, possde par les Maures pendant plusieurs sicles.
Le sang africain y est facile reconnatre et peut-tre est-ce son influence qu'est
d ce fait que 1'Espagnol est le peuple qui se croise le plus volontiers avec les
ngres,croisement qui rpugne la plupart des autres nations.
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
141
Les Juif eux-mmes qui ont pass si longtemps pour une race pure sont
constitus, au contraire, par des mlanges trs htrognes de Slaves et de Smites.
Il existe en effet, parmi eux deux types extrmement distincts, spars par un
vritable abme : le Juif dit allemand, d'origine slave et le Juif espagnol ou
portugais seul vrai descendant des Hbreux de la Palestine. On sait maintenant que
les Juifs dits allemands si nombreux dans nos provinces de I'Est et Paris ne sont
nullement de race juive : ce sont des descendants de Slaves, de Germains et de
Tatars convertis au judasme du VIII au IX sicle de notre re et en particulier de
Tatars du nord de la mer Noire. L'influence juive s'exera d'abord sur des peuplades
des bords du Volga, et se propagea de proche en proche jusqu'aux provinces
mridionales de l'Allemagne 27.
Malgr l'influence considrable des croisements. les transformations de
caractre dont est susceptible une race ne sont pas aussi profondes qu'on pourrait le
croire : les lments divers qu'elle contient se juxtaposent plutt qu'ils ne se
fusionnent et l'hrdit les maintient pendant longtemps.
Si tous les individus d'une mme race finissent par prendre un aspect gnral qui
les fait reconnatre au premier abord, et permet de distinguer, par exemple, d'un
coup d'il, un Anglais d'un Franais, c'est que chez des individus toujours en
contact, il s'tablit une sorte d'influence rciproque qui fait qu'aussi bien pour la
langue que pour les manires, la conduite, le style, chacun se modle
inconsciemment sur ses voisins ; mais ce n'est l, en ralit, qu'un vernis qui ne fait
que recouvrir des tendances trs diverses, filles de passs fort diffrents. L'hrdit
finit quelquefois par les fusionner ; mais, si elles sont trop divergentes, la fusion
est, comme nous allons le montrer, impossible.
III. - Influence des lments qui entrent
dans la constitution d'un peuple
sur son volution sociale.
Retour la table des matires; retour au dbut du chapitre
27
La conversion de populations au judasme est fort rare dans l'histoire, le Juif se souciant beaucoup plus
d'amasser de l'argent que de faire des proslytes. On trouvera les dtails relatifs l'origine des Juifs-Allemands
dans les tomes Il et VI du Bulletin de la Socit d'Anthropologie de Paris.
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
142
Les mlanges de races peuvent avoir, suivant les lments mis en prsence, des
rsultats tout fait avantageux, ou au contraire tout fait funestes.
Si le mlange est form par des lments qui, au lieu d'tre en opposition, se
compltent, les qualits d'une race peuvent s'ajouter aux qualits de l'autre et
former un tout suffisamment homogne. La nation anglaise en est un exemple.
Si les deux peuples qui s'unissent sont fort diffrents, non seulement par leur
tat de civilisation actuelle, mais surtout par leur pass, le Blanc et le Noir, par
exemple, il peut se prsenter plusieurs cas que nous allons considrer
successivement ; mais, dans tous ces cas, les rsultats sont toujours nuisibles et
montrent que le plus grand danger qui puisse exister pour un peuple est la prsence
sur son sol de races trop diffrentes.
Admettons d'abord que les races mises en prsence, bien que d'intelligence peu
diffrente, aient des caractres trs dissemblables : l'Anglais et l'Irlandais, par
exemple. Leur mlange tant impossible, il arrivera forcment que la race la plus
forte asservira la plus faible et ne pourra maintenir la soumission que par une
compression trs dure. Un rgime de fer seul peut faire vivre sous les mmes lois
deux races aussi dissemblables. Nous comprenons ce que put tre autrefois
l'nergie de la rsistance oppose, quand nous voyons prescrire, sous le rgne
d'lisabeth, la destruction des bestiaux et de la culture de plusieurs comts
irlandais, pour y faire mourir de faim les habitants qu'il tait impossible de russir
exterminer autrement, et nous pressentons facilement l'intensit des haines rgnant
alors, quand nous voyons un pote comme Spencer dcrire avec complaisance les
horribles tortures de cette famine prmdite. Aujourd'hui encore l'Irlandais prfre
migrer en masse ds qu'il le peut, que de vivre sous les lois de l'Angleterre, et
quand il quitte la patrie, ce n'est pas, comme l'crivait rcemment un tmoin
oculaire d'un dpart d'migrants, sans tourner vers la mtropole ses poings
menaants et jurer d'obtenir vengeance lui ou ses descendants.
Quand les deux races en prsence diffrent absolument par l'intelligence, le
caractre, les gots, les ides, le genre de vie, le sort de la plus faible n'est pas
seulement d'tre asservie, comme dans le cas prcdent, mais encore d'tre bientt
dtruite. L'Amricain qui ne vit que d'agriculture, l'Indien qui l'a en horreur et ne
pourrait se rsoudre habiter une maison, ne sauraient vivre sous les mmes lois.
Massacr directement ou tu par la faim, le plus faible n'a qu' disparatre.
Lorsque les deux races en prsence, bien qu'tant de caractres et d'intelligence
fort diffrents, arrivent se mlanger, l'Espagnol et le Ngre ou l'Indien, par
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
143
exemple, le rsultat, pour tre moins funeste en apparence que dans les cas
prcdents, n'est cependant pas sensiblement meilleur. Au lieu d'exister d'un
individu l'autre, l'antagonisme des lments contraires existe alors chez le mme
individu. Les aptitudes hrditaires contraires des parents qui ont contribu le
former luttent sans cesse entre elles, et il obit tantt l'une, tantt l'autre, sans
pouvoir adopter une rgle fixe de conduite. L'existence misrable des rpubliques
hispano-amricaines, voues une perptuelle anarchie, est la preuve des mauvais
rsultats que produisent les croisements entre race trs diffrentes. Sans prtendre
que c'est uniquement leurs croisements avec les barbares qu'est due la dcadence
des Romains, on ne peut nier que ces croisements y aient fortement contribu. La
participation des plbiens aux prrogatives patriciennes, celle des villes italiennes
et des peuples conquis au droit de cit, affaiblirent bientt ce qui faisait la force des
Romains, le culte de Rome.
Il y a donc des cas, et ces cas sont les plus nombreux, o les conqurants
doivent viter tout prix de se mlanger au peuple conquis. Je ne saurais approuver
le dur rgime auquel l'Angleterre a condamn l'Inde, mais je ne saurais non plus la
blmer d'avoir repouss tout mlange avec la race conquise et cart soigneusement
tous les mtis des affaires. L'union de l'Anglais et de l'Hindou, dit Bagehot, donne
un produit qui n'est pas seulement entre deux races, mais entre deux morales. Ceux
qui ont cette origine n'ont pas de croyance hrditaire, pas de place marque pour
eux dans le monde ; ils n'ont aucun de ces sentiments traditionnels et bien arrts
qui sont les soutiens de la nature humaine.
L'histoire de notre poque nous montre combien certaines nations ont mconnu
les ncessits rsultant des antagonismes crs par la diversit des races mises en
prsence. Sans doute les motifs rels de la guerre de la scession ont t tout autres
que la suppression de l'esclavage ; mais le fait seul qu'on ait pu prendre pour
prtexte de donner les mmes droits politiques un ngre et un blanc, sera
certainement, pour l'historien de l'avenir, connaissant les diffrences immenses de
sentiments et d'intelligence qui sparent les deux races, un sujet d'tonnement
profond. Il n'aura pas besoin de rechercher quelles furent les consquences du
rgime accord au ngre, pour deviner que le rgime qui convenait au blanc a d
lui tre fatal. Il devinerait facilement aussi, mme si l'histoire ne lui en disait rien,
qu' partir du jour o le ngre fut libre son niveau intellectuel et moral dut
considrablement baisser et sa mortalit s'lever en mme temps dans une
proportion trs grande. L'nergie, la prvoyance, la persvrance, le got du travail,
l'empire sur soi, l'initiative, le sentiment de la famille sont des qualits que
l'hrdit peut donner, mais qu'aucune institution ne saurait crer. La destine du
ngre en Amrique est forcment celle-ci : retomber dans un esclavage dguis,
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
144
pire que l'ancien, parce que personne n'aura alors intrt le mnager et
l'amliorer, ou prir sous l'influence des vices qu'il a emprunts la civilisation, et
qui taient les seuls emprunts qu'il ait pu lui faire. Tant qu'elles ne possdent pas le
niveau de sentiments que certaines civilisations leves comportent, les races
infrieures ne peuvent prosprer que dans la servitude.
La prsence du ngre sur le sol des tats-Unis ne saurait donc, pas plus que la
prsence du Peau-rouge, constituer un danger bien srieux pour les Amricains.
Que le ngre finisse comme le Peau-rouge, par tre parqu dans des territoires o
on ira l'exterminer sur une grande chelle, comme on le fait pour ce dernier, quand
il essaiera d'en sortir, ou que sa destine soit celle que j'ai mentionne plus haut, il
ne sera jamais bien srieusement craindre.
Ce qui constitue un danger bien autrement rel pour la grande rpublique, c'est
la prsence en proportion chaque jour croissante de deux lments trop levs par
l'intelligence pour pouvoir tre dtruits, trop divergents par leur caractre pour tre
assimils. Je veux parler de l'lment allemand, auquel j'ai dj fait allusion, et de
l'lment chinois dont je parlerai bientt. La statistique montre que le moment o
l'lment anglais ne sera plus en majorit aux tats-Unis est proche. On n'entrevoit
aucun autre moyen de maintenir en paix sur le mme sol des lments anims de
tendances si diffrentes qu'une dictature militaire trs dure. C'est par elle sans doute
que se terminera la premire phase de l'histoire de cette rpublique.
Le lecteur doit comprendre maintenant le rle que jouent dans l'volution d'une
socit les lments qui la composent. La communaut de langage est au fond peu
de chose ; ce qui importe, c'est cette communaut de sentiments qui fait que tous
les individus pensent d'une faon peu diffrente sur des sujets semblables, et sont
disposs se conduire d'une mme faon dans des cas analogues. C'est dans cette
communaut de sentiments que rside la force de l'Anglais. Chacun en naissant
apporte le mme sens pratique, le mme respect de l'ordre tabli, la mme
initiative, la mme habitude de se gouverner sans matre, le mme idal du devoir.
Une semblable communaut de sentiments est loin d'exister malheureusement
chez les races latines, et au premier rang des causes de dcadence prochaine qui les
menacent, je placerai certainement des divergences de sentiments qui sont
beaucoup plus encore le rsultat de diffrences ethniques, que de diffrences
d'ducation ou de condition d'existence.
En examinant plus haut les cas divers qui peuvent se prsenter lorsque des races
diffrentes sont en prsence, nous avons mentionn celui o l'une des deux races
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
145
asservissait l'autre sans se mlanger elle, ce qui est le cas de l'Anglais et de
l'Hindou, par exemple ; mais nous n'avons pas envisag encore les rsultats que
peut amener cet asservissement. Ils sont trop importants pour l'volution prsente
ou future des socits pour qu'il ne soit pas ncessaire de les exposer avec quelques
dtails.
Deux cas peuvent se prsenter : ou la race conqurante ne fait pas peser
durement son joug sur le vaincu, ou elle l'appesantit, au contraire, et considre ce
dernier comme une mine qu'elle a le droit d'exploiter entirement. Dans le premier
cas, c'est--dire si le joug du vainqueur est tolrable, le vaincu, moins
d'incompatibilit de caractre trop grande, l'accepte bientt, et les intrts du peuple
conqurant et du peuple conquis finissent par devenir communs. Tel fut le cas des
mahomtans dans l'Inde. Il serait difficile d'admettre que, en dehors de l'poque de
la conqute proprement dite, ce joug ait t intolrable, puisque les vaincus
adoptrent bientt la religion du vainqueur, et qu'il y a encore soixante millions de
sectateurs de Mahomet dans cette partie du globe.
Si, au lieu d'tre dbonnaire, le vainqueur impose un joug pesant, et s'il se borne
l'exploitation pure et simple du vaincu, ce dernier se soumet tant qu'il ne peut
faire autrement, mais avec l'ide constante d'une revanche prochaine, et tt ou tard
l'heure de cette revanche arrive quand la disproportion numrique entre
l'envahisseur et l'envahi est trop grande. Tel est le cas de l'Inde actuelle et de tous
les pays o les Anglais ont pu, comme en Chine, par exemple, imposer leurs lois.
Le rgime que les peuples civiliss imposent aujourd'hui aux nations conquises, ou
simplement soumises, est doux en apparence quand on le compare celui de ces
conqurants asiatiques qui dtruisaient tout sur leur passage, et pourtant jamais les
destructions d'hommes par les barbares n'ont gal en nombre les destructions
indirectes causes par les invasions des peuples civiliss modernes.
La preuve de cette assertion est facile. Laissons de ct les races tout fait
infrieures, comme les habitants de l'Ocanie, que les nations civilises ont peu
prs entirement dtruites en quelques annes, anantissant certains peuples, tels
que les Tasmaniens, jusqu'au dernier homme ; laissons galement de ct les
Peaux-rouges de l'Amrique extermins par le fer et la faim et dont les derniers
disparatront bientt ; laissons de ct encore les ngres, exclusivement exploits
par les blancs, qui, au dire de sir Bartle Frere, enlvent encore 500,000 hommes par
an l'Afrique, et ne parlons que des Hindous et des Chinois. Ce ne sont pas
assurment des races trs infrieures, car leur civilisation n'est pas au-dessous de ce
qu'tait la ntre au moyen ge. Des deux contres habites par ces peuples, l'une,
l'Inde, a t conquise par l'Angleterre, l'autre, la Chine, a seulement subi ses lois.
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
146
Voyons quels sont aujourd'hui les rsultats de ce contact de races aussi diffrentes,
et essayons de pressentir ce qu'il est appel produire dans l'avenir.
Aucun peuple n'est assurment plus mthodique que l'Anglais, et aucun ne
laisse moins de part au sentiment dans la politique. Tout est calcul d'avance et
soumis des lois fixes. Le systme colonial de l'Angleterre est simple et pratique ;
il repose essentiellement sur ces principes que la colonie, appartenant ceux qui
l'exploitent, doit produire le plus possible, qu'il faut tablir une barrire
infranchissable entre les vaincus et les vainqueurs, n'excuter de travaux comme les
routes, les chemins de fer, etc., que quand ils peuvent avoir une utilit stratgique
ou commerciale pour le conqurant. Si le vaincu n'est utilisable en aucune faon,
comme le Peau-rouge ou l'Australien, on lui applique la loi du plus fort, et on
l'extermine en masse ou on l'expulse simplement du territoire envahi. Priv de
ressources, il meurt de faim et sa race disparat rapidement.
Appliqus avec rigueur dans cette vaste colonie de deux cents millions
d'hommes qu'on appelle l'Inde, ces principes ont considrablement enrichi
l'Angleterre, mais en mme temps ils ont ruin la colonie, et cela un tel point, que
les hommes d'tat anglais sont effrays aujourd'hui, - non bien entendu du sort de
ces deux cents millions d'hommes, - mais de l'puisement prochain de cette source
de richesses. Chacun reconnat maintenant que les taxes ont dpass l'extrme
limite du supportable et que en beaucoup d'endroits, - c'est un Anglais, M.
Hyndman qui parle, - la population vit plus mal qu'autrefois et meurt presque de
faim. Montrant que, d'une part, l'Angleterre accable d'impts les indignes, alors
que de l'autre elle a ruin toutes leurs manufactures pour favoriser les importations
anglaises, l'auteur que je viens de citer ajoute : Nous marchons une catastrophe
sans pareille dans l'histoire du monde. Cette prdiction peut sembler pessimiste ;
elle ne l'est gure cependant quand on considre que dans la seule province de
Madras il y a, suivant la statistique officielle, seize millions de pauvres. Les
malheureux habitants sont obligs non seulement d'entretenir une arme qui cote
plus de quatre cents millions, une administration qui en cote cinquante, mais
encore d'envoyer annuellement l'Angleterre l'quivalent de cinq cents millions 28.
28
Le travail de M. Hyndman, d'o j'extrais ces chiffres, a paru dans The Ninetienth Century sous ce titre : la
Banqueroute de l'Inde, et a produit une grande sensation en Angleterre. Les diverses rponses qui y ont t faites
n'ont port que sur des dtails et n'ont pas modifi la valeur des faits tablis par l'auteur. Le tribut annuel de 500
millions que l'Angleterre retire de l'Inde n'a pas t contest ; on a discut seulement sur le nom qu'il fallait lui
donner. M. J. Morley, rpondant M. Hyndman dans la Fornightly Review, se borne dire propos de ce
drainage annuel de 500 raillions : Cette sorte d'coulement est certes chose grave. Le difficile serait de le
ralentir. La seule excuse faire valoir est que c'est la condition invitable de toute nation gouverne longue
distance par des trangers. Qu'on l'appelle tribut ou autrement, cet argent n'est pour les peuples de l'Inde que le
prix d'un gouvernement pacifique et rgulier. Je me demande ce que le cultivateur hindou, qui meurt de faim
parce que l'Anglais lui a tout pris, peut bien penser d'une telle excuse. Le prix de ce gouvernement pacifique et
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
147
La somme retire depuis vingt ans de l'Inde, par l'Angleterre, est value dix
milliards, sans compter l'argent dpens pour entretenir les conqurants, dont
chacun reoit pour son sjour dans la colonie un traitement de souverain. Le sjour
des fonctionnaires aux Indes est limit cinq ans, parce que l'on considre qu'aprs
ce dlai, ils doivent avoir ralis une brillante fortune. On aura une ide de leurs
dpenses, en sachant que le gouverneur de Bombay ayant dsir rcemment une
maison de campagne, le gouvernement lui a allou immdiatement 4,375,000
francs pour cet achat. Chose effrayante, dit M. Hyndman, les provinces du nordouest en taient rduites exporter leurs grains, alors que trois cent mille personnes
y mouraient de faim en quelques mois , et il rappelle qu'en 1877, dans la seule
prsidence de Madras, neuf cent trente-cinq mille personnes sont mortes de faim,
suivant les rapports officiels. Cette situation ne fait qu'augmenter, car la fertilit du
sol diminue rapidement par l'abus des cultures puisantes que ncessitent les
exigences des impts. Citerait-on un conqurant asiatique ayant fait autant de
victimes ? La dmonstration du fait que j'ai nonc en commenant est-elle
suffisamment complte ?
On conoit que le vaincu ne se plie pas une exploitation semblable sans
quelques rcriminations. Ce n'est que grce un rgime de fer qu'elles sont
touffes.
Les murs anglaises dans l'Inde sont odieuses et bien faites pour exciter la haine
contre leurs auteurs et leurs sectateurs , crit dans son livre sur l'Inde un ministre
plnipotentiaire franais, le comte de Rochechouart ; les Anglais sont des matres
srieux, ils n'ont pas la main lgre, et lorsqu'ils croient leurs intrts engags, ils
n'hsitent devant n'importe quelle mesure. L'histoire est remplie de traits qui ne font
honneur ni la gnrosit, ni mme la parfaite bonne foi des chefs de cette nation. Ces
faits n'ont pas t de nature augmenter les sympathies des trangers, et ont provoqu des
haines qui ont rsist au temps, et dont rien ne peut effacer les traces. Nulle part ces
haines ne sont plus vivaces qu'aux Indes et en Birmanie. L'histoire de la conqute du
Bengale renferme des dtails qui font que les noms de Warren, Husting et de lord Clive
sont synonymes de mensonge. Ce qui frappe le plus l'tranger ds qu'il met le pied dans
les Indes, c'est le mpris de l'indigne pour ses matres. Les Anglais ont bien des esclaves,
mais n'ont ni amis ni sujets.
La seule consolation de l'Indien soumis au rgime dont je viens de parler, c'est
l'espoir d'une prochaine et sanglante revanche : Les haines s'accumulent, crit le
rgulier doit lui sembler cher. Il n'y a pas d'excuse au pillage systmatique d'un pays ni la destruction de ses
habitants par la faim ; il n'y a qu'une raison donner : la loi du plus fort. C'est la seule qu'aient invoque les
diffrents conqurants qui ont envahi le pays, mais qui ont su cependant s'y maintenir sans se faire har, comme
le prouve ce fait qu'il y a soixante millions de mahomtans aux Indes, alors que les pasteurs anglais n'ont jamais
pu y faire de proslytes.
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
148
mme auteur ; survienne un incident insignifiant, imprvu, comme celui auquel on
attribue la dernire rbellion, en un clin dil la rvolte sera gnrale. L'Indien se
prpare sans cesse pour cet instant. Une secte, les Wahabites, vivant sur les
frontires, et considre par le gouvernement anglais, qui n'a jamais pu la
soumettre, comme un de ses plus redoutables ennemis, se maintient en levant dans
chaque village des taxes volontaires d'argent et d'hommes qui, malgr la pauvret
des habitants, ne sont jamais refuses.
Rien n'est plus humiliant pour l'Europen que de voir la haine et le mpris
qu'prouvent pour lui les peuples de l'Orient. Cette hypocrisie, qui nous fait afficher
des principes de haute morale alors que nous leur dclarons des guerres
meurtrires, sans autres motifs que celui de nous enrichir en les exploitant sans
merci, leur est spcialement odieuse. Ce n'est pas seulement l'Indien qui mprise
l'Europen ; chez le Chinois, le mme sentiment est aussi profond. Le diplomate
que je citais plus haut, et qui a vcu longtemps dans l'extrme Orient, s'exprime
ainsi ce sujet :
En Chine, les domestiques des blancs sont pleins de honte vis--vis de leurs
compatriotes d'tre obligs de subir leur contact... Malgr l'anciennet de nos
rapports avec ces peuples, nous n'avons pu encore forcer la porte de leur intrieur et
nous crer avec eux des rapports de socit suivis. A Pkin, par exemple, il existe
un seul Chinois qui nous invitait parfois dner, et il a par ce fait perdu toute la
considration de ses voisins ; je me souviens qu'au moment du massacre de
Tientsin, il vint me faire une visite, et comme je le remerciais de cette dmarche
trs courageuse pour un Asiatique : Ne me remerciez pas, me dit-il
mlancoliquement, s'il vous arrivait malheur, je serais galement tu.
Jamais le Romain n'a produit sur les peuples qu'il a coloniss une impression
pareille celle que produisent les blancs actuels sur les races infrieures. Le Peaurouge lui-mme a une triste ide de notre morale. Un Cheroki lettr, cit par M.
Dixon dans son livre sur la conqute blanche, crivait navement dans un journal
l'usage de ses compatriotes, propos de la supriorit reconnue par lui du blanc sur
l'Indien : En tant que peuple, nous ne sommes point aptes encore devenir des
citoyens amricains. Ce n'est pas que nous ne soyons suffisamment intelligents,
probes, industrieux ; mais nous n'avons ni la connaissance, ni l'habitude des fraudes
et des artifices dont la condition de libert autorise sinon encourage l'emploi vis-vis des gens confiants, et qui sont considrs comme un droit national.
Quant la triste opinion du Chinois l'gard de l'Europen, il faut avouer que
rien n'est plus justifi, et que l'histoire des relations de l'Europe civilise avec ce
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
149
pays au dix-neuvime sicle sera l'une des plus tristes pages de l'histoire de notre
civilisation. Nos descendants sont peut-tre appels l'expier chrement un jour.
Que pensera-t-on dans l'avenir de cette sanglante guerre, dite de l'opium, o la
Chine se vit force coups de canon d'accepter l'opium que les Anglais avaient
introduit chez elle, et que le gouvernement chinois, effray des dangers qui
rsultaient de son usage, voulait proscrire ? Aujourd'hui ce commerce rapporte, il
est vrai, cent cinquante millions par an l'Angleterre ; mais, d'aprs les valuations
les plus modres, celle du docteur Christlieb notamment, l'opium fait prir
annuellement six cent mille Chinois. La sanglante guerre de l'opium et le
commerce forc qui l'a suivie restent dans les souvenirs des Chinois comme un
exemple destin enseigner leurs enfants la valeur morale de ces Occidentaux
qu'ils persistent, - est-ce bien injustement ? - qualifier de barbares. Quand les
missionnaires anglais veulent les convertir, ils leur rpondent, au dire de l'auteur
que je citais plus haut : Quoi! vous nous empoisonnez pour nous dtruire et vous
venez aprs nous enseigner la vertu ! Sans doute le Chinois a tort en raisonnant
ainsi, car il ne comprend pas que l'Anglais possde hrditairement des maximes
d'une morale spciale fort rigide qu'il doit satisfaire, et qu'il satisfait en payant des
missionnaires destins prparer l'Asiatique la vie ternelle laquelle le conduit
rapidement l'opium qu'il lui vend : ce qui rappelle ce mot d'un correspondant de la
Gazette d'Auqsbourq, pendant la guerre, que les Anglais vendaient des armes aux
Franais pour tuer les Allemands, et du coton bon march aux mres et veuves
allemandes pour qu'elles puissent essuyer leurs larmes.
Mais les Chinois ne sont pas une race aussi infrieure qu'ont pu le faire supposer
aux Europens leurs conqutes faciles. Leur haine pour notre morale, notre religion
et nos murs ne les a pas empchs de comprendre les causes de notre force, et la
Chine subit en ce moment une transformation dont ne se proccupent gure les
hommes d'tat, mais dont il est facile ds aujourd'hui de prvoir les consquences.
Sa religion, ses moeurs sont trop anciennes pour pouvoir tre transformes ; mais
elle emprunte l'Europe ce qui fait sa force : ses connaissances militaires et ses
armes. J'ai dj dit qu'ils traduisent nos ouvrages de tactique militaire, et que dans
leur rcente guerre avec le Turkestan, ils avaient fait usage de canons Krupp et
d'armes tir rapide. Ils ne se sont pas borns ces acquisitions importantes, et
ayant vite reconnu que l'industrie du blanc ne dpassait nullement leurs capacits,
ils sont venus lui faire concurrence chez lui. L'Amrique a t un des premiers pays
envahis. Comme le Chinois est sobre, travailleur, intelligent, qu'il n'a pas de
besoins, et qu'un peu de riz et de th lui suffit, il peut travailler un prix trois fois
moindre que l'ouvrier amricain. On le reut donc d'abord bras ouverts ; mais
quand on vit qu'il accaparait une une toutes les industries, qu'il fabriquait mieux
que ses matres des objets qu'il n'avait jamais vus auparavant, comme des bottes
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
150
anglaises et du drap anglais ; qu'on pouvait l'employer tous les travaux et qu'il les
comprenait tous ; en un mot, que l'ouvrier amricain n'avait plus qu' se croiser les
bras, ce fut un soulvement gnral, chacun rclamant grands cris qu'on arrtt
cette invasion, et rcemment la ville de San-Francisco, qui renferme soixantequinze mille Chinois dans son sein, demandait au Congrs de frapper d'une taxe de
1,250 francs tout Chinois nouvellement dbarqu, et d'en limiter l'introduction. Il y
a dj longtemps que le gouvernement anglais avait frapp d'une taxe leve tout
individu de race jaune qui pntrait en Australie.
Je ne dirai pas que rien n'est plus injuste que de semblables mesures, car la
justice est un sentiment dont les peuples, comme les rois, ne tiennent compte que
quand il ne s'agit pas de leurs intrts ; mais je ferai observer que, mme en forant
la Chine recevoir les Europens chez elle et lui dfendant de laisser sortir ses
nationaux, il sera bien difficile d'expulser ces derniers du pays o ils sont installs,
ou simplement de les parquer dans un dsert et de les tuer coups de fusil, comme
cela se pratique l'gard des Peaux-rouges, quand la famine les obligerait sortir
de leurs enclos. Ce serait porter un coup funeste des industries dont ils sont
devenus aujourd'hui des agents indispensables. Il ne faut pas oublier non plus que
les Chinois, qui nous connaissent aujourd'hui, savent trs bien qu'ils sont quatre
cents millions et que rien ne leur sera plus facile avant longtemps que de pouvoir
leur tour expulser les trangers. Ils ont du reste entre les mains des moyens de
reprsailles plus puissants ; car avec les progrs de leur industrie ils peuvent porter
aux races blanches des coups redoutables. Ils ont dj nos armes, et commencent
connatre et pratiquer nos industries. Ils n'ont pas encore nos chemins de fer, mais
le jour o ils les auront, ils pourront, avec leurs aptitudes industrielles, le bas prix
de la main-duvre dont leur sobrit excessive leur permet de se contenter, leurs
richesses houillres, qui, au dire du gologue Richthofen, sont les plus
considrables du monde, faire aux manufactures anglaises une concurrence
mortelle. Les obliger prendre de force l'opium anglais et leur dfendre d'exporter
leurs marchandises, cela peut se faire tant qu'on est le plus fort ; mais la Chine sera
bientt assez puissante pour se dfendre, et elle se rappellera alors que si
l'Angleterre est bien loin, les frontires de l'Inde sont bien prs, et que au-del de la
Chine avec ses quatre cents millions d'habitants, il y a deux cents millions
d'Hindous, parmi lesquels trois millions de Chinois, et, sur l'autre ct de la
frontire, quatre-vingts millions de Russes prts prendre part la lutte
gigantesque dont l'Orient est destin devenir bientt le thtre. La civilisation a
bris la grande muraille de la Chine et sem la ruine dans ces contres lointaines.
Par un juste retour des choses, qui prouve que les violations des lois morales
s'expient toujours, le flot dont nous avons bris les digues dborde maintenant, et,
de tous les dangers auxquels les peuples civiliss sont exposs, cette invasion est le
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
151
plus grand peut-tre. Les Chinois n'ont pas encore migr en Europe, mais le
moment n'en est pas loin. Tout rcemment, des journaux anglais discutaient l'utilit
de les introduire en Angleterre pour permettre aux patrons de lutter contre les
grves. Une fois que l'Europe aura t envahie par eux, on pourra prvoir le jour o
, grce leur fcondit, leur habilet, aux minimes exigences que rend seule
possibles leur extrme sobrit, ils amneront, par leur concurrence, la disparition
de toute la population industrielle et agricole dont le niveau ne leur serait pas trs
suprieur, c'est--dire du plus grand nombre. Il n'y a que pour les travaux d'ordre
suprieur que leur concurrence n'est pas craindre, parce qu'un cerveau de Chinois
ne saurait dpasser un certain niveau. Je ne considrerais pas comme une hypothse
de ralisation impossible celle d'un avenir o la race jaune, actuellement la plus
nombreuse et la plus fconde de toutes, remplirait le monde et laisserait seulement
vivants les types les plus levs de la race blanche qu'une slection rpte, rsultat
de la concurrence, aurait fini par rendre trs suprieurs ce qu'ils sont maintenant.
Mais ce sont l des hypothses ralisables seulement dans un avenir lointain.
Les soucis dont la race jaune menace aujourd'hui la race blanche sont assez graves
pour qu'il y ait lieu de ne se proccuper que du prsent. Nous avons t semer la
guerre et la discorde chez ces nations lointaines, et troubler leur repos sculaire.
C'est leur tour maintenant de troubler le ntre. La lutte la plus gigantesque peuttre dont parlera l'histoire est celle qui, pour un avenir prochain, se prpare
actuellement en Asie. Aujourd'hui l'Angleterre est au fate de la puissance ; elle
rgne sans rivale sur les mers, gouverne l'cosse, l'Irlande, l'Australie, le Canada et
les Indes, protge la Turquie et l'gypte, se fait craindre de la Russie et force la
Chine subir ses lois. Elle est au sommet de la grandeur, mais elle y chancelle.
England totters at the apex of her greatness , crivait rcemment le plus
important des journaux anglais, et un des plus illustres hommes d'tat de
l'Angleterre, M. Gladstone, jetant, dans un article clbre (Kin beyond the sea), un
oeil inquiet sur l'avenir, prdisait la suprmatie prochaine des tats-Unis et la ruine
de l'Angleterre.
La grandeur des tats-Unis y sera pour beaucoup sans doute, et la dcroissance
constante, depuis dix ans, des exportations anglaises, dont le chiffre est maintenant
de prs de 4 milliards infrieur celui des importations, est la preuve du coup
terrible qu'a reu le commerce de l'Angleterre. Chaque anne elle exporte moins de
fer, de machines, de cotonnades, alors qu'elle est oblige d'importer plus de viande,
de crales et de denres coloniales. Mais bien d'autres causes de ruine la
menacent. Les haines qu'elle a souleves partout sont terribles, mme dans son
sein. L'Irlandais lui a vou une implacable rancune qu'il fait jurer ses fils, et il
n'attend qu'une occasion propice pour se soulever et demander compte de tant de
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
152
sicles d'oppression. Le jour o deux cents millions d'Hindous crieront vengeance
pour tant de millions d'tres tus par la faim, o quatre cents millions de Chinois,
leurs voisins, se souviendront qu'ils ont t dcims par l'opium, et o la Russie,
dont les frontires avoisinent l'Inde et la Chine, trouvera l'occasion favorable, que
deviendra la puissante Angleterre ? L'histoire seule rpondra cette question, mais
nous pouvons facilement prvoir que si elle doit sombrer dans quelque gigantesque
cataclysme, les inimitis des races soumises ses lois en seront la principale cause.
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
153
IV. - Nature des diffrences existant
entre les diverses races et entre les individus
d'une mme race.
Retour la table des matires; retour au dbut du chapitre
Ce serait le moment maintenant de dfinir nettement en quoi consistent ces
diffrences de sentiments et de caractre qui existent entre les diverses races et
entre les individus d'une mme race, et qui, filles d'un long pass, ne sauraient tre
modifies que par un long avenir. Les exemples qui prcdent ont montr quel
point les aptitudes des races diverses taient incompatibles, et nous avons
mentionn en passant la nature de quelques-unes de ces diffrences. Nous verrons
en quoi elles consistent, en tudiant les conceptions des divers peuples relatives la
morale, au droit, aux croyances. Les exposer ici, en dtail, serait impossible, car
une telle tche comprendrait elle seule plusieurs volumes. Les diffrences
intellectuelles et morales des diverses races ne sauraient, en effet, tre apprcies
qu'au moyen d'exemples montrant leurs rsultats et dont la runion constituerait en
ralit l'histoire de la civilisation de ces races. Se borner de sches numrations
et dire, par exemple, que l'Anglais est froid, tenace, mthodique, manque de got, a
les sens mousss par son milieu, est sensible au confortable, insensible aux ides
du beau et de l'lgance, et a pour besoin prdominant l'action ; ajouter ensuite que
l'Italien a des aptitudes prcisment contraires, ne peut avoir d'intrt que lorsqu'on
montre ces races voluant sous l'influence de leurs caractres, dans l'histoire.
C'est surtout en ce qui concerne les aptitudes intellectuelles que l'apprciation
des diffrences est difficile et ne peut se formuler qu'en s'appuyant sur de nombreux
exemples. Je me bornerai faire remarquer qu'on apprcie le plus souvent fort mal
la nature des diffrences existant dans la constitution intellectuelle de deux
individus donns, et que ce n'est pas par un examen superficiel qu'on peut dclarer
que l'un est suprieur l'autre. Ce ne sera certainement ni l'instruction plus ou
moins grande, ni le plus ou moins de succs obtenu dans la vie, qui pourraient
servir de guide. En ce qui concerne le succs, il est bien vident, en effet, qu'une
intelligence brillante, mais que n'accompagnent pas certaines qualits de caractre
comme la persvrance, la hardiesse, etc., par exemple, russira bien moins qu'une
intelligence beaucoup moins haute, mais ayant son service une tnacit considrable et sachant concentrer toutes ses facults sur un seul point. Les plus illustres
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
154
spcialistes ne possdent souvent qu'une intelligence trs ordinaire, mais
accompagne d'une persvrance trs grande. En ce qui concerne l'instruction, il est
non moins vident encore que ce n'est pas la plus ou moins grande somme de
connaissances que l'individu a pu acqurir qui peut servir de guide pour apprcier
l'tat de son intelligence ; ce serait mettre la mmoire au-dessus des facults
cratrices. Des inventeurs de gnie n'ont eu souvent leur service qu'une somme de
connaissances trs infrieure celle que possdaient des individus fort obscurs et
qui mritaient de rester obscurs. Les enfants des ngres russissent aussi bien dans
les tudes classiques, qui n'exigent gure que des efforts de mmoire, que les
enfants des blancs, et on a remarqu en Amrique que lorsqu'on donnait la mme
instruction aux garons et aux filles, les secondes l'emportaient souvent sur les
premiers. Je doute cependant que l'on puisse trouver un psychologiste moderne qui
voudrait en conclure que l'intelligence du ngre est gale celle du blanc, et que la
capacit intellectuelle de la femme est suprieure celle de l'homme.
S'il fallait absolument donner, en quelques mots, une formule pour mesurer
l'intelligence, je dirais, en rsumant ce que j'ai dj expos dans un autre chapitre,
qu'elle peut s'apprcier par le degr de l'aptitude associer - nullement accumuler
- le plus grand nombre d'ides et percevoir le plus nettement et le plus rapidement
possible leurs analogies et leurs diffrences. Une intelligence infrieure ne pourra
gure associer plus de deux ides la fois, et ne verra que leurs diffrences ou leurs
analogies apparentes. L'Esquimau sait que la glace fond dans la bouche ; il voit un
morceau de verre, substance qui ressemble la glace, et en conclut immdiatement
que le verre doit fondre dans la bouche. Des associations d'ides analogues sont la
base de toutes les croyances des tres infrieurs. Ce sont elles qui font croire
certains peuples qu'en mangeant la chair du tigre, on acquiert la bravoure de cet
animal, et qu'on s'expose, au contraire, devenir pusillanime comme le daim,
quand on se nourrit de la chair de ce dernier.
mesure qu'on s'lve dans l'chelle de l'intelligence, on voit se dvelopper
l'aptitude associer un plus grand nombre d'ides, et saisir derrire les apparences
leurs ressemblances relles et leurs diffrences. La baleine ressemble beaucoup
plus un poisson qu'a un cheval ou un lapin, et cependant le savant sait qu'entre
les deux premiers la ressemblance n'est qu'apparente, et, grce son aptitude
associer par la pense un grand nombre de caractres, il voit que la baleine est
beaucoup plus voisine du cheval et du lapin que du poisson.
Ce n'est que quand cette aptitude associer des ides et saisir leurs rapports
est trs dveloppe que peuvent se produire de grandes dcouvertes. C'est parce
qu'ils la possdaient un haut degr que Ocken reconnut l'analogie du crne et des
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
155
vertbres, Goethe, celle de la fleur et de la feuille ; Davy, celle de la potasse et des
oxydes mtalliques. Quand Newton identifia la chute d'un corps pesant sur la terre
avec l'attraction qui s'exerce entre les corps clestes, et que Franklin considra
l'tincelle lectrique et la foudre comme des manifestations du mme phnomne,
ils mettaient en jeu cette facult. C'est elle qui montre au gnral, sur le champ de
bataille, aussi bien qu'au savant dans son laboratoire, quelles sont, parmi les
associations possibles des lments qu'ils ont entre leurs mains, les combinaisons
qui donneront l'un la victoire, l'autre la dcouverte d'un fait nouveau. Cette
aptitude l'association des ides, et par suite aux gnralisations, c'est--dire la
runion dans un mme cadre de choses semblables, fait peu prs entirement
dfaut chez la femme, l'enfant et les tres infrieurs, et c'est en grande partie de son
absence que rsultent leur manque de logique et de mthode, leur incapacit
raisonner ou se laisser influencer par un raisonnement, et leur habitude de n'avoir
que l'impulsion du moment pour guide.
Je ne saurais entrer actuellement dans plus de dtails sur les diffrences
d'intelligence et de sentiments qui existent entre les diverses races et entre individus
d'une mme race. Elles apparatront, comme je l'ai dit plus haut, mesure que nous
avancerons dans cet ouvrage. Ce qu'il importe de retenir maintenant, c'est que ces
diffrences sont souvent trop profondes pour ne pas rendre impossible une
communaut d'existence entre certains individus et certaines races. Les exemples
prcdemment cits l'ont suffisamment dmontr.
L'existence de ces diffrences tant prouve, sans qu'il soit actuellement besoin
de nous appesantir sur leur nature, nous nous trouvons en prsence d'un problme
d'une importance sociale trs grande, et que nous devons essayer de rsoudre. Ce
problme est celui-ci : les diffrences existant entre les diverses races et entre les
individus d'une mme race, tendent-elles avec le temps s'effacer ou s'accrotre ?
V. - Les diffrences existant entre les races diffrentes et
entre individus de mme race tendent-elles s'effacer ou
s'accrotre ?
Retour la table des matires; retour au dbut du chapitre
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
156
Le problme que je viens d'noncer a une importance sociale considrable, et
cependant on ne voit pas qu'aucun observateur ait encore essay de le rsoudre. Il
est pourtant impossible de jeter le moindre regard sur l'avenir des socits actuelles,
sans savoir au pralable si les diffrences qui existent entre les races, et surtout
entre individus d'une mme race, tendent disparatre sous l'influence de la
civilisation, ou au contraire s'accrotre : en un mot, si nous marchons vers
l'galit, ou au contraire vers une ingalit de plus en plus accentue. La solution de
cette question m'a paru d'une importance telle, que je n'ai pas hsit y consacrer
de longues recherches.
Les expriences ne sont gure que la vrification d'hypothses que nous
formons d'aprs certaines observations. En ce qui concerne le problme pos cidessus, un raisonnement trs simple tend tablir que les diffrences existant entre
les individus et les races doivent s'accentuer au lieu de s'effacer. La civilisation ne
pouvant agir galement sur des intelligences ingales, et les plus dveloppes
devant ncessairement en profiter davantage que celles qui le sont moins, il est
facile de voir, par des considrations mathmatiques lmentaires, que la diffrence
qui les spare doit aller en augmentant chaque gnration.
Mais quelle que soit la probabilit, de ces prsomptions, elle ne saurait
quivaloir une certitude, et j'ai d rechercher si ces considrations purement
thoriques pouvaient tre dmontres par des preuves exprimentales videntes.
Fig.3
Variationsduvolumeducrnedel'hommeetdelafemme.
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
157
L'chelle place du ct gauche est l'chelle des volumes de 1100 2000 centimtres cubes. 1
centimtre = 100 centimtres cubes.
Il suffit de compter combien de millimtres sont compris horizontalement entre les points o
la courbe coupe les lignes horizontales correspondant au niveau des chiffres crits en marge pour
savoir combien sur 100 sujets il y en a d'une capacit crnienne donne. Soit, par exemple,
savoir combien sur 100 crnes parisiens modernes il y a de crnes de 1800 1900 centimtres
cubes. On voit immdiatement qu'entre les points o la courbe coupe les deux horizontales
correspondant aux chiffres 1800 et 1900 il y a 5mm 2. Ce nombre reprsente le chiffre cherch.
Sur 100 crnes parisiens, il y en a donc 5,2 dont la capacit crnienne est comprise entre 1800 et
1900 centimtres cubes.
La courbe suprieure (hommes clbres) a t construite avec les volumes des crnes d'une
collection de 42 hommes clbres que j'ai mesurs au Musum de Paris : (Boileau, Descartes, le
gnral Jourdan, l'astronome de Zach, Gall, etc.) Les autres courbes ont t construites avec les
crnes de diverses races que possde le Muse d'anthropologie. Les crnes des Parisiens
modernes proviennent du cimetire de l'Ouest.
Ces courbes, dont j'ai expliqu le mode de construction dans un prcdent chapitre, sont
destines mettre en vidence quelques-unes des conclusions de mon travail, notamment les
diffrences qui existent entre le volume du crne dans les races et les sexes.
Prenant pour base ce fait admis aujourd'hui par les anthropologistes que le
volume du cerveau, et partant le volume du crne, sont gnralement chez les races
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
158
et les individus en rapport avec le dveloppement de l'intelligence, j'ai fait sur
plusieurs milliers de crnes de races diffrentes que possde le Muse de la Socit
d'anthropologie de Paris, et sur un grand nombre de ttes vivantes, une srie de
recherches pour le dtail desquelles je renvoie le lecteur au travail que j'ai publi
sur cette question 29, et dont je me bornerai rsumer ici les principales conclusions.
Les voici :
29
Recherches anatomiques et mathmatiques sur les variations de volume du crne, par le Dr Gustave Le Bon,
in-8, avec 9 planches et 13 tableaux. (Mmoire couronn par la Socit d'anthropologie de Paris.)
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
159
Fig. 4
Diagramme destin montrer la diffrenciation
progressive du volume du crne entre individus
d'une mme race mesure qu'on s'lve dans
l'chelle des races et que la mme race se civilise.
L'chelle inscrite en marge reprsente des
centimtres cubes. 1 centimtre = 100 centimtres
cubes.
Chaque colonne reprsente par sa hauteur la plus
grande diffrence qu'on observe entre les crnes
les plus gros et les plus petits de chaque race.
1 Les variations de volume du crne dans l'espce humaine sont beaucoup plus grandes
qu'on ne l'avait suppos jusqu'ici, alors qu'on ne faisait porter les comparaisons que sur des
moyennes. Dans les races les plus leves, elles atteignent et dpassent frquemment 600
centimtres cubes. Un nombre considrable d'hommes occupent par le volume de leurs crnes
une place intermdiaire entre les grands singes anthropodes et les individus dont le crne est le
plus dvelopp.
2 La capacit moyenne du crne des races suprieures dpasse notablement celle des races
infrieures ; ruais ce qui constitue rellement la supriorit d'une race sur l'autre, c'est que la race
suprieure contient beaucoup plus de crnes volumineux que la race infrieure. Sur 100 Parisiens
modernes, il y a environ 11 sujets chez lesquels le volume du crne est compris entre 1700 et
1900 centimtres cubes, alors que sur le mme nombre de ngres on n'en trouve aucun dont le
crne atteigne les capacits qui viennent d'tre nonces. Chez les races trs infrieures, les
crnes les plus volumineux dpassent peine 1500 centimtres cubes 30. Entre les plus gros
crnes des races suprieures et les plus gros crnes des races infrieures la diffrence s'lve au
chiffre norme de 400 centimtres cubes.
3 Les diffrences de volume du crne existant entre les individus d'une mme race varient
considrablement d'une race l'autre. Elles sont d'autant plus grandes que la race est plus leve
30
Certaines races qu'on ne saurait mettre au premier rang, comme les Finnois modernes et les anciens Gaulois,
possdent des crnes assez volumineux, mais ce sont des races dont l'nergie et l'activit taient trs
dveloppes. Il ne faut pas oublier que le cerveau ne sert pas uniquement l'intelligence, il est en relation avec
la plupart des fonctions et est le sige des sentiments. Nous concevons facilement ds lors qu'une race suprieure
une autre par son activit, sa bravoure, son caractre nergique, etc., puisse avoir un cerveau plus volumineux
bien qu'elle lui soit infrieure par l'intelligence.
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
160
dans l'chelle de la civilisation. Aprs avoir group les volumes des crnes de chaque race par
sries progressives, en ayant soin de n'tablir de comparaisons que sur des sries assez
nombreuses pour que les termes en soient relis d'une faon graduelle, j'ai reconnu que la
diffrence de volume entre les crnes masculins adultes les plus grands et les crnes les plus
petits est en nombre rond de 200 centimtres cubes chez le gorille, de 280 chez les parias de
l'Inde, de 310 chez les Australiens, de 350 chez les anciens Egyptiens, de 470 chez les Parisiens
du XIIe sicle, de 600 chez les Parisiens modernes, de 700 chez les Allemands.
4 Les chiffres qui prcdent prouvent que les diffrences existant entre les crnes les plus
gros et les crnes les plus petits de chaque race croissent constamment mesure qu'on s'lve
dans l'chelle des races et des civilisations. Les ingalits de volume du cerveau, partant de
l'intelligence, existant entre les hommes s'accroissent donc constamment mesure qu'ils se
civilisent.
5 La taille a une influence sur le poids du cerveau, mais cette influence est trs minime, et ce
n'est pas elle que pourraient tre attribues les diffrences qui viennent d'tre signales. En
runissant en groupes un certain nombre d'individus de mme taille, et prenant le poids moyen
des cerveaux de chaque groupe, on reconnat qu'entre le poids moyen des cerveaux du groupe des
individus les plus grands et le poids moyen des cerveaux du groupe des individus les plus petits,
la diffrence atteint peine 100 grammes, alors qu'elle dpasse souvent 300 grammes entre des
cerveaux d'individus de mme taille.
6 Les diffrences de volume du crne qu'on observe chez les diverses catgorie d'individus
d'une mme race ne semblent pas pouvoir tre attribues d'autres causes qu' l'tat de
l'intelligence, puisque quand ces catgories sont suffisamment nombreuses elles comprennent
chacune videmment autant d'individus de mme taille et de mme poids. Les mesures effectues
sur 1200 ttes de sujets vivants m'ont prouv qu'au point de vue du volume du crne, les
individus se rangent nettement dans l'ordre suivant : 1 savants et lettrs, 2 bourgeois, 3 nobles
d'anciennes familles, 4 domestiques, 5 paysans 31.
7 Le volume du crne de l'homme et de la femme, mme quand on compare des sujets d'ge
gal, de taille gale et de poids gal, prsente des diffrences considrables en faveur de l'homme,
et cette ingalit va galement en s'accroissant avec la civilisation, en sorte qu'au point de vue de
la masse du cerveau, et par suite de l'intelligence, la femme tend se diffrencier de plus en plus
de l'homme. La diffrence qui existe, par exemple, entre la moyenne des crnes des Parisiens
contemporains et celle des Parisiennes, est presque double de celle observe entre les crnes
masculins et fminins de l'ancienne gypte. L'tude des cerveaux fminins montre que dans les
races les plus civilises, comme les Parisiens contemporains, il y a une notable proportion de la
population fminine dont le crne se rapproche plus par le volume de celui du gorille que des
crnes du sexe masculin les plus dvelopps.
8 Les crnes fminins des races suprieures o le rle de la femme est nul sont
remarquablement plus petits que les crnes fminins des races infrieures. Alors que la moyenne
31
Un observateur ingnieux, le Dr. Delaunay, a constat que les lves du sminaire de Saint-Sulpice ont
gnralement des ttes fort petites, alors que les lves d'coles scientifiques suprieures ont au contraire des
ttes trs grosses.
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
161
des crnes parisiens masculins les range parmi les plus gros crnes connus, la moyenne des
crnes parisiens fminins les place parmi les plus petits-crnes observs, bien au-dessous du
crne des Chinoises, et peine au-dessus des crnes des femmes de la Nouvelle-Caldonie 32.
32
Aprs avoir tudi au moyen des ressources de l'anatomie les diffrences d'intelligence existant entre les
hommes, et prouv nettement l'accroissement de ces diffrences, j'ai voulu tudier le problme au point de vue
physiologique. J'ai recherch d'abord quel tait parmi les actes du systme nerveux le plus facile soumettre
des mesures prcises. Je l'ai trouv dans l'acte rflexe. Il est, comme on le sait, l'lment le plus simple auquel
nous puissions actuellement rduire une opration intellectuelle, les plus compliques de ces oprations se
rduisant des associations hrditaires ou acquises d'actes rflexes. L'acte rflexe lui-mme n'est, en dernire
analyse, que la manifestation de cette proprit, dont nous avons constat l'existence chez tous les corps - morts
ou vivants - de ragir contre les changements de milieu. Chez les tres vivants, la raction ne suit pas
immdiatement l'excitation. Quand lil, l'oreille, la peau, etc., sont soumis une excitation, la raction ne se
fait qu'aprs quelques centimes de seconde. Contrairement l'opinion des astronomes, qui enseignent que
l'quation personnelle est une valeur constante pour chaque observateur, la dure du temps qui spare l'excitation
de la raction varie non seulement chez le mme individu suivant l'tat physiologique, mais aussi d'un ge
l'autre, d'une race l'autre. Nous n'avons pas encore termin cette partie de nos recherches. Malgr le concours
d'un collaborateur dvou, le Dr. G. Nol, ancien assistant de notre regrett matre Claude Bernard, il a fallu plus
d'un an d'essais et d'tudes pour arriver construire les nouveaux appareils destins ces mensurations. Nous
avons d, en effet, reprendre fond une foule de questions accessoires de physique et de mcanique fort
dlicates telles que celle des rgulateurs isochrones, par exemple. Le lecteur que ces appareils pourraient
intresser en trouvera la description dans l'ouvrage que j'ai publi sous ce titre : La mthode graphique et les
appareils enregistreurs, avec 67 figures dessines en partie mon laboratoire. (Librairie Lacroix, 1879.)
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
162
Je crois inutile d'insister longuement sur l'importance des conclusions qui
prcdent, et notamment de celles-ci : qu' mesure que les hommes se civilisent, ils
tendent se diffrencier davantage, et qu' mesure que nous avanons dans la
civilisation, la femme s'loigne de plus en plus de l'homme. Les diffrences de
plusieurs centaines de centimtres cubes qui existent entre les cerveaux les plus
gros des races suprieures et ceux des races infrieures, celles plus grandes encore
qui existent entre individus d'une mme race sont d'une importance considrable.
Elles constituent entre les hommes des abmes que rien ne saurait combler, et
contre lesquels les thories galitaires des socialistes ne sauraient prvaloir.
VI. - Accroissement des diffrences
existant entre la femme et l'homme
dans les races suprieures.
Retour la table des matires; retour au dbut du chapitre
La diffrenciation progressive que j'ai signale entre les cerveaux de l'homme et
de la femme est trs importante noter et doit nous arrter un instant. Ainsi que le
faisait remarquer un savant professeur du Musum, M. G. Pouchet, en rendant
compte de mes recherches, elle doit tre srieusement mdite par les partisans
d'une galit de droits entre l'homme et la femme .
Cette diffrenciation progressive de l'homme et de la femme mesure que nous
nous levons dans l'chelle des races, et partant de la civilisation, n'a rien qui,
psychologiquement, puisse nous surprendre. Dans les races infrieures, la
supriorit de l'homme sur la femme est fort minime. Celle-ci partage les travaux
de l'homme, travaille mme souvent plus que lui, et la ncessit la rend
industrieuse. Dans les races tout fait civilises, les nations latines notamment, la
femme mne, au contraire, une vie trs diffrente de celle de l'homme. L'ducation
qu'elle reoit n'exerce en aucune faon son intelligence, et tend mme beaucoup
plus la restreindre qu' la dvelopper. Elle reste donc stationnaire ou dcrot.
L'homme s'instruisant de plus en plus au contraire chaque gnration, les progrs
accumuls par l'hrdit finissent par l'loigner graduellement de la femme dont
intellectuellement il s'cartait d'abord fort peu.
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
163
L'examen attentif des courbes que j'ai reproduites plus haut montre qu'il y a dans
une mme race un certain nombre de cerveaux fminins suprieurs comme capacit
un certain nombre de cerveaux masculins. Ce nombre, relativement fort restreint
ne saurait modifier aucune des conclusions qui prcdent. Il prouve simplement
que dans chaque race il y a un petit nombre de femmes dont le cerveau a atteint
quelque dveloppement. C'est peine, du reste, si les crnes fminins les plus
volumineux dpassent un peu la moyenne des crnes masculins, c'est--dire la
simple mdiocrit, si le ct psychologique correspondait exactement au ct
anatomique.
Nous ne devons pas omettre de faire remarquer encore que, quand on opre sur
des moyennes, les diffrences que l'on constate en comparant les crnes de
l'homme et de la femme sont encore infrieures celles qui apparaissent quand on
compare - ce que permettent de faire nos courbes - les grands cerveaux de femmes
aux grands cerveaux d'hommes, les petits cerveaux de femmes aux petits cerveaux
d'hommes. L'tude de ces mmes courbes montrera galement ce fait,
thoriquement vident, du reste, que les femmes diffrent beaucoup moins entre
elles que les hommes ne diffrent entre eux par la capacit du cerveau.
L'infriorit du volume du crne de la femme, compar celui de l'homme,
principalement dans les races suprieures, est-elle accompagne d'une infriorit
intellectuelle correspondante ? Cette dernire infriorit est trop vidente, je crois,
pour tre conteste un instant, et on ne peut gure discuter que sur son degr.
[NOTE :
1 Les deux pages qui vont suivre sont la reproduction d'un passage de mon mmoire sur les
variations de volume du crne. Elles ont soulev des polmiques parfois assez vives dans diverses
revues franaises et trangres, et, en Allemagne notamment, o le savant naturaliste Carl Vogt a
t l'objet de nombreuses perscutions fminines pour avoir consacr deux articles l'expos de
mes recherches. Je conois peu je l'avoue, cette agitation devant les faits que j'ai noncs et qui
sont rests incontests. Je ne sais pas si, suivant la prdiction que me fait M. le Dr Fonssagrives,
professeur la Facult de Montpellier, dans une analyse de mon mmoire, je finirai comme
Orphe par tre dchir par les dames de mon temps, mais je crois que le chtiment serait peu
mrit, et prouverait seulement que les vrits les plus claires sont souvent les plus dangereuses
noncer. On n'a jamais trait d'ennemis des enfants, je pense, ceux qui reconnaissent l'tat
infrieur de leur intelligence ; pourquoi ne saurait-on galement prouver l'infriorit intellectuelle
des femmes sans tre considr comme leur ennemi ? Je crois au contraire qu'une apprciation
judicieuse de leur intelligence aurait pour rsultat de leur faire donner une ducation qui leur
permettrait d'obtenir une foule d'emplois qu'elles sont trs aptes remplir. Dans toutes les
professions o il faut plus d'habilet manuelle que de raisonnement, leur travail est gnralement
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
164
suprieur celui de l'homme. Leur donner une ducation en rapport avec leur intelligence
vaudrait infiniment mieux que d'essayer de leur faire croire qu'elles sont les gales de l'homme et
surtout de dterrer de vieux articles de physiologie dans lesquels on leur assure, sans avoir jamais
effectu de mensuration, que leur cerveau est sensiblement suprieur celui de l'homme, ainsi
que l'a fait le rdacteur d'une grande revue politique dont les thories sur le rle de la femme se
trouvaient mises en complet dsarroi par mes recherches. Rien n'est plus triste que de voir qu'en
Europe les femmes ne peuvent arriver gagner leur vie au prix du plus dur travail, et n'ont en
dehors du mariage d'autres ressources relles que la domesticit ou le libertinage.
Tous les psychologistes qui ont tudi l'intelligence des femmes ailleurs que
chez les romanciers et chez les potes, reconnaissent aujourd'hui qu'elles
reprsentent les formes les plus infrieures de l'volution humaine et sont beaucoup
plus prs des enfants et des sauvages que de l'homme adulte civilis. Elles ont des
premiers la mobilit et l'inconstance, l'absence de rflexion et de logique, l'incapacit raisonner ou se laisser influencer par un raisonnement, l'imprvoyance et
l'habitude de n'avoir que l'instinct du moment pour guide. On ne citerait pas dans
les sciences qui exigent du raisonnement une seule oeuvre remarquable produite
par une femme, et cependant beaucoup ont reu une ducation scientifique trs
complte. En Amrique seulement, six cents pratiquent la mdecine. Ce n'est que
dans certains arts qui s'exercent d'une faon inconsciente, comme le chant, la
musique, la posie, etc., et o parfois les peuples primitifs et les sauvages excellent,
qu'on les voit parfois se distinguer.
Ce qui constitue la femme un avantage srieux sur l'homme, c'est la
possession d'un instinct souvent trs sr qui lui fait inconsciemment deviner des
choses que ce dernier ne dcouvre que lentement par le raisonnement. C'est l une
aptitude prcieuse, mais possde galement par la plupart des tres infrieurs. Elle
est de mme ordre que l'instinct qui dit au singe si l'aliment qu'il tient la main lui
sera utile ou nuisible, l'abeille quelle est parmi les formes innombrables qu'elle
pourrait donner son alvole, celle qui contiendra le plus d'espace avec le moins de
dpense de matriaux possible.
On ne saurait nier, sans doute, qu'il existe des femmes fort distingues, trs
suprieures la moyenne des hommes, mais ce sont l des cas aussi exceptionnels
que la naissance d'une monstruosit quelconque, telle, par exemple, qu'un gorille
deux ttes, et par consquent ngligeables entirement.
Ce qui a fait croire aux potes et aux romanciers la supriorit de la femme sur
l'homme, c'est uniquement - en dehors, bien entendu, de ses qualits physiques
incontestes et du charme qu'elle rpand autour d'elle - l'exagration de ses
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
165
sentiments. Mais cette exagration mme contribue plus encore que l'infriorit de
son intelligence la rapprocher des sauvages et des enfants, et mme de
mammifres plus infrieurs encore. L'amour maternel, par exemple, est bien
autrement dvelopp chez certains singes, tels que la guenon, notamment, que chez
la femme, puisque la premire ne survit jamais la mort de ses petits. Certains
oiseaux contractent des unions indissolubles o ils font preuve des sentiments les
plus fidles et les plus tendres, et l'amour prouv par la femelle pour son
compagnon est si profond, qu'elle meurt bientt de douleur quand la mort vient le
lui enlever.
Invoquer en faveur du dveloppement intellectuel de la femme le rle
considrable qu'elle joue dans la marche des affaires humaines, et le fait qu'elle
nous mne souvent son gr, serait oublier que l'homme est bien plus conduit par
le sentiment que par la raison, et que c'est prcisment parce qu'elle agit
exclusivement sur nos sentiments, qui sont du domaine de l'instinct inconscient,
qu'elle a souvent autant d'empire sur nous. En dehors des motifs tirs de l'attrait
sexuel, qui constitue en ralit leur unique force, l'homme se laisse souvent
tyranniser par elles par un sentiment de mme ordre que celui qui le fait obir aux
volonts de petits enfants ou de jeunes mammifres, tels que les chats ou les chiens,
quand ils sont caressants et gracieux.
Ceux qui ont propos de donner aux femmes une ducation semblable celle
reue par l'homme, ont prouv combien ils ignoraient la nature de leur esprit. Il
serait dsirer, sans doute, qu'on leur donnt une ducation tout autre que celle
qu'elles reoivent aujourd'hui, qui ne leur fournit aucun moyen srieux d'existence
et augmente par trop la distance qui les loigne de nous ; mais vouloir donner aux
deux sexes, comme on commence le faire en Amrique, la mme ducation, et par
suite leur proposer les mmes buts, est une chimre dangereuse qui ne peut avoir
pour rsultat que de dpouiller la femme de son rle, l'obliger entrer en
concurrence avec l'homme, et lui ter tout ce qui constitue sa valeur et ses charmes.
Le jour, o, mprisant les occupations infrieures que la nature lui a donnes, la
femme quitterait son foyer et viendrait prendre part nos luttes, ce jour-l
commencerait une rvolution sociale o disparatrait tout ce qui constitue
aujourd'hui les liens sacrs de la famille, et dont l'avenir dirait qu'aucune n'a jamais
t plus funeste.
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
166
Deuxime partie
LES SOCITS
Leurs origines et leur dveloppement
livre II : Les facteurs de lvolution sociale
Chapitre X.
Influence du pass et de l'hrdit
Retour la table des matires; retour au dbut du chapitre
1. Les faits de l'hrdit. - L'hrdit s'tend toutes les modifications organiques et
mentales. - Les instincts qu'elle transmet sont parfois assez puissants pour l'emporter sur le
sentiment de la conservation lui-mme. - Hrdit de la constitution mentale. - Hrdit du
penchant au crime. -Difficult de transformer les penchants hrditaires. - Les qualits acquises
par les parents ne se fixent dans la race qu'aprs avoir t accumuls par l'hrdit pendant
plusieurs gnrations. - II. Les divers modes de l'hrdit. - Influence d'un seul parent ou de deux
parents. - Accumulation des qualits ou des dfauts dans les croisements entre parents. Influence des parents loigns. - Exemples divers d'influences ataviques. - Comment peuvent se
manifester chez les descendants des aptitudes que n'ont jamais possdes aucun de leurs
ascendants. - Influence de l'tat des parents au moment de la conception. - Influence de l'tat de la
mre pendant les premiers temps de la conception. - Explication des phnomnes de l'hrdit. Elle peut tre considre comme un mode de croissance du mme individu. - III. Les
consquences de l'hrdit. - Consquences relatives la transformation des espces. Consquences relatives la transmission des vertus ou des vices. - Dangers pour une socit de la
reproduction d'lments infrieurs mal adapts. - Erreurs de la philanthropie. - Imperfection de la
lgislation relative aux criminels. - Consquences de l'hrdit au point de vue de la transmission
des aptitudes intellectuelles et mentales. - Consquences politiques de l'hrdit. - Castes et
noblesse. - Influence de l'hrdit sur nos conceptions morales, religieuses et sociales. -Notre
morale est cre par notre pass. - Les gnrations qui nous ont prcds vivent toujours en nous.
- Puissante influence des morts.
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
167
I. - Les faits de l'hrdit.
Retour la table des matires; retour au dbut du chapitre
Aprs avoir montr le rle fondamental jou dans l'volution des socits par les
caractres des races qui les composent, et fait voir combien ces caractres rsultent
de leur pass, il nous reste indiquer comment et dans quelles limites nous hritons
de ce pass, c'est--dire mettre en vidence le rle de l'hrdit.
Nous allons faire voir que ce sont de lentes transformations accumules par elle
pendant des sicles qui ont cr l'individu tout entier, ses formes extrieures, son
caractre, son intelligence, sa morale, ses vertus et ses vices ; que ce qu'il peut
acqurir pendant sa vie constitue une valeur bien faible, si on le compare ce qu'il
apporte en naissant ; que cet apport reprsente un pass d'une extrme longueur,
vivant toujours en lui et formant le plus puissant mobile de sa conduite.
Nous commencerons par l'expos des faits, et aborderons ensuite leurs
consquences.
Parmi les diverses formes de l'hrdit, la conformation extrieure est la plus
facile constater. Tout le monde sait que la beaut, la laideur du visage sont
hrditaires, et que certaines familles conservent dans leurs traits des particularits
caractristiques. Naturellement ces transmissions ne se bornent pas uniquement au
visage, elles s'tendent toutes les parties du corps. Les moindres particularits de
structure, y compris des anomalies, comme la myopie, le bec de livre et la
claudication ; des tats pathologiques acquis, comme le cancer, la phthisie, etc.,
sont transmises aux descendants par leurs ascendants.
Mais nous avons nous occuper surtout dans ce chapitre de l'hrdit de la
constitution mentale. Ce sera donc sur des exemples dmontrant l'hrdit mentale
que nous devrons insister.
Les plus frappants sont fournis par les affections mentales. Leur hrdit a t
constate par tous les mdecins alinistes depuis longtemps. Suivant Esquirol, dans
la moiti des cas, la manie a une origine hrditaire. Il y a des familles, dit Lucas,
que l'alination mentale atteint tout entires. Toute la descendance mle d'une
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
168
famille noble de la ville de Hambourg, connue de Michalis, et, depuis le bisaeul,
remarquable par de grands talents militaires, tait quarante ans frappe
d'alination ; il n'en restait plus qu'un seul rejeton, officier comme son pre, qui le
snat de la ville interdit de se marier. L'ge critique arriv, il perdit la raison.
La transmission du penchant au suicide et au genre de suicide, est une de celles
qui nous prouvent le mieux la puissance de l'hrdit, puisqu'elle nous montre un
instinct aussi nergique que celui de la conservation personnelle annul par des
influences ancestrales. On comprend combien cette influence est grande quand on
voit des fils de suicids se tuer sans autre motif que cette voix imprieuse des
anctres qui gronde en eux. Un monomaniaque la fleur de l'ge, dit Moreau de
Tours, est pris de mlancolie et se noie volontairement ; son fils, d'une bonne sant,
riche, pre de deux enfants bien dous, se noie volontairement au mme ge. - Un
dgustateur qui s'est tromp sur la qualit d'un vin, dsespr, se jette l'eau. Il est
sauv ; mais plus tard il accomplit son dessein. Le mdecin qui avait soign ce
nouveau Vatel apprit que son pre et un de ses frres s'taient suicids au mme ge
et de la mme manire. A dix-sept ans, le fils de Prvost-Paradol, ambassadeur de
France aux tats-Unis sous l'Empire, se tue comme son pre, et de la mme faon.
Le Dr Maudsley parle d'un ngociant intelligent et heureux, mais d'une famille o
l'habitude du suicide tait gnrale, qui ne prenait jamais le chemin de fer,
moins d'y tre forc, et pour rien au monde ne ft mont dans un train express de
peur de cder une irrsistible envie de se jeter par la portire .
Si une disposition mentale aussi oppose l'intrt de l'individu peut tre
hrditaire, nous comprendrons facilement quel point les dispositions naturelles
doivent l'tre galement.
Elles le sont, en effet, et l'observation nous montre que tous les modes de
l'activit mentale, l'intelligence, les dispositions morales, et par consquent les
vertus et les vices, sont transmis par l'hrdit.
L'hrdit de l'intelligence et celle du talent sont d'une observation journalire.
Ce n'est pas seulement dans quelques familles privilgies qu'on voit une srie de
gens de talent se succder. La gnalogie de la plupart des hommes distingus,
savants, potes, littrateurs, artistes, hommes de guerre, prouve qu'il est fort rare
qu'ils aient t les seuls dans leur famille possder le talent qui les a illustrs.
C'est ainsi que le pre de Raphal tait peintre, que la mre de Van Dyck
peignait des fleurs, que Horace Vernet eut pour pre et grand-pre deux peintres
justement clbres, que les frres du Titien et son fils taient peintres, que, dans la
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
169
famille d'Eschyle, on comptait huit potes tragiques. Le pre de l'illustre auteur de
l'0rigine des espces tait un mdecin distingu, son grand-pre un naturaliste
clbre. On comptait cinq botanistes dans la famille de Jussieu. Les familles des
Bernouilli et des Cassini ont t longtemps clbres par leur gnie du calcul ; celle
des Lamoignon par ses aptitudes juridiques. M. Galton a montr l'influence de
l'hrdit dans un grand nombre de familles d'hommes illustres. Mais je renverrai
surtout le lecteur, dsireux d'approfondir le sujet, aux nombreux tableaux
gnalogiques qu'a dresss notre savant ami, le professeur Ribot, dans l'ouvrage
aujourd'hui classique qu'il a publi sur l'hrdit. La parent des hommes les plus
illustres y a t releve avec soin, et on n'en trouve gure dont les parents n'aient
t plus ou moins distingus.
Sans doute, en fouillant bien dans l'histoire, on trouverait peut-tre, de ci de l,
quelque garon d'curie dont le fils a t un homme remarquable ; mais je confesse
que dans tous les cas analogues, o aucune influence atavique n'est invocable, je
considrerai toujours la parent comme beaucoup plus certaine du ct maternel
que du ct paternel. Le code a raison de dire que le pre est celui indiqu par l'acte
de mariage, mais le physiologiste, qui ne croit gure aux miracles, a le droit de ne
pas toujours s'en tenir la fiction.
L'hrdit, que nous venons de reconnatre dans la conformation physique et les
aptitudes intellectuelles, se rencontre-t-elle aussi dans l'tat moral ? Il n'existe
aucune raison d'en douter et nous allons pouvoir la constater facilement.
L'hrdit des qualits et des vices est aussi fatale que celle des formes
extrieures. Les passions du jeu, des femmes, de l'avarice, du vol, etc., sont
hrditaires. Il y a des familles entires de voleurs et d'homicides de pre en fils.
Parmi les nombreux exemples que l'on pourrait citer, je me bornerai mentionner
celui de la famille J. Chrtien, rapport par le docteur Despine, et qui est tout fait
typique :
Jean Chrtien, souche commune, a trois enfants : Pierre, Thomas et JeanBaptiste. I. Pierre a pour fils Jean-Franois, condamn aux travaux forcs
perptuit pour vol et assassinat. II. Thomas a eu : 1 Franois, condamn aux
travaux forcs pour assassinat ; 2 Martin, condamn mort pour assassinat. Le fils
de Martin est mort Cayenne pour vol. III. Jean-Baptiste a eu pour fils JeanFranois, poux de Marie Tanr (d'une famille d'incendiaires). Ce Jean-Franois a
eu sept enfants : 1 Jean-Franois, condamn pour plusieurs vols, mort en prison ;
2Benot tombe du haut d'un toit qu'il escaladait et meurt ; 3 X., dit Clain,
condamn pour divers vols, mort vingt-cinq ans ; 4 Marie-Reine, morte en
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
170
prison, condamne pour vol ; 5 Marie-Rose, mme sort, mmes actes ; 6 Victor,
actuellement dtenu pour vol ; 7 Victorine, femme Lemaire, dont le fils est
condamn mort pour assassinat et vol.
Galton cite le cas d'une famille Jecker, en Amrique, dont la gnalogie a t
dresse jusqu' sept gnrations, comprenant 540 membres, dont un nombre
considrable ont fini en prison, au bagne ou sur l'chafaud.
Toutes les personnes qui ont observ les criminels, en s'affranchissant de toute
ide prconue, ont d reconnatre qu'il existe une constitution spciale produisant
le vice, comme il y en a une produisant la vertu :
Le sclrat, crit un savant professeur de mdecine lgale, le Dr Mausdley, n'est pas
sclrat par un choix dlibr des avantages de la sclratesse qui ne sont que duperie ou
pour les jouissances de la sclratesse qui ne sont qu'embches, mais par une inclination
de sa nature faisant que le mal lui est un bien et le bien un mal. Le fait qu'il cde l'attrait
du plaisir actuel en dpit des chances ou de la certitude d'un chtiment ou d'une
souffrance future est souvent la preuve non seulement d'une affinit naturelle pour le mal,
mais d'un dfaut d'intelligence et d'une faiblesse de la volont. Les directeurs de prisons
les plus rservs et les plus expriments sont amens tt ou tard se convaincre qu'il n'y
a aucun espoir de rformer les criminels d'habitude. Les tristes ralits que j'ai observes,
dit M. Chesterton, me contraignent dire que les neuf-diximes au moins des malfaiteurs
d'habitude n'ont ni le dsir, ni l'intention de renoncer leur genre de vie, ils aiment les
vices auxquels ils se sont adonns... 0 Dieu! que c'est donc bon de voler! quand encore
j'aurais des millions, je voudrais tout de mme tre voleur, ai-je entendu dire un jeune
coquin.
Tous ceux qui ont tudi les criminels, crit cet auteur, savent qu'il existe une classe
distincte d'tres vous au mal dont la horde se rassemble dans nos grandes villes au
quartier des voleurs, se livrant l'intemprance, aux vices, la dbauche, sans souci des
liens du mariage ou des empchements de la consanguinit et propageant toute une
population criminelle d'tres dgnrs. Car c'est encore un autre fait d'observation que la
classe criminelle constitue une varit dgnre ou morbide de l'espce humaine
marque par des caractres particuliers d'infriorit physique ou mentale. Cette sorte
d'individus, a-t-on justement dit, est aussi distinctement reconnaissable de la classe des
ouvriers honntes et bien ns qu'un mouton tte noire l'est de toutes les autres races de
moutons.
L'auteur conclut, ainsi, du reste, que ceux qui ont tudi srieusement la
question, que l'amlioration des criminels est la plus irralisable des chimres :
Une vritable rforme impliquerait la rformation du naturel de l'individu. Mais
comment ce qui s'est form par la succession des gnrations pourrait-il se rformer
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
171
dans le cours d'une seule vie ? Un More pourrait -il changer sa peau et un lopard
ses taches ?
Dans tous les cas de transmissions hrditaires tudis jusqu'ici, nous n'avons
pas recherch dans quelles limites les modifications acquises par les parents
pendant leur vie se transmettaient aux enfants. L'tude que nous avons faite de la
transformation des espces dans une autre partie de cet ouvrage, nous a montr que
les qualits acquises par les parents peuvent se transmettre, mais ne se fixent dans
la race que lorsqu'elles ont t rptes pendant un grand nombre de gnrations.
Nous avons suffisamment prouv pour qu'il soit inutile d'y revenir que c'est par
suite de l'accumulation de diffrences trs petites acquises chaque gnration que
les espces animales ont fini par se transformer.
Si l'hrdit n'avait pas conserv autrefois les modifications acquises par les
parents, les mmes types fixs une fois pour toutes se seraient reproduits toujours ;
si elle ne continuait pas aujourd'hui conserver ces modifications, les leveurs ne
pourraient jamais raliser dans les espces domestiques les transformations qu'ils
leur font subir au moyen d'une slection rpte pendant plusieurs gnrations.
Il nous resterait, aprs avoir tudi les faits qui prouvent l'hrdit mentionner
ceux qui lui semblent contraires. Nous indiquerons bientt les causes diverses de
ces exceptions apparentes en examinant les divers modes de l'hrdit.
II. - Les divers modes de l'hrdit.
Retour la table des matires; retour au dbut du chapitre
Le plus simple et le plus frquent des modes de l'hrdit est celui o l'enfant
hrite directement de ses parents immdiats. Il peut arriver alors qu'il tienne
galement ou ingalement des deux parents, ou seulement de l'un d'eux.
L'hypothse de la ressemblance exclusive un seul parent doit se raliser
infiniment rarement, et il semble mme bien difficile qu'elle puisse se raliser
entirement. Sans doute, il est assez frquent de voir des unions de ngres et de
blancs donner des enfants tout fait noirs ou tout fait blancs, et ne paraissant
tenir, par consquent, que de l'un des parents ; mais la similitude des formes
extrieures ne saurait permettre d'affirmer l'identit des formes intrieures. On a des
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
172
exemples authentiques d'individus ayant le physique de l'un des parents et le moral
de l'autre ; tel est, par exemple, le cas souvent cit de cet ingnieur ngre, fils d'une
ngresse et d'un blanc, qui tenait de sa mre tous les caractres physiques du ngre,
et de son pre tous les caractres moraux et intellectuels du blanc. Il mourut
correspondant de l'Acadmie des sciences. Dans les croisements entre chien et
loup, on voit souvent le mle ressembler au chien, mais avec le caractre froce du
loup, et la femelle ressembler physiquement au loup, mais avec le caractre doux et
caressant du chien.
L'enfant tient donc gnralement des deux parents qui lui ont donn le jour, et
non de l'un des deux ; mais l'observation dmontre qu'il tient toujours plus de l'un
que de l'autre. Tantt c'est le ct maternel qui prdomine, tantt le ct paternel.
On admet gnralement que, dans la majorit des cas, l'hrdit se fait entre sexes
de noms contraires, c'est--dire que le fils ressemble plus la mre et la fille
davantage au pre. Ce fait est connu des Arabes, qui prfrent pour leurs chevaux
une noble extraction du ct des femelles plutt que du ct des mles.
On pourrait se demander d'o l'enfant masculin qui ressemble sa mre prend
les qualits que cette dernire n'a pas, tant connus l'tat infrieur de l'intelligence
fminine et la nature particulire de ses sentiments. Je crois que dans ce cas c'est du
pre de la mre que l'enfant a hrit : cette dernire n'a fait que garder en germe et
transmettre des qualits qui ne pouvaient se dvelopper en elle. De mme, sans
doute, du ct paternel ; la fille qui ressemble son pre doit tenir surtout de la
mre de ce dernier. En ralit, dans les cas d'hrdit croise, qui sont les plus
communs, c'est au grand-pre maternel, et non la mre, que le fils ressemblerait,
suivant nous ; et c'est de sa grand'mre paternelle, bien plus que de son pre, que
tiendrait la fille.
Lorsque les individus qui se croisent appartiennent la mme famille, genre
d'union laquelle on a donn le nom de consanguine, il arrive naturellement que
les qualits et les dfauts communs aux divers membres de la famille se trouvent
accumuls ; et pour peu qu'il y ait au sein de cette famille quelque aptitude
morbide, elle s'accrot chez les descendants au point d'amener rapidement leur
dgnrescence et leur extinction.
Chez les animaux, les unions consanguines russissent pendant quelque temps
entre des individus choisis avec le plus grand soin ; mais si le choix n'est pas assez
bien dirig, le rsultat est funeste. Un leveur, dit Bates, croisa un verrat avec sa
fille, sa petite-fille, son arrire-petite-fille, et ainsi de suite pendant plusieurs
gnrations. Le rsultat fut que, dans plusieurs cas, les produits furent striles,
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
173
d'autres prirent, et parmi ceux qui survcurent, un certain nombre taient comme
idiots, et incapables de tter et de marcher droit.
Des rsultats analogues ont t constats sur l'homme, et la plupart des
mdecins reconnaissent aujourd'hui le danger des unions consanguines. Les
aristocraties, dit P. Lucas, rduites se recruter dans leur propre sein, s'teignent,
d'aprs Niebuhr, de la mme faon, et souvent en passant par la dgradation, la
folie, la dmence et l'imbcillit. Esquirol, Spurzheim, donnent du moins cette
raison de l'alination mentale et de son hrdit dans les grandes familles de France
et d'Angleterre. La surdimutit, dans les familles plus humbles, semble aussi
reconnatre la mme origine.
Chez les isralites, o les mariages consanguins sont frquents, on a observ un
nombre d'altrations diverses, rachitisme, maladies du systme nerveux, etc.,
beaucoup plus lev que dans les autres races. Les recherches des statisticiens ont
prouv que c'est chez eux qu'on rencontre le plus d'idiots.
Nous n'avons examin jusqu'ici que l'hrdit directe consistant dans la
transmission aux enfants des qualits paternelles et maternelles ; mais il est une
autre forme d'hrdit dans laquelle les enfants, au lieu de ressembler aux parents
dont ils sont ns, ont la constitution physique ou mentale d'anctres loigns morts
depuis longtemps. Cette forme d'hrdit a reu le nom d'atavisme ou d'hrdit en
retour. Elle tait bien connue des anciens, car, au dire de Plutarque, une femme
grecque accuse d'adultre parce qu'elle avait mis an monde un enfant noir, allgua
pour sa dfense qu'elle descendait en quatrime ligne d'un thiopien. Dans les
troupeaux de moutons laine noire, on a beau sacrifier tous les agneaux qui
prsentent la moindre trace de couleur blanche dans leur laine, l'influence
d'anctres reculs est telle, qu'il en reparat constamment.
C'est cette influence de parents loigns qui explique comment les enfants
peuvent ne ressembler nullement leur pre et leur mre. Il n'est pas rare
d'observer des faits analogues celui rapport par Lucas, de cette jument demisang arabe, croise avec des talons de race infrieure, qui en eut deux fils
infiniment suprieurs leurs parents.
Pour plusieurs observateurs, les cas de microcphalie qu'on constate quelquefois
chez l'homme seraient des phnomnes d'atavisme rappelant une des phases du
dveloppement de notre espce dans un pass dont la date se perd absolument dans
la nuit des temps. L'apparition frquente chez le cheval de doigts latraux est
galement un phnomne d'atavisme qui a permis de rattacher gologiquement ce
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
174
solipde l'hipparion, cheval fossile de l'poque miocne, qui possdait trois
doigts.
C'est cette influence des anctres qui lutte sans cesse contre la formation de
races nouvelles. Les hybrides, que cre si facilement l'agriculture, tendent toujours
retourner au type de leurs anctres. Chez les animaux, l'atavisme joue un rle tel,
que s'il fallait, suivant Sanson, opter entre deux reproducteurs, dont l'un offrirait,
avec des qualits moins parfaites, une longue suite d'aeux clbres par leurs
mrites spciaux, tandis que l'autre ne prsenterait que sa perfection individuelle,
nul doute qu'il n'y et lieu de prfrer le premier dans la plupart des cas .
Les cas d'atavisme que j'ai cits sont exceptionnels, mais ce qui ne l'est pas du
tout, c'est l'influence qu'exerce toute la srie des anctres sur la constitution
physique et mentale d'un tre. Nous en avons la preuve dans l'existence de certaines
habitudes hrditaires survivant depuis longtemps aux motifs qui les avaient fait
natre. On a observ que la paille des tigres de mnagerie ne pouvait servir de
litire aux chevaux. Ces derniers n'ont jamais vu de tigres, sans doute, mais leurs
anctres en ont vu et ont appris les craindre. Gratiolet parle d'un petit chien
n'ayant jamais vu de loup, qu'un vieux morceau de peau de cet animal use jusqu'au
cuir jetait, par son odeur, dans des convulsions d'pouvante. L'habitude du chien
d'aller cacher des aliments, mme quand il est nourri avec abondance, reprsente
galement des influences ancestrales.
Les cas d'hrdit dite indirecte dans lesquels les individus ne ressemblent pas
leurs parents directs, mais d'autres parents tels que l'oncle et le neveu, sont dus
videmment aussi des influences ancestrales. Le neveu ne ressemble alors
l'oncle que parce qu'ils ressemblent tous deux quelque anctre loign.
Parmi les divers modes d'hrdit, nous devons mentionner encore celui dit
d'influence, dans lequel l'auteur d'une premire conception exercerait sur tous les
autres enfants de la mme mre avec d'autres pres une influence prpondrante.
On a observ depuis longtemps que les enfants d'un second mariage reproduisent
souvent les traits et le caractre du premier mari, mort bien longtemps avant la
conception. Ils sont, en ralit, bien plus les fils de ce premier pre que ceux de son
successeur. Rien n'est plus commun que de voir le fils de l'amant tre en ralit le
fils du pre lgal ; et les anciens qui avaient observ ce fait, l'exprimaient en disant
que le fils de l'adultre rachetait la faute de la mre.
L'imagination de la mre n'a rien faire, bien entendu, dans les cas analogues,
car ils ont t observs chez les animaux. Une jument de pur sang saillie par un
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
175
talon vulgaire et devenue mre est souvent ensuite incapable de donner des
produits de pur sang avec un talon de sa race. C'est un fait que tous les leveurs de
chevaux connaissent parfaitement. Home rapporte qu'une jument anglaise,
accouple avec un ne mouchet, en eut des mulets mouchets comme leur pre.
Fconde les annes suivantes par un talon arabe, elle en eut chaque fois un
poulain brun tachet comme l'ne et ayant avec lui la plus grande ressemblance. On
a observ que quand une chienne a t fconde une premire fois par un chien de
race infrieure, toutes les fois qu'elle est ensuite fconde par un chien de sa race,
chacune de ses portes offre un ou plusieurs petits appartenant cette race
trangre.
Il arrive parfois que l'enfant possde certaines aptitudes que n'ont jamais
possdes aucun de ses parents rapprochs ou loigns. L'explication de ce fait me
parat trs simple. La constitution mentale rsultant uniquement, comme nous le
savons dj, d'associations dont un grand nombre sont hrditaires, il nous est trs
facile de comprendre que des associations d'aptitudes diverses, prises dans la srie
ancestrale, puissent constituer un type assez diffrent en apparence de ceux dont
l'individu est n, absolument comme nous voyons en chimie des corps dous de
certaines proprits engendrer par leur mlange des combinaisons doues de
proprits entirement diffrentes.
Pour bien comprendre la nature des diffrences pouvant exister entre les parents
et les enfants, nous devons faire remarquer encore que des associations
intellectuelles fort voisines peuvent produire des rsultats trs diffrents. Un
homme de gnie et un alin semblent, pour le vulgaire, se trouver aussi loigns
que possible l'un de l'autre dans une classification intellectuelle ; et cependant les
alinistes ont prouv que les associations d'ides qui produisent l'alin sont, au
contraire, trs voisines de celles qui produisent l'homme de gnie. On chercherait
vainement, dit le docteur Moreau, de Tours, une preuve plus clatante des rapports
qui existent entre l'tat nvropathique et certains tats intellectuels et affectifs, que
dans la famille de Pierre le Grand. Gnie sa plus haute puissance, imbcillit
congnitale, vertus et vices pousss l'extrme, frocit outre, emportements
maniaques irrsistibles, suivis de repentir, habitudes crapuleuses, morts
prmatures, attaques pileptiformes : tout se runit chez le czar Pierre ou dans sa
famille.
Le mme auteur a runi un grand nombre de faits du mme genre. Chez les
Cond, le talent, l'excentricit, la perversit morale, la folie se succdent tour tour.
Louis XI eut un pre fou, Tacite un fils idiot, Hoffmann tait d'une famille d'alins
et avait lui-mme des hallucinations.
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
176
D'autres causes que celles que je viens d'invoquer peuvent contribuer encore
diffrencier les enfants de leurs parents. Je veux parler de l'tat de ces derniers au
moment de la conception, et de celui de la mre pendant les premiers temps de la
gestation.
Nous ne connaissons pas assurment la srie des diverses consquences que
peut avoir l'tat physiologique des parents au moment de la conception sur le
produit de cette conception, mais cette influence a t mise nettement en vidence
pour quelques-unes d'entre elles. On sait notamment que les enfants conus pendant
l'ivresse sont vous une existence misrable et seront victimes d'affections
nerveuses varies, pilepsie, hypocondrie, idiotie, imbcillit, paralysie, etc. Le
docteur Lancereau en rapporte plusieurs exemples ; M. de Quatrefages cite le cas
qu'il a observ, d'une famille de trois enfants, dont le dernier conu pendant
l'ivresse du pre tait demi idiot et presque sourd, alors que les deux autres taient
vifs et intelligents. La loi de Carthage, qui dfendait de boire du vin le jour du
mariage, prouve que cette influence tait bien connue des anciens.
L'influence de l'tat de la mre pendant la premire priode du dveloppement
du produit de la conception peut tre considre, galement, comme suffisamment
tablie. La mre reprsente le milieu o luf se dveloppe, et l'observation
dmontre que les moindres altrations du milieu ont sur l'volution du contenu de
ce dernier une influence immdiate. Les expriences de M. Dareste sur les monstruosits ont prouv qu'en plaant les oeufs d'oiseaux dans certaines conditions
dtermines, on pouvait produire volont telle ou telle modification donne. Ces
faits nous permettent - non sans doute d'expliquer - mais au moins de comprendre
la possibilit des influences morales de la mre sur le produit de sa gestation.
L'histoire est remplie de faits qui montrent la croyance qu'on a eue dans tous les
temps relativement l'influence morale exerce par la mre sur le foetus, mais
beaucoup de ces faits semblent d'une authenticit douteuse. Montaigne parle dans
ses Essais d'une jeune fille prsente un roi de Bohme toute velue et hrisse,
que sa mre disait avoir t ainsi conue cause d'une image de saint Jean-Baptiste
pendue en son lit . Plusieurs auteurs prtendent que la frayeur qu'prouvait
Jacques Ier l'aspect d'une pe nue tenait l'pouvante que ressentit Marie Stuart,
sa mre, pendant sa grossesse en voyant assassiner Rizzio ; mais ce sont l des faits
de la ralit desquels nous ne savons rien, et qu'on ne peut que rapprocher de
l'histoire de ce ptre devenu grand calculateur, parce que, pendant sa grossesse, sa
mre se serait adonne au calcul.
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
177
Dans les temps modernes, divers mdecins instruits ont fait des observations
plus probantes que celles qui prcdent. Le docteur Libault en cite plusieurs
constates par lui, notamment celle d'un vigneron dont la tte ressemblait celle du
patron de son village tel qu'il tait reprsent dans l'glise du pays, parce que,
pendant tout le temps de sa grossesse, sa mre avait constamment l'esprit cette
ide que son enfant aurait une tte pareille celle du saint qu'elle contemplait sans
cesse.
Le mme mdecin reproduit dans son livre : Du sommeil et des tats analogues,
d'aprs un mdecin dAmiens, l'histoire curieuse d'une demoiselle de quatorze ans,
dont la peau, marque de petites taches brunes, tait recouverte de duvet, et
prsentait beaucoup d'analogie avec celle du tigre. tant enceinte, la mre de cette
jeune fille avait prouv, la vue d'un tigre, un branlement nerveux profond.
Le Dr Liebrecht, de Lige, a rcemment rapport, dans le Journal des sciences
mdicales de Bruxelles, plusieurs observations, toutes dues des mdecins, qu'on
pourrait rapprocher de la prcdente. Je citerai surtout parmi elles celle d'une
fermire qui, au dbut de sa grossesse, ayant vu un mendiant lui prsentant son bras
mutil pour exciter sa piti, accoucha d'un enfant manchot du mme bras. Le mme
auteur parle d'une marchande de drap qui, endormie dans son magasin, fut rveille
en sursaut par une dame porteuse de l'infirmit dite gueule de loup. Elle resta
proccupe de l'ide que son enfant natrait avec cette infirmit, ce qui arriva en
effet. Il cite ensuite l'exemple de la fille d'un mdecin qui fut proccupe longtemps
d'un enfant dont le lobule de l'une des oreilles tait bifide, et accoucha d'un enfant
prsentant la mme particularit, etc.
Ces faits mritent d'tre mdits, parce qu'ils ouvrent des aperus sur un sujet
dont l'tude n'a pas t aborde encore. L'tat physique, intellectuel et moral de la
mre pendant sa grossesse ayant une influence considrable sur l'enfant qu'elle
porte dans son sein, on conoit que de l'tude de cette influence peuvent dcouler
certains principes dont l'ensemble constituerait ce qu'on appellera peut-tre un jour
l'ducation antrieure.
Pour terminer ce paragraphe, il me reste rechercher l'explication des
phnomnes d'hrdit dcrits jusqu'ici. Elle touche la rgion si peu connue des
causes, et l'on ne peut former encore sur elle que des hypothses. La plus
vraisemblable a t imagine par Darwin. Elle repose sur ce fait, admis du reste par
tous les physiologistes modernes, que le corps d'un animal est un agrgat de
cellules ayant chacune leur vie propre, bien que concourant un but commun, et
que du concours de ces vies innombrables rsulte la vie gnrale de l'tre, qui n'est
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
178
ainsi qu'une rsultante. Suivant Darwin, ces cellules innombrables dont se compose
chaque tre mettraient sans cesse des germes d'une infinie petitesse, dous chacun
de la proprit de reproduire les cellules dont ils sont issus. Ces petits germes,
engendrs par les cellules aux diverses priodes de leur dveloppement, finiraient
par s'agrger ensuite en lments sexuels. La srie des anctres transmettrait ainsi
ses descendants des germes qui tous ne se dveloppent pas, mais seraient
susceptibles de se dvelopper. Chaque animal ou plante, dit ce savant, peut tre
compar un terrain rempli de graines dont la plupart germent promptement ; une
portion demeure quelque temps l'tat dormant, tandis que d'autres prissent.
Lorsque nous entendons dire qu'un homme porte dans sa constitution les germes
d'une maladie hrditaire, cette expression est littralement vraie. Il faut considrer
chaque tre vivant comme un microcosme, un petit univers compos d'une foule
d'organisations aptes se reproduire par elles-mmes, d'une petitesse inconcevable
et aussi nombreuses que les toiles du firmament.
Ainsi envisage, l'hrdit ne nous apparat plus que comme un mode de
croissance de l'individu. Le fils continue la ligne de ses anctres comme l'adulte
continue l'enfant. Le fils ne diffre gure plus en ralit du pre, qu'un tre adulte
ne diffre de ce qu'il tait pendant l'enfance. C'est lui-mme, mais rajeuni, que
revoit le vieillard touchant la tombe, dans ses petits-enfants sommeillant dans leur
berceau.
Cette pense de la perptuit du mme tre par l'hrdit a t exprime dans de
beaux vers que je reproduis, d'abord parce qu'ils expriment une pense juste, et
ensuite parce qu'ils prouvent que la science et la posie ne sont pas aussi opposes
qu'on le croit gnralement :
Elle se dissoudra, cette argile lgre,
Qu'ont mue en naissant la joie et la douleur.
Les vents vont dissiper cette noble poussire.
Qui fut jadis un cur ;
Mais d'autres curs natront qui renoront la trame.
De vos espoirs briss, de vos amours teints,
Perptuant vos pleurs, vos rves, votre flamme.
Dans les ges lointains.
Tous les tres formant une chane ternelle
Se passent en courant le flambeau de l'amour,
Chacun rapidement prend la torche ternelle
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
179
Et la rend son tour 33.
III. - Les consquences de l'hrdit.
Retour la table des matires; retour au dbut du chapitre
Les principales consquences de l'hrdit ont dj t numres dans ce
chapitre ou dans ceux qui l'ont prcd. Il suffira maintenant de les rsumer
rapidement et d'y ajouter celles que nous n'avons pas encore mentionnes.
La plus importante consquence de l'hrdit est la transformation des espces,
laquelle nous avons consacr un chapitre spcial. Nous savons que c'est parce que
l'hrdit conserve les modifications acquises par l'individu, et les fixe dans la race
quand elles ont t rptes pendant plusieurs gnrations, que les espces
infrieures, qui furent les premiers habitants du globe, sont devenues les tres
actuels.
Les consquences des lois de l'hrdit sont aussi importantes pour les individus
que pour les espces. Elles sont cependant gnralement mconnues. Nos unions se
font sans que nous nous inquitions en aucune faon de la constitution physique et
mentale de l'individu auquel nous nous unissons et de celle de ses ascendants. Un
leveur un peu au courant des lois de l'hrdit prend autrement de soins pour le
croisement de ses lapins et de ses cochons qu'on n'en prend gnralement dans les
unions humaines. Il est pourtant certain que les gnrations issues de nous porteront
longtemps la trace de cette famille nouvelle laquelle nous nous unissons sans la
connatre. S'il n'y avait que les parents en souffrir, je ne verrais pas d'inconvnient
ce juste chtiment de leur cupidit ou de leur indiffrence, mais c'est en ralit la
socit surtout qui en est finalement victime. Il est malheureusement impossible
d'empcher tant d'unions mal assorties, tant d'unions d'tres dbiles porteurs
d'affections hrditaires incurables, infirmes de corps ou d'esprit. On doit se borner
signaler les consquences de telles unions, sans la moindre esprance, du reste,
que cela puisse servir quelque chose.
Les lois de l'hrdit nous montrent combien est dangereuse pour une socit
cette philanthropie mal claire qui favorise la multiplication d'une foule d'tres
infrieurs et incapables, destins fatalement devenir les pires flaux du milieu o
33
Ackermann.
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
180
ils natront. J'ai montr dj combien les plus minents penseurs sont d'accord sur
ce point, et il est inutile d'y revenir maintenant. Je ferai seulement remarquer que la
partie dangereuse d'une socit se compose de quelques centaines de milliers
d'individus vous ncessairement par l'hrdit l'incapacit et au crime. La socit
croit se dfendre en enfermant tous les ans un nombre considrable de malfaiteurs ;
et pourtant une statistique impitoyable lui prouve qu'ils reviendront bientt devant
les mmes juges, mais pires qu'auparavant et vous fatalement nuire ceux parmi
lesquels ils vivent. Je suis convaincu que le lgislateur de l'avenir, pntr des lois
de l'hrdit, sachant, comme je l'ai montr plus haut, qu'on nat criminel, et que la
criminalit est absolument incurable, et se rappelant que le premier devoir d'une
socit est de se dfendre, fermera pour toujours les prisons et se bornera
soumettre une dportation perptuelle tous les rcidivistes, eux et leur postrit,
dans les cas de fautes graves.
Aujourd'hui, notre lgislation criminelle est purile ; les prisons ne servent
absolument qu' rendre les malfaiteurs plus dangereux et prparer de la besogne
aux magistrats. L o il y a une prison, il y a une association, dit M. Moreau
Christophe, inspecteur gnral des prisons, cit par M. Wyrouboff, de telle sorte
que la main de la justice, couvrant pour ainsi dire et enveloppant tout le pays d'un
immense rseau dont chaque maille est une prison, il s'ensuit que nos 3 bagnes, nos
20 maisons centrales, nos 362 maisons d'arrt, joints aux prisons municipales de
nos 2,800 cantons et aux chambres de sret de nos 2,238 casernes de gendarmerie,
sont autant de clubs antisociaux, autant de repaires de malfaiteurs, autant de
runions publiques de condamns, de prvenus, d'accuss, de mendiants
vagabonds, d'assassins, de voleurs, de prostitues qui s'associent de toutes parts
entre eux par les liens de la solidarit du crime.
Le lgislateur qui arrivera dbarrasser la socit de ce fonds vaseux que
chaque rvolution soulve, et qui, si l'on n'y prend pas garde, finira par nous
submerger, pourra tre considr certainement comme un des plus utiles
bienfaiteurs de l'humanit. Je respecte les naves illusions des moralistes qui croient
l'amlioration possible d'lments apportant leur infriorit en naissant, mais je
crois que peu d'illusions auront cot plus cher aux socits qui se sont laiss
influencer par elles.
Au point de vue de la constitution mentale, l'hrdit a des consquences
galement trs importantes. C'est elle, en effet, qui cre cette constitution. L'esprit
de l'tre qui vient au monde n'est pas une table rase, comme on le croyait encore au
dernier sicle. L'homme n'apporte aucune connaissance en naissant, mais il apporte
quelque chose de plus prcieux : des aptitudes trs variables, suivant l'individu ou
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
181
la race, se servir des connaissances qu'il va acqurir. Ce sont ces aptitudes qui
font que l'intelligence d'un sauvage et celle d'un tre civilis sont si diffrentes,
qu'il n'y a aucun systme d'ducation qui puisse amener le premier galer le
second. L'hrdit seule, en agissant pendant plusieurs gnrations, pourrait
produire une telle rntamorphose.
Les sentiments dont l'association constitue notre morale, nos aptitudes bonnes
ou mauvaises, nos vices et nos vertus, tant mis en nous par l'hrdit, et l'hrdit
reprsentant un pass d'une immense longueur, on conoit que l'ducation, qui
n'agit que pendant plusieurs annes, ne puisse avoir qu'une influence trs faible.
Assurment on ne saurait contester son rle, mais on peut la comparer un grain de
sable ajout une montagne. Sans doute la montagne n'a t forme que par
l'accumulation des grains de sable, mais il a fallu un grand nombre de sicles pour
les runir.
Ce pass immense que nous portons en nous-mmes, nous ne le sentons pas plus
que nous ne sentons la pression norme de l'atmosphre qui nous entoure ; son
existence n'en est pas moins relle. Le pauvre diable qui, malgr sa misre, rapporte
son lgitime propritaire le billet de banque qu'il a trouv ses pieds, et que
personne ne l'a vu ramasser, ne se doute pas que c'est ce pass qui a parl en lui. Ce
sont les croyances de nos anctres qui sont encore, sans que nous nous en doutions,
la base de notre morale actuelle.
Nous comprenons combien ce pass agit puissamment en nous, quand nous
voyons de nos jours encore des savants minents, habitus distinguer dans leurs
laboratoires la vrit de l'erreur, croire sans difficult aux superstitions religieuses
les plus absurdes, admettre, par exemple, que le monde a t cr par un tre
tellement vindicatif et froce, qu'il a puni toute la descendance du premier homme,
parce que celui-ci lui avait vol une pomme, et n'a pu apaiser sa colre qu'en
envoyant sur la terre son propre fils pour racheter par un supplice horrible cette
ancienne faute. Nous pourrions montrer que bien des esprits indpendants, que de
telles superstitions rvoltent ou font sourire et qui croient s'tre soustraits aux
influences hrditaires, en professent d'aussi tranges.
Les consquences de l'hrdit au point de vue politique et social sont
galement considrables. Trop visibles pour ne pas avoir t remarques des
anciens, elles ne leur ont pas chapp. C'est sur l'hrdit que les institutions les
plus fondamentales des socits se sont bases. Aussi bien chez les Juifs que chez
les Romains, les Hindous et les Chinois, il tait admis que le fils est l'image relle
du pre et doit possder ses qualits et ses dfauts. Plutarque, dans ses observations
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
182
sur les dlais de la justice divine, dit que les enfants des hommes vicieux et
mchants tant une drivation de l'essence de leurs parents , on doit justement
soumettre les seconds toutes les suites d'une action commise par les premiers .
C'est l, du reste, ce que met en pratique la loi chinoise qui, dans les cas de crimes
graves, punit galement les ascendants et les descendants des coupables. Le lecteur
croyant de la Bible ne saurait se rcrier sur l'injustice de ce chtiment, car le fait de
la rversibilit des peines est frquent dans la loi mosaque, et nous y voyons Dieu
se venger sur toute la postrit d'Adam de la faute de notre premier pre. Il fallait
du reste que les chrtiens fussent bien pntrs des lois de l'hrdit, pour avoir
perscut pendant dix-huit cents ans les Juifs cause des crimes commis, suivant
eux, par les anctres de ces derniers lorsqu'ils firent mourir leur Dieu.
C'est en se basant sur l'hrdit des qualits et des vices que toutes les socits
antiques ont fond les systmes qui, sous les noms divers de castes, de classes, de
noblesse, etc., se ramenaient runir dans un mme groupe rigoureusement spar
des autres les individus dous de qualits dtermines, afin de perptuer ces
qualits dans leurs descendants. Conserver la puret du sang tait une rgle
absolue, et la plupart des lgislateurs antiques ont t inflexibles sur ce point.
Lacdmone, on faisait prir les enfants ns faibles et contrefaits. Platon, au livre V
de sa Rpublique, recommande de ne pas lever les enfants de parents peu
estimables . Aristote, dans sa Politique, n'est pas moins explicite. Aux Indes, les
fondateurs du rgime des castes dfendaient, sous les peines les plus terribles,
l'union entre individus de castes diffrentes. L'tre n de l'union du brahmane avec
le coudra, c'est--dire de la premire avec la dernire caste, est considr comme
le plus infme des hommes .
L'extrait suivant des lois de Manou montre de quelle faon les lois
physiologiques de l'hrdit taient alors comprises :
Une femme met toujours au monde un fils dou des mmes qualits que celui qui l'a
engendr.
On doit reconnatre ses actions l'homme qui appartient une classe vile, qui est n
d'une mre mprisable.
Un homme d'une naissance abjecte prend le mauvais naturel de son pre ou celui de
sa mre, ou de tous les deux la fois. Jamais il ne peut cacher son origine.
Dans toutes les civilisations primitives, on retrouve sous une forme ou sous une
autre ce rgime des castes. Il existait au Prou. Suivant le savant anthropologiste
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
183
Morton, les crnes des Incas tmoignaient d'une prminence intellectuelle
dcide sur les autres races du pays .
La noblesse, qui se rapproche du systme des castes, mais en diffre en ce
qu'elle ne forme pas une classe rigoureusement ferme, repose aussi sur le principe
de l'hrdit. En thorie, ce serait une institution laquelle on ne saurait rien
reprocher, si une slection intelligente savait s'approprier les lments suprieurs
qui surgissent dans les diffrentes classes pour les runir en une seule ; mais, ne
des poques o les qualits guerrires taient seules utiles, elle ne pouvait propager
que ces qualits. La noblesse n'a eu que le privilge des vertus guerrires, et lorsque
les perfectionnements de l'armement les rendirent moins utiles, son rle s'effaa.
Les morts violentes et les unions consanguines ont toujours t, du reste, des
ennemis terribles, auxquels elle n'a pu chapper ou n'a chapp que par des fictions
assurant la conservation du nom, mais pas celle du sang. Benoiston de Chteauneuf
a montr, dans son mmoire sur la dure des familles nobles en France, que cette
dure n'excdait pas trois cents ans. Quant leur affaiblissement physique, il a t
trop frquemment observ, alors que la noblesse n'tait pas comme aujourd'hui
uniquement nominale, pour pouvoir tre contest. Pope, suivant Moreau de
Tours, faisait remarquer Spencer que l'air noble que la noblesse anglaise devait
avoir, tait prcisment celui qu'elle n'avait pas ; qu'en Espagne, on disait que
lorsqu'on annonait dans un salon un grand de cette nation, on devait s'attendre
voir entrer une espce d'avorton ; enfin, en France, on imprimait qu'en voyant cette
foule d'hommes qui composaient la haute noblesse de l'tat, on croyait tre dans
une socit de malades ; et le marquis de Mirabeau lui-mme, dans son Ami des
Hommes, les traite de pygmes, de plantes sches et mal nourries.
Considre comme base des institutions politiques, l'hrdit, dans ses fonctions
les plus importantes, telles que celles de souverain, a t un lment de stabilit
qu'on aurait difficilement remplac. Elle empchait toute comptition, ou au moins
rendait rares les comptitions et tous les troubles qu'elles entranent, lorsque le
mrite seul ou la prtention du mrite dcide.
videmment les institutions hrditaires se rattachent trop au pass pour ne pas
tre gnralement hostiles au progrs, et un certain moment elles deviennent plus
nuisibles qu'utiles. Cependant l'importance des traditions et des formes extrieures
est si grande dans les institutions politiques, le pass d'une nation pse tellement sur
elle, que les peuples qui, l'exemple des Anglais, ont su respecter l'aspect extrieur
de ces institutions hrditaires, tout en modifiant graduellement leur fond suivant le
besoin du moment, ont pu arriver sans bouleversement au faite de la grandeur.
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
184
Lorsqu'au contraire une nation veut briser brusquement avec son pass, elle se
voue pour longtemps des perturbations profondes. Les quatorze sicles de
catholicisme et de monarchie des nations latines pseront longtemps encore sur
elles. Dans leurs conceptions politiques les plus avances en apparence, il est facile
de dcouvrir l'influence hrditaire de ce pass. Sa puissance est trop formidable
pour qu'il soit possible de rompre brusquement avec lui. On ne russit gure, en
ralit, qu' rompre avec l'apparence et changer le nom des choses. Le radical
autoritaire, auquel on essaierait de prouver que par ses ides, son idal et sa
mthode, il est catholique et monarchique, considrerait assurment une telle
assertion comme absurde ; et pourtant elle serait trs juste. Il est catholique et
monarchique, et la foule qu'il croit avoir convertie l'est encore plus que lui. Sans
doute elle ne veut plus de rois, mais elle obit servilement aux ordres des plus
obscurs sectaires et rve un rgime o les proltaires, rois leur tour, dicteraient
des lois au reste de la nation. Elle mprise les anciens dieux, mais elle s'en est cr
de nouveaux : l'Humanit, la Raison, l'galit, etc., auxquels elle rend un culte
aussi jaloux et exclusif qu'autrefois aux premiers. Ce pass que nous maudissons,
en oubliant que nous en sommes fils, est mort pour toujours et ne peut revenir ;
mais, comme la robe de Nessus, il reste attach nos flancs, et il faudra bien des
gnrations encore avant qu'il ait cess d'tre tout-puissant sur nous.
Il serait inutile de pousser plus loin cette tude de l'influence de l'hrdit sur
nos conceptions ; trop de prjugs lveraient leur voix. Si je voulais la mettre
davantage en vidence, j'aurais citer bien d'autres preuves. Je montrerais, par
exemple, que nos rformateurs socialistes et communistes, qui se croient les plus
avancs, sont plus que personne sous l'influence hrditaire du pass, et qu'en
croyant regarder l'avenir, c'est au contraire sur un pass mort depuis longtemps
qu'ils jettent les yeux. L'tat social rv par Auguste Comte et les positivistes, avec
leur grand-prtre, leur hirarchie de philosophes, leur interdiction des recherches
qui sembleraient inutiles, ne diffrerait en rien du rgime catholique l'poque de
l'inquisition. L'idal des communistes reprsente gnralement des rminiscences
ataviques, - bien naturelles chez des cerveaux infrieurs sentant d'instinct que la
civilisation est trop leve pour eux, - d'un pass que la plupart des peuples
primitifs ont travers et o tout, en effet, depuis les femmes jusqu'au sol, tait
commun. Mais, dans ce pass, les hommes n'avaient pas t rendus
intellectuellement ingaux par des sicles de civilisation, et pour le rtablir il
faudrait anantir la civilisation d'abord, liminer soigneusement toutes les
supriorits intellectuelles ensuite, et instituer enfin un rgime despotique charg de
faire prir ces dernires aussitt qu'elles se manifesteraient. L'influence de
l'hrdit doit maintenant apparatre vidente. Les penseurs qui, comme Buckle,
ont ignor ou mconnu son importance, ont ignor ou mconnu aussi le rle des
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
185
plus puissants facteurs de l'volution sociale, et se sont interdit les moyens de
comprendre la gense et la transformation de nos sentiments et de nos croyances.
L'hrdit cre la forme du corps, le caractre, la morale et les croyances, et il est
impossible de rien comprendre au prsent sans se reporter au pass qui l'a
engendr. C'est lui qui a mis en nous ces sentiments sans lesquels aucune socit
n'est possible, ces aptitudes intellectuelles sans lesquelles aucune civilisation ne
peut grandir. Toutes ces gnrations qui dorment dans la poussire vivent
aujourd'hui en nous. Parmi les influences diverses qui mnent l'homme, la plus
puissante encore est celle des morts.
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
186
Deuxime partie
LES SOCITS
Leurs origines et leur dveloppement
livre II : Les facteurs de lvolution sociale
Chapitre XI.
Influence des illusions
et des croyances
Retour la table des matires; retour au dbut du chapitre
1. Influence des illusions. - Rle important qu'elles exercent sur l'volution de l'homme. Sous le nom d'idal elles constituent le but que poursuivent tous les hommes. - Leur ncessit et
leur puissance. - Danger de les dtruire. - L'homme ne peut s'en passer. - II. Influence des
croyances religieuses. - Les religions reprsentent les illusions formules en doctrines. -Idals
divers qu'elles ont proposs l'homme. - Toute-puissance des religions sur les mes dans
l'antiquit classique. - Le droit et les institutions politiques reposaient sur elles. - Tous les dtails
de la vie taient rgls par la religion. - Disparition des religions antiques. - Nouvel idal cr par
le christianisme. -Rle considrable qu'il a jou dans le monde. - Idal des religions de l'Inde. Leur influence. - Influence de la religion sur la conduite.
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
187
I. - Influence des illusions.
Retour la table des matires; retour au dbut du chapitre
L'influence des divers facteurs de l'volution sociale tant trs variable, suivant
les temps qui les ont vus agir, il n'est gure possible de les ranger par ordre
d'importance. Si leur valeur absolue devait servir les classer, ceux dont j'ai crit
les noms en tte de ce chapitre figureraient assurment en premire ligne.
En parcourant les ouvrages des auteurs qui ont crit sur la philosophie de
l'histoire, et essay par consquent de pntrer les causes des vnements, on ne
voit pas figurer les illusions comme facteurs de l'volution sociale. L'influence de
cette forme particulire des illusions constitue par les croyances religieuses, est la
seule qui soit reconnue, et encore il est rare qu'on lui accorde l'importance qu'elle
mrite.
J'ai indiqu dans un autre chapitre le rle fondamental des sentiments, et montr
qu'il suffirait de les anantir pour anantir du mme coup toute l'activit humaine.
Rechercher le plaisir et fuir la douleur, c'est cela que peut se ramener en dernire
analyse le but de toute existence.
Ds qu'il commena raisonner, l'homme reconnut bien vite que la vie tait, en
ralit, quelque chose de dur, que ce n'tait que trs exceptionnellement qu'on
atteignait le plaisir et qu'on fuyait la douleur. Le dsir enfantant toujours
l'esprance, il en arriva bientt esprer pour l'avenir ce qu'il ne pouvait obtenir
pour le prsent. Il se forma alors un idal de bonheur qui devint le but toujours
fuyant, mais toujours poursuivi, vers lequel tendirent tous ses efforts.
Le rle que joue l'idal ou, en d'autres termes, l'illusion dans l'existence de
l'homme, apparat clairement quand on considre que, quelles que soient les
conceptions diverses que nous nous formons de la vie, tous : croyants, sceptiques,
savants ou ignorants, nous esprons toujours la ralisation d'un idal quelconque de
gloire, de fortune, de richesses, de plaisirs, de dcouvertes, etc. Pour rendre l'enfer
effroyable, il a suffi de dire que c'tait un lieu o l'on perdait pour toujours
l'esprance. Grce cette ondoyante chimre, nous nous acheminons doucement
vers la tombe sans trop sentir les ronces du chemin.
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
188
Ces idals divers que l'homme poursuit jusqu'au tombeau varient suivant les
races, les ges, le degr de culture intellectuelle, les croyances, etc., et n'ont de
commun que leur irrsistible puissance sur nous. L'idal du sauvage est une
existence remplie de chasses et de combats, celui du savant, la connaissance de
l'inconnu. L'ambitieux a devant les yeux la fortune et les honneurs qu'il ne possde
pas encore. L'picurien songe aux plaisirs, le cocher de fiacre son pourboire, le
dvot une vie future, - une autre forme du pourboire, - o ses mortifications
recevront une gigantesque rcompense. Au fond la valeur relle de tous ces idals
est exactement celle des rves d'un mangeur d'opium, c'est--dire parfaitement
nulle.
Ce sont de vaines ombres, mais ce sont des ombres qui ont conduit l'humanit
jusqu'ici, et sont destines sans doute la guider toujours. Que serait l'homme sans
illusions et par consquent n'ayant rien esprer ou craindre ? Grce ces
charmeuses, si nous ne possdons pas le bonheur, au moins en avons-nous l'image.
Vraies souveraines du monde, les illusions cachent l'homme la ralit des choses
et crent un but son existence. Les soucis qu'il se donne pour courir aprs elles
l'empchent de trop penser. Pour rendre les hommes malheureux, comme l'a dit
Pascal, il suffirait de leur ter tous les soins et les soucis qui remplissent leur vie,
car alors ils se verraient et penseraient ce qu'ils sont, d'o ils viennent, o ils
vont .
Il n'est pas douteux, en effet, que pour la trs immense majorit des hommes la
vie est un lourd fardeau, sans compensation relle. Travailler douze heures par jour
une tche abrutissante dans une usine ou labourer pniblement la terre, pour avoir
le droit de recommencer le lendemain en attendant la vieillesse, les infirmits et la
pourriture du cercueil, reprsente la destine du plus grand nombre. Celle des
riches et des puissants n'est gure au fond meilleure. Quiconque les observe de prs
en est vite convaincu. Fatigu des grandeurs, l'auteur de l'Ecclsiaste, aprs avoir
montr la vanit de toutes choses, en arrivait conclure qu'il prfrait l'tat des
morts celui des vivants.
On n'a gure rfut l'Ecclsiaste, et ce n'est pas moi qui tenterai cette tche.
J'admets volontiers avec lui la vanit de nos joies et de nos esprances, et reconnais
que, plus on creuse la ralit des choses, plus elles se montrent sous un aspect noir.
L'homme apparat alors comme la dupe perptuelle des plus dcevants mirages ;
l'univers devient un immense abattoir, la vie une lutte de tous les instants consacre
la poursuite de buts insenss, l'amour un fantme qui ne laisse que des dceptions
derrire lui, la gloire une ide purile, le monde enfin un grand rve, o n'existe
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
189
rien de rel, et o l'on chercherait vainement un sage capable de rpondre la
question ironique, pose il y a dix-huit cents ans Jsus par le Romain Pilate :
Qu'est-ce que la vrit ?
Mais les illusions nous cachent tout cela. Grce ces sduisants fantmes, le
pessimiste le plus sombre a certainement rencontr dans sa vie des heures si
charmantes, qu'il et voulu les fixer pour toujours. Qu'importe qu'il s'agisse
d'apparences vaines ! Quand je vois jouer sur une scne un drame qui m'motionne,
je me soucie bien vraiment que les personnages, dont le sort m'attendrit, ne
reprsentent que des fictions!
L'importance du rle des illusions tant vidente, je ne m'explique gure la
persistance avec laquelle divers philosophes, tels que Schopenhauer et Hartmann,
se sont acharns contre elles. Serait-ce pour rendre l'homme heureux ? ils
n'admettent pas le bonheur. Serait-ce par amour de la vrit ? ils enseignent qu'elle
est aussi une illusion. Avant de dpenser tant d'efforts pour dtruire ces fantmes
enchanteurs, il faudrait se demander d'abord ce que deviendrait l'homme sans eux.
Le misrable attach son dur labeur, le martyr sur son bcher, le croyant qui passe
sa vie se mortifier, la mre qui espre revoir un jour le fils ador qu'elle vient de
perdre, ne connatraient qu'un sombre dsespoir sans leur puissant secours. Je
comparerais volontiers ces froces dtracteurs de l'illusion au prtendu sage qui, au
milieu d'un festin, viendrait m'apprendre qu'on a laiss tomber par mgarde dans les
plats des cheveux que je n'aurais pas aperus sans lui. Ce qui me procurait une
jouissance agrable, il y a un instant, ne va plus m'inspirer que rpulsion
maintenant. Il ne faut pas trop toucher toutes ces ombres dores qui cachent
l'homme l'horreur des choses. L'pe de Damocls n'est menaante que quand on
voit le fil lger qui la tient suspendue. Le sage n'est pas celui qui s'exhale en vaines
plaintes et ne voit que calamits partout. Je donnerais plutt un tel nom au
philosophe rsign qui, ayant suffisamment pntr les ralits de la vie et vu
l'envers des choses, sait que les illusions seules constituent le bonheur et ne les
mprise pas, profite des heures heureuses quand elles se prsentent, sait dire un
ternel adieu aux bonheurs d'occasion qu'il rencontre, afin d'avoir les regretter, est
indulgent pour les autres, se plie sans rcriminer devant les ncessits et ne cherche
pas trop dcouvrir ce que cachent les apparences.
II. - Influence des Croyances religieuses.
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
190
Retour la table des matires; retour au dbut du chapitre
L'importance des illusions dans l'existence de l'homme tant bien comprise, le
rle des religions, c'est--dire des illusions traduites en corps de doctrine, est facile
pressentir.
Les ncessits diverses qui ont donn naissance aux religions et ont rendu
possible l'tablissement de chacune d'elles, seront examines ailleurs. Je veux
seulement maintenant envisager le rle que jouent les religions quand elles sont
tablies. En ce qui concerne leur origine, je me bornerai dire que ce n'est pas
l'esprance en quelque chose de meilleur qui les a fait natre. Comme l'a dit
justement un pote latin, c'est la peur qui a d'abord enfant les dieux.
Une fois constitus, tous les cultes ont offert leurs adeptes quelque chose
esprer ou craindre. Les peuples civiliss qui ont laiss leurs traces dans l'histoire
nous apparaissent avec une organisation religieuse trs forte, o figurent toujours
les rcompenses et les chtiments, et en creusant un peu l'tude de leur organisation
politique et sociale, on reconnat que les institutions religieuses ont eu une
puissance telle que, dans toute l'antiquit classique, c'est de ces institutions que
l'tat politique et social drive.
Le seul but possible qu'une religion puisse offrir aux souhaits des hommes est le
bonheur : c'est le seul en ralit qu'elle leur ait gnralement offert.
L'affirmation que la vertu est le but de la vie, crit Bain dans son Trait de
logique, est presque toujours lie cette autre assertion : que, dans le cours
ordinaire des choses, la vertu fait le bonheur. Dans ce cas, on ne fait en dfinitive
que prendre un moyen dtourn pour dsigner le bonheur comme notre fin.
L'idal de bonheur que les religions offrent leurs adeptes ne se prsente pas
dans toutes sous la mme forme ; et, bien que ne traant pas dans ce chapitre
l'histoire des religions, je suis oblig de rappeler, en quelques mots, les illusions
dont chacune a fait esprer la ralisation ses sectateurs.
Un des philosophes pessimistes auxquels je faisais allusion plus haut,
l'ingnieux auteur de la Philosophie de l'inconscient, admet que dans la recherche
du bonheur l'humanit a parcouru trois stades d'illusions. Dans le premier,
reprsent par l'antiquit juive, grecque et latine, le bonheur est considr comme
ralisable pour l'individu dans la vie terrestre. Dans le second, reprsent par le
christianisme, il n'est plus ralisable que dans une vie future aprs la mort. Dans le
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
191
troisime enfin, que nous traversons aujourd'hui, il est considr comme ralisable
sur la terre, mais seulement dans le dveloppement futur du monde.
Ce que Hartmann appelle les trois stades de l'illusion correspond assez
exactement aux divers idals offerts par les religions ; et, tout incomplte que soit
une classification aussi succincte, elle suffira cependant pour le but que je me
propose dans ce paragraphe, de montrer l'influence des illusions religieuses sur
l'volution des socits.
Dans les plus anciennes formes de l'idal religieux, le bonheur est promis en ce
monde, pendant la vie de l'individu. Le plus souvent, dans la Bible le juste est
immdiatement rcompens et le coupable immdiatement puni. Celui qui observe
les commandements de Dieu obtient des richesses et jouit d'une longue vie. Quant
l'idal recherch, il consiste beaucoup plus dans le bonheur du peuple ou de la cit
que dans celui de l'individu. Dans toutes les socits antiques rgnait une sorte
d'gosme collectif - elles n'eussent pas exist sans lui - qui faisait que chaque
individu, se considrant comme le reprsentant du peuple entier, ressentait
profondment ce qui pouvait lui arriver de malheureux ou d'heureux. Un Athnien
ou un Romain ne voyait rien de plus souhaitable que la grandeur d'Athnes ou la
puissance de Rome.
J'ai dj montr que la prtendue libert antique n'avait jamais exist et ne
pouvait pas exister. Directement, ou par l'intermdiaire de l'tat auquel elle tait
troitement lie, la religion rglait absolument toutes les actions. Dans l'antiquit
classique, les moindres dtails de la vie taient revtus d'une sanction religieuse
qu'on ne pouvait transgresser sans encourir la colre d'un pouvoir surhumain. La
forme de l'tat y dcoulait de la religion, et cela tel point, comme le dit Hegel,
que la constitution politique d'Athnes et de Rome n'tait possible qu'avec le
paganisme particulier ces peuples .
La place occupe par la religion, dans la vie d'un Romain ou d'un Grec, tait
prpondrante. Sans parler des anctres qui avaient leur culte son foyer, il vivait
dans un peuple de dieux ; et, ces dieux, il fallait les craindre. On ne se dcidait
rien entre prendre sans avoir consult leur volont au moyen des prsages. Un chef
d'arme n'et pas russi se faire obir s'il n'et consult les auspices et immol des
victimes. Quand Camille veut vaincre les trusques, les Romains consultent les
oracles et excutent leurs prescriptions les plus compliques, telles que d'abaisser le
niveau d'un lac ; le succs n'arrivant pas encore, ils s'emparent d'un prtre trusque,
pour savoir par lui le secret des dieux. Un Spartiate ou un Athnien n'agissait pas
autrement ; un mauvais prsage le faisait renoncer l'entreprise la mieux combine.
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
192
Athnes tait couverte de temples et de chapelles. On consultait les auspices pour
se marier, pour s'embarquer ou pour commencer une entreprise quelconque. Nicias
commande une flotte athnienne pour aller prendre Syracuse sur la foi de certains
oracles, et est battu. Au moment o il allait commencer sa retraite, et alors qu'elle
tait facile encore, survient une clipse de lune dont le devin de l'arme tire la
conclusion qu'on doit attendre trois fois neuf jours. Nicias reste dans l'inaction et
passe tout ce temps en sacrifices et en prires. Les ennemis en profitent pour fermer
le port et dtruire entirement sa flotte et son arme. A la nouvelle du dsastre, les
Athniens ne reprochrent leur gnral que le choix d'un devin ignorant.
Les anciens dieux, juifs, grecs ou latins, taient des dieux spciaux chaque
peuple ou chaque cit, ne protgeant qu'eux et ne voulant pas d'trangers dans
leurs temples, mais c'taient des dieux que tous les peuples craignaient. Quand
Rome s'emparait d'une ville, elle s'emparait aussi des dieux des vaincus et tchait
de se concilier leur bienveillance en les adorant.
Il faudrait pntrer dans les mille dtails de la socit antique pour comprendre
quel point la religion rglait la moindre des choses, de l'individu la famille, de
cette dernire au gouvernement. Ce n'est qu'en pntrant dans ces dtails qu'on
comprend ce rgime social des anciens o, comme l'a dit M. F. de Coulanges, la
religion tait matresse absolue dans la vie prive et dans la vie publique, o l'tat
tait une communaut religieuse, le roi un pontife, le magistrat un prtre, la loi une
formule sainte ; o le patriotisme tait de la pit, l'exil une excommunication ; o
la libert individuelle tait inconnue, o l'homme tait asservi l'tat par son me,
par son corps, par ses biens ; o la haine tait obligatoire contre l'tranger ; o la
notion du droit et du devoir, de la justice et de l'affection, s'arrtait aux limites de la
cit ; o l'association humaine tait ncessairement borne dans une certaine
circonfrence, autour d'un prytane, et o on ne voyait pas la ncessit de fonder
des socits plus grandes 34.
Nous n'avons parl jusqu'ici que des religions de la Grce et de Rome ; mais, en
portant nos regards sur d'autres contres, l'gypte ou l'Inde, par exemple, nous
aurions trouv que toutes, sans exception, ont eu la mme influence et pli les mes
sous les mmes lois de fer. Nous avons assez montr, combien la fixit des
34
Fustel de Coulanges : la Cit antique. - En cherchant uniquement dans les changements de religion la raison
exclusive des changements sociaux, l'auteur a mconnu l'importance d'autres facteurs considrables qui
dterminent l'volution sociale. L'influence des religions est certainement immense ; mais je ne crois pas qu'on
puisse dire que par cela seul que l'tat n'avait plus sa religion officielle, les rgles du gouvernement des
hommes furent changes pour toujours. - Les religions n'ont d'influence qu' la condition de se mettre en
harmonie avec les besoins des peuples o elles s'tablissent ; et ce ne sont pas elles qui crent ces besoins,
rsultats de ncessits antrieures.
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
193
coutumes tait ncessaire dans les socits primitives et en mme temps difficile
tablir, pour reconnatre que les rgles tyranniques que les religions imposrent et
maintinrent par des sanctions terribles furent alors utiles. Les peuples ayant eu des
lois religieuses fortement constitues ont t les seuls progresser.
Lorsque, sous l'empire de causes que nous n'avons pas examiner maintenant,
les religions qui avaient form les bases sur lesquelles s'taient difies les
institutions et la morale du monde antique prirent, la religion nouvelle qui s'tablit
alors en Europe proposa l'homme un idal nouveau. Semblable en cela aux
religions de l'Inde, avec lesquelles il a, du reste, bien d'autres ressemblances encore,
le christianisme proclama que l'idal du bonheur n'tait pas ralisable dans cette
vie, et le reporta dans une vie future. Aussi pessimiste que les philosophes
modernes qui le sont le plus, le fondateur du christianisme proclama l'inanit des
choses de ce monde. L'homme doit traverser la vie comme une valle de larmes, et
supporter l'existence comme un fardeau, pour arriver une vie bienheureuse
remplie de dlices ternelles. De telles promesses correspondaient trop aux besoins
des mes, pour ne pas tre adoptes avec ardeur. Une religion semblable devait
devenir bientt la religion des pauvres, des affligs, des misrables, c'est--dire de
la majorit des hommes. Elle le devint en effet.
Mais, toute pessimiste qu'ait pu tre la conception du christianisme, elle devait
trouver, sur un autre point du globe, une conception plus pessimiste encore. Trs
analogue au christianisme, bien que fort suprieur lui dans les dtails
philosophiques, le bouddhisme poussa plus loin encore son mpris des choses de ce
monde. La vie lui parat chose si laide et lui inspire un dsespoir si incurable, qu'il
considre que la suprme rcompense qu'une religion puisse offrir ses disciples,
est le Nirvan, c'est--dire l'anantissement final, l'ternel repos, aprs des
transmigrations sans nombre. Il faut que la rcompense ait paru bien sduisante,
puisque, grce cette perspective, cette antique religion a pu envelopper l'homme,
dans le cours de sa vie, de prescriptions innombrables rglant les moindres dtails
de son existence. Vingt-huit enfers effroyables maintiennent, du reste, ses disciples
dans l'obissance.
Je ne veux pas examiner maintenant l'influence du bouddhisme : il faudrait
d'abord dcrire le caractre du milieu o il a pris naissance et des races o il s'est
dvelopp. Je me bornerai parler de l'idal du christianisme, religion ne dans des
temps que nos tudes classiques rendent prsents tous les esprits. On peut dire
que l'idal nouveau, cr par lui, eut sur les socits nouvelles une influence aussi
grande que celle, bien profonde pourtant, des religions qui l'avaient prcd. En
permettant tous les hommes d'aspirer au bonheur, et un bonheur ternel, il
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
194
donna ses croyants un solide appui contre les durets du sort. Aux dieux de
chaque cit, qui repoussaient l'tranger de leurs temples, il substitua un dieu
unique, le mme pour toutes les races, qui ne repoussait personne, proclamait tous
les hommes frres, leur enseignait qu'ils avaient des devoirs entre eux, et crait
ainsi une morale universelle. Le gouvernement et le droit des anciens taient
uniquement fonds sur la loi religieuse. Il les spara entirement ; et alors que
l'ancien droit ne pouvait changer, ou ne changeait qu'au moyen de fictions trs
difficiles tablir, parce qu'une tradition religieuse invariable ne les reconnaissait
pas, le droit nouveau put se modifier avec les intrts et les besoins de chaque
gnration nouvelle. la chute de l'Empire, le christianisme continua la civilisation
romaine, en recueillant d'elle ce qui pouvait tre sauv, et empcha les peuples que
Rome maintenait jadis sous sa loi, de se dissocier et de s'parpiller en tribus. Au
moyen ge, son indpendance relative lui permit d'adoucir les rapports des
seigneurs avec leurs sujets, des rois l'gard des peuples. Tout en adoucissant les
murs, il n'tait pas cependant l'homme les sentiments qui rendent les caractres
forts et nergiques, car il n'y a pas de caractres aussi forts et aussi nergiques que
ceux qui ont une foi profonde. Comme le fait remarquer Bagehot, propos d'un
passage o Carlyle parle de cette parole de Cromwell : Ayez confiance en Dieu,
et tenez votre poudre sche , la crainte de Dieu rendait aux soldats autant de
service que la poudre, et mme davantage. Cette concentration nergique de
sentiments puissants permet aux hommes de tout oser, de tout accomplir. C'est
grce cette foi aveugle que Mahomet, dont la religion n'tait, du reste, qu'une
forme particulire du christianisme, russit fanatiser les peuples et conqurir
une partie du monde.
Il s'en faut de beaucoup, malheureusement, que le rle du christianisme ait t
exclusivement utile ; mais, si le mal qu'il a produit par son intolrance cruelle, par
les flots de sang qu'il a verss et son hostilit au progrs, est grand, le bien qu'il a
produit fut certainement plus grand encore.
Je n'ai pas examin dans ce qui prcde l'influence que peuvent avoir les
croyances religieuses sur la conduite. Cette influence sera tudie dans le chapitre
consacr l'volution de la morale. J'y montrerai que cette influence est beaucoup
plus apparente que relle, qu'indpendante des religions, la morale fait partie de
l'hritage apport en naissant, et que, si les croyances des temps prsents peuvent
prparer la morale de l'avenir, la morale des ges actuels a t labore dans les
temps passs.
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
195
Deuxime partie
LES SOCITS
Leurs origines et leur dveloppement
livre II : Les facteurs de lvolution sociale
Chapitre XII.
Influence des institutions politiques
et de l'action des gouvernements.
Retour la table des matires; retour au dbut du chapitre
1. Relations entre les institutions d'un peuple et sa constitution mentale. - Anciennes ides sur
l'influence des institutions et des gouvernements. - Comment elles se sont modifies. - Ides
actuelles sur l'enchanement des faits historiques. - Les institutions politiques ne sont pas luvre
de la volont des hommes. - On les subit et on ne les choisit pas. - Preuves historiques. - Gense
de quelques institutions. - Esclavage, fodalit, royaut, etc. - Formation de la constitution
anglaise. - Valeur relative des institutions politiques. - Difficult de les transplanter. - Erreurs des
rformateurs politiques et sociaux. - II. Influence des gouvernements. - Conditions qui rendent
avantageuse ou nuisible leur intervention. - Cette intervention doit tre porte son maximum ou,
au contraire, rduite son minimum, suivant la race, les habitudes, les conditions d'existence, les
sentiments, etc. - Exemples divers.
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
196
I. - Relations entre les Institutions politiques
d'un Peuple et sa Constitution mentale.
Retour la table des matires; retour au dbut du chapitre
Rien n'est plus frappant pour l'observateur qui examine l'histoire des opinions
humaines, que de voir combien de doctrines, considres pendant des sicles
comme des vrits incontestables, ont fini par devenir, sous l'influence de certains
progrs scientifiques d'incontestables erreurs.
L'influence attribue aux gouvernements sur l'volution des peuples en est un
exemple. Ce fut pendant longtemps une vrit universellement admise que
l'volution des peuples tait la consquence de la perfection des institutions qui les
rgissent et de la qualit de leurs gouvernements.
Trs fonde en apparence, cette opinion l'est fort peu en ralit et n'a plus gure
pour partisans que quelques hommes d'tat attards ou des rvolutionnaires
obstinment ignorants. Aujourd'hui la plupart des historiens philosophes ont soin en
commenant leurs livres de marquer qu'ils se sont entirement affranchis de cette
vieille erreur.
Le lecteur qui nous a suivi jusqu'ici voit facilement pourquoi ils ont d s'en
dgager pour toujours. Les sentiments de l'homme diffrant entirement suivant les
temps, les lieux, les races et les institutions de chaque peuple et devant varier
suivant l'tat de ses sentiments, on conoit que les institutions qui conviennent aux
uns ne sauraient nullement convenir aux autres ; que ds lors il est impossible, aussi
bien pour un gouvernement que pour un peuple, de changer d'une faon durable ses
institutions, et par consquent que l'influence des gouvernements est beaucoup
moindre qu'elle ne le parat tout d'abord.
Cette conception a une importance telle, qu'il importe d'en indiquer nettement
l'origine. Ramene ce fait, que l'histoire est une suite d'vnements
rigoureusement enchans pouvant tre considrs comme les termes d'une srie
drivant les uns des autres, elle est fort ancienne ; on pourrait en retrouver la trace
dans les temps antiques, mais on ne la voit bien exprime que dans des auteurs
modernes. Elle est implicitement comprise dans cette ide de Leibnitz, qu'une
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
197
intelligence suffisamment pntrante pourrait lire dans les choses actuelles ce
qu'elles ont t et ce qu'elles seront. On la trouve plus clairement exprime dans
Kant, et surtout dans Hegel qui considrait que les arts et la philosophie d'un peuple
correspondent fatalement certains tats d'esprit et disparaissent avec eux ; mais
c'est principalement dans les crits du philosophe franais A. Comte que cette
conception historique se manifeste nettement.
Les opinions humaines, qui en dfinitive rglent la forme des socits, dit M. Littr,
rsumant la doctrine de Comte, ont une filiation propre, l'ordre n'en est aucunement
fortuit, elles se suivent d'aprs une loi dtermine. En d'autres termes, les socits ont une
force intrinsque qui annule les influences accidentelles et finit toujours par
prdominer... . A quoi ont servi, depuis soixante ans en France, et hors de France, les
efforts conservateurs, si ce n'est prparer des rvolutions et des ruines ? Les socits ne
sont point une cire molle qu'un gouvernement faonne son gr. Les tentatives chouent
galement, soit faire passer prmaturment un peuple sous une civilisation trop avance,
soit le repousser intempestivement vers une civilisation abandonne 35.
Si excellents que soient les arguments invoqus par A. Comte, il semble qu'ils
aient beaucoup plus touch ses lecteurs que lui-mme, puisque, aprs avoir bien
prouv l'impossibilit de rorganiser une socit son gr, il finit par proposer une
rorganisation nouvelle.
L'historien anglais Buckle, qui crivit aprs Comte, professa une opinion moins
nettement exprime peut-tre, mais au fond identique.
Pour quiconque a tudi l'histoire dans les sources primitives, cette opinion, que la
civilisation de l'Europe est due principalement l'habilet qui a t dploye par les
diffrents gouvernements et la sagacit avec laquelle les maux de la socit ont t
pallis par les remdes lgislatifs, peut avoir l'air d'tre assez extravagante pour qu'il soit
difficile de la rfuter avec la gravit ncessaire. En ralit, parmi toutes les thories
sociales qui ont jamais t inventes, il n'y en a aucune qui soit aussi insoutenable, aussi
errone sous tous les rapports que celle-ci. Nous avons d'abord la considration vidente
que les individus qui gouvernent un pays ont toujours t dans les circonstances
ordinaires des habitants de cette contre, nourris de sa littrature, levs dans ses
traditions et imbus de ses prjugs. De tels hommes ne sont tout au plus que les cratures
du sicle ; ils n'en sont jamais les crateurs. Les mesures qu'ils prennent sont le rsultat et
non la cause du progrs social 36.
Aujourd'hui cette doctrine est devenue gnrale parmi les historiens philosophes
au courant des recherches scientifiques modernes. Je me bornerai pour le prouver
citer quelques passages des auteurs qui ont le mieux appliqu la mthode
35
36
Littr, Conservation. Rvolution, Positivisme.
Buckle, Histoire de la civilisation anglaise, traduction franaise, t. 1er.
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
198
scientifique aux phnomnes historiques ou philosophiques, MM. Taine, Herbert
Spencer et F. de Coulanges.
Toute notre argumentation, crit Spencer, repose sur l'ide que, pour chaque socit
et pour chaque phase de son volution, il y a un mode de pense et de sentiment
appropri, et que tout mode de pense et de sentiment qui n'est pas adapt au degr
d'volution et aux conditions de milieu ne peut tre tabli d'une manire
permanente.....Pour qu'une socit subsiste, il faut qu'il y ait harmonie suffisante entre les
institutions ncessaires et les ides gnralement reues 37.
La forme sociale et politique dans laquelle un peuple peut entrer et rester, crit son
tour M. Taine, n'est pas livre son arbitraire, mais dtermine par son pass. Il faut que,
jusque dans ses moindres traits, elle se moule sur les traits vivants auxquels on l'applique :
sinon elle crvera et tombera en morceaux 38.
La mme ide est exprime par M. Fustel de Coulanges de la faon suivante :
Il nous a paru que ces institutions (celles de l'ancienne France) s'taient formes
d'une manire lente, graduelle, rgulire, et qu'il s'en fallait de beaucoup qu'elles pussent
avoir t le fruit d'un accident fortuit ou d'un brusque coup de force... Les institutions
politiques ne sont jamais luvre de la volont d'un homme ; la volont mme de tout un
peuple ne suffit pas les crer. Les faits humains qui les engendrent ne sont pas de ceux
que le caprice d'une gnration puisse changer. Les peuples ne sont pas gouverns suivant
qu'il leur plait de l'tre, mais suivant que l'ensemble de leurs intrts et le fond de leurs
opinions exigent qu'ils le soient. C'est sans doute pour ce motif qu'il faut plusieurs ges
d'hommes pour fonder un rgime politique et plusieurs autres ges d'hommes pour
l'abattre 39.
Comment s'est tablie cette croyance, si gnrale aujourd'hui chez les esprits
instruits ? Sur quelles bases repose-t-elle ? Dans quelles limites est-elle
acceptable ? Nous allons le rechercher maintenant.
Quand on examine aux lueurs de la science moderne les origines et le
dveloppement des institutions d'un peuple, on arrive bien vite se demander
comment l'ide de la ncessit de leur enchanement ne s'est pas prsente plus tt
aux historiens, et on ne russit le concevoir qu'en se rappelant que bien d'autres
vrits devenues banales ont mis des sicles pour s'tablir, et que la notion d'une
providence conduisant les choses son gr et pouvant les modifier suivant nos
prires - notion si rpandue encore - tait en opposition force avec cet
37
38
39
Herbert Spencer, Introduction l'tude de la science sociale.
Taine, les Origines de la France contemporaine, t. 1er.
Fustel de Coulanges, Histoire des institutions politiques de l'ancienne France, prface.
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
199
enchanement. Aussitt qu'on a russi s'affranchir de la notion d'une providence,
et qu'on suit dans ses dtails la filiation des institutions qui rgissent les socits, on
reconnat bientt que, loin d'tre le rsultat de nos caprices, elles sont la
consquence de ncessits sur lesquelles nos volonts ont une action bien faible.
Il faudrait tracer l'histoire d'un grand nombre d'institutions pour faire nettement
saisir les ncessits diverses qui les ont cres, et ce n'est pas un volume qui
suffirait une telle tche. On ne peut donc que se borner ici indiquer en traits
rapides la mthode qui permet d'arriver cette conception de la ncessit et de
l'enchanement des institutions.
Supposons que l'historien, pntr des principes que je viens d'indiquer, veuille
tudier la gense d'une institution telle que l'esclavage, par exemple, et l'histoire de
ses transformations. Laissant de ct les tirades sonores mais inutiles sur son
injustice, il recherche les ncessits qui lui ont donn naissance, et reconnat bientt
que cette institution se rencontre chez tous les peuples aussitt que, sortant de la
sauvagerie primitive, ils s'lvent vers la civilisation, et que ce n'est qu'autant
qu'elle apparat qu'ils russissent progresser ; que ce fut seulement du jour o,
dfaut des machines, qui n'existaient pas encore, l'homme fit travailler pour lui le
vaincu au lieu de le tuer, qu'il eut des loisirs, et que les arts, l'industrie et les
connaissances militaires purent se perfectionner. Suivant la mme institution
travers les sicles, il dcouvre par quelles transitions graduelles, filles les unes des
autres, l'esclavage des temps antiques est devenu le servage de la fodalit, dont
devait natre un jour le proltariat des temps modernes.
Supposons maintenant que le but du mme historien soit de comprendre la
gense et le dveloppement d'institutions plus compliques que celle que je viens
de mentionner, telles que la fodalit et la monarchie en France, par exemple, la
mthode restera la mme. Il n'imiterait pas les anciens historiens consacrant leur
loquence prouver les avantages ou les inconvnients de ces divers rgimes.
Sachant qu'il s'agit d'institutions ncessaires, il les examinerait comme un
naturaliste observe les transformations de l'embryon d'un mammifre quelconque.
Remontant aux origines, il montrerait la dissolution du vaste empire de
Charlemagne aprs sa mort, les invasions des barbares, le brigandage gnral, et
devant l'absence de scurit, la formation de centres de rsistance autour desquels
les habitants venaient bientt s'abriter pour y chercher un appui ; le chef militaire
exposant sa vie pour protger le colon, et ce dernier en cultivant ses terres en
change et lui payant des redevances : de nouveaux venus devenant ses serfs pour
obtenir la mme protection : enfin sous l'influence des ncessits de l'poque la
fodalit se constituant et grandissant graduellement. Il montrerait ensuite comment
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
200
les intrts gnraux commun tous ces chefs conduisirent donner l'un d'entre
eux le titre de roi avec une puissance presque nominale, qui ne servait qu' faire de
toutes ces petites patries, constitues par chaque manoir et son entourage une patrie
unique capable de lutter contre l'tranger, et mme d'envoyer, comme l'poque
des croisades, des armes au dehors. Il ferait voir que la puissance nominale de ce
roi devint forcment bientt trs relle, car, invoqu comme arbitre, servant d'appui
aux faibles, pouvant seul s'occuper d'intrts gnraux : construire des routes, des
forts, des canaux, etc., son rle devait constamment grandir. Suivant l'difice de la
royaut dans sa lente volution, il le montrerait s'levant pierre pierre de Hugues
Capet Louis XIV, et sa puissance, d'abord si faible, grandissant au point qu'il
arriva un jour o l'autorit du roi fut tout, et celle de ses anciens gaux rduite un
simulacre.
S'il voulait faire bien sentir ensuite les ncessits qui ont engendr notre
rvolution, il montrerait l'ancienne noblesse ayant conserv tous les privilges des
ges o elle rendait des services, mais ne les rendant plus ; la royaut, devenue
toute-puissante, s'isolant de la nation, n'entrant plus en relation avec elle, comme
jadis, par l'intermdiaire des tats Gnraux, se jetant dans l'arbitraire, ne sachant
pas se soumettre des rformes ncessaires, et creusant chaque jour l'abme qui
sparait le prsent du pass, en mme temps que se dissolvaient, sous l'influence du
mouvement scientifique, les croyances auxquelles elle avait t longtemps associe,
jusqu'au jour o, mine de toute part, un choc lger la brisa en morceaux.
Si l'historien que je suppose voulait suivre plus loin encore cet enchanement de
ncessits qui constituent l'histoire, et tudier le dveloppement de cette rvolution
qui marque la fin de notre ancien rgime ; il montrerait comment, aprs avoir t la
consquence naturelle du pass qui l'avait prcde, elle ne sut pas continuer ce
pass dont elle tait ne, et tenta vainement de reconstruire une socit de toutes
pices sur un idal rv par quelques philosophes ; comment elle devait chouer
dans cette tentative malgr un rgime de fer qui rduisait rien le rle de l'individu,
malgr un despotisme inquisitorial qui supprimait toute ombre de libert, malgr
des flots de sang verss, malgr une centralisation pousse plus loin qu'elle ne
l'avait jamais t et qui finit par faire de la France un vaste dsert intellectuel,
malgr enfin tous les moyens d'action dont elle pouvait librement disposer, et
comment, bien que partout triomphante, elle finit par s'affaisser d'elle-mme et en
fut rduite acclamer le premier Csar qui s'offrit elle. Il montrerait encore que
les changements si grands accomplis depuis un sicle dans les conditions
d'existence des hommes ne sont nullement dus la proclamation de quelques
principes thoriques, mais au dveloppement qu'ont pris les sciences et leurs
applications ; que la vapeur est une niveleuse autrement puissante que la guillotine,
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
201
et qu'une seule invention, comme les chemins de fer, a eu des rsultats
conomiques et sociaux auprs desquels seraient bien petits les rsultats de toutes
les rvolutions dont le monde a t le tmoin.
S'il voulait insister sur les dangers qu'il peut y avoir pour l'homme
mconnatre les lois de l'volution naturelle et troubler son cours, il suivrait cette
mme rvolution non seulement dans ses consquences immdiatement visibles,
mais dans celles moins visibles, et pourtant aussi profondes, qu'elle a eues sur les
mes. Il montrerait que, si elle a rendu de grands services l'homme en lui crant
un idal nouveau, en rveillant les esprits engourdis par les vieilles croyances, et en
propageant la libre pense travers le monde, elle a en mme temps dvelopp un
degr funeste les instincts rvolutionnaires des foules, et provoqu par suite les
ractions que ces instincts engendrent ; cr la croyance la toute-puissance de
l'tat, et, partant, au succs de ces appels la force qui, devenus le credo de tous
les partis, nous font osciller sans cesse de l'anarchie au despotisme ; fait natre dans
les foules une soif d'galit tout prix, ft-ce l'galit dans la servitude ; engendr,
enfin, ces inimitis de classes qui ont fait disparatre la fraternit pour longtemps et
menacent d'anantir la libert pour toujours.
Ce n'est qu'en suivant ainsi dans leurs profondeurs souterraines les origines des
choses, et en ne s'occupant pas des apparences, qu'on dcouvre la ncessit de leur
enchanement et les lois de leur succession. Rien de plus beau en apparence que la
Constitution anglaise, et plus d'un homme d'tat a essay de l'appliquer son pays.
Transplanter avec succs un arbre, aprs avoir coup ses racines, ne serait pas plus
difficile qu'une telle tche. Il suffit de suivre toute la srie des transformations de
cette constitution sous l'influence des caractres et des circonstances pour ne jamais
rver pareille entreprise. L'insuccs des institutions europennes au Japon, de celles
des tats-Unis dans les rpubliques espagnoles, et bien d'autres exemples que
chacun connat, nous disent ce que produisent de telles tentatives.
Pour indiquer, autant qu'il est possible de le faire en quelques lignes, le
mcanisme de la formation graduelle d'une constitution, j'emprunterai l'minent
historien et homme d'tat Macaulay, quelques extraits relatifs la formation de la
constitution anglaise, qui viennent l'appui de tout ce qui prcde.
Le monde, pendant ces quatre-vingts dernires annes, a t singulirement fcond
en lgislateurs en qui l'lment spculatif prdominait, l'exclusion de l'lment pratique.
L'Europe et l'Amrique ont d leur sagesse des douzaines de constitutions avortes,
constitutions qui ont vcu juste assez longtemps pour faire un tapage misrable, et ont pri
dans les convulsions. Mais, dans la lgislature anglaise, l'lment pratique a toujours
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
202
prdomin, et plus d'une fois prdomin avec excs sur l'lment spculatif. Ne point
s'inquiter de la symtrie, et s'inquiter beaucoup de l'utilit ; n'ter jamais une anomalie,
uniquement parce qu'elle est une anomalie ; ne jamais innover, si ce n'est lorsque quelque
malaise se fait sentir et alors innover juste assez pour se dbarrasser du malaise : n'tablir
jamais une proposition plus large que le cas particulier auquel on remdie : telles sont les
rgles qui depuis l'ge de Jean jusqu' l'ge de Victoria, ont gnralement guid les
dlibrations de nos deux cent cinquante parlements.
Prenant ensuite comme exemple une loi anglaise importante, l'acte de
tolrance , qu'il qualifie d'idal d'une grande loi anglaise, bien qu'elle semble un
chaos d'absurdits et de contradictions , il montre que cette loi, remplie de
contradictions que peut dcouvrir le premier colier venu en philosophie politique,
fit ce que n'et pu faire une loi compose par toute la science des plus grands
matres de philosophie politique.
Que ses articles soient gnants, purils, incompatibles entre eux, incompatibles avec
la vraie thorie de la libert religieuse, chacun doit le reconnatre. Tout ce qu'on peut dire
pour leur dfense est qu'ils ont t une grande masse de maux sans choquer une grande
masse de prjugs ; que, d'un seul coup et pour toujours, sans un seul vote de division
dans l'une ou dans l'autre chambre, sans une seule meute dans la rue, sans presque un
seul murmure mme dans les classes qui taient le plus profondment imprgnes de
bigoterie, ils ont mis fin une perscution qui s'tait dchane pendant quatre
gnrations, qui avait bris un nombre infini de curs, qui avait dsol un nombre infini
de foyers, qui avait rempli les prisons d'hommes dont le monde n'tait pas digne, qui avait
chass des milliers de ces laboureurs et de ces artisans honntes, actifs, religieux, qui sont
la vraie force des nations, et les avait forcs chercher un refuge au-del de l'Ocan,
parmi les wigwams des Indiens rouges et les repaires de panthres. Une telle dfense
paratra faible peut-tre des thoriciens troits. Mais probablement les hommes d'tat la
jugeront complte.
Rien n'est plus profondment juste que ces observations de l'minent historien.
Elles m'ont rappel cette rflexion que me faisait un de nos plus remarquables
hommes d'tat modernes : Ce que je redoute le plus pour un peuple, disait-il, c'est
l'influence politique des savants et des philosophes.
La sentence peut paratre paradoxale, elle est pourtant absolument justifie. Un
savant et un philosophe, trangers aux ncessits pratiques, - mme en les
supposant beaucoup moins thoriciens que ne l'tait le mathmaticien Auguste
Comte quand il fabriquait son systme politique, - voudront toujours tout dduire
de certains principes absolus parfaitement vrais, du reste, mais inapplicables, et ne
se plieront que bien difficilement des ncessits, en apparence absurdes, et en
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
203
faveur desquelles il n'y a, d'ailleurs, qu'un argument, mais un argument capital
faire valoir, c'est qu'elles sont des ncessits.
Je ne saurais mieux rsumer ce qui prcde, qu'en rptant ce que j'ai nonc en
commenant, que les peuples ne choisissent pas leur gr les institutions qui leur
semblent les meilleures ; elles correspondent des sentiments, des besoins qu'ils
n'ont pas crs et qu'ils ne sauraient changer. Oeuvre des sicles, elles ne sont
jamais celle d'un jour. On ne les choisit pas, on les subit.
Une institution, quelle qu'elle soit, n'a jamais qu'une valeur relative. La libert
est en principe une excellente chose, et la tyrannie une trs mauvaise chose. Il y eut
pourtant des temps et des peuples o ce fut la mauvaise chose qui tait excellente,
et la chose excellente qui mritait d'tre condamne.
Si les vnements sont aussi intimement enchans que nous venons de le dire,
nous devons nous attendre constater que tous les grands hommes qui ont eu la
puissance ncessaire pour changer la direction des tendances d'une poque n'ont
fond que des oeuvres phmres, condamnes prir avec eux. L'histoire nous
montre, en effet, que l'volution naturelle, trouble un instant au prix des plus
violents efforts, reprend bientt son cours, moins que la perturbation n'ait t
assez puissante pour briser pour toujours les lments sur lesquels elle a agi.
Philippe II use vainement son gnie et la grandeur de l'Espagne alors toutepuissante combattre l'esprit de libre examen qui, sous le nom de protestantisme,
se rpandait alors en Europe. Tous ses efforts ne russissent qu' jeter son pays dans
une dcadence dont il semble impuissant se relever jamais. Jacques II,
d'Angleterre, devait chouer plus tard dans une tche semblable. Moins puissant
que Philippe II, il dut quitter l'Angleterre avant d'avoir pu lui faire un mal rel ; et
son gendre, Guillaume, qui le remplaa et sut comprendre les tendances des esprits,
laissa la nation s'engager dans une voie qui devait bientt la conduire au fate de la
grandeur. Le grand roi Charlemagne russit bien, grce son gnie, restaurer pour
quelque temps l'Empire romain, mais son oeuvre devait prir avec lui, comme
prirent plus tard celle de Cromwell et celle de Napolon. Richelieu russit dans sa
tche d'agrandir la France royale aux dpens de la noblesse, ce qui tait la
consquence historique du pass de la royaut. Mais qui voudrait soutenir qu'avec
tout son gnie, il et russi galement dans la tche contraire ? La pression que l'on
peut exercer sur une nation est comparable celle qu'on peut oprer sur les corps
lastiques : s'ils ne sont pas dtruits, ils reprennent leur forme aussitt que 1a
pression a cess.
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
204
On ne peut faire qu'une objection ce qui prcde, c'est que l'histoire des cits
antiques nous montre des lgislateurs changeant les lois de ces cits et donnant
l'tat une organisation nouvelle. Ce sont certainement ces rminiscences de nos
tudes classiques qui nous ont conduits cette faon de penser, partage par des
esprits aussi sagaces que Montesquieu, propage par Rousseau, excute par la
Rvolution franaise, qu'il est possible de rorganiser une socit sur un plan
prconu. Mais, en raisonnant ainsi, on oublie que les conditions des cits antiques
taient entirement autres que celles d'aujourd'hui. Les changements apports par
les nouveaux lgislateurs taient beaucoup plus apparents que rels, car ils
n'atteignaient jamais les lois religieuses, dont drivaient les institutions politiques.
Ils ne portaient, du reste, que sur un petit groupe d'hommes libres et ne touchaient
pas aux questions d'conomie sociale, actuellement les plus graves de toutes. Par
l'esclavage, ces difficults conomiques, qui constituent aujourd'hui le fond des
problmes sociaux, se trouvaient cartes. Les lgislateurs antiques n'avaient
jamais, du reste, la prtention de donner un peuple les institutions thoriquement
les meilleures. J'ai donn aux Athniens, disait Solon, non les meilleures lois
qu'on puisse concevoir, mais les meilleures qu'ils puissent supporter.
Lorsqu'une tude suffisamment approfondie de l'enchanement des faits
historiques a fait pntrer dans 1'esprit les conceptions qui prcdent, on voit
nettement combien sont dangereuses les erreurs des rformateurs qui menacent les
socits modernes, et sont tous persuads qu'il suffit d'adopter leurs rveries pour
transformer ces socits au gr de leurs dsirs. Ils s'imaginent que l'tat ressemble
ces fes des contes orientaux qui pouvaient d'un coup de baguette raliser tous les
caprices, et ne peuvent comprendre qu'on ne dcrte pas plus l'galit ou le
bonheur, qu'on ne dcrte la suppression de la vieillesse, des infirmits et de la
mort. Leur ignorance des ncessits qui engagrent ces ingalits et les accroissent
constamment, est profonde 40. Il est facile de rver une rpartition gale des moyens
40
Les ides qui circulent aujourd'hui dans les classes ouvrires sur la possibilit de refaire une socit au gr
de leurs dsirs dpassent ce que l'on pourrait rver, et il y a vraiment dans leurs manifestations de quoi
dcourager leurs plus sincres amis. On comprend qu'aprs avoir combattu longtemps pour cette trange
conception d'Auguste Comte de la prpondrance des classes ouvrires, le plus fidle disciple de ce philosophe,
M. Littr, en soit arriv, dans son dernier ouvrage (Fragments de philosophie positive, 1876, p. 449),
reconnatre leur incapacit complte se gouverner. Quand on parcourt, par exemple, les comptes rendus des
sances du congrs ouvrier tenu en 1879 Marseille, et o les ouvriers ont envoy videmment ceux des leurs
qui leur semblaient les plus intelligents, on se demande ce qu'il y a de plus navrant, de l'absurdit des
propositions des orateurs ou de l'enthousiasme qu'elles ont produit chez les auditeurs. Que pensera de l'ducation
politique des masses, et de leur aptitude se gouverner, l'historien qui lira dans les comptes rendus de ce congrs
solennel des propositions comme celles-ci : Suppression des armes permanentes et des cultes, expropriation
immdiate de tous les propritaires, proprit collective et individuelle des terres, des usines, des chantiers, des
mines, des chemins de fer, des docks au profit des communes qui doivent les affermer aux groupes producteurs
fdrs entre eux, faire descendre les tyrans du trne, courir sus aux exploiteurs , proclame 1`galit de la
femme, la sparation complte des ouvriers et de la bourgeoisie, choisir uniquement les dputs parmi des
ouvriers rvolutionnaires , les autres n'tant que des charlatans ractionnaires et opportunistes . Quant aux
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
205
d'existence, le dpouillement de ceux qui ont au profit de ceux qui n'ont pas. Mais,
pour russir dans une telle tche, il faudrait donner d'abord tous les hommes des
capacits gales. Mme quand un nivellement brutal tablirait pour un jour l'galit
dans la misre, l'ingalit des intelligences la ferait disparatre le lendemain. Rpt
chaque jour par un pouvoir magique, au profit des membres incapables, ce partage
perptuel serait inutile encore, car, si une aisance suffisante engendre l'pargne et
arrte la reproduction trop rapide, une demi-pauvret ne produit pas l'pargne et n'a
d'autres rsultats qu'une multiplication trop grande de la population. Le nombre des
partageants augmentant sans cesse, alors que la richesse ne saurait galement
augmenter, il en rsulterait bientt une concurrence o ne triompheraient que les
plus forts, et qui dtruirait par consquent l'galit tablie.
Il est possible que, parmi tous les rformateurs qui prchent ces thories
enfantines, il y en ait quelques-uns s'intressant rellement au sort des masses qu'ils
essayent d'entraner. Un peu de rflexion leur montrerait qu'ils rendraient bien
d'autres services aux travailleurs en s'efforant d'lever leur niveau intellectuel par
l'instruction, qu'en leur prchant des doctrines que la science la plus lmentaire
condamne et qui ne peuvent enfanter que des rvolutions sanglantes, mres de tous
les despotismes. Avec les progrs de l'industrie moderne et des machines, ce qui
tend tre rtribu de plus en plus, ce n'est pas le travail manuel, mais
l'intelligence. C'est ce capital-l qu'il faut tcher d'acqurir ; ce sera plus facile
encore que de russir s'emparer de l'autre.
anciennes idoles, comme Louis Blanc, on les traite simplement de fusilleurs et d'assassins ; un orateur assure
que tous les dputs sont asserments Bonaparte ou des tourmenteurs pour le compte des jsuites . Un
autre se dclare l'ennemi des avocats qui plaident la mort de la Rpublique, des notaires qui dressent son
testament et des mdecins qui prparent son empoisonnement . Le vu que la proprit soit donne
collectivement tous , propos par 61 dlgus, a t adopt l'unanimit moins 10 voix. Le seul moyen
propos pour raliser ce vu est, bien entendu, la rvolution main arme.
Quand on se prend penser que, par le suffrage universel, le pouvoir peut tomber dans de telles mains, et
que l'anarchie qui en serait la consquence force se terminerait ncessairement par la venue d'un de ces Csars
au talon de fer que les foules sont toujours prtes, du reste, acclamer, on ne peut que jeter un triste regard sur
notre avenir.
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
206
II. - Influence des Gouvernements.
Retour la table des matires; retour au dbut du chapitre
Quelles conclusions d'ensemble dgagerons-nous de tout ce qui prcde ? En
prsence des ncessits qui engendrent toutes les institutions, et de l'impuissance
des peuples et des gouvernements les rformer au gr de leurs dsirs,
soutiendrons-nous avec toute une cole d'conomistes que l'influence de l'tat est
toujours inutile ou funeste, et qu'impuissant pour le bien il n'a d'action que pour le
mal ? Nos conclusions ne seront pas aussi gnrales. Nous reconnatrons que dans
un pays industriel l'intervention de l'tat est gnralement funeste, parce que
l'volution des choses qu'il veut rgler rsulte du jeu de facteurs trop nombreux
pour qu'il soit possible de prvoir ce qui rsultera de son action ; mais nous
reconnatrons aussi que, dans les pays militaires vivant surtout de conqutes, son
intervention peut tre fort utile. Ce n'est pas spontanment, certes, que les landes
incultes du marquis de Brandebourg sont devenues le puissant empire allemand. On
peut admettre que plus d'une ncessit conduisait les tats allemands se runir
sous un seul sceptre, mais il fallait le talent de grands gnraux pour que la
puissance tombt prcisment entre les mains o elle tombe. Sans doute l'unit
italienne se serait faite tt ou tard, mais, sans l'intervention d'un homme d'tat d'un
trs puissant gnie, elle et pu ne se faire que fort tard.
Malheureusement pour les pays qui les voient natre, ces grands hommes d'tat
n'ont pas un gnie assez vaste pour prvoir les consquences des mesures
conomiques qu'ils prennent, et, aprs avoir fond avec succs par la force, ils se
montrent gnralement impuissants dans la tche bien autrement difficile
d'organiser ce qu'ils ont su fonder. L'Allemagne en fournit actuellement et surtout
en fournira un frappant exemple. Les rsultats dsastreux de la plupart des mesures
conomiques prises par l'homme d'tat plac sa tte avec un pouvoir peu prs
absolu, pourront tre invoqus dans l'avenir comme exemple caractristique des
limites utiles dans lesquelles l'influence des hommes d'tat peut s'exercer.
Nous avons consacr un chapitre montrer, d'une part, que les peuples qui
purent russir se plier au joug de coutumes rigides, c'est--dire d'institutions assez
solidement tablies pour tre universellement respectes, furent les seuls qui
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
207
s'levrent la civilisation, et de l'autre, que les nations qui russirent ensuite se
soustraire dans de certaines limites au joug de ces institutions furent les seules qui
continurent progresser. Cette dmonstration nous enseigne dj qu'en
considrant les mmes peuples des poques diffrentes, on est amen
reconnatre qu'il y eut des temps o le joug de l'tat fut ncessaire, et d'autres au
contraire o il devint nuisible. Nous avons fait voir qu'au dbut de l'histoire des
peuples l'intervention de l'tat est indispensable, et qu'elle reste indispensable tant
qu'elle n'a pas russi crer des sentiments hrditaires capables d'amener
l'individu faire spontanment ce qu'il ne faisait d'abord que sous l'influence d'une
pression nergique.
Chez tous les peuples de l'antiquit classique, on trouve d'abord l'tat fortement
constitu. Nous avons montr combien dans l'antiquit grecque son joug tait
rigide ; la loi civile et la loi religieuse - en ralit elles n'en formaient qu'une avaient fini par prendre une telle puissance sur les mes, que le vritable tyran de
l'homme tait lui-mme. Mais, avant d'acqurir cette puissance, il fallut que la main
de l'tat ft longtemps pesante, car ce n'est pas sans peine que les hommes se plient
un joug quelconque. Si ces ges primitifs l'influence de l'tat n'avait pas t
toute-puissante, l'antiquit classique ne serait pas sortie de la barbarie, et l'histoire
n'aurait pas s'occuper d'elle.
Nous avons fait voir galement, dans un autre chapitre, que lorsqu'une nation est
forme de races doues de sentiments, d'aptitudes, d'intelligence diffrents, elle
tombe dans l'anarchie si les tendances des races diverses qui la composent peuvent
se manifester librement. Quel que soit leur degr de civilisation, ces races doivent,
comme les peuples primitifs, tre soumises une loi rigide. Dans les pays comme
le Mexique et les petites rpubliques espagnoles, forms de mlanges d'Indiens, de
ngres, de mtis, de blancs, dont les tendances et les sentiments sont absolument
diffrents, un gouvernement assez puissant pour contenir toutes ces tendances est
indispensable. S'il ne russit pas s'tablir, le pays tombe aussitt dans l'anarchie,
et, mesure qu'il s'y enfonce, il devient de plus en plus incapable d'en sortir.
L'histoire nous montre que les conditions qui permettent l'tablissement de
gouvernements libres ne se sont rencontres qu'exceptionnellement, et seulement,
dans tous les cas, une priode avance de la vie des peuples. Un gouvernement
capable de se laisser discuter sans courir risque de voir les lments qui le
composent se dissocier, et par suite prir devant l'invasion d'tats voisins mieux
disciplins, ne peut prendre naissance que parmi les peuples chez lesquels l'hrdit
a cr certains sentiments trs difficiles acqurir, tels que ceux de la
responsabilit et du devoir, l'habitude de savoir se gouverner soi-mme, de ne pas
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
208
se laisser influencer par les opinions extrmes et de ne modifier que
progressivement ce qui est tabli.
Rien nest plus utile que la discussion libre pour dvelopper les esprits ; elle
cre une atmosphre intellectuelle qui lve puissamment les mes ; mais rien
n'exerce une influence plus dissolvante, et partant plus dangereuse, sur des esprits
infrieurs ou mal prpars. J'ai dj cit ce mot trs juste d'un savant anglais que :
quelques chances qu'aient les tats libres d'tre dtruits par des forces extrieures,
ils sont bien plus exposs tre dtruits par leurs propres forces. Les
gouvernements libres peuvent tre compars l'atmosphre de certaines montagnes
qui tue les constitutions faibles, mais donne une grande vigueur celles qui
peuvent la supporter.
Lorsqu'un peuple est arriv cette priode de son volution, o il peut se
conduire lui-mme, et o la discussion libre est possible, l'influence de l'tat tend
se rduire son minimum, et cela est fort avantageux pour ce peuple, car ce qui est
d l'initiative prive est toujours meilleur que ce qui provient de celle de l'tat.
Tous les conomistes dont je parlais plus haut ont fait ressortir avec raison
combien l'intervention de l'tat est onreuse et parfois nuisible, mais en oubliant
toutefois de remarquer que pour certains peuples, o l'initiative individuelle est
nulle, les inconvnients rsultant de cette intervention sont moindres que ceux qui
rsulteraient de l'abstention. Il est reconnu maintenant que les travaux excuts par
l'tat cotent toujours plus cher que ceux excuts par les particuliers, et sont
gnralement moins bien faits. Ses agents n'ont, en effet, qu'un intrt indirect
faire conomiquement et bien ; tandis que, lorsque l'industriel travaille pour son
compte, ses intrts les plus essentiels sont directement enjeu. C'est seulement
quand l'initiative prive est nulle que cette intervention routinire, malhabile et
coteuse de l'tat, devient cependant ncessaire.
Ce qu'il y a de plus fcheux pour les peuples condamns par leur caractre
vivre sous des gouvernements possdant tout le pouvoir et toute l'initiative , c'est
qu'avec la meilleure volont du monde ces gouvernements sont exposs
commettre des erreurs fort dangereuses. Dans des civilisations o la complication
des intrts est trs grande, il est presque impossible de prvoir d'avance le rsultat
d'une mesure quelconque. Son influence directe et immdiate est souvent bien peu
de chose compare son influence indirecte et future, qui ne se manifestera parfois
que dans un avenir loign. Sans doute le meilleur serait de laisser les
modifications se faire progressivement ; mais, lorsque l'inconvnient est visible et
que le remde parat facile, rien n'est plus tentant, quand on est assez puissant, que
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
209
d'appliquer immdiatement le second gurir le premier. Lorsqu'on reconnut en
Angleterre que l'usure tait chose fort coteuse pour un pays, et qu'il semblait facile
d'y porter remde par de bonnes lois rpressives, on fit naturellement ces bonnes
lois. Elles n'eurent d'autre rsultat que d'augmenter l'usure que l'on voulait
combattre, l'emprunteur tant oblig de payer, outre le taux ancien, un intrt
supplmentaire pour les risques de punition que les svrits de la loi faisaient
courir au prteur.
Si ces erreurs peuvent se produire dans les pays o la discussion est libre, on
comprend combien elles sont plus frquentes dans ceux o elle n'est pas possible.
Colbert tait certainement un ministre remarquable, qui poursuivait avec le plus
grand zle la protection du commerce et de l'industrie. Il crut favoriser l'industrie en
la protgeant au dehors par des tarifs, au dedans par une rglementation minutieuse.
Son rglement du 18 mars 1671 sur la teinture ne forme pas moins de 317 articles,
prvoyant les moindres dtails de l'opration, et pourtant cette rglementation n'eut
d'autres rsultats que de ruiner la plupart des industries auxquelles elle s'appliquait.
Sous Louis XIII, les fabriques de Tours, qui comprenaient 7,000 mtiers et
occupaient 20,000 ouvriers, n'en possdrent bientt plus que 1,000, l'tranger ne
voulant plus des soieries fabriques suivant le got de Colbert mais non suivant le
sien. Ses rglements sur la dentelle et ses fondations de manufactures dotes de
privilges exclusifs faillirent ruiner aussi pour toujours cette industrie. Ses tarifs
douaniers provoqurent des mesures restrictives analogues dans les pays trangers,
nos ngociants en vins se virent fermer leurs principaux dbouchs d'exportation, et
les discussions qui en rsultrent furent l'origine de guerres ruineuses.
On voit quelles difficults entourent l'intervention des gouvernements lorsqu'elle
s'exerce dans un milieu d'une complexit trs grande. Les mesures les meilleures et
le mieux justifies d'abord peuvent finir par engendrer des consquences
dsastreuses.
La centralisation peut tre cite encore comme exemple de ce qui prcde.
Pendant longtemps elle a t une chose excellente, car aux poques de luttes elle
donnait de l'unit la nation, et laissait un pouvoir central impartial la dcision
des intrts locaux. Porte l'excs en France par la monarchie, exagre encore
par la Rvolution, elle a eu pour rsultat final d'absorber entirement au profit d'un
centre toute la vie locale, de donner aux citoyens l'habitude de tout attendre de
l'tat, de dtruire chez eux la moindre trace d'initiative, et de transformer la
province, suivant l'expression de M. Renan, en un vaste fumier intellectuel o des
milliers d'hommes s'agitent pour faire clore quelques brillants papillons . Quand
on voit dans nos petites villes de province ces faces ternes qu'aucune expression
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
210
n'anime plus, ces mes mortes que rien ne saurait rveiller, et qu'on sait ce que
deviennent bientt les esprits intelligents condamns subir cet touffant milieu,
on comprend quel point des institutions qui furent d'abord les meilleures peuvent
devenir un jour les plus dangereuses.
En prsence de tous ces faits et de beaucoup d'autres analogues, on s'explique
que les conomistes soient arrivs repousser avec nergie l'intervention de l'tat
dans les intrts publics. Parlant pour l'Angleterre, o l'initiative prive est
cependant trs grande, M. Spencer crit : Il y aurait rendre au publie un grand
service : ce serait d'analyser les lois faites... mettons pendant ces cinquante
dernires annes, et de comparer les rsultats esprs avec les rsultats obtenus.
Pour faire avec cela un livre plein de rvlations et d'enseignement, il suffirait de
prendre les exposs des motifs et de faire voir combien de fois les maux auxquels
on veut remdier sont purement l'effet de lois antrieures. Le difficile serait surtout
de faire tenir, dans un espace raisonnable, l'interminable histoire des rsultats
heureux qu'on s'tait promis et la place desquels on n'a obtenu que des dsastres
inattendus. Pour conclure d'une faon utile, on montrerait par quel succs le
lgislateur a t rcompens de son abstention, toutes les fois que, dcourag par
tant de leons, il s'est rsign ne plus rien faire.
Je crois cependant que l'opinion des conomistes sur ce point-l est exagre.
Un pays o l'tat abandonnerait tout l'initiative prive offrirait bientt, moins
que ce pays ne ft habit par une race possdant un degr bien rare le sentiment
de la responsabilit gnrale et une initiative exceptionnelle, l'image de ce qu'est la
Turquie, o le gouvernement ne s'occupe de rien. M. de Laveleye rapporte qu'il y a
quelques annes un prsident de la Nouvelle-Grenade, imbu des pures doctrines
conomiques, annona que dsormais l'tat, ramen son vritable rle, laisserait
tout l'initiative individuelle. Les conomistes d'applaudir. Au bout de peu de
temps, les routes taient rompues, les ports envahis, la scurit anantie,
l'instruction aux mains des moines, c'est--dire rduite rien. C'tait le retour
l'tat naturel et la fort primitive.
Aussi, mme dans les gouvernements les plus libres, - celui des tats-Unis, par
exemple - le pouvoir central est-il oblig de conserver toujours, outre bien entendu
les fonctions que personne ne lui a jamais contestes, comme le maintien de l'ordre
et des lois, une action plus ou moins tendue. Il existe certaines attributions que
seul il peut remplir, parce qu'il est dgag de tout autre intrt que celui de la chose
publique. C'est lui seul, par exemple, qui peut protger les lments infrieurs
qu'une socit renferme, et qui, par une anomalie trange, sont les plus hostiles
l'tat, sans la protection duquel une slection rigide, rsultant du jeu d'une libre
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
211
concurrence, les liminerait pourtant bientt. L'tat peut adoucir les rapports entre
classes diffrentes en empchant, autant que possible, l'gosme des unes d'abuser
de l'incapacit des autres. Seul encore il peut prendre certaines mesures, comme la
limitation du travail des enfants dans les manufactures, leur instruction obligatoire,
etc., que les intresss ne sauraient prendre eux-mmes.
Au point o nous avons conduit le lecteur, une difficult considrable se
prsente. Nous savons que l'intervention trop grande de l'tat est funeste, son
abstention complte, nuisible. Quelles sont entre ces deux extrmes les limites
utiles de son action ? Rsoudre entirement un tel problme serait fort difficile ; les
hommes d'tat les plus minents y ont souvent chou. Indiquer nettement quelles
sont ces limites suivant les temps et les peuples, constitue la science politique tout
entire, c'est--dire une science dont les fondements commencent se poser, mais
qui exigera bien des sicles encore avant de se constituer solidement, en admettant
qu'elle y arrive jamais.
Mais, si la solution de chaque problme particulier prsente des difficults trs
grandes, les lois d'une solution d'ensemble peuvent se formuler assez facilement.
On peut marquer dans une formule gnrale l'tendue des limites utiles de l'action
de l'tat, en disant qu'elle doit tre au maximum pendant la jeunesse des peuples, et
rester telle jusqu'au jour o des accumulations hrditaires suffisantes ont fini par
crer chez l'individu des sentiments le rendant capable de se gouverner lui-mme ;
qu'elle doit rester toujours trs grande chez les peuples composs d'lments trs
diffrents ; qu'elle doit tre au contraire son minimum chez les peuples composs
d'lments homognes et chez lesquels l'hrdit a cr les sentiments dont nous
venons de parler. On ajoutera enfin que l'influence de l'tat ne s'exerce utilement
que quand elle se manifeste d'une faon lente et progressive, et d'autant plus lente
et progressive que la civilisation est plus leve en complexit.
C'est sur cette dernire conclusion que je terminerai ce chapitre. Elle est la
consquence bien nette de tout ce qui prcde. Le lecteur qui ne serait pas
convaincu de sa justesse ne le serait pas davantage par les faits historiques que
j'aurais pu invoquer encore pour lui montrer que ce ne sont que les changements
effectus lentement et progressivement qui sont durables. Cette dmonstration a t
faite pour ainsi dire chaque page de cet ouvrage, et je me serais mme reproch
d'avoir tant insist sur une vrit en ralit banale, si l'ignorance des lois de
l'volution des socits n'tait pas si gnrale chez certains peuples. On sait ce que
cette ignorance a cot, il est triste d'avoir songer ce qu'elle cotera encore.
L'ide que des changements sociaux importants puissent se faire coups de dcrets
est malheureusement trop ancre dans une foule de cerveaux pour qu'on puisse
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
212
esprer de la voir disparatre. Elle appartient cette catgorie de croyances, bases
sur les sentiments, qu'aucun argument ne peut branler. Les fleuves de sang qu'elle
fera verser encore y suffiront peine.
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
213
Deuxime partie
LES SOCITS
Leurs origines et leur dveloppement
livre II : Les facteurs de lvolution sociale
Chapitre XIII.
Influence de l'instruction
et de l'ducation.
Retour la table des matires; retour au dbut du chapitre
1. Limites de la puissance de l'ducation. - Elle est un des rares facteurs dont l'homme
dispose. - Sa puissance est trs grande, mais gnralement exagre. - Son action ne se fait sentir
que lorsqu'elle s'est exerce pendant plusieurs gnrations. - C'est surtout sur les sentiments que
sa puissance est faible. - II. L'enseignement primaire. - Bases sur lesquelles il doit reposer.Notions qui doivent entrer dans l'enseignement primaire. - Comment ces notions doivent tre
enseignes. - Enseignement des sciences. - ducation morale. - Enseignement professionnel. Mauvais rsultats de notre enseignement primaire. - Difficult de le transformer. - III.
L'ducation des femmes. - Importance de cette ducation. - Ce qu'elle est dans divers pays. Pourquoi la femme ne doit pas recevoir une instruction semblable celle de l'homme. - Mme
dans les races infrieures, la femme peut, aussi bien que l'homme, acqurir l'instruction classique.
- Pourquoi ces succs ne prouvent rien en faveur de l'utilit pour elle de cet enseignement. - Au
point de vue intellectuel, l'homme et la femme ne se diffrencient profondment qu' l'ge adulte.
- La femme conserve toujours la constitution mentale de l'enfant. - Ses aptitudes. - Elle est trs
apte l'ducation de l'enfance. - IV. L'Enseignement secondaire. - Bases de cet enseignement. Ce qu'il importerait d'apprendre. - Rle funeste jou par le grec et le latin dans l'enseignement. La mme ducation ne saurait convenir toutes les intelligences. - Rsultats dsastreux produits
sur l'intelligence et les sentiments par notre ducation classique. - V. L'enseignement suprieur. Diversit des mthodes d'enseignement suprieur dans plusieurs pays. - Rsultats malheureux
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
214
produits par nos mthodes d'enseignement suprieur. Comment se forment nos professeurs. Profonde dcadence de notre enseignement suprieur. - Consquences sociales de l'ducation.
I. - Limites de la Puissance
de l'ducation.
Retour la table des matires; retour au dbut du chapitre
Les divers facteurs de l'volution sociale numrs jusqu'ici ont prsent pour la
plupart ce caractre commun, d'tre soustraits notre action. Nous ne pouvons
modifier notre pass, le milieu physique et intellectuel o nous sommes levs, nos
sentiments, notre intelligence.
Les facteurs dont nous allons maintenant examiner l'influence sont peu prs
les seuls dont nous soyons matres. L'ducation et l'instruction, c'est--dire l'art de
former le caractre et d'enrichir l'esprit, nous permettent seules de modifier
profondment l'homme lorsque nous pouvons les faire agir pendant plusieurs
gnrations. L'ducation agit surtout sur les sentiments, l'instruction sur l'intelligence. Leur importance a t comprise par les lgislateurs et les philosophes de
tous les pays, depuis Lycurgue et Platon jusqu'aux philosophes et aux hommes
d'tat modernes. Donnez-moi l'ducation, et je changerai la face de l'Europe
avant un sicle , a dit Leibniz.
Tout en reconnaissant l'influence de l'ducation, je considre que les limites de
cette influence sont plus troites qu'on ne le dit gnralement, et qu'elles sont mme
relativement restreintes quand on la fait agir seulement pendant la courte dure
d'une gnration. Il est possible qu'avec l'ducation on changerait la face de
l'Europe, mais ce ne serait pas en un sicle, comme le disait Leibniz. Son action
aurait certainement besoin d'tre accumule par l'hrdit pendant un temps plus
long.
Il ne faut pas oublier, en effet, que si l'ducation est un puissant facteur, elle se
trouve, ds qu'elle peut agir, en prsence de facteurs beaucoup plus puissants
qu'elle, parce qu'ils ont agi sur l'homme pendant plus longtemps. Le long pass que
nous apportons en naissant, et o tous nos anctres ont imprim leurs traces,
reprsente un poids immense que l'ducation ne peut soulever que quand son
influence a t accumule pendant plusieurs gnrations.
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
215
C'est surtout lorsqu'il s'agit de modifier nos sentiments hrditaires, c'est--dire
notre caractre, que l'ducation a une puissance en ralit bien faible. Le
philosophe que je citais plus haut disait que sur 100 hommes il y en a 90 qui sont
bons ou mauvais, utiles ou nuisibles la socit par l'instruction qu'ils ont reue, et
que c'est de l'ducation que dpend la grande diffrence qui existe entre eux .
Utiles ou nuisibles, je l'admets dans de certaines limites ; bons ou mauvais, je le
conteste formellement. Assurer que les diffrences qui existent entre les hommes
rsultent de leur ducation, c'est mconnatre le rle tout-puissant des sentiments
sur la conduite et la faon dont ils se transmettent par l'hrdit.
Il est donc ncessaire de marquer bien nettement ds le dbut de ce chapitre les
limites de l'influence de l'ducation, et de ne pas laisser le lecteur s'illusionner sur
sa puissance. Il a souvent entendu dire que l'ignorance est mre de tous les vices, et
la statistique lui prouvera en effet que c'est parmi les illettrs qu'on rencontre le
plus de criminels, mais un peu de rflexion suffira lui montrer que ce sont l des
concidences n'ayant que des relations apparentes. Sans doute, assurment, les gens
vicieux mais instruits commettent moins de crimes et dlits tombant sous
l'application de la loi que les individus la fois vicieux et ignorants, mais
l'instruction ne sert aux premiers qu' exercer leurs mauvais instincts sur un thtre
o la rpression est moins facile. Le sujet instruit, et en mme temps pervers,
n'arrtera pas sans doute les voyageurs sur les grands chemins, pour leur prendre
quelques sous, mais il se livrera des oprations infiniment moins dangereuses
pour lui, quoique exactement quivalentes au point de vue moral. Depuis la simple
tromperie sur la qualit de la marchandise vendue jusqu' la fondation de socits
financires vreuses qui ruineront des milliers de famille, la liste en est longue. S'il
russit, on le tiendra pour parfaitement honnte. S'il choue, les risques courus
auront t fort minimes, et de toute faon la statistique criminelle n'aura gure
s'occuper de lui. On peut avoir une intelligence trs haute, des connaissances trs
varies, et tre au point de vue moral un fort vilain gredin. J'en ai cit dans un autre
chapitre d'illustres exemples.
Il ne faut donc pas considrer l'ducation et l'instruction comme des baguettes
magiques , capables de transformer les sentiments que l'homme apporte en
naissant. Il suffit de voir combien diffrent entre eux des individus ayant reu
mme ducation et mme instruction, pour se convaincre combien serait errone
une telle croyance. Pour que leur action soit rellement profonde, il faut, je le
rpte, qu'elle s'exerce pendant plusieurs gnrations ; et c'est prcisment parce
qu'elles ne transforment l'homme qu'aprs avoir agi longtemps sur lui qu'aucun
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
216
rgime d'ducation ne saurait rapidement lever les races infrieures au niveau des
races suprieures.
Les transformations produites par l'ducation finissant par devenir la longue
considrables, son tude est trs importante. Nous aborderons cette tude par une
mthode un peu diffrente de celle qui nous a guid jusqu'ici. L'ducation tant un
des rares facteurs qui soient en notre pouvoir, nous ne nous bornerons pas dcrire
ce qu'elle produit telle qu'elle est : nous rechercherons aussi ce qu'elle pourrait
produire telle qu'elle devrait tre. Si nous critiquons souvent, ce ne sera pas
assurment dans l'esprance de provoquer des rformes, - les livres n'ont pas une
telle puissance, - mais simplement parce que ces critiques peuvent faire nettement
ressortir le rle utile ou nuisible de l'ducation sur l'volution sociale, ce qui est le
but de ce chapitre.
Les dveloppements qu'exigerait une tude complte des mthodes d'ducation
chez les peuples anciens et modernes ne pouvant trouver place ici, nous limiterons
notre tche l'examen des procds d'ducation actuellement en usage chez les
principales nations civilises. Nous partagerons cette tude en paragraphes
correspondant aux divisions habituellement reues, et envisagerons successivement
l'enseignement primaire, secondaire et suprieur.
II. - L'Enseignement primaire.
Retour la table des matires; retour au dbut du chapitre
Nous comprendrons dans l'enseignement primaire celui que l'enfant reoit de sa
mre ds son premier ge et auquel viennent s'ajouter les leons qui lui sont ensuite
donnes l'cole.
Ce qui se dveloppe d'abord chez l'enfant, ce sont les sens. Ce sont eux par
consquent qu'il s'agit de contribuer former. Il faut lui apprendre voir, entendre,
toucher, etc., en un mot, observer.
Cette premire ducation ne saurait commencer trop tt. Elle ne doit jamais tre
nglige, car elle donne l'esprit des habitudes dont il se ressentira toujours.
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
217
Les principes sur lesquels elle doit reposer sont aujourd'hui bien connus ; ils
sont appliqus dans beaucoup de pays, l'Allemagne, la Suisse et l'Amrique
notamment. Bien que ce soit un crivain franais, Rousseau, qui les ait formuls
nettement pour la premire fois, ils sont peu prs entirement inappliqus en
France. Au fond ils sont trs - simples. L'tude doit toujours tre agrable ; l'enfant
doit tre amen dsirer apprendre, et jamais y tre contraint. Les devoirs pnibles
escorts de punitions sont absolument bannis. L'enfant est conduit prendre le got
de l'observation, et le plaisir qu'il y trouve permet de juger de la valeur de la
mthode employe. Jamais on ne doit agir sur lui par l'autorit ni par des
explications destines tre crues sur parole, apprises et rptes par cur, mais,
en le mettant mme de trouver ces explications, on l'habitue enfin tre aussitt
que possible son propre guide et dcider par lui-mme. Telles sont les bases de ce
systme.
Le meilleur moyen pratique qu'on ait trouv pour mettre en application ces
principes est l'emploi de ce qu'on a nomm les leons de choses. Elles constituent
aujourd'hui un ensemble devenu classique dans les pays que j'ai cits plus haut. On
sait qu'elles consistent essentiellement dans ceci : Au lieu de dcrire l'enfant les
objets qu'il n'a pas sous les yeux et de lui faire apprendre par cur leurs proprits,
on lui montre ces objets et on lui fait chercher lui-mme leurs qualits et leurs
rapports.
Les leons de choses sont toujours reues avec plaisir par les enfants parce
qu'elles flattent leur curiosit. Elles ont pour rsultat de former trs rapidement leur
jugement au lieu de n'exercer uniquement que leur mmoire ; elles donnent le got
de l'tude au lieu d'en inspirer l'horreur, comme le font nos vieilles mthodes
classiques. Elles peuvent, du reste, tre pousses fort loin, beaucoup plus loin
mme que ne le croyait le ralisateur des ides de Rousseau, Pestalozzi. On peut les
appliquer utilement l'enseignement des sciences physiques et naturelles, des arts
utiles, de la gographie, etc. Une grande partie de la gomtrie peut mme tre ainsi
enseigne en prsentant l'enfant des objets construits de faon pouvoir tre
dcomposs et recomposs, et lui faisant rechercher la solution des problmes sa
porte. Spencer rapporte avoir vu une classe de petits garons s'intressant
tellement la solution des problmes gomtriques qui leur taient poss, qu'ils
attendaient l'heure de la leon avec la plus grande impatience. Il a vu des petites
filles demander pour les emporter chez elles des problmes rsoudre.
L'enseignement ne devant jamais tre dogmatique, et l'lve devant s'habituer
croire une chose, non parce que le matre la lui a dite, mais parce qu'il a reconnu
que c'tait ainsi, on conoit qu'il y ait un grand avantage commencer l'ducation
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
218
par un ordre de connaissances o la preuve soit toujours facile. Les sciences nous
donnent le type de cet ordre de connaissances ; la grammaire, le type d'un ordre de
connaissances contraires. Telle qu'elle est enseigne habituellement, c'est--dire
sans jamais montrer le pourquoi des choses, cette dernire constitue un
enseignement dogmatique trs funeste, qui accrot la tendance naturelle de l'esprit
accepter sans examen tout ce qui lui est prsent, et se contenter d'opinions toutes
faites. Il y a bien longtemps du reste qu'il est dmontr que ce n'est pas avec une
grammaire qu'on apprend une langue. Elle ne peut servir que quand on est dj trs
avanc dans l'tude de cette langue. Les grammaires ne sont nes que lorsque dj
les langues taient formes depuis longtemps ; elles les ont suivies, et il n'y a pas
un seul exemple qu'elles les aient prcdes.
Outre cette habitude d'observer par soi-mme que l'tude des sciences donne
rapidement, elles ont encore un ct utile vident. Celui qui a reu une bonne
instruction primaire comprenant la lecture, l'criture, le dessin, quelques notions
bien prcises d'histoire naturelle, de physique et de chimie, trouvera les appliquer
chaque jour, et en outre, comme je l'ai dit, elles lui auront form le jugement, donn
le got d'apprendre et l'auront rendu susceptible d'une culture ultrieure.
toutes ces notions nous ajouterons les lments d'une science que l'on peut
qualifier de fondamentale pour les nations modernes, et que pourtant on n'a encore
enseigne nulle part ; je veux parler de l'conomie politique et sociale. Elle seule
peut empcher l'enfant devenu homme d'tre victime des rveries des utopistes, lui
montrer les relations relles entre le capital et le travail, la valeur rciproque du
capital intellectuel et du travail manuel, les ressources que peuvent produire
l'pargne, l'association, etc. C'est une science qui peut sembler difficile et abstraite ;
elle l'est, en effet, dans les livres ; mais ce qu'elle possde de prcis, c'est--dire sa
partie rellement importante, pourrait tre formul avec des exemples bien clairs en
cent pages. Un tel livre, qui n'existe pas encore, mriterait de tenter un esprit
suprieur. Je n'en connais pas dont on pourrait dire qu'il serait plus utile.
L'ducation, telle que nous venons d'en indiquer les principes fondamentaux,
serait incomplte si elle ne comprenait un lment qui est peut-tre le plus
important de tous : l'ducation morale.
Sans doute l'ducation telle que nous l'avons dcrite apprend observer, juger,
se conduire, et est, en ralit, de l'ducation morale ; mais elle serait insuffisante
si le matre ne savait pas apprendre l'lve distinguer nettement ce qui est bien
de ce qui est mal et lui inculquer une claire notion du devoir.
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
219
Comment arrivera-t-il un tel rsultat ? Sera-ce au moyen de rgles de morale
apprises par cur et de sentencieux discours ? Il a fallu vraiment avoir une bien
grande ignorance de la constitution mentale d'un enfant pour avoir pu supposer
qu'on pourrait exercer ainsi sur sa conduite l'influence la plus lgre. Sera-ce au
moyen de principes religieux, c'est--dire par des promesses de rcompenses ou des
menaces de punitions dans une vie future ? Des perspectives aussi lointaines mme quand les hypothses religieuses seraient des vrits dmontres - n'ont
jamais eu sur la conduite d'un enfant une action quelconque. D'ailleurs ces
hypothses sont sans fondements, et l'enfant en grandissant l'apprendra bien vite.
Que deviendront alors les principes de morale qui n'avaient d'autre appui que de
telles bases ?
Les sources o nous puiserons les lments de son ducation morale seront
surtout son exprience personnelle. L'exprience seule instruit les hommes, et seule
aussi elle peut instruire les enfants. La rprobation gnrale qui suit certains actes,
l'approbation qui s'attache d'autres, montrent bientt l'enfant ce qui est bien et ce
qui est mal. L'exprience lui indique les consquences avantageuses ou fcheuses
de telles ou telles actions, et les ncessits qu'entranent les rapports avec ses
semblables, sur tout si on a toujours soin de lui faire supporter les consquences de
ses actes, et rparer les dommages qu'il a causs. Il faut qu'il apprenne par luimme que le travail, l'conomie, l'ordre, la loyaut, le got de l'tude ont pour
rsultat final d'accrotre son bien-tre, satisfaire sa conscience et portent ainsi en
eux leur rcompense. C'est seulement quand l'exprience a agi sur lui que le matre
peut intervenir utilement en condensant sous forme de prceptes les rsultats de
cette exprience.
L'ducation morale n'est complte que quand l'habitude de faire le bien et
d'viter le mal est devenue inconsciente. Malheureusement elle parvient rarement
un tel rsultat. Il n'y a gure que l'hrdit qui puisse crer une morale assez
puissante pour tre inconsciente.
L'ducation morale doit surtout apprendre l'individu se gouverner lui-mme
et avoir un respect inviolable du devoir. C'est ce but essentiel que tend
l'ducation anglaise, et il faut avouer qu'elle y russit parfaitement. Le souci
constant de ceux qui la dirigent est d'habituer l'enfant se dcider par lui-mme,
alors que nous ne lui apprenons qu' se laisser conduire. Il faut avoir observ de
prs deux enfants franais et anglais du mme ge en prsence d'une difficult, les
irrsolutions de l'un, la dcision de l,autre, pour comprendre la diffrence des
rsultats des deux ducations.
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
220
Un des plus puissants facteurs de l'ducation morale est le milieu. Je ne l'ai pas
mentionn parce qu'il n'est pas en notre pouvoir de le transformer. Le milieu moral,
constitu par les ides, la conduite, les conversations de ceux qui l'entourent, a sur
l'enfant une influence auprs de laquelle toutes les autres sont vraiment bien
faibles. L'hrdit seule est plus puissante.
L'enseignement primaire, s'adressant surtout des jeunes gens destins
travailler de leurs mains et entrer en quittant l'cole dans l'atelier ou dans la
ferme, ne peut tre considr comme rellement complet que s'il est en mme
temps professionnel. Les conditions de l'industrie moderne rendent la ncessit de
cette ducation professionnelle pralable plus grande que jamais. La division du
travail est maintenant pousse un tel point, que l'ouvrier est devenu une pure
machine excutant toujours le mme travail. Quand l'apprenti entre dans l'atelier, il
ne peut chapper l'une des alternatives que voici : ou bien le travail y est assez
spcialis pour qu'on puisse lui confier quelque ouvrage simple, mais assez
rmunrateur pour celui qui l'emploie, et alors on ne lui en confiera jamais d'autre ;
ou bien, la fabrication dont s'occupe l'atelier ne comportera pas une division du
travail assez grande pour qu'une partie du mtier puisse tre apprise facilement, et
alors, sur ses quatre ans d'apprentissage, on lui en fera consacrer trois de
vritables travaux de domesticit, sans aucun rapport avec son futur mtier. Dans
un excellent petit travail sur l'enseignement professionnel, un ancien ouvrier,
devenu plus tard dput, M. Corbon, insiste plusieurs fois sur ce fait qu'il a observ
bien souvent, que les trois quarts du temps pass en apprentissage sont absolument
perdus pour l'apprenti, et qu'un jeune homme d'une intelligence trs ordinaire peut
facilement apprendre un mtier en un an et plusieurs en quelques annes. Dans les
coles professionnelles de la ville de Paris, les jeunes gens mettent moins de temps
encore pour en apprendre un, et souvent en apprennent successivement plusieurs.
Avec les chmages si frquents aujourd'hui dans les conditions de l'industrie
moderne, cet apprentissage de plusieurs mtiers est indispensable.
Quel sera le professeur de l'enseignement professionnel au village ? Le meilleur
serait sans doute le matre d'cole, si on lui avait appris lui-mme un mtier. A son
dfaut, ce sera un ouvrier quelconque, menuisier, forgeron, etc. Son enseignement
sera autrement fcond que celui de l'usine, car chez lui la division du travail
n'existe pas, et il est oblig d'excuter de ses mains une foule de choses que dans
une usine on confie aux machines. Il n'est pas besoin de dmontrer que les parents
n'auraient qu' gagner cet enseignement professionnel qui, rduisant le temps
pass en apprentissage l'atelier, permettrait d'accrotre celui pass l,cole. On a
dit avec raison qu'il faut habituer le plus tt possible l'enfant au travail de la main,
et le placer le plus tard possible dans l'atelier. Quel que soit le mtier que l'enfant
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
221
pourrait avoir apprendre plus tard, le temps pass l'cole ne serait jamais perdu,
car l'habilet manuelle acquise dans un mtier diminue d'autant le temps ncessaire
pour en apprendre un autre.
Mais c'est pour le paysan surtout que l'enseignement professionnel serait utile et
pourrait avoir un rle social important. La statistique nous montre une immigration
croissante des campagnes vers les villes. Le paysan actuel dserte le champ pour
l'usine, - le purgatoire pour l'enfer. - Il mprise son mtier de cultivateur qu'il croit
trs infrieur celui de domestique o d'ouvrier. C'est le contraire assurment qui
est vrai, mais il faut le lui prouver. L'enseignement professionnel de l'agriculture,
avec un petit accessoire d'expriences de physique, de chimie, de dmonstrations
d'histoire naturelle, etc., simples et faciles rpter, arriverait lui faire
comprendre quel point sa profession d'agriculteur est autrement leve que celle
de rouage d'une usine, lot de la plupart des ouvriers des villes. C'est leurs racines
qu'il faut tudier nos plaies sociales, et, si j'insiste sur tous ces dtails, c'est que c'est
dans ces dtails mmes, et non dans les vagues considrations des rformateurs
politiques, que se trouve leur remde. Le jeune homme qui aura reu l'instruction
primaire, telle que je la conois, ne deviendra que bien rarement un ennemi de la
socit. Celui qui l'a reue telle qu'on la donne maintenant en France le devient
presque toujours.
J'ai parl jusqu'ici du rsultat utile d'une ducation bien dirige ; et,
malheureusement, de l'aveu des professeurs les plus comptents de notre
enseignement, y compris les ministres de l'instruction publique eux-mmes, notre
enseignement primaire est dplorablement mauvais. Alors que d'autres nations,
telles que la Suisse, l'Allemagne et l'Amrique notamment, ont compltement
transform le leur, nous en sommes encore des mthodes qui nous reportent
plusieurs sicles en arrire et correspondent des conditions d'existence
entirement disparues. Je prfrerais pour mon compte, et je ne suis pas seul de
cette opinion, l'ignorance complte l'instruction primaire qui se donne en France
aujourd'hui.
Il n'en faut pas juger, crit un savant professeur de notre Universit, M. Bral,
d'aprs quelques coles de nos grandes villes, ni d'aprs le mrite de quelques lves
choisis. C'est sur la masse des coliers, c'est sur le niveau des coles de campagne qu'il
convient de se faire une opinion. Nous constaterons alors que, si cet enseignement claire
l'esprit de nos enfants, c'est d'un jour si faible et si peu durable que la continuit de la nuit
ne vaudrait gure moins... Le demi-savoir que donnent nos coles recrute des soldats pour
l'meute aussi srement que l'ignorance. On a vu rcemment quel degr d'garement
pouvait tre conduite une population qu'on a pourvue de droits souverains sans l'avoir
d'abord instruite et claire. C'est en vain qu'on aura supprim l'insurrection ; si les causes
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
222
persistent, les effets se reproduiront. Sans l'instruction des masses, il est craindre qu'il ne
faille, des intervalles de plus en plus rapprochs, procder sur la population de nos
grandes villes des amputations chaque fois plus cruelles 41.
Cela nous semble terriblement craindre, en effet, et il suffit de rappeler ceux
qui vivent dans l'insouciance du lendemain les furieux anathmes et les menaces
que lancent aujourd'hui les classes ouvrires, dans leurs congrs, contre le capital et
la proprit. Il n'y a que deux moyens de se dfendre contre ces masses
menaantes : les dcimer priodiquement ou les instruire.
Une ducation qui aboutit ce que nous avons vu il y a quelques annes et ce
que nous entendons chaque jour n'est pas digne d'un tel nom. Tout le monde
reconnat aujourd'hui qu'elle doit tre entirement transforme, mais il y a dj bien
longtemps qu'on est d'accord sur ce point, et, en dehors de Paris et de quelques
grandes villes, aucune transformation srieuse n'a t tente. L'enseignement
primaire suprieur qu'on rve d'organiser aujourd'hui grands frais n'aurait de
chances de russir que s'il tait donn l'cole primaire elle-mme par l'instituteur
lui-mme et tait la suite naturelle, pour les lves qui peuvent y consacrer encore
une ou deux annes, de l'enseignement qui l'a prcd. Mais o sont les instituteurs
capables de cet enseignement ?
Une rforme quelconque de l'enseignement primaire, et mme, comme nous le
verrons bientt, de l'enseignement tous les degrs, est devenue aujourd'hui d'une
difficult trs grande, pour une raison que je ne vois gure invoque et qui me
semble cependant capitale. On parle sans cesse de modifier les programmes et les
mthodes. Rien, en effet, n'est plus facile, mais on oublie ce point essentiel, que ce
qu'il faudrait modifier surtout, ce sont les professeurs chargs d'appliquer ces
programmes et ces mthodes, et c'est l une tche de longue haleine, dont personne
ne s'est nullement souci jusqu'ici.
L'instituteur, qui, en Allemagne et en Amrique, est un homme instruit, honor,
et, dans le second de ces pays, largement rtribu, aime son mtier et le cultive
avec amour. Nos instituteurs sont de pauvres diables dclasss, demi-manants,
demi-bourgeois, obligs de se livrer, en dehors de leur emploi, des travaux
subalternes pour gagner de quoi vivre. A la merci de leur cur et de leur maire, ils
dtestent profondment un mtier qui ne leur apporte qu'humiliations et ne le
conservent que quand ils se sentent tout fait incapables de trouver autre chose.
Alors qu'on tchait ailleurs de les rendre le plus instruits possible, chez nous on a
limit de plus en plus l'instruction qu'ils reoivent dans les coles normales
41
Quelques mots sur l'instruction publique.
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
223
charges de les former. On a cru bien faire, dit M. Bral, en rtrcissant l'horizon
de nos matres d'cole : la crainte qu'ils ne se changent en hommes politiques se lit
chaque ligne de nos circulaires ministrielles... A vrai dire, sauf quelques
exceptions d'autant plus dignes d'loges, nos matres d'cole sont des sous-officiers
instructeurs. Ils en ont le parler bref et catgorique, ils ont comme eux le respect du
manuel imprim et la dfiance de tout ce qui n'a pas t prvu par les rglements.
Refaire les coles normales o se forment les instituteurs ; refaire surtout les
professeurs chargs de faire des instituteurs : on voit ce que peut tre une telle
tche, et on pressent la minime influence que peuvent avoir sur elle les circulaires
d'un ministre.
Ce n'est que lorsque le publie comprendra l'importance de l'ducation et qu'il s'y
intressera que des rformes seront possibles. Elles ne sont ralisables, en effet, que
par l'initiative prive. C'est elle seule que l'Amrique a d la rforme de son
enseignement ; mais bien des catastrophes seront encore ncessaires pour nous
convaincre de l'importance de semblables rformes. Lorsqu'un peuple veut
possder des institutions libres, l'ducation des classes infrieures doit tre la
proccupation la plus importante des classes claires. Ce n'est que chez des
nations instruites et leves dans le respect de la loi, du droit et des devoirs qu'une
dmocratie a des chances de vivre. Chez les autres, elle conduit toujours
l'anarchie et la dictature.
III. - L'ducation des Femmes.
Retour la table des matires; retour au dbut du chapitre
La premire ducation que l'enfant reoit lui est gnralement donne par sa
mre. Les impressions du premier ge tant les plus durables, on conoit combien il
importe que cette ducation premire soit convenablement conduite, et par
consquent que celle qui la dirige soit capable d'excuter une telle tche.
Nous nous trouvons donc conduit examiner ce que l'ducation des femmes
doit tre. Cette importante question a reu suivant les pays des solutions diverses,
mais dont aucune ne peut tre considre encore comme bien satisfaisante. Pour
tous les observateurs, la pire des solutions est celle qu'ont adopte les nations
latines, la France notamment. Les filles y sont enfermes jusqu' leur mariage dans
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
224
des couvents exclusivement dirigs par des Congrgations religieuses, et leur
ducation se borne quelques leons apprises par cur o il n'est jamais question
de leurs devoirs futurs de mres de famille. Le rgime clrical qu'elles y subissent a
deux consquences parfaitement nettes : au point de vue mental, il rduit encore
leur intelligence ; au point de vue moral, il les dprave. Quand elles chappent au
systme de compression auxquelles elles ont t soumises pendant toute leur
jeunesse, une raction toute naturelle se produit, et elles se jettent dans des
distractions de toute sorte, jusqu' l'ge o, les passions ne voulant plus d'elles,
elles tombent dans des pratiques mesquines de dvotion. N'ayant jamais appris se
conduire, elles ne sauront pas davantage l'apprendre leurs enfants. Elles ont du
reste conscience de leur incapacit remplir une telle tche, et elles s'en
dbarrassent en les envoyant en pension aussitt que la pension veut bien les
prendre, en attendant que le lyce leur ouvre ses portes.
En Angleterre, en Allemagne et en Suisse surtout, l'ducation fminine, bien que
fort loin encore de la perfection, est cependant meilleure. L'enseignement se donne
gnralement dans la famille ou dans un tablissement laque. La femme reoit
souvent des connaissances srieuses et apprend se conduire elle-mme ; ce qu'elle
a appris, elle saura naturellement l'enseigner. Je connais trop la diffrence de
constitution mentale qui nous spare des nations voisines, pour prtendre que le
mme rgime soit applicable partout ; mais je considre qu'en tous pays la place
d'une jeune fille est prs de sa mre, et non dans ces asiles d'ignorance et de
moralit douteuse qu'on nomme des couvents.
Les Amricains, suivant la coutume des peuples sans traditions, d'exagrer les
rformes qui paraissent utiles, ont t plus loin dans l'ducation des femmes
qu'aucune nation de l'Europe. Ils en sont arrivs leur donner exactement la mme
ducation qu' l'homme. La tentative est trop rcente pour qu'on puisse en juger
suffisamment les rsultats. A dfaut, donc, des donnes exprimentales sur
lesquelles il faut toujours tcher de s'appuyer pour formuler un jugement, je ne puis
raisonner que d'aprs les donnes de la psychologie ; or ces donnes condamnent
un tel rgime et permettent de prvoir qu'on en regrettera les consquences un jour.
Ce qui a fait croire au succs de cette ducation commune pour les deux sexes, c'est
ce fait bien des fois constat, que la femme russit tout aussi bien que l'homme
dans les tudes classiques ; mais on oublie alors que l'instruction ne sert qu' mettre
dans l'esprit des matriaux que l'intelligence, quand elle se dveloppe, pourra
utiliser : c'est l ce que saura faire l'homme, et ce que ne saura jamais faire la
femme. Les jeunes filles russissent aussi bien que les garons dans les tudes
classiques, qui ne sont gure au fond que des exercices de mmoire, parce que ces
tudes sont faites pour des enfants, et que la diffrenciation des intelligences dans
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
225
les deux sexes ne se manifeste que chez les adultes. La femme restant toujours
enfant, alors qu'en grandissant le jeune homme perd sa constitution mentale
d'enfant, ce n'est que plus tard qu'on peut apprcier combien leur aptitude utiliser
les mmes matriaux diffre. Les succs que la femme peut obtenir au collge, le
ngre, la ngresse mme les obtiennent. Dans les races comme dans les sexes, les
diffrences intellectuelles profondes ne se manifestent pas dans la premire
enfance. M. le professeur Hippeau, qui a visit l'Amrique, nous parle avec
admiration de jeunes ngresses qu'il a vues dans les classes, rptant trs bien des
dmonstrations de gomtrie, et traduisant admirablement Thucydide, et en conclut
que jamais on n'a mieux vu que les ngres et les blancs sont enfants d'un mme
Dieu ; que la nature n'a tabli entre les uns et les autres aucunes diffrences
essentielles .
Les savants adonns l'tude de l'anthropologie et de la psychologie n'ont pas,
comme les professeurs de notre universit, des lumires suffisantes pour dcider si
les ngres et les blancs sont les enfants d'un mme Dieu ; mais ils en ont assez pour
savoir que le ngre et le blanc sont intellectuellement spars par un abme, et que
cet abme est de mme nature que celui qui spare l'intelligence de l'homme civilis
de celle de la femme galement civilise. Un ngre, une ngresse ou une jeune fille
quelconque pourraient parfaitement traduire Thucydide, avoir des prix de grec,
Paris, aux grands concours, et cependant constituer au point de vue intellectuel des
tres trs infrieurs.
Une instruction analogue celle de l'homme ne peut avoir d'autre rsultat pour
les femmes que d'en faire des perroquets ennuyeux et pdants qui ddaigneront les
occupations de leur sexe, et passeront leur temps, comme nous le voyons dj en
Amrique, remplir les journaux de rcriminations bruyantes, uniformment
caractrises par le mme manque absolu de logique et de bon sens.
L'ducation de la femme doit tre en rapport avec l'tat de son intelligence et
avec son rle social. Il faut lui apprendre rendre son intrieur agrable, et lever
convenablement ses enfants. Il faut lui donner aussi des connaissances suffisantes
pour lever son esprit et lui permettre en mme temps de gagner honorablement sa
vie dans le cas o elle ne se marierait pas ou resterait veuve. Nombre d'emplois
dans les administrations publiques, l'industrie ou le commerce, seraient
parfaitement remplis par elle.
Mais c'est surtout dans l'ducation des enfants que la femme peut exceller quand
elle y a t convenablement prpare. Pour l'instruction primaire, en Amrique, et
mme pour une partie de l'instruction secondaire, on la prfre l'homme, qu'elle
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
226
tend de plus en plus remplacer. On la substituerait trs avantageusement je crois,
chez nous, toute une catgorie d'instituteurs - c'est la plus nombreuse - qui
s'entendraient infiniment mieux labourer la terre qu' lever des enfants. tant
beaucoup plus rapproche par sa nature de l'enfant que l'homme, la femme sait
mieux que ce dernier se mettre sa porte. Elle le comprend, sympathise toujours
avec lui, et sait beaucoup mieux se faire obir par sa grce et sa douceur que
l'homme par la crainte.
Ce serait dpasser le cadre de cet ouvrage que d'entrer dans des dtails sur ce
que 1'ducation des femmes pourrait tre. Il y aurait tout un livre faire sur ce
sujet, et je souhaite qu' dfaut d'un psychologiste ayant profondment tudi
l'intelligence fminine, il se trouve quelque femme d'un esprit assez lev pour
l'crire. L'instruction des femmes n'a mme pas t bauche en France ; mais il
n'en est pas de mme partout, et il existe en Europe plus d'un modle sinon imiter
entirement, au moins tudier avec soin. Telle est, par exemple, l'cole suprieure
des filles de Genve, qui compte 1000 lves externes dont un tiers trangres.
L'enseignement dure de la neuvime la quinzime anne, et, si on peut en juger
par les programmes, les matires y semblent beaucoup mieux choisies que dans nos
lyces. On y voit figurer, en effet, l'conomie politique, la lgislation actuelle,
l'histoire des civilisations, etc., qui ne sont mme pas mentionnes sur nos
programmes. N'avant pas eu occasion de voir des lves de cet tablissement, il
m'est impossible de dire exactement dans quelles limites les cerveaux fminins
profitent de cet enseignement.
IV. - L'Enseignement secondaire.
Retour la table des matires; retour au dbut du chapitre
C'est sous ce nom qu'on dsigne l'instruction et l'ducation classiques qu'on
donne aux classes aises, celles qui sont censes, par leurs capacits, leurs
lumires suprieures, diriger les autres. Il importe donc d'tudier en quoi consiste
cet enseignement, les lumires qu'il fournit, le dveloppement qu'il donne aux
qualits morales, et par consquent son rle sur l'volution sociale. Comme dans les
paragraphes qui prcdent, nous essaierons de bien faire comprendre ce rle, en
comparant ce qu'il est ce qu'il pourrait tre.
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
227
Les principes que nous avons considrs comme devant servir de base
l'instruction primaire sont encore ceux que nous adopterons pour l'enseignement
secondaire. Considrant avec Montaigne qu'il vaut mieux avoir la tte bien faite
que bien pleine, nous ne chercherons pas exercer la mmoire de l'lve, mais son
jugement et cela de faon lui donner la mthode et le got de l'tude. Nous nous
occuperons donc beaucoup moins de ce qu'il apprendra que de la faon dont il
l'apprendra.
Mais ce que nous continuerons lui enseigner tout d'abord, ce sera se
gouverner lui-mme, et non tre conduit s'imposer une rgle et la suivre.
Les matres anglais considrent avec raison que c'est l un des points les plus
essentiels de l'ducation, et ils en sont arrivs effacer toute ligne de dmarcation
entre la rcration et l'tude. Matre de son temps, le jeune homme sort et rentre
quand il veut. Il doit seulement tre l l'heure de ses repas l'heure des classes, et
avoir fini temps les devoirs impos.
Les choses que nous pouvons enseigner l'lve pendant les dix annes qu'il
restera au collge sont assurment fort nombreuses. Comme nous ne sommes plus
au temps o l'ducation n'tait gure que le privilge de fils de grands seigneurs
destins rester oisifs, ou d'aspirants la profession de moine, nous essayerons de
consacrer ces longues annes lui apprendre quelque chose d'utile.
Au premier rang de ces choses utiles, nous placerons encore les sciences.
D'abord comme je l'ai dit, elles habituent observer et juger par soi-mme et ne
pas se contenter de la parole du matre : mais en outre, elles ont plus tard dans la
vie des applications journalires. Nous les enseignerons, comme nous l'avons fait
prcdemment, fort peu avec les livres, beaucoup par l'exprience.
Jamais nous n'enseignerons les rsultats spars de leurs racines, comme on le
fait gnralement. Nous n'noncerons pas un principe ou une loi sans montrer la
srie de phases successives par lesquelles on a pass pour arriver les dmontrer.
Ces exposs historiques, entirement absents de nos livres classiques, ont
cependant une importance considrable. Eux seuls peuvent nous habituer
comprendre clairement comment voluent les choses.
Autant que possible l'lve construira lui-mme ses instruments de
dmonstration. Les plus imparfaits sortis de ses mains lui en apprendront plus que
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
228
les plus luxueux appareils des laboratoires 42. Si nous profitons du got qu'il y
prend, des difficults d'excution qu'il rencontre, pour lui donner quelques leons
de manipulation mcanique : limer, forger, souder, etc., en un mot pour lui
apprendre se servir de ses doigts, nous lui aurons rendu physiquement et moralement un service dont il sera srement reconnaissant plus tard. Outre l'utilit qu'il
retirera toujours de l'habilet qu'il aura ainsi acquise, nous lui aurons appris le lien
qui relie la thorie la pratique, donn des habitudes de prcision et d'observation
qu'il apportera ensuite ailleurs, montr ne pas mpriser ces arts manuels qui,
convenablement exercs, exigent beaucoup plus d'intelligence qu'une foule de
professions subalternes qui sont en dfinitive l'occupation exclusive de la grande
majorit des lettrs.
Nous commencerons donc par l'tude des sciences physiques et naturelles, et
parmi elles nous n'oublierons pas celles d'un usage journalier dans la vie, telles que
l'hygine, et, bien entendu, les notions de physiologie sur lesquelles elle repose.
Nous joindrons cette tude des sciences celle du dessin, de la littrature, de la
gographie et de l'histoire : la littrature, par la lecture des auteurs et jamais par leur
analyse ; l'histoire, en essayant de faire comprendre l'enchanement des
vnements, non par la biographie des conqurants, qui est gnralement le seul
objet qu'on offre aux mditations de la jeunesse, mais par l'histoire des arts, de
l'industrie, de la civilisation des diffrents peuples, en commenant par l'histoire de
la ville qu'il habite et des contres qui l'entourent. Nous commencerons la
gographie par la topographie applique l'endroit o l'on se trouve, de faon
faire comprendre les relations qui existent entre le terrain et la carte, en ayant soin
de passer par l'intermdiaire du plan en relief. Nous passerons alors la description
de pays de plus en plus loigns, en racontant comment ils ont t dcouverts, les
murs, les coutumes des races qui les peuplent, la production de leur sol, etc.
Tout en cultivant l'esprit, nous aurons soin de toujours exercer le corps. La
gymnastique aura donc une part importante dans l'ducation. Il servirait peu d'orner
l'esprit si le corps devait rester dbilit pour toujours. Notre ducation actuelle,
qu'on a si justement qualifie d'homicide, ne produit gure que ce funeste rsultat.
L'conomie politique et sociale, dont nous avons dj recommand
l'enseignement l'cole primaire, aura dans l'enseignement secondaire une part trs
grande. Nous n'hsiterons pas faire au jeune homme l'histoire de tous ces
42
L'minent physicien anglais Tyndall a fait un charmant petit volume sur l'lectricit, pour montrer qu'un
enfant d'une intelligence ordinaire pouvait construire lui-mme la plupart des instruments de dmonstration
employs en lectricit, avec une dpense de quelques francs.
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
229
problmes sociaux avec lesquels il va se trouver bientt en prsence dans la vie et
dont on ne lui apprend jamais le premier mot.
Enfin nous terminerons cette ducation par une tude qu'il ne faut aborder que
dans l'extrme enfance ou trs tard ; je veux parler de celle des langues. Cette tude
n'exerce nullement l'intelligence, mais constitue un moyen d'acqurir des
connaissances qu'il faut possder. Le jeune enfant les apprend avec les trangers,
sans en avoir conscience. S'il ne peut les apprendre cet ge, il faut en remettre
l'tude la fin de l'ducation. Par des mthodes dont la grammaire et le dictionnaire
sont soigneusement bannis, et dont j'ai eu plusieurs fois l'occasion de constater
l'efficacit, on peut apprendre en quelques mois lire couramment une langue,
alors que l'anglais ou l'allemand enseigns comme le grec et le latin pendant huit
ans au collge coups de grammaire et de dictionnaire, ne permettent pas cinq
lves sur cent de lire couramment, la fin de leurs tudes, une page d'un journal
anglais ou allemand.
Aujourd'hui, la connaissance d'au moins deux langues, l'anglais et l'allemand,
est absolument indispensable pour les voyages, les hautes tudes scientifiques ou
littraires, ou mme simplement pour les affaires commerciales ou industrielles.
Le lecteur aura remarqu, peut-tre, que, dans tout ce qui prcde, nous n'avons
mme pas mentionn ce qui fait le fond de notre enseignement classique, le grec et
le latin. C'est qu'en effet nous les supprimons entirement ou les rangeons parmi les
tudes de luxe, telles que la danse et l'quitation. L'utilit de cette suppression est,
du reste, peu prs universellement reconnue aujourd'hui, mme des professeurs
qui vivent de cet enseignement.
Notre ducation grco-latine reprsente un legs du pass qui a survcu aux
ncessits qui l'avaient fait natre. Au moyen ge, o il n'y avait d'autre littrature
que celle des anciens, o les sciences n'existaient pas, o tous les hommes instruits
crivaient et correspondaient en latin, cette langue tait ncessaire. Aujourd'hui que
personne n'crit plus en latin, que nous avons une littrature, que tous les anciens
auteurs ont t traduits bien des fois, que les sciences ont fait des progrs
immenses, et qu'il y a une foule de choses indispensables connatre, consacrer dix
ans de sa vie apprendre le latin et le grec, ou, pour mieux dire, essayer de les
apprendre, est une de ces absurdits que nos descendants auront peine
comprendre.
Inutiles videmment pour les usages actuels de la vie, le grec et le latin sont
inutiles galement pour le dveloppement de l'intelligence. Il importe d'insister sur
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
230
ce point, car le seul argument qu'on invoque encore en faveur de ces absurdes
tudes classiques, c'est qu'elles exercent l'intelligence, lvent l'esprit et le cur.
S'il en tait ainsi, je serais le premier les recommander ; car je ne considre rien
de plus important que de former le jugement et le caractre ; malheureusement,
l'enseignement de langues mortes donne un rsultat absolument contraire.
L'enseignement de la grammaire, par lequel l'lve commence ses tudes, lui fait
contracter des habitudes dogmatiques extrmement funestes au dveloppement de
la raison. Plus tard, les types de l'antiquit latine qu'on offre son admiration, le
portent instinctivement appliquer les institutions antiques aux temps modernes.
L'ducation classique porte de redoutables rvolutions dans ses flancs. Elle a
empoisonn et continue encore empoisonner la France.
Une telle assertion n'aura de valeur aux yeux de bien des lecteurs que si elle
vient des savants officiels chargs de l'enseignement, et, par consquent, le
connaissant bien ; c'est donc, puisqu'il le faut, uniquement sur leurs jugements que
je vais m'appuyer pour confirmer ce que je viens d'noncer.
Parlant de l'influence de l'ducation classique sur l'esprit des gnrations
modernes, M. F. de Coulanges, directeur de l'cole normale, s'exprime ainsi :
Notre systme d'ducation, qui nous fait vivre ds l'enfance au milieu des Grecs et
des Romains, nous habitue les comparer sans cesse nous, juger leur histoire d'aprs
la ntre et expliquer nos rvolutions par les leurs. Nos quatre-vingts dernires annes
ont montr clairement que l'une des grandes difficults qui s'opposent la marche de la
socit moderne, est l'habitude qu'elle a prise d'avoir toujours l'antiquit grecque et
romaine devant les yeux 43.
Examinant un autre point de vue l'influence de notre ducation latine sur
l'lve condamn faire parler, dans les discours qu'on lui impose, les hros des
temps antiques, M. Michel Bral, professeur au Collge de France, formule ainsi
qu'il suit son opinion :
L'lve appel toujours sortir de lui-mme prendra l'habitude d'exprimer des
sentiments de convention ; les exercices littraires de la classe seront pour lui ce qu'est le
thtre pour l'acteur. Ce sont les premiers symptmes d'une maladie intellectuelle qui
consiste se payer de mots, s'enfermer dans un rle et tirer de sa tte des passions
qu'on ne ressent point .
... Des jeunes gens gs de seize ans s'habituent regarder le sujet comme une chose
accessoire et faire passer le mrite littraire avant le fond des ides.
43
F. de Coulanges. Cit antique.
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
231
Quand la jeunesse de tout un pays est leve dans la proccupation exclusive de la
forme, il y a danger pour l'esprit et pour le sens moral de la nation.
... L'lve apprend plaider avec chaleur des causes qui ne le touchent pas. Ce
travail qu'on lui impose prpare au pays une gnration d'avocats mal informe et de
journalistes ignorants.
... On se plaint justement de la prcipitation outrecuidante avec laquelle nos jeunes
gens, en sortant du collge, tranchent des questions qui font hsiter les meilleurs juges ;
mais l'enseignement du lyce n'est-il pour rien dans ce dfaut, et se peut-il concevoir plus
mauvaise prparation la recherche de la vrit que ces joutes oratoires o l'colier
triomphe si peu de frais de ses adversaires 44 ?
Quant l'utilit du latin, M. Legouv l'a juge de la faon suivante en pleine
Acadmie franaise :
Quoi! lorsque tant d'objets merveilleux et utiles sollicitent notre curiosit, et
rclament l'effort de notre intelligence, lorsque tous les peuples nous ouvrent leurs
annales, quand la vie du pass et la vie du prsent clatent nos yeux sous tant de formes,
quand la nature lve un un tous ses voiles devant les investigations de la science... quoi !
c'est alors que nous prendrions l'enfance et l'adolescence dix ans, et quels dix ans ? la
fleur de la vie! pour leur enseigner mot mot, rgle rgle, comme s'ils devaient la parler
et l'crire, une langue qu'ils n'criront jamais, qu'ils ne parleront jamais! S'ils la savaient
au moins! mais ils ne la savent pas. Ce que l'on dcore du nom de discours latin est un
amalgame de style de toutes les poques qui ferait reculer Cicron d'horreur ! Nos enfants
perdent parodier les grands crivains le temps qu'ils devraient employer les connatre.
Sur cent lves sortant de rhtorique, il n'y en a pas quinze capables de lire correctement
vingt pages d'un livre latin 45.
Quant ce que nous connaissons de l'antiquit classique, par notre tude du
latin, c'est fort peu de chose, et, en consacrant deux mois la lecture des
traductions des classiques, on en saurait beaucoup plus sur cette antiquit que le
plus rudit des lves. M. Bral nous en fournit la preuve en nous donnant le
rsum suivant des lectures grecques et latines d'un lve de rhtorique.
Quand l'colier de rhtorique est arriv au bout de l'anne, il a ordinairement
vu les trois quarts d'une tragdie de Sophocle, les deux tiers d'un discours de
44
45
Bral. Loc. cit.
Legouv. Rponse au discours de rception de M. Gaston Boissier, 2 dcembre 1876.
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
232
Dmosthne, quatre ptres d'Horace et une cinquantaine de pages de Cicron.
Voil quoi se rduit ce commerce avec les grands esprits de l'antiquit 46.
Ce n'est pas en France seulement que des professeurs se sont levs contre
l'enseignement du grec et du latin. Dans un livre rcent sur l'ducation, M. Bain,
professeur l'universit d'Aberdeen, a attaqu cet enseignement avec toute la
vigueur de dialectique qu'on pouvait attendre de l'minent auteur du Trait de
logique. Il prend un un tous les arguments qu'on a fait valoir en faveur du grec et
du latin et n'a pas de peine montrer combien ces arguments sont purils.
Examinant d'abord les connaissances que contiennent les auteurs grecs et latins, il
montre qu'il n'y a pas un seul fait, pas un seul principe des sciences physiques ou
morales qui ne soit exprim d'une manire plus complte dans toutes les langues
modernes, et que les travaux de la philosophie grecque sont mieux connus de nos
jours, grce aux traducteurs et commentateurs, qu'ils ne l'taient il y a un sicle des
personnes qui possdaient le mieux cette langue ; qu'en ce qui concerne la
mdecine, Hippocrate a t traduit, et bien traduit, et que personne ne le lit plus
dans l'original. Il fait voir que les trsors littraires des anciens ne peuvent jamais
tre aussi bien appris dans l'original que dans les traductions, en raison de la
connaissance imparfaite de la langue qu'on peut acqurir au collge ; que, du reste,
les modles que pourraient nous offrir les langues mortes ont tellement t utiliss
qu'ils ont pass dans les langues que nous parlons depuis longtemps. Examinant
aussi l'argument que l'tude des langues mortes serait une discipline intellectuelle
que rien ne peut remplacer, il se dclare incapable de concevoir en quoi consiste
cette discipline, et montre que l'tude des langues mortes fait beaucoup travailler la
mmoire, mais que ce travail est une fatigue et non une discipline ; que si ce travail
avait de la valeur sur le dveloppement de l'intelligence, cette valeur serait
videmment la mme si l'tude se portait sur une langue vivante, qui elle, au moins,
pourrait servir quelque chose. Quant la prtention que la connaissance des
langues modernes exigerait la connaissance des langues anciennes, Bain fait voir,
qu'au lieu de rechercher le sens du mot original en latin, il vaut beaucoup mieux
l'apprendre tel qu'il est dans sa propre langue, attendu qu'il y est frquemment autre
que dans la langue d'o il tire son origine.
En rsum, l'minent professeur arrive une conclusion que je trouve encore
bien indulgente, mais qui se comprend chez un auteur oblig par son pass et sa
position de mnager beaucoup de prjugs : c'est que, loin de correspondre
l'norme dpense de temps et de force qu'exige pendant dix ans la culture du grec et
du latin, les rsultats utiles fournis par l'tude de ces deux langues sont peut-tre
quivalents deux ou trois heures de travail par semaine pendant un ou deux ans .
46
Bral. Loc. cit.
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
233
Deux heures de travail par semaine pendant une anne scolaire ne forment mme
pas cent heures, qui reprsentent elles-mmes environ un peu moins de quinze jours
de travail sept heures par jour. C'est dj beaucoup pour ce que valent le grec et le
latin. C'est ce maximum certainement que devrait tre rduite leur tude, si on
tenait mnager d'anciens prjugs.
Les esprits encore placs sous le joug des vieilles ides universitaires
rpondront ce qui prcde que, parmi les hommes minents que nous possdons,
le plus grand nombre est sorti du lyce ; par consquent que les rsultats de cet
enseignement classique ne sont pas aussi mauvais qu'on le prtend. Je ne nierai pas
qu'on rencontre des natures assez vigoureuses pour avoir rsist au rgime
universitaire. Elles ont chapp son action comme on chappe celle du cholra
ou de la fivre jaune ; mais ce serait faire une trange confusion que de supposer
qu'ils doivent leurs talents leurs tudes classiques. Dans une enqute qui a port
sur cent quatre-vingts reprsentants les plus minents de la science contemporaine,
Galton dit :
Je n'en trouve pas un qui, ayant t lev l'ancienne mode ( l'instruction classique)
s'en montre satisfait. Les hommes de science qui sortent des grandes coles publiques
n'ont rien fait d'ordinaire durant leur sjour. Ils ne pouvaient s'assimiler ce qu'on y
enseignait et maudissaient le vieux systme de tout leur cur... Je suis surpris de voir
combien peu d'examens ont passs l'universit des hommes minents qui y ont fait leurs
tudes... leur indpendance d'esprit et leur flegme ne les portent gure russir dans les
concours 47.
Une seule raison srieuse peut tre invoque aujourd'hui par les familles pour
s'excuser de condamner leurs enfants au supplice du grec et du latin, c'est que ces
langues conduisent aux diplmes universitaires qui ouvrent l'accs des
administrations et des carrires librales. Il n'y a videmment rien rpondre
cette objection, sinon qu'il est triste que l'opinion ne soit pas assez avance pour
imposer la suppression de ces diplmes dont un ancien professeur, aujourd'hui
acadmicien, M. Legouv, crit qu'ils sont un obstacle formel aux bonnes tudes,
un flau pour la jeunesse, une des causes principales de l'abaissement du got
littraire . Nous sommes peu prs, du reste, la seule nation qui ait conserv cette
sorte d'examen. Il y a longtemps qu'il est remplac en Allemagne par ce qu'on
appelle les examens de passage, qui ne permettent pas l'lve d'entrer dans une
classe suprieure sans avoir prouv qu'il possde les connaissances enseignes dans
la classe infrieure. Le certificat de maturit qui termine la dernire anne d'tude
n'est alors qu'une formalit sans importance.
47
Les hommes de science et leur rgime, confrence faite l'institution royale de la Grande-Bretagne (Revue
scientifique, 1873, p. 1039).
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
234
Ces examens de passage existent chez nous dans les rglements, mais ces
rglements n'ont jamais t appliqus. Leur utilit serait cependant capitale,
puisqu'ils permettraient d'empcher des lves sans aucune disposition pour
l'ennuyeuse tude des langues mortes de perdre dix ans de leur vie cette tude,
alors qu'ils auraient pu aborder avec succs d'autres branches de connaissances. Il a
fallu une ignorance vraiment curieuse de la nature humaine pour croire que, malgr
les aptitudes trs diffrentes des hommes, une mme ducation puisse leur
convenir. Tel esprit, n'ayant aucune aptitude pour les lettres, en a au contraire de
trs grandes pour les sciences, l'industrie, les beaux-arts, ou rciproquement. Si
nous n'avons pas su dcouvrir ces aptitudes chez l'enfant, au moins lui devons-nous
de le retirer temps de la voie o il s'est engag lorsqu'on reconnat qu'elle ne le
conduira rien, et de lui permettre d'en essayer une autre. C'est l prcisment ce
qui se passe en Allemagne. Si on reconnat, aprs un an ou deux d'essai, que
l'enfant n'a pas d'aptitude pour l'instruction classique, on le dirige vers un autre
ordre d'tudes (coles polytechniques, Enseignement professionnel, Realschulen,
etc.). Ces tudes ne lui ouvrent pas aujourd'hui la porte des universits ; mais on a
reconnu que, quelle que soit leur nature, elles dveloppaient galement
l'intelligence, et on recherche maintenant les moyens de donner aux lves sortant
de ces coles diverses les mmes droits qu' ceux qui ont fait des tudes classiques.
Il est vraiment honteux pour un pays d'obliger des jeunes gens possdant des
aptitudes fort diverses s'asseoir sur le lit de Procuste d'un mme enseignement.
Les rsultats de cet rgime uniforme sont parfaitement indiqus par M. Bral dans
le passage suivant :
Tout le monde sait ce qu'il faut entendre par la tte et par la queue de la classe ; mais
peu de personnes trangres nos lyces peuvent se figurer quelle distance surprenante
spare la tte de la queue. Tandis que sur cinquante lves il y en a dix qui travaillent avec
nergie et quinze qui suivent passablement, les vingt-cinq autres forment une arriregarde telle qu'en tranent aprs elles les armes mal organises. Qui ne se rappelle ces
lves en rhtorique, dplacs en rhtorique, mais qui n'auraient pas t plus leur place
en quatrime ?
Que dire d'un systme d'ducation qui produit ce rsultat, que les trois quarts
des jeunes gens qui y sont soumis perdent absolument leur temps ? Quel triste
gaspillage de l'intelligence humaine!
Malheureusement, nous sommes si peu avancs encore en matire d'ducation
que, en dehors de l'enseignement classique, il n'y a gure qu' Paris que nous
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
235
possdions quelques rares tablissements (Chaptal48 et Turgot notamment) donnant
une ducation autre que notre ducation classique. L'ducation qu'y reoit la
jeunesse est trs prfrable celle qu'on lui donne au lyce ; mais, tant que ces
tablissements ne se seront pas multiplis, que le certificat des tudes qui y auront
t faites ne donnera pas aux jeunes gens les mmes droits qu' ceux sortant des
lyces, ils ne pourront videmment se dvelopper.
Mais le lyce ne se borne pas enseigner le grec et le latin, il enseigne d'autres
choses, il donne l'ducation morale ; l'enfant y sjourne dix ans de sa vie. Si l'action
du latin et du grec est funeste son intelligence, il se peut que le reste de
l'instruction qu'il y reoit, l'ducation qu'on lui donne compensent ce que
l'enseignement des langues mortes peut avoir de fcheux.
Pour juger de la valeur de notre enseignement secondaire pris dans son
ensemble, nous procderons exactement comme nous l'avons fait pour le grec et le
latin, c'est--dire que nous nous bornerons donner le jugement de ceux qui sont
chargs de cet enseignement, depuis les professeurs jusqu'au ministre qui le dirige.
Tout d'abord, il importe d'examiner comment notre enseignement classique s'est
form. En fait, il existe, c'est un argument puissant en sa faveur, le seul mme en
vrit qu'on puisse invoquer. Son origine est exclusivement clricale. Cr pour
faire des moines, le collge a chang avec les sicles de destination, mais en
conservant scrupuleusement ses mthodes primitives, l'tude spciale des langues
mortes et une discipline particulire ayant pour but l'crasement complet de la
volont et de l'esprit de libre examen.
Qu'est-ce qu'un collge ? crit M. de Laprade. A l'origine et en principe, c'est un
couvent. Au moment de la Renaissance et de la Rforme, une foule de circonstances dont
l'numration nous entranerait trop loin, dterminrent la transformation de l'colier libre
dans sa famille ou chez un hte, en colier clotr et la fondation des premiers collges.
La force des choses appelait alors les ordres religieux cette cration. Le type naturel
d'une socit fonde par les moines, c'est le monastre. Le collge fut donc institu sur le
modle du couvent. L'universit du premier empire adopta et aggrava ce rgime. Appliqu
l'enfance, mme en des sicles mieux tremps et moins nerveux que le ntre, ce rgime
d'immobilit, d'abstinence, de compression physique et de contention d'esprit est une
institution aussi froce et aussi dltre que le Saint-Office 49.
48
La dure totale de l'enseignement dans cet tablissement est de six annes. Un cours de latin durant deux ans
est rserv aux lves qui se prparent au baccalaurat.
49
Laprade (de l'Acadmie franaise), l'ducation librale.
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
236
Si notre ducation du lyce est surtout mauvaise en raison de son origine
clricale, on conoit ce que doit tre celle des congrgations elles-mmes. Je crois
que, de tous les dangers qui menacent la France, aucun n'est aussi redoutable pour
elle que les progrs de cet enseignement. Il faut avoir observ de prs l'action
dmoralisante de ces clotres, s'tre rendu compte quel point ils transforment en
quelques annes un enfant au caractre franc et honnte en un petit tre dissimul,
plat et sournois, pour comprendre les dangers qu'ils prsentent. Dans une socit
aussi divise que la ntre, cet enseignement augmente encore les divisions, et,
l'excs engendrant l'excs, nous en arrivons ne plus avoir que deux partis, des
radicaux dmolisseurs ou des dvots hypocrites. Avec les examens de passage dont
je parlais plus haut, l'tat aurait un moyen certain de savoir o l'lve a fait ses
tudes, et je considre que ce devrait tre un devoir absolu pour lui de ne jamais
laisser entrer dans les administrations ou les tablissements d'enseignement
suprieur les lves des congrgations. Il faut laisser chacun la libert de
s'instruire comme il veut, bien que la libert de pervertir la jeunesse soit la plus
contestable de toutes ; mais il faut aussi laisser l'tat la libert de protger la
socit qu'il est appel dfendre.
Mais revenons l'ducation classique du lyce que nous avons choisie comme
type et qui, si mauvaise qu'elle soit, est encore trs suprieure celle que les
congrgations peuvent donner.
Douze heures par jour (douze heures!) d'immobilit et de silence sont imposs
pendant dix ans l'enfance. Un pareil travail ne saurait tre sans doute gaspill
inutilement. Voyons donc le profit qu'elle en retire.
En 1763, La Chalotais, procureur gnral au parlement de Bretagne, portait sur
notre enseignement classique un jugement que tous les auteurs modernes ont
reproduit, parce qu'il indique nettement encore, suivant eux, la valeur actuelle de
notre ducation classique. Le voici :
A l'exception d'un peu de latin qu'il faut apprendre de nouveau si l'on veut faire
quelque usage de cette langue, la jeunesse est intresse oublier tout ce que ses
prtendus instituteurs lui ont enseign. Est-ce l le prix que la nation doit retirer de dix
annes du travail le plus assidu ?
... Notre ducation se ressent partout de la barbarie des sicles passs, o l'on ne
faisait tudier que ceux qui se destinaient la clricature. Un tranger qui on
expliquerait ces dtails, s'imaginerait que la France veut peupler les sminaires, les
clotres et les colonies latines.
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
237
Prfre-t-on cet ancien jugement d'un magistrat, celui plus rcent et plus
autoris d'un ancien ministre de l'instruction publique lui-mme ? Voici comment
M. Jules Simon apprcie la valeur de cet enseignement :
Apprendre des leons, savoir par cur une grammaire ou un abrg, bien couter,
bien rpter, bien imiter ! Voil une plaisante ducation, o tout effort est un acte de foi
dans l'infaillibilit du matre et n'aboutit qu' nous diminuer et nous rendre impuissants.
L'ducation dans des conditions pareilles est une abdication pour dix ans ; aprs s'tre
pendant dix ans dsintress de soi, on ne se retrouve plus 50.
L'opinion des philosophes peut aussi tre intressante connatre. Voici
comment le clbre logicien Stuart Mill apprcie de son ct ce que sera l'esprit
d'un jeune homme ayant reu une bonne ducation classique bien complte :
La plupart des enfants et des jeunes gens qui on a appris beaucoup de choses, bien
loin de rapporter de leur ducation des facults fortifies, n'en sortent qu'avec des facults
surmenes. Ils sont bourrs de faits, d'opinions et de formules d'autrui qu'ils acceptent et
qui leur tiennent lieu du pouvoir de s'en faire eux-mmes. C'est ainsi qu'on voit des fils de
pres minents pour l'ducation desquels rien n'a t pargn, arriver l'ge mr en
dbitant comme des perroquets ce qu'ils ont appris dans leur enfance, incapables de se
servir de leur intelligence en dehors du sillon qu'on a trac pour eux 51.
J'ai dj cit plus haut, propos du latin, l'opinion de M. Bral, montrant que
notre ducation ne forme que des bavards prts parler sur ce qu'ils ne connaissent
pas. Le mme auteur montre quel point toute notre ducation classique tous ses
degrs ne nous habitue gure qu' prendre des mots pour des ralits, et forme des
gnrations d'esprits superficiels ne faisant que rpter sur chaque sujet une srie de
phrases toutes faites et incapables de penser par eux-mmes :
Bien des gens sont si peu habitus se servir de leur intelligence et ont la tte si
remplie d'expressions qu'on les voit ordinairement occups non penser ou chercher des
mots pour leurs penses, mais attendre la pense d'autrui pour y fixer une des
nombreuses phrases qu'ils tiennent en rserve... Nous voyons clairement ici l'effet d'un
enseignement tout verbal qui a nourri les intelligences de tours de phrases et de bonnes
expressions 52.
Un autre professeur des plus illustres, M. Renan, attribue aussi l'ducation
universitaire les mmes funestes rsultats :
50
51
52
J. Simon. La rforme de l'enseignement.
Stuart Mill. Mmoires.
Bral. Loc. cit.
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
238
L'Universit de France... rappelle trop les rhteurs anciens de la dcadence. Le mal
franais, qui est le besoin de prorer, la tendance tout faire dgnrer en dclamation,
une partie de l'universit l'entretient par son obstination mpriser le fond des
connaissances et n'estimer que le style et le talent 53.
Mais, si l'ducation intellectuelle que donne le lyce est ce point funeste que
c'est une question de savoir si l'ignorance complte ne serait pas une hygine
prfrable pour l'esprit, pouvons-nous esprer au moins que l'ducation morale y
sera meilleure et que dans ces sombres casernes, que les trangers ne peuvent
contempler sans stupfaction, les enfants deviendront des hommes ?
Il n'en est rien, hlas ! et l'influence que l'ducation classique exerce sur le
caractre est plus funeste encore que celle exerce sur l'intelligence. Les
professeurs les plus minents sont unanimes sur ce point :
Dix ans de ce rgime, dit M. J. Simon, font des hommes qui s'abandonnent l'excs
ou se rvoltent l'excs, et voil peut-tre la psychologie de la France 54.
Toute la vieille pdagogie monacale, toute la morale des collges universitaires et
autres, crit M. de Laprade, ne vise rien moins qu' la destruction de la volont.
Substituer son propre vouloir au libre arbitre de l'lve, le placer continuellement dans des
situations o il n'y a pas choisir, o la ncessit le contraint, o la force pse sur lui, o
il agit sous l'empire de la crainte et sans pouvoir consulter ni sa raison ni son cur, voil
toute la thorie du matre, voil toute la discipline du collge. Excrable systme dont la
corruption morale, la lchet, l'esprit de servitude sont les fruits naturels. Depuis trois
sicles ils empoisonnent la France 55.
A dix-huit ans, dit M. Bral, le lycen n'a pas plus la libre direction de sa personne,
de son temps, de ses facults, de son avoir, qu' dix : la responsabilit n'existe pas pour lui
le collge s'tant fait son tuteur pour toute chose. Il ne faut donc pas s'tonner si nos
enfants, une fois sortis du collge, ressemblent des chevaux chapps, se buttant toutes
les bornes, commettant toutes les sottises 56 .
Quant aux habitudes d'galit que semble produire la vie en commun, le mme
auteur les juge de la faon suivante :
Il est certain que pour l'observateur du dehors qui voit passer par longues files les
bataillons du lyce, l'ide de l'galit est la premire qui se prsente l'esprit. Mais c'est
53
54
55
56
Renan. Questions contemporaines, Prface.
Rforme de l'enseignement secondaire.
ducation librale.
Bral. L'instruct. publ. en France.
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
239
l'galit dans la servitude. Tout le monde est priv des mmes liberts et renferm dans les
mmes murs ; voil quoi se rduit ce bienfait de l'internat. On vante, il est vrai, une
autre galit qui rgnerait dans les relations des lves. Illusion et chimre ! une
dmocratie agite par des factions, une runion d'oligarchies : voil plutt l'image exacte
de la vie de collge. la compression exerce par l'autorit, viennent se joindre les
exigences d'une opinion oppressive et jalouse. Le plus grand nombre, jet dans cette
arne, songe avant tout assurer la tranquillit de sa vie en nouant des alliances avec les
forts. Ce n'est point l'abngation, c'est lgosme que dveloppe la vie en commun quand
elle n'est pas ennoblie par quelque sentiment lev 57.
Il y a bien d'autres choses encore du reste que dveloppe cette vie en commun,
et notamment une immoralit qu'on ne peut gure comparer qu' celle des bagnes et
des prisons. Un savant mdecin, M. Dally, qui a mrement tudi le sujet,
s'exprime ainsi :
Il m'est impossible de ne pas dire quelques mots de l'effroyable immoralit qui rgne
dans nos coles... J'affirme qu'en prsence de l'tat actuel des choses, de profondes et
rigoureuses rformes doivent tre ralises dans les murs des collges, o il faut aller
chercher le germe des dpravations qui dshonorent la socit 58.
Mais je me suis fait une loi de ne citer que des professeurs de l'Universit. J'ai
cit un mdecin en passant, parce que sa comptence en ces questions est
videmment trs grande. Je m'empresse d'appuyer ses dires par ceux d'un des
professeurs officiels que j'ai dj plusieurs fois cits :
quoi sert-il, crit M. Bral, de jeter un voile sur des faits que la plupart
connaissent, et ne faut-il pas mieux dire hautement la vrit aux parents qui hsitent sur le
seuil du collge ? Aprs avoir soigneusement veill sur les amitis et les liaisons de leurs
enfants, ils les introduisent tout coup dans une socit qui chappe leur contrle et qui
est plus mle qu'aucune de celles o un honnte homme, dans le cours ordinaire de la
vie, est expos passer ses jours. Parmi les collgiens qu'ils donnent pour compagnons
leurs fils, il en est qui dj la vie n'a plus grand'chose apprendre 59.
On conoit quel souvenir des nature distingues peuvent avoir gard d'un tel
rgime :
Je ne connais, crit M. de Laprade, aucun de nos contemporains qui n'ait conserv
du collge un souvenir plein d'horreur. Pour mon compte, je ne recommencerais pas mes
dix ans de lyce au prix du sceptre de Charlemagne et des lauriers du Dante. On a du reste
57
58
59
Bral. Loc. cit.
Dr Dally. Des mthodes d'enseignement.
Bral. Instr. publ.
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
240
plus de chance de sortir grand homme ou tout simplement homme sain de corps et d'esprit
de la plus sauvage mtairie des Alpes que d'une maison universitaire 60.
Quant aux rsultats du systme de rcompenses et de punitions qui sont les
bases ncessaires de notre enseignement, M. Bral en apprcie l'influence comme il
suit :
L'enfant s'habitue de la sorte chercher la rcompense de ses actes en dehors des
actes eux-mmes. Si l'on peut reprocher aux gnrations nouvelles le manque de
dsintressement, si l'on voit mme d'honntes gens rclamer avec instance le prix du
devoir accompli et se plaindre avec amertume quand la rcompense se fait attendre ; si,
une fois sorti du collge, l'ancien bon lve continue compter les progrs de ses
camarades et suivre d'un regard inquiet les succs de ses rivaux et contemporains, le
lyce n'est-il pour rien dans ces travers ? C'est lui qui nous apprend esprer une
distinction pour chaque effort et nous comparer sans cesse les uns aux autres... Ces
brillants lves du lyce entrent dans la socit dj surchargs d'honneurs. Que peut leur
offrir la vie pour rpondre de tels dbuts ? La fausse ide que les hommes ont droit
tre classs d'aprs leur valeur personnelle, comme si la socit tait la continuation du
collge, leur prpare de nombreuses dceptions 61.
La rflexion suivante, de M. P. Bert, peut servir de conclusion tout ce qui
prcde :
Je n'hsite pas le dire : l'ignorance fondamentale de la bourgeoisie qui sort de nos
collges, toute ptrie d'impuissante prsomption, est aussi redoutable pour les progrs de
l'esprit public et l'avenir de notre pays que celle des enfants du peuple qui ne franchissent
pas le seuil de l'cole 62.
Je n'ai, dans ce qui prcde, fait juger l'influence de l'ducation classique sur
l'intelligence et le caractre que par des professeurs de l'Universit. Si on leur
reprochait de voir trop en noir, il suffirait de citer l'opinion des savants trangers
l'Universit pour montrer qu'elle est identique :
Les galres, crit M. Michel Chevalier, sont un purgatoire, la vie de rgiment un
paradis ct de l'enfer de nos pensionnats. Est-il tonnant qu'aprs tre sorti de cet enfer,
on ait horreur de tout ce qui pourrait en rappeler le souvenir 63 ?
60
61
62
Laprade. Instr. librale.
Bral. Loc. cit.
Projet de loi sur l'organisation de l'enseignement suprieur, par P. Bert, professeur la Facult des sciences
de Paris.
63
Revue littraire, 24 mars 1873.
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
241
Dans une sance publique de l'Acadmie des sciences, M. Henry Deville a
apprci comme il suit l'influence de l'Universit :
Je fais partie de l'Universit depuis longtemps, je vais avoir ma retraite ; eh bien! je
le dclare franchement, voil en mon me et conscience ce que je pense : l'Universit,
telle qu'elle est organise, nous conduirait l'ignorance absolue.
Lors de la discussion sur la libert de l'enseignement. a dit M. Dumas dans la mme
sance, il avait t reconnu l'unanimit que le mode actuel d'enseignement dans notre
pays ne pouvait tre continu sans devenir pour lui une cause de dcadence 64.
Tout le monde, savants et professeurs, est donc bien d'accord. Comme le dit M.
Bral : L'enseignement est tous ses degrs rparer et reconstruire.
Malgr cette unanimit dans les critiques, malgr cette conviction gnrale de
tous les savants comptents, qu'envoyer un enfant au bagne ou au lyce revient
peu prs au mme, les rformes les plus lgres n'ont pas encore t tentes.
L'eussent-elles t, du reste, qu'on peut prdire d'avance qu'elles fussent restes
inutiles. C'est qu'en effet il ne faut pas oublier ce que j'ai dj dmontr bien des
fois : l'impuissance des rformes, lorsque les choses rformer sont en rapport avec
certains sentiments qui, eux, ne peuvent que trs lentement se transformer. Si
l'enseignement reste ce qu'il est, c'est videmment que les pres de famille le
trouvent satisfaisant. Pour qu'ils arrivent en comprendre les dangers, il faudrait
transformer entirement d'abord leur faon de penser. M. de Laprade s'merveille,
dit-il, de ce que, depuis plus de trente ans que s'agite la polmique sur
l'enseignement, l'uniformit la plus absolue n'a pas cess de rgner dans le mode
d'ducation, pas une vraie rforme n'a t introduite, essaye ou mme propose .
S'il y avait lieu de s'merveiller dans ces matires, ce serait, suivant moi, d'avoir
constater qu'une rforme et pu tre essaye, et, ayant t essaye, qu'elle et pu
russir.
En matire d'ducation, comme en matire de constitution, les peuples ont
exactement les institutions qu'ils mritent. Notre bourgeoisie trouve excellente
l'absurde ducation que reoivent ses fils et qu'elle-mme a reue. Que pouvonsnous cela ? Essayons de l'clairer sans trop nous bercer de l'espoir d'y russir.
Pour mon compte personnel, je ne peux pas dire avoir connu un seul pre de
famille qui j'aie pu faire comprendre l'importance de tout ce qui prcde.
L'exprience seule instruit les hommes, et elle se manifestera ici sous la forme de
ces catastrophes politiques et sociales qui, force de se rpter, finissent forcment
par faire rflchir les constitutions mentales les plus bornes.
64
Comptes rendus de l'Acadmie des sciences (les Mondes, 1871.
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
242
Au lendemain de nos dsastres, une main nergique et pu, peut-tre, oprer
dans notre ducation les mmes rformes que la Prusse au commencement de ce
sicle lorsqu'elle fut vaincue. La main nergique ne s'est pas trouve, et maintenant
elle se heurterait des rsistances universelles. Il y a quelques annes, un ministre
intelligent voulut rayer la versification latine de l'enseignement. Ce fut un tel
concert de protestations, qu'il fallut la rtablir. Toute une gnration de bourgeois
s'imagina que la patrie serait en danger si leurs rejetons n'apprenaient pas faire
des vers latins. Sur le rapport de M. Patin, - le nom de cet homme vnrable mrite
d'tre conserv, - le conseil de l'instruction publique obligea le ministre revenir
aux anciens errements. Tant que les catastrophes dont je parlais il y a un instant
n'auront pas instruit notre bourgeoisie, il n'y a qu' se rsigner et renoncer mme
se donner la peine de tcher de l'clairer.
Nous ne devons pas nous dissimuler d'ailleurs que, lors mme que la ncessit
de rformer notre ducation sera gnralement comprise, celui qu'on chargera de
ces rformes aura accomplir une lourde tche. Dcrter des mesures, faire des
programmes, tout cela est facile. Les faire excuter est autre chose. Il faut
remarquer et c'est l ce qui a chapp gnralement aux critiques, que pour
rformer l'enseignement il faudrait d'abord, comme je l'ai dj dit propos de
l'enseignement primaire, rformer les professeurs chargs de donner cet
enseignement.
Je suis loin de jeter un blme sur un corps de professeurs qui contient tant
d'hommes laborieux et dvous, dit M. Bral ; mais, enferms eux-mmes dans les
prjugs o ils retiennent les autres, ils lvent la gnration nouvelle comme ils
ont t levs.
Nous voici naturellement conduit dire quelques mots de l'enseignement
suprieur. L'examiner dans toutes ses branches tant impossible, nous nous
bornerons parler de la plus importante, celle destine former les professeurs, et
du mme coup les savants, car, dans notre pays, c'est peu prs exclusivement
parmi les professeurs officiels que se recrutent les savants.
V. - L'Enseignement suprieur.
Retour la table des matires; retour au dbut du chapitre
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
243
Parmi les raisons qui dmontrent l'impossibilit d'excuter facilement des
rformes srieuses dans l'ducation, on peut mettre au premier rang la faveur dont
jouissent dans le public nos grands tablissements d'enseignement suprieur,
l'cole polytechnique et l'cole normale, par exemple. Alors qu'on les cite partout
l'tranger comme types d'un enseignement absolument dtestable, alors que
l'exprience a dmontr qu'ils ne forment que des spcialistes aux ides troites, sur
lesquels la science n'a pas compter pour agrandir son domaine, et que c'est une
rgle gnrale, suivant l'expression de M. le professeur Bral, que l'on trouve
teints quarante ans ces brillants sujets de nos coles , nous rptons bien haut
que l'Europe nous envie de telles institutions, et celui qui tenterait d'y toucher
verrait se dresser contre lui la nation tout entire.
Ne voulant m'occuper que de la faon dont se forment les professeurs, je ne
parlerai ici que de l'cole normale. Suivant la mthode que j'ai adopte pour ce
chapitre, je ferai juger cette institution par les membres les plus autoriss de
l'enseignement. C'est l, certes, une mthode de dmonstration laquelle je n'aime
gure avoir recours, car la valeur d'une ide est indpendante de celui qui la
prsente ; mais, quand le lecteur ne reconnat de comptence sur certaines questions
qu' une classe dtermine de personnes, il n'y a pas d'autre moyen de le convaincre
que de citer l'opinion mme de ces personnes.
Voici d'abord sur notre corps universitaire dans son ensemble l'expression de
l'opinion gnrale, telle que l'a rsume M. le professeur Bral :
Le corps universitaire tait en 1810 peu prs l'expression des ides de la socit. En
1848 il tait dj si arrir qu'un observateur tranger pouvait crire : Le corps des
professeurs en France est devenu tellement stationnaire, qu'il serait impossible de trouver
une autre corporation qui, en ce temps de progrs gnral, surtout chez la nation la plus
mobile du monde, se maintienne avec autant de satisfaction sur les routes battues,
repousse avec autant de hauteur et de vanit toute mthode trangre, et voit une
rvolution dans le changement le plus insignifiant. Depuis que le livre d'o nous
extrayons ces lignes a t publi, vingt-quatre ans se sont couls : le portrait qu'on y
trace des mthodes de l'Universit est rest exact sur bien des points, mais les dfauts se
sont exagrs et les lacunes accuses davantage 65.
Quant l'cole normale charge de former les professeurs, voici ce qu'en pense
un des savants qui ont le plus illustr notre enseignement, M. Renan :
65
Bral. L'instruction publique.
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
244
Pouvons-nous oublier que cette brillante ppinire n'a rien form de ce qu'on est en droit
d'attendre d'une cole, qu'elle n'a pas donn un hellniste, pas un orientaliste, pas un
gographe pas un pigraphiste et, avant l'cole d'Athnes, pas. un archologue ? Pdante
sans tre savante, elle a voulu crer ce qui ne se cre pas, des historiens, des philosophes,
sans s'apercevoir que la philosophie est un art dont le secret ne s'apprend pas, tandis que
les connaissances qui servent l'alimenter et l'exciter s'apprennent. Ainsi, malgr tant de
srieux services, l'cole normale est reste presque strile pour le progrs de la grande
science. Avec son histoire de seconde main et sa philosophie de confiance, elle n'a produit
que peu de ces laborieux ouvriers qui se mettent la tte de la tranche pour la
continuer 66.
Les trangers, qui n'ont pas garder de mnagements, sont beaucoup moins
indulgents encore que M. Renan. Dcrivant dans ses plus petits dtails le rgime
intrieur de cet tablissement, M. Ernest Friese, professeur au Collge royal
franais de Berlin, crit :
On voit quel contrle minutieux les tudes des lves-professeurs sont soumises.
Leurs devoirs sont littralement taills pour chaque jour. Tout se passe avec une rgularit
crasante. Les programmes des examens ne laissent pas une ombre de mouvement ces
malheureux esclaves de la science. C'est absolument la vie et le rgime des lyces : la
classe, l'tude et le dortoir. C'est pire que le lyce, o du moins il n'y avait pas
incessamment des examens en perspective.
... Quelle triste existence pour des jeunes gens de vingt ans et plus ! et quelle triste
prparation aux fonctions de pdagogue que la charge le professeur avait comporter
toujours !... Traits en coliers jusqu'au moment o ils commencent professer, ces lves
sont mal prpars gouverner la jeunesse, car ils n'ont jamais appris se gouverner euxmmes... Il faut mme avoir des dispositions extraordinaires et des facilits remarquables
pour ne pas perdre le got des tudes srieuses, quand on est arrt sans cesse par des
examens, o l'on est jug sur des futilits et o il est souvent impossible de faire valoir ce
que l'on sait... Dans la pratique franaise, les examens multiplis l'infini deviennent une
entrave funeste de la science, et le mal qu'ils font est d'autant plus grave que les
professeurs des facults se recrutent dans le corps enseignant des lyces et s'y recruteront
toujours, tant qu'il n'y aura pas de docteurs libres 67
Qui admettra un instant, qu'un rgime semblable puisse crer autre chose que
des pdants bavards, bourrs de science comme un dictionnaire, mais incapables
d'avoir une ide eux sur un sujet quelconque, incapables surtout de la moindre
recherche originale ?
La comparaison faire entre nos professeurs et ceux de l'tranger est des plus
humiliantes pour nous. Rien de plus rare en France que de voir un professeur de
66
67
Renan. Dialogues et fragments philosophiques.
De l'enseignement secondaire en France, in-8. Berlin, 1878.
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
245
l'Universit produire la moindre recherche personnelle. C'est le contraire ailleurs.
En Allemagne, nous dit M. Bral, il n'y a gure de collges o l'on ne trouve
quelques hommes qui publient des mmoires d'rudition, collaborent des
journaux savants, etc. .
Pour subir leurs examens, nos professeurs ont appris certainement plus de
choses par cur que leurs collgues de l'tranger ; ils sont plus instruits, suivant le
sens qu'on attache gnralement en France ce mot. Pourquoi leur sont-ils si
infrieurs, et d'o vient leur incapacit si absolue rien produire ? Plusieurs causes
secondaires y concourent : l'ducation classique du lyce qui, ainsi que nous l'avons
vu, tue l'initiative et le got de l'observation personnelle ; leur dpendance troite
de bureaucrates hostiles par nature toute recherche indpendante ; mais la plus
importante de ces causes est la faon dont ils se recrutent. Pour arriver aux
situations rtribues du professorat, il faut subir toute une srie de concours, et ces
concours ne sont que des joutes oratoires et des exercices de mmoire, o le talent
rel et l'individualit surtout n'ont rien faire. De toutes les faons de juger de la
valeur d'un homme, le concours est la plus mauvaise. Les Allemands le considrent
avec raison comme une de nos plaies nationales, comme une des causes qui font
que le got de la science est si peu rpandu chez nous. L'ide qu'on puisse juger de
la valeur d'un savant par une de ces joutes oratoires qui obligent le candidat
consacrer exclusivement des exercices de mmoire le temps qu'il devrait
employer des recherches originales qui permettraient de l'apprcier, leur semble la
plus singulire des aberrations. L'opinion gnrale, en Europe, des effets produits
par le concours dans le professorat est assez bien reprsente par le passage suivant
de M. le professeur Friese :
Jules Simon, pour prouver que les concours pour les diffrentes agrgations des lyces
sont trs srieux et une garantie efficace du niveau des tudes, cite le fait que voici : Je
connais, dit-il, des membres de l'Institut, parmi les plus minents, qui ont t refuss
l'agrgation jusqu' trois fois. Il y a l pourtant de quoi faire rflchir. Tant pis pour un
systme qui aboutit des rsultats si bizarres. Il est vident que ce procd de constater
l'aptitude aux fonctions de l'enseignement est trs imparfait : il a l'inconvnient de ne pas
tenir compte du tout des tudes individuelles que chaque candidat a faites... Un jeune
homme qui a got la saveur de la science, qui, pendant un certain temps s'est livr corps
et me des recherches scientifiques de son choix, aura pourtant infiniment plus de
chances d'tre un jour un professeur capable d'inspirer ses lves le got des tudes, que
celui qui a pass les meilleures annes de sa vie forger des vers latins, composer des
thmes et des versions grecques, et crire de petites compositions latines et franaises
bien tournes. Voil pourtant les exercices par lesquels on se prpare avec les plus grandes
chances de succs aux preuves de l'agrgation, voil la seule chose sur laquelle les
aspirants au professorat sont jugs.
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
246
Certes, plus un jeune homme en France aura donn de temps de vraies tudes, plus il
sera initi la science, et plus il aura de chances d'tre refus avec clat l'agrgation.
Les savants minents de l'Institut, dont parle Jules Simon, en sont des exemples vivants.
Est-il vraiment juste qu' l'examen qui donne accs la carrire du professorat, il faille
avoir des connaissances gnrales plutt que de profondes ? Un savoir solide parat tre
chose fort inutile... Les beaux parleurs l'emporteront toujours l'agrgation sur les esprits
un peu plus lents se produire, si suprieurs que soient ces derniers 68.
Veut-on savoir comment se forme rellement un bon professeur, un homme qui
mritera le nom de savant au lieu de n'tre qu'un banal dictionnaire ? L'illustre
physiologiste Helmholtz va nous le dire :
Celui qui veut inspirer ses auditeurs une conviction complte de la vrit de ce qu'il
avance, doit avant tout savoir par exprience personnelle ce qui produit la conviction. Il
faut donc qu'il ait su s'avancer seul sur un terrain o personne ne lui avait fray le
chemin ; en d'autres termes, il faut qu'il ait travaill sur la frontire de la science humaine
et lui ait conquis de nouveaux domaines 69.
Les deux systmes allemand et franais, l'un dans lequel on juge de la valeur
d'un homme par les recherches originales qu'il a produites, l'autre par sa facilit
bien rciter ce qu'il a appris, ont malheureusement port leurs fruits. On sait ce
qu'est le corps des professeurs de l'Universit en Allemagne, et rcemment Du Bois
Reymond pouvait dire que tous les hommes d'un gnie original de son pays taient
sortis des Universits. Nos jeunes gens ne sont pas moins intelligents assurment
qu'ailleurs ; mais, obligs de se livrer au plus abrutissant travail, comment auraientils le temps d'exercer leurs facults de recherches ? Il faut avoir vu le travail de
lettrs chinois auquel se livrent les jeunes mdecins candidats l'agrgation en
mdecine, - car le systme est partout le mme, - obligs de consacrer
exclusivement leur temps cataloguer et apprendre par cur tout ce qui a t
produit sur les sujets qu'ils peuvent avoir traiter, pour comprendre l'influence
d'une aussi lamentable gymnastique sur l'esprit. Ils n'ont pas du reste regretter de
ne pas s'occuper de recherches originales ; car, de toutes les choses mal considres
tous les degrs de notre enseignement, ce sont celles-l qui le sont le plus ; et un
candidat ayant quelques travaux personnels son dossier est considr comme un
esprit indpendant, incapable de se plier au joug commun, et qu'il faut liminer
aussitt.
Ce que cet odieux rgime des concours a cot la France est vraiment
impossible dire. Tous les esprits originaux qui ne peuvent se soumettre un tel
68
69
De l'enseignement secondaire en France, 1878.
Revue scientifique, 1878.
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
247
rgime sont perdus pour la science. Refus l'agrgation, et sans ressources, notre
grand physiologiste Claude Bernard fut sur le point de partir pour exercer la
mdecine dans un village. Le hasard lui donna un protecteur. Que d'autres n'ont pas
eu ce hasard et ont d laisser perdre des facults prcieuses pour la science, et pour
le pays qui les a vus natre !
On se plaint que nos laboratoires soient dserts, notre enseignement suprieur
nul, que nous ne produisions plus rien, ne vivions que des traductions des travaux
trangers, et que le nombre de personnes cultivant la science se rduise de plus en
plus. Il serait vraiment trange qu'il en ft autrement.
En 1873, le ministre de l'instruction publique, dans un discours de distribution
de prix aux socits savantes, reconnaissait que notre enseignement suprieur
tait dans un tat dplorable 70 M. Duruy signalait dj cette infriorit en 1868.
On s'est imagin qu'on y remdierait en crant des chaires nouvelles et des
laboratoires nouveaux, et on les a crs. Qui pourrait dire que tant de dpenses
aient produit le plus faible rsultat ? L'enseignement suprieur est-il plus vivant, le
got de la science pure plus rpandu ? Les laboratoires ne sont-ils pas rests
presque dserts, et, parmi le petit nombre d'lves qui les ont frquents, combien
en citerait-on qui y aient t amens par le got de la science et non par le dsir de
se faciliter un examen ou d'obtenir un emploi ? L'histoire nous montre ce que
devient un pays priv des esprits originaux et indpendants qui font sa force.
L'Inquisition les a dtruits autrefois en Espagne. Qu'est devenue aujourd'hui
70
Le nombre des lves de nos quinze facults de lettres et de sciences a t en 1875, Paris except, d'aprs le
nombre d'inscriptions pour la licence, de treize lves par facult. Le nombre des professeurs tant en moyenne
de huit par facult, -Paris toujours except, - on ne peut admettre que les professeurs y soient bien chargs de
travail ; mais le got de la science a t tellement tu chez eux par l'ducation qu'ils ont subie, que la presquetotalit est devenue incapable de produire la moindre recherche. Ils en arrivent se dsintresser de la science,
au point de ne mme plus se donner la peine de faire leurs cours. En novembre 1877, sur dix cours dont
l'ouverture tait annonce la Facult des sciences de Paris, cinq taient faits par des supplants. Quel intrt
pourrait d'ailleurs pousser le professeur s'intresser la science qu'il est charg d'enseigner ? Il l'a tudie par
ncessit comme il l'et fait d'un mtier quelconque, et, ayant conquis une position fructueuse, il ne songe plus
qu' se reposer. Quelle diffrence avec son collgue des universits allemandes, forc de toujours continuer ses
efforts pour conserver sa rputation et ses lves, qui sont une des principales sources de ses revenus, et forc de
justifier la valeur de ses connaissances par des travaux sortis de son laboratoire ! Plusieurs professeurs faisant
des cours sur le mme sujet et possdant des laboratoires, l'mulation est grande et les travaux produits
considrables. Voil les vrais concours, ceux qui ne laissent pas chapper les hommes de valeur ; voil comment
se forment ces professeurs que les universits se disputent et qui rpandent partout autour d'eux le got des
recherches et de la science pure. Ce n'est pas en crant des chaires et des laboratoires qu'on arrivera le faire
revivre. Les corps savants se sont imagin remdier au mal en fondant des prix pour encourager les chercheurs.
Des concurrents srieux ne se prsentent mme plus. Dans un rcent rapport lu en 1879 devant l'Acadmie de
mdecine, le docteur Bergeron se faisait l'interprte de l'tat d'inquitude qu'prouve l'Acadmie voir les
travailleurs dserter en partie ses concours . Sur treize prix dcerner, six sont rests sans comptiteurs, et,
malgr toute l'indulgence possible, un seul a pu tre dcern.
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
248
l'Espagne ? Ce que l'Inquisition a fait autrefois, notre Universit l'accomplit
aujourd'hui.
Il serait fort intressant de rechercher maintenant chez chaque peuple les
consquences intellectuelles et morales, et par consquent sociales, de l'ducation.
Mais les dveloppements dj trop grands que j'ai d donner ce chapitre ne me
permettent pas d'aborder cette importante tude. Je me bornerai montrer ces
consquences dans un seul pays, celui o j'cris ces lignes. Il me suffira, pour bien
les mettre en vidence et justifier par consquent le titre de ce chapitre, de rsumer
en quelques lignes les pages qui prcdent.
L'ducation primaire, avons-nous dit, n'a d'autre rsultat que de prparer des
soldats pour l'meute, l'enseignement suprieur d'liminer tous les hommes
distingus ou d'annuler leur intelligence. Quant l'enseignement secondaire,
destin ces classes moyennes qui forment la partie la plus influente d'une nation
et qui en ralit dirigent les autres, son influence est plus funeste encore, et il nous
suffira de rappeler ce qu'il est pour faire comprendre ce qu'il peut engendrer.
Le jeune homme a t enferm dix ans dans les murs de ces sombres prisons
qu'on appelle des collges, et durant dix ans, pendant douze heures par jour, on l'a
occup entasser des rgles et des formules dans sa mmoire, chercher des mots
dans des dictionnaires, sans lui fournir une seule fois l'occasion d'utiliser sa raison.
On l'a habitu s'en rapporter servilement l'autorit du matre, sans jamais
s'efforcer d'exercer son jugement. L'initiative et l'indpendance d'esprit qu'il
pouvait possder ont t nergiquement rprimes par un systme de punitions et
de rcompenses qui fait l'tonnement de tous les trangers qui l'ont observ. Si l'on
recherche ce qu'il a appris, on voit qu'il a acquis le got des dclamations banales,
l'habitude de prendre des phrases sonores pour des ides, l'loquence pour la vrit.
Faire parler dans un style pompeux les dieux, les hros et les rois ; feindre, dans un
langage chaleureux, des sentiments qu'il n'prouve pas ; bien rciter un manuel
appris par cur ; traduire pniblement coups de dictionnaire un auteur latin ;
rpter machinalement quelques faits scientifiques dtachs de leurs racines et
destins par suite tre oublis bientt : tel est le bagage de ses connaissances.
L'ducation qui a pour but, chez d'autres peuples, de prparer l'homme la vie,
et qui, ds la plus tendre enfance, s'efforce d'exercer son raisonnement, son
initiative et son jugement, de lui apprendre surtout se conduire lui-mme, ne fait
chez nous que prparer des examens. Le rsultat final des mthodes employes
pour y arriver est, comme nous l'avons vu, de tuer pour toujours le got de l'tude,
d'abaisser le caractre et de fausser le jugement jamais.
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
249
C'est ainsi lev que le jeune homme fait son entre dans le monde, o il se
trouve aux prises avec des ralits qu'on lui a soigneusement caches, comme s'il
n'et jamais d les connatre. La connaissance des milieux o il va vivre, celle des
problmes sociaux qui s'y agiteront sans cesse, sont aussi nulles chez lui que s'il
sortait d'un couvent du moyen ge. Combien s'en trouvera-t-il qui auront le courage
de recommencer une ducation nouvelle dont la premire condition sera de dtruire
une une les illusions et les faons de penser acquises dans la premire ? Combien
se douteront seulement de l'utilit de cette ducation nouvelle ? Causez dans un
salon avec des hommes du monde sur un sujet quelconque, et voyez combien il s'en
trouve qui soient capables d'autre chose que de l'accomplissement machinal du
mtier qui les fait vivre, combien dont la conversation rvle la trace de rflexions
personnelles, au lieu d'tre un tissu de lieux communs, un cho banal d'ides futiles
et surannes ?
C'est avec ce lamentable, rgime universitaire, qui dbilite le corps, tue le
jugement et l'initiative et rend l'homme incapable de se conduire dans les
circonstances les plus simples, que sont formes nos classes dirigeantes. C'est lui
surtout qui a fait notre bourgeoisie actuelle avec son ignorance des ralits, son
absence d'esprit de conduite, son jugement superficiel, sa tendance s'en prendre
toujours d'autres des fautes commises par elle, sa confiance aveugle dans les
moyens de force et de rpression, et ses oscillations perptuelles des rvolutions au
despotisme.
L'ducation est peu prs le seul facteur de l'volution sociale dont l'homme
dispose, et l'exprience faite par divers pays a montr les rsultats qu'elle peut
produire. Ce n'est donc pas sans un sentiment de tristesse profonde que nous
voyons le seul instrument qui permette de perfectionner notre race et d'lever son
intelligence et sa morale, ne servir qu' abaisser l'une et pervertir l'autre.
Elle reste pourtant debout, cette vieille Universit, dbris caduc d'ges disparus,
bagne de l'enfance et de la jeunesse. Je ne suis pas de ceux qui rvent des
destructions ; mais quand je vois tout le mal qu'elle a fait, et le compare au bien
qu'elle aurait pu faire ; quand je pense ces belles annes de la jeunesse
inutilement perdues, tant d'intelligences teintes et de caractres avilis pour
toujours, je songe alors aux maldictions indignes que lanait le vieux Caton la
rivale de Rome, et rpterais volontiers comme lui : delenda Carthago.
Tous nos voeux accompagnent le petit nombre de penseurs qui, ayant compris
les dangers redoutables de notre ducation, ont entrepris de la transformer. En
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
250
prsence de l'hostilit des uns et de l'indiffrence des autres, de tels vux sont aussi
superflus sans doute que ceux forms par le matelot qui s'enfonce dans l'abme.
Mais ce sont des vux que ne peut s'empcher de former le philosophe qui,
derrire les brumes de l'avenir, entrevoit nos destines sombres.
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
L'homme et les socits.
LEURS ORIGINES ET LEUR HISTOIRE.
Deuxime partie
LES SOCITS
Leurs origines et leur dveloppement
Livre III.
Dveloppement
des socits
Retour la table des matires
251
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
252
Deuxime partie
LES SOCITS
Leurs origines et leur dveloppement
livre III : Dveloppement des socits
Chapitre I.
Dveloppement du langage
Retour la table des matires; retour au dbut du chapitre
1. Origine et formes diverses du langage. - Formes diverses du langage. - Il n'est pas une
facult spciale l'homme. - Tous les animaux ont un langage. - On peut passer par transitions
insensibles du langage des animaux celui de l'homme. - II. Langage des premiers hommes. Moyens de le reconstituer. - Comment il se rattache celui des autres vertbrs. - Naissance du
langage articul. - Il se composa d'abord de cris, d'interjections et de sons imitatifs. - Imperfection
du langage des races humaines infrieures. - Ncessit pour elles de complter leur langage par
des gestes. - Importance du langage par gestes chez beaucoup de peuples actuels. - III. Lois du
dveloppement du langage. - Formation et dveloppement des premires racines des langues. Formes que les langues ont ncessairement revtues dans leur dveloppement. - Monosyllabisme,
agglutination et flexion. - Ncessit pour les langues suprieures de traverser d'abord des formes
infrieures. - Transformations continuelles des langues. - Elles sont l'image de l'tat intellectuel et
social des peuples qui les parlent. - IV. Comment les peuples transforment leurs langues. - Un
peuple peut adopter la langue d'un autre peuple, mais il lui fait subir rapidement des
modifications en rapport avec son tat de civilisation. - Exemples des transformations prouves
par le latin en Italie, en Espagne et en Gaule. - Comment s'est form le franais. - Mcanisme de
la transformation des langues. - Il varie suivant le gnie de chaque peuple. - Exemples fournis par
la langue anglaise. V. Formation et dveloppement du langage crit. - Origines de l'criture. Elle
drive de la reprsentation directe des objets. - Ce mode de reprsentation se retrouve encore
chez beaucoup de peuples. - Sa prcision. - C'est de la reprsentation des objets que drivent les
hiroglyphes. - Comment l'criture reprsentant les objets eux-mmes s'est transforme en signes
indiquant le son des mots par lesquels on dsigne ces objets. - Exemples fournis par l'criture en
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
253
gypte. - Comment ces signes ont donn naissance aux divers systmes d'criture employs plus
tard. - Rsum.
Aprs avoir montr l'influence des divers facteurs qui dterminent l'volution
des lments constitutifs des socits, il nous reste faire voir comment ces
lments eux-mmes se sont transforms travers les ges. Une histoire complte
de leur volution exigerait bien des volumes, mais il suffira au but que je me
propose de montrer, pour les plus importants d'entre eux, les phases principales de
leur dveloppement et les lois de leurs transformations. Quant l'histoire proprement dite du dveloppement de chacune des socits humaines, ce serait une tche
trop considrable pour qu'on ait pu songer un instant l'entreprendre ici. Je me
propose de l'aborder avec les dtails qu'elle comporte dans un autre ouvrage dont
celui-ci n'est en ralit que la prface, et o j'essaierai de reconstituer l'histoire des
diverses civilisations qui se sont manifestes la surface de notre plante.
I. - Origines et Formes diverses
du Langage.
Retour la table des matires; retour au dbut du chapitre
La plus importante des acquisitions de l'homme, celle par laquelle il devait se
diffrencier le plus nettement un jour des tres dont il est issu et qui tait appele
exercer la plus grande influence sur son dveloppement intellectuel, fut
l'acquisition du langage.
Quand on tudie les langues telles qu'elles existent aujourd'hui chez les peuples
civiliss, ou telles qu'elles existaient jadis chez les nations dont l'histoire a gard le
souvenir, elles apparaissent sous la forme de mcanismes d'une complexit telle,
qu'il a sembl longtemps impossible de concevoir que leur invention puisse tre
attribue l'homme.
Mais la science moderne est parvenue ramener l'tude de ce problme celle
d'lments fort simples. Elle a montr qu'aucune langue ne sortit complte d'une
tte humaine, comme Minerve descendant tout arme du cerveau de Jupiter ; que,
loin d'tre le produit d'un effort logique de l'esprit humain, comme le croyaient les
philosophes du sicle dernier, les langues sont le rsultat d'acquisitions graduelles
inconscientes. Elle a fait voir enfin par quelle srie de transitions insensibles le
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
254
langage des animaux est devenu celui de l'homme, et comment les langues
grossires de nos premiers pres sont devenues les langues actuelles.
On ne donne habituellement le nom de langage qu'au langage articul, c'est-dire la parole. Mais la parole n'est qu'une des formes du langage. On doit, en
ralit, donner ce dernier nom tout signe quelconque : cri, geste, exclamation,
parole, criture, etc.. qui permet un tre vivant d'exprimer une ide, un besoin ou
un sentiment et de communiquer avec ses semblables.
Ainsi envisag, le langage est une aptitude que la plupart des animaux
possdent, et il ne peut en aucune faon tre considr comme une facult spciale
l'homme.
Que les signes qui servent de moyens d'expression et de communication soient
articuls et conventionnels, comme ils sont arrivs la longue le devenir dans
notre espce, ou simplement instinctifs, comme ils le sont encore chez les animaux,
il n'importe ; la sparation qu'on cherche tablir entre le langage instinctif et le
langage conventionnel ne serait justifie que si l'on pouvait prouver que le second
n'est pas issu du premier. Or, il n'en est pas ainsi ; des transitions insensibles les
relient l'un l'autre.
Il n'est pas de naturaliste qui ne sache aujourd'hui que les animaux ont leur
langage en rapport exact, comme celui de l'homme, avec leur intelligence et leurs
besoins. C'est avec ce langage qu'ils expriment leurs sentiments et leurs dsirs, se
prviennent d'un danger et s'associent dans un but commun.
Mme chez les animaux placs trs bas sur l'chelle vivante, tels que les
fourmis, par exemple, on retrouve sous une forme quelconque un langage. Des
observations patientes ont montr que ces dernires peuvent se concerter entre elles
pour l'excution d'un plan, tel que l'attaque d'un camp de fourmis rivales, s'associer
pour faire prisonnier un troupeau de pucerons, s'indiquer l'issue d'une chambre, etc.
Les colimaons eux-mmes paraissent avoir un langage. Darwin rapporte que deux
colimaons, l'un robuste et l'autre maladif, se trouvant dans un jardin o la
nourriture vint manquer, le colimaon robuste partit la recherche d'un endroit
mieux approvisionn. Ayant russi dans ses recherches, il revint au bout de vingtquatre heures auprs du colimaon malade auquel il communiqua probablement
le rsultat de son heureuse exploration, car tous deux partirent ensemble, et, suivant
le mme chemin, disparurent de l'autre ct du mur.
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
255
Chez les animaux infrieurs que nous venons de citer, le langage parat se faire
au moyen du toucher. Chez les animaux vertbrs, il consiste gnralement en cris
plus ou moins moduls, habituellement complts par diffrents gestes. Des singes
qui s'organisent en bandes pour aller piller un jardin envoient d'abord un claireur
en avant charg de la mission de reconnatre les lieux, puis de venir les informer
s'ils peuvent s'avancer sans danger. Les chefs de bandes des babouins transmettent
leurs camarades, au moyen de gestes et d'intonations divers, des commandements
nombreux. Suivant le naturaliste Brehm, le langage des singes serait assez vari.
Naturellement le langage des animaux n'est bien compris que par les individus
de la mme espce, mais les personnes habitues avoir des animaux autour d'elles
arrivent bien vite comprendre une partie de leur langage : un chat ou un chien qui
demande qu'on lui ouvre une porte, qu'on lui donne manger, qu'on lui rende ses
petits, a des cris et des gestes fort diffrents. L'amiti, l'amour, la peur, la jalousie,
l'inquitude, la tristesse de la sparation, la joie du retour, en un mot, des sentiments
trs varis sont parfaitement exprims par eux et peuvent tre compris par nous 71.
Le langage, sous des formes diverses, existe donc chez la plupart des tres
vivants et n'a rien de spcial l'homme. Il naquit le jour o ils se trouvrent dans la
ncessit de communiquer entre eux.
II. - Langage des premiers Hommes.
Retour la table des matires; retour au dbut du chapitre
Les mthodes de reconstitution auxquelles nous aurons recours pour arriver
nous faire une ide du langage des premiers hommes seront analogues celles dj
employes dans un prcdent chapitre pour reconstruire leur tat intellectuel
primitif. Ce n'est qu'en cherchant rtablir les anneaux de la srie existant entre le
langage des animaux les plus voisins de l'homme et celui des sauvages les plus
71
Les animaux arrivent bien vite, du reste, eux aussi, comprendre une partie de notre langage. J'ai ramen de
la Suisse allemande, il y a quelques annes, un chien de la varit dite Saint-Bernard, duquel je ne pouvais
d'abord me faire comprendre qu'en lui parlant allemand, mais qui, aprs un court sjour Paris, arriva trs vite
saisir ce que je lui disais en franais, comme, par exemple, que j'allais m'habiller pour sortir, l'ordre d'aller me
chercher mes bottines, celui de surveiller le chat pour l'empcher de drober quelque plat, le refus de lui
permettre de m'accompagner parce qu'il avait t dsobissant. Si je racontais devant lui un ami les ennuis dont
il avait t l'origine, par suite de quelque lapin trangl ou d'un chien mordu et la ncessit o je me trouverais
de m'en dbarrasser, il comprenait fort bien qu'il s'agissait de lui, poussait des gmissements plaintifs et finissait
par aller se rfugier sous un meuble si la conversation continuait sur le mme sujet.
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
256
infrieurs, que nous pourrons parvenir concevoir ce que dut tre le langage de nos
premiers pres.
Des cris, des exclamations et des gestes constituent, comme nous venons de le
voir dans le paragraphe prcdent, le langage des mammifres les plus levs. Ce
fut sans doute le seul dont l'homme sut d'abord faire usage. Comment et-il pu, en
effet, en possder un autre ?
Comme le dit avec raison un des plus clbres linguistes de notre temps, Max
Mller : Les interjections et les imitations sont les seuls matriaux possibles avec
lesquels le langage humain ait pu se former. C'est dans les modifications des
intonations expressives au moyen desquelles nos premiers aeux traduisaient les
sentiments divers prouvs par eux et dans l'imitation des sons produits par d'autres
animaux, ou par divers objets, que nous devons chercher les premires bauches du
langage articul. Le jour o nos primitifs anctres imitrent le hurlement d'une bte
froce ou le sifflement d'un serpent pour prvenir d'un danger des tres de leur
espce, le jour o ils imitrent un grognement de colre en signe de menace, la
premire esquisse du langage articul conventionnel tait ne.
Les premiers mots vraiment articuls dont l'homme fit usage furent donc, sans
doute, des cris, des interjections et des sons imitatifs lgrement altrs par l'usage.
L'observation justifie du reste cette hypothse, en faisant voir qu'en remontant aux
lments dont se composent les langues, c'est--dire leurs racines, on trouve un
grand nombre de mots imitatifs reproduisant le son des choses qu'ils expriment,
telles que, par exemple, l'aboiement d'un animal, le grondement du tonnerre, le
sifflement du serpent. Sans doute, toutes les racines ne sont pas imitatives, mais il
est permis de supposer que celles qui sont imitatives sont les plus anciennes,
qu'elles constiturent la premire couche des langues et que les autres se formrent
seulement plus tard.
Le vocabulaire de nombreuses gnrations d'hommes dut continuer se
composer pendant longtemps d'un mlange de cris instinctifs et de cris imitatifs.
Ces derniers, devenus conventionnels par le fait qu'ils n'taient qu'imitatifs,
s'cartrent de plus en plus, comme nous allons le montrer bientt, des sons d'o,
par imitation, ils avaient pris naissance.
Complt par des gestes, un tel langage put suffire l'homme pendant une
longue srie de sicles. A l'intelligence peu dveloppe de nos premiers pres il
fallait un vocabulaire bien plus restreint encore que celui des tribus sauvages dont
nous parlerons plus loin.
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
257
Pour avoir l'ide de ce que pouvait tre un tel langage, non seulement son
aurore, mais encore pendant de longues priodes, il faut nous reporter au langage
actuel des sauvages les plus infrieurs, sans perdre de vue toutefois que les langues
les plus simples que nous puissions tudier la surface du globe sont bien
autrement compliques que ne pouvaient l'tre celles des premiers hommes, car
elles reprsentent l'hritage d'un long pass que nos primitifs anctres n'eurent pas
derrire eux.
L'tat d'une langue tant le miroir fidle des connaissances du peuple qui la
parle, nous pouvons prvoir d'avance que la langue de ces tribus sauvages qui ne
comptent pas au-del de cinq, ignorent l'agriculture, ne possdent aucune ide
gnrale et n'ont aucune notion du lendemain, sera infiniment restreinte. Je n'ai pu
trouver de documents suffisamment prcis sur le nombre de mots contenus dans les
langues les moins dveloppes, mais on peut supposer que ces mots doivent tre en
quantit bien minime quand on sait que, mme chez les peuples les plus civiliss,
beaucoup d'habitants des campagnes n'ont pas dans leur vocabulaire plus de trois
cents mots 72.
Non seulement le vocabulaire de ces langues infrieures est des plus rduits,
non seulement, comme nous l'avons dj dit dans un prcdent chapitre, elles n'ont
pas de mots pour exprimer des ides gnrales : arbre, poisson, oiseau, par
exemple, mais encore les mots qu'elles possdent ont un sens fort vague et
expriment souvent des choses trs diffrentes ; aussi n'est-ce qu'au moyen de gestes
nombreux qu'elles peuvent tre compltes et acqurir un degr de prcision
suffisant.
Plus le langage est infrieur, comme chez les Bushmans et les Arapakas, par
exemple, plus il ncessite de signes. Les gestes sont mme alors ce point
ncessaires, que dans l'obscurit les indignes dont nous parlons ne peuvent, au dire
de plusieurs voyageurs, converser entre eux.
72
J'emprunte ce chiffre Mller (Science du langage, tr. fr., 1864, p. 187). Il rsulte des observations faites par
un ecclsiastique de campagne sur ses paroissiens (Dorsey : the study of the English language). Ce qui enrichit
considrablement une langue, ce sont les termes spciaux relatifs aux sciences, aux arts, l'industrie, etc., qui
apparaissent en grande quantit aussitt qu'une civilisation commence se dvelopper, mais dont le sens n'est
connu que d'un bien petit nombre de personnes. La langue anglaise possde plus de cent mille mots, et
cependant, d'aprs Mller, un Anglais de bonne socit qui a t au collge et l'universit, qui lit sa Bible,
son Shakespeare, le Times et se tient au fait de la littrature courante n'emploie gure dans la conversation plus
de trois ou quatre mille mots. - On n'en trouve que huit mille dans les ouvrages de Milton, et l'Ancien Testament
dit tout ce qu'il a nous dire avec cinq mille six cent quarante-deux mots.
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
258
Si les gestes sont pour ces populations un complment ncessaire du langage, on
comprend quel point ils taient plus indispensables encore l'homme primitif. Il
est probable que le langage par gestes joua, l'aurore de l'humanit, un rle tout au
moins aussi important que le langage articul. Aujourd'hui encore, chez les races
infrieures, les gestes servent non seulement de complment la parole, mais
encore de moyen exclusif de communication entre tribus parlant des langues
diffrentes ; grce au langage par gestes, des individus qui ne pourraient pas
comprendre un seul mot de leurs langues respectives arrivent parfaitement
s'entendre. Ce moyen de converser est en usage chez toutes les tribus du nord de
l'Amrique, dont les langues sont, comme on le sait, trs diffrentes entre elles.
D'aprs Tylor, les gestes employs sont naturels et ne possdent rien de
conventionnel. Suivant cet auteur, un habile sourd-muet comprendrait, premire
vue, le langage par gestes d'un Indien. On observe, en effet, que dans les coles de
sourds-muets les sauvages se font comprendre avec la plus grande facilit. Les
pantomimes qu'on joue souvent sur les petits thtres et que le public comprend
parfaitement, donnent une ide suffisante de ce que peut tre cette forme de
langage.
Il n'est gure de choses, si compliques qu'elles soient, que le langage par gestes
ne puisse exprimer. Une phrase comme celle-ci, par exemple, reproduite par
Lubock : J'ai rencontr six chariots trans par des boeufs, conduits par trois
Mexicains et trois Amricains et par un homme cheval , est exprime trs
rapidement par gestes par un Indien et comprise sans la moindre hsitation par un
individu d'une autre tribu 73 parlant une langue diffrente.
C'est qu'en ralit, le langage par gestes est une sorte de peinture des choses, et
les peuples les plus diffrents interprtent de la mme faon une peinture. Il est au
langage articul ce que l'criture idographique, constitue par la figuration
dessine des objets, est l'criture phontique, constitue par des signes
conventionnels destins reprsenter, non les objets eux-mmes, mais le son des
mots par lesquels on les dsigne.
Plus les langues sont compltes, plus les gestes y jouent un rle restreint, mais il
n'existe pas encore de langue assez parfaite pour que ce rle soit devenu
entirement nul. Pour qu'ils disparussent compltement, il faudrait que les mots
pussent exprimer des nuances bien plus dlicates que celles qu'ils traduisent. Quand
73
On trouve encore des traces du langage par gestes chez des peuples bien plus dvelopps que ceux dont
nous venons de parler. Un ancien capitaine du 63e rgiment de ligne, M. Michel, ma racont que, lorsqu'il
habitait la Kabylie (cercle de Dra-el-Mizan), il, voyait souvent les indignes causer entre eux de grandes
distances au moyen de gestes nombreux, accompagns de quelques cris gutturaux.
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
259
le mot est insuffisant, c'est au geste et l'expression de la physionomie que nous
sommes obligs d'avoir recours pour en apprcier la valeur. Eux seuls russissent
rendre les nuances si varies de l'interrogation, du doute, de la joie, de la colre, du
mpris, de la haine, de l'ironie, de l'amour, que les mots sont bien souvent
impuissants exprimer. L'orateur qui prononce un discours sans qu'aucun geste,
aucun jeu de la physionomie vienne en accentuer le sens, ne saurait prtendre
exercer sur son auditoire la mme influence que celui dont une mimique intelligente complte les paroles.
Nous ne pouvons naturellement rien savoir des mots qui constiturent les
langues primitives. En voyant combien sont varis les dialectes que parlent des
tribus pourtant trs voisines lorsqu'elles ne sont unies par aucun lien, et avec quelle
rapidit ils se transforment lorsque l'criture n'a pas fix les principales formes du
langage, nous pouvons conclure que les dialectes de nos premiers pres furent aussi
nombreux que changeants. A l'poque o nos anctres vivaient par petites hordes
isoles, chacune dut avoir le sien, incessamment modifi avec les circonstances et
les besoins. Lorsqu'il y avait encore des Tasmaniens, la population, bien que ne
comptant plus dans les derniers temps que cinquante individus, avait encore quatre
dialectes.
A mesure que les hommes primitifs se grouprent en socits de plus en plus
consistantes, le nombre des langues diminua et elles tendirent de plus en plus se
fixer. Nous aurons loccasion d'examiner plus loin quelques-unes des causes sous
l'influence desquelles les peuples arrivent perdre et acqurir une langue.
III. - Lois du Dveloppement
du Langage.
Retour la table des matires; retour au dbut du chapitre
En mme temps qu'elles diminuaient de nombre, les premires langues
commenaient leur volution vers des formes plus parfaites. Les primitives racines
formes par l'imitation plus ou moins exacte des cris, exclamations, bruits, qu'elles
voulaient reproduire, finirent par ne plus suffire. L'association des racines fut le
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
260
moyen qui se prsenta le plus naturellement l'esprit pour augmenter le nombre
des mots dont on pouvait faire usage. Nous retrouvons encore ces simples
associations dans les langues les moins dveloppes. En chinois, par exemple, le
mot f-m, qui signifie parents, est simplement compos du mot f, qui veut dire
pre, et du mot m, qui signifie mre.
Mais, comme le fait justement remarquer M. Mller, il est clair que cette addition de
mots la suite les uns des autres ne pourrait pas tre prolonge l'infini, autrement la vie
deviendrait trop courte pour achever une phrase. Nous pouvons nommer nos parents, nos
pre et mre, f-m ; mais comment nommerions-nous notre famille ? - Ici la facult
d'abstraire nous vient en aide. Un cas trs simple nous montrera comment le travail de la
pense et du langage pouvait tre abrg. Aussi longtemps que les hommes dsignrent
les moutons seulement comme des moutons, et les vaches seulement comme des vaches,
ils pouvaient trs bien indiquer les premiers par be, et les secondes par mou-ou ; mais
quand, pour la premire fois, ils prouvrent le besoin de parler d'un troupeau, ni be, ni
mou-ou ne pouvaient servir. Tant qu'il n'y eut dans le troupeau que des moutons et des
vaches, la combinaison be-mou-ou suffisait ; mais quand le troupeau renferma des
animaux d'une autre espce, les sons distincts qui les dsignaient durent tre vits avec
un soin particulier parce qu'ils auraient produit une mprise. - De mme encore, il tait
assez facile d'imiter les cris du coucou et du coq, et les sons coucou, coq pouvaient tre
employs comme les signes phontiques de ces deux oiseaux. Mais, quand on eut besoin
d'un signe phontique pour indiquer le chant d'oiseaux plus nombreux, ou peut-tre de
tous les oiseaux possibles, toute imitation d'une note spciale devint, non seulement
inutile, mais dangereuse, et rien ne pouvait conduire an nouveau but, sauf un compromis
entre tous ces sons imitatifs, une usure, un frottement, un effacement de tous leurs angles
aigus et distinctifs. Ce frottement, qui te chaque son imitatif sa spcialit, marche tout
fait paralllement la gnralisation de nos impressions, et nous n'avons pas d'autre
moyen de comprendre comment, aprs une longue lutte, les vagues imitations phontiques
d'impressions spciales devinrent les reprsentations phontiques dfinies de concepts
gnraux.
Par exemple, il dut y avoir beaucoup d'imitations exprimant la chute d'une pierre, d'un
arbre, d'une rivire, de la pluie, de la grle ; mais la fin elles se combinrent toutes dans
la racine simple pat, exprimant le mouvement rapide, soit pour tomber, soit pour fuir, soit
pour courir. En abandonnant tout ce qui pouvait rappeler l'auditeur le son spcial de tel
objet emport par un mouvement rapide, la racine pat devint apte signifier le concept
gnral de mouvement rapide, et cette racine, par sa vgtation, fournit ensuite une
quantit de mots en sanscrit, en grec, en latin et dans les autres langues aryennes. En
sanscrit, nous trouvons patati, il vole, il plane il tombe ; patagas et patangas, un oiseau,
et aussi une sauterelle ; patatram, une aile, la feuille d'une fleur, une feuille de papier, une
lettre ; pattrin, un oiseau ; patas, tomber, advenir, accident, et aussi chute dans le sens de
pch. En grec, [], je vole ; [], ail ; [], qui vole ou court rapidement ; [], fuite ; [] et [],
plume, aile ; [], rivire, etc. 74.
74
Lectures sur la science du 1angage.
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
261
Bien souvent les premires racines des langues auxquelles nous pouvons
remonter ne rappellent pas directement l'ide l'objet dont elles sont le signe, mais
seulement une des qualits de cet objet. Dans la racine sanscrite du mot cheval, on
ne retrouve rien qui rappelle le hennissement de cet animal. Elle exprime
simplement l'ide de rapidit, c'est--dire de l'une des qualits du cheval. Dans la
racine du mot fille, on ne retrouve aucune qualit impliquant quelque rapport avec
le pre ou la mre. Sa signification est : celle qui trait la vache, fonction qui, dans la
vie pastorale, tait dvolue la fille ane de la famille. De mme pour beaucoup
d'autres racines, telles que celle du mot loup, par exemple, qui exprime celui qui
dchire ; celle du soleil, qui veut dire celui qui enfante. Il est vident qu'une foule
d'autres dsignations semblables auraient pu devenir l'appellation du cheval, du
soleil, du loup, de la fille, etc. Une circonstance accidentelle, nullement la logique,
a fait adopter un qualificatif plutt qu'un autre.
Nous venons de voir comment se sont formes les premires racines des
langues ; recherchons maintenant comment se sont opres leurs transformations.
Le mcanisme de la formation des racines que nous avons dcrit ne permettait
gure d'en multiplier le nombre. Du reste, aux poques recules o elles prirent
naissance, les besoins qu'elles avaient traduire taient peu tendus ; aussi dans
chaque langue sont-elles peu nombreuses. Des langues fort riches, contenant plus
de cent mille mots, comme l'anglais, n'ont que quelques centaines de racines : le
sanscrit en a cinq cents, le chinois quatre cent cinquante, etc.
Ces racines constituent le noyau fondamental des langues ; elles en sont le
squelette. Tous les mots que les langues contiennent drivent de leurs
transformations.
Les recherches de la linguistique moderne ont montr que la transformation des
racines s'opre, pour chaque langue, d'une faon graduelle. Elles ont fait voir que,
dans leur volution progressive, les langues passent par trois formes principales
qu'on a dsignes sous les noms demonosyllabisme, agglutination et flexion.
Le monosyllabisme ou premire phase du dveloppement des langues, qu'on
dsigne aussi sous le nom d'poque des racines, est caractris par l'emploi exclusif
de mots isols ou unis, mais conservant toujours chacun leur sens indpendant.
Dans les phrases qui composent les langues appartenant cette priode on ne
trouve aucune indication de temps, de mode, de genre, de personne, pas de
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
262
conjonctions ni de prpositions ; l'ide est gnralement traduite d'une faon fort
vague.
Plusieurs langues en sont restes encore cette premire tape. Le chinois,
surtout sous sa forme ancienne, car le chinois moderne tend se transformer, est le
principal reprsentant du monosyllabisme primitif.
Le chinois est une langue compose d'environ cinq cents mots distincts,
comme nous les appellerions, dont chacun se compose d'une seule syllabe. Mais,
dans cette langue, l'intonation sert exprimer la pense, et ces cinq cents mots en
deviennent quinze cents par la varit des intonations 75. Ces mots ne sont pas,
comme dans la langue anglaise, des restes uss, contracts, de formes autrefois
inflchies ; il est au contraire peu prs certain que ce sont des racines qui ne se
sont pas dveloppes, des racines comme celles de la langue indo-europenne, la
diffrence prs du parti qu'en a tir une socit claire, en les travaillant pendant
des milliers d'annes. Elles ont reu une foule de significations diffrentes et
d'emplois formels ; elles ont t combines en phrases toutes faites. Il y en a qui
sont devenues auxiliaires ; d'autres, signes de relation ; d'autres, qui servent dans
des cas donns et sont analogues nos parties du discours 76.
L'emploi de mots composs ayant un sens diffrent de celui des lments qui
servent les former tend faire sortir le chinois moderne de l'tat monosyllabique.
La deuxime phase du langage ou l'agglutination, nomme aussi par Max
Mller l'poque des terminaisons, est, suivant la dfinition de cet auteur, celle o
plusieurs racines se runissant pour former un mot, la premire racine garde son
indpendance primitive, tandis que la seconde se rduit n'tre plus qu'une
terminaison.
Les langues ainsi formes sont en gnral nommes agglutinantes parce que la
seconde racine altre vient se coller la premire intacte. Elles reprsentent le
premier pas du monosyllabisme vers l'tat de flexion. La racine du mot y est encore
invariable et ne fait que se charger de prfixes et d'affixes qui n'altrent pas son
sens distinct et primitif.
Les langues agglutinantes comptent sur la surface du globe des reprsentants
nombreux. Je citerai parmi eux le japonais, le basque, le turc, divers idiomes
75
Ces quinze cents mots en se combinant en ont, suivant les chiffres donns par M. Kleczkowski, dans son
Cours de chinois, form prs de cinquante mille. (Note de l'auteur).
76
Whitney, Ve du langage, p. 195.
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
263
australiens ; les dialectes des ngres de l'Afrique, et enfin les diverses langues des
indignes de l'Amrique du Nord.
C'est surtout dans les anciennes langues de l'Amrique que l'agglutination prend
un grand degr de puissance. Elles sont riches d'expression, mais manquent de
clart et de simplicit ; un mot y renferme souvent tous les lments d'une pense
complexe, sans qu'aucun de ces lments puisse tre employ pourtant comme mot
isol. Au lieu d'avoir, par exemple, une phrase entire pour dire : Je construis ma
maison, le nahuatl, langue des anciens Mexicains, n'a qu'un seul mot :
nicalchihua, qui se compose des syllabes ni, cal et chihua, dont le sens spar est je
maison fais.
Cette agglutination pousse l'excs a pour rsultat la formation de mots fort
longs ; beaucoup ont jusqu' quatorze syllabes, ce qui reprsente presque la
longueur d'une ligne dans un ouvrage in-18 ordinaire. Des mots aussi longs
expriment frquemment pourtant des ides qui, dans les langues europennes, sont
graduellement arrives tre rendues d'une faon trs brve. C'est ainsi, par
exemple, que dans le vocabulaire des Indiens Pawnee le mot jour se dit
shakoorooeeshairet, le mot diable, tsaheekshkakooraiwah.
Dans la troisime phase du dveloppement du langage, c'est--dire dans la
priode nomme flexion, les racines, qui dans la forme prcdente taient
simplement accoles, s'unissent en s'altrant, et le sens que leur ensemble exprime
diffre plus ou moins de la signification des lments qui le constituent. Les
peuples les plus levs, Assyriens, Hbreux, Grecs, Latins, etc., ont seuls atteint
cette forme.
Les diverses phases du dveloppement du langage que nous venons de dcrire
ne sont pas naturellement spares d'une faon tranche ; elles sont relies entre
elles par des transitions insensibles. La classification que nous avons reproduite ne
fait en ralit qu'indiquer quelques-unes des principales divisions sous lesquelles il
est possible de runir les nombreuses formes successivement revtues par les
langues dans leurs transformations.
Les tapes diverses du dveloppement du langage peuvent tre franchies plus ou
moins rapidement, suivant les peuples qui en font usage ; mais, avant d'arriver aux
formes suprieures de leur dveloppement, toutes les langues doivent passer au
pralable par les tapes infrieures que nous avons dcrites. Beaucoup ont conserv
du reste des traces de leurs transformations. Les langues monosyllabiques, telles
que le chinois, prsentent des indices nombreux de leur tendance passer
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
264
l'agglutination ; les langues agglutinantes offrent de mme des preuves de leur
tendance passer la flexion, et dans les langues flexion, les langues smitiques
notamment, on retrouve des vestiges de l'agglutination, et mme du
monosyllabisme par lesquels elles ont d pralablement passer.
[NOTE :
Sur la thorie des trois ges du dveloppement des langues. La thorie d'aprs laquelle chaque
langue passe en se dveloppant par trois phases successives, monosyllabisme, agglutination et
flexion, repose sur un ensemble de faits trs nombreux et est devenue rapidement classique. Elle
a cependant t combattue par divers savants, notamment par MM. Renan et Sayce. Dans son
ouvrage, The Principles of comparative philology (1874), le second de ces auteurs, linguiste bien
connu par ses recherches sur les langues assyriennes, affirme (p. 138 et 158) que la langue
aryenne a toujours t une langue flexion. Un cerveau aryen ne peut produire, dit-il, qu'une
langue flexion. Aucune accumulation de civilisation, de temps ou d'influence trangre ne
saurait changer, suivant lui, le caractre fondamental d'une langue. Comme argument principal,
l'auteur invoque ce fait qu'aux plus lointaines poques auxquelles la philologie nous permette de
remonter, les Aryens possdaient un langage flexion, alors que leurs contemporains de la Chine
et de la Babylonie, bien plus civiliss qu'eux, n'avaient pas encore un tel langage.
La thorie de M. Sayce est analogue celle soutenue dj par M. Renan dans son livre sur
l'origine du langage. Je persiste aprs dix ans de nouvelles tudes, dit ce savant minent,
envisager le langage comme form d'un seul coup et comme sorti instantanment du gnie de
chaque race. (Origine du langage, 4e dition, p. 16.)
Je n'entreprendrai pas de discuter au point de vue linguistique les assertions que je viens de
citer, et je ne m'en occupe que parce qu'elles touchent aux lois gnrales du dveloppement des
choses exposes dans cet ouvrage. Il serait facile, je crois, de rpondre aux arguments de M.
Sayce tirs de l'tat infrieur des langues des Chinois et des Assyriens compares celle des
Aryens. On pourrait faire remarquer notamment que si, pour une raison quelconque, l'usage de
l'criture s'est rpandu plus tt chez un peuple que chez un autre, il a pu arriver que les lments
fondamentaux du langage se sont trouvs fixs une poque o ce langage tait encore peu
dvelopp : mais, je le rpte, je ne veux pas pntrer dans ce dbat, et cela avec d'autant plus de
raison qu'abstraction faite de tout argument philologique, la thorie prcdente doit tre
considre comme entirement insoutenable par quiconque est un peu au courant des lois
gnrales de l'volution. Je concderai volontiers que le cerveau d'un Aryen ne pense pas comme
le cerveau d'un Smite et que leurs langues ont d, dans leurs transformations, conserver des
traces de cette diffrence. Je concderais galement, si cela tait ncessaire, que la langue des
Aryens a pu devenir une langue flexion en passant par des formes encore inconnues, autres que
le monosyllabisme et l'agglutination : mais ce que je ne saurais admettre aucun titre, parce que
cela serait contraire aux principes les plus fondamentaux de la science et rentrerait entirement
dans la catgorie des miracles, c'est qu'une langue ait pu arriver une forme suprieure sans avoir
pralablement pass par des formes infrieures, qu'elle ait pu, comme le croit M. Renan, s'tre
forme d'un seul coup, tre sortie instantanment du gnie de chaque race.
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
265
Aux yeux d'un anthropologiste, une telle opinion a aussi peu de valeur que celle qui soutient
que l'homme a pu dbuter par l'tat civilis sans avoir pralablement pass par l'tat sauvage.
Cela est aussi inadmissible que de croire qu'un animal puisse arriver l'ge mr sans passer
d'abord par l'enfance et la jeunesse. Il est inutile de revenir ici sur ce que j'ai dj rpt bien des
fois dans le cours de cet ouvrage. Qu'il s'agisse d'une graine, d'un ovule ou d'une langue, les lois
gnrales de leur dveloppement sont toujours les mmes ; jamais les formes suprieures ne sont
atteintes sans qu'au pralable les formes infrieures aient t successivement franchies. En
contemplant un chne vigoureux ou un homme adulte, il serait difficile de reconnatre qu'ils
drivent tous deux d'une simple cellule, et pourtant, rien n'est plus certain. Si nous suivons pas
pas l'volution de cette cellule, nous constatons facilement comment se sont opres ses
transformations. Si nous ne considrons que les phases extrmes de ces changements, il devient
entirement impossible de concevoir comment ils ont pu s'effectuer. Pour comprendre ce qui est,
nous devons connatre ce qui a t.
Les langues se transforment donc constamment. Comme ceux des tres vivants,
leurs lments ne sauraient rester immobiles. Il n'existe pas pour elles, ainsi que le
supposaient les savants du dernier sicle, un tat de perfection qu'elles seraient
ensuite impuissantes dpasser.
A partir du jour o leurs premiers linaments commencrent se former, les
transformations des langues se continurent toujours. Une langue varie
constamment avec l'tat intellectuel et social du peuple qui la parle ; elle en suit
toutes les transformations. La langue d'un peuple, une poque donne, est en
rapport exact avec les ides et les besoins de cette poque. Ces ides et ces besoins
viennent-ils changer, la langue change avec eux. Il y a une grande diffrence entre
un Franais ou un Anglais d'aujourd'hui et un Franais ou un Anglais d'il y a mille
ans ; mais il y a aussi une grande diffrence dans leur langage, et le Franais ou
l'Anglais de notre temps ne comprendrait rien la langue que parlaient ses pres.
Cette volution des langues se continue d'une faon insensible mais constante.
Avec les progrs de l'industrie, des sciences et des arts, des mots nouveaux se
crent sans cesse, en mme temps que les mots anciens se transforment, changent
de sens ou disparaissent.
[NOTE :
Variation du sens des mots. Whitney donne plusieurs exemples montrant combien les mots
peuvent arriver s'carter de leur sens primitif. Je lui emprunte les suivants : Perplexe signifie
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
266
tress, entreml. Simple signifie qui n'a pas de pli, par opposition double, qui veut dire qui a
deux plis. Simplicit et duplicit expriment trs-bien deux qualits morales contraires.
Application contient la mme racine et dnote l'action physique de plier, tandis que impliquer
indique ce qui est pli dedans. Important veut dire littralement qui porte dedans, c'est--dire qui
a un contenu, qui n'est pas vide. Apprhension, c'est la prise d'une chose. Relation, c'est porter en
arrire, comme transfert, c'est porter travers, en latin ; et mtaphore, en grec, est peu prs la
mme chose. Investir signifie mettre dans des vtements. Dvelopper un sujet, c'est lui ter les
enveloppes qui le cachent. Trivial, c'est ce qu'on trouve en traversant la rue. Une occurrence est
une chose qui court au-devant de nous. Drivation voque l'ide trs-spciale de tirer de l'eau de
la rive d'un fleuve. Suggrer veut dire porter sous, ou fournir un argument ou une ide de
dessous, pour ainsi dire, et non de dessus, et ainsi de suite. Vie du langage, ch. v.)
Bien d'autres exemples d'altration du sens primitif des mots pourraient tre ajouts ceux
qui prcdent. Le mot cadran, par exemple, qui dsigne maintenant une surface circulaire o sont
inscrites les heures, indiquait d'abord conformment son tymologie une surface carre
(quadrans, quod quadrat, c'est--dire ce qui est carr). Chasser qui vient du latin captiare :
chercher prendre veut dire exactement le contraire de ce qu'indique son tymologie quand on
l'emploie dans le sens de chasser un individu de chez soi.
C'est surtout en donnant de la prcision aux mots que les langues arrivent se
perfectionner. ce point de vue, elles ont encore de grands progrs raliser. Il
suffit d'ouvrir un dictionnaire pour voir combien d'acceptions nombreuses a
souvent un mme mot 77. Malheureusement la prcision dans le sens des mots aura
toujours une valeur plus ou moins relative. La signification de ces derniers varie en
ralit suivant l'tat intellectuel et l'ducation des personnes qui les emploient. Ce
ne sont pas seulement des mots sens mal dfini, comme matire, me, esprit, etc.,
qui veillent dans la pense de ceux qui en font usage des acceptions trs
diffrentes ; des mots scientifiques comme force, lumire, lectricit, ont galement
des sens trs variables.
IV. - Comment les Peuples
transforment leurs Langues.
Retour la table des matires; retour au dbut du chapitre
77
Plus les langues sont infrieures, plus le sens des mots est vague et indcis. Je trouve dans l'intressant
avant-propos de la grammaire chinoise de M. Kleczkowski (Cours graduel et complet de chinois, gr. in-8, Paris,
1876, t. 1er) qu'un mot peut avoir en chinois jusqu' cinquante et soixante significations.
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
267
Examinons maintenant quelques-unes des causes sous l'influence desquelles un
peuple peut acqurir une langue et la transformer. Les facteurs de cette
transformation sont, comme nous allons le voir, fort nombreux. Nous choisirons
pour les mettre en vidence les langues dont l'histoire est la mieux connue.
L'observation nous montre tout d'abord qu'un peuple peut changer assez
facilement de langue et oublier compltement celle de ses anctres. Ce fait pourrait
au premier abord sembler contraire au principe nonc plus haut, que la langue d'un
peuple est l'image de son tat intellectuel et social, mais une telle dduction serait
errone. Sans doute, quand les Gaulois furent envahis par les Romains, ils adoptrent trs rapidement la langue de leurs vainqueurs, dont la civilisation tait bien
suprieure la leur ; mais ce qu'ils adoptrent dans cette langue, ce ne furent que
les parties appropries leur intelligence : le latin qui se parla dans les masses tait
un latin fort diffrent de celui des lettrs de Rome, et, comme nous le verrons
bientt, aprs un temps relativement trs court, ce latin populaire, adapt par les
Gaulois leurs ides et leurs besoins, se trouva entirement transform.
Lorsque par suite d'une invasion deux peuples se trouvent entirement
mlangs, leurs langues ne se fusionnent pas comme on pourrait le supposer tout
d'abord. Aprs un petit nombre de gnrations, une des deux langues se substitue
presque toujours entirement l'autre. Moins d'un sicle aprs la conqute romaine,
les Gaulois avaient oubli leur langue et parlaient latin. C'est peine si le franais
qui en drive a conserv une centaine de mots de la langue celtique que parlaient
nos pres.
Dans cette lutte de deux langues en prsence, celle qui doit triompher est
gnralement celle du peuple le plus civilis, que ce peuple soit le vainqueur ou le
vaincu. Aprs moins d'un sicle de conqute, les Gaulois, malgr l'immense
supriorit de leur nombre, parlaient latin. Quand plus tard ils furent envahis par les
peuples du Nord, ce furent, au contraire, ces derniers qui adoptrent la langue des
vaincus. Un sicle aprs la conqute de la Normandie, les soldats de Rollon avaient
oubli leur idiome scandinave et ne parlaient que le franais ; mais ces conqurants
taient des barbares, et, quand aprs s'tre empars de l'Angleterre, ils y apportrent
le franais appris par eux en France, ils ne purent pas plus l'imposer la nation
envahie qu'ils n'avaient russi autrefois imposer la Normandie leur jargon
grossier. Sans doute, quelques sicles auparavant, les Saxons, pourtant moins
civiliss qu'eux encore, avaient russi imposer leur langue aux habitants de la
Grande-Bretagne ; mais ces habitants taient alors aussi des barbares, et il n'y avait
par consquent aucune raison pour que le vainqueur subt l'ascendant du vaincu.
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
268
En suivant les transformations graduelles qui amenrent le latin des conqurants
de la Gaule devenir une langue nouvelle, on arrive facilement comprendre
comment un peuple finit par adapter une langue ses besoins, que cette langue soit
la sienne ou qu'elle lui soit impose par un vainqueur.
Le franais actuel drive, comme on le sait, du latin populaire qu'apportrent
aux Gaulois les soldats romains l'poque de leur conqute. Les invasions
germaines, qui eurent lieu quelques sicles plus tard, ne firent qu'ajouter la
langue, alors en voie de formation, un certain nombre de termes n'ayant pas leur
quivalent en latin et relatifs aux institutions judiciaires, politiques et guerrires des
nouveaux vainqueurs.
Subi par les Gaulois avec les institutions romaines, le latin fut bientt
transform par eux en une langue nouvelle ; de mme qu'introduit en Espagne et en
Italie, il devint bientt deux langues diffrentes en rapport avec le mode de penser
et d'agir des peuples qui les parlaient.
En Gaule, o se trouvaient des races fort diverses, le latin populaire forma
bientt deux idiomes assez distincts : celui parl au sud de la Loire ou langue d'oc
(encore reprsent par les patois provenal, languedocien et gascon), et celui en
usage au nord de la Loire ou langue d'oil. Parle par des populations assez
diffrentes, la langue d'oil finit par former elle-mme plusieurs dialectes : le
normand, le picard, le bourguignon et le franais. Ce dernier tait parl uniquement
dans la province nomme Ile-de-France. Sous Philippe-Auguste, ces quatre
dialectes avaient chacun leur littrature spciale et aucun d'eux n'avait de
prdominance sur les autres.
Quand le systme fodal disparut au profit d'une monarchie centrale, les divers
dialectes des provinces absorbes disparurent avec lui, et ce fut naturellement la
langue de la province qui avait domin les autres, c'est--dire celle de l'le-deFrance, qui prit leur place. C'est vers la fin du douzime sicle que le dialecte
franais commena avec les progrs de la monarchie tendre son influence 78. Il
devint bientt prdominant et les dialectes normand, picard et bourguignon
cessrent d'tre crits. Ils s'altrrent alors rapidement et tombrent l'tat de
78
Au fonds ancien de latin populaire transform qui forma le franais s'ajoutrent diverses poques des mots
d'origine trangre, imports par les guerres ou les relations avec l'Orient, l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne et
l'Angleterre. Il s'y ajouta encore un grand nombre de termes spciaux, forms par les savants aux dpens du grec
et du latin. Sur les vingt-sept mille mots du dictionnaire de l'Acadmie, quatorze mille ont cette dernire origine.
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
269
patois. La langue d'oc disparut aussi, ne laissant que les patois mentionns plus
haut.
Des faits analogues s'observrent en Italie, o le dialecte toscan supplanta les
autres dialectes (milanais, vnitien, sicilien) ; en Espagne, o le castillan supplanta
l'andalou et le navarrais.
La langue d'un peuple peut donc, comme on le voit, tre sans analogie aucune
avec celle de ses anctres ; mais, aprs un bien petit nombre de sicles, il a
compltement form son image la langue que les circonstances lui ont impose.
Il me semble impossible d'admettre, comme le font beaucoup de linguistes, que
la plus importante cause de transformation du langage rside dans les altrations de
la prononciation.
[NOTE :
2 Cette opinion est aujourd'hui descendue dans l'enseignement classique. Je la trouve
consigne plusieurs reprises dans les excellentes grammaires de M. Brachet : C'est
naturellement, dit cet auteur, le latin populaire que les soldats romains apportrent aux paysans
gaulois, qui le transformrent leur tour en franais, force d'en altrer la prononciation. Ce
passage d'un ouvrage destin l'enseignement lmentaire rsume l'opinion gnrale dj
expose par le mme auteur dans l'introduction de sa Grammaire historique. J'ai dj dit qu'elle
me semble inacceptable. Cette critique d'une opinion dont M. Brachet n'est, du reste, que l'cho
me fournit l'occasion de louer en passant les oeuvres de ce grammairien. I1 est un des bien rares
professeurs franais qui aient compris qu'une science quelconque, et la grammaire surtout, ne
peut s'enseigner qu'en montrant l'lve par quelles phases infrieures elle a d passer avant
d'arriver ses formes actuelles. En procdant autrement, comme on le fait encore aujourd'hui
d'une faon peu prs universelle en France, on fait appel la mmoire de l'lve aux dpens de
sa raison. Il s'habitue croire que les rgles grammaticales sont le rsultat de volonts
inexplicables, devant lesquelles il n'y a qu' s'incliner sans discussion. L'histoire d'une langue
montre, au contraire, qu'il n'est pas de rgle grammaticale, si bizarre qu'elle paraisse, qui ne soit
parfaitement explicable ; mais ce n'est que la connaissance de son tat antrieur qui peut
permettre de comprendre son tat actuel.
Sans doute, cette influence a sa valeur, et il suffit pour s'en convaincre de voir
comment un Anglais ou un Allemand altre nos mots en les prononant ; mais elle
est loin d'avoir l'importance qu'on lui attribue gnralement et aurait t tout fait
impuissante elle seule transformer le latin en franais, en italien et en espagnol.
Les Romains pouvaient bien imposer des barbares leur civilisation et leur langue ;
mais ces barbares ne pouvaient prendre de cette civilisation et de cette langue,
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
270
surtout de sa syntaxe, que ce qui tait en rapport avec leur capacit intellectuelle,
leurs ides et leurs besoins, et la langue que leur apporta le vainqueur devait bientt
se modifier l'image du peuple qui la parlait.
Ce qui dtermine en ralit l'volution d'une langue, ce sont les transformations
intellectuelles et sociales des nations qui la parlent. Une langue se met toujours en
rapport avec le caractre, la faon de sentir, l'ducation, les ides et les besoins de
ceux qui en font usage. Quand un peuple plus ou moins barbare apprend la langue
d'un peuple civilis, il n'emprunte d'abord cette langue que les mots en rapport
avec ses connaissances et son degr de civilisation ; puis, comme ces mots
correspondent en ralit des modes de penser et des faons de vivre qui ne sont
pas exactement les siennes, il finit par les modifier graduellement. Cinq sicles
aprs la conqute romaine, le latin populaire s'tait tellement transform en Gaule
que sa forme primitive n'tait plus comprise. Un des plus anciens monuments
littraires de notre langue, le serment des soldats de Charles le Chauve 1, montre le
profond travail de transformation qu'en quelques sicles le latin avait subi.
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
271
[NOTE :
Voici ce curieux vestige de l'ancien franais ; il remonte l'anne 842 et est, par consquent,
vieux d'environ mille ans :
TEXTE.
TRADUCTION :
Si Lodhuwigs sagramant, que son fadre
Karlo jurat, conservat, et Karlus meos
sendra de sua part non los tanit, si io
returnar non l'int pois, ne io, ne neuls
cui eo returnar int pois, in nulla adjudha
contra Lodhuwhig nun li iv er.
Si Louis garde le serment qu'il a jur
son frre Charles, et que Charles, mon
matre, de son ct, ne le tienne pas, si
je ne l'en puis dtourner, ni moi, ni nul
que j'en puis dtourner, ne lui serai en
aide contre Louis.
Le document suivant, qui est du dixime sicle, montre que la langue nouvelle servait dj
composer des vers ; on voit qu'elle a encore conserv, presque sans altration, bien des mots
latins. Ces vers sont extraits de la cantilne de sainte Eulalie :
TEXTE.
TRADUCTION :
Buona pulcella fuit Eulalia ;
Bel avret corps, bellezour anima.
Voldrent la veintre li Deo inimi,
Voldrent la faire diaule servir.
Elle n'out eskoltet les mais
conseilliers,
Qu'elle Deo raneiet chi maent sus en
ciel,
Ne por or ned argent ne paramenz,
Por manatce regiel ne preiemen ;
Neule cose non la povret omque pleier
La polle sempre non amast lo deo
me[nestier.
Une bonne vierge fut Eulalie ;
Beau corps avait et plus belle me.
Voulurent la vaincre les ennemis de
Dieu.
Voulurent la faire le diable servir.
Elle n'eut cout les mauvais conseillers.
Qu'elle reniait le Dieu qui habite au ciel,
Ni pour or, ni pour argent, ni pour
parure,
Ni pour menaces royales, ni pour
prires ;
Aucune chose ne la put jamais plier.
La jeune fille n'aimer pas toujours le
[service de Dieu.
La langue nouvelle prit rapidement son essor, et trois sicles plus tard nous la retrouvons
considrablement transforme et bien prs de la langue moderne. On peut en juger par le
fragment suivant, pour lequel une traduction devient inutile. Il s'agit de la narration des derniers
moments de Jeanne, comtesse d'Alenon, morte en 1292. L'auteur fait dire la mourante :
Chacuns s'inclinoit et s'agenouilloit contre moy. Que me valent ores ces palais et ces
chambres pares, et ces sales pares, ces beaux liz en courtines, vins et viandes, compaignies de
grans seigneurs et de grans dames, quand je serai demain encourtine d'un drap court et estroit, de
froide pierre et de terre ?
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
272
Le mcanisme physique de la transformation des mots se fait par des voies
diverses : altrations de leur prononciation, contraction syllabique et limination de
certaines lettres, changements dans leur signification, variation des formes
grammaticales, addition d'expressions nouvelles, etc.
Le travail de transformation des langues est bien plus rapide quand l'criture
n'est pas d'un usage gnral que lorsqu'elle est rpandue. Dans ce dernier cas, les
formes principales de la langue se trouvant fixes, les diffrences locales ne se
produisent plus et le langage se modifie bien plus lentement.
Il se modifie plus lentement, mais il continue cependant se transformer
toujours, et, dans les moins importantes de ces transformations, nous retrouvons
toujours les aptitudes intellectuelles spciales chaque peuple. Dans les
changements que la langue anglaise subit et qui se caractrisent surtout par
l'lagage de tout ce qui n'est pas indispensable et la simplification des formes
grammaticales, il est facile de reconnatre le gnie pratique de ce peuple pour
lequel le temps est ce qu'il y a de plus prcieux. Nous pouvons constater
aujourd'hui dans leurs mots usuels quelques-unes de ces transformations qui, aprs
n'avoir t que dans le langage populaire, commencent pntrer dans le langage
littraire et feront oublier compltement un jour les formes primitives dont elles
drivent. Des verbes, qui prenaient autrefois la dsinence en au pluriel, ne la
prennent plus. On dit par exemple : we tell (nous disons) au lieu de we tellen. Dans
le langage usuel : 1 can not est devenu I can't ; I have s'est transform en I've ; You
would en You'd, etc. Ces abrviations sont celles du langage populaire, mais elles
tendent de plus en plus se substituer la forme ancienne, et I can't au lieu de I can
not est, sans doute, destin devenir une forme rgulire, absolument comme God
be with you (Dieu soit avec vous) est devenu plus tard : Good by.
Quel que soit le mcanisme de ces transformations, elles se font, comme toutes
celles tudies jusqu'ici, d'une faon tout fait graduelle et comme le dit trs
justement M. Brachet : Au premier abord, la distance parat grande du latin des
paysans romains au franais de Voltaire, et, pour faire celui-ci avec celui-l, il a
suffi de changements infiniment petits continus pendant un temps infini. Cette
pense est fort juste, mais je crois qu'elle peut tre complte d'une faon qui
rsumera clairement tout ce qui prcde. Ce n'est pas seulement au latin des
paysans romains que se rattache le franais de Voltaire par des transitions
insensibles ; il se rattache aussi, pour le philosophe, par des transitions non moins
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
273
insensibles, aux hurlements et aux cris qui furent le premier langage des bimanes
anthropodes que la science nous assigne pour pres.
V. - Formation et Dveloppement
du Langage crit.
Retour la table des matires; retour au dbut du chapitre
L'criture, c'est--dire cette forme du langage destine donner la pense une
expression permanente, eut pour premire tape la reprsentation figure des
objets. Elle naquit en ralit le jour o l'homme imagina pour la premire fois de
reproduire les objets qui l'entouraient, et, comme il existe de ces reproductions qui
remontent cette priode primitive de l'humanit laquelle on a donn le nom
d'ge de la pierre taille, nous voyons que l'origine de l'criture est bien antrieure
l'histoire et remonte aux poques les plus lointaines.
La reprsentation directe des objets, au moyen de dessins plus ou moins
grossiers, constitue encore chez tous les peuples infrieurs le seul mode d'criture
en usage. Nous verrons plus loin qu'il permet de traduire d'une faon trs claire des
rcits dtaills.
Mais la reprsentation figure des objets est toujours fort longue. Les mmes
sujets reprsenter revenant frquemment, on se trouva naturellement port en
simplifier la figure en n'en reproduisant que quelques parties, et il arriva
graduellement que ces symboles n'eurent qu'une ressemblance parfois bien loigne
avec la chose qu'ils reprsentaient d'abord.
C'est ce mode d'criture, constitu par la copie plus ou moins simplifie des
objets, que convient le nom d'hiroglyphes. Il est, le primitif langage crit de tous
les peuples. On le retrouve encore en usage chez la plupart des races infrieures.
School-craft, dans son grand ouvrage sur les tribus indiennes 79, donne de
nombreuses planches d'hiroglyphes reprsentant des rcits d'vnements, des
ptitions, etc., rdigs par les Indiens au moyen de cette criture, et que toutes les
tribus, mme celles parlant des langues diffrentes, arrivent parfaitement
79
Historical and statistical information respecting the history, condition and prospects of the Indian Tribes of
the United States collected and prepared under the dirsetion of the Bureau of Indian affairs. Trois volumes in-4.
Philadelphie, 1851.
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
274
comprendre. Ces hiroglyphes expriment souvent, avec un petit nombre de figures
fort simples, des faits nombreux. L'auteur que nous venons de citer donne, entre
autres exemples 80, la reproduction d'hiroglyphes tracs sur un fragment d'corce et
destins informer des Indiens qu'une expdition compose de sept soldats
d'infanterie commands par un officier, accompagns d'un interprte, d'un
gologue, d'un secrtaire et de deux attachs, et conduits par deux Peaux-Rouges,
suivait une direction dtermine. Les hiroglyphes indiquaient que l'expdition
formait deux groupes spars, dsignaient les aliments dont elle s'tait nourrie la
veille, etc. Les figures taient fort simples, mais trs expressives : un marteau la
main indiquait le gologue, une pe, l'officier, etc., et leur excution ne dut pas
demander sans doute plus de temps que n'aurait ncessit une explication crite.
Voici, du reste, la reproduction de ce curieux document.
80
Tome I, page 337.
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
275
Fig.5.
Hiroglyphesindiens.
1. Officier commandant le dtachement, 1'pe qu'il tient la main indique sa qualit. - 2.
Secrtaire ; le livre qu'il tient montre sa profession. - 3. Gologue ; ainsi dsign par le marteau
qu'il tient la main - 4 et 5. Attachs. - 6. Interprte. - 7 et 8. Guides indiens. Ce sont les seules
figures humaines de tout le dessin reprsentes sans chapeau qui est le signe employ par les
Indiens pour distinguer la race rouge de la race blanche. - 9. Groupe de sept soldats d'infanterie. 10. Figures destines montrer que chacun tait arm d'un mousquet. - 11, 12 et 14. Indiquent
qu'une tortue et un oiseau, tus par l'expdition, lui avaient servi la veille de nourriture. -13 et 15.
Indiquent que l'expdition se composait de deux groupes spars ayant chacun leur feu spar. Le morceau d'corce sur lequel se trouvait ce dessin tait fix l'extrmit d'un morceau de bois
dont la direction indiquait la marche suivie par la troupe.
Comme dessin, cette figure peut sembler un peu primitive ; mais il ne faut pas oublier qu'elle
est simplement la traduction rapide au moyen de signes abrgs des choses que son auteur voulait
exprimer. L'art du dessin est, au contraire, pouss assez loin chez les Indiens de l'Amrique. En
comparant quelques-unes de leurs figures reproduites par Schoolcraft, dans l'ouvrage que j'ai
mentionn plus haut, avec celles des planches des grands ouvrages de Champollion, Rosellini, et
Lepsius, sur l'gypte, j'ai pu m'assurer que beaucoup d'entre elles ne sont pas sensiblement
infrieures celles que les gyptiens nous ont laisses.
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
276
La plupart des peuples ont fait d'abord usage d'un systme d'criture analogue.
Les primitifs hiroglyphes de l'gypte, dont malheureusement il ne nous reste pas
de traces, durent tre semblables. Ceux conservs sur les monuments gyptiens
appartiennent une priode de civilisation dj avance, et, partant, sont beaucoup
plus compliqus : au lieu d'tre exclusivement figuratifs des objets, ils sont
mlangs de signes destins reprsenter les divers sons du langage.
Nous avons dj vu que des usages remontant aux temps primitifs, tels, par
exemple, que l'emploi de couteaux de pierre dans certaines crmonies religieuses
des Hbreux, se sont perptus jusqu'aux poques historiques. On doit considrer
comme une survivance du temps o la reprsentation directe des objets tait le seul
mode d'criture connu, les dessins qui figurent sur les blasons des chevaliers du
moyen ge, et les signes par lesquels on reprsente encore, dans les almanachs et
les ouvrages d'astronomie, le soleil et les signes du zodiaque.
La premire phase du dveloppement du langage crit fut donc constitue par la
reprsentation plus ou moins simplifie des objets. On a donn cette
reprsentation le nom d'criture idographique, pour la distinguer de l'criture
phontique, c'est--dire de celle qui reprsente des sons, telle qu'elle exista plus
tard. Au lieu d'tre conventionnelle et d'indiquer, comme cette dernire, les sons des
mots par lesquels on dsigne les objets, l'criture idographique reprsente ces
objets eux-mmes.
Ce ne fut qu' la suite de transformations graduelles nombreuses que l'criture
idographique, l'criture-image, comme on pourrait l'appeler encore, arriva se
changer en criture phontique. Les travaux des gyptologues permettent de
concevoir comment dut se faire cette transformation. J'emprunte au savant
professeur d'archologie gyptienne du Collge de France, M. Maspero, le rsum
de leurs recherches sur ce point.
Le procd qui consistait exprimer l'objet par la peinture de l'objet mme, le soleil par un
disque, la lune par un croissant, ne permettait de rendre qu'un certain nombre d'ides toutes
matrielles. Il fallut aussitt recourir aux symboles. Les symboles sont de deux sortes, simples ou
complexes. Les simples se forment : par synecdoche, en peignant la partie pour le tout, la
prunelle pour l'il, la tte de buf pour le buf complet ; par mtonymie, en peignant la cause
pour l'effet, l'effet pour la cause, ou l'instrument pour luvre accomplie, le disque solaire pour le
jour ; le brasier fumant pour le feu ; le pinceau, l'encrier et la palette du scribe pour l'criture ; par
mtaphore, en peignant un objet qui avait quelque ressemblance relle ou suppose avec l'objet
de l'ide exprime, les parties antrieures du lion pour marquer l'ide de priorit ; la gupe pour la
royaut ; le ttard de grenouille pour la centaine de mille ; par nigme, en employant l'image d'un
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
277
objet qui n'a que des rapports fictifs avec l'objet de l'ide noter, un pervier sur un perchoir pour
l'ide de Dieu ; une plume d'autruche pour l'ide de justice.
Les idogrammes complexes se forment d'aprs les mmes principes que les idogrammes
simples. Ils consistent, l'origine, dans la runion de plusieurs images, dont la combinaison rend
une ide qu'un symbole simple n'aurait pu noter. Ainsi, en gyptien, un croissant renvers
accompagn d'une toile rend l'ide de mois ; un veau courant et le signe de l'eau, celle de soif.
L'criture idographique tait un moyen fort incomplet de fixer et de transmettre la pense.
Elle ne pouvait que placer des images et des symboles ct les uns des autres, sans tablir de
distinction entre les diffrentes parties du discours, sans noter les flexions spciales aux temps du
verbe, aux cas et au nombre des noms ; il fallut joindre la peinture des sons la peinture des
ides. Bien que par nature les symboles d'ides ne reprsentent aucun son, celui qui les lisait tait
oblig de les traduire par le mot attach dans la langue parle l'expression de la mme ide. Au
bout d'un certain temps, ils veillrent dans l'esprit de qui les voyait tracs, en mme temps
qu'une ide, le mot ou les mots de cette ide, partant une prononciation ; on s'habitua retrouver
sous chaque figure et sous chaque symbole une ou plusieurs prononciations fixes et habituelles
qui firent oublier au lecteur la valeur purement idographique des signes pour ne produire sur lui
que l'impression d'un ou de plusieurs sons.
Le premier essai de phontisme se fit par rbus ; on se servit des images sans tenir compte des
ides pour reprsenter le son propre leur sens premier. On en vint peindre, de la mme
manire, des mots semblables de son, mais divers de sens dans la langue parle. Le mme
assemblage de sons nower marquait, en gyptien, l'ide de luth, et l'ide abstraite de bont. En
groupant plusieurs signes, on crivit de longs mots, dont la prononciation se composait, en partie,
du son de tel signe, en partie de celui de tel autre. Le lapis-lazuli se dit, en gyptien, khesdeb ; on
crit quelquefois ce mot par la figure d'un homme qui tire (khes) la queue d'un cochon (deb).
Dans une langue o tous les mots n'ont qu'une seule syllabe, en chinois par exemple, l'emploi
du rbus ne pouvait manquer de produire une criture o chaque signe-idographique, pris dans
son acception phontique, reprsentait une syllabe isole. Dans les autres langues, le systme de
rbus ne donnait pas encore un moyen facile de dcomposer les mots en leurs syllabes
constitutives et de reprsenter chacune d'elles sparment par un signe fixe et invariable. On
choisit un certain nombre de caractres, auxquels on attribua non plus la valeur phontique qui
rsultait du son de toutes les syllabes, mais celle qui rsultait du son de la syllabe initiale. On en
vint de la sorte former des systmes d'criture o tous les caractres idographiques l'origine
ne reprsentaient plus l'ordinaire que des syllabes simples ou complexes 81.
Bien que vieux de plus de cinq mille ans, les hiroglyphes gyptiens que nous
possdons remontent une poque o l'gypte tait dj arrive un haut degr de
civilisation. L'criture idographique n'tait pas oublie encore, mais l'criture
phontique tait dj connue.
81
Histoire des peuples de lOrient, p. 570.
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
278
Parmi les hiroglyphes que les gyptiens nous ont laisss, les uns sont des
signes alphabtiques ayant chacun une articulation diffrente ; d'autres sont des
signes syllabiques reprsentant une ou plusieurs articulations formant syllabe ;
d'autres enfin sont purement idographiques ou figuratifs, c'est--dire reprsentatifs
des objets dont ils reproduisent les formes. Ces signes divers s'associent suivant les
besoins. Supposons, par exemple, qu'on veuille traduire en criture gyptienne cette
phrase : Dieu a cr les hommes. L'criture hiroglyphique, dit Champollion,
l'exprimerait trs clairement : 1 le mot Dieu par le caractre symbolique de l'ide
de Dieu ; 2 a cr, par les signes phontiques reprsentatifs des lettres qui
formaient le mot gyptien crer, prcds ou suivis des signes phontiques
grammaticaux qui marquaient que le mot radical crer tait la troisime personne
masculine du prtrit indicatif de ce verbe ; 3 les hommes, soit en crivant
phontiquement ces deux mots suivant les rgles de la grammaire, soit en traant le
signe figuratif homme suivi de trois points, signe grammatical du pluriel 82.
On voit que, tout en ayant russi passer de l'criture idographique, image des
ides, l'criture phontique, reproduction des sons, les gyptiens ne surent pas se
dbarrasser cependant de la premire. Ce sont les Phniciens qui gnralisrent
l'usage exclusif de la dernire. Laissant de ct les signes idographiques et
syllabiques, ils n'employrent que des signes alphabtiques. Les recherches les plus
rcentes ont confirm l'opinion jadis mise par Champollion, que l'alphabet
phnicien, dont hritrent les Grecs, les Romains, puis les peuples modernes, drive
de l'alphabet gyptien. L'alphabet hbreu parat avoir la mme source.
L'criture hiroglyphique gyptienne proprement dite n'tait gure employe
que sur les monuments. On se servait pour les usages habituels d'une criture
cursive forme d'hiroglyphes simplifis, qu'on dsigne sous le nom d'criture
hiratique. une poque qu'on peut placer entre les vingt et unime et vingtcinquime dynasties, elle se simplifia encore pour les usages du commerce et donna
naissance une criture cursive populaire dite dmotique. Son aspect ne rappelle
nullement au premier abord les hiroglyphes dont on dmontre facilement qu'elle
drive.
Nous avons vu, en tudiant le dveloppement du langage parl, que tous les
peuples n'ont pas encore atteint ses phases suprieures. Il en a t de mme pour
l'criture. Le passage de l'criture idographique l'criture phontique, ralis en
partie par les gyptiens, et compltement par les Phniciens, n'a pas t franchi sur
tous les points du globe ; les Chinois, par exemple, en sont encore rests l'criture
idographique, c'est--dire la reprsentation des objets par leur image simplifie.
82
Champollion Figeac, art. Hiroglyphes de l'Encycl. mod.
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
279
Rien n'est plus compliqu pour cette raison que l'criture chinoise. Elle comprend
environ cinquante mille signes diffrents, qui sont les formes gnralement fort
altres et devenues tout fait mconnaissables des objets que chaque signe
reprsentait d'abord. Cette criture tend lentement cependant passer l'tat
phontique, car il s'y est ajout un grand nombre de signes reprsentant des sons
qu'on associe aux signes idographiques, les uns indiquant le son, les autres
rappelant le sens. Mais, tant que la langue chinoise en restera au monosyllabisme
primitif, il semble bien difficile que l'criture devienne exclusivement phontique.
Les mots, en effet, sont en nombre assez limit, mais chacun d'eux exprime, suivant
la faon dont il est prononc, des choses fort diffrentes. D'aprs Max Mller, en
annamique, le mot ba prononc avec l'accent grave signifie dame ou anctre ,
prononc avec l'accent semi-grave il signifie rebut , avec l'accent circonflexe il
veut dire ce qui reste d'un fruit quand on l'a press , sans accent il signifie
trois , avec une lvation de la voix ou l'accent interrogatif il signifie
soufflet . La phrase suivante ba, ba, ba, ba, compos d'un mme mot rpt
quatre fois, mais avec quatre intonations diffrentes, peut signifier trois dames
ont donn un soufflet au favori du prince 83 . L'criture phontique ne saurait
videmment traduire facilement ces diverses intonations. La ncessit d'crire des
mots de sens fort diffrents de la mme faon entranerait ncessairement une
confusion trs grande.
De plus longs dveloppements relatifs l'histoire de l'volution du langage
seraient inutiles 84 ; nous sommes entr dans des explications suffisantes pour
montrer comment naquirent et se dvelopprent les divers signes destins
exprimer la pense humaine. Grce eux, l'homme put se concerter avec ses
semblables et transmettre aux gnrations futures, avec le souvenir du pass, les
rsultats de ses longs labeurs.
Au point de vue du dveloppement de l'intelligence, aucun progrs ne fut plus
important que l'acquisition du langage ; au point de vue du dveloppement de la
civilisation, son importance ne fut pas moindre. C'est partir du jour o le langage
crit commena se rpandre qu'on put justement dire que les gnrations
humaines qui se suivent doivent tre considres comme un mme homme
traversant les sicles en apprenant toujours. Les traditions seules ne conservent que
83
84
Nouvelles leons sur la science du langage, 1867, t. 1er.
Je renverrai le lecteur qui voudrait approfondir davantage les questions spciales que j'ai eu incidemment
traiter dans ce chapitre aux ouvrages suivants : Bopp, Grammaire compare ; Max Mller, Leons sur la science
du langage ; A. Schleicher, Ueber die Bedeutung der Sprache fr die Naturgeschichte der Menschen ; Key,
Language, its origin and development ; Whitney, la Vie du langage ; Hovelacque. La Linguistique moderne ;
Sayce, the Principles of comparative philology.
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
280
des chos bien vagues. Sans l'criture, l'homme se serait peine lev au-dessus de
la barbarie primitive et les sciences ne seraient pas nes.
Nous avons vu que l'laboration d'un langage fut fort lente ; qu'une langue est
l'image de l'tat intellectuel et social du peuple qui la parle et qu'elle se transforme
avec lui. Si, comme le disent d'antiques lgendes, le langage avait t invent par
un homme suprieur, la langue cre par lui aurait t faite son image, et les
peuples primitifs n'auraient pas t plus aptes en profiter, que le serait un sauvage
moderne utiliser les lois de l'algbre.
Nous avons montr comment naquirent les langues primitives et trac les lois de
leur dveloppement. Nous avons vu qu'a leur origine, elles furent bien imparfaites
et composes d'un nombre de mots fort restreint. Mais, si imparfaites qu'elles aient
pu d'abord tre, leur acquisition constitua pour nos primitifs anctres le plus
important de tous les progrs qu'ils pouvaient accomplir. S'il fallait prciser le jour
o nos antiques aeux mritrent le nom d'hommes, je dirais que ce fut celui o,
dans le langage compos de cris instinctifs qui fat le premier langage,
commencrent se montrer les signes conventionnels, origine premire des racines
des langues. Ce jour-l, le langage articul tait n, et tous les progrs futurs que
nos premiers pres devaient raliser plus tard se trouvaient en germe dans cette
primitive bauche. Sur la surface de notre plante, les civilisations humaines
allaient pouvoir paratre. Aux monstres des ges gologiques qui avaient t
pendant si longtemps les rois de la cration succdaient de nouveaux matres.
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
281
Deuxime partie
LES SOCITS
Leurs origines et leur dveloppement
livre III : Dveloppement des socits
Chapitre II.
Dveloppement de la famille.
Retour la table des matires; retour au dbut du chapitre
1. Erreurs des anciennes conceptions relatives l'tat primitif de la famille. - La famille n'a
pas dbut par l'tat patriarcal. -Mthodes qui permettent de reconstituer son tat primitif. - II.
Les communauts primitives. - La parent maternelle. - Les socits primitives ont pass par des
formes o les femmes taient possdes en commun. - Ces formes ne sont pas primitives. Usages religieux et sociaux drivs de la communaut fminine primitive. - Estime dans laquelle
la prostitution a t tenue chez un grand nombre de peuples. -Parent par les femmes. - Les
enfants n'ont port pendant longtemps que le nom de leurs mres. - III. Constitution de la parent
paternelle. - Restriction des droits de la communaut. - La communaut des femmes finit par se
rduire la communaut d'une seule entre parents. - Persistance de cet usage chez divers peuples.
- Comment le nom du pre a fini par se substituer celui de la mre. - IV. Condition des femmes
et des enfants dans les socits primitives. - La femme a toujours t considre comme une
esclave par tous les anciens peuples. - Les codes anciens et modernes l'ont envisage comme une
crature trs infrieure. - Sort des enfants dans les socits primitives. - Gnralit de
l'infanticide. - V. Constitution de la famille dans l'antiquit historique. - Puissance de son
organisation. - Elle avait pour chef le pre de famille. - Il tait le seul juge lgal de la famille. L'unit sociale des ges antiques tait la famille et non l'individu. - Transformations de la famille
dans les temps modernes. - Sa dissociation progressive.
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
282
I. - Erreurs des anciennes conceptions
relatives l'tat primitif de la Famille.
Retour la table des matires; retour au dbut du chapitre
L'organisation la plus simple de la famille qu'aient connue les historiens est l'tat
patriarcal. Pendant longtemps il a sembl que ces petits groupes composs du pre,
de la mre et de leurs descendants devaient reprsenter sa forme primitive.
C'est ainsi, en effet, que se manifeste la famille aussitt qu'elle apparat dans
l'histoire. Mais nous savons que l'histoire n'a commenc que longtemps aprs
l'existence de l'homme, et nous pouvons nous demander si avant l'ge des traditions
la famille possdait l'organisation que nous venons de mentionner.
Il y a vingt ans peine que ce problme a t tudi pour la premire fois 85. Les
investigateurs patients qui l'ont abord, ont reconnu bientt que l'organisation de la
famille avait t trs diffrente d'abord de ce qu'elle devint ensuite lorsque les
traditions ou les livres nous la font connatre.
Les sources qui permettent de reconstituer cet tat primitif sont celles
auxquelles nous avons dj puis plusieurs fois, et notamment l'tude des animaux
les plus voisins de l'homme et celle des sauvages, qui reprsentent, par leur
organisation, les formes infrieures par lesquelles l'humanit a successivement
pass. Les prsomptions que cette tude pourra fournir seront compltes par
l'examen des vestiges rests dans l'ancien droit des formes primitives de la famille.
Comme les fossiles des gologues, ces vestiges demi-effacs permettent de refaire
le tableau des anciens ges.
Cette reconstitution est trs incomplte encore, car bien des anneaux de la
chane du pass sont perdus sans retour. Elle suffit cependant pour prouver que les
ides que nous nous formions, il y a bien peu d'annes encore, de l'tat primitif de
85
Voici par ordre de date les travaux fondamentaux consacrs l'histoire des formes primitives de la famille :
J. Bachofen. Das Mutterrecht, eine Untersuchung ber die Gynaikokratie der alten Welt nach ihrer
religisen und rechtlichen Natur. Stuttgard, 1861. J. M. Lennan. Primitive marriage : an Inquiry into the origin
of the form of capture in marriage ceremonies. Edinburgh, 1865. J. Lubbock. The origin of civilisation and the
primitive condition of man. London, 1870. Giraud-Teulon. Les origines de la famille. Genve, 1874. Lewis H.
Morgan. Systems of consanguinity and affinity of the human family. Washington, 1871. Lewis H. Morgan.
Ancient society. London, 1817.
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
283
la famille taient trs errones, et que, comme le langage, la morale, le droit, la
religion, etc., elle a d subir toute une srie de transformations successives avant
d'arriver aux formes actuelles. Nous verrons que l'origine du mariage est
indpendante de toute institution politique ou religieuse, indpendante aussi de ces
sentiments divers, parfaitement inconnus alors, que nous appelons aujourd'hui le
dvouement et l'amour ; que les seuls sentiments qui prsidrent aux unions
primitives furent la violence, d'une part, la soumission force, de l'autre ; que
pendant ces longues priodes, les enfants ne connurent pas de pres, et que rien
n'existait de ce que nous appelons aujourd'hui famille.
II. - Les Communauts primitives.
- La Parent maternelle.
Retour la table des matires; retour au dbut du chapitre
Les observateurs qui ont tudi l'origine de la famille ont t conduits
admettre que, dans les socits primitives, l'union exclusive ou presque exclusive
de l'individu la mme femme n'existait pas. L'unit sociale, qui devait tre plus
tard la famille, puis l'individu, tait alors la tribu. Les femmes et le sol y taient
communs. Toutes les femmes appartenaient tous les mles de la tribu ; les enfants
n'avaient pas de pres particuliers et reconnaissaient comme tels tous les hommes
qui les entouraient.
Les faits que je citerai bientt paraissent bien dmontrer, en effet, que l'humanit
a pass par cet tat ; mais l'tude des socits animales les plus voisines de l'homme
ne nous permet pas d'admettre que la communaut reprsente la forme sociale
primitive. Dans les socits des animaux qui se rapprochent le plus de notre espce,
nous voyons en effet l'animal, monogame ou polygame, toujours jaloux de ses
prrogatives sexuelles, les dfendre avec nergie pendant le temps plus ou moins
long que dure son union, c'est--dire au moins pendant la priode ncessaire pour
lever ses petits. Certaines espces forment, comme nous l'avons montr, des
unions aussi parfaites que celles observes aujourd'hui chez l'homme, plus parfaites
mme, car la fidlit y est si constante et l'affection si profonde que la mort de l'un
des poux est bientt suivie de celle de l'autre. Chez aucune espce animale on
n'observe de mariage en commun. La persistance habituelle des anciens instincts
n'autorise donc pas admettre que, lorsque l'homme commena se dgager de
l'animalit primitive, il ait pu perdre rapidement ces sentiments primitifs. Il est ds
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
284
lors probable que, pendant un temps plus ou moins long, il vcut comme les singes,
dont nous avons parl dans les prcdents chapitres, c'est--dire par petites bandes
contenant plusieurs femelles pour un seul mle.
Mais ces primitifs instincts devaient se modifier devant les ncessits que
crrent des conditions d'existence nouvelles, et, une certaine priode de la vie
sociale de l'homme, on voit se manifester des habitudes telles que la promiscuit,
l'infanticide, l'esclavage des femmes, l'anthropophagie fminine, que ne connurent
jamais aucunes espces animales, et qui sont les rsultats des conditions constitues
par les premires bauches de ce qui devait s'appeler civilisation un jour 86. Ces
conditions d'existence nouvelles commencrent quand l'homme passa de la vie par
petites familles entirement isoles la runion en petites tribus analogues celles
dont nous retrouvons encore des types nombreux sur divers points du globe.
C'est en examinant prcisment l'tat de la famille chez ces tribus infrieures
que nous pouvons arriver nous faire une ide exacte de ce qu'il fut chez nos
primitifs anctres. On rencontre encore dans l'Inde et en Afrique, - Lubbock en
donne plusieurs exemples, - des tribus pratiquant le mariage en commun, et o par
consquent aucun enfant ne connat son pre.
Ce n'est pas seulement de nos jours que l'existence de cette forme de mariage, en admettant qu'on puisse donner un tel nom une telle chose, - a t constate.
Les auteurs classiques, Hrodote, Pline, Strabon, Diodore de Sicile, en citent un
grand nombre d'exemples. Tels taient les Galactophages de Scythie, dont les biens
et les femmes taient en commun et qui nommaient pres tous les gens gs, fils
tous les jeunes, et frres tous ceux du mme ge. Tels taient encore les habitants
de l'ancienne Irlande et de l'Angleterre, qui, au dire de Strabon et de Dion Cassius,
s'unissaient indistinctement avec toutes les femmes, y compris leurs mres, leurs
surs, etc.
Les mariages en commun ne se sont pas rencontrs seulement chez des peuples
barbares ou sauvages. Nous possdons des indications prcises prouvant qu'ils ont
exist d'abord chez des nations qui se sont civilises ensuite. Le Mah-bhrata les
mentionne dans les anciens temps de l'Inde : Les femelles de toutes les classes,
dit-il, sont communes sur la terre. Telles sont les vaches, telles sont les femmes,
chacune dans sa caste.
86
Lorsque les animaux se trouvent dans des conditions d'existence nouvelles, leurs instincts et leurs murs se
modifient galement. On n'observe pas de mariage en commun chez les animaux vivant en libert, mais il en est
autrement dans les socits artificielles cres par la captivit. J'ai observ sur des serins enferms dans des
cages des unions tout fait comparables au mariage en commun de nos lointains anctres.
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
285
Quelques sectes communistes modernes ont tent d'en revenir ces murs
primitives. Dans un travail rcent sur les socits communistes aux tats-Unis, M.
Ch. Nordhoff rapporte que les perfectionnistes d'Onida (tat de New-York) ont
leurs femmes en commun. Les enfants sont levs dans une salle d'asile commune.
Beaucoup de ces socits communistes vivent dans une situation assez prospre.
C'est surtout dans le monde smitique que les traces de la communaut primitive
des femmes se retrouvent facilement. Dans tout l'ancien Orient, en Babylonie, en
Syrie, en Armnie, en Phnicie, la loi religieuse prescrivait aux femmes la
prostitution momentane avant le mariage. En Babylonie, suivant Hrodote, chaque
femme devait s'offrir, une fois au moins, aux trangers dans le temple de Vnus
avant d'avoir le droit de se marier. La mme loi, suivant Strabon, existait en
Armnie. D'aprs Diodore de Sicile, aux les Balares, la marie appartenait la
premire nuit tous les htes prsents avant d'appartenir exclusivement au mari.
Dans la valle du Gange, les vierges devaient se faire dflorer dans les temples
ddis Juggernaut. Au Malabar, quand le roi se mariait, le grand-prtre avait droit
de passer les trois premires nuits avec la jeune reine. Au Cambodge, le mme
office est encore rempli par les prtres pour toutes les jeunes filles qui dsirent se
marier.
Des coutumes analogues se sont perptues dans certaines tribus de l'Inde.
Carver, dans son livre sur les peuples de l'Inde, raconte que, quand il vivait chez les
Nandowessies, une des femmes de la tribu jouissait d'une trs-grande considration
due ce que, dsirant rtablir une ancienne coutume qui tombait en dsutude, elle
avait invit quarante principaux guerriers de sa tribu, leur avait donn un festin et
les avait tous traits en maris. Celles qui donnaient des preuves analogues de leur
respect des anciennes coutumes taient toujours sres de trouver un mari du plus
haut rang.
Ces faits divers qui, avec nos murs modernes, nous semblent si tranges, et
qu'on observe pourtant chez tant de peuples, sont gnralement considrs
aujourd'hui comme des vestiges des formes primitives du mariage en commun,
alors que la femme tait, comme le sol, la proprit collective de tous les membres
de la tribu. Gardienne fidle des anciennes coutumes, la loi religieuse devait
conserver quelques traces de prostitution momentane pour maintenir la reconnaissance des anciens droits de la communaut.
Nous devons considrer galement sans doute comme un vestige de la forme
primitive du mariage en commun, et la reconnaissance du droit de chacun
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
286
possder toutes les femmes de la tribu, l'habitude qu'ont encore tant de peuples de
prter leurs femmes aux trangers. Les Esquimaux, suivant gede, les Gallas,
suivant Bruce, les Comanches, suivant Bancroft, les Mandans et diverses tribus du
sud de l'Amrique, suivant Mack-ensie, etc., ont encore cet usage. Lubbock assure
qu'il aurait exist chez les Romains ; mais je n'ai rien trouv de bien prcis cet
gard dans les auteurs latins.
Cette habitude d'offrir ainsi sa femme aux trangers n'existe plus aujourd'hui
chez les peuples civiliss ; mais nous pouvons trouver des degrs intermdiaires
entre cette habitude et la svre chastet qu'on a fini par exiger des femmes. Bien
des peuples qui ne prtent pas leurs femmes font cependant assez peu de cas de leur
fidlit.
Il est probable que l'on doit considrer encore comme une trace de la
communaut primitive le fait constat par plusieurs historiens que, dans l'antiquit
classique, les courtisanes taient souvent, non seulement plus recherches, - cela est
encore assez frquent aujourd'hui, - mais plus considres que les autres femmes.
Sans parler des grandes courtisanes de la Grce, telles qu'Aspasie, frquente par
Socrate et Pricls, et dont on pourrait dire qu'tant les seules femmes qui reussent
alors de l'instruction, il tait naturel qu'elles fussent plus apprcies, on peut citer
surtout les courtisanes de l'Inde qui, mme aujourd'hui encore, y sont trs honores.
Quand le fondateur du bouddhisme visita la ville indienne de Vesali, il prfra
descendre chez la grande-matresse des courtisanes que chez les magistrats de la
ville. En Abyssinie et au Japon, on a encore beaucoup de considration pour cette
profession. Dans la relation de son rcent voyage au Japon, M. le comte de
Rochechouart raconte qu'avant leur mariage les femmes vont passer quelques
annes dans les maisons de prostitution, avec l'autorisation de leur famille, pour s'y
amasser une dot.
Il ne faudrait pas croire, du reste, que chez les peuples o la femme se livre aux
trangers avant le mariage, et mme chez ceux o on l'offre ceux qui viennent
vous visiter, elle ne soit pas tenue une grande fidlit envers son mari. On exige
d'elle, an contraire, un respect scrupuleux de ses engagements, non sans doute par
un sentiment de jalousie qui ne se rencontre que chez certains peuples civiliss,
mais parce que l'adultre est considr comme une sorte de larcin, une atteinte au
droit du propritaire, qui se considre alors dans une situation analogue celle de
l'individu qui on volerait un objet qu'il aurait peut-tre consenti donner. Chez
certains Arabes du Nil Blanc, les femmes au dire de G. Teulon, ne sont astreintes
la chastet que certains jours de la semaine dont le nombre est dtermin par celui
des ttes de btail que le fianc a donn pour prsent sa femme .
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
287
Aprs avoir tabli l'existence de cet tat de communaut des femmes par lequel
ont pass sans doute tous les anciens peuples, nous devons nous demander
comment, sur de telles bases, la famille tait constitue. La promiscuit rendant la
connaissance de la paternit impossible, il est vident que la parent ne pouvait
s'tablir que du ct maternel. Les enfants, comme ceux de ces Lyciens dont parle
Hrodote, ne pouvaient avoir d'autre nom que celui de leur mre. Athnes, la
parent par les femmes parat avoir exist jusqu'au temps de Ccrops. Varron, dans
un passage cit par saint Augustin, assure que primitivement les enfants n'y
portaient que le nom de leur mre.
On trouve aussi dans les anciens documents que nous a laisss l'gypte la
preuve que la parent maternelle y a galement exist d'abord. Elle est mentionne,
en effet, dans beaucoup d'inscriptions. Nous voyons, en outre, suivant Hrodote,
que la loi imposait aux filles, et non aux fils, l'obligation de nourrir leurs parents
gs. videmment ce ne pouvait tre l qu'un rsidu des temps o la fille, hritant
du nom et de la fortune, pouvait supporter des charges.
Telle fut la forme primitive de la famille que les donnes de la science moderne
nous permettent de reconstituer : la mre ayant pour maris tous les hommes de la
tribu, l'enfant ayant galement tous ces hommes pour pres. Lorsque les individus
commencrent se diffrencier par leurs noms, ils n'eurent d'abord que celui de
leur mre et ne pouvaient en avoir d'autres.
III. - Constitution de la Parent paternelle.
Retour la table des matires; retour au dbut du chapitre
Comment la parent maternelle devint-elle paternelle ? Comment, en d'autres
termes, le pre devint-il le chef de la famille et substitua-t-il son nom celui de la
mre ?
Pour qu'un tel phnomne pt se produire, il fallait que la communaut
primitive des femmes et subi une transformation profonde. C'est donc l'histoire de
cette transformation que nous devons aborder d'abord.
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
288
Plusieurs motifs ont t invoqus pour l'expliquer. Il me semble qu'elle dut se
produire l'poque o l'homme, commenant la vie pastorale et agricole, eut besoin
d'esclaves pour l'aider dans ses travaux. Au lieu de tuer ses prisonniers, il les garda
pour l'aider et devint seul propritaire de ceux qu'il avait conquis, des femmes
notamment. Plusieurs individus ayant plus de chances de russir dans ces
expditions quand ils sont associs que lorsqu'ils sont isols, il dut arriver le plus
souvent que la mme femme se trouva appartenir plusieurs propritaires unis par
les liens de l'association ou de la parent.
La premire transformation de la communaut primitive fut donc sans doute la
restriction du droit de tous les membres de la tribu au profit d'un nombre restreint
d'individus.
On a donn le nom de polyandrie cette forme particulire du mariage dans
laquelle la femme est unie un petit nombre d'hommes. Elle existe encore chez
beaucoup de tribus de l'Inde et de l'Afrique, au Thibet, Ceylan, etc., mais les
individus auxquels la mme femme appartient sont gnralement frres ou parents.
Chez les Tottyars de l'Inde, les frres, oncles et neveux ont leurs femmes en
commun. Dans le pome du Mahabharata, les cinq frres Pandova pousent en
commun la belle Draupadi aux yeux couleur du lotus bleu . Jules Csar a
retrouv cette coutume chez les anciens Bretons. Les femmes, dit-il, taient
communes dix ou douze individus, surtout des frres ou des pres et des fils.
Les enfants taient regards comme ayant pour pre rel celui qui avait eu la
femme vierge.
En Russie la polyandrie est extrmement rpandue encore de nos jours. Chez la
plupart des paysans, le pre et le fils ont gnralement la mme femme en commun.
Cela provient surtout de l'usage de marier des jeunes filles dj grandes des
garons de dix douze ans. C'est le pre qui remplace alors le mari dans ses
fonctions matrimoniales. Quand ce dernier est devenu grand, tous deux participent
aux mmes prrogatives. M. de Lavelaye croit cependant que, depuis
l'mancipation, la promiscuit incestueuse est devenue un peu moins frquente.
L'habitude de ne s'unir qu'avec des femmes enleves par violence des tribus
voisines parat avoir t gnrale chez la plupart des peuples ; c'est ainsi que nous
voyons encore chez un grand nombre, tels que les Esquimaux, les Bdouins, les
Mongols, les habitants de l'Inde centrale, de l'Amrique du Sud, etc., o le mariage
par rapt n'existe plus, le fianc, esclave de la tradition qui montrait la capture
comme prliminaire ncessaire du mariage, s'emparer par un simulacre de combat
de celle dont il a obtenu la main. Cette crmonie existait mme Sparte, au dire
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
289
de Plutarque, et on en trouve des traces dans les coutumes romaines. Il paratrait
mme que, dans certaines parties de la France, l'usage voulait autrefois que la
marie simult une certaine rsistance au moment d'entre dans la maison du mari.
L'habitude de prendre par la force des femmes aux tribus voisines dut
naturellement diminuer mesure que diminuait l'hostilit entre tribus ; mais l'usage
de chercher une pouse hors de son clan tait trop enracin pour pouvoir
disparatre. On se procura par les moyens pacifiques, achat, change, etc., la femme
qu'on ne pouvait plus obtenir par l force. Partout, le mariage entre individus d'une
mme tribu est beaucoup plus rare que celui entre individus de tribus diffrentes.
En Australie, aucun homme ne peut pouser de femme portant le mme nom de
tribu que lui. Il en tait de mme dans beaucoup de tribus de l'Inde et de l'Afrique,
chez les Kalmouks, les Circassiens, etc. Chez quelques-unes, l'union entre les
individus de la mme tribu est considre comme un crime capital.
Lorsque l'usage, fond sur les droits de la conqute, eut permis un petit
nombre d'hommes d'tre les seuls possesseurs d'une mme femme, un lien
commena s'tablir entre l'enfant et le petit groupe d'individus qui pouvaient tre
son pre, et qui, nous l'avons dit, taient gnralement parents. Il est facile de
concevoir que, voyant toujours les enfants avec les mmes individus, on ait fini par
les dsigner par le nom de ces derniers.
Point n'est besoin d'avoir recours, pour expliquer ce passage de la parent
maternelle la parent paternelle, aux raisons mtaphysiques invoques par
Bachofen, ou d'admettre, avec Giraud-Teulon, que ce fut un homme de gnie, un
bienfaiteur de l'humanit qui eut pour la premire fois l'ide de donner son nom
un enfant .
Quand les peuples apparaissent dans l'histoire, la parent paternelle y est
organise solidement ; mais certains indices nous prouvent qu'elle ne devait pas y
exister depuis bien longtemps, et qu'ils avaient conserv le souvenir du temps o le
rle de la mre tait prpondrant. Eschyle nous fait assister la lutte entre l'ancien
droit maternel et le droit plus rcent du pre. Quand Oreste tue sa mre pour venger
son pre assassin par elle, les rinnyes le traduisent devant le tribunal des dieux ;
Oreste se dfend en disant qu'il est le parent de son pre et non de sa mre, et
Apollon confirme cette thse en soutenant que la mre n'est pas la gnratrice de
son enfant, mais seulement la nourrice du germe dpos par le pre dans son sein .
Les rinnyes protestent au nom de l'ancien droit maternel, mais, au nom du
nouveau, les dieux absolvent galit des voix le meurtrier.
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
290
La parent par le pre s'observe indiffremment chez les peuples monogames et
polygames. La monogamie ne semble s'tre tablie du reste que fort tard et encore
chez un petit nombre de nations. En ralit, elle n'a jamais t que fictive. Dans les
pays o l'homme n'a le droit d'pouser qu'une seule femme, il est bien rare qu'il n'en
ait pas en mme temps plusieurs. Par instinct, il est polygame, et cet instinct est fort
naturel, car il peut fconder un nombre considrable de femmes dans une anne,
alors que la femme pendant la mme priode ne peut gure donner naissance qu'
un seul tre. La fidlit n'a videmment d'importance, du reste, que du ct de la
femme. Plus forte que les codes, la morale publique l'a toujours ainsi compris.
On doit rattacher sans doute l'poque o la parent par les femmes tendit
devenir paternelle l'origine d'une coutume, bien singulire en apparence, qui existe
chez un grand nombre de peuplades sauvages sur les points les plus loigns du
globe, et mme chez des nations demi-civilises comme les Basques, par exemple.
Elle consiste en ceci : que quand la femme accouche, le mari se met au lit, simule
par ses contorsions les douleurs de l'enfantement et reoit les flicitations de ses
amis. C'est l probablement un de ces vestiges des anciens ges survivant aux
circonstances qui les ont fait natre. Il est probable que chez les peuples primitifs,
ce n'tait qu'au moyen d'une crmonie copiant grossirement l'acte qui rattache
l'enfant sa mre qu'on marquait bien nettement aux yeux de tous la part prise par
le pre l'existence du nouveau-n. Strabon avait dj signal cette coutume chez
les anciens Ibres. Chez eux, dit-il, lorsque les femmes accouchent, ce sont les
hommes qui prennent le lit leur place, et se font soigner par elles.
IV. - Condition des Femmes et des Enfants
dans les Socits primitives.
Retour la table des matires; retour au dbut du chapitre
Nous ne devons pas nous attendre trouver dans la famille primitive aucun des
sentiments qui servent, ou du moins ont servi de base la famille moderne. Pendant
longtemps la sympathie rciproque des poux, l'amour du pre pour les enfants y
sont rests peu prs entirement inconnus. Les femmes n'taient que des esclaves
pour lesquelles l'homme n'avait pas plus d'gards que pour ses btes de somme. De
nos jours encore, les Australiens les traitent exactement comme nous le faisons de
nos animaux domestiques, c'est--dire les tuent et les mangent quand l'ge
commence les affaiblir. Suivant M. Olfield, dans les territoires de l'Australie
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
291
indpendants des blancs, aucune femme n'arrive l'ge o elle deviendrait inutile ;
on la mange auparavant.
Manges ou non, les femmes n'ont t considres, chez tous les peuples n'ayant
pas atteint certaines formes de civilisation, que comme des esclaves destines
travailler pour l'homme. Il faut avancer fort tard dans l'histoire pour voir leur sort
s'amliorer et natre les sentiments affectueux avec lesquels, dans les temps
modernes, elles sont traites. Les Grecs les considraient gnralement comme des
cratures infrieures, bonnes uniquement s'occuper du mnage et propager
l'espce. Si la femme donnait naissance un tre contrefait, on se dbarrassait
d'elle. Sparte, suivant M. Troplong, on mettait mort cette malheureuse
crature qui ne promettait pas l'tat un soldat vigoureux.
Lorsqu'une femme tait fconde, dit le mme auteur, on pouvait l'emprunter
son mari pour donner la patrie des enfants d'une autre souche. Mme aux
poques les plus brillantes de leur civilisation, les Grecs n'eurent gure d'estime que
pour les htares. C'tait alors d'ailleurs les seules femmes ayant reu quelque
instruction.
Tous les lgislateurs antiques se sont, du reste, montrs fort durs pour les
femmes. Le digeste des lois hindoues les traite fort mal : La destine finale, le
vent, la mort, les rgions infernales, le poison, les serpents venimeux et le feu
dvorant, dit-il, ne sont pas pires que la femme.
La Bible n'est pas beaucoup plus tendre. Elle assure que la femme est plus
amre que la mort . Celui qui est agrable Dieu se sauvera d'elle, dit
l'Ecclsiaste. Entre mille hommes, j'en ai trouv un ; de toutes les femmes, je n'en
ai pas trouv une seule. Les proverbes des divers peuples ne se sont pas montrs
plus aimables : Il faut couter sa femme et ne jamais la croire , dit le Chinois. Le
Russe assure qu'en dix femmes il n'y a qu'une me . L'Italien conseille l'emploi
de l'peron pour un bon comme pour un mauvais cheval, et du bton pour une
bonne comme pour une mchante femme. L'Espagnol recommande de se garder
d'une mauvaise femme, mais de ne pas se fier une bonne. Tous les codes :
hindous, grecs, romains et modernes, la traitent en esclave ou en enfant. La loi de
Manou dit : La femme pendant son enfance dpend de son pre, pendant sa
jeunesse de son mari ; son mari mort, de ses fils ; si elle n'a pas de fils, des proches
parents de son mari, car une femme ne doit jamais se gouverner sa guise. Les
lois grecques et romaines disaient peu prs exactement la mme chose. A Rome,
le pouvoir de l'homme sur sa femme tait absolu ; c'tait une esclave qui ne
comptait pas dans la socit, ne pouvait avoir d'autre juge que son mari, et sur
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
292
laquelle il avait droit entier de vie et de mort. Le mari, dit Caton l'Ancien, est juge
de sa femme ; son pouvoir n'a pas de limites ; il peut ce qu'il veut. Tite-Live
raconte que le snat ayant dcrt la peine de mort contre ceux qui avaient assist
aux Bacchanales, le dcret fut excut l'gard des hommes, mais qu'une difficult
se prsenta relativement aux femmes, qui, ne dpendant que de leurs maris,
n'taient pas justiciables de l'tat. Ne voulant pas violer les vieux principes, le snat
laissa aux maris et aux pres le droit de prononcer la sentence. Le droit grec ne
traitait gure mieux la femme ; il ne lui reconnaissait aucun droit, mme pas celui
d'hriter.
Malmene par les lois et les religions, et traite partout en esclave, la femme ne
pouvait se dfendre qu'en dveloppant les instincts de coquetterie, de ruse et de
dissimulation qu'elle possdait naturellement. Reste sans culture, son intelligence
ne pouvait progresser, et, graduellement, la distance qui la spare de l'homme est
devenue un vritable abme.
Le rle des enfants, dans les socits primitives, ne semble pas avoir t
beaucoup meilleur que celui des femmes. Je ne parle pas de la famille des temps
classiques, dont j'aurai m'occuper plus loin, mais seulement de celle des ges
primitifs. L'amour paternel devait tre peu dvelopp, et l'enfant gnralement
considr comme un esclave destin augmenter la richesse du pre. Nous en
pouvons juger par ce qui se passe chez tous les peuples infrieurs qui vivent sur
divers points du globe. Le fils n'y est gure considr que comme le serviteur du
pre. Dans certaines tribus de l'Afrique, les pres vendent sans difficult leurs
enfants. Chez les Fantis, les riches prennent autant de femmes qu'ils en peuvent
nourrir, de faon obtenir un troupeau d'enfants qu'ils lvent pour en faire un
commerce lucratif avec les acheteurs d'esclaves.
Naturellement, dans ces conditions, les enfants ne professent pas pour leurs
parents une affection bien tendre. Nous avons montr, dans un prcdent chapitre,
que c'est un usage gnral chez beaucoup de peuples de s'en dbarrasser aussitt
que l'ge commence affaiblir leurs forces.
Mais c'est surtout le sort des enfants du premier ge qui laissait dsirer dans
les socits primitives. L'infanticide devait sans doute, comme aujourd'hui encore
chez la plupart des peuples sauvages, ou mme demi-civiliss, tre une habitude
gnrale. Tous les voyageurs en Australie rapportent que c'est une rgle constante
chez eux de tuer un certain nombre d'enfants de chaque femme. Dans certaines
rgions, on emploie leur chair pour amorcer les hameons ; dans d'autres, on les
mange. Dans la relation de son voyage en Australie, publie cette anne mme, M.
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
293
Dsir Charnay rapporte que dans l'ouest de l'Australie les enfants de la premire
femme sont tous tus. A l'ge de dix ans on les engraisse et on les mange. Dans
aucune partie de l'Australie on ne garde plus de deux enfants par femme, suivant le
mme auteur. Ceux qu'elle a en plus, gnralement au nombre de cinq six, sont
mangs. Dans ce dernier cas, la mre, suivant un autre auteur M. Olfield, se rpand
gnralement en lamentations, mais ces lamentations se calment aussitt qu'on lui a
jet un morceau du cadavre ronger 87. Chez certaines peuplades du midi de
l'Afrique, cites par M. Laylaud et divers voyageurs, on emploie les enfants dont on
veut se dbarrasser pour amorcer les piges lions, afin d'attirer ces derniers. Dans
les les Polynsiennes, Ellis n'a pu rencontrer une seule femme qui n'ait pas tu au
moins un de ses enfants.
Gnralement, ce sont les enfants du sexe fminin dont on se dfait, parce que
les femmes sont inutiles la guerre. On les tue le plus souvent aprs leur naissance,
mais d'autres fois quand elles ont atteint l'ge de quatre ans. En Chine, comme on le
sait, l'infanticide est pratiqu sur une grande chelle, en raison de l'impossibilit o
se trouvent beaucoup de parents d'lever leurs enfants.
Les peuples civiliss n'ont pas lieu de trop critiquer l'infanticide des sauvages,
car ils le pratiquent comme eux, bien qu'avec moins de franchise. Tous les ans, crit
le Dr Brochard, dans un travail couronn par l'Acadmie des sciences, 20,000
enfants quittent Paris, confis des femmes de la campagne qui les emmnent chez
elles pour les allaiter. De ces 20,000 enfants, combien en revient-il ? 5,000 au plus ;
les 15,000 autres meurent de faim, de misre ou d'autres accidents, victimes de
chutes, brls, ou mangs par les animaux. 300,000 depuis vingt ans, suivant
l'auteur, auraient succomb ces causes de destruction. Dans la discussion qui eut
lieu alors l'Acadmie de mdecine, propos de la question des nourrices, M.
Husson, alors directeur de l'Assistance publique, a rvl que dans plusieurs
dpartements, la Loire-Infrieure et la Seine-Infrieure, par exemple, la mortalit
des enfants en nourrice atteignait 90 pour 100. Les nourrices ayant la plus mauvaise
rputation sont souvent les plus recherches. On n'a fait, a dit M. Husson, que
lever un coin du voile qui cache le tableau. Le mal est seulement entrevu. On n'en
connat ni l'tendue ni la profondeur.
87
She may, however express her grief by uttering low, stifled moans, but how great soever her sorrow for the
loss of her child may be, it becomes somwhat assuaged when the head of the victim, the mother's legal
perquisite in all such cases, is thrown to her, and this she proceed to eat, sobbing the while.
Bien qu'oblig, faute de place, renoncer de plus en plus aux citations textuelles, j'ai reproduit le passage
prcdent parce qu'il montre quel point des sentiments primitifs, aussi nergiques que l'amour maternel,
peuvent finir par disparatre devant certaines ncessits sociales.
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
294
V. - Constitution de la Famille
dans l'Antiquit historique.
Retour la table des matires; retour au dbut du chapitre
Chez tous les peuples dont les livres ont gard la mmoire, Grecs, Hindous,
Romains, etc., la famille, quand elle se prsente dans l'histoire, est trs fortement
constitue.
Sous une forme plus ou moins analogue ce qu'on a nomm l'tat patriarcal,
chaque famille, sous les ordres absolus d'un pre, forme un groupe unique
possdant mmes intrts, mmes rites et mmes dieux. La religion domestique
reposait sur le culte des anctres, ce point que Platon a pu dfinir la parent la
communaut des dieux domestiques. Le sol lui-mme, proprit sacre de la
famille, sige du culte des anctres, tait quelque chose d'inalinable et d'indivisible
que le pre transmettait l'an de ses enfants. Ce n'est qu'assez tard que le sol
d'une famille put tre alin par elle. La loi des Douze Tables ne permettait mme
pas que la proprit ft confisque au profit des cranciers.
Ainsi constitue, la famille formait un ensemble dont toutes les units taient
rattaches les unes aux autres par des liens dont, avec nos ides modernes, il est
impossible de bien comprendre la force. Elle tait assise sur deux bases
inbranlables alors, la proprit et la religion, sur lesquelles dans les temps
modernes elle ne s'appuie plus.
Aucune puissance n'a jamais dpass celle du pre de famille dans les temps
antiques. A Rome, elle tait absolue. Le pre de famille avait droit de vie et de mort
sur tous les siens, et ses arrts taient sans appel ; car, si le chef de famille tait
soumis au jugement de la cit, sa famille n'avait d'autre juge que lui. Ses enfants ne
pouvaient rien acqurir en propre. Ce qu'ils gagnaient lui revenait. Du vivant de
leur pre, ils ne pouvaient avoir de foyer particulier. Mme maris, ils restaient
sous sa puissance.
La famille, sous l'autorit du pre qui en tait le chef, constituait, en y
comprenant sans doute les serviteurs et les esclaves, ce que les Romains nommaient
la gens. Ces familles, indpendantes et isoles, paraissent avoir t longtemps dans
les races aryennes, du Gange jusqu'au Tibre, la seule forme de socit, lorsque la
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
295
famille, dont nous avons dcrit les origines, fut dfinitivement constitue. Tous ces
petits groupes vivaient isols, sans liens religieux ou politiques.
Il est impossible de dire quand ces groupes isols finirent par s'agrger ; mais il
est facile de comprendre qu'ils taient ncessairement conduits se runir.
L'obligation de se dfendre contre leurs ennemis devait crer entre eux des
associations plus ou moins durables. Ce sont probablement des ncessits
guerrires, et non, ainsi que le croit M. Fustel de Coulanges, des croyances
religieuses communes, qui amenrent leur agrgation. Il est possible, comme le dit
cet auteur, qu' mesure que les hommes sentent qu'il y a pour eux des divinits
communes, ils s'unissent en groupes plus tendus ; mais, sans les ncessits que
je viens de mentionner, comment ces familles disperses, ayant chacune leurs
dieux, en seraient-elles arrives spontanment avoir des divinits communes ? On
comprend trs facilement au contraire qu'une famille, ayant frquemment russi
dans ses expditions avec celles qui s'taient associes elle, dut naturellement
continuer invoquer les mmes dieux pour obtenir leur protection. C'est ainsi que
naquirent sans doute les phratries grecques et les curies romaines, formes de
l'agrgation de plusieurs familles ayant chacune leurs dieux indpendants, mais
possdant des dieux communs. L'agrgation de phratries et de curies forma ensuite
les tribus dont la confdration devait constituer les cits. Je ne parle pas de la
runion des cits sous un seul gouvernement, car cette organisation sociale
n'apparat que fort tard. La pense que plusieurs villes puissent vivre sous l'autorit
d'un mme gouvernement fut d'abord inconnue des Grecs et des Romains.
Ces antiques divisions dont la famille tait la base subsistrent longtemps. Dans
les premiers sicles de Rome, le peuple votait par gentes et par curies. Il y avait
deux vestales par tribu, etc.
Depuis les ges antiques, la famille a subi des modifications diverses. Leur
histoire dtaille ne pouvant prendre place ici, je me bornerai en rappeler les plus
essentielles. La plus importante a t la substitution, comme unit sociale, de
l'individu la famille, la diminution graduelle de l'autorit et de la responsabilit du
pre de famille, et surtout enfin, du moins chez certains peuples, la dispersion du
foyer rsultant de l'miettement du patrimoine, divise par les codes entre tous les
enfants. L'avenir seul pourra apprcier nettement les consquences sociales
importantes produites par cette dernire transformation. Aujourd'hui, le mariage et
la famille ne ressemblent en rien ce qu'ils taient, non seulement dans la socit
antique, mais il y a peine quelques sicles. Le mariage n'est plus gure maintenant
qu'une association d'intrts entre gens qui ne se connaissent pas, et qui, lorsqu'ils
se connaissent, en arrivent trop souvent se dtester cordialement, jusqu'au jour o
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
296
la ncessit les oblige reconnatre qu'il est plus sage de se supporter. Soustraits
l'influence de la famille par le collge ou les professions industrielles, les enfants
deviennent des trangers pour les parents, et ne les considrent bientt que comme
des sortes de banquiers donns par la nature. Certes, bien des diffrences sparent
les socits modernes des socits antiques, mais une des plus profondes est, je
crois, celle-ci : L'homme des anciens ges avait une religion, un foyer, une famille.
L'homme des temps modernes n'a plus de religion ni de foyer, et c'est peine s'il lui
reste une famille.
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
297
Deuxime partie
LES SOCITS
Leurs origines et leur dveloppement
livre III : Dveloppement des socits
Chapitre III.
Dveloppement de la proprit.
Retour la table des matires; retour au dbut du chapitre
1. Les formes primitives de la proprit. - La proprit n'a pas toujours exist sous ses formes
actuelles. - L'ide de la proprit individuelle du sol ne pouvait natre que trs tard. - Formes de la
proprit chez les peuples primitifs. - La proprit chez les peuples chasseurs, pasteurs et
agriculteurs. - La proprit du sol en commun. - La redistribution poques priodiques aux
divers membres de la communaut. - Description du Mir en Russie. - Communaut des villages
dans l'Inde, Java, etc. - Ces formes de la proprit correspondent certaines priodes de
l'volution par lesquelles tous les peuples ont d successivement passer. - Rsultats que la
communaut des terres a engendrs. - II. volution de la proprit depuis qu'elle est devenue
individuelle. - tat de la proprit chez les Grecs et les Romains. - Apparition du droit de tester. Il n'est pas primitif. - L'origine de la proprit chez les Grecs et les Romains ne drive pas des
coutumes religieuses. - Elle n'est pas non plus celle qu'indiquent les lgistes. - Transformations de
la proprit. - L'emphytose. - Les bnfices. - Le fermage. - Les baux long terme. - Comment
dans les temps modernes la petite proprit tend disparatre et redevenir collective. -Avenir de
la proprit.
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
298
I. - Les Formes primitives
de la Proprit.
Retour la table des matires; retour au dbut du chapitre
La proprit n'a pas toujours exist sous les formes que nous lui connaissons
aujourd'hui. L'ide que le sol, l'air ou la lumire pouvait appartenir quelqu'un,
n'aurait pu tre comprise par nos premiers anctres, et il a fallu que l'humanit ait
parcouru la plus grande partie de son cycle pour que cette conception ait pu natre.
Ce n'est pas sans doute que l'instinct de la possession n'ait pas toujours exist
chez l'homme ; il s'observe, en effet, chez plusieurs espces animales d'o il drive,
et a d faire par consquent partie de l'hritage de nos premiers anctres. Mais sous
son tat primitif, cet instinct ne s'tend qu' des objets relatifs aux besoins
journaliers et l'alimentation. Sous cette forme, il est trs dvelopp chez l'enfant,
si dvelopp mme, qu'il dgnre le plus souvent en instinct du vol.
Mais, pour que l'ide de la proprit individuelle pt natre, il fallait que
l'homme et transform entirement ses conditions d'existence primitive. Tant qu'il
ne connaissait pas l'art de rendre les animaux domestiques et l'agriculture, c'est-dire tant qu'il mena la vie de chasseur, la possession du sol ne pouvait avoir aucun
intrt pour lui. La seule ide de proprit qu'il pt avoir alors, c'est que ses
territoires de chasse ne devaient pas tre envahis par d'autres tribus, sentiment
analogue celui d'un animal froce qui ne veut pas qu'un autre animal vienne rder
autour de sa tanire.
Lorsque l'agriculture fut connue, et alors l'humanit avait dj un immense
pass derrire elle, il s'coula encore un temps fort long avant que l'ide de
proprit personnelle appart. Le sol, comme les femmes, appartint d'abord tous
les membres d'une communaut. Ce n'est que bien lentement qu'ils arrivrent tre
la proprit d'abord temporaire, puis permanente d'une famille, et enfin d'un
individu.
Nous tudierons l'volution de la proprit, comme nous avons tudi celle de la
famille. L'examen de ses formes chez les populations divers degrs de
dveloppement, nous permettra de reconstituer les diverses phases de sa
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
299
transformation. Les vestiges des vieilles coutumes contenues dans l'ancien droit
nous fourniront les moyens de vrifier l'exactitude de ces reconstitutions.
Chez les peuples chasseurs, l'ide de la proprit ne se manifeste, comme je le
disais l'instant, que par l'exclusion pour les tribus voisines du droit de chasse sur
les territoires qu'ils occupent. La proprit de l'individu est limite ses armes et
ses objets personnels, les seules choses qui puissent lui tre utiles.
Certaines tribus, telles que les Esquimaux, nous donnent une ide assez exacte
de ce que pouvait tre la proprit chez des peuples exclusivement chasseurs, mais
obligs de mener une vie sdentaire une partie de l'anne. Ces tribus vivent encore
en communauts de plusieurs familles runies dans une mme cabane.
L'assemblage d'un certain nombre de ces cabanes constitue un village. Chaque
individu ne possde en propre que ses armes, ses vtements et son traneau ; le reste
des objets, tels que le grand bateau de chasse, les tentes, les fourrures, les
provisions appartient la famille. La cabane et certaines provisions exigeant pour
tre prpares le concours de plusieurs personnes, appartiennent la communaut
vivant sous le mme toit. Il y a mme certains objets qui sont la proprit commune
de tous les habitants du village.
Lorsque les peuples sont la fois chasseurs et agriculteurs, comme certaines
peuplades de l'Amrique, la tribu a ses territoires de chasse, ses pturages indivis,
et un territoire appartenant la communaut, sur lequel chaque famille peut cultiver
les portions inoccupes qui lui conviennent et qui restent sa proprit tant qu'elle
les cultive.
Quand les populations sont exclusivement pastorales, la jouissance des
pturages et de la fort est indivise entre tous les membres de la communaut.
Aussitt qu'elles deviennent agricoles, le sol est divis entre plusieurs familles qui
le cultivent tour tour, mais il reste la proprit commune de la tribu. Dans la
forme la plus primitive de la proprit, non seulement la terre, dont chacun cultive
tour tour une portion, est commune, mais les rcoltes le sont galement. Dans des
formes plus avances, la terre est bien commune et priodiquement redistribue
entre les membres, mais les produits du sol sont la proprit exclusive de celui qui
les a rcolts.
On retrouve des traces de ces formes primitives de la proprit, non seulement
dans l'antiquit classique, mais encore de nos jours. Diodore nous parle de
populations, qu'on suppose tre les Basques, o les rcoltes taient en commun, et
o chacun devait cultiver une portion dtermine du sol renouvelable tous les ans.
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
300
Actuellement, en Serbie et en Croatie, les Slaves autrichiens possdent un rgime
identique. On rencontre des communauts de villages dont les membres sont en
mme temps parents et copropritaires du sol. La proprit n'y est pas divise, mais
est cultive en commun, et les produits, runis en bloc, sont partags entre les
familles d'aprs leurs besoins supposs. La mme organisation se rencontre encore
dans quelques communes de la Russie, mais titre exceptionnel. Gnralement, un
pas considrable a t fait ; la terre appartient bien encore la communaut, mais
chacun en reoit pour plusieurs annes une portion qu'il cultive sa guise, et dont il
garde les produits pour soi.
Pour bien comprendre cette organisation, dont on retrouve l'existence chez tous
les anciens peuples, notamment chez les Germains, il faut l'tudier dans les pays o
elle existe encore. Nous la dcrirons telle qu'on l'observe en Russie, o trente-cinq
millions de paysans possdent actuellement ce rgime. En dehors des domaines
particuliers de l'tat et des propritaires, le sol cultivable de chaque commune
appartient une association d'individus nomme le Mir, forme de tous les chefs de
famille de la commune 88. Le Mir constitue une personne civile, seule propritaire
du sol, seul agent responsable vis--vis de l'tat, de l'impt et du recrutement. Il se
gouverne d'une faon trs indpendante. Son pouvoir est trs grand, puisqu'il peut
aller jusqu' condamner la dportation en Sibrie un de ses membres. Il peut
prescrire un des habitants du village absent de revenir immdiatement, et, si ce
dernier n'obit pas de suite l'injonction, le faire ramener par la police. Ses
dcisions sont sans appel.
L'unit du Mir est la famille ou l'agglomration de familles vivant sous le mme
toit. Les familles vivant isoles sont frquentes aujourd'hui, mais, avant
l'mancipation, elles taient l'exception. Chaque famille ou chaque communaut de
familles n'a en propre que sa maison et le jardin qui l'entoure. Ses membres vivent
d'une faon patriarcale sous l'autorit du chef de famille, lequel est l'administrateur
des gains de la petite communaut. Si, sa mort, elle se divise, on partage
galement la fortune commune sans tenir compte du degr de parent, mais
seulement du travail accompli. Chacun ayant eu la mme part au labeur, est
considr comme ayant les mmes droits. Le fils an peut mme tre exclu du
partage s'il est absent depuis longtemps. C'est l, comme on le voit, une liquidation,
et non une succession. Elle viole sans doute les prescriptions du Code, mais le
paysan ignore ces prescriptions et ne s'en proccupe pas.
88
Les meilleures descriptions du Mir que je connaisse ont t donnes par M. de Laveleye (De la proprit et
de ses formes primitives) ; et surtout par M. Mackensie Wallace (la Russie). J'ai eu plusieurs fois occasion, en
Russie, de constater l'exactitude des descriptions de ce dernier auteur. En ce qui concerne les communauts de
villages analogues au Mir qu'on rencontre dans l'Inde, on consultera surtout l'ouvrage de Summer Maine
(Villages communitees East and West).
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
301
La famille est donc, comme on le voit, une sorte d'association dont tous les
membres ont toutes choses en commun. Le Mir n'est qu'une runion de familles
ayant, non plus tout ce qu'elles possdent, mais seulement leurs terres, en commun
sous la gestion gnrale d'un mme chef. Le Mir paie au trsor un impt dtermin
par tte d'habitant, et distribue les terres entre ses membres absolument comme il
l'entend, et sans que personne puisse appeler de ses dcisions. Chaque famille
reoit un nombre de portions proportionnel au nombre de ses membres, en tenant
compte de l'ge, du sexe et de la capacit suppose de travail de chacun d'eux. Les
dlibrations sont publiques, et les femmes elles-mmes peuvent y prendre part ;
mais le paysan, qui a une fort mdiocre opinion de l'intelligence fminine, ne leur
permet gure d'intervenir longtemps dans la discussion.
La possession d'une part communale est loin d'tre toujours chose avantageuse.
Dans certaines communes, autour de Smolensk, par exemple, la terre est si pauvre,
qu'elle rapporte peine l'impt. Plusieurs portions peuvent constituer alors une
charge plutt qu'un bnfice. Dans d'autres zones, la terre tant au contraire fort
riche et le produit qu'on peut en tirer trs suprieur la taxe, la famille peut en
louer une ou plusieurs portions et s'occuper au besoin d'autres travaux que ceux
de la culture.
Le Mir procde la redistribution des terres aussi souvent qu'il le juge utile. Les
priodes de redistribution varient gnralement de 6 15 ans suivant les
communes. Chaque membre reoit plusieurs parcelles dans des champs spars et y
sme ce qui lui plat, mais des poques fixes par l'assemble. Les rcoltes
appartiennent aux possesseurs temporaires de chaque parcelle.
Le Mir existe en Russie depuis une antiquit fort haute. Aprs la suppression du
servage, son autorit a remplac entirement celle des seigneurs laquelle il tait
autrefois subordonn.
[NOTE :
Le dcret d'mancipation de 1861 avait pour but de transformer en petits propritaires
communaux les quarante millions de serfs de l'empire. L'autorit des Seigneurs fut abolie et le
paysan ne releva plus que du Mir. Il devint propritaire rel des terres qu'il exploitait et qui
faisaient autrefois partie des domaines du seigneur, moyennant une redevance paye pendant un
certain nombre d'annes ce dernier.
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
302
Le paysan n'accueillit pas le dcret d'mancipation avec un enthousiasme trs-vif. L'ide
d'tre appel homme libre ou serf lui tait extrmement indiffrente ; mais ce qui ne lui tait pas
indiffrent du tout, c'tait d'avoir payer une redevance nouvelle pour une terre qu'il savait bien
vaguement appartenir en droit au seigneur, mais qu'en fait il avait toujours vu entre les mains du
Mir. On eut beaucoup de peine l'clairer sur l'utilit de l'opration, et ce ne fut qu'aprs avoir t
vigoureusement btonn pendant plusieurs mois qu'il commena bien saisir les avantages de la
libert.
En vrit, dit M. Wallace, je suis port croire par les nombreux rcits de scnes de cette
poque que je tiens de tmoins oculaires, que rarement, sinon jamais, les serfs ont vu et
expriment autant de flagellation que pendant les trois premiers mois aprs leur
affranchissement. Les moralistes s'indigneront sans doute de l'indiffrence du paysan pour les
grands principes ; mais ces thoriciens oublient toujours que les hommes n'tant pas tous couls
dans le mme moule, ne sont pas influencs galement par les mmes motifs.
L'abolition du servage, c'est--dire la mise en libert relative de quarante millions de serfs, est
certainement un des vnements les plus importants de l'histoire moderne ; mais, bien que vingt
ans se soient couls depuis le dcret d'mancipation, il est encore impossible d'en juger les
consquences, et, sur ses rsultats, les avis sont en Russie fort partags. Sous des matres peu
exigeants, la condition du serf tait, suivant l'auteur anglais que je viens de citer, bien meilleure
que celle de la majorit des ouvriers agricoles anglais ; mais beaucoup de ces seigneurs se
montraient disposs abuser du pouvoir qu'ils avaient sur leurs serfs, et qui tait presque illimit,
puisque plusieurs ukases punissaient du knout et des mines le fait seul pour un serf d'lever une
plainte contre son seigneur. M. Wallace cite le cas d'une dame Saltzkoff qui fit prir une centaine
de ses serfs, dont plusieurs enfants de dix douze ans, dans les tortures, avant que l'autorit
songet intervenir. Les serfs attachs la terre n'taient gure vendus qu'avec elle, et leur sort
tait gnralement trs tolrable ; mais les serfs domestiques taient de simples esclaves qu'on
vendait absolument comme du btail, et auxquels n'tait d aucun salaire. M. Wallace a extrait de
la Gazette de Moscou des spcimens d'annonces prouvant qu'ils taient entirement assimils aux
bestiaux : vendre trois cochers bien dresss et deux filles, l'une de dix-huit ans, l'autre de
quinze ans . Dans cette maison on peut acheter un cocher et une vache hollandaise sur le point
de mettre bas . L'empereur Alexandre avait fini par interdire cette forme d'annonces ; mais,
jusqu'en 1955, la vente des esclaves se continua sous une forme plus ou moins dguise.
Beaucoup de propritaires se livraient mme l'levage des esclaves uniquement pour les vendre.
C'tait une industrie analogue celle de l'levage des cochons ou des lapins.
Quand le dcret d'mancipation fut promulgu, il y avait en Russie, en nombres ronds :
Serfs paysans des seigneurs
Serfs domestiques (esclaves
Serfs de l'tat
Total
20,200,000
1,500,000
23,000,000
44,700,000
On a cru pendant longtemps que cette forme de la proprit commune tait
spciale aux Slaves ; mais des recherches plus approfondies ont montr qu'elle
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
303
existait chez beaucoup d'autres peuples, et que chez ceux o elle n'existait plus on
en retrouvait des traces, ce qui nous permet bien d'affirmer, comme nous le disions
plus haut, que la possession du sol en commun a t la forme primitive de la
proprit.
Les communauts de villages avec partages priodiques ont exist dans
l'ancienne Germanie. Tacite nous dit que nul n'y a de champs limits ni de terrains
qui soient sa proprit. Les magistrats assignaient tous les ans des terres aux
familles vivant en commun. Quelques populations arabes de l'Algrie en sont
encore la priode d'volution des Germains au temps de Tacite. Chez certaines
tribus du ct de Constantine, les terres sont annuellement rparties par le cheik ;
dans d'autres, les familles les conservent, mais sans pouvoir les aliner. Chez
beaucoup de peuplades de l'Afrique, des communauts analogues celles que j'ai
dcrites sont en vigueur.
Mais c'est surtout aux Indes et Java que ces communauts s'observent. Les
dix-huit millions d'habitants de Java ont une organisation analogue celle que nous
avons dcrite pour la Russie. Les terres y sont priodiquement partages, mais la
population s'accroissant avec une rapidit excessive (elle n'tait que de 3,780,000
en 1808), les parts deviennent toujours plus petites, et on prvoit l'poque o la
proprit personnelle s'tablira forcment.
Dans l'Inde, la proprit est commune comme en Russie, mais son organisation
y a fait un pas de plus. Les terres sont cultives en commun par des associations
gnralement formes de membres de la mme famille, sous l'autorit de l'an ou
d'un chef lu, mais elles ne sont pas soumises des redistributions priodiques ;
chaque famille cultive son lot ; une partie du sol est rserve pour les pturages
communs. Un tranger peut acheter une part du fonds commun avec le
consentement des propritaires. Avec sa part, il prend les charges du vendeur. Les
villages sont gouverns par un conseil d'anciens et entretiennent frais communs le
matre d'cole, l'agent de police, le prtre et des ouvriers de diverses professions.
C'est une rpublique rurale sous un chef lectif.
La proprit tant devenue individuelle dans certaines parties de l'Inde, et
plusieurs systmes de fermage existant dans d'autres, les coutumes relatives la
proprit sont assez compliques ; et, faute de s'tre rendu compte des systmes
originaires de la tenure des terres, les Anglais ont commis dans leur administration
des erreurs qui leur ont cot fort cher et ont t sur bien des points la cause de la
ruine des cultivateurs.
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
304
Avec la srie d'exemples prcdents, nous pouvons nous faire une ide assez
nette des phases successives par lesquelles a d passer la proprit. Elle commence
par la communaut complte pour arriver la proprit temporaire partage des
poques d'abord trs rapproches, puis de plus en plus loignes, jusqu'au jour o
elle reste indfiniment dans les mains de la mme famille.
Les divers exemples de proprit en commun que nous avons cits, montrent
que l'organisation rve par les socialistes comme devant tre celle de l'avenir serait
au contraire un retour des formes d'volutions infrieures qu'ont d traverser tous
les peuples dans leur enfance, avant d'arriver leur ge mr.
Ce n'est qu'un intrt purement thorique qui pourrait nous conduire
rechercher ce que ces organisations transitoires de la proprit ont produit. Bons ou
mauvais, leurs rsultats ne sauraient servir d'exemple, les conditions qui rendaient
possible ces organisations primitives ayant disparu. En fait, ils ont t la fois
avantageux et nuisibles. Avantageux, en ce sens que chacun ayant droit une
portion du sol cultiver, l'extrme misre est impossible. Nuisibles, parce que
chacun n'ayant aucun intrt amliorer le fonds qu'il a temporairement, celui qui
le cultive ne fait que juste le ncessaire pour en retirer ce dont il a besoin, et, faute
de stimulant, reste toujours dans un tat de demi-misre dont il n'a aucune chance
de sortir, l'esprance d'agrandir ce qu'il possde lui tant interdite.
Tant que la terre disponible est trs abondante relativement au nombre des
habitants, il n'y a pas d'inconvnient ce qu'elle soit imparfaitement cultive,
chacun en ayant toujours assez pour en tirer de quoi subsister peu prs. Quand la
population s'accrot rapidement, et c'est ce qui a fini par se produire chez tous les
peuples civiliss, la part de chacun se rduisant en mme temps, il arrive un
moment o des procds de culture infrieurs doivent faire place des procds
perfectionns ; mais ces procds perfectionns, exigeant du temps et des dpenses,
ne peuvent tre tents que par celui qui se sait matre du sol auquel il consacre son
labeur. Les priodes de redistribution deviennent forcment alors de plus en plus
espaces jusqu'au jour o elles tombent entirement en dsutude, et ce jour-l la
proprit prive a pris naissance. La Russie en arrivera l lorsque l'tendue de son
sol ne sera plus aussi vaste relativement au nombre de ses habitants.
C'est un avenir qui ne saurait tre extrmement loign, si l'on songe que sa
population, qui n'tait que de 36 millions au commencement de ce sicle, s'lve
pour l'Europe seulement 80 millions aujourd'hui.
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
305
II. - volution de la Proprit
depuis qu'elle est devenue individuelle
Retour la table des matires; retour au dbut du chapitre
Chez les Grecs et les Romains, tels que nous les connaissons par les livres, les
formes primitives de la proprit taient dpasses depuis longtemps ; mais, quand
ils apparaissent dans l'histoire, ils ont dj derrire eux un long pass dont nous ne
savons rien. L'ancien droit a disparu en ne laissant que quelques vestiges. C'est
ainsi, par exemple, que certains territoires taient communs la gens, ou lui
retournaient quand le chef de la famille mourait sans enfants. Un droit important,
celui de tester, absolument inconnu aux anciens ges, existe. Des lgistes seuls
pouvaient s'imaginer que nos primitifs aeux aient trouv tout simple qu'un homme
ait par sa volont quelque influence aprs sa mort. Le fils hritait du pre, mais
parce qu'il continuait la famille, et non parce que c'tait la volont paternelle. Les
recherches modernes ont prouv qu'il tait impossible de retrouver dans le noyau
des anciennes lois aucun vestige du droit de tester ; partout o il apparat, il est
emprunt au droit romain. Le monument le plus antique du droit romain, la loi des
Douze Tables, reconnat ce droit, mais sans donner de dtails sur la faon dont se
faisait la transmission. Nous savons seulement que, primitivement, la femme
n'hritait jamais, les biens du pre passaient au fils, son dfaut au plus proche
parent agnat, et, dfaut d'agnats, ils retournaient la gens.
On a recherch dans la constitution religieuse des Grecs et des Romains l'origine
de la proprit prive. M. de Coulanges, notamment, la fait driver de la ncessit
d'avoir une demeure fixe pour le culte des anctres. L'ide de proprit prive,
dit-il, tait dans la religion mme. La famille qui, par devoir et par religion, reste
toujours groupe autour de son autel, se fixe au sol comme l'autel lui-mme. L'ide
de domicile vient naturellement. La famille s'est attache au foyer ; le foyer l'est au
sol : une relation troite s'tablit donc entre le sol et la famille.
De telles relations pouvaient et ont d en effet s'tablir ; mais je doute qu'elles
eussent jamais suffi transformer la proprit commune primitive en proprit
individuelle. Dans l'organisation du Mir, que nous avons dcrite, la maison et le
jardin qui l'entoure sont proprits prives et suffiraient au besoin au culte de toute
une lgion d'anctres ; ce qui n'empche pas le territoire agricole de se cultiver en
commun.
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
306
Les jurisconsultes romains, imits en cela par les modernes, assignent une autre
source la proprit prive. Elle eut pour origine, suivant eux, l'occupation pendant
les temps historiques de terres qui, aux temps prhistoriques, n'appartenaient
personne, res nullius.
Des thories semblables peuvent bien germer dans des cerveaux de lgistes,
mais non dans des cerveaux d'hommes primitifs. Si par hasard l'ide, qu'on peut
s'approprier une terre n'appartenant personne en l'occupant, se ft manifeste,
l'exprience et bien vite appris que l'occupation ne confre absolument aucun
droit, et qu'avant les ges civiliss, le mot de proprit tait simplement synonyme
d'aptitude garder. Or, dans les anciens ges, la communaut seule tait assez
puissamment organise pour exercer ce pouvoir.
Ce serait une tche intressante que de suivre l'volution de l'organisation de la
proprit depuis qu'elle est devenue prive, mais ce serait aussi une tche fort
longue. Je me bornerai donc indiquer quelques-uns des jalons de ses
transformations successives. Ces indications suffiront montrer que cette ide de
proprit, qui semble au premier abord quelque chose de trs stable, est comme
toutes choses dans un tat perptuel de transformation.
L'une des plus anciennes, et en mme temps des plus intressantes
transformations de la proprit a t l'emphytose, sorte de bail par lequel le
propritaire cdait perptuit au preneur, et souvent ses hritiers, sa terre
moyennant une redevance. Le fermier devenait ainsi une sorte de propritaire. Le
bailleur ne conservait sur la proprit qu'une certaine surveillance, et le droit de
rentrer en sa possession en cas de non-paiement de la redevance.
Le propritaire de la terre tait parfois l'tat. Ce fut prcisment le cas des terres
des frontires romaines gardes par des sortes de colons militaires auxquels l'tat
abandonnait la jouissance du territoire, en change d'une redevance reprsente
uniquement par le service militaire en cas de ncessit.
D'minents juristes, et notamment Summer Maine, admettent que c'est
probablement l'emphytose qui a t l'origine du rgime fodal. Les rois barbares
qui fondrent le rgime de la fodalit s'assurrent les services militaires de leurs
soldats en leur donnant des domaines en change ; mais ces bnfices, que le
bnficiaire possdait pour une certaine dure qui pouvait tout au plus se prolonger
pendant sa vie, n'taient pas hrditaires. Ce n'est gure que sous les successeurs de
Charlemagne qu'ils le devinrent. En Angleterre, la proprit individuelle n'existe
mme que par fiction. En droit strict, le sol anglais conquis par Guillaume
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
307
appartient encore au souverain. Ceux qui le possdent sont simplement tenanciers
de la couronne.
En Angleterre, la proprit est arrive subir des transformations qui se
continuent aujourd'hui, et qui rappellent une de celles que je viens de dcrire. Elle
est entre les mains d'un trs petit nombre de propritaires qui se trouvent dans la
ncessit de faire exploiter leurs terres par des fermiers. Ces derniers, obligs par
les besoins de l'agriculture moderne de faire des dpenses d'amlioration,
rclament, ce qu'ils ont obtenu dj du reste dans certaines rgions, des baux de
trente cinquante ans qui en feraient en ralit de vritables matres du sol. Ils
admettent bien les baux courte priode, mais sous la condition, en cas de nonrenouvellement, d'tre rembourss de toutes les dpenses effectues par eux pour
amliorer la proprit ; ce qui revient, en d'autres termes, reconnatre leur droit
la partie de la proprit cre par leur travail. Ce droit, qui a exist longtemps dans
le nord de l'Irlande, parat devoir bientt pntrer dans la loi anglaise.
Dans les temps modernes est apparue une nouvelle conception de la proprit,
qui s'est gnralise d'une faon trs rapide. C'est la possession en commun par un
nombre considrable d'individus de certains objets : maisons, usines, chemins de
fer, domaines agricoles, etc., l'administration desquelles ils ne prennent
directement aucune part, et dont le titre de proprit est simplement reprsent par
une action que les copropritaires peuvent ngocier et transmettre presque aussi
facilement que la monnaie ordinaire.
Cette nouvelle conception de la proprit, que reprsentent les socits
financires par actions, sera certainement considre par les conomistes de l'avenir
comme une des ides qui ont produit les plus grands changements dans les
conditions d'existence des hommes. Elle a transform l'industrie en permettant la
cration d'usines gigantesques, o, la division du travail tant pousse l'extrme,
l'objet excut peut tre fait dans des conditions d'conomie dont le petit fabricant
et le travailleur indpendant sont incapables. Mais, en ruinant la petite industrie, en
transformant l'ouvrier en un rouage machinal excutant mcaniquement un mme
travail, et devenant ainsi de moins en moins intelligent chaque jour, cette
transformation prpare nos descendants plus d'un souci. Le systme d'exploitation
en grand n'a pas encore envahi notre agriculture, mais bien des symptmes
permettent de redouter qu'il ne l'envahisse bientt. La proprit tant morcele en
France, la grande culture avec l'emploi des machines y est impossible. Les
conomistes n'ont eu aucune peine dmontrer que quarante petites fermes
transformes en une seule cotent infiniment moins exploiter et peuvent tre
beaucoup mieux exploites. Le fait matriel n'est pas contestable ; mais ce que les
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
308
conomistes oublient d'examiner, c'est l'influence morale considrable qu'exerce la
rpartition du sol entre des mains nombreuses. La proprit est la seule base
possible sur laquelle puisse s'appuyer une dmocratie voulant viter l'anarchie. La
triste condition de l'individu condamn dans une usine un abrutissant travail
engendre forcment dans son me la haine de l'ordre social. L'usine a fait de
l'ouvrier moderne un nomade sans patrie que rien n'attache au sol qui l'a vu natre
ou aux institutions qui l'entourent. Elle a t le plus puissant dmoralisateur des
classes sociales infrieures. La proprit du sol, si minime que soit la portion
possde, exerce une influence tout fait contraire. Nous devons redouter une
poque o, l'volution conomique laquelle nous assistons tant complte,
l'agriculture sera devenue galement manufacturire, et o toutes les petites
proprits, maintenant morceles, seront runies en d'immenses domaines. Ce jourl les petites fermes d'aujourd'hui auront fait place de vastes usines agricoles,
possdes par des lgions d'actionnaires, o l'ancien petit propritaire, devenu
ouvrier son tour, ne sera plus qu'un rouage. Toute la production industrielle et
agricole sera alors concentre dans des manufactures gigantesques o des millions
de manuvres, courbs sous un rgime plus dur que l'esclavage des temps antiques,
et dont des lois de fer pourront seules contenir les colres, regretteront les temps si
maudits autrefois par eux.
Lorsque l'organisation actuelle de la proprit aura disparu, les gnrations
futures devront chercher pour les socits de l'avenir de nouvelles bases. La
proprit est le dernier fondement encore debout, mais sap de toutes parts, des
difices politiques et sociaux des anciens ges.
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
309
Deuxime partie
LES SOCITS
Leurs origines et leur dveloppement
livre III : Dveloppement des socits
Chapitre IV.
Dveloppement des croyances religieuses.
Retour la table des matires; retour au dbut du chapitre
1. Formation des croyances religieuses. - Sentiment religieux chez l'animal. - Gense des
croyances religieuses. - lments dont se compose le sentiment religieux chez l'homme. - Ses
transformations, - II. volution des religions. - Ancienne division des cultes en ftichisme,
monothisme et polythisme. - Minime valeur de ce classement. - En quoi consiste rellement
l'volution des religions. - Les cultes primitifs. - Toutes les choses de la nature ont t
successivement adores. - Adoration des animaux, des astres, etc. - Culte des morts. - Sa
gnralit. - Origine des sacrifices. -Leur gnralit dans les religions. - Culte des grands
hommes. - Prtendue origine des dieux antiques suivant les linguistes. - Les grands cultes dits
monothistes. - Le judasme, le brahmanisme, le bouddhisme, le christianisme. - Tous ces cultes
ont t en ralit polythistes. - III. Comment les peuples transforment leurs religions. - De mme
que le langage, chaque culte se transforme suivant la constitution mentale du peuple qui le reoit.
- Comment le mme culte peut tre ftichiste, polythiste et monothiste, suivant les individus
qui l'ont adopt. - Exemples fournis par le bouddhisme et le christianisme transplants en divers
pays. - Formation de l'islamisme et du protestantisme. - IV. Les religions de l'avenir. - Les vieilles
croyances ne sont plus en rapport avec la conception du monde rsultant des dcouvertes de la
science moderne. - Disparition de la croyance dans l'ide de divinit. - Les vieilles croyances
s'vanouissent, mais le sentiment religieux reste vivant dans les mes. - Formation d'un idal
nouveau et de croyances nouvelles. - Les religions en voie de formation seront-elles meilleures
que celles qui les ont prcdes ?
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
310
Nous avons tudi dans un prcdent chapitre l'influence des croyances
religieuses sur l'existence de l'homme, sans rechercher comment ces croyances se
sont tablies. Nous allons tenter de montrer maintenant comment elles naissent et
se dveloppent.
L'ide que les religions puissent subir les lois de l'volution n'aurait pas eu de
sens pour la plupart des historiens il y a bien peu d'annes encore. Imbus ou non de
croyances religieuses, ils n'eussent pas manqu de faire observer que les religions
sont choses essentiellement dogmatiques, et qu'une fois tablies, tous les efforts de
leurs disciples tendent conserver immuable le dpt des vrits absolues rvles
par leurs fondateurs.
Bien que la science des religions soit toute moderne et commence peine se
constituer, il est possible de montrer dj que les croyances religieuses sont
soumises galement aux lois de l'volution, et que, de mme que les institutions
politiques, elles se transforment suivant les besoins des peuples qui vivent sous
leurs lois ; que la religion d'une race est toujours en rapport avec sa constitution
mentale ; que cette race peut bien changer de religion comme elle peut changer de
langue, mais que, de mme que le langage, la religion accepte est bientt
entirement transforme.
Sans doute, la science moderne a tabli que toutes les religions, depuis le
ftichisme le plus grossier jusqu'aux croyances les plus idales, ne sont que des
illusions pures ; mais il ne faut pas oublier que ces illusions ont profondment agit
et continuent encore agiter le monde. Ce n'est donc pas une tche vaine que de
rechercher les lois qui prsident leur naissance et leurs transformations.
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
311
I. - Formation des Croyances
religieuses.
Retour la table des matires; retour au dbut du chapitre
Si nous voulons bien comprendre les ncessits sous l'empire desquelles
naissent, grandissent et se transforment les religions, nous devons les examiner
d'abord sous leurs formes les plus infrieures et rechercher jusque chez l'animal
l'origine du sentiment religieux.
Pendant longtemps on a considr qu'une des distinctions fondamentales entre
l'animal et l'homme consistait dans ce que ce dernier seul possdait le sentiment
religieux.
Quand nous examinerons ce qu'on appelle le sentiment religieux, nous verrons
qu'il se compose d'lments assez complexes, parmi lesquels dominent surtout la
crainte, la conscience de la dpendance et le dsir d'obtenir quelque chose. Or il est
vident, comme le fait justement observer Darwin, qu'on retrouve le germe des
sentiments religieux chez les animaux, notamment dans l'amour profond qu'a le
chien pour son matre, amour auquel se joignent une soumission complte, un peu
de crainte, et peut-tre d'autres sentiments . Le professeur Braubach va jusqu'
admettre que le chien regarde son matre comme un dieu .
Des observations nombreuses, dont j'ai dj cit quelques-unes, prouvent qu'un
grand nombre de peuples ne possdent aucune ide de divinit. Les Fijiens, dit-on,
n'ont aucune crmonie religieuse et soutiennent avec orgueil qu'il n'y a pas de
diables dans leur pays. Mais tous les peuples possdent plus ou moins des
superstitions diverses qui constituent en dfinitive des croyances religieuses. Le
sauvage qui a plusieurs fois rencontr un serpent, alors qu'il entreprenait des
expditions suivies de succs, finit par en conclure que le serpent porte bonheur. Il
peut ne pas avoir de divinits, il a dj une croyance religieuse.
Aussi, bien que beaucoup de peuples n'aient aucune ide de ce que nous
appelons la divinit, tous possdent des croyances religieuses, et cela par la raison
que tous ont quelque chose esprer ou craindre. Contrairement l'opinion de
tant d'auteurs, le besoin d'expliquer ce qui les entoure n'est pour rien dans ces
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
312
croyances. Nous avons vu, en tudiant l'tat intellectuel des premiers hommes, que
la recherche de l'explication des phnomnes de l'univers est autant en dehors de
leurs proccupations, qu'elle peut l'tre de celles des paysans modernes. Demandez
l'homme des champs s'il s'tonne de voir une graine se transformer en arbre, le
soleil paratre le matin et disparatre le soir. Rien ne lui semble plus simple. Comme
tous les tres vivants, l'homme ne s'tonne que de ce qu'il n'est pas habitu voir.
Mais, si les sauvages ne s'tonnent pas du spectacle de la nature et n'prouvent
nullement le besoin de l'admirer, ils ont appris la craindre. Le sauvage qui a vu
apparatre dans ses songes l'ombre menaante d'un ennemi, qui a vu la foudre sortir
d'un nuage et tuer son semblable, le vent renverser sa cabane, sait que le monde est
plein de choses redoutables, et qu'il se trouve dans la dpendance complte de
puissances mystrieuses, le vent, l'orage, l'ombre des morts, etc., sur lesquelles il
est sans action. Toutes ces puissances qu'il ne connat pas, il ne peut naturellement
les comparer qu' celles qu'il connat ; il doit donc les supposer doues de volont,
c'est--dire semblables lui, et, comme l'exprience lui a prouv qu'il ne peut agir
sur ses semblables plus forts que lui que par des supplications et des prsents, il
agit de mme en prsence de chaque puissance inconnue qui se manifeste par ses
effets. Comme l'a dit le pote latin, c'est la peur, en ralit, qui a enfant les dieux :
Primus in orbe Deos fecit timor.
L'homme a toujours t prt adorer ce qui lui paraissait craindre. Lorsque les
Indiens, qui ne connaissaient pas les chevaux, virent les cavaliers espagnols avec
leurs armes feu, ils se mirent immdiatement adorer ces tres redoutables qui
vomissaient la foudre. Le sauvage qui aperoit un fusil pour la premire fois, et qui,
aprs avoir jug de ses effets terribles, lui adresse des prires et lui offre des
prsents, obit un sentiment de mme ordre. Le Pre Bougeyron rapporte que des
missionnaires ayant fait venir en Australie un bouledogue, les habitants, dsireux
d'obtenir les faveurs de cet tre inconnu, et, par consquent, surnaturel, que son
aspect faisait croire redoutable, vinrent en pompe lui offrir des prsents et lui tenir
un discours.
Cette adoration d'objets inconnus et redoutables est toujours, comme on le voit,
le rsultat d'une association d'ides qui se fait dans l'esprit du sauvage entre les
puissances qu'il ne connat pas et celles qu'il connat, et qui pour lui sont toujours
forcment du mme ordre. Le lion mordant la flche qui l'a atteint, l'enfant frappant
le mur contre lequel il s'est heurt, agissent sous l'influence d'associations inconscientes analogues.
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
313
C'est galement par des associations de choses diffrentes prises pour
semblables que peuvent s'expliquer un grand nombre de superstitions, telles que
l'adoration des ftiches, c'est--dire d'objets quelconques que l'on croit dous de
vertus surnaturelles. Un individu a constat que plusieurs choses heureuses lui
taient arrives quand il portait un objet ; l'association des ides lui fait croire
aussitt que cet objet a le pouvoir de porter bonheur, et il lui accorde
immdiatement la vnration que mrite un tel pouvoir.
C'est d'une faon analogue qu'ont d se former une foule de croyances trs
rpandues encore : celles, par exemple, qu'un morceau de corde de pendu puisse
porter bonheur ; que si treize personnes sont runies table, il en mourra une dans
l'anne ; qu'il est dangereux de partir en voyage un vendredi, etc. Ceux qui ont eu
occasion d'examiner des joueurs de profession n'ont pas besoin de savoir comment
se forment les croyances des sauvages pour s'expliquer comment le culte des
ftiches peut se constituer.
Telle a t, rduite son expression la plus simple, l'origine de nos croyances
religieuses. Il ne faut pas y chercher, comme je l'ai dit dj, l'admiration de la
nature ou le besoin de l'expliquer ; ce sont l des sentiments bien inconnus des
sauvages et que la grande majorit des hommes civiliss eux-mmes ne connaissent
gure. Il y faut moins chercher encore, comme l'a fait dans un ouvrage rcent un
clbre linguiste, une aspiration vers l'infini . Ce sont l des explications de
mtaphysiciens qui supposent aux sauvages leurs ides et leur faon de raisonner.
Demandez au rustre qui laboure sa terre s'il prouve parfois des aspirations vers
l'infini, autant vaudrait l'interroger sur la parent du grec avec le sanscrit.
Nous considrerons donc le sentiment religieux comme constitu en dernire
analyse par un mlange d'lments complexes o dominent surtout le sentiment de
dpendance troit de l'homme l'gard de ce qui l'entoure, la peur des puissances
qu'il suppose remplir la nature, la supposition que ces puissances sont analogues
lui, le dsir de se concilier leurs faveurs en leur offrant des prsents et en
s'humiliant devant elles. Qu' mesure que l'homme a avanc en civilisation, d'autres
lments soient venus s'ajouter ceux qui prcdent, je n'en disconviens pas ; mais
l'origine, et aujourd'hui encore, chez la plupart des hommes, le sentiment
religieux a t ce que je viens de dire. Avec le temps, et suivant la disposition des
caractres et l'tat des connaissances, les religions ont pu se transformer et devenir
l'amour du crateur et de ses cratures, la reconnaissance des devoirs qu'on se
suppose envers Dieu, l'admiration de l'ordre universel de la nature, le dsir de
connatre l'inconnu, et mme, chez certains philosophes, l'ide que les mondes et
les tres qui les habitent ne sont que de pures illusions, manifestations transitoires
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
314
de la divinit. Dans toutes ces transformations des sentiments religieux se retrouve
toujours au moins un des lments qui les constituaient d'abord, le sentiment de
notre dpendance.
II. - volution des Religions.
Retour la table des matires; retour au dbut du chapitre
On a cru pouvoir diviser en trois classes distinctes : le ftichisme, le
polythisme et le monothisme, les formes diverses par lesquelles les croyances
religieuses de l'humanit auraient successivement pass. Le ftichisme serait
caractris par la tendance envisager tous les phnomnes et tous les tres de la
nature comme dous de volonts analogues celles de l'homme, et constituant des
puissances suprieures qu'il faut adorer. Le polythisme serait constitu par
l'adoration d'tres suprieurs spars des choses de la nature et les gouvernant. Le
monothisme consisterait dans la croyance en un seul tre crateur et matre de
l'univers.
Ces distinctions nous semblent n'avoir qu'une importance trs secondaire. Les
sentiments qui ont prsid aux croyances ftichistes ont prsid galement aux
croyances polythistes, qui en diffrent bien plus en apparence qu'en ralit. Quant
au monothisme, on peut bien citer des religions qui se disent monothistes, mais
on ne citerait gure d'individus qui n'adorent qu'un seul dieu. La trinit du christianisme est entoure de tout un monde de demi-dieux : anges, saints, etc., divinits
trs puissantes ayant leurs fidles et leurs temples. Ce culte, donn souvent comme
type des religions monothistes, est au contraire un vritable mlange de
monothisme, de polythisme et mme de ftichisme, comme le prouve la foi en la
vertu des mdailles, des sources miraculeuses et des amulettes.
En fait, la principale volution que subissent les religions peut se ramener, au
point de vue de la forme, la restriction des cultes particuliers et l'extension des
cultes gnraux ; au point de vue du fond, la restriction progressive du nombre
des phnomnes dans lesquels intervient la puissance des dieux. L'homme le plus
religieux ne croit plus aujourd'hui qu'un dieu lance la foudre ou qu'une desse fait
mrir les moissons.
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
315
Laissant de ct ces considrations gnrales, nous allons, la lumire des
principes qui prcdent, examiner quelques-unes des croyances religieuses qui se
sont succd dans le cours des ges.
Nous avons vu, en tudiant la formation du sentiment religieux, comment
s'taient constitues les premires croyances de l'homme. Les choses qu'il craignait,
celles qu'il croyait pouvoir lui porter bonheur, taient celles qu'il adorait. Comme il
avait bien des choses craindre et que beaucoup d'entre elles avaient pu tre
associes aux vnements qui lui taient arrivs, la liste des objets de son adoration
tait immense, et on trouverait vrai dire bien peu d'tres ou d'objets qu'il n'ait pas
adors : les pierres, les plantes, les animaux, les fleuves, la mer, le soleil, les astres,
ont t l'objet de son culte.
Quelques-uns de ces cultes taient spciaux certains peuples ; mais il en est, le
culte des animaux, par exemple, qui ont exist peu prs partout. Le castor chez les
Peaux-Rouges, le jaguar dans les tribus du Brsil et de la Plata, les loups sur la cte
de Guine, le crocodile, le taureau sacr, l'ibis chez les anciens gyptiens, le
serpent chez les Hbreux et chez les Grecs, les Africains et la plupart des peuples,
et bien d'autres espces animales qu'il serait sans intrt d'numrer, ont t l'objet
de l'adoration des hommes.
Le culte des astres est galement extrmement commun. On a distingu ce culte
en culte ftichiste, dans lequel l'astre serait le dieu lui-mme, et en culte
polythiste, dans lequel l'astre serait seulement la demeure d'un dieu. Je doute
cependant que des diffrences si subtiles se soient jamais bien fortement implantes
dans le cerveau de la foule des adorateurs.
Mais, de tous les cultes, le plus gnral peut-tre a t celui des morts. Son
importance a t juge considrable par plusieurs auteurs modernes, MM. Spencer,
Summer Maine, F. de Coulanges notamment. Le premier des savants que je viens
de citer fait driver de leur adoration toutes les religions, le dernier y cherche
l'origine de toutes les institutions politiques et sociales de la Grce et de Rome. Le
culte des morts a eu videmment une importance considrable, mais ce serait
l'exagrer beaucoup que de le considrer comme ayant jou un rle aussi
prpondrant.
L'origine du culte des morts a d tre partout la mme. C'est celle qu'a trs bien
dcrite autrefois Lucrce. Voyant les morts se prsenter lui dans ses songes et
accomplir des choses merveilleuses, l'homme dut en conclure que la mort ne dtruit
pas les tres, qu'il reste d'eux quelque chose d'invisible et de puissant ; et comme
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
316
lui-mme, dans ses rves, pouvait voyager et accomplir certains actes, il devait en
conclure que cette partie invisible peut facilement se sparer du corps.
L'vanouissement devait galement lui faire croire que dans d'autres circonstances
elle peut galement s'absenter.
L'ide que l'me puisse se sparer du corps et avoir une existence indpendante
aprs la mort a t gnrale chez tous les peuples ; mais la conception qu'on s'est
faite de sa nature a t trs variable. Chez les Dakotas de l'Amrique du Nord,
l'me se subdivise aprs la mort, une partie reste sur terre, l'autre va dans l'air, une
troisime rejoint les esprits, une dernire reste prs du corps.
Gnralement ces mes vont rejoindre les anctres dans un autre monde ; mais
si, comme chez les Grecs et les Romains, les corps ne recevaient pas de spulture,
elles ne pouvaient y pntrer et restaient sur terre poursuivre les vivants.
Le sjour attribu aux esprits des morts a vari suivant les peuples. Le plus
habituel tait le tombeau lui-mme, - d'o la ncessit pour le corps d'avoir une
spulture. - Quelquefois l'me allait habiter dans les cavernes, les bois, les
montagnes, les profondeurs de la terre, ou au contraire diverses rgions du ciel.
Comment se concilier ces morts, dont les visites faites aux vivants pendant leur
sommeil avaient montr la puissance ? Par les seuls moyens que l'exprience a
enseigns l'homme pour se concilier les vivants, les supplications et les prsents.
Quels prsents leur offrir ? Ceux encore qui plaisent aux vivants. Chaque chose
ayant son ombre, l'ombre des prsents devait naturellement donner satisfaction
l'ombre des morts ; et c'est ainsi qu'on arriva placer sur le tombeau du dfunt des
aliments et enterrer avec lui des armes et des objets de costume et d'ornement. Si
le mort tait un guerrier puissant, on immolait pour le servir dans l'autre monde ses
chevaux et ses serviteurs. L'ombre du dfunt revtue de l'ombre de ses armes,
monte sur l'ombre de son coursier et entoure de l'ombre de ses serviteurs, pouvait
arriver ainsi en tenue convenable dans le royaume des morts. Au Dahomey, quand
un roi meurt, on commence par lui crer une garde du corps en immolant cent de
ses soldats, sans compter un certain nombre d'habitants, heureux d'accompagner
chez les ombres un si puissant souverain. Il en tait de mme au Prou. A la mort
d'un Inca, fils du soleil, on faisait prir sur sa tombe un grand nombre de femmes et
d'hommes ; des vierges du temple du Soleil taient immoles pour former une cour
au prince dfunt. A Bali, on immolait sur la tombe du sultan toutes les femmes de
son harem. Chez un grand nombre de peuples, on tue sur la tombe du mort ses
femmes et ses esclaves. Suivant Homre, Achille gorge aux funrailles de Patrocle
des prisonniers troyens avec les chevaux et les chiens de son ami. Lorsque
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
317
Clytemnestre est avertie par un songe que les mnes d'Agamemnon sont irrits
contre elle, elle se hte d'envoyer des aliments sur son tombeau. L'usage de
sacrifier des animaux et des esclaves sur la tombe des guerriers existait encore chez
les Gaulois.
Bien qu'on tcht de se concilier la faveur des morts, on n'enviait pas
gnralement leur sort. Nous en avons la preuve par ces paroles qu'Homre place
dans la bouche d'Achille descendu aux enfers : Ne cherche pas me consoler de
la mort, noble Ulysse ; j'aimerais mieux cultiver comme mercenaire le champ d'un
pauvre homme sans patrimoine et sans fortune que de rgner sur la foule entire
des ombres lgres.
C'est de ce culte des morts et de l'habitude de leur offrir des prsents et des
sacrifices que drivent la plupart des rites religieux. On ne peut dire qu'il ait perdu
son empire sur les mes, car de nos jours encore la plupart des religions, la religion
catholique notamment, possdent encore le culte des morts. On les croit assez
puissants en effet pour obtenir des faveurs.
Naturellement la puissance des morts devait varier suivant ce qu'ils avaient t
pendant leur vivant, et il devait arriver que les esprits des rois et des hros d'une
tribu taient l'objet du culte de tous les membres de la tribu et mme des tribus
voisines. L'histoire nous montre souvent des peuples voisins se disputant les
cendres d'un grand homme pour lui lever un temple et se concilier ainsi ses
faveurs. Les Spartiates drobent par supercherie les ossements d'Oreste, Athnes
s'empare de ceux de Thse enterrs dans l'le de Scyros et leur lve un temple
pour augmenter le nombre de ses dieux protecteurs.
Nous voyons ainsi apparatre clairement l'origine de toute une srie de divinits
nombreuses. Les Grecs et les Romains en taient arrivs diviniser leurs rois et
leurs empereurs. Chez eux, du reste, les mots dieux, esprits, dmons taient peu
prs synonymes. Les Romains dcernaient aux morts le nom de dieux mnes.
Rendez aux dieux mnes ce qui leur est d, dit Cicron ; ce sont des hommes qui
ont quitt la vie. Tenez-les pour des tres divins. Alors que les anciens enterraient
leurs morts dans le voisinage de leurs maisons, chaque maison devenait un temple.
L'homme, suivant l'expression d'un pote, vivait dans un peuple de dieux. De nos
jours encore ils sont si nombreux pour certains peuples que l'Arabe en jetant une
pierre devant lui demande pardon aux esprits qu'il a pu frapper.
La puissance qu'on supposait aux esprits leur faisait confier, chez certains
peuples, des fonctions bizarres. Les Fidjiens immolaient un homme au pied de
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
318
chaque pilier de la case d'un chef, pour attacher un esprit la conservation de
l'difice. Des superstitions analogues se sont conserves jusqu'au moyen ge. On
enfouissait frquemment dans les fondements des monuments un homme ou une
femme vivante, souvent la propre femme de l'architecte, pour lui assurer de la
solidit.
Quelquefois on destinait l'esprit se venger de quelque ennemi. Tylor rapporte
que deux brahmanes croyant qu'un homme leur avait vol quarante roupies prirent
leur propre mre et, de son consentement, lui couprent la tte afin que son ombre
pt tourmenter et poursuivre jusqu' la mort le voleur. Chez les Alfourous des
Moluques, on enterre des enfants vivants jusqu'au cou, et on les laisse l en plein
soleil en leur introduisant du sel et du poivre dans la bouche pour exciter leur soif
jusqu' leur mort, de faon les mettre en fureur et pouvoir lancer leur esprit
exaspr contre les ennemis de l'oprateur.
Chez tous les peuples, le principal moyen employ pour se concilier les esprits a
toujours t de leur offrir des sacrifices d'hommes ou d'animaux. Ceux offerts aux
dieux proprement dits ne diffraient des autres qu'en ce qu'ils se pratiquaient sur
une plus grande chelle. Chez les Phniciens, les Aztques, etc., on faisait rtir les
victimes petit feu, ou bien on les corchait vivantes. Au Mexique, on immolait
galement, suivant Bancroft, des nourrissons que les prtres dvoraient ensuite
avec les grands du royaume. On sacrifiait aussi des enfants que l'on faisait mourir
de faim et de peur en les enfermant dans des caves noires. Nous n'avons pas trop le
droit d'accuser ces peuples de frocit, si l'on songe qu'il n'y a pas fort longtemps
que nos anctres chrtiens croyaient tre agrables leur Dieu en enduisant de
soufre les prtendus hrtiques et en les faisant brler ensuite petit feu. Les dvots
diront que c'tait pour le bien de leur me, et que ces sacrifices taient faits au vrai
Dieu 89. Mais il n'y a pas un sauvage qui n'aurait le droit d'invoquer l'appui de ses
superstitions des raisons exactement semblables. Je ne vois aucune distinction
srieuse faire entre la frocit des uns et celle des autres. L'homme que le
sentiment religieux fanatise devient vraiment un bien vilain animal, et si, comme
nous le disent les religions, Dieu nous a crs son image, cela donne une fort
laide ide de ce crateur.
89
L'immolation des sorciers peut tre range aussi dans cette catgorie des sacrifices qu'on croyait agrables
aux divinits. Sans parler de l'Espagne, terre classique des bchers, o les Maures et les Juifs ne vont jamais
sans la sorcire, on en brle 7,000 Trves, et je ne sais combien Toulouse ; Genve 500 en trois mois, 800
Wurtzbourg, presque d'une fourne, 1,500 Bamberg (deux petits vchs). Ferdinand, le bigot cruel, empereur
de la guerre de Trente ans, fut oblig de surveiller tous ces bons vques, ils eussent brl tous leurs sujets... En
une seule fois, le seul Parlement de Toulouse met aux bchers 400 corps humains. Qu'on juge de l'horreur, de la
noire fume de tant de chair, de graisse qui, sous les cris perants, les hurlements, fond horrible, bouillonne.
Michelet, la Sorcire.
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
319
Les sacrifices humains, communs d'abord dans la plupart des religions, sont
devenus ensuite assez rares ; cependant ils se sont maintenus assez longtemps chez
des peuples civiliss, notamment chez les Grecs et les Romains. Nous avons vu
plus haut qu'Achille avait immol des guerriers troyens aux mnes de Patrocle.
Lubbock donne une liste assez longue de sacrifices humains accomplis par divers
empereurs : Csar, Auguste, Trajan, Commode, Caracalla et Hliogabale ;
cependant, au temps de Pline, ils taient dj devenus trs rares. Chez les Juifs, les
sacrifices humains n'existaient plus aux poques de la Bible, mais ils devaient avoir
t frquents auparavant ; on s'expliquerait difficilement autrement la facilit avec
laquelle Abraham excute les ordres du Seigneur, quand celui-ci lui eut prescrit de
lui offrir en holocauste son fils Isaac. Habituellement les Juifs n'offraient leurs
dieux que des animaux, mais ces sacrifices constituaient la partie la plus importante
de leurs rites. Presque tout le Lvitique est consacr aux prescriptions relatives
ces crmonies. Dans ces gorgements si agrables Jhovah et dont il vante
Mose l'agrable odeur lorsque brlent les pieds et les intestins, le nombre des
victimes tait considrable. Salomon gorge en une seule fois vingt-deux mille
boeufs et cent vingt mille brebis.
C'est surtout dans le culte des morts, notamment des morts illustres, qu'il faut
rechercher l'origine de la plupart des divinits de la Grce et de Rome. Diviniss
aprs leur mort, les grands hommes sont adors par une ou plusieurs villes, et la
lgende transformant leur histoire en fait des divinits de plus en plus puissantes ;
mais ce n'est que graduellement qu'ils arrivrent tre adors par tout un peuple.
Ce n'est que la similitude du nom qui a pu faire supposer plus tard qu'il en avait
toujours t ainsi. Il y avait en ralit d'abord un nombre considrable de Jupiters,
de Junons, d'Hercules, de Dianes, ayant chacun sa lgende et son culte. Rome avait
sa Junon et Vies avait la sienne, et quand le dictateur Camille assigea cette
dernire ville, il supplia la Junon de l'ennemi de lui tre favorable.
Tous les dieux de la Grce antique ne diffrent des hommes que parce qu'ils sont
plus puissants et immortels ; mais ils en ont les passions, le genre de vie, et il leur
arrive de se laisser sduire par de simples humains. Achille est le fils de Thtis.
ne a pour mre la blonde Vnus. A chaque page de la guerre de Troie, on voit les
dieux intervenir dans la lutte, ou mme combattre entre eux. Achille est considr
comme redoutable parce qu'il a toujours au moins l'un des immortels combattant
ses cts. Quand ne va tre tu par Achille, Neptune le soustrait aux coups du
hros. Apollon donne des conseils dans le combat Hector pour lui donner le
moyen d'viter un danger.
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
320
On sait que les linguistes modernes ont donn de l'origine des dieux antiques
une explication autre que celle qui prcde. Suivant eux, les choses de la nature, le
soleil, le feu, la lune, etc., auraient d'abord t adors comme des tres
impersonnels, et n'auraient ensuite t personnifis dans le cours des sicles que
parce qu'on a pris la lettre les expressions figures par lesquelles on les dsignait.
Les dieux n'auraient d'abord t que des noms, de simples pithtes appliqus par
les Aryens aux phnomnes qui frappaient leurs regards. Le Zeus des Grecs est un
mot sanscrit qui signifie brillant. Le mythe de la desse Sln, venant embrasser
son bien-aim Endymion dans la caverne de Latmos, reprsente la lune caressant de
ses ples rayons les flots o se couche mystrieusement le soleil.
Que quelques mythes aient pu prendre ainsi naissance, cela est possible. Que
tous les dieux aient eu une telle origine, cela ne saurait tre admis un seul instant.
Les causes qui font natre les croyances religieuses, et sur lesquelles nous avons
suffisamment insist, sont entirement indpendantes de ces subtilits linguistiques.
Examinons maintenant comment sont sortis des lments qui prcdent les
grands cultes, dits monothistes, qui depuis tant de sicles rgnent sur la majorit
des hommes. Les plus rpandus sont le judasme, le bouddhisme, le christianisme et
l'islamisme.
En fait, ce mot de monothisme est fort mal imagin, car aucun culte n'est
rellement monothiste. Si ces religions admettent un dieu principal crateur de
toutes choses, - et encore ce dieu comprend-il dans la plupart d'entre elles trois
personnes, - il est entour de nombreuses divinits infrieures, saints, anges,
prophtes, etc., ayant aussi leur culte. Le panthon hindou ou chrtien n'est pas
moins riche en divinits que l'tait l'Olympe.
Une des plus anciennes religions que nous connaissons, le judasme, est
habituellement cite comme monothiste ; mais c'est une assertion qui, pour un
lecteur attentif de la Bible, ne soutient pas l'examen. Loin d'tre monothistes, les
Juifs ont ador un grand nombre de dieux. Sans doute Jhovah rclamait sans cesse
la priorit par la voix de ses prtres, mais ses rclamations rptes sont peu
coutes, comme le prouve la ncessit o il se trouve de les renouveler
frquemment ; bien souvent le peuple a plus de confiance dans ses autres dieux
qu'en Jhovah lui-mme. Nous voyons au troisime livre des Rois que Salomon
ddie des temples Astart, Moloch et divers dieux. Les menaces de Jhovah ne
semblent pas effrayer beaucoup plus les descendants de Salomon qu'elles n'avaient
effray ce dernier, car Roboam offre en adoration Isral des veaux d'or. Au mme
livre des Rois, on voit que Baal possdait lui seul 450 prophtes dans Isral ; ce
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
321
qui implique videmment un culte trs rpandu. Il y avait bien d'autres divinits, du
reste, adores par les Juifs. Le culte de Priape notamment y semblait solidement
constitu. Au chapitre XV du troisime livre des Rois, il est dit en effet que : Asa
purgea Jrusalem des idoles que son pre y avait dresses. Il ta aussi l'autorit sa
grand'mre Maacha, afin qu'elle n'et plus l'intendance des sacrifices Priape.
Le culte ftichiste des pierres existait galement, car nous voyons Isae reprocher
Isral d'avoir mis sa confiance dans les pierres des torrents : Vous avez mis votre
confiance dans les pierres des torrents ; c'est l votre partage. Vous avez rpandu
des liqueurs pour les honorer, vous leur avez offert des sacrifices.
Naturellement, les auteurs de la Bible, sectateurs de Jhovah, qualifiaient de
faux dieux tous les rivaux de leur divinit ; mais bien que l'histoire des Juifs ne soit
connue qu' travers ces relations intresses, elle suffit pour assurer que les dieux
adors par eux ont t nombreux, et que Jhovah, malgr ses incessantes
rcriminations, n'a obtenu que fort tard une supriorit bien marque.
Il l'obtint cependant, et nous voyons par l un exemple du passage du
polythisme au monothisme. C'est ainsi toujours, du reste, qu'il s'effectue. Le Dieu
qu'on suppose le plus puissant finit par obtenir la suprmatie sur ses rivaux et les
supplanter. Chez les Grecs, Jupiter, qualifi de roi des dieux et des hommes, avait
fini aussi par prendre une suprmatie marque sur les autres dieux, et, si le culte des
vieilles divinits mythologiques et dur plus longtemps, il ft devenu aussi
monothiste que les cultes juif et chrtien.
Bien que n'ayant nullement l'intention d'esquisser ici l'histoire des grands cultes
monothistes, je suis oblig de dire quelques mots des plus importants d'entre eux,
afin de mettre en vidence les lois gnrales de leur gense et de leurs
transformations.
Au premier rang des plus anciens et des plus importants se trouvent les deux
grands cultes de l'Inde, le brahmanisme et le bouddhisme. Le bouddhisme, fond
par le bouddha Cakya-Mouni, six sicles avant Jsus-Christ, est assurment la plus
grandiose des conceptions philosophiques et religieuses qui soit sortie du cerveau
des hommes. Il nous offre ce spectacle, trange pour nous, d'une religion sans dieu,
- ce qui ne l'empche pas d'avoir une morale trs pure, - professe par 500 millions
de disciples.
Bien entendu, le bouddhisme ne sortit pas plus que le christianisme de toutes
pices de la tte de son fondateur. Par son scepticisme et beaucoup de ses ides
philosophiques, il drive trs nettement du brahmanisme qui l'avait prcd et dont
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
322
les doctrines philosophiques taient trs profondes. D'o vient cette cration ?
disent les Vdas ; est-elle luvre d'un crateur ou non ? Celui qui contemple du
haut du firmament, celui-l le sait. Peut-tre lui-mme ne le sait-il pas.
Dans cette antique religion des brahmes, les tres taient considrs comme
composs d'lments indestructibles ; aprs leur mort, ils se dissolvaient dans leurs
principes et retournaient au sein de Brahma, un des dieux de la grande trinit
hindoue. Dans une des fables de l'Hitopadsa, le sage Capila, voulant consoler un
pre de la mort de son fils, lui dit : A quoi bon de tant t'affliger ? Ne sais-tu pas
que le corps, compos des cinq lments, retourne dans le Pantchatouan (de
pantcha, cinq), et se rsout dans chacun de ses Principes ? Tout ce qui meurt tait
considr comme renaissant bientt, sous une forme ou sous une autre, mais avec
des lments semblables, ce qui est exactement ce que la chimie nous enseigne
aujourd'hui.
Dans la doctrine du Vdanta, une des branches les plus leves du
brahmanisme, il n'existe qu'un seul tre, cause du monde, et constituant ce monde
lui-mme. Tout vient de lui, tout est lui et tout rentre dans lui. Ce n'est que par
l'effet d'une illusion que les cratures s'attribuent une existence individuelle hors de
la divinit. L'univers n'est qu'un rve immense qui s'accomplit dans l'esprit
suprme.
Il est vident que ces hautes thories philosophiques seraient restes lettres
closes pour la foule ; mais pour elle le culte est matrialis sous forme de divinits
innombrables, dont l'existence n'est fictive que pour les fidles qui ont atteint aux
degrs suprieurs de l'initiation. Le culte des morts, notamment, joue un rle
considrable. Le brahmane doit se marier pour avoir des enfants qui puissent rendre
un culte ses mnes. Du reste, le brahmanisme comprend une infinit de sectes qui
ont choisi chacune quelques-unes des divinits du Panthon indien pour objet
spcial de leur culte.
C'est de cette antique religion que, par des transitions analogues celles qui
transformrent le judasme en christianisme, est sorti le bouddhisme. Il prit
naissance dans des circonstances analogues celles qui permirent l'closion du
christianisme. Il apparut parmi des races conquises, o il n'y avait plus pour les
foules d'autre philosophie possible que la rsignation et l'espoir dans quelque chose
de meilleur. La vie semblait alors si dure que ce quelque chose de meilleur dont
l'esprance devait conqurir tant d'mes fut simplement le nant.
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
323
Le dveloppement de cette doctrine ne pouvant trouver place ici, je me bornerai
emprunter M. Taine quelques extraits, traduits par lui, de l'important ouvrage de
Koeppen 90. Il est regrettable qu'il n'ait pas song, de mme que la plupart des
auteurs qui l'ont prcd, montrer comment la religion nouvelle naquit des cultes
antrieurs.
Il n'y a point de matire premire, point de principe qui se dveloppe, point de
Dieu crateur et antrieur au monde. Mme c'est une hrsie, l'hrsie du dernier
des six imposteurs, que d'affirmer l'existence d'un tre suprme crateur du
monde et de tout ce que le monde contient .
L'ide de l'tre stable et subsistant par soi-mme est aussi antipathique leur
doctrine que la forme circulaire l'est au carr. Point de cause premire. La nature est une
srie infinie de naissances et de destructions, un enchanement infini de causes qui sont
des effets et d'effets qui sont des causes, une ligne infinie en arrire, infinie en avant, de
dcompositions et de recompositions qui n'ont pas eu de commencement et qui n'auront
pas de terme. Telle est la vue d'ensemble laquelle ils sont conduits, d'un ct par leur
ide matresse du nant, de l'autre ct par le spectacle des choses incessamment
changeantes. Ayant supprim les causes fixes, il ne leur reste que la srie des effets
mobiles .
Aprs avoir quitt le palais de ses pres, akya-Mouni passe sept annes dans la
pnitence. L le prince de ce monde, Mara, dieu de l'amour, du pch et de la mort, vint
l'assaillir avec toutes ses tentations, par la terreur de ses temptes, par l'assaut de ses
armes, par les attraits de ses filles. Le saint homme demeure calme, l'effroi ne l'branle
point, car il considre tous les lments comme une illusion et un rve. La beaut ne le
sduit pas, car les corps les plus charmants ne lui semblent qu'une bulle d'eau et un
fantme. Les dmons sont vaincus et l'illumination intrieure commence. Il se rappelle ses
naissances antrieures et celles de toute les cratures, il embrasse d'un seul regard les
mondes immenses et innombrables, il saisit l'enchanement infini de tous les effets et de
toutes les causes, il perce travers l'apparence trompeuse du devenir et de l'tre, dcouvre
le nant, qui est la vraie substance des choses, et atteint la doctrine suprme qui conduit
au salut.
Quatre vrits composent cette doctrine. Toute existence est une souffrance, parce
qu'elle comporte la vieillesse, la maladie, la privation et la mort. Mais ce qui a fait d'elle
une souffrance, c'est le dsir, sans cesse renouvel et sans cesse contrari, par lequel nous
nous attachons aux objets, la jeunesse, la sant, la vie. - Donc, pour dtruire la
souffrance, il faut dtruire ce dsir. -Pour le dtruire, il faut renoncer soi-mme se
dlivrer de la soif de l'tre , ne plus sentir d'attrait pour un objet ni pour aucun tre.
Telle est la doctrine primitive. Trs probablement akya-Mouni n'est pas all au
del. Mais, en sondant plus avant, on trouve pour fondement une profonde conception
90
Die Religion des Buddha und ihre Enstehung.
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
324
mtaphysique, et les penseurs qui sont tous venus plus tard n'ont pas manqu de la
dgager. Le sage atteint au renoncement et l'insensibilit en considrant que tout tre
tant compos est prissable, qu'tant prissable il est une simple apparence sans solidit
ni support, un phnomne en train de disparatre, semblable l'cume qui se fait et se
dfait la surface de l'eau, l'image qui flotte dans un miroir ; bref, par la conviction
profonde que les choses ne sont pas. L'tre n'existant pas, la naissance n'existe pas ; par
l'anantissement de la naissance, la vieillesse, la mort, la misre, les lamentations, les
douleurs, l'inquitude, le trouble, sont anantis. C'est ainsi que le grand amas de douleurs
sera ananti.
Arriv cette conscience de son nant, l'homme chappe la souffrance ; car la
souffrance, comme l'tre, n'tant qu'une fume, s'vanouit avec l'tre dans
l'vanouissement universel. Il est dsormais affranchi ; les vnements n'ont plus de prise
sur lui, il se repose ternellement dans la pacifique sensation du vide qui est son fond et le
fond de toute chose. Il a touch le Nirvna, il est Bouddha.
Dans l'espace infini se trouvent un nombre infini de mondes travers lesquels,
pendant des myriades de sicles, migrent les cratures. Les cieux suprieurs ne touchent
plus le monde et sont clairs par leur propre lumire.
L sont les Bouddhas futurs, attendant le moment de s'incarner pour la dernire fois
et de sauver les mondes. Toute cette rgion est encore sous la domination de Mara, le
prince du dsir, le tentateur des Bouddhas. Pour s'affranchir de lui, il faut s'lever jusqu'
la suivante, entrer dans le monde des formes pures. L sont les Brahmas, puis les dieux de
la pure lumire, plongs dans l'intuition extatique, affranchis du raisonnement, et qui
pensent sans succession d'images ; plus haut les tres vertueux et purs ; plus haut encore,
les dlivrs, ceux qui ne sont plus assujettis la mtamorphose et ont chapp la
conscience et la douleur. Au degr suprieur s'ouvrent les quatre rgions du monde sans
couleur ni formes, o les corps thrs eux-mmes disparaissent ; c'est le ciel des
Bouddhas.
Ces rgions sont les suivantes : celle de l'espace sans limites, celle de la sagesse sans
limites, celle o il n'y a plus rien, celle o il n'y a plus ni pense, ni non-pens ; au del
s'tend le Nirvna, le pur rien, l'extinction complte.
Sortir non seulement de la vie, mais de l'tre, tel est le souverain bien. C'est cela
que les Bouddhas, travers des millions d'existences, aspirent et arrivent par des
sacrifices et des renoncements infinis, abandonnant ou donnant leurs biens, leur vie, leur
chair, la chair et la vie de leurs plus proches bien-aims, de leurs enfants, de leur
femme.
Sduisante doctrine qui depuis plus de deux mille ans tient la majorit des
hommes sous ses lois. De tous les mirages que l'imagination humaine a crs, elle
est un des plus charmants peut-tre. Quel penseur ne l'a souvent rv, ce repos
final, ce pur nant que la science nous dfend d'esprer ? Le repos du tombeau n'est
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
325
qu'un repos d'un jour, nous en sortons bientt sous des formes nouvelles. De ce
sommeil trompeur de la tombe, l'infatigable matire se dgage bien vite pour
former de nouveaux tres et recommencer des incarnations nouvelles, sans que rien
puisse jamais mettre un terme ces transmigrations ternelles.
Bien que la religion de Bouddha se ramne la ngation de toute divinit, elle a
une morale trs leve. Un chrtien convaincu, Max Mller, se voit lui-mme
oblig de l'avouer : La morale la plus leve qui ait t enseigne l'humanit
avant l'avnement du christianisme, dit-il, fut enseigne par des hommes aux yeux
desquels les dieux taient des ombres vaines, par des hommes qui n'levaient point
d'autels, qui n'en levaient pas mme au dieu inconnu.
Le bouddhisme se rapproche du christianisme non seulement par sa morale et
son mpris des choses du monde, mais aussi par ses pompes, Son organisation
religieuse et le pouvoir spirituel d'un chef unique analogue au pape. Il n'en diffre
gure en pratique que par l'idal de vie future qu'il propose aux mditations des
hommes. Au point de vue philosophique, les conceptions du bouddhisme, de mme,
du reste, que celles du brahmanisme, sembleront certainement, aux penseurs
dpourvus de prjugs, trs suprieures celles du christianisme.
Les circonstances au milieu desquelles naquit le christianisme se rapprochent
beaucoup, ainsi qu'il a t dit plus haut, de celles qui prsidrent la formation du
bouddhisme. Rome avait conquis le monde connu ; la paix romaine rgnait partout.
N'ayant plus lutter, le colosse commenait se dsagrger ; les vieilles croyances
n'avaient plus de prise sur les mes. Le nombre des dshrits, des misrables, des
pauvres, des opprims, des esclaves, de ceux qui n'avaient rien esprer tait
immense. Des illumins, gnralement d'origine juive ou syrienne, fondaient des
sectes diverses qui runissaient de nombreux partisans. Une d'entre elles devait
finir par l'emporter ; ce fut celle de Jsus et de Paul qui obtint ce rle. Tous les
peuples n'en formant qu'un sous la loi romaine, une religion universelle, impossible
quelques sicles plus tt, pouvait facilement se constituer.
J'ai montr dans un autre chapitre l'importance du rle que le christianisme a
jou dans le monde. Il n'est pas ncessaire d'y revenir maintenant. L'avenir seul, du
reste, apprciera avec une indpendance suffisante le rle de toutes ces croyances.
III. - Comment les Peuples
transforment leurs Religions.
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
326
Retour la table des matires; retour au dbut du chapitre
Les grandes religions qui se sont rpandues travers le monde se sont
propages parmi des races trs diffrentes, et par consquent parmi des
constitutions mentales fort diverses. Faut-il admettre qu'elles ont pli les peuples
leurs dogmes en apparence invariables, ou que ce sont, au contraire, leurs dogmes
qui se sont transforms suivant les peuples qui les ont adopts ? Un croyant
quelconque affirmera sans doute que, les dogmes tant invariables, les peuples sont
bien obligs de les accepter sans y rien changer ; mais un observateur attentif
reconnat bientt, malgr le petit nombre de documents laisss par les historiens,
qu'il en est des religions comme des langues et des institutions politiques ; qu'on
peut les imposer par la force ou la persuasion un peuple, mais que ce peuple leur
fait bientt inconsciemment subir des modifications qui les mettent en rapport avec
sa constitution mentale, c'est--dire avec son caractre, sa faon de sentir et de
penser. J'ai montr, dans un autre chapitre, ce qu'tait devenu bientt le latin en
Gaule. Les religions et les institutions transportes d'un peuple l'autre subissent
promptement des changements aussi profonds. Quand des hommes remarquables,
tels que Cakya-Mouni, Jsus-Christ, Luther, etc., crent ou plutt transforment une
religion, ils ne font en ralit que coordonner des croyances antrieures, et leur
faire subir les transformations en rapport avec des ncessits nouvelles. Ces
ncessits varient suivant chaque peuple. Tous ceux qui adoptent la religion qui
leur est apporte sont obligs de la transformer. Sans doute la lettre du dogme
restera invariable ; mais ce sera une vaine formule dont chacun interprtera le sens
sa faon, et, sous cette apparence uniforme d'une mme croyance, les peuples
divers seront, comme je l'ai dit dj, ftichistes, polythistes ou monothistes.
Entre les conceptions religieuses d'un chrtien comme Descartes et celles d'une
vieille dvote qui croit dans la puissance de ses amulettes, ou du lazzarone qui se
prosterne devant sa madone mais injurie celle qui se trouve ct, il n'y a de
commun que le nom de leur croyance. Au fond, le ftichisme de la dvote, le
polythisme du lazzarone et le monothisme probable du philosophe correspondent
des constitutions mentales absolument diffrentes.
La ncessit de se plier aux sentiments et l'intelligence de chacun des
sectateurs d'un culte avait t bien comprise par les anciennes religions de l'Inde,
dont nous avons dj admir la sagesse. La conception panthistique des choses
que j'ai cite plus haut serait trop leve pour tre la porte des foules. Il leur faut
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
327
des tres matriels adorer. Il existe pour elles tout un panthon de divinits
infrieures que les initis recommandent leur adoration bien que sachant qu'elles
n'existent pas. Le croyant qui veut arriver, par la mditation et l'tude, aux
rvlations suprieures, passe par une srie d'initiations dans lesquelles la croyance
s'pure de plus en plus avec les progrs de son intelligence, jusqu' ce qu'il arrive
envisager les dieux, les sacrifices, les crmonies et lui-mme comme des formes
vaines.
C'est surtout quand une mme religion passe d'un peuple un autre qu'on petit
suivre ses transformations. En passant en Chine, le bouddhisme s'est transform au
point qu'on l'a considr longtemps comme une religion nouvelle, et qu'on a eu
beaucoup de peine dcouvrir sa vritable origine. La haute philosophie de CakyaMouni ne pouvant pntrer dans des cervelles de race jaune s'est transforme en un
vritable polythisme, dont une des principales divinits est My, la mre de
Bouddha. Au Thibet et au Japon, le bouddhisme a subi galement des
transformations profondes. Le christianisme n'a pas eu en subir, par la raison que
son influence en Orient a t absolument nulle. Alors que le bouddhisme a conquis
pacifiquement l'Inde et la Chine, les missionnaires chrtiens n'ont jamais pu y
obtenir la moindre influence, malgr les guerres sanglantes dont ils ont t la cause.
Leur fanatisme et leur intolrance n'ont eu d'autres rsultats que de produire la plus
vive rpulsion chez les indignes.
Cette conception de la transformation des religions, par chaque peuple jette des
lumires profondes sur leur histoire. Sans doute, comme le dit Hegel, de la
religion dcoule fatalement la forme de l'tat . Mais la religion, d'o dcoule-telle, sinon de la constitution mentale de chaque race, c'est--dire de la majorit des
individus de cette race ? Dans toutes les questions sociales, c'est toujours cet
lment fondamental que nous nous trouvons obligs de remonter.
Ce serait prcisment en y remontant que nous arriverions comprendre les
principales transformations du christianisme, l'islamisme et le protestantisme,
vritables adaptations d'un mme culte aux besoins de races diffrentes.
L'islamisme, avec sa thorie de l'unit de Dieu, a t certainement une forme
purifie du christianisme, pratique par des esprits beaucoup plus distingus que
ceux adonns ce dernier culte. Il ne faut pas oublier, en effet, qu' une poque o
l'Europe tait en pleine barbarie, le dogme nouveau eut pour adeptes des races chez
lesquelles la littrature, les arts et les sciences brillaient du plus vif clat. Dans cet
empire immense o flottait, de la Tartarie l'Espagne, la bannire du prophte, et
qui faillit comprendre la France, florissaient des universits brillantes. Bagdad,
Sville, Grenade, Cordoue, etc., comptaient des milliers d'tudiants. Les Arabes
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
328
traduisaient l'Iliade et l'Odysse et faisaient en chimie, en astronomie, en physique
et dans diverses autres sciences, des dcouvertes importantes ; ils construisaient des
palais dont nous admirons aujourd'hui l'architecture savante. Aucune ville moderne
n'a dploy plus de got et d'lgance que les capitales arabes du X sicle, alors
que nous tions encore de purs barbares. Arrivs une certaine priode de
grandeur, les Arabes ont subi la loi commune, dcliner et mourir ; mais ils ont jou
dans l'histoire un rle dont il ne faut pas permettre l'intolrance de mconnatre la
grandeur.
Le protestantisme a reprsent galement une forme suprieure du christianisme
adapte aux besoins des peuples qui l'avaient accueillie. Il rendit d'abord le culte
moins polythiste, et plus tard, but qu'il ne se proposait nullement tout d'abord,
favorisa l'closion de la libre pense. Il apprit l'homme discuter ses croyances et
rgler lui-mme sa vie. Tel qu'il existe aujourd'hui avec ses sectes innombrables,
dont quelques-unes, telles que celle des unitariens, ne reconnaissent pas la divinit
du Christ, le protestantisme implique une culture intellectuelle trs suprieure
celle que la pratique du catholicisme exige, et reprsente dans certaines de ses
formes la religion la moins en opposition avec la conception des choses rsultant
des dcouvertes modernes.
Rien ne serait plus intressant que d'analyser les dispositions d'esprit qui
rendirent la Rforme possible chez certains peuples, impossible chez d'autres ; mais
c'est une tche que nous ne pouvons mme pas effleurer ici. Les historiens
tranchent facilement le problme en nous reprsentant Luther crant par sa fantaisie
la rforme, Henri VIII tablissant le protestantisme en Angleterre, sa fille Marie
Tudor rtablissant le catholicisme ; son autre fille lisabeth obligeant ses sujets
revenir au protestantisme , et les peuples obissant servilement tous ces caprices
de leurs matres ; mais ce sont l des explications enfantines qui ne mritent mme
pas la discussion.
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
329
IV. - Les Religions de l'Avenir.
Retour la table des matires; retour au dbut du chapitre
Les antiques croyances dont nous venons d'esquisser l'histoire taient en rapport
troit avec les ides des peuples qui les avaient adoptes. branle par les
dcouvertes de la science moderne, l'antique conception du monde a fini par se
trouver en complte opposition avec les vieilles croyances et chaque jour ces
dernires perdent un peu de leur empire sur les mes. Il n'y a que dans les parties du
globe o la science n'a pas pntr encore, telles que l'Orient, que les primitives
croyances ont conserv leur empire.
Les dcouvertes modernes ont branl jusqu' l'ide de la divinit, qui, il y a peu
d'annes encore, semblait difie sur des bases de granit. La psychologie nous a
montr que, confins absolument dans un troit relatif, et ignorant la ralit de
toutes choses, nous ne pouvions former que des conjectures sans fondement sur
leurs origines. Qu'il y ait quelque part des tres suprieurs nous, on peut l'admettre ; que ces tres se soient jamais occups de nous, il n'en existe pas la preuve
la plus lgre. Sans doute nous ne pouvons admettre que tous les milliers de
mondes qui peuplent l'espace soient arrivs exactement au mme degr d'volution
que le ntre, et il peut s'en trouver dont les habitants les plus misrablement dous
au point de vue intellectuel soient aussi suprieurs aux plus grands hommes de
l'humanit que Pascal ou Newton peuvent l'tre un crustac. Mais, je le rpte, on
ne citerait pas une preuve que l'un de ces tres ait jamais manifest autre chose que
la plus profonde indiffrence pour nous. Le fort peut craser le faible, le vice
triompher de la vertu, cela les proccupe aussi peu que la vie des insectes que nous
foulons en passant. Si de tels tres existent, si mme un crateur tout-puissant,
ayant quelque analogie avec notre ide de Dieu, se trouve au sommet des choses,
ils ne se sont jamais occups de nous, et nous n'avons pas nous occuper d'eux.
C'est en prsence de cette conviction croissante dans les mes que les vieilles
croyances s'teignent, et aujourd'hui une des plus puissantes d'entre elles, le dogme
chrtien, perd chaque jour son empire 91.
91
Les thologiens ont peu prs renonc eux-mmes trouver une preuve de l'existence de la divinit et en
sont rduits, comme base de leurs dmonstrations, des appels au sentiment. Voici par exemple un extrait que
j'emprunte un journal scientifique catholique, d'un cours profess par un M. Alix, que le journaliste qualifie de
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
330
Il a rgn dix-huit sicles sur les mes. Pendant ces dix-huit sicles, il a
envelopp l'homme d'illusions, adouci son existence et donn un but sa vie ; mais,
sous l'empire de ncessits nouvelles, il devait subir, comme les religions qui
l'avaient prcd, la loi fatale des choses : natre, grandir, dcliner et mourir.
Devant les clarts froides que la science moderne a projetes sur lui, il ne peut plus
vivre, et les gnrations modernes assistent maintenant aux convulsions qui
prsagent son agonie.
Sans doute, elles seront terribles, mais ses jours sont certainement compts.
Aujourd'hui, les vieux dogmes luttent en dsesprs ; l'hrdit les rend encore
puissants sur les mes, et, par moments, nous les voyons nergiquement revivre.
Nous avons assist une renaissance semblable au lendemain de nos dsastres. En
dpit des conqutes de la science moderne, on a vu une assemble souveraine,
compose d'hommes instruits et distingus, voter une loi dclarant d'utilit publique
l'glise que l'archevque de Paris, la suite d'une souscription nationale,
proposait d'lever sur la colline de Montmartre en l'honneur du Sacr-Coeur de
Jsus, pour appeler sur la France, et en particulier sur la capitale, la misricorde et
la protection divines . L'glise ddie ce culte du Sacr-Coeur, fond autrefois
par une pauvre fille hystrique, hallucine et folle, fut construite avec cette
ddicace : Sacratissimo cordi Jesu Christi Gallia poenitens et devota.
Le sceptique peut considrer de tels phnomnes d'un oeil railleur ; le
philosophe, qui remonte aux ncessits qui les ont engendrs, y voit une prouve
nouvelle de ce besoin d'illusions qui vit dans l'me des hommes, et dont on peut
certainement dire qu'aprs le sentiment de la faim, il est un des plus nergiques.
Le sentiment religieux est tellement enracin dans les mes, qu'il reparat
toujours sous une forme quelconque, mme chez ceux qui, par l'tendue de leur
culture, sembleraient soustraits son empire. La religion des philosophes s'appelle
la mtaphysique. Les forces de la nature, pesanteur, attraction, etc., par lesquelles
nous essayons aujourd'hui d'expliquer des phnomnes incomprhensibles, et qui
restent tout aussi incomprhensibles, du reste, aprs nos explications, ne sont pas
chef de la doctrine de l'universit catholique : Nous sommes certains, dit ce thologien, que Dieu existe.
Cependant aucune exprience ne peut le dmontrer, et l'homme religieux n'en a pas d'autres preuves
matrielles que les battements qui agitent son cur l'ide qu'on pourrait lui arracher sa croyance. On pourrait
en dire autant de l'existence de l'me. (Revue mdicale, 20 novembre 1876, p. 648.)
Si nous tions obligs de nous contenter dans les sciences des preuves que peuvent fournir les battements de
notre coeur en faveur de telle ou telle doctrine, je doute que les progrs raliss depuis Aristote aient t bien
marqus. Le coeur des thologiens a battu fortement l'ide qu'on pourrait leur arracher leurs croyances en
l'immobilit de la terre. Mais, heureusement pour les progrs de l'humanit, personne en dehors des thologiens
n'attache d'importance de pareils arguments.
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
331
sans parent avec les anciens dieux qui soutenaient le monde. La nature elle-mme,
cette bienfaisante et mystrieuse nature laquelle nous laissons maintenant le soin
de gurir nos maladies, n'est pas sans ressemblance avec la providence de nos
pres.
L'homme russira-t-il jamais se soustraire ce besoin religieux qui est au fond
de lui-mme ? Cela est bien douteux, et sans doute le dernier homme exhalera son
dernier soupir en invoquant encore ces vains mais puissants fantmes.
Si les dieux doivent prir pour toujours, ce ne sera srement pas le sicle actuel
qui les verra prir. L'ancienne religion n'est pas morte encore, et dj nous en
voyons se former une nouvelle en possession d'un idal nouveau.
Cet idal nouveau, que des esprances fondes sur les tonnantes dcouvertes de
la science moderne ont fait natre, n'est pas encore constitu sous forme de religion,
mais il ne lui manque gure que ce nom. Le bonheur n'est plus ralisable dans une
vie future, mais dans le monde actuel, grce une rorganisation radicale des
socits modernes. Une divinit suprieure, nomme Progrs, et d'autres divinits
accessoires, telles que l'Humanit, la Libert, la Fraternit, l'galit, conduiront
l'homme au bonheur.
La religion nouvelle a dj ses croyants, elle aura bientt ses martyrs. Les
peuples s'apprtent maintenant se massacrer pour l'idal nouveau, avec autant
d'acharnement et de conviction qu'ils l'ont fait jadis pour les idals anciens qu'ont
adors leurs pres.
Il serait difficile de prvoir ce que produira la religion future, en train de se
former maintenant. A en juger par les aspirations de ses diverses varits de
sectateurs, elle ne promet pas d'tre plus tolrante ni moins cruelle que les
anciennes. Tout porte croire, au contraire, qu'elle sera plus dure.
L'idal nouveau n'est pas plus ralisable, en effet, que ceux qui l'ont prcd,
mais l'idal ancien ne devait se raliser qu'aprs la mort, et personne ne pouvait
savoir qu'il avait t tromp. Avec l'idal nouveau, il sera vite facile, au contraire,
de voir qu'on s'est tromp ; on dclarera naturellement alors qu'on s'y est mal pris,
et il faudra recommencer chaque gnration des dmolitions et des rorganisations nouvelles.
Impuissante devant ces fatalits, la science doit se borner les prvoir. Elle
essaie d'clairer les hommes, mais avec la claire conscience du peu de succs de ses
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
332
tentatives. C'est la passion, et non la froide raison, qui conduit les foules. La raison
peut instruire l'homme, elle ne saurait crer une religion pour lui. C'est aux
hallucins qu'appartient ce rle. Le monde n'en a jamais manqu.
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
333
Deuxime partie
LES SOCITS
Leurs origines et leur dveloppement
livre III : Dveloppement des socits
Chapitre V.
Dveloppement de la morale.
Retour la table des matires; retour au dbut du chapitre
1.
Variabilit de la morale. - Origine de la morale. -Hypothses
errones sur son invariabilit. - Preuves de sa transformation. - II. Morale des animaux. Dveloppement des qualits morales chez l'animal. - Impossibilit d'tablir une sparation entre
le sens moral de l'homme et celui des animaux. - III. Morale des tres humains infrieurs :
sauvages, femmes et enfants. - tat barbare de la morale des sauvages. - Absence d'ides de
justice et de bienveillance - Pourquoi la morale de quelques tribus sauvages est assez dveloppe.
- La morale de l'enfant de l'homme civilis se rapproche de celle du sauvage. - tat infrieur du
dveloppement moral de la femme. - IV. Les facteurs de la morale. - Il n'y a point de principes
absolus d'o on puisse dduire la morale, mais il existe des facteurs nombreux, variables suivant
les temps, qui la dterminent. - Influence de ces divers facteurs. - L'utilit. - L'opinion. - Le
milieu. - La slection. - La coutume. - La sympathie. - La religion. -L'ducation. - Les lois. L'intelligence et la raison. - V. volution future de la morale. - L'tat moral d'un peuple a
gnralement plus d'influence sur sa destine que l'tat de son intelligence. - Influence de
l'abaissement de la moralit romaine sur la dcadence de Rome. - La morale actuelle s'appuie sur
des croyances en voie de disparatre. - Formation de la morale de l'avenir.
I. - Variabilit de la Morale.
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
334
Retour la table des matires; retour au dbut du chapitre
On dfinit habituellement la morale l'ensemble des rgles d'aprs lesquelles
nous dirigeons notre conduite.
Le sens moral serait l'aptitude qui permet l'homme de discerner le bien et le
mal, de juger si les motifs qui le font agir, lui et ses semblables, mritent d'tre
glorifis ou blms.
L'origine de cette aptitude a t, de la part des philosophes, l'objet de
controverses qui ne semblent pas prs d'tre termines. Il n'y a pas bien longtemps
encore, c'tait une croyance gnrale que le sens moral est une facult inne,
irrductible, tablie en nous par un crateur, et qui nous permet des jugements
absolus, sans appel, malgr les suggestions de l'intrt et des passions. Les
dfenseurs de cette doctrine, qui ont compt des penseurs tels que Kant, Condorcet,
Buckle, etc., soutiennent que la morale de tous les peuples est identique et reste
invariable travers les ges. Sans conteste, dit Buckle dans un passage que j'ai
dj cit, on ne trouvera rien au monde qui ait subi aussi peu de changements que
ces grands dogmes qui composent le systme moral : faire du bien autrui, sacrifier
son prochain ses propres volonts, l'aimer comme soi-mme, pardonner ses
ennemis, contenir ses passions, honorer ses parents, respecter ceux qui sont audessus de vous.
Condorcet soutenait galement que la morale de toutes les nations a t la
mme, et Kant disait que dans la morale nous ne sommes pas alls plus loin que les
anciens.
Les dcouvertes de la science moderne montrent combien est peu fonde une
telle croyance. Elles ont prouv que cet oracle mystrieux et surnaturel, appel le
sens moral, s'est form sous l'influence de causes faciles mettre en vidence, qu'il
a vari suivant les temps et les races, et qu'aux ges primitifs les lois de la morale
moderne eussent t absolument incompatibles avec les conditions d'existence des
hommes. Si nos premiers anctres avaient fait du bien autrui, sacrifi leur
prochain leurs propres volonts, mnag les vaincus, conserv des bouches inutiles,
ils ne seraient jamais sortis de la barbarie primitive et aucune civilisation n'aurait
pu natre.
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
335
En tudiant dans divers chapitres de cet ouvrage le dveloppement de nos
conceptions et notamment de celles relatives l'volution de la famille, j'ai montr
combien nos ides morales avaient subi des transformations profondes. Pascal
rsume nettement leur histoire quand il dit que le larcin, l'inceste, le meurtre des
enfants et des pres, tout a eu sa place entre les actions vertueuses . Sans doute il
en a t ainsi, mais ce n'est pas par suite des caprices humains, comme le croyait le
grand penseur. Les causes qui ont transform les vertus en crimes, appartiennent
ces ncessits qui chappent aux volonts des hommes, et c'est trs justement que
ce qui est vrit en de des Pyrnes est erreur au del .
Rechercher quelles furent ces ncessits et comment se sont lentement
transformes les lois morales qui dirigent notre conduite sera le but de ce chapitre.
II. - Morale des animaux.
Retour la table des matires; retour au dbut du chapitre
Pour bien comprendre l'volution de la morale chez l'homme, nous l'tudierons
d'abord sous ses formes les plus infrieures, et commencerons par rechercher ce
qu'elle est chez les animaux.
L'tude des socits animales prouve que, chez beaucoup d'entre elles, les
qualits morales sont trs dveloppes. J'ai dj eu occasion de montrer que le
dvouement au bien de la communaut, l'abngation, le travail, l'pargne, le
courage, l'obissance aux ordres des suprieurs, la tendresse pour les petits, la
constance dans l'affection, s'y observent frquemment. Plusieurs de ces qualits
sont mme plus dveloppes chez les animaux que chez bien des sauvages, ce que
l'on comprend facilement, en se souvenant que les bauches de la civilisation crent
d'abord des conditions peu favorables au dveloppement des qualits que nous
venons de mentionner. Les mmes animaux, que nous voyons se dvouer entre eux,
tuent souvent ceux des leurs qui, blesss, ne pourraient plus suivre le troupeau et
seraient condamns prir misrablement, comme si un secret instinct les
avertissait que cette mort rapide est le meilleur service qu'ils leur puissent rendre.
C'est l exactement ce que font les sauvages qui tuent leurs parents trop gs pour
suivre la tribu dans ses prgrinations.
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
336
En prsence des sentiments manifests par les animaux, on comprend trs bien
que des naturalistes, cependant fort religieux, comme Agassiz, aient pu arriver
cette conclusion que la gradation des facults morales dans les animaux
suprieurs et dans l'homme est tellement imperceptible que, pour dnier aux
premiers un certain sens de responsabilit et de conscience, il faut exagrer outre
mesure les diffrences qu'il y a entre eux et l'homme .
Le grand naturaliste Darwin est un de ceux qui ont runi le plus de faits
dmontrant que la morale de l'homme est l'panouissement de la morale des
animaux ; mais il semble que les conclusions tirer des faits runis par lui l'aient
un peu effray. Aprs avoir montr que certains animaux, comme le chien, savent
parfaitement dlibrer, choisir entre des motifs contraires, et possdent quelque
chose qui ressemble beaucoup la conscience , il arrive conclure de la faon
suivante : Je partage entirement l'opinion des auteurs qui admettent que, de
toutes les diffrences qui existent entre l'homme et les animaux, c'est le sens moral
ou la conscience qui est de beaucoup la plus importante.
Je crois qu'en nonant cette proposition, l'illustre naturaliste tait sous l'empire
de prjugs hrditaires auxquels il n'avait pas encore su se soustraire. En se basant
prcisment sur les faits si probants qu'il invoque, on pourrait retourner sa
proposition et dire : Que, de toutes les diffrences qui sparent l'homme des
animaux, c'est le sens moral ou la conscience qui est de beaucoup la moins
importante.
Les raisons sur lesquelles se fonde Darwin pour diffrencier la morale de
l'homme de celle des animaux sont en ralit trs -faibles : Un tre moral, dit-il,
est celui qui est capable de comparer ses actes ou ses motifs passs ou futurs, et de
les approuver ou de les dsapprouver. Nous n'avons aucune raison pour supposer
que les animaux infrieurs aient cette facult ; par consquent, lorsqu'un singe
brave le danger pour sauver son camarade, ou prend sa charge un singe orphelin,
nous n'appelons pas sa conduite morale. Mais, dans le cas de l'homme, qui seul
peut tre considr avec certitude comme un tre moral, les actions d'une certaine
classe sont appeles morales, qu'elles soient excutes aprs dlibration, aprs une
lutte contre des motifs contraires, par suite des effets d'habitudes acquises peu
peu, ou enfin d'une manire impulsive et par instinct.
Il semblerait, d'aprs le commencement de ce passage, qu'il n'y aurait d'tre
moral que celui qui est capable de comparer ses actes ou ses motifs passs ou futurs
et de les approuver ou de les dsapprouver. Mme s'il en tait ainsi, on ne pourrait
refuser le sens moral certains animaux comme le chien, par exemple. Ce dernier
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
337
sait trs bien, en effet, approuver ou dsapprouver ses propres actes et prouver des
remords. Nous en avons la preuve dans la violence de ses lamentations,
lorsqu'aprs avoir, par exemple, cd un accs de gourmandise et drob l'aliment
de son matre, il rflchit aux consquences de sa faute, c'est--dire la mauvaise
impression qu'elle produira et peut-tre au chtiment qui l'attend. A la fin du
paragraphe que je citais plus haut Darwin ajoute que chez l'homme, -- pourquoi
uniquement chez l'homme ? - les actions peuvent tre morales bien qu'instinctives,
et il confirme cette assertion dans le passage suivant : Un acte souvent rpt par
nous finit par se faire sans hsitation, sans dlibration, et alors ne se distingue plus
d'un instinct ; personne ne prtendra cependant que cet acte cesse d'tre moral.
Nous sentons tous, au contraire, qu'un acte ne peut pas tre considr comme
parfait, comme accompli de la manire la plus noble, s'il n'est pas excut
impulsivement sans rflexion et sans efforts, excut, en un mot, comme il le serait
par l'homme chez lequel les qualits requises sont innes.
Je partage entirement sur ce dernier point l'opinion de Darwin ; je tcherai
mme de montrer que la morale n'est rellement constitue que quand elle est
devenue tout fait instinctive. Mais, par cela mme qu'il en est ainsi, il n'y a
aucune raison de refuser le sens moral aux animaux sous le prtexte que leur
conduite est le plus souvent instinctive. Si l'homme n'tait bon et vertueux que par
raison, au lieu de l'tre par nature, c'est--dire par instinct, si sa morale n'avait pour
base que d'abstraits raisonnements, les hommes bons et vertueux seraient plus rares
que les diamants la surface du globe. L'homme n'ayant que la raison pour guide
peut bien exister dans les livres, mais il n'a jamais t donn un oeil humain de le
contempler. La raison ne nous sert gure qu' chercher aprs coup des motifs aux
actes que nos sentiments nous ont fait accomplir, et il est rare que les motifs qu'elle
croit dcouvrir soient rellement ceux qui nous font agir.
III. - Morale des tres humains infrieurs :
sauvages, femmes et enfants.
Retour la table des matires; retour au dbut du chapitre
Nous avons dj eu occasion de montrer combien, relativement nos ides
modernes, la morale des sauvages est infrieure. Tuer et piller sans scrupule tous
les individus trangers leur tribu, massacrer leurs parents gs, manger leurs
femmes quand elles vieillissent, tuer et souvent dvorer leurs enfants quand ils sont
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
338
trop nombreux, vivre dans la promiscuit la plus complte, leur semble tout naturel.
Compare aux rgles idales d'aprs lesquelles nous avons la prtention de juger
tout le genre humain, cette morale est assurment grossirement barbare. Elle est
cependant exactement adapte leurs conditions d'existence et a les mmes
sanctions que la ntre, c'est--dire l'opinion appuye par des prescriptions lgales et
religieuses. Quand un Vitien enterre en crmonie sa mre vivante parce qu'elle ne
peut plus gagner sa vie et approche de la vieillesse, il est convaincu, et toute sa
tribu est convaincue comme lui, qu'il remplit un devoir. Aussi les parents et amis
sont-ils invits la crmonie qui se fait en grande pompe et commence par un
grand festin. En ralit, fait remarquer Lubbock, ils considrent cet usage comme
une si grande preuve d'affection qu'on ne peut trouver que des fils pour s'en
acquitter. Ils ont, du reste, indpendamment des ncessits rsultant de leurs
conditions d'existence, des motifs religieux pour justifier leur conduite. Suivant
eux, en effet, l'individu mort devant revivre au ciel dans l'tat o il a quitt la terre,
leur dsir est que leurs parents meurent avant d'avoir t trop affects par la
vieillesse, et ce dsir est partag par les parents eux-mmes. Il ne faut pas oublier
quand nous jugeons la morale et les moeurs des races infrieures, que les ides et
les principes avec lesquels nous les jugeons n'ont pu tre acquis qu'aprs des
milliers d'annes d'efforts. Pour comprendre la gense des conceptions morales du
sauvage, il faut absolument mettre de ct ces ides de justice, de bienveillance, de
respect de la vie humaine que de lentes laborations sculaires ont fixes dans nos
mes. L'Australien n'a mme pas de mots dans sa langue pour les exprimer. Il ne
saurait les comprendre, et, le jour o il arriverait les comprendre, il ne serait plus
un sauvage. Dans quelques langues de la Polynsie, dit J. Lubbock, il n'y a qu'un
seul mot pour bon et bien, pour mauvais et mal. Aussi les missionnaires ont-ils eu
beaucoup de peine faire comprendre aux Caldoniens, par exemple, qu'il est mal
de manger son semblable. Je t'assure que c'est bon, rpondaient-ils au rvrend
vque qui leur disait que c'est mal.
Ce n'est pas sans doute que certains sauvages ne pratiquent parfois les vertus
que nous avons constates, du reste, chez les animaux. Elles sont mme plus
naturelles que les instincts contraires, et, lorsque les conditions d'existence rsultant
de la formation des socits ne les ont pas dtruites, on les observe gnralement.
Dans les pays o la douceur du climat, l'abondance de la nourriture rendent la vie
facile, la destruction des vieillards, des enfants et des bouches inutiles, ne s'observe
pas ; les individus ont des moeurs simples, hospitalires, et sont toujours prts
s'entr'aider. Certaines tribus de l'Inde, qui semblent des reprsentants des races
indignes qui occupaient le pays avant l'invasion aryenne, telles que les Kols, les
Santals, etc., possdent un haut degr le sentiment du devoir. Ils sont excellents
laboureurs, chasseurs et guerriers, et si braves, au dire de Tylor, qu'ils se font tuer
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
339
jusqu'au dernier plutt que de se rendre. Les Kurubars du Dekhan ne mentent
jamais, et cette rputation est si tablie, que dans les contestations ce sont eux qu'on
croit toujours. On leur confie sans hsitation la garde d'une rcolte, parce qu'on sait
qu'ils sont si honntes qu'ils mourraient de faim plutt que de drober un seul grain.
C'est trs exceptionnellement, malheureusement, que se sont rencontres les
conditions qui ont donn aux races infrieures une morale leve, et il faut avancer
gnralement assez loin dans l'histoire pour que la morale des peuples infrieurs
commence s'purer. Relativement nos ides modernes, la morale des Grecs du
temps d'Homre, quand on l'examine de prs, n'tait pas trs suprieure celle des
sauvages.
C'est surtout en examinant la morale des enfants, qui pendant la premire partie
de leur vie mentale reproduisent, comme nous le savons, les phases par lesquelles
ont pass leurs anctres, que nous pouvons reconnatre quel point la morale de ces
anctres a t infrieure. J'ai dj montr combien le sens moral est nul chez
l'enfant. Gourmands, voleurs, cruels, gostes, ignorant absolument la piti, ne
sachant pas rsister leurs impulsions, ils reprsentent trs bien l'tat moral des
sauvages et des premiers hommes. Le seul mobile de leur conduite est la crainte.
Ce n'est que par elle, et en aucune faon par des discours, qu'on arrive les habituer
dominer un peu leurs instincts, du moins quand ces instincts ne sont pas trop
forts, car, lorsqu'il s'agit de quelque chose de bien tentant, comme de battre un
camarade plus faible, torturer un animal, voler quelque gourmandise, etc., l'enfant
qui semble le mieux lev ne rsiste gure la tentation.
La femme, qu'on peut considrer au point de vue intellectuel comme
intermdiaire entre l'enfant et l'homme, n'occupe pas videmment la mme place au
point de vue moral. Elle peut tre assurment range parmi les tres infrieurs dont
la moralit est faible, mais ce qu'elle en possde diffre beaucoup de celle de
l'homme et de l'enfant. Elle a une morale d'impulsion sur laquelle les ides d'quit,
et mme souvent d'intrt personnel, n'ont aucune prise. Cette morale sans fixit,
que je qualifierais volontiers de baromtrique, en ce sens qu'elle est aussi variable
que les oscillations de la colonne mercurielle dans le baromtre, dpend tout fait
du milieu et des circonstances o les femmes se trouvent ou, en d'autres termes, de
l'instinct du moment. Celles invariablement bonnes ou invariablement mauvaises
sont l'exception. Ce qu'elles apportent gnralement en naissant, et ce qui les
diffrencie essentiellement de l'homme enfant, qui n'est qu'un petit animal goste
et cruel, c'est un fonds de douceur, de sympathie, de piti et de dvouement pour les
tres faibles et malheureux, aussi instinctif chez elles que le besoin de couver chez
l'oiseau. Alors que l'homme enfant ne songe gure qu'au mal qu'il pourra faire, la
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
340
petite fille a des instincts de gnrosit et de dvouement qu'il faut qu'elle satisfasse
sur un tre ou un objet quelconque. Le chat, l'oiseau, la fleur, la poupe, le
mendiant du coin, sont indiffremment l'objet de sa sympathie. A l'ge des
passions, ce besoin de dvouement se localisera sur l'individu qu'elle aimera. Sa
morale sera exactement alors la morale ncessaire pour lui plaire, et elle n'ira pas
au del. L'importance de leur rputation, la ncessit de ne faire que ce qui plat
l'homme et la peur du diable sont peu prs les seules bases sur lesquelles on
puisse s'appuyer, et sur lesquelles on s'appuie, en effet, dans l'ducation des filles,
pour leur donner une moralit, sinon relle, au moins apparente. Elle leur suffit et
nous suffit.
C'est prcisment cette absence de sens moral chez les femmes, jointe la
faiblesse de leur intelligence, qui rend si dangereuse l'influence qu'elles arrivent
souvent prendre dans les affaires srieuses. Une socit qui les laisserait s'occuper
des affaires publiques serait voue une dsorganisation aussi rapide que profonde.
L'homme n'attache gure d'importance ses hommages banals et ses galanteries
sentimentales, derniers vestiges du vieux rgime catholico-fodal. Il sait trs bien
que l'individu le plus intelligent peut s'prendre de la femme la plus borne, comme
il peut tre victime d'un coryza ou d'un drangement intestinal ; il sait aussi qu'entre
la plus grande dame et la plus modeste femme de chambre, il n'y a gure qu'une
diffrence de costumes et de manires, au besoin bien vite efface ; mais la femme
ignore tout cela. Nos hommages, elle les prend au srieux ; l'influence inconteste
qu'elle exerce, elle l'attribue son intelligence. L'ide qu'on laisse prendre ainsi aux
femmes d'elles-mmes leur prpare bien des dceptions. Loin de les encourager
dans ces illusions, leur ducation devrait tendre leur montrer la ncessit de ne
pas sortir du rle modeste, mais suffisant pour leurs aptitudes crbrales, que la
nature leur a donn. Cres pour la vie intrieure et les occupations du foyer toujours bien vide sans leur prsence -, elles n'en doivent pas sortir.
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
341
IV. - Les facteurs de la Morale.
Retour la table des matires; retour au dbut du chapitre
Des motifs divers, tels que la conscience, la raison, la sympathie, l'utilit, etc.,
ont t successivement considrs comme les bases de la morale. Les philosophes
qui les ont invoqus ont commis cette erreur, que nous avons souvent combattue,
d'attribuer une seule cause ce qui est d plusieurs. Leurs efforts infructueux
depuis plus de deux mille ans pour dduire la morale de certains principes, auraient
d cependant les clairer sur l'impossibilit d'une telle tche. Il n'y a point de
principes absolus, indpendants des institutions humaines, d'o l'on puisse, par des
raisonnements abstraits, dduire la morale ; mais il y a des facteurs, variables
suivant les poques, qui la dterminent. Ces facteurs sont trs nombreux, ainsi que
nous allons le montrer en examinant les principaux d'entre eux.
INFLUENCE DE L'UTILIT. - Les lois morales reprsentant forcment
l'opinion de la majorit des membres de la socit o elles se sont formes, et qui
les ont acceptes, on conoit que ce seront les choses utiles au bonheur de cette
socit qui seront considres comme morales. Il est facile de reconnatre, en effet,
que ce n'est gure, en dernire analyse, que le degr de bonheur ou de souffrance,
c'est--dire d'utilit, qu'un acte doit procurer aux membres d'une socit, qui le fait
qualifier de bon ou mauvais. Le but de tous nos efforts se ramne toujours, quelles
que soient nos croyances philosophiques ou religieuses, un bonheur prouver
sous une forme ou sous une autre, ou une peine fuir.
Mais les actions qui nous procurent notre bonheur nous ne sont pas toujours
celles qui sont utiles aux autres. Sans doute, il y a parfois concordance entre les
premires et les secondes, et les partisans de la morale utilitaire ont eu raison alors
de faire remarquer que notre intrt bien entendu est d'agir dans l'intrt gnral,
mais cette concordance est en ralit exceptionnelle. Il faut donc une obligation
plus puissante que la simple notion d'utilit pour nous amener sacrifier notre
intrt celui des autres. Je ne saurais par consquent admettre, avec Spencer, que
ce sont surtout les expriences d'utilit organises et consolides travers toutes les
gnrations passes qui ont cr nos facults d'intuition morale.
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
342
L'utilit est un facteur important de la morale, mais il n'acquiert son importance
que parce que d'autres facteurs, tels que l'opinion, la loi civile et religieuse, etc.,
amnent volontairement ou non l'individu obir aux ncessits du bonheur
gnral. Sans leur influence, l'homme, ayant choisir entre son propre intrt et
celui de la communaut, obirait toujours aux suggestions de l'gosme.
INFLUENCE DE L'OPINION. - Au premier rang des facteurs de la morale,
nous plaons l'opinion. C'est elle qui maintient, et est seule d'abord maintenir, les
conventions morales ncessaires l'existence d'un groupe donn d'individus. Les
prescriptions lgales et religieuses suivent l'opinion, mais ne la prcdent pas.
Quand l'opinion vient changer, ces prescriptions sont condamnes, elles aussi,
changer. De tous les mobiles qui peuvent conduire les hommes, l'approbation ou la
dsapprobation de leurs semblables constituent les plus nergiques. L'opinion est la
puissance que redoutent le plus la majorit des hommes. C'est elle qui fait mourir le
soldat son poste, fait supporter l'Indien sans plir les tortures du supplice, et
nous fait sacrifier nos intrts les plus chers au soin de notre rputation et de notre
honneur. En fait, ce n'est que chez un nombre d'individus fort restreint, que la
considration de la conduite en elle-mme, et non de la faon dont les autres la
jugeront, ait une influence quelconque sur les actions.
C'est donc l'opinion qui a cr ce que nous nommons le bien et le mal, le vice et
la vertu, conceptions qui n'ont de valeur relle que relativement aux socits au sein
desquelles elles sont nes. Appliqus la nature, de tels mots n'auraient aucun sens.
Dans l'univers, il n'y a ni bien ni mal, il n'y a que des ncessits, et il n'est pas
besoin de longues rflexions pour le comprendre. La foudre tombe indiffremment
sur le palais du riche ou sur la chaumire du pauvre. Les mmes fatalits entourent
l'existence d'un misrable parasite intestinal et celle du plus puissant gnie, et, pour
assurer la reproduction d'tres infimes, auprs desquels une moisissure constitue un
organisme suprieur, les plus utiles bienfaiteurs de l'humanit sont condamns
prir.
Aussitt que les hommes se runirent en socit, des ncessits imprieuses
dterminrent la naissance du bien et du mal. Certaines qualits, le courage, la
fidlit, le patriotisme, la discipline, l'esprit de dvouement, donnaient de tels
avantages aux agglomrations qui les possdaient, qu'elles devaient tre entoures
de marque d'approbation gnrale, alors que les dfauts contraires, la lchet, la
dloyaut, taient trop nuisibles tous pour ne pas tre universellement mpriss.
C'est ainsi que le courage, la fidlit, le patriotisme, devinrent des vertus ; la
lchet, la dloyaut, des vices. En pratiquant ces vertus, mme quand elles
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
343
devaient rester ignores, l'individu prouvait une sorte de reprsentation de
l'approbation qu'elles inspiraient. En cdant aux impulsions des vices, la mme
reprsentation de la dsapprobation gnrale devait produire ce que nous appelons
le remords et la honte.
Les vices et les vertus tant les produits de l'opinion, et l'opinion tant cre
elle-mme par la ncessit que les conditions d'existence engendrent, nous ne
devons pas nous tonner de voir l'opinion qualifier crimes ou vertus, suivant les
temps, des choses fort diffrentes, et nommer vertu une poque ce qu'elle devait
ensuite qualifier de crime une autre. Chez la plupart des peuples, le vol, le
meurtre l'gard des trangers la tribu, mme quand on n'tait nullement en
guerre avec eux, ont t considrs comme des actes recommandables, et dont il y
avait lieu de se glorifier. Chez beaucoup de sauvages, un homme ne trouve pas se
marier sans avoir au pralable tu quelqu'un. Chez les Indiens de l'Amrique du
Nord, on va scalper ses voisins d'une autre tribu par simple distraction, absolument
comme on va chez nous chasser le canard ou le lapin.
Mme chez des peuples aussi civiliss que les Grecs et les Romains, il n'y avait
aucune notion de devoir l'gard de l'tranger ou de l'ennemi, qualifications
presque synonymes. Phbidas, s'tant empar en pleine paix de la citadelle des
Thbains, Agsilas, interrog sur la justice de cette action, rpondit : Examinez
seulement si elle est utile la patrie ; dans ce dernier cas, elle est bonne. A des
poques trs avances de la civilisation latine, l'tranger n'avait pas le droit
d'invoquer la loi romaine.
INFLUENCE DU MILIEU. - L'influence du milieu a t assez tudie dans
cet ouvrage, pour que je puisse me borner la rappeler. L'homme dpend de son
milieu physique ou mental, et c'est surtout des exigences de ce milieu que dcoule
sa constitution morale. Ce n'est que quand ce dernier vient changer, que sa morale
peut la longue changer galement. Le milieu d'un peuple guerrier n'est pas celui
d'un peuple commerant, et forcment sa morale est autre. Celle d'une socit un
peu nombreuse, o la division des fonctions existe, ne peut tre celle d'une faible
tribu. A mesure que le milieu crot en complexit, les hommes deviennent de plus
en plus dpendants les uns des autres, et cette dpendance est l'origine de bien des
qualits morales. Les sentiments de violence, d'gosme, d'hostilit contre les
autres, tendent forcment disparatre. La ncessit de s'aider rciproquement, de
respecter ses engagements, pour obtenir le mme traitement des individus avec
lesquels on est en relation, apparat bientt.
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
344
INFLUENCE DE LA SLECTION. - La slection n'a jou qu'un rle assez
faible dans l'volution de la morale ; cependant son influence a d intervenir
plusieurs fois. Quand l'opinion a sanctionn certaines qualits, et que les
prescriptions civiles et religieuses leur ont aussi apport leur sanction, ceux qui s'en
cartent trop doivent disparatre. Les hommes violents, querelleurs, ont contre eux
tout le monde, et sont limins bientt ; ceux qui, dans un milieu travailleur, ne
peuvent se plier un travail rgulier, l'Indien aux tats-Unis, par exemple, finissent
par disparatre galement. La slection agit donc en liminant les instincts nuisibles
la conservation de l'espce.
INFLUENCE DE LA COUTUME. - La coutume est ce qui a t tabli par
l'opinion, et ce qui donne aux lois morales leur principale force. Elle varie
naturellement d'un temps l'autre, d'une race l'autre. Chez certains peuples, la
coutume exige qu'on tue ses parents gs ; chez d'autres, qu'on les protge ; et le
joug de la coutume est si puissant, que les victimes la subissent sans murmurer. Le
sens du mot morale signifie simplement l'action de se conformer aux coutumes
(mores) de la socit laquelle on appartient, et cette signification primitive est
vraisemblablement la meilleure.
INFLUENCE DE LA SYMPATHIE. - Le dveloppement de la sympathie,
c'est--dire de la bienveillance pour autrui, peut tre considr galement comme
un facteur puissant de la morale. Quand la bienveillance rciproque existe parmi les
individus d'une race, ce lien est plus fort que tous les autres et entrane toute une
srie de prescriptions morales dont l'nonc serait possible, mais dont l'observation
serait impossible sans lui.
Un des plus actifs ressorts de notre conduite, et par consquent de notre morale,
est donc la sympathie et ses drivs : la compassion, la charit et la piti. A qui les
possde, les lois et les religions sont inutiles ; qui ne les possde pas, rien ne
saurait les donner. Seuls ces sentiments puissants conduisent aux actions
dsintresses ; mais, par le fait mme que ce sont des sentiments, la froide raison
ne saurait avoir prise sur eux, et tout au plus peut-elle conduire l'homme les
feindre alors qu'il ne les prouve pas. C'est avec une sagesse profonde qu'au
premier rang des vertus, les philosophes chinois ont plac la piti. N'et-il fait que
tenter de rpandre la charit parmi les hommes, le christianisme mriterait qu'on
salut toujours avec respect sa grande ombre. C'est surtout de la dose plus ou moins
grande de sympathie que les divers individus possdent, que rsultent les
diffrences profondes de caractre qui existent entre eux. Quelques-uns, - c'est le
petit nombre, - la possdent un degr lev. La plupart n'en ont qu'une dose assez
faible et n'coutent gure que la voix puissante de l'gosme.
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
345
Les psychologues font gnralement driver la sympathie de notre aptitude
nous reprsenter, par la pense, ce que nous souffririons si nous nous trouvions
dans la position de la personne qui souffre. Il en rsulterait de la piti pour elle et le
dsir de soulager ses souffrances.
Cette origine de la sympathie me parat bien contestable. On ne saurait nier, en
effet, que les animaux, qui ne semblent pas possder une trs haute dose
d'imagination reprsentative, possdent cependant ce sentiment un haut degr,
que les femmes le possdent galement ; et que, d'un autre ct, des peuples
intellectuellement trs dvelopps, Grecs et Romains, ne l'ont eu qu' un degr trs
faible.
Le sentiment de la bienveillance est un sentiment assez complexe qui a d se
dvelopper son origine chez les individus faibles, ayant besoin de protection, ou
chez les individus ayant souffert les mmes maux. Les malheureux se sentent
toujours frres. Quand Rome eut asservi le monde, les sentiments de la sympathie
pouvaient se former facilement et se formrent en effet entre ces milliers d'esclaves
que menait si durement la main de leurs matres. Un tre faible sympathise
naturellement aux souffrances qu'il prouve et se sent toujours heureux d'avoir
protger un plus faible.
Quoi qu'il en soit des causes qui donnent naissance la sympathie et la
bienveillance, il n'est pas douteux, comme je le disais plus haut, que le dsir de
s'entr'aider, qui en rsulte, puisse tre un puissant facteur de la morale.
Malheureusement c'est un sentiment qui se cre et ne se commande pas. C'est l ce
qu'ont absolument oubli les auteurs modernes qui ont voulu en faire la base de la
morale. Subordonner l'gosme l'altrusme, c'est--dire soi-mme aux autres,
comme disent les positivistes, cela fait partie de la catgorie des prceptes qu'on
met dans les livres, que chacun reconnat bon pour le prochain, mais ne songe
gure observer. Vivre pour autrui, dit Comte, devient le rsum naturel de toute
la morale positive. Le conseil est excellent et, assurment, s'il tait suivi, tous les
hommes deviendraient des anges et l'ge d'or rgnerait sur la terre ; mais par quels
moyens amnerons-nous l'homme se sacrifier autrui ? C'est l ce qu'il faudrait
dcouvrir ; et, si l'on reconnat que la chose ne peut tre dcouverte, il faut
reconnatre en mme temps que de telles rgles de morale sont profondment
puriles.
INFLUENCE DES RELIGIONS. - Chez la plupart des peuples, la morale et la
religion ont d'abord t spares. Chez ceux o elles se sont ensuite runies, la
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
346
religion n'a fait qu'apporter aux coutumes existantes l'appui de ses sanctions. Dans
l'antiquit classique, les philosophes ne supposaient pas que la morale et besoin
des sanctions religieuses. Des penseurs tels que Socrate et Aristote ne dcouvraient
aucune relation entre elles. Ce n'est que dans les religions de Bouddha, de Mose,
du Christ et de Mahomet, qu'on voit apparatre des rgles de morale. Dans les
religions antrieures, elles sont inconnues. Le Vda ne contenait pas de
prescriptions de morale. Chez les Grecs et les Romains, ce furent les philosophes,
et non les religions, qui en noncrent les principes.
Le fait seul que des peuples, dont la morale tait indpendante de la religion, ont
eu cependant une morale leve, montre que l'homme peut trouver en dehors des
croyances religieuses des motifs puissants de conduite. L'amour, l'honneur, le
patriotisme, la crainte de l'opinion, et bien d'autres sentiments encore, ont eu sur lui
une influence au moins aussi profonde que les croyances religieuses. Chez les
anciens Romains, le culte de Rome exerait autant d'empire sur les mes que
devaient en exercer plus tard les dogmes des chrtiens. Il a cr chez les premiers
une grandeur d'me et des vertus auxquelles les seconds n'ont pu s'empcher de
rendre hommage. Mme chez les races infrieures, des sentiments analogues ont
eu, indpendamment de toute croyance, une puissance trs grande. Le martyr,
pendant son supplice, croyait que le ciel allait bientt s'ouvrir devant lui, et une
telle perspective adoucissait ses souffrances ; mais l'Indien, attach au poteau de
guerre, n'a pas un tel espoir, et pourtant, lui aussi, sait supporter la mort sans plir.
Il n'est pas douteux, cependant, que les croyances religieuses ont, pendant de
longs sicles, apport un puissant appui la morale. Pour le croyant, en effet, Dieu
voyait les actions secrtes que la loi ne voyait pas. Mais on ne saurait dire de la
morale qui n'a pour base que la religion, c'est--dire la crainte du chtiment et
l'espoir d'une rcompense, qu'elle soit une morale bien haute. Elle reprsente la
morale de l'intrt sous ses formes les moins leves, et ne convient gure qu' des
natures infrieures, telles que les femmes et les enfants. Celui qui fait le bien
uniquement pour tre rcompens au centuple dans une vie future, et qui vite le
mal de peur de l'enfer, peut tre compar l'esclave qui sert fidlement son matre
pour en obtenir un pourboire et viter quelques coups. De tels mobiles de conduite
sont beaucoup moins levs que ceux auxquels obissaient le Romain qui mourait
sans hsiter pour la grandeur de Rome, ou l'Indien qui supporte les tortures pour
accrotre le renom de sa tribu. La morale base sur les religions fait uniquement
dpendre notre destine des fantaisies de divinits cruelles, dont on ne peut obtenir
quelque chose que par des supplications basses. En ralit, elle avilit les mes et
n'inspire l'homme que le dsir de plaire son matre en s'humiliant assez. Elle ne
saurait, du reste, le retenir bien srieusement sur la pente du mal, car le pardon est
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
347
toujours facile obtenir. Comme Louis XI adorant ses madones avant de
commettre un crime, le dvot pchera sans scrupule, sachant bien qu'il n'a ensuite
qu' supplier sa divinit pour tre absous. Quand les diverses barrires que
l'opinion, la rpression lgale, etc., mettent sur la route qui conduit aux mauvaises
actions se sont montres impuissantes, l'influence des croyances religieuses se
montrera plus faible encore.
Aussi, ne devons-nous pas nous tonner de voir que les natures les plus
religieuses, les femmes, les sauvages et les enfants, par exemple, soient
prcisment les moins morales 92. Les races trs religieuses sont trop souvent aussi
les races les plus faiblement doues au point de vue moral. Parmi les nations
civilises, il n'y a gure de peuples chez lesquels le sentiment religieux soit plus
dvelopp que chez les Slaves, - une promenade d'une heure dans les rues de
Moscou enlve entirement l'tranger tout doute sur ce point, - et nanmoins il
n'en est gure dont la moralit soit reste un niveau plus bas.
Pour bien comprendre les limites de l'influence de la religion sur la morale, nous
ne devons pas oublier que la morale d'un peuple se forme sous l'influence de
ncessits sociales antrieures aux religions ou indpendantes d'elles. Les religions
ne font ensuite que l'adopter et lui prter l'appui de leur sanction. La morale
chrtienne, par exemple, n'a t en aucune faon cre par les fondateurs du
christianisme. Ses principes taient devenus des lieux communs qui tranaient dans
tous les livres au temps des premiers empereurs romains.
L'opinion, engendre elle-mme par les ncessits du milieu social, constitue,
ainsi qu'il a t dit, le plus puissant facteur de la morale. Aucune religion n'a os
condamner ce qu'elle approuvait. La guerre peut dsoler et ruiner un pays, les
religions seront toujours prtes chanter des Te Deum pour glorifier le vainqueur.
Il peut arriver que, pour se conformer aux consquences de certains principes, les
religions condamnent svrement ce que l'opinion ne rprouve gure, les duels et
92
La statistique ne peut fournir que des renseignements trompeurs sur l'influence qu'exerce la religion sur la
conduite, et il me semblerait fort injuste de tirer de certains cas particuliers des conclusions trop gnrales. Je
mentionnerai cependant, titre de document, que M. Duruy, quand il tait ministre, fit faire une statistique,
reproduite dans divers recueils (V. Dictionnaire encyclopdique des sciences mdicales, 2 srie, t. V, p. 39), de
laquelle il rsulte que dans le personnel des coles diriges par des congrgations, il se commet douze fois plus
de crimes et quatre fois plus de dlits que dans le personnel des coles laques. Il importe de remarquer toutefois
que les crimes et dlits des religieux sont gnralement d'une nature spciale (attentats contre les moeurs), et
qu'il n'est rien moins qu'quitable de comparer des clibataires forcs, exposs toutes les tentations, avec des
individus dont le plus grand nombre est mari.
Tout ce qu'on peut conclure de ces chiffres, c'est l'influence fcheuse du clibat sur la conduite dans
certaines circonstances dtermines, et l'impuissance de la religion dans les mmes cas.
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
348
l'infidlit conjugale, par exemple ; mais alors, mme aux ges de croyance,
l'influence des prescriptions religieuses est peu prs nulle.
Tout en reconnaissant donc que les croyances religieuses ont eu, comme nous
l'avons montr, une influence trs grande dans la vie des hommes, et mme que
pour les natures infrieures elles sont ncessaires, nous devons constater qu'en ce
qui concerne le dveloppement de la moralit, leur influence n'a jamais t aussi
grande qu'on le soutient gnralement. Nous dirons mme que, quand ces
croyances se sont affaiblies dans les mes, il arrive un moment o leur influence
devient beaucoup plus nuisible qu'utile. Donner uniquement pour base la morale
la religion, comme on le fait dans l'ducation de l'enfant, c'est l'exposer, lorsqu'il
aura reconnu plus tard le peu de fondement de la seconde, de perdre en mme
temps toute confiance en la premire. Quand la base d'un difice s'croule, tout
l'difice doit en mme temps tomber. En avanant dans la vie, la plupart des
hommes reconnaissent le peu de fondement des croyances religieuses, et, comme
dans leur enfance on leur a solennellement affirm qu'il n'y a pas de morale sans
Dieu, lorsque ce Dieu s'vanouit, il ne leur reste plus d'autre rgle de conduite que
leur intrt personnel limit strictement par ce que la loi dfend.
INFLUENCE DE L'EDUCATION. - J'ai dj discut ailleurs l'influence de
l'ducation, et dmontr combien cette influence est minime quand elle doit lutter
contre des aptitudes hrditaires contraires apportes par l'individu en naissant.
Comme le dit trs justement le savant recteur de l'Universit de Berlin, le
physiologiste Du Bois Reymond : L'ducation peut tout au plus dterminer la
mesure et la proportion dans lesquelles les facults qui sommeillent en nous
doivent se dvelopper. Elle ne cre en nous rien de nouveau, elle n'y touffe aucun
germe. Les plus magnifiques des cours sur la morale ne feront jamais d'un gredinn
un homme vertueux.
La vrit qui vient d'tre exprime a t reconnue par les plus grands
philosophes de tous les temps. La vertu n'est pas un effet de l'ducation, dit Platon.
Il n'est pas en notre pouvoir d'tre vertueux ou mprisable, crivait Socrate. Suivant
Aristote, les caractres semblent tre ce qu'ils sont par nature ; car, si nous
sommes justes, prudents, etc., c'est ds notre naissance. La Bible, dans son
langage mtaphorique, exprime la mme chose : On ne cueille point de figues sur
des pines, nous dit l'vangile selon saint Luc, et on ne coupe point de grappes de
raisin sur des ronces. L'homme de bien tire de bonnes choses du bon trsor de son
coeur et le mauvais en tire de mauvaises du mauvais trsor de son cur.
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
349
Mais, si minime que soit l'influence de l'ducation, ce n'est gure que par elle
que nous pouvons agir sur l'volution de la morale. Les modifications ralises
chaque gnration seront faibles, mais accumules par l'hrdit elles finiront la
longue par devenir trs grandes.
Nous devons d'autant moins, du reste, ngliger cet important facteur de la
morale qu'en son absence des qualits acquises par plusieurs gnrations peuvent se
perdre rapidement. Il en est de la constitution morale comme de la constitution
physique. Rien n'est plus difficile que de l'amliorer, rien n'est plus facile au
contraire que d'en troubler l'quilibre.
Je ne reviendrai pas sur ce que j'ai dit dans un autre chapitre de la faon dont
doit se faire l'ducation morale. Elle rsulte surtout de l'influence du milieu.
L'enfant qui a plusieurs fois entendu raconter avec admiration certains actes, et
avec mpris certains autres, finit par associer dans son esprit l'approbation gnrale
qui accompagne les uns avec la dsapprobation qui suit les autres. Quant
l'influence des maximes et des rgles de morale des livres, elle est radicalement
nulle. Les hypocrites et filandreuses homlies qu'on dbite dans nos traits de
morale n'ont jamais eu l'influence la plus lgre sur la conduite de personne. Cela
n'est pas, du reste, regretter. Il ferait une pitre figure dans le monde, celui qui
prendrait pour base de sa conduite la morale des livres.
INFLUENCE DES PRESCRIPTIONS LGALES. - Les lois sont, comme
les religions, postrieures la morale. Elles lui servent d'appui, mais ne la crent
pas, et sont, au contraire, cres par elle.
L'influence sur le maintien de la morale de la loi crite et des rpressions qui
l'accompagnent n'est pas douteuse. Pour celui qui n'apporte aucun sentiment de
moralit en naissant, et pour lequel l'opinion, les croyances religieuses ou
philosophiques et l'ducation ne sont pas un frein, il n'en reste plus d'autre que la
loi : sa morale consiste simplement alors viter ce que la loi punit. Bien des
hommes n'ont pas d'autre frein. C'est de leur nombre plus ou moins grand au sein
d'une socit que dpend la capacit de cette dernire se conduire elle-mme. Cette capacit est nulle lorsque, pour le plus grand nombre, il n'y a pas d'autres
obligations morales que celles que le gendarme sanctionne. Le jour o dans toutes
les classes la crainte du chtiment lgal est le seul frein moral, ce frein perd bientt
lui-mme tout empire et l'anarchie approche.
[NOTE :
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
350
Il suffit, pour comprendre combien la rpression lgale devient un faible soutien de la morale
quand la dmoralisation est gnrale, de voir ce qui se passe dans les pays, comme la Russie et
l'Amrique, o la corruption entre de plus en plus dans les murs. J'ai dj vant les sentiments
d'initiative, d'indpendance, de persvrance qui ont amen l'Amrique au faite de la grandeur,
mais il faut reconnatre qu'elle est depuis quelque temps sur la pente d'une dmoralisation
gnrale dont les consquences pourront devenir des plus funestes. Aujourd'hui les fonctions
politiques tous les degrs ne sont considres en Amrique que comme un moyen de gagner de
l'argent. Il est bien peu de fonctionnaires et de magistrats qui ne puissent tre achets. Les affaires
scandaleuses, arrives la connaissance du public depuis dix ans, ont prouv quel point la
corruption tait gnrale. Dans diverses affaires analogues celle du Central Pacific Rail road, il
fut dmontr que des sommes normes avaient t donnes des membres du congrs pour
obtenir des concessions et des subventions. Le prsident du Snat lui-mme, M. Colfax, dut
donner sa dmission. En 1875, le ministre de l'intrieur, M. Delano, fut convaincu d'avoir depuis
longtemps fait vendre son profit des rcoltes destines empcher les Indiens de mourir de
faim, et ralis ainsi des bnfices normes. Dans d'autres affaires, le ministre de la guerre, M.
Belknapp, puis le chef du cabinet du prsident Grant, le gnral Babcock, puis le ministre de la
marine, M. Bebson, etc., furent convaincus de vols gigantesques ; puis ce fut la municipalit de
New-York qui, au su de tout le monde, gardait pour elle l'argent des contribuables, et se
maintenait, grce aux politiciens de profession avec lesquels elle partageait. On conoit ce que
peut tre l'administration subalterne avec des chefs semblables. Aussi le pillage est-il gnral, et il
n'y a aucun moyen de l'empcher, car les agents chargs de la surveillance sont immdiatement
achets et s'associent aussitt au pillage. Il y a peu d'annes, les droits sur l'alcool ayant t
augments de 50 %, et la recette n'augmentant pas, on se trouva oblig de faire une enqute. Il en
rsulta que tous les fonctionnaires, depuis les chefs de l'administration centrale, protgs du reste
par le secrtaire particulier du prsident, jusqu'aux derniers des employs, s'entendaient avec les
contribuables pour voler le trsor. Devant l'tendue de la fraude, on dut se borner emprisonner
un chef de division la trsorerie, un inspecteur gnral et quelques agents subalternes. Le
secrtaire du prsident, traduit en cour d'assises, dment convaincu de concussion, ne fut sauv
que grce l'appui de son chef.
Ce qui est le plus triste dans ces manuvres, c'est que tous ces vols sur une grande chelle
semblent au public chose fort simple, et ne provoquent gure d'indignation que chez ceux
auxquels on n'a pas laiss prendre part aux oprations. La plupart des personnages que je citais
plus haut n'ont nullement perdu dans le public de leur prestige, le prsident de la Rpublique
mme les a couverts de sa protection et a continu donner des places lucratives aux plus
compromis. Il fallut mme qu'il allt bien loin dans cette voie, pour que la Chambre lui infliget
un blme sous forme du vote de la rduction de la moiti de son traitement.
Il est difficile de dire aujourd'hui quel sera l'avenir de la grande Rpublique amricaine. Je
suis de ceux qui croient qu'elle grandira encore ; mais, si ses murs ne changent pas, si elle
continue tout sacrifier au culte exclusif de l'argent, je doute qu'elle puisse, malgr son tonnante
vitalit, viter de tomber bientt dans l'anarchie et le despotisme.
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
351
La conduite des Europens dans les pays non civiliss, o ils se trouvent
soustraits l'influence de la loi, montre combien pour le plus grand nombre la
puissance des sanctions lgales est grande. Ce serait trs vainement qu'on
invoquerait contre cette influence la rgularit des crimes et dlits, car il est facile
de rpondre que, s'ils sont contenus dans des limites peu prs constantes, c'est en
raison mme de la crainte du chtiment.
Dans chaque milieu social, il y a des catgories entires d'individus pour
lesquels la rpression lgale constitue absolument la seule base de la morale. Sans
elle, la tromperie et les falsifications dangereuses, si rpandues en matires
commerciales, seraient universelles. Dans les grandes villes, les falsifications des
substances alimentaires s'oprent sans le moindre souci de la sant publique. Le
commerant en arrive ne plus regarder absolument que son intrt et finirait, si
des lois svres ne l'arrtaient pas dans cette voie, considrer comme toutes
naturelles des oprations analogues celles si frquemment constates dans notre
dernire guerre, telles que dlivrance de cartouches qui ne partent pas, de fusils qui
clatent dans la main des soldats, de souliers o le cuir de la semelle est remplac
par du carton, de vivres avaris, etc. ; ou des combinaisons analogues celles
auxquelles se livraient depuis de nombreuses annes des ngociants anglais, et qui
ont soulev une si vive indignation en Angleterre quand elles furent releves en
plein parlement par le dput Plimsol. Ces oprations consistaient, comme on sait,
assurer pour une forte somme des btiments peu prs hors d'usage et auxquels
on ne faisait subir que des rparations apparentes. On les envoyait ensuite dans
quelques parages dangereux, avec une forte charge, de faon les faire sombrer en
mer. Si on ne russissait pas la premire fois, on recommenait une seconde, en
introduisant dans des morceaux du charbon qui devait chauffer la machine, des
matires explosibles destines faire clater le vaisseau. Btiment et quipage
taient perdus, et il n'y avait plus qu' toucher la prime d'assurance.
Je suis loin de contester l'utilit des commerants. Bien qu'ils ne produisent rien
et ne soient que des rouages fort coteux entre le producteur et le consommateur,
ils sont videmment ncessaires ; mais il est indispensable qu'en ce qui les
concerne, le lgislateur soit extrmement dur et rserve son indulgence pour les
vritables producteurs qui font la richesse d'une nation : industriels, agriculteurs et
ouvriers. Rien n'avilit plus vite le caractre que la pratique du commerce, et c'est
prcisment parce que cela a t remarqu par tous les peuples, depuis les Grecs et
les Romains, que, tout en considrant les individus qui se livrent au ngoce comme
trs utiles, on les a toujours tenus en fort mdiocre estime. L'ancien droit
considrait le commerce de dtail comme une profession si vile, que le noble qui
l'exerait devenait par le fait mme roturier et taillable.
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
352
Dans un travail important intitul : Murs commerciales, l'minent philosophe
H. Spencer, aprs avoir dcrit les tromperies habituelles et l'immoralit basse des
commerants, puis discut les causes du mpris qu'ils inspirent tant de personnes
par suite de la dgradation du caractre qu'entrane la pratique de leur mtier,
arrive, cette conclusion que le commerce moderne ne peut gure tre compar
qu'au cannibalisme, et qu'avec les murs commerciales actuelles le ngociant qui,
par hasard, voudrait rester honnte serait infailliblement oblig de faire rapidement
faillite.
C'est surtout l'gard de cette varit du commerce constitue par la pratique
des spculations financires, que, dans l'intrt public, la rpression lgale dont je
parlais plus haut devrait tre extrmement svre. Le financier est, de tous les
commerants, le plus dpourvu des notions les plus lmentaires de morale ; il ne
possde que celles en dehors desquelles son commerce serait impossible, comme,
par exemple, de respecter ses engagements verbaux la Bourse. C'est l un genre
de probit analogue celle des voleurs de grands chemins, qui, aprs s'tre runis
pour piller une ferme, se croiraient dshonors s'ils faisaient tort d'un centime un
camarade dans le partage.
Les spculations de la haute banque tendent aujourd'hui absorber la fortune
publique avec une rapidit inquitante, et produisent une dmoralisation gnrale,
dont on ne souponne pas la profondeur. Toutes ces oprations financires :
emprunts d'gypte, de Turquie, de Honduras, d'Hati, etc., je ne parle que des plus
honntes, ont t lances par des spculateurs dont pas un n'ignorait qu'elles
plongeraient dans la misre des milliers de malheureux qui, sur leurs
recommandations, venaient y apporter leurs petites ressources pour augmenter leurs
maigres revenus. Il est triste d'avoir reconnatre que, pour gagner d'importantes
commissions 93, c'est--dire par cupidit pure, nos principaux tablissements de
crdit, nos plus grandes maisons de banque, spculent sur l'ignorance du public, sur
sa faiblesse et sur sa facilit se laisser prendre aux plus grossiers appts pour le
lancer dans cette voie. Il n'y a pas d'affaire, si vreuse qu'elle soit, qui ne trouve
immdiatement, condition de les payer assez, de gros financiers prts l'appuyer
de l'autorit de leur nom.
93
Importantes en effet. Sur un montant de 1,397,175,000 francs, produit de cinq emprunts gyptiens, les
banquiers ont touch, en pots-de-vin ou commissions, environ 522 millions (522,175,000 francs). 875 millions
seulement sont entrs dans les caisses gyptiennes. la fin de 1875, le gouvernement gyptien avait pay, pour
les intrts seulement, presque le montant de sa dette. On trouvera le dtail de ces chiffres dans un excellent
travail de M. Van den Berg (Revue scientifique, 1878, p. 698).
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
353
Parlant de la Bourse comme tablissement de spculation, le ministre des
finances d'un grand pays voisin l'a qualifie rcemment en plein parlement
d'arbre empoisonn qui dmoralise le peuple . Je souscris absolument cette
dfinition. On peut considrer sans doute, comme une perte fort regrettable, tous,
les milliards qu'ont cots la France les divers emprunts trangers et les affaires
vreuses qui n'auraient jamais russi sans l'appui des grands financiers. Mais ce qui
est beaucoup plus malheureux encore pour un pays que ces ruines, c'est l'action
absolument dmoralisante que toutes ces spculations exercent sur les esprits. Que
voulez-vous que pense de son mtier le petit agriculteur qui retire pniblement de
sa terre 3 ou 4 pour cent, alors que des spculateurs qui se prsentent sous les plus
puissants patronages lui laissent croire qu'il n'a qu' la vendre pour retirer de son
capital trois fois plus ? Faute de lois draconiennes, les gouvernements sont sans
action sur la puissante arme des forbans de la finance. Ils ne peuvent que tcher
d'clairer leurs victimes. Une bonne statistique, sous forme de tableaux graphiques
affichs dans toutes les coles, des oprations excutes par chacune des diverses
maisons financires depuis vingt ans, de ce que ces oprations ont cot et rapport
aux souscripteurs, serait une des meilleures dmonstrations qu'on pourrait offrir la
jeunesse, que la seule source relle de la richesse est encore le travail, et que les
plus redoutables ennemis de la fortune et de la moralit publiques ne sont pas
toujours dans les prisons et dans les bagnes 1.
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
354
[NOTE:
La morale que je qualifierai de financire me semble parfaitement reprsente par ce passage
plein d'humour de l'historien Carlyle, dont j'emprunterai la traduction M. Taine :
Supposons, dit-il, que des cochons (j'entends des cochons quatre pieds), dous de
sensibilit et d'une aptitude logique suprieure, ayant atteint quelque culture, puissent, aprs
examen et rflexion, coucher sur le papier, pour notre usage, leur ide de l'univers, de leurs
intrts et de leurs devoirs ; ces ides pourraient intresser un public plein de discernement
comme le ntre, et leurs propositions en gros seraient, celles qui suivent :
L'univers, autant qu'une saine conjecture peut le dfinir, est une immense auge porcs,
consistant en solides et en liquides, et autres varits, mais spcialement en relavures qu'on peut
atteindre et en relavures qu'on ne peut pas atteindre, ces dernires tant en quantit infiniment
plus grande pour la majorit des cochons.
Le mal moral est l'impossibilit d'atteindre les relavures. Le bien moral, la possibilit
d'atteindre lesdites relavures.
La posie des cochons consiste reconnatre universellement l'excellence des relavures et
de l'orge moulue, ainsi que la flicit des cochons dont l'auge est en bon ordre, et qui ont le ventre
plein. Grun !
Qui a fait le cochon ? Inconnu. Peut-tre le boucher.
Dfinissez le devoir complet des cochons. - La mission de la cochonnerie universelle et le
devoir de tous les cochons en tous les temps est de diminuer la quantit de relavures qu'on ne
peut atteindre, et d'augmenter la quantit de celles qu'on peut atteindre. Toute connaissance, toute
industrie, tout effort doit tre dirig vers ce terme, et vers ce terme seul. La science des cochons,
l'enthousiasme des cochons, le dvouement des cochons, n'ont pas d'autre but, c'est le devoir
complet des cochons.
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
355
INFLUENCE DE L'HRDIT. - L'hrdit est le vritable fixateur de la
morale. Les sentiments moraux crs par les facteurs que nous avons numrs sont
consolids par elle et deviennent la longue des sentiments inconscients que
l'individu apporte en naissant, et qui font que, sous les impulsions de l'honneur, du
patriotisme, du devoir, l'homme sacrifie sans hsiter sa vie. Le sens moral, comme
tous les sentiments, appartient au domaine des impulsions inconscientes, et il n'est
mme solidement constitu que quand il est devenu tout fait inconscient, c'est-dire indpendant de la raison. Examinez les individus franchement bons ou
mauvais qui vous entourent, et vous verrez qu'ils font le bien comme le mal de la
faon la plus instinctive. Quand le sens moral arrive ainsi faire partie de la
constitution, les prescriptions lgales et religieuses deviennent alors inutiles pour
appuyer la morale. Il n'est pas besoin de dfense lgale pour empcher le plus
pervers des Europens de tuer des vieilles femmes pour les dvorer, de massacrer
ses parents gs, d'engraisser ses enfants pour les manger. De tels actes, qui taient
des tentations puissantes pour nos lointains anctres, ne dterminent en nous qu'une
rpulsion profonde. Le jour o il en serait de mme pour tous les actes nuisibles, la
morale serait dfinitivement constitue et la rpression lgale entirement inutile.
Je n'ai pas besoin de dire que nous sommes fort loin de l'aurore d'un tel jour.
INFLUENCE DE L'INTELLIGENCE. - Les moralistes et les philosophes ont
attribu l'intelligence une grande influence sur 1e dveloppement de la morale.
Quelques-uns, suivant l'exemple de Kant, ont voulu fonder la loi morale sur la
raison pure. Il faut avoir vraiment pouss fort loin l'habitude de vivre dans les
abstractions et avoir bien peu observ les hommes, pour soutenir des opinions semblables. De tous les facteurs de la morale que nous avons numrs, la raison est
peut-tre le moins important. Sans doute le dveloppement de la rflexion et de
l'imagination reprsentative permet l'individu d'arriver mieux discuter les motifs
de ses actions, et interposer au besoin toute une srie de barrires entre
l'impulsion qui le pousse faire une chose et l'excution de cette chose ; elle pourra
bien lui montrer les avantages ou les inconvnients de tel ou tel acte, c'est--dire ce
qui est conforme son intrt ou ne l'est pas, mais elle ne met en jeu alors que les
ressorts du plus troit gosme, et on ne peut gure songer fonder des lois morales
sur de telles bases. Si l'tat de l'intelligence avait sur la morale une influence si
haute, on verrait le dveloppement de l'une tre habituellement parallle au
dveloppement de l'autre. Les divers exemples cits dans un autre chapitre
prouvent qu'il n'en est rien. Chacun n'a qu' jeter les yeux autour de soi pour
reconnatre combien ce dfaut de paralllisme entre l'tat de l'intelligence et l'tat
de la morale est frquent.
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
356
Loin de toujours fournir un solide appui la morale, la raison vient le plus
souvent contrarier ses suggestions, en mettant sous nos yeux les intrts personnels
que les sentiments moraux inconscients pourraient nous porter oublier. Ce n'est
pas certes la sage raison qui nous poussera exposer notre vie pour sauver celle
d'un inconnu qui se noie. Ce n'est pas elle non plus qui dira la femme de se
prcipiter dans les flammes pour sauver l'enfant qui lui est cher, au soldat de mourir
hroquement dans un coin obscur pour sauver l'honneur du drapeau, au chercheur
de sacrifier sa sant et sa fortune la dcouverte de quelques vrits nouvelles. Il
est heureux pour l'humanit que tant de martyrs de nobles causes aient su rester
sourds aux sages conseils de la raison.
Ce n'est en ralit qu'aux dpens de la morale que la raison peut intervenir trop
frquemment dans notre conduite. Quand elle y intervient toujours, la moralit
d'une race s'abaisse rapidement. Chacun alors se constitue une rgle de conduite
d'aprs son petit raisonnement personnel. Il songe surtout aux droits qu'il se
suppose, et la notion du devoir, - notion sacre, car elle est la base de toute
existence sociale, - tend bientt disparatre. Le misrable ne voit pas pourquoi il
est pauvre alors que d'autres ne le sont pas, et, ne le voyant pas, il en conclut qu'il
doit s'insurger contre l'ordre tabli. L'ouvrier raisonne de mme l'gard du patron,
le domestique l'gard de son matre, le soldat vis--vis de son chef. Quand la
notion du devoir s'est teinte dans les mes, il ne reste plus, pour maintenir
l'quilibre social, que la rpression lgale. Lorsqu'un peuple en est l, ses jours sont
compts et son heure va venir.
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
357
V. - volution future de la morale.
Retour la table des matires; retour au dbut du chapitre
Nous venons de voir combien sont nombreux les facteurs qui dterminent la
gense des facults morales. Les ncessits rsultant des conditions de milieu les
engendrent. L'opinion, les rpressions lgales et religieuses leur donnent leur
sanction, et ils finissent par se transformer en sentiments hrditaires que
l'ducation vient fortifier encore. Ainsi se forme la notion du devoir, la plus
importante de toutes, car sans elle une nation ne saurait subsister. Cette notion du
devoir peut varier d'un temps l'autre, il n'importe. Ce qui doit tre respect, c'est
la loi morale des temps o l'on vit. Elle est la base de tout ordre social, et, le jour o
elle disparat d'une socit, cette socit est condamne mourir. Ce n'est pas la
rpression lgale, quelque savante qu'on la suppose, qui saurait la remplacer. Sous
le rgne des empereurs, Rome possdait les lgislateurs les plus instruits qu'elle et
jamais connus ; mais, ces sentiments du devoir, d'obissance, de patriotisme, de
respect de l'ordre et de l'autorit, jadis tout-puissants sur les mes, et qui avaient fait
sa grandeur, avaient disparu. Lorsqu'ils se furent teints entirement, Rome fut
condamne prir. C'est beaucoup plus dans l'abaissement de la morale que dans
les diverses raisons invoques par les historiens qu'il faut rechercher les causes de
la dcadence de la puissance romaine. Pour juger de la destine d'un peuple,
informez-vous surtout de l'tat de sa morale. Ce n'est pas son intelligence, si
brillante qu'on la suppose, qui assurera sa prosprit et sa grandeur.
Le seul perfectionnement que nous pouvons rver pour la morale de l'avenir,
c'est que celle qui se formera sous l'influence des ncessits nouvelles cres par
les temps nouveaux finisse par devenir inconsciente. Malheureusement, si
l'volution des sciences et de l'industrie est aujourd'hui trs rapide, celle de la
morale est au contraire fort lente. La raison en est simple. Les progrs des sciences
sont les rsultats des applications des dcouvertes de quelques chercheurs dont
chacun profite ; les progrs de la morale ne peuvent se faire que par des
transformations gnrales, et l'hrdit seule est assez puissante pour produire de
telles transformations. Tant que la morale ne fait pas partie de l'hritage apport en
naissant, sa puissance est bien faible, et celle que crent seulement l'ducation,
l'opinion, le milieu, etc., constitue un difice bien fragile.
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
358
Aujourd'hui cet difice est plus fragile que jamais. Les progrs de l'esprit
humain ont ruin les croyances sur lesquelles s'tait lentement et pniblement
difie la morale de nos pres. A ce point de vue, les nations de l'Occident peuvent
tre compares aux Romains du temps des empereurs. Les antiques croyances
avaient disparu ; celles qui devaient leur succder n'taient pas nes ; l'ombre du
pass maintenait seule l'difice qui s'effondrait lentement. Quelles seront les
conceptions nouvelles qui serviront d'appui notre morale, lorsque les vieilles
croyances, dont l'hrdit maintient encore un peu la puissance sur les mes se
seront vanouies ? En attendant qu'elles aient pris naissance, il ne restera debout
d'autres lois morales que celles que le gendarme, dernier soutien des socits
mourantes, oblige respecter.
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
359
Deuxime partie
LES SOCITS
Leurs origines et leur dveloppement
livre III : Dveloppement des socits
Chapitre VI.
Dveloppement du droit.
Retour la table des matires; retour au dbut du chapitre
1. - Les origines du droit. - Erreurs des anciennes conceptions relatives l'tat primitif du
droit. - Gense de ces conceptions. -Elles drivent des thories des lgistes romains. - Comment
l'ide du droit naturel naquit l'poque romaine. - Bases relles du droit. - On ne peut le dduire
de principes absolus antrieurs l'existence des socits. - Il rsulte des conditions mmes
d'existence de chaque peuple et varie avec ces conditions. - Influence de l'opinion sur sa
formation. - Des peuples diffrents possdent forcment des codes diffrents. - Le droit ne peut se
maintenir qu'entre individus de forces gales. - Pourquoi les rgles des droits entre individus ne
sont jamais observes dans les relations entre peuples diffrents. - Ncessits qui conduiront un
jour les observer. - II. volution du droit. - Les codes n'ont jamais t crs par des lgislateurs
et reprsentent des ncessits indpendantes d'eux. - Applications de la mthode l'histoire de
l'volution du droit en ce qui concerne les dlits et les peines. - Formes primitives du droit de
punir. - Exerc uniquement d'abord par l'offens ou par ses parents, il apparat primitivement sous
forme de peine du talion. - Substitution graduelle de la compensation la peine du talion. Comment l'ide de dshonneur, accompagnant le crime, remplaa celle de simple dommage
rparer. - Pourquoi la socit arriva se substituer l'individu dans la rpression des dlits et des
peines. - Conception du droit de punir dans les codes modernes. - En quoi le but qu'ils se
proposent n'est nullement atteint. - Comment il pourrait l'tre. - Documents statistiques relatifs
l'influence de nos codes en matire de crimes et de rpression.
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
360
I. - Les origines du droit.
Retour la table des matires; retour au dbut du chapitre
Les restes des anciens codes nous montrent qu'en Orient et en Occident les
prescriptions religieuses, civiles et morales taient confondues. Ce ne fut qu' des
poques trs avances qu'elles commencrent se sparer.
Ce que les mtaphysiciens ont essay de faire pour la morale, les lgistes l'ont
galement tent pour le droit, et ont cru pouvoir le dduire de principes absolus
indpendants de l'existence des socits. Depuis l'poque romaine, ils admettent
que le droit crit drive d'un droit naturel primitif dont le progrs consiste se
rapprocher. J'ai montr dans un autre chapitre ce qu'tait ce droit naturel primitif et
combien l'ide qu'on s'en faisait tait errone.
Cette vieille ide d'un droit naturel, d'o drivent presque toutes les thories
connues sur la philosophie du droit, est entirement d'origine romaine. Les
Institutes de Justinien nous parlent d'un droit naturel, jus naturale que la raison
naturelle dicte tout le genre humain . Reconstituer la gense de cette conception
est facile. En dehors du droit civil, uniquement applicable aux Romains, il y avait le
jus gentium applicable aux trangers, et qui tait simplement une sorte de rsum
de tout ce qu'il y avait de commun dans les coutumes des anciennes nations qui
entouraient Rome. Toutes les fois que les Romains trouvaient un mme usage
adopt par un grand nombre de tribus, ils en concluaient qu'il faisait partie du droit
commun toutes les nations. Ce jus gentium, qui n'tait d'ailleurs qu'une sorte
d'annexe du droit romain l'usage des trangers considrs comme indignes d'tre
rgis par la loi romaine, grandit en importance, quand, sous l'influence des
philosophes grecs, les juristes finirent par y voir un droit driv de la nature, et
considrrent le jus gentium comme driv du jus naturae qu'aux ges primitifs la
nature aurait enseign aux hommes.
Les thories du droit naturel et de la perfection de l'tat de nature ont rgn
jusque dans les temps modernes, et, sauf de bien rares dissidents tels que Hobbes,
ont compt comme adeptes les philosophes et les juristes les plus minents. Nous
avons fait voir quelle immense influence cette thorie avait eue sur la rvolution
franaise. Toutes ses institutions eurent pour idal de retourner ce droit primitif o
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
361
tous les hommes, libres et gaux, auraient eu les uns pour les autres une amiti
fraternelle.
Mme en laissant de ct le rle qu'elle a jou dans les conceptions politiques
modernes, l'ide qu'on se faisait de l'tat de nature et du droit naturel a eu, malgr
sa fausset, une influence considrable sur les transformations du droit et sur les
relations internationales. cet tat suppos de nature se rattachaient en effet des
ides de simplification et de gnralisation qui amenrent le droit romain au degr
de perfection qui l'a fait adopter par la plupart des nations civilises. Ce ne fut qu'
l'aide de cette fiction d'un droit naturel primitif que Grotius et ses successeurs
russirent introduire dans le droit international des rgles qui eurent la plus
heureuse influence sur les relations des peuples entre eux, et ne furent gnralement
admises que parce qu'on les considrait comme drives du droit naturel primitif.
Je n'ai pas besoin de rappeler ce que fut en ralit l'tat de nature, tel que les
dcouvertes modernes de l'archologie prhistorique et de l'anthropologie nous ont
permis de le reconstituer. Dans l'tat de nature il n'y a qu'un droit, celui du plus fort,
et l'homme, comme tous les tres, n'apporte en naissant d'autres droits que celui de
vivre quand il le peut.
L'ide qu'un individu apporte des droits quelconques par le fait seul qu'il vient
au monde est une de ces conceptions enfantines qui peuvent bien germer dans des
cerveaux de socialistes ignorants, mais qui ne sont pas dignes de la discussion.
Mme l'tat civilis, quelles raisons pourrait-on faire valoir l'appui de cette
prtention d'apporter des droits en naissant ? Une seule peut-tre pourrait tre
invoque : ce serait l'utilit qu'il y a pour une socit protger les membres qui la
composent et concourent sa prosprit ; mais les seuls membres ayant besoin de
faire valoir ces droits sont les faibles, les incapables, les inutiles, c'est--dire
prcisment ceux qui, loin de concourir sa prosprit constituent pour elle des
germes de dissolution redoutables. Les droits reconnus ces membres infrieurs,
les soins employs pour favoriser leur multiplication ont des consquences sur
lesquelles je me suis dj tendu dans un autre chapitre, et sur lesquelles il serait
inutile de revenir maintenant.
Ce n'est pas l'homme, mais la ncessit seule qui a enfant les lois qui prsident
l'volution des socits. Qu'elles soient dures ou non, qu'importe ? nous devons
les subir. Or, ces lois nous montrent qu'au banquet de la vie il n'y a place que pour
les plus capables, et que c'est prcisment parce qu'il n'y a place que pour eux que
le progrs a t possible. Une socit compose d'tres d'intelligence moyenne,
apportant en naissant des capacits gales et des droits gaux, serait une socit de
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
362
grossiers sauvages incapables des plus fugitives bauches de civilisation, et obligs
de se dvorer entre eux poques priodiques pour entraver une multiplication trop
rapide. Jamais une telle socit ne ft sortie des priodes primitives dont nous
avons retrac la sombre histoire.
Si nous nous demandons maintenant quelle est, abstraction faite des rveries des
juristes, la base relle du droit, nous trouverons que, de mme que la morale, il ne
peut tre dduit d'aucun principe absolu, qu'il est fils de ncessits rsultant des
conditions d'existence o vit chaque socit. Ce sont ces ncessits seules qui
dterminent la sphre dans laquelle peut se mouvoir l'individu sans nuire autrui,
la balance entre la libert de chacun et celle des autres. Elles donnent naissance aux
coutumes que l'opinion impose, que les codes enregistrent ensuite, et auxquelles ils
donnent la sanction de leurs peines. La coutume devient alors souveraine ; mais ce
n'est pas seulement parce que la force lui donne son appui qu'elle est puissante. Elle
n'aurait pas eu en effet la force si elle n'avait pas possd d'abord l'opinion.
Assurment la force prime le droit, comme le dit le proverbe allemand, mais la
force matrielle n'agit pas toujours, et la force morale qui ne rgne que sur les mes
finit la longue par l'emporter sur elle. Les convictions et les croyances finissent
toujours par triompher quand elles sont profondes.
Nous pouvons donc considrer le droit, de mme que la morale, impos comme
tant surtout un produit de l'opinion. Il est l'expression des besoins de la socit
qu'il devra rgir. Sa valeur est par consquent tout fait relative. Des lois
excellentes pour un peuple peuvent tre trs mauvaises pour d'autres. La loi de
Lynch est le meilleur des codes, parce qu'il est le seul pratique et le seul efficace
pour des socits composes de ramassis d'aventuriers qu'une rpression nergique
et rapide peut seule contenir. Le code d'un peuple vivant dans l'anarchie ne saurait
tre celui d'une nation dont chaque membre sait tre son propre matre. Rechercher
si une loi est quitable ou non, c'est--dire conforme un critrium imaginaire
d'quit, est une tche purile. Ce qu'il faut savoir, c'est si elle correspond
exactement aux besoins de la socit pour laquelle elle a t faite. On ne peut, dit
sagement Herbert Spencer, appliquer une pnalit absolument juste, un peuple
barbare ou demi-barbare, comme il est clair qu'on ne peut lui donner une forme de
gouvernement absolument juste. De mme que pour cette nation le despotisme est
le rgime convenable, de mme, et pour cette nation aussi, un code criminel de la
dernire duret est celui qui convient. Ce qui excuse l'une et l'autre de ces institutions, c'est qu'elles sont ce que le caractre national peut supporter de meilleur ;
c'est que, moins rudes, elles laisseraient la confusion pntrer dans la socit, et
avec elle des maux bien plus cruels qu'elles n'en causent. Le despotisme a beau tre
mauvais : quand le choix est entre lui et l'anarchie, on peut dire que l'anarchie
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
363
amnerait des souffrances pires que le despotisme, et que celui-ci est justifi par le
malheur des temps.
Dans un prochain paragraphe nous montrerons combien notre ide du droit a
vari suivant les temps. On ne saurait donc, je le rpte encore, le dduire de
principes absolus antrieurs aux socits au sein desquelles il a pris naissance. Le
droit sera toujours la simple expression des ncessits que l'existence d'une
communaut entrane, et en dehors de cette communaut il n'aura aucune valeur.
Sans doute les lgistes nous parlent de principes de droit naturel, mais il suffit de
voir comment nous traitons les tres trangers notre socit, animaux et espces
humaines infrieures, pour comprendre combien ces considrations thoriques ont
une influence nulle dans la pratique. S'il apparaissait sur la terre une race d'hommes
dont l'intelligence ft la ntre ce qu'est cette dernire celle des animaux, nul
doute que ces tres transcendants ne nous traitassent exactement comme nous
traitons les autres espces vivantes. Ils nous rduiraient en esclavage, nous feraient
ventrer dans les bois par leurs chiens pour se distraire, comme nous le faisons
l'gard des cerfs, nous dissqueraient vifs au besoin pour faire des expriences, et
finalement nous enverraient l'abattoir aprs engraissage convenable, quand nous
ne pourrions plus travailler pour eux. Cette race suprieure possderait peut-tre,
bien que je ne voie vraiment pas quoi cela pourrait lui servir, des philosophes
raisonneurs qui invoqueraient, pour justifier cette conduite notre gard,
exactement les mmes raisons que nous invoquons pour justifier nos procds
l'gard des animaux, lorsque par hasard nous nous donnons la peine de la justifier.
La nature, qui ne s'inquite gure de nos subtilits philosophiques, et pour
laquelle il n'y a pas plus de droit et de justice que de bien ou de mal, nous traite
plus durement encore que ne le feraient les tres suprieurs dont je viens de parler.
Devant elle, tous les tres vivants sont gaux : le gnie de Newton, la puissance de
Csar ou la beaut d'Hlne ne psent pas plus devant elle que la vie du plus
misrable insecte. Science, jeunesse, beaut, intelligence, elle nous fait tout perdre
pour faciliter la reproduction de quelque parasite obscur.
Lorsque, laissant de ct les considrations thoriques, nous n'envisageons que
l'enchanement des faits tels qu'ils s'observent rellement, nous devons reconnatre
qu'il ne saurait tre question de droits, c'est--dire de choses respecter, qu'entre
individus naturellement ou artificiellement gaux et placs dans des conditions
gales. C'est prcisment parce que les nations voisines sont gnralement ingales
en puissance, que les rgles de droit et de morale sont si parfaitement absentes de
leurs relations. Dire que la force y prime le droit serait une banalit ; ce qu'il faut
dire, c'est que le seul droit qui y puisse rgner entre elles, c'est la force. La destine
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
364
d'un peuple faible qui n'a pas su se crer d'alliances est d'tre fatalement conquis
par des voisins plus forts. Il serait bien inutile, je pense, d'essayer de dmontrer une
loi aussi vidente et qui se trouve crite chaque page de l'histoire. Les Anglais,
qui appartiennent assurment une des races o la moralit et la notion du droit et
du devoir sont le plus dveloppes, pressurent l'Inde au point de faire mourir de
faim des millions d'hommes, et forcent coups de canon les Chinois acheter
l'opium qui les empoisonne, uniquement parce qu'ils sont les plus forts. La justice,
l'quit, etc., sont des mots dont les diplomates font un frquent usage, mais en y
attachant exactement la mme valeur qu'aux formules par lesquelles ils terminent
leurs lettres. En peut, temps, et aujourd'hui peut-tre plus que jamais, chaque
peuple sait que les droits qu'il peut faire valoir sont exactement proportionnels au
nombre de canons et de soldats qu'il possde. Il faut lire la correspondance des
diplomates et des souverains que l'histoire qualifie de grands, pour se convaincre
quel point y est pousse l'absence des notions les plus simples de droit et de morale.
La correspondance de l'illustre Frdric Il de Prusse est, ce point de vue,
particulirement curieuse. La proccupation de ne jamais manquer l'occasion de
dpouiller un voisin plus faible s'y lit chaque page. Trouver des prtextes
l'attaque est chose secondaire qu'on abandonne l'imagination des diplomates
quand l'attaque est commence. L'article du droit est l'affaire des ministres ; il est
temps d'y travailler, car les ordres aux troupes sont donns, crit le grand roi.
Avant lui, un diplomate ingnieux donnait un souverain sudois un conseil qui
rsume trs bien cette morale commune aux conqurants et aux dtrousseurs de
grands chemins. Dieu, disait-il, ne parle plus aujourd'hui aux princes par la voix
des prophtes ou par des songes. Mais il y a appel de Dieu partout o se prsente
une occasion favorable d'attaquer ses voisins ou d'tendre ses propres frontires.
Il serait fort injuste assurment de blmer dans de telles circonstances la
conduite des rois. Les peuples pensent exactement comme eux. Je ne connais pas
d'exemples dans l'histoire d'une nation qui ait trouv injuste qu'on la conduist piller
et conqurir un pays quelconque lorsque l'expdition avait russi.
Qu'il y ait un remde cette absence de respect du droit et de la morale dans les
relations entre peuples de forces ingales, cela peut sembler bien douteux. Il me
semble probable pourtant que la force des choses finira, dans un avenir plus ou
moins lointain, par engendrer le remde. Les mmes ncessits qui ont conduit les
membres d'une socit se respecter entre eux pour tre respects, conduiront les
peuples aux mmes rsultats. Les guerres devenant de plus en plus meurtrires et
coteuses, en mme temps que le rsultat pour le vainqueur devient de plus en plus
faible, il arrivera un moment o des expriences rptes auront tellement
convaincu chacun de cette vrit, que nul ne voudra s'exposer courir des risques
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
365
trs grands pour obtenir des rsultats trs petits. Chez les nations civilises, on ne
voit qu'exceptionnelle ment un individu en attaquer un autre dans la rue pour le tuer
et le voler, parce que l'agresseur, si dpourvu de principes qu'on le suppose, sait
cependant que, pour un avantage problmatique trs minime, il s'expose des
risques trs grands. C'est l certainement de la morale utilitaire sous sa forme la
plus basse. Mais cette morale-l possde au moins l'avantage d'tre parfaitement
claire et accessible toutes les intelligences. Dans les relations entre peuples
diffrents, on ne saurait en invoquer utilement d'autre. Suffisamment comprise, elle
procurerait des avantages incalculables. Aujourd'hui, les peuples de l'Europe sont
obligs de maintenir sous les armes le plus grand nombre de leurs hommes valides,
de se ruiner en dpenses militaires et d'accrotre constamment leurs armements.
Mais les ressources de chaque tat ayant forcment un terme, il arrivera un jour ou
quelque tat important se voyant sur le point d'avoir puis ses ressources, se
jettera, sous un prtexte quelconque ou mme sans aucun prtexte, sur quelque
nation voisine plus faible pour la piller. Le vol et le meurtre pratiqus sur une
grande chelle, c'est--dire ce qu'on dsigne sous le nom de conqutes, sont,
comme on nous l'a rpt pendant dix ans au collge, choses fort recommandables.
En gorgeant rapidement cent mille hommes et en ravageant quelques provinces,
on se couvre de beaucoup plus de gloire qu'en dcouvrant l'analyse spectrale ou les
lois de l'attraction. Jamais ministre d'un culte n'a refus ses Te Deum ces brillants
exploits. Ce n'est que quand une ducation un peu moins inintelligente que la ntre
aura pendant quelques gnrations clair les hommes sur leurs vritables intrts,
que nos conceptions actuelles et toutes les consquences que ces conceptions
entranent pourront changer.
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
366
II. - volution du droit.
Retour la table des matires; retour au dbut du chapitre
Nous ne saurions esquisser ici mme grands traits la transformation du droit
chez les diffrents peuples. Il nous suffisait de montrer l'influence des ncessits
qui lui ont donn naissance et l'ont transform, et ce que nous avons dit cet gard
prouve combien ces ncessits sont indpendantes des volonts des hommes. Il n'y
a que dans les livres qu'on ait jamais vu des lgislateurs comme Solon, Lycurgue,
Numa, etc., crer des codes de toutes pices. En ralit, ils n'ont fait que donner une
forme crite aux coutumes fixes par l'opinion. Loin que leur puissance ft assez
grande pour crer des lois nouvelles, elle ne leur suffisait mme pas pour abroger
les anciennes. Toutes les vieilles lois et coutumes taient en effet associes
quelques pratiques religieuses, et on n'osait pas y toucher, mme quand elles taient
en contradiction avec les nouvelles. Le code de Dracon ne fut pas aboli par celui de
Solon, ni les vieilles lois romaines par celles des Douze Tables.
Avant l'invention de l'criture, il ne pouvait exister naturellement que des
coutumes. Associes la plupart aux prescriptions religieuses, elles taient
maintenues par une aristocratie sacerdotale puissante. Lorsque l'criture fut connue
et rpandue, on grava les lois constitues par les anciennes coutumes sur des tables
de pierre ou de mtal. La loi grave devint alors quelque chose d'immuable.
Il a toujours t avantageux pour un peuple que ses lois, comme celles des
Romains, aient t graves de bonne heure, parce qu'alors elles n'ont pas enregistr
une foule de coutumes incohrentes qui finissent la longue par driver des
pratiques religieuses. Les codes hindous, crits fort tard, contiennent un grand
nombre d'absurdits : L'analogie, dit Sumner Maine, qui rend tant de services au
droit arriv l'ge de maturit, est le plus dangereux des piges dans l'enfance du
droit. Des prohibitions et des prescriptions limites l'origine, - et pour
d'excellentes raisons, - certains actes, deviennent applicables tous les actes du
mme genre, parce qu'un homme menac de la colre des dieux, s'il fait une chose,
craint naturellement de faire quoi que ce soit qui ressemble la chose dfendue.
Aprs que certains aliments ont t interdits pour des motifs d'hygine, la
prohibition s'tend tous les aliments qui ressemblent ceux qui sont dfendus,
lors mme que la ressemblance est fonde sur des analogies de fantaisie. Ainsi une
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
367
sage prescription pour assurer la propret gnrale cre, la longue, la routine des
ablutions pour la forme.
Le principal facteur de la naissance et de l'volution du droit est, comme je l'ai
dit, l'opinion. Elle seule est assez puissante pour transformer les lois. Ces dernires
ne font que la suivre et sont toujours en retard sur elle. Ce retard varie suivant
chaque peuple. C'est chez ceux o l'cart n'est pas trop grand entre le droit crit et
l'opinion, image fidle des ncessits sociales, que les progrs sont les plus rapides.
Ne pouvant songer dvelopper ici les divers lments qui entrent dans
l'histoire du droit, - tche qui incombe aux lgistes, mais qu'ils ont t impuissants
jusqu'ici accomplir, - je me bornerai, pour donner une ide de son volution,
indiquer grands traits les transformations principales d'un de ses chapitres les plus
importants, celui qui concerne les dlits et les peines.
Dans sa forme primitive, le droit de punir appartient exclusivement l'individu
offens, et n'est exerc que par lui. La peine est celle du talion. Le coupable, ou
son dfaut sa famille, car il ne faut pas oublier que dans les temps primitifs l'unit
fut toujours la famille et non l'individu, est poursuivi jusqu' rparation de
l'offense ; et l'opinion oblige la victime, ou son dfaut ses parents, exiger la
rparation du dlit.
Aussi la vengeance se poursuit-elle, non seulement sur toute la famille du
coupable, mais encore sur ses descendants ou ses ascendants. C'tait une maxime
gnrale du droit antique, que les enfants taient responsables des fautes de leur
pre. Mme devant les dieux, ils ne trouvaient pas grce. Je suis le Seigneur votre
Dieu, dit Jhovah au chapitre XX de l'Exode, le Dieu fort et jaloux qui venge
l'iniquit du pre sur les enfants jusqu' la troisime et la quatrime gnration.
Ce n'est qu' l'poque trs postrieure o fut crit le Deutronome, qu'on admit
chez les Juifs que les pres ne fussent pas mis mort pour les fautes de leurs
enfants, et rciproquement.
Cet usage de venger sur toute la famille la faute d'un de ses membres, qui existe
encore aujourd'hui en Chine et mme dans certaines parties peu civilises de
l'Europe, telles que la Corse et la Sardaigne, persista longtemps dans le droit
romain. Cicron, tout en reconnaissant la cruaut de cette coutume, reconnat aussi
que c'est une loi excellente au point de vue de l'utilit.
Sous sa forme la plus primitive, la seule peine admise pour une offense tait
celle du talion. Elle est la base du droit biblique. Celui qui aura bless quelqu'un
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
368
de ses concitoyens, dit le Lvitique, sera trait comme il a trait l'autre ; il recevra
fracture pour fracture, et perdra oeil pour oeil, dent pour dent ; il sera contraint de
souffrir le mme mal qu'il aura fait souffrir l'autre. L'Exode dit peu prs en
mmes termes la mme chose.
Ce droit de vengeance est la base de tout l'ancien droit des diffrents peuples. Il
suffit de parcourir l'histoire pour reconnatre qu'une des plus importantes
occupations des hommes a t de se venger des injures qu'ils avaient reues.
Ce droit de vengeance s'tendait mme aux animaux. La Bible prononce des
peines varies, tre brl, lapid, etc., contre des animaux auteurs de divers mfaits.
Les procs d'animaux ont continu, du reste, jusque dans des temps presque
modernes. Pierquin rapporte une longue suite de procs faits des animaux,
taureaux, chiens, cochons, coqs, etc., condamns tre brls ou pendus ; des
insectes divers, tels que les chenilles, condamns par les vques, aprs
informations contradictoires et plaidoiries solennelles, l'excommunication.
Ce droit de vengeance, exerc uniquement d'abord sous la forme de peine du
talion, ne pouvait se maintenir longtemps dans les socits en voie de progression.
L'exprience dmontra bientt que, dans une socit ayant quelques traces
d'organisation, la peine du talion ne donnait qu'une rparation insuffisante la
partie lse, et que son exercice entranait des luttes intestines nuisibles aux intrts
gnraux de la communaut. la peine du talion se substitua bientt une
compensation pcuniaire paye par l'offenseur l'offens. Le droit de vengeance
existait toujours, mais la vengeance de mme ordre que l'offense se substituait
une peine considre comme quivalente.
Le systme de la compensation apparat dans les anciens codes de tous les
peuples qui nous ont laiss des vestiges. Le sens primitif du mot peine, dans son
origine latine et grecque (poena, nolyn), signifie compensation. Aux temps
d'Homre, le meurtre se vengeait par une compensation paye aux parents de la
victime. La Bible contient plusieurs indications prouvant que ce systme fut
d'abord pratiqu gnralement chez les Juifs. On lit au chapitre XXI de l'Exode que
si un homme frappe une femme enceinte au point qu'elle accouche d'un enfant
mort, le coupable doit payer au mari une somme fixe par les arbitres. Le chapitre
XXII indique la compensation payer pour plusieurs crimes : Si quelqu'un vole
un boeuf ou une brebis, et qu'il les tue ou qu'il les vende, il rendra cinq bufs pour
un buf, et quatre brebis pour une brebis. Si quelqu'un met en dpt de l'argent
chez son ami, ou quelque meuble en garde, et qu'on le drobe chez celui qui en tait
le dpositaire, si l'on trouve le voleur, il rendra le double. Si le voleur ne se trouve
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
369
point, le matre de la maison sera oblig de se prsenter devant les juges, et il jurera
qu'il n'a point pris ce qui tait son prochain, et qu'il n'a point eu de part ce vol.
Les juges examineront la cause de l'un et de l'autre, et, s'ils condamnent le
dpositaire, il rendra le double celui qui tait le dpt. On lit dans le mme
chapitre que la sduction d'une vierge se payait en l'pousant ou en lui donnant une
dot.
La loi des Douze Tables infligeait des peines analogues. L'auteur d'un vol, non
surpris en flagrant dlit, payait le double de ce qu'il avait vol.
Dans tout le droit primitif, le crime n'tait nullement considr comme quelque
chose de dshonorant en soi-mme, mais simplement comme un dommage caus.
Le dommage pay, le coupable n'tait pas plus atteint dans son honneur et dans sa
considration que ne l'est aujourd'hui le directeur d'une compagnie de chemin de
fer qui est oblig d'indemniser les parents des victimes d'un accident.
Si l'on ouvre les Commentaires de Gaius, dit Sumner Maine, au chapitre o il
parle du droit pnal des Douze Tables, on verra qu'en tte des torts civils reconnus
par la loi romaine se trouvait le furtum ou vol. Les offenses que nous sommes
habitus considrer comme crimes sont considres comme torts, et non
seulement le larcin, mais l'attaque et le vol main arme sont runis par le
jurisconsulte avec l'entre par force sur la terre d'autrui et la diffamation crite ou
parle. Tous donnaient naissance une obligation ou vinculum juris, et taient
punis par le paiement d'une somme d'argent. Mais cette particularit est surtout
frappante dans les collections de lois des tribus germaniques. Toutes, sans
exception, contiennent un immense systme de compensations en argent pour
l'homicide, et la plupart ont un systme de compensations tout aussi tendu pour les
offenses moins graves. Dans la loi anglo-saxonne, crit M. Kemble, la vie de tout
homme libre tait value une somme d'argent, variable selon son rang ; une
somme d'argent compensait les blessures qui pouvaient lui tre infliges, et presque
tous les dommages qu'il pouvait souffrir dans ses droits civils, dans son honneur,
dans sa tranquillit, et la somme tait augmente suivant les circonstances qui
accompagnaient l'offense.
Mais, en dehors des offenses atteignant l'individu, il y avait celles atteignant la
tribu tout entire ou les dieux de la tribu. Ces dernires ne pouvaient tre venges
que par la socit elle-mme ; et c'est seulement dans de tels cas qu'apparat la
notion de crime. A mesure que la socit croissait en complexit, que tous ses
membres devenaient de plus en plus dpendants les uns des autres, on observa que
la communaut tout entire tait toujours plus ou moins lse par les torts des
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
370
particuliers l'gard les uns des autres et que le meurtrier, le voleur, l'incendiaire,
taient en ralit dangereux pour tous. La socit arriva alors se substituer
graduellement l'individu dans la poursuite du chtiment, et, au simple
ddommagement, s'ajouta ou se substitua un chtiment prononc au nom de la
communaut. Cette peine ainsi inflige au nom de tous entranait ncessairement
une atteinte l'honneur et la considration du coupable.
Le systme de la compensation se rduisit ainsi progressivement, et, la chute
de l'empire romain, il avait peu prs disparu. S'il reparut et se maintint pendant
longtemps, ce fut par suite de l'invasion de peuples, tels que les Germains, qui en
taient encore cette phase du droit primitif.
la notion de vengeance par la socit a fini par se substituer, dans les temps
modernes, en thorie du moins, l'ide que les lois ne sont pas institues pour venger
les socits, mais pour les protger en corrigeant les coupables, et refrner la
tendance au crime par l'exemple du chtiment.
Si les codes modernes taient rellement crits sous l'influence de tels principes,
ils seraient probablement parfaits ; mais ce qui se dgage de leur lecture attentive et
de l'examen des conditions dans lesquelles ils sont appliqus, c'est beaucoup plus la
vieille notion de vengeance que celle de protection, et en ralit la seconde est
peu prs entirement sacrifie la premire. Elle l'est mme ce point que, pour
satisfaire cet occulte besoin de vengeance, nous avons recours un systme de
punition qui rend le coupable beaucoup plus dangereux qu'il ne l'tait d'abord,
comme le prouve la progression des rcidives. Deux des buts thoriques cits plus
haut, protger la socit et corriger le coupable, ne sont donc pas atteints. Seul, le
troisime, effrayer par la crainte du chtiment, l'est peut-tre dans une certaine
mesure, mais en tout cas dans une mesure bien faible.
J'ai montr, dans le chapitre consacr l'tude de l'hrdit, combien les
mdecins qui ont tudi les vritables criminels taient convaincus de
l'impossibilit de les amender. Les habitus des prisons et des bagnes sont des
individus d'une constitution mentale spciale qu'ils apportent en naissant, ou qui
rsulte d'un tat pathologique dtermin, et sur laquelle nous ne pouvons rien. Les
rformer est une chose impossible et laquelle il est inutile de songer.
En partant de cette base indiscutable de l'impossibilit d'amender les vritables
criminels, je me suis vu conduit, dans le chapitre que je mentionnais l'instant,
cette conclusion, que le lgislateur de l'avenir, pntr de la ncessit o se trouve
une socit de se protger, et laissant entirement de ct les discussions vaines sur
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
371
le degr de responsabilit des criminels, fermera les prisons et emploiera les
nombreux millions qu'elles cotent dporter les criminels. La dportation dans
des contres demi-sauvages les placerait prcisment dans des milieux
correspondants leur intelligence et leur moralit infrieure, et ils pourraient
mme y prosprer. Quant aux simples violations de la loi peu dangereuses pour la
scurit publique, des amendes pcuniaires, ou, leur dfaut, un travail obligatoire
industriel ou agricole d'une dure variable, ou mme encore un service militaire
forc sous une discipline svre, seraient autrement efficaces que la prison.
Sans doute il existe un certain nombre de faits parfaitement incontestables,
notamment les expriences du gouverneur Oberman sur 600 prisonniers de Munich,
celles du capitaine Maconochie l'le de Norfolk, du colonel Montesinos Valence,
qui prouvent la possibilit d'amliorer certains dtenus. Ces faits montrent
seulement que beaucoup d'individus enferms dans les prisons y sont enferms
inutilement, et pourraient tre amends par divers moyens. Il ne faut pas oublier, en
effet, qu'en dehors des criminels proprement dits, il existe toute une catgorie - c'est
la plus nombreuse - de caractres neutres ou indcis, qui font indiffremment le
bien ou le mal suivant les influences agissant sur eux, et qui feront par consquent
le bien si on les place sous l'influence de motifs plus puissants que ceux qui les
poussaient au mal. L'esprance d'une rhabilitation prochaine, d'une rduction de
leur peine, un rgime graduellement amlior avec leur bonne conduite, la
possibilit de gagner de quoi rendre leur situation meilleure par un travail librement
choisi par eux, constituent de tels motifs. Ce sont prcisment les moyens auxquels
on avait recours dans les expriences auxquelles je faisais allusion plus haut ; mais,
bien que ces expriences aient t faites depuis longtemps, elles n'ont pas t
rptes et ne pouvaient gure l'tre. C'est que, pour les renouveler, il fallait des
hommes d'une aussi haute intelligence et d'un aussi grand caractre que ceux qui
les ont tentes, des hommes entreprenant une tche avec cette foi qui fait qu'on s'y
adonne tout entier. Peut-on esprer rencontrer de telles conditions chez les agents
subalternes qu'on place habituellement la tte des prisons, et dont les pouvoirs
sont limits du reste par des rglements fort prcis ?
Je crois donc que la conclusion laquelle je suis arriv plus haut, la dportation
des criminels, constitue actuellement la seule solution pratique de l'puration absolument indispensable - des lments dangereux d'une socit. Quant aux
vritables alins, il faut se rsoudre les enfermer perptuit, car ils sont
gnralement incurables et beaucoup plus dangereux en ralit que l'homme
raisonnable qui, sous l'influence d'une passion violente passagre, commet un
crime. Acquitter et mettre en libert, comme l'a fait rcemment un jury, un individu
qui a mthodiquement tu sa femme coups de hache, sous prtexte qu'tant
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
372
alcoolique, il tait irresponsable, c'est rejeter dans la socit un tre aussi dangereux
qu'un animal enrag.
Mme au point de vue humanitaire, qui, dans la circonstance, ne doit
videmment passer qu'en seconde ligne, le systme de dportation dont je viens de
parler serait beaucoup moins cruel que les peines qu'on inflige aujourd'hui aux
coupables et qui les rendent incapables ensuite de trouver aucun travail. Nous
enfermons annuellement en France plus de cent mille individus. Ils sortent des
prisons sans autre occupation possible que de conspirer contre la socit, y
propager leurs vices et corrompre ceux qui les entourent par leur funeste exemple.
Si, prenant une priode de dix ans, crivait un prsident de la cour de cassation,
M. Brenger, on additionnait le nombre de dtenus qui se succdent chaque anne
dans nos prisons, on trouverait que plus d'un million d'habitants sont venus s'y
plonger plus avant dans le crime, et que leur seul entretien a cot l'tat au-del
de cent trente millions.
Depuis que ces lignes ont t crites, rien n'est venu en modifier l'inquitante
justesse. Le nombre des individus emprisonns est devenu plus grand, et la somme
qu'ils cotent a presque doubl. Quant aux rcidives, elles croissent avec une
rapidit considrable, comme le prouve le tableau suivant :
Nombre des accuss en rcidive condamns en cour d'assises
et par les tribunaux correctionnels en France :
Annes
Nombre des rcidivistes condamns
1872
1873
1874
1875
1876
59,076
63,469
70,806
69,809
70,257
En cinq ans, les rcidives ont, comme on le voit, augment de 11,181.
En mme temps que les rcidives augmentent, que, sous l'influence des ides
humanitaires, les chtiments deviennent plus doux et que la peine de mort est de
plus en plus rarement applique, les crimes augmentent rapidement. Les chiffres
suivants puiss aux sources officielles en fourniront la preuve catgorique :
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
373
Nombre de crimes contre les personnes
(Assassinats, parricides, blessures, empoisonnements, etc.).
Annes
Nombre des accuss
1872
1873
1874
1875
1876
1,884
1,954
1,972
2,023
2,101
Peines de mort excutes
26
15
13
12
8
Je ne veux pas trop insister sur les graves enseignements que portent en eux ces
chiffres ; mais n'est-il pas remarquable qu' mesure que la peine de mort devient
plus rare, les crimes augmentent rapidement ? N'est-il pas vident qu'il y a l un
terrible argument contre sa suppression ?
Un savant conomiste, M. de Molinari, a fait rcemment des calculs instructifs
sur les chances de mort auxquelles on s'expose en exerant rgulirement le mtier
d'assassin ou certaines professions dangereuses, comme celle de mineur. Prenant en
considration le nombre de crimes commis annuellement, et le comparant aux
chances de mort dans certaines professions telles que celles des mineurs,
remarquant galement que dans les statistiques belges et anglaises - les seules
publies - les auteurs des trois quarts des crimes dnoncs la justice restent
inconnus, qu'un criminel seulement sur 6 peut tre atteint et puni, que sur 36
assassins il n'y en a qu'un de guillotin, l'auteur arrive cette conclusion, que le
mtier d'assassin est beaucoup moins prilleux que celui d'ouvrier mineur, et
qu'une Compagnie d'assurance qui assurerait des assassins et des ouvriers
mineurs pourrait demander aux premiers une prime infrieure celle qu'elle serait
oblige d'exiger des seconds.
Je ne me suis pas occup, dans ce qui prcde, des questions de responsabilit et
de libre arbitre. Elles ont t suffisamment discutes dans un prcdent chapitre et
n'ont rien faire du reste dans le question pratique que je viens de traiter. Le point
de vue o nous devons nous placer est celui-ci : La socit doit-elle d'abord se
protger, ou doit-elle, avant de se protger, prendre l'intrt des criminels ? Je
trouve dans un savant mmoire du Dr. Dally sur la prtendue irresponsabilit de
certains criminels, travail dont je partage tout fait les ides, le passage suivant
d'un journaliste, M. Sarcey, qui, laissant de ct toutes les discussions
philosophiques sur le libre arbitre, a parfaitement rsum la question : Quand une
vipre vous saute aux jambes, dit-il, vous ne vous demandez pas si elle a suivi son
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
374
instinct de vipre, si elle est coupable ou jusqu' quel point elle est responsable,
vous l'crasez du pied uniquement parce que c'est une bte nuisible et qu'aprs vous
avoir mordu, elle en pourra mordre d'autres. Vous faites une oeuvre utile en
dbarrassant l'humanit de cet ennemi qui infeste les bois et rend le sommeil sur
l'herbe trs dangereux. Est-elle juste ? C'est un point dont nous n'avons pas nous
occuper. Les moralistes philosopheront l-dessus si bon leur semble ; vous, vous
courez au plus press, qui est de dbarrasser la fort. Eh bien! les juges ne sont
point du tout les reprsentants de l'ternelle justice sur la terre ; ils n'ont pas pour
mission de sonder les reins et d'interroger les curs. C'est affaire Dieu ou ses
reprsentants, s'il en a. Ils n'ont t tablis, ou du moins ils n'auraient d l'tre que
pour dcider du degr de pril que fait courir un tre la socit. Lorsqu'un chien
est enrag, il ne m'importe gure de savoir d'o lui vient sa rage ; je l'enferme et je
l'abats. Quand un homme se met en rbellion contre le pacte social, il est indiffrent
que ce soit chez lui mauvaise ducation, perversion du sens moral, apptit drgl,
ou toute autre cause dterminante : ce qu'il y a de certain, c'est qu'il bouleverse
l'ordre tabli ; c'est qu' ct de lui, on n'est plus en sret ; il faut donc l'attacher
pour qu'il ne nuise plus, et attendre qu'il revienne de meilleurs sentiments. Prison
ou maison d'alins, il n'importe ; l'essentiel, c'est qu'il ait les mains lies.
Le moraliste Vauvenargues avait dj exprim une opinion analogue : Mais,
dira quelqu'un, si le vice est une maladie de notre me, il ne faut donc pas traiter les
vicieux autrement que les malades. Sans difficult, rien n'est si juste, rien n'est plus
humain. Il ne faut pas traiter un sclrat autrement qu'un malade, mais il faut le
traiter comme un malade. Or, comment en use-t-on avec un malade, par exemple,
avec un bless qui a la gangrne dans le bras ? Si l'on peut sauver le bras sans
risquer le corps, on sauve le bras ; mais, si l'on ne peut sauver le bras qu'au pril du
corps, on le coupe, n'est-il pas vrai ? Il faut donc en user de mme avec un sclrat ;
si on peut l'pargner sans faire tort la socit dont il est membre, il faut
l'pargner ; mais, si le salut de la socit dpend de sa perte, il faut qu'il meure, cela
est dans l'ordre.
Assurment si j'avais donner mon opinion sur l'tat psychologique des
criminels, je reconnatrais volontiers qu'ils sont irresponsables ; mais en quoi, je le
demande, ces tres dangereux mritent-ils plus d'gards que les milliers d'innocents
que nous envoyons journellement mourir sur les champs de bataille de contres
lointaines, pour dfendre l'honneur de causes que le plus souvent ils ne connaissent
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
375
mme pas ? Sur quoi pourrait-on se baser pour soutenir que la victime actuelle d'un
assassin ou au moins ses victimes futures sont moins dignes d'intrt que cet
assassin lui-mme ?
Les mdecins qui admettent le plus aujourd'hui l'tat de perturbation crbrale
des alins sont les premiers reconnatre pour la socit le droit et le devoir de
se mettre l'abri des criminels, qu'ils soient malades ou non, responsables ou non .
C'est cette conclusion qu'est arriv rcemment le Dr Bordier, dans un travail o il
donne les rsultats de son examen d'un certain nombre de crnes de guillotins,
dont les deux tiers, suivant lui, prsenteraient des lsions impliquant des altrations
pathologiques du cerveau 94.
Je n'insisterai pas davantage sur la grave question sociale que je viens de traiter
en passant et dont je ne me suis occup que parce que sa solution future reprsente
une des phases de l'volution de l'un des lments du droit dont je m'tais propos
de reconstituer les transformations. Les rformes dont j'ai parl viendront
certainement leur heure, mais il n'est pas dans notre pouvoir de rapprocher cette
heure. De mme que l'astronome prvoit, des sicles d'avance, la place qu'occupera
un astre dans le ciel, de mme aussi le savant, connaissant les lois de l'volution
sociale, peut soulever parfois le voile de l'avenir. Pas plus que l'astronome
cependant, il ne saurait se servir de sa connaissance de l'tat futur des choses pour
modifier leur tat prsent. Simple science d'observation, la science sociale doit
rester toujours dans l'observation pure.
94
J'ai eu entre les mains soixante crnes environ de guillotins et 40 crnes environ d'hommes clbres que j'ai
mesurs et dessins par des procds gomtriques trs prcis. Je publierai quelque jour le rsultat de ce
volumineux travail lorsque j'aurai pu comparer toutes ces mesures et dessins ceux d'un nombre suffisant de
crnes ayant appartenu des sujets dont les aptitudes pendant leur vie taient connues.
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
376
Deuxime partie
LES SOCITS
Leurs origines et leur dveloppement
livre III : Dveloppement des socits
Chapitre VII.
Dveloppement de l'industrie
et de l'conomie sociale.
Retour la table des matires; retour au dbut du chapitre
1. Formes primitives de l'industrie. - Elle est contemporaine des premiers hommes. - Son
existence chez les animaux. -L'ancienne industrie ne connaissait que la force musculaire comme
puissance motrice. - Dans l'antiquit classique, le travail tait exclusivement l'apanage des
esclaves. - II. Nouvelle organisation de l'industrie aprs la disparition de l'esclavage et du
servage. - Constitution de chaque industrie en corporations. - Rigueur des rgles qu'elles
imposaient. - En quoi elles taient adaptes aux besoins des temps o elles prirent naissance. - III.
L'industrie moderne. - Comment l'antique rgime des corporations disparut. - Influence des voies
de communication nouvelles et des dbouchs nouveaux. - Naissance de l'industrie libre. Influence des machines. -Influence de la dcouverte de la houille comme force motrice et de
l'emploi de la machine vapeur. - Influence considrable du progrs des sciences. - La
civilisation moderne est fonde sur elles. - Rsultats avantageux de l'industrie moderne. Comparaison entre l'aisance actuelle et l'aisance qui existait il y a quelques sicles. - Rsultats
dsavantageux de l'industrie. -Influence des tendances utilitaires. - Accroissement des diffrences
entre individus de diverses classes. - Lutte entre le capital et le travail. - Dgnrescence
intellectuelle et morale des classes infrieures produite par les conditions actuelles de l'industrie. Comment on pourrait y remdier. - IV. volution actuelle de l'industrie et de l'conomie socia1e.
- Tendance actuelle de la proprit industrielle prendre la forme collective. - Mcanisme de
l'association. - Formes diverses d'associations ouvrires. - Leur avenir. - Importance de faire
acqurir l'ouvrier un petit capital. - Comment on pourrait y arriver. - Infriorit des conceptions
des socialistes modernes. - Elles nous ramneraient des formes d'volution depuis longtemps
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
377
dpasses. - Pourquoi, malgr leur valeur nulle, ces conceptions sont peut-tre appeles jouer
un rle trs grand. - Les rvolutions scientifiques et industrielles ont une importance beaucoup
plus grande que les rvolutions politiques. - Les premires seules exercent une action durable
dans l'existence des hommes.
I. - Formes primitives Industrie.
Retour la table des matires; retour au dbut du chapitre
Examinant, dans un prcdent chapitre, l'influence du progrs de l'industrie sur
l'volution des socits, nous avons fait voir que ce fut seulement l'poque o, des
agglomrations humaines un peu nombreuses s'tant formes, la division du travail
put se produire que les premiers progrs industriels, apparurent. Avec eux, l'homme
commena se soustraire la dpendance de son milieu et entrer dans la voie qui
devait le conduire la civilisation.
Ce fut seulement quand les progrs de l'industrie eurent atteint un certain niveau
que les civilisations purent natre. Mais, bien avant l'ge o elles prirent naissance,
des connaissances industrielles importantes taient dj acquises. Les primitives
poques des ges de la pierre, dont nous avons retrac l'histoire, nous ont montr
une organisation du travail assez avance, puisque l'homme possdait dj des
ateliers de construction spciaux pour ses armes et pour divers objets.
Nous ne saurions nous tonner que l'industrie soit contemporaine des premiers
hommes, puisque dans le rgne animal elle est dj trs dveloppe. Sans parler des
travaux excuts par les fourmis, les abeilles et un grand nombre d'animaux
infrieurs, nous avons vu que les travaux accomplis par des animaux suprieurs,
tels que les castors, n'taient pas infrieurs ceux de certaines tribus sauvages.
Ce serait une tche aussi intressante qu'utile de tracer l'histoire de l'volution
de l'industrie humaine travers les civilisations et les ges ; mais les dtails
techniques et les dveloppements que ncessiterait un tel travail ne sauraient
prendre place ici. Nous devons donc nous borner quelques aperus rapides,
suffisants pour bien faire comprendre les principales phases de son dveloppement.
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
378
Nous avons reconstitu dj l'tat de l'industrie humaine dans les temps
prhistoriques et montr que des phases analogues se retrouvent chez les sauvages
modernes. Cette tude comparative nous a fait reconnatre que, sur les points les
plus loigns du globe, l'intelligence humaine a successivement franchi les mmes,
tapes.
Lorsque les peuples apparaissent dans l'histoire, c'est--dire lorsqu'ils lvent
des villes et connaissent l'criture, l'industrie a acquis dj un haut degr de
dveloppement. Les gigantesques travaux laisss par les gyptiens et les Assyriens,
puis plus tard par les Grecs et les Romains, et qui n'ont t surpasss que dans des
temps tout fait modernes, en sont la preuve.
Toute l'industrie ancienne, et nous pouvons appliquer cette qualification
d'industrie ancienne celle d'poques trs rapproches de nous, avait ce caractre
commun que la source principale o tait emprunte la force ncessaire pour faire
subir la matire ses transformations, tait le travail des tres vivants. La force que
nous empruntons la houille aujourd'hui, il fallait la demander la puissance
musculaire des animaux, et surtout de l'homme. Les travaux ainsi excuts tant
fort pnibles taient l'apanage des esclaves. Dans toute l'antiquit classique,
Rome comme en Grce, le travail manuel tait presque exclusivement excut par
eux. Lycurgue fit son possible pour empcher les Lacdmoniens de se livrer aux
arts industriels. A Rome, la population industrielle se composait surtout des
prisonniers provenant des pays conquis. Certains citoyens possdaient jusqu' vingt
mille esclaves. Ce n'tait que par un rgime de fer, ne laissant aucune place la
piti, qu'on maintenait dans l'obissance ces foules innombrables toujours prtes
se rvolter. Pour rendre la rpression plus facile, les esclaves de chaque matre
taient solidairement responsables de leurs fautes. Quand Pedanus Secundus, prfet
de Rome, fut assassin par un de ses esclaves, tous ceux qu'il possdait, au nombre
de quatre cents, bien qu'entirement innocents, furent excuts la suite d'un
jugement ratifi par le Snat.
Lorsque, des poques variables suivant chaque peuple, l'esclavage disparut, le
servage qui le remplaa n'amliora pas sensiblement le sort des classes ouvrires.
La seule considration qu'on puisse faire valoir en faveur de ce rgime, c'est que
l'existence de l'ouvrier tait assure, et que le matre avait tout intrt ne pas lui
rendre la vie trop dure afin de mnager ses forces.
II. - Nouvelle organisation de l'Industrie
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
379
aprs la disparition de l'Esclavage
et du Servage.
Retour la table des matires; retour au dbut du chapitre
Lorsque l'industrie cessa d'tre pratique uniquement par des serfs ou des
esclaves, elle subit une transformation importante ; chaque corps de mtier se
constitua en corporation spciale, rgie par des rglements minutieux. De telles
corporations, constitues d'une faon analogue, se retrouvent sur les points les plus
loigns du globe.
En examinant ce que fut leur organisation en Europe, et notamment en France,
du XIe sicle environ jusqu' la Rvolution franaise, on peut se faire une ide
suffisamment nette de cette phase importante du dveloppement de l'industrie.
A l'poque dont nous venons de parler, les divers corps de mtiers formaient des
corporations, rgies chacune par des lois trs-strictes qui ne laissaient leurs
membres aucune initiative individuelle et aucune libert : limitation du nombre des
matrises et des apprentis, dispositions nombreuses fixant les mthodes de
fabrication et les heures de travail, de faon empcher chacun de pouvoir faire
concurrence ses confrres en travaillant mieux ou davantage, stricte prohibition
des marchandises venant du dehors, etc. En raison de l'absence de moyens de
communication, les importations de produits trangers taient fort rares, mais,
quand elles se produisaient, elles taient rprimes svrement. En 1630, les
drapiers de Rouen brlrent eux-mmes, sans attendre aucun appui lgal, cent mille
livres de draps qu'avait voulu importer un navire anglais, et, plusieurs reprises, ils
rprimrent de la mme faon des tentatives analogues. Un Auvergnat ambulant ne
pouvait mme pas annoncer dans la rue son mtier de chaudronnier, sans tre
immdiatement saisi par les gardes du mtier et expuls de la ville.
Ce rgime se maintint en France pendant six ou sept sicles. Avec nos ides
actuelles, il peut paratre trs rigide. Il reprsente cependant une forme
d'organisation fort bien adapte aux besoins des temps pendant lesquels il se
maintint. Le peu d'tendue des marchs, l'absence des moyens de communication
rendant la concurrence presque impossible et le nombre des consommateurs
presque invariable, il fallait des rgles fixes pour empcher un excs de production
ou une imperfection des produits laquelle la concurrence remdie spontanment
aujourd'hui. Les rglements protgeaient du reste aussi bien l'ouvrier que le matre
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
380
et le consommateur. La corporation exerait l'gard de l'ouvrier une tutelle trs
utile. Les ouvriers de chaque corps de mtier taient en ralit des associs srs de
leurs dbouchs. Il existait entre eux une sorte de solidarit qui exerait une
puissante action morale. Sans doute l'ouvrier avait infiniment moins de libert que
maintenant, et n'avait gure d'espoir de voir sa condition s'amliorer, mais en
revanche il possdait beaucoup plus de scurit et de stabilit dans les moyens
d'existence qu'il n'en a aujourd'hui. La grande industrie a donn de nos jours
l'ouvrier plus de libert apparente ; mais, en l'abandonnant entirement ses
propres forces et le laissant la merci de ces chmages frquents que les crises
industrielles modernes engendrent, elle a rendu sa situation plus prcaire
qu'autrefois. Soustrait l'antique tutelle de la corporation, il n'a plus compter dans
l'impitoyable lutte pour l'existence que sur les ressources de son intelligence.
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
381
III. - L'Industrie moderne.
Retour la table des matires; retour au dbut du chapitre
Bien que le rgime des corporations et pour lui l'influence toute-puissante de la
tradition et de la coutume, il finit par disparatre. Plusieurs causes contriburent sa
chute. Les plus puissantes furent l'accroissement des relations commerciales,
rsultant de la dcouverte de routes nouvelles entre l'Europe et l'Orient, l'emploi
des machines, puis plus tard la dcouverte de la vapeur, et les transformations
industrielles dues au progrs des sciences.
Lorsque des routes nouvelles entre l'Europe et lOrient furent connues, le
commerce distance, qui n'avait eu autrefois pour objet que des matires
prcieuses, les seules qu'il y et intrt transporter en raison du prix du transport,
s'tendit rapidement une foule d'objets de consommation journalire. Le besoin
d'changer des marchandises exotiques contre des marchandises locales, celui de
fournir aux habitants des colonies nouvelles les produits dont elles pouvaient avoir
besoin, ncessitrent une production plus grande, et par consquent la cration de
nouveaux ateliers. Ne pouvant se former qu'en dehors du domaine des corporations,
ils s'tablirent gnralement dans les faubourgs des villes. Soustraits l'action des
corporations, dsireux de fabriquer leurs produits au meilleur march possible, ces
ateliers accueillirent avec plaisir les procds qui leur permettaient d'obtenir ce
rsultat. La division du travail et surtout l'emploi des machines furent les
principaux agents de cette transformation.
Mais quelque impulsion que l'accroissement des relations commerciales et
l'emploi des machines aient imprime l'industrie, son importance est bien faible si
on la compare avec les rsultats que l'emploi de la houille comme force motrice
devait produire. Depuis des milliers de sicles la terre renfermait une force motrice
lentement accumule pendant les ges gologiques et dont l'homme n'avait pas
souponn la puissance. Le jour o il la connut et o, grce l'emploi de la
machine vapeur, il sut l'utiliser, l'industrie devait subir des transformations plus
profondes que toutes celles dont les sicles passs avaient gard le souvenir. Du
sein de la terre allaient surgir des millions d'esclaves dociles, prts remplacer
l'homme dans son dur labeur et travailler pour lui. J'ai dj dit qu'en Angleterre
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
382
seulement, la force engendre par la houille annuellement brle dans les machines
vapeur, quivaut au travail de deux cents millions d'ouvriers.
Pour se faire une ide bien nette de l'impulsion donne l'industrie par la
dcouverte de l'emploi de la houille comme force motrice et de la machine
vapeur, il suffit de comparer l'importance de la production avant cette dcouverte et
quelques annes aprs. On admet gnralement que le mouvement d'importation et
d'exportation donne une mesure assez exacte de la puissance industrielle d'une
nation. Voici un extrait des dveloppements de ce mouvement commercial en
Angleterre, que j'emprunte M. de Molinari. On y voit que les exportations, qui
taient de 6,910,000 livres sterling (un peu moins de 173 millions de francs) en
1720, un demi-sicle avant l'emploi de la machine vapeur, taient en 1875, c'est-dire un sicle environ aprs cette dcouverte, de 223,494,000 livres sterling, soit
environ 5 milliards 500 millions de francs.
Annes
1720
1765
1800
1840
1850
1875
95
Importations Liv. sterl.
6,090,000
11,812,000
30,570,000
67,492,000
100,460,000
373,941,000
Exportations Liv. sterl.
6,910,000
15,763,000
43,152,000
116,480,000
197,309,000
223,494,000
On peut ajouter ces chiffres que, pour la seule Angleterre, la ncessit de
faciliter les transports a amen la construction de 26, 000 kilomtres de chemin de
fer ayant cot 15 milliards.
Quand on examine les procds de l'industrie ancienne, on voit qu'ils sont tout
fait empiriques, et que les thories scientifiques n'y jouent aucun rle. Pendant
longtemps l'industrie a devanc la science, mais aujourd'hui les rles sont
absolument changs. La seconde a devanc la premire et la dirige entirement. Les
dcouvertes de la chimie, de la physique, de la mcanique ont renouvel l'industrie
moderne ; et, comme ce sont surtout les dcouvertes industrielles qui ont
transform nos conditions d'existence, on peut dire que c'est la science que doit
tre attribu ce rsultat. Ce sont les dductions de certains principes de physique
qui ont permis la cration de la machine vapeur et de la tlgraphie lectrique. Ce
95
C'est en cette anne 1765 que Watt prit son brevet pour la machine vapeur.
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
383
sont encore des applications d'autres principes de science pure qui permettent au
navigateur de dterminer dans la nuit sombre la position exacte que son vaisseau
occupe sur l'Ocan, et la direction lui donner pour arriver exactement au port que
lui indique seule la baguette magique du calcul. La mme puissance du calcul lui a
fait dcouvrir sur les flots mobiles des routes qui, bien que plus longues en
apparence que les anciennes, abrgent de moiti pourtant la dure des voyages
maritimes 96.
De mme pour les autres sciences. Les applications des lois chimiques ont
entirement boulevers des industries vieilles de plusieurs sicles. C'est ainsi, par
exemple, que la dcouverte des couleurs extraites de la houille a compltement
transform l'industrie des matires colorantes. La fabrication de l'acier par les
procds scientifiques dus Bessemer a rvolutionn une des plus importantes
industries modernes, au point qu'on a valu 500 millions par an l'conomie
ralise par l'emploi de cette mthode, et que, d'aprs M. Price Williams, la
substitution des rails d'acier aux rails de fer raliserait pendant la dure de ces rails
une conomie qui, pour toutes les lignes de la Grande -Bretagne, se chiffrerait par
plus de 4 milliards 97.
Des exemples analogues aux prcdents sont fort nombreux. La chimie fabrique
maintenant de toutes pices des substances, comme l'alcool, que le mystrieux
laboratoire de la nature pouvait seul autrefois produire, et le jour n'est pas loin o
des lments de l'atmosphre et du sol elle retirera des matires alimentaires
comme le sucre et les corps gras. Grce son tude, la domination de l'homme sur
la nature devient chaque jour plus grande. C'est elle qui a dcouvert ces
merveilleux agents qui suppriment la douleur et ont fait mentir la maldiction
biblique lance jadis la femme par un Dieu irrit : Tu enfanteras dans la douleur.
96
Cette dcouverte est due, comme on le sait, au gnie du commandant Maury. Faite du fond d'un cabinet, elle
est aussi merveilleuse que celle de Le Verrier indiquant par la puissance du calcul la position exacte que devait
occuper dans l'espace un astre que nul n'avait encore vu. En utilisant les vents et les courants sans se proccuper
de la distance, Maury rduisit la dure des traverses au point de permettre un btiment voiles de n'employer
que 125 jours pour aller d'Angleterre en Australie, alors qu'il en fallait autrefois 250. Des indications analogues
permirent galement de rduire de moiti d'autres traverses telles que celle de New-York Rio-de-Janeiro, par
exemple.
97
Avant l'adoption des procds Bessemer, l'Angleterre fabriquait annuellement 50 mille tonnes d'acier fondu,
d'une valeur de 13 1500 francs la tonne. Le prix de la tonne tant tomb 250 francs par suite de l'emploi de
ces procds, elle en a fabriqu, en 1877, 750 mille tonnes, soit 15 fois plus qu'auparavant.
Contrairement au sort traditionnel des inventeurs, M. Bessemer a reu pour ses brevets plus de 30 millions ;
cette rmunration est loin certes d'tre exagre, si on la compare l'importance des services rendus. Un pays
qui consacrerait encourager quelques savants adonns uniquement des recherches scientifiques et choisis
parmi des esprits inventifs ce que cotent entretenir quelques milliers de soldats, en retirerait bien des fois
l'argent dpens.
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
384
Si la civilisation moderne est suprieure celle du moyen ge et des temps
antiques, elle le doit donc entirement aux dcouvertes profondes ralises par la
science dans les diverses branches des connaissances humaines, et, si l'on juge de
l'importance des dcouvertes futures par celles ralises dj, quelles limites
pourrions-nous fixer nos esprances ?
Les rsultats avantageux produits par les transformations scientifiques de
l'industrie moderne ne sont pas douteux, et il n'y a qu' en rappeler quelques-uns
pour rendre toute contestation impossible sur leur importance : Facilit et
commodit des relations et des transports incomparablement plus grandes
qu'autrefois par l'emploi des chemins de fer, des bateaux vapeur et des
tlgraphes ; famines rendues impossibles par la possibilit de transporter
rapidement les crales d'un hmisphre l'autre ; objets de consommation ou de
vtement qui taient choses de luxe autrefois comme le sucre, le caf, les pices, la
soie, etc., mis aujourd'hui la porte de tous ; les villes embellies et assainies ; le
confort, l'instruction et l'aisance devenus plus grands sont des rsultats que chacun
connat.
Mais le bien-tre n'est pas seulement plus grand qu'autrefois, il est galement
beaucoup plus gnral. A la fin du rgne de Louis XIV, Vauban valuait cent mille
seulement le nombre des familles aises en France. Les conomistes modernes
estiment que sur dix millions de familles existant aujourd'hui en France, il y en a un
million environ de tout fait aises. Les autres s'chelonnent entre la mdiocrit et
la gne ; mais, quelle que soit leur gne, il y a loin aujourd'hui du paysan le plus
misrable ce qu'il tait lorsque La Bruyre le dcrivait comme une varit
particulire d'animal farouche, se retirant la nuit dans des tanires et se nourrissant
de pain, d'eau et de racines, vivant au jour le jour, et expos mourir de faim la
moindre perte dans sa rcolte. M. Taine estime six millions le nombre de ceux
morts de faim et de misre dans l'espace de vingt-cinq ans :
Le pain de froment, dit cet auteur parlant des temps peu antrieurs la Rvolution,
cote comme aujourd'hui, de trois quatre sous la livre, mais la moyenne d'une journe
d'homme n'est que de dix-neuf sous au lieu de quarante, en sorte qu'avec le mme travail,
au lieu d'un pain, le journalier ne peut acheter que la moiti d'un pain. Tout calcul, et les
salaires tant ramens au prix du grain, on trouve que le travail annuel excut par
l'ouvrier rural pouvait alors lui procurer 959 litres de bl, aujourd'hui, 1,851 ; ainsi son
bien-tre s'est accru de 93 pour 100. Celui d'un matre-valet s'est accru de 70 pour 100 ;
celui d'un vigneron de 125 pour 100. Cela suffit pour montrer quel tait alors leur malaise.
- D'aprs les rapports des intendants, le fond de la nourriture en Normandie est l'avoine ;
dans l'lection de Troyes, le sarrasin ; dans la Marche et le Limousin, le sarrasin avec des
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
385
chtaignes et des raves ; en Auvergne, le sarrasin, les chtaignes, le lait caill et un peu de
chvre sale ; en Bauce, un mlange d'orge et de seigle ; en Berry, un mlange d'orge et
d'avoine. Point de pain de froment : le paysan ne consomme que les farines infrieures,
parce qu'il ne peut payer, son pain que deux sous la livre. Point de viande de boucherie :
tout au plus il tue un porc par an. Sa maison est en pis, couverte de chaume, sans
fentres, et la terre battue en est le plancher. Mme quand le terrain fournit de bons
matriaux, pierre, ardoises et tuiles, les fentres n'ont point de vitres. Dans une paroisse de
Normandie, en 1789, la plupart sont bties sur quatre fourches ; souvent ce sont des
tables ou des granges o l'on a lev une chemine avec quatre gaules et de la boue. Pour
vtements, des haillons, et souvent, en hiver, des haillons de toile. Dans le Quercy et
ailleurs, point de bas ni de souliers, ni de sabots. Impossible, dit Young, pour une
imagination anglaise de se figurer les animaux qui nous servirent Souillac, l'htel du
Chapeau-Rouge ; des tres appels femmes par la courtoisie des habitants, en ralit des
tas de fumier ambulants. Mais ce serait en vain qu'on chercherait en France une servante
d'htel proprement mise.
Malgr cette extrme misre, les impts s'levaient, dans la plupart des
provinces, au moins moiti du produit net des rcoltes des terres. Sur 100 francs
de revenu net, l'impt direct prenait au taillable 52 francs, plus de la moiti. C'est
peu prs cinq fois autant qu'aujourd'hui. La spoliation universelle et illimite leur
te jusqu'au dsir de l'aisance. La plupart pusillanimes, dfiants, engourdis, avilis,
peu diffrents des anciens serfs, ressemblent aux fellahs d'gypte, aux laboureurs
de l'Indoustan. Dans les villes, la condition de l'ouvrier n'tait pas meilleure, car
lui aussi tait cras d'impts.
Aprs avoir montr les rsultats utiles des dcouvertes scientifiques et
industrielles, nous devons mettre en vidence maintenant les inconvnients qu'elles
ont engendrs et surtout qu'elles paraissent destines engendrer. Ce n'est qu'en
ayant ces divers lments sous les yeux, et pesant leur valeur, que nous pourrons
nous faire une ide nette de leur importance.
Parmi les rsultats dsavantageux de l'industrie moderne, je mentionnerai
d'abord la tendance utilitaire qu'elle imprime de plus en plus aujourd'hui aux
esprits, et qui les porte dlaisser tout ce qui ne conduit pas un rsultat
immdiatement pratique, c'est--dire traduisible en argent. Les consquences de
cette tendance sur l'intelligence et les sentiments sont particulirement funestes. La
recherche du ct exclusivement utile des choses, l'habitude de circonscrire l'esprit
dans une activit n'ayant que le gain pour but, rendent goste, sec et dur, et
desschent tous les sentiments qui font le charme de l'existence. Cet esprit utilitaire,
qui semblait d'abord localis en Amrique, s'est peu peu infiltr en Europe, et
notre jeunesse commence professer le plus large ddain pour toutes les recherches
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
386
de science pure qui ne peuvent se traduire en avantages matriels immdiats. Nos
laboratoires de plus en plus dserts, les tudes philosophiques entirement
dlaisses, sont des indices malheureux de cet tat de choses. L'art et la littrature
eux-mmes se sont tourns vers le ct pratique, et, par leur ralisme grossier, se
sont rabaisss au got vulgaire de financiers borns et de bourgeois aux ides
troites. Le got des jouissances matrielles et de l'argent a fait dlaisser de plus en
plus toute recherche dsintresse 98. Si une raction ne se produit pas, l'industrie
finira par tuer la science, la littrature et l'art, c'est--dire les sources relles de tout
progrs.
Si nous examinons maintenant les rsultats matriels des progrs de l'industrie,
nous devons reconnatre que, si ces progrs ont eu pour effet d'lever le niveau des
classes moyennes, ils ont abaiss en mme temps celui des classes infrieures et
augment ainsi l'cart existant entre elles.
Avec la complication des mthodes et la spcialisation du travail propres
l'industrie actuelle, il faut beaucoup plus d'intelligence qu'autrefois celui qui
dirige et beaucoup moins au contraire celui qui excute. Apte seulement
accomplir un travail spcial qu'il apprend le plus vite possible pour rduire le plus
possible le temps de son apprentissage, l'ouvrier moderne est devenu bien infrieur
ce qu'il tait autrefois. Incapable d'un autre travail que la confection d'un objet
spcial, ou plutt d'une partie d'objet spciale, il est la merci des chmages que
les crises industrielles 99 rendent trs frquents. Ne connaissant qu'une partie du
98
L'Allemagne, laquelle on ne saurait refuser d'avoir t pendant longtemps un foyer de recherches
dsintresses dans toutes les branches du savoir humain, est entre galement aujourd'hui dans la voie
exclusive des recherches utilitaires. Le jugement d'un Franais pouvant tre tax de partialit, je me bornerai
reproduire celui qu'a publi rcemment, sous une forme naturellement adoucie, l'minent recteur de l'Universit
de Berlin, M. du Bois-Reymond : Dans la transformation que la dernire gnration a vue s'accomplir en
Allemagne, dit-il, n'a-t-on pas sacrifi le bon en mme temps que le mauvais ? En se gurissant de ses vagues
aspirations, de ses efforts striles, de sa dfiance de lui-mme, le peuple allemand n'a-t-il pas perdu beaucoup de
son enthousiasme pour l'idal, de son ardeur dsintresse pour la vrit, de sa vie de coeur profonde et
tranquille ? La rapide floraison de notre littrature a pass comme un songe. De mme que l'aimable causerie des
salons parisiens a t touffe par les sches ralits de la science et de la politique, de mme nous avons fait
mauvais accueil aux pigones des hros classiques et romantiques. Goethe lui-mme, s'il tait jeune de nos jours,
n'crirait probablement ni Goetz, ni Werther, ni Faust, il aimerait mieux dployer dans le Reichstag les facults
oratoires que lui reconnaissait Gall, et qu'il n'a pu exercer autrefois que devant les oiseaux de Malcsine. Au sein
de tout l'clat dont brille encore l'heure prsente la science allemande, nous avons la douleur de ne plus
rencontrer dans la gnration qui s'lve cette noble ardeur qui peut seule garantir la continuit des progrs
intellectuels. (Revue scientifique, 1878, page 681.)
99
Le tableau suivant de la valeur d'un certain nombre d'articles sur les marchs anglais en janvier 1873 et
janvier 1879, que j'emprunte M. Giffers, donne une ide de la profondeur des crises de l'industrie moderne.
Ces dprciations normes qui obligent vendre des objets fort au-dessous du prix qu'ils ont cot peuvent
sembler d'abord avantageuses en ce sens que le plus grand nombre en profite ; mais cet avantage n'est
qu'apparent : le plus grand nombre, ne gagnant presque plus rien pendant ces crises, ne peut profiter des
diminutions qui se produisent. Quant ceux qui coulent leurs stocks en baisse, leur perte est naturellement
immense.
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
387
mtier qu'il tait oblig d'tudier fond jadis, travaillant d'une faon purement
machinale, son niveau intellectuel a baiss rapidement.
Mais en mme temps que son niveau intellectuel baissait, son niveau moral
descendait galement, Imbu de l'importance des droits que des voix intresses lui
rappellent sans cesse, sans l'entretenir galement de ses devoirs, n'ayant pas acquis
par l'instruction et l'ducation la capacit requise pour se gouverner soi-mme,
priv de l'action tutlaire que l'ancienne corporation exerait sur lui et se croyant
l'gal de son patron, il s'est bientt cru la victime d'injustices sociales flagrantes et
est devenu rapidement l'ennemi de ceux qui l'employaient. L'antagonisme entre
patrons et ouvriers, c'est--dire entre le capital et le travail, antagonisme tout fait
exceptionnel sous l'ancien rgime des corporations, est aujourd'hui la rgle. Loin de
voir dans l'lvation croissante de son salaire un motif d'pargne ou un moyen de
s'instruire ou de mieux lever les siens, l'ouvrier n'y trouve trop souvent que le
moyen de satisfaire ses apptits et son got pour les distractions et les vices les plus
grossiers.
En mme temps que le niveau moral et intellectuel des classes infrieures
s'abaissait, leurs exigences grandissaient, comme le montrent les voeux mis par le
dernier congrs ouvrier de Marseille, et qui ne tendent rien moins qu' supprimer
violemment la proprit leur profit.
Loin donc de diminuer, comme on le croit, les diffrences existant jadis entre
classes, et qui n'taient souvent que nominales, la civilisation moderne a eu pour
rsultat d'agrandir moralement et intellectuellement ces diffrences.
L'infriorit morale des classes populaires actuelles n'a pas chapp aux
conomistes :
C'est prcisment dans les couches infrieures de la socit, crit M. de Molinari, que
l'on rencontre le moins de capacit gouvernante. La tutelle implique dans la servitude,
ayant cess d'y suppler, qu'est-il arriv ? C'est que les classes mancipes se sont
montres moins capables encore de bien employer leur revenu que de l'acqurir ; c'est
qu'elles ont laiss en souffrance la plupart des obligations entre lesquelles se partage la
consommation utile. Gnralement dpourvu de prvoyance, l'ouvrier ne se proccupe
que des besoins du jour, il ne met rien en rserve pour les maladies, les chmages, la
vieillesse. Sa consommation alimentaire est vicie par l'abus des liqueurs fortes ; le
cabaret lui enlve le plus clair de ses ressources, tout en altrant sa constitution physique
Valeur en janvier 1873.Valeur en janvier 1879.Fonte de ferla tonne de127 sh.43 sh.Charbon 30 sh.19
sh.Cuivre 91 liv. sterl.57 liv. sterl.tain 142 liv. sterl.61 liv. sterl.Cotonla livre10 deniers.5 3/8 deniers.Lainela
balle23 liv. sterl.13 liv. sterl.Sucrele quintal21 sh. 6 den.16 sh.
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
388
et morale. Il se marie et met des enfants au monde sans avoir la moindre ide des
obligations qu'impose la formation d'une famille. Faute de moyens suffisants pour
entretenir sa femme, lever ses enfants et leur donner l'ducation ncessaire, il oblige
l'une abandonner le mnage pour l'atelier ; il condamne les autres un travail prmatur
et dpassant leurs forces. Au lieu d'un pre, ils trouvent en lui, trop souvent, un matre
ivrogne et fainant qui les exploite comme des esclaves, sans avoir mme pour eux les
soins d'un propritaire intelligent pour son troupeau humain. Ceux qui arrivent l'ge
d'homme, affaiblis par un travail htif, le manque de soins et des habitudes prcoces de
dbauche, prises dans un milieu vici, valent moins que leurs pres : crme d'ailleurs
par l'impt du sang, qui enlve la fleur de chaque gnration, la classe ouvrire va
s'affaiblissant et se gtant, mme sous le rapport professionnel ; les bons ouvriers
deviennent de plus en plus rares. Comme les sauvages, ils ont emprunt d'abord les vices
de la civilisation ; le contact des classes civilises, en l'absence d'un appareil de tutelle,
leur a t funeste, et il l'a t d'autant plus que ce contact tait plus frquent et plus
proche. Aucune classe ne s'est plus gte que celle des domestiques sous le rgime du Self
government.
Aussi l'incapacit politique absolue des classes ouvrires a-t-elle t reconnue
par les penseurs les plus minents mme quand ils professaient les opinions
politiques les plus avances. J'ai dj cit dans un autre chapitre l'opinion de M.
Littr revenu d'anciennes erreurs. Je puis en rapprocher celle d'un autre penseur non
moins avanc, Herbert Spencer.
On doit se demander, et avec anxit, dit-il dans ses Essais de politique, si vraiment il
n'y a pas pril donner une part du pouvoir politique des gens qui se font des ides aussi
fausses sur les principes mmes de la socit et qui luttent avec tant d'obstination pour
faire triompher leurs erreurs. Quand on abdique sa libert personnelle aux mains de
despotes comme ceux qui gouvernent les associations ouvrires, a-t-on encore assez
d'indpendance pour exercer des droits politiques ? Quand on entend si mal ce que c'est
que la libert, quand on se figure qu'un homme ou un groupe d'hommes a le droit
d'empcher un patron et un employ de passer entre eux tel contrat qui leur plat, est-on
vraiment en tat de devenir un gardien, et de sa libert personnelle, et de la libert de ses
concitoyens ? Voil des gens qui ont, de la vraie droiture, une notion assez confuse pour
se faire un devoir d'obir aux ordres arbitraires des chefs de leurs associations, et
d'abdiquer ce droit qu'a tout individu de disposer de son travail son gr ; qui, pour obir
au devoir ainsi pris rebours, vont risquer de faire prir de misre leurs familles, qui
traitent de document odieux une pice o l'on demande simplement que le patron et
l'ouvrier soient libres de s'arranger entre eux ; en qui le sens du juste est si obtus, que les
voici prts malmener, priver d'ouvrage, faire prir de misre, et mme assassiner
ceux de leur classe qui se rvoltent contre la dictature et qui maintiennent leur droit de
vendre leur travail pour tel prix et telle personne qu'il leur semblera bon ; des hommes,
en un mot, prts devenir semblables des esclaves et des tyrans : il est bien permis d'y
regarder deux fois avant de leur donner des droits..
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
389
Il y a dans ces rsultats de l'industrie moderne des dangers redoutables qu'il vaut
mieux signaler nettement que de tenter de les cacher. Ils ne sont pas du reste sans
remde. En traitant de l'instruction des classes ouvrires, j'ai montr comment on
pourrait remdier l'insuffisance complte d'instruction technique et l'infriorit
intellectuelle auxquelles conduit la spcialisation trop grande des travaux
industriels actuels. C'est un danger auquel on tche de remdier maintenant dans
d'autres pays et dont nous ne nous proccupons pas assez. Les ouvriers capables de
fabriquer entirement une pice un peu complique, comme une montre par
exemple, et qui taient encore communs il y a trente ou quarante ans, ne se
rencontrent plus qu' l'tat d'infime exception 100. Instruire l'ouvrier et faire son
ducation morale sont aujourd'hui une ncessit de premier ordre. Ce n'est pas avec
la ridicule instruction primaire qu'on lui donne, et qui ne sert qu' fausser son
jugement et le rendre beaucoup plus dangereux, qu'on atteindra un tel but.
Interrog en 1848 sur la possibilit d'une rvolution en Angleterre, Robert Peel
rpondait que cela n'tait pas craindre, parce que les ouvriers anglais savaient trop
bien l'conomie politique. Ce n'est pas assurment la connaissance de l'conomie
politique seule qui empchera les classes populaires de faire des rvolutions et
mettra fit aux haines de castes qui sont aujourd'hui plus grandes que jamais, mais
c'est une de celles qui leur montreraient le mieux la vanit des utopies et des
rcriminations dont ils se nourrissent, et les convaincraient que ce n'est qu'en
levant d'abord leur niveau intellectuel et moral qu'ils russiront dans la trs
lgitime entreprise d'amliorer leur sort.
100
Je pourrais citer des industries, comme celle des instruments de prcision, qui se trouvent aujourd'hui, faute
d'ouvriers capables, dans un tel tat de dcadence en France qu'on peut dire que, les circonstances ne se
modifiant pas, elles auront disparu avant vingt ans. Il faut avoir t en relation avec nos grands constructeurs
pour savoir les difficults qu'ils prouvent pour faire tablir un instrument fabriqu sur un nouveau modle et
exigeant un peu d'intelligence de l'ouvrier. La plupart en sont arrivs refuser les commandes d'appareils un peu
dlicats. Un d'eux me racontait rcemment que, lorsqu'on eut besoin, pour les nouvelles lignes de chemins de fer
en construction, d'un certain nombre d'instruments de godsie de prcision, il fut impossible de se les procurer
Paris. L'ouvrier prfre aujourd'hui le travail spcialis de l'usine, o il n'a pas dployer la plus faible lueur
d'intelligence, et o l'apprentissage est rapide. Dans un discours prononc lors de la distribution des rcompenses
aux laurats de l'exposition des sciences appliques l'industrie, en 1879, M. Jules Simon tait oblig de
reconnatre combien nous nous tions laiss dpasser par les trangers, et concluait en disant que si nos coles
ne valent pas les leurs, avant dix ans d'ici ils nous battront sur tous les marchs .
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
390
IV. - volution actuelle de l'industrie
et de l'conomie sociale.
Retour la table des matires; retour au dbut du chapitre
En attendant les rsultats futurs de l'instruction, les classes ouvrires ont, par
divers systmes ayant l'association pour base, tent d'amliorer leur situation.
Continues avec persvrance, ces tentatives engendreront peut-tre dans l'tat de
l'industrie une volution importante.
Ainsi que cela a t dit dans un autre chapitre, la possession collective entre
associs est la forme que tend revtir, dans les temps modernes, la proprit des
choses les plus importantes : usines, canaux, chemins de fer et probablement, dans
un avenir assez prochain, le sol lui-mme. Le mcanisme de cette possession
collective, dans laquelle des associs qui ne se connaissent pas possdent en
commun des choses qu'ils n'ont jamais vues est d'une puissance formidable et en
mme temps d'une simplicit trs grande. Mais, lorsqu'au lieu de runir des
capitaux dj existants dans le but de crer une entreprise, on veut constituer la
mme entreprise avec le capital futur qu'engendreront dans l'avenir les bras des
associs, le mcanisme de l'association devient au contraire fort compliqu.
Quoique pouvant tre considres encore comme tant leurs dbuts, les
associations ouvrires semblent en voie de russir dans divers pays, tels que
l'Angleterre, o l'ducation morale des classes ouvrires commence se faire, mais
ce n'est qu'exceptionnellement qu'elles ont prospr chez nous. Je pense cependant
que, quand l'instruction et l'ducation auront un peu relev le niveau intellectuel et
moral des classes infrieures, ces associations rendront leur situation meilleure
qu'aujourd'hui et leur permettront de contrebalancer avec succs la fodalit
industrielle et financire qui se constitue maintenant et qui, proccupe
exclusivement de ses intrts, est souvent plus dure que celle d'autrefois.
Les principales formes de l'association qui proccupent le plus les ouvriers
aujourd'hui sont la participation aux bnfices et les socits coopratives.
La participation aux bnfices semble gnralement peu pratique. Participer aux
bnfices d'une entreprise implique qu'on participera aussi aux pertes possibles de
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
391
cette entreprise, et on ne peut videmment obliger des personnes vivant au jour le
jour travailler sans recevoir de salaire, lorsque cela deviendrait ncessaire. De
telles associations n'ont gure de chances de prosprer que dans les industries o la
mise de capitaux est presque nulle, les dbouchs certains, et qui surtout ont leur
tte des grants d'une capacit exceptionnelle 101.
Les socits coopratives, associations dans lesquelles un certain nombre de
travailleurs se runissent pour cooprer l'entreprise et partager les bnfices aprs
les salaires pays, me semblent une des formes les plus rationnelles de l'association.
En Allemagne, et en Angleterre surtout, les socits coopratives sont dj
nombreuses. La grande difficult de les faire prosprer provient de la raret des
grants capables de les diriger avec intelligence. C'est presque toujours par
insuffisance de direction et le dfaut d'accord qu'elles ont chou.
Mais parmi toutes les formes de l'association, il en est une qui n'a pas t
essaye, je crois, et qui me semble destine tre celle de l'avenir. Si par hasard il
existe quelque part un financier ayant souci des problmes sociaux, il aurait l une
belle exprience tenter. Admettons qu'une proprit industrielle quelconque,
usine, ferme, etc., soit fractionne en actions au porteur d'une valeur si petite, 5 ou
10 francs, je suppose, que ces parts se trouvent la porte des plus modestes
pargnes. L'ide d'tre propritaire en partie de l'exploitation o il travaille tenterait
vite l'ouvrier. Quand il aurait acquis quelques-unes de ces actions, qu'il se verrait le
matre d'en disposer son gr, qu'il saurait qu'elles lui rapportent une part du
revenu de l'entreprise, et que leur acquisition ne l'oblige rien, pas mme
continuer travailler dans l'usine dont il est actionnaire, il prendrait vite got
l'ide de s'amasser un petit capital, et, comme le capital qu'on gagne est un capital
qu'on sait gnralement conserver, il songerait beaucoup plus l'accrotre qu' le
dpenser.
Que le chiffre de l'conomie soit tout d'abord important ou non, il n'importe,
c'est surtout du rsultat moral que je m'occupe ici. Le jour o l'ouvrier commence
pargner, il prend en mme temps des habitudes d'ordre, de conduite rgulire qui
font de lui un autre homme. Ce n'est qu' partir de ce jour qu'il dserte le cabaret
pour la famille, la bibliothque ou la salle des cours. Quand l'ouvrier sera devenu
un petit capitaliste 102, c'est--dire quand le capital et le travail se trouveront plus ou
101
L'entreprise de peinture en btiments, fonde et dirige avec un plein succs par M. Lemaire Paris, est un
des rares exemples qu'on puisse citer en France de ce mode d'association.
102
Partant de ce principe trs contestable que le salaire des ouvriers ne peut s'lever au-dessus du minimum
ncessaire, Stuart Mill ne voulait pas qu'on donnt aux travailleurs agricoles le plus lger lopin de terre, parce
qu'alors, disait-il, l'ouvrier y travaillera la journe termine et les jours de fte, ce qui lui permettra de louer ses
bras meilleur march, d'o la consquence : augmentation de travail et diminution de salaire. En admettant
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
392
moins runis dans les mmes mains, la lutte actuelle entre ces deux lments
cessera forcment faute d'objet. Jusque-l, toute augmentation de salaire n'aboutira
qu' accrotre ses dpenses au cabaret, c'est--dire le dgrader davantage. Nos
cits industrielles renferment aujourd'hui des masses menaantes pouvant, sous la
conduite de meneurs habiles, devenir aussi dangereuses pour la civilisation que le
furent jadis les hordes d'Attila. Les insurrections de 1848 et de l871 montrent
combien seront terribles les luttes que nous aurons leur livrer encore si nous ne
voulons pas nous occuper srieusement de les amliorer. Il a fallu toute une srie de
circonstances heureuses pour que la dernire insurrection n'ait pas russi
transformer Paris en un monceau de dcombres, et anantir d'un seul coup les
trsors de science et d'art accumuls pendant tant de sicles.
Mais, pour donner l'ouvrier le got de l'pargne et le dsir de s'instruire, il faut
s'y prendre de bonne heure. L'cole primaire de l'avenir, fort diffrente de celle
d'aujourd'hui, contiendra srement, outre l'atelier dont j'ai parl en traitant de
l'ducation, une petite caisse d'pargne qui permettra l'ouvrier enfant de contracter
ces habitudes d'ordre et d'conomie qu'il lui sera facile ensuite de conserver, mais
qu'il lui serait bien difficile d'acqurir plus tard.
Ce ne sont pas assurment d'aussi lentes rformes que se proposent nos
socialistes modernes. L'ide d'apprendre l'ouvrier s'aider et s'lever lui-mme
n'est nullement leur devise. Leur rve est d'emprunter la toute-puissance qu'ils
supposent l'tat pour tout bouleverser au profit des classes infrieures en faisant
passer les instruments de travail et les capitaux entre les mains des socits
ouvrires. Toutes leurs combinaisons se ramnent toujours substituer l'initiative
individuelle celle de l'tat ou de son diminutif, la Commune, et revenir par la
violence une tutelle analogue celle des anciennes corporations, mais en ralit
mme que le principe pos par Mill soit juste, je crois que l'application de sa doctrine serait trs funeste. En
raisonnant comme il le fait, il laisse entirement de ct, en effet, - dfaut commun du reste la plupart des
conomistes, - un facteur d'une importance considrable, le facteur moral. Le lopin de terre appauvrira un peu
son possesseur, suivant lui. Mme si cela tait, et rien, je le rpte, ne dmontre qu'il en soit ainsi, cet
appauvrissement serait peu de chose en prsence de l'influence morale considrable que produisent sur l'ouvrier
ces quelques mtres de terre dont il est le matre. Avant leur possession, il n'avait d'autre patrie que le cabaret et
rien perdre dans le monde. Avec le fragment de sol dont il est matre, il possde un foyer, acquiert des gots
nouveaux, des habitudes d'ordre et de stabilit qu'il ne connaissait pas. Du jour o ce lopin de terre est lui, la
socit acquiert un dfenseur l o elle avait un ennemi.
Comme je l'ai fait remarquer dj propos de la division de la proprit, cette division peut tre dtestable
au point de vue de l'conomie de la production, mais, au point de vue social, elle est excellente. Je ne saurais
trop rpter que ce qui importe le plus pour la prosprit d'une socit, ce ne sont pas les institutions qui la
rgissent, mais bien l'tat des sentiments des individus qui la constituent. Il est mme trange qu'une vrit si
banale ait t si longtemps mconnue. On peut bien donner un peuple, comme on le fit en 1822 pour les ngres
des tats-Unis qui fondrent sur la cte d'Afrique la rpublique de Liberia, des institutions excellentes, mais, si
les sentiments de la population ne sont pas la hauteur de ces institutions, ces dernires n'empcheront pas la
socit de tomber dans la plus misrable dcadence.
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
393
beaucoup plus dure. Loin d'tre des conceptions de l'avenir, ces utopies ne
reprsentent, comme celles relatives la communaut de la proprit, qu'un retour
des formes d'volution infrieures que la civilisation nous fait dpasser.
Le communisme, que rvent beaucoup d'ouvriers, serait un retour des formes
d'volution plus infrieures encore. Il serait bien inutile, je crois, de dmontrer aux
lecteurs de cet ouvrage que cette conception enfantine n'a pour elle qu'une
simplicit apparente qui la rend accessible aux masses les plus ignorantes. L'galit
des biens obtenue au prix d'une rvolution sans exemple et de la destruction de la
civilisation actuelle ne subsisterait qu'un jour. Ds le lendemain la part des capables
grossirait fatalement aux dpens de celle des incapables, et l'ingalit dtruite serait
bien vite rtablie.
Mais ce sont l des arguments dont ne se proccupent gure les socialistes
modernes. Il est impossible de leur faire comprendre que les souffrances dont se
plaignent les classes infrieures ont des causes fort loignes de celles qu'ils leur
supposent, et sont aussi invitables que les infirmits, la vieillesse et la mort ; que
les hommes sont dous d'aptitudes intellectuelles trs ingales, et surtout enfin que
la somme des choses partager tant trs petite relativement au nombre des
partageants, ce sont uniquement les mieux dous qui peuvent en obtenir une part
suffisante. Les progrs de l'industrie, et non les institutions, ont port un million
les cent mille familles leur aise qui existaient sous Louis XIV. Neuf millions sont
encore entre la mdiocrit et la gne. Sans doute, c'est beaucoup trop ; mais il n'y a
pas de puissance humaine qui puisse donner immdiatement l'aisance de telles
foules. Il faudrait trouver pour cela le moyen de dcupler la production des produits
alimentaires, le btail notamment, celle des vtements, des objets d'art,
d'ornementation, etc., dont le million ais peut seul user largement. Or, la
production de ces objets n'tant pas susceptible de grandes variations, ou ne
pouvant varier sensiblement qu' la suite de dcouvertes industrielles nouvelles, ce
rsultat ne pourrait tre obtenu que par un miracle analogue celui de la
multiplication des pains dont parle l'vangile.
Les projets de rorganisation sociale qui hantent aujourd'hui tant de cerveaux
n'ont assurment aucune valeur, et la science ne doit s'occuper d'eux que pour
constater leur faiblesse en passant. Cela ne les empchera pas cependant de jouer
un rle important et d'engendrer des crises redoutables. Ce n'est pas en effet la
valeur d'une croyance qui fait sa force, - les croyances religieuses en sont la preuve,
- mais bien la puissance qu'elle exerce sur les mes. C'est surtout pour des erreurs
que l'humanit s'est passionne jusqu'ici. dfaut des convictions religieuses
qu'elle n'a plus, la foule ignorante croit en un ge d'or que doit engendrer la
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
394
rorganisation sociale rve par elle. Tchons de l'clairer si la chose est possible,
mais tchons aussi de nous prparer nous dfendre.
J'ai rsum aussi impartialement que je l'ai pu dans ce qui prcde les rsultats
avantageux et nuisibles des progrs de l'industrie moderne. Ce court expos a suffi
montrer l'importance de son rle et les phases successives de ses transformations.
En comparant l'influence exerce par l'industrie sur la civilisation moderne celle
produite par les diverses rvolutions politiques dont le monde a t le thtre, on
peut dire que l'action de la premire a t incomparablement plus grande que celle
des secondes. L'histoire ne s'occupe gure que des rvolutions politiques, mais ce
sont seulement les rvolutions scientifiques et industrielles qui exercent une
influence durable dans l'existence des hommes.
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
395
Gustave Le Bon (1881)
LHOMME ET LES SOCITS.
Leurs origines et leur dveloppement
RSUM
Retour la table des matires
Arriv aux limites de notre long labeur, nous allons jeter un coup d'il rapide
sur les routes que nous avons parcourues travers les gnrations et les ges.
Remontant d'abord l'origine des choses, nous avons essay de comprendre
comment a pu natre et se dvelopper cet immense univers dont l'homme et tous les
autres tres ne sont que des fragments ; comment la vie a pu se manifester la
surface de notre plante, et quelles lois ont prsid la naissance et la
transformation des espces animales qui s'y sont succd.
Comme couronnement de cette longue srie de transformations successives,
continues pendant toute la dure des ges gologiques, l'homme est apparu un
jour. Nous avons retrouv ses traces dans la profondeur d'un pass dont les
traditions avaient perdu le souvenir, mais dont les dbris pargns par le temps
nous ont permis de reconstituer l'histoire.
Nous avons vu qu' peine distinct d'abord des espces animales dont la slection
le fit sortir, il ignorait toutes choses, l'agriculture, les mtaux, l'art de rendre les
animaux domestiques, et n'avait que quelques pierres tailles pour armes. Le
suivant pas pas, nous avons montr par quelle srie de pnibles efforts il acquit
les germes de ses futurs progrs.
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
396
Nous avons recherch ensuite comment se forma sa constitution intellectuelle,
et comment les sentiments, ces puissants mobiles de toutes les actions humaines,
avaient pu natre et se transformer.
Cette tude du dveloppement physique et intellectuel de l'homme considr
comme individu, a form la premire partie de cet ouvrage. Il nous restait
rechercher l'origine et le dveloppement des socits que l'homme a formes ;
comment naquirent et se transformrent la famille, la proprit, les religions, le
droit, la morale, les institutions et les croyances ; et ce que rpond la science dans
son froid langage tant de questions qui passionnent les esprits aujourd'hui, et sont
les plus graves de toutes celles qui peuvent s'offrir aux mditations des hommes.
C'est cette importante tude qu'a t consacr le second volume de cet
ouvrage. La nature de la science sociale, ses limites et sa mthode ayant t
examines d'abord, nous avons recherch l'influence, si nglige des historiens, de
chacun des divers facteurs de l'volution sociale. Sans leur connaissance l'histoire
d'une socit ne saurait tre comprise.
Ayant rduit notre expos ses plus strictes limites, nous ne saurions songer le
rsumer davantage. Nous nous bornerons donc rappeler quelques-uns des points
les plus importants qui ressortent de notre tude.
Aprs avoir tudi l'action des milieux physiques et intellectuels, montr
l'influence de leurs variations et de l'adaptation croissante de l'homme son milieu
avec les progrs de la civilisation, nous avons fait voir l'immense influence exerce
par l'tat des sentiments sur l'volution sociale. Dans les passages consacrs cette
tude et dans ceux relatifs l'influence de la race, il a t montr que ce sont les
sentiments qui sont les vrais rgulateurs des socits, que leur influence est
incomparablement plus grande que celle des institutions politiques, et que, pour
pressentir la destine d'un peuple, ce sont surtout ses sentiments dont il faut
entreprendre l'tude.
Nous avons abord ensuite l'influence des progrs de l'agriculture, du
dveloppement de la population, de l'industrie, des institutions militaires et de
divers facteurs dont l'importance a vari suivant les poques et que nous n'avons
pas rappeler maintenant. Arrivant l'influence de la race, nous avons examin
l'action des lments qui entrent dans la constitution d'un peuple sur son volution
sociale. Nous avons fait voir que c'est de l'homognit plus ou moins grande de
ces lments que cette volution dpend ; que, dans les groupements auxquels on
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
397
donne le nom de nationalits, c'est beaucoup plus la communaut des ides et des
sentiments qui est importante que celle du langage, et que, si les ides et les
sentiments sont trop diffrents, l'anarchie ne peut tre vite que par une
compression trs dure.
Examinant successivement au point de vue anatomique et physiologique les
diffrences qui existent entre les races humaines et entre les individus d'une mme
race, nous sommes arriv cette conclusion, - une des plus importantes de notre
ouvrage, - que, loin de tendre l'galit, les hommes tendent se diffrencier de
plus en plus, et que cette diffrenciation qui s'accentue chaque gnration entre
individus de mme sexe dans les races suprieures, s'accrot galement entre
individus de sexes diffrents.
Nous n'avons pas recherch ce que pourra produire dans l'avenir cette
diffrenciation croissante entre individus de race suprieure, parce que des facteurs
divers, tels que l'invasion d'une race nouvelle, infrieure peut-tre, mais trs
nombreuse, - la race jaune, par exemple, - pourront faire disparatre ces lments
suprieurs ; mais, si la diffrenciation continue s'accentuer, il suffit de faire
intervenir le temps pour comprendre que les diffrences existant entre individus
d'une mme race finiront par devenir plus profondes que celles qui sparent le
singe du ngre. Les distinctions entre les diverses classes sociales deviendraient
alors beaucoup plus grandes et surtout plus relles qu'elles ne l'ont t aucune
poque de l'histoire. Quant aux races tout fait infrieures qui vivent encore la
surface du globe, l'histoire permet ds aujourd'hui de prdire les consquences de la
diffrenciation croissante qui s'est tablie entre elles et les peuples civiliss. Leur
destruction progressive les condamne bientt disparatre.
Ces grandes lois physiologiques que la science moderne met en vidence :
diffrenciation progressive des individus, limination des types infrieurs par la
slection, cration de l'intelligence et des sentiments par de lentes accumulations
hrditaires, et d'autres encore contredisent sans doute bien des ides qui rgnent
aujourd'hui ; mais le rle de la science est de rechercher ce qui est sans s'occuper de
ce qui peut nous plaire. L'individu qui se brise un membre en tombant par suite des
lois de l'attraction, ou qui perd par un incendie, consquence des lois des affinits
chimiques, tout ce qu'il possdait, peut bien maudire de telles lois ; mais ses
plaintes sont aussi vaines que celles qui s'adressent aux infirmits, la douleur ou
la mort. Le philosophe peut y compatir en passant, mais dans ses observations il n'a
pas s'occuper d'elles.
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
398
notre tude de l'influence de la race a succd celle du pass et de l'hrdit.
Nous avons montr que, parmi tant d'importants facteurs, ces derniers peuvent tre
rangs au nombre des plus importants. Nous avons vu que, si les institutions et
l'ducation peuvent, quand elles sont continues pendant des gnrations, modifier
lentement les hommes, ce ne sont pas elles qui seront capables de transformer leurs
aptitudes intellectuelles et morales pendant leur vie. En venant la lumire,
l'individu apporte avec lui un long pass. C'est durant ce pass, pendant lequel
chacun de ses anctres a dpos sa trace, que s'est forme la constitution mentale
qui le guidera pendant sa vie. Au pass lgu par nos pres, chaque gnration peut
ajouter quelque chose, mais ce quelque chose est toujours bien minime si on le
compare l'hritage apport en naissant.
Nous avons examin ensuite l'influence des illusions et des croyances, et il nous
a t facile de montrer que, vraies souveraines du monde, elles ont conduit jusqu'ici
les hommes, et que probablement elles les conduiront toujours. C'est sur cette
conclusion que nous avions termin la premire partie de cet ouvrage. Les faits que
nous avons eu invoquer en avanant dans notre tude ne pouvaient que la
confirmer davantage. L'homme, depuis son origine, passe son existence
poursuivre des idals, variables suivant le temps, les conditions et les races, mais
qui possdent tous ce caractre commun d'tre des illusions vaines.
L'tude de l'influence des institutions politiques a suivi celle de l'influence des
illusions. Nous nous proposions de dmontrer que ces institutions constituent un
des facteurs de l'volution sociale dont l'influence est la moins importante, car, si
les formes politiques qui peuvent tre imposes momentanment un peuple sont
variables, celles qu'il peut garder longtemps rsultent de son pass et de l'tat de ses
sentiments, c'est--dire d'lments qu'il ne peut crer. chaque phase de l'histoire
d'une race, il y a certaines institutions adaptes ses besoins, et il n'y en a pas
d'autres. La main d'un matre peut tre la meilleure chose possible une poque et
la libert une autre. Avec les ides actuelles, une telle dmonstration n'tait pas
facile, mais les quelques penseurs qui ont abord les phnomnes historiques avec
les mthodes scientifiques modernes tant arrivs des conclusions analogues,
nous n'tions pas seul les dfendre. Une telle dmonstration a une importance trs
grande, car parmi les consquences qui en dcoulent se trouve l'impossibilit
absolue de rorganiser une socit sur un plan prconu, comme tant de
rformateurs le rvent aujourd'hui.
Passant ensuite l'influence des gouvernements, nous avons montr dans
quelles limites leur action est utile suivant le dveloppement des peuples qu'ils
doivent gouverner ; quelles phases d'volution ncessitent un joug rigide et quelles
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
399
phases impliquent la discussion libre et la libert. Nous avons fait voir combien il
tait avantageux que l'influence de l'tat pt se rduire son minimum de faon
abandonner le plus possible l'initiative prive, mais qu'il fallait d'abord que celleci ft suffisamment dveloppe. tablir d'une faon durable une centralisation
puissante avec des institutions libres sera toujours impossible, parce que cette
centralisation finit par dtruire toute trace d'initiative dans les esprits. Les pays qui
ont fond des rpubliques durables, la Suisse, par exemple, n'y sont arrivs qu'en
restreignant les attributions du pouvoir central au profit des pouvoirs locaux, au
point de donner ces derniers une autonomie presque complte.
Le dernier des facteurs de l'volution sociale examin par nous a t l'ducation.
Elle est le seul dont l'homme puisse disposer. Nous devions, par consquent,
concentrer toute notre attention sur elle. Sans exagrer son importance, nous avons
fait voir, qu'accumule par l'hrdit, elle pouvait, la longue, produire des
rsultats trs-grands.
Ayant termin l'tude de tous ces facteurs de l'volution sociale, nous avons
abord l'histoire du dveloppement des plus importants lments qui entrent dans la
constitution d'une socit : langage, famille, proprit, religion, morale, droit,
conomie sociale, industrie, etc. Les suivant pas pas dans leurs transformations,
nous avons recherch les lois de leur naissance et de leur dveloppement. Les
conclusions rsultant de notre tude scientifique des choses se sont trouves
chaque page en contradiction avec les conceptions engendres par notre pernicieuse
ducation classique.
En terminant l'tude de ces importants lments de la constitution sociale :
famille, religion, proprit, etc., nous avons d reconnatre que les vieilles bases sur
lesquelles les socits avaient vcu jusqu'ici s'croulaient lentement, que ces bases
ne sont pas encore remplaces, et que jusqu'au jour o des croyances nouvelles,
filles des illusions anciennes, auront pris un empire suffisant sur les mes, les
convulsions qui nous agitent seront de plus en plus profondes. Il en a toujours t
ainsi aux poques de l'histoire o il n'y a plus conformit suffisante entre les
institutions, les sentiments, les croyances et la conduite.
Nos laborieuses recherches nous ayant montr que les facteurs de l'volution
sociale sont trs-nombreux, et susceptibles de s'associer de faons bien diffrentes,
nous ne pouvions songer baser sur leur tude quelques-unes de ces prtendues
lois historiques dont la simplicit apparente sduit, mais qui ne servent qu'
masquer les difficults des problmes qu'elles paraissent rsoudre. Il est facile de
dire, par exemple, que les peuples, dans leurs conceptions, passent par une forme
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
400
thologique, une forme mtaphysique, et une forme positive, ce qui revient
simplement constater qu'en avanant dans l'tude des choses, l'homme connat de
mieux en mieux leurs causes. Mais en quoi de telles gnralisations empiriques
pourraient-elles jeter une lumire quelconque sur l'volution des peuples ? Ce ne
sont pas elles qui nous diront les causes de la grandeur et de la dcadence de
nations aussi diffrentes que les Grecs, les Romains, les Arabes et les Espagnols, ni
pourquoi des institutions telles que la famille et la proprit ont subi les
transformations dont nous avons trac l'histoire.
Les facteurs qui dterminent l'volution des divers peuples variant d'un peuple
l'autre, ce n'est qu'en tudiant chaque peuple sparment, c'est--dire en traant
l'histoire de sa civilisation, que l'on peut arriver concevoir comment il se sont
transforms. C'est une tche que je me propose d'entreprendre dans un autre
ouvrage, mais que je ne pouvais mme pas songer effleurer ici.
De lois gnrales applicables tous les peuples, toutes les races, tous les
ges, il y en a bien peu dans l'histoire. Mais s'il en est une dont on ne puisse
mconnatre l'existence, c'est que toutes les choses de l'univers : tres vivants,
socits ou plantes suivent dans leurs transformations le cycle fatal que nous
avons dcrit : natre, grandir, dcliner et mourir.
Prise dans son ensemble, et considre comme individu, l'humanit est
certainement en progrs, car elle profite de toutes les expriences accumules par
les gnrations qui l'ont prcde. Un Grec d'aujourd'hui n'a plus les sentiments et
les aptitudes qui faisaient la grandeur de ses anctres au temps de Pricls. Il puise
cependant au trsor commun des dcouvertes, et les races les plus vieilles et les
plus uses sont beaucoup plus leves actuellement sur l'chelle de la civilisation
matrielle qu'elles ne le furent aux plus brillantes poques de leur grandeur.
Les individus et les socits subissant les mmes lois fatales de progrs et de
dcadence, nous ne pouvons esprer qu'il en soit autrement pour l'humanit ellemme. Nous devons admettre qu'elle progressera encore ; mais nous ne sommes
pas autoriss croire que ce progrs ne se terminera pas, lui aussi, par la dcadence
et la mort. Dj, du reste, elle est bien vieille, et la science commence pressentir
le sort qui l'attend. L'astronomie entrevoit dj l'heure o, entirement refroidie,
recouverte d'un blanc linceul de neige, notre plante promnera dans les espaces
clestes une surface dsole et morne. La vie aura cess alors d'animer sa surface.
Chefs-d'uvre de la civilisation, des sciences et des arts, demi-dieux de la pense
dont les gnrations rvraient la mmoire, l'heure de l'oubli aura sonn pour vous ;
vous disparatrez dans l'ocan des choses sans laisser une seule ride sa surface.
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
401
Mais le temps est ternel, et le repos ne saurait l'tre. Ce globe silencieux et
mort ne roulera pas toujours dans l'espace sa masse refroidie. Nous ne pouvons
former que des conjectures sur ses destines lointaines, mais aucune d'elles ne nous
autorise penser qu'il puisse rester ternellement inerte. Soit qu'obissant aux lois
de l'attraction qui entrane notre systme solaire vers des rgions inconnues de
l'espace, il finisse par se runir d'autres systmes, soit que le choc d'un corps
cleste lve sa temprature au point de le rduire en vapeur, il est destin, sans
doute, former de nouveau une nbuleuse d'o sortira, par une srie d'volutions
analogues celles que nous avons dcrites, un autre monde destin aussi tre
habit un jour en attendant qu'il prisse son tour, sans que nous puissions
entrevoir un terme cette srie ternelle de naissances et de destructions. N'ayant
jamais commenc, sans doute, comment pourrait-elle finir ?
Mais si ce sont les mmes lments de chaque monde qui servent, aprs sa
destruction, en reconstituer d'autres, il est ais de comprendre que les mmes
combinaisons, c'est--dire les mmes mondes habits par les mmes tres, ont d se
rpter bien des fois. Les combinaisons possibles que peuvent former un nombre
donn d'atomes tant limit, et le temps ne l'tant pas, toutes les formes possibles
de dveloppement ont t ncessairement ralises depuis longtemps, et nous ne
pouvons que rpter des combinaisons dj atteintes. Bien des fois sans doute, des
civilisations semblables aux ntres, des oeuvres identiques aux ntres, ont d
prcder notre univers. Comme Sisyphe roulant toujours le mme rocher, nous
rptons sans cesse la mme tche, sans que rien puisse mettre un terme ce fatal
toujours. Quelles rgions ignores des cieux pourraient abriter le nirvana suprme,
ce repos final qu'avaient rv les vieilles religions de l'Inde ? Ombres des temps
passs qui sembliez vanouies pour toujours dans la brume des ges et que la
baguette magique de la science voque son gr, n'esprez pas le repos, vous tes
immortelles.
Sans envisager mme les combinaisons lointaines des mondes qui ont prcd le
ntre ou qui lui succderont, et en restant dans l'troite limite des temps que
l'homme peut connatre, nous avons vu que c'est avec les dbris des tres d'hier que
se sont forms les tres d'aujourd'hui ou que se formeront ceux de demain. Le repos
du tombeau n'est qu'un repos d'un jour. Les gnrations prsentes contiennent les
gnrations futures, comme les gnrations du pass renfermaient celles des temps
prsents.
Et si jamais, lasse des discussions vaines et des passions striles, lasse de tant de
sang vers, lasse d'avoir bien plus lutter contre les maux qu'elle se cre elle-mme
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
402
que contre ceux dont la nature lui a impos le terrible joug, l'humanit pntre un
jour dans ces rgions sereines o, saisissant l'enchanement des choses, on explique
et ne critique plus, et o, comme jadis les dieux immortels, on assiste impassible
aux vnements qu'a fixs le destin ; si jamais elle comprend que tous les tres
humains qui se succdent dans le temps sont en ralit les mmes tres vieillissant
sans cesse et rajeunissant toujours, elle trouvera peut-tre dans les dveloppements
de cette conception grandiose les germes de croyances nouvelles capables
d'enseigner aux hommes la fraternit dont ils commencent peine parler, et la
tolrance qu'ils n'ont pas connue encore.
Mais ce sont l des hypothses fragiles. Aprs avoir voqu tant d'ombres des
vieux ges, reconstitu maint difice du pass, et tent d'embrasser dans une large
synthse l'humanit, la nature et les dieux, on aime se reposer d'une aussi lourde
tche, en laissant errer l'esprit dans les nbuleuses rgions des chimres. Il ne faut
pas nous y arrter trop longtemps. Tous les mystres que nous avons essay de
pntrer sont effleurs peine. Les sphinx de la vieille gypte regarderont
longtemps encore, avec leur ironique et tranquille sourire, les gnrations natre et
disparatre avant que la nature ait dit l'homme ses derniers secrets.
Ce que nous savons est en ralit peu de chose, et, dans tout ce que nous
croyons bien savoir, petite est la part de la vrit, et grande est celle de l'erreur. Le
chemin parcouru par l'homme depuis les antiques priodes de la barbarie primitive
est immense, mais celui qui lui reste parcourir avant d'arriver possder une
claire notion des choses est bien plus immense encore.
Ce n'est qu'en songeant la grandeur des progrs dj accomplis, que nous
pouvons contempler l'avenir avec espoir. L'observateur qui compare l'humanit
passe l'humanit actuelle ne saurait prendre en piti la vanit de nos efforts. Sans
doute il doit mourir, ce vieux monde qui nous donna le jour, mais l'enfant qui vient
de natre, lui aussi doit prir, et pourtant nous l'levons avec amour.
Longtemps avant les pessimistes modernes, l'Ecclsiaste lui aussi demandait
d'un ton amer ce que l'homme retire de tout le travail qui l'occupe sous le soleil,
mais nous pouvons lui demander ce qu'il et retir de son repos. Ne nous laissons
donc pas dtourner de notre persvrant labeur par des plaintes striles. Si le secret
du bonheur est quelque part, il est srement dans le travail. Par lui, l'homme remplit
son existence, oublie ses ennuis, tend ses horizons et amliore avec son propre sort
celui de ses descendants. Il ne pourrait accomplir de plus noble tche.
Gustave Le Bon, Lhomme et les socits. Deuxime partie : Les socits (1881)
FIN.
403
Vous aimerez peut-être aussi
- La Psychologie Des AdolescentsDocument6 pagesLa Psychologie Des AdolescentsMbagnick DiopPas encore d'évaluation
- La Psychologie Des AdolescentsDocument6 pagesLa Psychologie Des AdolescentsMbagnick DiopPas encore d'évaluation
- Etude Comparative Piaget VygotskyDocument11 pagesEtude Comparative Piaget VygotskyMbagnick DiopPas encore d'évaluation
- Definition de La PedagogieDocument3 pagesDefinition de La PedagogieMbagnick DiopPas encore d'évaluation
- Balzac Eugenie GrandetDocument225 pagesBalzac Eugenie GrandetMbagnick DiopPas encore d'évaluation