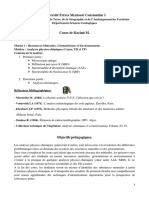Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Jda 319 114 115 L Empathie Inversee Au Coeur de La Relation Ethnographique
Jda 319 114 115 L Empathie Inversee Au Coeur de La Relation Ethnographique
Transféré par
daniel villalpandoDroits d'auteur :
Formats disponibles
Vous aimerez peut-être aussi
- L'adolescentDocument12 pagesL'adolescentStenr Bosten100% (2)
- Liste Des Prestataires 08-06-2018Document47 pagesListe Des Prestataires 08-06-2018Bouraoui Ben Ayed0% (1)
- Devoir 2 B MathsDocument1 pageDevoir 2 B MathsJennifer WandegePas encore d'évaluation
- MathsDocument1 pageMathsALIOUMAN100% (1)
- Programmation MAGELIS PDFDocument10 pagesProgrammation MAGELIS PDFassnadPas encore d'évaluation
- Les Usages de l'IADocument522 pagesLes Usages de l'IAMichel Gwos100% (2)
- Algebre de Boole Exercice CorrigeDocument3 pagesAlgebre de Boole Exercice Corrigemedsalemx3051Pas encore d'évaluation
- La Veille InformationnelleDocument24 pagesLa Veille InformationnellegingreauPas encore d'évaluation
- Dossier 21 22 Candidats InternationauxDocument4 pagesDossier 21 22 Candidats InternationauxDonatien Virpile Akpode EugenePas encore d'évaluation
- 3A Affectations Liste Totale Publiee Le 3 Fevrier 2009Document31 pages3A Affectations Liste Totale Publiee Le 3 Fevrier 2009Yaz Oprey0% (2)
- La Carte MentaleDocument13 pagesLa Carte MentaleRabia AouinaPas encore d'évaluation
- EDT-FASEG de La Semaine Du 06 DécembreDocument5 pagesEDT-FASEG de La Semaine Du 06 DécembresavadogosaidmahammadikibsiPas encore d'évaluation
- Chapitre 3 Les Donne Es L Information Et La ConnaissanceDocument33 pagesChapitre 3 Les Donne Es L Information Et La ConnaissanceYoann KombaPas encore d'évaluation
- Voyages Aux Iles Du Grand OceanDocument1 133 pagesVoyages Aux Iles Du Grand OceanSandra FelicianoPas encore d'évaluation
- Master 1. Rayons XDocument8 pagesMaster 1. Rayons Xbouchra boudjPas encore d'évaluation
- La Bienveillance D. TESSIERDocument24 pagesLa Bienveillance D. TESSIERJulien ColonnaPas encore d'évaluation
- CV HafidaDocument1 pageCV HafidaAnonymous v7CTzSaCIPas encore d'évaluation
- 338F83TQ 2021 2Document1 page338F83TQ 2021 2SadioPas encore d'évaluation
- Master MLS 17 18Document1 pageMaster MLS 17 18Hâ ELmessaoudi100% (1)
- Repartitions Mensuelles Harmonisees de La MaternelleDocument84 pagesRepartitions Mensuelles Harmonisees de La MaternelleDidier Didier100% (5)
- Boite A Outils Plan de Formation 32Document4 pagesBoite A Outils Plan de Formation 32Walid BouzirPas encore d'évaluation
- Bifao027 Art 07Document5 pagesBifao027 Art 07Hattusilis74Pas encore d'évaluation
- Master Salimata Sene MbodjDocument169 pagesMaster Salimata Sene MbodjcedricPas encore d'évaluation
- Fiche de Progression ChrispoDocument2 pagesFiche de Progression ChrispoRomuald BongoPas encore d'évaluation
- CM - Psych Com 4me Année 2016Document96 pagesCM - Psych Com 4me Année 2016Hamza Er-radaPas encore d'évaluation
- Avis de RecrutementDocument6 pagesAvis de RecrutementPhilomène K.Pas encore d'évaluation
Jda 319 114 115 L Empathie Inversee Au Coeur de La Relation Ethnographique
Jda 319 114 115 L Empathie Inversee Au Coeur de La Relation Ethnographique
Transféré par
daniel villalpandoTitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Jda 319 114 115 L Empathie Inversee Au Coeur de La Relation Ethnographique
Jda 319 114 115 L Empathie Inversee Au Coeur de La Relation Ethnographique
Transféré par
daniel villalpandoDroits d'auteur :
Formats disponibles
Journal des anthropologues
114-115 (2008)
Lempathie en anthropologie
................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Ghislaine Gallenga
Lempathie inverse au cur de la
relation ethnographique
................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Avertissement
Le contenu de ce site relve de la lgislation franaise sur la proprit intellectuelle et est la proprit exclusive de
l'diteur.
Les uvres figurant sur ce site peuvent tre consultes et reproduites sur un support papier ou numrique sous
rserve qu'elles soient strictement rserves un usage soit personnel, soit scientifique ou pdagogique excluant
toute exploitation commerciale. La reproduction devra obligatoirement mentionner l'diteur, le nom de la revue,
l'auteur et la rfrence du document.
Toute autre reproduction est interdite sauf accord pralable de l'diteur, en dehors des cas prvus par la lgislation
en vigueur en France.
Revues.org est un portail de revues en sciences humaines et sociales dvelopp par le Clo, Centre pour l'dition
lectronique ouverte (CNRS, EHESS, UP, UAPV).
................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Rfrence lectronique
Ghislaine Gallenga, Lempathie inverse au cur de la relation ethnographique, Journal des anthropologues
[En ligne], 114-115|2008, mis en ligne le 01 dcembre 2009, consult le 08 octobre 2015. URL: http://
jda.revues.org/319
diteur : Association franaise de anthropologues
http://jda.revues.org
http://www.revues.org
Document accessible en ligne sur :
http://jda.revues.org/319
Document gnr automatiquement le 08 octobre 2015. La pagination ne correspond pas la pagination de l'dition
papier.
Journal des anthropologues
Lempathie inverse au cur de la relation ethnographique
Ghislaine Gallenga
Lempathie inverse au cur de la relation
ethnographique
Pagination de ldition papier : p. 145-161
1
La notion dempathie, notion qui fait dbat au sein des sciences humaines et sociales, ne
semble pas constituer un thme de recherche en soi en anthropologie o elle est aborde de
manire collatrale au dtour de problmatiques de recherche plus gnrales. Jai moimme
t amene travailler cette notion au dtour dun questionnement plus large sur la mthode
de limmersion.
Une combinatoire de rflexions sur la critique du terrain issues de la mouvance postmoderne
et de lanthropologie rflexive souligne la nature dialogique du terrain dans la construction
de lobjet anthropologique (Kilani, 1994). Cependant, mme si le travail anthropologique
appartient une double temporalit le temps du terrain et le temps de lcriture mon propos
ne prend pas en compte les dbats centrs sur le rapport au texte et lautorit ethnographique.
Une des principales vises de lanthropologie consiste produire de la connaissance sur
lAutre. ce titre, lempathie pourrait acqurir un statut de mthode, voire de moyen daccs
la vision du monde de lautre. La question nest pas de savoir si lanthropologue doit tre
empathique sur le terrain ou si la mthodologie de lanthropologie passe par ou suscite de
lempathie. En dautres termes, il ne sagit pas ici dinterroger les affects et/ou les difficults
dintgration de lanthropologue sur son terrain mais danalyser la relation de linformateur
oriente vers lethnologue. Lobjectif ne consiste donc pas apporter une nouvelle contribution
scientifique lobjectivation de la mthodologie de lethnologie mme si le dbat impuls
par Geertz et dvelopp par les anthropologues postmodernes sur les pratiques et mthodes
de terrain tend accrditer ce processus de consolidation scientifique. Plutt que daboutir
une dfinition normative et superftatoire de lempathie, mon cheminement intellectuel ma
conduite insister davantage sur le renversement de perspective dans lanalyse de la relation
informateur/ethnologue et traiter ainsi de lempathie inverse.
Menant des recherches dans le champ de lethnologie de lentreprise, jai occup chaque
fois que je le pouvais un poste de travail pour mes enqutes de terrain. Mon questionnement
principal portait sur la dmonstration du caractre heuristique de cette mthode1. Jai t
amene percevoir les problmatiques lies loccupation dun poste de travail comme
une tape mthodologique constitutive dune meilleure apprhension de la dynamique de
lempathie inverse.
Jaborderai la faon dont les anthropologues se saisissent de lempathie aprs en avoir
brivement retrac la gnalogie. Enfin, janalyserai lensemble des ractions que la mthode
dimmersion suscite chez linformateur partir dexemples issus de mes diffrentes recherches
de terrain dans une banque, une fonderie et une entreprise de transports urbains. Si le champ
de lethnologie de lentreprise agit en tant que catalyseur dempathie inverse, je dmontrerai
quil sagit bien dun construit mthodologique qui est gnralisable lensemble de la
discipline anthropologique.
Lempathie, de lart lanthropologie
6
Le concept nomade dempathie qui migre sans cesse dune discipline lautre (Jorland, 2004)
comporte plusieurs origines. La notion dempathie einfhlung a t forge en 1873 par
Robert Vischer pour signifier une forme de sensibilit esthtique lie la projection de nos
tats affectifs dans les objets. Theodore Lipps lui confre en 1903 une acception largie
la comprhension de lexprience subjective dautrui. Pour cet auteur, leinfhlung est la
jouissance objective de soi: jouir esthtiquement signifie jouir de soimme dans un
objet sensible, se sentir en einfhlung avec lui . Le concept a ainsi trouv place dans les
thories expressionnistes de Wollheim (1994) sur lart de pntrer lintention de luvre dart.
Journal des anthropologues, 114-115 | 2008
Lempathie inverse au cur de la relation ethnographique
Le spectateur cherche percevoir le secret du tableau travers un comportement empathique.
En ce sens, la notion dempathie sapproche de ce que dautres auteurs avaient nomm
sympathie. Elle rejoint lexpression donne par Adam Smith dans son ouvrage Thorie
des sentiments moraux paru en 1759. Celuici attribuait la sympathie le fait de cantonner
son intrt personnel au second plan et de se mettre naturellement la place de ses semblables
pour prouver ce quils prouvent. Une telle acception nest pas sans voquer le rle que
JeanJacques Rousseau associait la piti, cet trange transfert dans lautre, dans son Discours
sur lorigine et les fondements de lingalit parmi les hommes en 1755:
Nous ne souffrons quautant que nous jugeons [] que lautre souffre, et ce nest pas dans
nous, mais dans lui que nous souffrons. Ainsi, nul ne devient sensible que quand son imagination
sanime et commence le transporter hors de lui (1959: 505506).
7
10
11
une poque o Bergson (1934) dfendait lintuition cratrice, Einstein et Infeld (1938)
revendiquaient leinfhlung au sens dintuition intellectuelle globale pour caractriser les
dcouvertes anticipatrices en physique. Geertz se posera plus tard la question: Quarrivetil
au verstehen quand leinfhlen disparat? (1986: 72).
Considr comme un processus essentiel de lintersubjectivit chez les phnomnologues
en qute danalyse de laltrit comme chez Husserl en 1929 lempathie ou einfhlung
devient par lespace dialogique quelle gnre un lieu de rencontre et non pas de constitution
dautrui (Husserl, 2000). Ds 1959, Rogers ouvre la voie aux analyses de la communication
interpersonnelle hrites du champ de la psychologie sociale en intgrant la dfinition de
lempathie comme notion clef dun processus dentre dans le monde perceptif dautrui.
Lempathie consistait selon lui percevoir le cadre de rfrence interne dune
personne avec prcision et avec ses composantes et significations motionnelles de faon les
ressentir comme si lon tait cette personne, mais cependant sans jamais oublier le "comme
si" (Rogers, 1968).
Par ailleurs, lempathie a trouv un champ privilgi dexpression avec la relation
soignantsoign. Si les termes grecs de pathos et pathen renvoient lide de souffrance,
lempathie dsignerait une tendance apprhender la souffrance dautrui, la pntrer, et
dans une certaine mesure lintrioriser. Lempathie peut ainsi tre apprhende selon un
double point de vue, celui de la connaissance et celui de lacte thrapeutique. La dfinition
la plus connue et la plus consensuelle provient de la philosophie. Elle mane de la plume de
lpistmologue Grard Jorland (op. cit.) qui associe lempathie la capacit de se mettre
mentalement la place des autres, soit la capacit de prendre mentalement le point de vue que
les autres ont sur le monde tout en conservant sa propre identit. Il nexiste ni confusion, ni
identification entre soi et autrui. En ce sens, lempathie se distingue de la sympathie. Autrement
dit, il sagit dun processus qui consiste prendre la perspective quautrui a sur le monde,
dfinition que je retiens dans cet article.
En dpit de la relative anciennet de ce concept nomade, ce dernier commence toutefois tre
questionn en anthropologie depuis une quinzaine dannes. En se basant sur la dfinition de
Jorland (ibid.) la notion dempathie pourrait tre inscrite au cur mme de la dfinition de
lanthropologie. Elle quivaudrait apprhender le point de vue de lautre sans se mettre sa
place, sans sidentifier lui, etc. Or, ce concept nest presque jamais directement abord au sein
de la littrature. On tourne autour, on y fait allusion mais le plus souvent on nemploie pas le
mot empathie. Si Malinowski parle dentrer dans la tte des indignes, Geertz utilise quant
lui la priphrase lire pardessus lpaule de lautre. On retrouve aussi certaines allusions
ce concept chez Laplantine. Ce dernier nhsite pas associer la pratique de lethnographie
un effort dacculturation lenvers. Selon lui, lethnographe est celui qui doit tre capable
de vivre en lui la tendance principale de la culture quil tudie (Laplantine, 2005: 20-21).
Peuttre les raisons de lapparition marginale de ce terme dans le champ de lanthropologie
sontelles lies son caractre trop galvaud et assimiles au fait de ressentir les motions
avec les autres terme tomb dans un relatif discrdit du fait mme de son caractre de mot
valise. Marcel Maget (1962) rattache dans son Guide dtudes directes des comportements
culturels lempathie lintuition et rejoint ainsi les dfinitions avances par Bergson (op.cit.)
Journal des anthropologues, 114-115 | 2008
Lempathie inverse au cur de la relation ethnographique
12
13
et Einstein (op. cit.) dans la gense de ce concept. Il poursuit que il ny a pas de raisons, dans
les essais de restitution des systmes culturels, de se priver [] des bnfices de limmersion
dans le milieu et des stimulations du mimtisme, de leinfhlung ou de lempathie.
Lvocation dempathie est introduite en tant que terme fourretout et dfaut de dfinition
prcise, elle sera cite lorsquon ne sait pas comment expliquer ou restituer lalchimie
dun terrain. Reprenant les propos de Radin, EvansPritchard souligne que la plupart
des bons enquteurs sont peine conscients de la manire exacte dont ils rcoltent leurs
informations (Radin in EvansPritchard, 1969 : 99). travers son commentaire sur
lobservation participante, Olivier Leservoisier (2005: 9-10) argumente quil ne sagit pas de
rester dans un flou artistique bien que la mthode repose sur les intuitions, lempathie et
les qualits humaines du chercheur. Kilani parle dailleurs de silences de la mthode
(1990 : 78). Lempathie est mme qualifie de vrification mentale aux dcouvertes de
lethnologue (LaburtheTolra, 1998: 107) et elle est assimile une pntration intuitive
de lun (que je suis) dans lautre, aux risques frquents et certes assums de commettre des
contresens (ibid.: 54).
Geertz, dans Du Point de vue de lindigne (1986: 7172) explicite la querelle qui surgit
autour de la publication posthume du journal de terrain de Malinowski en ces termes:
Le mythe du chercheur de terrain camlon, parfaitement accord son entourage exotique,
miracle vivant dempathie, de tact, de patience et de cosmopolitisme, tait dmoli par lhomme
qui avait peut-tre fait le plus pour le crer (ibid.: 71).
14
15
16
De mme, Kilani (1990: 88) analyse lillusion dempathie. Toutefois, lempathie na fait
lobjet que dun travail sporadique de conceptualisation en anthropologie. Jeanne FavretSaada
(1990) indique dans son article tre affect deux acceptions de lempathie. La premire
issue de lEncyclopeadia of Psychology suppose une prise de distance de lobservateur, la
seconde reprend la thse de leinflhung. . Bruno Martinelli (2001) dresse un tat des lieux plus
approfondi et problmatis et apporte ainsi des clairages nouveaux concernant les dfinitions,
les glissements smantiques, les usages, et les principales controverses lis cette notion dans
le champ de lethnologie et notamment travers la littrature postmoderne.
Dans cette mme littrature et dans celle de lanthropologie rflexive cette notion est
approche par le biais danalyses de retour de terrain et travers les processus dexplicitation
et dobjectivation. La majeure partie de ces contributions se focalisent sur les conditions de
production du texte anthropologique et notamment du horstexte (Affergan, 1999; Kilani,
1994; Adam, Borel, Calame & Kilani, 1990). Toutefois, sil est possible de dire que presque
toutes les questions souleves par lempathie sont abordes et traites dans ces littratures,
elles ne sont pas rattaches au terme mme dempathie si ce nest pour critiquer son acception
(Clifford, 1996) ou la nier (FavretSaada, op. cit.). La critique postmoderne provient dune
mouvance qui sinscrit dans la continuit de la tradition interprtative en anthropologie. James
Clifford dans son ouvrage Malaise dans la culture (op.cit.) stigmatise ltrange amalgame
de lexprience personnelle intense et de lanalyse scientifique. Engag dans une entreprise
de dmystification, leffet qualifi dempathie est le premier objet de la critique de Clifford. Il
devient ainsi lune des cibles privilgie des critiques dconstructionnistes de lethnographie
(Sperber, 1982; Clifford & Marcus, 1986; Geertz, 1982 & 1986; Darnell, 1995; Clifford,
op. cit.).
La question centrale revient savoir pourquoi aucun anthropologue na jamais vritablement
entam une dmarche de conceptualisation autour de cette notion? Mais peuttre sagitil
dun faux dbat, voire dun questionnement de deuxime ordre tant donn que cest davantage
ce que mobilise lempathie au sein de la discipline qui mrite lattention des chercheurs
plutt que datteindre une dfinition normative et strile de ce concept? Ne fait-on pas sur le
terrain de lempathie la manire de Monsieur Jourdain? Ou cette absence ne seraitelle tout
simplement pas induite par les confusions nes dun apport de connaissance sur cette notion
via dautres disciplines? Cela expliquerait la confusion de cette notion avec la sympathie,
comme cela apparat dans luvre de LviStrauss (1968), voire son amalgame frquent aux
mthodes utilises par les psychothrapeutes qui allient analyse du ressenti et comprhension.
Journal des anthropologues, 114-115 | 2008
Lempathie inverse au cur de la relation ethnographique
Limmersion en entreprise
17
18
19
Mon questionnement initial renvoie la thmatique de limmersion, problmatique centrale
de lanthropologie (Kilani, 1994). Malinowski dcrit cette pratique du chercheur comme le
fait de sefforcer de vivre exactement comme les indignes. Le chercheur apprend leur
langue, il participe toutes leurs activits, il sefforce dacqurir le sens de ce quils dfinissent
comme les bonnes manires (Malinowski, 1963: 6265). Tour tour, attache de direction
au sein dun tablissement bancaire en France, ouvrire dans une fonderie de pices internes
de robinets industriels en Roumanie et conductrice de bus dans une entreprise de transports
urbains en France, jai ainsi mis en pratique cette immersion par une occupation de poste dans
des lieux renvoyant chacun des problmes mthodologiques spcifiques.
Mon propos ne consiste ni dpeindre les dbats concernant les enjeux de limmersion, ni les
apports mthodologiques essentiels lis cette immersion dans les entreprises et encore moins
de revenir sur la question de loccupation ou non dun poste de travail2.
De manire concise, tre immerg dans une entreprise et occuper un poste de travail, cest
vouloir tre comme ou se sentir comme sans jamais vouloir, bien entendu, se
prendre pour. Ces proccupations font cho aux remarques de Kilani: Il ne sagit pas
pour lanthropologue de se confondre avec lautre au point de devenir luimme cet autre
(Kilani, 1994 : 41). Il est en effet illusoire et dangereux de penser que travailler comme
un chauffeur de bus va permettre, par exemple, dendosser lidentit professionnelle dun
chauffeur de bus. De la mme manire, tre chauffeur de bus nest pas une obligation pour
tudier les chauffeurs, ce nest quun biais mthodologique. In fine, loccupation dun poste
de travail facilite lintgration sur le terrain, une contextualisation des discours, des enqutes
plus fines ainsi quune comprhension approfondie des modalits de socialisation. Or, la
vritable richesse heuristique de loccupation dun poste de travail prend corps dans la relation
observateur/observ dans le processus de lenqute de terrain, processus que je qualifie ici
dempathie inverse.
Immersion et empathie inverse
20
La littrature anthropologique et principalement rflexive abonde en descriptions
concernant la place de lethnologue et notamment la faon dont ce dernier a ngoci son rle
ou sur ce qua induit le rle que linformateur a donn lethnologue. Pascale Jamoulle (2004:
35) voque la complexit de la position ethnographique:
Au cours du travail de terrain, lanalyse des perturbations lies lenqute, des positions
successives du chercheur et des affects engags est un outil dinterprtation constant de lunivers
de sens dans lequel lethnographe est plong.
21
Il mest apparu, dune manire gnrale, quil sagissait toujours de la mme orientation de
la relation, savoir de lethnologue vers linformateur, mme lorsquil sagissait danalyser
les rpercussions de lenqute ethnographique sur le propre terrain de ce dernier. Or,
loccupation dun poste de travail et plus gnralement lobservation participante me semblet-il, provoquent chez linformateur un malaise, un dsordre voire une double contrainte du
fait de la prsence de lethnologue qui devient alors un tranger proche. Dans lentreprise,
ce processus savre plus immdiat et sa visibilit en est accrue : linformateur se trouve
simultanment confront un collgue de travail et un chercheur. Cest la rponse
cette situation paradoxale qui constitue ce que je qualifie dempathie inverse. Ce nest bien
videmment pas lempathie qui est inverse mais le sens habituel de lecture de la relation
qui, lui, est invers. Jai dsign cette notion empathie inverse , par analogie avec le
complexe ddipe invers, dfaut dun terme plus adquat. Jaurais pu la qualifier de
contre-empathie ou dempathie symtrique, deux termes ne me satisfaisant par car ils
induisent la prsence automatique de lempathie du chercheur lendroit de linformateur3.
Cette empathie inverse par le malaise quelle provoque chez linformateur oblige celuici
soumettre lethnologue des tests et dfis, afin de le catgoriser et de le dcatgoriser de
la premire catgorisation o intuitivement linformateur lavait plac. Cest par ce jeu de
catgorisation/dcatgorisation quil nous informe de la manire dont il ordonne son monde.
Journal des anthropologues, 114-115 | 2008
Lempathie inverse au cur de la relation ethnographique
22
23
24
25
26
Lors de mes diffrentes occupations de poste, plusieurs informateurs me tmoignrent ainsi
leur empathie mon gard: Je comprends que tu veuilles travailler pour comprendre, mais
si jtais toi je ne travaillerais pas si je ntais pas oblig(e) de le faire ou en tant que
Franaise, ce ne doit pas tre facile pour toi ou toi qui est une femme, tu dois souffrir
de travailler quavec des hommes . Les bvues de lethnologue favorisent galement
lidentification, comme en tmoignrent les ractions de soutien de mes informateurs aprs la
premire sanction que je reus dans ltablissement bancaire au sein duquel jtais employe
ou leurs ractions quand jai malencontreusement percut une station service au volant de
mon autobus la Rgie des transports de Marseille (RTM).
La confrontation de lethnologue au systme hirarchique de lentreprise intervient comme un
lment supplmentaire qui facilite lidentification de linformateur lethnologue et permet
par la mme occasion de gnrer des marques dempathie inverse. Lors du conflit social li
linstauration dun double statut pour les chauffeurs de bus la RTM (Gallenga, 2005), le
fait quil mtait attribu un salaire plus modeste que les autres cadres favorisa lidentification
avec la situation laquelle ces derniers taient confronts. Il en fut de mme en Roumanie.
Je ntais pas rmunre pour le poste que joccupais alors dans la fonderie et cela connotait
lexploitation que les autres ouvriers avaient vcue et pensaient encore endurer. Ils qualifirent
ce titre mon travail de travail patriotique.
Par cette posture dimmersion, lethnologue, la fois collgue de travail et chercheur, pousse
linformateur se retrouver dans un conflit de loyaut et le confronte un malaise insoutenable
provoqu par linjonction paradoxale laquelle cet interlocuteur est expos4. Cest cette
situation de malaise lie un problme didentification immdiate de lethnologue qui force
linformateur se questionner. Cela gnre alors de lempathie contrairement la position de
consultant ou celle de passager clandestin. nouveau mon exprience personnelle du terrain
conforte une telle analyse. Pour sextraire de cette situation de malaise, les informateurs mont
soumise des tests. Ceuxci peuvent tre apparents des situations de dfi et de bizutage,
voire une exprience initiatique afin quils puissent se positionner plus facilement par rapport
moi. Ainsi, le premier jour o jarrivai au sein de latelier de fonderie de pice de robinetterie
en Transylvanie (Roumanie), on me confia un seau rempli de sable nicepe. Ce dernier tait
destin remplir des moules de confection. Lune des ouvrires sen saisit, le retourna et
mintima lordre de masseoir dessus, lendroit prcis du dmoulage et empilage des pices.
Assise cet emplacement, je tournais ainsi le dos la machine et recevais un jet de vapeur
une frquence irrgulire. Une ouvrire senquit de linconfort de ma situation: Questce
que tu restes l? Tu ne vois pas que tu reois plein de vapeur? Metstoi ailleurs. Je rpondis
que je venais darriver, que je ne connaissais pas les rouages du travail et que si Elena qui les
connaissait mavait indiqu de masseoir ici, il devait y avoir une raison qui mchappait. Ma
collgue rapporta mes propos dautres employes, qui venaient rgulirement senqurir de
mon inconfortable situation. Il sensuivit bientt un change entre elles. Lune des ouvrires
en qualit de porte-parole interpella Elena. Celle-ci surgit peu de temps aprs et dplaa mon
seau en me disant que je pouvais dsormais minstaller la place de mon choix. partir de
cet vnement, je fus dfinitivement intgre parmi les femmes.
Si les situations de dfi et de test que les ethnologues ont subir sur leur terrain sont
bien videmment courantes, elles mettent galement en uvre un passage de lempathie
la sympathie ou lantipathie. Face lambivalence des reprsentations de lethnologue,
linformateur essaie en quelque sorte de savoir qui il a en face de lui: un collgueapprenti
ou un chercheur?
Les informateurs dveloppent donc, dans un premier temps, une empathie visvis de
lethnologue qui, la suite de cette objectivation, se transforme en sympathie comme dans
mon exprience roumaine et celle de la RTM o les informateurs mont intgre et aide au
maximum de leurs possibilits ou en antipathie comme dans lexprience de la banque.
Dans ce dernier cas, les informateurs envoyrent la direction une lettre anonyme, car ils ne
supportaient plus le malaise cr par ma prsence, malaise exacerb par le fait que je prenais
de lavancement dans la hirarchie tout en continuant daffirmer ne pas vouloir faire carrire
Journal des anthropologues, 114-115 | 2008
Lempathie inverse au cur de la relation ethnographique
dans la banque et ntre intresse que par lethnologie. Cette lettre a finalement conduit
mon licenciement et donc mon exclusion du terrain.
Ltranger proche
27
28
Par la posture dtranger proche inhrent lethnographe, linformateur se voit contraint dtre
dans une relation dempathie parce quil cherche connatre lidentit relle de la personne
laquelle il est confront, do la succession de tests laquelle il va soumettre cette dernire. Sur
dautres terrains, cette empathie prend des formes plus diffuses et euphmises qui peuvent
demeurer moins visibles en raison de la lenteur de son processus dlaboration. Le point de
vue apparat ainsi centr sur linterlocuteur de lethnologue, do limportance de ne pas faire
du terrain sous couvert danonymat afin de pouvoir conserver la richesse de cette exposition
et danalyser le processus dempathie inverse.
En vue daccrditer le caractre gnralisable de mon point de vue, on pourrait reconsidrer
des monographies clbres comme celles dEvansPritchard ou de Malinowski et montrer
par le biais de la figure dtranger proche et de la mthode dimmersion que ces auteurs
ont galement suscit de lempathie inverse chez leurs informateurs. Je me contenterai
brivement de deux travaux plus rcents. Le premier exemple concerne le combat de coq
Bali de Geertz (1983). Si lexemple de la descente de police a maintes fois t comment et
critiqu comme le moyen pour lethnologue dtablir un rapport son objet et daccder ainsi
la socit balinaise, on peut aussi percevoir cette anecdote comme lexpression dune situation
produisant de lempathie inverse. En effet, Geertz en calquant son comportement sur celui des
Balinais acquiert la figure de ltranger proche. Ces derniers staient interrogs sur les raisons
de sa fuite alors que cette conduite ntait aucunement prescrite pour un tranger. Le paradoxe
n de ce questionnement va conduire les Balinais essayer de comprendre qui il est. Le second
exemple qui a galement aliment maints commentaires est celui de Jeanne FavretSaada (op.
cit.). Dans son article tre affect sur la sorcellerie dans le Bocage, lauteure explique que
la situation denqute sest dbloque et quelle a enfin pu accder des donnes de terrain
que quand ils ont pens que jy tais "prise", cestdire quand des ractions chappant
mon contrle leur ont montr que jtais affecte par les effets rels souvent dvastateurs
de telles paroles et de tels actes rituels (ibid. : 5). Aussi longtemps quelle demeurait
extrieure et trangre et perue comme une ethnologue, la situation senlisait. Il sensuit
alors une situation de sympathie ou dantipathie selon que lethnologue occupe le rle de
dsorceleuse ou ensorceleuse . Dans ces deux exemples, lempathie inverse nest pas
produite par loccupation dun poste de travail mais par la posture intellectuelle et mthodologique de ltranger proche rendue possible par limmersion de ces anthropologues sur leurs
terrains.
Conclusion
29
30
Dans la littrature anthropologique et principalement celle consacre la rflexivit5, il est
souvent fait cas des problmes que rencontre lethnologue, du rle quil a jou sur le terrain, de
sa posture ou de ses difficults dintgration, etc. En focalisant volontairement mon propos sur
linformateur et non lethnologue, jai opt pour un renversement de perspective analytique
qui sest rvl heuristique. La prsence de lanthropologue sur son terrain lui confre de
facto la posture de ltranger proche. Ainsi, la transgression des frontires culturelles par
lethnologue et par linformateur savre invitable. Cette posture rend difficile lidentification
de lethnologue par ses interlocuteurs en raison de la situation dinjonction paradoxale latente
qui suscite de lempathie inverse. Un tel processus permet lethnologue davoir accs la
manire dont la population catgorise et ordonne son monde. Lnonciation de ces savoirs
reprsente une des portes daccs la culture de lautre.
Si, comme le souligne Rabinow (1988: 136137), linformateur doit apprendre expliciter
sa propre culture et objectiver son propre univers du vcu pour apprendre le prsenter
lethnologue, linformateur transcende lui aussi la frontire en vue de comprendre la culture
du chercheur. Cette perception des choses sapparente un processus dobjectivation inverse,
soit une objectivation du vcu de lethnologue par linformateur rendue possible par lempathie
Journal des anthropologues, 114-115 | 2008
Lempathie inverse au cur de la relation ethnographique
inverse. En resituant le rapport informateur/chercheur au centre du questionnement du
processus de lenqute de terrain, lempathie inverse permet son tour dinterroger
lexprience de terrain dans une perspective singulire, et dintgrer la problmatique de la
constitution du savoir scientifique.
Bibliographie
AFFERGAN F., 1999 (dir.). Construire le travail anthropologique. Paris, PUF.
BERGSON 1934. La Pense et le Mouvant. Paris, PUF.
CLIFFORD J., 1996. De lautorit en ethnographie, Malaise dans la culture. Lethnographie; la
littrature et lart au XXe sicle. Paris, nsb-a: 29-59.
CLIFFORD J., MARCUS G. E. (eds), 1986. Writing Culture. The Poetics and Politics of Ethnography.
Berkeley/Los Angeles/London, University of California Press.
DARNELL R., 1995. Deux ou trois choses que je sais du postmodernisme , Gradhiva, 17 (Le
moment exprimental dans lanthropologie nordamricaine): 3-15.
DEVEREUX G., 1980. De langoisse la mthode dans les sciences du comportement. Paris, Aubier.
EINSTEIN A., INFELD L., 1938. Lvolution des ides en physique. Paris, Petite bibliothque Payot.
EVANS-PRITCHARD E. E., 1969. Anthropologie sociale. Paris, Payot.
FAVRET-SAADA J., 1990. tre affect, Gradhiva, 8: 3-9.
GALLENGA G., 2005. Une ethnologue dans la grve, Ethnologie franaise, XXXV (4): 723732.
GALLENGA G., 2007. Lempathie inverse : une heuristique de limmersion en entreprise , in
Leservoisier O., Vidal L. (dir.), Lanthropologie face ses objets. Nouveaux contextes ethnographiques.
Paris, ditions des Archives Contemporaines: 151-158.
GEERTZ C., 1983. Bali. Interprtation dune culture. Paris, Gallimard.
GEERTZ C., 1986. Savoir local, savoir global. Les lieux du savoir. Paris, PUF.
HUSSERL E., 2000 [1929]. Mditations cartsiennes. Introduction la phnomnologie. Paris, Vrin.
JAMOULLE P., 2004. Approche clinique et posture ethnologique, Pense Plurielle, (Souffrances
sociales), 8(2): 3137.
JORLAND G., 2004. Lempathie, histoire dun concept, in berthoz A., Jorland G. (dir.), Lempathie.
Paris, Odile Jacob: 19-49.
KILANI M., 1990. Les anthropologues et leur savoir: du terrain au texte, in Adam J.-M., Borel M.J., Calame C., Kilani M. (dir.), Le discours anthropologique. Paris, Mridiens Klincksieck: 71-109.
KILANI M., 1994. Linvention de lautre. Essai sur le discours anthropologique. Lausanne, Payot.
LABURTHE-TOLRA P., 1998. Critiques de la raison ethnologique. Paris, PUF.
LAPLANTINE F., 2005. La description ethnographique. Paris, Nathan Universit.
LESERVOISIER O. (dir.), 2005. Introduction. Lanthropologie rflexive comme exigence
pistmologique et mthodologique, Terrains ethnographiques et hirarchies sociales. Retour rflexif
sur la situation denqute. Paris, Khartala: 1-32.
LVI-STRAUSS C., 1968. Anthropologie structurale. Paris, Plon.
LIPPS T., 1905. Consonance and Dissonance , in Thomson W. (1995), Music. San Marino
(California), Everett Books.
MAGET M., 1962. Guide dtudes directes des comportements culturels. Paris, Civilisations du sud.
MALINOWSKI B., 1963. Les Argonautes du Pacifique occidental. Paris, Gallimard.
MARTINELLI B., 2001. "La malice gche lamiti". Rflexions sur lempathie en ethnologie, in
KISS A. (ed), Lempathie et la rencontre interculturelle. Paris, lHarmattan.
RABINOW P., 1988. Un ethnologue au Maroc. Rflexions sur une enqute de terrain. Mesnil-surlEstre, Hachette.
ROGERS C., 1968. Le dveloppement de la personne. Paris, Dunod.
ROUSSEAU J.-J., 1959 [1759]. uvres compltes, III. Discours sur lorigine et les fondements de
lingalit parmi les hommes. Paris, Gallimard: 505-506.
Journal des anthropologues, 114-115 | 2008
Lempathie inverse au cur de la relation ethnographique
SMITH A., 1999. Thorie des sentiments moraux. Paris, PUF.
SPERBER D., 1982. Le savoir des anthropologues trois essais. Paris, Hermann.
WOLLHEIM R., 1994. Lart et ses objets. Paris, Aubier.
Notes
1 Pour des dveloppements concernant ce questionnement, cf. Gallenga (2007).
2 Pour une synthse de ces dbats et une explicitation de la mthode, cf. Gallenga (2007).
3 Il ne sagit pas non plus de transfert ou de contretransfert, notions analyses par Georges Devereux
(1980) car ces deux dernires sont intimement lies et ressortent du domaine de linconscient, alors que
lempathie par dfinition se veut une dmarche volontaire et consciente.
4 Linjonction paradoxale telle quelle a t dveloppe par Gregory Bateson pourrait tre illustre sur
le terrain par lnonc suivant de lethnologue: Je te suis tranger mais considre-moi comme un des
tiens!
5 Le mot parle de lui-mme avec pour implicite le fait que lanthropologue et son anthropologie
constituent lobjet de la rflexivit.
Pour citer cet article
Rfrence lectronique
Ghislaine Gallenga, Lempathie inverse au cur de la relation ethnographique, Journal des
anthropologues [En ligne], 114-115|2008, mis en ligne le 01 dcembre 2009, consult le 08 octobre
2015. URL: http://jda.revues.org/319
Rfrence papier
Ghislaine Gallenga, Lempathie inverse au cur de la relation ethnographique, Journal
des anthropologues, 114-115|2008, 145-161.
propos de lauteur
Ghislaine Gallenga
Universit de Provence, IDEMEC. (Institut dethnologie mditerranenne, europenne
et comparative). MMSH 5 rue du Chteau de lHorloge. B.P. 647. 13094 Aix-enProvence.gallenga@mmsh.univ-aix.fr
Droits dauteur
Journal des anthropologues
Rsums
En cherchant rpondre la question en quoi loccupation dun poste de travail est-elle
heuristique pour le champ de lethnologie de lentreprise, lauteure dveloppe le concept
dempathie inverse en dcalant son regard de la dialectique ethnologueinformateur pour
adopter celui de la relation inverse informateurethnologue. Elle montre par lmme que cette
notion est non seulement gnralisable la pratique de terrain mais inscrite au cur de la
relation ethnographique.
Reversed Empathy at the Core of Ethnographical Relation
By questioning the issue whether occupying a working position is granted a heuristic
dimension in the field of anthropology of firms, the author develops a new concept of
reversed empathy. She does so by re-orienteering the traditional way of the anthropologist
Journal des anthropologues, 114-115 | 2008
Lempathie inverse au cur de la relation ethnographique
the informant relation and by focusing her analysis upon the informant-anthropologist relation.
She thereby demonstrates that nonetheless this notion is endowed with generalizing features
to fieldwork practice but that it also is embedded at the core of the ethnographical relation.
Entres dindex
Mots-cls :empathie inverse, immersion, ethnographie, terrain, mthodologie
Keywords :reversed empathy, immersion, ethnography, fieldwork, methodology
Journal des anthropologues, 114-115 | 2008
10
Vous aimerez peut-être aussi
- L'adolescentDocument12 pagesL'adolescentStenr Bosten100% (2)
- Liste Des Prestataires 08-06-2018Document47 pagesListe Des Prestataires 08-06-2018Bouraoui Ben Ayed0% (1)
- Devoir 2 B MathsDocument1 pageDevoir 2 B MathsJennifer WandegePas encore d'évaluation
- MathsDocument1 pageMathsALIOUMAN100% (1)
- Programmation MAGELIS PDFDocument10 pagesProgrammation MAGELIS PDFassnadPas encore d'évaluation
- Les Usages de l'IADocument522 pagesLes Usages de l'IAMichel Gwos100% (2)
- Algebre de Boole Exercice CorrigeDocument3 pagesAlgebre de Boole Exercice Corrigemedsalemx3051Pas encore d'évaluation
- La Veille InformationnelleDocument24 pagesLa Veille InformationnellegingreauPas encore d'évaluation
- Dossier 21 22 Candidats InternationauxDocument4 pagesDossier 21 22 Candidats InternationauxDonatien Virpile Akpode EugenePas encore d'évaluation
- 3A Affectations Liste Totale Publiee Le 3 Fevrier 2009Document31 pages3A Affectations Liste Totale Publiee Le 3 Fevrier 2009Yaz Oprey0% (2)
- La Carte MentaleDocument13 pagesLa Carte MentaleRabia AouinaPas encore d'évaluation
- EDT-FASEG de La Semaine Du 06 DécembreDocument5 pagesEDT-FASEG de La Semaine Du 06 DécembresavadogosaidmahammadikibsiPas encore d'évaluation
- Chapitre 3 Les Donne Es L Information Et La ConnaissanceDocument33 pagesChapitre 3 Les Donne Es L Information Et La ConnaissanceYoann KombaPas encore d'évaluation
- Voyages Aux Iles Du Grand OceanDocument1 133 pagesVoyages Aux Iles Du Grand OceanSandra FelicianoPas encore d'évaluation
- Master 1. Rayons XDocument8 pagesMaster 1. Rayons Xbouchra boudjPas encore d'évaluation
- La Bienveillance D. TESSIERDocument24 pagesLa Bienveillance D. TESSIERJulien ColonnaPas encore d'évaluation
- CV HafidaDocument1 pageCV HafidaAnonymous v7CTzSaCIPas encore d'évaluation
- 338F83TQ 2021 2Document1 page338F83TQ 2021 2SadioPas encore d'évaluation
- Master MLS 17 18Document1 pageMaster MLS 17 18Hâ ELmessaoudi100% (1)
- Repartitions Mensuelles Harmonisees de La MaternelleDocument84 pagesRepartitions Mensuelles Harmonisees de La MaternelleDidier Didier100% (5)
- Boite A Outils Plan de Formation 32Document4 pagesBoite A Outils Plan de Formation 32Walid BouzirPas encore d'évaluation
- Bifao027 Art 07Document5 pagesBifao027 Art 07Hattusilis74Pas encore d'évaluation
- Master Salimata Sene MbodjDocument169 pagesMaster Salimata Sene MbodjcedricPas encore d'évaluation
- Fiche de Progression ChrispoDocument2 pagesFiche de Progression ChrispoRomuald BongoPas encore d'évaluation
- CM - Psych Com 4me Année 2016Document96 pagesCM - Psych Com 4me Année 2016Hamza Er-radaPas encore d'évaluation
- Avis de RecrutementDocument6 pagesAvis de RecrutementPhilomène K.Pas encore d'évaluation