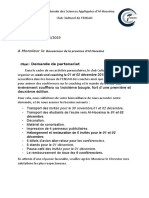Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
COURSpolycopié2
COURSpolycopié2
Transféré par
Tb Soufiane0 évaluation0% ont trouvé ce document utile (0 vote)
29 vues35 pagescours ponts chap 2
Copyright
© © All Rights Reserved
Formats disponibles
PDF ou lisez en ligne sur Scribd
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentcours ponts chap 2
Droits d'auteur :
© All Rights Reserved
Formats disponibles
Téléchargez comme PDF ou lisez en ligne sur Scribd
0 évaluation0% ont trouvé ce document utile (0 vote)
29 vues35 pagesCOURSpolycopié2
COURSpolycopié2
Transféré par
Tb Soufianecours ponts chap 2
Droits d'auteur :
© All Rights Reserved
Formats disponibles
Téléchargez comme PDF ou lisez en ligne sur Scribd
Vous êtes sur la page 1sur 35
2- TABLIERS DES GRANDS OUVRAGES
Vu limportance du panorama des grands ouvrages et la diversité des
Matériaux et des techniques utilisés, nous nous restreindrons isi a la
description des grands ouvrages les plus fréquemment construits ces
demiéres années au Marcc
— les ponts & poutres préfabriquées précontraintes :
— les ponts-caissons précontraints,
Les poutres précontraintes par post-tension permettent la réalisation de
tablier a travées indépencantes de portées entre 30 et 50 m. Les principaux
avantages de ce type d'ouvrage sont la robustesse, la facllité d'exécution et
"€conomie. Cependant leur faible élancement constitue un handicap en site
urbain|
Quant aux ponts-caissens, ils sont réalisés par poussage ou en
encerbellement (et parfois sur cintre si les conditions d'appui de
"échafaudage sont favoratles techniquement et économiquement).
Avec la technique de poussage unilatéral ou bilatéral, [a portée déterminante
courante est comprise entre 35 et 65 m
La construction par encorbellement autorise la réalisation de grandes portées
de 130 a 140 met permet méme d'atteindre 200 m
59
2.1. - LES PONTS A POUTRES PREFABRIQUEES
PRECONTRAINTES
2.1.4 - PRINCIPE :
La technique consiste a préfabriquer la structure maitresse du tablier @ savoir
les poutres, sur une aire spécifique et spécialement aménagée, a leur mise
en place sur les appuis definitifs par un procédé et des outils appropriés et &
la liaison transversale des poutres par un hourdis sous chaussée et des
entretoises.
Le tablier comporte généralement des travées isostatiques reliées par des
joints de dilatation dont leur nombre est souvent réduit, pour améliorer le
Confort de 'usager, en réaiisant une continuité du hourdis (dalle de continuité)
tous les deux ou trois travees.
2.1.2 - DOMAINE D'UTILISATION :
Les portées habituelles sétendent de 30 a 50 m, la portée économique et
fréquente étant entre 35 et 40 m.
La réalisation douvrage & poutres préfabriquées exige un matériel de
préfabrication et de mise en place assez coliteux et qui ne peut se justifier
€conomiquement que lorsque le nombre de Poutres est suffisant ( > 12 en
général).
2.1.3 - AVANTAGES ET INCONVENIENTS
2.4.3.1 - Avantages :
+ Rapidité d’exécuticn ;
* Standardisation des éléments et répétitivité des opérations assurant
des gains de coiit et de qualité ;
* Suppression des cntres et échafaudages.
2.1.3.2 - Inconvénients :
+ Multiplicité des joirts de chaussée ;
¢ Déformation différée des poutres vers le haut pouvant étre perceptible
par 'usager et méne nuisible a la sécurité.
60
2.1.4 - REGLES DE CONCEPTION ET DE PREDIMENSIONNEMENT
2.1.4.1 - Poutres :
Normalement les poutres sont en double té de hauteur constante et ayant les
caractéristiques géomeétricues suivantes
* hauteur économique de l'ordre de 1/17 ce la portée ;
* ame d'épaisseur constante en travée (18 & 25 cm avec un coffrage
vibrant et 25 30 cm si la vibratior du béton est assurée par
aiguilles). Au voisinage des appuis lame est épaissie
progressivement ;
* Table de compression de largeur au moins égale a 0,6 fois la
hauteur ;
* talon de section suffisante pour le passage des cables et la limitation
de la compression du béton.
L’espacement des poutres varie de 2,5 43,5 m.
TABLE _DE.
DE COMPRESSION
18/25 vibration externe
8/25 voration interne
— Caractéristiques géométriques des poutres en double té
@1
2.1.4.2 - Hourdis :
La disposition générale et la meilleure est le hcurdis monolithique coulé au
dessus des tables de compression
Une autre disposition peut étre également retenue et consistant & réaliser le
hourdis entre les tables de compression des poutres, cependant ce type de
hourdis présente un moins bon comportement mécanique que celui du
hourdis monolithique.
L'épzisseur du hourdis est suellement comprise entre 18 et 22 cm.
Pour Ie coffrage du hourds, l'on peut utiliser des panneaux suspendu aux
extrémités des ailes des poutres ou des prédalles préfabriquées en béton
armé, jouant le réle de coffiage perdu, et appuyées sur les alles des poutres
3.00
= Toller @ hourdis général monalithique
62
LUAISON_BETONNEE
ET Hou
= ‘oblier @ hourdis préfabriqué
2.1.4.3 - Entretoise:
La rigidité transversale du tablier est assurée par des entratoises reliant les
poutres,
Ces entretoises sont coulées sur place aprés le positionnement des poutres
et sont de deux types :
* Les entretoises d'appui, situées au droit des appuis, ont pour rdle
d’encastrer les poutres a la torsion, de rigidifier les extremités du
hourdis et de pernettre le vérinage du tablier pour remplacer les
appareils d'appui par exemple.
+ Les entretoises intermédiaires, situées en section courante, ont pour
role de solidariser transversalement les poutres pour mieux répartir
les charges excentées.
Ces demiares entretoises sont généralement supprimées en raison des
importantes sujétions qu’éles posent tant au niveau de la préfabrication des
poutres qu'au moment du coffrage et réalisation du hourdis.
Cependant, cette suppression entraine une certaine majoration de la
précontrainte qui est acceptable compte tenu de la simplification d'exécution
obtenue par ailleurs.
63
TRAVEES ISOSTATIOUES —TRAVEES ISCSTATIOUES TRAVEES CONTINUES
ave ATATION ATTELEES
|
aa
His tin
ser oppul Inermadicires
= Entretoisenent d'un toblier & poulres préfabriquées
2.1.4.4 - Dalles de continuité :
Afin d'améliorer le confort de I'usager et de limiter les coats diinstallation et
dentretien des joints de chaussée, I'on réalise actuellement une continuité du
hourdis entre les travées indépendantes et en ne prévoit les joints de
dilatation que tous les deux ou trois travées. Les éléments de transition sont
dits dalles de continuité, ;éalisés en béton armé et présentent une grande
souplesse par rapport aux ooutres.
2.1.5 - MODE OPERATIONNEL,
La réalisation dun tablier @ poutres préfabriquées et précontraintes s'effectue
suivant le processus ci-aprss
1. Préfabrication des poutres sur une plate-forme au sol prés de louvrages
et qui est prévue également pour le stockage. Le cycle classique de
préfabrication se comsose des étapes suivantes
64
* réalisation de le cage d’armatures avec les gaines et cables de
précentraintes et ce, sur un fond de moule ;
* coffrage des joues et bétonnage de la poutre ;
‘+ décoffrage des joues aprés prise du béton ;
* mise en tension de la premiére famille de cables aprés
durcissement suifisant du béton ;
stockage de la poutre.
2. Mise én piace des poutres par des engins spéciaux: grues, portiques
poutre de lancement, etc.
3. Exécution des entretoises d’extrémités et intermédiaires éventuellement
4, Coffrage et ferraillage du hourdis ; les éléments de coffrage étant fixés
aux poutres ;
5, Bétonnage du hourdis ;
6. Mise en tension de la deuxime famille de cables aprés durcissement du
béton du hourdis ;
7. Déplacement des équipements pour répéter les étapes précédentes
pour les travées suivantes ;
8. Pose des superstructures du tablier.
65
2.2 - LES PONTS-CAISSONS PRECONTRAINTS POUSSES
2.2.1 - PRINCIPE :
La technique consiste a construire le tablier en éléments successifs, derriére
une culée sur une aire terrestre, suivant l'axe de l'ouvrage, et ensuite 4 le
déplacer successivement et longitudinalement de maniére a l'amener a sa
position finale sur les piles et culées.
Le tablier est réalisé en plusieurs trongons assemblés par une précontrainte
provisoire nécassaire pour la reprise des moments alternatifs sollicitant
chaque section lors de la translation du tablier. Cette translation est
habtuellement assurée par des vérins hydrauliques fixés sur un des appuis.
Lopération de déplacement du tablier est dite poussage. Une fois le tablier
est sur ses appuis définitifs, |'on réalise la précontrainte finale.
ZONE DE CONSTRUCTON OU TABLER
setts fe gana rng ourtee
=|
ate om hem m RTT TIRT TTT TR TIS
Principe ce eonsucin ott fiers par poussoge,
2.2.2 - DOMAINE D'UTILISATION
Les portées habituelles sont comprises entre 35 et 65 m, des portées plus
importantes peuvent étre (éalisées moyennant das appuis provisoires.
oT
Le poussage demande une géométrie du tablier superposable a elle-méme
par déplacement d’ou une hauteur constante et des courbures (en long et en
plan) constantes.
2.2.3 - AVANTAGES ET INCONVENIENTS :
2.3.1 - Avantages :
* Rapidité d’exécution ;
* Standardisation des éléments et répétitivité des opérations procurant
des gains de coi et de qualits
+ Opérations au sol pratiquement en poste fixe ;
* Matériel de poussage robuste, léger et économique ;
* Suppression des cintres et échafaudages.
2.3.2 - Inconvénients :
* Contraintes géometriques en hauteur et courbures ;
* Nécessité de dis0ser d'une aire de longueur suffisante pour la
construction des 4éments du tablier ;
© Nécessité d'une piécontrainte provisoire.
2.2.4 - REGLES DE CONCEPTION ET DE PREDIMENSIONNEMENT
2.4.1 = STRUCTURE LONGITUDINALE :
Le tablier définitif a la forme d'une poutre continue, tubulaire, de hauteur
constante et reposant sur ses appuis.
Pour les grandes longueurs, des joints de dilatation intermédiaires peuvent
atre prévus, la précontrainte provisoire pouvant assurer la continuité lors du
poussage.
L’élancement du tablier (rapport entre la portée déterminante et la hauteur du
caisson) dépend du mode de lancement ; il est de l'ordre de
68
* 12.4 15 pour les tablie's travées multiples avec utilisation d'un avant-
bec pendant le poussage (d'une longueur entre 0,5 et 0,7 fois la rortée).
Un élancement plus élevé est possible avec un haubanage provisoire ou
moyennant des palées provisoires intermédiaires.
* 20 pour les tabliers @ trois travées poussés bilatéralement et qui ne
nécessitent ni avant-bec ni haubanage provisoire.
Joints_snire trangons
2 2 2 ye wa
' 1
a ee
y o> > ——
=o
Va Ve | fa
LIGNE MaYENNE DE LA PRECONTRAINTE LONGITUDINALE
= 9) Ss Sears woe
2.4.2 - STRUCTURE TRANSVERSALE
Hourdis supérieur
Ce hourdis esi surtout dimensionné par sa résistance au poingonnement et &
la flexion transversale.
Pour les caissons de largeur courante, I'épaisseur du hourdis est de 22 a 25
cm. Elle peut aller jusqu’a 28 ou 30 cm pour les caissons larges (plus de 18
m)
69
Ames
L’épaisseur des mes est dictée par le type de cAblage retenu, par la
résistance a effort tranchant et par les conditions de bonne mise er ceuvre
du béton. Elle varie habitiellement de 30 2 45 cm pour les ponts routiers et
de 40 & 50 om pour les pents ferroviaires.
Les ames peuvent égalenent étres épaissies progressivement (linéairement)
vers les appuis de maniérs 4 résister a |effort tranchant.
Normalement, l'espacement entre les ames est de 5 47 m et peut étre
augmenté a 9 m moyennant un hourdis nervuré.
Hourdis inférieur
Ce nourdis est surtout dimensionné par sa résistance @ la flexion transversale
et par le diamétre des gaines de cables s'il en comporte. Usuellement, son
épaisseur est de l’ordre de 20 cm (18 cm étant un minimum).
Au voisinage ces piles, l'épaisseur du hourdis est déterminée par I'importance
des contraintes de comprassion dues a la flexicn longitudinale, elle peut étre
prise égale a trois fois 'éraisseur en travée, soit donc de l'ordre de 60. om
Entretoise:
Des entretoises sont géxéralement prévues sur les appuis, au droit des
cassures du hourdis inférieur et des joints de dilatation. Elles sont évidées
pour permettre la circulation du personnel d'entretien et le passage des
canalisations de service.
9) structure tubuéire ) structure @ nervures
SECTIONS TRANSVERSALES TYPE
70
2.2.5 - MODE OPERATIONNEL
La réalisation d'un tablier-caisson précontraint poussé s‘effectue
habituellement suivant le processus qui suit
1. Construction d'un trorgon du tablier, dont la longueur fréquente et
comprise entre % et % d'une travée ; les étapes de construction étant les
suivantes :
+ assemblage des armatures et des cables de précontraintes ;
* bétonnage du hourdis inférieur et amorces des ames ;
© bétonnage des ames ;
* bétonnage du hourdis supérieur et des ancorbellements.
2. Mise en tension des cables de précontrainte provisoire aprés durcissement
du béton.
3. Désolidarisation du trongon de son fond de moule, décoffrage externe par
vérins, et sa pose sur ses appuis de glissement. Cette désolidarisation
peut étre assurée soit par le soulevement du trongon par des vérins, soit
par l'abaissement du moule qui doit étre monté sur des vérins
hydrauliques. Cette deuxiéme méthode est la meilleure car elle permet en
outre de régler le fond de moule et de compenser par exemple les
tassements éventuels.
4, Poussage du tablier moyennant des vérins de poussage et de guidage, la
vitesse d’avancement étant entre 2 et 5 m/heure.
5, Rétraction cu coffrage interne, qui s'est déplacé avec le trongon ors du
poussage, a sa position initiale aprés bétonnage du hourdis inférieur du
trongon suivant.
6. Répétition des étapes précédentes jusqu’a l'achévement du tablier.
7. Une fois le tablier terminé, 'on met en place la précontrainte finale avec
transformation éventue le d'une partie de la précontrainte provisoire pour la
rendre definitive.
71
=a
ar
|| |
= Sehama dt poussage Unilatial d'un pont 2 travées mullipes
72
coin
TT 7 4
T
Wy \
= Sthima de pouseoje bislolool dun pont 3 trois ‘aes
1 pouscse snp
Pewee
1) peusege ores arene
2) pose ete nawsonege
73
rosa 1
= Font & Chamainy-sur-rne« Phses ce consason
74
2.3.2 - DOMAINE D'UTILISATION
Les portées habituelles sont entre 60 et 150 m, les portées les plus
fréquentes sont comprises entre 70 et 90 m.
2.3.3 - AVANTAGES ET INCONVENIENTS :
3.3.1 - Avantages :
* Suppression des cintres et échafaudages ;
‘+ Réduction et optimisation des coffrages ;
* Mécanisation et ‘épétition des opérations autorisant des gains de
coat et de qualité
* Rapidité et souplesse d'exécution.
3.3.2 - Inconvénients :
Discontinuité du procédé puisque l'assemblage de tout louvrage ne se fait
que dans les demiéres étapes.
2.3.4 - REGLES DE CONCEPTION ET DE PREDIMENSIONNEMENT
3.4.4 - Structure longitudinale :
La construction par encorbellement successif permet de réaliser plusieurs
types de ponts et en partisuliers
* les portiques aticulés ou avec travée suspendue en clé ;
e les poutres et portiques continus ;
« les ponts a béquilles et en arc ;
* les ponts & haubans
Nous allons cependant nous limiter dans la suite aux seuls ponts-caissons
continus (poutres) pour lesquels nous donnerors les notions de conception et
d'exécution. Crest d'ailletrs le type douvrage le plus répandu.
76
2.3. - LES PONTS-CAISSONS CONSTRUITS PAR
ENCORBELLEMENT
2.3.1 - PRINCIPE :
La technique consiste & construire le tablier & partir de ses appuis par
tranches successives exécutées par encorbellements par rapport aux
précédentes. Chaque tranche est donc supportée par la précédente et aura &
supporter le poids de la tranche suivante & construire ains que le pods des
équipements et des surcharges durant les travaux.
Les tranches, dites voussoirs, sont soit coulées sur place soit préfabiquées
st solidarisées & celles déja exécutées et ce, alternativement de part et
diautre de l'appuis de meniére & maintenir I'équilibre du fiéau composé par
les deux consoles réalisées & l'avancement
La résistance des consdles est obienue par des cables de précontrainte
disposés dans la membrure supérieur.
Compte tenu du fait que les voussoirs symétriques ne sont pas exécutés
simultanément, il est nécessaire de stabiliser le fléau, qui est partiellement
déséquilibré durant la construction, par son encastrement sur I'appui ou par
un appui provisoire, II estcependant possible de réaliser des encorbellements
non symétriques a condition d’'assurer & chaque étape I’équilibre d’ensemble.
75
La hauteur des poutres-caissons est soit constante pour les ouvrages de
portée réduite (inférieure 4 80 m) soit variable pour les portées plus grande,
la Ici de variation est dans ce cas généralement parabolique.
La hauteur sur pile est de l'ordre de 1/20 (1/18 a 1/25) de la portée
déterminante pour les caissons & hauteur constante et de 1/17 (1/16 & 1/20)
pour les caissons a hauteur variable. La hauteur a la clé étant comprise entre
1/35 et 1/60 de la portée avec un minimum de 2,30 m pour permattre la visite
et l'entretien de 'ouvrage.
fleau
cables de fléau - K
rl 1 !
encastrement sur ple i \,appul provisire
, a. {j \
(éventuel) | {jventuel)
ple
~ Construction symétrique & partir des piles
©] toblier éxéouté
(7) ‘oblier en cours d’éxécution
—» sens de |'avancement de la construction
7
rive
_appui de to culée | =! each
cable de_précontraiare
oppui_inversé
cur cue
= Construetion dissimétrique & gorlir des piles
3.4.2 - Structure transversale
Pour les caractéristiques du hourdis supérieur, des ames, cu hourdis inférieur
et des entretoises, les principes de conception sont analogues 4 ceux
développés dens le cas des ponts-caissons poussés.
3.4.3 - Mode operationnel
La réalisation d'un pontcaisson par encorbelements successifs s'effectue
généralement selon le processus ci-aprés :
1. Exécution d'un voussoir sur pile par bétonnage sur un échafaudage
classique prenant appui sur le sol ou fixé @ a téte de pile lorsque celle-ci
est haute ou en sie aquatique. La longueur de ce voussoir est
habituellement supérieure au double de la longueur des voussoirs
courants, soit entre 7 et 10 m;
78
2. Encastrement de ce voussoir sur la pile de maniére & assurer la stabilité du
fléau a réaliser ;
3. Montage des équipages mobiles sur le vousscir sur pile ;
4, Exécution des voussdirs courants ou leur mise en place siils sont
préfabriqués ;
5, Réalisation de la précontrainte de solidarisation ;
6. Répatition des étapes précédentes jusqu'a l'achévement du tablier.
ie Nose ar a
_ + _
Wy _
tl g)
Extremité: ¥
re Fie 2
Arfieulation
centrale Eatrémité
travée de rive
= Phases de construction des portiques avec articulation en clé
73
1
u
os
=
Riéeou 1 ny Noussoir sur pile 2
Q 3 i -
= + -
aL |
|
Fléou 2
Exrémité
través derive
@)
Trove
indepéndanle
= Phasis de construct des porlique: over travée suspendue en clé
80
gli
BIOGRAPHIE
“Conception des ponts"- A. BERNARD GELY et J.A CALGARO - Presses
des Ponts et chaussées 1994
“Ponts en béton" - J.MATHIVAT - CHEC - 1989/1990
"Béton précontraint, tome 1" - ENTPE - 1987
“Beton précontraint, tome 2” - ENTPE - 1987
“Le projet de béton précontraint" - R. LACROIX et A FUENTES - Eyrolles -
1981
"Projet et construction ces ponts : Analyse structurale des tabliers de
ponts” J.A CALGARO et M. VIRLOGEUX - Presses des ponts et chaussées
- 1994,
81
CHAPITRE IV
FONDATION - PILES ET CULEES
1 - GENERALITES
On appelie cule l'ensemble de 'appui et des organes de raccordement de
Fouvrage au terrain,
On appelie piles les appuis intermédiaires des ponts a travées multiples.
Figure 4
Fig 1
Le type des piles et des cules dépend des divers facteurs suivants
~ du genre des fondations, done du terran,
— de la forme et de la largeur du tablier,
— des conditions imposées @ l'ouvrage et, en particulier, du site et des
abords.
2 - FONDATION
2.4 - GENERALITES
Le type des fondations dépend de trois facteurs
— la contrainte de compression admissible sur le sol
— les risques d'affouillements dans le cas d'ouvrage en site aquatique |
= les phénoménes de tassements qui doivent étre compatibles avec
Vintégrité des superstructures
Le type de fondations employés varie en fonction de la proximité ou de
\'éloignement du "bon sol’ par rapport au terrain naturel.
83
2.2 - LES FONDATIONS SLPERFICIELLES:
2.2.1 - Fondations superficielles en I'absence de nappa
Ce cas de figure est le plus simple que 'on puisse rencontrer . La fondation
est alors constituée par une semelle en béton armé, de forme rectangulaire,
carrée ou circulaire .Cette semelle est exécutée au fond d'une fouille sur une
couche de béton de propreté de 10 4 15 cm d'épaisseur.
Quel que Soit le type de pile (ou d'appui) ou le nombre des séments porteurs
verticaux, la fondation comporte une semelle unique, éventuellement raidie
(fig 2) pour <> les hétérogénéités locales du sol (points durs ou
poches de moindre résistance ).
La longueur des semelles est fixée par la dimension des appuis a leur base et
leur largeur est fixée par la qualité du sol de fondation au niveau considéré,
par la descente de charges et son centrage, ainsi que par le poids des terres
sus‘jacentes. Son épaisseur doit étre suffisante pour lui conférer une bonne
rigigité, généralement constante, et en tout état de cause, supérieure 4 60
cm,
Fig 2
2.2.2 - Fondations superficielles dans la nappe
Lorsque le sol est le siége d'une nappe, il est naturellement préférable, si les
caractéristiques le permettent, de placer la foncation au-dessus de la nappe
Si ce n'est pas possible, on exécute & sec la semelle sur un massif de béton
non armé pour lequel on peut se contenter d'un blindage de fouille plus
sommaire que si la fondation est relativement profonde.
Dans ce demier cas, et lorsque se posent des problémes d’emprise limitée,
on exécute la semelle a l'abri d'un blindage, parfois en bois sur des chantiers
d'importance modeste, mais le plus souvent en palplanches metalliques ou en
parois moulées
2.2.3 - Dispositions constructives
On note
— B: lalargeur de la semelle ;
— fh: son épaisseur ;
=: lalargeur de tappui.
L'épaisseur de la semelle doit satisfaire a la condition de rigidité, qui
s'exprime par:
Le ferraillage principal est celui disposé parallélement a sa largeur lorsque la
géométrie de la semelle n'est pas circulaire. || est calculé en fonction des
efforts qui lui sont appliqués. Dans le sens longitudinal, lorsque les appuis ne
sont pas "ponctuels” et quill n'y a pas de risques majeurs de défauts de
portance , le ferraillage n'est pas calculé : on prévoit un ferrailage de
répartition, proportionné au ferraillage principal, offrant une section minimale
égale & 0,5/100 de la meme section réparti en face supérieure. Par ailleurs,
on ne met d’étriers que si la contrainte de cisaillement maxirale est
supérieure au seuil suivant :
85
a, représente le pourcentage des armatures principales .Le dessin de la
Figure 3 résume I'ensembie de ces dispositions.
iqure 3
eb
a
hy > 60cm Dy 0.12%
ane 7
nS Oy 20.1%
51 TOE
Die >0.05%
Pas d’étriers si:
Us t= 25V@, MPa
Fig 3
2.2.4 - Cas particulier des fondations en téte de talus
Il arrive assez fréquemment que les appuis extremes des ouvrages
franchissant ces routes ou des autoroutes s'appuient directement, par
intermédiaire d'un simple sommier ou d'une semelle enterrée 2 faible
profondeur, en téte du talus des remblais d'eccés. Une telle solution est
rarement justifiée dans le cas de remblais rapportés ; en revanche, elle est
conomiquement intéressante dans le cas de remblais en place (la route
franchie étant alors en déblai ). Il convient toutefois de procéder a une
justification de la tenue dt talus au glissement avec le sommier d'appul
Le dessin de la Fiqure 4 donne un exemple de fondation en téte de talus.
2.2.5- Justification des fondations superficielles.
Dans le cadre de ce cours, qui est avant tout Ln cours de conception, nous
nlaborderons pas les questions relatives a la justifications des fondations. Le
lecteur se reportera aux cours de mécanique des sols et aux nombreuses
publications techniques sur le sujet
Disons simplement que cstte justification repose sur un modéle diinteraction
sol structure, modéle basé sur les hypothéses suivantes :
- la semelle est infiniment rigide dans toutes les directions ;
— le solne réagit pas aux contraintes de traction ;
= les contraintes de compression sont proportionnelles aux
déplacements verticaux.
Ces hypothéses conduisent & un diagramme de contraintes dans le sol qui
est linéaire ou plan, Dans |e cas d'une fondation rectangulaire que l'on étudie
sous solicitations transversales, les dessins et formules de la Figure 5
donnent directement les 1ésultats du calcul des contraintes. Du point de vue
de la portance, la contrainte de référence du sol, que fon compare a la
contrainte limite relative a 'état limite considéré, est la contrainte aux trois
quarts de la largeur comprimée.
87
Spat
mex
gues , su>ea
atte
imox= 380, =eM
Smin= 0
LES EFFORTS M, OVET Op S'ENTENDENT PAR UNITE DE LONGUEUR DE LA SEMILLE
Fig §
Lorsque on a affaire & une fondation sur massif de gros béton, le niveau de
fondation est situé a l'arese inférieure de ce massif, Mais, sous l'effet d'un
effort horizontal et d'un moment en téte, le déplacement induit fait réagr le sol
non seulement sous la base du gros béton, mais également sur ses cétés. La
détermination des contraintes équilibrant l'ensemble massif semelle est un
peu plus compliquée.
2.3 - PUITS MAROCAINS
Dans le cas de zones ‘ocheuses surmontées par un manteau diéboulis
d'épaisseur modérée, il est trés difficile d'apprécier le degré de stabilité de
ces éboulis. C'est pourcuoi, dans la plupart des cas, on recourt a des
méthodes d'exécution qui remanient au minimum le sol en place. Parmi ces
méthodes, la plus répandue est celle dite des puits marocains. On exécute
<< la main>> des forages dans les éboulis par tranches dun metre environ
et on bétonne un anneat de stabilisation immédiatement aprés l'excavation.
On réalise ainsi une fouile circulaire blindée par tranche de faible éraisseur
jusqu’a ce que I'on trouve un appui satisfaisant.
88
Les puits marocains peuvent étre de hauteur tres variable; ils constituent un
moce de fondation intermédiaire entre la fondation superficielle et !a fondation
profonde. Le dessin de la Figure 6 donne un exemple de puits marocain.
Figure 6
Principe
“Excavation manele 1
=Blindage au fur et & rnesure
de la progression de l'excavation
=Remplissage de l'excavation par
du béton arrné au non armé
Fig 6
2.4 - LES FONDATIONS SUR CAISSONS
C'est un cas particulier de fondations massives que |'on utilise lorsque le bon
sol se trouve & grande profondeur ou quand il y a risque d'effouillements,
Soit, par exemple, un lit de sable et de gravier affouillable. Ce sol constitue
une excellente base de fondation en dessous du niveau des plus grands
affouillements, On ne feut employer, pour ce faire, les batardeaux de
palolanches, 4 cause des risques de renarcs, ni les pieux puisque les
semelles qui les coiffent coivent étre descendues a un niveau inférieur celui
des affouillements, II est, dans ce cas, plus économique dlutiliser une
fondation sur caissons
ipe sur caissons
Ce principe consiste a faire descendre par gravité une boite sans fond (le
caisson) en enlevant le sol qui se trouve a l'intérieur.
89
Suivant la méthode employée pour extraire les déblais, on distingue :
~ Les caissons fonoés par havage,
— Les caissons foneés a I'air comprimé,
2.4.1 - Caissons fonces par havage
Le procédé par havage peut étre employé dans tous les cas.
Pour les profondeurs inféieures & 35,00 m, il entre en concurrence, parce
que plus économique, avec le fongage a I'air comprime. Au dela de cette
profondeur, le havage est |e seul procédé envisageable.
Les fouilles a lintérieur dt caisson peuvent étre effectuées par dragage sous
\'eau (Figure 7) (benne preneuse, hammer-grab....) ou a sec (Figure 8) si 'on
peut épuiser, ceci suivant que l'on se trouve en présence de terrains
perméables ou imperméatles.
Figure 7 Figure 8
Benne |
porieuse
| Pompe
4
HAVAGE SOUS V'EAU PAR DRAGAGE HAVAGE A SEC
Fig 7 Fig 8
Les parois latérales du caisson havé sont sourrises au frottement du terrain,
frotiement qui s'oppose 4 la descente du caisson et qui ne peut étre vaincu
que par le poids de ce demier.
Les vides nécassaires at havage occupent une fraction importante ce l'aire
horzontale; les parois sont soumises a la poussée d’Archiméde lorsque l'on
have par dragage sans epuiser : on ne dispose donc que d'une marge de
sécurité assez faible vis-é-vis du frottement, dont un ordre de grandeur, a une
profondeur supérieure a £,00 m est donné ci-dessous
90
NATURE DU SOL | FORCE DE FROTTEMENT LATERAL PAR
UNITE DE SURFACE LATERALE
limon, argile molle 0,07 - 0,29 bars
argile trés compacte 0,49 - 1,95 bars
sable peu compact 0,12 - 0,34 bars
sable compact 0,34 - 0,68 bars
ravier compact, 0,49 - 0.98 bars
Il convient done de prendie toutes les dispositions utiles pour lutter contre le
frottement latéral; on y parvient en surchargeant le caisson, en faisant des
injections d'eau, de bentonite sinon, on est conduit A prévoir le passage a l'air
comprimé.
Les conditions idéales d'emploi du havage se présentent lorsque la couche
de fondation est a la fois résistante et meuble, sans points durs (sable ou
gravier compact).
Aprés fongage du caisson on coule un bouchon en béton dosé a environ 400
kg de ciment a la partie inférieure de celui-ci, si|'épuisement est impossible ;
ensuite, on épuise et l'on continue le remplissage des alvéoles avec du gros
béton dosé @ environ 20) kg de ciment. On termine par la mise en place
d'une semelle en béton ermé dosé a environ 300 kg de ciment qui sert de
liaison entre le caisson etles superstructures.
2.4.2 - Caissons foncés a l'air comprime
Le poids du caisson est beaucoup plus important que celui d'un caisson havé,
les magonneries au-dessus de la chambre de travail étant pleines. De plus,
les lachures de pression, en supprimant ne partie de la poussée
d'Archimade, permettent de lutter efficacement contre le frottement latéral
On peut franchir les obstecles tels que blocs de magonneris, épaves, etc... et
asseoir parfaitement le caisson sur la couche de fondation, puisque lon
accéde directement au terrain et que l'utilisation des outils manuels ou
pneumatiques est possibla
En revanche, la profondeur de fondation est limitée & 35 m_ environ,
profondeur limite d'emplo’ pratique de l'air comprimé.
a1
Ce systéme est également beaucoup plus cher que son rival (augmentation
des frais de main d'oeuvre, durée du travail réduite,...) voir Figure 9.
Ce procédé est déconseilé dans le cas de terrains mous( vase, argile molle,
limons) dans lesquels le caisson risque de s'enfoncer bruscuement, ainsi que
dans le cas de la traveisée de vases organiques qui dégagent des gaz
délétéres.
Figure 9
—Sses
Béton de remplissoge
Ir. Housses,
=|, I b> Se!
. “Hl. s, V
Coutecu,
Chambre de travail
Fig 9
2.5 - FONDATIONS SUR PIEUX
2.5.1 - Généralités:
Conditions d'utilisations
Les pieux sont employés soit pour reporter les charges sur une couche
résistante profonde, en passant a travers un mauvais terrain, soit pour répartir
les charges dans un terrein médiocre et de grande épaisseur. Dans ces deux
cas, il est nécessaire de solidariser les pieux en téte par une semelle
disposée au-dessous du niveau des plus grands affouillements.
la présence dobstacles dans le sol (débris de maconnerie, blocs de
rocner,...) est difficilemen: compatible avec la mse en oeuvre de pieux battus;
il est préférable de prévor, dans ce cas, des pieux forés. Ce dernier type de
pieux est & employer également si l'on doit, pour atteindre le bon sol,
traverser une couche de ‘errain résistante, mais d'épaisseur insuffisante pour
venir y fonder l'ouvrage.
92
Dans les deux cas cités ci-dessus, on risque un refus au battage avant davoir
pu atteindre le niveau de fondation fixé.
la longueur minimum écoromique admissible pour les pieux est de l'ordre de
8 410 m ; en-dessous, il est préférable de descendre les fondations
directement au niveau du sol de fondation envisagée.
Résistance aux charges verticales
Les pieux équilibrent les charges verticales par résistance de pointe et par
frottement latéral, les detx termes sont affectés par la présence des pieux
voisins, 'ensemble des preux formant un pseuco massif pour lequel on doit
étudier la stabilité : chaque pieu ne devant pas porter plus que sa résistance
individuelle
Il est bien entendu que siles pieux reposent sur le rocher, la résistance d'un
pieu n'est plus affectée par celle de ses voisins si l'on ne prend en compte
que la résistance de pointe. Dans ce cas, la force portante des pieux est
souvent limitée par la résistance du béton.
2.5.2 - Pieux préparés a I'avance et enfoncés dans le sol
Généralités
Les pieux utilisés sont sot en bois, soit en métal, soit en béton armé. Ils sont
enfoncés dans le sol sot par battage, soit au moyen de vérins, soit par
vissage.
La suite de ce paragraphe est consacrée aux pieux préfabriqués battus en
béton armé.
La section transversale des pieux en béton armé est le plus souvent carrée,
parfois octogonale. Les pieux carrés de 0,25 m, 0,35 m et 0,40 m de céte sont
courants, les dimensions supérieures sont exceptionnelles.
L'élancement : rapport de la longueur la plus petite dimension, atteint
couramment 49 & 50, ce qui correspond a des longueurs de 20 a 30 m. Ii est
possible d'exécuter des pieux de plus grande longueur (50 m) par rallonges
successives ou entures, en coffrant verticalement la partie supérieure du pieu
battu et en raccordant les armatures de celui-c’ a celles du pieu a bettre sur
une hauteur dau moins 60 d a 80 d (d étant le diamétre des armatures
longitudinales des pieux).
La pointe du pieu dont louverture varie entre 60° et 90°, est généralement
pourvue d'un sabot métalique solidement liaisonné au corps du pieu.
93
Vous aimerez peut-être aussi
- Rapport Dcheira PDFDocument76 pagesRapport Dcheira PDFTb Soufiane100% (1)
- Eclairagisme Public Au Maroc (Autosaved)Document8 pagesEclairagisme Public Au Maroc (Autosaved)Tb SoufianePas encore d'évaluation
- TD1 OptimisationDocument2 pagesTD1 OptimisationTb SoufianePas encore d'évaluation
- TD 2Document2 pagesTD 2Tb SoufianePas encore d'évaluation
- Chapitre 1 - Presentation de La Comptabilité AnalytiqueDocument42 pagesChapitre 1 - Presentation de La Comptabilité AnalytiqueTb SoufianePas encore d'évaluation
- Examens National 2bac Se Eco Org 2013 N PDFDocument10 pagesExamens National 2bac Se Eco Org 2013 N PDFTb SoufianePas encore d'évaluation
- TP GÃ Otechnique 2014 15Document36 pagesTP GÃ Otechnique 2014 15Tb Soufiane100% (1)
- Chapitre 4 - Le Compte Presentation, Nature Et FonctionnementDocument13 pagesChapitre 4 - Le Compte Presentation, Nature Et FonctionnementTb SoufianePas encore d'évaluation
- Chapitre 2 - Hydraulique Des SolsDocument36 pagesChapitre 2 - Hydraulique Des SolsTb SoufianePas encore d'évaluation
- Compte Rendu de Réunion 20-05-2018Document2 pagesCompte Rendu de Réunion 20-05-2018Tb SoufianePas encore d'évaluation
- Institut Espagnol Al HoceimaDocument1 pageInstitut Espagnol Al HoceimaTb SoufianePas encore d'évaluation
- Demande D'assurer Une Séance de Sensibilité Au Profit Des ÉtudiantsDocument1 pageDemande D'assurer Une Séance de Sensibilité Au Profit Des ÉtudiantsTb SoufianePas encore d'évaluation
- A Monsieur Le Doyen de La Faculté Des Sciences Et Techniques DDocument1 pageA Monsieur Le Doyen de La Faculté Des Sciences Et Techniques DTb SoufianePas encore d'évaluation
- Office de La Protection Civile D'al HoceimaDocument1 pageOffice de La Protection Civile D'al HoceimaTb SoufianePas encore d'évaluation
- A Monsieur Le Directeur de AMIR-plage Al-HoceimaDocument1 pageA Monsieur Le Directeur de AMIR-plage Al-HoceimaTb SoufianePas encore d'évaluation
- Gouverneur de La Province D'al HoceimaDocument1 pageGouverneur de La Province D'al HoceimaTb Soufiane0% (1)
- A Monsieur L'adjoint Régional Du Ministère de L'éducation NationaleDocument2 pagesA Monsieur L'adjoint Régional Du Ministère de L'éducation NationaleTb SoufianePas encore d'évaluation
- S4-2 - ASSASSI Sami-AlgerieDocument8 pagesS4-2 - ASSASSI Sami-AlgerieTb SoufianePas encore d'évaluation
- Sujet Mur de SoutenementDocument1 pageSujet Mur de SoutenementTb SoufianePas encore d'évaluation
- HT S01Document2 pagesHT S01Tb SoufianePas encore d'évaluation
- Chap 1&2Document14 pagesChap 1&2Tb Soufiane100% (1)