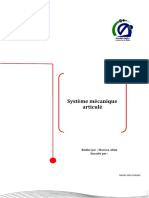Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Fabrication Mecanique 1
Fabrication Mecanique 1
Transféré par
sarahrou0 évaluation0% ont trouvé ce document utile (0 vote)
119 vues31 pagesCopyright
© © All Rights Reserved
Formats disponibles
PDF ou lisez en ligne sur Scribd
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
© All Rights Reserved
Formats disponibles
Téléchargez comme PDF ou lisez en ligne sur Scribd
0 évaluation0% ont trouvé ce document utile (0 vote)
119 vues31 pagesFabrication Mecanique 1
Fabrication Mecanique 1
Transféré par
sarahrouDroits d'auteur :
© All Rights Reserved
Formats disponibles
Téléchargez comme PDF ou lisez en ligne sur Scribd
Vous êtes sur la page 1sur 31
] les cahiers de la technologie
‘gondran. staron “collection a.captiez
FABRICATIONS _
les sept familles
de piéces 4 usiner
2
le ee
ri
a
I"degré
SNOLLVOIUa Va
Gy
SHNDINWOE
YY
AVL INI L RAVE
Les cahiers de la technologie
FABRICATIONS MECANIQUES
Productique
Collection A. Capliez
Les sept familles
de piéces a usiner
| — 1* degré —
M. Gondran R. Staron
Professeur agrégé de génie mécanique , Projessour certitié de lycée technique
El...
28, rue Monge, 75005 Paris
«Que sont devenues les civilisations
qui ont cessé d'innover? »
ISBN 2-7196-0628-9
© Editions CASTEILLA, 1986
25, rue Monge ~ 78008 Paris,
‘Towle roprésonttion, traduction, adapiation ou reproduction, nme pariolle, par tous procéidés, en tous pays, fale sans
‘auiorication prealablo est licte et exposerat le contrevenant & des pousuiter judiiaies. Raf, Loh du 11 mare 1957
PREFACE
L’évolution technologique sest accélérée au cours de ces demiéres années, Certains
Prétendent méme que cette évolution a été, et est encore, trop rapide eu égard aux
possibilités d'adaptation des individus a cette évolution, Cest bien mal apprécier les
Jacultés humaines, particuliérement celles des enfants et des adolescents, a tirer profit des
techniques qui participent au bien-étre et diminuent les efforts physiques et intellectuels,
Cette évolution technologique, en grande partie due a I'élaboration de nouveaux
matériaux et a la mise au point de procédés de fabrication de plus en plus sophistiqués,
mais surtout a Tintelligence et a Yesprit inventif des individus, nécessite une rapide et
permanente adaptation des enseignements technologiques, Par la force des choses, la
formation des ouvriers hautement qualifiés, des techniciens, des techniciens supérieurs et
des ingénieurs a beaucoup évolué ces derniéres années, Les stratégies pédagogiques:
enseignement technologique global, travail par centres dintérét autour de thémes,
séalisations de systémes techniques authentiques... ont &é adaptées & ce nouveau style de
formation plus concret, plus général et plus prospectif
En utilisant Jes matériels du moment comme suppor's de compréhension des
phénoménes technologiques, on développe aptitude a penser et a concevoir les matériels
de demain, Cette culture technique, fruit de la réflexion, de Yobservation, de Fanalyse et
de lexpérimentation est indispensable au technicien actuel qui se doit d’6tre un individu
pragmatique, doué d'un esprit synthétique et prospectif, surtout si lon songe quiil sera
opérationnel au XXI° siécle qui est a notre porte.
étude des constructions mécaniques, et plus particuliérement celle de la fabrication
des objets techniques qui entrent dans ces constructions, doivent bien entendu étre
adaptées a cette philosophic.
Aussi, pour aider les éléves, les étudiants et les enseignants, il sest avéré de rédiger
des cahiers de technologie dans lesquels sont développés les thémes fondamentaux
étudiés dans les programmes d'enseignement.
Ces cahiers, en nombre non limité, seront toujours actualisés au fur et & mesure des
évolutions technologiques.
En _rédigeant le présent cahier de technologie de fabrications mécaniques, Michel
Gondran, agrégé de génie mécanique et René Staron, dont la compétence professionnelle
et Ia grande expérience pédagogique sont reconnues de tous, ont parfaitement atteint Je
but recherché. Quills en soient félicités,
Partant des différentes étapes a franchir pour concevoir et fabriquer les objets
techniques, les deux auteurs onl, avec beaucoup doriginalité, de méthode et de rigueur,
classé et analysé sept familles de pidces dont lusinage fait objet d'une étude de
faisabilité ot Je «couple piéce-outil» est étudié en tenant compte des demiers progrés
fechnologiques.
Un autre cahier de technologie, des mémes auteurs, traitera des piéces de sept familles
du second degré dont les caractéristiques et Jes formes découlent normalement des sept
familles du premier degré.
Parfaitement a la portée des éléves et des étudiants qui préparent le baccalauréat de
technicien Fl (BTnF'l), aux étudiants des sections de B.T:S. fabrications mécaniques et 2
ceux des LUT. génie mécanique et productique, ces cahiers de technologie sont
également accessibles, en partie, aux éléves préparant le brevet d'études professionnelies
(BEP), surtout sis se destinent aux classes d’adaptation
A. CAPLIEZ
Inspecteur Général
de Education Nationale
TABLE DES MATIERES
1, Naissance d'un objet technique
2. la famille cylindrique longue extérieure
«arbre»
Phase 10: dressage, choix d'outil, efforts de
‘coupe
Phase 20: dressage, mise & longueur,
centrage
Phase 90. état de surface en tournage
Fhase 40: flexion dune fraise de petit
diamétre 2
Phase 60: défauts de cylindricité et citcula-
até
Phase 60: rectification en plongée oblique
Phase 70: étude des dispersions
3, La famille prismatique «corps»
Phase 20-30: étude de la cycloide
Phase 50: alésage
Phase 60: fraisage horizontal
Phase 90: contréle du paraliélisme
Phase 100: percage, étude du foret
Phase 110: mode d'action du foret
5: La famille hélicoidale «entraineur»
Phase 10: Je tour semi-antomatique, disper-
sions
ty
Wn
19
SERSSSSRB
8 8 @Be
Phase 20: calcul du rayon du bee de toutil
Re pour obtenir Ry
Phase 90; mandrinage
Phase 40: influence des divers éléments
addition
Phase 40: traitements thermiques
Phase 50: tourbillonnement
Phase 60: rectification cylindrique
6. La famille obtenue par déformation «rou-
lement»
Phaso 10: préparation du brut
Phase 20: matricage
Phase 30: rectification d'ébauche
Phase 40: traitements thermiquos
Phase 60: rectification de finition
Phase 60: controle et triage
Phase 10: découpage
Phase 20: emboutissage
Phase 30: rognage
7. la famille cylindrique longue intérieure
«support »
Phase 10: choix d'une solution d'alésage
Phase 20: contréle géométrique perpendi-
cularité, battement
Phase 30: régiage d'un train de fraises
8 1a famille obtenue par collage «rotor»
Phase 40: emmanchement par contraction
Phase 40: Jes ajustements ot tolérances
ageQg 2ZQe
S2eeseeg
S83 28 BESS
Bee
1. Naissance d’un objet technique
LS SEPT PAMILLES DOBJETS TECHNIQUES
Pour catistare loa basoine de la civilisation, Ja main do etre
Iumain est progressivement remplacée par le machine... La
‘mise en forme des surfaces planes sur Jo bois peut etre
‘oxécutée par Je rabot électrique: Cest la fonction.
le tochnicien est donc confronté & Tétude de cet OBJET
TECHNIQUE qui doit répondre & des exigoncos:
— commerciales et esthétiques;
= de maniabilité ot delicacies
— de confection et de sécurité
qui constituent le cahier des charges permettant ainsi de
réaliser des prototypes ot les premiers essais.
Fig. 13
——}—_ conrre renpu pessars
lies résultats de ces essais améneron! Jes technicions &
définis des projets, des notices do calcul (RAM,..) des
fesquisses do brut ron coté, des gammes prévisionnal
des codts estimatis, des dessins @ensemble et nomencla-
ture (Gg. LI, L4 ot 1.8),
= Fig. 4
PLAN D'ENSEMBLE — CONCEPTION ASSISTEE PAR ORDINATEUR (C.5.0.)
NAISANCE DUN OBJET TECHNIQUE
Do co dessin dlensemble, une étude plus alinée reposant
sur les conditions fonctionnelles do Tebjet technique per-
mottia de définit avec précision les caractéristiques ot la
Cotation fonctionnelle des dessins de définition de Ton-
semble des pidcos
re
Gee
Pia 16
MS SEP? PAMILLES DOBETS TECHNIQUES
alls roms
oh de Bema,
Llacherinement de Tobjet technique, de son état brut & sa
realisation finale, nécessite & chaque stade de production, le
respect impéretif dun contrat:
‘cote fabriqués;
qualkés geométriques ot do forme;
qualtés d'état de surface,
[co contrat peat tre respecté si le technicien réalise la
Jcompatiilté des intervalles de tolérances détiais fonction
[nellement (Re, forme, géométrie, dimonsion) avec coux que
jie moyen de production est en mesure de donner (O))
Fig. 19
MONTAGES DUSINAGE — OUTILLAGES — MACHINES CHOISIES
mode action pormettant de mattriser co
probleme réside dans la méthode des dispersions.
(Voir le cachier de technologie sur les dispersions).
Fig. 140
DISPERSIONS — FABRICATION ASSISTEE PAR ORDINATEUR (F.1.0.)
10
ous
orB
wre
[NAISSANCE DUN OBJET TECHNIQUE
Lorsque lavant-projet est établi, i convient de vé-
rifier la compatibilité des intervalles de tolérance du
Dureau d'études avec les intervalles de tolérance
quil est possible dobtenir sur la machine.
Le nombre des cotes fabriquées & réaliser rend
difficile cette vérification, il convient done détre plus
méthodique, dod Tutilité du tableau cartésien propo-
86, en rapport avec le corps repére 1 de rabot
électrique (fig. 1.11 et 1.12).
‘Les cotes fabriquées sont alors données en cote
moyenne et Tintervalle de tolérance qui leur est
attribué correspond & la somme des dispersions
réparties par moitié autour de la cote moyenne.
Exemple: cf2 = 29°08
TT.cf2 > 813 + O14
boot
012 0,04
iS
fe
3.
B
SS] ey
&) 2 3 .
a OP
ig)
B
stall
rd
1
i
Cote 11213] 415 1617/8] 9 Holab 2/13/14] 15[46}17 [18 49)
gr
Torin
24 Maxi | [|
,! 43 Maxi
% 4 &
an E |cf | IDI
55 4a A | che [|
SHIT fz | ers
r fe | cfs c
Si fr | cfs
2 fe | cfe
5 35, Pe | cfy [pe Cotes apporsil (Percoge)——
Ls | cre 1
! CT
Pig. Lit
n
[NAISSANCE DUN OBJET TECHNIQUE,
we de Tonsomble des objets techriquos permet
~ identifier des familles de pidces présentant une grande
oo ‘Srilide: groapement analogique.
8ial
[rete forme some
Abe
——}—ramites De Préces — GRovPEMENT ANALOGIQUE
Tools centres dintcte vont parmette de did m cocin
ransposables:
és sur les familles de Tensomblo des objets techniques.
- ——}—onjecrrs TRansposaniEs
Cotes oppareil (Reredge)
Chaque objectif transposable rogroupant plusieurs études
de cas portant sur:
Ae
vig
Als
Bey,
Aty
la mcicen a dono & an caponton des dimen de teva consiseaben dara a pools eer & We tee:
Te blocs, traneposabis:
Fig, 112
2. La famille cylindrique longue extérieure
« arbre »
Te cabior qui sult waite du premior centre dintérdt et peut|
suprendte Je lecteur par sa présentation.
Com a par, dune analyse de, fabrication dun objet
‘technique simple offoctivornent réalisé au cours d'une série
quo les objectifs transposables et los études de cas sont
mis en forme snivant le plan de la figure 1.16,
© Choix d‘outil PHASE 10
© Dresser centrer — PHASE 20
* Etat de surface — PHASE 20
* Flexion d’outil — PHASE 40
‘* Rectification — PHASES 50 et 60
Dispersion — PHASE 70
FAMILLE DOBJETS TECHNIQUES
So
! =[903
A — FICHE TECHNIQUE MACHINE.
B — PARAMETRES DU OU DES PROBLEMES CONCERNANT LA PHASE OU LOPERATION.
(© — SOWTIONS, CALCULS, SOUS FORME DETUDES DE CAS.
Fig, 118 Fig, 21. Arbre.
4 18
LES SEPT FAMILIES DOWETS TECHNIQUES
inde tecknologique
frase
PHASE 40
Fraisage
Flexion
petit diame
ETP
[ANALYSE DE FABRICATION
ti
gh cts 4Ho
i
Fig.a6
Pig. 27
PHASE 10
]__iindo technologique
‘ANALYSE DE FABRICATION
LA FAMILLE CYLINDRIQUE LONGUE EXTERIEURE « ARBRE»
PHASE 10 DRESSAGE — CHOIX D’OUTIL — EFFORTS DE COUPE
— Outil fragile. — Ouil fragile,
— Echanifement rapide de la pointe — Mauvaise évacuation de la chaleur,
de out. = eeattas
— # peut étre important, — Résorvé a la finition en dressage de
= Réservé pour les travaux do finiton,
— Fy nécessite un blocage da trainard. — Ebauche et finition en cylindrage.
Fig. 28
M Gentrage (fig. 2.8 et 2.9)
Une variation dans la profondeur des trous de centre,
lors du montage futur de la série de
piéces, entre pointes, une dispersion dans la mise en
position, Cette dispersion serait préjudiciable au
Tespect des cotes de longueur.
‘Trois possibilités permettent de limiter Al:
a) dressage de face en butée, centrage en butée
(série);
b) centrage en cote outil;
©) utilisation de pointe a ressort (fig. 2.9).
S—Su
ARSE
cole out
Fig 210, Pointe a rossort
TOUR A CHARIOTER ET A FILETER
DE GRANDE
Caractéristiques principales:
— Hauteur de pointes/banc 135,
= Distance fa 620
— Diamatce au-dessus a bane 315
— Diamétro au-dessus du chariot 180
— Diamétze alésage broche 40
= Diamdtro en pince 4
— Diamétre en limette 100
— Gono intérioar de la broche ws
— Céne intériour contre-poupée ws
|— Vitesse de broche 86-3000
{BS SEP? FAMILLES DORJETS TECHNIQUES
{UA FAMILLE CYLINDRIQUE LONGUE EXTERIEURE « ARBRE»
PHASE 20 DRESSAGE, MISE A LONGUEUR, CENTRAGE
Utilisation de machines 4 dresser-centrer permettant d'obtenir une longueur constante de piéces, ainsi qu'une
profondeur réguliére des trous de centre.
Cycle de travail (fig. 2.12):
1. avance rapide du fourreau: 4000 mm/min;
2, commutation sur avance de percage: 800 mrvmin;
3. commutation sur avance II de pergage:
400 rame/min;
4. temps de coupe a profondeur de finition réglage
de 0,3 & 8 secondes;
5. recul du fourreau en avance rapide, retour au
point de départ: 3.000 mm/min.
fore -eh
Fig. 18
Fig. 219, Exemples dlusinages possibles.
FICHE TECHNIQUE
‘MACHINE A CENTRER ET A DRESSER
Capacités dimonsionneites:
— Plage de sezrage: 16 & 160.
= Iatage mand daa acer: Rm = €00Nmms @ 110.
— longueur de pitoe admise: 60 &
= Hauteur de Yaxe do la broche au-dessas du bane: $20.
— Gamme des vitesses de rotation en vin:
180 ~ 250 - 285 - 800 - 710 - 1.000 - 1.400 - 2000,
Courso longitudinale du fourreav: 100,
Gomimanle automatique,
Gamme des vitosses davance on ran/min: deux avances
de trayail par cycle et par unité de percage. Variation
continse de 8 4400.”
— Avance rapide: 2 0.
Fig. 214
18
PHASE 30 ETAT DE SURFACE EN TOURNAGE
Uy a avantage A laisser une surépaisseur qui
permettra de réduire le coat de la rectification.
Prévoir entre 0,1 et 02mm. On obient ainsi une
demi-finition en tournage de borne qualité géométri-
que (cylindricité) et un état de surface compatible
avec Yopération de rectification.
‘Le choix de Toutil et donc de la forme de la partie
active, a une incidence directe sur Tétat de surface. R= rayon du bec de Tout
Ceci est particuliérement sensible dans les travaux Fig 215
débauche ot dos avances importantes sont utilisées,
Afin de réduire cette incidence, tout en allongeant la
durée de vie de Youtil, Yaifiteur «mouchera» tou-
jours Tangle de Joutil en réalisant un plat ou un
rayon sur le bec. La position de ce plat ou
Timportance du rayon, par rapport a la génératrice &
réaliser, est en relation directe avec Tétat de surface. Fo pm
De nombreuses recherches expérimentales de coupe 25
permettent de dégager les remarques fondamentales 20) XC 4S
suivantes : 48 ~
— la qualité de l'état de surface augmente avec la os
résistance A la rupture du matériau usiné (fig. 2.16). ” DURETE
— la vitesse de coupe n'a que peu diinfluence & 400 200 300 brinell
partir du motnent oii elle atteint une valeur conve-
nable. Fig. 216
Influence du rayon du bee de lout!
Tugosité Sur la ragesite
RE jem
Ves 20Y/min
\ Ver son S
influence de Navance gur_la
ot 92 5 oF 93 46 fin/en
Fig. 2.17, Influence da Yavance Fig, 218 Inftuonco du rayon du bee do foutil
‘sur Ja rugosité. ‘ur la rugosité.
19
MS SEP? PAMILLES DOSJETS TECHNIQUES
PHASE 40 FLEXION D'UNE FRAISE DE PETIT DIAMETRE
— Zone
— Zone
ravail en opposition.
travail en avalant,
Le mode de travail étant différent dans les deux
zones, les efforts en présence seront eux aussi
différents,
RR=F+R+.R
Les résultantes R sont a lorigine dune flexion de
Toutil, Cette flexion sera nulle aux extrémités de la
rainure. De plus, le sens d’avance changeant alterna-
tivement, il sera particuliérement difficile de respec-
ter la tolérance demandée.
Suivant le sens de Thélice, la somme des compo-
santes F, est a lorigine de engagement de Toutil
dans la matiére (d’od Tidée de fraises & extrémités
filetées du type «Stefenson»),
PHASE 60 _ DEFAUTS DE CYLINDRICITE ET CIRCULARITE
La génératrice de la meule doit étre rectiligne,
particuligrement dans le cas du travail de forme
(procéder a un diamantage). Le diamantage est
également nécessaire dans le travail d'enveloppe, la
zone A de la meule s'usant plus rapidement.
axe de la pitce doit ée parfaitement paralléle &
celui de la meule. Vérifer la position angulaire de Ja
fausse table de Ja machine, ainsi que orientation
éventuelle de la broche.
Une mauvaise mise en position de la piéce peut
ajouter un défaut de circularité. Vérifier particuliére-
ment les trous de centre, les roder, les tenir propres,
Péofaresian
Travail denveloppe Fig. 221 ‘Travail de forme
LA FAMILLE CYMINDRIQUE LONOUE EXVERIEURE «ARBRE
PHASE 60 RECTIFICATION EN PLONGEE OBLIQUE
— Pormet de résliser plusiours opérations dans Ja
méme phase (dressage cylindrique, céne).
— Supprime Ja nécessité d'une gorge de rectiica-
tion.
— le principe de la plongée oblique augmente la
précision de la machine:
M, = M, cos o
— La flexion de Ja meule est moins importante dans
Je cas d'un dressage de face.
S Dénomination d'une meule
@ Bxtériour
Epaiseeur
@ Imenew
‘Symbole abrasif (Constructew)
D Diamant
© Carbare
Grossour du grain 84 24 Gras
0 & 60 Moyen
ma 180 Fin
220 4 60). ‘Tres fin
/
FICHE TECHNIQUE
MACHINE A RECTIFIER CYLINDRIQUE
Capacités dimensionnelies:
— Hautour de pointes: 190
— Masse admissible entre pointes: 400%k9,
Diamétro masi de la moulo: 358.
= Largeur maxi de la rieule: 60.
Table:
= Course longitudinale (battosents).
= Commande manuollo et automatique.
= Gamme des vitesses Gavance en mavimin.: variation
‘continue de 80 & 4000.
= Pivotement: = 11°.
al
LES SEPT FAMILLES DORJETS TECHNIQUES
PHASE 70 ETUDE DES DISPERSIONS
Le but du controle est de vérifier un contrat fixé
préalablement & travers un dessin de définition de
produit. Mais il peut également étze a Lorigine d'une
réflexion sur les causes du non-respect d'une cote,
dune géométrie, d'un état de surface,
@ Contréle de la cote 449
Le nomrespect de cette cote peut trouver une
explication, nous l'avons vu, dans le choix de Toutil
et des conditions de coupe, mais également dans
Tusure de Youtil.
MH Usure de Toutil (cote 419) (fig. 2.24)
AB: Les arétes de Youtil sont vives, il y a un rodage
de la partie active et une usure rapide de celle-ci,
BC: Llusure est réguliére pour chaque pidce; elle
provient du frottement de la matidre sur Youtil.
CD: La partie active est émoussée; la coupe s'elfec-
tue dans de mauvaises conditions, il y a élévation de
température ot usure rapide,
Cette usure ou dispersion est dite systématique (Ds).
Elle est particuliérement importante en rectification,
Dimension pm
B
c
Nombre
Te pisces
Pa a2t
Controle de © 9002 A
les erreurs enregistrées peuvent avoir les cansos
suivantes:
— bavures, copeaux, poussiéres an niveau du réfé-
rentiel piéce/machine:
— ablocage variable en intensité;
— déformations élastiques;
> Mauvaise qualité de la machine-outil (jeu dans les
xoulements);
— élévation de température dune partie de la
‘machine,
22
‘™ Contréle de la cote 5,5 *3*
La remise en position d'un outil n'est pas rigoureuse
et donne lieu a une dispersion dont les origines sont:
— déformation élastique des butées;
— vitesse d'arrivée sur butée non constante;
— variation de la pression sur butée (butée tranche);
— variation des conditions de coupe, donc des
efforts de coupe (lubrification, usure de loutil, pro-
fondewr de passe, etc,).
™ Phénoménes thermiques
I y a élévation de température de l'ensemble
outil-pidce, mais également de la machine (broche,
roulement) en début et fin de poste. Elle est
particulitrement sensible sur les grosses machines et
Jes machines 4 commande numérique (locaux stabili-
sés a 20°C),
W Remarque sur Pusinage & chaud
de Vacier (domaine de la plasticité)
Uusinage a chaud consiste 4 chauffer la zone sur
laquelle agira Youtil de coupe. On diminue ainsi la
résistance a la traction et au cisaillement du métal.
Les résultats sont remarquables. Lusinage a 550°
conduit @ une réduction de 40 a 50% des efforts de
coupe, tout en ne produisant qu'une augmentation de
130 4 250°C de la température de Tinterface copeau-
outil,
Le débit de copeau est augmenté de 30 & 50%; la
tenue de Youtil est de 20 & 100 fois plus grande.
Pour des durée de vie doutil égales, dans les
mémes conditions de coupe, une élévation de tempé-
rature de 650° permet de doubler la vitesse de
coupe.
1 Dispersions d'une cote prérégiée (photo n° 1)
Le contréte dine cote sur une grande série de
piéces fait apparaitre un relevé répondant a la loi de
la courbe de Gauss,
— La majorité des piéces ont une cote voisine de la
cote moyenne,
— Par rapport a la cote moyenne, Ja dispersion peut
jouer & tous instants en pius cu en moins.
Nore
isper sion
max
cole
rant
C maxi
Fig, 228
—1l y a um nombre relativement faible de piéces
ayant la cote maxi ou la cote mini. .
— Suivant la valeur de TIT de la cote a réaliser, par
yapport a la valeur de la dispersion totale, peu de
piéces sont hors tolérance,
@ Conclusions
Le technicien du bureau des méthodes doit
connaitre parfaitement les dispersions de Tensemble
du parc machine. Ces valeurs peuvent étre appré-
ciges par relevés métrologiques, par échantillonnage
ou par évaluation d’aprés Texpérience profession-
nelle, ‘
© Cest ainsi que les machines précises seront
réservées aux travaux de finition et au personnel
qualifié.
[WA FAMILLE CYUINDRIQUE LONGUE EXTERIEURE «ARBRE»
© Le prix de revient de Yobjet technique sera en
partie fonction du choix de la machine-outil, par
rapport 4 la qualité & produire,
PRIX
IT Economique
f{—__»
—Dipersion machine — yy
por copport 9 lo tolerance
Fig. 226
W Incidences de la dispersion sur le réglage de cote
Seletion 4
4.2.
ate de edglage 24
jr
Solution 2
a régioge|
[Ecte ve rdgiage Cyt
Tipure Ga Toll ext 3 7a
dina augmentation dale
[Bataute geemairigues
Ew
ET Thierique ae |
reglege
[near Hod darealoge
Cote drkgioge Oud
Tisuce de Tous] woh @
une diminution de
Fig. 227
4
8. La famille prismatique «corps »
‘* Réalisation d'un plan horizontal - PHASES 20 ot 30.
‘* Réalisation d'un plan vertical - PHASE 40.
¢ Cylindre intérieur. Outil grain (plan, angle, réglage) - PHASE 50.
* Les plans paralléles (épaisseur du copeau, flexion) - PHASE 60.
'* Calculs de temps et usinage - PHASE 70,
© Contrdle de parallélisme - PHASE 90,
‘© Les trous cylindriques - PHASES 100 et 101,
COUPE BB
LP
Fig. 22. Comps,
1A FAMILLE PRISMATIQUE «CORPS»
LES SEPT FAMILLES DOBJETS TECHNIQUES
d Hp
us
i i
3 is
cod
5 2
° a -kS 4
1 ae I =
Hal “le
agagvss ag 8 a ie g l *
i q P S fr
aS Suns
ia eli ah ua
a, a af \ gs Ere
3 B,28 8 i
4 il ari E Be La H Hh
8 4g HE Ls bes a iMe e 2 5g g8
en eee @ yy tage i
tliat! [a al So) Ge
‘ia gig aa OE Gh pepe | 3
i JESU Bat El Z H ede 3 om i
ma
re me a
ort asa
ose
‘op sued ye sojouy —
op moweenounuy ~|
ie weaomee ved nomvoRai Wa ain fo Wy Sian at ROUWOTEEYE a aT
ge
LES SEPT FAMILLES DOSIETS TECHNIQUES
ll Fraisage en opposition effo
Dans la matiére le mouvement de rotation de la
fraise (V.) est en opposition avec le mouvement
davance (V).
A Tattaque de Ja matitre Tépaisseur du copeau est
nulle, la dent glisse, écrouit la surface et ne coupe
que lorsque cette épaisseur est égale au copeau
taillé minimum. Lusure de la fraise est importante et
le rendement peu élevé.
Les efforts de coupe tendent, & soulever la piace,
Par contre si la surface & usiner est brute les dents
atlaquent pas sor Ja crofte (voir Fi sur a figure
Be epee mini NE
Aig. 4.18 Fig 34
@ Fraisage en avalant ou en concordance
Dans la matiére le mouvement de rotation de la
fraise (V.) est dans le méme sens que le mouvement
davance (V).
‘Chaque dent attaque la matiére non écronie par
Yépaisseur maximale du copeau. Ce mode de travail
a un tes bon rendement et il est patticuliérement
recommandé pour Iusinage de certains aciers inoxy-
dables trés sensibles 8 Técrouissage.
es efforts de tendent & appliquer la pidce sur
Jes appuis (voir F, sur la figure 3.15).
Par contre le fraisage en avalant nécessite des
machines disposant d'un systéme de commande du
gove ecrovinsage
mouvement d'avance sans jeu: FRAISAGE EN
— soit un systéme vis-écrou a rattrapage de jeu; a
cSt une ique ou roulement ‘OPPOSITION CONCORDANCE
hélicoidal, Fig. 3.18
WM Inclinaison de la fraise
Avantage: gain de temps et aspect de surface.
Inconvénients:
— défaut géométrique;
~- usure prématurée & cause du copean mini (dents frottant sur le retour de la cycloide).
On comit OB = 60 et AB = 7 = 35
On caleule: OA -> OA = VOB? — ABT = 38,70
AC = 60 - 35,70 = 143
i DC _ 008
= me 9 > a = 0%!
sino Tg 7 00004008 -> or = roa"
Réglage: déplacement du comparateur monté sur la broche: (© circonférence du palpeur) > 2. tga
Détorminer cx dinetinsison maximal
de lane de ta broche de ta machine
afin de respecter la tolérance géomé-
‘rique (on suppose que axe de la
fraise coincide avec celui de la pid-
2).
Procédé de réglage?
Fig. 316
LA FAMILLE PRISMATIQUE « CORPS»
M Géométrie des outils — Taille hélicoidale
La taille est droite, hélicoidale a gauche ou a droite; angle d'nélice 10 a 45°.
Fig. 217 Pig 318
1 Rugosité — Moyens de contrdle du critéro statistique de profil Ra
y réel = y mosuré x cos a
1 transforme la composante y de déplacement da palpeur en
tension proportionnelie.
convertisseus vate laine
piézo-élecingue
Converissaur pitzo-Slectiawe. objeetita
Il transforme la composante y de vitesse de déplacement en
tension proportonnele,
Le microscope interférential
Big. 220
Fig. 8.19
atois
Fig. 921. Microscope interférantiel.
{LBS SEPD FAMIMLES DOBIETS TECHNIQUES
PHASE 50 ALESAGE
La concentricité implique une barre a grain.
| La rugosité, la qualité H7 implique 2barres:
— ébauche;
— finition.
Le profil sur @ 64H7 implique un outil avec x = 90°,
1 Position des grains
Lalésage (1) est terminé et @) rest que partie] >
impossible d'usiner @).
© et @ terminés mais cumul des fexions & Fattaque
de ®.
@ terminé attaque ot finition de (@. La flexion est
constante, la géométrie engendrée est compatible
avec H7.
i Etude des efforts
R-F+R+eR
Six = 48° Ebauche
F = 1SF,
F, = VSFe
Six = 90° — Finition
ERS | et 5 (section copeau)
KS
S=ixp
1 Flache sur la barre a grains
due F; = 0 (flambage)
F, = négligeable (torsion)
F, = @ obtenu = @ — 2fp (flexion)
Fig. 324
pzenr,
64 47
Fig. 822
Fig. 3.88
Mi Galcul des fléches «Sti»
m
wo
3 poutre encastrée
Er E = module élasticité aci
“1 = moment quadratique
M Calcul de la fléche sur J 26
X = 48° Fy = WSF. L = 160mm
8 x 18 x 008 x 0.8 = 228daN
LSF, = 0,78 daN
0,28 x 1907
t= NX 1 __ ~ 0,008:
3% a x 1O* x 008 x 28° =
WM Calcul de la fléche sur 2 64
X = 90° F, = WF, L = 100
5 x 18 x 0,05 x 08 = 228 daN (eas
VIOF, = 0,288daN
5 x 100°
t= 208 «10 __ = 0001
3X a.10* x 0,08 x 28* a
48-2 appuis simples
ier 2. 10%daNmm?
LA FAMILLE PRISMATIQUE «CORPS»
re oo5 at
et = 0,05 d'
+ Binsi Sl = 0,008
Soit 1/4 de TT de 26H7
Ainsi Bl, = 0,001
Soit, en cumulant les 2 fléches,
des outils travaillant simultanément)
Bh + 5h = 0,008 + 0,001
1/8 de TIT de 26H7
Caractéristiques:
Géne de roche 15040.
Avance: 48 de 0,02 a 3.
‘Tours de Broche $6 4 1500.
= Surface de table: 980 x 400,
— longueur de banc: 1800.
— Distance Inmette-broche: 1250,
— Course transversalo: 480.
Gourse verticale: 300.
= Moteur: 3,7 kw & 1600 vinin.
Fig. 328. Aléseuses
@ Exemples d'utilisation des éléments de construction modulaire
Fig. 27. Alésouses-fraiseusos contros dlusinage
4
LES SEPT PAMILLES DORJETS *ECHMTOUES
m Etude des caractéristiques géométriques
de Youtil de coupe: outil en main
Le Vo est 1 au plan dappui 2 et Pr 1 a V,, done Pr
1 appui,
Détermination de Yaréte de coupe par rapport aux
Vecteurs conus;
— vitesse de coupe _¥.;
—~ vitesse d'avance
‘@ Référentiel: « plans» utilisés (fig. 3.28)
@ Plan de référence Pr: 1 on tous lieux a V,.
@ Plan de travail P;: il contient V- et V;.
@ Plan d'aréte P,: 1 contient Yaréte et il est a Pr.
@ Plan vers Varviére P,: fini le téatréde entre P, et
Pe
'@ Position angulaire de Varéte dans ce xéférentiel
Xe (kappa): angle de direction d'aréte, aigu, entre
Tavance et Taréte projetées dans P..
Ys Psi): entre P, et P, projetés dans P,, c'est langle
de direction complémentaire de Youtil
4s (bambda): Angle d'inclinaison d'aréte compris
entre Taréte ot le plan de référence P,, projetés dans
lo plan daréte P,.
'M Angles des faces de Youtil dont intersection
forme Paréte de coupe
angle de dépouille: angle aigu entre la face de
dépouille et le plan P, (plan daréte).
Bi angle de taillant: angle aigu entre la face de
coupe ( et la face de dépouille.
Yi angle de coupe: angle aigu entre la face de
coupe @ et Je plan P, (plan de référence),
M Systames de définition des angles des faces de
Youtil
Laréte de coupe peut étre coupée suivant 4 systémes
dont Tindice respectif est donné aux angles 0, B, Y.
Aréte coupée suivant un angle:
= aigu latéral: systémes «latéraux», le plan de
section est P; (plan de travail) il définit a Bs, Yet
—- aigu vers Tarriére: systémes «vers Tarriére », la
section est suivant P, (plan vers Tarriére), elle détinit
Or Bor Voi
— orthogonal a l'aréte: systames «normaux», le plan
de section est P,, il est 1 a Taréte, ot ainsi fait un
angle de A avec le vecteur V, (1. a P), il définit o,,
Bos Yai
— orthogonal & Varéte dans P, mais également
orthogonal a P,: systémes «orthogonaux», le plan de
section est P,, il définit 0, Bo, Vo
32,
Fig. 328
Fig. 3.29, Systémes do aétisiton
des angles des faces do out
lM Caléuls et affitages des grains (fig. 3.30)
Loutil en position de tavail voit ses plans modifier
dans leur orientation car:
YWah+h
avec:
incidence directe en est la modification des angles
en relation avec P, et P,:
wey
Le support diaffitage est un syst8me mobile autour
de 3axes done 3 rotations: Ri, Re, Ry.
1 faut donc, partant des caractéristiques géométri-
ques de Toutil (plans et angles), définir 3 angles
orientation des rotations R, R; Ry du support
affitage.
@ Angles directs d'affiitage (fig. 3.31, 3.32, 3.33)
Définissons la ligne de plus grande pente: clest sur
elle que glisse une goutte d'eau descendant un plan
Considérons le point A de Taréte de coupe:
Gréce a P, et P., nous obtenons $
Grace a P, ot P,, nous obtenons T
‘en prolongeant la face de coupe.
La perpendiculaire issue de A sur oe P est la
i de plus grande pente de la face de coupe.
Taree des droites de méme niveau de la face de
coupe lui sont perpendiculaires (ST en est une).
AP, ligne de plus grande pente de la face de coupe
appartiont & un plan Py
Langle de cette droite de plus grande pente avec P,
‘est Yg.. c'est Tangle de la rotation R, d’affitage.
En résolvant les triangles rectangles sur AA', nous
obtenons:
13 Yq = Vig? Yo + tg?Ay pour Ry
Vangle entre P, et P; est repéré 3, clest angle de
position de la rotation R; dlaffitage.
En résolvant les triangles rectangulaires AA'T ot A'ST
on obtient:
33,
[IRS SEPT PAMILLES DORJETS TECHNIQUES
@ Angles directs daffitage
La troisiéme rotation Ry est obte-
nue par l'angle de direction d'aftt-
tage U.
Le méme probléme est traité pour
la face de dépouille et permet
dobtenir:
—le plan de plus grande pente
Pot
Tangle de cette pente cm, sur
By ial fact ;
jp tanale de cotto parte 6, sur a Rest altace freee
et les relations: ? Seo0se = 600 |
cotg on, = Veotg@a, + tah,
‘M1 Choix des outils et régiages (photos n™2 et 3)
Barres antivibratoires:
— utilisées pour Talésage en Tair, non adaptable
pour barres guidées;
— 2 réglages indépendants: radial A
axial B
Cartouches dalésage:
— Réglage radial + 1mm,
— Réglage axial +: 1 mm permet un réglage de (C.).
Unité triabore:
LA FAMILLE PRISMATIQUE «CORPS»
et 6, > ty + 8) = StF %
toh Fase
m Réglages
Dans les conditions de la phase de finition, f ot a stabilisées et identiques a lopération, relever la cote obtenue
Wt Affatage (prise en compte de la fiéche f =
Application sur la phase 80 pour Faréte principale de Toutil a aléser dresser sur @ 64H7, — Corriger au comparateur dans le méme sens,
— Face de coupe: — Face de dépouille & — Régler 4 nouveau & la cote.
Ya > t9¥q = V0008 + 018 oy > cotgo, = VO5I+ 003 boy comparateue
Vy = 22°1' 12" % = 6°00" ales éialons ore
0,363 95 Pm
tg (90° + 5,) = 283 — aoc tg (go? + 0,) = 28.
in = O76 s¢ > on6 2 ti 4
5, = — 28°50" 3
8, = ~ 1°0' 50" Xb
of mM | |
Fig. 3.98 I
™ Dessin des grains dalésage préxéglage
ig. 889. Montage de
Oui & aléser et dresser: O47 ‘pont oul a aldoor ig. 340, Cates de réglage,
laa
Fig. 897
Oull a aléser: @ 22H?
Téte universelle 4 dresser et aléser
Avance automatique en dressage obtenue par un
arzét en rotation de Ja partie supérieure (moletée).
Valésoir machine
Avec ou sans hélice, Lhélice peut étre inclinge &
Précision 0,008
PHD Asia gauiche, la coupe est descendante (copeaux poussés Galcal du
fo = 20° vers lavant) ou a droite (montante), realage identique
es ‘aux grains radiaux
MM Conditions de coupe
moots Les alésoirs d’ébauche int plutét en bout et les
ZSOWKOV 18.05-04.01 solrs d'ébauche coupent plutit en bout et
Dureté: Ro 65 alésoixs de finition coupent pratiquement sur la
Rugosite: Ra = 08 pétiphérie, ce qui nécessite une grande avance pour '
éviter de travailler au niveau du copeau taillé
vite
LES SPP PAMILLES DORIETS TECHNIQUES
Différents montages des grains, lames et calcul du déplacement du réglage fin
Vis_de_réglage
du flottement
Fig. 342, Outils alésage Muskegon + James.
@ Application sur la phase 50 sur 2 26H7
Tolérance de Valésage @ 26H7 IT = 0,021
Tolérance de Talésoix = 0,35IT = 0,007
@ maximal de Talésoir = 26,021 - 0,16IT = 28,021 — 0,003
© minimal de Valésoir = 26,018 — 0,36IT = 26,018 — 0,00:
+ 0,018
Mintervalle de tolérance est 0,007 et les écarts + 0,011 donnent pour Falésoir une tolérance my Un pierrage de
Youtil est nécessaire (réglage).
Unité triabore — grains inclinés
te sina dot x = Lsina
Fig. 44
™ Application sur la phase 50 sur 2 26H7
x = 0,02 maxi; a = 69°8; sina = 08; cosa = 06; tga = 1
Unité triabore:
= sar: on tre b= SE soit 1 = 0008 si Pas = 08.
Te réglage est obtenu par 1/20 de tour.
Grain incliné:
p= 19a on te ts = Fpi)
Ainsi ait une flexion conduisant & un défaut de
rectitude de axe de l'alésage.
Ml Mandrin flottant
Un alésoir monté directement dans la broche de la
machine tournera avec un certain faux rond: (défaut
de fabrication de Talésoir + défaut de la machine);
de ce fait i? va engendrer une surface d'un diamétre
supérieur & celui de Yalésoir et réaliser un alésage
hors tolérances.
Pour éviter cet inconvénient, il est fortement recom-
mandé dlutiliser un montage flottant pour monter
Talésoir sur la machine, il se centrera de lui-méme
dans l'alésage a état de demi-finition et réalisera
avec plus de certitude la dimension souhaitée,
Ce montage est inutile pour les alésoirs & lame
flottante.
PHASE 60 FRAISAGE HORIZONTAL
lM Calcul de Pépaisseur du copeau ¢
Avec pour valeur:
——f = VON = 220/160 = 1,376
—n = 16 dents
—~— + = is7e16 = 0088
0
Mage =
R
Vi8@o— 8) _
40
e = 0,086 x
e = 007
Attention: denture alternée soule une dent sur deux
enlive de la matiére ainsi fin doit étre multiplié par
oue = eX 2
107
Fig, 347
ns SEPP FAMILLES DORJETS TECHNIQUES
™ Application a la phase 60
2 triangles semblables
fin
e
Calculons AB (Pythagore)
AB= VR @ =a = VER a oR
op"
VaGR = 9) _ go7
R
e =e x 2= 007 x 2 = O14
e-t x
n
donc ¢ réel (denture alternée), vant 0,14 mm... plus élevé que tin.
MM Denture alternée
Une seule dent sur deux coupe la matiére sur un
cété. En pleine matiére cela a une incidence sur les
réglages, mais sur son usinage partie! (sur un cété)
comme en phase 80 également.
La section du copeau est double (voir calculs), La
coupe est progressive.
m Efforts
Effort de coupe: F = KRmS
Effort tangentiel: F, = F..cos S
Effort axial: Fy = F, sin 5°
& Calculs des efforts
Application a la phase 60 K = 5 Ry, = 18daNimm’ $ = e x 2= 0,14 x 2 = 028
Effort de coupe: F = 8 x 18 x 028 = 252daN
Effort tangentiel: F, = 28,2 cos 8° = 26,1 daN
Effort axial: F, = 25,2sin 8° = 22 daN
effort axial F,, en plein usinage fait fléchir la fraise et fausse la cote obtenue,
™@ Calcul de la dispersion Sli due 4 la flexion
FL?
p= Fu
KEI
or: F = Fy
R
3
Bh avec b = aR
2
F,.R_ Far?
RE 2RW "KEW?
Ainsi: f=
™ Conclusion
I apparalt que:
si F, augmente (S) ou si R augmente (2 de la fraise),
Bi augmente;
si Tépaisseur de la fraise augmente, alors dli dimi-
ue,
VUN = 220/160 =
n = 1,375/16 = 0,086
LA PAMILLE PRISMATIQUE «CORPS »
7 phase 60
™ Application & 1a Sli pour @ 160 6 = 10
ii pour @ 80 @ = 10 F,= 22 R= 80 k= 3 E = 2000 h-
F,= 22 R= 40 k=3 E= 2000 h=5 Sx 22 x 6400 _ gay
SF, RF 6 x 22 x 1600 - ee = 0
e £2 Ad X 1600 9,008 soit 3} 3 x 20000 x 126
KER’ 3 x 20000 x 128 e soit 1/100
Nécessité de pratiquer & des essais en pleine matiére pour obtenir la qualité H7 avec une fraise 3 tailles
extensible.
PHASE 60 CALCUL DU TEMPS D’'USINAGE
1m Solution A
— GChoisir un désaxage judicieux de la fraise pour
permetire un travail en concordance (poids de la
table rattrape Ie jeu).
Jonguewr usingo
vitesse dlavance ve
Application & la phase 60: avec L = 18 + 2 =
2mm et V; = 220 mnvmin
20 x 60
Temps dusinago ty = = = 546 secondes,
— Temps =
™ Solution B
— Le travail doit se faire en opposition (rattrapage
des jeux non automatique),
— Temps = longueur usinge yk
vitesse avance Ve
Mais dans ce cas, il faut calculer la longueur «bi
Calcul de «L» (fig. 3.50)
2 moyens possibles:
— les triangles semblables et le rapport des cétés;
—le théoréme de Pythagore dans les triangles
rectangles,
zt. 4 x
R R-@+da ¥
ou:
x= Vi — ety = VR R-1- a
M Application a la phase 60
r=9 d=5 V= 220
x= VP — dé = Vel — 25 = 75
y= VBR af = V1 600~ 675 = 304
et Lb = 2c + y) = 788 soit 76
@ Conclusions
Outre des avantages d'un travail en concordance, la
solution A permet un gain de temps de 20,12 — 545
t= 6X © _ 2072 secondes. = 18,27 secondes, soit pour 1500 piéces une écono-
220 mie de 6h 30.
39
LBS SEPT FAMILLES DOBJETS TECHNIQUES
PHASE 70 FRAISAGE VERTICAL
Fig. 382, Solution A
Fig. 8.89, Solution B.
Cette solution rest autorisée que dans le cas oil il
ny a pas de spécifications géométriques serrées et
conditionnelles,
@ Calcul du temps d'usinage
— Longuew usinge
tesse davance
i:b=e+1+@
Longueur usinée
Vitesse Favance
ici, il faut caleuler «1» ou Je gain sur «lL»,
1
gain
R + AB avec AB = VR® — (R - dy = Vd@r - & Fig. 854
‘®@ Application a la phase 70 SOLUTION B
SOLUTION cate du ona ¢ ~ -YAGR=D . VE —O x 60
baer lt @ avece=21= 89-92 — qvecd = 9 R= 922 = 16 Vy = 160mm/min
= _ Bx 1= 20
yo b Bxw econ car
VN ep ~ 77 Serondes t= 828 et ty — % — t= 27 — 82 = 218s
@ Conclusions
La solution B est bien meilleure si les conditions géométriques le permettent
Le rendement peut étre augmenté encore si la fraise est une fraise au carbure,
Le gain de temps est de §,2 secondes ; le temps d'usinage est ramené 4 21,85, soit, pour 1 500 pices, un gain de
2n30.
40
™ Calcul de temps d'usinage
Garder «ie
primer TanciaT)
repace du Sletaze|
mot
ay
Teper que
k= 08
frappel de «ks
fainter de
fet eflacomont
raison
et effacement
Nb de dents Z ou Pas,
Fig. 3.58. Outi
[LA FAMILLE PRISMATIQUE «CORPS »
a
LES SEPP PAMILLES DONJETS TECHNIQUES
M Calcul des temps d'usinage
LA FAMILLE PRISMATIQUE «CORPS»
™@ Calcul de temps d'usinage
Fig, 367, Paramétres de la piéoe,
Fig. 288, Conditions de travail arametres
er neem
1S SEPT PAMILLES DOSETS TECHNIQUES 1A FAMILLE PRISMATIQUE «CORPS »
™ Calcul des temps d'usinage Mi Calcul des temps d'usinage (programme sur HP9T)
|
|
w | ode we | one w | ore
pas cS Ps.
MxTRE vibe ovr,
sPoganne uw | mms | Pomanne wef asec | Propane
ltr 23 |ir= 2s
ov} us u | tx=0? a1 | tx= or
6 | coe @ | cac
a | {Pause | manta et 6 | stor | test ae s | sm | kent
| “Gir | datacom n| "5
| mw uw} os 4 | tour. | reper x
w | sos | 1+5e8 s|oe :
® | LaF els :
Prograce a} a | coy |
a | sms | k=1 & | x= y7| kos doa don
os | apna w | sos | tel | Gea
a | stor | %=1 aw | css am |
6 | t= or Bios a | Rs
| “ox ¥ a | 3
| sos | t= o1 @ | wate | sk=o3
| son | ved | mci | rappa de ale sf ot
| sts | Wen @ | sms | e-1
2 | oss a0. & | Gstr | reper & = 08
10 | casa 8 Pa) & | mice | “rppetae
uf oes Ca)
a | amp | Proganne
f | wc | Programe
w |ipe 2s @ Ju ts
& |ix=o m | te= or
w | cea | omc n | ac
nm] soz | erg
# | sto2 | gocea
& | icHRO |repere O aur | two |ropare @ sur
‘ico eu)
st | oss 3 » | cas sm
| wl] Rs
| sus | Pomaane we | imc | Programme
w |= 23]
a | aw pp mt |ir=23
@ | wea | te= 0
a | 03 3 mi cac | top
4 |i 20] esa sr le | sos | zouPens
4 [BS | plo on fod
8 | RuC2 | tapped de 0 a | oss sm
a) Bs
at | oss 305
6) 3S
ws | uc | Progranee
aw ies a, ae
| ew ppel
| Res z
a | 12a
| mca ®
e | a= 4
90 | 1 Pe | mn 0
oat
a} mcs | to?
a} css a
| BS
Fig, 2.88, Corrections dvontuollos «MN» ot «Vi,
‘alcul di temps at»
Vous aimerez peut-être aussi
- Cahier Des Charges Minibus - 2Document7 pagesCahier Des Charges Minibus - 2sarahrouPas encore d'évaluation
- Corrige - UTBM - Mecanique Et Technologie Pour L Ingenieur - 2007 - GMDocument14 pagesCorrige - UTBM - Mecanique Et Technologie Pour L Ingenieur - 2007 - GMsarahrouPas encore d'évaluation
- IND2103 Intra1 H00 QSDocument12 pagesIND2103 Intra1 H00 QSsarahrouPas encore d'évaluation
- 9 Demande Carriere StMeardGursonDocument124 pages9 Demande Carriere StMeardGursonsarahrouPas encore d'évaluation
- RJ 2016 CAPLP Externe - Genie Mecanique Option MV MA EC - 636603Document42 pagesRJ 2016 CAPLP Externe - Genie Mecanique Option MV MA EC - 636603sarahrouPas encore d'évaluation
- I1603 - Maintenance D'engins de Chantier Levage Manutention..Document2 pagesI1603 - Maintenance D'engins de Chantier Levage Manutention..sarahrouPas encore d'évaluation
- Finalpdf 2 2 ConvertiDocument55 pagesFinalpdf 2 2 ConvertisarahrouPas encore d'évaluation
- KAT - 2012 - Lunettes de Protection - FRDocument28 pagesKAT - 2012 - Lunettes de Protection - FRsarahrouPas encore d'évaluation
- Int - Fiche - Tech - Dynamique Rotor - 2013Document9 pagesInt - Fiche - Tech - Dynamique Rotor - 2013sarahrouPas encore d'évaluation
- France FreDocument14 pagesFrance FresarahrouPas encore d'évaluation
- Int Fiche Tech Engrenages 2013Document3 pagesInt Fiche Tech Engrenages 2013sarahrouPas encore d'évaluation