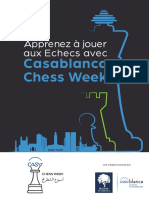Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Finance Pour Non-Financiers 2e Edition
Finance Pour Non-Financiers 2e Edition
Transféré par
Ayoub Aalili0 évaluation0% ont trouvé ce document utile (0 vote)
31 vues254 pagesTitre original
Finance Pour Non-financiers 2e Edition - Www.coursdefsjes.com(1)
Copyright
© © All Rights Reserved
Formats disponibles
PDF ou lisez en ligne sur Scribd
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
© All Rights Reserved
Formats disponibles
Téléchargez comme PDF ou lisez en ligne sur Scribd
0 évaluation0% ont trouvé ce document utile (0 vote)
31 vues254 pagesFinance Pour Non-Financiers 2e Edition
Finance Pour Non-Financiers 2e Edition
Transféré par
Ayoub AaliliDroits d'auteur :
© All Rights Reserved
Formats disponibles
Téléchargez comme PDF ou lisez en ligne sur Scribd
Vous êtes sur la page 1sur 254
ata On@ | O10] Bats)
sour NoN-financiers
PASC Nota e Clos ibet tele)
v Connaitre les indicateurs de performance
v Construire un business plan
v Dialoguer avec les financiers, banquiers
et actionnaires
ela 8)1 ie) \|
DUNOD
Illustration de couverture:
Misteratomic; © freepix
© Dunod, 2012, 2016
11, rue Paul Bert, 92247 Malakoff cedex
www.dunod.com
ISBN : 978-2-10-075239-3
le Code de la propriété intellecluelle n/avtorisont, cux termes de l'article
L 122-5, 2° et 3° o, d’une par, que les « copies ov reproductions strictement
réservées 6 I'usage privé du copiste et non destinées & une utilisation collective »
«t, d'outre part, que les analyses et les courte citations dans un but d'exemple et
illustration, « toute représentation ov reproduction intégrale ov partielle faite
sans le consentement de l'auteur ou de ses ayan's droit ou ayants cause est
ilicite » (art. L. 1224
Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constitve
rait done une contrefagon sanctionnée par les articles |. 3352 et suivants du
Code de la propriété intlleciuelle.
Toute reproduction non autrisée est un délit
© Dunod
Table des matiéres
Introduction
1. Les 4 piliers des états financiers
Pilier 1: le bilan
Pilier 2: le résultat
Pilier 3: le compte de résultat
Pilier 4: la trésorerie
2. La lecture des états financiers
La vision du banquier
Le fonds de roulement (FDR)
Le besoin en fonds de roulements (BFR)
La capacité d’autofinancement (CAF)
3. Technique et cosmétique des états financiers
Les stocks
Les amortissements
Les provisions
4, Diagnostic du risque de exploitation
Les soldes intermédiaires de gestion (SIG)
Les ratios de mesure de l'exploitation
Les ratios d’analyse du risque
5. Les 3 principes de la logique financiére
Premier principe de la logique financiére:
Ala recherche de la rentabilité
Deuxiéme principe de la logique financiére:
ala recherche de la réussite financiére
Troisiéme principe de la logique financiére:
ala recherche de la rentabilité et du risque encouru
Le diagnostic financier
6. Leffet de levier financier
Définition de levier financier
Principe de Veffet de levier
Illustration de effet de levier ou de effet de massue
Intérét de effet de levier: lors d’une conjoncture favorable
Table des matiéres
78
139
140
142
145
Dangers de l'effet de levier: lors d‘une conjoncture défavorable
Limites de V'effet de levier
7. Les attentes des apporteurs de ressources
financiéres
La logique de réussite du cété des actionnaires
La logique de réussite du cété des préteurs
Les financements «hybrides»
8. Les enjeux de la mesure de la performance
Le CMPR, un cocktail financier
Introduction 4 la création de valeur
9. La place des chiffres dans un business plan
Introduction au business plan
Les rubriques du business plan
Construction de la partie financiére d’un business plan
Business plan et montage de type LBO de reprise d'entreprise
10. La place des chiffres dans les tableaux
de bords financiers
Notion d'indicateur
Tableau de bord financier
Liste des acronymes
Bibliographie
Index
Table des figures
Table des tableaux
WV Finance pour non-financiers
146
148
© Dunod - Toute reproduction non autorisée est un délit,
Remerciements
A Sandra Michelet pour son expertise pédagogique, sa lecture attentionnée,
ses remarques pertinentes et son soutien dans Vécriture.
A Gilles Barjhoux et Dalida Prost, mes associés au sein de B2A Partners,
pour ce que nous avons construit ensemble depuis prés de 15 ans.
Sans leur soutien dans Vopérationnel, ce livre n’aurait pas pu se faire.
A Michel Coster, professeur d’entrepreneuriat et directeur de l'incubateur EMLYON,
Rémy Paliard, professeur de finance a 'EMLYON,
6 a VEMLYON,
pour leurs amitiés et la confiance qu’ils m/accordent.
et Isabelle Rousset, professeur de comptabil
A tous les clients que nous accompagnons,
pour leur fidélité et leur apport d’expérience.
Ama femme Virginie,
a ma fille Anna et mon fils Thao pour leur patience et leur soutien.
Enfin a mon éditrice, Jeanne Delorme,
pour son accompagnement et ses conseils avisés.
Mode d’emploi
Se poser les bonnes questions : quoi de mieux
qu'une situation concréte pour bien débuter !
| Mont Sarr
Petre wees
Savoir : un encadré technique
pour renforcer vos compétences.
cpa | En pratique : des sviets de
testa aystnes vine | ferrain pour que vous soyez
as idaaticicad plus efficace.
Faites le point : en un clin
d’ceil, la synthése du chapitre.
3 essere er een
Setaster wt he
\ etcpmiton mens paneie OO Se tester : avez-vous tout retenu 2
Saaeaatecaen Vérifiez que vos connaissances
= * | sont acquises.
A vous de jouer : sourez-
vous dénover une situation
réelle 2 Les conseils de
Vauteur vous y aideront.
v Finance pour non-financiers
Accés au e-learning
Retrouvez en ligne les corrigés des «A vous de jouer», de nombreux exer-
cices supplémentaires pour vous entrainer et tester vos connaissances, et
des fiches résumé. Un lexique en frangais et en anglais et un memento des
formules indispensables sont également disponibles.
Pour cela rien de plus simple!
Rendez-vous sur la page:
http://www.action-on-line.fr/dunod/finance/
ou flashez ce QRcode:
Saisissez les informations suivantes :
Utilisateur: dunod
Mot de passe: aolfinance
Avec la collaboration de Sandra Michelet, responsable pédagogique
R&D de la société Action on Line. Sandra Michelet est docteur en ingé-
nieurie de la communication personne-systéme de |’université de Grenoble.
ound 9102 @ qBuAdoa
Introduction
Lobjectif de cet ouvrage est de permettre 4 des non-spécialistes d’ac-
quérir les fondamentaux de la finance.
Cet ouvrage, qui ne nécessite aucun prérequis, apporte 4 lui seul les
fondamentaux nécessaires et suffisants des concepts de finance
entrepreneuriale et de gestion pour diriger un centre de profit.
Innovant, pour une utilisation opérationnelle immédiate, il
permet de mieux dialoguer avec les acteurs de la filigre financiére. Pour
ce faire, 'ouvrage fait le tri des concepts nécessaires et suffisants pour
des entrepreneurs, créateurs d’entreprises & fort potentiel ou repreneurs,
futurs responsables de centre de profit (qu’ils soient managers sortant
d'expériences, ou ingénieur en charge d'une activité de production). Cet
ouvrage est aussi trés utile pour des étudiants en business school qui
souhaitent acquérir une culture financiére, afin d’étre plus & l'aise lors de
Vapprofondissement des connaissances sur les concepts académiques.
Le parti pris de l'auteur est dialler, pour chacun des thémes traités, a
l'essentiel pour permettre aux lecteurs d’étre rapidement opérationnels.
Centré autour de I’énoncé des logiques dans chaque domaine, l’accent
est mis sur le cété ludique et vivant de la lecture. De trés nombreux
cas pratiques, études de cas, etc., avec un accompagnement en ligne
sur internet et des quiz, viennent illustrer les concepts au fil des chapitres.
En complément, chaque chapitre est accompagné de fiches-résumés qui
synthétisent «ce qu'il faut retenir», ainsi que de nombreux eas d’appl
cation (corrigés) sur le livre et en ligne, afin de tester vos connais-
sances. Vous pourrez vous référer au lexique, également disponible en
ligne, dont chacune des entrées posséde sa correspondance en langue
anglaise trés utilise dans le langage courant des financiers (indispensable
aux managers afin qu’ils puissent lire les reporting en mode anglo-saxon).
Ce livre est indispensable pour:
= pouvoir lire les états financiers ;
= dialoguer avec tous les acteurs de entrepreneuriat;
= prendre des décisions financiéres de managers
™ permettre aux managers et leurs équipes de devenir acteur de la
performance financiére de lentreprise;
= approfondir par la suite d'autres électifs dexpertise tels: évaluer
une entreprise, valoriser un investissement, approfondir la notion
financiére de création de valeur, présenter des budgets, réaliser un
business plan.
nance pour non-financiers
Les 4 piliers
des états financiers
Laurent décide avec deux amis, Clara et Alain, de créer une entre-
prise de vente de vétements, quiils nommeront Bacall. Pour ce faire,
ils conviennent d’apporter chacun la somme de 50000 €. Ainsi, les
150000 €, déposés dans une banque, constitueront le capital de |’en-
treprise, la société Bacall.
Par ailleurs, lentreprise Bacall a achelé les premigres pices en stock
pour étre vendues, pices quelle ne paiera a ses fournisseurs que dans
AS jours
Ainsi, l'entreprise est pratiquement préte & démarrer son activité. Elle
a en effet réalisé deux opérations essentielles, résumées dans le bilan
d'ouverture
Ressources stables, dont capital
150000€ (150000 €) + deties financidres (0 €)
45000 € Ressources «courtes» cesta-dire rem-
boursables & court terme
Total des ressources 195000 €
Conjointement, I’entreprise Bacall a dé, pour permettre le démarrage de
son activité, engendrer les frais suivants, que l'on désigne par «emplois »
car ils détaillent l'emploi des ressources financiéres:
90000 € Acquisition de loutil de travail
45000€ Acquisition du stock de démarrage
Total des emplois 135000 €
On constate qu'il reste méme de |’argent en caisse pour 60000 €.
Uentreprise, une fois créée, s‘engage dans la réalisation de ses objectifs
économiques, liés & son coeur de métier. Ainsi dans le cadre de notre
exemple, la société Bacall est une entreprise de commerce de vétements.
Son cycle d’exploitation est le suivant: I'entreprise recoit des vétements
de son fournisseur/créancier, puis elle les vend 4 ses clients dans
ses magasins. Cet argent lui permet de payer ses frais de fonction-
nement et éventuellement de dégager un bénéfice. Une attention
particuliére sera portée a l'existence d’un résultat bénéficiaire,
condition de survie de l’entreprise.
Il faut avoir & l'esprit, qu’il y a toujours deux questions 4 se poser, concer-
nant la provenance et la destination de l'argent. De plus, pour que la
société Bacall survive et soit pérenne, il faut comme pour toute entre-
prise, que ses fondateurs soient capables de répondre & tout moment a
deux autres questions supplémentaires exposées ci-dessous.
Les réponses 4 ces questions constituent le bilan, qui permet aux entre-
preneurs, par exemple, de:
— mieux connaitre leur activité ;
— mieux connaitre l'état de santé de leur concurrence ;
— s‘assurer de la solidité financiére d’un de leurs clients.
D’ob vient l’argent? C’est-d-dire quelles sont les ressources?
OW va Vargent? C'es!-d-dire quels emplois en fait-on? Dit encore
autrement, comment ont été employées les ressources financiéres ?
Qu’est-ce que l’entreprise posséde?
Qu’est-ce que l’entreprise doit?
Finance pour non-financiers
© Dunod - Toute reproduction non autorisée est un délit
Principe de la partie double
Exeiots —)
Il est possible de représenter la situation
financiére d’une entreprise. Pour ce faire,
on va répertorier & différentes dates succes-
sives:
= d'un cété, les ressources dont elle dis-
pose a chaque date;
- de l'autre cété, la maniére dont ces
ressources sont employées a la méme
date: les emplois.
Un tel état des lieux n’est rien d’autre qu'un bilan.
La comptabilité (et donc les états financiers) repose sur le principe dit
de la partie double, inventé par Luca Pacioli', un moine italien au
cle, meilleur ami de Léonard de Vinci. Ce principe peut se résumer
a loide des 2 régles élémentaires suivantes
= Premiére régle: le montant des ressources est toujours rigoureuse-
ment égal au montant des emplois.
= Deuxiéme régle: tout nouvel emploi doit correspondre soit 4 une
nouvelle ressource, soit & la réutilisation d’un emploi précédent.
Définition du bilan
| | Définition financiére
La définition financiére d’un bilan est la suivante: c'est un état qui, & une
date donnée, présente:
= a droite, la liste des ressources & disposition de l'entreprise ;
= & gauche, la maniére dont ces ressources sont employées.
1. luca Bertolomes Pa
moine fr
‘ol (1445-1517), dt Luca Pe
n ouwrage Summa de
‘oll, est un mathématicien et astrophysicien ital
ico, geomelia, de proportion et de pr
cain, Dar
(1494), il rassemble ensemble des méthodes et savoirfare complables de I’époque, ce qui lui vaut d’ére
considéré comme Iinventeur» de lo complabilté. C’est dons ce live qu'est préseniée la méthode véniienne
de tenve des compies, sment connve sous appellation «comptabilié en partie double» ou encore
«principe de la partie double»
1-Les 4 piliers des états financiers 5
I | | Définition juridique
Le bilan est un état qui, a une date donnée, présente:
= a droite, les dettes de lentreprise: dettes vi
vis des propriétaires
que sont les actionnaires et dettes vis-d-vis des tiers ;
= & gauche, le patrimoine de entreprise, clest-a-dire les biens qu'elle
posséde.
C’est ainsi que le cété gauche s‘appelle Actif et le cété droit Passif.
Ces deux grandes masses, I’actif et le passif, sont de méme montant: les
emplois qui figurent & l'actif sont égaux aux ressources qui figurent au
passif,
Figure 1 - Le bilan: de la définition financiére 4 la définition juridique
Structure du bilan et ses principales rubriques
| | Equilibre
Le mot «bilan» a la méme étymologie que le mot « balance». Il enregistre
léquilibre entre ce que posséde l’entreprise, et, ce qu'elle doit.
6 Finance pour non-financiers
3
© Dunod
Lentreprise posséde : En contrepartie, l'entreprise doit:
actif est découpé en trois grandes masses: l'acti
circulant et les dispon
= les biens d’équipement, = le capital, qui est une dette vis-d-vis
les stocks, et les créances, des actionnaires,
= les disponibilités. = les emprunts et dettes financiers,
a les dettes fournisseurs et autres dettes.
Composition de Vactif
isé, l'actif
= Actif immobil
Vactif immobilisé comprend les biens destinés & servir de fagon
durable & lactivité de l’entité, c’est-a-dire les biens qui restent dans
lentreprise plus d’un an.
Uactif immobilisé est composé par les immobilisations, c’est-d-dire
les dépenses réalisées ou les biens acquis 4 titre permanent, qui vont
participer 4 générer des profits 4 l'entreprise dans le futur.
Les immobilisations sont classées en trois catégories:
> Les immobilisations incorporelles (ou immatérielles).
Elles représentent des biens ou des droits n’ayant pas un caractére
matériel, que l'on ne peut pas «toucher .
> Les immobilisations corporelles. Elles enregistrent des biens
matériels destinés a servir de fagon durable 4 l'activité de entreprise.
> Les immobilisations financiéres. Ce sont principalement des
détentions de capital de filiales ou des dépéts et cautionnements
versés a titre de garantie.
Il est intéressant de noter que les immobilisations, incorporelles ou
corporelles, se déprécient dans le temps, et donc s‘amortissent.
= Actif circulant
actif circulant, quant & lui, comprend les biens dont la durée de vie
dans l'entreprise est par définition limitée & un exercice.
Vactif circulant est composé par:
> Les stocks. Il s‘agit de l'état des stocks au moment du bilan,
c'est-d-dire des valeurs d’exploitation destinées 4 étre vendues ou
consommées dans l'exercice.
> Les créances. Ce sont les créances de l'entreprise facturées
@ ses clients, les créances ou acomptes fait au personnel, les
organismes sociaux, ‘Etat, mais aussi les acomptes versés aux
fournisseurs.
= Disponibilités
Les disponibilités figurent dans le plan comptable sous trois rubriques
principales:
> les valeurs mobiligres de placement qui correspondent a un place-
ment temporaire des excédents de trésorerie;
> les comptes en banque ou assimilés;
> la caisse.
HB! | Composition du passif
Le passif est découpé en deux grandes masses: les capitaux propres
et les dettes.
= Capitaux propres
Les capitaux propres représentent les capitaux laissés 4 l'entreprise par les
propriétaires, par opposition aux dettes contractées 4 l'extérieur.
Les capitaux propres sont constitués par
> Le capital social. || représente les apports faits & la société
par les associés ou les actionnaires. Il ne peut pas étre modifié
sans ‘observation d'une procédure juridique spécifique, encore
appelée la régle de fixité du capital social.
> Les réserves. Elles sont constituées grace aux bénéfices anté-
rieurs réalisés par l'entreprise et non distribués.
> Le résultat net. Il correspond au bénéfice ou @ la perte réalisé
pendant l'année écoulée.
Attention: i] ne faut pas confondre le capital ou les réserves et le cash
stocké dans un coffre qui figure & l'actif; comme ’emploi des ressources
apportées 4 I'entreprise.
= Dettes
La rubrique « dettes » quant & elle est composée par:
> Les dettes financiéres. Elles regroupent les emprunts contractés
auprés des établissements de crédit et les autres dettes financiéres
comme les apports temporaires en compte courant versés par les
associés. ensemble pourra étre intitulé la «dette ».
Finance pour non-financiers
> Les dettes fournisseurs. Elles sont constituées de ce qui est
dO aux fournisseurs d’exploitation ou aux fournisseurs d’immobi-
lisations.
> Les autres dettes, fiscales et sociales. Elles regroupent
notamment les dettes fiscales et sociales mais aussi les salaires du
dernier mois restent 4 payer.
Au passif figure ce que je dois, que ce soit aux actionnaires ou & des tiers.
Figure 3 - Les rubriques du bilan
© Dunod - Toute reproduction non autorisée est un dé
ACTIF Immobilisé
CAPITAUX Propres.
> Immobilisations incorporelles
(ou immatérielles )
> Immobilisations corporelles
> Immobilisations financiéres
> Capital social
> Réserves
> Résultat net
ACTIF Circulant
of ET a ]
» Stocks
‘Autres créances
> Dettes financiéres
» Dettes fournisseurs
DISPONIBILITES
> Autres dettes fiscales et sociales
HB! | Eléments contenus dans le bilan
Tableau 1 - Eléments contenus dans la rubrique «Ac
Immobilisations
incorporelles
Immobilisations
corporelles
financiéres
Stocks
Créances clients
Valeur mobiliére
de placement
ACTIF
Exemples: brevet, logiciel, fonds de commerce
achetés, marque...
Exemples: terrains, immeuble, construction, machines,
installations techniques, matériels informatiques,
meubles, matériel de bureau, matériels de transport,
agencement, installations...
Exemples: préts accordés aux salariés, titres de parti-
cipation dans des filles, préts consentis & une filiale,
dépét et cautionnement...
Exemples: marchandises, produits finis et en cours,
matigres premigres.
Exemples: factures dues par les clients
Exemples: litres financiers, actions ou obligations
de rendement.
‘Compte courant & la banque de |'entreprise.
Argent liquide détenu par lentreprise.
1 -Les 4 piliers des états financiers
Tableau 2 - Eléments contenus dans la rubrique «Passif» du bilan
PASSIF
Capital soc Apport en copital des associés
Résultat, réserves Résultats cumulés depuis la création et non redistribués
et report a nouveau ‘aux actionnaires sous forme de dividendes.
Provision pour risques __Lilige potentiel constaté & la cléture de lexercice risquant
et charges diaboutir av paiement d'indemnités, d'une amende ov
de dommages:intérals (icenciemen, iige en cours, etc
Emprunts aupras des établissements de crédit et apports
en compte courant des actionnaires. Par exemple, un
associé qui avance de l'argent a lentreprise pour régler
les salaires: cet argent constitue une avance de tréso-
rerie, liquide et exigible par lassocié a tout moment,
Dettes fournisseurs Factures non payées aux fournisseurs.
Dettes fiscales Impéts, salaires et charges sociales non payés
et sociales 4 la cléture de l'exercice.
I! | Modéle de bilan présenté sous forme de tableau
= Rubrique Actif
Le tableau 3 présente un modéle de présentation de l'actif du bilan sous
forme de tableau
Tableau 3 - Modéle de présentation de l’actif du bilan’
Exercice N
ACTIF Amortissements
Brut et provisions Net Net
(a déduire)
Capital souscrit — non appelé ° 0 0
ACTIF IMMOBILISE
Immobilisations incorporelles:
Frais détablissement ° ° 0
Frais de recherche et de développement 0 o 0
Concessions, brevets, licences, ° ° °
marques, procédés, logiciels, droits
et valeurs similaires
Fonds commercial (1) ° ° 0 0
Source: www. plancomplable.com
10 Finance pour non-financiers
© Dunod - Toute reproduction non autorisée est un délit,
ACTIF
Autres
Immobilisations incorporelles en cours
Ayances et acomptes
Immobilisations corporelles
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériels,
et outillage indusiriels
Autres
Immobilisations corporelles en cours
‘Avances et acomptes
Immobilisations financiéres (2)
Participations
Créances rattachées & des participations
Titres immobilisés de Vact
de portefeville
Autres titres immobilisés
Prats
Autres
TOTAL!
‘ACTIF CIRCULANT
Stocks et en-cours ')
Matiéres premiéres et autres
‘approvisionnements
En cours de production
[biens et services]
Produits intermédicires et finis
Marchandises
Avances et acomples versés
sur commandes
Créances (3):
Créances clients " et comptes
rattachés
Autres
Capital souscrit - appelé, non versé
Brut
ooo°o
°°
o e000
°
ecco
Exercice N
Amortissements
et provisions Net
(a déduire)
0 0
° °
° 0
0 0
0 0
° °
0 0
° 0
° 0
0) °
0 0
° °
0 0
° 0
0 0
° °
° °
0 0
° °
° °
0 0
° 0
0 0
1 -Les 4 piers des états financiers
Exercice
NI
Net
coo°o ooo°0
eco°o
i
Exercice
Exercice N aD
act Amortissements
Brut et provisions “Net Net
(a déduire)
Valeurs mobiliéres de placement
Actions propres ° ° 0 0
Autres titres ° ° 0 0
Instruments de trésorerie ° 0 0 0
Disponibilités ° ° 0 0
Charges constatées d’avance (3) ° ° 0 0
TOTAL 0 ° ° 0
Charges & répartir sur plusieurs ° 0 0 0
exercices (Il)
Primes de remboursement 0 0 0
des emprunis (IV)
Ecarts de conversion Actif (V) oO 0 0
Fi 0 8 8
(1) Dont droit au bail
(2) Dont & moins d'un an (brut)
(3) Dont & moins d'un an (brut)
(A) Les actifs avec clause de réserve de propriété sont regroupés sur une ligne
dislincte portant la mention «dont... avec clause de réserve de propriété». En
cas d’impossibilité d’dentifer les biens, un renvoi au pied du bilan indique le
montant restant & payer sur ces biens. Le montant & payer comprend celui des
effets non échus.
(B) Si des titres sont évalués par équivalence, ce poste est subdivisé en deux sous-
postes «Parlicipations évaluées par équivalence» et «Autres participations».
Pour les titres évalués par équivalence, la colonne «Brut» présente la valeur
globale d’équivalence si elle est supérieure au cost d'acquisition. Dans le cas
contraire, le prix d’acauisition est retenu. La provision pour dépréciation glo-
bale du portefeuille figure dans la 2° colonne. a colonne «Net» présente la
valeur globale d’équivalence positive ou une valeur null,
(C) — Aventiler, le cas échéant, entre biens, d'une part, et services d'autre part
(D) _Créances résultant de ventes ou de prestations de services
(6) Poste a servir directement s'il n’existe pas de rachat par l'entité de ses propres
actions.
= Rubrique Passif
Le tableau 4 présente un modéle de présentation du passif avant réparti-
tion du bilan sous forme de tableau.
12 Finance pour non-financiers
Tableau 4 - Modéle de présentation du passif du bilan'
PASSIF Exercicen _Exercice N-1
Capitaux propres (*)
Capital [dont versé...] “ 0 °
Primes d’émission, de fusion, d'apport, 0 0
Ecart de réévalvation 0 °
Ecart d’équivalence 0 °
Réserves:
Réserve légale 0 °
Réserves statutaires ov contractvelles 0 °
Réserves réglementées 0 °
Autres 0 °
Report & nouveau ®! 0 °
Résultat de l’exercice [bénéfice ou perte] ® 0 °
Subyentions d'investissement 0 °
Provisions réglementées 0 0
Total | ° °
Provisions pour risques et charges
Provisions pour risques °
Provisions pour charges
Total II °
Dettes (1)
Emprunts obligataires convertibles 0 °
Autres emprunts obligataires 0 0
Emprunts et deltes auprés élablissements de crédits (2) 0 °
Emprunis et dettes financiéres diverses (3) 0 °
vances et acomples recus sur commandes en cours 0 0
Dettes fournisseurs et comples ratlachés 0 0
Dettes fiscales et sociales 0 °
5 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 0 oO
4 Autres deties 0 0
3 Instruments de trésorerie 0 o
5 Produits constatés d’avance (1) 0 0
£ Total Ill ° °
s Ecarts de conversion passif (IV) 0 0
: Total général (I + I+ Ill + IV) ° °
© Dunod
Source: www. plancomplable.cam
1-Les 4 piliers des états financiers 13
Dont & plus d'un an
Dont & moins d'un an
(2) Dont concours bancoires courants et soldes créditeurs de banques.
{3) Dont emprunts participatifs
(") Le cas échéant, une rubrique «Autres fonds propres» est intercalée entre la
rubrique le 5 janvier: elle vend des marchandises pour un montant
de 55000 € au comptant, réglé par chaque.
> Le 12 janvier: elle achéte un lot, a crédit, pour 50000 €.
le 15 janvier: elle revend le lot pour 60000 €, avec un crédit
accordé au client.
Le 24 janvier: elle paie des fournisseurs pour le premier lot acheté
v
v
par chéque.
> Le 28 janvier: elle achéte un troisigme lot de marchandises
au comptant pour 50000 €.
Nous allons détailler chacune de ces opérations et voir ainsi leur impact
sur le bilan
1) Le 5 janvier: vente de marchandises pour un montant de 55000 € au
comptant, réglé par chéque.
Le 5 janvier lentreprise revend son lot de marchandises en stock pour un
chiffre d’affaires de 55000 € payé au comptant par chéque.
(a) Le stock, d'une valeur de 45000 €, disparait car les marchan-
dises sont vendues.
(b) La banque augmente de 55000 € car on resoit un chéque de
ce montant.
(¢) Lactif total augmente donc de 10000 €, soit la marge réalisée
sur cette vente. Ces 10000 € représentent une ressource pour lentreprise,
ils doivent done figurer dans le passif du bilan.
On pourrait d'ailleurs qualifier cette ressource d’autoressource puisqu’ici,
elle ne vient ni des propriétaires ni des créanciers de l'entreprise, mais
directement de son exploitation
On vérifie une fois de plus que l'actif et le passif sont égaux, ils ont chacun
caugmenté du montant de la ressource générée. C’est un des points fonda-
mentaux du principe de la partie double.
16 Finance pour non-financiers
© Dunod - Toute reproduction non autorisée est un délit,
Figure 5 - Evolution du bilan de ’entreprise Bacall en date du 5 janvier
a » ol le > Capital
Vente de ~~ ‘Augmentation de iad
marchandises ia banque
ie stack ree este Sa
195 KE 195 KE D 205 KE 195 KE
(a) Disparition du stock (b) Augmentation de la banque
in?
Cra
= Autoressource
Marge réalisée sur
wees Ta vente de
rt Al 10 Ke
205 KE 205 Ke
(c) Autoressource
2) Le 12 janvier: achat d'un lot & erédit pour 50000 €.
Le 12 janvier, lentreprise acquiert 4 crédit un nouveau lot de marchandise
d'une valeur de 50000 €.
Elle enregistre une
dette fournisseur aU Figure 6 - Evolution du bilan de Ventreprise Bacall
passif, en contre- en date du 12 janvier
partie du stock ins- ” =
crit & Vactif.
, es
Wi Capital
(a) une augmen- pense sun nowveas
tation de 50000 € *“Sereuie**
de 50 KE “al
de l'actif; oy
BI
co
‘Autoressource 10 KE
Enregistrement une
‘nouvelle
dette fournisseur
255 KE 255 KE
(b) ‘apparition
d'une nouvelle dette
fournisseur.
3) Le 15 janvier, la revente du lot pour 60000 €, avec un crédit accordé
au client.
1-Les 4 piliers des états financiers 7
le 15 janvier, lentreprise revend le deuxiéme lot pour 60000 € avec un
réglement client & terme.
lly a création d'une nouvelle ressource de 10000 €, puisque |'entreprise
vend 60000 € des marchandises qu’elle avait achetées 50000 €.
Méme si les clients r’ont pas encore réglé, la vente est faite et la facture
; émise. Le résultat doit done
Figure 7 - Evolution du bilan de l’entreprise
gens alors étre enregistré méme
Bacall en date du 15 janvier
en l’absence de mouve-
ment de trésorerie.
Cette opération nous permet
de mettre en évidence un
point fondamental: résultat
et trésorerie ne sont
pas synonymes! II y a
un temps pour s‘engager a
payer en acceptant une facture, et un autre temps pour payer. Le résultat appa-
rait donc & lengagement de paiement alors que la trésorerie intervient lors du
paiement. Nous reviendrons un peu plus tard sur cette distinction (cf. encadré
«Savoir que résultat et trésorerie ne sont pas synonymes!>).
Evolution du bilan de Ventreprise Bacall gy 1. 24. janvier:
en date du 24 janvier .
paiement des four
z a)
eo le 24 janvier, len-
treprise régle son
g . fournisseur pour le
organ le acters, Premier lt de mor
eer B20KE eres gourissew® chandises —_d’une
aie valeur de 45000 €
acheté avant janvier.
Ce paiement se fait grace 4 l'argent dont elle dispose en banque.
Cette opération se traduit par
(a) une diminution de la banque;
(b) une diminution des dettes fournisseurs du méme montant soit
45000 €.
18 Finance pour non-financiers
© Dunod - Toute reproduction non autorisée est un délit,
5) le 28 janvier: achat d’un troisiéme lot comptant.
Le 28 janvier, lentreprise achéte un troisiéme lot de marchandises d'une
valeur de 50000 € qu'elle décide de payer immédiatement.
La structure de l‘actif change tandis que celle du passif n'est pas affectée
Jar cette opération.
Par celle operat Figure 9 - Evolution du bilan de lentreprise
En particulier, remarquez bien Bacall en date du 28 janvier
que cet achat non encore ett
vendu et son raglement comp-
fant n’ont pas eu diincidence
sur le résultat (l’autoressource),
malgré le décaissement. En fj
effet, résultat et trésorerie ne y
Achat dun 3éme |
sont pas synonymes, sinon le lot se morchandees }
Pas synony! do 50 KE j
compte en banque serait tou-
jours égal au résultat!
Important: Tant que la marchandise achetée est en stock — que celle-ci
soit payée comptant - avec diminution correspondante de la banque - ou
achetée 4 crédit - avec augmentation du méme montant des dettes fournis-
seurs, il n'y a pas encore d’incidence sur le résultat. On ne pourra en effet
parler de résultat qu‘aprés la consommation de la marchandise pour
tre vendue, par la marge alors réalisée. On verra plus loin, ’incidence de
cette notion majeure dans la construction du compte de résultat.
Figure 10 - Bilan simplifié de 'entreprise Bacall
ACTIF PASSIF
Immobil 90 Capital 150
Stock 50 Autoressource 20
Clients 60 Dettes d’exploitation 50
Banque 20
220 220
Ainsi, outre les ressources en provenance des propriétaires (le capital) et
les ressources en provenance des tiers (dettes financiéres et dettes fournis-
seurs), lentreprise génére une autoressource du fait de son activité.
1-Les 4 piliers des états financiers 19
Le vendeur regoit son
> A votre avis, la marge dégagée par les ventes du mois de jan-
vier peut-elle étre considérée comme le résultat définitif du mois
de janvier?
> la marge dégagée est un des éléments constitutifs de lautores-
source mais ce nest pas le seul, il faut aussi intégrer d'autres
consommations de produits ou de services, comme les salaires
par exemple. Regardons ce dernier point en détail.
Au début du mois, Bacall avait embauché un vendeur. Suite 4 cette
embauche, rien ne se passe au bilan, car le vendeur ne fait pas partie du
patrimoine de l'entreprise, il n’en
Figure 11 - Implication sur le bilan est pas propriétaire mais juste
ment du salaire du vendeur locataire! Le 31 janvier, le vendeur
a embauché précédemment recoit
son salaire de 2000 € pour la
période correspondant au mois de
janvier. Le paiement de ce salaire
implique une sortie de la banque
d'un montant de 2000 €.
oreccixe””
218 KE
la charge du salaire vient en
déduction de lautoressource de
20000 € dégagée par les ventes
de janvier. Le travail du vendeur a été un élément de l'opération de vente,
il est donc logique que le salaire soit payé par les ressources créées par
ce travail.
la réalisation des ventes n’a pas seulement nécessité le paiement de
salaires. Elle a également nécessité la consommation de ses immo-
bilisations 4 savoir du magasin et de son matériel. D’autres charges,
selon un mécanisme analogue, sont donc 4 imputer 4 l'activité du mois
de janvier:
Au cours de ce premier mois de travail, le chef d’entreprise évalue & 6000 €
la dépréciation, c'esta-dire la perte de valeur liée l'usure ou au vieillisse-
ment, de son outil de travail.
De plus en faisant l'inventaire de son stock d’une valeur de 50000 €,
il constate que des marchandises - achetées 2000 € - se sont détériorées
et sont devenues invendables. || s‘agit d'une dépréciation accidentelle.
20 Finance pour non-financiers
En outre, le chef d'entreprise fixe sa rémunération & 4000 € pour le mois
de janvier. Il décide de ne pas la percevoir immédiatement et de laisser
celle-ci en trésorerie pour |'instant.
Uentreprise a contracté une nouvelle dette — cette fois envers le chef d’en-
treprise ~ & inscrire ou passif dans les dettes financiéres, en «compte cou-
rant dassociés ». .
\, ai ae Figure 12 - Evolution du bilan
Les dettes d’exploitation selon lon charges enregiatrben
se montent maintenant lors du mois de janvier
& 50000 € - pour les
fournisseurs d’exploita-
tion + 4000 € pour le
chef d'entreprise — soit
54000 €. Avec en
contrepartie, la baisse
de lautoressource, qui
passe de 10000 a
6000 € pour équilibrer
le bilan.
Si nous avons bien enre-
gistré tout ce qui a été
consommé au cours de ce
premier mois, nous pou-
vons désormais parler
de résultat et non plus
diautoressource. En effet
aprés décision de lassem-
blée générale ordinaire,
réunie au moins une fois
par an, le résultat dégagé cose e ‘
par lentreprise appar Saved ros 4
fiendra bien, en propre,
o
210 KE 210 KE
@ ses actionnaires. C’est
pourquoi on relrouve le résultat au passif du bilan, dans les capitaux propres.
© Dunod - Toute reproduction non autorisée est un délit,
1-Les 4 piliers des états financiers 2
Résultat et variation des capitaux propres
Reprenons le cas d’étude constitué par la société Bacall afin de mieux
comprendre le discours.
Figure 13 - Relation entre capitaux propres, actif et dettes
a
Capitaux
propres
net | |g
ho Dettes
195 Ke 195 KE
Capitaux propres = Actif — Dettes
A la date de la création, soit le 7 janvier, les capitaux propres étaient de
150000 €. Ils étaient uniquement constitués par les apports des propriétaires.
Dans le bilan d’ouverture, la valeur de actif initial est de 195000 €,
la différence de 45000 € (195000 — 150000) ayant été financée par
des «capitaux étrangers » c’est-d-dire par des tiers. Ceux-ci constituent les
dettes initiales de l'entreprise.
Ainsi, on voit émerger une relation fondamentale :
Capitaux propres = Actif - Dettes = Actif - Fonds étrangers
En effet si en termes de ressources, les capitaux propres représentent les
capitaux en provenance des propriétaires, en termes d'emploi, ils repré-
sentent la partie de l'actif qui nest pas financée par des tiers.
Appliquons cette relation au bilan de cléture. Au 31 janvier, aprés
inventaire, ‘actif est évalué & 210000 € et les dettes 4 54000 €.
= Que sont devenus les capitaux propres?
D’aprés la relation, on sait que les capitaux propres sont égaux a la dif-
férence entre l'actif et les dettes, soit entre 210000 et 54000 €. D’ot
une valeur des capitaux propres de 156000 € (210000 - 54000)
= Variation des capitaux propres au cours de la période
Etant donné qu’ n'y a pas eu de nouveaux apports des proprié-
taires, la différence provient de activité propre de lentreprise,
22 Finance pour non-financiers
Toute reproduction non autrisée est un délit
© Dunod
Cest-d-dire du bénéfice - ou de la perte - quelle a dégagé entre
le 7 et le 31 janvier, soit, dans notre exemple, 6000 €.
Ainsi, les capitaux propres augmentent du montant du résultat.
EXEMPLE
A titre d’exemple, étudions les bilans d'une entreprise industrielle. Les figures 14
et 15 représentent respectivement le bilan d’ouverture de l'entreprise au 1* janvier
et au 31 décembre de l'année N.
Figure 14 - Bilan d’ouverture au 1 janvier de l’année N
ACTIF PASSIF
Terrains 80 Capital 350
Matériel 50 Deties d'exploitation 20
Batiment 10 Dettes financiéres 80
Machines 120
Stock 40
Créances clients 0
Banque 50
450 450
Figure 15 - Bilan d’ouverture au 31 décembre de l’année N
ACTIF PASSIF
Terrains 80 Capital 350
Matériel 100 —_Dettes d'exploitation 100
Bétiment 100 _Dettes financiéres 80
Machines 100
Stock 100
Créances clients 160
Banque 10
650 530
En comparant ces deux bilans, nous pouvons faire plusieurs constatations
= actif a augmenté de la différence entre 650 et 450, soit 200.
™ Les ressources, en provenance des propriétaires (capital) et des tiers (dettes),
‘ont augmenté de la différence entre 530 et 450, soit 80.
= La différence entre l'actif et le passif provient d'une autoressource (ressource
que l'entreprise a créée elle-méme] pour financer le supplément d’emplois.
Cette autoressource de 120 constitue le résultat de l’exercice.
1-Les 4 piliers des états financiers 23
Nous parlerons désormais de «eapitaux propres» pour désigner l'ensemble
Capital + Résultat.
Il se trouve, en effet, que cet ensemble provient des « propriétaires » de l'entreprise
puisque le résultat leur appartient. C’est méme la contrepartie du risque qu’ils
ont pris en engageant leur argent dans |’entreprise.
Notez bien, toutefois, que ce résultat, contrairement au capital, n‘est pas définiti-
vement acquis par l’entreprise. Ce sont les actionnaires qui décideront ultérieure-
ment — lors de l’Assemblée Générale Ordinaire - de l'affectation de ce résultat.
Soit, il sera laissé dans lentreprise et on l'appellera «réserves», soit, il sera dis-
tribué aux propriétaires actionnaires et on I'appellera dividendes.
Capitaux propres et variation des capitaux propres:
comment les calculer?
Copitaux propres Copitaux propres
Aciif — Dettes Capital + Résultat
Variation des capitaux propres
entre les deux bilans encadrant la période
Résultat
de la période
Pilier 3: le compte de résultat
Le compte de résultat fait apparaitre les charges et les produits qui ont
été enregistrés au cours de la période. Il regroupe toutes les opérations qui
ont enrichi (produits) ov appauvti (charges) lentreprise.
Il est trés important de rappeler qu’a ‘instant t, les charges ne sont pas
nécessairement des décaissements, ni les produits des encaissements.
Le moment correspondant 4 l'enregistrement des produits et des charges,
lors de mission ou de la réception des factures, n'est pas généralement
le méme que le moment du paiement.
La différence entre les charges et les produits (autrement dit le solde du
compte de résultat) est le résultat de l’entreprise.
24 Finance pour non-financiers
© Dunod - Toute reproduction non autorisée est un délit
Figure 17 - Notion de compte de résultat
CHARGES: PRODUITS
ere
DE RESULTAT
COMPTE
Le compte de résultat a ainsi été spécialement créé pour analyser, au fur
et mesure de chaque opération, la composition du résultat deéfinitif. Si le
solde est positif, on parle de bénéfice ; s'il est négatif c'est une perte. Si
le résultat est positif, c'est une ressource qui augmente les capitaux propres
au passif; s'il est négatif, il sagit alors d'une diminution de ressources qui
baisse les capitaux propres.
Charges < Produits > BENEFICE
Charges > Produits PERTE
En pratique
Présentation du compte de résultat
Comme le bilan, le compte de résultat se présente sous la forme dun
tableau en deux parties ol sont portées par convention:
— agauche: les opérations diminuant le résultat: ce sont les charges;
= adroite: les opérations augmentant le résultat: ce sont les produits.
Si, dla fin de la période, le cumul des produits est supérieur au cumul des
charges, le solde représente le résultat bénéficiaire de la période.
Par convention, on I'inscrit & gauche, ce qui permet d’équilibrer les deux
colonnes du compte.
Le compte de résultat permet de faire ressortir le résultat net de lentre-
prise: c'est-d-dire ce que l'entreprise a gagné (appelé aussi bénéfice) ou
ce que l’entreprise a perdu (appelé aussi perte) au cours de la période.
Le résultat net sera inscrit au niveau du bilan dans les capitaux propres,
pour le méme montant, bien sir! A défaut, il n'y aurait plus d’équilibre
dans la partie double.
1- Les 4 piliers des états financiers 25
Structure du compte de résultat et types d’activités
le compte de résultat permet grace 4 sa structure de distinguer trois
résultats correspondant & trois types d’activité différents:
> les activités d'exploitation;
> les activités financiéres ;
> les activités exceptionnelles.
Ces trois types d’activités sont générateurs de produits et de charges, pour
aboutir & trois résultats intermédiaires qu'il faudra bien distinguer.
H! | Compte de résultat et activités d’exploitation
Le niveau d’exploitation regroupe les produits et les charges relatifs & I'a
vité de production ou de commercialisation des produits ou des services
offerts par l'entreprise sur le marché. On y trouve
> les opérations d’achat et de revente pour les entreprises commer
ciales ;
> les opérations d’achat, de transformation et de vente, pour les
entreprises industrielles ;
> les opérations de prestation de services, pour les entreprises de
services.
les charges d’exploitation regroupent les consommations liées aux
opérations se déroulant lors du cycle d’exploitation. II sagit essentiellement:
> de consommation de matiéres: matiéres premiéres et matiéres
consommables;
> de consommation de services: sous-traitance, loyer, transport,
assurance, etc. ;
> des consommations de travail, génératrices de frais de personnel:
salaires bruts et cotisations patronales ;
> de la dépréciation des immobilisations : usure et vieillissement des
batiments, machines-outils, installations, etc.
les produits d’exploitation:
> La production vendue hors TVA est valorisée au prix de vente et
constitue ainsi le chiffre d’affaires. Notons d'ailleurs que la TVA
nenrichit pas l'entreprise, celle-ci n’étant que collecteur d'impat
pour le compte du Trésor Public. Aprés ‘avoir encaissée de ses
clients, elle la reversera mensuellement aprés déduction de la TVA
récupérable sur les achats de biens ou de services facturés par
ses fournisseurs,
26 Finance pour non-financiers
Vous aimerez peut-être aussi
- Liste Des Entreprises Maroc 2017Document61 pagesListe Des Entreprises Maroc 2017Ayoub AaliliPas encore d'évaluation
- Neghoscore Hotel RestaurantDocument35 pagesNeghoscore Hotel RestaurantAyoub AaliliPas encore d'évaluation
- 2017-07-07 Final ReportDocument25 pages2017-07-07 Final ReportAyoub AaliliPas encore d'évaluation
- 2017clfad015 YarafaDocument481 pages2017clfad015 YarafaAyoub AaliliPas encore d'évaluation
- Télémédecine Et Télésoin. Inclus 100 Cas Dusage Pour Une Mise en Oeuvre Réussie (Pierre Simon Thierry Moulin (Simon Etc.)Document352 pagesTélémédecine Et Télésoin. Inclus 100 Cas Dusage Pour Une Mise en Oeuvre Réussie (Pierre Simon Thierry Moulin (Simon Etc.)Ayoub AaliliPas encore d'évaluation
- Jeux D'echecsDocument51 pagesJeux D'echecsAyoub Aalili100% (1)
- 3302-Texte de L'article-26285-1-10-20200410Document10 pages3302-Texte de L'article-26285-1-10-20200410Ayoub AaliliPas encore d'évaluation
- Pourquoi Investir Dans Les OvoproduitsDocument5 pagesPourquoi Investir Dans Les OvoproduitsAyoub AaliliPas encore d'évaluation
- Prod Anim 2010 23 2 11 1Document11 pagesProd Anim 2010 23 2 11 1Ayoub AaliliPas encore d'évaluation
- Model Business Plan V1Document16 pagesModel Business Plan V1Ayoub Aalili100% (1)
- Annuaire Technopark 1 Seule VDDocument120 pagesAnnuaire Technopark 1 Seule VDkhadija100% (1)
- Guide Outlook 2007Document14 pagesGuide Outlook 2007Ayoub AaliliPas encore d'évaluation
- Business Plan Jurassic Park RestaurantsDocument24 pagesBusiness Plan Jurassic Park Restaurantsapi-3711324100% (2)