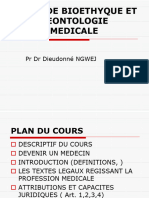Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Biophysique G2SBM Dr. Tresor
Biophysique G2SBM Dr. Tresor
Transféré par
Pierre muteb chiratCopyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Biophysique G2SBM Dr. Tresor
Biophysique G2SBM Dr. Tresor
Transféré par
Pierre muteb chiratDroits d'auteur :
Formats disponibles
Docteur ASSANI BENKITA TRESOR
[1]
Docteur ASSANI BENKITA TRESOR
BIOPHYSIQUE
Chapitre I : Généralités
Chapitre II : Anatomie du système auditif
Chapitre III : Acoustique physique
Chapitre IV : Biophysique sensorielle de l’audition
1. Définition
La biophysique est une discipline se trouvant au carrefour de la physique, de la
chimie, de la biologie et de la physiologie.
Elle est une science qui étudie les phénomènes physico-chimiques qui stimulent
l’organisme et la réponse biologique à cette stimulation. L’organisme est stimulé par
les organes de sens ou récepteur.
2. Organe de sens ou récepteur
C’est une zone de contact de l’organisme vivant avec le milieu ambiant qui l’entoure.
Il représente la seule source d’information concernant certains aspects de l’univers
(ex : l’œil, nous met en contact avec la lumière). Chaque organe de sens est sensible
à une variation d’une grandeur physico-chimique de l’univers ambiant et reste le seul
informateur de l’individu pour chaque cas spécifique
Notion de spécificité : un organe de sens est spécifique à une seule grandeur
physico-chimique.
Il existe beaucoup de récepteurs regroupés en trois groupes principaux :
Les récepteurs de la sensibilité extéroceptive ou récepteurs superficiels
- Le récepteur tactile superficiel
- Le récepteur thermique
- Le récepteur algique
- Le récepteur du goût
- Le récepteur de l’odorat
- Le récepteur de la vue ou de la vision
- Le récepteur de l’audition ou de l’ouïe
Docteur ASSANI BENKITA TRESOR
Docteur ASSANI BENKITA TRESOR
[2]
Les récepteurs de la sensibilité proprioceptive ou récepteurs profonds
- Le récepteur articulaire
- Le récepteur tendineux
- Le récepteur musculaire
- Le récepteur vestibulaire et les canaux semi-circulaires : participent au
maintien de l’équilibre
- Le cervelet qui joue un rôle secondaire dans l’équilibre
Les récepteurs articulaire, tendineux et musculaire renseignent sur la position des
différentes parties du corps.
Les récepteurs de la sensibilité intéroceptive ou récepteurs viscéraux
Ex : Le chémorécepteur, le barorécepteur
Les principes de fonctionnement des organes de sens
La biophysique traite des mécanismes par lesquels les variations physico-
chimiques franchissent les organes de sens pour y produire un effet.
Ainsi qu’il faille étudier :
Les grandeurs physico-chimiques : « stimulus »
La réception et la transmission des organes de sens
La transduction en une énergie bioélectrique
Le transport de l’énergie bioélectrique par les voies nerveuses jusqu’au centre
d’intégration
Docteur ASSANI BENKITA TRESOR
Docteur ASSANI BENKITA TRESOR
[3]
L’ana lyse de
l’information avec réponse psychologique
Les phénomènes de rétroaction (feedback)
Stimulus Récepteur Transforma Signal Conducteur Analyseur
teur
Lumière Œil Rétine Influx Nerf optique Aire visuelle
nerveux du cerveau
Son Oreille Cochlée Influx Nerf auditif Aire auditive
nerveux du cerveau
Pression, Peau Terminaiso Influx Nerf Aire du
douleur et n nerveuses nerveux sensitif,moe toucher du
température lle épinière cerveau
et le tronc
cérébral
Odeur Nez Tache Influx Nerf olfactif Aire
olfactive nerveux olfactive du
cerveau
Saveur Langue Bourgeons Influx Ners Aire
gustatifs nerveux crâniens et gustative du
Docteur ASSANI BENKITA TRESOR
Docteur ASSANI BENKITA TRESOR
[4]
tronc cerveau
cérébral
Chapitre II : ANATOMIE DU SYSTEME AUDITIF
Le système auditif comporte deux parties :
L’appareil auditif périphérique
Constitué par l’oreille, l’organe de sens (un récepteur).
L’oreille est subdivisée en :
- Oreille externe
- Oreille moyenne
- Oreille interne
L’appareil auditif central
Constitué par les voies auditives centrales :
- Les différents neurones
- Les noyaux centraux (les relais)
- Le centre d’intégration
L’OREILLE
I. L’oreille externe
Elle est composée :
De l’auricule ou pavillon : fait des gouttières et saillies
Docteur ASSANI BENKITA TRESOR
Docteur ASSANI BENKITA TRESOR
[5]
Du conduit auditif externe et
De la membrane tympanique :
Elle est concave, forme un angle de 45o (incliné de haut en bas, de dehors en
dedans) et ayant un diamètre de ± 10 mm et une épaisseur de 0.1 mm
II. L’oreille moyenne
Elle comprend :
Le contenant : La caisse du tympan : c’est une caisse rigide qui présente six
faces (antérieure, postérieure, interne, externe, supérieure et inférieure), elle
représente un cube et
Le contenu : Une chaine ossiculaire :
1. Os
2. Muscles
3. Ligaments
Les os sont :
Le Marteau, il a 3 parties :
Docteur ASSANI BENKITA TRESOR
Docteur ASSANI BENKITA TRESOR
[6]
Le manche qui s’attache au tympan
Le col et
La tête
L’Enclume, elle comprend :
La longue apophyse
La petite tête qui s’articule avec l’étrier
Le corps
La courte apophyse
L’Etrier, il comprend :
Deux manches
Une petite tête qui s’articule avec la petite tête de l’enclume
Une lame appelée Platine qui ferme la fenêtre ovale
Les muscles sont
Le tenseur du tympan ou muscle du marteau et
Le muscle Stapédien
III. L’Oreille interne
Elle comprend :
- Une partie antérieure, la cochlée qui se charge de l’audition
- Une partie postérieure, le vestibule qui s’occupe de l’équilibre
Mais l’oreille interne est constituée :
D’une caisse centrale, le vestibule
De trois canaux semi-circulaires
Docteur ASSANI BENKITA TRESOR
Docteur ASSANI BENKITA TRESOR
[7]
D’un limaçon, la cochlée
Par sa constitution complexe, l’oreille interne est appelée « LABYRINTHE ».
Et on distingue :
Le labyrinthe externe ou osseux et
Le labyrinthe interne ou membraneux
Donc il y a un vestibule osseux et membraneux et une cochlée osseuse et
membraneuse. L’oreille interne a la forme d’un escargot. Dans cette forme, la
cochlée se présente comme un tube contourné avec 2.5 spires environ. La première
spire s’appelle pr omontoire sur laquelle il y a la fenêtre ronde fermée par le tympan
secondaire. Sur la caisse ou le vestibule, il y a la fenêtre ovale fermée par la platine
de l’étrier qui est accompagnée par le ligament annulaire pour renforcer la fermeture.
A l’intérieur de la cochlée, il y a deux membranes :
- La membrane de REISNER (membrane supérieure)
- La membrane Basilaire (membrane inférieure)
Ces deux membranes se touchent à leur sommet (au fond) en laissant un petit
orifice (Hélicotrème), leur permettant de communiquer, et subdivisent la cochlée en
trois compartiments :
- La rampe vestibulaire (compartiment supérieur qui est en rapport avec la
fenêtre ovale)
- Le canal cochléaire (compartiment moyen)
- La rampe tympanique (compartiment inférieur qui est en rapport avec la
fenêtre ronde)
Ces compartiments sont remplis de liquide, les rampes vestibulaire et tympanique
sont remplies d’un liquide appelé « Périlymphe » et le canal cochléaire est rempli de
l’endolymphe.
Composition des liquides :
+ +
- L’endolymphe : riche en potassium K (150 mmol/l) et pauvre en sodium Na
(1 mmol/l)
+ +
- La périlymphe : riche en sodium Na (140 mmol/l) et pauvre en potassium K
(3 mmol/l)
Sur la membrane basilaire se trouve l’organe sensoriel même de l’audition qu’on
appelle « organe de Corti ». Il comprend des cellules sensorielles et des cellules de
soutien (cellules de Claudius).
Lorsqu’on fait une coupe transversale de la cochlée, la membrane basilaire présente :
Docteur ASSANI BENKITA TRESOR
Docteur ASSANI BENKITA TRESOR
[8]
- Un pilier interne et un pilier externe
- Les cellules ciliées internes qui sont les seules cellules sensorielles
- Les cellules ciliées externes qui possèdent à leur face latérale les fibres
d’actine et de myosine leur permettant de se contracter. Ce sont les cellules
les plus longues et leurs cils s’incrustent dans la membrane tectoriale,
membrane baignant dans l’endolymphe. Elles sont plus nombreuses que les
cellules ciliées internes, environ 30000 contre 3000.
Les cellules ciliées présentent un pôle apical, avec des cils, et un pôle basal limité
par la membrane basale. C’est au niveau du pôle basal qu’on retrouve une fente
synaptique faisant articuler la cellule ciliée à la première partie du neurone
(dendrite).
Les voies auditives centrales
Docteur ASSANI BENKITA TRESOR
Docteur ASSANI BENKITA TRESOR
[9]
Toutes les cellules ciliées ont, au niveau de leur pôle basal, une connexion
avec des neurones. Lorsque les noyaux de ces neurones sont mis en ensemble,
ils forment un agglomérat des noyaux appelé ganglion (ganglion de CORTI) et
tous ces neurones rassemblés constituent le nerf cochléaire. Le premier relai est
le relai bulbaire. L’influx nerveux part de la cochlée par le neurone cochléo-
bulbaire, puis il gagne le bulbe où il déguste pour aller au thalamus par le neurone
bulbo-thalamique et enfin de celui-ci au cortex cérébral (plus précisément l’aire 41
de Brondman qui est le centre d’intégration) par le neurone thalamo-cortical. La
décussation est le fait qu’une fibre nerveuse ou un neurone traverse la ligne
médiane au lieu de rester du côté homolatéral de son émergence.
- La voie afférente va des cellules ciliées internes au cortex
- La voie efférente va du cortex aux cellules ciliées externes
CHAPITRE III : ACOUSTIQUE PHYSIQUE
Un son est une onde mécanique, une énergie propagée dans un mouvement
vibratoire (sinusoïdal) non accompagnée de déplacement de la matière qu’il traverse.
Un son est physiquement défini par :
- sa fréquence : hauteur ou tonie
- son spectre de fréquence : timbre
- sa puissance surfacique : intensité, amplitude, sonie
A. Fréquence
C’est une sensation qui fait dire : le son est grave ou aigu
Docteur ASSANI BENKITA TRESOR
Docteur ASSANI BENKITA TRESOR
[10]
Les sons graves ont des basses fréquences tandis que les sons aigus ont des
fréquences hautes.
L’unité de mesure de la fréquence est le Hertz = nombre de cycle d’onde par seconde.
Le domaine audible de l’oreille humaine varie. Le seuil d’audibilité de l’oreille humaine
se situe entre 50 Hz à 20000 Hz
- les sons de fréquence ˂ 50 Hz = infrasons
- les sons de fréquence ˃ 20000 Hz = ultrasons ou échos
La fréquence de référence est 1000 Hz ou 1 KHz
B. Intensité (amplitude ou sonie)
C’est la pression qu’exerce l’onde dans le milieu qu’elle traverse.
C’est la sensation qui fait dire : le son est faible ou fort
Elle est liée non seulement à la puissance surfacique mais aussi à la fréquence.
Le seuil absolu c’est-à-dire la plus petite puissance acoustique produisant une
sensation sonore perceptible par l’oreille est de 24x10-5 dyne/cm2
La détermination pour toutes les fréquences du domaine audible est appelée
Audiométrie (seuil liminaire ou inférieur), l’Audiogramme est la courbe qui reflète le
domaine audible pour toutes les fréquences et l’Audiomètre est l’appareil utilisé pour
cette détermination.
En augmentant la puissance surfacique à partir du seuil liminaire d’audition, on
aboutit au seuil supérieur ou douloureux.
Le domaine audible est très étendu en termes de puissance surfacique : le SD
12 12
est 10 ˃ au SL c’est-à-dire le rapport entre le SD et le SL est de 10
Donc on utilise l’échelle de décibels pour quantifier la sonie avec comme valeur de
référence :
Docteur ASSANI BENKITA TRESOR
Docteur ASSANI BENKITA TRESOR
[11]
Wo = 10-12 w/m2 à 1000Hz
La sonie S est donc définie comme la sensation S en décibels (dB) d’un son de
puissance surfacique W :
w
S = 10 log
w0
C. Le Spectre de fréquence ou Timbre
Est la propriété d’un son qui permet de reconnaître deux sons complexes de
même hauteur et de même intensité. Il est émis par deux sources différentes :
instrument de musique,
D. Impédance Mécanique
Toute force engendrant un mouvement vibratoire doit vaincre une certaine
opposition du milieu, c’est l’impédance mécanique ou acoustique.
Elle résulte de l’association de 3 facteurs :
- La réactance de masse ou l’inertance
- La réactance élastique ou compliance
- La résistance de friction
Z= (Xm -Xk)2 +Rs
Z = Impédance total
Xm= réactance de masse
Xk = réactance élastique
Rs = résistance de friction
CHAPITRE IV : BIOPHYSIQUE SENSORIELLE DE L’AUDITION
Transmission du Son
Le stimulus, le son pénètre dans l’oreille par deux voies :
Docteur ASSANI BENKITA TRESOR
Docteur ASSANI BENKITA TRESOR
[12]
Conduction ou voie aérienne (air)
Conduction ou voie osseuse (à travers les os du crâne)
La conduction aérienne est la principale.
La transmission du son traverse successivement :
L’oreille externe
L’oreille moyenne
L’oreille interne
A. Transmission dans l’oreille externe
L’oreille externe joue le rôle de capter les sons qui se propagent dans l’air et les
latéralise sur la face externe du tympan
- Le pavillon joue le rôle de localiser le son
- Le CAE en forme de tuyau joue le rôle de transformer les ondes sphériques
(l’énergie sphérique) en ondes planes (énergie plane) et de présenter une
résonance d’environ 3000 Hz.
- Le tympan reçoit les vibrations sonores et les transmet aux osselets via le
manche du marteau qui lui est solidaire
B. Transmission dans l’oreille moyenne
L’oreille moyenne joue le rôle d’adaptateur d’impédance acoustique par deux
mécanismes :
- L’action du levier de la chaine ossiculaire qui diminue l’amplitude et augmente
la pression de 1.31 c’est-à-dire il existe un rapport entre le manche du marteau
et la longue apophyse de l’enclume et il est de 1.31
- Le rapport de surface du tympan à la fenêtre ovale assure une amplification
importante de pression. Le ty mpan est 18 fois plus grand que la fenêtre ovale
c’est-à-dire la surface de la platine est 18 fois plus petite que celle de la
membrane tympanique.
Docteur ASSANI BENKITA TRESOR
Docteur ASSANI BENKITA TRESOR
[13]
L’effet global de ces deux mécanismes qui est le produit de leurs rapports de
transformation équivaut à 1.31 x 18 = 24 donc une amplification globale de 24
La trompe d’Eustache : équilibre la pression qui s’exerce sur les deux faces de la
membrane tympanique (permet une bonne vibration du tympan). Au repos, la trompe
est fermée et elle s’ouvre à la déglutition et au bâillement mais jamais pendant la
phonation.
Les muscles :
- Le muscle du marteau (le tenseur du tympan) : sa contraction tend le tympan,
protège plus ou moins l’oreille interne et favorise le passage des sons aigus.
- Le muscle de l’étrier (muscle stapédien) : sa contraction protège l’oreille
interne contre les sons intenses grâce au reflexe stapédien qui est déclenché
par un niveau acoustique entre 70 et 90 dB
C. Transmission dans l’oreille interne
Transmission dans la cochlée
Le mécanisme cochléaire est complexe et sera envisagé successivement par les
mouvements suivants :
- Le mouvement des fenêtres
- Le mouvement des liquides et des membranes
- Le mouvement des cellules ciliées
a. Les mouvements des fenêtres
Les liquides étant incompressibles, leur mouvement n’est possible que s’il existe une
voie d’expansion ; ce rôle est joué par le tympan secondaire qui doit être en
déphasage avec le mouvement de la platine de l’étrier.
b. Les mouvements des liquides et des membranes
Les mouvements des liquides se font en déformant les trois membranes c’est-à-dire
quand il y a entrée de la platine dans la rampe vestibulaire ou de la membrane
Docteur ASSANI BENKITA TRESOR
Docteur ASSANI BENKITA TRESOR
[14]
tympanique dans la rampe tympanique, les membranes de Reisner et basilaire se
déforment en formant des dépressions ondulantes. Chaque mouvement de la platine
de l’étrier mobilise le canal cochléaire et son contenu. La fenêtre ronde joue le rôle
d’expansion
c. Les mouvements des cellules ciliées
Les cils oscillent selon un mouvement de cisaillement en relation avec les
mouvements de la platine de l’étrier.
TRANSDUCTION
La transduction est la transformation d’une énergie X en une autre énergie Y.
Le mouvement d’oscillation des cellules ciliées entraine l’ouverture des canaux
ioniques. Le k+ en abondance dans l’endolymphe entre dans la cellule et les Na+ et Cl-
sortent de la cellule en provoquant une dépolarisation de la membrane qui repousse
dans la fente synaptique du pôle basal de ces cellules les médiateurs chimiques
principalement le glutamate de sorte que leur présence dans la fente entraine la
dépolarisation de la dendrite qui fait générer un potentiel d’action sous forme d’influx
nerveux qui va se propager jusqu’au cortex cérébral.
NB : la tonotopie est la répartition en touches de piano des stimulations des
cellules ciliées internes par rapport aux différentes fréquences.
- La fréquence aigue stimule la base de la cochlée
- La fréquence grave stimule le sommet de la cochlée
EXERCICES DE BIOPHYSIQUE
1. Calculer le coefficient de pondération (adaptation d’impédance) dans l’oreille
moyenne chez un sujet dont les dispositions anatomiques présentent :
- Une longue apophyse de l’enclume qui équivaut à la moitié de la
longueur du manche du marteau
- La surface de la fenêtre ovale équivaut au 1/15e de la surface de la
membrane tympanique
Docteur ASSANI BENKITA TRESOR
Docteur ASSANI BENKITA TRESOR
[15]
A cet effet, calculer la puissance surfacique devant franchir la rampe vestibulaire si
une source sonore émet une énergie sonore Ws = 10-8 w/m2
2. Un sujet présente des dispositions anatomiques suivantes :
2
- La surface de la fenêtre ovale = 0.9 mm
- Le rayon de la membrane tympanique = 6 mm
- La longueur du manche du marteau = 4 mm
- La longueur de la longue apophyse de l’enclume = 1.5 mm
a. Calculer le coefficient de pondération (adaptation de l’impédance) dans
l’oreille moyenne
b. Calculer la puissance surfacique en dB d’une énergie sonore dont l’onde
équivaut à 10-4 w/m2
3. Un sujet anormal présente :
- Le diamètre de la membrane tympanique = 6mm
- Le rayon de la fenêtre ovale (en considérant que les bords sont
sphériques) = 1mm
- La longueur du manche du marteau = 0.3 cm
- La longueur de la longue apophyse = 1/3 de la longueur du manche
a. Calculer le coefficient de pondération
b. Calculer l’intensité en dB d’une énergie sonore de 10-5 w/m2
c. Est-ce que cette énergie peut entrainer le reflexe stapédien
d. Calculer l’énergie sonore qui se trouve à la porte de la rampe vestibulaire
Bon Travail à vous
Docteur ASSANI BENKITA TRESOR
Vous aimerez peut-être aussi
- Med Leg Séance Prof LebwazeDocument32 pagesMed Leg Séance Prof LebwazePierre muteb chiratPas encore d'évaluation
- PDF Sémiologie Neurologique D1 (2020-2021)Document224 pagesPDF Sémiologie Neurologique D1 (2020-2021)Pierre muteb chiratPas encore d'évaluation
- Chapitre 2 MT Principaux Systèmes Thérapeutiques TraditionnelsDocument16 pagesChapitre 2 MT Principaux Systèmes Thérapeutiques TraditionnelsPierre muteb chiratPas encore d'évaluation
- Cours de Déontologie MédicaleDocument108 pagesCours de Déontologie MédicalePierre muteb chiratPas encore d'évaluation
- Document MutebDocument2 pagesDocument MutebPierre muteb chiratPas encore d'évaluation