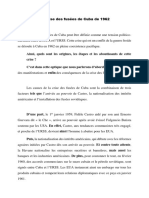Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Causes Lointaines Guerre PDF
Causes Lointaines Guerre PDF
Transféré par
lepoulpTitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Causes Lointaines Guerre PDF
Causes Lointaines Guerre PDF
Transféré par
lepoulpDroits d'auteur :
Formats disponibles
Andr Chradame (1925)
Les causes lointaines de la guerre
Ouvrage accompagn dune carte
Un document produit en version numrique par Jean-Paul Murcia, bnvole, professeur de philosophie, titulaire-remplaant rattach au Lyce Montchapet Dijon Courriel : j.p.murcia@free.fr Dans le cadre de la collection: "Les classiques des sciences sociales" Site web: http://www.uqac.uquebec.ca/zone30/Classiques_des_sciences_sociales/index.html Une collection fonde et dirige par Jean-Marie Tremblay, professeur de sociologie au Cgep de Chicoutimi. Une collection dveloppe en collaboration avec la Bibliothque Paul-mile-Boulet de l'Universit du Qubec Chicoutimi Site web: http://bibliotheque.uqac.uquebec.ca/index.htm
Andr Chradame (1925), Les Causes lointaines de la Guerre
Cette dition lectronique a t ralise par Jean-Paul Murcia, bnvole, professeur de philosophie, titulaire-remplaant rattach au Lyce Montchapet Dijon. : j.p.murcia@free.fr partir de :
Andr Chradame (1925) Les causes lointaines de la guerre
Une dition lectronique ralise partir du livre dAndr Chradame, Les causes lointaines de la guerre. vreux (Eure) : Imprimerie Ch. Hrissey, 1925, 164 pages. Polices de caractres utilise : Pour le texte: Times, 12 points. Pour les citations : Times 10 points. Pour les notes de bas de page : Times, 10 points. dition lectronique ralise avec le traitement de textes Microsoft Word 2001 pour Macintosh. Mise en page sur papier format LETTRE (US letter), 8.5 x 11) dition complte le 5 septembre 2003 Chicoutimi, Qubec.
Andr Chradame (1925), Les Causes lointaines de la Guerre
Table des matires
Prface Chapitre I Comment quelques Franais se sont efforcs d'tablir la responsabilit de la France dans la Guerre I. La Victoire de M. Fabre-Luce. II. La campagne de la revue Europe. III. MM. Ernest Judet et Georges Louis. IV. M. Caillaux sur l'origine de la guerre. Chapitre II La France n'a aucune responsabilit dans la Guerre I. La seule hypothse dans laquelle on peut supposer que la France n'aurait pas t entrane dans la lutte est absurde. II. Les faits rappels et les documents produits par M. Charles Humbert, rapporteur de la commission de l'arme au Snat en 1914, avant la guerre, dmontrent aussi nettement que possible le caractre agressif des armements de l'Allemagne depuis 1906. III. Des hommes d'tat britanniques, bien placs pour avoir su la vrit, M. Winston Churchill et Lord Grey, reconnaissent que la France a fait tout ce qu'elle a pu pour viter la guerre. Chapitre III Raisons fondamentales des erreurs de jugement de ceux qui dclarent que la France a une part de responsabilit dans la guerre I. Ils ne tiennent aucun compte des faits antrieurs mme quand ces faits tablissent de la faon la plus nette les intentions agressives austro-allemandes. II. Notamment, ils ne font aucune allusion aux tentatives d'emprunt, sur le march de Paris, cependant rvlatrices, faites en 1909 et en 1911 par les gouvernements hongrois et austro-hongrois. III. Ils ne ralisent pas l'importance capitale pour la paix du monde de l'indpendance de l'Europe centrale slave et latine. Chapitre IV Les conditions raliser pour discerner les vritables causes de la guerre I. Il ne faut pas chercher soutenir une thse, mais dgager la vrit que rvlent les faits essentiels. II. Pour trouver les vritables origines de la guerre, il faut remonter assez loin.
Andr Chradame (1925), Les Causes lointaines de la Guerre
Chapitre V
Les deux grandes raisons lointaines de la guerre I. Le pangermanisme. Le gouvernement de Berlin initiateur du plan et de la propagande pangermaniste. Le peuple allemand en accueillant avec une faveur toujours plus marque le programme allemand de domination universelle s'est rendu responsable lui aussi du cataclysme mondial. II. Le pacifisme. Pourquoi il est indispensable de montrer nettement le pril pacifiste. Preuves que j'attaque les pacifistes exclusivement dans l'intrt d'une paix vraiment durable. La politique pacifiste avant la guerre des pays de l'Entente. Comment les pacifistes ont prpar la Pangermanie. Le pacifisme procde d'une profonde ignorance de l'tranger et particulirement de la psychologie allemande. Le pacifisme avant 1914 tait tel chez les grandes puissances que si elle n'avait eu tenir compte que de celles-ci l'Allemagne aurait pu accomplir peu peu son expansion pangermaniste sans avoir besoin de faire la guerre.
Chapitre VI
Slavo-Latins et Germano-Magyars en Autriche-Hongrie avant la Guerre I. Diffrences capitales entre l'tat de la dmocratie en Occident et en Europe centrale. II. L'intrt europen des crises autrichiennes ds 1897. III. Les races en prsence en Autriche. IV. Pourquoi au point de vue europen, la rivalit des races prsente plus d'importance en Bohme que dans le reste de l'Autriche. La Bohme stratgique. Tchques et Allemands. V. La lutte propos des ordonnances sur les langues de 1897 marque les dbuts du Pangermanisme en Autriche. VI. La propagande croissante en Autriche des socits inspires de Berlin et ses rsultats ds 1897. VII. Situation intrieure gnrale de la monarchie des Habsbourg la veille de la guerre.
Conclusions Carte Les nationalits en Autriche-Hongrie
Andr Chradame (1925), Les Causes lointaines de la Guerre
ANDR CHRADAME
Les
Causes lointaines
de la Guerre
Ouvrage accompagn d'une Carte.
IMPRIMERIE CH. HRISSEY, 1925 vreux (Eure) France
Retour la table des matires
Andr Chradame (1925), Les Causes lointaines de la Guerre
Les causes lointaines de la guerre (1925)
Prface
Le 15 aot 1925
Retour la table des matires
Depuis longtemps, je veux publier une dmonstration documente des vritables causes de la guerre mondiale. Si trange que cela soit, en 1925, sept annes aprs l'armistice, les vritables causes du prodigieux conflit qui ensanglanta l'Europe sont encore fort mal connues. La preuve en rsulte, d'ailleurs, des grandes erreurs stratgiques de l'Entente pendant la guerre et de ses fautes politiques depuis la paix, fautes et erreurs aujourd'hui reconnues et amrement dplores par un nombre croissant des citoyens des pays allis. En effet, c'est essentiellement pour n'avoir pas exactement compris pourquoi l'Allemagne a fait la guerre, son objectif essentiel ayant t d'tablir son contrle sur l'Europe centrale, que les Allis n'ont pas ds le dbut dcouvert comment il fallait conduire la guerre pour vaincre vite l'Allemagne en faisant obstacle la partie principale de son plan. Si celle-ci avait t bien ralise Paris et Londres, les allis auraient organis au plus vite l'expdition Salonique-Vienne-Prague-Berlin qui, en outre, tait l'opration la plus propre mettre fin la pression allemande sur le front occidental, comme on finira bien par s'en persuader.
Andr Chradame (1925), Les Causes lointaines de la Guerre
De mme, si les dirigeants de la France avaient saisi, ds l'armistice, l'importance extrme pour l'avenir de la Paix et de la France, des tats slaves et latins de l'Europe centrale que la victoire allie venait de constituer ou d'agrandir, ils n'auraient pas admis que la Pologne, la Tchcoslovaquie, la Roumanie, la Yougoslavie et la Grce fussent sottement qualifies de pays intrts limits et ils auraient tenu avec nergie ce que les reprsentants de ces pays fussent constamment admis dans les grandes confrences de la paix, sur le mme pied que les autres puissances. Cette attitude de la France aurait suffit lui assurer la majorit dans les confrences et, aujourd'hui, elle n'aurait pas dplorer l'effroyable duperie dont elle a t victime pour s'tre livre, avec une inconcevable navet, MM. Wilson, Lloyd George, etc., aprs avoir cart d'elle, dans toutes les runions dcisives, ses fidles allis et amis de l'Europe centrale. L'tablissement des vritables causes de la guerre n'est donc pas seulement intressant pour l'intelligence historique du pass, il a, en outre, une importance capitale pour la comprhension du prsent et la prparation de lavenir. Mais j'ai attendu, pour produire mes preuves et arguments, le moment o leur action pourrait tre particulirement utile, c'est--dire, la priode o se trouverait en pleine volution vers le succs la manuvre allemande qu'au dbut de 1922 j'annonais en ces termes dans La Mystification des Peuples Allis, p. 259 : L'ide que l'Allemagne n'est pas seule responsable de la guerre a t lance surtout aprs que l'Allemagne eut obtenu par les accords de Londres (mai 1921) que sa dette ft fixe un chiffre relativement trs bas. Une fois ce rsultat assur, l'objectif des Allemands a t de ne plus rien payer du tout. En consquence, ils ont fait rpandre dans les pays allis l'ide que, tout bien considr, l'Allemagne n'est pas la seule responsable de la guerre. Le rsultat escompt de cette propagande est que, une fois admise l'ide que les responsabilits doivent tre partages, l'Allemagne ne doit pas tre seule payer les rparations. Si elle doit de ce chef, la France aussi lui doit. Par consquent, les deux dettes s'annulent finalement et conomiquement l'Allemagne gagnera la partie. Au dbut de 1925, cette manuvre allemande est en plein dveloppement dans tous les pays du monde. Dans une interview publie le 21 avril 1925, par le British United Press, le marchal Hindenburg, quelques jours avant d'tre lu Prsident du Reich, proclamait : L'Allemagne doit tre lave des mensonges rpandus sur les responsabilits de la guerre. Le moment est donc venu de publier ma dmonstration, afin de constituer l'arsenal de faits et d'arguments o pourront puiser ceux qui voudront rtablir la vrit. Le sujet est si tendu et si complexe qu'il demande tre expos en deux livres distincts. Le premier, celui-ci , expose Les Causes lointaines de la Guerre, c'est--dire celles qui, de 1895 1912, ont engendr virtuellement le conflit.
Andr Chradame (1925), Les Causes lointaines de la Guerre
Un second ouvrage, La Cause immdiate de la Guerre, dmontre que c'est essentiellement la volont des Germains de Vienne et de Berlin de dtruire les rsultats des guerres balkaniques de 1912-1913, consacrs par le Trait de Bucarest du 10 aot 1913, rsultats rendant impossible la ralisation du Pangermanisme, qui dchana la lutte mondiale. Mheudin par Ecouch (Orne). Le 15 aot 1925.
Andr Chradame (1925), Les Causes lointaines de la Guerre
Les causes lointaines de la guerre (1925)
Chapitre I
Comment quelques Franais se sont efforcs dtablir la responsabilit de la France dans la guerre
Retour la table des matires I. La Victoire de M. Fabre-Luce. II. La campagne de la revue Europe. III. MM. Ernest Judet et Georges Louis. IV. M. Caillaux sur l'origine de la guerre.
La manuvre allemande tendant convaincre l'opinion universelle que l'Allemagne n'est pas seule responsable de la guerre a fait des progrs d'autant plus rapides qu'elle a t puissamment aide dans le pays o on aurait pu croire un pareil concours impossible, c'est--dire en France. Assurment, aucun Franais d'une autorit morale reconnue n'a soutenu la thse de la culpabilit de la France. Ceux qui n'ont pas hsit l'appuyer, au contraire, gnralement avaient vu dj, pour des raisons diverses, leur autorit srieusement conteste. Il est cependant ncessaire de rappeler avec prcision ce qu'ils ont dit en raison du concours qu'ils ont prt la propagande allemande et afin d'tablir comment des affirmations odieuses et de pauvre valeur ont, cependant, pu se produire devant l'opinion publique en raison de la lamentable inertie d'une trop grande partie de celle-ci.
Andr Chradame (1925), Les Causes lointaines de la Guerre
10
I
La Victoire de M. Fabre-Luce
Retour la table des matires
M. Ernest Renauld dans son Histoire populaire de la Guerre 1914-1919 et M. Gouttenoire de Toury dans son livre : Poincar a-t-il voulu la guerre ? ont commenc la campagne tendant tablir que la France a une part de responsabilit dans l'clat de l'effroyable lutte. Elle a t continue, d'une faon plus mthodique, dans le livre La Victoire de M. Alfred Fabre-Luce, fils du vice-prsident du Crdit lyonnais. Je ferai de larges citations de cet ouvrage, non pas certes cause de sa valeur, mais en raison du parti qu'en ont tir les adversaires de la France. Le livre de M. Fabre-Luce constitue, en effet, le rquisitoire le plus complet qu'un cerveau systmatique puisse dresser, en ratiocinant sur le sens possible des dpches et pices diplomatiques changes avant la lutte, pour dmontrer la responsabilit de la France dans la guerre. L'Allemand le plus minutieux et le plus haineux serait difficilement arriv dresser un tableau plus tendancieux contre la France. M. Alfred Fabre-Luce a positivement la monomanie du culpabilisme de son pays. Cette forme de nvrose ayant pris un caractre presque pidmique dans les milieux pacifistes des pays qui furent allis, il est, au surplus, ncessaire d'en tudier la manifestation morbide au moyen d'un examen suffisamment approfondi du livre de M. Fabre-Luce. Pour M. Fabre-Luce, la France a provoqu l'Allemagne bien avant 1914. Du ct franais, c'est l'imprudence de Delcass qui a donn le dpart vers la guerre. A une saine politique d'ententes mditerranennes, ce ministre imprima une direction anti-allemande qui ne lui tait aucunement essentielle. Ngocier la question marocaine en dehors de l'Allemagne, acheter notre protectorat toutes les puissances maritimes de l'Europe, en affectant d'ignorer celle dont nous dpendions le plus, lui opposer systmatiquement les prcdents de son ancienne tradition continentale, que ses progrs rendaient prims, c'tait adopter une attitude qui ne pouvait se justifier que par un refus de reconnatre l'avnement de l'Allemagne comme puissance mondiale, et devait ncessairement tre sentie par elle comme une insulte . (v. op. cit., p. 259.) Les provocations de Berlin entraient dans le plan franais et on tait prt les dterminer par des piges . (v. op. cit., p. 268.) Mais entre temps, il y a le coup d'Agadir, voici encore une apparition brillante de la force allemande. Mais, le geste est-il sans prtexte? Il vient
Andr Chradame (1925), Les Causes lointaines de la Guerre
11
aprs un long silence de la France succdant une violation des accords signs . (v. op. cit., p. 125.) M. Fabre-Luce expose comme il suit que dans l'affaire du Maroc, la France n'a pas agi de bonne foi. Si l'on compare l'enchanement des faits tels qu'ils se dgagent des documents et des tmoignages avec les commentaires quotidiens des journaux de l'poque, on verra qu'en toutes ces occasions l'opinion franaise a t induite en erreur par une altration systmatique des faits. Cette infidlit de la chronique l'histoire a t particulirement marque en 1911. La presse a laiss croire au pays que l'Allemagne avait depuis 1909 renonc tous ses droits sur le Maroc et a affect de considrer sa protestation de 1911 comme une rclamation sans fondement, une simple provocation; puis elle a dnonc le march conclu comme une humiliation. Dj se dveloppait alors la manuvre qui allait mener en 1914 prsenter les dmarches de l'Allemagne Paris et Ptrograd (le 25 et le 29 juillet) comme des ultimatums. Dj se mlait au rcit des ngociations le langage de la guerre. Et le foss qui sparait les peuples s'en creusait chaque jour davantage . (v. op. cit., p. 128). Cette attitude de la France fut d'autant plus coupable que, d'aprs M. Fabre-Luce, la placide Allemagne faisait avant la guerre, preuve d'une remarquable modration. L'Allemagne n'a pas pratiqu la politique d'extension que ses moyens lui permettaient . (v. op. cit., p. 83.) L'action personnelle de l'Empereur (Guillaume II) sur la politique de son pays a t souvent reprsente avec exagration. Sans doute, ses manifestations brillantes ont eu beaucoup de retentissement en Europe et aggrav des situations difficiles. Mais si nous considrons plutt les actes que les expansions verbales, nous verrons que dans la plupart des circonstances importantes, Guillaume a bien t, comme le dit Schoen, un souverain strictement constitutionnel . (v. op. cit., p. 196.) Le trait de Bjorkoe, dj, est une tentative indirecte d'imposer l'alliance la France (il doit jouer contre elle, si elle n'y adhre pas). La manuvre de 1905 tend plus imprieusement au mme but. Pourtant, le Kaiser ne dsire pas aller jusqu' la guerre. Il trouve plus glorieux, plus moderne, plus conforme son ambition, d'tre l'empereur de la paix que l'empereur de la Victoire . (v. op. cit., p. 197.) Si la Russie est devenue belliqueuse, la faute en est pour une bonne part la France, nous apprend M. Fabre-Luce : Et le changement qui s'est produit Berlin pendant les derniers mois de l'avant-guerre s'est opr en rponse une volution de la politique franco-russe. (v. op. cit., p. 270.) Si la politique franaise de resserrement des alliances avait t conduite dans une intention de paix, il faudrait donc encore la dnoncer comme singulirement maladroite pour avoir cr Berlin tous les documents nous
Andr Chradame (1925), Les Causes lointaines de la Guerre
12
le dmontrent la conviction sincre que la Patrie tait en danger . (v. op. cit., p. 271.) Pour M. Fabre-Luce, en 1914, la douce Allemagne est tombe dans un pige, beaucoup plus qu'elle n'y a fait tomber les autres. Ainsi la politique de l'Allemagne a t fonde sur une double mprise (au moment du meurtre de Franois-Ferdinand) elle croit que la Triple Entente cdera, elle croit que s'il n'en tait pas ainsi, elle pourrait encore exercer temps sur l'Autriche une action conciliatrice. (v. op. cit., p. 35.) ce moment, Bethmann-Holweg a toutes les raisons de croire que le dsintressement autrichien est sincre et que la Russie s'en contentera . (v. op. cit., p. 38.) En ralit, il y a depuis le dbut entre l'Autriche et l'Allemagne un malentendu sur le but poursuivre et sur la porte de l'approbation allemande. (v. op. cit., p. 42.) Pour M. Fabre-Luce, M. Delcass et surtout M. Poincar sont les grands responsables de la guerre. C'est leur faute si : la France dsirant former une ligue de dfense contre l'Allemagne n'avait runi qu'un syndicat de conqurants. (v. op. cit., p. 138). Le Quai d'Orsay, lui aussi, est coupable. Il tmoigne que s'il ne tolrait pas un nouvel Agadir, il ne craint pas du moins d'en imposer un l'Allemagne. (v. op. cit., p. 159). En somme, Poincar chaque controverse internationale tente la chance. S'il trouve les vents contraires, il attend une occasion meilleure; s'il espre des allis un courant favorable, il choisit une ligne diplomatique inflexible, il dclare la Russie qu'au cas o l'Allemagne n'y adhrerait pas, le mcanisme de l'alliance serait aussitt mis en jeu. En mme temps, il met profit le dlai que lui conseillent les vnements pour raliser la tche de propagande qu'il s'est assigne. Aussitt lu, il a parl Isvolsky de la ncessit de prparer l'opinion un conflit balkanique. Et, en effet, se succdent en 1913 et 1914 des symptmes significatifs : envoi de Delcass comme ambassadeur Ptersbourg accompagn d'une lettre personnelle de Poincar au tsar, indiquant que sa mission principale sera de veiller la collaboration franco-russe en Orient et la construction de chemins de fer stratgiques; discours officiels o des phrases quivoques sont accentues d'un ton provocant; campagne d'articles o l'arme russe est glorifie sans mesure. Enfin quotidiennement, l'ide de la scurit menace est utilise pour justifier une politique dont la premire consquence est de crer chez l'ennemi un sentiment analogue; il n'y a plus qu' attendre les manifestations, qui seront leur tour le point de dpart d'une nouvelle surenchre de nationalisme. Ainsi peut-on, de part et d'autre, entraner la grande masse silencieuse et pacifique qui ne sort de son apathie que si on lui montre le fantme d'un envahisseur. (v. op. cit., p. 166.
Andr Chradame (1925), Les Causes lointaines de la Guerre
13
Comme il l'a fait plusieurs reprises en 1912 et en 1913, dans des circonstances graves, Poincar promet au gouvernement russe la fidlit de la France ds le dbut de la crise et sans avertissement ni rserve, le librant ainsi du frein que pourrait constituer le contrle alli ; il donne l'action commune des deux diplomaties, dans un litige o la France n'est pas directement intresse, une base rigide dont le maintien en toutes circonstances doit accrotre les chances de guerre ; enfin, prvenu des rsolutions extrmes et prmatures que va prendre la Russie, il se borne lui donner des conseils qui peuvent peut-tre rendre son action plus efficace, mais non plus pacifique . (v. op. cit., p. 205.) Donc, pas d'quivoque possible sur l'attitude de Poincar Ptersbourg entre le 20 et le 23 juillet (1914). Sans possder aucun lment d'apprciation sur la nature des revendications autrichiennes et sur les intentions de l'Allemagne, il a pris une position de rsistance nergique laquelle il a donn un caractre dfinitif, et qu'en effet il ne modifiera pas d'une ligne jusqu' la fin. Une telle politique postule que la volont de l'adversaire est une force aveugle, incapable de revirements et de nuances, et lui enlve ainsi la tentation d'une volution pacifique. Ds lors, il y a bien peu de chances d'viter la guerre; et d'ailleurs, Poincar a laiss la Russie carte blanche pour la dchaner quand elle voudra, puisque Palologue, deux jours aprs son dpart et, suivant des instructions, promet Sazonof, sans aucune rserve, ds la remise de l'ultimatum autrichien, que la France remplira toutes ses obligations d'allie, puisque Viviani, qui voyage avec le Prsident dclare Nekludof Stockholm, le 25 juillet, que si c'est la guerre pour vous, ce sera, bien entendu, aussi la guerre pour nous . (v. op. cit., p. 209). D'ailleurs, les conseils donns par Messimy paraissent exprimer une mconnaissance des conditions de la mobilisation russe si extraordinaire qu'elle n'est pas vraisemblable. N'tant pas susceptibles d'aucune application pratique, ils se ramnent en fait une approbation de la mobilisation gnrale, et il faut supposer que le gouvernement franais avait seulement pour but de la favoriser tout en dgageant sa responsabilit. Le soir du mme jour (30 juillet), Palologue, simulant une obissance de Ptersbourg, tlgraphiait : Le gouvernement russe a rsolu de procder secrtement aux premires mesures de la mobilisation gnrale ce qui, vrai dire, n'a aucun sens, la mobilisation gnrale tant par dfinition un ordre public qui ne peut rester ignor. Le lendemain 31, il confirmait plus simplement : La mobilisation gnrale est ordonne. Mais le gouvernement franais a substitu cette phrase laconique un texte fictif et explicatif o il justifie la dcision russe par la mobilisation gnrale autrichienne et les prparatifs allemands . (v. cit., op. p. 212 ) Quant Viviani, il n'est pas moins coupable que Poincar; M. Fabre-Luce l'accuse nettement d' altrer les faits . Viviani antidate de deux jours la dcision allemande de mobilisation, postdate d'un la dcision russe afin de la faire apparatre comme une rponse aux mesures germano-autrichiennes. (V. op. cit., p. 26.)
Andr Chradame (1925), Les Causes lointaines de la Guerre
14
Si le Gouvernement russe s'est laiss engager dans la guerre, en ralit, la responsabilit pour M. Fabre-Luce en remonte, pour une part trs notable, au gouvernement franais. Priv de l'appui d'une rsistance franaise, le gouvernement de Ptersbourg s'est laiss entraner peu peu par un courant belliqueux. Le Tsar veut sincrement la paix. Mais comment attendre qu'il l'impose jusqu'au bout quand on connat son caractre fminin, versatile et la lgret avec laquelle il s'est laiss entraner dans la guerre russo-japonaise? (v. op. cit., p. 213.) En prsence d'une pareille attitude de la France, les braves gens de Berlin ne sont-ils pas excusables de s'tre laisss emporter par les vnements ? M. Fabre-Luce qui parat ignorer compltement que le gouvernement de Berlin, grce son ancien et considrable rseau d'espionnage en Russie, tait beaucoup mieux renseign que le Tsar lui-mme, nous assure avec srnit : Le gouvernement allemand a donc les plus grandes difficults apprcier le degr de la mobilisation russe. Il ne peut pas se fier aux dclarations de Ptersbourg, puisqu'il est inform par le tsar lui-mme, le 29, qu'on l'a tromp pendant cinq jours. Il est port juger la situation comme grave, car, s'il semble ignorer la solidarit absolue des mobilisations russes, il discerne pourtant qu'il s'agit d'un grand mouvement progressif, qui s'panouira en agression si on ne l'arrte pas ds l'origine. Qu'on se reprsente dans cette atmosphre l'tat d'esprit des dirigeants assigs de nouvelles alarmantes et contradictoires ; l'excitation qui rgne Berlin et se transmet aux ngociations, o la hte constitue par elle-mme un facteur de guerre ; l'ascendant que prennent en prsence du danger les chefs militaires sur le gouvernement, la coalisation de peur , de mfiance et d'orgueil qui se forme et vient paralyser les volonts pacifiques ; on aura la vritable physionomie de la situation. (v. op. cit., p. 216.) Et nous revenons ici la mobilisation partielle russe comme au phnomne capital, car c'est son progrs, mal distinct de la mobilisation gnrale, qui a donn aux militaires le prtexte et l'audace ncessaires pour essayer de tourner la position du chancelier . (v. op. cit., p. 219.) notre sens, il n'est pas douteux que le 29, au moment o il a reu la nouvelle de la mobilisation des treize corps russes, le gouvernement allemand voulait sincrement la paix, et en apercevait les moyens. Ce jour-l une occasion s'offrait que le Chancelier avait toujours attendue et que seul le progrs menaant de la mobilisation ennemie l'a empch de saisir. (v. op. cit., 222.) Pour hter l'intervention russe tout en assurant l'intervention anglaise, on (le gouvernement franais) a t jusqu' violer deux reprises la convention militaire de 1892. Elle stipulait que le signal des mobilisations devait tre donn par la Triplice : c'est la Russie qui prend l'initiative ; que les mobilisations russe et franaise devaient tre simultanes ; deux jours s'coulent entre l'une et l'autre. Si le gouvernement franais a ainsi, contre l'avis initial de Viviani, retard sa dcision, c'est pour pouvoir organiser une prestidigitation
Andr Chradame (1925), Les Causes lointaines de la Guerre
15
diplomatique. On sait Paris que la mobilisation russe entranera fatalement la mobilisation allemande bref dlai ; en laissant celle-ci prcder la mobilisation franaise, on lui donne l'apparence d'en tre la seule cause; on semble rester fidle l'esprit dfensif de la double alliance. Le dnouement tant dj acquis Ptersbourg, avant de l'enregistrer Paris, on lui cherche des motifs. Pour justifier son attitude, le Quai d'Orsay feint de n'tre inform de la dcision russe qu'avec trente heures de retard; quand il transmet enfin la nouvelle Londres, c'est en la prsentant comme une rponse la mobilisation gnrale autrichienne, qui est intervenue depuis. Et ceci permet Poincar d'crire le 31 au Roi George V : Nous avons nous-mmes, ds le dbut de la crise, recommand nos allis une modration dont ils ne se sont pas dpartis et de lui prsenter encore, une heure o il sait la guerre certaine, l'intervention anglaise comme un facteur de paix . (v. op. cit., p. 227.) La provocation diplomatique venait des empires centraux, mais elle ne crait pas de pril urgent; la provocation militaire n'tait pas entirement inattendue, mais elle obligeait l'Allemagne des contre-mesures immdiates. En ralit, l'Allemagne et l'Autriche ont fait les gestes qui rendaient la guerre possible : la Triple Entente a fait ceux qui la rendaient certaine . (v. op. cit., p. 232.) Ainsi l'Europe entire a mal rsist la guerre. Il n'est pas lgitime pourtant d'en conclure, comme le font certains, une galit des groupes. L'excuse des empires centraux, c'est seulement d'avoir laiss des chances la paix; la faute de l'Entente, c'est surtout de ne les avoir pas saisies. (v. op. cit., p. 238.) Si les fautes de l'Entente sont moins clairement apparues que celles de leurs adversaires, c'est souvent pour des raisons fortuites, et d'apparence. (v. op. cit., p. 240.) Ces citations abondantes permettent de se convaincre que je n'ai pas exagr. Elles prouvent que, tout en paraissant vouloir rester objectif, M. Fabre-Luce s'efforce, avec une tnacit de maniaque, mettre en lumire tout ce qui tendrait prouver la part de responsabilit des dirigeants de la France et toutes les causes d'excuses que pourrait invoquer l'Allemagne. Ces soi-disant dmonstrations sont, au fond, sans la moindre valeur, pour les raisons suivantes : M. Fabre-Luce s'imagine navement que, parce qu'il est diplm de l'cole libre des Sciences Politiques, licenci en droit, en histoire et en philosophie que, parce qu'il a t attach au Quai d'Orsay, l'ambassade de Londres et au Ministre de l'Intrieur, il est en mesure de nous exposer les causes de la guerre. Or, M. Fabre-Luce, n en 1899, n'avait que 25 ans quand il publia son livre en 1924. En somme, il se contente d'piloguer sur des textes et un petit nombre de faits; il est manifeste qu'il n'a pas voyag, qu'il ignore profondment le Pangermanisme, l'Europe centrale et orientale et les grands faits essentiels qui y sont ns et qui constituent les causes fondamentales et anciennes de la guerre. (v. Ch. V et VI.)
Andr Chradame (1925), Les Causes lointaines de la Guerre
16
En somme M. Fabre-Luce ne sait rien de ce qui est pourtant indispensable pour avoir le droit d'exposer les causes de la guerre. Mais, naturellement, ces lacunes fondamentales n'ont pas empch le livre de M. Fabre-Luce de servir considrablement la propagande allemande. Le plus anti-franais des Anglais, le Dr. Morel, avant de rendre au Crateur son me de germanophile irrductible, a fait traduire et distribuer profusion le livre de M. Fabre-Luce en Angleterre, afin d'y dvelopper l'hostilit contre la France. Ce rsultat ayant t largement obtenu, on ne saurait donc contester M. Fabre-Luce la ralit de ce succs !
II
La campagne de la revue Europe
Retour la table des matires
En novembre 1924, le Revue Europe continua la campagne tendant tablir la responsabilit de la France en publiant des extraits du carnet de notes de M. Georges Louis qui fut ambassadeur de France St-Ptersbourg jusqu'en 1912. Celui-ci, notamment, a assur que M. Stephen Pichon lui aurait dit : Ah ! si on vous avait laiss l-bas; si vous tiez rest ambassadeur Ptersbourg et si j'avais t aux Affaires trangres, nous n'aurions pas eu la guerre , et M. Louis aurait rpliqu : Certainement, vous au Quai d'Orsay et M. Fallires llyse, la guerre n'clatait pas. J'ai dit cela un grand nombre de fois. M. Georges Louis a attribu M. Cambon et M. Palologue des propos analogues ceux de M. Pichon, tendant tous faire considrer M. Raymond Poincar comme le principal responsable de la guerre. MM. Pichon, Cambon, Palologue ont dmenti formellement les paroles qu'on leur attribuait; mais, comme on peut aisment l'imaginer, la publication des affirmations de M. Louis n'en fut pas moins accueillie Berlin avec enthousiasme. La presse allemande dclara que la responsabilit de M. Poincar au sujet de la guerre tait dsormais tablie.
III
MM. Ernest Judet et Georges Louis
Retour la table des matires
Puis, la campagne reprit de plus belle au dbut de 1925, quand parut le livre de M. Ernest Judet intitul : Georges Louis. Pendant une longue dure, directeur du Petit Journal, puis de L'clair, dans les annes qui prcdrent la guerre, M. Judet, tait depuis longtemps, en conflit avec M. Clemenceau.
Andr Chradame (1925), Les Causes lointaines de la Guerre
17
Celui-ci, au pouvoir pendant la guerre, accusa M. Judet de menes proallemandes. Condamn par contumace, M. Judet demanda la rvision de son procs en 1923. II obtint du jury un acquittement. Constatons d'abord les affirmations de M. Judet, telles qu'il les a produites dans son livre. Nous les confronterons ensuite avec les faits, afin de les apprcier aussi exactement que possible. Pour M. Judet, de 1912 1913, trois acteurs de marque se coalisrent contre un seul adversaire, pour faire virer dangereusement la politique europenne : alors conspirrent ensemble Isvolsky, Sazonoff et, derrire le rideau, dans la pnombre, M. Poincar . (v. op. cit. p. 15.) M. Judet adopte avec une satisfaction manifeste le point de vue suivant de M. Louis. Poincar s'est fait l'instrument d'Isvolsky, et c'est ce dernier qui, en liant partie avec Tittoni, a dclar la guerre tripolitaine. De la guerre balkanique est sortie la guerre actuelle . (v. op. cit., p. 246.) Pour M. Judet, c'est M. Isvolsky, principalement, qui a dchan la guerre : Chaque fois qu'Isvolsky prouvait le besoin urgent de stimuler le zle de notre gouvernement, il recourait aux grands moyens avec un aplomb gal au charlatanisme. .... Il a eu sa guerre : il est mort enseveli sous les dbris de sa patrie. (v. op. cit., p. 54.) S'il a quitt Saint-Ptersbourg, s'il est ambassadeur, c'est pour agir plus vite et rayonner plus loin, gouverner plus srement l'Europe et mener, mme au prix d'une guerre gnrale, la Russie ses fins, aux Dtroits et Constantinople. C'est le rve de ses nuits, l'uvre de ses jours. . (v. op. cit., p. 55.) Il avait sur le cur la journe du 15 septembre 1908 dans le chteau de Buchlau, o, hte du comte Berchtold, un accord fut rgl par ses soins entre l'Autriche-Hongrie et la Russie hritires de l'empire ottoman. Le comte d'Aerenthal devenait libre d'annexer la Bosnie-Herzgovine conformment aux stipulations du trait de Berlin; en retour, il acceptait le libre passage des Russes aux Dardanelles. (v. op. cit., p. 148.) Isvolsky surgit point pour accomplir le vu imprial. Il se faisait fort de racheter par l'ouverture des Dtroits, par une conscration nouvelle Sainte-Sophie, la perte de Port-Arthur et de l'hgmonie en Mandchourie. (v. op. cit., p. 302.) La destruction de l'Autriche tait son objectif; il la boycottait Paris comme Saint-Ptersbourg. Il ne souffrait pas que l'Autriche conservt des relations ordinaires avec nous, et que Saint-Ptersbourg admt une solution moyenne des rvolutions balkaniques. (v. op. cit., p. 190.) M. Judet accuse, juste titre d'ailleurs, M. Isvolsky de s'tre cr, prix d'argent, une bonne presse en France; mais, nous verrons plus loin que cette accusation doit tre tendue d'autres diplomates trangers en France.
Andr Chradame (1925), Les Causes lointaines de la Guerre
18
Si nous nous dcidons effectivement soulever maintenant la question des Dtroits (disait M. Isvolsky dans une dpche son gouvernement), il est trs important de nous proccuper d'avoir ici une bonne presse . Or, sous ce rapport, je suis priv de l'arme principale... Un exemple de l'avantage qu'il peut y avoir dpenser ici de l'argent pour la presse nous est fourni par l'affaire de la Tripolitaine. Je sais que Tittoni a travaill les principaux organes franais d'une faon trs approfondie et avec une main trs gnreuse. Les rsultats sont vidents. (v. op. cit., p. 73.) Donc, pour M. Judet, M. Isvolsky a dchan la guerre; mais, M. Georges Louis l'aurait empche si M. Poincar l'avait laiss faire. M. Judet reproduit, comme l'expression de la vrit certaine, cette affirmation de M. Georges Louis : C'est l'Allemagne qui a dclar la guerre, mais c'est par la faute de notre Gouvernement qu'elle a pu la faire clater. Elle n'attendait qu'une occasion, parce qu'elle tait prte et qu'elle savait que ses adversaires ne l'taient pas. Nous aurions d tout faire pour dtourner ou retarder le coup qu'elle voulait frapper. Nous avons au contraire laiss les fauteurs de la guerre prparer de longue main l'occasion qu'ils dsiraient faire natre. (v. op. cit., p. 298.) M. Judet est persuad que Nicolas II a commis la faute de ne pas couter M. Georges Louis qui seul aurait pu sauver la Russie. Nicolas II ne se douta certainement pas que l'ambassadeur invit sa table allait emporter avec lui la paix du monde et le salut de l'Empire des Romanoff. (v. op. cit., p. 229.) Quant aux tendances de M. Georges Louis, M. Judet les dfinit en ces lignes entre lesquelles il faut savoir lire : Soucieux des intrts techniques de nos armes de terre et de mer en liaison avec les armes russes, il rpudiait les intentions suspectes qui conduisaient tt ou tard la conflagration gnrale. N'est-ce pas le premier devoir d'un gouvernement qui se respecte de rendre les conflits difficiles et les ruptures impossibles ? Ayons des troupes encadres et instruites, des gnraux manuvriers, un matriel neuf et de bonnes armes en parfait tat! Mais l'conomie d'une guerre vaut mieux que ses alas tant que la dignit est sauve et que le recours au canon ne s'impose pas. Si la diplomatie n'est qu'une succursale accessoire du ministre de la guerre, si elle ne s'interpose pas avant que les affiches de mobilisation soient sur les murs, avant que la poudre ait parl, elle abdique, elle cesse d'exister. Quand elle cde trop tt la parole aux baonnettes, elle nglige d'puiser des ressources, des forces qui priment jusqu' la dernire minute. Georges Louis ne consentit jamais dserter son idal de diplomate. Il travaillait la paix et non la guerre. (v. op. cit. page 134.) M. Georges Louis craignait que la Russie ne ft une politique provocante dans les Balkans, mais il a constat lui-mme combien Nicolas II tait cet gard prudent et mesur.
Andr Chradame (1925), Les Causes lointaines de la Guerre
19
Mon entretien avec l'Empereur a port principalement sur le conflit italo-turc et sur la situation des Balkans. Je m'tais d'abord rfr l'audience que Sa Majest m'a accorde en septembre dernier. C'tait une occasion de rappeler indirectement la mmoire de l'Empereur toutes les raisons que la Russie a fait alors valoir en faveur d'une politique prudente, dans l'intrt des deux pays allis. Sa Majest s'est montre convaincue de la ncessit pour les deux gouvernements de se garder de toute action spare, et d'unir leurs efforts afin d'carter toutes les questions qui pourraient compliquer le conflit actuel. (v. op. cit., p. 104). Mais cette constatation de son ami, M. Louis, ne suffit cependant pas M. Judet. Il persiste considrer toute action russe dans les Balkans comme ayant t inadmissible. Dans un toast au roi du Montngro, Nicolas II a dit : Le long dveloppement pacifique et la prosprit du jeune royaume, sous la direction de Votre Majest, trouveront jamais un vif cho, la sympathie fraternelle et, o il le faudra, un soutien de ma part et de celle de la Russie . (v. op. cit., p. 176.) M. Judet imprime en italique ce o il le faudra comme l'quivalent d'une provocation l'Allemagne. M. Judet manifestement s'imagine que rien ne se faisait dans les Balkans que sous l'instigation de la Russie. C'est, ainsi que, subitement, clate l'annonce du trait serbo-bulgare. C'tait le premier anneau de la chane qui constituera l'Alliance balkanique. (v. op. cit., p. 178.) Pour M. Judet, comme pour M. Louis, la France aurait d dtourner la Russie des Balkans et, surtout, s'abstenir d'y trouver elle-mme le moindre intrt. Il fait grief M. Poincar d'avoir admis en 1912, mme en principe, que la guerre pt tre une consquence de la politique de l'Autriche dans les Balkans o cependant manifestement elle s'efforait de frayer les voies au germanisme. Le 4-17 novembre 1912, Isvolsky, continue M. Judet, revenait la charge, redoublait d'insistance et enlevait l'adhsion qui lui tait si chre : ... M. Poincar m'a rpondu qu'il lui tait impossible de formuler, mme titre priv, la ligne de conduite de la France dans l'ventualit d'une intervention active de l'Autriche, avant que le Gouvernement Imprial lui ai fait part de ses propres intentions. C'est la Russie, me dit-il, qu'il appartient de prendre l'initiative dans une question dans laquelle elle est la principale intresse : le rle de la France est de lui prter son concours le plus effectif...
Andr Chradame (1925), Les Causes lointaines de la Guerre
20
En somme, ajoute M. Poincar, tout cela revient dire que, si la Russie fait la guerre, la France la fera aussi puisque nous savons que dans cette question, derrire l'Autriche, il y aura l'Allemagne..... (v. op. cit., p. 60.) Le langage de M. Poincar tait le bon sens mme; mais M. Judet ne l'admet pas, car il persiste croire que les guerres balkaniques de 1912-1913 ont t le fait de la Russie. Si le gouvernement de M. Poincar continue M. Judet n'a pas su avant le mois d'aot que la guerre tait au fond des contrats signs en dehors de nous par l'Italie avec la Russie et par les agents russes avec les tats balkaniques, c'est qu'il n'a pas cout son ambassadeur (M. Louis) et, en essayant de le briser, en le diminuant, en l'obligeant se dfendre lui-mme au lieu de continuer son travail d'information et de surveillance, il s'est priv de l'agent indispensable pour prvenir la guerre balkanique, lui barrer la route et empcher la guerre mondiale. Ds le mois de janvier, Georges Louis appelait l'attention sur la politique austro-russe-italienne dont Isvolsky tait l'inventeur et le metteur en scne. (v. op. cit., p. 169) En exposant cette opinion, M. Judet ne fait que reproduire celle de M. Louis qui affirmait pour M. Sazonoff comme pour M. Isvolsky, ce n'est ni en Chine ni en Perse, mais dans les Balkans que la Russie doit porter actuellement le principal effort de sa politique . (v. op. cit., p.175.) M. Louis et M. Judet croyaient qu'il suffisait pour l'obtenir de rclamer dans les Balkans le maintien du statu quo. Quoi de plus rationnel, de plus sage, de plus urgent pour la France et non moins pour la Russie, dont nous ne pouvions pas nous sparer sans folie et dont il ne fallait pas pouser la dmence ? C'tait parler d'or : mais Paris la politique en zigzag manque toutes les occasions de mener la barque europenne autrement qu' la gaffe. (v. op. cit., p. 183). C'est donc avec dlices que M. Judet cite M. Crozier, ex-ambassadeur Vienne, crivant dans la Revue de France, avril 1921 : Quand M. Poincar est arriv au pouvoir, il avait son sige fait. Lui et Palologue taient des balkaniques. J'tais Franais et Europen : je fus rappel. Alors j'crivis au Prsident du Conseil pour le mettre en garde contre sa politique, en soulignant que si, avec la mienne, on n'tait pas sr d'viter la guerre, on gardait du moins le choix de l'heure. (v. op. cit., p. 189.) La thse de M. Louis est ainsi rsume : II tait donc clair que, si nous ne pouvions rsister fortement sur le terrain marocain, nous devions tre trs prudents sur le terrain serbe. C'tait l que l'Allemagne avait intrt engager le conflit. Nous sommes tombs en 1914 dans le pige que nous avions su viter en 1909 . (v. op. cit., p. 297.) Notre intrt tait donc d'empcher la question balkanique de grossir, puisque l tait le pige o l'Allemagne comptait nous prendre. Dj en 1909,
Andr Chradame (1925), Les Causes lointaines de la Guerre
21
la guerre avait failli clater. Mais le Gouvernement franais d'alors avait vu le danger, et il s'tait empress de le conjurer en laissant entendre au Ministre des Affaires trangres de Russie que nous ne pourrions pas le suivre, s'il continuait envenimer l'affaire serbe. Malheureusement M. Isvolsky, devenu ambassadeur en France, put reprendre Paris son duel avec le Ministre des Affaires trangres d'AutricheHongrie, et, bien qu'avertis les hommes qui dirigeaient nos affaires en 1912 le laissrent irriter de plus en plus la plaie serbe qu'il entretenait depuis quatre ans aux flancs de l'Autriche. Nous ne menons pas, on nous mne. L'Imprialisme anglais vaut l'Imprialisme allemand. Le Panslavisme vaut le Pangermanisme. L'glise grecque vaut lglise catholique. (v. op. cit., p. 298.) Pour appuyer son attaque, M. Judet fait tat de l'hostilit, bien connue des initis, qui exista dans ses dernires annes entre M. Deschanel et M. Poincar. D'aprs M. Louis, M. Deschanel lui aurait dit : Poincar a dclench la guerre parce que les Troisannistes croyaient qu'il y avait intrt faire la guerre avant que les adversaires n'aient eu le temps de modifier la loi. Il faudra nous dbarrasser plus tard de ces hommes, civils et militaires, qui nous ont men l. On instituera de grandes enqutes sur les causes de la guerre. Vous serez interrog : car vous savez. Et vous rendrez en rpondant un grand service. (v. op. cit., p. 299.) Et M. Judet qui, aprs la guerre, vit souvent M. Deschanel ajoute : Sur les responsabilits de la guerre, il tait inpuisable et il ne se gnait gure dans l'expression de son aversion l'gard de Poincar. C'est pourquoi sans doute, le 27 fvrier 1915, il s'ouvrait Louis : L'anne dernire, en juin, il m'a offert le pouvoir aprs l'chec de Ribot. C'tait un pige. S'il me pousse bout, je dclarerai que jamais je n'accepterai le pouvoir avec lui. (v. op. cit. p. 300.) Enfin le bouquet nous est donn la fin du livre, Georges Louis, dans ces lignes par lesquelles M. Judet innocente le Kaiser : Dans cet croulement, je ne vois pas la duplicit de Guillaume II, plus de vingt-cinq ans pseudo-arbitre de la paix, et mu soudainement en matre de la guerre. J'y lis en toutes lettres la dbilit d'une pense qui a flchi quand elle devait tre le plus inflexible, d'un caractre qui s'abat comme un roseau peint en fer, la minute psychologique o il aurait d bousculer les flatteurs et les alarmistes. Instruit par son inoubliable grand-pre, ayant trac ses sujets leur route vers la mer, il est tomb dans la plus basse des embches continentales, et il s'est effondr. (v. op. cit., p. 309.) Passons maintenant la rfutation des affirmations de M. Judet. Je me trouve, personnellement, d'autant plus mme de le faire que, jadis, je l'ai beaucoup connu.
Andr Chradame (1925), Les Causes lointaines de la Guerre
22
J'entrai en rapport avec lui, il y a plus de 26 ans. Il tait alors le Directeur tout puissant du Petit Journal. Dans cette priode, M. Judet tait un de ceux qui incarnaient en France l'ide de la rsistance arme ventuelle l'Allemagne. Il ne manquait pas une occasion de prconiser toutes les prcautions qu'il convenait de prendre contre une attaque des troupes du Kaiser dans l'une quelconque des directions que menaait la conception berlinoise de domination allemande universelle. Je ne saurais donner une meilleure preuve de cet tat d'esprit qu'en reproduisant les lignes par lesquelles M. Judet prsenta, sous les initiales de sa signature, ses lecteurs, l'article de moi qu'il publia dans Le Petit Journal du 19 septembre 1899 pour y dnoncer le pril pangermaniste, article qu'il avait intitul : L'EMPIRE ALLEMAND, SON BUT POLITIQUE ET L'AFFAIRE DREYFUS Tandis que la France, absorbe par l'affaire Dreyfus, cessait de se gouverner elle-mme, abandonnant le soin de ses propres destines et, plus forte raison, devenant incapable d'exercer la moindre influence au dehors, l'empereur allemand surveillait et mettait profit notre catalepsie. Il avait d'abord la satisfaction de suivre nos dfaillances sans aucun danger, et il travaillait froidement en exploiter les avantages pour l'avenir. Le rle exact, la fois machiavlique et tentateur de l'Allemagne, durant ces deux dernires annes, nous a souvent chapp il est ncessaire que nous le connaissions. Guide par une pense constante d'gosme pratique, elle se rglait sur le dveloppement de nos divisions intrieures, qu'elle activait au besoin, pour obtenir par le dsarmement de la France la suppression de notre rivalit militaire, et offrir alors son amiti humiliante notre dfinitive impuissance. En cas de succs, elle aurait sans guerre gagn la partie qui l'inquite le plus et pourrait ensuite se livrer sans inquitude aux oprations fructueuses qui hantent l'imagination de Guillaume II. Il est proccup, juste titre, de l'avenir prcaire de l'Autriche-Hongrie, o la disparition de Franois-Joseph est synonyme de liquidation gnrale. Le Kaiser de Berlin veut tre libre de ses mouvements pour le jour de l'action o le pangermanisme rclamera l'extension de l'empire des Hohenzollern vers le sud. Il importe autant la France d'tre forte pour cette suprme chance qu'il serait utile l'Allemagne de nous savoir faibles et hors de la concurrence europenne. Le dveloppement de cette question brlante a t tudi avec soin par M. Andr Chradame, brillant laurat de l'cole des Sciences Politiques, charg de plusieurs missions l'tranger, qui lui ont permis de suivre attentivement le mouvement des ides et des vnements extrieurs. Il appartient cette jeune gnration de patriotes dont la forte intellectualit n'a
Andr Chradame (1925), Les Causes lointaines de la Guerre
23
pas t gte par l'pidmie dcadente dont nous avons dplor nagure l'pouvantable explosion. tous ces titres, nous recommandons nos lecteurs l'article suivant qui les initiera aux motifs inaperus de la conduite de l'empereur allemand vis-vis de nous, qui les clairera sur la valeur de faits et de paroles souvent mal comprises. Ils seront admirablement avertis de l'intrt pressant qui nous fait un devoir de remettre en ordre les affaires franaises en vue de ce qui se prpare, de ce qui nous menace de l'autre ct de nos frontires. E. J.
Ces opinions de M. Judet firent que, comme il est bien connu, il mena dans Le Petit Journal une campagne trs ardente contre les dreyfusards qu'il accusait de faire le jeu de l'Allemagne en affaiblissant le moral militaire de la France. Dans cette lutte, M. Judet estimait que tous les moyens taient bons. Je l'ai donc entendu, bien des fois, parler avec admiration de Mme Bastian qui, employe l'ambassade d'Allemagne de la rue de Lille, avait souvent procur des papiers de l'attach militaire allemand, Schwartzkoppen, aux agents du 2e bureau franais. Aussi, est-ce avec stupfaction que, dans son livre sur M. Louis, j'ai constat que M. Judet parlait avec indignation du danger de s'tre procur des documents l'Ambassade d'Allemagne par des voies qui n'taient pas trs rgulires. M. Judet, cet gard, dit en effet : Les documents verts que l'Allemagne sans doute prtendrait avoir t vols dans son ambassade, contrairement aux rgles de l'exterritorialit, auraient pu entraner, une fois publis, des demandes formelles d'explication, aggraves ensuite par une demande d'excuses et un ultimatum pour finir. (v. op. cit., p. 316.) Jusque vers 1898, M. Judet eut la pense tendue vers une guerre contre l'Allemagne qu'il considrait comme invitable, en raison de la politique expansive de celle-ci. Son esprit combatif songeait tellement cette lutte qu'il fit procder, avec une prface de lui, une rdition du livre fort remarquable du commandant Ardant du Pic : Le Combat. Puis, en peu de mois, au moment de la mission Marchand et de Fachoda, l'objectif de M. Judet changea brusquement. M. Judet utilisa alors la tribune du Petit Journal, qu'il avait son entire disposition, pour pousser le colonel Marchand devenir le champion, en France, de la lutte contre l'Angleterre. L'volution de M. Judet alla mme si loin que, lorsque le colonel Marchand revint de Chine, en 1902, aprs la guerre contre les Boxers en passant par l'Allemagne, il parut favoriser une entrevue du colonel Marchand avec le Kaiser que certains s'efforaient de prparer. Le colonel Marchand sut, par luimme, viter de tomber dans le pige que, pour ma part, je dvoilai dans La Voix nationale (15 et 17 aot 1902). A partir de cette poque, mes relations avec M. Judet s'espacrent considrablement. Chaque fois que je le rencontrais je constatais qu'il tait de plus en plus hant par l'ide fixe de voir se dchaner, contre l'Angleterre, une guerre de la France allie l'Allemagne. Il
Andr Chradame (1925), Les Causes lointaines de la Guerre
24
essaya mme de me convertir ce point de vue, en me faisant valoir cet argument : La France ne peut pas tirer grand'chose de l'Allemagne, tandis qu' l'Angleterre on peut prendre. M. Judet faisait ainsi allusion aux colonies britanniques qu'il croyait possible de partager avec l'Allemagne. Cette conception de M. Judet ne me paraissant tenir aucun compte des prparations agressives de l'Allemagne qui se multipliaient dans toutes les directions, ne pouvant le suivre, je cessai donc de le voir, avant mme qu'il devnt directeur de L'clair. Je ne le rencontrai plus que fort rarement, lorsque le hasard nous runissait, quand nous traversions ensemble la barrire de la Porte Maillot Neuilly que nous habitions galement. En ralit, lorsque, au nom de la paix, M. Judet s'indigne de ce que M. Poincar, sous la prtendue influence de M. Isvolsky, aurait rendu possible la guerre de 1914, M. Judet s'explique incompltement sur ses sentiments pacifiques. Ce qui l'exaspre, ce n'est pas le fait que la guerre, considre en gnral, ait eu lieu, ce qui irrite au fond M. Judet c'est que la guerre contre l'Angleterre ne se soit pas produite la place de celle contre l'Allemagne dont, partir de Fachoda, il n'acceptait plus l'ide pour des raisons que je n'ai jamais t mme de discerner clairement. Dans les affirmations de M. Judet, il n'y a qu'une phrase correspondant entirement la vrit. C'est celle consistant accuser M. Isvolsky, afin de favoriser sa politique, d'avoir fait le ncessaire pour avoir une bonne presse . la suite de la publication des documents Raffalowitch, par L'Humanit en dcembre 1923, j'ai moi-mme signal le fait la page 26 de mon livre Les vraies raisons du chaos europen, paru en fvrier 1924. Mais le fragment du rapport de M. Isvolsky cit par M. Judet (v. p. 23) tablit aussi que le diplomate russe n'tait pas seul coutumier du fait, puisqu'il dit nettement que M. Tittoni, ambassadeur d'Italie avait travaill les principaux organes franais d'une faon trs approfondie et avec une main trs gnreuse , dans l'intrt des buts particuliers de la politique italienne. La vrit entire est, d'ailleurs, encore plus pnible. Il y a bien d'autres trangers qui, avant la guerre, ne manquaient pas de faire ce qu'il fallait pour influencer de trop nombreux organes de la presse franaise. Ce funeste tat de choses s'est encore aggrav depuis l'armistice. Avant la guerre, cette influence trangre ne s'exerait gnralement sur des organes de la presse franaise que du fait d'tats ayant des intrts analogues ceux de la France. Depuis l'armistice, cette pudeur relative qui retenait les agents de la publicit de certains organes n'existe plus. Des lecteurs avertis ne peuvent plus douter que certains organes de la presse franaise acceptent maintenant de se laisser influencer par des puissances ayant des intrts les plus opposs ceux de la France. C'est d'ailleurs cet tat de choses criminel, je n'hsite pas le qualifier ainsi, qui explique que, constamment maintenant, sont proposes l'opinion franaise les solutions les plus absurdes mais les plus conformes aux intrts allemands.
Andr Chradame (1925), Les Causes lointaines de la Guerre
25
Cette situation est une rsultante des difficults de la presse et de la conception absolument errone de la presse consistant admettre que la publicit doit compenser l'insuffisance du rendement de la vente pour payer les frais d'un journal. Or, par suite d'une dformation professionnelle, favorise par la difficult des temps, de trop nombreux organes en sont arrivs considrer les informations de politique trangre, mme les plus tendancieuses, comme de la publicit commerciale dont ils peuvent recevoir le prix du plus offrant. Pour toutes ces raisons, les critiques de M. Judet au sujet de l'action de M. Isvolsky sur la presse franaise touchent beaucoup moins M. Isvolsky luimme que les agents de publicit d'une certaine presse qui, sans paratre s'en douter, en sont arrivs une conception de la publicit qui constitue un pril mortel pour la France. Quant aux rpliques que j'ai faire aux autres affirmations de M. Judet, elles doivent tre prcdes de cette observation gnrale. Mes longs rapports avec M. Judet et, surtout, les informations que j'ai rapportes de mes nombreux voyages, m'ont permis de faire progressivement la constatation suivante : M. Judet avait la passion de la politique trangre; mais, sous une forme doctrinaire. N'ayant jamais voyag l'tranger pour y faire des enqutes srieuses sur la situation, sa conception de la politique trangre tait entirement arbitraire; c'tait la conception Judet. Elle ne tenait aucun compte d'un nombre considrable de ralits dont il ignorait l'existence parce qu'il n'avait pas t mme d'aller suivre sur place l'volution des vnements. Aussi, quand les choses ne tournaient pas comme il l'aurait voulu, ce n'tait pas sa conception qui tait fausse mais c'taient les vnements qui avaient tort. Il rsulte de cet tat d'esprit que les apprciations de M. Judet, dans son livre sur M. Louis sont dnues de valeur parce qu'elles sont gnralement bases sur des erreurs techniques monumentales. Par exemple, M. Judet attribue M. Isvolsky le dchanement des guerres balkaniques de 1912 et 1913 pour servir le Panslavisme, alors que ces guerres en ont t justement la ngation. Le Panslavisme, alors qu'il n'existait plus depuis longtemps, est rest la bte noire de M. Judet ainsi que le prouvent ces citations : Elle (la tte de M. Louis) fut livre un forcen avide d'incendie de l'Europe (Isvolsky) pour se ddommager de ses pas de clerc ou de ses malchances, et un ministre genoux devant les injonctions insatiables du Panslavisme. (v. op. cit., p. 25.) Si nos rgiments de jeunes soldats, saigns blanc et indomptables, n'avaient pas tenu sur la Marne un quart d'heure de plus que ceux de Guillaume II nous aurions, nous aussi, disparu de la carte d'Europe, pour avoir lch la bride aux extrmistes du Panslavisme. (v. op. cit. p. 135.)
Andr Chradame (1925), Les Causes lointaines de la Guerre
26
Quand Isvolsky s'avisa d'tre l'homme d'tat du Panslavisme, il n'eut plus de repos qu'il n'et donn ses dsirs inassouvis leurs plus glorieux apaisement. (v. op. cit., p. 147.) Isvolsky s'tait fait un plan qu'il a men jusqu' sa guerre. Lorsqu'il adresse sa lettre du 4 novembre M. de Selves pour attirer la France dans le pige balkanique, il recevait d'une main les subsides de Tittoni, et brandissait de l'autre les foudres du Panslavisme sur la dcadence de l'Empire ottoman. (v. op. cit., p. 164.) En outre, le nom seul de Delcass tait un programme et ses tats de services comblaient de joie les Panslavistes. (v. op. cit. p. 207.) Or, depuis le Trait de San-Stphano (1878) qui termina la guerre turcorusse, la Russie avait d renoncer appliquer les conceptions panslavistes proclames jadis par Katkoff. Cette renonciation avait t prcisment la consquence des dsirs d'indpendance grandissants des peuples balkaniques, lesquels, une fois librs, n'entendaient pas du tout tre des satellites de la Russie. Mme en Bulgarie, le pays slave qui, cependant, devait le plus la Russie, un parti nettement russophobe s'tait cr. Enfin, contrairement ce que croit M. Judet, et ce qui est connu dans toute l'Europe centrale, l'entente des tats balkaniques en 1912 s'tait faite sans que la Russie ait eu besoin de la provoquer et cette entente s'tait conclue entre les tats balkaniques sur des bases radicalement opposes au panslavisme, ainsi qu'il est facile de le dmontrer. M. Judet s'imagine que les guerres balkaniques de 1912-1913 se sont dclenches sous l'influence de M. Isvolsky afin d'installer la Russie Constantinople. Cette explication ne tient pas debout. D'abord, M. Isvolsky tait bien loin d'avoir dans les Balkans l'influence que lui attribue M. Judet et, en fait, c'tait non pas la Russie mais les Balkaniques, Bulgares et Grecs qui, pensant se jouer mutuellement, voulaient s'installer Constantinople, la faveur des guerres balkaniques, la place de la Russie, prcisment parce que, depuis longtemps dj, la Russie avait d abandonner son vieux rve de prendre pied sur le Bosphore. Dans la guerre balkanique de 1913, la latine Roumanie joua un grand rle. Or, comment pourrait-on penser srieusement que ce fut en faveur du panslavisme puisque les Roumains ont une mfiance inne pour tout ce qui est russe ? Parmi les balkaniques de 1912-1913, il n'y avait comme vraiment sympathiques la Russie que les Serbes, mais les Serbes eux-mmes, d'ailleurs spars gographiquement de la Russie, n'taient pas des panslavistes, ils taient des russophiles, ce qui n'est pas du tout la mme chose puisque, prcisment, cette expression de russophile fut cre pour succder celle de panslaviste, qui, depuis longtemps, n'avait plus de raison d'tre ayant perdu toute signification pratique. Par consquent, la croyance de M. Judet qui tait aussi celle de M. Louis, que sous l'influence d'Isvolsky les guerres de 1912-1913 et celle de 1914 ont t une consquence du panslavisme est une simple absurdit.
Andr Chradame (1925), Les Causes lointaines de la Guerre
27
M. Judet et M. Louis commettent encore une lourde erreur d'apprciation lorsqu'ils disent qu'en 1914 la France aurait d avoir la mme attitude qu'en 1909, lors de l'annexion de la Bosnie-Herzgovine. M. Judet rappelle quelle fut l'attitude de la France en 1909 ce sujet pour l'en fliciter ainsi : Depuis 1870, l'Allemagne n'avait qu'une seule fois adress un ultimatum une des puissances de la Triple Entente : c'tait en mars 1909, quand la Russie avait encourag la rsistance que la Serbie opposait aux exigences de l'Autriche. Mais la France avait fait entendre Saint-Ptersbourg qu'il ne fallait pas pousser les choses jusqu'au point o la guerre pourrait clater. L'alliance avait t conclue pour la protection des intrts vitaux de la France et de la Russie; la question serbe n'tait pas pour la Russie une question vitale. Il convenait donc de ne pas s'engager fond dans cette affaire. Ces conseils furent entendus et le Gouvernement imprial, qui d'ailleurs reconnaissait que son arme et ses finances n'taient pas suffisamment reconstitues pour qu'il pt entreprendre une grande guerre, donna au Gouvernement serbe le conseil de ne pas prolonger sa rsistance. (v. op. cit., p. 296.) Mais, MM. Judet et Louis n'ont pas compris que, prcisment, ce fut la carte blanche donne par la France et la Russie en 1909 l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie au sujet de l'annexion de la Bosnie-Herzgovine qui incitrent l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie poursuivre la politique d'expansion qui suivit et recommencer en 1914, avec une audace accrue, une nouvelle agression contre la Serbie afin d'assurer la domination du germanisme dans tous les Balkans et le triomphe du Hambourg-Bagdad, l'armature essentielle du plan pangermaniste. MM. Louis et Judet n'ont pas ralis que ce sont prcisment les incessantes capitulations de la France et de la Russie devant l'Allemagne dans les 20 dernires annes qui prcdrent 1914 qui engagrent l'Allemagne tre toujours plus exigeante et faire des demandes finissant par tre si inacceptables pour les peuples que, fatalement, elles devaient finir par provoquer la guerre. On pouvait cependant aisment prvoir quoi devait aboutir la capitulation de la Triple Entente en 1909, lors de l'annexion de la Bosnie et de l'Herzgovine. La meilleure preuve que j'en puisse donner consiste reproduire, sans y changer une virgule, les articles que je publiai ce moment dans Le Petit Journal, alors que le directeur tait, non plus M. Judet, mais M. Jules Prvet, snateur et vice-prsident du Snat. Sous le titre : quoi tient la dernire chance de paix, j'crivais le 20 mars 1909 : La dmarche de la France, de l'Angleterre et de la Russie Belgrade constitue la dernire chance de paix. C'est l'action de ces trois puissances que l'Europe devra peut-tre de s'arrter encore une fois sur les bords de l'abme. Tous les peuples leur sauront un gr infini de ce dernier effort s'il est couronn de succs ; mais ce rsultat considrable qu'il faut souhaiter, le maintien de la paix , ne saurait empcher de signaler et de dplorer quel prix il va sans doute tre atteint. En effet, si la paix est maintenue, ce sera, en ralit, au prix d'une lamentable faillite du droit international. Rien de plus vrai comme on va voir.
Andr Chradame (1925), Les Causes lointaines de la Guerre
28
Si la dmarche de la France, de l'Angleterre et de la Russie aboutit finalement, ce sera uniquement parce que cette dmarche a pour consquence de conseiller la Serbie de dclarer qu'elle ne songe pas protester contre le rcent trait austro-turc, ce qui contient implicitement l'adhsion l'annexion de la Bosnie et de l'Herzgovine non seulement de la Serbie, mais de l'Angleterre, de la France et de la Russie. Or, cette adhsion n'est rien moins que la reconnaissance, pralable toute confrence, de la violation formelle du trait de Berlin faite par l'Autriche-Hongrie, violation que l'Angleterre dclarait nagure et cela tombait sous le sens commun ne pouvoir tre ratifie que dans une confrence runissant tous les signataires du trait de Berlin. Nous nous trouvons donc bien en prsence d'une faillite incontestable du droit international dont on nous vantait les rapides et profonds progrs au moment des confrences de la paix la Haye. Une fois de plus ainsi les assurances des rhteurs sont dmenties par les faits, une fois de plus la Force prime le Droit et triomphe, et si la paix est conserve ce sera au prix de la reconnaissance par l'Europe de la rupture possible et clatante d'un contrat par une seule des parties contractantes. Quant l'Allemagne, qui approuve et appuie l'Autriche dans la violation de sa parole, quel document, quel contrat, quelle signature pourra-t-elle dsormais invoquer contre nous s'il nous plat un jour de dchirer le Trait de Francfort ? A. C. Pour souligner mieux encore les dangers pour la paix de cette capitulation, dans Le Petit Journal du 27 mars 1909, je publiai encore sous le titre : LA VRITABLE PORTE DU CONFLIT AUSTRO-SERBE Les dplorables agitations intrieures qui dsorganisent la France et menacent mme ses communications avec l'tranger l'empchent de saisir l'importance capitale et la porte europenne et mme universelle du conflit austro-serbe. Le plus grand nombre de Franais s'imaginent, en effet, que tout finira certainement par s'arranger pacifiquement et qu'en tout cas le conflit se rduit une querelle entre Vienne et Belgrade. Rien n'est malheureusement ni moins certain ni moins exact, car, en ralit, la question serbe n'est qu'un prtexte comme hier le Maroc la lutte ardente et profonde qui se livre entre le germanisme dirig de Berlin avec le concours et la complicit du cabinet de Vienne et l'Angleterre qui, avec l'appui de la France et de la Russie, cherche s'opposer l'hgmonie allemande en Europe et dans le monde. ***
Andr Chradame (1925), Les Causes lointaines de la Guerre
29
Les lecteurs du Petit Journal ont t si exactement renseigns sur les phases locales du conflit austro-serbe, qu'ils sont maintenant tout fait mme d'apprcier la signification grave de l'intransigeance de M. d'Aehrenthal, qui tient absolument, avant de consentir la paix, l'humiliation publique de la Serbie en la contraignant reconnatre, avec le concours de la Russie, de l'Angleterre et de la France, non plus seulement implicitement, mais d'une faon formelle et immdiate, l'annexion de la Bosnie et de l'Herzgovine ralise en violation flagrante du trait de Berlin, pacte europen. Rien, d'ailleurs, ne saurait mieux montrer la porte europenne du conflit austro-serbe que cette tactique de M. d'Aehrenthal travaillant associer les gouvernements de Saint-Ptersbourg, de Londres et de Paris la capitulation serbe. Comme nous croyons profondment qu'en politique trangre un peuple a toujours intrt connatre la vrit vraie le plus tt possible, nous ne voyons aucune raison de dissimuler le grand succs qu'est en train d'obtenir M. d'Aehrenthal. M. Isvolsky vient, en effet, de dclarer l'ambassadeur d'Autriche Saint-Ptersbourg que la Russie reconnat ds maintenant l'annexion de la Bosnie et de l'Herzgovine comme un fait accompli. Ne jouons pas sur les mots. Cette dclaration, faite en de pareilles circonstances, constitue la plus grave dfaite diplomatique que la Russie ait subie depuis la guerre russo-japonaise. Cette dfaite atteint, en outre, incontestablement l'Angleterre et la France qui avaient agi de concert avec la Russie Vienne. *** Cette humiliation des trois puissances de la Triple Entente suffira-t-elle, d'ailleurs, maintenir la paix? On peut craindre que non, car M. d'Aehrenthal pouss de Berlin voudra peut-tre, malgr les concessions excessives qui lui sont faites, mettre la main sur la Serbie. Dans ce cas, l'occupation militaire aura lieu trs bref dlai. Alors les dangers qui menaceront la paix de l'Europe auront rarement t plus grands. La Bulgarie verra dans cette occupation une menace directe de son indpendance, et le gouvernement de Ptersbourg, en dpit de son esprit pacifique, sincre et profond, ne pourra peut-tre plus retenir ses masses slaves exaspres par l'humiliation et la ruine de la politique sculaire russe dans les Balkans. Dans ce cas, l'entre en ligne de l'Allemagne est certaine, et par voie de consquence celle de l'Angleterre et de la France qu'on ne conoit mme pas pouvoir rester en dehors d'une conflagration vraiment europenne.
Andr Chradame (1925), Les Causes lointaines de la Guerre
30
Vous voyez donc comment, par une srie d'enchanements maintenant faciles discerner, la question austro-serbe n'est qu'un prtexte la lutte entre Berlin et Vienne d'une part, et Londres, Ptersbourg et Paris de l'autre, comment par consquent nous devrions prter la plus grande attention un conflit qui nous associe dj une dfaite diplomatique retentissante et nous menace encore d'une conflagration europenne. A. C. Qui pourrait maintenant contester que la guerre europenne de 1914 n'ait clat exactement selon ces prvisions de 1909? MM. Louis et Judet commettent encore une erreur monumentale lorsqu'ils prtendent que MM. Isvolsky et Poincar ont dtermin les guerres balkaniques de 1912-1913 ou que l'action de M. Louis aurait pu certainement en empcher l'clat. En ralit, les guerres de 1912-1913 sont rsultes de la volont des peuples balkaniques eux-mmes, voulant passionnment assurer leur avenir et leur libert qu'ils sentaient de plus en plus menacs, depuis que l'annexion de la Bosnie-Herzgovine leur avait dmontr tous les dangers du pangermanisme et du Hambourg-Bagdad. Ni M. Poincar, ni M. Isvolsky, ni le Tsar n'ont eu d'influence dcisive sur les vnements de 1912-1913 ; car, comme je l'ai expos avec pices l'appui dans Le Correspondant du 14 mai 1914, les Balkans se sont transforms en 1913, malgr l'Europe, aussi bien malgr la France, l'Angleterre et la Russie dont les Balkaniques avaient mesur la faiblesse en 1909, que malgr l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie. M. Judet prtend que la Russie pouvait exercer un droit de veto qui ne fut pas lanc ou que les Balkaniques passrent outre. (v. op. cit., p. 195.) Trs certainement, en effet, le veto de la Russie n'aurait pas arrt les Balkaniques; mais prcisment parce que la Russie n'avait plus et beaucoup prs dans les Balkans l'influence que lui attribue M. Judet. Je fus frapp de cette diminution de l'influence russe lors des nombreux voyages que je fis dans les Balkans; mais M. Judet, comme M. Louis, ignoraient cet tat de chose parce qu'ils n'avaient pas t mme de le contrler personnellement et directement. En somme, les critiques de M. Judet sont sans valeur essentiellement parce qu'elles manquent de bases techniques et qu'elles dnotent une ignorance complte du vritable tat de choses dans les Balkans et en Europe centrale. Pour fortifier ses critiques, M. Judet a invoqu l'autorit de M. Paul Deschanel, mais celle-ci ne saurait affaiblir les arguments que je viens d'opposer aux affirmations de M. Judet. J'ai fort bien connu M. Paul Deschanel; entre 1895 et 1900, j'ai t l'un de ses informateurs sur l'Europe centrale alors que, dj Prsident de la Chambre, il pronona son discours de rception l'Acadmie franaise dans lequel il fit de nombreuses allusions la question d'Autriche.
Andr Chradame (1925), Les Causes lointaines de la Guerre
31
J'ai eu ensuite l'occasion de revoir M. Paul Deschanel diverses reprises, avant, pendant et aprs la guerre, mme quand, dj fort souffrant, il fut Prsident de la Rpublique. J'ai pu constater que M. Paul Deschanel tait personnellement exaspr contre M. Poincar qu'il accusait de lui avoir souffl avant la guerre la Prsidence de la Rpublique au moment prcis o, lui, M. Deschanel, comptait tre lu aprs une longue prparation. Cette irritation personnelle, sans doute aggrave par son tat de sant, n'inclinait pas M. Deschanel tre parfaitement quitable envers M. Poincar au sujet des origines du conflit mondial. En outre, M. Deschanel, quoique excellemment intentionn, n'ayant jamais pu faire de voyages d'tudes l'tranger, n'avait pas une connaissance directe des questions extrieures. Il en rsulta que M. Deschanel, au sujet de l'Europe centrale, en tait rest aux conceptions qui, avant 1908, impliquaient, du point de vue franais, le maintien de l'Autriche-Hongrie. M. Deschanel n'ayant pu suivre directement les consquences si profondes, en Europe centrale, de l'annexion de la Bosnie-Herzgovine, aprs 1909, n'avait pas t mme de se convaincre qu'aprs cette date, en cas de guerre gnrale, la liquidation de l'Autriche-Hongrie tait une condition absolument ncessaire d'une paix franaise et anti-pangermaniste. C'est ce qu'ont prouv bien nettement les vnements depuis l'armistice en dmontrant d'une faon croissante que la cration de la Pologne, de la Tchcoslovaquie et de la Yougoslavie, consquences directes du dmembrement de l'Autriche-Hongrie, constituent les obstacles qui gnent le plus l'Allemagne pangermaniste. Cette preuve est faite par les tenaces et subtils efforts que fait l'Allemagne pour dtruire les frontires orientales fixes par les Traits de Paix. Or, cette solution du problme de l'Europe centrale, si conforme aux intrts de la France, par le morcellement de l'Autriche-Hongrie au profit des peuples slaves et latins qui la composaient essentiellement, M. Paul Deschanel ne l'avait pas admis comme ncessaire puisque, peu de temps avant sa mort, il tait encore de ceux qui, en France, dploraient le dmembrement de l'Autriche-Hongrie comme une faute commise au dtriment de la France. Ce retard dans l'information au sujet d'une question extrieure tout fait capitale achve d'enlever toute valeur probante au tmoignage de M. Deschanel invoqu par M. Judet. Enfin, ce qui caractrise la nature des efforts de M. Judet pour dmontrer la responsabilit de la France dans la guerre, ce sont ces lignes stupfiantes dans lesquelles il s'est efforc de rhabiliter le Kaiser. M. Judet a dclar, en 1925, qu'il ne voyait pas la duplicit de Guillaume II . Il affirme que celleci est tombe dans la plus basse des embches continentales (v. p. 31). Or, le 19 septembre 1899 (v. p. 32), quand la France tait absorbe par l'affaire Dreyfus, il crivait que l'empereur surveillait et mettait profit notre catalepsie , qu'il travaillait froidement en exploiter les avantages pour l'avenir, que l'Allemagne avait un rle la fois machiavlique et tentateur , que le Kaiser de Berlin voulait tre libre de ses mouvements pour le jour o l'action du pangermanisme rclamerait l'extension de l'empire des Hohenzollern vers le sud. Aprs d'aussi radicales et inadmissibles contradictions entre 1899 et 1925, un crivain en politique extrieure est jug.
Andr Chradame (1925), Les Causes lointaines de la Guerre
32
IV
M. Caillaux sur l'origine de la guerre
Retour la table des matires
Enfin, M. Joseph Caillaux dans le discours qu'il pronona le 21 fvrier 1925 au banquet qui lui fut offert Magic City a accus, lui aussi, M. Poincar de n'avoir pas empch la guerre. Pas su, pas voulu s'acharner la politique d'ententes, d'accords entre toutes les grandes nations, qui comportait, bien entendu, des concessions indispensables dans la vie des hommes, etc. (v. Le Temps, 21 fvrier 1925.) Or, qu'elles taient les concessions qu'aurait probablement consenties M. Caillaux l'Allemagne en juillet 1914? Il parait permis de supposer qu'elles eussent t en harmonie avec celles que, d'aprs l'amiral G. de Saint-Pair, attach naval de France Rome, M. Caillaux avait prconises en 1916, alors que la carte de guerre tait favorable Berlin. Que dsire l'Allemagne, aurait dit M. Caillaux ? La route de Bagdad qu'elle vient de conqurir; elle veut ensuite faire une grande Bulgarie et une grande Turquie d'Europe. En quoi cela nous gne-t-il ? Notre champ d'action est en Afrique. La Serbie disparatra, mais elle n'aura en dfinitive que ce qu'elle mrite. La Roumanie disparatra galement; mais, aprs tout, il vaut mieux que ce soit elle qui paye la casse que nous. (v. Le Matin, 21 dcembre 1917.) On peut donc supposer que M. Caillaux aurait voulu qu'on laisst l'Allemagne s'emparer de l'Europe centrale, en se basant sur cet argument : En quoi cela gne-t-il la France? Si M. Caillaux a tenu le langage que lui prte l'amiral de Saint-Pair, c'est que, comme tant de politiciens qui n'ont pas tudi sur place les problmes essentiels de la politique extrieure, il ne se doute pas que la vie de la France dpend absolument d'un certain quilibre de caractre anti-pangermaniste tabli en Europe centrale et dans les Balkans. Quoiqu'il en soit, il est certain que dans son discours de Magic City, M. Caillaux a exprim nettement l'opinion que des concessions faites par la France en 1914 lui auraient permis d'viter la guerre. C'est en quoi, comme tous ceux qui ont exprim cette croyance, il se trompe radicalement.
Andr Chradame (1925), Les Causes lointaines de la Guerre
33
Les causes lointaines de la guerre (1925)
Chapitre II
La France n'a aucune responsabilit dans la guerre
Retour la table des matires I. La seule hypothse dans laquelle on peut supposer que la France n'aurait pas t entrane dans la lutte est absurde. II. Les faits rappels et les documents produits par M. Charles Humbert, rapporteur de la commission de l'arme au Snat en 1914, avant la guerre, dmontrent aussi nettement que possible le caractre agressif des armements de l'Allemagne depuis 1906. III. Des hommes d'tat britanniques, bien placs pour avoir su la vrit, M. Winston Churchill et Lord Grey, reconnaissent que la France a fait tout ce qu'elle a pu pour viter la guerre.
I
La seule hypothse dans laquelle on peut supposer que la France n'aurait pas t entrane dans la lutte est absurde
Dans une seule hypothse, la France n'aurait pas t entrane dans la guerre. Pour le concevoir, il faut supposer que ni la Russie ni la France n'auraient pris le moindre intrt l'envahissement de la Serbie et que celle-ci aurait t jugule par l'Autriche-Hongrie appuye par Berlin sans que la
Andr Chradame (1925), Les Causes lointaines de la Guerre
34
moindre protestation s'levt. Dans ces conditions, la guerre gnrale n'aurait probablement pas eu lieu, car l'Allemagne n'aurait pas eu le moindre intrt la faire, puisqu'elle et obtenu sans batailles tout ce que la lutte la plus victorieuse aurait pu lui rapporter. En effet, une fois la Serbie dtruite, le prestige du germanisme, si gravement compromis par les victoires balkaniques slaves et latines de 1912-1913, et t compltement restaur en Europe centrale et les Slaves d'Autriche-Hongrie et des Balkans auraient t pratiquement rduits en servitude. La Russie, comme la France, ayant capitul, sans mme chercher ragir sur une question pour elles cependant vitale, auraient t rayes des grandes puissances et, aussi bien au point de vue conomique que politique, seraient devenues automatiquement des vassales de l'Allemagne. Celle-ci se ft trouve alors la matresse de l'Europe et le Plan pangermaniste et t d'un seul coup compltement ralis. Mais, l'hypothse que nous venons de faire n'est pas conforme au plus lmentaire bon sens. Si nous raisonnons en tenant compte de l'exprience des sicles, nous reconnatrons que l'hypothse que nous venons de formuler peut tre suppose seulement thoriquement mais non pratiquement. On n'a jamais vu d'tats ayant le rang de grandes puissances consentir brusquement l'abandonner. Donc la France et la Russie, par le seul fait qu'elles taient des grandes puissances ayant un intrt vital au maintien de leur indpendance, ne pouvaient pas ne pas s'intresser la violence qui tait faite la Serbie, non pas seulement en se plaant au point de vue moral, mais en raison de la prodigieuse rupture d'quilibre que l'crasement de la Serbie devait fatalement dterminer en Europe puisque cet crasement aurait dtermin automatiquement la vassalit de la France et de la Russie envers l'Allemagne. L'hypothse que nous venons de faire est donc sans aucune valeur, cette hypothse tant absurde puisqu'elle n'aurait pu se poser dans la ralit.
II
Les faits rappels et les documents produits par M. Charles Humbert, rapporteur de la commission de l'arme au Snat en 1914, avant la guerre, dmontrent aussi nettement que possible le caractre agressif des armements de l'Allemagne depuis 1906, p.
Retour la table des matires
Les mesures militaires prises dans les annes qui prcdrent la guerre, en Allemagne et en France, prouvent nettement que la France n'a pas la plus lgre responsabilit positive dans l'clat de la guerre; Il est piquant de le dmontrer en rappelant les faits contenus dans quelques passages des documents produits par M. Charles Humbert dans son livre Chacun son tour. M. Humbert l'a publi pour attaquer M. Poincar ; mais, en fait, il prend la dfense de celui-ci contre ceux qui l'accusent d'avoir dchan la guerre. Quand je dnonce la responsabilit de M. Raymond Poincar dans
Andr Chradame (1925), Les Causes lointaines de la Guerre
35
la grande catastrophe, je n'entends pas l'accuser d'avoir voulu la guerre, je l'accuse de n'avoir pas voulu la prparer, la sachant probable, prochaine, invitable, (v. op. cit. p. 5.) Cette formule, si diffrente de celles de MM. Louis, Judet, Caillaux, etc., nous rapproche de la vrit. En effet, tout ce qu'on peut regretter de l'action de M. Poincar avant la guerre, ce n'est pas ce qu'il a fait, c'est ce que la situation des esprits au Parlement franais ne lui a pas permis de faire de plus. Le livre de M. Humbert est intressant en ce sens que M. Humbert, rapporteur de la Commission de l'Arme au Snat avant la guerre, en produisant des documents pour prouver qu'il a fait plus qu'aucun autre parlementaire pour hter les armements protecteurs de la France, rappelle en mme temps les faits dmontrant le caractre nettement agressif des armements de l'Allemagne depuis 1906 et l'insuffisance des ripostes franaises. Ai-je besoin, Monsieur le Prsident, de vous rappeler mes longs et dcourageants efforts, a crit M. Humbert M. Poincar le 19 juin 1915? Depuis 1906, il ne s'est pas pass de semaine que je n'aie fait entendre mon pays les avertissements les plus formels et les plus pressants. J'ai signal tous les armements de l'Allemagne. J'ai dnonc notre insouciance, notre inaction. J'ai dit toutes les insuffisances de notre matriel de guerre. J'ai rclam toutes les amliorations que les faits dmontrent indispensables. Cette action, je l'ai poursuivie devant l'opinion publique, dans les assembles parlementaires, auprs des administrations comptentes. J'ai fait campagne dans la grande presse quotidienne; j'ai publi des livres, dont l'un, Sommes-nous dfendus , a eu un retentissement considrable. Je suis intervenu la tribune de la Chambre et du Snat, dans les commissions des deux assembles. partir du dbut de 1912, mes instances se sont faites plus directes, plus prcises; l'effort allemand, aprs le trait du 4 novembre 1911 sur le Maroc et le Congo, s'affirmait formidable; l'effort franais ne se dessinait mme pas. Mes dmarches se sont rptes auprs du Prsident du Conseil. (v. op. cit., p. 334.) Dans son discours au Snat du 13 juillet 1914, discours purement documentaire, qui mrite d'tre lu compltement (v. Journal Officiel du 14 juillet 1914), M. Charles Humbert, en qualit de rapporteur de la Commission de l'Arme, a rappel : Effectivement, l'effort allemand, messieurs, n'a pas t suivi en France, et il s'en faut, avec l'attention qu'il mritait; la preuve en est qu' la date du 23 mai 1912, par exemple, le ministre de la Guerre lui-mme se contentait d'adresser l'tat-major gnral de l'arme une note conue en ces termes : 23 mai 1912. Note de service. L'tat-major de l'arme est pri de faire connatre quelles mesures il a prises et compte prendre pour rpondre l'effort militaire allemand. (v. op. cit., p. 371.)
Andr Chradame (1925), Les Causes lointaines de la Guerre
36
Le Gouvernement pour ne pas effrayer la nation en lui rvlant la situation de son arme, voulait que ces dpenses fussent au moins engages sans que le Parlement et en dlibrer, mais le journal Le Temps ayant publi les grandes lignes du programme, l'observation du secret devint impossible et l'on se dcida dposer le projet de loi ... (v. op. cit., p. 373.) Le ministre de la Guerre (M. Millerand) rpondant le 14 juillet 1914 M. Humbert, donc la veille de la guerre, en fut rduit plaider les circonstances attnuantes et reconnatre lui-mme : J'en viens maintenant au matriel d'artillerie lourde de campagne; sur ce point, nous faisons en ce moment j'insiste sur ces mots en ce moment un trs gros effort. Il est trs exact que de 1900 1911 l'effort a t trs notablement moindre en France qu'en Allemagne, car pendant que nos voisins introduisaient dans l'artillerie de campagne l'obusier de 15 et le mortier de 21, pour notre part nous fabriquions uniquement 104 pices Rimailho qui ont dj une certaine anciennet. (v. op. cit., p. 415.) Dans ce mme discours, le ministre de la Guerre (M. Millerand) fut amen constater que si la France n'a pas dpens en temps utile les crdits ncessaires sa dfense, la responsabilit en remonte surtout certains membres du gouvernement. Voici une lettre, dit le ministre, qui tablit ce dsaccord frquent entre le dpartement de la guerre et celui des finances, dsaccord sur lequel je suis oblig d'appeler tout particulirement l'attention du Snat. M. Gaudin de VILLAINE. Mais il y avait des prsidents du Conseil!... M. le Ministre. Cette lettre du ministre des Finances au ministre de la Guerre est date du 13 mai 1913. Un premier programme d'acclration de 420 millions avait t soumis au Parlement en fvrier 1913; mais, la suite des expriences d'Otchakoff et du camp de Mailly, le ministre de la Guerre avait trouv propos et je rends hommage ce sujet M. Etienne de faire examiner nouveau par ses services, les besoins de la dfense nationale; il avait tabli un programme complmentaire d'acclration de 504 millions, ce qui portait 924 millions les besoins du dpartement. la suite de la communication faite le 26 avril au dpartement des finances, ce dernier rpondit, la date du 26 avril 1913 : Vous savez, monsieur le Ministre et cher collgue, que, comme mes prdcesseurs, je suis dispos ne marchander aucun des sacrifices qu'exige la scurit de nos frontires. Mais vous voudrez bien reconnatre avec moi qu'une partie de la puissance du pays rside dans la solidit de ses finances. Nous ne pourrions, sans la compromettre, tendre dans une trs large mesure les engagements dj pris et je me plais penser que vous ne vous refuserez pas rviser, dans le sens d'une rduction trs importante, les projets dont vous avez bien voulu me faire part.
Andr Chradame (1925), Les Causes lointaines de la Guerre
37
En ce qui concerne les 504.500.000 francs destins accrotre la dotation de la 3e section du budget de votre dpartement, il rsulte des explications changes au Conseil des ministres, que le Gouvernement ne pourrait accueillir cette proposition l'heure prsente et majorer de plus de 100 p. 100 les demandes dont la Chambre n'a pas t saisie au mois de fvrier dernier sans qu'il lui ait t donn l'assurance qu'un examen complet des besoins avait t effectu et que les prvisions avaient t formes en tenant compte de toutes les possibilits de fabrication pour une priode de cinq ans. Nous ne pourrions donc envisager qu'un simple remaniement du projet de loi tel qu'il figure au rapport de M. Clmentel et la modification pourrait consister, soit de rpartir sur de nouvelles bases entre les divers services les autorisations d'engagement, soit en relever modrment le total, si la ncessit en est reconnue, et le porter, par exemple, aux environs de 450 millions de francs . Ainsi, continue le ministre, alors que le ministre de la Guerre affirmait, aprs tude complte, aprs des expriences qui avaient t foudroyantes dans leurs rsultats, qu'il tait absolument ncessaire de renforcer le matriel, les approvisionnements et l'organisation dfensive du territoire et d'engager ce titre 504 millions 500.000 francs de plus de dpenses non renouvelables , on lui en offrait 30 ! Mouvements divers. M. Gaudin de Villaine. Quel tait ce ministre des finances? Quel tait le prsident du Conseil cette poque? On fuit toujours les responsabilits 1. M. le ministre. Je ne fuis aucune responsabilit. M. Gaudin de Villaine. Ce n'est pas vous que nous mettons en cause. Mais celui qui a crit cette lettre tait ministre des Finances; il y avait un prsident du Conseil responsable. La place de ces gens est devant la HauteCour . (v. op. cit., p. 427.) Cette rponse du ministre de la Guerre (M. Millerand) faite le 14 juillet M. Charles Humbert la tribune du Snat, suffit tablir que si la France s'est trompe avant 1914, ce n'est pas pour avoir fait trop d'armements mais pour n'en avoir pas fait assez. La France n'a commis aucune faute morale lui crant une responsabilit dans la guerre, mais elle a fait des fautes matrielles en ne prenant pas suffisamment les prcautions qui lui auraient, vraisemblablement, permis de l'viter. Tout esprit droit est maintenant convaincu que si la France avait dpens, en temps utile, 500 millions pour avoir une artillerie lourde prte en 1914, l'Allemagne n'aurait probablement pas os faire la guerre. Il est ainsi dmontr que cette dpense apparemment belliqueuse, mais commande par le bon sens
1
En mai 1913, le prsident du Conseil tait M. Lon Barthou, le ministre des Finances M. Charles Dumont et le ministre de la Guerre M. tienne.
Andr Chradame (1925), Les Causes lointaines de la Guerre
38
et la sagesse des nations, aurait assur la France le bienfait du maintien de la paix et lui aurait procur une prodigieuse conomie d'hommes et d'argent.
III
Des hommes d'tat britanniques, bien placs pour avoir su la vrit, M. Winston Churchill et Lord Grey, reconnaissent que la France a fait tout ce qu'elle a pu pour viter la guerre
Retour la table des matires
tant donn l'enchanement des faits essentiels depuis 1895, dbut du mouvement pangermaniste (v. chapitres V et VI), il tait impossible la France d'viter la guerre en 1914. C'est ce qu'ont reconnu deux hommes d'tat britanniques dont la loyaut est d'autant plus apprciable que, depuis l'armistice, les rapports franco-anglais sont devenus plus difficiles. Dans son livre La Crise Mondiale (1911-1915) M. Wiston Churchill a proclam : La justice envers la France exige la dclaration explicite que la conduite de son gouvernement, dans cette effroyable conjoncture, fut impeccable; il adhra instantanment toute proposition capable d'assurer la paix. Il s'abstint de toute forme de provocation, il compromit mme sa propre scurit en retirant ses troupes de couverture. Il n'y avait aucune chance pour la France d'chapper cette preuve. (Cit par Le Temps, 9 janvier 1925.) De son ct, lord Grey, dans les fragments de ses mmoires que la Westminster Gazette a publis le 27 avril 1925 a lui aussi reconnu : La France redoutait la guerre et elle fit tout ce qu'elle put pour l'viter. Un observateur inform et impartial ne peut pas aboutir une autre opinion.
Andr Chradame (1925), Les Causes lointaines de la Guerre
39
Les causes lointaines de la guerre (1925)
Chapitre III
Raisons fondamentales des erreurs de jugement de ceux qui dclarent que la France a une part de responsabilit dans la guerre
I. Ils ne tiennent aucun compte des faits antrieurs, mme quand ces faits tablissent de la faon la plus nette les intentions agressives austro-allemandes. II. Notamment, ils ne font aucune allusion aux tentatives d'emprunt, sur le march de Paris, cependant rvlatrices, faites en 1909 et en 1911 par les gouvernements hongrois et austro-hongrois. III. Ils ne ralisent pas l'importance capitale pour la paix du monde de l'indpendance de l'Europe centrale slave et latine.
Retour la table des matires
Tous ceux qui cherchent dmontrer que la France a une part de responsabilit dans la guerre aboutissent forcment un jugement erron en raison des causes d'erreurs fondamentales de leur jugement qui sont les suivantes.
Andr Chradame (1925), Les Causes lointaines de la Guerre
40
I
Ils ne tiennent aucun compte des faits antrieurs mme quand ces faits tablissent de la faon la plus nette les intentions agressives austro-allemandes
Retour la table des matires
Ils discutent et piloguent sur des phrases de documents diplomatiques ou sur les incidents multiples qui furent changs ou se produisirent depuis l'assassinat de Franois-Ferdinand jusqu' la guerre, ils tirent encore argument de certains vnements des deux au trois dernires annes qui prcdrent la lutte, mais ils ne parlent jamais des faits antrieurs 1911 qui ont cependant engendr le conflit. Ils ne font pas d'allusion srieuse au mouvement pangermaniste qui, depuis 1895, avait conquis la grande majorit des Allemands. Ils ne disent pas que sous l'action de la propagande nergique des socits pangermanistes, ceux-ci avaient t persuads, avec raison d'ailleurs au point de vue technique, que le premier acte faire pour raliser leur plan de domination universelle consistait asseoir solidement la suprmatie du germanisme sur l'Europe centrale et orientale. Les pacifistes qui veulent tablir la responsabilit de la France omettent tous de parler du Hambourg-Bagdad et des consquences invitablement funestes pour la paix de l'Europe de l'annexion de la Bosnie-Herzgovine en 1909 qui fut l'une des tapes de la descente germanique vers l'Orient. N'attachant aucune importance ces faits cependant essentiels, ils ne songent mme pas se demander si les mesures de prcautions prises par MM. Delcass, Poincar, Sazonoff, etc., n'taient pas simplement comme elles l'ont t les consquences ncessaires, et bien insuffisantes d'ailleurs, des prparatifs d'agression austro-allemande qui se manifestrent avec un clat particulier et croissant de 1908 aot 1914.
II
Notamment, ils ne font aucune allusion aux tentatives d'emprunt, sur le march de Paris, cependant rvlatrices, faites en 1909 et en 1911 par les gouvernements hongrois et austrohongrois
Retour la table des matires
Mais, pourra-t-on objecter, si les Franais qui prtendent que le gouvernement de Paris a une part des responsabilits dans la guerre ne parlent pas de ce qui s'est pass en Europe centrale avant 1911, c'est que, comme tant d'autres, n'y tant pas alls, ils n'ont pu apprcier sur place l'importance des vnements qui s'y droulaient, depuis 1909 surtout, et qui devaient engendrer la guerre.
Andr Chradame (1925), Les Causes lointaines de la Guerre
41
Cette supposition peut tre faite pour plaider les circonstances attnuantes; mais, une autre question se pose. Comment expliquer que MM. Louis, Judet, Caillaux, etc., par exemple, oublient compltement de signaler les tentatives d'emprunt hongrois, fin 1909, et austro-hongrois, fin 1911, qui furent sur le point d'tre mis sur le march de Paris dans des conditions qu'ils n'ont pu ignorer? En effet, ces tentatives d'emprunt qui furent sur le point d'aboutir, grce de nombreuses et influentes collaborations franaises Paris, taient prodigieusement instructives ; elles avaient pour objectif essentiel de fournir l'Autriche-Hongrie, par un procd indirect mais ais discerner, l'argent ncessaire ses armements afin d'assurer pour toujours, d'accord avec Berlin, par une pression belliqueuse, la pntration austro-allemande dans les Balkans. Cependant, M. Judet savait bien l'importance politique qu'avait toute mission d'emprunt tranger sur la place de Paris. Il a prt, en effet, grande attention aux efforts faits en vue de l'admission la cote franaise d'un emprunt bulgare de 180 millions (v. Georges Louis, p. 195). Il a mme prtendu qu'Isvolsky avait appuy l'admission la cote Paris de cet emprunt qui constituait un trsor de guerre pour Ferdinand . (v. op. cit. p. 195). Il a assur, en outre, qu'Isvolsky passa la fin de 1912 et le printemps de 1913 contrarier cette politique conservatrice de la Paix, que Philippe Crozier dfendit Vienne . (v. op. cit., p. 304). Que cette affirmation est stupfiante et en opposition avec les faits! M. Philippe Crozier, ambassadeur de France Vienne, par l'effet d'une prodigieuse aberration, dtermine sans doute par son ardent dsir de devenir, aprs sa retraite de diplomate franais, administrateur de l'Oesterreichische Laenderbank ce qui d'ailleurs eut lieu, appuya Paris les tentatives d'emprunt hongrois et austro-hongrois dont j'ai parl plus haut, alors que cependant ces emprunts avaient pour but de permettre l'Autriche-Hongrie de se prparer la guerre. Aucun doute cet gard n'est possible. M. Wickham Steed, qui tait alors le correspondant du Times Vienne avant d'en devenir le directeur pendant la guerre, et dont les informations ont toujours t d'une sret parfaite, dans son livre Trente ans de souvenirs , Through Thirty Years, dit au sujet de la tentative d'emprunt austro-hongrois Paris en 1911. La crise d'Agadir et Vienne des rpercussions fort curieuses. Aehrenthal se tint ostensiblement l'cart de l'Allemagne pendant l't et l'automne de 1911, mais peu aprs la signature Berlin de l'accord francoallemand, l'Ambassadeur de France Vienne, M. Crozier, proposa son collgue allemand, Herr von Tschirschky d'en demander conjointement la reconnaissance Aehrenthal. Tschirschky rpondit sur un ton froid qu'il n'avait pas reu d'instructions cet effet; mais lorsque M. Crozier se rendit seul auprs d'Aehrenthal pour lui demander son assentiment grand fut son tonnement de trouver chez lui l'Ambassadeur d'Allemagne. En prenant cong d'Aehrenthal von Tschirschky dit doucereusement M. Crozier : Le Ministre vous dira qu'il ne peut encore reconnatre l'accord cause de certaines formalits remplir entre les gouvernements autrichien
Andr Chradame (1925), Les Causes lointaines de la Guerre
42
et hongrois, et parce qu'il y a aussi d'autres points considrer. Aehrenthal employa son tour les mmes termes et expliqua Crozier que les autres points consistaient en une demande austro-hongroise de compensation sous forme d'un emprunt d'un milliard consentir par la France l'Autriche et la Hongrie que celles-ci se partageraient par moiti. Cette compensation insinua-t-il, encouragerait la Double Monarchie tre dans l'avenir plus indpendante de l'Allemagne. L'Ambassadeur de France mordit l'hameon. Il demanda, il est vrai, une assurance que les fonds ne seraient ni employs dans un but militaire, ni mis la disposition de l'Allemagne assurance qu'Aehrenthal fournit avec d'autant plus d'empressement que les banques autrichiennes avaient dj avanc d'importantes sommes au gouvernement pour la construction de vaisseaux de guerre et pour d'autres buts politiques. Sans tre directement employs des dpenses militaires ou navales, les fonds venant de France auraient permis aux banques de se refaire et d'avancer d'autres sommes au fur et mesure des besoins, pendant que l'on mettrait le surplus la disposition des banques allemandes harceles par les demandes de l'industrie et les exigences du gouvernement imprial pour ses dpenses militaires et navales. De fait, ce moment mme, deux banques franaises avaient avanc 275 millions de francs pour sauver des pires embarras les banques allemandes. Sur l'avis de M. Crozier les parties intresses Paris appuyrent la demande d'Aehrenthal, laquelle M. Caillaux, Prsident du Conseil, rserverait, assurait-on, un accueil favorable. J'avisai discrtement le Times de ce qui se passait et attendis le moment opportun pour en informer le public. Il tait craindre que le gouvernement franais donnt son assentiment l'emprunt avant d'avoir consult l'opinion franaise et le gouvernement britannique. Une indiscrtion commise vers la mi-dcembre 1911, par la Newe Freie Presse me permit de publier un premier avertissement et le 26 dcembre, un courageux crivain franais, M. Andr Chradame, qui avait tant contribu en dmasquant le pangermanisme instruire ses compatriotes sur le pril allemand, fit paratre dans Le Petit Journal une vigoureuse protestation contre la politique qui consisterait mettre l'pargne franaise la disposition de l'Autriche-Hongrie et de l'Allemagne. L'un des effets de l'mission Paris d'un gros emprunt austro-hongrois serait de mettre la France dans l'impossibilit de persister dans son refus l'Allemagne de se procurer des fonds pour ses armements sur le march franais. Cette protestation mit en veil l'opinion publique franaise tout comme mes avertissements avaient en Angleterre mis le public sur ses gardes. Une enqute du Times dmontra que les financiers anglais taient opposs l'mission, sur le march anglais, de la moindre part d'un emprunt autrichien. En rsum, le projet choua au grand ennui d'Aehrenthal, de Caillaux et des cercles financiers et diplomatiques franais qui y taient intresss. Cependant la rancune des financiers franais s'exera contre M. Andr Chradame et lui cota sa situation au Petit Journal et son nom fut marqu d'une croix d'un si beau noir que je pus constater qu'elle ne s'tait pas efface pour certains lments de la finance franaise mme en 1916.
Andr Chradame (1925), Les Causes lointaines de la Guerre
43
Il est clair que si MM. Crozier et Caillaux ont connu ces tentatives d'emprunt, MM. Louis et Judet n'ont pu les ignorer. Pourquoi donc n'en parlent-ils pas ? Je me borne, pour l'instant, citer ce passage du livre de M. Steed ; on conviendra qu'il ne manque pas d'intrt bien qu'il ne se rapporte qu' la tentative d'emprunt austro-hongrois de 1911. Celle de l'emprunt hongrois de 1909 fut, peut-tre, plus significative encore, se produisant au lendemain mme de l'annexion de la Bosnie et de l'Herzgovine. Les tentatives d'emprunts hongrois en 1909 et austro-hongrois en 1911 sur le march de Paris sont encore peu prs inconnues du public ; elles ont cependant une importance capitale et rvlatrice pour la comprhension de l'enchanement des vnements qui dterminrent la guerre. Il est parfaitement vrai que j'ai t tenacement poursuivi par les rancunes de ceux qui m'ont fait payer trs cher le fait d'avoir contribu maintenir la paix de la France et de l'Europe en contribuant notablement faire chouer les emprunts en question en 1909 et 1911, donc en ralentissant considrablement les armements austro-hongrois. Le rcit des procds, trs divers, qui furent employs contre moi, depuis, pour me punir de l'efficacit de mon initiative, ne formera pas la partie la moins curieuse de mes souvenirs . Quoi qu'il en soit, quand l'histoire des tentatives d'emprunt hongrois de 1909 et austro-hongrois de 1911 sur le march de Paris sera compltement connue, on se demandera pourquoi des parangons de la paix comme MM. Judet, Louis et consorts n'ont pas fait la moindre allusion ces tentatives d'emprunt qu'ils n'ont pu ignorer et qui dmontraient cependant nettement la prparation militaire agressive de l'Autriche-Hongrie, le brillant second de l'Allemagne.
III
Ils ne ralisent pas l'importance capitale pour la paix du monde de l'indpendance de l'Europe centrale slave et latine, p.
Retour la table des matires
Enfin, ceux qui veulent incriminer la France en lui reprochant de s'tre intresse la Serbie n'emploient cet argument que parce que, dans l'hypothse la plus bienveillante, ils ignorent l'importance extraordinaire de l'Europe centrale slave et latine pour la paix du monde et la scurit de la France. Pour tre quitable, il faut ajouter que beaucoup d'excellents Franais commettent aussi la mme erreur. Les uns et les autres ne ralisent pas encore la solidarit absolument vitale et rciproque qui existe entre la France, d'une part, et la Pologne, la Tchcoslovaquie, la Yougoslavie, la Roumanie et la Grce, d'autre part. Mme l'heure actuelle, beaucoup de Franais croient que
Andr Chradame (1925), Les Causes lointaines de la Guerre
44
la France peut se cantonner dans l'Occident de l'Europe et se dsintresser de ce qui se passe dans sa partie centrale et orientale. Ils ne saisissent pas encore que cette attitude serait mortelle pour la France et que la vie de celle-ci dpend rigoureusement d'une certaine forme d'quilibre dans les Balkans et en Europe centrale, laquelle peut seulement rsulter d'une pleine indpendance de la Pologne, de la Tchcoslovaquie, de la Yougoslavie, de la Roumanie et de la Grce. Cependant, depuis l'armistice, des faits indiscutables ont dj prouv nettement qu'il en est bien ainsi. Si la victoire des Allis avait laiss subsister l'Autriche-Hongrie, si elle n'avait pas servi constituer autour de l'Allemagne des tats indpendants nouveaux ou agrandis, comme la Pologne, la Tchcoslovaquie, la Yougoslavie, la Roumanie et la Serbie, l'Allemagne, dont l'Autriche-Hongrie aurait fatalement continu tre la vassale, serait dj la matresse de l'Europe. C'est, en ralit, la transformation de l'Europe centrale qui, en donnant l'indpendance aux Slaves et aux Latins, prcdemment soumis au joug germano-magyar, a constitu la partie la plus relle et la plus efficace de la victoire des allis. La situation existant au dbut de 1925 le prouve clairement. cette date, l'Allemagne, ayant russi esquiver les rparations dues la France, a retourn la situation financire son profit. Ce rsultat est pour elle considrable ; cependant, l'Allemagne n'a pas encore regagn la partie et elle ne peut pas encore reprendre une politique nettement pangermaniste, prcisment parce que les consquences territoriales de la victoire allie en Europe centrale subsistent du fait de la vitalit des tats slaves et latins de l'Europe centrale, lesquels font obstacle l'expansion pangermaniste. Le 18 mai 1925, M. Stresemann dans un discours au Reichstag n'a mme pas hsit dclarer : Il n'y a cependant personne en Allemagne qui puisse reconnatre, comme un fait dfinitif, la frontire de l'Est ! C'est pourquoi, d'ailleurs, l'Allemagne travaille avec tant de tnacit modifier les frontires orientales par des moyens subtils et indirects en attendant de pouvoir les dtruire par des moyens violents et directs. En juillet 1920, elle a fait agir ses agents de Moscou contre la Pologne. Elle a chou; le secours donn par la France ayant notablement contribu la victoire des Polonais sous Varsovie. En 1925, elle a lanc le projet de pacte de scurit dont l'un des objectifs est la destruction du couloir de Dantzig. Si elle russissait cette premire opration, il n'y a pas de doute que l'Allemagne travaillerait ensuite enlever successivement tous les lments de leur indpendance aux divers tats slaves et latins de l'Europe centrale. Ces faits prouvent combien la France a eu raison de s'intresser en 1914 la Serbie, puisque, de plus en plus, il apparat que la scurit de la France dpend de l'Europe centrale slave et latine dont la Serbie est une base capitale. Ceux qui accusent les dirigeants de la France d'avoir compris toutes ces consquences de l'ultimatum austro-hongrois la Serbie ont donc compltement tort.
Andr Chradame (1925), Les Causes lointaines de la Guerre
45
Quoi qu'il en soit, les erreurs de jugement fondamentales de ceux qui veulent incriminer la France ont ceci de bon qu'elles montrent quels cueils il faut viter pour arriver mettre en lumire les vritables causes de la guerre.
Andr Chradame (1925), Les Causes lointaines de la Guerre
46
Les causes lointaines de la guerre (1925)
Chapitre IV
Les conditions raliser pour discerner les vritables causes de la guerre
I. Il ne faut pas chercher soutenir une thse, mais dgager la vrit que rvlent les faits essentiels. II. Pour trouver les vritables origines de la guerre, il faut remonter assez loin.
I
Il ne faut pas chercher soutenir une thse, mais dgager la vrit que rvlent les faits essentiels
Retour la table des matires
Il ne s'agit pas, dans cet ouvrage, de dfendre une thse opposer celle des pacifistes. Cette remarque est ncessaire car des discussions multiples sur la guerre et la paix menes dans les pays allis d'Occident depuis 1914, il ressort que beaucoup s'imaginent que toute question de politique trangre est susceptible de donner lieu deux opinions contradictoires, c'est--dire deux thses, l'une positive, l'autre ngative qu'on peut galement soutenir, de mme qu'on apprend la confrence des avocats dfendre avec une gale aisance le pour et le contre d'une mme question. Cette faon d'envisager les choses a
Andr Chradame (1925), Les Causes lointaines de la Guerre
47
fait que, dans la presse allie, on a parl, par exemple, de la thse du maintien de l'Autriche-Hongrie et de la thse de son dmembrement . Or, un problme de politique trangre ne comporte pas de thses mais seulement une solution juste et des solutions fausses. Si des divergences fondamentales apparaissent souvent sur les solutions donner un problme extrieur, c'est uniquement parce que, dans un mme pays, il y a des hommes qui connaissent les questions trangres ayant fait ce qu'il faut pour les apprendre, alors que d'autres, infiniment plus nombreux d'ailleurs, parlent de ces questions avec une extrme assurance bien que les ignorant profondment. Ce sont ces derniers qui croient que des thses peuvent exister. Il n'en est pas ainsi. L'ensemble des ralits militaires, navales, politiques, conomiques, ethnographiques, psychologiques, nationales, lesquelles se sont infiniment multiplies dans le quart de sicle prcdant la guerre, spcialement en Europe centrale forment des lments positifs, indpendants de toutes les apprciations. Ces ralits constituent comme une norme machine aux rouages nombreux, ayant chacun une dimension prcise, tournant avec une certaine vitesse pour donner un rsultat dtermin. Cette machine gigantesque et complexe s'est constitue peu peu sous la pression des ncessits, son fonctionnement tant indispensable la vie des peuples. Mais si l'existence de cette machinerie est un fait, cette existence est cependant fort mal comprise. Il en est ainsi parce que, si les lments composant la machine politique sont tout aussi certains que les rayons X, de mme que ces derniers, ils sont invisibles. Ceux-ci ne peuvent tre perus et utiliss qu' l'aide d'appareils spciaux. De mme, les ralits constitutives de la machinerie sciences politiques qui assure la vie des peuples, sont perceptibles dans leur forme et leur fonction seulement ceux ayant subi un entranement intellectuel sciences politiques spcial. Or, trs malheureusement, le nombre de ceux qui dans les pays allis sont arrivs un degr suffisant de culture sciences politiques est encore infime, alors qu'il est relativement trs grand chez les Allemands, lesquels d'ailleurs se servent de ces sciences admirables pour tenter d'tablir leur domination sur le monde. Une preuve peut tre donne qu'il existe bien dans le domaine de la politique trangre une vritable science dont les mthodes sres donnent ceux qui savent les appliquer, des rsultats identiques. Par exemple, les quelques spcialistes de la politique trangre en France et en Angleterre qui, quinze ans environ avant la guerre, ont tudi sur place la question d'Autriche-Hongrie, quoique ayant travaill sparment, sans se connatre, donc sans aucune entente pralable, ont t unanimes conseiller, une fois la guerre engage, la mme solution du problme de l'Europe centrale. En effet, contrairement l'opinion gnrale admise en France et en Angleterre, ils ont prconis le dmembrement de l'Autriche-Hongrie dont les rsultats avantageux pour contenir l'Allemagne pangermaniste se manifestent maintenant progressivement.
Andr Chradame (1925), Les Causes lointaines de la Guerre
48
Mais si une question de politique trangre ne peut comporter qu'une solution quand elle est envisage par les citoyens d'un mme pays, c'est--dire par des hommes ayant les mmes intrts gnraux, par contre, cette mme question de politique trangre comporte naturellement une solution trangre diffrente quand elle est considre par des citoyens appartenant un tat dont les intrts gnraux sont opposs ceux des premiers. Par exemple, l'Allemagne avait le plus grand intrt au maintien de l'Autriche-Hongrie alors que les Allis avaient les meilleures raisons d'en vouloir le dmembrement. De mme, on conoit aisment que l'Europe peut tre organise d'aprs deux conceptions radicalement diffrentes. Il y a la conception pangermaniste qui repose sur un terrorisme scientifiquement entretenu pour dtruire tout lment de rsistance sans aucun souci de la libert humaine. Mais l'Europe peut tre organise sur une autre base. En effet, elle peut tre essentiellement fonde sur le groupement des peuples dcids respecter la libert des Allemands (France, Belgique, Pologne, Tchcoslovaquie, Yougoslavie, Roumanie, Grce, etc.,) mais en ayant pris toutes les dispositions ncessaires afin de s'opposer ventuellement aux ralisations pangermanistes qui mettraient fin l'indpendance des slaves et des latins. Donc, en politique trangre, les solutions sont diffrentes si les points de vue sont divers, mais si le problme est envisag du mme angle par diverses personnes, celles-ci, la condition bien entendu d'tre rellement et exactement documentes , ne peuvent pas prconiser des solutions sensiblement diffrentes. Enfin, il tombe sous le sens commun que les ralits mcaniques de la grande machine politique qui permet aux peuples de vivre ne sauraient tre modifies par des arguments thoriques les plus subtils ou les plus ingnieux. Donc, les discussions inspires par des thses sont sans la moindre valeur. Ces raisonnements permettent de se persuader qu'il n'y a pas de thses en politique trangre, pas plus qu'en mcanique. Par consquent, relativement aux origines de la guerre, il n'y a pas de thorie prconiser de prfrence une autre, il n'y a qu' chercher soutenir une opinion qui soit vraie et cette opinion ne peut tre vraie que si elle procde d'une constatation consciencieuse des ralits.
II
Pour trouver les vritables origines de la guerre, il faut remonter assez loin, p.
Retour la table des matires
Afin de dgager avec exactitude les origines de la guerre, il faut d'abord remonter ses causes principales lointaines; le Pangermanisme qui commena se dvelopper en Allemagne vingt annes avant de dchaner la lutte et le Pacifisme des autres pays qui, dans la mme priode, favorisa d'une faon extraordinaire la croissance des ambitions pangermanistes (v. chapitre V).
Andr Chradame (1925), Les Causes lointaines de la Guerre
49
Afin de remonter assez haut dans le pass et de me prserver contre toute influence pouvant rsulter des vnements actuels trop passionnants, je me servirai comme lments de dmonstration de faits bien tablis et de textes publis par moi longtemps avant la guerre dans des livraisons de revues maintenant puises. Le public ne peut donc plus se les procurer. Ces textes, bien antrieurs la guerre, contenant des constatations faites sur place, tant reproduits scrupuleusement, constituent des documents impartiaux puisqu'en raison de leur date, ils se trouvent soustraits aux impressions trop ardentes que la priode actuelle pourrait me faire prouver. Le chapitre VI, par exemple, de ce livre relatif la priode de lutte des Slaves et des Allemands en Autriche-Hongrie qui lia la partie, devant aboutir la guerre, est constitu par une tude rsultant de mes premiers voyages en Europe centrale. J'eus la plus grande peine, jadis, publier ce travail. Il devait paratre Paris dans Le Correspondant la fin de 1897, il y a donc vingt-huit ans. J'tais jeune et l'acceptation de mon article par M. Lavedan pre, qui prsidait alors aux destines de cette influente revue, m'avait rempli de joie. Je me croyais enfin mme de dvoiler l'opinion publique franaise le grand danger pangermaniste alors totalement inconnu, dont je venais de dcouvrir l'tendue aprs plusieurs annes de minutieuses enqutes en Allemagne et en Autriche-Hongrie. Mais une grande dception, qui devait tre suivie de beaucoup d'autres du mme genre, m'attendait. Bien qu'admis, compos et ayant ses preuves corriges, mon article ne parut pas. J'appris plus tard qu'une influence ultra-conservatrice alors toute puissante au Correspondant, celle du marquis de Vogu, mit en dernire heure son veto la publication de mon travail jug subversif et rvolutionnaire parce que favorable la dmocratie. J'y prconisais, en effet, l'introduction du fdralisme en AutricheHongrie en faveur des populations slaves et latines, ce qui fut estim comme une attaque inadmissible dirige contre le pouvoir monarchique des Habsbourg. Mais, j'ai conserv ces preuves du Correspondant dates du 21 dcembre 1897. C'est le texte qu'elles contenaient que je reproduis exactement. Le contrle de l'authenticit des dates que j'indique pour cette tude et mme pour son texte est possible, car aprs son chec au Correspondant mon tude parut, avec de trs lgres modifications de forme, sons le pseudonyme d'Albert Lefranc, sous le titre de L'Empire allemand et les affaires autrichiennes dans le numro de janvier-fvrier 1898 de la Revue du droit public et de la science politique en France et l'tranger. M. Larnaude, professeur la Facult de Droit de Paris et plus tard son doyen, tait le directeur de cette revue. La publication de mon tude lui valut les protestations violentes de ses collgues d'Outre-Rhin. Furieux de constater que, pour la premire fois, on soulevait en France le voile sur les menes pangermanistes, ils dmentirent avec indignation mes allgations dont le temps a depuis tabli l'entire vrit. On pourra constater que ces textes aprs vingt-huit annes sont encore d'actualit puisqu'ils tablissent l'origine des vues annexionnistes sur l'Autriche de l'Allemagne que celle-ci s'efforce de raliser en 1925.
Andr Chradame (1925), Les Causes lointaines de la Guerre
50
La mthode que je viens d'exposer me permettra, j'espre, de dmontrer avec certitude dans les deux chapitres suivants Les Causes anciennes de la Guerre. Ensuite les bases fondamentales de la dmonstration tant poses, le lecteur saisira sans effort La Cause immdiate de la Guerre dmontre dans le livre faisant suite celui-ci. Cette cause immdiate rsulte de la volont de Berlin et de Vienne d'enrayer les progrs de l'esprit d'indpendance des peuples slaves et latins de l'Europe centrale rsultant des guerres balkaniques de 1912-1913, cristallises dans le Trait de Bucarest du 10 aot 1913.
Andr Chradame (1925), Les Causes lointaines de la Guerre
51
Les causes lointaines de la guerre (1925)
Chapitre V
Les deux grandes raisons lointaines de la guerre
I. LE PANGERMANISME. Le gouvernement de Berlin initiateur du plan et de la propagande pangermaniste. Le peuple allemand en accueillant avec une faveur toujours plus marque le programme allemand de domination universelle s'est rendu responsable lui aussi du cataclysme mondial. II. LE PACIFISME. Pourquoi il est indispensable de montrer nettement le pril pacifiste. Preuves que j'attaque les pacifistes exclusivement dans l'intrt d'une paix vraiment durable. La politique pacifiste avant la guerre des pays de l'Entente. Comment les pacifistes ont prpar la Pangermanie. Le pacifisme procde d'une profonde ignorance de l'tranger et particulirement de la psychologie allemande. Le pacifisme avant 1914 tait tel chez les grandes puissances que si elle n'avait eu tenir compte que de celles-ci l'Allemagne aurait pu accomplir peu peu son expansion pangermaniste sans avoir besoin de faire la guerre.
I
PREMIRE RAISON LOINTAINE DIRECTE DE LA GUERRE. LE PANGERMANISME
Retour la table des matires
Mon livre Le Plan Pangermaniste dmasqu a mis en lumire cette raison fondamentale lointaine de la gigantesque lutte mondiale mais, en ralit, ce livre, paru au dbut de 1916, n'a fait que prsenter sous une forme vulgarisatrice les donnes beaucoup plus compltes et plus prcises, plus scientifiquement exposes dans mes ouvrages antrieurs. Je renvoie donc ceux-ci et particulirement deux d'entre eux. L'Europe et la question d'Autriche au seuil du XXe sicle, paru en 1901, expose avec de nombreuses cartes,
Andr Chradame (1925), Les Causes lointaines de la Guerre
52
traductions de textes allemands et fac-simils de documents le plan pangermaniste fondamental de 1895 tel que je venais de 1e dcouvrir de 1896 1900 et tel qu'il a t exactement ralis par les Allemands de 1914 1918. Mon livre Le Chemin de fer de Bagdad, paru en 1903, complte le prcdent. Il expose les raisons et les moyens de la coopration turco-allemande qui s'est manifeste sous toutes les formes depuis 1914 jusqu' octobre 1918. Des documents contenus et des faits constats dans les trois ouvrages plus haut cits, il rsulte incontestablement que dans la priode 1892-1916, c'est-dire pendant vingt-quatre annes : 1 Le gouvernement de Berlin a, sans rpit, prpar un plan de domination universelle dj prcis dans ses lignes fondamentales en 1895 et ensuite sans cesse tendu et mis au point ; 2 Ce plan dans certaines hypothses tait ralisable sans guerre, mais celle-ci tant galement prvue, un formidable instrument de lutte qui, d'ailleurs, devait servir de menace constante afin d'assurer la capitulation en pleine paix des voisins de l'Allemagne devant ses prtentions, tait incessamment rendu plus puissant par le gouvernement de Berlin ; 3 Depuis 1895, le programme des mainmises pangermanistes essentielles a t expliqu tout le peuple allemand au moyen d'une propagande puissante, mthodiquement effectue, surtout l'aide de nombreuses confrences et de brochures rpandues profusion ; 4 Pendant dix-neuf annes, de 1895 1914, de propagande pangermaniste publique sans cesse plus intense, aucune protestation susceptible d'tre vraiment efficace n'a t faite par un parti allemand important contre le plan berlinois de domination universelle ; 5 Le peuple allemand dans son immense majorit en entrant en guerre savait parfaitement bien que celle-ci avait pour but de lui assurer un gigantesque butin, perspective qui lui a fait accepter d'avance les plus durs sacrifices pour obtenir finalement d'immenses profits matriels. Cet tat d'esprit a t encore dmontr par le fait que le 19 juillet 1917, les plus modrs des dputs allemands du Reichstag assuraient vouloir la paix sur la base de la formule ni annexions ni indemnits . Or, l'application de cette formule, en raison des ralits de la carte de guerre et des faits accomplis cette poque, et abouti pratiquement permettre la Pangermanie centrale de se cristalliser, ce qui suffisait assurer l'Allemagne aprs un court dlai, par voie de consquences inluctables, la ralisation de la totalit de toutes les autres ambitions pangermanistes. La justification de cette proposition se trouve dans ma brochure parue au dbut de 1918 : Les bnfices de guerre de l'Allemagne et la formule boche ni annexions ni indemnits . Au surplus, depuis la publication de ce travail, les faits certains ont dmontr premptoirement que la formule ni annexions ni indemnits n'a jamais t de la part de l'Allemagne et de ses vassaux qu'une manuvre destine favoriser les courants pacifistes dans les pays allis. En avril 1918, la Germania a d'ailleurs cyniquement reconnu : La rsolution de juillet n'tait qu'une question de tactique, qui contribua raffermir le pouvoir des bolcheviks et qui renfora le dsir de paix l'Est. Aujourd'hui cette tactique
Andr Chradame (1925), Les Causes lointaines de la Guerre
53
est carte. A l'Ouest, le but est maintenant d'atteindre une paix victorieuse par la force des armes. (V. Le Temps, 18 avril 1918.) Enfin, les social-dmocrates du Kaiser se sont rsigns aux formidables annexions germaniques l'est avec une telle facilit qu'il est difficile de douter que cette violation cynique de leurs principes ne ft accepte secrtement par eux depuis fort longtemps. Ils ne se sont inclins qu'en novembre 1918, aprs le dsastre bulgare et l'effondrement de l'Autriche-Hongrie. Les textes anciens et les faits acquis concordent donc pour prouver avec une vidence indiscutable que le Pangermanisme et le plan concret d'annexions et de mainmises qui en est rsult constitue la raison profonde lointaine et directe de la guerre.
II
SECONDE RAISON LOINTAINE INDIRECTE DE LA GUERRE. LE PACIFISME
Retour la table des matires
Quand je publiai mon livre Le Plan Pangermaniste dmasqu, au dbut de 1916, on pouvait alors esprer que la lutte finirait sans qu'il ft indispensable de dmontrer comment le Pacifisme qui longtemps avant la guerre a rgn dans les pays aujourd'hui allis, a considrablement contribu la provoquer. Si cet expos de la seconde raison lointaine de la guerre avait t fait au commencement de 1916, il aurait pu porter atteinte l'union sacre qui tait la base de l'entente morale rgnant cette poque dans les pays allis, et qui tait indispensable la conduite de la guerre. En effet, au dbut de 1916, le silence des pacifistes permettait de penser qu'enseigns par la formidable leon des faits odieux rsultant de l'agression austro-allemande, ils avaient pour toujours renonc leurs funestes illusions d'avant-guerre. En outre, cette poque, beaucoup de pacifistes notoires de jadis proclamaient nettement la ncessit de chtier les crimes allemands. Enfin, un trs grand nombre d'anciens pacifistes de bonne foi faisaient vaillamment leur devoir de soldats contre l'imprialisme prussien. Dans ces conditions, il aurait pu tre contraire au maintien de l'union morale si ncessaire conserver dans l'intrt commun des Allis, de rappeler ces pacifistes d'avant-guerre qu'ils avaient personnellement des responsabilits extraordinairement lourdes dans le dchanement de l'affreux cataclysme. Mais au moment mme o je rvise ces lignes, c'est-dire au milieu de 1925, la situation morale dans les pays allis est prodigieusement diffrente de ce qu'elle tait au dbut de 1916. Depuis la rvolution russe, mars 1917, notamment, jusqu'au dbut de l'offensive allemande contre le front d'occident, mars 1918, c'est--dire exactement pendant une anne, un courant pacifiste d'abord faible et dissimul s'est ensuite violemment dchan
Andr Chradame (1925), Les Causes lointaines de la Guerre
54
dans les pays de l'Entente. Les pacifistes meneurs de ce mouvement ne sont pas en ralit trs nombreux, mais ils ont dispos de puissants moyens d'action qui leur ont permis d'agir de plus en plus sur les milieux dirigeants de tous les pays allis. L'arrt prmatur de la guerre par l'armistice du 11 novembre 1918 a grandement favoris leur action. Depuis lors, par suite de l'incapacit dont ont fait preuve les dirigeants de l'Entente devant les problmes poss par la paix, et en raison de la dception trs comprhensible prouve par les peuples des grands pays de l'Entente, l'action des pacifistes est devenue prpondrante. Ils ont russi transformer la victoire des Allis en dfaite, au moins financirement, et ils font tout ce qui est ncessaire pour rendre encore possible le triomphe de l'Allemagne, mme au point de vue territorial. Les pacifistes constituent donc de dangereux monomanes contre l'action desquels on ne saurait trop se prmunir. *** Afin de pouvoir dmontrer avec une entire efficacit la responsabilit du pacifisme dans l'clat de la guerre je tiens le faire dans des conditions telles qu'aucune arrire-pense ne puisse m'tre suppose. Il faut qu'on soit bien persuad, en effet, que si je prends partie les pacifistes c'est uniquement parce que, contrairement aux apparences, ils sont, en ralit, de trs dangereux ennemis de la paix car ils favorisent avec une impardonnable inconscience les plus formidables ambitions allemandes. Le meilleur moyen pour moi de prouver que mon attaque du pacifisme est faite exclusivement dans l'intrt de la paix est de dmontrer que tous mes efforts avant la guerre ont eu pour constante proccupation le maintien d'une paix honorable et que, rellement, les solutions que j'ai prconises jadis constituaient vraiment les moyens les plus propres empcher la guerre. La reproduction fidle de quelques passages de mes ouvrages antrieurs la guerre et relatifs aux problmes tout fait essentiels de la politique universelle fera la dmonstration ncessaire. En 1901, dans mon livre : L'Europe et la question d'Autriche, au seuil du XXe sicle, j'crivais page 296 ces lignes prouvant trs nettement que quand jadis j'ai rclam des armements, ce fut uniquement parce que leur ralisation dans une proportion suffisante constituait, tant donn les buts politiques poursuivis par le gouvernement de Berlin et ses incessantes mesures militaires, le procd le plus efficace d'empcher la guerre. Rien plus que la dfaillance de la France ne saurait encourager les pangermanistes persvrer dans leur oeuvre. Ils savent que plus la puissance militaire de la France sera diminue, et plus ils auront de chance d'entraner le gouvernement de Berlin au moment dcisif. La force restant, aujourd'hui comme hier, l'argument suprme de toutes les grandes crises internationales, on peut dire hardiment : l'existence d'une arme franaise en bon ordre matriel et moral, toujours en tat d'intervenir, est le plus sr moyen d'empcher, par le seul fait de son existence, l'immixtion de l'empire allemand dans les affaires de l'Autriche : par contre tout
Andr Chradame (1925), Les Causes lointaines de la Guerre
55
affaiblissement de l'arme franaise accrot d'autant les chances de ralisation du plan pangermaniste. En ce qui concerne l'Autriche-Hongrie dont le sort a t si discut dans les pays allis, depuis la guerre, personne n'a t plus ferme partisan que moimme de l'intgrit de la Monarchie de Habsbourg, tant que le maintien de cette intgrit a pu tre honntement considr comme un moyen de maintenir la paix. Dans l'ouvrage cit plus haut, page 415, j'crivais en 1901 : Le gouvernement de Berlin travaille politiquement dtruire l'Autriche; la France et la Russie doivent travailler politiquement la consolider. Et je concluais pages 425-426 ce mme livre par ces lignes : L'Autriche est un tat pacifique, mais l'influence mauvaise de la cour de Berlin sur la cour de Vienne peut encore la pousser dans des complications orientales. Le fdralisme mettrait obstacle ce dernier danger. Les peuples de Cisleithanie se neutralisant les uns par les autres, ayant surtout s'occuper sur leur propre sol de questions conomiques et sociales, pourraient tmoigner efficacement de leur rpugnance pour les grandes acquisitions territoriales. L'Autriche deviendrait alors un modrateur des ambitions allemandes d'une puissance extrme et, avec une force encore plus grande que par le pass, elle resterait la clef de vote de l'difice europen. Or, que faut-il pour assurer au monde tous ces bnfices ? Simplement la volont de prvoir temps. S'il est vrai qu'actuellement un danger redoutable menace l'Europe, tous les moyens existent d'y parer. C'est aux Franais et aux Russes, au Tsar et au gouvernement de la Rpublique, qu'il appartient d'empcher la question d'Autriche de jamais se poser. Il dpend d'eux d'assurer aux peuples, pour une priode nouvelle, ce bien suprme : la paix. En ralit donc, je n'ai envisag comme possible le dmembrement de l'Autriche que quand l'emprise de Berlin sur Vienne fut devenue irrmdiable, c'est--dire partir de 1909, aprs l'annexion de la Bosnie et de l'Herzgovine qui dmontra l'indissoluble solidarit des intrts imprialistes des dynasties des Habsbourg et des Hohenzollern. Mais, bien que celle opinion ft la mienne depuis 1909, je me suis bien gard de l'exposer avant la guerre car alors il fallait viter tout ce qui pouvait mettre le feu aux poudres en Europe. Cela est si vrai que dans la prface de mon livre : 12 ans de propagande en faveur des peuples balkaniques, paru en 1913, entre la premire et la seconde guerre balkanique, j'crivais encore le 28 mai de cette mme anne : La politique extrieure de la France doit suivre de prs l'action certaine du succs militaire des slaves des Balkans sur l'volution interne de l'AutricheHongrie, tat avec lequel nous devons dsirer amliorer progressivement nos rapports, admettant que tout ce qui pourra favoriser cette volution, autant que possible dans le cadre des frontires actuelles de l'empire des Habsbourg, est un rsultat hautement dsirable au point de vue franais.
Andr Chradame (1925), Les Causes lointaines de la Guerre
56
Comprendre qu'il est de notre intrt que l'Autriche-Hongrie voluant soit dans les meilleurs termes possibles avec la Russie et tous les tats balkaniques. J'ai donc t austrophile , comme on dit encore aujourd'hui, jusqu' la plus extrme limite possible. Je n'ai soutenu la conception du dmembrement de l'Autriche-Hongrie que depuis le dbut de la guerre mondiale, parce que la paix ayant t dtruite, par la complicit certaine de Vienne et de Berlin, il est impossible de la rtablir conformment au droit et de reconstituer l'Europe d'aprs le principe des nationalits sans liquider absolument le systme d'oppression germano-magyare qui s'appelle l'Autriche-Hongrie et qui constitue l'une des bases les plus indispensables du militarisme prussien. Autre exemple. Depuis longtemps dj l'intervention de troupes japonaises en Europe m'est apparue comme un moyen efficace de maintenir la paix lorsque l'Allemagne voudrait la troubler. A la suite de plusieurs voyages d'tudes en Russie et aprs la guerre russo-japonaise je n'avais plus d'illusions sur l'tendue du rendement ventuel des armes russes dans une guerre europenne. En 1906 j'crivais donc dans mon livre Le Monde et la guerre russojaponaise, page 414 : On doit admettre que la Russie, avant dix ou quinze ans, ne sera point redevenue une grande puissance militaire en condition, par exemple, de prendre part d'une faon vraiment efficace une guerre contre l'Allemagne. D'autre part, j'tais convaincu que les dirigeants de Berlin, de Vienne et de Budapest tenant avant tout aux principes aristocratiques bases de leur puissance, se sentant menacs par les progrs croissants des peuples dmocratiques de l'Europe centrale dont le dveloppement tendait barrer automatiquement et en pleine paix la route au Pangermanisme, n'hsiteraient pas rduire en servitude ces peuples non germains; j'tais encore persuad que cette agression se produirait dans des conditions tellement odieuses que malgr l'intensit de leur pacifisme les autres grands tats se verraient contraints la guerre. Je cherchai donc quelles forces pourraient bien, lors de cette ventualit, venir remplacer ou soutenir en Europe les forces russes qui vraisemblablement ne pourraient pas remplir d'une faon suffisamment efficace leur tche contre l'Allemagne. La frquentation en 1903 de hautes personnalits militaires japonaises et divers indices recueillis au pays du Soleil Levant m'avaient inclin croire que si les tats europens d'Occident, la France et l'Angleterre, se dcidaient traiter enfin les Japonais sur un vritable pied d'galit, ceux-ci seraient susceptibles en raison la fois de leur ralisme, de leur esprit de pntration et de leur idalisme, de comprendre le danger pangermaniste. Je pensai qu'une diplomatie franco-anglo-russe prvoyante pourrait organiser par une entente avec Tokyo l'envoi en Europe de forces japonaises, qui pourraient compenser l'insuffisance d'organisation selon moi certaine des armes russes. Dans la revue Lnergie Franaise du 11 mai 1907, page 289, j'exposai donc comment une entente diplomatique pouvait tre conclue, afin au cas o l'Allemagne dclarerait la guerre en Europe, de permettre aux troupes nipponnes de prendre part la lutte sur le sol du Vieux Monde . Mais si, ds 1907, je prconisais l'intervention japonaise, en mme temps, je marquais trs nettement que celle-ci devait tre prpare uniquement dans l'intrt du maintien de la paix. En effet, dans ce mme article de Lnergie Franaise, je disais textuellement page 289 :
Andr Chradame (1925), Les Causes lointaines de la Guerre
57
En tout cas, il faudrait qu'une combinaison de cette nature, si elle entre jamais dans la ralit diplomatique, ne puisse prendre un caractre offensif contre l'Allemagne ; elle doit n'tre qu'une mesure de prcaution trs puissante, tenue en rserve pour le cas o se produiraient des ventualits belliqueuses, dont nous ne prendrions pas l'initiative. Conue ainsi et renferme dans ces limites, la menace des Japonais cooprant en Europe avec les troupes franaises et anglaises, est l'un des plus srs moyens de faire comprendre Berlin la ncessit de ne pas troubler la paix. Ainsi envisage, l'entre en scne de l'lment jaune sur le sol du Vieux Monde deviendrait un acte de prvoyance et de conservation europenne. Enfin, propos de l'Alsace-Lorraine la page 666 de mon livre : La Crise Franaise, paru en 1912, donc la veille de la guerre, j'ai nettement dclar que si la reprise de l'Alsace-Lorraine est l'un des lments ncessaires de l'idal national de la France, le droit de revendication de la France tait cependant infrieur son obligation morale devant l'humanit entire de ne pas dchaner la guerre. Un peuple qui oublie la chair de sa chair est destin la mort nationale. Mais comprenons bien que, si la France a le devoir imprescriptible de se souvenir des provinces perdues, elle n'a pas le droit de mettre le feu l'Europe pour son seul intrt particulier. Sans doute, la question d'AlsaceLorraine ne se rsoudra jamais que par la guerre, mais cette guerre, ce n'est pas nous d'en prendre l'initiative. Elle viendra des Allemands eux-mmes et rsultera du choc des vnements, probablement comme une consquence presque fatale des tendances de l'Allemagne l'hgmonie. La question d'Alsace-Lorraine se rsoudra alors par l'effet de cette grande lutte ne, non directement cause d'elle, mais propos de l'quilibre europen. Il s'agira cet instant suprme d'tre victorieux et comme nous ne pouvons pas connatre le moment prcis de ce formidable conflit, le problme consiste pour nous tre toujours prts. Ces dclarations et suggestions sont nettes. Elles s'tendent de 1901 1913 et des vnements accomplis permettent grandement de croire que la paix aurait t conserve si les mesures prconises jadis dans ces lignes avaient t prises : armements suffisants en France, diplomatie franco-russe favorisant l'volution fdrale de l'Autriche-Hongrie possible jusqu'en 1909, cration d'une confdration balkanique ralisable jusqu'en 1908, peut-tre mme jusqu'en 1912, organisation de l'intervention de troupes japonaises en Europe. Aprs ces rappels de documents et de faits, personne de bonne foi ne saurait douter que si maintenant je montre l'immense danger du pacifisme et de ses propagateurs c'est uniquement en raison de ma conviction profonde que j'espre faire partager que l'action des pacifistes a puissamment contribu au dchanement du Pangermanisme d'o est sortie l'affreuse guerre mondiale. ***
Andr Chradame (1925), Les Causes lointaines de la Guerre
58
Le rsultat capital obtenu par les pacifistes avant la guerre avait t de dterminer dans les pays qui furent allis une orientation de la politique trangre caractrise par l'acceptation d'incessantes concessions devant les prtentions sans cesse renaissantes des gouvernants de Berlin et de Vienne qui se sont multiplies particulirement depuis 1890. Assurment, dans la pense de leurs auteurs, les acceptations des demandes germaniques furent faites dans le but de maintenir la paix mais, pour les raisons qui vont tre exposes et qui sont encore fort mal connues, en ralit, malgr les bonnes intentions de leurs auteurs, ces concessions en raison de leur caractre excessif ont constitu pour l'Autriche et pour l'Allemagne les plus puissants encouragements qu'on pouvait imaginer des ambitions dmesures. Remarquons tout d'abord que dans les vingt-cinq annes qui prcdrent la guerre deux courants d'ides apparemment opposes se dchanrent en Europe. D'une part, le gouvernement de Berlin poussant aux limites extrmes l'application du militarisme prussien, organisait matriellement la ralisation de la Pangermanie et au moyen d'une propagande intense prparait moralement le peuple allemand tout entier l'acceptation des diverses ventualits susceptibles d'assurer la domination universelle l'Allemagne prussianise. D'autre part, exactement dans la mme priode, un courant pacifiste intense prconisait le dsarmement en Russie, en Angleterre et en France. Il est vident que ce courant d'opinion a singulirement facilit la tche des pangermanistes parce qu'il a ralis l'extrieur des frontires de l'Allemagne la tche complmentaire de celle accomplie dans les limites de l'Empire de Guillaume II. Il faut remarquer que le pacifisme s'est dchan indpendamment de la forme des tats, aussi bien dans des monarchies constitutionnelles comme l'Angleterre que dans une Rpublique comme la France ou dans un Empire absolu comme l'tait l'Empire des Tsars. On doit noter encore que dans chacun des pays de l'Europe aujourd'hui allis, le pacifisme n'a pas t le monopole des partis d'opposition car il a infect plus ou moins des fractions de tous les partis. Nombreux d'ailleurs furent les pacifistes parmi les dirigeants des pays de l'Entente, Lord Lansdowne et Sir Edward Grey, par exemple, qui prsidrent la direction des affaires trangres de la Grande-Bretagne ont t des pacifistes notoires. Le tsar Nicolas II, autocrate de toutes les Russies, fut aussi un pacifiste fort agissant. C'est lui, en effet, qui a t le tenace initiateur de la confrence de La Haye dont les rsultats ont t bien diffrents de ceux attendus par ceux qui la favorisrent. Sous l'influence des ides pacifistes, les faits ou groupes de faits qui de la part des gouvernements europens aujourd'hui allis furent des concessions faites l'Allemagne en vue d'assurer la paix mais qui Berlin furent considrs comme des capitulations morales invitant accrotre toujours davantage les prtentions pangermanistes ont t si nombreux que je puis seulement rappeler les plus essentiels. Je citerai par exemple.
Andr Chradame (1925), Les Causes lointaines de la Guerre
59
1 La facilit avec laquelle la Russie de 1890 1904 se laissa dtourner par la diplomatie allemande de sa politique traditionnelle dans les Balkans pour aller, selon les suggestions de Berlin, s'engager en Extrme-Orient, pour s'y faire finalement battre par le Japon, ce qui laissa le champ libre l'Allemagne dans l'Orient europen. 2 Le trait franco-allemand du 4 novembre 1911 en vertu duquel la France cda 275.000 kilomtres carrs du Congo franais l'Allemagne alors que, pratiquement, ce trait confirmait si solidement les hypothques conomiques allemandes sur le Maroc que le 9 novembre 1911, une fois le trait sign, le chancelier allemand, M. de Bethmann-Hollweg pouvait dclarer avec vrit au Reichstag : Nous n'avons rien donn au Maroc que nous n'ayons dj donn et nous avons gagn un agrandissement de notre domaine colonial. De fait, la France tait tellement lie par ce trait qu'il fallut la guerre mondiale pour qu'elle put tablir au Maroc les lignes tlgraphiques et les chemins de fer que le trait du 4 novembre 1911 lui interdisait d'entreprendre sans avoir, au pralable, obtenu l'autorisation de Berlin la fois quant l'excution de ces travaux et l'ordre de leur ralisation. 3 L'incomprhension vritablement extraordinaire par sa persistance dont firent preuve la fois la France, l'Angleterre et la Russie dans l'affaire du chemin de fer de Bagdad. A partir de 1900 cependant, il tait manifeste que ce chemin de fer tait destin devenir l'armature de tout le plan allemand de domination universelle. Or, lors de l'entrevue de Potsdam en novembre 1910, Nicolas II accepta dfinitivement l'excution des chemins de fer allemands en Turquie et leur raccordement avec ceux que la Russie pourrait construire en Perse. D'autre part dans ses retentissants mmoires, le prince Lichnowsky a rvl qu'en 1912-1913 Sir Edward Grey lui fit l'norme concession d'accepter bnvolement l'excution des lignes allemandes dans l'empire ottoman. En vertu de cet accord anglo-allemand, la zone d'influence britannique tait dlimite sur la cte du golfe Persique et dans la rgion des chemins de fer Smyrne-Adin, la zone d'influence conomique franaise comprenait la Syrie et l'Armnie russe, mais le gros morceau, la Msopotamie entire jusqu' Bassorah, c'est--dire le morceau de choix, dont la possession assurait la domination du reste de l'Empire ottoman, tait reconnue par l'Angleterre comme zone des intrts allemands. Sir Edward Grey alla donc au-devant des dsirs pangermanistes en consentant l'Allemagne la ralisation du Hambourg-Bagdad ; il est clair que si Sir Edward Grey agit ainsi, ce fut par effet de son zle pacifiste et dans la croyance qu'en abandonnant l'Orient l'Allemagne, celle-ci laisserait la paix au reste du monde. Cette nave conviction tait d'ailleurs fort rpandue chez les pacifistes socialistes d'Occident pour lesquels, constate le prince Lichnowsky, Sir Edward Grey avait des sympathies. Or, comme ce dernier, les socialistes pacifistes taient gnralement d'avis que pour viter la guerre, le mieux tait de s'incliner sans rsistance devant les volonts de Berlin. C'est pourquoi beaucoup d'entre eux acceptaient par avance trs nettement les plans allemands sur l'Europe centrale et sur le Hambourg-Golfe Persique.
Andr Chradame (1925), Les Causes lointaines de la Guerre
60
Rien ne saurait mieux tablir l'existence formelle de cette opinion que les quelques lignes extraites d'un livre publi en 1913 par un dput socialiste franais notoire, M. Marcel Sembat. Cet ouvrage publi sous le titre curieux Faites un roi, sinon faites la paix, mrite une attention toute particulire pour deux raisons. D'abord, M. Sembat y traitait des questions les plus graves avec une comptence et une perspicacit dont le degr moyen est suffisamment indiqu par cette apprciation : Cela se rgle en huit jours, une guerre du XXe sicle. (Op. cit., p. 126.) Ensuite, si ce livre n'exprimait certainement pas l'opinion de l'immense majorit du peuple franais, il correspondait tellement aux tendances du groupe trs agissant des pacifistes franais qu'au mois d'aot 1913, il en tait sa dix-huitime dition, ce qui pour un ouvrage de ce genre constituait un succs de librairie sans prcdent . Le grand systme de M. Sembat pour viter la guerre se rsumait dans la capitulation pralable, complte et de bonne grce devant les volonts de l'Allemagne mme sur les points les plus essentiels. M. Sembat conseillait donc aux Franais l'abandon dfinitif de toute ide de revendication de l'Alsace-Lorraine. En outre, la page 145 de son livre, M. Sembat dclare : Bismarck lance l'Autriche le mot d'ordre fameux Drang nach Osten ! En marche vers l'Orient ! Par clairvoyance lmentaire, nous aurions d nous en fliciter ! Vers l'Orient ? Cela dtournera de nous le courant germanique ! Aimiez-vous mieux qu'il coule l'ouest ? Bismarck nous montre la Tunisie et l'Afrique ; il montre la race allemande l'Orient; nous avons chance de ne pas nous heurter ! Sommes-nous contents ? Nous sommes furieux ! exasprs ! Pour moi, je ne trouve rien de plus bte que cette fureur qui nous prend quand l'Allemagne forme des plans sur l'Anatolie, sur le chemin de fer de Bagdad, sur toute l'Asie Mineure. Je lui crierais de grand cur : Bon voyage ! Dans son tat de virginit gographique, ethnographique, conomique, psychologique, nationale, M. Sembat, pas plus que Sir Edward Grey d'ailleurs, ne s'est dout que donner l'Allemagne l'Orient, c'est lui fournir les moyens d'asservir, en outre, l'Occident. L'ide que la mainmise germanique sur l'Europe centrale pourrait bien entraner l'esclavage de populations dmocratiques ayant droit la libert n'arrte pas davantage M. Sembat. Parlant des intrts de la Russie dans les Balkans la page 182 de son ouvrage M. Sembat assurait par avance le gouvernement du Tsar que la France se refuse tirer l'pe pour ses intrts dans les Balkans, pour la Bosnie-Herzgovine, pour le cochon serbe . Or, comme on va voir, en 1913, M. Sembat exprimait des opinions aboutissant pratiquement aux mmes rsultats que ceux qu'aurait prconiss M. Caillaux en 1916. En effet, dans le rquisitoire du gouverneur militaire de Paris du 10 dcembre 1917 contre l'ex-prsident du conseil franais, le langage suivant est attribu M. Caillaux lorsque, se trouvant en Italie en dcembre 1916, il s'effora d'amener la paix la France et l'Italie. Tous les frais de la guerre, disait M. Caillaux, devront tre pays par la Russie et les
Andr Chradame (1925), Les Causes lointaines de la Guerre
61
Balkans. La Serbie disparatra et n'aura que ce qu'elle mrite. Quant la Roumanie, elle disparatra galement, c'est un malheur, mais il vaut mieux que ce soit elle qui paye la casse que nous. Ainsi, en pleine guerre, M. Caillaux, la grande indignation de la France, connaissant alors le plan pangermaniste aurait recommand la mme solution laquelle aboutissaient en fait, en pleine paix, les opinions de M. Sembat en 1913 dont alors on ne ralisait pas les consquences. Or, en 1913, prcisment Sir Edward Grey travaillait, secrtement d'ailleurs, combler les vux de M. Sembat puisqu'il cdait bnvolement l'Allemagne la Msopotamie comme sphre d'influence exclusive ainsi que l'a rvl le prince Lichnowsky. Des socialistes trs reprsentatifs des opinions dominantes de leur parti comme M. Sembat et des gouvernants pacifistes comme Sir Edward Grey jouant un rle dcisif, taient donc absolument d'accord sur la ligne de conduite gnrale suivre dont les vnements ont prouv le caractre funeste. Les faits incontestables tablis par le mmoire Lichnowsky tant l, on peut conclure sans crainte de se tromper : avant la guerre, croyant ainsi l'viter et par l'effet d'une profonde ignorance des ralits et des consquences de leurs concessions, les socialistes pacifistes et les pacifistes des pays qui furent allis inconsciemment sans doute mais en fait trs rsolument prparaient la Pangermanie comme depuis l'armistice ils la prparent nouveau sans paratre s'en douter davantage. *** Le pacifisme a pour cause gnrale profonde la trs faible connaissance qu'on doit malheureusement constater dans les pays de l'Entente des choses de l'extrieur, donc de l'Allemagne. Il en rsulte que ceux qui par temprament sont ports l'idologie discutent de la guerre et de la paix au moyen de principes abstraits et de conceptions a priori sans avoir pour se prserver des erreurs de jugement la connaissance de faits prcis soigneusement contrls. Ces idologues voient donc les pays trangers comme ils voudraient qu'ils soient et non pas comme ils sont. C'est dans cette catgorie d'esprits ports la thorie que se recrutent les pacifistes. Il est ais de comprendre que si ceux-ci connaissent trs peu les ralits extrieures matrielles, ils ignorent encore bien plus les ralits extrieures immatrielles, la psychologie du peuple allemand notamment. Or, toute l'erreur pacifiste a pour raison trs prcise une mconnaissance absolue de la psychologie des Allemands. Les faits de politique extrieure pacifiste de 1890 1914, c'est--dire les concessions infinies faites l'Allemagne ou l'Autriche dans cette priode ont t gnralement considres en Angleterre, en Russie et en France comme des actes de sagesse propres assurer la paix. Or, cette apprciation procde d'une mconnaissance totale du caractre allemand. Ceux qui dans les pays allis ont cru et croient encore que faire une concession aux Allemands est le plus sr procd de les engager rpondre par des concessions correspondantes se trompent absolument. L'Allemand prussianis voit une preuve de faiblesse dans toute concession qui lui est faite. Celle-ci a pour rsultat de l'inciter exiger bientt davantage. Il faudrait que dans les pays allis on se pntrt de cette vrit connue de tous ceux qui ont
Andr Chradame (1925), Les Causes lointaines de la Guerre
62
vraiment observ de prs l'Allemagne et les Allemands. Ceux-ci en raison d'un atavisme sculaire qu'il est impossible de songer changer rapidement, respectent uniquement la force matrielle dirige par une force intellectuelle qui les connaisse bien. L'unique moyen d'obliger l'Allemagne conserver la paix est de l'y contraindre, conformment au droit assurment, mais par des moyens de force plus puissants que les siens et toujours prts tre employs. Les faits prouvent trs nettement le danger des concessions aux Allemands. Avant le trait franco-allemand du 4 novembre 1911 relatif au Maroc, qu' l'heure actuelle beaucoup de braves gens en France peu informs considrent encore comme un acte ayant contribu au maintien de la paix, M. Paul LeroyBeaulieu avait trs bien prvu dans l'conomiste franais de 11 septembre 1911 que ce trait encourageait les Allemands de nouvelles prtentions. Offrir, disait le grand conomiste, des immensits une nation qui n'a pas risqu ni un seul soldat ni un seul centime et qui se contente de nous soumettre un chantage obstin, c'est en encourager la rptition indfinie . Or, en effet, les pangermanistes ne furent nullement satisfaits des normes concessions que M. Caillaux fit l'Allemagne, mais ils estimrent que la menace ayant obtenu dj un srieux rsultat il fallait la recommencer la plus prochaine occasion. La preuve que tout arrangement avec .les Allemands pouvant tre attribu la crainte d'employer la force est toujours interprt par eux comme une capitulation provoquant aussitt de nouvelles exigences de leur part rsulte trs nettement des importantes rvlations faites au milieu de septembre 1917 au journal Le Temps par M. Iswolski, ex-ministre du Tsar Nicolas II. Guillaume II ayant expos dans une conversation M. Iswolski qu'il voulait entraner la France dans une alliance avec l'Allemagne contre l'Angleterre, le ministre russe fit remarquer l'Empereur allemand : Il y a entre la France et l'Allemagne la question d'Alsace-Lorraine. Mais elle est rgle, rpondit Guillaume II. Dans l'affaire du Maroc, j'ai jet le gant la France. La France a refus de le relever, elle a donc refus de se battre avec moi, par consquent la question d'Alsace-Lorraine n'existe plus entre nous. Ainsi donc, d'aprs un tmoignage qui n'est pas douteux, c'est l'Empereur allemand lui-mme qui nous a appris que toutes les fois qu' propos d'un conflit on ne veut pas se battre avec l'Allemagne, cette attitude est interprte Berlin comme une capitulation. Or, en raison de leur psychologie qui videmment ne saurait tre change, cette faon d'interprter les concessions des voisins est celle de la quasi-totalit des Allemands. La vrit stricte est que, quand on a le bon droit pour soi et les moyens de force permettant de le faire respecter, toute concession faite l'Allemagne constitue une lourde erreur psychologique qu'il faut payer chrement car elle conduit fatalement un conflit beaucoup plus grave que celui qu'on a vit. Les faits permettent encore de vrifier la justesse de ce point de vue. Il tombe sous le sens commun que vers 1900 une opposition nergique et efficace aurait pu tre faite au projet allemand du chemin de fer de Bagdad par la Russie, la France et l'Angleterre. L'accord de ces trois puissances aurait pu tre ralis car pour des esprits clairvoyants, ds lors, il tait trs clair qu'elles taient galement menaces dans leurs intrts vitaux par le Bagdad. D'autre part, cette poque, ces trois puissances disposaient de forces devant
Andr Chradame (1925), Les Causes lointaines de la Guerre
63
lesquelles Berlin aurait d s'incliner car l'opinion allemande n'avait pas encore t passionne par la connaissance du plan pangermaniste. Donc, avec un effort relativement trs faible, la condition d'agir avec tnacit et rsolution, on et obtenu alors un immense rsultat. Comme les conceptions pangermanistes sont toutes fondes sur la ralisation du Hambourg-Bagdad, elles eussent t ruines par la base au moyen d'une opposition efficace faite au projet de chemin de fer allemand de Bagdad. Le poison pangermaniste qui cette poque commenait seulement se rpandre et t dtruit avant d'avoir pu infecter la quasi-totalit des Allemands. Les incessantes prtentions nouvelles allemandes, depuis 1900, n'auraient pas pu se manifester aprs cette opposition nergique au premier acte de ralisation pangermaniste et ainsi la catastrophe mondiale n'aurait pas pu se produire. En ralit donc, les concessions incessantes qui ont t faites jadis avec les meilleures intentions par la France, la Russie et l'Angleterre aux Allemands n'ont fait que les inciter rclamer toujours davantage et accrotre sans cesse leurs exigences. C'est pourquoi il est vrai et raisonnable de conclure que ces concessions faites jadis par les Allis d'aujourd'hui sous l'influence des pacifistes taient exactement le contraire de ce qu'il et fallu faire car elles ont constitu une constante surexcitation des ambitions allemandes d'o est sortie la guerre. En somme, le Pacifisme a cr l'atmosphre toute spciale qui tait indispensable pour permettre la plante vnneuse du Pangermanisme de crotre et de se dvelopper. *** Donc s'il est exact de dire que le pacifisme a t une raison lointaine de la guerre parce qu'il a cr un tat de choses la rendant beaucoup plus facile l'Allemagne, par consquent incitant le gouvernement de Berlin aux prtentions les plus excessives, il est galement vrai que le pacifisme avait donn aux grandes puissances une telle habitude de la concession-capitulation que si les grandes puissances seules avaient exist en Europe, l'Allemagne vraiment n'aurait pas eu besoin de leur faire la guerre pour parvenir ses fins. L'Italie, allie de l'Allemagne, s'ouvrait volontairement toutes les entreprises germaniques. En France, les Allemands jouissaient d'une libert incroyable et croissante. Certains d'entre eux obtenaient des concessions industrielles extrmement importantes. Londres, les Allemands avaient pntr partout. La doctrine du libre-change leur assurait toute facilit commerciale dans les immenses territoires britanniques. Quand le gouvernement de Berlin avait une prtention nouvelle (chemin de fer de Bagdad, Congo franais, privilges conomiques au Maroc) en fait aprs quelques tiraillements et un semblant de rsistance pour la forme, il obtenait de la France, de la Russie et de l'Angleterre tout ce qui tait ncessaire la ralisation en pleine paix du plan pangermaniste. Des hommes comme M. Giolitti en Italie, Caillaux en France, lord Haldane et Sir Edward Grey en Angleterre, entretenaient dans ces trois pays la situation optima pour les projets de Berlin. Sir Edward Grey les secondait mme de toutes ses forces puisqu'il concda sans aucune difficult la Msopotamie l'Allemagne, ce qui pratiquement assurait celle-ci l'hgmonie sur toute l'Europe centrale et sur les Balkans.
Andr Chradame (1925), Les Causes lointaines de la Guerre
64
En somme, la France et l'Angleterre taient gouvernes par des cabinets d'esprit rellement pacifiste et en Russie le peuple avait des sentiments nettement pacifistes. C'est ce que j'ai constat, en 1906, la page 413 de mon livre Le Monde et la guerre russo-japonaise, dans lequel je citais ces lignes d'Alexandre Briant-chaninoff dont la rvolution russe de 1917 a dmontr l'clatante vrit : Le peuple russe est pacifique par sa nature, il l'est mme un tel point que, malgr le rgime de l'autocratie militaire qu'il subissait depuis deux cents ans, le militarisme n'a jamais eu en Russie ni aptres ni disciples influents. Tout au contraire, le Russe, par son caractre d'un mysticisme inn, est enclin bien plus prter l'oreille aux utopies de l'autre extrme ; non seulement il rve un certain internationalisme comportant de suite comme consquence naturelle l'antimilitarisme, mais il veut mettre ses rves en pratique. Donc en dfinitive, en raison du pacifisme et des capitulations indfinies qu'il dterminait, la cause relle, la cause essentielle de la guerre ne saurait tre trouve ni en Russie, ni en France, ni en Angleterre. aucun de ces trois pays, le gouvernement de Berlin n'avait besoin de faire la guerre puisqu'en pleine paix il faisait aisment accepter chacun d'eux ce qui tait ncessaire la ralisation continue de ses plans les plus ambitieux.
Andr Chradame (1925), Les Causes lointaines de la Guerre
65
Les causes lointaines de la guerre (1925)
Chapitre VI
Slavo-latins et Germano-Magyars en Autriche-Hongrie avant la guerre
I. Diffrences capitales entre l'tat de la Dmocratie en Occident et en Europe centrale. II. L'intrt europen des crises autrichiennes ds 1897. III. Les races en prsence en Autriche. IV. Pourquoi, au point de vue europen, la rivalit des races prsente plus d'importance en Bohme que dans le reste de l'Autriche. La Bohme stratgique. Tchques et Allemands. V. La lutte propos des ordonnances sur les langues de 1897 marque les dbuts du Pangermanisme en Autriche. VI. La propagande croissante en Autriche des socits inspires de Berlin et ses rsultats ds 1897. VII. Situation intrieure gnrale de la monarchie des Habsbourg la veille de la guerre.
Retour la table des matires
On a pu constater dans les pages prcdentes pour quelles raisons la cause relle de la guerre ne saurait tre trouve ni l'est ni l'ouest de l'Allemagne; on va maintenant saisir pourquoi cette cause relle, cette cause essentielle de la guerre ne peut tre gographiquement dcouverte qu'en Europe centrale. Pour comprendre clairement pourquoi il en est ainsi, il est indispensable de saisir tout d'abord les diffrences capitales existant entre l'tat de la dmocratie en Occident (France et Angleterre) et chez les peuples slaves et latins, qui furent sujets des Habsbourg.
Andr Chradame (1925), Les Causes lointaines de la Guerre
66
I
Diffrences capitales entre l'tat de la dmocratie en Occident et en Europe centrale
Retour la table des matires
En Angleterre, l'avnement d'un rgime dmocratique a t le rsultat d'une lente volution parlementaire. Comme ce rgime a concid avec la longue priode brillante de l'empire britannique, les Anglais se sont peu peu habitus considrer ce rgime comme fort satisfaisant. Il en rsulta l'tat d'esprit suivant. Dans le quart de sicle qui prcda la guerre, au point de vue extrieur, les Anglais vcurent sur leurs anciennes conceptions sans prouver aucunement le besoin de les moderniser : par suite, ils ignorrent compltement le pril pangermaniste et crurent pouvoir s'occuper librement de leurs problmes sociaux intrieurs en se laissant compltement gagner par les ides pacifistes. Cet ensemble fit que la dmocratie britannique au moment o l'aristocratie allemande organisait toutes ses forces, se trouvait dans l'tat d'atonie et de passivit le plus favorable qu'on pt concevoir la ralisation des projets gigantesques du gouvernement de Berlin. En France, la dmocratie est le rsultat de la rvolution franaise fonde sur la dclaration des droits de l'homme et du citoyen. Mais depuis 1789, on en est rest en France la phase thorique sans s'tre suffisamment proccup de faire passer dans la ralit l'admirable formule rpublicaine : libert, galit, fraternit. D'ailleurs, la Restauration et le second Empire taient des rgimes qui ne permettaient pas l'organisation de la dmocratie. Quand la troisime Rpublique fut fonde en 1871 on aurait pu y procder, mais alors il et fallu que les classes dites dirigeantes aient rempli leur devoir social. Ce sont, en effet, les grands industriels et les grands commerants parce que certains d'entre eux avaient une culture intellectuelle suffisante pour comprendre la ncessit des rformes sociales en mme temps qu'ils possdaient les moyens matriels de crer de grands journaux et de faire des organisations lectorales indpendantes qui auraient d prendre l'initiative d'organiser sincrement la dmocratie franaise. Il n'en fut malheureusement pas ainsi. Imbus d'ides ractionnaires ou inactifs par simple gosme, ne comprenant pas le caractre indispensable d'une volution dmocratique profonde, la plupart des bourgeois aiss qui avaient les moyen d'agir boudrent la Rpublique. Leur abstention ddaigneuse eut cette consquence. Peu peu la reprsentation parlementaire de la nation passa des politiciens professionnels, c'est--dire des hommes qui considrent leur vie publique non comme un service qu'ils veulent rendre leur pays mais comme une vritable carrire qui doit avant tout assurer leur existence personnelle. Des politiciens de ce type sont entrs dans une proportion trop grande dans tous les partis franais. Pour la plupart intelligents et beaux parleurs, leur proccupation essentielle tait d'assurer leur rlection. Ils ne se souciaient point des intrts gnraux du pays car ils ne les connaissaient pas. Ces politiciens ne se proccupaient
Andr Chradame (1925), Les Causes lointaines de la Guerre
67
pas davantage de ce qui se passait l'extrieur, mme en Allemagne, malgr la terrible leon de 1870. Aprs la crise d'Agadir certains d'entre eux sentirent bien que des vnements graves pourraient surgir, mais chez la plupart cette sensation fut vague et ils se flattaient que si l'orage clatait ce serait beaucoup plus tard. L'tat actuel des choses durerait bien autant qu'eux. Inconscients des ralits extrieures toujours plus menaantes, ces politiciens proccups avant tout de maintenir dans leur circonscription lectorale un tat d'esprit favorable leurs intrts personnels c'est--dire leur rlection, faisaient des discours rassurants. La paix tait de plus en plus assure, on devait par consquent diminuer le poids des armements. A la veille mme de la guerre, beaucoup d'entre eux soutenaient qu'on pouvait sans danger abandonner le service militaire de trois ans pour revenir celui de deux ans. Comment, tant donne l'ignorance gnrale en France des choses de l'tranger, les braves lecteurs franais, malgr les admirables qualits de bon sens et de patriotisme dont ils ont donn de si incontestables preuves pendant la guerre, ne se seraient-ils pas laiss prendre aux harangues de tant de beaux parleurs? Ceux-ci discouraient avec tant de conviction qu'ils se grisaient de leurs phrases sonores et taient persuads eux-mmes de la valeur de leurs arguments thoriques. En haranguant frquemment leurs lecteurs, ils croyaient rellement remplir tout leur devoir car la plupart de ces politiciens professionnels croyaient fort srieusement qu'ils avaient agi quand ils avaient parl. Il rsulta de cet ensemble que la dmocratie en France au lieu d'organiser ses forces pour le meilleur service de son peuple admirable fusa simplement dans la verbalit. Ainsi donc, avant la guerre, exactement dans la mme priode o les Allemands organisaient formidablement l'imprialisme au moyen d'une connaissance approfondie des ralits acquise l'aide des grandes sciences politiques appliques, les dmocraties d'Occident (France et Angleterre), pour les raisons diffrentes mais concordantes restaient dans un tat rudimentaire particulirement favorable la ralisation des projets de Berlin. Guillaume II pouvait-il souhaiter un tat de choses plus conforme la ralisation de ses fins que les dmocraties occidentales subissant d'une faon particulirement intense les influences de genre divers mais de consquences identiques d'un Giolitti Rome, d'un Caillaux en France, d'un Haldane ou d'un Grey Londres ? Par contre, dans le quart de sicle qui prcda la guerre, l'tat de la dmocratie des peuples slaves et latins en Europe centrale et c'est l le point capital saisir devint de plus en plus contraire la ralisation du plan allemand de domination universelle. En Autriche, les Polonais, les Tchco-Slovaques, les Yougo-Slaves, les Roumains, physiquement trs vigoureux et plus prolifiques que les Allemands taient opprims depuis des sicles soit par les Allemands seuls, soit depuis 1866 par des Allemands ayant combin leurs efforts de domination avec les Magyars. A partir du XIXe sicle, ces peuples opprims peu peu touchs par l'esprit de la rvolution franaise se passionnrent pour le principe de la libert humaine dont la premire application en Europe centrale impliquait la libration de leurs nationalits. Il en rsulta que dans la mme priode o Anglais et
Andr Chradame (1925), Les Causes lointaines de la Guerre
68
Franais pour les raisons rappeles plus haut tombrent dans un tat d'atonie politique, les peuples slaves et latins, sujets malgr eux des Habsbourg se lancrent dans le combat pour la libert avec une nergie toujours croissante. Contraints de mener une lutte de tous les instants contre des oppresseurs aussi rsolus et aussi habiles que les Allemands et les Magyars, les Slaves et les Latins d'Autriche-Hongrie restrent constamment sur le terrain des ralits. Tout en ayant pour idal les principes de la Rvolution franaise, ils ne se payrent donc pas de mots comme les citoyens d'Occident. Ne voyant que les faits, les Slaves et Latins d'Autriche-Hongrie finirent par raliser trs bien le danger allemand sans cesse grandissant alors que celui-ci restait entirement incompris en Occident. Cette clairvoyance intellectuelle chez des peuples nombreux et physiquement forts dtermina cette situation. Autant en Occident la dmocratie tait dans un tat favorable aux ralisations pangermanistes, autant son tat en Europe centrale leur tait contraire. On conoit donc par consquent, que si le gouvernement de Berlin avait intrt voir maintenir la dmocratie l'Occident en raison de son tat spcial il avait le plus grand intrt la dtruire en Europe centrale.
II
L'intrt europen des crises autrichiennes ds 1897
Retour la table des matires
Depuis trente annes surtout, la lutte des Slavo-Latins contre les GermanoMagyars en Autriche-Hongrie est devenue sans cesse plus aigu. Mais en raison de cette extraordinaire ignorance des choses de l'tranger qui rgna en France et en Angleterre avant la guerre, cette lutte de la dmocratie en Europe centrale contre les aristocraties allemande et magyare coalises, bien qu'elle soit la vritable cause de la guerre mondiale, est encore peu prs inconnue dans les pays qui furent allis au moment mme o j'cris ces lignes c'est-dire sept annes presque aprs l'armistice. Afin de donner une impression particulirement vivante de l'instant prcis o les Slaves d'Autriche entrrent en lutte directe avec les Pangermanistes, je reproduis ici une tude datant de 1897 (voir p. 129), qui donne un aperu rapide de cette courte mais capitale priode de l'histoire du monde. Ce texte de 1897 ne parle pas de la Hongrie parce qu' cette poque c'est en Autriche que se concentra le grand combat entre Slaves et Pangermanistes qui tout rcemment, en 1895, venaient d'tablir leur premier plan concret. C'est seulement un peu aprs 1897 que la lutte s'tendit la Hongrie en raison de l'identit des intrts aristocratiques existant entre les grands propritaires fonciers magyars et les junkers prussiens. Aprs ce rappel ncessaire des vnements particulirement importants qui prcdrent l'anne 1897, on trouvera la fin de ce chapitre une vue d'ensemble des luttes nationales la veille de la guerre dans toute la monarchie des Habsbourg considre dans son ensemble. En 1897 j'crivais :
Andr Chradame (1925), Les Causes lointaines de la Guerre
69
La dmission du comte Badeni, les troubles de Prague, la situation parlementaire Vienne, proccupent vivement. L'attitude de la presse allemande, l'intervention de Mommsen dans les affaires autrichiennes, ne sont pas pour calmer les inquitudes. Les vnements d'Autriche ne constituent pas un accident quelconque dans la politique intrieure de cet tat. Leur porte est plus haute, il faut en prciser le cadre, en mesurer les forces, en calculer les consquences. La question qui se pose en Autriche est de savoir si les Slaves y jouiront de droits en rapport avec leur nombre ou s'ils continueront vivre sous un rgime purement allemand. Loin d'tre restreint aux frontires de l'Empire, l'intrt des affaires autrichiennes rayonne largement au dehors. Pas une puissance en Europe ne peut s'en dsintresser; de leur solution dpend la paix ou la guerre. Pour comprendre la situation, point n'est besoin de refaire l'histoire d'Autriche, trame serre de pactes, d'alliances, de mariages, de compromis, de diplmes. Il sufft de toucher quelques sommets de cette histoire et d'esquisser, larges traits, l'ethnographie des peuples de l'empire autrichien.
III
Les races en prsence en Autriche
Retour la table des matires
Jadis, aux premiers sicles, les Slaves possdaient non seulement les terres de l'Autriche, mais encore une grande partie des territoires de l'empire allemand actuel 1. Mis en contact avec la civilisation latine, touchs de son clat, duqus par elle, les Allemands acquirent une puissance suprieure. Leur expansion s'exera l'Est et au Sud-Est. Les masses slaves durent cder la pousse du flot germanique. En Autriche, la conqute allemande eut une fortune diverse; ses empreintes n'eurent pas partout la mme profondeur. Suivant qu'avec les sicles, la cristallisation de l'lment germanique devint on non parfaite, l'Autriche se divisa en deux rgions distinctes : celle o les Allemands chassrent vraiment du sol les Slaves, celle o ils ne firent que les submerger et les recouvrir.
1
L'Allemagne moderne s'est en grande partie forme par la conqute progressive et par la colonisation des pays qui taient slaves la fin du IXe sicle. (Freeman, Histoire gnrale de l'Europe, p. 194.)
Andr Chradame (1925), Les Causes lointaines de la Guerre
70
Ces deux tats si diffrents de cristallisation dterminent les groupes ethnographiques de l'Autriche contemporaine. Ils sont la fois la cause et la clef des vnements actuels. Dans les provinces au sud de la Bavire, dans la haute et la basse Autriche, en Styrie et en Carinthie, la cristallisation fut complte, la conqute allemande absolue. Les Slaves abandonnrent le sol ; partout ailleurs, ils ne furent que domins et subjugus. En distinguant quatre groupes ethnographiques, on donne la rpartition des lments slaves et allemands en Autriche sa forme la plus simple. Au centre, le groupe allemand, comprenant les provinces dj nommes, avec la capitale Vienne (voir la carte, p. 151). Au sud, un groupe slave (Slovnes et Croates), form de l'Istrie, de la Carniole et de la Dalmatie. Au nord, un second groupe de Slaves, les Tchques, habitant le royaume de Bohme, qui comprend aussi la Moravie et la Silsie. Au nord-est enfin, un troisime groupe slave compos de Polonais et de Ruthnes, dont le territoire forme un arc immense au nord de la Hongrie. Donc, au centre et l'ouest un groupe allemand, partout ailleurs des Slaves. Mais, circonstance sur laquelle il faut insister, aucun de ces groupes ne prsente une homognit absolue. Dans chacun d'eux, il y a un mlange d'Allemands et de Slaves, dont les proportions varient. Vienne mme n'est pas une ville purement allemande, puisque sur une population de 1 million et demi d'habitants, on compte plus de 200.000 Tchques 1. Dans les groupes slaves, c'est absolument la mme chose : on y trouve des enclaves allemandes. A ce point de vue, je ne parlerai que du groupe slave du nord, car, c'est la prsence au nord et au nord-est de la Bohme de majorits allemandes, minorits dans l'ensemble de ce royaume mais majorits chez elles, qui dtermine l'intrt de l'empire allemand pour les affaires autrichiennes. La rpartition des nationalits en Bohme est un fait capital ; j'y reviendrai tout l'heure. Quelles sont maintenant les forces respectives de ces deux lments slave et allemand, dont la runion constitue l'Autriche.
1
Ce chiffre est celui de 1897. Vienne, en 1914, il y avait prs de 400.000 Slaves, c'est-dire qu'en dix-sept ans la population slave de la capitale autrichienne avait presque doubl (1918).
Andr Chradame (1925), Les Causes lointaines de la Guerre
71
Fidle un principe que je me suis impos en crivant cette tude, je ne citerai que des chiffres et des documents allemands. La statistique allemande accuse la prsence en Autriche de 14.805.000 Slaves et de 8.840.000 Allemands. Je ne suspecterai pas la sincrit de cette statistique parce qu'elle est allemande, mais je dois signaler le procd qui a servi l'tablir. La base d'valuation n'a pas t, comme on pourrait le croire, la race ou la nationalit, mais la langue usuelle de conversation, la Uebungssprache. On a compt comme Allemands, tous individus parlant allemand dans la vie courante. Qu'en est-il rsult ? En raison des frontires tendues que prsentent les groupes slaves limits par des terres allemandes et surtout cause des prrogatives sculaires dont la langue allemande jouit en Autriche, un grand nombre de Slaves de race et de cur sont dans l'obligation de parler allemand. De ce seul chef la statistique a t incontestablement fausse. Malgr cette cause d'erreur, cette statistique allemande accuse une formidable majorit de 6 millions en faveur de l'lment slave en Autriche 1. Cette supriorit du nombre, cependant sculaire, n'a servi en rien et ne sert encore en rien aux Slaves. Forts de leur civilisation suprieure et plus ancienne, les Allemands d'Autriche les tiennent toujours dans l'oppression et la dpendance. Tout prs de nous, lorsque, en 1867, le comte de Beust conclut le compromis austro-hongrois, disposant de l'empire, l'lment slave ne fut mme pas consult. Encore aujourd'hui, l'administration, l'arme, tous les grands rouages de l'tat sont entre des mains allemandes. *** Mais, avec le sicle, un lment nouveau est entr en ligne et lentement a chang le fond des choses. Cet lment, c'est l'ide de nationalit, fille de la Rvolution franaise. Ce qui se passe en Autriche n'est pas un vnement nouveau, mais une priode nouvelle d'une volution depuis longtemps commence. C'est le dveloppement irrsistible et continu de l'ide motrice, de l'ide force de ce sicle : l'ide de nationalit.
1
Les chiffres de ce fragment de chapitre datant de 1897 sont naturellement ceux qui taient les derniers connus cette poque. Depuis lors, ces chiffres ont beaucoup vari surtout en raison de la puissante prolificit des populations slaves de l'Autriche. Le tableau insr la page 153 rsume la situation ethnographique de l'Autriche-Hongrie la veille de la guerre (1918).
Andr Chradame (1925), Les Causes lointaines de la Guerre
72
Aujourd'hui, aprs avoir permis la rsurrection des nations chrtiennes des Balkans, constitu l'Allemagne et l'Italie, l'ide de nationalit rend la vie les nations slaves de l'Autriche. Depuis cinquante ans surtout, s'accomplit dans cet empire un travail de renaissances nationales : lentement, tous les peuples slaves se ressaisissent. Trs superficiellement germaniss, les Polonais sont arrivs assez vite a arracher de larges concessions au gouvernement de Vienne. Plus meurtris et plus diviss, les Slaves du sud n'ont fait que se reprendre : ils n'ont encore peu prs rien obtenu.
IV
Pourquoi au point de vue europen, la rivalit des races prsente plus d'importance en Bohme que dans le reste de l'Autriche La Bohme stratgique. Tchques et Allemands
Retour la table des matires
Mais o la rsurrection nationale a t vraiment inoue, c'est en Bohme. Sur cette partie de l'Autriche, il faut concentrer l'attention, non seulement parce que Prague vient d'tre le thtre de graves vnements, mais parce que les Tchques sont la tte du slavisme autrichien et qu'une fraction de ce pays est menace d'annexion l'empire allemand. Losange de montagnes dont la pointe nord s'enfonce en fer de lance dans le royaume de Saxe, la Bohme, par ses frontires, semble avoir t cre pour abriter un peuple libre. Pendant des sicles, le destin ne l'a pas voulu. Jadis brillant et riche, le royaume de Bohme tomba sous la domination allemande aprs la bataille de la Montagne-Blanche, en 1620. Sa noblesse nationale fut dpossde. Les couches germaniques touffrent tout; la langue tchque mme disparut. Ce fut, comme les historiens tchques appellent cette priode, le sommeil de la nation . Mais, au dbut du sicle, la conception franaise de 1'ide de patrie son tour toucha la Bohme. De grands patriotes : ungmann, Palacky, Safarik, Rieger, entreprirent une tche qui paraissait insense : refaire la nation tchque. La langue tchque fut reconstitue sur quelques vieux manuscrits chapps jadis aux autodafs des germanisateurs. Les vieilles chansons retrouves dcidrent le rveil de la conscience nationale. Ds lors, le recul des
Andr Chradame (1925), Les Causes lointaines de la Guerre
73
Allemands commena. Parti de Prague, le mouvement s'irradia dans tout le royaume. Partout, comme des morts qui renaissent, les Tchques ont travers les couches germaniques qui, depuis des sicles, les touffaient : aujourd'hui, ils sont entirement reconstitus en. corps de nation. Bien connue, cette extraordinaire rsurrection sera un des tonnements de la future histoire. Mais si la nation tchque est refaite, le sol de la Bohme n'est pas entirement reconquis. Au nord et au nord-est, l'lment tchque se heurte des terres o l'lment germanique est mieux cristallis. L'arc de cercle qui, en partant de l'est, comprend les villes de Trautenau, de Reichemberg, d'Aussig, de Carlsbad et d'Eger, contient une population en majorit allemande. C'est la Bohme allemande, expression qui n'a d'ailleurs rien d'absolu, car cette rgion comprend elle-mme d'importantes enclaves slaves. Trs riche en mines et en chutes d'eau, elle est la partie la plus industrielle de la Bohme. Les chefs d'entreprises, quoique Allemands, sont obligs de recourir aux ouvriers tchques, en raison de leur habilet professionnelle et du bon march de leur main-d'uvre. Ainsi se sont formes les enclaves slaves, dites minorits tchques du nord de la Bohme. Les plus importantes sont aux environs de Dux, de Brux et de Bodenbach. Quoi qu'il en soit des droits et de l'histoire, le sol de la Bohme est partag entre deux lments ennemis : la rgion slave, habite par 4 millions de Tchques, et la rgion du nord et du nord-est peuple de 2 millions d'Allemands. Lintrt de cette rpartition ethnographique rside moins dans la rivalit des races en prsence que dans l'importance de la rgion occupe, en Bohme, par les Allemands. Les frontires nord de la Bohme sont entirement montagneuses. l'ouest de l'Elbe ce sont les monts Mtalliques, l'est, ce sont les montagnes des Gants. Succession de forteresses naturelles, cette rgion est au plus haut point stratgique. Commande par quelques passages, elle est la clef de la Bohme, sa possession ouvre la route de Vienne. Ce sont ces qualits stratgiques du nord de la Bohme, habit par une majorit allemande, qui vont forcer les grandes puissances surveiller attentivement les affaires autrichiennes. *** Les Allemands de Bohme, peu peu refouls au nord du royaume par l'lment tchque renaissant, n'ont pas voulu et ne veulent pas voir les causes profondes de ce mouvement. Ils sentent seulement leurs avantages perdus. Ils
Andr Chradame (1925), Les Causes lointaines de la Guerre
74
voient disparatre leurs privilges sculaires. leur mpris des Tchques a succd une haine violente qui se traduit par des vexations sans nombre. Craignant de paratre partial, je laisse un Allemand le soin de caractriser les rapports existant entre les deux races. Au congrs du parti allemand du droit, tenu en aot Francfort-sur-leMein, le baron de Schele de Hanovre a dclar : Les Allemands de Bohme que je connais par moi-mme et non par oudire, considrent les Tchques comme une nation mprisable. Ils ne craignent pas de les outrager publiquement, de la plus grossire faon, en employant des expressions que je ne saurais reproduire ici. Les procds que supposent ces paroles n'ont eu qu'un rsultat : concentrer les Tchques et dcupler leurs forces.
V
La lutte propos des ordonnances sur les langues de 1897 marque les dbuts du Pangermanisme en Autriche
Retour la table des matires
En dpit d'une loi lectorale uniquement favorable l'lment allemand, en 1896 les Tchques ont envoy au Reichsrath soixante-six dputs, devenant ainsi le parti slave le plus important de toute l'Autriche. Ds lors, le gouvernement a d compter avec eux. Pour obtenir leur concours, le comte Badeni, en avril 1897, a rendu les ordonnances rglant l'emploi des langues dans le royaume de Bohme. Ces ordonnances ont pour but de remdier aux plus criants abus rsultant des prrogatives accordes jusqu'ici la langue allemande. J'en rsume les dispositions essentielles : toute rclamation adresse aux ministres de l'Intrieur, des Finances, du Commerce, de l'Agriculture, aux autorits judiciaires, il sera rpondu dans la langue de cette rclamation. Les actes officiels seront rdigs dans la langue des destinataires. Les autorits devront communiquer avec les communes et les arrondissements dans la langue de ces divisions administratives. Les communications gnrales seront rdiges en deux langues. Contre tout accus, il sera requis dans sa langue. Tout jugement sera rendu dans la langue de l'accus. Toute dposition sera rdige dans la langue des tmoins.
Andr Chradame (1925), Les Causes lointaines de la Guerre
75
Enfin, une srie de mesures a pour objet d'assurer, partir du 1er juillet 1901, la connaissance pratique des deux langues par les fonctionnaires. En somme, donc, le tchque n'est mme pas mis sur un pied d'galit avec l'allemand qui reste, comme jadis, la langue intrieure des administrations des Postes, des Tlgraphes, de l'Arme et de la Gendarmerie. Comment donc des dispositions si justes, si modres, ont-elles pu causer l'agitation actuelle ? La raison en est simple. Les Allemands de Bohme ne peuvent se faire l'ide que le rveil de la nation tchque doive leur coter quelque chose. Cette consquence, obstinment, ils ne veulent pas l'admettre. Tous les efforts des Tchques pour les amener reconnatre rationnellement le bien-fond de leurs rclamations, sont rests infructueux. tout argument, les Allemands de Bohme, s'inspirant du proverbe magyar : L'homme slave n'est pas un homme , ont rpondu : Nous n'avons pas discuter avec vous, vous tes d'une race infrieure. Depuis dix mois, ils n'ont pas chang d'avis, et encore aujourd'hui, ils rclament le retrait des ordonnances sans discussion. Le comte Badeni ne voulant pas manquer sa parole, on s'est ligu contre lui. Ds le dbut, les Allemands de Bohme ont fait appel aux autres Allemands d'Autriche. Le plus grand nombre de ceux-ci ont pris fait et cause pour les frres du nord. Les protestations faites contre les ordonnances par la plupart des communes allemandes de l'Autriche le prouvent nettement. Mais une fois runis, les Allemands d'Autriche se sont encore trouvs trop faibles contre les masses slaves et leurs dputs au Reichsrath. Au nom du Pangermanisme, ils ont eu recours aux Allemands d'Allemagne. En franchissant la frontire, subitement le dbat a chang de caractre : de grave, la situation s'est faite menaante; de local, l'intrt des affaires d'Autriche est devenu europen. En discutant dans la presse ou dans les runions les ordonnances, Allemands d'Autriche et Allemands d'Allemagne sont arrivs soulever d'un bloc la question du slavisme autrichien. Avec stupeur, ils ont alors constat les progrs, senti la force et les consquences. Les Allemands d'Autriche ont compris qu'ils marchaient la perte de leur domination sculaire, les Allemands d'Allemagne la ruine de la TripleAlliance. De cette vision de l'avenir est ne comme une vaste coalition tacite pour la dfense des intrts communs. Dans les deux empires, quelques hommes n'allant pas au fond des choses, se laissant griser par les mots, pangermanistes convaincus, ont pris rapidement leur parti.
Andr Chradame (1925), Les Causes lointaines de la Guerre
76
Continuer l'agitation en Autriche, sous le prtexte des ordonnances, surchauffer l'opinion en Allemagne et forcer le gouvernement de Berlin intervenir, tel est leur plan politique. Chez les plus fougueux, les moins craindre cause de leur exagration, il ne s'agit rien moins que d'annexer, sous la forme plus ou moins dguise d'un gigantesque Zollverein, l'Autriche entire l'empire allemand. Les autres, plus modrs et plus dangereux, se contenteraient, comme prix de cette intervention, de voir annexer la Bohme du nord, la Bohme stratgique.
VI
La propagande croissante en Autriche des socits inspires de Berlin et ses rsultats ds 1897
Retour la table des matires
Depuis quelques mois, une campagne ardente rpand ces projets dans toutes les terres allemandes : or ces projets portent en eux la guerre, ils exigent l'attention de l'Europe. Malheureusement, il ne s'agit pas ici d'assertions vagues et mal dfinies. Trop de preuves srieuses existent d'un tel tat d'esprit. Le dput autrichien Prade, le mme qui, le jour anniversaire de Sedan, a dclar avoir pour souverain Guillaume II, s'est charg, au dbut de septembre, de prciser, dans la Volkzeitung, de Reichemberg, la situation. Il ne s'agit plus, dit-il, des ordonnances sur les langues ni d'tablir un accord entre dputs allemands et tchques, accord impossible cause de la diffrence des ides, il s'agit de savoir si l'Autriche sera une grande puissance politique et sociale sous une direction allemande ou un tat fdral tchque, polonais, allemand, qui fera une politique slavo-clricale et qui, plus tard, se tournera contre l'empire allemand. Depuis quelques mois, les dclarations analogues abondent, les manifestations annexionnistes se multiplient. Les socits pangermanistes de l'empire allemand s'agitent fivreusement. Dirige par M. Hasse, dput au Reischtag, l'une d'elles, rcemment encore peu connue, l'Alldeutscher Verband (l'Union pangermanique), cherche diriger le courant et renforcer le mouvement. Elle a organis, Leipzig, le jour anniversaire de Sedan, une srie de ftes o, en fraternisant, Allemands d'Autriche et Allemands d'Allemagne ont confondu, dans une mme haine, les Slaves d'Autriche et les Franais. Au banquet qui a termin la journe le rdacteur, Hoger d'Efer, se faisant l'interprte des Allemands de Bohme, a dclar : Jamais nous n'abandonnerons le combat, car nous savons que
Andr Chradame (1925), Les Causes lointaines de la Guerre
77
derrire nous sont les 50 millions d'Allemands de l'empire. Notre devise nous, Allemands de Bohme, reste toujours : Un Dieu, un empereur, un empire. Ces paroles sont la traduction fidle des sentiments de la majorit des Allemands d'Autriche. Les cartes postales, avec dessins, que les Allemands aiment changer pendant leurs voyages, ont manifest partout des sentiments identiques. J'en possde deux, l'une o un saint Michel allemand repousse du pied dans les flammes un Slave tenant les ordonnances; l'autre o le Michel allemand, un bton la main, est prt frapper sur les Tchques. La premire consquence d'une telle campagne a t l'affaiblissement du loyalisme des Allemands d'Autriche envers Franois-Joseph. Dans la Bohme allemande, ce loyalisme n'existe rellement plus. Les bustes de Bismarck ont remplac ceux des descendants des Habsbourg, le drapeau autrichien a fait place au drapeau allemand et le chant national est devenu la Wacht am Rhein. Quant la haine contre les Tchques, elle s'est rpandue au nord de la Bohme dans toutes les rgions allemandes. Un seul exemple en donne l'ide. Le 15 octobre dernier, le conseiller Foehler n'a pas craint de dposer sur le bureau du Conseil municipal de Vienne la proposition dont j'extrais les passages suivants :1 Toute fonction municipale, tout travail municipal, ne sera plus confi un Tchque; 2 un appel sera fait la population viennoise pour la prvenir contre le danger menaant de la tchquisation ; pour lui demander de ne confier ni une place ni un travail un Tchque qui manifesterait, d'une manire quelconque, ses sentiments anti-allemands. Les rcents troubles de Vienne ont montr combien cette proposition correspondait aux passions d'une fraction importante de l'opinion. Au Reichsrath, les dputs allemands annexionnistes reprsentent fidlement leurs lecteurs. Tout le monde connat la violence des manifestations pangermanistes du chevalier de Schnerer. En plein Parlement, le dput Wolf s'est cri : Vive la Germanie irrdentiste . Le 24 mai, devant une assemble de professeurs runis Salzbourg, le dput Iro n'a pas craint de dclarer : Il nous faut la runion de l'empire d'Autriche l'Allemagne. L'Autriche deviendra une province confdre, comme les autres provinces allemandes. L'empereur pourra continuer s'appeler empereur, s'il le veut. Pour nous, nous comptons sur notre mre la Germanie, qui n'abandonnera pas ses enfants en Autriche. Ces appels ont trouv en Allemagne un puissant cho. Partout dans l'empire allemand, on suit de la faon la plus cordiale et la plus sympathique le combat que les Allemands mnent en Autriche, pour leur nationalit et leur langue , constatait un journal allemand.
Andr Chradame (1925), Les Causes lointaines de la Guerre
78
La propagande matrielle a suivi de prs ces preuves d'intrt platonique. Cet t, des milliers d'appels ont t rpandus dans le nord de la Bohme. A Reichemberg, Teplitz, Saaz, Krumau, Tetschen, on a distribu profusion des brochures reproduisant en tte la Germania. On pouvait y lire les lignes suivantes : Aux agissements impudents des Tchques, il n'y a qu'une rponse faire : chassons les Tchques de toutes les maisons allemandes, de toutes les fabriques allemandes... C'est le devoir de tout bon Allemand d'agir ainsi. Plus de domestiques, plus d'ouvriers tchques; qu'un Allemand n'achte plus chez un Tchque ou chez ceux qui les soutiennent . Le 22 aot, les Leipziger Neueste Nachriten ont numr les conditions auxquelles l'empire autrichien peut subsister. Parmi celles-ci, je relve : la reconnaissance de l'allemand comme langue dtat en Autriche ; l'entre de tout l'empire dans une union douanire et commerciale avec l'empire allemand. C'est bien, on en conviendra, l'annexion peine dguise. En Allemagne, les individus partagent la passion des journaux. Le lendemain de son duel avec le comte Badeni, le dput Wolf a reu de tous les points de l'empire allemand plus de six cents tlgrammes de flicitations. Des cartes postales avec portraits des adversaires, les conditions et le rsultat du duel ont chang travers la frontire le Deutscher Gruss (salut allemand) des particuliers. Tout rcemment enfin, Mommsen montre le succs de la campagne entreprise. Sa lettre la Neue Freie Presse ne constate pas seulement les sympathies des classes claires allemandes pour le mouvement antislave en Autriche, elle constitue une dangereuse excitation. J'en rappelle la phrase principale dj si commente : Soyez unis, restez Allemands avant tout; c'est mon premier conseil. Et puis, soyez durs; ce n'est pas par la raison qu'on peut faire entrer quelque chose dans la tte d'un Tchque, mais surtout par les coups; c'est l mon second conseil . Paroles dcevantes qui font douter de la raison humaine. Comment un vieillard, un savant, un historien, a-t-il pu les crire ? D'autres passages de la mme lettre indiquent bien la porte des vnements actuels. Il s'agit de tout pour vous, c'est une lutte la vie la mort, une lutte d'o doit sortir le triomphe de la civilisation allemande. De mme que les Allemands d'Autriche regardent vers l'Allemagne, de mme les Allemands regardent vers l'Autriche . Le Danube comme le Rhin restera un fleuve allemand. L'enthousiasme soulev Berlin par ce manifeste prouve quel point les Allemands d'Allemagne se solidarisent avec ceux d'Autriche.
Andr Chradame (1925), Les Causes lointaines de la Guerre
79
Mais ce n'est pas tout. Cette opinion allemande qui en Autriche et en Allemagne, rclame l'annexion du nord de la Bohme, il semble qu'on la prpare depuis des annes. J'ai entre les mains le Manuel de gographie pour les coles suprieures de filles, de M. G. Brust et H. Berdrow (staedt Lehrern in Berlin). Cet ouvrage a t publi, en 1895, chez Klinkhardt Leipzig. On trouve ceci : Page 6. L'empire allemand est divis en cinq parties. Quatrime partie : L'enceinte nord de la Bohme (Die nrdliche Umwallung Bhmens). Les auteurs du manuel, considrant sans doute l'tat de l'opinion, annexent, ds maintenant, l'empire allemand la partie nord, la partie stratgique du royaume de Bohme. On ne saurait mettre cette singulire erreur sur le compte d'une faute d'impression, car, la page 36 de l'ouvrage, on trouve la carte de cette quatrime partie de l'empire allemand, l'enceinte nord de la Bohme . Voil ce que, depuis au moins deux annes, on enseigne aux jeunes gens de l'empire allemand. Y a-t-il l autre chose que la prparation scientifique de l'annexion? C'est cet ensemble de faits group, clair, raisonn, qui constitue une menace pour la paix... Comment permettre l'Empire le plus militaire du monde de possder la forteresse naturelle qui commande l'Europe centrale ? Comment alors, si l'on suppose cette conqute ralise, donner l'Empire allemand, tenant sous ses canons un peuple sans dfense, la tentation de s'tendre jusqu' Vienne, au centre de ce groupe allemand, son voisin par la Bavire, qui ds maintenant l'appelle ? Comment, une fois Vienne, lui donner la tentation plus forte encore de la mer, lui montrer un chemin facile travers les Slaves du sud impuissants ? Laisser s'accomplir l'annexion de la Bohme stratgique, c'est vouloir dans l'avenir l'Allemagne de Hambourg Trieste.
Andr Chradame (1925), Les Causes lointaines de la Guerre
80
VII
Situation intrieure gnrale de la monarchie des Habsbourg la veille de la guerre
Retour la table des matires
Tel tait le tableau qu'on pouvait dessiner en 1897 de la lutte entre Slaves et Allemands en Autriche. Depuis cette date, elle n'a fait que s'aggraver et s'tendre toute la Hongrie, o, d'accord avec les gouvernants allemands de Vienne, les gouvernements magyars de Budapest oppriment cruellement les Slaves (Serbo-Croates, Slovaques et Ruthnes) et les Latins (Roumains). Ainsi donc, en rsum, dans toute la monarchie des Habsbourg, Slaves et Latins devenus de plus en plus conscients de leurs droits ont lev des protestations sans cesse plus vhmentes contre l'hgmonie germanomagyare. Malgr leur tnacit, les efforts des Slavo-Latins ne pouvaient pas aboutir par des moyens lgaux pour les deux raisons capitales suivantes. En Hongrie, la loi lectorale tait viole si cyniquement par tous les cabinets magyars qui se succdaient au pouvoir qu'il a toujours t impossible aux Slavo-Latins d'obtenir, et beaucoup prs, des dputs proportionnellement leur nombre. En Autriche, la pression lectorale tant moins inique qu'en Hongrie, les Slaves, tout en ne pouvant pas avoir le chiffre de dputs dus leur nombre, sont arrivs parfois possder en fait la majorit au Parlement de Vienne. Mais ce rsultat apparemment si important ne leur a servi rien car les ministres de Vienne ne relvent que de l'empereur d'Autriche et quand le Reichsrath s'est prononc contre leur dsir, ces ministres l'ont renvoy purement et simplement, gouvernant ensuite au moyen du fameux paragraphe 14, texte constitutionnel dont l'application absolutiste rduit nant tous les efforts du Parlement de Vienne. tant donn ces diverses conditions, on conoit que la lutte des SlavoLatins contre les Germano-Magyars en Autriche-Hongrie tait devenue la fois formidable et exaspre. Comme cette lutte avait avant tout un caractre national et racial le meilleur procd de donner une notion aussi exacte que possible des forces opposes est de rsumer dans le tableau ci-contre quel tait l'tat des peuples et des races en Autriche-Hongrie la veille mme de la guerre.
Andr Chradame (1925), Les Causes lointaines de la Guerre
81
Les nationalits en Autriche-Hongrie
Les peuples soumis aux Habsbourg appartenaient neuf nationalits relevant de quatre races. Ils taient rpartis entre trois rgions bien distinctes : L'Autriche ou Cisleithanie ; La Hongrie ou Transleithanie (qui comprend la Croatie-Slavonie, dote d'un rgime spcial) ; La Bosnie et l'Herzgovine, dont la situation constitutionnelle n'tait pas nettement dfinie, mais qui peut tre considre comme une sorte de territoire d'empire. Or, ces chiffres taient faux, car ils taient tablis par les Allemands et Magyars leur seul profit, au dtriment des Slaves et des Latins qui sont, en ralit, beaucoup plus nombreux. Et cependant, en prenant ces chiffres systmatiquement truqus par les administrations de Vienne et de Budapest, on constate ce fait qui domine tous
Andr Chradame (1925), Les Causes lointaines de la Guerre
82
les autres. Dans les dernires annes ayant prcd la guerre, dans l'empire des Habsbourg comptant 50 millions de sujets (sans les trangers), 12 millions d'Allemands et 10 millions de Magyars soit 22 millions de GermanoMagyars, tenaient sous le joug 28 millions de Slaves et de Latins.
Chiffres arrondis en dizaines de mille) Autriche Allemands 9.950.000 Tchques 6.440.000 Polonais 4.970.000 Ruthnes 3.520.000 Slovnes 1.260.000 Serbo-Croates 790.000 Italiens 770.000 Roumains 280.000 27.980.000 Hongrie Magyars 10.050.000 Roumains 2.950.000 Serbo-Croates 2.940.000 Allemands 2.040.000 Slovaques 1.970.000 Ruthnes 480.000 Bosnie et Herzgovine Serbo-Croates (orthodoxes ou musulmans dorigine serbe) 2.000.000
20.430.000
2.000.000
Rapport des nationalits et des races (Chiffres arrondis en dizaines de millions) Autriche 3 races et 8 nationalits Germains (Allemands) Slaves (Tchques, Polonais, Ruthnes, Slovnes, SerboCroates) Latins (Italiens et Roumains 10 17 Hongrie 4 races et 6 nationalits Magyars (race spciale dorigine asiatique) Slaves (Serbo-Croates, Slovaques, Ruthnes) Latins (Roumains Germains (Allemands Les races de tout lEmpire Slaves.................................................................................................................. Germains (Allemands) ....................................................................................... Magyars .............................................................................................................. Latins .................................................................................................................. 24.000.000 12.000.000 4.000.000 50.000.000 10 5 Bosnie et Herzgovine 1 race et 1 nationalit Slave (Serbo-Croates) 2
3 2
Or, les Slavo-Latins qui depuis quelques annes taient devenus pleinement conscients de leurs droits, mais taient dans l'impossibilit de trouver une voie lgale pour obtenir gain de cause, furent tout coup encourags accentuer leurs revendications et les faire aboutir au besoin par des moyens rvolutionnaires.
Andr Chradame (1925), Les Causes lointaines de la Guerre
83
Les causes lointaines de la guerre (1925)
Conclusions
Retour la table des matires
Le Trait de Bucarest du 10 aot 1913 enregistra les rsultats des guerres balkaniques de 1912-1913. Elles avaient tourn contrairement toutes les prvisions et aux ardents espoirs des gouvernements de Vienne et de Berlin. La Bulgarie et la Turquie, puissances germanophiles des Balkans, avaient t vaincues par la Roumanie, la Grce, et surtout par la Serbie, tats dont les sympathies pour la Triple Entente taient de plus en plus manifestes. La situation tablie par le Trait de Bucarest du 10 aot 1913 bouleversa tous les plans de Berlin. D'abord, elle crait une barrire d'tats antipangermanistes dans les Balkans (v. la carte P. 62 du Plan pangermaniste dmasqu). La ralisation du Hambourg-Bagdad se trouvait ainsi d'autant plus compromise que le nouvel tat de choses dans les Balkans allait dterminer, en Autriche-Hongrie, un renversement des forces politiques qui devait fatalement faire perdre sa suprmatie au germanisme. En effet, les succs des Roumains, des Grecs et des Serbes en 1913, eurent pour effet rflexe d'accrotre, dans une norme proportion, la volont, chez les Slavo-Latins opprims en Autriche-Hongrie, de hter leur libration du joug germano-magyar en obtenant des droits proportionnels leur nombre, c'est--
Andr Chradame (1925), Les Causes lointaines de la Guerre
84
dire en imposant, tout le moins, le fdralisme la dynastie des Habsbourg. Le mouvement s'annonant irrsistible, c'tait le triomphe certain des Slaves et des Latins dans leur longue lutte contre les Habsbourg et ce triomphe allait se produire automatiquement, en pleine paix, par le seul effet des consquences psychologiques du Trait de Bucarest. Or, l'expansion dmocratique des Slaves et des Latins de l'AutricheHongrie ne pouvait manquer de dterminer ces deux rsultats : 1 Anantir l'hgmonie des lments aristocratiques germano-magyars en Autriche-Hongrie et, par consquent, permettre le dveloppement de peuples nettement anti-germains et plus prolifiques que les Allemands. 2 Mettre un obstacle radical l'accomplissement du plan pangermaniste berlinois bas tout entier sur la ralisation du Hambourg-Golfe Persique. Les deux consquences du Trait de Bucarest signifiaient donc l'effondrement certain de toutes les ambitions allemandes prpares depuis vingt ans et la fin du pouvoir des Habsbourg, dynastie allemande qui, depuis l'annexion de la Bosnie et de l'Herzgovine, ne pouvait plus se maintenir au pouvoir qu'en restant sous l'gide des Hohen-zollern. Cette volution des choses tait si videmment certaine que les gouvernements de Berlin et de Vienne se mirent trs aisment d'accord, ds le lendemain mme du Trait de Bucarest, sur la ncessit de principe de dtruire l'tat de choses cr par lui. Ce trait est du 10 aot 1913 et c'est le 6 novembre 1913, pendant le sjour du roi Albert de Belgique Potsdam que le Kaiser annona ce dernier que la guerre tait invitable et prochaine (v. Barons Beyens. L'Allemagne avant la guerre, p. 24.) L'assassinat de l'archiduc Franois-Ferdinand, en juillet 1914, fut considr comme un excellent prtexte l'crasement de la Serbie considre Berlin et Vienne comme l'ennemie principale du germanisme puisqu'elle tait devenue la base des forces anti-pangermanistes dans les Balkans. Une fois la Serbie rduite et humilie, tous les autres Slaves et Latins de l'Europe centrale seraient, par voie de consquences, contraints de subir nouveau l'hgmonie germanique. C'est pourquoi la volont de dtruire l'tat de choses cr par le Trait de Bucarest constitue La Cause immdiate de la Guerre, c'est--dire sa cause la plus apparente mais, en ralit cette cause fut une cause secondaire parce que celle-ci tait domine par une autre cause que nous allons dgager comme conclusion du prsent livre. Assurment, pour bien comprendre comment la nouvelle situation balkanique, existant la fin de 1913, devait fatalement et prodigieusement ragir sur celle de l'Autriche-Hongrie, il est indispensable de bien saisir La Cause immdiate de la Guerre, c'est--dire pourquoi, en 1912-1913, la Serbie, la Roumanie, la Grce ont pu transformer les Balkans malgr l'Europe, aussi bien malgr la Triple Entente qui tait nettement pacifiste, que malgr la Triplice. L'expos de cette situation fait l'objet du livre : La Cause immdiate de la Guerre qui est la suite de celui-ci. Sa documentation permet de comprendre par des constatations diverses et multiples que, si les Allemands de Vienne et de Berlin dcidrent d'craser la Serbie, mme en risquant une
Andr Chradame (1925), Les Causes lointaines de la Guerre
85
guerre mondiale, c'tait avant tout pour sauver l'hgmonie germano-magyar en Autriche-Hongrie. En outre, en donnant un tableau exact de l'tat moral et de la situation des forces matrielles de chacun des tats balkaniques la veille de la guerre mondiale, La Cause immdiate de la Guerre contient les arguments de fait dmontrant que c'est en ralit l'tat de choses cr par le Trait de Bucarest du 10 aot 1913 qui a permis, en octobre 1918, la victoire des Allis sur le Danube, victoire qui, en fait, a dtermin la capitulation des Allemands sur le front ouest le 11 novembre 1918. Cette vrit se trouve pratiquement constate par ce passage de la lettre que, le 3 octobre 1918, le marchal Hindenburg crivait au Chancelier de l'Empire : Par suite de l'croulement du front de Macdoine et de la diminution des rserves qui en est rsulte pour le front occidental... la situation devient de jour en jour plus critique... Dans ces conditions, il vaut mieux cesser la lutte. La Cause immdiate de la Guerre complte donc la dmonstration de ce livre : Les Causes lointaines de la Guerre. Les deux ouvrages tablissent la complte vrit de ce que le comte de Karoly proclamait le 12 dcembre 1916 la Chambre hongroise : L'Allemagne se bat pour le Berlin-Badgad . (v. Le Journal de Genve, 30 dcembre 1916.) Par consquent, en toute dernire analyse, on aboutit conclure que la guerre a pour cause essentielle, profonde et ancienne, le Pangermanisme dont la ralisation impliquait la ncessit, pour les Allemands, de conserver l'Autriche-Hongrie en sa forme ancienne afin de pouvoir faire durer l'hgmonie germano-magyar sur les Slaves et les Latins de l'Europe centrale, le maintien de cette hgmonie tant une condition indispensable de la ralisation du Hambourg-Bagdad. C'est uniquement par l'effet des rpercussions politiques de l'ultimatum la Serbie que la guerre s'est dveloppe gographiquement surtout l'Occident de l'Europe entre l'Allemagne d'une part, la France, l'Angleterre et les tatsUnis d'autre part. Mais il est capital pour la comprhension du pass, du prsent et de l'avenir, de raliser que, si les gouvernements de Berlin et de Vienne ont dchan la guerre en 1914, ce ne fut pas surtout, comme on le croit gnralement encore dans les pays allis, cause de la Russie, de la France ou de l'Angleterre, mais principalement et substantiellement afin d'assurer l'hgmonie allemande sur l'Europe centrale. FIN.
Vous aimerez peut-être aussi
- CombatDocument1 pageCombatYankhoba DiedhiouPas encore d'évaluation
- Albert Pike Le Nouvel Ordre Mondial PDFDocument45 pagesAlbert Pike Le Nouvel Ordre Mondial PDFionanic72100% (1)
- Histoires de Mercenaires 1960 - 1967Document84 pagesHistoires de Mercenaires 1960 - 1967Victor E RosezPas encore d'évaluation
- Les Aït Laâziz Face À La... - La Dépêche de KabylieDocument7 pagesLes Aït Laâziz Face À La... - La Dépêche de KabylieDon MassimoPas encore d'évaluation
- Bombardement ColonisationDocument6 pagesBombardement ColonisationNour El ImanePas encore d'évaluation
- BIKGUDocument3 pagesBIKGUValmir BekteshiPas encore d'évaluation
- La Bataille de BouvinesDocument4 pagesLa Bataille de BouvinesandreaPas encore d'évaluation
- Hoja de Respuestas TermanDocument3 pagesHoja de Respuestas TermansmcontrePas encore d'évaluation
- Orchestral Manoeuvres in The DarkDocument1 pageOrchestral Manoeuvres in The DarkGeckool100% (2)
- RefugiesDocument44 pagesRefugiesKarim HachimPas encore d'évaluation
- L'armeeDocument2 pagesL'armeeAura Mariana CimpoiasuPas encore d'évaluation
- Agua Bella - Mix BellaDocument27 pagesAgua Bella - Mix BellaGonzalo Alfaro UgazPas encore d'évaluation
- Conflits Et Territoires - Patrimoine - Derrière L'idée de Consensus, Les Enjeux D'appropriation de L'espace Et Des Conflits - Presses Universitaires François-RabelaisDocument11 pagesConflits Et Territoires - Patrimoine - Derrière L'idée de Consensus, Les Enjeux D'appropriation de L'espace Et Des Conflits - Presses Universitaires François-RabelaisSalas KaPas encore d'évaluation
- La Crise Des Fusées de CubaDocument4 pagesLa Crise Des Fusées de Cubachelmytoka5Pas encore d'évaluation
- DayZ Origins 1.7.7 Changelog FR (Incomplet)Document4 pagesDayZ Origins 1.7.7 Changelog FR (Incomplet)Quentin CaillaudPas encore d'évaluation
- (Superpartituras - Com.br) Haja o Que HouverDocument2 pages(Superpartituras - Com.br) Haja o Que HouverRaquel Couto YeahlandPas encore d'évaluation
- Julie NOEL - Contrat 635a6c90bc3138077bbbaa6dDocument5 pagesJulie NOEL - Contrat 635a6c90bc3138077bbbaa6dJujuPas encore d'évaluation
- Cinéma Et SociétéDocument166 pagesCinéma Et SociétéAna CienfuegosPas encore d'évaluation
- PDF Les Francais en Indochine Des Annes 1830 A La Fin de La Deuxieme Guerre MondialeDocument11 pagesPDF Les Francais en Indochine Des Annes 1830 A La Fin de La Deuxieme Guerre Mondialeaxel azertyuiopPas encore d'évaluation
- Terre Information Magazine N° 204Document59 pagesTerre Information Magazine N° 204Uncle JoffePas encore d'évaluation
- Le Chronotope D'un Barrage Contre Le Pacifique de Marguerite Duras21323Document11 pagesLe Chronotope D'un Barrage Contre Le Pacifique de Marguerite Duras21323Bra khalPas encore d'évaluation
- Handbook French 0Document130 pagesHandbook French 0Aware and Awake100% (1)
- Propellant GuideDocument46 pagesPropellant Guideexplo_boy33% (3)
- Jean AnouilhDocument10 pagesJean AnouilhKUKIPas encore d'évaluation
- Lista Pariuri Jihlava Porumbel NetDocument3 pagesLista Pariuri Jihlava Porumbel NetdlgdesignsrvPas encore d'évaluation
- ComptaDocument22 pagesComptaAbdoul Moustalif NanaPas encore d'évaluation
- L'affaire Des Déserteurs de CasablancaDocument5 pagesL'affaire Des Déserteurs de CasablancaSARIM FASSI FIHRIPas encore d'évaluation
- Révolution FrançaiseDocument40 pagesRévolution FrançaisePepe ZamoraPas encore d'évaluation
- La Chine de 1945 Aux Années 1990Document37 pagesLa Chine de 1945 Aux Années 1990luxmealexdiop24100% (1)
- Calendrier Scolaire 2023 2024Document1 pageCalendrier Scolaire 2023 2024durandPas encore d'évaluation