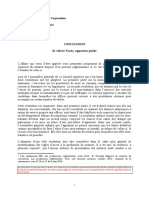Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Représentation Et Rôles Des Lieux Dans Le Film de Welles
Représentation Et Rôles Des Lieux Dans Le Film de Welles
Transféré par
le neveu de JacquesTitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Représentation Et Rôles Des Lieux Dans Le Film de Welles
Représentation Et Rôles Des Lieux Dans Le Film de Welles
Transféré par
le neveu de JacquesDroits d'auteur :
Formats disponibles
Rombeaut A Kafka Welles Lieux
Représentation et rôles des lieux dans le film de Welles
I quels lieux ?
-nombreux : appartement de K ; banque et ses différents services ; chambre de l’avocat, de Mlle
Burstner, de Titorelli, etc… K, dès lors qu’il quitte son appartement, découvre une foule de lieux inconnus
jusqu’alors.
-pour l’essentiel urbains : grande ville insituable, mais moderne, contemporaine (barres de HLM ;
architecture des années 50-60 sauf pour la fin et l’exécution où l’on semble s’éloigner de la ville, traverser un
village et arriver en pleine nature…
-ces lieux sont organisés autour de plusieurs oppositions :
-intérieurs et extérieurs
-espaces immenses (bureau de K et des employés, cathédrale et espaces resserrés (chambre de
K ; de Titorelli, placard du fouetteur, tous les couloirs…)
-lieux privés (chambre de K ; de Titorelli, de l’avocat…) et lieux publics (premier
interrogatoire, banque, déambulations au milieu des « accusés », théâtre). Remarquons que dans le film, K. ne
revient pas une seule fois à sa chambre…
-lieux « modernes » et lieux marqués par le passé (architecture d’aujourd’hui marquée par les
années 50 et des intérieurs aux lourds tapis,, tentures, tapisseries, mobiliers…). D’ailleurs, Welles tourne
principalement dans deux lieux : la gare d’Orsay du XIXème siècle et une nouvelle ville en Yougoslavie.
-lieux aux lignes orthogonales (chambre de K, bureaux de la banque, HLM…) et lieux plus
baroques (chambre de Mlle Burstner, de l’avocat, motifs décoratifs en spirales et arrondis…). Ces espaces
« baroques » aux décorations surchargées, exubérantes, aux meubles nombreux, contournés, donnent assez vite
une impression de désordre, de complexité qui trouble, fait tourner et perdre la tête…
-à tous ces lieux, on peut ajouter un dernier lieu qui est l’image dans laquelle « habite » K.
II Leur représentation
-des lieux qui ne sont qu’un seul lieu : petit à petit -parce qu’il retrouve des personnages qu’il avait
semblé avoir abandonnés, parce que ses réactions (angoisse, oppression) se répètent, parce qu’il est confronté à
chaque fois à son procès- on comprend que K. déambule dans un seul et même lieu. C’est l’idée que le tribunal
est partout à la fois et d’une certaine manière nulle part. (le « vrai » tribunal que K. n’atteint ni dans le livre ni
dans le film est « ailleurs », interdit. C’est un des aspects de la parabole. Il approche, il perçoit, il pressent mais
l’homme de la campagne n’atteint jamais le lieu ultime de la Loi. [Donner des exemples]
- des lieux qui « communiquent ». plus que dans le roman (où les ellipses temporelles, l’étalement de
l’histoire sur un an imposent des transitions et des pauses dans la succession des lieux), le film -dans lequel
l’histoire est concentrée sur deux ou trois jours- fait se communiquer entre eux de manière surprenante les lieux.
Sans souci de vraisemblance, K. ouvre une porte, un couloir et il pénètre dans un nouveau lieu. La topographie
du tribunal semble régie par une organisation, un plan « diabolique ». Ici, communiquer ne signifie pas un
bonheur mais au contraire administre à chaque instant la preuve qu’on « en » sort pas. Le fait d’avoir tourné les
scènes « d’intérieur » dans la gare d’Orsay (désaffectée) donne qui plus est une sorte d’unité (matériaux,
architecture) aux lieux traversés. [Donner des exemples]
-trop « grands » ou trop « petits »
si la chambre de K lui ressemble (un peu étriquée, bien rangée, propre, un peu austère ; parfaite
pour un célibataire), en revanche dès l’arrestation, le héros va aller de lieu en lieu jamais en harmonie avec lui…
Ou le lieu est trop grand et K semble perdu ; ou le lieu est trop resserré ou étroit et K y semble étouffer…. Les
lieux tels qu’ils sont montrés dans le film écrasent K. par leurs dimensions [Donner des exemples] ou au
contraire l’écrasent parce qu’il y est littéralement comprimé.
-des lieux oppressants : qu’ils soient vides ou pleins, les lieux oppressent. Il suffit d’observer les
réactions de Joseph K. (tel que le joue Perkins) pour se rendre compte du malaise qui est, à chaque fois, le sien.
Ce qui oppresse, c’est qu’ils recèlent des coins et des recoins d’où peut toujours, à la lueur d’une lampe, à la
lueur d’un regard surgir un individu (L’étudiant, Block, le secrétaire du tribunal). Chaque lieu semble « guetter »
K. et être l’occasion d’une rencontre pas forcément désirée (les petites filles). La traverse de chaque lieu est une
épreuve pour K. Il faut se baisser, se faufiler, courir, grimper…. Plus d’un lieu ressemble à une prison (le
meilleur exemple est la cage de Titorelli ou le « canari » K. est guetté par les yeux de chat des fillettes…)
-un immense labyrinthe
Rombeaut A Kafka Welles Lieux
-tous les lieux qui constituent le tribunal semblent communiquer. Mais ils communiquent que
parce que K. erre. C’est lui qui, en explorant ou en fuyant, ajoute une pièce à une autre… Finalement, K. comme
une sorte d’explorateur involontaire « découvre » l’immensité du tribunal. Mais dans cette marche en avant, il se
perd plus qu’il ne trouve. Les lieux sont labyrinthiques : escaliers, couloirs, se succèdent, se ressemblent et
diffèrent. La profondeur de champ adoptée par Welles fait que chaque lieu (chaque image) est à elle seule une
sorte d’échiquier où le pion K. se déplace au hasard. Jamais K. ne revient en arrière. Ajoutons encore que les
ombres portées, les horizontales et verticales qui organisent les images des lieux ajoutent à la confusion. Par
opposition, le lieu de son exécution -désert, rural et vide- semble signifier que son errance est achevée. K. est
sorti du labyrinthe. [Donner des exemples]
-des lieux mystérieux : K. (en dehors de « sa chambre » et de « sa » banque ») arrive toujours dans des
lieux jusqu’alors inconnus. Il découvre. Il est toujours en terrain inconnu, explorateur qui n’a pas le temps
d’explorer. Mystérieux, ces meubles qui recèlent ; ces casiers débordants, ces étagères où les dossiers
s’empilent, poussiéreux ; mystérieuses, ces pénombres, ces ombres ; mystérieux, ces objets abandonnés par qui ;
mystérieux aussi ce « gris » uniforme, un peu ouaté, dense qui est celui de l’image ; mystérieux, ces miroirs qui
reflètent le vrai et le faux ; mystérieuses, les apparitions ; ces portes fermées dont on n’a pas la clé ou qui se
ferment devant soi…
III Les rôles de cette représentation des lieux
-donner un équivalent visuel à l’œuvre de Kafka : cette remarque est simple mais il faut la faire. On
passe d’un moyen d’expression à un autre. Le cinéma ne peut que montrer là où la littérature suggère et laisse
imaginer. Le cinéma est donc obligé de se poser la question de la représentation de ces lieux. Comment
représenter le tribunal, la chambre…. Les « vides » du texte, le cinéma les remplit d’images. On voit que dans le
même temps qu’il « obéit » au roman, il ne peut que le trahir. Trahissons donc ouvertement semble dire Welles.
-Une fois quittée, la chambre « maternelle et confortable » de K ne se retrouvera plus. (Dans le roman,
c’est vrai aussi ; preuve que K. a perdu désormais toute intimité et vie privée ; au mieux, on le retrouve à la
banque…). Les lieux que découvre K et qu’il traverse sans jamais en voir le bout (sauf quand il en sera « rejeté »
pour son exécution) raconte -accompagnent en tous les cas- son « procès » (au sens de processus enclenché lors
de l’arrestation et qui n’est pas forcément le procès strictement juridique). Entre le triomphalisme (K. en tribun
dans une quasi réunion politique…) des premiers contacts avec la justice et la fuite éperdue dans des couloirs
(égoûts ? comme ceux du Troisième Homme dont Welles était l’interprète), avec aux basques la meute hurlante
des louves-Erinyes, on voit que les choses ont « évolué ». Le parcours dans les lieux (dans l’organique tribunal
dont il est expulsé comme un déchet) témoigne de son parcours, dans son procès, avec la justice
-Plus que les personnages qu’on y rencontre, les lieux sont la métaphore du tribunal. Ils sont à la fois la
réalité matérielle du tribunal (au sens de site, de bâtiment) mais ils sont dans le même temps, la métaphore d’un
tribunal qu’on ne voit jamais et que K. cherche. Les lieux sont toujours ce qu’ils sont et autre chose. Ce qui fait
que K. est à la fois tout près du tribunal (il est dans ses lieux mêmes) et toujours très loin (ce n’est jamais dans la
bonne pièce ; il y a toujours un couloir nouveau à prendre ; une porte qui se ferme… Le tribunal se donne et se
refuse…. D’où l’inquiétante étrangeté qui sourd de tous les lieux traversés…
-Mais les lieux dans la manière même dont Welles les filme manifestent la puissance du tribunal. On
comprend à chaque instant que K peut disparaître quand le tribunal le voudra, qu’on joue avec lui au jeu du chat
et de la souris. Prisonnier du tribunal et en même temps, libre ( ?) de s’y promener et de s’y perdre, K ne fait
manifestement pas le poids (ne serait-ce que dans ses confrontations physiques entre lui -frêle et gracile, presque
effeminé- et l’avocat Huld-Welles -au physique imposant en harmonie avec le tribunal).
-Ces lieux tels que Welles les représentent peuvent à bon droit peindre le tableau d’une société inhumaine, qui
nie les droits de l’individu. Si l’on tient compte du contexte historique (Guerre Froide ; connaissance
rétrospective et contemporaine des totalitarismes ; visions orwellienne et huxleyienne du monde [1984 et Le
meilleur des mondes] massification, uniformisation, bureaucratisation (que des cinéastes comme Jacques Tati
-de façon comique- dans Play-Time 1967 ou Jean-Luc Godard dans Alphaville 1965, Truffaut dans Farenheit
451 1966 ou encore la télévision avec le célèbre feuilleton Le Prisonnier mettront également en scène), alors on
peut assimiler la vision wellessienne du monde que découvre K. comme une peinture critique de cette société.
L’individu -coupable ou non, ou alors coupable de revendiquer son individualité- s’y débat un instant avant
d’être écrasé, éliminé. Cet aspect du traitement des lieux est vrai surtout au travers de la description des
architectures modernes (ensembles de béton aux lignes dures), des alignements géométriques de bureaux, de la
présence inquiétante de l’ordinateur…
Vous aimerez peut-être aussi
- LUZOLO BAMBI - Cours de Procédure PénalDocument200 pagesLUZOLO BAMBI - Cours de Procédure PénalNicodeme Tshishimbi50% (2)
- Jean Carbonnier - Droit PublicDocument9 pagesJean Carbonnier - Droit PublicPascal MbongoPas encore d'évaluation
- La Faute de Gestion FinalDocument76 pagesLa Faute de Gestion FinalMéry EmPas encore d'évaluation
- Dialnet LAMEDIATIONPENALE 8935353Document15 pagesDialnet LAMEDIATIONPENALE 8935353othmane benosmanePas encore d'évaluation
- Decision Du 05 05 2021Document8 pagesDecision Du 05 05 2021Football Total RegalPas encore d'évaluation
- Méthodologie Analyse Décision de JusticeDocument7 pagesMéthodologie Analyse Décision de JusticeVianney AZPas encore d'évaluation
- Barème UV 2023Document6 pagesBarème UV 2023Tom BruneauPas encore d'évaluation
- UntitledDocument13 pagesUntitledTamaraPas encore d'évaluation
- Recours Pour Exces de PouvoirDocument3 pagesRecours Pour Exces de PouvoirAlex DiedhiouPas encore d'évaluation
- Ouvrir PCDocument13 pagesOuvrir PCPaul JeanPas encore d'évaluation
- Fiche+1-3 Exemple Trame de Proces VerbalDocument3 pagesFiche+1-3 Exemple Trame de Proces VerbalDaouda DiarraPas encore d'évaluation
- Droit Constitutionnel - Les Institutions - CorrigéDocument6 pagesDroit Constitutionnel - Les Institutions - Corrigédiokoul439Pas encore d'évaluation