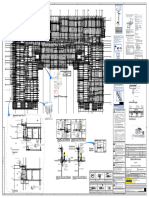Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Gresillon Almuth La Mise en Oeuvre - Pp.5-96
Gresillon Almuth La Mise en Oeuvre - Pp.5-96
Transféré par
Adriana López Gómez0 évaluation0% ont trouvé ce document utile (0 vote)
14 vues48 pagesGRESILLON_ALMUTH_La_Mise_en_oeuvre_
Copyright
© © All Rights Reserved
Formats disponibles
PDF ou lisez en ligne sur Scribd
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentGRESILLON_ALMUTH_La_Mise_en_oeuvre_
Droits d'auteur :
© All Rights Reserved
Formats disponibles
Téléchargez comme PDF ou lisez en ligne sur Scribd
Télécharger au format pdf
0 évaluation0% ont trouvé ce document utile (0 vote)
14 vues48 pagesGresillon Almuth La Mise en Oeuvre - Pp.5-96
Gresillon Almuth La Mise en Oeuvre - Pp.5-96
Transféré par
Adriana López GómezGRESILLON_ALMUTH_La_Mise_en_oeuvre_
Droits d'auteur :
© All Rights Reserved
Formats disponibles
Téléchargez comme PDF ou lisez en ligne sur Scribd
Télécharger au format pdf
Vous êtes sur la page 1sur 48
Almuth GrEsILLON
La mise en oeuvre
Itinéraires génétiques
CNRS EDITIONS
15, rue Malebranche — 75005 Paris
© CNRS EDITIONS, Paris, 2008
ISBN: 978-2-271-06668-8
Ouverture
Ingres aurait, dit-on, introduit l’ordre dans le repos ;
moi, je voudrais, au-dela du pathos,
introduire U'ordre dans le mouvement.
La genése, en tant que mouvement de la forme,
recouvre lessentiel de P@uvre.
{...] quelle que soit la nécessité interne ou externe,
dont il provient, le chemin qui méne 4 la forme
a une importance supérieure au but, a Vaboulissement
de cette voie, [...] La forme ne doit donc jamais
et en aucun cas étre considérée comme accomplissement,
résultat, fin en soi; mais comme genése, devenir, étre.
Paul Klee!
I west pas absurde de penser que la critique
puisse trouver des développements inattendus
par l’examen des manuscrits originaux.
Paul Valéry”
La critique génétique constitue aujourd’ hui une approche majeure
de la littérature. « Majeure » au double sens du terme. D’abord au sens
ott elle est devenue adulte: aprés ses débuts empiriques, elle a, 4 la fin
des années soixante-dix, affirmé son identité en se donnant un nom},
puis, en 1992, en se dotant d’une revue, Genesis, dont les numéros sont
autant de jalons dans |’élaboration d’un nouvel objet scientifique.
«Majeure» également au sens ot elle fait désormais partie des courants
importants de la critique liitéraire francaise’.
1. Ces fragments se trouvent dans Paul Klee, La Pensée créatrice, Paris, Dessain
et Tolra, 1973, respectivement aux pages 5, 457 et 169.
2, Paul Valéry, «Le manuscrit», in Le Manuscrit autographe, n° 1, Paris, Auguste
Blaizot, janvier-février 1926.
3. Voir Essais de critique génétique, Louis Hay, ed., Paris, Flammarion, 1979.
4. A preuve, trois signes: en 1990, un manuel universitaire intitulé Introduction aux
méthodes critiques pour l’analyse littéraire (Paris, Bordas, 1990; 2° éd., Nathan, 2002)
consacre un chapitre 2 la critique génctique. En 1998, méme phénoméne dans le «Que
sais-je» que Michel Jarrety a publié sur la Critique littéraire francaise au xx* siécle.
Enfin, en 2000, on voit paraitre chez Delagrave un manuel de frangais destiné aux classes
de seconde qui intitule un de ses onze dossiers «Du manuscrit & la publication».
6 La mise en ceuvre
S’étant dotée d’ outils et d’instruments appropriés a Ja constitu-
tion de l’avant-texte, la critique génétique a mis au point une méthode
d’analyse qui permet de reconstituer la genése des ceuvres. Ces analyses
requiérent certes un savoir-faire précis (description matérielle, déchif-
frement, transcription, classement chronologique), une terminologie
spécialisée et, le cas échéant, le recours 4 des programmes informati-
ques. Mais il serait erroné de croire que la méthode génétique consiste
essentiellement en descriptions positivistes et sophistications techni-
ques, Les outils ont pour seule finalité de permettre l’accés 4 «P euvre
qui se fait»*. Quant a l’intérét pour les ceuvres en devenir, il répond
sans nul doute 4 une interrogation générale de notre temps. Qu’il s’agisse
de littérature ou d’ceuvres appartenant a d’autres domaines de la créa-
tion artistique et intellectuelle, toujours surgit la méme question:
«Comment ca s’est passé ?». L’approche génétique se voit ainsi appli-
quée non seulement a la littérature, mais aussi a!’ écriture musicale ou
scientifique, de méme qu’a l’architecture, au dessin, au théatre et au
cinéma®, si bien qu’on a pu parler d’une «critique génétique généra-
lisée »?. En effet, 2 condition de disposer de traces témoignant de
processus, on sait désormais, grace 4 des protocoles précis, mettre au
jour les mouvements et moments gréce auxquels quelque chose d’in-
forme se métamorphose pour devenir forme, ceuvre.
Pour autant, il ne suffit pas de montrer, il faut expliquer et inter~
préter les mouvements génétiques. Il faut ce « trajet critique » évoqué
par Starobinski, qui est «an composé de rigueur méthodologique (Hé
aux techniques et 4 leurs procédés vérifiables) et de disponibilité réflexive
(libre de toute astreinte systématique) », trajet critique qui «ressemble
au voyage de ceux qui ‘partent pour partir’, sans savoir ot la pérégri-
nation les ménera»*, C’est & cette démarche interprétative que 1a géné-
tique doit d’étre considérée comme un courant critique. Un parmi d’ autres,
bien entendu. Du reste, ces autres courants, relevant de la critique du
5. Paul Klee: «[...] toute ceuvre n’est pas de prime abord un produit; elle n’est
pas une ceuvre qui est, mais avant toul genése, ceuvre qui se fait», ap. cit., p. 437.
6. Voir les numéros thématiques de la revue Genesis consacrés a la musique contem-
poraine (n° 4, 1993), & la psychanalyse (n° 8, 1995), l’architecture (n° 14, 2000), I’écri-
ture scientifique (0° 20, 2003), la philosophie (n° 22, 2003), les formes artistiques
(n® 24, 2004), le théatre (n° 26, 2005) et le cinéma (n° 28, 2006).
7. Voir Louis Hay, La littérature des écrivains, Paris, José Corti, 2002, p. 395.
8. Jean Starobinski, 1’ il vivant 17, La relation critique [1970], éd. revue et
augmentée, Paris, Gallimard, coll. Tel, 2001, p. 34 sq. et 53. — C’est moi qui souligne.
Ouverture 7
texte, ne sont pas absents de la méthode génétique. Dés lors qu’il s’agit
d’'interpréter, le généticien prend nécessairement position dans un paysage
théorique. Aussi existe-t-il — en fonction des affinités du critique et de
ce que les différents avant-textes peuvent eux-mémes suggérer — des
analyses génétiques dont les unes s’inspirent plutét de la narratologie
ou de la poétique, les autres, de la sociocritique ou de la psychanalyse,
d’autres encore, de la thématique ou de la linguistique. La critique avant-
textuelle s’ inspite donc plus ou moins directement des principes classi-
ques de la critique littéraire. Toutefois, ce rapport unilatéral est en train
de se transformer. Des notions comme « intertextualité », « stylistique »
ou «thématique », lorsqu’elles se trouvent mises 4 l’épreuve de ’avant-
texte, se dotent de contenus plus dynamiques, et connaissent ainsi un
réel renouveau,
Mais la critique génétique a aussi ses impératifs propres. D’em-
blée, et par essence, |’ avant-texte implique le multiple, «les sentiers qui
bifurquent» (Borges), les alternatives non résolues et les impasses.
Partant, la construction du sens, instable et non linéaire, n’est pas sans
ruptures ni contradictions. Pour autant, elle ne permet pas la spécula-
tion infinie. Les énoncés de l’avant-texte et leurs possibilités de signi-
fication, s’ils sont multiples, n’ existent qu’en nombre fini et demandent
a @tre lus a La lettre. Les manuscrits sont des garde-fous autant contre
l’assignation d’un et d’un seul sens que contre les interprétations sans
tivages.
Ayant participé dés le début 4 I’ élaboration de la méthode géné-
tique, i] me semble qu’aprés des années d’apprentissage, ot il a fallu
affiiter les outils, expliquer la démarche et en justifier I’intérét, le temps
est venu d’insister davantage sur le pouvoir explicatif et la force inter-
prétative de la génétique. Montrer la critique génétique a l’euvre, en
prenant a bras-le-corps les matériaux de I’ écriture, en essayant de faire
voir comment le lecteur-généticien construit des pistes possibles pour
Linterprétation, montrer aussi que ces interprétations peuvent révoquer
en doute, corriger, affiner ou complexifier des interprétations canoniques
de l’ceuvre finie, voila l’ objectif principal du présent ouvrage. Ainsi, ce
west pas la visée théorique ou l’exposé d’un corps de doctrine, mais la
lecture de cing dossiers génétiques qui est au centre de mon entreprise.
8 La mise en euvre
Ces lectures ont toutes en commun un attachement fondamental
aux formes de la langue qui changent: «mots sous les mots», mots qui
naissent, voyagent, se frottent 4 d’ autres, disparaissent et reparaissent
dans un contexte nouveau ; mots qui meurent, remplacés par d’ autres.
Et au-dessus du mot, le syntagme ou la phrase qui se cherche, se gonfle,
rétrécit et se déplace. C’est dans la tension entre ces éléments langa-
giers que se construit du sens et que se dégage peu a peu, y compris a
travers des fourvoiements et des impasses, la forme de ’ceuvre. Dans
la mesure of toutes mes lectures procédent pour I essentiel de la compa-
raison entre, respectivement, une forme «a» et sa réécriture en «b»
(puis en «c», «d>, etc.) et qu’elles essaient systématiquement d’éva-
luer les identités et les différences entre «a» et «b» (puis «b» et «c»,
etc.), elles restent, mutatis mutandis, fidéles au principe structuraliste!?.
Cela peut paraitre paradoxal, quand on songe 4 la matiére premiére
protéiforme, chaotique, bref, non structurée des brouillons'!. Mais cher-
cher dans le fouillis des feuillets 4 isoler des paradigmes de compa-
raison, ce n’est, apres tout, qu’une autre fagon, pour reprendre un mot
de Klee, d’«introduire l’ordre dans le mouvement»,
Reste 4 dire un mot sur le choix et la nature des cing dossiers.
Tous appartiennent 4 l’dge d’or de la génétique, celui qui, dans Vhis-
toire culturelle de la France, nous a transmis les plus riches trésors
manuscrits. Avec Flaubert, Zola et Proust, c’est de la prose, avec Super-
vielle et Ponge, de la poésie. De cette différence découle une autre:
grace ala forme bréve, la poésie permet un parcours génétique global,
tandis que, dans le cas de la prose, le volume des matériaux génétiques
est en général tel que le critique est d’emblée amené a faire des choix,
soit pour n’étudier qu’une partie des matériaux, soit pour privilégier
un axe précis de lecture. Ainsi, dans le dossier flaubertien, j’étudie la
montée d’un personnage dans l’avant-texte de l’un des Trois contes.
On verra que celui de Salomé, tel qu’il apparait dans les manuscrits,
semble plus ambivalent que celui que la critique textuelle a commenté
jusqu’a présent. Dans la Béte humaine de Zola, I’ étade du dénouement
9. Ces formes peuvent étre de volume variable: mot, syntagme, phrase, suite
d’énoncés.
10. La ditférence fondamentale réside cependant dans le fait qu’au sens strict, le
vapport structural eittre des unités «a» et «b» est de nature symétrique, alors que dans
le contexte génétique, il est nécessairement orienté puisque soumis &]’ordre du temps.
11, Le premier chapitre reviendra sur cet apparent paradoxe.
Ouverture 9
narratif illustre qu’aux différents stades de I’ écriture, la fin du roman
reste infiniment mobile et que Ja solution définitivement adoptée n’ était
en rien prévisible, — quoi que, par ailleurs, l’on ait pu dire sur Zola et
sa pratique de «!’écriture 4 programme». Quant au continent noir des
brouillons proustiens, c’est encore une autre piste interprétative qui est
choisie : I’ analyse d’un motif (la matinée), qui, tel un fil d’ Ariane,
traverse l’ensemble des manuscrits de /a Prisonniére. Par rapport 4 ces
situations qui imposent un choix, l’interprétation génétique d’un bref
poeme de Supervielle présente un cas heuristiquement idéal. La genése,
attestée par cing feuillets manuscrits, correspondant a cing états succes-
sifs de I’écriture du poéme, peut étre étudiée exhaustivement, pas 4 pas,
jusque dans ses ultimes surprises. Enfin, choisir un dossier de Ponge
est tout sauf innocent puisque cet auteur, on le sail, a été l’un des premiers
a publier la fabrique d’une de ses ceuvres. La genése de L’Ardoise,
conservée sur quarante-cing feuillets, met au jour des réseaux de sens
d’une complexité et d’une richesse que la version imprimée n’ aurait
sans doute pas laissé prévoir.
Ces études de corpus s’appuient sur, et prolongent mon ouvrage
précédent, Eléments de critique génétique (Puf, 1994). Les principes de
base en sont rappelés bri¢vement dans la premiére partie, qui comporte
également des ajustements et éclairages nouveaux. Ainsi, sur le rapport
4 la philologic, sur Ja valeur respective du document original et de ses
substituts, sur le couple indissociable lecture-écriture et sur la notion de
rature, qui est a la fois éradication et irradiation.
Deux chantiers nouveaux sont proposés dans la troisiéme partie.
D’une part, immense question de la genése théatrale, jusqu’ ici étran-
gement laissée pour compte par les études génétiques. Genése complexe
par excellence, puisque, a cété de la genése textuelle, avec ses docu-
ments propres, existe la genése scénique, avec les cahiers de mise en
scéne, les textes annotés des acteurs et du souffleur, les esquisses de la
mise en espace, les enregistrements des répétitions, etc. En outre, ces
deux types de genése ne se succédent pas simplement |’un 4 l’autre,
mais sont multiplement imbriqués. Le scénique est toujours déja copré-
sent dans la genése du texte, mais il produit aussi des effets en retour
sur celui-ci, en lui imposant des réécritures spécifiques. Du coup, certaines
frontires de la méthode génétique s’avérent poreuses. La fin de l’avant-
texte devient floue & partir du moment od I’auteur, sous leffet de la
scéne, se met & réécrire et A modifier son texte. De méme, le rdle éminent
10 La mise en ceuvre
joué par le metteur en scéne fait de celui-ci souvent une sorte de co-
auteur, si bien que la question de I’ écriture «a plusieurs mains» est posée
avec insistance.
Autre probléme de fond pour circonscrire le champ ¢ application
de la génétique: les siécles littéraires pour lesquels n’existent pas de
brouillons. Sont concernées, pour des raisons différentes, la littérature
frangaise entre 1550 et 1750, et celle du xxi siécle. La question commune
est alors de savoir si les documents génétiques traditionnels — les manus-
crits de travail — peuvent étre remplacés par d’ autres documents compor-
tant également des indices du processus qui a donné naissance aux
ceuvres. Pour la littérature de la Renaissance et de |’Age classique, on
dispose certes de divers documents de «sources», ainsi que de multi-
ples éditions revues et corrigées du vivant de Pauteur. Mais ces docu-
ments prérédactionnels et postéditoriaux obligent & admetire I’ existence
dune génétique de l’imprimé. En outre, le moment initial de la genése
et la phase de la textualisation — donc les moments clés du processus
scriptural — sont absents de ce type de dossier.
AY autre bout, l’écriture électronique, connue pour livrer des résul-
tats toujours lisses, propres et matériellement parfaits, semble annuler
toute trace de processus, Non sans fondement on a pu comparer le destin
de la critique génétique avec celui de l’anthropologie appliquée aux
Indiens d’ Amérique: des initiatives de recherche prises juste avant que
objet d’étude lui-méme vienne 4 disparaitre... Pourtant, certaines expé-
riences incitent 4 plus d’optimisme, par exemple quand Jacques Roubaud
utilise pour le Grand Incendie de Londres des logiciels qui enregistrent
en temps réel toutes les impulsions électroniques de I’ écriture et permet-
tent ainsi, «mieux sans doute que la préservation [...] de différents états
d’un texte sur écran, [...] de saisir ce qu’est la génétique d’un texte A
l’époque de la composition électronique »!?,
oe
Face & ces trajectoires interprétatives et 4 ces nouveaux chantiers,
une question s’impose: d’oi vient cet intérét des généticiens et de certains
créateurs pour l’aventure des formes en devenif, pour les facettes
12. Jacques Roubaud, « Bronilion 2000, in Marie Odile Germain et Danidle
Thibault (eds.), Brouillons d'écxivains, Paris, Bibliotheque nationale de France, 2001,
p. 190.
Ouverture 1
protéiformes de leur avénement ? Pour ma part, je vois une explication
possible dans ce que j’ai envie d’ appeler des «accidents heureux». En
effet, ce qui est fascinant dans ces processus, c’est qu’on assiste a des
moments d’ arrét, de rupture, de court-circuit, de biffure, de turbulence
et de choc, de catastrophe, d’impasse, de chute et d’écroulement, ces
instants oti, au sein d’une élaboration, quelque chose soudainement
résiste et se bloque, fait barrage au systéme et va 4 |’ encontre du mouve-
ment amorcé. Mais ce n’est pas tout, ou plutot, ce n’est que la face néga-
tive du phénoméne. L’important, c’est de voir que ces accidents, loin
@’étre forcément des échecs, peuvent étre 2 la fois rupture d’un chemin
et irruption d’une voie nouvelle, court-circuit et étincelle, épreuve de la
perte et bonheur de la surprise. Il faut qu’une ligne soit brisée, un ordre,
transgressé, une logique, mise en défaut pour que du nouveau puisse
nattre. Hl faut un rejet de l’ancien pour frayer la route a des «rejetons».
C’est cette simultanéité-la qui me suggére l’hypothése des « accidents
heureux »: moments de stupeur et de risque, aspects non programma-
bles, non prévisibles et non prédictibles des processus d’invention. Ce
sont les «Informulables soubresauts de l’ esprit. Inapaisables » de Beckett,
ce sont les «mouvements et contre-mouvements » de Klee, «les erreurs
gui sont en fait des chances, [...], les erreurs réussies, magnifiques » de
Duras, c’est «le fécond désordre» de Valéry.
Dans le travail @’ écriture (littéraire, musical, ou autre), ce «moment
névralgique», qui résiste et insiste, prend corps sous une forme parti-
culiére, celle de la rature, apparaissant d’abord comme «une pure défi-
cience» et pouvant ensuite donner lieu 4 un nouveau départ}?, Michaél
Levinas a cemé l’enjeu dialectique de ces moments dans un article inti-
tulé «De la rature et de Vaccident dans la création musicale» :
Tout travail d’écriture comporte un moment of ce qui découle du projet
initial semble se refuser A ce projet et appelle la rature, [...] un moment od
Je processus prévisible sera bouleversé par la découverte. [...] Il y a rature,
mais il y a aussi esquisse nouvelle. Ce sont les possibles de la création
musicale. L’idée musicale est la perspective de ces possibles, une fagon de
nouvelles cellules génératrices. Elles apparaissent soit comme surprises,
au sens haydnien du terme, soit comme accident, au sens boulézien,'*
13. Notons que cette propriété d’étre créatrice de nouvelles formes n’est cepen-
dant pas inhérente A routes les ratures; ainsi, une correction grammaticale n’est en
général pas de Pordre de ’invention.
14, Article paru in Genesis, n° 1, 1992, p. 113-116, ici p. 113.
12 La mise en euyre
La référence a Pierre Boulez est capitale pour cette hypothése de
accident. En effet, en maints endroits de son ceuyre théorique, notam-
ment dans les textes issus de son enseignement au Collége de France,
Boulez évoque la pertinence de la notion d’« accident». Lorsqu’ il parle
d’inventivité et expose la mémoire du créateur et le rapport 4 ses modéles,
il note que ces références a la tradition certes existent, mais qu’ «un acci-
dent important [...] peut curicusement les remettre en question». Et
Boulez ajoute que, pour le compositeur, de tels accidents «peuvent corro-
borer ou détruire ses prévisions, infléchir sa vision vers d’ autres solu-
tions »'®, En tout cas, et c’est 14 Pintérét théorique de Boulez, cette
«possibilité de I’ accident » est considérée comme essentielle pour l’acte
de création:
[...] la composition est faite de déductions a partir d’idées fondamen-
tales [...]. Mais la déduction peut, et méme doit, s’infléchir a partir de
Paccident, du geste; ta forme doit pouvoir dévier de sa trajectoire prévue
pour découvrir des territoires qui n’étaient pas «programmeés». (ibid.
p. 332)
Ainsi, l’accident «consiste 4 pouvoir intégrer Vimprévisjble dans
le prévu » (p. 333). Mais cette intégration implique un processus dialec-
tique, ot loi et accident s’affrontent et s’enrichissent mutuellement:
Je pense que la liberté fondamentale de composer ne peut se trouver que
dans l’arrachement, dans accident constamment absorbé par la loi, en
méme temps que dans la destruction sans cesse renouvelée de la loi par
Vaccident. (p. 336)
Cette dialectique entre « vision globale et accident de l’instant,
hasard aboli et libre arbitre préservé, primauté de l’ordre et transgres~
sion de la loi» (p. 408) devient le principe méme de l’ invention:
Hy acycle d’échanges, sinon imprévisible, du moins pas entigrement
prévisible, il y a dialectique de la loi et de l’accident. Un univers musical
sans loi ne peut exister [...]; mais Ia loi seule ne permet pas a accident
dexister, et prive ainsi la musique de la part la plus spontanée de ses
15. Ces textes furent d’abord publiés en 1989 sous te titre Jalons (pour une décennie).
Dix ans d’enseignement au Collége de France (1978-1988), puis repris en 2005 dans
Points de repére. Lecons de musique, dans les deux cas chez Christian Bourgois. C’est
selon cette demiére édition que nous citons.
16, Ibid. p. 79 et p. 84.
Ouverture 13
moyens d’expression [...]. On ne peut acquiescer a une pareifle mutila-
tion de l’invention: l’accident doit pouvoir étre constamment absorbé
par la Joi en méme temps que la loi doit sans cesse étre rénovée par |’ac-
cident. De ces deux péles de l’écriture, aucun ne saurait disparaitre sans
dommage. (p. 418-419)
Cette tension essentielle entre programme d’ élaboration et acci-
dent, entre travail et trouvaille, entre régularité et excés, est a l’ceuvre
dans d’autres domaines de la création. Ainsi, certains types de jeux de
mots, comme le,mot-valise, naissent exactement de ce genre de téles-
copage: la linéarité de la langue est brisée par I’ accident, par l’irruption
dune homophonie’. Mais |’invention intellectuelle en général, y compris
la découverte scientifique, bien qu’ obéissant 4 des démarches spécifi-
ques, n’est pas tellement éloignée de ce schéma théorique. On songe
aux travaux de Judith Schlanger, notamment a /’Invention intellectuelle
(Paris, Fayard, 1983), qui insiste sur la complexité du processus, fait de
«reprises, de surprises et de réorganisations», s’élaborant dans la durée
et impliquant «une dimension de risque» et une «solitude proprement
intellectuelle, qui tient au fait de déplacer ce qui est en place, de perdre
ce qui était certain, d’ organiser ce qui était informe et de séjourner dans
ce qu’on anticipe»!®, L’accident heureux n’a done rien & voir avec un
quelconque miracle, et encore moins avec un mystére ou une épiphanie,
c’est plutét, dans un voyage au long cours, un état de crise, une panne,
od advient soudain quelque chose d’imprévisible et de productif. Ainsi,
méme quand Hinstein écrit: « Tout a coup, il me vint V’idée la plus
heureuse de ma vie. Le champ gravitationnel n’a qu’ une existence rela-
tive», cette soudaineté de l’idée prend évidemment place dans une longue
chaine de déductions!?, Quant 4 la «panne» et son réle au sein de la
découverte, un chimiste dit qu’ « elle fait irruption et obstacle dans un
processus qui a jusqu’ici fait ses preuves», ou encore qu’elle est «la
conséquence de l’irruption d’un phénoméne totalement imprévisible »”°.
17. Voir Abmuth Grésillon, La rgle et fe monstre: le mot-valise, Tébingen, Niemeyer,
1984.
18. Judith Schlanger, «L’invention dans la pensée», in nudes frangaises, n° 26-
3, 1990, p. 22 sq.
19. Voir Jean Le Tourneux, «Pourquoi Einstein inventa-t-il une théorie dont personne
n’avait besoin ?», in Etudes frangaises, n° 26-3, 1990, p. 91-99.
20. Jean Jacques, L’imprévu ou la science des objets trouvés, Paris, Editions Odile
Jacob, 1990.
14 La mise en @uvre
C’est dans ce contexte qu’il faut rappeler aussi la thése de « 1’ erreur
féconde». Elle repose sur des expériences au cours desquelles Je scien-
tifique commet une erreur qui soudain se retourne en avantage, ou encore,
trouve des choses qu’il n’a nullement cherchées?'.
Revenons 4 la littérature. J’ai fait cette digression pour mieux expli-
quer mon intérét pour les ratures: elles sont partie intégrante, peut-étre
méme la partie la plus visible, du processus de création, L’ultime rature
dans la genése d’un poéme de Supervielle est ce titre exemplaire: d’un
méme trait de plume, il y a biffiure du «pain dur» ainsi que des « brouil-
lons aux ratures noires » et invention de ce «cozur écarlate » qui régle de
maniére inespérée les questions syntaxiques et de rime croisée laissées
jusque-la en souffrance. De méme, aprés d’interminables élaborations
d’une fin possible pour la Béte humaine, Zola trouve soudain cette idée
du train fou, écrasant tout sur son passage et s’arrétant dans l’incertain
de P’ Histoire. Quant & L’Ardoise de Ponge, on verra |’étonnante émer-
gence d’un triple intertexte, aussi passionnant que difficile, qui fera pour-
tant les frais d’une rature générale et définitive.
Tous ces itinéraires de la création sont des mises en euvre, Aun
double titre: parce qu’elles mettent en scéne le devenir euvre, et parce
quwelles mettent en ceuvre la méthode génétique. D’un cété comme de
autre, ces pérégrinations génétiques seront sinueuses et imprévisibles.
Voyages dans des pays lointains, dans des terres étranges et étrangéres,
comme le rappelle le latin peregrinus. Voyages d’ écrivains qui s’enga-
gent dans l’aventure de la création avec ses voies complexes, ses multi-
ples bifurcations, retours en arriére, arréts et accélérations, mais aussi
les voyages qui sont les miens et que j’ai entrepris pour comprendre et
interpréter ces trajectoires jamais rectilignes de la genése, en cherchant
4 aller jusqu’a «1a limite du pays fertile »””. Ces pérégrinations ne sont
pas des promenades tranquilles, ni des vagabondages oii l’on se laisse
porter au gré des hasards, ni, encore moins, des divagations ov l’esprit
se plait a errer sans but. Plutét des explorations d’ oti Je risque n’est pas
absent et pour lesquelles méme le mécréant a intérét & prendre son baton.
de pélerin. Au bout de la pérégrination, aucune terre sainte. Mais, pour
le créateur, une ceuvre, dont il sait qu’ elle «n’ aura jamais un visage défi-
21. Ibid., p. 101-116,
22. Titre d'une aquavelte de Kice : « Monument & Ja limite du pays fertile» (1929);
c’est & ce tableau que renvoie I’ ouvrage de Pierre Boulez, Le Pays fertile. Paul Klee,
texte préparé et présenté par Paule Thévenin (Paris, Gallimard, 1989),
Ouverture 15
> nitivement fixé»”*, et pour le critique, le tracé d’un chemin interprétatif,
qui ne sera jamais qu’un parmi d’autres.
Et de loin en loin, je crois voir passer l’ombre de Peregrina, V’étrange
étrangére de Mérike™, bohémienne & Ja peau sombre, aux yeux trou-
blants et au chant funeste, figure fixée nulle part, sinon aux limites de
ja raison, — figure-symbole de la quéte de I’ artiste.
Paris et Montolieu, mai 2004
Remerciements :
.. La genese de ce livre doit beaucoup aux travaux qui ont été menés au sein de Vins-
- titut des Textes et Manuscrits Modernes (ITEM-ENS/CNRS) : que mes collégues,
frangais et étrangers, mais aussi V institution du CNRS, qui m’a permis de mener
ces recherches tout au long de ma carriére, trouvent ici expression de ma grati-
_ tude. Un chaleureux merci & Lydie Rauzier pour le soutien technique qu'elle m’a
apporté dans la mise au point de Viconographie et de certaines transcriptions.
Tous mes remerciements vont également aux Bibliothéques et Archives qui m’ont
autorisée & reproduire des manuscrits : Bibliotheque nationale de France, Biblio-
théque littéraire Jacques Doucet, Bibliotheque historique de la Ville de Paris,
Musée du Louvre, Bibliotheque Municipale de Grenoble, Klassik Stiftung Weimar
{Nietgsche-Archiv), Arno Schmidt Stiftung Bargfeld, Carlfriedrich Claus Archiv
(Kunstsammlungen Chemnitz), Adolf Wolfli-Stifteng Bern, Robert Walser-Stifrung
Zurich, Paul Sacher-Stiftung Basel, Fondo Manoscritti di autori moderni e contem-
poranei (Universita degli Studi, Pavia).
Je remercie enfin tout particulidrement les écrivains ou ayants droit qui m’ont
autorisée & publier certains manuscrits : Michel Butor, Armande Ponge, Jean
Ristat (Aragon), Martine Boivin-Champeaux (Paul Valéry), Nathalie Mauriac
Dyer (Proust) ainsi que les successions Guillaume Apollinaire, Jules Supervielle.
23, Pierre Boulez: «Ce qui est important, c’est que I’ ceuvre ait |’infini des possi-
bilités devant elle [. ..]. L’intérét n’est pas de comparer deux visages @’une cere, mais
de savoir que cette ceuvre n’aura jamais un visage définitivement fixé.» (in Par volonté
et par hasard, Entretiens avec Célestin Delidge, Paris, Ed. du Seuil, 1975, p. 108)
24. Po&me écrit entre 1824 et 1828, inséré ensuite dans le roman inachevé Maler
Nolten, dont le personage d’Elisabeth est le double romanesque de Peregrina.
PREMIERE PARTIE
La critique génétique :
origines, définitions, méthodes
Chapitre premier :
Du texte au manuscrit*
Texte veut dire Tissu; mais alors que jusqu’ici ona
toujours pris ce tissu pour un produit, un voile tout
fait, derriére lequel se tient, plus ou moins caché, le
sens (la vérité}, nous accentuons maintenant, dans
le tissu, Vidée générative que le texte se fait, se
travaille a travers un entrelacs perpétuel,
Roland Barthes!
UN PEU D’HISTOIRE
Le structuralisme avait assigné a la notion de texte un statut de
choix: unité close sur elle-méme, achevée, garantie par sa cohérence et
sa structure internes. Mais le texte ainsi statufié a, depuis, perdu de sa
superbe —& telle enseigne qu’on Ini a volé non seulement la statue, mais
aussi le statut: «Le texte n’existe pas», déclarait, non sans un brin de
provocation, Jacques Petit en 1975, tandis qu’en 1985, Louis Hay consa-
crait un article? & cette formule a la fois célébre et téméraire?. Ce renver-
sement est di a une redécouverte du manuscrit. Redécouverte d’un objet
* Ce texte reprend des éléments & quelques publications antéricures : « Les manus-
crits littéraires : le texte dans tous ses états », Pratiques, n° 57, mars 1988; «La critique
génétique: entre philologie et théorie littéraire », Valéry, aujourd'hui (Anne Mairesse-
Landes et Serge Bourjea (eds), Montpellier, Bulletin des Etudes Valéryennes, n° 72-73,
1996; «La critique génétique : origines et méthodes», Genesi, Critica, Edizioni (Paolo
D’lorio et Nathalie Ferrand, eds), Amali della Scuola Normale superiore, Pisa, 1998,
1, Roland Barthes, Le Plaisir du texte, Paris, id. du Seuil, 1973, p. 100 sq.
2. Louis Hay, «Le texte n’existe pas», Poétique, n° 62, 1985, p. 147-158.
3. Les amateurs du texte clos et unique, prenant la formule & la lettre, ont soup-
gonné Ja critique génétique de youloir évacuer I’ objet méme des études littéraires.
20
La mise en euvre
servait un destin nouveau. Au lieu d’étre
nent du texte, au lieu d’illustrer, comme
quétes littéraires du début du xx° si&cle, les
sychologie du sujet créateur, le manuscrit deve-
yjet scientifique permettant de reconstruire les
auquel la «critiqn
«avant-textes »*, sur la multiplicité des états d'une ceuvre
nascendi. Dans la plupart des cas, il s’agit, aujourd’hui encore,
scrits autographes, donc écrits par la main de l’auteur. Ils donnent
‘Jes tremblés, interruptions, pulsions et envols d’une main dont le
tracé est le témoin d’une dynamique passée. C’est assurément un regard
nouveau sur la littérature. Regard nouveau sur un objet certes ancien,
mais doté d’une valeur nouvelle: les brouillons des ceuvres, considérés
non plus seulement pour leur valeur muséale et patrimoniale, ni seule-
ment pour exemplifier !a parole singuliére des chefs-d’ ceuvre, mais appré-
hendés en tant que traces de processus d’écriture. C’est A travers ces
indices d’écriture, de ratures et de réécriture — traces a la fois foldtres et
pourtant figées dans l’espace graphique de la page —, que le généticien
re-construit les étapes successives de 1’ élaboration textuelle. Le processus
n’est donc pas accessible directement, il résulte @’un travail qui trans-
forme les indices visuels de l’espace graphique en propriétés temporelles
d'un événément scriptural. Les signes manuscrits, foisonnants, protéi-
formes et multisémiotiques, exigent du critique-généticien qu’ il congoive
la littérature non plus comme une forme finic, mais comme un faire.
La premiére occurrence du terme «critique génétique» date de 1979.
Elle figure sur la couverture d'un ouvrage publié chez, Flammarion, qui
regroupe sous le titre Essais de critique génétique un texte de Louis
Aragon, expliquant les raisons du don de ses manuscrits au CNRS, une
postface de Louis Hay intitulée «La critique génétique: origine et pers-
pectives », et, entre ces deux contributions liminaires, cing études exem-
plaires de dossiers génétiques*. Volume qui a fait date: i] marque Pespace
4, Depuis l’ouvrage de Jean Bellemin-Noél: Le texte et l’avant-texte (Paris, Larousse,
1972), on entend par « avant-texte» l’ensemble des documents — notes, plans, scéna-
tios, ébauches, brouillons, copies au net, épreuves corrigées ~ qui ont matériellement
précédé Ie texte.
5. Raymonde Debray Genette sur Flaubert, Jean Bellemin-Noél sur Valery, Clau-
dine Quémar et Bernard Brun sur Proust et Henri Mitterand sur Zola.
Du texte au manuscrit 21
d’un nouveau champ pour les études littéraires, défini par son commerce
direct avec les écrivains ou, plus souvent, avec les traces écrites que ceux-
ci ont bien voulu nous laisser aprés leur mort®. Depuis cette «premiére »,
vingt-cing ans ont passé, riches en publications’, mais marqués aussi par
des tétonnements, des discussions internes et méme quelques polémi-
ques publiques®, Qu’en est-il aujourd’hui? Quelle est la place de la critique
génétique par rapport aux autres courants de la critique ? Qu’adviendra-
til de la critique génétique dans le contexte des nouveaux média? Survivra-
t-elle aux modes qui traversent réguliérement le continent des études
littéraires ? Mais tout d’abord: d’ou vient-elle?
Elle est née en France, au seuil des années 1960/1970, dans un
contexte historique dominé par une querelle, fagon xx° siécle, des Anciens
et des Modernes. Les uns la rapprochent de la philologie, tandis que les
autres V identifient a un structuralisme triomphant. Aussi a-t-on entendu
parler tantot d’une «harmonie retrouvée entre le lansonisme et la textua-
lité»®, tant6t d’un «changement de paradigme» A la Kuhn’®, caractéri-
6, De nos jours, on rencontre de plus en plus fe cas oi, de son vivant, un écrivain
Iegue ou préte — sous forme de dép6t — ses manuscrits 4 une institution de conserva-
tion ou de recherche; cf. les exemples d’ Aragon (don au CNRS) ou de Robbe-Grillet
(dépét 4 PIMEC). Les Allemands ont méme, pour l'occasion, créé un néologisme:
« VorlaB» (= ce qu’on laisse avant la mort; mot créé sur le modéle du terme consacré
«NachlaB», qui désigne l'ensemble des manuscrits qu’un auteur laisse aprés sa mort).
7. On ne citera ici que la collection «Textes et Manuscsits » publiée chez CNRS
Editions ; les numéros de 1a revue Genesis (Paris, Jean-Michel Place, 1992 sq.); le
volume dirigé par Louis Hay, Les manuscrits des écrivains (Paris, Hachette-CNRS,
1993), la synthése présentée par Almuth Grésillon, Elémenis de critique génétique. Lire
les manuscrits modernes (Paris, Puf, 1994); 1’ introduction de Pierre-Marc de Biasi, La
génétique des textes (Paris, Nathan, 2000, coll. « 128 ») ; et ’ ouvrage de Louis Hay, La
littérature des écrivains (Paris, José Corti, 2002). Pour plus d’informations, cf. la biblio-
graphie qui figure dans les numéros impairs de ta revue Genesis.
8, A titre d’exemple, l’éditorial de la revue Mesure (signé par Michel Crouzet,
n° 1, 1989, p. 12-13), ou les propos de Jean-Yves Tadié dans le n° 102 du Débat
(aovembre-décembre 1998, p. 174-181); pour une réplique, voir Louis Hay, dans le
n° 105 de la méme revue (mai-aoiit 1999, 188-190). Ou encore Particle de Laurent
Jenny, paru dans Le Monde du 20 décembre 1996 sous le titre « Divagations généti-
ciennes», article auquel répond Pierre-Mare de Biasi par «Les désarrois de 'hermé-
neute» (in Le Monde, 14 février 1997).
9, Antoine Compagnon, « Pour un tableau de la critique littéraire contemporaine»,
in Encyclopedia Universalis, «Symposium », 1987, p. 465.
10. Michel Espagne, «Le changement de paradigme dans les manuscrits», in
Annali della Scuola Normale Superiore de Pisa, Classe di Lettere e Filosofia, Serie I,
Vol. XT, 3, Pisa, 1983, p. 785-816.
22 La mise en ceuvre
sant l’entrée de la critique littéraire dans 1’ age de la «science»!! ou méme
@ « une sorte de révolution copernicienne»!*, Qu’en est-il exactement ?
Ceux qui répétent imperturbablement que la critique génétique serait
née de la philologie font fausse route ou sont de mauvaise foi. Soit ils
renyoient A un concept idéal, selon jequel la philologie est la science géné-
rale des textes, mais alors, toute activité critique reléverait de la philo-
logie. Soit ils se référent 4 une (pseudo-) tradition philologique, qui aurait
inspiré autour de Gustave Lanson un courant d’ études de genése (Albalat,
Rudler, Audiat), Mais si la philologie a en France une relative tradition
dans les études anciennes et médiévales, elle n’a jamais vraiment conquis
le territoire des études littéraires modernes. C’est méme cette absence de
tradition philologique qui a, en fin de compte, rendu possible la naissance
de la «critique génétique» en France, et c’est cette méme singularité histo-
rique qui explique que dans des pays & forte tradition philologique
—l’Allemagne, I’Italie, la Belgique, etc. — la critique génétique ait suscité
pendant longtemps des échos sceptiques ou perplexes.
Quant au véritable background théorique, c’est, en dépit des appa-
rences, le structuralisme. Avec son cortége de principes épistémologi-
ques, il a— plus en sous-main que de maniére combative, parfois peut-étre
méme malgré lui - favorisé l’émergence de la critique génétique, En
s’inspirant de titres comme L’uvre ouverte de Umberto Eco ou L’Ar-
chéologie du savoir de Michel Foucault, en s’aidant plus ou moins expli-
citement de certaines notions phares du structuralisme, comme « trace»
et «dissémination » de Derrida, « génotexte/phénotexte » de Saumjan et
Kristeva, « polyphonie » de Bakhtine, «transformation» de Chomsky, les
généticiens ont progressivement construit une nouvelle fagon d’appré-
hender la littérature. Ils ont cru devoir balayer la notion de structure pour
lui substituer celles de processus ou de genése. Or, il faut bien admettre
qu’en termes de techniques d’analyse, la méthode structurale a conservé
11, Sous le titre général « Vers une science de la littérature », I’ Encyclopedia
Universalis public un article de Pierre-Marc de Biasi, «L’ Analyse des manuscrits et la
genése de Pocuvre», in «Symposium », 1989, p, 924-937.
12, fiie Marty, «Pourquoi la génétique ? », in O2 en est la théorie littéraire ?,
Paris, Textuel, Paris VIL, 2000, p. 53.
13, Voir Gérard Genette, «La destitution “formaliste” de I’ intention anctoriale,
poussée symboliquement jusqu’au meurtre de P’autenr [...], et la valorisation “struc-
turaliste” de l'autonomie du texte, favorisent l’assomption des matériaux génétiques
comme objets littéraires a part entitre » (L’Guvre de Vari, Paris, Ed. du Seuil, 1994,
p. 223 sq.).
Du texte au manuscrit 23
toute sa pertinence. En effet, le meilleur moyen de cerner les propriétés
dun processus ne consiste-t-il pas, de proche en proche, en une compa-
raison systématique de deux états successifs, considérés comme provi-
soirement stabilisés, et susceptibles de représenter deux ensembles de
traits, régis — selon l’enseignement structural — par des ressemblances et
des différences ? Par conséquent, le lien de la critique génétique au struc-
turalisme est complexe: derriére le geste orgueilleux de rejet du texte se
masquent en fait des rapports médiatisés de filiation.
Néanmoins, I’ objet de la critique génétique n’est pas le méme que
celui du structuralisme. Si celui-ci, par définition, analyse des formes
finies, celle-la prend pour objet des formes en mouvement. L’étymo-
logie du mot «brouillon» en témoigne, puisqu’elle nous renvoie @ une
étrange ambiguité: d’un cdté, une matiére en ébullition, en devenir, de
Vautre, quelque chose de boueux et de malpropre, — comme si l’étin-
celle de l’ invention coincidait avec l’instant méme oi la plume se met
a fourcher; comme s’il y avait un rapport nécessaire entre avenement
et accident de l’écriture; comme si toute création se résumait dans ce
vers de Baudelaire: «J’ai pétri de 1a boue / Et j’en ai fait de lor.» D’un
cété, done, ces pages parsemées de ratures, contredisant toute image de
régularité et d’idéal de clarté. Caractéristique confirmée par une série
d’expressions employées dans les descriptions génétiques: «fouillis »,
«foisonnement», «fatras», «flux», «fourvoiements», « bégaiements»,
«pictinements », «repentirs », «ratés », «avortons», «chaos», «désordre»,
«émiettement» «turbulence», «bruit verbal», «entrelacs de discours
hétérogénes » ; « pages erratiques, parasitées, éclatées » ; et méme cette
exclamation d’un généticien : «de l’ébauche a la débauche ! » De P autre
cété, le brouillon est aussi le «cristal », le précieux témoin de l’acte créa-
teur, le support sur lequel le Verbe devient chair, le lieu ots 1a genése
s’effectue et se lit, l’espace de l’invention od la dynamique langagitre
inscrit superbement sa trace.
Ce «double bind» de I’ objet manuscrit, sa fonciére ambivalence,
peut faire penser & 1a Notice de Freud sur le bloc magique!4. Ce Wunder-
block, inventé au début des années 1920, réunit, grace 4 un systéme de
deux couches superposées, les qualités des deux supports classiques: la
14. Voir Sigmund Freud, «Notiz iiber den Wunderblock», in S, Freud, Studienaus-
gabe, t. 3, Francfort sur le Main, Fischer, 1975, p. 364-369. — Voir le commentaire de
Jacques Derrida, « Frend et la scéne de I’écriture», in L’Ecriture et la différence, Paris,
fid. du Seuil, 1967, coll, Points, 1979, p. 293-340, ici p. 328 suiv.
24 La mise en euvre
capacité de l’ardoise 4 recevoir des inscriptions toujours nouvelles, et
le pouvoir du papier de conserver des inscriptions 4 travers le temps. II
suffit d’actionner un systéme de tirette, et le bloc magique efface certes
l’écriture de la couche supérieure, mais en en gardant la trace sur la
couche inférieure. Cette image, appliquée aux diverses couches du texte
en devenir, est-elle susceptible de dire quelque chose sur le rapport entre
texte et avant-texte ? Suffirait-il de lire le texte pour y dénicher sa genése ?
La strate supérieure (le texte) donnerait-elle ainsi accés A la strate infé-
rieure (la genése}? Un peu a la fagon dont Jabés dit: « Tu crois effacer
Je mot. Ignores-tu que la barre est transparente ? » (dans L’Ineffacable.
Linapergu, Gallimard, 1980, p. 18).
La magie de l’image est tentante. Pourtant, la transparence
texte/avant-texte n’est justement pas automatique, le texte final ne révéle
rien de sa genése tant que l’on ne pénétre pas dans l’embrouillamini des
brouillons. Il ne donne a voir I’ épaisseur et la polyphonie de sa genése,
la face nocturne et les éclairs de son invention, qu’a celui qui va a la
découverte des traces qui l’ont précédé.
Pinsiste 4 bon escient sur cet aspect, car il concerne une condition
sine qua non de la méthode génétique. On peut certes réver et spéculer
sur les mystéres de la création, mais la critique génétique ne peut opérer
qu’en présence de traces écrites qui témoignent du processus scriptural.
Ce principe fondamental assigne en méme temps une frontidre infran-
chissable: les ceuvres pour lesquelles n’existe aucune trace de leur élabo-
ration échappent nécessairement 4 |’investigation génétique!>, Et
matheureusement, les raisons sont légion qui expliquent que de telles
traces puissent faire défaut: tel contexte historico-culturel qui ne valo-
rise que I’ ceuvre imprimée et pousse a supprimer les manuscrits dés qu’ils
sont devenus livre; l’auteur lui-méme qui se refuse a conserver ce qu’il
considére comme non abouti, malpropre et avorté ; les familles qui détrui-
sent ce qui leur parait compromettant; enfin, les guettes, voyages et exils,
qui effacent jamais des parties essentielles du patrimoine écrit.
METHODES D’ APPROCHE
Mais prenons maintenant une situation plus propice, celle ot des
documents de genése existent. Qu’est-ce alors que leur appliquer la
15. On y reviendra av dernier chapitre de cet ouvrage.
Du texte au manuscrit 25
méthode de la critique génétique ? Imaginons en effet une liasse de
manuscrits, parvenue jusqu’a nous dans ce «fécond désordre» dont parle
Valéry. Liasse dont nous savons qu’elle comporte les matériaux écrits
que l’écrivain a laissés comme traces d’une invention textuelle. Comment
traquer ces traces ? Comment accéder A cette « pensée sauvage»?
Comment la faire parler sans dire n’importe quoi ? Sous peine de donner
dans Varbitraire absolu, le généticien doit se soumettre d’abord au langage
d’un objet sémiotique particulier, en procédant 4 ce qu’on appelle «I ana-
lyse matérielle »'®, Celle-ci, s’inspirant de la codicologie appliquée aux
manuscrits anciens, consiste 4 décrire la nature des supports ~ cahier,
carnet, calepin, feuille volante, format, filigrane — caractéristiques qui
aident souvent a dater le document. Mais la méme démarche sert aussi
a recueillir les renseignements fournis par les instruments d’ écriture et
le tracé d’une main : passage de l’encre au crayon, plume plus ou moins
fine, ductus passant de la calligraphie a 1’ impétuosité presque indéchif-
frable, — autant d’indices qui permettent d’accéder 4 la scansion des
divers rythmes d’écriture.
Lanalyse matérielle doit également prendre en compte des espaces
sémiotiques complexes: sur telle page de Valéry ou de Hugo, Stendhal,
Pouchkine, Zola ou Michaux, 1’écriture verbale se mélange avec du
dessin. Les questions sont alors nombreuses : existe-t-i! un rapport entre
les deux types de notations ? Le griffonnage n’est-il qu'un passe-temps
pendant le tarissement du flux scriptural ou constitue-t-il au contraire
une autre facon d’élaborer un texte ? Lequel des deux tracés précéde
autre? Le dessin aide-t-il le scripteur 8 construire un espace pour la
fiction ? Survit-il A la phase d’élaboration ou s’éteint-il dés lors que le
texte a trouvé sa voie ? Comment les deux systémes cognitifs fonction-
nent-ils entre eux ? En tout cas, c’est un domaine passionnant ol beau~
coup d’hypothéses restent & vérifier!’, y compris celle selon laquelle le
dessin serait un tracé plus «libre», plus « spontané», « plus prés de Pin-
conscient» que les élaborations verbales du langage articulé. Henri
16. Voir Louis Hay, «Le manuscrit: langage de objet», Bulletin de la Biblio-
theque nationale, 3¢ année, n° 2, juin 1978.
47. Pour ensemble de ce domaine, voir Serge Sérodes, «Le dessin des écrivains.
Prélude & une approche sémiotique», Genesis, n° 10, 1996, p. 95-109. — Yale French
Studies, n° 84, «Boundaries. Writing and Drawing», 1994, ~ Voir aussi les Actes (2
paraitre) du Colloque «Le dessin dans les manuscrits littéraires» (ITEM-ENS-IMLI,
novembre 2002).
26 La mise en ceuvie
Michaux semble aller dans ce sens: «Je tiens a aller par des traits plutot
que par des mots, c’est toujours pour entrer en relation avec ce que j’ai
de plus précieux, de plus vrai, de plus replié, de plus “mien” ».‘8
Quant 4 l’espace textuel de la page manuscrite, il ressemble parfois
a de réelles mises en scéne de l’écriture: depuis les Contemplations,
Victor Hugo n’écrit d’abord que sur la colonne de droite, en se réser-
vant la colonne de gauche pour toutes sortes d’ ajouts et d’insertions ulté-
rieures ; le Proust des Cahiers complete ses «belles pages » sur le verso
des feuillets précédents, puis sur ses célébres paperoles ; Valéry entre-
coupe l’enchainement textuel non seulement par des dessins, mais aussi
par des formules algébriques et des listes de mots mis visiblement en
attente ; James Joyce et Walter Benjamin barrent le mot qui figure dans
une liste dés lors qu’ils en ont fait usage dans la rédaction en cours. Il
y adone, au sein méme des brouillons, des régularités scénographiques
qui ont leur sémiotique et leur esthétique propres.
Lanalyse matérielle est suivie d’ wn exercice souvent fastidieux :
toute trace verbale écrite doit étre déchiffrée. L’image que présentent
certains brouillons dit assez la difficulté de cette tache, qui débouche
sur l’établissement d’ une «transcription diplomatique » dactylographiée,
c’est--dire une reproduction du manuscrit qui respecte fidélement les
blancs des interlignes et des marges ainsi que l’emplacement exact des
formes dans l’unité de la page.
Jusqu’ici, avant-texte est resté enfermé dans la matérialité inerte
du document. Mais il est bien clair que le lecteur du manuscrit a déja
accumulé bon nombre d’informations susceptibles de restituer la vie
d'une écriture en mouvement: le trait des tracés, emplacement des
variantes, les marginalia, les biffures, les béquets et les signes de renvoi
sont autant d’indices grace auxquels il est possible de reconstruire la
chronologie relative d’un dossier. Pour cela, le plus logique est de
remonter progressivement du texte imprimé vers les débuts de I’ écri-
ture, en suivant en quelque sorte le principe téléologique a l’envers.
Remontée systématique, organisée essentiellement en fonction des lieux
invariants entre les différents états de la genése. On compare du compa-
table, en laissant provisoirement de cdté ce qui excéde ce syst&me (les
failles, les chemins de traverse, les trous, les alternatives suspendues,
les hapax, les « fausses pistes», les bribes abandonnées). L’ objectif est
18. Henti Michanx, Fmergences-Résurgences, Geneve, Editions d’ Art Albert Skira
[1972] 1993, p. 18.
Du texte au manuscrit 27
: de restituer le principal fil conducteur de l’écriture, celui qui permet
d’ordonner les matériaux selon les lois d’une filiation linéaire, celles
qui président aux arbres de la généalogie, bref, les lois du «stemma».
Cette remontée organisée peut étre identifiée a la démarche philo-
logique. En effet, la rigueur philologique permet d’établir le classement
chronologique des feuillets 4 l’intérieur d’un dossier de genése. Mais
pour la critique génétique, il s’agit d’un simple outil descripuf et non
d'un principe théorique ; d’un moyen, non d'une fin.
Une fois que le classement est établi, le généticien peut s’adonner
a sa vraie passion : chercher 4 comprendre la lente émergence d’une
ceuvre, cerner et interpréter tout ce qui est irréductible 4 la démarche
philologique du classement, & savoir les sinuosités et titonnements de
Pécriture, les avortons, le métadiscours scriptural, les pulsions soudaines
du tracé, les gribouillages et les croquis, les chemins qui ne conduisent
nulle part, les notes qui ne se raccrochent & aucun segment textuel, bref,
tout ce qui aurait pu devenir texte mais ne I’est pas devenu®, tout ce
qu’ on pourrait appeler avec Michel Serres la «noise» de Tavant-texte”
ou, en jouant sur un titre d’ouvrage de Jack Goody, «la déraison
graphique». Se met alors en place un jeu de pistes ott tous les rappro-
chements sont permis et oi le regard de l’interpréte circule en toute
liberté pour traquer les virtualités et virtuosités de I’écriture. La téléo-
logie n’est ici plus de mise. La seule interdiction est d’aller 4 l’encontre
de la chronologie matérielle, c’est-’-dire de vouloir expliquer par exemple
comment A serait issu de B, alors que la succession des feuillets montre
a l’évidence que B est issu de A.
Cette partie interprétative de la génétique, celle qui va au-dela de
la description philologique, n’a pas besoin d’une théorie unifiée. Chaque
généticien suit plus ou moins sa propre pente, les uns ayant plus de goiit
pour une approche pure et dure des formes, les autres se trouvant plus
portés vers l’exégése, la critique thématique, la psychanalyse, la socio-
critique ou la phénoménologie. Quelle que soit cependant I’ orientation
critique, ce dont personne ne peut se passer pour commenter un processus
génétique, c’est une pensée du mouvement et de la complexité.
19, Gérard Genette: «[...} le plus important, mais aussi le plus ambigu des effets
davant-texte est peut-étre la maniére dont, entourant fe texte “final” de toute 1a masse,
parfois énorme, de ses états passés, l’étude génétique confronte ce qu’il est 4 ce qu'il
fut, Ace qu’il aurait pu étre, A ce qu’il a failfi devenir [...].» (in Seuils, Paris, Bd. du
Seuil, 1987, p. 369)
20. Michel Serres, Genése, Paris, Grasset, 1982, p. 32 sq.
28 La mise en euvre
Le noyau central de la démarche génétique consiste 4 mettre en
lumiére aussi bien les lignes de force que les failles de invention, les
ambivalences et la dynamique souvent trouble de ces processus d’écri-
ture lesquels, en réalité, font penser plus souvent & la théorie des catas-
trophes qu’& V’arborescence réglée des « stemmas » philologiques,
davantage aux «rhizomes » de Deleuze-Guattari qu’a la logique binaire
du raisonnement structural, plus souvent aux constellations hypertex-
tuelles qu’au Texte avec un T majuscule.
Chapitre 2
Du manuscrit au chercheur*
BcrIvains, CONSERVATEURS, CHERCHEURS
Lécrivain écrit, le conservateur conserve, le chercheur cherche.
Derriére ces lapalissades simplistes se tissent des interférences, des inter-
actions et des coopérations multiples!.
Deux types de témoignages peuvent illustrer cette synergic: les
testaments d’écrivains et les odyssées de fonds manuscrits. Tous deux
impliquent a la fois I’écrivain, I’ archiviste et le chercheur.
Prenons l’exemple de Kafka, qui a laissé un testament pour le moins
ambivalent:
Cher Max, peut-étre ne me reléverai-je plus cette fois ; il est fort probable
qu’aprés ce mois de fidvre pulmonaire une pneumonie se déclarera; et
méme le fait que je l’ annonce par écrit ne pourra pas 1’empécher, encore
que cela ait quelque pouvoir. Voici donc dans cette éventualité ma dernitre
volonté au sujet de tout ce que j’ai écrit:
De tout ce que j’ai écrit, seuls les livres [...] sont valables.[...], cela ne
signifie pas que je souhaite qu’ils soient réimprimés et transmis aux temps
futurs ; s’ils pouvaient au contraire étre entitrement perdus, cela corres-
* Ce texte est issn d’une conférence intitulée «Le chercheur face aux manuserits:
passion et raison, savoir et silence», et prononcée le 1* décembre 1997 4 un Colloque
de ’ IMEC (Abbaye d’ Ardenne) sur « Archives et création».
1. Cette typologie ne peut étre qu’une premi&re approche de trois domaines dont
les frontigres ne sont pas étanches. Ainsi, beaucoup de conservateurs sont aussi cher-
cheurs, et certains conservateurs ou chercheurs sont aussi écrivains, Par ailleurs, le
terme de chercheur n’est évidemment pas réservé au personnel d’une institution ; il
regroupe des doctorants, des enseignants, des enseignants-chercheurs et des chercheurs
(faisant partie on non d’un établissement de recherche).
30 La mise en wuvre
pondrait entiérement 4 mon désir. Simplement, puisqu’ils existent, je
n'empéche personne de les avoir, si quelqu’un en a envie.
En revanche, tout le reste de ce que j’ai ccrit (les textes imprimés dans
des revues, les manuscrits, les lettres), dans 1a mesure of on peut mettre
la main dessus ou les obtenir des destinataires (tu connais 1a plupart
entre eux, il s’agit pour l’essentiel de ***, n’ oublie surtout pas les quel-
ques cahiers que *** détient), tout cela, sans exception, doit atre détruit,
de préférence sans le lire (je ne Uempéche pas cependant d’y jeter un
coup d’ceil, mais je préférerais toutefois que cela n’ efit pas lieu; si tu ne
Je fais pas, personne en tout cas n’a le droit d’en prendre connaissance)
— tout cela sans exception doit tre bralé, ce que je te prie de faire le plus
tot possible’.
La lecture de ce texte aurait dfi amener Max Brod a briller l’essen-
tiel des papiers de Kafka. L’ami, sensible peut-étre au sens caché de
cette ultime missive, n’en a pas tenu compte. Les manuscrits ont survécu
non seulement a la destruction souhaitée par leur auteur, mais aussi &
une longue odyssée pendant laquelle ils ont voyagé entre le domicile de
Max Brod a Prague, la Bibliothéque Salman Schocken a Jérusatem, le
coffre-fort d’une banque suisse, avant de trouver leur «derniére demeure »
4 la Bodleian Library d’Oxford et au Deutsches Literaturarchiv de
Marbach, institutions de conservation qui autorisent aujourd’ hui les
éditeurs scientifiques 4 photographier ou scanner ces manuscrits figu-
rant comme fac-similés dans I’édition critique en cours’. Ainsi, testa-
ment et odyssée montrent de maniére exemplaire — et parfois
contradictoire - comment I’écrivain, l’exécuteur testamentaire, les collec-
.tionneurs, maisons d’édition, archives publiques, chercheurs et éditeurs
scientifiques ont réussi a construire la mémoire d’ une ceuvre. La boucle
manuscrits-archives-recherche est bouclée.
Pourtant, la question de la mémoire de I’écrit est ambigué. Sil’ on
s’en tient av support papier, on peut rappeler ce qu’en dit en 1765 I’ En-
2. Testament publié par Max Brod dans sa postface a la premire édition du Procéy
(1925); cité ici dans la traduction de Claude David, parne dans Franz Katka, Euvres
Completes, Paris, Gallimard, Editions de la Pléiade, t. 1V, 1989, p. 1195 sq.
3. Franz Kafka-Ausgabe, Historisch-kritische Ausgabe séimtlicher Handschrifien,
Drucke und Typoskripte, herausgegeben von Roland Reug und Peter Staengle, Frank-
furt, Basel, Stroemfeld Verlag ; déja parn notamment Der Process et Die Verwandlung,
Beschreibung eines Kampfes, Oxforder Quartheft 17. Tous les volumes reproduisent
en regard manuscrit et transcription diplomatique, que lon trouve également sous forme
de CDROM.
‘Du manuscrit au chercheur 31
cyclopédie (tome XT), sous l’entrée « papier»: « Merveilleuse invention
gui est d’un si grand usage dans la vie, qui fixe la mémoire des faits et
inunortalise les hommes». A cet éloge universel vient répondre sur un
on plus sceptique un conte de Borges, écrit en 1942 et intitulé i unes
ou la mémoire*. Ty est question d’un jeune Indien d’ Uruguay qui, a la
suite d’un accident subi a l’Age de dix-huit ans, se réveille infirme, mais
doté «d’une perception ct d’une mémoire infaillibles ». Trés vite, on
remarque !’ ambivalence de ce don nouveau: la mémoire de Funes stocke
absolument tout, sans distinction. Le narrateur en tire ta legon suivante:
«Je soupgonne cependant qu’il n’était pas tres capable de penser. Penser
¢’est oublier des différences, c’est généraliser, abstraire. Dans le monde
surchargé de Funes, il n’y avait que des details [...].» On ne s’étonnera
pas d’apprendre que Funes meurt assez rapidement, a Vingt-etun ans,
emporté par une congestion pulmonaire, — comme si Ja mémoire téra-
tologique qui s’était emparée de lui avait fini par lui couper le souffle,
Jittéralement.
On aura compris le sens précis que je donne a ces deux références.
Certes, les manuscrits littéraires fixent sur le papier une partie du patri-
‘moine que toute nation de culture se doit de sauvegarder. Mais dans le
- méme temps, pour reprendre les termes de I’ Encyclopédie, si Pon nen
fait pas un « grand usage dans la vie», ces traces restent mémoire morte.
Enfin, si !’on veut bien entendre la triste histoire de Funes et l’ appliquer
4a tentation évidente qu’ exercent les nouveaux médias et 4 leur pouvoir
quasi illimité en matiére de stockage et de mémorisation, il est clair que
toute mémoire non activée et non ordonnée par la curiosité interroga-
trice et structurante des cherchcurs est mortifére, mortifére au sens ott
elle tue la pensée, au lieu de engendrer. ;
Etudier la genése des textes consiste 4 faire vivre ou revivre la
mémoire dont les manuscrits sont Jes supports. Supports éminemment
fragiles, objets & la fois matériels et intellectuels, ils permettent d’ex-
ploiter scientifiquement le précieux patrimoine conservé dans les collec-
tions, bibliothéques et archives littéraires. Cette recherche serait
strictement impossible si la collecte, la sauvegarde ct la conservation,
de méme que la restauration et la remise en état de ces papiers, souvent
menacés de destruction, n’ étaient pas garanties. La critique génétique
n’existerait pas s’il n’y avait pas d’abord le geste conservateur qui
constitue le patrimoine littéraire et veille 4 sa survie.
4, In Borges, Fictions, Paris, Gallimard, coll. Folio, 1986, p. 109-118.
32 La mise en euvre
Aussi est-il naturel que les démarches des conservateurs et celles
des chercheurs soient complémentaires. Citons-en quelques exemples.
Lenrichissement des fonds publics, ¢’ est--dire la découverte et la
collecte des manuscrits autographes, passe souvent par des circuits assez
secrets oll patience, diplomatie, séduction et discrétion sont pareille-
ment requises. Amener un écrivain (ou ses ayants droit) a donner ou &
vendre ses manuscrits est une démarche délicate dans laquelle excellent
les conservateurs, mais od il arrive que le chercheur joue un réle de
passeur. Il suffit, pour s’en convaincre, de rappeler l’événement auquel
l'Institut des Textes et Manuscrits Modernes (ITEM/CNRS) doit sa créa-
tion. En 1966, grace 4 l’initiative et 4 l’obstination de Louis Hay, la
Bibliothéque nationale de France a pu acquérir un immense fonds de
manuscrits d’un poéte allemand du x1x* siécle, Heinrich Heine, qui repré-
sente aujourd’ hui le fonds allemand le plus important en France.
Autre exemple, le legs de ’ensemble de ses propres manuscrits
ainsi que de ceux d’Elsa Triolet que Louis Aragon a fait en 1976 au
Centre national de la recherche scientifique, qui l’a confié A son tour,
sous forme de dépét, a la Bibliothéque nationale de France. Lors de la
remise officielle au CNRS, Aragon commentait ainsi sa démarche :
Ti s’agissait de donner 4 ceux qui veulent plus directement connaitre et
comprendre ce qui s’est écrit dans ce siécle [...], la possibilité non seule-
ment d’ examiner mes livres, mais 4 proprement parler mon écriture. Pour
cela, ne fallait-il pas mettre 4 la portée de ceux que l’on appelle les cher-
cheurs, non seulement !’écrit figé par la publication, mais le texte en.
devenir, saisi pendant le temps de I’écriture, avec ses ratures comme ses
repentirs [...].
Ala découverte et al’ acquisition de manuscrits succéde tout natu-
tellement un premier classement, qui est également du ressort des conser-
vateurs, Mais il n’est pas rare que ce travail se fasse sous forme de
coopération entre archivistes et chercheurs. Par ailleurs, les spécialistes
du papier et de la restauration peuvent, a partir des fibres, colles et
encres, procurer maint renseignement précieux pour la datation d’une
écriture®.
5. Voir Louis Aragon, «D"un grand art nouveau: fa recherche», in Essais de critique
génétique (Louis Hay, ed.), Paris, Flammarion, 1979, p. 5-19.
6. Voir Louis Hay, «Les manuscrits au laboratoire», Lex Manuscrits des écrivains
(Louis Hay, ed.), Paris, Hachette — CNRS Editions, 1993, p. 122-137.
Du manuscrit au chercheur 33
Enfin, le chercheur peut jouer aussi un réle d’ expert: pour évaluer
_ des manuscrits qui sont proposés a la vente; pour authentifier une main
_ ou détecter des faux. Il y a quelques années, un manuscrit faussement
- attribué & Nerval fut propos¢ 4 la vente; aprés avis du spécialiste de
Nerval, la Bibliothéque nationale a heureusement renoncé a préempter.
En sens inverse, les conservateurs et bibliothécaires jouent un réle
capital dans le travail quotidien des chercheurs. Ils connaissent V’his-
toire des fonds, savent ot trouver des dossiers génétiques pertinents,
sont d’excellent conseil pour demander I’ autorisation des ayants droit,
- proposent pour publication des manuscrits inédits conservés dans leur
merveilleux trésor. Et surtout, ils offrent sans compter au chetcheur leur
érudition, qui est aussi immense que leur modestie’. Cette interaction
_ se manifeste de plus en plus souvent dans des projets communs: expo-
sitions, publications, colloques et séminaires.
Mais lidylle entre conservateurs et chercheurs n’est pas, ne peut
pas étre, de tous les instants. Sur d’ autres points, deux logiques s’ oppo-
sent. Conserver des documents et en reconstruire les parcours scriptu-
raux sont deux activités qui n’obéissent pas nécessairement aux mémes
regles.
une époque od I’ Etat a pris plus clairement conscience de son
role de protecteur du patrimoine, les conservateurs des archives publi-
ques défendent a juste titre, et avec vigueur, les fonds dont ils ont la
charge contre toutes les agressions qui les menacent. Hl est donc normal
que les archives fassent tout pour limiter l’accés aux manuscrits origi-
naux, en renvoyant le chercheur a I’un ou l'autre des supports substi-
tuts: microfiches, microfilms, photocopies, fac-similés et toute la gamme
- des reproductions numérisées. Car, si le chercheur est certes un excel-
* lent garant pour la valorisation des manuscrits, il est aussi une cause de
destruction de ces objets fragiles. Toute manipulation implique d’une
certaine maniére mise 4 mal, menace, agression. Conscient de la néces-
sité de protéger les originaux, le généticien accepte de travailler dans
toute Ja mesure du possible sur des supports-substituts. Mais ce méme
chercheur, et c’est la un réel paradoxe, ne peut faire autrement que de
revendiquer, du moins pour certaines étapes de son travail, la possibi-
lité d’accés a l’original. Pourquoi? Parce que la meilleure reproduction
7, Je tiens A apporter ce témoignage de gratitude a tous les conservateurs qui ont
guidé mes pas, que ce soit en France (BnF, IMEC, on BLID) ou en Allemagne (notam-
ment 4 Marbach),
34 La mise en @uvre
n’est qu’une image appauvrie, une mémoire défectueuse. Le manuscrit
autographe, en effet, est un objet unique qui perd une partie de ses carac-
téristiques matérielles quand son message est reproduit sur un autre
support. Ces substituts transmettent, certes, fidtlement le message verbal
du manuscrit, mais ne fournissent pas le détail codicologique de l’ori-
ginal: 1’épaisseur du papier, les filigranes, les formats, les marques de
déchirure lorsqu’un cahier est démembré, etc. De méme, avec les repro-
ductions en noir et bianc, on perd des informations que fournissent les
différents instruments d’écriture, tel par exemple le passage de l’encre
au crayon ou l’usage de plusieurs couleurs, éventuellement spécifiques
de différentes phases rédactionnelles®. ‘Toutes ces informations aident
cependant a identifier un tracé, a dater un dossier’, 4 le classer et A fixer
les étapes successives de la rédaction. Comment le chercheur pourrait-
il proposer des interprétations génétiques valides si celles-ci ne repo-
sent pas sur des prémisses validées ?
Sans aucun doute, quiconque travaille sur la genése des textes doit
pouvoir se reporter 4 I’ original s*il ne veut courir d’immenses risques
d’erreur dans l’établissement de Vavant-texte. De méme, toute opéra-
tion d’interprétation est vouée a l’échec tant que les indices matériels
ne sont pas correctement exploités. Quant a la reproduction numérisée,
elle fait réver le généticien, désireux de pouvoir disposer sur l’écran de
son ordinateur personnel toute la mémoire d’un texte, et d’avoir ainsi
«sous la main» tous les manuscrits qu’il veut, de «zoomer» sur des
zones difficiles 4 déchiffrer ou de rapprocher dans I’ espace de la fenétre
différents états de la genése. Mais la fable de Borges citée plus haut
montre bien que la facilité du stockage illimité peut étre aussi un piége :
elle peut reporter toujours plus loin le moment de l"interprétation.
8. C’est ce qui est arrivé lors d'un début de travail génétique sur l’édition fac-
similé des Champs magnétiques de Breton et Soupault. Le regard sur original a révélé
que les réécritures provenaient en fait de différents instruments (encre blene, crayon
noif et crayon rouge), dont chacun signalait une campagne d’écriture dififérente,
9. Ainsi dans le cas d’un manuscrit de Winckelmann, écrit pour sa célébre Histoire
de Vart chez les Anciens et daté dans |'inventaire officiel de 1748. L’analyse du support,
et notamment du filigrane, a permis de conclure qu’il s’agissait d’un papier de prove-
nance italienne dont on sait avec certitude que Winckelmann ne s’ était pas servi avant
de séjoumer en Italie. Par conséquent, le terminus a quo de la date de rédaction ne peut
pas étre antérieur A l'année 1756, date de Yarrivée de Winckelmann en Italie, — Voir
Marianne Bocketkamp, «Les manuscrits de J.J, Winckelmann tus en filigrane» ; in Ie
Encontro de Ecdotica e Critica Genética (1991), Joao Pessoa, 1993, p. 73-84,
Du manuscrit au chercheur 35
Confrontés aux problémes de la sauvegarde d’ objets éminemment
fragiles, et aux possibilités comme aux mirages des nouveaux outils de
stockage numérique, appelés valoriser, chacun a sa maniére, le patri-
moine littéraire, conservateurs et chercheurs sont traversés par des désirs
et des impératifs 4 la fois comrauns et différents. Il n’en demeure pas
moins que la complémentarité est plus que jamais de mise. Une mémoire
nationale coupée de la recherche est une mémoite morte. De la méme
maniére, une génétique littéraire oublieuse des impératifs de ta conser-
vation serait une absurdité.
LE CHERCHEUR FSCE AU MANUSCRIT :
PASSION ET RAISON
Les manuscrits sont des objets 4 facettes multiples : objet de patri-
moine et de musée, objet de spéculation épistémologique et financiére!®,
objet de passion et de connaissance, objet de mode et objet-fétiche. L’ac-
tuel engouement pour les manuscrits ne se limite pas a la littérature. Un
manuscrit des Beatles se vend chez Sotheby’s dans la méme efferves-
cence (certes pas encore au méme prix !) qu’un manuscrit de Leonard
de Vinci ou d’ Albert Einstein", Visiblement, les manuscrits sont objet
d’investissement, dans tous les sens du terme. Seul le fait qu’ils repré-
sentent une bribe de vie, de survie au-dela de la mort, une possibilité de
gloire posthume, semble pouvoir expliquer ce rapport passionnel. Il y
va de l’émotion et de affect, du désir de possession et d’ identification.
Toucher un original, c’est d’abord une immersion symbolique, od Von.
sent le tremblé d’une main, la vibration d’un corps. Le transcendant
«ceci est mon corps» semble au premier contact plus fort que la notion
analytique de corpus.
10. Le journal Le Monde en date du 12-13 avril 1998 yante dans son supplément
«Argent», sous la ubrique «Placements», les vertus des autographes et manuscrits,
«domaine accessible du marché de Part»...
11. En 1995, Sotheby’s a vendu une chanson des Beatles (1 page !) 8 200 000 euros.
environ, En 1994, Bill Gates a acquis le célébre Codex Hammer de Léonard de Vinci
pour I’équivalent de 25 millions d’euros, En 1996, Sotheby’s offrait la vente le plus
ancien manuscrit de la théorie de la relativité d’Einstein en l’estimunt a 4,5 millions
euros.
36 La mise en ceuvre
Le manuscrit porte trace, il maintient en vie, il fait comme si. Tendu
ainsi entre la vie et la mort, il est régi par des testaments et des contrats
dont Je vocabulaire environnant rappelle la gravité juridique et symbo-
lique: droit de propriété, droit moral, droits de succession, ayants droit,
monopole d’ exploitation, exécuteur testamentaire. Sont de la méme veine
les polémiques et procés autour des manuscrits, textes et transcriptions
de Lacan, Barthes, Foucault, Artaud, dont les ayants droit ont tenté de
refuser la publication. Le journal Le Monde du 18 octobre 1991 en a rendu
compte sous le titre «A qui appartient la parole des maitres diparus?».
Cet aspect passione! est alimenté par les écrivains eux-mémes
qui, paradoxalement, interdisent expressément qu’on touche a leurs
manuscrits, alors que, dans le méme temps, ils'ne font rien pour les
détruire. Le manuscrit reléve de la sphére intime, de l’inaliénable. C’est
ce qu’exprime Flaubert dans une lettre & Louise Colet en lui parlant du
lien indissociable entre l’ auteur et son manuscrit:
Pourvu que mes manuscrits durent autant que moi, c’est tout ce que je
veux, C’est dommage qu’il me faudrait un trop grand tombeau ; je les
ferais enterrer avec moi, comme un sauvage fait de son cheval — ce sont
ces pauvres pages-Id, en effet, qui m’ont aidé & traverser la longue plaine.'”
Le chercheur qui se trouve pour la premiére fois face 4 un manus-
crit littéraire est souvent exposé a ce drame du corps mort et du manus-
crit vivant. D’oii, a plus forte raison, son désir spontané et sans doute
inconscient de retrouver le corps de |’écrivain, en se tenant au plus prés
de la trace écrite.
Ainsi, quand je commence & travailler sur un nouveau dossier ct
que je me trouve pour la premiére fois face 4 un manuscrit autographe,
jl m’ arrive encore, faisant fi des avantages de l’ordinateur, de fabriquer
une transcription 4 la main (cf. ma transcription manuscrite d’une page
de Supervielle, infra, p. 181). Le résuitat a quelque chose de troublant:
ma main mime le tracé de P original, comme si dans cette illusion du
corps-’-corps, dans cette fusion des écritures, je commengais a
comprendre quelque chose de ce qui s’est écrit la; comme si dans ce
premier contact, a force de copier, ma main se confondait avec celle de
autre; «comme si», pour citer Arlette Farge, «en dépliant l’archive,
on avait obtenu le privilége de toucher au réel»'9,
12. Lettre 4 Louise Colet du 3 avril 1852.
13. Arlette Farge, Le gofit de V’archive, Paris,
|. du Seuil, 1989, p, 18.
Du manuscrit au chercheur 37
Cet «effet de réel» fonctionne a tous les coups, pour le meilleur,
mais aussi pour le pire. On se souvient de l’exploit de ce faussaire qui,
en 1983, cinquante ans aprés la prise du pouvoir par les nazis, a réussi
a faire croire a l’existence de carnets autographes de Hitler qu’il avait
lui-méme fabriqués de toutes piéces. Avec le soutien de la presse a
sensation, l’ensemble des médias fut saisi d’une excitation peu commune,
les historiens furent pour le moins troublés, les experts en écriture,
perplexes. Il a fallu l’analyse scientifique du papier, de la colle et de
Vencre pour prouver qu’il s’agissait d’un faux. Lillusion de vérité a
failli marcher'4,
Cette troublante proximité de I’ objet manuscrit permet de s’en
imprégner émotionnellement. Elle ne permet assurément pas la compré-
hension intellectuelle ni l'interprétation génétique, Au plaisir de la passion
doit s’allier le travail de la raison, a la proximité immediate, la saine
mise a distance. C’est dans cette tension qu’on peut espérer remplacer
les mythes et mystéres de 1a création par un savoir subtil et raisonné sur
Jes processus d’écriture.
Une fois 1’émotion initiale passée, |’ objet manuscrit exige un
regard plus froid. Sinon, comment ferait-on pour procéder au classe-
ment d’un fonds ou pour constituer un dossier génétique ? Concréte-
ment, l’expérience de ces matériaux nous apprend vite 4 oublier le
charme esthétisant du premier regard et le vain espoir de détenir tous
les témoins de la genése. Méme le dossier le plus complet ne contient
jamais exhaustivement toutes les étapes de la création. D’ épaisses
couches de brouillons mentaux ont souvent précédé la premiére nota-
tion écrite. Goethe en témoigne, quand il commente la genése d’un de
ses poémes :
T’ai porté cette ballade longtemps a l’intérieur de moi-méme [...] avant
de la coucher sur du papier. Elle résulte de longues années de rumina-
tion. J’ai ensuite fait trois ou quatre tentatives de rédaction avant de réussir
a lui donner sa forme actuelle!>.
Et, plus prés de nous, Michel Butor, insiste 4 son tour:
14, Voir Albert Gruijs, «Le support de la pensée; analyse du papier», in La Nais-
sance du texte (Louis Hay, ed.), Paris, Corti, 1989, p. 23-32.
1S. Goethe, Gespriiche mit Eckermann, 16 décembre 1828.
38 La mise en eeuvre
Lorsque je me mets maintenant A aborder I’ exécution de ces projets
anciens, la premiére ligne que j’écris est une ligne qui repose déja sur
dix ou quinze ans de brouillons mentaux, de ratures mentales.'©
Les traces seront toujours Jacunaires, partielles, incomplétes. Les
processus mentaux, les discours d’époque, l’intertexte absent érigent
une colonne de silence qui est aussi éloquente que le dit du manuscrit!”,
De méme, et pour les mémes raisons, l’accés a l’origine de la créa-
tion est impossible, L’auteur lui-méme ne peut accéder & cette couche
qui est toujours de l’autre cété du miroir. Aragon, réfléchissant a sa
propre trajectoire, dit sechement: «Chacun raconte sa vie 4 sa maniére,
mais qui peut trouver moyen de raconter sa téte ?» (Les Incipit. Je n’ai
jamais appris a écrire, Genbve, Skira, 1969, p. 52). Impossible enfin
d’étre assuré de tenir en main tous les maillons de la chaine écrite ;
nombreux sont les cas ot !’on croyait disposer d’un tout et ot soudain,
a l'occasion d’une vente ou d’un héritage, un élément jusque-1a incomnu
s’ajoute au dossier pour semer le doute et jeter je désordre. Ainsi la
dernitre version d’ Albertine disparue, dont la découverte est venue &
jamais troubler ce que Il’ on croyait étre la structure définitive de la
Recherche.
Dans d’ autres cas, on sait pertinemment qu’un certain état de la
genése a existé, mais il a disparu dans les vicissitudes de la vie. C’est
le cas d’un podme de Heine, «Lebensfahrt» («Le voyage de la vie»),
pour lequel un brouillon a été retrouvé en 1933, Il contenait, selon la
description qui en a été faite & I’ époque, Vesquisse la plus ancienne ;
Vautodafé de 1933, le nazisme, la guerre et V’exil ont effacé toute trace
de ce manuscrit!®.
Par conséquent, le chercheur ne peut jamais étre tout & fait assuré
de la fiabilité de son corpus. Il a affaire & des traces en elles-mémes incon-
testables, mais lacunaires, 4 des blancs of le manuscrit refuse de parler.
La conscience de cette fragilité des matériaux génétiques doit 6tre omni-
présente dans le travail de reconstruction. La logique, l’inférence, le
raisonnement de cause a effet ne permettent pas toujours une interpréta-
16. Michel Butor in Georges Charbonnier, Entretiens avec Michel Butor, Paris,
1967, p. 130.
17, Voir Bernard Beugnot: «Silences et béances du manuscrit: le cas Ponge», in
Romanic Review, Vol. 86, Number 3, May £995, p. 473-484.
18, Voir mon article: « Wege und Inrwege. Zu Heines Gedicht “Lebensfahrt” », in
Lili (Zeitschrift fiir Literaturwissenschaft und Linguistik), n° 68, 1987, p. 84-103.
Du manuscrit au chercheur 39
tion univoque des chemins de la genése. II faut admettre d’emblée que
la reconstruction génétique n’est qu’une hypothése parmi d’ autres.
C’est l’ ensemble de ces facteurs qui préside 4 l’analyse génétique.
La passion pour l’autographe doit aller de pair avec un savoir qui tient
compte des insuffisances matérielles, des piéges intellectuels et des
silences obstinés. Retracer l’histoire de la genése d’un texte n’est donc
pas chose simple ; savoir comment tel écrivain a «écrit certains de [ses]
livres» reléve d’une investigation qui n’est pas sans risques. Risques
propres, du reste, 4 toute entreprise critique.
L’G@UVRE ET LA LITTERATURE FACE AUX MANUSCRITS
J’ai insisté un peu lourdement sur les prémisses complexes et l’as~
pect périlleux de l’entreprise génétique. En outre, on sait & quel point
elle est chronophage. Le jeu en vaut-il la chandelle ? Peut-on espérer un
savoir nouveau, non seulement sur la genése de telle ceuvre, mais sur ce
que c’est au juste que le commerce avec les manuscrits des ceuvres litté-
raires ?
Au cours de la premi&re moitié du xx? siécle, certaines études d’ins-
piration génétique ont cherché & montrer comment analyse des manus-
crits éclairait la voie royale par laquelle le travail d’ écriture avait conduit
au chef-d’ ceuvre. Dans cette perspective, on étudie le dossier manuscrit
d'une ceuvre pour prouver que ce qui résulte in fine des nombreuses
réécritures est bien un chef-d’ oeuvre. Quod erat demonstrandum. Les
chutes, rebuts et autres avortons & la poubelle, le cristal de |’ élaboration
parfaite sur un piédestal. Cette démarche, tautologique dans son prin-
cipe, ne produit rien de nouveau. Elle lit le manuscrit pour confirmer la
beauté de I’ceuvre!®. La méthode de Ia critique génétique vise, au contraire,
a ébraniler Ja notion d’ceuvre, en déstabilisant, interrogeant et modifiant
ses contours.
19. Voir par exemple Gustave Lanson, «Un manuscrit de Paul et Virginie. Etude
sur invention de Bernardin de Saint-Pierre », [1908], republié in Etudes d'histoire
liuéraire réunies et publiées par ses collégues, ses éleves et ses amis, Paris, Libraitie
ancienne Honoré Champion, 1930, p. 224-258.
40 La mise en euvre
Comme on I’a noté, la démarche génétique plaide en faveur de
«ceuvre ouverte». Ouverte sur sa production, elle l’est aussi sur sa
réception et signifie une textualité prise avec tout son avant-texte, ses
notes de lecture, ses esquisses, ses schémas, brouillons de rédaction et
de révision, ses versions successives et ses éditions critiques. Il en découle
que toute la discussion sut la version « autorisée», « canonique », ou sur
celle qui refléterait le mieux «]’intention de l’auteur» devient problé-
matique. Ces «témoins textuels » sont, chacun a sa maniére, des morceaux.
d’un ensemble: ’ ceuvre. Ainsi, les trois Galilée de Brecht, celui de 1939,
écrit au Danemark, celui de 1947, écrit aux Etats-Unis, et celui de 1955,
écrit 4 Berlin, peuvent étre considérés comme trois faces historiquement
déterminées de la méme ceuvre, De méme, pour le Partage de midi de
Claudel, on aura a la fois la version de 1905 et celle de 1948, Et chaque
version de chaque ceuvre aura été précédée d’ esquisses et de brouillons
rédactionnels”®,
Lcuvre est désormais comprise dans son mouvement. Celui-ci,
loin d’8tre identifiable & une ligne ininterrompue, implique des béances
et des arréts, des bifurcations, des manques et des blancs. A la dyna-
mique interne de V écriture s’ajoute la dynamique externe de I’ histoire
dans laquelle une ceuvre surgit, évolue, se transmet, s’efface ou dispa-
raft. Dans cette perspective, le commerce avec la littérature sera plus
tiche, mais aussi plus difficile et plus ambitieux. Les critéres d’éva-
luation et les certitudes de la critique ne fonctionnent plus comme
avant.
Ces déplacements ne sont pas sans incidence sur I’édition des textes,
Comment représenter le multiple ? Qu’ opposer a une tradition philolo-
gique et textologique séculaire qui a mis tout son art a établir le vrai
texte, le meilleur texte, le texte ne varietur? Pour V édition scientifique,
Phypertexte sera sans doute l’ outil privilégié de l'avenir. Il permettra de
naviguer dans tous les états de Ja genése, de les rapprocher et de les
compater, en visualisant les liens de parenté, La navigation hypertex-
tuelle remplacera utilement les apparats critiques trop souvent illisibles
de 1’ édition papier. Mémoire vive au sens propre du terme, sans cesse
ravivée, réactivée, enrichie, contrdlée et mise en question par le cher-
20, Pour les exemples de Brecht et Claudel, voir dans ce volume le chapitre 11,
intitulé «Genéses théatrales »,
Du manuscrit au chercheur 41
cheur, I’hypertexte ressemble aux anciens arts de la mémoire”', mais il
est aussi mémoire de l'avenir”,
Avec ’accent mis sur le processus, l’esthétique littéraire ne sort
pas indemne. L’idéal de la perfection est en train de céder le pas & des
formes plus complexes, le critére de 1a finitude s’effacera devant les
ceuvres inachevées, et on se demandera si I’ ceuvre n’est pas, 4 propre-
tment parler, inachevable. Le commerce avec la littérature est un processus
sans fin.
21, Voir Frances A. Yates, L’art de la mémoire, [1966], trad. frang., Paris, Galli-
mard, 1975.
22. Voir le numéro 196 de la revue Diogéne (oct.-déc. 2001, coordonné par Jean-
Gabriel Ganascia et Jean-Louis Lebrave), consacré A «Retour vers le futur, Supports
anciens et modernes de la connaissance ».
Chapitre 3
Comment lire
un manuscrit moderne ?*
Un manuscrit peut étre admiré pour son esthétique propre, on peut
éventuellement I’ acheter, souvent a prix d’or, et le conserver dans une
collection privée ou publique. Pourtant, on n’accédera & sa valeur d’ objet
inteflectuel qu’a travers la lecture. C’est de la maniére dont on lit ces
pages noircies d’écriture, raturées a outrance, gribouillées et surchar-
gées d’ajouts que dépend la capacité a les construire en objet scienti-
fique: seule une lecture attentive 4 l'ensemble des indices visuels et
spatiaux saura traduire ceux-ci en indices temporels, eux-mémes néces-
saires pour établir une chronologie des opérations impliquées dans une
genése. C’est encore de ce que le généticien aura / que dépendra tout
jugement sur |’ acte d’écriture, toute interprétation de la genése et toute
évaluation du processus langagier, esthétique et intellectuel mis en ceuvre
dans un avant-texte.
Lire est, de manidre générale, une activité finalisée dans laquelle la
perception visuelle, la compréhension intellectuelle et la mise en corres-
pondance de-ces deux types de processus produisent ensemble de nouvelles
connaissances. Lire un manuscrit permet de comprendre les «sentiers de
la création» et d’élucider les processus mentaux qui président a l’inven-
tion littéraire. Ne pas prendre au sérieux Ja maniére complexe dont un
lecteur appréhende le manuscrit, ne pas donner toute sa dimension 4 cet
acte initial, c’est risquer de se méprendre sut I’ objet méme de la critique
génétique, c’est ignorer la différence entre texte et manuscrit.
Des écrivains, on sait le rapport multiple qu’ ils ont a la lecture. Ils
sont lecteurs de textes (littéraires ou érudits)!, mais aussi lecteurs de
* Une autre version de ce texte a paru sous Je titre « Méthode de lecture» dans Les
manuscrits des écrivains (Louis Hay, ed), Paris, Hachette et CNRS Editions, 1993,
p. 138-161.
t, Voir chapitre suivant.
44 La mise en ceuvre
leurs propres manuscrits. Ils sont nombreux 4 rappeler que « lire et écrire
sont une méme expérience » (Martin Walser), ou que c’ est travers leur
expérience de lecteur qu’ ils sont devenus écrivains, ou encore, par méta-
phore, qu’ils ne sont que les lecteurs d'un message venu d’ ailleurs: «Je
n’ai jamais écrit mes romans, je les ai lus » (Aragon). Comme tout autre
scripteur, ils passent aussi une certaine partie de leur temps A ce qui s’ap-
pelle communément — et étrangement — «se relire». Certains prétendent
méme lire leur propre manuscrit avec la distance, avec les yeux d’un
autre; «Je suis mon propre lecteur par lequel |’ auteur en moi est sans
cesse tenu en bride», dit Louis-René des Foréts. D’ autres, cependant,
refusent a l’auteur toute capacité a étre son propre lecteur: on ne se lit
jamais entigrement avec les yeux d’un autre. Ainsi, pour Jean-Paul Sartre,
auteur et le lecteur sont «deux agents distincts »:
[...] Pécrivain ne peut pas lire ce qu'il écrit, au lieu que le cordonnier
peut chausser les souliers qu’il vient de faire, s’ils sont 4 sa pointure, et
Varchitecte habiter la maison qwil a construite (...] Or, l’opération d’écrire
comporte une quasi-lecture implicite qui rend la vraie lecture impossible.
Quand les mots se forment sous sa plume, !’auteur les voit, sans doute,
mais il ne les voit pas comme le lecteur puisqu’il les connaft avant de les
écrire; son regard n’a pas pour fonction de réveiller en les frélant des
mots endormis qui attendent d’étre us, mais de contréler le tracé des
signes, c’est une mission purement régulatrice, en somme, et la vue ici
n’apprend rien, sauf de petites erreurs de 1a main. (in Qu’est-ce que la
littérature ?, 1948, Paris, Gallimard, coll. Idées, p. 52 sq.)
Se relire n’implique cependant ni la méme dépense, ni la méme
attente, ni les mémes anticipations, ni le méme plaisir que I’ acte de lire.
Nous laisserons ici hors de notre champ te geste du scripteur qui se relit,
pour ne viser que le geste du lecteur-généticien qui cherche 4 lire un
manuscrit, et A le lire au sens le plus exigeant, Si la raison de ce geste
est claire — on veut accéder aux mécanismes de |’ écriture — le moyen
d’y parvenir l’est moins. En effet, comment s’y prendre pour lire quelque
chose qui précisément n’est pas (encore) du texte?
COMMENT DECHIFFRER LES TRACES ?
L’écriture manuscrite pose d’emblée un probléme particulier: elle
est la résultante de plusieurs facteurs, dont certains sont collectifs — toute
Comment lire un manuscrit moderne ? 45
écriture refléte plus ou moins le code graphique appris 4 l’école — et
@ autres, individuels, dont certains sont de nouveau soit invariants, soit
soumis A variation, a |’évolution ou la déformation par le temps, par
Vhumeur, ou l’outil d’écriture. C’est grace 4 des traditions nationales
sur la maniére de tracer certaines lettres que I’ ceil exercé distingue sans
risque d’erreur une écriture frangaise d’une écriture allemande, alors
que les deux pays emploient aujourd’ hui le méme alphabet. Coté indi-
viduel, la mémoire visuelle de certains tracés d’ écriture fait que, dés la
réception d’une lettre et la perception de l’adresse sur l’enveloppe, le
destinataire sait souvent immédiatement gui en est |’ expéditeur. Inver-
sement, sil’on n’a pas appris tel type d’alphabet, par exemple |’ écriture
gothique de !’allemand, fe plus passionnant manuscrit rédigé dans cet
alphabet restera illisible. Par ailleurs, et a fortiori, il ne sert 4 rien de
connaitre I’ alphabet si I’on ne connait pas la langue impliquée, et c’est
bien pourquoi j’ai besoin de l'aide d’un slavisant pour comprendre les
tracés cyrilliques d’ Aragon citant, dans un manuscrit de La Mise 4 mort,
un vers de Lermontov (fig. 1). Et quand on connait et l’alphabet et la
langue, tout n’est pas forcément gagné, tant un tracé individuel peut étre
difficile & déchiffrer: ainsi par exemple un des « microgrammes » de
Robert Walser (fig. 2). Le déchiffrement devient évidemment plus aisé
au fur et A mesure que |’ ceil du lecteur intériorise l'image globale ct les
traits particuliers d’un tracé, Mais ce qui rend la lecture du manuscrit
réellement plus difficile que la lecture «normale » des textes imprimés,
ce sont «les mots sous les mots», 1’écriture sous la rature. Le lecteur
doit en effet déchiffrer ce qui figure sous le trait de la biffure ou sous le
tracé d’un mot écrit en surcharge (sans parler des patés d’encre qui recou-
vrent définitivement certaines séquences écrites)*. La lecture des variantes
de manuscrits oblige 4 interrompre le fil continu et l’orientation normale
des mouvements de 1’ceil. Prenons un cas précis. Au début du Cahier 3
de ce qui deviendra A la Recherche du temps perdu, Proust écrit ceci
(ceprésentation simplifiée) :
Le jour n’ avait pas encore tracé cette ligne blanche en dessous de laquelle
vient sinstallez se placer la fenétre
2. Pour le déchiffrement des ratures, voir Jean-Louis Lebrave, «Lecture et analyse
des brouillons », Langages n° 69, 1983, p. 11-25; pour une interprétation des ratures,
voir Almuth Grésillon, « Rature, silence, censure», Le sens et ses hétérogénéités,
CH. Parvet, ed.), Paris, Bd. du CNRS, 1991, p. 191-202; voir également infra, chap. 5.
46 La mise en eeuvre
hp TA Livonia’ fos Coy mentite meee zie
© clewine Da vara cowntinromating py Rite acy, pel Vere
Be cbaieun Wom tone. Sn Re (puttin ned ip pat fred pne woe
niin Baated Atode’be boii, , ermane ORipe pad prebienee de
ue Wryaroda Trion Sane fader Giiintien: Ab coms be mee
Ciao :
SOS ah pe eo,
Lg gpeton, Mark roe Bee
DR ee A
Bian epee mA
other .
Tah tae payatt
pens
ts itm,
wi oN cast
. spakyso linet
oe A
Vig. 1: Aragon, manuscrit de La Mise 4 mort (CNRS-BnF, fonds Aragon-Triolet)
Tnévitablement, le lecteur lit d’ abord «en dessous de laquelle vient
s’installer», et l’ceil avance sans doute méme jusqu’a la séquence «la
fenétre» ; puis le regard, effectuant un retour en arriére, correspondant
a la «traduction» du signe de biffure, repart ensuite dans la linéarité
gauche-droite pour déchiffrer «en dessous de laquelle vient se placer la
fenétre ». De méme, lorsque le généticien lit dans un manuscrit de
Holderlin un empilement paradigmatique de variantes, figurant dans
l’espace interlinéaire, comme le suivant:
Comment lire un manuscrit moderne ? 47
Der Nachtgeist, der himmelstiirmende, der hat beschwazet unser Land
mit
unbindigen
sabtiadiger:
aaiiedicher
daendiicher
Sprachen viel, endichtrisehen...,
(esprit de la nuit, a Passaut du ciel, a étourdi notre pays, en lui parlant
en d’innombrables langages, nen-poctiques, nen-finis, nen-pacifids, non-
pertinents, non-maitrisés)
le balayage horizontal-syntagmatique de la lecture est nécessairement
interrompu par celui, vertical, du paradigme de variantes. Le spécialiste
de manuscrits sait que la premiére unité écrite du paradigme est celle
qui figure sur la ligne du texte («undichtrisch »), que celle-ci a été
remaplacée par l’unité figurant immédiatement au-dessus (ou en dessous),
et ainsi de suite. Il part du principe que le regard parcourt ce paradigme
en mimant le sens de I’ ordre scriptural, c’ est-4-dire de bas en haut (donc
en sens contraire de l’acte de Jecture «standard», qui procéde de haut
en bas), pour s’arréter sur la dernigre variante, celle qui survit
(«unbindig»). Ces petits exemples suffiront pour linstant 4 montrer
combien la lecture du manuscrit excéde pat certains aspects les procé-
dures deta lecture normale.
Tout cela fait partie de cette phase initiale du déchiffrement qui
représente |’ étape premiere et indispensable de la lecture du manuscrit.
On sait assez les erreurs d’interprétation dues 4 des déchiffrements
erronés et qui ont ensuite persisté a travers des générations. Un exemple
classique en la matiére figure dans un manuscrit de Heinrich von Kleist:
Jes éditeurs avaient lu «Schmerz» (= “souffrance”) au lieu de «Schmutz»
“souillure”), confusion aprés tout pardonnable quand on sait 4 quel
point les tracés de ces deux mots allemands se ressemblent dans une
écriture gothique un peu relachée, Simplement, pendant des décennies,
les spécialistes ont lu et interprété « Schmerz und Glanz meiner Seele »
(= « souffrance et splendeur de mon Ame») au lieu de « Schmutz und
Glanz meiner Seele» (= « souillure et splendeur de mon Ame»)!
Le déchiffreur se doit de prendre en méme temps conscience de la
qualité toute visuelle du manuscrit, od un ductus personnel, une certaine
occupation de l’espace, |’ orientation assez libre des lignes d’ écriture, la
gestion des marges, l’emploi d’ outils différents, voire le recours a plusieurs
supports (par exemple l’un collé sur l’autre, comme c’est le cas des
48 La mise en euvre Comment lire un manuscrit moderne ? 49
fameuses paperoles de Proust), bref tous ces traits du visible, viennent
s’ajouter au lisible proprement dit et requiérent alors un autre type de
perception que celle du déchiffrement linéaire d’une chaine de carac-
teres. Afin de souligner cette double nature de la lecture du manuscrit,
nous parlerons de sa « vilisibilité »3. Valéry, lorsqu’il parlait du «Coup
de dés» de Mallarmé, avait déja souligné l’ importance «du systéme
verbal et visuel» de ces pages. Lire a la fois Je lisible et le visible, cela
exige une concentration, une souplesse et une acuité du regard qui
risquent, devant ces «champs de bataille » (fig. 3) de certains manus-
crits, de faire perdre au lecteur son latin et de lui faire conclure que tout
cela est du chinois ou de P’hébreu.
abe i
i
ns
dh
iat
oe
i
ge ie
G s
ey hag fe a se,
Ei aUpte ne ulate gains eae}
: 2
in No facet
oat faut UNGAG 3 iy peat
pte?
20 US pall, aig out
tener cedure eed ein
a MeN
chi
oe
fo Bet Wal pesto eters» aay oy
Tatas Met rf RY
te ph eine ae
Ge a SS ges
ee oo ate is Mihas oe atom Oy
a
Dy pbs ep
eles Me fata Fle RT aoe | aed
Pe tnalin BB Sik ob been TSE oO hiro SG
eee che ME eee
x cf ay = . <
Fig. 3: Francesco Leonetti, brouillon de “Campo di battaglia”
(Pavia, Fondo di manuscritti dei autori contemporanei)
3. Le terme est emprunté a Jacques Anis, qui caractérise ainsi avec bonheur la lecture
de certaines créations poétiques comme les calligrammes de Michel Leiris ; voir Jacques
Anis, « Vilisibilité du texte poétique», Langue Frangaise, n° 59, 1988, p. 88-102.
. 2: Robert Walser, «microgramme » n° 186, Aus dein Bleistiftgebiet, t.1,
Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1985, © Robert Walser-Stiftung, Zurich.
50 La mise en euvre
COMMENT LIRE UNE SPATIALITE PROTEIFORME ?
Loccupation de l’espace graphique dans J’ acte de 1a lecture — tout
comme |’occupation du sol en géographie — intervient de maniére déter-
minante. A Ja linéarité du déchiffrement (qui peut étre entrecoupée soit
par des retours en arriére soit par des points ot Je paradigmatique se
projette sur le syntagmatique) vient s’associer, on I’a souligné, un second
paramétre, de nature visuelle, qui est d’un autre ordre et qui permet de
regarder le manuscrit comme on regarde un tableau.
Qui ne connait ces manuscrits-tableaux oi I’ écriture part littérale-
ment dans tous les sens, ot l’on ne sait guére dans quel sens tenir le
feuillet, ni ot il commence ni ot il finit (fig. 4). L’écriture se fait image,
Absent ut Cattende cpbinece — bs prafmde,
fab arcttLle ppiciitin jut WhR Me leek
tele poke Piet get M peas AUD Aree boy”
pal ke, ean gic Sent e — Pivrne Oe
chapireetinmele pat face fo
Fig. 4: Paul Valéry, brouillon d’Agathe
(BaF, Nafr. 19019, £°148 1°)
Comment lire un manuscrit moderne ? 51
le déchiffrement devient perception d’un tableau, qui se donne a voir
plus qu’il ne se donne & lire, Ce qui déroute le lecteur-généticien, c’est
que la relative sécurité d’un déroulement linéaire de V’écriture, inter-
rompu tout au plus par des « paquets» de variantes, céde ici la place a
un déroulement « multivectoriel », c’est-a-dire qui prend toute liberté
par rapport a l’espace graphique de la page: la ligne peut étre de longueur
variable, 1’écriture peut suivre une orientation horizontale, verticale,
diagonale, ou s’inscrire téte-béche.,.
Une telle occupation de l’espace graphique par une écriture protéi-
- forme n’est cependant pas nouvelle. Depuis des siécles, bien avant le
«Coup de dés» mallarméen, poétes, calligraphes et imprimeurs ont
transformé I’ écriture alphabétique en figures ludiques et symboliques*.
Deux exemples: le premier (fig. 5), datant de 1645 et fabriqué par un
calligraphe de Darmstadt, représente un speculum hominis, entouré de
quatorze blocs numérotés d’écriture et traversé lui-méme dans son corps
de multiples fragments écrits ; le second (pl. I; les planches couleur sont
regroupées a la suite de la page 96), un calligramme d’ Apollinaire,
témoigne de la complicité artistique particuliére entre poéte, aqarelliste
et imprimeur.
« Vision simultanée de la Page », remarquait Mallarmé 4 propos de
sa propre invention (Préface au «Coup de dés» ): cette écriture qui se
_ déploie dans tous les sens et dont la perception peut se faire tout au plus,
comme le disait spirituellement Valéry, en une « succession simultanée »,
on l’observe chez, certains écrivains (fig. 6) dont les manuscrits illus-
trent des tracés débridés qui, tout en étant réellement de I’ écriture, sont
plus prés des arts plastiques que de la ligne réguliére de l’écrit. On |’ ob-
serve surtout chez des écrivains-dessinateurs comme Henri Michaux ou
. des peintres-écrivains comme Masson, ou Carlfriedrich Claus avec ses
«Sprachblitter» (pl. ID, pour lesquels 1’écriture, parfois seulement
simulée, semble étre une sorte de passeur entre l'image et la pensée, Le
cas de Claus est particuliérement intéressant, car ses expériences graphico-
scripturaires se veulent délibérément exploration de processus mentaux.
Ce n’est certainement pas un hasard si l’on trouve dans les écrits théo-
tiques de ce dessinateur-écrivain des passages lumineux sur la lecture
de manuscrits littéraires !
4, Pour le rapport texte-image, voir Anne-Marie Christin, L’image écrite ou la
_ Déraison graphique, Paris, Flammarion, 1995.
52 La mise en vuvre x Comment lire un manuscrit moderne ? 53
© Voici le commentaire que Claus nous livre d’un manuserit de Hélderlin :
Sur le folio, toutes les phases scripturales de ce processus sont présences
simultanées, tableau. Retransformer cette image écrite en mouvement
jangagier, done déchiffrer, lire, c’ est difficile, parfois presque impossible.
Mais ce qui est possible, c’est de suivre les traces écrites avec un ceil en
état de vive attention ; c’est ce qui rend sensible a la variation de I’épais-
seur temporelle, & l’accélération, au blocage, au ralentissement, au chevau-
chement de vitesses identiques ou différentes ou a interruption de tel
ensemble de lignes ; c’est également ce gui permet de produire émotions,
sensations et impulsions dont on n’ avait pas conscience auparavant. Etablir
ainsi des relations potentielles entre des espaces visuels et des mouve-
ments, en partant de la base matérielle du manuscrit et de ses interfé-
rences avec le champ de la création littéraire, c’est ouvrir de nouvelles
dimensions sémantiques et non-sémantiques dans et sur le « work in
progress » méme. (Claus, Erwachen am Augenblick. Sprachblatter. Cata-
logue d’ exposition, Minster, 1990, p. 140; c’est moi qui traduis).
Fig. 5: Adam Fabritius, calligraphe allemand du XVM siécle, “Speculum
hominis” (reproduit dans Jeremy Adier et Ulrich Ernst, eds, Text als Figur:
Visuelle Poesie von der Antike bis zur Moderne, Herzog-August-Bibliothek
Woilfenbiittel, Weinheim, VCH, 3e éd. 1990, p. 198)
Fig. 6: Paul Valéry, brouillon de Charmes
(Bak, Nafr. 19010, Cahier brouillons 2, f° 12 y°)
54 La mise en wuvre
On comptera également parmi ces écritures imagées — sortes de
pages-paysages — cerlaines notes manuscrites de Butor, dont on connait
par ailleurs les nombreuses collaborations avec ses amis peintres :
constructions autant scripturales que plastiques, lignes et courbes qui
viennent traverser des listes et tableaux d’écriture (pl. ILD.
Cette transgression de la linéarité est encore plus sensible dans une
des ceuvres d’ Adolf Wolfli (pl. IV): délire composé entre scriptural et
pictural, délire ici au sens propre, puisque Wolfli, ’exclu de toute culture,
Va produit au cours des trente-cing ans de son internement 4 l’asile de
ja « Waldau» (prés de Berne).
A propos de telles turbulences de la ligne écrite, de ses brisures,
courbures et orientations démultipliées, face a l’inextricable mélange
d’écriture et de dessin, au désordre composé de ces espaces-pages, la
science du généticien reste muette, les habituels repéres et recettes s’avé-
rent inefficaces. Comment appliquer a ces tracés erratiques un quel-
conque principe de hiérarchie, comment y isoler les habituels critéres
d’un avant-aprés, comment mettre de l’ordre dans ce qui s’affiche si
incontestablement comme désordre, anarchie, chaos, errance, bref,
comment réduire ces simultanéités en successions ? Il serait erroné de
youloir transformer ces «champs de bataille » en feuillets réglés comme
du papier 4 musique. Mais il serait également improductif d’en rester a
une béate admiration pour les voies innombrables et, au fond, impéné-
trables de la création. Ce que la «lecture » de telles pages réclame, c’est
un ceil sensible au multiple, au non déterminé, et un esprit prét 4 inclure
V’indécidable dans la chaine de ses opérations. On pense de nouveau &
certaines notions développées par Claus, qui montrent qu’il faut sortir
des sentiers battus et risquer l’inconnu: il faudrait, dit-il, opérer avec
des « doigts mentaux » (= “Hirnfinger”) et une «conscience manuelle »
( “HandbewuBtsein”). Les méthodes de lecture du manuscrit en sorti-
ront a coup sir enrichies.
Quoi qu’il en soit, il faut, 1a aussi, commencer par déchiffrer.
Gageons que l’activité méme de déchiffrer fait découvrir en méme temps
des relations entre tels signifiants épars et tels signifiés dispersés. Et
probablement, certaines de ces relations supportent qu’on découvre entre
elles une chronologie relative. On verra plus loin de quelle batterie de
critéres et de raisonnements le généticien doit disposer pour dégager ces
hiérarchies enfouies dans |’apparente simultandité de la page.
Comment lire un manuscrit moderne ? 55
COMMENT COMPRENDRE LES TRACES
ET (RE)CONSTRUIRE LA GENESE ?
Déchiffrer et comprendre ne sont que les deux faces, en interac-
tion permanente, d’une seule et méme activité : la lecture, précisément.
Ce n’est que pour des raisons heuristiques que nous avons décidé de
présenter successivement les phases de la perception et de la compré-
hension. 11 fallait en effet démontrer clairement que le matériau du manus-
crit impose des stfatégies particuliéres a la visibilité comme 4 la lisibilité.
A cette restriction prés, la lecture de manuscrits, comme la lecture
en général, n’a de sens que si elle produit du sens, Il s’agit donc de
savoir comment le lecteur passe du visible au lisible et du lisible a1’ in-
telligible ; ou encore, comment il « traduit» la trace graphique en opéra-
tion mentale, et, dans le cas du manuscrit notamment, comment il
traduit l’indice spatial (par exemple l’emplacement d’une réécriture
dans l’espace de la marge) en valeur temporelle. Si l’objectif de la
lecture « normale» consiste & comprendre un écrit, celui de la lecture
@un manuscrit consiste 4 comprendre la genése d’une écriture, c’ est-
a-dire a reconstituer a partir d’une organisation spatiale la chronologie
et le sens des opérations scripturales. Dans ce processus de recons-
truction, le lecteur dispose d’une sorte de « grammiaire de la lisibilité »,
qui associe aux catégories grammaticales classiques & la fois des critéres
pragmatiques et textuels et les indices matériels et topographiques de
Vécriture.
Malheureusement, on ne dispose d’ aucun «protocole» de tous les
raisonnements, hypothéses, anticipations, inductions, inférences, asso-
ciations, etc, qu’un lecteur de manuscrits peut faire en patcourant ne
serait-ce qu’ une seule page; et on sait encore moins comment il arrive &
maitriser finalement l’ensemble d’un dossier manuscrit dont il vise 4
restituer la genése. Ces raisonnements activent et mobilisent en tout cas
des énergies intellectuelles, des savoirs récents ou enfouis, des opéra-
tions et des représentations mentales complexes, Au-dela de ces généra-
lités, notre ignorance est grande. Car, la plupart du temps, le lecteur fait
des inférences, mais ne les rationalise pas comme telles ; il procéde a des
recoupements et des associations, mais de fagon non réflexive, puisque
son objectif n’est pas d’ observer les stratégies de sa lecture, mais d’ar-
river 4 en extraire des significations génétiques. Par conséquent, tout ce
56 La mise en euvre
que nous pourrons proposer dans les lignes qui suivent, c’est de réunir
quelques-unes de nos expériences de lectrice de manuscrits. Ces opéra-
tions peuvent s’effectuer dans un ordre variable; nous les organisons
cependant selon un fil qui pourrait, aprés tout, constituer le squelette
d'une future grammaire de la lisibilité du manuscrit.
Significations liées 4 la matérialité du manuscrit
La perception visuelle d’un manuscrit fournit des informations
sémiotiques qui peuvent, a leur tour, engendrer des raisonnements indis-
pensables & la reconstruction de la genése, Dans ce cas, le lecteur tire
argument de certaines particularités du support ou de |’outil ainsi que
de V’aspect physique de l’écriture elle-méme.
Le support
Sil s’agit par exemple d’un calepin ou d’un carnet, il y a de fortes
chances que son contenu soit fait de notations hybrides — choses vues,
idées-éclairs « mises en mémoire » ou simplement traces de la vie quoti-
dienne, S’il s’agit d’un cahies, le contenu reléve en général déja de
certains états rédactionnels. Dans le cas des Cahiers de Proust, on sait
en outre que son écriture ne peut étre antérieure 4 1908, car avant cette
date, Proust écrivait sur des feuilles volantes. Si, chez Colette, on rencontre
du luxueux papier bleu, on sait qu’il s’agit d’un manuscrit postérieur 4
1923. Si l'on s’occupe de certains avant-textes de Michel Leiris, on sait
qu’il a conservé de ses expéditions d’ethnologue la pratique de la fiche.
Si Claudel, Valéry ou Malraux écrivent sur tel papier & en-téte d’un
ministére, on peut s’en servir pour Ja datation. Enfin, si, chez Heine, on
détecte tel filigrane, spécifique de tel papetier italien, on peut en induire
que I’ écriture du feuillet en question correspond a la période du séjour
de l’auteur en Italie.
Les outils d’écriture
Les pratiques sont de nouveau individuellement différenciées. De
tel manuscrit de Heine révélant a 1a fois des passages a l’encre et au
Conunent lire un manuscrit moderne ? 57
crayon, on peut inférer que les passages au crayon représentent néces-
sairement des réécritures ou ajouts datant des derniéres années de sa
vie: de plus en plus malade depuis 1848, et done alité, il ne poavait plus
recourir a usage de la plume et de l’encrier. De I’écriture du Chateau
de Kafka, on cite tel exemple od, en plein milieu d’ une phrase, 1’ écri-
ture passe de l’encre au crayon: interrompu par un départ en voyage, le
scripteur a dG renoncer a la plume et a l’encrier et ne pouvait poursuivre
gu’au crayon, A inverse, Valéry avait I’habitude de travailler avec un
jeu de plumes, d’encres et de crayons sur sa table, si bien que l’emploi
d'outils différents sur une méme page n’est pas pertinent pour la data-
tion.
Le tracé
Le lecteur peut enregistrer certains écarts par rapport a l’image
moyenne de I’ écriture «normale» d’un scripteur précis et les interpréter
en fonction de faits biographiques: la déformation de I’écriture de Nerval
au cours de sa maladie; les marques d’ affect qui font que telle inscrip-
tion impulsive de Valéry rend I’ écriture pratiquement méconnaissable ;
Vinsistance avec laquelle Robert Walser, en parlant de ses « micro-
grammes», rappelle «!’effondrement de [sa] main, une sorte de crampe»,
due 4 Pusage de la plume dont il s’est «péniblement, lentement libéré
par la voie du crayon».
Significations construites par Valternance écriture-lecture
Regardons maintenant une page ot I’écriture part dans plusieurs
sens (fig. 7); elle fait partie du dossier de Lucien Leuwen de Stendhal®
et est présentée comme « PLAN», puisque le mot figure deux fois sur la
partie droite du feuillet. Ici, peu de renseignements spatiaux sur la chro-
nologie; en revanche, le déchiffrement et la compréhension permettent
d’affecter des chiffres (de 1 49) aux diverses zones écrites indiquant ainsi
Vordre temporel de 1’écriture. Stendhal a df procéder de la maniére
suivante : en haut du feuillet, il a dessiné d’abord au centre de la page un
5. Voir Jacques Neefs, «Marges», De /a Lettre aut livre, (Louis Hay, ed.), Paris,
Lid, du CNRS, 1989, p. 75-77.
58 La mise en @uvre
cout Mat aw 3 1 9 Mai PLAN om
pie vanite ee et augmente Jes grannes a
affaires, Hse yott ruin, meuri, et Leuwen si jens Sous Be Seeder
uit ay & a 9
trove pouvee. So place vat son une ressouee.
ace je sonpe 2 cect
Mine. teen footie pour ta tte
perdre, Au dSsexpoir ethene elle Ie
: Eatenchies
suit dons wn village prog XXXXX vb Hl s'est
tmoviantanéwent se cabinets Higeires pour foams de chambre. St eee
Bie ce
Soe ent ee
& Mi tbet
Co phn a to Waal saucers wm duo
al de ne pas mvoir le Septuce comme ctlsh
ae te Gan aca
De reste if peint ow peut peinére
Stoic te ie Wambassude & Rome, of Mme, de Stn peur do enter, Le ei
PB eo de Rome Fee, iateiges contce Iwi, Van Petre ameust, Le pe
Fig. 7: Stendhal, manuscrit de Lucien Leuwen
(Bibliothéque municipale de Grenoble, ms. R 301, t. 1, f° 376)
Comment lire un manuscrit moderne ? 59
motif en forme de chapiteau, dans lequel il inscrit «Nuit du 8 au 9 Mai
1834» (= 1) ; voila pour la datation absolue. Ensuite, aprés avoir tracé
en lettres d’imprimerie « PLAN », il procéde a des notations autobiogra-
phiques, «Je ne sors pas... », suivis d’un vague projet d’écriture, «Premiére
jidée... » (= 2), done rien encore qui reléve vraiment @’un «plan». C’est
pourquoi il va retracer ce mot & l’identique, en lettres d’imprimerie, qui
sera cette fois-ci suivi sur le reste de la partie de droite d’une.sorte de
plan-résumé (= 3), Vient alors 1’occupation de la page de gauche, qui
commence par l’inscription, faite plus tard dans cette méme nuit d’in-
somnie, «9 Mai 1834» (= 4), Le texte du plan-résumé se poursuit alors
sur toute la page de gauche (= 5), pour s’achever en deux nouvelles zones
d’écriture, d’abord celle du milieu de page, oti sept lignes serrées vien-
nent se placer & la verticale (= 6), puis celle, toute petite, en biais, et en
surimpression sur le trait droit du chapiteau (= 7). Et Je texte de ce plan
s’arréte, significativement, sur la question de savoir si toutes ces petites
histoires «si intéressantes dans la réalité, feront [...] bien dans P’ Art», —
retour donc au métadiscours. Mais le scripteur n’a pas encore fini de
«signer» son manuscrit; dans le bord haut & droite, il griffonne «Bon
4 Juillet» (= 8), et comme pour donner un statut universellement défi-
nitif 4 ce «bon a tirer», il inscrit, en surimpression A sa propre écriture,
dans un tracé extraordinairement net et empruntant une courbe qui traverse
littéralement le haut de la page droite «Good le 4 Juillet» (= 9). Ce feuillet,
écrit pourtant sans ratures et ne représentant en fait aucune complication
exceptionnelle, permet d’imaginer comment le lecteur doit 4 1a fois capter
les renseignements visuels et les comprendre en méme temps que le
message linguistique, lui-méme fait de plusieurs niveaux discursifs. Sans
doute faut-il avoir fait-ce genre de parcours de lecteur pour éyaluer ’ap-
port spécifigue des manuscrits 4 une théorie générale de la lecture.
Présentons maintenant un exemple bref, mais extraordinairement
dense de l’acte de lecture intervenant sur une réécriture minimale. Le
remplacement d’une seule lettre — «d» par «t», dans dors par tords —
entraine toute une batterie d’ autres changements et réoriente totalement
Ja lecture et l’attribution d’une signification. Dans un manuscrit du poéme
«LIdéal», Baudelaire a réécrit les deuxiéme et troisiéme vers:
Premiére version:
Qu bien toi, grande Nuit, fille de Michel-Ange
gui dors paisiblement dans une pose étrange
et tes appas taillés aux bouches des Titans
60 La mise en wuvre \
Deuxiéme version:
Ou bien toi, grande Nuit, fille de Michel-Ange
qui tors [sic] paisiblement dans une pose étrange
tes appas fagonnés aux bouches des Titans
Ponge, lecteur de cette variante, remarque lapidairement A propos
de ce changement de «dors» en «tor(d)s »: « Un trait modifie tout,
change tout... Cela supprime “et” et cela permet “faconnés”»®, En effet,
ie changement de «dors» en «tords » change totalement la syntaxe
(verbe absolu / verbe transitif); «les appas » devenant ainsi complé-
ment direct, la conjonction «et» doit étre supprimée ; du coup, il manque
un pied 4 l’alexandrin du dernier vers, que vient réparer le remplace-
ment de « taillés» par « fagonnés ». Quant A la sémantique, elle ne sort
pas indemne de la transformation de « dormir paisiblement» en « tordre
paisiblement ».
Lire de prés les mouvements de I’ écriture et de la réécriture permet
ainsi de comprendre et d’interpréter un certain nombre de traces graphi-
ques. Mais tout n’est pas rationalisable ni interprétable, tant s’en faut.
Quand le lecteur tombe sur une alternative lexicale non résolue, des
critéres de position dans !’espace graphique peuvent certes !’éclairer sur
ja chronologie relative, mais en |’ absence de traits de biffure et en l’ab-
sence d’ autres paramétres (comme par exemple la comparaison avec
une version postérieure), il sera impossible de savoir pour quelle «lecture»
il faut en définitive opter. Ainsi dans le manuscrit d’un poéme inédit de
Valéry oi on lit ceci:
Si c’est Pheure / Laisse-moi / Tu pleures / j’ai froid / Tu me verses / la
liqueur / Qui perce berce / le cceur
Tout ce que le lecteur retiendra, c’est que l’indécidable de cette
séquence joue entre deux lextmes antonymes (« percer le coeur» vs.
«bereer le coeur»), réunis ici dans une ambivatence non réductible.
Au cours de Ja lecture du manuscrit et des interférences qu’elle
produit avec la mémoire, il n’y a pas uniquement mobilisation active
des savoirs et construction cognitive, il y a aussi des surprises, des intui-
tions soudaines, des paris et pistes qui émergent quasiment de |’ incons-
cient. Je n’ oublierai pas cette expérience de généticienne débutante, ot
6, Francis Ponge, Pratiques d’ écriture ou Vinachévement perpétuel, Paris, Hermann,
1984, p. 100 sq.
Comment lire un manuscrit moderne ? 61
je me suis piquée au jeu du déchiffrement d’une page manuscrite de
Proust. J’ignorais 4 peu prés tout de la Recherche comme du manuscrit
en question, mais le déchiffrement et la lecture répétée de cette page me
rendirent attentive 4 des récurrences d’ expressions linguistiques du temps,
notamment a la fréquence des adverbes «déja» et «encore». Et de réver
tout d’un coup 4 une hypothése inattendue: ces récurrences linguisti-
ques concernant des adverbes de temps devaient avoir un rapport direct
et symbolique avec la genése de ce roman, roman sur le temps, sur l’écri-
ture et le temps de I’écriture. Renseignement pris auprés des spécia-
listes, le feuillet én question (le premier du Cahier 1) se révélait étre tout
simplement l’un des avant-textes de la premiére phrase du roman! En
effet, au terme de nombreuses réécritures, ce segment textuel se retrouve
sur une dactylographie od une ultime correction manuscrite de Proust
yemplace le jeu sur «déja» et «encore» par le célébre incipit de la
Recherche : « Longtemps, je me suis couché de bonne heute » 7.
Reconstructions de la genése
La lecture du manuscrit, nous l’avons dit, n’a de sens que si elle
produit des connaissances sur la genése de l’écriture. Or, nous n’ avons
encore presque rien dit de l’espace génétique quand il excéde la dimen-
sion de la page.
Comment passe-t-on du microcosme d’une page au macrocosme
d’un dossier génétique ? A supposer que le dossier soit complet ~- c’est-
a-dire qu’il comporte toutes les piéces connues de la genése de telle ou
telle ceuvre — le généticien procédera d’abord a une lecture synthétique
de ces pieces et les rangera selon un ordre chronologique probable. Du
reste, l’auteur lui-méme lui apporte parfois son assistance : en «nommant»
le type de documents (Zola intitulant « Yebauche» une liasse de feuil-
lets, Flaubert ou Stendhal écrivant «Plan» en haut d’un folio), en datant
soigneusement les feuillets (comme Ponge), ou en léguant son fonds
manuscrit muni de l’ordre chronologique de toutes les piéces.
Voici un exemple de cette lecture 4 la fois détaillée et globale d’un
manuscrit, Etudiant le dossier génétique de la Préface a Lutéce de Hein-
7. Voir Almuth Grésillon, «ENCORE du temps perdu, DEJA la Recherche»,
Langages, n° 69, 1983, p. 111-124.
62
La mise en wuvre
rich Heine, je restai perplexe devant un folio dont le contenu séman-
tique coincidait parfaitement avec le reste du dossier, mais qui, en bas,
s’arrétait en plein milieu d’une phrase dont la fin ne figurait sur aucun
des autres feuillets. De deux choses lune: ou bien la suite — donc un
autre, voire d’autres feuillet(s) — s’était perdue, ou bien elle existait
ailleurs. Je fis le voyage de Diisseldorf pour vérifier le dossier original.
Surprise: sous forme heureusement non reliée, la chemise comportait
non seulement le manuscrit de ladite Préface, mais aussi celui d’un texte
publié aprés 1a mort de l’auteur sous le nom de Denkschrifi, et dont la
parenté thématique avec la Préface m’ avait déja frappée auparavant. La
Jecture de ce second dossier apporta la clé du mystére: ja suite du folio
isolé de la Préface se trouvait dans le dossier de la Denkschrift. Mieux
encore: il s’avéra que tout au long de la rédaction, les deux piéces, sépa-
rées par les hasards de la publication, avaient fait partie du méme travail
d écriture; c’est seulement au moment oti Heine décida de publier ia
Préface qu’ il retrancha une partie du texte. Une erreur d’archivage et de
classement, suivic d’une absence de note éditoriale sur l’origine commune
des deux textes, et voila comment, du méme coup, la genése de Préface-
Denkschrift fut entigrement a revoir®,
Reconstruire une genése, c’est tenter de mettre un ordre rationnel
dans des pices dont I’ écriture n’a pas toujours progressé rationnelle-
ment, Cela n’implique en rien que le lecteur doive négliger ce qui,
dans le manuscrit, lui parait illogique ou ambivalent, ct reléve souvent
des accidents et impasses de I’écriture. Il les exploitera d’autant mieux
que son matériau aura pris la forme maitrisable d’un avant-texte, ¢’est-
a-dire d’un ensemble génétique organisé en fonction de critéres aussi
rationnels que possible, Ainsi, on peut partir du principe qu’il existe
un style particulier pour les scénarios : trés nominal, of les rares verbes
sont souvent au présent atemporel. Dans un scénario de Flaubert, le
lecteur observe une quinzaine de transformations de verbes au présent
en verbes au passé. Il en conclut que cette transformation marque le
passage du scénario au temps du récit, a la véritable élaboration
textuelle.
Un autre critére extr€mement stir pour orienter l’ordre de la lecture:
Vemplacement d’une séquence d’abord dans espace de la marge (qui
8. Almuth Grésillon et Barbara Geiger, «Les brouillons allemands de la Préface *.,
& Lutéce», Cahier Heine, n° 1, Paris, PENS, 1975, p. 9-41.
63
Coniment lire un manuscrit moderne ?
sert de réservoir pour des idées a écrire ou & ajouter), puis la réappari-
tion, au folio suivant, de la méme séquence insérée dans le fil du texte.
Enfin, quand d’un folio 4 P'autre on constate des suppressions de
descriptions, de détails pittoresques, de tours rhétoriques et de compa-
raisons, on peut étre assez certain que |’écriture est passée d’un stade
d’laboration-amplification 2 un stade de condensation, situé vers la fin
du processus de rédaction,
Les parcours du lecteur sont remplis d’embfiches, et ils le sont
parce que l’écriture lest, Nous finirons par le rappel d’un imbroglio
concernant la représentation temporelle dans un dossier génétique de
Proust®, Rappelons qu’un narrateur malade et ne dormant plus que le
jour, évoque des scénes de brusque réveil pendant la nuit, de méme que
des nuits ot il dormait bien, «comme tout le monde», parcours temporel
qui se poursuit 4 travers seize réécritures de la méme scéne, ot visible-
ment les représentations narrativo-temporelles sont contradictoires, —
usqu’a ce «coup de texte» lié a la découverte de \’adverbe « autrefois »
"par lequel l’ancrage temporel du récit sera solidement installé'?:
Autrefois j’avais commu comme tout le monde Ja douceur de m’éveiller
en pleine nuit...
: En attribuant des significations 4 ces séquences parfois a la limite
_de intelligible et prises dans des errances scripturaires difficiles 4
‘lucider, la lecture se transforme en compréhension, le décodage devient
reconstruction génétique, le dossier prend progressivement les allures
de cet objet scientifique que nous nommons « avant-texte». A partir de
la lecture de I’avant-texte commence une autre aventure, |’ interpréta-
tion. C’est encore de Ja lecture, mais cette lecture-la obéit & des choix
plus subjectifs et suppose un horizon théorique précis.
: Lire un manusctit est une activité de lecture bien particuligre. Acti-
vité complexe en raison des difficultés de déchiffrement propres & |’écri-
ture manuscrite et des données visuelles peu explorées par les recherches
sur la lecture, complexe & cause de V orientation du fil de la lecture sans
cesse brisé par les espaces remplis de réécritures, complexe enfin parce
9. Voir Almuth Grésillon, Jean-Louis Lebrave, Catherine Viollet, Proust a la lettre.
Les intermittences de l’écriture, Tusson, Du Lérot, 1990, chap. 4.
10. Voir Claudine Quémar, «De Vessai sur Sainte-Beuve au fulur roman: quel-
‘ques aspects du projet proustien & la lumiére des avant-textes», Bulletin d’informations
proustiennes, n° 8, 1978, p. 7-14.
64 La mise en euvre \;
qu'elle exige du lecteur qu’il feuillette un «livre » dans lequel la méme
«histoire» est parfois racontée plus de dix fois, jamais tout a fait de la
méme facon, et parfois méme trés mal, «livre» dont les milliers de signes ~
graphiques n’ont de sens que s’il les ordonne temporellement les uns
par rapport aux autres, et dont la richesse ne lui apparait que s’il mobi-
lise toutes ses capacités d’ association, d’inférence, d’imagination, de
ruse et de mémoire. Vu sous cet angle cognitif, lire un manuscrit ressemble
bien au titre d’un des dessins de Carlfriedrich Claus (fig. 8): «Denk-
gange» (= “Parcours mentaux”). Ceite activité, qui est comme un voyage
dans l’espace, fait passer d’un folio @ l'autre, d’une note marginale au
texte définitif, d’un contenu fictionnel 4 un souvenir biographique, d’ une
version 4 ses réécritures, d’un texte au journal intime, d’une formule
réussic & ses premiers bégaiements, du texte fini aux franges étonnantes
de l’inconnaissable origine. La lecture du manuscrit est la source de
multiples actes de compréhension et d’interprétation ; elle conduit des
premiéres traces écrites de la production jusqu’aux termes, toujours
renouvelés, de la réception. « Lire», disait Michel de Certeau, est «un
braconnage»!!.
11. Michel de Certeau, « Lire: un braconnage», in L'Invention du quotidien [,
«Arts de faire», Paris, UGE, 10/18, 1980, p. 279-296,
Comment lire un manuscrit moderne ? 65
Fig. 8: Carlfriedrich Claus, « Denkgange. Handeln im Schlaf»,
manuscrit n° 48 dans Aggregat K, Stiftung Carlfriedrich Claus Archiv,
Kunstsammlungen Chemnitz © ADAGP
Chapitre 4
Lire pour écrire*
. Mais qu’a-t-il ainsi @ réver toute la journée [...] ?
Mais qu’a-t-il ainsi a lire toute la journée [...]?
Mais qu’a-t-il ainsi 4 griffonner barbouiller raturer
recopier toute la journée ?
Miche Butor!
DEUX ACTIVITES INDISSOCIABLEMENT LIEES
Lecture et écriture sont au centre de toute recherche génétique. Car
tout auteur est d’abord lecteur, Il lit a la fois pour son plaisir et pour se
-documenter en vue d’un projet d’écriture. I lui arrive de prendre des
“notes dans les livres des autres. I] écrit, il réécrit, il se fait publier, il
trouve A son tour des lecteurs.
Pendant longtemps, la recherche a soigneusement séparé en deux
‘champs distincts les travaux consacrés a !’écriture et ceux consacrés
a la lecture. Cela avait sans doute des raisons heuristiques: il a fallu
e donner le temps et les moyens d’étudier les syst8mes d’écriture et
s processus d’ apprentissage et d’analyse de la production écrite, de
tméme qu’il a faliu explorer I’ histoire de Ja lecture, souvent lige A I’his-
re du livre, et, du cété littéraire, 4 la théorie de la réception. Cette
éparation entre les deux champs a dominé les années soixante, soixante-
ix et quatre-vingt du siécle précédent. C’est seulement depuis une
* Une premitre version de ce texte a paru sous le titre « Lire pour écrire : Flaubert
ctor el scriptor», Lesen und Schreiben in Europa (1500-1900) (Alfred Messerli,
‘oger Chartier, eds), Basel, Schwabe, 2000, p. 593-608,
1. Michel Butor, /mprovisations sur Flaubert, 1984.
68 La mise en euyre j,
quinzaine d’ années que I’on s’interroge simultanément sur ces deux
activités de esprit humain qui, de fait, ont bien souvent partie liée.
En effet, comme tout scripteur est lecteur avant de prendre la plume,
tout lecteur qui cherche 4 comprendre et & interpréter un processus
écrit, se glisse, bien malgré lui, dans l’habit du scripteur afin de mieux
reconstruire les voies et le sens de |’écriture.
En simplifiant, on pourrait dire avec Bakhtine qu’on écrit toujours
avec les textes des autres et qu’une vaste partie des écrits existants n'est
faite que de réécritures de choses lues, Je ne m’attarderai pas ici sur le
concept de discours polyphonique ni sur la théorie de I’ inter- ou de Phy-
pertextualité. Ce qui m’intéresse davantage, c’est cette tension dialec-
tique entre des choses qu’ on lit expressément pour alimenter un projet
décriture et le processus méme de cette écriture. J’examinerai donc les
notes de lecture que!’ on prend en vue d’un projet d’écriture, pour pouvoir
écrive. Avant tout, il faut analyser comment un lecteur-scripteur sélec-
tionne, oriente et finalise ses lectures, comment il les découpe, frag-
mente et ampute pour Jes copier et les mettre en fiches, comment il
ingore, digére, rejette, transforme, déforme ou cite plus ou moins fidé-
lement ses sources. Qu’advient-il de ces choses Jues (qui coexistent
@ailleurs a cOté des chases vues, sues ou entendues) lorsqu’il s’agit de
rédiger un texte?
Je pars de I’hypothése qu’en littérature, le geste du «lire pour
écrire», méme s’il est attesté 4 des époques plus reculées, porte le sceau,
des temps modernes, et notamment d’un nouveau rapport au savoir et a
la science tel qu’il s’est instauré dans la deuxiéme moitié du x1x° siécle.
D’une part, Paccés au savoir, la transmission des connaissances, le
fantasme de la bibliothéque et le mythe de Ja science prennent de plus
en plus le devant de la scéne ; d’ autre part, au cours du XIx® siécle, avec
Pavénement de l’école obligatoire, la lecture et I’ écriture sont devenues ©
dans nos aires culturelles des compétences de plus en plus communé-
ment partagées. Par conséquent, a la question générale « QUI lit pour
écrire ?», on peut répondre aujourd’ hui: «en principe, tout le monde».
Toutefois, certains types de textes semblent se préter mieux que d’au-»
tres A Pexercice du «lire pour écrire»: textes destinés a |’information
(guides, reportages, manuels scolaires et universitaires, ouvrages didac-
tiques et de vulgarisation), textes scientifiques (théses, articles, ouvrages
savants, érudition). A priori, il semble s’agir de la catégorie des textes
non fictionnels et, plus précisément, de ceux dont I’écriture exige une
documentation précise, un «état présent» du savoir établi, soit pour la.
simple transmission, soit pour la réfutation et le dépassement de ce savoir. .
Lire pour écrire 69
Toujours est-il que ce savoir emprunté 4 d’ autres textes est en principe
soumis & une déontologie précise : le texte-cible doit porter la référence
du texte-source; il faut rendre 4 César ce qui est 4 César; une source
utilisée et non citée comme telle permet d’ accuser I’anteur négligent de
plagiat, Cette régle de la citation des sources est d’ autant plus contrai-
gnante que le texte reléve non pas de Ja simple compilation, mais vise
a produire un savoir nouveau.
Mais le scripteur ne lit-il que pour trouver des informations précises,
combler des trous de mémoire, faire le point sur une situation historique
ou géographique; vérifier exactitude des connaissances qu’il désire
mettre en ceuvre ou mettre en cause ? Est-on si sir que le geste du «lire
pour écrire» est l’apanage des textes 4 valeur informative, documen-
taire et scientifique ? La lecture n’est-elle pas aussi un formidable moteur
pour mettre en branle l’imagivaire, pour faire réver autant que pour faire
savoir, pour déclencher des associations verbales et visuelles, qui trans-
formeront la source lue en bribe d’ écriture, le fragment d’autrui en Enoncé
nouveau? Hcoutons ce que dit Michel Foucault:
Limaginaire se loge entre le livre et la lampe. On ne porte plus le fantas-
tique dans son coeur; on ne Vattend pas non plus des incongruités de la
nature ; on le puise a l’exactitude du savoir; sa richesse est en attente dans
Je document. Pour réver, il ne faut pas fermer les yeux, il faut lire. La vraie
image est connaissance. Ce sont des mots déja dits, des recensions exactes,
des masses d’ informations minuscules, d’infimes parcelles de monuments
et des reproductions de reproductions qui portent dans ’expérience moderne
Jes pouvoirs de l’impossible. I.n’y a plus que a rumeur assidue de la répé-
tition qui puisse nous transmettre ce qui n’a lieu qu’une fois. L’imaginaire
ne se constitue pas contre Je réel pour le nier ou le compenser, il s’étend
entre les signes, de livre 4 livre, dans ’interstice des redites et des commen-
taires; il nait et se forme dans Ventre-deux des textes.*
Foucault parle de l’imaginaire du x1x¢ siécle, siécle du savoir par
excellence, mais loin de viser des discours scientifiques, il traite d’une
ceuvre de Flaubert, La Tentation de saint Antoine. Flaubert, 4 V image
de saint Antoine, est & la fois lector et scriptor.
Reprenons notre propos initial: comment peut-on observer et
analyser le rapport qui existe entre les textes lus et le processus d’ écri-
ture qui en résulte ? Certes, le texte final peut en porter Ja marque; c’est
le cas lorsque la source est explicitement citée ou indiquée en référence.
2. Michel Foucault, «La Bibliothéque fantastique », in: Gérard Genette et Tzvetan
Todorov (eds.), Travail de Flaubert, Paris, Le Scuil, coll. Points, 1983, p. 106.
70 La mise en wuvre \.
Mais il existe des possibilités plus intéressantes et plus subtiles pour
controler et reconstruire le parcours qui va de Ja lecture a ’écriture: il
suffit d’ouvrir les archives of sont conservées les traces manuscrites de
la genése de certains textes. 11 est vrai que la chance de trouver ces traces
est proportionnelle a Ja valeur intellectuelle, artistique, symbolique et
patrimoniale que l’histoire culturelle a attribuée au cours du temps a
certaines ceuvres. C’est bien Ia raison pour laquelle on dispose plus faci-
Jement des manuscrits des grands écrivains que de ceux de homme de
la rue?. Dans les archives littéraires, on trouve des trésors de ce type
précis d’intertextualité ob les auteurs ont puisé dans toutes sortes d’ou-
vrages pour préparer leur propre livre.
Zola, par exemple, a, plume & la main, lu des ouvrages sur Phéré-
dité, sur le travail dans la mine, sur les grands boulevards ou sur ies
chemins-de fer’. Déblin a procédé, dans le manuscrit de Berlin Alexan-
derplatz, 4 des collages spectaculaires de coupures de journaux. Thomas
Mann, pour donner du corps au personnage de Leverkiihn, a introduit
dang le manuscrit du Doktor Faustus nombre de détails empruntés aux
écrits théoriques d’ Adorno*. Roland Barthes, s’il cite littéralement la
Correspondance de Flaubert, intégre sans trace de nombreuses infor-
mations cueillies dans les ouvrages d’ Antoine Albalat sur le style et les
pratiques d’écriture des grands auteurs. Plus étonnant : |’ écriture poétique,
que l’on a coutume d’assimiler plus a des faits de rythmes, de réves ct
de voix intéricures, témoigne elle aussi de lectures qui agissent sur elle.
Un Francis Ponge se nourrit réguliérement du savoir du Littré, dont de
larges extraits figurent dans ses dossiers génétiques®.
Ainsi, les dossiers de genése permettent de suivre a la trace le
processus discursif par lequel un scripteur s’appropric les textes d’au-
trui. La lecture des sources est souvent d’emblée finalisée, et les notes
que le scripteur prend sur des ouvrages correspondent déja 4 des choix,
des adaptations 4 un projet mental. Les prélevements peuvent alors entrer
3. Les «écritures ordinaires» n’ont jusqu’en des temps récents que trés peu inté-
ressé le regard des spécialistes, Un réel intérét pour ces textes est d@ notamment & des
historiens comme Arlette Farge, Daniel Fabre, Philippe Lejeune et Philippe Aztiores.
4. Voir phus loin, chap. 7.
5. Notamment de sa Philosophie der neuen Musik. Le philosophe-musicologue,
bien que tras flutté de rendre service an célébre romancier, ne Pentendait cependant.
ppas de cette oreille ! Quand Thomas Mann, quelque pen géné d’avoir copié, ni explique
qu'il ne peut tout de méme pas, dans un roman, introduire nne note de bas de page,
Adomo préfére couper les ponts.
6. Voir plus loin, chap. 10.
Lire pour écrire 71
en conflit avec la matiére verbale du scripteur, et il en résulte une forma-
tion de compromis entre texte d’autrui et texte propre. Voici un exemple
de ce parcours du «lire pour écrire ».
FLAUBERT : NOTES DE LECTURE POUR HERODIAS
Comme Foucault, je choisirai Flaubert, car cet : «La citadelle de
Machaerous se dressait 2 l’orient de la mer morte'®, sur un pic de basalte
15, Je sepraduis en italique les segments qni sont des reprises littérales des ouvrages
Jus par Flaubert.
16. Cf Emest Renan, Vie de Jésus, 1863, p. 110: « Makaur on Machéro était une
forteresse batie [...] 1 Porient de la mer morte».
716 La mise en euvre
ayant la forme d’un céne'™. Quatre vallées profondes Ventouraient"’,
deux vers les flancs, une en face, la quatri¢me au-dela. » (fig. 14)
A cété de tels processus d’absorption réussie, il y a bien des notes
qui sont simplement abandonnées. Tel détail géographique — par exemple
Vindication des «3 800 pieds au-dessus de la mer Morte» — ou tel détail
pittoresque — le «parasol A pompons » sous lequel Hérode découyre
Salomé — font les frais d’une condensation qui succéde a la phase d’am-
plification!®. La débauche des notes céde le pas & une phase de renon-
cement: c’est la force du texte de fiction qui l’emporte sur l’exactitude
et authenticité du fait réel. Mais I’écriture de fiction n’aurait pas été
possible sans la phase de lecture. C’est bien ce que Flaubert nous rappelle
dans une lettre du 18 décembre 1859:
Si je vais si lentement, c’est qu’un livre est pour moi une maniére spéciale
de vivre. A propos d’un mot ou d’une idée, je fais des recherches, je me
perds dans des lectures et dans des réveries sans fin.
17. Cf Tristram, op. cit, p. 258: «the ancient fortress, on the top of a conical hill
[...] The citadel was placed on the summit of the cone», p. 258-259).
18. Cf Auguste Parent, Machaerous, 1868, p. 34: «Le rocher, en effet, forme bien
un pic compiétement isolé, d'une grande hauteur, et entouré, dans chaque direction, de
vallées larges et profondes.»
19. Pour ce mouvement régulier chez, Flaubert qui méne d'une amplification»
: «Flaubert et la:
extréme & une condensation sans merci, voir Pierre-Marc de Bia:
poétique du non-finito», Le Manuscrit inachevé (Louis Hay, ed.), Paris, Editions du
CNRS, 1986, p. 45-73.
Lire pour écrire q7
z «hd sf Pb pe
: 3 Hb nnn, Castide’ v0
iy ane af rete Ry dente os Soon Ae ey alt
ee tr atamivn Tad dB gas bo
Ariens bow 1 rygies evden Ppa
ve shel Akin gave a
mpd = quack oct 4
rai Bil spas lint OPE - “iti
ae
Imani. & a in rob raha wel Btrtoch 0
oneta Qf
na ele setae nba 6 6 He Oe
Bipeloaig, $09 A vet 1 vere Spe 2 lee “
hye toa fay
lle
pay edison &y, anak» ag een pm
as efor } ay
98 tein OE ap vg
tem tO in ben
anne
4 hoe, savy ol yes
vet Me agit des amy,
fash
fetus ae? _ ne
bb eo
+ we "ee *
wk,
thie Oe ae pth whet
ee
bette oe.
fine Grape ee fe apie ot bob
Rasa, Bethe roe ten hgh fe tom rot
a Bayathi ore ©
m Si ge
sayhte a
Gyradtea = aeons TARR, 2
pale ne fo tab ptt ib,
‘ Pa ey
Gates. cag a me .
Fig. 10: Extraits finalisés sur feuille volante, (Bibliothéque nationale de France,
Nafr. 23663, t. HI, f° 659)
78 La mise en ceuvre Lire pour écrire 79
a fe the
Lecce pO cn gue mepatn 1 -
fo a bs a os a pre.
ee haa Cia a a ve “eh
tye foster Hen Diet, Pu bi iat? flo sobonw-
based cokirt at ype ae en Heahnay. « bebe: :
Bent bate ie 3 board we Hope Bk hn Pts
erecta he go a be Te dee foce oh Ce ort HO a de
whe tay an om We awe jheo wi (ib be Moen 7 sh 2, Peele hes,
tel cheba eho abe pin brsbepte ke pe es Bagg nine TON a oer
Soma nh sake acs we en MO ye . tea RIEL, bs Jt Bip 4
Bh ame ahi whe i f
tne "pliealoor™) Lay
epee
age el a
oe eh a be BOS ott ea
Ce ft yl ee ee
ae oe i 2 br a
fiatly ot i geet ot eh
ache his ose ar ete
-
ook Yaeeny dee agi et *
fe wat
fan lo
ave
nf
apt,
we
ane. a
Pace fe
aan ah oho
. . re s ts her, yar
Fig. 11: Condensé de notes (BnF, Nafr. 23663, t. I, f° 705) een care
Fig. 12: Cohabitation de deux discours, Flaubert et Tristram
(BnE, Naf. 23663, t, II, f° 720)
80
La mise en ceuyre
CO ae
ae
Lt ne faint velo
leciyabe soit ee ie
dri an Lua hfe my \ Ae hase! ey,
Fe, aon Mae ° cn fee na .
- a per Fy par een in,
at ta Fa when
be jit MEN woke Boa jp et?
sane oer wh 6 Hi bhtn ff mn eh, get tS eth we
Tg wl nes BO eg omen Ste et ne
Lye wt woe eee oT Ne
Coa Te te hae OL po
R Malic pe he ve ete Fe
rar ae PORE
| pact Sook dae a he
"Tite? Sm en hs oe ween Pp hm
HOY we oe Ghee iv pee
vases “e ot,
ie bast i Hote gp 2 ae is
2
Lire pour écrire
Fig. 13: Cohabitation et greffe
(BoF, Nafr, 23663, t. IL, f° 732 v°)
ee wise ah
Le ena Ge teachstion 2 Foot Ae pe
se ce Jo fol ot a jie
panda Cte ee Bow AE
Bap aint oe pen oe let
cp paonet brie Pk fox
eainsnt OE ash Fe
i»
81
I
ben
Fig. 14: Greffe réussie: le début du texte d’ Hérodias, mise au net autographe
(Buf, Nafr. 23663, t. I, f° 58)
Chapitre 5
La rature*
Rien de plus beau qu'un beau brouillon. Dire cect
quand je reparlerai de poésie. Mythification de la
Rature (ratisser ~ rater — radere — rasum), Un
poéme complet serait le poéme de ce Poéme & partir
de Vembryon fécondé — et les états successifs, les
interventions inattendues, les approximations, Voila
la vraie Genese... Epopée du Provisoire,
Paul Valéry!
DE LA MATERIALITE GRAPHIQUE DES RATURES?
La rature efface du déja-écrit. Jusqu’au Haut Moyen-Age, cette
opération ne laissait guére de traces; le grattoir servait 4 éliminer du
précieux parchemin les tracés jugés obsolétes ; la tablette de cire pouvait
redevenir lisse aprés usage. Ce n’est que depuis la généralisation du
support papier que l’on trouve des traces visibles de rature: le trait qui
* Ce texte reprend un article publié sous le titre «Raturer, rater, rayer, éradiquer,
radiet, irradier», paru dans Ratures et repentirs (Bertrand Rougé, ed.), Pau, Publica-
tions de I’ Université de Pau, 1996, p. 49-60.
1, Paul Valéry, Cahiers, Paris, Ed, du CNRS, t. XV, p. 481.
2. Pour une description des diverses formes, fonctions et topographies de Ja rature
AL'intérieur de espace manuscrit, je renvoie aux pages 66 471 de mon ouvrage Eléments
de critique génétique (1994) ainsi qu’ mon article «Rature, silence, censure», paru dans
Le sens et ses hétérogénités (sous la direction d’ Herman Partet, Editions du CNRS, 1991,
p. 191-202). Je renvoie également a deux articles de Pierre-Mare de Biasi, «Qu’est-ce
qu'une rature?», para dans Ratures et repentirs (Bertrand Rougé, ed., Publications de la
Faculté de Pau, 1996, p. 17-47), et «Mille et une ratures» (in Brouillons d’écrivains.
[Catalogue d’ exposition}, Paris, Bibliothéque nationale de France, 2001, p. 145-150).
84 La mise en euvre
biffe un mot, la ligne oblique qui rend caduc un paragraphe ou une page,
les hachures et quadrillages qui recouvrent |’ écrit comme les barreaux
d’une prison (fig. 15), les tracés curvilignes qui masquent I’ écriture tout
en imitant la forme de celle-ci (fig. 16)°, le paté d’encre qui rend la trace
a jamais opaque et lui confére la couleur du deuil (fig. 17). A toutes ces
traces visibles s’ajoutent des formes immatérielles de la rature, par
lesquelles un paragraphe se trouve sans cesse réécrit, sans que les versions
dépassées soient marquées comme caduques. Notons encore que ces
techniques variées sont attestées également dans d’autres domaines de
la création: compositions musicales, (pl. V), dessins, plans d’architec-
ture, manuscrits scientifiques, etc. Depuis le xx° siécle, la trace de la
rature est de nouveau menacée: par la gomme qui efface, le Tipp-Ex qui
recouvre d’une tache blanche, et surtout, par Pimpulsion électronique
qui opére un deleatur définitif. Entre ces deux bornes historiques, le
Moyen-Age et le xx® siécle, la rature est un effacement visible, une trace
lisible. Quant & sa fonction, elle sert soit A supprimer, soit 4 remplacer*,
soit a différer, donc a déplacer ailleurs dans l’espace graphique.
SYNONYMIES, HOMOPHONIES ET ETYMOLOGIES?
Tl existe en frangais de nombreux termes pour désigner le geste pat
lequel on annule une trace écrite: barrer, biffer, effacer, gommer, gratter,
racler, raturer, rayer, Relevant du méme champ sémantique («action de
supprimer»), les verbes radier, éradiquer, bien que non spécifiques de
Pécrit, viennent compléter la série. Et l’on devine derriére les affinités
phoniques et sémantiques qui relient raturer, radier, rater, rayer, éradi-
quer une chatne étymologique sur laquelle il faudra revenir.
3, Jacques Anis a proposé le terme de «treillis» pour caractériser cette forme de
la rature; voir «La rature et I’ écriture (I’exemple de Ponge}», TEM (Textes en main),
n° 10/11, Grenoble, 1992, p. 23-31.
4. L'opération de remplacement se compose de deux parties dont la biffure du
segment initial est la premiére et l’insertion du segment nouveau, la seconde. On appelle
surcharge une forme spécifiqne du remplacement: celle od le scripteur, sans recourir
au trait de biffure, inscrit le segment de remplacement en lien et place, c’est-a-dire sur
le tracé méme, du segment premier.
5. Nous avons consulté Le Robert, Le Dictionnaire historique de la langue fran-
gaise et le Dictionnaire étymologique de Bloch et von Wartburg.
La rature
Vig. 15: Hachures et quadrillages. Un brouillon d’ Emilio Gadda pour
La Madonna dei filosofi, chap, IV,
(Pavia, Fondo manuscritti, Universita degli Studi, Pavia)
85
86 La mise en oeuvre
a
Ye ty
ee
Fig. 16: Ratures curvilignes. Un manuscrit de Nietzsche pour Ecce Homo
(Klassik Stiftung Weimar, Nietzsche-Archiv GSA, ms. D25)
Je voudrais d’abord m’ arréter un instant sur la réflexion de Michel
Leiris 8 la fin de l’ ouvrage intitulé Biffures. Il y explique que tout son
travail poétique part de l’homophonie entre /e bifur — sorte @’ abrévia-
tion de bifurcation — et la biffure :
[...] f'eus recours, en n’y voyant tout d’abord qu’un terme séduisant, &
expression de bifitrs pour désigner, dans mon jargon personnel, les maté.
riaux si peu commodes a étiqueter que je voulais amasser et brasser
soubresauts, trébuchements ou glissements de pensée se produisant a
Yoccasion d’une félure, d’un miroitement [...] ou d’une quelconque.
singularité, rocailleuse ou fuyante, se manifestant dans le discours, —
pertes de pied ou sautes de niveau a la faveur desquelles l’individu qui
les subit se sent jeté dans un état de particuliére acuité et qui [...] lui
débouchent |’horizon, — remous, rides, écumes ou autres altérations de.
Ja surface (a I’ ordinaire tranquille) de la langue, qui sont les générateurs
d'une poésie trés spéciale [...] (M. Leiris, Biffures, (1948), 2° éd. 1975,
Paris, Gallimard, p. 278)
La rature 87
~ act nse
Antinrt): Shep Tok, gediendhroioh =" kr oft aes
yoteWni entre nous) = Hu “ekNn Sma “uA End OSr
Dekusntestriobte Akt, don Jadenomiededetenn Keunt « @
Hammond egern ropottert | aulddodiioh, gwen Maeta
violletoht reent dheregt), qourtisce eturze Ginkooh abe
(nage revon cusneuant
taup, aber doh seck¥él kusn velumwventanute
fake aren 1Dfvohosdtteh =" yungte Youd) fe vet #
Annex’ noah dor ‘Linenastetar wax eech 2znbalick 1) bine
deriient ptt 1). /.the SERRA, oricset
‘Bheorattéehon :
par rapport a la version connue, publiée aprés 1a mort de Proust, la moitié
du texte avait disparu de ce dactylogramme. Rature immense, certes,
mais sur laquelle tous les proustiens s’accordent pour dire qu’elle ne
pouvait s’expliquer que par un projet de réagencement global du roman,
dans lequel la moitié raturée d’ Albertine disparue aurait 4 coup stir
retrouvé une place. Seule la mort a pu en quelque sorte imprimer sur
cette version ultime d°Albertine disparue le sceau de l’inachévement.
Pendant prés de quinze ans (entre 1908 et 1922), Proust a écrit et
réécrit une seule et méme ceuvre, qu’il métamorphose maintes fois et
dont le flux scriptural ne peut se comprendre que comme un mécanisme
ov écriture, rature, déplacement et réécriture sont en perpétuelle inter-
action. Quand il procéde a une rature d’ ordre textuel, il y a fort & parier
que lunité biffée se retrouve ailleurs, et parfois méme démultiplige, en
divers endroits, La rature, loin d’annuler, permet de différer, déplacer,
disséminer, multiplier.
15. Voir Nathalie Mauriac Dyer, Proust inachevé. Le dossier «Albertine disparue »,
Paris, ditions Honoré Champion, 2005.
La rature 95
Je résume briévement un exemple, en I’ occurrence |’écriture du
motif de la matinée dans la Recherche. En 1908, Proust commence a
remplir des cahiers, ceux du « Contre Sainte-Beuve », qu’il prévoyait de
publier avec le sous-titre « Souvenirs d’ une matinée». La description de
la matinée va de rature en rature, le « Contre Sainte-Beuve» ne voit
jamais le jour, mais le texte se transforme progressivement en un roman
sur le temps et la mémoire. En témoigne en particulier un feuillet dacty-
lographié, ot toute la scéne de la matinée est gommée et remplacée par
le célébre incipit du roman, « Longtemps, je me suis couché de bonne
heure ». Autrement dit, la fin matinale du Contre Sainte-Beuve se méta-
morphose en début nocturne de la Recherche. Or, le motif de la matinée
n’est pas perdu pour autant. Tout se passe comme si la rature initiale du
motif l’avait fait croitre souterraimement, a 1a maniére d’un rhizome,
comme si la rature méme produisait une irradiation spectaculaire sur
Yensemble de l’ceuvre, et le romans’achave, dans Le temps retrouvé,
sur la « Matinée chez la princesse de Guermantes », qui est une sorte de
lointain souvenir de la «matinée avec maman» du Contre Sainte-Beuve.
En réalité, cette ultime matinée, celle vers qui, depuis la rature premiére,
convergent toutes les autres, est une « matinée de I’ ceuvre 3 faire »!®,
Ainsi la rature originelle de la matinée conduit-elle, moyennant
déconstruction et multiplication, vers une matinée littéralement radieuse,
celle de la création. La rature de Proust est bien a Ja fois disparition et
renaissance, perte et gain, radiation et rayonnement. Elle reproduit a la
lettre (Cahier 3, f° 1) ’équivoque étymologique entre raie, source étymo-
logique de rayer, et rai, source étymologique de rayon.
LitTBRATURER
I reste cependant un probléme. Si la rature est a la fois disparition
et renaissance, s’il est vrai qu’elle irradie subtilement le texte, on pour-
rait croire qu’il suffit de lire le texte imprimé pour en induire la genése.
On ferait donc I’ économie de ces analyses fastidieuses od il faut déchif-
frer, lire les mots-sous-les-mots, comparer, collationner, retrouver les
pistes perdues, transcrire, «réécrire» les bifurcations et biffures par
16. Au chapitre 8, je reviendrai plus longuement sur le motif de ia matinée, mais
dans le cadre de ’écriture de La Prisonniére.
96 La mise en euvre
lesquelles l’ écriture a dd passer pour advenir? L’espoir de gagner ainsi
du témps est une illusion. La relation manuscrit-texte, nous l’avons vu
a (avers. Limage trompeuse du « Wunderblock » (chap. 1), est une rela-
tion:transitive. Elle sé révéle seulement a qui s’aventure dans l’ opaque
ele multiple des sédiments successifs de |’écriture. L’couvre donne a
vir ses atures et ses Virtualités secrétes & condition qu’on accepte d’ex-
plorer les manuscrits. Le chemin inverse, c’ est-A-dire spéculer a partir
_du'seul texte final et inventer les couches possibles de l’avant-texte, ce
_ chemin-Ia reléve soit de la fiction, soit de la paresse, La genése de l’écri-
ture n’est pas un mirage. Elle repose sur un réel, écrit et transmis, qui
demande a étre déchiffré et interprété.
Sous ce rapport, la rature n’est plus identifiable uniquement a la
couleur noire du deuil, de la perte. Elle symbolise aussi la force dyna-
mique et lumineuse de la création, C’est A partir de cette conception
dialectique de la rature que prend tout son sens le mot-valise «littéra-
turer» forgé par Queneau:
Eh bien, dit Etienne avec bienveillance, faut supprimer cet épisode, le
raturer, — Le littératurer, ajouta Saturnin?”,
Ainsi la rature est-elle une condition absolue de toute littérature.
C’est ce que Marcel Duchamp avait soutenu bien plus tét en lancant son
célébre «Lis tes ratures !», dont se sont par la suite inspirés sans doute
Jacques Lacan pour son titre d’ article « Lituraterre »'8 et Jean Bellemin-
Noél, qui inaugure son ouvrage Le Texte et l’avant-texte par la phrase
«La littérature commence avec la rature. »! En 1976-1977, Roland
Barthes consacre son séminaire de L’Ecole des hautes études A ce méme
theme”. Et quand Héléne Cixous évoque ses propres ratures et repen-
tirs, elle n’y voit «personne d’autre que le démon de l’écriture»?!, Les
nouvelles techniques de l’information ne changeront rien 2 ce rapport
fondamental entre écriture, rature et réécriture, — A ceci prés que les
ratures ne seront plus immédiatement visibles?”.
17. Raymond Queneau, Le Chiendent, Paris, Gallimard, 1956, p. 295,
18. Voir son article dans Littérature, n° 3, 1971.
19, Jean Bellemin-Noél, Le texte ef avant-texte, Paris, Larousse, 1972 p. 5.
20, Roland Barthes, uvres completes, Nouvelle édition revue, corrigée et présentée
par Erie Marty, 2002, t. V p. 361
21, Héléne Cixous, Repentirs [Catalogue d'exposition}, Réunion des Musées natio-
naux, 1994, p. 64.
22. On reviendea sur les conséquences de cette mutation technologique au chapitre 12.
Planche I : Apollinaire, BnF, manuscrit figurant dans Peintures de Léopold
Survage, Aquarelles d'Iréne Lagut, p. 66 gauche.
Vous aimerez peut-être aussi
- Comme Il Faut - AmDocument2 pagesComme Il Faut - AmDarry GuiltterPas encore d'évaluation
- Libertango - 3 Pianos - Piano 1Document3 pagesLibertango - 3 Pianos - Piano 1Driden_69Pas encore d'évaluation
- Casi Te Envidio - Trombon 1Document2 pagesCasi Te Envidio - Trombon 1Oscar Raul Clares QuispePas encore d'évaluation
- I Got Rhythm - Trumpet in BB 4Document2 pagesI Got Rhythm - Trumpet in BB 4Adriano SilvaPas encore d'évaluation
- (Piano) Brigitte - Sauver Ma PeauDocument8 pages(Piano) Brigitte - Sauver Ma PeauPierre GauthierPas encore d'évaluation
- Antosha Haimovich - Arpeggio For Jazz Saxophone PDFDocument9 pagesAntosha Haimovich - Arpeggio For Jazz Saxophone PDFUnikodo KodoPas encore d'évaluation
- Peromira TrompasDocument1 pagePeromira TrompasLuis José ColomaPas encore d'évaluation
- NF en Iso 3834-1Document17 pagesNF en Iso 3834-1VandebruggePas encore d'évaluation
- Attention Mesdames Et Messieurs - GuitareDocument3 pagesAttention Mesdames Et Messieurs - GuitareNicolas SchiffPas encore d'évaluation
- Algèbre 1Document10 pagesAlgèbre 1Ismail MoPas encore d'évaluation
- 1420 - 3e ÉTAGE+valves - 2022-07-22Document1 page1420 - 3e ÉTAGE+valves - 2022-07-22SébastienPas encore d'évaluation
- Flor Palida - TromboneDocument3 pagesFlor Palida - TromboneJhonny MorenoPas encore d'évaluation
- Flor Palida - Alto Sax.Document4 pagesFlor Palida - Alto Sax.Carlos Xavier QuilumbaPas encore d'évaluation
- Imaniyath PDFDocument50 pagesImaniyath PDFMD.T.R. RehmanPas encore d'évaluation
- Paul Desmond - Samba Cantina PDFDocument4 pagesPaul Desmond - Samba Cantina PDFPeter PeukerPas encore d'évaluation
- Finale 2009 - (100 Anos EL CONDOR PASA - Drum SetDocument2 pagesFinale 2009 - (100 Anos EL CONDOR PASA - Drum SetFactor David Esquivel ChavezPas encore d'évaluation
- Minha Gratidão-Raquel Melo (Trompete2)Document1 pageMinha Gratidão-Raquel Melo (Trompete2)João paulo FloresPas encore d'évaluation
- ProbailityDocument42 pagesProbailityYassine Er-rabbanyPas encore d'évaluation
- Etude Expérimentale de L'identification Des Sources Acoustiques Dans Les Jets Par L'analyse de La Fluctuation de Pression en ChampDocument235 pagesEtude Expérimentale de L'identification Des Sources Acoustiques Dans Les Jets Par L'analyse de La Fluctuation de Pression en ChampChristophe PicardPas encore d'évaluation
- Finale 2005 - (MANTECA - 002G Piano)Document5 pagesFinale 2005 - (MANTECA - 002G Piano)josePas encore d'évaluation
- Plan de Masse 01Document1 pagePlan de Masse 01Abdennour MouatePas encore d'évaluation
- Menu TigrisDocument28 pagesMenu Tigrisandani cakti prasetyaPas encore d'évaluation
- Al Que Es Digno - Venció - Trompeta II - Mus PDFDocument2 pagesAl Que Es Digno - Venció - Trompeta II - Mus PDFMarvin RubenPas encore d'évaluation
- Asi Fue B PDFDocument30 pagesAsi Fue B PDFJuanca ChugchilanPas encore d'évaluation
- El Liston Detu Pelo - Trompeta BB 2Document1 pageEl Liston Detu Pelo - Trompeta BB 2Felipe ChipanaPas encore d'évaluation
- Manual Eaton 9px 5-6kva PTDocument44 pagesManual Eaton 9px 5-6kva PTLeopoldo LopesPas encore d'évaluation
- A Dormir Juntitos Sax TenorDocument5 pagesA Dormir Juntitos Sax TenorbandasmarcialesPas encore d'évaluation
- ESA SOY YO - Score - Tenor Sax.Document3 pagesESA SOY YO - Score - Tenor Sax.Papylus EmpaticusPas encore d'évaluation
- PROPUESTA DRENAJE AGUAS LLUVIAS-Presentación1Document1 pagePROPUESTA DRENAJE AGUAS LLUVIAS-Presentación1via sitionuevofonsecaPas encore d'évaluation
- Anexo - C1 - Trabajos en AlturaDocument1 pageAnexo - C1 - Trabajos en AlturaujeidohjahaotydhkfPas encore d'évaluation
- Ana MiléDocument2 pagesAna MiléCAMILO HERNANDEZ ARISTIZABALPas encore d'évaluation
- Skycity: Twin VillaDocument1 pageSkycity: Twin Villaibrahim kamelPas encore d'évaluation
- Una Aventura - Trompeta 1Document2 pagesUna Aventura - Trompeta 1OsvaldoUrzuaValdebenitoPas encore d'évaluation
- Finale 2005 - (CALLE LUNA CALLE SOL - 004G Piano)Document7 pagesFinale 2005 - (CALLE LUNA CALLE SOL - 004G Piano)josePas encore d'évaluation
- APU YAYA JESUCRISTOx - Wagner TubaDocument1 pageAPU YAYA JESUCRISTOx - Wagner TubaFredy Quispe MamaniPas encore d'évaluation
- 1 Feipl Aiims Acad CHW Schematic Layout 29-09-2021 Hvac SchematicDocument1 page1 Feipl Aiims Acad CHW Schematic Layout 29-09-2021 Hvac Schematicngoc tanPas encore d'évaluation
- DASFDASDASDocument1 pageDASFDASDASAndres Felipe Moreno PerezPas encore d'évaluation
- Calendarul Minerveiu Pe Anul 1909, Mica Enciclopedie Populara A Vietii Practice, 11, 1909Document356 pagesCalendarul Minerveiu Pe Anul 1909, Mica Enciclopedie Populara A Vietii Practice, 11, 1909Ciprian LupuPas encore d'évaluation
- OECD 223 Avian Acute Oral Toxicity Test 29072016Document28 pagesOECD 223 Avian Acute Oral Toxicity Test 29072016Ellóra Diniz GomesPas encore d'évaluation
- 3164 102 Me0 DW 001 0Document1 page3164 102 Me0 DW 001 0Yair Sánchez blancoPas encore d'évaluation
- ENAMORADA DE MI PAIS - MUS Horn in F PDFDocument2 pagesENAMORADA DE MI PAIS - MUS Horn in F PDFMiguel Angel FloresPas encore d'évaluation
- Course Pack For PoetryDocument37 pagesCourse Pack For PoetryLady MarupokPas encore d'évaluation
- SALVE SALVE - Trumpet in BB 1Document1 pageSALVE SALVE - Trumpet in BB 1Edy Layme RiosPas encore d'évaluation
- Grupo 8918 Revision SistematicaDocument1 pageGrupo 8918 Revision SistematicaMARIANO SERGIO FABRICIO DE LA CRUZ RAMOSPas encore d'évaluation
- EL NEGRO Y EL PATRON - Trombone 1Document2 pagesEL NEGRO Y EL PATRON - Trombone 1david patiñoPas encore d'évaluation
- 2 - Opera Mercadorias 1Document20 pages2 - Opera Mercadorias 1DANIEL ALVES DA SILVAPas encore d'évaluation
- Got To Be RealDocument3 pagesGot To Be RealAlessandroPas encore d'évaluation
- 24-Mambo No. 5 - Bass Tuba BB - MusDocument2 pages24-Mambo No. 5 - Bass Tuba BB - MusSTUDIO R.K.RPas encore d'évaluation
- Decreto #37.2022 - Nomeia A Comissao Organizadora - Conferencia Municipal de EducacaoDocument1 pageDecreto #37.2022 - Nomeia A Comissao Organizadora - Conferencia Municipal de EducacaoNadia ReginaPas encore d'évaluation
- Plano Nuevo Codigo Urbano Añelo DefinitivoDocument1 pagePlano Nuevo Codigo Urbano Añelo Definitivojosedevp30Pas encore d'évaluation
- (Arreglos) - Mix Frankie Ruiz #2Document20 pages(Arreglos) - Mix Frankie Ruiz #2José Gabriel Siza AguilarPas encore d'évaluation
- Antosha Haimovich - Arpeggio For Jazz Saxophone PDFDocument9 pagesAntosha Haimovich - Arpeggio For Jazz Saxophone PDFRandy MarmerPas encore d'évaluation
- 364-004923-1023-Edificio Mon Amour - Soporte de Losa - Piso 18Document1 page364-004923-1023-Edificio Mon Amour - Soporte de Losa - Piso 18melanie.1608.floPas encore d'évaluation
- Peromira Sax. TenoresDocument1 pagePeromira Sax. TenoresLuis José ColomaPas encore d'évaluation
- Adolorido - Trompeta BB 1Document1 pageAdolorido - Trompeta BB 1Luis Franco Nina MedinaPas encore d'évaluation
- Al Que Es Digno - Venció - Trompeta I.mus PDFDocument2 pagesAl Que Es Digno - Venció - Trompeta I.mus PDFRogelioPas encore d'évaluation
- BOE-AUTORIZACION - Formulario - FrancaisDocument2 pagesBOE-AUTORIZACION - Formulario - FrancaisAnas BouraydaPas encore d'évaluation
- Rutinas - Ricardo Sandoval - MerengueDocument2 pagesRutinas - Ricardo Sandoval - MerengueJoletmarPas encore d'évaluation
- Mix Antaño 2Document44 pagesMix Antaño 2Jhonatan Castro TorrealvaPas encore d'évaluation