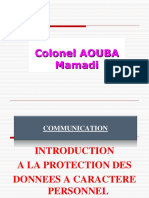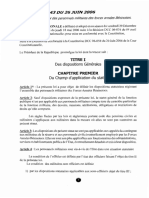Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
CESM Garde-Côtes
CESM Garde-Côtes
Transféré par
Simon RourouxTitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
CESM Garde-Côtes
CESM Garde-Côtes
Transféré par
Simon RourouxDroits d'auteur :
Formats disponibles
La fonction garde-ctes,
la marine nationale et les nouvelles exigences d'ordre public en mer
Centre dtudes Suprieures de la Marine
Commissaire en chef de 1re classe (marine)
Thierry DUCHESNE
Chef du bureau action de ltat en mer tat-major de la marine
cesm.etudes@marine.defense.gouv.fr
SAFER SEAS 2011 Colloque Lordre public en mer 12 13 mai 2011-05-11 Le Quartz, Brest
La fonction garde-ctes, la marine nationale et les nouvelles exigences dordre public en mer
Lorsque madame le professeur Annie Cudennec ma propos dintervenir dans ce colloque sur lordre public en mer, jai ressenti, dabord une profonde gratitude pour cette demande, mais aussi beaucoup dintrt car effectivement, il est rare pour nous marins de pouvoir voquer ce sujet trs juridique de lordre public en mer. Notion juridique imagine pour la terre, beaucoup ont du mal imaginer que lordre public puisse avoir une ralit en mer. Et pourtant les missions dordre public de la marine sont bien relles et on peut dire quelles ne font que crotre avec lvolution des enjeux et des technologies. Nanmoins avant de mattaquer cette tche, il ma fallu me replonger dans mes vieux grimoires de droit pour me rappeler prcisment ce que recouvrait cette notion. En la comparant avec la ralit actuelle et, ma grande satisfaction, jai pu constater que mes repres de juriste navaient pas trop chang : lordre public cest toujours la paix interne garantie par lEtat au travers, de la scurit, de la salubrit et de la tranquillit publiques Donc notre monde change. La mer nchappe pas cette volution mais cela passe plus inaperu pour le terrien. 1. Les nouveaux enjeux influant sur lordre public en mer On assiste actuellement en mer lapparition de deux phnomnes majeurs. Le premier est la criminalisation de lespace maritime qui est aussi devenu un enjeu de scurit. Lautre phnomne est la monte des besoins de protection de lenvironnement. 1.2 Premier enjeu : la criminalisation de lespace maritime. Les missions dordre public en mer ont beaucoup volu. Dans les annes quatre-vingt les principales missions dordre public consistaient dans des missions de police des pches, dbordant parfois sur du maintien de lordre en mer, et dans la prvention et la lutte contre les pollutions. La loi sur lexercice par ltat de ses pouvoirs de police en mer de 1994 est lhritire de linstruction du Premier ministre de 1989 sur lemploi de la force dans le cadre des missions de police des pches. Brest se rappelle sans doute les actions muscles conduites par le prfet maritime, la fin des annes quatre-vingt dix, lencontre des fameux marques 1
masques , ces chalutiers espagnols sans licence qui venaient tenter leur chance dans le golfe de Gascogne en masquant leurs immatriculations. Mais cette priode parait dj comme un long fleuve tranquille en comparaison de celle que nous vivons aujourdhui. Car aujourdhui, nous avons bascul dans un autre monde. Aristote disait quil y a trois sortes dhommes: les vivants, les morts, et ceux qui vont sur la mer . Mais aujourdhui, hors la dimension potique, il ny a plus quun monde divis entre les vivants, terre et en mer, et les morts. On peut dater ce changement dpoque fvrier 1978, lorsque le dpartement de la dfense amricain lana son premier satellite GPS (Global Positionning System). Ce systme initialement militaire a eu des consquences que ses inventeurs navaient sans doute pas imagines. En mer, il y a eu deux rvolutions : linvention de la boussole et larrive du satellite. Grce ce dernier il nest plus ncessaire aujourdhui davoir suivi une formation maritime approfondie pour savoir se dplacer en haute mer. Par ailleurs, la dmocratisation de la communication par satellite a apport de nouvelles facilits. Les systmes Globalstar, Inmarsat, ou Iridium permettent dsormais aux marins dtre en contact permanent avec le monde des vivants.. Mais comme tout progrs, ces rvolutions technologiques profitent aussi aux organisations criminelles qui disposent dsormais des outils pour tirer partie des atouts offerts par lespace maritime, espace de libert et de communication. Celles-ci, sur tous les continents, ont la capacit de positionner leurs cibles en mer, de sy donner rendez-vous et de communiquer avec leurs hommes pour donner leurs consignes. On assiste une internationalisation de la criminalit qui dsormais exploite lespace maritime comme une zone daction et de refuge. La consquence est que tous les indicateurs relatifs aux activits criminelles en mer virent au rouge. Depuis une dizaine dannes la croissance des cas de piraterie, des trafics illgaux de produits stupfiants et dtres humains et est sans prcdent. Pour lutter contre ces phnomnes, lemploi des moyens de la marine nationale est de plus en plus frquent compte tenu de leur caractre hauturier et de la ncessit demployer des systmes darmes complexes. 1.2. Deuxime enjeu : la demande de protection de lenvironnement Une autre volution notable est celle de la prise de conscience de la fragilit des ocans et de lardente ncessit dsormais de les protger pour la survie de lHumanit. Les confrences internationales de Johannesburg et de Rio avaient dj pos des principes fondamentaux. La mer, que lon pensait immense et inpuisable, a commenc dlivrer des signaux des signes inquitants de perte de biodiversit et de rarfaction des ressources. La communaut internationale a pris la mesure de la dgradation de lenvironnement maritime. Elle a dcid de ragir et de mieux contrler la gestion de ces espaces. 2. Les rcentes volutions de nos institutions maritimes pour rpondre aux enjeux dordre public. Pour satisfaire ces nouveaux besoins dordre public, une volution des institutions tait devenue indispensable. Cette volution a eu lieu. Depuis 2000, notre organisation administrative et judiciaire a su sadapter et un nouveau cadre juridique a t mis en place.
La premire des volutions a t la transformation du prfet maritime, de prfet de lurgence en prfet de la mer. Je ne napprofondirai pas sur ce point qui ne se trouve pas au cur de cette intervention mais il ne faut pas perdre de vue que le dcret du 6 fvrier 2004 relatif lorganisation de laction de lEtat en mer a renforc les pouvoirs du prfet maritime, et de son homologue outre-mer, le dlgu du gouvernement pour laction de lEtat en mer, en lui confiant, notamment, de nouvelles responsabilits dans les domaines : de la protection de lenvironnement, notion beaucoup plus large que celle du dcret de 1978 qui le restreignait la prvention et la lutte contre la pollution, de la coordination de la lutte contre les activits illicites, nouvelle mission confie au PREMAR en 2004.
Le principal atout de notre organisation maritime repose sur le fait quil ny a quun seul reprsentant de lEtat en mer. On retrouve l luvre magistrale de Bonaparte et son souci defficacit avec la cration du prfet maritime seul charg de la police des eaux et rades dans larrondissement maritime. Le prfet maritime est en charge de la police administrative en mer. Il dicte des mesures de police gnrale ncessaire au maintien de lordre public. Pour ce faire, il dispose notamment du pouvoir rglementaire dont il use, par exemple, pour rglementer la navigation ou effectuer des mises en demeure lorsque lenvironnement est menac. Il assure aussi de nombreuses polices spciales comme celle de la protection de lenvironnement ou de la sauvegarde des personnes et des biens. La circonscription du prfet maritime nest pas le dpartement mais la zone maritime. L nous entrons dans une autre dimension combien fluctuante et perturbante pour le non marin. Car la zone maritime est dabord constitue despaces maritimes ayant un statut juridique international. Mme la mer territoriale, pour les juristes oprationnels, entre dans la catgorie de lespace international en raison de cette servitude trs forte quest le passage inoffensif. Seules les eaux maritimes intrieures sont des espaces de souverainet de lEtat ctier. Le cadre administratif daction sappuie donc sur les zones maritimes qui sont fixes par le code de la dfense (article D 3223-55). Un arrt du ministre de la dfense (20 aot 2007) dlimite chacune des dix zones maritimes : 3 en mtropole, 5 outre mer et 2 ne jouxtant pas des territoires franais. La zone maritime comprend des espaces placs sous la juridiction de la France (eaux intrieures, mer territoriale, zone conomique) mais aussi en haute mer sur laquelle la France peut exercer certaines attributions, soit lgard de ses propres navires soit lgard de certains navires trangers en vertu de conventions internationales (sans besoin de laccord de lEtat du pavillon pour les crimes internationaux dont la piraterie - ; avec laccord de lEtat du pavillon pour la lutte contre le narcotrafic et limmigration). Les volutions rcentes ont renforc lefficacit de ce dispositif en dsignant pour chacun de ces espaces une juridiction de rattachement. Cela est le cas depuis une dizaine dannes pour la lutte contre la pollution maritime avec la cration des tribunaux du littoral maritime spcialiss, ventuellement comptents sur les ressorts de plusieurs cours dappel (six tribunaux cres par le dcret n2002-196 du 11 fvrier 2002 spcialiss dans la lutte contre la pollution maritime). Dans les domaines de la criminalit comme la lutte contre le trafic illicite de stupfiants, contre limmigration illicite par mer et contre la piraterie, les tribunaux comptents sont ceux du sige de lautorit maritime ou celui du port vers lequel le navire a t drout. Aujourdhui un vritable tandem prfet maritime / procureur de la Rpublique sest mis en place, donnant beaucoup defficacit ces luttes.
La dernire volution la plus notable est la cration dune fonction garde-ctes. Celle-ci est ne du besoin de mettre en place une organisation nationale apte sintgrer dans le dispositif maritime europen qui se met en place. Voulue par le Prsident de la Rpublique, discours du 16 juillet 2009 au Havre, elle a vu rellement le jour l'occasion du comit interministriel de la mer du 8 dcembre 2009. Grce linstauration dune fonction garde-ctes, la France peut conserver une organisation AEM adapte qui regroupe lensemble des institutions participant cette fonction. Cette formule permet de plus dviter lexclusion priori des marines militaires europennes qui ont toutes vocation participer cette fonction , une poque o leur contribution va prendre de plus en plus dimportance en raison des enjeux de scurit en mer ncessitent des moyens de plus en plus hauturiers et sophistiqus. La fonction garde-ctes, c'est d'abord un comit directeur qui a t instaur par le dcret du 22 juillet 2010 et qui se runit sous l'autorit du secrtaire gnral de la mer, reprsentant du Premier ministre. Le comit directeur contribue la dfinition des politiques conduites au titre de la fonction garde-ctes et l'identification des priorits d'action et des mesures d'organisation en dcoulant. Compos des directeurs des principales administrations intervenant en mer, il constitue linstance danimation et darbitrage de la fonction garde-ctes. Ce comit s'est dj runi plusieurs reprises et a permis de donner des impulsions significatives dans certains domaines de la politique maritime de notre pays. Actuellement le comit directeur, au travers de son groupe de travail permanent, travaille activement sur la dfinition de priorits nationales pour l'action de l'Etat en mer. Ces priorits seront bientt valides par le Premier ministre. Elles serviront de rfrentiel pour permettre aux administrations de conduire leur politique d'acquisition de moyens et de dfinir leurs missions. Le centre oprationnel de la fonction garde-ctes (CoFGC) est entr en fonction en septembre 2010. Adoss ltat-major de la marine mais travaillant au profit du SG Mer, ce centre est compos dofficiers appartenant toutes les administrations intervenant en mer. Chaque jour le CoFGC dite un bulletin quotidien de situation maritime qui apporte aux plus hautes autorits de l'Etat une synthse des informations dintrt maritime franais dans le monde. Le CoFGC agrge au niveau central les informations dintrt maritime et apporte un soutien aux autorits centrales lors dvnements de mer. Il a galement pour vocation de mettre disposition des autorits et des administrations le rfrentiel documentaire de l'action de l'Etat en mer. Il fournit galement des analyses permettant de rorienter le dispositif AEM et anime un rseau national, europen et international avec les autres centres en charge des questions maritimes. La fonction garde-ctes s'est aussi lance dans un projet original de mutualisation des moyens de surveillance et de veille maritimes en Polynsie franaise. Partant du constat que plusieurs administrations avaient des besoins convergents dans ces domaines, le Premier ministre a demand la mise en place d'un centre maritime commun pour la Polynsie. Ce projet a pour objectif de rassembler les systmes de surveillance et de direction des oprations dans un centre commun pour amliorer l'efficacit de chaque administration grce au recoupement de l'information, et pour conomiser des moyens humains prcieux (mutualisation de la veille des frquences radios).
D'autres projets ambitieux ont t mis en route. La marine a pris la responsabilit de la conduite d'un groupe de travail de la fonction garde-ctes destin dfinir, pour le compte du SG Mer, les besoins des diffrentes administrations dans le domaine de la surveillance maritime, notamment pour relever les dfis des nouveaux systmes de surveillance europen et pour assurer la matrise des espaces maritimes outre-mer. Sur tous ces sujets de la fonction garde-ctes la marine est trs prsente. Elle fonde beaucoup d'espoir dans cette nouvelle organisation qui lui permettra de relever les dfis du vingt et unime sicle, ceux de l'ocan globalis. Quels sont les enjeux dordre public auxquels nous sommes confronts en mer? Conformment la dfinition de lordre public, je vous propose de les dcliner en enjeux de scurit, de salubrit et de tranquillit publiques. 3. Les enjeux de scurit publique. 3.1 La police du trafic maritime des produits stupfiants. Le trafic de stupfiant par voie de mer a pris des proportions considrables. Les sommes en jeu seraient quivalentes la valeur du march mondial des hydrocarbures. Actuellement plus de 1000 tonnes de cocane sont produites chaque anne par la Colombie dont plus de la moiti sont exportes vers lEurope. Ne nous leurrons pas, cest une vritable guerre que nos dmocraties sont confrontes. Lvolution du Mexique est trs inquitante et significative des capacits de dstabilisation gnres par le trafic des produits stupfiants. Dj certains Etats ont bascul dans le camp des narcotrafiquants. Cest le cas par exemple de la Guine-Bissau qui est classe dans la catgorie des narco-Etats par l'Office contre la drogue et le crime des Nations unies (ONUDC), car ses dirigeants, mme au plus haut niveau, sont impliqus dans le trafic de drogue. Les hommes politiques qui ont essay de sy opposer ont t soit excuts, soit ont d fuir leur pays, soit sont dans lobligation de composer localement avec la ralit mafieuse. La drogue arrive par avion et par navire via l'archipel des Bijagos. Ces les, dont une partie a t acquise par des rseaux mafieux, sont quipes de piste d'atterrissage de fortune datant de la seconde guerre mondiale. Des complicits sont achetes tous les niveaux par les cartels colombiens qui ont galement investi dans le secteur immobilier. Une centaine d'entre eux se serait ainsi installe demeure dans le pays. Au dbut des annes 2000, la Guine Bissau a servi de pionnire dans l'acheminement de la cocane sud-amricaine en Europe, via l'Afrique de l'Ouest. Elle est maintenant concurrence comme tape pour cette marchandise par d'autres pays de la rgion. Les moyens employs sont aussi de nature de plus en plus guerrire. Nous sommes maintenant confronts, non seulement des go-fast, non seulement des navires semisubmersibles mais aussi dsormais de vritables sous-marins comme celui qui a t saisi le 15 fvrier dernier dans la jungle colombienne. Ce type de sous-marin, fabriqu en polyester peut transporter jusqu 10 tonnes de fret, embarquer 5 personnes et plonger une dizaine de mtres.
La marine est engage sur plusieurs fronts dans cette lutte contre le trafic de drogue : aux Antilles o elle vient de renforcer ses moyens en y affectant depuis lanne dernire une frgate supplmentaire, au large de lAfrique (route de lEurope dite route des les ou golfe de Guine) et en Mditerrane o nous sommes confronts un intense trafic de rsine de cannabis avec lemploi dembarcations trs rapides, les fameux go-fast. Les interceptions sont frquentes. Deux aux Antilles depuis le dbut de lanne dont une saisie importante de 3,6 tonnes de cocane par la frgate Germinal, le 14 fvrier 2011. En Mditerrane, les interceptions de go-fast sont ralises chacune de nos oprations Lvrier (dispositif maritime de lutte contre le trafic de stupfiants). Le dispositif juridique mis en place fonctionne bien. Il sappuie principalement sur la convention de Vienne du 20 dcembre 1988 qui organise les modalits concrtes de coopration entre les Etats parties. Larticle 17 de la convention de Vienne dispose cette fin qu une partie qui a des motifs raisonnables de souponner quun tat battant son pavillon se livre au trafic () peut demander aux autres parties de laider mettre fin cette utilisation ( et) peut demander lautorisation cet tat de prendre les mesures appropries lgard de ce navire . Les modalits dapplication par la France de larticle 17 de la convention de Vienne font lobjet de la loi du 29 avril 1996 relative au trafic de stupfiants en haute mer et portant adaptation de la lgislation franaise larticle 17 de la convention des Nations Unies sur le trafic illicite des stupfiants et substances psychotropes, faite Vienne (20 dcembre 1988). En vertu de ces textes, les demandes darraisonnement et de dvolution de la comptence juridictionnelle transitent par la voie diplomatique. La France, lorsquelle intervient sur un navire tranger, fait le choix de dissocier la demande relative larraisonnement de celle concernant lobtention de la comptence juridictionnelle. Les dispositions pertinentes du droit national en matire de lutte contre le trafic illicite de stupfiants en haute mer figurent dans la loi du 15 juillet 1994 telle qu'elle a t modifie par la loi du 29 avril 1996. Cette loi prcise les conditions dans lesquelles, au-del des eaux territoriales franaises, les commandants des btiments et aronefs dEtat peuvent procder la recherche et la constatation des infractions relatives la lgislation sur les stupfiants. A lintrieur des eaux territoriales franaises, les commandants des btiments et aronefs dEtat peuvent user des dispositions gnrales des articles L1521-1 10 du code de la dfense. 3.2 La police de limmigration illgale par voie de mer. LEurope est confronte un nouveau dfi avec larrive massive dimmigrants irrguliers sur son territoire. Ces mouvements de populations ont pris une importance particulire depuis cinq ans avec la dstabilisation de nombreux Etats du sud. Chaque anne ce sont donc prs de 130 000 immigrants illgaux qui parviennent rejoindre le continent europen (source FRONTEX) en franchissant illgalement les frontires. Ces mouvements de population, mal maitriss, peuvent devenir des facteurs de fragilit des Etats de lUnion europenne. Pour faire face ce phnomne, lUnion europenne sest dote dune agence pour la gestion de la coopration oprationnelle aux frontires extrieures, FRONTEX.
Mais lexercice des pouvoirs de police en mer, en lespce la rpression de limmigration irrgulire, est une responsabilit qui ne peut tre exerce que par les Etats en vertu de la loi du pavillon. FRONTEX ne peut donc fonctionner que par lintermdiaire des Etats, dont la France, qui disposent des pouvoirs de police en mer, des lgislations rpressives et des juridictions pnales. Les btiments de la marine sont habilits constater les infractions limmigration dans des conditions prcises (loi du 15 juillet 1994 modifie par la loi du 22 avril 2005) et leur a confr, en droit interne, des possibilits de rpression. La marine est donc sollicite pour la ralisation des missions de lutte contre limmigration illgale. Elle agit soit au large de nos ctes, soit au large des pays de dpart, gnralement dans le cadre des missions FRONTEX. Trop souvent, la lutte contre limmigration illicite en mer est assimile la lutte terre, espace de souverainet. Or le statut international des espaces maritimes modifie radicalement la donne. En effet la dfinition de limmigration illgale par voie maritime est actuellement pratiquement inexistante en droit international de la mer. Aujourdhui seul le Protocole de Palerme du 15 novembre 2000, ratifi par la France, prvoit la recherche, lincrimination et la rpression en haute mer de trafiquants ou passeurs de migrants. En revanche il nest pas possible de qualifier dimmigrant irrgulier une personne se trouvant dans un espace soumis aux lois daucun Etat. Quant la validit dune interception dans la mer territoriale, encore faudra-t-il prouver la volont de dbarquer de faon illgale des personnes interceptes. Il ny a donc pas de clandestin dans un espace qui est ouvert tous car international. Les immigrants illgaux ne le deviennent que lorsquils ont pos le pied terre. Cest pourquoi la stratgie de la lutte soriente rsolument lencontre des passeurs. En 2010, la Grce a rduit de faon sensible limmigration par voie de mer en sattaquant avec efficacit aux passeurs grce des techniques didentification. Les passeurs ayant t lourdement condamns, ces mthodes ont permis de tarir les flux maritimes en provenance de la Turquie ce qui a fait exploser les passages illgaux sur la frontire terrestre, ncessitant lenvoi de renforts terrestres de la part de FRONTEX. 4. La salubrit publique : la protection de lenvironnement en mer. La protection de lenvironnement en mer devient un enjeu considrable pour les Etats europens. La rglementation europenne dans ce domaine est prolixe. Nanmoins, les principales directives europennes sont les directives Natura 2000 (oiseaux de 1979 et habitats de 1992) et la directive cadre stratgie marine de 2008. Le plan daction pour la mer dcid en 2005 dans le cadre de la stratgie nationale pour la biodiversit a affich la ncessit de dvelopper rapidement le rseau franais daires marines protges (AMP). Dans son discours du 16 juillet 2009, le Prsident de la Rpublique a raffirm lobjectif de dvelopper un rseau daires marines protges couvrant 10% des zones sous juridiction franaise dici 2012 et 20% dici 2020 dont 5% constitues en rserves de pche dans la mer territoriale et 10% en zones sous juridiction dici 2020. La France a une responsabilit particulire dans ce domaine. Sur les 45 habitats que lEurope sest engage protger, 35 (75%) sont prsents dans les eaux mtropolitaines franaises. La France, deuxime domaine maritime mondial aprs les USA avec 11 millions de km sur trois
ocans, se situe au 4me rang de la faune menace et au 9me rang de la flore menace. Elle a ainsi une responsabilit particulire dans la protection des espaces naturels. La loi du 14 avril 2006 dresse une liste de 6 catgories daires marines protges dont les parcs naturels marins (ex : Iroise), les parcs nationaux ayant une partie maritime ou les sites Natura 2000. La marine, dont fait partie la gendarmerie maritime, a dj une responsabilit importante en matire de la protection de la biodiversit en assurant la police des pches dans les espaces soumis notre juridiction que ce soit dans le Pacifique, en Atlantique ou en Ocan Indien. Mais le classement de vastes zones outre-mer, comme cest dj le cas du parc naturel marin de Mayotte et demain de celui des Glorieuses, nous impose de revoir entirement notre politique de surveillance et de moyens mettre en uvre. La salubrit cest aussi la prvention des accidents de mer dans laquelle la marine nationale est trs implique. Prvenir les accidents de mer cela signifie tre en mesure de mettre en uvre les prescriptions de la convention de Bruxelles du 29 novembre 1969 sur lintervention en haute mer. En mettant en place un dispositif cohrent dquipes dintervention, dhlicoptres lourds et de remorqueurs de haute mer, la marine a mis disposition du prfet maritime un systme darme indispensable la prvention des accidents de mer et leffectivit des mises en demeure. Lactualit montre que les leons du Torrey canyon ou de lAmoco Cadiz peuvent tre perdues de vue. Le retrait annonc par les Britanniques de tous leurs moyens dassistance en mer, notamment dans le pas de Calais o nous co-affrtons un remorqueur de haute mer, est une difficult majeure pour notre pays. Sen remettre aux rgles de lassistance prive comme le prtendent actuellement les Britanniques, est soit de linconscience, soit du cynisme. Car dans le mme temps les rgles maritimes changent en raison de la survenance dun phnomne rcurrent, le gigantisme des navires. Ainsi lOMI a modifi sa position pour faire face aux phnomnes des grands navires passagers. A loccasion dun amendement au manuel international de recherche et de sauvetage aronautiques et maritimes (manuel IAMSAR) la doctrine relative au sauvetage des grands navires passagers a t modifie. Cet amendement est entr en vigueur le 1er juin 2006. Il prvoit que dsormais, plutt que de favoriser lvacuation en mer des passagers, lEtat ctier doit tout mettre en uvre pour maintenir le navire et lamener en un lieu sr avant de procder une vacuation. Pour cela il doit disposer dquipes dintervention muscle, dhlicoptres lourds et de remorqueurs de haute mer, tout ce que la GrandeBretagne est en train dabandonner. 5. La tranquillit publique : la police de la piraterie maritime. Enfin les nouveaux enjeux de tranquillit publique peuvent tre illustrs par la rsurgence massive de la piraterie qui a pris un nouveau visage. La police de la piraterie est la plus ancienne en mer. La piraterie nest pas un phnomne nouveau mais elle connat un regain dactivit sensible ces dernires annes en raison de lexistence dEtats ctiers faillis et de larrive de nouvelles technologies qui facilitent cette activit criminelle. La piraterie a toujours t considre comme un flau et un crime suffisamment grave pour appeler un traitement particulier. Elle justifie donc une exception au principe dapplication exclusive de la loi du pavillon. Cette coutume a t inscrite dans la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (CNUDM).
Pour disposer des outils juridiques de lutte contre la piraterie le Parlement vient dadopter cette anne une loi rpressive (loi n 2011-13 promulgue le 5 janvier 2011). Cette loi est venue opportunment rintroduire linfraction de piraterie dans notre corpus lgislatif, cette infraction ayant t supprime tort du code pnal en 2007 pour des raisons de simplification administrative, malgr nos protestations Ce texte comporte trois apports principaux pour la marine : - elle habilite les commandants des navires de ltat, et demain ainsi que certains officiers (commandant en second, commissaire, chef de lquipe de visite, dcret en prparation) constater les infractions de piraterie et en rechercher et apprhender leurs auteurs ; - elle habilite les seuls commandants ordonner lemploi de la force, conformment au code de la dfense, pour intercepter un navire souponn de se livrer la piraterie ; - elle reconnait aux commandants le droit dordonner des mesures de coercition lencontre de lquipage du navire contrl (se limitant la scurit de lintervention, la protection des personnes, des biens et du navire). A cette occasion ont t dfinies les conditions de rtention en mer des personnes interceptes. Ce dispositif de libert publique ne sapplique pas la seule piraterie mais toutes les missions de police en mer pour lesquelles des personnes peuvent tre contrles voire retenues. Mais il sagit l dun autre sujet. Les proccupations dordre public en mer, comme terre, ne cessent dvoluer. Jespre avoir contribu cette rflexion. Les enjeux y sont majeurs et vont continuer se dvelopper, dans un monde de plus en plus dpendant de la bonne circulation des personnes et des biens. La France a de srieux atouts pour relever ces dfis : une organisation maritime efficiente et efficace, qui na quasiment pas dquivalent dans les grandes Nations, que nous devons continuer amliorer ; une arme de mer qui est aussi une marine nationale, permettant la France dassurer sur lespace maritime ce fameux continuum dfense et scurit ; une appartenance lEurope qui est la seule dimension pouvant nous permettre dexister dans le monde venir ;
mais la France a aussi de bons marins, la pche, au commerce ou dEtat. Et si le dicton anglais dit vrai Une mer calme na jamais fait un bon marin alors assurment nous serons encore meilleurs demain !
Commissaire en chef de 1re classe (marine) Thierry Duchesne Chef du bureau action de lEtat en mer Etat-major de la marine
Vous aimerez peut-être aussi
- Rapport Alternatif Sur Les Violations Des Droits de L'homme Contre Les Personnes LGBT - EPU RDCDocument13 pagesRapport Alternatif Sur Les Violations Des Droits de L'homme Contre Les Personnes LGBT - EPU RDCChristian RumuPas encore d'évaluation
- Sujet Enquete Préliminaire Et Enquete de FlagranceDocument3 pagesSujet Enquete Préliminaire Et Enquete de FlagranceBichara Soumaine50% (2)
- Introduction Generale Au DroitDocument101 pagesIntroduction Generale Au DroitMohammed Jniyeh100% (1)
- Convention FrancaisDocument93 pagesConvention Francaisom_mk60% (5)
- Comment Faire Sauter Les PVDocument39 pagesComment Faire Sauter Les PVcaca75Pas encore d'évaluation
- A Protection Des Donnees A Caractere Perso 22Document117 pagesA Protection Des Donnees A Caractere Perso 22Henri paterne BoundioPas encore d'évaluation
- 4.69.7 Decret-Loi Agence Nationale de Renseignemen PDFDocument6 pages4.69.7 Decret-Loi Agence Nationale de Renseignemen PDFDéodat SalehPas encore d'évaluation
- Ben 94851Document36 pagesBen 94851Dieu Peut ToutPas encore d'évaluation
- Comp1 3ASDocument2 pagesComp1 3ASsara25100% (1)
- Contes Populaires Berbères Recueillis PDFDocument279 pagesContes Populaires Berbères Recueillis PDFLop LopmanPas encore d'évaluation