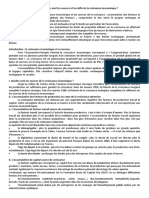Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Chapitre 12 Action Publique Environnement Cours
Chapitre 12 Action Publique Environnement Cours
Transféré par
MorinCopyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Chapitre 12 Action Publique Environnement Cours
Chapitre 12 Action Publique Environnement Cours
Transféré par
MorinDroits d'auteur :
Formats disponibles
Chapitre 12 : Quelle action publique pour l’environnement ?
- Savoir identifier les différents acteurs (pouvoirs publics, ONG, entreprises, experts, partis, mouvements citoyens) qui
participent à la construction des questions environnementales comme problème public et à leur mise à l’agenda politique ;
comprendre que ces acteurs entretiennent des relations de coopération et de conflit.
- Comprendre que l’action publique pour l’environnement articule différentes échelles (locale, nationale, européenne,
mondiale).
- En prenant l’exemple du changement climatique :
- connaître les principaux instruments dont disposent les pouvoirs publics pour faire face aux externalités négatives sur
l’environnement : réglementation, marchés de quotas d'émission, taxation, subvention à l’innovation verte ; comprendre
que ces différents instruments présentent des avantages et des limites, et que leur mise en œuvre peut se heurter à des
dysfonctionnements de l’action publique ;
- comprendre qu’en présence de bien commun les négociations et accords internationaux liés à la préservation de
l’environnement sont contraints par des stratégies de passager clandestin et les inégalités de développement entre pays.
Introduction : Pourquoi agir pour l’environnement ?
Depuis 1972 et la publication, sous l’égide du Club de Rome, du rapport « Halte à la croissance », dit « rapport
Meadows », plusieurs événements ont favorisé la prise de conscience de l’existence de limites à la croissance économique.
Les chocs pétroliers des années 1970 révèlent la fragilité de cette ressource naturelle. Il en va de même pour les craintes
sur la diminution de la biodiversité, l’extinction de certaines espèces animales ou la déforestation. Des accidents industriels
majeurs comme celui de l’usine de Bhopal en Inde en 1984, de Tchernobyl en 1986, de Fukushima en 2011, les nombreuses
marées noires, montrent les dégâts d’une production intensive sur l’environnement. Les conséquences induites par le
réchauffement climatique comme la fonte des glaces, la progression des zones arides, les catastrophes climatiques
destructrices, semblent aller dans le même sens. Au final, l’enjeu environnemental coïncide avec celui de la permanence
d’une vie authentiquement humaine sur Terre.
A l’initiative du Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) créé en 1972, la commission dite «
Brundtland » (du nom de Gro Harlem Brundtland, premier ministre norvégien) a publié un rapport, titré Notre avenir à tous
(1987), appelant de ses vœux un développement durable ou soutenable (en anglais sustainable). Celui-ci y est défini
comme répondant « aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs
». Le développement durable doit chercher à concilier les impératifs de croissance économique (pilier économique), de
justice sociale (pilier social) et de préservation de l’environnement (pilier écologique). Cette définition relativement floue a
été interprétée de deux manières contradictoires.
La soutenabilité faible : cette conception du développement durable repose sur la croyance dans l’efficacité du
progrès technique qui apportera des solutions aux problèmes écologiques et sociaux. Selon les partisans de la soutenabilité
faible, il est possible se substituer du capital physique au capital naturel de manière à maintenir constant le stock de capital
global. Cette conception s’illustre à travers la courbe environnementale de Kuznets selon laquelle, à mesure qu’une société
se développe, le niveau de pollution diminue.
La soutenabilité forte : cette conception du développement durable repose sur la complémentarité du capital
naturel et du capital physique. Il existe des dégradations irréversibles de l’environnement qui compromettent à terme
l’existence même de l’humanité. Il faut donc respecter un principe de précaution, c’est-à-dire s’abstenir mettre en œuvre
de nouvelle techniques tant que la preuve de leur innocuité n’a pas été démontrée.
L’action publique pour l’environnement soulève donc des débats théoriques qui se répercutent sur les actions
concrètes menées par les acteurs politiques. Les débats théoriques s’associent à la dimension mondiale de l’enjeu pour
complexifier encore plus l’action.
I- Comment l’action publique environnementale se construit-elle ?
Les questions environnementales font intervenir une grande diversité d’acteurs : pouvoirs publics, Organisation
Non Gouvernementales (ONG), entreprises, experts, partis politiques et mouvements citoyens. Ils se mobilisent pour en
faire un problème public ainsi que pour mettre ces questions d’environnement en bonne place sur l’agenda politique.
Ces différents acteurs peuvent se trouver dans une logique de coopération mais aussi de conflit.
L’action publique pour l’environnement suppose de s’appuyer sur différents niveaux d’intervention : local, national,
européen, et mondial.
A. Différents acteurs participent à la construction des questions environnementales…
a. … comme problème public…
Il n’est pas évident qu’une action publique pour l’environnement soit menée. Les questions écologiques ont en
effet longtemps été négligées, perçues comme des freins à l’activité économique. Pour que les pouvoirs publics se décident
à concevoir et à mettre en œuvre des politiques publiques dans le domaine de l’environnement, il faut généralement que
des acteurs très divers se mobilisent. Les ONG, les entreprises, les experts, dont les scientifiques, les partis politiques, et
les mouvements citoyens peuvent concourir à la définition et à la médiatisation des problématiques environnementales.
Ces différents acteurs montrent finalement pourquoi il est important de s’en préoccuper et proposent souvent des
mesures de remédiation. Les pouvoirs publics eux-mêmes peuvent participer à l’introduction des thèmes écologiques dans
le débat public. Dès lors, ils deviennent des problèmes publics, c’est-à-dire qu’ils appellent des actions préventives et
réparatrices de la part des pouvoirs publics. Par exemple, afin de favoriser la transition écologique, en 2017, le ministre de
l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie, Nicolas Hulot, a fait voter une loi qui interdit la recherche ainsi que
l'exploitation des hydrocarbures en France à partir de 2040.
b. … et à leur mise à l’agenda politique.
Ainsi, les promoteurs de problème public procèdent par étape : tout d’abord, ils identifient une question qu’ils
jugent importante ; ensuite, ils en proposent un cadrage, c’est-à-dire qu’ils communiquent sur la nature du problème, ses
causes et les solutions qui leur semblent optimales. Enfin, dernière étape, les promoteurs de problème public espèrent
qu’il soit mis à l’agenda politique. Ce qui signifie que la question soulevée est pleinement posée dans le débat public et que
cela pourrait susciter l’intervention des pouvoirs publics pour y répondre. Pour cela, ils doivent argumenter pour justifier
l’importance du problème posé, par exemple, à l’aide de rapports rédigés par des scientifiques, et ainsi favoriser sa prise en
compte par l’opinion publique et les autorités. Les médias sont utilisés pour atteindre ces objectifs.
Par exemple, sous la pression de l’opinion publique qui se déclare favorable à des mesures écologiques, Nicolas
Sarkozy organise le « Grenelle de l’environnement » entre septembre et décembre 2007. Il s’agit d’un ensemble de
rencontres entre les pouvoirs publics et différents acteurs du développement durable comme les entreprises, les ONG ou
encore les associations. Des décisions sont prises comme la réduction du C02 de 20% dans le secteur du transport entre
1990 et 2020. (Dans les faits augmentation de 9% sur la période).
c. Ces acteurs entretiennent des relations de coopération et de conflit
Les divers acteurs impliqués dans la construction des problèmes publics environnementaux ne sont pas toujours
d’accord entre eux. Ils peuvent entretenir des rapports de coopération, c’est-à-dire que tout en poursuivant leur propre
objectif, ils tiennent compte de ceux d’autres acteurs pour affirmer des intérêts communs et agir ensemble. La coopération
permet de promouvoir avec plus d’efficacité les questions environnementales comme problème public. Cela suppose que
les acteurs proposent des cadrages similaires, du moins compatibles, du problème. Par exemple, le parti politique EELV
(Europe Ecologie – Les Verts) travaille de concert avec des associations environnementales pour populariser les thèmes
écologiques dans le débat public.
Mais certains acteurs peuvent également entrer en conflit dans la construction des problèmes publics
environnementaux car ils portent des visions opposées et concurrentes d’un même problème. Chacun des acteurs en
conflit cherche alors à imposer son propre cadrage. Par exemple, la loi Hulot de 2017 est fortement critiquée par les
associations environnementales qui considèrent que la date de 2040 pour arrêter la recherche d’hydrocarbure est
beaucoup trop lointaine.
Il peut également arriver qu’un acteur ait intérêt à empêcher la construction d’un problème public
environnemental. S’il atteint son objectif, le conflit peut tout à fait conduire à un « enterrement » du problème posé.
Par exemple, en 2019, le mouvement des « gilets jaunes » a poussé les pouvoirs publics à suspendre une hausse prévue de
la taxe carbone appliquée aux carburants automobiles. Ceci venant de l'inquiétude des répercussions de cette hausse sur le
pouvoir d'achat d'un grand nombre de ménages français.
B. L’action publique pour l’environnement articule différentes échelles d’intervention :
Pour être efficace, l’action publique pour l’environnement utilise différents niveaux d’intervention. Il y a bien sûr
l’action de l’Etat à un niveau national par la promulgation de lois mais il peut se révéler plus pertinent d’agir à d’autres
échelons.
L’échelle locale, notamment pas le biais des collectivités locales : régions, départements, communes qui
connaissent mieux le « terrain » que l’Etat et qui participent concrètement à la mise en œuvre des politiques
environnementales en les adaptant aux spécificités locales. On retrouve ici la logique de décentralisation qui anime les
institutions françaises depuis 40 ans. Par exemple, ce sont les régions qui gèrent les transports publics et peuvent donc
réduire leur émission de CO2.
L’échelle européenne : de nombreuses mesures sont prises au niveau européen et appliquée dans les pays de l’UE
(Union européenne). C’est le principe de subsidiarité qui s’applique, lorsqu’il est plus efficace que la décision soit prise à
l’échelle européenne, l’Etat et les collectivités locales doivent s’effacer. Par exemple, les normes énergétiques sont
déterminées au niveau européen pour s’appliquer à l’ensemble de l’industrie des pays de l’UE.
L’échelle mondiale est essentielle, en particulier sur la question du changement climatique. Il s’agit en effet d’un
bien commun mondial. Le climat bénéficie à chacun d’entre-nous, il est dit non exclusif, mais en l’utilisant librement, et en
polluant, nous réduisons la possibilité des autres d’en bénéficier, c’est donc aussi un bien rival. Les négociations et
accords internationaux visent donc à réguler les usages afin d’empêcher la dégradation du climat. Par exemple, l’ONU a
créé le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) en 1988 dont les rapports ont conduit au
protocole de Kyoto (1997) qui vise à une réduction mondiale des émissions de gaz à effet de serre de 5% entre 1990 et
2012.
Il n’est pas toujours facile de mettre en place une action publique européenne ou internationale dans le domaine
environnemental.
Tout d’abord, certains États sont tentés de se comporter en passagers clandestins, c’est-à-dire de bénéficier des
efforts des autres sans s’y soumettre eux-mêmes. Par exemple, en 2017, Donald Trump décide de retirer les Etats-Unis de
l’Accord de Paris (2015) sur le climat qui se donne un objectif de réduction du réchauffement climatique.
Ensuite, les inégalités de développement entre pays posent question : ne faut-il pas demander un effort plus
important aux pays développés, qui sont aussi les plus gros pollueurs et depuis plus longtemps ? On parle aujourd’hui
d’une « dette climatique » de ces pays vis-à-vis des États en voie de développement. Par exemple, la Chine refuse
aujourd’hui les injonctions des pays développés sur les questions environnementales, considérant que cela conduirait à
réduire sa croissance économique.
Concernant les problématiques sur la biodiversité, les collectivités peuvent mettre en place des mesures de
protection adaptées aux écosystèmes singuliers présents sur leur territoire. L’Union européenne joue aussi un rôle décisif
dans l’action publique pour l’environnement : les politiques environnementales menées en France sont, pour 75% d’entre
elles, une traduction des décisions prises au niveau européen. Agir à cette échelle permet d’harmoniser les politiques des
États-membres, évitant le dumping environnemental.
Enfin, face à des enjeux concernant l’ensemble de la planète, se met aussi en place une action publique mondiale.
En témoigne la création de groupes d’experts intergouvernementaux, tels que le Groupe international d’experts pour le
climat (GIEC) ou la Plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES), qui
produisent des états des lieux et scénarios quant à l’état de l’environnement mondial.
II- Comment lutter contre le changement climatique ?
Pour lutter contre les effets néfastes du changement climatique, les pouvoirs publics disposent de plusieurs
instruments : la réglementation, les mesures incitatives (la taxation et la subvention) et les marchés des quotas
d’émission. Chacun de ces outils possède des avantages et des limites.
Il existe également des négociations et des accords internationaux qui visent à la préservation de
l’environnement. Mais le climat est un bien commun, ce qui peut provoquer des stratégies de passager clandestin. En
outre, dans un contexte d’inégalités de développement entre pays, la question du développement durable n’est pas
nécessairement une priorité pour tous les Etats.
A. Les différents instruments des pouvoirs publics pour lutter contre les externalités négatives liées au changement
climatique
a. Le changement climatique souffre d’externalités négatives
Les externalités négatives surviennent lorsque les actions des agents économiques génèrent des conséquences
néfastes qui ne passent pas par le marché. Ainsi, celui qui est à l’origine d’une externalité négative n’est pas sanctionné par
le paiement d’une indemnité compensatoire. Par exemple, l’activité économique d’une usine provoque l’émission de
dioxyde de carbone (CO2) qui est très polluante puisqu’elle accélère le réchauffement climatique. Il s’agit d’une externalité
négative car, en l’absence d’intervention des pouvoirs publics, les responsables de la pollution ne sont pas sanctionnés.
Pour lutter contre les externalités négatives qui renforcent les changements climatiques, les pouvoirs publics
disposent de différents types d’instruments.
b. La réglementation
La réglementation pour lutter contre le changement climatique consiste à fixer une norme environnementale. Par
exemple, les constructeurs automobiles doivent respecter un seuil maximum d’émission de CO2. Dans l’Union
européenne, pour une voiture neuve, la norme sera fixée à 95 grammes de CO2/km au plus tard pour 2021.
La réglementation présente l’avantage de la simplicité : il suffit de voter une loi ou un décret pour la mettre en
place. Cet instrument bénéficie également de la longue expérience des pouvoirs publics en la matière et qui peut avoir été
menée avec succès dans d’autres domaines. Par exemple, c’est d’abord par la réglementation que l’Etat est parvenu à
réduire de façon très significative le nombre de morts sur la route. Enfin, en fixant une norme, la politique climatique
permet de connaître avec certitude le niveau de pollution qui sera atteint, et ainsi de respecter les seuils de dangerosité.
Dès lors, la norme est privilégiée en cas de menace grave et peut aller jusqu’à l’interdiction complète d’un produit ou d’un
procédé. Par exemple, contenu dans les appareils de réfrigération et les aérosols, le chlorofluorocarbure (CFC), un gaz très
nocif pour la couche d’Ozone, est interdit depuis 1987.
En revanche, la réglementation peut être à l’origine d’inconvénients. Tout d’abord, le niveau de pollution optimal
est très souvent difficile à connaître, ce qui rend difficile la définition d’une norme. Si la règle est trop faible, l’objectif
environnemental ne sera pas atteint. Si la norme est trop stricte, cela peut conduire à des stratégies de contournement.
Par exemple, les industries polluantes sont délocalisées dans des territoires qui ont des réglementations
environnementales plus souples. Cela est néfaste sur le plan climatique, le plan des emplois et de la croissance
économique.
De plus, une fois la norme fixée et respectée, les agents économiques ne sont plus incités à améliorer leur
comportement. Il « suffit » de respecter le seuil retenu.
Enfin, les effets bénéfiques de la norme peuvent être neutralisés par un effet volume ou effet rebond : la
pollution générée par la production ou consommation de chaque bien diminue mais la quantité de biens augmente, si bien
que la pollution totale ne diminue pas. Par exemple, lorsque la première norme d’émission de CO2 a été imposée aux
constructeurs automobiles, au début des années 1990, le parc automobile a fortement augmenté. Au bout du compte, une
nouvelle demande a conduit à l’augmentation totale de la pollution.
c. Les instruments incitatifs
Pour lutter contre les changements climatiques, les pouvoirs publics utilisent aussi des instruments incitatifs qui
visent à répondre directement aux externalités. Il s’agit d’internaliser les effets de l’action menée par un agent
économique : celui qui est vertueux c’est-à-dire qu’il favorise l’environnement – soit ici une externalité positive – sera
récompensé par une subvention ; en revanche, celui qui est responsable d’externalités négatives sera sanctionné par
une taxe. L’objectif n’est donc pas d’interdire mais d’encourager les activités bénéfiques pour l’environnement, par
exemple en subventionnant les innovations bas carbone et en pénalisant financièrement les activités polluantes par
exemple avec une taxe carbone. Il s’agit donc bien d’inciter les agents à modifier leurs comportements dans le sens d’un
plus grand respect du climat.
Ces instruments incitatifs sont plus souples que la réglementation, chacun pouvant faire le choix de moins polluer
ou pas en fonction de ses propres coûts de dépollution ou d’investissement. La taxe environnementale ou écotaxe génère
aussi l’avantage d’un double dividende : d’une part, elle entraîne une diminution de la pollution, c’est le principe du
« pollueur-payeur ». D’autre part, elle engendre de nouvelles recettes fiscales, ce qui peut par exemple conduire l’Etat à
baisser d’autres impôts. Mais cela peut aussi permettre aux pouvoirs publics de renforcer des mesures favorables au
climat.
Par exemple, la composante carbone de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) rapporte
sept milliards d’euros qui sont utilisés par l’Etat pour financer la transition énergétique et notamment les énergies
renouvelables comme l’éolien ou le photovoltaïque.
Cependant, les taxes environnementales peuvent être source d’inégalités économiques parmi les ménages,
puisque le poids du prélèvement augmente à mesure que diminue leur revenu. De même, toutes les entreprises n’ont pas
les mêmes moyens financiers d’absorption de la hausse des coûts générée par la taxe écologique. Enfin, comme pour la
réglementation, il n’est pas aisé de déterminer le niveau optimal des taxes environnementales : si elle est trop faible,
l’objectif climatique n’est pas atteint ; si elle est trop forte elle renforce les inégalités et peut provoquer des stratégies de
contournement comme la délocalisation. Si bien que certains pays utilisent le dumping environnemental pour attirer les
entreprises sur leur territoire et ainsi profiter des emplois créés.
d. Les marchés de quotas d’émission
Dernier instrument envisageable pour lutter contre le changement climatique : les marchés de quotas d’émission.
Ronald Coase (1910-2013) publie en 1960 The problem of social cost. Pour cet auteur, la redéfinition des droits de propriété
privée, notamment par l’institution de « droits d’émission » et la création d’un marché de ces droits, peut se substituer
avantageusement à l’établissement d’écotaxes.
Les pouvoirs publics distribuent aux entreprises des permis de polluer qui s’apparentent à des « droits à polluer »
qui existent en quantité limitée. Aussi, les entreprises vertueuses, qui parviennent à réduire leur pollution, peuvent
revendre les permis de polluer « économisés » aux entreprises qui polluent davantage. Il y a donc une incitation forte à
la dépollution : les gains obtenus sur le marché de quotas d’émission justifient en quelque sorte l’investissement dans une
technologie de production verte. En fait, chacune des entreprises présentes sur le marché des quotas d’émission peut faire
le choix de réduire ses émissions pour revendre une partie de ses quotas à d’autres entreprises ou bien continuer à polluer
et, si nécessaire, d’acheter des permis à polluer supplémentaires. Outre cette souplesse, cet instrument permet de fixer un
plafond de pollution, déterminé par la quantité totale de permis de polluer, et permet de répartir plus efficacement les
efforts en fonction des coûts de dépollution de chaque firme. En revanche, pour être parfaitement efficace, il faut que les
quotas d’émission soient bien répartis et distribués en quantité suffisamment faible. Par exemple, depuis 2005, il existe un
marché européen de quotas d’émission qui couvre près de 50% des émissions industrielles de l’Union européenne. Au
départ, le volume des quotas d’émission distribués s’est révélé trop important pour atteindre l’objectif environnemental.
Ce surplus de permis a entrainé une forte réduction du prix des quotas d’émissions, diminuant d’autant l’incitation à moins
polluer.
e. La complémentarité des types d’intervention
Si en théorie, il est possible de distinguer les trois instruments de la politique climatique, en pratique leur
complémentarité est indéniable.
D’une part, la réglementation est indispensable pour mettre en œuvre la taxation et le marché des quotas
d’émission. En effet, seuls les pouvoirs publics peuvent imposer et collecter des écotaxes aux agents économiques. De
même, les marchés de quotas d’émissions n’apparaissent pas spontanément mais sont institués par les pouvoirs publics.
D’autre part, la taxation écologique ne peut être efficace que si son niveau est adéquat. Or, seul le marché peut
fixer le prix de la pollution. La mise en place d’un marché des quotas d’émissions est donc indispensable pour indiquer aux
pouvoirs publics quel niveau de taxation est optimal.
B. Les négociations et accords internationaux sont contraints
La question du changement climatique est également discutée au niveau mondial. Le climat est en effet un bien
commun mondial. Les négociations et accords internationaux visent donc à réguler l’ensemble des pratiques qui
dégradent le climat.
a. Tragédie des biens communs et stratégie du passager clandestin
En 1968, le biologiste Garrett Hardin (1915-2003) a publié « La tragédie des communs ». Dans cet article, il explique
que les biens environnementaux sont des biens communs : placés en libre accès, on peut craindre une surexploitation des
ressources naturelles comme les pâturages ou les bancs de poisson. Puisque le climat est un bien commun mondial, il
relève de ce risque. Une gestion mondiale du climat est donc nécessaire, notamment pour empêcher les comportements
de passager clandestin que sont tentés d’adopter un certain nombre de pays. C'est-à-dire que ces Etats peuvent trouver un
intérêt à bénéficier des efforts fournis par la communauté internationale sans y prendre part. Pour autant, les
comportements de passager clandestin ne mettent pas nécessairement en danger les accords internationaux : malgré la
défection de certains pays, les autres États peuvent conserver un intérêt à coopérer pour lutter contre le changement
climatique. Par exemple, le protocole de Montréal signé en 1987 vise à l’interdiction mondiale des substances qui réduisent
la couche d’ozone, 191 pays l’ont adopté. Ce qui n’est pas la totalité du monde. Mais la couche d’ozone est aujourd’hui en
bien meilleur état qu’au milieu des années 1980.
b. Une autre contrainte : les inégalités de développement entre pays
L’action internationale pour le climat est également confrontée aux inégalités de développement entre pays. Les
pays riches réclament des efforts environnementaux que les pays en développement ne sont pas toujours enclins à fournir.
Pour se développer, depuis les Révolutions industrielles, les pays riches ont fait un usage immodéré des ressources
naturelles et sont restés longtemps les responsables de dégâts écologiques. Les pays pauvres estiment souvent qu’ils n’ont
pas aujourd’hui à être freinés dans leur processus d’émergence économique par des contraintes environnementales qui
n’étaient pas respectées hier par les pays riches. Si bien qu’il n’est pas toujours facile de leur faire signer des accords
internationaux qui visent à protéger le climat.
Conclusion : Du développement durable à la décroissance.
D’un point de vue théorique, les débats sur les formes du développement durable, qu’il s’agisse de la soutenabilité
faible ou forte, aboutissent à la nécessaire prise en compte d’une politique de décroissance. En effet, si le progrès
technique pose plus de problèmes qu’il n’apporte de solution et si la mise en place d’un principe de précaution est
indispensable, alors la croissance qui repose sur le progrès technique sera nécessairement freinée.
La décroissance, c’est-à-dire une diminution progressive du PIB, constitue actuellement la critique la plus radicale
du capitalisme. Elle conteste sa domination au même titre que le communisme a pu le faire au XXème siècle. Ses principes
sont ceux d’une réduction de la production, du temps de travail et de la consommation associée à un revenu universel
permettant à chacun de couvrir ses besoins vitaux.
Vous aimerez peut-être aussi
- Chapitre 1 Sources Defis CroissanceDocument6 pagesChapitre 1 Sources Defis CroissanceMorinPas encore d'évaluation
- Chapitre 8 Presentation Crises FinancieresDocument8 pagesChapitre 8 Presentation Crises FinancieresMorinPas encore d'évaluation
- Chapitre 3 Presentation Commerce InternationalDocument12 pagesChapitre 3 Presentation Commerce InternationalMorinPas encore d'évaluation
- Chapitre Ecole Destins IndividuelsDocument9 pagesChapitre Ecole Destins IndividuelsMorinPas encore d'évaluation
- Chapitre 8 Presentation Mobilite SocialeDocument11 pagesChapitre 8 Presentation Mobilite SocialeMorinPas encore d'évaluation