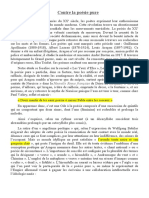Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
La Mort de de L'auteur Commentaire
La Mort de de L'auteur Commentaire
Transféré par
Bra khal0 évaluation0% ont trouvé ce document utile (0 vote)
37 vues4 pagesTitre original
La mort de de l'auteur commentaire
Copyright
© © All Rights Reserved
Formats disponibles
PDF ou lisez en ligne sur Scribd
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
© All Rights Reserved
Formats disponibles
Téléchargez comme PDF ou lisez en ligne sur Scribd
0 évaluation0% ont trouvé ce document utile (0 vote)
37 vues4 pagesLa Mort de de L'auteur Commentaire
La Mort de de L'auteur Commentaire
Transféré par
Bra khalDroits d'auteur :
© All Rights Reserved
Formats disponibles
Téléchargez comme PDF ou lisez en ligne sur Scribd
Vous êtes sur la page 1sur 4
Compte rendu critique de « La mort de auteur >
Roland Barthes, Manteia, n° 5, 1968.!
Introduction
Roland Barthes (1915-1980) est un critique littéraire et sémiologue francais. Ses
travaux portent principalement sur Ia linguistique, la sémiotique, la psychanalyse,
Fanthropologie et histoire des idées. En 1968, il proclame la « mort de auteur » dans
un article éponyme. Ainsi, aprés la mort de Dieu décrétée par Nietzsche”, puis la mort de
Thomme annoneée par Foucault’, la mort de auteur est l'un des demniers bastions de
Pautorité transcendante & tomber.
Dans «La mort de auteur», Barthes s'inserit en faux contre la critique
traditionnelle centrée sur la figure de Mauteur. Cette approche lansonienne congoit
Feuvre comme un espace propice a expression de la subjectivité auctoriale C'est
pourquoi elle privilégie la biographie, le contexte ainsi que la description des intentions
de l’auteur et de sa psychologie.
Dans ce qui suit, nous nous attacherons & montrer comment cette critique
transcendante, fondée sur l'intention et l'autorité de auteur, est contestée par Barthes,
equel Barthes préconise une critique immanente qui postule la « mort de l'auteur » et,
par voie de conséquence, le primat du texte, du lecteur et de linterprétation. Ces trois
postulats majeurs impliquent une nouvelle définition de I’écriture
1. Une nouvelle définition de ’écriture
Dans son article « La mort de l’auteur », Barthes propose une nouvelle définition
de I’écriture congue comme composition sans voix. Pour étayer son propos, il sappuie
sur une phrase tirée de la nouvelle Sarrasine de Balzac dont il interroge la source et
Porigine : qui parle ? qui écrit ? qui raconte ? qui dit le texte?
Le sémiologue frangais est persuadé qu’on ne peut trancher ces questions
fondatrices dans la mesure ot « Iécriture est destruction de toute voix, de toute origine.
* Varticlea été d’abord publié dans sa version anglaise dans la revue ameéricaine Aspen, no. 5-6 en 1967.
La version frangaise n'a été publiée que plus tard dans le magazine Mantela, no. 5, 1968.
2 ¢ Gott ist tot » est un apophtegme de Friedrich Nietzsche qui se trouve dans Le Goi Sovoir (1882) et Ansi
parlat Zorathoustra (1883). Cette formule nietzschéenne peut étre comprise comme un constat de la
déchristianisation, mats aussi comme une critique de a religosité.
> Michel Foucault, Les Mots et les choses, Paris, Galimard, 1966.
L’écriture, c'est ce neutre, ce composite, cet oblique oi fuit notre sujet, le noir-et-blane
ob vient se perdre toute identité, 4 commencer par celle-la méme du corps qui écrit ».
Pour Barthes done, I’écriture est un processus qui dissipe lidentité auctoriale.
Bien entenda, il faut entendre par-la l’écriture en tant que pratique « intransitive »,
autotélique, cest-i-dire Mécriture prise dans sa dimension symbolique. En d'autres
termes, I’écriture ne prendrait corps que sur le cadavre de I'auteur (pp. 60-61). Barthes
rappelle d’ailleurs que la notion d’« auteur» est une notion modeme qui ne s‘est
développée que depuis la fin du Moyen Age, avec l’idéologie capitaliste ambiante et le
positivisme naissant.
2. De empire de auteur
empire du langage
Certains écrivains ont essayé de rompre avec cette tradition qui privilégie auteur
au détriment du lecteur. Ai
i, pour Mallarmé, « c'est le langage qui parle, ce n'est pas
Fauteur ». De son cété, Valéry revendique la « condition essentiellement verbale de la
littérature ». Selon lui, Mécriture ne serait qu'une activité linguistique « hasardeuse ».
Pour sa part, Proust remet en question le rapport écrivain/personnage. Le narrateur chez
lui nest pas celui qui écrit, mais celui qui veut écrire : le roman sachéve lorsque le
narrateur parvient a écrire. Par ce tour de force, Proust renverse radicalement le rapport
entre l'aeuvre et la vie: i ne met pas sa vie dans le roman, il fait de sa vie une ceuvre dart
dont la Recherche* est le modéle.
Les surréalistes ont eux aussi participé & la désacralisation de l'auteur, et ce, en
utilisant des techniques subversives : saccade de mots, automatisme, écriture & plusieurs,
cadavre exquis®, etc.
Enfin la linguistique n’est pas en reste. Elle postule que l’énonciation est un
«processus vide », que son fonctionnement ne repose pas nécessairement sur des
personnes. En d’autres termes, le langage s’articule autour d’un « sujet », non dune
personne, Ce « sujet » est vide en dehors de I’énoneiation qui le définit.
Avee Brecht, auteur va quasiment disparattre. Cette dissolution de instance
auctoriale (Barthes parle d’« éloignement », « distancement ») détermine l’essence méme
du texte moderne. Ce changement de paradigme a eu deux conséquences. La premitre
“Ala recherche du temps perdu est un roman de Marcel Proust, écrit de 1906 8 1922, en sept tomes
Cette ceuvre romanesque magistrale est une réflexion psychologique sur la littérature, sur la mémoire et
sur le temps.
§ Jeu lttéraire invente par les surréalistes (1925) : chaque participant écrit tour de rdle une partie d'une
phrase, dans ordre S-V-C, sans savoir ce que le précédent @ écrit. La premigre phrase qui en résulta
fut :« Le cadavre exquis boira le vin nouveau ».
2
réside dans le changement de la conception du temps. « Le scripteur moderne nait en
méme temps que son texte ». Le rapport d’antéeédence n’existe plus, L’auteur « n'est en
rien le sujet dont son livre serait le prédicat ». Il n’y a d’autre temps que celui de
lénonciation, Le texte s’écrit dans le hic et nunc de son énonciation®. De 1a découle la
seconde conséquence. L’écriture devient un acte performatif d'inscription (et non
expression) qui n’a d’autre origine que le langage lui-méme (contrairement 2 la
conception classique qui fait de I’écriture une activité expressive d’« enregistrement », de
« représentation » et de « peinture »).
3. Le texte : un espace 4 dimensions multiples
Le texte est un réceptacle d’écritures variges dont aucune n’est originelle. C’est un
tissu de citations : Bouvard et Pécuchet’ révélent la nature de I’écriture comme imitation
de textes antérieurs et comme acte de mixage de textes. Le texte est un dictionnaire, voire
une encyclopédie intériorisée, un tissu de signes qui s’expliquent par d'autres signes.
L’auteur n’a désormais plus lieu d’étre. Il a cédé la place un scripteur dépourvu
de « passions, humeurs, sentiments, impressions ». Un scripteur qui puise son écriture
dans un immense dictionnaire tout composé.
4, Lire-déméler au lieu de lire-déchiffrer
Barthes congoit donc Mécriture comme activité plurielle. Pour lui, le texte est un
tissu. C’est pourquoi il préconise une lecture soucieuse de « déméler » ce réseau de fils
au lieu de chercher vainement & en « déchiffrer » le sens. En effet, 'ombre de l’auteur
une fois estompée, « déchiffrer » devient un acte superflu. Déchifirer au sens d’expliquer
le texte par l’auteur, ce qui revient a fermer I’écriture, a en imposer une seule lecture.
Cette démarche d inspiration traditionnelle convient a la critique d’obédience beuvienne
qui s’efforce de découvrir l’auteur sous I’ceuvre
En revanche, «déméler > le texte, c'est parcourir l’espace de M’écriture sans
chercher a en percer le sens. Car I’écriture implique un sens et, ipso facto, !’évacuation
de ce sens. Déméler le texte repose done sur I’évanescence du sens. Cette conception de
V’écriture comme pratique multiple refusant d’imposer un sens unique permet de libérer
la littérature de ces carcans que sont la raison, la science, 1a loi.
5. La lecture en tant que véritable lieu de I’éeriture
L’essence de I’écriture réside dans le dialogue entre les ceuvres. Autrement dit, le
texte est ancré dans Iintertexte. Cette origine multiple se concentre en un lieu unique : Ie
Lici et maintenant de son énonciation.
> Ce roman éponyme de Gustave Flaubert fut publié en 1881 & titre posthume.
lecteur. Le péle lectoral est donc le lieu d’unité du texte congu comme intertexte. Par voie
de conséquence, l’unité du texte ne provient pas de son origine, mais de sa destination :
Je lecteur en tant qu’entité impersonnelle dépourvue d’histoire, de biographie, de
psychologie. Or la critique traditionnelle a toujours négligé le rOle qui échoit au lecteur.
Liavenir de Iécriture dépend done du lecteur, dont la naissance implique la mort
de l’auteur : « La naissance du lecteur doit se payer de la mort de auteur ».
Conclusion
En proclamant la «mort de auteur», Barthes rejette la critique transcendante
4 inspiration lansonienne. En lieu et place, il préconise une critique immanente centrée
sur le texte et le lecteur. Dans cette perspective, Michel Foucault ne tardera pas, lui aussi,
4 régler son sort 4 l’auteur dans une conférence donnée en 1969 sous le titre « Qu’est-ce
qu’un auteur ? »*
Néanmoins, convenons que ce postulat de l’effacement de I’auteur, fondé sur la
doxa du lecteur-créateur héritée de la doctrine structuraliste, a été remis en question par
Barthes lui-méme, notamment dans Le Plaisir du texte oii le sémiologue francais semble
réhabiliter la figure de l’auteur : « Mais dans le texte, d’une certaine fagon, je désire
auteur :j’ai besoin de sa figure (qui n’est ni sa représentation, ni sa projection) comme
il a besoin de la mienne »°. Bien entendu, l'auteur dont il sagit ici ne renvoie pas &
individu réel doté dun état civil, mais a image d’auteur que le lecteur construit & partir
du texte, loin des référents extratextuels.
* Michel Foucault, « Qu'est-ce qu'un auteur ? » (1968), Dits et Ecrits 1954-1969, t, Paris, Gallimard, 2001.
Roland Barthes, Le Plaisir du texte, Paris, Sev, 1973, pp. 45-86,
4
Vous aimerez peut-être aussi
- RDH 2020 Synthese VF 0Document62 pagesRDH 2020 Synthese VF 0Bra khalPas encore d'évaluation
- Mondo 1Document3 pagesMondo 1Bra khalPas encore d'évaluation
- Pour Un Chant NationalDocument2 pagesPour Un Chant NationalBra khalPas encore d'évaluation
- HELIBDocument1 pageHELIBBra khalPas encore d'évaluation
- Contre La Poésie PureDocument2 pagesContre La Poésie PureBra khalPas encore d'évaluation
- Contre La Poésie PureDocument2 pagesContre La Poésie PureBra khalPas encore d'évaluation
- AdjectifDocument47 pagesAdjectifBra khalPas encore d'évaluation
- Le Chronotope D'un Barrage Contre Le Pacifique de Marguerite Duras21323Document11 pagesLe Chronotope D'un Barrage Contre Le Pacifique de Marguerite Duras21323Bra khalPas encore d'évaluation
- Mondo Est Un Garçon Qui Vit en Marge de La VilleDocument1 pageMondo Est Un Garçon Qui Vit en Marge de La VilleBra khalPas encore d'évaluation
- Présentations Du Recueil Les Yeux D'elsaDocument9 pagesPrésentations Du Recueil Les Yeux D'elsaBra khalPas encore d'évaluation
- Marguerite DURAS, Un Barrage Contre Le Pacifique, Une Mère Exemplaire (Commentaire Composé)Document4 pagesMarguerite DURAS, Un Barrage Contre Le Pacifique, Une Mère Exemplaire (Commentaire Composé)Bra khalPas encore d'évaluation
- DRISS CHRAÏBI, UNE ÉCRITURE DE TRAVERSE Stéphanie DelayreDocument7 pagesDRISS CHRAÏBI, UNE ÉCRITURE DE TRAVERSE Stéphanie DelayreBra khalPas encore d'évaluation
- La Boîte À Merveilles de Séfrioui La Dimension EthnographiqueDocument7 pagesLa Boîte À Merveilles de Séfrioui La Dimension EthnographiqueBra khalPas encore d'évaluation