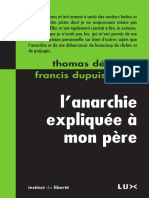Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
La Famille
La Famille
Transféré par
fherremansCopyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
La Famille
La Famille
Transféré par
fherremansDroits d'auteur :
Formats disponibles
Pierre Brchon
Professeur de science politique, directeur honoraire de lInstitut dtudes politiques de Grenoble
(1976)
La famille
Ides traditionnelles, ides nouvelles.
Un document produit en version numrique par Rjeanne Toussaint, ouvrire bnvole, Chomedey, Ville Laval, Qubec Courriel: rtoussaint@aei.ca Dans le cadre de la collection: "Les classiques des sciences sociales" Site web: http://www.uqac.ca/Classiques_des_sciences_sociales/ Une collection dveloppe en collaboration avec la Bibliothque Paul-mile-Boulet de l'Universit du Qubec Chicoutimi Site web: http://bibliotheque.uqac.uquebec.ca/index.htm
Pierre Brchon, La famille. Ides traditionnelles, ides nouvelles. (1976)
Politique d'utilisation de la bibliothque des Classiques
Toute reproduction et rediffusion de nos fichiers est interdite, mme avec la mention de leur provenance, sans lautorisation formelle, crite, du fondateur des Classiques des sciences sociales, Jean-Marie Tremblay, sociologue. Les fichiers des Classiques des sciences sociales ne peuvent sans autorisation formelle: - tre hbergs (en fichier ou page web, en totalit ou en partie) sur un serveur autre que celui des Classiques. - servir de base de travail un autre fichier modifi ensuite par tout autre moyen (couleur, police, mise en page, extraits, support, etc...), Les fichiers (.html, .doc, .pdf, .rtf, .jpg, .gif) disponibles sur le site Les Classiques des sciences sociales sont la proprit des Classiques des sciences sociales, un organisme but non lucratif compos exclusivement de bnvoles. Ils sont disponibles pour une utilisation intellectuelle et personnelle et, en aucun cas, commerciale. Toute utilisation des fins commerciales des fichiers sur ce site est strictement interdite et toute rediffusion est galement strictement interdite. L'accs notre travail est libre et gratuit tous les utilisateurs. C'est notre mission. Jean-Marie Tremblay, sociologue Fondateur et Prsident-directeur gnral, LES CLASSIQUES DES SCIENCES SOCIALES.
Pierre Brchon, La famille. Ides traditionnelles, ides nouvelles. (1976)
Cette dition lectronique a t ralise par Rjeanne Toussaint, bnvole,
Courriel: rtoussaint@aei.ca
partir de :
Pierre Brchon Professeur de science politique, directeur honoraire de lInstitut dtudes politiques de Grenoble LA FAMILLE. Ides traditionnelles, ides nouvelles. Paris : Les ditions Le Centurion, 1976, 197 pp. Collection : Socioguides, no 13.
[Autorisation formelle accorde par lauteur le 18 fvrier 2011 de diffuser ce livre dans Les Classiques des sciences sociales.] Courriel : pierre.brechon@iep-grenoble.fr
Polices de caractres utilise : Comic Sans, 12 points. dition lectronique ralise avec le traitement de textes Microsoft Word 2008 pour Macintosh. Mise en page sur papier format : LETTRE US, 8.5 x 11 dition numrique ralise le 18 octobre 2011 Chicoutimi, Ville de Saguenay, Qubec.
Pierre Brchon, La famille. Ides traditionnelles, ides nouvelles. (1976)
Professeur de science politique, directeur honoraire de lInstitut dtudes politiques de Grenoble
Pierre Brchon
LA FAMILLE. Ides traditionnelles, ides nouvelles..
Paris : Les ditions Le Centurion, 1976, 197 pp. Collection : Socioguides, no 13.
Pierre Brchon, La famille. Ides traditionnelles, ides nouvelles. (1976)
[195]
Table des matires
Quatrime de couverture Avant-propos
Premire partie FAMILLE, TRADITIONALISME ET CONSERVATISME SOCIAL Chapitre 1. Les ides traditionalistes au XIXe sicle
L'ingalit, principe de la famille et de la socit La socit politique et l'glise, l'image de la famille Garantir l'autorit du pre Famille saine, socit saine Chapitre 2. La rpartition ingalitaire des rles familiaux
Chez les traditionalistes : la soumission de la femme Dans l'glise catholique : le modle de la Sainte Famille La famille dans l'opinion publique aujourd'hui Rles diffrencis selon le sexe et famille double carrire Chapitre 3. La famille, cellule de base de la socit : prsence du traditionalisme aujourd'hui
La conception catholique La famille chez les hommes politiques conservateurs La famille havre de paix
Pierre Brchon, La famille. Ides traditionnelles, ides nouvelles. (1976)
Deuxime partie MARXISME ET FAMILLE Chapitre 4. Les thoriciens marxistes
La pense de Marx et d'Engels La pense de Bebel et Lnine La pense de B. Muldworf Chapitre 5. Trois exemples significatifs
Le parti communiste franais Le mouvement de libration des femmes La famille en Chine populaire Troisime partie ANARCHISME ET FAMILLE Chapitre 6. Les thoriciens du XIXe sicle
Godwin et Proudhon Charles Fourier Emile Henry James Guillaume Les partisans du divorce et de l'union libre Chapitre 7. A L'anarchisme familial aujourdhui
Wilhehm Reich Sexualit et culture : l'opposition entre Freud et Reich Rvolution sociale et rvolution sexuelle Les fonctions de la famille et du mariage monogame Famille autoritaire et monte du fascisme
Herbert Marcuse Le tract du docteur Carpentier Trois contestations actuelles du mariage et de la famille Relations prnuptiales et union libre Les communauts
Pierre Brchon, La famille. Ides traditionnelles, ides nouvelles. (1976)
Quatrime partie PERSONNALISME ET FAMILLE Chapitre 8. La rconciliation entre amour et institution
Emmanuel Mounier Gabriel Madinier et Gabriel Marcel Jean Lacroix Chapitre 9. Personnalisme et familles aujourd'hui
L'volution de la conception catholique du mariage, du couple et de la famille Amour et institution familiale aujourd'hui Pour un personnalisme renouvel : Franois Chirpaz La famille, une structure ouverte
CONCLUSION
* **
Annexe. Considrations prospectives sur l'avenir de la famille
Pierre Brchon, La famille. Ides traditionnelles, ides nouvelles. (1976)
LA FAMILLE. Ides traditionnelles, ides nouvelles.
Quatrime de couverture
Retour la table des matires
Les changements de murs et de socit touchent profondment l'institution familiale. Les ides sur le mariage, le couple, la femme, l'ducation, mais aussi beaucoup d'aspects de la vie conomique, sociale et politique sont en cause dans cette volution. Et la famille ne laisse personne indiffrent. On en parle beaucoup aujourd'hui, pour la dfendre ou la critiquer, pour la sacraliser ou la dmythiser. Parler de la famille n'est jamais neutre. On en parle de manire diffrente suivant les courants de pense dont on est marqu, parfois sans le savoir. Pierre Brchon clarifie nos discussions actuelles sur la famille en exposant successivement et en confrontant ces grands courants dont elles dpendent : traditionalisme, marxisme, anarchisme, personnalisme. Les ides sur la famille que l'on croit nouvelles ont des racines plus anciennes, les ides reconnues d'habitude pour traditionnelles continuent d'imprgner la pense et la pratique. Ce livre montre comment ces courants opposs sont prsents chez les penseurs contemporains et servent de base des politiques familiales. On les trouve, plus qu'en filigrane, dans les prises de position politiques ou simplement dans la diversit de l'opinion publique. Plus profondment encore ils jouent un
Pierre Brchon, La famille. Ides traditionnelles, ides nouvelles. (1976)
rle important dans nos ractions et prises de position les plus quotidiennes. Ce livre important servira d'instrument de travail et de rflexion pour tous ceux - travailleurs sociaux, responsables, tudiants... - qui veulent comprendre la ralit familiale d'aujourd'hui et ses problmes, tant pour des raisons personnelles que pour des proccupations professionnelles. Pierre Brchon, n en 1947 Grenoble, mari, diplm dtudes Suprieures en Sciences Politiques, est charg d'enseignement l'Institut d'tudes Politiques de Grenoble et collabore avec le Centre thologique de Meylan dont la qualit des recherches interdisciplinaires est largement reconnue. Il a entrepris successivement des recherches systmatiques sur l'idologie familiale dans le Parti Communiste Franais puis dans l'glise catholique.
Pierre Brchon, La famille. Ides traditionnelles, ides nouvelles. (1976)
10
[5]
Marie-Hlne
Nous n'irons pas au but un par un mais par deux Nous connaissant par deux nous nous connatrons tous Nous nous aimerons tous et nos enfants riront De la lgende noire o pleure un solitaire.
Paul Eluard.
Pierre Brchon, La famille. Ides traditionnelles, ides nouvelles. (1976)
11
[7]
LA FAMILLE. Ides traditionnelles, ides nouvelles.
AVANT-PROPOS
Retour la table des matires
une poque o l'on parle de crise de la famille, o l'on entend parfois reprendre la formule clbre de Gide Familles, je vous hais 1 , comment les Franais peroivent-ils la famille ? La considrent-ils comme une ralit dpasse ou au contraire estiment-ils qu'elle est le lieu du bonheur et de l'panouissement des individus ? De fait la famille est fortement valorise par l'opinion publique. Dans une enqute ralise sur l'agglomration grenobloise 2 , la question : Pour vous, qu'est-ce que la famille ? , 80% des interviews rpondaient par une apprciation nettement positive sur la ralit familiale. Certaines formules employes taient trs laudatives : la famille, c'est tout dans la vie , c'est ce qu'il y a de plus beau , c'est le seul moyen de vivre , cest la seule chose qui compte .
1
Notons d'ailleurs que la vritable formule de Gide est : Familles, je vous hais ! foyers clos ; portes refermes ; possessions jalouses du bonheur , dans Les nourritures terrestres, p. 74. Enqute ralise en 1971 par un groupe d'tudiants de l'Institut dtudes Politiques de Grenoble, sous la direction de Jacqueline Freyssinet et Pierre Kukawka, la demande de l'Union dpartementale des Associations Familiales. Les commentaires et citations faits ici sont tirs du rapport d'enqute.
Pierre Brchon, La famille. Ides traditionnelles, ides nouvelles. (1976)
12
L'enqute sur la famille lance en mars 1972 par l'hebdomadaire La Vie Catholique 3 , en lien avec lI.F.O.P., apporte des conclusions semblables. [8] 130 000 rponses aux 2 questionnaires sont parvenues au journal, accompagnes de 6 000 lettres de lecteurs. Ce nombre constitue un record absolu par rapport toutes les enqutes lances en France par un organe de presse. Ceci montre l'cho qu'ont les problmes familiaux dans l'opinion publique. La publication des rsultats fin 1972 montrait que, si la famine volue, dans un monde lui-mme en changement, elle continue se porter - somme toute - assez bien. Les Franais continuent lui faire confiance. D'aprs ces enqutes, la famille apparat donc comme une ralit largement admise et elle est mme considre comme une valeur, un moyen de se raliser et d'tre heureux. S'il y a aujourd'hui des contestations de la famille, elles ne sont le fait que d'une portion limite de la population. D'ailleurs le mariage, institution qui cre lgalement la famille, est toujours beaucoup pratiqu en France. 92 % des Franaises se marient. Ce pourcentage parat assez stable depuis plusieurs annes 4 . La situation franaise est trs diffrente de celle de la Sude o le nombre des mariages est pass de 61 000 en 1966 41 000 en 1971, tandis que le nombre des naissances extra-matrimoniales passait de 12 000 en 1961 25 000 en 1971. L'union libre y progresse beaucoup, ce qui n'est pas le cas dans notre pays.
Cette enqute n'tait pas faite seulement pour mieux connatre l'opinion des Franais sur la famille mais aussi pour susciter un profond mouvement d'opinion et de rflexion sur la famille (extrait d'un tract de lancement de l'enqute, encart dans l'hebdomadaire). C'est pourquoi huit rencontres rgionales furent organises au printemps 73 dans diffrentes villes franaises et une rencontre nationale Les tats gnraux de la famille runirent pendant deux jours, en fvrier 74 Paris, des spcialistes des sciences humaines, des hommes politiques et des personnalits religieuses venus s'exprimer sur les problmes familiaux devant un public fourni. Les rsultats de cette enqute ont t publis par P. VILLAIN, 130 000 familles prennent la parole, Cerf, 1973. Cependant le nombre annuel des mariages commence diminuer (416 000 en 1972, 400 000 en 73, 390 000 en 74) et le nombre des naissances illgitimes augmente lentement (65 000 en 1973).
Pierre Brchon, La famille. Ides traditionnelles, ides nouvelles. (1976)
13
Si on conteste peu la famille, on parle beaucoup aujourd'hui des ralits familiales, directement ou indirectement. Cest un sujet qui passionne. Les problmes du divorce, de la contraception et de l'avortement, de la place de la femme dans la socit, de l'ducation sexuelle et de l'abaissement de l'ge de la majorit, ont t rcemment des points chauds de l'actualit. Toute loi nouvelle, touchant de prs ou de loin l'institution familiale, est loccasion de prises de positions nombreuses dans l'opinion. A travers les ides dbattues, on peut voir se profiler des conceptions diffrentes de la famille. Ainsi, si l'on pense qu'admettre le divorce par consentement mutuel anantit la famille, c'est au nom d'une conception de la famille structure indissoluble ; l'indissolubilit est alors considre comme un lment ncessaire de la dfinition de la famille. De mme, les positions que l'on prend en matire d'ducation sexuelle montrent la conception que l'on a des rapports parents-enfants. Cet engouement pour les problmes de la famille a-t-il toujours exist ou est-il un phnomne rcent ? Je me rfrerai en la matire au livre classique [9] de Philippe Aris, L'enfant et la vie familiale sous l'Ancien Rgime 5 qui fait autorit et dmolit allgrement quelques ides toutes faites. Nous croyons gnralement assez spontanment que la famille a toujours t un des lieux fondamentaux de la structuration des individus, comme si elle avait toujours t elle-mme une ralit trs consistante. Or Ph. Aris nous montre que la structure familiale sous lAncien Rgime avait beaucoup moins d'importance que de nos jours. Certes on naissait dans une famille qui donnait un nom et prdestinait dans une certaine mesure l'avenir de l'individu. Mais les enfants quittaient trs vite leur famille pour l'apprentissage chez un matre, dans une autre famille. Parfois on ne connaissait pas l'existence de ses frres et surs. La mort d'un enfant n'apparaissait pas aux parents aussi dramatique qu'aujourd'hui ; car l'enfant n'tait pas valoris comme il l'est actuellement. Ce n'tait ni l'cole ni la famille qui assuraient l'ducation de l'enfant ; celle-ci se faisait plutt sur le tas , au cours de l'apprentissage d'un mtier, dans une famille o l'enfant ne se distinguait pas d'un serviteur ou d'un domestique. Les
Seuil, 1960, rdit en 1973, 503 p.
Pierre Brchon, La famille. Ides traditionnelles, ides nouvelles. (1976)
14
familles duraient peu, tant donn la forte mortalit 6 . Si la vie familiale existait au Moyen Age elle subsistait dans le silence, elle n'veillait pas un sentiment assez fort pour inspirer pote ou artiste 7 . Aris explique ce phnomne : La vie d'autrefois, jusqu'au XVIIe sicle, se passait en public (...) la densit sociale ne laissait pas de place la famille 8 . Ce n'est que trs progressivement, partir du XVIe sicle, que le sentiment de la famille va se former paralllement la monte du sentiment de l'enfance. L'enfant sera choy ; objet d'affection, on se souciera de plus en plus de son ducation, il devient le centre de la vie familiale, vie familiale qui s'toffe et devient plus intime. La famille prouve le besoin de se retirer du monde , la maison devient un lieu familial alors qu'elle tait pratiquement auparavant un lieu public : dans la mme pice de la maison, on mangeait, on dormait et on recevait les clients . Les ftes collectives deviennent progressivement des ftes familiales. Ce sentiment de la famille qui devient trs fort au XVIIIe sicle, surtout chez les nobles et les bourgeois, concerne la famille conjugale et non pas la famille largie, runissant sous le mme toit plusieurs gnrations. Cette famille, ou sinon la famille elle-mme, du moins l'ide qu'on s'en faisait quand on voulait la reprsenter et l'exalter, parat tout fait semblable [10] la ntre 9 . Elle est construite sur le triangle pre, mre, enfant. Certains traditionalistes qui, au XIXe sicle et encore aujourd'hui, regrettent la mort de la famille patriarcale et de la famille souche 10 , regrettent en fait la mort d'un mythe qui n'a jamais correspondu une ralit de faon durable en France. La thse d'Aris sur la quasi-inexistence sociale de la famille largie
6 7 8 9 10
Lesprance moyenne de vie tait de 25 ans au XVIIe sicle. Sur 100 naissances, 25 personnes seulement atteignaient l'ge de 45 ans. Ph. ARIS, op. cit., p. 406. Ph. ARIS, op. cit., p. 460. Ph. ARIS, op. cit., p. 407. Ils appellent famille patriarcale une famille o plusieurs enfants maris continuent habiter avec leurs parents. On a donc trois gnrations sous le mme toit. La famille souche est un peu plus rduite. Un seul des enfants maris cohabite avec ses parents et ses frres et surs non maris.
Pierre Brchon, La famille. Ides traditionnelles, ides nouvelles. (1976)
15
est aujourd'hui confirme par de nombreuses monographies 11 et ne peut srieusement tre conteste. Ce n'est que dans les classes aises de la noblesse que l'on a vu, au Moyen ge, certaines poques de troubles o l'tat tait spcialement faible, la famille s'largir plus de deux gnrations. Les idologies traditionalistes constituent le premier systme de pense qui ait insist sur la ralit familiale. Et ceci se comprend. On ne pouvait pas rflchir sur la famille tant qu'elle n'avait pas une consistance propre, tant qu'elle ne constituait pas un lieu important de structuration des individus, tant qu'elle n'tait pas un tissu dense de relations affectives. Ainsi les penseurs catholiques, depuis une poque trs ancienne, dveloppent une conception du mariage, indissoluble et monogame, ayant pour finalit la procration ; on trouve aussi chez eux une certaine suspicion l'gard de la sexualit et des passions, notamment de l'amour, mais pas de pense structure et cohrente sur la ralit familiale. Ce n'est qu'au XIXe sicle que les papes parleront de la famille, dgageant une sorte de modle de famille promouvoir, modle de famille qui doit beaucoup celui que dsiraient les traditionalistes. D'autres courants de pense, notamment l'anarchisme et le marxisme, s'opposeront la pense traditionaliste et catholique. Le XIXe sicle sera ainsi une poque de lutte idologique autour des questions familiales : conception de l'institution familiale, conception du couple, option pour ou contre l'autorisation du divorce. Ces dbats ne sont pas morts mme s'ils se prsentent d'une faon nouvelle. Il faudra tudier les diffrentes thses en prsence au XIXe sicle et voir leurs prolongements aujourd'hui. Si l'on veut saisir les ides modernes sur la famille, il convient de savoir d'o nous venons, il faut rappeler les thories chronologiquement plus anciennes mais qui continuent marquer notre poque. [11] C'est pourquoi, aprs une premire partie consacre aux thories conservatrices de la famille, nous aborderons dans les deux parties
11
Voir le numro spcial de la revue Annales, Famille et socit , juilletoctobre 1972, n 4-5, 435 p.
Pierre Brchon, La famille. Ides traditionnelles, ides nouvelles. (1976)
16
suivantes les systmes de pense qui ont contest le traditionalisme familial, savoir le marxisme et l'anarchisme. Dans une dernire partie nous traiterons d'un courant de pense plus rcent, le personnalisme, souvent anim par des philosophes chrtiens. Dans chacune de ces parties, nous ne nous contenterons pas de rapporter la pense des auteurs les plus reprsentatifs. Nous chercherons saisir en quoi ces thses sont encore actuelles et dans quelle mesure elles sont encore dfendues par des organisations, des partis politiques, des associations diverses ou tout simplement vhicules par l'opinion publique. Ainsi nous naviguerons entre le pass et le prsent, entre les thories rationalises, les programmes d'action et les idologies latentes. Ce livre se veut avant tout informatif. Au risque d'tre lassant, nous avons cherch largir au maximum le champ d'investigation, classer dans quelques grands courants de pense le plus possible d'opinions familiales, exprimes par les personnes et les groupes les plus divers. C'est donc un instrument de travail qui vous est propos ; j'espre qu'il suscitera vos propres rflexions.
Pierre Brchon, La famille. Ides traditionnelles, ides nouvelles. (1976)
17
[13]
LA FAMILLE. Ides traditionnelles, ides nouvelles.
Premire partie
Famille, traditionalisme et conservatisme social
Retour la table des matires
Pierre Brchon, La famille. Ides traditionnelles, ides nouvelles. (1976)
18
[14]
Les ides familiales des traditionalistes sont trs lies des projets politiques conservateurs. Comme nous le verrons pour tous les courants de pense analyss dans ce livre, les ides familiales ne sont jamais des en soi . Elles s'intgrent toujours dans un systme de pense, elles sont toujours dpendantes d'une conception de la socit. Le premier chapitre analysera prcisment les conceptions familiales des traditionalistes du XIXe sicle en lien avec leur conception de la socit. Nous pourrons alors aborder dans un deuxime temps leur perception de la rpartition des rles au sein de la famille. Cette conception des rles du pre et de la mre a t reprise pendant trs longtemps dans les documents officiels de l'glise catholique et les mentalits contemporaines en sont encore imprgnes. Enfin le troisime chapitre fera s'interroger sur la postrit du traditionalisme aujourd'hui. Au terme de ce parcours , il devrait tre possible de mieux comprendre combien l'idologie traditionaliste a marqu et marque encore notre culture.
Pierre Brchon, La famille. Ides traditionnelles, ides nouvelles. (1976)
19
[15]
Premire partie. Famille, traditionalisme et conservatisme social
LA FAMILLE. Ides traditionnelles, ides nouvelles.
Chapitre 1
Les ides traditionalistes au XIXe sicle
Retour la table des matires
Le traditionalisme au XIXe sicle est reprsentatif d'une ide de la famille qui se manifeste jusqu' notre poque. Pour le comprendre, il faut le replacer dans son contexte politique : 1789, la Rvolution franaise, la dclaration des droits de l'homme et du citoyen, la chute des anciennes classes dirigeantes et l'essor de la bourgeoisie, la refonte de la lgislation et de l'administration, des rvolutionnaires anticlricalistes, une glise anti-rvolutionnaire. Les traditionalistes sont des anti-rvolutionnaires qui voient, dans les ides des philosophes des lumires et des encyclopdistes du XVIIIe sicle, la cause principale de la dgradation sociale et de la Rvolution franaise. Deux auteurs ont domin le courant traditionaliste au dbut du XIXe sicle : Joseph de Maistre (1753-1821) et Louis de Bonald (1754-1840). Ils s'en prennent tout spcialement J.J. Rousseau en qui ils voient le principal reprsentant de la philosophie des lumires. Rousseau croit l'galit naturelle des hommes ; pour lui le pouvoir doit maner du peuple souverain, la socit se forme par le contrat social, c'est--dire l'abandon
Pierre Brchon, La famille. Ides traditionnelles, ides nouvelles. (1976)
20
par les hommes de leurs intrts particuliers, l'acceptation de la volont et de l'intrt gnral. Mais pour Rousseau l'individu en socit reste libre : certes, par le pacte social, il passe d'un tat d'indpendance un statut dpendant, il devient citoyen et sujet , acteur politique soumis au pouvoir du peuple souverain. Mais l'tat doit respecter les droits de l'individu. Cette ide de Rousseau se concrtisera dans la dclaration des droits de l'homme et du citoyen. [16]
L'ingalit, principe de la famille et de la socit.
Retour la table des matires
Pour les traditionalistes au contraire, les hommes naissent ingaux. Pour de Bonald, tout pouvoir vient de Dieu ; c'est faire preuve d'esprit anti-religieux que de penser que le pouvoir sa source dans le contrat social, dans l'entente des individus. Les traditionalistes ne pouvaient admettre cette ddivinisation de la source du pouvoir. De plus, selon de Bonald, en parlant des droits des personnes gales Rousseau aurait favoris les ambitions des hommes, leur rvolte, leur individualisme 12 , l'anarchie dans la socit. Pour de Bonald, les hommes en socit, les sujets n'ont que des devoirs l'gard du pouvoir. Faire une dclaration des droits de l'homme et du citoyen est donc une absurdit. Alors que les rvolutionnaires dfendent les droits de l'individu, les traditionalistes veulent affirmer les droits naturels de la famille. Ils sont en fait des royalistes, des partisans des privilges ; ils prchent le retour l'Ancien Rgime, seul tat capable de maintenir et de conserver la socit dans son ordre naturel, c'est--dire parfait. L encore Rousseau et de Bonald s'opposent. Pour Rousseau, l'tat de nature est un tat d'origine, un tat de parfaite harmonie originelle en-
12
Les traditionalistes opposent souvent l'individualisme rvolutionnaire leur dfense de la famille. On peut estimer que leur vision de l'histoire est fausse : aux XIXe et XXe sicles, la famille est plus solide que dans les sicles prcdents. Elle n'a pas t anantie par lindividualisme.
Pierre Brchon, La famille. Ides traditionnelles, ides nouvelles. (1976)
21
tre l'homme et la nature ; tous les besoins de l'individu, tre indpendant, isol, sont combls par la nature. Pour de Bonald, au contraire, l'tat naissant, l'tat natif est imparfait, il est perfectible. L'tat naturel n'est pas l'tat d'origine, c'est l'tat rendu parfait par la vie en socit, c'est l'tat de vie selon l'ordre des lois fondamentales qui s'imposent l'homme. Les uvres de de Bonald visent prcisment rvler aux hommes obnubils par les ides rvolutionnaires l'ordre naturel des socits qui vient dtre ananti par la Rvolution franaise. Considrons d'un peu plus prs ces thories.
De Bonald part de l'ide de socit qu'il dfinit comme la runion des
tres semblables pour la fin de leur reproduction et de leur conservation 13 . Cette dfinition mrite commentaire. En parlant de runion des tres semblables, de Bonald s'oppose Rousseau pour qui les hommes sont gaux. Des tres semblables appartiennent tous l'humanit mais ne sont pas gaux
puisqu'ils ont dans la socit des fonctions diffrentes 14 . Pour l'auteur, une ingalit de fonction est identiquement une ingalit de nature. Le but de la socit, c'est de se reproduire et de se conserver. Une socit ne saurait [17] voluer partir du moment o elle a atteint son tat naturel et parfait o le pouvoir est devenu fixe. Elle doit y demeurer, sans changement, fidle ses lois fondamentales. Mais le concept de socit s'applique pour de Bonald plusieurs groupes d'hommes : la famille, socit domestique, - l'tat, socit politique, - l'glise, socit religieuse. Dans chaque forme de socit, on retrouve la mme structure, le mme ordre de fonctionnement. Toute socit est compose de trois personnes distinctes l'une de l'autre, qu'on peut appeler personnes sociales, POUVOIR, MINISTRE, SUJET, qui reoivent diffrents noms des divers tats de socit : pre, mre, enfants, dans la socit domestique ; Dieu, prtres, fidles, dans la socit religieuse ; rois ou chefs suprmes, nobles ou fonctiontrois fonctions dans toute socit, incarne chacune par une personne (physique ou sociale) : la fonction d'autorit, le pouvoir qui mane toujours en dernier ressort de Dieu et qui ne peut se partager ; la fonction de mdiation, de service, de ministre pour faire appliquer les dcisions du pouvoir ; la fonction de sujet qui se dfinit ngativement : les sujets sont ceux qui n'ont au-
naires publics, faux ou peuple, dans la socit politique 15 . Il y a donc
13 14 15
L. DE BONALD, Lgislation primitive, 1802, dans la 4e dition de 1847, p. 48. Cf. Dmonstration philosophique du principe constitutif de la socit, Oeuvres, tome 12, p. 93.
Essai analytique, Oeuvres, tome 1, 4e dition de 1840, p. 5.
Pierre Brchon, La famille. Ides traditionnelles, ides nouvelles. (1976)
22
cun pouvoir, qui n'ont qu' recevoir, qu' obir. Leur fonction est prcisment de n'avoir pas de fonction sociale propre, d'tre agis par d'autres. Ces trois fonctions se retrouvent dans toute socit. L'humanit est en fait conue par de Bonald et les traditionalistes comme une pyramide de socits hirarchises, chacune tant dfinie par le pouvoir qui la rgit : Dieu, pouvoir souverain sur tous les tres ; lHomme-Dieu, pouvoir sur l'humanit tout entire qu'il reprsente dans sa personne divine ; l'homme, chef de l'tat, pouvoir sur les hommes de l'tat qu'il reprsente tous dans sa personne publique ; l'homme-pre, pouvoir sur les hommes de la famille qu'il reprsente tous dans sa personne domestique, forment la chane et la hirarchie des pouvoirs sociaux 16 . Chaque pouvoir est donc subordonn un autre, mme s'il a une certaine autonomie dans sa sphre propre. Dieu et la religion sont au sommet. L'tat et la famille sont subordonns. La thorie du pouvoir de de Bonald est une thorie thocratique dont l'idal est la chrtient. La socit soumise au pouvoir divin sera forte et durable ; celle soumise au pouvoir de l'homme sera faible et variable 17 .
Donc, pour de Bonald, la famille est une socit c'est--dire un ordre, une structure de personnes dont chacune a sa fonction propre, dtermine. Au pre le pouvoir sur sa femme et ses enfants, pouvoir qui ne se partage pas et qui est perptuel (en toute socit, de Bonald est partisan de la monocratie oppose la dmocratie). Le pre a toujours pouvoir sur sa femme et ses enfants puisque le mariage est indissoluble, puisque jusqu' leur mort les enfants sont toujours mineurs ou sujets dans la famille, mme alors qu'ils sont majeurs dans ltat 18 , puisque ce pouvoir paternel [18] s'tend mme aprs la mort de l'homme qui l'exerce, par des dispositions testamentaires, et il se perptue encore, quoique d'une autre sorte, par le droit d'anesse, une des plus anciennes lois du monde et des plus gnralement pratiques et si impolitiquement abolie par quelques socits qui ont mis (...) le bien-tre de l'individu qui passe avant la conservation de la socit qui demeure 19 . Ainsi, de Bonald ragit contre des modifications de la lgislation des successions introduites par la Rvolution franaise : le partage gal des biens des parents tant dsormais la
16 17 18 19
Lgislation primitive, op. cit., p. 150. Essai analytique, op. cit., p. 99. Lgislation primitive, op. cit., p. 168. Dmonstration philosophique, op. cit., pp. 101-102.
Pierre Brchon, La famille. Ides traditionnelles, ides nouvelles. (1976)
23
loi, on ne peut plus avantager l'an. De Bonald le regrette mais il insiste peu sur ce point alors qu'un autre traditionaliste, Frdric Le Play, comme nous le verrons plus loin, y voit une des causes principales de la ruine de la famille et de la socit. Pour de Bonald les lois d'un ordre suprieur l'ordre domestique constituent la seule limite au pouvoir du pre. Le pre ne peut demander sa femme et ses enfants des actions qui iraient contre les lois de l'tat ou de la religion, contre les lois fondamentales. La mre est le ministre dans la famille, c'est-dire qu'elle obit au pre et met en uvre - sous ses ordres - l'activit productive et conservatrice de la famille. La mre de famille participe du pouvoir domestique dont elle est l'agent ncessaire ou le moyen naturel. Son autorit est non gale mais semblable celle de son poux et lui est subordonne -, elle est inamovible, parce que le lien conjugal est indissoluble 20 . Elle commande aux enfants dont elle assure la premire ducation. Sans aucune indpendance, elle est un peu comme l'adjudant entre le capitaine et l'homme de troupe. L'enfant, sujet de l'action du pre et de la mre, n'a qu'un devoir : celui d'couter et d'obir. Il n'a point de fonctions qui lui soient propres 21 . L'enfant doit honorer son pre et sa mre, c'est--dire les aimer et les respecter. Ce principe s'applique aux enfants mais aussi toute socit. C'est la Loi du pouvoir . S'ils respectent le pouvoir, la paternit du chef, que ce soit dans la famille ou dans l'tat, les hommes pourront vivre dans des socits heureuses et fortes. Le bonheur s'identifie chez de Bonald au respect de l'autorit qui a toujours la coloration de la paternit : Le pouvoir domestique, politique et religieux n'est que la paternit d'une famille ou domestique ou publique ou particulire ou gnrale ; le raisonnement le prouve et le langage usuel y est conforme. Il appelle Dieu le pre de l'univers et les chefs des nations les pres de leurs peuples 22 . Donc la socit politique est une grande [19] famille. D'ailleurs chronologiquement la famille aurait t, selon l'auteur, la premire socit. Il y aurait eu d'abord des familles isoles les unes des autres. En se multipliant, les familles se sont rapproches. Des querelles risquaient de s'lever entre famil-
20 21 22
Lgislation primitive, op. cit., pp. 167-168. Dmonstration philosophique, op. cit., p. 105. Essai analytique, op. cit., p. 142.
Pierre Brchon, La famille. Ides traditionnelles, ides nouvelles. (1976)
24
les. D'o la ncessit d'mergence d'un pouvoir public, d'un tat, susceptible de poser des lois rgissant les rapports entre les familles. Ainsi si la famille est une runion d'individus, l'tat est pour de Bonald une runion de familles : La socit domestique est donc une socit de production et de conservation des individus (...). La socit publique, aussi appele tat ou gouvernement, est une socit de production et de conservation des familles 23 . Dans l'tat, le pouvoir et les ministres tendent toujours devenir des familles, c'est--dire se rendre hrditaires . On sera pouvoir ou ministre de pre en fils. C'est la situation naturelle et parfaite de la socit publique. Lorsque le pouvoir est fixe, c'est-dire unique, perptuel et hrditaire, il y a ainsi une famille pouvoir, des familles ministres et des familles sujettes ; la socit est tout entire dans les familles 24 . Pour de Bonald, la famille est bien cellule de base de la socit. Cette expression, qu'on continue employer actuellement avec des contenus varis, prend l tout son sens : les diffrentes fonctions sociales sont exerces par des familles, ltat doit promouvoir et conserver les familles, viter leurs querelles. Il ne s'adresse pas aux individus mais aux familles. tat et famille sont btis sur la mme structure, sur les mmes lois fondamentales. Aussi, pour les traditionalistes, la Rvolution franaise sera-t-elle considre la fois comme la ruine de l'tat et de la famille. Ruine de l'tat parce qu'elle est base sur l'ide de dmocratie, de partage du pouvoir politique, de souverainet du peuple. Ruine de la famille parce qu'elle introduit le partage du pouvoir paternel avec la femme et les enfants. De Bonald estime que l'introduction du divorce dans la lgislation en 1792 met en danger la vie familiale. Le divorce rciproque donne la femme juridiction sur le mari, en lui attribuant le pouvoir de le juger et de le condamner, soit qu'elle provoque le divorce, ou seulement qu'elle le ratifie 25 . Le pouvoir de divorcer est un pouvoir usurp par la femme. Car il ne peut y avoir deux volonts et deux pouvoirs dans la famille. Le divorce rompt non seulement un lien indissoluble, qu'il n'est pas dans le pouvoir des hommes de dissoudre, mais il introduit en fait
23 24 25
Dmonstration philosophique, op. cit., p. 106. Essai analytique, op. cit., p. 200.
Du divorce, 1801, dans Oeuvres, tome 5, 4e dition 1839, p. 144.
Pierre Brchon, La famille. Ides traditionnelles, ides nouvelles. (1976)
25
la dmocratie dans la famille. La rpudiation de la femme par l'homme pouvait se comprendre dans une socit encore imparfaite, [20] comme la socit judaque. Cette loi de rpudiation n'est pas contre nature puisque le droit de rpudier appartient l'homme qui conserve son pouvoir domestique naturel sur sa femme et ses enfants. La rpudiation est trs diffrente, selon de Bonald, du divorce mutuel : La rpudiation conserve au mari le pouvoir naturel de juger la femme et de la condamner au renvoi 26 . De Bonald reproche principalement au divorce, non pas de rompre l'unit d'un couple (ce mot ne fait d'ailleurs pas partie de son vocabulaire), mais de tuer le pre . Ceci est trs rvlateur. Tout comme la Rvolution a dpos le roi, par l'introduction du divorce, elle il dpose le pre et lui arrache ses enfants 27 . Mais l'uvre nfaste de la Rvolution sur la famille ne s'arrte pas l'introduction du divorce : Le pouvoir paternel prit avec l'autorit maritale ; la minorit des enfants fut abrge, et le pre perdit, par l'galit force des partages, la sauvegarde de l'autorit, le moyen de punir et de rcompenser 28 .
Mais aprs l'excs de dsordre rvolutionnaire, de Bonald reconnat qu'on est revenu un tat social moins contre nature. Le Directoire restreint la dmocratie, on chercha en mme temps ter la famille des mains des femmes et des enfants ; on posa quelques limites la licence du divorce ;
le pre obtint la permission de disposer de quelque partie de ses biens 29 . Le 18 Brumaire et l'avnement de Napolon I rtablissent un principe d'unit : Mme le code civil (...) cherche reconstituer le pouvoir domestique, en rendant le pouvoir marital mieux dfendu contre le divorce et le pouvoir paternel plus libre dans la disposition des proprits domestiques 30 . Pour de Bonald, la restauration de l'Ancien Rgime, de la socit naturelle, stable, ordonne, hirarchise, sans changement, est en cours avec Napolon. Le courant traditionaliste, courant dominant dans les milieux aristocratiques et ecclsiastiques du dbut du XIXe sicle, va voir galement dans la restauration de la monarchie en 1814 l'aube d'une re nouvelle de stabilit et de bonheur dans un ordre social rtabli.
26 27 28 29 30
Du divorce, op. cit., p. 144. Du divorce, op. cit., p. 118. Du divorce, op. cit., pp. 183-184. Du divorce, op. cit., p. 184. Du divorce, op. cit., pp. 184-185.
Pierre Brchon, La famille. Ides traditionnelles, ides nouvelles. (1976)
26
La socit politique et lglise, l'image de la famille.
Retour la table des matires
Raymond Deniel a fort bien analys la mentalit traditionaliste l'poque de la Restauration 31 . Il a, pour ce faire, analys quatre priodiques catholiques de 1815 1830. Il note que, pour ces milieux, si la restauration [21] politique est en bonne voie, il convient nanmoins de rester trs vigilant, car les ides rvolutionnaires sont de plus en plus admises, elles passent dans les mentalits. Les journaux dnoncent le matrialisme du temps, le culte de l'argent. On est aujourd'hui cupide, on veut s'enrichir, on veut devenir puissant. Tout le monde, dplorent-ils, a de l'ambition. Autrefois le pauvre regardait le riche comme son pre , aujourd'hui il le combat. En 1829, un mandement de l'vque de Blois, rapport par le journal lAmi de la religion et du roi, souligne cette soif d'avancement. Personne n'accepte plus la condition o la Providence l'a fait natre 32 . Les milieux traditionalistes n'aiment pas non plus la grande industrie car elle dveloppe les ingalits sociales, la fortune des uns et la misre des autres. Le peuple exploit risque de se rvolter, ce qui compromettrait le rtablissement de l'ordre social. Ils regrettent le soutien apport par ltat l'industrie alors que l'agriculture est nglige. Or leur vision d'une socit ordonne, stable, est une socit essentiellement rurale. Les campagnes n'ont pas encore t corrompues par l'influence nfaste des lumires , par l'esprit du temps. Elles n'ont pas encore t atteintes par l'esprit de critique sociale et l'anticlricalisme qui fleurissent dans les villes ; on y a encore du respect filial pour les autorits. La famille idale des traditionalistes est donc une famille rurale. De Bonald le reconnat d'ailleurs : Je n'ai parl que de la famille agricole et propritaire, la seule qui soit indpendante, qui puisse ne travailler que pour elle, et nait pas besoin pour vivre de vendre son temps et son
31 32
R. DEMEL, Une image de la famille et de la socit sous la Restauration, Ed. Ouvrires, 1965, 303 p. R. DENIEL, op. cit., p. 49.
Pierre Brchon, La famille. Ides traditionnelles, ides nouvelles. (1976)
27
industrie, et l'on peut remarquer que, dans les leons que donne l'vangile la socit, presque tous les exemples sont tirs de la famille agricole 33 . L'idal familial de Le Play, sur lequel nous reviendrons, sera galement agricole. Donc la mentalit traditionaliste de l'poque rejette l'argent et le commerce, tout ce qui est urbain, car c'est un univers sans stabilit, un univers o les conditions sont fluides. Au contraire l'univers agricole, la proprit terrienne sont bien considrs car ils perptuent les conditions .
On retrouve pratiquement dans les quatre journaux tudis par R. Deniel la pense de de Bonald sur la famille 34 . Tous regrettent l'affaiblissement de l'autorit paternelle, source de dgradation pour linstitution familiale. Tous se flicitent de linterdiction du divorce en 1816. Tous considrent que l'tat est l'image de la famille. Ltat doit veiller la cohsion et l'unit des familles. C'est son intrt car, pour les traditionalistes, la solidit de la [22] monarchie dpend de la stabilit des familles. R. Deniel cite ce propos le discours d'un dput la Chambre : Ltat se forme de la runion des familles, tout ce qui nuit la famille, tout ce qui en altre l'union, en dtriore les sentiments, en provoque la dissolution, nuit donc essentiellement l'tat 35 . Toute la presse traditionaliste et catholique tablit donc le mme lien que de Bonald entre famille et socit politique. Bases sur les mmes principes, ces deux institutions se renforcent l'une l'autre ; ltat renforce la famille par la lgislation qu'il tablit, les familles renforcent ltat en le servant, en tant soumises au pouvoir, en enseignant aux enfants le respect de l'ordre, en duquant leur moralit pour qu'ils ne se laissent pas entraner par leurs instincts, par les passions mauvaises. R. Deniel cite un mandement de l'vque de Bayeux (en 1823) expliquant aux parents qu'ils contribuent au maintien de l'ordre en vitant de laisser crotre des inclinations vicieuses dans l'me de leurs enfants 36 . Les traditionalistes conoivent en fait l'tat et l'glise sur le modle de la famille, puisqu'on y discerne les mmes fonctions, et tout spcialement le pouvoir paternel. Louis XVIII est considr comme le pre du peuple par les journaux catholiques et la famille royale comme la famille ayant lgitimement le pouvoir de pouvoir du roi ne vient pas du sacre mais de son hrdit familiale).
33 34
DE BONALD, Dmonstration philosophique, op. cit., p. 106. D'ailleurs de Bonald crivait dans Le Conservateur et dans L'Ami de la religion et du roi (plus rarement), l'poque organe officieux de la hirarchie catholique franaise. Discours du dput Trinquelage cit par R. DENIEL, op. cit., p. 104. Voir R. DENIEL, op. cit., p. 107.
35 36
Pierre Brchon, La famille. Ides traditionnelles, ides nouvelles. (1976)
28
Le modle familial est galement appliqu l'glise. La paternit est applique au pape et aux vques. De Maistre publie en 1819 un livre intitul Du pape o il se dclare partisan du pouvoir temporel et spirituel du pape, autorit suprme, reprsentant de Dieu sur terre. Dieu tant la source de toute autorit, tout pouvoir lgitime doit tenir compte du pouvoir du reprsentant de Dieu. Mgr de Bruillard, lors de son premier sermon comme vque de Grenoble, disait ses nouveaux diocsains : Comme pre, dont nous prouvons pour vous toute la tendresse, tre occup sans cesse pourvoir aux besoins de la grande famille 37 , telle est notre volont. Le diocse est considr comme une grande famille, runissant les petites familles que sont les paroisses, sous l'autorit de l'vque. Comme l'vque est pre de son diocse, le cur l'est aussi dans sa paroisse. Mgr de Bonald, fils de l'crivain souvent cit dans ce chapitre, donnait ses prtres ce conseil : lorsque, par une peinture vive des jugements de Dieu, vous avez port une terreur salutaire dans l'me de vos auditeurs , ne descendez jamais de la tribune sacre sans que quelques paroles pleines d'une tendresse toute pastorale et d'une affection toute paternelle tombent de vos lvres 38 .
Finalement, il semble bien que partout dans la famille, dans l'tat ou dans l'glise, la paternit soit toujours comprise comme alliant la fois la bont et l'autorit. Le systme des traditionalistes, c'est en fait un paternalisme gnralis. Toute autorit est transforme en paternit. Le pouvoir est cens prendre des dcisions concernant des personnes qu'il aime comme un pre, des personnes dont il veut le bien, mais dont il [23] attend aussi une affection respectueuse. Cette attitude paternaliste se rencontre encore aujourd'hui auprs de certains capitaines d'industries ou cadres militaires qui se considrent comme le pre du rgiment ou le pre de l'usine et des ouvriers, estimant mettre leurs efforts au service du bien de leurs subordonns. On sait ce que pensent les syndicats ouvriers de ce genre de politique patronale, considre comme une des mthodes pour intgrer la classe ouvrire au systme capitaliste. La diffrence qu'on peut dceler entre les penseurs traditionalistes tels que R. Deniel les prsente et les uvres de de Bonald porte
37 38
Sermon rapport dans L'Ami de la religion et du roi, cit par R. DENIEL, op. cit., p. 143. Cit par L'Ami de la religion et du roi et par R. DENIEL, op. cit., p. 143.
Pierre Brchon, La famille. Ides traditionnelles, ides nouvelles. (1976)
29
sur la taille de la famille idale. De Bonald ne parle pas de la famille largie, runissant plusieurs gnrations sous le mme toit, toute la maison tant soumise l'autorit du patriarche , du chef de famille 39 . R. Deniel estime que pour les traditionalistes la seule famille digne de ce nom, c'est la famille rurale, la famille tendue d'autrefois, dont les assises reposaient sur un patrimoine foncier et hrditaire 40 . La famille dont parle de Bonald, mme s'il s'agit d'une famille agricole, est fonde sur le triangle pre-mre-enfant, elle est donc deux gnrations. C'est une famille trs dtermine par l'autorit du pre de la cellule conjugale et non pas par celle du pater-familias de la famille largie. La famille selon de Bonald est restreinte mais elle est trs ordonne, trs rgule.
Garantir lautorit du pre.
Retour la table des matires
Il en sera autrement, quelques dizaines d'annes plus tard, avec le sociologue traditionaliste Frdric Le Play (1806-1882). Son ouvrage sur la famille s'intitule. L'organisation de la famille selon le vrai modle signal par lhistoire de toutes les races et de tous les temps. Ce titre est fort significatif. Il suggre qu'on peut dduire des lois de l'histoire le vrai, le seul, l'unique modle de famille qui soit valable pour les hommes et les socits. Ds l'introduction de son livre, Le Play se situe nettement dans le courant traditionaliste 41 . Les nations qui sont prospres sont celles qui appliquent les vrits traditionnelles . Les nations en tat de dcadence - la France en donne des signes : depuis 1789, les institutions y sont instables, on y pratique la strilit dans le mariage, les classes sociales [24] sont divises par la
39 40 41
De Bonald nous dit simplement que les parents ascendants () participent du pouvoir domestique . Lgislation primitive, op. cit., p. 168. R. DENIEL, op. cit., p. 96. Un prfacier d'une rdition des uvres de Le Play chez Plon en 1941 note que sa thorie rejoint le programme du Marchal Ptain Famille, Patrie, Travail, Discipline .
Pierre Brchon, La famille. Ides traditionnelles, ides nouvelles. (1976)
30
haine et l'envie - sont celles qui s'inspirent des erreurs modernes. En France notre plus fatale erreur est de dsorganiser par les empitements de ltat l'autorit du pre de famille, la plus naturelle et la plus fconde des autonomies, celle qui conserve le mieux le lien social, en rprimant la corruption originelle, en dressant les jeunes gnrations au respect et l'obissance 42 . Voil qui est clair. Dans les rgimes de libert, le pre est le principal agent de l'ordre social 43 . Donc les institutions et les murs doivent garantir son autorit car c'est sur son action que repose l'ordre social, la stabilit publique, la paix dans les familles, l'harmonie dans le gouvernement local et l'tat. Le rle conservateur du pre de famille passe par l'ducation qu'il donne ses enfants, ducation qui doit tre rpressive pour discipliner leur nature, pour combattre leurs mauvais instincts : La dcadence devient imminente, ds que les socits ngligent un moment d'opposer ce flau naturel la discipline de l'ducation 44 . Mais l'influence conservatrice du pre passe aussi par son exemple (il continue et transmet les traditions des anctres) et par la transmission de son autorit et de sa mission (sociale) un hritier, soigneusement choisi et prpar.
Cette action si importante du pre suppose que les liens entre gnrations soient constants, et donc ne s'arrtent pas avec l'entre des enfants dans la vie active. C'est la proprit agricole cultive par la famille qui permet le mieux au pre de remplir sa mission. Mais ce systme, pour se maintenir, ncessite une lgislation qui le favorise, une lgislation qui garde intact le patrimoine familial de gnration en gnration. Cest pourquoi Le Play critique les lois sur l'hritage issues de la Rvolution qui ont t au pre la libert testamentaire. Le pre ne peut plus dsormais lguer tous ses biens un seul de ses fils, l'hritier. Au nom de l'galit des enfants, on a donc favoris le morcellement des terres, on a bris les exploitations familiales pour lesquelles Le Play ne tarit pas d'loges. En effet, le rgime de famille qui convient le mieux pour l'action du pre est la famille souche, famille largie que Le Play dfinit ainsi : c Un des enfants, mari prs des parents, vit en communaut avec eux et perptue, avec leur concours, la tradition des anc-
42 43 44
F. LE PLAY, LOrganisation lAvertissement.
de la famille, Tequi, 1871, p. XVI de
L'Organisation de la famille, op. cit., p. 8. LOrganisation de la famille, op. cit., p. 109.
Pierre Brchon, La famille. Ides traditionnelles, ides nouvelles. (1976)
31
tres 45 . On a donc au moins trois gnrations au foyer. Parmi les enfants du pre, l'un est lhritier et va s'tablir au foyer avec son pouse ou poux, d'autres vont se marier et s'tablir ailleurs, les clibataires restent au foyer paternel et continuent travailler sur l'exploitation familiale. tant donn la nombreuse progniture que Le Play souhaite pour la famille souche et qu'il constate au Pays basque franais, cette unit familiale compte une quinzaine de personnes. Cette famille souche rpond aux [25] impratifs de l'organisation sociale idale qui doit assurer, par un choix judicieux de l'hritier et par les habitudes prsidant la conclusion des mariages, la succession rapide et la fcondit des gnrations ; perptuer au foyer paternel, par la cohabitation des parents et de l'hritier, les traditions de travail d'honneur et de vertu, c'est--dire les vrais titres de la famine la considration de ses concitoyens ; confrer les bienfaits de cette organisation sociale toutes classes utiles de la socit et, en consquence, faire prosprer les paysans, les tenanciers et les ouvriers ruraux vous aux travaux usuels, comme les grands propritaires adonns aux plus hautes fonctions de l'agriculture et de l'industrie, de l'arme, de la magistrature et du gouvernement ; enfin fonder l'harmonie de ces classes extrmes sur lalliance des intrts comme sur les sentiments du respect et de l'affection 46 .
Famille saine, socit saine.
Retour la table des matires
Pour Le Play, on rencontre deux autres rgimes de la famille dans le monde : la famille patriarcale et la famille instable. La famille patriarcale est plus large que la famille souche : tous les fils se marient et vivent au foyer paternel. Cette forme familiale fait rgner la stabilit au plus haut degr. La famille instable, c'est l'autre extrme : les enfants quittent le foyer paternel ds qu'ils se suffisent eux-mmes. Les enfants ont l'esprit d'indpendance et non pas celui des traditions familiales. Dans les socits famille instable, il y aurait excs d'individualisme et d'insatiables besoins de nouveauts, tout ceci ne pouvant que conduire une poque de souffrance. Selon Le Play, la famille souche est un rgime intermdiaire entre famille instable et famille patriarcale. Il est moins stable que la famille patriarcale puisque la fa-
45 46
L'Organisation de la famille, op. cit., p. 10. L'Organisation de la famille, op. cit., p. 91.
Pierre Brchon, La famille. Ides traditionnelles, ides nouvelles. (1976)
32
mille largie ne contrle pas tous les enfants. Il y a donc l un risque de dsordre dans la mesure o, malgr leur bonne ducation, ils peuvent retomber dans le vice originel des jeunes gnrations . Mais ce rgime, mieux que les deux autres, concilie la vertu avec un certain dveloppement de richesse chez les individus et de puissance chez les gouvernants 47 par le fait qu'il dgage une main-d'uvre (gnralement travailleuse et docile) pour l'industrie des villes, pour l'arme, pour l'tablissement des colonies. Donc pour Le Play le rgime de la famille imprime aux populations leur caractre distinctif et cre ainsi leur destine. La famille patriarcale entretient l'esprit de tradition et de communaut. La famille instable dveloppe l'esprit de nouveaut et d'individualisme. Quant la famille souche, elle conjure les exagrations et runit les avantages de ces deux tendances opposes 48 . [26] On retrouve l le schma assez constant chez les traditionalistes. L'essentiel pour le bon ordre d'une socit, pour sa prosprit, c'est que la famille soit saine. Si la famille est bien organise, sous l'affectueuse mais nanmoins solide autorit du pre, la socit sera ordonne et stable. Les traditionalistes font donc jouer la famille un rle dterminant. Si l'on veut restaurer la socit, il faut d'abord restaurer la famille. Leur vision de l'histoire peut se rsumer de la faon suivante : on avait atteint un tat de quasi-perfection, o la famille et l'tat taient solides, stables. Ensuite est venue une poque de troubles, la belle harmonie sociale a t dtruite 49 . Si l'on veut mainte-
47 48 49
LOrganisation de la famille, op. cit., p. II. LOrganisation de la famille, op. cit., p. II. Les familles souches de la France ont eu souffrir successivement des maux manant de la monarchie absolue, des erreurs du XVIIIe, sicle, des rvolutions dchanes en 1789, du matrialisme et des murs drgles de notre temps LE PLAY, Organisation de la famille, op. cit., p. 97. Le Play idalise le pass. Il projette son modle de la famille souche sur les sicles passs, comme si elle avait toujours exist. Il est en fait clair aujourd'hui que la famille conjugale tait dj trs rpandue sous l'Ancien Rgime. Au terme d'une tude comparative portant sur la priode XVIe-XVIIIe sicles, Peter Laslett estime dans un article de la revue Annales (numro spcial Famille et Socit, op. cit.)
Pierre Brchon, La famille. Ides traditionnelles, ides nouvelles. (1976)
33
nant reconstruire l'ordre social, il faut reconstruire la famille. D'ailleurs Le Play intitule un de ses chapitres la rforme sociale par la famille souche et le testament . Il faut rendre aux pres de famille la libert testamentaire ; ainsi les patrimoines seraient conservs, les familles souches pourraient continuer vivre 50 , modestement mais en tant heureuses et vertueuses, sur leurs domaines. Elles ne seraient pas alors contraintes, comme maintenant, pour prserver l'unit du patrimoine, restreindre au maximum leur natalit, ce qui est fort dommageable pour l'tat 51 .
que dans tous les pays sauf au Japon la famille nuclaire domine par rapport la famille largie et aux mnages multiples. Alors qu'actuellement, selon Le Play, l'institution du partage forc favorise la famille instable, morcelle les terres et cre des propritaires indigents. En fait, la coutume du partage galitaire existait dj en certaines rgions franaises depuis plusieurs sicles. De plus, on peut dire que ce n'est pas le Code civil qui a impos l'ide du partage galitaire. Lide d'galit entre enfants tait passe dans les murs. Si bien que lorsque la lgislation a permis nouveau, sous la Restauration, d'avantager l'un des enfants, bien peu de familles l'ont fait. Le Play est partisan de la famille nombreuse, ce qui n'tait pas le cas de de Bonald. Les traditionalistes du dbut du XIXe sicle taient plutt malthusiens, ce n'est que dans la deuxime moiti du sicle qu'ils sont devenus natalistes. Au dbut du XXe sicle, ce courant nataliste s'est beaucoup exprim au sein des associations familiales. Ces associations tiennent en 1920 et 1923 des tats gnraux des familles de France o elles adoptent une dclaration des droits de la famille. Le premier droit revendiqu est ainsi libell : La famille a le droit de se multiplier. C'est d'elle que la patrie tient ses citoyens, ses soldats, ses artisans, ses missionnaires, ses pionniers. Tout ce qui entrave la transmission de la vie - propagande morale, dsorganisation du travail, mauvaise rpartition du travail ou des charges publiques - atteint la famille dans le plus essentiel de ses droits. (Cf. Les fondements d'une politique familiale, 2e session des tats gnraux, Spes, 1923, 159 p.). Le Dictionnaire apologtique de la foi catholique (tome I, article famille rdig par H. Taudire, 1911, colonnes 1871-1897) nous donne ce conseil : Croissez et multipliez, prescrit Dieu qui veut la multiplication de l'espce, le nombre pour faire le plus possible d'heureux lus (colonne 1880). A la suite du traditionalisme, les milieux catholiques de la premire moiti du XXe sicle sont trs natalistes. Le Pre de Lestapis crit encore en 1950 : Combien d'enfants faut-il mettre au monde ? Le christianisme rpond, non pas purement et simplement le plus possible, mais (...) le plus possible que nous pourrons bien lever (dans Discours de Pie XII aux sages-femmes du 29 octobre 51 : Les vraies valeurs de la vie conjugale.
50
51
Pierre Brchon, La famille. Ides traditionnelles, ides nouvelles. (1976)
34
[27] Le XIXe sicle a t travers par un fort courant traditionaliste qui voit dans la famille l'institution centrale restaurer pour rtablir l'ordre social. Cette restauration de la famille vise toujours renforcer l'autorit du pre puisque pour les traditionalistes une famille sans pre, et donc sans autorit, est comme un corps sans tte. Il n'y a pas de famille sans puissance paternelle. Par contre, jamais les traditionalistes ne parlent de l'amour dans la famille. On parle de l'affectueuse autorit exercer envers les enfants. Mais l'amour du couple n'est jamais l'objet de dveloppements. Le mariage est considr comme un contrat entre deux volonts, mais l'amour des deux personnes nest jamais estim ncessaire ni pour le bien des poux et de la famille, ni pour le bien de la socit. L'amour est considr par les traditionalistes comme une passion pour le moins suspecte, un sentiment draisonnable, le contraire de l'ordre. Dans la prface du livre de R. Deniel, Jean Lacroix crit que pour les traditionalistes l'introduction de l'amour dans cette cellule sociale si parfaitement hirarchise ne pourrait que la pervertir 52 . La seule fin de la famille, nous l'avons vu avec de Bonald, c'est la production et la conservation des enfants . Si la famille est une institution sans amour, si elle est une structure hirarchise o chaque personne a sa fonction dtermine, il reste
52
Traduction et commentaires du R.P.S. de Lestapis, Spes, 1953, p. 52). Pie XII dans une allocution l'Association italienne des familles nombreuses (20 janvier 1958) se dclare partisan de la famille nombreuse. Elle oblige les poux sortir de leur gosme, tre gnreux, elle permet de renforcer la sant de la nation : Les familles nombreuses, loin d'tre la maladie sociale , sont la garantie et la sant physique et morale d'un peuple (cf. Le Mariage, les enseignements pontificaux. Descle, 1960, p. 446). Le Concile Vatican II et l'encyclique Humanae vitae reconnatront que les parents doivent dterminer en conscience le nombre d'enfants qu'ils peuvent accueillir et duquer dans de bonnes conditions. La ncessit de planifier les naissances est reconnue, mais cette planification ne doit pas tre goste et elle doit exclure les moyens anti-conceptionnels non naturels. Il y aurait beaucoup dire sur la conception de la sexualit sous-jacente cette position. Jean LACROIX, prface du livre de R. Deniel, op. cit., p. 14.
Pierre Brchon, La famille. Ides traditionnelles, ides nouvelles. (1976)
35
maintenant prciser comment est conue par les traditionalistes la rpartition des rles au sein de la famille. Nous nous demanderons aussi si l'on trouve encore aujourd'hui des thses analogues dans l'opinion publique.
Pierre Brchon, La famille. Ides traditionnelles, ides nouvelles. (1976)
36
[28]
Premire partie. Famille, traditionalisme et conservatisme social
LA FAMILLE. Ides traditionnelles, ides nouvelles.
Chapitre 2
La rpartition ingalitaire des rles familiaux
Retour la table des matires
Une famille, c'est un tissu de relations, c'est aussi un ensemble de rles dfinis socialement. L'organisation de la vie familiale dpend de ce que la socit ou l'opinion publique attendent d'un pre, d'une mre, d'un enfant. Si ceux-ci ne jouent pas les rles que la socit leur dfinit, ils seront considrs comme de mauvais pres ou de mauvaises mres. Mais l'opinion publique n'a pas forcment sur le sujet un jugement unique. Mme si un modle de rles des pres et mres domine dans la socit un moment donn, il n'est pas forcment le seul. D'autres modles peuvent tre en cours de formation, soutenus par des idologies, des courants de pense nouveaux. C'est un peu cette situation qu'il nous faut analyser. Auparavant je rappellerai la conception traditionaliste parce qu'on la retrouve encore frquemment aujourd'hui l'tat latent dans la pense de beaucoup de couples, de familles ou d'auteurs,
Pierre Brchon, La famille. Ides traditionnelles, ides nouvelles. (1976)
37
Chez les traditionalistes : la soumission de la femme.
Retour la table des matires
Pour les traditionalistes, la famille est une hirarchie. La femme est toujours soumise, subordonne l'autorit du mari. Il n'y a jamais galit entre le pre et la mre, ce serait l'anarchie dans la famille, la confusion entre pouvoir et ministre selon la terminologie de de Bonald. Joseph de Maistre affirme que si le sexe faible sait tre fort dans des priodes troubles, pendant les guerres, au service des uvres de charit, etc... ce n'est pourtant pas son rle habituel. La femme ne doit user de force, tre active que dans les cas exceptionnels (pour suppler l'homme [29] dfaillant). En temps normal, elle doit toujours faire preuve de modestie et de rserve. Elle doit donner l'image d' une vie harmonieuse, paisible, efface 53 . Chez tous les penseurs conservateurs, on retrouve l'ide d'une nature masculine et d'une nature fminine, diffrentes l'une et l'autre et qui conduisent des rles spcifiques dans la famille. Pour les traditionalistes, le pre, qui a toute autorit, peut en dlguer une partie sa femme, notamment pour l'ducation de la premire enfance. Mais il doit donner le bon exemple ses enfants, viter la familiarit avec eux (ce serait faire montre d'un esprit d'galit dmocratique). Il doit protger ses enfants et donc viter de les faire participer aux problmes du monde. Il faut les prserver de l'esprit du temps : pres, n'inspirez pas vos enfants cette tendance irrflchie vers l'esprit d'innovation, d'anarchie et de rvolte 54 . Le pre doit aussi pouvoir choisir l'cole de ses enfants, cole qui ne doit pas tre au monopole de l'tat. Pour Lamennais, le monopole de l'tat en matire d'enseignement va contre l'autorit du pre, il renverse les principes constitutifs de la famille puisque l'ducation des enfants est
53 54
R. DENIEL, op. cit., p. 120. DECAMPE, Considrations sur l'tat actuel des murs, cit par R. DENIEL, op. cit., p. 110.
Pierre Brchon, La famille. Ides traditionnelles, ides nouvelles. (1976)
38
avant tout une responsabilit du pre, qu'il peut dlguer en partie sa femme et l'cole de son choix. De plus le monopole est jug dangereux idologiquement, ltat dfendant les principes rvolutionnaires. Phnomne symptomatique de la rpartition des rles selon le sexe, au dcs du pre, les traditionalistes estiment que c'est le fils ain qui doit remplacer le pre dans ses fonctions et non pas la mre. Le fils an protgera sa mre, la vnrera, s'occupera du patrimoine familial et de l'ducation de ses frres et surs. Quant la mre, les traditionalistes la conoivent avant tout comme l'ducatrice du premier ge, y compris en matire religieuse. Ainsi la dfinit Mgr Freyssinous (nomm la tte de l'universit franaise sous la Restauration). De Bonald souligne galement qu'elle a la charge du foyer : Au pre appartient la direction des affaires extrieures, la mre celle des soins intrieurs. Plus les enfants sont jeunes, plus le soin en appartient la mre 55 . Plus largement, la mentalit traditionaliste analyse par R. Deniel lui reconnat trois fonctions, trois domaines. La femme accomplie s'occupe du foyer, de l'intrieur, elle secourt des pauvres, elle pratique assidment la religion. Sa fonction essentielle est nanmoins le foyer : Les femmes appartiennent la famille et non la socit politique, et la nature les a faites pour les soins domestiques et non pour [30] les fonctions publiques. Leur ducation doit donc tre domestique dans son objet et elles devraient la trouver dans le giron maternel 56 . Naturellement faites pour le foyer, les femmes n'ont pas s'instruire outre mesure. L'ducation auprs de leur mre sera amplement suffisante. Voil en clair l'opinion de de Bonald et du traditionalisme. D'ailleurs Lamennais crivait : Si quelque chose est par sa nature indpendante de l'administration, c'est sans doute l'ducation des filles destines une vie de retraite et uniquement occupes des soins de la famille 57 . Donc pour les traditionalistes, les rles dans la famille sont diffrencis, il n'y a pas une fonction parentale globale qui serait assure par le couple ; cette diffrenciation des rles est base sur le sexe, sur la nature sexue des individus.
55 56 57
DE BONALD, Lgislation primitive, op. cit., p. 234. DE BONALD, Lgislation primitive, op. cit., p. 414. Lamennais cit par R. DENIEL, op. cit., pp. 190-191.
Pierre Brchon, La famille. Ides traditionnelles, ides nouvelles. (1976)
39
Dans l'glise catholique : le modle de la Sainte Famille.
Retour la table des matires
Cette diffrenciation des rles selon le sexe apparat dans toute la littrature catholique du XIXe sicle et mme du XXe sicle, pratiquement jusqu' une poque trs rcente. A notre avis, les positions de l'glise catholique en la matire refltent des strotypes sociaux et les modles de rles familiaux qui ont cours en France et dans le monde occidental. Prenons quelques exemples. Dans un de ses livres : Le mariage chrtien, Mgr Dupanloup (vque d'Orlans, n en 1802, mort en 1878) fait de trs longs dveloppements pour dire ce qu'est, selon lui, un pre et une mre. Et il termine son tude par cette belle envole : Tel est un pre, telle est une mre : belle et sainte alliance de la force et de la douceur, de la puissance et de la grce, de la sagesse et de l'amour, d'o naissent, dans une fcondit sans tache, la vie, la scurit, la joie, la douce paix, la noble abondance, la pieuse harmonie des vertus au foyer domestique et enfin la grande loi du respect 58 . Donc le pre c'est l'autorit, la puissance, la raison alors que la femme pourrait se dfinir par l'affectivit et la douceur.
Cette conception des rles parentaux se retrouve dans le culte de la Sainte Famille qui se dveloppe la fin du XIXe sicle. La Sainte Famille est propose comme modle de famille promouvoir. Lon XIII crit dans la lettre apostolique Neminem Fugit (14-6-1892) : Les pres de famille possdent en Joseph un modle accompli de la vigilance et de la prvoyance paternelles ; la trs sainte Vierge, mre de Dieu, est pour les mres un admirable modle de l'amour, de la modestie, de l'esprit de soumission et de la foi parfaite ; dans la personne de Jsus qui leur tait soumis (Luc 2, 51) les enfants [31] ont un modle divin d'obissance admirer, vnrer, imiter 59 . Ce texte nous montre que l'glise a en fait projet sur la famille de Jsus le modle familial des traditionalistes. S'appuyant sur cette concep58 59
143.
Mgr DUPANLOUP, Le Mariage chrtien, Tqui, 15e dition en 1908, p. 113. Cit dans Le Mariage, Descle, coll. Les enseignements pontificaux, 1961, p.
Pierre Brchon, La famille. Ides traditionnelles, ides nouvelles. (1976)
40
tion de rles parentaux dfinis selon le sexe, lglise s'opposera jusqu' une poque rcente au travail de la mre de famille. Pie XI, dans son encyclique Quadragesimo anno (1931), qualifie le travail de la mre d' abus nfaste et qu'il faut tout prix faire disparatre . Dans une lettre pastorale de 1933, consacre la famille, Mgr Caillot, vque de Grenoble, rappelle que le pre est le chef de la famille. Il doit remplir le rle conomique : assurer son foyer d'abord le pain de chaque jour . Il estime ensuite que la femme est avant tout la gardienne du foyer, selon une expression assez rpandue l'poque. Elle s'occupe de la maison et assure l'harmonie entre les membres de la famille. Mais pour que la mre de famille soit vraiment la gardienne du foyer, il faut qu'elle y puisse rester demeure. Par consquent, tout ce qui l'empchera d'y rester, tout ce qui l'appellera et la retiendra au dehors, ne pourra que prjudicier la famille . La place de la mre est donc nettement dtermine : le foyer, le mari et les enfants. Les questions politiques restent un privilge de l'homme, le travail salari va l'encontre de sa vocation de mre 60 .
Il faut attendre la fin de la Deuxime Guerre mondiale pour trouver dans quelques textes catholiques une timide volution vers des rles moins figs et moins dtermins par l'ide d'une nature humaine . On souligne moins la prminence du pre. Ainsi la dclaration de l'piscopat franais sur la personne humaine, la famille, la socit, en 1945, estime que si les poux ont des rles diffrents et complmentaires, ils doivent nanmoins tout dcider en commun. De mme que la loi civile franaise a abandonn en 1970 la notion de puissance paternelle au profit de celle d'autorit parentale 61 , les documents les plus
60
61
Au IIIe congrs de l'association Laissez-les-vivre, en novembre 1974 Versailles, Mme Moyret, magistrat, a tenu des propos o l'on retrouve la mme conception des rles masculins et fminins : L'homme et la femme sont complmentaires. Il ne faut pas transgresser les lois naturelles. Mme dans les pays socialistes ce sont les femmes qui donnent le jour aux enfants. Le vrai rle de la femme dans la socit est celui de mre au sein de la famille, compagne et soutien de l'homme, ducatrice des enfants, mnagre. Il faut donc que soit reconnue dans le systme conomique la plus-value dont elle est productrice (cf. compte rendu du journal Le Monde du 19 fvrier 1974). L'article 213 du Code civil lu aux poux le jour de leur mariage, disait jusqu' cette date que le mari est le chef de la famille et que la femme concourt avec le mari assurer la direction morale et matrielle de la famille . Dsormais il est rdig ainsi - Les poux assurent ensemble la direction morale et matrielle de la famille. Ils pourvoient l'ducation des enfants et prparent
Pierre Brchon, La famille. Ides traditionnelles, ides nouvelles. (1976)
41
rcents des vques franais parlent de l'autorit parentale. On ne souligne plus son caractre naturel. [32] Ainsi Mgr Marty, archevque de Paris, reconnat dans sa lettre de Carme 1973 que l'autorit dans la famille ne va plus aujourd'hui de soi, qu'elle n'est plus naturelle : maintenant les parents n'ont d'autorit que dans la mesure o le jeune estime l'homme et la femme qu'ils sont (...). Ils n'ont d'autorit que dans la mesure o ils font preuve d'amour et de vrit . Il dveloppe cette ide : l'autorit aujourd'hui, c'est instaurer un dialogue dans la famille, c'est permettre aux membres de la famille de se rencontrer, c'est viter une attitude de dmission, de renoncement sa responsabilit parentale. Les parents ne doivent pas tre des dredons . Donc, mme si elle est lente, il y a une volution dans les textes de la hirarchie catholique. Cette volution suit l'volution des strotypes et des modles familiaux dans la socit. Les textes officiels rcents ne soutiennent plus les positions traditionalistes. Les rles parentaux sont prsents de faon moins rigide et moins spcifie selon le sexe. Ils sont moins considrs comme naturels.
Mais certaines publications grand tirage propagent encore - avec un certain appui officiel - les thories anciennes. Ainsi en est-il du Livre de la famille. Encyclopdie des poux et des parents chrtiens, dont la rdaction est dirige par P. Winninger. Ce livre a un certain appui officiel puisqu'il s'ouvre sur une lettre logieuse du Cardinal Renard, archevque de Lyon, qui tait jusqu'en 1973 prsident de la Commission piscopale de la famille. Ce livre connat une grosse diffusion : plus de 100 000 exemplaires vendus de 1964 1970. Beaucoup de prtres l'ont prt des fiancs, il a t offert de jeunes maris en cadeau. Les sujets abords sont trs varis : cela va des conseils pour l'ducation des bbs aux rgles du savoir-vivre, en passant par la prire en famille, les conseils d'hygine, sans oublier le guide juridique. Examinons la 8e dition revue et corrige, publie en 1970. On y retrouve toutes les conceptions traditionnelles des rles du pre et de la mre. Qu'on en juge ! Par nature et par vocation, le pre est l'autorit (...) Il est le Seigneur de sa femme et de ses enfants (...) non pas pour craser mais pour protger. Il peut dlguer son autorit sa femme, aux grands parents, aux enfants plus gs, aux domestiques... S'il a autorit dans sa famille, l'activit principale du pre est hors du foyer. C'est pourquoi il leur avenir. La femme sort ainsi de son rle subordonn. Elle est juridiquement gale son mari.
Pierre Brchon, La famille. Ides traditionnelles, ides nouvelles. (1976)
42
est comme le pont entre le monde et la famille , il ramne la famille les nouvelles du monde et les commente. Il dirige ainsi la politique extrieure de la famille 62 . Il doit garder du temps pour sa femme et ses enfants et discuter avec eux ; enfin le pre est le chef religieux, il exerce un sacerdoce dans sa famille : il conduit les siens au Christ. Quant la mre, la maternit
est la vocation de la mre et sa gloire 63 , la mre consacre sa vie entire au foyer (...) Elle est mnagre (...) Elle nourrit les siens (...) Elle habille, raccommode, lave et repasse (...) Elle coute son homme, ce grand enfant, lui raconter avec confiance ses rves et ambitions, sans se moquer de lui () [33] La mre est le trait d'union entre le pre et ses enfants 64 . Elle prpare sa fille fonder un foyer, en lui enseignant tenir une maison et en la prparant l'amour. La mre est gardienne des traditions alors que le pre
construit l'avenir du foyer 65 . Les ides traditionalistes sont toujours l, fermement dfendues, pour l'essentiel. Comme chez de Bonald, la mre reste un intermdiaire entre le pre et ses enfants. Elle est toujours limite au foyer et son travail salari apparat comme une mauvaise solution (au moins plein temps) : Certaines femmes, victimes des ides la mode, prennent sans ncessit un emploi hors du foyer. Or la prsence de la mre au foyer assure les biens les plus prcieux et fondamentaux, source de tous les autres : des enfants bien levs, des familles unies et paisibles, l'ordre social et l'avenir heureux. Au contraire, l'loignement de la mre branle tous
ces biens 66 . Cette description des vertus familiales est trs conservatrice. La famille, avec prsence de la mre au foyer, permet de maintenir l'ordre social, identifi l'avenir heureux.
propos des rles parentaux dans ce livre, je voudrais encore faire une remarque. La couverture du livre est constitue par deux photos : celle du haut nous montre une jeune mre et son bb, celle du bas, un enfant (d'environ 6 ans) qui donne un biberon un chat. Entre les deux photos, le titre Le livre de la famille en grosses lettres, encyclopdie des parents et des poux chrtiens en lettres plus petites. D'aprs cette couverture, la famille, c'est essentiellement la femme et l'enfant (accessoirement le chat et le biberon !). Le pre, dont on nous dit que la tche essentielle est hors du foyer, mme s'il dtient l'autorit, dont on regrette qu'il joue au compagnon ou qu'il dmissionne de son rle de pre, semble tre le grand absent de la fa-
62 63 64 65 66
Le livre de la famille, Bayard-Presse, 8e dition, 1970, p. 304.
Le livre de la famille, op. cit., p. 306. Le livre de la famille, op. cit., p. 308. Le livre de la famille, op. cit., p. 309. Le livre de la famille, op. cit., p. 538.
Pierre Brchon, La famille. Ides traditionnelles, ides nouvelles. (1976)
43
mille 67 . L'encyclopdie semble ainsi reflter une image toute faite - autrement dit un strotype - trs rpandue aujourd'hui encore : la famille est spontanment identifie la relation mre-enfant. Ce strotype peut s'expliquer par la situation des familles franaises actuelles o la mre assume bien souvent seule les responsabilits ducatives ; mais il s'intgre aussi fort bien au systme de pense traditionaliste : partir du moment o le rle essentiel du pre est de subvenir aux besoins matriels de la famille et o la mre doit rester au foyer dont elle est la gardienne , mme si le pre conserve une autorit thorique sur sa femme et ses enfants, on comprend qu'il soit peru comme extrieur la vie familiale. Si le modle des rles familiaux propos par ce livre est inspir par des thories conservatrices, il faut cependant admettre que beaucoup de familles actuelles s'y reconnatront encore 68 , totalement ou partiellement.
[34]
La famille dans l'opinion publique aujourdhui.
Retour la table des matires
La famille fonde sur des rles diffrencis selon le sexe semble avoir encore bien des adeptes. Dans l'enqute ralise Grenoble, que nous avons dj cite 69 , plusieurs questions concernaient les rles parentaux. Il est intressant d'en analyser les rsultats. Une trs grande majorit d'enquts, 89%, pensent que le partage de l'autorit pour l'ducation des enfants - admis juridiquement par la loi sur l'autorit parentale - est plutt une bonne chose. Donc, dans l'abstrait, l'ide que la femme participe la fonction d'autorit rencontre un
67
68
Les photos l'intrieur du livre confirment l'impression donne par la page de couverture. Il y a onze photos o lon voit la mre et son fils et seulement trois o l'on voit le pre et son fils. Beaucoup de dtails montrent que les auteurs du livre sont dpendants - peuttre inconsciemment - d'une image de la famille bourgeoise. C'est ce modle qu'ils dcrivent et qu'ils prnent, en parlant par exemple des domestiques de la famille, mais aussi travers tout le manuel du savoir-vivre : positions des convives table, faon de faire le service, de se tenir table, code de politesse, rdaction de la correspondance, etc. Ce livre suggre en fait de se conformer aux faons de vivre de la petite et moyenne bourgeoisie franaise. cf. J. FREYSSINET et P. KUKAWKA, Rapport d'enqute : Les grenoblois et la famille, 3e partie, LE.P. Grenoble.
69
Pierre Brchon, La famille. Ides traditionnelles, ides nouvelles. (1976)
44
large consensus. Mais, nous le verrons, les rponses d'autres questions de la mme enqute montrent que les modles anciens de rpartition des rles selon le sexe restent ancrs dans les esprits. On demandait galement aux enquts de se prononcer sur la ralit familiale qu'ils connaissent : votre avis, existe-t-il actuellement en France galit entre l'homme et la femme au sein de la famille ? Une faible majorit, 56%, pensent que l'galit existe alors que 39% sont d'un avis contraire. Il est intressant de voir comment se ventilent ces rponses. Ce sont les personnes ayant le niveau d'tude le plus faible qui pensent le plus facilement que l'galit existe. Ceux qui ont fait des tudes suprieures croient moins l'galit ralise entre l'homme et la femme. De mme l'ge intervient. Plus on est vieux, plus on croit que l'galit existe. Ce sont les jeunes qui y croient le moins. Ce rsultat peut s'expliquer de deux faons : d'une part les personnes ges ont connu une situation o la femme tait davantage soumise. Une femme clibataire, d'environ 40 ans, dclarait lors d'une session sur la famille : Ma grand-mre tait soumise mon grand-pre ; maman pouvait discuter avec mon pre ; mes frres et surs vivent l'galit absolue avec leurs conjoints. Les personnes les plus ges, ayant connu une situation plus ingalitaire 70 , admettent plus facilement que l'galit existe. Au contraire, les jeunes qui n'ont pas connu la situation passe sont plus exigeants. Leurs aspirations l'galit sont plus radicales. Donc l'apprciation de l'galit ralise ou non varie selon le groupe socio-culturel auquel on appartient. Les jugements ports sur les ralits ne sont jamais neutres. Nous les analysons toujours avec les valeurs, les schmas, les modles, les grilles de lecture qui sont ceux de notre milieu de vie. L'tude de [35] l'image de la famille dans la publicit tend galement montrer que l'aspiration l'galit est de plus en plus forte. En effet l'image des rapports entre poux que nous proposent les publicits est une image assez galitaire 71 .
70
Notons cependant que, depuis fort longtemps, dans les familles ouvrires la mre avait un rle important dans les prises de dcisions. Elle gre le budget et prend les dcisions financires. Voir ce sujet l'article de Jacqueline Freyssinet La famille change. Pourquoi ? dans le collectif La famille hier, demain, Cerf, coll. Dossiers libres, 1974, pp. 29-37.
71
Pierre Brchon, La famille. Ides traditionnelles, ides nouvelles. (1976)
45
L'enqute faite Grenoble essayait enfin - l'aide de deux questions ouvertes - de recueillir les opinions des Grenoblois sur le rle du pre et de la mre dans la famille. Il ne s'agissait plus de dcrire ce qu'ils percevaient comme pour l'galit ou l'ingalit, mais de s'engager idologiquement : votre avis, de nos jours, dans une famille, quel doit tre le rle principal du pre ? votre avis, de nos jours dans une famille, quel doit tre le rle idal de la mre ? Trois thmes reviennent principalement pour dfinir le rle du pre, plusieurs thmes apparaissant souvent dans la mme rponse : Le pre subvient aux besoins matriels de la famille, il doit assurer par son salaire l'entretien de sa femme et de ses enfants, faire vivre sa famille le mieux possible . Le pre dtient la fonction d'autorit. Il est celui qui commande et guide la famille. Il doit se faire respecter, ne pas jouer au grand frre avec ses enfants. Il doit trancher les dbats en dernier ressort. Le pre remplit un rle moral. Il doit donner l'exemple, tre un modle pour ses enfants, il doit savoir les couter et les aider rsoudre leurs problmes.
Quant aux rles de la mre, on peut galement en distinguer trois : Elle doit tenir son mnage , s'occuper de l'intrieur, de la cuisine. Elle doit s'occuper de l'ducation des enfants, leur apprendre bien se conduire, les soigner, en un mot les aimer comme une mre . La mre assure la cohsion affective de la famille. Elle cre l'ambiance la maison, elle est la mdiatrice des enfants auprs du pre. Elle rend harmonieuses les relations familiales.
Pierre Brchon, La famille. Ides traditionnelles, ides nouvelles. (1976)
46
Dfinissant ainsi les rles de la mre, il ne faut pas s'tonner si 58% des enquts pensent que le travail de la femme a une influence plutt nfaste sur la vie familiale. Donc les rles tels qu'ils ressortent de cette enqute sont trs dfinis selon le sexe. On retrouve le vieux modle dj prsent chez les traditionalistes du XIXe sicle. Ce modle, encore largement vcu, pse sur les mentalits et l'ducation des enfants. Dans l'enqute, la nouveaut vient de ceux qui expriment des rticences l'gard de la question elle-mme, disant en substance : pre et mre n'ont pas dans la famille de rles spcifiques. Ils assurent ensemble les responsabilits qui sont celles du couple. Il me semble que ce type de rponse - ou de non-rponse ! - illustre assez bien [36] le modle nouveau de rpartition des rles qui commence s'installer dans un certain nombre de jeunes couples. Nous y reviendrons.
Rles diffrencis selon le sexe et famille double carrire .
Retour la table des matires
Notons auparavant que les rsultats de cette enqute sur la population grenobloise rejoignent la description que fait Talcott Parsons, sociologue amricain, des familles amricaines 72 . Au terme de son analyse, il conclut que les rles de l'homme et de la femme sont trs diffrencis. Le pre a le rle instrumental , il exerce une profession, il assure la subsistance matrielle de la famille. La mre travaille rarement, elle fait le mnage, s'occupe des enfants, elle exprime la vie affective de la famille. Parsons appelle cela le rle expressif . Les enfants sont duqus en fonction de ces rles sociaux. Les garons doivent avant tout apprendre un mtier. Par contre on prpare surtout les filles leurs tches familiales, tre plus tard de bonnes mres, selon leur vocation fondamentale. Si elles ont appris un mtier, ce sera gnralement un mtier fminin c'est--dire tout ce qui touche l'ducation et au social, ou encore tous les mtiers faible qualification et sous-pays. Selon une enqute rcente de l'hebdomadaire Time, une volution se dessine dans la diffrenciation des rles aux tats-Unis : La socit amricaine parat mieux accepter les femmes
72
Voir Talcott PARSONS, Elments pour une sociologie de l'action, Traduction de F. Bourricaud, Plon, 1955, p. 109-150. F. Bourricaud traduit des parties d'uvres de Parsons dites aux tats-Unis entre 1949 et 1952.
Pierre Brchon, La famille. Ides traditionnelles, ides nouvelles. (1976)
47
qui ne se conforment pas l'image traditionnelle de la mnagre ou de la starlette 73 . On pourrait dj critiquer l'analyse de Parsons 74 dans la mesure o ce qu'il dcrit est peut-tre moins la situation de la famille amricaine que la situation des familles des classes moyennes, dans leurs couches les plus ges. Mais les thses de Parsons sont critiquer de faon plus radicale. Cet auteur, en effet, n'entend pas seulement dcrire la famille amricaine, sa structure et ses valeurs. Il voit dans la forme de famille dcrite, avec des rles spcifis selon le sexe, la forme de famille la mieux adapte pour que le systme social fonctionne bien, soit bien quilibr. Le modle traditionnel des rles serait le modle parfait, celui qui est le plus susceptible de permettre la famille de remplir ses deux fonctions principales : la socialisation de l'enfant , c'est--dire son apprentissage [37] des valeurs, des attitudes et des rles et la stabilisation de la personnalit adulte , c'est--dire la ralisation de l'quilibre psychologique et affectif des poux.
Andre Michel montre fort bien que le modle des rles spcialiss selon le sexe ne peut pas socialiser l'enfant aux valeurs modernes de la socit, et notamment l'ide d'galit entre les sexes. D'autre part l'quilibre et l'panouissement du couple ne sont pas assurs par ce modle des rles familiaux. Donc la famille, telle que la dcrit et la prne Parsons, ne remplit pas les deux fonctions fondamentales qu'il lui reconnat : elle socialise mal l'enfant, elle n'assure pas l'quilibre motionnel des poux. Revenons sur ces deux points. La jeune fille s'identifie sa mre, et donc, comme elle, elle se prpare surtout la famille et au mariage. Elle compte sur son futur mari pour assurer sa subsistance. Elle a peu le souci de formation professionnelle et sa famille ne l'y pousse pas. On apprend aux filles jouer la poupe alors que le garon joue au mcano. Les enfants voient bien comment les rles sont rpartis dans la famille. Mme si la mre travaille, c'est souvent elle qui assure l'essentiel des tches mnagres. Cette situation tend tre considre par les enfants comme normale, puisque c'est celle que vivent leurs parents. Leur comportement futur sera vraisemblablement calqu sur celui de leurs parents. Andre Michel en conclut : La famille conjugale de type par-
73 74
Le Monde du 18 mars 1972 prsente les rsultats de cette enqute. Voir la critique qu'en fait Andre MICHEL, Sociologie de la famille et du mariage, P.U.F. coll. Sup. 1972, p. 222.
Pierre Brchon, La famille. Ides traditionnelles, ides nouvelles. (1976)
48
membres 75 . D'autre part un sociologue amricain, Gronseth, estime que le non-travail de la femme amricaine entrane souvent une attitude captative l'gard de son enfant. Ainsi la prise d'autonomie et d'indpendance de l'enfant est retarde et le libre dveloppement de sa sexualit est impossible. La famille parsonienne conduit la rpression sexuelle de l'enfant. Cette rpression sexuelle a des consquences sociales : agressivit des individus et
sonien qui est le modle familial le plus rpandu dans les socits occidentales industrialises ne socialise pas les jeunes aux valeurs d'galit et de dmocratie dans la mesure o elle n'incarne pas ces valeurs de modernit dans son comportement quotidien et dans l'accomplissement des rles par ses
des groupes sociaux, dveloppement du fascisme 76 . La famille parsonienne socialise donc mal l'enfant. Russit-elle mieux stabiliser la personnalit adulte ? Il ne semble pas. Parsons lui-mme dcrit les nvroses de la femme et parle des graves tensions qui affectent le rle fminin . Il semble qu'en fait, plus il y a diffrenciation des rles, moins la femme est satisfaite de son tat de mariage. La femme qui n'a qu'un rle expressif dans la famille est dpendante conomiquement de son mari, elle risque d'avoir une image dvalorisante d'elle-mme. Le manque d'galit dans les rles conjugaux risque de se traduire souvent par de mauvais rapports au sein du couple 77 .
[38] Donc la famille parsonienne ne peut remplir ses fonctions. D'autres modles familiaux, encore minoritaires, mais qui s'affirment progressivement devraient tre plus adapts la transmission des valeurs modernes. C'est le cas de la famille double carrire 78 . Elle se caractrise par le travail l'extrieur de la famille des deux poux. Tous deux exercent le rle instrumental 79 . De ce fait la femme a peu
75 76 77
Andre MICHEL, op. cit., p. 98. Gronseth reprend ici la thse de Reich dont nous reparlerons. Mais l'galit plus grande entre homme et femme ralise notamment par le travail ne rsout pas tous les problmes du couple. C'est ce que montre notamment une enqute ralise par Andre MICHEL, Activit professionnelle de la femme et vie conjugale, Ed. du C.N.R.S. 1974, 192 p. Cette tude confirme que le travail fminin favorise le partage des tches mnagres mais les difficults de communication dans le couple ne semblent pas en tre amoindries. Rhona et Robert RAPOPORT ont publi rcemment en France la monographie de 5 familles o l'homme et la femme travaillent : Une famille, deux carrires, Denol-Gonthier, 1973. Dans une enqute o l'on interrogeait des femmes de 18 25 ans, 87% trouvaient normal que ce soit elles qui gagnent provisoirement largent du mnage.
78
79
Pierre Brchon, La famille. Ides traditionnelles, ides nouvelles. (1976)
49
de temps consacrer au mnage et aux enfants. Un partage des tches domestiques entre les poux tend s'tablir. En tout cas, il est souvent souhait par les pouses et accept par les poux. Mais on s'aperoit qu'il y a souvent un cart important entre la volont affirme et le partage effectif. Mme seconde par son mari, la femme garde le plus souvent une tche mnagre plus importante que celle du mari. Ce sont chez les jeunes couples niveau culturel lev que le partage des tches semble le plus dsir et le plus effectif. On voit des pres de famille qui langent les enfants, qui donnent le biberon, qui font la cuisine ou la vaisselle. Dans ces familles, les dcisions sont gnralement prises en commun, il y a davantage de dialogue entre les poux. Cette famille double carrire tend devenir de plus en plus frquente 80 . Ce sera peut-tre demain le modle dominant. Car de plus en plus, les jeunes filles veulent avoir un mtier, leur scolarit s'allonge, elles ne se contentent plus d'un accomplissement par le mariage. Elles quittent leur famille d'orientation (o elles sont nes) lorsqu'elles sont salaries, voulant prendre leur indpendance, mme si elles ne sont pas maries. Une fois maries, tant qu'elles le peuvent, elles gardent leur mtier, soit par ncessit conomique, pour donner la famille un niveau de vie plus lev, soit par volont d'avoir une activit professionnelle qui leur donne une insertion sociale, qui leur permette de se raliser autrement qu'en tant la femme de leur mari . Avec la baisse de la natalit, il est plus facile pour la jeune mre de conserver son emploi ; nanmoins le manque d'quipements collectifs : crches, jardins d'enfants, coles maternelles, oblige certaines jeunes mres le quitter. Dans cette famille double carrire , il n'y a donc plus diffrenciation des rles selon le sexe. Les deux poux exercent la fois le rle instrumental et le rle expressif, mme si certaines tches sont faites plutt par l'un ou plutt par l'autre [39] selon les comptences de chaque individu ! On commence mme voir quelques familles o la femme travaille plein temps et l'homme mitemps, s'occupant le reste de la journe des enfants et des tches domestiques. On peut penser que cette famille double carrire transmettrait mieux les valeurs, en particulier l'idal galitaire, dans
80
En 1965, pour la tranche d'ge de 20 65 ans, 35% des femmes maries travaillaient.
Pierre Brchon, La famille. Ides traditionnelles, ides nouvelles. (1976)
50
la mesure o cette forme de rpartition des rles respecte mieux l'galit de l'homme et de la femme dans la famille. Au modle de rles familiaux bas sur la diffrenciation des sexes tend s'opposer un modle nouveau, celui de la famille double carrire , o pre et mre exercent tous deux la fois le rle instrumental et le rle expressif. Cette situation est de plus en plus valorise par une partie de l'opinion franaise.
Pierre Brchon, La famille. Ides traditionnelles, ides nouvelles. (1976)
51
[40]
Premire partie. Famille, traditionalisme et conservatisme social
LA FAMILLE. Ides traditionnelles, ides nouvelles.
Chapitre 3
La famille, cellule de base de la socit : prsence du traditionalisme aujourd'hui
Retour la table des matires
La famille, cellule de base de la socit : cette expression est encore trs employe aujourd'hui. C'est le clich, le strotype qui vient l'esprit de beaucoup de gens lorsqu'on les interroge brlepourpoint sur ce qu'est la famille. Bien souvent, semble-t-il, ils veulent simplement dire que c'est une ralit trs importante, qui tient beaucoup de place dans leur vie. Ils n'expriment pas par l leur philosophie de la famille. Je voudrais, dans ce chapitre, analyser quelques formes actuelles de forte valorisation de la famille, que cette valorisation soit le fait d'un auteur, d'une cole de pense, ou qu'elle soit simplement une tendance latente d'une partie de l'opinion. Mais, au pralable, je voudrais tenter d'claircir le contenu de cette expression ambigu, forge dans le courant traditionaliste. Pour ce dernier, dire que la famille est la cellule de base de la socit voque
Pierre Brchon, La famille. Ides traditionnelles, ides nouvelles. (1976)
52
un contenu beaucoup plus prcis que pour le Franais moyen d'aujourd'hui. Un traditionaliste veut dire par l que la famille est une structure qui ne se conteste pas, que c'est une structure naturelle, donne d'avance, quelque chose dintangible quil est sacrilge de dtruire. Car s'attaquer la famille (comme l'ont fait, disent-ils, les rvolutionnaires), c'est s'attaquer la cellule constitutive de la socit ; c'est donc mettre tout l'difice social en pril. Balzac, que l'on peut rattacher aux traditionalistes comme tous les romanciers qui forment ce qu'on a appel le clan des B (Balzac, Bourget, Barrs, Bordeaux, Bazin), disait : La famille doit tre le point de dpart de toutes les institutions. De la bonne constitution de chaque famille, de sa solidit, de l'exercice effectif de l'autorit par le pre, dpendrait le bon ordre de la socit. [41] Concevoir la socit comme fonctionnant sur le modle de la famille est tentant pour un conservateur. Car c'est donner au pouvoir tabli un caractre sacr, puisqu'on le pare du prestige de la paternit. S'en prendre l'autorit revient s'en prendre son pre, un pre qui est pourtant plein d'affection pour ses enfants et qui ne fait montre d'autorit que pour leur bien. Une telle conception de la famille et de la socit peut servir des projets politiques ractionnaires, mais elle repose en fait sur une analyse sociologique fausse. La socit ne peut pas tre rduite un conglomrat de familles. Faire de la famille la cellule de base de la socit, c'est oprer un choix - qui n'est jamais justifi - parmi les nombreux groupes sociaux et institutions qui tendent structurer la socit. Peut-on isoler une cellule de base de la socit, comme si celle-ci tait faite de parties homognes ? De fait, il faut plutt la concevoir comme un enchevtrement de rapports humains de nature et d'intensit diffrentes, un enchevtrement de groupes humains, chaque individu appartenant , plusieurs groupes, tant reli plusieurs communauts . Admettre que, lorsque la famille est solide, la socit sera solide, c'est faire de la famille un facteur dterminant de l'volution sociale. Or, rien n'est moins sr. On peut au contraire penser que la famille est plutt dtermine par la socit. En tout cas, telle est la perspective d'explication marxiste du phnomne familial. Nous y reviendrons plus en dtail au cours de la deuxime partie.
Pierre Brchon, La famille. Ides traditionnelles, ides nouvelles. (1976)
53
Si l'on veut avec cette expression la famille, cellule de base de la socit , faire admettre toute la conception traditionaliste de la famille, c'est aujourd'hui inacceptable, car la socit n'est pas construite l'image de la famille. Pourtant on peut admettre cette expression en un autre sens. En effet, la famille est bien la base de la sociabilit humaine. Elle est le lieu d'apprentissage des rapports sociaux, c'est une des institutions qui assurent la socialisation de l'enfant. Donc, selon le type d'ducation que donnent les familles, selon la manire dont elles socialisent l'enfant, la socit sera modifie. D'ailleurs, dans le deuxime chapitre, l'importance de la structure des rles familiaux pour la transmission des valeurs a t souligne. Si l'on veut simplement dire, lorsqu'on emploie l'expression famille, cellule de base de la socit , que la famille est le premier lieu de la socialisation de l'enfant et de l'intriorisation des valeurs, cette expression est alors tout fait acceptable. Mais en fait, son utilisation reste dangereuse dans la mesure o elle est toujours employe dans un contexte qui ne permet pas de savoir quel sens on entend lui donner. Dans beaucoup de cas, son emploi semble traduire une trs forte valorisation de la vie familiale, valorisation qui va souvent de pair avec un certain conservatisme social. Pour ce chapitre, j'ai retenu trois formes actuelles de forte valorisation [42] de la ralit familiale. J'analyserai tout d'abord la conception catholique, puis celle de quelques hommes politiques de droite, enfin l'idal latent des gens qui voient dans la famille un havre de paix, un refuge au milieu d'une socit de conflits.
La conception catholique.
Retour la table des matires
Comme nous l'avons dj vu propos des rles parentaux, les conceptions traditionalistes ont t trs lies la pense catholique. On retrouve dans les textes des vques et des papes du XIXe et du XXe sicles la conception de la famille, cellule de base de la socit . Daniel Boureau, dressant un bilan de la tradition conciliaire de 1846 1870, crit ceci : La famille est conue comme la base de la
Pierre Brchon, La famille. Ides traditionnelles, ides nouvelles. (1976)
54
socit, sa cellule premire et quasi germinale, d'o tout le reste procde ou qu'il doit panouir, servir et prolonger 81 . Lon XIII est le premier pape parler longuement de la famille. Auparavant, les papes parlaient surtout du mariage pour dfendre son indissolubilit, affirmer le caractre naturel et divin de l'institution monogame. Il est certain qu'une telle conception du mariage qui est sacralis s'harmonise bien avec la conception traditionaliste. Qu'il y ait eu des liens troits entre les deux ne doit donc pas nous tonner.
Lon XIII parle beaucoup de la famille, qu'il appelle une socit domestique , expression qui tait celle de de Bonald, fort significative : famille et socit sont sur le mme modle. Dans Rerum Novarum (1891), la grande encyclique de Lon XIII, le pape donne une dfinition de la famine : La famille est une socit proprement dite, avec son autorit et son gouvernement propres : l'autorit et le gouvernement paternels 82 . Dans d'autres crits, le pape revient souvent sur l'ide que de la bonne constitution de la famille
dpend le bon tat de la socit 83 . Pie XI reprend les mmes ides que Lon XIII, ides qui semblent l'vidence et ne sont jamais discutes : Le mal s'est infiltr jusqu'aux racines profondes de la socit, c'est--dire jusqu' la cellule de la famille 84 . La socit, sera le reflet du foyer 85 .
Mgr Caillot, en 1933, explicite dans la lettre de Carme dj cite le sens de l'expression cellule sociale applique la famille : On entend dire souvent que la famille est "cellule sociale". C'est trs exact quant l'origine, [43] puisque la famille est la premire socit, et aussi quant l'importance, car tant vaudra la famille, tant vaudra la socit. C'est pourquoi l'intrt de la socit, comme son devoir, est d'ordonner les lois et les murs au bien de la famille 86 . En 1946 encore, le cardinal Suhard parle de
81 82 83
D. BOUREAU, La mission des parents, Cerf, 1970, p. 301. Le Mariage, op. cit., p. 140. Par exemple : La famille renferme les prmices de la socit et c'est en grande partie dans l'enceinte domestique que se forme la destine des tats. Encyclique Sapientiae christianae (1890) ; cit dans Le Mariage, op. cit., p. 137. Encyclique Ubi arcano du 23 dcembre 1922, dans Le Mariage, op. cit., p. 177. Lettre Quod novas l'piscopat du Venezuela, du 25 avril 1923 dans Le Mariage, op. cit., p. 178. Lettre de 1933, op. cit., p. 4.
84 85 86
Pierre Brchon, La famille. Ides traditionnelles, ides nouvelles. (1976)
55
la famille, incomplte, mais premire cellule de la socit 87 historiquement et ontologiquement. En 1945, la dclaration de l'piscopat franais, dj cite, parlait de la famille, socit naturelle tablie par Dieu , qui est le germe de la socit 88 .
t 89 . Si Pie XI et Pie XII pensent, comme les traditionalistes, que la famille est cellule de base de la socit, ce n'est pas au terme d'une analyse sociologique sujette volution. La fonction de la famille dans la socit est quelque chose de naturel, d'tabli par Dieu. Toute la socit apparat ainsi fige dans des rapports naturels, puisqu'elle est fonde sur une institution divine, sacre. Le conservatisme social en est renforc, il s'appuie sur la volont divine. Pie XII a d'ailleurs repris la mtaphore du corps humain, chre aux traditionalistes : La famille est le principe de la socit. Comme le corps humain se compose de cellules vivantes qui ne sont pas simplement poses cte cte, mais constituent par leurs relations intimes et constantes un tout organique, ainsi la socit est forme, non point d'un conglomrat d'individus, tres sporadiques qui apparaissent un instant pour s'vanouir ensuite, mais de la communaut conomique et de la solidarit morale des familles, qui transmettent de gnration en gnration le prcieux hritage d'un mme idal, d'une mme civilisation et d'une mme foi, assurant ainsi la cohsion et la continuit des liens sociaux 90 . Ce texte montre que l'insistance de la hirarchie dfendre la famille tient au pouvoir de conservation sociale qu'elle lui reconnat. Dans la stratgie de Pie XII comme de Lon XIII, la famille doit permettre de perptuer la civilisation chrtienne. C'est par elle que se transmettent la foi et les valeurs humaines que les papes veulent dfendre.
Pie XII, qui a beaucoup parl de la famille, emploie une formule voisine. Il parle du foyer familial, tabli par Dieu comme cellule vitale de la soci-
Il faut attendre le Concile Vatican II, dont les textes sont le plus souvent le fruit d'un compromis, pour voir merger des perspectives renouveles. On voit apparatre des termes comme communaut de vie et d'amour pour dsigner la famille, communaut conjugale .
87 88 89 90
Dans La famille, lettre pastorale du Cardinal SUHARD, Spes, 1946, p. 35. Voir La Documentation Catholique, 1964 col. 4. Allocution l'Union internationale des organismes familiaux, 1949, cite dans Le Mariage, op. cit., p. 331. Allocution aux jeunes poux, 1940, dans Le Mariage, op. cit., p. 268. On retrouve dans ce texte non seulement la mtaphore du corps humain, mais aussi le vieux clivage individu/famille, galement frquent dans la littrature traditionaliste.
Pierre Brchon, La famille. Ides traditionnelles, ides nouvelles. (1976)
56
On nous parle du couple et de l'amour des poux. On sort donc d'une perspective uniquement institutionnelle et lgaliste. La famille est dsormais prsente de faon plus existentielle, l'affectivit y est rintgre. On insiste sur le [44] rle des parents (on ne spare pas les rles du pre et de la mre) dans l'ducation de l'enfant, notamment pour leur ducation religieuse. Les parents doivent tre tmoins de la foi auprs de leurs enfants. Mais, l encore, la fonction de la famille dans la socialisation humaine et religieuse de l'enfant n'est pas considre comme relevant simplement de l'organisation des hommes. Ce n'est pas un fait sociologique, c'est une volont divine : Le Crateur a fait de la communaut conjugale l'origine et le fondement de la socit humaine (...). Cette mission d'tre la cellule premire et vitale de la socit, la famille elle-mme l'a reue de Dieu 91 . Donc, mme si les textes rcents de la hirarchie catholique ne reprennent pas la pense traditionaliste classique - laissant ce soin aux penseurs catholiques intgristes et d'extrme-droite - ils affirment constamment l'intervention de Dieu dans la constitution de la famille humaine. Il y a une structure familiale voulue par Dieu, base sur le couple monogame, uni indissolublement pour toute la vie. La fonction sociale de cette structure familiale est galement dtermine par Dieu lui-mme. Sur ces bases, on comprend que la famille ait t l'objet d'attention de la part de l'glise. Il tait plus facile de se pencher sur le rseau des relations primaires, plutt que d'affronter les problmes complexes des relations secondaires, des relations collectives et de pouvoir. Tout se passe comme si, pendant longtemps, la hirarchie catholique avait cru pouvoir solutionner le problme social en faisant appel des valeurs familiales, ce qui tait une faon de rgler au niveau des relations courtes ce qui relve des relations longues 92 .
91 92
Concile VATICAN II, Dcret sur l'apostolat des lacs, n 11. Ainsi lorsque Lon XIII voquait le problme social, regrettant notamment l'opposition des patrons et des ouvriers, il avait souvent recours des images familiales. Dans la grande famille humaine, tous sont les fils du mme pre cleste ; mme si les ingalits de conditions sont naturelles, il faut refaire l'unit et la cohsion du corps social par un esprit de charit. La socit comme la
Pierre Brchon, La famille. Ides traditionnelles, ides nouvelles. (1976)
57
Les textes ecclsiaux parlent toujours de la famille, de ce qu'elle doit tre naturellement et ontologiquement et ne parlent pratiquement jamais de la famille ouvrire, de la famille paysanne, de la famille bourgeoise. Tout au plus commence-t-on reconnatre timidement que l'glise n'a pas dfendre ni canoniser un modle de famille, li une culture donne. Mais on soutient tout aussitt que l'glise doit dfendre des valeurs invariantes qui sont plus que de vagues orientations et constituent pratiquement un modle familial : Le sens du mariage chrtien, son unit et son indissolubilit, les exigences naturelles de l'amour conjugal au regard de l'panouissement des poux et de la procration, le respect [45] absolu d la vie humaine, le rle primordial des parents dans l'ducation, la place de la famille dans la socit et dans l'glise , tels sont, selon le cardinal Villot 93 , les points de rfrence essentiels , la base de l'institution familiale invariante. Les formes culturelles dont on reconnat le caractre changeant sont en fait fort troites. De plus, comment discerner ce qui, une poque donne, est invariant, et ce qui est relatif et changeant ? La lettre du cardinal Villot n'apporte pas cette question de rponse satisfaisante. Il me semble personnellement que l'invariant d'une poque est toujours dfini culturellement. Telle socit, telle culture, vont valoriser tel aspect, telle ralit. Ce qui est valoris par la socit apparat alors comme invariant pour ceux qui le valorisent. Mais l'invariant lui-mme, ou ce que nous appelons tel aujourd'hui, est entre les mains des hommes. C'est nous qui nous construisons notre morale et nos valeurs. La famille sera donc ce qu'on la fera. On peut s'attendre ce que les chrtiens cherchent dans l'vangile le critre des valeurs familiales invariantes. Mais l'vangile, ce n'est pas la lgislation primitive de de Bonald. On n'y trouve pas une conception vidente et simple des valeurs promouvoir. Selon la thologie catholique, l'vangile doit s'interprter en glise. Or, toute interprtation est videmment culturelle, elle est le fait d'hommes et de femmes qui sont situs socialement. Il n'y a pas d'interprtation neutre de l'vangile et il n'y a pas de conception neutre de la famille !
famille est faite pour tre une cellule unie et harmonieuse, si chacun admet sa condition. Lettre du Cardinal VILLOT la Semaine Sociale de Metz, 1972. Dans Couples et familles dans la socit d'aujourd'hui, Chronique Sociale de France, pp. 5-11.
93
Pierre Brchon, La famille. Ides traditionnelles, ides nouvelles. (1976)
58
En tout cas, la conception actuelle de la hirarchie catholique sur la famille, position trs ferme sur un certain nombre de principes jugs fondamentaux, coupe l'glise du contact avec certaines cultures trs diffrentes de la ntre : grande difficult ainsi pour l'glise s'implanter en milieu polygame, incomprhension chez nous des personnes qui vivent de nouvelles relations familiales (union libre, communauts, divorce et remariage, relations prnuptiales...). Cette excessive importance donne aux problmes familiaux par l'glise fait que l'on peut se demander parfois quelle est la mission de l'glise : annoncer Jsus Christ ou faire rgner un certain ordre familial ?
La famille chez les hommes politiques conservateurs
Retour la table des matires
Actuellement la pense familiale traditionaliste rapparat galement, de faon plus ou moins marque, dans les milieux politiques conservateurs et modrs. L'ide de la famille, cellule de base de la socit , merge [46] nouveau. L'homme politique franais qui, ces dernires annes, a le plus parl de la famille est Georges Pompidou. Il a consacr ce sujet tout un discours lors du 25e anniversaire de l'Union Nationale des Associations Familiales 94 . Il considre la famille comme la cellule partir de laquelle s'difie et se constitue la socit. Elle est l'lment susceptible de la rgnrer : De tous les groupes sociaux, elle est celui qui a le mieux rsist ; elle est surtout celui qui est le mieux plac pour survivre toutes les crises de notre civilisation (...). Elle est la mieux place pour rsister aux branlements, parce qu'elle est fonde sur la nature, sur la loi de l'espce (...). La famille me parat aussi parfaitement adapte quelques-unes des aspirations les plus profondes de notre poque , notamment aux besoins contradictoires d'indpendance et de solidarit. Chacun trouve dans sa famille la possibilit d'tre la fois lui-mme et partie d'un ensemble . La famille serait un lieu quelque peu idyllique, o l'on peut tou94
Publi dans le journal Le Monde du 6-7 dcembre 1970.
Pierre Brchon, La famille. Ides traditionnelles, ides nouvelles. (1976)
59
jours venir se reposer, refaire ses forces. Certes, reconnat Georges Pompidou, la famille n'est pas toujours unie, les divorces augmentent, il y a des naissances prnuptiales. Mais, justement, la venue de l'enfant change les perspectives : Dsormais, au hasard des rapprochements individuels, se substitue la loi du couple runi autour d'un enfant sur lequel se rgle la vie commune. Tout compte fait, fondamentalement, la famille en France est reste saine, et son avenir n'est pas moralement compromis . La vision de la situation que brossait Georges Pompidou n'est donc pas la vision pessimiste des traditionalistes qui, depuis le XIXe sicle, dnoncent la ruine de la famille (une famille qui, semble-t-il, n'en finit pas de mourir et djoue ainsi leurs pronostics !). Les divorces et les naissances prnuptiales ne semblent pas alarmer outre mesure l'ancien prsident, alors que les traditionalistes et certains catholiques y voient au contraire la mort de l'institution familiale. Aprs cette analyse de situation, Georges Pompidou poursuit : Le but, c'est donc de donner la famille, telle qu'elle se cre aujourd'hui, plus tt et peuttre plus la lgre qu'autrefois, ses meilleures chances de dure et de solidit. L on retrouve des ides qui sont la fois celles des traditionalistes et celles des chrtiens : la famille doit, si possible, durer. Pour que la famille dure et soit solide, les parents comme l'tat ont chacun son rle : la solidit des jeunes couples dpend de l'exemple que leur auront donn leurs parents ; les parents ne doivent pas abdiquer leur autorit. Mais l'tat a aussi des devoirs l'gard des familles ; cela se traduit dans la lgislation qu'il met en place : autorit parentale, divorce, [47] avortement, contraception. L'tat doit aussi crer les conditions morales et matrielles favorables la vie de la famille . Pour cela, il doit avoir des rapports avec les associations familiales et mettre en uvre une politique active en matire de prestations familiales, de logement, de garderies d'enfants, d'enseignement... En conclusion, Georges Pompidou revient des thmes plus idologiques : Il ne faudrait pas conclure de mes propos que la socit actuelle, qui tend tre un agglomrat d'individus, doit devenir un simple agglomrat de familles. Il est bien vident que la vie personnelle et collective dborde le cadre familial et que la ncessit de recrer des
Pierre Brchon, La famille. Ides traditionnelles, ides nouvelles. (1976)
60
solidarits s'impose non seulement sur le plan de la famille, mais sur celui de la cit, de la nation, voire d'un cadre plus large, comme aussi de la profession ou de la spiritualit. J'ai simplement voulu dire que de tous les instruments notre disposition pour rendre une me notre socit et assurer ainsi sa survie, la famille est le plus disponible, le plus solide et un des plus efficaces. Donc la famille est considre par Georges Pompidou comme ayant un rle social trs important jouer, puisqu'elle doit permettre la rgnrescence de la socit, qui est trop un agglomrat d'individus au lieu d'tre un tissu de solidarits.
D'autres hommes politiques de mme tendance ont eu l'occasion de prciser leur conception de la famille, mais gnralement de faon plus brve. C'est ainsi qu'on lit dans la revue Parents (janvier 1973) : la famille, o s'duquent les enfants, ne peut pas tre trs diffrente de ce qu'elle tait dans le pass (Michel Poniatowski, rpublicain indpendant). Il faut remettre l'honneur cette irremplaable cellule sociale, dont le rle est essentiel pour l'quilibre du couple et l'panouissement des enfants (Jean Lecanuet, Centre dmocrate). C'est l que l'on doit acqurir les principes essentiels du comportement humain (Alain Peyrefitte, U.D.R.) 95 .
tir de laquelle on peut construire l'avenir 96 . Dans cette dclaration comme dans celle de Georges Pompidou, la famille est un noyau dur , naturel, qui n'a pas avoir de principe explicatif. Au contraire, c'est lui qui explique la socit. Ltat a des devoirs l'gard de la famille, mais celle-ci est relativement autonome, elle rsiste mieux que les autres institutions aux changements [48] du sicle. Elle apparat ainsi comme la base d'une restauration sociale, d'une rgnrescence. On retrouve la mme ide dans les thses d95
Quelques mois plus tard, dans sa dclaration de politique gnrale l'Assemble nationale, Pierre Messmer, premier ministre, a repris les arguments de G. Pompidou en 1970 : La famille est la cellule de base de notre socit, elle qui a le moins mal rsist aux bouleversements de notre sicle et par-
96
Dans le mme article, Franois Mitterrand, premier secrtaire du P.S., estimait que la famille est la cellule de base de la socit ; Georges Marchais, secrtaire gnral du P.C.F., souhaitait le dveloppement harmonieux de la famille ; c'est un des foyers d'enrichissement de l'individu . Quant Michel Rocard, P.S.U., il affirmait que dans la socit socialiste d'autres modles que la famille seront possibles, mme si la famille y garde la place principale . Cf. Le Monde du 12 avril 1973.
Pierre Brchon, La famille. Ides traditionnelles, ides nouvelles. (1976)
61
fendues par les puissantes associations de parents d'lves de l'enseignement libre (APEL). Monsieur O'Mahony, prsident national des APEL, dclarait en 1973 : Le seul pilier encore solide dans notre socit, c'est la famille. Elle pourra de moins en moins s'en remettre l'cole ; aussi faut-il instaurer une collaboration plus troite. Les problmes d'ducation religieuse, affective, sexuelle, doivent tre rsolus en commun, l'cole et la maison. (cf. le compte rendu de la dlgation nationale des APEL, runie Nice, dans Le Monde du 5.6.73). Si l'on considre ce qu'ont dit les candidats aux lections prsidentielles de mai 74, on constate qu'ils ont peu parl de la famille. Cependant Valry Giscard d'Estaing, rpublicain indpendant, dclarait au cours d'un meeting le 11 mai Poitiers : La famille doit tre protge et dfendue. Dans notre socit si mouvante et parfois mme si inquitante, elle est la stabilit. Dans notre environnement si incertain, elle est la scurit. Dans notre monde si dur, elle est la tendresse. Tout doit tre fait pour que les enfants de ce pays naissent et grandissent dans des familles solides et unies. Cette dclaration oppose famille et monde. Dans un monde incertain, dur, inquitant, la famille est au contraire stabilit, scurit, tendresse. C'est un peu une le au milieu d'un ocan, ou plutt un coin de paradis entour d'un monde infernal. Cette conception, qui affleurait dj chez Pierre Messmer et chez Georges Pompidou, correspond bien ce que vivent beaucoup de gens, pour qui la famille est surtout un refuge, un havre de paix, la soupape de sret par rapport un monde professionnel fait de conflits et de difficults permanentes. J'y reviendrai ci-dessous. Dans les professions de foi des onze candidats au premier tour des lections prsidentielles de mai 1974, les rfrences la famille sont rares. C'est assez comprhensible. Il est difficile un candidat qui veut runir beaucoup de suffrages sur son nom de s'engager dans une question trop idologique. Il diviserait ses lecteurs et perdrait des voix. Tout au plus peut-il reprendre des formules vagues, qui seront contestes par peu de monde, mme si elles sont fort ambigus. Sur les neuf candidats dont j'ai pu le : Ren Dumont, Alain Krivine et Arlette Laguiller 98 . Les trois candidats d'extrme-gauche ne parlent pas de la famille. En parler, serait-ce automatiquement la dfendre, prendre parti pour elle ? Quatre candidats en parlent fort peu, par allusion, sans s'engager idologiquement, se contentant souvent de mentionner des objectifs de politique
97 98
retrouver les professions de foi 97 , trois ne parlent pas du tout de la famil-
Je n'ai pas pu trouver celles de MM. Renouvin et Sebag. Nanmoins cette dernire souligne qu'elle est une candidate fminine et s'lve contre la situation de la femme dans la socit actuelle.
Pierre Brchon, La famille. Ides traditionnelles, ides nouvelles. (1976)
62
familiale : Franois Mitterand rappelle que la mre de famille connat bien des soucis : hausse des prix, manque d'emploi pour les jeunes, etc... Jacques Chaban-Delmas affirme qu'il ne peut y avoir de changement que dans l'ordre, un ordre profond, ncessaire de la cellule familiale la socit tout entire, en passant par l'entreprise... Il note ensuite que la politique de la famille (..) doit bnficier du contrat de progrs promis par le prsident Georges Pompidou . Emile Muller se propose d'instituer un revenu minimum familial . [49] Enfin, Valry Giscard d'Estaing veut assurer la scurit des Franais face aux charges de famille . Seuls deux candidats parlent plus longuement et plus explicitement de la famille. Ce sont deux candidats d'extrme-droite. Jean Royer, qui se veut candidat libre hors des partis , pense qu'il faut chercher bien intgrer dans la vie nationale les communauts naturelles , et notamment les familles. Suit un paragraphe intitul la vie familiale . Le premier problme soulev est celui de l'avortement viter par plusieurs mesures relevant des individus ou de l'tat. De toute manire, aider la mre accepter et accueillir son enfant constitue une ncessit fondamentale de la cellule de base de notre socit . Deuxime problme soulev : il faut quilibrer le rle professionnel et conjugal ou maternel de l'pouse en dveloppant le travail mi-temps, en instituant le salaire de la mre au foyer, en adaptant le fonctionnement des crches aux besoins des familles. Troisime problme enfin : par des mesures fiscales en faveur des familles, par une plus juste rpartition des allocations familiales, par un encouragement l'accession la proprit, l'tat agira pour l'panouissement des familles. On ne retrouve pas l entirement la philosophie traditionaliste. Mais la rfrence la famille comme communaut naturelle 99 , la place faite au problme de l'avortement et la position dfendue sur ce sujet, ainsi que la volont de prserver la place de la mre au foyer, dnote des ides conservatrices.
Les positions de ce candidat rejoignent celles du Mouvement Laissez-lesvivre, compos en majorit de catholiques pour qui une politique sociale et familiale hardie est le corollaire du droit la naissance . Le Congrs de ce Mouvement, runi Strasbourg en mai 1973, a souhait la cration d'un mi-
99
Charles Maurras, leader de l'Action Franaise, pensait au dbut du sicle que la socit doit s'appuyer sur des communauts naturelles , c'est--dire des communauts dont l'histoire a prouv la pertinence. Il en retenait trois : la famille, la rgion, la corporation de mtier. D'ailleurs Maurras tait un admirateur du traditionaliste Le Play ; il crivait : Qu'il s'agisse de relever la natalit ou d'organiser le travail, de reconstituer ou d'assurer le foyer domestique, ou de procder la dcentralisation, toutes les rformes srieuses qui se prparent devant nous tirent de Le Play leur substance.
Pierre Brchon, La famille. Ides traditionnelles, ides nouvelles. (1976)
63
nistre de la famille, susceptible de mener une vritable politique familiale, protgeant mres et enfants dans les domaines des prestations familiales, de la Scurit Sociale, du logement, de l'enseignement, de l'ducation et de la fiscalit . Il s'est prononc pour la cration d'un salaire maternel, car les tches multiples de la mre de famille constituent une prestation de travail considrable dont bnficie la socit . Ce salaire, vers la femme se consacrant entirement l'ducation de son ou de ses enfants , devrait tre gal au SMIC (cf. compte rendu des travaux de ce congrs dans Le Monde du 8.5.73). Plus rcemment, le Mouvement Laissez-les-vivre a protest contre les projets de modification du quotient familial, estimant que les familles qui ont eu le courage d'lever des enfants en ptiraient. L'UNAF et les associations familiales catholiques ont pris des positions semblables. Or on sait que le quotient familial aboutit favoriser beaucoup les familles revenus levs par rapport aux familles modestes. La rduction d'impt est en effet beaucoup plus forte pour une famille revenus levs que pour une famille faibles revenus. On peut donc douter du caractre hardi de la politique sociale et [50] familiale revendique par ces mouvements. Leur politique familiale dfend - au moins en partie - les intrts des couches sociales majoritaires dans ces mouvements. L'autre candidat d'extrme-droite, Jean-Marie Le Pen, qui se dit candidat de salut public, soutenu par la droite sociale, populaire et nationale , dveloppe de faon beaucoup plus nette l'idologie traditionaliste. La France traverse une grave crise : la dcadence morale et civique qui mine notre socit . Le dsordre est partout : dans la rue, dans l'entreprise, dans la famille, dans les esprits et dans les curs. La socit est menace par la mise en cause des hirarchies naturelles . On retrouve tout fait le catastrophisme des traditionalistes 100 . La crise n'est pas d'abord conomique, elle est morale. C'est une position idaliste. Parmi les dix orientations politiques et sociales essentielles de J.M. Le Pen, l'une s'intitule : dfendre la cellule familiale . Il n'est pas, crit son auteur, de socit libre et stable si la famille n'en assure la continuit. L'tat a le devoir d'aider matriellement et moralement ceux et celles qui ont accept les lourdes charges familiales. Dans l'immdiat, le criminel projet de loi en faveur de l'avortement doit tre combattu, et ses initiateurs, les membres du gouvernement encore en fonction, dnoncs sans faiblesse.
Ces positions extrmistes de dfense de la famille sont aussi celles de certains intgristes catholiques. Je cite un opuscule de Marcel Clment,
100
Une brochure des Comits de Dfense de la Rpublique, publie dbut 1974, soulignant que les jeunes sont soumis beaucoup d'influences nfastes (drogue, sexe, cole, politique), conclut : L'autorit naturelle des parents demeure le dernier rempart contre cette entreprise de dtournement de mineurs.
Pierre Brchon, La famille. Ides traditionnelles, ides nouvelles. (1976)
64
opuscule publi pour la campagne lectorale lors des lections lgislatives de mars 1973, et destin dnoncer le programme commun de la gauche. Cet opuscule s'intitule le programme du totalitarisme 101 . Lanti-communisme viscral est le trait dominant de cette brochure, qui consacre deux pages la nationalisation de la famille : c'est en effet, selon M. Clment, le rsultat qu'aurait le programme commun de la gauche, s'il venait tre appliqu. Ce programme substitue l'initiative de l'tat celle des familles. Les familles perdraient leur autonomie. La famille ne serait plus cellule de vie prive . Ce programme, c'est l'intgration des individus dans la collectivit idologique d'entreprise, de quartier, de mouvements de jeunesse ou de maisons de clibataires . C'est la mainmise de ltat totalitaire sur les enfants ds leur plus jeune ge. C'est l'exaspration de l'individualisme sexuel et de l'gosme affectif, avec en contrepartie l'encadrement idologique de l'tat totalitaire. Quand on connat le programme commun de la gauche en matire familiale - il ne comporte aucune mesure d'ordre trs rvolutionnaire - y voir de si funestes consquences fait sourire !
En rsum, les milieux politiques conservateurs valorisent beaucoup la famille qu'ils considrent comme une ralit sociale importante, un noyau dur et stable permettant de rsister aux changements et qu'il faut [51] donc protger. Nous verrons dans la deuxime partie que la gauche porte aussi un certain intrt la famille et qu'elle a des positions en la matire, positions videmment diffrentes de celles de droite et d'extrme-droite.
La famille havre de paix.
Retour la table des matires
La survalorisation de la famille se retrouve encore l'tat latent dans l'idal de beaucoup de personnes, qui considrent la famille comme un havre de paix, comme un refuge. La socit serait mauvaise : l'homme y est alin dans son travail, il ne trouve aucun intrt dans une vie professionnelle routinire, o il n'a aucune responsabilit. Les rapports professionnels sont des rapports hirarchiques : toujours un
101
Le programme du totalitarisme, par Marcel CLMENT. Supplment au journal L'Homme nouveau n 588 du 13 dcembre 1972. Voir, en ce qui concerne la famille, pp. 9-10.
Pierre Brchon, La famille. Ides traditionnelles, ides nouvelles. (1976)
65
chef affronter, qui est l pour surveiller... Si l'on veut s'imposer, il faut se battre ; pour avoir de la promotion, il faut parfois ruser, entrer dans les vues de la direction, ramper . La socit est donc vue comme un lieu de conflits durs, pres, o l'on ne rencontre que bien rarement comprhension, solidarit, relations amicales. Ayant une perception telle de la socit, perception base souvent sur des ralits, certains ont tendance idaliser la vie familiale, y voir le havre de paix, le lieu protg l'abri des conflits, le paradis o l'on pourra communier avec autrui, aimer et tre aim, vivre sans masque, en transparence, sans tre jug. La famille apparat comme le lieu des relations galitaires, o le face face est possible, alors que la socit nest que hirarchie. C'est ainsi que, rpondant une enqute faite auprs de travailleurs sur leur perception de la hirarchie, un ouvrier disait : Il n'y a pas de hirarchie dans la famille. Ce serait bien s'il y avait autant de remises en cause dans l'entreprise que dans la famille. Hirarchie et famille sont antinomiques : la hirarchie est exclue quand il y a des liens affectifs 102 . La famille serait donc le lieu du bonheur, [52] oppos une socit qui ne rserverait l'homme que des dsillusions. Dans cette perspective, la famille est bien toujours considre comme une cellule. Elle est en effet un milieu autonome, clos sur luimme, ferm aux influences extrieures nfastes. Mais l'expression cellule de base de la socit s'applique mal, dans la mesure o elle
102
Des travailleurs parlent de la hirarchie , C.F.D.T. Aujourd'hui n 8, juilletaot 1974, p. 6. L'auteur de l'article commentait ainsi : On peut cependant se demander si cette affirmation ne traduit pas aussi un refus de poser les problmes de pouvoir et d'autorit au sein de la famille, pour ne pas risquer de remettre en cause son fonctionnement. On trouve dans le mme numro un dessin humoristique de Sabadel, constitu par quatre images de la mme personne diffrentes poques de sa vie. Encore petit enfant, la maison, on nous la montre en train de dire oui, papa ; un peu plus grande, l'cole, elle dit oui, m'sieur ; puis l'arme oui, chef ; enfin l'usine oui, patron . Ce dessin humoristique a toute une signification. Pour Sabadel, la hirarchie se retrouve dans toutes les institutions. La famille, l'cole, l'arme, apparaissent comme les premires institutions qui conditionnent l'individu et lui apprennent tre ensuite soumis dans l'entreprise. Si l'on veut que les travailleurs acceptent de faon moins docile l'autorit dans l'entreprise, il faut donc agir sur toutes les institutions, modifier tous les rapports sociaux.
Pierre Brchon, La famille. Ides traditionnelles, ides nouvelles. (1976)
66
implique que famille et socit sont en prolongement, sont relies l'une l'autre, alors que l'idal de la famille havre de paix repose sur une opposition famille-socit. La famille serait presque extrieure la socit. Les deux optiques se rconcilient d'ailleurs chez certains traditionalistes et hommes politiques modrs pour lesquels, nous l'avons vu, la famille est un noyau dur , une cellule autonome , presque une forteresse partir de laquelle on peut tenter de reconstruire une socit bonne, alors qu'elle tait jusque-l mauvaise. En fait cependant, la plupart des gens qui voient dans la famille un havre de paix ne veulent pas faire de leur famille la position avance d'une restauration sociale. Ils ne demandent rien d'autre que de pouvoir jouir d'un bonheur familial, d'un confort moyen, de l'intimit du foyer. Je suis personnellement frapp par l'attitude constate chez certains jeunes couples qui, partir du moment o ils sont maris, abandonnent pratiquement toutes leurs relations amicales, renoncent leurs engagements politiques ou syndicaux passs, se replient sur un cercle trs troit, une vie deux dans la semaine, la visite aux parents pendant le week-end, comme si la vie conjugale et la naissance des enfants pouvaient suffire leur bonheur. Nous retrouvons dans la publicit cette image d'une famille, lieu du bonheur et du confort, havre de paix o il n'y a aucun conflit et o les problmes de la vie professionnelle sont vacus 103 . videmment cette image publicitaire est une image mythique, ce n'est pas la vie relle des familles. Mais si la publicit continue nous la prsenter et si cette image continue avoir un impact sur beaucoup, c'est qu'elle correspond leur idal familial. Si beaucoup aspirent raliser ce modle, ils sont aussi dus par ce qu'ils vivent en famille. Leur idal, qui demeure, n'aboutit pas. Car ils vont faire l'exprience du conflit dans la famille. Ce lieu qu'ils croyaient abrit est en fait travers par les conflits sociaux. Les rapports du couple seront parfois tendus, mme si l'amour des poux subsiste. Surtout les rapports avec les enfants, notamment au moment de l'adolescence, n'auront rien d'idyllique. Beaucoup de parents vont alors se culpabiliser parce que cette vie familiale, chaude et fraternelle,
103
Cf. l'article de J. FREYSSINET dans La famille hier, demain, op. cit., pp. 3637.
Pierre Brchon, La famille. Ides traditionnelles, ides nouvelles. (1976)
67
dont ils rvent, eh bien ! [53] leurs enfants n'en veulent pas. Ils ne pensent pas et n'agissent pas comme leurs parents ; ils revendiquent leur autonomie par rapport leur famille.
On peut se demander si l'chec d'un certain nombre de couples, chec qui se traduit par un divorce et donc par l'clatement d'une famille, n'est pas d leur dsir de vivre des relations sans conflits. Ils s'taient maris croyant trouver dans leur couple, dans leur foyer, le bonheur, y investissant toutes leurs nergies, et en fait ils dcouvrent le conflit prsent dans leurs rapports conjugaux, dans leur foyer. C'est cette thse qui est dveloppe dans une table ronde sur le mariage en crise , publie par Esprit en septembre 1972. Il n'y a pas crise du mariage, puisqu'on se marie beaucoup et qu'on attend du couple et de la famille la russite affective, la valorisation personnelle. On demande peut-tre au mariage et la famille plus qu'ils ne peuvent apporter, dans la mesure o, sociologiquement, ce sont avant tout des institutions permettant de transmettre les valeurs d'une socit, des institutions qui canalisent et rglementent l'expression de la sexualit dans une socit. Donc il n'y a pas crise du mariage, il y a crise de ce que la socit attend aujourd'hui du mariage 104 . On en attend beaucoup, mais l'exprience de l'insatisfaction, de la dception, est galement frquente. Les poux ayant investi beaucoup dans la vie familiale (d'autant plus que leur vie professionnelle et sociale manque d'intrt), un mariage malheureux, un chec de l'amour sont ressentis par eux beaucoup plus durement qu'autrefois. Car ils sont plus exigeants sur la qualit de leurs relations entre poux, ils en attendent le bonheur. De plus, par rapport aux socits primitives , et mme par rapport la socit d'Ancien Rgime, il manque chez nous le clan , le groupe intermdiaire entre famille nuclaire et socit. Aujourd'hui, sortis du cercle familial, beaucoup d'individus sont des isols dans la foule, des solitaires au milieu des masses. On peut se demander quelles sont les consquences sociales et politiques de ce repliement de beaucoup de gens sur la vie familiale, sur l'intimit du foyer 105 . Il me semble que cette tendance au repliement familial favorise le conservatisme social. La socit apparaissant globalement comme dcevante,
104
105
La croissance du nombre des divorces n'est pas signe d'une crise du mariage et de la famille. Cela montre un fort attachement l'idal familial. Si l'on divorce, c'est parce qu'on estime que la famille doit donner le bonheur auquel on a droit. Si elle ne le donne pas, beaucoup en tirent les consquences et se sparent. De plus, on divorce souvent pour se remarier. C'est prcisment cette tendance faire de la famille un foyer clos quAndr Gide avait en horreur. Mounier aussi, comme nous aurons l'occasion de le voir.
Pierre Brchon, La famille. Ides traditionnelles, ides nouvelles. (1976)
68
beaucoup n'en attendent plus rien, ne s'y intressent plus. Ils ne suivent plus l'actualit, n'ont plus de projet social et politique, l'idal familial leur suffit. Une campagne lectorale la tlvision arrive difficilement sortir ces personnes de leur apathie. C'est la socit, cette intruse, qui fait irruption dans leur intimit. Tout le problme pour les candidats est prcisment d'essayer de conqurir ces voix peu stabilises, en montrant que leur programme permettrait une vie familiale meilleure, un meilleur niveau de vie, etc... Donc il me semble que l'idal de la famille refuge, havre de paix, va de pair avec une certaine passivit politique. Or toute passivit politique favorise en fait [54] le pouvoir en place. Celui qui investit toutes ses nergies dans sa famille n'est pas un militant. Ce n'est pas lui qui lancera une action de quartier, ou qui animera une grve dans son usine ou son atelier.
* * * Nous avons analys dans ce chapitre trois courants actuels qui ne sont pas de mme nature : la pense catholique, les milieux politiques conservateurs, une tendance de l'opinion. Dans les trois cas on retrouve une forte valorisation de la famille, mme si celle-ci s'appuie sur des raisons diffrentes. Et dans les trois cas, il semble bien que cette valorisation de la famille aille de pair avec des conceptions sociales et politiques conservatrices, ou qu'elle soit lie une apathie sociale et politique. Voir dans la famille une cellule de base de la socit ou un havre de paix, une cellule protge, ce sont donc des positions qui ne sont pas neutres politiquement. Il convenait de le dmontrer. Les thories sociales conservatrices font jouer la famille un rle minent. Pour les traditionalistes, la famille a une causalit, puisqu'elle fonde la socit qui est en germe dans la famille. Cette ide traditionaliste a eu, comme nous l'avons vu, une longue postrit. Et on la retrouve encore l'tat latent dans l'expression ambigu la famille, cellule de base de la socit . De mme le paternalisme que l'on retrouve toujours dans les thses traditionalistes est une attitude sociale que l'on rencontre encore fort souvent chez les gens qui dtiennent une parcelle d'autorit. De mme encore la conception des rles parentaux spcifis selon le sexe. Les ides traditionalistes ont en fait marqu toute la culture, comme elles ont marqu la pense ca-
Pierre Brchon, La famille. Ides traditionnelles, ides nouvelles. (1976)
69
tholique. Jean Lacroix crit d'ailleurs : Il n'est sans doute pas de conception qui ait davantage influenc la pense catholique sous ses diffrentes formes 106 . Il convenait de rappeler ces thories au dbut de ce livre, car nous en sommes encore tous plus ou moins imprgns, ne serait-ce qu' travers les strotypes et les modles qu'il est facile de contester en parole, mais qu'il est plus difficile de contester dans la pratique quotidienne. Nanmoins ces thories, notamment dans leur expression la plus absolue au XIXe sicle (poque o dfendre la famille, c'tait dfendre l'ancien rgime politique, social et religieux, c'tait prendre parti pour la Restauration et condamner la Rvolution), ces thories ne sont pas restes sans [55] contestations. D'autres systmes de pense ont prsent d'autres visions de la famille, notamment le marxisme et l'anarchisme. Ce sont ces ractions au traditionalisme que nous allons prsenter dans la deuxime et la troisime parties.
106
Jean LACROIX, La famille et le mouvement des ides, leon la Semaine Sociale de Bordeaux 1957. Publi en annexe des ditions rcentes de Force et faiblesses de la famille, Seuil, 1957. pp. 166-167.
Pierre Brchon, La famille. Ides traditionnelles, ides nouvelles. (1976)
70
[57]
LA FAMILLE. Ides traditionnelles, ides nouvelles.
Deuxime partie
Marxisme et famille
Retour la table des matires
Pierre Brchon, La famille. Ides traditionnelles, ides nouvelles. (1976)
71
[58]
LA FAMILLE. Ides traditionnelles, ides nouvelles.
Deuxime partie. Marxisme et famille
Chapitre 4
Les thoriciens marxistes
Retour la table des matires
Si les traditionalistes parlent abondamment de la famille, les matres penser du marxisme sont, quant eux, plutt discrets sur ce sujet. La famille na certainement pas, dans leur systme, la place dominante qu'elle occupe chez les traditionalistes. On ne trouve chez Marx lui-mme que des passages pars, assez brefs, consacrs la famille, passages souvent d'interprtation dlicate. Engels est plus prolixe sur le sujet ; s'appuyant sur les thses de Morgan, que lon pourrait considrer comme le pre de l'ethnologie, Engels crit un livre qui se veut une histoire des institutions familiales, expliques par le dveloppement des socits. Beaucoup d'auteurs ont repris et enrichi les thses de Marx et Engels. Il n'est pas question d'en proposer une tude complte. J'ai donc fait un choix ; cinq auteurs seront analyss ici pour voir quelle est leur conception de la famille : Marx, Engels, Bebel, Lnine, Muldworf. Cette succession est chronologique mais peut paratre curieuse, tous ces au-
Pierre Brchon, La famille. Ides traditionnelles, ides nouvelles. (1976)
72
teurs ne se situant pas sur le mme plan. Marx et Engels sont des pres fondateurs incontests, Lnine peut tre qualifi de la mme faon, dans la mesure o il a enrichi et peut-tre corrig - en fonction de sa pratique politique - certaines thses de Marx et dEngels. Par contre Bebel est un vulgarisateur des ides marxistes et Muldworf est un mdecin franais, membre du parti communiste, qui tente d'allier les thses marxistes avec les apports de la psychanalyse. [59]
La pense de Marx et dEngels.
Retour la table des matires
Chronologiquement, le premier texte o Marx voque la famille est un passage des Manuscrits de 1844 107 . Marx n'a pas encore crit ses grands ouvrages et sa thorie n'est pas encore affermie. Il se situe dans ce texte plus en philosophe qu'en conomiste. Il utilise un langage abstrait, marqu par Hegel et Feuerbach. Ce texte peut se rsumer, me semble-t-il, en trois affirmations : La sexualit est naturelle en l'homme. Comme les animaux, l'homme est un tre de besoin. Il a un instinct sexuel. Mais la sexualit est aussi d'emble sociale ; le besoin sexuel naturel ne peut se satisfaire sans la prsence d'autrui 108 .
107
108
Karl MARX, Manuscrits de 1844, dans Oeuvres compltes, La Pliade, tome 2, traduit par Maximilien Rubel, p. 78. [Livre disponible dans Les Classiques des sciences sociales. JMT.] Jean Lacroix souligne que la pense de Marx est ici fort proche de celle de Hegel. Pour Hegel, la famille est la fois nature et esprit ( essence humaine devenue nature pour l'homme ). La famille est une institution encore proche de la nature, elle est l'esprit en son immdiatet ; elle ne repose pas sur un contrat social, sur un accord des volonts. Cf. J. LACROIX, Force et faiblesses de la famille, op. cit., pp. 158-162.
Pierre Brchon, La famille. Ides traditionnelles, ides nouvelles. (1976)
73
La manire dont la sexualit est vcue concrtement dans une socit est rvlatrice de la qualit humaine des autres rapports sociaux.
Donc le rapport homme-femme n'a pas de causalit propre. La manire dont il est vcu n'influence pas la socit. C'est au contraire la qualit, la nature des autres rapports sociaux qui marquent le rapport homme-femme. Marx nous dit : regardez l'tat des rapports homme-femme, vous connatrez l'tat de la socit. Si la femme est esclave , c'est que l'homme est alin, que la socit qui produit l'esclavage de la femme n'est pas humaine : Dans le comportement l'gard de la femme, proie et servante de la volupt commune, s'exprime l'infinie dgradation de l'homme vis--vis de luimme. Donc Marx souligne l'importance du rapport homme-femme. Mais il n'en fait qu'un rvlateur. La dgradation du rapport homme-femme ne rend pas l'homme alin et la socit inhumaine (comme le penseraient les traditionalistes). La famille ne peut plus tre conue comme cellule de base de la socit . La situation de la famille est le reflet, le miroir d'une socit humaine aline, l'alination tant due la proprit prive des moyens de production : L'abolition positive de la proprit prive, l'appropriation de la vie humaine, signifient donc la suppression positive de toute alination, par consquent le retour de l'homme hors de la religion, de la famille, de l'tat, etc... son existence humaine, c'est--dire sociale 109 . Marx condamne-t-il l toute forme d'institution familiale ? Je ne le pense pas. Il condamne la forme de famille produite par une socit aline. En effet la socit capitaliste produit une famille bourgeoise et une famille proltaire, toutes [60] deux alines. Pour Marx la famille ne peut tre panouie, humaine, dans une socit qui ne l'est pas. Mais quelle est, selon Marx, la situation de la famille dans ces deux classes sociales ?
La famille bourgeoise est, selon Marx, une famille dissolue, une famille sans moralit : La bourgeoisie a dchir le voile de sentiment et d'motion qui couvrait les relations familiales et les a rduites n'tre que de simples rapports d'argent 110 . Sur quelle base repose l'actuelle famille bourgeoise ? Sur le capital, le profit individuel 111 .
109 110 111
Karl MARX, Manuscrits de 1844, Editions sociales, p. 88. [Livre disponible dans Les Classiques des sciences sociales. JMT.] MARX et ENGELS, Le manifeste du Parti communiste, Le monde en 10-18, 1962, p. 23. [Livre disponible dans Les Classiques des sciences sociales. JMT.] Le manifeste du parti communiste, op. cit., p. 41.
Pierre Brchon, La famille. Ides traditionnelles, ides nouvelles. (1976)
74
Nos bourgeois, non contents d'avoir leur disposition les femmes et les filles des proltaires, sans parler de la prostitution officielle, trouvent un singulier plaisir dans la sduction rciproque de leurs pouses. Le mariage bourgeois est, en ralit, la communaut des femmes maries (...). Il est vident, du reste, qu'avec l'abolition du rgime de production actuel, disparatra la communaut des femmes qui en drive, c'est--dire la prostitution officielle et non officielle 112 . Les structures de la famille demeurent puisqu'on se marie pour des questions de proprit et d'argent, mais les rapports rels des bourgeois sont souvent diffrents de ceux qui sont normalement prvus par les institutions familiales et la morale officielle : Le jeune bourgeois, quand il le peut, se rend indpendant de sa propre famille et, pratiquement, abolit pour son propre compte les liens familiaux. Mais le mariage, la proprit, la famille restent thoriquement intacts, parce qu'ils constituent, dans la pratique, le fondement sur lequel la bourgeoisie a difi sa domination (...) L'histoire montre que la bourgeoisie donne la famille les caractres de la famille bourgeoise, o l'ennui et l'argent constituent le seul lien, et dont le corrlatif est la dissolution bourgeoise de la famille, qui n'empche pas la famille de continuer d'exister 113 . Si la famille bourgeoise est une faade hypocrite, la famille du proltaire est condamne par la grande industrie qui dtruit tout lien de famille chez le proltaire et transforme les enfants en simples articles de commerce, en simples instruments de travail 114 . nouveau dans le Capital, Marx explique que le dveloppement industriel capitaliste ncessite davantage de main-d'uvre et que la machine permet d'utiliser des femmes et des enfants, sans grande force musculaire 115 . Vu la faiblesse [61] des salaires, le pre de famille est oblig de jouer un rle de marchand d'esclaves , il vend la force de travail de ses jeunes enfants aux capitalistes. Marx s'insurge contre cette situation inhumaine. La femme et les enfants sont obligs de
112 113 114 115
Le manifeste du parti communiste, op. cit., p. 43. MARX et ENGELS, L'idologie allemande., 1845, Editions sociales, p. 207. [Livre disponible dans Les Classiques des sciences sociales. JMT.] Le manifeste du parti communiste, op. cit., p. 42.
Cf. Le Capital, livre I, 4e section, XV, 3 et 9 dans Oeuvres compltes, op. cit.,
pp. 939-940 et 993-995.
Pierre Brchon, La famille. Ides traditionnelles, ides nouvelles. (1976)
75
tuation inhumaine. La femme et les enfants sont obligs de travailler ; ils sont ainsi comme l'homme mis sous le bton du capital . Donc la famille du proltaire semble condamne par l'volution conomique capitaliste. Mais Marx n'est pas aussi pessimiste. D'une part le proltaire n'a pas de proprit, ses relations avec sa femme et ses enfants n'ont donc plus rien de commun avec celles de la famille bourgeoise 116 . Cette ide sera dveloppe par Engels, montrant que la famille, dbarrasse des problmes de proprit, peut tre fonde sur l'amour des poux. Nous y reviendrons. D'autre part, si terrible et si dgotante que paraisse dans le milieu actuel la dissolution des anciens liens de famille, la grande industrie, grce au rle dcisif qu'elle assigne aux femmes et aux enfants, en dehors du cercle de famille, dans des procs de production socialement organiss, n'en cre pas moins la nouvelle base conomique sur laquelle s'lvera une forme suprieure de la famille et des relations entre les sexes 117 . Donc, pour Marx, l'ancienne base conomique de la famille, qui reposait sur le travail de l'homme l'extrieur et celui de la femme au foyer pour l'entretien de la famille est dtruite par le capital. Cela semble - court terme rvoltant puisque femmes et enfants sont obligs d'aller travailler. Mais Marx - de faon assez prophtique - voit fort bien que le travail hors de la famille pour la femme et les jeunes, qui leur donne un rle social nouveau, aura des consquences sur l'institution familiale ellemme. Lorsqu'on dit aujourd'hui que le travail fminin favorise l'indpendance de la femme par rapport l'homme, que n'tant plus confine derrire ses casseroles , la femme peut se situer d'gale gal avec son mari, on est tout fait dans la mme ligne que le raisonnement de Marx il y a cent ans. Donc, selon Marx, les rapports internes la famille sont dpendants de la situation et de l'tat de dveloppement conomiques. De mme quil y a eu autrefois un mode oriental , un mode grec et romain de la famille, de mme qu'il y a actuellement un mode germano-chrtien de la famille (avec une famille bourgeoise et une famille proltaire), il y aura demain un nouveau mode de famille en accord avec l'tat de dveloppement des forces productives et des rapports
116 117
Le manifeste du parti communiste, op. cit., p. 33. Le Capital, op. cit., pp. 994-995.
Pierre Brchon, La famille. Ides traditionnelles, ides nouvelles. (1976)
76
de production. Ce mode nouveau sera suprieur au prcdent car il ira dans le sens de l'histoire, ce sera vraisemblablement un mode familial adapt une socit socialiste. Marx affirme nettement que la fin du capitalisme, ce n'est pas la fin de [62] toute famille. Dj l'intrieur du capitalisme se crent des bases pour une nouvelle forme de famille qui triomphera dans le socialisme. Lorsque Marx parle d'abolition de la famille, il ne s'agit ni d'abolir le rapport homme-femme (valoris dans les Manuscrits de 1844) ni mme de travailler directement abolir une forme condamne de famille. Car toute socit civile correspond une institution familiale, on ne peut aller contre cette loi. L'volution des processus de production conduit naturellement la dcomposition progressive de la forme concrte de famille engendre par la socit capitaliste. Pour Marx, il faut agir sur les formations sociales, sur les infrastructures conomiques. Il est inutile de chercher abolir les superstructures, les institutions-reflets, miroir de la socit capitaliste. Elles se transformeront ou tomberont d'elles-mmes lorsque la socit aura volu, se sera transforme. Engels va dvelopper et illustrer la pense de Marx sur la famille dans un ouvrage rest classique, L'Origine de la famille, de la proprit prive et de l'tat publi en 1884. Ce que Marx a surtout affirm, savoir que la structure familiale chaque poque dpendait de l'organisation conomique, Engels va chercher le vrifier travers une grande fresque historique, des origines jusqu' nos jours. Il s'appuie pour cela sur les thses des savants de lpoque, Bachofen et surtout Morgan. Ces savants n'taient pas des marxistes ni des partisans systmatiques du primat de l'conomique . Mais leurs tudes ethnologiques les avaient conduits des dcouvertes tout fait nouvelles l'poque. Bachofen explique dans Le droit maternel publi en 1861 que la famille monogamique n'a pas toujours exist. La famille patriarcale de la Bible, identifie gnralement la famille bourgeoise du XIXe sicle, n'est pas un modle universel. Selon lui, l'humanit a vcu, aux origines, des rapports sexuels dpourvus de rgles. La socit tait alors gyncocrate ; les mres taient considres et respectes. Une telle position a t remise en question par les ethnologues actuels. Lvi-Strauss montre par exemple que, dans toutes les socits primitives on retrouve le tabou de l'inceste, l'interdiction des rapports sexuels avec les membres de sa famille. Le tabou de l'inceste permet
Pierre Brchon, La famille. Ides traditionnelles, ides nouvelles. (1976)
77
la socit d'exister puisque c'est une loi de l'change et de la communication, de la rciprocit : La prohibition de l'usage sexuel de la fille ou de la sur contraint donner en mariage la fille ou la sur un autre homme, et, en mme temps, elle cre un droit sur la fille ou la sur de cet autre homme 118 . La loi de l'interdiction de l'inceste [63] rationalise les changes de femmes et de dons. Ainsi des alliances entre groupes sociaux trangers se nouent par l'change des femmes. Le tissu social se cre, la nature se dpasse elle-mme dans une culture. Lvi-Strauss ne croit pas l'existence d'un matriarcat, d'un pouvoir des femmes dans les socits primitives. Pour lui, le mariage assure un change des femmes entre deux groupes d'hommes. La femme n'est qu'un objet d'change parmi d'autres. On retrouve une critique voisine de la promiscuit sexuelle originelle dans le livre de Serge Moscovici La socit contre nature 119 . Les mythes sur l'origine de l'homme et de la socit sont btis sur l'ide que du dsordre on passe l'ordre, soit par l'intervention d'un Dieu qui ordonne le monde, soit par l'intermdiaire d'un facteur interne la socit. Chez Engels encore, on retrouve ce schma qui conoit l'volution sociale comme un passage du dsordre l'ordre : on passe du communisme primitif la proprit prive, de la promiscuit sexuelle originelle la famille monogamique. Or Serge Moscovici montre que dans toutes les socits connues de la prhistoire, aussi loin que l'on puisse remonter, on trouve des socits organises et hirarchises selon l'ge et le sexe. Georges Balandier, dans son livre rcent Anthropologiques 120 , montre lui aussi qu' l'intrieur de toute socit, on rencontre de grandes coupures qui constituent des socits dans la socit . Ce sont des rapports gnralement ingalitaires. On constate trois ruptures fondamentales, les frontires traces selon le sexe, l'ge et le systme d'ingalit dominant 121 . Balandier va plus loin que Moscovici. Celui-ci en effet ne concluait pas de la prsence toujours constate de hirarchies sociales selon l'ge et le sexe leur ncessit. Il n'en concluait
118 119 120 121
LVI-STRAUSS, Les structures lmentaires de la parent, Mouton, 1968, p. 60 ; cit par A. MICHEL, op. cit., p. 46. Union gnrale d'ditions, Coll. 10-18. 1972, 448 p. [Livre disponible dans Les Classiques des sciences sociales. JMT.] P.U.F. 1974, 278 p. G. BALANDIER, op. cit., p. 10.
Pierre Brchon, La famille. Ides traditionnelles, ides nouvelles. (1976)
78
pas que l'ingalit tait ternelle. Tandis que Balandier semble penser qu'il n'y a pas de socit sans ingalit, du moins dans certains domaines. Une socit sans hirarchie serait un rve utopique qui a peuttre une fonction sociale mais qui n'est pas ralisable : Les socits n'existent que par les hirarchies porteuses d'ingalits et de tensions, mais en les corrigeant par l'ouverture de domaines o la contrainte se relche, o les distances sociales s'effacent, o la fraternit masque le rapport hirarchique 122 . Quoi qu'il en soit du matriarcat primitif, mme si Bachofen s'est tromp quant l'existence de socits primitives sans rglementation de la sexualit, son affirmation a eu une extrme importance. Car elle voulait s'appuyer sur une tude srieuse et non plus sur une option idologique. [64] On sortait de l'ide reue, savoir que la monogamie existait l'origine puisque la Bible nous dcrit le premier couple, Adam et Eve, et que c'est une structure qui ne se discute pas, qui est parfaite et divine. D'une re thologique, on entrait dans l're ethnologique et sociologique 123 . On peut d'ailleurs estimer qu'avec La socit
122 123
G. BALANDIER, op. cit., p. 108. De ce point de vue, il est symptomatique que, pour rpondre au livre d'Engels, on ait prouv le besoin dans certains milieux catholiques, de se situer sur le mme terrain que lui, les tudes ethnologiques. Ainsi le Pre GEMELLI publie en Italie en 1923 L'origine de la famille (Ed. Marcel Rivire. Traduction de R. Jolivet). Il veut rfuter la thse volutionniste selon laquelle la forme de la famille serait passe progressivement de la promiscuit primitive la monogamie et aussi rfuter l'ide que la monogamie est lie la proprit prive. Pour lui, ds l'origine de l'humanit, la monogamie existait. Quand nous avons voulu dterminer les caractres de la famille primitive, c'est l'tude des Pygmes et des Pygmodes qu'il nous fallut recourir. Nous dcouvrmes alors la vraie famille primitive, avec sa rigoureuse monogamie, sa stabilit caractristique et, sa base, l'exogamie ; elle se prsente nous, riche de sentiments moraux levs, conservs par une discipline svre et une tradition solide pendant des millnaires. De plus, la femme est libre, avec des droits gaux ceux du mari ; la famille est heureuse, ayant peu de dsirs satisfaire ; l'ducation des enfants est l'objet des soins des parents (GEMELLI, op. cit., pp. 179-180). Ce portrait de la famille primitive correspond merveille avec l'idal familial que l'on avait dans beaucoup de milieux catholiques. La famille primitive est une famille naturellement saine. La corruption n'est pas originelle. I !union libre est une dviation et un recul moral, dus des conditions particulires . Et donc, ceux qui veulent fonder sur les faits ethnologiques leur conception touchant
Pierre Brchon, La famille. Ides traditionnelles, ides nouvelles. (1976)
79
archaque publie en 1877, Morgan a fond l'ethnologie en tant que
science 124 . Il montre que l'volution de la famille est subordonne l'volution des conditions matrielles d'existence 125 . Engels fait une lecture matrialiste de Morgan qui il emprunte beaucoup d'analyses sur la priode prhistorique. Les analyses sur la famille monogamique et ses liens avec la proprit prive sont dues Engels lui-mme. Lorsque la premire dition de L'origine de la famille parat, Marx est mort depuis un an. Mais il avait lu et apprci l'uvre de Morgan. Il avait rdig des notes sur cette uvre, notes dont Engels s'est inspir. Dans la prface de la premire dition, Engels nous dit que Morgan a redcouvert, quarante ans aprs Marx, la conception matrialiste de l'histoire. Cette conception matrialiste peut se rsumer ainsi : c'est l'tat des forces productives qui dtermine l'organisation de [65] la famille et l'organisation politique. Et Engels avance immdiatement une conclusion d'analyse : Moins le travail est dvelopp, plus est restreinte la somme de ses produits et par consquent, la richesse de la socit, plus se montre prdominant l'empire exerc sur l'ordre social par les liens du sang 126 . Andr Michel note que cette thse est reprise aujourd'hui par l'ethnologue G. Balandier pour comparer les socits dites dveloppes et les socits dites sous-dveloppes : Dans les premires, centres sur la production, les liens de parent occupent une place, sinon inexistante, du moins mineure tant dans la vie quotidienne des individus que dans les institutions politiques et conomiques ; par contre dans les socits en voie de dveloppement, o la production est limite, les droits et devoirs l'gard de la parent tendue constituent souvent l'essentiel des obligations de l'individu et les groupes fonds sur la parent (relle ou suppose) invesla constitution future de la famille, l'union libre ou le divorce (...), ne peuvent se rclamer des rsultats de l'ethnologie moderne : ils leur sont catgoriquement contraires (GEMELLI, op. cit., pp. 182-183). Si la famille est ds l'origine monogamique, la monogamie est voulue par Dieu. L'union libre au contraire est une dviation, elle ne saurait correspondre l'tat des rapports de production dans notre socit. Jean-Michel PALMIER, Aux origines de l'anthropologie moderne : un marxiste malgr lui, article du journal Le Monde du 4 fvrier 1972. Mais il est incohrent avec lui-mme puisqu'il continue penser qu'une Intelligence suprme distribue les germes d'ides d'o natra la civilisation. Engels cit par Andre MICHEL, op. cit., p. 30.
124 125 126
Pierre Brchon, La famille. Ides traditionnelles, ides nouvelles. (1976)
80
tissent les institutions politiques et conomiques 127 . Donc dans les socits en voie de dveloppement, la famille serait cellule de base de la socit, non pas par nature mais parce que les forces productives sont peu dveloppes. Dans les socits industrielles, la famine jouerait un rle assez mineur dans l'organisation sociale.
tat de la production tat sauvage Cueillette, chasse, pche. Proprit commune du sol. conomie domestique communiste. tat barbare Agriculture et levage. L'conomie communiste se dgrade progressivement. Civilisation Artisanat et industrie. Production marchande. Proprit prive et lutte des classes.
Institution familiale
Organisation politique
Mariage par groupe (famille consanguine et punaluenne)
Gens et tribus dmocratiques
Famille apparie (passage du droit maternel au droit paternel) Famille patriarcale
Les chefs deviennent hrditaires.
Famille monogamique (avec adultre et prostitution)
tat ingalitaire la solde de la classe dominante.
Sur cette base, quelle est la vision historique d'Engels ? Il distingue trois tats caractriss chacun par stade de la production. A chaque stade [66] correspond un type de famille. On peut rsumer (en la simplifiant) la vision d'Engels sur le tableau prsent page 65.
Pour Engels, mesure que les forces productives se dveloppent, on assiste un rtrcissement progressif de la famille. A l'tat sauvage, la famille tait trs large. Le commerce sexuel sans rgles a mme probablement exist mais on n'en a aucun indice historique. La premire forme historique que nous pouvons reconstituer partir de l'tude du systme de parent encore existant chez les Indiens iroquois, c'est le mariage par groupe. Il a eu
127
Andre MICHEL, op. cit., p. 30.
Pierre Brchon, La famille. Ides traditionnelles, ides nouvelles. (1976)
81
au moins deux formes, la famille consanguine et la famille punaluenne. Dans la famille consanguine, frres et surs sont maris et femmes les uns des autres. Seuls les rapports sexuels entre parents et enfants sont exclus. Dans la famille punaluenne, les rapports entre frres et surs sont galement exclus. Mais un groupe de surs vit avec un groupe d'hommes, ou un groupe de frres avec un groupe de femmes. Selon Engels, le communisme primitif exigeait une forme de famille aussi tendue que possible. Plusieurs mles doivent faire partie de la mme entit pour que le groupe ait des chances de subsister. Dans le mariage par groupe, on ne peut reconnatre que la filiation fminine puisque la femme a plusieurs poux. La femme est alors considre ; hommes et femmes sont gaux. Un droit maternel s'instaure ainsi que la gens, groupe de consanguins en ligne maternelle qui n'ont pas le droit de se marier entre eux. Dans la gens, on pratique donc l'exogamie . Il y a bien dj division du travail entre les sexes : les hommes font la guerre, vont la chasse et la pche pendant que les femmes s'occupent de la maison, prparent la nourriture et fabriquent les vtements. Mais chacun est producteur. Il n'y a pas encore de classes sociales car la proprit est commune, la socit est alors dmocratique et galitaire. Tout le monde participe aux dcisions. Tout ceci va voluer dans l'tat barbare, qui reprsente la charnire, la transition entre un monde des origines, sorte de paradis sur terre et la civilisation, monde de l'alination et de l'oppression. L'tat barbare correspond une phase d'expansion conomique : progressivement l'homme domestique les animaux et cultive les plantes. La division du travail va prendre de nouvelles formes. L'homme, qui avait toujours t propritaire des instruments de travail et charg de procurer la nourriture au groupe va s'approprier une nouvelle source d'alimentation : les troupeaux, initialement proprit de la gens. Il s'appropriera ensuite une nouvelle source de travail : l'esclave. L'conomie domestique va progressivement se dgrader. Pourquoi est-ce cette poque qu'apparat la famille apparie, fonde sur un couple relativement stable (avec infidlit occasionnelle) mais avec un lien conjugal facilement dnouable ? Engels n'en fournit aucune explication conomique. Il explique en fait l'avnement de la famille apparie par l'extension des interdictions de mariage entre consanguins. Le dveloppement de la famille dans l'histoire primitive consiste donc dans le rtrcissement incessant du cercle qui, l'origine, comprenait la tribu tout entire, et au sein duquel rgne la communaut conjugale entre les deux sexes. Par l'exclusion progressive des parents d'abord les plus proches, puis des parents de plus en plus loigns, et finalement mme des parents par alliance, toute espce de mariage par groupe devient pratiquement impossible, et il ne reste enfin que le seul couple, [67] uni provisoirement par des liens en-
Pierre Brchon, La famille. Ides traditionnelles, ides nouvelles. (1976)
82
core fort lches 128 . Engels suggre aussi que la femme a d conqurir le droit de ne se livrer qu' un seul homme, les relations sexuelles multiples lui apparaissant de plus en plus humiliantes et oppressives. Ce progrs ne pouvait pas maner des hommes, ne serait-ce que parce que jamais les hommes n'ont eu jusqu' nos jours l'ide de renoncer aux agrments du mariage par groupe de fait 129 . Engels ne donne donc pas une explication directement conomique du passage la famille apparie. Il constate simplement que son apparition correspond une phase du dveloppement conomique. partir du moment o prdomine la famille apparie, on connat le pre de l'enfant. Au fur et mesure que les richesses s'accroissent, le pre prend davantage d'importance dans la famille. Il va utiliser ce pouvoir accru pour remplacer le droit maternel par le droit paternel. Dsormais l'enfant fera partie de la te historique du sexe fminin 131 . La femme devint l'esclave du plaisir de l'homme, simple instrument de reproduction.
gens 130 de son pre et hritera de lui. Ce fut, dit Engels, la grande dfai-
Le pouvoir des hommes va se renforcer et se concrtiser dans une nouvelle forme de famille : la famille patriarcale, la jointure entre l'tat barbare et la civilisation. Le pre, propritaire d'une exploitation agricole et des troupeaux, sera tout-puissant sur sa femme, ses enfants et les esclaves. Cette famille contient en miniature tous les antagonismes qui, par la suite,
se dvelopperont largement, dans la socit et dans son tat 132 . C'est donc dans la famille que naissent et se vivent la division du travail et les pre-
128
129 130 131 132
F. ENGELS, L'origine de la famille, de la proprit prive et de l'tat, in K. Marx et F. Engels, Oeuvres choisies en 3 volumes, tome 3, ditions du Progrs, Moscou 1970, pp. 236-237. [Livre disponible dans Les Classiques des sciences sociales. JMT.] Pascal LAIN, prix Goncourt 1974, commentant la thse d'Engels dans La femme et ses images (Stock, 1974), note que, pour Engels, le social s'obtient par soustraction dans le biologique (p. 261). L'organisation sociale nat progressivement par l'interdiction d'un type de relations. Bien avant Lvi-Strauss, Engels a eu l'intuition que la sociabilit implique la rglementation sexuelle, mais cette rglementation n'implique pas selon lui une ingalit naturelle entre l'homme et la femme, la femme n'tant qu'une monnaie d'change entre les mains des hommes (d'aprs les tudes de Lvi-Strauss, contestes d'ailleurs par d'autres ethnologues. Voir ce sujet E. LEACH, LVI-STRAUSS, Seghers, 1970). F. ENGELS, op. cit., p. 241. Groupe de consanguins qui n'ont pas le droit de se marier entre eux. F. ENGELS, op. cit., p. 245. K. MARX cit par F. ENGELS, op. cit., p. 246.
Pierre Brchon, La famille. Ides traditionnelles, ides nouvelles. (1976)
83
mires luttes de classes ; ceci n'est pas d la structure mme de la famille mais aux conditions conomiques extrieures.
Dans l'tat de civilisation, pour que la domination de l'homme se maintienne, le lien conjugal est renforc. Nous nous trouvons devant la famille monogamique. Dsormais seul l'homme peut dnouer le lien conjugal et rpudier sa femme. Les enfants doivent tre d'une paternit inconteste (pour l'hritage). Donc seul l'homme aura le droit d'tre infidle (les enfants naturels n'hritent pas). Historiquement, pour Engels, la monogamie n'est donc pas du tout, l'origine, le fruit de l'amour [68] des deux partenaires. Elle rsulte de l'opposition des sexes, de la proprit prive et du mode de transmission du patrimoine aux enfants. Ce fut la premire forme de famille base non sur les conditions naturelles, mais sur des conditions conomiques, savoir : la victoire de la proprit prive sur la proprit commune et spontane 133 . La monogamie est ne de la concentration de richesses importantes dans une seule main, la main d'un homme, et du dsir de lguer ces richesses aux enfants de cet homme et d'aucun autre 134 . Paralllement la monogamie se dveloppe la prostitution qui maintient ainsi l'antique libert sexuelle... pour les hommes. Par contre l'adultre de la femme est trs svrement puni pour viter des naissances d'enfants dont la paternit soit douteuse. Pour Engels, la situation qu'il observe dans la bourgeoisie du XIXe sicle est encore celle d'une monogamie impose par des motifs conomiques : Dans les classes o il y a quelque chose hriter, la libert de contracter mariage n'est pas plus grande qu'un cheveu 135 . Les parents marient leurs enfants selon les besoins du patrimoine, on ne se marie pas par amour dans la bourgeoisie. Historiquement, la monogamie n'a donc jamais t parfaite loin de l. Mais partir de la monogamie - en elle, ct d'elle ou contre elle, selon les cas - le plus grand progrs moral dont nous lui soyons redevables : l'amour individuel moderne entre les deux sexes, auparavant inconnu dans ce monde 136 , peut se dvelopper. C'est ce
133 134 135 136
F. ENGELS, op. cit., p. 252. F. ENGELS, op. cit., p. 261. F. ENGELS, op. cit., p. 259. F. ENGELS, op. cit., p. 256.
Pierre Brchon, La famille. Ides traditionnelles, ides nouvelles. (1976)
84
mouvement qu'Engels dcrit en analysant la situation de famille du proltaire. Le proltaire n'a pas de proprit transmettre. La suprmatie de l'homme n'a plus de moyen pour s'exercer, d'autant plus que : Depuis que la grande industrie, arrachant la femme la maison, l'a envoye sur le march du travail et dans la fabrique et qu'elle en fait assez souvent le soutien de la famille, toute base a t enleve, dans la maison du proltaire, l'ultime vestige de la suprmatie masculine 137 . On retrouve l l'ide esquisse par Marx dans le Capital. La suprmatie masculine n'a plus de base conomique. Mais selon Engels, l'galit n'en est pas pour autant aussitt ralise dans la famille. Certes la femme retrouve le droit au divorce ; on se spare plutt que de se tromper. Mais toute oppression de la femme n'a pas disparu : l'esclavage domestique de la femme continue : Dans la famille, l'homme est le bourgeois, la femme joue le [69] rle du proltariat 138 La femme continuera d'tre exploite tant que la famille sera une unit conomique. Si l'on ne vit pas encore l'galit parfaite dans la famille du proltaire, on y vit dj une monogamie fonde sur l'amour et non plus sur la proprit prive et la transmission du patrimoine. L'amour sexuel ne peut tre et n'est rgle vritable des relations avec la femme que dans les classes opprimes, c'est--dire, de nos jours, dans le proltariat 139 . De fait, chez Engels, la famille du proltaire joue, par rapport la monogamie, le mme rle que joue chez Marx le proltariat par rapport la rvolution. De mme que le proltariat est la classe rvolutionnaire, de mme la famille du proltaire est un modle pour la famille venir, base sur l'amour rciproque des poux.
137 138 139
F. ENGELS, op. cit., p. 258. F. ENGELS, op. cit., p. 260. F. ENGELS, op. cit., p. 258.
Pierre Brchon, La famille. Ides traditionnelles, ides nouvelles. (1976)
85
Andr Stil, romancier, membre du P.C.F. a repris dans ses romans, la mme ide, notamment dans Le premier choc, roman en trois tomes publi vers 1950. Stil met en scne des ouvriers, des gens simples qui vivent - quasi naturellement - des solidarits de classes... On se comprend et on s'entraide entre ouvriers. C'est un monde fraternel malgr les difficults de la vie. Le militant du parti est toujours prsent au milieu de ce monde, il en est l'animateur. Andr Stil montre que l'amour est une ralit dans les familles ouvrires, et tout spcialement dans les familles de militants. Le foyer du militant est exemplaire, on y prend grand soin des enfants. Malgr la misre, on a le souci de bien les habiller, de les tenir propres Les poux s'aiment et luttent ensemble pour faire advenir une socit plus fraternelle, plus humaine, plus juste. Les poux ne trouvent pas seulement leur bonheur dans la vie familiale mais dans l'action politique et syndicale. Stil nous montre la difficult qu'ont les militants pour mener la fois vie de famille et action politique, la difficult aussi pour la femme du militant s'affirmer en face de son mari, plus form politiquement. L'amour semble une super valeur qui mobilise aussi bien pour la vie de famille que pour l'action politique. Donc l'amour est possible dans la famille ouvrire (alors que Stil nous dcrit, en contrepoint, des familles bourgeoises o rgne la dsunion, o l'on semble incapable d'aimer) mais il est rendu difficile par la misre : cause d'elle, il faut parfois se sparer de ses enfants, sparation douloureuse. Stil nous montre que, pour une famille, quitter un logement insalubre et trop troit, c'est vivre mieux, moins sur les nerfs. Il explique aussi comment le travail professionnel trop long, les heures supplmentaires et les guerres (coloniales) dtruisent la vie familiale. La famille dcrite par Stil tend en fait vers le modle de la famille selon Engels : la famille, lieu d'amour entre les poux. Dans le milieu ouvrier, tout spcialement chez les militants, on vit dj un monde nouveau, on vit les valeurs socialistes qui sont, selon Stil, des valeurs ouvrires.
[70] Mais quel est, selon Engels, l'avenir de la famille ? Pour Engels, la monogamie ne disparatra pas avec la disparition de ses conditions historiques de ralisation : la proprit prive. De fait, c'est maintenant que la vritable monogamie va s'instaurer. On va sortir de la monogamie hypocrite qui caractrisait la bourgeoisie. La prostitution va disparatre. L'galit va s'tablir progressivement entre l'homme et la femme dans la famille. L'conomie domestique prive va se transformer en industrie sociale et l'ducation des enfants sera publique. Il n'y aura donc plus d'esclavage domestique de la femme. Dans le socia-
Pierre Brchon, La famille. Ides traditionnelles, ides nouvelles. (1976)
86
lisme, avec la proprit collective, on ne reviendra pas l'antique libert sexuelle des origines. Car la monogamie fonde sur l'amour correspond la nature de l'homme, son tre profond : L'amour sexuel est exclusif par nature... Le mariage fond sur l'amour sexuel est donc, par nature, conjugal 140 . Ce qui va disparatre de la monogamie, c'est la prpondrance de l'homme et l'indissolubilit du mariage. Si le mariage fond sur l'amour est seul moral, seul l'est aussi le mariage o l'amour persiste 141 . L'indissolubilit juridique ne visait qu' perptuer des conditions conomiques. Il faudra donc rtablir la libert du divorce. Aprs avoir dress ce cadre, Engels termine cette vision de l'avenir de la famille dans le socialisme par un appel la crativit des gnrations futures. Les gnrations qui n'auront pas connu [71] la situation actuelle o les rapports des sexes sont dpendants des si140 141
la communaut des femmes comme l'ont prtendu abusivement certains adversaires du marxisme, notamment certains moralistes catholiques. Le Pre ANCEL, dans un petit livre Marxisme et famille (1938, d. de la Fdration Nationale Catholique) le reconnat. Il cite Paul Vaillant-Couturier, membre du parti communiste, qui crivait dans un article de l'Humanit : Notre conception du droit l'amour est prcisment le contraire du droit au drglement sexuel (cit par P. Ancel, p. 37). Mais le P. Ancel reproche au marxisme une fausse conception de l'amour. Pour lui, il y a trois sortes d'amour : l'instinct sexuel qui ne peut conduire qu'au mariage par groupe, l'amour sensible qui conduit l'union libre et le vritable amour humain, dit amour spirituel , qui s'panouit dans la monogamie indissoluble. Les marxistes en resteraient l'amour sensible, c'est--dire fond seulement sur l'attrait mutuel d'un homme et d'une femme. Selon le P. Ancel, ils n'ont pas compris que le vritable amour humain doit tre don mutuel et total. Ce don total, qui engage tout l'tre, avec son intelligence et sa volont, ne peut tre passager (comme l'amour sensible). Il est perptuel. En face du marxisme revendiquant la monogamie base sur l'amour, le P. Ancel prne la monogamie indissoluble au nom d'un amour authentiquement humain. Pour lui, la monogamie n'est pas lie au systme de proprit prive et l'conomie, mme s'il reconnat valables certaines critiques du marxisme l'gard du mariage bourgeois, qui est souvent un mariage d'intrt. Le P. Ancel refuse de considrer la famille comme une superstructure (dpendante de l'infrastructure conomique) car elle dcoule de la nature de l'homme. Il n'a pas vu que la famille pour Engels n'est pas seulement une superstructure : la monogamie fonde sur l'amour ne se justifie pas par l'conomique. C'est un rapport humain dsalin.
les Manuscrits de 1844. F. ENGELS, op. cit., p. 268. L'idal familial du marxisme n'est donc pas du tout
F. ENGELS, op. cit., p. 267. Engels est l fort proche des thses de Marx dans
Pierre Brchon, La famille. Ides traditionnelles, ides nouvelles. (1976)
87
tuations conomiques, se creront leur propre pratique sans se soucier des prvisions actuelles que nous pouvons faire sur leur comportement familial. Dans le communisme, les rapports entre les sexes seront des rapports privs, o la socit n'a pas intervenir. Et de fait elle n'interviendra plus partir du moment o la proprit prive sera supprime et o les enfants seront levs en commun. Au terme de cette prsentation de L'origine de la famille, de la proprit prive et de l'tat on peut faire quelques remarques et se poser quelques questions. La famille semble devoir perdre dans l'avenir toute base conomique. Pourtant Engels affirme qu'elle se maintiendra et que l'amour y sera vcu. Donc une institution sans base conomique peut vivre et tre fconde. Engels n'est donc pas du tout mcaniciste : il ne croit pas la concordance totale et parfaite entre une base conomique et une institution sociale. Sans base conomique, la famille monogamique subsistera parce que l'amour est par nature exclusif. Mais on peut se demander si pour subsister la famille monogamique ne devra pas matriser les conditions matrielles, mettre l'conomie son service 142 . La pense d'Engels sur l'avenir laisse planer une ambigut : d'une part il affirme sa confiance en la monogamie fonde sur l'amour deux, d'autre part il lance un appel la crativit et la libert des gnrations futures en face de la vie sexuelle. Selon que l'on privilgie l'un ou l'autre aspect, on aboutit des positions et des pratiques fort diffrentes. Ainsi, en Union Sovitique, on s'est appuy sur l'appel la libert pour dicter la premire lgislation familiale, trs souple, o le divorce tait trs simple. On s'appuie aujourd'hui sur les textes qui dfendent la monogamie fonde sur l'amour deux pour justifier une lgislation plus ferme, favorisant la dure du couple et de la famille.
La thse de Morgan et d'Engels sur la promiscuit primitive est aujourd'hui abandonne. On a montr que la monogamie existait dj, dans certaines socits, au palolithique. On ne croit plus, non plus, un volutionnisme unilinaire selon lequel la famille, partir de formes identiques dans toutes les socits primitives, se serait dveloppe partout de la mme faon pour
142
Ce point de vue est dvelopp par H. DESROCHES, Signification du Marxisme, Editions ouvrires, 1949, pp. 150-155.
Pierre Brchon, La famille. Ides traditionnelles, ides nouvelles. (1976)
88
la parent et le statut respectif des sexes 143 . D'autre part, il semble bien qu'aujourd'hui [72] encore, dans la socit franaise, il y ait une relation entre famille et proprit prive. Mme si les mariages de convenance sont devenus assez rares 144 , les liens entre famille et proprit prive sont encore visibles dans le droit franais : la femme franaise nhrite pas de son mari au mme titre que ses enfants, les collatraux ont galement droit l'hritage du conjoint dcd, l'adultre fminin est puni plus svrement que l'adultre masculin. Pour Andre Michel, ces rgles juridiques expriment la primaut des rgles de transmission du patrimoine et l'impratif du maintien de la proprit prive et du bien de famille , toujours prsent au
aboutir un modle unique. Mais le livre d'Engels est toujours actuel. D'une part la science prhistorique accorde encore aujourd'hui une importance considrable au dveloppement des techniques pour expliquer la structure de
sein de l'institution familiale 145 . Enfin, ce livre inspire encore la politique familiale de certains pays ou mouvements. Ainsi, dans les pays socialistes, on a essay de socialiser progressivement les tches mnagres : cantines, laveries collectives, quipement en France ; nous y reviendrons. Les mouvements de libration de la galement rclame par les partis communistes de beaucoup de pays, notamment en France, nous y reviendrons. Les mouvements de libration de la femme se rclament aussi du livre dEngels, mme s'ils n'en tirent pas les mmes conclusions que les partis communistes.
Au terme de cette tude sur la famille dans l'uvre de Marx et d'Engels, je voudrais souligner ce qui, mon avis, constitue leur apport principal, qui aujourd'hui apparat souvent comme banal mais qui, leur poque, tait une rvolution dans la pense. On peut dire que Morgan, Marx et Engels sont les premiers sociologues de la famille, les premiers avoir adopt une dmarche qui cherche expliquer les institutions et pas seulement porter un jugement moral leur gard. Avec
143 144
A. MICHEL, op. cit., p. 27. De plus, mme si les mariages ne sont plus arrangs par les familles, ils ne rsultent pas seulement d'un choix libre des deux poux. Ce choix est conditionn par leur ducation, par leurs habitudes sociales, par leur position de classe. Le mariage entre le PDG et sa secrtaire est une situation que l'on rencontre souvent dans les romans-photos, rarement dans la ralit. Habituellement, on se marie avec quelqu'un de mme milieu social. Il y a homogamie sociale entre l'homme et la femme au sein du couple. D'aprs une enqute faite sur les couples maris aprs 1960, il y a mme degr d'instruction dans 60% des couples, mme religion dans 71% mme niveau de vie dans 47%. A. MICHEL, op. cit., p. 35.
145
Pierre Brchon, La famille. Ides traditionnelles, ides nouvelles. (1976)
89
Marx et Engels, la famille n'est plus une donne naturelle, un ordre parfait respecter, ce n'est plus une structure prtablie par un Dieu grand horloger, c'est un rapport social privilgi qui volue en fonction des transformations conomiques. Dans l'avenir, dans un monde sans alination et sans luttes de classes, dans un monde sans proprit prive, la famille trouvera son statut rel, celui qui correspond l'tre mme de l'homme et de la femme, rconcilis avec eux-mmes : la famille sera naturellement humanisante, et elle sera fonde sur la libert de l'amour. Si, pour les traditionalistes, la famille tait considre comme la base et le modle de la socit, pour les marxistes c'est exactement l'inverse : [73] la socit dtermine la famille. On peut schmatiser cette opposition entre les deux systmes de pense. Pour les traditionalistes, la famille dtermine et engendre la socit :
FAMILLE
SOCIT
Avec Marx et Engels, la socit dtermine la famille : SOCIT FAMILLE
Donc, pour les marxistes, la famille est une institution qui fait partie de la superstructure sociale. Cette superstructure est dtermine par l'tat des forces productives et des rapports de production. Mais certains marxistes (et notamment Louis Althusser s'appuyant sur des textes de Marx et d'Engels) estiment que la superstructure a une autonomie relative par rapport l'infrastructure. Donc la forme de la famille ne serait pas simplement le reflet d'une conomie donne. Mme si elle est dtermine en dernire instance par l'conomie, la famille peut avoir une causalit, une certaine influence sur les socits. On peut estimer qu'elle favorise la reproduction des rapports de production : elle va renforcer le systme conomique et social qui lui a
Pierre Brchon, La famille. Ides traditionnelles, ides nouvelles. (1976)
90
donn naissance 146 . Ainsi le systme capitaliste [74] cre la famille bourgeoise qui sera garante de l'ordre bourgeois. Le schma des rapports famille-socit dans le marxisme peut alors tre complt comme suit :
146
Le jeu des rapports entre infrastructure et superstructure, entre socit et famille, peut s'illustrer par la situation de la famille en Yougoslavie. Avant l'avnement du socialisme en Yougoslavie, la famille y tait trs structure et hirarchise. Si l'on applique un schma marxiste mcaniste , la rvolution autogestionnaire en Yougoslavie aurait d immdiatement se traduire par une modification de la structure familiale. Or il n'en est rien : On a relev la persistance de relations trs autoritaires dans les familles mmes de ceux qui, depuis des annes, baignent dans la dmocratie d'entreprise et participent l'autogestion. De mme, bien que les coles soient autogres, on a not le traditionalisme des mthodes d'enseignement et la distance entre matres et lves (A. MEISTER, Lautogestion : les quivoques du cas yougoslave dans Le Monde du 3 juillet 1974. Donc la rvolution dans la famille ne suit pas immdiatement la rvolution sociale. L'institution familiale a une autonomie relative par rapport l'infrastructure socioconomique. De ce fait, la famille va avoir une certaine influence sur la socit. Ainsi Meister constate que, en Yougoslavie, les chefs lus dans le cadre de l'autogestion s'accrochent au pouvoir et que, paralllement, la base accepte trs facilement de se laisser guider par d'autres. Elle ne cherche pas beaucoup contrler ses chefs alors qu'elle en a les moyens. Meister essaie d'expliquer ce phnomne : La famille, la religion, l'cole ne lui ont-elles pas enseign se tenir sa place et obir aux chefs ? Il n'est pas exagr d'mettre l'hypothse qu'une part des difficults de la dmocratie d'autogestion (comme des autres formes de dmocratie d'ailleurs) provient des attitudes de soumission inculques par ces institutions (A. MEISTER, op. cit., Le Monde du 2 juillet 1974). La famille, comme d'autres institutions, joue donc actuellement un rle de frein parce que son volution a t moins rapide que l'volution des structures conomiques. Reich (cf. troisime partie, ch. vu), tudiant le mme problme pour l'Union Sovitique, aboutit une conclusion plus radicale : le fait que la structure familiale n'ait pas t rvolutionne explique l'chec de la Rvolution socialiste en Union Sovitique.
Pierre Brchon, La famille. Ides traditionnelles, ides nouvelles. (1976)
91
Dans cette perspective, Louis Althusser considre la famille comme un appareil idologique d'tat 147 c'est--dire une institution ou organisation qui renforce l'ordre tabli et la reproduction des rapports de production. Parmi les appareils idologiques d'tat, il cite les glises, l'cole, la famille, les organes d'information, les partis politiques, les syndicats, les organismes culturels (lettres, beaux-arts, sports...). Il est fort regrettable pour notre sujet qu'Althusser n'explicite pas beaucoup la fonction de la famille en tant quA.I.E. (c'est ainsi qu'on les appelle couramment !). D'ailleurs il ne prtend pas que ce soit la seule fonction de la famille puisqu'il prcise : La famille remplit manifestement d'autres fonctions que celles d'un A.I.E. Elle intervient dans la reproduction de la force de travail. Elle est, selon les modes de production, unit de production et (ou) unit de consommation. Pour Althusser, chaque poque, il y a des A.I.E. dominants. Sous l'Ancien Rgime, l'glise et la famille jouaient ainsi un rle central parmi les diffrents appareils idologiques. Aujourd'hui il estime que ce sont l'cole et la famille qui occupent le centre du dispositif. Ce sont l les deux A.I.E. qui concourent le plus maintenir et reproduire les structures de la socit capitaliste 148 . Nous aurons l'occasion
147
148
Cf. L. ALTHUSSER, Idologie et appareils idologiques d'tat. Notes pour une recherche. Sur la reproduction des conditions de la production , la Pense, juin 1970. [Texte disponible dans Les Classiques des sciences sociales. JMT.] Althusser affirme ces thses mais il ne fait pas l'analyse pour les dmontrer.
Pierre Brchon, La famille. Ides traditionnelles, ides nouvelles. (1976)
92
de voir dans la troisime partie que Reich et Marcuse accentuent encore le rle de la famille. Cette institution idologique devient presque, chez eux, le facteur dterminant de l'volution sociale. [75]
La pense de Bebel et Lnine.
Retour la table des matires
Beaucoup d'auteurs socialistes vont, la fin du XIXe sicle et au dbut du XXe, reprendre et prolonger la pense de Marx et Engels sur la famille. Il n'est bien entendu pas question de les prsenter tous. J'ai donc fait un choix : prsenter la pense de Bebel et Lnine. Pourquoi ce choix ? L'ouvrage d'Auguste Bebel La femme et le socialisme 149 , fort volumineux, a eu un norme retentissement en Allemagne. Bebel a t, avec Wilhelm Liebknecht, un des pionniers de la socialdmocratie allemande ; c'est par ce livre de Bebel que les ides socialistes ont t vulgarises la fin du XIXe sicle en Allemagne. Lnine a t le premier socialiste la tte d'un tat et, par ses uvres thoriques, il a complt sur plusieurs points la pense de Marx et d'Engels et apparat aujourd'hui comme un des pres fondateurs du marxisme. BEBEL Si nous regardons le plan de l'ouvrage de Bebel, on s'aperoit qu'il ne traite pas que de la femme. Aprs avoir, dans la premire partie, parl de la femme dans le pass et dans la deuxime partie de la
149
A. BEBEL, La femme et le socialisme. 1re dition en 1879, Dietz Verlag. Berlin. 537 p., dition franaise de 1964. Le contenu de l'ouvrage a t plusieurs fois remani par Bebel lui-mme. Les dernires retouches de Bebel datent de 1909. L'dition franaise a t faite d'aprs la 60e dition allemande et comporte une prface de Jacques Duclos. [Livre disponible dans Les Classiques des sciences sociales. JMT.]
Pierre Brchon, La famille. Ides traditionnelles, ides nouvelles. (1976)
93
femme l'poque actuelle , la troisime partie traite de l'tat et la socit et la quatrime de la transformation socialiste de la socit . Ce livre est en fait un ouvrage de vulgarisation des thses socialistes. Pourquoi alors Bebel consacre-t-il tant de place parler de la femme et de la famille et pourquoi intitule-t-il son livre la femme et le socialisme ? C'est, me semble-t-il, parce que, comme beaucoup de socialistes, Bebel considre que l'tat du rapport entre l'homme et la femme dans une socit est rvlateur de la situation sociale de cette socit. Comme chez Marx, le rapport homme-femme est rvlateur de la qualit des autres rapports sociaux. Dans notre socit, la femme est opprime. Elle ne sera vritablement et compltement libre que dans le socialisme. L'mancipation complte de la femme et son galit avec l'homme sont un des buts vers lesquels tend notre civilisation et aucune puissance au monde ne [76] peut en empcher la ralisation. Mais elle n'est possible que sur la base d'une transformation radicale qui supprimera la domination de l'homme sur l'homme (par consquent du capitaliste sur le travailleur) 150 . Opprime comme le proltaire, la femme doit lutter ses cts. D'ailleurs le livre se termine par cette phrase : L'avenir appartient au socialisme, c'est--dire en premier lieu l'ouvrier et la femme.
Ce thme a t repris, autour des annes 1950, par Hubert Biberman dans son film clbre Le sel de la terre. Ce film montre la lutte de mineurs mexicains qui mnent une longue grve pour le renforcement de la scurit dans la mine. Il montre paralllement la vie des femmes de mineurs, esclaves domestiques, peu comprises par leurs maris. Tout comme Flora Tristan avant
Marx et Engels 151 , Biberman montre que l'tre le plus opprim trouve toujours quelqu'un d'autre opprimer : sa femme. Progressivement, au cours de la grve, les femmes vont s'imposer auprs de leurs maris, se montrer indispensables la russite de leurs luttes et elles vont y participer activement, remplaant notamment leurs maris au piquet de grve. Les femmes obtiendront d'tre considres dans la pratique comme gale par leurs maris. C'est seulement partir de ce moment-l que les maris participeront aux tches mnagres qu'ils jugeaient jusque-l humiliantes. Avec la lutte des femmes aux cts des hommes, c'est une nouvelle rpartition des rles dans le couple
150 151
A. BEBEL, op. cit., p. 502. Flora Tristan, morte en 1844, dont les uvres ont t dcouvertes en France rcemment, disait que la femme est la proltaire du proltaire .
Pierre Brchon, La famille. Ides traditionnelles, ides nouvelles. (1976)
94
qui s'labore. Nous reviendrons sur cette question de l'articulation entre lutte des classes et lutte des femmes qui est un des points centraux des dbats actuels entre la gauche et les mouvements fministes rvolutionnaires.
Bebel reprend la vision historique d'Engels, expliquant chaque forme de famille par un tat des rapports de production, l'ingalit de la femme apparaissant comme chez Engels avec la proprit prive. Il montre que depuis trs longtemps la femme est opprime. C'est pourquoi, souligne-t-il, elle a tendance considrer sa condition infrieure comme naturelle. La femme doit lutter pour acqurir l'galit juridique avec l'homme. Il faudrait qu'elle puisse accder toutes les professions et prendre part la vie publique. Son galit juridique progresse lentement. Mais pour que l'galit entre l'homme et la femme soit effective, il faut revoir toute l'ducation. Chez nous rgnent, surtout en ce qui concerne l'ducation des femmes, des ides trs arrires. Que la femme doive, elle aussi, avoir de la vigueur, du courage et de la rsolution, c'est pour beaucoup encore une hrsie. Ces qualits seraient anti-fminines 152 . Il faut sortir d'un systme ducatif bas sur la contrainte, contrainte notamment dans les rapports entre les sexes. La stricte sparation des sexes l'cole et dans [77] tous les rapports sociaux (...) entrave le dveloppement de la femme 153 . Bebel a bien vu l'importance de l'cole et de l'ducation dans l'intriorisation du modle des rapports homme-femme. La femme apprend se percevoir comme infrieure ds l'cole. Son mancipation en est rendue d'autant plus difficile. Sur ce point, Bebel innove par rapport Marx et Engels qui n'avaient pas soulign cet aspect. Bebel soutient, comme Engels, une morale des rapports au sein du couple. Il part d'un principe gnral : chaque homme et chaque femme doivent pouvoir satisfaire leurs besoins sexuels. La continence durable est contre nature et risque d'aboutir des troubles graves, suicide ou folie. Mais, si la satisfaction de l'instinct sexuel est ncessaire, lhomme n'est pourtant pas un animal. Il doit y avoir attirance et accord spirituel entre les partenaires. Sinon l'union des sexes s'effec-
152 153
A. BEBEL, op. cit., p. 177. A. BEBEL, op. cit., p. 177.
Pierre Brchon, La famille. Ides traditionnelles, ides nouvelles. (1976)
95
tue de faon toute machinale, c'est alors un acte immoral 154 . Bebel soutient d'ailleurs sur la sexualit des ides trs actuelles. Pour lui, il ne faut pas en faire un sujet tabou et il faut introduire l'ducation sexuelle l'cole pour que homme et femme apprennent connatre leurs besoins sexuels. Mais il regrette l'abus des plaisirs sexuels : c'est beaucoup plus nfaste que l'abstinence 155 . Cela conduit l'impuissance et la strilit. Bebel reprend l une ide commune de son temps. Il condamne aussi le dveloppement du malthusianisme, de la contraception et de l'avortement : La crainte du dnuement, la peur de ne pas pouvoir lever les enfants comme il convient sont les raisons principales qui poussent les femmes de toutes les classes sociales des actes en contradiction avec les lois de la nature 156 . Donc Bebel allie une conception socialiste et une vision morale. Ce que sont les institutions sociales est bien dtermin par les rapports conomiques mais il y a des lois de la nature humaine que l'homme doit respecter. Les lois de la nature, selon Bebel, sont souvent ce que la socit de l'poque admet comme valeurs... Ses conceptions, quoique socialistes, n'en sont pas moins trs dpendantes de la morale communment admise l'poque dans toutes les classes sociales.
Comme pour Marx et Stil, c'est la bourgeoisie qui dsagrge la famille du proltaire. Bebel nous dcrit les difficults de la famille ouvrire. Dans les classes infrieures, le mariage d'argent est peu prs inconnu. Gnralement l'ouvrier se marie par amour mais les causes de troubles de sa vie conjugale ne manquent pas. De nombreux enfants amnent soucis et peines [78] et trop souvent la misre s'installe au foyer. Maladies et dcs sont les
htes habituels des familles ouvrires 157 . De plus le chmage est frquent et l'inscurit permanente. De tels coups du sort amnent la mauvaise humeur et l'amertume et cet tat d'esprit explose souvent au cours de la vie familiale, lorsque journellement, chaque heure, se font entendre des rclamations demandant le strict ncessaire et qu'on ne peut satisfaire. Disputes et batailles clatent. Il s'ensuit la ruine du mnage et de la
famille 158 . Les logements sont souvent insalubres. tant trop petits, il y rgne dans beaucoup de cas une promiscuit, source d'immoralit. Pour
154 155 156 157 158
A. BEBEL, op. cit., p. 136. A. BEBEL, op. cit., p. 233. A. BEBEL, op. cit., p. 166.
A. BEBEL, op. cit., p. 157. Ibid.
Pierre Brchon, La famille. Ides traditionnelles, ides nouvelles. (1976)
96
dans beaucoup de cas une promiscuit, source d'immoralit. Pour oublier sa situation et celle de sa famille, souvent le mari joue ou boit pendant que la femme s'occupe du mnage et des enfants. Le tableau de la famille ouvrire bross par Bebel est moins optimiste que celui d'Engels : pour ce dernier, le fait que les ouvriers et ouvrires se marient par amour suffisait changer fondamentalement les rapports de l'homme et de la femme. Bebel, comme Marx dans le Manifeste du parti communiste, montre que l'unit familiale, que l'amour des poux sont gravement perturbs par les mauvaises conditions d'existence des familles ouvrires.
Bebel fait galement la mme analyse que Marx du travail fminin. Il est encore plus exploit que le travail masculin. L'ducation des enfants souffre de la ncessit o est la femme de travailler. La vie de famille est perturbe par le travail de la femme. Il favorise dans une proportion effarante les progrs de l'immoralit, de la dgnrescence, des maladies de toutes sortes et de la mortalit infantile 159 . Bebel n'en conclut pas pour autant que la femme ne doit pas travailler comme le faisait le premier congrs de l'Association internationale des travailleurs. Un texte vot par le congrs affirmait : La femme a reu de la nature des fonctions dtermines ; sa place est dans la famille. Ce texte montre combien le schma de rpartition des rles tait ancr dans les mentalits, au point d'apparatre comme naturel mme dans la classe ouvrire. Bebel, au contraire, reconnat que le travail de plus en plus frquent de la femme est un mouvement irrversible et que, donc, il ne faut pas s'y opposer. Bebel n'est pas un grand novateur. C'est plutt un vulgarisateur de la pense de Marx et dEngels. Mais il insiste plus qu'eux sur les problmes de l'galit entre l'homme et la femme, sur la ncessit de repenser l'ducation qui, actuellement, reproduit l'infriorit fminine et la fait apparatre comme naturelle.
159
A. BEBEL, op. cit., pp. 257-258.
Pierre Brchon, La famille. Ides traditionnelles, ides nouvelles. (1976)
97
[79] LNINE Tout comme Bebel, Lnine a davantage parl de l'mancipation de la femme que de la famille. Mais il n'a pas rdig d'ouvrage sur la question. Ses prises de position sont parses tout au long de son uvre ; ce sont souvent des articles crits en fonction de l'actualit 160 . Comme ses prdcesseurs, Lnine note l'importance du travail fminin pour l'mancipation de la femme, il rclame la libert du divorce car l'absence de cette libert constitue une super-brimade l'gard du sexe opprim 161 . Peu aprs la Rvolution de 1917, Lnine et le parti bolchevik ralisent l'galit juridique de la femme par rapport l'homme ; on abolit les procs de divorce, on supprime la diffrence entre enfant naturel et enfant lgitime, on donne la femme le droit de vote et le droit d'tre lue. Lnine les encourage tre actives dans les entreprises, dans l'administration de l'tat. Mais Lnine est bien conscient que l'mancipation de la femme ne se ramne pas une question juridique. Pour tre gale l'homme, la femme doit tre soustraite l'esclavage domestique , il faut la librer du joug abrutissant et humiliant ; ternel et exclusif, de la cuisine et de la chambre coucher 162 . Pour cela, comme le soulignait dj Engels, il faut que l'conomie domestique prive soit remplace par une conomie collective. En 1919, Lnine affirmait que des progrs taient dj faits dans cette direction : cration de rfectoires publics, de crches, de jardins d'enfants. Mais l'conomie domestique collective ne sera vraiment ralise que dans le socialisme. Enfin, pour tablir dans la ralit l'galit de l'homme et de la femme, il faut duquer les hommes dont beaucoup sont encore victimes des prjugs et des modles anciens : Il y a trs peu de maris, mme parmi les proltaires, qui pensent allger sensiblement les peines et les soucis de leurs femmes ou mme les en
160 161 162
Ces textes sont rassembls dans un ouvrage des ditions sociales Sur l'mancipation de la femme, Coll. Classiques du marxisme. LNINE, Texte de 1916 Sur l'mancipation de la femme, p. 52. LNINE, 8 mars 1920, op. cit., pp. 106-107.
Pierre Brchon, La famille. Ides traditionnelles, ides nouvelles. (1976)
98
dbarrasser compltement, en les aidant au travail fminin (...). L'ancienne domination du mari survit sous une forme latente (...). Notre travail communiste parmi les masses de femmes, notre activit politique comporte une grande part de travail d'ducation parmi les hommes 163 . [80] Lnine a aussi t amen prciser sa conception de l'amour. Car, en 1917, dans les dbuts de la Rvolution, une certaine confusion se faisait jour entre les thses communistes et les thses anarchistes. Certains rvolutionnaires, notamment certaines femmes, demandaient la libert de l'amour. Alexandra Kollonta (1872-1952) par exemple, agitatrice et militante importante du parti bolchevik, en 1917 et 1918 commissaire du peuple aux Affaires sociales 164 , estime que le grand-amour-passion est rare. C'est pourquoi elle prconise l'amourjeu , l'amour-rotique fait d'attirance sexuelle et de sentiment dans lequel chaque personne conserve sa libert. C'est un amour sans engagement durable. On retrouve l tout fait l'idal amoureux de certains anarchistes. Pour Kollonta, l'amour-jeu devrait faire partie de l'ducation des enfants, pour combattre les tendances l'gosme, l'individualisme, au repliement sur la structure traditionnelle de la famille. Sur l'importance du travail fminin, sur la ncessaire mancipation de la femme, Lnine et Kollonta avaient des ides voisines. Qu'on en juge par cette citation de Kollonta en 1918 : Les femmes, naturellement, jouissaient de tous les droits, mais en pratique, videmment, elles vivaient encore sous l'ancien joug : aucune autorit dans la vie familiale, asservies par un millier de tches domestiques, ayant charge tout le fardeau de la maternit, et mme des questions d'ordre matriel, car beaucoup de femmes se trouvaient seules dans la
163
164
LNINE, op. cit., p. 149. Ce texte est tir d'une brochure publie par Clara ZETKIN, Notes de mon carnet, Lnine tel qu'il fut. Bureau d'dition, 1934. Clara Zetkin rapportait des entretiens qu'elle avait eus avec Lnine sur le problme de la femme et de la libert de l'amour. l'Est comme l'ouest, les rares femmes qui accdent des responsabilits ministrielles sont gnralement charges des questions sociales, familiales, de l'enfance... toutes choses qui rejoignent l'image que l'on se fait traditionnellement de la femme.
Pierre Brchon, La famille. Ides traditionnelles, ides nouvelles. (1976)
99
vie, rsultat de la guerre et d'autres circonstances 165 . Leur divergence porte sur la conception de l'amour ; Lnine en a une vision assez classique . En 1915 dj, dans deux lettres adresses Inessa Armand 166 , Lnine se dclare oppos l'amour libre, qui est une revendication bourgeoise. Vouloir l'amour libre, c'est nier le srieux de l'amour et demander la libert de l'adultre. Inessa Armand disait : Mme une passion et une liaison phmres sont plus potiques et plus pures que les baisers sans amour des conjoints 167 . Lnine n'en disconvient pas. Les baisers sans amour des conjoints sont malpropres et hypocrites. Mais pour lui, l'amour se ralise normalement dans le mariage civil proltarien et non [81] pas dans une liaison phmre. Dans ses entretiens avec Clara Zetkin, Lnine s'en prend aux thses anarchisantes de certains communistes et notamment la thorie du verre d'eau : Vous connaissez sans doute la fameuse thorie d'aprs laquelle, dans la socit communiste, satisfaire ses instincts sexuels est aussi simple et aussi insignifiant que d'avaler un verre d'eau. (...) Ses partisans affirment que c'est une thorie marxiste. Merci pour ce marxisme pour lequel tous les phnomnes et toutes les modifications qui interviennent dans la superstructure idologique de la socit se dduisent immdiatement, (...) uniquement de la base conomique (...). Je considre la fameuse thorie du verre d'eau comme non marxiste et anti-sociale par-dessus le march (...). En amour il y a deux intresss et il en vient un troisime, un tre nouveau. C'est ici que se cache l'intrt social, que nat le devoir envers la collectivit. tant communiste, je ne ressens aucune sympathie pour la thorie du verre d'eau, encore qu'elle porte l'tiquette de l'amour affranchi 168 . Comme Engels, Lnine est partisan de la libert de l'amour c'est--dire d'un amour libr de tout ce qui l'alinait : la proprit prive et le patri165 166
Autobiographie d'une femme sexuellement mancipe, Ed. Gt-le-Coeur, 1973,
p. 34. Inessa Armand (1875-1920), ne Paris, leve Moscou, membre du parti bolchevik partir de 1904, a eu des responsabilits importantes aux cts d'Alexandra Kollonta dans le mouvement internationaliste fminin. Ses rapports avec Lnine sont complexes et ne furent probablement pas seulement intellectuels. LNINE, op. cit., p. 48. LNINE, op. cit., pp. 136-137.
167 168
Pierre Brchon, La famille. Ides traditionnelles, ides nouvelles. (1976)
100
moine transmettre. Mais la libert de l'amour, pour Lnine, ce n'est pas l'amour sans rgles, ce n'est pas l'amour irresponsable. Pour lui, on ne doit jamais sparer dans l'amour la satisfaction de l'instinct sexuel et l'aspect social : l'enfant nat de l'amour 169 et il est sujet de droit. Les partenaires doivent en tre conscients. C'est la condition pour que l'exercice de la sexualit soit humain et non bestial. Pour Lnine, la thorie du verre d'eau n'est pas une thorie marxiste parce qu'elle est mcaniciste . Pour les partisans de la thorie du verre d'eau, la proprit prive ayant t supprime, la monogamie n'a plus de base conomique et donc elle est voue disparatre. Automatiquement, une autre structure familiale remplace la monogamie, l'union libre, les rapports phmres sans contraintes entre les sexes. Lnine croit au contraire la valeur de l'amour sexuel stable et il n'en cherche pas une justification conomique : Ce versant humaniste est-il fidle au marxisme ? o est-ce un rsidu de systmes plus anciens ? Lnine, comme Engels et Bebel, serait-il victime de l'idologie familiale dominante aussi bien en Russie qu'en Allemagne, Angleterre ou France ? A chacun de se prononcer. [82]
La pense de B. Muldworf.
Retour la table des matires
une poque beaucoup plus rcente, cette question de la morale marxiste a t reprise par Bernard Muldworf, mdecin, psychiatrepsychanalyste, membre du mouvement franais pour le planning familial et membre du P.C.F. Il veut uvrer sur les problmes de la sexualit l'laboration d'un humanisme scientifique 170 , c'est--dire dbarrass de la marque de l'idologie dominante, des prjugs hrits d'une socit bourgeoise. L'humanisme scientifique cherche conna169 170
Cette rfrence l'enfant ne suffit plus, une poque ou la contraception est trs sre, pour condamner les rapports sexuels extra-conjugaux. Voir ce sujet Humanisme scientifique et problmes de la sexualit . Cahiers du Centre d'tudes et de recherches marxistes, 1971, n 84. Le mme texte a t galement publi dans La Pense, n 155, fvrier 1971.
Pierre Brchon, La famille. Ides traditionnelles, ides nouvelles. (1976)
101
tre les besoins humains spcifiques et rels qui sont satisfaire. L'thique, la morale scientifique sera celle qui, sur la base d'une connaissance des besoins humains, biologiques et sociaux, psychologiques et affectifs, recherchera toujours l'panouissement maximum des personnes. Un marxiste doit donc aborder la sexualit dans ses manifestations concrtes : amour, couple, famille, etc... en soulignant que le fait sexuel n'est jamais un fait sexuel isol, mais qu'il se traduit d'emble comme un fait culturel 171 et social, ainsi que Marx le disait dj dans les Manuscrits de 1844. La sexualit aborde dans ses manifestations concrtes, en particulier travers l'institution familiale, voil qui rejoint nos perspectives. Il m'a sembl intressant de prsenter la faon dont un thoricien marxiste d'aujourd'hui, qui possde les acquis de la psychologie et de la psychanalyse, considre la famille et les relations au sein du couple. Muldworf dfinit la sexualit comme une fonction de reproduction qui a deux caractristiques : elle obit la ncessit spcifiquement humaine de la recherche du plaisir et elle est une activit de relation , lie l'affectivit. Parce qu'elle est humaine et sociale, la sexualit n'est jamais entirement libre, sans lois. Trs tt chez l'enfant, la sexualit (qui n'est pas encore gnitale !) est rprime. C'est le pre qui joue ce rle. Il spare l'enfant de son premier objet d'amour , sa mre. Par son existence mme et sa relation privilgie la mre, le pre interdit ce rve de la possession (...) exclusive de la mre par l'enfant 172 . Donc, ds l'tape oedipienne de la sexualit, l'enfant fait l'apprentissage du dsir et de la satisfaction diffre , tape ncessaire dans la formation de la personnalit de l'enfant. Muldworf prend donc l parti dans les dbats qui depuis Freud, divisent les psychanalystes et ethnologues. Pour Freud, et [83] Muldworf est d'accord avec lui sur ce point, le complexe d'Oedipe est universel ; en tout cas on retrouve toujours un triangle dipien : l'enfant, son objet naturel, substitut de la mre, le porteur de la loi , substitut du pre.
171 172
B. MULDWORF, Sexualit et fminit, Ed. sociales, 1970, p. 15. B. MULDWORF, Le mtier de pre, Casterman, 1972, p. 45.
Pierre Brchon, La famille. Ides traditionnelles, ides nouvelles. (1976)
102
Malinowski 173 . Ayant analys les comportements sexuels de la population des les Trobriand, en Nouvelle-Guine, vers les annes 1920, il affirme ne pas y avoir rencontr le complexe d'Oedipe, Wilhelm Reich s'est inspir des thses de Malinowski dans ses analyses sur la rpression sexuelle 174 , d'o viendraient tous les maux (ou presque) de notre socit. Un psychanalyste, Ernest Jones, a repris l'tude de Malinowski sur les les Trobriand pour dfendre les thses freudiennes de l'universalit du complexe d'Oedipe. Selon lui, le pre biologique est effectivement, aux yeux de l'enfant, un bon pre et non pas le porteur de la loi, de la rpression. Mais il y a bien, chez les Trobriandais, un porteur de la loi. Ce rle de mauvais pre est assur par l'oncle maternel. Plus rcemment, un professeur amricain de psychologie et de psychiatrie, Bruno Bettelheim, s'est repos la question en analysant le systme ducatif dans les kibboutzim israliens 175 . Les enfants, ds le plus jeune ge, ne dpendent pas directement de leurs parents. Ils sont duqus par la communaut du kibboutz, ils vivent entre eux, soigns et duqus par une metapelet, femme qui s'occupe d'un groupe d'enfants. La fonction ducative est donc prise en charge par la communaut. L'enfant reoit une ducation trs libre : on impose peu de convenances ou d'interdits l'enfant. Comme chez les Trobriandais, cette organisation sociale conduirait l'absence de complexe d'Oedipe car les parents n'ont pas de rle autoritaire, et ne sont pas les seuls adultes en contact avec l'enfant. Les parents n'ont pas de rles diffrencis. Ils travaillent tous les deux et s'occupent de leurs enfants pendant deux heures tous les soirs, heures de dtente. Ainsi, les parents apparaissent l'enfant comme trs gentils mais impuissants alors que les metapelets sont dtestables, mais trs puissantes. Selon Bettelheim, la metapelet n'est pourtant pas un substitut du pre, un porteur de loi, car l'action affectueuse des parents empche un conflit oedipien autour de la
L'universalit du complexe d'Oedipe a t conteste par l'ethnologue
metapelet.
Partisan de l'universalit du complexe d'Oedipe, Muldworf estime que la vie sexuelle a toujours t organise, qu'il n'y a jamais eu d'ge d'or de la libert sexuelle. Pour lui, les pulsions et les instincts ne suffisent pas constituer la personnalit : Notre psychisme se consti173
JMT.]
174 175
Cf. MALINOWSKI, La vie sexuelle des sauvages du Nord-Ouest de la Mlansie, Payot, 1970. [Livre disponible dans Les Classiques des sciences sociales. Cf. W. REICH, L'irruption de la morale sexuelle, Payot, 1974. Nous parlerons
de ce livre dans la troisime partie. Voir Bruno BETTELHEIM, Les enfants du rve, Robert Laffont, Paris, 1971, 392 p.
Pierre Brchon, La famille. Ides traditionnelles, ides nouvelles. (1976)
103
tue par une sorte de rpression du biologique 176 . Il y a une rpression de la sexualit [84] qui est ncessaire pour que la personnalit se structure. Mais il y a galement une rpression nfaste de la sexualit, une rpression non plus naturelle mais sociale. Dans une socit aline et alinante, la sexualit est un rapport alin. L'organisation de la vie sociale, dans une socit de classes, fausse et obscurcit tous les rapports humains, y compris le rapport des sexes. Dans la socit moderne (...) les rapports de l'homme et de la femme, qui expriment le besoin profond de communion de l'homme avec son semblable, sont pervertis et se transforment en leur contraire : ils deviennent des rapports de lutte o la ruse, la force, la coquetterie deviennent les armes respectives des protagonistes 177 . Dans une socit o tout est marchandise, o tout se vend et s'achte, tous les rapports humains deviennent des rapports de force, des rapports mercantiles. Ainsi la socit, notamment travers les media, nous livre une image des rapports de l'homme et de la femme qui ne correspond plus aux besoins humains profonds. La femme est rduite une condition de marchandise, d' objet , de ftiche . L'infriorit de la femme s'explique donc partir des structures conomiques et sociales. Elle n'a rien de naturel. Muldworf s'en prend l Freud pour qui l'infriorit fminine est biologique. Pour Freud, la femme ne possdant pas de pnis, symbole de la puissance, est naturellement infrieure. La fminit est une fatalit, un destin. Freud est ce niveau victime de l'idologie dominante. Freud prtend que l'homme a la puissance sociale parce qu'il est dou d'un organe sexuel particulier. Nous pensons au contraire que c'est parce que l'homme a la puissance sociale que son organe sexuel est symbole de force. Ce n'est pas l'absence de phallus que la femme regrette, c'est sa place seconde dans la production sociale 178 . Aprs avoir prcis ses positions l'gard des thses freudiennes, comment Muldworf va-t-il ragir en face de la revendication de la libert sexuelle , de la volont de librer l'amour des structures ali176 177 178
B. MULDWORF, Humanisme scientifique et problmes de la sexualit , Cahiers du CERM, n 89, 1971, p. 15. B. MULDWORF, Sexualit et fminit, op. cit., pp. 43-44. B. MULDWORF, Sexualit et fminit, op. cit., p. 77.
Pierre Brchon, La famille. Ides traditionnelles, ides nouvelles. (1976)
104
nantes que seraient le couple stable et la famille (voir plus loin les thses anarchistes et gauchistes) ? Il essaie d'apprcier les besoins humains. Il constate que l'esprance de dure et de fidlit est inhrente la formation de tout couple. La dure et la fidlit sont des composantes, des dynamismes affectifs de l'amour . Par ailleurs, quel que soit l'avenir de la structure familiale, l'enfant aura toujours besoin d'une structure d'levage pour apprendre contrler ses pulsions, rglementer ses besoins, en un mot pour que sa personnalit se structure. Pour cet entourage attentif et affectueux de l'enfant, n en tat de dtresse originelle , la famille lui semble [85] une structure qui peut tre valable : Nous pensons que la famille et le couple sont encore loin d'avoir puis toutes leurs ressources 179 . Donc le couple stable est celui qui rpond le mieux la fois aux besoins de l'enfant et aux conditions de russite, d'panouissement de la rencontre amoureuse. La famille a un rle irremplaablement formateur pour l'enfant. Elle existera encore trs probablement dans la socit communiste o les hommes seront rconcilis avec eux-mmes et avec autrui. La socit tout entire ne sera jamais une grande famille. La socit communiste ne sera pas une socit sans rpression naturelle, sans structuration sociale lmentaire, sans structure d'levage. La famille se maintiendra mais elle ne sera plus comme actuellement une structure aline par les conditions socioconomiques : C'est l'anxit issue des problmes de la vie sociale qui suscite ce repliement sur soi de la cellule familiale et en rend l'atmosphre touffante et contraignante 180 . Muldworf conteste ici la famille vcue comme un refuge, comme une cellule close, idal et ralit aujourd'hui frquente cause de l'impossibilit d'panouissement dans la profession et dans la vie sociale. Certains disent aujourd'hui encore famille, foyer clos, je vous hais ; ils ont peut-tre raison de trouver trique et contestable cette forme de structure familiale mais ce n'est pas ce niveau qu'il faut lutter. Si l'on veut que la famine ne soit plus une cellule ferme, il faut en fait changer la situation conomique et sociale, il faut une rvolution politique. De la mme manire, la revendication de la libert sexuelle est mystificatrice : d'une
179 180
B. MULDWORF, Ladultre, Casterman, 1970, p. 182. B. MULDWORF, Le mtier de pre, op. cit., p. 161.
Pierre Brchon, La famille. Ides traditionnelles, ides nouvelles. (1976)
105
part l'homme est tre-de-dsir. Ce dsir nat du refoulement originaire de la pulsion sexuelle, de la satisfaction diffre. L'interdit sexuel est ncessaire la naissance du dsir. D'autre part, le bouleversement des structures de la vie sexuelle dpend des bouleversements socioconomiques. Pour Muldworf, dans la socit actuelle, changer les structures de la sexualit, du couple et de la famille, c'est mettre c la charrue avant les bufs . Il vaut mieux se contenter d'essayer d'amnager la situation puisqu'on ne peut pas actuellement la rvolutionner. Il vaut mieux en matire familiale un rformisme raliste qu'un rvolutionnarisme utopique . Ce nest que dans une socit non rpressive, dbarrasse depuis longtemps de l'oppression de classe, qu'il sera possible (et peut-tre mme souhaitable) d'exprimenter de nouvelles formes de relations affectives et de vie sexuelle.
Aprs avoir affirm que les ncessits psychologiques de l'panouissement de l'individu conduisaient actuellement privilgier la structure famille et le couple stable, Muldworf reconnat pourtant que les lois psychologiques () [86] laissent, dans leur relative souplesse, une certaine marge de choix : c'est chaque individu, connaissant ses limites, de prendre les risques qu'il se sent en tat d'assumer 181 .
Donc on peut envisager des expriences sexuelles et affectives parallles qui soient enrichissantes ; mais vu notre morale et culture actuelles, ces types d'expriences sont rarement heureux 182 .
pouvoir l'employer s'il en ressent le besoin 183 . Ces rapports ne diminuent pas les possibilits d'aimer les jeunes, s'ils ne sont pas simple passade sexuelle.
C'est dans un article de L'Humanit Dimanche que Muldworf est all le plus loin dans la reconnaissance de nouvelles formes de vie sexuelle, notamment pour les jeunes : La libert sexuelle, telle que nous l'entendons, c'est--dire qui favorise l'panouissement, suppose que garons et filles n'aient pas besoin de se cacher, qu'ils aient des endroits o se rencontrer pour faire l'apprentissage des relations affectives. Entre 15 et 16 ans, en gnral, l'adolescent atteint une maturation sexuelle complte. Il devrait
181 182 183
B. MULDWORF, L'adultre, op. cit., pp. 180-181. Humanisme scientifique et problmes de la sexualit, op. cit., p. 19. Article de L'Humanit Dimanche n 28 du 20 au 26 octobre 1971.
Pierre Brchon, La famille. Ides traditionnelles, ides nouvelles. (1976)
106
Cet article a suscit un certain nombre de remous de la part de lecteurs de L'Humanit Dimanche. L'un d'entre eux s'tonne qu'un article de ce journal du parti justifie le changement de partenaire. Il oppose la position de Muldworf celle de Lnine, combattant la thorie du verre deau. Il semble bien que cette position de Muldworf, considr comme un intellectuel du parti , ait choqu et n'ait pas t admise facilement par tous. Elle reprsente une ouverture par rapport la politique prudente du P.C.F. dans ces domaines comme nous le verrons dans le chapitre suivant.
La pense de Muldworf est une tentative orthodoxe pour rapprocher Marx et Freud, pour faire admettre par les marxistes les acquis de la psychanalyse, discipline longtemps considre comme trs suspecte. Il y l une tentative intressante, mais conteste par les thoriciens gauchistes qui voient en Muldworf (et dans les thses du P.C.F. sur la famille) la reprise de la pense ambiante, de l'idologie dominante, une dfense de la famille alors qu'eux dsirent sa fin en tant que structure sociale. Pour eux, la famille est une structure rpressive. Il faut la combattre pour qu'une socit non rpressive puisse natre. Donc, si depuis Freud on a pris conscience de l'importance de la sexualit sur la vie de l'individu et la structuration de la socit, la psychanalyse ne forme pas un courant de pense unifi. Ceux qui ont t forms cette discipline n'en restent pas moins marqus par les idologies et les doctrines auxquelles ils se rattachent. Ainsi, ce qu'on appelle le freudo-marxisme, la tentative pour rconcilier Freud et Marx, comporte au moins deux grands courants : l'un qui reste trs marqu par le marxisme et la pense des pres fondateurs , l'autre qui s'en loigne davantage pour se rapprocher des thses anarchistes. [87] C'est ce qui explique que, dans ce livre, je n'ai pas consacr une partie pour tudier les consquences sur les idologies familiales des dcouvertes concernant la sexualit. J'ai, au contraire, tudi la pense de Muldworf en traitant des thoriciens marxistes et j'aborderai Reich et Marcuse dans la troisime partie, consacre l'anarchisme.
Pierre Brchon, La famille. Ides traditionnelles, ides nouvelles. (1976)
107
[88]
LA FAMILLE. Ides traditionnelles, ides nouvelles.
Deuxime partie. Marxisme et famille
Chapitre 5
Trois exemples significatifs :
le Parti Communiste Franais, le Mouvement de Libration des Femmes, la Chine socialiste
Le parti communiste franais
Retour la table des matires
Retrouve-t-on dans les textes du P.C.F. la mme thorie de la famille que chez les penseurs marxistes ? Le P.C.F. se dit et se veut le dfenseur de la famille . Mais quelle famille dfend-il ? Plusieurs textes insistent pour rappeler que la famille n'est pas une structure immuable et naturelle. Le parti est en cela fidle Marx et Engels qui ont toujours considr la famille comme faisant partie des superstructures sociales, reflet des rapports de production. Ainsi Yvonne Dumont, qui intervient souvent sur les problmes de la famille et de la femme au nom du parti communiste, contestait les positions traditionalistes de Monsieur Pompidou, exprimes dans son discours
Pierre Brchon, La famille. Ides traditionnelles, ides nouvelles. (1976)
108
l'U.N.A.F. 184 : Notre conception est autre. Nous pensons que la famille est le produit d'une socit donne. Elle se transforme et volue avec la transformation et l'volution des rapports de production, elle en reflte les contradictions, elle n'est pas le noyau partir duquel s'difie la socit, elle est un des supports que ladite socit utilise 185 . Gilbert Mury, dans une intervention la Semaine de la pense marxiste, en 1965, essayait de vrifier que la structure familiale reproduit toujours la structure sociale, les rapports de production. une socit rurale a [89] correspondu, selon lui, une famille rurale, famille patriarcale marque par la confusion des rles , puisque la famille rurale est la fois unit de production et groupe d'intimit pour ses membres. Au contraire, dans les villes, s'est dveloppe la famille Napolon , la famille bourgeoise caractrise par le monopole du pouvoir conomique entre les mains du pre. La dot et l'hritage sont, dans cette structure, trs importants. Enfin au XIXe sicle se constitue la famille proltarienne. Vu les conditions de misre, les couples y sont trs instables, les unions libres sont nombreuses. Avec l'amlioration des conditions de vie ouvrire, avec la baisse de la dure de travail, le foyer ouvrier va devenir plus stable : Il va disposer des quelques heures quotidiennes ncessaires pour se construire sur une connaissance rciproque 186 . Il est fond sur l'amour et non plus sur le patrimoine. Aujourd'hui, avec la proltarisation des classes moyennes, le type de la famille ouvrire s'tend au dtriment de la famille Napolon . Gilbert Mury estime ainsi vrifier la thse de Marx et dEngels sur la rfraction de la socit globale dans la famille . On trouve galement dans les textes du P.C.F. une analyse de la situation familiale actuelle 187 . Les rapports du couple tendent de plus
184 185 186
Discours cit dans le chapitre 3, p. 45.
munisme, juillet-aot 1971, p. 43.
Yvonne Dumont, Rflexions sur la conception de la famille , Cahiers du com-
187
Gilbert MURY, Intervention la Semaine de la pense marxiste, publie dans Femmes du XXe sicle, P.U.F. 1965, p. 135. Gilbert Mury, secrtaire du Centre d'tudes et de Recherches marxistes, a quitt le P.C.F. en 1966 pour adhrer au parti communiste franais marxiste-lniniste (P.C.M.L.F.). Y. Dumont, Rflexions sur la conception de la famille, op. cit., pp. 44-48.
Pierre Brchon, La famille. Ides traditionnelles, ides nouvelles. (1976)
109
en plus l'galit parce que la femme participe la production, de par son travail. Les rapports parents-enfants sont moins marqus par l'autoritarisme paternel. Cette volution vers une famille plus galitaire et moins autoritaire s'explique en fonction mme du rle grandissant de la classe ouvrire et du dveloppement de la conscience civique et rvolutionnaire 188 . La famille ouvrire, o l'galit du couple est plus relle que dans la famille bourgeoise, prfigure et annonce la famille de demain, dans la socit socialiste. L, enfin, la famille pourra devenir le foyer de l'amour et du bonheur personnel des hommes et duquer la jeune gnration (...). Parce que nous travaillons promouvoir la seule socit nouvelle convenant notre temps, le socialisme, nous sommes persuads que la famille, loin de disparatre, pourra atteindre un stade suprieur et que le terme de famille monogamique prendra enfin tout son sens 189 . Voil qui est clair : le P.C.F. est pour la monogamie. On retrouve l la conception des matres penser du marxisme que nous avons dj longuement dveloppe. Par [90] contre, le parti est trs rserv l'gard de nouvelles formes de vie familiale et l'gard de la libert sexuelle : Fausse solution (...) celle qui consisterait orienter vers les exemples des tentatives de vie collective dans les pays nordiques. Solutions d'avant garde prfigurant la vie amoureuse des temps futurs ? Ractions, en fait, contre une socit o l'homme est un loup pour l'homme. Il n'est pas vrai que la libert sexuelle dont on parle tant est en quelque sorte le pralable la libert politique ou une forme d'accs la pense rvolutionnaire. Elle dtourne du vritable combat politique. En fait, si on veut accder de nouvelles modalits de vie du couple ou de vie de famille, qui sont encore crer, il faut dans un premier temps, donner aux formes actuelles du couple et de la famille leur maximum de conditions concrtes pour russir 190 . Alors que Muldworf mettait sur le compte de l'or-
188 189 190
Y. Dumont, dans Femmes du XXe sicle, op. cit., p. 86. Y. Dumont, Rflexions sur la conception de la famille, op. cit., pp. 43-44. Comparez cette dclaration avec la position de B. Muldworf, chapitre 4. Bulletin Les communistes et la famille, rdig aprs des journes d'tudes sur le travail du parti parmi les femmes, 23-24 mai 1970, p. 13. Sur la forme de l'institution familiale, le Parti socialiste estime dans son programme de gouvernement Changer la vie (Flammarion 1972, p. 133) qu'il ne faut pas dmembrer
Pierre Brchon, La famille. Ides traditionnelles, ides nouvelles. (1976)
110
ganisation sociale dfectueuse le repliement de la cellule familiale sur elle-mme, il est symptomatique de voir qu'ici le mme phnomne sert expliquer les tentatives de vie communautaire 191 .
Si la famille volue dj, l'intrieur du capitalisme, vers la forme qu'elle aura dans le socialisme, cette volution est freine par le systme d'exploitation dans lequel nous vivons. Dans notre socit, les conditions de vie faites aux familles sont mauvaises. On peut dire que, par certains cts, aujourd'hui comme au temps de Marx, le capitalisme dsagrge la famille . Le niveau de vie des familles est trop bas, les salaires et les allocations familiales ne progressent pas assez alors que l'inflation est constante, on ne construit pas assez d'quipements collectifs, les cadences de travail sont inhumaines, les logements loyer modr ne sont pas assez nombreux. Tout cela influe sur la vie des familles et constitue, pour le P.C.F., des revendications constantes. Pour lui, la dfense de la famille, c'est d'abord la dfense de son niveau de vie et de son cadre de vie 192 . Le parti ne cherche pas agir sur la structure [91] familiale elle-mme, mais sur ce qui l'environne et la conditionne : l'conomie et la politique. Le bonheur de la famille ne dpend pas seulement de la qualit de l'pouse, de sa faon d'arranger coquettement sa maison et sa personne, ou de grer adroitement son budget 193
191
la famille qui rsulte de la dcision formelle de deux tres responsables de vivre ensemble. Le P.S. a reconnat l'union libre . Ce n'est d'ailleurs pas contradictoire. Une socit o l'homme est un loup pour l'homme peut conduire au repliement sur elles-mmes aussi bien de la cellule familiale que des communauts. Pour le Parti socialiste, la politique familiale doit avoir deux finalits : Assurer aux familles les moyens d'une vie normale. (C'est une exigence de justice) et permettre le renouvellement de la population . En fonction de ces deux objectifs, le programme de gouvernement du parti socialiste prvoit tout un arsenal de mesures : pour augmenter le systme d'aide financire aux familles et le rendre plus juste, galement pour multiplier les moyens sanitaires et ducatifs destins aux enfants en bas ge (crches, coles maternelles). Pour le parti socialiste (comme pour le parti communiste), la politique dmographique doit avant tout viser assurer de meilleures conditions de vie aux familles : La politique du logement et d'une manire gnrale l'exprience d'une socit meilleure offerte par la politique socialiste permettront un dveloppement harmonieux de la population franaise. Les hommes ne craignent pas de donner la vie quand l'avenir leur offre un espoir. (Changer la vie, Programme de gouvernement du parti socialiste, Flammarion, 1972, pp. 131-134). Bulletin Les communistes et la famille, op. cit., p. 5.
192
193
Pierre Brchon, La famille. Ides traditionnelles, ides nouvelles. (1976)
111
comme l'idologie bourgeoise voudrait le faire croire travers la presse fminine : toute la politique conomique et sociale du gouvernement a des rpercussions sur la vie familiale. C'est ce niveau l qu'il faut revendiquer. Pour le P.C.F. changer la vie, c'est d'abord changer les structures conomi-
ques et politiques 194 . Transformer les rapports individuels, les mentalits, cela l'intresse, il ne laisse pas ce terrain d'autres mais son optique est toujours de ramener ces problmes un choix politique, une option anticapitaliste ou au moins anti-gouvernementale. Le P.C.F. ne cherche pas changer la famille mais changer la socit. Ce qui probablement modifiera la famille. Le P.C.F. considre toujours la famille comme une superstructure, mais c'est une superstructure valorise : la transformation des rapports de production permettra l'avnement d'une famille de qualit suprieure.
Le parti mise sur la famille conjugale, sur le modle habituel de structure familiale. Mais il est partisan d'une lgislation librale en matire de divorce. Depuis plusieurs annes, il demandait (comme l'ensemble de la gauche franaise) l'introduction dans le droit du divorce par consentement mutuel. Dans les dbats parlementaires qui, en 1975, ont t consacrs la rforme du divorce, les lus communistes ont estim que le projet gouvernemental n'allait pas assez loin. Admettant bien le divorce par consentement mutuel, la nouvelle loi maintient en partie la notion de faute en matire de divorce. Ceci semble contestable aux lus communistes 195 . Le divorce ne devrait pas tre une sanction , rsultant du [92] dlit de l'un des deux conjoints, infidle au contrat qu'il a accept par son mariage. Le divorce doit en fait
194
195
Le parti socialiste est du mme avis. Franois Mitterrand, premier secrtaire, dclarait aux tats gnraux de la famille (runis par la Vie catholique) : Sans la rforme des structures conomiques essentielles, ni la femme, ni la famille, ne pourront trouver leur vritable place (...) Sans libration conomique, les autres librations, y compris la libration spirituelle, n'auront pas lieu. (2 et 3 fvrier 1974). De plus les lus communistes ont reproch au projet gouvernemental son insuffisance en matire de pensions alimentaires. En effet, la loi vote permet, en cas de non paiement de la pension, de la faire prlever par la puissance publique, sans avoir entamer une procdure judiciaire. Mais la loi ne prvoit pas la cration d'un fond de garantie, qui permettrait de payer immdiatement au pensionn ce qui lui est d, sans avoir attendre que la puissance publique ait russi faire payer le dbiteur, parfois d'ailleurs insolvable. Rien non plus n'est prvu pour favoriser la rinsertion professionnelle de la femme divorce non salarie.
Pierre Brchon, La famille. Ides traditionnelles, ides nouvelles. (1976)
112
tre considr comme un constat ou un remde , la solution la moins mauvaise pour les enfants quand l'amour des parents s'est dissous. Pour le P.C.F., le mariage ne devrait pas tre d'abord un contrat juridique, dfinissant des droits et obligations, mais exprimer le dsir de bonheur et la responsabilit assume ensemble par deux individus qui crent une famille. Le divorce marque l'chec de l'amour mais reconnatre le divorce, ce n'est pas dissoudre l'institution familiale. Pour le parti communiste, la solidit familiale ne saurait dpendre d'une lgislation, elle est fonction de l'amour du couple. Pour certains conservateurs au contraire - ils ont eu l'occasion de s'exprimer dans le dbat parlementaire voqu prcdemment - faciliter le divorce, c'est dtruire l'institution familiale, car c'est offrir au couple de mettre fin au contrat qu'il a souscrit. Ils estiment que ce contrat doit tre irrvocable partir du moment o il a t librement accept. Ils ont en fait une conception juridique de la ralit, comme si la seule existence juridique d'une institution la faisait exister dans la ralit. Les positions thoriques du P.C.F. sur la famille sont dans la droite ligne de la pense de Marx, Engels et Lnine. Mais on trouve galement toute une image de la famille en analysant les textes de propagande adresss par le P.C.F. aux femmes. Dans ces textes, le P.C.F. semble plus reflter l'opinion franaise sur la famille, les images, les modles ancrs dans les mentalits que proposer un modle nouveau de famille, une famille pour le socialisme. La famille apparat dans ces textes comme tant avant tout de la responsabilit de la femme. C'est la femme qui est cense s'occuper directement des enfants, c'est elle qui fait preuve de sentiment maternel. Certes, thoriquement, la femme n'est pas limite la famille. Le P.C.F. parle assez frquemment de la femme travailleuse, mre, citoyenne . Elle n'est pas seulement mre de famille, mais elle a aussi des responsabilits dans la production et dans la vie culturelle, sociale et politique. Tout ce qui est valeur et moyen d'panouissement pour l'homme l'est donc aussi pour la femme. Et notamment le travail. Tout comme l'homme, elle a droit au travail : Il est facteur d'mancipation pour la femme, dans la mesure o elle y puise amlioration de ses conditions de vie et de celles de sa famille, indpendance conomique, lment dcisif pour l'galit dans le couple, sentiment de solidarit envers les autres travailleurs, ouver-
Pierre Brchon, La famille. Ides traditionnelles, ides nouvelles. (1976)
113
ture vers une vie dpassant le cadre familial 196 . [93] Pour le P.C.F., le travail de la femme n'est pas nuisible aux enfants, comme l'idologie bourgeoise veut le faire croire. Ce qui leur est nuisible, ce n'est pas le travail de la mre, c'est le manque d'quipements collectifs qui permettent aux enfants d'tre mieux pris en charge par la socit. Par ailleurs, le P.C.F. critique l'idologie de la femme au foyer. C'est une faon de maintenir l'infriorit de la femme, d'viter sa prise de conscience politique. De plus le travail fminin est une ncessit conomique. Le P.C.F. est donc oppos tout ce qui ressemble, de prs ou de loin, un salaire de la mre au foyer 197 . Ce genre de subventions exerce sur la mre une pression qui risque de la dissuader d'aller travailler. Ce qu'il faut, c'est augmenter le niveau de vie de toutes les familles, que la mre travaille ou non. Pour cela, il faut fortement revaloriser les allocations familiales. A priori le P.C.F. semble donc partisan inconditionnel du travail de la femme. Mais les choses sont moins simples. Car le parti communiste entend rassembler sur ses positions le plus grand nombre possible de femmes et donc il ne peut ngliger les femmes de travailleurs , les mnagres 198 . Il doit viter de les culpabiliser. Il souligne au contraire que travailleuses et mnagres ont les mmes intrts, les mmes revendications, les mmes aspirations. L'idal, dit depuis quelques annes le P.C.F. - il tait auparavant plus nettement partisan inconditionnel du travail de la femme - serait le libre choix pour la femme entre le travail et l'entretien du mnage. Or ce libre choix n'existe pas : On sait que la plupart des femmes maries et des mres travaillent d'abord par ncessit, parce qu'un seul salaire ne permet pas la famille de vivre normalement. Par ailleurs, beaucoup d'autres qui voudraient travailler en sont empches par l'absence d'emplois disponibles dans leur localit, par leur manque
196 197
Madeleine VINCENT, Femmes, un dbat ouvert , Cahiers du communisme, septembre 1970, p. 106. Il est tout fait symptomatique que l'allocation de salaire unique reprsente l'heure actuelle presque 20% de la masse des prestations familiales alors que l'allocation pour frais de garde de l'enfant, rcemment cre, ne reprsente pas mme 1%. Il ne dit jamais les femmes au foyer expression qui serait trop pjorative. Il n'y a pas de femmes au foyer , il n'y a qu'une idologie de la femme au foyer .
198
Pierre Brchon, La famille. Ides traditionnelles, ides nouvelles. (1976)
114
de formation professionnelle, par la pnurie d'quipements sociaux pour la garde des enfants, par la ncessit de rester constamment auprs d'un malade, d'un vieillard, d'un infirme que la socit abandonne la charge des familles 199 . Le P.C.F. veut montrer que la situation actuelle de la mre travailleuse ou mnagre est le rsultat de conditionnements socio-conomiques. En fait le libre choix supposerait [94] un salaire plus lev pour chaque travailleur, des allocations familiales revalorises, la reconnaissance de la fonction sociale de la maternit, de manire que la femme puisse concilier le travail et l'ducation des enfants. Si le libre choix existait, beaucoup de femmes choisiraient trs certainement de travailler, surtout dans les jeunes gnrations. Donc si le P.C.F. souligne tout ce que le travail peut apporter la femme et la famille, il n'en fait pas un absolu : ni obligation, ni interdiction, mais libre choix 200 .
Le parti revient trs souvent sur le problme de la conciliation entre ces deux fonctions de la femme : le travail et la maternit. Les femmes ont une double responsabilit sociale , produire des richesses, reproduire la vie humaine. La femme fait donc une double journe, une l'usine et une seconde au foyer puisque c'est sur elle que retombent les charges de la cuisine et des soins aux enfants. C'est pourquoi il faut reconnatre la femme des droits particuliers dcoulant de sa responsabilit maternelle. Le P.C.F. propose des mesures en ce sens, notamment la prolongation 16 semaines des congs maternit, l'indemnisation de congs pour soigner un enfant malade, une indemnit de frais de garde pour les enfants de moins de trois ans (finance par une contribution patronale), l'ouverture de nombreuses crches et la multiplication des quipements collectifs qui rpondent aux besoins des enfants : maisons de l'enfance, restaurants scolaires, colonies de vacances, centres ars, espaces verts. En somme, il faut que l'tat participe davantage la prise en charge matrielle de l'ducation de l'enfant et cre des structures amliorant son cadre de vie. Le P.C.F. rclame pour la mre des droits particuliers car la responsabilit familiale est certes commune l'homme et la femme, mais c'est la femme qui porte l'enfant, le met au monde et assure la
plus grande part des soins et de l'ducation qu'il exige 201 . De plus il faut
199 200 201
Bulletin La femme et le travail, rdig aprs les journes d'tudes sur le travail du parti parmi les femmes (23-24 mai 1970) pp. 9-10. Y. DUMONT, Sur quelques problmes actuels de la famille , Cahiers du communisme, juin 1969, p. 67.
Bulletin La femme et le travail, op. cit., p. 8.
Pierre Brchon, La famille. Ides traditionnelles, ides nouvelles. (1976)
115
tenir compte des capacits physiques plus limites de la femme et donc lui interdire les mtiers trop pnibles. L'galit entre l'homme et la femme ne se rduit pas une identit. Le parti communiste franais demande la fin de l'esclavage domestique de la femme qui sera rendue possible par la gnralisation des appareils mnagers et la collectivisation de certaines tches mnagres. Donc le parti communiste ne cherche pas une solution aux problmes de la femme dans une redfinition des fonctions de l'homme et de la femme au sein du couple, car ce serait une solution individuelle qui ne remettrait pas en cause l'organisation conomique. On transformerait l'esclavage de la femme en esclavage du couple alors qu'il faut les librer tous les deux. Certes le partage des tches mnagres entre l'homme et la femme ne peut pas nuire l'quilibre du mnage, et c'est une chose de plus en plus naturelle, notamment chez les jeunes couples. Mais l n'est pas la vritable solution. Par contre, lorsque la socit socialiste cre les conditions pour que les travaux mnagers deviennent une industrie sociale, avec la production et l'utilisation des appareils [95] mnagers en grand nombre, le dveloppement des rseaux de cantines, restaurants et services communs par groupe d'immeubles, comme les centres de raccommodage ou les entreprises de grand nettoyage des logements, voil qui dchargerait rellement et la femme et le couple, voil qui permettrait la famille de mieux remplir ses autres fonctions, ses tches d'un contenu plus humain, son rle d'ducatrice que des parents gaux (participant l'un et l'autre la vie professionnelle, aux activits intellectuelles et sociales) sont aptes assumer 202 . Si le P.C.F. reconnat que la femme est oblige de faire une double journe et qu'elle est une esclave domestique, il ne reporte pas pour autant ses accusations contre le sexe masculin. Car le vrai responsable de l'esclavage de la femme, ce n'est pas l'homme mais les monopoles capitalistes. Le P.C.F. reproche justement au Mouvement de libration de la femme d'une part sa mconnaissance du rle de la maternit dans l'panouissement de la femme, d'autre part sa faon de considrer les hommes comme les ennemis des femmes, de faire de la diffrence sexuelle une diffrence de classes.
Rsumons-nous : le parti communiste franais nous parle surtout des responsabilits familiales de la mre. Ce n'est que dans les textes les plus rcents qu'il parle des tches ducatives des parents . Le rle du pre dans la famille est trs peu soulign. Le pre n'est pas cens avoir des problmes familiaux. La femme est bien travailleuse, mre, citoyenne mais en fait le travail fminin devrait dpendre de son libre choix, la maternit devrait lui donner des droits spciaux dans son travail ; pourquoi des congs pour garder un enfant malade
202
Bulletin Les communistes et la famille, op. cit., pp. 12-13.
Pierre Brchon, La famille. Ides traditionnelles, ides nouvelles. (1976)
116
seraient-ils toujours pris par la femme ? L'homme serait-il incapable d'accomplir certaines tches ? Pourquoi serait-ce toujours la femme qui devrait sacrifier sa vie professionnelle ses enfants ? Le P.C.F. me semble, ce niveau, victime de l'image traditionnelle et encore largement vcue selon laquelle le pre travaille l'extrieur, la mre s'occupe avant tout de ses enfants. La responsabilit premire du pre, c'est son travail l'extrieur alors que la responsabilit premire de la mre, c'est l'ducation de ses enfants. Si les poux arrivent travailler tous les deux et partager les tches mnagres, c'est qu'ils sont hroques mais on ne leur en demande pas tant dans les structures sociales actuelles. Le rle prpondrant que le P.C.F. accorde la maternit dans les responsabilits de la femme apparat encore travers les nombreux discours adresss aux femmes pour leur suggrer d'agir pour la paix dans le monde. Si les femmes agissent pour la paix (donc s'engagent politiquement), c'est parce qu'elles sont mres, qu'elles connaissent le prix de la vie. Vu leur instinct maternel, elles sont plus sensibles aux atrocits des guerres qui tuent des enfants et des jeunes en pleine force de l'ge, qui brisent des familles. Donc la puissance de l'amour maternel ne permet [96] plus aux mres de se cantonner dans les soins quotidiens aux enfants, mais leur dicte de s'opposer tout ce qui les menace et en premier lieu la menace atomique 203 . Il est trs curieux de constater que ce qui motive l'action de la femme pour la paix, ce n'est pas sa qualit de citoyenne, ce n'est pas sa conscience politique. Le P.C.F. estime ncessaire et possible d'veiller sa conscience en partant de ses sentiments maternels 204 . Ceci aboutit renforcer dans l'image qu'a le parti communiste de la femme la dimension maternelle, conue comme faisant partie de sa nature, de sa vocation. La maternit devient le ciment de l'unit entre les femmes de toutes les classes sociales et de tous les pays. La femme semble porter seule le souci des enfants, l'amour de l'enfant semble un monopole
203
S. BERTRAND La promotion de la femme dans le monde , Cahiers du communisme, avril 1958, p. 594. 204 J. VERMEERSCH Les femmes dans le combat pour le progrs et la dmocratie dans Le rle des femmes dans la nation , Cahiers du communisme, supplment mars 1968, p. 170.
Pierre Brchon, La famille. Ides traditionnelles, ides nouvelles. (1976)
117
fminin. On pourrait penser un matriarcat familial 205 . L'image que le parti communiste franais donne de la famille, pratiquement limite la mre et l'enfant, me semble en fait tre le reflet de la situation existante : une certaine dmission du pre est frquente, la responsabilit familiale retombe souvent sur la mre. Le discours du P.C.F. adress aux femmes, parce qu'il est un discours de propagande visant unir toutes les femmes, s'appuie sur les images et strotypes traditionnels de la mre et de la famille. Et ces strotypes correspondent une partie de la ralit existante. La relation entre la mre et l'enfant - privilgie par la socit - apparat aussi dans le discours du parti communiste comme la relation fondamentale l'intrieur de la famille. Le discours du P.C.F. sur la famille est donc deux niveaux. Il y a un discours thorique sur la famille et l'galit de la femme assez fidle la position des matres penser du marxisme mais, travers certains discours de propagande adresss aux femmes, on rencontre une conception beaucoup plus traditionnelle de la famille. [97]
Le Mouvement de libration des femmes
Retour la table des matires
Le P.C.F. s'adresse aux femmes pour prendre en charge leurs intrts, il se dit le dfenseur de la famille ; mais un certain nombre de femmes, regroupes dans le Mouvement de libration des femmes, critiquent sa position. Elles dnient un parti politique le droit d'exprimer leurs revendications, leurs aspirations. En effet, les militantes du M.L.F., qui sont parfois d'anciennes militantes de mouvements rvolutionnaires, ont fait l'exprience du caractre essentiellement mas205
Je n'exagre pas : Que nous soyons communistes, socialistes, chrtiens, nous mettons des enfants au monde et nous serions indignes du doux nom de maman si nous n'tions pas capables de dfendre nos petits, si nous tions moins qu'une mre poule qui protge ses poussins, moins qu'un animal qui dfend ses petits jusqu' la mort. J. VERMEERSCH, Des tmoignages d'union pour la dfense de la paix . Discours de 1949 cit dans Les femmes dans la nation, recueil de discours dit par le P.C.F., 1961, p. 69.
Pierre Brchon, La famille. Ides traditionnelles, ides nouvelles. (1976)
118
culin des partis politiques. Dans les partis politiques, mme de gauche, dans les mouvements rvolutionnaires, mme les plus extrmistes, les femmes n'arrivent pas prendre la parole sur un pied d'galit avec les hommes. Elles sont le plus souvent relgues dans des tches subalternes de collage d'affiches, ventuellement orientes vers une commission sociale... Le M.L.F., n aprs Mai 1968, qui sort des catacombes au dbut de 1971, est un mouvement anti-politique, en ce sens qu'il ne veut pas s'identifier un parti politique, et qu'il refuse les pratiques de tous les partis. Mais il a bien conscience d'avoir une action politique, en cherchant lutter contre l'oppression dont sont victimes les femmes. Mouvement peu organis, anti-structures (les structures apparaissant comme le symbole des organisations baignant dans une civilisation patriarcale et rpressive), anti-autorit (il n'y a pas de systme lgal faisant merger une direction du mouvement, ce qui d'ailleurs permet parfois des leaders de s'imposer plus facilement), le M.L.F. fait porter son action sur des luttes ponctuelles, susceptibles de faire prendre conscience d'un problme important pour les femmes, pour leur libration. Ainsi la premire action largement connue du M.L.F. a t la publication par le Nouvel Observateur en avril 1971 du Manifeste des 343 femmes qui dclaraient s'tre fait avorter. A travers la lutte pour l'avortement libre et gratuit, les femmes posaient une revendication : le droit des femmes disposer de leur propre corps, le droit de dcider de leur maternit, de refuser d'tre de simples instruments de la reproduction. En choisissant le nombre de ses maternits, la femme veut manifester son autonomie eu gard aux intrts de "l'espce" ou de la socit, de la famille , elle devient le sujet, pour la premire fois, de sa propre maternit 206 . Ce point est capital car la maternit s'avre la raison permanente de l'ingalit entre les sexes, et [98] ainsi la pierre d'achoppement de toute vritable "libration" des femmes 207 . Mais la lutte pour le droit de disposer librement de son corps n'est qu'un des aspects de l'action du M.L.F. Plus globalement, ce mouvement entend modifier tous les rapports entre hommes et femmes, transformer les rapports
206 207
Pascal LAIN, op. cit., p. 191. Pascal LAIN, op. cit., p. 190.
Pierre Brchon, La famille. Ides traditionnelles, ides nouvelles. (1976)
119
de domination en rapports librs. Pour le M.L.F., les femmes actuellement ne peuvent tre libres car elles sont opprimes par la masse des hommes. Il faut donc quelles se retrouvent entre elles pour s'affirmer, pour que, de leur dynamique, merge une nouvelle identit fminine (et non plus une fminit qui ne serait que le complment et l'instrument des besoins masculins). Les hommes sont donc exclus des runions du mouvement. Lors des rencontres du M.L.F. qui ont marqu la premire grve des femmes , dbut juin 1974, le seul homme prsent tait la nurse qui s'occupait de la crche. Ce dtail anecdotique est symptomatique. L'homme est, la rigueur, accueilli s'il accepte de se taire pour que les femmes puissent s'exprimer, s'autocrer. Le mouvement exprimente l'inverse de la situation sociale : les femmes sont rduites au silence dans la socit patriarcale et masculine , phallocratique 208 . Dans le mouvement, seules les femmes ont droit la parole. L'homme, qui exceptionnellement a t accept, est invit s'occuper des soins aux enfants, c'est--dire de ce que la socit rserve habituellement la femme 209 . Depuis 1972-1973, des tendances se sont formes au sein du M.L.F. Un seul point d'accord entre toutes les tendances : la socit est une socit faite par les hommes. Il faut donc s'opposer aux hommes et la masculinit (qu'on peut dfinir comme une volont de totale domination). Le problme primordial, discut au M.L.F., semble celui du rapport avec l'homme. L'homme apparat gnralement comme l'ennemi, celui qui opprime la femme. Le rapport des femmes du M.L.F. avec leur mari ou leur compagnon semble souvent difficile, au dire mme des intresses. Les relations avec "eux" sont trs difficiles. Je veux continuer ma vie avec mon homme mais nous connaissons des priodes de forte hostilit. Une femme en lutte est une ennemie pour l'homme , dit une militante du mouvement 210 . Cette tendance au repli des
208 209
C'est--dire o le pouvoir appartient au mle, celui qui possde le phallus, l'organe sexuel masculin. Le M.L.F. condamnait en dcembre 1973 les mesures d'aide la mre , embryon de salaire social rserv la mre car en allouant une somme drisoire la mre et elle seule, le pouvoir confine dfinitivement les femmes dans leur rle de mnagre et d'ducatrice . Le Monde du 20 dcembre 1973. Cf. enqute de Nicole Muchnik Le M.L.F., c'est toi, c'est moi , Le Nouvel Observateur, n 459 du 27 aot au 2 septembre 1973, p. 57.
210
Pierre Brchon, La famille. Ides traditionnelles, ides nouvelles. (1976)
120
femmes sur elles-mmes [99] pour pouvoir s'affirmer, cette faon de considrer l'homme comme l'ennemi font que l'homosexualit apparat certaines comme rvolutionnaire 211 , au moins pour un temps : L'homosexualit est-elle rvolutionnaire ? Ce qui nous intresse, c'est le dclenchement d'une nouvelle culture. Le monde doit tre repens en termes compltement diffrents. Si l'on veut viter de se dfinir par rapport aux hommes, il est plus facile de commencer par se couper d'eux. L'homosexualit primaire des femmes devrait n'tre qu'un passage vers une htrosexualit retrouve et vraiment libre 212 . Les militantes du M.L.F. vivent des situations familiales diversifies : certaines sont maries, d'autres vivent en union libre, d'autres sont homosexuelles. Toutes dsirent se librer - l o elles sont - de l'oppression masculine, toutes veulent la libert sexuelle, ce qui remet en cause l'institution familiale et le couple lui-mme. Les militantes de la tendance psychanalyse et politique insistent sur la ncessit de la rvolution l'intrieur de soi-mme. Compose surtout d'intellectuelles, cette tendance organise des runions, des week-ends d'analyse. Elles veulent lutter non pas contre les hommes, mais contre la masculinit qui peut exister inconsciemment mme chez les femmes. Ces militantes refusent les actions ponctuelles de libration organises par les autres tendances du mouvement, estimant que cela quivaut revendiquer le statut de l'homme dans la socit. Alors que le problme n'est pas l. Il faut crer une nouvelle faon d'tre femme, en refusant de se dfinir par rapport aux hommes, en refusant de revendiquer la masculinit et de se vouloir l'gale de l'homme.
Les tendances fministes et fministes rvolutionnaires insistent sur l'unit de toutes les femmes qui semblent former une nouvelle classe sociale. La bourgeoise et la proltaire sont opprimes de faon diffrente, mais elles le sont toutes les deux. Toutes deux sont tenues en infriorit par leur mari, qu'il soit bourgeois ou proltaire. Si elles ne sont pas salaries, elles sont toutes deux dpendantes conomiquement de leur mari, esclaves
211 212
Se sentant menaces, d'autres femmes avaient cr en 1971, au sein du M.L.F. un groupe Femmes maries . Opinions de militantes rapportes par Nicole MUCHNIK, op. cit., p. 64. La dernire de ces citations mane d'Antoinette dont l'autorit sur la tendance psychanalyse et politique semble forte.
Pierre Brchon, La famille. Ides traditionnelles, ides nouvelles. (1976)
121
domestiques, enfermes dans leur cuisine. D'ailleurs comment prciser la position de classe des mnagres ? Dfinir leur classe par l'emploi qu'occupe leur mari, c'est encore une faon de refuser leur identit. Faut-il alors parler d'une classe des employes de maison ? C'est l'optique de certaines militantes du M.L.F. La femme mnagre (qu'elle soit par ailleurs salarie ou non)
minit exige du temps 214 . Des messages d'amour seront crits au rouge lvres sur des dossiers confidentiels, des femmes se croiseront les bras,
est une employe gratuite, une esclave du mari 213 . En tout cas, la lutte des femmes semble toujours dominer [100] la lutte des classes, mme chez les militantes qui essaient d'articuler les deux perspectives : depuis l'avnement de la proprit prive, la famille et la civilisation patriarcale se sont dveloppes et la femme y est en esclavage. La lutte des sexes aurait une origine conomique lointaine. Pour unir toutes les femmes et les faire agir ensemble, ces tendances du M.L.F. ont imagin en 1974 une grve des femmes , grve non pas traditionnelle puisqu'il n'y avait pas de a mots d'ordre (perspective trop organisationnelle, presque militaire) mais seulement des mots de dsordre concernant tous les domaines o la femme est opprime : dans le travail salari, dans le travail domestique et l'ducation des enfants, dans les achats de consommation, dans le service sexuel du mari. Cette action visait provoquer une vaste discussion sur la situation des femmes et ses causes. Quelques exemples de ces mots de dsordre : Puisque les patrons nous veulent sduisantes, fminines , soyons hyper-fminines (...). Refaisons aussi souvent que ncessaire notre maquillage et notre coiffure, rparons sur le champ le moindre caillage de notre vernis ongle, sortons ostensiblement notre vaporisateur de dodorant sans lequel nous empoisonnerions l'atmosphre. S'il y a des lettres taper, elles attendront. La f-
et d'autres les ouvriront... leurs surs. ... 215 Dnonons le sexisme, la drague, le viol. Dnonons 1'utifisation du corps des femmes dans les revues et la publicit. Ne nous laissons plus afficher, acheter, violer. Nous sommes
213
214 215
Claude Alzon refuse cette perspective car toutes les femmes ne travaillent pas pour leur mari ; d'autre part certaines vivent seules. Il remarque que l'oppression de la femme par l'homme revt deux aspects : une exploitation conomique du travail fminin et une domination politique, qui prive la femme de tout pouvoir de dcision. Or, plus on gravit les chelons de la socit, moins la femme est exploite, mais plus, en revanche, la domination qu'elle subit s'alourdit. Claude ALZON, Les femmes forment-elles une classe sociale ? Le Monde du 29-30 avril 1973. Le mme auteur a dvelopp cette thse dans Femme potiche et femme boniche. Pouvoir bourgeois et pouvoir mle, Ed. Maspero, 1973. Evelyne LE GARREC Le printemps des femmes , Politique Hebdo, n 119 du 14 au 20 mars 1974. Tract du M.L.F. cit par Katherine Aub, La premire grve des femmes , Le Monde du 9-10 juin 1974.
Pierre Brchon, La famille. Ides traditionnelles, ides nouvelles. (1976)
122
tation 217 . De fait, cette grve des femmes sera surtout l'occasion de deux journes de discussion. Des dbats sont organiss Paris o 2 000 femmes environ viennent discuter. Une manifestation dans la capitale rassemble 200 militantes. Le M.L.F. fait parler de lui par ses actions spectaculaires mais il ne rassemble pas les foules, semble-t-il. La tendance fministe du M.L.F. a galement fond en mars 1974 la Ligue du droit des femmes , prside par S. de Beauvoir. Les buts de l'organi-
notre propre avenir, pas celui des hommes 216 . Nous voulons dcouvrir ensemble, nous communiquer nos recettes de vie, et pas nos recettes de cuisine (...) Nous voulons avoir le droit de nous aimer entre femmes ; nous voulons sortir de nos maisons-prisons ; nous voulons vivre ensemble dans l'amour et la fte recres ; nous voulons tout et le reste, tout de suite et sans limi-
sation sont dvelopps dans un manifeste 218 . Le texte commence par dresser un tat [101] de la situation. Thoriquement gale l'homme, la femme est en fait opprime par l'homme : elle assume la charge exclusive des enfants et un travail domestique , elle est sous-paye dans son travail, elle ne peut choisir librement sa maternit, elle sert d'appt publicitaire ; ds l'enfance, on lui inculque la soumission et l'obissance l'homme . Cette domination des hommes est si ancre dans les habitudes qu'elle semble naturelle beaucoup de femmes, conditionnes par leur ducation et par tout l'environnement social. Donc il faut nous changer nous-mmes . Nous devons nous dbarrasser des notions d'infriorit et de passivit que l'homme nous a inculques. Pour faire face cette situation, la ligue se propose donc de dnoncer sous toutes ses formes la discrimination de sexe , dans le travail salari mais aussi dans la relation sexuelle et dans l'ducation. On nie notre droit la libre disposition de notre corps et l'galit sexuelle. Il faut abolir la morale masculine qui se rserve le droit au plaisir, l'initiative sexuelle et nous cantonne aux rles de vierges, puis de mres ou de putains. On nous mutile psychologiquement ds l'enfance : on prpare la fillette tre non pas elle-mme, mais la seconde de l'homme, on touffe en elle toute initiative et toute crativit. Il faut attaquer le sexisme sa base, dans les manuels scolaires et livres pour enfants, o apparat l'image de la petitefille-gentille-et-jolie-qui-aide-maman-et-qui-obit--papa. Enfin la Ligue cherchera faire appliquer les droits existants des femmes, elle dnoncera les pseudo-droits comme l'allocation de la mre au foyer , elle cherchera promouvoir un droit nouveau des femmes , c'est--dire en fait modifier le droit tout entier pour que la femme accde aux pouvoirs de dcision. Le manifeste se termine en reconnaissant que ce programme ne pourra tre ralis que par un bouleversement total des rapports sociaux et des va216 217 218
Vers une grve des femmes , Le Monde du 22 fvrier 1974. Ibid. Publi dans Le Monde du 8 mars 1974.
Pierre Brchon, La famille. Ides traditionnelles, ides nouvelles. (1976)
123
leurs qui sont la base de notre civilisation patriarcale, marque par l'exploitation .
Les militantes du M.L.F. considrent la famille comme une structure qui transmet l'oppression de la femme, et donc comme un des lieux o doit se vivre la libration. Il faut donc contester la famine ; les militantes le font par leur comportement familial individuel mais aussi par des actions collectives du mouvement. Ainsi, le 28 mai 1972, jour de la fte des mres, les militantes ont dfil sur les Champs Elyses pour contester cette fte, dont elles rappellent qu'elle a t cre par le gouvernement de Vichy. Cette fte est intolrable aux yeux du M.L.F. car c'est une fte de la femme-mre. Notre socit ne reconnat la valeur de la femme que si elle est mre. Or prcisment, selon le M.L.F., la maternit impose la femme est un des lieux de son alination. Pour attirer l'attention, les militantes s'taient habilles de jupes plisses et de chaussettes blanches, elles portaient des nuds dans les cheveux et des sucettes la main ; tous ces dtails vestimentaires taient destins montrer que la femme est considre comme une mineure dans notre socit et que la mre est infantilise par sa situation dans la famille. Les militantes ont rclam cor et cri pour la plus ge de leurs adhrentes le prix Cognacq-Jay, [102] dont on sait qu'il rcompense habituellement des mres de familles nombreuses 219 . Si pour obtenir leurs droits, les femmes doivent s'opposer l'homme dominateur, la famille, fonde sur le rapport homme-femme, sur la diffrenciation sexuelle, ne peut trouver grce aux yeux des militantes du M.L.F. L'homme, dans la famille comme dans la socit, apparat comme dominateur, la structure familiale tant une institution au service de l'homme, lui permettant d'aliner la femme. Les
219
rception au palais de l'lyse le 27 mai 1972, l'occasion de la fte des mres, d'une dlgation de treize mres de familles nombreuses auxquelles le prsident de la Rpublique, G. Pompidou, a remis la mdaille d'or de la famille franaise. Il s'est cette occasion dclar oppos au malthusianisme, a rappel l'importance de la cellule sociale qu'est la famille cadre d'ducation des enfants et facteur de stabilit morale . travers ces deux manifestations, on est en prsence de deux idologies radicalement opposes.
Le Monde du 30 mai 1972 rapporte en parallle la manifestation du M.L.F. et la
Pierre Brchon, La famille. Ides traditionnelles, ides nouvelles. (1976)
124
thses du M.L.F. sont peu compatibles avec le marxisme 220 ; le rapport homme-femme, valoris par Marx, n'a plus d'importance. La femme se dfinit par elle-mme, de faon autonome. Toute dfinition par rapport l'homme serait automatiquement une alination. Les rapports du M.L.F. avec le P.C.F. sont trs mauvais. Les militantes du M.L.F. reprochent au P.C.F. de vouloir dfendre la famille, sans jamais souligner quel est son rle idologique, sans jamais dire que la femme est exploite dans le couple. Le P.C.F. dfend le niveau de vie des familles, comme si cela pouvait suffire transformer les rapports sociaux. Il annonce ce bonheur familial dans le socialisme comme si la rvolution des superstructures devait suivre instantanment la rvolution de l'infrastructure. Le M.L.F. reproche beaucoup au P.C.F. une phrase de son programme de gouvernement Changer de cap : La famille s'insrera harmonieusement dans la socit. Certaines militantes accusent le P.C.F. de reprendre ainsi sous d'autres termes l'idologie de Vichy : Travail, famille, patrie . Le M.L.F. reproche au P.C.F. de ne pas parler de libert sexuelle, ni de partage des tches domestiques avec les hommes au sein du couple, ni de remise en cause de leur mentalit par les hommes. Pour le M.L.F., le parti communiste ne considre la femme que dans son rle de mre, tout comme la tradition bourgeoise patriarcale. Donc, pour le M.L.F., le P.C.F. ne libre pas la femme. La femme reste sa place, mais on la lui fera plus confortable 221 , grce des amnagements matriels (quipements collectifs... aides...). [103] On peut se demander si cette position radicale, en prtendant fonder une nouvelle identit fminine, en prtendant permettre la femme de vivre son autonomie, n'aboutit pas une position individualiste, un individualisme des sexes. La femme suit ses propres volonts et refuse les institutions de la socit phallocratique. Il n'y a plus alors de rapports lgitimes entre un homme et une femme dans la mesure o l'homme est toujours l'oppresseur qui vole la femme son identit. L'idologie du M.L.F. utilise la pense de Marx, d'Engels et des socia220 221
Incompatibles aussi avec les thses de Freud pour qui l'infriorit fminine est quasi naturelle, la femme manquant de pnis, organe de la puissance. Evelyne LE GARREC, Luttes de femmes, luttes de classes , Dossier Politique Hebdo du 11 mai 1972.
Pierre Brchon, La famille. Ides traditionnelles, ides nouvelles. (1976)
125
listes, dans la mesure o ils ont soulign que la femme tait opprime, que le proltaire trouvait toujours quelqu'un opprimer, sa femme. Mais sa contestation est beaucoup plus radicale, sa pense est souvent plus proche des penseurs gauchistes , dont nous parlerons dans la troisime partie, que des socialistes 222 . Si nous avons insr ici cette section sur le M.L.F., c'est parce que celui-ci se rfre nanmoins aux socialistes et qu'il critique le parti communiste franais, dont nous avons parl prcdemment.
La famille en Chine populaire
Retour la table des matires
Aprs avoir analys comment le P.C.F. et le M.L.F. considraient la famille, il m'a paru intressant de regarder comment se prsentait la situation des familles dans un pays socialiste qui prtend appliquer la thorie marxiste. Plutt que d'voquer lUnion sovitique, dont j'ai dj un peu parl et sur laquelle j'aurai l'occasion de revenir puisque W. Reich a beaucoup rflchi sur l'chec de la rvolution sexuelle en Union sovitique aprs 1917, j'ai choisi d'tudier la situation de la famine chinoise 223 . Il est intressant de considrer quelles ont t les transformations de cette famille chinoise et des rapports entre les sexes depuis que le socialisme a triomph. [104] Quelle tait donc la situation familiale en Chine avant la Rvolution de 1949 ? Jusque-l les ides occidentales avaient trs peu pntr.
222 223
Comme Reich, elles proposent finalement le retour une socit matriarcale, o la sexualit serait libre. Voir sur ce sujet : Claudie BROYELLE, La moiti du ciel : le mouvement de libration des femmes aujourd'hui en Chine, Denol-Gonthier, 1973. La Chine pour nous, collectif publi sous la direction de Philippe LAURENT, Centurion Resma, 1974. Ariette LADUGUIE, Une famille et trois gnrations , dans Le Monde diplomatique, novembre 1973, p. 32. Jean HOUDART, Les femmes sont la moiti du ciel , Le Monde du 3 octobre 1974. Los Wheeler SNOW, La vie des femmes en Chine populaire , deux articles du Monde, les 31 juillet 1971 et 1er aot 1971.
Pierre Brchon, La famille. Ides traditionnelles, ides nouvelles. (1976)
126
Tout au plus, des contacts avec ces ides affectaient les ports de la cte et un peu les villes le long des grands fleuves. Dans les campagnes chinoises, les coutumes de l'ancienne Chine sont maintenues. La famille a une trs grande importance dans l'organisation sociale. Elle est sacralise. On rend un culte aux anctres de la famille. On invoque et on connat ses anctres jusqu' la cinquime gnration. chaque vnement familial important, l'an des hommes dirige une runion devant l'autel familial, ce qui est une faon d'associer les morts aux vnements. Ainsi on a le sentiment de la continuit familiale. Au-del d'une famille, on est membre d'un clan. Dans ce systme, l'individu se dvoue pour sa famille et non pas pour la collectivit, le parti ou l'tat. Il y avait l un obstacle l'action rvolutionnaire que l'tat ne pouvait tolrer. D'autant que l'autorit du chef de famille est presque totale. La morale est trs stricte. Ds l'ge de sept-huit ans, l'ducation des garons et des filles est entirement spare. La solidarit familiale est trs grande, les devoirs l'gard des membres de la famille tant prioritaires par rapport au service de l'tat. Souvent plusieurs gnrations cohabitent sous le mme toit, bien que dans les classes pauvres la cellule familiale se limite parfois aux parents et aux enfants. Dans cette famille de l'ancienne Chine, la femme est bien des gards en situation d'infriorit 224 . Elle est marie par sa famille. Mais son futur poux, qu'elle ne connat pas, n'est pas davantage consult. Le mariage est l'affaire des deux familles, il est souvent arrang par un entremetteur professionnel. L'amour n'est pas la cause des mariages. Les poux se rencontrent souvent pour la premire fois le jour du mariage. La femme chinoise doit obissance sa nouvelle famille et en particulier sa belle-mre. Elle est traite trs durement tant qu'elle n'a pas de garon. Ensuite elle prend beaucoup plus d'importance, car elle a assur un descendant son mari. C'est trs important puisque ainsi le culte des anctres pourra se poursuivre. D'ailleurs pour tre sr que le culte des anctres puisse se continuer, les familles marient leurs enfants trs jeunes. La famille a un rle conomique. Elle permet l'homme d'avoir des fils qui l'entretiendront dans l'avenir. La femme est servante et mre . Elle doit accepter la polygamie de son mari,
224
Mao Ts-toung crivait en 1927 : Le Chinois est traditionnellement soumis trois systmes d'autorit (la politique, le clan et la religion...) mais la femme, de surcrot doit subir l'autorit maritale.
Pierre Brchon, La famille. Ides traditionnelles, ides nouvelles. (1976)
127
surtout si elle n'a pas pu lui donner de garons. Si elle perd son mari, il lui est trs difficile de se remarier. On ne divorce pas comme on veut. Mais le renvoi de l'pouse est relativement facile. Une des raisons [105] admise est l'excs de bavardage ! En fait cette famille chinoise comme tous les cadres sociaux anciens en Chine ne reposait pas sur une loi juridique crite mais sur la morale confucenne. De mme, aujourd'hui le rgime repose plus sur la morale rvolutionnaire, incarne par la pense du prsident Mao que sur une loi. Nanmoins, peu aprs l'avnement du nouveau rgime, une loi sur le mariage est promulgue en avril 1950. Il ne s'agissait pas de dtruire la famille chinoise mais de lui ter sa trop grande puissance, qui favorisait le conservatisme social. Cette loi de 1950 interdit l'arrangement du mariage par les familles. Lgalement la fille ne pourra se marier avant dix-huit ans le garon avant vingt ans. Mais on incite les jeunes retarder davantage leur mariage. On invite le garon ne pas se marier avant vingt-huit ans et la fille avant vingt-cinq ans. Il s'agit surtout d'manciper les futurs poux par rapport leur famille. Plus ils sont gs, plus ils peuvent faire pression pour se marier librement. Le mariage sera enregistr civilement, ce n'est plus seulement une affaire entre deux familles, l'tat s'y intresse. La rpudiation de l'pouse, la bigamie et le concubinage sont interdits, de mme que l'infanticide. Il arrivait en effet que l'on noie les nouveau-ns, notamment les filles. La vente des filles au plus offrant est galement interdite. Le divorce de la femme est facilit. Cela permettra, dans les annes qui suivirent, de rgler des cas douloureux. On donne d'ailleurs souvent raison la femme dans les divorces car elle a t la victime de l'ancien rgime. Donc cette loi de 1950 permet l'mancipation familiale de la femme. Dsormais le couple peut se fonder par amour et peut vivre sur une base d'galit. Mais, en fait, le parti aura beaucoup de mal pour faire appliquer cette loi. Il faudra plusieurs campagnes de masse pour y arriver. Cette loi allait contre les privilges des pres. Certains cadres du parti taient touchs, notamment ceux qui avaient plusieurs pouses. Par cette loi, l'galit de la femme, ide tout fait nouvelle pour les Chinois, peut progresser, les rapports entre les individus deviennent libres ; ils ne sont plus dtermins par la famille, ils sont fonds sur l'amour. Grce cette loi, applique progressivement, la famille chinoise va perdre une partie de l'importance qu'elle avait dans
Pierre Brchon, La famille. Ides traditionnelles, ides nouvelles. (1976)
128
l'ancien systme. La solidarit avec la famille tendue n'tant plus l'impratif numro un, la collectivisation sera dsormais possible, le socialisme pourra se dvelopper. Mais une forme de famille assez originale va subsister et s'panouir. Progressivement le niveau de vie des familles s'lve. Les personnes qui reviennent actuellement de Chine soulignent que les familles vivent modestement mais ne manquent pas du ncessaire. Souvent mme elles conomisent et placent la banque un peu d'pargne. Evidemment on n'en est pas la civilisation de l'automobile ; les logements sont encore trs souvent [106] troits et la douche n'est pas gnralise. Mais les loyers et l'ensemble de l'alimentation sont des prix trs bas et stables alors que les salaires augmentent lentement. Les familles bnficient de tout un environnement, mme dans les campagnes : crches pour les enfants, coles, soins mdicaux souvent gratuits, ateliers de couture, de blanchissage, cantines... La femme enceinte suit de nombreux contrles mdicaux (beaucoup plus qu'en France o nous sommes trs en retard sur ce point), partir du septime mois de grossesse elle ne travaille plus que sept heures par jour. Elle a droit deux mois de cong-maternit (14 semaines en France). Les crches et services sociaux tant trs nombreux, la reprise de son travail ne posera pas de questions. D'ailleurs les mres sont autorises quitter leur travail pour aller allaiter leur enfant la crche de l'usine. Ces absences ne sont pas dcomptes de leur salaire.
Comment la Chine a-t-elle rsolu le problme de la double journe de la femme ? Convaincu que la femme devait travailler pour tre indpendante conomiquement et participer la vie sociale, le nouveau rgime devait rsoudre le problme de l'esclavage domestique de la femme. ce problme, le P.C.F. rpondait : dveloppons les appareils mnagers et collectivisons les tches mnagres. C'est bien la voie que l'Union sovitique a choisie : les plans quinquennaux cherchent faire passer dans la ralit la fin de l'esclavage domestique. L'tat prend progressivement en charge certaines tches mnagres. La voie chinoise est un peu diffrente. D'une part, les tches mnagres ne sont pas prises en charge par l'tat mais de plus en plus par la collectivit. Ce n'est pas seulement une querelle de mots. Cela veut dire qu'en Chine, les femmes ont souvent pris l'initiative, dans un quartier, dans une usine, de se regrouper pour organiser ensemble une crche, une laverie, un atelier de raccommodage, un restaurant, etc... On s'organise avec les moyens du bord, souvent sans moyens techniques importants. D'autre part, on s'efforce
Pierre Brchon, La famille. Ides traditionnelles, ides nouvelles. (1976)
129
de lutter contre l'antique division du travail, aussi bien entre travail manuel et travail intellectuel qu'entre travail de l'homme et travail de la femme. Dans les immeubles, le nettoyage est pris en charge par l'ensemble des habitants. L'homme qui refuse de prendre sa part se fait sermonner par sa femme et par ses voisins. Donc tous participent, la mesure de leurs moyens, au travail domestique. La situation n'est pas parfaite. La rpartition des tches mnagres entre l'homme et la femme n'est probablement pas encore entirement galitaire, mais un effort est fait dans ce sens. Les enfants sont duqus dans la mme optique. Ds la crche, l'ducation est entirement mixte, on fait faire les mmes travaux au garon et la fille. On s'efforce de montrer aux garons que le travail domestique n'est pas un monopole fminin. De plus les jeunes font trs tt des stages en usine. Ils s'intgrent donc tt au monde des adultes. On ne retrouve pas comme chez nous un phnomne jeune . De mme les vieillards ne sont pas exclus de la vie sociale. Ils vivent chez leurs enfants, touchent une retraite gnralement gale 70 % de leur salaire. Ils se rendent utiles. Ils dchargent les travailleurs en s'occupant de bricolage, de nettoyage du quartier, de la garde des petits-enfants, dans leur famille ou mme souvent la crche. Les grandsparents assurent la premire socialisation politique de [107] leurs petitsenfants en leur racontant les conditions de vie de l'ancienne socit. La coupure entre les gnrations tend ainsi disparatre en Chine, il n'y a pas sgrgation selon l'ge.
La famille existe donc toujours, avec une forme assez classique, une morale plutt stricte mais qui ne fait pas problme puisqu'elle est intriorise par les individus ; mais la famille n'est pas une cellule close ; elle est ouverte sur l'usine et le quartier ; elle est insre dans une collectivit humaine locale avec laquelle les changes sont nombreux. L'ide que tous doivent participer, dans la mesure de leurs moyens, la vie de la communaut, a fait son chemin. La solidarit familiale de nagure, fonde sur un systme hirarchique, a t remplace par la solidarit collective, fonde sur la morale rvolutionnaire. On se marie tard, aux environs de la trentaine. La taille des familles tend se rduire. La natalit tait trs forte aprs la rvolution, et le nouveau gouvernement encourageait la natalit. Ce n'est que vers les annes 1960 que le gouvernement chinois a mis en place une politique de limitation des naissances. On explique qu'il faut contrler les naissances pour difier un tat socialiste ; les contraceptifs sont distribus largement et gratuitement. En cas de grossesse indsire, l'avortement est gratuit, mais il n'est vraiment libre qu' partir de la
Pierre Brchon, La famille. Ides traditionnelles, ides nouvelles. (1976)
130
troisime grossesse et il est assez peu pratiqu, tant donn la gnralisation de la contraception et la pratique assez frquente de la strilisation masculine et fminine. Mais l'idologie rvolutionnaire n'est pas passe d'une politique nataliste un refus systmatique de l'enfant. Le conseil donn est le suivant : Un enfant, c'est peu, deux, c'est bien, trois, c'est trop. Le divorce par consentement mutuel est admis, mais il est en fait assez rare. Car les mentalits poussent rester unis. Admis dans la loi, le divorce est rprouv par la morale. Une vritable conciliation est mene par le juge lorsque l'un des poux demande le divorce. Le juge fait souvent un sermon pour pousser les poux rester unis, et il n'admet pas toujours immdiatement le divorce. Les relations sexuelles avant le mariage seraient rares ; elles choquent l'opinion. Les jeunes semblent tout fait d'accord pour pratiquer l'abstinence presque jusqu' la trentaine et consacrent leur jeunesse dvelopper leur formation politique, travailler pour le bien de leur pays. De mme la prostitution est pratiquement inconnue en Chine l'heure actuelle. La sexualit est un sujet quasiment tabou. On se mobilise pour le travail et le dvouement la communaut ; ce qui suppose l'mancipation de la femme, car tous y participent. Mais le plaisir familial, le plaisir sexuel, l'amour passent au second plan. La chastet, la rserve et la pudeur, qui font partie de la culture chinoise, rejoignent en fait les impratifs de la Rvolution. [108] Donc en Chine, la libration de la femme n'a rien voir avec ce que prne en France le M.L.F. La libration sexuelle et la destruction de la famille n'apparaissent pas comme des pralables la libration fminine. En Chine, la libration de la femme passe d'abord par son indpendance conomique, sa participation part entire l'dification de la socit socialiste. La femme apparat comme mancipe et presque gale son mari alors que la morale reste assez traditionnelle. Le socialisme a incontestablement cass l'ancienne structure familiale chinoise. Il n'a pas tu la famille qui semble se porter assez bien, mais qui n'est que l'un des centres d'intrts des hommes et des femmes. L'galit entre l'homme et la femme a beaucoup progress, de par les rformes lgislatives mais aussi de par une action incessante - que l'on
Pierre Brchon, La famille. Ides traditionnelles, ides nouvelles. (1976)
131
ne retrouve pas en Union Sovitique - pour briser la division du travail, la rpartition des tches selon le sexe. La thorie marxiste de la famille ne s'applique donc pas dans un parti politique ou dans un pays socialiste comme quelque chose de mathmatique et d'automatique. Cette thorie est une base qui doit tre harmonise avec la culture du pays ainsi qu'avec les ncessits politiques un moment donn. En s'inspirant de la mme thorie socialiste, la Chine, l'URSS et la Yougoslavie - trois pays dont nous parlons dans ce livre - vivent des formes d'institution familiale qui ne sont pas identiques.
Pierre Brchon, La famille. Ides traditionnelles, ides nouvelles. (1976)
132
[109]
LA FAMILLE. Ides traditionnelles, ides nouvelles.
Troisime partie
Anarchisme et famille
Retour la table des matires
Pierre Brchon, La famille. Ides traditionnelles, ides nouvelles. (1976)
133
[110]
LA FAMILLE. Ides traditionnelles, ides nouvelles.
Troisime partie. Anarchisme et famille
Chapitre 6
Les thoriciens du XIXe sicle
Retour la table des matires
la pense traditionaliste qui faisait de la famille le fondement de la socit, les marxistes rpondaient : vous faites erreur, la famille est un reflet de la socit, reflet qui, pour certains, peut avoir son tour une certaine efficacit. L'anarchisme va galement se situer par rapport au traditionalisme. Il ragit contre une conception de la socit, structure hirarchique, cadre rigide, et contre une conception de la famille, structure touffante , lieu de la domination de l'homme sur sa femme et ses enfants. L'anarchisme oppose au traditionalisme une conception non hirarchique des rapports humains. Il prtend que les hommes peuvent vivre naturellement en harmonie, s'ils ne sont pas contraints par une socit oppressive. L'anarchisme est en effet une conception globale de la socit. Il a eu de nombreux thoriciens dont les thses ne sont pas toujours concordantes. Il n'y a pas de dogme ou de catchisme anarchiste, il n'est pas un penseur qui fasse l'unanimit, qui apparaisse comme le pre incontest de la doctrine. Le contenu luimme de l'anarchisme ne saurait tolrer aucun dogmatisme, aucune soumission un penseur, chef d'cole.
Pierre Brchon, La famille. Ides traditionnelles, ides nouvelles. (1976)
134
Qu'est-ce que l'anarchisme ? Le mot voque souvent pour nos contemporains individualisme, ngation totale (nihilisme), dsordre gnralis. Pourtant, si certains courants anarchistes, en particulier le nihilisme russe 225 , [111] ont parfois vhicul ce genre de doctrine, on ne peut identifier l'anarchisme avec aucun de ces trois termes. L'anarchisme est, avant tout, un anti-autoritarisme, un refus du pouvoir tatique : le mal (...), aux yeux des anarchistes, ne rside pas dans telle forme de gouvernement plutt que dans telle autre. Il est dans l'ide gouvernementale elle-mme, il est dans le principe d'autorit 226 . Ce refus de l'tat se fonde sur une conception de l'homme : pour les anarchistes, l'homme doit tre libre et autonome. Il ne peut abdiquer sa libert, il ne peut remettre son pouvoir de dcision sur sa vie un tat autoritaire, un pouvoir central. Si l'homme est libre et autonome, il n'est pas pour autant sans relations. L'anarchisme n'est pas un individualisme troit. Jean Lacroix crit propos des anarchistes : Voulant la libration radicale de l'homme, ils le conoivent comme un tre essentiellement sociable. Leur but est de dtruire la contrainte sociale pour donner libre cours la sociabilit naturelle 227 . Mais alors, sans contrainte des individus, une socit est-elle possible ? Comment vont tre rguls les rapports entre les hommes ? L'anarchisme se propose de reconstruire la vie en commun sur la base de la volont individuelle autonome 228 . Pour les anarchistes,
225
226
Voir le Catchisme de Netchaiev. Le rvolutionnaire y apparat comme ayant un seul but qui le mobilise entirement : la destruction de la socit par tous les moyens, y compris le terrorisme. Dans cette optique, la famille devient sans importance. Le rvolutionnaire est un tre dur et froid : Tous les sentiments d'affection, les sentiments ramollissants de parent, d'amiti, d'amour, de reconnaissance doivent tre touffs en lui par la passion unique et froide de l'uvre rvolutionnaire. E. MOUNIER, Anarchie et personnalisme dans Oeuvres de Mounier, volume 1, Seuil 1961, p. 659. Dclaration des anarchistes accuss devant le tribunal correctionnel de Lyon, lue par Kropotkine le 19 janvier 1883. Texte rapport par Daniel GURIN, Ni Dieu ni Matre : anthologie de l'anarchisme, tome 2, Maspero 1970, p. 127. Jean LACROIX, Force et faiblesses de la famille, op. cit., p. 176. Henri ARVON, Article Anarchisme dans Encyclopedia Universalis, vol. 1, p. 988.
227 228
Pierre Brchon, La famille. Ides traditionnelles, ides nouvelles. (1976)
135
l'ordre social doit reposer sur un contrat librement conclu entre les individus : La substitution, (...) dans les rapports humains, du libre contrat, perptuellement rvisable et rsoluble, la tutelle administrative et lgale, la discipline impose, tel est notre idal 229 . Le contrat anarchiste n'est pas de mme nature que le contrat social de Rousseau, car le contrat est pass entre personnes libres et qui le demeurent ; le contrat est toujours provisoire et rvocable. Il y a toujours, chez les anarchistes, refus de toute ide d'indissolubilit, d'irrvocabilit d'un contrat, alors qu'il n'en est pas ainsi chez Rousseau. Proudhon, un des thoriciens anarchistes les plus connus, a critiqu vivement l'ide de contrat social chez Rousseau. Le contrat social de Rousseau renforce, selon lui, l'tatisme car il donne l'tat une lgitimit populaire. Rousseau exige en fait de chaque citoyen l'alination de sa libert la communaut tatique. D'ailleurs, pour les anarchistes, l'idal n'est pas un seul contrat qui runirait les individus sous la bannire [112] d'un tat, il faut une multiplicit de contrats imbriqus. Il y a des contrats d'ordre professionnel, d'autres qui relvent de l'organisation d'une commune, ou d'une rgion, enfin d'un tat. L'idal serait, selon Proudhon, une sorte d'quilibre entre ces contrats toujours provisoires ; il en rsulte une unit sociale librement consentie, sans qu'aucun individu n'abdique le principe de l'autonomie de la volont individuelle. Ainsi Proudhon (1809-1865) rejette l'ide de dmocratie centralise, issue de la Rvolution franaise, car le centralisme y est trop fort. Il n'y a plus de communauts et de groupes intermdiaires entre l'individu et l'tat 230 . L'idal politique des anarchistes n'est pas la dmocratie mais le fdralisme runissant des collectivits restreintes toujours sur la base de contrats rvocables. tant donn ces principes gnraux, le mariage tel qu'il tait conu au XIXe sicle ne pouvait videmment pas tre admis par les anarchistes. Ils ne pouvaient accepter l'ide chrtienne, reprise par le Code Civil, d'un mariage, contrat indissoluble et irrvocable, dans la mesure
229 230
Dclaration des anarchistes de Lyon, 1883, dans D. GURIN, op. cit., t. 2, p. 128. Proudhon a t sur ce point repris et utilis par Maurras. Ce contrervolutionnaire reprochait aussi la Rvolution Franaise d'avoir ananti les corps intermdiaires et notamment les corporations d'Ancien Rgime.
Pierre Brchon, La famille. Ides traditionnelles, ides nouvelles. (1976)
136
o il avait t librement contract par deux individus. Pour un anarchiste, l'homme ne peut jamais abdiquer sa libert et ne saurait donc conclure un contrat dfinitif, qu'il soit d'ordre politique ou conjugal. L'idal conjugal des anarchistes sera donc gnralement l'union libre. De la mme faon, les anarchistes ne pouvaient admettre la conception traditionaliste de la famille, conue comme une institution naturellement hirarchise, o le pre impose sa discipline sa femme et ses enfants. Les anarchistes ont toujours critiqu cette conception de la famille, qu'ils voyaient l'uvre dans la bourgeoisie ; pour eux, le pre ne saurait se dfinir par son autorit puisque l'autorit est toujours anti-humaine : Ce que veut l'anarchisme, c'est une humanit fraternelle sans pre, c'est l'galit o tous seront frres : la fin de l'autorit paternelle, c'est la mort de toute autorit 231 . L'humanit ne sera alors plus faite du respect des pres, mais de l'amour entre les frres. La famille ne sera plus une institution contraignante, elle sera forme par les liens d'amour qu'prouvent les uns pour les autres le pre, la mre et les enfants. Cet amour familial ne peut se vivre dans une structure touffante comme l'est la famille bourgeoise, rglemente par la socit. Aux traditionalistes qui faisaient de la famille une institution sans amour , les anarchistes rpondent en revendiquant l'amour sans institution . Dans les deux systmes, on retrouve un mme postulat sous-jacent : l'amour et l'institution [113] familiale sont exclusifs l'un de l'autre. Ils ne peuvent tre vcus conjointement. Pour les anarchistes, comme pour les traditionalistes, l'amour c'est la passion qui est incompatible avec les cadres juridiques, avec les lois. Pour prserver la structure familiale, les traditionalistes en concluaient que l'amour est nfaste ; les anarchistes au contraire, pour prserver la libert de l'amour, contestent la structure familiale. Nanmoins, la pense anarchiste concernant la famille n'est pas aussi unifie que pourraient le laisser croire les dveloppements prcdents.
231
J. LACROIX, Force et faiblesses de la famille, op. cit., p. 177.
Pierre Brchon, La famille. Ides traditionnelles, ides nouvelles. (1976)
137
GODWIN et PROUDHON
Retour la table des matires
Ainsi, Proudhon est en matire familiale plus proche des traditionalistes que des anarchistes. Il est ennemi du divorce, de la pornographie , de l'rotisme dgotant qui perd la jeunesse et la famille , et fait prendre en horreur le mariage et la gnration . Il n'applique pas la famille les principes qu'il soutient pour l'organisation sociale. Proudhon, bien que socialiste, considre la famille comme une espce d'institution naturelle : Tout attentat la famille est une profanation de la justice, une trahison envers le peuple et la libert, une insulte la Rvolution 232 . Proudhon fait de la famille, comme les traditionalistes, la cellule de base de la socit . La famille a sa causalit propre, c'est grce elle que le socialisme pourra s'difier : L'homme et la femme forment, au moral comme au physique, un tout organique, dont les parties sont complmentaires (...). Cet organisme a pour but de crer la justice () c'est--dire la civilisation et toutes ses merveilles 233 .
232 233
Cit par H. ARVON, L'anarchisme, P.U.F. Coll. Que sais-je ?, n 479, 6e dition 1974, pp. 45-46. PROUDHON - Essai d'une philosophie populaire. De la justice dans la rvolution et dans l'glise, Bruxelles. A. LACROIX, Verboeckhoven, 1869, 10e tude. Amour et Mariage, chap. III. Texte, cit dans A. MICHEL, Sociologie de la famille et du mariage, op. cit., p. 25. Jean Lacroix n'est pas d'accord avec cette interprtation de la pense proudhonienne. Il estime qu'il y a chez Proudhon une rupture entre famille et socit. La socit civile est base sur un contrat alors que la famille est fonde sur l'amour. Proudhon est partisan de l'galit dans la socit, de la hirarchie dans la famille. Famille et socit sont d'essence diffrente : le paternalisme, vrai dans la famille, est faux dans la cit. La famille chez Proudhon ne peut donc pas tre considre comme une cellule sociale de base . Cf. J. LACROIX, Force et faiblesses de la famille, Seuil, 1957, pp. 175-176.
Pierre Brchon, La famille. Ides traditionnelles, ides nouvelles. (1976)
138
[114]
Chez Proudhon, l'ide selon laquelle l'homme et la femme dans le couple sont complmentaires permet de justifier l'infriorit de la femme, sa soumission son mari, sa dpendance conomique : Le rle de la femme n'est point la vie extrieure, la vie de relation et d'agitation, mais bien la vie intrieure : celle du sentiment et de la tranquillit du foyer domestique 234 . Proudhon considre comme naturelle la rpartition des rles selon le sexe. L'homme est fait pour la vie extrieure la famille, pour la socit, la femme est faite pour l'intrieur familial et l'ducation des enfants. Proudhon accepte la structure familiale qu'il connat, celle qu'il a vue vivre en FrancheComt dans sa jeunesse, celle qu'il vit dans sa propre famille. D'aprs ses lettres sa femme, il apparat comme un mari trs autoritaire envers elle, qu'il aimait pourtant passionnment. Il eut une vie familiale heureuse dont on a un tmoignage par le tableau de Gustave Courbet : Proudhon et ses filles.
Mais avant Proudhon, certains penseurs proches de l'anarchisme, avaient condamn le mariage ainsi l'anglais Godwin (1756-1836), clbre par un livre publi en 1793 Une enqute sur la justice politique et sur son influence sur la vertu et le bonheur universel. Il s'oppose tout ce qui opprime l'individu, mais il est aussi ennemi des passions, des instincts humains. L'homme, individu autonome, doit se contrler, doit vivre selon sa raison et non pas selon ses instincts. C'est pourquoi Godwin condamne le mariage, comme tous les liens humains trop forts. Car le mariage risque d'engluer l'individu, de tuer son autonomie ; l'individu risque de s'y perdre, sous l'influence d'autrui. Godwin dira que le mariage est une loi et la pire des lois ; le mariage est une proprit et la pire des proprits . De plus, dans le mariage, les deux conjoints risquent de se laisser aller leurs passions plutt que de suivre chacun sa raison. Donc, l'anarchisme de Godwin n'est pas un anarchisme dbrid, ce n'est pas la libration des dsirs comme chez Fourier. L'individu doit tre autonome, mais doit autocensurer ses passions, grce sa raison.
234
Texte de Proudhon cit dans Annie KRIEGEL, Les communistes franais, Seuil, 1968, p. 265.
Pierre Brchon, La famille. Ides traditionnelles, ides nouvelles. (1976)
139
Chez Godwin, comme dans tout un courant anarchiste 235 , la volont de librer l'individu ne s'accompagne pas d'une morale du tout est permis , mais au contraire d'une morale assez stricte que l'individu s'impose. Croire un tel systme suppose une grande confiance dans la capacit de tout homme s'auto-administrer, s'autorguler, cela suppose de croire la valeur de la personne humaine 236 . [115]
Charles Fourier
Retour la table des matires
Mais il existe un courant anarchiste partisan du tout est permis , il n'y a plus de morale. Le pre semble en tre Charles Fourier (1772-1837) 237 . Jean Lacroix rsume bien le projet de Fourier lorsqu'il crit : Au rgne de la contrainte, constitutif de la civilisation, il
235
L'thique anarchiste dveloppe le sens de la responsabilit individuelle bien plus qu'elle ne prdispose un relchement moral o l'individu, au lieu de s'af-
236
firmer, finit par sombrer et disparatre , estime Henri ARVON dans l'article Anarchisme de l'Encyclopedia Universalis, op. cit.
237
On comprend que les personnalistes se soient assez bien retrouvs dans certaines ides anarchistes. Voir par exemple : Anarchie et personnalisme dans MOUNIER, Oeuvres, tome 1, op. cit., pp. 651-725. On retrouve chez Max STIRNER (1806-1856) une pense proche de celle de Godwin. Dans son livre L'Unique et sa proprit, Stirner dfinit l'homme comme un tre original, unique, rebelle toute intgration politique et sociale. C'est pourquoi, il condamne l'tat qui opprime la volont des individus, la Socit qui nous impose des devoirs, qui exploite notre force de travail, l'Homme, concept divinis par Feuerbach, tre idal que chacun devrait raliser. En fait la Socit et l'Homme n'existent pas, seul existe Moi, tre unique qui doit me faire valoir moimme dans une libre association, dsintresse avec autrui. Henry ARVON, dans l'article qu'il consacre Max Stirner dans l'Encyclopedia Universalis, conclut en disant que Stirner est avant tout un moraliste : Ce qui lui importe, c'est de nous sauver de la sclrose, de l'oppression subie, de la dpersonnalisation accepte, de ce risque de dpossession perptuellement prsent. Vol. 15, p. 389. Qui, comme Proudhon, est n en Franche-Comt.
Pierre Brchon, La famille. Ides traditionnelles, ides nouvelles. (1976)
140
a voulu substituer celui du dsir, caractristique de l'harmonie 238 . Pour Fourier, la civilisation n'est pas un tat dfinitif, mais plutt un tat passager. Avant l'tat de civilisation, on avait eu l'dnisme, la sauvagerie, le patriarcat et la barbarie 239 . La civilisation se caractrise par la multiplicit des changes et par la division du travail. Mais c'est, plus fondamentalement, un tat fond sur la contrainte. Dans la civilisation, les personnes agissent par contrainte, soit parce que les hommes sont dans des rapports de domination, d'oppression les uns par rapport aux autres, soit parce que la morale que l'on enseigne invite chaque individu accomplir un devoir, respecter des interdits. Il n'y a pas actuellement de libert cratrice, on ne peut suivre ses passions, le dsir de l'homme n'est pas pris en compte. Pour Fourier, cet tat est mauvais. Le rgne de la contrainte aboutira la mort des socits. la place de l'tat de civilisation, Fourier propose l'tat d'harmonie, dont le ressort serait le dsir libr des individus. Fourier conoit une socit de production et de consommation o chacun travaillerait en satisfaisant son dsir, au lieu d'tre asservi aux ncessits du systme de la division rigide du travail. Il n'y aurait plus d'antagonisme ville-campagne, ni d'antagonisme entre travail manuel et travail intellectuel. Cet tat d'harmonie peut dj se vivre dans une communaut restreinte, le phalanstre [116] que Fourier se proposait de crer 240 , constitu par 810 personnes de chaque sexe ; chaque personne tant d'un caractre diffrent, les 810 personnes reprsentent en fait l'me humaine totale. Dans le phalanstre, l'homme pourra vivre selon ses passions, qui projettent les individus hors d'eux-mmes, les dcentrent, les panouissent. Ce premier phalanstre serait en fait un microcosme, un monde libr en virtualit. Fourier concevait son largissement progressif jusqu'aux dimensions du monde. Fourier n'est pas partisan de l'galit totale. Il maintient dans le phalanstre une hi-
238 239 240
Jean LACROIX, Actualit de Fourier, le rgne du dsir , dans Le Monde du 2 juin 1972. On remarquera la parent avec les trois tapes historiques d'Engels. Il mourra avant. Mais ses nombreux disciples tenteront plusieurs expriences, gnralement phmres.
Pierre Brchon, La famille. Ides traditionnelles, ides nouvelles. (1976)
141
rarchie des caractres qui ont plus ou moins de force. Mais chacun doit aimer l'autre, celui qui est infrieur ou diffrent. Les ides familiales de Fourier sont trs lies ses conceptions sociales. Pour lui, le mariage dans l'tat de civilisation est un esclavage. L'amour-passion ne peut librement s'exprimer, puisqu'il n'a pas droit de cit, seul est reconnu le mariage, systme de contrainte, d'esclavage d'une femme par son mari : S'il faut, dans l'ordre barbare, abrutir les femmes, leur persuader qu'elles n'ont point d'me pour les disposer se laisser vendre au march et enfermer dans un srail, il faut de mme dans l'ordre civilis hbter les femmes ds leur enfance pour les rendre convenables aux dogmes philosophiques, la servitude du mariage et l'avilissement de tomber sous la puissance d'un poux 241 . Comme Robert Owen, socialiste utopiste anglais, Fourier voit dans le mariage une forme lgalise de prostitution : De mme qu'en grammaire deux ngations valent une affirmation, de mme, en morale conjugale, deux prostitutions valent une vertu 242 . Ces textes montrent le diagnostic port par Fourier sur la situation de la femme au XIXe sicle. Tout comme Marx et Engels, qui d'ailleurs le citent, il voit dans la situation de la femme un rvlateur de l'tat de la socit : Le changement d'une poque historique se laisse toujours dterminer en fonction du progrs des femmes vers la libert parce que c'est ici, dans le rapport de la femme avec l'homme, du faible avec le fort, qu'apparat de la faon la plus vidente la victoire de la nature humaine sur la brutalit. Le degr de l'mancipation fminine est la mesure du degr de l'mancipation gnrale 243 . tant donn que la civilisation est le rgne de la contrainte, la femme ne peut qu'y vivre en opprime. Au contraire, dans l'tat d'harmonie, la femme sera libre, elle sera gale l'homme. Les passions tant elles [117] aussi libres, hommes et femmes pourront
241 242
Cit dans le journal Le Monde, dossier l'utopie retrouve du 2 juin 1972. Cit par MARX et ENGELS, La Sainte Famille, Ed. Sociales. 1969, p. 231. Ce mme texte de Fourier est galement cit par ENGELS dans L'origine de la famille, de la proprit prive et de l'tat. [Livre disponible dans Les Classiques des sciences sociales. JMT.] Cit dans MARX et ENGELS, La Sainte Famille, op. cit., p. 231. [Livre disponible dans Les Classiques des sciences sociales. JMT.]
243
Pierre Brchon, La famille. Ides traditionnelles, ides nouvelles. (1976)
142
jouir librement l'un de l'autre, sans aucun interdit. Plus de mariage, plus de cadres qui entravent la libre expression de la sexualit 244 . Dans le nouveau monde amoureux, il n'y aura plus de famille monogamique car c'est une des institutions fondamentales sur laquelle s'appuie la civilisation, rgne de la contrainte. L'rotisme, ainsi que des rapports libres et galitaires entre les sexes se dvelopperont. Il n'y aura plus de rgles, on pourra changer de partenaire, l'homosexualit pourra se pratiquer ainsi que l'inceste. Cette rhabilitation du dsir et des passions par Fourier est encore trs actuelle aujourd'hui. Aux partisans de Freud qui voient dans la rpression des instincts une ncessit permettant la civilisation de se dvelopper, qui considrent les ralits sociales comme de l'nergie sexuelle sublime, Deleuze et Guattari, psychanalystes qui ont publi en 1972 Lanti-Oedipe, ouvrage 245 renversant plus d'une thorie tablie, rpondent que le dsir est le moteur de l'action humaine. L'homme est une machine dsirante . Le dsir n'est pas dans la conscience, dans la pense, il est une ralit, il fait partie de l'infrastructure au mme titre que la production matrielle. L'homme produit non seulement des biens mais aussi des dsirs. Et ces deux productions sont, selon Deleuze et Guattari, aussi dterminantes l'une que l'autre pour le devenir social.
EMILE HENRY
Retour la table des matires
Les ides de Fourier ont eu des postrits varies. Ainsi un anarchiste terroriste de la fin du XIXe sicle, Emile Henry, reprend un certain nombre des thses de Fourier. Emile Henry, n en 1972, fit sauter une forte charge d'explosifs dans un caf parisien en fvrier 1894. Arrt et mis en prison, il y crivit une lettre adresse au directeur pour lui rsumer les thses anarchistes. Pour lui, la socit
244 245
Vers la fin du XIXe sicle, E. Armand, anarchiste individualiste, rclamait aussi la libert sexuelle et la pluralit amoureuse . ditions de Minuit, 470 p., trs difficiles lire.
Pierre Brchon, La famille. Ides traditionnelles, ides nouvelles. (1976)
143
bourgeoise repose sur deux principes fondamentaux, l'autorit et la proprit. Ces deux principes sont tout spcialement l'uvre dans trois institutions : la famille, la patrie et la religion. Une socit anarchiste devra donc supprimer les principes de la socit actuelle et les institutions qui les entretiennent 246 . Elle les remplacera par [118] une organisation spontane et naturelle ; la libert des individus crera spontanment un ordre humain. L'idal anarchiste, selon Emile Henry, c'est : Au lieu de l'organisation autoritaire actuelle, groupement des individus par sympathies et affinits, sans lois et sans chefs. Plus de proprit individuelle ; mise en commun des produits ; travail de chacun selon ses besoins, consommation de chacun selon ses besoins, c'est--dire, son gr. Plus de famille, goste et bourgeoise, faisant de l'homme la proprit de la femme, et de la femme la proprit de l'homme, exigeant de deux tres qui se sont aims un moment d'tre lis l'un l'autre jusqu' la fin de leurs jours. La nature est capricieuse, elle demande toujours de nouvelles sensations. Elle veut l'amour libre. C'est pourquoi nous voulons l'union libre. Plus de patries, plus de haines entre frres (...). Remplacement de l'attachement troit et mesquin du chauvin sa patrie, par l'amour large et fcond de l'humanit tout entire (). Plus de religions, forges par des prtres pour abtardir les masses Au contraire dveloppement continu des sciences (...). En un mot, plus d'entrave aucune au libre dveloppement de la nature humaine. Libre closion de toutes les facults physiques, crbrales et mentales 247 . Emile Henry est bien conscient qu'une socit construite sur les principes anarchistes n'arrivera pas immdiatement l'harmonie parfaite . Mais, en deux ou trois gnrations, l'homme peut tre arrach l'influence de la civilisation artificielle d'aujourd'hui et
246
247
De la mme faon, l'anarchiste Gustave LEFRANAIS (1826-1901) rclamait l'tablissement de la proprit collective, la suppression de l'hritage qui reproduit les privilges et l'tablissement de l'union libre. Cf. Souvenirs d'un rvolutionnaire, de Gustave LEFRANAIS, 1973, la Tte des feuilles, 491 p. Emile HENRY, Lettre au directeur de la Conciergerie, dans D. GURIN, op. cit., tome 3, pp. 64-65.
Pierre Brchon, La famille. Ides traditionnelles, ides nouvelles. (1976)
144
revenir l'tat de nature, qui est l'tat de bont et d'amour 248 . Chez Emile Henry comme chez Fourier, la libration des forces naturelles suppose la contestation des institutions en place, des structures sociales oppressives parmi lesquelles la famille joue un rle trs important. N'oublions pas que les anarchistes jugent de l'importance de la famille comme structure familiale partir de la ralit sociale du XIXe sicle o, effectivement, dans la bourgeoisie, la famille, cellule sociale de base, est une ralit trs omni-prsente et trs contraignante.
JAMES GUILLAUME
Retour la table des matires
Mais les thses anarchistes l'gard de la famille ne sont pas toujours aussi radicales. Je voudrais prsenter ici la pense d'un anarchiste suisse, [119] James Guillaume, disciple de Bakounine et exclu comme lui de la premire internationale au Congrs de La Haye en 1872. Essayant de caractriser ce que doit tre une rvolution anarchiste, il souligne qu' il ne s'agit pas d'amliorer certaines institutions du pass pour les adapter une socit nouvelle, mais de les supprimer. Ainsi, suppression radicale du gouvernement, de l'arme, des tribunaux, de l'glise, de l'cole, de la banque et de tout ce qui s'y rattache 249 . La famille n'apparat pas dans cette numration des institutions supprimer, ce qui montre que James Guillaume y attache moins d'importance dans la structuration sociale qu'un Fourier ou un Emile Henry. Cependant, selon lui, l'entretien et l'ducation de l'enfant ne sont pas d'abord une fonction familiale comme on le croit spontanment aujourd'hui. On a l'habitude de considrer l'enfant comme la proprit de ses parents , alors qu'en fait l'enfant n'est la proprit de per-
248
249
Selon Emile Henry, pour faire triompher cet idal, il faut commencer par dtruire l'ancienne socit. Le moyen qu'il emploie c'est l'attentat, c'est le terrorisme.
Ides sur l'organisation sociale dans D. GURIN, op. cit., tome 2, p. 70.
Pierre Brchon, La famille. Ides traditionnelles, ides nouvelles. (1976)
145
sonne, il s'appartient lui-mme . Si l'enfant n'appartient pas ses parents, son entretien et son ducation sont une responsabilit qui incombe la socit et plus prcisment la commune, dfinie comme l'ensemble des travailleurs habitant une mme localit . Donc chaque commune aura dterminer l'organisation qu'elle jugera la meilleure pour l'entretien de ses enfants : ici on prfrera la vie en commun, l on laissera les enfants leur mre au moins jusqu' un certain ge, etc... 250 .
James Guillaume se dfend de vouloir ainsi dtruire la famille Il y a des gens qui prtendent qu'une mesure d'organisation sociale qui met l'entretien de l'enfant la charge de la socit, n'est autre chose que la destruction de la famille . C'est l une expression vide de sens ; tant que le concours de deux individus de sexe diffrent sera ncessaire pour la procration d'un nouveau-n, tant qu'il y aura des pres et des mres, le lien naturel de parent entre l'enfant et ceux qui il doit la vie ne pourra pas tre effac des
ami plus g un ami plus jeune 252 . Une socit libre et galitaire, btie sur les principes anarchistes, ne dtruira pas la famille mais, elle apprendra au contraire au pre, la mre, l'enfant s'aimer, s'estimer, respecter leurs droits mutuels 253 , ce qui n'est pas actuellement le cas dans les familles, vu la tyrannie exerce par le pre sur ses enfants . [120]
relations sociales 251 . Donc Guillaume ne dtruit pas la famille, elle continue bien d'exister mais sa fonction est limite la procration qui est source de liens affectifs entre le pre, la mre et l'enfant. Les rapports entre les parents et les enfants ne seront plus des liens autoritaires mais des relations de simple affection . Les relations du pre au fils seront, non plus celles d'un matre un esclave, mais celles d'un instituteur un lve, d'un
Dans cette socit libre et galitaire, les affections familiales ne conduiront pas se replier sur la cellule familiale car les individus seront aussi anims par un amour plus haut et plus noble, celui de la grande famille humaine . Donc la famille ne sera plus une structure hirarchique, mais un lieu ouvert et non exclusif o pourront se vivre des relations affectives. On peut estimer que cette conception de la famille est mise en pratique dans les kibboutzim israliens. Comme on a dj eu l'occasion de le dire, l'entretien
250 251
Ides sur l'organisation sociale, dans D. GURIN, op. cit., p. 86. Ides sur l'organisation sociale, dans D. GURIN, op. cit., p. 88. 252 Ides sur l'organisation sociale, dans D. GURIN, op. cit., p. 89. 253 Ides sur l'organisation sociale, dans D. GURIN, op. cit., p. 89.
Pierre Brchon, La famille. Ides traditionnelles, ides nouvelles. (1976)
146
des enfants est pris en charge par le kibboutz, les parents n'ayant plus de fonction autoritaire mais seulement un rle affectif auprs de leurs enfants.
Les partisans du divorce et de l'union libre.
Retour la table des matires
La prsentation que nous venons de faire des ides familiales d'un certain nombre de thoriciens anarchistes ne rend pas compte du climat d'opposition trs fort entre traditionalistes et anarchistes au XIXe sicle, notamment en France. Les anarchistes rclamaient que l'on reconnaisse l'union libre et, au minimum, le divorce car pour eux, l'association de l'homme et de la femme ne doit dpendre que de l'amour des deux individus. La socit n'a pas intervenir, par sa lgislation, dans les rapports de l'homme et de la femme. Si l'on est emprisonn dans cette institution sociale qu'est le mariage, il faut que la socit accepte que l'on puisse se sparer si l'on ne s'aime plus. Reconnatre le divorce, ce serait assouplir l'institution familiale, la rendre moins contraignante. Tout comme les socialistes, les anarchistes ne conoivent pas que l'union de l'homme et de la femme puisse s'appuyer sur autre chose que l'amour. Celui-ci leur apparat comme ncessaire. S'il a disparu, il vaut mieux se sparer. La propagande en faveur du divorce est donc base sur l'ide que l'homme et la femme ont droit au bonheur et l'amour, cela fait partie des droits de l'homme. La loi de 1792, qui tablissait le divorce, disait dans son prambule : L'Assemble Nationale, considrant combien il importe de faire jouir les Franais de la facult du divorce, qui rsulte de la libert individuelle dont un engagement indissoluble serait la perte... De mme, le projet de Code Civil de Cambacrs prvoyait : Le divorce est fond sur la nature, sur la raison, sur la justice. Le droit de libert personnelle est le droit de disposer de soi. Il est juste qu'une union forme pour le bonheur de deux individus cesse ds que l'un des deux n'y trouve plus le bonheur qu'il y a cher-
Pierre Brchon, La famille. Ides traditionnelles, ides nouvelles. (1976)
147
ch. Qui pourrait exiger du cur de l'homme qu'il reste attach l o il ne se sent pas heureux 254 ? [121] Alfred Naquet, parlementaire qui a fait voter en France la loi de 1884 sur le divorce, tait un partisan affich des thses anarchistes 255 . D'ailleurs, l'expos des motifs de la loi le montre clairement, tout comme ses ouvrages antrieurs, notamment Religion, proprit, famille. Dans ce livre, publi en 1869, Naquet critiquait les doctrines distes et religieuses, il dfendait le principe de la proprit en y mettant un certain nombre de restrictions, il attaquait vigoureusement le mariage et la famille actuelle. Il dresse un tableau idyllique de l'union libre 256 telle qu'elle est vcue dans les milieux populaires. Dans ces unions, on trouve un grand calme, une grande intimit, parce que, avec la libert, l'homme sent la femme libre de se sparer de lui s'il ne reste pas digne d'elle ; parce qu'il prend ds lors plus de souci de sa conduite que celui qui se repose sur les droits que la loi lui attribue, parce que la mme influence s'exerce de la mme manire sur la femme, toutes raisons qui font natre une prvenance rciproque et loignent toutes les occasions de discordes 257 .
Naquet considre que l'homme doit suivre ses passions et notamment ses passions sexuelles. Le besoin sexuel est un besoin de nature, tout comme le besoin de manger, de boire et de respirer. Si lon ne satisfait pas son instinct sexuel, on s'expose aux pires dchances : Quiconque veut se convaincre de la ncessit de satisfaire l'instinct gnsique n'a qu' ouvrir un ouvrage de pathologie. Que de maux n'y trouvera-t-il pas, depuis ceux que la chastet
254
255
J'ai trouv ces citations, ainsi que celles qui suivent sur le divorce et l'union libre, dans le livre de J. LECLERCQ, La Famille, Namur et Louvain, 1950, 3e dition, d. Wesmael-Charlier et Socit d'tudes morales, sociales et juridiques, 483 p. En matire conjugale et familiale, car, au plan politique, il est moins extrmiste : s'il dut s'exiler en Espagne en 1869 cause de ses ides rpublicaines et s'il rclama un impt sur le capital ainsi que le rachat par l'tat des mines et des chemins de fer, il fut aussi ml au boulangisme et l'affaire de Panama . NAQUET a galement publi un livre intitul : Vers l'union libre. A. NAQUET, Religion, proprit, famille, 1869, p. 232.
256 257
Pierre Brchon, La famille. Ides traditionnelles, ides nouvelles. (1976)
148
engendre directement, jusqu' ceux dont elle est la cause indirecte, en poussant ses malheureuses victimes des habitudes de dpravation qui ont sur la sant les plus funestes rsultats 258 . cause de la publication de ce livre, l'empire napolonien condamna Naquet 4 mois de prison pour outrage la morale publique et pour attaque contre les droits de la famille et le principe
de la proprit, qu'il avait cependant dfendu 259 . Les dbats entre conservateurs et progressistes en matire politique, religieuse et familiale n'taient donc pas seulement de vifs dbats d'ides. La rpression physique tait un argument que le pouvoir ne ddaignait pas !
Naquet a men de longues campagnes en faveur du divorce. Il a publi un ouvrage sur ce thme en 1876. On y retrouve la thse anarchiste sur le contrat de mariage, contrat rsiliable et non pas indissoluble : Le [122] mariage ne peut plus tre considr que comme un contrat rsultant de la libre volont des contractants. Or il est de la nature de tous les contrats de pouvoir tre rsilis, soit d'un commun accord, lorsque les deux parties contractantes y consentent, soit par la volont d'une seule des parties, si l'autre n'a pas rempli les conditions du contrat 260 . Pour Naquet, comme pour tout un courant de l'poque, le divorce doit tre possible de manire que l'amour ne soit pas contrecarr par l'institution, de manire que lorsqu'on aime une autre personne que son conjoint, on puisse vivre avec elle une nouvelle aventure. Les frres Margueritte insistent beaucoup dans ce sens dans une tude, Le mariage libre, publie en 1905. Ils citent notamment Zola - Je suis pour que l'homme et la femme qui se sont aims et qui ont enfant s'aiment toujours, jusqu' la mort. C'est la vrit, la beaut et c'est le bonheur. Mais je suis pour la libert absolue de l'amour, et si le divorce est ncessaire, il le faut sans entraves, par le
258
259 260
A. NAQUET, Religion, proprit, famille, p. 234. Largument mdical a souvent t employ tort en matire de sexualit, que ce soit par les partisans du rigorisme ou par ceux du libertinage . Cf. article A. NAQUET dans le Larousse : Grand dictionnaire universel du XIXe sicle, vol. 11. NAQUET. Le divorce, 1876, p. 19. La loi de 1884 n'a pas, en fait, admis cette conception du mariage puisqu'elle ne reconnat pas le divorce par consentement mutuel. Au contraire la loi vote en 1975 distingue prcisment un divorce par consentement mutuel et un divorce demand seulement par un des poux.
Pierre Brchon, La famille. Ides traditionnelles, ides nouvelles. (1976)
149
consentement mutuel et mme par la volont d'un seul 261 . Le divorce est donc toujours lgitim par le droit des individus l'amour, et les partisans du divorce sont souvent aussi partisans de l'union libre. Le dbat entre thses anarchistes et traditionalistes s'est exprim travers la littrature. Certains romans ou pices de thtre sont de vritables plaidoyers. Ainsi George Sand publie en 1834 un roman, Jacques. Le hros, Jacques, n'est plus aim par sa femme. Elle se dtourne de lui et aime un autre homme. Jacques, qui est, lui, toujours amoureux, va se tuer pour permettre sa femme d'pouser un autre homme. Le divorce impossible est ainsi rendu responsable de la mort d'un homme. De mme, la pice de Paul Hervieu, les Tenailles, dcrit un mnage o la vie est infernale, mais o il n'y a pas de solution puisque les conjoints ne peuvent divorcer. Cette pice fait apparatre le divorce comme la seule faon pour sortir d'une situation intenable. Cette littrature anarchisante met galement souvent en relief l'oppression de la femme par l'homme dans le couple. Le mariage apparat comme un enfer ou comme le comble de l'hypocrisie, rarement en tout cas comme le lieu de l'amour. L'union libre est au contraire prsente comme tant fonde sur un rapport galitaire entre les sexes, comme btie sur des rapports de sincrit et d'amour entre les deux compagnons. trop vouloir dfendre une thse, traditionalistes et anarchistes en arrivent tre caricaturaux et proposer des images trs idalises de l'tat de vie qu'ils dfendent.
261
Paul et Victor MARGUERITTE, Le mariage libre , dans Quelques ides, 1905, p. 169.
Pierre Brchon, La famille. Ides traditionnelles, ides nouvelles. (1976)
150
[123]
LA FAMILLE. Ides traditionnelles, ides nouvelles.
Troisime partie. Anarchisme et famille
Chapitre 7
L'anarchisme familial aujourdhui
Retour la table des matires
Au XXe sicle, certains intellectuels ont continu dfendre les thses anarchistes, en matire conjugale et familiale. Mais ils n'ajoutent aucune note originale, l'essentiel ayant t labor au XIXe sicle. Inutile donc de prsenter ces thses qui reprennent toujours les mmes arguments. Il parat plus intressant, au contraire, de s'arrter en compagnie d'un penseur qui sorte de l'ordinaire . Comme celle des anarchistes, son uvre est un cri de rvolte contre les socits autoritaires. Comme Fourier, il propose une libration du dsir, une socit sans rpression ; mais il prtend fonder la ncessit de cette libration dans ses dcouvertes psychanalytiques. Il s'agit de Wilhelm Reich (1897-1957), la fois mdecin psychanalyste et militant politique rvolutionnaire.
Pierre Brchon, La famille. Ides traditionnelles, ides nouvelles. (1976)
151
A. WILHELM REICH
Sexualit et culture : l'opposition entre Freud et Reich.
Retour la table des matires
Reich s'oppose aux thses de Freud, qui a t le premier mettre en valeur le rle de la sexualit dans la constitution de la personnalit et des socits 262 . Freud a dcouvert que l'instinct sexuel est prsent en l'homme [124] ds la petite enfance. L'enfant cherche raliser son dsir, se donner du plaisir, que ce soit en ttant le sein de sa mre, le biberon, son pouce ou en se masturbant. Freud nous dit que l'enfant est un pervers polymorphe , c'est--dire qu'on retrouve chez lui, ltat latent, tout le catalogue des perversions sexuelles. Mais cette volont qu'a l'enfant de vivre selon le principe de plaisir , de satisfaire son dsir inpuisable, ne va pas aller de soi. La sexualit de l'enfant va passer par des crises, notamment le complexe d'Oedipe et de castration. L'enfant ne pourra pas satisfaire certains objets de son dsir, le parent de sexe oppos (ou l'envie du pnis chez la fille) ; il devra reconvertir son dsir, le transfrer sur d'autres objets, accepter que le dsir ne soit pas satisfait immdiatement. C'est au travers de ces crises de la sexualit infantile que les diverses composantes de la sexualit, ce que Freud appelle les pulsions partielles, vont s'intgrer sous la dominance de la zone gnitale en vue de la relation sexuelle avec un partenaire de sexe oppos. Si cette intgration ne se fait pas, l'individu sera atteint de nvrose. Toute sa personnalit sera en fait marque par cette mauvaise intgration de la sexualit. Quelle est, selon Freud, la cause de ces nvroses ? Dans un article crit en 1908, Morale sexuelle civilise et maladies nerveuses des temps modernes , publi dans La vie sexuelle (pp. 28-46), il soutient
262
Cf. la prsentation fort claire de Michel SIMQN : Comprendre la sexualit aujourd'hui, Chronique sociale de France, Collection l'Essentiel, 1975, 96 p. Ce dossier prsente les thses de Freud, Reich, Marcuse, Klein, Lacan.
Pierre Brchon, La famille. Ides traditionnelles, ides nouvelles. (1976)
152
que le grand nombre des nvroses que l'on peut constater provient d'une rpression exagre de la sexualit dans notre socit. Cette rpression de la sexualit empche le dveloppement d'une vie sexuelle satisfaisante. Elle s'exprime dans une morale trop stricte. Freud va donc prcher pour une rpression sexuelle moins svre. Jusque-l Reich pourrait s'accorder avec Freud. Il n'a rien redire sur cette thorie de la sexualit. Mais Freud va plus loin. Il estime qu'il faut limiter la pulsion sexuelle, l'duquer. Car, selon lui, il ne peut y avoir de civilisation, de relations sociales entre les hommes sans nergie sexuelle sublime , c'est--dire sans une drivation de la pulsion sexuelle vers un but social et culturel. Donc Freud souligne deux aspects opposs : il s'lve contre une rpression trop forte de la sexualit, cause de nombreuses nvroses, mais il estime ncessaire la rpression d'une partie de la pulsion sexuelle au profit du dveloppement culturel. La civilisation ne peut s'tablir que si les individus renoncent au principe de plaisir et se soumettent au principe de ralit , la loi sociale, la voix de la raison, la satisfaction diffre. Reich refuse d'admettre que la culture doit son existence au refoulement de l'instinct et au renoncement l'instinct 263 . En effet, il existe des civilisations trs cultives o les individus ont une vie sexuelle libre, [125] naturelle, sans tabous. C'est ce qu'il montre dans L'irruption de la morale sexuelle, publi pour la premire fois en 1931. Il analyse et commente dans ce livre l'tude de Malinowski sur les populations des les Trobriand. La socit trobriandaise est une socit o rgne le communisme primitif : on est en prsence d'une proprit commune, d'une division du travail, d'une socialisation des tches, d'une rpartition des produits en fonction de ce travail 264 . Cette socit est organise sur une base matriarcale : on ignore le rle de l'homme dans la procration, c'est la femme seule qui donne vie l'enfant, le clan est form par tous les consanguins de la ligne maternelle. Le chef de la famille n'est pas l'poux, c'est l'oncle maternel, vritable tuteur des enfants de sa sur , alors que l'poux tient plutt le rle d'un ami qu'on estime 265 . Or, dans cet263 264 265
REICH, La rvolution sexuelle , Le Monde en 10/18, 1968, p. 55. REICH, l'Irruption de la morale sexuelle, Payot, 1974, p. 67.
L'Irruption de la morale sexuelle, op. cit., p. 69.
Pierre Brchon, La famille. Ides traditionnelles, ides nouvelles. (1976)
153
te socit matriarcale, il constate que la sexualit des enfants et des adolescents est libre et mme encourage par la socit. Les enfants peuvent librement pratiquer leurs jeux sexuels ; les adolescents peuvent librement satisfaire leur sexualit gnitale.
La socit trobriandaise se distingue de la ntre, non pas par l'existence d'une expression de la sexualit chez les jeunes - malgr tous les interdits, les jeunes occidentaux satisfont aussi leurs besoins sexuels - mais par le climat qui accompagne l'expression de la sexualit. Aux Iles Trobriand, il n'y a pas d'interdits pesant sur la sexualit pr-conjugale 266 . Donc, les individus n'ont pas de complexe de culpabilit, la satisfaction sexuelle apparat comme naturelle et sans problme. De ce fait, la structuration de la personnalit des Trobriandais n'est pas anti-sexuelle. Ainsi de mme que dans la socit autoritaire, la rpression sexuelle prpare le terrain toutes les formes d'inhibitions psychiques, de mme dans la socit matriarcale la libert sexuelle est la base de la libert caractrielle qui assure un lien social
bien fond au plan libidinal entre les membres de la socit 267 . Les Trobriandais et Trobriandaises jouissent de la puissance orgastique alors que les civiliss sont incapables d'accder la satisfaction gnitale parce que leur structure sexuelle est nvrose du fait des inhibitions morales acquises par l'ducation 268 . [126] Dans la socit trobriandaise matriarcale, on ne rencontre pas de nvroses et de perversions sexuelles. Au contraire, dans les Iles Amphlett, voisines des les Trobriand, mais o la morale sexuelle est stricte et o la sexualit prconjugale est proscrite, on constate que le lien familial est beaucoup plus fort et l'autorit patriarcale plus marque. Or prcisment, Malinowski juge les habitants des Iles Amphlett comme une communaut de neurasthniques alors que les trobriandais sont ouverts, joyeux, cordiaux , en
266
267 268
Le seul interdit est la prohibition de l'inceste. Mais, selon Reich, l'interdiction de l'inceste ne saurait tre considre comme une restriction de la sexualit (Irruption de la morale sexuelle, Payot, 1974, p. 38) car dans une socit o la sexualit se satisfait librement, le dsir d'inceste est faible. Son interdiction ne pose pas de problme dans la mesure o la sexualit se satisfait par ailleurs. Ce n'est que lorsque toute vie sexuelle est interdite, comme chez nous, que le dsir d'inceste devient trs fort, vu l'intimit familiale entre le frre et la sur ; un refoulement profond de ce dsir est alors ncessaire. Il a des consquences pathologiques. L'irruption de la morale sexuelle, op. cit., p. 40. L'irruption de la morale sexuelle, op. cit., p. 52.
Pierre Brchon, La famille. Ides traditionnelles, ides nouvelles. (1976)
154
un mot sociables. Donc, conclut Reich, les nvroses sont les consquences
culier, la morale sexuelle devient forte une fois que l'on est mari 270 . La monogamie conjugale est gnrale. On peut se sparer assez facilement de son poux (comme dans la famille apparie d'Engels) mais l'infidlit conjugale n'est pas tolre. De plus, la femme est exclue de l'exercice du pouvoir, l'poux dfend des intrts de proprit, il se marie en tenant compte de ses intrts conomiques, et cherche faire bnficier son fils de privilges. Le chef de clan accumule les richesses alors que, dans la socit matriarcale, les richesses circulaient constamment d'une famille l'autre par le systme de la dot. Le chef construit son pouvoir, qui tend devenir permanent, sur sa richesse accumule par le privilge de la polygamie et par la pratique du mariage endogame entre la nice du chef et son fils. C'est la seule faon pour le chef de rcuprer la dot qu'il doit servir annuellement l'poux de sa sur. Reich veut ainsi nous montrer comment le patriarcat, qui comporte la fois une structure sociale autoritaire, une infriorit de la femme, une division de la socit en classes et une morale anti-sexuelle, est en fait issu d'un matriarcat primitif o il n'y avait pas d'exploitation conomique d'une classe par l'autre, o la femme n'tait pas tenue en infriorit, o la sexualit tait auto-rgule et l'autorit faible et non hrditaire. Il s'oppose ainsi l'hypothse du patriarcat primitif de Freud 271 , hypothse reposant sur le mythe de la horde primitive et du meurtre du premier pre. De ce meurtre seraient issues la culpabilit, l'ambivalence des sentiments, l'interdiction de
269 270
de l'ordre social patriarcal 269 . Mais Reich ne considre pas que les peuples des les Trobriand vivent dans un matriarcat pur. On peut observer un systme patriarcal naissant qui est en train de prendre le relais du matriarcat primitif. Il y a donc des contradictions au sein de cette socit en parti-
L'irruption de la morale sexuelle, op cit., p. 57.
Il est curieux de constater que Lon Blum propose pour la France l'institution d'une situation un peu comparable celle des les Trobriand. Les jeunes gens ont, selon lui, un instinct polygamique. Ils sont ardents et aiment changer de partenaire. Blum souhaite que la polygamie soit reconnue pour les jeunes, le mariage monogame tant rserv aux gens d'ge mr. cf. Lon BLUM, Du mariage, 2e dition, 1907. Pour Reich si l'on opte pour l'antriorit du patriarcat et de sa forme familiale, on considre la morale impose comme immuable et inscrite dans la nature de l'homme . (Irruption de la morale sexuelle, op. cit., pp. 166-167). Pour pouvoir penser un avenir o la sexualit serait libre, auto-rgule naturellement, o il n'y aurait donc plus infriorit de la femme, exploitation d'une classe par une autre, autorit et hirarchie dans la socit, Reich essaie de montrer que cette situation a exist l'origine. Elle est cense correspondre la nature de l'homme.
271
Pierre Brchon, La famille. Ides traditionnelles, ides nouvelles. (1976)
155
l'inceste, toutes choses qui pour Reich, ne sont pas naturelles et originelles. Pour lui la morale anti-sexuelle n'est pas originelle, elle a une histoire, elle surgit dans l'humanit aprs la [127] dfaite du matriarcat. La morale antisexuelle est produite par les hommes qui dtiennent la puissance conomique et politique un moment donn et veulent la conserver. Mais il existe des civilisations volues qui ignorent le refoulement de la sexualit et plus spcialement de la gnitalit : elles sont au contraire pro-sexuelles et favorables l'panouissement de la vie sexuelle de leurs membres. Le refoulement sexuel n'est nullement la condition du dveloppement culturel et de l'ordre social tout court 272 .
En fait, pour Reich, la rpression de la sexualit ne permet pas l'existence de la culture, elle cre une forme spcifique de culture, la culture patriarcale , la culture fonde sur l'oppression et l'autoritarisme. Alors que dans sa pratique thrapeutique, Freud plaide pour la renonciation consciente l'instinct sexuel, permettant ainsi d'viter les dviances sexuelles, Reich explique que cela est tout fait insuffisant. Il ne suffit pas d'tre conscient de son refoulement pour le dominer. Il faut pouvoir satisfaire ses besoins naturels. Il faut librer la puissance orgastique et gnitale des individus. Pour Reich en effet les pulsions de l'inconscient ne sont pas anti-sociales. Il admet bien avec Freud l'existence de pulsions anti-sociales : fantasme du meurtre du pre pour s'approprier la mre, besoin du pnis, impulsions sadiques, etc... Mais selon Reich, ces pulsions anti-sociales ne sont pas naturelles en l'homme, elles proviennent de la rpression sociale de la sexualit, d'une structure sociale patriarcale et autoritaire . Freud n'a pas compris, selon Reich, qu'il y avait dans l'inconscient, au-del des pulsions anti-sociales (que Reich appelle pulsions secondaires) des pulsions primaires, naturelles l'amour, le travail, la raison...). Reich comprend en fait la structure caractrielle des individus comme trois cercles concentriques. S'il n'y avait pas de rpression sociale de la sexualit, l'individu serait sans contradiction interne, il serait naturellement bon et sociable. Ses pulsions primaires, son tre profond, son noyau biologique pourraient librement s'exprimer et s'panouir. Ce n'est pas le cas actuellement. Les pulsions primaires sont actuellement enfouies en l'homme, c'est le premier cercle, le plus intrieur. Le
272
L'irruption de la morale sexuelle, op. cit., pp. 186-187.
Pierre Brchon, La famille. Ides traditionnelles, ides nouvelles. (1976)
156
deuxime cercle, ce sont les pulsions secondaires, le refoulement des pulsions primaires, tous les vices latents en l'homme. Le troisime cercle, c'est la faade de l'homme, son apparence extrieure, que Reich appelle la cuirasse caractrielle . Ce sont la politesse, la courtoisie, le sens du devoir et de la conscience professionnelle, la soumission lautorit, le respect des chefs, toutes les valeurs sociales que l'homme doit son ducation. En effet, ce troisime cercle est en contact direct avec l'environnement social, [128] c'est--dire avec les forces de la rpression : l'tat, l'glise, l'cole, la famille 273 . Tout le problme pour Reich consiste agir sur la socit (et non pas sur un individu comme le faisait Freud) pour supprimer la cause du dveloppement des pulsions secondaires. Il faut donc travailler casser notre socit patriarcale autoritaire , fonde sur l'autorit du pre, sur la famille patriarcale. L'opposition entre Reich et Freud est donc fondamentale : Freud dit (surtout dans Malaise dans la civilisation) : tez la rgulation sociale, la morale, une certaine rpression et c'est le retour la loi de la jungle, des rapports uniquement fonds sur le principe de plaisir immdiat, sur la maxime de Hobbes : l'homme est un loup pour l'homme . Reich rtorque : tez la rpression sexuelle, et vous trouverez l'homme naturel qui est immdiatement, spontanment, sociable et bon. Toutes les dviances que nous constatons aujourd'hui : viols, meurtres, agressions, prostitution, pornographie, etc..., tout cela n'est que le fruit des pulsions secondaires, nes de la rpression sociale des pulsions primaires. Donc une rgulation morale de la sexualit, qui rprime les besoins naturels de l'homme, est , proscrire. Il faut lui substituer une autorgulation naturelle , une rgulation par l'conomie sexuelle . Finalement, si l'on voulait classer Reich et Freud dans une histoire de la philosophie politique, on pourrait dire que le premier est un fils de Rousseau et le second un disciple de Hobbes. Dans le dbat entre Reich et Freud, on retrouve en fait la question que posaient les thses anarchistes : une socit non rpressive est-elle possible ? Freud estime que non. Sans rpression, il n'y a pas d'ordre social, il n'y a que le chaos. Reich pense au
273
La structure caractrielle concentrique de l'individu est le rsultat de l'affrontement de forces opposes : les pulsions primaires et les forces de rpression.
Pierre Brchon, La famille. Ides traditionnelles, ides nouvelles. (1976)
157
contraire qu'une socit autorgule est possible : sans la rpression de la socit patriarcale autoritaire, on reviendrait au paradis perdu, l'harmonie primitive spontane, une socit de type matriarcal, sans autorit du pre, et donc sans refoulement sexuel.
Rvolution, sociale et rvolution sexuelle.
Le problme de Reich est donc de savoir comment dtruire cette socit patriarcale autoritaire. Pour transformer la socit, pour que les hommes puissent panouir toutes leurs virtualits, notamment sexuelles, suffit-il d'une transformation conomique de la socit ? Reich pense que non et il s'oppose en cela Marx. Il estime que la rvolution, pour russir, doit [129] tre la fois conomique, politique, culturelle et sexuelle. Reich rflchit dans la deuxime partie de La Rvolution sexuelle sur l'exprience russe 274 . la suite de la rvolution de 1917, on avait vu se dvelopper, reconnait-il, un dbut de rvolution sexuelle ; les anciens cadres par lesquels passait la rpression sexuelle, notamment la famille, taient branls : le mariage monogamique est remis en question par la facilit trs grande du divorce (par consentement mutuel), les relations extra-conjugales ne sont plus dlictueuses, on ne condamne plus les homosexuels. Le pouvoir du pre est aboli (thoriquement au moins), l'galit juridique entre l'homme et la femme est ralise, l'avortement est possible pendant les trois premiers mois de la grossesse, les moyens anti-conceptionnels sont autoriss 275 et on peut instruire les femmes sur leur usage. On essaie d'amliorer la situation concrte de la femme, mre de famille : on lui donne 16 semaines de cong-maternit, on cre des crches dans les usines, des jardins d'enfants sans interdits, sans punitions o la crativit et l'initiative de l'enfant sont favorises. Si on avait continu dans cette voie, on aurait vu germer, pense Reich, une nouvelle gnration d'hommes et de femmes qui n'auraient pas t marqus par la r274 275
Partie intitule : La lutte pour la nouvelle forme de vie en Union Sovitique. Ce qui tait une faon de dissocier le plaisir sexuel et la procration. Le blocage entre ces deux lments est, selon Reich, un moyen de rpression de la sexualit.
Pierre Brchon, La famille. Ides traditionnelles, ides nouvelles. (1976)
158
pression de la sexualit. Mais en fait, vers 1930, on assiste un retour en arrire. La famille autoritaire, qui avait t branle par ces rformes, est rtablie dans ses droits anciens. Reich va essayer d'expliquer cet chec, de montrer ce qu'il signifie et les leons qu'il faut en tirer.
partir du moment o la rvolution a triomph, o la socit a t transforme, les besoins sexuels des individus n'taient plus contrecarrs par des questions conomiques puisque la proprit prive tait abolie. Mais la structure caractrielle des individus restait inchange, structure qu'ils avaient hrite de la socit ancienne, patriarcale et autoritaire. De fait la rvolution dans la superstructure idologique fait faillite parce que le support de cette rvolution, la structure psychologique des tres humains, n'a
pas comme tant aussi leur moteur 277 . Reich se distingue donc des marxistes orthodoxes pour qui la rvolution conomique est la base permettant toutes les librations, la rconciliation des individus avec eux-mmes. Selon Reich, il a manqu en Union Sovitique une thorie de la rvolution sexuelle. Certains marxistes ont cru que la dsagrgation de la famille tait en fait due une influence capitaliste. Certains dirigeants ont eu peur de la libert sexuelle des masses, parce qu'ils taient encore eux-mmes soumis l'idologie familiale ancienne et parce que leur structure psychique n'avait pas volu. Reich avance aussi l'hypothse suivante : la contestation de la famille en Union Sovitique immdiatement aprs la rvolution, permettait au nouveau rgime de mieux s'implanter car les jeunes devenaient ainsi plus indpendants de leurs parents qui risquaient de vhiculer l'idologie autoritaire, l'idologie politique du rgime antrieur. En 1935, le rgime n'avait plus craindre une influence politique nfaste des parents sur leurs enfants. La majorit du peuple russe est alors acquise au nouveau rgime. Si l'on prolonge l'ide de Reich, on peut mme estimer que la famille autoritaire, rtablie dans ses droits, a jou un rle d'intgration des jeunes au nouveau rgime,
276 277
pas chang 276 . Reich a bien vu que la rvolution culturelle ne suit pas spontanment et immdiatement la rvolution conomique et politique. Il y a dcalage entre les deux. Pour que la rvolution sexuelle russisse, pour que les masses librent leur sexualit, transforment leur mentalit, il faut changer la structure psychique des masses et pas seulement les structures conomiques. C'est la structure psychique des masses qui dtermine le dveloppement de la socit (...). Aucune thorie du devenir historique ne peut tre appele rvolutionnaire si [130] elle considre la structure psychique des masses comme une simple rsultante des processus conomiques, et non
W. REICH, La rvolution sexuelle, op. cit., p. 238. W. REICH, La rvolution sexuelle, op. cit., p. 252.
Pierre Brchon, La famille. Ides traditionnelles, ides nouvelles. (1976)
159
la nouvelle idologie dominante, un rgime qui devenait de plus en plus autoritaire et bureaucratique.
La conclusion de Reich est qu'une rvolution totale ne peut tre seulement conomique et politique. Elle doit aussi tre culturelle, c'est--dire viser la transformation des rapports humains entre les hommes, promouvoir un style de vie selon le libre jeu des pulsions vitales. Elle doit enfin tre sexuelle, c'est--dire dtruire la famille patriarcale, autoritaire, monogamique pour que la sexualit des individus puisse se dvelopper librement. L'institution familiale est actuellement base sur le triangle pre-mre-enfant. Cette structure triangulaire fait que l'enfant est fix ses parents, il subit leur autorit, leur rpression et leurs interdits sexuels. L'ducation de l'enfant dans la structure triangulaire est responsable de son inhibition sexuelle et sociale. Pour Reich, la famille est le principal lieu d'incubation de l'atmosphre idologique du conservatisme . Elle est une fabrique didologies autoritaires et de structures mentales conservatrices 278 . C'est dans la famille patriarcale autoritaire monogamique, o le pre reproduit l'intrieur de la cellule familiale la fonction rpressive de l'tat autoritaire et prpare ainsi des citoyens soumis, que se forme la structure caractrielle des individus. [131]
Les fonctions de la famille et du mariage monogame.
Selon Reich, la famille a finalement une double fonction politique 279 : d'une part, elle se reproduit elle-mme. Pour que la famille
278 279
W. REICH, La rvolution sexuelle, op. cit., pp. 131-132. Cette double fonction politique de la famille correspond aux fonctions qu'ALTHUSSER reconnat aux appareils idologiques d'tat (cf. son article dans la Pense de juin 1970 : Idologie et appareils idologiques d'tat. Sur la reproduction des conditions de la production , o il cite la famille comme l'un des appareils idologiques d'tat). Les appareils idologiques d'tat cherchent
Pierre Brchon, La famille. Ides traditionnelles, ides nouvelles. (1976)
160
patriarcale autoritaire se reproduise, on duque les enfants en vue du mariage monogame et de la famille, on idalise ces institutions leurs yeux. De plus, on rprime leur sexualit naturelle, on inhibe leur activit gnitale : on interdit les jeux sexuels des enfants, la masturbation chez les adolescents, les relations sexuelles entre jeunes. Donc la condition de la reproduction de la famille monogame patriarcale, c'est la mutilation sexuelle de l'enfant. D'autre part, la famille rend l'individu apeur par la vie et craintif devant l'autorit 280 . La famille cre la cuirasse caractrielle de l'individu, le troisime cercle dont nous avons parl prcdemment. Ainsi, elle renouvelle sans cesse la possibilit de soumettre des populations entires la frule d'une poigne de dirigeants 281 , que ce soit en Union Sovitique ou dans l'Allemagne hitlrienne 282 .
tant donn cette double fonction de la famille, il n'est pas tonnant, nous dit Reich, que la famille apparaisse aux yeux des conservateurs comme le rempart de l'ordre social, il n'est pas tonnant que les conservateurs considrent que la famille garantit la stabilit de l'tat et de la socit. Effectivement, elle joue bien cette fonction. Les traditionalistes s'en rjouissent, Reich le dplore, mais ils sont en fait d'accord sur l'analyse des fonctions de la famille dans la socit. Reich conclut : La valeur attribue la famille devient donc la cl de l'apprciation gnrale de chaque type d'or-
dre social 283 . On est tout fait dans le schma de pense traditionaliste : l'institution familiale dtermine la socit. Si l'institution familiale est patriarcale, autoritaire et monogamique, la socit sera patriarcale, autoritaire et rpressive. Mais, la diffrence des traditionalistes qui voyaient dans la famille un noyau naturel, un donn incontestable, Reich maintient bien que la famille est une structure produite, qu'elle s'explique par l'tat de la socit, par ses structures conomiques : Alors que les thories conservatrices font de la famille la base, la cellule de la socit humaine, l'tude de ses variations au cours de l'histoire et de ses fonctions sociales permanentes rvle qu'elle est le rsultat de constellations conomiques dtermi-
280 281 282 283
se reproduire et reproduire les rapports de production existants. [Texte disponible dans Les Classiques des sciences sociales. JMT.] W. REICH, La rvolution sexuelle, op. cit., p. 141. W. REICH, La rvolution sexuelle, op. cit., p. 141. Cf., plus loin, l'analyse du livre de REICH, Psychologie de masse du fascisme, Payot, 1972, 341 p. W. REICH, La rvolution sexuelle, op. cit., p. 141.
Pierre Brchon, La famille. Ides traditionnelles, ides nouvelles. (1976)
161
nes (...). Lorsque la sexologie, la morale et le [132] droit conservateurs persistent voir dans la famille la base de ltat et de la socit , ils ont raison en ceci que la famille autoritaire est effectivement partie intgrante et condition de l'tat autoritaire et de la socit autoritaire 284 .
Aprs avoir vu comment Reich considre la famille, il nous reste prsent prciser sa conception du mariage monogame, qui est la base de l'institution familiale patriarcale. Comme Engels, Reich pense que, historiquement, la monogamie a t impose par les structures conomiques, et qu'elle demeure pour les mmes raisons : Le mariage trouve sa raison d'tre dans ce qui fut son substrat ds l'origine, savoir la proprit prive des moyens de production. Cela veut dire que le mariage est socialement ncessaire tant que persistent ces conditions conomiques 285 . La fidlit et la virginit de la femme sont trs importantes dans un rgime de proprit prive (aux mains des hommes) : il faut que la paternit des enfants soit bien tablie puisqu'ils hritent de leur pre 286 . Pour garantir et perptuer le mariage monogame, il faut dvelopper une morale sexuelle rpressive, une idologie monogamique car l'idologie monogamique de l'individu (...) apparat comme un puissant mcanisme de rpression contre ses propres dsirs sexuels, dsirs qui ignorent tout de la distinction monogamiepolygamie, et ne connaissent que la satisfaction 287 . S'il tait laiss ses propres dsirs, l'individu ne serait pas spontanment monogame, d'o la ncessit de l'idologie monogamique, de la rpression sexuelle. La monogamie n'est pas inne en l'homme, elle ne peut qu'tre inculque par l'ducation. Qui opre cette ducation ? La socit et son usine idologie, i.e. la famille autoritaire, fonde sur la monogamie
284 285 286
W. REICH, La rvolution sexuelle, op. cit., p. 131. W. REICH, La rvolution sexuelle, op. cit., p. 206. Dans son dition de 1944, Reich complte son texte. Il constate qu'en Union Sovitique, o la proprit prive a t abolie, le mariage coercitif n'en a pas moins t rtabli. En fait le mariage et la famille coercitive peuvent se maintenir grce l'autorit de l'tat, mme aprs la disparition de la proprit prive des moyens de production. La structure psychique des individus, soumis et refouls sexuellement, fait qu'ils continuent admettre la monogamie et la famille coercitive. W. REICH, La rvolution sexuelle, op. cit., p. 219.
287
Pierre Brchon, La famille. Ides traditionnelles, ides nouvelles. (1976)
162
coercitive 288 . L'idologie monogamique permet la famille monogamique de se reproduire elle-mme comme nous l'avons vu prcdemment. Mais dans la socit actuelle, o la monogamie est la seule institution familiale reconnue, il y a beaucoup de prostitution et d'adultres car les hommes ont besoin d'objets d'amour . La morale officielle devient immoralit pratique. C'est la contradiction du systme actuel : la monogamie [133] est ncessaire pour que se transmette la proprit prive, mais la modification constante de la personnalit des individus fait que les poux lgaux n'prouvent souvent plus d'amour l'un pour l'autre et les besoins sexuels des individus aboutissent des relations extra-conjugales.
Reich ne peut admettre le mariage monogame 289 . Celui-ci est fond sur la proprit prive, il constitue la base de l'institution familiale coercitive, il rend la femme et les enfants dpendants du pre, il est une structure ingalitaire. De plus, il maintient unis des gens qui ne s'aiment plus, pour qui la vie
commune devient un vritable enfer 290 . Le mariage monogame indissoluble est en contradiction avec l'conomie sexuelle, avec l'auto-rgulation de leur sexualit par des hommes autonomes et libres. la place du mariage monogame, Reich propose l'tablissement d'une relation durable s'accompagnant de tendresse. C'est le type de relation sexuelle le plus conforme l'conomie sexuelle car c'est celui qui permet la meilleure satisfaction sexuelle des individus. Mais dans la relation durable fonde sur le dsir, il y a fatalement des priodes de faible attraction ; l'un des partenaires risque d'tre attir par d'autres personnes. Il faut, selon Reich, reconnatre la lgitimit de l'attraction par d'autres. Le partenaire ne doit pas tre posses288 289
W. REICH, La rvolution sexuelle, op. cit., p. 204. Reich critique aussi la thse de ceux qui veulent rformer le mariage en rotisant les relations sexuelles. Il s'agirait de librer la sexualit des individus l'intrieur de la relation conjugale. Reich ne peut tre d'accord puisque la structure familiale, base de la socit autoritaire ne serait pas remise en cause. De plus, on ne peut valablement rotiser des relations qu'entre des partenaires libres. Si les poux ne s'aiment plus, l'rotisation de leurs relations est un non-sens. On retrouve ici la conception anarchiste prsente prcdemment. Selon Reich, le caractre infernal du mariage est attest par un fait statistique : partout o le divorce est admis, il augmente beaucoup alors que le nombre des mariages progresse lentement.
290
Pierre Brchon, La famille. Ides traditionnelles, ides nouvelles. (1976)
163
sif, ne pas considrer l'autre comme sa proprit prive. Alors que dans la morale sexuelle traditionnelle, imprgne par l'esprit de proprit, l'homme possde sa femme qui se donne lui ; l'homme n'aime pas, il conquiert...
Reich se dfend de vouloir dtruire la famille. Ce qu'il veut dtruire c'est une structure rpressive dont il constate les consquences dsastreuses sur le psychisme des individus. Mais il admettrait tout fait la valeur d'un groupe familial qui ne reposerait que sur le libre attachement des poux l'un l'autre. Alors que dans l'institution familiale actuelle, selon lui, mari et femme ne peuvent s'aimer et ne peuvent aimer valablement leurs enfants. On ne rencontre pas dans la famille actuelle des liens d'amour, mais l'esclavage conomique des femmes, l'esclavage moral des enfants, leur rpression sexuelle. Donc ce que nous voulons dtruire, dit Reich, c'est la haine que cre la famille, bien qu'elle puisse prendre l'apparence extrieure de l'amour 291 . [134]
Famille autoritaire et monte du fascisme.
De mme que Reich appliquait sa thorie de la structure caractrielle des individus et de la famille monogame coercitive la socit russe pour comprendre l'chec de la rvolution, il l'applique la socit allemande Pour comprendre le succs du nazisme parmi les masses 292 . Cette rflexion de Reich se trouve dans Psychologie de mas291 292
W. REICH, La rvolution sexuelle, op. cit., p. 79. Plusieurs sociologues allemands ont rflchi au mme problme. Dahrendorf, par exemple, explique la faiblesse de la dmocratie en Allemagne par le systme de valeurs dominant dans ce pays. Distinguant les valeurs publiques (rgulant les rapports collectifs) et les valeurs prives (rgulant le comportement individuel), il estime que les valeurs prives prdominent dans la culture allemande (au dtriment des valeurs publiques). Selon lui, les valeurs publiques sont transmises par l'cole alors que les valeurs prives le sont par la famille. Il faut donc tablir qu'en Allemagne l'institution familiale prime sur l'institution scolaire. Dahrendorf en donne quelques tmoignages. La constitution de la Rpublique Fdrale mentionne le droit et le devoir de la famille d'duquer ses enfants. Dans les conflits ports devant les tribunaux, on tranche le plus sou-
Pierre Brchon, La famille. Ides traditionnelles, ides nouvelles. (1976)
164
rdit (aprs correction) par Reich, aprs la guerre, aux tats-Unis. La monte du fascisme pose question Reich. Comment expliquer, en effet, qu'en priode de crise conomique, o les chmeurs se multiplient, o les conditions de vie des ouvriers deviennent plus prcaires, on assiste non pas un renforcement des organisations ouvrires, non pas un progrs dans la prise de conscience de la classe ouvrire, mais un succs incontestable de l'idologie fasciste ? Le marxisme est pris en dfaut : les contradictions conomiques de plus en plus exacerbes auraient d conduire la rvolution proltaire ; c'est Hitler qui triomphe. On ne peut expliquer le succs du nazisme qu'en admettant que les masses ont t consentantes, qu'elles ont dsir l'avnement d'Hitler. Si les masses ont dsir un systme autoritaire, c'est parce que leur structure caractrielle les y prdisposait. Les masses [135] allemandes avaient t duques dans une socit et des familles patriarcales autoritaires 293 . Ainsi s'tait forme leur cuirasse caractvent les diffrends au profit de la famille et au dtriment de l'cole. Les enfants ne suivent l'cole que le matin. L'cole n'assure que la formation intellectuelle, le reste du processus de socialisation tant laiss la famille. Enfin, selon diverses enqutes, le sens de la famille est la qualit que presque 50% des Allemands souhaitent possder en priorit. Donc, la socialisation trop exclusivement familiale semble nfaste puisqu'elle est incapable de dvelopper les valeurs collectives. Mais Dahrendorf oublie que, selon le type de structure familiale, la socialisation peut tre diffrente. Une structure familiale moins stricte pourrait peut-tre socialiser aux valeurs collectives. Alors que Reich explique le politique par le familial, Dahrendorf l'explique par le rapport famille-cole (cf. R. DAHRENDORF, Gesellschaft und Demokratie in Deutschland, Munich, Piper und Co, 1966, cit par P. LAZARSFELD, Qu'est-ce que la sociologie ? Gallimard coll. Ides, 1970, pp. 52-54). Les tudes faites par l'cole de Francfort (M. Horkheimer, T. Adorno, W. Benjamin, E. Fromm, H. Marcuse) montraient aussi, plusieurs annes avant la prise de pouvoir par Hitler, que la classe ouvrire ne rsisterait probablement pas au mouvement hitlrien parce que la famille allemande favorisait la soumission l'autorit (P. LAZARSFELD, op. cit., p. 124). Pierre SOUYRI, commentant ce livre de Reich, note fort justement qu' en faisant de la famille patriarcale la citadelle de l'esprit ractionnaire et le centre d'incubation de la peste fasciste , Reich transgresse allgrement un formidable tabou auquel l'humour noir de Marx n'avait adress que quelques grimaces. La critique de l'institution familiale chez Reich est en effet radicale alors que Marx y accorde peu d'intrt. La famille n'a pas dans son syst-
se du fascisme , dit pour la premire fois au Danemark en 1933,
293
Pierre Brchon, La famille. Ides traditionnelles, ides nouvelles. (1976)
165
rielle, leur soumission quasi-instinctive l'autorit, leur peur de la rvolution. Les masses acceptent et dsirent un ordre oppressif, une socit d'exploitation qui va contre leurs intrts conomiques de classe parce que leur ducation familiale leur a fait intrioriser la soumission.
Mais les masses, c'est un terme gnrique. Reich va donc analyser comment se comportent les diffrentes classes sociales l'gard du nazisme et tenter d'expliquer leur plus ou moins grande permabilit de par les particularits de linstitution familiale dans ces classes sociales. Ce sont surtout les classes moyennes, encore appeles la petite bourgeoisie , et la paysannerie qui soutiennent le plus vivement le nazisme. Reich explique cette constatation par le fait que, dans ces classes sociales, la famille a une fonction de production : le groupe familial et l'entreprise concident. De ce fait, le pre de famille aura, dans ces classes sociales, une autorit particulirement forte. La rpression des enfants et la soumission des femmes y sont d'autant plus grandes. C'est dans ces deux classes sociales que la cuirasse caractrielle des individus sera donc la plus marque ; les petits bourgeois et les paysans auront le sens du devoir et de l'honneur, ils dsireront la soumission l'autorit. Le petit bourgeois est un homme demeur, infantilis, qui transfre sur le chef national sa confiance dans la toute puissance de la protection du pre et jouit de son identification narcissique avec le grand homme 294 .
Si le fascisme s'est surtout rpandu dans les masses paysannes et l'intrieur de la petite bourgeoisie, la classe ouvrire elle-mme a t atteinte. Reich explique ce phnomne par le caractre non homogne de la classe ouvrire. On trouve dans le proltariat des gens qui ont t levs dans une famille paysanne, qui ont parfois t euxmmes paysans pendant une partie de leur vie. Leur structure caractrielle a en fait t trs marque par leur ducation dans une famille patriarcale paysanne. D'autre part, on trouve dans le proltariat une aristocratie ouvrire, c'est--dire une couche d'ouvriers relativement privilgie, qui par dsir dascension sociale, est tente d'adopter les
me la place centrale qu'elle occupe chez Reich. Cf. Pierre SOUYRI, La famille, foyer d'incubation du fascisme, Annales, numro spcial sur Famille et Socit, op. cit., pp. 1228 -1231. Pierre SOUYRI, op. cit., p. 1230.
294
Pierre Brchon, La famille. Ides traditionnelles, ides nouvelles. (1976)
166
valeurs et les modes de vie de la petite bourgeoisie. Reich explique par ces deux phnomnes la contamination [136] de la classe ouvrire. Donc, le fait de l'exploitation capitaliste de la classe ouvrire ne suffit pas en faire une classe rvolutionnaire. La classe ouvrire ne peut devenir classe rvolutionnaire que si elle n'est plus contamine par l'institution familiale, autoritaire et patriarcale. Sans rvolution sexuelle, il ne peut y avoir de rvolution proltaire.
B. Herbert Marcuse
Retour la table des matires
On retrouve chez Marcuse une conception de la socit et de la famille proche de celle de Reich. Il considre la socit comme rpressive, comme dominatrice. L'homme y est de plus en plus rduit tre unidimensionnel , c'est--dire intgr, sans possibilit de raction, de contestation, de ngation. Marcuse se pose la mme question que Reich : une socit non rpressive est-elle possible ? Il distingue entre une rpression normale et une rpression sociale : il admet bien qu'il n'y a pas de civilisation possible sans une certaine part de renoncement une satisfaction immdiate des pulsions. Mais il faut distinguer cette rpression normale de la rpression sociale qu'on peut constater actuellement. Marcuse appelle principe de rendement la forme particulire que prend le principe de ralit dans la socit actuelle.
Dans chaque mode de domination, chaque poque, chaque forme du principe de ralit se concrtise dans un systme d'institutions et de rela-
tions sociales, de lois et de valeurs 295 . Actuellement, le mode de domination est bas sur le principe de rendement qui est celui d'une socit oriente vers le gain et la concurrence dans un processus d'expansion constante , une socit o le travail est alin c'est--dire pnible puisque l'homme n'y trouve aucune satisfaction 296 . ct d'une rpression norma295 296
MARCUSE, Eros et civilisation, Editions de Minuit, Collection Points, 1971, p. 45. MARCUSE, Eros et civilisation, op. cit., p. 52.
Pierre Brchon, La famille. Ides traditionnelles, ides nouvelles. (1976)
167
le, fondamentale de la sexualit, il y a une rpression qui est due au type de socit dans lequel nous vivons. Il y a en fait une sur-rpression sociale des pulsions qui permet la socit en place de se reproduire. Ainsi les modifications et les dviations de l'nergie instinctuelle, rendues ncessaires par la perptuation de la famille monogamique-patriarcale, (...) sont des exemples de sur-rpression appartenant aux institutions d'un principe de ralit particulier 297 . Marcuse est donc bien d'accord avec Reich pour considrer la famille comme une institution rpressive, cette rpression tant utile la reproduction sociale. D'ailleurs Marcuse appelle la famille une usine idologique de la rpression .
[137] Reich et Marcuse sont les matres penser d'un certain gauchisme dont le slogan prfr exprime bien le primat du principe de plaisir sur le principe de ralit : Nous voulons tout, tout de suite. Donc, plus de rpression, plus de principe de ralit, nous voulons vivre en laissant s'exprimer nos instincts, nous voulons vivre selon le principe de plaisir. Plus d'ordre social rpressif, plus de structure familiale impose de l'extrieur. Vive l'autorgulation sociale, chacun de se crer la vie familiale qui correspond ses dsirs. De l'autorgulation sexuelle et sociale natront une harmonie spontane, un tat social naturellement bon.
Le tract du docteur Carpentier.
La mme idologie s'exprimait en 1972 dans le tract du docteur Carpentier 298 qui a dfray la chronique et a valu son auteur d'tre suspendu un an par le Conseil de l'Ordre des mdecins. Ce tract commenait par un liminaire qui en exprime l'esprit : Apprenons faire l'amour, car c'est le chemin du bonheur ! C'est la plus merveilleuse faon de se parler et de se connatre. Donc l'exercice de la sexualit libre, selon les dsirs que l'on ressent, est cens crer
297 298
MARCUSE, Eros et civilisation, op. cit., p. 46. Baptis ainsi par la presse, mais en fait sign collectivement par un comit d'action pour la libration de la sexualit au sein duquel militait le Docteur Carpentier. Ce tract a t publi par Le Monde des 11 et 12 fvrier 1973.
Pierre Brchon, La famille. Ides traditionnelles, ides nouvelles. (1976)
168
sexuelle.
des rapports humains entre les individus. La plus grande partie du tract consistait dcrire de faon prcise mais succincte les organes sexuels et leur fonctionnement, prciser comment se droule l'acte sexuel, jusqu' l'orgasme et comment viter les risques de grossesses. de nombreuses reprises, le tract insiste sur le vif plaisir que ressentent les partenaires en faisant l'amour. Tout un paragraphe est consacr souligner l'intrt de la masturbation pour bien connatre les plaisirs que le corps peut procurer, l'intrt de l'homosexualit pour des jeunes qui la socit interdit les relations htrosexuelles. Mais le tract reconnat que les relations htrosexuelles cependant paraissent les plus riches de plaisir . Donc, le plaisir prouv est (ici) le seul critre de jugement de la validit d'une pratique de la sexualit. Le tract vise clairement encourager toutes les relations sexuelles des jeunes, du baiser au cot en passant par les caresses les plus varies. Il incite apprendre faire l'amour pour progresser dans le plaisir prouv. Il cherche dculpabiliser les gens. En matire sexuelle, il n'y a pas des gens normaux et des gens anormaux . Ce qui compte, c'est le plaisir que l'on prouve dans la pratique choisie. Il n'y a qu'un danger, c'est [138] le refoulement des dsirs. Ainsi le tract reprend nettement la thse de Reich : tout refoulement doit tre vit, il faut toujours satisfaire l'instinct sexuel. La rpression sexuelle est la cause de l'impuissance et de la frigidit des deux tiers des gens. Apprenez donc plutt vivre selon vos dsirs, vous aurez ainsi du plaisir et votre puissance orgastique ne sera pas perturbe. Ce que le tract du docteur Carpentier propose aux jeunes lycens franais, c'est en fait de vivre leur sexualit comme les jeunes trobriandais dont Reich nous entretient dans L'irruption de la morale
tait d au manque d'ducation sexuelle dans les familles et les coles 299 ; lorsqu'elle existe, elle se limite gnralement un cours sur les mcanismes de la reproduction. On se garde le plus souvent de parler du plaisir et de r299
Le tract a t beaucoup comment et critiqu. Certains ont cri au scandale, trouvant tout fait dplac cet encouragement la licence, cet outrage aux bonnes murs . Certains ont soulign que le succs de ce tract
Ce tract a au moins eu un mrite : permettre des discussions entre jeunes sur le sujet, et parfois entre parents et enfants, ou avec des ducateurs.
Pierre Brchon, La famille. Ides traditionnelles, ides nouvelles. (1976)
169
flchir sur la place de la sexualit dans la vie des individus. Or, ce tract parlait du plaisir, mais la vision de la sexualit qu'il comporte, vision hrite de Reich, est contestable et a t conteste. Le journal La Croix 300 regrette notamment que ce tract donne une image fausse et dforme de la sexualit humaine ... La sexualit y est rabaisse au rang de recherche goste du plaisir. La relation l'autre en est compltement absente alors que pour l'auteur de l'article, la sexualit est d'abord une relation entre deux liberts qui s'engagent dans l'amour ; l'exercice de la sexualit doit traduire l'amour que se portent deux tres, c'est un acte o homme et femme s'engagent totalement, corps et esprit. Notons d'ailleurs que le mot amour dans le tract dsigne essentiellement l'acte sexuel et non pas le sentiment que se portent deux individus.
Quoi que l'on pense de ce tract, il est certain qu'il exprime une contestation violente de la morale sexuelle la plus couramment admise et inculque aux jeunes. Il conteste notamment l'ide que la sexualit gnitale ne devrait s'exercer qu'avec sa femme, l'intrieur de la famille monogame indissoluble.
Trois contestations actuelles du mariage et de la famille.
Cette mentalit anti-institutionnelle, anti-mariage, se retrouve aujourd'hui, de faon plus ou moins marque, dans plusieurs types de comportement. Il me semble que l'on peut distinguer trois formes de contestation [139] du mariage, se situant des niveaux diffrents : les relations prnuptiales, l'union libre, le phnomne des communauts.
Relations prnuptiales et union libre
Les relations prnuptiales ne constituent pas une contestation radicale de l'institution du mariage, puisque ceux qui les pratiquent se marient gnralement ensuite. Mais elles contestent une certaine
300
Dans un article de Y. de Gentil-Baichis, le 14 dcembre 1972.
Pierre Brchon, La famille. Ides traditionnelles, ides nouvelles. (1976)
170
conception du mariage, peru comme l'autorisation donne par la socit de pratiquer les relations sexuelles, comme leur lgitimation. Avant le mariage, les relations sexuelles sont interdites, aprs elles sont permises avec le partenaire choisi. Cette faon de concevoir le mariage est aujourd'hui massivement conteste par la pratique des jeunes. D'aprs le rapport Simon sur le comportement sexuel des Franais 301 , 61% des hommes et 26% des femmes reconnaissent avoir eu des relations sexuelles avant leur mariage. Mais 21% des femmes et 39% des hommes ont eu en fait ces rapports pr-conjugaux avec leur futur conjoint 302 . Si l'on compare l'ge moyen du mariage et l'ge moyen du premier rapport sexuel 303 , on constate des dcalages :
HOMMES Age moyen du mariage en 1972 Age moyen du premier rapport sexuel (ensemble de la population adulte) Age moyen du premier rapport sexuel pour la tranche dge : 20-29 ans 24,5 19,2 18,2
FEMMES 22,5 21,5 19,1
L'ge du premier rapport sexuel tend baisser et l'cart entre l'homme et la femme diminue. L'cart entre l'ge du mariage et l'ge du premier rapport sexuel est surtout important pour l'homme qui a plus souvent des rapports prcoces et prnuptiaux, la fille restant plus souvent vierge jusqu' son mariage. D'aprs une enqute de la Sofres ralise fin 1971, et publie dans [140] l'Express 304 , 40% des jeunes de 15-20 ans disaient avoir dj eu des relations sexuelles. On pourrait s'attendre ce que les catholi301 302
Rapport Simon sur le comportement sexuel des franais, Charron et Julliard,
dition abrge, 1972, 355 p. Ces chiffres varient beaucoup avec l'ge. Ainsi chez les 20-29 ans, seulement 9% des hommes et 25% des femmes ont leur premier rapport sexuel avec l'poux aprs leur mariage. D'aprs statistiques de lI.N.E.D. et Rapport Simon. Les jeunes et l'amour , L'Express du 6-12 mars 1972.
303 304
Pierre Brchon, La famille. Ides traditionnelles, ides nouvelles. (1976)
171
ques, dont la doctrine anti-relations prnuptiales est constamment raffirme par les autorits ecclsiastiques 305 , soient les moins atteints par cette pratique. Or, selon une enqute du Centre Jean Bart, un tiers des fiancs catholiques qui suivent un Centre de Prparation au mariage Paris considrent les relations prconjugales comme normales. Il y a, me semble-t-il, dans ces statistiques la manifestation d'une modification de la perception du mariage. Il est de moins en moins considr comme le dbut de la vie sexuelle complte. Dans l'enqute publie par lExpress, on a galement demand aux jeunes de 15-20 ans : Pensez-vous qu'un homme et une femme vivant ensemble doivent ncessairement se marier ? Ils rpondent ainsi : Oui, srement Cela vaut mieux Pas forcment Non, c'est inutile 17 % 28 % 46 % 9%
45 % 55%
Aux 55% qui avaient choisi les deux dernires rponses, on a alors demand : pourquoi est-ce inutile de se marier ? Les rponses sont trs significatives : - parce qu'il est bon de faire un essai deux avant le mariage - parce que c'est superflu lorsqu'on s'aime vraiment - parce qu'on perd sa libert - parce qu'il ne faut se marier que lorsqu'on a des enfants 48% 26% 19% 16%
305
Lunion sexuelle de deux personnes non maries restera toujours une faute grave , Monseigneur Puech, Prsident de la Commission Episcopale de la Famille, dans Le Monde du 5 septembre 1974. Il ne peut tre question, dans l'thique chrtienne, de mariage l'essai , ni de relations prnuptiales (...). Ces relations prnuptiales ne respectent pas l'amour, ni les personnes en cause , Cardinal Renard, archevque de Lyon, ancien Prsident de la commission piscopale de la famille, interview accorde l'cho-Libert et la Dpche de Saint-Etienne, publie le 13 septembre 1972.
Pierre Brchon, La famille. Ides traditionnelles, ides nouvelles. (1976)
172
La premire et la dernire rponse sont le tmoignage que beaucoup de jeunes ne contestent pas socialement le mariage, mais refusent d'en faire [141] un engagement trop rapide, sans prparation, sans essai 306 . Le mariage serait rserv au moment o on s'engage vraiment, matrialis dans la volont d'avoir des enfants. C'est finalement reconnatre l'importance de l'engagement conjugal, qui ne peut se faire sans avoir prouv sa capacit de vie commune. On voit apparatre dans les deuxime et troisime rponses deux contestations plus fondamentales du mariage, l'une au nom de la libert individuelle, l'autre au nom d'une conception de l'amour qui doit tre le seul lien entre les conjoints. travers ces deux rponses, il me semble que l'on rencontre deux conceptions de l'union libre. Il faut distinguer l'union libre qui se veut fidlit l'un l'autre, fonde sur un amour solide et sans intervention tatique, d'avec l'union libre, sans projet de stabilit dans la relation. Mais ce deuxime type d'union libre semble assez rare. L'union libre elle-mme est assez peu pratique. Peu de gens en France adoptent ce type d'institution familiale (probablement environ 2% de la population). Mais davantage de gens se dclarent thoriquement partisans de l'union libre. Dans l'enqute grenobloise, cite au dbut de ce livre, 10% de la population enqute disaient prfrer l'union libre au mariage. Entre les souhaits et la ralit, pourquoi un tel cart ? Probablement pour plusieurs raisons. Deux me paraissent fondamentales : au plan matriel, pour tout ce qui concerne les avantages sociaux, deux jeunes qui vivent ensemble et veulent lever des enfants ont intrt tre maris. D'autre part, les pressions sociales en faveur du mariage sont fortes : les familles acceptent parfois quelques mois de vie commune entre deux jeunes qui ont un projet de mariage, elles tolrent trs mal que cette situation s'ternise. C'est pourquoi, beaucoup d'adeptes de l'union libre finissent par passer par la mairie , accomplissent la formalit qui satisfait l'environnement social, qui vite que leurs enfants soient dconsidrs cause de la situation matrimoniale de leurs parents.
306
D'aprs l'enqute de la Vie catholique sur la famille (cf. P. VILLAIN, op. cit.) 98% des adultes et 94 % des jeunes qui ont rpondu l'enqute pensent que la fidlit dans le mariage est indispensable ou importante.
Pierre Brchon, La famille. Ides traditionnelles, ides nouvelles. (1976)
173
Les partisans de l'union libre ne contestent gnralement pas le principe de la monogamie ; leur comportement n'est gnralement pas dict par le dsir de multiplier leurs relations sexuelles. Ils ont le plus souvent un dsir de relation durable entre eux. Et l'on rencontre, notamment dans la classe ouvrire, ou dans les milieux intellectuels, de vieux couples vivant en union libre depuis plusieurs dizaines d'annes, des couples unis, stables, fonds sur l'amour. Ce qu'ils refusent dans le mariage, c'est d'abord l'engagement dfinitif qui leur est demand 307 . Selon eux, on ne peut s'engager sur l'avenir. Lavenir [142] est une aventure, il est vivre, on ne peut l'crire l'avance. C'est toujours l'ide anarchiste qu'un contrat ne peut qu'tre provisoire et rvocable. Les deux poux revendiquent leur autonomie. Ils se refusent ce que l'un possde l'autre. Or, le mariage leur parat favoriser cette mainmise de l'un sur l'autre. Ce qu'ils refusent dans le mariage, c'est galement le contrle que la socit entend avoir sur leur amour, sur leur union. Ils refusent cette intrusion de la socit dans leurs rapports inter-individuels. Pour eux, le couple est un dialogue inter-personnel dans lequel la socit n'a pas intervenir. Leur contestation du mariage, c'est finalement la contestation d'une socit qui ne respecte pas la libert des individus, qui cherche toujours se les approprier, mettre la main sur eux, les enfermer dans des cadres, dans des structures. Ce qu'ils dsirent, c'est vivre deux des rapports autorguls et non pas rgis par une institution juridique 308 . Ils
307
308
Voici comment R. SAVATIER, juriste trs oppos l'union libre, considre cet tat de vie : Logiquement, l'union libre veut tre celle o chacun des partenaires entend garder sa libert, c'est--dire ne se lier par aucun devoir. Ni fidlit, ni subordination, ni assistance obligatoire. Tout cela, donn par amour, ne doit durer, dans la pense des amants libres, que ce que durera l'amour. Ces amants ne s'engagent rien pour l'avenir, l'indpendance de tous deux tant sacre. Sur les pages de leur vie, rien n'est crit d'une encre indlbile. Voil ce que serait l'union libre vritable. (Le droit, l'amour et la libert, Librairie gnrale de droit, 1937). Pour Savatier, l'union dite libre ne l'est pas en fait. Car, pour lui, la vraie libert consiste s'engager dfinitivement. La famille lgitime, tant en faveur de l'enfant, doit tre publique et organise. La famille naturelle, btie sur l'gosme des poux, est au contraire occulte et inorganise. Selon Savatier, l'union libre mconnat le fait que toute union vritable, tout contrat engageant des liberts, doit se traduire dans le droit. Il est dans la nature de l'amour de s'appuyer sur une structure juridique qui l'exprime.
Lunion libre se prsente comme un geste de contestation sociale. Elle se veut
libration de la mainmise d'une socit sur ses membres, mainmise qui tait, pour une part, assure par la mainmise d'un conjoint sur l'autre. N'y voir qu'un libertinage immoral ou amoral, c'est renoncer y dcouvrir un ventuel projet moral diffrent qui peut-tre l'habite, celui d'une socit moins contraignante
Pierre Brchon, La famille. Ides traditionnelles, ides nouvelles. (1976)
174
contestent en fait le droit que la socit s'arroge de rglementer la sexualit humaine. Comme tous les hommes, ils ont bien besoin de relations sociales plus larges que le couple, d'une certaine reconnaissance par leur environnement amical de leurs liens privilgis. Mais ils refusent que cette reconnaissance soit officialise, qu'elle soit un acte juridique par lequel l'tat reconnatrait leur union, tout en leur imposant sa propre conception du mariage. Pour eux, rgulation tatique du mariage et libert de l'amour sont inconciliables.
La volont de contestation sociale travers la contestation du mariage est gnralement latente chez les partisans de l'union libre. Mais elle est parfois plus explicite. Il en est ainsi dans ce tmoignage d'un couple vivant en union libre : La famille tant la cellule de base de cette socit et le mariage traditionnel tant l'acte par lequel la socit institue la cellule fondamentale qui constitue ses propres bases, repenser cet acte institutionnel [143] est, par consquent, la premire faon de mettre en chec la socit 309 . Il m'apparat fort symptomatique de retrouver ici, comme chez Reich, la mme conception des rapports famille-socit que chez les traditionalistes. Un marxiste ne pourrait admettre une telle dclaration. Pour lui, la premire faon de mettre en chec la socit, de transformer les rapports sociaux, c'est de renverser le gouvernement, expression politique de la classe dominante.
Les communauts
Contestation de la rgulation tatique du mariage, l'union libre n'est gnralement pas une contestation du triangle familial premre-enfant, ni de la monogamie. Pour trouver, en acte, ce type de contestation, il faut considrer les communauts, et plus prcisment certains types de communauts, car sous le vocable de communaut, on
o la conscience et la libert des personnes pourraient s'exprimer davantage. Pierre DELOOZ, le Refus du mariage, dans un numro d'changes consacr aux couples informels , n 117, 1974, p. 4. Monique Roy et Jean MARDEL, Cet amour que nous vivons, changes, les couples informels , op. cit., p. 13.
309
Pierre Brchon, La famille. Ides traditionnelles, ides nouvelles. (1976)
175
range des choses trs diffrentes. Cela va du groupe de couples qui se runissent frquemment pour rflchir sur leur vie, partager les soucis, se dtendre ensemble, passer des vacances en commun, organiser des services communautaires : garderie des enfants, lavage du linge, etc., prendre en charge collectivement l'ducation des enfants du groupe, jusqu'aux communauts d'habitat commun. Dans certaines communauts, le couple stable garde son importance et les enfants sont d'abord ceux des parents avant d'tre ceux du groupe. La communaut est alors un groupe intermdiaire, un lieu de relation plus large que le couple qui permet d'viter que le couple ne soit plong seulement dans la socit, dans la foule solitaire. Celui-ci a un groupe intermdiaire pour s'exprimer et se situer en vrit avec et par rapport d'autres. Dans ce type de communaut, il s'agit de recrer, autour de la cellule familiale, le milieu de vie, la communaut de village qui existait autrefois, alors que de nos jours, la socit de consommation individualise les familles. Max Delespesse, thologien canadien, dveloppe cette ide dans son livre Jsus et la triple contestation : tradition, famille, proprit 310 . Pour lui, la famille est dpersonnalise par la socit actuelle : tout favorise la consommation individuelle, le travail est abrutissant, les gens sont nerveux. Quand on rentre dans son foyer, on n'a plus la force de partager, de s'exprimer en famille, on regarde la tlvision. Or, on continue esprer dans la famille, attendre le bonheur de la [144] vie familiale ; cette contradiction fait souvent craquer la famille. Pour Delespesse, l'homme a besoin d'un groupe intermdiaire, d'une communaut, capable de limiter les agressions de la socit et de la transformer peu peu. La communaut devrait d'abord sortir le mnage de son isolement affectif , spirituel , conomique et politique , sortir les jeunes de leur isolement de gnration 311 . Ain310 311
ditions Fleurus. Novalis, 1972. Max DELESPESSE, op. cit., pp. 97-100. Dans la suite de son livre, Delespesse considre quelle a t l'attitude de Jsus l'gard de la famille. Il rappelle quelques paroles vangliques qu'on oublie trop facilement, parce qu'elles montrent que la famille n'tait pas pour Jsus un absolu. Si Jsus a insist sur la permanence du couple, il a insist encore davantage sur l'clatement de la famille vers la communaut. (p. 113). En effet, le Christ affirme la primaut de la construction de l'glise sur les liens familiaux. Quitte ta famille pour entrer
Pierre Brchon, La famille. Ides traditionnelles, ides nouvelles. (1976)
176
si, les jeunes pourraient rencontrer d'autres adultes que leurs parents, ils auraient de multiples identifications possibles des adultes diffrents les uns des autres. Finalement, pour Delespesse, la condition de survie de la famille nuclaire, c'est prcisment qu'elle puisse s'inclure et se fortifier dans une communaut plus large. L'idal de la famille, havre de paix, refuge goste, ne peut que conduire l'chec. La seule chance de russite pour la famille, c'est d'tre une structure ouverte, une structure relationnelle. Tout comme Max Delespesse, le philosophe Franois Chirpaz 312 estime que la revendication communautaire est une consquence de l'isolement des familles conjugales. Les familles sont aujourd'hui moins dpendantes de la parent, mais elles ne sont pas pour autant libres. La cellule familiale est limite un espace triqu, celui de l'appartement urbain ; les enfants ne dpendent que de leurs parents alors que la famille rurale permettait des rapports avec d'autres adultes. L'espace et le milieu relationnel de la famille sont aujourd'hui trop restreints, la famille vit sur elle-mme par manque d'apports extrieurs. Autrefois, l'homme pouvait rsoudre ce problme en fuyant sa famille aprs son travail pour se rfugier au caf. De nos jours, on fuit l'appartement urbain triqu pour la rsidence secondaire, si on en a les moyens. Ceux qui veulent vivre des relations communautaires refusent ces tentations. Ils fuient un espace humain appauvri pour un espace o on puisse vivre une vie autre, des relations plus humaines. [145]
Parmi les communauts avec habitat commun (ce qui est assez rare), il faut encore distinguer. Dans certaines communauts, le couple garde sa structuration propre, dans d'autres, la communaut devient rellement une grande famille sans couples stables. Les relations sexuelles ne sont en principe pas rglementes. Tout homme peut prtendre avoir un rapport sexuel dans la communaut ecclsiale. C'est l ta vraie famille. Finalement cest en prnant paradoxalement l'clatement de la famille dans la communaut que Jsus a maintenu le couple humain dans son intgrit et a donn la famille ellemme un quilibre librateur. (Delespesse, op. cit., p. 118). F. CHIRPAZ, La relation privilgie de l'amour dans l'institution familiale , dans Couples et familles dans la socit d'aujourd'hui, 59e semaine sociale Metz, Chronique Sociale de France, 1972, p. 154.
312
Pierre Brchon, La famille. Ides traditionnelles, ides nouvelles. (1976)
177
avec une femme de la communaut et inversement. Seuls comptent les dsirs de chaque individu, un moment donn. Il semble bien que les communauts sexuelles soient gnralement assez prcaires, assez phmres. Dans Esprit, en mars 1971, une femme a racont l'exprience qu'elle avait faite dans une communaut sexuelle. Ce tmoignage, histoire d'une tentative , est suivi par plusieurs commentaires. La communaut sexuelle en question runissait des hommes et des femmes de milieux cultivs. Ce qu'ils voulaient au dpart, c'tait vivre dans une structure capable de satisfaire tous les besoins affectifs et sexuels de ses membres. Ils dsiraient vivre en groupe, sans frustration. Est-ce un projet possible ? La vie en socit, la relation humaine ne supposent-elles pas que l'on accepte une certaine frustration personnelle pour tenir compte d'autrui ? Ils voulaient vivre en transparence, sans crans, pouvoir tout se dire, tout accepter de l'autre, se refuser par principe brimer autrui, se refuser tre possessif par rapport son partenaire sexuel. De fait, les drames ont t nombreux. Ils ont dcouvert que, malgr leurs intentions, ils acceptaient mal qu'un autre membre de la communaut ait des rapports sexuels avec leur partenaire habituel. Les conflits, ns des rapports sexuels au sein du groupe, sont devenus de plus en plus nombreux et importants. La communaut s'est finalement dissoute. Cet chec peut s'expliquer de plusieurs faons. On peut estimer que le projet n'est pas en soi irralisable mais qu'il est en fait trs difficile russir dans la mesure o tous les membres de la communaut avaient eu une ducation bourgeoise, dans une famille bourgeoise. Cette ducation marque les individus. Malgr leurs intentions de se montrer non possessifs, ils taient souvent jaloux les uns des autres. Ils voulaient vivre la communaut sexuelle alors qu'ils taient encore dpendants d'une ducation en vue de la relation monogame exclusive. On peut aussi estimer que l'chec est d au manque d'quilibre psychologique des membres de la communaut. Ils avaient presque tous vcu auparavant une exprience malheureuse de mariage. Ils n'avaient pas russi tablir deux une relation vritable ; ils sont venus la chercher dans la communaut. On peut se demander si leur projet communautaire n'a pas t une faon de fuir la difficult de la relation conjugale, une tentative pour rsoudre collectivement leurs problmes personnels. Mais on peut galement expliquer cet chec de la tentative par la conception de l'amour qui y prsidait. L'amour ne cherche-t-il pas la dure ? N'est-ce pas une de ses dimensions importantes ? Si l'amour cherche la dure, tout projet de vie collective qui se refuse par principe se donner les moyens pour que l'amour puisse durer, n'est-il pas vou l'chec ? Je ne veux pas trancher cette question dlicate, mais elle me semble devoir tre pose. Pour l'instant, en tout cas, la communaut sexuelle semble rarement apporter le bonheur ses membres, elle semble rarement tre un tat de vie stable.
Pierre Brchon, La famille. Ides traditionnelles, ides nouvelles. (1976)
178
Je ne pense pas m'tre loign du sujet de ce chapitre en y traitant des relations prnuptiales, de l'union libre et des communauts. Ces trois formes de contestation, en acte, de l'institution familiale, me semblent [146] souvent relever d'une mentalit anarchisante. On y trouve le mme refus des interdits sexuels, le mme refus d'une intervention de l'tat dans le mariage et la famille, le mme refus de faire de la famille une structure tablie, toute faite, codifie une fois pour toutes. Qui dit contestation de la famille dit en effet nouvelle forme de vie, nouvelle structure familiale puisque, tant que la socit continue, il faut bien que, d'une faon ou d'une autre, les fonctions qu'assume, plus ou moins bien, la famille, soient remplies. Il faut bien que des femmes mettent au monde des enfants si l'on veut que la socit se reproduise, il faut bien qu'une structure d'ducation permette leur insertion sociale et leur intriorisation des valeurs, il faut bien enfin que les besoins affectifs des individus trouvent se satisfaire. L'anarchisme familial, ce n'est pas le nihilisme, mais c'est une transformation assez radicale de la famille, sa ngation en tant que structure institutionnelle au profit d'une famille toujours faire, crer, dans la continuelle nouveaut des rapports entre les hommes ; si les hommes et les femmes sont libres et autonomes, il leur revient d'autorguler leurs rapports familiaux, au lieu d'avoir se couler dans des institutions donnes. L'anarchiste veut toujours rinventer la structure o il volue, que ce soit la structure tatique, ecclsiale ou familiale. En tout cas, le mariage monogame et la famille traditionnelle lui semblent inadquats pour exprimer l'amour dont il veut vivre. Amour et institutions seraient irrconciliables. C'est contre ce postulat que les personnalistes ont ragi.
Pierre Brchon, La famille. Ides traditionnelles, ides nouvelles. (1976)
179
[147]
LA FAMILLE. Ides traditionnelles, ides nouvelles.
Quatrime partie
Personnalisme et famille
Retour la table des matires
Pierre Brchon, La famille. Ides traditionnelles, ides nouvelles. (1976)
180
[149]
LA FAMILLE. Ides traditionnelles, ides nouvelles.
Quatrime partie. Personnalisme et famille
Chapitre 8
La rconciliation entre amour et institution
Retour la table des matires
Lorsque l'on parle du personnalisme, une rfrence s'impose : Emmanuel Mounier. Il a t le catalyseur de la pense personnaliste autour de la revue Esprit, cre en octobre 1932. C'est donc d'abord chez Mounier que nous chercherons une conception personnaliste de la famille. Comme pour les traditionalistes, les marxistes et les anarchistes, la pense personnaliste sur la famille ne peut se sparer d'une conception de la socit. Tout systme de pense cherche la cohrence et donc ses conceptions familiales sont relies tout un ensemble de penses structures.
Pierre Brchon, La famille. Ides traditionnelles, ides nouvelles. (1976)
181
Emmanuel Mounier
Retour la table des matires
Comment Mounier considre-t-il la socit des annes 1930-1935 ? Quelle est la voie qu'il propose pour un renouveau social, pour une socit plus humaine ? Si l'on regarde la socit, on voit une multitude de groupes et d'organisations, mais point de communaut. Dans notre monde dominent aujourd'hui l'indiffrence et l'anonymat. Chaque personne s'est peu peu abandonne l'anonymat du monde de lon. Le monde moderne, c'est cet affaissement collectif, cette dpersonnalisation massive 313 . Malgr la communication plus grande que devraient assurer entre les hommes la [150] facilit des transports et la possibilit accrue de transmettre les ides, il n'y a plus de relle communication entre les hommes : Il n'y a plus de prochain, il n'y a que des semblables. Couples mornes, o chacun ctoie le partenaire dans un consentement vulgaire et distrait des habitudes standards. Camaraderies incertaines, biologiques, groupes par des circonstances ou des fonctions, non par des vnements ou des choix. Gele fade des lecteurs de Paris Soir, et tous ces prcipits mls dans une grande ville, suspendus, instables : une goutte de hasard les a agglomrs, une goutte de hasard les dissipera. Dsolment de l'homme sans dimensions intrieures, incapable de rencontres 314 . Le monde de l'on, ce sont les socits de masse, les socits impersonnelles , dpersonnalises o les hommes ne sont plus que les lments d'un nombre , socits individualistes qui sont propices l'avnement des tyrans. La plus exacte ralisation de cet homme dpersonnalis est peut-tre le proltaire du XXe sicle, perdu dans la servitude sans visage des troupeaux humains, des grandes villes, des immeubles-casernes, des partis aveugles, de la machine administrative et de la machine cono313
314
Emmanuel MOUNIER, Rvolution personnaliste et communautaire, dans Oeuvres de Mounier, Tome 1, Seuil, p. 186. [Livre disponible dans Les Classiques des sciences sociales. JMT.] E. MOUNIER, op. cit., p. 186.
Pierre Brchon, La famille. Ides traditionnelles, ides nouvelles. (1976)
182
mique imperturbable du capitalisme, quand il s'est laiss submerger au surplus par la mdiocrit petite bourgeoise, au lieu de prendre conscience de sa misre et de sa rvolte 315 . Derrire ces traits on peut reconnatre les dmocraties librales et parlementaires d'Occident, ces fausses dmocraties puisqu'elles ne promeuvent pas la responsabilit des personnes. ct de ces socits impersonnelles, on rencontre les socits en nous autres dont le plus bel exemple est le fascisme, socits non plus passives et amorphes mais mues par une volont collective. La personne n'y a aucune libert, elle n'existe que dans le nous ; il s'tablit alors, de la part de chaque membre de la collectivit, une sorte de dlgation de personnalit. Ils se dmettent de toute initiative, de toute volont propre, pour s'en reposer sur un homme qui voudra pour eux, jugera pour eux, agira pour eux 316 . Dans ces socits la personne ne saurait s'panouir, car elle se perd dans l'exaltation collective, elle n'est pas autonome, responsable et libre. La personne ne pourra s'panouir que dans une socit communautaire, fonde sur l'amour et non pas sur la contrainte ou l'intrt. Mounier sait trs bien qu une telle communaut, rve par les anarchistes, chante par Pguy dans sa cit harmonieuse, n'est pas de ce monde 317 . Mais parfois, dans un amour, avec une famille, quelques amis, nous frlons [151] cette communaut personnelle 318 . Cette communaut existe lorsque l'autre devient pour moi un prochain, un toi , une deuxime personne et non plus un lui , une troisime personne et que je suis pour lui un je . Le rapport du je au tu est l'amour, par lequel ma personne se dcentre en quelque manire et vit dans l'autre tout en se possdant et en possdant son amour. L'amour est l'unit de la communaut 319 . Beaucoup de familles souhaitent vivre selon ce modle communautaire, mais elles ne sont souvent que de fausses personnes collectives fondes sur le mpris, ou la scurit, ou l'habitude vitale, ou le donnant-donnant 320 . Ainsi la
315 316 317 318 319 320
E. MOUNIER, op. cit., p. 197. E. MOUNIER, op. cit., p. 198. E. MOUNIER, op. cit., p. 202. E. MOUNIER, op. cit., p. 203. E. MOUNIER, op. cit., p. 193. E. MOUNIER, op.cit., p. 204.
Pierre Brchon, La famille. Ides traditionnelles, ides nouvelles. (1976)
183
rvolution personnaliste et communautaire est ncessaire mais c'est une voie trs difficile qui peut se raliser d'abord au niveau de petits groupes et devrait s'tendre progressivement la dimension de la socit. La famille devrait avoir un rle jouer dans cette rvolution communautaire, car elle est, selon Mounier, l'un des lieux o peut s'exprimenter la communaut. En effet, la famille est le lieu privilgi de la vie prive, o se vivent les relations proches, o les individus font l'exprience que l'on se trouve en se donnant. La vie prive est le champ d'essai de notre libert, la zone d'preuve o toute conviction, toute idologie, toute prtention doit traverser l'exprience de la faiblesse et dpouiller le mensonge, le vrai lieu o se forge, dans les communauts lmentaires, le sens de la responsabilit. En cela elle est aussi indispensable la formation de l'homme qu' la solidit de la cit 321 . Pour Mounier la famille a une mission, elle est en soi ncessaire, elle lui semble tre le milieu humain optimum pour la formation de la personne 322 , une communaut dirige vers l'accomplissement mutuel de chacun 323 , un lieu o les personnes peuvent se promouvoir lune par l'autre. Mais Mounier n'idalise pas la famille, il s'en prend d'ailleurs en termes trs vifs tous les fanatiques de la dfense de la famille qui confondent un mode passager de famille dans une socit donne avec les valeurs permanentes qu'on peut reconnatre la famille 324 . L'volution de la socit leur parat condamner l'institution familiale. Pour la sauver, ils essaient de dfendre des murs et des pratiques dpasses, condamnes par les [152] mutations sociales. Ainsi ils dfendront l'artisanat familial (surtout pour la femme), la maison familiale, l'autoritarisme paternel (pouss parfois jusqu'au droit de regard sur la profession et le mariage des enfants). Pour Mounier, il faut avoir l'esprit de ne pas confondre conservatisme et fidlit, et, la famille, au lieu de se compromettre dans des restaurations acadmiques, trouvera
321 322 323 324
E. MOUNIER, Manifeste au service du personnalisme, octobre 1936, dans Oeuvres, tome 1, p. 559. E. MOUNIER, op. cit., p. 562. E. MOUNIER, op. cit., p. 566. Le cardinal Villot, secrtaire d'tat au Vatican, dans sa lettre sur la famille (adresse la Semaine sociale de Metz, dj cite), cherche aussi faire cette distinction entre valeurs permanentes et formes changeantes.
Pierre Brchon, La famille. Ides traditionnelles, ides nouvelles. (1976)
184
dans des formes neuves un affermissement de ses structures fondamentales 325 . Mounier ragit et se dmarque par rapport aux traditionalistes, aux dfenseurs inconditionnels de l'institution familiale dans ses formes passes. Pour lui, ces formes sont mauvaises et doivent tre revivifies pour pouvoir servir la personnalisation des individus. Mounier critique en effet trs vivement la mentalit que l'on retrouve dans nombre de familles de la socit capitaliste et petite bourgeoise de l'entre-deux guerres. Il faut admettre, estime-t-il, une bonne partie de la critique marxiste de la vie prive et des relations familiales dans la mesure o la bourgeoisie a effectivement faonn et dform les valeurs de la vie prive, la transformant en refuge empoisonn des influences ractionnaires , en faisant un milieu sans amour, un monde de l'avarice et de l'indiffrence petite bourgeoise, un monde goste qui s'est forg une religion d'appartement bonhomme et indulgente, une religion des dimanches, une thologie des familles 326 . Ainsi la famille, appele tre une structure personnalisante, ne remplit pas automatiquement son rle. Comme toute socit, la famille peut engendrer le conformisme, l'hypocrisie et l'oppression 327 . De fait, aujourd'hui, la famille est bien souvent un rgime cellulaire , une prison 328 . Il faut avoir le courage de dire que la famille, et la meilleure souvent, tue spirituellement autant et plus peut-tre de personnes par son troitesse, ou son avarice, ou ses peurs, ou ses automatismes tyranniques que n'en fait sombrer la dcomposition des foyers 329 . La bourgeoisie dcadente, qui ne manque jamais de faire l'apologie des vertus familiales , a en fait transform la famille en une socit commerciale , o les intrts d'argent sont prdominants : L'amour s'y dtermine au niveau de la clas325 326 327 328
E. MOUNIER, Manifeste au service du personnalisme, op. cit., p. 563. E. MOUNIER, op. cit., p. 558 ; Mounier reconnat donc l'influence de la classe dominante sur la famille et sur la religion, y compris sur l'expression de la foi. E. MOUNIER, op. cit., p. 563. Mounier fait ainsi un jeu de mot sur cellule-cellulaire . Il admet bien que la famille soit une cellule sociale , car elle est la premire des socits de l'enfant (Cf. Le personnalisme, dans Oeuvres, tome 3, op. cit., p. 515) mais il dnonce une famille qui est trop souvent cellulaire , pression touffante pour les personnes. E. MOUNIER, Manifeste au service du personnalisme, op. cit., p. 563.
329
Pierre Brchon, La famille. Ides traditionnelles, ides nouvelles. (1976)
185
se et au volume de la dot, la fidlit au code de la considration et du prestige, les naissances aux exigences du confort. [153] Le mariage y oscille du virement de compte l'extension d'une affaire, de l'opration publicitaire au renflouement. La femme, toujours elle, sert de marchandise. Les mmes qui s'acquittent ainsi de leurs fidlits aux traditions entretiennent des salaires ouvriers qui obligent la femme faire sa pleine journe d'usine pour nourrir les enfants dont on l'honore ; ou des salaires fminins qui poussent quelque forme de prostitution la plus grande partie du proltariat fminin des villes 330 . Nos bourgeois qui veulent dfendre la famille feraient bien, rappelle Mounier, de ne pas oublier les responsabilits crasantes d'une conomie inhumaine et d'une morale pharisaque descendue des classes riches. Mounier est donc trs virulent, autant que Marx, dans la dnonciation de l'alination de la famille par la bourgeoisie, alination qui touche aussi bien, mais pour des raisons diffrentes, la famille du proltaire que la famille du bourgeois. La famille bourgeoise constitue en socit close fait preuve dans les affaires d'un juridisme avare et troit. Cellule goste, elle se fait passer pour vertueuse, alors qu'en fait elle opprime ses membres les plus faibles, elle est une prison obscure o des personnes innombrables sont tues petit feu sous la protection de la loi 331 .
S'il critique avec vhmence et passion la famille bourgeoise de l'entredeux guerres, Mounier ne prtend pas du tout que la vie familiale doit tre dsincarne ou indpendante de la vie sociale. Il n'est pas partisan d'un
anarchisme familial 332 . Simplement il veut souligner que la famille dpasse toujours les dterminations biologiques et sociales dans lesquelles elle est incarne. En ce sens elle est une aventure offerte pour la personnalisation des individus. Pour Mounier, l'intrieur de la famille, communaut de personnes, la femme doit trouver une place gale celle de son mari, alors qu'elle est encore bien souvent tenue en infriorit. Mounier ne fait pas, comme Engels, du travail fminin gnralis la condition ncessaire de la libration de la femme, mais il estime que le travail de la jeune fille, grce
330 331 332
E. MOUNIER, op. cit., p. 564. E. MOUNIER, op. cit., p. 565. D'ailleurs Mounier reconnat que l'autorit est ncessaire dans la famille comme dans toute socit, mais qu'elle est un service plus qu'un rapport de droit strict.
Pierre Brchon, La famille. Ides traditionnelles, ides nouvelles. (1976)
186
l'indpendance financire qu'il procure, lui permettrait d'tre plus libre dans le choix d'un poux et viterait son dsuvrement. Une fois marie, le travail pourra constituer un excellent antidote contre l'gosme du
couple 333 jusqu' la maternit. Ensuite, l'enfant devant normalement occuper au moins en partie la femme, le travail mi-temps, voire une occupation bnvole, peuvent tre des solutions lui vitant de perdre le contact avec le monde extrieur et d'tre limite son foyer. Pour [154] Mounier, l'inhumanit du rgime actuel, qui contraint la femme pauvre au travail forc, et l'arrache son foyer, les excs d'une certaine conception marxiste, ne justifient nullement la sotte raction d'un retour au foyer matriellement conu et systmatiquement appliqu, qui couperait la femme
plus compltement du monde 334 . La prsence de la femme au foyer serait moins ncessaire si l'outillage mnager tait plus rpandu, si le mari acceptait davantage de charges mnagres, si on cherchait moins le raffinement du confort bourgeois, si on ne confondait pas trop souvent intimit du couple et promiscuit permanente. L'idologie de la femme au foyer , trs prise dans les milieux catholiques et bourgeois de l'poque, n'est pas mnage. Ces milieux semblent tre la cible favorite de Mounier, ce qui n'est pas tonnant dans la mesure o, chrtien, son action vise en particulier rechercher les voies d'une foi plus authentique et plus vivante qui aurait dpouill les vieilles reliques d'une religion embourgeoise. Selon Mounier l'tat doit garantir les droits de la femme dans la famille ; il doit aussi protger l'enfant contre des familles trop possessives. Toutes les institutions qui participent l'ducation de l'enfant que ce soit la famille, l'cole, l'tat doivent respecter la libert de l'enfant, doivent viter l'touffement de sa personnalit au nom d'intrts gostes de groupe. Mais l'ducation n'est pas pour autant conue par Mounier comme le simple veil des instincts naturels de l'enfant, comme le simple dveloppement de sa crativit et de sa spontanit. Pour Mounier, l'ducation est interventionniste , elle doit former une personne. Dans ce but, il faut trouver un quilibre entre ducation dans le milieu familial et participation des groupes o l'enfant pourra retrouver ses camarades. Donc, si l'tat doit reconnatre les droits de la famille puisqu'elle est une
333
334
E. MOUNIER, Manifeste au service du personnalisme , op. cit., p. 567. L'gosme du couple et le caractre clos de la famille apparaissent Mounier comme un danger constant de la famille contre lequel il faut lutter. La communaut familiale risque toujours de se dgrader en refuge touffant. [Livre disponible dans Les Classiques des sciences sociales. JMT.] E. MOUNIER, op. cit., p. 567. Lorsque Mounier parle des excs d'une certaine conception marxiste, il se rfre probablement aux positions du P.C.F. de l'poque. Nous avons vu dans le chapitre 5 que les conceptions actuelles du P.C.F. ne font pas du travail fminin un absolu puisque le P.C.F. revendique avant tout la possibilit effective pour la femme de choisir le travail ou les tches mnagres.
Pierre Brchon, La famille. Ides traditionnelles, ides nouvelles. (1976)
187
communaut naturelle de personnes , il doit aussi limiter son pouvoir et viter ses abus possibles sur les membres de la famille. Mounier revient sur les problmes de l'ducation dans son Trait du caractre (1946). Il souligne que la famille est pour l'enfant un donn, quelque chose que l'on ne choisit pas et qui ne s'change pas. Milieu permanent de relations, la famille une forte influence sur les opinions de l'enfant. Mais elle n'est ni la source de tous les maux de l'adulte, ni une ralit parfaite et sans tare. Psychologiquement, on peut analyser la famille comme plusieurs communauts articules : la communaut parents-enfants, la communaut fraternelle, la communaut conjugale. Les rapports parents-enfants sont ceux qui sont le plus dterminants sur la personnalit de l'enfant. Pendant l'enfance, les parents apparaissent comme porteurs d'idal et source d'affection dsintresse. la pubert, les parents perdent leur caractre mythique, ils cessent d'tre considrs par l'enfant comme des dieux infaillibles. Cette remise en cause est normale, les parents doivent l'accepter et mme la favoriser. Pour cela, ds l'enfance, leur autorit et leur affection doivent tre modres : ni autoritarisme sans amour, consistant prendre plaisir plier un tre faible ses caprices ( le mtier d'ducateur, qui est un mtier
d'amour, est envahi [155] de sadiques lgers 335 ), ni affection accaparante ou projection sur les enfants des dsirs et des projets avorts des parents. L'enfant ne doit pas se sentir nglig ou abandonn par ses parents mais, l'inverse, il ne doit pas tre protg et contrl au point de n'avoir plus aucune initiative personnelle. Le style ducatif des parents est dterminant pour la personnalit de l'enfant qui se structure trs tt. Une mre nerveuse, qui est tour tour cajoleuse et exigeante, rendra l'enfant semblable elle-mme. Un pre dur forme des tres pour toujours tremblants ou rvolts 336 . Le rapport fraternel est aussi dans la famille un rapport important pour la personnalit de l'enfant. Rapport d'galit, il est la fois rapport de camaraderie et de concurrence. La rivalit apparat notamment au cours des premires annes dans l'accs l'affection des parents. Ainsi, lors d'une nouvelle naissance, frres et surs sont jaloux du nouveau-n qui est l'objet de toutes les attentions parentales. Il faut apprendre l'enfant accepter que l'affection de ses parents soit partage avec d'autres, avec ses frres et surs. Mounier rappelle aussi que la composition de la socit fraternelle influence la personnalit. Ainsi la personnalit d'un enfant sera diffrente selon qu'il est fils unique ou qu'il aura plusieurs frres et surs, selon que
335 336
E. MOUNIER, Trait du caractre, dans Oeuvres, tome 2, p. 99. E. MOUNIER, op. cit., p. 102. On est l dans l'ordre de la description plus que de la thorie gnralisatrice. Reich dirait : la structure familiale autoritaire, qui est la rgle gnrale de nos socits, forme toujours des tres tremblants.
Pierre Brchon, La famille. Ides traditionnelles, ides nouvelles. (1976)
188
son frre ou sa sur sera de sexe oppos. Les liens plus ou moins forts la parent tendue auront eux aussi leur influence, rendant les enfants plus ou moins sociables, plus ou moins marqus par les traditions familiales. Les problmes relationnels et psychologiques du grand adolescent et du jeune adulte ne s'arrteront pas avec la sortie du milieu familial ; la cration d'un nouveau foyer est dpendante de l'ducation reue auparavant. Le caractre de la personne est modifi par ses nouveaux rapports au sein du couple. Puis viendront les problmes d'adaptation du couple l'enfant ; les parents devront accepter leur tour l'mancipation de leurs enfants.
La famille, tissu de relations toujours en volution, faonne donc en permanence la personnalit de ses membres, de leur naissance leur mort. Mais la famille n'est pas pour autant une puissance d'automatisme , elle n'est pas porteuse pour l'individu de fatalits inluctables, elle lui apporte ce qu'il a choisi de la faire, et s'il le veut, elle est l'ducatrice de sa libert 337 . Donc, pour Mounier, la famille peut tre une structure personnalisante, elle peut tre une communaut de personnes. Mais cela ne va pas de soi. La famille ne remplira sa vocation que si des personnes libres et responsables le veulent bien. D'autre part, les personnes devront lutter contre la lourdeur des mentalits familiales, des habitudes petites bourgeoises. La famille n'est pas un donn pur. On nat dans une famille imparfaite, parfois touffante ; il faut savoir se librer de ce carcan [156] sans pour autant dnier la famille toute valeur. Mme si son passif historique est lourd, la famille n'est pas qu'une valeur ractionnaire. Elle a un sens, elle peut tre un tremplin pour une rvolution personnaliste et communautaire, si elle cesse d'tre l'opium de la bourgeoisie . Donc pour Mounier, la famille est influence par l'conomique et le social, mais elle n'est pas entirement dtermine. Il n'adopte pas une conception de la socit o la superstructure s'explique toujours par l'infrastructure. Pour Mounier, la superstructure familiale a sa raison d'tre, a sa valeur propre, a son autonomie. Si la famille est actuellement aline par la bourgeoisie, c'est en vertu d'un dsordre historique, et non pas cause d'une loi sociologique qui postule que les appareils idologiques sont toujours monopoliss par la classe dominante. Donc Mounier n'ap-
337
E. MOUNIER, op. cit., p. 107.
Pierre Brchon, La famille. Ides traditionnelles, ides nouvelles. (1976)
189
plique pas une thorie marxiste mais ses analyses historiques rejoignent celles des marxistes.
Gabriel Madinier et Gabriel Marcel
Retour la table des matires
Mounier n'est pas le seul personnaliste avoir rflchi sur la famille. D'autres philosophes en parlent, notamment Gabriel Madinier et Gabriel Marcel. Gabriel Madinier prolonge dans Conscience et amour, dont le soustitre est Essai sur le nous, la pense d'Emmanuel Mounier sur les relations inter-personnelles. Mounier affirmait que la communaut personnelle est rapport entre un je et un tu , c'est--dire fonde sur l'amour. Madinier applique cette problmatique au couple conjugal qu'il considre comme un nous presque parfait. Dans le couple, l'amour ralise aussi compltement qu'il est possible des tres de chair et de sang la transformation du lui en toi 338 . Ainsi la personne peut faire l'exprience du nous , du deux en un . Ce nous est encore plus complet dans la famille lorsque de nouveaux toi sont suscits par les poux et que l'ducation par les parents suscite et promeut de nouvelles personnes. L'amour l'intrieur de la famille ne sera pas goste, si dans ce groupe limit, nous aimons de manire promouvoir les personnes du groupe. La famille n'est donc pas automatiquement un foyer clos. Tout dpend de la manire dont vivent les membres de la famille. Pour Madinier, la socit est avant tout fonde sur des rapports juridiques, mme si le but idal et [157] utopique que se proposent les hommes est de construire une socit fonde sur l'amour. Dans la socit, on ne peut chercher l'amour que par la mdiation de la justice, de la raison, d'un certain ordre juridique aussi juste que possible. La justice sociale va donc chercher concilier les oppositions entre les hommes, la justice cre la scurit et l'ordre social . Mais le but atteindre c'est une socit base sur l'amour. La
338
Gabriel MADINIER, Conscience et Amour, 1938, 3e dition 1962, P.U.F., p. 119.
Pierre Brchon, La famille. Ides traditionnelles, ides nouvelles. (1976)
190
famille est une des rares communauts o l'amour prime sur la justice. La justice y apparat peu car elle n'est pas ncessaire, lorsque l'amour domine. Elle n'est l que comme le dessin virtuel de ce qui ne doit pas tre transgress 339 . Donc, pour Madinier, la structure juridique de la famine n'a pas d'importance lorsqu'on s'aime effectivement. A la diffrence du corps social, l'unit du couple ne repose pas sur un ordre juridique, mais sur l'amour des poux. Madinier propose un certain quilibre entre l'amour et l'institution, quilibre qui tait ni aussi bien par les traditionalistes que par les anarchistes. Dans la famille, l'amour est premier et dernier, il englobe et dpasse la structure juridique destine rappeler, si ncessaire, ce qui ne doit pas tre transgress, pour que l'amour soit authentique. En 1954, dans La conscience morale, Gabriel Madinier se demande comment se forme la conscience morale de la personne humaine 340 . Pour lui, la famille en est le milieu privilgi, mais pas exclusif dans la mesure o toutes les relations sociales de l'enfant, donc aussi ses relations avec le groupe de ses contemporains , concourent la formation de sa conscience morale. Nanmoins la responsabilit de l'ducation incombe avant tout la famille. L'ducation morale se fera d'abord par l'obissance de l'enfant ses parents 341 . Ainsi, il saura ce qui est permis et dfendu, ce que ses parents considrent comme bien et mal pour lui. Progressivement l'enfant devra se forger son propre jugement c'est--dire savoir par lui-mme ce qui est bien et mal, il devra dcider ce qu'il s'autorise et s'interdit. Donc, aprs avoir us d'autorit, les parents devront chercher faire rflchir l'enfant, le faire raisonner sur ce qui est moral et ne l'est pas. Mais l'acquisition de sa conscience morale dpendra aussi du milieu social qui impose d'autorit certaines conceptions , des exemples qu'il recevra de ses parents et de son entourage. Ainsi la famille sera pour l'enfant le centre d'intgration d'influences diverses, le groupe restreint et intime, o la nature a fait le dvouement joyeux, o, objet d'une sollicitude de tout instant, l'enfant lentement se dtache de ses parents et conquiert son autonomie . Madinier souligne ainsi d'un point de vue
339 340 341
G. MADINIER, op. cit., p. 119. G. MADINIER, La conscience morale, P.U.F., 4e dition 1963, pp. 100-104. Madinier ne craint pas comme Reich le refoulement du dsir chez l'enfant.
Pierre Brchon, La famille. Ides traditionnelles, ides nouvelles. (1976)
191
philosophique ce [158] que psychologues et sociologues 342 s'accordent reconnatre : la famille est un des lieux privilgis de la formation de la personnalit, un des lieux o l'enfant se socialise et intriorise les valeurs que lui propose son environnement.
Ce rapprochement entre philosophie et sciences humaines ne conviendrait probablement pas Gabriel Marcel. En effet, selon lui, la ralit fami-
vu crateur 344 . C'est une dcision familiale, c'est un acte spirituel qui ne saurait se prendre en fonction de l'environnement social, par exemple en fonction des problmes dmographiques mondiaux. G. Marcel regrette qu'en matire familiale on ait toujours tendance dresser des rquisitoires ou des professions de foi au lieu d'approfondir des expriences. Mais il pense que l'on est en face d'une crise de la famille, dans la mesure o les divorces se multiplient ainsi que les pratiques abortives. Il part en guerre contre l'esprit des moralistes sociologues qui prnent l'individualisme et l'assouplissement de la structure familiale. Si la famille est en crise, c'est parce que notre civilisation perd le sens du sacr, d'un accomplissement d'ellemme au-del d'elle-mme. Normalement la famille devrait tre une valeur et une prsence ; elle est une valeur dans la mesure o l'on est fier d'appartenir telle famille, o l'on est valoris par cette appartenance qui donne des assises intrieures . Elle est une prsence dans la mesure o elle est ressentie comme un lment protecteur dans un monde menaant et
liale 343 dpasse toujours ce que peuvent en dire les sciences humaines. Les choses humaines doivent tre traites humainement et non pas par la mthode scientifique. L'homme est un mystre que la science ne peut lucider car l'observateur y est intimement impliqu. De la mme manire, Gabriel Marcel parle d'un mystre familial . Je ne peux parler de la famille comme d'un problme, comme d'une ralit qui me serait extrieure. Un mystre ne peut s'apprhender que par la rflexion et le tmoignage sur ce que l'on vit. La famille ne peut se rationaliser : on ne dcide pas d'avoir un enfant comme on dciderait d'un achat important. Car la volont d'avoir un enfant est un
hostile 345 . La famille donne l'individu une certaine scurit car elle est un
342 343
Voir les dveloppements consacrs Talcott Parsons et Andre Michel. Voir notamment Le mystre familial confrence prononce en 1942, publie dans Homo viator, 1944, Aubier-Montaigne, pp. 95-132 et la prface Recherche de la famille, ouvrage collectif, Ed. familiales de France, 1949, pp. 7-11. G. Marcel a fait en 1943 une confrence, dite dans Homo viator ayant pour titre Le vu crateur comme essence de la paternit . Les images du cocon, du nid ou du berceau, sont celles qui traduisent le plus exactement ce que j'appellerais l'lment duvet de la ralit familiale dans
344 345
Pierre Brchon, La famille. Ides traditionnelles, ides nouvelles. (1976)
192
nous et un chez nous , un foyer, un habitat permanent , un toujours , une prennit . La famille voque donc selon Gabriel Marcel la dure et la continuit des tres 346 , les traditions et les ambiances familiales. G. Marcel regrette qu'aujourd'hui le sens de la continuit familiale tende s'affaiblir. Les causes en sont multiples. Les exigences [159] conomiques poussent le proltariat changer souvent d'habitation. La permanence de l'habitat tend donc disparatre avec toutes les douces habitudes qu'il crait. Les esprits rvolutionnaires diffusent des idologies anti-familiales. On est entr dans une re de changement li l'industrialisation. On a ainsi perdu le souci du pass, on a soif du prsent ; le rythme de la vie s'acclre beaucoup. Or il existe (...) un lien troit entre l'acclration du rythme vital et l'apparition d'une humanit de plus en plus pauvre intrieurement 347 . Cette acclration se rencontre surtout en ville o l'homme est transform en machine et en automate, il n'a plus le temps de vivre selon le rythme des saisons, il est coup de la nature. La vie en ville est quasiment
ressort de sa vitalit propre : la fidlit et l'esprance 349 . La famine est atteinte parce que l'homme se dpersonnalise, il cherche se distraire, il se fuit lui-mme au lieu de chercher s'accomplir. La vraie famille commence, pour Gabriel Marcel, lorsque deux individus s'unissent avec une volont de dure, avec le dsir de s'accomplir l'un par l'autre, de se personnaliser mutuellement. Cet accomplissement se concrtise dans la venue de l'enfant. partir de ce moment-l les poux ne sont plus seulement lis par leur volont commune mais par l'existence de cet tre commun. Cet accomplissement des poux suppose une gnrosit fondamentale , ne pas calculer, ne pas raisonner selon les intrts financiers ; cette gnrosit s'exprime notamment dans l'acceptation d'une progniture nombreuse. Mais G. Marcel, la diffrence de la thologie catholique classique, refuse de dire que la procration est la fin du mariage. La procration concrtise l'union antrieure des poux. Mariage et procration forment des phases complmentaires d'une certai-
contre-nature 348 . Finalement, pour G. Marcel, sous l'effet de tous ces facteurs, la famille s'est trouve en fin de compte atteinte dans le double
Homo viator, op. cit., p. 107. On peut se demander s'il ne s'agit pas d'un mythe.
346
La famille peut-elle tre hors des conflits ?
Ce sentiment est encore trs fort aujourd'hui, au moins dans certains milieux. Ainsi dans beaucoup de familles, lors d'un mariage d'un jeune couple, on dsire faire un cadeau qui reste, qui dure toute la vie.
347 348
Homo viator, op. cit., p. 111.
On retrouve chez G. Marcel comme chez certains cologistes modernes le vieil antagonisme ville-campagne qui tait le fait des traditionalistes du XIXe sicle. L'idologie du retour la terre a donc eu des partisans fort varis au cours de l'histoire !
349
Homo viator, op. cit., p. 113.
Pierre Brchon, La famille. Ides traditionnelles, ides nouvelles. (1976)
193
lial est un mystre de fidlit et d'esprance 351 . Mais qui dit fidlit, ne dit pas conservatisme pur et simple de la ralit familiale (comme le penserait un traditionaliste). Il s'agit plutt d'une fidlit cratrice , d'une fidlit la vie. Les poux devront faire face leurs responsabilits. Les enfants qui leur sont donns devront tre levs en cherchant leur transmettre le meilleur des traditions familiales, ce qu'elles ont de plus authentique, en les prservant du suaire d'gosme et de lchet qui risque au contraire de recouvrir peu peu une humanit de plus en plus dgage de ses attaches
ne histoire que chacun de nous a vivre 350 . La dure et la gnrosit procratrice sont des valeurs fondamentales de la famille et le mystre fami-
ontologiques 352 . Cette action de la famille risque [160] d'tre contrecarre par l'tat moderne tentaculaire, s'il compromet cette promotion dans l'tre des individus, dans et par leurs relations familiales. Mystre de fidlit , la famille est aussi a mystre d'esprance , c'est--dire exprience de communion , foi dans un avenir humain. Finalement, pour G. Marcel, les choses humaines et les relations familiales ne sont solides que dans la mesure o elles sont rfres un ordre surhumain , que l o s'exprime la foi dans l'homme , une certaine pit fondamentale envers la vie 353 .
Si Gabriel Marcel et Emmanuel Mounier sont tous deux des philosophes chrtiens et se rfrent tous deux au personnalisme, leur conception de la famille ne semble pas identique. Gabriel Marcel apparat comme un nostalgique des traditions familiales, mme s'il invite la fidlit cratrice. Il ne met pas en cause, comme le faisait Mounier, le monde bourgeois. Au contraire il explique les dsordres familiaux surtout par l'volution des mentalits. En un mot, autant Mounier pouvait apparatre novateur, dans la mesure o sa pense regroupait des
350 351
Homo viator, op. cit., p. 121. Homo vialor, op. cit., p. 123. tant donn la manire dont G. Marcel valorise la
famille, il ne pouvait que condamner le divorce et les pratiques anticonceptionnelles.
352
Homo viator, op. cit., p. 126. La tonalit de ce texte est traditionaliste : l'tre
353
authentique, ce qui est bon pour la famille est puiser dans la tradition familiale, alors que l'humanit actuelle vhicule l'gosme et la lchet. On n'est pas loin de l'ide d'une restauration sociale grce une restauration familiale.
Homo viator, op. cit., p. 132.
Pierre Brchon, La famille. Ides traditionnelles, ides nouvelles. (1976)
194
chrtiens partisans d'un certain changement social 354 , autant Gabriel Marcel semble encore proche du traditionalisme. Il s'en spare nanmoins sur un point essentiel. Si elle est ncessaire, l'institution juridique n'est jamais pour lui suffisante, tout dpend de l'esprit des personnes qui l'animent. Il ne se satisfait pas d'une bonne organisation juridique de la famille. Il faut toujours considrer l'intentionnalit des personnes, le sens qu'elles donnent aux ralits dont elles vivent.
Jean Lacroix
Retour la table des matires
Aprs la Deuxime Guerre mondiale, la rflexion sur la famille a connu un regain d'intrt dans les milieux personnalistes. Louis Doucy, Paul Archambault crivent des ouvrages sur la famille 355 . Jean Lacroix publie lui aussi en 1948 un ouvrage sur le sujet Force et faiblesses de la famille. [161] Cet ouvrage aura beaucoup de retentissement. Comme tous les personnalistes, Lacroix refuse de considrer la famille seulement dans les fonctions qu'elle joue, que ce soit la fonction biologique de reproduction ou sa fonction sociale. Ainsi Louis Doucy critique la pense biologique en matire familiale, pense qui souligne la complmentarit anatomique des sexes, l'organe sexuel masculin correspondant parfaitement l'organe sexuel fminin, cette correspondance naturelle s'exprimant dans l'acte procrateur. Pour lui, tout ceci n'est que de l'infantilisme imaginatif , c'est prostituer l'tre familial dans les tristes arsenaux de la propagande familialiste 356 . De mme,
354
Le mouvement Esprit fait partie des premires tentatives importantes pour dsolidariser l'glise catholique des orientations politiques de droite et dextrme droite. L. DOUCY, Introduction une connaissance de la famille, ditions familiales de France, 1946, 208 p. P. ARCHAMBAULT, La famille, uvre damour, ditions familiales de France, 1950, 132 p. lments de doctrine familiale, Ed. U.N.A.F. 1946. Ces ouvrages sont aujourd'hui difficiles trouver, mme dans les bibliothques. L. Doucy, Propositions sur la sociologie familiale dans Recherche de la famille, op. cit., p. 77.
355
356
Pierre Brchon, La famille. Ides traditionnelles, ides nouvelles. (1976)
195
trop vouloir se braquer sur la fonction sociale de la famille, une certaine sociologie traditionaliste ne la considre plus que comme cellule sociale , dernier rempart de l'ordre et ultime bastion contre les assauts du monde moderne 357 . Durkheim lui-mme considre la famille dans une perspective fonctionnaliste. La famille ne lui parat avoir un avenir que si elle joue une fonction sociale, que dans la mesure o la naissance des enfants impose aux parents des devoirs. Lacroix se refuse considrer la famille extrieurement comme un phnomne social rduit une chose, un objet. Il veut chercher comprendre ce qu'est la famille de l'intrieur, il veut saisir le sens de la famille et pas seulement son utilit : Notre but est trs exactement le dvoilement progressif de l'tre familial 358 . Dans le premier chapitre de Force et faiblesses de la famille, Lacroix essaie de comprendre pourquoi la famille est aujourd'hui conteste. Selon lui, ce n'est pas seulement parce qu'elle est souvent l'opium de la bourgeoisie ou un nud de vipres , c'est surtout parce qu'elle est perue comme une structure autoritaire, comme fonde sur l'autorit du pre. Or, notre socit moderne veut avant tout s'manciper de la hirarchie et de l'autorit. Elle dsire tuer le pre que ce soit dans la famille, dans l'entreprise ou dans la socit. Dans la famille, la ncessit de tuer le pre est aujourd'hui reconnue par les psychologues. Pour tre adulte, l'enfant doit s'opposer son pre, il doit, d'une certaine faon, prendre sa place. La lutte est donc inscrite au cur de l'affection. On a montr que l'adulte ragira, dans sa vie professionnelle, en face de ses suprieurs, comme il ragissait en face de son pre. Tuer le pre semble donc ncessaire [162] si l'adulte veut par exemple savoir contester l'autorit dans l'entreprise. Le chef dentreprise paternaliste ragit comme tout pre de famille : il allie l'affection l'autorit ou plutt il cache sous des dehors affectueux la domination qu'il exerce sur ses employs. Dans la socit, la hirarchie est galement conteste. Lacroix analyse le pas357 358
Jean LACROIX, Force et faiblesses de la famille, Seuil, 1975, p. 7. Jean LACROIX, op. cit., p. 12. Lacroix souligne dans son introduction que son projet de connatre existentiellement la famille rejoint exactement celui de Doucy, dans son Introduction une connaissance de la famille, malgr une diffrence de mthode assez vidente (p. 11).
Pierre Brchon, La famille. Ides traditionnelles, ides nouvelles. (1976)
196
sage de l'Ancien Rgime la Rvolution franaise comme le passage d'une civilisation du pre une civilisation du frre. Le pouvoir absolu du roi est un pouvoir conu sur le mode paternel alors que la dmocratie o tous les sujets sont censs tre gaux est un rgime de fraternit. La fraternit rvolutionnaire s'est d'ailleurs affirme dans le parricide royal. Donc, pour Lacroix, clairer le sens de la famille aura bien des prolongements sociaux. travers le problme de la famille, se pose une question plus large : peut-on concilier la revendication d'autonomie de l'homme, sa volont de n'tre plus dpendant d'un pre, d'une autorit, et la reconnaissance dtre fils, d'avoir reu notre existence d'un autre ? Pour connatre le sens de la famille, il faut la dcrire, faire une phnomnologie de la famille qui dboucherait sur une ontologie, dvoiler ltre familial. Pour Lacroix, la famille apparat d'abord comme un lieu de repos et de calme, comme un chez nous o l'homme peut se recrer, un heu d'intimit o le secret de chacun peut tre devin sans tre exprim, un lieu protg des regards indiscrets o l'on vit sans masque, en transparence 359 . La chaude intriorit familiale, l'intimit du foyer ne se justifient pas par leur utilit. Elles sont donnes gratuitement. Dans cette intimit familiale, l'individu se socialise, fait la premire exprience de rapports autrui. Dans le nous familial , je m'intriorise par l'autre. Ainsi la famille m'apprend que je ne me dcouvre moi-mme qu'en m'ouvrant aux autres. La famille institue donc un renversement des rapports sociaux. Les premiers rapports sociaux sont des rapports de guerre et de lutte mort entre matres et esclaves, entre homme et femme. Chacun cherche possder l'autre, se l'approprier. Or, dans la famille, la lutte y est transforme en reconnaissance mutuelle 360 . Par l'amour, je ne cherche plus possder l'autre, mais au contraire je lui avoue mon dsir de puissance, je le reconnais comme autre, je dcide de me faire son serviteur, son esclave au lieu de chercher tre son matre. Jean Lacroix appelle cette exprience l'aveu. L'aveu est en fait double, il est aveu autrui de ma faute, et il est aveu de mon amour. S'avouer l'un lautre, c'est se reconnatre mutuellement comme autre. Avouer sa faiblesse, c'est
359 360
Lacroix reprend ici des analyses de G. Marcel et de Madinier. J. LACROIX, op. cit., p. 58.
Pierre Brchon, La famille. Ides traditionnelles, ides nouvelles. (1976)
197
faire confiance [163] l'autre en sachant qu'on ne sera pas jug, c'est accepter que l'autre ait pouvoir sur moi et rciproquement. L'aveu suppose l'amour et le renforce. J'avoue ma faiblesse celui que j'aime, pas un autre. L'aveu est finalement le don l'autre, se remettre entre ses mains. Le fondement du couple est donc l'aveu, c'est--dire l'amour mutuel 361 . Cet aveu est total : il est aveu du corps et aveu de l'esprit, aveu non pas ralis une fois pour toutes mais qui se prolonge tout au long de l'existence et permet au couple de se dcouvrir et de s'intrioriser toujours davantage l'un par l'autre. Voil donc, pour Jean Lacroix, le sens de la famille : elle est un foyer d'amour , le lieu mme de la parfaite rciprocit et de la communication des consciences. L'homme ne devient homme et la femme vraiment femme que dans la rciprocit familiale 362 .
Cet amour du couple qui consiste tre un sans jamais cesser d'tre deux va chercher s'objectiver. L'enfant est prcisment la manifestation de l'unit du couple. Et l, Lacroix cite Hegel : Les parents aiment les enfants comme leur amour, comme leur tre substantiel 363 . Donc, pour Lacroix, la procration n'est pas la fin du mariage, comme le pensait la thologie catholique classique. D'ailleurs, toujours considrer le mariage par ses fins, c'est ne pas sortir de la perspective de l'utilit, de la fonction des choses, alors que la perspective de Lacroix est celle de l'tre. La procration n'est pas la fin du mariage, elle est la ralisation du vu profond de l'union des poux, elle incarne l'amour des poux. L'amour comporte en lui-mme un dsir de fcondit. La famille tant le lieu o s'exprimente la reconnaissance des personnes, est bien en un sens, pour Lacroix, cellule sociale. Mais ce n'est pas au sens des sociologues et des dfenseurs de la famille, dont nous avons parl dans la premire partie. La famille est cellule sociale en ce sens trs prcis qu'elle est la source de toute existence physique, morale et so-
361
362
Pour Lacroix, le mariage ncessite donc l'amour, ce qui n'tait pas le cas pour les traditionalistes. Lorsque les poux ne se promeuvent plus l'un par l'autre, lorsqu'ils ne s'aiment plus, le mariage devient effectivement un carcan, une structure alinante. Cf. J. LACROIX, op. cit., pp. 63-64. Ces analyses sont l'oppos de celles des fministes pour qui la femme ne peut devenir femme qu'en luttant contre l'homme. Le rapport amoureux n'est alors jamais conu comme personnalisant. Pour les personnalistes chaque sexe ne peut tre lui-mme que dans son don l'autre sexe. J. LACROIX, op. cit., p. 69.
363
Pierre Brchon, La famille. Ides traditionnelles, ides nouvelles. (1976)
198
ciale. La famille manifeste que l'homme ne se suffit pas lui-mme, mais qu'il nexiste et ne grandit que par ses relations, par la reconnaissance d'autrui, dont l'exprience fondamentale se fait dans la famille. La famille est le lieu de ce que Jean Lacroix appelle le social priv . L'enfant dans la famille apparat la fois comme dpendant de ses parents et en mme temps se crant lui-mme dans ses relations autrui. La famille n'est donc pas seulement une relation de paternit, elle est aussi relation de fraternit. Ceux qui aujourd'hui conoivent l'homme comme un sujet autonome auraient tendance ne considrer que les relations de fraternit, les traditionalistes ne considraient [164] que la relation de paternit. Dans un cas lhomme se construit lui-mme, dans l'autre cas, il ne doit son existence qu' autrui. La perspective de Lacroix unit paternit et fraternit. Aprs avoir ainsi analys quel est le sens de la famille, il va en tudier ses fonctions, et plus particulirement la fonction ducative et la fonction sociale. La fonction ducative est directement lie l'tre mme de la famille ses membres se font progressivement lun par l'autre dans leur aveu rciproque. L'ducation de la personne est une socialisation. Mais le jeune enfant nest que capacit de dveloppement, folie non raisonne. L'enfant a besoin d'une norme que la famille va lui fournir. L'ducation familiale consiste donc donner des cadres mentaux l'enfant, lui apprendre raisonner, discipliner son incohrence psychologique . Lducation doit tre ni simple dressage comme le pensaient les traditionalistes, ne laissant aucune part la libert cratrice, ni simple inspiration de sa libert, sans jamais contraindre l'enfant, comme le voudraient les anarchistes, Reich et tous les adeptes ac-
tuels de l'ducation sans contraintes 364 . La famille doit d'abord donner des rgles morales l'enfant, transmettre une tradition, des murs, mais progressivement lenfant doit tre capable de s'en librer ; les parents doivent accepter ce passage. L'enfant doit devenir responsable et libre, capable de critiquer les rgles qui lui ont t inculques. L'ducation est donc en fait intriorisation des murs par l'enfant, elle assure la socialisation de la jeune gnration . L'institution familiale est par excellence le milieu de
culture de l'enfant 365 . La famille institue en particulier une discipline de
364
365
Voir par exemple O. NEILL, Libres enfants de Summerhill. Pour Lacroix comme pour Madinier, l'ducation doit tre la fois dressage et ducation la libert cratrice. J. LACROIX, op. cit., p. 87. Lducation se fait en particulier par un sentiment d'admiration des enfants. Cette admiration les pousse l'imitation des parents. Les rapports parents-enfants sont la base d'une morale de la contrainte . Les rapports entre frres et surs donnent naissance une morale de la rciprocit .
Pierre Brchon, La famille. Ides traditionnelles, ides nouvelles. (1976)
199
l'instinct sexuel 366 ; elle canalise l'expression de la sexualit et vite ainsi lanarchie sociale. Elle ordonne l'instinct sexuel l'expression de l'amour dans la famille. L'instinct est donc comme spiritualis plutt que frein par
l'institution familiale 367 . De plus, pour Lacroix, la famille duque le dsir sexuel des frres et surs en prohibant l'inceste, et permet ainsi la socit de se maintenir. Une socit qui pratiquerait l'inceste serait une socit o la vie deviendrait impossible, le niveau intellectuel et moral irait en se dgradant. En ce sens effectivement l'ordre dans la cit dpend des discipli-
nes familiales 368 . Lacroix est l dans la mme optique que Freud. L'instinct sexuel doit tre disciplin pour que la culture puisse se dvelopper. Lducation la matrise sexuelle se fait dans la famille.
[165] Si la famille a une fonction ducative, elle ne doit pas se replier sur elle-mme, car elle doit ouvrir ses membres sur la socit. La sociabilit, apprise dans la famille, doit tre exprimente dans des communauts plus larges. Une famille, cellule close, ne peut donc atteindre son but qui est de socialiser et de personnaliser ses membres, non pas pour elle-mme, mais pour une socit plus large. Seule une famille ouverte peut donc correspondre 1'intention de la famille, son tre. L'amour conjugal des poux doit se dilater au-del d'eux-mmes, s'ouvrir d'autres groupes. L'adolescence, en niant sous un certain rapport la famille, en ralise en fait l'intention. Car la famille est faite pour projeter l'enfant dans le monde ; lieu du social priv , la famille doit s'ouvrir au social public . La famille ne sera une structure ouverte que si l'homme et la femme sont tous deux ouverts sur la socit. Il est donc trs dommageable pour la famille que l'ouverture au monde ne soit que le fait de l'homme, par son travail professionnel. Il risque alors de subordonner sa femme sa profession et de ne
366 367
Qui n'est pas de soi violent. Si linstinct sexuel parat aujourd'hui violent c'est parce que notre socit cultive et dveloppe cet instinct. On est fort loin de la conception reichienne de la sexualit o l'instinct est de soi crateur et n'a pas tre spiritualis. La conception de la sexualit exprime par Lacroix est aussi celle qu'exprimait le journal La Croix critiquant le tract du docteur Carpentier (cf. chapitre 7). J. LACROIX, op. cit., p. 102.
368
Pierre Brchon, La famille. Ides traditionnelles, ides nouvelles. (1976)
200
considrer la famille que comme le lieu o il se dlasse de ses soucis extrieurs. La femme est alors rduite au rle d'instrument de reproduction. Cette situation a engendr la raction fministe : Lacroix la trouve exagre mais l'explique par la situation faite la femme dans beaucoup de familles. On a trop oubli que la femme est aussi une personne et a besoin de liens - sociaux plus larges que sa famille. Les fministes expriment imparfaitement, mais expriment tout de mme une revendication authentiquement personnaliste quand ils s'lvent contre une conception trop troite de la mre au foyer 369 . Lacroix reproche aux fministes une conception individualiste de leur libration alors que la femme ne peut se librer que par et dans des relations sociales. Selon lui, l'ducation de l'enfant assure par la mre n'est pas forcment abrutissante, mais pour ne pas l'tre, il faut que la femme ait, elle aussi, une formation sociale , ventuellement un mtier. D'ailleurs, la non-participation des femmes la vie professionnelle est aussi nocive pour la vie familiale que pour la vie de la cit. Certains mtiers gagnent tre exercs la fois par des hommes et par des femmes, notamment le mtier d'enseignant. Mais si Lacroix estime que la famille doit tre une structure ouverte sur la socit, il refuse de considrer, comme les traditionalistes, que la famille, lieu du social priv , et la nation, lieu du social public , sont de mme nature. La nation est tout autre chose qu'une association de familles , beaucoup d7autres groupes concourent la structuration sociale. Entre social priv et social public , entre famille et socit, il y a donc [166] la fois continuit et rupture. Continuit parce que la famille doit s'ouvrir sur plus large qu'elle, parce que l'ducation la relation, commence dans la famille, va se poursuivre dans d'autres groupes. Mais il y a aussi rupture. Car la socit n'est pas une grande famille , elle ne peut et ne doit pas fonctionner sur le modle familial comme le voulaient les traditionalistes. Alors que la famille repose sur l'union sexuelle, la socit repose, selon Lacroix, sur la sympathie , sur le besoin d'tre entour d'autres tres semblables nous. De plus, alors que la famille est le rgne de
369
J. LACROIX, op. cit., p. 132.
Pierre Brchon, La famille. Ides traditionnelles, ides nouvelles. (1976)
201
l'amour , la socit est le rgne du droit 370 . Mais droit et amour ne peuvent rester indpendants l'un de l'autre. Le droit doit informer l'amour familial et l'amour sous la forme de l'amiti fraternelle, est la perptuelle source vivifiante du lien social 371 . Donc tat et famille doivent mutuellement se reconnatre. L'tat donne la famille une armature juridique et la famille socialise les membres de l'tat. Mme si l'institution familiale varie dans sa forme juridique selon les temps et les lieux, elle a une mission permanente, socialiser ses membres et tre ainsi la base de tout ordre humain. En permanence la famille apprend aux hommes qu'il faut surmonter les oppositions et redevenir un pour enfanter et crer 372 , elle est un appel l'unit au-del des divisions des sexes. Le courant personnaliste, que Lacroix appelle aussi l'cole catholique de l'amour institu , a donc men une rflexion qui permet de faire se rejoindre une perspective institutionnelle et la perspective des philosophies modernes de l'amour 373 . Ce courant se refuse ne considrer la famille que comme un donn objectif, il en cherche l'tre profond et l'intention. Il montre que la famille est la fois base sur la subjectivit de ses membres, sur l'amour des poux comme le soulignait toute la tradition anarchiste et sur une institution objective comme le rptait tout le courant traditionaliste. L'institution se fonde dans la subjectivit des personnes ; c'est l'amour des poux qui institue la famille. L'institution apparat comme un prolongement ncessaire de cette subjectivit. L'amour du couple ne peut se passer, s'il veut se raliser et s'accomplir, d'une institution objective qui l'exprime. L'institutionnalisation est donc une tendance permanente des individus. L'institution ne devient dangereuse que lorsqu'elle est dsaccorde avec la subjectivit des personnes, que lorsque les personnes ne peuvent plus se promouvoir mutuellement dans les institutions [167] o elles sont insres. L'institution devient alors un carcan, un obstacle au lieu d'tre un outil de personnalisation. Elle n'est plus
370 371 372 373
On retrouve l, sous des termes hgliens, la distinction que faisait Madinier entre Amour et Justice. J. LACROIX, op. cit., p. 142. J. LACROIX, op. cit., p. 153. Cf. J. LACROIX, op. cit., p. 180.
Pierre Brchon, La famille. Ides traditionnelles, ides nouvelles. (1976)
202
en accord avec l'tre de l'homme. Les formes de l'institution familiale pourront changer, s'adapter aux situations, aux cultures, l'institution familiale sera toujours ncessaire pour que la personne puisse s'panouir dans une relation je-tu , pour que l'amour, valeur humaine permanente, puisse se vivre. L'amour nous constitue, il est pour l'homme une relation primordiale.
Pierre Brchon, La famille. Ides traditionnelles, ides nouvelles. (1976)
203
[168]
LA FAMILLE. Ides traditionnelles, ides nouvelles.
Quatrime partie. Personnalisme et famille
Chapitre 9
Personnalisme et familles aujourd'hui
Retour la table des matires
N de penseurs chrtiens, le personnalisme a eu une forte influence sur l'volution de la conception catholique du mariage, du couple et de la famille. Mais le personnalisme ne s'est pas dvelopp par hasard, il est lui-mme le produit des conceptions et des mentalits dont vivent les familles.
L'volution de la conception catholique du mariage, du couple et de la famille.
Situons tout d'abord trs brivement - au risque d'tre caricatural - quelle tait, depuis saint Augustin, la conception traditionnelle du mariage et du couple. On concevait l'amour et l'institution du mariage comme deux ralits spares. L'ide pratiquement constamment d-
Pierre Brchon, La famille. Ides traditionnelles, ides nouvelles. (1976)
204
veloppe par la tradition tait que la procration tait le but essentiel du mariage. L'amour tait secondaire, pas ncessaire et mme parfois considr comme suspect. Car l'amour, c'est la passion irrationnelle alors que le mariage, c'est la raison, c'est une institution juridique, un contrat indissoluble entre deux parties. Si l'amour tait suspect, le plaisir l'tait encore plus. Pour beaucoup de moralistes, les relations sexuelles ne se justifiaient que par l'intention procratrice des poux. Cette tradition catholique s'est impose pratiquement toute la socit, dans la mesure o l'glise tait l'appareil idologique dominant. Ainsi l'amour courtois du Moyen Age ne se droulait pas dans le cadre de l'institution familiale, mais en dehors d'elle. Ce qui montre bien que la famille n'tait pas perue comme le [169] lieu de l'amour. Dans la socit, progressivement, partir du XVIIIe sicle, l'ide du couple fond sur l'amour des poux s'est dveloppe 374 . Le marxisme et l'anarchisme en tmoignent leur faon. Mais dans l'glise, la conception traditionnelle s'est maintenue pendant tout le XIXe sicle. On la retrouve encore synthtise dans l'encyclique du pape Pie XI Casti Connubii, publie le 31 dcembre 1930. Le pape affirme d'abord l'origine divine du mariage, institu par Dieu et restaur par le Christ. Donc la nature du mariage est absolument soustraite la libert de l'homme en sorte que quiconque l'a contract se trouve du mme coup soumis ses lois divines et ses exigences essentielles 375 . Le mariage est considr comme une institution naturelle et divine sur laquelle l'homme n'a aucun pouvoir. La subjectivit des individus est sans importance, l'institution du mariage tant parfaitement dfinie par Dieu, et rvle l'homme dans l'Ancien et le Nouveau Testament : le couple sera constitu par un seul homme et une seule femme, unis par un lien indissoluble et perptuel. Ce lien indissoluble et perptuel est un lien juridique qui cre des droits et des devoirs rciproques. L'amour des poux n'est pas ncessaire la solidit de ce lien. Outre que cette interprtation de la Bible n'est pas sans poser problme, la conception du mariage et du couple, institutions parfaitement dfinies
374
375
Paralllement le plaisir sexuel a t rhabilit (au point d'tre aujourd'hui conu par certains comme un absolu) ; les relations sexuelles sont le plus souvent voulues d'abord pour le bonheur des poux ; la contraception a d'ailleurs permis de sparer plaisir et procration dans les relations sexuelles. PIE XI, Casti Connubii, traduction franaise, Editions Spes, 1936, p. 10.
Pierre Brchon, La famille. Ides traditionnelles, ides nouvelles. (1976)
205
par Dieu, sous-traites au pouvoir de l'homme, ne peut plus tre reue par les hommes d'aujourd'hui. D'une part, avec le dveloppement de la sociologie et de l'ethnologie, le mariage et le couple apparaissent comme des institutions minemment sociales, qui sont codifies par les socits de faons diverses, en fonction de tout un ensemble de variables socio-conomiques. Dautre part, on accorde de plus en plus d'importance, comme on l'a vu notamment dans l'anarchisme, la subjectivit des personnes, leurs relations vcues. Si l'homme et la femme sont libres et matres de leur avenir, le couple et le mariage ne peuvent tre conus comme une institution toute faite sur laquelle ils n'auraient aucune prise. Cette conception traditionnelle de l'institution familiale ne peut manquer d'apparatre comme renforant l'ordre tabli et le divinisant. Le modle bourgeois du couple et de la famille sera considr comme le modle de famille donn par Dieu. Nanmoins, l'amour des poux n'est pas compltement absent de la perspective de l'encyclique. On souligne que les poux doivent tre unis [170] par un saint et pur amour ; cet amour ne doit pas tre seulement sensible, bas sur la simple attirance charnelle ; il doit plutt tre un don mutuel des poux. Mais le mariage et le couple sont dfinis comme orients en priorit vers la procration des enfants. conception du mariage et du couple va progressivement voluer, surtout sous l'influence de certains thologiens et des philosophes personnalistes. Quelques thologiens allemands ont t les premiers rhabiliter l'amour conjugal, montrer sa ncessit l'intrieur du couple. Von Hildebrand enseignait en 1925 que le rapport conjugal licite exige l'amour. Il refusait l'approche biologique de toute la tradition, justifiant les rapports sexuels seulement par la procration. Pour lui l'acte conjugal a galement un sens pour l'homme en tant qu'tre humain, celui d'tre l'expression et l'accomplissement de l'amour conjugal et de la communaut de vie 376 . Dix ans plus tard, Herbert Doms 377 rflchit sur le vieux problme des fins du mariage. Pour lui, la fin premire n'est pas l'enfant mais le couple lui-mme. Dieu veut
376 377
Casti Connubii marque, me semble-t-il, la fin d'une poque. La
Cf. Jean-Louis FLANDRIN, Lglise et le contrle des naissances, Flammarion, 1970, pp. 93-94. Herbert Doms, Du sens et de la fin du mariage, 1938.
Pierre Brchon, La famille. Ides traditionnelles, ides nouvelles. (1976)
206
que l'homme et la femme s'aiment, qu'ils soient une seule chair. Le rapport conjugal a donc valeur en lui-mme, il est accomplissement de soi en l'autre. Doms peut tre considr comme le premier thologien personnaliste : le vcu existentiel des personnes devient pour lui premier par rapport aux finalits objectives de l'institution et par rapport sa fonction biologique ou sociale. La pense de Doms aura en France une influence sur les philosophes catholiques et personnalistes. Par contre, la papaut va condamner la thse de Doms : pour elle La fin premire du mariage, c'est l'enfant. Les fins secondaires lui sont subordonnes et non pas galement principales et indpendantes 378 . Les fins secondaires, savoir l'aide mutuelle des poux et leur amour doivent tre subordonnes au devoir impratif et premier de procration.
Condamnes, ces ides continuent faire leur chemin lentement. Ainsi le Cardinal Suhard, archevque de Paris, dit toujours dans sa lettre pastorale de Carme en 1946, que la procration est la fin primaire de la famille, mais il affirme aussi que l'homme et la femme s'unissent parce qu'ils s'ai-
ment 379 . [171] Cette affirmation banale est en fait assez nouvelle dans un texte manant de la hirarchie catholique. Mais dans les documents plus rcents, l'amour est beaucoup plus soulign. Au Concile Vatican II, le chapitre de la constitution Gaudium et Spes consacr au mariage et la famille, a t l'objet d'pres discussions entre les tenants des thses traditionalistes de la finalit procratrice du mariage et ceux qui dfendaient les thses nouvelles qu'on peut qualifier de personnalistes. Les tenants du conservatisme auraient voulu qu'on raffirme le canon 1081, paragraphe 2 : le contrat est un acte de la volont par lequel chaque partie accepte le droit conjugal , droit permanent et uniquement orient vers la gnration des enfants. Pour eux, l'amour dans le mariage est souvent un amour de concupiscence , l'uvre de la chair est suspecte, elle est vicie par le pch. Seule l'intention procratrice la lgitime. Les dfenseurs des thses personnalistes affirment que l'amour humain est bon et sain, il lgitime l'acte sexuel. La pro-
378 379
Dcret du Saint-Office du 29 mars 1944. 6. Le mme document valorise la famille dans un sens personnaliste : Bien loin d'tre le rsidu appauvri de la socit, la famille, une et indissoluble, est une source vive d'nergie, une force qui part de son amour intrieur pour dborder au dehors ; c'est l'amour qui s'incarne dans une institution pour durer et se survivre (op. cit., pp. 35-36).
La famille. Lettre pastorale de son minence le Cardinal Suhard, Spes, 1946, p.
Pierre Brchon, La famille. Ides traditionnelles, ides nouvelles. (1976)
207
cration n'est qu'une suite normale, une conscration de l'amour des poux. Les personnalistes ont d s'expliquer : on les tenait pour partisans du divorce, de l'union libre, de l'hdonisme. Ils ont d montrer que les caractres d'unit et d'indissolubilit n'taient pas seulement des conditions du contrat, mais des exigences de l'amour 380 . On a finalement abouti un texte de compromis 381 , auquel la minorit conservatrice s'est rallie. Le mot couple fait son entre dans le vocabulaire des documents officiels. Le document dit que le couple est une communaut profonde de vie et d'amour . La fcondit est considre comme une qualit naturelle de l'amour. L'acte sexuel signifie et favorise le don rciproque des poux. C'est un acte qui engage totalement les personnes et permet leur communication, leur communion dans l'amour. C'est donc beaucoup plus qu'un simple acte physiologique destin engendrer de nouvelles vies humaines.
L'encyclique Humanae Vitae, publie en 1968, confirme cette nouvelle faon de concevoir le mariage. L'encyclique part de l'amour des poux et en montre les composantes. Le vritable amour conjugal est la fois sensible et spirituel , c'est un amour sans rserves indues ni calculs gostes , c'est un amour fidle et exclusif , c'est enfin un amour fcond 382 . Dsormais on parlera dans l'glise catholique aussi bien du [172] sacrement de mariage que du sacrement de l'amour . L'amour des poux est alors considr comme un rappel et une manifestation de l'amour de Dieu pour les hommes. Donc la pense personnaliste qui a soulign la place de l'amour des poux dans l'institution familiale a eu une influence sur l'glise catholique. D'ail-
380
L'glise dans le monde de ce temps, Collectif, Tome 2, Cerf, Unam Sanctam
n 65b. 1967, p. 423. Au concile Vatican II le pre Delhaye a particip comme expert tous les dbats sur le mariage.
Philippe DELHAYE, Dignit du mariage et de la famille dans Vatican II dans
381
382
Le chapitre de Gaudium et Spes intitul Dignit du mariage et de la famille vient au dbut de la deuxime partie consacre quelques problmes urgents. Il est suivi par un chapitre sur la culture, un sur la vie conomico-sociale, un autre sur la vie de la communaut politique, enfin un sur la sauvegarde de la paix et la construction des nations. La place du chapitre sur la famille l'intrieur de la deuxime partie montre l'importance que les pres conciliaires ont accorde cette question. Voir Actes du Concile, Tome 3, Cerf 1966, pp. 7687, n 47 52.
Humanae vitae, Encyclique du 25 juillet 1968, numro 9, Editions du Centurion,
1968, pp. 32-33.
Pierre Brchon, La famille. Ides traditionnelles, ides nouvelles. (1976)
208
leurs la lettre du Cardinal Villot la Semaine sociale de Metz 383 , reprend les ides de Jean Lacroix : Si le foyer (...) apparat comme le lieu privilgi o peuvent s'tablir des rapports unifis et fconds entre les personnes, en surmontant le dsir et l'agressivit, n'est-ce pas la socit tout entire qui pourra en bnficier ? Le mme document affirme ensuite que la socit ne se dveloppe pas sur le mme modle que la famille puisqu'il y a une logique propre la socit, lieu des tensions et des rapports de force. Mais la relation de fraternit, issue de la paternit et de la maternit, contient une puissance de conciliation et d'unit qui intervient tous les niveaux de la vie sociale. On pourrait dire que, comme chez Jean Lacroix, le social priv informe le social public , il y a entre les deux la fois rupture et continuit.
Amour et institution familiale aujourdhui
Retour la table des matires
Si, depuis trente ans, les thses personnalistes se sont dveloppes, si l'glise catholique les a intgres son discours , ce n'est pas un hasard. Cela correspond un mouvement plus profond des mentalits dans la socit. D'une part l'amour apparat aujourd'hui massivement comme une valeur et d'autre part l'institution du mariage et du couple est peu conteste et continue tre massivement pratique. Si amour et institution sont vcus et concilis par les membres de la socit, il fallait bien qu'ils se concilient aussi dans des doctrines plus structures. On ne pouvait en rester l'opposition entre amour et institution que traduisent les courants anarchistes et traditionalistes. Le personnalisme reprsente, au niveau des doctrines, une forme de conciliation entre amour et institution. Mais on peut aussi analyser la revendication du divorce - qu'on a vu se dvelopper au XIXe sicle comme une volont d'ajuster l'institution familiale sur l'amour des poux. Et si, aujourd'hui, le nombre des divorces augmente, on peut l'expliquer de la mme manire. Tant que le mariage apparaissait avant tout comme un contrat indissoluble, [173] comme un engagement juri-
383
Publie dans Couples et familles dans la socit d'aujourd'hui, op. cit., pp. 5-11.
Pierre Brchon, La famille. Ides traditionnelles, ides nouvelles. (1976)
209
dique sans retour 384 , l'indissolubilit du mariage-contrat tait valorise. Aujourd'hui o l'accent est mis sur l'amour des poux, ce qui devient important dans le couple, c'est la fidlit 385 . D'aprs le rapport Simon 386 , il semble bien que la fidlit apparaisse comme une valeur recherche, notamment par les jeunes couples. Ceux-ci estiment d'ailleurs que cette fidlit doit s'imposer aussi bien l'homme qu' la femme, alors qu'autrefois seule la fidlit de la femme tait considre comme importante (pour tre sr de la paternit de ses enfants). Si l'on ne s'aime plus, si la fidlit n'est plus possible, le couple prfrera constater son chec et se sparer. Si on recourt de plus en plus au divorce, c'est donc en particulier parce qu'on considre le mariage comme coextensif l'amour alors qu'autrefois on le considrait comme indissoluble, quelque ft l'tat des relations du couple. On prfrait tre infidle l'autre plutt que de divorcer. L'ide de couple stable ne semble pas beaucoup conteste l'heure actuelle, on admet mme que l'amour s'institutionnalise mais on voudrait que cette institutionnalisation ne devienne pas blocage si l'amour venait disparatre. L'amour apparat bien aujourd'hui comme une valeur. Un rsultat d'enqute permet de le vrifier 387 : on a pos la mme question : Est-ce que l'amour a de l'importance pour vous ? deux chantillons reprsentatifs de la population franaise ge de 15 29 ans en 1957 et en 1968. On obtenait les rsultats suivants :
384 385 386 387
Les deux contractants avaient d'ailleurs l'un envers l'autre des droits et des devoirs reconnus. Il y avait un devoir conjugal que la femme devait remplir. J'emprunte cette remarque pertinente P. VILLAIN, op. cit. p. 24.
Rapport Simon sur le comportement sexuel des Franais, Charron et Julliard,
dition abrge, 1972, 355 p. Enqute I.F.O.P. rapporte par Aim Savard, Couple et mariage dans le monde moderne , Informations Catholiques Internationales, n 411 du 1er juillet 1972.
Pierre Brchon, La famille. Ides traditionnelles, ides nouvelles. (1976)
210
1957 JEUNES de 15 29 ans Beaucoup Assez Peu Pas du tout 48 % 32 % 13 % 6%
1968 JEUNES de 15 29 ans 56 % 27 % 6% 5%
80 %
83 %
19 %
11 %
Mais en 1968 on a galement interrog les 30-39 ans, c'est--dire pratiquement la mme population que celle interroge en 1957. Or, dix ans plus tard, elle croit davantage l'amour qu'auparavant. [174] LES 30-39 ANS en 1968
Beaucoup Assez Peu Pas du tout 55 % 35 % 5% 2% 90 %
7%
L'amour semble tre une valeur qui ne se dvalue pas, il apparat au contraire avoir de plus en plus d'importance et imposer de plus en plus la fidlit commune comme le montre la mme enqute :
1957 15-29 ANS La fidlit est essentielle pour les deux partenaires La fidlit est essentielle pour la femme seulement 82 % 9%
1968 15-29 ANS 86 % 2%
1968 30-39 ANS 92 % -
Pierre Brchon, La famille. Ides traditionnelles, ides nouvelles. (1976)
211
Certes il faut tre prudent avec des rsultats de sondage de ce type. Car les interviews ont probablement des perceptions de l'amour et de la fidlit qui ne sont pas toutes identiques ; on peut accorder de l'importance l'amour physique ou l'amour platonique, selon le cas, on n'aura pas le mme comportement. Des enqutes sur des questions plus prcises permettent d'affiner l'analyse. Ainsi dans l'enqute de la SOFRES auprs des 15-20 ans 388 , seulement 22% de cette classe d'ge disent qu'il est valable d'avoir des relations sexuelles sans s'aimer, alors que 40% disent avoir dj eu des relations sexuelles. On peut donc penser que les jeunes revendiquent la libert sexuelle non pour se livrer un libertinage incontrl, mais pour faire l'apprentissage de l'amour, un amour qui serait la fois affectif et physique. Il me semble qu'il y a des correspondances entre ces conceptions actuelles et la philosophie de l'amour institu. La subjectivit vcue s'objective, s'institutionnalise en souhaitant durer : l'institution familiale est un outil, un appui pour l'amour, mais elle ne saurait devenir un carcan si l'amour disparat. L'institution doit se conformer l'amour. En disant cela, je vais peut-tre plus loin que ce qu'auraient pens les personnalistes des annes 1950, mais il me semble que le courant qu'ils inauguraient va dans ce sens.
388
Publie par LExpress, op. cit.
Pierre Brchon, La famille. Ides traditionnelles, ides nouvelles. (1976)
212
[175]
Pour un personnalisme renouvel : Franois Chirpaz
Retour la table des matires
La pense personnaliste, dans la mesure o elle part d'une phnomnologie, d'une description des situations, pour rechercher plus profondment le sens des ralits, doit en permanence tre adapte l'volution des situations. C'est ce qu'a tent de faire Franois Chirpaz dans une communication la Semaine sociale de Metz en 1972 389 . Il critique la comprhension traditionnelle des personnalistes, selon laquelle l'amour concide quasi naturellement avec l'institution familiale et l'espace du priv. L'espace public est le lieu des conflits, le lieu de la concurrence conomique alors que l'espace priv serait celui de la vritable relation humaine, l'endroit o l'on peut vivre sans masques, sans tre sur le qui-vive. Mme si cette distinction a du vrai, Chirpaz estime que la famine n'est pas tout fait un monde priv, car de plus en plus le monde public pntre dans la famille par toute une srie d'influences : par les media, les journaux, la tlvision, par la publicit qui vient tenter les membres du foyer, leur suggrant d'assouvir leur besoin de consommation. Le travail de la mre de famille et les conflits de gnrations sont aussi l pour rappeler que la famille n'est pas hors des conflits, qu'elle n'est pas ce havre de paix dont on rve toujours. Les passions du monde ne s'arrtent plus au seuil du foyer. De mme, estime Chirpaz, nous avons l'habitude de penser l'amour comme s'exprimant dans la famille. Mais ce n'est pas toujours le cas. La famille n'est pas toujours le lieu o l'amour peut s'exprimer puisqu'elle est parfois un foyer clos, une cellule goste. Nous estimons trop gnralement la famille comme le lieu o se nouent les liens les plus essentiels pour la constitution et le devenir de l'homme. Donc nous valorisons la
389
F. CHIRPAZ, La relation privilgie de l'amour dans l'institution familiale dans Couples et Familles, op. cit., pp. 149-164.
Pierre Brchon, La famille. Ides traditionnelles, ides nouvelles. (1976)
213
famille comme lieu du priv et comme lieu de la relation affective privilgie . Or certains jeunes, voulant instaurer une vie communautaire remplaant la vie familiale, et certaines fministes, refusant d'tre dfinies par l'homme et limites au foyer quotidien, contestent le milieu familial traditionnel comme lieu primordial de vie. En fait ces contestations rappellent que l'identification entre famille et relation amoureuse ne va pas de soi, elle n'est qu'une possibilit : il peut y avoir concidence entre l'amour de deux personnes et le cadre social de la procration lgale et reconnue , concidence entre l'amour mutuel et la structure familiale en tant qu'elle est une organisation de la sexualit et qu'elle dsigne ceux qui sont interdits mon dsir sexuel. Mais pour que [176] cette coexistence soit effective, il faut que l structure familiale soit purifie. Elle est un nud complexe de relations et selon les poques et les cultures, son centre peut tre diffrent. Pour que l'amour soit institu dans la famille, il faut que la famille se purifie, se dcentre : il faut qu'un certain modle des rles familiaux o la femme est toujours infrieure et dfinie par l'homme soit bris, il faut que la famille comme structure autoritaire soit anantie. Donc, au terme de son analyse, Chirpaz estime que l'amour ne saurait tre confondu avec l'institution familiale, mais il en est la possibilit, il est ce qu'elle peut devenir si elle veut devenir relation vridique 390 . Mais l'institution familiale ne se modifie pas volont, par une dcision autoritaire. Car la famille est toujours le produit de toute une culture qu'elle concourt reproduire ; de plus elle ne peut jamais tre abolie, tant un lieu de socialisation indispensable pour l'individu. Elle ne peut qu'tre transforme progressivement, en cherchant ce qu'elle devienne le lieu o l'amour peut se raliser 391 . Donc Chirpaz insiste beaucoup plus que Lacroix sur les transformations que doit subir la structure familiale pour pouvoir exprimer l'amour. La contestation de l'institution familiale sera bnfique si elle a pour rsultat de faire voluer la famille vers un tat lui permettant de mieux exprimer l'amour des poux et l'amour des parents pour leurs enfants, ncessaire toute ducation.
390 391
F. CHIRPAZ, op. cit., p. 162. F. CHIRPAZ, op. cit., p. 160.
Pierre Brchon, La famille. Ides traditionnelles, ides nouvelles. (1976)
214
La famille, une structure ouverte.
Retour la table des matires
La famille ne sera le lieu o l'amour s'institue que si elle est une structure ouverte, que si elle refuse de se constituer en milieu clos, en lieu protg, en havre de paix qui mobilise toutes les nergies des individus. Pour que la famille soit une institution qui panouisse la personne, il faut qu'elle renonce tre une institution totalisante, qui se suffirait elle-mme. Plus la famille est vcue comme un refuge, moins elle peut assurer une fonction de socialisation, moins elle peut jouer un rle d'intermdiaire entre l'individu et la socit. Autrement dit, la famille ne peut tre une structure de personnalisation que si elle vite de s'enfermer dans une contradiction : vouloir se constituer en milieu autonome, dans l'intriorit scurisante du foyer alors que la socit pntre - qu'on le veuille ou non - dans la famille. Une famille ne sera personnalisante que si elle [177] est une structure relativise, que si elle n'est pas le seul lieu o ses membres investissent leurs nergies et peut-tre mme leur affectivit. Il me semble que certains aujourd'hui sont conscients de cette ncessit, pour l'quilibre mme des relations humaines, d'ouvrir la cellule familiale au-del d'elle-mme. Il est ncessaire que la famille soit accueillante d'autres si l'on veut que les enfants puissent s'identifier d'autres adultes qu' leurs parents, si l'on veut que les enfants puissent rencontrer facilement leurs camarades sur un plan non-scolaire.
La famille ne pourra tre lieu de l'amour que si elle reconnat l'autonomie des personnes qui la constituent, que si l'homme reconnat l'autonomie de sa femme au lieu de l'opprimer, que si les parents reconnaissent l'autonomie de leurs enfants, que si la famille n'est pas une famille fusionnelle. Khalil Gibran, pote libanais, a trs bien exprim cet aspect. L'amour du couple, pour tre vrai, suppose une certaine distance entre les deux conjoints, une altrit. Pour pouvoir tre un, il ne faut pas cesser d'tre deux : Chantez et dansez ensemble et soyez joyeux, mais demeurez chacun seul, de mme que les cordes d'un luth sont seules cependant qu'elles vibrent de la mme harmonie , ... Tenez-vous ensemble, mais pas trop proches non plus : car les piliers du temple s'rigent distance, et le chne et le cyprs ne croissent pas dans
Pierre Brchon, La famille. Ides traditionnelles, ides nouvelles. (1976)
215
l'ombre l'un de l'autre 392 . De mme que le couple ne peut s'panouir que sur la base d'une vritable relation duelle, qui suppose une certaine galit sans identit - entre les poux, la relation parents-enfants suppose - pour tre authentique - la reconnaissance de l'autonomie personnelle de l'enfant 393 . L'enfant n'appartient pas ses parents (comme le disait dj l'anarchiste James Guillaume) : Vos enfants ne sont pas vos enfants. Ils sont les fils et les filles de l'appel de la Vie elle-mme. Ils viennent travers vous mais non de vous. Et bien qu'ils soient avec vous, ils ne vous appartiennent pas. Les enfants sont projets dans la vie et dans la socit par leurs parents. Mais les parents doivent renoncer vouloir faire leurs enfants leur image : Vous pouvez leur donner votre amour, mais non point vos penses, car ils ont leurs propres penses. (...) Vous pouvez vous efforcer d'tre comme eux, mais ne tentez pas de les faire comme VOUS 394 . Or il semble bien qu'aujourd'hui l'autonomie de l'enfant n'est pas toujours respecte. D'une part l'enfant est peut-tre trop attendu, trop dsir, trop valoris. On veut tellement s'en occuper, russir son ducation, en faire quelqu'un qu'on a un peu tendance touffer sa spontanit, surveiller avec une affection tatillonne [178] tous ses faits et gestes. D'autre part on peut estimer avec le docteur Grard Mendel 395 qu'il y a actuellement une exploitation affective de l'enfant par l'adulte. Ne sachant plus ce que sera l'avenir, n'ayant plus de point de repre dans un monde en perptuel changement, les adultes reportent leurs espoirs sur leurs enfants, ils se projettent en eux, souhaitant qu'ils ralisent tout ce qu'ils n'ont pas eux-mmes russi faire. Ils adorent leurs enfants et ils cherchent les accaparer, les garder le plus souvent possible auprs d'eux, alors qu'eux souhaitent rester entre jeunes, faire leurs expriences avec leurs pairs. Mme si l'autorit paternelle est aujourd'hui plus faible qu'autrefois, respecter l'autonomie de l'enfant ne va donc pas de soi.
392 393
Khalil GIBRAN, Le prophte, Casterman 1972, p. 18. (Premire dition anglaise en 1923 ; premire dition franaise en 1956). Un texte rcent de la C.F.D.T. exprime la mme exigence : aprs avoir rappel que l'panouissement de la famille dpend de conditions conomiques et sociales, le document affirme : Le rle de la famille est notamment d'assurer l'panouissement et la construction de la personnalit de l'enfant par le dveloppement de son autonomie et de ses possibilits de relations et d'insertion dans la socit (extrait d'un texte adopt par le Conseil National de la C.F.D.T. publi dans Syndicalisme Hebdo du 25 avril 1974). K. GIBRAN, op. cit., p. 19. G. MENDEL, Autorit et pouvoir , La Nef n 50, La famille pourquoi faire ? janvier-mars 1973, pp. 7-20.
394 395
Pierre Brchon, La famille. Ides traditionnelles, ides nouvelles. (1976)
216
Vouloir faire de la famille une structure ouverte, c'est aussi reconnatre que la famille ne saurait tre aujourd'hui le seul lieu de la socialisation de l'enfant 396 , la seule institution qui permette l'intriorisation des valeurs. Certes la famille garde en ce domaine un rle important. Car la famille - o l'enfant nat sans l'avoir voulu - dtermine l'appartenance un milieu social. Selon les professions du pre et de la mre la socialisation de l'enfant sera diffrente. Si mon pre est ouvrier, je n'intrioriserai pas les valeurs de la mme manire que s'il est cadre suprieur. La profession des parents dtermine le niveau de vie des familles, leurs relations et leurs habitudes sociales, ventuellement leur perception de la socit et leur appartenance politique. De plus la famille est le lieu de la pratique religieuse. L'enfant va tre initi la religion de ses parents 397 . Mme s'il rejette ensuite cette religion, le systme de valeurs qui accompagnait la foi de son enfance le marquera durablement. Enfin, la famille donne un type d'ducation plus ou moins autoritaire ou permissive. Ceci joue sur la structuration de la personnalit de l'enfant et sur son attitude dans la socit. On a pu montrer par exemple qu'il y a une corrlation entre une faible autorit dans la famille (tous les membres de la famine participent aux prises de dcisions) et une attitude permissive de l'enfant dans la socit. Donc la famille continue de jouer un rle trs important dans la socialisation [179] de l'enfant. Mais cette socialisation passe aussi par d'autres institutions 398 , notamment par l'cole qui donne l'enfant
396
397
On pourra se reporter aux tudes d'Annick Percheron, spcialiste de sociologie politique, sur la socialisation politique des enfants ; elle a publi un livre : L'univers politique des enfants, Armand Colin, 1974, 278 p. D'aprs les enqutes de sociologie religieuse faites autour des annes 1965, lorsque les deux parents pratiquent, il y a une trs forte probabilit que les enfants pratiquent eux aussi 25 ans. Mais on peut se demander si cette continuit dans la pratique n'est pas en train de baisser fortement, d'une part parce que la foi tant moins vidente dans un monde scularis, les parents en parlent moins facilement aux enfants (cf. ce sujet G. DUPERRAY, Les familles, lglise et la foi, Le Centurion 1973. Notamment chapitre 4, Vers une famille sculire ), d'autre part parce que la socialisation par la famille n'est plus automatique. Il convient de souligner le rle croissant de la Tlvision dans la socialisation de l'enfant. Beaucoup d'enfants passent deux trois heures quotidiennement
398
Pierre Brchon, La famille. Ides traditionnelles, ides nouvelles. (1976)
217
des connaissances, un savoir objectif, mais qui lui transmet aussi une vision, une reprsentation du monde. Ainsi les manuels scolaires ne sont pas neutres, ils ne sont pas constitus de science pure , on peut y discerner des idologies (qui seront d'ailleurs diffrentes selon les manuels). On pourrait dire la mme chose des enseignants ! L'cole cre aussi pour l'enfant un milieu de vie et de relations avec son groupe d'ge. L'enfant s'duque dans ses relations avec les camarades de son ge. Une transmission des valeurs se fait aussi par l. Et si l'cole et la famille ne font pas d'ducation sexuelle de l'enfant, le groupe d'ge la prend volontiers en charge ! Nous arrivons ainsi un problme beaucoup discut actuellement : les enfants et les jeunes forment-ils un groupe autonome, peut-on dire qu'ils constituent une classe d'ge avec sa propre culture et ses propres valeurs ? Dans ce cas, la socialisation familiale et scolaire serait en pril dans la mesure o cette socialisation ne se ferait plus comme une transmission des valeurs des adultes aux enfants mais comme une mergence et une autocration d'une culture et de valeurs propres aux jeunes, par les jeunes. Ainsi l'institution familiale comme instance de collaboration entre les gnrations serait condamne de par l'importance que prendrait dans la socit le conflit des gnrations. Cette crise de la socialisation par la famille serait une consquence d'un conflit social comparable un conflit de classes.
Ainsi, Margaret Mead, anthropologue amricaine, a consacr un livre, Le
foss des gnrations 399 , l'tude de cette question. Elle estime qu'on
rencontre trois modles de transmission de la culture l'intrieur des diffrentes socits humaines. Dans les cultures post-figuratives , le changement est trs lent, la nouvelle gnration apprend tout de la gnration prcdente. Avoir l'exprience du pass permet de matriser le prsent et donc les anciens sont ceux qui exercent le pouvoir. En transmettant leur savoir et leur culture leurs enfants, ils leur permettent de se situer dans le monde
399
devant le poste de tlvision. Mme s'ils regardent le poste en famille, ils en discutent plus entre jeunes qu'avec leurs parents, signe que le dialogue parents-enfants fonctionne mal dans notre socit. On peut d'ailleurs se demander dans quelle mesure les enfants ne s'identifient pas actuellement autant aux hros qu'ils voient sur le petit cran qu' leurs parents. En ce sens les possibilits d'identification aux adultes seraient fort nombreuses. Denol-Gonthier, 1971, 155 p. (dition amricaine en 1970).
Pierre Brchon, La famille. Ides traditionnelles, ides nouvelles. (1976)
218
sans beaucoup de problmes, le prsent ressemblant beaucoup au pass. Dans les cultures co-figuratives au contraire, le changement devient beaucoup plus rapide. Les enfants vivent une situation trs diffrente de celle qu'ont connue leurs pres dans leur jeunesse. Ils ne peuvent se contenter de reprendre les modles culturels de leurs [180] parents. La socialisation ne se fait plus par les parents et les adultes mais essentiellement par le groupe des pairs. Paralllement les adultes s'adaptent la situation nouvelle. Il y a donc un foss, entre les deux gnrations qui scrtent chacune ses modles mais avec un fond culturel commun. Les ans peuvent encore se maintenir au pouvoir. Au contraire dans les cultures prfiguratives , la gnration adulte est compltement dphase . Elle n'est plus adapte un monde technologique entirement nouveau. Seuls les jeunes peuvent matriser, au moins en partie, ce monde nouveau. Ils vont donc progressivement imposer leur culture aux gnrations adultes. Dans un monde en trs rapide changement, les jeunes auront le pouvoir et imposeront en permanence des volutions culturelles ou mme des rvolutions culturelles , tant donn l'obsolescence acclre du savoir, des comptences et des modles culturels. D'aprs Margaret Mead, mme si on peut voir coexister ensemble, dans la mme socit, ces trois types de cultures, on s'achemine de plus en plus vers une culture de type prfiguratif. Or chaque gnration vit de faon isole, il n'y a plus communications culturelles entre les ges. Il serait trs important de les rtablir pour que les jeunes puissent initier les adultes, leur donner des points de repre dans cette civilisation inconnue. Par ailleurs, dans un monde en perptuelle mutation, il faudrait que les parents cessent de vouloir donner leurs enfants des modles, des faons de faire (elles seront inadaptes et inadquates) mais cherchent au contraire leur favoriser l'adaptation au changement, librer leur imagination. En partant de perspectives non plus anthropologiques mais sociologiques et psychanalytiques, Grard Mendel 400 arrive des conclusions assez concordantes avec celles de M. Mead. Il estime qu'on se trouvait jusqu' prsent en face d'un conflit de gnrations par lequel l'adolescent cherchait prendre la place du pre et des ans. Il s'agissait de tuer le pre pour le remplacer, prendre sa place pour faire comme lui, dans un monde peu diffrent du sien. La crise de gnrations dans laquelle nous sommes aujourd'hui plongs va beaucoup plus loin. Il ne s'agit plus de prendre la place du pre, mais de refuser son hritage socio-culturel, de refuser le modle culturel transmis par le pre. Pourquoi ce refus de la culture passe ? Parce que nous sommes dans un monde nouveau, o la technique est trs dveloppe ; l'homme se sent impuissant devant les mcanismes technologiques, il se sent aussi dmuni devant cette nouvelle nature technologique que l'tait le primitif devant la nature originelle, non transforme par l'homme (vcue inconsciem-
400
G. MENDEL, La crise de gnrations. tude socio-psychanalytique, Payot 1969.
Pierre Brchon, La famille. Ides traditionnelles, ides nouvelles. (1976)
219
ment comme une Mre toute puissante). L'homme se sent de moins en moins matre du monde qu'il a produit, il a de plus en plus l'impression d'tre domin par une puissance fantastique (vcue inconsciemment selon Mendel comme une seconde Mre Nature) d'o ce dsaveu de la culture ancienne tout fait inadapte la situation actuelle. Il n'y a donc plus aujourdhui de relations entre parents et enfants. Cette situation de non matrise du monde par les individus risque d'avoir de funestes consquences. Des tres qui ne matrisent pas leur monde acceptent leur soumission. On risque ainsi d'arriver des rgimes politiques fascistes, qu'il s'agisse de totalitarisme tatique, de technocratie ou de nihilisme idologique. Rejetant les valeurs anciennes, on risque de se rfugier dans l'apathie politique ou la contestation de principe du monde [181] actuel non domin, ce qui aboutit des comportements de retraits, de marginalisation. Il faut donc que l'homme reconquire la matrise du monde et ceci ne peut se faire que dans une collaboration des gnrations. Il faut donc grer cette crise, il faut que les jeunes puissent s'exprimer en groupe pour avoir un impact sur la culture, actuellement monopolise par la gnration adulte, Il faut que les jeunes se structurent, qu'ils prennent conscience d'eux-mmes en tant que classe sociale 401 . Ils ont d'ailleurs commenc le faire en mai 1968. partir de l, ils peuvent avoir un certain pouvoir en face des adultes 402 et une nouvelle culture peut peut-tre merger, fruit d'une influence rciproque entre gnrations ; seule une coducation des gnrations permettra l'dification d'un homme-adulte sur
401
402
De mme que le P.C.F. refusait de substituer la lutte des sexes la lutte des classes, il refuse de lui substituer la lutte, des gnrations. Pas plus que les femmes, les jeunes ne sauraient constituer une classe sociale. Selon le P.C.F. il y a eu de tous temps des conflits de gnrations, conflits normaux qui n'ont rien voir avec des conflits de classes. Si ces conflits sont aujourd'hui plus aigus, ce n'est pas parce que jeunes et adultes auraient des intrts de classes opposs. En fait, les jeunes sont, tout comme les adultes, victimes du capitalisme. Ils sont dgots par ce systme injuste et ils ont tendance en rendre responsables les adultes. Mais en fait, ils peuvent se retrouver unis avec les adultes pour combattre ce rgime qui ne satisfait pas leurs aspirations lgitimes. Le P.C.F. refuse de considrer que les jeunes doivent se rvolter contre leurs parents, le pre tant symbole de l'autorit. Les jeunes ne doivent pas se rvolter contre le pre mais contre le capitalisme. Pour Mendel, les parents nont plus d'autorit, ils ne sont plus considrs par leurs enfants comme des dieux, qui matrisent le monde et dont il est important d'tre aim pour ne pas tre abandonn. Il n'y a pas eu dmission des pres mais sous l'effet de l'volution socio-conomique, les pres ont perdu leur autorit, ils sont des rois dtrns. L'autorit est aujourd'hui entre les mains de la puissance technologique. D'o les traditions et les institutions craquent. Mais les parents ont encore du pouvoir, ils peuvent contraindre leurs enfants. Cf. Mendel, Autorit et pouvoir dans La Net, op. cit., pp. 7-20.
Pierre Brchon, La famille. Ides traditionnelles, ides nouvelles. (1976)
220
tous les plans, capable d'opposer les valeurs comme contre-force la puissance technique. Le but ne nous parat pouvoir tre atteint que par une rvolution psychique collective, quivalent d'un certain point de vue de la Rvolution Nolithique, une rvolution psychique capable d'assurer la matrise progressive et scientifique de l'autorit alinante, seconde Mre-Nature, qu'est devenue la puissance technologique 403 .
Donc pour Margaret Mead comme pour Grard Mendel, la crise de la famille est avant tout le produit d'une crise de civilisation. Le problme des rapports parents-enfants n'est pas un problme de psychologie individuelle, c'est un problme social et culturel. Il faut donc le traiter ce niveau. Pour Mendel, le conflit parents-enfants ne peut se grer au niveau familial mais dans une relation beaucoup plus collective. Il faut que la socit accepte de donner du pouvoir aux jeunes, qu'elle accepte de crer un cadre o les enfants pourraient librement se dvelopper, faire l'preuve de leur pouvoir et de leurs responsabilits. Il faut tablir un statut [182] d'galit entre l'enfant et l'adulte 404 . Il faut accepter l'autonomie des jeunes si jeunes et adultes veulent, ensemble, pouvoir matriser l'univers technologique. Donc au nom d'exigences socio-politiques, Mendel nous invite la mme attitude que celles des personnalistes (au nom d'exigences thiques) : le respect de l'autonomie des personnes, notamment des jeunes, Si le conflit parents-enfants ne peut se rgler au niveau familial, il impose cependant, me semble-t-il, une attitude nouvelle ce niveau. Si la famine ne peut plus tre le lieu de la transmission automatique des valeurs - tant donn la formation d'une culture de jeunes , tant donn aussi que la famille n'est plus la seule institution de socialisation des enfants - elle peut encore tre un carrefour et un creuset o se ngocient les valeurs 405 ; elle peut tre un lieu de dialogue entre pa-
403 404 405
G. MENDEL, La crise des gnrations, op. cit., p. 231. Cf. MENDEL, Pour dcoloniser l'enfant, Payot 1971, troisime partie. Cela suppose de la part des parents une attitude ouverte que des jeunes couples exprimaient ainsi : Nous croyons que ce sont nos enfants qui nous apprendront ce que nous devons tre avec eux et pour eux. Nous croyons aujourd'hui que nous avons surtout la responsabilit de leur crer un espace o ils puissent prendre le risque d'expriences et de dcisions morales libres de notre autorit.
Pierre Brchon, La famille. Ides traditionnelles, ides nouvelles. (1976)
221
rents et enfants autonomes, c'est--dire non pas un lieu de rapports sereins mais un lieu conflictuel o, la mme table, parents et enfants s'affrontent, dressent des compromis instables, laborent ensemble une culture nouvelle dont on peut esprer qu'elle sera plus humaine. Parents et enfants mettent sur la table les valeurs reues par des canaux forts divers et c'est de l que peuvent sortir, peut-tre, des tres plus responsables, mieux arms pour affronter le prsent et construire un avenir meilleur.
Pierre Brchon, La famille. Ides traditionnelles, ides nouvelles. (1976)
222
[183]
LA FAMILLE. Ides traditionnelles, ides nouvelles.
CONCLUSION
Retour la table des matires
Traditionalisme, Marxisme, Anarchisme, Personnalisme : ces diffrents courants de pense expriment, depuis le XIXe sicle, les conceptions opposes de la ralit familiale, que nous retrouvons, de manires diverses, dans les mentalits contemporaines. Notre recherche nous a permis de percevoir des liens qui unissent conceptions de la famille et conceptions de la socit. Elle nous a permis galement d'entrevoir derrire telle ou telle idologie familiale le type de pratique sociale et familiale qui la sous-tendent. Le traditionalisme, conception chronologiquement la plus ancienne, nous est apparue comme une dfense des droits de l'institution familiale. Cette institution est conue comme structure quasi parfaite, comme un donn tout fait, avec sa judicieuse hirarchie interne. La famille est alors perue comme la cellule et le modle de l'ordre social. Si la famille est solide, tout l'difice social sera bien construit. Cette conception de la famille, nous l'avons vu, est encore dfendue aujourd'hui par des hommes politiques de droite, elle subsiste aussi dans les milieux intgristes catholiques. Elle subsiste galement, de faon plus diffuse, dans les mentalits, par exemple chez ceux qui voient dans l'largissement de la lgislation sur le divorce la mort de la famille.
Pierre Brchon, La famille. Ides traditionnelles, ides nouvelles. (1976)
223
Face au traditionalisme, nous avons analys deux types de ractions : le marxisme et l'anarchisme. Le marxisme a remis en cause l'ide selon laquelle la famille tait un donn tout fait, une structure qui ne supportait pas le changement. Les penseurs marxistes ont montr que la famille voluait en fonction de l'volution des socits, qu'elle en tait un produit. Cette ide est aujourd'hui trs gnralement admise. On ne peut plus srieusement penser la famille comme indpendante de tout le systme social, conomique et juridique. Ce serait nier toutes les tudes de sciences humaines menes depuis un sicle. Mais si la famille est dpendante des ralits sociales et suit leur volution, cela ne veut pas dire pour autant qu'elle ne puisse pas exprimer, en fonction prcisment des ralits socio-conomiques qui l'entourent, [184] des valeurs et des aspirations permanentes des hommes. Les pres du marxisme eux-mmes l'ont reconnu implicitement puisqu'ils condamnent moins la famille en tant que telle qu'une certaine forme de famille, alinante dans une socit de classes. L'anarchisme constitue le deuxime courant de pense qui s'est oppos fortement au traditionalisme. Au rgne de l'institution sans amour, il veut substituer l'amour sans institution, la transparence des rapports sociaux. Pour l'anarchisme, la mdiation de l'institution est toujours un obstacle, un handicap la rencontre vraie entre les hommes. La famille institutionnelle ne peut donc qu'empcher l'expression de l'amour, elle ne peut qu'tre rpressive. Avec Reich, cette rpression familiale devient l'explication fondamentale de toute rpression sociale et politique. Enfin, au-del du marxisme et de l'anarchisme, le personnalisme est un essai plus rcent pour rconcilier amour et institution. On peut l'analyser comme un courant de pense se situant sur les frontires qui sparent anarchisme et traditionalisme, comme une tentative pour concilier les inconciliables. Reconnaissant la subjectivit des personnes comme l'anarchisme, le personnalisme considre nanmoins l'institutionnalisation de la famille comme le seul moyen capable de permettre l'amour de raliser son vu intime : durer. Mdiation ncessaire pour l'panouissement et la personnalisation des individus, l'institution permet aux sujets d'objectiver leurs relations. Elle ne doit pas pour
Pierre Brchon, La famille. Ides traditionnelles, ides nouvelles. (1976)
224
autant tre absolutise. Elle est au service de l'amour des poux et cet amour implique parfois une contestation de l'institution. L'anarchisme, comme le personnalisme, accordent peu d'importance au substrat socio-conomique de la famille. En ce sens, le marxisme garde son originalit. Anarchistes et personnalistes expriment un idal de la famille ; les marxistes au contraire ne dcrivent pas une forme idale de famille, dcoulant de la nature des tres ; ils montrent quel est le type de famille qui semble aller dans le sens de l'histoire, quel est le type de famille qui pourrait s'instaurer dans le socialisme, dans un monde sans alination. Les anarchistes et les personnalistes essaient de mettre en uvre leur idal de la famille, les marxistes cherchent avant tout transformer la socit. Normalement, la structure familiale devrait s'en trouver modifie et permettre une forme suprieure de rapports entre les sexes. Le lecteur aura peut-tre t surpris de ne pas trouver une partie de ce livre consacre la pense familiale de l'glise catholique. En effet, on dit souvent que l'glise a, en ce domaine, une grande influence. Elle aurait, au cours des sicles, impos l'Occident chrtien, sa conception de la famille. Cette thse ne me parat pas satisfaisante. Certes l'glise a justifi et sacralis un certain nombre de conceptions familiales, elle a [185] tabli un droit du mariage et a eu, par l, un certain pouvoir de contrle sur l'tablissement des familles. Mais il me semble que l'glise a - en Europe au moins - t davantage le reflet de conceptions et de mentalits prexistantes que l'instigatrice d'une conception nouvelle de la famille. J'ai cherch le montrer en retraant l'volution de la pense catholique, autrefois trs proche des positions traditionalistes (cf. chapitres 2 et 3), aujourd'hui proche des thses personnalistes (cf. chapitre 9). *
Voil donc bross un panorama des idologies familiales. Au terme de ces investigations, o nous avons chemin l'intrieur de courants de pense opposs, que pouvons-nous conclure ? Et d'abord faut-il
Pierre Brchon, La famille. Ides traditionnelles, ides nouvelles. (1976)
225
conclure ? Je suis tent de laisser ouvertes plusieurs options possibles, de laisser finalement le lecteur choisir. Cependant - et le texte l'a dj montr - une piste semble carter : le traditionalisme. Il est bti sur une analyse sociologique fausse : la famille n'est pas l'institution de base de la socit, elle n'est pas le noyau dur partir duquel se structurerait le corps social ; on ne peut la considrer comme tant le facteur dterminant de la ralit sociale. Par l est aussi exclue la perspective de Reich en tant qu'elle est l'envers du traditionalisme et semble - au moins dans certains passages - considrer l'institution familiale comme la premire instance rvolutionner si l'on veut librer l'humanit. Mais si la famille n'est pas le facteur dterminant de la ralit sociale, faut-il, avec les marxistes, penser qu'elle est dtermine par l'conomique ? Tout dpend de la dfinition donne au terme dterminer . Si l'on veut dire que la structure familiale est le simple produit immdiat des conditions conomiques et sociales, cela me parat videmment faux. Et ce n'est d'ailleurs pas ce que pensent gnralement les marxistes. Il est clair que l'volution de la famille ne suit pas directement et mcaniquement l'volution socio-conomique de la socit. Lvolution de la famille a probablement une certaine autonomie par rapport l'volution socio-conomique. son tour, la forme de la famille a certainement une influence sur le dveloppement social. Entre famille et socit, il y a de multiples interactions que les sociologues s'efforcent de mettre en vidence, sans toujours parvenir expliciter ce qui est cause et ce qui est effet, tout, dans une formation sociale, tant troitement imbriqu. Les marxistes estiment que, dans ce tissu complexe d'interactions, il faut admettre la prminence du facteur conomique. En dernire instance, c'est--dire indirectement, mme si cela n'apparat pas clairement, l'conomique dtermine [186] la forme de famille que l'on peut vivre un moment donn. Parler de dtermination en dernire instance, c'est reconnatre que toutes les instances qui, ct de l'conomique, influencent la famille - que ce soit le droit, la politique de ltat, les religions, les doctrines philosophiques, les idologies ambiantes, etc. - peuvent elles-mmes tre expliques par les conditions conomiques et sociales.
Pierre Brchon, La famille. Ides traditionnelles, ides nouvelles. (1976)
226
Mais qu'est-ce qui est expliqu en dernire instance par l'conomique ? Est-ce l'tre mme de la famille, son essence, ou seulement les formes qu'elle prend une poque donne ? Si la ralit familiale est entirement dtermine et rduite par l'explication socio-conomique, la famine n'est que le pur produit d'une socit de classes. Il est bien vident que la famille n'aura plus de raisons d'tre le jour o cette socit aura disparu. La transformation de la socit, le passage la socit sans classes devraient se traduire par la mort de toute forme d'institution familiale. Si l'on pense au contraire que la famille - audel des formes dtermines qu'elle prend dans chaque socit et qui peuvent s'expliquer en dernire instance par l'conomique - exprime un besoin permanent de l'homme, la rvolution sociale ne devrait pas conduire la mort de la famille, mais sa transformation. D'une structure familiale en partie alinante dans une socit alinante, on devrait pouvoir passer progressivement, aprs la rvolution sociale, une structure familiale panouissante. L'aspiration la communion, prsente en tout homme, pourrait alors se raliser davantage. On pourrait vivre l'unit sans cesser d'tre deux . La famille, en tant qu'elle exprime et rprime la sexualit, ne serait pas condamne ; au contraire elle pourrait prendre - comme nous l'avons vu avec Engels sa forme la plus leve : la monogamie fonde sur l'amour . Dans cette perspective, une volont de transformer la famille appelle d'abord une transformation de la socit, et non pas une action directe sur l'institution familiale, comme le veulent les anarchistes. Mais faut-il faire un choix aussi tranch : dcider d'agir pour le changement de socit ou dcider de vivre ds aujourd'hui une nouvelle forme de famille, sans se proccuper des structures socioconomiques ? Admettre avec le marxisme qu'une rvolution socioconomique permettrait une qualit de vie meilleure pour les personnes et les familles, n'empche pas d'agir dans le domaine des relations familiales. Il est possible - et certains le font - de chercher transformer sa pratique familiale pour que les rapports familiaux soient vcus de faon plus galitaire et plus panouissante. Il est mme possible de crer de nouveaux types de rassemblements familiaux ainsi que le suggre le mouvement communautaire. Si l'on admet que la famille a une certaine autonomie par rapport la socit, il n'est [187] pas illgitime de chercher transformer les rapports familiaux, il
Pierre Brchon, La famille. Ides traditionnelles, ides nouvelles. (1976)
227
n'est pas illgitime de chercher vivre la famille dans des formes nouvelles. travers ce problme : faut-il changer la socit pour que la famille se transforme, ou faut-il aussi commencer vivre autrement, on retrouve le vieux dbat : faut-il changer les structures ou changer les personnes, faut-il agir sur les mcanismes sociaux ou transformer son cur ? Mais ce dbat ne doit pas tre tranch : changeons les structures parce qu'elles conditionnent les possibilits d'panouissement de l'homme. Mais modifions aussi notre faon de vivre car l'homme n'est pas le pur produit des structures sociales. Cherchons donc la fois transformer la socit et vivre la famille d faon renouvele, en tant toujours la poursuite de structures sociales et de rapports familiaux plus humains et plus panouissants.
Pierre Brchon, La famille. Ides traditionnelles, ides nouvelles. (1976)
228
[189]
LA FAMILLE. Ides traditionnelles, ides nouvelles.
ANNEXE Considrations prospectives sur l'avenir de la famille
Retour la table des matires
Je voudrais dans cette annexe prsenter - de faon critique - les thses d'Alvin Toffler contenues dans Le choc du futur 406 concernant l'avenir de la famille. tudier ces perspectives me semble avoir deux intrts : Mettre en vidence que les formes d'institutions familiales que nous connaissons actuellement ne sont pas forcment ternelles. D'autres formes sont pensables. On va peut-tre vers une situation o l'institution familiale aura, au sein de la mme socit, des formes plus diversifies, dont certaines pourront nous tonner ou nous choquer. Il est sain de penser et d'envisager sereinement le futur pour ne pas se crisper sur le pass.
406
Denol, 1970, 539 p. Le chapitre 11 s'intitule La famille en lambeaux , pp. 233-253.
Pierre Brchon, La famille. Ides traditionnelles, ides nouvelles. (1976)
229
Montrer que l'avenir reste ouvert et que c'est nous de le faire. On ne peut, au nom d'une science du futur, dire ce que sera la famille en l'an 2000.
La rflexion de Toffler part de la situation actuelle. Il constate que le changement est de plus en plus acclr dans notre monde. Ceci pose lhomme des problmes nouveaux : saura-t-il s'adapter au changement, un futur inconnu, saura-t-il viter le traumatisme psychologique, le choc du futur, le malaise qui nous saisit dans un monde o l'on n'a plus de points de repres ? De plus en plus, tout sera phmre et provisoire. Rien ne sera plus stable et durable. On entre de plus en plus dans la socit du prt jeter , puisque nous consommons des biens de plus en plus prissables, de moins en moins faits pour durer, qu'il s'agisse des mouchoirs, des automobiles ou des poupes pour les enfants (autrefois on s'attachait sa poupe, la seule, l'unique que l'on conservait toute son enfance, alors que maintenant on en change frquemment, dsirant en avoir une toujours plus sophistique). Dans ce monde essoufflant tellement tout va vite pour survivre, pour chapper ce que nous avons appel le choc du futur, l'individu doit devenir infiniment plus souple et plus comptent que jamais auparavant. Il doit tre l'afft d'un mode d'ancrage totalement nouveau, car toutes les vieilles racines - religion, patrie, communaut, famille ou profession - tremblent actuellement devant l'ouragan de cette tendance gnrale l'acclration 407 . [190] La famille qui tait l'un des lieux stables o l'individu pouvait se recrer, refaire ses forces, s'adapter au monde, semble donc vaciller sous l'effet de l'volution du monde. Que va-t-il lui arriver ? Va-t-elle se dissoudre compltement ? ou subsister sans modifications 408 ? Aucune de ces deux perspectives ne se ralisera selon Toffler. On risque plutt de voir merger de nouvelles formes, inattendues, de familles. Toffler essaye de prciser quelques tendances possibles de l'ave407 408
A. TOFFLER, op. cit., p. 46. Plus on serait dans le monde de l'phmre, plus la famille deviendrait une valeur-refuge.
Pierre Brchon, La famille. Ides traditionnelles, ides nouvelles. (1976)
230
nir de la famille. Tout d'abord la mystique de la maternit a toute chance de disparatre lorsque le bb-prouvette sera une ralit. La femme n'aura plus alors de rle spcifique dans la maternit et donc elle ne pourra plus tre valorise par l. La filiation ne sera plus dfinie biologiquement mais lgalement 409 ; on peut d'ailleurs penser qu'on pourra produire des enfants ayant plus de deux parents biologiques. De plus, selon Toffler, l'homme super-industriel sera contraint d'inventer des formes familiales indites 410 . De mme que l'on est pass de la famille tendue en milieu agricole la famille nuclaire en milieu industriel, il est bien possible que l'on passe de la famille nuclaire la famille sans enfants, rduite au couple dans le monde super-industriel. Pour Toffler, plus le monde s'industrialise, plus il faut une main-duvre mobile. La famille nuclaire s'explique par la ncessit de la mobilit gographique. Cette mme ncessit va continuer rduire la famille. Un problme se pose : comment reproduire la socit, si la famille se rduit au couple ? Toffler ne manque pas d'explications. Quelques familles deviendront spcialistes de l'ducation et s'y consacreront pleinement, levant leurs enfants et ventuellement ceux des couples qui ne dsirent pas avoir des tches ducatives. D'autres attendraient d'tre la retraite pour lever des enfants 411 . Toffler explique la probabilit, de la naissance de ces familles spcialises par la prise de conscience actuelle de la difficult de l'ducation et de la ncessit de sortir de l'amateurisme en ce domaine. Les parents biologiques ne seraient plus que des sortes de parrains , venant voir de temps en temps leurs enfants dans leur vraie famille, qui serait du type famille nombreuse, famille tendue. Selon Toffler, beaucoup de parents seraient trs heureux de pouvoir ainsi se dcharger sur d'autres de l'ducation des enfants. Ceci mrite critique. Toffler part d'un point de vue discutable et mme faux. Il n'est pas vrai que la famille nuclaire se soit impose
409
410 411
Il y a bien dj une dfinition lgale de la filiation. Le pre prsum de tout nouveau-n d'une femme marie est son mari. D'autre part on peut adopter un enfant et dans ce cas il apparat lgalement comme fils d'un pre et d'une mre d'adoption au mme titre que les autres enfants. A. TOFFLER, op. cit., p. 236. Je plains ces enfants levs par des retraits...
Pierre Brchon, La famille. Ides traditionnelles, ides nouvelles. (1976)
231
cause de la ncessaire mobilit gographique dans le monde moderne. Les tudes historiques montrent que la famille nuclaire existait en Europe et qu'elle tait mme le modle dominant bien avant l'industrialisation, dans un milieu agricole. De plus, il n'est pas sr que les hommes des socits futures acceptent indfiniment de se plier aux besoins de l'conomie et d'tre frquemment dracins. Pour ce qui est de la France, beaucoup de mouvements de grve concernant la dfense de l'emploi et revendiquant de nouveaux emplois [191] qualification gale dans le mme secteur gographique sont l pour le prouver. D'autre part, on voit mal en quoi les enfants empchent les parents d'tre mobiles. Actuellement, ils suivent leurs parents. moins d'en venir un rythme de mobilit o les individus changeraient si souvent de rsidence qu'aucune continuit scolaire ne serait possible. Mais ceci n'est pas pour demain. Il faut noter aussi qu'actuellement en France il y a de moins en moins de couples sans enfants, beaucoup moins qu'il y a cinquante ans. La tendance actuelle ne va donc pas dans le sens indiqu par Toffler. Certes il y a moins de familles nombreuses et on peut effectivement penser que cette tendance durera. La famille type serait donc de plus en plus constitue par le pre, la mre et deux enfants. On peut peut-tre expliquer la rduction du nombre d'enfants par la forte mobilit sociale, mais ceci me semble trs insuffisant. Il faut faire entrer en ligne de compte la soif de bien-tre et de confort ainsi que le dsir de bien lever ses enfants, d'o la ncessit de ne pas en avoir trop. Enfin, s'il est vrai que l'appel des spcialistes de l'ducation est de plus en plus ressenti comme une ncessit, les parents se sentant souvent incomptents, il n'est pas du tout sr que ces spcialistes formeront des familles d'accueil. On peut imaginer des systmes diffrents : par exemple un systme dans lequel chaque famille lverait ses enfants avec une possibilit d'appel trs frquent aux spcialistes qui assureraient de multiples services ducatifs. On peut aussi penser un systme d'ducation hors de la famille, du type de celui qui fonctionne dans les kibboutzim israliens. Mais l, on est plus dans le domaine des pures conjectures sur le futur que dans le domaine des hypothses vraisemblables. On risque donc de ne faire que projeter sur le futur ses propres souhaits, ce que fait Toffler dans les affirmations qui viennent d'tre rapportes.
Pierre Brchon, La famille. Ides traditionnelles, ides nouvelles. (1976)
232
Les premires thses de Toffler concernaient surtout la taille de la famille. Mais il fait aussi des pronostics sur la dure des unions conjugales. Il constate d'abord que la poursuite de l'amour dans la vie familiale a t rige par beaucoup de gens en idal de vie 412 . Mais, dans un monde o rien n'est stable, l'volution des poux a de plus en plus de chances d'tre dissemblable au fil des annes. Donc vouloir que, dans la socit actuelle et du futur, dans ce monde de l'phmre, le mariage et l'amour durent indfiniment, c'est une volont qui risque d'tre contrecarre par les faits. D'ailleurs aujourd'hui dj beaucoup de couples divorcent, prfrant se sparer lorsqu'ils ne s'entendent plus. Dans l'avenir, beaucoup de personnes pourraient connatre plusieurs mariages successifs. Le mariage en srie c'est--dire l'enchanement de mariages temporaires successifs - est taill sur mesure pour l'ge de l'phmre, dans lequel tous les rapports de lhomme, tous ses liens avec le monde qui l'entoure, sont l'image d'une peau de chagrin 413 Toffler imagine les squences suivantes. On ferait une premire exprience de vie deux, qui serait un mariage l'essai, non lgalis. Puis entre vingt et quarante ans, avec le partenaire du mariage l'essai ou avec un autre, on vivrait [192] un premier mariage lgal. Certains auront des enfants de ce premier mariage, qu'ils les lvent eux-mmes ou s'en dchargent sur d'autres. Vers quarante ans, lorsque il faut s'adapter au dpart des grands enfants, qui eux-mmes se marient, certains couples se briseraient et on assisterait la formation de nouveaux couples. Ceci n'est qu'un des scnarios possibles. En tous cas, pour Toffler, dans l'ensemble, le nombre moyen de mariages par tte augmentera, lentement mais srement 414 . Mais il y aura une gamme trs varie de courbes conjugales . D'ailleurs, s'il y a des familles spcialises dans l'ducation, des parents professionnels, il sera plus facile de divorcer, beaucoup de couples tant sans enfants. On devrait voir de plus en plus des mariages entre poux d'ges diffrents. Dans cette situation le rapport des enfants aux adultes devrait se modifier, les influences parentales sur
412
413 414
A. TOFFLER, op. cit., p. 244. Ceci rejoint les constatations faites par beaucoup d'enqutes ; nous avons eu l'occasion d'voquer certaines d'entre elles prcdemment. A. TOFFLER, op. cit., p. 246. A. TOFFLER, op. cit., p 250.
Pierre Brchon, La famille. Ides traditionnelles, ides nouvelles. (1976)
233
l'enfant tant de plus en plus nombreuses : parents biologiques, nouveau conjoint du pre ou de la mre, parents professionnels. Toffler en conclut que la famille perdra le peu qui lui reste de sa fonction de transmission des valeurs la jeune gnration 415 . Cette thse de Toffler sur la dure du couple me semble plus srieuse que la prcdente. Il semble bien en effet que l'on soit de plus en plus devant une situation o l'amour est valoris mais o le divorce progresse. Il est d'ailleurs aux tats-Unis beaucoup plus frquent qu'en France. Si environ un couple sur huit divorce en France, il y en a plus d'un sur quatre aux tats-Unis. Si cette tendance a bien des chances de se poursuivre, on voit par contre mal pourquoi il en rsulterait la fin de la fonction de socialisation par la famille. Simplement cette socialisation se fera par plusieurs familles. Mais elle dpendra toujours en partie, me semble-t-il, du rapport adulte-jeune. A moins que d'autres facteurs, ceux dont parlent M. Mead et G. Mendel, n'interviennent et ne deviennent dterminants. La perspective de Mead et de Mendel est d'ailleurs trs diffrente de celle de Toffler. Devant une situation nouvelle qu'ils constatent ; ils proposent une politique. Il faut rtablir le dialogue entre gnrations, il faut grer le conflit. Au contraire, Toffler se contente de prolonger les tendances qu'il constate, comme si aucune action humaine n'tait possible pour les inflchir. La situation qui vient d'tre dcrite sur la taille et la dure des familles concerne la situation la plus rpandue. En effet les masses, elles, s'accrochent aux formes du pass 416 . Mais Toffler estime que d'autres formes d'institutions familiales se dvelopperont, des formes d'avant-garde . La premire forme d'avant-garde et donc marginale pourrait tre la a famille communale : L'phmre a pour effet d'accrotre la solitude et l'alination de l'individu dans la socit, aussi nous pouvons nous attendre une multiplication des expriences dans le domaine du mariage par groupe 417 . Des communes pourraient se multiplier, bases sur une mme foi politique ou religieuse, vitant l'isolement des individus. Mais, videmment, ce mouvement sera limit par la ncessaire mobilit gographique qui empche la
415 416 417
A. TOFFLER, op. cit., p. 251. A. TOFFLER, op. cit., p. 243. A. TOFFLIER, op. cit., p. 239.
Pierre Brchon, La famille. Ides traditionnelles, ides nouvelles. (1976)
234
formation de communauts durables. Pour cette raison, les communes prolifreront en premier lieu dans les couches de la socit qui ne sont pas soumises la discipline industrielle - les retraits, [193] les jeunes, les personnes en rupture de ban, les tudiants, ainsi que parmi certains membres de professions librales ou certains techniciens travaillant leur compte 418 . On peut effectivement imaginer que les communauts se multiplieront. Mais on doit tre assez rserv sur l'avenir de cette forme de relations humaines, dans la mesure o les expriences actuelles sont souvent peu solides, en partie cause des contraintes de la socit. Toffler lui-mme devrait admettre que, comme pour un couple, l'volution des membres d'une communaut a toute chance d'tre dissemblable et que, donc, leur vie commune risque d'tre provisoire. A moins que la famille collective ne se structure trs fortement sous l'effet de sa marginalit ou d'une foi religieuse ou politique. On entrerait alors dans une communaut familiale comme on entre dans un ordre monastique, qui reprsente d'ailleurs une forme permanente de communaut de clibataires. Avec la tombe des tabous sexuels, on risque aussi, d'aprs Toffler, de voir prolifrer des familles homosexuelles , constitues par deux personnes de mme sexe, avec ou sans enfants. Devraient aussi de plus en plus se rencontrer des familles incompltes , constitues par un adulte et des enfants, mais aussi des familles de pices et de morceaux 419 constitues par des poux divorcs-remaris et leurs enfants. Voil donc les formes familiales d'avant-garde dont Toffler estime qu'elles se dvelopperont dans l'avenir. Il ne fait ici que prolonger et annoncer le dveloppement des formes familiales que l'on voit poindre dj aujourd'hui, aux tats-Unis mais aussi en France. Donc, pour Toffler, la famille, dans un monde en mutation, ne peut pas ne pas se transformer. Et l, on ne peut qu'tre d'accord avec lui. Mais peut-on prvoir quel sera le futur ? Rien n'est moins sr. On ne peut que faire des hypothses, ce qui n'est pas forcment sans int418 419
A. TOFFLER, op. cit., p. 241. Cette expression de Toffler n'est pas heureuse. Mme s'ils ont dj t maris et eu des enfants au sein d'un autre couple, les divorcs-remaris n'en forment pas moins une structure familiale qui peut avoir son unit ; comme toute autre famille, son intention est de dpasser la simple juxtaposition des individus.
Pierre Brchon, La famille. Ides traditionnelles, ides nouvelles. (1976)
235
rt. Toffler admet bien finalement son incapacit dfinir exactement le futur. Aprs avoir prsent comme assur le dveloppement des tendances qu'il repre, il reconnat : Nous pouvons prfrer un futur un autre, mais nous ne pouvons pas perptuer le pass 420 . Le changement - en matire familiale comme en tout domaine - s'impose l'homme. Nanmoins, la famille apparat comme une institution plus stable que beaucoup d'autres. Elle n'volue pas au mme rythme. Le changement y est beaucoup plus lent. L'volution ne peut sociologiquement tre vite, mais les acteurs sociaux peuvent l'orienter ; les hommes et les femmes peuvent ainsi chercher satisfaire au mieux, dans des formes familiales nouvelles, leurs besoins permanents d'affection, de communication et de communion entre sexes et gnrations. B faut donc viter les attitudes trop dogmatiques et trop normatives pour que les aspirations des individus puissent ventuellement se vivre et s'institutionnaliser dans des formes nouvelles, si les formes anciennes ne permettent plus la satisfaction de ces aspirations. Fin du texte
420
A. TOFFLER, op. cit., p. 252.
Vous aimerez peut-être aussi
- L'Accusateur, Scénario MaléficesDocument13 pagesL'Accusateur, Scénario MaléficesChristopheGenoud100% (2)
- Maximilien RubelDocument66 pagesMaximilien RubelAnastopoulos7Pas encore d'évaluation
- Reclus Pourquoi Sommes-Nous AnarchistesDocument4 pagesReclus Pourquoi Sommes-Nous AnarchistesAmilcar ZinicaPas encore d'évaluation
- These MarclengletDocument457 pagesThese MarclengletFelipe PinhoPas encore d'évaluation
- Marwen Bouassida Shibl Shumayyil, Portrait D'un Darwiniste RévoltéDocument6 pagesMarwen Bouassida Shibl Shumayyil, Portrait D'un Darwiniste RévoltéMarwen BouassidaPas encore d'évaluation
- L Anarchie Expliquee A Mon Pere PDFDocument46 pagesL Anarchie Expliquee A Mon Pere PDFAnonymous a2H1i8J100% (1)
- Maurice Joyeux - AutogestionDocument26 pagesMaurice Joyeux - AutogestionLu LarPas encore d'évaluation
- Gracia - Persistencia de Las Practicas Horizontales en La Argentina Desde 1857 Hasta HoyDocument508 pagesGracia - Persistencia de Las Practicas Horizontales en La Argentina Desde 1857 Hasta Hoypablorf_84Pas encore d'évaluation
- Pierre Joseph Proudhon - Liberte Partout Et ToujoursDocument365 pagesPierre Joseph Proudhon - Liberte Partout Et ToujoursGloria ChristiPas encore d'évaluation
- Autre Futur - Maintien de L Ordre en AnarchieDocument9 pagesAutre Futur - Maintien de L Ordre en AnarchieJanoPas encore d'évaluation
- Badiou, Alain - On A Raison de Se Révolter (2018, Fayard)Document39 pagesBadiou, Alain - On A Raison de Se Révolter (2018, Fayard)Hassan HamoPas encore d'évaluation
- Louise Lyle, Charles Darwin Dans "Le Jardin Des Supplices"Document12 pagesLouise Lyle, Charles Darwin Dans "Le Jardin Des Supplices"Anonymous 5r2Qv8aonfPas encore d'évaluation
- Petit Manuel IndividualisteDocument5 pagesPetit Manuel IndividualisteNonna SalicePas encore d'évaluation
- Chrono ItalieDocument156 pagesChrono Italiequico36Pas encore d'évaluation
- Dossier NegationnismeDocument20 pagesDossier Negationnismequico36Pas encore d'évaluation
- Corrige Epreuve Bac Philo 2012Document2 pagesCorrige Epreuve Bac Philo 2012Floare de LotusPas encore d'évaluation
- Pressbook Alexandre MENDELDocument24 pagesPressbook Alexandre MENDELAlexandre MendelPas encore d'évaluation
- Drapeau Noir Equerre Compas PDFDocument100 pagesDrapeau Noir Equerre Compas PDFspinoza007Pas encore d'évaluation