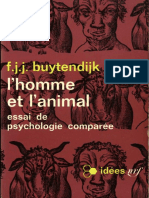Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Autres Ecrits
Autres Ecrits
Transféré par
LauraPalmerTitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Autres Ecrits
Autres Ecrits
Transféré par
LauraPalmerDroits d'auteur :
Formats disponibles
JACQUES LACAN
Autres crits
DITIONS DU SEUIL
21, rue Jacob, Paris VI
e
ISBN 978-2-02-048647-7
> ditions du Seuil, avril 2001
Les rfrences concernant la premire publication
des textes figurent en fin d'ouvrage
Le Code de la proprit intellectuelle interdit les copies ou reproductions destines une
utilisation collective Toute reprsentation ou reproduction intgrale ou partielle faite par quelque
procd que ce soit, sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants cause, est illicite et constitue
une contrefaon sanctionne par les articles L.335-2 et suivants du Code de b proprit intellectuelle.
www.seuil.com
Prologue
Le centenaire de Lacan en cette anne 2001 nous est occasion
de prsenter ce recueil au public. Les crits qui le composent ont
tous t publis ( l'exception de deux) du vivant de l'auteur.
Le centenaire de la naissance est rare clbrer. Il suppose de
l'uvre une continuation de l'homme qui voque la survie.
Ces lignes de Lacan, crites en 1956 pour le centenaire de Freud,
n'taient pas sans ironie, puisqu'il ne voyait dans cette survie
qu'un faux-semblant, justifiant son retour Freud . C'tait au
temps o l'appareil international auquel celui-ci avait donn
mandat de dire le vrai sur le vrai dans la psychanalyse se rv-
lait pour tre son teignoir.
La publication du prsent recueil ne s'inscrit dans aucun
retour Lacan . C'est que, croyons-nous, Lacan ne s'est pas loi-
gn. Il est l. Toujours d'actualit, ou dfinitivement intempestif?
Peut-tre est-il l la faon bien particulire de la Lettre vole.
Quoi qu'il en soit, vingt ans aprs sa mort il n'est personne
qui feigne - srieusement s'entend - qu'il ait t surclass dans la
psychanalyse comme sujet suppos savoir. L'accueil fait ses
Sminaires en tmoigne : ils sont reus par les praticiens et par le
public comme des livres d'aujourd'hui, non de jadis.
Surtout, il n'y a pas d'orthodoxie lacanienne. Il y a, oui, des
lacaniens, il y en a mme plthore. Lacan, pour sa part, a dit o il
plaait sa mise : ... l'effet qui se propage n'est pas de communi-
cation de la parole, mais de dplacement du discours. Freud,
incompris, fut-ce de lui-mme, d'avoir voulu se faire entendre,
est moins servi par ses disciples que par cette propagation...
Certes, il fonda une cole. Il l'appelait mon cole . Il prit
soin de la dissoudre peu avant de mourir. Comment montrer
mieux qu'il ne confiait le soin de sa survie nulle assemble
de fidles ? Il se savait ex-sister. Cette graphie qu'il utilisait signale
que l'on existe moins dans, ou avec, que hors.
7
PROLOGUE
N'allait-il pas jusqu' supposer parfois que ses crits, protgs
par leur pouvoir d'iUecture , tels des hiroglyphes au dsert,
ex-sisteraient la psychanalyse mme? Quand il lui arrivait
de prvoir l'clips de celle-ci, il ne faisait fond que sur eux
seuls : C'est quand la psychanalyse aura rendu les armes devant
les impasses croissantes de notre civilisation (malaise que Freud
en pressentait) que seront reprises par qui ? les indications de mes
crits,
Quelques annes plus tard, il ne voyait plus dans l'crit qu'un
dchet, bon pour la poubellication . Mais il lui arrivait aussi de
prtendre : Il suffit de dix ans pour que ce que j'cris devienne
clair pour tous... Le disait-il tongue in cheek ? Plutt faut-il pen-
ser que ce tous excluait ceux qu'il appelait les idiots (ceux
qui ne s'y connaissent pas).
Sans doute lit-on peu Lacan dans le grand public. Cela fait
songer au mot de Picasso : Combien de personnes ont lu
Homre ? Cependant tout le monde en parle. On a ainsi cr la
superstition homrique. Il y a une superstition lacanienne. Ne
pas s'en satisfaire n'empche pas d'admettre un fait, qui est un
fait de transfert.
La parution du prsent recueil ne sera pas sans incidence sur
ce transfert. Elle fera ex-sister, croyons-nous, un autre Lacan
celui devenu classique (autrement dit, class) sous le signe de la
parole et du langage. L'ouverture des crits voquait dj ce qui
se lve la fin de ce recueil sous le nom d'objet a ( lire : objet
petit a) . Cet objet est ainsi l'alpha des Autres crits.
Il n'en est pas l'omga. Ce qui se laisse entrevoir in fine pointe
au-del. Pour le dire en bref: de la jouissance (concept qui runit
et dplace ce qui chez Freud se nomme Lust, voire Lustgewinn,
Libido, et Befriedigung, satisfaction, de la pulsion), le petit a est
seulement le noyau laborable dans un discours, c'est--dire n'est
pas rel, n'est qu'un semblant. D'o procde la thse radicale
selon laquelle le rel est l'exclu du sens, y compris du sens
joui . Cette thse discute dans son dernier enseignement oral
n'a t reprise par Lacan dans aucun de ses crits ; elle donne
ce recueil sa ligne de fuite.
Le dernier texte des crits tait de dcembre 1965, son
Ouverture d'octobre 1966. Nous avons runi ici les crits
8
PROLOGUE
majeurs publis ensuite dans la revue Scilicet; repris les comptes
rendus des sminaires des Hautes tudes ; joint la Tlvision,
de 1973; retenu la plupart des prfaces, articles, et notes, de la
priode. Ce second recueil prend donc la suite du premier.
Nous avons voulu aussi qu'il en reproduise la composition
et se trame avec lui. C'est ainsi que nous sommes revenu sur
la priode que Lacan appelait de ses antcdents et sur la
suivante, qui va du Discours de Rome (1953) la parution
des crits (1966), pour donner ici le plus important de ce qui
n'avait pu trouver place dans le recueil prcdent ; c'est le cas en
particulier de l'article d'encyclopdie sur Les complexes fami-
liaux (1938). Cet ensemble est distribu dans les seconde, troi-
sime et quatrime parties du volume.
La cinquime regroupe les textes consacrs l'Ecole, de l' Acte
de fondation de 1964 la Lettre de dissolution de 1980.
Les trois dernires parties font retour la chronologie.
Enfin, pour beaucoup de raisons, Lituraterre nous a paru
comme prdestin occuper ici la place dvolue dans les Ecrits
au Sminaire sur La Lettre vole .
J.-A.M.
Fvrier 2001
Lituraterre
Ce mot se lgitime de YErnout et Meillet : lino, litura, liturarius.
Il m'est venu, pourtant, de ce jeu du mot dont il arrive qu'on fasse
esprit : le contrepet revenant aux lvres, le renversement l'oreille.
Ce dictionnaire (qu'on y aille) m'apporte auspice d'tre fond
d'un dpart que je prenais (partir, ici est rpartir) de l'quivoque
dont Joyce (James Joyce, dis-je), glisse d' letter a litter> d'une lettre
(je traduis) une ordure.
On se souvient qu'une messe-haine lui vouloir du bien, lui
offrait une psychanalyse, comme on ferait d'une douche. Et de Jung
encore...
Au jeu que nous voquons, il n'y et rien gagn, y allant tout
droit au mieux de ce qu'on peut attendre de la psychanalyse sa
fin.
A faire litire de la lettre, est-ce saint Thomas encore qui lui
revient, comme l'uvre en tmoigne tout de son long?
Ou bien la psychanalyse atteste-t-elle l sa convergence avec ce
que notre poque accuse du dbridement du lien antique dont se
contient la pollution dans la culture ?
J'avais brod l-dessus, comme par hasard un peu avant le mai
de 68, pour ne pas faire dfaut au paum de ces affluences que je
dplace o je fais visite maintenant, Bordeaux ce jour-l. La civili-
sation, y rappelai-je en prmisse, c'est l'gout.
Il faut dire sans doute que j'tais las de la poubelle laquelle j'ai
riv mon sort. On sait que je ne suis pas seul , pour partage,
l'avouer.
L'avouer ou, prononc l'ancienne, l'avoir dont Beckett fait
balance au doit qui fait dchet de notre tre, sauve l'honneur de la
littrature, et me relve du privilge que je croirais tenir ma place.
La question est de savoir si ce dont les manuels semblent faire
tal, soit que la littrature soit accommodation des restes, est affaire
11
LITURATERRE
de collocation dans l'crit de ce qui d'abord serait chant, mythe
parl, procession dramatique.
Pour la psychanalyse, qu'elle soit appendue l'dipe, ne la quali-
fie en rien pour s'y retrouver dans le texte de Sophocle. L'vocation
par Freud d'un texte de Dostoevski ne suffit pas pour dire que la
critique de textes, chasse jusqu'ici garde du discours universitaire,
ait reu de la psychanalyse plus d'air.
Ici mon enseignement a place dans un changement de configura-
tion qui s'affiche d'un slogan de promotion de l'crit, mais dont
d'autres tmoignages, par exemple, que ce soit de nos jours qu'enfin
Rabelais soit lu, montrent un dplacement des intrts quoi je
m'accorde mieux.
J'y suis comme auteur moins impliqu qu'on n'imagine, et mes
crits, un titre plus ironique qu'on ne croit : quand il s'agit soit de
rapports, fonction de Congrs, soit disons de lettres ouvertes o je
fais question d'un pan de mon enseignement.
Loin en tout cas de me commettre en ce frotti-frotta littraire
dont se dnote le psychanalyste en mal d'invention, j'y dnonce la
tentative immanquable dmontrer l'ingalit de sa pratique moti-
ver le moindre jugement littraire.
Il est pourtant frappant que j'ouvre ce recueil d'un article que
j'isole de sa chronologie, et qu'il s'y agisse d'un conte, lui-mme
bien particulier de ne pouvoir rentrer dans la liste ordonne des
situations dramatiques : celui de ce qu'il advient de la poste d'une
lettre missive, d'au su de qui se passent ses renvois, et de quels termes
s'appuie que je puisse la dire venue destination, aprs que, des
dtours qu'elle y a subis, le conte et son compte se soient soutenus
sans aucun recours son contenu. Il n'en est que plus remarquable
que l'effet qu'elle porte sur ceux qui tour tour la dtiennent, tout
arguant du pouvoir qu'elle confre qu'ils soient pour y prtendre,
puisse s'interprter, ce que je fais, d'une fminisation.
Voil le compte bien rendu de ce qui distingue la lettre du signi-
fiant mme qu'elle emporte. En quoi ce n'est pas faire mtaphore de
l'pistole. Puisque le conte consiste en ce qu'y passe comme muscade
le message dont la lettre y fait priptie sans lui.
Ma critique, si elle a lieu d'tre tenue pour littraire, ne saurait
porter, je m'y essaie, que sur ce que Poe fait d'tre crivain former
un tel message sur la lettre. Il est clair qu' n'y pas le dire tel quel, ce
12
LITURATERRE
n'est pas insuffisamment, c'est d'autant plus rigoureusement qu'il
l'avoue.
Nanmoins l'lision n'en saurait tre lucide au moyen de
quelque trait de sa psychobiographie : bouche plutt qu'elle en serait.
(Ainsi la psychanalyste qui a rcur les autres textes de Poe ici
dclare forfait de son mnage.)
Pas plus mon texte moi ne saurait-il se rsoudre par la mienne :
le vu que je formerais par exemple d'tre lu enfin convenable-
ment. Car encore faudrait-il pour cela qu'on dveloppe ce que j'en-
tends que la lettre porte pour arriver toujours sa destination.
Il est certain que, comme d'ordinaire, la psychanalyse ici reoit, de
la littrature, si elle en prend du refoulement dans son ressort une
ide moins psychobiographique.
Pour moi si je propose la psychanalyse la lettre comme en souf-
france, c'est qu'elle y montre son chec. Et c'est par l que je
l'clair : quand j'invoque ainsi les lumires, c'est de dmontrer o
elle fait trou. On le sait depuis longtemps : rien de plus important en
optique, et la plus rcente physique du photon s'en arme.
Mthode par o la psychanalyse justifie mieux son intrusion : car
si la critique littraire pouvait effectivement se renouveler, ce serait
de ce que la psychanalyse soit l pour que les textes se mesurent
elle, l'nigme tant de son ct.
Mais ceux dont ce n'est pas mdire avancer que, plutt qu'ils
l'exercent, ils en sont exercs, tout le moins d'tre pris en corps - ,
entendent mal mes propos.
J'oppose leur adresse vrit et savoir : c'est la premire o aussi-
tt ils reconnaissent leur office, alors que sur la sellette, c'est leur
vrit que j'attends. J'insiste corriger mon tir d'un savoir en
chec : comme on dit figure en abyme, ce n'est pas chec du savoir.
J'apprends alors qu'on s'en croit dispens de faire preuve d'aucun
savoir.
Serait-ce lettre morte que j'aie mis au titre d'un de ces morceaux
que j'ai dits crits..., de la lettre l'instance, comme raison de l'incons-
cient?
N'est-ce pas dsigner assez dans la lettre ce qui, devoir insister,
n'est pas l de plein droit si fort de raison que a s'avance? La dire
moyenne ou bien extrme, c'est montrer la bifidit o s'engage
toute mesure, mais n'y a-t-il rien dans le rel qui se passe de cette
13
LITURATERRE
mdiation ? La frontire certes, sparer deux territoires, en symbo-
lise qu'ils sont mmes pour qui la franchit, qu'ils ont commune
mesure. C'est le principe de YUmwelt, qui fait reflet de YInnenwelt.
Fcheuse, cette biologie qui se donne dj tout de principe : le fait
de l'adaptation notamment; ne parlons pas de la slection, elle
franche idologie se bnir d'tre naturelle.
La lettre n'est-elle pas... littorale plus proprement, soit figurant
qu'un domaine tout entier fait pour l'autre frontire, de ce qu'ils
sont trangers,jusqu' n'tre pas rciproques?
Le bord du trou dans le savoir, voil-t-il pas ce qu'elle dessine.
Et comment la psychanalyse, si, justement ce que la lettre dit la
lettre par sa bouche, il ne lui fallait pas le mconnatre, comment
pourrait-elle nier qu'il soit, ce trou, de ce qu' le combler, elle
recoure y invoquer la jouissance?
Reste savoir comment l'inconscient que je dis tre effet de lan-
gage, de ce qu'il en suppose la structure comme ncessaire et suffi-
sante, commande cette fonction de la lettre.
Qu'elle soit instrument propre l'criture du discours, ne la rend
pas impropre dsigner le mot pris pour un autre, voire par un
autre, dans la phrase, donc symboliser certains effets de signifiant,
mais n'impose pas qu'elle soit dans ces effets primaire.
Un examen ne s'impose pas de cette primarit, qui n'est mme
pas supposer, mais de ce qui du langage appelle le littoral au littral.
Ce que j'ai inscrit, l'aide de lettres, des formations de l'incons-
cient pour les rcuprer de ce dont Freud les formule, tre ce
qu'elles sont, des effets de signifiant, n'autorise pas faire de la lettre
un signifiant, ni l'affecter, qui plus est, d'une primarit au regard du
signifiant.
Un tel discours confusionnel n'a pu surgir que de celui qui
m'importe. Mais il m'importe dans un autre que j'pingle, le temps
venu, du discours universitaire, soit du savoir mis en usage partir du
semblant.
Le moindre sentiment que l'exprience quoi je pare, ne peut se
situer que d'un autre discours, et d garder de le produire, sans
l'avouer de moi. Qu'on me l'pargne Dieu merci ! n'empche pas
qu' m'importer au sens que je viens de dire, on m'importune.
Si j'avais trouv recevables les modles que Freud articule dans
une Esquisse se forer de routes impressives, je n'en aurais pas pour
14
LITURATERRE
autant pris mtaphore de l'criture. Elle n'est pas l'impression, ce
n'en dplaise au bloc magique.
Quand je tire parti de la lettre Fliess 52
e
, c'est d'y lire ce que
Freud pouvait noncer sous le terme qu'il forge du WZ, IVahr-
nehmungszeichen, de plus proche du signifiant, la date o Saussure
ne l'a pas encore reproduit (du signans stocien).
Que Freud l'crive de deux lettres, ne prouve pas plus que de
moi, que la lettre soit primaire.
Je vais donc essayer d'indiquer le vif de ce qui me parat produire
la lettre comme consquence, et du langage, prcisment de ce que
je dis : que l'habite qui parle.
J'en emprunterai les traits ce que d'une conomie du langage
permet de dessiner ce que promeut mon ide que littrature peut-
tre vire lituraterre.
On ne s'tonnera pas de m'y voir procder d'une dmonstration
littraire puisque c'est l marcher du pas dont la question se produit.
En quoi pourtant peut s'affirmer ce qu'est une telle dmonstration.
Je reviens d'un voyage que j'attendais de faire au Japon de ce que
d'un premier j'avais prouv... de littoral. Qu'on m'entende demi-
mot de ce que tout l'heure de Y Umwelt j'ai rpudi comme rendant
le voyage impossible : d'un ct donc, selon ma formule, assurant son
rel, mais prmaturment, seulement d'en rendre, mais de maldonne,
impossible le dpart, soit tout au plus de chanter Partons .
Je ne noterai que le moment que j'ai recueilli d'une route nouvelle,
la prendre de ce qu'elle ne fut plus comme la premire fois interdite.
J'avoue pourtant que ce ne fut pas l'aller le long du cercle arctique
en avion, que me fit lecture ce que je voyais de la plaine sibrienne.
Mon essai prsent, en tant qu'il pourrait s'intituler d'une sibri-
thique, n'aurait donc pas vu le jour si la mfiance des Sovitiques
m'avait laiss voir les villes, voire les industries, les installations mili-
taires qui leur font prix de la Sibrie, mais ce n'est que condition
accidentelle, quoique moins peut-tre la nommer accidentelle, y
indiquer l'accident d'un amoncellement de l'occire.
Seule dcisive est la condition littorale, et celle-l ne jouait qu'au
retour d'tre littralement ce que le Japon de sa lettre n'avait sans
doute fait ce petit peu trop qui est juste ce qu'il faut pour que je le
ressente, puisque aprs tout j'avais dj dit que c'est l ce dont sa
langue s'affecte minemment.
15
LITURATERRE
Sans doute ce trop tient-il ce que l'art en vhicule : j'en dirai le
fait de ce que la peinture y dmontre de son mariage la lettre, trs
prcisment sous la forme de la calligraphie.
Comment dire ce qui me fascine dans ces choses qui pendent,
kakmono que a se jaspine, pendent aux murs de tout muse en ces
lieux, portant inscrits des caractres, chinois de formation, que je sais
un peu, mais qui, si peu que je les sache, me permettent de mesurer
ce qui s'en lide dans la cursive, o le singulier de la main crase
l'universel, soit proprement ce que je vous apprends ne valoir que du
signifiant : je ne l'y retrouve plus mais c'est que je suis novice. L au
reste n'tant pas l'important, car mme ce que ce singulier appuie
une forme plus ferme, et y ajoute la dimension, la demansion, ai-je
dj dit, la demansion du papeludun, celle dont s'voque ce que
j'instaure du sujet dans le Hun-En-Peluce, ce qu'il meuble l'angoisse
de l'Achose, soit ce que je connote du petit a ici fait l'objet d'tre
enjeu de quel pari qui se gagne avec de l'encre et du pinceau ?
Tel invinciblement m'apparut, cette circonstance n'est pas rien :
d'entre-les-nuages, le ruisseDement, seule trace apparatre, d'y oprer
plus encore que d'en indiquer le relief en cette latitude, dans ce qui
de la Sibrie fait plaine, plaine dsole d'aucune vgtation que de
reflets, lesquels poussent l'ombre ce qui n'en miroite pas.
Le ruissellement est bouquet du trait premier et de ce qui l'efface.
Je l'ai dit : c'est de leur conjonction qu'il se fait sujet, mais de ce que
s'y marquent deux temps. Il y faut donc que s'y distingue la rature.
Rature d'aucune trace qui soit d'avant, c'est ce qui fait terre du
littoral. Litura pure, c'est le littral. La produire, c'est reproduire cette
moiti sans paire dont le sujet subsiste. Tel est l'exploit de la calligra-
phie. Essayez de faire cette barre horizontale qui se trace de gauche
droite pour figurer d'un trait l'un unaire comme caractre, vous
mettrez longtemps trouver de quel appui elle s'attaque, de quel
suspens elle s'arrte. A vrai dire, c'est sans espoir pour un occident.
Il y faut un train qui ne s'attrape qu' se dtacher de quoi que ce
soit qui vous raye.
Entre centre et absence, entre savoir et jouissance, il y a littoral
qui ne vire au littral qu' ce que ce virage, vous puissiez le prendre
le mme tout instant. C'est de a seulement que vous pouvez vous
tenir pour agent qui le soutienne.
Ce qui se rvle de ma vision du ruissellement, ce qu'y domine
16
LITURATERRE
la rature, c'est qu' se produire d'entre les nuages, elle se conjugue
sa source, que c'est bien aux nues qu'Aristophane me hle de trou-
ver ce qu'il en est du signifiant : soit le semblant, par excellence, si
c'est de sa rupture qu'en pleut, effet ce qu'il s'en prcipite, ce qui y
tait matire en suspension.
Cette rupture qui dissout ce qui faisait forme, phnomne,
mtore, et dont j'ai dit que la science s'opre en percer l'aspect,
n'est-ce pas aussi que ce soit d'en congdier ce qui de cette rupture
ferait jouissance ce que le monde ou aussi bien l'immonde, y ait
pulsion figurer la vie.
Ce qui de jouissance s'voque ce que se rompe un semblant,
voil ce qui dans le rel se prsente comme ravinement.
C'est du mme effet que l'criture est dans le rel le ravinement
du signifi, ce qui a plu du semblant en tant qu'il fait le signifiant.
Elle ne dcalque pas celui-ci, mais ses effets de langue, ce qui s'en
forge par qui la parle. Elle n'y remonte qu' y prendre nom, comme
il arrive ces effets parmi les choses que dnomme la batterie signi-
fiante pour les avoir dnombres.
Plus tard de l'avion se virent s'y soutenir en isobares, fut-ce
obliquer d'un remblai, d'autres traces normales celles dont la pente
suprme du relief se marquait de cours d'eau.
N'ai-je pas vu Osaka comment les autoroutes se posent les
unes sur les autres comme planeurs venus du ciel? Outre que l-bas
l'architecture la plus moderne retrouve l'ancienne se faire aile
s'abattre d'un oiseau.
Comment le plus court chemin d'un point un autre se serait-il
montr sinon du nuage que pousse le vent tant qu'il ne change pas
de cap ? Ni l'amibe, ni l'homme, ni la branche, ni la mouche, ni la
fourmi n'en eussent fait exemple avant que la lumire s'avre soli-
daire d'une courbure universelle, celle o la droite ne se soutient
que d'inscrire la distance dans les facteurs effectifs d'une dynamique
de cascade.
Il n'y a de droite que d'criture, comme d'arpentage que venu du
ciel.
Mais criture comme arpentage sont artefacts n'habiter que le
langage. Comment l'oublierions-nous quand notre science n'est
oprante que d'un ruissellement de petites lettres et de graphiques
combins ?
17
LITURATERRE
Sous le pont Mirabeau certes, comme sous celui dont une revue
qui fut la mienne se fit enseigne, l'emprunter ce pont-oreille
Horus Apollo, sous le pont Mirabeau, oui, coule la Seine primitive,
et c'est une scne telle qu'y peut battre leV romain de l'heure cinq
(cf. L'Homme aux loups). Mais aussi bien n'en jouit-on qu' ce qu'y
pleuve la parole d'interprtation.
Que le symptme institue l'ordre dont s'avre notre politique,
implique d'autre part que tout ce qui s'articule de cet ordre soit pas-
sible d'interprtation.
C'est pourquoi on a bien raison de mettre la psychanalyse au chef
de la politique. Et ceci pourrait n'tre pas de tout repos pour ce qui
de la politique a fait figure jusqu'ici, si la psychanalyse s'en avrait
avertie.
Il suffirait peut-tre, on se dit a sans doute, que de l'criture nous
tirions un autre parti que de tribune ou de tribunal, pour que s'y
jouent d'autres paroles nous en faire le tribut.
Il n'y a pas de mtalangage, mais l'crit qui se fabrique du langage
est matriel peut-tre de force ce que s'y changent nos propos.
Est-il possible du littoral de constituer tel discours qui se caract-
rise de ne pas s'mettre du semblant? L est la question qui ne se
propose que de la littrature dite d'avant-garde, laquelle est elle-
mme fait de littoral : et donc ne se soutient pas du semblant, mais
pour autant ne prouve rien que la cassure, que seul un discours peut
produire, avec effet de production.
Ce quoi semble prtendre une littrature en son ambition de
lituraterrir, c'est de s'ordonner d'un mouvement qu'elle appelle
scientifique.
Il est de fait que l'criture y a fait merveille et que tout marque
que cette merveille n'est pas prs de se tarir.
Cependant la science physique se trouve, va se trouver ramene la
considration du symptme dans les faits, par la pollution de ce que
du terrestre on appelle, sans plus de critique de YUmwelt, l'environ-
nement : c'est l'ide d'Uexktill behaviourise, c'est--dire crtinise.
Pour lituraterrir moi-mme, je fais remarquer que je n'ai fait dans
le ravinement qui l'image, aucune mtaphore. L'criture est ce ravi-
nement mme, et quand je parle de jouissance, j'invoque lgitime-
ment ce que j'accumule d'auditoire : pas moins par l celles dont je
me prive, car a m'occupe.
18
LITURATFRRE
Je voudrais tmoigner de ce qui se produit d'un fait dj marqu :
savoir celui d'une langue, le japonais, en tant que la travaille l'cri-
ture.
Qu'il y ait inclus dans la langue japonaise un effet d'criture, l'im-
portant est qu'il reste attach l'criture et que ce qui est porteur de
l'effet d'criture y soit une criture spcialise en ceci qu'en japonais
elle puisse se lire de deux prononciations diffrentes : en on-yomi sa
prononciation en caractres, le caractre se prononce comme tel
distinctement, en kun-yomi la faon dont se dit en japonais ce qu'il
veut dire.
a serait comique d'y voir dsigner, sous prtexte que le caractre
est lettre, les paves du signifiant courant aux fleuves du signifi.
C'est la lettre comme telle qui fait appui au signifiant selon sa loi
de mtaphore. C'est d'ailleurs : du discours, qu'il la prend au filet du
semblant.
Elle est pourtant promue de l comme rfrent aussi essentiel que
toute chose, et ceci change le statut du sujet. Qu'il s'appuie sur un
ciel constell, et non seulement sur le trait unaire, pour son identifi-
cation fondamentale, explique qu'il ne puisse prendre appui que sur
le Tu, c'est--dire sous toutes les formes grammaticales dont le
moindre nonc se varie des relations de politesse qu'il implique
dans son signifi.
La vrit y renforce la structure de fiction que j'y dnote, de ce
que cette fiction soit soumise aux lois de la politesse.
Singulirement ceci semble porter le rsultat qu'il n'y ait rien
dfendre de refoul, puisque le refoul lui-mme trouve se loger
de la rfrence la lettre.
En d'autres termes le sujet est divis comme partout par le lan-
gage, mais un de ses registres peut se satisfaire de la rfrence
l'criture et l'autre de la parole.
C'est sans doute ce qui a donn Roland Barthes ce sentiment
enivr que de toutes ses manires le sujet japonais ne fait enveloppe
rien. L'Empire des signes, intitule-t-il son essai voulant dire : empire
des semblants.
Le Japonais, m'a-t-on dit, la trouve mauvaise. Car rien de plus
distinct du vide creus par l'criture que le semblant. Le premier est
godet prt toujours faire accueil la jouissance, ou tout au moins
l'invoquer de son artifice.
19
LITURATERRE
D'aprs nos habitudes, rien ne communique moins de soi qu'un
tel sujet qui en fin de compte ne cache rien. Il n'a qu' vous mani-
puler : vous tes un lment entre autres du crmonial o le sujet
se compose justement de pouvoir se dcomposer. Le bunraku, thtre
des marionnettes, en fait voir la structure tout ordinaire pour ceux
qui elle donne leurs murs elles-mmes.
Aussi bien, comme au bunraku tout ce qui se dit pourrait-il tre
lu par un rcitant. C'est ce qui a d soulager Barthes. Le Japon est
l'endroit o il est le plus naturel de se soutenir d'un ou d'une inter-
prte, justement de ce qu'il ne ncessite pas l'interprtation.
C'est la traduction perptuelle faite langage.
Ce que j'aime, c'est que la seule communication que j'y aie eue
(hors les Europens avec lesquels je sais manier notre malentendu
culturel), c'est aussi la seule qui l-bas comme ailleurs puisse tre
communication, de n'tre pas dialogue : savoir la communication
scientifique.
Elle poussa un minent biologiste me dmontrer ses travaux,
naturellement au tableau noir. Le fait que, faute d'information, je
n'y compris rien, n'empche pas d'tre valable ce qui restait crit l.
Valable pour les molcules dont mes descendants se feront sujets,
sans que j'aie jamais eu savoir comment je leur transmettais ce qui
rendait vraisemblable qu'avec moi je les classe, de pure logique,
parmi les tres vivants,
Une ascse de l'criture ne me semble pouvoir passer qu'
rejoindre un c'est crit dont s'instaurerait le rapport sexuel.
1911
II
Les complexes familiaux
dans la formation de l'individu
Essai d'analyse dune fonction en psychologie
PARU EN 1938 DANS L* ENCYCLOPDIE FRANAISE
INTRODUCTION
L'INSTITUTION FAMILIALE
La famille parat d'abord comme un groupe naturel d'individus
unis par une double relation biologique : la gnration, qui donne
les composants du groupe ; les conditions de milieu que postule
le dveloppement des jeunes et qui maintiennent le groupe pour
autant que les adultes gnrateurs en assurent la fonction. Dans les
espces animales, cette fonction donne lieu des comportements
instinctifs, souvent trs complexes. On a d renoncer faire driver
des relations familiales ainsi dfinies les autres phnomnes sociaux
observs chez les animaux. Ces derniers apparaissent au contraire si
distincts des instincts familiaux que les chercheurs les plus rcents
les rapportent un instinct original, dit d'interattraction.
L'espce humaine se caractrise par un dveloppement singulier
des relations sociales, que soutiennent des capacits exceptionnelles
de communication mentale, et corrlativement par une conomie
paradoxale des instincts qui s'y montrent essentiellement susceptibles
de conversion et d'inversion et n'ont plus d'effet isolable que
de faon sporadique. Des comportements adaptatifs d'une varit
infinie sont ainsi permis. Leur conservation et leur progrs, pour
dpendre de leur communication, sont avant tout uvre collective
et constituent la culture ; celle-ci introduit une nouvelle dimension
dans la ralit sociale et dans la vie psychique. Cette dimension sp-
cifie la famille humaine comme, du reste, tous les phnomnes
sociaux chez l'homme.
23
LES COMPLEXES FAMILIAUX DANS LA FORMATION DE L'INDIVIDU
Si, en effet, la famille humaine permet d'observer, dans les toutes
premires phases des fonctions maternelles, par exemple, quelques
traits de comportement instinctif identifiables ceux de la famille
biologique, il suffit de rflchir ce que le sentiment de la paternit
doit aux postulats spirituels qui ont marqu son dveloppement,
pour comprendre qu'en ce domaine les instances culturelles domi-
nent les naturelles, au point qu'on ne peut tenir pour paradoxaux
les cas o, comme dans l'adoption, elles s'y substituent.
Cette structure culturelle de la famille humaine est-elle entire-
ment accessible aux mthodes de la psychologie concrte : observa-
tion et analyse ? Sans doute, ces mthodes suffisent-elles mettre en
vidence des traits essentiels, comme la structure hirarchique de la
famille, et reconnatre en elle l'organe privilgi de cette contrainte
de l'adulte sur l'enfant, contrainte laquelle l'homme doit une tape
originale et les bases archaques de sa formation morale.
Mais d'autres traits objectifs : les modes d'organisation de cette
autorit familiale, les lois de sa transmission, les concepts de la des-
cendance et de la parent qui lui sont joints, les lois de l'hritage et
de la succession qui s'y combinent, enfin ses rapports intimes avec
les lois du mariage - obscurcissent en les enchevtrant les relations
psychologiques. Leur interprtation devra alors s'clairer des don-
nes compares de l'ethnographie, de l'histoire, du droit et de la
statistique sociale. Coordonnes par la mthode sociologique, ces
donnes tablissent que la famille humaine est une institution. L'ana-
lyse psychologique doit s'adapter cette structure complexe et n'a
que faire des tentatives philosophiques qui ont pour objet de rduire
la famille humaine soit un fait biologique, soit un lment tho-
rique de la socit.
Ces tentatives ont pourtant leur principe dans certaines appa-
rences du phnomne familial ; pour illusoires que soient ces appa-
rences, elles mritent qu'on s'y arrte, car elles reposent sur des
convergences relles entre des causes htrognes. Nous en dcri-
rons le mcanisme sur deux points toujours litigieux pour le psy-
chologue.
Entre tous les groupes humains, la famille joue un rle primordial
dans la transmission de la culture. Si les traditions spirituelles, la
garde des rites et des coutumes, la conservation des techniques et du
patrimoine lui sont disputes par d'autres groupes sociaux, la famille
24
LES COMPLEXES FAMILIAUX DANS LA FORMATION DE L'INDIVIDU
prvaut dans la premire ducation, la rpression des instincts,
l'acquisition de la langue justement nomme maternelle. Par l elle
prside aux processus fondamentaux du dveloppement psychique,
cette organisation des motions selon des types conditionns par
l'ambiance, qui est la base des sentiments selon Shand; plus large-
ment, elle transmet des structures de comportement et de reprsen-
tation dont le jeu dborde les limites de la conscience.
Elle tablit ainsi entre les gnrations une continuit psychique
dont la causalit est d'ordre mental. Cette continuit, si elle rvle
l'artifice de ses fondements dans les concepts mmes qui dfinissent
l'unit de ligne, depuis le totem jusqu'au nom patronymique, ne se
manifeste pas moins par la transmission la descendance de disposi-
tions psychiques qui confinent l'inn ; Conn a cr pour ces effets
le terme d'hrdit sociale. Ce terme, assez impropre en son ambi-
gut, a du moins le mrite de signaler combien il est difficile au
psychologue de ne pas majorer l'importance du biologique dans les
faits dits d'hrdit psychologique.
Une autre similitude, toute contingente, se voit dans le fait que
les composants normaux de la famille telle qu'on l'observe de nos
jours en Occident : le pre, la mre et les enfants, sont les mmes
que ceux de la famille biologique. Cette identit n'est rien de plus
qu'une galit numrique. Mais l'esprit est tent d'y reconnatre une
communaut de structure directement fonde sur la constance des
instincts, constance qu'il lui faut alors retrouver dans les formes
primitives de la famille. C'est sur ces prmisses qu'ont t fondes
des thories purement hypothtiques de la famille primitive, tantt
l'image de la promiscuit observable chez les animaux, par des
critiques subversifs de l'ordre familial existant ; tantt sur le modle
du couple stable, non moins observable dans l'animalit, par des
dfenseurs de l'institution considre comme cellule sociale.
Les thories dont nous venons de parler ne sont appuyes sur
aucun fait connu. La promiscuit prsume ne peut tre affirme
nulle part, mme pas dans les cas dits de mariage de groupe : ds
l'origine existent interdictions et lois. Les formes primitives de la
famille ont les traits essentiels de ses formes acheves : autorit sinon
concentre dans le type patriarcal, du moins reprsente par un
conseil, par un matriarcat ou ses dlgus mles ; mode de parent,
hritage, succession, transmis, parfois distinctement (Rivers), selon une
25
LES COMPLEXES FAMILIAUX DANS LA FORMATION DE L'INDIVIDU
ligne paternelle ou maternelle. Il s'agit bien l de familles humaines
dment constitues. Mais loin qu'elles nous montrent la prtendue
cellule sociale, on voit dans ces familles, mesure qu'elles sont plus
primitives, non seulement un agrgat plus vaste de couples biolo-
giques, mais surtout une parent moins conforme aux liens naturels
de consanguinit.
Le premier point est dmontr par Durkheim, et par Fauconnet
aprs lui, sur l'exemple historique de la famille romaine ; l'examen
des noms de famille et du droit successoral, on dcouvre que trois
groupes sont apparus successivement, du plus vaste au plus troit : la
gens, agrgat trs vaste de souches paternelles ; la famille agnatique,
plus troite mais indivise ; enfin la famille qui soumet la patria potes-
tas de l'aeul les couples conjugaux de tous ses fils et petits-fils.
Pour le second point, la famille primitive mconnat les liens
biologiques de la parent : mconnaissance seulement juridique dans
la partialit unilinale de la filiation ; mais aussi ignorance positive
ou peut-tre mconnaissance systmatique (au sens de paradoxe de
la croyance que la psychiatrie donne ce terme), exclusion totale
de ces liens qui, pour ne pouvoir s'exercer qu' l'gard de la pater-
nit, s'observerait dans certaines cultures matriarcales (Rivers et
Malinowski). En outre la parent n'est reconnue que par le moyen
de rites qui lgitiment les liens du sang et au besoin en crent de
fictifs : faits du totmisme, adoption, constitution artificielle d'un
groupement agnatique comme la zadruga slave. De mme, d'aprs
notre code, la filiation est dmontre par le mariage.
A mesure qu'on dcouvre des formes plus primitives de la famille
humaine, elles s'largissent en groupements qui, comme le clan,
peuvent tre aussi considrs comme politiques. Que si l'on trans-
fre dans l'inconnu de la prhistoire la forme drive de la famille
biologique pour en faire natre par association naturelle ou artificielle
ces groupements, c'est l une hypothse contre laquelle choue la
preuve, mais qui est d'autant moins probable que les zoologistes
refusent - nous l'avons vu - d'accepter une telle gense pour les
socits animales elles-mmes.
D'autre part, si l'extension et la structure des groupements fami-
liaux primitifs n'excluent pas l'existence en leur sein de familles
limites leurs membres biologiques - le fait est aussi incontestable
que celui de la reproduction bisexue -, la forme ainsi arbitraire-
26
LES COMPLEXES FAMILIAUX DANS LA FORMATION DE L'INDIVIDU
ment isole ne peut rien nous apprendre de sa psychologie et on ne
peut l'assimiler la forme familiale actuellement existante.
Le groupe rduit que compose la famille moderne ne parat pas,
en effet, l'examen, comme une simplification mais plutt comme
une contraction de l'institution familiale. Il montre une structure
profondment complexe, dont plus d'un point s'claire bien mieux
par les institutions positivement connues de la famille ancienne que
par l'hypothse d'une famille lmentaire qu'on ne saisit nulle part.
Ce n'est pas dire qu'il soit trop ambitieux de chercher dans cette
forme complexe un sens qui l'unifie et peut-tre dirige son volu-
tion. Ce sens se livre prcisment quand, la lumire de cet examen
comparatif, on saisit le remaniement profond qui a conduit l'institu-
tion familiale sa forme actuelle ; on reconnat du mme coup qu'il
faut l'attribuer l'influence prvalente que prend ici le mariage, insti-
tution qu'on doit distinguer de la famille. D'o l'excellence du terme
famille conjugale , par lequel Durkheim la dsigne.
I. LE COMPLEXE, FACTEUR CONCRET
DE LA PSYCHOLOGIE FAMILIALE
C'est dans l'ordre original de ralit que constituent les relations
sociales qu'il faut comprendre la famille humaine. Si, pour asseoir ce
principe, nous avons eu recours aux conclusions de la sociologie, bien
que la somme des faits dont elle l'illustre dborde notre sujet, c'est
que l'ordre de ralit en question est l'objet propre de cette science.
Le principe est ainsi pos sur un plan o il a sa plnitude objective.
Comme tel, il permettra djuger selon leur vraie porte les rsultats
actuels de la recherche psychologique. Pour autant, en effet, qu'elle
rompt avec les abstractions acadmiques et vise, soit dans l'observa-
tion du behaviour, soit par l'exprience de la psychanalyse, rendre
compte du concret, cette recherche, spcialement quand elle s'exerce
sur les faits de la famille comme objet et circonstance psychique ,
n'objective jamais des instincts, mais toujours des complexes.
Ce rsultat n'est pas le fait contingent d'une tape rductible de la
thorie ; il faut y reconnatre, traduit en termes psychologiques mais
27
LES COMPLEXES FAMILIAUX DANS LA FORMATION DE L'INDIVIDU
conforme au principe prliminairement pos, ce caractre essentiel
de l'objet tudi : son conditionnement par des facteurs culturels,
aux dpens des facteurs naturels.
Le complexe, en effet, lie sous une forme fixe un ensemble de
ractions qui peut intresser toutes les fonctions organiques depuis
l'motion jusqu' la conduite adapte l'objet. Ce qui dfinit le
complexe, c'est qu'il reproduit une certaine ralit de l'ambiance, et
doublement.
1) Sa forme reprsente cette ralit en ce qu'elle a d'objective-
ment distinct une tape donne du dveloppement psychique ;
cette tape spcifie sa gense.
2) Son activit rpte dans le vcu la ralit ainsi fixe, chaque
fois que se produisent certaines expriences qui exigeraient une
objectivation suprieure de cette redite ; ces expriences spcifient
le conditionnement du complexe.
Cette dfinition elle seule implique que le complexe est domin
par des facteurs culturels : dans son contenu, reprsentatif d'un objet ;
dans sa forme, lie une tape vcue de robjectivation ; enfin dans sa
manifestation de carence objective l'gard d'une situation actuelle,
c'est--dire sous son triple aspect de relation de connaissance, de
forme d'organisation affective et d'preuve au choc du rel, le com-
plexe se comprend par sa rfrence l'objet. Or, toute identification
objective exige d'tre communicable, c'est--dire repose sur un critre
culturel ; c'est aussi par des voies culturelles qu'elle est le plus souvent
communique. Quant l'intgration individuelle des formes d'objec-
tivation, elle est l'uvre d'un procs dialectique qui fait surgir chaque
forme nouvelle des conflits de la prcdente avec le rel. Dans ce pro-
cs il faut reconnatre le caractre qui spcifie l'ordre humain, savoir
cette subversion de toute fixit instinctive, d'o surgissent les formes
fondamentales, grosses de variations infinies, de la culture.
Si le complexe dans son plein exercice est du ressort de la culture,
et si c'est l une considration essentielle pour qui veut rendre
compte des faits psychiques de la famille humaine, ce n'est pas dire
qu'il n'y ait pas de rapport entre le complexe et l'instinct. Mais, fait
curieux, en raison des obscurits qu'oppose la critique de la bio-
logie contemporaine le concept de l'instinct, le concept du com-
plexe, bien que rcemment introduit, s'avre mieux adapt des
objets plus riches ; c'est pourquoi, rpudiant l'appui que l'inventeur
28
LES COMPLEXES FAMILIAUX DANS LA FORMATION DE L'INDIVIDU
du complexe croyait devoir chercher dans le concept classique de
l'instinct, nous croyons que, par un renversement thorique, c'est
l'instinct qu'on pourrait clairer actuellement par sa rfrence au
complexe.
Ainsi pourrait-on confronter point par point : 1) la relation de
connaissance qu'implique le complexe, cette connaturalit de l'or-
ganisme l'ambiance o sont suspendues les nigmes de l'instinct ;
2) la typicit gnrale du complexe en rapport avec les lois d'un
groupe social, la typicit gnrique de l'instinct en rapport avec la
fixit de l'espce ; 3) le protisme des manifestations du complexe
qui, sous des formes quivalentes d'inhibition, de compensation,
de mconnaissance, de rationalisation, exprime la stagnation devant
un mme objet, la strotypie des phnomnes de l'instinct, dont
l'activation, soumise la loi du tout ou rien , reste rigide aux
variations de la situation vitale. Cette stagnation dans le complexe
tout autant que cette rigidit dans l'instinct - tant qu'on les rfre
aux seuls postulats de l'adaptation vitale, dguisement mcaniste du
finalisme, on se condamne en faire des nigmes ; leur problme
exige l'emploi des concepts plus riches qu'impose l'tude de la vie
psychique.
Nous avons dfini le complexe dans un sens trs large qui n'ex-
clut pas que le sujet ait conscience de ce qu'il reprsente. Mais c'est
comme facteur essentiellement inconscient qu'il fut d'abord dfini
par Freud. Son unit est en effet frappante sous cette forme, o elle
se rvle comme la cause d'effets psychiques non dirigs par la
conscience, actes manques, rves, symptmes. Ces effets ont des
caractres tellement distincts et contingents qu'ils forcent d'admettre
comme lment fondamental du complexe cette entit paradoxale :
une reprsentation inconsciente, dsigne sous le nom d'imago.
Complexes et imago ont rvolutionn la psychologie et spciale-
ment celle de la famille qui s'est rvle comme le lieu d'lection
des complexes les plus stables et les plus typiques : de simple sujet de
paraphrases moralisantes, la famille est devenue l'objet d'une analyse
concrte.
Cependant les complexes se sont dmontrs comme jouant un
rle d' organiseurs dans le dveloppement psychique ; ainsi domi-
nent-ils les phnomnes qui, dans la conscience, semblent les mieux
intgrs la personnalit ; ainsi sont motives dans l'inconscient non
29
LES COMPLEXES FAMILIAUX DANS LA FORMATION DE L*INDIVIDU
seulement des justifications passionnelles, mais d'objectivables ratio-
nalisations. La porte de la famille comme objet et circonstance psy-
chique s'en est du mme coup trouve accrue.
Ce progrs thorique nous a incit donner du complexe une
formule gnralise, qui permette d'y inclure les phnomnes
conscients de structure semblable. Tels les sentiments o il faut voir
des complexes motionnels conscients, les sentiments familiaux sp-
cialement tant souvent l'image inverse de complexes inconscients.
Telles aussi les croyances dlirantes, o le sujet affirme un complexe
comme une ralit objective ; ce que nous montrerons particulire-
ment dans les psychoses familiales. Complexes, imagos, sentiments
et croyances vont tre tudis dans leur rapport avec la famille et en
fonction du dveloppement psychique qu'ils organisent depuis l'en-
fant lev dans la famille jusqu' l'adulte qui la reproduit.
1. Le complexe du sevrage
Le complexe du sevrage fixe dans le psychisme la relation du
nourrissage, sous le mode parasitaire qu'exigent les besoins du pre-
mier ge de l'homme ; il reprsente la forme primordiale de l'imago
maternelle. Partant, il fonde les sentiments les plus archaques et les
plus stables qui unissent l'individu la famille. Nous touchons ici
au complexe le plus primitif du dveloppement psychique, celui
qui se compose avec tous les complexes ultrieurs ; il n'est que plus
frappant de le voir entirement domin par des facteurs culturels et
ainsi, ds ce stade primitif, radicalement diffrent de l'instinct.
Il s'en rapproche pourtant par deux caractres : le complexe du
sevrage, d'une part, se produit avec des traits si gnraux dans toute
l'tendue de l'espce qu'on peut le tenir pour gnrique ; d'autre
part, il reprsente dans le psychisme une fonction biologique, exer-
ce par un appareil anatomiquement diffrenci : la lactation. Aussi
comprend-on qu'on ait voulu rapporter un instinct, mme chez
l'homme, les comportements fondamentaux qui lient la mre l'en-
fant. Mais c'est ngliger un caractre essentiel de l'instinct : sa rgu-
lation physiologique manifeste dans le fait que l'instinct maternel
cesse d'agir chez l'animal quand la fin du nourrissage est accomplie.
Chez l'homme, au contraire, c'est une rgulation culturelle qui
30
LES COMPLEXES FAMILIAUX DANS LA FORMATION DE L'INDIVIDU
conditionne le sevrage. Elle y apparat comme dominante, mme si
on le limite au cycle de l'ablactation proprement dite, auquel rpond
pourtant la priode physiologique de la glande commune la classe
des mammifres. Si la rgulation qu'on observe enjalit n'apparat
comme nettement contre nature que dans des pratiques arrires -
qui ne sont pas toutes en voie de dsutude - , ce serait cder une
illusion grossire que de chercher dans la physiologie la base instinc-
tive de ces rgles, plus conformes la nature, qu'impose au sevrage
comme l'ensemble des murs l'idal des cultures les plus avan-
ces. En fait, le sevrage, par l'une quelconque des contingences op-
ratoires qu'il comporte, est souvent un traumatisme psychique dont
les effets individuels, anorexies dites mentales, toxicomanies par la
bouche, nvroses gastriques, rvlent leurs causes la psychanalyse.
Traumatisant ou non, le sevrage laisse dans le psychisme humain
la trace permanente de la relation biologique qu'il interrompt. Cette
crise vitale se double en effet d'une crise du psychisme, la premire
sans doute dont la solution ait une structure dialectique. Pour la
premire fois, semble-t-il, une tension vitale se rsout en intention
mentale. Par cette intention, le sevrage est accept ou refus ; l'inten-
tion certes est fort lmentaire, puisqu'elle ne peut pas mme tre
attribue un moi encore l'tat de rudiment ; l'acceptation ou le
refus ne peuvent tre conus comme un choix, puisqu'en l'absence
d'un moi qui affirme ou nie ils ne sont pas contradictoires ; mais,
ples coexistants et contraires, ils dterminent une attitude ambiva-
lente par essence, quoique l'un d'eux y prvale. Cette ambivalence
primordiale, lors des crises qui assurent la suite du dveloppement,
se rsoudra en diffrenciations psychiques d'un niveau dialectique
de plus en plus lev et d'une irrversibilit croissante. La prvalence
originelle y changera plusieurs fois de sens et pourra de ce fait y
subir des destines trs diverses ; elle s'y retrouvera pourtant et dans
le temps et dans le ton, elle propres, qu'elle imposera et ces crises
et aux catgories nouvelles dont chacune dotera le vcu.
C'est le refus du sevrage qui fonde le positif du complexe, savoir
l'imago de la relation nourricire qu'il tend rtablir. Cette imago
est donne dans son contenu par les sensations propres au premier
ge, mais n'a de forme qu' mesure qu'elles s'organisent mentale-
ment. Or, ce stade tant antrieur l'avnement de la forme de
l'objet, il ne semble pas que ces contenus puissent se reprsenter
31
LES COMPLEXES FAMILIAUX DANS LA FORMATION DE L'INDIVIDU
dans la conscience. Us s'y reproduisent pourtant dans les structures
mentales qui modlent, avons-nous dit, les expriences psychiques
ultrieures. Ils seront rvoqus par association l'occasion de celles-
ci, mais insparables des contenus objectifs qu'ils auront informs.
Analysons ces contenus et ces formes.
L'tude du comportement de la prime enfance permet d'affirmer
que les sensations extro-, proprio- et introceptives ne sont pas
encore, aprs le douzime mois, suffisamment coordonnes pour
que soit acheve la reconnaissance du corps propre, ni corrlative-
ment la notion de ce qui lui est extrieur.
Trs tt pourtant, certaines sensations extroceptives s'isolent
sporadiquement en units de perception. Ces lments d'objets
rpondent, comme il est prvoir, aux premiers intrts affectifs.
En tmoignent la prcocit et l'lectivit des ractions de l'enfant
l'approche et au dpart des personnes qui prennent soin de lui.
Il faut pourtant mentionner part, comme un fait de structure, la
raction d'intrt que l'enfant manifeste devant le visage humain :
elle est extrmement prcoce, s'observant ds les premiers jours
et avant mme que les coordinations motrices des yeux soient
acheves. Ce fait ne peut tre dtach du progrs par lequel le visage
humain prendra toute sa valeur d'expression psychique. Cette valeur,
pour tre sociale, ne peut tre tenue pour conventionneDe. La puis-
sance ractive, souvent sous un mode ineffable, que prend le masque
humain dans les contenus mentaux des psychoses parat tmoigner
de l'archasme de sa signification.
Quoi qu'il en soit, ces ractions lectives permettent de concevoir
chez l'enfant une certaine connaissance trs prcoce de la prsence
qui remplit la fonction maternelle, et le rle de traumatisme causal
que, dans certaines nvroses et certains troubles du caractre, peut
jouer une substitution de cette prsence. Cette connaissance, trs
archaque et pour laquelle semble fait le calembour claudlien de
co-naissance , se distingue peine de l'adaptation affective. Elle
reste tout engage dans la satisfaction des besoins propres au premier
ge et dans l'ambivalence typique des relations mentales qui s'y bau-
chent. Cette satisfaction apparat avec les signes de la plus grande
plnitude dont puisse tre combl le dsir humain, pour peu qu'on
considre l'enfant attach la mamelle.
Les sensations proprioceptives de la succion et de la prhension
32
LES COMPLEXES FAMILIAUX DANS LA FORMATION DE L'INDIVIDU
font videmment la base de cetfe ambivalence du vcu, qui ressort
de la situation mme : l'tre qui absorbe est tout absorb et le
complexe archaque lui rpond dans l'embrassement maternel. Nous
ne parlerons pas ici avec Freud d'auto-rotisme, puisque le moi n'est
pas constitu, ni de narcissisme, puisqu'il n'y a pas d'image du moi ;
bien moins encore d'rotisme oral, puisque la nostalgie du sein
nourricier, sur laquelle a quivoque l'cole psychanalytique, ne relve
du complexe du sevrage qu' travers son remaniement par le com-
plexe d'dipe. Cannibalisme , mais cannibalisme fusionnel, inef-
fable, la fois actif et passif; toujours survivant dans les jeux et mots
symboliques, qui, dans l'amour le plus volu, rappeent le dsir
de la larve, - nous reconnatrons en ces termes le rapport la ralit
sur lequel repose l'imago maternelle.
Cette base elle-mme ne peut tre dtache du chaos des sensa-
tions introceptives dont elle merge. L'angoisse, dont le prototype
apparat dans l'asphyxie de la naissance, le froid, li la nudit du tgu-
ment, et le malaise labyrinthique auquel rpond la satisfaction du ber-
cement organisent par leur triade le ton pnible de la vie organique
qui, pour les meilleurs observateurs, domine les six premiers mois de
l'homme. Ces malaises primordiaux ont tous la mme cause : une
insuffisante adaptation la rupture des conditions d'ambiance et de
nutrition qui font l'quilibre parasitaire de la vie intra-utrine.
Cette conception s'accorde avec ce que, l'exprience, la psycha-
nalyse trouve comme fonds dernier de l'imago du sein maternel :
sous les fantasmes du rve comme sous les obsessions de la veille se
dessinent avec une impressionnante prcision les images de l'habitat
intra-utrin et du seuil anatomique de la vie extra-utrine. En pr-
sence des donnes de la physiologie et du fait anatomique de la
non-mylinisation des centres nerveux suprieurs chez le nouveau-
n, il est pourtant impossible de faire de la naissance, avec certains
psychanalystes, un traumatisme psychique. Ds lors cette forme de
l'imago resterait une nigme si l'tat postnatal de l'homme ne mani-
festait, par son malaise mme, que l'organisation posturale, tonique,
quilibratoire, propre la vie intra-utrine, survit celle-ci.
Il faut remarquer que le retard de la dentition et de la marche,
un retard corrlatif de la plupart des appareils et des fonctions, dter-
mine chez l'enfant une impuissance vitale totale qui dure au-del des
deux premires annes. Ce fait doit-il tre tenu pour solidaire de ceux
33
LES COMPLEXES FAMILIAUX DANS LA FORMATION DE L'INDIVIDU
qui donnent au dveloppement somatique ultrieur de l'homme son
caractre d'exception par rapport aux animaux de sa classe : la dure
de la priode d'enfance et le retard de la pubert ? Quoi qu'il en soit,
il ne faut pas hsiter reconnatre au premier ge une dficience bio-
logique positive, et considrer l'homme comme un animal nais-
sance prmature. Cette conception explique la gnralit du com-
plexe, et qu'il soit indpendant des accidents de l'ablactation. Celle-ci
- sevrage au sens troit - donne son expression psychique, la premire
et aussi la plus adquate, l'imago plus obscure d'un sevrage plus
ancien, plus pnible et d'une plus grande ampleur vitale : celui qui,
la naissance, spare l'enfant de la matrice, sparation prmature
d'o provient un malaise que nul soin maternel ne peut compenser.
Rappelons en cet endroit un fait pdiatrique connu, l'arriration
affective trs spciale qu'on observe chez les enfants ns avant terme.
Ainsi constitue, l'imago du sein maternel domine toute la vie
de l'homme. De par son ambivalence pourtant, elle peut trouver se
saturer dans le renversement de la situation qu'elle reprsente, ce
qui n'est ralis strictement qu' la seule occasion de la maternit.
Dans l'allaitement, l'treinte et la contemplation de l'enfant, la mre,
en mme temps, reoit et satisfait le plus primitif de tous les dsirs. Il
n'est pas jusqu' la tolrance de la douleur de l'accouchement qu'on
ne puisse comprendre comme le fait d'une compensation reprsen-
tative du premier apparu des phnomnes affectifs : l'angoisse, ne
avec la vie. Seule l'imago qui imprime au plus profond du psychisme
le sevrage congnital de l'homme peut expliquer la puissance, la
richesse et la dure du sentiment maternel. La ralisation de cette
imago dans la conscience assure la femme une satisfaction psy-
chique privilgie, cependant que ses effets dans la conduite de la
mre prservent l'enfant de l'abandon qui lui serait fatal.
En opposant le complexe l'instinct, nous ne dnions pas au
complexe tout fondement biologique, et en le dfinissant par cer-
tains rapports idaux, nous le relions pourtant sa base matrielle.
Cette base, c'est la fonction qu'il assure dans le groupe social ; et ce
fondement biologique, on le voit dans la dpendance vitale de l'in-
dividu par rapport au groupe. Alors que l'instinct a un support orga-
nique et n'est rien d'autre que la rgulation de celui-ci dans une
fonction vitale, le complexe n'a qu' l'occasion un rapport organique,
quand il supple une insuffisance vitale par la rgulation d'une
34
LES COMPLEXES FAMILIAUX DANS LA FORMATION DE L'INDIVIDU
fonction sociale. Tel est le cas du complexe du sevrage. Ce rapport
organique explique que l'imago de la mre tienne aux profondeurs
du psychisme et que sa sublimation soit particulirement difficile,
comme il est manifeste dans l'attachement de l'enfant aux jupes de
sa mre et dans la dure parfois anachronique de ce lien.
L'imago pourtant doit tre sublime pour que de nouveaux rap-
ports s'introduisent avec le groupe social, pour que de nouveaux
complexes les intgrent au psychisme. Dans la mesure o elle rsiste
ces exigences nouvelles, qui sont celles du progrs de la personna-
lit, l'imago, salutaire l'origine, devient facteur de mort.
Que la tendance la mort soit vcue par l'homme comme objet
d'un apptit, c'est l une ralit que l'ana-lyse fait apparatre tous
les niveaux du psychisme ; cette ralit, il appartenait l'inventeur
de la psychanalyse d'en reconnatre le caractre irrductible, mais
l'explication qu'il en a donne par un instinct de mort, pour blouis-
sante qu'elle soit, n'en reste pas moins contradictoire dans les
termes ; tellement il est vrai que le gnie mme, chez Freud, cde
au prjug du biologiste qui exige que toute tendance se rapporte
un instinct. Or, la tendance la mort, qui spcifie le psychisme de
l'homme, s'explique de faon satisfaisante par la conception que
nous dveloppons ici, savoir que le complexe, unit fonctionnelle
de ce psychisme, ne rpond pas des fonctions vitales mais l'insuf-
fisance congnitale de ces fonctions.
Cette tendance psychique la mort, sous la forme originelle que
lui donne le sevrage, se rvle dans des suicides trs spciaux qui se
caractrisent comme non violents , en mme temps qu'y apparat
la forme orale du complexe : grve de la faim de l'anorexie mentale,
empoisonnement lent de certaines toxicomanies par la bouche,
rgime de famine des nvroses gastriques. L'analyse de ces cas montre
que, dans son abandon la mort, le sujet cherche retrouver l'imago
de la mre. Cette association mentale n'est pas seulement morbide.
Elle est gnrique, comme il se voit dans la pratique de la spulture,
dont certains modes manifestent clairement le sens psychologique de
retour au sein de la mre ; comme le rvlent encore les connexions
tablies entre la mre et la mort, tant par les techniques magiques
que par les conceptions des thologies antiques ; comme on l'observe
enfin dans toute exprience psychanalytique assez pousse.
Mme sublime, l'imago du sein maternel continue jouer un
35
LES COMPLEXES FAMILIAUX DANS LA FORMATION DE L'INDIVIDU
rle psychique important pour notre sujet. Sa forme la plus soustraite
la conscience, celle de l'habitat prnatal, trouve dans l'habitation et
dans son seuil, surtout dans leurs formes primitives, la caverne, la
hutte, un symbole adquat.
Par l, tout ce qui constitue l'unit domestique du groupe familial
devient pour l'individu, mesure qu'il est plus capable de l'abstraire,
l'objet d'une affection distincte de celles qui l'unissent chaque
membre de ce groupe. Par l encore, l'abandon des scurits que
comporte l'conomie familiale a la porte d'une rptition du
sevrage et ce n'est, le plus souvent, qu' cette occasion que le com-
plexe est suffisamment liquid. Tout retour, fut-il partiel, ces scu-
rits peut dclencher dans le psychisme des ruines sans proportion
avec le bnfice pratique de ce retour.
Tout achvement de la personnalit exige ce nouveau sevrage.
Hegel formule que l'individu qui ne lutte pas pour tre reconnu
hors du groupe familial n'atteint jamais la personnalit avant la
mort. Le sens psychologique d cette thse apparatra dans la suite
de notre tude. En fait de dignit personnelle, ce n'est qu' celle des
entits nominales que la famille promeut l'individu et eue ne le peut
qu' l'heure de la spulture.
La saturation du complexe fonde le sentiment maternel ; sa subli-
mation contribue au sentiment familial ; sa liquidation laisse des
traces o on peut la reconnatre : c'est cette structure de l'imago
qui reste la base des progrs mentaux qui l'ont remanie. S'il fallait
dfinir la forme la plus abstraite o on la retrouve, nous la caractri-
serions ainsi : une assimilation parfaite de la totalit l'tre. Sous cette
formule d'aspect un peu philosophique, on reconnatra ces nostalgies
de l'humanit : mirage mtaphysique de l'harmonie universelle,
abme mystique de la fusion affective, utopie sociale d'une tutelle
totalitaire, toutes sorties de la hantise du paradis perdu d'avant la
naissance et de la plus obscure aspiration la mort.
2. Le complexe de l'intrusion
Le complexe de l'intrusion reprsente l'exprience que ralise le
sujet primitif, le plus souvent quand il voit un ou plusieurs de ses
semblables participer avec lui la relation domestique, autrement dit,
36
LES COMPLEXES FAMILIAUX DANS LA FORMATION DE L*INDIVIDU
lorsqu'il se connat des frres. Les conditions en seront donc trs
variables, d'une part selon les cultures et l'extension qu'elles donnent
au groupe domestique, d'autre part selon les contingences indivi-
duelles, et d'abord selon la place que le sort donne au sujet dans
l'ordre des naissances, selon la position dynastique, peut-on dire, qu'il
occupe ainsi avant tout conflit : celle de nanti ou celle d'usurpateur.
La jalousie infantile a ds longtemps frapp les observateurs : J'ai
vu de mes yeux, dit saint Augustin, et bien observ un tout-petit en
proie la jalousie : il ne parlait pas encore et il ne pouvait sans plir
arrter son regard au spectacle amer de son frre de lait (Confes-
sions, I, vu). Le fait ici rvl l'tonnement du moraliste resta long-
temps rduit la valeur d'un thme de rhtorique, utilisable toutes
fins apologtiques.
L'observation exprimentale de l'enfant et les investigations psy-
chanalytiques, en dmontrant la structure de la jalousie infantile, ont
mis au jour son rle dans la gense de la sociabilit et, par l, de la
connaissance elle-mme en tant qu'humaine. Disons que le point
critique rvl par ces recherches est que la jalousie, dans son fond,
reprsente non pas une rivalit vitale mais une identification mentale.
Des enfants entre six mois et deux ans tant confronts par couple
et sans tiers et laisss leur spontanit ludique, on peut constater le
fait suivant : entre les enfants ainsi mis en prsence apparaissent des
ractions diverses o semble se manifester une communication.
Parmi ces ractions un type se distingue, du fait qu'on peut y recon-
natre une rivalit objectivement dfinissable : il comporte en effet
entre les sujets une certaine adaptation des postures et des gestes,
savoir une conformit dans leur alternance, une convergence dans
leur srie, qui les ordonnent en provocations et ripostes et permet-
tent d'affirmer, sans prjuger de la conscience des sujets, qu'ils ra-
lisent la situation comme double issue, comme une alternative.
Dans la mesure mme de cette adaptation, on peut admettre que
ds ce stade s'bauche la reconnaissance d'un rival, c'est--dire
d'un autre comme objet. Or, si une telle raction peut tre trs
prcoce, elle se montre dtermine par une condition si dominante
qu'elle en apparat comme univoque : savoir une limite qui ne
peut tre dpasse dans l'cart d'ge entre les sujets. Cette limite se
restreint deux mois et demi dans la premire anne de la priode
envisage et reste aussi stricte en s'largissant.
37
LES COMPLEXES FAMILIAUX DANS LA FORMATION DE L'INDIVIDU
Si cette condition n'est pas remplie, les ractions que l'on observe
entre les enfants confronts ont une valeur toute diffrente. Exami-
nons les plus frquentes : celles de la parade, de la sduction, du des-
potisme. Bien que deux partenaires y figurent, le rapport qui caract-
rise chacune d'elles se rvle l'observation, non pas comme un
conflit entre deux individus, mais dans chaque sujet, comme un
conflit entre deux attitudes opposes et complmentaires, et cette
participation bipolaire est constitutive de la situation elle-mme. Pour
comprendre cette structure, qu'on s'arrte un instant l'enfant qui
se donne en spectacle et celui qui le suit du regard : quel est le plus
spectateur? Ou bien qu'on observe l'enfant qui prodigue envers
un autre ses tentatives de sduction : o est le sducteur? Enfin, de
l'enfant qui jouit des preuves de la domination qu'il exerce et de
celui qui se complat s'y soumettre : qu'on se demande quel est le
plus asservi. Ici se ralise ce paradoxe : que chaque partenaire confond
la patrie de l'autre avec la sienne propre et s'identifie lui ; mais qu'il
peut soutenir ce rapport sur une participation proprement insigni-
fiante de cet autre et vivre alors toute la situation lui seul, comme
le manifeste la discordance parfois totale entre leurs conduites. C'est
dire que l'identification, spcifique des conduites sociales, ce stade,
se fonde sur un sentiment de l'autre, que l'on ne peut que mcon-
natre sans une conception correcte de sa valeur tout imaginaire.
Quelle est donc la structure de cette imago ? Une premire indi-
cation nous est donne par la condition reconnue plus haut pour
ncessaire une adaptation relle entre partenaires, savoir un cart
d'ge trs troitement limit. Si l'on se rfre au fait que ce stade est
caractris par des transformations de la structure nerveuse assez
rapides et profondes pour dominer les diffrenciations individuelles,
on comprendra que cette condition quivaut l'exigence d'une
similitude entre les sujets. Il apparat que l'imago de l'autre est lie
la structure du corps propre et plus spcialement de ses fonctions
de relation, par une certaine similitude objective.
La doctrine de la psychanalyse permet de serrer davantage le pro-
blme. Elle nous montre dans le frre, au sens neutre, l'objet lectif
des exigences de la libido qui, au stade que nous tudions, sont
homosexuelles. Mais aussi elle insiste sur la confusion en cet objet de
deux relations affectives, amour et identification, dont l'opposition
sera fondamentale aux stades ultrieurs.
38
LES COMPLEXES FAMILIAUX DANS LA FORMATION DE L'INDIVIDU
Cette ambigut originelle se retrouve chez l'adulte, dans la pas-
sion de la jalousie amoureuse, et c'est l qu'on peut le mieux la saisir.
On doit la reconnatre, en effet, dans le puissant intrt que le sujet
porte l'image du rival : intrt qui, bien qu'il s'affirme comme
haine, c'est--dire comme ngatif, et bien qu'il se motive par l'objet
prtendu de l'amour, n'en parat pas moins entretenu par le sujet de
la faon la plus gratuite et la plus coteuse et souvent domine tel
point le sentiment amoureux lui-mme, qu'il doit tre interprt
comme l'intrt essentiel et positif de la passion. Cet intrt confond
en lui l'identification et l'amour, et, pour n'apparatre que masqu
dans le registre de la pense de l'adulte, n'en confre pas moins la
passion qu'il soutient cette irrfutabilit qui l'apparente l'obses-
sion. L'agressivit maximum qu'on rencontre dans les formes psy-
chotiques de la passion est constitue bien plus par la ngation de
cet intrt singulier que par la rivalit qui parat la justifier.
Mais c'est tout spcialement dans la situation fraternelle primitive
que l'agressivit se dmontre pour secondaire l'identification. La
doctrine freudienne reste incertaine sur ce point ; l'ide darwinienne
que la lutte est aux origines mmes de la vie garde en effet un grand
crdit auprs du biologiste ; mais sans doute faut-il reconnatre ici le
prestige moins critiqu d'une emphase moralisante, qui se transmet
en des poncifs tels que : homo homini lupus. Il est vident, au contraire,
que le nourrissage constitue prcisment pour les jeunes une neu-
tralisation temporaire des conditions de la lutte pour la nourriture.
Cette signification est plus vidente encore chez l'homme. L'appari-
tion de la jalousie en rapport avec le nourrissage, selon le thme
classique illustr plus haut par une citation de saint Augustin, doit
donc tre interprte prudemment. En fait, la jalousie peut se mani-
fester dans des cas o le sujet, depuis longtemps sevr, n'est pas en
situation de concurrence vitale l'gard de son frre. Le phnomne
semble donc exiger comme pralable une certaine identification
l'tat du frre. Au reste, la doctrine analytique, en caractrisant
comme sadomasochiste la tendance typique de la libido ce mme
stade, souligne certes que l'agressivit domine alors l'conomie
affective, mais aussi qu'elle est toujours la fois subie et agie, c'est--
dire sous-tendue par une identification l'autre, objet de la violence.
Rappelons que ce rle de doublure intime que joue le maso-
chisme dans le sadisme a t mis en relief par la psychanalyse et que
39
LES COMPLEXES FAMILIAUX DANS LA FORMATION DE L'INDIVIDU
c'est l'nigme que constitue le masochisme dans l'conomie des
instincts vitaux qui a conduit Freud affirmer un instinct de mort.
Si Ton veut suivre l'ide que nous avons indique plus haut, et
dsigner avec nous dans le malaise du sevrage humain la source du
dsir de la mort, on reconnatra dans le masochisme primaire le
moment dialectique o le sujet assume par ses premiers actes de
jeu la reproduction de ce malaise mme et, par l, le sublime et le
surmonte. C'est bien ainsi que sont apparus les jeux primitifs de
l'enfant l'il connaisseur de Freud : cette joie de la premire
enfance de rejeter un objet du champ de son regard, puis, l'objet
retrouv, d'en renouveler inpuisablement l'exclusion, signifie bien
que c'est le pathtique du sevrage que le sujet s'inflige nouveau, tel
qu'il l'a subi, mais dont il triomphe maintenant qu'il est actif dans sa
reproduction.
Le ddoublement ainsi bauch dans le sujet, c'est l'identification
au frre qui lui permet de s'achever : elle fournit l'image qui fixe
l'un des ples du masochisme primaire. Ainsi la non-violence du
suicide primordial engendre la violence du meurtre imaginaire du
frre. Mais cette violence n'a pas de rapport avec la lutte pour la vie.
L'objet que choisit l'agressivit dans les primitifs jeux de la mort est,
en effet, hochet ou dchet, biologiquement indiffrent ; le sujet
l'abolit gratuitement, en quelque sorte pour le plaisir, il ne fait que
consommer ainsi la perte de l'objet maternel. L'image du frre non
sevr n'attire une agression spciale que parce qu'elle rpte dans
le sujet l'imago de la situation maternelle et avec elle le dsir de la
mort. Ce phnomne est secondaire l'identification.
L'identification affective est une fonction psychique dont la
psychanalyse a tabli l'originalit, spcialement dans le complexe
d'dipe, comme nous le verrons. Mais l'emploi de ce terme au
stade que nous tudions reste mal dfini dans la doctrine ; c'est
quoi nous avons tent de suppler par une thorie de cette identifi-
cation dont nous dsignons le moment gntique sous le terme de
stade du miroir.
Le stade ainsi considr rpond au dclin du sevrage, c'est--dire
la fin de ces six mois dont la dominante psychique de malaise,
rpondant au retard de la croissance physique, traduit cette prmatu-
ration de la naissance qui est, comme nous l'avons dit, le fond spci-
fique du sevrage chez l'homme. Or, la reconnaissance par le sujet de
40
LES COMPLEXES FAMILIAUX DANS LA FORMATION DE L'INDIVIDU
son image dans le miroir est un phnomne qui, pour l'analyse de
ce stade, est deux fois significatif: le phnomne apparat aprs six
mois et son tude ce moment rvle de faon dmonstrative les
tendances qui constituent alors la ralit du sujet ; l'image spculaire,
en raison mme de ces affinits, donne un bon symbole de cette
ralit : de sa valeur affective, illusoire comme l'image, et de sa struc-
ture, comme elle reflet de la forme humaine.
La perception de la forme du semblable en tant qu'unit mentale
est lie chez l'tre vivant un niveau corrlatif d'intelligence et de
sociabilit. L'imitation au signal la montre, rduite, chez l'animal
de troupeau ; les structures chomimiques, chopraxiques en mani-
festent l'infinie richesse chez le singe et chez l'homme* C'est le sens
primaire de l'intrt que l'un et l'autre manifestent leur image sp-
culaire. Mais si leurs comportements l'gard de cette image, sous la
forme de tentatives d'apprhension manuelle, paraissent se ressem-
bler, ces jeux ne dominent chez l'homme que pendant un moment,
la fin de la premire anne, ge dnomm par Bhler ge du
chimpanz parce que l'homme y passe un pareil niveau d'intelli-
gence instrumentale.
Or, le phnomne de perception qui se produit chez l'homme
ds le sixime mois est apparu ds ce moment sous une forme toute
diffrente, caractristique d'une intuition illuminative, savoir, sur le
fonds d'une inhibition attentive, rvlation soudaine du comporte-
ment adapt (ici geste de rfrence quelque partie du corps
propre) ; puis ce gaspillage jubilatoire d'nergie qui signale objec-
tivement le triomphe ; cette double raction laissant entrevoir le
sentiment de comprhension sous sa forme ineffable. Ces caractres
traduisent selon nous le sens secondaire que le phnomne reoit
des conditions libidinales qui entourent son apparition. Ces condi-
tions ne sont que les tensions psychiques issues des mois de prma-
turation et qui paraissent traduire une double rupture vitale : rupture
de cette immdiate adaptation au milieu qui dfinit le monde de
l'animal par sa connaturalit ; rupture de cette unit de fonctionne-
ment du vivant qui asservit chez l'animal la perception la pulsion.
La discordance, ce stade chez l'homme, tant des pulsions que
des fonctions, n'est que la suite de l'incoordination prolonge des
appareils. Il en rsulte un stade affectivement et mentalement consti-
tu sur la base d'une proprioceptivit qui donne le corps comme
41
LES COMPLEXES FAMILIAUX DANS LA FORMATION DE L'INDIVIDU
morcel : d'une part, l'intrt psychique se trouve dplac sur des
tendances visant quelque recollement du corps propre ; d'autre
part, la ralit, soumise d'abord un morcellement perceptif, dont
le chaos atteint jusqu' ses catgories, espaces , par exemple, aussi
disparates que les statiques successives de l'enfant, s'ordonne en refl-
tant les formes du corps, qui donnent en quelque sorte le modle de
tous les objets.
C'est ici une structure archaque du monde humain dont l'analyse
de l'inconscient a montr les profonds vestiges : fantasmes de dmem-
brement, de dislocation du corps, dont ceux de la castration ne sont
qu'une image mise en valeur par un complexe particulier ; l'imago
du double, dont les objectivations fantastiques, telles que des causes
diverses les ralisent divers ges de la vie, rvlent au psychiatre
qu'elle volue avec la croissance du sujet; enfin, ce symbolisme
anthropomorphique et organique des objets dont la psychanalyse,
dans les rves et dans les symptmes, a fait la prodigieuse dcouverte.
La tendance par o le sujet restaure l'unit perdue de soi-mme
prend place ds l'origine au centre de la conscience. Elle est la source
d'nergie de son progrs mental, progrs dont la structure est dter-
mine par la prdominance des fonctions visuelles. Si la recherche
de son unit affective promeut chez le sujet les formes o il se
reprsente son identit, la forme la plus intuitive en est donne,
cette phase, par l'image spculaire. Ce que le sujet salue en elle,
c'est l'unit mentale qui lui est inhrente. Ce qu'il y reconnat, c'est
l'idal de l'imago du double. Ce qu'il y acclame, c'est le triomphe
de la tendance salutaire.
Le monde propre cette phase est donc un monde narcissique.
En le dsignant ainsi nous n'voquons pas seulement sa structure
libidinale par le terme mme auquel Freud et Abraham, ds 1908,
ont assign le sens purement nergtique d'investissement de la
libido sur le corps propre ; nous voulons aussi pntrer sa structure
mentale avec le plein sens du mythe de Narcisse ; que ce sens indique
la mort : l'insuffisance vitale dont ce monde est issu ; ou la rflexion
spculaire : l'imago du double qui lui est centrale ; ou l'illusion de
l'image : ce monde, nous Talions voir, ne contient pas d'autrui.
La perception de l'activit d'autrui ne suffit pas en effet rompre
l'isolement affectif du sujet. Tant que l'image du semblable ne joue
que son rle primaire, limit la fonction d'expressivit, elle
42
LES COMPLEXES FAMILIAUX DANS LA FORMATION DE L'INDIVIDU
dclenche chez le sujet motions et postures similaires, du moins
dans la mesure o le permet la structure actuelle de ses appareils.
Mais tandis qu'il subit cette suggestion motionnelle ou motrice,
le sujet ne se distingue pas de l'image elle-mme. Bien plus, dans la
discordance caractristique de cette phase, l'image ne fait qu'ajouter
l'intrusion temporaire d'une tendance trangre. Appelons-la intru-
sion narcissique : l'unit qu'elle introduit dans les tendances contri-
buera pourtant la formation du moi. Mais, avant que le moi
affirme son identit, il se confond avec cette image qui le forme,
mais l'aline primordialement.
Disons que le moi gardera de cette origine la structure ambigu
du spectacle qui, manifeste dans les situations plus haut dcrites du
despotisme, de la sduction, de la parade, donne leur forme des
pulsions, sadomasochiste et scoptophilitique (dsir de voir et d'tre
vu), destructrices de l'autrui dans leur essence. Notons aussi que
cette intrusion primordiale fait comprendre toute projection du moi
constitu, qu'elle se manifeste comme mythomaniaque chez l'enfant
dont l'identification personnelle vacille encore, comme transitiviste
chez le paranoaque dont le moi rgresse un stade archaque, ou
comme comprhensive quand elle est intgre dans un moi normal.
Le moi se constitue en mme temps que l'autrui dans le drame de
la jalousie. Pour le sujet, c'est une discordance qui intervient dans la
satisfaction spectaculaire, du fait de la tendance que celle-ci suggre.
Elle implique l'introduction d'un tiers objet qui, la confusion
affective, comme l'ambigut spectaculaire, substitue la concur-
rence d'une situation triangulaire. Ainsi le sujet, engag dans la
jalousie par identification, dbouche sur une alternative nouvelle o
se joue le sort de la ralit : ou bien il retrouve l'objet maternel et va
s'accrocher au refus du rel et la destruction de l'autre ; ou bien,
conduit quelque autre objet, il le reoit sous la forme caractris-
tique de la connaissance humaine, comme objet communicable,
puisque concurrence implique la fois rivalit et accord ; mais en
mme temps il reconnat l'autre avec lequel s'engage la lutte ou le
contrat, bref il trouve la fois l'autrui et l'objet socialis. Ici encore
la jalousie humaine se distingue donc de la rivalit vitale immdiate,
puisqu'elle forme son objet plus qu'il ne la dtermine ; elle se rvle
comme l'archtype des sentiments sociaux.
Le moi ainsi conu ne trouve pas avant l'ge de trois ans sa consti-
43
LES COMPLEXES FAMILIAUX DANS LA FORMATION DE L'INDIVIDU
tution essentielle ; c'est celle mme, on le voit, de l'objectivit fonda-
mentale de la connaissance humaine. Point remarquable, celle-ci
tire sa richesse et sa puissance de l'insuffisance vitale de l'homme
ses origines. Le symbolisme primordial de l'objet favorise tant son
extension hors des limites des instincts vitaux que sa perception
comme instrument. Sa socialisation par la sympathie jalouse fonde sa
permanence et sa substantialit.
Tels sont les traits essentiels du rle psychique du complexe
fraternel. En voici quelques applications.
Le rle traumatisant du frre au sens neutre est donc constitu
par son intrusion. Le fait et l'poque de son apparition dterminent
sa signification pour le sujet. L'intrusion part du nouveau venu pour
infester l'occupant ; dans la famille, c'est en rgle gnrale le fait
d'une naissance et c'est l'an qui en principe joue le rle de patient.
La raction du patient au traumatisme dpend de son dvelop-
pement psychique. Surpris par l'intrus dans le dsarroi du sevrage, il
le ractive sans cesse son spectacle : il fait alors une rgression qui
se rvlera, selon les destins du moi} comme psychose schizophr-
nique ou comme nvrose hypocondriaque ; ou bien il ragit par la
destruction imaginaire du monstre, qui donnera de mme soit des
impulsions perverses, soit une culpabilit obsessionnelle.
Que l'intrus ne survienne au contraire qu'aprs le complexe de
l'dipe, il est adopt le plus souvent sur le plan des identifications
parentales, plus denses affectivement et plus riches de structure, on
va le voir. Il n'est plus pour le sujet l'obstacle ou le reflet, mais une
personne digne d'amour ou de haine. Les pulsions agressives se
subliment en tendresse ou en svrit.
Mais le frre donne aussi le modle archaque du moi. Ici le
rle d'agent revient l'an comme au plus achev. Plus conforme
sera ce modle l'ensemble des pulsions du sujet, plus heureuse sera
la synthse du moi et plus relles les formes de l'objectivit. Cette
formule est-elle confirme par l'tude des jumeaux? On sait que de
nombreux mythes leur imputent la puissance du hros, par quoi est
restaure dans la ralit l'harmonie du sein maternel, mais c'est au
prix d'un fratricide. Quoi qu'il en soit, c'est par le semblable que
l'objet comme le moi se ralise : plus il peut assimiler de son parte-
naire, plus le sujet conforte la fois sa personnalit et son objectivit,
garantes de sa future efficacit.
44
LES COMPLEXES FAMILIAUX DANS LA FORMATION DE L'INDIVIDU
Mais le groupe de la fratrie familiale, divers d'ge et de sexe, est
favorable aux identifications les plus discordantes du moi. L'imago
primordiale du double sur laquelle le moi se modle semble d'abord
domine par les fantaisies de la forme, comme il apparat dans
le fantasme commun aux deux sexes de la mre phallique ou dans le
double phallique de la femme nvrose. D'autant plus facilement se
fixera-t-elle en des formes atypiques, o des appartenances acces-
soires pourront jouer un aussi grand rle que des diffrences orga-
niques ; et l'on verra, selon la pousse, suffisante ou non, de l'instinct
sexuel, cette identification de la phase narcissique, soit engendrer les
exigences formelles d'une homosexualit ou de quelque ftichisme
sexuel, soit, dans le systme d'un moi paranoaque, s'objectiver dans
le type du perscuteur, extrieur ou intime.
Les connexions de la paranoa avec le complexe fraternel se mani-
festent par la firquence des thmes de filiation, d'usurpation, de
spoliation, comme sa structure narcissique se rvle dans les thmes
plus paranodes de l'intrusion, de l'influence, du ddoublement, du
double et de toutes les transmutations dlirantes du corps.
Ces connexions s'expliquent en ce que le groupe familial, rduit
la mre et la fratrie, dessine un complexe psychique o la ralit
tend rester imaginaire ou tout au plus abstraite. La clinique montre
qu'effectivement le groupe ainsi dcomplt est trs favorable
l'closion des psychoses et qu'on y trouve la plupart des cas de
dlires deux.
3. Le complexe d
f
dipe
C'est en dcouvrant dans l'analyse des nvroses les faits dipiens
que Freud mit au jour le concept du complexe. Le complexe
d'dipe, expos, vu le nombre des relations psychiques qu'il int-
resse, en plus d'un point de cet ouvrage, s'impose ici - et notre
tude, puisqu'il dfinit plus particulirement les relations psychiques
dans la famille humaine - et notre critique, pour autant que Freud
donne cet lment psychologique pour la forme spcifique de la
famille humaine et lui subordonne toutes les variations sociales de
la famille. L'ordre mthodique ici propos, tant dans la considration
des structures mentales que des faits sociaux, conduira une rvision
45
LES COMPLEXES FAMILIAUX DANS LA FORMATION DE L'INDIVIDU
du complexe qui permettra de situer dans l'histoire la famille pater-
naliste et d'clairer plus avant la nvrose contemporaine.
La psychanalyse a rvl chez l'enfant des pulsions gnitales dont
l'apoge se situe dans la quatrime anne. Sans nous tendre ici sur
leur structure, disons qu'elles constituent une sorte de pubert psy-
chologique, fort prmature, on le voit, par rapport la pubert
physiologique. En fixant l'enfant par un dsir sexuel l'objet le plus
proche que lui offrent normalement la prsence et l'intrt, savoir
le parent de sexe oppos, ces pulsions donnent sa base au complexe ;
leur frustration en forme le nud. Bien qu'inhrente la prma-
turation essentielle de ces pulsions, cette frustration est rapporte
par l'enfant au tiers objet que les mmes conditions de prsence
et d'intrt lui dsignent normalement comme l'obstacle leur
satisfaction : savoir au parent du mme sexe.
La frustration qu'il subit s'accompagne, en effet, communment
d'une rpression ducative qui a pour but d'empcher tout aboutis-
sement de ces pulsions et spcialement leur aboutissement mastur-
batoire. D'autre part, l'enfant acquiert une certaine intuition de la
situation qui lui est interdite, tant par les signes discrets et diffus qui
trahissent sa sensibilit les relations parentales que par les hasards
intempestifs qui les lui dvoilent. Par ce double procs, le parent
de mme sexe apparat l'enfant la fois comme l'agent de l'inter-
diction sexuelle et l'exemple de sa transgression.
La tension ainsi constitue se rsout, d'une part, par un refou-
lement de la tendance sexuelle qui, ds lors, restera latente - laissant
place des intrts neutres, minemment favorables aux acquisitions
ducatives - jusqu' la pubert ; d'autre part, par la sublimation de
l'image parentale qui perptuera dans la conscience un idal repr-
sentatif, garantie de la concidence future des attitudes psychiques
et des attitudes physiologiques au moment de la pubert. Ce double
procs a une importance gntique fondamentale, car il reste inscrit
dans le psychisme en deux instances permanentes : celle qui refoule
s'appelle le surmoi, celle qui sublime, l'idal du moi. Elles reprsen-
tent l'achvement de la crise dipienne.
Ce schma essentiel du complexe rpond un grand nombre
de donnes de l'exprience. L'existence de la sexualit infantile est
dsormais inconteste ; au reste, pour s'tre rvle historiquement
par ces squelles de son volution qui constituent les nvroses, elle
46
LES COMPLEXES FAMILIAUX DANS LA FORMATION DE L'INDIVIDU
est accessible l'observation la plus immdiate, et sa mconnaissance
sculaire est une preuve frappante de la relativit sociale du savoir
humain. Les instances psychiques qui, sous le nom du surmoi et
d'idal du moi, ont t isoles dans une analyse concrte des symp-
tmes des nvroses ont manifest leur valeur scientifique dans la
dfinition et l'explication des phnomnes de la personnalit ; il y a
l un ordre de dtermination positive qui rend compte d'une foule
d'anomalies du comportement humain et, du mme coup, rend
caduques, pour ces troubles, les rfrences l'ordre organique qui,
encore que de pur principe ou simplement mythiques, tiennent lieu
de mthode exprimentale toute une tradition mdicale.
A vrai dire, ce prjug qui attribue l'ordre psychique un carac-
tre piphnomnal, c'est--dire inoprant, tait favoris par une
analyse insuffisante des facteurs de cet ordre et c'est prcisment la
lumire de la situation dfinie comme dipienne que tels accidents
de l'histoire du sujet prennent la signification et l'importance qui
permettent de leur rapporter tel trait individuel de sa personnalit ; on
peut mme prciser que lorsque ces accidents affectent la situation
dipienne comme traumatismes dans son volution, ils se rptent
plutt dans les effets du surmoi ; s'ils l'affectent comme atypies dans
sa constitution, c'est plutt dans les formes de l'idal du moi qu'ils se
refltent. Ainsi, comme inhibitions de l'activit cratrice ou comme
inversions de l'imagination sexuelle, un grand nombre de troubles,
dont beaucoup apparaissent au niveau des fonctions somatiques
lmentaires, ont trouv leur rduction thorique et thrapeutique.
Dcouvrir que des dveloppements aussi importants pour l'homme
que ceux de la rpression sexuelle et du sexe psychique taient soumis
la rgulation et aux accidents d'un drame psychique de la famille,
c'tait fournir la plus prcieuse contribution l'anthropologie
du groupement familial, spcialement l'tude des interdictions que
ce groupement formule universellement et qui ont pour objet le
commerce sexuel entre certains de ses membres. Aussi bien, Freud en
vint-il vite formuler une thorie de la famille. Elle tait fonde sur
une dissymtrie, apparue ds les premires recherches, dans la situation
des deux sexes par rapport l'dipe. Le procs qui va du dsir di-
pien sa rpression n'apparat aussi simple que nous l'avons expos
d'abord que chez l'enfant maie. Aussi est-ce ce dernier qui est pris
constamment pour sujet dans les exposs didactiques du complexe.
47
LES COMPLEXES FAMILIAUX DANS LA FORMATION DE L'INDIVIDU
Le dsir dipien apparat, en effet, beaucoup plus intense chez le
garon et donc pour la mre. D'autre part, la rpression rvle, dans
son mcanisme, des traits qui ne paraissent d'abord justifiables que si,
dans sa forme typique, elle s'exerce du pre au fils. C'est l le fait du
complexe de castration.
Cette rpression s'opre par un double mouvement affectif
du sujet : agressivit contre le parent l'gard duquel son dsir
sexuel le met en posture de rival ; crainte secondaire, prouve en
retour, d'une agression semblable. Or, un fantasme soutient ces deux
mouvements, si remarquable qu'il a t individualis avec eux en
un complexe dit de castration. Si ce terme se justifie par les fins
agressives et rpressives qui apparaissent ce moment de l'dipe,
il est pourtant peu conforme au fantasme qui en constitue le fait
original.
Ce fantasme consiste essentiellement dans la mutilation d'un
membre, c'est--dire dans un svice qui ne peut servir qu' chtrer
un mle. Mais la ralit apparente de ce danger, jointe au fait que la
menace en est rellement formule par une tradition ducative,
devait entraner Freud le concevoir comme ressenti d'abord pour
sa valeur relle et reconnatre dans une crainte inspire de mle
mle, en fait par le pre, le prototype de la rpression dipienne.
Dans cette voie, Freud recevait un appui d'une donne sociolo-
gique : non seulement l'interdiction de l'inceste avec la mre a un
caractre universel, travers les relations de parent infiniment
diverses et souvent paradoxales que les cultures primitives frappent
du tabou de l'inceste, mais encore, quel que soit dans une culture le
niveau de la conscience morale, cette interdiction est toujours
expressment formule et la transgression en est frappe d'une rpro-
bation constante. C'est pourquoi Frazer reconnat dans le tabou de la
mre la loi primordiale de l'humanit.
C'est ainsi que Freud fait le saut thorique dont nous avons
marqu l'abus dans notre introduction : de la famille conjugale qu'il
observait chez ses sujets, une hypothtique famille primitive conue
comme une horde qu'un mle domine par sa supriorit biologique
en accaparant les femelles nubiles. Freud se fonde sur le lien que l'on
constate entre les tabous et les observances l'gard du totem, tour
tour objet d'inviolabilit et d'orgie sacrificielle. Il imagine un drame
de meurtre du pre par les fils, suivi d'une conscration posthume
48
LES COMPLEXES FAMILIAUX DANS LA FORMATION DE L'INDIVIDU
de sa puissance sur les femmes par les meurtriers prisonniers d'une
insoluble rivalit : vnement primordial, d'o, avec le tabou de la
mre, serait sortie toute tradition morale et culturelle.
Mme si cette construction n'tait ruine par les seules ptitions
de principe qu'elle comporte - attribuer un groupe biologique la
possibilit, qu'il s'agit justement de fonder, de la reconnaissance
d'une loi - , ses prmisses prtendues biologiques elles-mmes,
savoir la tyrannie permanente exerce par le chef de la horde, se
rduiraient un fantme de plus en plus incertain mesure qu'avance
notre connaissance des anthropodes. Mais surtout les traces univer-
sellement prsentes et la survivance tendue d'une structure matriar-
cale de la famille, l'existence dans son aire de toutes les formes fon-
damentales de la culture, et spcialement d'une rpression souvent
trs rigoureuse de la sexualit, manifestent que l'ordre de la famille
humaine a des fondements soustraits la force du mle.
Il nous semble pourtant que l'immense moisson des faits que le
complexe d'dipe a permis d'objectiver depuis quelque cinquante
ans peut clairer la structure psychologique de la famille, plus avant
que les intuitions trop htives que nous venons d'exposer.
Le complexe d'dipe marque tous les niveaux du psychisme ;
mais les thoriciens de la psychanalyse n'ont pas dfini sans ambi-
gut les fonctions qu'il y remplit ; c'est faute d'avoir distingu suffi-
samment les plans de dveloppement sur lesquels ils l'expliquent.
Si le complexe leur apparat en effet comme l'axe selon lequel Vvo-
lution de la sexualit se projette dans la constitution de la ralit, ces deux
plans divergent chez l'homme d'une incidence spcifique, qui est
certes reconnue par eux comme rpression de la sexualit et sublimation
de la ralit, mais doit tre intgre dans une conception plus rigou-
reuse de ces rapports de structure : le rle de maturation que joue le
complexe dans l'un et l'autre de ces plans ne pouvant tre tenu pour
parallle qu'approximativement.
L'appareil psychique de la sexualit se rvle d'abord chez l'enfant
sous les formes les plus aberrantes par rapport ses fins biologiques,
et la succession de ces formes tmoigne que c'est par une matu-
ration progressive qu'il se conforme l'organisation gnitale. Cette
maturation de la sexualit conditionne le complexe d'dipe, en
formant ses tendances fondamentales, mais, inversement, le com-
plexe la favorise en la dirigeant vers ses objets.
49
LES COMPLEXES FAMILIAUX DANS LA FORMATION DE L'INDIVIDU
Le mouvement de l'dipe s'opre, en effet, par un conflit trian-
gulaire dans le sujet ; dj, nous avons vu le jeu des tendances issues
du sevrage produire une formation de cette sorte ; c'est aussi la
mre, objet premier de ces tendances, comme nourriture absorber
et mme comme sein o se rsorber, qui se propose d'abord au dsir
dipien. On comprend ainsi que ce dsir se caractrise mieux chez
le mle, mais aussi qu'il y prte une occasion singulire la ractiva-
tion des tendances du sevrage, c'est--dire une rgression sexuelle.
Ces tendances ne constituent pas seulement, en effet, une impasse
psychologique ; elles s'opposent en outre particulirement ici l'atti-
tude d'extriorisation, conforme l'activit du mle.
Tout au contraire, dans l'autre sexe, o ces tendances ont une
issue possible dans la destine biologique du sujet, l'objet maternel,
en dtournant une part du dsir dipien, tend certes neutraliser le
potentiel du complexe et, par l, ses effets de sexualisation, mais, en
imposant un changement d'objet, la tendance gnitale se dtache
mieux des tendances primitives et d'autant plus facilement qu'elle
n'a pas renverser l'attitude d'intriorisation hrite de ces ten-
dances, qui sont narcissiques. Ainsi en arrive-t-on cette conclusion
ambigu que, d'un sexe l'autre, plus la formation du complexe est
accuse, plus alatoire parat tre son rle dans l'adaptation sexuelle.
On voit ici l'influence du complexe psychologique sur une
relation vitale et c'est par l qu'il contribue la constitution de la
ralit. Ce qu'il y apporte se drobe aux termes d'une psychogense
intellectualiste : c'est une certaine profondeur affective de l'objet.
Dimension qui, pour faire le fond de toute comprhension subjec-
tive, ne s'en distinguerait pas comme phnomne, si la clinique des
maladies mentales ne nous la faisait saisir comme telle en proposant
toute une srie de ses dgradations aux limites de la comprhension.
Pour constituer en effet une norme du vcu, cette dimension ne
peut qu'tre reconstruite par des intuitions mtaphoriques : densit
qui confre l'existence l'objet, perspective qui nous donne le sen-
timent de sa distance et nous inspire le respect de l'objet. Mais elle se
dmontre dans ces vacillements de la ralit qui fcondent le dlire :
quand l'objet tend se confondre avec le moi en mme temps qu'
se rsorber en fantasme, quand il apparat dcompos selon l'un de
ces sentiments qui forment le spectre de l'irralit, depuis les senti-
ments d'tranget, de dj vu, de jamais vu, en passant par les fausses
50
LES COMPLEXES FAMILIAUX DANS LA FORMATION DE L'INDIVIDU
reconnaissances, les illusions de sosie, les sentiments de devinement,
de participation, d'influence, les intuitions de signification, pour
aboutir au crpuscule du monde et cette abolition affective qu'on
dsigne formellement en allemand comme perte de l'objet (Objekt-
verlust).
Ces qualits si diverses du vcu, la psychanalyse les explique par les
variations de la quantit d'nergie vitale que le dsir investit dans
l'objet. La formule, toute verbale qu'elle puisse paratre, rpond, pour
les psychanalystes, une donne de leur pratique ; ils comptent avec
cet investissement dans les transferts opratoires de leurs cures ;
c'est sur les ressources qu'il offre qu'ils doivent fonder l'indication du
traitement. Ainsi ont-ils reconnu dans les symptmes cits plus haut
les indices d'un investissement trop narcissique de la libido, cepen-
dant que la formation de l'dipe apparaissait comme le moment et
la preuve d'un investissement suffisant pour le transfert .
Ce rle de l'dipe serait corrlatif de la maturation de la sexua-
lit. L'attitude instaure par la tendance gnitale cristalliserait selon
son type normal le rapport vital la ralit. On caractrise cette atti-
tude par les termes de don et de sacrifice, termes grandioses, mais
dont le sens reste ambigu et hsite entre la dfense et le renonce-
ment. Par eux une conception audacieuse retrouve le confort secret
d'un thme moralisant : dans le passage de la captativit l'oblativit,
on confond plaisir l'preuve vitale et l'preuve morale.
Cette conception peut se dfinir une psychogense analogique ;
elle est conforme au dfaut le plus marquant de la doctrine analy-
tique : ngliger la structure au profit du dynamisme. Pourtant l'exp-
rience analytique elle-mme apporte une contribution l'tude des
formes mentales en dmontrant leur rapport - soit de conditions,
soit de solutions - avec les crises affectives. C'est en diffrenciant
le jeu formel du complexe qu'on peut tablir, entre sa fonction et la
structure du drame qui lui est essentielle, un rapport plus arrt.
Le complexe d'dipe, s'il marque le sommet de la sexualit
infantile, est aussi le ressort de la rpression qui en rduit les images
l'tat de latence jusqu' la pubert ; s'il dtermine une condensation
de la ralit dans le sens de la vie, il est aussi le moment de la subli-
mation qui chez l'homme ouvre cette ralit son extension dsin-
tresse.
Les formes sous lesquelles se perptuent ces effets sont dsignes
51
LES COMPLEXES FAMILIAUX DANS LA FORMATION DE L'INDIVIDU
comme surmoi ou idal du moi, selon qu'elles sont pour le sujet
inconscientes ou conscientes. Elles reproduisent, dit-on, l'imago du
parent du mme sexe, l'idal du moi contribuant ainsi au confor-
misme sexuel du psychisme. Mais l'imago du pre aurait, selon la
doctrine, dans ces deux fonctions, un rle prototypique en raison de
la domination du mle.
Pour la rpression de la sexualit, cette conception repose, nous
l'avons indiqu, sur le fantasme de castration. Si la doctrine le rap-
porte une menace relle, c'est avant tout que, gnialement dyna-
miste pour reconnatre les tendances, Freud reste ferm par l'ato-
misme traditionnel la notion de l'autonomie des formes ; c'est ainsi
qu' observer l'existence du mme fantasme chez la petite fille ou
d'une image phallique de la mre dans les deux sexes, il est contraint
d'expliquer ces faits par de prcoces rvlations de la domination du
mle, rvlations qui conduiraient la petite fille la nostalgie de la
virilit, l'enfant concevoir sa mre comme virile. Gense qui, pour
trouver un fondement dans l'identification, requiert l'usage une
telle surcharge de mcanismes qu'elle parat errone.
Or, le matriel de l'exprience analytique suggre une interpr-
tation diffrente ; le fantasme de castration est en effet prcd par
toute une srie de fantasmes de morcellement du corps qui vont en
rgression de la dislocation et du dmembrement, par l'viration,
l'ventrement, jusqu' la dvoration et l'ensevelissement.
L'examen de ces fantasmes rvle que leur srie s'inscrit dans une
forme de pntration sens destructeur et investigateur la fois, qui
vise le secret du sein maternel, cependant que ce rapport est vcu
par le sujet sous un mode plus ambivalent proportion de leur
archasme. Mais les chercheurs qui ont le mieux compris l'origine
maternelle de ces fantasmes (Melanie Klein) ne s'attachent qu' la
symtrie et l'extension qu'ils apportent la formation de l'dipe,
en rvlant par exemple la nostalgie de la maternit chez le garon.
Leur intrt tient nos yeux dans l'irralit vidente de leur struc-
ture : l'examen de ces fantasmes qu'on trouve dans les rves et dans
certaines impulsions permet d'affirmer qu'ils ne se rapportent
aucun corps rel, mais un mannequin htroclite, une poupe
baroque, un trophe de membres o il faut reconnatre l'objet nar-
cissique dont nous avons plus haut voqu la gense : conditionne
par la prcession, chez l'homme, de formes imaginaires du corps sur
52
LES COMPLEXES FAMILIAUX DANS LA FORMATION DE L'INDIVIDU
la matrise du corps propre, par la valeur de dfense que le sujet
donne ces formes, contre l'angoisse du dchirement vital, fait de
la prmaturation.
Le fantasme de castration se rapporte ce mme objet : sa forme,
ne avant tout reprage du corps propre, avant toute distinction
d'une menace de l'adulte, ne dpend pas du sexe du sujet et dter-
mine plutt qu'elle ne subit les formules de la tradition ducative.
Il reprsente la dfense que le moi narcissique, identifi son double
spculaire, oppose au renouveau d'angoisse qui, au premier moment
de l'dipe, tend l'branler : crise que ne cause pas tant l'irruption
du dsir gnital dans le sujet que l'objet qu'il ractualise, savoir la
mre. A l'angoisse rveille par cet objet le sujet rpond en repro-
duisant le rejet masochique par o il a surmont sa perte primor-
diale, mais il l'opre selon la structure qu'il a acquise, c'est--dire
dans une localisation imaginaire de la tendance.
Une telle gense de la rpression sexuelle n'est pas sans rfrence
sociologique : elle s'exprime dans les rites par lesquels les primitifs
manifestent que cette rpression tient aux racines du lien social :
rites de fte qui, pour librer la sexualit, y dsignent par leur forme
orgiaque le moment de la rintgration affective dans le Tout ; rites
de circoncision qui, pour sanctionner la maturit sexuelle, mani-
festent que la personne n'y accde qu'au prix d'une mutilation cor-
porelle.
Pour dfinir sur le plan psychologique cette gense de la rpres-
sion, on doit reconnatre dans le fantasme de castration le jeu imagi-
naire qui la conditionne, dans la mre l'objet qui la dtermine. C'est
la forme radicale des contrepulsions qui se rvlent l'exprience
analytique pour constituer le noyau le plus archaque du surmoi et
pour reprsenter la rpression la plus massive. Cette force se rpartit
avec la diffrenciation de cette forme, c'est--dire avec le progrs par
o le sujet ralise l'instance rpressive dans l'autorit de l'adulte ;
on ne saurait autrement comprendre ce fait, apparemment contraire
la thorie, que la rigueur avec laquelle le surmoi inhibe les fonc-
tions du sujet tende s'tablir en raison inverse des svrits relles
de l'ducation. Bien que le surmoi reoive dj de la seule rpres-
sion maternelle (disciplines du sevrage et des sphincters) des traces
de la ralit, c'est dans le complexe d'dipe qu'il dpasse sa forme
narcissique.
53
LES COMPLEXES FAMILIAUX DANS LA FORMATION DE L'INDIVIDU
Ici s'introduit le rle de ce complexe dans la sublimation de la
ralit. On doit partir, pour le comprendre, du moment o la doc-
trine montre la solution du drame, savoir de la forme qu'elle y
a dcouverte, de l'identification. C'est, en effet, en raison d'une
identification du sujet l'imago du parent de mme sexe que le sur-
moi et l'idal du moi peuvent rvler l'exprience des traits
conformes aux particularits de cette imago.
La doctrine y voit le fait d'un narcissisme secondaire ; elle ne
distingue pas cette identification de l'identification narcissique : il y a
galement assimilation du sujet l'objet; elle n'y voit d'autre diff-
rence que la constitution, avec le dsir dipien, d'un objet de plus
de ralit, s'opposant un moi mieux form ; de la frustration de
ce dsir rsulterait, selon les constantes de l'hdonisme, le retour du
sujet sa primordiale voracit d'assimilation et, de la formation du
moi, une imparfaite introjection de l'objet : l'imago, pour s'imposer
au sujet, se juxtapose seulement au moi dans les deux exclusions de
l'inconscient et de l'idal.
Une analyse plus structurale de l'identification dipienne permet
pourtant de lui reconnatre une forme plus distinctive. Ce qui appa-
rat d'abord, c'est l'antinomie des fonctions que joue dans le sujet
l'imago parentale : d'une part, elle inhibe la fonction sexuelle, mais
sous une forme inconsciente, car l'exprience montre que l'action
du surmoi contre les rptitions de la tendance reste aussi incons-
ciente que la tendance reste refoule. D'autre part, l'imago prserve
cette fonction, mais l'abri de sa mconnaissance, car c'est bien la
prparation des voies de son retour futur que reprsente dans
la conscience l'idal du moi. Ainsi, si la tendance se rsout sous les
deux formes majeures, inconscience, mconnaissance, o l'analyse a
appris la reconnatre, l'imago apparat elle-mme sous deux struc-
tures dont l'cart dfinit la premire sublimation de la ralit.
On ne souligne pourtant pas assez que l'objet de l'identification
n'est pas ici l'objet du dsir, mais celui qui s'y oppose dans le tri-
angle dipien. L'identification de mimtique est devenue propitia-
toire ; l'objet de la participation sadomasochique se dgage du sujet,
prend distance de lui dans la nouvelle ambigut de la crainte et
de l'amour. Mais, dans ce pas vers la ralit, l'objet primitif du dsir
parat escamot.
Ce fait dfinit pour nous l'originalit de l'identification di-
54
LES COMPLEXES FAMILIAUX DANS LA FORMATION DE L'INDIVIDU
pienne : il nous parat indiquer que, dans le complexe d'dipe, ce
n'est pas le moment du dsir qui rige l'objet dans sa ralit nou-
velle, mais celui de la dfense narcissique du sujet.
Ce moment, en faisant surgir l'objet que sa position situe comme
obstacle au dsir, le montre aurol de la transgression sentie comme
dangereuse ; il apparat au moi la fois comme l'appui de sa dfense
et l'exemple de son triomphe. C'est pourquoi cet objet vient nor-
malement remplir le cadre du double o le moi s'est identifi d'abord
et par lequel il peut encore se confondre avec l'autrui ; il apporte
au moi une scurit, en renforant ce cadre, mais du mme coup
il le lui oppose comme un idal qui, alternativement, l'exalte et le
dprime.
Ce moment de l'dipe donne le prototype de la sublimation
autant par le rle de prsence masque qu'y joue la tendance, que
par la forme dont il revt l'objet. La mme forme est sensible en
effet chaque crise o se produit, pour la ralit humaine, cette
condensation dont nous avons pos plus haut l'nigme : c'est cette
lumire de l'tonnement qui transfigure un objet en dissolvant ses
quivalences dans le sujet et le propose non plus comme moyen
la satisfaction du dsir, mais comme ple aux crations de la passion.
C'est en rduisant nouveau un tel objet que l'exprience ralise
tout approfondissement.
Une srie de fonctions antinomiques se constitue ainsi dans le
sujet par les crises majeures de la ralit humaine, pour contenir les
virtualits indfinies de son progrs ; si la fonction de la conscience
semble exprimer l'angoisse primordiale et celle de l'quivalence
reflter le conflit narcissique, celle de l'exemple parat l'apport ori-
ginal du complexe d'dipe.
Or, la structure mme du drame dipien dsigne le pre pour
donner la fonction de sublimation sa forme la plus minente, parce
que la plus pure. L'imago de la mre dans l'identification dipienne
trahit, en effet, l'interfrence des identifications primordiales ; elle
marque de leurs formes et de leur ambivalence autant l'idal du moi
que le surmoi : chez la fille, de mme que la rpression de la sexua-
lit impose plus volontiers aux fonctions corporelles ce morcelage
mental o l'on peut dfinir l'hystrie, de mme la sublimation de
l'imago maternelle tend tourner en sentiment de rpulsion pour
sa dchance et en souci systmatique de l'image spculaire.
55
LES COMPLEXES FAMILIAUX DANS LA FORMATION DE L'INDIVIDU
L'imago du pre, mesure qu'elle domine, polarise dans les deux
sexes les formes les plus parfaites de l'idal du moi, dont il suffit
d'indiquer qu'elles ralisent l'idal viril chez le garon, chez la fille
l'idal virginal. Par contre, dans les formes diminues de cette imago
nous pouvons souligner les lsions physiques, spcialement celles qui
la prsentent comme estropie ou aveugle, pour dvier l'nergie
de sublimation de sa direction cratrice et favoriser sa rclusion dans
quelque idal d'intgrit narcissique. La mort du pre, quelque
tape du dveloppement qu'elle se produise et selon le degr
d'achvement de l'dipe, tend, de mme, tarir en le figeant le
progrs de la ralit. L'exprience, en rapportant de telles causes
un grand nombre de nvroses et leur gravit, contredit donc l'orien-
tation thorique qui en dsigne l'agent majeur dans la menace de la
force paternelle.
S'il est apparu dans l'analyse psychologique de l'dipe qu'il doit
se comprendre en fonction de ses antcdents narcissiques, ce n'est
pas dire qu'il se fonde hors de la relativit sociologique. Le ressort le
plus dcisif de ses effets psychiques tient, en effet, ce que l'imago
du pre concentre en elle la fonction de rpression avec celle de
sublimation ; mais c'est l le fait d'une dtermination sociale, celle
de la famille paternaliste.
L'autorit familiale n'est pas, dans les cultures matriarcales, repr-
sente par le pre, mais ordinairement par l'oncle maternel. Un
ethnologue qu'a guid sa connaissance de la psychanalyse, Mali-
nowski, a su pntrer les incidences psychiques de ce fait : si l'oncle
maternel exerce ce parrainage social de gardien des tabous familiaux
et d'initiateur aux rites tribaux, le pre, dcharg de toute fonction
rpressive, joue un rle de patronage plus familier, de matre en
techniques et de tuteur de l'audace aux entreprises.
Cette sparation de fonctions entrane un quilibre diffrent du
psychisme, qu'atteste l'auteur par l'absence de nvrose dans les
groupes qu'il a observs aux les du nord-ouest de la Mlansie.
Cet quilibre dmontre heureusement que le complexe d'dipe est
relatif une structure sociale, mais il n'autorise en rien le mirage
paradisiaque, contre lequel le sociologue doit toujours se dfendre :
l'harmonie qu'il comporte s'oppose en effet la strotypie qui
marque les crations de la personnalit, de l'art la morale, dans de
semblables cultures, et l'on doit reconnatre dans ce revers, confor-
56
LES COMPLEXES FAMILIAUX DANS LA FORMATION DE L'INDIVIDU
mment la prsente thorie de l'dipe, combien l'lan de la subli-
mation est domin par la rpression sociale, quand ces deux fonc-
tions sont spares.
C'est au contraire parce qu'elle est investie de la rpression que
l'imago paternelle en projette la force originelle dans les sublima-
tions mmes qui doivent la surmonter ; c'est de nouer en une telle
antinomie le progrs de ces fonctions que le complexe d'dipe
tient sa fcondit. Cette antinomie joue dans le drame individuel,
nous la verrons s'y confirmer par des effets de dcomposition; mais
ses effets de progrs dpassent de beaucoup ce drame, intgrs qu'ils
sont dans un immense patrimoine culturel : idaux normaux, statuts
juridiques, inspirations cratrices. Le psychologue ne peut ngliger
ces formes qui, en concentrant dans la famille conjugale les condi-
tions du conflit fonctionnel de l'dipe, rintgrent dans le progrs
psychologique la dialectique sociale engendre par ce conflit.
Que l'tude de ces formes se rfre l'histoire, c'est l dj une
donne pour notre analyse ; c'est en effet un problme de structure
qu'il faut rapporter ce fait que la lumire de la tradition historique
ne frappe en plein que les annales des patriarcats, tandis qu'elle
n'claire qu'en frange - celle mme o se maintient l'investigation
d'un Bachofen - les matriarcats, partout sous-jacents la culture
antique.
Nous rapprocherons de ce fait le moment critique que Bergson
a dfini dans les fondements de la morale ; on sait qu'il ramne sa
fonction de dfense vitale ce tout de l'obligation par quoi il
dsigne le lien qui clt le groupe humain sur sa cohrence, et qu'il
reconnat l'oppos un lan transcendant de la vie dans tout mou-
vement qui ouvre ce groupe en universalisant ce lien ; double source
que dcouvre une analyse abstraite, sans doute retourne contre ses
illusions formalistes, mais qui reste limite la porte de l'abstrac-
tion. Or si, par l'exprience, le psychanalyste comme le sociologue
peuvent reconnatre dans l'interdiction de la mre la forme concrte
de l'obligation primordiale, de mme peuvent-ils dmontrer un pro-
cs rel de l' ouverture du lien social dans l'autorit paternaliste et
dire que, par le conflit fonctionnel de l'dipe, elle introduit dans
la rpression un idal de promesse.
S'ils se rfrent aux rites de sacrifice par o les cultures primi-
tives, mmes parvenues une concentration sociale leve, ralisent
57
LES COMPLEXES FAMILIAUX DANS LA FORMATION DE L'INDIVIDU
avec la rigueur la plus cruelle - victimes humaines dmembres ou
ensevelies vivantes - les fantasmes de la relation primordiale la
mre, ils liront, dans plus d'un mythe, qu' l'avnement de l'autorit
paternelle rpond un temprament de la primitive rpression sociale.
Lisible dans l'ambigut mythique du sacrifice d'Abraham, qui au
reste le lie formellement l'expression d'une promesse, ce sens
n'apparat pas moins dans le mythe de l'dipe, pour peu qu'on ne
nglige pas l'pisode du Sphinx, reprsentation non moins ambigu
de l'mancipation des tyrannies matriarcales, et du dclin du rite du
meurtre royal. Quelle que soit leur forme, tous ces mythes se situent
l'ore de l'histoire, bien loin de la naissance de l'humanit dont les
sparent la dure immmoriale des cultures matriarcales et la stagna-
tion des groupes primitifs.
Selon cette rfrence sociologique, le fait du prophtisme par
lequel Bergson recourt l'histoire en tant qu'il s'est produit mi-
nemment dans le peuple juif, se comprend par la situation lue qui
fut cre ce peuple d'tre le tenant du patriarcat parmi des groupes
adonns des cultes maternels, par sa lutte convulsive pour mainte-
nir l'idal patriarcal contre la sduction irrpressible de ces cultures.
A travers l'histoire des peuples patriarcaux, on voit ainsi s'affirmer
dialectiquement dans la socit les exigences de la personne et l'uni-
versalisation des idaux : tmoin ce progrs des formes juridiques qui
ternise la mission que la Rome antique a vcue tant en puissance
qu'en conscience, et qui s'est ralise par l'extension dj rvolu-
tionnaire des privilges moraux d'un patriarcat une plbe immense
et tous les peuples.
Deux fonctions dans ce procs se rflchissent sur la structure
de la famille elle-mme : la tradition, dans les idaux patriciens, de
formes privilgies du mariage ; l'exaltation apothotique que le
christianisme apporte aux exigences de la personne. L'glise a int-
gr cette tradition dans la morale du christianisme, en mettant au
premier plan dans le lien du mariage le libre choix de la personne,
faisant ainsi franchir l'institution familiale le pas dcisif vers sa
structure moderne, savoir le secret renversement de sa prpond-
rance sociale au profit du mariage. Renversement qui se ralise au
XV
e
sicle avec la rvolution conomique d'o sont sorties la socit
bourgeoise et la psychologie de l'homme moderne.
Ce sont en effet les rapports de la psychologie de l'homme
58
LES COMPLEXES FAMILIAUX DANS LA FORMATION DE L'INDIVIDU
moderne avec la famille conjugale qui se proposent l'tude du
psychanalyste ; cet homme est le seul objet qu'il ait vraiment soumis
son exprience, et si le psychanalyste retrouve en lui le reflet
psychique des conditions les plus originelles de l'homme, peut-il
prtendre le gurir de ses dfaillances psychiques sans le com-
prendre dans la culture qui lui impose les plus hautes exigences, sans
comprendre de mme sa propre position en face de cet homme
au point extrme de l'attitude scientifique ?
Or, en notre temps, moins que jamais, l'homme de la culture occi-
dentale ne saurait se comprendre hors des antinomies qui constituent
ses rapports avec la nature et avec la socit : comment hors d'elles,
comprendre et l'angoisse qu'il exprime dans le sentiment d'une
transgression promthenne envers les conditions de sa vie, et les
conceptions les plus leves o il surmonte cette angoisse en recon-
naissant que c'est par crises dialectiques qu'il se cre, lui-mme et
ses objets?
Ce mouvement subversif et critique o se ralise l'homme trouve
son germe le plus actif dans trois conditions de la famille conjugale.
Pour incarner l'autorit dans la gnration la plus voisine et sous
une figure familire, la famille conjugale met cette autorit la
porte immdiate de la subversion cratrice. Ce que traduisent dj
pour l'observation la plus commune les inversions qu'imagine l'en-
fant dans l'ordre des gnrations, o il se substitue lui-mme au
parent ou au grand-parent.
D'autre part, le psychisme n'y est pas moins form par l'image
de l'adulte que contre sa contrainte : cet effet s'opre par la transmis-
sion de l'idal du moi, et le plus purement, nous l'avons dit, du pre
au fils; il comporte une slection positive des tendances et des
dons, une progressive ralisation de l'idal dans le caractre. C'est
ce procs psychologique qu'est d le fait des familles d'hommes
minents, et non la prtendue hrdit qu'il faudrait reconnatre
des capacits essentiellement relationnelles.
Enfin et surtout, l'vidence de la vie sexuelle chez les reprsen-
tants des contraintes morales, l'exemple singulirement transgressif
de l'imago du pre quant l'interdiction primordiale exaltent au
plus haut degr la tension de la libido et la porte de la sublimation.
C'est pour raliser le plus humainement le conflit de l'homme
avec son angoisse la plus archaque, c'est pour lui offrir le champ clos
59
LES COMPLEXES FAMILIAUX DANS LA FORMATION DE L'INDIVIDU
le plus loyal o il puisse se mesurer avec les figures les plus profondes
de son destin, c'est pour mettre porte de son existence indivi-
duelle le triomphe le plus complet contre sa servitude originelle,
que le complexe de la famille conjugale cre les russites suprieures
du caractre, du bonheur et de la cration.
En donnant la plus grande diffrenciation la personnalit avant
la priode de latence, le complexe apporte aux confrontations
sociales de cette priode leur maximum d'efficacit pour la for-
mation rationnelle de l'individu. On peut en effet considrer que
l'action ducative dans cette priode reproduit dans une ralit plus
leste et sous les sublimations suprieures de la logique et de la
justice, le jeu des quivalences narcissiques o a pris naissance le
monde des objets. Plus diverses et plus riches seront les ralits
inconsciemment intgres dans l'exprience familiale, plus forma-
teur sera pour la raison le travail de leur rduction.
Ainsi donc, si la psychanalyse manifeste dans les conditions
morales de la cration un ferment rvolutionnaire qu'on ne peut
saisir que dans une analyse concrte, elle reconnat, pour le produire,
la structure familiale une puissance qui dpasse toute rationali-
sation ducative. Ce fait mrite d'tre propos aux thoriciens -
quelque bord qu'ils appartiennent - d'une ducation sociale pr-
tentions totalitaires, afin que chacun en conclue selon ses dsirs.
Le rle de l'imago du pre se laisse apercevoir de faon saisissante
dans la formation de la plupart des grands hommes. Son rayonne-
ment littraire et moral dans l're classique du progrs, de Corneille
Proudhon, vaut d'tre not ; et les idologues qui, au XIX
e
sicle,
ont port contre la famille paternaliste les critiques les plus subver-
sives ne sont pas ceux qui en portent le moins l'empreinte.
Nous ne sommes pas de ceux qui s'affligent d'un prtendu rel-
chement du lien familial. N'est-il pas significatif que la famille se soit
rduite son groupement biologique mesure qu'elle intgrait les
plus hauts progrs culturels ? Mais un grand nombre d'effets psycho-
logiques nous semblent relever d'un dclin social de l'imago pater-
nelle. Dclin conditionn par le retour sur l'individu d'effets extrmes
du progrs social, dclin qui se marque surtout de nos jours dans les
collectivits les plus prouves par ces effets : concentration cono-
mique, catastrophes politiques. Le fait n'a-t-il pas t formul par le
chef d'un tat totalitaire comme argument contre l'ducation tradi-
60
LES COMPLEXES FAMILIAUX DANS LA FORMATION DE L'INDIVIDU
tionnelle ? Dclin plus intimement li la dialectique de la famille
conjugale, puisqu'il s'opre par la croissance relative, trs sensible par
exemple dans la vie amricaine, des exigences matrimoniales.
Quel qu'en soit l'avenir, ce dclin constitue une crise psycholo-
gique. Peut-tre est-ce cette crise qu'il faut rapporter l'apparition
de la psychanalyse elle-mme. Le sublime hasard du gnie n'explique
peut-tre pas seul que ce soit Vienne - alors centre d'un tat qui
tait le melting-pot des formes familiales les plus diverses, des plus
archaques aux plus volues, des derniers groupements agnatiques
des paysans slaves aux formes les plus rduites du foyer petit-
bourgeois et aux formes les plus dcadentes du mnage instable, en
passant par les paternalismes fodaux et mercantiles - qu'un fils du
patriarcat juif ait imagin le complexe d'dipe. Quoi qu'il en soit,
ce sont les formes de nvroses dominantes la fin du sicle dernier
qui ont rvl qu'elles taient intimement dpendantes des condi-
tions de la famille.
Ces nvroses, depuis le temps des premires divinations freu-
diennes, semblent avoir volu dans le sens d'un complexe caractriel
o, tant pour la spcificit de sa forme que pour sa gnralisation -
il est le noyau du plus grand nombre des nvroses - , on peut recon-
natre la grande nvrose contemporaine. Notre exprience nous porte
en dsigner la dtermination principale dans la personnalit du
pre, toujours carente en quelque faon, absente, humilie, divise ou
postiche. C'est cette carence qui, conformment notre conception
de l'dipe, vient tarir l'lan instinctif comme tarer la dialectique
des sublimations. Marraines sinistres installes au berceau du nvros,
l'impuissance et l'utopie enferment son ambition, soit qu'il touffe
en lui les crations qu'attend le monde o il vient, soit que, dans l'ob-
jet qu'il propose sa rvolte, il mconnaisse son propre mouvement.
II. LES COMPLEXES FAMILIAUX EN PATHOLOGIE
Les complexes familiaux remplissent dans les psychoses une fonc-
tion formelle : thmes familiaux qui prvalent dans les dlires pour
leur conformit avec l'arrt que les psychoses constituent dans le
61
LES COMPLEXES FAMILIAUX DANS LA FORMATION DE L'INDIVIDU
moi et dans la ralit ; dans les nvroses, les complexes remplissent une
fonction causale : incidences et constellations familiales qui dter-
minent les symptmes et les structures, selon lesquels les nvroses
divisent, introvertissent ou invertissent la personnalit. Telles sont, en
quelques mots, les thses que dveloppe ce chapitre.
Il va de soi qu'en qualifiant de familiales la forme d'une psychose
ou la source d'une nvrose, nous entendons ce terme au sens strict de
relation sociale que cette tude s'emploie dfinir en mme temps
qu' le justifier par sa fcondit objective : ainsi ce qui relve de
la seule transmission biologique doit-il tre dsign comme hr-
ditaire et non pas comme familial , au sens strict de ce terme,
mme s'il s'agit d'une affection psychique, et cela malgr l'usage
courant dans le vocabulaire neurologique.
1. Les psychoses thme familial
C'est dans un tel souci de l'objectivit psychologique que nous
avons tudi les psychoses quand, parmi les premiers en France, nous
nous sommes attach les comprendre dans leur rapport avec la
personnalit : point de vue auquel nous amenait la notion, ds lors
de plus en plus reconnue, que le tout du psychisme est intress par
la lsion ou le dficit de quelque lment de ses appareils ou de ses
fonctions. Cette notion, que dmontraient les troubles psychiques
causs par des lsions localisables, ne nous en paraissait que plus
applicable aux productions mentales et aux ractions sociales des
psychoses, savoir ces dlires et ces pulsions qui, pour tre pr-
tendus partiels, voquaient pourtant par leur typicit la cohrence
d'un moi archaque, et dans leur discordance mme devaient en tra-
hir la loi interne.
Que l'on se rappelle seulement que ces affections rpondent au
cadre vulgaire de la folie et l'on concevra qu'il ne pouvait s'agir
pour nous d'y dfinir une vritable personnalit, qui implique
la communication de la pense et la responsabilit de la conduite.
Une psychose, certes, que nous avons isole sous le nom de paranoa
d'autopunition, n'exclut pas l'existence d'une semblable personna-
lit, qui est constitue non seulement par les rapports du moi, mais
du surmoi et de l'idal du moi, mais le surmoi lui impose ses effets
62
LES COMPLEXES FAMILIAUX DANS LA FORMATION DE L'INDIVIDU
punitifs les plus extrmes, et l'idal du moi s'y affirme dans une
objectivation ambigu, propice aux projections ritres ; d'avoir
montr l'originalit de cette forme, en mme temps que dfini par
sa position une frontire nosologique, est un rsultat qui, pour limit
qu'il soit, reste l'acquis du point de vue qui dirigeait notre effort.
Le progrs de notre recherche devait nous faire reconnatre, dans
les formes mentales que constituent les psychoses, la reconstitution
de stades du moi, antrieurs la personnalit ; si l'on caractrise en
effet chacun de ces stades par le stade de l'objet qui lui est corrlatif,
toute la gense normale de l'objet dans la relation spculaire du sujet
l'autrui, ou comme appartenance subjective du corps morcel,
se retrouve, en une srie de formes d'arrt, dans les objets du dlire.
Il est remarquable que ces objets manifestent les caractres consti-
tutifs primordiaux de la connaissance humaine : identit formelle,
quivalence affective, reproduction itrative et symbolisme anthro-
pomorphique, sous des formes figes, certes, mais accentues par
l'absence ou l'effacement des intgrations secondaires, que sont pour
l'objet sa mouvance et son individualit, sa relativit et sa ralit.
La limite de la ralit de l'objet dans la psychose, le point de
rebroussement de la sublimation nous parat prcisment donn par
ce moment, qui marque pour nous l'aura de la ralisation dipienne,
savoir cette rection de l'objet qui se produit, selon notre formule,
dans la lumire de l'tonnement. C'est ce moment que reproduit
cette phase, que nous tenons pour constante et dsignons comme
phase fconde du dlire : phase o les objets, transforms par une
tranget ineffable, se rvlent comme chocs, nigmes, significations.
C'est dans cette reproduction que s'effondre le conformisme, super-
ficiellement assum, au moyen duquel le sujet masquait jusque-l le
narcissisme de sa relation la ralit.
Ce narcissisme se traduit dans la forme de l'objet. Celle-ci peut se
produire en progrs sur la crise rvlatrice, comme l'objet dipien
se rduit en une structure de narcissisme secondaire - mais ici l'objet
reste irrductible aucune quivalence et le prix de sa possession,
sa vertu de prjudice prvaudront sur toute possibilit de compensa-
tion ou de compromis : c'est le dlire de revendication. Ou bien la
forme de l'objet peut rester suspendue l'acm de la crise, comme si
l'imago de l'idal dipien se fixait au moment de sa transfiguration
- mais ici l'imago ne se subjective pas par identification au double,
63
LES COMPLEXES FAMILIAUX DANS LA FORMATION DE L'INDIVIDU
et l'idal du moi se projette itrativement en objets d'exemples,
certes, mais dont l'action est tout externe, plutt reproches vivants
dont la censure tend la surveillance omniprsente : c'est le dlire
sensitif de relations. Enfin, l'objet peut retrouver en de de la crise
la structure de narcissisme primaire o sa formation s'est arrte.
On peut voir dans ce dernier cas le surmoi, qui n'a pas subi le
refoulement, non seulement se traduire dans le sujet en intention
rpressive, mais encore y surgir comme objet apprhend par le moi,
rflchi sous les traits dcomposs de ses incidences formatrices, et,
au gr des menaces relles ou des intrusions imaginaires, reprsent
par l'adulte castrateur ou le frre pntrateur : c'est le syndrome de la
perscution interprtative, avec son objet sens homosexuel latent.
A un degr de plus, le moi archaque manifeste sa dsagrgation
dans le sentiment d'tre pi, devin, dvoil, sentiment fondamental
de la psychose hallucinatoire, et le double o il s'identifiait s'oppose
au sujet, soit comme cho de la pense et des actes dans les formes
auditives verbales de l'hallucination, dont les contenus autodiffama-
teurs marquent l'affinit volutive avec la rpression morale, soit
comme fantme spculaire du corps dans certaines formes d'hallu-
cination visuelle, dont les ractions-suicides rvlent la cohrence
archaque avec le masochisme primordial. Enfin, c'est la structure
foncirement anthropomorphique et organomorphique de l'objet
qui vient au jour dans la participation mgalomaniaque, o le sujet,
dans la paraphrnie, incorpore son moi le monde, affirmant qu'il
inclut le Tout, que son corps se compose des matires les plus pr-
cieuses, que sa vie et ses fonctions soutiennent l'ordre et l'existence
de l'Univers.
Les complexes familiaux jouent dans le moi, ces divers stades o
l'arrte la psychose, un rle remarquable, soit comme motifs des
ractions du sujet, soit comme thmes de son dlire. On peut mme
ordonner sous ces deux registres l'intgration de ces complexes au
moi selon la srie rgressive que nous venons d'tablir pour les
formes de l'objet dans les psychoses.
Les ractions morbides, dans les psychoses, sont provoques
par les objets familiaux en fonction dcroissante de la ralit de ces
objets au profit de leur porte imaginaire : on le mesure, si l'on part
des conflits qui mettent aux prises lectivement le revendicateur
avec le cercle de sa famille ou avec son conjoint - en passant par la
64
LES COMPLEXES FAMILIAUX DANS LA FORMATION DE L'INDIVIDU
signification de substituts du pre, du frre ou de la sur que l'obser-
vateur reconnat aux perscuteurs du paranoaque - pour aboutir
ces filiations secrtes de roman, ces gnalogies de Trinits ou
d'Olympes fantastiques, o jouent les mythes du paraphrnique.
L'objet constitu par la relation familiale montre ainsi une altration
progressive : dans sa valeur affective, quand il se rduit n'tre que
prtexte l'exaltation passionnelle, puis dans son individualit,
quand il est mconnu dans sa ritration dlirante, enfin dans son
identit elle-mme, quand on ne le reconnat plus dans le sujet que
comme une entit qui chappe au principe de contradiction.
Pour le thme familial, sa porte expressive de la conscience dli-
rante se montre fonction, dans la srie des psychoses, d'une crois-
sante identification du moi un objet familial, aux dpens de la
distance que le sujet maintient entre lui et sa conviction dlirante :
on le mesure, si l'on part de la contingence relative, dans le monde
du revendicateur, des griefs qu'il allgue contre les siens - en passant
par la porte de plus en plus existentielle que prennent les thmes
de spoliation, d'usurpation, de filiation, dans la conception qu'a de
soi le paranoaque pour aboutir ces identifications quelque
hritier arrach de son berceau, l'pouse secrte de quelque prince,
aux personnages mythiques de Pre tout-puissant, de Victime filiale,
de Mre universelle, de Vierge primordiale, o s'affirme le moi du
paraphrnique.
Cette affirmation du moi devient au reste plus incertaine
mesure qu'ainsi elle s'intgre plus au thme dlirant : d'une sthnie
remarquablement communicative dans la revendication, elle se rduit
de faon tout fait frappante une intention dmonstrative dans
les ractions et les interprtations du paranoaque, pour se perdre
chez le paraphrnique dans une discordance dconcertante entre la
croyance et la conduite.
Ainsi, selon que les ractions sont plus relatives aux fantasmes et
que s'objective plus le thme du dlire, le moi tend se confondre
avec l'expression du complexe et le complexe s'exprimer dans
rintentionnalit du moi. Les psychanalystes disent donc commun-
ment que dans les psychoses les complexes sont conscients, tandis
qu'ils sont inconscients dans les nvroses. Ceci n'est pas rigoureux,
car, par exemple, le sens homosexuel des tendances dans la psychose
est mconnu par le sujet, encore que traduit en intention perscu-
65
LES COMPLEXES FAMILIAUX DANS LA FORMATION DE L'INDIVIDU
tive. Mais la formule approximative permet de s'tonner que ce
soit dans les nvroses, o ils sont latents, que les complexes aient
t dcouverts, avant d'tre reconnus dans les psychoses, o ils sont
patents. C'est que les thmes familiaux que nous isolons dans
les psychoses ne sont que des effets virtuels et statiques de leur struc-
ture, des reprsentations o se stabilise le moi ; ils ne prsentent donc
que la morphologie du complexe sans rvler son organisation, ni
par consquent la hirarchie de ses caractres.
D'o l'vident artifice qui marquait la classification des psychoses
par les thmes dlirants, et le discrdit o tait tombe l'tude de
ces thmes, avant que les psychiatres y fussent ramens par cette
impulsion vers le concret donne par la psychanalyse. C'est ainsi que
d'aucuns, qui ont pu se croire les moins affects par cette influence,
rnovrent la porte clinique de certains thmes, comme l'rotoma-
nie ou le dlire de filiation, en reportant l'attention de l'ensemble
sur les dtails de leur romancement, pour y dcouvrir les caractres
d'une structure. Mais seule la connaissance des complexes peut
apporter une telle recherche, avec une direction systmatique,
une sret et une avance qui dpassent de beaucoup les moyens de
l'observation pure.
Prenons par exemple la structure du thme des interprtateurs
filiaux, telle que Srieux et Capgras l'ont dfinie en entit nosolo-
gique. En la caractrisant par le ressort de la privation affective,
manifeste dans l'illgitimit frquente du sujet, et par une formation
mentale du type du roman de grandeur d'apparition normale
entre huit et treize ans, les auteurs runiront la fable, mrie depuis
cet ge, de substitution d'enfant, fable par laquelle telle vieille fille de
village s'identifie quelque doublure plus favorise, et les prten-
tions, dont la justification parat quivalente, de quelque faux dau-
phin . Mais que celui-ci pense appuyer ses droits par la description
minutieuse d'une machine d'apparence animale, dans le ventre
de laquelle il aurait fallu le cacher pour raliser l'enlvement initial
(histoire de Richemont et de son cheval extraordinaire , cite par
ces auteurs), nous croyons pour nous que cette fantaisie, qu'on peut
certes tenir pour superftatoire et mettre au compte de la dbilit
mentale, rvle, autant par son symbolisme de gestation que par la
place que lui donne le sujet dans son dlire, une structure plus
archaque de sa psychose.
66
LES COMPLEXES FAMILIAUX DANS LA FORMATION DE L'INDIVIDU
Il reste tablir si les complexes qui jouent ces rles de motiva-
tion et de thme dans les symptmes de la psychose ont aussi un
rle de cause dans son dterminisme ; et cette question est obscure.
Pour nous, si nous avons voulu comprendre ces symptmes par
une psychogense, nous sommes loin d'avoir pens y rduire le
dterminisme de la maladie. Bien au contraire, en dmontrant dans la
paranoa que sa phase fconde comporte un tat hyponoque : confu-
sionnel, onirique, ou crpusculaire, nous avons soulign la ncessit
de quelque ressort organique pour la subduction mentale o le sujet
s'initie au dlire.
Ailleurs encore, nous avons indiqu que c'est dans quelque tare
biologique de la libido qu'il fallait chercher la cause de cette stagna-
tion de la sublimation o nous voyons l'essence de la psychose. C'est
dire que nous croyons un dterminisme endogne de la psychose
et que nous avons voulu seulement faire justice de ces pitres patho-
gnies qui ne sauraient plus mme passer actuellement pour repr-
senter quelque gense organique : d'une part la rduction de la
maladie quelque phnomne mental, prtendu automatique, qui
comme tel ne saurait rpondre l'organisation perceptive, nous
voulons dire au niveau de croyance, que l'on relve dans les symp-
tmes rellement lmentaires de l'interprtation et de l'halluci-
nation ; d'autre part la prformation de la maladie dans des traits
prtendus constitutionnels du caractre, qui s'vanouissent, quand
on soumet l'enqute sur les antcdents aux exigences de la dfini-
tion des termes et de la critique du tmoignage.
Si quelque tare est dcelable dans le psychisme avant la psychose,
c'est aux sources mmes de la vitalit du sujet, au plus radical, mais
aussi au plus secret de ses lans et de ses aversions, qu'on doit la pres-
sentir, et nous croyons en reconnatre un signe singulier dans le
dchirement ineffable que ces sujets accusent spontanment pour
avoir marqu leurs premires effusions gnitales la pubert.
Qu'on rapproche cette tare hypothtique des faits anciennement
groups sous la rubrique de la dgnrescence ou des notions plus
rcentes sur les perversions biologiques de la sexualit, c'est rentrer
dans les problmes de l'hrdit psychologique. Nous nous limitons
ici l'examen des facteurs proprement familiaux.
La simple clinique montre dans beaucoup de cas la corrlation
d'une anomalie de la situation familiale. La psychanalyse, d'autre
67
LES COMPLEXES FAMILIAUX DANS LA FORMATION DE L'INDIVIDU
part, soit par l'interprtation des donnes cliniques, soit par une
exploration du sujet qui, pour ne savoir tre ici curative, doit rester
prudente, montre que l'idal du moi s'est form, souvent en raison
de cette situation, d'aprs l'objet du frre. Cet objet, en virant la
libido destine l'dipe sur l'imago de l'homosexualit primitive,
donne un idal trop narcissique pour ne pas abtardir la structure de
la sublimation. En outre, une disposition en vase clos du groupe
familial tend intensifier les effets de sommation, caractristiques de
la transmission de l'idal du moi, comme nous l'avons indiqu dans
notre analyse de l'dipe ; mais alors qu'il s'exerce l normalement
dans un sens slectif, ces effets jouent ici dans un sens dgnratif.
Si l'avortement de la ralit dans les psychoses tient en dernier
ressort une dficience biologique de la libido, il rvle aussi une
drivation de la sublimation o le rle du complexe familial est
corrobor par le concours de nombreux faits cliniques.
Il faut noter en effet ces anomalies de la personnalit dont
la constance dans la parent du paranoaque est sanctionne par
l'appellation familire de nids de paranoaques que les psychiatres
appliquent ces milieux ; la frquence de la transmission de la para-
noa en ligne familiale directe, avec souvent aggravation de sa forme
vers la paraphrnie et prcession temporelle, relative ou mme abso-
lue, de son apparition chez le descendant ; enfin l'lectivit presque
exclusivement familiale des cas de dlires deux, bien mise en
vidence dans des collections anciennes, comme celle de Legrand
du Saulle dans son ouvrage sur le dlire des perscutions , o
l'ampleur du choix compense le dfaut de la systmatisation par
l'absence de partialit.
Pour nous, c'est dans les dlires deux que nous croyons le mieux
saisir les conditions psychologiques qui peuvent jouer un rle dter-
minant dans la psychose. Hormis les cas o le dlire mane d'un
parent atteint de quelque trouble mental qui le mette en posture de
tyran domestique, nous avons rencontr constamment ces dlires
dans un groupe familial que nous appelons dcomplt, l o l'iso-
lement social auquel il est propice porte son effet maximum, savoir
dans le couple psychologique form d'une mre et d'une fille ou
de deux surs (voir notre tude sur les Papin), plus rarement d'une
mre et d'un fils.
68
LES COMPLEXES FAMILIAUX DANS LA FORMATION DE L'INDIVIDU
2. Les nvroses familiales
Les complexes familiaux se rvlent dans les nvroses par un abord
tout diffrent : c'est qu'ici les symptmes ne manifestent aucun
rapport, sinon contingent, quelque objet familial. Les complexes y
remplissent pourtant une fonction causale, dont la ralit et le dyna-
misme s'opposent diamtralement au rle que jouent les thmes
familiaux dans les psychoses.
Si Freud, par la dcouverte des complexes, fit uvre rvolution-
naire, c'est qu'en thrapeute, plus soucieux du malade que de la
maladie, il chercha le comprendre pour le gurir, et qu'il s'attacha
ce qu'on ngligeait sous le titre de contenu des symptmes, et qui
est le plus concret de leur ralit : savoir l'objet qui provoque une
phobie, l'appareil ou la fonction somatique intresss dans une
hystrie, la reprsentation ou l'aflfect qui occupent le sujet dans
une obsession.
C'est de cette manire qu'il vint dchiffrer dans ce contenu
mme les causes de ces symptmes : quoique ces causes, avec les
progrs de l'exprience, soient apparues plus complexes, il importe
de ne point les rduire l'abstraction, mais d'approfondir ce sens
dramatique, qui, dans leur premire formule, saisissait comme une
rponse l'inspiration de leur recherche.
Freud accusa d'abord, l'origine des symptmes, soit une sduc-
tion sexuelle que le sujet a prcocement subie par des manuvres
plus ou moins perverses, soit une scne qui, dans sa petite enfance,
l'a initi par le spectacle ou par l'audition aux relations sexuelles des
adultes. Or, si d'une part ces faits se rvlaient comme traumatiques
pour dvier la sexualit en tendances anormales, ils dmontraient
du mme coup comme propres la petite enfance une volution
rgulire de ces diverses tendances et leur normale satisfaction par
voie auto-rotique. C'est pourquoi, si d'autre part ces traumatismes
se montraient tre le fait le plus commun soit de l'initiative d'un
frre, soit de l'inadvertance des parents, la participation de l'enfant
s'y avra toujours plus active, mesure que s'affirmaient la sexualit
infantile et ses motifs de plaisir ou d'investigation. Ds lors, ces
tendances apparaissent formes en complexes typiques par la struc-
ture normale de la famille qui leur offrait leurs premiers objets. C'est
69
LES COMPLEXES FAMILIAUX DANS LA FORMATION DE L'INDIVIDU
ainsi que nul fait plus que la naissance d'un frre ne prcipite une
telle formation, en exaltant par son nigme la curiosit de l'enfant,
en ractivant les mois primordiaux de son attachement la mre
par les signes de sa grossesse et par le spectacle des soins qu'elle
donne au nouveau-n, en cristallisant enfin, dans la prsence du pre
auprs d'elle, ce que l'enfant devine du mystre de la sexualit, ce
qu'il ressent de ses lans prcoces et ce qu'il redoute des menaces
qui lui en interdisent la satisfaction masturbatoire. Telle est du moins,
dfinie par son groupe et par son moment, la constellation familiale
qui, pour Freud, forme le complexe nodal des nvroses. Il en a dgag
le complexe d'dipe, et nous verrons mieux plus loin comment
cette origine commande la conception qu'il s'est forme de ce
complexe.
Concluons ici qu'une double instance de causes se dfinit par le
complexe : les traumatismes prcits qui reoivent leur porte de
leur incidence dans son volution, les relations du groupe familial
qui peuvent dterminer des atypies dans sa constitution. Si la pra-
tique des nvroses manifeste en effet la frquence des anomalies
de la situation familiale, il nous faut, pour dfinir leur effet, revenir
sur la production du symptme.
Les impressions issues du traumatisme semblrent une premire
approche dterminer le symptme par une relation simple : une part
diverse de leur souvenir, sinon sa forme reprsentative, au moins
ses corrlations affectives, a t non pas oublie, mais refoule dans
l'inconscient, et le symptme, encore que sa production prenne
des voies non moins diverses, se laissait ramener une fonction
d'expression du refoul, lequel manifestait ainsi sa permanence dans
le psychisme. Non seulement en effet l'origine du symptme se
comprenait par une interprtation selon une clef qui, parmi d'autres,
symbolisme, dplacement, etc., convnt sa forme, mais le symptme
cdait mesure que cette comprhension tait communique
au sujet. Que la cure du symptme tnt au fait que fut ramene
la conscience l'impression de son origine, en mme temps que se
dmontrt au sujet l'irrationalit de sa forme - une telle induction
retrouvait dans l'esprit les voies frayes par l'ide socratique que
l'homme se dlivre se connatre par les intuitions de la raison. Mais
il a fallu apporter la simplicit comme l'optimisme de cette
conception des corrections toujours plus lourdes, depuis que l'exp-
70
LES COMPLEXES FAMILIAUX DANS LA FORMATION DE L'INDIVIDU
rience a montr qu'une rsistance est oppose par le sujet l'luci-
dation du symptme et qu'un transfert affectif qui a l'analyste pour
objet est la force qui dans la cure vient prvaloir.
Il reste pourtant de cette tape la notion que le symptme nvro-
tique reprsente dans le sujet un moment de son exprience o il
ne sait pas se reconnatre, une forme de division de la personnalit.
Mais mesure que l'analyse a serr de plus prs la production du
symptme, sa comprhension a recul de la claire fonction d'expres-
sion de l'inconscient une plus obscure fonction de dfense contre
l'angoisse. Cette angoisse, Freud, dans ses vues les plus rcentes, la
considre comme le signal qui, pour tre dtach d'une situation
primordiale de sparation, se rveille la similitude d'un danger
de castration. La dfense du sujet, s'il est vrai que le symptme frag-
mente la personnalit, consisterait donc faire sa part ce danger
en s'interdisant tel accs la ralit, sous une forme symbolique ou
sublime. La forme que l'on reconnat dans cette conception du
symptme ne laisse en principe pas plus de rsidu que son contenu
tre comprise par une dynamique des tendances, mais elle tend
transformer en termes de structure la rfrence du symptme au
sujet en dplaant l'intrt sur la fonction du symptme quant aux
rapports la ralit.
Les effets d'interdiction dont il s'agit constituent des relations qui,
pour tre inaccessibles au contrle conscient et ne se manifester
qu'en ngatif dans le comportement, rvlent clairement leur forme
intentionnelle la lumire de la psychanalyse ; montrant l'unit
d'une organisation depuis l'apparent hasard des achoppements des
fonctions et la fatalit des sorts qui font chouer l'action jusqu'
la contrainte, propre l'espce, du sentiment de culpabilit. La psy-
chologie classique se trompait donc en croyant que le moi, savoir
cet objet o le sujet se rflchit comme coordonn la ralit qu'il
reconnat pour extrieure soi, comprend la totalit des relations
qui dterminent le psychisme du sujet. Erreur corrlative une
impasse dans la thorie de la connaissance et l'chec plus haut
voqu d'une conception morale.
Freud conoit le moi, en conformit avec cette psychologie qu'il
qualifie de rationaliste, comme le systme des relations psychiques
selon lequel le sujet subordonne la ralit la perception consciente ;
cause de quoi doit lui opposer d'abord sous le terme de surmoi
71
LES COMPLEXES FAMILIAUX DANS LA FORMATION DE L'INDIVIDU
le systme, dfini l'instant, des interdictions inconscientes. Mais
il nous parat important d'quilibrer thoriquement ce systme en
lui conjoignant celui des projections idales qui, des images de gran-
deur de la folle du logis aux fantasmes qui polarisent le dsir
sexuel et l'illusion individuelle de la volont de puissance, mani-
feste dans les formes imaginaires du moi une condition non moins
structurale de la ralit humaine. Si ce systme est assez mal dfini
par un usage du terme d' idal du moi qu'on confond encore avec
le surmoi, il suffit pourtant pour en saisir l'originalit d'indiquer
qu'il constitue comme secret de la conscience la prise mme qu'a
l'analyste sur le mystre de l'inconscient ; mais c'est prcisment
pour tre trop immanent l'exprience qu'il doit tre isol en
dernier lieu par la doctrine : c'est quoi cet expos contribue.
Si les instances psychiques qui chappent au moi apparaissent
d'abord comme l'effet du refoulement de la sexualit dans l'enfance,
leur formation se rvle, l'exprience, toujours plus voisine, quant
au temps et la structure, de la situation de sparation que l'analyse
de l'angoisse fait reconnatre pour primordiale et qui est celle de la
naissance.
La rfrence de tels effets psychiques une situation si originelle
ne va pas sans obscurit. Il nous semble que notre conception
du stade du miroir peut contribuer l'clairer : elle tend le trau-
matisme suppos de cette situation tout un stade de morcelage
fonctionnel, dtermin par le spcial inachvement du systme ner-
veux; elle reconnat ds ce stade l'intentionnalisation de cette situa-
tion dans deux manifestations psychiques du sujet : l'assomption
du dchirement originel sous le jeu qui consiste rejeter l'objet, et
l'affirmation de l'unit du corps propre sous l'identification
l'image speculaire. Il y a l un nud phnomnologique qui, en
manifestant sous leur forme originelle ces proprits inhrentes
au sujet humain de mimer sa mutilation et de se voir autre qu'il
n'est, laisse saisir aussi leur raison essentielle dans les servitudes,
propres la vie de l'homme, de surmonter une menace spcifique et
de devoir son salut l'intrt de son congnre.
C'est en effet partir d'une identification ambivalente son sem-
blable que, par la participation jalouse et la concurrence sympa-
thique, le moi se diffrencie dans un commun progrs de l'autrui et
de l'objet. La ralit qu'inaugure ce jeu dialectique gardera la dfor-
72
LES COMPLEXES FAMILIAUX DANS LA FORMATION DE L'INDIVIDU
mation structurale du drame existentiel qui la conditionne et qu'on
peut appeler le drame de l'individu, avec l'accent que reoit ce
terme de l'ide de la prmaturation spcifique.
Mais cette structure ne se diffrencie pleinement que l o on l'a
reconnue tout d'abord, dans le conflit de la sexualit infantile, ce qui
se conoit pour ce qu'elle n'accomplit qu'alors sa fonction quant
l'espce : en assurant la correction psychique de la prmaturation
sexuelle, le surmoi, par le refoulement de l'objet biologiquement
inadquat que propose au dsir sa premire maturation, l'idal du
moi, par l'identification imaginaire qui orientera le choix sur l'objet
biologiquement adquat la maturation pubrale.
Moment que sanctionne l'achvement conscutif de la synthse
spcifique du moi l'ge dit de raison ; comme personnalit, par
l'avnement des caractres de comprhensibilit et de responsabilit,
comme conscience individuelle, par un certain virage qu'opre le
sujet de la nostalgie de la mre l'affirmation mentale de son auto-
nomie. Moment que marque surtout ce pas affectif dans la ralit, qui
est li l'intgration de la sexualit dans le sujet. Il y a l un second
nud du drame existentiel que le complexe d'dipe amorce en
mme temps qu'il rsout le premier. Les socits primitives, qui
apportent une rgulation plus positive la sexualit de l'individu,
manifestent le sens de cette intgration irrationnelle dans la fonc-
tion initiatique du totem, pour autant que l'individu y identifie son
essence vitale et se l'assimile rituellement : le sens du totem, rduit
par Freud celui de l'dipe, nous parat plutt quivaloir l'une de
ses fonctions : celles de l'idal du moi.
Ayant ainsi tenu notre propos de rapporter leur porte concrte
- c'est--dire existentielle - les termes les plus abstraits qu'a labors
l'analyse des nvroses, nous pouvons mieux dfinir maintenant le
rle de la famille dans la gense de ces affections. Il tient la double
charge du complexe d'dipe : par son incidence occasionnelle dans
le progrs narcissique, il intresse l'achvement structural du moi ;
par les images qu'il introduit dans cette structure, il dtermine une
certaine animation affective de la ralit. La rgulation de ces effets
se concentre dans le complexe, mesure que se rationalisent les
formes de communion sociale dans notre culture, rationalisation
qu'il dtermine rciproquement en humanisant l'idal du moi.
D'autre part, le drglement de ces effets apparat en raison des
73
LES COMPLEXES FAMILIAUX DANS LA FORMATION DE L'INDIVIDU
exigences croissantes qu'impose au moi cette culture mme quant
la cohrence et l'lan crateur.
Or, les alas et les caprices de cette rgulation s'accroissent
mesure que le mme progrs social, en faisant voluer la famille vers
la forme conjugale, la soumet plus aux variations individuelles. De
cette anomie qui a favoris la dcouverte du complexe, dpend
la forme de dgradation sous laquelle le connaissent les analystes :
forme que nous dfinirons par un refoulement incomplet du dsir
pour la mre, avec ractivation de l'angoisse et de l'investigation,
inhrentes la relation de la naissance ; par un abtardissement nar-
cissique de l'idalisation du pre, qui fait ressortir dans l'identifica-
tion dipienne l'ambivalence agressive immanente la primordiale
relation au semblable. Cette forme est l'effet commun tant des inci-
dences traumatiques du complexe que de l'anomalie des rapports
entre ses objets. Mais ces deux ordres de causes rpondent respec-
tivement deux ordres de nvroses, celles dites de transfert et celles
dites de caractre.
Il faut mettre part la plus simple de ces nvroses, c'est--dire la
phobie sous la forme o on l'observe le plus frquemment chez
l'enfant : celle qui a pour objet l'animal.
Elle n'est qu'une forme substitutive de la dgradation de l'dipe,
pour autant que l'animal grand y reprsente immdiatement la mre
comme gestatrice, le pre comme menaant, le petit frre comme
intrus. Mais elle mrite une remarque, parce que l'individu y retrouve,
pour sa dfense contre l'angoisse, la forme mme de l'idal du moi,
que nous reconnaissons dans le totem et par laquelle les socits
primitives assurent la formation sexuelle du sujet un confort
moins fragile. Le nvros ne suit pourtant la trace d'aucun souvenir
hrditaire , mais seulement le sentiment immdiat, et non sans
profonde raison, que l'homme a de l'animal comme du modle de la
relation naturelle.
Ce sont les incidences occasionnelles du complexe d'dipe
dans le progrs narcissique qui dterminent les autres nvroses de
transfert : l'hystrie et la nvrose obsessionnelle. Il faut en voir le
type dans les accidents que Freud a d'emble et magistralement
prciss comme l'origine de ces nvroses. Leur action manifeste que
la sexualit, comme tout le dveloppement psychique de l'homme,
est assujettie la loi de communication qui le spcifie. Sduction ou
74
LES COMPLEXES FAMILIAUX DANS LA FORMATION DE L'INDIVIDU
rvlation, ces accidents jouent leur rle, en tant que le sujet, comme
surpris prcocement par eux en quelque processus de son recolle-
ment narcissique, les y compose par l'identification. Ce processus,
tendance ou forme, selon le versant de l'activit existentielle du sujet
qu'il intresse - assomption de la sparation ou affirmation de son
identit - , sera rotis en sadomasochisme ou en scoptophilie (dsir
de voir ou d'tre vu). Comme tel, il tendra subir le refoulement
corrlatif de la maturation normale de la sexualit, et il y entranera
une part de la structure narcissique. Cette structure fera dfaut la
synthse du moi et le retour du refoul rpond l'effort constitutif
du moi pour s'unifier. Le symptme exprime la fois ce dfaut et
cet effort, ou plutt leur composition dans la ncessit primordiale
de fuir l'angoisse.
En montrant ainsi la gense de la division qui introduit le symp-
tme dans la personnalit, aprs avoir rvl les tendances qu'il
reprsente, l'interprtation freudienne, rejoignant l'analyse clinique
de Janet, la dpasse en une comprhension dramatique de la nvrose,
comme lutte spcifique contre l'angoisse.
Le symptme hystrique, qui est une dsintgration d'une fonc-
tion somatiquement localise : paralysie, anesthsie, algie, inhibition,
scotomisation, prend son sens du symbolisme organomorphique - struc-
ture fondamentale du psychisme humain selon Freud, manifestant
par une sorte de mutilation le refoulement de la satisfaction gnitale.
Ce symbolisme, pour tre cette structure mentale par o l'objet
participe aux formes du corps propre, doit tre conu comme la
forme spcifique des donnes psychiques du stade du corps mor-
cel ; par ailleurs certains phnomnes moteurs caractristiques du
stade du dveloppement que nous dsignons ainsi, se rapprochent
trop de certains symptmes hystriques, pour qu'on ne cherche pas
ce stade l'origine de la fameuse complaisance somatique qu'il faut
admettre comme condition constitutionnelle de l'hystrie. C'est
par un sacrifice mutilateur que l'angoisse est ici occulte; et l'effort
de restauration du moi se marque dans la destine de l'hystrique
par une reproduction rptitive du refoul. On comprend ainsi que
ces sujets montrent dans leurs personnes les images pathtiques du
drame existentiel de l'homme.
Pour le symptme obsessionnel, o Janet a bien reconnu la disso-
ciation des conduites organisatrices du moi - apprhension obs-
75
LES COMPLEXES FAMILIAUX DANS LA FORMATION DE L'INDIVIDU
dante, obsession-impulsion, crmoniaux, conduites coercitives, obses-
sion ruminatrice, scrupuleuse, ou doute obsessionnel -, il prend son
sens du dplacement de Vaffect dans la reprsentation ; processus dont
la dcouverte est due aussi Freud.
Freud montre en outre par quels dtours, dans la rpression
mme, que le symptme manifeste ici sous la forme la plus fr-
quente de la culpabilit, vient se composer la tendance agressive
qui a subi le dplacement. Cette composition ressemble trop aux
effets de la sublimation, et les formes que l'analyse dmontre dans
la pense obsessionnelle - isolement de l'objet, dconnexion causale
du fait, annulation rtrospective de l'vnement - se manifestent
trop comme la caricature des formes mmes de la connaissance,
pour qu'on ne cherche pas l'origine de cette nvrose dans les pre-
mires activits d'identification du moi, ce que beaucoup d'analystes
reconnaissent en insistant sur un dploiement prcoce du moi chez
ces sujets ; au reste les symptmes en viennent tre si peu dsint-
grs du moi que Freud a introduit pour les dsigner le terme
de pense compulsionnelle. Ce sont donc les superstructures de la
personnalit qui sont utilises ici pour mystifier l'angoisse. L'effort de
restauration du moi se traduit dans le destin de l'obsd par une
poursuite tantalisante du sentiment de son unit. Et l'on comprend
la raison pour laquelle ces sujets, que distinguent frquemment des
facults spculatives, montrent dans beaucoup de leurs symptmes
le reflet naf des problmes existentiels de l'homme.
On voit donc que c'est l'incidence du traumatisme dans le
progrs narcissique qui dtermine la forme du symptme avec son
contenu. Certes, d'tre exogne, le traumatisme intressera au moins
passagrement le versant passif avant le versant actif de ce progrs, et
toute division de l'identification consciente du moi parat impliquer
la base d'un morcelage fonctionnel : ce que confirme en effet le
soubassement hystrique que l'analyse rencontre chaque fois qu'on
peut reconstituer l'volution archaque d'une nvrose obsession-
nelle. Mais une fois que les premiers effets du traumatisme ont
creus leur lit selon l'un des versants du drame existentiel : assomp-
tion de la sparation ou identification du moi, le type de la nvrose
va en s'accusant.
Cette conception n'a pas seulement l'avantage d'inciter saisir de
plus haut le dveloppement de la nvrose, en reculant quelque peu
76
LES COMPLEXES FAMILIAUX DANS LA FORMATION DE L'INDIVIDU
le recours aux donnes de la constitution o l'on se repose toujours
trop vite : elle rend compte du caractre essentiellement individuel
des dterminations de l'affection. Si les nvroses montrent, en effet,
par la nature des complications qu'y apporte le sujet l'ge adulte
(par adaptation secondaire sa forme et aussi par dfense secondaire
contre le symptme lui-mme, en tant que porteur du refoul), une
varit de formes telle que le catalogue en est encore faire aprs
plus d'un tiers de sicle d'analyse - la mme varit s'observe dans
ses causes. Il faut lire les comptes rendus de cures analytiques et sp-
cialement les admirables cas publis par Freud pour comprendre
quelle gamme infinie d'vnements peuvent inscrire leurs effets dans
une nvrose, comme traumatisme initial ou comme occasions de sa
ractivation - avec quelle subtilit les dtours du complexe dipien
sont utiliss par l'incidence sexuelle : la tendresse excessive d'un
parent ou une svrit inopportune peuvent jouer le rle de sduc-
tion comme la crainte veille de la perte de l'objet parental, une
chute de prestige frappant son image peuvent tre des expriences
rvlatrices. Aucune atypie du complexe ne peut tre dfinie par des
effets constants. Tout au plus peut-on noter globalement une com-
posante homosexuelle dans les tendances refoules par l'hystrie, et
la marque gnrale de l'ambivalence agressive l'gard du pre dans
la nvrose obsessionnelle ; ce sont au reste l des formes manifestes
de la subversion narcissique qui caractrise les tendances dter-
minantes des nvroses.
C'est aussi en fonction du progrs narcissique qu'il faut conce-
voir l'importance si constante de la naissance d'un frre : si le mou-
vement comprhensif de l'analyse en exprime le retentissement dans
le sujet sous quelque motif: investigation, rivalit, agressivit, culpa-
bilit, il convient de ne pas prendre ces motifs pour homognes ce
qu'ils reprsentent chez l'adulte, mais d'en corriger la teneur en se
souvenant de l'htrognit de la structure du moi au premier ge ;
ainsi l'importance de cet vnement se mesure-t-elle ses effets
dans le processus d'identification : il prcipite souvent la formation
du moi et fixe sa structure une dfense susceptible de se manifester
en traits de caractre, avaricieux ou autoscopique. Et c'est de mme
comme une menace, intimement ressentie dans l'identification
l'autre, que peut tre vcue la mort d'un frre.
On constatera aprs cet examen que si la somme des cas ainsi
77
LES COMPLEXES FAMILIAUX DANS LA FORMATION DE L'INDIVIDU
publis peut tre verse au dossier des causes familiales de ces
nvroses, il est impossible de rapporter chaque entit quelque ano-
malie constante des instances familiales. Ceci du moins est vrai des
nvroses de transfert ; le silence leur sujet d'un rapport prsent au
Congrs des psychanalystes franais en 1936 sur les causes familiales
des nvroses est dcisif. Il n'est point pour diminuer l'importance
du complexe familial dans la gense de ces nvroses, mais pour faire
reconnatre leur porte d'expressions existentielles du drame de
l'individu.
Les nvroses dites de caractre, au contraire, laissent voir certains
rapports constants entre leurs formes typiques et la structure de la
famille o a grandi le sujet. C'est la recherche psychanalytique qui a
permis de reconnatre comme nvrose des troubles du comporte-
ment et de l'intrt qu'on ne savait rapporter qu' l'idiosyncrasie du
caractre ; elle y a retrouv le mme effet paradoxal d'intentions
inconscientes et d'objets imaginaires qui s'est rvl dans les symp-
tmes des nvroses classiques ; et elle a constat la mme action de
la cure psychanalytique, substituant pour la thorie comme pour
la pratique une conception dynamique la notion inerte de consti-
tution.
Le surmoi et l'idal du moi sont, en effet, des conditions de struc-
ture du sujet. S'ils manifestent dans des symptmes la dsintgration
produite par leur interfrence dans la gense du moi, ils peuvent
aussi se traduire par un dsquilibre de leur instance propre dans la
personnalit : par une variation de ce qu'on pourrait appeler la for-
mule personnelle du sujet. Cette conception peut s'tendre toute
l'tude du caractre, o, pour tre relationnelle, elle apporte une base
psychologique pure la classification de ses varits, c'est--dire un
autre avantage sur l'incertitude des donnes auxquelles se rfrent
les conceptions constitutionnelles en ce champ prdestin leur
panouissement.
La nvrose de caractre se traduit donc par des entraves diffuses
dans les activits de la personne, par des impasses imaginaires dans
les rapports avec la ralit. Elle est d'autant plus pure qu'entraves
et impasses sont subjectivement plus intgres au sentiment de
l'autonomie personnelle. Ce n'est pas dire qu'elle soit exclusive
des symptmes de dsintgration, puisqu'on la rencontre de plus en
plus comme fonds dans les nvroses de transfert. Les rapports de la
78
LES COMPLEXES FAMILIAUX DANS LA FORMATION DE L'INDIVIDU
nvrose de caractre la structure familiale tiennent au rle des
objets parentaux dans la formation du surmoi et de l'idal du moi.
Tout le dveloppement de cette tude est pour dmontrer que le
complexe d'dipe suppose une certaine typicit dans les relations
psychologiques entre les parents, et nous avons spcialement insist
sur le double rle que joue le pre, en tant qu'il reprsente l'autorit
et qu'il est le centre de la rvlation sexuelle ; c'est l'ambigut
mme de son imago, incarnation de la rpression et catalyseur d'un
accs essentiel la ralit, que nous avons rapport le double pro-
grs, typique d'une culture, d'un certain temprament du surmoi et
d'une orientation minemment volutive de la personnalit.
Or, il s'avre l'exprience que le sujet forme son surmoi et
son idal du moi, non pas tant d'aprs le moi du parent, que d'aprs
les instances homologues de sa personnalit : ce qui veut dire que
dans le processus d'identification qui rsout le complexe dipien,
l'enfant est bien plus sensible aux intentions, qui lui sont affecti-
vement communiques de la personne parentale, qu' ce qu'on peut
objectiver de son comportement.
C'est l ce qui met au premier rang des causes de nvrose la
nvrose parentale et, encore que nos remarques prcdentes sur la
contingence essentielle au dterminisme psychologique de la nvrose
impliquent une grande diversit dans la forme de la nvrose induite,
la transmission tendra tre similaire, en raison de la pntration
affective qui ouvre le psychisme enfantin au sens le plus cach du
comportement parental.
Rduite la forme globale du dsquilibre, cette transmission est
patente cliniquement, mais on ne peut la distinguer de la donne
anthropologique brute de la dgnrescence. Seule l'analyse en dis-
cerne le mcanisme psychologique, tout en rapportant certains effets
constants une atypie de la situation familiale.
Une premire atypie se dfinit ainsi en raison du conflit qu'im-
plique le complexe d'dipe spcialement dans les rapports du fils
au pre. La fcondit de ce conflit tient la slection psychologique
qu'il assure en faisant de l'opposition de chaque gnration la pr-
cdente la condition dialectique mme de la tradition du type pater-
naliste. Mais toute rupture de cette tension, une gnration don-
ne, soit en raison de quelque dbilit individuelle, soit par quelque
excs de la domination paternelle, l'individu dont le moi flchit
79
LES COMPLEXES FAMILIAUX DANS LA FORMATION DE L'INDIVIDU
recevra en outre le faix d'un surmoi excessif. On s'est livr des
considrations divergentes sur la notion d'un surmoi familial;
assurment elle rpond une intuition de la ralit. Pour nous, le
renforcement pathogne du surmoi dans l'individu se fait en fonc-
tion double : et de la rigueur de la domination patriarcale, et de la
forme tyrannique des interdictions qui resurgissent avec la structure
matriarcale de toute stagnation dans les liens domestiques. Les
idaux religieux et leurs quivalents sociaux jouent ici facilement
le rle de vhicules de cette oppression psychologique, en tant qu'ils
sont utiliss des fins exclusivistes par le corps familial et rduits
signifier les exigences du nom ou de la race.
C'est dans ces conjonctures que se produisent les cas les plus
frappants de ces nvroses, qu'on appelle d'autopunition pour la pr-
pondrance souvent univoque qu'y prend le mcanisme psychique
de ce nom ; ces nvroses, qu'en raison de l'extension trs gnrale de
ce mcanisme on diffrencierait mieux comme nvroses de destine, se
manifestent par toute la gamme des conduites d'chec, d'inhibition,
de dchance, o les psychanalystes ont su reconnatre une inten-
tion inconsciente ; l'exprience analytique suggre d'tendre tou-
jours plus loin, et jusqu' la dtermination de maladies organiques,
les effets de l'autopunition. Ils clairent la reproduction de certains
accidents vitaux plus ou moins graves au mme ge o ils sont appa-
rus chez un parent, certains virages de l'activit et du caractre, pass
le cap d'chances analogues, l'ge de la mort du pre par exemple,
et toutes sortes de comportements d'identification, y compris sans
doute beaucoup de ces cas de suicide, qui posent un problme
singulier d'hrdit psychologique.
Une seconde atypie de la situation familiale se dfinit dans la
dimension des effets psychiques qu'assure l'dipe en tant qu'il pr-
side la sublimation de la sexualit : effets que nous nous sommes
efforcs de faire saisir comme d'une animation Imaginative de la ra-
lit. Tout un ordre d'anomalies des intrts s'y rfre, qui justifie
pour l'intuition immdiate l'usage systmatis dans la psychanalyse
du terme de libido. Nulle autre en effet que l'ternelle entit du
dsir ne parat convenir pour dsigner les variations que la clinique
manifeste dans l'intrt que porte le sujet la ralit, dans l'lan
qui soutient sa conqute ou sa cration. Il n'est pas moins frappant
d'observer qu' mesure que cet lan s'amortit, l'intrt que le sujet
80
LES COMPLEXES FAMILIAUX DANS LA FORMATION DE L'INDIVIDU
rflchit sur sa propre personne se traduit en un jeu plus imaginaire,
qu'il se rapporte son intgrit physique, sa valeur morale ou sa
reprsentation sociale.
Cette structure d'involution intrapsychique, que nous dsignons
comme introversion de la personnalit, en soulignant qu'on use
de ce terme dans des sens un peu diffrents, rpond la relation du
narcissisme, telle que nous l'avons dfinie gntiquement comme
la forme psychique o se compense l'insuffisance spcifique de la
vitalit humaine. Ainsi un rythme biologique rgle-t-il sans doute
certains troubles affectifs, dits cyclothymiques, sans que leur mani-
festation soit sparable d'une inhrente expressivit de dfaite et
de triomphe. Aussi bien toutes les intgrations du dsir humain se
font-elles en des formes drives du narcissisme primordial.
Nous avons pourtant montr que deux formes se distinguaient
par leur fonction critique dans ce dveloppement : celle du double
et celle de l'idal du moi, la seconde reprsentant l'achvement et la
mtamorphose de la premire. L'idal du moi en effet substitue
au double, c'est--dire l'image anticipatrice de l'unit du moi, au
moment o celle-ci s'achve, la nouvelle anticipation de la maturit
libidinale du sujet. C'est pourquoi toute carence de l'imago forma-
trice de l'idal du moi tendra produire une certaine introversion
de la personnalit par subduction narcissique de la libido. Introver-
sion qui s'exprime encore comme une stagnation plus ou moins
rgressive dans les relations psychiques formes par le complexe du
sevrage, - ce que dfinit essentiellement la conception analytique de
la schizonoa.
Les analystes ont insist sur les causes de nvroses que constituent
les troubles de la libido chez la mre, et la moindre exprience
rvle en effet dans de nombreux cas de nvrose une mre frigide,
dont on saisit que la sexualit, en se drivant dans les relations
l'enfant, en ait subverti la nature : mre qui couve et choie, par une
tendresse excessive o s'exprime plus ou moins consciemment un
lan refoul ; ou mre d'une scheresse paradoxale aux rigueurs
muettes, par une cruaut inconsciente o se traduit une fixation
bien plus profonde de la libido.
Une juste apprciation de ces cas ne peut viter de tenir compte
d'une anomalie corrlative, chez le pre. C'est dans le cercle vicieux
de dsquilibres libidinaux, que constitue en ces cas le cercle de
81
LES COMPLEXES FAMILIAUX DANS LA FORMATION DE L'INDIVIDU
famille, qu'il faut comprendre la frigidit maternelle pour mesurer
ses effets. Nous pensons que le sort psychologique de l'enfant dpend
avant tout du rapport que montrent entre elles les images parentales.
C'est par l que la msentente des parents est toujours nuisible l'en-
fant, et que, si nul souvenir ne demeure plus sensible en sa mmoire
que l'aveu formul du caractre mal assorti de leur union, les formes
les plus secrtes de cette msentente ne sont pas moins pernicieuses.
Nulle conjoncture n'est en effet plus favorable l'identification
plus haut invoque comme nvrosante, que la perception, trs sre
chez l'enfant, dans les relations des parents entre eux, du sens nvro-
tique des barrires qui les sparent, et tout spcialement chez le pre
en raison de la fonction rvlatrice de son image dans le processus
de sublimation sexuelle.
C'est donc la dysharmonie sexuelle entre les parents qu'il faut
rapporter la prvalence que gardera le complexe du sevrage dans un
dveloppement qu'il pourra marquer sous plusieurs modes nvro-
tiques.
Le sujet sera condamn rpter indfiniment l'effort du dta-
chement de la mre - et c'est l qu'on trouve le sens de toutes sortes
de conduites forces, allant de telles fugues de l'enfant aux impul-
sions vagabondes et aux ruptures chaotiques qui singularisent la
conduite d'un ge plus avanc ; ou bien, le sujet reste prisonnier des
images du complexe, et soumis tant leur instance ltale qu' leur
forme narcissique - c'est le cas de la consomption plus ou moins
intentionnalise o, sous le terme de suicide non violent, nous avons
marqu le sens de certaines nvroses orales ou digestives ; c'est le
cas galement de cet investissement libidinal que trahissent dans
l'hypocondrie les endoscopies les plus singulires, comme le souci,
plus comprhensible mais non moins curieux, de l'quilibre ima-
ginaire des gains alimentaires et des pertes excrtoires. Aussi bien
cette stagnation psychique peut-elle manifester son corollaire social
dans une stagnation des liens domestiques, les membres du groupe
familial restant agglutins par leurs maladies imaginaires en un
noyau isol dans la socit, nous voulons dire aussi strile pour son
commerce qu'inutile son architecture.
Il faut distinguer enfin une troisime atypie de la situation fami-
liale, qui, intressant aussi la sublimation sexuelle, atteint lecti-
vement sa fonction la plus dlicate, qui est d'assurer la sexualisation
82
LES COMPLEXES FAMILIAUX DANS LA FORMATION DE L'INDIVIDU
psychique, c'est--dire un certain rapport de conformit entre la
personnalit imaginaire du sujet et son sexe biologique : ce rapport
se trouve invers des niveaux divers de la structure psychique,
y compris la dtermination psychologique d'une patente homo-
sexualit.
Les analystes n'ont pas eu besoin de creuser bien loin les donnes
videntes de la clinique pour incriminer ici encore le rle de la
mre, savoir tant les excs de sa tendresse l'endroit de l'enfant
que les traits de virilit de son propre caractre. C'est par un triple
mcanisme que, au moins pour le sujet mle, se ralise l'inversion :
parfois fleur de conscience, presque toujours fleur d'observation,
une fixation affective la mre, fixation dont on conoit qu'elle
entrane l'exclusion d'une autre femme ; plus profonde, mais encore
pntrable, fut-ce la seule intuition potique, l'ambivalence narcis-
sique selon laquelle le sujet s'identifie sa mre et identifie l'objet
d'amour sa propre image spculaire, la relation de sa mre lui-
mme donnant la forme o s'encastrent jamais le mode de son
dsir et le choix de son objet, dsir motiv de tendresse et d'du-
cation, objet qui reproduit un moment de son double ; enfin, au
fond du psychisme, l'intervention trs proprement castrative par o
la mre a donn issue sa propre revendication virile.
Ici s'avre bien plus clairement le rle essentiel de la relation entre
les parents ; et les analystes soulignent comment le caractre de la
mre s'exprime aussi sur le plan conjugal par une tyrannie domes-
tique, dont les formes larves ou patentes, de la revendication senti-
mentale la confiscation de l'autorit familiale, trahissent toutes leur
sens foncier de protestation virile, celle-ci trouvant une expression
minente, la fois symbolique, morale et matrielle, dans la satisfac-
tion de tenir les cordons de la bourse . Les dispositions qui, chez
le mari, assurent rgulirement une sorte d'harmonie ce couple ne
font que rendre manifestes les harmonies plus obscures qui font de
la carrire du mariage le lieu lu de la culture des nvroses, aprs
avoir guid l'un des conjoints ou les deux dans un choix divinatoire
de son complmentaire, les avertissements de l'inconscient chez un
sujet rpondant sans relais aux signes par o se trahit l'inconscient de
l'autre.
L encore une considration supplmentaire nous semble s'im-
poser, qui rapporte cette fois le processus familial ses conditions
83
LES COMPLEXES FAMILIAUX DANS LA FORMATION DE L'INDIVIDU
culturelles. On peut voir dans le fait de la protestation virile de
la femme la consquence ultime du complexe d'dipe. Dans la
hirarchie des valeurs qui, intgres aux formes mmes de la ralit,
constituent une culture, c'est une des plus caractristiques que l'har-
monie qu'elle dfinit entre les principes mle et femelle de la vie.
Les origines de notre culture sont trop lies ce que nous appelle-
rions volontiers l'aventure de la famille paternaliste, pour qu'elle
n'impose pas, dans toutes les formes dont elle a enrichi le dvelop-
pement psychique, une prvalence du principe mle, dont la porte
morale confre au terme de virilit suffit mesurer la partialit.
Il tombe sous le sens de l'quilibre, qui est le fondement de toute
pense, que cette prfrence a un envers : fondamentalement, c'est
l'occultation du principe fminin sous l'idal masculin, dont la
vierge, par son mystre, est travers les ges de cette culture le signe
vivant. Mais c'est le propre de l'esprit, qu'il dveloppe en mystifi-
cation les antinomies de l'tre qui le constituent, et le poids mme
de ces superstructures peut venir en renverser la base. Il n'est pas
de lien plus clair au moraliste que celui qui unit le progrs social
de l'inversion psychique un virage utopique des idaux d'une
culture. Ce lien, l'analyste en saisit la dtermination individuelle dans
les formes de sublimit morale, sous lesquelles la mre de l'inverti
exerce son action la plus catgoriquement masculante.
Ce n'est pas par hasard que nous achevons sur l'inversion psy-
chique cet essai de systmatisation des nvroses familiales. Si en effet
la psychanalyse est partie des formes patentes de l'homosexualit
pour reconnatre les discordances psychiques plus subtiles de l'inver-
sion, c'est en fonction d'une antinomie sociale qu'il faut comprendre
cette impasse imaginaire de la polarisation sexuelle, quand s'y enga-
gent invisiblement les formes d'une culture, les murs et les arts, la
lutte et la pense.
Le nombre treize et la forme logique
de la suspicion
PARU DANS LES CAHIERS D*ART 1945-1946
Plus inaccessible nos yeux, faits pour les signes
du changeur... (Discours sur la causalit psy-
chique ).
Une fois encore nous partirons d'un de ces problmes arithm-
tiques, o les modernes ne voient gure que rcration, non sans
que la notion ne les hante des virtualits cratrices qu'y dcouvrait
la pense traditionnelle.
Celui-ci est d M. Le Lionnais qu'on nous dit fort initi en
ces arcanes et qui se trouve ainsi avoir troubl les veilles de quelques
Parisiens. Du moins est-ce sous ce jour qu'il nous fut propos par
Raymond Queneau qui, grand expert en ces jeux o il ne voit
pas le moindre objet o mettre l'preuve son agilit dialectique, et
non moins rudit en ces publications rserves o on les cultive,
peut tre suivi quand il avance que sa donne est originale. La voici.
Le problme des douze pices
Sur douze pices d'apparence semblable, l'une que nous dirons
mauvaise, se distingue par une diffrence de poids, imperceptible
sans appareil de mesure, diffrence dont il n'est pas dit qu'elle soit en
plus ou en moins.
On demande de trouver cette pice parmi les autres en trois
peses en tout et pour tout, pour lesquelles on dispose du seul
instrument d'une balance deux plateaux, l'exclusion de tout
poids-talon ou de toute autre tare que les pices en cause elles-
mmes.
La balance qu'on nous donne ici comme appareil, jouera pour
nous comme support d'une forme logique, que nous appelons
85
LE NOMBRE TREIZE ET LA FORME LOGIQUE DE LA SUSPICION
forme de la suspicion ambigu, et la pese nous montrera sa fonc-
tion dans la pense
l
.
Solution du problme
Ce problme requiert une invention opratoire des plus simples, et
tout fait la mesure de l'esprit humain. Nous doutons pourtant
qu'elle soit la porte de cette mcanique dont le nom de machine
penser exprime assez la merveille. C'est qu'il y aurait beaucoup
dire sur l'ordre des difficults qu'opposent respectivement l'esprit
les formes dveloppes du jeu des nombres, et les formes les plus
simples dont c'est une question de savoir si elles contiennent impli-
citement les autres.
Pour qui donc voudra s'essayer rsoudre notre problme, prci-
sons ici que ses conditions doivent tre prises la rigueur, - c'est--
dire que tout rsultat constat lors de la mise en balance de 2 pices
ou de 2 groupes de pices (toujours videmment en nombre gal),
compte pour une pese, soit que les plateaux s'quilibrent ou que
l'un d'eux l'emporte.
Cette remarque a pour but que le chercheur, quand il en sera au
moment, semble-t-il invitable, o la difficult lui paratra sans issue,
ne tergiverse pas supposer, par exemple, qu'un double essai, se rap-
portant au mme temps opratoire, puisse tre tenu pour une seule
pese, mais bien plutt qu'anim de la certitude que la solution
existe, il persvre au fond de l'impasse jusqu' en dcouvrir la faille.
i. L'tude ici dveloppe prend sa place dans les analyses formelles initiales d'une
logique collective, laquelle se rfrait dj le morceau publi dans le numro prc-
dent des Cahiers d'art sous le titre Le temps logique et l'assertion de certitude anti-
cipe (repris in crits, d. du Seuil, 1966, p. 197-213).
La forme ici dveloppe, quoiqu'elle compare la succession, n'est point de
l'ordre du temps logique et se situe comme antrieure dans notre dveloppement.
Elle fait partie de nos approches exemplaires pour la conception des formes
logiques o doivent se dfinir les rapports de l'individu la collection, avant que se
constitue la classe, autrement dit avant que l'individu soit spcifi.
Cette conception se dveloppe en une logique du sujet, que notre autre tude
fait nettement apercevoir, puisque nous en venons sa fin tenter de formuler le
syllogisme subjectif, part o le sujet de l'existence s'assimile l'essence, radicale-
ment culturelle pour nous, quoi s'applique le terme d'humanit.
86
LE NOMBRE TREIZE ET LA FORME LOGIQUE DE LA SUSPICION
Qu'il nous rejoigne alors pour en considrer avec nous la structure.
Guidons, en l'attendant, le lecteur plus docile.
Le petit nombre des preuves permises commande de procder
par groupe. Le rappel de la donne que la prsence de la mauvaise
pice est certaine parmi les 12, pourrait nous dissuader de les rpar-
tir d'abord par moiti dans les plateaux : cette donne, en effet, pour
rendre certain que l'un des groupes de 6 l'emportera sur l'autre,
diminuera d'autant l'intrt d'une telle preuve. Ce raisonnement
pourtant se rvlera n'tre qu'approximatif.
La justification vritable du procd qui russit, est que la pese
dans une balance deux plateaux a trois issues possibles, selon qu'ils
se font quilibre ou que l'un ou l'autre l'emporte. Certes, dans le
cas de leur dsquilibre, rien ne nous fait reconnatre de quel ct
est l'objet qu'il faut en rendre responsable. Nanmoins nous serons
fonds oprer selon une distribution tripartite, forme que nous
retrouvons sous plus d'une incidence dans la logique de la collection.
La premire pese et le problme des quatre
Extraits de nos douze pices, mettons donc en balance deux
groupes de quatre.
Le cas de leur quilibre nous laisse trouver la mauvaise pice
parmi les quatre restantes. Problme dont la solution paratra facile
en deux peses, encore qu'il faille la formuler sans prcipitation.
Prcisons qu' la deuxime pese nous mettrons dans chaque pla-
teau une et une seule de ces quatre pices. Les plateaux s'quili-
brent-ils ? Les deux pices sont donc bonnes, et l'une d'elles, oppo-
se en une troisime pese l'une quelconque des restantes, ou bien
manifestera en celle-ci la mauvaise pice, ou permettra de la situer
par limination dans l'ultime non prouve.
L'un des plateaux au contraire Femporte-t-il la deuxime pese ?
La mauvaise pice est parmi les deux mises en balance, et les deux
pices restantes, tant ds lors certainement bonnes, la situation, sem-
blable celle du cas prcdent, sera rsolue de la mme faon, c'est-
-dire en comparant entre elles une pice de chaque groupe.
Le dveloppement du problme montrera qu'il n'est pas vain de
remarquer ici que ce procd rsout un problme qu'on peut consi-
87
LE NOMBRE TREIZE ET LA FORME LOGIQUE DE LA SUSPICION
drer comme autonome : celui de la pice mauvaise dtecter entre
quatre par le moyen de deux peses, soit le problme immdiatement
infrieur au ntre. Les huit pices intresses dans notre premire
pese, ne sont en effet nullement intervenues dans la recherche de la
mauvaise pice parmi les quatre restantes.
Le hic de la difficult et la suspicion divise
Revenons maintenant cette premire pese pour envisager le
cas o l'un des groupes de quatre mis en balance, l'emporte.
Ce cas est le hic de la difficult. Apparemment il nous laisse la
mauvaise pice dtecter entre huit, et le faire en deux peses,
aprs que ces deux peses se sont montres tout juste suffisantes
pour la dtecter entre quatre.
Mais si la pice mauvaise reste bien reconnatre entre huit, la
suspicion, dirons-nous, qui pse sur chacune d'elles, est d'ores et dj
divise. Et nous touchons ici une dialectique essentielle des rap-
ports de l'individu la collection, en tant qu'ils comportent l'ambi-
gut du trop ou du trop peu.
Ds lors le rsultat de la deuxime pese peut se formuler comme
suit:
Les pices qui sont dans le plateau le plus charg, ne sont suspectes que
d'tre lourdes ; celles qui sont dans le plus lger, ne sont suspectes que d'tre
trop lgres.
La rotation tripartite ou le tri
Telle est la racine de l'opration qui permet de rsoudre notre
problme et que nous appellerons la rotation tripartite, ou encore par
calembour avec son rle de triage, le tri.
Cette opration nous apparatra comme le nud dans le dve-
loppement d'un drame, qu'il s'agisse du problme des douze, ou,
comme nous le verrons, de son application des collections sup-
rieures. La troisime pese ici, comme dans les autres cas toutes les
peses qui suivent, ne feront figure aprs elle que de dnouement
liquidatif.
88
LE NOMBRE TREIZE ET LA FORME LOGIQUE DE LA SUSPICION
Voici le schma de cette opration :
Plateau lourd Plateau lger
Pices bonnes
La rotation tripartite ou le Cri
On voit qu'on y fait intervenir trois pices dj dtermines
comme bonnes, telles qu'en effet elles nous sont fournies, autre
rsultat de la premire pese, dans les quatre pices restantes,
- puisque la mauvaise pice est certainement parmi les huit incluses
dans la pese.
Il existe d'ailleurs une forme de l'opration qui ne fait pas inter-
venir ces pices, - et procde par redistribution des seules pices
dj en balance, aprs exclusion de certaines. Mais quelle que soit
l'lgance d'une telle conomie des lments, je me tiendrai l'ex-
pos de la forme ici reprsente pour plusieurs raisons, savoir :
1 que la distribution tripartite des lments dans l'preuve qui
prcde immdiatement l'opration, donne ncessairement un
nombre d'lments, purs de la suspicion, toujours plus que suffisant
pour que cette forme soit applicable dans l'extension ad indefinitum
que nous donnerons de notre problme, et plus largement encore, on
le verra, avec le complment essentiel que nous allons lui apporter;
2 que cette forme de l'opration est plus maniable mentalement
pour ceux qui ne se sont point rompus la concevoir en se soumet-
tant l'preuve de sa trouvaille ;
3 qu'enfin une fois rsolue par la pese qui la conclut, elle laisse
la moindre complexit aux oprations liquidatives.
89
LE NOMBRE TREIZE ET LA FORME LOGIQUE DE LA SUSPICION
Notre rotation tripartite consiste donc en ceci :
Qu'on substitue trois pices bonnes trois pices quelconques du
plateau, par exemple, le plus charg, - puis les trois pices extraites
de ce plateau trois pices prises dans le plateau le plus lger, les-
quelles ds lors resteront exclues des plateaux.
La deuxime pese et la disjonction dcisive
Il suffit de constater en une deuxime pese l'effet de cette nou-
velle distribution, pour pouvoir en conclure selon chacun des trois
cas possibles les rsultats suivants :
Premier cas : les plateaux s'quilibrent. Toutes les pices y sont donc
bonnes. La mauvaise se trouve alors parmi les trois pices exclues
du plateau qui s'avrait le plus lger la premire pese, et comme
telle on sait qu'elle ne peut tre qu'une pice plus lgre que les autres.
Deuxime cas : changement de ct du plateau qui l'emporte.
C'est alors que la mauvaise pice a chang de plateau. Elle se trouve
donc parmi les trois qui ont quitt le plateau qui s'avrait le plus
lourd la premire pese, et comme telle on sait qu'elle ne peut tre
qu'une pice plus lourde que les autres.
Troisime cas : la balance reste incline du mme ct qu' la
premire pese. C'est que la mauvaise pice se trouve parmi les deux
qui n'ont pas boug. Et nous savons en outre que, si c'est la pice
demeure dans le plateau le plus lourd, il ne peut s'agir que d'une
pice plus lourde, si c'est l'autre, ce ne peut tre qu'une pice plus lgre
que les autres.
La troisime pese dans les trois cas
Men ce degr de disjonction, le problme n'offre plus de rsis-
tance srieuse.
Une pice en effet, dont on a dtermin ds lors qu'elle doit
tre plus lgre dans un cas, plus lourde dans l'autre, sera dtecte
entre trois, en une pese qui mettra en balance deux d'entre elles o
elle apparat sans ambigut, faute de quoi elle s'avre tre la troi-
sime.
90
LE NOMBRE TREIZE ET LA FORME LOGIQUE DE LA SUSPICION
Pour le troisime cas, nous n'avons qu' runir les deux pices
suspectes dans un mme plateau et garnir l'autre de deux quel-
conques des autres pices, pures ds lors de toute suspicion, pour
que la pese dsigne la mauvaise pice. En effet, le plateau des pices
suspectes se manifestera srement ou comme plus charg ou comme
plus lger que l'autre, car il porte srement ou bien une pice trop
lourde ou bien une pice trop lgre, et nous saurons donc laquelle
incriminer, pour peu que nous n'ayons pas perdu de vue l'indivi-
dualit de chacune, autrement dit de quel plateau de la deuxime
pese elle provient.
Voici donc le problme rsolu.
La collection maxima accessible n peses
Pouvons-nous ds lors dduire la rgle qui, pour un nombre
dtermin de peses, nous donnerait le nombre maximum de pices
entre lesquelles ces peses permettraient d'en dtecter une et une
seule, caractrise par une diffrence ambigu, autrement dit la
raison de la srie des collections maxima, dtermines par une
admission croissante de peses?
Nous pouvons voir en effet que si deux peses sont ncessaires
pour dtecter la mauvaise pice dans une collection de quatre, et
si trois nous permettent de rsoudre le problme des douze, c'est
que deux peses sont encore suffisantes pour trouver la pice entre
huit, ds lors qu'une premire pese y a rparti deux moitis, entre
lesquelles se divisent la suspicion de l'excs et celle du dfaut. On
prouvera facilement qu'une application adquate de la rotation
tripartite permet d'tendre cette rgle aux collections suprieures, et
que quatre peses rsolvent aisment le problme pour 36 pices,
et ainsi de suite, en multipliant par 3 le nombre N des pices chaque
fois qu'on accorde une unit de plus au nombre n des peses per-
mises.
En formulant N comme gal 4 fois 3
W
"
2
, dterminons-nous
le nombre maximum de pices qui soit accessible l'puration
de n peses ? Il suffira d'en tenter l'preuve pour constater que le
nombre est en fait plus grand, et que la raison en est dj manifeste
au niveau de notre problme.
91
LE NOMBRE TREIZE ET LA FORME LOGIQUE DE LA SUSPICION
M. Le Lionnais, soit qu'il ait obi au prcepte traditionnel qui
ordonne que sachant dix on n'enseigne que neuf, soit par bien-
veillance ou malice, s'avre nous avoir fait la partie trop facile.
Si sa donne en effet nous a conduit un procd qui garde sa
valeur, nous allons voir que la comprhension du problme resterait
mutile, pour qui n'apercevrait pas que trois peses sont capables de
dtecter la mauvaise pice non seulement entre douze, mais entre treize,
Dmontrons-le donc maintenant.
Le problme des treize
Les huit premires pices reprsentent bien tout ce qui peut tre
ici mis enjeu la premire pese. Et dans le cas o elles sont toutes
bonnes, cas que plus haut nous avons envisag en premier, il restera
cinq pices, entre lesquelles deux peses nous paratront insuffisantes
dterminer la mauvaise pice, et le seraient vraiment, si ce niveau
du problme ces cinq pices taient les seuls lments dont nous
disposions.
A examiner en effet le problme limit deux peses, il apparat
bien que le nombre de quatre pices est le maximum accessible
leur porte. Encore pouvons-nous remarquer que trois pices seule-
ment peuvent y tre effectivement mises l'preuve, la quatrime
ne venant jamais sur un plateau, et n'tant incrimine dans le cas
extrme que sur le fondement de la donne qui certifie l'existence
d'une mauvaise pice.
La mme remarque vaudra pour ce groupe que nous sommes
en train de considrer comme rsidu dans le problme suprieur (et
vaudra seulement pour ce cas unique, car la dtection d'une pice
par limination lors d'une pese o elle n'entre pas, telle qu'on
l'observe dans d'autres moments possibles du problme, tient ce
que sa prsence dans un groupe s'est effectivement manifeste lors
d'une pese antrieure).
Mais quand notre groupe de cinq pices nous est donn comme
rsidu, le cas n'est pas semblable celui de quatre pices isoles. Car
ici d'autres pices ont t, par la pese antrieure, reconnues pour
bonnes, et une seule suffit pour changer la porte des deux peses
qui nous sont imparties.
92
LE NOMBRE TREIZE ET LA FORME LOGIQUE DE LA SUSPICION
La position par-trois-et-un
Qu'on veuille bien en effet considrer la figure suivante :
La position par-trois-et-un
On voudra bien y reconnatre les deux plateaux de la balance,
dans l'un d'eux sous la forme d'un rond plein la pice bonne
que nous introduisons, dans le mme plateau l'une des cinq pices
suspectes, et dans l'autre une couple encore de ces cinq pices. Telle
sera la disposition de notre deuxime pese.
Deux cas :
Ou bien ces plateaux se feront quilibre, et la pice mauvaise sera
trouver parmi les deux restantes des cinq pices, en une pese
qui la rvlera dans l'une d'elles en l'prouvant avec la mme pice
bonne, qui ici nous suffit encore, faute de quoi il nous faudra la
reconnatre dans l'ultime et non prouve.
Ou bien l'un des plateaux l'emporte, et nous retrouvons la suspi-
cion divise, mais ici de faon ingale : entre une seule pice, sus-
pecte dans un sens, et deux, qui le sont dans le sens oppos.
Il suffira alors que nous empruntions l'une des deux restantes,
ce moment assures d'tre bonnes, pour la substituer la suspecte
isole, et que nous remplacions par cette dernire une des suspectes
couples, excutant ainsi la plus rduite des rotations tripartites, ou
rotation triple, pour que le rsultat nous en soit immdiatement lisible
en une troisime pese :
- soit que le mme plateau l'emporte, manifestant la mauvaise
pice dans celle-ci des deux couples qui n'a pas boug ;
93
LE NOMBRE TREIZE ET LA FORME LOGIQUE DE LA SUSPICION
- soit qu'il y ait quilibre, montrant que la mauvaise pice est
cette autre de la couple qui a t expulse du plateau ;
- soit que changeant le ct qui l'emporte, la mauvaise pice soit
l'isole qui a chang de plateau.
La disposition ici dcisive, celle qui ordonne la pese des trois
pices suspectes avec une pice bonne, - nous la dsignons comme
position par-trois-et-un.
Cette position par-trois-et-un est la forme originale de la logique de
la suspicion. L'on ferait une erreur en la confondant avec la rotation
tripartite, bien qu'elle se rsolve dans cette opration.Tout au contraire
peut-on voir que seule cette position donne l'opration sa pleine
efficacit dans notre problme. Et de mme qu'elle apparat comme le
ressort vritable pour le rsoudre, seule elle permet aussi de rvler
son sens authentique. C'est ce que nous allons dmontrer maintenant.
Le problme des quarante
Passons en effet au problme de quatre peses pour rechercher
quel nombre de pices va s'tendre leur porte, dans les mmes
conditions du problme.
Nous apercevons aussitt qu'une premire pese peut envelopper
avec succs non pas seulement deux fois douze pices, selon la rgle
que suggrait la premire rsolution du problme dit des douze, mais
bien deux fois treize pices.
Que le dsquilibre y apparaisse, en effet, la rotation tripartite,
opre avec l'apport de neuf pices bonnes, est capable de dtecter
entre les 26 de la premire pese la mauvaise pice en trois peses.
La pese aprs le tri les disjoindra en effet en deux groupes de
neuf de suspicion univoque, dans le cas de laquelle une troisime
pese de trois contre trois, manifestera la prsence de la mauvaise
pice, soit dans l'un de ces groupes, soit dans celui des trois restantes,
ou, quel qu'il soit, l'isolera enfin une quatrime et dernire pese,
et en un groupe de huit, de suspicion divise, o nous savons dj
trouver la pice en deux peses.
Mais les 26 premires pices se sont-elles avres bonnes, il nous
reste trois peses, et c'est ici que la position par-trois-et-un va dmon-
trer sa valeur.
94
LE NOMBRE TREIZE ET LA FORME LOGIQUE DE LA SUSPICION
Pour remplir le champ d'un nouveau tri, elle nous indiquera
en effet d'engager non pas seulement quatre contre quatre pices,
comme le suggre l'tude du cas des trois peses, mais cinq contre
quatre pices, compltes par une pice bonne. Aprs les dmonstra-
tions qui prcdent, la figure suivante suffira dmontrer la solubi-
lit de la position des neuf pices, quand la mauvaise s'y rvle par le
dsquilibre des plateaux.
On voit ci-dessous le schma du tri, qui l'preuve de la troisime
pese rvlera dans quel groupe de trois suspectes est la mauvaise
pice, une quatrime suffisant l'isoler dans tous les cas.
Mais l'quilibre des plateaux manifeste-t-il que la mauvaise pice
n'est pas encore l, - rduits ds lors que nous sommes la marge
de deux peses, nous agirons comme au niveau correspondant du
problme des treize en mettant trois nouvelles pices suspectes
deux contre une en balance avec l'aide d'une pice bonne, et faute
d'y voir se rvler la prsence recherche (et ds lors isolable la
pese suivante), il nous restera une pese pour prouver encore une
pice, et pouvoir mme dsigner la pice mauvaise dans une autre
ultime sur le seul fondement de la donne que cette pice existe.
D'o rsultera qu' l'preuve de quatre peses :
26+ 9 + 3 + 1 + 1 = 40 pices sont accessibles.
Le tri complt sur la position par-trois-et-un
(en noir, les pices introduites comme bonnes)
95
LE NOMBRE TREIZE ET LA FORME LOGIQUE DE LA SUSPICION
La rgle gnrale de la conduite des oprations
A reproduire la mme recherche pour un nombre suprieur de
peses, on verra se dgager la rgle qui ordonne la conduite des op-
rations pour cette recherche. C'est savoir :
Mettre en jeu le tri si la mauvaise pice rvle sa prsence parmi
celles qu'enveloppe la premire pese. Sinon :
Introduire la position par-trois-et-un, ds qu'on dispose d'une pice
bonne, c'est--dire, dans les conditions ici poses, ds l'ordonnance
de la deuxime pese, et la renouveler pour toutes les peses qui sui-
vent, jusqu' ce que la mauvaise pice rvle sa prsence dans l'une
d'elles.
Mettre alors en jeu la rotation tripartite, qui est le moment de
virage de toute l'opration. La position par-trois-et-un s'isole dans un
des groupes, dont le tri opre la disjonction.
Si la pese qui conclut ce tri repre la pice dans ledit groupe,
seul cas complexe rsoudre, rpter sur lui le tri, avec la mme pos-
sibilit que se maintienne la position par-trois-et-un, et la mme indi-
cation pour la rsoudre, jusqu' puisement.
Quelques rgles supplmentaires devraient tre ajoutes pour
conduire la recherche sur une collection quelconque, c'est--dire
non maxima.
La raison de la srie des collections maxima
Mais ces rgles-ci nous permettent de voir que cinq peses pour-
ront atteindre au maximum :
1 + 1 + 3 + 9 + 27 + 80 = 121 pices;
- que six peses atteindront :
1 + 1 + 3 + 9 + 27 + 81 + 242 = 364 pices (chiffire singulier),
et ainsi de suite :
96
LE NOMBRE TREIZE ET LA FORME LOGIQUE DE LA SUSPICION
- que, sous une forme algbrique, la vraie formule, cherche plus
haut, de n sera telle que :
n = 1 + 1 + 3 + 3
2
+ 3
3
... + (3
n
-M),
ou bien :
= l + 3 + 3
2
+ 3
3
. . . + 3
w
-
1
,
o l'on voit que chaque nombre N, correspondant un nombre n
de peses, s'obtient en multipliant le nombre N', correspondant
(n-1) peses, par 3 et en ajoutant une unit ce produit.
Cette formule exprime avec une vidence parfaite la puissance tri-
partitrice de la balance partir de la deuxime pese, et comme telle
nous manifeste par son seul aspect que les oprations ont t ordon-
nes de faon qu'elles comblent tout le champ numrique offert
cette puissance.
Cette confirmation est spcialement importante pour les premiers
nombres de la srie, en ce qu'elle dmontre leur adquation la
forme logique de la pese, et particulirement pour le nombre treize,
pour autant que l'apparent artifice des oprations qui nous l'ont fait
dterminer, pouvait nous laisser dans le doute, soit sur ce qu'un nou-
veau joint permt de le dpasser, soit sur ce qu'il laisst vide une
marge fractionnelle sous la dpendance de quelque discontinuit
irrductible dans l'arrangement d'oprations d'aspect dissymtrique.
Le sens du nombre treize
Ds lors le nombre treize montre son sens comme exprimant la
position par-trois-et-un, - et non pas certes parce qu'il s'crit avec ces
deux chiffres : ce n'est l que pure concidence, car cette valeur lui
appartient indpendamment de sa rfrence au systme dcimal. Elle
tient ce que treize reprsentant la collection que dterminent trois
peses, la position par-trois-et-un exige pour son dveloppement
trois preuves : une premire pour pouvoir fournir l'individu pur
de la suspicion, la seconde qui divise la suspicion entre les individus
qu'elle inclut, une troisime qui les discrimine aprs la rotation triple.
(Ceci la diffrence de l'opration du tri qui n'en exige que deux.)
97
LE NOMBRE TREIZE ET LA FORME LOGIQUE DE LA SUSPICION
La forme logique de la suspicion
Mais la lumire de la formule de N, nous pouvons encore avancer
dans la comprhension de la position par-trois-et~un comme forme
logique, - en mme temps que dmontrer que dans notre problme,
la donne, quoique contingente, n'est par arbitraire.
Si le sens de ce problme se rapporte la logique de la collection,
o il manifeste la forme originale que nous dsignons du terme de
suspicion, c'est que la norme laquelle se rapporte la diffrence
ambigu qu'il suppose, n'est pas une norme spcifie ni spcifiante,
elle n'est que relation d'individu individu dans la collection,
- rfrence non l'espce, mais l'uniforme.
C'est ce qu'on met en vidence, si, restant donn que l'individu
porteur de la diffrence ambigu est unique, on supprime la donne
de son existence dans la collection, pour la remplacer par l'appoint
d'un individu talon, donn hors de la collection.
On peut tre alors surpris de constater que rien strictement n'est
chang dans les formes, ni dans les chiffres, que dterminera la nou-
velle donne applique notre problme.
Certes ici les pices devant tre prouves jusqu' la dernire,
aucune ne pourra tre tenue pour mauvaise en position de rsidu
externe la dernire pese, et la porte de cette pese en sera dimi-
nue d'une unit. Mais la pice-talon, pour ce fait que nous pour-
rons en disposer au dpart, nous permettra d'introduire la position
par-trois-et-un ds la premire pese et accrotra d'une unit le groupe
inclus dans celle-ci. Or la donne de cette pice, qui parat d'un si
grand prix notre intuition forme la logique classificatoire, n'aura
absolument aucun autre effet.
En quoi se manifeste que l'uniformit des objets de la donne dans
notre problme ne constitue pas une classe, et que chaque pice doit tre
pese individuellement.
Quel que soit en effet le nombre des individus en cause dans notre
problme, le cas exige d'tre ramen ce que rvle la pese unique :
la notion absolue de la diffrence, racine de la forme de la suspicion.
Cette rfrence de l'individu chacun de tous les autres est l'exi-
gence fondamentale de la logique de la collection, et notre exemple
dmontre qu'elle est loin d'tre impensable.
98
LE NOMBRE TREIZE ET LA FORME LOGIQUE DE LA SUSPICION
La balance du Jugement dernier
Pour l'exprimer dans le registre d'un rve qui hante les hommes,
celui du Jugement dernier, nous indiquerons qu' fixer mille mil-
liards le nombre des tres qu'impliquerait cette grandiose manifes-
tation, et sa perspective ne pouvant tre conue que de l'me en tant
qu'unique, la mise l'preuve de l'un par tous les autres selon la pure
ambigut de la pese que nous reprsentent les figures tradition-
nelles, s'effectuerait trs au large en 26 coups, et qu'ainsi la crmo-
nie n'aurait nulle raison de traner en longueur.
Nous ddions cet apologue ceux pour qui la synthse du parti-
culier et de l'universel a un sens politique concret. Pour les autres,
qu'ils s'essaient appliquer l'histoire de notre poque les formes
que nous avons dmontres ici.
Le phnomne du nombre et le retour la logique
En cherchant nouveau dans les nombres une fonction gn-
ratrice pour le phnomne, nous paraissons retourner d'antiques
spculations que leur caractre approximatif a fait rejeter par la
pense moderne. C'est qu'il nous parat justement que le moment
soit venu de retrouver cette valeur phnomnologique, condition
d'en pousser l'extrme rigueur l'analyse. Sans doute y apparatra-
t-il des singularits qui, pour n'tre pas sans analogie de style avec
celles qui se manifestent dans la physique, voire dans la peinture ou
dans le nouveau style des checs, dconcerteront les esprits, l o
leur formation n'est qu'habitude, en leur donnant le sentiment
d'une rupture d'harmonie, qui irait dissoudre les principes. Si pr-
cisment nous suggrons qu'il faille oprer un retour la logique,
c'est pour en retrouver la base, solide comme le roc, et non moins
implacable, quand elle entre en mouvement.
1945
La psychiatrie anglaise et la guerre
PARU EN 1947 DANS L'VOLUTION PSYCHIATRIQUE
Lorsque en septembre 1945 je fus Londres, les feux venaient
peine de tomber pour la Ville, du Jour : V-Day
9
o elle avait clbr
sa victoire.
La guerre m'avait laiss un vif sentiment du mode d'irralit sous
lequel la collectivit des Franais l'avait vcue de bout en bout.
Je ne vise pas ici ces idologies foraines qui nous avaient balancs
de fantasmagories sur notre grandeur, parentes des radotages de la
snilit, voire du dlire agonique, des fabulations compensatoires
propres l'enfance. Je veux plutt dire chez chacun cette mcon-
naissance systmatique du monde, ces refuges imaginaires, o, psy-
chanalyste, je ne pouvais qu'identifier pour le groupe, alors en proie
une dissolution vraiment panique de son statut moral, ces mmes
modes de dfense que l'individu utilise dans la nvrose contre son
angoisse, et avec un succs non moins ambigu, aussi paradoxalement
efficace, et scellant de mme, hlas ! un destin qui se transmet des
gnrations.
Je pensais donc sortir du cercle de cet enchantement dltre pour
entrer dans un autre rgne : l o aprs le refus crucial d'un compro-
mis qui et t la dfaite, l'on avait pu sans perdre prise travers les
pires preuves, mener la lutte jusqu' ce terme triomphant, qui
maintenant faisait paratre aux nations la vague norme qu'elles
avaient vue prs de les engloutir, n'avoir t qu'une illusion de l'his-
toire, et des plus vite rompues.
Ds cet abord ni jusqu' la fin de mon sjour qui dura 5 semaines,
cette attente d'un autre air ne fut due. Et c'est sous forme d'vi-
dence psychologique que je touchai cette vrit que la victoire de
l'Angleterre est du ressort moral, - je veux dire que l'intrpidit
de son peuple repose sur un rapport vridique au rel, que son ido-
logie utilitariste fait mal comprendre, que spcialement le terme
d'adaptation trahit tout fait, et pour quoi mme le beau mot de
ralisme nous est interdit en raison de l'usage infamant o les clercs
101
LA PSYCHIATRIE ANGLAISE ET LA GUERRE
de la Trahison ont avili sa vertu, par une profanation du verbe qui
pour longtemps prive les hommes des valeurs offenses.
Nous devons donc aller parler d'hrosme, et en voquer les
marques, ds les premires apparues notre dbott, dans cette Ville
grle tous les deux cents mtres de rue, d'une destruction verticale,
au reste cure au net, et s'accommodant mal du terme de ruine,
dont le prestige funbre, mme joint par une intention flatteuse au
souvenir grandiose de la Rome antique dans les propos de bienvenue
tenus la veille par un de nos envoys les plus minents, avait t
mdiocrement got par des gens qui ne se reposent pas sur leur
histoire.
Aussi svres et sans plus de romantisme les autres signes qui,
mesure du progrs du visiteur, lui se dcouvraient par hasard ou
destination, - depuis la dpression que lui dcrivait en mtaphores
somnambuliques, au gr d'une de ces conjonctions de la rue favori-
se par l'entraide perptue des temps difficiles, telle jeune femme
de la classe aise qui allait fter sa libration du service agricole, o
comme clibataire, elle venait d'tre mobilise pendant quatre ans,
- jusqu' cet puisement intime des forces cratrices que, par leurs
aveux ou par leurs personnes, mdecins ou hommes de science,
peintres ou potes, rudits, voire sinologues, qui furent ses interlo-
cuteurs, trahissaient par un effet aussi gnral que l'avait t leur
astreinte tous, et jusqu' l'extrme de leur nergie, aux services
crbraux de la guerre moderne : organisation de la production,
appareils de la dtection ou du camouflage scientifiques, propagande
politique ou renseignements.
Quelque forme que depuis ait pu prendre cette dpression rac-
tionneUe l'chelle collective, je tmoigne qu'il s'en dgageait alors
un facteur tonique qu'aussi bien je tairais comme trop subjectif, s'il
n'avait trouv pour moi son sens dans ce qui me fut rvl du secteur
de l'effort anglais que j'tais qualifi pour juger.
Il faut centrer le champ de ce qu'ont ralis les psychiatres en
Angleterre pour la guerre et par elle, de l'usage qu'ils ont fait de leur
science au singulier et de leurs techniques au pluriel, et de ce que
l'une comme les autres ont reu de cette exprience. Tel est, en effet,
le sens du titre que porte le livre du brigadier gnral Rees auquel
nous nous rfrerons sans cesse : The Shaping ofPsychiatry by the War.
Il est clair qu' partir du principe de la mobilisation totale des
102
LA PSYCHIATRIE ANGLAISE ET LA GUERRE
forces de la nation qu'exige la guerre moderne, le problme des
effectifs dpend de l'chelle de la population, ce pour quoi, dans
un groupe rduit comme celui de l'Angleterre mtropolitaine, tous,
hommes et femmes, durent tre mobiliss. Mais il se double d'un
problme de l'efficience, qui requiert autant un rigoureux emploi
de chaque individu que la meilleure circulation des conceptions les
plus audacieuses des responsables jusqu'aux derniers des excutants.
Problme o une rationalisation psychologique aura toujours plus
dire son mot, mais auquel les qualifications du temps de paix, la
haute ducation politique des Anglais et une propagande dj experte
pouvaient suffire.
Tout autre tait la question qui se posait de constituer de toutes
pices une arme l'chelle nationale, du type des armes conti-
nentales, dans un pays qui n'avait qu'une petite arme de mtier,
pour s'tre oppos obstinment la conscription jusqu' la veille du
conflit. Il faut considrer dans tout son relief ce fait qu'on recourut
une science psychologique toute jeune encore, pour oprer ce qu'on
peut appeler la cration synthtique d'une arme, alors qu' peine
venait cette science de mettre au jour de la pense rationnelle la
notion d'un tel corps, comme groupe social d'une structure originale.
C'est bien en effet dans les crits de Freud que pour la premire
fois dans les termes scientifiques de la relation d'identification,
venaient d'tre poss le problme du commandement et le pro-
blme du moral, c'est--dire toute cette incantation destine rsor-
ber entirement les angoisses et les peurs de chacun dans une solida-
rit du groupe la vie et la mort, dont les praticiens de l'art
militaire avaient jusqu'alors le monopole. Conqute de la raison qui
vient intgrer la tradition elle-mme en l'allgeant et la portant
une puissance seconde.
On a pu voir lors des deux foudroyantes victoires du dbarque-
ment en France et du passage du Rhin, qu' niveau gal dans
la technique du matriel, et la tradition militaire tant toute du ct
de l'arme qui l'avait porte au degr le plus haut qu'ait connu le
monde et venait encore de la renforcer de l'appoint moral d'une
dmocratisation des rapports hirarchiques, dont la valeur angois-
sante comme facteur de supriorit avait t signale par nous lors
de notre retour de l'Olympiade de Berlin en 1936, toute la puis-
sance de cette tradition ne pesa pas une once contre les conceptions
103
LA PSYCHIATRIE ANGLAISE ET LA GUERRE
tactiques et stratgiques suprieures, produits des calculs d'ingnieurs
et de marchands.
Ainsi a achev sans doute de se dissiper la mystification de cette
formation de caste et d'cole, o l'officier conservait l'ombre du
caractre sacr qui revtait le guerrier antique. On sait au reste par
l'exemple de l'autre des vainqueurs qu'il n'est pas de corps constitu
o il soit plus salutaire au peuple qu'on porte la hache, et que c'est
l'chelle d'un ftichisme qui donne ses plus hauts fruits dans
l'Afrique centrale, qu'il faut estimer l'usage encore florissant de s'en
servir comme de magasin d'idoles nationales.
Quoi qu'il en soit, il est reconnu que la position traditionnelle du
commandement ne va pas dans le sens de l'initiative intelligente.
C'est pourquoi en Angleterre, quand au dbut de 1939 les vne-
ments se prcipitaient, on vit repousser par les autorits suprieures
un projet prsent par le Service de sant de l'Arme, aux fins d'or-
ganiser l'instruction non seulement physique, mais mentale des
recrues. Le principe en avait pourtant t appliqu ds la guerre
prcdente aux tats-Unis sous l'impulsion du docteur Thomas
W. Salmon.
Quand la guerre clata en septembre, l'Angleterre ne disposait
donc que d'une douzaine de spcialistes sous les ordres de Rees
Londres ; deux consultants taient attachs au corps expditionnaire
en France et deux aux Indes. En 1940, les cas afflurent dans les
hpitaux sous la rubrique d'inadaptation, de dlinquances diverses,
de ractions psychonvrotiques, et c'est sous la pression de cette
urgence que fut organise, au moyen des quelque deux cent cin-
quante psychiatres intgrs par la conscription, l'action dont nous
allons montrer l'ampleur et la souplesse. Un esprit animateur les avait
prcds : le colonel Hargreaves, en mettant au point un premier essai
de tests liminatoires adapts des tests de Spearman, dont on tait
parti dj au Canada pour donner forme aux tests de Penrose-
Raven.
Le systme qu'on adoptera ds lors est celui dit Pulhems, dj
prouv dans l'arme canadienne, dans lequel une cote de 1 5 est
affecte chacune des sept lettres symboliques qui rpondent res-
pectivement la capacit physique gnrale, aux fonctions des
membres suprieurs (upper limbs), infrieurs (lower limbs), l'audition
(hear), la vue (eyes), la capacit mentale (soit l'intelligence), la
104
LA PSYCHIATRIE ANGLAISE ET LA GUERRE
stabilit affective enfin, o donc deux cotes sur sept sont d'ordre
psychologique.
Une premire slection est faite sur les recrues *, qui en dtache le
dcile infrieur.
Cette slection, soulignons-le, ne vise pas les qualits critiques et
techniques, que requiert la prvalence des fonctions de transmission
dans la guerre moderne, non moins que la subordination du groupe
de combat au service d'armes qui ne sont plus des instruments,
mais des machines. Ce qu'il s'agit d'obtenir dans la troupe, c'est une
certaine homognit qu'on tient pour un facteur essentiel de son
moral.
Tout dficit physique ou intellectuel en effet prend pour le sujet
l'intrieur du groupe une porte affective, en fonction du processus
d'identification horizontale que le travail de Freud, voqu plus
haut, suggre peut-tre, mais nglige au profit de l'identification, si
l'on peut dire, verticale, au chef.
Tranards l'instruction, ravags par le sentiment de leur infrio-
rit, inadapts et facilement dlinquants, moins encore par manque
de comprhension qu'en raison d'impulsions d'ordre compensa-
toire, terrains ds lors lus des raptus dpressifs ou anxieux ou des
tats confusionnels sous le coup des motions ou commotions de la
ligne de feu, conducteurs naturels de toutes les formes de contagion
mentale, les sujets affects d'un trop grand dficit doivent tre isols
comme dullards, ce dont notre ami le docteur Turquet ici prsent,
donne l'quivalent franais non pas dans le terme d'arrir, mais
dans celui de lourdaud. C'est autrement dit ce que notre langage
familier appelle du mot de dbilard, qui exprime moins un niveau
mental qu'une valuation de la personnalit.
Aussi bien, d'tre groups entre eux, ces sujets se montrent-ils
aussitt infiniment plus efficaces, par une libration de leur bonne
volont, corrlative d'une sociabilit ds lors assortie ; il n'est pas
jusqu'aux motifs sexuels de leurs dlits qui ne se rduisent, comme
pour dmontrer qu'ils dpendent moins chez eux d'une prtendue
i. Remarquons au passage qu'en Angleterre, de mme que le policeman pr-
cde, en tant que reprsentant de l'autorit civile, tout dfil de troupes sur la voie
publique, c'est le ministre du Travail qui tient le rle de notre conseil de rvision et
dcide de ceux des citoyens qui seront recrues pour l'arme.
105
LA PSYCHIATRIE ANGLAISE ET LA GUERRE
prvalence des instincts, qu'ils ne reprsentent la compensation de
leur solitude sociale. Tel est du moins ce qui s'est manifest dans
l'utilisation, en Angleterre, de ce rsidu que l'Amrique pouvait
s'offrir le luxe d'liminer. Aprs les avoir employs aux travaux agri-
coles, on dut plus tard en faire des pionniers, mais qu'on maintint
l'arrire du front.
Pour les units ainsi pures de leurs lments infrieurs, elles
virent baisser les phnomnes de choc et de nvrose, les effets de
flchissement collectif, dans une proportion qu'on peut dire gom-
trique.
Cette exprience fondamentale, le gnral major Rees en voit
l'application un problme social de notre civilisation, immdiate-
ment accessible la pratique, sans qu'elle accorde rien aux scabreuses
thories de l'eugnisme, et tout l'oppos, on le voit, du mythe
anticipatoire du Brave New World, de Huxley
l
.
Ici trouvent leur lieu de coopration plusieurs disciplines dont,
pour si thoriques que les tiennent certains d'entre nous, il faudra
bien que tous s'en informent. Car c'est cette condition que nous
pouvons et devons justifier la prminence qui nous revient dans
l'usage l'chelle collective des sciences psychologiques. Si les psy-
chiatres anglais en effet l'ont fait reconnatre, avec un succs sur
lequel j'aurai revenir, au cours de l'exprience de la guerre, ceci
est d, nous le verrons, non seulement au grand nombre des psy-
chanalystes parmi eux, mais ce que tous ont t pntrs par la
diffusion des concepts et des modes opratoires de la psychanalyse.
C'est, en outre, que des disciplines peine apparues notre horizon,
telles que la psychologie dite de groupe, sont parvenues dans le monde
anglo-saxon une laboration suffisante pour, dans l'uvre d'un
i. Ainsi sommes-nous ports sur un terrain o mille recherches de dtail font
apparatre rigoureusement grce un usage de la statistique qui n'a, il faut le dire,
rien faire avec ce que le mdecin dsigne de ce nom dans ses communications
scientifiques , toutes sortes de corrlations psychogntiques qui sont dj intres-
santes au niveau des plus simples, comme la courbe de corrlation croissante et
continue de la gale et des poux avec la dcroissance du niveau mental, mais qui
prennent une porte doctrinale quand elles permettent de rapporter prcisment
une inadquation du sujet sa fonction, un mauvais placement social, une affec-
tion gastro-intestinale, que le langage l-bas dsigne peu prs comme dyspepsie
du rengag .
106
LA PSYCHIATRIE ANGLAISE ET LA GUERRE
Kurt Lewin, ne s'exprimer en rien de moins qu'au niveau math-
matique de l'analyse vectorielle.
Ainsi dans un long entretien que j'eus avec deux des mdecins
que je vais vous prsenter comme des pionniers de cette rvolution
qui transporte tous nos problmes l'chelle collective, j'entendis
l'un d'eux m'exposer froidement que, pour la psychologie de groupe,
le complexe d'dipe tait l'quivalent de ce qu'on appelle en phy-
sique le problme des trois corps, problme dont on sait d'ailleurs
qu'il n'a pas reu de solution complte.
Mais il est de bon ton chez nous de sourire de ces sortes de sp-
culations, sans qu'on en soit pour autant plus prudent dans le dog-
matisme.
Aussi je vais essayer de vous prsenter au naturel ces deux hommes
dont on peut dire que brille en eux la flamme de la cration, chez
l'un comme glace dans un masque immobile et lunaire, qu'accen-
tuent les fines virgules d'une moustache noire, et qui non moins
que la haute stature et le thorax de nageur qui le supportent, donne
un dmenti aux formules kretschmriennes, quand tout nous avertit
d'tre en prsence d'un de ces tres solitaires jusque dans leurs
plus hauts dvouements, et tel que nous le confirme chez celui-ci
l'exploit dans les Flandres d'avoir suivi la badine la main son tank
l'assaut et paradoxalement forc ainsi les mailles du destin, - chez
l'autre, scintillante, cette flamme, derrire le lorgnon au rythme d'un
verbe brlant d'adhrer encore l'action, l'homme, dans un sourire
qui retrousse une brosse fauve, se recommandant volontiers de com-
plter son exprience d'analyste d'un maniement des hommes,
prouv au feu d'octobre 17 Petrograd. Celui-l Bion, celui-ci
Rickmann, ont publi ensemble dans le numro du 27 novembre 43
de The Lancet qui quivaut pour sa destination comme pour son
format notre presse mdicale, un article qui se rduit six
colonnes de journal, mais qui fera date dans l'histoire de la psychia-
trie.
Sous le titre significatif d' Intra-Group Tensions in Therapy.
Their Study as the Task of the Group , c'est--dire : Les tensions
intrieures au groupe dans la thrapeutique. Leur tude propose
comme tche du groupe , les auteurs nous apportent de leur activit
dans un hpital militaire un exemple concret, qui, pour en clairer
avec un dpouillement et, dirai-je, une humilit parfaite, l'occasion
107
LA PSYCHIATRIE ANGLAISE ET LA GUERRE
en mme temps que les principes, prend la valeur d'une dmonstra-
tion de mthode. J'y retrouve l'impression du miracle des premires
dmarches freudiennes : trouver dans l'impasse mme d'une situa-
tion la force vive de l'intervention.Voici Bion en proie aux quelque
400 oiseaux d'un service dit de rducation.
Les importunits anarchiques de leurs besoins occasionnels:
requtes d'autorisations exceptionnelles, irrgularits chroniques de
leur situation, vont lui apparatre ds l'abord comme destines
paralyser son travail en lui soustrayant des heures, dj arithmti-
quement insuffisantes pour rsoudre le problme de fond que pose
chacun de ces cas, si on les prend un par un. C'est de cette difficult
mme que Bion va partir pour franchir le Rubicon d'une innova-
tion mthodique.
Ces hommes, en effet, comment les considrer dans leur situation
prsente ? Sinon comme des soldats qui ne peuvent se soumettre la
discipline, et qui resteront ferms aux bienfaits thrapeutiques qui
en dpendent, pour la raison que c'est l le facteur mme qui les a
runis ici. ?
Or, sur un thtre de guerre que faut-il pour faire une troupe mar-
chante de cet agrgat d'irrductibles qu'on appelle une compagnie
de discipline ? Deux lments : la prsence de l'ennemi qui soude
le groupe devant une menace commune, et un chef, qui son
exprience des hommes permet de fixer au plus prs la marge
accorder leurs faiblesses, et qui peut en maintenir le terme par son
autorit, c'est--dire par ceci que chacun sait qu'une responsabilit
une fois prise, il ne se dgonfle pas.
L'auteur est un tel chef chez qui le respect de l'homme est
conscience de soi-mme, et capable de soutenir quiconque o qu'il
l'engage.
Quant au danger commun, n'est-il pas dans ces extravagances
mmes qui font s'vanouir toute raison du sjour ici de ces hommes,
en s'opposant aux conditions premires de leur gurison? Mais il
faut leur en faire prendre conscience.
Et c'est ici qu'intervient l'esprit du psychanalyste, qui va traiter la
somme des obstacles qui s'opposent cette prise de conscience
comme cette rsistance ou cette mconnaissance systmatique, dont il
a appris la manuvre dans la cure des individus nvross. Mais ici
il va la traiter au niveau du groupe.
108
LA PSYCHIATRIE ANGLAISE ET LA GUERRE
Dans la situation prescrite Bion a mme plus de prise sur le
groupe que le psychanalyste n'en a sur l'individu, puisqu'en droit au
moins et comme chef, il fait partie du groupe. Mais c'est justement
ce que le groupe ralise mal. Aussi le mdecin devra-t-il en passer
par la feinte inertie du psychanalyste, et s'appuyer sur la seule prise
de fait qui lui est donne, de tenir le groupe porte de son verbe.
Sur cette donne, il se proposera d'organiser la situation de faon
forcer le groupe prendre conscience de ses difficults d'existence
en tant que groupe, - puis le rendre de plus en plus transparent
lui-mme, au point que chacun de ses membres puisse juger de faon
adquate des progrs de l'ensemble, - l'idal d'une telle organisation
tant pour le mdecin dans sa lisibilit parfaite, et telle qu'il puisse
apprcier tout instant vers quelle porte de sortie s'achemine chaque
cas confi ses soins : retour son unit, renvoi la vie civile ou
persvration dans la nvrose.
Voici donc en bref le rglement qu'il promulgue en un meeting
inaugural de tous les hommes : il va tre form un certain nombre
de groupes qui se dfiniront chacun par un objet d'occupation,
mais ils seront entirement remis l'initiative des hommes, c'est--
dire que chacun non seulement s'y agrgera son gr, mais pourra
en promouvoir un nouveau selon son ide, avec cette seule limita-
tion que l'objet en soit lui-mme nouveau, autrement dit ne fasse
pas double emploi avec celui d'un autre groupe. tant entendu qu'il
reste loisible chacun, tout instant, de retrouver le repos de la
chambre ad hoc, sans qu'il en rsulte d'autre obligation pour lui que
de le dclarer la surveillante-chef.
L'examen de la marche des choses ainsi tablies, fera l'objet d'un
rassemblement gnral qui aura lieu tous les jours midi moins dix
et durera une demi-heure.
L'article nous fait suivre en un progrs captivant la premire oscilla-
tion des hommes l'annonce de ces mesures qui, eu gard aux habi-
tudes rgnantes en un tel lieu, engendrent le vertige (et j'imagine
l'effet qu'elles eussent produit dans le service qui fut le mien au Val-
de-Grce), puis les premires molles formations qui se prsentent
plutt comme une mise l'preuve de la bonne foi du mdecin;
bientt les hommes se prenant au jeu, un atelier de charpenterie,
un cours prparatoire pour agents de liaison, un cours de pratique
cartographique, un atelier d'entretien des voitures se constituent, et
109
LA PSYCHIATRIE ANGLAISE ET LA GUERRE
mme un groupe se consacre la tache de tenir jour un diagramme
clair des activits en cours et de la participation de chacun,- rcipro-
quement le mdecin, prenant les hommes l'uvre comme eux-
mmes Font pris au mot, a vite l'occasion de leur dnoncer dans
leurs propres actes cette inefficacit, dont il leur entend sans cesse
faire grief au fonctionnement de l'arme, - et soudain la cristallisa-
tion s'opre d'une autocritique dans le groupe, marque entre autres
par l'apparition d'une corve bnvole, qui, d'un jour l'autre,
change l'aspect des salles, dsormais balayes et nettes, par les pre-
miers appels l'autorit, la protestation collective contre les tire-au-
flanc, profiteurs de l'effort des autres, et quelle ne fut pas l'indigna-
tion du groupe ls (cet pisode n'est pas dans l'article), le jour o
les ciseaux cuir eurent disparu ! Mais chaque fois qu'on fait appel
son intervention, Bion avec la patience ferme du psychanalyste
renvoie la balle aux intresss : pas de punition, pas de remplacement
des ciseaux. Les tire-au-flanc sont un problme propos leur
rflexion, non moins que la sauvegarde des ciseaux de travail ; faute
de pouvoir les rsoudre, les plus actifs continueront travailler pour
les autres et l'achat de nouveaux ciseaux se fera aux frais de tous.
Les choses tant ainsi, Bion ne manque pas d' estomac , et quand
un malin propose d'instituer un cours de danse, loin de rpondre par
un rappel aux convenances que sans doute le promoteur lui-mme
de l'ide croit provoquer, il sait faire fond sur une motivation plus
secrte, qu'il devine dans le sentiment d'infriorit propre tout
homme cart de l'honneur du combat : et passant outre aux risques
de critique, voire de scandale, il y prend appui pour une stimulation
sociale, en dcidant que les cours seront donns le soir aprs le ser-
vice par les grades des ATS de l'hpital (ces initiales dsignent
en Angleterre les femmes mobilises) et qu'ils seront rservs ceux
qui, ignorants de la danse, ont encore l'apprendre. Effectivement le
cours, qui a lieu en prsence de l'officier faisant fonction de direc-
teur de l'hpital, ralise pour ces hommes une initiation un style
de comportement, qui par son prestige relve en eux le sentiment
de leur dignit.
En quelques semaines, le service dit de rducation tait devenu
le sige d'un nouvel esprit que les officiers reconnaissaient chez les
hommes lors des manifestations collectives, d'ordre musical par
exemple, o ils entraient avec eux dans un rapport plus familier :
110
LA PSYCHIATRIE ANGLAISE ET LA GUERRE
esprit de corps propre au service, qui s'imposait aux nouveaux venus,
mesure du dpart de ceux qu'il avait marqus de son bienfait.
Maintenu par l'action constante du mdecin animateur, le sentiment
des conditions propres l'existence du groupe, en faisait le fonds.
Il y a l le principe d'une cure de groupe, fonde sur l'preuve
et la prise de conscience des facteurs ncessaires un bon esprit de
groupe. Cure qui prend sa valeur originale, auprs des diverses tenta-
tives faites dans le mme registre, mais par des voies diffrentes, dans
les pays anglo-saxons.
Rickmann applique la mme mthode dans la salle d'observation
o il a affaire un nombre plus rduit de malades, mais aussi un
groupement de cas moins homogne. Il doit alors la combiner avec
des entretiens individuels, mais c'est toujours sous le mme angle qu'y
sont abords les problmes des malades. Il fait ce propos cette
remarque, qui plus d'un apparatra fulgurante, que, si l'on peut dire
que le nvros est gocentrique et a horreur de tout effort pour
cooprer, c'est peut-tre parce qu'il est rarement plac dans un milieu
dont tout membre soit sur le mme pied que lui en ce qui concerne
les rapports avec son semblable.
Je ddie la formule ceux de mes auditeurs qui voient la condi-
tion de toute cure rationnelle des troubles mentaux dans la cration
d'une no-socit, o le malade maintienne ou restaure un change
humain, dont la disparition elle seule double la tare de la maladie.
Je me suis attard reproduire les dtails si vivants de cette exp-
rience, parce qu'ils me paraissent gros de cette sorte de naissance,
qu'est un regard nouveau qui s'ouvre sur le monde. Que si certains
y objectent le caractre spcifiquement anglais de certains traits,
je leur rpondrai que c'est la un des problmes qu'il faut soumettre
au nouveau point de vue : comment se dtermine la part mobili-
sable des effets psychiques du groupe? et son taux spcifique varie-
t-il selon l'aire de culture ? Une fois que l'esprit a conu un nouveau
registre de dtermination, il ne peut s'y soustraire si facilement.
Par contre un tel registre donne un sens plus clair des observa-
tions qui s'exprimaient moins bien dans les systmes de rfrence dj
en usage : telle la formule qui court sans plus de rserve dans les pro-
pos du psychanalyste qui est mon ami Turquet, quand il me parle de
la structure homosexuelle de la profession militaire en Angleterre, et
qu'il me demande si cette formule est applicable l'arme franaise.
111
LA PSYCHIATRIE ANGLAISE ET LA GUERRE
Quoi d'tonnant certes pour nous de constater que tout orga-
nisme social spcialis trouve un lment favorable dans une dfor-
mation spcifique du type individuel, quand toute notre exprience
de l'homme nous indique que ce sont les insuffisances mmes de
sa physiologie qui soutiennent la plus grande fcondit de son psy-
chisme.
Me rfrant donc aux indications que j'ai pu retirer d'une exp-
rience parcellaire, je lui rponds que la valeur virile, qu'exprime
le type le plus pouss de la formation traditionnelle de l'officier
chez nous, m'est apparue plusieurs reprises comme une compensa-
tion de ce que nos anctres auraient appel une certaine faiblesse au
dduit.
Assurment moins dcisive est cette exprience que celle que
j'eus en 40 d'un phnomne molculaire l'chelle de la nation :
je veux dire l'effet macrant pour l'homme d'une prdominance
psychique des satisfactions familiales, et cet inoubliable dfil, dans le
service spcial o j'tais attach, de sujets mal rveills de la chaleur
des jupes de la mre et de l'pouse, qui, par la grce des vasions qui
les menaient plus ou moins assidment leurs priodes d'instruc-
tion militaire, sans qu'ils y fussent l'objet d'aucune slection psycho-
logique, s'taient trouvs promus aux grades qui sont les nerfs de
combat : du chef de section au capitaine. Le mien ne me permettait
pas d'accder autrement que par ou-dire aux chantillons que nous
avions de l'inaptitude la guerre des cadres suprieurs. J'indiquerai
seulement que je retrouvais l l'chelle collective l'effet de dgra-
dation du type viril que j'avais rapport la dcadence sociale de
Y imago paternelle dans une publication sur la famille en 1938.
Ceci n'est pas une digression, car ce problme du recrutement des
officiers est celui o l'initiative psychiatrique a montr son rsultat
le plus brillant en Angleterre. Au dbut de la guerre, le recrutement
empirique par le rang s'avra absurde, en ceci d'abord qu'on s'aper-
ut trs vite qu'on est loin de pouvoir tirer de tout excellent sous-
officier un officier, fut-il mdiocre, et que lorsqu'un excellent sous-
officier a manifest son chec comme aspirant-officier, il retourne
son corps l'tat de mauvais sous-officier. En outre, un tel recrute-
ment ne pouvait rpondre l'normit de la demande d'une arme
nationale, toute faire sortir du nant. La question fut rsolue de
faon satisfaisante par un appareil de slection psychologique, dont
112
LA PSYCHIATRIE ANGLAISE ET LA GUERRE
c'est merveille qu'il ait pu s'galer d'emble ce qu'on ne ralisait
auparavant qu'au bout d'annes d'coles.
L'preuve de slection majeure pour les officiers tait la premire
et la plus large ; prliminaire toute instruction spciale, elle se passait
au cours d'un stage de 3 jours dans un centre o les candidats taient
hbergs et, dans les rapports familiers d'une vie commune avec les
membres de leur jury, s'offraient d'autant mieux leur observation.
Ils devaient subir durant ces 3 jours une srie d'examens qui
visaient moins dgager leurs capacits techniques, leur quotient
d'intelligence, ni plus prcisment ce que l'analyse de Spearman nous
a appris isoler dans le fameux facteur comme le pivot de la fonc-
tion intellectuelle, mais bien plutt leur personnalit, soit spcia-
lement cet quilibre des rapports avec autrui qui commande la
disposition des capacits elles-mmes, leur taux utilisable dans le rle
du chef et dans les conditions du combat. Toutes les preuves ont
donc t centres sur la dtection des facteurs de la personnalit.
Et d'abord les preuves crites, qui comportent un questionnaire
des antcdents personnels et familiaux du candidat, - des tests d'as-
sociation verbale, qui s'ordonnent pour l'examinateur en un certain
nombre de sries que dfinit leur ordre motionnel, des tests dits
d' aperception thmatique , dus Murray, qui portent sur la signi-
fication attribue par le sujet des images qui voquent de faon
ambigu un scnario et des thmes de tension affective leve (nous
faisons circuler ces images, trs expressives au reste de traits spci-
fiques de la psychologie amricaine, plus encore que de l'anglaise),
enfin par la rdaction de deux portraits du sujet tels qu'il peut les
concevoir produits respectivement par un ami et par un critique
svre.
Puis une srie d'preuves o le sujet est plac dans des situations
quasi relles, dont les obstacles et les difficults ont vari avec l'esprit
inventif des examinateurs et qui rvlent ses attitudes fondamentales
quand il est aux prises avec les choses et avec les hommes.
Je signalerai pour sa porte thorique l'preuve dite du groupe sans
chefqu'on doit encore aux rflexions doctrinales de Bion. On consti-
tue des quipes de dix sujets environ, dont aucun n'est investi d'une
autorit prtablie: une tache leur est propose qu'ils doivent
rsoudre en collaboration et dont les difficults chelonnes intres-
sent l'imagination constructive, le don d'improvisation, les qualits
113
LA PSYCHIATRIE ANGLAISE ET LA GUERRE
de prvision, le sens du rendement, - par exemple : le groupe doit
franchir une rivire au moyen d'un certain matriel qui exige d'tre
utilis avec le maximum d'ingniosit, sans ngliger de prvoir sa
rcupration aprs usage, etc. Au cours de l'preuve certains sujets se
dgageront par leurs qualits d'initiative et par les dons impratifs
qui leur auront permis de les faire prvaloir. Mais ce que notera
l'observateur, c'est moins ce qui apparat chez chacun de capacits
de meneur, que la mesure dans laquelle il sait subordonner le souci
de se faire valoir l'objectif commun, que poursuit l'quipe et o
elle doit trouver son unit.
La cotation de cette preuve n'est retenue que pour un premier
triage. Un entretien avec le psychiatre, sur le mode libre et confi-
dentiel propre l'analyse, tait propos chacun des candidats dans
les dbuts du fonctionnement de l'appareil; par la suite il fat, pour
des raisons d'conomie de temps, rserv aux seuls sujets qui s'taient
signals aux preuves prcdentes par des ractions douteuses.
Deux points mritent d'tre retenus : d'une part le fair play qui
rpondait chez les candidats au postulat d'authenticit que suppose
de faire intervenir en dernier ressort l'entretien psychanalytique, et
le tmoignage le plus habituellement recueilli, fut-ce de ceux-l qui
s'y taient vus reconnatre inaptes, que l'preuve se soldait pour eux
par le sentiment d'avoir vcu une preuve des plus intressantes ;
d'autre part le rle qui revient ici au psychiatre, sur quoi nous allons
nous arrter un instant.
Bien que ce soient des psychiatres, Wittkaver, Rodger, Sutherland,
Bion, qui aient conu, mis sur pied, perfectionn l'appareil, le psy-
chiatre n'a en principe dans les dcisions du jury qu'une voix par-
ticulire. Le prsident et le vice-prsident sont des officiers chevron-
ns choisis pour leur exprience militaire. Il est galit avec le
psychologist que nous appelons ici psycho-technicien, spcialiste
l
bien plus abondamment reprsent dans les pays anglo-saxons que
chez nous en raison de l'emploi bien plus large qu'on en fait dans
les fonctions d'assistance publique, d'enqute sociale, d'orientation
i. Ces social workers, comme on les dsigne encore, qui ont un statut social bien
dfini en Angleterre, y taient pourtant moins nombreux qu'aux tats-Unis.
Leur multiplication, dans les conditions de formation abrge imposes par la
guerre, doit poser maintenant le problme de leur rsorption.
114
LA PSYCHIATRIE ANGLAISE ET LA GUERRE
professionnelle, voire de slection d'initiative prive des fins de
rendement industriel. Il n'est pas enfin jusqu'aux sergents, auxquels
taient confies la surveillance et la collation des preuves, qui ne
participassent une partie au moins des dlibrations.
On voit donc qu'on s'en remet pour conclure un jugement sur
le sujet dont l'objectivit cherche sa garantie dans des motivations
largement humaines, bien plus que dans des oprations mcaniques.
Or l'autorit que la voix du psychiatre prend dans un tel concert
lui dmontre quelle charge sociale lui impose sa fonction. Cette
seule dcouverte par les intresss qui en tmoignent tous de faon
univoque, et parfois leur propre tonnement, contraint ceux-l
mmes qui ne veulent concevoir cette fonction que sous l'angle
born que dfinit jusqu' prsent le mot d'aliniste, reconnatre
qu'ils sont en fait vous une dfense de l'homme qui les promeut,
quoi qu'ils en aient, une minente fonction dans la socit. A un
tel largissement de leurs devoirs qui rpond selon nous une dfi-
nition authentique de la psychiatrie comme science, comme sa
vraie position comme art humain, l'opposition chez les psychiatres
eux-mmes n'est pas moindre, croyez-le, en Angleterre qu'en France.
Seulement en Angleterre elle a d cder chez tous ceux qui ont
particip l'activit de guerre, comme est tombe aussi cette oppo-
sition traiter d'gal gal avec les psychologues non mdecins,
dont on peut voir l'analyse qu'elle ressortit un noli me tangere
qu'on retrouve bien plus que frquemment la base de la vocation
mdicale, non moins que dans celle de l'homme d'glise et de
l'homme de loi. Ce sont l en effet les trois professions qui assurent
un homme de se trouver, l'endroit de son interlocuteur, dans une
position o la supriorit lui est garantie l'avance. Par bonheur
la formation que nous apporte notre pratique peut nous porter
tre moins ombrageux, du moins ceux d'entre nous qui sont assez
peu obrs personnellement pour pouvoir en tirer profit pour leur
propre catharsis. Ceux-l accderont cette sensibilit des profon-
deurs humaines qui n'est certes pas notre privilge, mais qui doit
tre notre qualification.
Ainsi le psychiatre n'aura pas seulement une place honorable et
dominante dans des fonctions consultatives, telles que celles que
nous venons d'voquer, mais lui s'offriront les voies nouvelles
qu'ouvrent des expriences comme celles de Varea psychiatrist. Cette
115
LA PSYCHIATRIE ANGLAISE ET LA GUERRE
fonction, inaugure elle aussi dans l'arme anglaise, peut se traduire
comme celle du psychiatre attach la rgion militaire. Libr de
toute astreinte de service et rattach aux seules autorits suprieures,
il a pour fonction d'enquter, de prvoir et d'intervenir pour tout ce
qui, dans les rglements et les conditions de vie, intresse la sant
mentale des mobiliss dans un district dtermin. C'est ainsi que les
facteurs de certaines pidmies psychiques, nvroses de masse, dlin-
quances diverses, dsertions, suicides, ont pu tre dfinis et entravs,
et que tout un ordre de prophylaxie sociale apparat possible pour
l'avenir.
Une telle fonction aura sans doute sa place dans l'application
du plan Beveridge qui prconise, signalons-le, une proportion de
l'espace qualifi pour le traitement des cas de nvrose gale 5% de
l'hospitalisation gnrale, chiffre qui dpasse tout ce qui a t prvu
jusqu'ici pour la prophylaxie mentale. Rees, dans le livre auquel
nous nous rfrons sans cesse, voit la fonction de Yarea psychiatrist en
temps de paix couvrir une rgion de 50 75 000 habitants. Serait de
son ressort tout ce qui, dans les conditions de subsistance et les rap-
ports sociaux d'une telle population, peut tre reconnu pour influer
sur son hygine mentale. Peut-on, en effet, ergoter encore sur la psy-
chogense des troubles mentaux, quand la statistique une fois de plus
a manifest l'tonnant phnomne de la rduction avec la guerre des
cas de maladies mentales, tant dans le civil qu' l'arme ? Phno-
mne qui n'a pas t moins net en Angleterre o il s'est manifest
envers et l'encontre des effets prsums des bombardements sur la
population civile. On sait que les corrlations statistiques du phno-
mne ne permettent pas, mme l'examen le moins prvenu, de le
rapporter aucune cause contingente telle que restriction d'alcool,
rgime alimentaire, effet mme psychologique de l'occupation
trangre, etc.
Le livre de Rees ouvre par ailleurs une curieuse perspective sur le
pronostic sensiblement meilleur des psychoses quand eues sont trai-
tes dans les conditions sensiblement moins isolantes que constitue
le milieu militaire
l
.
i. Signalons en passant les statistiques o deux praticiens anglais non psychiatres
ont manifest la corrlation entre les ulcres peptiques et duodnaux et les aires de
bombardement arien.
116
LA PSYCHIATRIE ANGLAISE ET LA GUERRE
Pour revenir la contribution de la psychiatrie la guerre, je ne
m'tendrai pas sur les slections spciales dont taient l'objet les
troupes de choc (commandos), les units blindes, la RAF, la Royal
Navy. Celles qui avaient t organises dans une poque antrieure
sur la base des mesures d'acuit sensorielle et d'habilet technique,
durent se complter aussi des qualifications de la personnalit qui
sont la part du psychiatre. Car lorsqu'il s'agit par exemple de confier
un pilote un appareil de l'ordre du million de livres, les ractions
typiques comme celle de la fuite en avant prennent toute leur
porte quant aux risques, et les exclusives doctrinales portes par les
Allemands ne les ont pas empchs de recourir, pour y parer, aux
investigations psychanalytiques qui avaient fait leurs preuves.
De mme, le psychiatre s'est trouv partout prsent sur la ligne
de feu, en Birmanie, en Italie, auprs des commandos, comme sur les
bases ariennes et navales, et partout sa critique s'est exerce sur
les nuds significatifs que rvlaient les symptmes et les comporte-
ments.
Les pisodes de dpression collective apparaissaient trs clective-
ment dans les commandos qui avaient fait l'objet d'une slection
insuffisante, et je ne ferai qu'voquer ce jeune psychiatre qui, pour
rejoindre les units parachutes qu'il devait suivre sur le front
d'Italie, emportait dans son bagage rduit d'aviateur le livre de
Melanie Klein, qui l'avait initi la notion des mauvais objets ,
introjects la priode des intrts excrmentiels, et celle, plus
prcoce encore, du sadisme oral : vue qui s'avra trs fconde pour la
comprhension de sujets, dj situs psychologiquement par leur
recrutement volontaire.
Les vues psychanalytiques ne furent pas moins l'honneur, la
guerre passe, pour l'uvre du reclassement dans la vie civile des
prisonniers de guerre et des combattants d'outre-mer.
On destina cette uvre un certain nombre de centres spciaux,
dont l'un install dans la demeure seigneuriale de Hartfield, rsi-
dence encore du marquis de Salisbury, et reste pure en son archi-
tecture originale de n'tre pas sortie depuis sa construction au
XVI
e
sicle de la famille des Cecil, fut par moi visit par une de ces
radieuses journes qu'offre souvent, et cette anne-l avec une gn-
rosit particulire, l'octobre londonien. On m'y laissa m'y promener
mon aise assez longtemps pour que je fusse convaincu de l'entire
117
LA PSYCHIATRIE ANGLAISE ET LA GUERRE
libert dont jouissaient les hbergs, libert qui s'avrait compatible
avec le maintien de tableaux anciens dans une salle grande comme
la galerie des Glaces, qui servait de dortoir, non moins qu'avec le
respect de l'ordre dans le rfectoire o, moi-mme invit, je pus
constater qu'hommes et officiers se groupaient selon leur choix
l'ombre d'une impressionnante garde d'armures.
Je pus m'entretenir avec le major Doyle par lequel je me fis
reconnatre d'abord et avec son team mdical; je rapporterai de lui
ces deux seuls propos que le problme essentiel ici tait celui de la
rduction des fantasmes qui ont pris un rle prvalent dans le psy-
chisme des sujets pendant les annes d'loignement ou de rclusion,
- que la mthode de traitement animant le centre, s'inspirait toute
des principes du psychodrame de Moreno, c'est--dire d'une thra-
peutique instaure en Amrique et qu'il faut ranger aussi dans les
psychothrapies de groupe, de filiation psychanalytique. Indiquons seu-
lement que la catharsis y est obtenue chez les sujets, mme et parti-
culirement chez les psychotiques, en leur permettant d'abragir
dans un rle qu'on leur fait assumer dans un scnario partiellement
livr leur improvisation.
De mme ici meetings de discussion, libres ou dirigs, ateliers
d'essai de toutes sortes, libert absolue dans l'emploi de leur temps
(ma premire dcouverte des lieux m'avait fait admirer que certains
se complussent flner entre les chemines et les artes aigus d'une
toiture digne de l'imagination de Gustave Dor), visites d'usines ou
causeries sur les problmes sociaux et techniques du temps prsent,
- seront la voie qui permettra a tant de sujets de revenir d'vasions
imaginaires vers le mtier de tenancier de pub ou vers quelque
profession errante et de reprendre le chemin de l'emploi antrieur.
Les conseils qualifis d'assistantes sociales et de conseillers juridiques
ne leur manqueront pas pour rgler les difficults professionnelles et
familiales. Pour juger de l'importance de l'uvre, qu'il suffise de dire
que 80% des hommes des catgories sus-vises choisissent librement
de passer par cet clusage, o leur sjour, abrg ou prolong sur leur
demande, est en moyenne de six semaines.
A la fin de ma visite, le retour du directeur, le colonel Wilson, me
donna la satisfaction d'entendre des propos qui me firent sentir que
sur le plan social la guerre ne laisse pas l'Angleterre dans cet tat,
dont parle l'vangile, du Royaume divis.
118
LA PSYCHIATRIE ANGLAISE ET LA GUERRE
Ainsi la psychiatrie a servi forger l'instrument par quoi l'Angle-
terre a gagn la guerre. Inversement, la guerre a transform la psy-
chiatrie en Angleterre. En ceci comme en d'autres domaines, la
guerre s'est avre accoucheuse de progrs, dans la dialectique essen-
tiellement conflictuelle qui parat bien caractriser notre civilisation.
Mon expos s'arrte au point o se dcouvrent les horizons qui nous
projettent dans la vie publique, voire, horreur! dans la politique.
Sans doute y trouverons-nous des objets d'intrt qui nous ddom-
mageront de ces passionnants travaux du type dosage des produits
de dsintgration urique dans la paraphrnie fabulante , produits
eux-mmes intarissables de ce snobisme d'une science postiche, o
se compensait le sentiment d'infriorit qui dominait devant les
prjugs de la mdecine une psychiatrie d'ores et dj rvolue.
Ds lors qu'on entre dans la voie des grandes slections sociales,
et que, devanant les pouvoirs publics, de puissantes organisations
prives comme la Hawthorne Western Electric aux Etats-Unis les
ont dj mises en uvre leur profit, comment ne voit-on pas que
l'tat devra y pourvoir au bnfice de tous et que dj sur le plan
d'une juste rpartition des sujets suprieurs autant que des dullards,
on peut valuer l'ordre de 200000 travailleurs les units sur les-
quelles devront porter les slections?
Comment ne voit-on pas que notre association au fonctionnaire,
l'administrateur et au psychotechnicien, est dj inscrite dans des
organisations comme celles dites de child guidance aux Etats-Unis et
en Angleterre?
Qu'on ne confonde pas notre assentiment ceci avec un pseudo-
ralisme toujours en qute d'une dgradation qualitative.
A aucun moment des ralisations que nous proposons en exemple,
nous n'avons pu oublier la haute tradition morale dont elles sont res-
tes ici empreintes. A toutes a prsid un esprit de sympathie pour les
personnes, qui n'est pas plus absent de cette sgrgation des dullards,
o n'apparat nulle dchance du respect d tous les hommes.
Qu'il nous suffise de rappeler qu' travers les plus treignantes
exigences d'une guerre vitale pour la collectivit, et le dveloppe-
ment mme d'un appareil d'intervention psychologique qui d'ores
et dj est une tentation pour la puissance, le principe a t maintenu
en Grande-Bretagne du respect de l'objection de conscience.
A vrai dire les risques que comporte un tel respect pour les int-
119
LA PSYCHIATRIE ANGLAISE ET LA GUERRE
rets collectifs, sont apparus l'exprience se rduire des propor-
tions infimes, et cette guerre a, je pense, suffisamment dmontr que
ce n'est pas d'une trop grande indocilit des individus que viendront
les dangers de l'avenir humain. Il est clair dsormais que les puis-
sances sombres du surmoi se coalisent avec les abandons les plus
veules de la conscience pour mener les hommes une mort accep-
te pour les causes les moins humaines, et que tout ce qui apparat
comme sacrifice n'est pas pour autant hroque.
Par contre le dveloppement qui va crotre en ce sicle des
moyens d'agir sur le psychisme
!
, un maniement concert des images
et des passions dont on a dj fait usage avec succs contre notre
jugement, notre rsolution, notre unit morale, seront l'occasion de
nouveaux abus du pouvoir.
Il nous semblerait digne de la psychiatrie franaise qu' travers les
taches mmes que lui propose un pays dmoralis, elle sache formuler
ses devoirs dans des termes qui sauvegardent les principes de la vrit.
DISCUSSION
[Au terme de la discussion de cette confrence, faite L'volution
psychiatrique, l'auteur conclut la runion par ces mots :]
Je remercie ceux qui ont bien voulu donner leur assentiment
comme ceux qui ont t mes contradicteurs, de leurs remarques et
objections. Je tiens affirmer nouveau la conception unitaire, qui
est la mienne en anthropologie. Aux objections de principe, qui ont
t souleves contre le rle qui a t celui de la psychiatrie pendant
la guerre, je rponds par un E pur si muove, dclinant qu'on ne
donne mon expos d'autres sens, ni d'autre mrite.
i. Il est un dossier du Psychologkal Warfare qui, pensons-nous, ne sera pas publi de
sitt.
Prmisses tout dveloppement possible
de la criminologie
RSUM DES RPONSES APPORTES LORS DE LA DISCUSSION
DU RAPPORT INTRODUCTION THORIQUE AUX FONCTIONS
DE LA PSYCHANALYSE EN CRIMINOLOGIE* (XIII
e
CONFRENCE
DES PSYCHANALYSTES DE LANGUE FRANAISE, 29 MAI 1950)
Dans une srie de rponses chacune des personnes qui sont
intervenues et dont il est impossible de restituer les moments qui
n'ont point t enregistrs, tout spcialement dans un long dialogue
avec Hesnard, j'ai trouv l'occasion de raffirmer les prmisses essen-
tielles que je tiens pour imposes par l'exprience analytique tout
dveloppement possible de la criminologie.
L'analyse, en tant qu'elle est, dans les limites de certaines conven-
tions techniques, essentiellement dialogue et progrs vers un sens,
maintiendra toujours prsente au cur de ses consquences objecti-
vables en termes scientifiques, la plnitude dramatique du rapport
de sujet sujet ; si elle part en effet de l'appel de l'homme l'homme,
elle se dveloppe dans une recherche qui va au-del de la ralit de
la conduite : nommment la vrit qui s'y constitue.
Nulle mthode donc ne rendra moins possible d'luder la relation
dialectique qui lie le Crime la Loi, en tant que celle-ci est la fois
normative (impratif catgorique) et contingente (Loi positive).
C'est dire qu'elle ne saurait appuyer aucun abaissement scientiste ou
pragmatiste du niveau des problmes.
Or, c'est l la pente mme de la criminologie, telle qu'elle appa-
rat entendre le discours de M. Hesnard, dans la pleine antinomie
de ses effets : savoir que, si elle va humaniser le traitement du cri-
minel, elle ne le fait qu'au prix d'une dchance de son humanit,
si tant est que l'homme se fasse reconnatre de ses semblables par les
actes dont il assume la responsabilit.
1. Cf. crits, d. du Seuil, 1966, p.125-149.
121
PRMISSES TOUT DVELOPPEMENT DE LA CRIMINOLOGIE
Le lazaret certes est la solution idale du problme que pose le
crime l'idalisme scientiste. Et sans doute est-elle valable pour parer
aux actes qu'une dtermination organique exclut avec certitude du
cercle de l'interaction sociale. Encore cette exclusion est-elle rare-
ment aussi complte qu'on le suppose trop simplement (et mme
dans les tats pileptiques, cas exemplaire en la matire).
La psychanalyse tend le domaine des indications d'une cure
possible du criminel comme tel: en manifestant l'existence de
crimes qui n'ont de sens que compris dans une structure ferme de
la subjectivit, nommment celle qui exclut le nvros de la rali-
sation authentique de l'autre en touffant pour lui les preuves de la
lutte et de la communication sociale, structure qui le laisse en proie
cette racine tronque de la conscience morale que nous appelons le
surmoi, autrement dit l'ambigut profonde du sentiment que
nous isolons dans le terme de culpabilit.
Encore est-il que, si la reconnaissance de la morbidit de ces cas
permet de leur viter heureusement avec la dgradation pniten-
tiaire le stigmate qui s'y attache dans notre socit, il reste que la
gurison ne saurait y tre autre chose qu'une intgration par le sujet
de sa responsabilit vritable, et qu'aussi bien est-ce l ce quoi il
tendait par des voies confuses dans la recherche d'une punition qu'il
peut tre parfois plus humain de lui laisser trouver.
La dnonciation de l'Univers morbide de la faute ne peut avoir
pour corollaire ni pour fin l'idal d'une adaptation du sujet une
ralit sans conflits.
Ceci parce que la ralit humaine n'est pas seulement le fait de
l'organisation sociale, mais un rapport subjectif qui, pour tre ouvert
la dialectique pathtique qui doit soumettre le particulier l'univer-
sel, prend son dpart dans une alination douloureuse de l'individu
dans son semblable, et trouve ses cheminements dans les rtorsions
de l'agressivit.
Aussi comprenons-nous le fait de cette importante fraction des
criminels dont M. Hesnard nous affirme, combien justement, qu'on
ne trouve chez eux absolument rien relever comme anomalie psy-
chique. Et ce n'est pas peu que sa grande exprience et sa rigueur de
clinicien nous tmoignent que c'est l le cas courant devant lequel
le psychiatre sans ide prconue demeure d'abord tonn.
Seul le psychanalyste qui sait quoi s'en tenir sur la structure
122
PRMISSES TOUT DVELOPPEMENT DE LA CRIMINOLOGIE
du moi en tant que tel, comprendra aussi la cohrence des traits
que prsentent ces sujets et qu'on nous dpeint pour leur idalisme
gocentrique, leur apologtique passionnelle, et cette trange satis-
faction de l'acte accompli o leur individualit semble s'enfermer
dans sa suffisance.
Ces criminels que nous avons appels ici les criminels du moi, sont
les victimes sans voix d'une volution croissante des formes direc-
trices de la culture vers des rapports de contrainte de plus en plus
extrieure.
Aussi bien la socit o ces criminels se produisent ne les prend-
elle pas sans mauvaise conscience comme boucs missaires et le rle
de vedette qu'elle leur confre si facilement manifeste bien la fonc-
tion relle qu'ils y assurent. D'o ce mouvement de l'opinion qui
se plat d'autant plus les tenir pour alins qu'elle reconnat chez
eux les intentions de tous.
Seule la psychanalyse, pour ce qu'elle sait comment tourner les
rsistances du moi, est capable dans ces cas de dgager la vrit de
l'acte, en y engageant la responsabilit du criminel par une assomp-
tion logique, qui doit le conduire l'acceptation d'un juste chti-
ment.
Qui oserait pourtant poursuivre sans trembler une telle tache, s'il
n'y est investi par une thologie ?
Seul l'Etat, avec la Loi positive qu'il soutient, peut donner l'acte
criminel sa rtribution. L'acte sera donc soumis un jugement fond
abstraitement sur des critres formels, o se reflte la structure du
pouvoir tabli. Le verdict restera livr, non sans scandale mais non
plus sans raison, au jeu des dbats les moins vridiques : d'o rsulte
non moins logiquement cette reconnaissance du droit de l'accus au
mensonge, que l'on dnomme respect de la conscience individuelle.
Cet enchanement implacable heurte trop - du moins encore
pour un temps - les valeurs de vrit maintenues dans la conscience
publique par les disciplines scientifiques, pour que les meilleurs
esprits ne soient point tents sous le nom de criminologie par le rve
d'un traitement entirement objectif du phnomne criminel.
Ainsi M. Piprot d'Alleaumes nous adjure de concerter, aux fins
de dterminer les conditions de l'tat dangereux, toutes les sciences de
l'homme, mais sans tenir compte des pratiques juridiques en exercice.
A quoi nous lui disons alors : Vous revenez au leurre, pourtant
123
PRMISSES TOUT DVELOPPEMENT DE LA CRIMINOLOGIE
perc jour, des catgories du crime naturel. Mais l'ethnographie
comme l'histoire nous tmoignent que les catgories du crime ne
sont que relatives aux coutumes et aux lois existantes. De mme que
la psychanalyse vous affirme que la dtermination majeure du crime,
c'est la conception mme de la responsabilit que le sujet reoit
de la culture o il vit.
C'est pourquoi Lacan et Cnac crivent : La responsabilit, c'est-
-dire le chtiment... , et lient l'apparition de la criminologie
elle-mme une conception de la peine qu'ils dsignent aprs
Tarde comme conception sanitaire, mais qui, pour tre nouvelle, ne
s'en inscrit pas moins que les prcdentes dans une structure de la
socit. Point de vue o nous avons t honors de l'approbation de
plusieurs,des juristes prsents aujourd'hui.
Mais si une telle conception de la peine a t porte par un
mouvement humanitaire dont il n'est pas question de contester les
fondements, les progrs de l'poque depuis Tarde nous en ont mon-
tr les dangers : savoir la dshumanisation qu'elle implique pour le
condamn.
Nous disons qu'elle aboutit la limite, pour obtenir le redresse-
ment de Can, mettre dans le parc concentrationnaire exactement
le quart de l'humanit. Qu'on veuille bien reconnatre dans cette
image o nous incarnons notre pense, la forme utopique d'une
tendance dont nous ne prtendons pas prvoir les mtamorphoses
futures, puisque sa ralisation supposerait l'tablissement de l'Empire
universel.
C'est pourquoi il est une conciliation ncessaire entre les droits de
l'individu tels qu'ils sont garantis actuellement par l'organisation
juridique (n'oublions pas tout ce qui reste suspendu de libert la
distinction quant au rgime pnal du droit politique et du droit
commun par exemple) et les progrs ouverts par la science notre
manuvre psychologique de l'homme.
Pour une telle conciliation, la psychanalyse apporte une mesure
essentielle.
Certes elle est scientifiquement fconde, car elle a dfini des
structures qui permettent d'isoler certaines conduites pour les sous-
traire la commune mesure, et dans celles-l qui restent en relever,
elle fait comprendre les jeux de mirage et de compensation, elle
rtablit dans sa clart dialectique cet engluement des motivations
124
PRMISSES TOUT DVELOPPEMENT DE LA CRIMINOLOGIE
agressives dans une alination foncire, o venaient chouer les
spculations drisoires des utilitaristes sur la valeur intimidante de la
peine.
Il n'est point jusqu'aux tnbres d'un destin plus inchangeable
que toutes les incidences biographiques, qu'elle n'claire avec la
notion d'automatisme de rptition de la clart nocturne d'un sens
inscrit dans l'ordre du corps.
Les notions conjugues du surmoi, du moi et du a ne ressortis-
sent donc point une vaine casuistique et peuvent guider l'action de
la pense du pdagogue, du politique et du lgislateur.
L'action concrte de la psychanalyse est de bienfait dans un
ordre dur. Les significations qu'elle rvle dans le sujet coupable ne
l'excluent point de la communaut humaine. Elle rend possible une
cure o le sujet n'est point lui-mme alin, et la responsabilit
qu'elle restaure en lui rpond l'espoir, qui palpite en tout tre
honni, de s'intgrer dans un sens vcu.
Mais de ce fait elle affirme aussi qu'aucune science des conduites
ne peut rduire la particularit de chaque devenir humain, et qu'au-
cun schma ne peut suppler dans la ralisation de son tre cette
recherche o tout homme manifeste le sens de la vrit.
La vrit o la psychanalyse peut conduire le criminel, ne peut
tre dtache du fondement de l'exprience qui la constitue, et ce
fondement est le mme qui dfinit le caractre sacr de l'action
mdicale : savoir le respect de la souffrance de l'homme.
La psychanalyse du criminel a des limites qui sont exactement
celles o commence l'action policire, dans le champ de laquelle elle
doit se refuser d'entrer. C'est pourquoi elle ne s'exercera pas sans
peine, mme l o le dlinquant, infantile, par exemple, bnficie
d'une certaine protection de la loi.
Mais c'est prcisment parce que la vrit qu'elle recherche est
la vrit d'un sujet qu'elle ne peut que maintenir la notion de la
responsabilit, sans laquelle l'exprience humaine ne comporte
aucun progrs.
Intervention au I
er
Congrs mondial
de psychiatrie
FAITE LE 26 SEPTEMBRE I95O AU GRAND AMPHITHTRE
DE LA SORBONNE, LORS DE LA SANCE PLNIRE VOLUTION
ET TENDANCES ACTUELLES DE LA PSYCHANALYSE
La notion de rmotion laquelle Fessai thorique de Raymond
de Saussure marque un retour, ne nous parat pas pouvoir suppler
celle de la situation qui la domine, et l'pithte d'hallucine n'y
change rien, sinon de nous rappeler qu'aucune rtrospection du
malade, hors de l'analyse qui la rsout en ses significations, ne vaut
pour nous que sous caution de son contrle. Ds lors les vacances,
ici tenues pour raliser l'accs du sujet au plaisir, nous semblent un
critre un peu trop conformiste, pour relguer au second plan toute
une histoire obsessionnelle.
Aussi bien devons-nous tenir ici le plus grand compte de l'aver-
tissement combien justifi de Thomas de Quincey concernant
l'assassinat, savoir qu'il mne au vol, puis au mensonge et bientt
la procrastination, et dire qu'une faute de logique a conduit notre
ami une etiologie dsute, une anamnese incertaine et, pour tout
dire, au manque d'humour.
Quel intrt peut-il y avoir, en effet, traduire notre exprience
dans les catgories par o M. Piaget avec ses questionnaires spare
la psychologie de l'enfant d'une idale psychologie de l'adulte qui
serait celle du philosophe dans l'exercice de ses fonctions : qu'on se
rapporte aux critres noncs page 144 dans la distinction du sub-
jectif et de l'objectif, la rciprocit des points de vue, etc., pour voir
si je dis vrai.
Pourquoi chercher fonder sur ces fallacieuses objectivations de
structure ce que nous dcouvrons par la mthode la plus contraire :
savoir par une dialectique familire, au niveau des intrts parti-
culiers du sujet, o la seule vertu des significations incluses dans
le langage, mobilise les images mmes qui son insu rigent sa
conduite et s'avrent rgler jusqu' ses fonctions organiques?
127
INTERVENTION AU I
er
CONGRS MONDIAL DE PSYCHIATRIE
Notre procd part de la similitude implique dans l'usage de la
parole, similitude supra-individuelle sans doute comme son support,
mais c'est par l que se sont accomplies les dcouvertes impensables
au sens commun (n'en dplaise M. Alexander), qui n'ont pas seule-
ment boulevers notre connaissance de l'homme, mais, on peut le
dire, inaugur celle de l'enfant.
Car le fait de structure essentiel pour l'tude du psychisme de
l'enfant, n'est-il pas qu'en parlant, et pour cause, la langue dont se
servent les adultes, il use de ses formes syntaxiques avec une justesse
frappante ds les dbuts de son apprentissage ?
Aussi n'est-ce pas seulement de nous que viennent les critiques
que mritent les notions de pense primitive, de pense magique,
voire celles de pense vcue, dont je salue ici la nouveaut. Et un
ethnographe comme M. Claude Lvi-Strauss qui les articule dfini-
tivement dans le chapitre intitul L'Illusion archaque , de son livre
majeur, les illustre volontiers de cette remarque : qu'aux adultes des
socits primitives leurs propres enfants paraissent participer des
formes mentales qui pour eux caractrisent l'homme civilis.
Recourons donc pour comprendre notre exprience aux concepts
qui s'y sont forms : l'identification, par exemple, et si nous devons
chercher appui dans une autre science, que ce soit dans la linguis-
tique, dans la notion de phonme par exemple, promue par M. Roman
Jakobson, puisque le langage dtermine la psychologie plus que la
psychologie ne l'explique.
Et que M. de Saussure nous pardonne notre critique d'un travail
qui reste une trs brillante observation de clinique psychosomatique.
Nous allons voir maintenant chez M. Alexander un expos rigou-
reux de la pense de Freud aboutir une complte inversion de
son sens, sous l'influence d'un facteur que nous tacherons de dfinir.
L'accent qu'il met juste titre sur le terme de prverbal pour
dsigner le champ de l'inconscient dynamique, nous rappelle, - avec
l'importance qu'y ont les phnomnes proprement linguistiques du
lapsus, du calembour, etc., - que Freud exigeait de la dfinition du
refoul, que la situation en ait t quelque moment verbalise.
Mme Melanie Klein, en procdant chez l'enfant ds l'apparition
du langage une vritable incantation du vcu du stade infans, a
soulev des objections qui ne tiennent rien de moins qu' l'ternel
problme de l'essence de l'innomm.
128
INTERVENTION AU I
er
CONGRS MONDIAL DE PSYCHIATRIE
Nous voquons ici son uvre non pas seulement parce que
Mlle Anna Freud, tout oppose qu'elle se soit montre cette sorte
de transgression qui la fonde, est seule en avoir fait ici mention,
mais parce que nous voyons en cet exemple illustre que les fruits de
notre technique ne peuvent tre apprcis sainement qu' la lumire
de la notion de vrit. Si cette notion en effet peut tre limine en
physique d'oprations qu'on peut tenir pour dnues de sens, nous
ne pouvons, sous peine de plonger notre pense dans les tnbres,
cesser de la soutenir dans sa vigueur socratique : c'est--dire oublier
que la vrit est un mouvement du discours, qui peut valablement
clairer la confusion d'un pass qu'elle lve la dignit de l'his-
toire, sans en puiser l'impossible ralit.
C'est, en effet, cette dialectique mme qui opre dans la cure et
qu'on y dcouvre parce qu'elle a jou dans l'homme depuis sa
venue au monde jusqu' pntrer toute sa nature travers les crises
formatrices o le sujet s'est identifi en s'alinant.
Ainsi Y ego, syndic des fonctions les plus mobiles par quoi l'homme
s'adapte la ralit, se rvle-t-il nous comme une puissance d'illu-
sion, voire de mensonge : c'est qu'il est une superstructure engage
dans l'alination sociale. Et si la thorie des instincts nous montre
une sexualit o pas un lment de la relation instinctuelle : tendance,
organe, objet, n'chappe la substitution, la rversion, la conver-
sion, c'est que le besoin biologique dont la porte est supra-indivi-
duelle, tait le champ prdestin aux combinaisons de la symbolique
comme aux prescriptions de la Loi.
Ds lors en s'attachant dans sa technique abrge l'galisation
des tensions de Y ego, M. Alexander peut faire uvre d'ingnieur.
Il mconnat l'esprit mme de la thrapeutique freudienne, qui,
posant le sujet entre la logique qui le porte l'universel et la ralit
o il s'est alin, respecte le mouvement de son dsir. La vrit qui
fera son salut, il n'est pas en votre pouvoir de la lui donner, car elle
n'est nulle part, ni dans sa profondeur, ni dans quelque besace,
ni devant lui, ni devant vous. Elle est, quand il la ralise, et si vous tes
l pour lui rpondre quand elle arrive, vous ne pouvez la forcer en
prenant la parole sa place.
Aussi bien la thorie de la sexualit que M. Alexander introduit
sous le chef de la psychosomatique nous rvle-t-elle le sens de sa
position : la sexualit, nous l'avons entendu, est une forme spcifique
129
INTERVENTION AU I
er
CONGRS MONDIAL DE PSYCHIATRIE
de dcharge pour toutes les tensions psychologiques en excs. Ainsi
la dialectique freudienne qui a rvl la vrit de l'amour dans le
cadeau excrmentiel de l'enfant ou dans ses exhibitions motrices,
se renverse ici en un bilanisme hors nature o la fonction sexuelle se
dfinit biologiquement comme un surplus de l'excrtion, psycho-
logiquement comme un prurit n d'un moi la limite de son effi-
cacit.
La thorie nous intresse en ce qu'elle manifeste que toute
science dite psychologique doit tre affecte des idaux de la socit
o elle se produit, non certes que nous la rapportions ce que la
littrature nous apprend des manifestations du sexe en Amrique,
mais plutt par ce qui s'en dduit la prendre au pied de la lettre,
savoir : que les animaux mcaniques qu'on est en train de monter
un peu partout sur le ressort du feedback, puisque dj ils voient,
s'agitent et peinent pour leurs besoins, ne manqueront pas de mani-
fester d'ici peu une neuve envie de faire l'amour.
Dsignons la carence subjective ici manifeste dans ses corrlatifs
culturels par la lettre petit c, symbole auquel il est loisible de donner
toute traduction qui paratra convenir. Ce facteur chappe aux soins
comme la critique, tant que le sujet s'en satisfait et qu'il assure la
cohrence sociale. Mais si l'effet de discordance symbolique que
nous appelons la maladie mentale, vient le dissoudre, ce ne saurait
tre notre tche que de le restaurer. Il est ds lors dsirable que l'ana-
lyste l'ait, si peu que ce soit, surmont.
C'est pourquoi l'esprit de Freud restera quelque temps encore
notre horizon tous, pourquoi aussi, remerciant Mlle Anna Freud de
nous en avoir rappel une fois de plus l'ampleur de vues, nous nous
rjouirons que M. Levine apprenne que certains en Amrique mme
le tiennent comme nous pour menac.
III
Discours de Rome
PRONONC LE 26 SEPTEMBRE 1953 POUR INTRODUIRE
LE RAPPORT FONCTION ET CHAMP DE LA PAROLE
ET DU LANGAGE EN PSYCHANALYSE
l
Mes amis , c'est ainsi que le Dr Lacan s'adresse
2
une assemble
dont il mettra la rencontre sous le signe de l'amiti. Amiti des confrres
romains, garante pour ceux qu'elle accueille que ce n'est ni en tou-
ristes, ni en envahisseurs, mais en htes qu'ils peuvent prendre l'air de
la ville, et sans s'y sentir trop barbares . Amiti qui soutient l'union en
ce Congrs solennel, de ceux qui viennent de fonder en un nouveau
pacte la conscience de leur mission. Et l'orateur ici souligne que si la
jeunesse qui domine parmi les adhrents du nouveau mouvement
dit les promesses de son avenir, l'effort et les sacrifices que reprsente
la prsence de leur quasi-totalit en ce lieu de ralliement dessinent
dj son succs. Qu' cette amiti participent donc tous ceux qu'aura
ici mens le sentiment des intrts humains emports par l'analyse.
Se fiant la lecture que ses auditeurs ont pu faire du rapport dis-
tribu, certes crit dans le mode parl, mais trop long pour tre
effectivement reproduit dans sa prsente adresse, l'orateur se conten-
tera de prciser la signification de son discours.
Il remarque que si ce qu'il apporte aujourd'hui est le fruit d'une
mditation lentement conquise contre les difficults, voire les errances
d'une exprience parfois guide, plus souvent sans repres, travers les
quelque vingt-cinq annes o le mouvement de l'analyse, au moins
en France, peut tre considr comme sporadique, - c'est de tou-
jours qu'il en avait rserv l'hommage toux ceux qui depuis la
guerre s'taient rassembls en un effort dont le commun patrimoine
lui avait sembl devoir primer les manifestations de chacun. De
1. Cf. crits, d. du Seuil, 1966, p.237-322.
x. Pour des considrations de volume, le discours du Dr Lacan est ici rsum sur
la stnotypie complte qui en a t recueillie Rome. D'o l'usage partiel du style
indirect dans sa rdaction.
133
DISCOURS DE ROME
toujours veut dire, bien entendu : depuis le temps qu'il fut venu
en tenir les concepts et leur formule. Car il n'a fallu rien de moins
que l'empressement des jeunes aprs la guerre recourir aux sources
de l'analyse, et la magnifique pression de leur demande de savoir,
pour que l'y ment ce rle d'enseigner dont il se fut sans eux tou-
jours senti indigne.
Ainsi est-il juste en fin de compte que ceux-l mmes entendent
la rponse qu'il tente d'apporter une question essentielle qui la lui
ont pose.
Car, pour tre lude, le plus souvent par l'un des interlocuteurs
dans l'obscur sentiment d'en pargner la difficult l'autre, une
question n'en reste pas moins prsente essentiellement tout ensei-
gnement analytique et se trahit dans la forme intimide des questions
o se monnaye l'apprentissage technique. Monsieur (sous-entendu,
qui savez ce qu'il en est de ces ralits voiles : le transfert, la rsis-
tance), que faut-il faire, que faut-il dire (entendez : que faites-vous,
que dites-vous ?) en pareil cas ?
Un recours au matre si dsarm qu'il renchrit sur la tradition
mdicale au point de paratre tranger au ton moderne de la science,
cache une incertitude profonde sur l'objet mme qu'il concerne.
De quoi s'agit-il? voudrait dire l'tudiant, s'il ne craignait d'tre
incongru. Que peut-il se passer d'effectif entre deux sujets dont
l'un parle et dont l'autre coute ? Comment une action aussi insai-
sissable en ce qu'on voit et en ce qu'on touche, peut-elle atteindre
aux profondeurs qu'elle prsume ?
Cette question n'est pas si lgre qu'elle ne poursuive l'analyste
jusque sur la pente d'un retour, au demeurant parfois prcoce,
et qu'essayant alors de s'y galer, il n'y aille de sa spculation sur la
fonction de l'irrationnel en psychanalyse, ou de toute autre misre
du mme acabit conceptuel.
En attendant mieux, le dbutant sent son exprience s'tablir
dans une suspension hypothtique o elle parat toujours prte se
rsoudre en un mirage, et se prpare ces lendemains d'objectivation
forcene o il se paiera de ses peines.
C'est que d'ordinaire sa psychanalyse personnelle ne lui rend
pas plus facile qu' quiconque de faire la mtaphysique de sa propre
action, ni moins scabreux de ne pas la faire (ce qui veut dire, bien
entendu, de la faire sans le savoir).
134
DISCOURS DE ROME
Bien au contraire. Il n'est, pour s'en rendre compte, que d'affron-
ter l'analyste l'action de la parole en lui demandant de supposer
ce qu'emporterait sa plnitude, dans une exprience o s'entrevoit,
et probablement se confirme, qu' en bannir tout autre mode d'ac-
complissement, elle doit, au moins, y faire prime.
Partir sur l'action de la parole en ce qu'elle est celle qui fonde
l'homme dans son authenticit, ou la saisir dans la position origi-
nelle absolue de l' Au commencement tait le Verbe... du qua-
trime vangile, auquel l' Au commencement tait l'action de
Faust ne saurait contredire, puisque cette action du Verbe lui est
coextensive et renouvelle chaque jour sa cration, - c'est par l'un et
l'autre chemin aller droit par-del la phnomnologie de Valter ego
dans l'alination imaginaire, au problme de la mdiation d'un Autre
non second quand l'Un n'est pas encore. C'est mesurer aussi aux
difficults d'un tel abord, le besoin d'inconscience qu'engendrera
l'preuve d'une responsabilit porte une instance qu'on peut bien
dire ici tymologique. Expliquer du mme coup que si jamais ce
point les incidences de la parole n'ont t mieux offertes la dcom-
position d'une analyse spectrale, ce n'a gure t que pour mieux
permettre au praticien des alibis plus obstins dans la mauvaise foi
de son bon sens et des refus de sa vocation la hauteur de ce
qu'on peut appeler son minence s'il lui est imparti de s'galer la
possibilit de toute vocation.
Aussi bien alibis et refus prennent-ils apparence de l'aspect
ouvrier de la fonction du praticien. A tenir le langage pour n'tre
que moyen dans l'action de la parole, le bourdonnement assourdis-
sant qui le caractrise le plus communment va servir le rcuser
devant l'instance de vrit que la parole suppose. Mais on n'invoque
cette instance qu' la garder lointaine, et pour donner le change sur
les donnes aveuglantes du problme : savoir que le rle consti-
tuant du matriel dans le langage exclut qu'on le rduise une
scrtion de la pense, et que la probation de masse des tonnes et des
kilomtres o se mesurent les supports anciens et modernes de sa
transmission, suffit ce qu'on s'interroge sur l'ordre des interstices
qu'il constitue dans le rel.
Car l'analyste ne se croit pas par l renvoy la part qu'il prend
l'action de la parole pour autant qu'elle ne consiste pas seulement
pour le sujet se dire, ni mme s'affirmer, mais se faire reconnatre.
135
DISCOURS DE ROME
Sans doute l'opration n'est-elle pas sans exigences, sans quoi elle ne
durerait pas si longtemps. Ou plutt est-ce des exigences qu'elle dve-
loppe une fois engage que le bienfait de l'analyse se dgage.
Le merveilleux attach la fonction de l'interprtation et qui
conduit l'analyste la maintenir dans l'ombre alors que l'accent
devrait tre mis avec force sur la distance qu'elle suppose entre le
rel et le sens qui lui est donn - et proprement la rvrence de
principe et la rprobation de conscience qui enveloppent sa pratique
obstruent la rflexion sur la relation intersubjective fondamentale
qui la sous-tend.
Rien pourtant ne manifeste mieux cette relation que les condi-
tions d'efficacit que cette pratique rvle. Car cette rvlation du
sens exige que le sujet soit dj prt l'entendre, c'est dire qu'il ne
l'attendrait pas s'il ne l'avait dj trouve. Mais si sa comprhension
exige l'cho de votre parole, n'est-ce pas que c'est dans une parole
qui dj de s'adresser vous, tait la vtre, que s'est constitu le mes-
sage qu'il doit en recevoir ? Ainsi l'acte de la parole apparat-il moins
comme la communication que comme le fondement des sujets dans
une annonciation essentielle. Acte de fondation qu'on peut parfai-
tement reconnatre dans l'quivoque qui fait trembler l'analyste
ce point suprme de son action, pour lequel nous avons voqu plus
haut le sens tymologique de la responsabilit : nous y montrerons
volontiers maintenant la boucle proprement gordienne de ce nud
o tant de fois les philosophes se sont essays souder la libert la
ncessit. Car il n'y a bien sr qu'une seule interprtation qui soit
juste, et c'est pourtant du fait qu'elle soit donne que dpend la
venue l'tre de ce nouveau qui n'tait pas et qui devient rel,
dans ce qu'on appelle la vrit.
Terme d'autant plus gnant ce qu'on s'y rfre que l'on est
plus saisi dans sa rfrence, comme il se voit chez le savant qui veut
bien admettre ce procs patent dans l'histoire de la science, que
c'est toujours la thorie dans son ensemble qui est mise en demeure
de rpondre au fait irrductible, mais qui se refuse l'vidence que
ce n'est pas la prminence du fait qui se manifeste ainsi, mais
celle d'un systme symbolique qui dtermine l'irrductibilit du
fait dans un registre constitu, - le fait qui ne s'y traduit d'aucune
faon n'tant pas tenu pour un fait. La science gagne sur le rel en le
rduisant au signal.
136
DISCOURS DE ROME
Mais elle rduit aussi le rel au mutisme. Or le rel quoi l'ana-
lyse s'affronte est un homme qu'il faut laisser parler. C'est la mesure
du sens que le sujet apporte effectivement prononcer le je que
se dcide s'il est ou non celui qui parle : mais la fatalit de la parole,
soit la condition de sa plnitude, veut que le sujet la dcision
duquel se mesure proprement chaque instant l'tre en question
dans son humanit, soit autant que celui qui parle, celui qui coute.
Car au moment de la parole pleine, ils y ont part galement.
Sans doute sommes-nous loin de ce moment, quand l'analys
commence parler. coutons-le : entendons ce je mal assur,
ds qu'il lui faut se tenir la tte des verbes par o il est cens faire
plus que se reconnatre dans une ralit confuse, par o il a faire
reconnatre son dsir en l'assumant dans son identit : j'aime, je
veux. Comment se fait-il qu'il tremble plus en ce pas qu'en aucun
autre, si ce n'est que si lger qu'il en fasse le saut, il ne peut tre
qu'irrversible, et justement en ceci qu' la merci sans doute de
toutes les rvocations, il va dsormais les exiger pour ses reprises.
Sans doute tiendra-t-il ordinairement l'auditeur que ce pas
mme n'ait aucune importance ; il ne tient pas au sujet que son tre
ne soit ds lors entr dans l'engrenage des lois du bla-bla-bla ; mais il
tient encore moins au choix du psychanalyste de s'intresser ou non
l'ordre o le sujet s'est ainsi engag. Car s'il ne s'y intresse pas,
il n'est tout bonnement pas un psychanalyste.
Ceci parce que c'est cet ordre et nul autre qu'appartient
le phnomne de l'inconscient, dcouverte sur quoi Freud a fond
la psychanalyse.
Car o situer de grce les dterminations de l'inconscient si ce
n'est dans ces cadres nominaux o se fondent de toujours chez
l'tre parlant que nous sommes l'alliance et la parent, dans ces lois
de la parole o les lignes fondent leur droit, dans cet univers de dis-
cours o elles mlent leurs traditions ? Et comment apprhender les
conflits analytiques et leur prototype dipien hors des engagements
qui ont fix, bien avant que le sujet fut venu au monde, non pas
seulement sa destine mais son identit elle-mme ?
Le jeu des pulsions, voire le ressort de l'affectivit, ne reste pas
seulement mythique, trouvt-on le localiser en quelque noyau de la
base du cerveau ; il n'apporte l'inconscient qu'une articulation uni-
latrale et parcellaire. Observez ce que nous appelons bizarrement le
137
DISCOURS DE ROME
matriel analytique ; n'en chicanons pas le terme matriel donc,
si l'on veut, mais matriel de langage, et qui, pour constituer du
refoul, Freud nous l'assure en le dfinissant, doit avoir t assum
par le sujet comme parole. Ce n'est pas improprement que l'amnsie
primordiale est dite frapper dans le sujet son histoire. Il s'agit bien en
effet de ce qu'il a vcu en tant qu'historis. L'impression n'y vaut
que signifiante dans le drame. Aussi bien comment concevoir qu'une
charge affective reste attache un pass oubli, si justement
l'inconscient n'tait sujet de plein exercice, et si le deus de la coulisse
affective n'y sortait justement de la machina intgrale d'une dialec-
tique sans coupure ?
Ce qui prime dans la pousse qui prend issue dans le retour
du refoul, c'est un dsir sans doute, - mais en tant qu'il doit se faire
reconnatre, et parce qu'inscrit ds l'origine dans ce registre de la
reconnaissance, c'est au moment du refoulement le sujet, et non pas
cette inscription imprescriptible, qui de ce registre s'est retir.
Aussi bien la restauration mnsique exige par Freud comme la
fin de l'analyse ne saurait-elle tre la continuit des souvenirs purs,
imagins par Bergson dans son intgration mythique de la dure,
- mais la priptie d'une histoire, marque de scansions, o le sens
ne se suspend que pour se prcipiter vers l'issue fconde ou ruineuse
de ce qui fut problme ou ordalie. Rien ne s'y reprsente qui ne
prenne place en quelque phrase, fut-elle interrompue, que ne sou-
tienne une ponctuation, ft-elle fautive; et c'est l ce qui rend
possible la rptition symbolique dans l'acte, et le mode d'insistance
o il apparat dans la compulsion. Pour le phnomne de transfert, il
participe toujours l'laboration propre de l'histoire comme telle,
c'est--dire ce mouvement rtroactif par o le sujet, en assumant
une conjoncture dans son rapport l'avenir, rvalue la vrit de son
pass la mesure de son action nouvelle.
La dcouverte de Freud, c'est que le mouvement de cette dialec-
tique ne dtermine pas seulement le sujet son insu et mme par les
voies de sa mconnaissance, ce que dj Hegel avait formul dans la
ruse de la raison mise au principe de la phnomnologie de l'esprit,
- mais qu'il le constitue en un ordre qui ne peut tre qu'excentrique
par rapport toute ralisation de la conscience de soi ; moyennant
quoi de l'ordre ainsi constitu se reportait toujours plus loin la limite,
toujours plus souverain l'empire dans la ralit de l'tre humain,
138
DISCOURS DE ROME
qu'on n'avait pu l'imaginer d'abord. C'est ainsi qu' la ressemblance
des pierres qui dfaut des hommes eussent acclam celui qui
portait la promesse faite la ligne de David, et contrairement au
dire d'Hsiode qui de la bote ouverte sur les maux dont la volont
de Jupiter afflige jamais les mortels, fait surgir les maladies qui
s'avancent sur eux en silence , nous connaissons dans les nvroses,
et peut-tre au-del des nvroses, des maladies qui parlent.
Les concepts de la psychanalyse se saisissent dans un champ de
langage, et son domaine s'tend aussi loin qu'une fonction d'appa-
reil, qu'un mirage de la conscience, qu'un segment du corps ou de
son image, un phnomne social, une mtamorphose des symboles
eux-mmes peuvent servir de matriel signifiant pour ce qu'a
signifier le sujet inconscient.
Tel est l'ordre essentiel o se situe la psychanalyse, et que nous
appellerons dsormais l'ordre symbolique, A partir de l, on posera
que traiter ce qui est de cet ordre par la voie psychanalytique, exclut
toute objectivation qu'on puisse proprement en faire. Non pas que
la psychanalyse n'ait rendu possible plus d'une objectivation fconde,
mais elle ne peut en mme temps la soutenir comme donne et la
rendre l'action psychanalytique : ceci pour la mme raison qu'on
ne peut la fois, comme disent les Anglais, manger son gteau et
le garder. Considrez comme un objet un phnomne quelconque
du champ psychanalytique et l'instant ce champ s'vanouit avec
la situation qui le fonde, dont vous ne pouvez esprer tre matre
que si vous renoncez toute domination de ce qui peut en tre saisi
comme objet. Symptme de conversion, inhibition, angoisse ne sont
pas l pour vous offrir l'occasion d'entriner leurs nuds, si sdui-
sante que puisse tre leur topologie ; c'est de les dnouer qu'il s'agit,
et ceci veut dire les rendre la fonction de parole qu'ils tiennent
dans un discours dont la signification dtermine leur emploi et leur
sens.
On comprend donc pourquoi il est aussi faux d'attribuer la
prise de conscience le dnouement analytique, que vain de s'tonner
qu'il arrive qu'elle n'en ait pas la vertu. Il ne s'agit pas de passer d'un
tage inconscient, plong dans l'obscur, l'tage conscient, sige
de la clart, par je ne sais quel mystrieux ascenseur. C'est bien l
l'objectivation, par quoi le sujet tente ordinairement d'luder sa res-
ponsabilit, et c'est l aussi o les pourfendeurs habituels de l'intel-
139
DISCOURS DE ROME
lectualisation, manifestent leur intelligence en l'y engageant plus
encore.
Il s'agit en effet non pas de passage la conscience, mais de pas-
sage la parole, n'en dplaise ceux qui s'obstinent lui rester
bouchs, et il faut que la parole soit entendue par quelqu'un l o
elle ne pouvait mme tre lue par personne : message dont le chiffre
est perdu ou le destinataire mort.
La lettre du message est ici l'important. Il faut, pour le saisir,
s'arrter un instant au caractre fondamentalement quivoque de la
parole, en tant que la fonction est de celer autant que de dcouvrir.
Mais mme s'en tenir ce qu'elle fait connatre, la nature du lan-
gage ne permet pas de l'isoler des rsonances qui toujours indiquent
de la lire sur plusieurs portes. C'est cette partition inhrente l'ambi-
gut du langage qui seule explique la multiplicit des accs possibles
au secret de la parole. Il reste qu'il n'y a qu'un texte o se puisse lire
la fois et ce qu'elle dit et ce qu'elle ne dit pas, et que c'est ce
texte que sont lis les symptmes aussi intimement qu'un rbus
la phrase qu'il figure.
Depuis quelque temps la confusion est complte entre la multipli-
cit des accs au dchiffrement de cette phrase, et ce que Freud
appelle la surdtermination des symptmes qui la figurent. Une bonne
part d'une psychologie prtendument analytique a t construite sur
cette confusion : la premire proprit tient pourtant essentiellement
la plurivalence des intentions de la phrase eu gard son contexte ;
l'autre au dualisme du signifiant et du signifi en tant qu'il se rper-
cute virtuellement de faon indfinie dans l'usage du signifiant.
La premire seule ouvre la porte ce que toute relation de com-
prhension ramne indissolublement des causes finales. Mais la
surdtermination dont parle Freud ne vise nullement restaurer
celles-ci dans la lgitimit scientifique. Elle ne noie pas le poisson du
causalisme dans la fluidit d'un paralllisme psycho-physiologique
qu'un certain nombre de ttes molles croient pouvoir conforter
de sa leon. Elle dtache seulement du texte sans fissure de la causa-
lit dans le rel, l'ordre institu par l'usage signifiant d'un certain
nombre de ses lments, en tant qu'il tmoigne de la pntration
du rel par le symbolique, - l'exigence causaliste ne perdant pas
ses droits rgir le rel pour apparatre ne reprsenter qu'une prise
spciale de cette action symbolisante.
140
DISCOURS DE ROME
Que cette remarque tmoigne au passage des bornes irrductibles
que la pense de Freud oppose toute immixtion d'un idalisme
bon march * la mode de Jaspers.
Freud en effet est trop cohrent en sa pense pour que la surd-
termination quoi il rapporte la production du symptme entre un
conflit actuel en tant qu'il reproduit un conflit ancien de nature
sexuelle, et le support non pas adventice d'une bance organique
(pine lsionnelle ou complaisance du corps) ou imaginaire (fixa-
tion), lui fut apparue autre chose qu'une chappatoire verbale
ddaigner, s'il ne s'agissait en l'occasion de la structure qui unit le
signifiant au signifi dans le langage. Et c'est pour le mconnatre
que l'on glisse identifier le rapport entier de l'homme ses objets,
un fantasme de cot diversement imagin : sommeil de la raison
o a sombr la pense analytique et qui ne cesse pas d'y enfanter de
nouveaux monstres.
Car nous en sommes au point de nous interroger si l'analyse est
ce leurre par quoi l'on teint chez le sujet des besoins prtendument
rgressifs en leur donnant s'puiser par les voies imaginaires qui
leur sont propres, sans que le peu de ralit qui les supporte puisse
jamais les satisfaire, ou si elle est la rsolution des exigences symbo-
liques que Freud a rvles dans l'inconscient et que sa dernire
topique a lies avec clat l'instinct de mort. Si cette deuxime
conception est la vraie, l'erreur que reprsente la premire devient
vidente, avec l'aberration o toute la pratique analytique est actuel-
lement engage.
Je vous prie seulement de noter le lien qu'ici j'affirme entre la
deuxime position, seule pour nous correcte, et la reconnaissance
pour valable de la position de Freud combien discute, sur l'instinct
de mort. Ce que vous confirmerez constater que toute abrogation
de cette partie de son uvre s'accompagne chez ceux qui s'en tar-
guent, d'un reniement qui va jusqu' ses principes, en ce que ce sont
les mmes, et non pas par hasard, qui ne cherchent plus rien dans le
sujet de l'exprience analytique qu'ils ne situent au-del de la parole.
Entrons maintenant dans la question des rapports de la psychana-
lyse avec la psychologie.
i. On sait que c'est l un qualificatif dont M. Jaspers lui-mme fait volontiers
usage.
141
DISCOURS DE ROME
Je suis d'accord avec mon collgue Lagache pour affirmer l'unit
du champ o se manifeste le phnomne psychologique. C'est ainsi
que ce que nous venons de dfinir comme le champ psychanaly-
tique informe bien entendu la psychologie humaine aussi profond-
ment que nous le constatons dans notre exprience, et mme plus
loin qu'il n'est coutume de le reconnatre : comme les psychologues
s'en apercevraient s'ils voulaient bien ne pas empcher d'entrer
les concepts psychanalytiques au seuil du laboratoire o aucune des
isolations constituantes de l'objet ne saurait les mettre hors de
jeu, par exemple pour rsoudre les paradoxes vainement attribus
la consolidation dans la rminiscence ou ceux laisss pendants dans
les rsistances de l'animal l'apprentissage du labyrinthe temporel.
Il reste qu'on mconnat l'ordre entier dont la psychanalyse, en
y instaurant sa rvolution, n'a fait que rappeler la prsence de tou-
jours, poser qu'il n'est rien, dans les relations intressant la totalit
de l'individu humain, qui ne relve de la psychologie.
Ceci est faux, et non pas seulement en raison de prjugs latents
aux modes d'objectivation positive o cette science s'est histori-
quement constitue. Prjugs qui seraient rectifiables dans un reclas-
sement des sciences humaines dont nous avons donn le crayon :
tant entendu que toute classification des sciences, bien loin d'tre
question formelle, tient toujours aux principes radicaux de leur
dveloppement.
S'il est si important pour nous de poser que la psychologie ne
couvre pas le champ de l'existence humaine, c'est qu'elle en est une
particularisation expresse, valable historiquement, et que la science
de ce nom, pour tout dire, est insparable d'une certaine ralit
prsuppose, celle qui se caractrise comme un certain type de rela-
tion de l'homme lui-mme dans l'poque dite moderne, type
auquel l'appellation d'homo psychologicus ne nous parat apporter rien
de forc dans son terme.
On ne saurait en effet trop insister sur la corrlation qui lie l'ob-
jectivation psychologique la dominance croissante qu'a prise dans
le vcu de l'homme moderne la fonction du moi, partir d'un
ensemble de conjonctures sociales, technologiques et dialectiques,
dont la Gestalt culturelle est visiblement constitue au dbut du
xvil
c
sicle.
Les impasses cres par cette sorte de mutation, dont seule la
142
DISCOURS DE ROME
psychanalyse nous permet d'entrevoir maintenant les corrlations
structurantes, ont puissamment motiv cet aveu du malaise de la
civilisation la fin du XIX
e
sicle, dans lequel on peut dire que la
dcouverte freudienne constitue un retour des lumires. C'est pour-
quoi il s'agit bien d'un nouvel obscurantisme quand tout le mouve-
ment prsent de la psychanalyse se rue dans un retour aux croyances
lies ce que nous avons appel le prsuppos de la psychologie,
- au premier rang desquelles la prtendue fonction de synthse
du moi, pour avoir t cent fois rfute, et bien avant et hors de la
psychanalyse, par toutes les voies de l'exprience et de la critique,
mrite bien dans sa persistance d'tre qualifie de superstition.
La notion de moi que Freud a dmontre spcialement dans la
thorie du narcissisme en tant que ressort de toute namoration
(Verliebtheit) et dans la technique de la rsistance en tant que suppor-
te par les formes latente et patente de la dngation (Verneinung),
accuse de la faon la plus prcise ses fonctions irralisantes : mirage
et mconnaissance. Il la compltait d'une gense qui clairement situe
le moi dans l'ordre des relations imaginaires et montre dans son ali-
nation radicale la matrice qui spcifie comme essentiellement intra-
subjective l'agressivit interhumaine. Mais dj sa descendance spi-
rituelle, prenant de la leve du tabou sur un mot, prtexte tous
les contresens, et de celle de l'interdit sur un intrt, occasion d'un
retour d'idoltrie, nous prparait les lendemains de renforcement
propdeutique du moi o maintenant tend se rsorber l'analyse.
C'est qu'aussi bien ladite descendance n'avait pas eu le temps
d'assimiler le sens de la dcouverte de l'inconscient, faute d'avoir
reconnu dans sa manuvre analytique la grande tradition dialec-
tique dont elle reprsentait pourtant la rentre clatante. Tout au
contraire, les pigones furent bientt pris de vergogne l'endroit
d'un matriel symbolisant dont, sans parler de son tranget propre,
l'ordonnance tranchait sur le style de la science rgnante la faon
de cette collection de jeux privilgis que celle-ci relgue dans les
rcrations, mathmatiques ou autres, voire qui voque ces arts lib-
raux o le Moyen Age ordonnait son savoir, de la grammaire la
gomtrie, de la rhtorique la musique.
Tout les invitait pourtant reconnatre la mthode dialectique la
plus dveloppe dans le procd essentiel par o la psychanalyse
dans son exprience conjugue le particulier l'universel, dans sa
143
DISCOURS DE ROME
thorie subordonne le rel au rationnel, dans sa technique rappelle
le sujet son rle constituant pour l'objet, dans mainte stratgie
enfin recoupe la phnomnologie hglienne, - ainsi dans la rtorsion
au discours de la belle me, du secours qu'elle apporte au dsordre
du monde o sa rvolte prend son thme. Thme, soit dit en passant,
dont on ne saurait imputer l'engeance l'introversion du prome-
neur solitaire, quand nous nous souvenons qu'il fut produit sur la
scne du monde par le conqurant combien extraverti, Camoens,
dans le titre d'un de ses grands pomes.
Ce n'est pas en effet de psychologie que Freud se soucie, ni
de renforcer le moi de sa patiente, ni de lui apprendre supporter la
frustration, quand il est par Dora pris partie sur la situation scanda-
leuse o l'inconduite de son pre la prostitue. Bien au contraire, c'est
cette situation mme qu'il la renvoie et pour obtenir d'elle l'aveu
de l'actif et constant soutien qu'elle y apporte et sans quoi cette
situation n'et pu un instant se perptuer.
Aussi bien seul l'exercice de cette dialectique permet-il de ne
pas confondre l'exprience analytique avec une situation deux
qui, d'tre aborde comme telle, ne peut engendrer chez le patient
qu'un surcrot de rsistances, quoi l'analyste son tour ne croit
pouvoir remdier qu'en s'abandonnant aux siennes, aboutissant en
fin de compte cette mthode que les meilleurs avouent, sans plus
mme en ressentir l'avertissement d'une gne : chercher un alli,
disent-ils, dans la partie saine du moi du patient pour remanier
l'autre la mesure de la ralit. Qu'est-ce donc l, sinon refaire le
moi du patient l'image du moi de l'analyste ? Le processus se dcrit
en effet comme celui de la refente du moi (splitting ofthe ego) de
gr ou de force, la moiti du moi du sujet est cense passer du bon
ct de la barricade psychologique, soit celui o la science de l'ana-
lyste n'est pas conteste, puis la moiti de la moiti qui reste, et ainsi
de suite. On comprend que dans ces conditions on puisse esprer la
rforme du pcheur, nous voulons dire du nvros ; tout le moins,
ou son dfaut, son entre au royaume de Yhomo psychanalyticus,
odieux entendre, mais sr de son salut.
Le moi pourtant n'est jamais qu'une moiti du sujet, vrit pre-
mire de la psychanalyse ; encore cette moiti n'est-elle pas la bonne,
ni celle qui dtient le fil de sa conduite, de sorte que dudit fil il reste
retordre, et pas seulement un peu. Mais qu'importe ! Chacun ne
144
DISCOURS DE ROME
sait-il pas depuis quelque temps que le sujet dans sa rsistance use
de telle ruse qu'il ira jusqu' prendre le maquis de la perversion
avoue, la strada de l'incontinence passionnelle, plutt que de se
rendre l'vidence : savoir qu'en dernire analyse il est prgnital,
c'est--dire intress, - o l'on peut voir que Freud fait retour
Bentham, et la psychanalyse au bercail de la psychologie gnrale.
Inutile donc d'attaquer un tel systme o tout se tient, sinon pour
lui contester tout droit s'appeler psychanalyse.
Pour revenir, quant nous, une vue plus dialectique de l'exp-
rience, nous dirons que l'analyse consiste prcisment distinguer
la personne tendue sur le divan analytique de celle qui parle. Ce
qui fait dj avec celle qui coute trois personnes prsentes dans la
situation analytique, entre lesquelles il est de rgle de se poser
la question qui est de base en toute matire d'hystrie : o est le moi
du sujet? Ceci admis, il faut dire que la situation n'est pas trois,
mais bien quatre, le rle du mort comme au bridge tant toujours
de la partie, et tellement qu' n'en pas tenir compte il est impossible
d'articuler quoi que ce soit qui ait un sens l'endroit d'une nvrose
obsessionnelle.
Aussi bien est-ce par le mdium de cette structure o s'ordonne
tout transfert, qu'a pu se lire tout ce que nous savons de la structure
des nvroses. De mme que si le truchement de la parole n'tait
pas essentiel la structure analytique, le contrle d'une analyse par
un analyste qui n'en a que le rapport verbal, serait strictement
impensable, alors qu'il est un des modes les plus clairs et les plus
fconds de la relation analytique (cf. le rapport).
Sans doute l'ancienne analyse, dite du matriel, peut-elle
paratre archaque nos esprits pris la dite d'une conception
de plus en plus abstraite de la rduction psychothrapique. A en
reprendre pourtant le legs clinique, il apparatra de plain-pied avec
la reprise que nous tentons de l'analyse freudienne en ses principes.
Et, puisque nous voquions tout l'heure, pour situer cette phase
ancienne, la science d'une poque prime, souvenons-nous de la
sagesse que contenait celle-ci dans ses exercices symboliques et de
l'exaltation que l'homme y pouvait prendre quand se brisaient les
vases d'un verre encore opalis. Et j'en tirerai pour vous un signe
sur lequel vous guider.
Plus d'une voie se propose votre recherche, en mme temps que
145
DISCOURS DE ROME
des entraves y sont mises de toutes parts au nom d'interdits, de
modes, de prtentions au classicisme , de rgles souvent impn-
trables et, pour tout dire, de mystifications, - j'entends le terme au
sens technique que lui a donn la philosophie moderne. Quelque
chose caractrise pourtant ces mystres et leurs douteux gardiens.
C'est la morosit croissante des taches et des termes o ils appliquent
leurs efforts et leurs dmonstrations.
Apprenez donc quel est le signe o vous pourrez vous assurer
qu'ils sont dans l'erreur. La psychanalyse, si elle est source de vrit,
l'est aussi de sagesse. Et cette sagesse a un aspect qui n'a jamais tromp
depuis que l'homme s'affronte son destin. Toute sagesse est un
gay savoir. Elle s'ouvre, elle subvertit, elle chante, elle instruit, elle rit.
Elle est tout langage. Nourrissez-vous de sa tradition, de Rabelais
Hegel. Ouvrez aussi vos oreilles aux chansons populaires, aux mer-
veilleux dialogues de la rue...
Vous y recevrez le style par quoi l'humain se rvle dans
l'homme, et le sens du langage sans quoi vous ne librerez jamais la
parole.
RPONSES AUX INTERVENTIONS
21 septembre 1953
Les raisons de temps ne justifieraient pas que j'lude rien des
questions qu'on m'a poses, et ce ne serait pas sans arbitraire aprs
mon discours que je prtendrais que ma rponse l'une pt valoir
pour celle qui n'en serait pas moins la mme d'tre d'un autre. Si
donc, m'adressant dans ma rponse chacun, je fais un choix dans
ces questions, c'est que je pense ne pouvoir ici satisfaire aucune, si
elle n'est valable pour tous.
Je commencerai donc par remercier Daniel Lagache du soin
qu'il a mis vous reprsenter dans une clart systmatique les direc-
tions et les incidences de mon rapport : il n'et pas mieux fait en la
solennit d'une soutenance de thse, si justifies que soient ses
remarques sur la rupture manifeste en mon travail des lois du dis-
cours acadmique.
146
DISCOURS DE ROME
Aussi Tordre qu'il y retrouve le restituer, pour employer ses
termes, une raison raisonnante, ne peut-il m'apparatre que comme
la palme accorde une intention qui fut la mienne et que je dirai
proprement vridique, entendant par l dsigner ce qu'elle vise plus
encore que ce qui l'inspire.
Une vrit en effet, tel est le centre unique o mon discours trouve
sa cohrence interne et par quoi il prtend tre pour vous ce qu'il
sera si vous voulez bien y recourir en nos travaux futurs : cet ABC,
ce rudiment dont le dfaut se fait sentir parfois en un enseignement
toujours engag en quelque problme actuel, et qui concerne les
concepts dialectiques : parole, sujet, langage, o cet enseignement
trouve ses coordonnes, ses lignes et centre de rfrence. Ceci, non
pas en vous proposant ces concepts en des dfinitions formelles o
vous trouveriez occasion renouveler les entifications qu'ils visent
dissoudre, mais en les mettant votre porte dans l'univers de langage
o ils s'inscrivent dans le moment qu'ils prtendent en rgir le mou-
vement, car c'est vous rfrer leur articulation dans ce discours que
vous apercevrez l'emploi exact o vous pourrez les reprendre dans la
signification nouvelle o il vous sera donn d'en faire usage.
Je vais maintenant la question qui me semble avoir t ramene
de faon saisissante, fut-ce l'tat dcomplt, en plus d'une inter-
vention.
Quel lien faites-vous, me suis-je entendu interpeller, entre cet
instrument de langage dont l'homme doit accepter les donnes tout
autant que celles du rel et cette fonction de fondation qui serait
celle de la parole en tant qu'elle constitue le sujet dans la relation
intersubjective ?
Je rponds : en faisant du langage le mdium o rordonner
l'exprience analytique, ce n'est pas sur le sens de moyen qu'im-
plique ce terme, mais sur celui de lieu que nous mettons l'accent :
forons encore jusqu' le dire lieu gomtrique pour montrer qu'il
n'y a l nulle mtaphore.
Ce qui n'exclut pas, bien loin de l, que ce ne soit en chair et en
os, c'est--dire avec toute notre complexit charnelle et sympathi-
sante, que nous habitions ce lieu, et que ce soit prcisment parce
que tout s'y passe de ce qui peut nous intresser de pied en cap,
que l'empire va si loin des correspondances dveloppes dans les
dimensions de ce lieu.
147
DISCOURS DE ROME
Tel s'bauche le fondement d'une thorie de la communication
interhumaine, dont seule peut-tre notre exprience peut se trouver
en posture de prserver les principes, l'encontre de cette dbauche
de formulations aussi simplettes que prcipites qui font les frais des
spculations la mode sous ce chef.
Il reste que c'est dans le parti pris propre la notion de commu-
nication que nous orientons dlibrment notre conception du lan-
gage, sa fonction d'expression n'tant mentionne, que nous
sachions, qu'une seule fois dans notre rapport.
Prcisons donc ce que le langage signifie en ce qu'il commu-
nique : il n'est ni signal, ni signe, ni mme signe de la chose, en tant
que ralit extrieure. La relation entre signifiant et signifi est tout
entire incluse dans l'ordre du langage lui-mme qui en conditionne
intgralement les deux termes.
Examinons d'abord le terme signifiant. Il est constitu par un
ensemble d'lments matriels lis par une structure dont nous indi-
querons tout l'heure quel point elle est simple en ses lments,
voire o l'on peut situer son point d'origine. Mais, quitte passer
pour matrialiste, c'est sur le fait qu'il s'agit d'un matriel que j'in-
sisterai d'abord et pour souligner, en cette question de lieu qui
fait notre propos, la place occupe par ce matriel : seule fin de
dtruire le mirage qui semble imposer par limination le cerveau
humain comme lieu du phnomne du langage. O pourrait-il bien
tre en effet ? La rponse est pour le signifiant : partout ailleurs.
Sur cette table voici, plus ou moins dispers, un kilo de signifiant.
Tant de mtres de signifiant sont l enrouls avec le fil du magnto-
phone o mon discours s'est inscrit jusqu' ce moment. C'est le
mrite, peut-tre le seul, mais imprescriptible, de la thorie moderne
de la communication d'avoir fait passer dans le srieux d'une pra-
tique industrielle (ce qui est plus que suffisant aux yeux de tous pour
lui donner son affidavit scientifique) la rduction du signifiant en
units insignifiantes, dnommes units Hardey, par o se mesure, en
fonction de l'alternative la plus lmentaire, la puissance de commu-
nication de tout ensemble signifiant.
Mais le nerf de l'vidence qui en rsulte, tait dj pour ce qui
nous intresse dans le mythe forg par Rabelais, ne vous disais-je pas
le cas qu'on en peut faire, des paroles geles. Bourde et coquecigrue,
bien sr, mais dont la substantifique moelle montre qu'on pouvait
148
DISCOURS DE ROME
mme se passer d'une thorie physique du son, pour atteindre la
vrit qui rsulte de ce savoir que ma parole est l, dans l'espace
intermdiaire entre nous, identique aux ondes qui la vhiculent de
ma glotte vos oreilles. A quoi nos contemporains ne voient que du
feu, et non pas seulement comme on pourrait le croire pour ce que
le srieux de la pratique industrielle, dont Dieu me garde de me
gausser, manque au gay savoir, mais sans doute pour quelque raison
de censure, puisque les gorges chaudes qu'ils font du gnie d'antici-
pation dont ce mythe ferait la preuve, ne leur dcouvrent pas la
question : anticipation de quoi ? A savoir quel sens inclus aux ralisa-
tions modernes du phonographe a-t-il pu guider l'auteur de cette
fantaisie, s'il est vrai qu'elle les anticipe ?
Passons au signifi. Ce n'est pas la chose, vous ai-je dit, qu'est-ce
donc ? Prcisment le sens. Le discours que je vous tiens ici, pour ne
pas chercher plus loin notre exemple, vise sans doute une exprience
qui nous est commune, mais vous estimerez son prix ce qu'il vous
communique le sens de cette exprience, et non pas cette exp-
rience elle-mme. Vous communiqut-il mme quelque chose qui
fut proprement de cette dernire, ce serait seulement pour autant
que tout discours en participe, question qui, pour tre justement
celle en suspens, montre que c'est elle qu'est suspendu l'intrt
de ma communication
1
. Si donc le questionneur qui le bon sens a
t si bien partag qu'il ne tient pas pour moins promise sa certi-
tude la rponse sa question renouvele de tout l'heure, la repose
en effet :
Et ce sens, o est-il? La rponse correcte ici, nulle part,
pour tre oppose quand il s'agit du signifi celle qui convenait au
signifiant, ne l'en dcevra pas moins, s'il en attendait quelque chose
qui se rapprocht de la dnomination des choses . Car, outre que,
contrairement aux apparences grammaticales qui la font attribuer au
substantif, nulle partie du discours n'a le privilge d'une telle
i. Puis-je verser ici au dossier le remarquable aveu que j'ai reu plus rcemment
de l'un des assidus d'un cours o j'ai eu traiter de la psychanalyse l'usage de sp-
cialistes qui ne s'y destinaient pas : Je n'ai pas toujours compris les choses que vous
nous disiez (on sait que je ne mnage gure mes auditeurs), mais j'ai pu constater
que vous aviez, sans que je sache comment, transform ma faon d'entendre les
malades dont j'avais m'occuper.
149
DISCOURS DE ROME
fonction, le sens n'est jamais sensible que dans l'unicit de la signifi-
cation que dveloppe le discours.
C'est ainsi que la communication interhumaine est toujours
information sur l'information, mise l'preuve d'une communaut
de langage, numrotage et mise au point des cases de la cible qui
cerneront les objets, eux-mmes ns de la concurrence d'une rivalit
primordiale.
Sans doute le discours a-t-il affaire aux choses. C'est mme
cette rencontre que de ralits elles deviennent des choses. Tant
il est vrai que le mot n'est pas le signe de la chose, qu'il va tre la
chose mme. Mais c'est justement pour autant qu'il abandonne le
sens, - si l'on en exclut celui de l'appel, au reste plutt inoprant
en tel cas : comme il se voit aux chances minimes dans l'ensemble
qu' l'nonc du mot femme une forme humaine apparaisse, mais
grandes par contre qu' s'crier ainsi son apparition on la fasse fuir.
Que si l'on m'oppose traditionnellement que c'est la dfinition
qui donne au mot son sens, je le veux bien : ce n'est pas moi pour lors
qui aurai dit que chaque mot suppose en son usage le discours entier
du dictionnaire... - voire de tous les textes d'une langue donne.
Reste que, mis part le cas des espces vivantes, o la logique
d'Aristote prend son appui rel, et dont le lien la nomination
est dj suffisamment indiqu au livre biblique de la Gense, toute
chosification comporte une confusion, dont il faut savoir corriger
l'erreur, entre le symbolique et le rel.
Les sciences dites physiques y ont par de faon radicale en rdui-
sant le symbolique la fonction d'outil disjoindre le rel, - sans
doute avec un succs qui rend chaque jour plus claire, avec ce prin-
cipe, la renonciation qu'il comporte toute connaissance de l'tre, et
mme de l'tant, pour autant que celui-ci rpondrait Ftymologie
au reste tout fait oublie du terme de physique.
Pour les sciences qui mritent encore de s'appeler naturelles,
chacun peut voir qu'elles n'ont pas fait le moindre progrs depuis
l'histoire des animaux d'Aristote.
Restent les sciences dites humaines, qui furent longtemps dso-
rientes de ce que le prestige des sciences exactes les empchait
de reconnatre le nihilisme de principes que celles-ci n'avaient pu
soutenir qu'au prix de quelque mconnaissance interne leur ratio-
nalisation, - et qui ne trouvent que de nos jours la formule qui leur
150
DISCOURS DE ROME
permettra de les distancer : celle qui les qualifie comme sciences
conjecturales.
Mais l'homme n'y paratra bientt plus de faon srieuse que
dans les techniques o il en est tenu compte comme des ttes
d'un btail ; autrement dit, il y serait bientt plus effac que la nature
dans les sciences physiques, si nous autres psychanalystes ne savions
pas y faire valoir ce qui de son tre ne relve que du symbolique.
Il reste que c'est l ce qui ne saurait tre, si peu que ce soit, cho-
sifi, - aussi peu que nous n'y songeons pour la srie des nombres
entiers ou la notion d'une esprance mathmatique.
C'est pourtant dans ce travers que tombe mon lve Anzieu
en m'imputant une conception magique du langage qui est fort
gnante en effet pour tous ceux qui ne peuvent faire mieux que
d'insrer le symbolique comme moyen dans la chane des causes, faute
de le distinguer correctement du rel. Car cette conception s'impose
dfaut de la bonne : Je dis mon serviteur : "Va !" et il va , comme
s'exprime l'vangile, "Viens !" et il vient . Magie incontestable
que tout cela, si quotidienne qu'elle soit. Et c'est bien parce que
toute mconnaissance de soi s'exprime en projection, Anzieu mon
ami, que je vous parais victime de cette illusion. Car reconnaissez
celle laquelle vous cdez quand le langage vous parat n'tre qu'un
des modles entre autres qu'il m'est loisible de choisir, pour com-
prendre notre exprience dans l'ordre des choses, sans vous aperce-
voir que, si j'ose dire, il y fait tache dans cet ordre, puisque c'est avec
son encre que cet ordre s'crit.
A la vrit, cet ordre s'est crit en bien des registres avant que
la notion des causes y rgisse entres et sorties. Les lignes d'ordre
sont multiples qui se tracent entre les ples o s'oriente le champ du
langage. Et pour nous acheminer du ple du mot celui de la parole,
je dfinirai le premier comme le point de concours du matriel le
plus vide de sens dans le signifiant avec l'effet le plus rel du symbo-
lique, place que tient le mot de passe, sous la double face du non-
sens o la coutume le rduit, et de la trve qu'il apporte l'inimiti
radicale de l'homme pour son semblable. Point zro, sans doute,
de l'ordre des choses, puisqu'aucune chose n'y apparat encore, mais
qui dj contient tout ce que l'homme peut attendre de sa vertu,
puisque celui qui a le mot vite la mort.
Vertu de reconnaissance lie au matriel du langage, quelles
151
DISCOURS DE ROME
chanes du discours concret vont-elles la relier l'action de la parole
en tant qu'elle fonde le sujet?
Pour vous faire connatre aux emplois que les primitifs donnent
au mot parole l'extension qu'ils donnent sa notion, voire le lien
essentiel qui l'unit, plus saisissant ici d'apparatre radical, l'efficace
de ces techniques dont souvent nous n'avons plus le secret, et o se
confirme la fonction fondamentalement symbolique de leurs produits
comme de leur change, je vous renvoie au livre parfois embrouill,
mais combien suggestif qu'est le Do kamo de Leenhardt.
Mais rien ne fonde plus rigoureusement notre propos que la
dmonstration apporte par Lvi-Strauss que l'ensemble des structures
lmentaires de la parent, au-del de la complexit des cadres nomi-
naux qu'il suppose, tmoigne d'un sens latent de la combinatoire qui
pour n'tre rendu patent qu' nos calculs, n'a d'quivalent que les
effets de l'inconscient que la philologie dmontre dans l'volution
des langues.
Les remarques sur la concidence des aires culturelles o se rpar-
tissent les langues selon les systmes primordiaux d'agrgation mor-
phologique avec celles que dlimitent les lois de l'alliance au fonde-
ment de l'ordre des lignes, convergent en une thorie gnralise de
l'change, o femmes, biens, et mots apparaissent homognes, pour
culminer en l'autonomie reconnue d'un ordre symbolique, manifeste
en ce point zro du symbole o notre auteur formalise le pressenti-
ment qu'en donne de toujours la notion de mana.
Mais comment ne pas dire encore que le fruit de tant de science
nous tait dj offert en un gay savoir, quand Rabelais imagine le
mythe d'un peuple o les liens de parent s'ordonneraient en nomi-
nations strictement inverses celles qui ne nous paraissent qu'illu-
soirement conformes la nature ? Par quoi nous tait dj propose
cette distinction de la chane des parents et de la trame relle des
gnrations dont le tressage abonde en rptitions de motifs qui
justement substituent l'identit symbolique l'anonymat individuel.
Cette identit vient en fait contre-pente de la ralit, autant que
les interdits s'opposent aux besoins sans ncessit naturelle. Et qu'on
n'excepte mme pas le lien rel de la paternit, voire de la maternit,
l'un et l'autre conqutes fraches de notre science : qu'on lise Eschyle
pour se convaincre que l'ordre symbolique de la filiation ne leur
doit rien.
152
DISCOURS DE ROME
Voici donc l'homme compris dans ce discours qui ds avant sa
venue au monde dtermine son rle dans le drame qui donnera son
sens sa paroleK Ligne la plus courte, s'il est vrai qu'en dialectique la
droite le soit aussi, pour tracer le chemin qui doit nous mener, de
la fonction du mot dans le langage, la porte dans le sujet de la
parole.
Maints autres pourtant nous offrent leurs couches parallles en ce
dduit, aux chanes en fuseau de ce champ de langage, - o l'on
peut voir que la prise du rel en leur squence n'est jamais que la
consquence d'un enveloppement de l'ordre symbolique.
Le dmontrer serait les parcourir. Indiquons-en pourtant un
moment privilgi, que nous ferait oublier celui o nous sommes
venus de remettre la chane des causes la direction de l'univers, si
nous ne nous rappelions qu'il tait son antcdent ncessaire.
Pour que la dcision du vrai et du faux se librt de l'ordalie,
longtemps seule preuve opposer l'absolu de la parole, il a fallu
en effet que les jeux de l'agora, au cours de l'uvre o se donna un
sens plus pur aux mots s'affiontant des tribus, dgagent les rgles
de la joute dialectique par quoi avoir raison reste toujours avoir
raison du contradicteur.
Sans doute est-ce l moment d'histoire, miracle si l'on veut,
qui vaut un hommage ternel aux sicles de la Grce qui nous le
devons. Mais on aurait tort d'hypostasier en ce moment la gense
d'un progrs immanent. Car outre qu'il entrana sa suite tant de
byzantinismes qu'on situerait mal dans ce progrs, si peu dignes
qu'ils soient de l'oubli, nous ne saurions faire de la fin mme qu'on
i. Qu'on nous excuse de rapporter encore un commentaire rcent des faits ce
discours. Comme nous invitions, conformment cette remarque, la distingue
ambassadrice d'une rpublique de l'au-del europen de nagure, considrer ce
qu'elle devait, autant et plus qu'aux gnes de ses gniteurs, voire sa nourriture de
chair et d'images, la singularit du fait d'tat civil qui lui attribuait le nom, disons
d'Olga Durantschek, nous pmes surprendre le tout--trac de l'innocence dans sa
verdeur, en ces mots qui jaillirent : Mais c'est un hasard ! En quoi cette me pure,
peu soucieuse des conqutes du matrialisme dialectique, retrouvait l'accident, en
tant qu'oppos la substance par la tradition scolastique, en mme temps que la
base authentique de sa coexistence avec la petite bourgeoise la plus frue de sa per-
sonne, combien humaine, dans la croyance irrprime qu'elle tait elle, bien elle ,
elle jamais prvue sans doute en sa radieuse apparition au monde par une science
incre.
153
DISCOURS DE ROME
lui supposerait dans un causalisme achev, une tape si dcisive
qu'elle renvoie jamais les autres au pass absolu.
Et prenez la peine, je vous prie, d'ouvrir les yeux sur ce qui en
manire de sorcellerie se passe votre porte, si la raison de mon
discours n'a pas l'heur de vous convaincre.
C'est que pour les liaisons de l'ordre symbolique, c'est--dire
pour le champ de langage qui fait ici notre propos, tout est toujours l.
C'est l ce qu'il vous faut retenir, si vous voulez comprendre la
contestation formelle par Freud de toute donne en faveur d'une
tendance au progrs dans la nature humaine. Prise de position cat-
gorique, bien qu'on la nglige au dtriment de l'conomie de la
doctrine de Freud, sans doute en raison du peu de srieux o nous
ont habitus en cette matire nos penseurs patents, Bergson y
compris, - de l'cho qu'elle parat faire une pense ractionnaire
devenue lieu commun, - de la paresse aussi qui nous arrte d'extra-
ire du pied de la lettre freudienne le sens que nous pouvons tre srs
pourtant d'y trouver toujours.
Ne peut-on en effet se demander, se fier ce verdict de Freud
son apoge, s'il ne rend pas non avenu l'tonnement qu'il marquait
encore douze ans plus tt propos de l'Homme aux loups,
de l'aptitude si manifeste en ce nvros, maintenir ses conceptions
sexuelles et ses attitudes objectales prcdentes ple-mle avec les
nouvelles qu'il avait russi acqurir et s'il se fut ds lors attard
l'hypothse d'un trait de constitution en ce cas, plus que ne le com-
portait la voie o son sens du symbolique l'engageait dj pour le
comprendre.
Car ce n'est pas bien entendu quelque fumeuse Volkerpsycho-
logie, mais bien l'ordre que nous voquons ici, qu'il se rfrait en
vrit, en rapprochant ds l'abord ce phnomne nvrotique du fait
historique, port son attention par son got rudit de l'ancienne
Egypte, de la coexistence, aux diverses poques de son Antiquit,
de thologies relevant d'ges bien diffrents de ce qu'on appelle plus
ou moins proprement la conscience religieuse.
Mais quel besoin surtout d'aller si loin dans le temps, voire dans
l'espace, pour comprendre la relation de l'homme au langage ? Et si les
ethnographes depuis quelque temps s'entranent l'ide qu'ils pour-
raient trouver leurs objets dans la banlieue de leur propre capitale, ne
pourrions-nous, nous qui avons sur eux l'avance que notre terrain
154
DISCOURS DE ROME
soit notre couche et notre table Je parle ici du mobilier analytique,
au moins tenter de rattraper le retard que nous avons sur eux dans la
critique de la notion de rgression, par exemple, quand nous n'avons
pas en chercher les bases ailleurs que dans les formes fort dialec-
tiquement diffrencies sous lesquelles Freud prsenta cette notion
ds qu'introduite ? Au lieu de quoi notre routine la rduit l'emploi
toujours plus grossier des mtaphores de la rgression affective.
Ce n'est donc pas une ligne du discours, mais toutes (et chacune en
son genre portant effet de dtermination dans le sens, c'est--dire de
raison), qui vont se rassembler l'autre ple du champ de langage,
celui de la parole. Il n'est pas en reste sur le ple du mot pour la sin-
gularit de la structure qu'il prsente en une forme contrarie. S'il
s'agissait en effet dans celui-l du concours de la pure matrialit du
langage avec l'effet optimum de l'acte de reconnaissance, on voit ici
en quelque sorte diverger de l'intention de reconnaissance, la forme
de communication la plus paradoxale. Si l'on ne recule la formuler
telle que l'exprience l'impose, on y recueille en termes clatants
l'quation gnrale de la communication transsubjective, - en quoi
nous est fourni le complment ncessaire la thorie moderne de la
communication, laquelle n'a de sens qu' se rfrer strictement
l'autre ple de notre champ. Cette formule, la voici : l'action de
la parole pour autant que le sujet entende s'y fonder, est telle que
l'metteur, pour communiquer son message, doit le recevoir du rcep-
teur, encore n'y parvient-il qu' l'mettre sous une forme inverse.
Pour l'prouver aux angles opposs des intentions les plus diver-
gentes en la relation de reconnaissance, celle qui s'engage devant la
transcendance et devant les hommes dans la foi de la parole donne,
et celle qui fait fi de toute mdiation par l'autre pour s'affirmer
en son seul sentiment, - nous la trouvons confirme dans les deux
cas en sa squence formelle.
Dans le premier, elle apparat avec clat dans le tu es ma femme
ou le tu es mon matre par o le sujet fait montre de ne pouvoir
engager en premire personne son hommage lige dans le mariage
ou dans la discipline, sans investir l'autre comme tel de la parole o
il se fonde, au moins le temps qu'il faut celui-ci pour en rpudier
la promesse. A quoi se voit de faon exemplaire que la parole n'est
en aucun des sujets, mais en le serment qui les fonde, si lgrement
que chacun vienne y jurer sa foi.
155
DISCOURS DE ROME
Le second cas est celui du refus de la parole qui, pour dfinir
les formes majeures de la paranoa, n'en prsente pas moins une
structure dialectique dont la clinique classique, par le choix du terme
d'interprtation pour dsigner son phnomne lmentaire, montrait
dj le pressentiment. C'est du message informul qui constitue
l'inconscient du sujet, c'est--dire du je l'aime que Freud y a
gnialement dchiffr, qu'il faut partir pour obtenir avec lui dans leur
ordre les formes de dlire o ce message se rfracte dans chaque cas.
On sait que c'est par la ngation successive des trois termes du
message, que Freud en fait une dduction qui impose le rapproche-
ment avec les jeux de la sophistique.
C'est nous d'y trouver la voie d'une dialectique plus rigoureuse,
mais constatons ds maintenant que la formule que nous donnons
de la communication transsubjective, ne s'y rvle pas moins brillante
l'usage.
Elle nous conduira seulement reconnatre les effets de la disso-
ciation de l'imaginaire et du symbolique, - l'inversion symbolique
pour ce que le tu est ici exclu, entranant subversion de l'tre du
sujet, - la forme de rception du message par l'autre se dgradant
en rversion imaginaire du moi.
Il reste que c'est s'additionner sur l'objet (homosexuel) du
sentiment qui n'ose pas dire son nom que ces effets, pour disso-
cis qu'ils s'y maintiennent, vont la moindre subversion de l'tre
pour le sujet, c'est--dire lui vitent d'tre-pour-la-haine dans
'rotomanie, o le je l'aime devient dans l'inversion symbolique
ce n'est pas lui, mais elle que j'aime , pour s'achever dans la rver-
sion imaginaire en elle m'aime (ou il pour le sujet fminin). Si
cependant l'hrosme marqu dans la rsistance aux preuves
pouvait un instant donner le change sur l'authenticit du sentiment,
la fonction strictement imaginaire de l'autre intress, se trahit assez
dans l'intrt universel attribu l'aventure.
A s'additionner par contre sur le sujet, les deux effets, symbolique
et imaginaire, par les transformations en ce n'est pas moi qui
l'aime, c'est elle , et il l'aime (elle) (au genre prs du pronom
pour le sujet fminin), - aboutissent au dlire de la jalousie, dont la
forme proprement interprtative comporte une extension indfinie
des objets rvlant la mme structure gnralise de l'autre, mais o
la haine vient monter dans l'tre du sujet.
156
DISCOURS DE ROME
Mais c'est porter sur la relation que fonde la parole latente, que
l'inversion rfractant ses effets sur les deux termes que dsubjective
galement le refus de la mdiation par l'Autre, fait passer le sujet du
je le hais de sa dngation latente, par l'impossibilit de l'assumer
en premire personne, au morcellement projectif de l'interprtation
perscutive dans le rseau sans fin de complicits que suppose son
dlire, cependant que son histoire se dsagrge dans la rgression
proprement imaginaire du statut spatio-temporel dont nous avons
mis en valeur la phnomnologie dans notre thse, comme propre-
ment paranoaque.
Si certains d'entre vous en ce point ont dj laiss natre sur leurs
lvres le Que nul n'entre ici s'il n'est dialecticien que suggre
mon discours, qu'ils y reconnaissent aussi sa mesure.
Car l'analyse dialectique que nous venons de tenter du dploie-
ment des structures dlirantes, Freud n'y a pas seulement trouv un
raccourci, il lui a donn son axe y tracer son chemin au ras des
formes grammaticales sans paratre embarrass que ce fut la une
dduction trop verbale *.
Que donc vous soyez rompus aux arts de la dialectique n'exige
pas pour autant que vous soyez des penseurs. Ce que vous compren-
drez facilement tre juste assez dniaiss pour ne plus croire que la
pense soit suppose dans la parole. Car, outre que la parole s'accom-
mode fort bien du vide de la pense, l'avis que nous recevons des
penseurs est justement que pour l'usage que l'homme en fait d'ordi-
naire, la parole si tant est qu'il y ait quelque chose en penser, c'est
bien qu'elle lui a t donne pour cacher sa pense. Qu'il vaille
mieux, en effet, pour la vie de tous les jours cacher a , fut-ce au
prix de quelque artifice, c'est ce qu'on accordera sans peine savoir
quels borborygmes sont habituellement revtus du nom pompeux
de penses : et qui mieux qu'un analyste pourrait se dire pay pour
le savoir ? L'avis des penseurs pourtant n'est, mme par nous, pas pris
fort au srieux, ce qui ne fait que leur rendre raison, ainsi qu' la
position que nous soutenons prsentement et qui se renforce d'tre
pratiquement celle de tout le monde.
Leur commun pessimisme n'est pourtant pas seul en faveur de
i. Cf. le cas du prsident Schieber, in Cinq Psychanalyses, PUF, 1954, p.308-309.
CW>;VHI
t
p.299-300.
157
DISCOURS DE ROME
l'autonomie de la parole. Quand hier nous tions tous saisis du
discours de notre transparente Franoise Dolto, et que dans ma fra-
ternelle accolade je lui disais qu'une voix divine s'tait fait entendre
par sa bouche, elle me rpondit comme un enfant qu'on prend au
fait : Qu'ai-je donc dit ? J'tais si mue d'avoir parler que je ne
pensais plus ce que je pouvais dire. Pardi ! Franoise, petit dragon
(et pourquoi le dire petit si ce n'est qu'il s'agisse du lzard d'Apol-
lon), tu n'avais pas besoin d'y penser pour nous faire don de ta
parole, et mme pour en fort bien parler. Et la desse mme qui
t'et souffl ton discours, y et pens moins encore. Les dieux sont
trop identiques la bance imaginaire que le rel offre la parole,
pour tre tents par cette conversion de l'tre o quelques hommes
se sont risqus, pour que la parole devnt pense, pense du nant
qu'elle introduit dans le rel et qui ds lors va par le monde dans le
support du symbole.
C'est d'une telle conversion qu'il s'agit dans le cogito de Descartes,
et c'est pourquoi il n'a pu songer faire de la pense qu'il y fondait
un trait commun tous les hommes, si loin qu'il tendt le bnfice
de son doute leur faire crdit du bon sens. Et c'est ce qu'il prouve
dans le passage du Discours que cite Anzieu, en n'apportant pour dis-
tinguer l'homme de son semblant dans l'tendue, d'autres critres
que ceux-l mmes que nous donnons ici pour ceux de la parole.
Comme il le montre rfuter par avance l'escamotage que les
modernes en font dans le circuit dit du stimulus-response : Car on
peut bien, dit-il en effet, concevoir qu'une machine soit tellement
faite qu'elle profre des paroles [...] propos des actions corporelles
qui causeront quelques changements en ses organes, comme si on
la touche en quelque endroit, qu'elle demande ce qu'on veut lui
dire : si, en un autre, qu'elle crie qu'on lui fait mal , - pour se
confier au double critre quoi la machine fera selon lui dfaut,
savoir qu'il ne sera pas possible que ces paroles, elle les arrange
diversement et pour rpondre au sens de tout ce qui se dira en
sa prsence : soit les deux termes de substitution combinatoire du
signifiant et de transsubjectivit fondamentale du signifi o nous
caractrisons mot et parole dans le langage.
Si donc Anzieu pense ici arguer contre moi, c'est en raison du
prjug commun sur l'harmonie de la parole la pense qui est ce
que je mets en doute. Je passe sur l'inadquation de l'exemple dont
158
DISCOURS DE ROME
Descartes ne peut mais, puisque l'automate n'est pris par lui que
pour cet aspect de leurre de l'anim dont son poque s'enchantait :
alors que la machine nous apparat - j ' y reviendrai quelque jour -
comme un ensemble d'lments symboliques, organis de faon
prcisment ce qu'ils s'arrangent diversement en des squences
orientes, et assez capable de rpondre au sens des questions
qu'on lui propose en son langage, pour que ce qu'on lui a attribu
improprement de pense puisse lgitimement tre imput la fonc-
tion d'une moiti de la parole.
Et ceci nous mne droit au sens du surralisme dont je dirai
qu'Anzieu ne le mconnat pas moins, porter les confusions qui
nous sont lgues avec la notion d'automatisme au compte d'une
pense magique qui, pour tre le lieu commun d'un certain
retour la psychologie de notre discipline, en est aussi le plus mani-
feste alibi.
Le surralisme en effet prend bien sa place dans une srie d'mer-
gences dont l'empreinte commune donne sa marque notre poque :
celle d'un dvoilement des relations de l'homme l'ordre symbo-
lique. Et le retentissement mondial de ses inventions les plus gamines
montre assez qu'il prludait un avnement plus grave, et plus sombre
aussi bien, tel le Dieu-enfant dont Durer a grav la figure, animant de
ses jeux parodiques le monde d'une Mlancolie en gsine. Panique
nue de symboles confus et de fantasmes morcelants, le surralisme
apparat comme une tornade au bord de la dpression atmosphrique
o sombrent les normes de l'individualisme humaniste. Si l'auto-
nomie de la conscience de soi tait dj condamne par l'achve-
ment du discours sur le Savoir dans Hegel, ce fut l'honneur de
Freud d'avoir profil au berceau de ce sicle la figure et l'ombre, sur
le nouvel individu, de la puissance contraire. Empire du langage,
il commande dans l'avnement historique du discours de l'auto-
accusation avant de promettre, aux murmures d'oracle de la machine
calculer. Un pouvoir plus originel de la raison semble surgir par
l'clatement du concept dans la thorie logico-mathmatique des
ensembles, de l'unit smantique dans la thorie linguistique du
phonme. A cette lumire tout le mouvement phnomnologique,
voire existentialiste, apparat comme la compensation exaspre
d'une philosophie qui n'est plus sre d'tre matresse de ses motifs ;
et qu'il ne faut pas confondre, bien qu'on les y dmarque, avec les
159
DISCOURS DE ROME
interrogations qu'un Wittgenstein ou qu'un Heidegger portent sur
les rapports de l'tre et du langage, si pensives de s'y savoir incluses,
si lentes en chercher le temps.
Si c'est donc dans le pouvoir que j'accorde au langage qu'Anzieu
veut trouver le sens de mon propos, qu'il renonce m'affubler
de romantiques parrainages : sans renier mes amitis surralistes,
ni dsavouer le style la Marat de leur discours, c'est plutt sous
l'intercession de M. de Tocqueville que je mettrais le mien. Et
en ceci au moins que j'indique, que le langage se librer des
humaines mdiations qui le masquaient jusqu' ce jour, montre un
pouvoir auprs duquel les prtentions d'Ancien Rgime de celles-ci
l'absolu, apparatront des attnuations drisoires.
Si ces dclarations paraissent oses, du moins tmoignent-elles
que je ne prends pas la contradiction qu'on m'oppose pour un dfaut
la rponse que je peux attendre, - tout au contraire quand chez
Anzieu elle manifeste cette proximit la vrit qui ne s'obtient
qu' ce que ce soit la vrit qui nous serre de prs.
C'est mme au point que certains enthousiasmes, pour approba-
tifs qu'ils soient, peuvent m'inspirer plus de rserve : qu'on s'applau-
disse des effets de libration que mon propos fait ressentir, d'accord,
mais qu'on le fasse juste assez vite pour que ces applaudissements
s'teignent avec l'euphorie de ce sentiment.
Le primat de la technique n'est pas ici mis en cause, mais les men-
songes de son enseignement. Il n'est pas question d'y faire rentrer
la fantaisie, mais d'en carter les mystres. Or le mystre est solidaire
de privilges o tout le monde trouve son compte sans quoi l'on n'y
tiendrait pas tant, et toute dmystification est importune, d'y attenter.
Il est rel qu'on respire mieux ce que les brumes d'une tache se
lvent, mais non moins vrai que ses obstacles ne sont pas abaisss
pour autant. Sans doute je vous affranchis en vous rappelant que la
parole qui gurit dans l'analyse ne peut tre que la vtre, mais je
vous rends dans le langage au matre le plus revche vos mrites.
Il n'est pas de domaine, en effet, o il suffise moins de se faire valoir
pour se faire reconnatre, ni o la prudence comme l'audace soient
plus souvent prises sans vert : il suffit pour le comprendre de vous
souvenir que les retours de la fortune sont la figure humaine des lois
de la dialectique, et donc que ce n'est pas se confier la parole
qu'on peut esprer les viter.
160
DISCOURS DE ROME
Pour en avoir une autre issue, il faudrait, si l'on me permet la
mtaphore, en agir avec le langage comme on a fait avec le son : aller
sa vitesse pour en franchir le mur. Aussi bien en parlant du bang-
bang de l'interprtation vraie, userait-on d'une image assez conve-
nable la rapidit dont il lui faut devancer la dfense du sujet, la
nuit o elle doit le plonger pour qu'il en fasse ressurgir ttons les
portants de la ralit, sans l'clairage du dcor.
L'effet en est rare obtenir, mais son dfaut vous pouvez vous
servir de ce mur mme du langage que je ne tiens pas, lui, pour une
mtaphore puisque c'est un corollaire de mon propos qu'il tient sa
place dans le rel.
Vous pouvez vous en servir pour atteindre votre interlocuteur,
mais condition de savoir que, ds qu'il s'agit d'utiliser ce mur, vous
tes l'un et l'autre en de, et qu'il faut donc viser l'atteindre par la
bande et non l'objectiver au-del.
C'est ce que j'ai voulu indiquer en disant que le sujet normal par-
tage cette place avec tous les paranoaques qui courent le monde
pour autant que les croyances psychologiques o s'attache ce sujet
dans la civilisation, constituent une varit de dlire qu'il ne faut
pas tenir pour plus bnigne d'tre quasi gnrale. Assurment rien
ne vous autorise y participer sinon dans la mesure justement pose
par Pascal o ce serait tre fou par un autre tour de folie que de
n'tre pas fou d'une folie qui apparat si ncessaire.
Ceci ne saurait aucunement justifier que vous chaussiez les pieds
de plomb de la pdagogie, se part-elle du titre d'analyse des rsis-
tances, pour faire l'ours qui expliquerait la danse son montreur.
Il est tout fait clair, si l'analyse didactique a un sens, que c'est
vous entendre rpondre au sujet, que vous saurez ce qu'il vous
dit. Inversement voyez l le secret du miracle permanent qu'est
l'analyse dite contrle. Mais ceci suppose que, si peu que ce soit,
votre analyse personnelle vous ait fait apercevoir cette alination
vous-mme, qui est la rsistance majeure quoi vous avez affaire
dans vos analyses.
Ainsi vous ferez-vous entendre de la seule place qui soit occupe
ou devrait l'tre, au-del du mur du langage, savoir la vtre.
Il y a l un long chemin technique tout entier reprendre, et tout
d'abord dans ses notions fondamentales puisque la confusion est son
comble et que le battage qu'on mne autour du contre-transfert, s'il
161
DISCOURS DE ROME
part d'une bonne intention, n'y a apport qu'un bruit de surcrot.
Comment en effet, ne pas strictement savoir qui parle en vous,
pourriez-vous rpondre celui qui vous demande qui il est? Car
c'est l la question que votre patient vous pose, et c'est pourquoi
quand Serge Leclaire ose ici vous la poser avec lui, ce n'est pas de la
rponse qu'elle implique de moi lui : Tu es mon disciple , que je
lui suis redevable puisque dj il s'est dclar tel pour la poser, mais
c'est de celle qu'il mrite de moi devant vous : Tu es un analyste ,
que je lui rends le tmoignage pour ce qu'il a brav en la posant.
Je dois ici limiter ma rponse. Pour suivre Granoff l o dj
il nous engage en attaquant l'emploi qu'on fait en psychanalyse de
la relation d'objet, il me faudrait anticiper sur le chemin que, je
l'espre, nous parcourrons ensemble, et qui peut-tre impose d'en pas-
ser d'abord par la question de l'instinct de mort, soit par le passage le
plus ardu qu'ait fray la pense de Freud, en juger par la prsomp-
tion avec laquelle on le ddaigne. Je n'ai jamais song vous guider ici
dans les paisseurs de sens, o le dsir, la vie et la mort, la compulsion
de rptition, le masochisme primordial sont si admirablement dcho-
sifis, pour que Freud les traverse de son discours. Au carrefour qui
ouvre ce chemin, je vous donnais hier un rendez-vous sans date.
A vrai dire, c'est Juliette Boutonier qui par son admirable lettre,
m'empche de m'y drober en concluant. Elle sait bien que je ne
songe pas faire tort l'imaginaire, moi dont le nom reste attach au
stade du miroir. Non seulement je mets l'image au fondement de la
conscience, mais je retendrais bien partout. Le reflet de la montagne
dans le lac, dirais-je, joue peut-tre son rle dans un rve du cosmos,
oui, mais nous n'en saurons jamais rien tant que le cosmos ne sera pas
revenu de son mutisme. Les scrupules dont Juliette Boutonier ceint
mon discours, seraient donc superflus s'ils ne trouvaient leur point de
chute dans l'objection qu'ils prparent : pourquoi l'quation serait-elle
ncessaire que j'tablis entre le symbole et la mort?
Faute d'en pouvoir maintenant dfinir le concept, je l'illustrerai
de l'image dont le gnie de Freud semble jouer comme d'un leurre
pour nous mettre au cur fulgurant de l'nigme.
Il a surpris le petit d'homme au moment de sa saisie par le
langage et la parole. Le voici, lui et son dsir. Cette balle qu'un
fil retient, il la tire lui, puis la jette, il la reprend et la rejette. Mais
il scande sa prise et son rejet et sa reprise d'un oo, aa, oo, quoi le
162
DISCOURS DE ROME
tiers sans qui il n'y a pas de parole ne se trompe pas en affirmant
Freud qui l'coute que cela veut dire : Fort ! Da ! Parti ! Voil ! Parti
encore... ou mieux selon le vocable auquel un auteur oubli avait
fait un sort : Napus !
Au reste peu importe que ce que l'enfant module soit d'une arti-
culation aussi fruste puisque, dj, y apparat form le couple phon-
matique o la linguistique, en le pas majeur qu'elle a fait depuis, a
reconnu le groupe d'opposition lmentaire, dont une batterie assez
courte pour tenir en un tableau d'un quart de page donne le mat-
riel vocalique d'une langue donne.
S'il est presque trop beau de voir le signifiant faire avnement
sous la forme de son pur lment, en va-t-il de mme de la signifi-
cation qui merge dans le mme temps ? Comment au moins ne pas
se le demander devant ce jeu si simple ?
Car que fait-il, cet enfant de cet objet sinon de l'abolir cent
reprises, sinon de faire son objet de cette abolition. Sans doute n'est-
ce que pour que cent fois renaisse son dsir, mais ne renat-il
pas dj dsir de ce dsir? Nul besoin donc de reconnatre par le
contexte et le tmoin que le mal d'attendre la mre a trouv ici son
transfert symbolique. Le meurtre de la chose dont Juliette Bouto-
nier a relev le terme dans mon discours, est dj l. Il apporte tout
ce qui est, ce fonds d'absence sur quoi s'enlveront toutes les pr-
sences du monde. Il les conjoint aussi ces prsences de nant, les
symboles, par quoi l'absent surgit dans le prsent. Et le voici ouvert
jamais au pathtique de l'tre. Va-t'en ! lancera-t-il son amour
pour qu'il revienne, Viens donc ! se sentira-t-il forc de murmu-
rer celui dont dj il s'absente.
Ainsi le signifiant sous sa forme la plus rduite apparat-il dj
superlatif tout ce qu'il peut y avoir signifier, et c'est pourquoi
nous ne pouvons garder l'illusion que la gense ait ici le privilge
de se calquer sur la structure. La question de savoir quel minimum
d'oppositions signifiantes constitue le quantum ncessaire la consti-
tution d'un langage n'est pas ici de mise, non plus que celle du
minimum de joueurs ncessaires pour qu'une partie s'engage o le
sujet puisse dire : Parole !
Car l'autrui comme le dsir sont dj l dans les fantmes inclus
dans cet objet symbolisant, avec la mort qui de l'avoir saisi premire,
en sortira tout l'heure la dernire pour faire, muette, la quatrime
163
DISCOURS DE ROME
au jeu. Le jeu, c'est le sujet. Mais il n'empche que le battage des
cartes le prcde, que les rgles se sont labores sans lui, que d'autres
ont biseaut les cartes, qu'il peut en manquer au paquet, que les
vivants mmes qui joueront sous la livre des fantmes, ne feront
d'annonce qu' leur couleur, et qu' quelque jeu que l'on joue, l'on
sait qu'on ne jouera jamais qu'au jeu. Si bien que dans YAleajacta est,
qui sonne chaque instant, ce ne sont pas les mots : Les ds rou-
lent , qu'il faut entendre, mais bien plutt pour le redire de l'humour
qui me rattache au monde : Tout est dit. Assez jact d'amour.
Ce n'est pas dire que ce que l'action humaine engage dans le jeu,
ne vive pas, bien sr, mais c'est d'y revivre. Telle elle se fige dans ce
qu'elle rassemble en un ftiche, pour le rouvrir un nouveau ras-
semblement o le premier s'annule ou se confond. (Ici Anzieu qui
retrouve son Kant, opine du bonnet.) Mais ce sont toujours les
quatre du dbut qui se comptent.
Aussi bien rien ne peut-il se passer qui ne les laisse dans leur
ordre ? C'est pourquoi, avant de m'effacer moi-mme, j'accorderai
M. Perrotti que la musique n'est pas sans avoir son mot dire en
leur ballet, et mme que les tambours sacrs
1
nous rappellent les
rsonances organiques qui prludrent la promulgation de leurs
lois, mais qu'en dire de plus ? Sinon de remarquer que l'analyse ne se
fait pas en musique, pour accorder qu'il s'y passe aussi de l'ineffable.
Mais c'est aussi le parti pris de ce discours que de rpondre ce qui
se propose seulement comme ineffable par un Ds lors n'en par-
lons plus dont la dsinvolture peut prter critique.
Mais n'en montre-t-on pas une plus grande encore mconnatre
que si les moyens de l'analyse se limitent la parole, c'est que, fait digne
d'tre admir en une action humaine, ils sont les moyens de sa fin
2
?
i. Dont nous retrouvmes avec Marcel Griaule le nom abyssin dans ces nacaires
qu'il ne faut pas prendre pour des trompettes.
2. De ce texte a t retranch le passage qui rpondait la remarquable commu-
nication de M. Banziger : eussions-nous mme reproduit cette rponse, qu'il et
fallu l'amplifier pour qu'elle pt satisfaire sa vise, qui n'tait rien de moins que de
dfinir la relation de l'analyse cette zone mystique dont il nous semble de pure
mthode de l'exclure de son champ, si centrale qu'y apparaisse sa place.Y tait indi-
qu de mme le sens systmatique de l'ostracisme de Freud par rapport toute
forme plus ou moins ocanique de religiosit.
L'invisibilit du lieu de la coupure confirme-t-elle le propos avou de ce dis-
cours de se soutenir dans une multivocit aussi gale que possible entre ses parties?
La psychanalyse vraie
y
et la fausse
ARGUMENT D'UNE COMMUNICATION POUR UN CONGRS
TENU BARCELONE EN SEPTEMBRE 1958
1. Pour distinguer la vraie psychanalyse de la fausse, on se rfre
une notion de la psychanalyse authentique, et une notion d'une
psychanalyse conforme la vrit manifeste par son exprience.
S'il s'agit pourtant ici de vrit proprement parler, c'est qu'autant
dans l'ordre de sa dcouverte que dans celui o elle opre des fins
curatives, le rapport de l'homme la vrit est dominant.
Ainsi la psychanalyse fausse ne l'est pas seulement du fait de
s'carter du champ qui motive son procd. Cet cart, quelles qu'en
soient les intentions effectives, exige un oubli ou une mconnais-
sance. Et l'un et l'autre la condamnent des effets pernicieux.
2. La psychanalyse vraie a son fondement dans le rapport de
l'homme la parole. Cette dtermination dont l'nonc est vident,
est l'axe par rapport auquel doivent tre jugs et jaugs ses effets :
ceux-ci tant entendus dans leur extension la plus gnrale, savoir
non seulement comme changements diversement bnfiques, mais
comme rvlation d'un ordre effectif dans des faits jusqu'alors rests
inexplicables, vrai dire apparition de faits nouveaux.
Ce rapport de l'homme la parole est vident dans le mdium
de la psychanalyse : ce qui rend d'autant plus extraordinaire qu'on le
nglige dans son fondement.
Mais il s'agit d'un cercle, car ne pas reconnatre le fondement,
on cherche ailleurs le mdium : savoir dans on ne sait quel affect
immdiat, vritable dlire couvrir une action par o l'homme
approche peut-tre au plus prs du foyer constituant de la raison.
C'est le spectacle que nous offre la psychanalyse en tant qu'elle
cherche se justifier des mthodes des disciplines coexistantes en
son champ, ce qu'elle ne fait qu'au prix de substantifications
mythiques et d'alibis fallacieux.
Que le substrat biologique du sujet soit dans l'analyse intress
165
LA PSYCHANALYSE VRAIE, ET LA FAUSSE
jusqu'en son fonds, n'implique nullement que la causalit qu'elle
dcouvre y soit rductible au biologique. Ce qu'indique la notion,
primordiale dans Freud, de surdtermination, jamais lucide jusqu'
prsent.
Qu'on ne croie pas pour autant trouver ici la position dite cultura-
liste. Car pour autant qu'elle se rfre un critre social de la norme
psychique, elle contredit encore plus l'ordre dcouvert par Freud en
ce qu'il montre d'antriorit radicale par rapport au social
1
.
3. A revenir l'mergence (dans la gnialit de Freud) de l'inter-
prtation (Deutung) des rves, de la psychopathologie quotidienne et
du trait d'esprit, soit au registre de ce qui ds lors vient au jour de la
connaissance et de la praxis sous le nom d'inconscient, on reconnat
que ce sont les lois et les effets propres au langage qui en constituent
la causalit ; causalit qu'il faut dire logique plutt que psychique, si
l'on donne logique l'acception des effets du logos et non pas seu-
lement du principe de contradiction.
Les mcanismes dits du condens (Verdichtung) et du virement
(Verschiebung) recouvrent exactement les structures par o s'exercent
dans le langage les effets de mtaphore et de mtonymie. C'est--
dire les deux modes o la construction la plus rcente de la thorie
linguistique (Roman Jakobson et consorts
2
) subsume dans une
structure spcifique (impossible retrancher mme du fonctionne-
ment physiologique des appareils mis dans le vivant au service du
langage), l'action propre du signifiant, en tant qu'il faut considrer
cette action comme engendrant la signification dans le sujet dont
elle s'empare, en le marquant comme signifi.
Il ne s'agit pas ici de YAnschluss par o l'on tente aujourd'hui de
faire rentrer la psychanalyse dans une psychologie perptuant un
hritage acadmique sous l'tiquette de psychologie gnrale,- voire
de l'assimiler aux plus rcentes assomptions de la matire humaine
sous les rubriques varies de la sociologie.
Il s'agit de la lecture suggestive de l'anticipation, faite par Freud
dans l'analyse de l'inconscient, des formules mmes o Ferdinand de
Saussure, dix ans aprs la Traumdeutung, fonde l'analyse des langues
i. Totem et Tabou.
2. Cf. Roman Jakobson et Morris Halle, Fundamentab o/Language, 1956.
166
LA PSYCHANALYSE VRAIE, ET LA FAUSSE
positives. Car la linguistique a dplac le centre de gravit des sciences,
dont le titre, singulirement inactuel d'tre promu depuis lors de
sciences humaines, conserve un anthropocentrisme dont Freud a
affirm que sa dcouverte ruinait le dernier bastion,- en dnonant
l'autonomie o le sujet conscient des philosophes maintenait l'attri-
but propre l'me dans la tradition du zoologisme spiritualiste.
4. Toute promotion de l'intersubjectivit dans la personnologie
humaine ne saurait donc s'articuler qu' partir de l'institution d'un
Autre comme lieu de la parole. C'est l'autre scne , anderer Schaus-
platz, o Freud, empruntant le terme Fechner, dsigne ds l'ori-
gine le plateau gouvern par la machinerie de l'inconscient.
C'est sur cette scne que le sujet apparat comme surdtermin
par l'ambigut inhrente au discours. Car dans la communication
parle, mme quand il s'agit de transmission objective , l'entri-
nement dans le discours domine l'effet de signal, de mme que la
mise l'preuve du code rtroflchit l'action de message. Qu'on
passe la fonction de pacte de la parole, on touchera aussitt que nul
message du sujet ne s'articule qu' se constituer dans l'Autre sous
une forme inverse : Tu es ma femme, tu es mon matre.
Structure mconnue dans les prmisses des thories modernes de
l'information o devrait pourtant tre marque l'antriorit du
rcepteur par rapport toute mission.
Ici- encore Freud devance ces travaux en permettant de distinguer
le sujet cfomme strictement constitu par les symboles-indices, indi-
quant dans le discours sa place comme metteur du message, du
sujet en tant qu'il entre dans le message, non, comme on le croit,
comme objet qui s'y reprsente, mais comme signifiant qui s'y
donne : ce qui est possible pour ce que les images qui conduisent ses
fonctions, deviennent par l'opration de la demande, symboles-images
du discours.
5. C'est cette capture imaginaire du sujet dans le discours de
l'Autre qui semble aller si loin que de pouvoir intresser sa physio-
logie la plus intime. C'est elle qui centre la notion vulgaire qui s'est
substitue, de par son emploi en psychanalyse, au concept rigoureux
du symbolique : car il faut dfinir celui-ci comme constitu dans la
chane signifiante, seul lieu pensable de la surdtermination comme
167
LA PSYCHANALYSE VRAIE, ET LA FAUSSE
telle, par la double possibilit qu'elle ouvre la combinaison et la
substitution des lments discrets qui sont le matriel du signifiant.
Mais la fascination propre Vimaginaire, ici distingu du symbo-
lique, s'est exerce sur ceux-l mmes, savoir les psychanalystes, qui
en dcouvraient les formes dans la dialectique o le sujet se rvlait
symbolis.
Le double effet de l'imaginaire en tant qu'cran opposant son
filtre la communication du message inconscient, et en tant qu'l-
ment constitu du code symbolique, a t confondu par eux en une
seule puissance, qu'ils n'ont pu ds lors apprcier qu' des effets de
rsonance, aux interfrences de plus en plus obscurcies.
Il en est rsult notamment que la rsistance du discours n'a
jamais t distingue de la rsistance du sujet.
La suite s'en est manifeste dans un contresens toujours accru
mesure que Freud dans une hte, qu'il faut bien dire angoissante,
en suivre la trace dans un style de bouteille la mer , nous donnait
le rectifier en articulant la fonction du moi dans la topique intra-
subjective.
Ce leurre imaginaire o Freud situe le moi dans son Introduc-
tion au narcissisme ds 1914 et dont nous-mme, dans le dbut de
notre carrire, avons voulu restaurer le relief sous le nom de stade du
miroir, le fait brutal que l'analyse du moi soit introduite (ne conna-
trait-on des articles de Freud que leur titre, ce qui est plus frquent
qu'on ne croit chez les analystes) avec et sous l'angle de la psycho-
logie collective, - tout cela qui est fait pour donner au moi un statut
analytique o sa fonction imaginaire se coordonne sa valeur d'objet
idal, disons le mot : mtonymique -, n'a servi que de prtexte
l'introduction d'une orthopdie psychique qui s'acharne avec une
obstination gteuse un renforcement du moi : ngligeant que c'est
l aller dans le sens du symptme, de la formation de dfense,
de l'alibi nvrotique, - et s'abritant d'une harmonie prtablie de la
maturation des instincts la morale dont le postulat restera attach
l'histoire de notre poque comme le tmoignage d'un obscuran-
tisme sans prcdent.
6. Les positions ici avances sous une forme radicale rsument le
double travail d'un commentaire de textes que nous poursuivons
depuis sept ans dans un sminaire hebdomadaire couvrant par an
168
LA PSYCHANALYSE VRAIE, ET LA FAUSSE
environ trois cents pages de l'uvre de Freud, et d'un enseigne-
ment de prsentation clinique et de contrle thrapeutique qui se
poursuit depuis cinq ans sous l'gide de la Clinique des maladies
mentales et de l'encphale (Pr Jean Delay) de la Facult de mde-
cine de Paris.
Les consquences de ce travail thorique et pratique sur la direc-
tion de la cure, - au triple point de vue de la place de l'interpr-
tation dans l'analyse, du maniement du transfert, et des normes
mmes o se fixent les buts et la terminaison de la cure - , ont t
exposes au colloque international tenu cette anne Royaumont
par la Socit franaise de psychanalyse, soit par le groupe qui nous
accompagne dans ce labeur.
Les mmes personnalits dont la place dans la Socit internatio-
nale de psychanalyse a pour effet que la langue franaise est la seule
langue de grande culture dans laquelle il n'y ait pas de traduction
complte des uvres de Freud
1
, la partie traduite y tant tisse
d'oublis, de non-sens, de falsifications et d'erreurs qui en rendent la
lecture au mieux inintelligible et au pire controuve , sont aussi
celles que nous rencontrons pour s'opposer toute discussion de
ces travaux dans la Socit internationale de psychanalyse, fonde
par Freud.
7. Un facteur unifie les directions qu'on appelle phases de la
doctrine de Freud : elles fixent les lignes cardinales de la recherche
o devait-s'orienter le problme jamais ouvert par sa dcouverte,
celui des rapports liant le sujet au signifiant. C'est le problme de
l'identification, quant au sujet. Quant ses relations au rel, il exclut
absolument la position de la ralit comme purement et simplement
donne, quoi la psychanalyse aujourd'hui se rfre, tant par l'usage
qu'elle fait de la notion de sens de la ralit, voire d'preuve de la
i. Les raffinements de cette situation valent la peine d'tre mentionns : une
traduction scrupuleuse faite par un membre de notre groupe, d'un article de Freud
essentiel et toujours non traduit, n'est pas autorise paratre.
Nous devons ajouter que cette situation ne nous vise pas personnellement, car
c'est l mme grce quoi les lettres de Freud Fliess - publies contre la volont
testamentaire de Freud, ce qui peut tre excusable - le sont travers un caviardage
qui apparat aux critiques les moins prvenus (cf. Erik Erikson, //P, vol. XXXVI,
1955, p.l) aussi intolrable que suspect, ce qui est en tout cas sans excuse.
169
LA PSYCHANALYSE VRAIE, ET LA FAUSSE
ralit, que par l'appui qu'elle y trouve pour se rduire une pratique
de plus en plus organise d'une pdagogie corrective.
Il va de soi que nous ne mettons pas ce faisant en question la pri-
maut du rel, simplement nous rappelons que le langage y introduit
une dimension de nature le mettre en question . C'est au niveau
de cette mise en question que se situe le drame de la nvrose.Vouloir
rduire celle-ci dans sa vracit irrductible, ne petit conduire
qu' un recul du symptme jusqu'aux racines mmes de l'tre, la
destruction de ce qui tmoignait dans la souffrance.
En fait la rsistance rencontre tmoigne elle seule de l'impasse
de l'entreprise, et la compulsion de rptition dcouverte par Freud
a t aussi par lui identifie l'insistance d'une vrit qui clame
encore dans le dsert de l'ignorance.
L'opposition dialectique, c'est--dire lie par une relation d'occul-
tation alternante, du principe de ralit au principe de plaisir, n'est
concevable qu'au niveau de l'identification signifiante. Ils ne peu-
vent du point de vue de l'adaptation que se confondre strictement.
Or toute la psychanalyse se dveloppe dans la dimension de leur
conflit. Ainsi la promotion d'une sphre sans conflit au centre de la
thorie, comme au pivot de l'action thrapeutique, nous apporte de
New York le signe dernier du renoncement achev aux principes
d'une dcouverte, - de son dtournement des fins de suggestion
sociale et d'assujettissement psychologique.
8. Il n'a pas manqu de gens pour nous faire grief de solliciter
Freud, et de manquer l'essentiel, en rduisant au champ de la
parole et du langage, - objet du rapport par lequel Rome, en 1953,
s'est inaugure la vie de notre groupe -, un mouvement de l'tre
qui le soutient et le dpasse de toutes parts. Du prverbal l'inef-
fable, il n'est pas de catgorie qu'on n'agite pour nous rebuter, au
silence prs dont on se mfie ajuste titre.
Articulons ici que nous ne confondons pas plus l'tre avec le
dicible, que nous ne tenons l'tant pour l'antithse de la raison.
Bien au contraire, ramenant sa source freudienne la souffrance
dont la nvrose nous rvle le pathtique bien tempr, nous ten-
tons de saisir le dsir dans les rets mmes o Freud nous le montre
fix. Ces rets sans doute le traversent et l'articulent dans l'interro-
gation passionne qui arrache le vivant, demi dhiscent de la vie,
170
LA PSYCHANALYSE VRAIE, ET LA FAUSSE
qu'est l'homme, la condition du besoin. Pour l'lever la position
de cette demande sans objet, que nous appelons l'amour, la haine et
l'ignorance.
C'est l, entre l'inconditionnel de cette demande et la satisfaction
dont on prtend l'touffer, que surgit cette condition quasi perverse
en sa forme absolue qu'est le dsir. Place prdestine chez le sujet
parlant pour que la Vnus aveugle de la nature y cherche dans l'an-
goisse son symbole vivant. Ici le phallus, o les Anciens voyaient
le signe o le logos marque la vie de son empreinte, et dont ce
n'est pas en vain que le mystre devait tre tu, puisqu' tre dit,
il ne pouvait tre que dgrad, nous a rvl sa fonction symbo-
lique : dans le complexe de castration. Ce que la psychanalyse d'au-
jourd'hui tente de rduire la fonction imaginaire d'un objet
partiel .
Mais nous devons entendre Freud quand il nous dit que dans le
rve, seule son laboration l'intresse. Le dsir inconscient, indiqu
dans la mtaphore onirique, n'a d'objet que mtonymique. Il est
dsir au-del de la reconnaissance autant que reconnaissance quoi
se drobe le dsir.
Enseignement trop ardu pour que les augures de la psychanalyse
d'aujourd'hui n'en soient pas venus se dire : Un rve aprs tout
n'est qu'un rve , et mme en faire le mot de passe dont ils se
saluent.
Ce rve et ce dsir en effet ne sont pas articulables en termes
d'adaptation la ralit, soit en ces termes qui, sous le nom de tension
vcue, de rsistance affective, de partie saine ou distordue du moi, de
relation duelle entre l'analys et l'analyste, font revivre les tonnantes
mystifications de la psychothrapie autoritaire.
C'est donc bien nous, et non pas eux, qui disons que le dsir, qu'il
soit du rve ou de la veille, n'est pas articulable dans la parole. Mais
il n'est pas vrai pourtant qu'il ne soit pas articul dans le langage, et
que, glissant comme l'anneau du jeu de furet au fil de la mtonymie
qui le retient dans un cercle de fantasme, il ne produise pas mta-
phoriquement le signifi du symptme o ce fantasme se ralise.
9. Nous voici tout prs des problmes de la cure et de la distinc-
tion profonde entre la suggestion et le transfert. Le transfert est ce
lien l'Autre qu'tablit la forme de demande quoi l'analyse fait
171
LA PSYCHANALYSE VRAIE, ET LA FAUSSE
sa place, pour que de cette place cette rptition, o ce n'est pas le
besoin qui se rpte, mais l'au-del qu'y dessine la demande, puisse
tre saisie dans son effet de dsir et analyse dans son effet de sug-
gestion.
C'est mesure que l'effet de suggestion issu de l'inconscient dis-
sipe ses mirages, que le dsir doit s'articuler en tant que signifiant
dans la question existentielle qui donne son horizon au transfert.
En quelque terme que celle-ci se rsolve, c'est au lieu de l'Autre
que le sujet se trouvera : la place de ce qui tait (Wo Es war...) et
qu'il faut qu'il assume (..., soll Ich werden).
Ici le prcepte Tu aimeras ton prochain comme toi-mme
ne sonne pas moins trangement que le Tt twam asi, comme on
l'prouve y rpondre la premire personne o clate l'absurdit
qu'il y aurait prendre son dernier terme pour son dernier mot, tan-
dis que l'autre boucle son cercle a l'achever : Comme toi-mme, tu
es ceci que tu hais parce que tu l'ignores.
Nulle part comme dans Freud de nos jours ne se respire l'air de
la raison conqurante, ni ce style dont au xvm
e
sicle l'homme
s'avana vers la dnudation de son dsir, pour en poser, sous la figure
de la nature, Dieu la question. Pointe unique dans l'histoire d'une
philosophie qui avait fait sa loi de la ngation du dsir. Pointe dont
on s'tonne constater comment la philosophie a russi la discr-
diter comme celle d'une clart artificielle, voire artificieuse, alors
qu'elle posait la question la plus profonde.
Sans doute cette philosophie des lumires, et son parangon
l'homme du plaisir, ont-ils fait une erreur. Ils ont voulu expliquer ce
qui s'opposait leur question par l'imposture et faire de l'obscuran-
tisme un complot contre la libert de la nature.
C'est de cette erreur que nous subissons le retour. Car les monstres
qu'on forge pour les besoins d'une cause nous apportent la preuve la
plus tonnante de la puissance de la vrit : ils viennent eux-mmes
au jour.
Ceux qui ont mon ge ont pu saisir comment la propagande anti-
allemande des Allis de la Grande Guerre, a engendr l'hidrisme,
qui la justifia aprs coup.
Plus paradoxalement, mais par un retour du mme ordre, la
reprise d'une mise en question essentielle de l'homme par rapport
la nature, au nom cette fois de la vrit qui la pntre, aboutit ce
172
LA PSYCHANALYSE VRAIE, ET LA FAUSSE
rsultat singulier : que ceux-l mmes dont le rinventeur de cette
question a voulu faire les gardiens de son legs, s'organisent pour le
transformer en instrument d'quivoque et de conformisme et se
constituent rellement en une glise qui sait que son autorit est de
nant, puisqu'elle renie ce qui est son action mme, en la ravalant
aux connivences d'un aveuglement qu'elle-mme entretient.
10. Comment ne pas reconnatre en effet la fausset de leur
position dans son apparence mme, savoir ce contraste qui fait que
la psychanalyse est tout juste tolre dans sa pratique, quand son
prestige est universel : quand psychanalyse de... , de quelque objet
qu'il s'agisse, veut dire pour tous qu'on entre dans la raison profonde
d'une apparente draison, et que pourtant dans la science la psy-
chanalyse vit dans une sorte de quarantaine qui n'a rien faire avec
l'effet de la spcialisation.
Situation faite de mconnaissances accordes, et que n'explique
plus depuis longtemps la prtendue rsistance des lacs. Si celle-ci
est quelque part maintenant, ce n'est pas ailleurs que chez les psy-
chanalystes eux-mmes, et patente dans cet effort de se faire valoir
par les analogies les plus btardes et les fictions les plus douteuses,
- conjoint cette bgueulerie qu'ils manifestent devant les emplois
diversement abusifs qui sont faits au-dehors des notions qu'ils diffu-
sent, non sans en ressentir une secrte complaisance.
Faut-il voir dans le consentement dont ils jouissent dans la moiti
du monde civilis un effet du pardon que mritent ceux qui ne
savent pas ce qu'ils font ? Ou revenir la preuve, que constitue, pour
la vrit d'une tradition, l'indignit de ses ministres?
Nul doute que la confiance privilgie dans la parole qu'implique
le maintien du choix de ses moyens formels, soit le principe de
vrit par quoi la psychanalyse subsiste, malgr l'imbcillit des
idaux dont elle l'assaisonne.
Sans doute cela suffit-il, - non pas que la parole ne soit le vhi-
cule naturel de l'erreur, lu du mensonge, et normal du malentendu,
mais parce qu'elle se dploie dans la dimension de la vrit, et ainsi
la suscite, fut-ce l'horreur du sujet.
C'est bien l un truisme, et mme le truisme par excellence. Il
retrouve les propos que nous venons d'avancer, pour repenser la psy-
chanalyse et reconduire sa mission.
173
LA PSYCHANALYSE VRAIE, ET LA FAUSSE
Un mystre subsiste pourtant sur les conditions propres la garde
du patrimoine disciplinaire qu'engendre un champ o le praticien
lui-mme doit se tenir au niveau du sujet qu'il dcouvre, - savoir
ici non pas le sujet de la connaissance, il en face du monde rel,
- mais le sujet de la parole, c'est--dire en tant qu'il merge la
dimension de la vrit.
C'est une ncessit profonde que Freud est confront quand il
se soucie instamment de fonder la communaut qui assurera cette
garde. Est-ce seulement un accident quand il s'abandonne romanti-
quement y laisser s'insrer ce praesidium secret o se prfigurent
les appareils les plus modernes de notre politique ? J'ai dj touch
ce sujet ailleurs en me fondant sur les documents vertigineux livrs
par Jones. Nous sommes alors en 1912.
Le fruit, il faut le savourer maintenant dans cette thorie de la
validation des thories par les conciles
!
, qu'un membre de la cama-
rilla qui a dtenu aprs la dernire guerre dans la Socit internatio-
nale les pouvoirs excutifs, articula^sans la moindre vergogne.
Mimtisme singulier de l'histoire l'endroit de cette analyse
d'une Eglise sans foi, d'une arme sans patrie, que Freud nous a
donne, dans un ouvrage plus haut cit, et o il faut reconnatre que
l'art a une fois de plus forg une forme signifiante avant son mer-
gence dans le rel.
Ici la psychanalyse se manifeste elle-mme passion dans l'acte qui
la constitue, suscitant nouveau en son sein le mot de ralliement
dont Voltaire conspuait l'imposture : crasons l'infme.
Juin 1958
i. Cf. Ernst Kris, The Nature of Psychoanalytic Propositions and their Valida-
tion , in Freedom and Exprience, Ithaca, Cornell University Press, 1947.
Maurice Merleau-Ponty
1. On peut exhaler le cri qui nie que l'amiti puisse cesser de vivre.
On ne peut dire la mort advenue sans meurtrir encore. J'y renonce,
l'ayant tent, pour malgr moi porter au-del mon hommage.
Me recueillant pourtant au souvenir de ce que j'ai senti de
l'homme en un moment pour lui de patience amre.
2. Que faire d'autre que d'interroger le point que met l'heure
soudaine un discours o nous sommes tous entrs ?
Et son dernier article qu'on reproduit ici, titre : L'il et
l'esprit
1
, - en parler d'o il est fait, si j'en crois le signe d'une tte
propice, pour que je l'entende : de ma place.
3. C'est bien la dominante et la sensible de l'uvre entire qui
donnent ici leur note. Si on la tient pour ce qu'elle est : d'un phi-
losophe, au sens de ce qu'un choix qui seize ans y aperoit son
avenir (il l'attesta), y ncessite de professionnel. C'est dire que le lien
proprement universitaire couvre et retient son intention, mme
prouv
K
impatiemment, mme largi jusqu' la lutte publique.
4. Ce n'est pas l pourtant ce qui insre cet article dans le senti-
ment, point deux fois en son exorde et en sa chute, d'un change-
ment trs actuel devenir patent dans la science. Ce qu'il voque
comme vent de mode pour les registres de la communication, com-
plaisance pour les vnalits oprationnelles, n'est not que comme
apparence qui doit conduire sa raison.
C'est la mme quoi nous tentons de contribuer du champ pri-
vilgi la rvler qu'est le ntre (la psychanalyse freudienne) : la
raison par quoi le signifiant s'avre premier en toute constitution
d'un sujet.
i. In AH de France, 1961, p. 187-208.
175
MAURICE MERLEAU-PONTY
5. L'il pris ici pour centre d'une rvision du statut de l'esprit,
comporte cependant toutes les rsonances possibles de la tradition
o la pense reste engage.
C'est ainsi que Maurice Merleau-Ponty, comme quiconque
en cette voie, ne peut faire que de se rfrer une fois de plus l'il
abstrait que suppose le concept cartsien de l'tendue, avec son cor-
rlatif d'un sujet, module divin d'une perception universelle.
Faire la critique proprement phnomnologique de l'esthtique
qui rsulte de cette rarfaction de la foi faite l'il, n'est pas pour
nous ramener aux vertus de connaissance de la contemplation pro-
pose l'ascse du nous par la thorie antique.
Ce n'est point non plus pour nous attarder au problme des illu-
sions optiques et de savoir si le bton rompu par la surface de l'eau
dans le bassin, la lune plus grosse d'aborder l'horizon, nous mon-
trent ou non la ralit : Alain dans son nuage de craie y suffit.
Disons-le parce que mme Maurice Merleau-Ponty ne semble
pas franchir ce pas : pourquoi ne pas entriner le fait que la thorie
de la perception n'intresse plus la structure de la ralit quoi la
science nous a fait accder en physique. Rien de plus contestable,
tant dans l'histoire de la science que dans son produit fini, que ce
motif dont il se prend autoriser sa recherche qu'issue de la percep-
tion, la construction scientifique y devrait toujours revenir. Bien
plutt tout nous montre-t-il que c'est en refusant les intuitions per-
ues du pondral et de Vimpetus que la dynamique galilenne a
annex les deux la terre, mais au prix d'y introduire ce que nous
touchons aujourd'hui dans l'exprience du cosmonaute : un corps
qui s'ouvrir et se fermer sans peser en rien ni sur rien.
6. La phnomnologie de la perception est donc bien autre chose
qu'un codicille une thorie de la connaissance dont les dbris font
l'attirail d'une psychologie prcaire.
Elle n'est pas plus situable dans la vise, qui n'habite plus prsent
que le logicisme, d'un savoir absolu.
Elle est ce qu'elle est : savoir une collation d'expriences dont
il faut lire l'ouvrage inaugural de Maurice Merleau-Ponty
1
pour
i. Phnomnologie de la perception, Gallimard, 1945.
176
MAURICE MERLEAU-PONTY
mesurer les recherches positives qui s'y sont accumules, et leur
stimulation pour la pense, sinon la drision o elles font paratre
les btifications sculaires sur l'illusion d'Aristote, voire l'examen
clinique moyen de l'ophtalmologiste.
Pour en faire saisir l'intrt, choisissons un petit fait dans l'im-
mense trame de covariances de mme style qui sont commentes
en cet ouvrage, celui par exemple la page 360 de l'clairage violent
qui apparat en manire de cne blanchtre pour ce que le supporte
un disque, peine visible d'tre noir et surtout d'tre le seul objet
qui l'arrte. Il suffit d'y interposer un petit carr de papier blanc
pour qu'aussitt l'aspect laiteux s'en dissipe et que se dtache
comme distinct d'tre clair en son contraste le disque noir.
Mille autres faits sont de nature nous imposer la question de
ce qui rgle les mutations souvent saisissantes que nous observons
par l'addition d'un lment nouveau dans l'quilibre de ces facteurs
exprimentalement distingus que sont l'clairage, les conditions
fond-forme de l'objet, notre savoir son endroit, et tiers lment, ici
le vif, une pluralit de gradations que le terme de couleur est insuf-
fisant dsigner, puisqu'outre la constance qui tend rtablir dans
certaines conditions une identit perue avec la gamme dnom-
mable sous des longueurs d'onde diffrentes, il y a les effets conju-
gus de reflet, de rayonnement, de transparence dont la corrlation
n'est mme pas entirement rductible de la trouvaille d'art l'arti-
fice de laboratoire. Comme il s'prouve de ce que le phnomne
visuel de la couleur locale d'un objet n'a rien faire avec celui de la
plage colore du spectre.
Qu'il nous suffise d'indiquer dans quelle direction le philosophe
tente d'articuler ces faits, en tant qu'il est fond leur donner asile,
soit en ceci au moins que tout un art de cration humaine s'y
rattache que la ralit physicienne rfute d'autant moins qu'elle s'en
loigne toujours plus, mais qu'il n'est pas dit pour autant que cet art
n'a de valeur que d'agrment, et qu'il ne recle pas quelque autre
accs un tre, ds lors peut-tre plus essentiel.
7. Cette direction exige vers ce qui ordonne les covariances ph-
nomnalement dfinies de la perception, le philosophe de notre
temps va la chercher, on le sait, dans la notion de la prsence, ou
pour mieux en traduire littralement le terme de l'allemand, de
177
MAURICE MERLEAU-PONTY
A A
l'Etre-l, quoi il faut ajouter prsence (ou Etre-l)-dans-par--
travers-un-corps. Position dite de l'existence, en tant qu'elle essaie
de se saisir dans le moment d'avant la rflexion qui dans son exp-
rience introduit sa distinction dcisive d'avec le monde en l'veillant
la conscience-de-soi.
Mme restitue trop videmment partir de la rflexion redou-
ble que constitue la recherche phnomnologique, cette position
se targuera de restaurer la puret de cette prsence la racine du
phnomne, dans ce qu'elle peut globalement anticiper de sa mou-
vance dans le monde. Car bien entendu des complexits homologues
s'ajoutent du mouvement, du tact, voire de l'audition, comment
omettre du vertige, qui ne se juxtaposent pas mais se composent avec
les phnomnes de la vision.
C'est cette prsupposition qu'il y ait quelque part un lieu de
l'unit, qui est bien faite pour suspendre notre assentiment. Non
qu'il ne soit manifeste que ce lieu soit cart de toute assignation
physiologique, et que nous ne soyons satisfaits de suivre en son dtail
une subjectivit constituante l o elle se tisse fil fil, mais non pas
rduite tre son envers, avec ce qu'on appelle ici l'objectivit
totale.
Ce qui nous tonne, c'est qu'on ne profite pas aussitt de la struc-
ture si manifeste dans le phnomne, - et dont il faut rendre justice
Maurice Merleau-Ponty de n'y faire plus, au dernier point, de
rfrence aucune Gestalt naturaliste -, pour non y opposer, mais y
accorder le sujet lui-mme.
Qu'est-ce qui objecte dire de l'exemple plus haut cit, - o
l'clairage est manifestement homologue du tonus musculaire dans
les expriences sur la constance de la perception du poids, mais ne
saurait masquer sa localit d'Autre - , que le sujet en tant qu'au
premier temps il l'investit de sa consistance laiteuse, au second temps
n'y est plus que refoul. Et ce, par le fait du contraste objectivant
du disque noir avec le carr blanc qui s'opre de l'entre significa-
tive de la figure de ce dernier sur le fond de l'autre. Mais le sujet qui
l s'affirme en formes claires est le rejet de l'Autre qui s'incarnait
en une opacit de lumire.
Mais o est le primum, et pourquoi prjuger de ce qu'il soit seu-
lement un percipiens, quand ici se dessine que c'est son lision qui
rend au perceptum de la lumire elle-mme sa transparence.
178
MAURICE MERLEAU-PONTY
Pour tout dire, il nous semble que le je pense auquel on entend
rduire la prsence, ne cesse pas d'impliquer, quelque indtermi-
nation qu'on l'oblige, tous les pouvoirs de la rflexion par quoi se
confondent sujet et conscience, soit nommment le mirage que
l'exprience psychanalytique met au principe de la mconnaissance
du sujet et que nous-mme avons tent de cerner dans le stade du
miroir en l'y rsumant.
Quoi qu'il en soit, nous avons revendiqu ailleurs, nommment
sur le sujet de l'hallucination verbale
1
, le privilge qui revient
au perception du signifiant dans la conversion oprer du rapport du
percipiens au sujet.
8. La phnomnologie de la perception vouloir se rsoudre en
la prsence-par-le-corps, vite cette conversion, mais se condamne
la fois dborder de son champ et se rendre inaccessible une exp-
rience qui lui est trangre. C'est ce qu'illustrent les deux chapitres
de l'ouvrage de Maurice Merleau-Ponty sur le corps comme tre
sexu
2
et sur le corps comme expression dans la parole
3
.
Le premier ne le cde pas en sduction la sduction quoi l'on
avoue y cder de l'analyse existentielle, d'une lgance fabuleuse,
quoi J.-P. Sartre se livre de la relation du dsir
4
. De l'engluement de
la conscience dans la chair la qute dans l'autre d'un sujet impos-
sible saisir parce que le tenir en sa libert, c'est l'teindre, de cette
leve pathtique d'un gibier qui se dissipe avec le coup, qui ne le tra-
verse mme pas, du plaisir, ce n'est pas seulement l'accident mais l'is-
sue qui impose l'auteur son virage, en son redoublement d'impasse,
dans un sadisme, qui n'a plus d'autre chappatoire que masochiste.
Maurice Merleau-Ponty, pour en inverser le mouvement, semble
en viter la dviation fatale, en y dcrivant le procs d'une rvla-
tion directe du corps au corps. Elle ne tient vrai dire que de l'vo-
cation d'une situation pense ailleurs comme humiliante, laquelle
comme pense de la situation supple au tiers, que l'analyse a mon-
tr tre inhrent dans l'inconscient la situation amoureuse.
i. In La Psychanalyse, PUF, t. 4, p.1-5 et la suite.
2. Phnomnologie de la perception, op. cit., p. 180-202.
3.J&i<*.,p.202-232.
4. J Jean-Paul Sartre, L'tre et le Nant.
179
MAURICE MERLEAU-PONTY
Disons que ce n'est pas pour rendre plus valable pour un freudien
la reconstruction de Sartre. Sa critique ncessiterait une prcision,
mme pas encore bien reconnue dans la psychanalyse, de la fonction
du fantasme. Nulle restitution imaginaire des effets de la cruaut ne
peut y suppler, et il n'est pas vrai que la voie vers la satisfaction
normale du dsir se retrouve de l'chec inhrent la prparation du
supplice K Sa description inadquate du sadisme comme structure
inconsciente, ne l'est pas moins du mythe sadianiste. Car son passage
par la rduction du corps de l'autre l'obscne se heurte au para-
doxe, bien autrement nigmatique le voir rayonner dans Sade, et
combien plus suggestif dans le registre existentiel, de la beaut
comme insensible l'outrage
2
. L'accs rotologique pourrait donc
tre ici meilleur, mme hors de toute exprience de l'inconscient.
Mais il est clair que rien dans la phnomnologie de l'extra-
polation perceptive, si loin qu'on l'articule dans la pousse obscure
ou lucide du corps, ne peut rendre compte ni du privilge du
ftiche dans une exprience sculaire, ni du complexe de castration
dans la dcouverte freudienne. Les deux se conjurent pourtant pour
nous sommer de faire face la fonction de signifiant de l'organe
toujours signal comme tel par son occultation dans le simulacre
humain, - et l'incidence qui rsulte du phallus en cette fonction
dans l'accs au dsir tant de la femme que de l'homme, pour tre
maintenant vulgarise, ne peut pas tre nglige comme dviant ce
qu'on peut bien appeler en effet l'tre sexu du corps.
9. Si le signifiant de l'tre sexu peut tre ainsi mconnu dans le
phnomne, c'est pour sa position doublement cele dans le fan-
tasme, soit de ne s'indiquer que l o il n'agit pas et de n'agir que de
son manque. C'est en quoi la psychanalyse doit faire sa preuve d'un
avancement dans l'accs au signifiant, et tel qu'il puisse revenir sur sa
phnomnologie mme.
On excusera mon audace du mode dont j'appellerai ici en
tmoigner le second article mentionn de Maurice Merleau-Ponty
sur le corps comme expression dans la parole.
1. Ibid.
2. Lieu analys dans mon sminaire L'thique de la psychanalyse, 1959-1960 (paru
aux d. du Seuil, 1986).
180
MAURICE MERLEAU-PONTY
Car ceux qui me suivent reconnatront, combien mieux file, la
mme thmatique dont je les entretiens sur la primaut du signi-
fiant dans l'effet de signifier. Et je me remmore l'appui que j'ai pu y
trouver aux primes vacances d'aprs la guerre, quand mrissait mon
embarras d'avoir ranimer dans un groupe pars encore une com-
munication jusque-l rduite au point d'tre peu prs analphabte,
freudiennement parlant cela s'entend, de ce que le pli s'y conservt
des alibis l'usage d'habiller une praxis sans certitude de soi.
Mais ceux-l qui retrouveront leurs aises en ce discours sur la
parole (et fut-ce y rserver ce qui y rapproche un peu trop discours
nouveau et parole pleine), n'en sauront pas moins que je dis autre
chose, et nommment :
- que ce n'est pas la pense, mais le sujet, que je subordonne au
signifiant,
- et que c'est l'inconscient dont je dmontre le statut quand je
m'emploie y faire concevoir le sujet comme rejet de la chane
signifiante, qui du mme coup se constitue comme refoul primor-
dial.
Ds lors ils ne pourront consentir la double rfrence des
idalits, aussi bien incompatibles entre elles, par quoi ici la fonction
du signifiant converge vers la nomination, et son matriel vers un
geste o se spcifierait une signification essentielle.
Geste introuvable, et dont celui qui porte ici sa parole la dignit
de paradigme de son discours, et su avouer qu'il n'offrait rien de tel
percevoir son audience.
Ne savait-il pas au reste qu'il n'est qu'un geste, connu depuis saint
Augustin, qui rponde la nomination : celui de l'index qui montre,
mais qu' lui seul ce geste ne suffit pas mme dsigner ce qu'on
nomme dans l'objet indiqu.
Et si c'tait la geste que je voudrais mimer, du rejet par exemple,
pour y inaugurer le signifiant : jeter, n'implique-t-elle pas dj
l'essence vraie du signifiant dans la syntaxe instaurant en srie les
objets soumettre au jeu du jet.
Car au-del de ce jeu, ce qu'articule, oui, seulement l mon geste,
c'est le je vanouissant du sujet de la vritable nonciation. Il suffit
en effet que le jeu se ritre pour constituer ce je qui, de le rpter,
dit ce je qui s'y fait. Mais ce je ne sait pas qu'il le dit, rejet qu'il
est comme en arrire, par le geste, dans l'tre que le jet substitue
181
MAURICE MERLEAU-PONTY
l'objet qu'il rejette. Ainsi je qui dis ne peut tre qu'inconscient de ce
que je fais, quand je ne sais pas ce que faisant je dis.
Mais si le signifiant est exig comme syntaxe d'avant le sujet pour
l'avnement de ce sujet non pas seulement en tant qu'il parle mais
en ce qu'il dit, des effets sont possibles de mtaphore et de mto-
nymie non seulement sans ce sujet, mais sa prsence mme s'y
constituant du signifiant plus que du corps, comme aprs tout l'on
pourrait dire qu'elle fait dans le discours de Maurice Merleau-Ponty
lui-mme, et littralement.
De tels effets sont, je l'enseigne, les effets de l'inconscient, y trou-
vant aprs coup, de la rigueur qui en revient sur la structure du lan-
gage, confirmation du bien-fond de les en avoir extraits.
10. Ici mon hommage retrouve l'article sur l'il et l'esprit, qui,
d'interroger la peinture, ramne la vraie question de la phnomno-
logie, tacite au-del des lments que son exprience articule.
Car l'usage d'irrel de ces lments dans un tel art (dont notons
au passage que pour la vision il les a manifestement discerns plutt
que la science) n'exclut pas du tout leur fonction de vrit, ds lors
que la ralit, celle des tables de la science, n'a plus besoin de s'assu-
rer des mtores.
C'est en quoi la fin d'illusion que se propose le plus artificieux
des arts, n'a pas tre rpudie, mme dans ses uvres dites abs-
traites, au nom du malentendu que l'thique de l'Antiquit a nourri
sous cette imputation, de l'idalit d'o elle partait dans le problme
de la science.
L'illusion ici prend sa valeur de se conjuguer la fonction de
signifiant qu'on dcouvre l'envers de son opration.
Toutes les difficults que dmontre la critique sur le point non
seulement du comment fait, mais du ce que fait la peinture, laissent
entrevoir que l'inconscience o semble subsister le peintre dans sa
relation au ce que de son art, serait utile rapporter comme forme
professionnelle la structure radicale de l'inconscient que nous
avons dduite de sa commune individuation.
Ici le philosophe qu'est Maurice Merleau-Ponty fait honte aux
psychanalystes d'avoir dlaiss ce qui peut ici apparatre d'essentiel
porte de se mieux rsoudre.
Et l encore de la nature du signifiant, - puisque aussi bien il faut
182
MAURICE MERLEAU-PONTY
prendre acte de ce que, s'il y a progrs dans la recherche de Maurice
Merleau-Ponty, la peinture intervient dj dans la phnomnologie
de la perception, entendons dans l'ouvrage, et justement en ce
chapitre o nous avons repris la problmatique de la fonction de la
prsence dans le langage.
11. Ainsi sommes-nous invits nous interroger sur ce qui relve
du signifiant s'articuler dans la tache, dans ces petits bleus et
petits marron dont Maurice Merleau-Ponty s'enchante sous la
plume de Czanne pour y trouver ce dont le peintre entendait faire
sa peinture parlante.
Disons, sans pouvoir faire plus que de nous promettre ici de le
commenter, que la vacillation marque dans tout ce texte de l'objet
l'tre, le pas donn la vise de l'invisible, montrent assez que c'est
ailleurs qu'au champ de la perception qu'ici Maurice Merleau-
Ponty s'avance.
12. On ne peut mconnatre que ce soit intresser le champ
du dsir que le terrain de l'art prenne ici cet effet. Sauf ne pas
entendre, comme c'est le cas le plus ordinairement des psychana-
lystes eux-mmes, ce que Freud articule de la prsence maintenue
du dsir dans la sublimation.
Comment s'galer la pese subtile qui se poursuit ici d'un ros
de l'il, d'une corporalit de la lumire o ne s'voque plus que
nostalgiquement leur thologique primaut ?
Pour l'organe, de son glissement presque imperceptible du sujet
vers l'objet, faut-il pour rendre compte s'armer de l'insolence d'une
bonne nouvelle qui, de ses paraboles dclarant les forger express-
ment pour qu'elles ne soient point entendues, nous traverse de cette
vrit pourtant prendre au pied de la lettre que l'il est fait pour
ne point voir?
Avons-nous besoin du robot achev de l'Eve future, pour voir le
dsir plir son aspect non de ce qu'elle soit aveugle, comme on le
croit, mais de ce qu'elle ne puisse pas ne pas tout voir?
Inversement ce dont l'artiste nous livre l'accs, c'est la place de ce
qui ne saurait se voir : encore faudrait-il le nommer.
Quant la lumire, nous souvenant du trait dlicat dont Maurice
Merleau-Ponty en modle le phnomne en nous disant qu'elle
183
MAURICE MERLEAU-PONTY
nous conduit vers l'objet clair*, nous y reconnatrons la matire
ponyme y tailler de sa cration le monument.
Si je m'arrte l'thique implicite en cette cration, ngligeant
donc ce qui l'achve en une uvre engage, ce sera pour donner
un sens terminal cette phrase, la dernire nous en rester publie,
o elle parat se dsigner elle-mme, savoir que si les crations ne
sont pas un acquis, ce n'est pas seulement que, comme toutes choses
elles passent, c'est aussi qu'elles ont presque toutes leur vie devant
elles .
Qu'ici mon deuil, du voile pris la Piet intolrable qui le sort
me force rendre la cariatide d'un mortel, barre mon propos, fut
bris.
i. Cf. Phnomnologie de la perception, op. cit., p.357.
IV
Les quatre concepts fondamentaux
de la psychanalyse
COMPTE RENDU DU SMINAIRE I964
L'hospitalit reue de l'cole normale suprieure, un auditoire
trs accru indiquaient un changement de front de notre discours.
Pendant dix ans, il avait t dos aux capacits de spcialistes ; sans
doute seuls tmoins recevables de l'action par excellence que leur
propose la psychanalyse, mais, aussi bien, que les conditions de leur
recrutement laissent trs ferms l'ordre dialectique qui gouverne
cette action.
Nous avons mis au point un pyocvov leur usage, en l'mettant
selon une propdeutique qui n'en avanait aucun tage avant qu'ils
aient pu mesurer le bien-fond du prcdent.
C'est la prsentation que nous devions renverser, nous parut-il,
trouvant dans la crise moins l'occasion d'une synthse que le devoir
d'clairer l'abrupt du rel que nous restaurions dans le champ lgu
par Freud nos soins.
Bien loin d'tre une rduction hglienne de ce rel (sinon pour
le raffirmer comme rationnel), notre eflfort avait donn son statut
la subversion produite dans le sujet du savoir. Notre expos de cette
anne choisissait les quatre concepts qui jouent dans cette subversion
une fonction originante : l'inconscient, la rptition, le transfert, la
pulsion - pour les redfinir chacun et les montrer nous par la topo-
logie qui les soutient en une fonction commune.
Permanente donc restait la question qui fait notre projet radical :
celle qui va de : la psychanalyse est-elle une science ? : qu'est-ce qu'une
science qui inclut la psychanalyse ?
Vinconscient maintenu selon notre propos inaugural comme effet
de signifiant, et structur comme un langage, fut ici repris comme
pulsation temporelle.
187
LES QUATRE CONCEPTS FONDAMENTAUX DE LA PSYCHANALYSE
Dans la rptition fut mise au jour la fonction de xu%T| qui s'abrite
derrire son aspect d'auTnocxov : le manque la rencontre ici s'isole
comme rapport au rel.
Le transfert comme temps de fermeture li la tromperie de
l'amour, s'intgrait cette pulsation.
De la pulsion nous donnmes une thorie qui, en cette mi-
anne 65 o soudain l'on nous presse de livrer ce rsum, n'a pu
encore tre dmarque.
Raison de sa constance, topologie dite de bord, expliquant le pri-
vilge des orifices, statut d'action en retour, dissociation du but et de
l'objet, sont ici apparus pour la premire fois.
Ce tableau de chasse ne dit pas les contours ncessaires assurer
un tel nud, ni ce qu'il enserre.
Nous y marqumes une fois de plus la premption du sujet cart-
sien en tant qu'il se distingue du sujet de la connaissance comme
sujet de la certitude - et comment, revaloris par l'inconscient, il
passe au rang de pralable de l'action psychanalytique.
De mme, la pulsion scopique, pour nous servir de paradigme,
reut-elle un dveloppement particulier. Y dmontrer l'antinomie
de la vision et du regard avait le but d'y atteindre le registre, fonda-
mental pour la pense de Freud, de l'objet perdu.
Cet objet, nous l'avons formul comme la cause de cette position
du sujet que subordonne le fantasme.
Mais la parution simultane, en une rcoUation pieuse, de l'uvre
Le Visible et VInvisjble, o s'interrompait l'heure mme de son
avnement la conversion manifeste de l'interrogation de Merleau-
Ponty, devait nous solliciter de marquer la priorit qui revient aux
traits structuraux, dans tout essai d'atteinte ontique. Nous en suspen-
dmes l'approche, tout en annonant les positions subjectives de
l'tre pour l'anne venir.
On lira avec le temps les limites o nous avons fait rentrer,
par l'implication de nos dires, l'effet de relchement subi par notre
thmatique mesure d'une diffusion qui fut notre surprise ce
tournant. Cette correction intresse le sort de tout ce qui se rallie,
trop largement maintenant, sous l'enseigne du structuralisme.
Une fois de plus s'y confirme, dans le progrs de la science, la
corrlation thique dont la psychanalyse a les clefs, et dont le sort
donc est prcaire.
188
LES QUATRE CONCEPTS FONDAMENTAUX DE LA PSYCHANALYSE
C'est pourquoi notre dernier temps est revenu un fondement de
grande logique, en remettant en cause sur la base de ce lieu du Grand
Autre, promu par nous comme constituant du sujet, la notion, avilie
par l'-vau-1'eau de la critique politique, de l'alination.
1965
Hommage fait Marguerite Duras,
du ravissement de Loi V. Stein
Du ravissement,- ce mot nous fait nigme. Est-il objectif ou sub-
jectif ce que Loi V Stein le dtermine ?
Ravie. On voque l'me, et c'est la beaut qui opre. De ce sens
porte de main, on se dptrera comme on peut, avec du symbole.
Ravisseuse est bien aussi l'image que va nous imposer cette figure
de blesse, exile des choses, qu'on n'ose pas toucher, mais qui vous
fait sa proie.
Les deux mouvements pourtant se nouent dans un chiffre qui se
rvle de ce nom savamment form, au contour de l'crire : Loi
V. Stein.
LolV. Stein : ailes de papier,V ciseaux, Stein, la pierre, au jeu de la
mourre tu te perds.
On rpond : O, bouche ouverte, que veux-je faire trois bonds
sur l'eau, hors-jeu de l'amour, o plong-je ?
Cet art suggre que la ravisseuse est Marguerite Duras, nous les
ravis. Mais si, presser nos pas sur les pas de Loi, dont son roman
rsonne, nous les entendons derrire nous sans avoir rencontr per-
sonne, est-ce donc que sa crature se dplace dans un espace ddou-
bl ? ou bien que l'un de nous a pass au travers de l'autre, et qui
d'elle ou de nous alors s'est-il laiss traverser?
O l'on voit que le chiffre est nouer autrement : car pour le
saisir, il faut se compter trois.
Lisez plutt.
La scne dont le roman n'est tout entier que la remmoration,
c'est proprement le ravissement de deux en une danse qui les soude,
et sous les yeux de Loi, troisime, avec tout le bal, y subir le rapt de
son fianc par celle qui n'a eu qu' soudaine apparatre.
Et pour toucher ce que Loi cherche partir de ce moment, ne
nous vient-il pas de lui faire dire un je me deux , conjuguer
douloir avec Apollinaire ?
191
HOMMAGE FAIT MARGUERITE DURAS
Mais justement elle ne peut dire qu'elle souffre.
On pensera suivre quelque clich, qu'elle rpte l'vnement.
Mais qu'on y regarde de plus prs.
C'est voir gros qu'il est reconnaissable dans ce guet o Loi
dsormais maintes fois reviendra, d'un couple d'amants dans lequel
elle a retrouv comme par hasard, une amie qui lui fut proche avant
le drame, et l'assistait son heure mme :Tatiana.
Ce n'est pas l'vnement, mais un nud qui se refait l. Et c'est
ce que ce nud enserre qui proprement ravit, mais l encore, qui ?
Le moins dire est que l'histoire met ici quelqu'un en balance, et
pas seulement parce que c'est lui dont Marguerite Duras fait la voix
du rcit : l'autre partenaire du couple. Son nom, Jacques Hold.
Car lui non plus, n'est pas ce qu'il parat quand je dis : la voix du
rcit. Bien plutt est-il son angoisse. O l'ambigut revient encore :
est-ce la sienne ou celle du rcit?
Il n'est en tout cas pas simple montreur de la machine, mais bien
l'un de ses ressorts et qui ne sait pas tout de ce qui l'y prend.
Ceci lgitime que j'introduise ici Marguerite Duras, y ayant au
reste son aveu, dans un troisime ternaire, dont l'un des termes est le
ravissement de Loi V. Stein pris comme objet dans son nud mme,
et o me voici le tiers y mettre un ravissement, dans mon cas dci-
dment subjectif.
Ce n'est pas l un madrigal, mais une borne de mthode, que
j'entends ici affirmer dans sa valeur positive et ngative. Un sujet est
terme de science, comme parfaitement calculable, et le rappel de son
statut devrait mettre un terme ce qu'il faut bien dsigner par
son nom : la goujaterie, disons le pdantisme d'une certaine psycha-
nalyse. Cette face de ses bats, d'tre sensible, on l'espre, ceux qui
s'y jettent, devrait servir leur signaler qu'ils glissent en quelque sot-
tise : celle par exemple d'attribuer la technique avoue d'un auteur
quelque nvrose : goujaterie, et de le dmontrer comme l'adoption
explicite des mcanismes qui en font l'difice inconscient : sottise.
Je pense que, mme si Marguerite Duras me fait tenir de sa
bouche qu'elle ne sait pas dans toute son uvre d'o Loi lui vient,
et mme pourrais-je l'entrevoir de ce qu'elle me dit la phrase
d'aprs, le seul avantage qu'un psychanalyste ait le droit de prendre
de sa position, lui fut-elle donc reconnue comme telle, c'est de se
rappeler avec Freud qu'en sa matire, l'artiste toujours le prcde et
192
HOMMAGE FAIT MARGUERITE DURAS
qu'il n'a donc pas faire le psychologue l o l'artiste lui fraie la
voie.
C'est prcisment ce que je reconnais dans le ravissement de
Loi V. Stein, o Marguerite Duras s'avre savoir sans moi ce que
j'enseigne.
En quoi je ne fais pas tort son gnie d'appuyer ma critique sur
la vertu de ses moyens.
Que la pratique de la lettre converge avec l'usage de l'inconscient,
est tout ce dont je tmoignerai en lui rendant hommage.
J'assure ici celui qui Ut ces lignes la lumire de la rampe prs
de s'teindre ou revenue, voire de ces rives du futur o Jean-Louis
Barrault par ces Cahiers entend faire aborder la conjonction unique
de l'acte thtral, que du fil que je vais drouler, il n'est rien qui ne
se repre la lettre du ravissement de Loi V. Stein, et qu'un autre
travail fait ce jour mon cole ne lui permette de ponctuer. Au
reste je ne m'adresse pas tant ce lecteur que je ne m'excuse de son
for pour m'exercer au nud que je dtords.
Il est prendre la premire scne, o Loi est de son amant
proprement drobe, c'est--dire qu'il est suivre dans le thme de
la robe, lequel ici supporte le fantasme o Loi s'attache le temps
d'aprs, d'un au-del dont elle n'a pas su trouver le mot, ce mot qui,
refermant les portes sur eux trois, l'et conjointe au moment o son
amant et enlev la robe, la robe noire de la femme et dvoil sa
nudit. Ceci va-t-il plus loin? Oui, l'indicible de cette nudit qui
s'insinue remplacer son propre corps. L tout s'arrte.
N'est-ce pas assez pour que nous reconnaissions ce qui est arriv
Loi, et qui rvle ce qu'il en est de l'amour ; soit de cette image,
image de soi dont l'autre vous revt et qui vous habille, et qui vous
laisse quand vous en tes drobe, quoi tre sous ? Qu'en dire quand
c'tait ce soir-l, Loi toute votre passion de dix-neuf ans, votre
prise de robe et que votre nudit tait dessus, lui donner son clat ?
Ce qui vous reste alors, c'est ce qu'on disait de vous quand vous
tiez petite, que vous n'tiez jamais bien l.
Mais qu'est-ce donc que cette vacuit? Elle prend alors un sens :
vous ftes, oui, pour une nuit jusqu' l'aurore o quelque chose
cette place a lch : le centre des regards.
Que cache cette locution? Le centre, ce n'est pas pareil sur toutes
les surfaces. Unique sur un plateau, partout sur une sphre, sur une
193
HOMMAGE FAIT MARGUERITE DURAS
surface plus complexe a peut faire un drle de nud. C'est le
ntre.
Car vous sentez qu'il s'agit d'une enveloppe n'avoir plus ni
dedans, ni dehors, et qu'en la couture de son centre se retournent
tous les regards dans le vtre, qu'ils sont le vtre qui les sature et
qu' jamais, Loi, vous rclamerez tous les passants. Qu'on suive Loi
saisissant au passage de l'un l'autre ce talisman dont chacun se
dcharge en hte comme d'un danger : le regard.
Tout regard sera le vtre, Loi, comme Jacques Hold fascin me
dira pour lui-mme prt aimer toute Loi .
Il est une grammaire du sujet o recueillir ce trait gnial. Il
reviendra sous une plume qui l'a point pour moi.
Qu'on vrifie, ce regard est partout dans le roman. Et la femme
de l'vnement est bien facile reconnatre de ce que Marguerite
Duras la dpeint comme non-regard.
J'enseigne que la vision se scinde entre l'image et le regard, que le
premier modle du regard est la tache d'o drive le radar qu'offre
la coupe de l'il l'tendue.
Du regard, a s'tale au pinceau sur la toile, pour vous faire mettre
bas le vtre devant l'uvre du peintre.
On dit que a vous regarde, de ce qui requiert votre attention.
Mais c'est plutt l'attention de ce qui vous regarde qu'il s'agit
d'obtenir. Car de ce qui vous regarde sans vous regarder, vous ne
connaissez pas l'angoisse.
C'est cette angoisse qui saisit Jacques Hold quand, de la fentre de
l'htel de passe o il attend Tatiana, il dcouvre, la lisire du champ
de seigle en face, Loi couche.
Son agitation panique, violente ou bien rve, aurez-vous le temps
de la porter au registre du comique, avant qu'il se rassure significati-
vement, de se dire que Loi le voit sans doute. Un peu plus calme
seulement, former ce second temps qu'elle se sache vue de lui.
Encore faudra-t-il qu'il lui montre, propitiatoire la fentre,
Tatiana, sans plus s'mouvoir de ce que celle-ci n'ait rien remarqu,
cynique de l'avoir dj la loi de Loi sacrifie, puisque c'est dans la
certitude d'obir au dsir de Loi qu'il va, d'une vigueur dcuple,
besogner son amante, la chavirant de ces mots d'amour dont il sait
que c'est l'autre qui ouvre les vannes, mais de ces mots lches dont il
sent aussi qu'il n'en voudrait pas pour elle.
194
HOMMAGE FAIT MARGUERITE DURAS
Surtout ne vous trompez pas sur la place ici du regard. Ce n'est
pas Loi qui regarde, ne serait-ce que de ce qu'elle ne voit rien. Elle
n'est pas le voyeur. Ce qui se passe la ralise.
L o est le regard, se dmontre quand Loi le fait surgir l'tat
d'objet pur, avec les mots qu'il faut, pour Jacques Hold, encore
innocent.
Nue, nue sous ses cheveux noirs , ces mots de la bouche de Loi
engendrent le passage de la beaut de Tatiana la fonction de tache
intolrable qui appartient cet objet.
Cette fonction est incompatible avec le maintien de l'image nar-
cissique o les amants s'emploient contenir leur namoration, et
Jacques Hold aussitt en ressent l'effet.
Ds lors il est lisible que, vous raliser le fantasme de Loi, ils
seront de moins en moins l'un et l'autre.
Ce n'est pas, manifeste dans Jacques Hold, sa division de sujet qui
nous retiendra plus longtemps, c'est ce qu'il est dans l'tre trois o
Loi se suspend, plaquant sur son vide le je pense de mauvais rve
qui fait la matire du livre. Mais, ce faisant, il se contente de lui don-
ner une conscience d'tre qui se soutient en dehors d'elle, en Tatiana.
Cet tre trois pourtant, c'est bien Loi qui l'arrange. Et c'est pour
ce que -le je pense de Jacques -Hold vient hanter Loi d'un soin
trop proche, la fin du roman sur la route o il l'accompagne d'un
plerinage au lieu de l'vnement, - que Loi devient folle.
Dont en effet l'pisode porte des signes, mais dont j'entends faire
tat ici que je le tiens de Marguerite Duras.
C'est que la dernire phrase du roman ramenant Loi dans le
champ de seigle, me parat faire une fin moins dcisive que cette
remarque. O se devine la mise en garde contre le pathtique de la
comprhension. Etre comprise ne convient pas Loi, qu'on ne
sauve pas du ravissement.
Plus superflu reste mon commentaire de ce que fait Marguerite
Duras en donnant existence de discours sa crature.
Car la pense mme o je lui restituerais son savoir, ne saurait
l'encombrer de la conscience d'tre dans un objet, puisque cet objet,
elle l'a dj rcupr par son art.
C'est l le sens de cette sublimation dont les psychanalystes sont
encore tourdis de ce qu' leur en lguer le terme, Freud soit rest
bouche cousue.
195
HOMMAGE FAIT MARGUERITE DURAS
Seulement les avertissant que la satisfaction qu'elle emporte n'est
pas prendre pour illusoire.
Ce n'tait pas parler assez fort sans doute, puisque, grce eux, le
public reste persuad du contraire. Prserv encore, s'ils n'en vien-
nent pas professer que la sublimation se mesure au nombre
d'exemplaires vendus pour l'crivain.
C'est que nous dbouchons ici sur l'thique de la psychanalyse,
dont l'introduction dans mon sminaire fut la ligne de partage pour
la planche fragile de son parterre.
C'est devant tous pourtant qu'un jour je confessais avoir tenu, toute
cette anne, la main serre dans l'invisible, d'une autre Marguerite,
celle de UHeptamron. Il n'est pas vain que je rencontre ici cette
ponymie.
C'est qu'il me semble naturel de reconnatre en Marguerite Duras
cette charit svre et militante qui anime les histoires de Marguerite
d'Angoulme, quand on peut les lire, dcrass de quelques-uns des
prjugs dont le type d'instruction que nous recevons a pour mis-
sion expresse de nous faire cran l'endroit de la vrit.
Ici l'ide de l'histoire galante . Lucien Febvre a tent dans un
ouvrage magistral d'en dnoncer le leurre.
Et je m'arrte ce dont Marguerite Duras me tmoigne d'avoir
reu de ses lecteurs, un assentiment qui la frappe, unanime porter
sur cette trange faon d'amour : celle que le personnage dont j'ai
marqu qu'il remplit ici la fonction non du rcitant, mais du sujet,
mne en offrande Loi, comme tierce assurment loin d'tre tierce
exclue. c
Je m'en rjouis comme d'une preuve que le srieux garde encore
quelque droit aprs quatre sicles o la momerie s'est applique
faire virer par le roman la convention technique de l'amour courtois
un compte de fiction, et masquer seulement le dficit, laquelle
cette convention parat vraiment, de la promiscuit du mariage.
Et le style que vous dployez, Marguerite Duras, travers votre
Heptamron, et peut-tre facilit les voies o le grand historien que
j'ai nomm plus haut, s'efforce comprendre l'une ou l'autre de ces
histoires qu'il tient pour ce qu'elles nous sont donnes pour tre
des histoires vraies.
Tant de considrations sociologiques qui se rfrent aux varia-
tions d'un temps l'autre de la peine de vivre, sont de peu auprs de
196
HOMMAGE FAIT MARGUERITE DURAS
la relation de structure qu' tre de l'Autre, le dsir soutient l'objet
qui le cause.
Et l'aventure exemplaire qui fait se vouer jusqu' la mort l'Ama-
dor de la nouvelle X, qui n'est pas un enfant de chur, un amour,
pas du tout platonique pour tre un amour impossible, lui fut parue
une nigme moins opaque n'tre pas vue travers les idaux de
Yhappy end victorien.
Car la limite o le regard se retourne en beaut, je l'ai dcrite,
c'est le seuil de l'entre-deux-morts, lieu que j'ai dfini et qui n'est
pas simplement ce que croient ceux qui en sont loin : le lieu du mal-
heur.
C'est autour de ce lieu que gravitent, m'a-t-il sembl pour ce
que je connais de votre uvre, Marguerite Duras, les personnages
que vous situez dans notre commun pour nous montrer qu'il en est
partout d'aussi nobles que gentils hommes et gentes dames le furent
aux anciennes parades, aussi vaillants foncer, et fussent-ils pris dans
les ronces de l'amour impossible domestiquer, vers cette tache, noc-
turne dans le ciel, d'un tre offert la merci de tous... dix heures et
demie du soir en t.
Sans doute ne sauriez-vous secourir vos crations, nouvelle Mar-
guerite, du mythe de l'me personnelle. Mais la charit sans grandes
esprances dont vous les animez n'est-elle pas le fait de la foi dont
vous avez revendre, quand vous clbrez les noces taciturnes de la
vie vide avec l'objet indescriptible.
1965
Problmes cruciaux pour la psychanalyse
COMPTE RENDU DU SMINAIRE I964- I965
Le problme mis au centre tient en ces termes : l'tre du sujet
- o nous portait la pointe de nos rfrences antrieures.
Que l'tre du sujet soit refendu, Freud n'a fait que le redire sous
toutes les formes, aprs avoir dcouvert que l'inconscient ne se tra-
duit qu'en nuds de langage, a donc un tre de sujet.
C'est de la combinatoire de ces nuds qu'est franchie la censure,
laquelle n'est pas une mtaphore, de porter sur leur matriel.
D'emble Freud affirme que toute conception d'un recs de la
conscience vers l'obscur, le potentiel, voire l'automatisme, est inad-
quate rendre compte de ces effets.
Voil qui n'est rappel que pour carter toute philosophie de
l'emploi que nous avons fait cette anne du cogito, lgitime, croyons-
nous, de ce que le cogito ne fonde pas la conscience, mais justement
cette refente du sujet.
Il suffit de l'crire :
Je suis pensant : Donc je suis \
Et de constater que cette nonciation, obtenue d'une ascse,
refend l'tre, lequel, de ses deux bouts, ne se conjoint qu' manifes-
ter la torsion qu'il a subie dans son nud. Causation? Retourne-
ment ? Ngativit ? C'est cette torsion dont il s'agit de faire la topo-
logie.
Piaget et Vygotsky, du premier au second illustrent le gain qu'on
ralise repousser toute hypothse psychologique des rapports du
sujet au langage, mme quand c'est de l'enfant qu'il s'agit. Car cette
hypothse n'est que l'hypothque qu'un tre-de-savoir prend sur
l'tre-de-vrit que l'enfant a incarner partir de la batterie signi-
fiante que nous lui prsentons et qui fait la loi de l'exprience.
Mais c'est anticiper sur une structure qu'il faut saisir dans la
1. Ou : / am thinking : Therefore I atn .
199
PROBLMES CRUCIAUX POUR LA PSYCHANALYSE
synchronie, et d'une rencontre qui ne soit pas d'occasion. C'est ce
que nous fournit cet embrayage du 1 sur le 0, venu nous du point
o Frege entend fonder l'arithmtique.
De l on aperoit que l'tre du sujet est la suture d'un manque.
Prcisment du manque qui, se drobant dans le nombre, le soutient
de sa rcurrence - mais en ceci ne le supporte que d'tre ce qui
manque au signifiant pour tre l'Un du sujet : soit ce terme que
nous avons appel dans un autre contexte le trait unaire, la marque
d'une identification primaire qui fonctionnera comme idal.
Le sujet se refend d'tre la fois effet de la marque et support de
son manque.
Quelques rappels de la formalisation o se retrouve ce rsultat,
seront ici de mise.
D'abord notre axiome, fondant le signifiant : comme ce qui
reprsente un sujet [non pas pour un autre sujet, mais] pour un autre
signifiant .
Il situe le lemme, qui vient d'tre racquis d'une autre voie : le
sujet est ce qui rpond la marque par ce dont elle manque. O se
voit que la rversion de la formule ne s'opre qu' introduire un
de ses ples (le signifiant) une ngativit.
La boucle se ferme, sans se rduire tre un cercle, de supposer
que le signifiant s'origine de l'effacement de la trace.
La puissance des mathmatiques, la frnsie de notre science ne
reposent sur rien d'autre que sur la suture du sujet. De la minceur de
sa cicatrice, ou mieux encore de sa bance, les apories de la logique
mathmatique tmoignent (tnorme de Gdel), toujours au scan-
dale de la conscience.
On ne s'illusionne pas sur le fait qu'une critique ce niveau, ne
saurait dcaper la plaie des excrments, dont l'ordre de l'exploitation
sociale, qui prend assiette de cette ouverture du sujet (et ne cre donc
pas l'alination), s'emploie recouvrir ladite plaie, avec plus ou
moins de conscience. Il faut mentionner la tache qu'ici remplit,
depuis la crise ouverte du sujet, la philosophie. Servante de plus d'un
matre.
Il est d'autre part exclu qu'aucune critique portant sur la socit y
supple, puisqu'elle-mme ne saurait tre qu'une critique venant de
la socit, c'est--dire implique dans le commerce de cette sorte de
pensement que nous venons de dire.
200
PROBLMES CRUCIAUX POUR LA PSYCHANALYSE
C'est pourquoi seule l'analyse de cet objet peut l'affronter dans son
rel... qui est d'tre l'objet de l'analyse (propos de l'anne prochaine).
Nous ne nous contentons pas pourtant de suspendre ce qui serait
un aveu de forfait dans notre abord de l'tre du sujet, l'excuse d'y
retrouver sa fondation de manque.
C'est prcisment la dimension qui droute, de notre enseigne-
ment que de mettre l'preuve cette fondation, en tant qu'elle est
dans notre audience.
Car comment reculerions-nous voir que ce que nous exigeons
de la structure quant l'tre du sujet
1
, ne saurait tre laiss hors de
cause chez celui qui le reprsente minemment (pour le reprsenter
d'tre et non de pense, tout comme fait le cogito), savoir le psy-
chanalyste ?
C'est bien ce que nous trouvons dans le phnomne, notable
cette anne-l, de l'avance prise par une autre partie de notre audi-
toire nous donner ce succs, disons : de confirmer la thorie que
nous tenons pour juste, de la communication dans le langage. Nous
l'exprimons dire que le message n'y est mis qu'au niveau de celui
qui le reoit.
Sans doute faut-il faire place ici au privilge que nous tenons du
lieu doit nous sommes l'hte.
Mais ne pas oublier dans la rserve qu'inspire ce qui parat de trop
ais dans cet effet de sminaire, la rsistance qu'elle comporte, et qui
se justifie.
Elle se justifie de ce que les engagements soient d'tre et non de
pense, et que les deux bords de l'tre du sujet se diversifient ici de
la divergence entre vrit et savoir.
La difficult d'tre du psychanalyste tient ce qu'il rencontre
comme tre du sujet : savoir le symptme.
Que le symptme soit tre-de-vrit, c'est ce quoi chacun
consent, de ce qu'on sache ce que psychanalyse veut dire, quoi qu'il
soit fait pour l'embrouiller.
Ds lors on voit ce qu'il en cote l'tre-de-savoir, de reconnatre
les formes heureuses de ce quoi il ne s'accouple que sous le signe
du malheur.
i. Exigence qui ne nous parat pas de trop au regard de l'extension du rallie-
ment structuraliste.
201
PROBLMES CRUCIAUX POUR LA PSYCHANALYSE
Que cet tre-du-savoir doive se rduire n'tre que le compl-
ment du symptme, voil ce qui lui fait horreur, et ce qu' l'lider, il
fait jouer vers un ajournement indfini du statut de la psychanalyse
- comme scientifique s'entend.
C'est pourquoi mme le choc qu' clore l'anne sur ce ressort
nous produismes, n'vita pas qu' sa place se rptt le court-circuit.
Il nous en revint, d'une bonne volont vidente se parer de para-
doxe, que c'est la faon dont le praticien le pense, qui fait le symp-
tme. Bien sr est-ce vrai de l'exprience des psychologues par o
nous avons introduit le grelot. Mais c'est aussi rester, comme psy-
chothrapeute, au niveau de ce qui fait que Pierre Janet n'a jamais
pu comprendre pourquoi il n'tait pas Freud.
La dive bouteille est la bouteille de Klein. Ne fait pas qui veut,
sortir de son goulot ce qui est dans sa doublure. Car tel est construit
le support de l'tre du sujet.
5 avril 1966
Q
Rponses des tudiants en philosophie
I. CONSCIENCE ET SUJET
- Vous avez parl du mirage engendr par la confusion de la conscience et
du sujet, mirage que l'exprience psychanalytique dnonce. Or, la philosophie
parle de conscience (cogito cartsien, conscience transcendantale, conscience de
soi hglienne, cogito apodktique de Husserl, cogito pr-rflexifde Sartre...) ;
comment l'exprience psychanalytique rend-elle compte de la mconnaissance
engendre chez un sujet par le fait de s'identifier sa conscience ?
- Qu'est-ce que la conscience pour un psychanalyste ?
- Est-il possible dfaire sortir quelqu'un de sa conscience? Le sujet
d'une conscience n'est-il pas condamn elle ?
Ce dont vous dites que j'ai parl, me semble plutt extrait par
vous d'un texte que j'ai crit en hommage la mmoire de Maurice
Merleau-Ponty, le seul, j'espre, prter une confusion que je dois
clairer d'abord dans votre lecture.
J'cris que le "je pense" auquel on entend rduire la prsence
(d'aprs ce qui prcde : celle du sujet phnomnologique) ne cesse
pas d'impliquer [...] tous les pouvoirs de la rflexion par quoi se
confondent sujet et conscience . Ceci ne veut pas dire qu'il n'y a
rien l de confusionnel. En un point minent de l'ascse cartsienne,
celui que prcisment ici j'invoque, conscience et sujet concident.
C'est de tenir ce moment privilgi pour exhaustif du sujet qui est
trompeur, - d'en faire la pure catgorie que la prsence du regard
comme opacit dans le visible viendrait faire chair de la vision
(contexte de ma phrase).
C'est au contraire de ce moment de concidence lui-mme en
tant qu'il est saisi par la rflexion, que j'entends marquer la place par
203
RPONSES DES TUDIANTS EN PHILOSOPHIE
o l'exprience psychanalytique fait son entre. A seulement tre
tenu dans Le temps, ce sujet du je pense rvle ce qu'il est : l'tre
d'une chute. Je suis ce qui pense : donc je suis , l'ai-je comment
ailleurs, marquant que le donc , trait de la cause, divise inaugurale-
ment le je suis d'existence du je suis de sens.
Cette refente, c'est proprement ce dont la psychanalyse nous
donne l'exprience quotidienne. J'ai l'angoisse de la castration en
mme temps que je la tiens pour impossible. Tel est l'exemple cru
dont Freud illustre cette refente, reproduite tous les niveaux de la
structure subjective.
Je dis qu'on doit la tenir pour principielle et comme le premier
jet du refoulement originel.
Je dis que les consciences philosophiques dont vous talez la
brochette jusqu'au culmen de Sartre n'ont d'autre fonction que de
suturer cette bance du sujet et que l'analyste en reconnat l'enjeu
qui est de verrouiller la vrit (pour quoi l'instrument parfait serait
videmment l'idal que Hegel nous promet comme savoir absolu).
Le prtexte dont cette opration se pare de toujours, se trahit du
style de bon aptre dont il s'est illustr spcialement dans le discours
de Leibniz. C'est pour sauver la vrit , qu'on lui ferme la porte.
C'est pourquoi la question d'une erreur initiale dans la philo-
sophie s'impose, ds que Freud a produit l'inconscience sur la scne
qu'il lui assigne ( l'autre scne , l'appelle-t-il) et qu'il lui rend le
droit la parole.
C'est ce sur quoi Lacan revient, pour ce que cette leve du sceau
est si redoutable que ses praticiens eux-mmes ne songent qu' la
relguer. Ce droit, dis-je, l'inconscient le tient de ce qu'il structure
de langage, et je m'en expliquerais de l'clat sans fin dont Freud fait
retentir ce fait, si vous m'aviez pos la question autour des termes
inconscient et sujet.
J'eusse pu alors y apporter ce complment que cette raison mme
ne suffit pas fonder ce droit, qu'il y faut, comme au fondement de
tout droit, un passage l'acte, et que c'est devant quoi le psychana-
lyste aujourd'hui se drobe.
C'est pourquoi ce que j'enseigne, ne s'adresse pas de premier jet
aux philosophes. Ce n'est pas, si je puis dire, sur votre front que je
combats.
Car il est remarquable que vous me posiez des questions sans
204
RPONSES DES TUDIANTS EN PHILOSOPHIE
autrement vous inquiter d'o je suis fond soutenir les positions
que vous me prtez plus ou moins exactes. La place de renonciation
est essentielle ne pas lider de tout nonc, sachez-le.
Mfiez-vous donc de votre prcipitation : pour un temps encore,
l'aliment ne manquera pas la broutille philosophique. Simplement
le passage l'acte psychanalytique pourrait lui indiquer de recon-
natre la substance du ct de la pnurie.
La psychanalyse n'a pas rendre compte la philosophie de l'erreur
philosophique, comme si la philosophie partir de l devait s'en
rendre compte . Il ne peut rien y avoir de tel, puisque de se l'imagi-
ner, c'est prcisment l'erreur philosophique elle-mme. Le sujet n'y
a pas le tort de s'identifier sa conscience, comme vous me le faites
dire, Dieu sait pourquoi, mais de ne pouvoir de l que laisser chap-
per la topologie qui se joue de lui dans cette identification.
J'ai dit : topologie. Car c'est ici ce qui prvaut. Je veux dire que
sans la structure, impossible de rien saisir du rel de l'conomie de
l'investissement comme on dit, mme sans savoir ce qu'on dit.
C'est de manquer de l'laboration qu'a prpare ici pour nous
la linguistique, que Freud hsitait prendre parti sur l'origine de la
charge, qu'il distinguait dans la conscience, fort perspicace la
reconnatre pour dmesure au regard de la minceur d'piphno-
mne o entendait la rduire une certaine physiologie et s'en lib-
rant indiquer ses suivants le phnomne de l'attention pour en
dcoudre.
Index apparemment insuffisant : les psychanalystes ont rarement
su se servir d'une clef quand Freud ne leur a pas appris comment
elle ouvre. Peut-tre l'avance que j'entreprends cette anne vers un
certain objet dit petit a permettra-t-elle l-dessus quelque progrs.
J'espre donc avoir remis sa place la fonction d'une confusion
qui est d'abord dans votre question.
La suite du texte, si c'est bien celui quoi vous vous rfrez,
montre prcisment que ce qu'il vise en ce point, est le danger du
ravalement du sujet au moi. C'est cette recentration de la thorie
psychanalytique sur le moi, qu'il m'a fallu dnoncer longuement
dans une priode de sommeil de la psychanalyse, pour rendre possible
un retour Freud.
Cet accessoire dsaffect, le moi nommment, qui n'a plus servi
que d'enseigne dans la psychologie elle-mme ds qu'elle s'est vou-
205
RPONSES DES TUDIANTS EN PHILOSOPHIE
lue un peu plus objective, par quel sort tait-il relev l o l'on se
serait attendu ce que la critique en fut reprise partir du sujet?
Ceci ne se conoit que du glissement qu'a subi la psychanalyse de
se trouver confronte l'exploitation managriale de la psychologie,
spcialement dans ses usages de recrutement pour les emplois.
Le moi autonome, la sphre libre de conflits, propos comme nou-
vel Evangile par M. Heinz Hartmann au cercle de New York, n'est
que l'idologie d'une classe d'immigrs soucieux des prestiges qui
rgentaient la socit d'Europe centrale quand avec la diaspora de la
guerre ils ont eu s'installer dans une socit o les valeurs se sdi-
mentent selon l'chelle de Yincome tax.
J'anticipais donc sur la mise en garde ncessaire en promouvant
ds 1936 avec le stade du miroir un modle d'essence dj structurale
qui rappelait la vraie nature du moi dans Freud, savoir une identi-
fication imaginaire ou plus exactement une srie enveloppante de
telles identifications.
Notez pour votre propos que je rappelle cette occasion la diff-
rence de l'image l'illusoire (l' illusion optique ne commence
qu'au jugement, auparavant elle est regard objectiv dans le miroir).
Heinz Hartmann, fort cultiv en ces matires, put entendre ce
rappel ds le Congrs de Marienbad o je le profrai en 1936. Mais
on ne peut rien contre l'attrait de varier les formes du camp de
concentration : l'idologie psychologisante en est une.
Vous autres philosophes ne me semblez avoir besoin de ce registre
de mes remarques que si dj Alain ne vous a pas suffi.
Etes-vous assez difis pour me dispenser de rpondre sur les
moyens de faire sortir quelqu'un de sa conscience ? Je ne suis pas
Alphonse Allais, qui vous rpondrait : l'corcher.
Ce n'est pas sa conscience que le sujet est condamn, c'est son
corps qui rsiste de bien des faons raliser la division du sujet.
Que cette rsistance ait servi loger toutes sortes d'erreurs (dont
l'me) n'empche pas cette division d'y porter des effets vridiques,
tel ce que Freud a dcouvert sous le nom dont vacille encore l'as-
sentiment de ses disciples : la castration.
206
RPONSES DES TUDIANTS EN PHILOSOPHIE
IL PSYCHANALYSE ET SOCIT
- Quel est le rapport entre le sujet d'une praxis rvolutionnaire visant
le dpassement de son travail alin et le sujet du dsir alin ?
- Quelle est, d'aprs vous, la thorie du langage implique par le
marxisme?
- Que pensez-vous de cette expression rcente de Mannoni qui, parlant
de la cure psychanalytique, la caractrise comme l'intervention d'une insti-
tution dans une autre institution ( une rcente runion des psychothra-
peutes institutionnels) ?
- Cela pose le problme de la fonction sociale de la maladie mentale
et de la psychanalyse. Quelle est la signification sociale du fait que le psy-
chanalyste doit tre pay par l'analys ? Le psychanalyste doit-il tenir compte
du fait que sa cure est une thrapie de classe ?
Sujet du dsir alin, vous voulez dire sans doute ce que j'nonce
comme : le dsir de - est le dsir de l'Autre, ce qui est juste, ceci
prs qu'il n'y a pas de sujet de dsir. Il y a le sujet du fantasme,
c'est--dire une division du sujet cause par un objet, c'est--dire
bouche par lui, ou plus exactement l'objet dont la catgorie de la
cause tient la place dans le sujet. (
Cet objet est celui qui manquera la considration philosophique
pour se situer, c'est--dire pour savoir qu'elle n'est rien.
Cet objet est celui que nous arrivons dans la psychanalyse ce
qu'il saute de sa place, comme le ballon qui chappe de la mle
pour s'offrir la marque d'un but.
Cet objet est celui aprs quoi l'on court dans la psychanalyse, tout
en mettant toute la maladresse possible sa saisie thorique.
C'est seulement quand cet objet, celui que j'appelle l'objet petit a,
et que j'ai mis au titre de mon cours de cette anne comme l'objet
de la psychanalyse, aura son statut reconnu, qu'on pourra donner un
sens la prtendue vise que vous attribuez la praxis rvolution-
naire d'un dpassement par le sujet de son travail alin. En quoi
peut-on bien dpasser l'alination de son travail? C'est comme si
vous vouliez dpasser l'alination du discours.
207
RPONSES DES TUDIANTS EN PHILOSOPHIE
Je ne vois dpasser cette alination que l'objet qui en supporte
la valeur, ce que Marx appelait en une homonymie singulirement
anticipe de la psychanalyse, le ftiche, tant entendu que la psycha-
nalyse dvoile sa signification biologique.
Or cet objet causal est celui dont la coupe rgle prend forme
thique dans l'embourgeoisement qui scelle l'chelle plantaire le
sort de ce qu'on appelle non sans pertinence les cadres.
Trouvez l un linament de ce qui pourrait faire passer votre
question l'tat d'bauche.
Mais pour viter toute mprise, prenez acte que je tiens que la
psychanalyse n'a pas le moindre droit interprter la pratique rvo-
lutionnaire - ce qui se motivera plus loin - , mais que par contre la
thorie rvolutionnaire ferait bien de se tenir pour responsable de
laisser vide la fonction de la vrit comme cause, quand c'est l
pourtant la supposition premire de sa propre efficacit.
Il s'agit de mettre en cause la catgorie du matrialisme dialec-
tique, et l'on sait que pour ce faire les marxistes ne sont pas forts,
quoique dans l'ensemble ils soient aristotliciens, ce qui n'est dj
pas si mal.
Seule ma thorie du langage comme structure de l'inconscient,
peut tre dite implique par le marxisme, si toutefois vous n'tes pas
plus exigeants que l'implication matrielle dont notre dernire
logique se contente, c'est--dire que ma thorie du langage est vraie
quelle que soit la suffisance du marxisme, et qu'elle lui est ncessaire
quel que soit le dfaut qu'elle y laisse.
Ceci pour la thorie du langage que le marxisme implique logi-
quement.
0
Pour celle qu'il a implique historiquement. Je n'ai gure encore
vous offrir dans ma modeste information de ce qui se passe au-del
d'un certain rideau doctrinal, que trente pages de Staline qui ont mis
fin aux bats du marrisme (du nom du philologue Marr qui tenait le
langage pour une superstructure ).
Enoncs du bon sens premier concernant le langage et nomm-
ment sur ce point qu'il n'est pas une superstructure, par quoi le
marxiste se place dsormais concernant le langage trs au-dessus du
no-positivisme logicien.
Le minimum que vous puissiez m'accorder concernant ma tho-
rie du langage, c'est, si cela vous intresse, qu'elle est matrialiste.
208
RPONSES DES TUDIANTS EN PHILOSOPHIE
Le signifiant, c'est la matire qui se transcende en langage. Je vous
laisse le choix d'attribuer cette phrase un Bouvard communiste ou
un Pcuchet qu'moustillent les merveilles de l'ADN.
Car vous auriez tort de croire que je me soucie de mtaphysique
au point de faire un voyage pour la rencontrer.
Je l'ai domicile, c'est--dire dans la clinique o je l'entretiens
dans des termes qui me permettent de vous rpondre sur la fonction
sociale de la maladie mentale lapidairement : sa fonction, sociale avez-
vous bien dit, c'est l'ironie. Quand vous aurez la pratique du schizo-
phrne, vous saurez l'ironie qui l'arme, portant la racine de toute
relation sociale.
Quand cette maladie est la nvrose pourtant, l'ironie manque
sa fonction, et c'est la trouvaille de Freud de l'y avoir reconnue tout
de mme, moyennant quoi il l'y restaure dans son plein droit, ce qui
quivaut la gurison de la nvrose.
Maintenant la psychanalyse a pris la succession de la nvrose :
elle a la mme fonction sociale, mais elle aussi, elle la manque. Je
tente d'y rtablir dans sts droits l'ironie, moyennant quoi peut-tre
aussi gurirons-nous de la psychanalyse d'aujourd'hui.
Que la psychanalyse doive tre paye n'implique pas que ce soit
une thrapie de classe, mais ls deux sont tout ce qui y reste actuel-
lement de l'ironie. ^
Ceci peut passer pour une rponse trop ironique. Si vous y rfl-
chissez, elle vous paratra srement plus authentique que si je vous
renvoyais ce que j'ai dit plus haut de la fonction du ftiche.
Je m'aperois que j'ai laiss de ct Mannoni, faute de savoir
ce qu'il a dit exactement. Nous le trouverons bientt aux Temps
modernes.
III. PSYCHANALYSE ET PHILOSOPHIE
-Jusqu' quel point la psychanalyse peut-elle rendre compte de la philo-
sophie et en quel sens est-elle habilite dire que la philosophie, c'est de la
paranoa (dans un texte indit de Freud que commente Kaufmann) ?
209
RPONSES DES TUDIANTS EN PHILOSOPHIE
- Si Villusion est le dernier mot de la sublimation, quel rapport entretient-
elle avec V idologie? La sublimation n'est-elle pas une forme d'alination?
- Comment, l'intrieur de l'enseignement de la philosophie, concevez-
vous celui de la psychanalyse ?
J'en ai dj assez dit pour tre court, car tout ceci ne me plat
gure.
Que la philosophie relve de la paranoa, relve de l'tape sau-
vage de l'ironie freudienne. Ce n'est certainement pas un hasard
quand Freud la rserve l'indit (la rfrence Alphonse Allais ne
serait pas ici encore hors de saison, ne nous tonnons donc pas d'y
rencontrer Kaufinann, qui connat l'ironie).
Je regrette que vous croyiez que la sublimation est une illusion. La
moindre lecture de Freud vous convaincrait qu'il dit exactement le
contraire.
La religion, oui, une illusion, dit Freud, mais c'est qu'il y voit une
nvrose.
Je ne sais pas ce que l'on peut attendre de l'intrieur de l'ensei-
gnement de la philosophie, mais j'y ai fait rcemment une exp-
rience qui m'a laiss la proie d'un doute : c'est que la psychanalyse
ne puisse y contribuer ce qu'on appelle l'hermneutique, qu'
ramener la philosophie ses attaches d'obscurantisme.
Car faire tat de l'conomique en la matire, c'est--dire de
l'obscur (puisqu'en mme temps, l'on se targue de n'en avoir pas
l'exprience), au point mme o l'on devrait comme philosophe se
confronter l'achoppement du sujet, ceci relve <$le la mme opra-
tion dont se forme le fantasme clbre de l'homme aux rats, qui mit
deux paquets de merde sur les yeux qui, comme par hasard, taient
ceux d'Anna Freud, la fille de son psychanalyste.
Ainsi le philosophe oprerait-il avec la vrit, quand elle risque
de le voir dans sa pauvret particulire.
Mais tout ceci n'est pas aussi grave, et les vises religieuses sont ici
assez avoues (elles ne se cachent gure de nos jours) pour qu'on
puisse dire que la psychanalyse n'y est pas intresse.
210
RPONSES DES TUDIANTS EN PHILOSOPHIE
IV PSYCHANALYSE ET ANTHROPOLOGIE
- Peut-il y avoir ou y a-t-il une discipline fondamentale qui rendrait
compte de Vunit des sciences humaines ? Y a-t-il un objet unique des
sciences humaines ?
La psychanalyse peut-elle fonder une anthropologie ?
L'anthropologie la meilleure ne peut aller plus loin que de faire
de l'homme l'tre parlant. Je parle moi-mme d'une science dfinie
par son objet.
Or le sujet de l'inconscient est un tre parf, et c'est l'tre de
l'homme ; si la psychanalyse doit tre une science, ce n'est pas l un
objet prsentable.
En fait la psychanalyse rfute toute ide jusqu'ici prsente de
l'homme. Il faut dire que toutes, tant qu'elles fussent, ne tenaient
plus rien ds avant la psychanalyse.
L'objet de la psychanalyse n'est pas l'homme ; c'est ce qui lui
manque, - non pas manque absolu, mais manque d'un objet. Encore
faut-il s'entendre sur le manque dont il s'agit, c'est celui qui met
hors de question qu'on en mentionne l'objet.
Ce n'est pas le pain rare, c'est la brioche quoi une reine ren-
voyait ses peuples en temps de famine.
C'est l l'unit des sciences humaines si vous voulez, c'est--dire
qu'elle fait sourire si l'on n'y reconnat la fonction d'une limite.
Elle fait sourire d'un certain usage de l'interprtation, comme
passez-muscade de la comprhension. Une interprtation dont on
comprend les effets, n'est pas une interprtation psychanalytique. Il
suffit d'avoir t analys ou d'tre analyste pour savoir cela.
C'est pourquoi la psychanalyse comme science sera structuraliste,
jusqu'au point de reconnatre dans la science un refus du sujet.
19 fvrier 1966
Prsentation des
Mmoires d'un nvropathe
PARU EN 1966 DANS LES CAHIERS POUR L.'ANALYSE
Cette traduction tait attendue. Exactement depuis notre smi-
naire de Tanne 1955-56. Nous nous souvenons d'avoir son
annonce vu se dresser l'oreille de Mme Ida Macalpine qui en hta
sans doute celle qu'alors, avec l'aide de son fils, elle donna en anglais :
on constate qu'elle et pu prendre son temps.
Peut-tre un retard si peu motiv mrite-t-il qu'on le retienne
plus longtemps sous l'attention, ou qu'on y revienne.
Quoi qu'il en soit, ce sminaire, cinquime de notre enseigne-
ment et le troisime du toit de Sainte-Anne, nous montre, comme il
nous arrive quand nous nous reportons ces textes enregistrs, bien
des thmes nlgn seulement ncessaires alors l'largissement des
catgories reues dans notre auditoire, mais pour certains d'entre ces
thmes, la date d'o ils devaient poursuivre la carrire qui les fait
maintenant courir les revues, entendons celles du bel air, ou si l'on
veut, du bel esprit.
S'il en est qui viennent dans ces courts mots d'introduction dont
nous accompagnerons la suite de ce que donnera ici notre ami le
Dr Duquenne, ce ne sera que de s'clairer de la lumire du texte ici
produit.
Car ne l'oublions pas, du cas Schreber Freud n'a connu rien
d'autre que ce texte. Et c'est ce texte qui porte en lui tout ce qu'il a
su tirer de rvlateur en ce cas.
C'est pourquoi ce sminaire qui s'intitulait de la 4
e
des dites cinq
grandes psychanalyses de Freud, ne pouvait mieux tendre son
assiette qu' l'appuyer sur le texte mme qui lui servit d'objet. Ce
qu' notre su, nous fumes le premier faire avec cette ampleur.
Non pas, bien sr, que Mme Ida Macalpine ne prsente en pr-
puis en post-face une psychanalyse de ce texte qui se veut correc-
trice de Freud. Mais elle ne vint que pour qu'en nos deux derniers
213
PRSENTATION DES MMOIRES D'UN NVROPATHE
sminaires de l'an (27 juin-4 juillet) nous fassions rentrer Freud dans
ses droits, y revenant dans l'article o seulement deux ans aprs nous
avons resserr, en une construction trs dcisive pour la suite, peu
prs les deux tiers de la matire couverte dans l'anne. Il s'agit de
l'article auquel on peut se reporter sur la question prliminaire
tout traitement possible de la psychose
l
.
Disons que le texte de Schreber est un grand texte freudien, au
sens o, plutt que ce soit Freud qui l'clair, il met en lumire la
pertinence des catgories que Freud a forges, pour d'autres objets
sans doute, et d'un point pour la dfinition duquel il ne suffit pas
d'invoquer le gnie, moins que l'on n'entende par l une longue
aisance garde l'endroit du savoir.
Certes Freud ne rpudierait pas la mise son compte de ce texte,
quand c'est dans l'article o il le promeut au rang de cas qu'il
dclare qu'il ne voit ni indignit, ni mme risque, se laisser guider
par un texte aussi clatant, dt-il s'exposer au reproche de dlirer
avec le malade, qui ne semble gure l'mouvoir.
L'aise que Freud se donne ici, c'est simplement celle, dcisive en
la matire, d'y introduire le sujet comme tel, ce qui veut dire ne pas
jauger le fou en termes de dficit et de dissociation des fonctions.
Alors que la simple lecture du texte montre avec vidence qu'il n'est
rien de pareil en ce cas.
C'est bien l pourtant que le gnie, s'il est cette aise, ne suffit pas
encore. Car pour construire le sujet comme il convient partir de
l'inconscient, c'est de logique qu'il s'agit, comme il suffit d'entrou-
vrir un livre de Freud pour s'en apercevoir, et dont il ne reste pas
moins que nous soyons le premier en avoir feit la remarque.
Faire crdit au psychotique ne serait rien de plus en ce cas, que ce
qui restera de tout autre, aussi libralement trait : enfoncer une
porte ouverte, n'est absolument pas savoir sur quel espace elle ouvre.
Quand nous lirons plus loin sous la plume de Schreber que c'est
ce que Dieu ou l'Autre jouisse de son tre passive, qu'il donne lui-
mme support, tant qu'il s'emploie ne jamais en lui laisser flchir
une cogitation articule, et qu'il suffit qu'il s'abandonne au rien-
penser pour que Dieu, cet Autre fait d'un discours infini, se drobe,
i. D'une question prliminaire tout traitement possible de la psychose , in
crits, d. du Seuil, 1966, p. 531-583.
214
PRSENTATION DES MMOIRES D'UN NVROPATHE
et que de ce texte dchir que lui-mme devient, s'lve le hur-
lement qu'il qualifie de miracul comme pour tmoigner que la
dtresse qu'il trahirait n'a plus avec aucun sujet rien faire, - ne
trouve-t-on pas l suggestion s'orienter des seuls termes prcis que
fournit le discours de Lacan sur Freud?
La thmatique que nous mesurons la patience qu'exige le ter-
rain o nous avons la faire entendre, dans la polarit, la plus rcente
s'y promouvoir, du sujet de la jouissance au sujet que reprsente le
signifiant pour un signifiant toujours autre, n'est-ce pas l ce qui va
nous permettre une dfinition plus prcise de la paranoa comme
identifiant la jouissance dans ce lieu de l'Autre comme tel.
Voil-t-il pas que le texte de Schreber s'avre un texte inscrire
dans le discours lacanien, il faut le dire aprs un long dtour o
c'est d'ailleurs que ce discours a rassembl ses termes. Mais la
confirmation en est du mme aloi que celle qu'en reoit le discours
de Freud, ce qui n'est gure surprenant, puisque c'est le mme
discours.
A vrai dire, cette traduction vient clairer ce discours le plus
rcent, exactement comme il en fut pour le discours premier de
Freud. C
Elle nous permettra quant nous, peut-tre de reprendre le fil qui
nous a conduit l'aventure freudienne. Soit cette tranche ouverte
avec notre thse, ce cas Aime que nous n'inscrivons pas dans le
recueil qui parat de nos crits.
O remarquera peut-tre en effet, mentionne en quelques
points de ce recueil, cette phase de notre rflexion qui fut d'abord
celle d'un psychiatre, laquelle s'armait du thme de la connaissance
paranoaque. A nous aider en cette collation, quelqu'un a dj not
que nous n'clairons gure cette notion dont il reste fort peu de
traces.
Quelle belle carrire d'essayiste nous eussions pu nous faire avec
ce thme favorable toutes les modulations de l'esthtique ! Qu'on
se rappelle seulement ce que savait en drouler notre ami Dali.
Certes la connaissance paranoaque est de tout ce qui se pare
d'tre connaissance, la moins obscne, mais ce n'est pas pour dimi-
nuer son obtusion.
Selon un rythme dont nous avons pris l'habitude, notre thse
commena d'tre lue aprs dix ans dans des lieux d'avant-garde
215
PRSENTATION DES MMOIRES D'UN NVROPATHE
comme l'asile de Saint-Alban, et bien entendu la Clinique de la
Facult de Paris (1932-1942).
Il fallut que l'insuffisance de l'enseignement psychanalytique
clatt au grand jour pour nous engager dans sa tache. 1956-1966
marquent le mme cart. Encore nous reste-t-il deux ans pour don-
ner la question prliminaire sa pleine suite.
Qu'est-ce dire, sinon que nous ne nous sommes jamais intres-
ss qu' la formation de sujets capables d'entrer dans une certaine
exprience que nous avons appris centrer o elle est?
O elle est - comme constitue par la vraie structure du sujet -
qui comme telle n'est pas entire, mais divise, et laissant choir un
rsidu irrductible, dont l'analyse logique est en train.
Or il est facile d'introduire la pense cette structure, aussi facile
que d'introduire un enfant, d'un ge relativement prcoce (dans le
dveloppement scolaire, sinon dans les phases analytiques), l'tude
des mathmatiques par la thorie des ensembles.
C'est au niveau de la mathmatique en train de se faire que com-
mencent les affres.
Ainsi peut-on donner l'ide de la rsistance que rencontre chez
les psychanalystes la thorie d'o dpend leur formation mme.
A ceci prs qu'ici le rsidu irrductible de la constitution du sujet
est port au maximum de son emploi anxiogne par la fonction psy-
chanalysante.
Un type d'actes manques, les seuls peut-tre mriter leur nom
puisque dans la nvrose ils sont des actes russis, un type d'actes
manques exprs saille trs videmment au sein de la transmission
thorique qu'implique la formation du psychanalyste.
C'est l, on le conoit, domaine o la preuve est la plus dlicate,
mais comment n'en pas voir une dans cette invraisemblable indif-
frence au texte des Mmoires du prsident Schreber - qui fait
qu'en anglais il a t publi par une hors-groupe (Mme Ida Macal-
pine au titre d'lve d'Edward Glover, tenant trop vif de quelques
exigences scientifiques, n'est pas inscrite, sauf nouveaut, la socit
de Londres), qu'en France c'est en une zone combien sensible mais
de frange par rapport un groupe (celui qu'assure notre enseigne-
ment), zone que reprsentent les Cahiers pour l'analyse, que viennent
au jour enfin les Mmoires auxquels nous avons consacr tant de
soins.
216
PRSENTATION DES MMOIRES D'UN NVROPATHE
Puissent-ils rappeler ceux qui peuvent aller jusqu' entendre
ce que nous avons dit de l'implication dans le symptme du sujet
suppos savoir, la veille d'une journe sur la clinique, comme le fait
que la conception du trouble psychiatrique est affaire du clinicien,
- ce qu'impose le seul abord de ce texte poignant.
C'est que ledit clinicien doit s'accommoder une conception
du sujet, d'o il ressort que comme sujet il n'est pas tranger au
lien qui le met pour Schreber, sous le nom de Flechsig, en position
d'objet d'une sorte d'rotomanie mortifiante, et que la place o il
se tient dans la photographie sensationnelle dont s'ouvre le livre
d'Ida Macalpine, soit devant l'image murale gante d'un cerveau, a
en l'affaire un sens.
Il ne s'agit l de nul accs une ascse mystique, non plus que
d'aucune ouverture efiusive au vcu du malade, mais d'une position
quoi seule introduit la logique de la cure.
L'objet de la psychanalyse
COMPTE RENDU DU SMINAIRE 1965-1966
Le sminaire de cette anne s'est occup, suivant sa ligne, de la
fonction longtemps repre dans l'exprience psychanalytique au
titre de la relation dite d'objet.
On y professe qu'elle domine pour le sujet analysable sa relation
au rel, et les objets oral ou anal y sont promus, aux dpens d'autres,
dont le statut pourtant manifeste, y demeure incertain.
C'est que si les premiers reposent directement sur la relation de
la demande, bien propice l'intervention corrective, les autres exi-
gent une thorie plus complexe, puisque n'y peut tre mconnue
une division du sujet, impossible rduire par les seuls efforts de la
bonne intention : tant la division mme dont se supporte le dsir.
Ces autres objets, nommment le regard et la voix (si nous lais-
sons venir l'objet enjeu dans la castration), font corps avec cette
division du sujet et en prsentifient dans le champ mme du peru
la partie lide comme proprement libidinale. Comme tels, ils font
reculer l'apprciation de la pratique, qu'intimide leur recouvrement
par la' relation spculaire, avec les identifications du moi qu'on y veut
respecter.
Ce rappel suffit motiver que nous ayons insist de prfrence
sur la pulsion scopique et sur son objet immanent : le regard.
Nous avons donn la topologie qui permet de rtablir la prsence
du percipiens lui-mme dans le champ o il est pourtant perceptible,
quand ne l'est mme que trop dans les effets de la pulsion (exhibi-
tion et voyeurisme).
Cette topologie qui s'inscrit dans la gomtrie projective et les
surface de Yanalysis situs, n'est pas prendre comme il en est des
modles optiques chez Freud, au rang de mtaphore, mais bien pour
reprsenter la structure elle-mme. Elle rend compte de l'impuret
du perceptum scopique, en retrouvant ce que nous avions cru pouvoir
indiquer de la prsence du percipiens, irrcusable de la marque qu'elle
219
L'OBJET DE LA PSYCHANALYSE
emporte du signifiant, quand elle se montre monnaye dans le ph-
nomne jamais conu de la voix psychotique.
L'exigence absolue, en ces deux points, d'une thorie du dsir
nous reporte la rectification des flchissements de la pratique,
l'autocritique ncessaire de la position de l'analyste, qui va aux
risques attachs sa propre subjectivation, s'il veut rpondre honn-
tement fut-ce seulement la demande.
Petit discours l'ORTF
DIFFUS LE 2 DCEMBRE 1966
Je rponds ici une question que m'a pose Georges Charbon-
nier sur le manifeste que constitue le discours qui date de 1953 et
qu'on appelle mon discours de Rome, lieu propice en effet l'issue
de la psychanalyse comme science.
Parole et langage, oui, sont avec ce discours au centre de ces crits
qui sont ceux d'un psychanalyste.
J'ai t appel par les conditions difficiles qu'a rencontres le
dveloppement de cette pratique en France, y prendre une posi-
tion qui est une position d'enseignement.
Cette position part des faits, et pour cela il a fallu qu'elle y
retourne.
Des faits, cela veut dire des faits examins pour voir en quoi ils
consistent : c'est dire encore des faits scientifiquement tablis.
Mme sans le savoir, tout le monde tient maintenant pour des
faits, ce qui ne fut longtemps que rebuts purs et simples : ce qu'on
appelait les actes manques ; de mme pour ce qui s'tait rduit la
porte d'objets curieux qu'un amateur faisait valoir d'un coup de
revers de manche : les rves. Remarquons que tout le monde sait le
nom de Freud grce qui notre ide des choses s'est ainsi compl-
te. On souponne encore que pour le mot d'esprit, Freud a apport
quelque chose qui ne permet plus d'en considrer l'effet de rire
comme futile, et qu'il est devenu par l un fait digne d'une consid-
ration autre que purement philosophique.
Sur quoi ce changement repose-t-il?
Qu'on aille y voir dans les textes originaux, dans les textes de
Freud lui-mme, non pas dans ceux des ombres heureuses qui se
sont mises prophtiser de sa bonne nouvelle, ni des exploitants qui
leur ont succd : on verra que ces faits dans Freud sont tablis
comme des faits de langage.
Les rves s'y traduisent comme une version au collge, grce un
221
PETIT DISCOURS L'ORTF
dictionnaire que chacun a dans sa tte et qui s'appelle l'association
libre : association libre de quoi ? de ce qu'il lui vient raconter.
Mais ce ne sont pas les choses ici qui Freud donnent le sens, mais
les points de concours qui se dgagent d'un texte, et d'une sorte de
dcalque dont il rapplique le mot sur le mot, la phrase sur la phrase,
le verbal sur le verbal, ceci jusqu'au calembour.
Les obtus disent maintenant qu'il s'agit l du prconscient. C'est
justement dans la fonction de ce qui le tourmente, ce prconscient,
de ce qui fait sa sensation lui, Freud le formule en ces termes,
que le prconscient rencontre des mots dont il n'a pas le contrle.
D'o lui viennent-ils? Prcisment de l'inconscient o il gte
comme refoul, Freud ne le dit pas autrement.
Que ces mots ne soient pas la drive, c'est--dire que leur drive
ne relve que d'une loi des mots - d'une logique radicale que je
tente d'tablir, voil qui va une rvision totale de tout ce qui a pu
se penser jusqu'ici de la pense.
Disons que la pense ne peut plus tre le sujet, au sens lgu par
la philosophie. A savoir la fonction de la conscience, telle qu'elle
devient dans l'idologie volutionniste aussi bien que dans l'ida-
lisme existentialiste, en deux sens d'ailleurs impossibles conjoindre,
la raison d'tre du monde.
Il n'y a rien faire contre l'volutionnisme : l'homme continuera
se croire la fleur de la cration, c'est la croyance fondamentale de
ce qui le constitue comme tre religieux. De mme qu'il fallait que
la fivre existentialiste couvrit un moment, celui de l'aprs-dernire
guerre - o la conscience de tous et de chacun n'avait pas trs bonne
mine. Toute une jeunesse a support son loisir forc de se sentir
fortement-en-situation, c'est une forme de la prire. La cabale des
dvots n'est pas l o la dnoncent ceux qui parlent d'humeur, c'est-
-dire tort et travers.
Tout ceci n'a aucune raison d'arrter le mouvement de la science
qui consiste toujours inaugurer un calcul d'o soit limin tout
prjug au dpart.
Aprs cela, le savant n'a plus qu' suivre. Son inconscient ne lais-
sera pas le calcul s'arrter, justement du fait que les prsupposs du
calcul auront laiss en blanc la place o il pourra jouer.
On peut s'tonner ici que je semble mconnatre la part de l'ex-
prience au sens physique dont ce mot rsonne, mais c'est justement
222
PETIT DISCOURS L'ORTF
que je ne la mconnais pas : l'exprience de l'inconscient prise au
niveau o je l'installe, ne se distingue pas de l'exprience physique.
Elle est aussi extrieure au sujet, celui-ci tant pris au sens tradition-
nel. Je la dsigne au lieu de l'Autre : l'inconscient est le discours de
l'Autre, est ma formule.
Il est structur comme un langage : ce qui est plonasme ncessit
pour me faire entendre, puisque langage est la structure.
L'inconscient n'est pas pulsation obscure du prtendu instinct,
ni cur de l'tre, mais seulement son habitat.
Non seulement le langage est un milieu aussi rel que le monde dit
extrieur, mais il faut tre aussi crtinis qu'on l'est par les imagina-
tions o se sont constitues jusqu'ici la thorie de la connaissance et
les prtendues mthodes concrtes de l'ducation, pour luder ce fait
massif (mais justement il ne devient un fait qu'une fois support d'une
condition scientifique) que l'homme crot fait sa croissance - autant
immerg dans un bain de langage que dans le milieu dit naturel.
Ce bain de langage le dtermine avant mme qu'il soit n. Ceci
par l'imermdiaire du dsir o ses parents l'accueillent comme un
objet, qu'ils le veuillent ou pas, privilgi. Ce que le moindre veil
clinique permet d'apercevoir dans ses consquences incalculables
jusqu'ici, mais sensibles dans tous les tres, et ce qu'ignorent les
patouillages du religieux comme du mdecin concernant la rgula-
tion des naissances.
Or, le dsir n'est pas la passion inutile , o se formule l'impuis-
sance le penser, des thoriciens de l'intention existentielle.
Le dsir est proprement la passion du signifiant, c'est--dire Peffet
du signifiant sur l'animal qu'il marque et dont la pratique du langage
fait surgir un sujet - un sujet non pas simplement dcentr, mais
vou ne se soutenir que d'un signifiant qui se rpte, c'est--dire
comme divis.
D'o cette autre formule : le dsir de l'homme (si l'on peut dire),
c'est le dsir de l'Autre. En l'Autre est la cause du dsir, d'o
l'homme choit comme reste.
Tout ceci s'nonce en une suite scientifique partir du moment
o il y a une science du langage aussi fonde et aussi sre que la
physique, ce qui est le cas au point o en est la linguistique - c'est le
nom de cette science - d'tre considre partout maintenant pour
ce qui est du champ humain comme une science pilote.
223
PETIT DISCOURS L'ORTF
On a entendu qu' humain et homme nous mettons des
guillemets pour autant que dans ce que reprsentent ces termes est
dj prsent l'effet du langage, et qu'ils doivent donc rester en sus-
pens tant que la science ncessite par l'effet de l'inconscient, ne sera
pas plus assure dans sa mthode et ses principes.
Ainsi le fondement de l'histoire marxiste, savoir l'alination que
la production en tant que telle introduit dans le sujet, trouve-t-il ici
un supplment qui n'est pas moins matrialiste, au sens o nulle
pure et simple intentionnalit, nulle plus ou moins bonne intention
ne peut des effets de l'inconscient surmonter les tours.
Ces propos indiquent seulement une direction de travail : qui
ne concerne que ceux-l qui peuvent y fonctionner. C'est bien
pourquoi nous n'avons pas cru devoir rassembler nos crits pour un
plus vaste public que celui auquel ils s'adressaient : savoir les psy-
chanalystes -jusqu' maintenant.
Soit avant que parmi ceux-ci se ft opre la scission, mme
si pour beaucoup d'entre eux elle n'est pas encore claire, par o
certains se dcident enfin reconnatre dans tout ce que Freud a
apport de fulgurant en psychologie, l'effet de cisaille que le langage
apporte dans les fonctions de l'animal qui parle : par tout cet tage-
ment de structures que j'ai dcrites sous leur nom le plus commun,
car elles s'appellent la demande et le dsir, en tant qu'elles remanient
radicalement le besoin.
Ainsi proprement se conoit la succession de ces phases diverse-
ment interferentes que Freud a isoles comme pulsions. Ainsi peut
tre correctement men le remaniement dans ^pratique psychana-
lytique.
Que Freud montre que ces effets de cisaillage sont majeurs dans
ce qu'on doit appeler la pratique sexuelle de l'tre parlant, ceci
n'implique aucune dcouverte concernant la biologie du sexe, et
tous ceux qui ont fait faire quelques pas ce chapitre de la biologie,
le plus difficile, rient des bafouillages auxquels la psychanalyse jus-
qu' ce jour, donne crdit dans le public.
Une logomachie qui traite des rapports entre l'homme et la
femme partir d'une harmonie analogique qui s'originerait de ceux
du spermatozode et de l'ovule, parat simplement grotesque ceux
qui savent tout ce qui s'tage de fonctions complexes et de ques-
tions irrsolues entre ces deux niveaux d'une polarit, la polarit du
224
PETIT DISCOURS L'ORTF
sexe dans le vivant, qui reprsente en elle-mme peut-tre l'chec
du langage.
Une telle psychanalyse met la notion la plus confuse d'une matu-
ration instinctuelle au service d'une obscure prcherie sur le don qui
impose ses effets au patient par la suggestion la plus grossire, celle
qui rsulte de ce consentement confus qui prend ici nom de morale.
La seule chose qui reste sans explication dans cet obscurantisme
sans prcdent, c'est comme les effets de la rgression dite galement
instinctuelle, effets qui marquent dans le fait le progrs du traite-
ment, auraient pour rsultat cette prtendue maturation.
Les choses apparaissent sous un tout autre aspect chez moi o
l'on dit qu'il s'agit de rvler la structure du dsir, et ceci en tant
que justement le sexualise l'impuissance du langage rendre raison
du sexe.
Les choses sont aussi plus honntement poses quand on ne pro-
met pas du mme lan la leve de telle interdiction inconsciente
entravant la pratique sexuelle, et la solution du monde de problmes
que soulgve le rapport d'un homme et d'une femme dans le moindre
conjungo.
Ce que je dis l, tout le monde le sait, mais chacun ne s'en berce
que plus aisment d'un raccommodage des superstitions les plus
cules.
On n'y peut rien, et le mauvais usage de toute vrit est son
cueil le plus ordinaire. Mon livre n'en fait tat qu'incidemment.
Mes Ecrits rassemblent les bases de la structure dans une science
qui est construire - et structure veut dire langage - , pour autant
que le langage comme ralit fournit ici les fondements.
Le structuralisme durera ce que durent les roses, les symbolismes
et les Pmasses : une saison littraire, ce qui ne veut pas dire que
celle-ci ne sera pas plus fconde.
La structure, elle, n'est pas prs de passer parce qu'elle s'inscrit
dans le rel, ou plutt qu'eue nous donne une chance de donner un
sens ce mot de rel, au-del du ralisme qui, socialiste ou non,
n'est toujours qu'un effet de discours.
Si je maintiens le terme de sujet pour ce que construit cette
structure, c'est pour que ne reste aucune ambigut sur ce qu'il s'agit
d'abolir, et qu'il s'abolisse, au point que son nom soit raffect ce
qui le remplace.
225
PETIT DISCOURS L'ORTF
Et je n'aurai pas encore publi ce recueil de mes crits, si ce qui
s'y met, et spcialement depuis quinze ans, d'tre reu par moi
du lieu de l'Autre o s'inscrit le discours de ceux que j'coute et
dans les termes o chaque psychanalyste reconnat ceux-l mmes
que chaque semaine lui fournit mon sminaire, n'avait fini par cou-
rir tout seul hors du champ o on peut le contrler. Malgr moi,
je dois le dire, mais non sans quelque raison, puisqu'en cet ensei-
gnement se joue le sort qu' tous rserve l'avenir de la science,
laquelle court aussi, et bien en avant de la conscience que nous
avons de ses progrs.
Il me fallait par ces crits mettre une barrire aux convoitises
maintenant en route des faussaires toujours de service sous la bannire
de l'Esprit.
V
c
Acte de fondation
Je fonde - aussi seul que je l'ai toujours t dans ma relation
la cause psychanalytique - l'Ecole franaise de psychanalyse, dont
j'assurerai, pour les quatre ans venir dont rien dans le prsent ne
m'interdit de rpondre, personnellement la direction.
Ce titre dans mon intention reprsente l'organisme o doit
s'accomplir un travail - qui, dans le champ que Freud a ouvert, res-
taure le soc tranchant de sa vrit - qui ramne la praxis originale
qu'il a institue sous le nom de psychanalyse dans le devoir qui lui
revient e^notre monde - qui, par une critique assidue, y dnonce
les dviations et les compromissions qui amortissent son progrs en
dgradant son emploi.
Cet objectif de travail est indissoluble d'une formation dispenser
dans ce mouvement de reconqute. C'est dire qu'y sont habilits de
plein droit ceux que moi-mme j'ai forms, qu'y sont convis tous
ceux qui peuvent contribuer mettre de cette formation le bien-
fond de l'preuve.
Ceux qui viendront dans cette cole s'engageront remplir une
tache soumise un contrle interne et externe. Ils sont assurs en
change que rien ne sera pargn pour que tout ce qu'ils feront de
valable, ait le retentissement qu'il mrite, et la place qui conviendra.
Pour l'excution du travail, nous adopterons le principe d'une
laboration soutenue dans un petit groupe. Chacun d'eux (nous
avons un nom pour dsigner ces groupes) se composera de trois per-
sonnes au moins, de cinq au plus, quatre est la juste mesure. PLUS
UNE charge de la slection, de la discussion et de l'issue rserver
au travail de chacun.
Aprs un certain temps de fonctionnement, les lments d'un
groupe se verront proposer de permuter dans un autre.
La charge de direction ne constituera pas une chefferie dont le
service rendu se capitaliserait pour l'accs un grade suprieur,
229
ACTE DE FONDATION
et nul n'aura se tenir pour rtrograd de rentrer dans le rang d'un
travail de base.
Pour la raison que toute entreprise personnelle remettra son
auteur dans les conditions de critique et de contrle o tout travail
poursuivre sera soumis l'cole.
Ceci n'implique nullement une hirarchie la tte en bas, mas une
organisation circulaire dont le fonctionnement, facile programmer,
s'affermira l'exprience.
Nous constituons trois sections dont j'assurerai la marche avec
deux collaborateurs me secondant pour chacune.
1. SECTION DE PSYCHANALYSE PURE, soit praxis et doctrine de la
psychanalyse proprement dite, laquelle est et n'est rien d'autre - ce
qui sera tabli en son lieu - que la psychanalyse didactique.
Les problmes urgents poser sur toutes les issues de la didac-
tique trouveront ici se frayer la voie par une confrontation entre-
tenue entre des personnes ayant l'exprience de la didactique et
des candidats en formation. Sa raison d'tre tant fonde sur ce qu'il
n'y a pas voiler : savoir le besoin qui rsulte des exigences profes-
sionnelles chaque fois qu'elles entranent l'analys en formation
prendre une responsabilit si peu que ce soit analytique.
C'est l'intrieur de ce problme et comme un cas particulier
que doit tre situ celui de l'entre en contrle. Prlude dfinir ce
cas sur des critres qui soient autres que de l'impression de tous et
du prjug de chacun. Car on sait que c'est actuellement sa seule
loi, quand la violation de la rgle implique dans l'observance de ses
formes est permanente.
Ds le dpart et en tout cas un contrle qualifi sera dans ce cadre
assur au praticien en formation dans notre cole.
Seront proposs l'tude ainsi instaure les traits par o je romps
moi-mme avec les standards affirms dans la pratique didactique,
ainsi que les effets qu'on impute mon enseignement sur le cours
de mes analyses quand c'est le cas qu'au titre d'lves mes analyss y
assistent. On y inclura, s'il le faut, les seules impasses retenir de ma
position dans une telle cole, savoir celles que l'induction mme
quoi vise mon enseignement, engendrerait dans son travail.
230
ACTE DE FONDATION
Ces tudes, dont la pointe est la mise en question de la routine
tablie, seront colliges par le directoire de la section qui veillera aux
voies les plus propices soutenir les effets de leur sollicitation.
Trois sous-sections :
- Doctrine de la psychanalyse pure ;
- Critique interne de sa praxis comme formation ;
- Contrle des psychanalystes en formation.
Je pose enfin en principe de doctrine que cette section, la premire,
comme aussi bien celle dont je dirai au titre 3 la destination, ne s'arr-
tera pas en son recrutement la qualification mdicale, la psychanalyse
pure n'tant pas en elle-mme une technique thrapeutique.
2. SECTION DE PSYCHANALYSE APPLIQUE, ce qui veut dire de th-
rapeutique et de clinique mdicale.
Y seront des groupes mdicaux, qu'ils soient ou non composs
de sujets psychanalyss, pour peu qu'ils soient en mesure de contri-
buer l'exprience psychanalytique ; par la critique de ses indica-
tions dans ses rsultats, - par la mise l'preuve des termes catgo-
riques et des structures que j'y ai introduits comme soutenant le
droit-fil de la praxis freudienne, - ceci dans l'examen clinique, dans
les dfinitions nosographiques, dans la position mme des projets
thrapeutiques.
Ici encore trois sous-sections :
- Doctrine de la cure et de ses variations ;
- Casuistique ;
- Information psychiatrique et prospection mdicale.
Un directoire pour authentifier chaque travail comme de l'cole,
et tel que sa composition exclue tout conformisme prconu.
3. SECTION DE RECENSEMENT DU CHAMP FREUDIEN.
Elle assurera d'abord le compte rendu et la censure critique de
tout ce qu'offirent en ce champ les publications qui s'y prtendent
autorises.
Elle entreprendra la mise au jour des principes dont la praxis
231
ACTE DE FONDATION
analytique doit recevoir dans la science son statut. Statut qui, si parti-
culier qu'il faille enfin le reconnatre, ne saurait tre celui d'une
exprience ineffable.
Elle appellera enfin instruire notre exprience comme la com-
muniquer ce qui du structuralisme instaur dans certaines sciences
peut clairer celui dont j'ai dmontr la fonction dans la ntre, -
en sens inverse ce que de notre subjectivation, ces mmes sciences
peuvent recevoir d'inspiration complmentaire.
A la limite, une praxie de la thorie est requise, sans laquelle
l'ordre d'affinits que dessinent les sciences que nous appelons
conjecturales, restera la merci de cette drive politique qui se
hausse de l'illusion d'un conditionnement universel.
Donc encore trois sous-sections :
- Commentaire continu du mouvement psychanalytique ;
-Articulation aux sciences affines;
- Ethique de la psychanalyse, qui est la praxis de sa thorie.
Le fonds financier constitu d'abord par la contribution des
membres de l'Ecole, par les subventions qu'elle obtiendra ventuel-
lement, voire les services qu'elle assurera en tant qu'Ecole, sera
entirement rserv son effort de publication.
Au premier rang un annuaire rassemblera les titres et le rsum
des travaux, o qu'ils aient paru, de l'Ecole, annuaire o figureront
sur leur simple demande tous ceux qui y auront t en fonction.
On adhrera l'Ecole en s'y prsentant en un groupe de travail
constitu comme nous l'avons dit.
L'admission au dpart sera dcide par moi-mme sans que je
tienne compte des positions prises par quiconque dans le pass
l'endroit de ma personne, sr que je suis que ceux qui m'ont quitt,
ce n'est pas moi qui leur en veux, c'est eux qui m'en voudront tou-
jours plus ne pouvoir en revenir.
Ma rponse au reste ne concernera que ce que je pourrai pr-
sumer ou constater sur titres de la valeur du groupe et de la place
qu'il entendra remplir d'abord.
L'organisation de l'Ecole sur le principe de roulement que j'ai
indiqu, sera livre par les soins d'une commission agre par une
premire assemble plnire qui se tiendra dans un an. Cette com-
232
ACTE DE FONDATION
mission l'laborera sur l'exprience parcourue l'chance de la
deuxime anne, o une seconde assemble aura l'approuver.
Il n'est pas ncessaire que les adhsions couvrent l'ensemble
de ce plan pour qu'il fonctionne. Je n'ai pas besoin d'une liste
nombreuse, mais de travailleurs dcids, comme j'en suis d'ores et
dj.
21 juin 1964
NOTE ADJOINTE
Cet acte de fondation tient pour nant de simples habitudes. Il a
paru pourtant laisser ouvertes quelques questions ceux que ces
habitudes rgissent encore.
Un guide de l'usager, en 7 titres, donne ici les rponses les plus
sollicites, - d'o l'on supposera les questions qu'elles dissipent.
1. Du didacticien
Un psychanalyste est didacticien de ce qu'il a fait une ou plu-
sieurs psychanalyses qui se sont avres didactiques.
C'est une habilitation de fait, qui s'est toujours passe ainsi en fait
et qui ne relve de rien de plus que d'un annuaire entrinant des
faits, sans mme qu'il ait se prtendre exhaustif.
L'usage du consentement des pairs est rendu caduc d'avoir permis
l'introduction toute rcente de ce qu'on appelle la liste , ds lors
qu'une socit a pu utiliser celle-ci des fins qui mconnaissaient de
la faon la plus claire les conditions mmes de l'analyse entre-
prendre comme de l'analyse en cours.
Conditions dont l'essentielle est que l'analys soit libre de choisir
son analyste.
233
ACTE DE FONDATION
2. De la candidature VEcole
Autre chose est la candidature une cole, autre chose la quali-
fication d'une psychanalyse didactique.
La candidature l'Ecole exige une slection rgler selon ses buts
de travail.
La charge en sera tenue au dpart par un simple comit d'accueil,
dit Cardo, c'est--dire gond dit en latin, ce qui en indique l'esprit.
Rappelons que la psychanalyse didactique n'est exige que pour
la premire section de l'cole, si elle est souhaitable pour toutes.
3 .De la psychanalyse didactique
La qualification d'une psychanalyse comme didactique s'est prati-
que jusqu' prsent par une slection, dont il sufft, pour la juger, de
constater qu'elle n'a permis d'articuler aucun de ses principes depuis
qu'elle dure.
Aucun n'a plus de chances de se dgager dans l'avenir, sauf
rompre d'abord avec un usage qui s'offre la drision.
Le seul principe certain poser et d'autant plus qu'il a t
mconnu, est que la psychanalyse est constitue comme didactique
par le vouloir du sujet, et qu'il doit tre averti que l'analyse contes-
tera ce vouloir, mesure mme de l'approche du dsir qu'il recle.
4. De la psychanalyse didactique dans la participation a VEcole
Ceux qui entreprennent une psychanalyse didactique le font de
leur chef et de leur choix.
Le titre 1 de cette note implique mme qu'ils peuvent tre en
position d'autoriser leur psychanalyste comme didacticien.
Mais l'admission l'cole leur impose la condition qu'on sache
qu'ils en ont engag l'entreprise, o et quand.
Car l'cole, quelque moment que le sujet entre en analyse, a
mettre ce fait en balance avec la responsabilit qu'elle ne peut dcli-
ner de ses consquences.
234
ACTE DE FONDATION
Il est constant que la psychanalyse ait des effets sur toute pratique
du sujet qui s'y engage. Quand cette pratique procde, si peu que ce
soit d'effets psychanalytiques, il se trouve les engendrer au lieu o il
a les reconnatre.
Comment ne pas voir que le contrle s'impose ds le moment
de ces effets, et d'abord pour en protger celui qui y vient en posi-
tion de patient?
Quelque chose est ici en jeu d'une responsabilit que la ralit
impose au sujet, quand il est praticien, de prendre ses risques.
Feindre d'ignorer ce fait est l'incroyable fonction qu'on conserve
dans la pratique de l'analyse didactique : le sujet est cens ne pas
pratiquer, ou tenu pour violer de son fait une rgle de prudence,
voire d'honntet. Qu' observer cette rgle, le sujet en arrive faire
dfaut sa fonction, n'est pas hors des limites de ce qui se passe, on
le sait, d'autre part.
L'cole ne saurait s'abstraire de cet tat de choses dsastreux, en
raison mme du travail qu'eUe est faite pour garantir.
C'est pourquoi elle assurera les contrles qui conviennent
la situation de chacun, en faisant face une ralit, dont fait partie
l'accord de l'analyste.
Inversement, une solution insuffisante pourra motiver pour elle
une rupture de contrat.
5. De l'engagement dans Vcole
On s'engage maintenant dans l'cole par deux accs :
1) Le groupe constitu par choix mutuel selon l'acte de fondation
et qui s'appellera un cartel, se prsente mon agrment avec le titre
du travail que chacun entend y poursuivre.
2) Les individus qui veulent se faire connatre pour quelque pro-
jet que ce soit, trouveront le chemin utile auprs d'un membre du
Carde : les noms des premiers en avoir accept la charge sur ma
demande, seront publis avant le 20 juillet. Moi-mme dirigerais
vers l'un d'entre eux, qui m'en ferait la demande.
235
ACTE DE FONDATION
6. Du statut de l'cole
Ma direction personnelle est provisoire, quoique promise pour
quatre ans. Ils nous semblent ncessaires la mise en train de l'cole.
Si son statut juridique est d'ores et dj celui de l'association
dclare sous la loi de 1901, nous croyons devoir d'abord faire passer
dans son mouvement le statut interne qui sera, dans un dlai fix,
propos au consentement de tous.
Rappelons que la pire objection que l'on puisse faire aux socits
de forme existante, est le tarissement du travail, manifeste jusque
dans la qualit, qu'elles causent chez les meilleurs.
Le succs de l'cole se mesurera la sortie de travaux qui soient
recevables leur place.
7. De Vcole comme exprience inaugurale
Cet aspect s'impose assez, pensons-nous, dans l'acte de fondation,
et nous laissons chacun d'en dcouvrir les promesses et les cueils.
A ceux qui peuvent s'interroger sur ce qui nous guide, nous
dvoilerons sa raison.
L'enseignement de la psychanalyse ne peut se transmettre d'un
sujet l'autre que par les voies d'un transfert de travail.
Les sminaires , y compris notre cours des Hautes tudes, ne
fonderont rien, s'ils ne renvoient ce transfert.
Aucun appareil doctrinal, et notamment le ntre, si propice qu'il
puisse tre la direction du travail, ne peut prjuger des conclusions
qui en seront le reste.
PRAMBULE
Cette fondation, on peut soulever d'abord la question de son
rapport l'enseignement qui ne laisse pas sans garantie la dcision de
son acte.
236
ACTE DE FONDATION
On posera que, si qualifis soient ceux qui seront en mesure d'y
discuter cet enseignement - l'cole ni n'en dpend, ni mme ne le
dispense puisqu'il se poursuit en dehors.
Si pour cet enseignement en effet, l'existence d'une audience qui
n'a pas encore pris sa mesure, s'est rvle au mme tournant qui
imposa l'cole, il importe d'autant plus de marquer ce qui les spare.
cole freudienne de Paris,- ce titre tenu en rserve dans l'acte de
fondation annonce bien les intentions d'o l'on procde, qui s'en
tient ses termes.
Passons le lieu dont on reprend, non sans titre le faire, avec
l'cusson d'origine le dfi qu'il emporte, dj de Freud salu : l'cole
s'affirme d'abord freudienne, pour ce que, - s'il est une vrit qui
sans doute se supporte d'une prsence patiente la ritrer, mais
qui de cet effet est devenu conscience comme de l'aire franaise,
- c'est que le message freudien dpasse de loin en sa radicalit
l'usage qu'en font les praticiens d'obdience anglophone.
Mme si l'on prte la main en France comme ailleurs une pra-
tique mitige par le dferlement d'une psychothrapie associe aux
besoins de l'hygine mentale,- c'est un fait qu'aucun praticien n'est
sans montrer sa gne ou son aversion, voire drision ou horreur,
mesure des occasions qu'il s'offre de s'immerger au lieu ouvert o
la pratique ici dnonce prend forme imprialiste : conformisme de
la vise, barbarisme de la doctrine, rgression acheve un psycho-
logisme pur et simple, - le tout mal compens par la promotion
d'une clricature, facile caricaturer, mais qui dans sa componction
est bien le. reste qui tmoigne de la formation par quoi la psychana-
lyse ne se dissout pas dans ce qu'elle propage.
Ce discord, qu'on l'image de l'vidence qui surgit interroger
s'il n'est pas vrai qu' notre poque la psychanalyse est partout, les
psychanalystes autre part.
Car il n'est pas vain qu'on puisse s'tonner que le seul nom de
Freud, de l'espoir de vrit qu'il conduit, fasse figure s'affronter au
nom de Marx, soupon indissip, bien qu'il soit patent que l'abme
en soit incomblable, qu'en la voie par Freud entrouverte pourrait
s'apercevoir la raison pourquoi choue le marxisme rendre compte
d'un pouvoir toujours plus dmesur et plus fou quant au politique,
si encore ne joue pas un effet de relance de sa contradiction.
Que les psychanalystes soient hors d'tat djuger des maux o ils
237
ACTE DE FONDATION
baignent, mais qu'ils se sentent y faire dfaut, - c'est assez pour
expliquer qu'ils y rpondent par un enkystement de la pense.
Dmission qui ouvre la voie une fausse complaisance, porteuse pour
le bnficiaire des mmes effets qu'une vraie : en ce cas, l'estampille
qu'ils galvaudent des termes dont ils ont la garde pour l'entreprise
qui n'est nullement en soi le ressort de l'conomie rgnante, mais
est commode la mise en condition de ceux qu'elle emploie, et
mme aux hauts grades : l'orientation psychologique et ses divers
offices.
Ainsi la psychanalyse est trop en attente et les psychanalyses trop
en porte faux pour que l'on puisse en dnouer le suspens d'ailleurs
que du point mme o ils ont pris cart : savoir dans la formation
de psychanalyste.
Non point que l'cole ne dispose de ce qui l'assure de ne
rompre aucune continuit : savoir des psychanalystes irrpro-
chables de quelque point de vue qu'on se place, puisqu'il et suffi
pour eux comme il en a t pour le reste des sujets forms par
Lacan, qu'ils reniassent son enseignement pour tre reconnus par
une certaine Internationale , et qu'il est notoire qu'ils ne doivent
qu' leur choix et leur discernement d'avoir renonc cette
reconnaissance.
C'est l'cole qui remet en question les principes d'une habili-
tation patente, et du consentement de ceux qui notoirement l'ont
reue.
En quoi freudienne s'avre-t-elle encore, le terme d'cole venant
maintenant notre examen.
Il est prendre au sens o dans les temps antiques il voulait dire
certains lieux de refuge, voire bases d'opration contre ce qui dj
pouvait s'appeler malaise dans la civilisation.
A nous en tenir au malaise de la psychanalyse, l'cole entend
donner son champ non pas seulement un travail de critique :
l'ouverture du fondement de l'exprience, la mise en cause du
style de vie sur quoi elle dbouche.
Ceux gui s'engagent ici se sentent assez solides pour noncer
l'tat de choses manifeste : que la psychanalyse prsentement n'a
rien de plus sr faire valoir son actif que la production de psy-
chanalystes, - dt ce bilan apparatre comme laissant dsirer.
Non pas qu'on s'y abandonne quelque auto-accusation. On y
238
ACTE DE FONDATION
est conscient que les rsultats de la psychanalyse, mme en leur tat
de douteuse vrit, font figure plus digne que les fluctuations de
mode et les prmisses aveugles quoi se fient tant de thrapeutiques
en le domaine o la mdecine n'a pas fini de se reprer quant ses
critres (ceux de la rcupration sociale sont-ils isomorphes ceux
de la gurison ?) et semble mme en retrait quant la nosographie :
nous disons la psychiatrie devenue une question pour tous.
Il est mme assez curieux de voir comment la psychanalyse joue
ici le paratonnerre. Comment sans elle se ferait-on prendre au
srieux l o l'on se fait mrite de s'y opposer. D'o un statu quo o
le psychanalyste prend aise du gr qu'on lui sait de son insuffisance.
La psychanalyse s'est pourtant d'abord distingue de donner un
accs la notion de gurison en son domaine, savoir : rendre leurs
sens aux symptmes, donner place au dsir qu'ils masquent, rectifier
sous un mode exemplaire l'apprhension d'une relation privilgie,
- encore et-il fallu pouvoir l'illustrer des distinctions de structure
qu'exigent les formes de la maladie, les reconnatre dans les rapports
de l'tre qui demande et qui s'identifie cette demande et cette
identification elles-mmes.
Encore faudrait-il que le dsir et le transfert qui les animent aient
soulev ceux qui en ont l'exprience jusqu' leur rendre intolrables
les concepts qui perptuent une construction de l'homme et de
Dieu o entendement et volont se distinguent d'une prtendue
passivit du premier mode l'arbitraire : activit qu'elle attribue au
second.
La rvision qu'appellent de la pense les connexions au dsir que
Freud lui impose, semble hors des moyens du psychanalyste. Sans
doute s'clipsent-ils des mnagements qui les flchissent la faiblesse
de ceux qu'il secourt.
Il est un point pourtant o le problme du dsir ne peut tre
lud, c'est quand il s'agit du psychanalyste lui-mme.
Et rien n'est plus exemplaire du pur bavardage que ce qui a cours
sur ce propos : que c'est l ce qui conditionne la sret de son inter-
vention.
Poursuivre dans des alibis la mconnaissance qui s'abrite ici de
faux papiers, exige la rencontre du plus valable d'une exprience
personnelle avec ceux qui la sommeront de s'avouer, la tenant pour
un bien commun.
239
ACTE DE FONDATION
Les autorits scientifiques elles-mmes sont ici l'otage d'un pacte
de carence qui fait que ce n'est plus du dehors qu'on peut attendre
une exigence de contrle qui serait l'ordre du jour partout
ailleurs.
C'est l'affaire seulement de ceux qui, psychanalystes ou non,
s'intressent la psychanalyse en acte.
C'est eux que s'ouvre l'cole pour qu'ils mettent l'preuve
leur intrt, ne leur tant pas interdit d'en laborer la logique.
NOTE POUR L'ANNUAIRE
L'cole dont on doute aussi peu qu'elle soit freudienne que de
Paris, a trouv enfin son local.
De quelques agents qu'ait pris corps ce qui y fit six ans obstacle, il
faut reconnatre que ce ne fut pas au dtriment d'un seul groupe,
mais aux dpens de tous ceux qui se soutiennent d'un enseigne-
ment, en France s'entend.
Il est des missions impudentes, une veulerie intellectuelle qui
depuis 1957 ont rabattu leur ton.
Elles y ont gagn de pouvoir garder figure dans la conjoncture
prsente.
Ceci devrait suggrer dans la psychanalyse quelque retour sur son
affaire.Y viendra-t-on ?
Un demi-sicle aprs que Freud l'a dote de sa seconde topique,
rien ne s'enregistre de son fait, qui soit plus sr que celui troublant
de sa persistance.
Inflation notoire qui, s'pauler de l'poque, rend le vraisem-
blable plus tentant que le vridique.
Sans l'assiette d'une formation o l'analyse s'articule d'un dca-
lage du discours dont Lacan dresse l'acte, nul n'y passera la tenta-
tive contraire.
Quand la mainmise universitaire montre besoin se contenter de
notre moindre semblant.
Tous les espoirs seront donc l'aise ailleurs que dans notre
cole.
240
ACTE DE FONDATION
Mais ils y trouveraient ceux qui dix ans, ni seize, ni dix-huit,
n'ont paru ngociables, d'un travail grce quoi il y a du psychana-
lyste encore la hauteur de ce que suppose qu'on lui fasse signe : de
ce qu'on sait au moins.
28 fvrier 1911
Proposition du 9 octobre 1967
sur le psychanalyste de l'cole
Avant de la lire, je souligne qu'il faut l'entendre sur le
fonds de la lecture, faire ou refaire, de mon article :
Situation de la psychanalyse et formation du psycha-
nalyste en 1956 (pages 459-486 de mes crits).
Il va s'agir de structures assures dans la psychanalyse et de garan-
tir leur effectuation chez le psychanalyste.
Ceci s'offre notre cole, aprs dure suffisante d'organes bau-
chs sur des principes limitatifs. Nous n'instituons du nouveau que
dans le fonctionnement. Il est vrai que de l apparat la solution du
problme de la Socit psychanalytique.
Laquelle se trouve dans la distinction de la hirarchie et du gradus.
Je vais produire au dbut de cette anne ce pas constructif :
1) le produire - vous le montrer ;
2) vous mettre en fait en produire l'appareil, lequel doit repro-
duire ce pas en ces deux sens.
Rappelons chez nous l'existant.
D'abord un principe : le psychanalyste ne s'autorise que de lui-
mme. Ce principe est inscrit aux textes originels de l'cole et
dcide de sa position.
Ceci n'exclut pas que l'cole garantisse qu'un analyste relve de
sa formation.
Elle le peut de son chef.
Et l'analyste peut vouloir cette garantie, ce qui ds lors ne peut
qu'aller au-del : devenir responsable du progrs de l'cole, devenir
psychanalyste de son exprience mme.
A y regarder de cette vue, on reconnat que ds maintenant c'est
ces deux formes que rpondent :
I. l'AME ou analyste membre de l'cole, constitu simplement
par le fait que l'cole le reconnat comme psychanalyste ayant fait
ses preuves.
C'est l ce qui constitue la garantie venant de l'cole, distingue
243
PROPOSITION SUR LE PSYCHANALYSTE DE L'COLE
d'abord. L'initiative en revient l'cole, o l'on n'est admis la
base que dans le projet d'un travail et sans gard de provenance ni de
qualifications. Un analyste-praticien n'y est enregistr au dpart qu'au
mme titre o on l'y inscrit mdecin, ethnologue, et tutti quanti.
II. l'AE ou analyste de l'cole, auquel on impute d'tre de ceux
qui peuvent tmoigner des problmes cruciaux aux points vifs o ils
en sont pour l'analyse, spcialement en tant qu'eux-mmes sont la
tche ou du moins sur la brche de les rsoudre.
Cette place implique qu'on veuille l'occuper : on ne peut y tre
qu' l'avoir demand de fait, sinon de forme.
Que l'cole puisse garantir le rapport de l'analyste la formation
qu'elle dispense, est donc tabli.
Elle le peut, et le doit ds lors.
C'est ici qu'apparat le dfaut, le manque d'invention, pour rem-
plir un office (soit celui dont se targuent les socits existantes) en y
trouvant des voies diffrentes, qui vitent les inconvnients (et les
mfaits) du rgime de ces socits.
L'ide que le maintien d'un rgime semblable est ncessaire
rgler le gradus, est relever dans ses effets de malaise. Ce malaise ne
suffit pas justifier la maintenance de l'ide. Encore moins son
retour pratique.
Qu'il y ait une rgle du gradus est impliqu dans une cole,
encore plus certainement que dans une socit. Car aprs tout dans
une socit, nul besoin de cela, quand une socit n'a d'intrts que
scientifiques.
Mais il y a un rel en jeu dans la formation mme du psychana-
lyste. Nous tenons que les socits existantes se fondent sur ce rel.
Nous partons aussi du fait qui a pour lui toute apparence, que
Freud les a voulues telles qu'elles sont.
Le fait n'est pas moins patent - et pour nous concevable - que ce
rel provoque sa propre mconnaissance, voire produise sa ngation
systmatique.
Il est donc clair que Freud a pris le risque d'un certain arrt.
Peut-tre plus : qu'il y a vu le seul abri possible pour viter l'extinc-
tion de l'exprience.
Que nous nous affrontions la question ainsi pose, n'est pas mon
privilge. C'est la suite mme, disons-le^ au moins pour les analystes
de l'cole, du choix qu'ils ont fait de l'cole.
244
PROPOSITION SUR LE PSYCHANALYSTE DE L'COLE
Ils s'y trouvent groups de n'avoir pas voulu par un vote accepter
ce qu'il emportait : la pure et simple survivance d'un enseignement,
celui de Lacan.
Quiconque ailleurs reste dire qu'il s'agissait de la formation des
analystes, en a menti. Car il a suffi qu'on vote dans le sens souhait
par l'IPA, pour y obtenir son entre toutes voiles dehors, l'ablution
reue prs pour un court temps d'un sigle made in English (on n'ou-
bliera le French group). Mes analyss, comme on dit, y furent mme
particulirement bienvenus, et le seraient encore si le rsultat pouvait
tre de me faire taire.
On le rappelle tous les jours qui veut bien l'entendre.
C'est donc un groupe qui mon enseignement tait assez pr-
cieux, voire assez essentiel, pour que chacun dlibrant ait marqu
prfrer son maintien l'avantage oflfert, - ceci sans voir plus loin, de
mme que sans voir plus loin, j'interrompais mon sminaire la
suite dudit vote -, c'est ce groupe en mal d'issue que j'ai oflfert
la fondation de l'cole.
A ce choix dcisif pour ceux qui sont ici, se marque la valeur de
l'enjeu. Il peut y avoir un enjeu, qui pour certains vaille au point de
leur tre essentiel, et c'est mon enseignement.
Si ledit enseignement est sans rival pour eux, il l'est pour tous,
comme le prouvent ceux qui s'y pressent sans en avoir pay le prix,
la question tant suspendue pour eux du profit qui leur en reste
permis.
Sans rival ici ne veut pas dire une estimation, mais un fait : nul
enseignement ne parle de ce qu'est la psychanalyse. Ailleurs, et de
faon avoue, on ne se soucie que de ce qu'elle soit conforme.
Il y a solidarit entre la panne, voire les dviations que montre la
psychanalyse et la hirarchie qui y rgne, - et que nous dsignons,
bienveillamment on nous l'accordera, comme celle d'une coopta-
tion de sages.
La raison en est que cette cooptation promeut un retour un
statut de la prestance, conjoignant la prgnance narcissique la ruse
comptitive. Retour qui restaure des renforcements du relaps ce que
la psychanalyse didactique a pour fin de liquider.
C'est l'effet qui porte son ombre sur la pratique de la psychana-
lyse, - dont la terminaison, l'objet, le but mme s'avrent inarticu-
lables aprs un demi-sicle au moins d'exprience suivie.
245
PROPOSITION SUR LE PSYCHANALYSTE DE L'COLE
Y porter remde chez nous doit se faire de la constatation du
dfaut dont j'ai fait tat, loin de songer le voiler.
Mais c'est pour prendre en ce dfaut, l'articulation qui manque.
Elle ne fait que recouper ce qu'on trouvera partout, et qui est su
depuis toujours, c'est qu'il ne suffit pas de l'vidence d'un devoir
pour le remplir. C'est par le biais de sa bance, qu'il peut tre mis en
action, et il l'est chaque fois qu'on trouve le moyen d'en user.
Pour vous y introduire, je m'appuierai sur les deux moments du
raccord de ce que j'appellerai respectivement dans ce dduit la psy-
chanalyse en extension, soit tout ce que rsume la fonction de notre
cole en tant qu'elle prsentifie la psychanalyse au monde, et la psy-
chanalyse en intension, soit la didactique, en tant qu'elle ne fait pas
que d'y prparer des oprateurs.
On oublie en effet sa raison d'tre prgnante, qui est de constituer
la psychanalyse comme exprience originale, de la pousser au point
qui en figure la finitude pour en permettre l'aprs-coup, effet de
temps, on le sait, qui lui est radical.
Cette exprience est essentielle l'isoler de la thrapeutique, qui
ne distord pas la psychanalyse seulement de relcher sa rigueur.
Observerai-je en effet qu'il n'y a aucune dfinition possible de la
thrapeutique si ce n'est la restitution d'un tat premier. Dfinition
justement impossible poser dans la psychanalyse.
Pour le primum non nocere, n'en parlons pas, car il est mouvant de
ne pouvoir tre dtermin primum au dpart : quoi choisir de ne
pas nuire ! Essayez. Il est trop facile dans cette condition de mettre
l'actif d'une cure quelconque le fait de n'avoir pas nui quelque
chose. Ce trait forc n'a d'intrt que de tenir sans doute d'un ind-
cidable logique.
On peut trouver le temps rvolu o ce quoi il s'agissait de ne
pas nuire, c'tait l'entit morbide. Mais le temps du mdecin est
plus intress qu'on ne croit dans cette rvolution, - en tout cas
l'exigence devenue plus prcaire de ce qui rend ou non mdical un
enseignement. Digression.
Nos points de raccord, o ont fonctionner nos organes de
garantie, sont connus : c'est le dbut et la fin de la psychanalyse,
comme aux checs. Par chance, ce sont les plus exemplaires pour sa
structure. Cette chance doit tenir de ce que nous appelons la ren-
contre.
246
PROPOSITION SUR LE PSYCHANALYSTE DE L'COLE
Au commencement de la psychanalyse est le transfert. Il l'est par
la grce de celui que nous appellerons l'ore de ce propos : le psy-
chanalysant
1
. Nous n'avons pas rendre compte de ce qui le condi-
tionne. Au moins ici. Il est au dpart. Mais qu'est-ce que c'est?
Je suis tonn que personne n'ait jamais song m'opposer, vu
certains termes de ma doctrine, que le transfert fait lui seul objec-
tion l'intersubjectivit. Je le regrette mme, vu que rien n'est plus
vrai : il la rfute, il est sa pierre d'achoppement. Aussi bien est-ce
pour tablir le fond o l'on puisse en apercevoir le contraire, que
j'ai promu d'abord ce que d'intersubjectivit implique l'usage de la
parole. Ce terme fut donc une faon, faon comme une autre, dirais-
je, si elle ne s'tait pas impose moi, de circonscrire la porte du
transfert.
L-dessus, l o il faut bien qu'on justifie son lot universitaire, on
s'empare dudit terme, suppos, sans doute parce que j'en ai us, tre
lvitatoire. Mais qui me lit, peut remarquer l' en rserve dont je
fais jouer cette rfrence pour la conception de la psychanalyse. Cela
fait partie des concessions ducatives quoi j'ai d me livrer pour le
contexte d'ignorantisme fabuleux o j'ai d profrer mes premiers
sminaires.
Peut-on maintenant douter qu' rapporter au sujet du cogito ce
que l'inconscient nous dcouvre, qu' en avoir dfini la distinction
de l'autre imaginaire, dit familirement, petit autre, du lieu d'opra-
tion du langage, pos comme tant le grand Autre, j'indique assez
qu'aucun sujet n'est supposable par un autre sujet, - si ce terme
doit bien tre pris du ct de Descartes. Qu'il lui faille Dieu ou
plutt la vrit dont il le crdite, pour que le sujet vienne se loger
sous cette mme cape qui habille de trompeuses ombres humaines,
- que Hegel le reprendre pose l'impossibilit de la coexistence
des consciences, en tant qu'il s'agit du sujet promis au savoir,
- n'est-ce pas assez pour pointer la difficult, dont prcisment
notre impasse, celle du sujet de l'inconscient, offre la solution - ,
qui sait la former.
Il est vrai qu'ici Jean-Paul Sartre, fort capable de s'apercevoir que
la lutte mort n'est pas cette solution, puisqu'on ne saurait dtruire
i. Ce qu'on appelle d'ordinaire : le psychanalys, par anticipation.
247
PROPOSITION SUR LE PSYCHANALYSTE DE L'COLE
un sujet, et qu'aussi bien elle est dans Hegel sa naissance prpose,
en prononce huis clos la sentence phnomnologique : c'est l'en-
fer. Mais comme c'est faux, et de faon justiciable de la structure, le
phnomne montrant bien que le lche, s'il n'est pas fou, peut fort
bien s'arranger du regard qui le fixe, cette sentence prouve aussi que
l'obscurantisme a son couvert mis pas seulement aux agapes de
droite.
Le sujet suppos savoir est pour nous le pivot d'o s'articule tout
ce qu'il en est du transfert. Dont les effets chappent, faire pince
pour les saisir du pun assez maladroit s'tablir du besoin de la rp-
tition la rptition du besoin.
Ici le lvitant de l'intersubjectivit montrera sa finesse interro-
ger : sujet suppos par qui ? sinon par un autre sujet.
Un souvenir d'Aristote, une goutte des catgories, prions-nous,
pour dcrotter ce sujet du subjectif. Un sujet ne suppose rien, il est
suppos.
Suppos, enseignons-nous, par le signifiant qui le reprsente pour
un autre signifiant.
crivons comme il convient le suppos de ce sujet en mettant le
savoir sa place d'attenance de la supposition :
S ^S
5 (S
1
, S
2
,... S")
On reconnat la premire ligne le signifiant S du transfert,
c'est--dire d'un sujet, avec son implication d'un signifiant que nous
dirons quelconque, c'est--dire qui ne suppose que la particularit
au sens d'Aristote (toujours bien venu), qui de ce fait suppose
encore d'autres choses. S'il est nommable d'un nom propre, ce n'est
pas qu'il se distingue par le savoir, comme nous allons le voir.
Sous la barre, mais tduite l'empan supposant du premier signi-
fiant : le s reprsente le sujet qui en rsulte impliquant dans la paren-
thse le savoir, suppos prsent, des signifiants dans l'inconscient,
signification qui tient la place du rfrent encore latent dans ce rap-
port tiers qui l'adjoint au couple signifiant-signifi.
On voit que si la psychanalyse consiste dans le maintien d'une
situation convenue entre deux partenaires, qui s'y posent comme le
248
PROPOSITION SUR LE PSYCHANALYSTE DE L'COLE
psychanalysant et le psychanalyste, elle ne saurait se dvelopper
qu'au prix du constituant ternaire qu'est le signifiant introduit dans
le discours qui s'en instaure, celui qui a nom : le sujet suppos savoir,
formation, elle, non d'artifice mais de veine, comme dtache du
psychanalysant.
Nous avons voir ce qui qualifie le psychanalyste rpondre
cette situation dont on voit qu'elle n'enveloppe pas sa personne.
Non seulement le sujet suppos savoir n'est pas rel en effet, mais il
n'est nullement ncessaire que le sujet en activit dans la conjonc-
ture, le psychanalysant (seul parler d'abord), lui en fasse l'imposi-
tion.
C'est mme si peu ncessaire que ce n'est pas vrai d'ordinaire : ce
que dmontre dans les premiers temps du discours, une faon de
s'assurer que le costume ne va pas au psychanalyste, - assurance
contre la crainte qu'il n'y mette, si je puis dire, trop tt ses plis.
Ce qui nous importe ici c'est le psychanalyste, dans sa relation au
savoir du sujet suppos, non pas seconde mais directe.
Il est clair que du savoir suppos, il ne sait rien. Le S* de la pre-
mire ligne n'a rien faire avec les S en chane de la seconde et ne
peut s'y trouver que par rencontre. Pointons ce fait pour y rduire
'tranget de l'insistance que met Freud nous recommander
d'aborder chaque cas nouveau comme si nous n'avions rien acquis
de ses premiers dchiffrements.
Ceci n'autorise nullement le psychanalyste se suffire de savoir
qu'il ne sait rien, car ce dont il s'agit, c'est de ce qu'il a savoir.
Ce qu'il a savoir, peut tre trac du mme rapport en rserve
selon lequel opre toute logique digne de ce nom. a ne veut rien
dire de particulier , mais a s'articule en chane de lettres si rigou-
reuses qu' la condition de n'en pas rater une, le non-su s'ordonne
comme le cadre du savoir.
L'tonnant est qu'avec a on trouve quelque chose, les nombres
transfinis par exemple. Qu'tait-il d'eux, avant? J'indique ici leur
rapport au dsir qui leur a donn consistance. Il est utile de penser
l'aventure d'un Cantor, aventure qui ne fut pas prcisment gratuite,
pour suggrer l'ordre, ne fut-il pas, lui, transfini, o le dsir du psy-
chanalyste se situe.
Cette situation rend compte l'inverse, de l'aise apparente dont
s'installe aux positions de direction dans les socits existantes ce
249
PROPOSITION SUR LE PSYCHANALYSTE DE L'COLE
qu'il faut bien appeler des nants. Entendez-moi : l'important
n'est pas la faon dont ces nants se meublent (discours sur la
bont ?) pour le dehors, ni la discipline que suppose le vide sou-
tenu l'intrieur (il ne s'agit pas de sottise), c'est que ce nant
(du savoir) est reconnu de tous, objet usuel si l'on peut dire, pour
les subordonns et monnaie courante de leur apprciation des
Suprieurs.
La raison s'en trouve dans la confusion sur le zro, o l'on reste en
un champ o elle n'est pas de mise. Personne qui se soucie dans le
gradus d'enseigner ce qui distingue le vide du rien, ce qui pourtant
n'est pas pareil, - ni le trait repre pour la mesure, de l'lment
neutre impliqu dans le groupe logique, non plus que la nullit de
l'incomptence, du non-marqu de la navet, d'o tant de choses
prendraient leur place.
C'est pour parer ce dfaut, que j'ai produit le huit intrieur et
gnralement la topologie dont le sujet se soutient.
Ce qui doit disposer un membre de l'cole pareilles tudes est
la prvalence que vous pouvez saisir dans l'algorithme plus haut
produit, mais qui n'en demeure pas moins pour ce qu'on l'ignore,
la prvalence manifeste o que ce soit : dans la psychanalyse en
extension comme dans celle en intension, de ce que j'appellerai
savoir textuel pour l'opposer la notion rfrentielle qui la
masque.
De tous les objets que le langage ne propose pas seulement au
savoir, mais qu'il a d'abord mis au monde de la ralit, de la ralit
de l'exploitation interhumaine, on ne peut dire que le psychanalyste
soit expert. a vaudrait mieux, mais c'est de fait plutt court.
Le savoir textuel n'tait pas parasite avoir anim une logique
dont la ntre trouve leon sa surprise (je parle de celle du Moyen
Age), et ce n'est pas ses dpens qu'elle a su faire face au rapport du
sujet la Rvlation.
Ce n'est pas de ce que la valeur religieuse de celui-ci nous est
devenue indiffrente, que son effet dans la structure doit tre
nglig. La psychanalyse a consistance des textes de Freud, c'est l un
fait irrfutable. On sait ce que, de Shakespeare Lewis Carroll, les
textes apportent son gnie et ses praticiens.
Voil le champ o se discerne qui admettre son tude. C'est
celui dont le sophiste et le talmudiste, le colporteur de contes et
250
PROPOSITION SUR LE PSYCHANALYSTE DE L'COLE
l'ade ont pris la force, qu' chaque instant nous rcuprons plus ou
moins maladroitement pour notre usage.
Qu'un Lvi-Strauss en ses mythologiques, lui donne son statut
scientifique, est bien pour nous faciliter d'en faire seuil notre slec-
tion.
Rappelons le guide que donne mon graphe l'analyse et l'articu-
lation qui s'en isole du dsir dans les instances du sujet.
C'est pour noter l'identit de l'algorithme ici prcis, avec ce qui
est connot dans Le Banquet comme yaX\ia.
O est mieux dit que ne l'y fait Alcibiade, que les embches
d'amour du transfert n'ont de fin que d'obtenir ce dont il pense que
Socrate est le contenant ingrat?
Mais qui sait mieux que Socrate qu'il ne dtient que la significa-
tion qu'il engendre retenir ce rien, ce qui lui permet de renvoyer
Alcibiade au destinataire prsent de son discours, Agathon (comme
par hasard) : ceci pour vous apprendre qu' vous obsder de ce qui
dans le discours du psychanalysant vous concerne, vous n'y tes pas
encore.
Mais est-ce l tout? quand ici le psychanalysant est identique
YayaX\ia, la merveille nous blouir, nous tiers, en Alcibiade. N'est-
ce pas pour nous occasion d'y voir s'isoler le pur biais du sujet
comme rapport libre au signifiant, celui dont s'isole le dsir du savoir
comme dsir de l'Autre ?
Comme tous ces cas particuliers qui font le miracle grec, celui-ci
ne nous prsente que ferme la bote de Pandore. Ouverte, c'est la
psychanalyse, dont Alcibiade n'avait pas besoin.
Avec ce que j'ai appel la fin de partie, nous sommes - enfin -
l'os de notre propos de ce soir. La terminaison de la psychanalyse
dite superftatoirement didactique, c'est le passage en effet du psy-
chanalysant au psychanalyste.
Notre propos est d'en poser une quation dont la constante est
l'ToA+ia.
Le dsir du psychanalyste, c'est son nonciation, laquelle ne sau-
rait s'oprer qu' ce qu'il y vienne en position de Yx :
de cet x mme, dont la solution au psychanalysant livre son tre
et dont la valeur se note (- <p), la bance que l'on dsigne comme la
fonction du phallus l'isoler dans le complexe de castration, ou (a)
251
PROPOSITION SUR LE PSYCHANALYSTE DE L'COLE
pour ce qui l'obture de l'objet qu'on reconnat sous la fonction
approche de la relation prgnitale. (C'est elle que le cas Alcibiade
se trouve annuler : ce que connote la mutilation des Herms.)
La structure ainsi abrge vous permet de vous faire ide de ce
qui se passe au terme de la relation du transfert, soit : quand le dsir
s'tant rsolu qui a soutenu dans son opration le psychanalysant, il
n'a plus envie la fin d'en lever l'option, c'est--dire le reste qui
comme dterminant sa division, le fait dchoir de son fantasme et le
destitue comme sujet.
Voil-t-il pas le grand motus qu'il nous faut garder entre nous, qui
en prenons, psychanalystes, notre suffisance, alors que la batitude
s'offre au-del de l'oublier nous-mmes ?
N'irions-nous l'annoncer, dcourager les amateurs ? La destitu-
tion subjective inscrite sur le ticket d'entre... n'est-ce point provo-
quer l'horreur, l'indignation, la panique, voire l'attentat, en tout cas
donner le prtexte l'objection de principe ?
Seulement faire interdiction de ce qui s'impose de notre tre,
c'est nous offrir un retour de destine qui est maldiction. Ce qui
est refus dans le symbolique, rappelons-en le verdict lacanien, repa-
rat dans le rel.
Dans le rel de la science qui destitue le sujet bien autrement dans
notre poque, quand seuls ses tenants les plus minents, un Oppen-
heimer, s'en affolent.
Voil o nous dmissionnons de ce qui nous fait responsables,
savoir : la position o j'ai fix la psychanalyse dans sa relation la
science, celle d'extraire la vrit qui lui rpond en des termes dont
le reste de voix nous est allou.
De quel prtexte abritons-nous ce refus, quand on sait bien quelle
insouciance protge vrit et sujets tout ensemble, et qu' promettre
aux seconds la premire, cela ne fait ni chaud ni froid qu' ceux qui
dj en sont proches, parler de destitution subjective n'arrtera
jamais l'innocent, qui n'a de loi que son dsir.
Nous n'avons de choix qu'entre affronter la vrit ou ridiculiser
notre savoir.
Cette ombre paisse recouvrir ce raccord dont ici je m'occupe,
celui o le psychanalysant passe au psychanalyste, voil ce que notre
Ecole peut s'employer dissiper.
252
PROPOSITION SUR LE PSYCHANALYSTE DE L'COLE
Je n'en suis pas plus loin que vous dans cette uvre qui ne peut
tre mene seul, puisque la psychanalyse en fait l'accs.
Je dois me contenter ici d'un flash ou deux la prcder.
A l'origine de la psychanalyse, comment ne pas rappeler ce que,
d'entre nous, a fait enfin Mannoni, que le psychanalyste, c'est Fliess,
c'est--dire le mdicastre, le chatouilleur de nez, l'homme qui se
rvle le principe mle et le femelle dans les nombres 21, 28, ne
vous en dplaise, bref ce savoir que le psychanalysant, Freud le scien-
tiste, comme s'exprime la petite bouche des mes ouvertes l'cu-
mnisme, rejette de toute la force du serment qui le lie au pro-
gramme de Helmholtz et de ses complices.
Que cet article ait t donn une revue qui ne permettait
gure que le terme du sujet suppos savoir y part autrement
que perdu au milieu d'une page, n'te rien au prix qu'il peut avoir
pour nous.
En ious rappelant l' analyse originelle , il nous remet au pied
de la dimension de mirage o s'assoit la position du psychanalyste
et nous suggre qu'il n'est pas sr qu'elle soit rduite tant qu'une
critique scientifique n'aura pas t tablie dans notre discipline.
Le titre prte la remarque que la vraie originelle ne peut tre
que la seconde, de constituer la rptition qui de la premire fait un
acte, car c'est elle qui y introduit l'aprs-coup propre au temps
logique, qui se marque de ce que le psychanalysant est pass au psy-
chanalyste. 0e veux dire Freud lui-mme qui sanctionne l de
n'avoir pas fait une auto-analyse.)
Je me permets en outre de rappeler Mannoni que la scansion du
temps logique inclut ce que j'ai appel le moment de comprendre,
justement de l'effet produit (qu'il reprenne mon sophisme) par la
non-comprhension, et qu' luder en somme ce qui fait l'me de
son article il aide ce qu'on comprenne -ct.
Je rappelle ici que le tout-venant que nous recrutons sur la base
de comprendre ses malades , s'engage sur un malentendu qui n'est
pas sain comme tel.
Flash maintenant o nous en sommes. Avec la fin de l'analyse
hypomaniaque, dcrite par notre Balint comme le dernier cri, c'est
le cas de le dire, de l'identification du psychanalysant son guide,
- nous touchons la consquence du refus dnonc plus haut (louche
253
PROPOSITION SUR LE PSYCHANALYSTE DE L'COLE
refus: VerleugnungH), lequel ne laisse plus que le refuge du mot
d'ordre, maintenant adopt dans les socits existantes, de l'alliance
avec la partie saine du moi, laquelle rsout le passage l'analyste, de
la postulation chez lui de cette partie saine au dpart. A quoi bon
ds lors son passage par l'exprience.
Telle est la position des socits existantes. Elle rejette notre pro-
pos dans un au-del de la psychanalyse.
Le passage du psychanalysant au psychanalyste, a une porte dont
ce reste qui fait leur division est le gond, car cette division n'est
autre que celle du sujet, dont ce reste est la cause.
Dans ce virage o le sujet voit chavirer l'assurance qu'il prenait
de ce fantasme o se constitue pour chacun sa fentre sur le rel, ce
qui s'aperoit, c'est que la prise du dsir n'est rien que celle d'un
dstre.
En ce dstre se dvoile l'inessentiel du sujet suppos savoir, d'o
le psychanalyste venir se voue l'ayocjia de l'essence du dsir, prt
le payer de se rduire, lui et son nom, au signifiant quelconque.
Car il a rejet l'tre qui ne savait pas la cause de son fantasme,
au moment mme o enfin ce savoir suppos, il l'est devenu.
Qu'il sache de ce que je ne savais pas de l'tre du dsir, ce qu'il
en est de lui, venu l'tre du savoir, et qu'il s'efface. Sicut palea,
comme Thomas dit de son uvre la fin de sa vie, - comme du
fumier.
Ainsi l'tre du dsir rejoint l'tre du savoir pour en renatre ce
qu'ils se nouent en une bande faite du seul bord o s'inscrit un seul
manque, celui que soutient l'&yafia.
La paix ne vient pas aussitt sceller cette mtamorphose o le
partenaire s'vanouit de n'tre plus que savoir vain d'un tre qui se
drobe.
Touchons l la futilit du terme de liquidation pour ce trou o
seulement se rsout le transfert. Je n'y vois, contre l'apparence, que
dngation du dsir de ^analyste.
Car qui, apercevoir les deux partenaires jouer comme les deux
pales d'un cran tournant dans mes dernires lignes, ne peut saisir
que le transfert n'a jamais t que le pivot de cette alternance mme.
Ainsi de celui qui a reu la clef du monde dans la fente de l'im-
pubre, le psychanalyste n'a plus attendre un regard, mais se voit
devenir une voix.
254
PROPOSITION SUR LE PSYCHANALYSTE DE L'COLE
Et cet autre qui, enfant, a trouv son reprsentant reprsentatif
dans son irruption travers le journal dploy dont s'abritait le
champ d'pandage des penses de son gniteur, renvoie au psycha-
nalyste l'effet d'angoisse o il bascule dans sa propre djection.
Ainsi la fin de la psychanalyse garde en elle une navet, dont la
question se pose si elle doit tre tenue pour une garantie dans le
passage au dsir d'tre psychanalyste.
D'o pourrait donc tre attendu un tmoignage juste sur celui
qui franchit cette passe, sinon d'un autre qui, comme lui, Y est encore,
cette passe, savoir en qui est prsent ce moment le dstre o
son psychanalyste garde l'essence de ce qui lui est pass comme un
deuil, sachant par l, comme tout autre en fonction de didacticien,
qu' eux aussi a leur passera.
Qui pourrait mieux que ce psychanalysant dans la passe, y
authentifier ce qu'elle a de la position dpressive ? Nous n'ventons
l rin dont on se puisse donner les airs, si on n'y est pas.
C'est ce que je vous proposerai tout l'heure comme l'office
confier pour la demande du devenir analyste de l'cole certains
que nous y dnommerons : passeurs.
Ils auront chacun t choisis par un analyste de l'Ecole, celui qui
peut rpondre de ce qu'ils sont en cette passe ou de ce qu'ils y
soient revenus, bref encore lis au dnouement de leur exprience
personnelle.
C'est eux qu'un psychanalysant, pour se faire autoriser comme
analyste de l'Ecole, parlera de son analyse, et le tmoignage qu'ils
sauront accueillir du vif mme de leur propre pass sera de ceux
que ne recueille jamais aucun jury d'agrment. La dcision d'un tel
jury en serait donc claire, ces tmoins bien entendu n'tant pas
juges.
Inutile d'indiquer que cette proposition implique une cumulation
de l'exprience, son recueil et son laboration, une sriation de sa
varit, une notation de ses degrs.
Qu'il puisse sortir des liberts de la clture d'une exprience,
c'est ce qui tient la nature de F aprs-coup dans la signifiance.
De toute faon cette exprience ne peut pas tre lude. Ses
rsultats doivent tre communiqus : l'Ecole d'abord pour cri-
tiques, et corrlativement mis porte de ces socits qui, tout
exclus qu'elles nous aient faits, n'en restent pas moins notre affaire.
255
PROPOSITION SUR LE PSYCHANALYSTE DE L'COLE
Le jury fonctionnant ne peut donc s'abstenir d'un travail de
doctrine, au-del de son fonctionnement de slecteur.
Avant de vous en proposer une forme, je veux indiquer que
conformment la topologie du plan projectif, c'est l'horizon
mme de la psychanalyse en extension, que se noue le cercle int-
rieur que nous traons comme bance de la psychanalyse en inten-
sion.
Cet horizon, je voudrais le centrer de trois points de fuite pers-
pectifs, remarquables d'appartenir chacun l'un des registres dont la
collusion dans l'htrotopie constitue notre exprience.
Dans le symbolique, nous avons le mythe dipien.
Observons par rapport au noyau de l'exprience sur lequel nous
venons d'insister, ce que j'appellerai techniquement la facticit de
ce point. Il relve en effet d'une mythognie, dont on sait qu'un des
constituants est sa redistribution. Or l'dipe, d'y tre ectopique
(caractre soulign par un Kroeber), pose un problme.
L'ouvrir permettrait de restaurer, la relativer mme, sa radicalit
dans l'exprience.
Je voudrais clairer ma lanterne simplement de ceci que, retirez
l'dipe, et la psychanalyse en extension, dirai-je, devient tout
entire justiciable du dlire du prsident Schreber.
Contrlez-en la correspondance point par point, certainement
pas attnue depuis que Freud l'a note en n'en dclinant pas l'im-
putation. Mais laissons ce que mon sminaire sur Schreber a oflfert
ceux qui pouvaient l'entendre.
Il y a d'autres aspects de ce point relatifs nos rapports l'ext-
rieur, ou plus exactement notre extraterritorialit, - terme essen-
tiel en Y Ecrit, que je tiens pour prface cette proposition.
Observons la place que tient l'idologie dipienne pour dispen-
ser en quelque sorte la sociologie depuis un sicle de prendre parti,
comme elle dut le faire avant, sur la valeur de la famille, de la famille
existante, de la famille petite-bourgeoise dans la civilisation, - soit
dans la socit vhicule par la science. Bnficions-nous ou pas de
ce que l nous couvrons notre insu ?
256
PROPOSITION SUR LE PSYCHANALYSTE DE L'COLE
Le second point est constitu par le type existant, dont la facticit
cette fois est vidente, de l'unit : socit de psychanalyse, en tant
que coiffe par un excutif l'chelle internationale.
Nous l'avons dit, Freud l'a voulu ainsi, et le sourire gn dont il
rtracte le romantisme de la sorte de Komintern clandestin auquel
il a d'abord donn son blanc-seing (cf. Jones, cit dans mon crit),
ne fait que mieux le souligner.
La nature de ces socits et le mode sur lequel elles obtemprent,
s'clairent de la promotion par Freud de l'Eglise et de l'Arme
comme modles de ce qu'il conoit comme la structure du groupe.
(C'est par ce terme en effet qu'il faudrait traduire aujourd'hui Masse
de sa Massenpsychologie.)
L'effet induit de la structure ainsi privilgie s'claire encore d'y
ajouter la fonction dans l'glise et dans l'Arme du sujet suppos
savoir. Etude pour qui voudra l'entreprendre : elle irait loin.
i^s'en tenir au modle freudien, apparat de faon clatante la
faveur qu'en reoivent les identifications imaginaires, et du mme
coup la raison qui enchane la psychanalyse en intension y limiter
sa considration, voire sa porte.
Un de mes meilleurs lves en a fort bien report le trac sur
l'dipe lui-mme en dfinissant la fonction du Pre idal.
Cette tendance, comme on dit, est responsable de la relgation
au point d'horizon prcdemment dfini de ce qui est qualifiable
d'oedipien dans l'exprience.
La troisime facticit, relle, trop relle, assez relle pour que le
rel soit plus bgueule le promouvoir que la langue, c'est ce que
rend parlable le terme du : camp de concentration, sur lequel il nous
semble que nos penseurs, vaguer de l'humanisme la terreur, ne se
sont pas assez concentrs.
Abrgeons dire que ce que nous en avons vu merger, pour
notre horreur, reprsente la raction de prcurseurs par rapport ce
qui ira en se dveloppant comme consquence du remaniement des
groupements sociaux par la science, et nommment de l'universa-
lisation qu'elle y introduit.
Notre avenir de marchs communs trouvera sa balance d'une
extension de plus en plus dure des procs de sgrgation.
Faut-il attribuer Freud d'avoir voulu, vu son introduction de
257
PROPOSITION SUR LE PSYCHANALYSTE DE L'COLE
naissance au modle sculaire de ce processus, assurer en son groupe
le privilge de la flottabilit universelle dont bnficient les deux
institutions susnommes ? Ce n'est pas impensable.
Quoi qu'il en soit, ce recours ne rend pas plus ais au dsir du
psychanalyste de se situer dans cette conjoncture.
Rappelons que si l'IPA de la Mitteleuropa a dmontr sa pr-
adaptation cette preuve en ne perdant dans lesdits camps pas un
seul de ses membres, elle a d ce tour de force de voir se produire
aprs la guerre une rue, qui n'tait pas sans avoir sa doublure de
rabattage (cent psychanalystes mdiocres, souvenons-nous), de can-
didats dans l'esprit desquels le motif de trouver abri contre la mare
rouge, fantasme d'alors, n'tait pas absent.
Que la coexistence , qui pourrait bien elle aussi s'clairer d'un
transfert, ne nous fasse pas oublier un phnomne qui est une de
nos coordonnes gographiques, c'est le cas de le dire, et dont les
bafouillages sur le racisme masquent plutt la porte.
La fin de ce document prcise le mode sous lequel pourrait tre
introduit ce qui ne tend, en ouvrant une exprience, qu' rendre
enfin vritables les garanties recherches.
On les y laisse sans partage aux mains de ceux qui ont de l'acquis.
On n'oublie pas pourtant qu'ils sont ceux qui ont le plus pti des
preuves imposes par le dbat avec l'organisation existante. Ce que
doivent le style et les fins de cette organisation au black-out port
sur la fonction de la psychanalyse didactique, est vident ds
qu'un regard y est permis : d'o l'isolement dont elle se protge elle-
mme.
Les objections qu'a rencontres notre proposition, ne relvent pas
dans notre cole d!une crainte aussi organique.
Le fait qu'elles se soient exprimes sur un thme motiv, mobilise
dj l'autocritique. Le contrle des capacits n'est plus ineffable, de
requrir de plus justes titres.
C'est une telle preuve que l'autorit se fait reconnatre.
Que le public des techniciens sache qu'il ne s'agit pas de la
contester, mais de l'extraire de la fiction.
L'Ecole freudienne ne saurait tomber dans le tough sans humour
d'un psychanalyste que je rencontrai mon dernier voyage aux USA :
258
PROPOSITION SUR LE PSYCHANALYSTE DE L'COLE
Ce pourquoi je n'attaquerai jamais les formes institues, me dit-il,
c'est qu'elles m'assurent sans problme d'une routine qui fait mon
confort.
Discours l'cole freudienne de Paris
Prsente le 9 octobre 1967 aux psychanalystes en titre (AE
et AME) de l'cole freudienne de Paris, la proposition sur le
psychanalyste de l'cole fut discute par ceux-ci, et soumise
un vote consultatif, lors d'une seconde runion tenue au mois
de novembre. En rponse, J. Lacan rdigea pour la troisime
runion, du 6 dcembre, le texte qui suit ; il fut publi augment
d'un commentaire dat du 1
er
octobre 1970 (2000).
L'immixtion de mon fait, depuis l'anne dernire, de la fonction
de l'acte dans le rseau (quelque usage de ce terme qu'aient fait cer-
tains avis leur tour exprims), dans le texte, disons, dont mon dis-
cours se trame, - l'immixtion de l'acte tait le pralable ce que ma
proposition dite du 9 octobre part.
Est-elle acte ? C'est ce qui dpend de ses suites, ds les premires
se produire.
Le cercle ici prsent de ce qu'il en ait reu non seulement
l'adresse, mais l'aval, fut choisi par moi dans l'cole, d'y constituer
deux classes. a devrait vouloir dire qu'on s'y sente plus gaux
qu'ailleurs et lever du mme coup un handicap pratique.
Je respectais l'approximation du tri d'o sont sortis les AE et les
AME, tels qu'ils sont ports sur l'annuaire de 1965, celui dont la
question se pose s'il doit demeurer le produit majeur de l'cole.
Je respectais non sans raison ce que mritait l'exprience de cha-
cun en tant qu'value par les autres. Une fois ce tri opr, toute
rponse de classe implique l'galit suppose, l'quivalence mutuelle,
toute rponse courtoise, s'entend.
Inutile donc que quiconque, pour s'y croire chef de file, nous
assourdisse des droits acquis de son coute , des vertus de son
contrle et de son got pour la clinique, ni qu'il prenne l'air
entendu de celui qui en tient un bout de plus qu'aucun de sa classe.
261
DISCOURS L'COLE FREUDIENNE DE PARIS
Mme X. et Mme Y. valent de ces chefs autant que MM. P. etV.
On peut admettre cependant que vu le mode sous lequel le tri
s'est toujours opr dans les socits de psychanalyse, voire celui
dont nous-mmes fmes tris, une structuration plus analytique de
l'exprience prvale chez certains.
Mais comment se distribue cette structuration dont personne, que
je sache, ne peut prtendre, hors le personnage qui a reprsent la
mdecine franaise au bureau de l'Internationale psychanalytique,
que ce soit une donne (lui, dit que c'est un don !), voil le premier
point dont s'enqurir. Le point second devient alors de faire des
classes telles non seulement qu'elles entrinent cette distribution
mais qu' servir la produire, elles la reproduiront.
Voil des temps qui mriteraient de subsister dans cette produc-
tion mme, faute de quoi la question de la qualification analytique
eut tre souleve d'o l'on veut : et pas plus concernant notre
cole, comme nous le persuaderaient ceux qui la veulent aussi
propice leur gouverne qu'ils en ont le modle ailleurs.
Si dsirable qu'il soit d'avoir une surface (qu'on irait bien de
l'intrieur branler), elle n'a de porte que d'intimider, non
d'ordonner.
L'impropre n'est pas qu'un quelconque s'attribue la supriorit,
voire le sublime de l'coute, ni que le groupe se garantisse sur ses
marges thrapeutiques, c'est qu'infatuation et prudence fassent office
d'organisation.
Comment esprer faire reconnatre un statut lgal une exp-
rience dont on ne sait pas mme rpondre ?
Je ne peux faire mieux pour honorer les non licet que j'ai recueillis
que d'introduire Flusion prise d'un drle de biais, partir de cet
tre le seul >* dont on se donne les gants d'y saluer l'infatuation la
plus commune en mdecine, non pas mme pour le couvrir de
' tre seul , qui, pour le psychanalyste, est bien le pas dont il entre
en son office chaque matin, ce qui serait dj abusif, mais pour,
de cet tre le seul, justifier le mirage en faire le chaperon de cette
solitude.
Ainsi fonctionne Yi(a) dont s'imaginent le moi et son narcissisme,
faire chasuble cet objet a qui du sujet fait la misre. Ceci parce
que le (a), cause du dsir, pour tre la merci de l'Autre, angoisse
262
DISCOURS L'COLE FREUDIENNE DE PARIS
donc l'occasion, s'habille contraphobiquement de l'autonomie
du moi, comme le fait le bernard-Permite de n'importe quelle cara-
pace.
On fait donc artifice dlibr d'un organon dnonc, et je me
demande quelle faiblesse peut animer une homlie si peu digne de
ce qui se joue. Vad hominem s'en situe-t-il de me faire entendre
qu'on me protge des autres leur montrer qu'ils sont pareils moi,
ce qui permet de faire valoir qu'on me protge de moi-mme.
Mais si j'tais seul en effet, seul fonder l'Ecole, comme, d'en
noncer l'acte, je l'ai dit bille en tte : seul comme je l'ai toujours
t dans ma relation la cause analytique... , me suis-je cru le
seul pour autant? Je ne l'tais plus, du moment mme o un seul
m'embotait le pas, pas par hasard celui dont j'interroge les grces
prsentes. Avec vous tous pour ce que je fais seul, vais-je prtendre
tre isol ?
Qu'est-ce que ce pas, d'tre fait seul, a faire avec le seul qu'on se
croit tre le suivre ? Ne me fi-je l'exprience analytique, c'est--
dire ce qui m'en vient de qui s'en est dbrouill seul? Croirais-je
tre seul l'avoir ; alors pour qui parlerais-je ? C'est plutt d'en avoir
plein la bouche de l'coute, la seule tant la sienne, qui ferait billon
l'occasion.
Il n'y a pas d'homosmie entre le seul et seul.
Ma solitude, c'est justement quoi je renonais en fondant l'E-
cole, et qu'a-t-elle voir avec celle dont se soutient l'acte psychana-
lytique, sinon de pouvoir disposer de sa relation cet acte ?
Car si cette semaine revenu faire sminaire, j'ai sans plus tarder,
pos l'acte psychanalytique, et des trois termes l'interroger sur
sa fin : vise idale, clture, aporie de son compte rendu, - n'est-il
pas remarquable que, des minents qui m'en refusent ici la cons-
quence, de ceux mmes dont c'est l'habitude (habitude des autres)
qu'on les y voie, nul n'y ait paru ? Si aprs tout ma proposition leur
fait passion au point de les rduire au murmure, n'eussent-ils pu
attendre d'une articulation patente qu'elle leur offrt points rfu-
ter?
Mais c'est bien que je ne sois pas seul m'inquiter de cet acte,
qu'on se drobe qui est le seul prendre le risque d'en parler.
Ce que j'ai obtenu d'un sondage confirme qu'il s'agit d'un symp-
tme, aussi psychanalytiquement dtermin que le ncessite son
263
DISCOURS L'COLE FREUDIENNE DE PARIS
contexte et que l'est un acte manqu, si ce qui le constitue est d'ex-
clure son compte rendu
1
.
On verra bien si c'est faon o l'on gagne de se parer, fut-ce me
retourner la question : si, de ne pas s'y pointer, c'est tout vu. On ne
veut pas cautionner l'acte. Mais l'acte ne dpend pas de l'audience
trouve pour la thse, mais dans ce qu'en sa proposition elle reste
pour tous lisible au mur, sans que rien contre ne s'nonce.
D'o vous ftes ici requis d'y rpondre et sans tarder. Tiendrait-
on cette hte pour vice de forme, n'aurais-je dit ce qui s'oublie de la
fonction logique de la hte ?
Elle est de la ncessit d'un certain nombre d'effectuations qui a
bien faire au nombre des participants pour qu'une conclusion s'en
reoive, mais non au compte de ce nombre, car cette conclusion
dpend dans sa vrit mme des ratages qui constituent ces effectua-
tions comme temps.
Appliquez mon histoire de relaxes, mis l'preuve d'avoir justi-
fier quelle marque ils portent (blanche ou noire) pour avoir la clef
des champs : c'est bien parce que certains savent que vous ne sortirez
pas, quoi qu'ils disent, qu'ils peuvent faire que leur sortie soit une
menace, quel que soit votre avis.
L'inou, qui le croirait sauf l'entendre inscrit sur bande, c'est que
mon opration s'identifie du fantasme sadien, que deux personnes
tiennent pour crach dans ma proposition. La posture se rompt, dit
l'un d'eux , mais c'est de construction. L'autre y alla de la clinique.
O le dommage pourtant? quand pas plus loin ne va-t-il que
n'en souffre le personnage vaporeux de l'histoire, qui pour avoir, des
barreaux d'une grille tts pas pas, retrouv l'un marqu d'abord,
concluait : Les salauds, ils m'ont enferm. C'tait la grille de
l'Oblisque, t il avait lui la place de la Concorde.
O est le dedans, o le dehors : les prisonniers la sortie, pas ceux
de mon apologue, se posent la question, parat-il.
Je la propose celui qui sous le coup d'une vapeur aussi philo-
sophique (avant ma proposition) me faisait confidence (peut-tre seu-
lement rvait devant moi) du lustre qu'il retirerait dans notre petit
monde faire savoir qu'il me quittait, au cas que son envie l'emportt.
i. Ainsi quelqu'un n*a-t-il nulle intention de n'y pas venir, c'est seulement
d'avoir cette heure rendez-vous avec son dentiste.
264
DISCOURS L'COLE FREUDIENNE DE PARIS
Qu'il sache en cette preuve que je gote assez cet abandon pour
penser lui quand je dplore que j'aie si peu de monde qui com-
muniquer les joies qui m'arrivent.
Qu'on ne croie pas que moi aussi je me laisse aller. Simplement je
dcolle de ma proposition assez pour qu'on sache que m'amuse
qu'chappe sa minceur, laquelle devrait dtendre mme si l'enjeu
n'est pas mince. Je n'ai avec moi dcidment que des Suffisances la
manque, la manque d'humour en tout cas.
[Qui verra donc que ma proposition se forme du modle du trait
d'esprit, du rle de la dritte Person
l
?] Car il est clair que si tout acte
n'est que figure plus ou moins complte de l'acte psychanalytique,
il n'y en a pas qui domine ce dernier. La proposition n'est pas acte
au second degr, mais rien de plus que l'acte psychanalytique, qui
hsite, d'tre dj en cours.
Je mets toujours balises ce qu'on s'y retrouve en mon discours.
Au liminaire de cette anne, luit celle-ci qui s'homologue de ce
qu'il n'y ait pas d'Autre de l'Autre (de fait), ni de vrai sur le vrai (de
droit) : il n'y a pas non plus d'acte de l'acte, vrai dire impensable.
Ma proposition gte ce point de l'acte, par quoi s'avre qu'il ne
russit jamais si bien qu' rater, ce qui n'implique pas que le ratage
soit son quivalent, autrement dit puisse tre tenu pour russite.
Ma proposition n'ignore pas que le discernement qu'elle appelle,
implique, de cette non-rversibilit, la saisie comme dimension :
[autre scansion du temps logique, le moment de rater ne russit
l'acte que si l'instant d'y passer n'a pas t passage l'acte, de paratre
suivre le temps pour le comprendre
2
].
On voit bien l'accueil qu'elle reoit qu' ce temps je n'ai pas
pens. J'ai seulement rflchi ce qu'elle doive l'entamer.
Qu'elle attaque l'acte psychanalytique par le biais dont il s'institue
dans l'agent, ne le rate que pour ceux qui font que l'institution soit
l'agent dudit acte ; c'est--dire qui sparent l'acte instituant du psy-
chanalyste de l'acte psychanalytique.
Ce qui est d'un rat qui n'est nulle part le russi.
Alors que l'instituant ne s'abstrait de l'acte analytique qu' ce
i. Ceci a t saut lors de la rponse d'o les crochets dont je l'encadre ;
j'indique l cette structure de ce que personne ne s'en soit encore aperu...
z. Mme remarque qu' l'instant.
265
DISCOURS L'COLE FREUDIENNE DE PARIS
qu'il y fasse manque, justement d'avoir russi mettre en cause le
sujet. C'est donc par ce qu'elle a rat que la russite vient la voie
du psychanalysant, quand c'est de l'aprs-coup du dsir du psycha-
nalyste et des apories qu'il dmontre.
Ces apories sont celles que j'ai illustres il y a un instant d'un
badinage plus actuel qu'il n'y paraissait, puisque, si le vaporeux
du hros permet de rire l'couteur, c'est de le surprendre de la
rigueur de la topologie construite de sa vapeur.
Ainsi le dsir du psychanalyste est-il ce lieu dont on est hors sans
y penser, mais o se retrouver, c'est en tre sorti pour de bon, soit
cette sortie ne l'avoir prise que comme entre, encore n'est-ce pas
n'importe laquelle, puisque c'est la voie du psychanalysant. Ne lais-
sons pas passer que dcrire ce lieu en un parcours d'infinitifs, dit
l'inarticulable du dsir, dsir pourtant articul du sens-issue de ces
infinitifs, soit de l'impossible dont je me suffis ce dtour.
C'est l qu'un contrle pourrait sembler n'tre pas de trop, mme
s'il en faut plus pour nous dicter la proposition.
C'est autre chose que de contrler un cas : un sujet (je souligne)
que son acte dpasse, ce qui n'est rien mais qui, s'il dpasse son acte,
fait l'incapacit que nous voyons fleurir le parterre des psychana-
lystes : [qui se manifestera devant le sige de l'obsessionnel par
exemple, de cder sa demande de phallus, l'interprter en termes
de coprophage, et ainsi, de la fixer sa chiasse, ce qu'on fasse enfin
dfaut son dsir
1
).
A quoi a rpondre le dsir du psychanalyste ? A une ncessit
que nous ne pouvons thoriser que de devoir faire le dsir du sujet
comme dsir de l'Autre, soit de se faire cause de ce dsir. Mais pour
satisfaire cette ncessit, le psychanalyste est prendre tel qu'il est
dans la demande, nous venons de l'illustrer.
La correction du dsir du psychanalyste, ce qu'on dit reste
ouverte, d'une reprise du bton du psychanalysant. On sait que ce
sont l propos en l'air. Je dis qu'ils le resteront tant que les besoins ne
se jugeront pas partir de l'acte psychanalytique.
C'est bien pourquoi ma proposition est de s'intresser la passe
o l'acte pourrait se saisir dans le temps qu'il se produit.
i. Mme remarque qu'auparavant. Ajoutons que c'est l de quoi donner un autre
poids au rseau dont on s'agitait en ce dbat.
266
DISCOURS L'COLE FREUDIENNE DE PARIS
Non certes de remettre quiconque sur la sellette, pass ce temps :
qui aurait pu le craindre ? Mais on en a senti atteint le prestige du
galon. C'est l mesurer la puissance du fantasme d'o surgirent, pour
vous de frais la dernire fois, les primes sauts qui ont lanc l'institu-
tion dite internationale, avant qu'elle en devnt la consolidation.
Ceci pour tre juste, montre notre Ecole pas en si mauvais chemin
de consentir ce que certains veulent rduire la gratuit d'apho-
rismes quand il s'agit des miens. S'ils n'taient pas effectifs, aurais-je
pu dbusquer d'une mise au pas alphabtique la position de se terrer
qui fait rgle rpondre tout appel l'opinion dans un convent
analytique, voire y fait simagre du dbat scientifique, et ne s'y
dride pour aucune probation.
D'o par contraste ce style de sortie, malmenant l'autre, qu'y
prennent les interventions, et la cible qu'y deviennent ceux qui
se risquent y contrevenir. Murs aussi fcheuses pour le travail que
rprhensibles au regard de l'ide, aussi simplette qu'on la veuille,
d'une communaut d'Ecole.
Si y adhrer veut dire quelque chose, n'est-ce pas pour que
s'ajoute la courtoisie que j'ai dit lier le plus strictement les classes,
la confraternit en toute pratique o elles s'unissent.
Or il tait sensible que l'acte psychanalytique, solliciter les plus
sages d'en faire avis, s'y traduisait en note de hargne, pour que le ton
en montt mesure que l'vitement invitablement s'en levait.
Car si, les entendre, il devient notoire qu'on y entre plus avant
de vouloir s'en sortir, comment sauf tre dbord, ne pas se fier
sa structure.
Il y suffirait, je pense, d'un plus srieux rseau pour la serrer. Vous
voyez comme je tiens ces mots qu'on veut me rendre meschans
1
!
Je gage qu'ils seront pour moi, si je leur conserve mes faveurs.
Je ne parle pas du retournement qu'on promet mes aphorismes.
Je croyais ce mot destin porter plus loin le gnie de celui-l qui
n'hsite pas en rabattre ainsi l'emploi.
En attendant, c'est bien d'avouer la garantie qu'elle croit devoir
son rseau, pris au sens de ses pupilles au titre de la didactique, que
du premier jet et d'y revenir formellement, quelqu'un qui nous
ferons hommage de la place qu'elle a su prendre dans le milieu psy-
i.Voir quelques lignes plus bas.
267
DISCOURS L'COLE FREUDIENNE DE PARIS
chiatrique au nom de l'cole, a dclar devoir s'opposer toute
suite qui rsulte de ma proposition. L'argumentation qui a suivi fut
un parti pris de l : o elle tient pour tranch que la didactique ne
saurait qu'en tre affecte ? Oui, mais pourquoi dans le pire sens ?
Nous n'en savons encore rien.
Je ne vois aucun inconvnient ce que la chose qui du rseau
s'intitule comme patronage du didacticien sur sa clique quand celle-
ci s'y complat, soit propose l'attention pour peu qu'un soupon
de raison s'en promette un succs : mais consultez sa courageuse
dnonciation dans Y International Journal, a vous en dira long sur ce
qui peut suivre de ce courage.
Prcisment il me semblait que ma proposition ne dnonait pas
le rseau, mais dans sa plus minutieuse disposition se mettait en tra-
vers. D'o m'tonne moins de voir qu'on s'alarme de la tentation
qu'elle offre aux vertueux du contr'rseau. Ce qui me barrait cette
vue, sans doute tait-ce de me refuser de m'tonner que mon rseau
ne m'tranglt pas ?
Vais-je m'attarder discuter d'un mot comme le plein transfert
en son usage de hourvari. J'en ris parce que chacun sait que c'est le
coup has le plus usuel toujours faire ses preuves dans un champ o
les intrts ne se mnagent pas plus qu'ailleurs.
Mme ne pas tre dans le coup, on est frapp de percevoir dans
tel factum faire avis diffus l'avance, que le rseau mien serait
plus dangereux que les autres de tisser sa toile, c'est crit en toutes
lettres : de la rue de Lille la rue d'Ulm K Et alors ?
Je ne crois pas au mauvais got d'une allusion mon rseau fami-
lial. Parlons de mon bout d'Oulm (a fera Lewis Carroll) et de ses
Cahiers pour Vanalyse.
Est-ce que je propose d'installer mon bout d'Oulm au sein des
AE ? Et pourquoi pas, si par hasard un bout d'Oulm se faisait analy-
ser? Mais pris en ce sens, mon rseau, je l'affirme, n'en a aucun qui
y ait pris rang, ni y soit en instance.
Mais le rseau dont il s'agit est pour moi d'autre trame, de repr-
senter l'expansion de l'acte psychanalytique.
Mon discours, d'avoir retenu des sujets que n'y prpare pas l'ex-
i. De mon cabinet professionnel l'cole normale suprieure o mon sminaire
se tenait l'poque et y tait cout d'une gnration.
268
DISCOURS L'COLE FREUDIENNE DE PARIS
prience dont il s'autorise, prouve qu'il tient le coup d'induire
ces sujets se constituer de ses exigences logiques. Ce qui suggre
que ceux qui, ladite exprience, l'ont, ne perdraient rien se former
ces exigences qui en sortent, pour les lui restituer dans leur
coute , dans leur regard clinique, et pourquoi pas dans leurs
contrles. O ne les rend pas plus indignes d'tre entendues qu'elles
puissent servir en d'autres champs.
Car l'exprience du clinicien comme l'coute du psychanalyste
n'ont pas tre si assures de leur axe que de ne pas s'aider des
repres structuraux qui de cet axe font lecture. Ils ne seront pas de
trop pour, cette lecture, la transmettre, qui sait : pour la modifier, en
tout cas pour l'interprter.
Je ne vous ferai pas l'injure d'arguer des bnfices que l'cole tire
d'un succs que j'ai longtemps russi carter de mon travail et qui,
venu, ne l'affecte pas.
Cela me fait souvenir d'un nomm dindon (en anglais) dont il
m'a fallu supporter en juillet 62 les propositions malpropres, avant
qu'une commission d'enqute dont il tait l'entremetteur, mt en
jeu son homme de main. Au jour prvu pour le verdict, convenu au
dpart de la ngociation, il s'acquittait avec mon enseignement,
d'alors plus de dix ans, me dcerner le rle de sergent-recruteur,
l'oreille de ceux qui collaboraient avec lui semblant sourde ce qui,
eux, par cette voie leur revenait de l'histoire anglaise, de jouer les
recruts ivrognes.
Certains sont plus sourcilleux aujourd'hui devant la face d'expan-
sion de mon discours. A se rassurer d'un effet de mode dans cet afflux
de mon public, ils ne voient encore pas que pourrait tre contest
le droit de priorit qu'ils croient avoir sur ce discours de l'avoir tenu
sous le boisseau.
C'est quoi ma proposition parerait, ranimer dans le champ de
la psychanalyse ses justes suites.
Encore faudrait-il que ce ne soit pas de ce champ que vnt le mot
de non-analyste pour un office que je reconnais le voir resurgir :
chaque fois que mon discours fait acte en ses effets pratiques, ce mot
pingle ceux qui l'entendent bien ainsi.
C'est sans gravit pour eux. L'exprience a montr que, pour
rentrer en grce, la prime est faible payer. Qui se spare de moi,
redeviendra analyste de plein exercice, au moins de par l'investiture
269
DISCOURS L'COLE FREUDIENNE DE PARIS
de l'Internationale psychanalytique. Un petit vote pour m'exclure,
que dis-je, mme pas : une abstention, une excuse donne temps,
et l'on retrouve tous ses droits l'Internationale, quoique form de
pied en cap par ma pratique intolrable. On pourra mme user de
mes termes, pourvu qu'on ne me cite pas, puisque ds lors ils n'au-
ront plus de consquence, pour cause du bruit les couvrir. Que ne
l'oublie ici personne, la porte n'est pas referme.
Il y a nanmoins pour redevenir analyste un autre moyen que
j'indiquerai plus tard parce qu'il vaut pour tous, et pas seulement
pour ceux qui me doivent leur mauvais pas, telle une certaine
bande--Mbius, vrai ramassis de non-analystes
!
.
C'est que, quand on va jusqu' crire que ma proposition aurait
pour but de remettre le contrle de l'Ecole des non-analystes, je
n'irai pas moins qu' relever le gant.
Et jouer de dire que c'en est bien en effet le sens : je veux
mettre des non-analystes au contrle de l'acte analytique, s'il faut
entendre par l que l'tat prsent du statut de l'analyste non seule-
ment le porte luder cet acte, mais dgrade la production qui en
dpendrait pour la science.
En un autre cas, ce serait bien de gens pris hors du champ en
souffrance qu'on attendrait intervention. Si cela ne se conoit pas
ici, c'est en raison de l'exprience dont il s'agit, celle dite de l'in-
conscient puisque c'est de l que se justifie trs sommairement l'ana-
lyse didactique.
Mais prendre le terme d'analyste dans le sens o tel ou tel
peut s'imputer d'y manquer au titre d'un conditionnement mal
saisissable sinon d'un standard professionnel, le non-analyste n'im-
plique pas le non-analys, qu'videmment je ne songe pas faire
accder, vu la port" d'entre que je lui donne, la fonction d'ana-
lyste de l'cole.
Ce n'est mme pas le non-praticien qui serait en cause, quoique
admissible cette place. Disons que j'y mets un non-analyste en
esprance, celui qu'on peut saisir d'avant qu' se prcipiter dans l'ex-
i. C'est le ramassis s'tre commis dans le premier numro de Scilicet, dont la
parution devait faire l'objet bientt de curieuses manuvres dont pour certains le
scandale ne tint qu' leur divulgation.
A la date du 6 dcembre, c'tait encore venir.
270
DISCOURS L'COLE FREUDIENNE DE PARIS
prience, il prouve, semble-t-il dans la rgle, comme une amnsie
de son acte.
Est-il concevable autrement qu'il me faille faire merger la passe
(dont personne ne me discute l'existence) ? Ceci par le moyen de
la redoubler du suspense qu'y introduit sa mise en cause aux fins
d'examen. C'est de ce prcaire que j'attends que se sustente mon
analyste de l'cole.
Bref c'est celui-l que je remets l'Ecole, soit entre autres la
charge d'abord de dtecter comment les analystes n'ont qu'une
production stagnante, - sans issue thorique hors mon essai de la
ranimer -, o il faudrait faire mesure de la rgression conceptuelle,
voire de l'involution imaginaire prendre au sens organique. (La
mnopause pourquoi pas ? et pourquoi n'a-t-on jamais vu d'inven-
tion de jeune en psychanalyse ?)
Je n'avance cette tche qu' ce qu'elle fasse rflexion pour (j'en-
tends qu'elle rpercute) ce qu'il y a de plus abusif la confier au psy-
chosociologue, voire l'tude de march, entreprise dont vous ne
vous tes pas autrement aperus (ou bien alors comme semblant, c'est
russi), quand la pourvut de son gide un psychanalyste professeur.
Mais observez que si quelqu'un demande une psychanalyse pour
procder sans doute, c'est l votre doctrine, dans ce qu'a de confus
son dsir d'tre analyste, c'est cette procession mme qui, de tomber
en droit sous le coup de l'unit de la psychologie, va y tomber en
fait. v
C'est pourquoi c'est d'ailleurs, de l'acte psychanalytique seule-
ment, qu'il faut reprer ce que j'articule du dsir du psychana-
lyste , lequel n'a rien faire avec le dsir d'tre psychanalyste.
Et si l'on ne sait mme pas dire, sans s'enfoncer dans le vaseux du
personnel au didactique , ce qu'est une psychanalyse qui intro-
duit son propre acte, comment esprer que soit lev ce handicap
fait pour allonger son circuit, qui tient ce que nulle part l'acte psy-
chanalytique n'est distingu de la condition professionnelle qui le
couvre ?
Faut-il attendre que l'emploi existe de mon non-analyste soute-
nir cette distinction pour qu'une psychanalyse (une premire un
jour) se demander comme didactique sans que l'enjeu en soit un
tablissement, quelque chose survienne d'un ordre perdre sa fin
chaque instant ?
271
DISCOURS L'COLE FREUDIENNE DE PARIS
Mais la demande de cet emploi est dj une rtroaction de l'acte
psychanalytique, c'est--dire qu'elle en part.
Qu'une association professionnelle ne puisse y satisfaire, la pro-
duire a ce rsultat de forcer celle-ci l'avouer. Il s'agit alors de savoir
si l'on y peut rpondre d'ailleurs, d'une cole par exemple.
Peut-tre serait-ce l raison pour quelqu'un de demander une
analyse un analyste-membre-de... l'cole, sans quoi au nom de
quoi pourrait-elle s'y attendre ? au nom de la libre entreprise ? qu'on
dresse alors autre boutique.
Le risque pris, pour tout dire, dans la demande qui ne s'articule
que de ce qu'advienne l'analyste, doit tre tel objectivement que
celui qui n'y rpond qu' la prendre sur lui, soit : d'tre l'analyste,
n'aurait plus le souci de devoir la frustrer, ayant assez retordre de la
gratifier de ce qu'en vienne mieux qu'il ne fait sur l'heure.
Faon d'coute, mode de clinique, sorte de contrle, peut-tre
plus portante en son objet prsent de le viser son dsir plutt que
de sa demande.
Le dsir du psychanalyste , c'est l le point absolu d'o se triangule
l'attention ce qui, pour tre attendu, n'a pas tre remis demain.
Mais le poser comme j'ai fait, introduit la dimension o l'analyste
dpend de son acte, se reprer du fallacieux de ce qui le satisfait,
s'assurer par lui de n'tre pas ce qui s'y fait.
C'est en ce sens que l'attribut du non-psychanalyste est le garant
de la psychanalyse, et que je souhaite en effet des non-analystes, qui
se distinguent en tout cas des psychanalystes d' prsent, de ceux qui
payent leur statut de l'oubli de l'acte qui le fonde.
Pour ceux qui me suivent en cette voie, mais regretteraient pour-
tant une qualification reposante, je donne comme je l'ai promis,
l'autre voie que de me laisser : qu'on me devance dans mon discours
le rendre dsuet. Je saurai enfin qu'il n'a pas t vain.
En attendant, il me faut subir d'tranges musiques. Voil-t-il pas
la fable mise en cours du candidat qui scelle un contrat avec son
psychanalyste : Tu me prends mes aises, moi je te fais la courte
chelle. Aussi fort que malin (qui sait un de ces normaliens qui vous
dnormaliseraient une socit tout entire avec ces trucs chiqus
qu'ils ont tout loisir de mijoter pendant leurs annes de feignantise),
ni vu ni connu, je les embrouille, et tu passes comme une fleur : ana-
lyste de l'cole selon la proposition.
272
DISCOURS L'COLE FREUDIENNE DE PARIS
Mirifique ! ma proposition n'aurait-elle engendr que cette souris
qu'elle y devient rongeur elle-mme. Je demande : ces complices,
que pourront-ils faire d'autre partir de l qu'une psychanalyse o
pas une parole ne pourra se drober la touche du vridique, toute
tromperie d'tre gratuite y tournant court. Bref une psychanalyse
sans mandre. Sans les mandres qui constituent le cours de toute
psychanalyse de ce qu'aucun mensonge n'chappe la pente de la
vrit.
Mais qu'est-ce que a veut dire quant au contrat imagin, s'il ne
change rien ? Qu'il est futile, ou bien que mme quand quiconque
n'en a vent, il est tacite.
Car le psychanalyste n'est-il pas toujours en fin de compte la
merci du psychanalysant, et d'autant plus que le psychanalysant ne
peut rien lui pargner s'il trbuche comme psychanalyste, et s'il ne
trbuche pas, encore moins. Du moins est-ce ce que nous enseigne
l'exprience.
Ce qu'il ne peut lui pargner, c'est ce dstre dont il est affect
comme du terme assigner chaque psychanalyse, et dont je
m'tonne de le retrouver dans tant de bouches depuis ma propo-
sition, comme attribu celui qui en porte le coup, de n'tre dans la
passe connoter que d'une destitution subjective : le psychanalysant.
Pour parler de la destitution subjective, sans vendre la mche du
baratin pour le passeur, soit ce dont les formes en usage jusqu'ici
dj font rver leur aune, - j e l'aborderai d'ailleurs.
Ce dont il s'agit, c'est de faire entendre que ce n'est pas elle qui
fait dstre, tre plutt, singulirement et fort. Pour en avoir l'ide,
supposez la mobilisation de la guerre moderne telle qu'elle intervient
pour un homme de la Belle Epoque. a se trouve chez le futuriste
qui y Ht sa posie, ou le publiciste qui rameute le tirage. Mais pour
ce qui est de l'effet d'tre, a se touche mieux chez Jean Paulhan.
Le Guerrier appliqu, c'est la destitution subjective dans sa salubrit.
Ou bien encore imaginez-moi en 61, sachant que je servais mes
collgues rentrer dans l'Internationale, au prix de mon enseigne-
ment qui en sera proscrit. Je poursuis pourtant cet enseignement,
moi au prix de ne m'occuper que de lui, sans m'opposer mme au
travail d'en dtacher mon auditoire.
Ces sminaires dont quelqu'un les relire, s'criait devant moi
rcemment, sans plus d'intention m'a-t-il sembl, qu'il fallait que
273
DISCOURS L'COLE FREUDIENNE DE PARIS
j'eusse bien aim ceux pour qui j'en tenais le discours, voil un autre
exemple de destitution subjective. Eh bien, je vous en tmoigne, on
tre assez fort en ce cas, au point de paratre aimer, voyez-vous a.
Rien faire avec le dstre dont c'est la question de savoir com-
ment la passe peut l'affronter s'affubler d'un idal dont le dstre
s'est dcouvert, prcisment de ce que l'analyste ne supporte plus le
transfert du savoir lui suppos.
C'est sans doute quoi rpondait le Heil ! du kapo de tout
l'heure quand se sentir lui-mme cribl de son enqute, il souf-
flait : Il nous faut des psychanalystes tremps. Est-ce dans son jus,
qu'il voulait dire ?
Je n'insiste pas : voquer les camps, c'est grave, quelqu'un a cru
devoir nous le dire. Et ne pas les voquer?
J'aime mieux au reste rappeler le propos du thoricien d'en face
qui de toujours se fait amulette de ce qu'on psychanalyse avec son
tre : son tre le psychanalyste naturellement. Dans certains cas,
on a a porte de la main au seuil de la psychanalyse, et il arrive
qu'on l'y conserve jusqu' la fin.
Je passe sur ce que quelqu'un qui s'y connat, me fait fasciste, et
pour en finir avec les broutilles, je retiens avec amusement que ma
proposition et impos l'admission de Fliess l'Internationale psy-
chanalytique, mais rappelle que Y ad absurdum ncessite du doigt,
et qu'il choue ici de ce que Freud ne pouvait tre son propre pas-
seur, et que c'est bien pourquoi il ne pouvait relever Fliess de son
dstre.
Si j'en crois les souvenirs si prcis que Mme Blanche Reverchon-
Jouve me fait parfois l'honneur de me confier, j'ai le sentiment
que, si les premiers disciples avaient soumis un passeur choisi
d'entre eux, disons : non leur apprhension du dsir de l'analyste,
- dont la notion n'tait pas mme apercevable alors - si tant est que
quiconque y soit maintenant -, mais seulement leur dsir de l'tre,
l'analyste, le prototype donn par Rank en sa personne du Je ne
pense pas et pu tre situ beaucoup plut tt sa place dans la
logique du fantasme.
Et la fonction de l'analyste de l'cole ft venue au jour ds
l'abord.
Car enfin il faut qu'une porte soit ouverte ou ferme, ainsi est-on
274
DISCOURS L'COLE FREUDIENNE DE PARIS
dans la voie psychanalysante ou dans l'acte psychanalytique. Ou peut
les faire alterner comme une porte bat, mais la voie psychanalysante
ne s'applique pas l'acte psychanalytique, dont la logique est de sa
suite.
Je suis en train de dmontrer choisir pour mon sminaire telles
de ces propositions discrtes que noie la littrature psychanalytique,
que chaque fois qu'un psychanalyste capable de consistance fait
prvaloir un objet dans l'acte psychanalytique (cf. article de Winni-
cott
1
), il doit dclarer que la voie psychanalysante ne saurait que
le contourner : n'est-ce pas indiquer le point d'o seul ceci est
pensable, le psychanalyste lui-mme en tant qu'il est cause du
dsir?
J'en ai assez dit, je pense, pour qu'on entende qu'il ne s'agit nulle-
ment d'analyser le dsir du psychanalyste. Nous n'oserons parler
mme de sa place nette, avant d'avoir articul ce qui le ncessite de
la demande du nvros, laquelle donne le point d'o il n'est pas arti-
culable.
Or la demande du nvros est trs prcisment ce qui condi-
tionne le port professionnel, la simagre sociale dont la figure du
psychanalyste est prsentement forge.
Qu'il favorise en ce statut l'grnement des complexes identifica-
toires n'est pas douteux, mais a^a limite, et celle-ci n'est pas sans
faire en retour opacit.
Tel est, dsign de la plume de Freud lui-mme, le fameux narcis-
sisme de la petite diffrence, pourtant parfaitement analysable le
rapporter la fonction qu'en le dsir de l'analyste occupe l'objet (a).
Le psychanalyste, comme on dit, veut bien tre de la merde, mais
pas toujours la mme. C'est interprtable, condition qu'il s'aper-
oive que d'tre de la merde, c'est vraiment ce qu'il veut, ds qu'il se
fait l'homme de paille du sujet-suppos-savoir.
Ce qui importe n'est donc pas cette merde-ci, ou bien celle-l.
Ce n'est pas non plus n'importe laquelle. C'est qu'il saisisse que
i. Cf. OnTransference , lJP
t
octobre 1956, nIV/V, p.386-388. Article que j'in-
troduisis le 29 novembre 1967 pour indiquer comment l'auteur ne repre un objet
privilgi de son exprience, le qualifier de faise self, qu' exclure sa manuvre de
la fonction analytique telle qu'il la situe. Or il n'articule cet objet que du processus
primaire, pris de Freud.
J'y dcle le lapsus de l'acte psychanalytique.
275
DISCOURS L'COLE FREUDIENNE DE PARIS
cette merde n'est pas de lui, pas plus que de l'arbre qu'elle couvre au
pays bni des oiseaux : dont, plus que l'or, elle fait le Prou.
L'oiseau de Vnus est chieur. La vrit nous vient pourtant sur des
pattes de colombe, on s'en est aperu. Ce n'est pas une raison pour
que le psychanalyste se prenne pour la statue du marchal Ney.
Non, dit l'arbre, il dit non, pour tre moins rigide, et faire dcouvrir
l'oiseau qu'il reste un peu trop sujet d'une conomie anime de
l'ide de la Providence.
Vous voyez que je suis capable d'adopter le ton en usage quand
nous sommes entre nous. J'en ai pris un peu chacun de ceux
qui ont manifest leur avis, la hargne prs, j'ose le dire : car vous le
verrez avec le temps, dont a se dcante comme l'cho du Loup-y-
es-tu ? .
Et concluons. Ma proposition n'et chang que d'un cheveu la
demande de l'analyse une fin de formation. Ce cheveu et suffi,
pourvu que se st sa pratique.
Elle permettait un contrle non inconu de ses suites. Elle ne
contestait nulle position tablie.
S'y opposent ceux qui seraient appels son exercice. Je ne puis
le leur imposer.
Mince comme un cheveu, elle n'aura pas se mesurer l'ampleur
de l'aurore.
Il suffirait qu'elle l'annonce.
J'arrte l le morceau, les dispositions pratiques dont il se clt
n'ayant plus d'intrt eh ce 1
er
octobre 70. Qu'on sache pourtant que
de n'tre pas lu, il fut dit autrement, au reste comme en tmoigne
la version enregistre, le suivre ligne ligne. Ceux qui d'y avoir
t pris, la reurent, pourront, de sa syntaxe parle, apprcier l'in-
flexion.
Celle-ci se fait plus patiente, d'autant que vif est le point qui fait
enjeu.
La passe, soit ce dont personne ne me dispute l'existence, bien
que la veille fut inconnu au bataillon le rang que je viens de lui don-
ner, la passe est ce point o d'tre venu bout de sa psychanalyse, la
place que le psychanalyste a tenue dans son parcours, quelqu'un fait
276
DISCOURS L'COLE FREUDIENNE DE PARIS
ce pas de la prendre. Entendez bien : pour y oprer comme qui l'oc-
cupe, alors que de cette opration il ne sait rien, sinon quoi dans
son exprience elle a rduit l'occupant.
Que rvle qu' applaudir ce que je marque ainsi ce tournant,
on ne s'en oppose pas moins la disposition la plus proche en
tirer : soit qu'on offre qui le voudrait d'en pouvoir tmoigner, au
prix de lui remettre le soin de l'clairer par la suite ?
videmment on touche l la distance, qui tient de moi sa dimen-
sion, distance du monde qui spare le bonhomme qu'on investit, qui
s'investit, ce peu importe, mais qui fait la substance d'une qualifica-
tion : formation, habilitation, appellation plus ou moins contrle,
c'est tout un, c'est habit, voire habitus ce que le bonhomme le
porte, - qui, dis-je, spare le bonhomme, du sujet qui n'arrive l que
de la division premire qui rsulte de ce qu'un signifiant ne le repr-
sente que pour un autre signifiant, et que cette division, il l'prouve
reconnatre que l'autre signifiant: Ur, l'ourigine (au dpart
logique), est refoul. Par quoi, si on le lui ressortait (ce qui ne saurait
tre le cas, car nous dit Freud, c'est le nombril de l'inconscient), alors
ce serait de son reprsentant qu'il perdrait les pdales : ce qui laisse-
rait la reprsentation dont il s'imagine tre la chambre noire, alors
qu'il n'en est que le kalidoscope, dans une pagaille ce qu'il y
retrouve fort mal les effets de symtrie dont s'assurent sa droite et
sa gauche, ses droits et ses torts, le remettre d'assiette au giron de
l'ternel.
Un tel sujet n'est pas donn d'une intuition qui fasse bonheur
soutenir la dfinition de Lacan.
Mais l'extrmisme de celle-ci dmarque des implications dont se
pare la routine de la qualification traditionnelle, les ncessits qui
rsultent de la division du sujet : du sujet tel qu'il s'labore du fait de
l'inconscient, soit du hio
9
dont faut-il que je rappelle qu'il parle
mieux que lui, d'tre structur comme un langage, etc. ?
Ce sujet ne s'veille qu' ce que pour chacun au monde, l'affaire
devienne autre que d'tre le fruit de l'volution qui de la vie fait
au dit monde une connaissance : oui, une connerie-sens dont ce
monde peut dormir sur ses deux oreilles.
Un tel sujet se construit de toute l'exprience analytique, quand
Lacan tente par son algbre de le prserver du mirage d'en tre Un :
par la demande et le dsir qu'il pose comme institus de l'Autre, et
277
DISCOURS L'COLE FREUDIENNE DE PARIS
par la barre qui rapplique d'tre l'Autre mme, faire que la division
du sujet se symbolise du S barr, lequel, sujet ds lors des affects
imprvisibles, un dsir inarticulable de sa place, se fait une cause
(comme on dirait : se fait une raison), se fait une cause du plus-de-
jouir, dont pourtant, le situer de l'objet a, Lacan dmontre le dsir
articul, fort bien, mais de la place de l'Autre.
Tout a ne se soutient pas de quatre mots, mais d'un discours
dont il faut noter qu'il fut d'abord confidentiel, et que son passage
au public ne permettait en rien un autre fanal de mme sous-cape
dans le marxisme, de se laisser dire que l'Autre de Lacan, c'est Dieu
mis en tiers entre l'homme et la femme. Ceci pour donner le ton de
ce que Lacan trouve comme appui hors de son exprience.
Nanmoins il se trouve qu'un mouvement qu'on appelle structu-
ralisme, patent dnoncer le retard pris sur son discours, une crise,
j'entends celle dont Universit et marxisme sont rduits nager, ne
rendent pas dplac d'estimer que le discours de Lacan s'y confirme,
et ce d'autant que la profession psychanalytique y fait dfaut.
Dont ce morceau prend sa valeur de pointer d'abord d'o se
fomentait une proposition : le temps de l'acte, quoi nulle tempori-
sation n'tait de mise puisque c'est l le ressort mme de son tam-
ponnement.
On s'amuserait ponctuer ce temps par l'obstacle qu'il manifeste.
D'un Directoire consult qui prend la chose la bonne de s'en
sentir encore juge, non sans que s'y distingue telle ferveur prendre
la flche avant de prendre le vent, mais nettement dj telle froideur
ressentir ce qui ici ne peut qu'teindre sa rclame.
Mais de l'audience plus large, quoique restreinte, quoi prudent,
j'en remets l'avis, un tremblement s'lve chez ceux dont c'est
l'tablissement, que le point que j'ai dit reste couvert pour tre
leur merci. Ne montrais-je pas ma faon de sortie discrte pour
ma Situation de la psychanalyse en 1956 , que je savais qu'une
satire ne change rien ?
Comme il faudrait que changent ceux dont l'exercice de la pro-
position rpond au titre de la nomination de passeurs, du recueil de
leur tmoignage, de la sanction de ses fruits, leur non licet l'emporte
sur les licet qui font pourtant, quels qu'en soient les quemadmodum,
majorit aussi vaine qu'crasante.
On touche l ce qui s'obtient cependant de n'avoir pas tempo-
278
DISCOURS L'COLE FREUDIENNE DE PARIS
ris, et ce n'est pas seulement que, fraye par l'moi de mai dont
s'agitent mme les associations psychanalytiques, il faut dire mme
les tudiants en mdecine dont on sait qu'ils prirent leur temps pour
y venir, ma proposition passera haut la main un an et demi plus tard.
A ne livrer, qu' l'oreille qui puisse en rtablir l'cart, les thmes,
le ton dont les motifs se lchent l'occasion des avis que j'ai solli-
cits d'office, ma rponse laisse, de l'avatar qui me fait sort, une trace
propre, je ne dis pas un progrs, je ne prtends rien de tel, on le
sait, mais un mouvement ncessaire.
Ce que je puis dnoncer concernant l'accession la fonction de
psychanalyste, de la fonction de l'influence dans son approche, de la
simagre sociale dans son graus, de l'ignorance qualifie pour ceux
qu'on poste en rpondre, n'est rien auprs du refus d'en connatre
qui du systme fait bloc.
Car on n'a qu' ouvrir le journal officiel dont l'association donne
ses actes une porte internationale pour y trouver, littralement
dcrit, autant et plus que je n'en peux dire. Quelqu'un m'a suggr
relire l'preuve de mon texte de prciser le numro dont j'y fais
rfrence, de Y International Journal. Je ne m'en donnerai pas la peine :
qu'on ouvre le dernier paru. On y trouvera, fut-ce ce qu'un titre
l'annonce de ce terme mme, V irrvrence qui fait cortge la for-
mation du psychanalyste : on y touche que c'est bien de lui faire
enseigne qu'il s'agit. C'est qu' n'emporter aucune proposition d'al-
ler plus loin dans ces impasses, tous les courages, c'est ce que plus
haut je laisse entendre, sont permis.
Autant dire, quoique seulement depuis mai 68, de dbats rono-
typs qui me parviennent de l'Institut psychanalytique de Paris.
A la diffrence de l'cole o se produit ma proposition, de ces
endroits ne vient nul cho que personne en dmissionne, ni mme
qu'il en soit question.
Pour moi, je n'ai rien forc. Je n'ai eu qu' ne pas prendre parti
contre ma proposition ce qu'elle me revienne elle-mme du floor,
il me faut le dire : sous des formules plus ou moins bien inspires,
pour que la plus sre s'impose de loin la prfrence des votants, et
que l'Ecole pt venir au jour d'tre allge de ses empcheurs, sans
que ceux-ci eussent se plaindre ni de la solde prise en son temps
de leurs services, ni de l'aura garde de sa cote.
Je relis des notes qui me font reproche de cette issue, tenant la
279
DISCOURS L'COLE FREUDIENNE DE PARIS
perte que j'en supporte pour signe d'un manque de sagesse. Serait-
elle plus grande que ce qu'y dmontre de sa ncessit mon dis-
cours ?
Je sais de la curieuse haine
l
de ceux qui d'autrefois furent emp-
chs de savoir ce que je dis, ce qu'il faut y reconnatre du transfert,
soit au-del de ce qui s'impose de mon savoir, ce qu'on m'en sup-
pose, quoi qu'on en ait.
Comment l'ambivalence, pour parler comme ceux qui croient
qu'amour et haine ont un support commun, ne serait-elle pas plus
vive d'un sujet divis de ce que je le presse de l'acte analytique?
Occasion de dire pourquoi je n'ai pu longtemps mettre qu'au
compte d'histoires le fait tonnant, le prendre de son biais national,
que mon discours fut rejet de ceux-l mmes qu'et d intresser
le fait que sans lui, la psychanalyse en France serait ce qu'elle est en
Italie, voire en Autriche, o qu'on aille pcher ce qu'on sait de
Freud !
L'anecdote, c'est le cas faire de l'amour : mais comment donc
ce dont chacun dans le particulier fait sa rgle, peut-il prter cette
inflation dans l'universel ? Que l'amour ne soit que rencontre, c'est-
-dire pur hasard (comique ai-je dit), c'est ce que je ne puis mcon-
natre dans ceux qui furent avec moi. Et ce qui leur laisse aussi bien
leurs chances, en long, en large et en travers. Je n'en dirais pas autant
de ceux qui contre moi furent prvenus, - qu'ils aient mrit de
l'tre n'y changeant rien.
Mais tout de mme a me lave aux yeux des sages de tout attrait
pour la srie dont je suis le pivot, mais non pas le ple.
Car l'pisode de ceux qu'on pouvait croire m'tre rests pas par
hasard, permet de toucher/que mon discours n'apaise en rien l'hor-
reur de l'acte psychanalytique.
Pourquoi ? Parce que c'est l'acte, ou plutt ce serait, qui ne sup-
porte pas le semblant.
Voil pourquoi la psychanalyse est de notre temps l'exemple d'un
i. Le croira-t-on : dans le cas dont je l'illustre dans Scilicet, 1, on a remis a de la
mme veine : soit une lettre dont on se demande par quel bout la prendre, de l'irr-
pressible de son envoi ou de la confiance qui m'y est faite.
Je dis : le sentiment de ma ralit y est conforme l'ide qu'on se fait de la
norme du ct en question, et que je dnoncerai en ces termes : la ralit est ce sur
quoi on se repose pour continuer rver.
280
DISCOURS L'COLE FREUDIENNE DE PARIS
respect si paradoxal qu'il passe l'imagination, de porter sur une disci-
pline qui ne se produit que du semblant. C'est qu'il y est nu un tel
point que tremblent les semblants dont subsistent religion, magie,
pit, tout ce qui se dissimule de l'conomie de la jouissance.
Seule la psychanalyse ouvre ce qui fonde cette conomie dans
l'intolrable : c'est la jouissance que je dis.
Mais l'ouvrir, elle le ferme du mme coup et se rallie au sem-
blant, mais un semblant si impudent, qu'elle intimide tout ce qui
du monde y met des formes.
Vais-je dire qu'on n'y croit pas ce qu'on fait? Ce serait mcon-
natre que la croyance, c'est toujours le semblant en acte. Un de mes
lves un jour a dit l-dessus de fort bonnes choses : on croit ne pas
croire ce qu'on fait profession de feindre, mais c'est une erreur, car
il suffit d'un rien, qu'il en arrive par exemple ce qu'on annonce,
pour qu'on s'aperoive qu'on y croit, et que d'y croire, a fait trs
peur.
Le psychanalyste ne veut pas croire l'inconscient pour se recru-
ter. O irait-il, s'il s'apercevait qu'il y croit se recruter de semblants
d'y croire ?
L'inconspient, lui, ne fait pas semblant. Et le dsir de l'Autre n'est
pas un vouloir la manque.
Introduction de Scilicet
au titre de la revue
de l'cole freudienne de Paris
A QUI S'ADRESSE SCIUCET?
Scilicet : tu peux savoir, tel est le sens de ce titre. Tu peux savoir
maintenant, que j'ai chou dans un enseignement qui ne
s'est adress douze ans qu' des psychanalystes, et qui de leur fait,
depiris quatre ans, a rencontr ce quoi, en dcembre 1967 l'Ecole
normale suprieure o je parle, j'ai fait hommage comme au
nombre.
Dans l'un et l'autre de ces temps, j'ai chou rompre le mauvais
charme qui s'exerce de l'ordre en vigueur dans les Socits psycha-
nalytiques existantes, sur la pratique de la psychanalyse et sur sa pro-
duction thorique, l'une de l'autre solidaires.
Cette revue est l'un des moyens dont j'attends de surmonter dans
mon cole, qui se distingue en son principe desdites Socits, l'obs-
tacle qui m'a rsist ailleurs.
Scilicet : tu peux savoir ce qu'il en adviendra maintenant.
A qui ce tu s'adresse-t-il pourtant? N'es-fw rien que l'enjeu
situer dans un temps qui ne se dessine qu' tre l'origine d'une par-
tie quoi il n'aura manqu que d'tre joue ? Ce temps n'est rien,
mais il te fait doublement perdue, Eurydice, toi qui subsistes comme
enjeu.
Je dis que la psychanalyse ne joue pas le jeu avec toi, qu'elle ne
prend pas en charge ce dont pourtant auprs de toi elle se rclame.
C'est de ceci : que l'tre qui pense ( ceci prs qu'il l'est en tant qu'il
ne le sait pas), que cet tre, dis-je, n'est pas sans se penser comme
question de son sexe : sexe dont il fait bien partie de par son tre
puisqu'il s'y pose comme question.
Que ces effets soient maintenant irrpudiables, de ce que de leur
rvlation soit apparu le trait sauvage des expdients dont on y pare,
283
INTRODUCTION DE SCILICET
qu'il soit probable que la sauvagerie s'en accroisse chaque jour
mesure du reniement de cette rvlation, voil ce dont la psychana-
lyse est directement responsable de faire dfaut dnoncer le dfaut
qui est au dpart.
C'est ce qu'elle fait en le reportant au ratage d'un bien-tre oral.
Dviation servir d'exemple pour le statut de l'idologie, quand on
sait de source observe la place de la digestion dans la morale pro-
fessionnelle du psychanalyste.
Tu que je cherche, sache bien que j'ai ma part de rigolade.
C'est pourquoi je dcide de t'appeler : bachelier, pour te rappeler
ta place dans cet empire du pdantisme, devenu assez prvalent pour
que ta chute mme en ce monde ne te promette rien de plus qu'
l'gout de la culture. N'espre pas y chapper, mme t'inscrire au
Parti.
C'est ainsi que je suis moi-mme allou au baquet dit structu-
raliste et qu'un des plus distingus de mes tenants, m'a averti : Vous
tes maintenant au niveau du bachelier (autrement dit : il veut du
Lacan).
Il reste ceci de prserv que ton nom cache bachelor. Du moins
sache que je l'y suppose, n'tant pas de ces cuistres qui le mot fran-
glais puisse voquer autre chose que la langue anglaise elle-mme :
bachelor, c'est--dire pas encore mari.
De ce fait tu n'es pas oblig de soutenir de la rvrence due aux
mrites d'une personne, l'inconsidr d'un parti pris dans la ques-
tion en cause.
Maintenant laisse-moi te prsenter : Scilicet.
Qui S'ADRESSERA AU BACHELIER ?
Cette revue se fonde sur le principe du texte non sign, du moins
pour quiconque y apportera un article en tant que psychanalyste.
Tel est le remde de cheval, le forcing, voire le forceps, dont l'inspi-
ration m'est venue comme seule propre dnouer la contorsion par
quoi en psychanalyse l'exprience se condamne ne livrer passage
rien de ce qui pourrait la changer.
Le nud tant de ce qu'il est de la nature de cette exprience
que celui qui en rend compte ses collgues ne puisse fixer d'autre
284
INTRODUCTION DE SCIUCET
horizon sa littrature, que d'y faire bonne figure.Voici ce dont tu le
dlivres de faire rentrer ici le srieux.
Ceci pos, il importe de distinguer le non sign de l'anonymat.
Car il peut inclure qu' un dlai prs, que l'exprience rglera des
tapes qu'elle engendre, les noms se dclarent d'une liste assumant
l'ensemble de la publication.
Pour tout auteur sensible l'air de poubelle dont notre poque
affecte tout ce qui de cette rubrique n'est pas strictement scienti-
fique, ce qui justifie d'un flot montant le mot de poubellication que
nous y avons lanc, c'est dj l sauver la dignit laquelle ont droit
ceux que rien n'oblige la perdre. S'il faut en passer, nous le disions
l'instant, par le tout--1'gout, qu'on y ait au moins les commodi-
ts du radeau.
Au point que tu pourrais, bachelier, te demander comment nous
avons pu ne pas nous aviser plus tt du prix pour nous d'une for-
mule qui est dj de bonne rgle au meilleur champ de la critique.
Quelle vanit nous point-elle donc, je dis : nous les psychana-
lystes, pour que nul n'y ait vu la solution du problme permanent
suspendre notre plume, celui de la moindre allusion qui nous vienne
fairf rfrence d'un cas? Rfrence, on le sait, toujours porte
d'tre dnonciatrice, de ce qu'elle ne soutienne un si commun
dtour qu'il ne prenne appui du trait le plus particulier.
Or ce qui fait obstacle ici n'est pas tant que le sujet s'y recon-
naisse, plutt que d'autres l'y reprent par son psychanalyste.
Allons plus loin dans ce qui pse pour nous causer un bien autre
embarras. Cette pitoyable confusion dont tmoigne le tout-venant
de notre production thorique, la mme qui des effets de l'ennui
prvient sa nocivit, n'a de cause qu'un souci dont le tort est d'tre
dplac.
N'tant pas Freud (Roi ne suis), ni Dieu merci ! homme de lettres
(prince ne daigne), ce qui nous est permis d'originalit se limite au
rogaton que nous en avons adopt d'enthousiasme (Rohan suis) de
ce que Freud l'ait une fois dnomm. Cette fois nous l'avons
compris : il l'appelle le narcissisme de la petite diffrence.
Mais quoi bon si l'on ne signe pas, se distinguer de la scription
du reprsentant reprsentatif, qui ne veut rien dire (pour expli-
quer le refoul), quand la traduction de Vorstellungsreprsentanz par
le reprsentant de la reprsentation veut dire ce qu'elle veut dire, et
285
INTRODUCTION DE SCILICET
que, fonde ou non rendre compte du refoul, c'est tout au moins
l'explication de Freud?
Et quoi bon aussi si l'on n'a rien de plus en dire, promouvoir
la Verleugnung intraduisible *, sinon pour montrer qu'on a lu Freud,
comme un grand, - quand, faute de pouvoir vrifier qui est grand
au bas d'une page, la tournure louche du terme ne se rabattra que
trop bien sur la propre pousse du col quoi il sert de montant?
Voil-t-il pas des piges qui, d'tre ds lors carts, valent bien
l'abngation trs relative que constitue l'incognito dans un milieu
de spcialistes. J'aimerais savoir qui a nui de n'avoir pas sign une
partie de son ouvrage d'un autre nom que celui de Bourbaki.
Dois-je dire que c'est la signature collective sous laquelle une
quipe a refait, sur le fondement de la thorie des ensembles, l'di-
fice entier des mathmatiques ?
Oui, si c'est l'occasion de marquer ce qui, outre la modestie qui
s'impose nous de la laxit trop grande encore de nos symboles,
nous empche de nous faire abri du nom de Canrobert. C'est qu'en
notre entreprise il nous faut surmonter des coordonnes de temps
logique (cf. mes crits, sous ce titre) qui seront motives plus loin,
et qui, pour n'tre pas absentes, ce que nous pouvons en apprcier,
du champ mathmatique, y sont pourtant solubles assez pour per-
mettre l'avnement de ce qui est loin de se rduire un label
d'usage.
Indiquons seulement qu'une telle dnomination suppose la cou-
ture acheve de la place du sujet dans la configuration signifiante, et
qu'elle ne pourrait figurer dans notre champ qu' obturer ce dont
nous devons prserver la bance.
Ce serait garer l'attention que de confirmer ce que nous en
indiquons ici, de ce que la figure d'un tel sujet s'accommode d'tre
emprunte l'pope de la dbandade, ou, si l'on veut, au jeu de
massacre.
Sens-y, bachelier, le prlude ce qu'il me faille m'y offrir mainte-
nant moi-mme.
i. Intraduisible mme par : dmenti.
286
INTRODUCTION DE SCIUCBT
DE CE QUE SIGNE LACAN
Le nom d'quipe est en impasse de ce que nous poserons de
fait avant d'en montrer l'conomie : c'est pour le dire bille en tte
que notre nom propre, celui de Lacan, est, lui, inescamotable au pro-
gramme.
Je ne vais pas ici rappeler ce qui rsulte, l o un systme symbo-
lique tient l'tre de ncessiter qu'on le parle, de ce qu'une Verwerfung
s'y opre : soit le rejet d'un lment qui lui est substantiel. La formule
en est pierre d'angle de mon enseignement : il reparat dans le rel.
Eh bien, c'est ce qui dans le discours psychanalytique est arriv
pour mon nom, et c'est l ce qui rend impossible de retirer sa signa-
ture de ma part dans SciliceL
Ce qui a fait ce nom devenir trace ineffaable, n'est pas mon fait.
Je n'en dirai, sans plus d'accent, que ceci : un dplacement de forces
s'est fait autour, o je ne suis pour rien qu' les avoir laisses passer.
Sans doute tout tient-il dans ce rien o je me suis tenu l'endroit
de ces forces, pour ce que les miennes ce moment me paraissaient
juste sijffire me maintenir dans le rang.
Qu'on ne feigne pas d'entendre que je devais pour cela me
contenir. Si je n'ai rien distrait, fut-ce pour ma protection, d'une
place que d'autre part personne ne songeait tenir, c'est m'effacer
devant elle pour ne m'y voir qu'en dlgu.
Je passerai ici sur les pripties d'o, dans la psychanalyse, ma
position est sortie faite. Elle doit beaucoup ceux qui campent en
son centre.
Mais elle m'oblige ramener au nom de Freud le mouvement
qu'elle en a pris au dpart.
Qu' ce nom attienne non plus une Socit, mais une cole, c'est
ce qui comporte qu' nous en tenir l'organe dont en Scilicet cette
cole s'appareille, elle l'ouvre tout ce qui fait recours Freud, fut-
ce pour y justifier ce qui s'en transmet dans ladite Socit.
Nous n'avons d'autre but que de permettre dans cette Socit
mme le bris des liens dont elle entrave ses propres fins.
Disons que nous irons jusqu' publier une fois ce qui ne ferait
que prtendre dpasser son niveau prsent : titre dmonstratif.
Mais n'est-ce pas faire la partie belle quiconque de ses tenants
287
INTRODUCTION DE SCIUCET
que de lui offrir la place qui, d'tre anonyme pour lui dans Scilicet, le
restera, s'il lui convient ailleurs?
Le public nous jugera la faon dont nous tiendrons le dfi ici
port, s'il est relev l o il s'adresse.
Que de la part que je prendrai dans la rdaction de Scilicet, il n'y
ait rien qui ne soit sign de mon nom en fera l'preuve juste.
Et c'est pourquoi je m'engage aussi ne pas intervenir sur le texte
de ce qui y sera admis pour s'articuler du propos de Lacan.
Ce propos lacanien est celui d'une transcription telle qu'aprs
avoir runifi le champ de la psychanalyse, elle donne l'acte qui le
soutient le statut dont le point culmine aux derniers traits de mon
enseignement.
Il doit ici faire ses preuves pour qui n'en a pas l'usage. Mais ds
maintenant il se pose comme rompant la contestation, ouvrir cer-
tains points de pratique qui sont ceux-l prcisment que l'organisa-
tion mme de la psychanalyse aujourd'hui est faite pour rendre
intouchables ; savoir ce que la psychanalyse didactique peut se pro-
poser comme fin.
C'est ici que nous retrouvons l'enjeu qui fait de toute la partie
une affaire beaucoup moins gage que notre exposition jusqu'ici ne
le laisse penser.
Qu'on me permette de clore ce chapitre d'un petit apologue,
bien soupeser avant d'en rire.
Que ce fut Shakespeare qui joua le ghost dans Hamlet, est peut-
tre le seul fait de nature rfuter l'nonc de Borges : que Shakes-
peare fut, comme il dit, personne (nobody, niemand).
Pour que la psychanalyse par contre redevienne ce qu'elle n'a
jamais cess d'tre \ un acte venir encore, il importe qu'on sache
que je ne joue pas le ghost, et pour cela, moi, que je signe.
UN BUT DE CONSOLIDATION
PPH. Passera pas l'hiver. Telle est l'irrvrence dont une jeunesse
qui nous doit d'tre laisse ses seuls moyens dans ses rapports avec
la vie, rtablit la distanciation qui convient la classe d'ge laquelle
j'appartiens.
288
INTRODUCTION DE SCIUCET
J'aimerais que son sigle vnt prendre l'autorit de celui du PMU
pour que s'y livre la structure de pari, d'o une psychosociologie
qui ne serait pas pur bouffonnage, prendrait son fil.
Ce serait bien l'honneur qui devrait revenir la psychanalyse que
d'assurer ce premier pas. Faute d'y rpondre, il est juste qu'elle en
trahisse la vrit comme plus patente en son sein.
Le ton qu'elle prendrait pourtant serait plus drle seulement
trancher sur l'abjection de celui qui y est courant.
En ce dduit qui concerne la mort de l'autre, elle recourra,
comme son ordinaire, au babyisme grce quoi elle laisse intacte la
vrification de l'thique, celle qui s'adorne du chevrotement d'un et
nunc erudimini sculaire. Il lui suffira d'en charger le bb qui vous
nonce son papa : Quand tu seras mort... , peu prs du mme
temps qu'il a l'usage de la parole.
A chaque hiver donc passer, la question se pose de ce qu'il y a
de ngociable tre lve de Lacan. C'est une action, au sens bour-
sier, dont on conoit qu'on la garde, si l'on sait (il faut le savoir pour
suivre ici la mcanique) que mon enseignement est le seul qui, au
moins en France, ait donn Freud quelque suite.
La transaction, d'autre part, cela ne se sait pas moins, s'en est faite
de faon qui peut passer pour profitable, puisqu'une habilitation qui
se targue d'tre internationale en tait le prix.
Il est clair que je dois mettre quelque chose l'abri de ces effets
de march.
L'obstacle est qu'ils aient pris force d'tre intgrs la propagande
dont ladite Internationale a pris l'office en ma faveur.
Imagine, bachelier, car il faut que je t'aide pour que tu saches ce
qu'il en est du ct dont tu serais en droit d'attendre un air diffrent
de la vachardise quoi tout te promet, imagine ce que tu pourras de
la formation du psychanalyste, d'aprs l'obissance qu'a obtenue
d'une salle de garde (une salle de garde cela voulait dire : fronde per-
manente, en un temps), l'obissance, dis-je, qu'a obtenue d'une salle
de garde, de la Salle de garde de Sainte-Anne pour la nommer, la
Socit qui reprsentait Paris ladite Internationale, y profrer en
son nom l'interdit de franchir la porte o se tenait chaque retour
du mercredi, l'heure de midi et deux pas, un enseignement, le
mien, qui bien entendu tait de ce fait l'objet d'un commentaire
plus ou moins appropri, mais permanent.
289
INTRODUCTION DE SCIUCET
Cette obissance n'a cass qu'aprs sept ans passs, par l'effet
du mauvais exemple qu'osrent donner certains de la rompre, ds
qu'une titularisation leur eut donn garantie suffisante contre une
vindicte directoriale. (Garons plus du tout bachelors, aprs la tren-
taine passe, tu les retrouveras plus loin.)
Tu conois, je pense, la puissance de pntration qu'en prend le
dire, ainsi cern, car il ne suffit pas de se terrer, il faut marcher au
pas, et comment le faire si on ne sait pas ce qu'il est interdit de
penser. C'est qu' l'ignorer, il n'est pas impensable qu'on se mette
le penser tout seul : a devient mme plus que probable admettre
qu'il puisse y avoir dans un enseignement, au reste offert toute
critique, fut-ce ce seul grain de vrit, dont voulait bien faire hom-
mage Freud, bien que gardant l'pine d'avoir t conduit par
lui, le responsable d'une formation , - qui, aprs tout, rpond son
titre dans une certaine finalit.
Je ne puis laisser ce ct sans indiquer ce qui s'en implique de ce
que la psychanalyse permet de dfinir techniquement comme effet
de transfert.
A toutes fins difiantes, je publierai le poulet prodigieux d' ambi-
valence (pour user du mot dont la bonne ducation psychanaly-
tique dsigne la haine, car chacun s'y veut averti que ce soit masque
de l'amour), du poulet, dis-je, que j'ai reu d'un des plus dous de la
troupe ainsi forme, pour m'tre laiss aller simplement lui faire
savoir le bien que je pensais d'un de ses propos (ceci d'une sorte
d'lan pour quoi je n'ai gure de loisir et dont je n'attendais pas de
spciale reconnaissance, en tout cas nulle qui fut aussi rmunratrice).
Je ne peux rien la peine du transfert mis ici en son lieu.
Nous revenons l'embarras que Scilicet doit lever.
Je l'ai dit : c'est celui qui touche au ngociable du titre d'tre
notre lve.
Nous entendons, dans les limites du PPH qui en dfinit l'ala,
assurer ce titre d'un avenir moins spculatif.
Il suffirait que ceux de mes lves que j'aurai reconnus comme
tels de ce qu'ils aient contribu ce titre Scilicet, veuillent tenir
pour ferme l'avenir qu'ils ne reconnatront eux-mmes, au titre
qu'ainsi ils tiennent de moi, que ceux qu'ils auront admis la mme
contribution.
Ceci suppose une qualit dont leur propre travail donnera la
290
INTRODUCTION DE SCILICET
mesure, et peut teindre le ballant, par quoi les effets de march
dcrits rpercutent notre passif, soit d'un retour qu'il faut dire
juste, ce que nous devons de crdit l'Internationale.
Prcisons bien que Scilicet n'est ferm personne, mais que qui-
conque n'y aura pas figur, ne saurait tre reconnu pour tre de mes
lves.
Ceci me parat la seule voie l'avnement de Canrobert, avec
notre PPH rvolu.
Car nous pouvons tenir pour dmontre la faiblesse de ce qui ne
se pare d'un usage mme contrl de nos termes, qu' en coiflfer
une formation personnelle , comme on dit ailleurs, prise d'une
tout autre source.
C'est bien l que s'avoue l'essence de fiction dont se supporte le
standard dit international de la psychanalyse didactique. Comment tel
qui connat mieux que personne, pour continuer de s'en rgaler,
l'exorbitant de la thorie du psychanalyste qui l'a form, peut-il croire
que de cette formation il ne reste pas marqu, assez pour ne pouvoir
tre plus qu' ct de cette place du sujet o advient le psychanalyste ?
Car si cet exorbitant, je l'ai dnonc dans son ressort le plus
intime, si j'ai fait exemple de ses ravages dans des sances de travail
o ce tel a particip, comment peut-il croire qu'il suffise du rajout
de ma construction thorique pour corriger les effets que sa place
retient de cet exorbitant?
Qu'on ne me force pas donner noms et exemples. C'est moi ici
qui fais uhe formation plus de crdit que ceux qui s'y sont tenus,
et je ne le fais que d'exprience, tout inclin que j'aie t la tenir
pour rversible, de ce qu'elle m'offre une oreille avertie.
Mais ce qui tranche en la question, c'est qu'on reste solidaire
d'une transmission qu'on sait feinte ; c'est qu' y garder son confort,
on en dmontre son mpris.
Nul dveloppement de mon propos n'est attendre de qui s*cn
fait une plume de plus.
Reste qu'il en est qui sont prs de moi depuis toujours et qui ont
reu chacun de mes termes en quelque sorte de naissance.
De leur naissance la psychanalyse, c'est le mieux, mais aussi bien
n'est-ce quelquefois que de la naissance de ces termes qui leur a
donn du tintouin, le mme qu' moi, qu'ils me pardonnent.
De cette souche sont provenus des rejets excellents, fort dignes
291
INTRODUCTION DE SCILICET
d'tre retenus, et gnralement cits avec avantage, sinon toujours
pertinemment par ceux qui s'essaient traduire mon enseignement
pour le dehors.
Elle a nanmoins subi une sorte de gel d'une tentative pour se
faire reconnatre dans l'Internationale, tentative dont le malheur fut,
il faut le dire, mrit, puisqu'il tait, ds son principe notoire autant
qu'explicite qu'aucun mrite de doctrine ne prsentait le moindre
intrt pour les instances invoques, mais seulement l'observance
respecter d'un certain conformisme.
Qu'une gnration trane la marque de s'tre sentie proprement
joue, est d'autant plus irrmdiable que ce fut bien eflfectivement ce
que pouvaient et ce que firent les instances en question. Or cette
marque consolide la passion mme sans laquelle un jeu aussi minable
et t sans prise.
C'est pour cela que la ngociation du titre : lve de Lacan, reste
le signe de l'inassouvissement qui leur barre une suite plus radicale.
Puisse le champ de Scilicet leur permettre de dissiper une fascina-
tion assurment fort coteuse, d'avoir pour eux occup les annes
qui pour la moyenne des esprits donnent la crativit sa chance,
avant qu'elle se tarisse.
Dans la carrire ici ouverte, aucune position n'est acquise d'avance.
Et que le PPH s'inverse en HPP : hol prtention pareille !
Ce premier numro comprendra deux parties :
L'une s'ouvre de la contribution que j'ai apporte l'Ecole, en
une proposition que je publie en tmoignage de ce que mon pou-
voir y trouve sa limite
l
.
Elle se complte de trois discours prpars pour des confrences
dont j'ai t pri dans trois villes d'Italie, et dont l'cole a l'hommage
2
.
La deuxime partie inaugure Scilicet, d'tre non signe.
1968
i. Ce texte est repris ici mme, p. 243-259.
2. Ces trois textes sont repris ici mme, p. 329-359.
Adresse l'cole
ADRESSE DU JURY D'ACCUEIL L'ASSEMBLE
AVANT SON VOTE, LE 25 JANVIER 1969
Il y a la psychanalyse et il y a l'cole.
A distinguer en ceci que l'cole se prsente comme une per-
sonne morale, soit comme tout autre corps : qui se soutient de per-
sonnes, elles physiques et un peu l.
La psychanalyse par contre est fonction de l'ordre du sujet, lequel
se dmontre dpendre de l'objet qui, ce sujet, le refend.
Peser les personnes, nonciation dont on n'aurait os esprer
l'impudence, est le moyen le plus impropre au recrutement du psy-
chanalyste, qui fonctionne mme partir d'une personne de peu
de poids. C'est pourtant ce qui s'est fait, Dieu sait comment ! jusqu'
ce jour.
Ce que met en cause la proposition du 9 octobre 1967, c'est de
savoir si la psychanalyse est faite pour l'cole, ou bien l'cole pour
la psychanalyse.
D'un ct la rponse brouille les traces des exploits de bel esprit
sur le dvouement Lacan, soit la personne de son auteur.
D'un autre ct, on argumente comme si, dans l'cole, les per-
sonnes n'taient pas dj l, comme on dit : en titre, et bel et bien.
Or c'est ce dont la proposition tient compte. Car si elle va dci-
der de ce que l'cole produise ou non du psychanalyste, elle ne
mconnat pas que la psychanalyse ne se produit pas sans moyens,
qui ne vont pas sans de personnes se composer, ni sans, avec elles,
composer.
La thorie de la formation, avons-nous crit, est absente. Qu'on lise
le texte : elle est dite absente au moment qu'il ne faudrait pas, et nulle
contradiction ajouter que c'est au moment o se rsout une psycha-
nalyse. Il faut bien, bien ou mal, en effet que le pas se rsolve, pour
quoi l'on se rsout en fait se passer de l'examen de la psychanalyse.
Faudrait-il pour autant contester les personnes, soit les situations
293
ADRESSE L'COLE
acquises ? Ce serait se priver de l'acquis des situations, et c'est ce que
la proposition prserve.
A en partir, nul n'est contraint de se soumettre cet examen d'un
moment, qu'elle marque comme la passe : ceci parce qu'elle le
redouble d'un consentement cet examen mme, lequel elle pose
comme preuve de capacit prendre part la critique comme au
dveloppement de la formation.
C'est cette libert mme qui impose la slection d'un corps dit
AE. Et s'il est ainsi confluent au corps existant dj sous ce titre, c'est
qu'il n'y a aucune raison de refuser ce corps la capacit dont la
nouvelle slection se motive.
Il y a tout lieu au contraire qu'il en reoive ici l'hommage.
Que cet hommage, tel le dcline, pourquoi pas ? Qu'on applau-
disse cette dmission comme un dfi, nous rappelle que la dmago-
gie ne saurait tre unilatrale. Il y faut aussi un public : ceci prouve
qu'il ne manque pas.
Mais n'empche pas qu'il faille s'en remettre lui pour trancher
des mrites des candidats un premier jury.
En l'absence, oui, en l'absence de toute pratique d'un tel accs
qui ne relve du pse-personne, l'assemble choisit ceux qui auront
en trouver une diffrente.
C'est faire fonds, Lacan l'a dit, sur l'esprit de la psychanalyse, qu'il
faut bien censer pouvoir se manifester par vous, puisqu'on ne peut
l'attendre ailleurs.
De toute faon il faudra bien que vous en passiez par l'attribution
certains de fonctions directives, pour obtenir une distribution pru-
dente de votre responsabilit collective. C'est un usage qui peut se
discuter en politique ; il est invitable dans tout groupe qui fait tat
de sa spcialit au regard du corps social. A ce regard rpond l'AME.
Ces ncessits sont de base. Elles psent mme in absentia pour
employer un terme de Freud. Simplement, in absentia, elles se
dchanent dans tous les sens du mot.
Or le temps court et d'une sorte qui exclut qu'on continue de
s'en tirer par des valabrgags.
C'est pourquoi les principes concernant l'accession au titre de
psychanalyste dans l'Ecole freudienne de Paris , repris de la proposi-
tion du 9 octobre par le jury d'accueil, sont prsents au vote de
l'assemble sans un changement
294
ADRESSE L'COLE
Sur l'avis du directeur, l'assemble votera en versant l'urne un
bulletin o s'aligne, de gauche droite dans l'ordre du moindre
assentiment, chacun des trois projets qui lui sont prsents : soit A,
celui du jury d'accueil, B, celui de la liste que P. Alien se trouve
alphabtiquement ouvrir, C, celui d'Abdouchli.
Ce mode de vote dit prfrentiel est un test au sens o il permet
de se produire (dans 9% des cas pour un groupe de votants aussi
tendu que le ntre) l'effet Condorcet.
On sait que cet effet dsigne le rsultat inconsistant, o un choix
dominant un autre et celui-ci un troisime, le troisime domine
nanmoins le premier, ce qui exclut d'en rien conclure.
Il serait ici signifiant redoutablement d'une carence de ce que
nous avons appel l'esprit de la psychanalyse.
KJ. Arrow, pour se rfrer un autre ordre, celui d'une dtermi-
nation' logique de l'intrt gnral, a dmontr qu'hors l'unanimit,
celui-ci ne saurait se dterminer que de l'opinion d'un seul.
Un corps constitu, quel qu'il soit, peut se permettre d'ignorer
tout de la logique et de lui substituer le psychodrame par exemple.
Ceci n'empche pas la logique de tourner, et de faire tourner ce
corps avec elle, pour ou contre ses aises
1
.
i. La proposition A, prfre par la majorit absolue des votants, fut adopte
(2000).
Allocution sur l'enseignement
PRONONCE POUR LA CLTURE DU CONGRS DE L'COLE
FREUDIENNE DE PARIS, LE 19 AVRIL I97O, PAR SON DIRECTEUR
Je n'ai rien prpar
l
pour clore, comme le pli s'en est pris, de
mon allocution ce congrs.
C'est que, vous avez pu le voir, mesure qu'il s'avanait, j'en
notais toujours plus.
Ainsi l'ai-je pouss de la voix le premier jour, ayant le sentiment
d'avoir quelque chose y dgeler.
Puis m'en suis tenu couter d'un silence dont la garde me fut de
profit. Car ce congrs loin de m'ennuyer, comme a m'arrive disons
parfois, m'a grandement retenu, mme tenir compte des absences
dont je m'excuse auprs de ceux qui auraient pu y trouver manque.
Pour tout dire, ce congrs m'a t un enseignement. a peut
paratre bien le cas de le dire, d'un congrs sur l'enseignement.
Mais c'est peut-tre l que se trouve le cheveu, la vrit la cri-
nire, ce n'est srement pas qu'il ait atteint son objet, pas srement
mme qu'il soit entr dans son sujet.
Car notons-le aprs Nemo, qui de sa jeunesse nous fait espoir,
notre congrs s'annonait : de l'enseignement. Pas moins : pas de
l'enseignement de la psychanalyse, de l'enseignement tout court.
Que quelque chose vous soit, ce qu'ainsi on s'en exprime : un
enseignement, ne veut pas dire qu'elle vous ait rien appris, qu'en
rsulte un savoir.
J'y donne rflexion, entendez-la balistique, m'tonner qu'il ait
paru tout instant aller de soi que l'enseignement, c'tait transmis-
sion d'un savoir, horizon tant pris de la balanoire faire aller et
retour de l'enseignant l'enseign : leur relation, pourquoi pas ? c'est
1. A l'inverse de ce qu'il en est pour ma rponse de plus haut, le texte est
ici second, dont le parl sera distribu de mme. [La rponse dont il s'agit est le
Discours l'cole freudienne de Paris , ici-mme, p. 261-281.]
297
ALLOCUTION SUR L'ENSEIGNEMENT
le bateau qu'il y faut, trouver la foire de notre temps sa vole pas
autrement folle que la relation mdecin-malade par exemple.
L'actif et le passif, le transitif et le corollaire, l'informatif et l'entro-
pique, rien n'est de trop pour le pot-bouille de ce mange.
Une remarque assainir notre cas : c'est que l'enseignement pour-
rait tre fait pour faire barrire au savoir. Le plus humble des pda-
gogues, comme on dirait sans rire, peut quiconque en donner le
soupon.
D'o jaillit le peu d'vidence disons : de la relation savoir-ensei-
gnement.
Peut-tre n'en paratrait-il pas excessif de postuler que le savoir
est chose au monde plus rpandue que l'enseignement ne se l'ima-
gine?
Pourquoi resterait-on sourd au glissement que cette anne plus
encore, j'imposais au savoir l'homologuer la jouissance?
S'il semble que le psychanalyste et pu s'aviser plus tt de ce que
l'implique peu prs tout ce qu'il dit, n'est-ce pas recouper la
chose de ce que l'enseignement est l l'obstacle ce qu'il sache ce
qu'il dit?
Il y suffit de voir que sur ce biais c'est l'instinct qui le droute, soit
une notion qui ne tient que de la fabrique de l'enseignement.
Bien sr est-il dans mes principes de n'esprer rien de ce que
mon discours soit pris comme enseignement. Mais ne venons pas
tout de suite ce point qui a fait dbat ce dernier jour.
Il reste trange que mes formules, mes quadripodes de cette
anne, n'aient mme pas t invoques dans les propos elles les plus
tangents. Alors qu'on n'aurait rien perdu les poser au tableau noir.
C'est le temps qu'il faut, je dois l'admettre, ce qu'on en vienne
mon discours l o il est fait pour servir. Telle, ma thse de mdecine
a t le fil dontTosquelles m'a dit avoir dml le labyrinthe que lui
fut le Saint-Alban o la guerre, les guerres plutt, l'avaient port.
Mais quand il me l'a appris, je pouvais croire qu'elle dormait, ma
belle thse, tout autant que les dix ans que a avait dur avant. Pour-
quoi cette Belle au Bois, la ferais-je maintenant courir?
Enseignants, donc vous me ftes. Non sans que m'en poigne
quelque dstre : a doit se sentir depuis un moment. En suis-je de
vous plus enseign ? Car ce n'est pas l le couple obligatoire, dont
viennent de se rebattre vos oreilles.
298
ALLOCUTION SUR L'ENSEIGNEMENT
Ce qui de l'aimant l'aim fait route peu sre, devrait rendre plus
prudent , de ces couples de participes, se fier au transport.
Je suis surpris que, plutt que du transitif induire le transit, on n'y
ait jamais vu occasion d'introduire l'ambivalence, et d'un pas moins
courant ce que mal(e)honntet s'en batte.
Que l'aimant emporte le ha, pour tre net, a ne veut pas dire
qu'amour et haine, c'est tout un, autrement dit : ont le mme sup-
port. Deux au contraire.
Qu'on parte pour cette partition de : partant, parti. Ce sera
mieux.
De l ce que le transitif ne le soit pas tant qu'on l'imagine, il n'y
a qu'un pas... de la transition dont rien ne se vhicule.
Et qu'on ne m'arrte pas ce que j'ai dit : que l'amour est
toujours rciproque, car justement c'est de ce qu' susciter l'aimant,
ce n'estrpas ce dont il est pris.
D'o revient l'pingle : comique.
A la vrit, c'est de la division du sujet qu'il s'agit : qui de son
battement fait l'objet surgir en deux places sans support.
Je ne peux tre enseign qu' la mesure de mon savoir, et ensei-
gnant, il y a belle lurette que chacun sait que c'est pour m'instruire.
Ambivalence dont ce n'est pas que le psychanalyste la confirme,
que sa position se rehausse.
C'est de la relation plutt, l le mot n'est pas bouffon, la relation :
psychanalysant-psychanalyse que nous marquons un but en l'affaire.
A condition bien sr qu'on sache o est le psychanalysant. Il
est vrai que c'est comme si tout le monde en avait t averti du
moment mme o le mot : psychanalysant a t par moi profr
pour en dbaptiser ledit : psychanalys, de mode fianais.
Lui aurais-je jou au psychanalysant, de ce qu'il n'y en ait plus
que pour lui chez mes collgues, le mauvais tour de faire que, pour
tre psychanalys, c'est midi sonn, qu'aussi bien il peut se rsigner
ne l'tre pas plus qu'au dire de Freud ne le sera jamais un psychana-
lyste?
Mais laissons cela quand ce dont il s'agit, c'est de quoi vient tre
analys. Si on le sait, pourquoi ne pas le dire, dire qu'on le sait,
entends-je.
Reste savoir si on l'enseigne. C'est l qu'il faut revenir la
remarque de Nemo. Pour l'enseignant, le chercher d'ailleurs que de
299
ALLOCUTION SUR L'ENSEIGNEMENT
son office, de son office quant au savoir, soit : de ce qu'il est effet
de l'enseignement.
Je surmonte ce qui me fait fatigue de devoir sur le tableau poser
ce que j'ai appel mes quadripodes, et je vous invite vous fier ce
que ce soit o est l'S barr, que l'enseignant se trouve, se trouve
quand il y a de l'enseignant, ce qui n'implique pas qu'il y en ait tou-
jours dans l'S barr.
Cela veut dire que l'enseignant se produit au niveau du sujet, tel
que nous l'articulons du signifiant qui le reprsente pour un autre
signifiant, qui sait lequel ? Y suffisant que cet autre se sache, pour que
le sujet sorte du savoir y rentrer : n'est-ce pas proprement le mou-
vement dont l'enseignant, l'enseignant comme essence, se sustente ?
Comme statut, cela dpend d'o le discours lui fait place.
Vous savez que cette anne j'en ai articul quatre du glissement
de quatre termes sur quatre positions, orientes d'en permettre la
permutation rotatoire.
Dans le discours que je dis du Matre, c'est bonnement l'ensei-
gnant, le lgislateur (Lycurgue, qu'il ose s'appeler parfois), qui sup-
porte la loi, cette loi dont c'est merveille que nul ne soit cens
l'ignorer, de ce que c'est l'enseignant mme.
N'est-ce pas l toucher comment pour la jouissance, d'tre lgi-
fr, - s'idalise, et s'incarner n'en est qu'une forme, la raison dont le
sujet fait le fantme : raison, qui va jusqu' de Desse charnelle se
supporter.
C'est dans cette trace qu'un Hegel persuade l'esclave qu' tra-
vailler, il va de son savoir atteindre l'absolu, que l'absolu de l'em-
pire du matre sera son empyre lui : il peut atteindre ce dimanche
de la vie dont un humoriste a fort bien crayonn la farce dont,
s'en faire l'assidu, il n'avait pas perdu le nord.
Le plus drle est encore ce qu'on s'imagine en politique d'avoir
corrig de l'entreprise, alors que c'est de l qu'Hegel triomphe en
l'improbable duperie qu'il avoue : de la ruse de la raison.
Le savoir venant la place de l'agent, c'est le quart de tour dont
avec Charlemagne disons, s'institue le discours de l'Universit. Bien
sr l'histoire ne suffit-elle pas dcrire la structure.
Le savoir fait agent, rejoint notre propos, de s'avrer tre l'ensei-
gnement. L'enseignement est le savoir que cette place d'o il rgne,
300
ALLOCUTION SUR L'ENSEIGNEMENT
dnature en somme. Qu'on me pardonne l le sommaire, mais cet en
somme c'est aussi le savoir mis en Somme, avec un grand S, et pour-
quoi en cette voie me priver : le somme, pour tre l, vaut la somme.
Le sommeil du savoir engendre des monstres, vrai dire polics :
suivre le guide de mon S barr, vous voyez que l'enseignant se trouve
ici au registre de la production, ce qui ne sort pas du vraisemblable.
Dire de quelle ordonnance cette production s'agence ne serait
rien de plus que de laisser la crise prsente de l'Universit s'avrer
comme structure, faire ritournelle son sujet, de notre : c'est un
enseignement.
Il est vident que c'est ce que le plus-de-jouir qui s'incarne
des gosses de matre, ne reste en rien enseign, sauf se servir de
l'enseignant, que ceux qui en ont de famille la recette, relveront
les signifiants-matres qui ne sont pas la production, mais la vrit de
l'Universit. (Cf. S
1
dans le quadripode.) Cela pour, d'Oxford et
de Cambridge, tre vent, c'est--dire trop tal pour ne pas s'tre
dtendu, n'en garde pas ressort moins vif en des lieux d'impudence
pas moindre.
Il faut noter ici pourtant que pour venir l'enseignement, le
savoir doit par quelque point tre savoir de matre, avoir quelque
signifiant-matre faire sa vrit. C'est la marque des arts dits lib-
raux dans l'Universit mdivale. La libralit dont ils prennent
mandat, n'est rien d'autre... On peut s'attarder aux exemples o
l'usure du temps laisse voir trs bien les fils de la structure, l o
ils n'ont plus d'intrt de ne plus rien conduire. Un savoir passer
par le compagnonnage, fait autre fonction de la matrise.
C'est de ce qui s'appelle la science qu'il s'agit pour nous, d'en
apprcier l'appoint au discours du capitalisme. Y faut-il l'Universit ?
Je n'ai fait cette anne qu'affirmer l'antcdent qui me parat sr,
que dans sa racine grecque la science, ce qui se dit moTr||xr|, si bien
la reconduit la ntre, est affaire de matre o la philosophie se situe
d'avoir donn au matre le dsir d'un savoir, la spoliation de l'esclave
s'y consommant de ce savoir nouveau (scienza nuova).
C'est l'intrt de voir apparatre dans le quadripode que je
dsigne du discours de l'hystrique, un savoir comme production
du signifiant-matre lui-mme, mis en place d'tre interrog du sujet
port l'agent.
301
ALLOCUTION SUR L'ENSEIGNEMENT
Sans doute est-ce l faire nigme, mais qui claire beaucoup de
choses oser reconnatre en Socrate la figure de l'hystrie, et dans
le balayage quoi Descartes procde des savoirs, le radicalisme de la
subjectivation o le discours de la science trouve la fois l'acos-
misme de sa dynamique et l'alibi de sa notique, pour ne rien chan-
ger l'ordre du discours du Matre.
On touche l, la mesure des deux quarts de tour opposs dont
s'engendrent deux transformations complmentaires, que la science,
nous fier notre articulation, se passerait pour se produire du
discours universitaire, lequel par contre s'avrerait de sa fonction de
chien de garde pour la rserver qui de droit.
C'est du demi-tour constitu par le discours de l'analyste, soit du
discours qui prend sa place d'tre d'une distribution oppose celle
du discours du Matre, primaire, que le savoir vient la place que
nous dsignons de la vrit.
Du rapport du savoir la vrit prend vrit ce qui se produit de
signifiants-matres dans le discours analytique, et il est clair que l'am-
bivalence de l'enseignant l'enseign rside l o de notre acte, nous
faisons voie au sujet en le priant de s'associer librement (ce qui veut
dire : de les faire matres) aux signifiants de sa traverse.
Cette production la plus folle pour n'tre pas enseignable comme
nous ne l'prouvons que trop, ne nous libre pas pour autant de
l'hypothque du savoir.
C'est donc lapsus qu' tter de l'enseignement, certains font
d'avancer on ne sait quelle subversion du savoir.
Bien au contraire le savoir fait-il la vrit de notre discours.
Notre discours ne se tiendrait pas si le savoir exigeait le truche-
ment de l'enseignement. D'o l'intrt de l'antagonisme que je sou-
ligne ici entre l'enseignement et le savoir. Nanmoins est-ce du
rapport du savoir la vrit que notre discours pose la question,
ce qu'il ne puisse la rsoudre que des voies de la science, c'est--dire
du savoir du matre.
C'est en cela que la faon dont la vrit se formalise dans la
science, savoir la logique formelle, est pour nous point de mire ce
que nous ayons l'tendre la structure du langage. On sait qu'en
cela est le noyau d'o procde mon discours.
302
ALLOCUTION SUR L'ENSEIGNEMENT
Il faut savoir si ce discours tombe sous le coup de l'enseignement.
Puisqu'en somme il ne s'est agi que de cela : de l'embarras que
mon enseignement cause dans l'Ecole.
Pourquoi ceux qui s'en emparent, n'y mettraient-ils, au got,
voire l'aise d'autres aptres, que verbiage emprunt ?
S'agit-il l de sommer quiconque de faire la preuve du bien-senti
de ce qu'il exprime ? A la vrit, qui se ferait tmoin de l'accent de
vrit ?
Pourtant je sais ce que je trouve redire, d'tre repris dans telle
suite, d'un tour universitaire qui ne trompe pas la vider de l'acte
qui l'a faite.
A quoi Kaufmann a beau jeu d'agiter qu'aprs tout je ne fais
pas un cours de psychanalyse (c'est bien ce que je revendique et
l'on voit le malentendu), - et que le meilleur de ce que j'inspire,
satisfait au discours universitaire, preuve que le graphe est de bon
ton, voire de bon usage en maints champs, cadrs par l'Universit, de
l'enseignement.
Je n'y vois certes pas d'objection, si ce n'est qu'il reste curieux
que le graphe, o qu'il prospre, ne se soit produit qu' y tre
import du discours du psychanalyste.
Soit d'o l'acte commande que la cause du dsir soit l'agent du
discours.
Ce qui me sauve de l'enseignement, c'est l'acte, et ce qui tmoigne
de l'acte, c'est que je n'ai jamais eu de lendemain pour mon abri, ni
d'abri que je ne tienne de ce qui, rester sourd ce que j'apporte,
s'offre le luxe d'taler qu'il peut se passer de son manque pour sub-
sister fort lourdement : ce qui va de soi pour l'Universit, se voyant
de reste pour tout le monde.
Ne sait-elle pas en effet que l'acte mme du psychanalyste, peut
par elle tre calibr comme conjecture de son manque : tout le pre-
mier, je l'ai nonc.
Que j'actualise cette conjecture, la paye de me tolrer.
Ce qui rpugne dans un style qui s'atteste universitaire reprendre
mon discours, ce n'est pas qu'il le reprenne dans sa teneur, mais dans
l'abri que j'y prends d'ailleurs. C'est bien distinct de la faon servile
ou non de le reproduire.
303
ALLOCUTION SUR L'ENSEIGNEMENT
C'est la distance du pastiche au plagiat, mais aussi bien : fait qui
l'clair.
A-t-on aperu que le pastiche joue moins de l'imitation que
du dplacement par o le discours apparat en squatter. Quand le
plagiat tient plutt du dmnagement.
Ces deux faons pourtant ne vont pas plus loin que de dissminer
ma parole, faute d'emporter la moindre ide de mon discours.
C'est que la premire est en dfaut du discours universitaire, la
seconde ferme tout autre.
Quelque lapsus gros ou subtil, c'est ce dont s'prouve o l'on se
place en mon discours.
Ainsi fit Abdouchli tout l'heure de rebuter d'une savate preste,
la prtention tre mise stupfiante, que le jury d'agrment et
se surveiller d'un dstre qui fut au gr de tout censeur. Qui et pu
imaginer, dit-il, que le dstre fut un tat dont quiconque pt s'ins-
taller en aucune activit ? Ajoutons qu'il ne se profile qu' dfendre
l'Autre d'un acte d'abord, et que loin d'tre la disponibilit sans
doute acquise qu'on voulait dire, c'est de la prendre comme danger
que son apparition fait passe.
C'est bien de le maintenir bon droit comme danger indis-
pensable ce qu'il y ait un vrai passant, que Tostain se trouve tenir
tte Irne Roubleff sur ce dont elle croit devoir le corriger rap-
peler o trbuchent ceux qui attribuent le dstre au psychanaly-
sant. C'est que passants ne sont ni psychanalysant ni psychanalys,
puisque c'est entre les deux que a passe, sauf ce que rien ne se soit
pass.
Enfin Guattari est sagace poser la question d'o l'effet du lan-
gage s'impose au corps, par-ce qui en revient l'idal d'une part, de
l'objet a de l'autre. C'est un pathos pour l'idal, mais aussi une
corp$(t)ification. C'est dans l'objet a que la jouissance y fait retour,
mais ce que ruine de l'me ne s'y consomme que d'un incor-
porel. Et le questionneur me rpondre, semble viter mes piges
feints.
Ce qu'il me faut bien accentuer, c'est qu' s'offrir l'enseigne-
ment, le discours psychanalytique amne le psychanalyste la posi-
tion du psychanalysant, c'est--dire ne produire rien de matri-
sable, malgr l'apparence, sinon au titre de symptme.
304
ALLOCUTION SUR L'ENSEIGNEMENT
C'est pourquoi medeor serait bien le terme ce qu'il s'en autorise,
si l'on n'y pouvait dsigner rien comme moyen d'autre que la voix
dont il opre, seulement avouer la faille irrmdiable de ce que le
psychanalysant ne fasse pas le poids de ce qui en choit de psychana-
lys.
La vrit peut ne pas convaincre, le savoir passe en acte.
Note italienne
Tel qu'il se prsente, le groupe italien a a pour lui qu'il est tri-
pode. a peut suffire faire qu'on s'assoie dessus.
Pour faire le sige du discours psychanalytique, il est temps de le
mettre l'essai : l'usage tranchera de son quilibre.
Qu'il pense - avec ses pieds , c'est ce qui est la porte de l'tre
parlant ds qu'il vagit.
Encore fera-t-on bien de tenir pour tabli, au point prsent, que
voix pour-ou-contre est ce qui dcide de la prpondrance de la
pense si les pieds marquent temps de discorde.
Je leur suggre de partir de ce dont j'ai d faire refonte d'un autre
groupe, nommment l'EFP.
L'analyste dit de l'Ecole, AE, dsormais s'y recrute de se soumettre
l'preuve dite de la passe quoi cependant rien ne l'oblige, puis-
qu'aussi bien, l'Ecole en dlgue certains qui ne s'y offrent pas, au
titre d'analyste membre de l'cole, AME.
Le groupe italien, s'il veut m'entendre, s'en tiendra nommer
ceux qui y postuleront leur entre sur le principe de la passe prenant
le risque qu'il n'y en ait pas.
Ce principe est le suivant, que j'ai dit en ces termes.
L'analyste ne s'autorise que de lui-mme, cela va de soi. Peu lui
chaut d'une garantie que mon Ecole lui donne sans doute sous le
chiffre ironique de l'AME. Ce n'est pas avec cela qu'il opre. Le
groupe italien n'est pas en tat de fournir cette garantie.
Ce quoi il a veiller, c'est qu' s'autoriser de lui-mme il n'y ait
que de l'analyste.
Car ma thse, inaugurante de rompre avec la pratique par quoi de
prtendues Socits font de l'analyse une agrgation n'implique pas
pour autant que n'importe qui soit analyste.
307
NOTE ITALIENNE
Car en ce qu'elle nonce, c'est de l'analyste qu'il s'agit, elle
suppose qu'il y en ait.
S'autoriser n'est pas auto-ri(tuali)ser.
Car j'ai pos d'autre part que c'est du pas-tout que relve l'ana-
lyste.
Pas-tout tre parler ne saurait s'autoriser faire un analyste. A
preuve que l'analyse y est ncessaire, encore n'est-elle pas suffisante.
Seul l'analyste, soit pas n'importe qui, ne s'autorise que de lui-
mme.
Il y en a, maintenant c'est fait : mais c'est de ce qu'ils fonction-
nent. Cette fonction ne rend que probable l'ex-sistence de l'analyste.
Probabilit suffisante pour garantir qu'il y en ait : que les chances
soient grandes pour chacun, les laisse pour tous insuffisantes.
S'il convenait pourtant que ne fonctionnent que des analystes, le
prendre pour but serait digne du tripode italien.
Je voudrais frayer ici cette voie s'il veut la suivre.
Il faut pour cela (c'est d'o rsulte que j'aie attendu pour la
frayer), il faut pour cela du rel tenir compte. Soit de ce qui ressort
de notre exprience du savoir :
Il y a du savoir dans le rel. Quoique celui-l, ce ne soit pas l'ana-
lyste, mais le scientifique qui a le loger.
L'analyste loge un autre savoir, une autre place, mais qui du
savoir dans le rel doit tenir compte. Le scientifique produit le
savoir, du semblant de s'en faire le sujet. Condition ncessaire mais
pas suffisante. S'il ne sduit pas le matre en lui voilant que c'est l
sa ruine, ce savoir restera enterr comme il le fut pendant vingt
sicles o le scientifique se crut sujet, mais seulement de dissertation
plus ou moins loquente.
Je ne reviens ce trop connu que pour rappeler que l'analyse
dpend de cela, mais que pour lui de mme a ne suffit pas.
Il fallait que la clameur s'y ajoute d'une prtendue humanit pour
qui le savoir n'est pas fait puisqu'elle ne le dsire pas.
Il n'y a d'analyste qu' ce que ce dsir lui vienne, soit que dj par
l il soit le rebut de ladite (humanit).
Je dis dj : c'est l la condition dont par quelque ct de ses
aventures, l'analyste doit la marque porter. A ses congnres de
savoir la trouver. Il saute aux yeux que ceci suppose un autre
308
NOTE ITALIENNE
savoir d'auparavant labor, dont le savoir scientifique a donn le
modle et porte la responsabilit. C'est celle mme que je lui impute,
d'avoir aux seuls rebuts de la docte ignorance, transmis un dsir
indit. Qu'il s'agit de vrifier : pour faire de l'analyste. Quoi qu'il en
soit de ce que la science doit la structure hystrique, le roman de
Freud, ce sont ses amours avec la vrit.
Soit le modle dont l'analyste, s'il y en a un, reprsente la chute, le
rebut ai-je dit, mais pas n'importe lequel.
Croire que la science est vraie sous le prtexte qu'elle est trans-
missible (mathmatiquement) est une ide proprement dlirante que
chacun de ses pas rfute en rejetant aux vieilles lunes une premire
formulation. Il n'y a de ce fait aucun progrs qui soit notable faute
d'en savoir la suite. Il y a seulement la dcouverte d'un savoir dans le
rel. Ordre qui n'a rien faire avec celui imagin d'avant la science,
mais que nulle raison n'assure d'tre un bon heur.
L'analyste, s'il se vanne du rebut que j'ai dit, c'est bien d'avoir
un aperu de ce que l'humanit se situe du bon heur (c'est o elle
baigne : pour elle n'y a que bon heur), et c'est en quoi il doit avoir
cern la cause de son horreur, de sa propre, lui, dtache de celle
de tous, horreur de savoir.
Ds lors, il sait tre un rebut. C'est ce que l'analyste a d lui faire
au moins sentir. S'il n'en est pas port l'enthousiasme, il peut bien
y avoir eu analyse, mais d'analyste aucune chance. C'est ce que ma
passe , de frache date, illustre souvent : assez pour que les passeurs
s'y dshonorent laisser la chose incertaine, faute de quoi le cas
tombe sous le coup d'une dclinaison polie de sa candidature.
C'aura une autre porte dans le groupe italien, s'il me suit en cette
affaire. Car l'cole de Paris, il n'y a pas de casse pour autant. L'ana-
lyste ne s'autorisant que de lui-mme, sa faute passe aux passeurs, et
la sance continue pour le bon heur gnral, teint pourtant de
dpression.
Ce que le groupe italien gagnerait me suivre, c'est un peu plus
de srieux que ce quoi je parviens ma prudence. Il faut pour cela
qu'il prenne un risque.
J'articule maintenant les choses pour des gens qui m'entendent.
Il y a l'objet (a). Il ex-siste maintenant, de ce que je l'aie construit.
Je suppose qu'on en connat les quatre substances pisodiques, qu'on
309
NOTE ITALIENNE
sait quoi il sert, de s'envelopper de la pulsion par quoi chacun se
vise au cur et n'y atteint que d'un tir qui le rate.
a fait support aux ralisations les plus effectives, et aussi bien aux
ralits les plus attachantes.
Si c'est le fruit de l'analyse, renvoyez ledit sujet ses chres tudes.
Il ornera de quelques potiches supplmentaires le patrimoine cens
faire la bonne humeur de Dieu. Qu'on aime le croire, ou que a
rvolte, c'est le mme prix pour l'arbre gnalogique d'o subsiste
l'inconscient.
Le ga(r)s ou la garce en question y font relais congru.
Qu'il ne s'autorise pas d'tre analyste, car il n'aura jamais le temps
de contribuer au savoir, sans quoi il n'y a pas de chance que l'analyse
continue faire prime sur le march, soit : que le groupe italien ne
soit pas vou l'extinction.
Le savoir en jeu, j'en ai mis le principe comme du point idal
que tout permet de supposer quand on a le sens de l'pure : c'est
qu'il n'y a pas de rapport sexuel, de rapport j'entends, qui puisse se
mettre en criture.
Inutile partir de l d'essayer, me dira-t-on, certes pas vous, mais
si vos candidats, c'est un de plus rtorquer, pour n'avoir nulle
chance de contribuer au savoir dans lequel vous vous teindrez.
Sans essayer ce rapport de l'criture, pas moyen en effet d'arriver
ce que j'ai, du mme coup que je posais son inex-sistence, propos
comme un but par o la psychanalyse s'galerait la science :
savoir dmontrer que ce rapport est impossible crire, soit que c'est
en cela qu'il n'est pas affirmable mais aussi bien non rfutable : au
titre de la vrit.
Avec pour consquence qu'il n'y a pas de vrit qu'on puisse dire
toute, mme celle-ci, puisque celle-ci on ne la dit ni peu ni prou.
La vrit ne sert rien qu' faire la place o se dnonce ce savoir.
Mais ce savoir n'est pas rien. Car ce dont il s'agit, c'est qu'acc-
dant au rel, il le dtermine tout aussi bien que le savoir de la
science.
Naturellement ce savoir n'est pas du tout cuit. Car il faut l'inventer.
Ni plus ni moins, pas le dcouvrir puisque la vrit n'est l rien
de plus que bois de chauffage, je dis bien : la vrit telle qu'elle pro-
cde de la f...trerie (orthographe commenter, ce n'est pas la
f...terie).
310
NOTE ITALIENNE
Le savoir par Freud dsign de l'inconscient, c'est ce qu'invente
l'humus humain pour sa prennit d'une gnration l'autre, et
maintenant qu'on l'a inventori, on sait que a fait preuve d'un
manque d'imagination perdu.
On ne peut l'entendre que sous bnfice de cet inventaire : soit
de laisser en suspens l'imagination qui y est courte, et de mettre
contribution le symbolique et le rel qu'ici l'imaginaire noue (c'est
pourquoi on ne peut le laisser tomber) et de tenter, partir d'eux,
qui tout de mme ont fait leurs preuves dans le savoir, d'agrandir
les ressources grce quoi ce fcheux rapport, on parviendrait s'en
passer pour faire l'amour plus digne que le foisonnement de bavar-
dage, qu'il constitue ce jour, - sicut palea, disait le saint Thomas en
terminant sa vie de moine. Trouvez-moi un analyste de cette tuile,
qui brancherait le truc sur autre chose que sur un organon bauch.
Je conclus : le rle des passeurs, c'est le tripode lui-mme qui
l'assurera jusqu' nouvel ordre puisque le groupe n'a que ces trois
pieds.
Tout doit tourner autour des crits paratre.
1973
Peut-tre Vincennes...
PARU EN JANVIER 1975 DANS ORNICAR ?
Peut-tre Vincennes s'agrgeront les enseignements dont Freud
a formul que l'analyste devait prendre appui, d'y conforter ce qu'il
tient de sa propre analyse : c'est--dire savoir pas tant ce quoi elle
a servi, que de quoi elle s'est servie.
Pas d'argument ici sur ce que j'en enseigne. Mme ceux qui y
obvient, sont forcs d'en tenir compte.
Maintenant ce dont il s'agit n'est pas seulement d'aider l'analyste
de sciences propages sous le mode universitaire, mais que ces
sciences trouvent son exprience l'occasion de se renouveler.
Linguistique - Qu'on sait tre ici la majeure. Qu'un Jakobson
justifie telles de mes positions, ne me suffit pas comme analyste.
Que la linguistique se donne pour champ ce que je dnomme
de la langue pour en supporter l'inconscient, elle y procde d'un
purisme qui prend des formes varies, justement d'tre formel. Soit
d'exclure non seulement du langage, l' origine disent ses fonda-
teurs, mais ce que j'appellerai ici sa nature.
Il est exclu qu'en vienne bout une psychologie quelconque.
C'est dmontr.
Mais le langage se branche-t-il sur quelque chose d'admissible au
titre d'une vie quelconque, voil la question qu'il ne serait pas mal
d'veiller chez les linguistes.
Ce dans les termes qui se soutiennent de mon imaginaire et de
mon rel : par quoi se distinguent deux lieux de la vie, que la
science cette date spare strictement.
J'ai pos de long en large que le langage fait nud de ces lieux, ce
qui ne tranche rien de sa vie lui, ventuelle, si ce n'est qu'il porte
plutt la mort.
De quoi son parasitisme peut-il tre dit homologue ? Le mtalan-
313
PEUT-TRE VINCENNES...
.gage de ce dire suffit le rejeter. Seule une mthode qui se fonde
d'une limite prfigure, a chance de rpondre tout autrement.
J'indique ici la convergence : 1) de la grammaire en tant qu'elle
fait scie du sens, ce qu'on me permettra de traduire de ce qu'elle
fasse ombre de la proie du sens ; 2) de l'quivoque, dont justement je
viens djouer, quand j'y reconnais l'abord lu de l'inconscient pour
en rduire le symptme (cf. ma topologie) : de contredire le sens.
Autrement dit de faire le sens, autre au langage. Ce dont d'autres
signes tmoignent partout. C'est un commencement (soit ce que
saint Jean dit du langage).
J'insiste dsigner de vraie une linguistique qui prendrait la
langue plus srieusement , en profrant l'exemple dans l'tude de
J.-C. Milner sur les noms de qualit (cf. Arguments linguistiques chez
Marne).
Logique - Pas moins intressante.
A condition qu'on l'accentue d'tre science du rel pour en
permettre l'accs du mode de l'impossible.
Ce qui se rencontre dans la logique mathmatique.
Puis-je indiquer ici que l'antithse du rationnel l'irrationnel a
toujours t emprunte d'ailleurs que du langage ? Ce qui laisse en
suspens l'identification de la raison au logos, pourtant classique.
A se souvenir de ce qu'Hegel l'identifiait au rel, il y a peut-tre
raison de dire que c'est de ce que la logique y aille.
Topologie - J'entends mathmatique, et sans qu'en rien encore,
l'analyse puisse ( mon sens) l'inflchir.
Le nud, la tresse, la fibre, les connexions, la compacit : toutes les
formes dont l'espace fait faille ou accumulation sont l faites pour
fournir l'analyste de ce dont il manque : soit d'un appui autre que
mtaphorique, aux fins d'en sustenter la mtonymie.
L'analyste moyen , soit qui ne s'autorise que de son garement,
y trouvera son bien sa mesure, - soit le redoublera : au petit bon-
heur la chance.
Antiphilosophie - Dont volontiers j'intitulerais l'investigation de ce
que le discours universitaire doit sa supposition ducative . Ce
n'est pas l'histoire des ides, combien triste, qui en viendra bout.
314
PEUT-TRE VINCENNES...
Un recueil patient de l'imbcillit qui le caractrise permettra, je
l'espre, de la mettre en valeur dans sa racine indestructible, dans son
rve ternel.
Dont il n'y a d'veil que particulier.
Lettre de dissolution
Je parle sans le moindre espoir - de me faire entendre notam-
ment. Je sais que je le fais - y ajouter ce que cela comporte d'in-
conscient.
C'est l mon avantage sur l'homme qui pense et ne s'aperoit
pas que d'abord il parle. Avantage que je ne dois qu' mon exp-
rience.
Car dans l'intervalle de la parole qu'il mconnat ce qu'il croit
faire pense, l'homme s'embrouille, ce qui ne l'encourage pas.
De sort que l'homme pense dbile, d'autant plus dbile qu'il
enrage... justement de s'embrouiller.
Il y a un problme de l'cole. Ce n'est pas une nigme. Aussi, je
m'y oriente, point trop tt.
Ce problme se dmontre tel, d'avoir une solution : c'est la dis la
dissolution.
A entendre comme de l'Association qui, cette cole, donne
statut juridique.
Qu'il suffise d'un qui s'en aille pour que tous soient libres, c'est,
dans mon nud borromen, vrai de chacun, il faut que ce soit moi
dans mon cole.
Je m'y rsous pour ce qu'elle fonctionnerait, si je ne me mettais
en travers, rebours de ce pour quoi je l'ai fonde.
Soit pour un travail, je l'ai dit - qui, dans le champ que Freud
a ouvert, restaure le soc tranchant de sa vrit - qui ramne la
praxis originale qu'il a institue sous le nom de psychanalyse dans
le devoir qui lui revient en notre monde - qui, par une critique
assidue, y dnonce les dviations et les compromissions qui amor-
tissent son progrs en dgradant son emploi. Objectif que je main-
tiens.
C'est pourquoi je dissous. Et ne me plains pas desdits membres
de l'cole freudienne - plutt les remerci-je pour avoir t
317
LETTRE DE DISSOLUTION
par eux enseign, d'o moi, j'ai chou - c'est--dire me suis
embrouill.
Cet enseignement m'est prcieux. Je le mets profit.
Autrement dit, je persvre.
Et appelle s'associer derechef ceux qui, ce janvier 1980, veulent
poursuivre avec Lacan.
Que l'crit d'une candidature les fasse aussitt connatre de moi.
Dans les 10 jours, pour couper court la dbilit ambiante, je
publierai les adhsions premires que j'aurai agres, comme enga-
gements de critique assidue de ce qu'en matire de dviations et
compromissions l'EFP a nourri.
Dmontrant en acte que ce n'est pas de leur fait que mon cole
serait Institution, effet de groupe consolid, aux dpens de l'effet de
discours attendu de l'exprience, quand elle est freudienne. On sait
ce qu'il en a cot, que Freud ait permis que le groupe psychanaly-
tique l'emporte sur le discours, devienne Eglise.
L'Internationale, puisque c'est son nom, se rduit au symptme
qu'elle est de ce gue Freud en attendait. Mais ce n'est pas elle qui
fait poids. C'est l'Eglise, la vraie, qui soutient le marxisme de ce qu'il
lui redonne sang nouveau... d'un sens renouvel. Pourquoi pas la
psychanalyse, quand elle vire au sens ?
Je ne dis pas a pour un vain persiflage. La stabilit de la religion
vient de ce que le sens est toujours religieux.
D'o mon obstination dans ma voie de mathmes - qui n'em-
pche rien, mais tmoigne de ce qu'il faudrait pour, l'analyste, le
mettre au pas de sa fonction.
Si je pre-svre, c'est que l'exprience faite appelle contre-exp-
rience qui compense.
Je n'ai pas besoin de beaucoup de monde. Et il y a du monde
dont je n'ai pas besoin. ,
Je les laisse en plan afin qu'ils me montrent ce qu'ils savent faire,
hormis m'encombrer, et tourner en eau un enseignement o tout
est pes.
Ceux que j'admettrai avec moi feront-ils mieux? Au moins pour-
ront-ils se prvaloir de ce que je leur en laisse la chance.
318
LETTRE DE DISSOLUTION
Le Directoire de l'EFP, tel que je l'ai compos, expdiera ce qui se
trane d'affaires dites courantes, jusqu' ce qu'une Assemble extra-
ordinaire, d'tre la dernire, convoque en temps voulu conform-
ment la loi, procde la dvolution de ses biens, qu'auront estims
les trsoriers.
Guitrancourt, ce 5 janvier 1980
VI
La logique du fantasme
COMPTE RENDU DU SMINAIRE I966- I967
Notre retour Freud heurte chacun du vide central au champ
qu'il instaure, et pas moins ceux qui en ont la pratique.
On serait chez eux soulag d'en rduire le mot d'ordre l'his-
toire de la pense de Freud, opration classique en philosophie, voire
son vocabulaire. On tourne les termes nouveaux dont nous struc-
turons un objet, nourrir des taches de libraire.
Pousser toujours plus loin le primat logique qui est au vrai de
l'exprience, est rendre ce tour la poussire qu'il soulve.
Ou je ne pense pas ou je ne suis pas, avancer en cette formule
Yergo retourn d'un nouveau cogito, impliquait un passez-muscade
qu'il faut constater russi.
C'est qu'il prenait ceux qu'il visait la surprise d'y trouver la
vertu de notre schma de l'alination (1964), ici saillante aussitt
d'ouvrir le joint entre le a et l'inconscient.
Une diffrence morganienne d'aspect, s'anime de ce qu'un choix
forc la rende dissymtrique. Le je ne pense pas qui y fonde en
effet le sujet dans l'option pour lui la moins pire, reste corn du
suis de ^intersection nie par sa formule. Le pas-je qui s'y sup-
pose, n'est, d'tre pas, pas sans tre. C'est bien a qui le dsigne
et d'un index qui est point vers le sujet par la grammaire. a, c'est
l'ergot que porte le ne, nud qui glisse au long de la phrase pour
en assurer l'indicible mtonymie.
Mais tout autre est le pense qui subsiste complmenter
le je ne suis pas dont l'affirmation est refoule primairement.
Car ce n'est qu'au prix d'tre comme elle faux non-sens, qu'il
peut agrandir son empire prserv des complicits de la conscience.
De l'querre qui se dessine ainsi, les bras sont oprations qui se
dnomment : alination et vrit. Pour retrouver la diagonale qui
rejoint ses extrmits, le transfert, il suffit de s'apercevoir que tout
323
LA LOGIQUE DU FANTASME
comme dans le cogito de Descartes, il ne s'agit ici que du sujet suppos
savoir.
La psychanalyse postule que l'inconscient o le je ne suis pas
du sujet a sa substance, est invocable du je ne pense pas en tant
qu'il s'imagine matre de son tre, c'est--dire ne pas tre langage.
Mais il s'agit d'un groupe de Klein ou simplement du pont-aux-
nes scolastique, c'est dire qu'il y a un coin quart. Ce coin combine
les rsultats de chaque opration en reprsentant son essence dans
son rsidu. C'est dire qu'il renverse leur relation, ce qui se lit les
inscrire d'un passage d'une droite une gauche qui s'y distinguent
d'un accent.
Il faut en effet que s'y close le cycle par quoi l'impasse du sujet se
consomme de rvler sa vrit.
Le manque tre qui constitue l'alination, s'installe la rduire
au dsir, non pas qu'il soit ne pas penser (soyons spinozien ici), mais
de ce qu'il en tienne la place par cette incarnation du sujet qui
s'appelle la castration, et par l'organe du dfaut qu'y devient le
phallus. Tel est le vide si incommode approcher.
Il est maniable d'tre envelopp du contenant qu'il cre. Retrou-
vant pour ce faire les chutes qui tmoignent que le sujet n'est
qu'effet de langage : nous les avons promues comme objets a. Quels
qu'en soient le nombre et la faon qui les maonne, reconnaissons-y
pourquoi la notion de crature, de tenir au sujet, est pralable toute
fiction. On y a seulement mconnu le nihil mme d'o procde la
cration, mais le Dasein invent pour couvrir ces mmes objets peu
catholiques, ne nous donne pas meilleure mine leur regard.
C'est donc au vide qui les centre, que ces objets empruntent
la fonction de cause o ils viennent pour le dsir (mtaphore par
parenthse qui ne peut plus tre lude revoir la catgorie de la
cause).
L'important est d'apercevoir qu'ils ne tiennent cette fonction dans
le dsir qu' y tre aperus comme solidaires de cette refente (d'y
tre la fois ingaux, et conjoignant la disjoindre), de cette refente
o le sujet s'apparat tre dyade - soit prend le leurre de sa vrit
mme. C'est la structure du fantasme note par nous de la paren-
thse dont le contenu est prononcer : S barr poinon a.
Nous revoil donc au nihil de l'impasse ainsi reproduite du sujet
suppos savoir.
324
LA LOGIQUE DU FANTASME
Pour en trouver le hile, avisons-nous qu'il n'est possible de la
reproduire que de ce qu'elle soit dj rptition se produire.
L'examen du groupe ne montre en effet jusqu'ici dans ses trois
oprations que nous sommes : alination vrit et transfert, rien qui
permette de revenir zro les redoubler : loi de Klein posant
que la ngation se redoubler s'annule.
Bien loin de l, quand s'y opposent les trois formules dont la
premire ds longtemps frappe par nous s'nonce : il n'y a pas
d'Autre de l'Autre, autrement dit pas de mtalangage, dont la seconde
renvoie son inanit la question dont l'enthousiasme dj dnonce
qui fait scission de notre propos : que ne dit-il le vrai sur le vrai ?
dont la troisime donne la suite qui s'en annonce : il n'y a pas de
transfert du transfert.
Le report sur un graphe des sens ainsi interdits est instructif des
convergences qu'il dmontre spcifier chaque sommet d'un nombre.
Encore faut-il ne pas masquer que chacune de ces oprations
est dj le zro produit de ce qui a insr au rel ce qu'elle traite,
savoir ce temps propre au champ qu'elle analyse, celui que Freud a
atteint le dire tre : rptition.
La prtention qu'elle contient est bien autre chose que ce com-
mandement du pass dont on la rend futile.
Elle est cet acte par quoi se fait, anachronique, l'immixtion de la
diffrence apporte dans le signifiant. Ce qui fut, rpt, diffre,
devenant sujet redite. Au regard de l'acte en tant qu'il est ce qui
veut dire, tout passage l'acte ne s'opre qu' contresens. Il laisse
part Yacting out o ce qui dit n'est pas sujet, mais vrit.
C'est pousser cette exigence de l'acte, que le premier nous
sommes correct prononcer ce qui se soutient mal d'un nonc la
lgre, lui courant : le primat de l'acte sexuel.
Il s'articule de l'cart de deux formules. La premire : il n'y a pas
d'acte sexuel, sous-entend : qui fasse le poids affirmer dans le sujet
la certitude de ce qu'il soit d'un sexe. La seconde : il n'y a que l'acte
sexuel, implique : dont la pense ait lieu de se dfendre pour ce que
le sujet s'y refend : cf. plus haut la structure du fantasme.
La bisexualit biologique est laisser au legs de Fliess. Elle na rien
faire avec ce dont il s'agit : l'incommensurabilit de l'objet a
l'unit qu'implique la conjonction d'tres du sexe oppos dans l'exi-
gence subjective de son acte.
325
LA LOGIQUE DU FANTASME
Nous avons employ le nombre d'or dmontrer qu'elle ne peut
se rsoudre qu'en manire de sublimation.
Rptition et hte ayant dj t par nous articules au fonde-
ment d'un temps logique , la sublimation les complte pour qu'un
nouveau graphe, de leur rapport orient, satisfasse en redoublant
le prcdent, complter le groupe de Klein - pour autant que ses
quatre sommets s'galisent de rassembler autant de concours opra-
tionnels. Encore ces graphes d'tre deux, inscrivent-ils la distance du
sujet suppos savoir son insertion dans le rel.
Par l ils satisfont la logique que nous nous sommes propose,
car elle suppose qu'il n'y a pas d'autre entre pour le sujet dans le
rel que le fantasme.
A partir de l le clinicien, celui qui tmoigne que le discours de
ses patients reprend le ntre tous les jours, s'autorisera donner
place quelques faits dont autrement on ne fait rien : le fait d'abord
qu'un fantasme est une phrase, du modle d'un enfant est battu, que
Freud n'a pas lgu aux chiens. Ou encore : que le fantasme, celui-ci
par exemple et d'un trait que Freud y souligne, se retrouve dans des
structures de nvrose trs distinctes.
Il pourra alors ne pas rater la fonction du fantasme, comme on
le fait n'employer, sans la nommer, notre lecture de Freud qu' s'attri-
buer l'intelligence de ses textes, pour mieux renier ce qu'ils requirent.
Le fantasme, pour prendre les choses au niveau de l'interprtation,
y fait fonction de l'axiome, c'est--dire se distingue des lois de
dduction variables, qui spcifient dans chaque structure la rduc-
tion des symptmes, d'y figurer sous un mode constant. Le moindre
ensemble, au sens mathmatique du terme, en apprend assez pour
qu'un analyste s'y exercer, y trouve sa graine.
Ainsi rendu au clavier logique, le fantasme ne lui fera que mieux
sentir la place qu'il tient pour le sujet. C'est la mme que le clavier
logique dsigne, et c'fcst la place du rel.
C'est dire qu'elle est loin du bargain nvrotique qui a pris ses
formes de frustration, d'agression, etc., la pense psychanalytique au
point de lui faire perdre les critres freudiens.
Car il se voit aux mises en acte du nvros, que le fantasme, il ne
l'approche qu' la lorgnette, tout occup qu'il est sustenter le dsir
de l'Autre en le tenant de diverses faons en haleine. Le psychana-
lyste pourrait ne pas se faire son servant.
326
LA LOGIQUE DU FANTASME
Ceci l'aiderait en distinguer le pervers, affront de beaucoup
plus prs l'impasse de l'acte sexuel. Sujet autant que lui bien sr,
mais qui fait des rets du fantasme l'appareil de conduction par o il
drobe en court-circuit une jouissance dont le heu de l'Autre ne le
spare pas moins.
Avec cette rfrence la jouissance s'ouvre l'ontique seule
avouable pour nous. Mais ce n'est pas rien qu'elle ne s'aborde mme
en pratique que par les ravinements qui s'y tracent du lieu de
l'Autre.
O nous avons pour la premire fois appuy que ce lieu de
l'Autre n'est pas prendre ailleurs que dans le corps, qu'il n'est pas
intersubjectivit, mais cicatrices sur le corps tgumentaires, pdon-
cules se brancher sur ses orifices pour y faire office de prises, arti-
fices ancestraux et techniques qui le rongent.
Nous avons barr la route au quiproquo qui, prenant thme du
masochisme, noie de sa bave le discours analytique et le dsigne pour
un prix haut-le-cur.
La monstration du masochisme suffit y rvler la forme la plus
gnrale abrger les vains essais o se perd l'acte sexuel, monstra-
tion d'autant plus facile qu'il procde s'y doubler d'une ironique
dmonstration.
Tout ce qui lide un saillant de ses traits comme fait pervers, suffit
disqualifier sa rfrence de mtaphore.
Nous pensons aider rprimer cet abus en rappelant que le
mot de couardise nous est fourni comme plus propre pingler
ce qu'il dsigne dans le discours mme des patients. Ils tmoignent
ainsi qu'ils peroivent mieux que les docteurs, l'ambigut du
rapport qui lie l'Autre leur dsir. Aussi bien le terme a-t-il ses
lettres de noblesse d'tre consign par Freud dans ce qui de la
bouche de l'Homme aux rats, lui a paru digne d'tre recueilli pour
nous.
Nous ne pouvons omettre le moment de fin d'une d'anne o
nous avons pu invoquer le nombre comme facteur de notre audience,
pour y reconnatre ce qui supplait ce vide dont l'obstruction
ailleurs, loin de nous cder, se rconforte nous rpondre.
Le ralisme logique ( entendre mdivalement), si impliqu
dans la science qu'elle omet de le relever, notre peine le prouve.
Cinq cents ans de nominalisme s'interprteraient comme rsistance
327
LA LOGIQUE DU FANTASME
et seraient dissips si des conditions politiques ne rassemblaient
encore ceux qui ne survivent qu' professer que le signe n'est rien
que reprsentation.
La mprise du sujet suppos savoir
L'INSTITUT FRANAIS DE NAPLES, LE 14 DCEMBRE 1967
Qu'est-ce que l'inconscient ? La chose n'a pas encore t comprise \
L'effort des psychanalystes pendant des dcades ayant t ras-
surer sur cette dcouverte, la plus rvolutionnaire qui fut pour la
pense, d'en tenir l'exprience pour leur privilge, - il est vrai que
l'acquis en restait d'apprciation prive - , les choses en arrivrent
ce qu'ils fissent la rechute que leur ouvrait cet effort mme, d'tre
motiv dans l'inconscient : d'avoir voulu s'en rassurer eux-mmes,
ils russirent oublier la dcouverte.
Ils y eurent d'autant moins de peine que l'inconscient n'gare
jamais mieux qu' tre pris sur le fait, mais surtout qu'ils omirent
de relever ce que Freud en avait pourtant dnot : que sa structure
ne tombait sous le coup d'aucune reprsentation, tant plutt de son
usage qu'il n'y et gard que pour s'en masquer (Rucksicht aufDars-
tellbarkeit).
La politique que suppose toute provocation d'un march, ne peut
tre que falsification : on y donnait alors innocemment, faute du
secours des sciences humaines . C'est ainsi qu'on ne savait pas que
c'en tait une que de vouloir faire rassurant YUnheimlich, le fort peu
rassurant qu'est l'inconscient, de sa nature.
La chose admise, tout est bon pour servir de modle rendre
compte de l'inconscient : le pattern de comportement, la tendance
instinctive, voire la trace phylogntique o se reconnat la rminis-
cence de Platon : - l'me a appris avant de natre - , l'mergence
dveloppementale qui fausse le sens des phases dites prgnitales
(orale, anale), et drape pousser l'ordre gnital au sublime... Il faut
entendre la mmerie analytique se donner carrire l-dessus, de
1. Ce texte et les deux suivants, prpars pour des confrences, n'ont pas t lus,
comme le prcise une indication de l'auteur, reproduite dans les Repres biblio-
graphiques (2000).
329
LA MPRISE DU SUJET SUPPOS SAVOIR
faon inattendue la France s'y tant distingue de la pousser au
ridicule. Il se corrige de ce qu'on sache tout ce qui peut s'y couvrir :
la moins discrte coprophilie l'occasion.
Ajoutons la liste la tlologie, pour faire scission des fins de
vie aux fins de mort. Tout cela de n'tre autre que reprsentation,
intuition toujours nave et, pour le dire, registre imaginaire, est assu-
rment air gonfler l'inconscient pour tous, voire chanson susciter
l'envie d'y voir chez aucun. Mais c'est aussi flouer chacun d'une
vrit qui miroite ne s'offrir qu'en fausses prises.
Mais en quoi donc dmontres fausses, me dira-t-on, que diable ?
- Simplement de l'incompatibilit o la tromperie de l'inconscient
se dnonce, de la surcharge rhtorique dont Freud le montre argu-
menter. Ces reprsentations s'additionnent, comme il se dit du chau-
dron, dont le mfait s'carte de ce qu'il ne m'a pas t prt 1, de
ce que, quand je l'ai eu, il tait perc dj 2, de ce qu'il tait par-
faitement neuf 3, au moment de le rendre. Et mets-toi a que tu
me montres o tu voudras.
Ce n'est tout de mme pas du discours de l'inconscient que nous
allons recueillir la thorie qui en rend compte.
Que l'apologue de Freud fasse rire, prouve qu'il touche au bon
endroit. Mais il ne dissipe pas l'obscurantisme qui le relgue aux
amusettes.
C'est ainsi que j'ai fait biller trois mois, dcrocher le lustre dont
je croyais l'avoir une fois pour toutes clair, mon auditoire, lui
dmontrer dans le Witz de Freud (le mot d'esprit, traduit-on) l'arti-
culation mme de l'inconscient. Ce n'tait pas la verve qui me faisait
dfaut, qu'on m'en croie, ni, j'ose le dire, le talent.
L j'ai touch la force d'o rsulte que le Witz soit inconnu au
bataillon des Instituts de psychanalyse, que la psychanalyse appli-
que ait t le rayon rserv Ernst Kris, le non-mdecin du trio
new-yorkais, et que le discours sur l'inconscient soit un discours
condamn : il ne se soutient ^en effet que du poste sans espoir de tout
mtalangage.
Il reste que les malins le sont moins que l'inconscient, et c'est ce
qui suggre de l'opposer au Dieu d'Einstein. On sait que ce Dieu
n'tait pas du tout pour Einstein une faon de parler, quand plutt
faut-il dire qu'il le touchait du doigt de ce qui s'imposait : qu'il tait
compliqu certes, mais non pas malhonnte.
330
LA MPRISE DU SUJET SUPPOS SAVOIR
Ceci veut dire que ce qu'Einstein tient dans la physique (et c'est
l un fait de sujet) pour constituer son partenaire, n'est pas mauvais
joueur, qu'il n'est mme pas joueur du tout, qu'il ne fait rien pour le
drouter, qu'il ne joue pas au plus fin.
Suffit-il de se fier au contraste d'o ressortirait, marquons-le,
combien l'inconscient est plus simple, - et de ce qu'il roule les
malins, faut-il le mettre plus haut que nous dans ce que nous
croyons bien connatre sous le nom de malhonntet ? C'est l qu'il
faut tre prudent.
Il ne suffit pas qu'il soit rus, ou tout au moins qu'il en ait l'air.
Conclure l est vite fait pour les bjaunes dont toute la dduction
s'en trouvera farcie par la suite. Dieu merci ! pour ceux qui j'ai
eu faire, j'avais l'histoire hglienne ma porte, dite de la ruse de
la raison, pour leur faire sentir une diffrence o nous allons peut-
tre faire comprendre pourquoi ils sont perdus d'avance.
Observons le comique, - j e ne le leur ai jamais soulign, car avec
les dispositions que nous leur avons vues plus haut, o cela serait-il
all ? - , le comique de cette raison qui il faut ces dtours intermi-
nables pour nous mener quoi ? ce qui se dsigne par la fin de
l'histoire comme savoir absolu.
Rappelons-nous ici la drision d'un tel savoir qu'a pu forger
l'humour d'un Queneau, de s'tre form sur les mmes bancs que
moi en Hegel, soit son dimanche de la vie , ou l'avnement du
fainant et du vaurien, montrant dans une paresse absolue le savoir
propre satisfaire l'animal ? ou seulement la sagesse qu'authentifie le
rire sardonique de Kojve qui fut tous deux notre matre.
Tenons-nous-en ce contraste : la ruse de la raison abattrait la
fin son jeu.
Ceci nous ramne ce sur quoi nous sommes passs un peu vite.
Si la loi de nature (Dieu de la physique) est complique, comment
se fait-il que nous ne l'atteignions qu' jouer la rgle de la pense
simple, entendons l : qui ne redouble pas son hypothse de faon
en rendre aucune superflue ? Est-ce que ce qui s'est imag l dans
l'esprit d'Occam du rasoir, ne nous permettrait pas, du bout que
nous savons, de faire hommage l'inconscient d'un fil qui, somme
toute, s'est rvl pas mai tranchant ?
Voil qui nous introduit peut-tre mieux cet aspect de l'incons-
cient, par quoi il ne s'ouvre pas tant qu'il ne s'ensuive qu'il se ferme.
331
LA MPRISE DU SUJET SUPPOS SAVOIR
Ds lors rendu plus coriace une seconde pulsation ? La chose est
claire de l'avertissement o Freud a si bien prvu ce que nous avons
commenc par relever, du rengrgement de refoulement qui s'est
produit dans la moyenne clinique, se fiant ses disciples pour y
mettre du leur, d'une pente d'autant mieux intentionne que moins
intentionnelle cder l'irrsistible du behaviourisme pour paver
cette voie.
O le propos prsent fait apercevoir ce qui se formule, qui lit
Freud notre cole tout au moins : que la discipline behaviouriste se
dfinit de la dngation (Verneinung) du principe de ralit.
Voil-t-il pas o rendre place l'opration du rasoir, en souli-
gnant que ma polmique ici non plus qu'ailleurs n'est digressive,
pour dmontrer que c'est au joint mme de la psychanalyse l'objet
qu'elle suscite que le psychanalyste ouvre son sens d'en tre le dchet
pratique ?
Car, o il semble que je dnonce pour trahison la carence du
psychanalyste, je serre 'aporie dont j'articule cette anne l'acte psy-
chanalytique.
Acte que je fonde d'une structure paradoxale de ce que l'objet
y soit actif et le sujet subverti, et o j'inaugure la mthode d'une
thorie de ce qu'elle ne puisse, en toute correction, se tenir pour
irresponsable de ce qui s'avre de faits par une pratique.
Ainsi est-ce au vif de la pratique qui a fait plir l'inconscient, que
j'ai maintenant prendre son registre.
Il y faut ce que je dessine d'un procs nou de sa propre struc-
ture. Toute critique qui serait nostalgie d'un inconscient dans sa
prime fleur, d'une pratique dans sa hardiesse encore sauvage, serait
elle-mme pur idalisme. Simplement notre ralisme n'implique pas
le progrs dans le mouvement qui se dessine de la simple succession.
Il ne l'implique nullement parce qu'il le tient pour une des fantaisies
les plus grossires de ce qui mrite en chaque temps d'tre class
idologie, ici comme effet- de march en tant qu'il est suppos par
la valeur d'change. Il y faut que le mouvement de l'univers du dis-
cours soit prsent au moins comme la croissance intrts compo-
ss d'un revenu d'investissement.
Seulement quand il n'y a pas d'ide de progrs, comment appr-
cier la rgression, la rgression de la pense naturellement? Obser-
vons mme combien cette rfrence la pense est sujette caution
332
LA MPRISE DU SUJET SUPPOS SAVOIR
tant qu'elle n'est pas dfinie, mais c'est aussi que nous ne pouvons
la dfinir tant que nous n'avons pas rpondu la question de ce
qu'est l'inconscient. Car l'inconscient, la premire chose en dire, ce
qui veut dire son : ce que c'est, le quod est, x ti ori, en tant que
c'est le sujet de tout ce qui peut lui tre attribu, c'est ce que Freud
en dit d'abord en effet : c'est des penses.
Aussi bien le terme de rgression de la pense, a-t-il tout de
mme ici l'avantage d'inclure la pulsation indique par nos prlimi-
naires : soit ce mouvement de retrait prdateur dont la succion vide
en quelque sorte les reprsentations de leur implication de connais-
sance, ceci tantt de l'aveu mme des auteurs qui se prvalent de ce
vidage (behaviouriste, ou mythologisant au meilleur cas), tantt de
ce qu'ils n'en soutiennent la bulle qu' la farcir de la paraffine
d'un positivisme moins de saison encore ici qu'ailleurs (migration
de la libido, prtendu dveloppement affectif).
C'est du mouvement mme de l'inconscient que procde la
rduction de l'inconscient l'inconscience, o le moment de la
rduction se drobe de ne pouvoir se mesurer du mouvement comme
de sa cause.
Nulle prtention de connaissance ne serait de mise ici, puisque
nous ne savons mme pas si l'inconscient a un tre propre, et que
c'est de ne pouvoir dire c'est a qu'on l'a appel du nom de
a (Es en allemand, soit : a, au sens o l'on dit a barde ou a
dconne ). En fait l'inconscient c'est pas a , ou bien c'est a,
mais la gomme . Jamais aux p'tits oignons.
Je suis un tricheur de vie , dit un gosse de quatre ans en se
lovant dans les bras de sa gnitrice, devant son pre qui vient de lui
rpondre : Tu es beau sa question : Pourquoi tu me regardes ?
Et le pre n'y reconnat pas (mme de ce que l'enfant dans l'inter-
valle l'ait feint d'avoir perdu le got de soi du jour o il a parl)
l'impasse que lui-mme tente sur l'Autre, en jouant du mort. C'est
au pre qui me l'a dit, d'ici m'entendre ou non.
Impossible de retrouver l'inconscient sans y mettre toute la gomme,
puisque c'est sa fonction d'effacer le sujet. D'o les aphorismes de
Lacan : L'inconscient est structur comme un langage , ou bien
encore : L'inconscient, c'est le discours de l'Autre .
Ceci rappelle que l'inconscient, ce n'est pas de perdre la mmoire ;
c'est de ne pas se rappeler de ce qu'on sait. Car il faut dire, selon
333
LA MPRISE DU SUJET SUPPOS SAVOIR
l'usage du non-puriste : je m'en rappelle
1
, soit : je me rappelle
l'tre (de la reprsentation) partir de cela. De quoi ? D'un signi-
fiant.
Je ne m'en rappelle plus. a veut dire, je ne me retrouve pas l-
dedans. a ne me provoque nulle reprsentation d'o se prouve
que j'aie habit l.
Cette reprsentation, c'est ce qu'on appelle souvenir
2
. Le sou-
venir, le glisser dessous, est de deux sources qu'on a confondues
jusqu'ici :
1) l'insertion du vivant dans la ralit qui est ce qu'il en imagine
et qui peut se mesurer la faon dont il y ragit ;
2) le lien du sujet un discours d'o il peut tre rprim, c'est--
dire ne pas savoir que ce discours l'implique.
Le formidable tableau de l'amnsie dite d'identit, devrait ici tre
difiant.
Il y faut impliquer que l'usage du nom propre, de ce qu'il soit
social, n'y livre pas que ce soit l son origine. Ds lors on peut bien
appeler amnsie l'ordre d'clips qui se suspend sa perte : l'nigme
ne s'en distingue que mieux que le sujet n'y perde aucun bnfice
de l'appris.
Tout ce qui est de l'inconscient, ne joue que sur des effets de lan-
gage. C'est quelque chose qui se dit, sans que le sujet s'y reprsente,
ni qu'il s'y dise, - ni qu'il sache ce qu'il dit.
L n'est pas la difficult. L'ordre d'indtermination que constitue
le rapport du sujet un savoir qui le dpasse, rsulte, peut-on dire,
de notre pratique, qui l'implique, aussi loin qu'elle est interpr-
tative.
Mais qu'il puisse y avoir un dire qui se dise sans qu'on sache qui le
i. De ceci, dit le sujet, je ne me rappelle pas. Soit : l'appel d'un signifiant
dont il faudrait qu'il me reprsente pour un autre signifiant , je ne rponds pas
prsent , pour la raison que de l'effet de cet appel, je ne me reprsente plus rien.
Je suis une chambre obscure o l'on a allum * plus moyen que s'y peigne par son
trou d'pingle l'image de ce qui se passe au-dehors.
L'inconscient n'est pas subliminal, faible clart. Il est la lumire qui ne laisse pas
sa place l'ombre, ni s'insinuer le contour. Il reprsente ma reprsentation l o
elle manque, o je ne suis qu'un manque du sujet.
D'o le terme dans Freud de : reprsentant de la reprsentation.
2. Il est amusant de noter ici que : se souvenir de, vient du : se rappeler de,
rprouv des puristes, lequel est attest du XIV
e
sicle.
334
LA MPRISE DU SUJET SUPPOS SAVOIR
dit, voil quoi la pense se drobe : c'est une rsistance on-tique.
0e joue sur le mot on en franais, dont je fais, non sans titre, un sup-
port de l'tre, un v, un tant, et non pas la figure de l'omnitude :
bref le sujet suppos savoir.)
Si on, l'omnitude, a fini par s'habituer l'interprtation, c'est
d'autant plus facilement qu'il y a beau temps qu'elle y est faite, par la
religion.
C'est mme par l qu'une certaine obscnit universitaire, celle
qui se dnomme l'hermneutique, trouve son beurre dans la psy-
chanalyse.
Au nom du pattern, et du phylos voqu plus haut, de l'talon-
amour qui est la pierre philosophale du fiduciaire intersubjectif,
et sans que personne se soit jamais arrt au mystre de cette ht-
roclite Trinit, l'interprtation donne toute satisfaction... qui
propos ? Avant tout au psychanalyste qui y dploie le moralisme
bnisseur dont les dessous sont dits plus haut.
C'est--dire qui se couvre de n'agir en tout cas que pour le bien :
conformisme, hritage et ferveur rconciliatrice, font la triple
mamelle qu'offre celui-l au petit nombre de ceux qui, d'en avoir
entendu l'appel, en sont dj lus.
Ainsi les pierres o son patient trbuche, ne sont plus que les
pavs de ses bonnes intentions, lui, faon sans doute pour le psy-
chanalyste de ne pas renier la mouvance de l'enfer quoi Freud
s'tait rsign (Si nequeoflectere Superos...).
Mais ce n'est peut-tre pas cette pastorale, de ce propos de ber-
gerie, que Freud procdait. Il suffit de le lire.
Et qu'il ait appel mythologie la pulsion, ne veut pas dire qu'il ne
faut pas prendre au srieux ce qu'il y montre.
Ce qui s'y dmontre, dirons-nous plutt, c'est la structure de
ce dsir dont Spinoza a formul que c'est l'essence de l'homme. Ce
dsir, qui de la dsidration qu'il avoue dans les langues romanes,
subit ici la dflation, qui le ramne son dstre.
Et il est assez bouffon, si le psychanalyste a bien touch, de son
inhrence la pulsion anale, que l'or, c'est de la merde, de le voir
bourrer du doigt la plaie au flanc qu'est l'amour, avec la pommade
de l'authentique, dont l'or estfons et... origo.
C'est pourquoi le psychanalyste n'interprte plus comme la belle
poque, on le sait. C'est pour, lui-mme, en avoir souill la source vive.
335
LA MPRISE DU SUJET SUPPOS SAVOIR
Mais comme il faut bien qu'il marche droit, il svre, c'est--dire
qu'il corrige le dsir et qu'il s'imagine qu'il svre (frustration, agres-
sion, etc.). Castigat mores, dirons-nous : ridendo? Non, hlas ! c'est sans
rire : il chtre les murs de son propre ridicule.
L'interprtation, il la reporte sur le transfert qui nous ramne
notre on.
Ce que le psychanalyste d'aujourd'hui pargne au psychanalysant,
c'est bien ce que nous avons dit plus haut : ce n'est pas ce qui le
concerne, qu'il est bientt prt gober puisqu'on y met les formes,
les formes de la potion... Il ouvrira son gentil petit bec de bcot ;
l'ouvrira, l'ouvrira pas. Non, ce que le psychanalyste couvre, parce
que lui-mme s'en couvre, c'est qu'il puisse se dire quelque chose,
sans qu'aucun sujet le sache.
Men, men, tkel, oupharsin. Si a apparat sur le mur pour que
tout le monde le lise, a vous fout un empire par terre. La chose est
rapporte en bon lieu.
Mais du mme souffle, on en attribue la farce au Tout-Puissant, de
sorte que le trou est referm du mme coup dont on le rapporte, et
l'on ne prend mme pas garde que par cet artifice le fracas lui-mme
sert de rempart au dsir majeur, le dsir de dormir. Celui dont Freud
fait la dernire instance du rve.
Pourtant ne pourrions-nous nous apercevoir que la seule diff-
rence, mais la diffrence qui rduit au nant ce dont elle diffre, la
diffrence d'tre, celle sans quoi l'inconscient de Freud est futile,
c'est qu' l'oppos de tout ce qui a t avant lui produit sous le label
de l'inconscient, il marque bien que c'est d'un lieu qui diffre de
toute prise du sujet qu'un savoir est livr, puisqu'il ne s'y rend qu'
ce qui du sujet est la mprise ?
Le Vergreifen (cf. Freud : la mprise, c'est son mot pour les actes
dits symptomatiques), dpassant le Begriff (ou la prise), promeut
un rien qui s'affirme et s'impose de ce que sa ngation mme l'in-
dique la confirmation qui ne fera pas dfaut de son effet dans la
squence.
Une question soudain se lve, de faire apparatre la rponse qui en
prmunissait de lui tre sup-pose. Le savoir qui ne se livre qu' la
mprise du sujet, quel peut bien tre le sujet le savoir avant?
Si la dcouverte du nombre transfini, nous pouvons fort bien la
supposer s'tre ouverte de ce que Cantor ait achopp tripoter dia-
336
LA MPRISE DU SUJET SUPPOS SAVOIR
gonalement des dcimales, nous n'irons pas pour autant rduire la
question de la fureur que sa construction dchane chez un Kronec-
ker. Mais que cette question ne nous masque pas cette autre concer-
nant le savoir ainsi surgi : o peut-on dire que le nombre transfini,
comme rien que savoir , attendait celui qui devait se faire son
trouveur ? Si ce n'est en aucun sujet, c'est en quel on de l'tre ?
Le sujet suppos savoir, Dieu lui-mme pour l'appeler par le nom
que lui donne Pascal, quand on prcise son inverse : non pas le
Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, mais le Dieu des philosophes,
le voici dbusqu de sa latence dans toute thorie. Theoria, serait-ce
la place au monde de la tho-logie ?
- De la chrtienne assurment depuis qu'elle existe, moyennant
quoi l'athe nous apparat celui qui y tient le plus fort. On s'en
doutait : et que ce Dieu-l tait un peu malade. Ce n'est pas la cure
d'oecumnisme qui va le rendre plus vaillant, ni l'Autre avec un
grand A, celui de Lacan, non plus je crains.
Pour la Dio-logie qu'il conviendrait d'en sparer : et dont les Pres
s'tagent de Mose James Joyce en passant par Matre Eckhart, il
nous semble que c'est encore Freud qui lui marque le mieux sa
place. Comme je l'ai dit : sans cette place marque, la thorie psy-
chanalytique se rduirait ce qu'elle est pour le meilleur et pour le
pire, un dlire du type schrebrien : Freud, lui, ne s'y est pas tromp
et ne recule pas le reconnatre (cf. prcisment son cas Schre-
ber).
Cette place du Dieu-le-Pre, c'est celle que j'ai dsigne comme
le Nom-du-Pre et que je me proposais d'illustrer dans ce qui devait
tre ma treizime anne de sminaire (ma onzime Sainte-Anne),
quand un passage l'acte de mes collgues psychanalystes m'a forc
d'y mettre un terme, aprs sa premire leon. Je ne reprendrai jamais
ce thme, y voyant le signe que ce sceau ne saurait tre encore lev
pour la psychanalyse.
En effet c'est un rapport si bant qu'est suspendue la position
du psychanalyste. Non pas seulement est-il requis de construire la
thorie de la mprise essentielle au sujet de la thorie : ce que nous
appelons le sujet suppos savoir.
Une thorie incluant un manque qui doit se retrouver tous les
niveaux, s'inscrire ici en indtermination, l en certitude, et former
le nud de Pininterprtable, je m'y emploie non certes sans en
337
LA MPRISE DU SUJET SUPPOS SAVOIR
prouver l'atopie sans prcdent. La question est ici : que suis-je
pour oser une telle laboration ? La rponse est simple : un psycha-
nalyste. C'est une rponse suffisante, si Ton en limite la porte ceci
que j'ai d'un psychanalyste, la pratique.
Or c'est bien dans la pratique d'abord que le psychanalyste a
s'galer la structure qui le dtermine non pas dans sa forme men-
tale, hlas ! c'est bien l qu'est l'impasse, mais dans sa position de
sujet en tant qu'inscrite dans le rel : une telle inscription est ce qui
dfinit proprement l'acte.
Dans la structure de la mprise du sujet suppos savoir, le psycha-
nalyste (mais qui est, et o est, et quand est, puisez la lyre des cat-
gories, c'est--dire l'indtermination de son sujet, le psychanalyste ?),
le psychanalyste pourtant doit trouver la certitude de son acte, et la
bance qui fait sa loi.
Irai-je rappeler ceux qui en savent quelque chose, l'irrducti-
bilit de ce qui en reste la fin de la psychanalyse, et que Freud a
point (dans Analyse finie et indfinie) sous les termes de la castration,
voire de l'envie du pnis ?
Peut-il tre vit que m'adressant une audience que rien ne
prpare cette intrusion de l'acte psychanalytique, puisque cet acte
ne se prsente elle que sous des dguisements qui le ravalent et
le dvient, le sujet que mon discours cerne, ne demeure ce qu'il
reste pour notre ralit de fiction psychologisante : au pire le sujet de
la reprsentation, le sujet de l'vque Berkeley, point d'impasse de
l'idalisme, au mieux le sujet de la communication, l'intersubjectif
du message et de l'information, hors d'tat mme de contribuer
notre affaire ?
Bien qu'on ait t pour me produire en cette rencontre, jusqu' me
dire mie j'tais Naples populaire, je ne puis voir dans le succs de
mes crits plus que le signe que mon travail merge en ce moment
du pressentiment universel, qui ressortit d'autres mergences plus
opaques.
Cette interprtation est srement juste, s'il s'avre que cet cho se
produit au-del du champ firanais, o cet accueil s'explique mieux
de l'exclusion o je l'ai vingt ans maintenu.
Aucun critique, depuis la parution de mon livre, n'ayant fait son
mtier qui est de rendre compte, part un nomm Jean-Marie
Auzias, dans un de ces petits livres-torchons dont la lgret pour la
338
LA MPRISE DU SUJET SUPPOS SAVOIR
poche n'excuse pas les ngligences typographiques, cela s'appelle
Clefs du structuralisme : le chapitre IX m'est consacr et ma rfrence
est utilise dans les autres. Jean-Marie Auzias, je rpte, est un
critique estimable, avis rara.
Malgr son cas, je n'attends de ceux qui ici je parle que de
confirmer le malentendu.
Retenez au moins ce dont vous tmoigne ce texte que j'ai jet
votre adresse : c'est que mon entreprise ne dpasse pas l'acte o elle
est prise, et que donc elle n'a de chance que de sa mprise.
Encore de l'acte psychanalytique faut-il dire qu' tre de sa rv-
lation originelle, l'acte qui ne russit jamais si bien que d'tre man-
qu, cette dfinition n'implique pas (non plus qu'ailleurs en notre
champ) la rciprocit, notion si chre la divagation psychologique.
C'est dire qu'il ne suffit pas qu'il choue pour russir, que
le ratage lui seul n'ouvre pas la dimension de la mprise ici en
question.
Un certain retard de la pense dans la psychanalyse, - en laissant
aux jeux de l'imaginaire tout ce qui peut se profrer d'une exp-
rience poursuivie la place que Freud lui a faite - , constitue un
ratage sans plus de signification.
C'est pourquoi il est toute une part de mon enseignement qui
n'est pas acte analytique, mais thse, et polmique elle inhrente,
sur les conditions qui redoublent la mprise propre l'acte, d'un
chec dans sa retombe.
De n'avoir pu changer ces conditions, laisse mon effort dans le
suspens de cet chec.
La fausse mprise, ces deux termes nous au titre d'une comdie
de Marivaux, trouve ici un sens renouvel qui n'implique nulle
vrit de trouvaille. C'est Rome qu'en mmoire d'un tournant de
mon entreprise, demain je donnerai, comme il se peut, la mesure
de cet chec avec ses raisons.
Le sort dira s'il reste gros de l'avenir qui est aux mains de ceux
que j'ai forms.
DE ROME 53 ROME 67 :
La psychanalyse. Raison d'un chec
AU MAGISTERO DE L'UNIVERSIT DE ROME, LE 15 DCEMBRE 1967
18 HEURES, EN LA PRSENCE DE NOTRE AMBASSADEUR
En 1953 mon discours, celui que mon entourage appelle le
discours de Rome, s'est donc tenu au lieu o je le reprends aujour-
d'hui
1
.
Fonction et champ de la parole et du langage dans la psychana-
lyse, tels en furent les termes : fonction de la parole, - champ du lan-
gage - , c'tait interroger la pratique et renouveler Je statut de l'in-
conscient.
Comment luder en effet au moins une interrogation sur ce qui
n'est pas un donn : ce qu'inaugure la parole, essentiellement entre
deux tres, quand la parole est l'instrument, te seul dont use cette
pratique ? Comment mme esprer situer ce qui se dplace au-del,
sans connatre le bti dont elle constitue cet au-del suppos comme
tel?
Et pour l'inconscient, comment cette date ne pas y relever cette
dimension oublie justement d'y tre vidente : sa structure, si clai-
rement ds son apparition isomorphe au discours, - isomorphisme
d'autant plus frappant que sa forme a anticip la dcouverte dont il
s'tablit, que c'est dans le langage, en second, qu'ont t poses les
formes, mtaphore, mtonymie qui en sont les prototypes, et qui
avaient surgi masques, c'est--dire sans que soit reconnu au langage
d'en poser les fondements, dans les mcanismes primaires dcrits par
Freud : condensation et dplacement ?
Un rien d'enthousiasme... - comme je l'cris dans la remise en
place dont j'introduis dans mes crits la recollection de ce titre - ...
1. A quelques kilomtres prs.
341
LA PSYCHANALYSE. RAISON D'UN CHEC
accueillit ces propos qui en furent si gchs l, que la gche ne les
quitta plus pour dix ans. Un rien d'enthousiasme o dj pouvait se
lire sous le signe de quel empetrement psychologisant, ils taient
reus.
L'hypothse psychologique est trs simple. C'est une mtonymie.
Au lieu de dire trente rafiots, vous dites : trente voiles, au lieu de deux
btes humaines, prtes en faire une deux dos, vous dites : deux
mes.
Si c'est un moyen de mconnatre que l'me ne subsiste que de la
place o les deux btes, chacune sa faon, dessinent la rgle de
l'incommensurable de leur copulation, et cette place, la couvrir,
- alors l'opration est russie : j'entends, la mconnaissance est per-
ptue, dont la psychanalyse constitue au moins la rupture. Il n'est
juste de dire : au moins, qu' ce qu'elle la mette en question. Pour
la thorie donc, c'est de rviser cette mtonymie qu'elle prend son
pralable.
Ce qui fait ici la fallace (o il y a phallace cache), ce qui fait la
fallace de la mtonymie de l'me, c'est que l'objet qu'elle partialise,
en est tenu pour autonome. Il est clair que je n'ai pu parler de deux
btes qu' ce qu'elles veuillent se conjoindre, et la flotte des trente
navires veut dire un dbarquement. Les mes sont toujours monades,
- et les trente voiles, le signe du vent. Ce que cet emploi de la mto-
nymie donne de plus valable, c'est la Monadologie et son comique
latent, c'est aussi le souffle qui dissipe les Armadas.
L'uvre de Leibniz en effet ne l'illustre en premier qu' rtablir
ristiquement qu'il ne faut pas partir du Tout, que c'est la partie qui
le tient et le contient. Que chaque monade y soit le Tout, la relve
d'en dpendre, ce qui soustrait la dernire-ne de nos sottises, la
personnalit totale, aux embrassements des amateurs. Il y pointerait
au bout du compte la juste considration de l'organe, celle qui en
fait l'embarras de la fonction.
Pour ce qui est du vent dans les voiles, il nous rappelle que le
dsir de l'homme est excentrique, que c'est au lieu de l'Autre qu'il
se forme .juste dans ce cabinet particulier o de la coquille o gte
l'hutre s'voque l'oreille de la jolie femme avec un got de compli-
ment.
Cette structuration si prcise en tant qu'elle fonde le dsir, je l'ai
introduite en fvrier-mars 1958 en partant de la dynamique si pro-
342
LA PSYCHANALYSE. RAISON D'UN CHEC
prement trace par Freud de l'dipe fminin, d'y dmontrer sa
distinction de la demande, de l'vidence qu'elle y prend.
Il devenait facile ensuite de rduire l'aberration, dont se motive
de nos jours la rserve traditionnelle spcifier le psychanalyste :
soit ce recours la frustration dont il n'y a pas trace chez Freud. Si le
psychanalyste ne peut pas rpondre la demande, c'est seulement
parce qu'y rpondre est forcment la dcevoir, puisque ce qui y est
demand, est en tout cas Autre-Chose, et que c'est justement ce
qu'il faut arriver savoir.
Demande de l'amour au-del. En de, absolu du manque quoi
s'accroche le dsir.
Si le rien d'enthousiasme au dpart signe dj le malentendu,
c'est que d'abord mon discours ne fut pris, par tel sourd exemplaire,
que pour la peinturlure simplement propre relancer la vente de ses
joujoux. (Gnial, dit-il alors.)
Car n'est-ce pas joujoux le terme qui convient une faon de
prendre les mots dont Freud a fait le choix pour reprer une topique
qui a ses raisons dans le progrs de sa pense : moi idal ou idal du
moi par exemple, dans le sens qu'ils peuvent avoir la facult des
lettres, dans la psychologie moderne , celle qui sera scientifique
ncessairement puisque moderne, tout en restant humaniste d'tre
psychologie: vous reconnaissez l l'aube attendue des sciences
humaines, de la carpe-lapin, du poisson-mammifre, de la sirne,
quoi ! Elle donne ici son la : mettre dans ces mots de la topique freu-
dienne, un contenu de l'ordre de ce qui s'apprcie dans les livrets
scolaires.
J'ai fait l'honneur (ainsi s'exprime un amateur qui se rgale de ce
dialogue) d'une rprimande fort polie
l
ce procd qui ne va rien
de moins qu' noncer que le a, c'est en somme le mauvais moi. Il
m'a fallu couter a patiemment. Hlas ! combien d'auditeurs ici
sont en position de mesurer l'inconcevable d'un tel impair?
Je n'ai pas attendu pourtant cette exprience tonnante pour
pingler de l'ignorance enseignante, terme replacer dans sa juste
opposition l'ignorance docte, ce qui a cours comme valeur de la
coulisse intellectuelle au titre de la btise acadmique.
i. P. 647-684 de mes crits.
343
LA PSYCHANALYSE. RAISON D'UN CHEC
Le trafic d'autorit tant la rgle de son march, je me trouvais,
dix ans aprs, ngoci par ses soins, et comme ce fut dans les condi-
tions de noir qui sont celles du gang anafreudien, ce fut ma tte sim-
plement qui fut livre comme dessous-de-table pour la conclusion
d'un gentleman's agreement avec l'IPA, dont il me faut bien indiquer
ici l'incidence politique dans le procs de mon enseignement.
Que soit ici not pour la drlerie du fait qu' peine le ngo-
ciateur avait-il reu cash, pour cette livraison, sa reconnaissance
titre personnel, qu'il gravissait la tribune du Congrs, de la sorte
de Congrs qui sert de faade ces choses, un Congrs sis Edim-
bourg, disons-le pour l'histoire, pour y faire retentir les mots du dsir
et de la demande, devenus des mots clefs pour toute l'audience fran-
aise, mais dont pour s'en faire un mrite l'chelle internationale,
il lui manquait l'intelligence. (Autre occasion de rire pour l'amateur
cit plus haut.)
Qu'on ne se mprenne pas. Je ne fais rien ici que m'acquitter de
ce que je dois un partenaire dans l'extension de mon audience : car
c'en fut l'origine. Comme ce succs me vaut l'attention de l'assem-
ble prsente, il rend paradoxal que je me produise devant elle au
titre de l'chec.
C'est qu'aussi bien n'ai-je pas voulu un succs de librairie, ni son
branchement sur le battage autour du structuralisme, ni ce qui n'est
pour moi que poubellication...
C'est que je pense que le bruit ne convient pas au psychanalyste,
et moins encore au nom qu'il porte et qui ne doit pas le porter.
Ce qui revient mon nom, ce sont ces parties caduques de mon
enseignement dont j'entendais qu'elles restassent une propdeu-
tique rserves : puisque aussi bien elles ne sont rien que ce qui
m'est chu d'une charge prliminaire : soit de dcrasser l'ignorance
dont il n'est pas dfavorable qu'en ait procd de toujours le recru-
tement pour la psychanalyse, mais qui a pris valeur de drame de ce
qu'elle y emporte ses installations premires : dans la mdecine et la
psychologie nommment.
C'est l ce qui dans le recueil des crits est le plus reconnaissable
une critique, dont c'est tout dire qu'elle ne soit plus un mtier,
mais une crcelle : de ce fait je n'ai pas me plaindre, elle n'a pas
ralenti l'intrt que son effort et tempr.
Il arrive en effet que quelqu'un s'aperoive qu'il s'agit l-dedans
344
LA PSYCHANALYSE. RAISON D'UN CHEC
de la dialectique de Hegel, puis de la communication intersub-
jective. N'importe : elles sont tenues pour faire bon mnage, et d'en
dduire incontinent que ce sont les rfrences o j'entends ramener
la psychanalyse.
Donnant rsonance nigaude ce qui se rabche, en toute mau-
vaise foi cette fois, dans les milieux avertis.
Le fait que s'tale au titre d'une anne de mon sminaire (60-61)
le terme de disparit subjective pour en connoter le transfert,
n'y change rien. Non plus qu'il n'en sera de ce que j'aie donn hier
Naples une confrence sur la mprise du sujet suppos savoir ,
qui apparemment ne laisse pas le sujet suppos savoir absolu sr
de rejoindre son assiette.
Au reste un article de 60 prcisment : Subversion du sujet ,
met les points sur les i. Non sans que, ds l'origine, le stade du miroir
n'ait t prsent comme la vtille qui pourrait rduire la lutte
dite de pur prestige comme dissension originaire du Matre et de
l'Esclave, au patatras.
Alors pourquoi en fais-je tat? -Justement pour signaler au
psychanalyste le Jourdain qu'il franchit aisment pour revenir cette
prose : sans le savoir. Quand ce Jourdain n'est rien que l'aune qu'il
transporte avec lui et qui l'annexe, sans mme qu'il l'imagine, la
non-coexistence des consciences, tout comme un simple Jean-Paul
Sartre.
Et puis comment rectifier l'analyse proprement sauvage que le
psychanalyste d'aujourd'hui fait du transfert, sinon dmontrer, ce
que j'ai fait une anne durant, en partant du Banquet de Platon, qu'il
n'est aucun de ses effets qui ne se juge, mais pour s'en soutenir aussi,
de ce que nous appellerons ici (pour aller vite) ce postulat du sujet
suppos savoir? Or c'est le postulat dont c'est le cas de l'inconscient
qu'A l'abolisse (c'est ce que j'ai dmontr hier) : ds lors le psycha-
nalyste est-il le sige d'une pulsion plutomythique ou le servant
d'un dieu trompeur?
Peut-tre cette divergence dans sa supposition, mrite-t-elle
d'tre question pose son sujet, quand ce sujet doit se retrouver
dans son acte.
C'est quoi j'ai voulu mener, d'une ristique dont chaque dtour
fut l'objet d'un soin dlicat, d'une consomption de mes jours dont la
pile de mes propos est le monument dsert, un cercle de sujets dont
345
LA PSYCHANALYSE. RAISON D'UN CHEC
le choix me paraissait celui de l'amour, d'tre comme lui : fait du
hasard.
Disons que je me suis vou la rforme de l'entendement,
qu'impose une tche dont c'est un acte que d'y engager les autres. Si
peu que l'acte flanche, c'est l'analyste qui devient le vrai psycha-
nalys, comme il s'en apercevra aussi sr qu'il est plus prs d'tre la
hauteur de la tche.
Mais ceci laisse voil le rapport de la tche l'acte.
Le pathtique de mon enseignement, c'est qu'il opre ce point.
Et c'est ce qui dans mes Ecrits, dans mon histoire, dans mon ensei-
gnement, retient un public au-del de toute critique. Il sent que
quelque chose s'y joue dont tout le monde aura sa part.
Quoique ce ne se dcle que dans des actes insparables d'un voi-
sinage qui chappe la publicit.
C'est pourquoi mon discours, si mince soit-il auprs d'une uvre
comme celle de mon ami Claude Lvi-Strauss, fait balise autrement,
dans ce flot montant de signifiant, de signifi, de a parle , de trace,
de gramme, de leurre, de mythe, voire de manque, de la circulation
desquels je me suis maintenant dessaisi. Aphrodite de cette cume, en
a surgi au dernier temps la diffrance, avec un a. a laisse de l'espoir
pour ce que Freud consigne comme le relais du catchisme.
Tout de mme tout n'est pas pass l'gout. L'objet (a) n'y nage
pas encore, ni l'Autre avec grand A. Et mme Yi(a), image du petit
autre spculaire, ni la fin du moi qui ne frappe personne, ni la sus-
picion narcissique porte dans l'amour, ne sont encore du tout-
venant. Pour la perversion kantifie (non des quantas, de Kant avec
un fe), a commence.
Pour revenir nos moutons, la tche, c'est la psychanalyse. L'acte,
c'est ce par quoi le psychanalyste se commet en rpondre.
On sait qu'il est admis que la tche d'une psychanalyse l'y pr-
pare : ce pour quoi elle est qualifie de didactique.
Comment de l'une l'autre passerait-on, si la fin de l'une ne
tenait pas la mise au point d'un dsir poussant l'autre ?
Rien sur ceci n'a t articul de dcent. Or, je tmoigne (pour en
avoir une exprience de trente ans) que mme dans le secret o
se juge cette accession, soit : par l'office de psychanalystes qualifis, le
mystre s'paissit encore. Et toute preuve d'y mettre une cohrence,
et notamment pour moi d'y porter la mme question dont j'inter-
346
LA PSYCHANALYSE. RAISON D'UN CHEC
roge l'acte lui-mme, dtermine jusque chez certains que j'ai pu
croire dtermins me suivre, une rsistance assez trange.
Il importe l'entre de ce domaine rserv de noter ce qui est
patent, c'est que la formation de mes lves n'est pas conteste. Non
seulement elle s'impose d'elle-mme, mais elle est fort apprcie,
l mme o elle n'est reconnue que sous la condition expresse -
o il faut qu'ils s'engagent noir sur blanc - , de ne me plus en rien
aider.
Aucun autre examen n'y est port. Aussi bien dans les conditions
prsentes, cet examen manque-t-il de tout autre critre que de
la notorit. La qualification de psychanalyse personnelle dont on a
cru pouvoir amliorer la psychanalyse didactique, n'est rien de plus
qu'un aveu d'impuissance o se dnonce la faon du lapsus, que la
psychanalyse didactique est en effet bien personnelle, mais celui
qui la-dirige.
Tel est le point d'achoppement. Quelque chose qu'avec combien
de discrtion, puisque je l'ai rduit au vhicule d'un tirage part
pour l'auteur, dont j'ai voulu pourtant que 1956 fixt la subjectivit
dominante dans les Socits de psychanalyse, quelque chose qu'on
n'a qu' lire dans mes crits maintenant pour en connatre autre
chose qu'une satire, la structure l articule de ces tages d'intronisa-
tion, dont le moindre engage dans l'chelle de Jacob de ce que j'ai
appel Suffisance, coiffe qu'elle est du ciel des Batitudes, cette
figure dploye non pour railler, mais la faon du doyen Swift
dont je dsigne qu'elle s'inspire, pour que s'y lise l'ironie d'une
capture modelant les volonts particulires, tout cet ordre de cr-
monie, j'y ai touch en vain.
Il se profile au premier pas d'une psychanalyse engage pour
s'y faire valoir. Il y apporte indlbile sa marque par le truchement
de l'analyste, de ce qu'il en soit couronn. Il est le ver ds le bour-
geon du risque pris pour didactique. C'est pour cela qu'on a pari.
Sans doute cet idal va-t-il pouvoir tre analys, dit-on, dans les
motifs de l'entreprise, mais c'est omettre cette pointe de l'existence
qu'est le pari.
L'importance de l'enjeu n'y fait rien : il est aprs tout drisoire.
C'est le pas du pari qui constitue ce que la psychanalyse, mesure
mme de son srieux, joue contre le sujet, puisque ce pari elle doit
le rendre sa folie. Mais l'enjeu obtenu la fin offre ce refuge dont
347
LA PSYCHANALYSE. RAISON D'UN CHEC
tout homme se fait rempart contre un acte encore sans mesure : le
refuge du pouvoir.
Il n'est que d'entendre la faon dont les psychanalystes parlent
de la pense magique, pour y sentir rsonner la confirmation de
la puissance rien moins que magique qu'ils repoussent, celle de tou-
cher comme personne ce qui est le sort de tous : qu'ils ne savent
rien de leur acte, et moins encore : de ce que l'acte qu'ils font entrer
au jeu des causes, c'est de se donner pour en tre la raison.
Cet acte qui s'institue en ouverture de jouissance comme
masochiste, qui en reproduit l'arrangement, le psychanalyste en
corrige l'hybris d'une assurance, celle-ci : que nul de ses pairs ne
s'engouffre en cette ouverture, que lui-mme donc saura se tenir
au bord.
D'o cette prime donne l'exprience, condition qu'on soit
bien sr d'o elle se close pour chacun. La plus courte est ds lors
la meilleure. Etre sans espoir, c'est l aussi tre sans crainte.
L'ineptie exorbitante que tolre un texte pourvu qu'il soit sign
du nom d'un psychanalyste reconnu, prend sa valeur quand je la cite
(cf. pages 605-606 des Ecrits et la suite, les extraits de Maurice Bouvet
sur les vertus de l'accs au gnital).
Le jeune psychanalyste qu'elle frappe croit que je l'ai dforme
l'extraire. Il vrifie et constate tout ce qui l'encadre, la confirme,
voire l'accentue. Il avoue avoir lu la premire fois le texte comme
plausible d'tre un auteur grave.
Il n'est nul moment de l'enfance qui connaisse un tat aussi dli-
rant de dfrence pour les ans qui, quoi qu'ils disent, sont excuss,
de ce qu'on tient pour acquis : qu'ils ont leur raison de ne pas dire ni
plus, ni moins. C'est ce dont il s'agit.
Maurice Bouvet, quand je l'ai connu, valait mieux que l'orvitan
dont il a forg le prospectus. Moi-mme je me modre : vous en
avez la preuve dans l'atermoiement, auquel j'avoue avoir soumis
mon texte sur la Socit psychanalytique.
Une faible bauche que j'en avais ce mme Bouvet donne
pour notre cercle lors d'une crise qui tenait plutt de la farce et o
il vira, l'avait alarm de l'atteinte qu'elle portait, me dit-il, au narcis-
sisme en tant que dominant le rgime du groupe.
Effectivement, il s'agit moins du narcissisme de chacun que de
ce que le groupe se sent en garde d'un narcissisme plus vaste. Il n'est
348
LA PSYCHANALYSE. RAISON D'UN CHEC
pour en juger que de sonder l'ampleur du dtour que prend un
Michel Foucault pour en venir nier l'homme.
Toutes les civilisations dfraient la fonction de contrebattre les
effets de ce narcissisme un emploi diffrenci : fou ou bouffon.
Personne de raisonnable, de son chef, ne relvera dans notre
cercle la passion d'Antonin Artaud.
Si l'un de mes lves s'enflammait dans ce sens, je tenterais de le
calmer. Disons mme que je n'oublie pas d'y tre dj parvenu.
Je joue donc la rgle du jeu, comme fit Freud, et n'ai pas
m'tonner de l'chec de mes efforts pour dnouer l'arrt de la pen-
se psychanalytique.
J'aurai marqu pourtant que d'un moment de dmarcation
entre l'imaginaire et le symbolique ont pris dpart notre science et
son champ.
Je ne vous ai pas fatigus de ce point vif, d'o toute thorie s'ori-
ginera qui redonnerait dpart son complment de vrit.
C'est quand la psychanalyse aura rendu ses armes devant les
impasses croissantes de notre civilisation (malaise que Freud en pres-
sentait), que seront reprises par qui ? les indications de mes crits.
De la psychanalyse
dans ses rapports avec la ralit
L'INSTITUT FRANAIS DE MILAN, LE 18 DCEMBRE 1967
l 8 H 30
Si tonnant que cela puisse paratre, je dirai que la psychanalyse,
soit ce qu'un procd ouvre comme champ l'exprience, c'est la
ralit. La ralit y est pose comme absolument univoque, ce qui
de nos jours est unique : au regard de la faon dont l'emptrent les
autres discours.
Car ce n'est que des autres discours que le rel vient flotter.
Ne nous attardons pas au passe-passe du mot : rel. Retenons qu'il
indique que, pour le psychanalyste, les autres discours font partie de
la ralit.
Celui qui crit ces lignes peut bien dire l'effet de dnuement
dont il ressent sa place, au moment d'aborder ce thme dont on ne
sait quel respect l'a tenu cart. Son si tonnant que cela puisse
paratre... est oratoire, c'est--dire secondaire, et ne dit pas ce qui
l'arrte ici.
Il se sait, il l'avoue, simplement raliste ... - Au sens mdival ?
croit-il entendre, le tracer d'un point d'interrogation. C'est dj
la marque qu'il en a trop dit, et que l'infection dont ne peut plus se
dptrer le discours philosophique, l'idalisme inscrit au tissu de sa
phrase, va faire l son entre.
Il faut prendre les choses autrement. Qu'est-ce qui fait qu'une
psychanalyse est freudienne, voil la question.
Y rpondre conduit jusqu'o la cohrence d'un procd dont on
connat la caractristique gnrale sous le nom d'association libre
(mais qui ne se livre pas pour autant), impose de prsupposs sur les-
quels l'intervention, et nommment celle en cause : l'intervention
du psychanalyste est sans prise.
Ceci est fort remarquable et explique que, de quelque vise de
profondeur, d'initiation, ou de style, qu'un boasting dissident se
351
DE LA PSYCHANALYSE DANS SES RAPPORTS AVEC LA RALIT
targue, elle reste futile auprs de ce qu'implique le procd. Je ne
veux affliger personne. Mais c'est pourquoi la psychanalyse reste
freudienne dans son ensemble : c'est parce qu'elle l'est dans son axe.
C'est que le procd est d'origine solidaire du mode d'interven-
tion freudien.
Ce qui prouve la puissance de ce que nous appelons le procd,
c'est qu'il n'est aussi bien pas exclu que le psychanalyste n'en ait
aucune espce d'ide. Il en est l-dessus de stupides : vrifiez, c'est
facile. Naturellement si vous savez vous-mme ce que veut dire : une
question.
Je tacherai dire ce que n'est pas l'axe du procd.
L'assomption mystique d'un sens au-del de la ralit, d'un quel-
conque tre universel qui s'y manifeste en figures, - est-elle compa-
tible avec la thorie freudienne et avec la pratique psychanalytique ?
- Assurment celui qui prendrait la psychanalyse pour une voie
de cette sorte se tromperait de porte. A ce qu'elle se prte ventuel-
lement au contrle d'une exprience intrieure , ce sera au prix
de dpart d'en changer le statut.
Elle rpugnera l'aide d'aucun soma hallucinogne, quand dj
on sait qu'elle objecte celle de la narcose.
Pour tout dire, elle exclut les mondes qui s'ouvrent une muta-
tion de la conscience, une ascse de la connaissance, une effusion
communicative.
Ni du ct de la nature, de sa splendeur ou de sa mchancet,
ni du ct du destin, la psychanalyse ne fait de l'interprtation une
hermneutique, une connaissance, d'aucune faon, illuminante ou
transformante.
Nul doigt ne saurait s'y indiquer comme d'un tre, divin ou pas.
Nulle signature des choses, ni providence des vnements.
Ceci est bien soulign dans la technique - du fait qu'elle n'im-
pose nulle orientation de l'me, nulle ouverture de l'intelligence,
nulle purification prludant la communication.
Elle joue au contraire sur la non-prparation. Une rgularit
quasi bureaucratique est tout ce qui est exig. La lacisation aussi
complte que possible du pacte pralable installe une pratique sans
ide d'lvation.
Mme de prparer ce qui sera dit dans la sance, est un inconv-
nient o l'on sait que se manifesteront rsistance, voire dfenses.
352
DE LA PSYCHANALYSE DANS SES RAPPORTS AVEC LA RALIT
Indiquons que ces deux mots ne sont pas synonymes, bien
qu'on les emploie, je parle des psychanalystes, tort et travers. Peu
leur importe au reste qu'au dehors on les prenne dans le sens diffus
d'opposition bien ou mal oriente, d'tre salubre ou non. Ils pr-
frent mme a.
Ce qui est attendu de la sance, c'est justement ce qu'on se refuse
attendre, de crainte d'y trop mettre le doigt : la surprise, a soulign Reik.
Et ceci exclut tout procd de concentration : cette exclusion est
sous-jacente l'ide d'association.
Au prsuppos de l'entreprise, ce qui domine est un matter-of-faet.
Ce que nous avons surprendre, est quelque chose dont l'incidence
originelle fut marque comme traumatisme. Elle n'a pas vari de ce
que la stupidit qu'elle implique, se soit transfre au psychanalyste.
Ce qui reste dans l'ide de situation dont se totalisent les effets
qu'on dit dformants, les dirait-on informants mme qu'il s'agirait
de la mme chose.
L'ide d'une norme n'y apparat jamais que comme construite.
Ce n'est pas l le matriel , comme on dit significativement.
L-dessus si vous entendez parler de la fonction d'un moi auto-
nome, ne vous y trompez pas : ne s'agit que de celui du genre de
psychanalyste qui vous attend 5
e
Avenue. Il vous adaptera la ralit
de son cabinet.
L'on ne saura jamais vraiment ce que doit Hider la psychana-
lyse, sinon par l'analyste de Goebbels. Mais pour le retour qu'en a
reu la psychanalyse, il est l.
Ce n'est qu'un branchement abusif, mais difiant, sur ce dont
il s'agit dans la relativit introduite par l'inconscient. C'est dans la
ralit qu'elle s'inscrit.
Relativit restreinte d'abord. Le matriel reste le type de son
propre mtabolisme. Il implique une ralit comme matrielle elle-
mme, c'est--dire non interprtable au titre, dirait-on, de l'preuve
qu'elle constituerait pour une autre ralit qui lui serait transcen-
dante : qu'on mette ce terme au chef du cur ou de l'esprit. Elle ne
saurait tre en elle-mme mise en question : elle est Anank, nous
dit Freud : diktat aveugle.
C'est pourquoi l'interprtation dont s'opre la mutation psycha-
nalytique porte bien l o nous le disons : sur ce qui, cette ralit, la
dcoupe, de s'y inscrire sous les espces du signifiant.
353
DE LA PSYCHANALYSE DANS SES RAPPORTS AVEC LA RALIT
Ici notons que ce n'est pas pour rien que Freud fait usage du
terme Realitt quand il s'agit de la ralit psychique.
Realitt et non Wirklichkeit, qui ne veut dire qu'oprativit : autant
dire ce quoi le psychanalyste d'aujourd'hui fait ses courbettes pour
la frime.
Tout est dans la bance par quoi le psychique n'est nullement
rgle pour oprer, de faon efficace, sur la ralit, y compris sur ce
qu'il est en tant qu'il en fait partie. Il ne comporte en lui-mme que
nature, non connature. Il n'est nullement fait d'accord avec une ra-
lit qui est dure ; laquelle il n'y a de rapport que de s'y cogner :
une ralit dont le solide est la meilleure mtaphore. A entendre au
sens de l'impntrable, et non de la gomtrie. (Car nulle prsence
du polydre, symbole platonicien des lments : au moins apparem-
ment dans cette ralit
!
.)
Toute Weltanschauung est tenue dans l'ide de Freud pour
caduque et sans importance. Elle n'est, il le dit, rien de plus que sup-
plance aux noncs rvlatoires d'un catchisme qui, pour parer
l'inconnu, reste ses yeux sans rival. Ce n'est pas l, faut-il le dire,
position de complaisance, c'est affirmation de l'inaptitude de la
connaissance s'accoler rien d'autre qu' une opacit sans remde.
Mais la complicit marque ici la position vraiment chrtienne,
l'accs interdit au champ de la Rvlation, a son sens - dans l'his-
toire.
Le nerf de la relativit n'est introduit au principe de la ralit
psychique qu'en ceci paradoxalement que le processus d'adaptation
n'y est que secondaire.
Car les centres dont elle s'organise dans les schmas dont
Freud l'ordonne (cf. systme *F), ne sont nulle fonction de synthse,
mais bien d'interposition dans un circuit plus direct : le processus
primaire est d'obstruction.
Le processus secondaire nous est dcrit comme s'en passant,
comme ne lui tant en rien raccord, pour ce qui lui est rserv de
ttonnements.
Ce changement d'ordre ne va pas sans difficult : vrai dire abs-
i. Ironie que ceux qui me suivent, situeront de ce que du rel , en tant que
registre dduit du symbolique et de l'imaginaire, il n'est ici souffl qu'un mot.
L'nonc prsent dfinit le seuil psychanalytique.
354
DE LA PSYCHANALYSE DANS SES RAPPORTS AVEC LA RALIT
traite, car il ne fait que dire crment ce que l'exprience fabrique.
En tout cas il repousse tout recours quelque thorie de la forme,
voire aucune phnomnologie s'imaginer de la conscience non
thtique.
Le primaire, de sa structure, ne fonctionne que d'un tout ou rien
de trace. Aussi bien tromp dans sa prise, est-ce cette trace qu'il
rgresse . Le mot n'est propre qu' indiquer le renversement d'une
force, car il n'a pas d'autre rfrence. L'hallucination n'est tenue pour
en rsulter que d'un rapport des plus lointains avec ses formes
cliniques.
Elle n'est l que pour signifier que du psychisme, c'est l'insatisfac-
tion qui est le premier constituant.
Ce qui y satisfait ne serait fray en aucun cas par le processus
primaire, si le processus secondaire n'y parait.
Je ne veux pas m'tendre ici sur la faon dont est conu le pro-
cessus secondaire. C'est une simple pice rapporte des thories de
toujours, en tant qu'elles restent adhrer l'ide qui a produit son
dernier rejet dans la formule de la sensation, guide de vie , d'une
infrence toujours aussi peu assise.
Le recours l'articulation du stimulus la rponse, tenue pour
quivalente du couple sensori-moteur, n'est qu'une fiction de l'ex-
prience o l'intervention motrice n'est due qu' l'exprimentateur,
et o l'on traduit la raction de l'organisme maintenu dans l'tat de
passivit, en l'ide qu'il a senti quelque chose.
Rien n'indique qu'un tel forage donne le modle d'un quel-
conque fonctionnement propre au biologique.
L'ide du couple tension-dcharge est plus souple. Mais la ten-
sion fort mal dfinie n'implique nullement que la sensation s'y rgle
d'aucune fonction d'homostase, ce que Freud aperoit fort bien
en exclure l'opration dans un systme dtach du circuit tension-
nel, qu'il dsigne comme co.
Bref, plus l'on entre dans l'implication des schmes freudiens, plus
c'est pour voir que le plaisir y a chang de valeur.
Principe du bien pour les Anciens qui en recueillaient l'embarras
de rendre compte qu'il y et des plaisirs dont l'usage est nuisible,
le voici devenu le heu du monde o ne passe qu'une ombre que
rien ne saurait saisir : moins que l'organisme y prenne l'ombre pour
la proie, qu'il n'est lui-mme proie de l'ombre, soit rcuse de sa
355
DE LA PSYCHANALYSE DANS SES RAPPORTS AVEC LA RALIT
conduite cette connaissance dont s'est imagine la fonction de
l'instinct.
Tel est le support dont le sens doit s'estimer de ce qu'il faille le
construire pour rendre compte de ce qui est en cause, ne l'oublions
pas : savoir l'inconscient.
Qu' la physiologie de cette construction, rien d'apprhendable
dans les fonctions de l'organisme (nulle localisation d'appareil en
particulier) ne rponde prsentement : hors des temps du sommeil.
Voil-t-il pas qui en dit long, s'il faut supposer ces temps une per-
manence mythique hors de leur instance effective ?
Pourquoi ne pas saisir que cet angle si fort marquer l'cart du
principe du plaisir au principe de ralit, c'est prcisment de faire
place la redite de l'inconscient qu'il se soutient, que l'inconscient
est l en un ternaire, dont ce n'est pas qu'il soit fait de manque qui
nous empche d'en tracer la ligne comme fermant un triangle ?
Suivez-moi un instant remarquer l'affinit du signifiant ce lieu
de vide.
Appelons-y, quoique ce ne soit pas l que nous l'y situerons enfin,
ce lieu de l'Autre, de ce qu'assurment ce soit bien l ce dont nous
avons montr que le requiert le dsir.
Il est significatif que dans Freud le dsir ne se produise jamais que
du nom de Wunsch. Wunsch, wish, c'est le souhait. Il n'y a de souhait
qu'nonc. Le dsir n'est prsent que sous la demande.
Si rien de ce qui s'articule dans le sommeil n'est admis l'analyse
que de son rcit, n'est-ce pas supposer que la structure du rcit ne
succombe pas au sommeil?
Ceci dfinit le champ de l'interprtation analytique.
Ds lors nul tonnement que l'acte, en tant qu'il n'existe que
d'tre signifiant, se rvle apte supporter l'inconscient : qu'ainsi ce
soit l'acte manqu qui s'avre russi, n'en est que le corollaire, dont
il est seulement curieux qu'il faille l'avoir dcouvert pour que le
statut de l'acte soit enfin fermement distingu de celui du faire.
Le dire, le dire ambigu de n'tre que matriel du dire, donne le
suprme de l'inconseient dans son essence la plus pure. Le mot d'es-
prit nous satisfait d'en rejoindre la mprise en son lieu. Que nous
soyons jous par le dire, le rire clate du chemin pargn, nous dit
Freud, avoir pouss la porte au-del de laquelle il n'y a plus rien
trouver.
356
DE LA PSYCHANALYSE DANS SES RAPPORTS AVEC LA RALIT
Dsir qui se reconnat d'un pur dfaut, rvl qu'il est de ce que
la demande ne s'opre qu' consommer la perte de l'objet, n'est-ce
pas l assez pour expliquer que son drame ne se joue que sur ce que
Freud appelle l'Autre scne, l o le Logos, dchu d'tre du monde
la raison spermatique, s'y rvle comme le couteau y faire entrer la
diffrence?
A ce seul jeu de la coupure, le monde se prte l'tre parlant.
Ce sont ces coupures o il s'est cru longtemps chez lui, avant que
s'animant d'une conjoncture de robot, elles ne le refoulent dans ce
qui d'elles se prolonge dans sa ralit, qu'on n'appelle en effet psy-
chique que de ce qu'elle soit chute du corps.
Interrogeons pourquoi l'tre parlant dvitalise tellement ce corps
que le monde lui en a paru longtemps tre l'image. Moyennant quoi
le corps est microcosme. Notre science a mis fin ce rve, le monde
n'est pas un macrocorps. La notion de cosmos s'vanouit avec ce
corps humain qui, de se barder d'un poumon de mtal, s'en va tracer
dans l'espace la ligne, inoue des sphres, de n'avoir figur jusque-l
que sur le papier de Newton comme champ de la gravitation. Ligne
o le rel se constitue enfin de l'impossible, car ce qu'elle trace est
impensable : les contemporains de Newton ont marqu le coup.
Il suffit de reconnatre le sensible d'un au-del du principe de
ralit dans le savoir de la science, pour que l'au-del du principe du
plaisir qui a pris place dans l'exprience psychanalytique, s'claire
d'une relativit plus gnralisable.
La ralit de l'cart freudien fait barrire au savoir comme le plai-
sir dfend l'accs la jouissance.
C'est occasion nous rappeler ce qu'il y a entre eux s'tablir de
jonction disjonctive, dans la prsence du corps.
L'trange est ce quoi le corps se rduit dans cette conomie. Si
profondment mconnu d'tre par Descartes rduit l'tendue, il
faudra ce corps les excs imminents de notre chirurgie pour
qu'clate au commun regard que nous n'en disposons qu' le faire
tre son propre morcellement, qu' ce qu'il soit disjoint de sa jouis-
sance.
Tiers au-del dans ses rapports la jouissance et au savoir, le
corps fait le lit de l'Autre par l'opration du signifiant.
Mais de par cet effet, qu'en reste-t-il? Insensible morceau en
driver comme voix et regard, chair dvorable ou bien son excr-
357
DE LA PSYCHANALYSE DANS SES RAPPORTS AVEC LA RALIT
ment, voil ce qui de lui vient causer le dsir, qui est notre tre sans
essence.
La dualit saisie ici de deux principes, ne nous divise comme sujet
qu' tre trois fois rpte de chaque essence qui s'en spare, cha-
cune saisie de sa perte en la bance des deux autres.
Nous les appellerons : jouissance, savoir et vrit.
Ainsi est-ce de la jouissance que la vrit trouve rsister au
savoir. C'est ce que la psychanalyse dcouvre dans ce qu'elle appelle
symptme, vrit qui se fait valoir dans le dcri de la raison.
Nous, psychanalystes, savons que la vrit est cette satisfaction
quoi n'obvie pas le plaisir de ce qu'elle s'exile au dsert de la jouis-
sance.
Sans doute le masochiste sait, cette jouissance, l'y rappeler,
mais c'est dmontrer (prcisment de n'y parvenir qu' exalter de
sa simulation une figure dmonstrative), ce qu'il en est pour tous du
corps, qu'il soit justement ce dsert.
La ralit, de ce fait, est commande par le fantasme en tant que
le sujet s'y ralise dans sa division mme.
La satisfaction ne s'y livre qu'au montage de la pulsion, soit
ce dtour qui livre assez son affinit l'instinct de ce qu'il faille,
pour le dcrire, mtaphoriser le cercle du catgut qu'une aiguille
courbe s'emploierait coudre ensemble deux grandes lvres.
Pour la ralit du sujet, sa figure d'alination, pressentie par la
critique sociale, se livre enfin de se jouer entre le sujet de la connais-
sance, le faux sujet du je pense , et ce rsidu corporel o j'ai suffi-
samment, je pense, incarn le Dasein, pour l'appeler par le nom qu'il
me doit : soit l'objet (a).
Entre les deux, il faut choisir :
Ce choix est le choix de la pense en tant qu'elle exclut le je
suis de la jouissance, lequel je suis est je ne pense pas .
La ralit pense est la vrit de l'alination du sujet, elle est son
rejet dans le dstre, dans le je suis renonc.
Ce que le je ne pense pas de l'analyste exprime, c'est cette
ncessit qui le'rejette dans le dstre.
Car ailleurs il ne peut tre que je ne suis pas .
Le psychanalysant est celui qui parvient raliser comme alina-
tion son je pense , c'est--dire dcouvrir le fantasme comme
moteur de la ralit psychique, celle du sujet divis.
358
DE LA PSYCHANALYSE DANS SES RAPPORTS AVEC LA RALIT
Il ne le peut qu' rendre l'analyste la fonction du (a), que lui ne
saurait tre, sans aussitt s'vanouir.
L'analyste doit donc savoir que, loin d'tre la mesure de la ralit,
il ne fraye au sujet sa vrit qu' s'offrir lui-mme comme support
de ce dstre, grce quoi ce sujet subsiste dans une ralit aline,
sans pour autant tre incapable de se penser comme divis, ce dont
l'analyste est proprement la cause.
Or c'est l que le psychanalyste se trouve dans une position inte-
nable : une alination conditionne d'un je suis dont, comme
pour tous, la condition est je ne pense pas , mais renforce de ce
rajout qu' la diffrence de chacun, lui le sait. C'est ce savoir qui
n'est pas portable, de ce que nul savoir ne puisse tre port d'un
seul.
D'o son association ceux qui ne partagent avec lui ce savoir
qu' ne pas pouvoir l'changer.
Les psychanalystes sont les savants d'un savoir dont ils ne peuvent
s'entretenir. C'est une autre affaire que la mystagogie du non-savoir.
Puisque l'analyste ne se refuse pas au principe du plaisir, ni celui
de la ralit, simplement il y est l'gal de celui qu'il y guide, et il
ne peut, ne doit d'aucune faon l'amener les franchir.
Il ne lui apprend rien l-dessus, ne faisant plus que le guigner, s'il
lui arrive de transgresser l'un ou l'autre.
Il ne partage avec lui qu'un masochisme ventuel, de la jouissance
duquel il se tient carreau.
D'o la part de mconnaissance sur laquelle il difie une suffi-
sance fonde sur une sorte de savoir absolu, qui est plutt point zro
du savoir.
Ce savoir n'est d'aucune faon exerc, de ce qu' le faire passer
l'acte, le psychanalyste attenterait au narcissisme d'o dpendent
toutes les formes.
L'analyste se fait le gardien de la ralit collective, sans en avoir
mme la comptence. Son alination est redouble, - de ce qu'il
puisse y chapper.
Allocution sur les psychoses de l'enfant
PRONONCE LE 22 OCTOBRE 1967
EN CONCLUSION DE JOURNES TENUES SUR CE THME
Mes amis,
Je voudrais d'abord remercier Maud Mannoni, qui nous devons
la runion de ces deux jours, et donc, tout ce qui a pu s'en dgager.
Elle a russi dans son dessein, grce cette extraordinaire gnrosit,
caractristique de sa personne, qui lui a fait payer auprs de chacun,
de son effort, le privilge d'amener de tous les horizons quiconque
pouvait donner rponse une question qu'elle a faite sienne. Aprs
quoi, s'effacer devant l'objet, elle en faisait interrogations rece-
vables.
Pour partir de cet objet qui est bien centr, je voudrais vous en
faire sentir l'unit partir de quelques phrases que j'ai prononces
il y a quelque vingt ans dans une. runion chez notre ami Henri Ey,
dont vous savez qu'il a t dans le champ psychiatrique franais, ce
que nous appellerons un civilisateur. Il a pos la question de ce qu'il
en est de la maladie mentale d'une faon dont on peut dire qu'au
moins a-t-elle veill le corps de la psychiatrie en France, la plus
srieuse question sur ce que ce corps lui-mme reprsentait.
Pour ramener le tout sa plus juste fin, je devais contredire
l'organo-dynamisme dont Ey s'tait fait le promoteur. Ainsi sur
l'homme en son tre, m'exprimais-je en ces termes : Loin que la
folie soit la faille contingente des fragilits de son organisme, elle est
la virtualit permanente d'une faille ouverte dans son essence. Loin
qu'elle soit pour la libert une insulte (comme Ey l'nonce), elle
est sa plus fidle compagne, elle suit son mouvement comme une
ombre. Et l'tre de l'homme non seulement ne peut tre compris
sans la folie, mais il ne serait pas l'tre de l'homme, s'il ne portait en
soi la folie comme la limite de sa libert.
A partir de l, il ne peut pas vous paratre trange qu'en notre
runion aient t conjointes les questions portant sur l'enfant, sur
361
ALLOCUTION SUR LES PSYCHOSES DE L'ENFANT
la psychose, sur l'institution. Il doit vous paratre naturel que nulle
part plus qu'en ces trois thmes, soit voque plus constamment la
libert. Si la psychose est bien la vrit de tout ce qui verbalement
s'agite sous ce drapeau, sous cette idologie, actuellement la seule
ce que l'homme de la civilisation s'en arme, nous voyons mieux le
sens de ce qu' leur tmoignage font nos amis et collgues anglais
dans la psychose, de ce qu'ils aillent justement dans ce champ et
justement avec ces partenaires instaurer des modes, des mthodes
o le sujet est invit se profrer dans ce qu'eux pensent comme
des manifestations de sa libert.
Mais n'est-ce pas l une perspective un peu courte, je veux dire,
est-ce que cette libert suscite, suggre par une certaine pratique
s'adressant ces sujets, ne porte pas en elle-mme sa limite et son
leurre ?
Pour ce qui est de l'enfant, de l'enfant psychotique, ceci
dbouche sur des lois, lois d'ordre dialectique, qui sont en quelque
sorte rsumes dans l'observation pertinente que le Dr Cooper a
faite, que pour obtenir un enfant psychotique, il y faut au moins
le travail de deux gnrations, lui-mme en tant le fruit la troi-
sime.
Que si enfin la question se pose d'une institution qui soit pro-
prement en rapport avec ce champ de la psychose, il s'avre que
toujours en quelque point situation variable y prvale un rapport
fond la libert.
Qu'est-ce dire ? Assurment pas que j'entende ainsi d'aucune
faon clore ces problmes, ni non plus les ouvrir comme on dit, ou
les laisser ouverts. Il s'agit de les situer et de saisir la rfrence d'o
nous pouvons les traiter sans nous-mmes rester pris dans un certain
leurre, et pour cela de rendre compte de la distance o gte la corr-
lation dont nous sommes nous-mmes prisonniers. Le facteur dont
il s'agit, est le problme le plus brlant notre poque, en tant que,
la premire, elle a ressentir la remise en question de toutes les
structures sociales par le progrs de la science. Ce quoi, pas seule-
ment dans notre domaine nous psychiatres, mais aussi loin que
s'tendra notre univers, nous allons avoir affaire, et toujours de faon
plus pressante : la sgrgation.
Les hommes s'engagent dans un temps qu'on appelle plantaire,
o ils s'informeront de ce quelque chose qui surgit de la destruction
362
ALLOCUTION SUR LES PSYCHOSES DE L'ENFANT
d'un ancien ordre social que je symboliserai par l'Empire tel que son
ombre s'est longtemps encore profile dans une grande civilisation,
pour que s'y substitue quelque chose de bien autre et qui n'a pas
du tout le mme sens, les imprialismes, dont la question est la
suivante : comment faire pour que des masses humaines, voues au
mme espace, non pas seulement gographique, mais l'occasion
familial, demeurent spares ?
Le problme au niveau o Oury l'a articul tout l'heure du
terme juste de sgrgation, n'est donc qu'un point local, un petit
modle de ce dont il s'agit de savoir comment nous autres, je veux
dire les psychanalystes, allons y rpondre : la sgrgation mise
l'ordre du jour par une subversion sans prcdent. Ici n'est pas
ngliger la perspective d'o Oury pouvait formuler tout l'heure
qu' l'intrieur du collectif, le psychotique essentiellement se prsente
comme le signe, signe en impasse, de ce qui lgitime la rfrence la
libert.
Le plus grand pch, nous dit Dante, est la tristesse. Il faut nous
demander comment nous, engags dans ce champ que je viens de
cerner, pouvons tre en dehors cependant.
Chacun sait que je suis gai, gamin mme on dit : je m'amuse.
Il m'arrive sans cesse, dans mes textes, de me livrer des plaisanteries
qui ne sont pas du got des universitaires. C'est vrai. Je ne suis pas
triste. Ou plus exactement, je n'ai qu'une seule tristesse, dans ce qui
m'a t trac de carrire, c'est qu'il y ait de moins en moins de per-
sonnes qui je puisse dire les raisons de ma gaiet, quand j'en ai.
Venons pourtant au fait que si nous pouvons poser les questions
comme il s'est fait ici depuis quelques jours, c'est qu' la place de
l'X qui est en charge d'y rpondre, l'aliniste longtemps, puis le psy-
chiatre, quelqu'un d'ailleurs a dit son mot qui s'appelle le psychana-
lyste, figure ne de l'uvre de Freud.
Qu'est cette uvre?
Vous le savez, c'est pour faire face aux carences d'un certain
groupe que j'ai t port cette place que je n'ambitionnais en rien,
d'avoir nous interroger, avec ceux qui pouvaient m'entendre, sur
ce que nous faisions en consquence de cette uvre, et pour cela
d'y remonter.
Juste avant les sommets du chemin que j'instaurai de sa lecture
avant d'aborder le transfert, puis l'identification, puis l'angoisse, ce
363
ALLOCUTION SUR LES PSYCHOSES DE L'ENFANT
n'est pas hasard, l'ide n'en viendrait personne, si cette anne,
la quatrime avant que mon sminaire prt fin Sainte-Anne, j'ai
cru devoir nous assurer de l'thique de la psychanalyse.
Il semble en effet que nous risquions d'oublier dans le champ
de notre fonction qu'une thique est son principe, et que ds lors,
quoi qu'il puisse se dire, et aussi bien sans mon aveu, sur la fin de
l'homme, c'est concernant une formation qu'on puisse qualifier
d'humaine qu'est notre principal tourment.
Toute formation humaine a pour essence, et non pour accident,
de refrner la jouissance. La chose nous apparat nue - et non plus
travers ces prismes ou lentilles qui s'appellent religion, philoso-
phie. .. voire hdonisme, car le principe du plaisir, c'est le frein de la
jouissance.
C'est un fait qu' la fin du XIX
e
sicle et non sans quelque anti-
nomie avec l'assurance prise de l'thique utilitariste, Freud a ramen
la jouissance sa place qui est centrale, pour apprcier tout ce que
nous pouvons voir s'attester, au long de l'histoire, de morale.
Qu'a-t-il fallu de remuement, j'entends aux bases pour que ce
gouffre en rmerge quoi nous jetons en pture deux fois par
nuit? deux fois par mois? notre rapport avec quelque conjoint
sexuel ?
Il n'est pas moins remarquable que rien n'a t plus rare en nos
propos de ces deux jours que le recours l'un de ces termes qu'on
peut appeler le rapport sexuel (pour laisser de ct l'acte), l'incons-
cient, la jouissance.
Ce ne veut pas dire que leur prsence ne nous commandait pas,
invisible, mais aussi bien, dans telle gesticulation derrire le micro,
palpable.
Nanmoins, jamais thoriquement articule.
Ce qui s'entend (inexactement) de ce que Heidegger nous
propose du fondement prendre dans l'tre-pour-la-mort, prte
cet cho qu'il fait retentir des sicles, et des sicles d'or, du pnitent
comme mis au cur de la vie spirituelle. Ne pas mconnatre aux
antcdents de la mditation de Pascal le support d'un franchisse-
ment de l'amour et de l'ambition, ne nous assure que mieux du
lieu commun, jusqu'en son temps, de la retraite o se consomme
l'affrontement de l'tre-pour-la-mort. Constat qui prend son prix
de ce que Pascal; transformer cette ascse en pari, la clt en fait.
364
ALLOCUTION SUR LES PSYCHOSES DE L'ENFANT
Sommes-nous pourtant la hauteur de ce qu'il semble que nous
soyons, par la subversion freudienne, appels porter, savoir l'tre-
pour-le-sexe?
Nous ne semblons pas bien vaillants en tenir la position.
Non plus bien gais. Ce qui, je pense, prouve que nous n'y sommes
pas tout fait.
Et nous n'y sommes pas en raison de ce que les psychanalystes
disent trop bien pour supporter de le savoir, et qu'ils dsignent grce
Freud comme la castration : c'est l'tre-pour-le-sexe.
L'affaire s'claire de ceci que Freud a dit en historiettes et qu'il
nous faut mettre en pingle, c'est que, ds qu'on est deux, l'tre-
pour-la-mort, quoi qu'en croient ceux qui le cultivent, laisse voir
au moindre lapsus que c'est de la mort de l'autre qu'il s'agit. Ce qui
explique les espoirs mis dans l'tre-pour-le-sexe. Mais en contraste,
l'exprience analytique dmontre que, quand on est deux, la castra-
tion que le sujet dcouvre, ne saurait tre que la sienne. Ce qui pour
les espoirs mis dans l'tre-pour-le-sexe, joue le rle du second terme
dans le nom des Pecci-Blunt : celui de fermer les portes qui s'taient
d'abord grandes ouvertes.
Le pnitent perd donc beaucoup s'allier au psychanalyste. Au
temps o il donnait le ton, il laissait libre, incroyablement plus que
depuis l'avnement du psychanalyste, le champ des bats sexuels,
comme il est sous forme de mmoires, ptres, rapports et traits
plaisants, maints documents pour l'attester. Pour le dire, s'il est diffi-
cile de juger justement si la vie sexuelle tait plus aise au XVII
e
ou
au xvm
e
sicle qu'au ntre, le fait par contre que les jugements y
aient t plus libres concerner la vie sexuelle, se dcide en toute
justice nos dpens.
Ce n'est certes pas trop de rapporter cette dgradation la pr-
sence du psychanalyste , entendue dans la seule acception o l'em-
ploi de ce terme ne soit pas d'impudence, c'est--dire dans son effet
d'influence thorique, prcisment marqu du dfaut de la thorie.
A se rduire leur prsence, les psychanalystes mritent qu'on
s'aperoive qu'ils ne jugent ni mieux ni plus mal des choses de la vie
sexuelle que l'poque qui leur fait place, qu'ils ne sont dans leur
vie de couple pas plus souvent deux qu'on ne l'est ailleurs, ce qui
ne gne pas leur profession puisqu'une telle paire n'a rien faire
dans l'acte analytique.
365
ALLOCUTION SUR LES PSYCHOSES DE L'ENFANT
Bien sr la castration n'a de figure qu'au terme de cet acte,
mais couverte de ceci qu' ce moment le partenaire se rduit ce
que j'appelle l'objet a - c'est--dire, comme il convient, que l'tre-
pour-le-sexe a s'prouver ailleurs : et c'est alors dans la confusion
croissante qu'y apporte la diffusion de la psychanalyse elle-mme,
ou de ce qui ainsi s'intitule.
Autrement dit ce qui institue l'entre dans la psychanalyse provient
de la difficult de l'tre-pour-le-sexe, mais la sortie, lire les psychana-
lystes d'aujourd'hui n'en serait rien d'autre qu'une rforme de l'thique
o se constitue le sujet. Ce n'est donc pas nous, Jacques Lacan, qui
ne nous fions qu' oprer sur le sujet en tant que passion du langage,
mais bien ceux qui l'acquittent d'en obtenir l'mission de belles paroles.
C'est rester dans cette fiction sans rien entendre la structure
o elle se ralise, qu'on ne songe plus qu' la feindre relle et qu'on
tombe dans la forgerie.
La valeur de la psychanalyse, c'est d'oprer sur le fantasme. Le
degr de sa russite a dmontr que l se juge la forme qui assujettit
comme nvrose, perversion ou psychose.
D'o se pose seulement s'en tenir l, que le fantasme fait
la ralit son cadre : vident l !
Et aussi bien impossible bouger, n'tait la marge laisse par la
possibilit d'extriorisation de l'objet a.
On nous dira que c'est bien ce dont on parle sous le terme d'objet
partiel.
Mais justement le prsenter sous ce terme, on en parle dj trop
pour en rien dire de recevable.
S'il tait si facile d'en parler, nous l'appellerions autrement que
l'objet a.
Un objet qui ncessite la reprise de tout le discours sur la cause,
n'est pas assignable merci, mme thoriquement.
Nous ne touchons ici ces confins que pour expliquer comment
dans la psychanalyse, on fait si brivement retour la ralit, faute
d'avoir vue sur son contour.
Notons qu'ici nous n'voquons pas le rel, qui dans une exp-
rience de parole ne vient qu'en virtualit, qui dans l'difice logique
se dfinit comme l'impossible.
Il faut dj bien des ravages exercs par le signifiant pour qu'il soit
question de ralit.
366
ALLOCUTION SUR LES PSYCHOSES DE L'ENFANT
Ceux-ci sont saisir bien temprs dans le statut du fantasme,
faute de quoi le critre pris de l'adaptation aux institutions
humaines, revient la pdagogie.
Par impuissance poser ce statut du fantasme dans l'tre-pour-
le-sexe (lequel se voile dans l'ide trompeuse du choix subjec-
tif entre nvrose, perversion ou psychose), la psychanalyse bcle
avec du folklore un fantasme postiche, celui de l'harmonie loge
dans l'habitat maternel. Ni incommodit ni incompatibilit ne
sauraient s'y produire, et l'anorexie mentale s'en relgue comme
bizarrerie.
On ne saurait mesurer quel point ce mythe obstrue l'abord
de ces moments explorer dont tant furent voqus ici. Tel celui
du langage abord sous le signe du malheur. Quel prix de consis-
tance attend-on d'pingler comme prverbal ce moment juste
prcder l'articulation patente de ce autour de quoi semblait flchir
la voix mme du prsentateur : la gage ? la gche ? J'ai mis du temps
reconnatre le mot : langage.
Mais ce que je demande quiconque a entendu la communication
que je mets en cause, c'est oui ou non, si un enfant qui se bouche les
oreilles, on nous le dit, quoi? quelque chose en train de se parler,
n'est pas dj dans le postverbal, puisque du verbe il se protge.
En ce qui concerne une prtendue construction de l'espace
qu'on croit saisir l naissante, il me semble plutt trouver le moment
qui tmoigne d'une relation dj tablie l'ici et l-bas qui sont
structures de langage.
Faut-il rappeler qu' se priver du recours linguistique, l'obser-
vateur ne saurait que manquer l'incidence ventuelle des opposi-
tions caractristiques dans chaque langue connoter la distance, fut-
ce entrer par l dans les nuds que plus d'une nous incite situer
entre l'ici et le l-bas ? Bref il y a du linguistique dans la construction
de l'espace.
Tant d'ignorance, au sens actif qui s'y recle, ne permet gure
d'voquer la diffrence si bien marque en latin du taceo au silet.
Si le silet y vise dj, sans encore qu'on s'en effraye, faute du
contexte des espaces infinis , la configuration des astres, n'est-ce
pas pour nous faire remarquer que l'espace en appelle au langage
dans une tout autre dimension que celle o le mutisme pousse une
parole plus primordiale qu'aucun motn-mom.
367
ALLOCUTION SUR LES PSYCHOSES DE L'ENFANT
Ce qu'il convient d'indiquer ici, c'est pourtant le prjug irr-
ductible dont se grve la rfrence au corps tant que le mythe qui
couvre la relation de l'enfant la mre n'est pas lev.
Il se produit une lision qui ne peut se noter que de l'objet a
9
alors que c'est prcisment cet objet qu'elle soustraira aucune prise
exacte.
Disons donc qu'on ne la comprend qu' s'opposer ce que ce
soit le corps de l'enfant qui rponde l'objet a : ce qui est dlicat, l
o ne se fait jour nulle prtention semblable, laquelle ne s'animerait
qu' souponner l'existence de l'objet a.
Elle s'animerait justement de ce que l'objet a fonctionne comme
inanim, car c'est comme cause qu'il apparat dans le fantasme.
Cause au regard de ce qu'est le dsir dont le fantasme est le
montage.
Mais aussi bien par rapport au sujet qui se refend dans le fantasme
en s'y fixant d'une alternance, monture qui rend possible que le
dsir n'en subisse pas pour autant de retournement.
Une plus juste physiologie des mammifres placenta ou sim-
plement la part mieux faite l'exprience de l'accoucheur (dont
on peut s'tonner qu'elle se contente en fait de psychosomatique
des caquets de l'accouche sans douleurs) serait le meilleur antidote
un mirage pernicieux.
Qu'on se souvienne qu' la cl, on nous sert le narcissisme pri-
maire comme fonction d'attraction intercellulaire postule par les
tissus.
Nous fumes les premiers situer exactement l'importance tho-
rique de l'objet dit transitionnel, isol comme trait clinique par
Winnicott.
Winnicott lui-mme se maintient, pour l'apprcier, dans un
registre de dveloppement.
Sa finesse extrme s'extnue ordonner sa trouvaille en paradoxe
ne pouvoir que l'enregistrer comme frustration, o elle ferait de
ncessit besoin, toute fin de Providence.
L'important pourtant n'est pas que l'objet transitionnel prserve
l'autonomie de l'enfant mais que l'enfant serve ou non d'objet tran-
sitionnel la mre.
Et ce suspens ne livre sa raison qu'en mme temps que l'objet
livre sa structure. C'est savoir celle d'un condensateur pour la
368
ALLOCUTION SUR LES PSYCHOSES DE L'ENFANT
jouissance, en tant que par la rgulation du plaisir, elle est au corps
drobe.
Est-il loisible ici d'un saut d'indiquer qu' fuir ces alles tho-
riques, rien ne saurait qu'apparatre en impasse des problmes poss
l'poque.
Problmes du droit la naissance d'une part - mais aussi dans la
lance du : ton corps est toi, o se vulgarise au dbut du sicle un
adage du libralisme, la question de savoir, si du fait de l'ignorance
o ce corps est tenu par le sujet de la science, on va venir en droit,
ce corps, le dtailler pour l'change.
Ne discerne-t-on pas de ce que j'ai dit aujourd'hui la conver-
gence ? En pinglerons-nous du terme de l'enfant gnralis, la
consquence ? Certains antimmoires tiennent ces jours-ci l'actua-
lit (pourquoi ainsi - sont-ils ces mmoires? si c'est de n'tre pas
des confessions, nous avertit-on, n'est-ce pas l depuis toujours la
diffrence des mmoires?). Quoi qu'il en soit l'auteur les ouvre par
la confidence d'trange rsonance dont un religieux lui fit adieu :
J'en viens croire, voyez-vous, en ce dclin de ma vie, lui dit-il,
qu'il n'y a pas de grandes personnes.
Voil qui signe l'entre de tout un monde dans la voie de la
sgrgation.
N'est-ce pas de ce qu'il faille y rpondre que nous entrevoyons
maintenant pourquoi sans doute Freud s'est senti devoir rintroduire
notre mesure dans l'thique, par la jouissance ? Et n'est-ce pas tenter
d'en agir avec vous comme avec ceux dont c'est la loi ds lors, que
de vous quitter sur la question : quelle joie trouvons-nous dans ce
qui fait notre travail ?
NOTE
Ceci n'est pas un texte, mais une allocution improvise.
Nul engagement ne pouvant justifier mes yeux sa transcrip-
tion mot pour mot que je tiens pour futile, il me faut donc l'ex-
cuser.
D'abord de son prtexte : qui fut de feindre une conclusion dont
369
ALLOCUTION SUR LES PSYCHOSES DE L'ENFANT
le manque, ordinaire aux Congrs, n'exclut pas leur bienfait dont
ce fut le cas ici.
Je m'y prtai pour rendre hommage Maud Mannoni : soit
celle qui, par la rare vertu de sa prsente, avait su prendre tout ce
monde aux rets de sa question.
La fonction de la prsence, est, dans ce champ comme partout ;
juger sur sa pertinence.
Elle est certainement exclure, sauf impudence notoire, de l'op-
ration psychanalytique.
Pour la mise en question de la psychanalyse, voire du psychana-
lyste lui-mme (pris essentiellement), elle joue son rle suppler au
manque d'appui thorique.
Je lui donne cours en mes crits comme polmique, fait d'inter-
mde en des lieux d'interstice, quand je n'ai pas d'autre recours
contre l'obtusion qui dfie tout discours.
Bien sr est-elle toujours sensible dans le discours naissant, mais
c'est prsence qui ne vaut qu' s'effacer enfin, comme il se voit dans
la mathmatique,
Il en est une pourtant dans la psychanalyse qui se soude la tho-
rie : c'est la prsence du sexe comme tel, entendre au sens o l'tre
parlant le prsente comme fminin.
Que veut la femme ? est, on le sait, l'ignorance o reste Freud
jusqu'au terme, dans la chose qu'il a mise au monde.
Ce que femme veut, aussi bien d'tre encore au centre aveugle
du discours analytique, emporte dans sa consquence que la femme
soit psychanalyste-ne (comme on s'en aperoit ce que rgentent
l'analyse les moins analyses des femmes).
Rien de tout cela ne se rapporte au cas prsent puisqu'il s'agit de
thrapie et d'un concert qui ne s'ordonne la psychanalyse qu' le
reprendre en thorie.
C'est ici qu'il m'a fallu y suppler pour tous autres que ceux
qui m'entendent, par une sorte de prsence qu'il me faut bien
dire d'abus... puisqu'elle va de la tristesse qui se motive d'une gaiet
rentre jusqu' en appeler au sentiment de l'incompltude l o il
faudrait situer celle-ci en logique.
Une telle prsence fit, parat-il, plaisance. Que trace donc reste ici
de ce qui porte comme parole, l o l'accord est exclu : l'aphorisme,
la confidence, la persuasion, voire le sarcasme.
370
ALLOCUTION SUR LES PSYCHOSES DE L'ENFANT
Une fois de plus, on l'aura vu, j'ai pris l'avantage de ce qu'un
langage soit vident o l'on s'obstine figurer le prverbal.
Quand verra-t-on que ce que je prfre est un discours sans
paroles ?
26 septembre 1968
Note sur l'enfant
Semble-t-il voir l'chec des utopies communautaires la position
de Lacan nous rappelle la dimension de ce qui suit.
La fonction de rsidu que soutient (et du mme coup maintient) la
famille conjugale dans l'volution des socits, met en valeur l'irr-
ductible d'une transmission - qui est d'un autre ordre que celle de la
vie selon les satisfactions des besoins - mais qui est d'une constitution
subjective, impliquant la relation un dsir qui ne soit pas anonyme.
C'est d'aprs une telle ncessit que se jugent les fonctions de la
mre et du pre. De la mre : en tant que ses soins portent la marque
d'un intrt particularis, le fut-il par la voie de ses propres manques.
Du pre : en tant que son nom est le vecteur d'une incarnation de la
Loi dans le dsir.
Dans la conception qu'en labore Jacques Lacan, le symptme de
l'enfant se trouve en place de rpondre ce qu'il y a de symptoma-
tique dans la structure familiale.
Le symptme, c'est l le fait fondamental de l'exprience analy-
tique, se dfinit dans ce contexte comme reprsentant de la vrit.
Le symptme peut reprsenter la vrit du couple familial. C'est
l le cas le plus complexe, mais aussi le plus ouvert nos interven-
tions.
L'articulation se rduit de beaucoup quand le symptme qui
vient dominer ressortit la subjectivit de la mre. Ici, c'est direc-
tement comme corrlatif d'un fantasme que l'enfant est intress.
La distance entre l'identification l'idal du moi et la part prise
du dsir de la mre, si elle n'a pas de mdiation (celle qu'assure
normalement la fonction du pre) laisse l'enfant ouvert toutes les
prises fantasmatiques. Q devient l' objet de la mre, et n'a plus de
fonction que de rvler la vrit de cet objet.
L'enfant ralise la prsence de ce que Jacques Lacan dsigne
comme l'objet a dans le fantasme.
373
NOTE SUR L'ENFANT
Il sature en se substituant cet objet le mode de manque o se
spcifie le dsir (de la mre), quelle qu'en soit la structure spciale :
nvrotique, perverse ou psychotique.
Il aline en lui tout accs possible de la mre sa propre vrit, en
lui donnant corps, existence, et mme exigence d'tre protg.
Le symptme somatique donne le maximum de garantie cette
mconnaissance ; il est la ressource intarissable selon les cas tmoi-
gner de la culpabilit, servir de ftiche, incarner un primordial
refus.
Bref, l'enfant dans le rapport duel la mre lui donne, immdia-
tement accessible, ce qui manque au sujet masculin : l'objet mme
de son existence, apparaissant dans le rel. Il en rsulte qu' mesure
de ce qu'il prsente de rel, il est offert un plus grand subor-
nement dans le fantasme.
Octobre 1969
L'acte psychanalytique
COMPTE RENDU DU SMINAIRE 1967-1968
L'acte psychanalytique, ni vu ni connu hors de nous, c'est--dire
jamais repr, mis en question bien moins encore, voil que nous le
supposons du moment lectif o le psychanalysant passe au psycha-
nalyste.
C'est l le recours au plus communment admis du ncessaire
ce passage, toute autre condition restant contingente auprs.
Isol ainsi de ce moment d'installation, l'acte est porte de
chaque entre dans une psychanalyse.
Disons d'abord : l'acte (tout court) a lieu d'un dire, et dont il
change le sujet. Ce n'est acte, de marcher qu' ce que a ne dise pas
seulement a marche , ou mme marchons , mais que a fasse
que j'y arrive se vrifie en lui.
L'acte psychanalytique semble propre se rverbrer de plus de
lumire sur l'acte, de ce. qu'il soit acte se reproduire du faire mme
qu'il commande.
Par l remet-il l'en-soi d'une consistance logique, de dcider si
le relais peut tre pris d'un acte tel qu'il destitue en sa fin le sujet
mme qui l'instaure.
Ds ce pas s'aperoit que c'est le sujet ici dont il faut dire s'il est
savoir.
Le psychanalysant, au terme de la tche lui assigne, sait-il
mieux que personne la destitution subjective o elle a rduit
celui-l mme qui la lui a commande ? Soit : cet n-soi de l'objet a
qui, ce terme, s'vacue du mme mouvement dont choit le psy-
chanalysant pour ce qu'il ait dans cet objet, vrifi la cause du dsir.
Il y a l savoir acquis, mais qui ?
A qui paie-t-il le prix de la vrit dont la limite le sujet trait
serait l'incurable ?
Est-ce de cette limite qu'un sujet se conoit qui s'ofire repro-
duire ce dont il a t dlivr ?
375
L'ACTE PSYCHANALYTIQUE
Et quand ceci mme le soumet se faire la production d'une
tche qu'il ne promet qu' supposer le leurre mme qui pour lui
n'est plus tenable ?
Car c'est partir de la structure de fiction dont s'nonce la vrit,
que de son tre mme il va faire toffe la production... d'un irrel.
La destitution subjective n'est pas moindre interdire cette passe
de ce qu'elle doive, comme la mer, tre toujours recommence.
On souponne pourtant que l'cart ici rvl de l'acte la dignit
de son propos, n'est prendre qu' nous instruire sur ce qui en fait
le scandale : soit la faille aperue du sujet suppos savoir.
Toute une endoctrination, psychanalytique de titre, peut ignorer
encore qu'elle nglige l le point dont toute stratgie vacille de
n'tre pas encore au jour de l'acte psychanalytique.
Qu'il y ait de l'inconscient veut dire qu'il y a du savoir sans sujet.
L'ide de l'instinct crase la dcouverte : mais elle survit de ce que
ce savoir ne s'avre jamais que d'tre lisible.
La ligne de la rsistance tient sur cet ouvrage aussi dmesurment
avanc que peut l'tre une phobie. C'est dire qu'il est dsespr de
faire entendre qu'on n'a rien entendu de l'inconscient, si l'on n'est
pas all plus loin.
C'est savoir que ce qu'il introduit de division dans le sujet de ce
qu'un savoir qui tient au reste, ne le dtermine pas, suppose, rien
qu' ce qu'on l'nonce ainsi, un Autre, qui, lui le sait d'avant qu'on
ne s'en soit aperu. On sait que mme Descartes se sert de cet Autre
pour garantir au moins la vrit de son dpart scientifique.
C'est l par quoi toutes les -logies philosophiques, onto-, tho-,
cosmo-, comme psycho-, contredisent l'inconscient. Mais comme
l'inconscient ne s'entend qu' tre cras d'une des notions les plus
btardes de la psychologie traditionnelle, on ne prend mme pas garde
que l'noncer rend impossible cette supposition de l'Autre. Mais
il suffit qu'elle ne soit pas dnonce, pour que l'inconscient soit
comme non avenu.
D'o l'on voit que les pires peuvent faire leur mot d'ordre du
retour la psychologie gnrale .
Pour dnouer ceci, il faut qu'une structure de l'Autre s'nonce
qui n'en permette pas le survol. D'o cette formule : qu'il n'y a
pas d'Autre de l'Autre, ou notre affirmation qu'il n'y a pas de mta-
langage.
376
L'ACTE PSYCHANALYTIQUE
Confirmons cette dernire du fait que ce qu'on appelle mta-
langage dans les mathmatiques n'est rien que le discours dont
un langage veut s'exclure, c'est--dire s'efibrce au rel. La logique
mathmatique n'est pas, comme on ne peut nous l'imputer que de
mauvaise foi, une occasion de rajeunir un sujet de notre cru. C'est
du dehors qu'elle atteste un Autre tel que sa structure, et justement
d'tre logique, ne va pas se recouvrir elle-mme : c'est (S (/i)) de
notre graphe.
Qu'un tel Autre s'explore, ne le destine rien savoir des effets
qu'il comporte sur le vivant qu'il vhicule en tant que sujet- ses
effets. Mais si le transfert apparat se motiver dj suffisamment de la
primarit signifiante du trait unaire, rien n'indique que l'objet a n'a
pas une consistance qui se soutienne de logique pure.
Il est ds lors avancer que le psychanalyste dans la psychanalyse
n'est pas sujet, et qu' situer son acte de la topologie idale de
l'objet <t, il se dduit que c'est ne pas penser qu'il opre.
Un je ne pense pas qui est le droit, suspend de fait le psychana-
lyste l'anxit de savoir o lui donner sa place pour penser pour-
tant la psychanalyse sans tre vou la manquer.
L'humilit de la limite o l'acte s'est prsent son exprience,
lui bouche de la rprobation dont il s'nonce qu'il est manqu, les
voies plus sres qu'elle recle pour parvenir ce savoir.
Aussi bien sommes-nous partis, pour lui rendre courage, du
tmoignage que la science peut donner de l'ignorance o elle est de
son sujet par l'exemple du dpart pavlovien, repris le faire illustrer
l'aphorisme de Lacan : qu'un signifiant est ce qui reprsente un sujet
pour un autre signifiant. O l'on voit que c'est d'en saisir la rampe
quand elle tait encore dans le noir, que l'exprimentateur s'est
fait espoir bon march d'avoir mis le chapeau dans le lapin. Cette
ingniosit de lapsus suffit pourtant rendre compte d'une assez
ample adquation des noncs pavloviens, o l'garement de qui ne
pense qu'aux berges o faire rentrer la crise psychanalytique, trouve
un bon alibi universitaire.
Est donc encore bien naf celui qui prend cho de tout cet apo-
logue pour rectifier que le sujet de la science n'est jamais o on le
pense, puisque c'est l prcisment notre ironie...
Il reste trouver appel l o l'affaire a lieu. Et ce ne peut tre que
dans la structure que le psychanalyste monte en symptme, quand
377
L'ACTE PSYCHANALYTIQUE
frapp soudain d'une Grce inverse, il vient lever une prire
idoltrique son coute , ftiche en son sein surgi d'une voie
hypocondriaque.
Il y a une aire de stigmates qu'impose l'habitation du champ, par
faute du sens repr de l'acte psychanalytique. Elle s'offre assez pni-
blement la pnombre des conciles o la collection qui s'en identi-
fie prend figure d'glise parodique.
Il n'est certes pas exclu que s'y articulent des aveux propres au
recueil. Telle cette forgerie qui se prononce du : the self, premire
peut-tre de cette surface sortir de la liste des morphmes que
rend tabous qu'ils soient de Freud.
C'est qu'elle a pris son poids, si ce n'est mme sa trouvaille,
du psychanalyste rencontrer pour vous imposer le respect de l'em-
preinte reue de la passion de la psychanalyse.
Nous avons fait vivre l'crit o il affile au clair du self, comme
rendu tangible et s'avrant d'tre un effet de compression, l'aveu que
sa passion n'a place et vertu qu' sortir des limites fort bien rappeles
comme tant celles de la technique. Elles le serviraient mieux
pourtant s'inscrire dans la charte de l'acte une fois remise cette
page qui ne saurait tre tourne que d'un geste changeant le sujet,
celui-l mme dont le psychanalyste se qualifie en acte.
Ce self'lanc sera pourtant - le thme prolifre, et dans le sens de
l'auspice dont il est n - la perte du psychanalyste, disqualifi par
lui. L'lment culte de sa profession est comme en autre cas, le signe
d'une ingalit l'acte.
Aussi bien l'acte lui-mme ne peut-il fonctionner comme prdi-
cat. Et pour l'imputer au sujet qu'il dtermine, convient-il de repo-
ser de nouveaux termes toute Yinventio medii : c'est quoi peut
s'prouver l'objet a.
Que peut-on dire de tout psychanalyste, sinon rendre vident
qu'il n'en est aussi bien aucun ?
Si d'autre part rien ne peut faire qu'il existe un psychanalyste,
sinon la logique dont l'acte s'articule d'un avant et d'un aprs, il est
clair que les prdicats prennent ici la dominance, moins qu'ils ne
soient lis par un effet de production.
Si le psychanalysant fait le psychanalyste, encore n'y a-t-il rien
d'ajout que la facture. Pour qu'elle soit redevable, il faut qu'on nous
assure qu'il a du psychanalyste.
378
L'ACTE PSYCHANALYTIQUE
Et c'est quoi rpond l'objet a.
Le psychanalyste se fait de l'objet a. Se fait, entendre : se fait
produire ; de l'objet a : avec de l'objet a.
Ces propos frlent trop l'endroit o paraissent achopper les quan-
tificateurs logiques, pour que nous n'ayons pas fleuret de leur
instrument. Nous sentons l'acte psychanalytique cder rompre la
prise dans l'universel quoi c'est leur mrite de ne pas satisfaire.
(Et voil qui va excuser Aristote d'osciller, plus gnialement
encore qu'il n'a su isoler l'imoxeiHEVOV, ne pouvoir faire que d'y
rcuprer l'oxria par l'intervalle.)
Car ce que cet acte aperoit, c'est le noyau qui fait le creux dont
se motive l'ide de tout, la serrer dans la logique des quantifica-
teurs.
Ds lors peut-tre permet-il de la mieux dnommer d'une dsa-
fication.
O le psychanalyste trouve compagnie de faire la mme opra-
tion. Est-ce au niveau du quartier libre offert cette fin au discours ?
Tel est bien en effet l'horizon que trace la technique, mais son
artifice repose sur la structure logique laquelle il est fait confiance
juste titre, car elle ne perd jamais ses droits. L'impossibilit prouve
du discours pulvrulent est le cheval le Troie par o rentre dans la
cit du discours le matre qu'y est le psychotique.
Mais l encore comme ne voit-on que le prlvement corporel
est dj fait dont est faire du psychanalyste, et que c'est quoi il
faut accorder l'acte psychanalytique.
Nous ne pouvions de l'acte dessiner l'abrupt logique qu' temp-
rer ce qu'il soulve de passion dans le champ qu'il commande,
mme s'il ne le fait qu' s'y soustraire. C'est sans doute faute d'ap-
porter ce temprament, que Winnicott s'est cru devoir d'y contri-
buer de son self lui. Mais aussi d'en recevoir cet objet transitionnel
des mains plus distantes de l'enfant, qu'il nous faut bien lui rendre
ici, puisque c'est partir de lui que nous avons d'abord formul
l'objet a.
Ramenons donc l'acte psychanalytique ce que laisse celui
qu'il allge ce qu'il a pour lui mis en route : c'est qu'il lui reste
dnonc que la jouissance, privilgie de commander le rapport
sexuel, s'offre d'un acte interdit, mais que c'est pour masquer que ce
rapport ne s'tablit que de n'tre pas vrifiable exiger le moyen
379
L'ACTE PSYCHANALYTIQUE
terme qui se distingue d'y manquer : ce qu'on appelle avoir fait de la
castration sujet.
Le bnfice en est clair pour le nvros puisque c'est l rsoudre
ce qu'il reprsentait comme passion.
Mais l'important est qu' quiconque il s'en livre que la jouissance
tenue perverse, est bel et bien permise par l, puisque le psycha-
nalyste s'en fait la clef, il est vrai pour la retirer aux fins de son op-
ration. Par quoi il n'y a qu' la lui reprendre pour lui rendre son
emploi vrai, qu'il en soit ou non fait usage.
Ce solde cynique doit bien marquer le secondaire du bnfice
passionnel. Que l'axiologie de la pratique psychanalytique s'avre
se rduire au sexuel, ceci ne contribue la subversion de l'thique
qui tient l'acte inaugural, qu' ce que le sexuel se montre de nga-
tivits de structure.
Plaisir, barrire la jouissance (mais non l'inverse). Ralit faite
du transfert (mais non l'inverse). Et principe de vanit, suprme, ce
que le verbe ne vaille qu'au regard de la mort (regard, souligner,
non mort, qui se drobe).
Dans l'thique qui s'inaugure de l'acte psychanalytique, moins
thiquette, qu'on nous pardonne, qu'il n'en fut jamais entrevu ce
qu'on soit parti de l'acte, la logique commande, c'est sr de ce qu'on
y retrouve ses paradoxes.
A moins, sr aussi, que des types, jdes normes s'y rajoutent comme
purs remdes.
L'acte psychanalytique, pour y maintenir sa chicane propre, ne
saurait y tremper.
Car de ses repres s'claire que la sublimation n'exclut pas
la vrit de jouissance, en quoi les hrosmes, mieux s'expliquer,
s'ordonnent d'tre plus ou moins avertis.
Aussi bien l'acte psychanalytique lui-mme est-il toujours la
merci de Yacting out dont nous avons assez dpeint plus haut sous
quelles figures il grimace. Et il importe de relever combien de nature
nous en prvenir est l'approche de Freud elle-mme, quand ce
n'est pas tellement du mythe qu'il l'a soutenue d'abord, mais du
recours la scne. dipe comme Agamemnon reprsentent des
mises en scne. On en voit aujourd'hui la porte ce que s'y cram-
ponne l'arriration qui a voulu faire signature de malencontre,
s'aventurer d'exgse sur l'objet a.
380
L'ACTE PSYCHANALYTIQUE
Car si l'acte moral s'ordonne de l'acte psychanalytique, c'est pour
recevoir son En-Je de ce que l'objet a coordonne d'une exprience
de savoir.
C'est de lui que prend substance l'insatiable exigence que Freud
articule, le premier, dans le Malaise de la civilisation. Nous relevons
d'un autre accent cet insatiable de ce qu'il trouve sa balance dans
l'acte psychanalytique.
Pourquoi ne pas porter l'actif de cet acte que nous en ayons
introduit le statut mme temps ?
Ni reculer, cet -temps, le profrer ds six mois, dont non
seulement thorique, mais effective au point d'tre, en notre cole,
d'effraction, sa proposition a devanc un dchanement qui d'acc-
der notre entour, nous fait oser le reconnatre pour tmoigner
d'un rendez-vous.
Suffira-t-il de remarquer qu'en l'acte psychanalytique l'objet a
n'est cens venir qu'en forme de production pour quoi le moyen,
d'tre requis par toute exploitation suppose, se supporte ici du
savoir dont l'aspect de proprit est proprement ce qui prcipite une
faille sociale prcise ?
Irons-nous interroger si c'est bien l'homme qu'un antiros
rduisait une seule dimension qui dans l'insurrection de mai se
distingue?
Par contre la mise la masse de l'En-Je par une prise dans le
savoir dont ce n'est pas la dmesure qui tant crase, que l'apurement
de sa logique qui du sujet fait pur clivage, voil o se conoit un
changement dans l'amarrage mme de l'angoisse dont il faut dire
que pour l'avoir doctrine de n'tre pas sans objet, nous avons l
aussi de justesse saisi ce qui dj passe au-del d'une crte.
Voil-t-il pas assez pour que l'acte exig dans le champ du savoir,
fasse rechute la passion du signifiant - qu'il y ait quelqu'un ou per-
sonne pour faire office de starter.
Pas de diffrence une fois le procs engag entre le sujet qui se
voue la subversion jusqu' produire l'incurable o l'acte trouve sa
fin propre, et ce qui du symptme prend effet rvolutionnaire, seule-
ment de ne plus marcher la baguette dite marxiste.
Ce qu'on a cru pingler ici de la vertu d'une prise de parole, n'est
qu'anticipation suspecte du rendez-vous qu'il y a bien, mais o la
parole n'advient que de ce que l'acte tait l. Entendons : tait l un
381
L'ACTE PSYCHANALYTIQUE
peu plus, ne ft-elle pas arrive, tait l l'instant qu'elle arrivait
enfin.
C'est bien en quoi nous nous tenons pour nous, n'avoir pas man-
qu la place que nous confre en ce dduit le drame des psychana-
lystes d'aujourd'hui, et pour devoir reconnatre que nous en savons
un peu plus que ceux qui ridiculement n'ont pas rat cette occasion
de s'y montrer en acteurs.
Nous la trouvons bien l de toujours cette avance dont c'est
assez qu'elle existe pour qu'elle ne soit pas mince, quand nous nous
souvenons de l'apprciation, faite par tel, que dans le cas d'o reste
provenir tout ce que nous savons de la nvrose obsessionnelle, Freud
avait t fait comme un rat . C'est l en effet ce qu'il suffisait de
savoir lire de l'Homme aux rats, pour qu'on se soutnt au regard de
l'acte psychanalytique.
Mais qui entendra, mme parmi ceux-l qui sortant de notre
mditation de cet acte, ce qui pourtant s'indique en clair dans ces
lignes mmes, d'o demain viendra tre relay le psychanalyste,
comme aussi bien ce qui dans l'histoire en tnt lieu ?
Nous sommes pas peu fier, qu'on la sache, de ce pouvoir d'illec-
ture que nous avons su maintenir inentam dans nos textes pour
parer, ici par exemple, ce que l'historialisation d'une situation offre
d'ouverture, bnie, ceux qui n'ont de hte qu' l'histrioniser pour
leurs aises.
Donner trop comprendre est faire issue l'vitement, et c'est
s'en faire le complice que de la mme livraison qui remet chacun
sa droute, fournir un supplment d'Ailleurs pour qu'il s'empresse
de s'y retrouver.
Nous fussions-nous si bien gard approcher ce qui s'impose
d'avoir situ l'acte psychanalytique : d'tablir ce qui, lui-mme, le
dtermine de la jouissance et les faons du mme coup dont il lui
faut s'en prserver? On en jugera par les miettes qui en sont retom-
bes sur l'anne suivante.
L encore nous ne trouvons pas d'augure nul que la coupure se
soit faite pour nous en dispenser.
Que l'intrt reste en de, pour ne pas manquer ce qui proli-
fre d'ignorer simplement un lemme comme celui-ci, par nous
lgu, du passage : l'acte, de ce sminaire, qu' il n'y a pas de trans-
fert du transfert . C'est bien pourtant quoi se bute sans la moindre
382
L'ACTE PSYCHANALYTIQUE
ide de ce qu'il articule, le rapport d'un prochain congrs (cf. The
Non-Transference Relationship , in IJP> 1969, part. I, vol. 50).
Si n'tait pas irrmdiable de s'tre employ dans le commerce
du vrai sur le vrai (troisime de manque), ce Congrs de Rome et
pu recueillir un peu plus de ce qui, une fois, de la fonction comme
du champ que dtermine le langage, s'y est profr en acte.
Communiqu le 10 juin 1969
VII
Prface l'dition des crits
en livre de poche
A quelqu'un,
grce qui ceci est plutt signe...
Un signifiant qui donne prise sur la Reine, que soumet-il qui
s'en empare ? Si la dominer d'une menace vaut le vol de la lettre
que Poe nous prsente en exploit, c'est dire que c'est son pouvoir
qu'il est pass la bride. A quoi enfin? A la Fminit en tant qu'elle
est toute-puissante, mais seulement d'tre la merci de ce qu'on
appelle, ici pas pour des prunes, le Roi.
Par cette chane apparat qu'il n'y a de matre que le signifiant.
Atout matre : on a bti les jeux de cartes sur ce fait du discours.
Sans doute, pour jouer l'atout, faut-il qu'on ait la main. Mais cette
main n'est pas matresse. Il n'y-a pas trente-six faons djouer une
partie, mme s'il n'y en a pas seulement une. C'est la partie qui
commande, ds que la distribution est faite selon la rgle qui la sous-
trait au moment de pouvoir de la main.
Ce que le conte de Poe dmontre par mes soins, c'est que l'effet
de sujtion du signifiant, de la lettre vole en l'occasion, porte avant
tout sur son dtenteur d'aprs-vol, et qu' mesure de son parcours,
ce qu'il vhicule, c'est cette Fminit mme qu'il aurait prise en son
ombre.
Serait-ce la lettre qui fait la Femme tre ce sujet, la fois tout-
puissant et serf, pour que toute main qui la Femme laisse la lettre,
reprenne avec, ce dont la recevoir, elle-mme a fait lais ? Lais
veut dire ce que la Femme lgue de ne l'avoir jamais eu : d'o la
vrit sort du puits, mais jamais qu' mi-corps.
Voici pourquoi le Ministre vient tre chtr, chtr, c'est le mot
de ce qu'il croit toujours l'avoir : cette lettre que Dupin a su reprer
de son vidence entre les jambes de sa chemine de haute lisse.
Ici ne fait que s'achever ce qui d'abord le fminise comme d'un
387
PRFACE L'DITION DES CRITS EN LIVRE DE POCHE
rve, et j'ajoute (p.41) que le chant dont ce Lecoq voudrait, en le
poulet qu'il lui destine, faire son rveil ( un dessein si funeste... ), il
n'a aucune chance de l'entendre il supportera tout de la Reine, ds
lors qu'elle va le dfier.
Car la Reine redevenue gaie, voire maligne, ne fera pas pice sa
puissance de ce qu'elle l'ait, sans qu'il le sache, dsarme, - en tout
cas pas auprs du Roi dont on sait, par l'existence de la lettre, et c'est
mme tout ce qu'on en sait, que sa puissance est celle du Mort que
chaque tour du jeu amincit.
Le pouvoir du Ministre s'affermit d'tre la mesure du maso-
chisme qui le guette.
En quoi notre Dupin se montre gal en son succs celui du psy-
chanalyste, dont l'acte, ce n'est que d'une maladresse inattendue de
l'autre qu'il peut venir porter. D'ordinaire, son message est la seule
chute effective de son traitement : autant que celui de Dupin, devant
rester irrvl, bien qu'avec lui l'affaire soit close.
Mais expliquerais-je, comme on en fera l'preuve du texte qui ici
garde le poste d'entre qu'il a ailleurs, ces termes toujours plus,
moins ils seront entendus.
Moins entendus des psychanalystes, de ce qu'ils soient pour eux
aussi en vue que la lettre vole, qu'ils la voient mme en eux, mais
qu' partir de l ils s'en croient, comme Dupin, les matres.
Ils ne sont matres en fait que d'user de mes termes tort et
travers. Ce quoi plusieurs se sont ridiculiss. Ce sont les mmes
qui m'affirment que ce dont les autres se mfient, c'est d'une
rigueur laquelle ils se sentiraient ingaux.
Mais ce n'est pas ma rigueur qui inhibe ces derniers, puisque ses
piges n'ont d'exemple que de ceux qui m'en font avis.
Que l'opinion qui reste Reine, m'en sache gr, n'aurait de sens
que de lui valoir ce livre de poche, uademecum qu'on l'appelait dans
l'ancien temps, et rien de neuf, si je n'en profitais pour situer ce
qu'elle m'apporte de mes Ecrits comme bruit.
Je dois me persuader qu'ils ne soient pierre dans l'eau qu' ce
qu'elle en fut dj l'onde, et mme l'onde de retour.
Ceci m'est rendu tangible de ce que ceux ici choisis, me sem-
blent paves tombes au fond. Pourquoi m'en tonnerais-je ? quand
ces crits, ce n'est pas seulement recueillis qu'ils furent en mmoire
de rebuts, mais composs qu'ils ont t ce titre.
388
PRFACE L'DITION DES CRITS EN LIVRE DE POCHE
Rptant dans leur sort de sonde, celui de la psychanalyse en tant
qu'esquif gob d'emble par cette mer.
Drle de radoub que de montrer qu'il ne nage bien qu' atterrir.
Car c'est un fait d'histoire : mettez son banc une chiourme
prouve d'ahaner la voix, et la psychanalyse s'choue, - au soula-
gement des gens du bord. Jamais aucun progressisme n'a fait mieux,
ni d'une faon si sre rassurer, ce qu'il faut faire tout de suite.
Bref on lira mon discours dit de Rome en 1953, sans que puisse
plus compter que j'aie t strictement empch, depuis le terme mis
en France aux plaisirs d'une Occupation dont la nostalgie devait
encore la hanter vingt ans par la plume si juste en son exquisit de
Sartre, strictement barr, cQs-je, de toute charge, si mince fut-elle,
d'enseignement. L'opposition m'en tant notifie comme provenant
d'un Monsieur Piron dont je n'eus au reste aucun signe direct
moi, au titre de mon incomprhensibilit.
On voit que je l'tais de principe, car je n'avais eu l'occasion de la
dmontrer qu'aux plus banaux de ses entours, et ce que j'avais crit
alors, n'tait nullement abstrus (si peu que je rougirais de republier
ma thse, mme si elle ne relve pas de ce que l'ignorance alors
enseignante tenait pour le bon sens en l'illustrant de Bergson).
Je voudrais qu'on me crdite de ce *jue ce retard qui me fut
impos, de huit ans, me force pousser, tout au long de ce rapport,
d'neries, soyons exact : de paulhaneries, que je ne puis que hihaner
pour les oreilles qui m'entendent. Mme le cher Paulhan ne m'en a
point tenu rigueur, lui qui savait jusqu'o Kant avec Sade dton-
nerait dans son bestiaire
1
(cet crit est ici absent).
Le mnage n'est jamais bien fait que par qui pourrait faire mieux.
Le tcheron est donc impropre la tache, mme si la tche rduit
quiconque faire le tcheron. J'appelle tche ranger ce qui trane.
noncer que l'inconscient s'est rencontr d'abord dans le
discours, que c'est toujours l qu'on le trouve dans la psychanalyse,
ce peut ncessiter qu'on l'articule avec appui, s'il en faut le prlimi-
naire : avant qu'il vienne comme second temps que le discours lui-
mme mrite qu'on s'arrte aux structures qui lui sont propres, ds
que l'on songe que cet effet ne semble pas y aller de soi.
i. La NRF
t
un n fut-il redoubl dans son sigle.
389
PRFACE L'DITION DES CRITS EN LIVRE DE POCHE
C'est une ide qui se prcise de relever ces structures mmes,
et ce n'est nullement s'en remettre aux lois de la linguistique que de
les prier de nous dire si elles s'en sentent dranges.
On doit s'habituer aux maniements des schmes, scientifiquement
repris d'une thique (la stocienne en l'occasion), du signifiant et
du Xeictv. Et aussitt on s'aperoit que ce Xexxv ne se traduit pas
bien. On le met en rserve, et on joue un temps du signifi, plus
accessible et plus douillet ceux qui s'y retrouvent, dans l'illusion
qu'ils pensent quoi que ce soit qui vaille plus que tripette.
Le long de la route, on s'aperoit, avec retard heureusement, c'est
mieux de ne pas s'y arrter, que s'lvent des protestations. Le rve
ne pense pas... , crit un professeur fort pertinent dans toutes les
preuves qu'il en donne. Le rve est plutt comme une inscription
chiffonne. Mais quand ai-je dit quoi que ce soit qui y objecte ?
Mme si au chiffonn, je n'ai, selon ma mthode de commentaire
qui s'astreint s'en tenir aux documents, fait sort qu'au niveau de la
girafe que le petit Hans en qualifie.
Outre que cet auteur ne saurait mme avancer les faits dont
il argue qu' tenir pour tabli ce que j'articule du rve, soit qu'il
requiert un support textuel, ce que j'appelle proprement l'instance
de la lettre avant toute grammatologie, o peut-il prendre que j'aie
dit que le rve pense? Question que je pose sans m'tre relu.
Par contre il dcouvre que ce que j'inscris comme effet du signi-
fiant, ne rpond nullement au signifi que cerne la linguistique, mais
bel et bien au sujet.
J'applaudis cette trouvaille d'autant plus qu' la date o parais-
sent ses remarques, il y a beau temps que je martle qui veut l'en-
tendre, que le signifiant (et c'est en quoi je le distingue du signe) est
ce qui reprsente un sujet pour un autre signifiant.
Je dis qui veut l'entendre, car une telle articulation suppose un
discours ayant dj port des effets, effets de Xeicrv prcisment.
Car c'est d'une pratique de l'enseignement o se dmontre que l'in-
sistance de ce qui est nonc, n'est pas tenir pour seconde dans
l'essence du discours, - que prend corps, quoique je l'aie point de
ce ressort ds sa premire sortie, mon terme du : point de capiton.
Par quoi Xeicrv se trouve traduit mon gr, sans que je m'en
targue, tant plutt que stocologue, stoque d'avance l'endroit de
ce qui pourra s'en redire.
390
PRFACE L'DITION DES CRITS EN LIVRE DE POCHE
Ce n'est pas pour autant aller aussi loin que je pourrais dans ce
que m'apporte ma parution en livre de poche. Elle tient pour moi
d'un innarrable que seul mesurera un jour un bilan statistique d'un
matriel de syntagmes auxquels j'ai donn cours.
J'ai fourni de meilleurs embotages tout un march de la culture.
Mea culpa.
Il n'y a pas de mtalangage. Cette affirmation est possible de ce
que j'en aie ajout un la liste de ceux qui courent les champs de la
science. Elle sera justifie, s'il produit l'effet dont s'assurera que l'in-
conscient EST un discours.
Ce serait que le psychanalyste vienne en tre le XeKtov, mais
pas dmoli pour autant.
Que le lecteur du livre de poche se laisse prendre au jeu que j'ai
clbr moi tout seul, Vienne d'abord, puis Paris, en l'honneur
de la Chose freudienne pour le centenaire de Freud. S'il s'anime de la
rigolade pince, dont l'a accueilli mon auditoire d'alors, il saura qu'il
est dj de mes intimes et qu'il peut venir mon Ecole, pour y faire
le mnage.
... de quelque chose lire de ce
14. XII. 69.
Prface une thse
PRFACE JACQUES LACAN , OUVRAGE
D'ANIKA RIFFLET-LEMAIRE PARU BRUXELLES
EN I97O
A deux de ces personnes qu'on appelle des nullits, ce qui dans
l'opinion, tudiante tout au moins, ne fait que mieux valoir leur titre
occuper la place de professeur, je disais, il y a bien quelque treize
ans : N'oubliez pas qu'un jour vous donnerez comme sujet de
thse ce que j'cris pour l'instant
1
.
Comme d'un vu qu'elles s'en informassent : o je contrlerais si
le zro a bien l'ide de la place qui lui donne son importance.
C'est donc arriv. Il n'est rien arriv eux, moi seulement : me
voici sujet de thse par mes crits.
Que ce soit d au choix d'une personne jeune n'est pas nouveau.
Mon discours de Rome, dix ans aprs sa parution, fit l'aventure d'un
intellectuel mergeant dans une universit amricaine d'un tunnel
de trappeur, ma surprise.
On sait qu'il faut une deuxime hirondelle pour faire le prin-
temps. Unique donc en cette place, mme s'il y en a plusieurs. Un
sourire se multiplie quand c'est celui d'une jeune personne.
Anthony, Anika, une Antonella qui me traduit en italien : en ces
initiales, quel signe insiste d'un vent nouveau ?
Qu'icelle donc me pardonne dont je profite pour dsigner ce
qu'elle efface le montrer
2
.
Mes crits sont impropres la thse, universitaire spcialement :
antithtiques de nature, puisqu' ce qu'ils formulent, il n'y a qu' se
prendre ou bien les laisser.
Chacun n'est d'apparence que le mmorial d'un refus de mon
discours par l'audience qu'il incluait : strictement les psychanalystes.
1. Note de Fauteur : il ne s'agit pas, ici, de S. Leclaire et de J. Laplanche, dont il
sera question plus loin.
2. Qu'ici l'on m'entende : le montrer comme il convient.
393
PRFACE UNE THSE
Mais justement les incluant sans les retenir, chacun dmontre d'un
biais de plus qu'il n'est pas de savoir sans discours.
Car ce qu'il serait ce savoir : soit l'inconscient qu'on imagine, est
rfut de l'inconscient tel qu'il est : un savoir mis en position de
vrit, ce qui ne se conoit que d'une structure de discours.
Impensable discours de ne pouvoir tre tenu qu' ce qu'on en
soit ject. Parfaitement enseignable pourtant partir d'un mi-dire :
soit la technique qui tient compte de ce que la vrit ne se dit
jamais qu' moiti. Ceci suppose que le psychanalyste ne se mani-
feste jamais que d'un discours asymptomatique, ce qui est bien en
effet le moins qu'on en attende.
A la vrit cet impossible est le fondement de son rel. D'un rel
d'o se juge la consistance des discours o la vrit boite, et jus-
tement de ce qu'elle boite ouvertement, l'inanit par contre du
discours du savoir, quand s'affirmant de sa clture, il fait mentir les
autres.
C'est bien l l'opration du discours universitaire quand il fait
thse de cette fiction qu'il appelle un auteur, ou de l'histoire de la
pense, ou bien encore de quelque chose qui s'intitule d'un progrs.
Illustrer d'un exemple une incompatibilit comme celle dont il
s'agit, est toujours fallacieux.
Il est clair qu'elle touche ce qu'il en est de l'lve.
Je pourrais faire tat d'un contraste et dire qu'en 1960 mes
deux L ne battaient que d'une, de ce que l'une d'ailes fut de ceux
qu'on ne prend pas sans univers. J'entends l ce lichen qui vous uni-
fie la fort, quand il faut qu'elle vous cache l'arbre.
Il ne s'agit cette date de rien de moins que de faire entendre
mon enseignement, lequel s'nonce du lieu le plus minent de la
psychiatrie franaise, tous les huit jours alors depuis sept ans, en une
leon indite, pour ses destinataires exprs, psychiatres et psychana-
lystes, qui pourtant le laissent en marge.
Ce phnomne singulier est le fait de sgrgations, l comme
ailleurs effets de discours, mais qui, pour interfrer dans le champ
concret, y statuent de promulgations diffrentes d'origine et de
date.
Sgrgation d'abord de la psychiatrie dans la Facult de mde-
cine, o la structure universitaire panouit son affinit au rgime
patronal. Cette sgrgation se soutient de ce que la psychiatrie fait
394
PRFACE UNE THSE
elle-mme office de sgrgation sociale. Le rsultat est que la psy-
chiatrie dsigne une chambre d'ami au titre des fonds libraux de
l'Universit, les ayants droit de ce logis tant refouls dans le ghetto,
dit autrefois non sans justesse : asilaire.
Un tel lieu prte aux exploits de civilisation, o s'tablit le fait du
prince (en l'occasion notre ami Henri Ey).
Il peut y survenir un diktat libral, comme partout o l'arbitraire
s'offre de faille entre domaines ncessits.
C'est donc de nulle autre faveur, de nul progrs dialectique, que
procde ce qui m'arrive par Bonneval, fief d'Henri Ey, dans mon
champ.
Le champ du psychanalyste, si l'on y songe, c'est beaucoup plus
de configuration politique que de connexion praticienne que se
motive l'habitat qu'il a trouv dans la psychiatrie. Il y fut command
par son antipathie du discours universitaire, antipathie qui, pour
n'avoir reu que de mon enseignement sa raison, n'en a pas moins
d'efficacit quand, symptme, elle se traduit d'institutions qui vhi-
culent des bnfices secondaires.
Pour l'articulation sgrgative de l'institution psychanalytique, il
suffira de rappeler que le privilge d'y entrer aprs-guerre se mesu-
rait ce que tous les analystes d'Europe centrale se fussent, les annes
d'avant, rescaps dans les pays atlantiques, - de l la fourne,
contenir peut-tre d'un numerus clausus, qui s'annonait d'une inva-
sion russe prvoir.
La suite est squelle maintenue par la domination tablie du dis-
cours universitaire aux URSS et de son antipathie
l
du discours sec-
taire, par contre aux USA florissant d'y tre fondateur.
Le jeu symptomatique explique ce prodige qu'une certaine Ip-
pe pt interdire avec effet aux moins de cinquante ans de son ob-
dience, l'accs mon sminaire, et voir ce dcret confirm par le
troupeau tudiant jusqu'en la salle de garde situe quatre cents
pas de la clinique universitaire (cf. la chambre d'ami) o je parlais
l'heure du djeuner.
Que la mode prsente ne se croie pas moins grgaire ; elle n'est
que forme mtabolique du pouvoir croissant de l'Universit, qui
i. Le refus de la sgrgation est naturellement au principe du camp de concen-
tration.
395
PRFACE UNE THSE
aussi bien m'abrite sur ses parvis. Le discours de l'Universit est
dsgrgatif, mme s'il vhicule le discours du matre, puisqu'il ne le
relaye qu' le librer de sa vrit. La Science lui parat garantir le
succs de ce projet. Insoluble.
Que nul pourtant ne sous-estime l'autonomie de ce discours au
nom de sa dpendance budgtaire. Ce n'est l rgler son compte
personne. Ce qui y est dchir ne peut tre surpris qu' partir d'un
autre discours d'o se rvlent ses coutures.
Il est plus accessible de dmontrer l'incapacit du discours univer-
sitaire retourner ce discours dont il se voit rapetass, un procd
quivalent.
Les deux cheminements se confondent quand il arrive qu'en
son sein quelque chose se fasse sentir du discours qu'il refoule,
et d'autant plus certainement qu'il n'est nulle part assur. Ce fut
l'preuve un jour d'un Politzer qui ajoutait son marxisme d'tre
une me sensible.
A rouvrir le livre de poche o reparat, contre toute vraisem-
blance du consentement de son auteur, cette critique des fonde-
ments de la psychologie , on n'imagine pas les formules, dont il
interroge si les penses abandonnes elles-mmes sont encore les
actes du "je" . D'o il rpond du mme jet : C'est impossible
(p. 143 de l'ustensile).
Et p. 151 : Les dsirs inconscients... la conscience les peroit,
mais aucun moment une activit en premire personne, un acte
ayant forme humaine (italiques de l'auteur) et impliquant le "je" n'in-
tervient. Mais il reste que ce dsir est soumis des transformations
qui ne sont plus des actes du "je"... Les systmes trop autonomes
rompent la continuit du "je" et l'automatisme des processus de
transformation et d'laboration exclut son activit.
Voici o en revient la prtendue critique, l'exigence des postu-
lats tenus pour les plus arrirs mme l o ils ne persistent, savoir
dans la psychologie universitaire, qu' rester la fonder quoi qu'elle
veuille.
Ce n'est pas d'un recours l'auteur, dont procderait le discours
universitaire, que j'expliquerai comment, promouvant justement le
rcit comme cela mme dont se cerne l'exprience analytique,
il en ressort, fantme, pour n'y avoir jamais regard.
C'est dans le nominalisme essentiel l'Universit moderne, soit
396
PRFACE UNE THSE
celle dont s'enfume le capitalisme, que je ferai lire l'chec scanda-
leux de cette critique. L est le discours o l'on ne peut que se
prendre toujours plus, mme et surtout le maudire. (Opration
combien risible aprs coup.)
Mes L s'en tirent d'un coup d'ventail dont ils chassent cette
premire personne de l'inconscient. Eux savent bien comment
cet inconscient, je l'entu-ile, leur gr. C'est en personne , nous
disent-ils, qu'il vaut mieux l'engoncer.
Ils auraient pu se souvenir pourtant que je fais dire la vrit Je
parle , et que si j'nonce qu'aucun discours n'est mis de quelque
part qu' y tre retour du message sous une forme inverse, ce n'est
pas pour dire que la vrit qu'ainsi un Autre rverbre, soit Tue et
Toit avec Lui.
A Politzer, j'eusse propos l'image du Je innombrable, dfini du
seul rapport l'unit qu'est la rcurrence. Qui sait? Je l'eusse remis
au transfini.
Mais l'important n'est pas de ces gaudrioles. C'est qu'il devait tre
frappant pour mes deux L que je m'tais dispens, et pour cause on
le voit, d'une rfrence qu'ils ne relvent donc qu' vouloir en faire
rvrence aux seules penonnes que cela touche, celles qui n'ont rien
faire avec la psychanalyse.
Marxisme du CNRS ou phnomnologie des formes, l'hostilit,
d'espce, ou l'amiti, de conjoncture, qui de ces positions s'attestent
au seul discours en question, en reoivent l'efficience pour quoi ils
sont appels l : neutraliss, ils deviendront neutralisants.
Pour ceux qu'un discours, d'eux inou de ce que depuis sept ans
ils fassent sur lui le silence, guind de l'attitude dite du parapluie
aval, l'ide pointe qu'ils n'ont rien d'autre restituer que le para-
pluie philosophique dont grand bien fasse aux autres.
Aprs tout, s'il est exportable, c'est occasion faire rserve de
devises qui aient cours chez Y Aima Mater.
On le voit bien quand le rapport sur l'inconscient se place au
march parallle, fort justement frontonn des Temps modernes.
Le march commun professionnel affine sa sensibilit.
Que va devenir l'inconscient l-dedans ?
Qu'on se limite ce qui l'articule de l'appareil du signifiant, a
valeur de propdeutique. On pourrait dire que je n'ai pas fait autre
chose prsenter Signorelli (comme l'entre de l'oubli dans le
397
PRFACE UNE THSE
discours!) la Socit de philosophie. Mais c'tait l pour un
contexte : le prjug substantialiste dont ne pouvait manquer d'y
tre affect l'inconscient, relevait d'une intimidation produire par
l'crasant de sa matire de langage, voire d'un dsarroi soutenir
d'en laisser le suspens.
Ici il s'agit de gens (du moins si l'on tient s'adresser, sans com-
poser de tiers, aux interlocuteurs valables), de gens dis-je, dont le
mythe est crdit d'une pratique. Le fabuleux, comme en toute foi,
s'y arme du solide. a jute le moi fort de toutes parts, et l'agressivit
ponger ; passons sur le suprme du gnital, qui est vraiment de
grande cuisine.
Se limiter ce que j'ai fix d'algorithme propre crire le rapport
de la mtaphore comme structure signifiante avec le retour (dmon-
tr fait de signifiant) du refoul, ne prend valeur que d'extrait d'une
construction dont l'pure au moins pourrait tre indique.
Le lecteur d'aujourd'hui, disons le jeune, son terrain mental a t
balay par des effets de convergence du discours o j'ai contribu,
non sans que la question de la distance exige pour les effets maxi-
maux ne m'ait interloqu avant que j'y mdite. Il ne peut plus avoir
ide de l'inaudible, il y a si peu d'ans, d'un propos, le mien, qui
maintenant court partout. Peut-tre encore chez les mdecins pas
encore balints, mesurera-t-il quel point c'est vivable d'ignorer
compltement l'inconscient, ce qui maintenant pour lui (pour lui,
immense, grce moi, pauvre) veut dire : ignorer l'inconscient, c'est-
-dire le discours.
Je vois bien l'embarras de mes deux L aborder ce convent. Je ne
crois pas que ce soit l ce qui suffise les faire d'une libre dcision
carter tout recours au graphe qui a t construit pour eux de mon
sminaire sur les formations de l'inconscient (1957-1958).
Cet appareil dont se figure... (Dieu sait que c'est un risque), o se
figure l'apparole (qu'on accueille, de ce monstre-mot, l'quivoque),
l'apparole, dis-je, qui se fait de l'Autre (dit Grand Autre), panier
perc, pour accrocher de quatre coins le basket du dsir, que l'a,
balle-objet, va raidir en fantasme, cet appareil rigoureux, on s'tonne
qu' le sortir, on n'ait pas rendu secondaires, ou bien tenu pour rso-
lus les chipotages sur la double inscription, puisqu'ils le sont par
Freud lui-mme, "d'avoir promu, je dirai de mon style pressenti, le
mysticpad.
398
PRFACE UNE THSE
Certes les difficults de travail qui sont pour beaucoup dans l'in-
dication de la psychanalyse, ne sont pas pour rien ravives dans la
passe qui fait l'analyste. C'est qu'elles concernent essentiellement le
rapport la vrit.
(Ce dernier mot n'est pas facile manier, mais ce peut tre de ce
que son sens vacille, que son emploi soit correctement rgl.)
Je ne serais pas moi-mme pris dans le discours analytique si
j'ludais ici l'occasion de dmontrer juste ce qu'emporte le discours
universitaire.
Partons de l'tonnement.
Admettons qu'il soit correct d'user, brute, de la formule de la
mtaphore, telle que je la donne dans mon crit sur Schreber (p.557
des crits), savoir :
S - -^s (h
y
#
x * Vs '
Cette scription est l, comme la suite le montre, pour en faire surgir
la fonction du signifiant Phallus, comme signe de la passion du signi-
fiant . C'est ce que le x, dsigner habituellement la variable, indique.
La formule originelle, originale aussi, donne dans L'instance de
la lettre (p.515) est:
f ( | ) S = S(+)s.
qui se commente du texte entier de cet crit et ne se prterait, elle,
pas, ce qui devrait retenir notre L, la transcription qu'on va voir.
Il s'agit de celle qu'on opre partir de... l'analogie d'une scrip-
tion de la proposition arithmtique qu'il faut dnuder de la mettre
en chifire : 1/4 4/16, ce qui fait en eflfet 1 (1/16) (encore est-ce un
hasard).
Mais que cet 1/16 puisse s'crire (pas par hasard) :
J_
16
J_
4
399
PRFACE UNE THSE
quelle raison y voir de transcrire la formule (I), aux accents prs des
lettres, en :
il
s
s
Pour tout dire, qu'a faire la barre dont Saussure inscrit l'infran-
chissable relatif du signifiant au signifi, dont on m'impute (fausse-
ment) d'y retrouver la barrire de l'inconscient au prconscient, avec
la barre, quelle qu'elle soit, dont s'indique la proportion euclidienne ?
Un peu du tintement du dialogue que j'avais eu, cette mme
anne en juin, avec M. Perelman pour rfuter sa conception analo-
gique de la mtaphore (cf. p.889-892 de mes crits), aurait suffi
arrter sur cette pente celui qu'elle fascine.
Elle le fascine, mais comment? Quel est le terme dont les trois
points de suspension qui plus haut prcdent le mot analogie, mon-
trent que je ne sais quel saint le vouer? Quel est le mot dsigner
la similarit dont se dirige la manipulation d'un boulier par un
idiot?
Il n'y a pas l barguigner. C'est bien de mon discours que l'au-
teur s'autorise pour le reprendre sa faon, et qui n'est pas la bonne,
pour rester celle dont l'universitaire m'coute et qui est instructive.
Je dois le dire : j'ai mis navement, d'un moment difficile o je
dsesprais du psychanalyste, quelque espoir non dans le discours uni-
versitaire que je n'avais encore pas moyen de cerner, mais dans une
sorte d' opinion vraie que je supposais son corps (Hnaurme ! et
dit qui l'on sait).
J'ai vu quelques membres de ce corps attirs par ma pture. J'en
attendais le suffrage. Mais eux, c'tait de la copie qu'ils en faisaient.
Aussi qu'advient-il de mon L, une petite L de poussin encore ?
La voici se faire envergure d'imaginer cette formule : l'inconscient
est la condition du langage.
a, c'est d'aile : un de mes fidles m'assure qu'alors il s'exprima
de ces phonmes.
Or ce que je dis, c'est que le langage est la condition de l'inconscient.
Ce n'est pas pareil, c'est mme exactement le contraire. Mais de
ce fait on ne peut dire que ce soit sans rapport.
400
PRFACE UNE THSE
Aile aurait battu dire que l'inconscient tait l'implication logique
du langage : pas d'inconscient en effet sans langage. C'aurait pu tre
un frayage vers la racine de l'implication et de la logique elle-mme.
Aile et remont au sujet que suppose mon savoir.
De ce fait, peut-tre, qui sait? Aile m'et devanc dans ce quoi
j'arrive.
O et mme pu la porter son S/S infrieur, qui, tel qu'aile, ne
peut rien vouloir dire d'autre sinon qu'un signifiant en vaut un
autre, ce partir du moment o, aile en tait avertie, elle admet
qu'un signifiant est capable de se signifier lui-mme.
Car savoir la diffrence qu'il y a de l'usage formel du signifiant,
not S, sa fonction naturelle, note S, il et apprhend le dtour
mme dont se fonde la logique dite mathmatique.
Mais comme on ne peut pas tout redcouvrir par soi-mme, c'est
bien la paresse, l'insondable des pchs dont s'difie la Tour du
Capital, qu'il faut rapporter le dfaut de son information.
A y suppler, qu'aile se demande ce qui s'offre l o j'en suis
comme question : c'est savoir quelle satisfaction se rencontre
presser le S, signifiant naturel, d'prouver ce qu'une formalisation
toujours plus avance de sa pratique permet d'y dceler d'irrduc-
tible comme langage ?
Serait-ce l que fait nud ce qui fait le savoir ne pas se dtacher
de la jouissance, mais nanmoins n'tre jamais que celle de l'Autre ?
Ah ! pourquoi s'attarde-t-aile ce que Freud jamais a dsign
du narcissisme de la petite diffrence.
Petite, cela suffit ce qu'elle diffre de l'intervalle qui spare la
vrit de l'erreur.
Ce dont Freud ne semble pas avoir su qu'il pouvait rendre grce,
c'est de lui devoir, ce narcissisme, d'tre Freud jamais, c'est--dire
sa vie durant, et au-del pour tout un cercle, de ne pouvoir manquer
d'tre cit comme, en ce qu'il dit, indpassable.
C'est qu'il a le bonheur de n'avoir pas ses trousses la meute uni-
versitaire.
Seulement ce qu'il appelait sa bande lui.
a permet la mienne de simplement vrifier son discours.
Mais avec moi, elle est bien drle. Quand partir de la structure
du langage, je formule la mtaphore de faon rendre compte de ce
qu'il appelle condensation dans l'inconscient, la mtonymie pour de
401
PRFACE UNE THSE
mme en motiver le dplacement, Ton s'y indigne que je ne cite pas
Jakobson (dont d'ailleurs dans ma bande on ne souponnerait pas...
le nom si je ne l'avais prononc).
Mais quand on s'aperoit, le lire enfin, que la formule dont j'ar-
ticule la mtonymie diffre assez de celle de Jakobson, pour que le
dplacement freudien, lui le fasse dpendre de la mtaphore, alors
on me le reproche comme si je la lui avais attribue.
Bref, on s'amuse.
Quand il me faut rendre compte aprs des annes de sommeil (de
sommeil des autres) de ce que j'ai dit la cohue de Bonneval (renatre
arbre et sur mes bras, tous les oiseaux, tous les oiseaux... comment
survivre leur jacassement ternel?), je ne peux faire en un crit
( Position de l'inconscient ) que de rappeler que l'objet a est le
pivot dont se droule en sa mtonymie chaque tour de phrase.
O le situer cet objet a, l'incorporel majeur des stociens ? Dans
l'inconscient ou bien ailleurs ? Qui s'en avise ?
Que cette prface fasse prsage une personne qui ira loin.
Au bon parti qu'elle a tir des sources universitaires, il manque
forcment ce que la tradition orale dsignera pour le futur : les textes
fidles me piller, quoique ddaignant de me le rendre.
Ils intresseront transmettre littralement ce que j'ai dit : tels que
l'ambre gardant la mouche, pour ne rien savoir de son vol.
Ce Nol 1969
Radiophonie
REPONSES
1
SEPT QUESTIONS POSES PAR M. ROBERT GEORGIN
POUR LA RADIODIFFUSION BELGE, 1970
QUESTION I
Dans les crits, vous affirmez que Freud anticipe, sans s'en rendre
compte, les recherches de Saussure et celles du Cercle de Prague. Pouvez-
vous vous expliquer sur ce point ?
RPONSE
Votre question me surprend d'emporter une pertinence qui
tranche sur les prtentions l' entretien que j'ai carter. C'est
mme une pertinence redouble, - deux degrs plutt. Vous me
prouvez avoir lu mes crits, ce qu'apparemment on ne tient pas pour
ncessaire obtenir de m'entndre.Vous y choisissez une remarque
qui implique l'existence d'un autre mode d'information que la
mdiation de masse : que Freud anticipe Saussure, n'implique pas
qu'un bruit en ait fait prendre conscience l'un non plus qu'
l'autre.
De sorte qu' me citer (vous), j'ai rpondu dj votre citation
avant de m'en rendre compte : c'est ce que j'appelle me surprendre.
Partons du terme d'arrive. Saussure et le Cercle de Prague pro-
duisent une linguistique qui n'a rien de commun avec ce qui avant
s'est couvert de ce nom, retrouvt-elle ses clefs entre les mains des
stociens, - mais qu'en faisaient-ils ?
La linguistique, avec Saussure et le Cercle de Prague, s'institue
d'une coupure qui est la barre pose entre le signifiant et le signifi,
pour qu'y prvale la diffrence dont le signifiant se constitue absolu-
1. De ces rponses les quatre premires ont t diffuses par la RTB (3
e
pro-
gramme) les 5,10,19 et 26 juin 1970. Elles ont t reprises par l'ORTF (France-
Culture) le 7 juin 1970.
403
RADIOPHONIE
ment, mais aussi bien effectivement s'ordonne d'une autonomie qui
n'a rien envier aux effets de cristal : pour le systme du phonme
par exemple qui en est le premier succs de dcouverte.
On pense tendre ce succs tout le rseau du symbolique en
n'admettant de sens qu' ce que le rseau en rponde, et de l'inci-
dence d'un effet, oui, - d'un contenu, non.
C'est la gageure qui se soutient de la coupure inaugurale.
Le signifi sera ou ne sera pas scientifiquement pensable, selon
que tiendra ou non un champ de signifiant qui, de son matriel
mme, se distingue d'aucun champ physique par la science obtenu.
Ceci implique une exclusion mtaphysique, prendre comme fait
de dstre. Aucune signification ne sera dsormais tenue pour aller
de soi : qu'il fasse clair quand il fait jour par exemple, o les stociens
nous ont devanc, mais j'ai dj interrog : quelle fin?
Duss-je aller brusquer certaines reprises du mot, je dirai smio-
tique toute discipline qui part du signe pris pour objet, mais pour
marquer que c'est l ce qui faisait obstacle la saisie comme telle du
signifiant.
Le signe suppose le quelqu'un qui il fait signe de quelque chose.
C'est le quelqu'un dont l'ombre occultait l'entre dans la linguistique.
Appelez ce quelqu'un comme vous voudrez, ce sera toujours une
sottise. Le signe suffit ce que ce quelqu'un se fasse du langage
appropriation, comme d'un simple outil ; de l'abstraction voil le
langage support, comme de la discussion moyen, avec tous les pro-
grs de la pense, que dis-je ? de la critique, la clef.
Il me faudrait anticiper (reprenant le sens du mot de moi
moi) sur ce que je compte introduire sous la graphie de l'achose,
/, apostrophe, a, c, h, 0, etc., pour faire sentir en quel effet prend posi-
tion la linguistique.
Ce ne sera pas un progrs : une rgression plutt. C'est ce dont
nous avons besoin contre l'unit d'obscurantisme qui dj se soude
aux fins de prvenir l'achose.
Personne ne semble reconnatre autour de quoi l'unit se fait, et
qu'au temps de quelqu'un o se recueillait la signature des choses ,
du moins ne pouvait-on compter sur une btise assez cultive, pour
qu'on lui accroche le langage la fonction de la communication.
Le recours la communication protge, si j'ose dire, les arrires de
ce que prime la linguistique, en y couvrant le ridicule qui y rap-
404
RADIOPHONIE
plique a posteriori de son fait. Supposons-la montrer dans l'occulta-
tion du langage la figure du mythe qu'est la tlpathie. Freud lui-
mme se laisse prendre cet enfant perdu de la pense : qu'elle
se communique sans parole. Il n'y dmasque pas le toi secret de la
cour des miracles dont il ouvre le nettoyage. Telle la linguistique
reste colle la pense qu'elle (la pense) se communique avec la
parole. C'est le mme miracle invoqu faire qu'on tlptisse du
mme bois dont on pactise : pourquoi pas le dialogue dont vous
apptent les faux jetons, voire les contrats sociaux qu'ils en atten-
dent. L'afiect est l bon pied bon il pour sceller ces effusions.
Tout homme (qui ne sait ce que c'est?) est mortel (rassemblons-
nous sur cette galit communicable entre toutes). Et maintenant
parlons de tout , c'est le cas de le dire, parlons ensemble, passant
muscade de ce qu'il y a sous la tte des syllogistes (pas d'Aristote,
notons-le) qui d'un seul cur (depuis lui) veulent bien que la
mineure mette Socrate dans le coup. Car il en ressortirait aussi bien
que la mort s'administre comme le reste, et par et pour les hommes,
mais sans qu'ils soient du mme ct pour ce qui est de la tlpathie
que vhicule une tlgraphie, dont le sujet ds lors ne cesse pas
d'embarrasser.
Que ce sujet soit d'origine marqu de division, c'est ce dont la
linguistique prend force au-del des badinages de la communication.
Oui, force mettre le pote dans son sac. Car le pote se produit
d'tre... (qu'on me permette de traduire celui qui le dmontre, mon
ami Jakobson en l'espce)... se produit d'tre mang des vers, qui
trouvent entre eux leur arrangement sans se soucier, c'est manifeste,
de ce que le pote en sait ou pas. D'o la consistance chez Platon de
l'ostracisme dont il frappe le pote en sa Rpublique, et de la vive
curiosit qu'il montre dans le Cratyle pour ces petites btes que lui
paraissent tre les mots n'en faire qu' leur tte.
On voit combien le formalisme fut prcieux soutenir les pre-
miers pas de la linguistique.
Mais c'est tout de mme de trbuchements dans les pas du
langage, dans la parole autrement dit, qu'elle a t anticipe .
Que le sujet ne soit pas celui qui sache ce qu'il dit, quand bel et
bien se dit quelque chose par le mot qui lui manque, mais aussi dans
l'impair d'une conduite qu'il croit sienne, cela ne rend pas ais de le
loger dans la cervelle dont il semble s'aider surtout ce qu'elle
405
RADIOPHONIE
dorme (point que l'actuelle neurophysiologie ne dment pas), voil
d'vidence l'ordre de faits que Freud appelle l'inconscient.
Quelqu'un qui l'articule, au nom de Lacan, dit que c'est a ou
rien d'autre.
Personne, aprs lui maintenant, ne peut manquer le lire dans
Freud, et qui opre selon Freud psychanalyser, doit s'y rgler sauf
le payer du choix de la btise.
Ds lors noncer que Freud anticipe la linguistique, je dis moins
que ce qui s'impose, et qui est la formule que je libre maintenant :
l'inconscient est la condition de la linguistique.
Sans l'ruption de l'inconscient, pas moyen que la linguistique
sorte du jour douteux dont l'Universit, du nom des sciences
humaines, fait encore clipse la science. Couronne Kazan par les
soins de Baudouin de Courtenay, elle y fut sans doute reste.
Mais l'Universit n'a pas dit son dernier mot, elle va de a faire
sujet de thse : influence sur le gnie de Ferdinand de Saussure du
gnie de Freud ; dmontrer d'o vint l'un le vent de l'autre avant
qu'existt la radio.
Faisons comme si elle ne s'en tait pas passe de toujours, pour
assourdir autant.
Et pourquoi Saussure se serait-il rendu compte, pour emprunter
les termes de votre citation, mieux que Freud lui-mme de ce que
Freud anticipait, notamment la mtaphore et la mtonymie laca-
niennes, lieux o Saussure genuit Jakobson.
Si Saussure ne sort pas les anagrammes qu'il dchiffre dans la posie
saturnienne, c'est que ceux-ci jettent bas la littrature universitaire. La
canaillerie ne le rend pas bte ; c'est parce qu'il n'est pas analyste.
Pour l'analyste au contraire, tremper dans les procds dont s'ha-
bille l'infatuation universitaire, ne vous rate son homme (il y a l
comme un espoir) et le jette droit dans une bourde comme de dire
que l'inconscient est la condition du langage : l il s'agit de se faire
auteur aux dpens de ce que j'ai dit, voire serin, aux intresss :
savoir que le langage est la condition de l'inconscient.
Ce qui me fait rire du personnage est un strotype : au point que
deux autres, eux l'usage interne d'une Socit que sa btardise uni-
versitaire a tue, ont os dfinir le passage Vacte et Vacting out exac-
tement des termes dont leur adresse expresse j'avais oppos l'un
l'autre, mais intervertir simplement ce que j'attribuais chacun.
406
RADIOPHONIE
Faon, pensaient-ils, de s'approprier ce que personne n'avait su en
articuler avant.
Si je dfaillais maintenant, je ne laisserais d'oeuvre que ces rebuts
choisis de mon enseignement, dont j'ai fait bute l'information,
dont c'est tout dire qu'elle le diffuse.
Ce que j'ai nonc dans un discours confidentiel, n'en a pas
moins dplac l'audition commune, au point de m'amener un audi-
toire qui m'en tmoigne d'tre stable en son normit.
Je me souviens de la gne dont m'interrogeait un garon qui
s'tait ml, se vouloir marxiste, au public fait de gens du Parti (le
seul) qui avait afflu (Dieu sait pourquoi) la communication de ma
dialectique du dsir et subversion du sujet dans la psychanalyse .
J'ai gentiment (gentil comme je suis toujours) point la suite
dans mes crits, l'ahurissement qui me fit rponse de ce public.
Pour lui, croyez-vous donc, me disait-il, qu'il suffise que vous
ayez produit quelque chose, inscrit des lettres au tableau noir, pour
en attendre un effet ? .
Un tel exercice a port pourtant, j'en ai eu la preuve, ne serait-ce
que du rebut qui lui fit un droit pour mon livre, - les fonds de la
Fondation Ford qui motivent de telles runions d'avoir les pon-
ger, s'tant trouvs alors impensablement sec pour me publier.
C'est que l'effet qui se propage n'est pas de communication de la
parole, mais de dplacement du discours.
Freud, incompris, ft-ce de lui-mme, d'avoir voulu se faire
entendre, est moins servi par ses disciples que par cette propagation :
celle sans quoi les convulsions de l'histoire restent nigme, comme
les mois de mai dont se droutent ceux qui s'emploient les rendre
serfs d'un sens, dont la dialectique se prsente comme drision.
QUESTION II
La linguistique, la psychanalyse et l'ethnologie ont en commun la notion
de structure, partir de cette notion, ne peut-on imaginer l'nonc d'un
champ commun qui runira un jour psychanalyse, ethnologie et linguistique?
407
RADIOPHONIE
RPONSE
( Pques 70, en guise d'uf ?)
Suivre la structure, c'est s'assurer de l'effet du langage.
a ne se fait qu' carter la ptition de principe qu'il la repro-
duise de relations prises au rel. Au rel qui serait entendre de ma
catgorie.
Car ces relations font partie aussi de la ralit en tant qu'elles l'ha-
bitent en formules qui y sont aussi bien prsentes. La structure s'at-
trape de l.
De l, c'est--dire du point o le symbolique prend corps. Je vais
revenir sur ce : corps.
Il serait tonnant qu'on ne voie pas qu' faire du langage une
fonction du collectif, on retourne toujours supposer quelqu'un,
grce qui la ralit se redouble de ce qu'il se la reprsente, pour
que nous n'ayons plus qu' reproduire cette doublure : bref au gu-
pier de l'idalisme.
J'en viendrai au terme quelqu'un qui n'est pas de ce cru : quel-
qu'un lui faire signe.
De la veine indique, la connaissance ne se motive qu' faire
adaptation d'un suppos dans l'existence, qui, quel qu'il se produise
comme moi, organisme, voire espce, n'en pourrait dire rien qui
vaille.
Si la connaissance ne nat qu' larguer le langage, ce n'est pas pour
qu'elle survive qu'il faut l'y raccorder, mais pour la dmontrer mort-
ne.
D'autre structure est le savoir qui, le rel, le cerne, autant que
possible comme impossible. C'est ma formule qu'on sait.
Ainsi le rel se distingue de la ralit. Ce, pas pour dire qu'il
soit inconnaissable, mais qu'il n'y a pas question de s'y connatre,
mais de le dmontrer. Voie exempte d'idalisation aucune.
Pas de raison pourtant de parquer les structuralistes, si ce n'est se
leurrer qu'ils prennent la relve de ce que l'existentialisme a si bien
russi : obtenir d'une gnration qu'elle se couche dans le mme lit
dont elle est ne.
Personne qui n'ait sa chance d'insurrection se reprer de la
structure, puisqu'en droit elle fait la trace du dfaut d'un calcul
venir.
408
RADIOPHONIE
Que ceci prface l'accueil que je vais faire au pool que vous ima-
ginez.
Je reviens d'abord au corps du symbolique qu'il faut entendre
comme de nulle mtaphore. A preuve que rien que lui n'isole le
corps prendre au sens naf, soit celui dont l'tre qui s'en soutient
ne sait pas que c'est le langage qui le lui dcerne, au point qu'il n'y
serait pas, faute d'en pouvoir parler.
Le premier corps fait le second de s'y incorporer.
D'o l'incorporel qui reste marquer le premier, du temps d'aprs
son incorporation. Rendons justice aux stociens d'avoir su de ce
terme : l'incorporel, signer en quoi le symbolique tient au corps.
Incorporelle est la fonction, qui fait ralit de la mathmatique,
rapplication de mme effet pour la topologie, ou l'analyse en un
sens large pour la logique.
Mais c'est incorpore que la structure fait l'affect, ni plus ni
moins, affect seulement prendre de ce qui de l'tre s'articule, n'y
ayant qu'tre de fait, soit d'tre dit de quelque part.
Par quoi s'avre que du corps, il est second qu'il soit mort ou
vif.
Qui ne sait le point critique dont nous datons dans l'homme,
l'tre parlant : la spulture, soit o, d'une espce, s'affirme qu'au
contraire d'aucune autre, le corps mort y garde ce qui au vivant
donnait le caractre : corps. Corpse reste, ne devient charogne, le
corps qu'habitait la parole, que le langage corpsifiait.
La zoologie peut partir de la prtention de l'individu faire l'tre
du vivant, mais c'est pour qu'il en rabatte, seulement qu'elle le
poursuive au niveau du polypier.
Le corps, le prendre au srieux, est d'abord ce qui peut porter la
marque propre le ranger dans une suite de signifiants. Ds cette
marque, il est support de la relation, non ventuel, mais ncessaire,
car c'est encore la supposer que de s'y soustraire.
D'avant toute date, Moins-Un dsigne le lieu dit de l'Autre (avec
le sigle du grand A) par Lacan. De l'Un-en-Moins, le lit est fait
l'intrusion qui avance de l'extrusion ; c'est le signifiant mme.
Ainsi ne va pas toute chair. Des seules qu'empreint le signe les
ngativer, montent, de ce que corps s'en sparent, les nues, eaux
suprieures, de leur jouissance, lourdes de foudres redistribuer
corps et chair.
409
RADIOPHONIE
Rpartition peut-tre moins comptable, mais dont on ne semble
pas remarquer que la spulture antique y figure cet ensemble
mme, dont s'articule notre plus moderne logique. L'ensemble vide
des ossements est l'lment irrductible dont s'ordonnent, autres
lments, les instruments de la jouissance, colliers, gobelets, armes :
plus de sous-lments numrer la jouissance qu' la faire rentrer
dans le corps.
Ai-je anim la structure ? Assez, je pense, pour, des domaines
qu'elle unirait la psychanalyse, annoncer que rien n'y destine les
deux que vous dites, spcialement.
La linguistique livre le matriel de l'analyse, voire l'appareil dont
on y opre. Mais un domaine ne se domine que de son opration.
L'inconscient peut tre comme je le disais la condition de la linguis-
tique. Celle-ci n'en a pas pour autant sur lui la moindre prise.
Car elle laisse en blanc ce qui y fait effet : l'objet a dont montrer
qu'il est l'enjeu de l'acte psychanalytique, j'ai pens clairer tout
autre acte.
Cette carence du linguiste, j'ai pu l'prouver d'une contribution
que je demandai au plus grand qui ft parmi les Franais pour
en illustrer le dpart d'une revue de ma faon, si peu qu'elle en fut
marque dans son titre : la psychanalyse, pas moins. On sait le cas
qu'en firent ceux qui d'une grce de chiens battus m'y firent
conduite, la tenant pourtant d'assez de cas pour saborder la chose en
son temps.
C'est bien d'une autre - grce est encore peu dire - que me fut
accorde l'attention que mritait 4'intrt jamais relev avant moi de
Freud pour les mots antithtiques, tels qu'apprcis par un Abel.
Mais si le linguiste ne peut faire mieux qu'il parut au verdict que
le bon aise du signifi exige que les signifiants ne soient pas antith-
tiques, ceci suppose que d'avoir parler l'arabe, o de tels signifiants
abondent, s'annonce comme de parer une monte de fourmilire.
Pour prendre un exemple moins anecdotique, remarquons que le
particulier de la langue est ce par quoi la structure tombe sous l'effet
de cristal, que j'ai dit plus haut.
Le qualifier, ce particulier, d'arbitraire est lapsus que Saussure a
commis, de ce qu' contrecur certes, mais par l d'autant plus
offert au trbuchement; il se rempardait l (puisqu'on m'apprend
410
RADIOPHONIE
que c'est un mot de moi) du discours universitaire dont j'ai montr
que le recel, c'est justement ce signifiant qui domine le discours du
matre, celui de l'arbitraire.
C'est ainsi qu'un discours faonne la ralit sans supposer nul
consensus du sujet, le divisant, quoi qu'il en ait, de ce qu'il l'nonce
ce qu'il se pose comme l'nonant.
Seul le discours qui se dfinit du tour que lui donne l'analyste,
manifeste le sujet comme autre, soit lui remet la clef de sa division,
- tandis que la science, de faire le sujet matre, le drobe, la mesure
de ce que le dsir qui lui fait place, comme Socrate se met me le
barrer sans remde.
Il n'y a pas moindre barrire du ct de l'ethnologie. Un enqu-
teur qui laisserait son informatrice lui conter fleurette de ses rves,
se fera rappeler l'ordre, les mettre au compte du terrain. Et le
censeur, ce faisant, ne me paratra pas, fut-il Lvi-Strauss, marquer
mpris de mes plates-bandes.
O irait le terrain s'il se dtrempait d'inconscient? a n'y
ferait, quoi qu'on en rve, nul effet de forage, mais flaque de notre
cru.
Car une enqute qui se limite au recueil d'un savoir, c'est d'un
savoir de notre tonneau que nous la nourririons.
D'une psychanalyse elle-mme, qu'on n'attende pas de recenser
les mythes qui ont conditionn un sujet de ce qu'il ait grandi au
Togo ou au Paraguay. Car la psychanalyse oprant du discours qui
la conditionne, et que je dfinis cette anne le prendre par son
envers, on n'en obtiendra pas d'autre mythe que ce qui en reste en
son discours : l'dipe freudien.
Du matriel dont se fait l'analyse du mythe, coutons Lvi-Strauss
noncer qu'il est intraduisible. Ceci bien l'entendre : car ce qu'il
dit, c'est que peu importe en quelle langue ils sont recueillis : tou-
jours de mme analysables, de se thoriser des grosses units dont
une mythologisation dfinitive les articule.
On saisit l le mirage d'un niveau commun avec l'universalit du
discours psychanalytique, mais, et du fait de qui le dmontre, sans
que l'illusion s'en produise. Car ce n'est pas du jeu de mythmes
apologtiques que propagent les Instituts qu'un psychanalyste fera
jamais interprtation.
411
RADIOPHONIE
Que la cure ne puisse se passer que dans une langue particulire
(ce qu'on appelle : positive), mme jouer de la traduire, y fait
garantie qu' il n'y a pas de mtalangage , selon ma formule. L'effet
de langage ne s'y produit que du cristal linguistique. Son universalit
n'est que la topologie retrouve, de ce qu'un discours s'y dplace.
L'accs topologique y tant mme assez prgnant pour que la
mythologie s'y rduise l'extrme.
Ajouterai-je que le mythe, dans l'articulation de Lvi-Strauss,
soit : la seule forme ethnologique motiver votre question, refuse
tout ce que j'ai promu de l'instance de la lettre dans l'inconscient.
Il n'opre ni de mtaphore, ni mme d'aucune mtonymie. Il ne
condense pas, il explique. Il ne dplace pas, il loge, mme changer
l'ordre des tentes.
Il ne joue qu' combiner ses units lourdes, o le complment,
d'assurer la prsence du couple, fait seul surgir un arrire-plan.
Cet arrire-plan est justement ce que repousse sa structure.
Ainsi dans la psychanalyse (parce qu'aussi bien dans l'inconscient)
l'homme de la femme ne sait rien, ni la femme de l'homme. Au
phallus se rsume le point de mythe o le sexuel se fait passion du
signifiant.
Que ce point paraisse ailleurs se multiplier, voil ce qui fascine
spcialement l'universitaire qui, de structure, a la psychanalyse en
horreur. D'o procde le recrutement des novices de l'ethnologie.
O se marque un effet d'humour. Noir bien sr, se peindre de
faveurs de secteur.
Ah ! faute d'une universit qui serait ethnie, allons d'une ethnie
faire universit.
D'o la gageure de cette pche dont se dfinit le terrain comme le
lieu o faire crit d'un savoir dont l'essence est de ne se transmettre
pas par crit.
Dsesprant de voir jamais la dernire classe, recrons la premire,
l'cho de savoir qu'il y a dans la classification. Le professeur ne
revient qu' l'aube... celle o se croit dj la chauve-souris de Hegel.
Je garderai mme distance, dire la mienne la structure : passant
le dernier comme psychanalyste faire le tour de votre interpel-
lation.
D'abord que, sous prtexte que j'ai dfini le signifiant comme ne
l'a os personne, on ne s'imagine pas que le signe ne soit pas mon
412
RADIOPHONIE
affaire ! Bien au contraire c'est la premire, ce sera aussi la dernire.
Mais il y faut ce dtour.
Ce que j'ai dnonc d'une smiotique implicite dont seul le
dsarroi aurait permis la linguistique, n'empche pas qu'il faille la
refaire, et de ce mme nom, puisqu'en fait c'est de celle faire, qu'
l'ancienne nous le reportons.
Si le signifiant reprsente un sujet, selon Lacan (pas un signifi),
et pour un autre signifiant (ce qui veut dire : pas pour un autre
sujet), alors comment peut-il, ce signifiant, tomber au signe qui de
mmoire de logicien, reprsente quelque chose pour quelqu'un?
C'est au bouddhiste que je pense, vouloir animer ma question
cruciale de son : Pas de fume sans feu.
Psychanalyste, c'est du signe que je suis averti. S'il me signale le
quelque chose que j'ai traiter, je sais d'avoir la logique du signi-
fiant trouv rompre le leurre du signe, que ce quelque chose est
la division du sujet : laquelle division tient ce que l'autre soit ce qui
fait le signifiant, par quoi il ne saurait reprsenter un sujet qu' n'tre
un que de l'autre.
Cette division rpercute les avatars de l'assaut qui, telle quelle,
l'a affronte au savoir du sexuel, - traumatiquement de ce que cet
assaut soit l'avance condamn l'chec pour la raison que j'ai dite,
que le signifiant n'est pas propre donner corps une formule qui
soit du rapport sexuel.
D'o mon nonciation : il n'y a pas de rapport sexuel, sous-
entendu : formulable dans la structure.
Ce quelque chose o le psychanalyste, interprtant, fait intrusion
de signifiant, certes je m'extnue depuis vingt ans ce qu'il ne le
prenne pas pour une chose, puisque c'est faille, et de structure.
Mais qu'il veuille en faire quelqu'un est la mme chose : a va la
personnalit en personne, totale, comme l'occasion on dgueule.
Le moindre souvenir de l'inconscient exige pourtant de mainte-
nir cette place le quelque deux, avec ce supplment de Freud qu'il
ne saurait satisfaire aucune autre runion que celle logique, qui
s'inscrit : ou l'un ou l'autre.
Qu'il en soit ainsi du dpart dont le signifiant vire au signe, o
trouver maintenant le quelqu'un, qu'il faut lui procurer d'urgence ?
C'est le hic qui ne se fait nunc qu' tre psychanalyste, mais aussi
lacanien. Bientt tout le monde le sera, mon audience en fait
413
RADIOPHONIE
prodrome, donc les psychanalystes aussi. Y suffirait la monte au
znith social de l'objet dit par moi petit a, par l'effet d'angoisse que
provoque l'videment dont le produit notre discours, de manquer
sa production.
Que ce soit d'une telle chute que le signifiant tombe au signe,
l'vidence est faite chez nous de ce que, quand on n'y sait plus
quel saint se vouer (autrement dit : qu'il n'y a plus de signifiant
frire, c'est ce que le saint fournit), on y achte n'importe quoi, une
bagnole notamment, quoi faire signe d'intelligence, si l'on peut
dire, de son ennui, soit de l'affect du dsir d'Autre-chose (avec un
grand A).
a ne dit rien du petit a parce qu'il n'est dductible qu' la
mesure de la psychanalyse de chacun, ce qui explique que peu de
psychanalystes le manient bien, mme le tenir de mon sminaire.
Je parlerai donc en parabole, c'est--dire pour drouter.
A regarder de plus prs le pas de fume, si j'ose dire, peut-tre
franchira-t-on celui de s'apercevoir que c'est au feu que ce pas
fait signe.
De quoi il fait signe, est conforme notre structure, puisque
depuis Promthe, une fume est plutt le signe de ce sujet que
reprsente une allumette pour sa bote, et qu' un Ulysse abordant
un rivage inconnu, une fume au premier chef laisse prsumer que
ce n'est pas une le dserte.
Notre fume est donc le signe, pourquoi pas du fumeur? Mais
allons-y du producteur de feu : ce sera plus matrialiste et dialec-
tique souhait.
Qu'Ulysse pourtant donne le quelqu'un, est mis en doute se
rappeler qu'aussi bien il n'est personne. Il est en tout cas personne
ce que s'y trompe une fate polyphmie.
Mais l'vidence que ce ne soit pas pour faire signe Ulysse que
les fumeurs campent, nous suggre plus de rigueur au principe du
signe.
Car elle nous fait sentir, comme au passage, que ce qui pche
voir le monde comme phnomne, c'est que le noumne, de ne
pouvoir ds lors faire signe qu'au vot5, soit : au suprme quelqu'un,
signe d'intelligence toujours, dmontre de quelle pauvret procde
la vtre supposer que tout fait signe : c'est le quelqu'un de nulle
part qui doit tout manigancer.
414
RADIOPHONIE
Que a nous aide mettre le : pas de fume sans feu, au mme pas
que le : pas de prire sans dieu, pour qu'on entende ce qui change.
Il est curieux que les incendies de fort ne montrent pas le quel-
qu'un auquel le sommeil imprudent du fumeur s'adresse.
Et qu'il faille la joie phallique, l'urination primitive dont l'homme,
dit la psychanalyse, rpond au feu, pour mettre sur la voie de ce qu'il
y ait, Horatio, au ciel et sur la terre, d'autres matires faire sujet
que les objets qu'imagine votre connaissance.
Les produits par exemple la qualit desquels, dans la perspective
marxiste de la plus-value, les producteurs, plutt qu'au matre, pour-
raient demander compte de l'exploitation qu'ils subissent.
Quand on reconnatra la sorte de plus-de-jouir qui fait dire a
c'est quelqu'un , on sera sur la voie d'une matire dialectique peut-
tre plus active que la chair Parti, employe comme baby-sitter de
l'histoire. Cette voie, le psychanalyste pourrait l'clairer de sa passe.
QUESTION III
L'une des articulations possibles entre psychanalyste et linguistique
ne serait-elle pas le privilge accord la mtaphore et la mtonymie,
par Jakobson sur le plan linguistique, et par vous sur le plan psychana-
lytique ?
RPONSE
Je pense que, grce mon sminaire de Sainte-Anne dont sort
celui qui a traduit Jakobson en fianais, plus d'un de nos auditeurs
en ce moment sait comment la mtaphore et la mtonymie sont par
Jakobson situes de la chane signifiante : substitution d'un signifiant
un autre pour l'une, slection d'un signifiant dans sa suite pour
l'autre. D'o rsulte (et seulement l chez Jakobson : pour moi le
rsultat est autre) que la substitution se fait de similarits, la slection
de contigus.
C'est qu'il s'agit l d'autre chose que du letton, de ce qui rend
lisible un signifi, et qui n'est pas rien pour maintenir la condition
stocienne. Je passe : c'est ce que j'ai dnomm du point de capiton,
pour illustrer ce que j'appellerai l'effet Saussure de disruption du
415
RADIOPHONIE
signifi par le signifiant, et prciser ici qu'il rpondait tout juste
mon estime de l'audience-matelas qui m'tait rserve, bien entendu
d'tre Sainte-Anne, quoique compose d'analystes.
Il fallait un peu crier pour se faire entendre d'une troupe o des
fins diverses de ddouanement faisaient nud chez certains. Confor-
mment au style ncessit pour cette poque par les vaillances dont
la prcdente avait su se garer.
Et ce n'est pas pour rien que j'ai introduit mon point de capiton
du jeu des signifiants dans les rponses faites par Joad au collabo-
rateur Abner, acte I, scne I d'Athalie : rsonance de mon discours
procdant d'une corde plus sourde les intresser.
Un lustre franchi, quelqu'un se rue faire du point de capiton
qui l'avait retenu sans doute, l' ancrage que prend le langage dans
l'inconscient. Ledit inconscient son gr, soit l'oppos le plus
impudent de tout ce que j'avais articul de la mtaphore et de la
mtonymie, ledit inconscient s'appuyant du grotesque figuratif du
chapeau de Napolon trouver dans le dessin des feuilles de l'arbre,
et motivant son got d'en prdiquer le reprsentant du reprsen-
tatif.
(Ainsi le profil d'Hider se dgagerait-il d'enfances nes des tran-
ches souffertes par leurs pres lors des meudonneries du Front
populaire.)
La mtaphore et la mtonymie, sans requrir cette promotion
d'une figurativit foireuse, donnaient le principe dont j'engendrais le
dynamisme de l'inconscient.
La condition en est ce que j'ai dit de la barre saussurienne qui
ne saurait reprsenter nulle intuition de proportion, ni se traduire
en barre de fraction que d'un abus dlirant, mais, comme ce qu'elle
est pour Saussure, faire bord rel, soit sauter, du signifiant qui flotte
au signifi qui flue.
C'est ce qu'opre la mtaphore, laquelle obtient un effet de sens
(non pas de signification) d'un signifiant qui fait pav dans la mare
du signifi.
Sans doute ce signifiant ne manque-t-il dsormais dans la chane
que d'une faon juste mtaphorique, quand il s'agit de ce qu'on
appelle posie pour ce qu'elle relve d'un faire. Comme elle s'est
faite, elle peut se dfaire. Moyennant quoi on s'aperoit que l'effet
de sens produit, se faisait dans le sens du non-sens : sa gerbe n'tait
416
RADIOPHONIE
pas avare ni haineuse (cf. mon Instance de la lettre ), pour la raison
que c'tait une gerbe, comme toutes les autres, bte manger comme
est le foin.
Tout autre est l'effet de condensation en tant qu'il part du refou-
lement et fait le retour de l'impossible, concevoir comme la limite
d'o s'instaure par le symbolique la catgorie du rel. L-dessus
un professeur videmment induit par mes propositions (qu'il croit
d'ailleurs contrer, alors qu'il s'en appuie contre un abus dont il
s'abuse, sans nul doute plaisir) a crit des choses retenir.
Au-del de l'illustration du chapeau trouver dans les feuillages
de l'arbre, c'est de la feuillure de la page qu'il matrialise joliment
une condensation dont l'imaginaire s'lide d'tre typographique :
celle qui des plis du drapeau fait lire : rve d'or, les mots qui s'y
disloquent d'y crire ports plat : rvolution d'octobre.
Ici l'effet de non-sens n'est pas rtroactif dans le temps, comme
c'est l'ordre du symbolique, mais bien actuel, le fait du rel.
Indiquant pour nous que le signifiant ressurgit comme couac dans
le signifi de la chane suprieure la barre, et que s'il en est dchu,
c'est d'appartenir une autre chane signifiante qui ne doit en aucun
cas recouper la premire, pour ce qu' faire avec elle discours, celui-
ci change, dans sa structure.
Voil plus qu'il n'en faut pour justifier le recours la mtaphore
de faire saisir comment oprer au service du refoulement, elle pro-
duit la condensation note par Freud dans le rve.
Mais, au lieu de l'art potique, ce qui opre ici, c'est des raisons.
Des raisons, c'est--dire des effets de langage en tant qu'ils sont
pralables la signifiance du sujet, mais qu'ils la font prsente ne
pas en tre encore jouer du reprsentant.
Cette matrialisation intransitive, dirons-nous, du signifiant au
signifi, c'est ce qu'on appelle l'inconscient qui n'est pas ancrage,
mais dpt, alluvion du langage.
Pour le sujet, l'inconscient, c'est ce qui runit en lui ses condi-
tions : ou il n'est pas, ou il ne pense pas.
Si dans le rve il ne pense pas, c'est pour tre l'tat de peut-tre.
En quoi se dmontre ce qu'il reste tre au rveil et par quoi le rve
s'avre bien la voie royale connatre sa loi.
La mtonymie, ce n'est pas du sens d'avant le sujet qu'elle joue
(soit de la barrire du non-sens), c'est de la jouissance o le sujet se
417
RADIOPHONIE
produit comme coupure : qui lui fait donc toffe, mais le rduire
pour a une surface lie ce corps, dj le fait du signifiant.
Non bien entendu que le signifiant s'ancre (ni s'encre) dans la
chatouille (toujours le truc Napolon), mais qu'il la permette entre
autres traits dont se signifie la jouissance et dont c'est le problme
que de savoir ce qui s'en satisfait.
Que sous ce qui s'inscrit glisse la passion du signifiant, il faut
la dire : jouissance de l'Autre, parce qu' ce qu'elle soit ravie d'un
corps, il en devient le lieu de l'Autre.
La mtonymie oprant d'un mtabolisme de la jouissance dont
le potentiel est rgl par la coupure du sujet, cote comme valeur ce
qui s'en transfre.
Les trente voiles dont s'annonce une flotte dans l'exemple rendu
clbre d'tre un lieu de la rhtorique, ont beau voiler trente fois le
corps de promesse que portent rhtorique ou flotte, rien ne fera
qu'un grammairien ni un linguiste en fasse le voile de Maa.
Rien ne fera non plus qu'un psychanalyste avoue qu' faire passer
sa muscade sans lever ce voile sur l'office qu'il en rend, il se ravale au
rang de prestidigitateur.
Pas d'espoir donc qu'il approche le ressort de la mtonymie quand,
faire son catchisme d'une interrogation de Freud, il se demande
si l'inscription du signifiant, oui ou non, se ddouble de ce qu'il y ait
de l'inconscient (question qui personne hors de mon commentaire
Freud, c'est--dire de ma thorie, ne saurait donner aucun sens).
Est-ce que ce ne serait pas pourtant la coupure interprtative elle-
mme, qui, pour l'nonneur sur la touche, fait problme de faire
conscience ? Elle rvlerait alors la topologie qui la commande dans
un cross-cap, soit dans une bande de Mbius. Car c'est seulement de
cette coupure que cette surface, o de tout point, on a accs son
envers, sans qu'on ait passer de bord ( une seule face donc), se
voit par aprs pourvue d'un recto et d'un verso. La double inscrip-
tion freudienne ne serait donc du ressort d'aucune barrire saussu-
rienne, mais de la pratique mme qui en pose la question, savoir la
coupure dont l'inconscient se dsister tmoigne qu'il ne consistait
qu'en elle, soit que plus le discours est interprt, plus il se confirme
d'tre inconscient. Au point que la psychanalyse seule dcouvrirait
qu'il y a un envers au discours, - condition de l'interprter.
Je dis ces choses difficiles, de savoir que l'inaptitude de mes audi-
418
RADIOPHONIE
teurs les met avec elles de plain-pied. Que le vice du psychanalyste
d'tre personne par son acte plus que toute autre dplace, l'y rende
d'autre faon inapte, c'est ce qui fait chacun de mes crits si circon-
locutoire faire barrage ce qu'il s'en serve bouche-que-veux-tu.
Il faut dire que le dsir d'tre le matre contredit le fait mme du
psychanalyste : c'est que la cause du dsir se distingue de son objet.
Ce dont tmoigne la mtonymie du linguiste, est porte d'autres
que le psychanalyste.
Du pote par exemple qui dans le prtendu ralisme fait de la
prose son instrument.
J'ai montr en son temps que l'hutre gober qui s'voque de
l'oreille que Bel-Ami s'exerce charmer, livre le secret de sa jouis-
sance de maquereau. Sans la mtonymie qui fait muqueuse de cette
conque, plus personne de son ct pour payer l'cot que l'hyst-
rique exige, savoir qu'il soit la cause de son dsir elle, par cette
jouissance mme.
On voit ici que le passage est ais du fait linguistique au symp-
tme et que le tmoignage du psychanalyste y reste inclus. On s'en
convainc ds qu'il commence s'exalter de son coute : hystrie
de son middle ge. Le coquillage aussi entend la sienne, c'est bien
connu, - et qu'on veut tre le bruit de la mer, sans doute de ce que
l'on sache que c'est elle qui l'a caill.
Ils ne bavaient pas encore de l'coute, ceux qui voulaient que je
fasse Jakobson plus d'honneur, pour l'usage dont il m'tait.
Ce sont les mmes qui depuis me firent objection de ce que cet
usage ne lui fut pas conforme en la mtonymie.
Leur lenteur s'en apercevoir montre quel crumen les spare de
ce qu'ils entendent avant qu'ils en fassent parabole.
Ils ne prendront pas la lettre que la mtonymie est bien ce qui
dtermine comme opration de crdit (Verschiebung veut dire : vire-
ment) le mcanisme inconscient mme o c'est pourtant rencaisse-
jouissance sur quoi l'on tire.
Pour ce qui est du signifiant rsumer ces deux tropes, je dis
mal, parat-il, qu'i/ dplace quand je traduis ainsi : es entstellt quelque
part dans mes Ecrits. Qu'il dfigure, dans le dictionnaire, on me l'en-
voie dire par exprs, voire ballon-sonde (encore le truc de la figure
et de ce qu'on peut y papouiller). Dommage que pour un retour
Freud o l'on voudrait m'en remontrer, on ignore ce passage du
419
RADIOPHONIE
Mose o Freud tranche qu'il entend ainsi Y Entstellung, savoir
comme dplacement, parce que, ft-il archaque, c'est l, dit-il, son
sens premier.
Faire passer la jouissance l'inconscient, c'est--dire la compta-
bilit, c'est en effet un sacr dplacement.
On constatera d'ailleurs se faire renvoyer, par l'index de mon
livre, de ce mot aux passages qui virent de son emploi, que je le traduis
(comme il faut) au gr de chaque contexte.
C'est que je ne mtaphorise pas la mtaphore, ni ne mtonymise
la mtonymie pour dire qu'elles quivalent la condensation et au
virement dans l'inconscient. Mais je me dplace avec le dplacement
du rel dans le symbolique, et je me condense pour faire poids de
mes symboles dans le rel, comme il convient suivre l'inconscient
la trace.
QUESTION IV
Vous dites que la dcouverte de l'inconscient aboutit une seconde rvolu-
tion copernicienne. En quoi l'inconscient est-il une notion clef qui subvertit
toute thorie de la connaissance ?
RPONSE
Votre question va chatouiller les espoirs, teints de fais-moi
peur, qu'inspire le sens dvolu notre poque au mot : rvolution.
On pourrait marquer son passage une fonction de surmoi dans la
politique, un rle d'idal dans la carrire de la pense. Notez que
c'est Freud et non pas moi qui joue ici de ces rsonances dont seule
la coupure structurelle peut sparer l'imaginaire comme super-
structure .
Pourquoi ne pas partir de l'ironie qu'il y a mettre au compte
d'une rvolution (symbolique) une image des rvolutions astrales
qui n'en donne gure l'ide ?
Qu'y a-t-il de rvolutionnaire dans le recentrement autour du
soleil du monde solaire ? A entendre ce que j'articule cette anne
d'un discours du matre, on trouvera que celui-ci y clt fort bien
la rvolution qu'il crit partir du rel : si la vise de rjciOTfj|iT| est
420
RADIOPHONIE
bien le transfert du savoir de l'esclave au matre, - ceci au contraire
du passez-muscade impayable dont Hegel voudrait dans le savoir
absolu rsorber leur antinomie, la figure du soleil est l digne d'ima-
ger le signifiant-matre qui demeure inchang mesure mme de
son recel.
Pour la conscience commune, soit pour le peuple , l'hliocen-
trisme, savoir que a tourne autour, implique que a tourne rond,
sans qu'il y ait plus y regarder. Mettrai-je au compte de Galile,
l'insolence politique que reprsente le Roi-Soleil?
De ce que les ascendants contraris qui rsultent de la bascule de
l'axe de la sphre des fixes sur le plan de l'cliptique, gardassent la
prsence de ce qu'ils ont de manifeste, les Anciens surent tirer les
images appuyer une dialectique guide d'y diviser savoir et vrit :
j'en pinglerais un photocentrisme d'tre moins asservissant que
l'hlio.
Ce que Freud, son dire exprs, dans le recours Copernic
allgoris de la destitution d'un centre au profit d'un autre, relve en
fait de la ncessit d'abaisser la superbe qui tient tout monocen-
trisme. Ceci en raison de celui auquel il a affaire dans la psychologie,
ne disons pas : son poque, parce qu'il est dans la ntre encore
inentam : il s'agit de la prtention dont un champ s'y constitue au
titre d'une unit dont il puisse se recenser. Pour bouffon que ce
soit, c'est tenace.
Pas question que cette prtention se soucie de la topologie qu'elle
suppose : savoir celle de la sphre, puisqu'elle ne souponne mme
pas que sa topologie soit problme : on ne peut supposer autre ce
qu'on ne suppose nullement.
Le piquant, c'est que la rvolution copernicienne fait mtaphore
approprie au-del de ce dont Freud la commente, et c'est en quoi
de la lui avoir rendue, je la reprends.
Car l'histoire soumise aux textes o la rvolution copernicienne
s'inscrit, dmontre que ce n'est pas l'hliocentrisme qui fait son
nerf, au point que c'tait pour Copernic lui-mme - le cadet de ses
soucis. A prendre l'expression au pied de la lettre, soit au sens de : pas
le premier, elle s'tendrait aux autres auteurs de ladite rvolution.
Ce autour de quoi tourne, mais justement c'est le mot viter,
autour de quoi gravite l'effort d'une connaissance en voie de se
reprer comme imaginaire, c'est nettement, comme on le lit faire
421
RADIOPHONIE
avec Koyr de l'approche de Kepler la chronique, de se dptrer de
l'ide que le mouvement de rotation, de ce qu'il engendre le cercle
(soit : la forme parfaite), peut seul convenir l'affection du corps
cleste qu'est la plante.
Introduire en effet la trajectoire elliptique, c'est dire que le corps
plantaire vire prcipiter son mouvement (galit des aires cou-
vertes par le rayon dans l'unit du temps : deuxime loi de Kepler)
autour du foyer occup par le luminaire matre, mais s'en retourne
le ralentir du plus loin d'un autre foyer inoccup, lui sans aucun feu
faire lieu.
Ici gt le pas de Galile : ailleurs que dans l'chauffoure de son
procs o il n'y a parti prendre que de la btise de ceux qui ne
voient pas que lui, travaille pour le pape. La thologie a ce prix,
comme la psychanalyse, de tamiser d'une telle chute les canailles.
Le pas de Galile consiste en ce que par son truchement la loi
d'inertie entre enjeu dont va s'clairer cette ellipse.
Par quoi enfin Newton, mais quel temps de comprendre doit-il
encore s'couler avant le moment de conclure - , Newton, oui,
conclut un cas particulier de la gravitation qui rgle la plus banale
chute d'un corps.
Mais l encore la vraie porte de ce pas est touffe : qui est celle
de l'action, - en chaque point d'un monde o ce qu'elle subvertit,
c'est de dmontrer le rel comme impossible -, de l'action, dis-je, de
h formule qui en chaque point soumet l'lment de masse l'attrac-
tion des autres aussi loin que s'tend ce monde, sans que rien y joue
le rle d'un mdium transmettre cette force.
Car c'est bien l qu'est le scandale que la conscience laque (celle
dont la btise, tout l'inverse, fait la commune canaille) a fini par
censurer, simplement de s'y faire sourde.
Sous le choc du moment, les contemporains pourtant y ragirent
vivement, et il faut notre obscurantisme pour avoir oubli l'objec-
tion que tous sentaient alors : du comment chacun des lments de
masse pouvait tre averti de la distance mesurer pour qu'il en pest
aucun autre.
La notion de champ n'explique rien, mais seulement met noir sur
blanc, soit suppose qu'est crit ce que nous soulignons pour tre la
prsence effective non de la relation, mais de sa formule dans le rel,
soit ce dont d'abord j'ai pos ce qu'il en est de la structure.
422
RADIOPHONIE
Il serait curieux de dvelopper jusqu'o la gravitation, premire
ncessiter une telle fonction, se distingue des autres champs, de
l'lectromagntique par exemple, proprement faits pour ce quoi
Maxwell les a mens : la reconstitution d'un univers. Il reste que le
champ de gravitation, pour remarquable que soit sa faiblesse au
regard des autres, rsiste l'unification de ce champ, soit au remon-
tage d'un monde.
D'o je profre que le LEM alunissant, soit la formule de New-
ton ralise en appareil, tmoigne de ce que le trajet qui l'a port l
sans dpense, est notre produit, ou encore : savoir de matre. Parlons
d'acosmonaute plutt que d'insister.
Il serait aussi intressant de pointer jusqu'o la rectification
einsteinienne dans son toffe (courbure de l'espace) et dans son
hypothse (ncessit d'un temps de transmission que la vitesse finie
de la lumire ne permet pas d'annuler) dcolle de l'esthtique trans-
cendantale, j'entends celle de Kant.
Ce qu'on soutiendrait de ce qui la pousse, cette rectification,
l'ordre quantique : o le quantum d'action nous renvoie d'une bute
plus courte qu'on ne s'y serait attendu de la physique, l'effet d'acte
qui se produit comme dchet d'une symbolisation correcte.
Sans nous y risquer, posons que la charte de la structure, c'est
Y hypothses nonfingo de Newton. Il y a des formules qu'on n'ima-
gine pas. Au moins pour un temps, elles font assemble avec le rel.
On voit que les sciences exactes avec leur champ avaient articul
cette charte, avant que je ne l'impose la correction des conjecturales.
C'est le seul levier pouvoir mettre hors d'tat d'y faire couvercle
ce qui tourne de la meule : psychologie d'indchaussable ce que
Kant y relaie Wolff et Lambert, et qui tient en ceci : qu'axe sur le
mme pivot dont traditionnellement s'embrochent ontologie, cos-
mologie, sans que thologie leur fasse leon, l'me, c'est la connais-
sance que le monde a de soi-mme, et prcisment ce qui pare
tre reconnu ainsi, de l'alibi d'une Chose-en-Soi qui se droberait
la connaissance.
A partir de l on ajoute aux fantasmes qui commandent la ralit,
celui du contrematre.
C'est pour ramener sa frule la rvolution freudienne, qu'une
clique mandate pour la lyse-Anna de l'analyse a rdit ce Golem
au titre du moi autonome.
423
RADIOPHONIE
S'il y a trace chez Kant de l'office qu'on lui impute d'avoir par
la cosmologie newtonienne, c'est ce que s'y tope quelque part,
comme d'une pomme un poisson, la formule newtonienne,
et pour marquer que la Vernunji ou le Verstand n'y ont rien faire
d' priori. Ce qui est sr non moins de l'exprience dite sensible, ce
que je traduis : non avertie encore de la structure.
Le noumne tient du mirage dont des fonctions veulent se faire
prendre pour organes, avec pour effet d'embrouiller les organes
trouver fonction. Ainsi cette fonction veuve ne se fait valoir que
comme corps tranger, chute d'un discours du matre quelque peu
prim. Ses surs en raison sont hors d'tat, pures ou pratiques
qu'elles s'affirment, d'en remontrer plus que la spcularisation dont
procdent les solides qui ne peuvent tre dits de rvolution qu'
contribuer aux intuitions gomtriques les plus traditionnelles qui
soient.
Que seule la structure soit propice l'mergence du rel d'o se
promeuve neuve rvolution, s'atteste de la Rvolution, de quelque
grand R que la franaise l'ait pourvue. Elle se fut rduite ce qu'elle
est pour Bonaparte comme pour Chateaubriand : retour au matre
qui a l'art de les rendre utiles (consultez l'Essai qui s'en intitule en
1801) ; le temps passant, ce qu'elle est pour l'historien fort digne
de ce nom,Tocqueville : shaker faire dgradation des idologies de
l'Ancien Rgime ; ce que les hommes d'intelligence n'y entendent
pas plus que d'une folie dont s'extasier (Ampre) ou camisoler
(Taine) ; ce qui en reste pour le lecteur prsent d'une dbauche
rhtorique peu propre la faire respecter.
Il en serait ainsi si Marx ne l'avait replace de la structure qu'il en
formule dans un discours du capitaliste, mais de ce qu'elle ait forclos
la plus-value dont il motive ce discours. Autrement dit c'est de l'in-
conscient et du symptme qu'il prtend proroger la grande Rvolu-
tion : c'est de la plus-value dcouverte qu'il prcipite la conscience
dite de classe. Lnine passant l'acte, n'en obtient rien de plus
que ce qu'on appelle rgression dans la psychanalyse : soit les temps
d'un discours qui n'ont pas t tenus dans la ralit, et d'abord d'tre
intenables.
C'est Freud qui nous dcouvre l'incidence d'un savoir tel qu' se
soustraire la conscience, il ne s'en dnote pas moins d'tre struc-
tur, dis-je, comme un langage, mais d'o articul ? peut-tre de
424
RADIOPHONIE
nulle part o il soit articulable, puisque ce n'est que d'un point
de manque, impensable autrement que des effets dont il se marque,
et qui rend prcaire que quelqu'un s'y connaisse au sens o s'y
connatre, comme fait l'artisan, c'est tre complice d'une nature
quoi il nat en mme temps qu'elle : car ici il s'agit de dnaturation ;
qui rend faux d'autre part que personne s'y reconnaisse, ce qui
impliquerait le mode dont la conscience affirme un savoir d'tre se
sachant.
L'inconscient, on le voit, n'est que terme mtaphorique dsigner
le savoir qui ne se soutient qu' se prsenter comme impossible, pour
que de a il se confirme d'tre rel (entendez discours rel).
L'inconscient ne disqualifie rien qui vaille dans cette connaissance
de nature, qui est plutt point de mythe, ou mme inconsistance se
dmontrer de l'inconscient.
Bref il suffit de rappeler que la bipolarit se trahit essentielle
tout ce qui se propose des termes d'un vrai savoir.
Ce qu'y ajoute l'inconscient, c'est de la fournir d'une dynamique
de la dispute qui s'y fait par une suite de rtorsions ne pas man-
quer de leur ordre qui fait du corps table de jeu.
Les sommations qui en reviennent, selon notre schme : d'tre le
fait d'une fiction de l'metteur, c'est moins du refoulement qu'elles
tmoignent en ce qu'il n'est pas moins construit, que du refoul
faire trou dans la chane de vigilance qui n'est pas plus que trouble
du sommeil.
A quoi prend garde la non-violence d'une censure dont tout sens
reoit le dmenti se proposer pour vritable, mais dont l'adversaire
jubile d'y prserver le non-sens (nonsense plutt), seul point par o il
fait nature (comme de dire qu'il fait eau).
Si l'inconscient, d'une autre donne, fait sujet de la ngation,
l'autre savoir s'emploie le conditionner de ce quoi comme signi-
fiant il rpugne le plus : une figure reprsentable.
A la limite s'avoue de quoi le conflit fait fonction ce que place
nette soit faite au rel, mais pour que le corps s'y hallucin.
Tel est le trajet o naviguent ces bateaux qui me doivent, rappe-
lons-le, d'tre enregistrs comme formations de l'inconscient.
A en fixer le bti correct, j'ai d prter patience ceux dont
c'tait le quotidien, sans de longtemps qu'ils en distinguent la
structure.
425
RADIOPHONIE
A vrai dire, il a suffi qu'ils craignent de m'y voir surgir au rel,
pour qu'un rveil s'en produise, tel qu'ils ne trouvent pas mieux
que, du jardin dont je peignais leurs dlices, me rejeter moi-mme.
D'o je fis retour au rel de l'ENS, soit de l'tant (ou de l'tang) de
l'Ecole normale suprieure o le premier jour que j'y pris place, je
fus interpell sur l'tre que j'accordais tout a. D'o je dclinai
d'avoir soutenir ma vise d'aucune ontologie.
C'est qu' ce qu'elle fut, vise, d'un auditoire rompre ma
logie, de son onto je faisais l'honteux.
Toute onto bue maintenant, je rpondrai, et pas par quatre che-
mins ni par fort cacher l'arbre.
Mon preuve ne touche l'tre qu' le faire natre de la faille que
produit l'tant de se dire.
D'o l'auteur est relguer se faire moyen pour un dsir qui le
dpasse.
Mais il y a entremise autre qu'a dit Socrate en acte.
Il savait comme nous qu' l'tant, faut le temps de se faire
tre.
Ce faut le temps , c'est l'tre qui sollicite de l'inconscient pour
y faire retour chaque fois que lui faudra, oui faudra le temps.
Car entendez que je joue du cristal de la langue pour rfracter
du signifiant ce qui divise le sujet.
Y faudra le temps, c'est du franais que je vous cause, pas du
chagrin, j'espre.
Ce qui faudra de ce qu'il faut le temps, c'est l la faille dont se dit
l'tre, et bien que l'usage d'un futur de cette forme pour le verbe :
faillir ne soit pas recommand dans un ouvrage qui s'adresse aux
Belges, il y est accord que la grammaire le proscrire faudrait ses
devoirs.
Si peu s'en faut qu'elle en soit l, ce peu fait preuve que c'est bien
du manque qu'en franais le falloir vient au renfort du ncessaire, y
supplantant Y il estuet de temps, de Y est opus temporis, le pousser l'es-
tuaire o les vieilleries se perdent.
Inversement ce falloir ne fait pas par hasard quivoque dit
au mode, subjectif du dfaut : avant ( moins) qu'il ne faille y
venir...
C'est ainsi que l'inconscient s'articule de ce qui de l'tre vient
au dire.
426
RADIOPHONIE
Ce qui du temps lui fait toffe n'est pas emprunt d'imaginaire,
mais plutt d'un textile o nuds ne diraient rien que des trous qui
s'y trouvent.
Ce temps logique n'a pas d'En-soi que ce qui en choit pour faire
enchre au masochisme.
C'est ce que le psychanalyste relaie d'y faire figure de quelqu'un.
Le faut du temps, il le supporte assez longtemps pour qu'
celui qui vient s'y dire, il ne faille plus que de s'instruire de ce
qu'une chose n'est pas rien : justement celle dont il fait signe quel-
qu'un.
On sait que j'en introduisis l'acte psychanalytique, et je ne prends
pas comme d'accident que l'moi de mai m'ait empch d'en venir
bout.
Je tiens ici marquer que quelqu'un ne s'y assoit que de la faon,
de l'effaon plutt, qu'il y impose au vrai.
Un seul savoir donne ladite effaon : la logique pour qui le vrai
et le faux fie sont que lettres oprer d'une valeur.
Les stociens le pressentirent de leur pratique d'un masochisme
politis, mais ne le poussrent au point que les sceptiques dussent
faire trve de leur mythique invocation d'une vrit de nature.
Ce sont les refus de la mcanique grecque qui ont barr la route
une logique dont se pt difier une vrit comme de texture.
A la vrit, seule la psychanalyse justifie le mythique ici de la
nature reprer dans la jouissance qui en tient lieu se produire
d'effet de texture.
Sans elle, il suffit de la logique mathmatique pour faire super-
stition du scepticisme rendre irrfutables des assertions aussi peu
vides que :
- un systme dfini comme de l'ordre de l'arithmtique n'obtient
la consistance de faire en son sein dpartage du vrai et du faux,
qu' se confirmer d'tre incomplet, soit d'exiger l'indmontrable de
formules qui ne se vrifient que d'ailleurs ;
- cet indmontrable s'assure d'autre part d'une dmonstration qui
en dcide indpendamment de la vrit qu'il intresse ;
- il y a un indcidable qui s'articule de ce que l'indmontrable
mme ne saurait tre assur.
Les coupures de l'inconscient montrent cette structure, l'attester
de chutes pareilles cerner.
427
RADIOPHONIE
Car me voici revenir au cristal de la langue pour, de ce que falsus
soit le chu en latin, lier le faux moins au vrai qui le rfute, qu'
ce qu'il faut de temps pour faire trace de ce qui a dfailli s'avrer
d'abord. A le prendre de ce qu'il est le participe pass defallere, tom-
ber, dont faillir et falloir proviennent chacun de son dtour, qu'on
note que l'tymologie ne vient ici qu'en soutien de l'effet de cristal
homophonique.
C'est le prendre comme il faut, faire double ce mot, quand
il s'agit de plaider le faux dans l'interprtation. C'est justement
comme falsa, disons bien tombe, qu'une interprtation opre d'tre
ct, soit : o se fait l'tre, du pataqu'est-ce.
N'oublions pas que le symptme est ce falsus qui est la cause dont
l'analyse se soutient dans le procs de vrification qui fait son tre.
Nous ne sommes srs, pour ce que Freud pouvait savoir de ce
domaine, que de sa frquentation de Brentano. Elle est discrte,
soit reprable dans le texte de la Verneinung.
J'y ai fray la voie au praticien qui saura s'attacher au ludion
logique que j'ai forg son usage, soit l'objet a, sans pouvoir suppler
l'analyse, dite personnelle, qui l'a parfois rendu impropre la
manier.
Un temps encore pour ajouter ce dont Freud se maintient, un
trait que je crois dcisif: la foi unique qu'il faisait aux Juifs de ne pas
faillir au sisme de la vrit. Aux Juifs que par ailleurs rien n'carte
de l'aversion qu'il avoue par l'emploi du mot : occultisme, pour tout
ce qui est du mystre. Pourquoi ?
Pourquoi sinon de ce que le Juif depuis le retour de Babylone,
est celui qui sait lire, c'est--dire que de la lettre il prend distance de
sa parole, trouvant l l'intervalle, juste y jouer d'une interprtation.
D'une seule, celle du Midrasch qui se distingue ici minemment.
En effet pour ce peuple qui a le Livre, seul entre tous s'affirmer
comme historique, ne jamais profrer de mythe, le Midrasch repr-
sente un mode d'abord dont la moderne critique historique pour-
rait bien n'tre que l'abtardissement. Car s'il prend le Livre au pied
de sa lettre, ce n'est pas pour la faire supporter d'intentions plus
ou moins patentes, mais pour, de sa collusion signifiante prise en sa
matrialit : de ce que sa combinaison rend oblig de voisinage
(donc non voulu), de ce que les variantes de grammaire imposent de
choix dsinentiel, tirer un dire autre du texte : voire y impliquer ce
428
RADIOPHONIE
qu'il nglige (comme rfrence), l'enfance de Mose par exemple.
N'est-il rien d'en rapprocher ce que de la mort du mme, Freud
tenait ce qu'il fut su, au point d'en faire son message dernier?
Surtout y mettre la distance -jamais prise avant moi - du travail
de Sellin dont la rencontre sur ce point ne lui parut pas ddaigner,
quand son dvergondage d'tre d'une plume fort qualifie dans
l'exgse dite critique, va jeter sur les gonds mmes de la mthode
la drision.
Occasion de passer l'envers (c'est le propos de mon sminaire
de cette anne) de la psychanalyse en tant qu'elle est le discours
de Freud, lui suspendu. Et, sans recours au Nom-du-Pre dont j'ai
dit m'abstenir, biais lgitime prendre de la topologie trahie par ce
discours.
Topologie o saille l'idal monocentrique (que ce soit le soleil
n'y change rien) dont Freud soutient le meurtre du Pre, quand,
de laisser voir qu'il est rebours de l'preuve juive patriarcale, le
totem et 4e tabou l'abandonnent de la jouissance mythique. Non la
figure d'khnaton.
Qu'au dossier de la signifiance ici en jeu de la castration, soit
vers l'effet de cristal que je touche : de la faux du temps.
Note pour ma rponse la IV
e
question
Je voudrais qu'on sache que ce texte ne prtend pas rendre
compte de la rvolution copernicienne telle qu'elle s'articule
dans l'histoire, mais de l'usage... mythique qui en est fait. Par Freud
notamment.
Il ne suffit pas de dire par exemple que l'hliocentrisme fut le
cadet des soucis de Copernic.
Comment lui donner son rang? il est certain au contraire, - on
sait que je suis form aux crits de Koyr l-dessus , qu'il lui parais-
sait admirable que le soleil fut l o il lui donne sa place parce que
c'est de l qu'il jouait le mieux son rle de luminaire. Mais en est-ce
l le subversif?
Car il le place non pas au centre du monde, mais en un lieu assez
voisin, ce qui, pour la fin admire et pour la gloire du crateur, va
aussi bien. Il est donc faux de parler d'hliocentrisme.
429
RADIOPHONIE
Le plus trange est que personne, qu'on entende bien : des sp-
cialistes hors Koyr, ne relve que les rvolutions de Copernic ne
concernent pas les corps clestes, mais les orbes. Il va de soi pour
nous que ces orbes sont traces par les corps. Mais, on rougit d'avoir
le rappeler, pour Ptolme comme pour tous depuis Eudoxe, ces
orbes sont des sphres qui supportent les corps clestes et la course
de chacun est rgle de ce que plusieurs orbes la supportent concur-
remment, 5 peut-tre pour Saturne, 3 mon souvenir pour Jupiter.
Que nous importe ! comme aussi bien de celles qu'y ajoute Aristote
pour tamponner entre deux corps clestes, les deux qu'on vient de
nommer par exemple, l'effet attendre des orbes du premier sur
celles du second. (C'est qu'Aristote veut une physique qui tienne.)
Qui ne devrait s'apercevoir de a, je ne dis pas lire Copernic
dont il existe une reproduction phototypique, mais simplement y
peler le titre : De revolutionibus orbium coelestium ? Ce qui n'em-
pche pas des traducteurs notoires (des gens qui ont traduit le texte)
d'intituler leur traduction : Des rvolutions des corps clestes.
Il est littral, ce qui quivaut ici dire : il est vrai, que Copernic
est ptolmaste, qu'il reste dans le matriel de Ptolme, qu'il n'est
pas copernicien au sens invent qui fait l'emploi de ce terme.
Est-il justifi de s'en tenir ce sens invent pour rpondre un
usage mtaphorique ? c'est le problme qui se pose en toute mta-
phore.
Comme dit peu prs quelqu'un, avec les arts on s'amuse, on
s'amuse avec les lzards. On ne doit pas perdre l'occasion de rappeler
l'essence crtinisante du sens quoi le mot commun convient.
Nanmoins ce.reste exploit strile, si une liaison structurale n'en
peut tre aperue.
A question d'interviewer, vaut rponse improvise. Du premier
jet ce qui m'est venu,- venu du fond d'une information que je prie
de croire n'tre pas nulle -, c'est d'abord la remarque dont l'hlio-
centnsme, j'oppose un photocentrisme d'une importance structu-
rale permanente. On voit de cette note quelle niaiserie tombe
Copernic de ce point de vue.
Koyr la grandit, cette niaiserie, la rfrer au mysticisme propag
du cercle de Marsile Ficin. Pourquoi pas en effet? La Renaissance
fut occultiste, c'est pourquoi l'Universit la classe parmi les res de
progrs.
430
RADIOPHONIE
Le tournant vritable est d Kepler et, j'y insiste, dans la sub-
version, la seule digne de ce nom, que constitue le passage qu'il a
pay de combien de peine, de l'imaginaire de la forme dite parfaite
comme tant celle du cercle, l'articulation de la conique, de l'ellipse
en l'occasion, en termes mathmatiques.
Je collapse incontestablement ce qui est le fait de Galile, mais
il est clair que l'apport de Kepler ici lui chappait, et pourtant c'est
lui qui dj conjugue entre ses mains les lments dont Newton
forgera sa formule : j'entends par l la loi de l'attraction, telle que
Koyr l'isole de sa fonction hyperphysique, de sa prsence syn-
taxique (cf. tudes newtoniennes, p.34).
A la confronter Kant, je souligne qu'elle ne trouve place dans
aucune critique de la raison imaginaire.
C'est de fait la place forte dont le sige maintient dans la science
l'idal d'univers par quoi elle subsiste. Que le champ newtonien ne
s'y laisse pas rduire, se dsigne bien de ma formule : l'impossible,
c'est le rel.
C'est de ce point une fois atteint, que rayonne notre physique.
Mais inscrire la science au registre du discours hystrique, je
laisse entendre plus que je n'en ai dit.
L'abord du rel est troit. Et c'est de le hanter, que la psychanalyse
se profile.
QUESTION V
Quelles en sont les consquences sur le plan :
a) de la science;
b) de la philosophie ;
c) plus particulirement du marxisme, voire du communisme ?
RPONSE
Votre question, qui suit une liste prconue, mrite que je marque
qu'elle ne va pas de soi aprs la rponse qui prcde.
Elle semble supposer que j'aie acquiesc ce que l'incons-
cient. .. subvertit toute thorie de la connaissance , pour vous citer,
431
RADIOPHONIE
aux mots prs que j'lide pour les en sparer : (l'inconscient) est-il
une notion clef qui , etc.
Je dis : l'inconscient n'est pas une notion. Qu'il soit une clef? a
se juge l'exprience. Une clef suppose une serrure. Il existe assur-
ment des serrures, et mme que l'inconscient fait jouer correcte-
ment, pour les fermer? pour les ouvrir? a ne va pas de soi que
l'un implique l'autre, a fortiori qu'ils soient quivalents.
Il doit nous suffire de poser que l'inconscient est. Ni plus ni
moins. C'est bien assez pour nous occuper un moment encore aprs
le temps que a a dur, sans que jusqu' moi personne ait fait un
pas de plus. Puisque pour Freud, c'tait reprendre de la table rase
en chaque cas : de la table rase, mme pas sur ce qu'il est, il ne peut le
dire, hors sa rserve d'un recours organique de pur rituel : sur ce qu'il
en est dans chaque cas, voil ce qu'il veut dire. En attendant, rien de
sr, sinon qu'il est, et que Freud, en parler, fait de la linguistique.
Encore personne ne le voit-il, et contre lui, chacun s'essaie faire
rentrer l'inconscient dans une notion d'avant.
D'avant que Freud dise qu'il est, sans que a soit, ni a, et notam-
ment pas non plus le a.
Ce que j'ai rpondu votre question IV, veut dire que l'incons-
cient subvertit d'autant moins la thorie de la connaissance qu'il n'a
rien faire avec elle pour la raison que je. viens de dire : savoir,
qu'il lui est tranger.
C'est sans qu'il y soit pour rien qu'on peut dire que la thorie de
la connaissance n'est pas, pour la raison qu'il n'y a pas de connais-
sance qui ne soit d'illusion ou de mythe. Ceci, bien sr, donner
au mot un sens qui vaille la peine d'en maintenir l'emploi au-del
de son sens mondain : savoir que je le connais veut dire : je lui ai
t prsent ou je sais ce qu'il fait par cur (d'un crivain notam-
ment, d'un prtendu auteur en gnral).
A noter, pour ceux qui le rvffiOi aecurcv pourrait servir de
muleta en l'occasion, puisque ce n'est rien d'autre, que cette vise
d'exploit exclut toute thorie depuis que la consigne en a t bran-
die par le trompeur delphique. Ici, l'inconscient n'apporte ni renfort
ni dception : mais seulement que le aeauxv sera forcment coup
en deux, au cas qu'on s'inquite encore de quelque chose qui y
ressemble aprs avoir dans une psychanalyse mis l'preuve son
inconscient.
432
RADIOPHONIE
Brisons donc l : pas de connaissance. Au sens qui vous permet-
trait l'accolade d'y envelopper les rubriques dont vous croyez main-
tenant pousser votre question. Pas de connaissance autre que le
mythe que je dnonais tout l'heure. Mythe dont la thorie ds
lors relve de la mytho-logie ( spcifier d'un trait d'union) ncessi-
tant au plus une extension de l'analyse structurale dont Lvi-Strauss
fournit les mythes ethnographiques.
Pas de connaissance. Mais du savoir, a oui, la pelle, n'en savoir
que faire, plein des armoires.
De l, certains (de ces savoirs) vous crochent au passage. Il y suffit
que les anime un de ces discours dont cette anne j'ai mis en circu-
lation la structure. tre fait sujet d'un discours peut vous rendre sujet
au savoir.
Si plus aucun discours n'en veut, il arrive qu'on interroge un
savoir sur son usage prim, qu'on en fasse l'archologie. C'est plus
qu'ouvrage d'antiquaire, si c'est afin d'en mettre en fonction la
structure.
La structure, elle, c'est une notion : d'laborer ce qu'il s'ensuit
pour la ralit, de cette prsence en elle des formules du savoir,
dont je marquais plus haut qu'elle est son avnement notionnel.
Il y a des savoirs dont les suites peuvent rester en souffrance, ou
bien tomber en dsutude.
Il y en a un dont personne n'avait l'ide avant Freud, dont
personne aprs lui ne l'a encore, sauf en tenir de moi par quel bout
le prendre. Si bien que j'ai pu dire tout l'heure que c'est au regard
des autres savoirs que le terme d'inconscient, pour celui-ci, fait
mtaphore. A partir de ce qu'il soit structur comme un langage,
on me fait confiance avec fruit : encore faut-il qu'on ne se trompe
pas sur ceci que c'est plutt lui, si tant est que ce ne soit abus de le
pronommer, lui, l'inconscient, qui par ce bout vous prend.
Si j'insiste marquer ainsi mon retard sur votre hte, c'est qu'il
vous faut vous souvenir que l o j'ai illustr la fonction de la
hte en logique, je l'ai souligne de l'effet de leurre dont elle peut
se faire complice. Elle n'est correcte qu' produire ce temps : le
moment de conclure. Encore faut-il se garder de la mettre au service
de l'imaginaire. Ce qu'elle rassemble est un ensemble : les prison-
niers dans mon sophisme, et leur rapport une sortie structure
d'un arbitraire : non pas une classe.
433
RADIOPHONIE
Il arrive que la hte errer dans ce sens, serve plein cette ambi-
gut des rsultats, que j'entends rsonner du terme : rvolution, lui-
mme.
Car ce n'est pas d'hier que j'ai ironis sur le terme de tradition
rvolutionnaire.
Bref, je voudrais marquer l'utilit en cette trace de se dmarquer
de la sduction.
Quand c'est de production que l'affaire prend son tour.
O je pointe le pas de Marx.
Car il nous met au pied d'un mur dont on s'tonne qu'il n'y ait
rien d'autre reconnatre, pour que quelque chose s'en renverse,
pas le mur bien sr, mais la faon de tourner autour.
L'efficacit des coups de glotte au sige de Jricho laisse penser
qu'ici le mur fit exception, vrai dire n'pargnant rien sur le
nombre de tours ncessaire.
C'est que le mur ne se trouve pas, dans cette occasion, l o on
le croit, de pierre, plutt fait de l'inflexible d'une vagance extra.
Et si c'est le cas, nous retrouvons la structure qui est le mur dont
nous parlons.
A le dfinir de relations articules de leur ordre, et telles qu' y
prendre part, on ne le fasse qu' ses dpens.
Dpens de vie ou bien de mort, c'est secondaire. Dpens de
jouissance, voil le primaire.
D'o la ncessit du plus-de-jouir pour que la machine tourne, la
jouissance ne syndiquant l que pour qu'on l'ait de cette eflfaon,
comme trou combler.
Ne vous tonnez pas qu'ici je ressasse quand d'ordinaire je cours
mon chemin.
C'est qu'ici refaire une coupure inaugurale, je ne la rpte pas,
je la montre se redoublant recueillir ce qui en choit.
Car Marx, la plus-value que son ciseau, le dtacher, restitue au
discours du capital, c'est le prix qu'il faut mettre nier comme moi
qu'aucun discours puisse s'apaiser d'un mtalangage (du formalisme
hglien en l'occasion), mais ce prix, il l'a pay de s'astreindre suivre
le discours naf du capitaliste son ascendant, et de la vie d'enfer
qu'il s'en est faite.
C'est bien le cas de vrifier ce que je dis du plus-de-jouir. La
Mehrwert, c'est la Marxlust, le plus-de-jouir de Marx.
434
RADIOPHONIE
La coquille entendre jamais l'coute de Marx, voil le cauri
dont commercent les Argonautes d'un ocan peu pacifique, celui de
la production capitaliste.
Car ce cauri, la plus-value, c'est la cause du dsir dont une co-
nomie fait son principe : celui de la production extensive, donc
insatiable, du manque--jouir. Il s'accumule d'une part pour
accrotre les moyens de cette production au titre du capital. Il tend
la consommation d'autre part sans quoi cette production serait
vaine, justement de son ineptie procurer une jouissance dont elle
puisse se ralentir.
Quelqu'un nomm Karl Marx, voil calcul le lieu du foyer noir,
mais aussi capital (c'est le cas de le dire) que le capitaliste (que celui-
ci occupe l'autre foyer d'un corps jouir d'un Plus ou d'un plus-
de-jouir faire corps), pour que la production capitaliste soit assure
de la rvolution propice faire durer son dur dsir, pour citer l le
pote qu'elle mritait.
Ce qui est instructif, c'est que ces propos courent les rues (
la logique prs bien sr, dont je les pourvois). Qu'ils sortent sous la
forme d'un malaise que Freud n'a fait que pressentir, allons-nous
le mettre au compte de l'inconscient ? Certainement, oui : il s'y
dsigne que quelque chose travaille. Et ce sera une occasion d'obser-
ver que ceci n'inflchit nullement l'implacable discours qui en se
compltant de l'idologie de la lutte des classes, induit seulement les
exploits rivaliser sur l'exploitation de principe, pour en abriter
leur participation patente la soif du manque--jouir.
Quoi donc attendre du chant de ce malaise ? Rien, sinon de
tmoigner de l'inconscient qu'il parle, - d'autant plus volontiers
qu'avec le non-sens il est dans son lment. Mais quel effet en
attendre puisque, vous le voyez, je souligne que c'est quelque chose
qui est, et pas une notion clef?
A se rapporter ce que j'ai instaur cette anne d'une articulation
radicale du discours du matre comme envers du discours du
psychanalyste, deux autres discours se motivant d'un quart de tour
faire passage de l'un l'autre, nommment le discours de l'hyst-
rique d'une part, le discours universitaire de l'autre, ce qui de l
s'apporte, c'est que l'inconscient n'a faire que dans la dynamique
qui prcipite la bascule d'un de ces discours dans l'autre. Or, tort
ou raison, j'ai cru pouvoir risquer de les distinguer du glissement -
435
RADIOPHONIE
d'une chane articule de l'effet du signifiant considr comme
vrit - , sur la structure - en tant que fonction du rel dans la
dispersion du savoir.
C'est partir de l qu'est juger ce que l'inconscient peut
subvertir. Certainement aucun discours, o tout au plus apparat-il
d'une infirmit de parole.
Son instance dynamique est de provoquer la bascule dont un
discours tourne un autre, par dcalage de la place o l'effet de
signifiant se produit.
A suivre ma topologie faite la serpe, on y retrouve la premire
approche freudienne en ceci que l'effet de progrs attendre de
l'inconscient, c'est la censure.
Autrement dit, que pour la suite de la crise prsente, tout indique
la procession de ce que je dfinis comme le discours universitaire,
soit, contre toute apparence tenir pour leurre en l'occasion, la
monte de sa rgie.
C'est le discours du matre lui-mme, mais renforc d'obscuran-
tisme.
C'est d'un effet de rgression par contre que s'opre le passage au
discours de l'hystrique.
Je ne l'indique que pour vous rpondre sur ce qu'il en est des
consquences de votre notion prtendue, quant la science.
Si paradoxale qu'en soit l'assertion, la science prend ses lans
du discours de l'hystrique.
Il faudrait pntrer de ce biais les corrlats d'une subversion
sexuelle l'chelle sociale, avec les moments incipients dans l'his-
toire de la science.
Ce serait rude mise l'preuve d'une pense hardie.
Elle se conoit de partir de ceci que l'hystrique, c'est le sujet
divis, autrement dit c'est l'inconscient en exercice, qui met le
matre au pied du mur de produire un savoir.
Telle fut l'ambition induite chez le matre grec sous le nom de
PmaTfjHV L o la Soa le guidait pour l'essentiel de sa conduite,
il fut somm, - et nommment par un Socrate hystrique avou de
ce qu'il dit ne s'y connatre qu'en affaire de dsir, patent par ses
symptmes pathognomoniques - de faire montre de quelque chose
qui valt la txvn de l'esclave et justifit de ses pouvoirs de matre.
Rien trancher de son succs, quand un Alcibiade n'y montre
436
RADIOPHONIE
que cette lucidit d'avouer, lui, ce qui le captive en Socrate, l'ob-
jet a, que j'ai reconnu dans Yar/o^ia dont on parle au Banquet, un
plus-de-jouir en libert et de consommation plus courte.
Le beau est que ce soit le cheminement du platonisme qui ait
rejailli dans notre science avec la rvolution copernicienne. Et s'il
faut lire Descartes et sa promotion du sujet, son je pense, je suis
donc , il ne faut pas en omettre la note Beeckman : Sur le point
de monter sur la scne du monde,je m'avance masqu...
Lisons le cogito le traduire selon la formule que Lacan donne du
message dans l'inconscient ; c'est alors : Ou tu n'es pas, ou tu ne
penses pas , adress au savoir. Qui hsiterait choisir?
Le rsultat est que la science est une idologie de la suppression
du sujet, ce que le gentilhomme de l'Universit montante sait fort
bien. Et je le sais tout autant que lui.
Le sujet, se rduire la pense de son doute, fait place au retour
en force du signifiant-matre, le doubler, sous la rubrique de l'ten-
due, d'une extriorit entirement manipulable.
Que le plus-de-jouir, donner la vrit du travail qui va suivre,
y reoive un masque de fer (c'est de lui que parle le larvatus prodeo),
comment ne pas voir que c'est s'en remettre la dignit divine (et
Descartes s'en acquitte) d'tre seule garante d'une vrit qui n'est
plus que fait de signifiant ?
Ainsi se lgitime la prvalence de l'appareil mathmatique, et l'in-
fatuation (momentane) de la catgorie quantit.
Si la qualit n'tait pas aussi encombre de signifi, elle serait aussi
propice au discernement scientifique : qu'il suffise de la voir faire
retour sous la forme de signes (+) et (-) dans l'difice de l'lectro-
magntisme.
Et la logique mathmatique (Dieu merci ! car moi, j'appelle Dieu
par son nom-de-Dieu de Nom) nous fait revenir la structure dans
le savoir.
Mais vous voyez que si la connaissance n'a pas encore repris
connaissance, c'est que ce n'est pas du fait de l'inconscient qu'elle l'a
perdue. Et il y a peu de chances que ce soit lui qui la ranime.
De mme qu'on sait que la connaissance a err en physique, tant
qu'elle a voulu s'insrer de quelque dpart esthsique,- qu'est reste
noue la thorie du mouvement, tant qu'elle ne s'est pas dptre
du sentiment de l'impulsion, - que c'est seulement au retour du
437
RADIOPHONIE
refoul des signifiants, qu'est d qu'enfin se livre l'quivalence du
repos au mouvement uniforme, de mme le discours de l'hystrique
dmontre qu'il n'y a aucune esthsie du sexe oppos (nulle connais-
sance au sens biblique) rendre compte du prtendu rapport sexuel.
La jouissance dont il se supporte est, comme toute autre, articule
du plus-de-jouir par quoi dans ce rapport le partenaire ne s'atteint :
1) pour le vit qu' l'identifier l'objet a, fait pourtant clairement
indiqu dans le mythe de la cte d'Adam, celui qui faisait tant rire,
et pour cause, la plus clbre pistolire de l'homosexualit fmi-
nine, 2) pour la virgo qu' le rduire au phallus, soit au pnis imagin
comme organe de la tumescence, soit l'inverse de sa relle fonction.
D'o les deux rocs : 1) de la castration o le signifiant-femme
s'inscrit comme privation, 2) de l'envie du pnis o le signifiant-
homme est ressenti comme frustration.
Ce sont cueils mettre la merci de la rencontre l'accs prn
par des psychanalystes la maturit du gnital.
Car c'est l l'idal btard dont ceux qui se disent d'aujourd'hui
masquent qu'ici la cause est d'acte et de l'thique qu'il anime, avec
sa raison politique.
C'est aussi bien ce dont le discours de l'hystrique questionne
le matre : Fais voir si t'es un homme ! Mais la reprsentation de
chose, comme dit Freud, ici n'est .plus que reprsentation de son
manque. La toute-puissance n'est pas ; c'est bien pour cela qu'elle se
pense. Et qu'il n'y a pas de reproche lui en faire, comme le psycha-
nalyste s'y obstine imbcilement.
L'intrt n'est pas l : faire son deuil de l'essence du mle, mais
produire le savoir dont se dtermine la cause qui fait dfi en son
tant.
L-dessus, l'on dira non sans prtexte que les psychanalystes
en question ne veulent rien savoir de la politique. L'ennuyeux est
qu'ils sont assez endurcis pour en faire profession eux-mmes, et que
le reproche leur en vienne de ceux qui, pour s'tre logs au discours
du matre Marx, font obligation des insignes de la normalisation
conjugale : ce qui devrait les embarrasser sur le point pineux d'
l'instant.
Dtail au regard de ce qui nous intresse : c'est que l'inconscient
ne subvertira pas notre science lui faire faire amende honorable
aucune forme de connaissance.
438
RADIOPHONIE
Qu'il fasse semblant parfois de ce que la nique qu'il y introduit,
soit celle des nocturnes habitant l'aile effondre du chteau de la
tradition, l'inconscient s'il est clef, ce ne le sera qu' fermer la porte
qui berait dans ce trou de votre chambre coucher.
Les amateurs d'initiation ne sont pas nos invits. Freud l-dessus
ne badinait pas. Il profrait l'anathme du dgot contre ces sorti-
lges et n'entendait pas que Jung ft que rebruit nos oreilles des airs
de mandatas.
a n'empchera pas les offices de se clbrer avec des coussins
pour nos genoux, mais l'inconscient n'y apporterait que des rires
peu dcents.
Pour l'usage mnager, il serait recommander comme tournesol
constituer l'ventail du ractionnaire en matire de connaissance.
Il restitue par exemple Hegel le prix de l'humour qu'il mrite,
mais en rvle l'absence totale dans toute la philosophie qui lui suc-
cde, mis part Marx.
Je n'en dirai que l'chantillon dernier venu ma connaissance ,
ce retour incroyable la puissance de l'invisible, plus angoissant
d'tre posthume et pour moi d'un ami, comme si le visible avait
encore pour aucun regard apparence d'tant.
Ces simagres phnomnologiques tournent toutes autour de
l'arbre fantme de la connaissance supranormale, comme s'il y en
avait une de normale.
Nulle clameur d'tre ou de nant qui ne s'teigne de ce que le
marxisme a dmontr par sa rvolution effective : qu'il n'y a nul
progrs attendre de vrit ni de bien-tre, mais seulement le virage
de l'impuissance imaginaire l'impossible qui s'avre d'tre le rel
ne se fonder qu'en logique : soit l o j'avertis que l'inconscient
sige, mais pas pour dire que la logique de ce virage n'ait pas se
hter de l'acte.
Car l'inconscient joue aussi bien d'un autre sens : soit partir de
l'impossibilit dont le sexe s'inscrit dans l'inconscient, maintenir
comme dsirable la loi dont se connote l'impuissance jouir.
Il faut le dire : le psychanalyste n'a pas ici prendre parti, mais
dresser constat.
C'est en quoi je tmoigne que nulle rigueur que j'aie pu mettre
marquer ici les dfaillances de la suture, n'a rencontr des commu-
nistes qui j'ai eu affaire qu'une fin de non-recevoir.
439
RADIOPHONIE
J'en rends compte du fait que les communistes, se constituer
dans l'ordre bourgeois en contre-socit, seulement vont contre-
faire tout ce dont le premier se fait honneur : travail, famille, patrie, y
font trafic d'influence, et syndicat contre quiconque de leur discours
viderait les paradoxes.
A dmontrer ceux-ci comme facteur de pathologie, soit depuis
mes propos sur la causalit psychique, partout o mon eflfort et pu
desceller le monopole psychiatrique, je n'ai jamais recueilli d'eux,
de rponse qui ne s'alignt sur l'hypocrisie universitaire, dont ce
serait une autre histoire que de prdire le dploiement.
Il est vident que maintenant ils se servent de moi tout autant
qu'elle. Moins le cynisme de ne pas me nommer : ce sont gens hono-
rables.
QUESTION VI
En quoi savoir et vrit sont-ils incompatibles ?
RPONSE
Incompatibles. Mot joliment choisi qui pourrait nous permettre
de rpondre la question par la nasarde qu'elle vaut : mais si, mais
si, ils compatissent.
Qu'ils sourent ensemble, et l'un de l'autre : c'est la vrit.
Mais ce que vous voulez dire, si je vous le prte bien, c'est
que vrit et savoir ne sont pas complmentaires, ne font pas un
tout.
Excusez-moi : c'est une question que je ne me pose pas. Puisqu'il
n'y a pas de tout.
Puisqu'il n'y a pas de tout, rien n'est tout.
Le tout, c'est l'index de la connaissance. J'ai assez dit, me semble-
til, qu' ce titre, il est impossible de le pointer.
a ne m'empchera pas d'enchaner du primesaut que la vrit
souffre tout : on pisse, on tousse, on crache dedans. Ma parole !
s'crie-t-elle du style que j'ai esquiss ailleurs. Qu'est-ce que vous
faites?Vous croyez-vous chez vous? a veut dire qu'elle a bien
une notion, une notion clef de ce que vous faites. (Mais pas vous de
440
RADIOPHONIE
ce qu'elle est, et c'est en cela, enfin voyez-vous, que l'inconscient
consiste.) Pour revenir elle, qui nous occupe pour l'instant, dire
qu'elle souffre tout, rose du discours ! peut vouloir dire que a ne
lui fait ni chaud ni froid. C'est ce qui laisse penser que manifeste-
ment elle soit aveugle ou sourde, au moins quand elle vous regarde,
ou bien que vous l'assignez.
A vrai dire, c'est--dire se mesurer elle, on fera toujours mieux
pour l'approcher de se munir d'un savoir lourd. C'est donc plus que
compatible, comme comptabilit, - soit ce qui vous intresse
d'abord puisque le savoir peut solder les fiais d'une affaire avec la
vrit, si l'envie vous en prend.
Solder jusqu'o? a, on ne sait pas, c'est mme ce par quoi
le savoir est bien forc de ne s'en fier qu' lui pour ce qui est de
faire le poids.
Donc, le savoir fait dot. Ce qu'il y a d'admirable, c'est la prten-
tion de qui voudrait se faire aimer sans ce matelas. Il s'offre la poi-
trine nue. Qu'adorable doit tre son non-savoir , comme on s'ex-
prime assez volontiers dans ce cas !
tonnez-vous qu'on ressorte de l, tenant, bon chien, entre les
dents, sa propre charogne !
Naturellement a n'arrive plus, mais a se sait encore. Et cause
de cela, il y en a qui jouent le faire, mais de semblant. Vous voyez
tout ce qui trafique partir de ce que savoir et vrit soient
incompatibles.
Je ne pense a que parce que c'est un leurre qu'on a, je crois,
imagin pour en justifier un amok fait mon gard : posons qu'une
personne qui se plaindrait d'tre mordue par la vrit, s'avouerait
comme f.. .ue psychanalyste.
Trs prcisment je n'ai articul la topologie qui met frontire
entre vrit et savoir, qu' montrer que cette frontire est partout
et ne fixe de domaine qu' ce qu'on se mette aimer son au-del.
Les voies des psychanalystes restent prserves assez pour
que l'exprience propre les clairer n'en soit encore qu'au pro-
gramme.
C'est pourquoi je prendrai le dpart d'o chacun fait de son
abord tranglement : exemplaire, d'tre exempt de l'exprience.
N'est-il pas tonnant que de la formule quoi depuis plus d'une
dcade j'ai donn essor, celle dite du sujet suppos savoir, pour
441
RADIOPHONIE
rendre raison du transfert, personne, et mme au cours de cette anne
o la chose s'talait au tableau, plus vidente que la case y ft
inscrite sparment de la bille la remplir, personne, dis-je, n'en a
avanc la question : est-ce, suppos qu'il est ce sujet, savoir la vrit ?
Vous apercevez-vous o a va ? N'y pensez pas surtout, vous ris-
queriez de tuer le transfert.
Car du savoir dont le transfert fait le sujet, il s'avre mesure que
l'assujetti y travaille, qu'il n'tait qu'un savoir y faire avec la vrit.
Personne ne rve que le psychanalyste est mari avec la vrit.
C'est mme pour a que son pouse fait grelot, certes ne pas trop
remuer, mais qu'il faut l comme un barrage.
Barrage quoi ? A la supposition qui serait le comble : de ce qui
ferait le psychanalyste fianc la vrit.
C'est qu' la vrit avec il n'y a pas de rapports d'amour possibles,
ni de mariage, ni d'union libre. Il n'y en a qu'un de sr, si vous voulez
qu'elle vous ait bien, la castration, la vtre, bien entendu, et d'elle,
pas de piti.
Savoir que c'est comme a, n'empche pas que a arrive, et bien
sr, encore moins qu'on l'vite.
Mais on l'oublie quand on l'vite, alors que quand c'est arriv,
on ne le sait pas moins.
C'est, me semble-t-il, le comble de. la compatibilit. On grincerait
des dents -n'en pas faire : la comblatibilit, pour qu'un bruit de vol
vous en revienne qui fait batte et proprement patibulaire.
C'est que de la vrit, on n'a pas tout apprendre. Un bout
suffit : ce qui s'exprime, vu la structure, par : en savoir un bout.
L-dessus j'ai su conduire certains, et je m'tonne d'en dire autant
la radio. C'est qu'ici ceux qui m'coutent n'ont pas, entendre ce
que je dis, l'obstacle de m'entendre. O m'apparat que cet obstacle
tient ce qu'ailleurs j'aie le calculer.
Or je ne suis pas ici former le psychanalyste, mais rpondre
vos questions ceci qui les remet leur place.
Sa discipline ce qu'il me suive, lui, le pntre de ceci : que le
rel n'est pas d'abord pour tre su.
Comme vrit, c'est bien la digue dissuader le moindre essai
d'idalisme. Alors qu' la mconnatre, il prend rang sous les cou-
leurs les plus contraires.
Mais ce n'est pas une vrit, c'est la limite de la vrit.
442
RADIOPHONIE
Car la vrit se situe de supposer ce qui du rel fait fonction dans
le savoir, qui s'y ajoute (au rel).
C'est bien en effet de l que le savoir porte le faux tre, et
mme tre-l, soit Dasein t'assaner jusqu' ce qu'en perdent le
souffle tous les participants de la crmonie.
A vrai dire, ce n'est que du faux tre qu'on se proccupe
en tant que telle de la vrit. Le savoir qui n'est pas faux, s'en
balance.
Il n'y en a qu'un o elle s'avre en surprise. Et c'est pourquoi
il est considr comme d'un got douteux, quand c'est bien de la
grce freudienne qu'il produit quelques pataqu'est-ce dans le dis-
cours.
C'est ce joint au rel, que se trouve l'incidence politique o le
psychanalyste aurait place s'il en tait capable.
L serait l'acte qui met enjeu de quel savoir faire la loi. Rvolu-
tion qui arrive de ce qu'un savoir se rduise faire symptme, vu du
regard mme qu'il a produit.
Son recours alors est la vrit pour laquelle on se bat.
O s'articule que l'effet de vrit tient ce qui choit du savoir,
soit ce qui s'en produit, d'impuissant pourtant nourrir ledit effet.
Ciruit pas moins vou ne pouvoir tre perptuel qu'aucun mou-
vement,- d'o se dmontre ici aussi le rel d'une autre nergtique.
C'est lui, ce rel, l'heure de la vrit passe, qui va s'brouer jus-
qu' la prochaine crise, ayant retrouv du lustre. On dirait mme que
c'est la fte de toute rvolution : que le trouble de la vrit en soit
rejet aux tnbres. Mais au rel, il n'est jamais vu que du feu, mme
ainsi illustr.
QUESTION VII
Gouverner, duquer, psychanalyser sont trois gageures impossibles tenir
Pourtant cette perptuelle contestation de tout discours, et notamment du
sien, il faut bien que le psychanalyste s'y accroche. H s'accroche un savoir-
le savoir analytique - que par dfinition il conteste. Comment rsolvez-vous
- ou pas - cette contradiction ? Statut de l'impossible ? L'impossible, c'est le
rel?
443
RADIOPHONIE
RPONSE
Pardon si, de cette question encore, je n'atteins la rponse qu' la
rhabiller de mes mains.
Gouverner, y duquer, psychanalyser sont gageures en effet, mais
qu' dire impossibles, on ne tient l que de les assurer prmatu-
rment d'tre relles.
Le moins qu'on puisse leur imposer, c'est d'en faire la preuve.
Ce n'est pas l contester ce que vous appelez leur discours.
Pourquoi le psychanalyste en aurait-il au reste le privilge, s'il ne se
trouvait les agencer du pas, le mme qu'il reoit du rel, pousser le
sien?
Notons que ce pas, il l'tablit de l'acte mme dont il l'avance ; et
que c'est au rel dont ce pas fait fonction, qu'il soumet les discours
qu'il met au pas de la synchronie du dit.
S'installant du pas qu'il produit, cette synchronie n'a d'origine
que de son mergence. Elle limite le nombre des discours qu'elle
assujettit, comme j'ai fait au plus court de les structurer au nombre
de quatre d'une rvolution non permutative en leur position, de
quatre termes, le pas de rel qui s'en soutient tant ds lors univoque
dans son progrs comme dans sa rgression.
Le caractre opratoire de ce pas est qu'une disjonction y rompt
la synchronie entre des termes chaque fois diffrents, justement de
ce qu'elle soit fixe.
A la vrit l n'a lyse faire de son nom ce qui, dans le proverbe que
vous agitez aprs Freud, s'appelle gurir et qui fait rire trop gaiement.
Gouverner, duquer, gurir donc qui sait? Par l'analyse, le qua-
trime y rabattre d'y faire figure de Lisette : c'est le discours de
l'hystrique.
Mais quoi ! l'impossibilit des deux derniers s'en proposerait-elle
sous le mode d'alibi des premiers ? Ou bien plutt de les rsoudre
en impuissance ?
Par l'analyse, l n'a lyse, permettez ce jeu encore, que l'impossi-
bilit de gouverner ce qu'on ne matrise pas, la traduire en impuis-
sance de la synchronie de nos termes : commander au savoir. Pour
l'inconscient, c'est coton.
Pour l'hystrique, c'est l'impuissance du savoir que provoque son
discours, s'animer du dsir, - qui livre en quoi duquer choue.
444
RADIOPHONIE
Chiasme frappant de n'tre pas le bon, sinon dnoncer d'o les
impossibilits se font aise se profrer en alibis.
Comment les obliger dmontrer leur rel, de la relation mme
qui, tre l, en fait fonction comme impossible ?
Or la structure de chaque discours y ncessite une impuissance,
dfinie par la barrire de la jouissance, s'y diffrencier comme dis-
jonction, toujours la mme, de sa production sa vrit.
Dans le discours du matre, c'est le plus-de-jouir qui ne satisfait le
sujet qu' soutenir la ralit du seul fantasme.
Dans le discours universitaire, c'est la bance o s'engouffre le
sujet qu'il produit de devoir supposer un auteur au savoir.
Ce sont l vrits, mais o se lit encore qu'elles sont piges vous
fixer sur le chemin d'o le rel en vient au fait.
Car elles ne sont que consquences du discours qui en provient.
Mais ce discours, il a surgi de la bascule o l'inconscient, je l'ai
dit, fait dynamique le faire fonction en progrs , soit pour le pire,
sur le discours qui le prcde d'un certain sens rotatoire.
Ainsi le discours du matre trouve sa raison du discours de l'hyst-
rique ce qu' se faire l'agent du tout-puissant, il renonce
rpondre comme homme ce qu' le solliciter d'tre, l'hystrique
n'obtenait que de savoir. C'est au savoir de l'esclave qu'il s'en remet
ds lors de produire le plus-de-jouir dont, partir du sien (du sien
savoir), il n'obtenait pas que la femme fut cause de son dsir (je ne
dis pas : objet).
D'o s'assure que l'impossibilit de gouverner ne sera serre dans
son rel qu' travailler rgressivement la rigueur d'un dveloppe-
ment qui ncessite le manque jouir son dpart, s'il le maintient
sa fin.
C'est au contraire d'tre en progrs sur le discours universitaire
que le discours de l'analyste lui pourrait permettre de cerner le rel
dont fait fonction son impossibilit, soit ce qu'il veuille bien sou-
mettre la question du plus-de-jouir qui a dj dans un savoir sa
vrit, le passage du sujet au signifiant du matre.
C'est supposer le savoir de la structure qui, dans le discours de
l'analyste, a place de vrit.
C'est dire de quelle suspicion ce discours doit soutenir tout ce
qui se prsente cette place.
Car l'impuissance n'est pas la guise dont l'impossible serait la
445
RADIOPHONIE
vrit, mais ce n'est pas non plus le contraire : l'impuissance rendrait
service fixer le regard si la vrit ne s'y voyait pas au point de s'en-
voyer. .. en l'air.
Il faut cesser ces jeux dont la vrit fait les frais drisoires.
Ce n'est qu' pousser l'impossible en ses retranchements que
l'impuissance prend le pouvoir de faire tourner le patient l'agent.
C'est ainsi qu'elle vient en acte en chaque rvolution dont la
structure ait pas faire, pour que l'impuissance change de mode
bien entendu.
Ainsi le langage fait novation de ce qu'il rvle de la jouissance et
surgir le fantasme qu'il ralise un temps.
Il n'approche le rel qu' la mesure du discours qui rduise le dit
faire trou dans son calcul.
De tels discours, l'heure actuelle il n'y a pas des tas.
446
RADIOPHONIE
Note sur la rponse la VIF question
Pour faciliter la lecture, je reproduis ici les schmes structuraux des
quatre discours qui ont fait cette anne le sujet de mon sminaire. Pour
ceux qui n'en ont pas suivi le dveloppement.
Discours de l'envers de la psychanalyse
Discours du Matre
o impossibilit
s'claire par
rgression du :
Discours de l'Universit
s'claire de son
progrs dans le :
Discours de l'Hystrique
8 S,
" "57
Discours de l'Analyste
% impossibilit &
Les places sont celles de :
l'agent l'autre
la vrit la production
Les termes sont :
Sj le signifiant-matre
S
2
le savoir
S le sujet
a le plus-de-jouir
L'tourdit
En contribuant au 50
e
anniversaire de l'hpital Henri-Rousselle
pour la faveur que les miens et moi y avons reue dans un travail
dont j'indiquerai ce qu'il savait faire, soit passer la prsentation, je
rends hommage au Dr Daumzon qui me l'a permis.
Ce qui suit ne prjuge, selon ma coutume, rien de l'intrt qu'y
prendra son adresse : mon dire Sainte-Anne fut vacuole, tout comme
Henri-Rousselle et, l'imagine-t-on, depuis presque le mme temps,
y gardant en tout tat de cause le prix de cette lettre que je dis par-
venir toujours o elle doit.
Je pars de miettes, certes pas philosophiques, puisque c'est de mon
sminaire de cette anne ( Paris-I) qu'elles font relief.
J'y ai inscrit deux reprises au tableau (d'une troisime Milan
o itinrant, j'en avais fait banderole pour un flash sur le discours
psychanalytique ) ces deux phrases :
Qu'on dise reste oubli derrire ce qui se dit dans ce qui
s'entend.
Cet nonc qui parat d'assertion pour se produire dans une
forme universelle, est de fait modal, existentiel comme tel : le sub-
jonctif dont se module son sujet, en tmoignant.
Si le bienvenu qui de mon auditoire me rpond assez pour que le
terme de sminaire ne soit pas trop indigne de ce que j'y porte de
parole, ne m'avait de ces phrases dtourn, j'eusse voulu de leur
rapport de signification dmontrer le sens qu'elles prennent du
discours psychanalytique. L'opposition qu'ici j'voque devant tre
plus loin accentue.
Je rappelle que c'est de la logique que ce discours touche au rel
le rencontrer comme impossible, en quoi c'est ce discours qui
la porte sa puissance dernire : science, ai-je dit, du rel. Qu'ici me
449
L'TOURDIT
pardonnent ceux qui d'y tre intresss, ne le savent pas. Les mna-
gerais-je encore, qu'ils l'apprendraient bientt des vnements...
La signification, d'tre grammaticale, entrine d'abord que la
seconde phrase porte sur la premire, en faire son sujet sous forme
d'un particulier. Elle dit : cet nonc, puis qualifie celui-ci de l'asser-
tif de se poser comme vrai, l'en confirmant d'tre sous forme de
proposition dite universelle en logique : c'est en tout cas que le dire
reste oubli derrire le dit.
Mais d'antithse, soit du mme plan, en un second temps elle
en dnonce le semblant : l'affirmer du fait que son sujet soit
modal, et le prouver de ce qu'il se module grammaticalement
comme : qu'on dise. Ce qu'elle rappelle non pas tant la mmoire
que, comme on dit : l'existence.
La premire phrase n'est donc pas de ce plan thtique de vrit
que le premier temps de la seconde assure, comme d'ordinaire, au
moyen de tautologies (ici deux). Ce qui est rappel, c'est que son
nonciation est moment d'existence, c'est que, situe du discours,
elle ex-siste la vrit.
Reconnaissons ici la voie par o advient le ncessaire : en bonne
logique s'entend, celle qui ordonne ses modes de procder d'o elle
accde, soit cet impossible, modique sans doute quoique ds lors
incommode, que pour qu'un dit soit vrai, encore faut-il qu'on le
dise, que dire il y en ait.
En quoi la grammaire mesure dj force et faiblesse des logiques
qui s'en isolent, pour, de son subjonctif, les cliver, et s'indique en
concentrer la puissance, de toutes les frayer.
Car, j'y reviens une fois de plus, il n'y a pas de mtalangage
tel qu'aucune des logiques, s'intituler de la proposition, puisse s'en
faire bquille (qu' chacune reste son imbcillit), et si l'on croit
le retrouver dans ma rfrence, plus haut, au discours, je le rfute de
ce que la phrase qui a l'air l de faire objet pour la seconde, ne s'en
applique pas moins significativement celle-ci.
Car cette seconde, qu'on la dise reste oubli derrire ce qu'elle
dit. Et ceci de faon d'autant plus frappante qu'assertive, elle sans
rmission au point d'tre tautologique en les preuves qu'elle avance,
- dnoncer dans la premire son semblant, elle pose son propre
dire comme inexistant, puisqu'en contestant celle-ci comme dit de
450
L'TOURDIT
vrit, c'est l'existence qu'elle fait rpondre de son dire, ceci non pas
de faire ce dire exister puisque seulement elle le dnomme, mais
d'en nier la vrit - sans le dire.
A tendre ce procs, nat la formule, mienne, qu'il n'y a pas d'uni-
verselle qui ne doive se contenir d'une existence qui la nie. Tel le
strotype que tout homme soit mortel, ne s'nonce pas de nulle part.
La logique qui le date, n'est que celle d'une philosophie qui feint cette
nullibiquit, ce pour faire alibi ce que je dnomme discours du
matre.
Or ce n'est pas de ce seul discours, mais de la place o font tour
d'autres (d'autres discours), celle que je dsigne du semblant, qu'un
dire prend son sens.
Cette place n'est pas pour tous, mais elle leur ex-siste, et c'est de l
que s'hommologue que tous soient mortels. Ils ne peuvent que l'tre
tous, parce qu' la mort on les dlgue de cette place, tous il faut
bien, puisque c'est l qu'on veille la merveille du bien de tous. Et
particulirement quand ce qui y veille y fait semblant du signifiant-
matre ou du savoir. D'o la ritournelle de la logique philosophique.
Il n'y a donc pas d'universel qui ne se rduise au possible. Mme
la mort, puisque c'est l la pointe dont seulement elle s'articule. Si
universelle qu'on la pose, elle ne reste jamais que possible. Que la loi
s'allge de s'affirmer comme formule de nulle part, c'est--dire
d'tre sans raison, confirme encore d'o part son dire.
Avant de rendre l'analyse le mrite de cette aperception, acquit-
tons-nous envers nos phrases remarquer que dans ce qui s'en-
tend de la premire, se branche galement sur l'existence du reste
oubli que relve la seconde et sur le ce qui se dit qu'elle-mme
dnonce comme, ce reste, le couvrant.
O je note au passage le dfaut de l'essai transformationnel de
faire logique d'un recours une structure profonde qui serait un
arbre tages.
Et je reviens au sens pour rappeler la peine qu'il faut la philo-
sophie - la dernire en sauver l'honneur d'tre la page dont
l'analyste fait l'absence - pour apercevoir ce qui est sa ressource,
lui, de tous les jours : que rien ne cache autant que ce qui dvoile,
que la vrit, 'AXfjeia = Verborgenheit.
451
L'TOURDIT
Ainsi ne reni-je pas la fraternit de ce dire, puisque je ne le
rpte qu' partir d'une pratique qui, se situant d'un autre discours,
le rend incontestable.
Pour ceux qui m'coutent... ou pire, cet exercice n'et fait que
confirmer la logique dont s'articulent dans l'analyse castration et
dipe.
Freud nous met sur la voie de ce que l'ab-sens dsigne le sexe :
c'est la gonfle de ce sens-absexe qu'une topologie se dploie o
c'est le mot qui tranche.
Partant de la locution : a ne va pas sans dire , on voit que c'est
le cas de beaucoup de choses, de la plupart mme, y compris de la
chose freudienne telle que je l'ai situe d'tre le dit de la vrit.
N'aller pas sans... c'est faire couple, ce qui, comme on dit, ne va
pas tout seul .
C'est ainsi que le dit ne va pas sans dire. Mais si le dit se pose
toujours en vrit, fut-ce ne jamais dpasser un midit (comme je
m'exprime), le dire ne s'y couple que d'y ex-sister, soit de n'tre pas
de la dit-mension de la vrit.
Il est facile de rendre cela sensible dans le discours de la math-
matique o cpnstamment le dit se renouvelle de prendre sujet
d'un dire plutt que d'aucune ralit, quitte, ce dire, le sommer de
la suite proprement logique qu'il implique comme dit.
Pas besoin du dire de Cantor pour toucher cela. a commence
Euclide.
Si j'ai recouru cette anne au premier, soit la thorie des
ensembles, c'est pour y rapporter la merveilleuse efflorescence qui,
d'isoler dans la logique l'incomplet de l'inconsistant, l'indmontrable
du rfutable, voire d'y adjoindre l'indcidable de ne pas arriver
s'exclure de la dmontrabilit, nous met assez au pied du mur de
l'impossible pour que s'vince le ce n'est pas a , qui est le vagisse-
ment de l'appel au rel.
J'ai dit discours de la mathmatique. Non langage de la mme.
Qu'on y prenne garde pour le moment o je reviendrai l'incons-
cient, structur comme un langage, ai-je dit de toujours. Car c'est
dans l'analyse qu'il s'ordonne en discours.
Reste marquer que le mathmaticien a avec son langage le
mme embarras que nous avec l'inconscient, le traduire de cette
452
L'TOURDIT
pense qu'il ne sait pas de quoi il parle, fut-ce l'assurer d'tre vrai
(Russell).
Pour tre le langage le plus propice au discours scientifique, la
mathmatique est la science sans conscience dont fait promesse
notre bon Rabelais, celle laquelle un philosophe
l
ne peut que res-
ter bouch : la gaye science se rjouissait d'en prsumer ruine de
l'me. Bien sr, la nvrose y survit.
Ceci remarqu, le dire se dmontre, et d'chapper au dit. Ds lors
ce privilge, il ne l'assure qu' se formuler en dire que non , si,
aller au sens, c'est le contien qu'on y saisit, non la contradiction, la
rponse, non la reprise en ngation, - le rejet, non la correction.
Rpondre ainsi suspend ce que le dit a de vritable.
Ce qui s'claire du jour rasant que le discours analytique apporte
aux autres, y rvlant les lieux modaux dont leur ronde s'accomplit.
Je mtaphoriserai pour l'instant de l'inceste le rapport que la
vrit entretient avec le rel. Le dire vient d'o il la commande.
Mais ne peut-il y avoir aussi dire direct?
Dire ce qu'il y a, a ne vous dit rien, chers petits de la salle de
garde, sans doute dite ainsi de ce qu'elle se garde bien de contrarier
le patronat o elle aspire (et quel qu'il soit).
Dire ce qu'il y a, pendant longtemps a vous haussa son homme
i. Le philosophe s'inscrit (au sens o on le dit d'une circonfrence) dans le dis-
cours du matre. Il y joue le rle du fou. a ne veut pas dire que ce qu'il dit soit
sot ; c'est mme plus qu'utilisable. Lisez Shakespeare.
a ne dit pas non plus, qu'on y prenne garde, qu'il sache ce qu'il dit. Le fou de
cour a un rle : celui d'tre le tenant-lieu de la vrit. Il le peut s'exprimer
comme un langage, tout comme l'inconscient. Qu'il en soit, lui, dans l'inconscience
est secondaire, ce qui importe est que le rle soit tenu.
Ainsi Hegel, de parler aussi juste du langage mathmatique que Bertrand Rus-
sell, n'en loupe pas moins la commande : c'est que Bertrand Russell est dans le dis-
cours de la science.
Kojve que je tiens pour mon matre, de m'avoir initi Hegel, avait la mme
partialit l'gard des mathmatiques, mais il faut dire qu'il en tait au temps de
Russell, et qu'il ne philosophisait qu'au titre du discours universitaire o il s'tait
rang par provision, mais sachant bien que son savoir n'y fonctionnait que comme
semblant et le traitant comme tel : il l'a montr de toutes manires, livrant ses notes
qui pouvait en faire profit et posthumant sa drision de toute l'aventure.
Ce mpris qui tut le sien, se soutenait de son discours de dpart qui tut aussi
celui o il retourna : le grand commis sait traiter les bouffons aussi bien que les
autres, soit en sujets, qu'ils sont, du souverain.
453
L'TOURDIT
jusqu' cette profession qui ne vous hante plus que de son vide : le
mdecin qui dans tous les ges et sur toute la surface du globe, sur ce
qu'il y a, se prononce. Mais c'est encore partir de ceci que ce qu'il
y a, n'a d'intrt qu' devoir tre conjur.
Au point o l'histoire a rduit cette fonction sacrale, je comprends
votre malaise. Pas mme possible pour vous, le temps n'y tant
plus, de jouer au philosophe qui fut la mue dernire o, de faire la
valetaille des empereurs et des princes, les mdecins se survcurent
(Usez Fernel).
Sachez pourtant, quoique l'analyse soit d'un autre sigle - mais
qu'elle vous tente, a se comprend - ce dont je tmoigne d'abord.
Je le dis, de ce que ce soit dmontr sans exception de ceux que
j'ai appels mes dandys : il n'y a pas le moindre accs au dire de
Freud qui ne soit forclos - et sans retour dans ce cas - par le choix
de tel analyste.
C'est qu'il n'y a pas de formation de l'analyste concevable hors
du maintien de ce dire, et que Freud, faute d'avoir forg avec le dis-
cours de l'analyste, le lien dont auraient tenu les socits de psycha-
nalyse, les a situes d'autres discours qui barrent son dire ncessaire-
ment.
Ce que tous mes crits dmontrent.
Le dire de Freud s'infre de la logique qui prend de source le dit
de l'inconscient. C'est en tant que Freud a dcouvert ce dit qu'il ex-
siste.
En restituer ce dire, est ncessaire ce que le discours se constitue
de l'analyse (c'est quoi j'aide), ce partir de l'exprience o il s'avre
exister.
On ne peut, ce dire, le traduire en termes de vrit puisque de
vrit il n'y a que midit, bien coup, mais qu'il y ait ce midit net (il
se conjugue en remontant : tu mdites, je mdis), ne prend son sens
que de ce dire.
Ce dire n'est pas libre, mais se produit d'en relayer d'autres qui
proviennent d'autres discours. C'est se fermer dans l'analyse (cf. ma
Radiophonie, le numro juste d'avant de cet apriodique) que leur
ronde situe les lieux dont se cerne ce dire.
Ils le cernent comme rel, c'est--dire de l'impossible, lequel
s'annonce :
454
L'TOURDIT
il n'y a pas de rapport sexuel
Ceci suppose que de rapport (de rapport en gnral), il n'y a
qu'nonc, et que le rel ne s'en assure qu' se confirmer de la
limite qui se dmontre des suites logiques de l'nonc.
Ici limite immdiate, de ce que n'y a rien faire rapport d'un
nonc.
De ce fait, nulle suite logique, ce qui n'est pas niable, mais que ne
suffit supporter nulle ngation : seulement le dire que : nya.
Nia n'y apportant que juste d'homophonie ce qu'il faut en fran-
ais pour, du pass qu'il signifie, d'aucun prsent dont s'y connote
l'existence marquer que nya la trace.
Mais de quoi s'agit-il ? Du rapport de l'homme et de la femme en
tant justement qu'ils seraient propres, de ce qu'ils habitent le lan-
gage, faire nonc de ce rapport.
Est-ce l'absence de ce rapport qui les exile en stabitat? Est-ce
d'iabiter que ce rapport ne peut tre qu'inter-dit?
Ce n'est pas la question : bien plutt la rponse, et la rponse qui
la supporte, - d'tre ce qui la stimule se rpter - , c'est le rel.
Admettons-le : o il est-l. Rien attendre de remonter au dluge,
alors que dj celui-ci se raconte de rtribuer le rapport de la
femme aux anges.
Illustrons pourtant cette fonction de la rponse d'un apologue,
logue aux abois d'tre fourni par le psychologue, puisque l'me est
aboi, et mme, prononcer (a) petit a, (a)boi.
Le malheur est que le psychologue, pour ne soutenir son secteur
que de la thologie, veut que le psychique soit normal, moyennant
quoi il labore ce qui le supprimerait.
Vlnnenwelt et VUmwelt notamment, alors qu'il ferait mieux de
s'occuper de l'homme-volte qui fait le labyrinthe dont l'homme ne
sort pas.
Le couple stimulus-rponse passe l'aveu de ses inventions. Appe-
ler rponse ce qui permettrait l'individu de se maintenir en vie est
excellent, mais que a se termine vite et mal, ouvre la question qui
se rsout de ce que la vie reproduit l'individu, donc reproduit aussi
bien la question, ce qui se dit dans ce cas qu'elle se r-pte.
C'est bien ce qui se dcouvre de l'inconscient, lequel ds lors
s'avre tre rponse, mais de ce que ce soit elle qui stimule.
455
L'TOURDIT
C't aussi en quoi, quoi qu'il en ait, le psychologue rentre dans
Thomme-volte de la rptition, celle qu'on sait se produire de l'in-
conscient.
La vie sans doute reproduit, Dieu sait quoi et pourquoi. Mais la
rponse ne fait question que l o il n'y a pas de rapport supporter
la reproduction de la vie.
Sauf ce que l'inconscient formule : Comment l'homme se
reproduit-il ? , ce qui est le cas.
- A reproduire la question , c'est la rponse. Ou pour te faire
parler , autrement dit qu'a l'inconscient, d'ex-sister.
C'est partir de l qu'il nous faut obtenir deux universels, deux
tous suffisamment consistants pour sparer chez des parlants, - qui,
d'tre des, se croient des tres -, deux moitis telles qu'elles ne s'em-
brouillent pas trop dans la cotration quand ils y arrivent.
Moiti dit en franais que c'est une affaire de moi, la moiti de
poulet qui ouvrait mon premier livre de lecture m'ayant en outre
fray la division du sujet.
Le corps des parlants est sujet se diviser de ses organes, assez
pour avoir leur trouver fonction. Il y faut parfois des ges : pour
un prpuce qui prend usage de la circoncision, voyez l'appendice
l'attendre pendant des sicles, de la chirurgie.
C'est ainsi que du discours psychanalytique, un organe se fait
le signifiant. Celui qu'on peut dire s'isoler dans la ralit corporelle
comme appt, d'y fonctionner (la fonction lui tant dlgue d'un
discours) :
a) en tant que phanre la faveur de son aspect de plaquage amo-
vible qui s'accentue de son rectilit,
b) pour tre attrape, o ce dernier accent contribue, dans les
diverses pches qui font discours des voracits dont se tamponne
l'inexistence du rapport sexuel.
On reconnat, mme de ce mode d'vacuation, bien sr l'organe
qui d'tre, disons, l'actif du mle, fait celui-ci, dans le dit de la
copulation, dcerner l'actif du verbe. C'est le mme que ses noms
divers, dans la langue dont j'use, bien symptomatiquement fmi-
nisent.
Il ne faut pourtant pas s'y tromper : pour la fonction qu'il tient
du discours, il est pass au signifiant. Un signifiant peut servir bien
456
L'TOURDIT
des choses tout comme un organe, mais pas aux mmes. Pour la
castration par exemple, s'il fait usage, a n'a (bonheur en gnral) pas
les mmes suites que si c'tait l'organe. Pour la fonction d'appt,
si c'est l'organe qui s'offre hameon aux voracits que nous situions
l'instant, disons : d'origyne, le signifiant au contraire est le poisson
engloutir ce qu'il faut aux discours pour s'entretenir.
Cet organe, pass au signifiant, creuse la place d'o prend effet
pour le parlant, suivons-le ce qu'il se pense : tre, l'inexistence du
rapport sexuel.
L'tat prsent des discours qui s'alimentent donc de ces tres, se
situe de ce fait d'inexistence, de cet impossible, non pas dire, mais
qui, serr de tous les dits, s'en dmontre pour le rel.
Le dire de Freud ainsi pos se justifie de ses dits d'abord, dont il se
prouve, ce que j'ai dit, - se confirme s'tre avou de la stagnation
de l'exprience analytique, ce que je dnonce, - se dvelopperait de
la ressortie du discours analytique, ce quoi je m'emploie, puisque,
quoique sans ressource, c'est de mon ressort
1
.
Dans la confusion o l'organisme parasite que Freud a greffe sur
son dire, fait lui-mme greffe de ses dits, ce n'est pas petite affaire
qu'une chatte y retrouve ses petits, ni le lecteur un sens.
Le fouillis est insurmontable de ce qui s'y pingle de la castration,
des dfils par o l'amour s'entretient de l'inceste, de la fonction du
pre, du mythe o l'dipe se redouble de la comdie du Pre-
Orang, du prorant Outang.
On sait que j'avais dix ans pris soin de faire jardin la franaise de
ces voies quoi Freud a su coller dans son dessin, le premier, quand
pourtant de toujours ce qu'elles ont de tordu tait reperable pour
quiconque et voulu en avoir le cur net sur ce qui supple au
rapport sexuel.
Encore fallait-il que fut venue au jour la distinction du sym-
bolique, de l'imaginaire et du rel : ceci pour que l'identification
la moiti homme et la moiti femme, o je viens d'voquer que
l'affaire du moi domine, ne fut pas avec leur rapport confondue.
i. Ici s'arrte ce qui parat concurremment dans le mmorial d'Henri-
Rousselle.
457
L'TOURDIT
Il sufft que l'affaire de moi comme l'affaire de phallus o l'on a
bien voulu me suivre l'instinct, s'articulent dans le langage, pour
devenir affaire de sujet et n'tre plus du seul ressort de l'imaginaire.
Qu'on songe que c'est depuis l'anne 56 que tout cela et pu passer
pour acquis, y et-il eu consentement du discours analytique.
Car c'est dans la question pralable de mes crits, laquelle tait
lire comme la rponse donne par le peru dans la psychose, que
j'introduis le Nom-du-Pre et qu'aux champs (dans cet crit, mis en
graphe) dont il permet d'ordonner la psychose elle-mme, on peut
mesurer sa puissance.
Il n'y a rien d'excessif au regard de ce que nous donne l'exp-
rience, mettre au chef de l'tre ou avoir le phallus (cf. ma Bedeu-
tung des crits) la fonction qui supple au rapport sexuel.
D'o une inscription possible (dans la signification o le possible
est fondateur, leibnizienne) de cette fonction comme <Dx, quoi les
tres vont rpondre par leur mode d'y faire argument. Cette articu-
lation de la fonction comme proposition est celle de Frege.
Il est seulement de l'ordre du complment que j'apporte plus
haut toute position de l'universel comme tel, qu'il faille qu'en un
point du discours une existence, comme on dit : s'inscrive en faux
contre la fonction phallique, pour que la poser soit possible , ce
qui est le peu de quoi elle peut prtendre l'existence.
C'est bien cette logique que se rsume tout ce qu'il en est du
complexe d'dipe.
Tout peut en tre maintenu se dvelopper autour de ce que
j'avance de la corrlation logique de deux formules qui, s'inscrire
mathmatiquement Vx Ox, et 3x Et, s'noncent :
la premire, pour tout x, Ox est satisfait, ce qui peut se traduire
d'unV notant valeur de vrit; ceci, traduit dans le discours analy-
tique dont c'est la pratique de faire sens, veut dire que tout sujet
en tant que tel, puisque c'est l l'enjeu de ce discours, s'inscrit dans
la fonction phallique pour parer l'absence du rapport sexuel (la
pratique de faire sens, c'est justement de se rfrer cet ab-sens) ;
la seconde, il y a par exception le cas, familier en mathmatique
(l'argument x = 0 dans la fonction exponentielle x/%), le cas o il
existe un x pour lequel Ox, la fonction, n'est pas satisfaite, c'est--
dire ne fonctionnant pas, est exclue de fait.
458
L'TOURDIT
C'est prcisment d'o je conjugue le tous de l'universelle, plus
modifi qu'on ne s'imagine dans le pourtout du quanteur, Vil existe
un que le quantique lui apparie, sa diffrence tant patente avec
ce qu'implique la proposition qu'Aristote dit particulire. Je les
conjugue de ce que Vil existe un en question, faire limite au pour-
tant, est ce qui l'affirme ou le confirme (ce qu'un proverbe objecte
dj au contradictoire d'Aristote).
La raison en est que ce que le discours analytique concerne,
c'est le sujet, qui, comme effet de signification, est rponse du rel.
Cela je l'articulai, ds l'onze avril 56, en ayant texte recueilli, d'une
citation du signifiant asmantique, ce pour des gens qui y eussent pu
prendre intrt s'y sentir appels une fonction de djet.
Frayage certes pas fait pour qui que ce soit qui se lever du
discours universitaire, le dvie en cette dgoulinade hermneutique,
voire smiologisante, dont je m'imagine rpondre, ruisselante qu'elle
est maintenant de partout, faire de ce que l'analyse en ait fix la
dontologie.
Que j'nonce l'existence d'un sujet la poser d'un dire que non
la fonction propositionnelle Ox, implique qu'elle s'inscrive d'un
quanteur dont cette fonction se trouve coupe de ce qu'elle n'ait
en ce point aucune valeur qu'on puisse noter de vrit, ce qui veut
dire d'erreur pas plus, le faux seulement entendre falsus comme du
chu, ce o j'ai dj mis l'accent.
En logique classique, qu'on y pense, le faux ne s'aperoit pas qu'
tre de la vrit l'envers, il la dsigne aussi bien.
Il est donc juste d'crire comme je le fais : 3x <bx. L'un qui
existe, c'est le sujet suppos de ce que la fonction phallique y fasse
forfait. Ce n'est au rapport sexuel que mode d'accs sans espoir,
la syncope de la fonction qui ne se soutient que d'y sembler, que de
s'y embler, dirai-je, ne pouvant suffire, ce rapport, seulement
l'inaugurer, mais tant par contre ncessaire achever la consistance
du supplment qu'elle en fait, et ce de fixer la limite o ce semblant
n'est plus que d-sens.
Rien n'opre donc que d'quivoque signifiante, soit de l'astuce
par quoi l'ab-sens du rapport se tamponnerait au point de suspens
de la fonction.
C'est bien le d-sens qu' le mettre au compte de la castration,
je dnotais du symbolique ds 56 aussi ( la rentre : relation d'objet,
459
L'TOURDIT
structures freudiennes : il y en a compte rendu), le dmarquant par l
de la frustration, imaginaire, de la privation, relle.
Le sujet s'y trouvait dj suppos, rien qu' le saisir du contexte
que Schreber, par Freud, m'avait fourni de l'exhaustion de sa psychose.
C'est l que le Nom-du-Pre, faire lieu de sa plage, s'en dmon-
trait le responsable selon la tradition.
Le rel de cette plage, ce qu'y choue le semblant, ralise sans
doute le rapport dont le semblant fait le supplment, mais ce n'est
pas plus que le fantasme ne soutient notre ralit, pas peu non plus
puisque c'est toute, aux cinq sens prs, si l'on m'en croit.
La castration relaie de fait comme lien au pre, ce qui dans chaque
discours se connote de virilit. Il y a donc deux dit-mensions du
pourtouthomme, celle du discours dont il se pourtoute et celle des
lieux dont a se thomme.
Le discours psychanalytique s'inspire du dire de Freud procder
de la seconde d'abord, et d'une dcence tablie prendre dpart de
ces - qui l'hritage biologique fait largesse du semblant. Le hasard
qui semble ne devoir pas se rduire de sitt en cette rpartition se
formule de la sex ratio de l'espce, stable, semble-t-il, sans qu'on
puisse savoir pourquoi : ces - valent donc pour une moiti, mle
heur moi.
Les lieux de ce thommage se reprent de faire sens du semblant,
- par lui, de la vrit qu'il n'y a pas de rapport, - d'une jouissance
qui y supple, - voire du produit de leur complexe, de l'effet dit (par
mon office) du plus-de-jouir.
Sans doute le privilge de ces alles lgantes serait-il gain
rpartir d'un dividende plus raisonn que ce jeu de pile ou face
(dosage de la sex ratio), s'il ne se prouvait pas de l'autre dimension
dont ce thommage se pourtoute, que a en aggraverait le cas.
Le semblant d'heur pour une moiti s'avre en effet tre d'un
ordre strictement inverse l'implication qui la promet l'office d'un
discours.
Je m'en tiendrai le prouver de ce qu'en ptisse l'organe lui-mme.
Pas seulement de ce que son thommage soit un dommage a priori
d'y faire sujet dans le dire de ses parents, car pour la fille, a peut
tre pire.
460
L'TOURDIT
C'est plutt que tant plus de Va posteriori des discours qui l'atten-
dent il est happ (la happiness qu'on dit a aux USA), tant plus l'or-
gane a-t-il d'affaires en porter.
On lui impute d'tre motif... Ah ! n'et-on pu mieux le dresser,
je veux dire l'duquer. Pour a on peut toujours courir.
On voit bien dans le Satyricon que d'tre command, voire
implor, surveill ds le premier ge, mis l'tude in vitro, ne change
rien ses humeurs, qu'on se trompe de mettre au compte de sa
nature, quand, au contraire, ce n'est que du fait que ne lui plaise pas
ce qu'on lui fait dire, qu'il se bute.
Mieux vaudrait pour l'apprivoiser avoir cette topologie dont
relvent ses vertus, pour tre celle que j'ai dite qui voulait m'en-
tendre pendant que se poursuivait la trame destine me faire taire
(anne 61-62 sur l'identification). Je l'ai dessine d'un cross-cap, ou
mitre qu'on l'appelle encore... Que les vques s'en chapotent,
n'tonne pas.
Il faut dire qu'il n'y a rien faire si on ne sait pas d'une coupure
circulaire, - de quoi ? qu'est-elle ? pas mme surface, de ne rien d'es-
pace sparer - , comment pourtant a se dfait.
Il s'agit de structure, soit de ce qui ne s'apprend pas de la pra-
tique, ce qui explique pour ceux qui le savent qu'on ne l'ait su que
rcemment. Oui, mais comment? -Justement comme a : mcom-
ment.
C'est bien du biais de cette fonction que la btardise de l'orga-
nodynamisme clate, plus encore que d'ailleurs. Croit-on que ce
soit par l'organe mme que l'ternel fminin vous attire en haut, et
que a marche mieux (ou pire) ce que la moelle le libre de signi-
fier?
Je dis a pour le bon vieux temps d'une salle de garde qui d'en
tout cela se laisse paumer, avoue que sa rputation de foutoir ne
tient qu'aux chansons qui s'y glapissent.
Fiction et chant de la parole et du langage, pourtant n'en eussent-
ils pu, garons et filles, se permettre contre les Permatres dont il faut
dire qu'ils avaient le pli, les deux cents pas faire pour se rendre l
o je parlai dix ans durant. Mais pas un ne le fit de ceux qui j'tais
interdit.
Aprs tout qui sait? La btise a ses voies qui sont impntrables.
Et si la psychanalyse la propage, l'on m'a entendu, Henri-Rousselle
461
L'TOURDIT
justement, m'en assurer professer qu'il en rsulte plus de bien que
de mal.
Concluons qu'il y a maldonne quelque part. L'dipe est ce que
je dis, pas ce qu'on croit.
Ce d'un glissement que Freud n'a pas su viter impliquer -
dans l'universalit des croisements dans l'espce o a parle, soit
dans le maintien, fcond semble-t-il, de la sex ratio (moiti-moiti)
chez ceux qui y font le plus grand nombre, de leurs sangs mls - ,
la signifiance qu'il dcouvrait l'organe, universelle chez ses por-
teurs.
Il est curieux que la reconnaissance, si fortement accentue par
Freud, de la bisexualit des organes somatiques (o d'ailleurs lui fait
dfaut la sexualit chromosomique), ne l'ait pas conduit la fonc-
tion de couverture du phallus l'gard du germen.
Mais sa touthommie avoue sa vrit du mythe qu'il cre dans
Totem et Tabou, moins sr que celui de la Bible bien qu'en portant
la marque, pour rendre compte des voies tordues par o procde, l
o a parle, l'acte sexuel.
Prsumerons-nous que de touthomme, si reste trace biologique,
c'est qu'il n'y en ait que d'race se thommer, et qu'dale se pour-
touter.
Je m'explique : la race dont je parle n'est pas ce qu'une anthropo-
logie soutient de se dire physique, celle que Hegel a bien dnote
du crne et qui le mrite encore d'y trouver bien aprs Lavater et
Gall le plus lourd de ses mensurations.
Car ce n'est pas l, comme on l'a vu d'une tentative grotesque
d'y fonder un Reich dit troisime, ce n'est pas l ce dont aucune
race se constitue (ce racisme-l dans le fait non plus).
Elle se constitue du mode dont se transmettent par l'ordre d'un
discours les places symboliques, celles dont se perptue la race des
matres et pas moins des esclaves, des pdants aussi bien, quoi il
faut pour en rpondre des pds, des scients, dirai-je encore ce
qu'ils n'aillent pas sans des scis.
Je me passe donc parfaitement du temps du cervage, des Barbares
rejets d'o les Grecs se situent, de l'ethnographie des primitifs et du
recours aux structures lmentaires, pour assurer ce qu'il en est du
racisme des discours en action.
462
L'TOURDIT
J'aimerais mieux m'appuyer sur le fait que des races, ce que nous
tenons de plus sr est le fait de l'horticulteur, voire des animaux
qui vivent de notre domestique, effets de l'art, donc du discours :
ces races d'homme, a s'entretient du mme principe que celles de
chien et de cheval.
Ceci avant de remarquer que le discours analytique pourtoute a
contrepente, ce qui se conoit s'il se trouve en fermer de sa boucle
le rel.
Car c'est celui o l'analyste doit tre d'abord l'analys, si, comme
on le sait, c'est bien l'ordre dont se trace sa carrire. L'analysant,
encore que ce ne soit qu' moi qu'il doive d'tre ainsi dsign (mais
quelle trane de poudre s'gale au succs de cette activation), l'analy-
sant est bien ce dont le cervice ( salle de garde), le cou qui se ploie,
devait se redresser.
Nous avons jusqu'ici suivi Freud sans plus sur ce qui de la fonc-
tion sexuelle s'nonce d'un pourtout, mais aussi bien en rester une
moiti, des deux qu'il repre, quant lui, de la mme toise d'y
reporter dit-mensions les mmes.
Ce report sur l'autre dmontre assez ce qu'il en est de l'ab-sens
du rapport sexuel. Mais c'est plutt, cet ab-sens, le forcer.
C'est de fait le scandale du discours psychanalytique, et c'est
assez dire o les choses en sont dans la Socit qui le supporte, que
ce scandale ne se traduise que d'tre touff, si l'on peut dire, au
jour.
Au point que c'est un monde soulever que ce dbat dfunt
des annes 30, non certes qu' la pense du Matre ne s'affrontent
pas Karen Horney, Hlne Deutsch, voire Ernest Jones, d'autres
encore.
Mais le couvercle mis dessus depuis, depuis la mort de Freud,
suffire ce que n'en filtre plus la moindre fume, en dit long sur la
contention quoi Freud s'en est, dans son pessimisme, dlibrment
remis pour perdre, vouloir le sauver, son discours.
Indiquons seulement que les femmes ici nommes, y firent appel
- c'est eur penchant dans ce discours - de l'inconscient la voix
du corps, comme si justement ce n'tait pas de l'inconscient que
le corps prenait voix. Il est curieux de constater, intacte dans le
discours analytique, la dmesure qu'il y a entre l'autorit dont
463
L'TOURDIT
les femmes font effet et le lger des solutions dont cet effet se
produit.
Les fleurs me touchent, d'autant plus qu'elles sont de rhtorique,
dont Karen, Hlne, - laquelle n'importe, j'oublie maintenant, car
je n'aime pas de rouvrir mes sminaires - , dont donc Horney ou la
Deutsch meublent le charmant doigtier qui leur fait rserve d'eau au
corsage tel qu'il s'apporte au dating, soit ce dont il semble qu'un rap-
port s'en attende, ne serait-ce que de son dit.
Pour Jones, le biais de cervice (cf. dernire ligne avant le dernier
intervalle) qu'il prend qualifier la femme de la deutrophallicit, sic,
soit dire exactement le contraire de Freud, savoir qu'elles n'ont
rien faire avec le phallus, tout en ayant l'air de dire la mme chose,
savoir qu'elles en passent par la castration, c'est sans doute l le
chef-d'uvre quoi Freud a reconnu que pour la cervilit
attendre d'un biographe, il avait l son homme.
J'ajoute que la subtilit logique n'exclut pas la dbilit mentale qui,
comme une femme de mon cole le dmontre, ressortit du dire paren-
tal plutt que d'une obtusion native. C'est partir de l que Jones tait
le mieux d'entre lesoym,puisqu'avec les Juifs Freud n'tait sr de rien.
Mais je m'gare revenir au temps o ceci, je l'ai mch, mch
pour qui ?
Vil n'y a pas de rapport sexuel n'implique pas qu'il n'y ait pas de
rapport au sexe. C'est bien l mme ce que la castration dmontre,
mais non pas plus : savoir que ce rapport au sexe ne soit pas distinct
en chaque moiti, du fait mme qu'il les rpartisse.
Je souligne. Je n'ai pas dit : qu'il les rpartisse d'y rpartir l'organe,
voile o se sont fourvoyes Karen, Hlne, Dieu ait leurs mes si ce
n'est dj fait. Car ce qui est important, ce n'est pas que a parte des
titillations que les chers mignons dans la moiti de leur corps ressen-
tent qui est rendre son moi-haut, c'est que cette moiti y fasse
entre en emperesse pour qu'elle n'y rentre que comme signifiant-
m'tre de cette affaire de rapport au sexe. Ceci tout uniment (l en
effet Freud a raison) de la fonction phallique, pour ce que c'est bien
d'un phanre unique qu' procder de supplment, elle, cette fonc-
tion, s'organise, trouve Yorganon qu'ici je revise.
Je le fais en ce qu' sa diffrence, - pour les femmes rien ne le
guidait, c'est mme ce qui lui a permis d'en avancer autant couter
les hystriques qui font l'homme - , sa diffrence, rpt-je, je ne
464
L'TOURDIT
ferai pas aux femmes obligation d'auner au chaussoir de la castra-
tion la gaine charmante qu'elles n'lvent pas au signifiant, mme si
le chaussoir, de l'autre ct, ce n'est pas seulement au signifiant, mais
bien aussi au pied qu'il aide.
De faire chaussure, c'est sr, ce pied, les femmes (et qu'on m'y
pardonne d'entre elles cette gnralit que je rpudie bientt, mais
les hommes l-dessus sont durs de la feuille), les femmes, dis-je, se
font emploi l'occasion. Que le chausse-pied s'y recommande, s'en-
suit ds lors, mais qu'elles puissent s'en passer doit tre prvu, ce, pas
seulement au MLF qui est d'actualit, mais de ce qu'il n'y ait pas de
rapport sexuel, ce dont l'actuel n'est que tmoignage, quoique, je le
crains, momentan.
A ce titre l'lucubration freudienne du complexe d'dipe, qui
y fait la femme poisson dans l'eau, de ce que la castration soit chez
elle de dpart (Freud dixit), contraste douloureusement avec le fait
du ravage qu'est chez la femme, pour la plupart, le rapport sa mre,
d'o elle semble bien attendre comme femme plus de substance que
de son pre, - ce qui ne va pas avec lui tant second, dans ce ravage.
Ici j'abats mes cartes poser le mode quantique sous lequel l'autre
moiti, moiti du sujet, se produit d'une fonction la satisfaire, soit
la complter de son argument.
De deux modes dpend que le sujet ici se propose d'tre dit
femme. Les voici :
Ex Ox et Ax Ox.
Leur inscription n'est pas d'usage en mathmatique. Nier, comme
la barre mise au-dessus du quanteur le marque, nier qu'existe un ne
se fait pas, et moins encore que pourtout se pourpastoute.
C'est l pourtant que se livre le sens du dire, de ce que, s'y conju-
guant le nyania qui bruit des sexes en compagnie, il supple ce
qu'entre eux, de rapport nyait pas.
Ce qui est prendre non pas dans le sens qui, de rduire nos
quanteurs leur lecture selon Aristote, galerait le nexistum au nulnest
de son universelle ngative, ferait revenir le [if\ ndvxe, le pastout
(qu'il a pourtant su formuler), tmoigner de l'existence d'un sujet
dire que non la fonction phallique, ce le supposer de la contra-
rit dite de deux particulires.
Ce n'est pas l le sens du dire, qui s'inscrit de ces quanteurs.
465
L'TOURDIT
Il est : que pour s'introduire comme moiti dire des femmes, le
sujet se dtermine de ce que, n'existant pas de suspens la fonction
phallique, tout puisse ici s'en dire, mme provenir du sans raison.
Mais c'est un tout d'hors univers, lequel se lit tout de go du quan-
teur comme pastout.
Le sujet dans la moiti o il se dtermine des quanteurs nis, c'est
de ce que rien d'existant ne fasse limite de la fonction, que ne sau-
rait s'en assurer quoi que ce soit d'un univers. Ainsi se fonder de
cette moiti, elles ne sont pastoutes, avec pour suite et du mme
fait, qu'aucune non plus n'est toute.
Je pourrais ici, dvelopper l'inscription que j'ai faite par une
fonction hyperbolique, de la psychose de Schreber, y dmontrer
dans ce qu'il a de sardonique l'effet de pousse--la-femme qui
se spcifie du premier quanteur : ayant bien prcis que c'est de
l'irruption < Un-pre comme sans raison, que se prcipite ici l'effet
ressenti comme de forage, au champ d'un Autre se penser comme
tout sens le plus tranger.
Mais porter sa puissance d'extrme logique la fonction, cela
drouterait. J'ai dj pu mesurer la peine que la bonne volont a
prise de l'appliquer Hlderlin : sans succs.
Combien plus ais n'est-il pas, voire dlice se promettre, de
mettre au compte de l'autre quanteur, le singulier d'un confin ,
ce qu'il fasse la puissance logique du pastout s'habiter du recs de la
jouissance que la fminit drobe, mme ce qu'elle vienne se
conjoindre ce qui fait thomme...
Car ce confin de s'noncer ici de logique, est bien le mme dont
s'abrite Ovide le figurer de Tirsias en mythe. Dire qu'une femme
n'est pas toute, c'est ce que le mythe nous indique de ce qu'elle soit
la seule ce que sa jouissance dpasse, celle qui se fait du cot.
C'est aussi bien pourquoi c'est comme la seule qu'elle veut tre
reconnue de l'autre part : on ne l'y sait que trop.
Mais c'est encore o se saisit ce qu'on y a apprendre, savoir
qu'y satisft-on l'exigence de l'amour, la jouissance qu'on a d'une
femme la divise, lui faisant de sa solitude partenaire, tandis que
l'union reste au seuil.
Car quoi l'homme s'avouerait-il servir de mieux pour la femme
dont il veut jouir, qu' lui rendre cette jouissance sienne qui ne la
fait pas toute lui : d'en elle la re-susciter.
466
L'TOURDIT
Ce qu'on appelle le sexe (voire le deuxime, quand c'est une
sotte) est proprement, se supporter de pastoute, P'Exepo qui ne
peut s'tancher d'univers.
Disons htrosexuel par dfinition, ce qui aime les femmes, quel
que soit son sexe propre. Ce sera plus clair.
J'ai dit : aimer, non pas : elles tre promis d'un rapport qu'il n'y
a pas. C'est mme ce qui implique l'insatiable de l'amour, lequel
s'explique de cette prmisse.
Qu'il ait fallu le discours analytique pour que cela vienne se
dire, montre assez que ce n'est pas en tout discours qu'un dire vient
ex-sister. Car la question en fut des sicles rebattue en termes d'in-
tuition du sujet, lequel tait fort capable de le voir, voire d'en faire
des gorges chaudes, sans que jamais c'ait t pris au srieux.
C'est la logique de PTSxepo qui est faire partir, y tant remar-
quable qu'y dbouche le Parmnide partir de l'incompatibilit de
l'Un l'Etre. Mais comment commenter ce texte devant sept cents
personnes ?
Reste la carrire toujours ouverte l'quivoque du signifiant :
T'Etepo, de se dcliner en r'Etepa, s'thrise, voire s'htarise...
L'appui du deux faire d'eux que semble nous tendre ce pastout,
fait illusion, mais la rptition qui est en somme le transfini, montre
qu'il s'agit d'un inaccessible, partir de quoi, l'numrable en tant
sr, la rduction le devient aussi.
C'est ici que s'emble, je veux dire : s'emblave, le semblable dont
moi seul ai tent de dnouer l'quivoque, de l'avoir fouille de
l'hommosexu, soit de ce qu'on appelait jusqu'ici l'homme en
abrg, qui est le prototype du semblable (cf. mon stade du miroir).
C'est l'^Etepo, remarquons-le, qui, s'y embler de discord, rige
l'homme dans son statut qui est celui de l'hommosexuel. Non de
mon office, je le souligne, de celui de Freud qui, cet appendice, le lui
rend, et en toutes lettres.
Il ne s'emble ainsi pourtant que d'un dire s'tre dj bien
avanc. X^e qui frappe d'abord, c'est quel point l'hommodit a pu
se suffire du tout-venant de l'inconscient, jusqu'au moment o, le
dire structur comme un langage,j'ai laiss penser qu' tant
parler, ce n'est pas lourd qui en est dit : que a cause, que a cause,
mais que c'est tout ce que a sait faire. On m'a si peu compris,
467
L'TOURDIT
tant mieux, que je peux m'attendre ce qu'un jour on m'en fasse
objection.
Bref on flotte de l'lot phallus, ce qu'on s'y retranche de ce qui
s'en retranche.
Ainsi l'histoire se fait de manuvres navales o les bateaux font
leur ballet d'un nombre limit de figures.
Il est intressant que des femmes ne ddaignent pas d'y prendre
rang : c'est mme pour cela que la danse est un art qui florit quand
les discours tiennent en place, y ayant le pas ceux qui ont de quoi,
pour le signifiant congru.
Mais quand le pastoute vient dire qu'il ne se reconnat pas
dans celui-l, que dit-il, sinon ce qu'il trouve dans ce que je lui ai
apport, soit :
le quadripode de la vrit et du semblant, du jouir et de ce qui
d'un plus de -, s'en dfile se dmentir de s'en dfendre,
et le bipode dont l'cart montre l'ab-sens du rapport,
puis le trpied qui se restitue de la rentre du phallus sublime qui
guide l'homme vers sa vraie couche, de ce que sa route, il l'ait per-
due.
Tu m'as satisfaite, petithomme. Tu as compris, c'est ce qu'il
fallait. Va, d'tourdit il n'y en a pas de trop, pour qu'il te revienne
l'aprs midit. Grce la main qui te rpondra ce qu'Antigone tu
l'appelles, la mme qui peut te dchirer de ce que j'en sphynge mon
pastoute, tu sauras mme vers le soir te faire l'gal de Tirsias et
comme lui, d'avoir fait l'Autre, deviner ce que je t'ai dit.
C'est l surmoiti qui ne se surmoite pas si facilement que la
conscience universelle.
Ses dits ne sauraient se complter, se rfuter, s'inconsister,
s'indmontrer, s'indcider qu' partir de ce qui ex-siste des voies de
son dire.
D'o l'analyste d'une autre source que de cet Autre, l'Autre de
mon graphe et signifi de S de A barr : pastoute, d'o saurait-il
trouver redire ce qui foisonne de la chicane logique dont le
rapport au sexe s'gare, vouloir que ses chemins aillent l'autre
moiti ?
468
L'TOURDIT
Qu'une femme ici ne serve l'homme qu' ce qu'il cesse d'en
aimer une autre ; que de n'y pas parvenir soit de lui contre elle
retenu, alors que c'est bien d'y russir, qu'elle le rate,
- que maladroit, le mme s'imagine que d'en avoir deux la fait
toute,
- que la femme dans le peuple soit la bourgeoise, qu'ailleurs
l'homme veuille qu'elle ne sache rien :
d'o saurait-il s'y retrouver en ces gentillesses - il y en a
d'autres - , sauf de la logique qui s'y dnonce et quoi je prtends le
rompre ?
Il m'a plu de relever qu'Aristote y flchit, curieusement de nous
fournir les termes que je reprends d'un autre dduit. Cela n'et-il
pas eu son intrt pourtant qu'il aiguillt son Monde du pastout
en nier l'universel? L'existence du mme coup ne s'tiolait plus de
la particularit, et pour Alexandre son matre l'avertissement et
pu tre bon : si c'est d'un ab-sens comme-pas-un dont se nierait
l'univers que se drobe le pastout qui ex-siste, il aurait ri, tout le
premier c'est le cas de le dire, de son dessein de l'univers empi-
rer.
C'est l justement que passifou, le philosophe joue d'autant
mieux l'air du midit qu'il peut le faire en bonne conscience. On
l'entretient pour dire la vrit : comme le fou il sait que c'est tout
fait faisable, condition qu'il ne suture (Sutor...) pas outre sa
semellit.
Un peu de topologie vient maintenant.
Prenons un tore (une surface formant anneau). Il saute aux
yeux qu' le pincer entre deux doigts tout de son long partir d'un
point pour y revenir, le doigt d'en haut d'abord tant en bas enfin,
c'est--dire ayant opr un demi-tour de torsion durant l'accomplis-
sement du tour complet du tore, on obtient une bande de Mbius :
condition de considrer la surface ainsi aplatie comme confondant
les deux lames produites de la surface premire. C'en est ce que
l'vidence s'homologue de l'videment.
Il vaut de la dmontrer de faon moins grossire. Procdons
d'une coupure suivant le bord de la bande obtenue (on sait qu'il est
unique). Il est facile de voir que chaque lame, ds lors spare de
469
L'TOURDIT
celle qui la redouble, se continue pourtant justement dans celle-ci.
De ce fait, le bord pris d'une lame en un point est le bord de l'autre
lame quand un tour l'a men en un point conjugu d'tre du mme
travers , et quand d'un tour supplmentaire il revient son point
de dpart, il a, d'avoir fait une double boucle rpartie sur deux
lames, laiss de ct une autre double boucle qui constitue un second
bord. La bande obtenue a donc deux bords, ce qui suffit lui assurer
un endroit et un envers.
Son rapport la bande de Mbius qu'elle figurait avant que nous
y fassions coupure, est... que la coupure l'ait produite.
L est le tour de passe-passe : ce n'est pas recoudre la mme
coupure que la bande de Mbius sera reproduite puisqu'elle n'tait
que feinte d'un tore aplati, mais c'est par un glissement des deux
lames l'une sur l'autre (et aussi bien dans les deux sens) que la double
boucle d'un des bords tant affronte elle-mme, sa couture
constitue la bande de Mbius vraie .
O la bande obtenue du tore se rvle tre la bande de Mbius
bipartie - d'une coupure non pas double tour, mais se fermer
d'un seul (faisons-la mdiane pour le saisir... imaginairement).
Mais du mme coup ce qui apparat, c'est que la bande de Mbius
n'est rien d'autre que cette coupure mme, celle par quoi de sa
surface elle disparat.
Et la raison en est qu' procder d'unir soi-mme, aprs glisse-
ment d'une lame sur l'autre de la bande bipartie, la double boucle
d'un des bords de cette mme bande, c'est tout au long la face
envers de cette bande que nous cousions sa face endroit.
O il se touche que ce n'est pas du travers idal dont une bande
se tord d'un demi-tour, que la bande de Mbius est imaginer ;
c'est tout de son long qu'elle fait n'tre qu'un son endroit et son
envers. Il n'y a pas un de ses points o l'un et l'autre ne s'unissent.
Et la bande de Mbius n'est rien d'autre que la coupure un seul
tour, quelconque (bien qu'image de l'impensable mdiane ), qui
la structure d'une srie de lignes sans points.
Ce qui se confirme imaginer cette coupure se redoubler (d'tre
plus proche de son bord) : cette coupure donnera une bande de
Mbius, elle vraiment mdiane, qui, abattue, restera faire chane
avec la Mbius bipartie qui serait applicable sur un tore (ceci de
comporter deux rouleaux de mme sens et un de sens contraire ou,
470
L'TOURDIT
de faon quivalente : d'tre obtenus de la mme, trois rouleaux de
mme sens) : on voit l que l'ab-sens qui rsulte de la coupure
simple, fait l'absence de la bande de Mbius. D'o cette coupure
= la bande de Mbius.
Reste que cette coupure n'a cette quivalence que de bipartir
une surface que limite l'autre bord : d'un double tour prcisment,
soit ce qui fait la bande de Mbius. La bande de Mbius est donc
ce qui d'oprer sur la bande de Mbius, la ramne la surface
torique.
Le trou de l'autre bord peut pourtant se supplmenter autrement,
savoir d'une surface qui, d'avoir la double boucle pour bord, le
remplit - d'une autre bande de Mbius, cela va de soi, et cela donne
la bouteille de Klein.
Il y a encore une autre solution : prendre ce bord de la dcoupe
en rondelle qu' le drouler il tale sur la sphre. A y faire cercle,
il peut se rduire au point : point hors-ligne qui, de supplmenter
la ligne sans points, se trouve composer ce qui dans la topologie se
dsigne du cross-cap.
C'est l'asphre, l'crire : /, apostrophe. Le plan projectif autre-
ment dit, de Desargues, plan dont la dcouverte comme rdviisant
son horizon un point, se prcise de ce que ce point soit tel que
toute ligne trace d'y aboutir ne le franchit qu' passer de la face
endroit du plan sa face envers.
Ce point aussi bien s'tale-t-il de la ligne insaisissable dont se
dessine dans la figuration du cross-cap, la traverse ncessaire de la
bande de Mbius par la rondelle dont nous venons de la suppl-
menter ce qu'elle s'appuie sur son bord.
Le remarquable de cette suite est que l'asphre (crit : /, apos-
trophe), commencer au tore (elle s'y prsente de premire main),
ne vient l'vidence de son asphricit qu' se supplmenter d'une
coupure sphrique.
Ce dveloppement est prendre comme la rfrence - expresse,
je veux dire dj articule - de mon discours o j'en suis : contri-
buant au discours analytique.
Rfrence qui n'est en rien mtaphorique. Je dirais : c'est de
l'toffe qu'il s'agit, de l'toffe de ce discoun,- si justement ce n'tait
pas dans la mtaphore tomber l.
471
L'TOURDIT
Pour le dire, j'y suis tomb; c'est dj fait, non de l'usage du
terme l'instant rpudi, mais d'avoir, pour me faire entendre d'
qui je m'adresse, fait-image, tout au long de mon expos topolo-
gique.
Qu'on sache qu'il tait faisable d'une pure algbre littrale, d'un
recours aux vecteurs dont d'ordinaire se dveloppe de bout en bout
cette topologie.
La topologie, n'est-ce pas ce n'espace o nous amne le discours
mathmatique et qui ncessite rvision de l'esthtique de Kant?
Pas d'autre toffe lui donner que ce langage de pur mathme,
j'entends par l ce qui est seul pouvoir s'enseigner : ceci sans
recours quelque exprience, qui d'tre toujours, quoi qu'elle en
ait, fonde dans un discours, permet les locutions qui ne visent en
dernier ressort rien d'autre qu', ce discours, l'tablir.
Quoi m'autorise dans mon cas me rfrer ce pur mathme ?
Je note d'abord que si j'en exclus la mtaphore, j'admets qu'il
puisse tre enrichi ^t qu' ce titre il ne soit, sur cette voie, que
rcration, soit ce dont toute sorte de champs nouveaux mathma-
tiques se sont de fait ouverts. Je me maintiens donc dans l'ordre que
j'ai isol du symbolique, y inscrire ce qu'il en est de l'inconscient,
pour y prendre rfrence de mon prsent discours.
Je rponds donc ma question : qu'il faut d'abord avoir l'ide,
laquelle se prend de mon exprience, que n'importe quoi ne peut
pas tre dit. Et il faut le dire.
Autant dire qu'il faut le dire d'abord.
Le signifi du dire n'est, comme je pense l'avoir de mes phrases
d'entre fait sentir, rien qu'ex-sistence au dit (ici ce dit que tout
ne peut pas se dire). Soit : que ce n'est pas le sujet, lequel est effet de
dit.
Dans nos asphres, la coupure, coupure ferme, c'est le dit. Elle,
fait sujet : quoi qu'elle cerne...
Notamment, comme le figure la sommation de Popilius d'y
rpondre par oui ou par non, notamment, dis-je, si ce qu'elle cerne,
c'est le concept, dont se dfinit l'tre mme : d'un cercle autour -
se dcouper d'une topologie sphrique, celle qui soutient l'univer-
sel, le quant-au-tout : topologie de l'univers.
L'ennui est que l'tre n'a par lui-mme aucune espce de sens.
Certes l o il est, il est le signifiant-matre, comme le dmontre le
472
L'TOURDIT
discours philosophique qui, pour se tenir son service, peut tre
brillant, soit : tre beau, mais quant au sens le rduit au signifiant-
m'tre. M'tre sujet le redoublant l'infini dans le miroir.
J'voquerai ici la survivance magistrale, combien sensible quand
elle s'treint aux faits modernes , la survivance de ce discours,
celui d'Aristote et de saint Thomas, sous la plume d'Etienne Gilson,
laquelle n'est plus que plaisance : m'est plus-de-jouir .
C'est aussi bien que je lui donne sens d'autres discours, l'auteur
aussi, comme je viens de le dire. J'expliquerai cela, ce qui produit le
sens, un peu plus loin.
L'tre se produit donc notamment . Mais notre asphre sous
tous ses avatars tmoigne que si le dit se conclut d'une coupure qui
se ferme, il est certaines coupures fermes qui de cette asphre ne
font pas deux parts : deux parts se dnoter du oui et du non pour
ce qu'il en est ( de l'tre ) de l'une d'elles.
L'important est que ce soit ces autres coupures qui ont effet de
subversion topologique. Mais que dire du changement par elles sur-
venu?
Nous pouvons le dnommer topologiquement cylindre, bande,
bande de Mbius. Mais y trouver ce qu'il en est dans le discours
analytique, ne peut se faire qu' y interroger le rapport du dire au
dit.
Je dis qu'un dire s'y spcifie de la demande dont le statut logique
est de l'ordre du modal, et que la grammaire le certifie.
Un autre dire, selon moi, y est privilgi : c'est l'interprtation,
qui, elle, n'est pas modale, mais apophantique. J'ajoute que dans
le registre de la logique d'Aristote, elle est particulire, d'intresser le
sujet des dits particuliers, lesquels ne sont postons (association libre)
des dits modaux (demande entre autres).
L'interprtation, ai-je formul en son temps, porte sur la cause du
dsir, cause qu'elle rvle, ceci de la demande qui de son modal
enveloppe l'ensemble des dits.
Quiconque me suit dans mon discours sait bien que cette cause
je l'incarne de l'objet (a)
9
et cet objet, le reconnat (pour ce que
l'ai nonc ds longtemps, dix ans, le sminaire 61-62 sur l'iden-
tification, o cette topologie, je l'ai introduite), l'a, je l'avance, dj
reconnu dans ce que je dsigne ici de la rondelle supplmentaire
473
L'TOURDIT
dont se ferme la bande de Mbius, ce que s'en compose le cross-
cap.
C'est la topologie sphrique de cet objet dit (a) qui se projette
sur l'autre du compos, htrogne, que constitue le cross-cap.
Imaginons encore selon ce qui s'en figure graphiquement de
faon usuelle, cette autre part. Qu'en voyons-nous ? Sa gonfle.
Rien n'est plus de nature ce qu'elle se prenne pour sphrique.
Ce n'en est pas moins, si mince qu'on en rduise la part torse d'un
demi-tour, une bande de Mbius, soit la mise en valeur de l'asphre
du pastout : c'est ce qui supporte l'impossible de l'univers, - soit
prendre notre formule, ce qui y rencontre le rel.
L'univers n'est pas ailleurs que dans la cause du dsir, l'universel
non plus. C'est de l que procde l'exclusion du rel...
... de ce rel : qu'il n'y a de rapport sexuel, ceci du fait qu'un ani-
mal stabitat qu'est le langage, que d'iabiter c'est aussi bien ce
qui pour son corps fait organe, - organe qui, pour ainsi lui ex-sister,
le dtermine de sa fonction, ce ds avant qu'il la trouve. C'est mme
de l qu'il est rduit trouver que son corps n'est pas sans autres
organes, et que leur fonction chacun, lui fait problme, - ce dont
le dit schizophrne se spcifie d'tre pris sans le secours d'aucun
discours tabli.
J'ai la tche de frayer le statut d'un discours, l o je situe qu'il y
a... du discours : et je le situe du lien social quoi se soumettent les
corps qui, ce discours, labitent.
Mon entreprise parat dsespre (l'est du mme fait, c'est l le
fait du dsespoir) parce qu'il est impossible que les psychanalystes
forment un groupe.
Nanmoins le discours psychanalytique (c'est mon frayage) est
justement celui qui peut fonder un lien social nettoy d'aucune
ncessit de groupe.
Comme on sait que je ne mnage pas mes termes quand il s'agit
de faire relief d'une apprciation qui, mritant un accs plus strict,
doit s'en passer, je dirai que je mesure l'effet de groupe ce qu'il
rajoute d'obscnit imaginaire l'effet de discours.
D'autant moins s'tonnera-t-on, je l'espre, de ce dire qu'il
est historiquement vrai que ce soit l'entre enjeu du discours ana-
474
L'TOURDIT
lyrique qui a ouvert la voie aux pratiques dites de groupe et que ces
pratiques ne soulvent qu'un effet, si j'ose dire, purifi du discours
mme qui en a permis l'exprience.
Aucune objection l la pratique dite de groupe, pourvu qu'elle
soit bien indique (c'est court).
La remarque prsente de l'impossible du groupe psychanalytique
est aussi bien ce qui en fonde, comme toujours, le rel. Ce rel,
c'est cette obscnit mme : aussi bien en vit-il (entre guillemets)
comme groupe.
Cette vie de groupe est ce qui prserve l'institution dite inter-
nationale, et ce que j'essaie de proscrire de mon cole, contre les
objurgations que j'en reois de quelques personnes doues pour a.
Ce n'est pas l l'important, ni qu'il soit difficile qui s'installe
d'un mme discours de vivre autrement qu'en groupe, - c'est qu'y
appelle, j'entends : ce rempart du groupe, la position de l'analyste
telle qu'elle est dfinie par son discours mme.
Comment l'objet (a) en tant qu'il est d'aversion au regard du
semblant o l'analyse le situe, comment se supporterait-il d'autre
confort que le groupe ?
J'y ai dj perdu pas mal de monde : d'un cur lger, et prt ce
que d'autres y trouvent redire.
Ce n'est pas moi qui vaincrai, c'est le discours que je sers. Je vais
dire maintenant pourquoi.
Nous en sommes au rgne du discours scientifique et je vais le
faire sentir. Sentir de l o se confirme ma critique, plus haut, de
l'universel de ce que l'homme soit mortel .
Sa traduction dans le discours scientifique, c'est l'assurance-vie. La
mort, dans le dire scientifique, est affaire de calcul des probabilits.
C'est, dans ce discours, ce qu'elle a de vrai.
Il y a nanmoins, de notre temps, des gens qui se refusent
contracter une assurance-vie. C'est qu'ils veulent de la mort une
autre vrit qu'assurent dj d'autres discours. Celui du matre par
exempl/qui, en croire Hegel, se fonderait de la mort prise comme
risque ; celui de l'universitaire, qui jouerait de la mmoire ter-
nelle du savoir.
Ces vrits, comme ces discours, sont contestes, d'tre contes-
tables minemment. Un autre discours est venu au jour, celui de
Freud, pour quoi la mort, c'est l'amour.
475
L'TOURDIT
a ne veut pas dire que l'amour ne relve pas aussi du calcul des
probabilits, lequel ne lui laisse que la chance infime que le pome
de Dante a su raliser. a veut dire qu'il n'y a pas d'assurance-
amour, parce que a serait l'assurance-haine aussi.
L'amour-haine, c'est ce dont un psychanalyste mme non laca-
nien ne reconnat ajuste titre que l'ambivalence, soit la face unique
de la bande de Mbius, - avec cette consquence, lie au comique
qui lui est propre, que dans la vie de groupe, il n'en dnomme
jamais que la haine.
Je renchane d'avant : d'autant moins de motif l'assurance-
amour qu'on ne peut qu'y perdre, - comme fit Dante, qui dans les
cercles de son enfer, omet celui du conjungo sans fin.
Donc dj trop de commentaire dans l'imagerie de ce dire qu'est
ma topologie. Un analyste vritable n'y entendrait pas plus que
de faire ce dire, jusqu' meilleure se prouver, tenir la place du
rel.
La place du dire est en effet l'analogue dans le discours math-
matique de ce rel que d'autres discours serrent de l'impossible de
leurs dits.
Cette dit-mension d'un impossible qui va incidemment jusqu'
comprendre l'impasse proprement logicienne, c'est ailleurs ce qu'on
appelle la structure.
La structure, c'est le rel qui se fait jour dans le langage. Bien sr
n'a-t-elle aucun rapport avec la bonne forme .
Le rapport d'organe du langage l'tre parlant, est mtaphore.
Il est encore stabitat qui, de ce que labitant y fasse parasite, doit
tre suppos lui porter le coup d'un rel.
Il est vident qu' m'exprimer ainsi comme sera traduit ce que
je viens de dire, je glisse une conception du monde , soit au
dchet de tout discours.
C'est bien de quoi l'analyste pourrait tre sauv de ce que son
discours le rejette lui-mme, l'clairer comme rebut du langage.
C'est pourquoi je pars d'un fil, idologique je n'ai pas le choix,
celui dont se tisse l'exprience institue par Freud. Au nom de quoi,
si ce fil provient de la trame la mieux mise l'preuve de faire tenir
ensemble les idologies d'un temps qui est le mien, le rejetterais-je ?
Au nom de la jouissance ? Mais justement, c'est le propre de mon fil
476
L'TOURDIT
de s'en tirer : c'est mme le principe du discours psychanalytique, tel
que, lui-mme, il s'articule.
Ce que je dis vaut la place o je mets le discours dont l'analyse
se prvaut, parmi les autres se partager l'exprience de ce temps.
Le sens, s'il y en a un trouver, pourrait-il me venir d'un temps
autre : je m'y essaie - toujours en vain.
Ce n'est pas sans raison que l'analyse se fonde du sujet suppos
savoir : oui, certes elle le suppose remettre en question le savoir, ce
pour quoi c'est mieux qu'il en sache un bout.
J'admire l-dessus les airs pinces que prend la confusion, de ce
que je l'limine.
Il reste que la science a dmarr, nettement du fait de laisser tom-
ber la supposition, que c'est le cas d'appeler naturelle, de ce qu'elle
implique que les prises du corps sur la nature le soient, ce qui,
de se controuver, entrane une ide du rel que je dirais bien tre
vraie. Hlas ! ce n'est pas le mot qui au rel convienne. On aimerait
mieux pouvoir la prouver fausse, si par l s'entendait : chue (falsa),
soit glissant des bras du discours qui l'treint.
Si mon dire s'impose, non, comme on dit, d'un modle, mais du
propos d'articuler topologiquement le discours lui-mme, c'est du
dfaut dans l'univers qu'il procde, condition que pas lui non
plus ne prtende le suppler.
De cela ralisant la topologie , je ne sors pas du fantasme mme
en rendre compte, mais la recueillant en fleur de la mathmatique,
cette topologie, - soit de ce qu'elle s'inscrive d'un discours, le plus
vid de sens qui soit, de se passer de toute mtaphore, d'tre mto-
nymiquement d'ab-sens, je confirme que c'est du discours dont
se fonde la ralit du fantasme, que de cette ralit ce qu'il y a de
rel se trouve inscrit.
Pourquoi ce rel ne serait-ce pas le nombre, et tout cru aprs
tout, que vhicule bien le langage ? Mais ce n'est pas si simple, c'est
le cas de le dire (cas que je me hte toujours de conjurer en disant
que c'est le cas).
Car ce qui se profre du dire de Cantor, c'est que la suite des
nombres ne reprsente rien d'autre dans le transfini que l'inaccessi-
bilit qui commence au deux, par quoi d'eux se constitue l'num-
rable l'infini.
Ds lors une topologie se ncessite de ce que le rel ne lui revienne
477
L'TOURDIT
que du discours de l'analyse, pour ce discours, le confirmer, et que
ce soit de la bance que ce discours ouvre se refermer au-del des
autres discours, que ce rel se trouve ex-sister.
C'est ce que je vais faire maintenant toucher.
Ma topologie n'est pas d'une substance poser au-del du re} ce
dont une pratique se motive. Elle n'est pas thorie.
Mais elle doit rendre compte de ce que, coupures du discours,
il y en a de telles qu'elles modifient la structure qu'il accueille
d'origine.
C'est pure drobade que d'en extrioriser ce rel de standards,
standards dits de vie dont primeraient des sujets dans leur existence,
ne parler que pour exprimer leurs sentiments des choses, la pdan-
terie du mot affect n'y changeant rien.
Comment cette secondarit mordrait-elle sur le primaire qui l
se substitue la logique de l'inconscient?
Serait-ce effet de la
N
sagesse qui y interviendra ? Les standards
quoi l'on recourt, y contredisent justement.
Mais argumenter dans cette banalit, dj l'on passe la tho-
logie de l'tre, la ralit psychique, soit ce qui ne s'avalise analyti-
quement que du fantasme.
Sans doute l'analyse mme rend-elle compte de ce pige et glisse-
ment, mais n'est-il pas assez grossier pour se dnoncer partout o
un discours sur ce qu'il y a, dcharge la responsabilit de le produire.
Car il faut le dire, l'inconscient est un fait en tant qu'il se sup-
porte du discours mme qui l'tablit, et, si seulement des analystes
sont capables d'en rejeter le fardeau, c'est d'loigner d'eux-mmes la
promesse de rejet qui les y appelle, ce mesure de ce que leur voix y
aura fait effet.
Qu'on le sente du lavage des mains dont ils loignent d'eux le dit
transfert, refuser le surprenant de l'accs qu'il offre sur l'amour.
A se passer dans son discours, selon la ligne de la science, de tout
savoir-faire des corps, mais pour un discours autre, - l'analyse,
- d'voquer une sexualit de mtaphore, mtonymique souhait par
ses accs les plus communs, ceux dits pr-gnitaux, lire extra -,
prend figure de rvler la torsion de la connaissance. Y serait-il
dplac de faire le pas du rel qui en rend compte le traduire
478
L'TOURDIT
d'une absence situable parfaitement, celle du rapport sexuel dans
aucune mathmatisation ?
C'est en quoi les mathmes dont se formule en impasses le
mathmatisable, lui-mme dfinir comme ce qui de rel s'en-
seigne, sont de nature se coordonner cette absence prise au rel.
Recourir au pastout, Yhommoinsun, soit aux impasses de la
logique, c'est, montrer l'issue hors des fictions de la Mondanit,
faire fixion autre du rel : soit de l'impossible qui le fixe de la struc-
ture du langage. C'est aussi bien tracer la voie dont se retrouve en
chaque discours le rel dont il s'enroule, et renvoyer les mythes dont
il se supple ordinairement.
Mais de l profrer qu'il s'en faut du rel que rien ne soit tout,
ce dont l'incidence l'endroit de la vrit irait tout droit apho-
risme plus scabreux, - ou, la prendre d'autre biais, mettre que le
rel se ncessite de vrifications sans objet, est-ce l seulement
prendre la relance de la sottise s'pingler du noumne : soit que
l'tre fuit la pense... Rien ne vient bout de cet tre qu'un peu
plus je daphnise, voire laurifice en ce noumne dont vaut mieux
dire que pour qu'il se soutienne, faut qu'il y en ait plusieurs
couches...
Mon tracas est que les aphorismes qu'au reste je me contente de
prsenter en bouton, fassent refleurs des fosss de la mtaphysique,
(car le noumne, c'est le badinage, la subsistance futile...). Je parle
qu'ils se prouveront tre de plus-de-(w*e5e, plus drles, pour le
dire, que ce qui nous mne ainsi...
... quoi? Faut-il que je sursaute, que je jure que je ne l'ai pas
vu tout de suite alors que vous, dj... ces vrits premires, mais
c'est le texte mme dont se formulent les symptmes des grandes
nvroses, des deux qui, prendre au srieux le normal, nous disent
que c'est plutt norme maie.
Voil qui nous ramne au sol, peut-tre pas le mme, mais peut-
tre aussi que c'est le bon et que le discours analytique y fait moins
pieds de/plomb.
Mettons en train ici l'affaire du sens, plus haut promise de sa
diffrence d'avec la signification.
Nous permet de l'accrocher l'normit de la condensation entre
ce qui pense de notre temps (avec les pieds que nous venons de
479
L'TOURDIT
dire) et la topologie inepte quoi Kant a donn corps de son propre
tablissement, celui du bourgeois qui ne peut imaginer que de la
transcendance, l'esthtique comme la dialectique.
Cette condensation en effet, nous devons la dire entendre au
sens analytique , selon la formule reue. Quel est ce sens, si juste-
ment les lments qui s'y condensent, se qualifient univoquement
d'une imbcillit semblable, voire sont capables de s'en targuer du
ct de ce qui pense , le masque de Kant par contre paraissant de
bois devant l'insulte, sa rflexion prs de Swedenborg : autrement
dit, y a-t-il un sens de l'imbcillit ?
A ceci se touche que le sens ne se produit jamais que de la tra-
duction d'un discours en un autre.
Pourvus que nous voil de cette petite lumire, l'antinomie tres-
saille qui se produit de sens signification : qu'un faible sens vienne
surgir jour rasant des dites critiques de la raison pure, et du
jugement (pour la raison pratique, j'en ai dit le foltre en le mettant
du ct de Sade, lui pas plus drle, mais logique), - ds que leur sens
donc se lve, les dits de Kant n'ont plus de signification.
La signification, ils ne la tiennent donc que du moment o ils
n'avaient pas de sens, pas mme le sens commun.
Ceci nous claire les tnbres qui nous rduisent aux ttons. Le
sens ne manque pas aux vaticinations dites prsocratiques : impos-
sible de dire lequel, mais asysent. Et que Freud s'en pourlche,
pas des meilleures au reste puisque c'est d'Empdocle, n'importe,
il avait, lui, le sens de l'orientation ; a nous suffit voir que l'inter-
prtation est du sens et va contre la signification. Oraculaire, ce qui
ne surprend pas de ce que nous savons lier d'oral la voix, du dpla-
cement sexuel.
C'est la misre des historiens : de ne pouvoir lire que le sens, l o
ils n'ont d'autre principe que de s'en remettre aux documents de la
signification. Eux aussi donc en viennent la transcendance, celle
du matrialisme par exemple, qui, historique , l'est hlas ! l'est au
point de le devenir irrmdiablement.
Heureusement que l'analyse est l pour regonfler l'historiole :
mais n'y parvenant que de ce qui est pris dans son discours, dans
son discours de fait, elle nous laisse le bec dans l'eau pour ce qui
n'est pas de notre temps, - ne changeant par l rien de ce que l'hon-
ntet force l'historien reconnatre ds qu'il a situer le moindre
480
L'TOURDIT
sacysent. Qu'il ait charge de la science de l'embarras, c'est bien l'em-
barrassant de son apport la science.
Il importe donc beaucoup, ceux-ci comme beaucoup
d'autres? que l'impossibilit de dire vrai du rel se motive d'un
mathme (Ton sait comment je le dfinis), d'un mathme dont se
situe le rapport du dire au dit.
Le mathme se profre du seul rel d'abord reconnu dans le lan-
gage : savoir le nombre. Nanmoins l'histoire de la mathmatique
dmontre (c'est le cas de le dire) qu'il peut s'tendre l'intuition,
condition que ce terme soit aussi chtr qu'il se peut de son usage
mtaphorique.
Il y a donc l un champ dont le plus frappant est que son dve-
loppement, l'encontre des termes dont on l'absorbe, ne procde
pas de gnralisation, mais de remaniement topologique, d'une
rtroaction sur le commencement telle qu'elle en efface l'histoire.
Pas d'exprience plus sre en rsoudre l'embarras. D'o son attrait
pour la pense : qui y trouve le nonsense propre l'tre, soit au dsir
d'une parole sans au-del.
Rien pourtant faire tat de l'tre qui, ce que nous l'noncions
ainsi, ne relve de notre bienveillance.
Tout autre est le fait de l'indcidable, pour en prendre l'exemple
de pointe dont se recommande pour nous le mathme : c'est le rel
du dire du nombre qui est en jeu, quand de ce dire est dmontr
qu'il n'est pas vrifiable, ceci ce degr second qu'on ne puisse
mme l'assurer, comme il se fait d'autres dj dignes de nous retenir,
d'une dmonstration de son indmontrable des prmisses mmes
qu'il suppose, - entendons bien d'une contradiction inhrente le
supposer dmontrable.
On ne peut nier qu'il y ait l progrs sur ce qui du Mnon en reste
questionner de ce qui fait l'enseignable. C'est certes la dernire
chose dire qu'entre les deux il y a un monde : ce dont il s'agit
tant qu', cette place vient le rel, dont le monde n'est que chute
drisoire.
C'est pourtant le progrs qu'il faut restreindre l, puisque je ne
perds pas de vue le regret qui y rpond, savoir que l'opinion vraie
dont au Mnon fait sens Platon, n'a plus pur nous qu'ab-sens de
signification, ce qui confirme de la rfrer celle de nos bien-
pensants.
481
L'TOURDIT
Un mathme l'et-elle port, que notre topologie nous fournit?
Tentons-la.
a nous conduit l'tonnement de ce que nous vitions sou-
tenir de l'image notre bande de Mbius, cette imagination rendant
vaines les remarques qu'et ncessites un dit autre s'y trouver
articul : mon lecteur ne devenait autre que de ce que le dire passe
le dit, ce dire tant prendre d'au dit ex-sister, par quoi le rel m'en
ex-sist(ait) sans que quiconque, de ce qu'il fut vrifiable, le pt faire
passer au mathme. L'opinion vraie, est-ce la vrit dans le rel en
tant que c'est lui qui en barre le dire ?
Je l'prouverai du redire que je vais en faire.
Ligne sans points, ai-je dit de la coupure, en tant qu'elle est, elle, la
bande de Mbius ce qu'un de ses bords, aprs le tour dont elle se
ferme, se poursuit dans l'autre bord.
Ceci pourtant ne peut se produire que d'une surface dj pique
d'un point que j'ai dit hors ligne de se spcifier d'une double boucle
pourtant talable sur une sphre : de sorte que ce soit d'une sphre
qu'il se dcoupe, mais de son double bouclage qu'il fasse de la
sphre une asphre ou cross-cap.
Ce qu'il fait passer pourtant dans le cross-cap s'emprunter de la
sphre, c'est qu'une coupure qu'il fait mbienne dans la surface
qu'il dtermine l'y rendre possible, la rend, cette surface, au mode
sphrique : car c'est de ce que la coupure lui quivaille, que ce dont
elle se supplmentait en cross-cap s'y projette , ai-je dit.
Mais comme de cette surface, pour qu'elle permette cette cou-
pure, on peut dire qu'elle est faite de lignes sans points par o par-
tout sa face endroit se coud sa face envers, c'est partout que le
point supplmentaire pouvoir se sphriser, peut tre fix dans un
cross-cap.
Mais cette fixion doit tre choisie comme unique point hors
ligne, pour qu'une coupure, d'en faire un tour et un unique, y ait
effet de la rsoudre en un point sphriquement talable.
Le point donc est l'opinion qui peut tre dite vraie de ce que le
dire qui en fait le tour la vrifie en effet, mais seulement de ce que
le dire soit ce qui la modifie d'y introduire la 8a comme rel.
Ainsi un dire tel que le mien, c'est d'ex-sister au dit qu'il en
permet le mathme, mais il ne fait pas pour moi mathme et se pose
ainsi comme non-enseignable avant que le dire s'en soit produit,
482
L'TOURDIT
comme enseignable seulement aprs que je l'ai mathmatis selon
les critres mnoniens qui pourtant ne me l'avaient pas certifi.
Le non-enseignable, je l'ai fait mathme de l'assurer de la fixion
de l'opinion vraie, fixion crite avec un x, mais non sans ressource
d'quivoque.
Ainsi un objet aussi facile fabriquer que la bande de Mbius
en tant qu'elle s'imagine, met porte de toutes mains ce qui est
inimaginable ds que son dire s'oublier, fait le dit s'endurer.
D'o a procd ma fixion de ce point 5a ce que je n'ai pas dit,
je ne le sais pas et ne peux donc pas plus que Freud en rendre
compte de ce que j'enseigne , sinon suivre ses effets dans le dis-
cours analytique, effets de sa mathmatisation qui ne vient pas d'une
machine, mais qui s'avre tenir du machin une fois qu'il l'a produite.
Il est notable que Cicron ait su dj employer ce terme : Ad
usum autem orationis, incredibile est, nisi diligenter attenderis,
quanta opra machinata natura sit (Cicron, De natura deorum, II, 59,
149), mais plus encore que j'en aie fait exergue aux ttonnements de
mon dire ds le 11 avril 1956.
La topologie n'est pas faite pour nous guider dans la structure.
Cette structure, elle l'est - comme rtroaction de l'ordre de chane
dont consiste le langage.
La structure, c'est l'asphrique recel dans l'articulation langagire
en tant qu'un effet de sujet s'en saisit.
Il est clair que, quant la signification, ce s'en saisit de la sous-
phrase, pseudo-modale, se rpercute de l'objet mme que comme
verbe il enveloppe dans son sujet grammatical, et qu'il y a faux effet
de sens, rsonance de l'imaginaire induit de la topologie, selon que
l'effet de sujet fait tourbillon d'asphre ou que le subjectif de cet
effet s'en rflchit .
Il y a ici distinguer l'ambigut qui s'inscrit de la signification,
soit de la boucle de la coupure, et la suggestion de trou, c'est--dire
de structure, qui de cette ambigut fait sens
1
.
i. Il paratra, j'espre ici, que de l'imputation de structuralisme, entendre
comme comprhension du monde, une de plus au guignol sous lequel nous est
reprsente l' histoire littraire (c'est de cela qu'il s'agit), n'est malgr la gonfle de
publicit qu'elle m'a apporte et sous la forme la plus plaisante puisque j'y tais
483
L'TOURDIT
Ainsi la coupure, la coupure instaure de la topologie ( l'y faire,
de droit, ferme, qu'on le note une bonne fois, dans mon usage au
moins), c'est le dit du langage, mais ne plus le dire en oublier.
Bien sr y a-t-il les dits qui font l'objet de la logique prdicative
et dont la supposition universalisante ressortit seulement la sphre,
je dis : la, je dis : sphre, soit : que justement la structure n'y trouve
qu'un supplment qui est celui de la fiction du vrai.
On pourrait dire que la sphre, c'est ce qui se passe de topologie.
La coupure certes y dcoupe ( se fermer) le concept sur quoi
repose la foire du langage, le principe de l'change, de la valeur, de
la concession universelle. ^(Disons qu'elle n'est que matire pour
la dialectique, affaire de discours du matre.) Il est trs difficile de
soutenir cette dit-mension pure, de ce qu'tant partout, pure elle ne
l'est jamais, mais l'important est qu'elle n'est pas la structure. Elle est
la fiction de la surface dont la structure s'habille.
Que le sens y soit tranger, que l'homme est bon , et aussi bien
le dit contraire, a ne veuille dire strictement rien qui ait un sens, on
peut juste titre s'tonner que personne n'ait de cette remarque
(dont une fois de plus l'vidence renvoie l'tre comme videment)
fait rfrence structurale. Nous risquerons-nous au dire que la
coupure en fin de compte n'ex-siste pas de la sphre ? - Pour la
raison que rien ne l'oblige se fermer, puisqu' rester ouverte elle y
produit le mme effet, qualifiable du trou, mais de ce qu'ici ce terme
ne puisse tre pris que dans l'acception imaginaire de rupture de
surface : vident certes, mais de rduire ce qu'il peut cerner au vide
d'un quelconque possible dont la substance n'est que corrlat (com-
possible oui ou non : issue du prdicat dans le propositionnel avec
tous les faux pas dont on s'amuse).
Sans l'homosexualit grecque, puis arabe, et le relais de l'eucha-
ristie, tout cela et ncessit un Autre recours bien avant. Mais on
comprend qu'aux grandes poques que nous venons d'voquer, la
religion seule en fin de compte, de constituer l'opinion vraie, l'pOf|
oot, pt ce mathme donner le fonds dont il se trouvait de fait
embarqu dans la meilleure compagnie, n'est peut-tre pas ce dont j'aie lieu d'tre
satisfait.
Et de moins en moins dirais-je, mesure qu'y fait monte une acception dont la
vulgate s'noncerait assez bien de ce que les routes s'expliquent de conduire d'un
panneau Michelin un autre : Et voil pourquoi votre carte est muette.
484
L'TOURDIT
investi. Il en restera toujours quelque chose mme si l'on croit le
contraire, et c'est pourquoi rien ne prvaudra contre l'glise jusqu'
la fin des temps. Puisque les tudes bibliques n'en ont encore sauv
personne.
Seuls ceux pour qui ce bouchon n'a aucun intrt, les thologiens
par exemple, travailleront dans la structure... si le cur leur en dit,
mais gare la nause.
Ce que la topologie enseigne, c'est le lien ncessaire qui s'tablit
de la coupure au nombre de tours qu'elle comporte pour qu'en soit
obtenue une modification de la structure ou de l'asphre (/, apos-
trophe), seul accs concevable au rel, et concevable de l'impossible
en ce qu'elle le dmontre.
Ainsi du tour unique qui dans l'asphre fait lambeau sphrique-
ment stable y introduire l'effet du supplment qu'elle prend du
point hors ligne, l'p6t| Sot. Le boucler double, ce tour, obtient
tout autre chose : chute de la cause du dsir d'o se produit la bande
mbienne du sujet, cette chute le dmontrant n'tre qu'ex-sistence
la coupure double boucle dont il rsulte.
Cette ex-sistence est dire et elle le prouve de ce que le sujet reste
la merci de son dit s'il se rpte, soit : comme la bande mbienne
d'y trouver son jaxng (vanouissement).
Point-nud (cas de le dire), c'est le tour dont se fait le trou,
mais seulement en ce sens que du tour, ce trou s'imagine, ou s'y
machine, comme on voudra.
L'imagination du trou a des consquences certes : est-il besoin
d'voquer sa fonction pulsionnelle ou, pour mieux dire, ce qui
en drive (Trieb)? C'est la conqute de l'analyse que d'en avoir fait
mathme, quand la mystique auparavant ne tmoignait de son
preuve qu' en faire l'indicible. Mais d'en rester ce trou-l, c'est la
fascination qjai se reproduit, dont le discours universel maintient son
privilge, bien plus elle lui rend corps, du discours analytique.
Avec l'image rien jamais n'y fera. Le semblable Soupirera mme
de ce qui s'y emblave.
Le trou ne se motive pas du clin d'oeil, ni de la syncope mnsique,
ni du cri. Qu'on l'approche de s'apercevoir que le mot s'emprunte
du motus, n'est pas de mise l d'o la topologie s'instaure.
Un tore n'a de trou, central ou circulaire, que pour qui le regarde
485
L'TOURDIT
en objet, non pour qui en est le sujet, soit d'une coupure qui n'im-
plique nul trou, mais qui l'oblige un nombre prcis de tours de dire
pour que ce tore se fasse (se fasse s'il le demande, car aprs tout un
tore vaut mieux qu'un travers), se fasse, comme nous nous sommes
prudemment content de l'imager, bande de Mbius, ou contre-
bande si le mot vous plat mieux.
Un tore, comme je l'ai dmontr il y a dix ans des gens en mal
de m'envaser de leur contrebande eux, c'est la structure de la
nvrose en tant que le dsir peut, de la r-ptition indfiniment
numrable de la demande, se boucler en deux tours. C'est cette
condition du moins que s'en dcide la contrebande du sujet, - dans
ce dire qui s'appelle l'interprtation.
Je voudrais seulement faire un sort la sorte d'incitation que peut
imposer notre topologie structurale.
J'ai dit la demande numrable dans ses tours. Il est clair que si le
trou n'est pas imaginer, le tour n'ex-siste que du nombre dont il
s'inscrit dans la coupure dont seule la fermeture compte.
J'insiste : le tour en soi n'est pas comptable ; rptitif, il ne ferme
rien, il n'est ni dit ni dire, c'est--dire nulle proposition. D'o ce
serait trop dire qu'il ne relve pas d'une logique, qui reste faire
partir de la modale.
Mais si comme l'assure notre figuration premire de la coupure
dont du tore se fait la bande de Mbius, une demande y suffit, mais
qui peut se r-pter d'tre numrable, autant dire qu'elle ne s'appa-
rie au double tour dont se fonde la bande qu' se poser du transfini
(cantorien).
Reste que la bande ne saurait se constituer qu' ce que les tours
de la demande soient de nombre impair.
Le transfini en restant exigible, de ce que rien, nous l'avons dit, ne
s'y compte qu' ce que la coupure s'en ferme, ledit transfini, tel
Dieu lui-mme dont on sait qu'il s'en flicite, y est somm d'tre
impair.
Voil qui ajoute une dit-mension la topologie de notre pratique
du dire.
Ne doit-elle pas rentrer dans le concept de la rptition en tant
qu'elle n'est pas laisse elle-mme, mais que cette pratique la
conditionne, comme nous l'avons aussi fait observer de l'incons-
cient?
486
L'TOURDIT
Il est saisissant, - encore que dj vu pour ce que je dis, qu'on
s'en souvienne -, que l'ordre (entendons : l'ordinal) dont j'ai effecti-
vement fray la voie dans ma dfinition de la rptition et partir de
la pratique, est pass tout fait dans sa ncessit inaperu de mon
audience.
J'en marque ici le repre pour une reprise venir.
Disons pourtant la fin de l'analyse du tore nvrotique.
L'objet (a) choir du trou de la bande s'en projette aprs coup
dans ce que nous appellerons, d'abus imaginaire, le trou central du
tore, soit autour de quoi le transfini impair de la demande se rsout
du double tour de l'interprtation.
Cela, c'est ce dont le psychanalyste a pris fonction le situer de
son semblant.
L'analysant ne termine qu' faire de l'objet (a) le reprsentant
de la reprsentation de son analyste. C'est donc autant que son deuil
dure de l'objet (a) auquel il l'a enfin rduit, que le psychanalyste per-
siste causer son dsir : plutt maniaco-dpressivement.
C'est l'tat d'exultation que Balint, le prendre ct, n'en dcrit
pas moins bien : plus d'un succs thrapeutique , trouve l sa
raison, et substantielle ventuellement. Puis le deuil s'achve.
Reste le stable de la mise plat du phallus, soit de la bande, o
l'analyste trouve sa fin, celle qui assure son sujet suppos du savoir :
... que, le dialogue d'un sexe l'autre tant interdit de ce qu'un
discours, quel qu'il soit, se fonde d'exclure ce que le langage y apporte
d'impossible, savoir le rapport sexuel, il en rsulte pour le dialogue
l'intrieur de chaque (sexe) quelque inconvnient,
... que rien ne saurait se dire srieusement (soit pour former
de srie limite) qu' prendre sens de l'ordre comique, - quoi pas
de sublime Xvoire Dante l encore) qui ne fasse rvrence,
... et puis que l'insulte, si elle s'avre par l'&co tre du dialogue
le premier mot comme le dernier (conferomre), le jugement de
mme, jusqu'au dernier , reste fantasme, et pour le dire, ne touche
au rel qu' perdre toute signification.
De tout cela il saura se faire une conduite. Il y en a plus d'une,
mme des tas, convenir aux trois dit-mensions de l'impossible :
telles qu'elles se dploient dans le sexe, dans le sens, et dans la signi-
fication.
487
L'TOURDIT
S'il est sensible au beau, quoi rien ne l'oblige, il le situera de
l'entre-deux-morts, et si quelqu'une de ces vrits lui parest bonne
faire entendre, ce n'est qu'au mi-dire du tour simple qu'il se fiera.
Ces bnfices se soutenir d'un second-dire, n'en sont pas moins
tablis, de ce qu'ils le laissent oubli.
L est le tranchant de notre nonciation de dpart. Le dit pre-
mier, idalement de prime-saut de l'analysant, n'a ses effets de struc-
ture qu' ce que parsoit le dire, autrement dit que l'interprtation
fasse partre.
En quoi consiste le partre ? En ce que produisant les coupures
vraies : entendre strictement des coupures fermes quoi la
topologie ne permet pas de se rduire au point-hors-ligne ni, ce qui
est la mme chose, de ne faire que trou imaginable.
De ce partre, je n'ai pas exposer le statut autrement que de
mon parcours mme, m'tant dj dispens de connoter son mer-
gence au point, plus haut, o je l'ai permise.
En faire arrt(re) dans ce parcours serait du mme coup le pn-
trer, le faire tre, et mme presque est encore trop.
Ce dire que je rappelle l'ex-sistence, ce dire ne pas oublier,
du dit primaire, c'est celui que la psychanalyse peut prtendre se
fermer.
Si l'inconscient est structur comme un langage, je n'ai pas dit :
par. L'audience, s'il faut entendre par l quelque chose comme une
acoustique mentale, l'audience que j'avais alors tait mauvaise, les
psychanalystes ne l'ayant pas meilleure que les autres. Faute d'une
remarque suffisante de ce choix (videmment pas un de ces traits
qui les touchaient, de les -pater - sans plus d'ailleurs), il m'a fallu
auprs de l'audience universitaire, elle qui dans ce champ ne peut
que se tromper, faire tal de circonstances de nature m'empcher
de porter mes coups sur mes propres lves, pour expliquer que j'aie
laiss passer une extravagance telle que de faire de l'inconscient la
condition du langage , quand c'est manifestement par le langage
que je rends compte de l'inconscient : le langage, fis-je donc trans-
crire dans le texte revu d'une thse, est la condition de l'inconscient.
Rien ne sert rien, quand on est pris dans certaines fourchettes
mentales, puisque me voici forc de rappeler la fonction, spcifie en
logique, de l'article qui porte au rel de l'unique l'effet d'une dfini-
488
L'TOURDIT
don, - un article, lui partie du discours c'est--dire grammatical,
faisant usage de cette fonction dans la langue dont je me sers, pour y
tre dfini dfini.
Le langage ne peut dsigner que la structure dont il y a effet
de langages, ceux-ci plusieurs ouvrant l'usage de l'un entre autres
qui donne mon comme sa trs prcise porte, celle du comme un
langage, dont justement diverge de l'inconscient le sens commun.
Les langages tombent sous le coup du pastous de la faon la plus
certaine puisque la structure n'y a pas d'autre sens, et que c'est en
quoi elle relve de ma rcration topologique d'aujourd'hui.
Ainsi la rfrence dont je situe l'inconscient est-elle justement
celle qui la linguistique chappe, pour ce que comme science elle
n'a que faire du partre, pas plus qu'elle ne noumne. Mais elle nous
mne bel et bien, et Dieu sait o, mais srement pas l'inconscient,
qui de la prendre dans la structure, la droute quant au rel dont
se motive le langage : puisque le langage, c'est a mme, cette drive.
La psychanalyse n'y accde, elle, que par l'entre en jeu d'une
Autre dit-mention, laquelle s'y ouvre de ce que le meneur (du
jeu) fasse semblant d'tre l'effet de langage majeur, l'objet
dont s'(a)nime la coupure qu'elle permet par l : c'est l'objet (a) pour
l'appeler du sigle que je lui affecte.
Cela, l'analyste le paye de devoir reprsenter la chute d'un dis-
cours, aprs avoir permis au sens de s'enserrer autour de cette chute
quoi il se dvoue.
Ce que dnonce la dception que je cause bien des linguistes
sans issue possible pour eux, bien que j'en aie, moi, le dml.
Qui ne peut voir en effet me lire, voire me l'avoir entendu
dire en clair, que l'analyste est ds Freud trs en avance l-dessus sur
le linguiste, sur Saussure par exemple qui en reste l'accs stocien,
le mme .que celui de saint Augustin? (Cf. entre autres, le De magis-
tro, dont a en dater mon appui, j'indiquais assez la limite : la distinc-
tion signans-signatum.)
Trs en avance, j'ai dit en quoi : la condensation et le dplacement
antcdant la dcouverte, Jakobson aidant, de l'effet de sens de la
mtaphore et de la mtonymie.
Pour si peu que l'analyse se sustente de la chance que je lui en
offre, cette avance, elle la garde, - et la gardera d'autant de relais que
l'avenir veuille apporter ma parole.
489
L'TOURDIT
Car la linguistique par contre pour l'analyse ne fraye rien, et le
soutien mme que j'ai pris de Jakobson, n'est, l'encontre de ce qui
se produit pour eflfacer l'histoire dans la mathmatique pas de l'ordre
de l'aprs-coup, mais du contrecoup, - au bnfice, et second-dire,
de la linguistique.
Le dire de l'analyse en tant qu'il est efficace, ralise l'apophan-
tique qui de sa seule ex-sistence se distingue de la proposition. C'est
ainsi qu'il met sa place la fonction propositionnelle, en tant que,
je pense l'avoir montr, elle nous donne le seul appui suppler
l'ab-sens du rapport sexuel. Ce dire s'y renomme, de l'embarras que
trahissent des champs aussi parpills que l'oracle et l'hors-discours
de la psychose, par l'emprunt qu'il leur fait du terme d'interprtation.
C'est le dire dont se ressaisissent, en fixer le dsir, les coupures
qui ne se soutiennent comme non fermes que d'tre demandes.
Demandes qui d'apparier l'impossible au contingent, le possible au
ncessaire, font semonce aux prtentions de la logique qui se dit
modale.
Ce dire ne procde que du fait que l'inconscient, d'tre structur
comme un langage , c'est--dire lalangue qu'il habite, est assujetti
l'quivoque dont chacune se distingue. Une langue entre autres n'est
rien de plus que l'intgrale des quivoques que son histoire y a
laisses persister. C'est la veine dont le rel, le seul pour le discours
analytique motiver son issue, le rel qu'il n'y a pas de rapport sexuel,
y a fait dpt au cours des ges. Ceci dans l'espce que ce rel intro-
duit l'un, soit l'uni du corps qui en prend origine, et de ce fait
y fait organes cartels d'une disjonction par o sans doute d'autres
rels viennent sa porte, mais pas sans que la voie quadruple de ces
accs ne s'infinitise ce que s'en produise le nombre rel .
Le langage donc, en tant que cette espce y a sa place, n'y fait effet
de rien d'autre que de la structure dont se motive cette incidence du
rel.
Tout ce qui en parest d'un semblant de communication est tou-
jours rve, lapsus ou joke.
Rien faire donc avec ce qui s'imagine et se confirme en bien
des points d'un langage animal.
Le rel l n'est pas carter d'une communication univoque dont
aussi bien les animaux, nous donner le modle, nous feraient leurs
dauphins : une fonction de code s'y exerce par o se fait la nguen-
490
L'TOURDIT
tropie de rsultats d'observation. Bien plus, des conduites vitales
s'y organisent de symboles en tout semblables aux ntres (rection
d'un objet au rang de signifiant du matre dans l'ordre du vol de
migration, symbolisme de la parade tant amoureuse que du combat,
signaux de travail, marques du territoire), ceci prs que ces sym-
boles ne sont jamais quivoques.
Ces quivoques dont s'inscrit l'-ct d'une nonciation, se
concentrent de trois points-nuds o l'on remarquera non seule-
ment la prsence de l'impair (plus haut jug indispensable), mais
qu'aucun ne s'y imposant comme le premier, l'ordre dont nous
allons les exposer s'y maintient et d'une double boucle plutt que
d'un seul tour.
Je commence par l'homophonie, - d'o l'orthographe dpend.
Que dans la langue qui est la mienne, comme j'en ai jou plus haut,
deux soit quivoque d'eux, garde trace de ce jeu de l'me par quoi
faire d'eux deux-ensemble trouve sa limite faire deux d'eux.
On en trouve d'autres dans ce texte, du partre au s'emblant.
Je tiens que tous les coups sont l permis pour la raison que
quiconque tant leur porte sans pouvoir s'y reconnatre, ce sont
eux qui nous jouent. Sauf ce que les potes en fassent calcul et que
le psychanalyste s'en serve l o-il convient.
O c'est convenable pour sa fin : soit pour, de son dire qui en
rescinde le sujet, renouveler l'application qui s'en reprsente sur le tore,
sur le tore dont consiste le dsir propre l'insistance de sa demande.
Si une gonfle imaginaire peut ici aider la transfinisation phal-
lique, rappelons pourtant que la coupure ne fonctionne pas moins
porter sur ce chiffonn, dont au dessin girafode du petit Hans j'ai fait
gloire en son temps.
Car l'interprtation se seconde ici de la grammaire. A quoi, dans
ce cas commfc dans les autres, Freud ne se prive pas de recourir. Je
ne reviens pas ici sur ce que je souligne de cette pratique avoue en
maints exemples.
Je relve seulement que c'est l ce que les analystes imputent
pudiquement Freud d'un glissement dans l'endoctrination. Ce
des dates (cf. celle de l'Homme aux rats) o il n'a pas plus d'arrire-
monde leur proposer que le systme en proie des incitations
internes .
Ainsi les analystes qui se cramponnent au garde-fou de la psy-
491
L'TOURDIT
chologie gnrale , ne sont mme pas capables de lire dans ces cas
clatants, que Freud fait aux sujets rpter leur leon , dans leur
grammaire.
A ceci prs qu'il nous rpte que, du dit de chacun d'eux, nous
devons tre prts rviser les parties du discours que nous avons
cru pouvoir retenir des prcdents.
Bien sr est-ce l ce que les linguistes se proposent comme idal,
mais si la langue anglaise parest propice Chomsky, j'ai marqu que
ma premire phrase s'inscrit en faux d'une quivoque contre son
arbre transformationnel.
Je ne te le fais pas dire. N'est-ce pas l le minimum de l'inter-
vention interprtative ? Mais ce n'est pas son sens qui importe dans
la formule que lalangue dont j'use ici permet d'en donner, c'est que
l'amorphologie d'un langage ouvre l'quivoque entre Tu l'as et
et Je le prends d'autant moins ma charge que, chose pareille, je
ne te l'ai par quiconque fait dire .'
Chiffre 3 maintenant : c'est la logique, sans laquelle l'interprtation
serait imbcile, les premiers s'en servir tant bien entendu ceux
qui, pour de l'inconscient transcendantaliser l'existence, s'arment du
propos de Freud qu'il soit insensible la contradiction.
Il ne leur est sans doute pas encore parvenu que plus d'une
logique s'est prvalue de s'interdire ce fondement, et de n'en pas
moins rester formalise , ce qui veut dire propre au mathme.
Qui reprocherait Freud un tel effet d'obscurantisme et les nues
de tnbres qu'il a aussitt, de Jung Abraham, accumules lui
rpondre ? - Certes pas moi qui ai aussi, cet endroit (de mon
envers), quelques responsabilits.
Je rappellerai seulement qu'aucune laboration logique, ce partir
d'avant Socrate et d'ailleurs que de notre tradition, n'a jamais pro-
cd que d'un noyau de paradoxes, - pour se servir du terme,
recevable partout, dont nous dsignons les quivoques qui se situent
de ce point qui, pour venir ici en tiers, est aussi bien premier ou
second.
A qui chou-je cette anne de faire sentir que le bain de Jou-
vence dont le mathme dit logique a retrouv pour nous sa prise
et sa vigueur, ce sont ces paradoxes pas seulement rafrachis d'tre
promus en de nouveaux termes par un Russell, mais encore indits
de provenir du dire de Cantor?
492
L'TOURDIT
Irai-je parler de la pulsion gnitale comme du cata-logue des
pulsions pr-gnitales en tant qu'elles ne se contiennent pas elles-
mmes, mais qu'elles ont leur cause ailleurs, soit dans cet Autre
quoi la gnitalit n'a accs qu' ce qu'il prenne barre sur elle
de la division qui s'effectue de son passage au signifiant majeur, le
phallus?
Et pour le transfini de la demande, soit la r-ptition, reviendrai-
je sur ce qu'elle n'a d'autre horizon que de donner corps ce que le
deux ne soit pas moins qu'elle inaccessible seulement partir de l'un
qui ne serait pas celui de l'ensemble vide ?
Je veux ici marquer qu'il n'y a l que recueil, - sans cesse aliment
du tmoignage que m'en donnent ceux-l bien sr dont j'ouvre
l'oreille -, recueil de ce que chacun peut aussi bien que moi et eux
tenir de la bouche mme des analysants pour peu qu'il se soit auto-
ris prendre la place de l'analyste.
Que la pratique avec les ans m'ait permis d'en faire dits et redits,
dits, ddits, c'est bien la bulle dont tous les hommes se font la place
qu'ils mritent dans d'autres discours que celui que je propose.
A s'y faire d'race guidants qui s'en remettent des guids,
pdants... (cf. plus haut).
Au contraire dans l'accession au lieu d'o se profre ce que
j'nonce, la condition tenue d'origine pour premire, c'est d'tre
l'analys, soit ce qui rsulte de l'analysant.
Encore me faut-il pour m'y maintenir au vif de ce qui m'y auto-
rise, ce procs toujours le recommencer.
O se saisit que mon discours est par rapport aux autres contre-
pente, ai-je dit dj, et se confirme mon exigence de la double
boucle pour que l'ensemble s'en ferme.
Ceci autour d'un trou de ce rel dont s'annonce ce dont aprs-
coup il n'y a pas de plume qui ne se trouve tmoigner : qu'il n'y a
pas de rapport sexuel.
Ainsi s'explique ce mi-dire dont nous venons bout, celui par
quoi la femme de toujours serait leurre de vrit. Fasse le ciel enfin
rompu de la voie que nous ouvrons lacte, que certaines de n'tre
pastoutes, pour l'hommodit en viennent faire l'heure du rel. Ce
qui ne serait pas forcment plus dsagrable qu'avant.
493
L'TOURDIT
a ne sera pas un progrs, puisqu'il n'y en a pas qui ne fasse
regret, regret d'une perte. Mais qu'on en rie, la langue que je sers
s'y trouverait refaire le joke de Dmocrite sur le jiT|Sev : l'extraire
par chute du \vr\ de la (ngation) du rien qui semble l'appeler, telle
notre bande le fait d'elle-mme sa rescousse.
Dmocrite en effet nous fit cadeau de 1'CTO|LIO du rel radical,
en lider le pas , jifj, mais dans sa subjonctivit, soit ce modal dont
la demande refait la considration. Moyennant quoi le 8v fut bien
le passager clandestin dont le clam fait maintenant notre destin.
Pas plus matrialiste en cela que n'importe qui de sens, que moi
ou que Marx par exemple. Pour Freud je n'en jurerais pas : qui sait
la graine de mots ravis qui a pu lever dans son me d'un pays o la
Kabbale cheminait.
A toute matire, il faut beaucoup d'esprit, et de son cru, car sans
cela d'o lui viendrait-il ? C'est ce que Freud a senti, mais non sans
le regret dont je parlais plus haut.
Je ne dteste donc pas du tout certains symptmes, lis l'intol-
rable de la vrit freudienne.
Ils la confirment, et mme croire prendre force de moi. Pour
reprendre une ironie de Poincar sur Cantor, mon discours n'est
pas strile, il engendre l'antinomie, et mme mieux : il se dmontre
pouvoir se soutenir mme de la psychose.
Plus heureux que Freud qui, pour en aborder la structure, a d
recourir l'pave des Mmoires d'un dfunt, c'est d'une reprise de
ma parole que nat mon Schreber (et mme ici biprsident, aigle
deux ttes).
Mauvaise lecture de mon discours sans doute, c'en est une bonne :
c'est le cas de toutes : l'usage. Qu'un analysant en arrive tout anim
sa sance, suffit pour qu'il enchane tout droit sur sa matire di-
pienne, - comme de partout m'en revient le rapport.
Evidemment mon discours n'a pas toujours des rejets aussi heu-
reux. Pour le prendre sous l'angle de l' influence chre aux thses
universitaires, cela semble pouvoir aller assez loin, au regard notam-
ment d'un tourbillon de smantophilie dont on le tiendrait pour
prcdent, alors d'une forte priorit c'est ce que je centrerais du
mot-valise... On movalise depuis un moment perte de vue et ce
n'est hlas ! pas sans m'en devoir un bout.
Je ne m'en console ni ne m'en dsole. C'est moins dshonorant
494
L'TOURDIT
pour le discours analytique que ce qui se produit de la formation
des socits de ce nom. L, c'est de tradition le philistinisme qui
donne le ton, et les rcentes sorties contre les sursauts de la jeunesse
ne font rien de plus que s'y conformer.
Ce que je dnonce, c'est que tout est bon aux analystes de cette
filire pour se dfiler d'un dfi dont je tiens qu'ils prennent exis-
tence, - car c'est l fait de structure les dterminer.
Le dfi, je le dnote de l'abjection. On sait que le terme d'absolu
a hant le savoir et le pouvoir, - drisoirement il faut le dire : l sem-
blait-il, restait espoir, que les saints ailleun reprsentent. Il faut en
dchanter. L'analyste dclare forfait.
Quant l'amour dont le surralisme voudrait que les mots le
fassent, est-ce dire que a en reste l? Il est trange que ce que
l'analyse y dmontre de recel, n'y ait pas fait jaillir ressource de
semblant.
Pour terminer selon le conseil de Fenouillard concernant la
limite,
je salue Henri-Rousselle dont prendre ici occasion, je n'oublie
pas qu'il m'offre lieu , ce jeu du dit au dire, en faire dmonstration
clinique. O mieux ai-je fait sentir qu' l'impossible dire se mesure
le rel - dans la pratique ?
et date la chose de :
Belil, le 14 juillet 12
Belil o l'on peut penser que Charles I
er
quoique pas de ma
ligne, m'a fait dfaut, mais non, qu'on le sache, Coco, forc-
ment Belil, d'habiter l'auberge voisine, soit l'ara tricolore que
sans avoir explorer son sexe, j'ai d classer comme htro - ,
de ce qu'on le dise tre parlant.
Avis au lecteur japonais
Qu'on me traduise en japonais, me laisse perplexe. Parce que c'est
une langue dont je me suis approch : la mesure de mes moyens.
J'en ai pris une haute ide. J'y reconnais la perfection qu'elle
prend de supporter un lien social trs raffin dans son discours.
Ce lien, c'est celui mme que mon ami Kojve, l'homme le plus
libre que j'aie connu, dsignait du : snobisme.
C'tait l chez lui fait d'humour, et fort loin de l'humeur qu'on
se croit en devoir de montrer quant ce mode d'tre, au nom de
l'humain.
Plutt nous avertissait-il (j'entends : nous, les Occidentaux) que
ce fut partir du snobisme qu'une chance nous restt d'accder la
chose japonaise sans en tre trop indignes, - qu'il y avait au Japon
matire plus sre que chez nous justifier ledit mode.
Note marginale : ce que j'avance ainsi, certains en France le rap-
procheraient sans doute de cet Empire des signes dont Barthes nous a
ravis, pour peu qu'ils en aient vent. Que ceux qui au Japon se sont
agacs de cette bluette tonnante, me fassent confiance : je n'en ferai
part qu' ceux qui ne peuvent pas confondre.
Ceci dit, du Japon je n'attends rien. Et le got que j'ai pris de ses
usages, voire de ses beauts, ne me fait pas en attendre plus.
Notamment pas d'y tre entendu.
Ce n'est certes pas que les Japonais ne tendent l'oreille tout ce
qui peut s'lucubrer de discours dans le monde. Ils traduisent, tra-
duisent, traduisent tout ce qui en parat de lisible : et ils en ont bien
besoin. Autrement ils n'y croiraient pas : comme a, ils se rendent
compte.
Seulement voil : dans mon cas, la situation est pour eux diff-
rente. Justement parce que c'est la mme que la leur : si je ne peux
pas y croire, c'est dans la mesure o a me concerne. Mais ceci ne
constitue, entre les Japonais et moi, pas un facteur commun.
497
AVIS AU LECTEUR JAPONAIS
J'essaie de dmontrer des matres , des universitaires, voire
des hystriques, qu'un autre discours que le leur vient d'apparatre.
Comme il n'y a que moi pour le tenir, ils pensent en tre bientt
dbarrasss me l'attribuer, moyennant quoi j'ai foule m'couter.
Foule qui se leurre, car c'est le discours du psychanalyste, lequel
ne m'a pas attendu pour tre dans la place.
Mais a ne veut pas dire que les psychanalystes le savent. On
n'entend pas le discours dont on est soi-mme l'effet.
Note marginale : a se peut quand mme. Mais alors on se fait
expulser par ce qui fait corps de ce discours. a m'est donc arriv.
Je reprends de cette note : les Japonais ne s'interrogent pas sur leur
discours ; ils le retraduisent, et dans ceux mmes que je viens de dire.
Us le font avec fruit, entre autres du ct du Nobel.
Toujours le snobelisftie.
Que peut ds lors leur faire le fait de mes difficults avec un
discours des psychanalystes auquel personne d'entre eux que j'aie
rencontr ne s'est jamais intress ? Sinon au titre de l'ethnologie de
la peuplade amricaine, o a n'apparat que comme dtail.
L'inconscient, (- pour savoir ce que c'est, lire le discours que ces
Ecrits consignent pour tre celui de Rome - ) , l'inconscient, dis-je,
est structur comme un langage.
C'est ce qui permet la langue japonaise d'en colmater les for-
mations si parfaitement que j'ai pu assister la dcouverte par une
Japonaise de ce que c'est qu'un mot d'esprit : une Japonaise adulte.
D'o se prouve que le mot d'esprit est au Japon la dimension
mme du discours le plus commun, et c'est pourquoi personne qui
habite cette langue, n'a besoin d'tre psychanalys, sinon pour rgu-
lariser ses relations avec les machines--sous, - voire avec des clients
plus simplement mcaniques.
Pour les tres vraiment parlants, Yon-yomi suffit commenter
le kun-yomi. La pince qu'ils font l'un avec l'autre, c'est le bien-tre
de ceux qu'ils forment ce qu'ils en sortent aussi frais que gaufre
chaude.
Tout le monde n'a pas le bonheur de parler chinois dans sa
langue, pour qu'elle en soit un dialecte, ni surtout, - point plus
fort -, d'en avoir pris une criture sa langue si trangre que a
y rende tangible chaque instant la distance de la pense, soit de
l'inconscient, la parole. Soit l'cart si scabreux dgager dans les
498
AVIS AU LECTEUR JAPONAIS
langues internationales, qui se sont trouves pertinentes pour la
psychanalyse.
Si je ne craignais le malentendu, je dirais que pour qui parle japo-
nais, c'est performance usuelle que de dire la vrit par le mensonge,
c'est--dire sans tre un menteur.
On m'a demand une prface pour mon dition japonaise. J'y dis
ce que je pense pour ce dont, quant au Japon, je n'ai aucune ide,
savoir : ce qu'est le public.
De sorte que j'ai envie de l'inviter fermer mon livre, sitt cette
prface lue ! J'aurais l'espoir de lui laisser un souvenir indulgent.
Je tremble qu'il poursuive, dans le sentiment o je suis de n'avoir
jamais eu, dans son pays, de communication qu' ce qu'elle
s'opre du discours scientifique, ici je veux dire : par le moyen du
tableau noir.
C'est une communication , qui n'implique pas que plus d'un y
comprenne ce qui s'y agite, voire mme qu'il y en ait un.
Le discours de l'analyste n'est pas le scientifique. La communi-
cation y rpercute un sens. Mais le sens d'un discours ne se procure
jamais que d'un autre.
Maintenant imaginons qu'au Japon comme ailleurs, le discours
analytique devienne ncessaire pour que subsistent les autres, je veux
dire : pour que l'inconscient renvoie leur sens. Telle qu'y est faite la
langue, on n'aurait ma place besoin que d'un stylo. Moi, pour
la tenir, cette place, il me faut un style.
Ce qui ne se traduit pas, hors l'histoire d'o je parle.
\
Ce 27 janvier 1972
VIII
Postface au Sminaire XI
Ainsi se lira - ce bouquin je parie.
Ce ne sera pas comme mes crits dont le livre s'achte : dit-on,
mais c'est pour ne pas le lire.
Ce n'est pas prendre pour l'accident, de ce qu'ils soient diffi-
ciles. En crivant crits sur l'enveloppe du recueil, c'est ce que j'en-
tendais moi-mme m'en promettre : un crit mon sens est fait
pour ne pas se lire.
C'est que a dit autre chose.
Quoi? Comme c'est o j'en suis de mon prsent dire, je prends
ici cas de l'illustrer, selon mon usage.
Ce qu'on vient de lire, au' moins est-ce suppos de ce que je le
postface, n'est donc pas un crit.
Une transcription, voil un mot que je dcouvre grce la modes-
tie de J.-A. M., Jacques-Alain, Miller du nom : ce qui se lit passe--
travers l'criture en y restant indemne.
-Gr ce qui se lit, c'est de a que je parle, puisque ce que je dis est
vou l'inconscient, soit ce qui se lit avant tout.
Faut-il que j'insiste ? - Naturellement : puisque ici je n'cris pas.
A le faire, je posteffacerais mon sminaire, je ne le postfacerais pas.
J'insisterai, comme il faut pour que a se lise.
Mais j'ai encore. rendre l'auteur de ce travail de m'avoir
convaincu, - de m'en tmoigner son cours durant , que ce qui se lit
de ce que je dis, ne se lit pas moins de ce que je le dise. L'accent
mettre tant sur le dire, car le je peut bien encore courir.
Bref qu'il pourrait y avoir profit pour ce qui est de faire consistant
le discours analytique, ce que je me fie ce qu'on me relise. Le
503
POSTFACE AU SMINAIRE XI
mettre l'heure de ma venue l'cole normale n'tant l que
prendre note de la fin de mon dsert.
On ne peut douter par le temps que j'y mis de ce que l'issue me
dplaise que j'ai qualifie de poubellication. Mais qu'on p'oublie ce
que je dis au point d'y mettre le tour universitaire, vaut bien que
j'en marque ici l'incompatibilit.
Poser l'crit comme je le fais, qu'on remarque qu' la pointe c'est
acquis, voire qu'on en fera son statut.Y serais-je pour un peu, n'em-
pcherait pas que ce fut tabli bien avant mes trouvailles, puisque
aprs tout l'crit comme pas--lire, c'est Joyce qui l'introduit, je
ferais mieux de dire : l'intraduit, car faire du mot traite au-del des
langues, il ne se traduit qu' peine, d'tre partout galement peu
lire.
Moi cependant vu qui je parle, j'ai ter de ces ttes ce qu'elles
croient tenir de l'heure de l'cole, dite sans doute maternelle de ce
qu'on y possde la dmaternalisation : soit qu'on apprenne lire
en s'alphabtissant. Comme si l'enfant savoir lire d'un dessin que
c'est la girafe, d'un autre que c'est guenon qui est dire n'apprenait
pas seulement que le G dont les deux s'crivent, n'a rien faire de
se lire puisqu'il n'y rpond pas.
Que ce qui se produit ds lors d'anorthographie ne soit
jugeable qu' prendre la fonction de l'crit pour un mode autre
du parlant dans le langage, c'est o l'on gagne dans le bricolage
soit petit petit, mais ce qui irait plus vite ce qu'on sache ce
qu'il en est.
a ne serait dj pas mal que se lire s'entendt comme il convient,
l o on a le devoir d'interprter. Que ce soit la parole o ne se lise
pas ce qu'elle dit, voil pourtant ce dont l'analyste sursaute pass le
moment o il se poussah, ah ! se donner de l'coute jusqu' ne
plus tenir debout.
Intention, dfi on se dfile, dfiant on se dfend, refoule, rencle,
tout lui sera bon pour ne pas entendre que le pourquoi me mens-
504
POSTFACE AU SMINAIRE XI
tu me dire le vrai ? de l'histoire qu'on dit juive de ce que c'y soit
le moins bte qui parle n'en dit pas moins que c'est de n'tre pas
un livre de lecture que l'indicateur des chemins de fer est l le
recours par quoi se lit Lemberg au lieu de Cracovie - ou bien
encore que ce qui tranche en tout cas la question, c'est le billet que
dlivre la gare.
Mais la fonction de l'crit ne fait pas alors l'indicateur, mais la
voie mme du chemin de fer. Et l'objet (a) tel que je l'cris c'est lui
le rail par o en vient au plus-de-jouir ce dont s'habite, voire
s'abrite la demande interprter.
Si du butinage de l'abeille je lis sa part dans la fertilit des plantes
phanrogames, si j'augure du groupe plus ras-de-terre se faire vol
d'hirondelles la fortune des temptes,- c'est bien de ce qui les porte
au signifiant de ce fait que je parle, que j'ai rendre compte.
Souvenir ici de l'impudence qu'on m'imputa pour ces crits
d'avoir du mot fait ma mesure. Une Japonaise en tait hors-de-soi,
ce dont je m'tonnai.
C'est que je ne savais pas, bien que propuls, justement par
ses soins, l o s'habite sa langue, que ce lieu pourtant je ne le ttais
que du pied. Je n'ai compris que depuis ce que le sensible y reoit
de cette criture qui de Yon-yomi au kun-yomi rpercute le signifiant
au point qu'il s'en dchire de tant de rfractions, quoi le journal le
moindre, le panonceau au carrefour satisfont et appuient. Rien
n'aide autant refaire des rayons qui ruisselant d'autant de vannes, ce
qui-de la source par Amaterasu vint au jour.
C'est au point que je me suis dit que l'tre parlant par l peut se
soustraire aux artifices de l'inconscient qui ne l'atteignent pas de s'y
fermer. Cas limite me confirmer.
Vous ne comprenez pas stcriture.Tant mieux, ce vous sera raison
de l'expliquer. Et si a reste en plan, vous en serez quitte pour l'em-
barras. Voyez, pour ce qui m'en reste, moi j'y survis.
Encore faut-il que l'embarras soit srieux pour que a compte.
Mais vous pouvez pour a me suivre : n'oubliez pas que j'ai rendu ce
505
POSTFACE AU SMINAIRE XI
mot son sort dans mon sminaire sur l'angoisse, soit l'anne
d'avant ce qui vient ici. C'est vous dire qu'on ne s'en dbarrasse si
facilement que de moi.
En attendant que l'chelle vous soit propice de ce qui se lit ici : je
ne vous y fais pas monter pour en redescendre.
Ce qui me frappe quand je relis ce qui fut ma parole c'est la
sret qui me prserva de faire btise au regard de ce qui me vint
depuis.
Le risque chaque fois me parat entier et c'est ce qui me fait
fatigue. Que J.-A. M. me l'ait pargn, me laisse penser que ce ne
sera rien pour vous, mais aussi bien me fait croire que si j'en
rchappe, c'est que d'crit j'ai plus que je n'crois.
Rappelons pour nous qui nous croyons moins qu'au Japon, ce
qui s'impose du texte de la Gense, c'est que d'ex nihilo rien ne s'y
cre que du signifiant. Ce qui va de soi puisqu'en effet a ne vaut
pas plus.
L'inconvnient est qu'en dpende l'existence, soit ce dont seul le
dire est tmoin.
Que Dieu s'en prouve et d depuis longtemps le remettre sa
place. Soit celle dont la Bible pose que ce n'est pas mythe, mais bien
histoire, on l'a marqu, et c'est en quoi l'vangile selon Marx ne se
distingue pas de nos autres.
L'affreux est que le rapport dont se fomente toute la chose, ne
concerne rien que la jouissance et que l'interdit qu'y projette la reli-
gion faisant partage avec la panique dont procde cet endroit la
philosophie, une foule de substances en surgissent comme substituts
la seule propre, celle de l'impossible ce qu'on en parle, d'tre le
rel.
Cette stance-par-en-dessous ne se pourrait-il qu'elle se livrt
plus accessible de cette forme pour ou l'crit dj du pome fait le
dire le moins bte ?
Ceci ne vaut-il pas la peine d'tre construit, si c'est bien ce que je
prsume de terre promise ce discours nouveau qu'est l'analyse ?
Non pas que puisse s'en attendre jamais ce rapport dont je dis
que c'est l'absence qui fait l'accs du parlant au rel.
506
POSTFACE AU SMINAIRE XI
Mais l'artifice des canaux par o la jouissance vient causer ce
qui se lit comme le monde, voil, Ton conviendra, ce qui vaut que
ce qui s'en lit, vite l'onto-,Toto prend note, l'onto-, voire l'onto-
tautologie.
Pas moins qu'ici.
Le 1
er
janvier 1973
Tlvision
Celui qui m'interroge
sait aussi me lire. - J. L.
I
- Je dis toujours la vrit : pas toute, parce que
toute la dire, on n'y arrive pas. La dire toute, c'est S (A)
impossible, matriellement : les mots y manquent.
C'est mme par cet impossible que la vrit tient
au rel.
J'avouerai donc avoir tent de rpondre la
prsente comdie et que c'tait bon pour le
panier.
Rat donc, mais par l mme russi au regard
d'une erreur, ou pour mieux dire : d'un errement.
Celui-ci sans trop d'importance, d'tre d'occa-
sion. Mais d'abord, lequel ?
L'errement consiste en cette ide de parler pour
que des idiots me comprennent.
Ide qui me touche si peu naturellement qu'elle
n'a pu que m'tre suggre. Par l'amiti. Danger.
Car il n'y a pas de diffrence entre la tlvision
et le public devant lequel je parle depuis long-
temps, ce qu'on appelle mon sminaire. Un regard
i. Le texte tait paru prcd d'un avertissement : l."Une mission sur Jacques
Lacan", souhaitait le Service de la recherche de l'ORTF. Seul fut mis le texte ici
publi. Diffusion en deux parties sous le titre Psychanalyse, annonce pour la fin jan-
vier. Ralisateur : Benot Jacquot. 2. J'ai demand celui qui vous rpondait de cri-
bler ce que j'entendais de ce qu'il me disait. Le fin est recueilli dans la marge, en
guise de manuductio. - J.-A. Miller, Nol 1973 (2000).
509
TLVISION
dans les deux cas : qui je ne m'adresse dans
(a 0 S) aucun, mais au nom de quoi je parle.
Qu'on ne croie pas pour autant que j'y parle
la cantonade. Je parle ceux qui s'y connaissent,
aux non-idiots, des analystes supposs.
L'exprience prouve, mme s'en tenir l'at-
troupement, prouve que ce que je dis intresse
bien plus de gens que ceux qu'avec quelque raison
je suppose analystes. Pourquoi ds lors parlerais-je
d'un autre ton ici qu' mon sminaire ?
Outre qu'il n'est pas invraisemblable que j'y
suppose aussi des analystes m'entendre.
J'irais plus loin : je n'attends rien de plus des
JL analystes supposs, que d'tre cet objet grce
S
2 quoi ce que j'enseigne n'est pas une auto-analyse.
Sans doute sur ce point n'y a-t-il que d'eux, de
ceux qui m'coutent, que je serai entendu. Mais
mme ne rien entendre, un analyste tient ce rle
que je viens de formuler, et la tlvision le tient
ds lors aussi bien que lui.
J'ajoute que ces analystes qui ne le sont que
d'tre objet - objet de l'analysant -, il arrive que je
m'adresse eux, non que je leur parle, mais que je
S, - S
2
parle d'eux : ne serait-ce que pour les troubler. Qui
sait ? a peut avoir des effets de suggestion.
Le croira-t-on ? Il y a un cas o la suggestion ne
peut rien : celui o l'analyste tient son dfaut de
l'autre, de celui qui l'a men jusqu' la passe
comme je dis, celle de se poser en analyste.
Heureux les cas o passe fictive pour formation
inacheve : ils laissent de l'espoir.
510
TLVISION
II
-Urne semble, cher docteur, que je n'ai pas ici riva-
liser d'esprit avec vous... mais seulement vous donner
lieu de rpondre. Aussi vous n'aurez de moi que les
questions les plus minces - lmentaires, voir vulgaires.
Je vous lance : L'inconscient - drle de mot !
- Freud n'en a pas trouv de meilleur, et il n'y
a pas y revenir. Ce mot a l'inconvnient d'tre
ngatif, ce qui permet d'y supposer n'importe
quoi au monde, sans compter le reste. Pourquoi
pas? A chose inaperue, le nom de partout
convient aussi bien que de nulle part .
C'est pourtant chose fort prcise.
Il n'y a d'inconscient que chez l'tre parlant.
Chez les autres, qui n'ont d'tre qu' ce qu'ils soient La condition
nomms bien qu'ils s'imposent du rel, il y a de de Vinconsdent,
l'instinct, soit le savoir qu'implique leur survie.
c$est
^ l
an
Z*i* *
Encore n'est-ce que pour notre pense, peut-tre
l inadquate.
Restent les animaux en mal d'homme, dits pour
cela d'hommestiques, et que pour cette raison
parcourent des sismes, d'ailleurs fort courts, de
l'inconscient.
L'inconscient, a parle, ce qui le fait dpendre
du langage, dont on ne sait que peu : malgr ce
que je dsigne comme linguisterie pour y grouper
ce qui prtend, c'est nouveau, intervenir chez les
hommes au nom de la linguistique. La linguistique
tant la science qui s'occupe de lalangue, que j'cfts ... lequel
en un seul mot d'y spcifier son objet, comme il se ex-siste
fait de toute autre science.
^langue :
511
TLVISION
hypothse
analytique.
i(a)
La pense n'a
Vme-corps
qu'un rapport
d'ex-sistence.
Le peu
que la ralit
tient du rel
Cet objet pourtant est minent, de ce que
ce soit lui que se rduise plus lgitimement
qu' tout autre la notion mme aristotlicienne de
sujet. Ce qui permet d'instituer l'inconscient
de l'ex-sistence d'un autre sujet l'me. A l'me
comme supposition de la somme de ses fonctions
au corps. Ladite plus problmatique, malgr que
ce soit de la mme voix d'Aristote Uexkll,
et qu'elle reste ce que les biologistes supposent
encore, qu'ils le veuillent ou pas.
En fait le sujet de l'inconscient ne touche
l'me que par le corps, d'y introduire la pense :
cette fois de contredire Aristote. L'homme ne pense
pas avec son me, comme l'imagine le Philosophe.
Il pense de ce qu'une structure, celle du langage
- le mot le comporte - de ce qu'une structure
dcoupe son corps, et qui n'a rien faire avec
l'anatomie. Tmoin l'hystrique. Cette cisaille
vient l'me avec le symptme obsessionnel : pen-
se dont l'me s'embarrasse, ne sait que faire.
La pense est dysharmonique quant l'me.
Et le vo$ grec est le mythe d'une complaisance
de la pense l'me, d'une complaisance qui serait
conforme au monde, au monde (Utnwelt) dont
l'me est tenue pour responsable, alors qu'il n'est
que le fantasme dont se soutient une pense, ra-
lit sans doute, mais entendre comme grimace
du rel.
// reste qu'on vient vous,psychanalyste,pour, dans
ce monde que vous rduisez au fantasme, aller mieux.
La gurison, c'est aussi un fantasme ?
- La gurison, c'est une demande qui part de la
voix du souffrant, d'un qui souffre de son corps ou
de sa pense. L'tonnant est qu'il y ait rponse, et
512
TLVISION
que de tout temps la mdecine ait fait mouche par
des mots.
Comme tait-ce avant que fut repr l'incons-
cient? Une pratique n'a pas besoin d'tre claire
pour oprer : c'est ce qu'on peut en dduire.
- L'analyse ne se distinguerait donc de la thrapie que
d' tre claire ? Ce n'est pas ce que vous voulez dire.
Permettez que je formule ainsi la question : Psychana-
lyse et psychothrapie, toutes deux n'agissent que par des
mots. Elles s'opposent cependant. En quoi ?
- Par le temps qui court, il n'est pas de psycho-
thrapie dont on n'exige qu'elle soit d' inspiration
psychanalytique . Je module la chose pour les
guillemets qu'elle mrite. La distinction maintenue
l, serait-elle seulement de ce qu'on n'y aille pas au
tapis... au divan veux-je dire ?
a met le pied rtrier aux analystes en mal de
passe dans les socits , mmes guillemets, qui,
pour n'en rien vouloir savoir, je dis : de la passe,
y supplent par des formalits de grade, fort l-
gantes pour y tablir stablement ceux qui y
dficient plus d'astuce dans leurs rapports que
dans leur pratique.
C'est pourquoi je vais produire ce dont cette
pratique prvaut dans la psychothrapie.
Dans la mesure o l'inconscient y est intress,
il y a deux versants que livre la structure, soit le
langage.
Le versant du sens, celui dont on croirait que
c'est celui de l'analyse qui nous dverse du sens
flot pour le bateau sexuel.
Il est frappant que ce sens se rduise au non-
sens : au non-sens du rapport sexuel, lequel est
Pouvoir
des mots
Il n'est
structure que
de langage.
513
TLVISION
patent depuis toujours dans les dits de l'amour.
Patent au point d'tre hurlant : ce qui donne une
haute ide de l'humaine pense.
Encore y a-t-il du sens qui se fait prendre pour
le bon sens, qui par-dessus le march se tient pour
le sens commun. C'est le sommet du comique,
ceci prs que le comique ne va pas sans le savoir
du non-rapport qui est dans le coup, le coup du
sexe. D'o notre dignit prend son relais, voire sa
relve.
Le bon sens reprsente la suggestion, la comdie
le rire. Est-ce dire qu'ils suffisent, outre qu'ils
soient peu compatibles ? C'est l que la psychoth-
rapie, quelle qu'elle soit, tourne court, non qu'elle
n'exerce pas quelque bien, mais qui ramne au
pire.
D'o l'inconscient, soit l'insistance dont se
manifeste le dsir, ou encore la rptition de ce qui
d - (S 0 D) s'y demande, - n'est-ce pas l ce qu'en dit Freud
du moment mme qu'il le dcouvre ?
d'o l'inconscient, si la structure qui se recon-
nat de faire le langage dans lalangue, comme je le
dis, le commande bien,
nous rappelle qu'au versant du sens qui dans la
parole nous fascine - moyennant quoi cette parole
l'tre fait cran, cet tre dont Parmnide imagine la
pense -,
nous rappelle qu'au versant du sens, je conclus,
l'tude du langage oppose le versant du signe.
Comment mme le symptme, ce qu'on appelle
tel dans l'analyse, n'a-t-il pas l trac la voie ? Cela
jusqu' Freud qu'il a fallu pour que, docile l'hys-
trique, il en vienne lire les rves, les lapsus, voire
les mots d'esprit, comme on dchiffre un message
chiffr.
II n'y a pas
de rapport
sexuel.
514
TLVISION
- Prouvez que c'est bien l ce que dit Freud, et tout
ce qu'il dit
- Qu'on aille aux textes de Freud rpartis sur
ces trois chefs - les titres en sont maintenant tri-
viaux -, pour s'apercevoir qu'il ne s'agit de rien
d'autre que d'un dchiffrage de dit-mension signi-
fiante pure.
A savoir que l'un de ces phnomnes est na-
vement articul : articul veut dire verbalis, nave-
ment selon la logique vulgaire, l'emploi de lalangue
simplement reu.
Puis que c'est progresser dans un tissu d'qui-
voques, de mtaphores, de mtonymies, que Freud
voque une substance, un mythe fluidique qu'il
intitule de la libido.
Mais ce qu'il opre rellement, l sous nos yeux La pratique
fixs au texte, c'est une traduction dont se dmontre de Freud
que la jouissance que Freud suppose au terme de
processus primaire, c'est dans les dfils logiques
o il nous mne avec tant d'art qu'elle consiste
proprement.
Il n'est que de distinguer, ce quoi tait parvenue
ds longtemps la sagesse stocienne, le signifiant du
signifi (pour en traduire les noms latins comme .
Saussure), et l'on saisit l'apparence l de phno-
mnes d'quivalence dont on comprend qu'ils aient
Freud pu figurer l'appareil de l'nergtique.
Il y a un effort de pense faire pour que s'en
fonde la linguistique. De son objet, le signifiant. Pas
un linguiste qui ne s'attache le dtacher comme
tel, et du sens notaniment.
J'ai parl de versant du signe pour en marquer
l'association au signifiant. Mais le signifiant en
diffre en ceci que la batterie s'en donne dj dans
lalangue.
515
TLVISION
Parler de code ne convient pas, justement de
supposer un sens.
Lalangueest La batterie signifiante de lalangue ne fournit
la condition que le chiflSre du sens. Chaque mot y prend selon
du sens, le contexte une gamme norme, disparate, de sens,
sens dont l'htroclite s'atteste souvent au diction-
naire.
Ce n'est pas moins vrai pour des membres
entiers de phrases organises. Telle cette phrase : les
non-dupes errent, dont je m'arme cette anne.
Sans doute la grammaire y fait-elle bute de
l'criture, et pour autant tmoigne-t-elle d'un rel,
mais d'un rel, on le sait, qui reste nigme, tant
qu' l'analyse n'en saille pas le ressort pseudo-
Lobjet (a) sexuel : soit le rel qui, de ne pouvoir que mentir
au partenaire, s'inscrit de nvrose, de perversion ou
de psychose.
Je ne l'aime pas , nous apprend Freud, va loin
dans la srie s'y rpercuter.
En fait, c'est de ce que tout signifiant, du pho-
nme la phrase, puisse servir de message chiffr
(personnel, disait la radio pendant la guerre) qu'il
se dgage comme objet et qu'on dcouvre que
c'est lui qui fait que dans le monde, monde de
l'tre parlant, il y a de l'Un, c'est--dire de l'l-
ment, le GTOixTov du grec.
Suffit-il
d*un signifiant
pourfonder
le signifiant
Un?
&
Ce que Freud dcouvre dans l'inconscient, je
n'ai tout l'heure pu qu'inviter ce qu'on aille
voir dans ses crits si je dis juste, c'est bien autre
chose que de s'apercevoir qu'en gros on peut
donner un sens sexuel tout ce qu'on sait, pour la
raison que connatre prte la mtaphore bien
connue de toujours (versant de sens que Jung
exploita). C'est le rel qui permet de dnouer
effectivement ce dont le symptme consiste,
savoir un nud de signifiants. Nouer et dnouer
n'tant pas ici des mtaphores, mais bien prendre
516
TLVISION
comme ces nuds qui se construisent rellement
faire chane de la matire signifiante.
Car ces chanes ne sont pas de sens mais de
jouis-sens, crire comme vous voulez conform-
ment l'quivoque qui fait la loi du signifiant.
Je pense avoir donn une autre porte que ce
qui trane de confusion courante, au recours quali-
fi de la psychanalyse.
III
- Les psychologues, les psychothrapeutes, les psy-
chiatres, tous les travailleurs de la sant mentale - c'est
la base, et la dure, qu'ils se coltinent toute la misre du
monde. Et l'analyste, pendant ce temps ?
- Il est certain que se coltiner la misre, comme 5i
vous dites, c'est entrer dans le discours qui la t
conditionne, ne serait-ce qu'au titre d'y protes-
ter.
RJen que dire ceci, me donne position - que
certains situeront de rprouver la politique. Ce
que, quant moi, je tiens pour quiconque exclu.
Au reste les psycho- quels qu'ils soient, qui
s'emploient votre suppos coltinage, n'ont pas
protester, mais collaborer. Qu'ils le sachent ou
pas, c'est ce qu'ils font.
C'est bien commode, me fais-je rtorsion trop
facile, bien commode cette ide de discours, pour
rduire le jugement ce qui le dtermine. Ce qui
me frappe, c'est qu'en fait on ne trouve pas mieux
m'opposer, on dit : intellectualisme. Ce qui ne
fait pas le poids, s'il s'agit de savoir qui a raison.
517
TLVISION
Ce n'est
qu'au discours
analytique
qu'ex-siste
Vinconscient
comme freudien..,
, qu'auparavant
on coutait,
mais comme
autre chose,
C'est
un savoir
qui travaille,,.
,. sans matre :
S
2
//S,.
Ce d'autant moins qu' rapporter cette misre
au discours du capitaliste, je dnonce celui-ci.
J'indique seulement que je ne peux le faire
srieusement, parce qu' le dnoncer je le ren-
force, - de le normer, soit de le perfectionner.
J'interpole ici une remarque. Je ne fonde pas
cette ide de discours sur l'ex-sistence de l'incons-
cient. C'est l'inconscient que j'en situe,- de n'ex-
sister qu' un discours.
Vous l'entendez si bien qu' ce projet dont j'ai
avou le vain essai, vous annexiez une question sur
l'avenir de la psychanalyse.
L'inconscient en ex-siste d'autant plus qu' ne
s'attester en clair que dans le discours de l'hyst-
rique, partout ailleurs il n'y en a que greffe : oui, si
tonnant que cela paraisse, mme dans le discours
de l'analyste o ce qu'on en fait, c'est culture.
Ici parenthse, l'inconscient implique-t-il qu'on
l'coute ? A mon sens, oui. Mais il n'implique sre-
ment pas sans le discours dont il ex-siste qu'on
l'value comme savoir qui ne pense pas, ni ne cal-
cule, ni ne juge, ce qui ne l'empche pas de tra-
vailler (dans le rve par exemple). Disons que c'est
le travailleur idal, celui dont Marx a fait la fleur
de l'conomie capitaliste dans l'espoir de lui voir
prendre le relais du discours du matre : ce qui est
arriv en eflfet, bien que sous une forme inatten-
due. Il y a des surprises en ces affaires de discours,
c'est mme l le fait de l'inconscient.
Le discours que je dis analytique, c'est le lien
social dtermin par la pratique d'une analyse. Il vaut
d'tre port la hauteur des plus fondamentaux
parmi les liens qui restent pour nous en activit.
- Mais de ce qui fait lien social entre les analystes,
vous tes vous-mme, n'est-ce pas, exclu...
518
TLVISION
- La Socit, - dite internationale, bien que ce
soit un peu fictif, l'affaire s'tant longtemps rduite
tre familiale - Je l'ai connue encore aux mains
de la descendance directe et adoptive de Freud : si
j'osais - mais je prviens qu'ici je suis juge et par-
tie, donc partisan , je dirais que c'est actuellement
une socit d'assistance mutuelle contre le discours
analytique. La SAMCDA.
Sacre SAMCDA!
Ils ne veulent donc rien savoir du discours qui
les conditionne. Mais a ne les en exclut pas : bien
loin de l, puisqu'ils fonctionnent comme analystes,
ce qui veut dire qu'il y a des gens qui s'analysent
avec eux.
A ce discours donc, ils satisfont, mme si cer-
tains de ses effets sont par eux mconnus. Dans
l'ensemble la prudence ne leur manque pas; et
mme si ce n'est pas la vraie, a peut tre la bonne.
Au reste, c'est pour eux qu'il y a des risques.
Venons-en donc au psychanalyste et n'y allons
pas par quatre chemins. Ils nous mneraient tous
aussi bien l o je vais dire.
C'est qu'on ne saurait mieux le situer objective-
ment que de ce qui dans le pass s'est appel : tre
un sajnt.
Un saint durant sa vie n'impose pas le respect
que lui vaut parfois une aurole.
Personne ne le remarque quand il suit la voie de
Baltasar Gracian, celle de ne pas faire d'clats,
- <o Amelot de La Houssaye a cru qu'il crivait
de l'homme de cour.
Un saint, pour me faire comprendre, ne fait
pas la charit. Plutt se met-il faire le dchet : Lobjet (a)
il decharite. Ce pour raliser ce que la structure incam
impose, savoir permettre au sujet, au sujet de
l'inconscient, de le prendre pour cause de son
dsir.
519
TLVISION
C'est de l'abjection de cette cause en effet que
le sujet en question a chance de se reprer au
moins dans la structure. Pour le saint a n'est pas
drle, mais j'imagine que, pour quelques oreilles
cette tl, a recoupe bien des trangets des faits
de saint.
Que a ait effet de jouissance, qui n'en a le sens
avec le joui ? Il n'y a que le saint qui reste sec,
macache pour lui. C'est mme ce qui pate le plus
dans l'affaire. pate ceux qui s'en approchent et ne
s'y trompent pas : le saint est le rebut de la jouis*
sance.
Parfois pourtant a-t-il un relais, dont il ne se
contente pas plus que tout le monde. Il jouit. Il
n'opre plus pendant ce temps-l. Ce n'est pas que
les petits malins be le guettent alors pour en tirer
des consquences se regonfler eux-mmes. Mais
le saint s'en fout, autant que de ceux qui voient l
sa rcompense. Ce qui est se tordre.
Puisque se foutre aussi de la justice distributive,
c'est de l que souvent il est parti.
A la vrit le saint ne se croit pas de mrites,
ce qui ne veut pas dire qu'il n'ait pas de morale. Le
seul ennui pour les autres, c'est qu'on ne voit pas
o a le conduit.
Moi, je cogite perdument pour qu'il y en ait
de nouveaux comme a. C'est sans doute de ne pas
moi-mme y atteindre.
Plus on est de saints, plus on rit, c'est mon prin-
cipe, voire la sortie du discours capitaliste, - ce qui
ne constituera pas un progrs, si c'est seulement
pour certains.
520
TLVISION
IV
- Depuis vingt ans que vous avez avanc votre for-
mule, que l'inconscient est structur comme un langage,
on vous oppose, sous des formes diverses : Ce ne sont
l que - des mots, des mots, des mots. Et de ce qui ne
s'embarrasse pas de mots, qu'en faites-vous ? Quid de
l'nergie psychique, ou de l'affect, ou de la pulsion ?
-Vous imitez l les gestes avec lesquels on feint
un air de patrimoine dans la SAMCDA.
Parce que, vous le savez, au moins Paris dans la
SAMCDA, les seuls lments dont on se sustente
proviennent de mon enseignement. Il filtre de par-
tout, c'est un vent, qui fait bise quand a souffle
trop fort. Alors on revient aux vieux gestes, on se
rchauffe se pelotonner en Congrs.
Parce que ce n'est pas un pied de nez que je
sors comme a aujourd'hui, histoire de faire rire
la tl, la SAMCDA. C'est expressment ce titre
que Freud a conu l'organisation quoi ce discours
analytique, il le lguait.
Il savait que l'preuve en serait dure, l'exprience
de ses premiers suivants l'avait l-dessus difi.
^ Prenons d'abord la question de l'nergie naturelle.
- L'nergie naturelle, a fait ballon pour exer-
cices dmontrer que l aussi on a des ides.
L'nergie, - c'est vous qui lui mettez la banderole
de naturelle, parce que dans ce qu'ils disent, a
va de soi que c'est naturel : quelque chose de fait
521
TLVISION
Le mythe
libidinal
Pas moyen
d'tablir
une nergtique
de la jouissance.
pour la dpense, en tant qu'un barrage peut le
retenir et le rendre utile. Seulement voil, ce n'est
pas parce que le barrage, a fait dcor dans un pay-
sage, que c'est naturel, l'nergie.
Qu'une force de vie puisse constituer ce qui
s'y dpense, c'est une grossire mtaphore. Parce que
l'nergie n'est pas une substance, qui par exemple se
bonifie ou qui devient aigre en vieillissant -, c'est
une constante numrique qu'il faut au physicien
trouver dans ses calculs, pour pouvoir travailler.
Travailler de faon conforme ce qui, de Galile
Newton, s'est foment d'une dynamique pure-
ment mcanique : ce qui fait le noyau de ce qu'on
appelle plus ou moins proprement une physique,
strictement vrifiable.
Sans cette constante qui n'est rien de plus
qu'une combinaison de calcul, - plus de physique.
On pense que les physiciens en prennent soin et
qu'ils arrangent les quivalences entre masses,
champs et impulsions pour qu'un chiffre puisse en
sortir qui satisfasse au principe de la conservation
de l'nergie. Encore faut-il que ce principe on
puisse le poser, pour qu'une physique satisfasse
l'exigence d'tre vrifiable : c'est un fait d'exp-
rience mentale, comme s'exprimait Galile. Ou,
pour mieux dire : la condition que le systme soit
mathmatiquement ferm prvaut mme sur la
supposition qu'il soit physiquement isol.
Ce n'est pas de mon cru, cela. N'importe quel
physicien sait de faon claire, c'est--dire prte se
dire, que l'nergie n'est rien que le chiffre d'une
constance.
Or ce qu'articule comme processus primaire
Freud dans l'inconscient - a, c'est de moi, mais
qu'on y aille et on le verra -, ce n'est pas quelque
chose qui se chiffre, mais qui se dchiffre. Je dis : la
jouissance elle-mme. Auquel cas elle ne fait pas
nergie, et ne saurait s'inscrire comme telle.
522
TLVISION
Les schmas de la seconde topique par o Freud
s'y essaie, le clbre uf de poule par exemple,
sont un vritable pudendum et prteraient l'ana-
lyse, si l'on analysait le Pre. Or je tiens pour exclu
qu'on analyse le Pre rel, et pour meilleur le
manteau de No quand le Pre est imaginaire.
De sorte que plutt m'interrog-je sur ce qui
distingue le discours scientifique du discours hys-
trique o, il faut le dire, Freud, recueillir son
miel, n'y est pas pour rien. Car ce qu'il invente,
c'est le travail des abeilles comme ne pensant, ne
calculant, ne jugeant pas, soit ce qu'ici mme j'ai
relev dj, - quand aprs tout ce n'est peut-tre
pas l ce qu'en pense von Frisch.
Je conclus que le discours scientifique et le S _ ,
discours hystrique ont presque la mme structure, * ,\*
ce qui explique l'erreur que Freud nous suggre
a 2
de l'espoir d'une thermodynamique dont l'incons-
cient trouverait dans l'avenir de la science sa post-
hume explication.
On peut dire qu'aprs trois quarts de sicle il
ne se dessine pas la plus petite indication d'une
telle promesse, et mme que l'ide recule de faire
endosser le processus primaire par le principe qui,
se dire du plaisir, ne dmontrerait rien, sinon que
nous tenons l'me comme la tique la peau d'un Le Bien-dire
chien. Car cette fameuse moindre tension dont ne dit pas
Freud articule le plaisir, qu'est-ce d'autre que o est le Bien.
l'thique d'Aristote ?
Ce ne peut tre le mme hdonisme que celui
dont les picuriens se faisaient enseigne. Il fallait
qu'ils eussent quelque chose de bien prcieux en
abriter, de plus secret mme que les stociens, pour
de cette enseigne qui ne voudrait dire maintenant
que psychisme, se faire injurier du nom de pour-
ceaux.
Quoi qu'il en soit, je m'en suis tenu Nico-
maque et Eudme, soit Aristote, pour en difie-
523
TLVISION
rencier vigoureusement l'thique de la psychana-
lyse, - dont je frayai la voie toute une anne.
L'histoire de l'affect que je ngligerais, c'est le
mme tabac.
Qu'on me rponde seulement sur ce point : un
affect, a regarde-t-il le corps ? Une dcharge d'adr-
Nulle harmonie naline, est-ce du corps ou pas ? Que a en drange
de l'tre les fonctions, c'est vrai. Mais en quoi a vient-il
dans le monde... de l'me ? C'est de la pense que a dcharge.
Alors ce qui est peser, c'est si mon ide que
... s'il parle, l'inconscient est structur comme un langage,
permet de vrifier plus srieusement l'affect, - que
celle qui s'exprime de ce que ce soit un remue-
mnage dont se produit un meilleur arrangement.
Car c'est a qu'on m'oppose.
Ce que je dis de l'inconscient va-t-il ou non plus
loin que d'attendre que l'affect, telles les alouettes
dj rties, vous tombe dans le bec, adquat? Adae-
quatio, plus bouffonne d'en remettre sur une autre
bien tasse, conjoindre cette fois rei, de la chose,
affectus, l'affect dont elle se recasera. Il a fallu arriver
notre sicle pour que des mdecins produisent
a.
Je n'ai, pour moi, fait que restituer ce que Freud
nonce dans un article de 1915 sur le refoulement,
et dans d'autres qui y reviennent, c'est que l'affect
est dplac. Comment se jugerait ce dplacement,
si ce n'est par le sujet que suppose qu'il ne vienne
l pas mieux que de la reprsentation?
Cela, je l'explique de sa bande pour comme
lui l'pingler, puisqu'aussi bien je dois reconnatre
que j'ai affaire la mme. Seulement ai-je dmon-
tr par un recours sa correspondance avec Fliess
(de l'dition, la seule qu'on ait, de cette correspon-
dance, expurge) que ladite reprsentation, sp-
cialement refoule, ce n'est rien de moins que la
La mtonymie
pour le corps
est de rgle...
524
TLVISION
structure et prcisment en tant que lie au postu- ... car le sujet
lat du signifiant. Cf. lettre 52 : ce postulat y est crit, de k pense
Dire que je nglige l'affect, pour se rengorger de #' mtaphoris,
le faire valoir, comment s'y tenir sans se rappeler
qu'un an, le dernier de mon sjour Sainte-Anne,
je traitai de l'angoisse ?
Certains savent la constellation o je lui fis
place. L'moi, l'empchement, l'embarras, diffren-
cis comme tels, prouvent assez que l'affect, je n'en
fais pas peu de cas.
Il est vrai que de m'entendre Sainte-Anne,
c'tait interdit aux analystes en formation dans la
SAMCDA.
Je ne le regrette pas. J'ai affect si bien mon
monde , cette anne-l, fonder l'angoisse de l'ob-
jet qu'elle concerne - loin d'en tre dpourvue (
quoi en restent les psychologues qui n'y ont pu
apporter plus que sa distinction de la peur...) , la
fonder, dis-je de cet abjet comme je dsigne main-
tenant plutt mon objet (a), qu'un de chez moi
eut le vertige (vertige rprim), de me laisser, tel
cet objet, tomber.
Reconsidrer l'affect partir de mes dires,
reconduit en tout cas ce qui s'en est dit de sr.
La simple rsection des passions de l'me, comme
sdnlfc Thomas nomme plus justement ces affects,
la rsection depuis Platon de ces passions selon
le corps : tte, cur, voire comme dit m&o\iia
ou surcur, ne tmoigne-t-elle pas dj de ce qu'il
faille pour leur abord en passer par ce corps, que je
dis n'tre affect que par la structure ?
J'indiquerai par quel bout se pourrait donner
suite srieuse, entendre pour srielle, ce qui
dans cet effet prvaut de l'inconscient.
La tristesse, par exemple, on la qualifie de
dpression, lui donner l'me pour support, ou la
tension psychologique du philosophe Pierre Janet.
525
TLVISION
Il n'est
thique
que du
Bien-dire,...
... savoir
que de
non-sens.
Au
rendez-vous
avecl'(z),...
Mais ce n'est pas un tat d'me, c'est simplement
une faute morale, comme s'exprimait Dante, voire
Spinoza : un pch, ce qui veut dire une lchet
morale, qui ne se situe en dernier ressort que de la
pense, soit du devoir de bien dire ou de s'y
retrouver dans l'inconscient, dans la structure.
Et ce qui s'ensuit pour peu que cette lchet,
d'tre rejet de l'inconscient, aille la psychose,
c'est le retour dans le rel de ce qui est rejet, du
langage ; c'est l'excitation maniaque par quoi ce
retour se fait mortel.
A l'oppos de la tristesse, il y a le gay savoir,
lequel est, lui, une vertu. Une vertu n'absout per-
sonne du pch, - originel comme chacun sait. La
vertu que je dsigne du gay savoir en est l'exemple,
de manifester en quoi elle consiste : non pas com-
prendre, piquer dans le sens, mais le raser d'aussi prs
qu'il se peut sans qu'il fasse glu pour cette vertu,
pour cela jouir du dchiffrage, ce qui implique que
le gay savoir n'en fasse au terme que la chute, le
retour au pch.
O en tout a, ce qui fait bon heur? Exacte-
ment partout. Le sujet est heureux. C'est mme sa
dfinition puisqu'il ne peut rien devoir qu' l'heur,
la fortune autrement dit, et que tout heur lui est
bon pour ce qui le maintient, soit pour qu'il se
rpte.
L'tonnant n'est pas qu'il soit heureux sans
souponner ce qui l'y rduit, sa dpendance de la
structure, c'est qu'il prenne ide de la batitude,
une ide qui va assez loin pour qu'il s'en sente
exil.
Heureusement que l nous avons le pote pour
vendre la mche : Dante que je viens de citer, et
d'autres, hors les roulures de ceux qui font cagnotte
au classicisme.
Un regard, celui de Batrice, soit trois fois rien,
un battement de paupires et le dchet exquis qui
526
TLVISION
en rsulte : et voil surgi l'Autre que nous ne
devons identifier qu' sa jouissance elle, celle que
lui, Dante, ne peut satisfaire, puisque d'elle il ne
peut avoir que ce regard, que cet objet, mais dont
il nous nonce que Dieu la comble ; c'est mme
de sa bouche eue qu'il nous provoque en rece-
voir l'assurance.
A quoi rpond en nous: ennui. Mot dont,
faire danser les lettres comme au cinmatographe
jusqu' ce qu'elles se replacent sur une ligne,
j'ai recompos le terme : unien. Dont je dsigne
l'identification de l'Autre l'Un. Je dis : l'Un mys-
tique dont l'autre comique, faire minence dans
le Banquet de Platon, Aristophane pour le nommer,
nous donne le cru quivalent dans la bte--deux-
os dont il impute Jupiter qui n'en peut mais, la
bisection : c'est trs vilain, j'ai dj dit que a ne
se fait pas. On ne commet pas le Pre rel dans de
telles inconvenances.
Reste que Freud y choit aussi: car ce qu'il
impute l'ros, en tant qu'il l'oppose Thanatos,
comme principe de la vie , c'est d'unir, comme
si, part une brve cotration, on n'avait jamais
vu deux corps s'unir en un.
Ainsi l'affect vient-il un corps dont le propre
serait d'habiter le langage, - je me geaite ici de
pltjfries qui se vendent mieux que les miennes - ,
l'affect, dis-je, de ne pas trouver de logement, pas de
son got tout au moins. On appelle a la morosit,
la mauvaise humeur aussi bien. Est-ce un pch, a,
un grain de folie, ou une vraie touche du rel ?
Vous voyez que l'affect, ils auraient mieux fait,
les SAMCDA, pour le moduler, de prendre mon
crin-crin. a les aurait mens plus loin que de
bayer aux corneilles.
. . . 5i c'est
jouissance
de femme,..
... VAutre
prend
ex-sistence,.
... mats
non pas
substance
d'Un.
Car
rien n'est tout
aux dfils
du signifiant,...
... l'affect
est discord,...
Que vous compreniez la pulsion dans ces gestes
vagues^ dont de mon discours on se garantit, c'est
527
TLVISION
me faire la part trop belle pour que je vous en sois
reconnaissant, car vous le savez bien, vous qui d'une
brosse impeccable avez transcrit mon XI
e
Smi-
naire : qui d'autre que moi a su se risquer en dire
quoi que ce soit?
Pour la premire fois, et chez vous notamment,
je sentais m'couter d'autres oreilles que moroses :
soit qui n'y entendaient pas que j'Autrifiais l'Un,
comme s'est rue le penser la personne mme
qui m'avait appel au lieu qui me valait votre
audience.
A lire les chapitres 6,7,8,9 et 13,14 de ce Smi-
naire XJ, qui n'prouve ce que l'on gagne ne pas
traduire Trieb par instinct, et serrant au plus prs
et la pulsion cette pulsion de l'appeler drive, en dmonter,
drive, puis remonter, collant Freud, la bizarrerie ?
A m'y suivre, qui ne sentira la diffrence qu'il
y a, de l'nergie, constante chaque fois reprable
de l'Un dont se constitue l'exprimental de la
science, au Drang ou pousse de la pulsion qui,
jouissance certes, ne prend que de bords corporels,
-j'allais en donner la forme mathmatique, - sa
permanence? Permanence qui ne consiste qu'en
la quadruple instance dont chaque pulsion se sou-
tient de coexister trois autres. Quatre ne donne
accs que d'tre puissance, la dsunion quoi il
s'agit de parer, pour ceux que le sexe ne suffit pas
Aussi rendre partenaires.
nepuis-je Certes je n'en fais pas l l'application dont se
dire distinguent nvrose, perversion et psychose.
ce que tu es Je l'ai faite ailleurs : ne procdant jamais que
pour moi. selon les dtours que l'inconscient y fait chemins
revenir sur ses pas. La phobie du petit Hans, j'ai
montr que c'tait a, o il promenait Freud et son
pre, mais o depuis les analystes ont peur.
528
TLVISION
V
- Il y a une rumeur qui chante : si on jouit si mal,
c'est qu'il y a rpression sur le sexe, et, c'est la faute,
premirement la famille, deuximement la socit, et
particulirement au capitalisme. La question se pose.
- a, c'est une question - me suis-je laiss dire,
car de vos questions j'en parle - , une question qui
pourrait s'entendre de votre dsir de savoir com-
ment y rpondre, vous-mme, l'occasion. Soit :
si elle vous tait pose, par une voix plutt que
par une personne, une voix ne se concevoir
que comme provenant de la tl, une voix qui
n'ex-siste pas, ce de ne rien dire, la voix pourtant,
au nom de quoi, moi, je fais ex-sister cette
rponse, qui est interprtation.
A le dire crment, vous savez que j'ai rponse a-+ S
tout, moyennant quoi vous me prtez la question : S
2
vous vous fiez au proverbe qu'on ne prte qu'au
riche. Avec raison.
Qui ne sait que c'est du discours analytique que
j'ai fait fortune? En quoi je suis un self mode mon.
Il y en a eu d'autres, mais pas de nos jours.
Freud n'a pas dit que le refoulement provienne
de la rpression : que (pour faire image), la castra-
tion, ce soit d ce que Papa, son moutard qui se
tripote la ququette, brandisse : On te la coupera,
sr, si tu remets a.
Bien naturel pourtant que a lui soit venu la
pense, Freud, de partir de l pour l'exprience,
- entendre de ce qui la dfinit dans le discours
analytique. Disons qu' mesure qu'il y avanait,
529
TLVISION
Le refoulement il penchait plus vers l'ide que le refoulement
originaire tait premier. C'est dans l'ensemble la bascule de
la seconde topique. La gourmandise dont il dnote
le surmoi est structurale, non pas effet de la civili-
sation, mais malaise (symptme) dans la civilisa-
tion .
De sorte qu'il y a lieu de revenir sur l'preuve,
partir de ce que ce soit le refoulement qui pro-
duise la rpression. Pourquoi la famille, la socit
elle-mme ne seraient-elles pas crations s'difier
du refoulement? Rien de moins, mais a se pour-
rait de ce que l'inconscient ex-siste, se motive de
la structure, soit du langage. Freud limine si
peu cette solution que c'est pour en trancher qu'il
s'acharne sur le cas de l'Homme aux loups, lequel
homme s'en trouve plutt mal. Encore semble-t-il
que ce ratage, ratage du cas, soit de peu auprs de
sa russite : celle d'tablir le rel des faits.
S'il reste nigmatique, ce rel, est-ce au discours
analytique, d'tre lui-mme institution, qu'il faut
l'attribuer?
Point d'autre recours alors que le projet de la
science pour venir bout de la sexualit : la sexo-
logie n'y tant encore que projet. Projet quoi, il
y insiste, Freud faisait confiance. Confiance qu'il
avoue gratuite, ce qui en dit long sur son thique.
Or le discours analytique, lui, fait promesse :
d'introduire du nouveau. Ce, chose norme, dans
le champ dont se produit l'inconscient, puisque ses
impasses, entre autres certes, mais d'abord, se rv-
lent dans l'amour.
Ce n'est pas que tout le monde ne soit averti de
ce nouveau qui court les rues -, mais il ne rveille
personne, pour la raison que ce nouveau est trans-
cendant : le mot est prendre du mme signe qu'il
constitue dans la thorie des nombres, soit math-
matiquement.
Du nouveau
dans Vamour
530
TLVISION
D'o ce n'est pas pour rien qu'il se supporte du
nom de trans-fert.
Pour rveiller mon monde, ce transfert je
l'articule du sujet suppos savoir . Il y a l expli-
cation, dpliement de ce que le nom n'pingle
qu'obscurment. Soit : que le sujet, par le transfert,
est suppos au savoir dont il consiste comme sujet
de l'inconscient et que c'est l ce qui est transfr _
sur l'analyste, soit ce savoir en tant qu'il ne pense, ^2
ni ne calcule, ni ne juge pour n'en pas moins por-
ter effet de travail.
a vaut ce que a vaut, ce frayage, mais c'est
comme si je fltais... ou pire comme si c'tait la
frousse que je leur foutais.
SAMCDA simplicitas : ils n'osent. Us n'osent
s'avancer o a mne.
Ce n'est pas que je ne me dcarcasse ! Je profre
l'analyste ne s'autorise que de lui-mme . J'insti-
tue la passe dans mon Ecole, soit l'examen de ce
qui dcide un analysant se poser en analyste,
- ceci sans y forcer personne. a ne porte pas
encore, je dois l'avouer, mais l on s'en occupe, et
mon cole, je ne l'ai pas de si longtemps.
Ce n'est pas que j'aie l'espoir qu'ailleurs on
cesse de faire du transfert retour l'envoyeur. C'est
J'attribut du patient, une singularit qui ne nous
touche qu' nous commander la prudence, dans
son apprciation d'abord, et plus que dans son
maniement. Ici l'on s'en accommode, mais l o
irions-nous?
Ce que je sais, c'est que le discours analytique ne
peut se soutenir d'un seul. J'ai le bonheur qu'il y Transfini
en ait qui me suivent. Le discours a donc sa chance, du discours
Aucune effervescence,- qui aussi bien se suscite
de lui - , ne saurait lever ce qu'il atteste d'une Impossible
maldiction sur le sexe, que Freud voque dans son du Bien-dire
Malaise. sur le sexe,.
531
TLVISION
Si j'ai parl d'ennui, voire de morosit, propos
de l'abord divin de l'amour, comment mcon-
natre que ces deux affects se dnoncent - de pro-
pos, voire d'actes - chez les jeunes qui se vouent
des rapports sans rpression -, le plus fort tant que
les analystes dont ainsi ils se motivent leur oppo-
sent bouche pince.
Mme si les souvenirs de la rpression familiale
n'taient pas vrais, il faudrait les inventer, et on n'y
manque pas. Le mythe, c'est a, la tentative de don-
ner forme pique ce qui s'opre de la structure.
... c'est L'impasse sexueUe scrte les fictions qui ratio-
de structure,... nalisent l'impossible dont elle provient. Je ne les dis
pas imagines, j'y lis comme Freud l'invitation au
rel qui en rpond.
... lire L'ordre familial ne fait que traduire que le Pre
le mythe n'est pas le gniteur, et que la Mre reste contaminer
d'dipe. la femme pour le petit d'homme ; le reste s'ensuit.
Ce n'est pas que j'apprcie le got de l'ordre
qu'il y a chez ce petit, ce qu'il nonce dire :
Personnellement (sic) j'ai horreur de l'anarchie.
Le propre de l'ordre, o il y en a le moindre, c'est
qu'on n'a pas le goter puisqu'il est tabli.
C'est arriv dj quelque part par bon heur,
et c'est heur bon tout juste dmontrer que a y
va mal pour mme l'bauche d'une libert. C'est
le capitalisme remis en ordre. Au temps donc pour
le sexe, puisqu'en effet le capitalisme, c'est de l
qu'il est parti, de le mettre au rancart.
Vous avez donn dans le gauchisme, mais autant
que je le sache, pas dans le sexo-gauchisme. C'est
que celui-ci ne tient qu'au discours analytique, tel
qu'il ex-siste pour l'heure. Il ex-siste mal, de ne faire
que redoubler la maldiction sur le sexe. En quoi il
se montre redouter cette thique que je situais du
Bien-dire.
532
TLVISION
- N'est-ce pas reconnatre seulement qu'il n'y a rien
attendre de la psychanalyse pour ce qui est d'apprendre
faire l'amour? D'o on comprend que les espoirs se
reportent sur la sexologie.
- Comme je l'ai tout l'heure laiss entendre,
c'est plutt la sexologie dont il n'y a rien
attendre. On ne peut par l'observation de ce qui
tombe sous nos sens, c'est--dire la perversion, rien
construire de nouveau dans l'amour.
Dieu par contre a si bien ex-sist que le paga-
nisme en peuplait le monde sans que personne y
entende rien. C'est o nous revenons.
< Dieu merci ! comme on dit, d'autres traditions
nous assurent qu'il y a eu des gens plus senss, dans
le Tao par exemple. Dommage que ce qui pour
eux faisait sens soit pour nous sans porte, de Sagesse?
laisser froide notre jouissance.
Pas de quoi nous frapper, si la Voie comme je l'ai
dit passe par le Signe. S'il s'y dmontre quelque
impasse, - je dis bien : s'assure se dmontrer,
- c'est l notre chance que nous en touchions le
rel pur et simple, - comme ce qui empche d'en
dire toute la vrit.
Il n'y aura de di-eu-re de l'amour que ce compte Dieu
fait, dont le complexe ne peut se dire qu' se faire est dire.
tordu.
- Vous n'opposez pas aux jeunes, comme vous dites,
bouche pince. Certes pas, puisque vous leur avez lanc
un jour, Vincennes : Comme rvolutionnaires, vous
aspirez un matre. Vous l'aurez. En somme, vous
dcouragez la jeunesse.
533
TLVISION
- Ils me cassaient les pieds selon la mode de
l'poque. Il me fallait marquer le coup.
Un coup si vrai que depuis ils se pressent mon
sminaire. De prfrer, somme toute, la trique ma
bonace.
- D'o vous vient par ailleurs l'assurance de pro-
phtiser la monte du racisme ? Et pourquoi diable le
dire ?
- Parce que ce ne me parat pas drle et que
pourtant, c'est vrai.
Dans l'garement de notre jouissance, il n'y a
que l'Autre qui la situe, mais c'est en tant que nous
en sommes spars. D'o des fantasmes, indits
quand on ne se mlait pas.
Laisser cet Autre son mode de jouissance,
c'est ce qui ne se pourrait qu' ne pas lui imposer
le ntre, ne pas le tenir pour un sous-dvelopp.
S'y ajoutant la prcarit de notre mode, qui
dsormais ne se situe que du plus-de-jouir, qui
mme ne s'nonce plus autrement, comment esp-
rer que se poursuive l'humanitairerie de com-
mande dont s'habillaient nos exactions ?
Dieu, en reprendre de la force, finirait-il par
ex-sister, a ne prsage rien de meilleur qu'un
retour de son pass funeste.
534
TLVISION
VI
- Trois questions rsument pour Kant, voir le Canon
de la premire Critique, ce qu'il appelle Vintrt de
notre raison: Que puis-je savoir? Que dois-je
faire? Que m'est-il permis d'esprer? Formule qui,
vous ne Vignorezpas, est drive de Vexgse mdivale,
et prcisment d'Agostino de Dock. Luther la cite, pour la
critiquer. Voici Veocercke que je vous propose : y rpondre,
votre tour, ou y trouver redire.
- Le terme ceux qui m'entendent devrait,
aux propres oreilles qu'il intresse, se rvler d'un
autre accent ce qu'y rsonnent vos questions,
au point que leur apparaisse quel point mon
discours n'y rpond pas.
Aussi bien n'y et-il que moi qui elles fissent
cet effet, qu'il serait encore objectif, puisque c'est
moi qu'elles font objet ce qu'il choie de ce dis-
cours, au point d'entendre qu'il les exclut, - la
chose allant au bnfice (pour moi il est vrai
secondaire) de me rendre raison de ce dont je me
casse la tte quand, ce discours, j'y suis : - de l'assis-
tance qu'il recueille, pour moi lui sans mesure.
A cette assistance, a apporte de ne plus entendre
a.
Il y a l de quoi m'inciter , votre flottille kan-
tienne, m'en faire embarcation pour que mon
discours s'offre l'preuve d'une autre structure.
- Eh bien, que puis-je savoir?
535
TLVISION
Je le sapais - Mon discours n'admet pas la question de ce
dj,... qu'on peut savoir, puisqu'il part de le supposer
comme sujet de l'inconscient.
Bien sr n'ignor-je pas le choc que fat New-
ton pour les discours de son poque et que c'est l
ce dont procde Kant et sa cogitature. Il en ferait
bord, de celle-ci, bord prcurseur l'analyse, quand
il l'affronte Swedenborg, mais pour tater de
Newton, il retourne l'ornire philosophique de
s'imaginer que Newton rsume de ladite le piti-
nement. Kant serait-il parti du commentaire de
Newton sur le livre de Daniel qu'il n'est pas sr
qu'il y et trouv le ressort de l'inconscient. Ques-
tion d'toffe.
L-dessus je lche le morceau de ce que rpond
le discours analytique l'incongru de la question :
que puis-je savoir? Rponse :
...car rien qui n'ait la structure du langage en tout cas,
a-priori d'o il rsulte que jusqu'o j'irai dans cette limite,
' est une question de logique.
le langage,... Ceci s'affirme de ce que le discours scientifique
russisse l'alunissage o s'atteste pour la pense
l'irruption d'un rel. Ceci sans que la mathma-
tique ait d'appareil que langagier. C'est ce dont
les contemporains de Newton marquaient le coup.
Ils demandaient comment chaque masse savait la
distance des autres. A quoi Newton : Dieu, lui,
le sait - et fait ce qui faut.
Mais le discours politique, - ceci noter - ,
entrant dans l'avatar, l'avnement du rel, l'alunis-
sage s'est produit, au reste sans que le philosophe
qu'il y a en chacun par la voie du journal s'en
meuve sinon vaguement.
L'enjeu maintenant est de quoi aidera sortir
le rel-de-la-structure : de ce qui de la langue ne
fait pas chiffre, mais signe dchiffrer.
536
TLVISION
Ma rponse donc ne rpte Kant qu' ceci
prs que se sont dcouverts depuis les faits de Tin-
conscient, et qu'une logique s'est dveloppe de
la mathmatique comme si dj le retour de ces
faits la suscitait. Nulle critique en effet, malgr le
titre bien connu de ses ouvrages, ne vient juger
en eux de la logique classique, en quoi il tmoigne
seulement tre jouet de son inconscient, qui de ne
penser ne saurait juger ni calculer dans le travail
qu'il produit l'aveugle.
Le sujet de l'inconscient, lui, embraye sur le
corps. Faut-il que je revienne sur ce qu'il ne se
situe vritablement que d'un discours, soit de ce
dont l'artifice fait le concret, oh combien ! *
Quoi de l peut se dire, du savoir qui ex-siste
pour nous dans l'inconscient, mais qu'un discours
seul articule, quoi peut se dire dont le rel nous
vienne par ce discours ? Ainsi se traduit votre ques-
tion dans mon contexte, c'est--dire qu'elle parat
folle.
Il faut pourtant oser la poser telle pour avancer
comment, suivre l'exprience institue, pour-
raient venir propositions dmontrer pour la
soutenir. Allons.
Peut-on dire par exemple que, si L'homme veut
La femme, il ne l'atteint qu' chouer dans le
champ de la perversion? C'est ce qui se formule
de l'exprience institue du discours psychanaly-
tique. Si ceb se vrifie, est-ce enseignable tout le Le mathme
monde, c'est--dire scientifique, puisque la science
s'est fray la voie de partir de ce postulat ?
Je dis que a l'est, et d'autant plus que, comme
le souhaitait Renan pour l'avenir de b science ,
c'est sans consquence puisque La femme n'ex-siste La femme
pas. Mais qu'elle n'ex-siste pas, n'exclut pas qu'on
en fasse l'objet de son dsir. Bien au contraire, d'o
le rsultat.
537
... mats pas
la logique
des classes.
Pas de discours
qui ne soit
du semblant.
TLVISION
Moyennant quoi L'homme, se tromper, ren-
contre une femme, avec laquelle tout arrive : soit
d'ordinaire ce ratage en quoi consiste la russite de
l'acte sexuel. Les acteurs en sont capables des plus
hauts faits, comme on le sait par le thtre.
Le noble, le tragique, le comique, le bouffon (
se pointer d'une courbe de Gauss), bref l'ventail
de ce que produit la scne d'o a s'exhibe - celle
qui clive de tout lien social les affaires d'amour -
l'ventail, donc, se ralise, - produire les fan-
tasmes dont les tres de parole subsistent dans ce
qu'ils dnomment, on ne sait trop pourquoi, de la
vie . Car de la vie , ils n'ont notion que par
l'animal, o n'a que faire leur savoir.
Rien ne tu-moigne, en effet, comme s'en sont
bien aperus les potes du thtre, que leur vie
eux tres de parole ne soit pas un rve, hors le fait
Tues... qu'ils tu-ent ces animaux tu---toi mme, c'est
le cas de le dire dans lalangue qui m'est amie d'tre
mie(nne).
Car en fin de compte l'amiti, la <Pikia plutt
d'Aristote (que je ne msestime pas de le quitter),
c'est bien par o bascule ce thtre de l'amour
dans la conjugaison du verbe aimer avec tout ce
qui s'ensuit de dvouement l'conomie, la loi
de la maison.
Comme on le sait, l'homme habite et, s'il ne sait
pas o, n'en a pas moins l'habitude. L'Oo, comme
dit Aristote, n'a pas plus faire avec l'thique, dont
il remarque l'homonymie sans parvenir l'en cli-
ver, que n'en a le lien conjugal.
Comment, sans souponner l'objet qui tout
cela fait pivot, non |9o, mais 8o, l'objet (a) pour
le nommer, pouvoir en tablir la science ?
Il est vrai qu'il restera accorder cet objet
du mathme que La science, la seule encore ex-
sister : La physique, a trouv dans le nombre et la
538
TLVISION
dmonstration. Mais comment ne trouverait-il pas
chaussure meilleure encore dans cet objet que j'ai
dit, s'il est le produit mme de ce mathme situer
de la structure, pour peu que celle-ci soit bien
l'en-gage, l'en-gage qu'apporte l'inconscient la
muette ?
Faut-il pour en convaincre, revenir sur la trace
qu'en donne dj le Mnon, savoir qu'il y a accs
du particulier la vrit ?
C'est coordonner ces voies qui s'tablissent
d'un discours, que mme ce qu'il ne procde que
de l'un l'un, du particulier, se conoit un nou-
veau que ce discours transmette, aussi incontesta-
blement que du mathme numrique.
1
II y suffit que quelque part le rapport sexuel
cesse de ne pas s'crire, que de la contingence
s'tablisse (autant dire), pour qu'une amorce soit L'amour
conquise de ce qui doit s'achever le dmontrer,
ce rapport, comme impossible, soit l'instituer
dans le rel.
Cette chance mme, on peut l'anticiper, d'un
recours l'axiomatique, logique de la contingence
quoi nous rompt ce dont le mathme, ou ce
qu'il dtermine comme mathmaticien, a senti la
ncessit : se laisser choir du recours aucune vi-
dence.
Ainsi poursuivrons-nous partir de l'Autre, de
l'Autre radical, qu'voque le non-rapport que le
sexe incarne, - ds qu'on y aperoit qu'il n'y a de
l'Un peut-tre que par l'exprience de l'(a)sexu.
Pour nous il a autant de droit que l'Un d'un
axiome faire sujet. Et voici ce que l'exprience ici
suggre. D'abord que s'impose pour les femmes
cette ngation qu'Aristote carte de porter sur
l'universel, soit de n'tre pas-toutes, \vi\ rcvte. V* 4>#
Comme si carter de l'universel sa ngation,
Aristote ne le rendait pas simplement futile : le
dictus de omni et nullo n'assure d'aucune ex-sistence,
539
TLVISION
comme lui-mme en tmoigne , cette ex-sistence,
ne l'affirmer que du particulier, sans, au sens fort,
s'en rendre compte, c'est--dire savoir pourquoi :
- l'inconscient.
C'est d'o une femme,- puisque de plus qu'une
Tx* <5x on ne peut parler - une femme ne rencontre
L'homme que dans la psychose.
Posons cet axiome, non que L'homme n'ex-
siste pas, cas de La femme, mais qu'une femme
se l'interdit, pas de ce que soit l'Autre, mais de ce
S (A) qu' il n'y a pas d'Autre de l'Autre , comme je le
dis.
Ainsi l'universel de ce qu'elles dsirent est de
la folie : toutes les femmes sont folles, qu'on dit.
C'est mme pourquoi elles ne sont pas toutes,
c'est--dire pas folles-du-tout, arrangeantes plutt :
au point qu'il n'y a pas de limites aux concessions
que chacune fait pour un homme : de son corps,
de son me, de ses biens.
N'en pouvant mais pour ses fantasmes dont il
est moins facile de rpondre.
Elle se prte plutt la perversion que je tiens
(S 0 a) pour celle de L'homme. Ce qui la conduit la
mascarade qu'on sait, et qui n'est pas le mensonge
que des ingrats, de coller L'homme, lui imputent.
Plutt l'-tout-hasard de se prparer pour que le
fantasme de L'homme en elle trouve son heure de
vrit. Ce n'est pas excessif puisque la vrit est
femme dj de n'tre pas toute, pas toute se dire
en tout cas.
Mais c'est en quoi la vrit se refuse plus
souvent qu' son tour, exigeant de l'acte des airs
de sexe, qu'il ne peut tenir, c'est le ratage : rgl
comme papier musique.
Laissons a de traviole. Mais c'est bien pour la
femme que n'est pas fiable l'axiome clbre de
M. Fenouillard, et que, passes les bornes, il y a la
limite : ne pas oublier.
540
TLVISION
Par quoi, de l'amour, ce n'est pas le sens qui
compte, mais bien le signe comme ailleurs. C'est
mme l tout le drame.
Et l'on ne dira pas qu' se traduire du discours
analytique, l'amour se drobe comme il le fait
ailleurs.
D'ici pourtant que se dmontre que ce soit de
cet insens de nature que le rel fasse son entre Il n'y a pas
dans le monde de l'homme - soit les passages, tout de rapport
compris : science et politique, qui en coincent sexuel
L'homme alun, - d'ici l il y a de la marge.
Car il y faut supposer qu'il y a un tout du rel,
ce qu'il faudrait prouver d'abord puisqu'on ne
suppose jamais du sujet qu'au raisonnable. Hypo-
teses non fxngo veut dire que n'ex-sistent que des
discours.
- Que dois-je faire ?
- Je ne peux que reprendre la question comme
tout le monde me la poser pour moi. Et la rponse
est simple. C'est ce que je fais, de ma pratique tirer
l'thique du Bien-dire, que j'ai dj accentue.
Prenez-en de la graine, si vous croyez qu'en
d'autres discours celle-ci puisse prosprer.
Mais j'en doute. Car l'thique est relative au
discours. Ne rabchons pas.
L'ide kantienne de la maxime mettre
l'preuve de l'universalit de son application, n'est Ne demande
que la grimace dont s'esbigne le rel, d'tre pris quefaire?
d'un seul ct. que celui
Le pied de nez rpondre du non-rapport ontk disir
l'Autre quand on se contente de le prendre au pied *'"*&*
de la lettre.
Une thique de clibataire pour tout dire,
541
TLVISION
celle qu'un Montherlant plus prs de nous a incar-
ne.
Puisse mon ami Claude Lvi-Strauss structurer
son exemple dans son discours de rception
l'Acadmie, puisque l'acadmicien a le bon heur
de n'avoir qu' chatouiller la vrit pour faire
honneur sa position.
Il est sensible que grce vos soins, c'est l que
j'en suis moi-mme.
- J'aime la pointe. Mais si vous ne vous tes pas
refus cet exercice, d'acadmicien en effet, c'est que vous
en tes, vous, chatouill. Et je vous le dmontre, puisque
vous rpondez la troisime question.
- Pour que m'est-il permis d'esprer?,
je vous la rtorque, la question, c'est--dire que
je l'entends cette fois comme venant de vous.
Ce que j'en fais pour moi, j'y ai rpondu plus
haut.
Comment me concernerait-elle sans me dire
quoi esprer? Pensez-vous l'esprance comme sans
objet?
Vous donc comme tout autre qui je donnerais
du vous, c'est ce vous que je rponds, esprez ce
qu'il vous plaira.
Sachez seulement que j'ai vu plusieurs fois
l'esprance, ce qu'on appelle : les lendemains qui
chantent, mener les gens que j'estimais autant que
je vous estime, au suicide tout simplement.
Pourquoi pas ? Le suicide est le seul acte qui
puisse russir sans ratage. Si personne n'en sait
rien, c'est qu'il procde du parti pris de ne rien
savoir. Encore Montherlant, qui sans Claude je
ne penserais mme pas.
542
TLVISION
Pour que la question de Kant ait un sens, je
la transformerai en: d'o vous esprez? En quoi
vous voudriez savoir ce que le discours analytique
peut vous promettre, puisque pour moi c'est tout
cuit.
La psychanalyse vous permettrait d'esprer Ne veux-tu
assurment de tirer au clair l'inconscient dont rien savoir
vous tes sujet. Mais chacun sait que je n'y encou- *
u
destin
rage personne, personne dont le dsir ne soit pas V*
u
f
ait
dcid. l'inconscient?
Bien plus, excusez-moi de parler des vous de
mauvaise compagnie, je pense qu'il faut refuser
le discours psychanalytique aux canailles: c'est
srement l ce que Freud dguisait d'un prtendu
-critrium de culture. Les critres d'thique ne sont
malheureusement pas plus certains. Quoi qu'il en
soit, c'est d'autres discours qu'ils peuvent se juger,
et si j'ose articuler que l'analyse doit se refuser
aux canailles, c'est que les canailles en deviennent
btes, ce qui certes est une amlioration, mais sans
espoir, pour reprendre votre terme.
Au reste le discours analytique exclut le vous
qui n'est pas dj dans le transfert, de dmontrer ce
rapport au sujet suppos savoir qu'est une mani-
festation symptomatique de l'inconscient.
'^ J'y exigerais de plus un don de la sorte dont
se crible l'accs la mathmatique, si ce don exis-
tait, mais c'est un fait que, faute sans doute de ce
qu'aucun mathme hors les miens, ne soit sorti de
ce discours, il n'y a pas encore de don discernable
leur preuve.
La seule chance qui en ex-siste ne relve que du
bon heur, en quoi je veux dire que l'espoir n'y fera
rien, ce qui suffit le rendre futile, soit ne pas le
permettre.
543
TLVISION
VII
- Titillez donc voir la vrit que Boileau versifie
comme suit : Ce que Von conoit bien, s*nonce claire-
ment. Votre style, etc.
A qui joue
sur le cristal
de la langue,...
. un jars
toujours
mange
le sexe.
- Du tac au tac je vous rponds. Il suffit de dix
ans pour que ce que j'cris devienne clair pour
tous, j'ai vu a pour ma thse o pourtant mon
style n'tait pas encore cristallin. C'est donc un fait
d'exprience. Nanmoins je ne vous renvoie pas
aux calendes.
Je rtablis que ce qui s'nonce bien, l'on le
conoit clairement - clairement veut dire que a
fait son chemin. C'en est mme dsesprant, cette
promesse de succs pour la rigueur d'une thique,
de succs de vente tout au moins.
a nous ferait sentir le prix de la nvrose par
quoi se maintient ce que Freud nous rappelle : que
ce n'est pas le mal, mais le bien, qui engendre la
culpabilit.
Impossible de se retrouver l-dedans sans un
soupon au moins de ce que veut dire la castra-
tion. Et ceci nous claire sur l'histoire que Boileau
l-dessus laissait courir, clairement pour qu'on
s'y trompe, savoir qu'on y croie.
Le mdit install dans son ocre rput : Il n'est
pas de degr du mdi-ocre au pire , voil ce que
j'ai peine attribuer l'auteur du vers qui humo-
rise si bien ce mot.
Tout cela est facile, mais a va mieux ce qui se
rvle, d'entendre ce que je rectifie pieds de
plomb, pour ce que a est : un mot d'esprit qui
personne ne voit que du feu.
544
TLVISION
Ne savons-nous que le mot d'esprit est lapsus
calcul, celui qui gagne la main l'inconscient ? a
se lit dans Freud sur le mot d'esprit.
Et si l'inconscient ne pense, ne calcule, etc., c'est
d'autant plus pensable.
On le surprendra rentendre, si on le peut,
ce que je me suis amus moduler dans mon
exemple de ce qui peut se savoir, et mieux : moins
de jouer du bon heur de lalangue que d'en suivre
la monte dans le langage...
Il a fallu mme un coup de pouce pour que je
m'en aperoive, et c'est l o se dmontre le fin du
site de l'interprtation.
Devant le gant retourn supposer que la main
savait ce qu'elle faisait, n'est-ce pas le rendre, le
gant, justement quelqu'un que supporteraient La
Fontaine et Racine ?
L'interprtation doit tre preste pour satisfaire
l'entreprt.
De ce qui perdure de perte pure ce qui ne a_
parie que du pre au pire. (~ 9)
... ou pire
COMPTE RENDU DU SMINAIRE I 97I - I 972
Titre d'un choix. D'autres s'...oupirent. Je mets ne pas le faire
mon honneur. Il s'agit du sens d'une pratique qui est la psychanalyse.
Je note que j'ai doubl ce sminaire, d'un autre s'intitulant du
savoir du psychanalyste , men de l'air de sarcasme que m'inspirait
Sainte-Anne o je faisais retour.
En quoi mon titre des Hautes-Etudes justifie-t-il qu' Paris-I-II
dont j'tais l'hte, j'ai parl de l'Un, c'est ce qu'on et pu me
demander puisque ce fut tacite.
Que l'ide n'en soit venue personne, tient l'avance qu'on
m'accorde dans le champ de la psychanalyse.
Ceux que je dsigne de s'.. .oupirer, c'est l'Un que a les porte.
Au reste je ne faisais pas pense de l'Un, mais partir du dire
qu' y a de l'Un , j'allais aux termes que dmontre son usage, pour
en faire psychanalyse.
Ce qui est dj dans le Parmnide, Le. le dialogue de Platon, par
une curieuse avant-garde. J'en ai indiqu la lecture mes auditeurs,
mais l'ont-ils faite ? Je veux dire : l'ont-ils lu comme moi ? n'est pas
-indiffrent au compte rendu prsent.
La date du discours analytique indique d'appliquer sur un rel tel
que le triangle arithmtique, mathmatique par excellence, soit trans-
missible hors sens, l'analyse dont Frege engendre l'Un de l'ensemble
vide, n de son temps, - soit o il glisse l'quivoque du nom de
nombre zro, pour instaurer que zro et un, a fasse deux. D'o
Cantor remet en question toute la srie des nombres entiers et ren-
voie le dnombrable au premier infini, K
0
nomm, le premier Un
autre reporter du premier le tranchant : celui qui de fait le coupe
du deux.
C'est bien ce que Leibniz pressentait avec sa monade, mais que,
faute de la dptrer de l'tre, il laissait dans la confusion plotinienne,
celle qui profite la dfense et illustration du matre.
547
. . . OU PIRE
C'est o s\..oupirent les analystes qui ne peuvent se faire tre
promus comme abjection la place dfinie de ce que l'Un l'occupe
de droit, avec l'aggravation que cette place est celle du semblant, soit
l o l'tre fait la lettre, peut-on dire.
Comment se feraient-ils ce que ce soit du ct de l'analysant
que l'Un s'admette quoiqu'il y soit mis au travail (cf. plus loin) ?
Ce qu'ils supportent encore moins, c'est l'inbranlable de l'Un
dans la science moderne, non que s'y maintienne l'univers, mais
que la constance de l'nergie y fasse pivot au point que mme les
refus de l'univocit par la thorie des quantas ne rfutent pas cette
constance unique, voire que la probabilit promeuve l'Un comme
l'lment le plus prs de la nature, ce qui est comique.
C'est que se faire tre de l'abjection suppose l'analyste autrement
enracin dans une pratique qui joue d'un autre rel : celui-l mme
que c'est notre enjeu de dire.
Et c'est autre chose que la remarque que l'abjection dans le
discours scientifique ait rang de vrit, pas moins. Ce manifeste ds
l'origine dans l'hystrie de Socrate, et dans les eflfets de la science,
revenir au jour plus tt qu'on ne peut l'imaginer.
Mais que trouver reprendre de l'au-moins-moi des analystes,
quand c'est ce dont je tiens le coup ?
Pourquoi, de ce que votre fille soit muette, Freud a-t-il su rendre
compte ? C'est la complicit que nous venons de dire, celle de l'hys-
trie la science. Au reste, la question n'est pas de la dcouverte de
l'inconscient, qui dans le symbolique a sa matire prforme, mais
de la cration du dispositif dont le rel touche au rel, soit ce que
j'ai articul comme le discours analytique.
Cette cration ne pouvait se produire que d'une certaine tradi-
tion de l'Ecriture, dont le joint est sonder avec ce qu'elle nonce
de la cration.
Une sgrgation en rsulte, contre quoi je ne suis pas, quoiqu'une
formation qui s'adresse tout homme, j'y prfre, mme si suivre
mes formules pas-toute femme elle n'inclut.
Ce non pas qu'une femme soit moins doue pour s'y soutenir,
bien au contraire, et justement de ce qu'elle ne s'...oupire pas de
l'Un, tant de l'Autre, prendre les termes du Parmnide.
548
. . . OU PIRE
A dire crment la vrit qui s'inscrit des noncs de Freud sur la
sexualit, il n'y a pas de rapport sexuel.
Cette formule fait sens de les rsumer. Car si la jouissance
sexuelle s'injecte si loin dans les relations de celui qui prend tre
de la parole - car c'est cela l'tre parlant - , n'est-ce pas qu'il n'a au
sexe comme spcifiant un partenaire, aucun rapport quantifiable,
dirais-je pour indiquer ce qu'exige la science (et ce qu'elle applique
l'animal).
Il n'est que trop concevable que l'ide universitaire embrouille
ceci de le classer dans le pansexualisme.
Alors que si la thorie de la connaissance ne fut longtemps que
mtaphore des rapports de l'homme la femme imagine, c'est
bien s'y opposer que se situe le discours analytique. (Freud rejette
Jung.)
'" Que de l'inconsistance des dires antiques de l'amour, l'analyse ait
la tache de faire la critique, c'est ce qui rsulte de la notion mme de
l'inconscient en tant qu'il s'avre comme savoir.
Ce que nous apporte l'exprience dispose de l'analyse, c'est que
le moindre biais du texte des dits de l'analysant, nous donne une
prise l-dessus plus directe que le mythe qui ne s'agre que du gn-
rique dans le langage.
C'est revenir l'tat civil certes, mais pourquoi pas cette voie
d'humilit?
S'il y a solidarit - et rien de plus avancer - , entre le non-
rapport des sexes et le fait qu'un tre soit parlant, c'est l faon aussi
Valable que les errements de la conscience, de situer le suppos chef-
d'uvre de la vie, elle-mme cense tre ide reproductrice, quand
aussi bien le sexe se lie la mort.
Ds lors, c'est dans les nuds du symbolique que l'intervalle situ
d'un non-rapport est reprer dans son orographie laquelle, de faire
monde pour l'homme, peut aussi bien se dire mur, et procdant de
l'(a)mur.
D'o le mot d'ordre que je donne l'analyste de ne pas ngliger
la discipline linguistique dans l'abord desdits nuds.
Mais ce n'est pas pour qu'il esquive, selon le mode qui du savoir
dans le discours universitaire fait semblant, ce que dans ce champ
cern comme linguistique, il y a de rel.
Le signifiant Un n'est pas un signifiant entre autres, et il surmonte
549
. . . OU PIRE
ce en quoi ce n'est que de l'entre-d'eux de ces signifiants que le
sujet est supposable, mon dire.
Mais c'est o je reconnais que cet Un-l n'est que le savoir
suprieur au sujet, soit inconscient en tant qu'il se manifeste comme
ex-sistant, - le savoir, dis-je, d'un rel de l'Un-tout-seul, tout-seul l
o se dirait le rapport.
Sauf ce que n'ait que zro de sens le signifiant par quoi l'Autre
s'inscrit d'au sujet tre barr, S(A) j'cris a.
C'est pourquoi je nomme nades
1
les Uns d'une des sries latrales
du triangle de Pascal. Cet Un se rpte, mais ne se totalise pas de
cette rptition : ce qui se saisit des riens de sens, faits de non-sens,
reconnatre dans les rves, les lapsus, voire les mots du sujet pour
qu'il s'avise que cet inconscient est le sien.
Sien comme savoir, et le savoir comme tel affecte sans doute.
Mais quoi ? c'est la question o l'on se trompe.
- Pas mon sujet (celui que j'ai dit il y a un moment : qu'il
constitue dans son semblant, je disais sa lettre).
- L'me non plus, ce que s'imaginent les imbciles, au moins
le laissent-ils croire, quand on retrouve les lire cette me avec
quoi l'homme pense, pour Aristote, l'me que reconstruit un
Uexkull, sous les espces d'un Innenwelt qui de YUmwelt est le
trait-portrait.
Je dis, moi, que le savoir affecte le corps de l'tre qui ne se fait
tre que de paroles, ceci de morceler sa jouissance, de le dcouper
par l jusqu' en produire les chutes dont je fais le (a)
y
lire objet
petit 4, ou bien abjet, ce qui se dira quand je serai mort, temps o
enfin l'on m'entendra, ou encore l'(a)cause premire de son dsir.
Ce corps n'est pas le systme nerveux, bien que ce systme serve
la jouissance en tant que dans le corps il appareille la prdation ou
mieux la jouissance de YUmwelt pris en manire de proie - qui de
YUmwelt donc ne figure pas le trait-pour-trait, comme on persiste
le rver d'un rsidu de veille philosophique, dont la traduction en
affect marque le non-analys.
i. Prcisons : la monade, c'est donc l'Un qui se sait tout seul, point-de-rel du
rapport vide ; la nade, c'est ce rapport vide insistant, reste l'hnade inaccessible, 1' N
0
de la suite des nombres entiers par quoi deux qui l'inaugure symbolise dans la
langue le sujet suppos du savoir.
550
. . . OU PIRE
Il est donc vrai que le travail (du rve entre autres) se passe de
penser, de calculer, voire de juger. Il sait ce qu'il a faire. C'est sa
dfinition : il suppose un sujet , c'est DerArbeiter.
Ce qui pense, calcule et juge, c'est la jouissance, et la jouissance
tant de l'Autre, exige que l'Une, celle qui du sujet fait fonction soit
simplement castre, c'est--dire symbolise par la fonction imagi-
naire qui incarne l'impuissance, autrement dit par le phallus.
Il s'agit dans la psychanalyse d'lever l'impuissance (celle qui rend
raison du fantasme) l'impossibilit logique (celle qui incarne le
rel). C'est--dire de complter le lot des signes o se joue le fatum
humain. Il y suffit de savoir compter jusqu' 4, le 4 o convergent les
trois grandes oprations numriques, 2 et 2,2 fois 2,2 puissance 2.
L'Un pourtant, que je situe du non-rapport, ne fait pas partie de
ces 4, ce justement de n'en faire que l'ensemble. Ne l'appelons plus
la monade, mais l'Un-dire en tant que c'est de lui que viennent
ex-sister ceux qui in-sistent dans la rptition, dont il faut trois pour
la fonder (je l'ai dit ailleurs), ce qui va fort bien isoler le sujet des 4,
en lui soustrayant son inconscient.
C'est ce que l'anne laisse en suspens, selon l'ordinaire de la pen-
se qui ne s'en excepte pas pour autant de la jouissance.
D'o apparat que pense ne procde que par voie d'thique.
Encore faut-il mettre l'thique au pas de la psychanalyse.
L'Un-Dire, de se savoir l'Un-tout-seul, parle-t-il seul ? Pas de dia-
logue ai-je dit, mais ce pas-de-dialogue a sa limite dans l'interprta-
tion, par o s'assure comme pour le nombre le rel.
- ^l en rsulte que l'analyse renverse le prcepte de : bien faire et
laisser dire, au point que le bien-dire satis-fasse, puisqu'il n'y a qu'
plus-en-dire que rponde le pas-assez.
Ce que lalangue franaise illustre du dit : com-bien pour faire
question de la quantit.
Disons que l'interprtation du signe rend sens aux effets de signi-
fication que la batterie signifiante du langage substitue au rapport
qu'il ne saurait chiffrer.
Mais le signe en retour produit jouissance par le chiffre que per-
mettent les signifiants : ce qui fait le dsir du mathmaticien, de chif-
frer au-del du jouis-sens.
Le signe est obsession qui cde, fait obcession (crite d'un c) a la
jouissance qui dcide d'une pratique.
551
. . . OU PIRE
Je bnis ceux qui me commentent de s'affronter la tourmente
qui soutient une pense digne, soit : pas contente d'tre battue des
sentiers du mme nom.
Fassent ces lignes trace du bon heur, leur sans le savoir.
Introduction l'dition allemande
d'un premier volume des crits
Le sens du sens (the meaning of meaning), on s'en est pos la ques-
tion. Je pointerais d'ordinaire que c'tait d'en avoir la rponse, s'il
ne s'agissait pas simplement l d'un passez-muscade universitaire.
Le sens du sens dans ma pratique se saisit (Begriff) de ce qu'il fuie :
entendre comme d'un tonneau, non d'une dtalade.
C'est de ce qu'il fuie (au sens : tonneau) qu'un discours prend son
sens, soit : de ce que ses effets soient impossibles calculer.
Le comble du sens, il est sensible que c'est l'nigme.
Pour moi qui ne m'excepte pas de ma rgle susdite, c'est de la
rponse, trouve de ma pratique, que je pose la question du signe au
signe : de comment se signale qu'un signe est signe.
Le signe du signe, dit la rponse qui fait pr-texte la question,
c'est que n'importe quel signe fasse aussi bien fonction de tout
autre, prcisment de ce qu'il puisse lui tre substitu. Car le signe
n'a de porte que de devoir tre dchiffr.
Sans doute faut-il que du dchiffrage, la suite des signes prenne
sens. Mais ce n'est pas parce qu'une dit-mension donne l'autre son
-terme qu'elle livre sa structure.
Nous avons dit ce que vaut l'aune du sens.Y aboutir ne l'empche
pas de faire trou. Un message dchiffr peut rester une nigme.
Le relief de chaque opration - l'une active, l'autre subie reste
distinct.
L'analyste se dfinit de cette exprience. Les formations de l'in-
conscient, comme je les appelle, dmontrent leur structure d'tre
dchiffrables. Freud distingue la spcificit du groupe : rves, lapsus
et mots d'esprit, du mode, le mme dont il opre avec eux.
Sans doute Freud s'arrte-t-il quand il a dcouvert le sens sexuel
de la structure. Ce dont dans son uvre on ne trouve que soupon,
il est vrai formul, c'est que du sexe le test ne tient qu'au fait du sens,
car nulle part, sous aucun signe, le sexe ne s'inscrit d'un rapport.
553
INTRODUCTION L'DITION ALLEMANDE DES CRITS
C'est bon droit pourtant que de ce rapport sexuel l'inscription
pourrait tre exige : puisque le travail est reconnu, l'inconscient,
du chiffrage, - soit de ce que dfait le dchifirage.
Il peut passer pour plus lev dans la structure de chiffrer que de
compter. L'embrouille, car c'est bien fait pour a, commence l'am-
bigut du mot chiffre.
Le chiffre fonde l'ordre du signe.
Mais d'autre part jusqu' 4, jusqu' 5 peut-tre, allons jusqu'
6 maximum, les nombres qui sont du rel quoique chiffr, les
nombres ont un sens, lequel sens dnonce leur fonction de jouis-
sance sexuelle. Ce sens n'a rien voir avec leur fonction de rel,
mais ouvre un aperu sur ce qui peut rendre compte de l'entre de
rel dans le monde de l' tre parlant (tant bien entendu qu'il
tient son tre de la parole). Souponnons que la parole a la mme
dit-mension grce quoi le seul rel qui ne puisse pas s'en inscrire,
c'est le rapport sexuel.
Je dis : souponnons, pour les personnes, comme on dit, dont le
statut est si li au juridique d'abord, au semblant de savoir, voire la
science qui s'institue bien du rel, qu'elles ne peuvent mme pas
aborder la pense que ce soit l'inaccessibilit d'un rapport que
s'enchane l'intrusion de cette part au moins du reste du rel.
Ceci chez un tre vivant dont le moins qu'on puisse dire, c'est
qu'il se distingue des autres d'habiter le langage, comme dit un
Allemand que je m'honore de connatre (comme on s'exprime pour
dnoter d'avoir fait sa connaissance). Cet tre se distingue par ce
logis lequel est cotonneux en ce sens qu'il le rabat, le dit tre, vers
toutes sortes de concepts, soit de tonneaux, tous plus futiles les uns
que les autres.
Cette futilit, je l'applique, oui, mme la science dont il est
manifeste qu'elle ne progresse que par la voie de boucher les trous.
Qu'elle y arrive toujours, c'est ce qui la fait sre. Moyennant quoi
eue n'a aucune espce de sens. Je n'en dirai pas autant de ce qu'elle
produit, qui curieusement est la mme chose que ce qui sort par
la fuite dont la bance du rapport sexuel est responsable : soit ce que
je note de l'objet (a), lire petit a.
Pour mon ami Heidegger voqu plus haut du respect que je
lui porte, qu'il veuille bien s'arrter un instant, vu que j'mets
purement gratuit puisque je sais bien qu'il ne saurait le faire, s'arrter,
554
INTRODUCTION L'DITION ALLEMANDE DES CRITS
dis-je, sur cette ide que la mtaphysique n'a jamais rien t et ne
saurait se prolonger qu' s'occuper de boucher le trou de la politique.
C'est son ressort.
Que la politique n'atteigne le sommet de la futilit, c'est bien en
quoi s'y affirme le bon sens, celui qui fait la loi : je n'ai pas le sou-
ligner, m'adressant au public allemand qui y a ajout traditionnelle-
ment le sens dit de la critique. Sans qu'il soit vain ici de rappeler o
cela l'a conduit vers 1933.
Inutile de parler de ce que j'articule du discours universitaire,
puisqu'il spcule de l'insens en tant que tel et qu'en ce sens ce qu'il
peut produire de meilleur est le mot d'esprit qui pourtant lui fait
peur.
Cette peur est lgitime, si l'on songe celle qui plaque au sol les
analystes, soit les parlants qui se trouvent tre assujettis ce discours
analytique, dont on ne peut que s'tonner qu'il soit advenu chez des
tres, je parle des parlants, dont c'est tout dire qu'ils n'ont pu s'ima-
giner leur monde qu' le supposer abruti, soit de l'ide qu'ils ont
depuis pas si longtemps de l'animal qui ne parle pas.
Ne leur cherchons pas d'excuse. Leur tre mme en est une. Car
ils bnficient de ce destin nouveau, que pour tre, il leur faille
ex-sister. Incasables dans aucun des discours prcdents, il faudrait
qu' ceux-ci ils ex-sistent, alors qu'ils se croient tenus prendre
appui du sens de ces discours pour profrer celui dont le leur se
contente, juste titre d'tre plus fuyant, ce qui l'accentue.
Tout les ramne pourtant au solide de l'appui qu'ils ont dans le
signe : ne serait que le symptme auquel ils ont affaire, et qui, du
signe fait gros nud, nud tel qu'un Marx l'a aperu mme s'en
tenir au discours politique. J'ose peine le dire, parce que le freudo-
marxisme, c'est l'embrouille sans issue.
Rien ne les enseigne, mme pas que Freud fut mdecin et que le
mdecin comme l'amoureuse n'a pas la vue trs longue, que c'est
donc ailleurs qu'il faut qu'ils aillent pour avoir son gnie : nomm-
ment se faire sujet, non d'un ressassement, mais d'un discours, d'un
discours sans prcdent dont il arrive que les amoureuses se fassent
gniales s'y retrouver, que dis-je ? l'avoir invent bien avant que
Freud l'tablisse, sans que pour l'amour au reste il leur serve rien,
c'est patent.
Moi qui serais le seul, si certains ne m'y suivaient, me faire sujet
555
INTRODUCTION L'DITION ALLEMANDE DES CRITS
de ce discours, je vais une fois de plus dmontrer pourquoi des ana-
lystes s'en embarrassent sans recours.
Alors que le recours c'est l'inconscient, la dcouverte par Freud
que l'inconscient travaille sans y penser, ni calculer, juger non plus et
que pourtant le fruit est l : un savoir qu'il ne s'agit que de dchiffirer
puisqu'il consiste dans un chiffrage.
A quoi sert-il ce chiffrage ? dirais-je pour les retenir, en abondant
dans la manie, pose d'autres discours, de l'utilit (dire : manie de
l'utile ne nie pas l'utile). Le pas n'est pas fait par ce recours, qui
pourtant nous rappelle qu'hors ce qui sert, il y a le jouir. Que dans le
chiffrage est la jouissance, sexuelle certes, c'est dvelopp dans le dire
de Freud, et bien assez pour en conclure que ce qu'il implique,
c'est que c'est l ce qui fait obstacle au rapport sexuel tabli, donc
ce que jamais puisse s'crire ce rapport :je veux dire que le langage
en fasse jamais trace autre que d'une chicane infinie.
Bien sr entre les tres qui sexus le sont (quoique le sexe ne
s'inscrive que du non-rapport), il y a des rencontres.
Il y a du bon heur. Il n'y a mme que a : au petit bonheur la
chance ! Les tres parlants sont heureux, heureux de nature, c'est
mme d'icelle tout ce qui leur reste. Est-ce que de par le discours
analytique, a ne pourrait pas devenir un peu plus?Voil la question
dont ritournelle, je ne parlerais pas si la rponse n'tait dj.
En termes plus prcis, l'exprience d'une analyse livre celui que
j'appelle l'analysant - ah ! quel succs j'ai obtenu chez les prtendus
orthodoxes avec ce mot, et combien par l ils avouaient que leur
dsir dans l'analyse, c'tait de n'y tre pour rien - livre l'analysant,
dis-je donc, le sens de ses symptmes. Eh bien, je pose que ces exp-
riences ne sauraient s'additionner. Freud l'a dit avant moi : tout dans
une analyse est recueillir - o l'on voit que l'analyste ne peut se
tirer des pattes -, recueillir comme si rien ne s'tait d'ailleurs tabli.
Ceci ne veut rien dire sinon que la fuite du tonneau est toujours
rouvrir.
Mais c'est aussi bien l le cas de la science (et Freud ne l'entendait
pas autrement, vue courte).
Car la question commence partir de ceci qu'il y a des types de
symptme, qu'il y a une clinique. Seulement voil : elle est d'avant le
discours analytique, et si celui-ci y apporte une lumire, c'est sr
mais pas certain. Or nous avons besoin de la certitude parce qu'elle
556
INTRODUCTION L'DITION ALLEMANDE DES CRITS
seule peut se transmettre de se dmontrer. C'est l'exigence dont
l'histoire montre notre stupeur qu'elle a t formule bien avant
que la science y rponde, et que mme si la rponse a t bien autre
que le frayage que l'exigence avait produite, la condition dont elle
partait, soit que la certitude en fut transmissible, y a t satisfaite.
Nous aurions tort de nous fier ne faire que remettre a - fut-ce
avec la rserve du petit bonheur la chance.
Car il y a longtemps que telle opinion a fait sa preuve d'tre
vraie, sans que pour autant elle fasse science (cf. le Mnon o c'est de
a qu'il s'agite).
Que les types cliniques relvent de la structure, voil qui peut dj
s'crire quoique non sans flottement. Ce n'est certain et transmis-
sible que du discours hystrique. C'est mme en quoi s'y manifeste
un rel proche du discours scientifique. On remarquera que j'ai
parl du rel, et pas de la nature.
Par o j'indique que ce qui relve de la mme structure, n'a pas
forcment le mme sens. C'est en cela qu'il n'y a d'analyse que du
particulier : ce n'est pas du tout d'un sens unique que procde une
mme structure, et surtout pas quand elle atteint au discours.
Il n'y a .pas de sens commun de l'hystrique, et ce dont joue chez
eux ou elles l'identification, c'est la structure, et non le sens comme
a se lit bien au fait qu'elle porte sur le dsir, c'est--dire sur le
manque pris comme objet, pas sur la cause du manque. (Cf. le rve
de la belle bouchre - dans la Traumdeutung - devenu par mes soins
exemplaire. Je ne prodigue pas les exemples, mais quand je m'en
mle, je les porte au paradigme.)
Les sujets d'un type sont donc sans utilit pour les autres du
mme type. Et il est concevable qu'un obsessionnel ne puisse don-
ner le moindre sens au discours d'un autre obsessionnel. C'est mme
de l que partent les guerres de religion : s'il est vrai que pour la reli-
gion (car c'est le seul trait dont elles font classe, au reste insuffisant),
il y a de l'obsession dans le coup.
C'est de l que rsulte qu'il n'y a communication dans l'analyse
que par une voie qui transcende le sens, celle qui procde de la
supposition d'un sujet au savoir inconscient, soit au chiffrage. Ce que
j'ai articul : du sujet suppos savoir.
C'est pourquoi le transfert est de l'amour, un sentiment qui prend
l une si nouvelle forme qu'elle y introduit la subversion, non
557
INTRODUCTION L'DITION ALLEMANDE DES CRITS
qu'elle soit moins illusoire, mais qu'elle se donne un partenaire qui a
chance de rpondre, ce qui n'est pas le cas dans les autres formes. Je
remets enjeu le bon heur, ceci prs que cette chance, cette fois eue
vient de moi et que je doive la fournir.
J'insiste : c'est de l'amour qui s'adresse au savoir. Pas du dsir : car
pour le Wisstrieb, et-il le tampon de Freud, on peut repasser, il n'y
en a pas le moindre. C'en est mme au point que s'en fonde la pas-
sion majeure chez l'tre parlant : qui n'est pas l'amour, ni la haine,
mais l'ignorance. Je touche a du doigt tous les jours.
Que les analystes, disons ceux qui seulement de se poser comme
tels en tiennent l'emploi, et je l'accorde de ce seul fait : rellement,
que les analystes, je le dis donc au sens plein, qu'ils me suivent ou
pas, n'aient pas encore compris que ce qui fait entre dans la matrice
du discours, ce n'est pas le sens mais le signe, voil qui donne l'ide
qu'il faut de cette passion de l'ignorance.
Avant que l'tre imbcile prenne le dessus, pourtant d'autres, pas
sots, nonaient de l'oracle qu'il ne rvle ni ne cache : crr||xaiva il
fait signe.
C'tait au temps d'avant Socrate, qui n'est pas responsable, quoi-
qu'il ft hystrique, de ce qui suivit : le long dtour aristotlicien.
D'o Freud d'couter les socratiques que j'ai dits, revint ceux
d'avant Socrate, ses yeux seuls capables de tmoigner de ce qu'il
retrouvait.
Ce n'est pas parce que le sens de leur interprtation a eu des effets
que les analystes sont dans le vrai, puisque mme serait-elle juste, ses
effets sont incalculables. Elle ne tmoigne de nul savoir, puisqu' le
prendre dans sa dfinition classique, le savoir s'assure d'une possible
prvision.
Ce qu'ils ont savoir, c'est qu'il y en a un de savoir qui ne calcule
pas, mais qui n'en travaille pas moins pour la jouissance.
Qu'est-ce qui du travail de l'inconscient ne peut s'crire ? Voil
o se rvle une structure qui appartient bien au langage si sa fonc-
tion est de permettre le chiffrage. Ce qui est le sens dont la linguis-
tique a fond son objet en l'isolant : du nom de signifiant.
C'est le seul point dont le discours analytique a se brancher sur
la science, mais si l'inconscient tmoigne d'un rel qui lui soit
propre, c'est inversement l notre chance d'lucider comment le lan-
gage vhicule dans le nombre le rel dont la science s'labore.
558
INTRODUCTION L'DITION ALLEMANDE DES CRITS
Ce qui ne cesse pas de s'crire, c'est support du jeu de mots que
lalangue mienne a gard d'une autre, et non sans raison, la certitude
dont tmoigne dans la pense le mode de la ncessit.
Comment ne pas considrer que la contingence, ou ce qui cesse
de ne pas s'crire, ne soit par o l'impossibilit se dmontre ou ce
qui ne cesse pas de ne pas s'crire. Et qu'un rel de l s'atteste qui,
pour n'en pas tre mieux fond, soit transmissible par la fuite quoi
rpond tout discours.
Le 7 octobre 1973
Prface L'veil du printemps
Ainsi un dramaturge aborde en 1891 l'affaire de ce qu'est pour les
garons de faire l'amour avec les filles, marquant qu'ils n'y songe-
raient pas sans l'veil de leurs rves.
Remarquable d'tre mis en scne comme tel: soit pour s'y
dmontrer ne pas tre pour tous satisfaisant, jusqu' avouer que si a
rate, c'est pour chacun.
Autant dire que c'est du jamais vu.
Mais orthodoxe quant Freud -j'entends : ce que Freud a dit.
Cela prouve du mme coup que mme un Hanovrien (car j'en ai
d'abord, il faut que je l'avoue, infr que Wedekind tait juif), que
mme un Hanovrien, dis-je et n'est-ce pas beaucoup dire ? est capable
de s'en aviser. De s'aviser qu'il y a un rapport du sens la jouissance.
Que cette jouissance soit phallique, c'est l'exprience qui en
rpond.
Mais Wedekind, c'est une dramaturgie. Quelle place lui donner?
Le fait est que nos Juifs (freudiens) s'y intressent, on en trouvera
l'attestation dans ce programme *.
Il faut dire que la famille Wedekind avait plutt roul sa bosse
travers le monde, participant d'une diaspora, celle-ci idaliste :
d'avoir d quitter la terre-mre pour chec d'une activit rvolu-
tionnaire . Est-ce l ce qui fit Wedekind, je parle de notre drama-
turge, s'imaginer d'tre de sang juif? Au moins son meilleur ami en
tmoigne-t-il.
Ou bien est-ce une affaire d'poque, puisque le dramaturge, la
date que j'ai note, anticipe Freud et largement?
Puisqu'on peut dire qu' ladite date, Freud cogite encore l'in-
i. Programme du spectacle mont par Mme Brigitte Jaques dans le cadre du
Festival d'automne en 1974 ; l'dition comportait le texte de la sance de la Socit
psychologique du mercredi (Vienne, 1907) consacre la pice.
561
PRFACE VVEIL DU PRINTEMPS
conscient, et que pour l'exprience qui en instaure le rgime, il ne
l'aura pas mme sa mort mise encore sur ses pieds.
a devait me rester de le faire avant que quelque autre m'en
relve (pas plus juif peut-tre que je ne le suis).
Que ce que Freud a repr de ce qu'il appelle la sexualit fasse
trou dans le rel, c'est ce qui se touche de ce que personne ne s'en
tirant bien, on ne s'en soucie pas plus.
C'est pourtant exprience porte de tous. Que la pudeur
dsigne : du priv. Priv de quoi ? Justement de ce que le pubis
n'aille qu'au public, o il s'affiche d'tre l'objet d'une leve de voile.
Que le voile lev ne montre rien, voil le principe de l'initiation
(aux bonnes manires de la socit, tout au moins).
J'ai indiqu le lien de tout cela au mystre du langage et au fait
que ce soit proposer l'nigme que se trouve le sens du sens.
Le sens du sens est qu'il se lie la jouissance du garon comme
interdite. Ce nom pas certes pour interdire le rapport dit sexuel,
mais pour le figer dans le non-rapport qu'il vaut dans le rel.
Ainsi fait fonction de rel, ce qui se produit effectivement, le
fantasme de la ralit ordinaire. Par quoi se glisse dans le langage ce
qu'il vhicule : l'ide de tout quoi pourtant fait objection la
moindre rencontre du rel.
Pas de langue qui ne s'en force, non sans en geindre de faire
comme elle peut, dire sans exception ou se corser d'un num-
ral. Il n'y a que dans les ntres, de langues, que a roule bille en tte,
le tout,- le tout et toi, si j'ose dire.
Moritz, dans notre drame, parvient pourtant s'excepter, en quoi
Melchior le qualifie de fille. Et il a bien raison : la fille n'est qu'une
et veut le rester, ce qui dans le drame passe l'as.
Reste qu'un homme se fait L'homme se situer de l'Un-entre-
autres, s'entrer entre ses semblables.
Moritz, s'en excepter, s'exclut dans l'au-del. Il n'y a que l qu'il
se compte : pas par hasard d'entre les morts, comme exclus du rel.
Que le drame l'y fasse survivre, pourquoi pas ? si le hros y est mort
d'avance.
C'est au royaume des morts que les non-dupes errent , dirais-je
d'un titre que j'illustrai.
Et c'est pour cela que je n'errerai pas plus longtemps suivre
Vienne, dans le groupe de Freud, les gens qui dchiffrent l'envers
562
PRFACE L'VEIL DU PRINTEMPS
les signes tracs par Wedekind en sa dramaturgie. Sauf peut-tre les
reprendre de ce que la reine pourrait bien n'tre sans tte qu' ce
que le roi lui ait drob la paire normale, de ttes, qui lui reviendrait.
N'est-ce pas les lui restituer (de supposer face cache) que sert
ici l'Homme dit masqu. Celui-l, qui fait la fin du drame, et pas
seulement du rle que Wedekind lui rserve, de sauver Melchior des
prises de Moritz, mais de ce que Wedekind le ddie sa fiction,
tenue pour nom propre.
J'y lis pour moi ce que j'ai refus expressment ceux qui ne
s'autorisent que de parler d'entre les morts : soit de leur dire que
parmi les Noms-du-Pre, il y a celui de l'Homme masqu.
Mais le Pre en a tant et tant qu'il n'y en a pas Un qui lui
convienne, sinon le Nom de Nom de Nom. Pas de Nom qui soit
son Nom-Propre, sinon le Nom comme ex-sistence.
Soit le semblant par excellence. Et l' Homme masqu dit a pas
mal.
Car comment savoir ce qu'il est s'il est masqu, et ne porte-t-il
pas masque de femme, ici l'acteur?
Le masque seul ex-sisterait la place de vide o je mets La
femme. En quoi je ne dis pas qu'il n'y ait pas de femmes.
La femme comme version du Pre ne se figurerait que de Pre-
version.
Comment savoir si, comme le formule Robert Graves, le Pre
lui-mme, notre pre ternel tous, n'est que Nom entre autres de
la Desse blanche, celle son dire qui se perd dans la nuit des temps,
en tre la Diffrente, l'Autre jamais dans sa jouissance, - telles ces
formes de l'infini dont nous ne commenons rnumration qu'
savoir que c'est elle qui nous suspendra, nous.
Le 1
er
septembre 1974
Joyce le Symptme
Joyce le Symptme entendre comme Jsus la Caille : c'est son
nom. Pouvait-on s'attendre autre chose d'emmoi : je nomme. Que
a fasse jeune homme est une retombe d'o je ne veux retirer
qu'une seule chose. C'est que nous sommes z'hommes.
LOM: en franais a dit bien ce que a veut dire. Il suffit
de l'crire phontiquement : a le fauntique (faun...), sa mesure :
l'eaubscne. crivez a eaub... pour rappeler que le beau n'est pas
autre chose. Hissecroibeau crire comme l'hessecabeau sans lequel
hihanappat qui soit ding! d'nom dhom. LOM se lomellise qui
mieux mieux. Mouille, lui dit-on, faut le faire : car sans mouiller pas
d'hessecabeau.
LOM, LOM de base, LOM cahun corps et nan-na Kun. Faut
le dire comme a : il ahun^.. et non : il estun... (cor/nich). C'est
l'avoir et pas l'tre qui le caractrise. Il y a de l'avoiement dans le
qu'as-tu? dont il s'interroge fictivement d'avoir la rponse toujours.
J'ai a, c'est son seul tre. Ce que fait le f...toir dit pistmique
quand il se met bousculer le monde, c'est de faire passer l'tre
avant l'avoir, alors que le vrai, c'est que LOM a, au principe. Pour-
quoi ? a se sent, et une fois senti, a se dmontre.
Il a (mme son corps) du fait qu'il appartient en mme temps
trois... appelons a, ordres. En tmoignant le fait qu'il jaspine pour
s'affairer de la sphre dont se faire un escabeau.
Je dis a pour m'en faire un, et justement d'y faire dchoir la
sphre, jusqu'ici indtrnable dans son suprme d'escabeau. Ce
pourquoi je dmontre que l'S.K.beau est premier parce qu'il pr-
side la production de sphre.
L'S.K.beau c'est ce que conditionne chez l'homme le fait qu'il
vit de l'tre (
s
qu'il vide l'tre) autant qu'il a - son corps : il ne l'a
d'ailleurs qu' partir de l. D'o mon expression de parltre qui se
substituera l'ICS de Freud (inconscient, qu'on Ut a) : pousse-toi
565
JOYCE LE SYMPTME
de l que je m'y mette, donc. Pour dire que l'inconscient dans Freud
quand il le dcouvre (ce qui se dcouvre c'est d'un seul coup,
encore faut-il aprs l'invention en faire l'inventaire), l'inconscient
c'est un savoir en tant que parl comme constituant de LOM. la
parole bien entendu se dfinissant d'tre le seul lieu, o l'tre ait un
sens. Le sens de l'tre tant de prsider l'avoir, ce qui excuse le
bafouillage pistmique.
L'important, de quel point - il est dit de vue , c'est discuter?
ce qui importe donc sans prciser d'o, c'est de se rendre compte
que de LOM a un corps - et que l'expression reste correcte, - bien
que de l LOM ait dduit qu'il tait une me - ce que, bien
entendu, vu sa biglerie, il a traduit de ce que cette me, elle aussi,
il l'avait.
Avoir, c'est pouvoir faire quelque chose avec. Entre autres, entre
autres avisiont dites possibles de pouvoir toujours tre suspen-
dues. La seule dfinition du possible tant qu'il puisse ne pas avoir
lieu : ce qu'on prend par le bout contraire, vu l'inversion gnrale
de ce qu'on appelle la pense.
Aristote, Pacon contrairement au B de mme rime, crit que
l'homme pense avec son me. En quoi se prouverait que LOM l'a,
elle aussi, ce qu'Aristote traduit du \>otJ. Je me contente moi de
dire : nud, moins de barouf. Nud de quoi quoi, je ne le dis pas,
faute de le savoir, mais j'exploite que trinit, LOM ne peut cesser de
l'crire depuis qu'il s'immonde. Sans que la prfrence de Victor
Cousin pour la triplicit y ajoute : mais va pour, s'il veut, puisque le
sens, l c'est trois ; le bon sens, entends-je.
C'est pour ne pas le perdre, ce bond du sens, que j'ai nonc
maintenant qu'il faut maintenir que l'homme ait un corps, soit qu'il
parle avec son corps, autrement dit qu'il parltre de nature. Ainsi surgi
comme tte de l'art, il se dnature du mme coup, moyennant quoi il
prend pour but, pour but de l'art le naturel, tel qu'il l'imagine nave-
ment. Le malheur, c'est que c'est le sien de naturel : pas tonnant
qu'il n'y touche qu'en tant que symptme. Joyce le Symptme
pousse les choses de son artifice au point qu'on se demande s'il n'est
pas le Saint, le saint homme ne plus p'ter. Dieu merci car c'est
lui qu'on le doit, soit ce vouloir qu'on lui suppose (de ce qu'on sait
dans son cur qu'il n'ex-siste pas) Joyce n'est pas un Saint. Il joyce
trop de l'S.K.beau pour a, il a de son art art-gueil jusqu' plus soif.
566
JOYCE LE SYMPTME
A vrai dire il n'y a pas de Saint-en-soi, il n'y a que le dsir d'en
fignoler ce qu'on appelle la voie, voie canonique. D'o l'on ptme
l'occasion dans la canonisation de l'glise, qui en connat un bout
ce qu'elle s'y reconique, mais qui se f... le doigt dans l'il dans tous
les autres cas. Car il n'y a pas de voie canonique pour la saintet,
malgr le vouloir des Saints, pas de voie qui les spcifie, qui fasse des
Saints une espce. Il n'y a que la scabeaustration ; mais la castration
de l'escabeau ne s'accomplit que de l'escapade. Il n'y a de Saint qu'
ne pas vouloir l'tre, qu' la saintet y renoncer.
C'est ce que Joyce maintient seulement comme tte de l'art : car
c'est de l'art qu'il fait surgir la tte dans ce Bloom qui s'aline pour
faire ses farces de Flower et d'Henry (comme l'Henry du coin,
l'Henry pour les dames). Si en fait il n'y a que lesdites dames en
rire, c'est bien ce qui prouve que Bloom est un saint. Que le saint en
rie, a dit tout. Bloom embloomera aprs sa mort quoique du cime-
tire il ne rie pas. Puisque c'est l sa destination, qu'il trouve amre-
dante, tout en sachant qu'il n'y peut rien.
Joyce, lui, voulait ne rien avoir, sauf l'escabeau du dire magistral,
et a suffit ce qu'il ne soit pas un saint homme tout simple, mais le
symptme ptyp.
S'il Henrycane le Bloom de sa fantaisie, c'est pour dmontrer
qu' s'affairer tellement de la spatule publicitaire, ce qu'il a enfin,
de l'obtenir ainsi, ne vaut pas cher. A faire trop bon march de son
corps mme, il dmontre que LOM a un corps ne veut rien dire,
s'il n'en fait pas tous les autres payer la dme.
Voie trace par les Frres mendiants : ils s'en remettent la charit
publique qui doit payer leur subsistance. N'en restant pas moins
que LOM (crit L.O.M.) ait son corps, revtir entre autres soins.
La tentative sans espoir que fait la socit pour que LOM n'ait
pas qu'un corps est sur un autre versant : voue l'chec bien sr,
rendre patent que s'il en ahun, il n'en a aucun autre malgr que
du fait de son parltre, il dispose de quelque autre, sans parvenir le
faire sien.
A quoi il ne songerait pas, on le suppose, si ce corps qu'il a, vrai-
ment il l'tait. Ceci n'implique que la thorie bouffonne, qui ne
veut pas mettre la ralit du corps dans l'ide qui le fait. Antienne,
on le sait, aristotlienne. Quelle exprience, on se tue l'imaginer, a
pu l faire obstacle pour lui ce qu'il platonise, c'est--dire dfie la
567
JOYCE LE SYMPTME
mort comme tout le monde en tenant que l'ide suffira ce corps le
reproduire. Mes tempes si choses interroge Molly Bloom qui
c'tait d'autant moins venu porte qu'elle y tait dj sans se le
dire. Comme des tas de choses quoi on croit sans y adhrer : les
escabeaux de la rserve o chacun puise.
Qu'il y ait eu un homme pour songer faire le tour de cette
rserve et donner de l'escabeau la formule gnrale, c'est l ce que
j'appelle Joyce le Symptme. Car cette formule, il ne l'a pas trouve
faute d'en avoir le moindre soupon. Elle tranait pourtant dj par-
tout sous la forme de cet ICS que j'pingle du parltre.
Joyce, prdestin par son nom, laissait la place Freud pas moins
consonant. Il faut la passion d'EUmann pour en faire croix sur
Freud :pace tua, je ne vais pas vous dire la page, car le temps me pres-
santifie. La fonction de la hte dans Joyce est manifeste. Ce qu'il n'en
voit pas, c'est la logique qu'elle dtermine.
Il a d'autant plus de mrite la dessiner conforme d'tre seule-
ment faite de son art qu'un eaube jeddard, comme Ulysse, soit un jet
d'art sur l'eaube scne de la logique elle-mme, ceci se lit ce qu'elle
calque non pas l'inconscient, mais en donne le modle en temps-
prant, en faisant le pre du temps, le Floom ballique, le Xinbad
le Phtarin quoi se rsume le symdbad du symdptme ou dans Ste-
phens Deedalus Joyce se reconnat le fils ncessaire, ce qui ne cesse pas
de s'crire de ce qu'il se conoive, sans que pourtant hissecroiebeau,
de l'hystoriette d'Hamlet, hystrise dans son Saint-Pre de Cocu
empoisonn par l'oreille zeugma, et par son symptme de femme,
sans qu'il puisse faire plus que de tuer en Claudius l'escaptome pour
laisser place celui de rechange qui fort embrasse pre-ternit.
Joyce se refuse ce qu'il se passe quelque chose dans ce que l'his-
toire des historiens est cense prendre pour objet.
Il a raison, l'histoire n'tant rien de plus qu'une fuite, dont ne se
racontent que des exodes. Par son exil, il sanctionne le srieux de
son jugement. Ne participent l'histoire que les dports : puisque
l'homme a un corps, c'est par le corps qu'on l'a. Envers de Vhabeas
corpus.
Relisez l'histoire : c'est tout ce qui s'y lit de vrai. Ceux qui croient
faire cause dans son remue-mnage sont eux aussi des dplacs sans
doute d'un exil qu'ils ont dlibr, mais de s'en faire escabeau les
aveugle.
568
JOYCE LE SYMPTME
Joyce est le premier savoir bien escaboter pour avoir port
l'escabeau au degr de consistance logique o il le maintient, art-
gueilleusement, je viens de le dire.
Laissons le symptme ce qu'il est : un vnement de corps, li
ce que : l'on l'a, l'on l'a de l'air, l'on l'aire, de l'on l'a. a se chante
l'occasion et Joyce ne s'en prive pas.
Ainsi des individus qu'Aristote prend pour des corps, peuvent
n'tre rien que symptmes eux-mmes relativement d'autres
corps. Une femme par exemple, elle est symptme d'un autre corps.
Si ce n'est pas le cas, elle reste symptme dit hystrique, on veut
dire par l dernier. Soit paradoxalement que ne l'intresse qu'un
autre symptme : il ne se range donc qu'avant dernier et n'est de
plus pas privilge d'une femme quoiqu'on comprenne bien mesu-
rer le sort de LOM comme parltre, ce dont elle se symptomatise.
C'est des hystriques, hystriques symptmes de femmes (pas toutes
comme a sans doute, puisque c'est de n'tre pas toutes (comme a),
qu'elles sont notes d'tre des femmes chez LOM, soit de l'on l'a),
c'est des hystriques symptmes que l'analyse a pu prendre pied
dans l'exprience.
Non sans reconnatre d'emble que toutom y a droit. Non seule-
ment droit mais supriorit, rendue vidente par Socrate en un
temps o LOM commun ne se rduisait pas encore et pour cause,
de la chair canon quoique dj pris dans la dportation du corps
et sympthomme. Socrate, parfait hystrique, tait fascin du seul
symptme, saisi de l'autre au vol. Ceci le menait pratiquer une
sorte de prfiguration de l'analyse. Et-il demand de l'argent pour
a au lieu de frayer avec ceux qu'il accouchait que c'et t un ana-
lyste, avant la lettre freudienne. Un gnie quoi !
Le symptme hystrique, je rsume, c'est le symptme pour LOM
d'intresser au symptme de l'autre comme tel : ce qui n'exige pas le
corps corps. Le cas de Socrate le confirme, exemplairement.
Pardon tout a n'est que pour spcifier de Joyce de sa place.
Joyce ne se tient pour femme l'occasion que de s'accomplir en
tant que symptme. Ide bien oriente quoique rate dans sa chute.
Dirai-je qu'il est symptomatologie. Ce serait viter de l'appeler par le
nom qui rpond son vu, ce qu'il appelle un tour de farce dans
Finnegans Wake page 162 (et 509) o il l'nonce proprement par l'as-
tuce du destin en force qu'il tenait de Verdi avant qu'on nous l'assne.
569
JOYCE LE SYMPTME
Que Joyce ait joui d'crire Finnegans Wake a se sent. Qu'il l'ait
publi, je dois a ce qu'on me l'ait fait remarquer, laisse perplexe,
en ceci que a laisse toute littrature sur le flan. La rveiller, c'est
bien signer qu'il en voulait la fin. Il coupe le souffle du rve, qui
tranera bien un temps. Le temps qu'on s'aperoive qu'il ne tient
qu' la fonction de la hte en logique. Point soulign par moi, sans
doute de ce qu'il reste aprs Joyce que j'ai connu vingt ans,
quelque chose crever dans le papier hyginique sur quoi les lettres
se dtachent, quand on prend soin de scribouiUer pour la rection du
corps pour les corpo-rections dont il dit le dernier mot connu day-
sens, sens mis au jour du symptme littraire enfin venu concomp-
tion. La pointe de l'inintelligible y est dsormais l'escabeau dont on
se montre matre. Je suis assez matre de lalangue, celle dite franaise,
pour y tre parvenu moi-mme ce qui fascine de tmoigner de la
jouissance propre au symptme. Jouissance opaque d'exclure le sens.
On s'en doutait depuis longtemps. Etre post-joycien, c'est le
savoir. Il n'y a d'veil que par cette jouissance-l, soit dvalorise de
ce que l'analyse recourant au sens pour la rsoudre, n'ait d'autre
chance d'y parvenir qu' se faire la dupe... du pre comme je l'ai
indiqu.
L'extraordinaire est que Joyce y soit parvenu non pas sans Freud
(quoiqu'il ne suffise pas qu'il l'ait lu) mais sans recours l'exprience
de l'analyse (qui l'et peut-tre leurr de quelque fin plate).
Prface l'dition anglaise
du Sminaire XI
Quand l'esp d'un laps, soit puisque je n'cris qu'en franais :
l'espace d'un lapsus, n'a plus aucune porte de sens (ou interprtation),
alors seulement on est sr qu'on est dans l'inconscient. On le sait, soi.
Mais il suffit que s'y fasse attention pour qu'on en sorte. Pas
d'amiti n'est l qui cet inconscient le supporte.
Resterait que je dise une vrit. Ce n'est pas le cas : je rate. Il n'y
a pas de vrit qui, passer par l'attention, ne mente.
Ce qui n'empche pas qu'on coure aprs.
Il y a une certaine faon de balancer stembrouille qui est satis-
faisante pour d'autres raisons que formelles (symtrie par exemple).
Comme satisfaction, elle ne s'atteint qu' l'usage, l'usage d'un
particulier. Celui qu'on appelle dans le cas d'une psychanalyse
(psych =, soit fiction d'-) analysant. Question de pur fait : des ana-
lysants, il y en a dans nos contres. Fait de ralit humaine, ce que
l'homme appelle ralit,
Notons que la psychanalyse a, depuis qu'elle ex-siste, chang.
Invente par un solitaire, thoricien incontestable de l'inconscient
(qui n'est ce qu'on croit, je dis : l'inconscient, soit rel, qu' m'en
croire), elle se pratique maintenant en couple. Soyons exact, le soli-
taire en a donn l'exemple. Non sans abus pour ses disciples (car dis-
ciples, ils n'taient que du fait que lui, ne st pas ce qu'il faisait).
Ce que traduit l'ide qu'il en avait : peste, mais anodine l o il
croyait la porter, le public s'en arrange.
Maintenant, soit sur le tard, j'y mets mon grain de sel : fait d'hys-
toire, autant dire d'hystrie : celle de mes collgues en l'occasion, cas
infime, mais o je me trouvais pris d'aventure pour m'tre intress
quelqu'un qui m'a fait glisser jusqu' eux m'avoir impos Freud,
l'Aime de mathse.
J'eusse prfr oublier a : mais on n'oublie pas ce que le public
vous rappelle.
571
PRFACE L'DITION ANGLAISE DU SMINAIRE XI
Donc il y a l'analyste compter dans la cure. Il ne compterait
pas, j'imagine, socialement, s'il n'y avait Freud lui avoir fray la
voie. Freud, dis-je, pour le nommer lui. Car nommer quelqu'un
analyste, personne ne peut le faire et Freud n'en a nomm aucun.
Donner des bagues aux initis, n'est pas nommer. D'o ma proposi-
tion que l'analyste ne s'hystorise que de lui-mme : fait patent, Et
mme s'il se fait confirmer d'une hirarchie.
Quelle hirarchie pourrait lui confirmer d'tre analyste, lui en
donner le tampon ? Ce qu'un Cht me disait, c'est que je l'tais, n.
Je rpudie ce certificat : je ne suis pas un pote, mais un pome. Et
qui s'crit, malgr qu'il ait l'air d'tre sujet.
La question reste de ce qui peut pousser quiconque, surtout aprs
une analyse, s'hystoriser de lui-mme.
a ne saurait tre son propre mouvement puisque sur l'analyste, il
en sait long, maintenant qu'il a liquid, comme on dit, son transfert-
pour. Comment peut lui venir l'ide de prendre le relais de cette
fonction ?
Autrement dit y a-t-il des cas o une autre raison vous pousse
tre analyste que de s'installer, c'est--dire de recevoir ce qu'on
appelle couramment du fric, pour subvenir aux besoins de vos -
charge, au premier rang desquels vous vous trouvez vous-mme,
- selon la morale juive (celle o Freud en restait pour cette affaire).
Il faut avouer que la question (la question d'une autre raison) est
exigible pour supporter le statut d'une profession, nouvelle-venue
dans l'hystoire. Hystoire que nous ne disons pas ternelle parce que
son aetas n'est srieux qu' se rapporter au nombre rel, c'est--dire
au sriel de la limite.
Pourquoi ds lors ne pas soumettre cette profession l'preuve
de cette vrit dont rve la fonction dite inconscient, avec quoi elle
tripote ? Le mirage de la vrit, dont seul le mensonge est attendre
(c'est ce qu'on appelle la rsistance en termes polis) n'a d'autre
terme que la satisfaction qui marque la fin de l'analyse.
Donner cette satisfaction tant l'urgence quoi prside l'analyse,
interrogeons comment quelqu'un peut se vouer satisfaire ces cas
d'urgence.
Voil un aspect singulier de cet amour du prochain mis en
exergue par la tradition judaque. Mme l'interprter chrtienne-
ment, c'est--dire comme jean-f.. .trerie hellnique, ce qui se prsente
572
PRFACE L'DITION ANGLAISE DU SMINAIRE XI
l'analyste est autre chose que le prochain : c'est le tout-venant d'une
demande qui n'a rien voir avec la rencontre (d'une personne de
Samarie propre dicter le devoir christique). L'offre est antrieure
la requte d'une urgence qu'on n'est pas sr de satisfaire, sauf
l'avoir pese.
D'o j'ai dsign de la passe cette mise l'preuve de l'hystori-
sation de l'analyse, en me gardant, cette passe, de l'imposer tous
parce qu'il n'y a pas de tous en l'occasion, mais des pars dsassortis.
Je l'ai laisse la disposition de ceux qui se risquent tmoigner au
mieux de la vrit menteuse.
Je l'ai fait d'avoir produit la seule ide concevable de l'objet, celle
de la cause du dsir, soit de ce qui manque.
Le manque du manque fait le rel, qui ne sort que l, bouchon.
Ce bouchon que supporte le terme de l'impossible, dont le peu que
nous savons en matire de rel, montre l'antinomie toute vraisem-
blance.
Je ne parlerai de Joyce o j'en suis cette anne, que pour dire qu'il
est la consquence la plus simple d'un refus combien mental d'une
psychanalyse, d'o est rsult que dans son uvre il l'illustre. Mais
je n'ai fait encore qu'effleurer a, vu mon embarras quant l'art, o
Freud se baignait non sans malheur.
Je signale que comme toujours les cas d'urgence m'emptraient
pendant que j'crivais a.
J'cris pourtant, dans la mesure o je crois le devoir, pour tre au
pair avec ces cas, faire avec eux la paire.
Paris, ce 17 mai 1976
Annexes
Nous donnons en annexes quatre textes.
On trouvera d'abord la premire version de la Proposition
du 9 octobre 1967 sur le psychanalyste de l'cole , telle que lue
ce jour-l devant les analystes (AE et AME) de l'cole freu-
dienne de Paris. Ce texte a t publi en avril 1978 dans la col-
lection Analytica, comme supplment au numro 13 de la
revue Ornkar?.
Le deuxime texte est celui d'une note publie sans titre la
fin du premier numro de la revue Scilicet, parue au cours du pre-
mier trimestre 1968.
Viennent ensuite le liminaire du deuxime numro et une
note terminale, prcde de la liste des auteurs ayant contribu
aux deux premiers numros de la revue (2000).
1
PREMIRE VERSION
DE LA PROPOSITION DU 9 OCTOBRE 1967
SUR LE PSYCHANALYSTE DE L'COLE
Il s'agit de fonder dans un statut assez durable pour tre soumis
l'exprience, les garanties dont notre cole pourra autoriser de sa
formation un psychanalyste - et ds lors en rpondre.
Pour introduire mes propositions, il y a dj mon acte de fonda-
tion et le prambule de l'annuaire. L'autonomie de l'initiative du
psychanalyste y est pose en un principe qui ne saurait souffrir chez
nous de retour.
575
ANNEXES
L'cole peut tmoigner que le psychanalyste en cette initiative
apporte une garantie de formation suffisante.
Elle peut aussi constituer le milieu d'exprience et de critique qui
tablisse voire soutienne les conditions des garanties les meilleures.
Elle le peut et donc elle le doit, puisqu'cole, elle ne l'est pas
seulement au sens o elle distribue un enseignement, mais o elle
instaure entre ses membres une communaut d'exprience, dont le
cur est donn par l'exprience des praticiens.
A vrai dire, son enseignement mme n'a de fin que d'apporter
cette exprience la correction, cette communaut la discipline
d'o se promeut la question thorique par exemple, de situer la psy-
chanalyse au regard de la science.
Le noyau d'urgence de cette responsabilit n'a pu faire que de
s'inscrire dj l'annuaire.
Garantie de formation suffisante : c'est FAME - l'analyste
membre de l'Ecole.
Aux AE, dits analystes de l'Ecole, reviendrait le devoir de l'institu-
tion interne soumettant une critique permanente l'autorisation
des meilleurs.
Nous devons ici insrer l'Ecole dans ce qui pour elle, est le cas,
Expression qui dsigne une position de fait retenir d'vnements
relgus dans cette considration.
L'cole, de son rassemblement inaugural ne peut omettre qu'il
s'est constitu d'un choix pour ses membres dlibr, celui d'tre
exclu de l'Association psychanalytique internationale.
Chacun sait en effet que c'est sur un vote, lequel n'avait d'autre
enjeu que de permettre ou d'interdire la prsence de mon enseigne-
ment, qu'a t suspendue leur admission l'IPA, sans autre consid-
ration tire de la formation reue, et spcialement sans objection de
ce qu'elle fut reue de moi. Un vote, un vote politique, suffisait pour
tre admis l'Association psychanalytique internationale, comme
l'ont montr ses suites.
Il en rsulte que ceux qui se sont regroups dans ma fondation,
ne tmoignent par l de rien d'autre que du prix qu'ils attachent
un enseignement - qui est le mien, qui est de fait sans rival - pour
soutenir leur exprience. Cet attachement est de pense pratique,
disons-le, et non pas d'noncs conformistes : c'est pour l'air, nous
irons jusqu' cette mtaphore, que notre enseignement apporte au
576
ANNEXES
travail, qu'on a prfr tre exclu que de le voir disparatre et mme
que de s'en sparer. Ceci se conclut aisment de ce que nous ne dis-
posons jusqu' prsent d'aucun autre avantage dont nous puissions
balancer la chance ainsi dcline.
Avant d'tre un problme proposer quelques cavillations ana-
lytiques, ma position de chef d'Ecole est un rsultat d'une relation
entre analystes, qui depuis dix-sept ans s'impose nous comme un
scandale.
Je souligne que je n'ai rien fait en produisant l'enseignement
qui m'tait confi dans un groupe, ni pour en tirer la lumire moi,
notamment par aucun appel au public, ni mme pour trop souligner
les artes qui auraient pu contrarier la rentre dans la communaut,
laquelle restait pendant ces annes le seul souci vritable de ceux
qui m'avait runi une prcdente infortune (soit la sanction donne
par les soins de Mlle Anna Freud une sottise de manuvre, com-
mue elle-mme sous la consigne que je n'en sois pas averti).
Cette rserve de ma part est notable par exemple dans le fait
qu'un texte essentiel trouver dans mes Ecrits pour donner, sous la
forme invitable de la satire, la critique dont tous les termes sont
choisis, des Socits analytiques en exercice ( Situation de la psy-
chanalyse en 1956 ) - que ce texte tenir pour prface notre
effort prsent, a t retenu par moi jusqu' l'dition qui le livre.
J'ai donc prserv dans ces preuves, on le sait, ce que je pouvais
donner. Mais j'ai prserv aussi ce qui d'autres paraissait obtenir.
Ces rappels ne sont l que pour situer justement l'ordre de conces-
sion ducative auquel j'ai soumis mme les temps de ma doctrine.
Cette mesure toujours tenue, laisse maintenant oublier l'obscu-
rantisme incroyable de l'audience o j'avais la faire valoir.
Ceci pour dire qu'ici il me faudra devancer, dans les formules
vous proposer maintenant, les suites que je suis en droit d'attendre, et
notamment des personnes prsentes, pour ce qu'il m'a t permis
d'en mettre jusqu'alors.
Du moins a-t-on pour infrer ce qui vient ici, sous toutes les
formes possibles, dj de moi l'indication.
Nous partons de ceci que la racine de l'exprience du champ de la
psychanalyse pos en son extension, seule base possible motiver une
Ecole, est trouver dans l'exprience psychanalytique elle-mme,
nous voulons dire prise en intension : seule raison juste formuler
577
ANNEXES
de la ncessit d'une psychanalyse introductive pour oprer dans ce
champ. En quoi donc nous nous accordons de fait avec la condition
partout reue de la psychanalyse dite didactique.
Pour le reste, nous laissons en suspens ce qui a pouss Freud cet
extraordinaire joke que ralise la constitution des Socits psychana-
lytiques existantes, car il n'est pas possible de dire qu'il les aurait
voulues autrement.
Ce qui importe, c'est qu'elles ne peuvent se soutenir dans leur
succs prsent sans un appui certain dans le rel de l'exprience ana-
lytique.
Il faut donc interroger ce rel pour savoir comment il conduit
sa propre mconnaissance, voire produit sa ngation systmatique.
Cefeed-back dviant ne peut, comme nous venons de le poser, tre
dtect que dans la psychanalyse en intension. Du moins l'isolera-
t-on ainsi de ce qui dans l'extension relve de ressorts de compti-
tion sociale, par exemple, qui ne peuvent faire ici que confusion.
Qui avoir quelque vue du transfert, pourrait douter qu'il n'y a
pas de rfrence plus contraire l'ide de l'intersubjectivit ?
Au point que je pourrais m'tonner qu'aucun praticien ne se soit
avis de m'en faire objection hostile, voire amicale. Ce m'aurait t
occasion de marquer que c'tait bien pour qu'il y pense, que j'ai d
rappeler d'abord ce qu'implique de relation intersubjective l'usage
de la parole.
C'est pourquoi tout bout de champ de mes crits, j'indique ma
rserve sur l'emploi de ladite intersubjectivit par cette sorte d'uni-
versitaires qui ne savent se tirer de leur lot, qu' s'accrocher des
termes qui leur semblent lvitatoires, faute de saisir leur connexion
l o ils servent.
Il est vrai que ce sont les mmes qui favorisent l'ide que la praxis
analytique est faite pour ouvrir notre relation au malade la com-
prhension. Complaisance ou malentendu qui fausse notre slection
au dpart, o se montre qu'ils ne perdent pas tellement le nord
quand il s'agit de la matrielle.
Le transfert, je le martle depuis dj quelque temps, ne se conoit
qu' partir du terme du sujet suppos savoir.
A m'adresser d'autres, je produirais d'emble ce que ce terme
implique de dchance constituante pour le psychanalyste, l'illustrer
du cas originel. Fliess, c'est--dire le mdicastre, le chatouilleur de nez,
578
ANNEXES
mais qui cette corde prtend faire rsonner les rythmes archty-
piques, vingt et un jours pour le maie, vingt-huit pour la femelle, trs
prcisment ce savoir qu'on suppose fond sur d'autres rets que ceux
de la science qui l'poque se spcifie d'avoir renonc ceux-l.
Cette mystification qui double l'antiquit du statut mdical, voil
qui a suffi creuser la place o le psychanalyste s'est log depuis.
Qu'est-ce dire, sinon que la psychanalyse tient celui qui doit tre
nomm le psychanalysant : Freud le premier en l'occasion, dmon-
trant qu'il peut concentrer en lui le tout de l'exprience. Ce qui ne
fait pas une autoanalyse pour autant.
Il est clair que le psychanalyste tel qu'il rsulte de la reproduction
de cette exprience, par la substitution du psychanalysant originel sa
place, se dtermine diffremment par rapport au sujet suppos savoir.
Ce terme exige une formalisation qui l'explique.
Et justement qui bute aussitt sur l'intersubjectivit. Sujet sup-
pos par qui ? dira-t-on, sinon par un autre sujet.
Et si nous supposions provisoirement qu'il n'y a pas de sujet sup-
posable par un autre sujet? On sait en effet que nous ne nous rf-
rons pas ici au sens vague du sujet psychologique qui est prcis-
ment ce que l'inconscient met en question.
N'est-il pas acquis que le sujet transcendantal, disons celui du
cogito, est incompatible avec la position d'un autre sujet? Dj dans
Descartes, on saisit qu'il n'en saurait tre question, sinon passer par
Dieu comme garant de l'existence. Hegel remet les choses au point
avec la fameuse exclusion de la coexistence des consciences. D'o
part la destruction de l'autre, inaugurale de la phnomnologie de
l'esprit, mais de quel autre ? On dtruit le vivant qui supporte la
conscience, mais la conscience, celle du sujet transcendantal, c'est
impossible. D'o le huis-clos o Sartre conclut : c'est l'enfer. L'obs-
curantisme lui non plus ne semble pas prs de mourir si vite.
Mais peut-tre poser le sujet comme ce qu'un signifiant repr-
sente pour un autre signifiant, pourrons-nous rendre la notion du
sujet suppos plus maniable : le sujet est l bien suppos, trs prcis-
ment sous la barre elle-mme tire sous l'algorithme de l'implica-
tion signifiante. Soit :
S > S'
s
579
ANNEXES
Le sujet est le signifi de la pure relation signifiante.
Et le savoir, o l'accrocher? Le savoir n'est pas moins suppos,
nous venons d'en prendre l'ide - que le sujet. La ncessit de la
porte de l'criture musicale pour rendre compte du discours s'im-
pose ici une fois de plus, pour faire saisir vivement le
suppos
sujet savoir
Deux sujets ne sont pas imposs par la supposition d'un sujet,
mais seulement un signifiant qui reprsente pour un autre quel-
conque, la supposition d'un savoir comme attenante un signifi,
soit un savoir pris dans sa signification.
C'est l'introduction de ce signifiant dans la relation artificielle du
psychanalysant en puissance ce qui reste l'tat d'x, savoir le psy-
chanalyste, qui dfinit comme ternaire la fonction psychanalytique.
Il s'agit d'en extraire la position ainsi dfinie du psychanalyste.
Car celui qui se dsigne ainsi, ne saurait, sans malhonntet radi-
cale se glisser dans ce signifi, mme si son partenaire l'en habille (ce
qui n'est nullement le cas moyen), dans ce signifi qui est imput
le savoir.
Car non seulement son savoir n'est pas de l'espce de ce que
Fliess lucubre, mais trs prcisment c'est l ce dont il ne veut rien
savoir. Comme il se voit dans ce rel de l'exprience tout l'heure
invoqu l o il est : dans les Socits, si l'ignorance o l'analyste se
tient de ce qui pourrait mme commencer s'articuler de scienti-
fique dans ce champ, la gntique par exemple, ou l'intersexualit
hormonale. Il n'y connat rien, on le sait. Il n'a en connatre la
rigueur qu'en manire d'alibi pour les confrres.
Les choses du reste trouvent leur place tout de suite, se souvenir
de ce qu'il y a, pour le seul sujet en question (qui est, ne l'oublions
pas, le psychanalysant) savoir.
Et ceci introduire la distinction depuis toujours prsente l'ex-
prience de la pense telle que l'histoire la fournit : distinction du
savoir textuel et du savoir rfrentiel.
Une chane signifiante, telle est la forme radicale du savoir dit
textuel. Et ce que le sujet du transfert est suppos savoir, c'est, sans
580
ANNEXES
que le psychanalysant le sache encore, un texte, si l'inconscient est
bien ce que nous nous savons : structur comme un langage.
N'importe quel clerc d'autrefois, voire sophiste, colporteur de
contes, ou autre talmudiste, serait tout de suite ici au fait. On aurait
tort de croire pourtant que ce savoir textuel a termin sa mission
sous prtexte que nous n'admettons plus de rvlation divine.
Un psychanalyste, au moins de ceux qui nous apprenons rfl-
chir, devrait pourtant reconnatre ici la raison de la prvalence d'un
texte au moins, celui de Freud, dans sa cogitation.
Disons que le savoir rfrentiel, celui qui se rapporte au rfrent,
dont vous savez qu'il complte le ternaire dont les deux autres
termes sont signifiant et signifi, autrement dit le connote dans la
dnotation, n'est bien entendu pas absent du savoir analytique, mais
il concerne avant tout les eflfets du langage, le sujet d'abord, et ce
qu'on peut dsigner du terme large de structures logiques.
Sur normment d'objets que ces structures impliquent, sur
presque tous les objets qui par elles viennent conditionner le
monde humain, on ne peut dire que le psychanalyste sache grand-
chose.
a vaudrait mieux, mais c'est variable.
La question est non pas de ce qu'il sait, mais de la fonction de ce
qu'il sait dans la psychanalyse.
Si nous nous en tenons ce point nodal que nous y dsignons
comme intensif, soit la faon dont il a parer l'investiture qu'il
reoit du sujet suppos savoir, la discordance apparat vidente de ce
qui va s'en inscrire aussitt dans notre algorithme :
S (S, S' ...)
s... (S',S",S'"...S)
Tout ce qu'il sait n'a rien voir avec le savoir textuel que le sujet
suppos savoir lui signifie : l'inconscient qu'implique l'entreprise du
psychanalysant.
Simplement le signifiant qui dtermine un tel sujet, a tre
retenu par lui pour ce qu'il signifie : le signifi du texte qu'il ne sait
pas.
Tel est ce qui commande l'tranget o lui parat la recommanda-
581
ANNEXES
tion de Freud, si insistante pourtant, laquelle s'articule expressment
comme d'exclure tout ce qu'il sait dans son abord de chaque nou-
veau cas.
L'analyste n'a d'autre recours que de se placer au niveau du s de la
pure signification du savoir, soit du sujet qui n'est pas encore dter-
minable que d'un glissement qui est dsir, de se faire dsir de
l'Autre, dans la pure forme qui s'isole comme dsir de savoir.
Le signifiant de cette forme tant ce qui est articul dans Le Ban-
quet comme l'oyaXjia, le problme de l'analyste est reprsentable (et
c'est pourquoi nous lui avons fait la place que l'on sait) dans la faon
dont Socrate supporte le discours d'Alcibiade, c'est--dire trs prci-
sment en tant qu'il vise un autre, Agathon, au nom ironique prci-
sment dans ce cas.
Nous savons qu'il n'y a pas d'ro^ia que celui qui veut sa pos-
session, puisse obtenir.
L'enveloppe (quelle qu'en soit la disgrce qui fasse le psychana-
lyste paratre la constituer), est une enveloppe qui sera vide, s'il
l'ouvre aux sductions de l'amour ou de la haine du sujet.
Mais ce n'est pas dire que la fonction de l'&yocjia du sujet sup-
pos savoir, ne puisse tre pour le psychanalyste, comme je viens
d'en baucher les premiers pas, la faon de centrer ce qu'il en est de
ce qu'il choisit de savoir.
Dans ce choix, la place du non-savoir est centrale.
Elle n'en est pas moins articulable en conduites pratiques. Celle
du respect du cas par exemple, nous l'avons dit. Mais celles-ci restent
parfaitement vaines hors d'une thorie ferme de ce qu'on refuse et
de ce qu'on admet de tenir pour tre savoir.
Le non-savoir n'est pas de modestie, ce qui est encore se situer
par rapport soi ; il est proprement la production en rserve de la
structure du seul savoir opportun.
Pour nous rfrer au rel de l'exprience, suppos dcelable dans
la fonction des Socits, trouvons l forme saisir pourquoi des tres
qui se distinguent par un nant de la pense, reconnu de tous et
accord comme de fait dans les propos courants (c'est l l'important),
sont aisment mis dans le groupe en position reprsentative.
C'est qu'il y a l un chapitre que je dsignerai comme la confu-
sion sur le zro. Le vide n'est pas quivalant au rien. Le repre dans
la mesure n'est pas l'lment neutre de l'opration logique. La nul-
582
ANNEXES
lit de l'incomptence n'est pas le non-marqu par la diffrence
signifiante.
Dsigner la forme du zro est essentiel, qui (c'est la vise de
notre 8 intrieur), place au centre de notre savoir, soit rebelle ce
que s'y substituent les semblants d'un batelage ici trs singulirement
favoris.
Car justement parce que tout un savoir exclu par la science ne
peut qu'tre tenu l'cart de la psychanalyse, si l'on ne sait pas dire
quelle structure logique y supple au centre (terme ici approch),
n'importe quoi peut y venir - (et les discours sur la bont).
C'est dans cette ligne que se place la logique du fantasme. La
logique de l'analyste est Yyo^ia qui s'intgre au fantasme radical
que construit le psychanalysant.
Cette ordination de l'ordre de savoir en fonction dans le procs
analytique, voil ce autour de quoi doit tourner l'admission dans
l'cole. Elle implique toutes sortes d'appareils - dont l'me est
trouver dans les fonctions dj dlgues dans le Directoire - Ensei-
gnement, Direction de travaux, Publication.
Elle comporte le groupement de certains livres publier en col-
lection - et au-del une bibliographie systmatique. Je ne m'en tiens
l qu' des indications.
Ce propos est fait pour montrer comment se raccordent imm-
diatement les problmes en extension, ceux, centraux l'intension.
C'est ainsi qu'il nous faut reprendre la relation du psychanalysant
au psychanalyste, et comme dans les traits d'checs passer du dbut
la fin de partie.
Que dans la fin de partie la clef se trouve du passage de l'une des
deux fonctions l'autre, c'est ce qui est exig par la pratique de la
psychanalyse didactique.
Rien qui l ne reste confus ou voil. Je voudrais indiquer com-
ment notre Ecole pourrait oprer pour dissiper cette tnbre.
Je n'ai pas mnager ici de transition pour ceux qui me suivent
ailleurs.
Qu'est-ce qui la fin de l'analyse vient tre donn savoir?
Dans son dsir, le psychanalysant peut savoir ce qu'il est. Pur
manque en tant que (- <p), c'est par le mdium de la castration quel
que soit son sexe qu'il trouve la place dans la relation dite gnitale.
Pur objet en tant que (a) il obture la bance essentielle qui s'ouvre
583
ANNEXES
dans l'acte sexuel, par des fonctions qu'on qualifiera de prgnitales.
Ce manque et cet objet, je dmontre qu'ils ont mme structure.
Cette structure ne peut tre que rapport au sujet, au sens admis par
l'inconscient. C'est elle qui conditionne la division de ce sujet.
Leur participation l'imaginaire (de ce manque et de cet objet)
est ce qui permet au mirage du dsir de s'tablir sur le jeu aperu du
rapport de causation par o l'objet (a) divise le sujet (d (S 0 a)).
Mais apercevez l vous-mme ce qu'il en est de ce que j'ai appel
le psychanalysant plus haut. Si je le dis tre cette cause de sa division,
c'est en tant qu'il est devenu ce signifiant qui suppose le sujet du
savoir. Il n'y a que lui ne pas savoir qu'il est l'&yajxa du procs
analytique (comment quand c'est Alcibiade, ne pas le reconnatre ?),
ni quel autre signifiant inconnu (et combien nul d'ordinaire) sa
signification de sujet s'adresse.
Sa signification de sujet ne dpasse pas l'avnement du dsir, fin
apparente de la psychanalyse, mais il y reste la diffrence du signifiant
au signifi qui va choir sous la forme du ( (p) ou de l'objet (a) entre
lui et le psychanalyste pour autant que celui-ci va se rduire au
signifiant quelconque.
C'est pourquoi je dis que c'est dans ce (- <p) ou ce (a) qu'apparat
son tre. L'tre de Yyc^ia, du sujet suppos savoir, achve le procs
du psychanalysant, dans une destitution subjective.
Voil-t-il pas ce que nous ne pourrions noncer qu'entre nous ?
N'est-ce pas l assez pour semer la panique, l'horreur, la maldic-
tion, voire l'attentat? En tout cas justifier les aversions prjudicielles
l'entre dans la psychanalyse ?
Certes il y a trouble une certaine pointe de l'analyse, mais il n'y
a d'angoisse lgitime (dont j'ai fait tat) qu' pntrer - et il le faut
pour la psychanalyse didactique - dans ce qu'il faut bien appeler un
au-del de la psychanalyse, dans la vritable garde o succombe pr-
sentement toute nonciation rigoureuse sur ce qui s'y passe.
Cette garde rencontre l'insouciance qui protge le plus srement
vrit et sujets tout ensemble, et c'est pourquoi profrer devant
les seconds la premire, cela ne fait, on le sait bien, ni chaud ni froid,
qu' ceux qui en sont proches. Parler de destitution subjective n'ar-
rtera pas l'innocent.
Il faut seulement avoir prsent qu'au regard du psychanalysant, le
psychanalyste, et mesure qu'on est plus loin dans la fin de partie,
584
ANNEXES
est en position de reste au point que c'est bien lui que ce qu'on
appellerait d'une dnotation grammaticale qui en vaut mille, le
participe pass du verbe, conviendrait plutt en cet extrme.
Dans la destitution subjective, l'clips du savoir va cette reparu-
tion dans le rel, dont quelqu'un vous entretient parfois.
Celui qui a reconstruit sa ralit de la fente de l'impubre rduit
son psychanalyste au point projectif du regard.
Celui qui, enfant, s'est trouv dans le reprsentant reprsentatif
de sa propre plonge travers le papier journal dont s'abritait le
champ d'pandage des penses paternelles, renvoie au psychanalyste
l'effet de seuil o il bascule dans sa propre djection.
La psychanalyse montre n sa fin une navet dont c'est une ques-
tion poser, si nous pouvons la mettre au rang de garantie dans le
passage au dsir d'tre psychanalyste.
Il vaut donc de reprendre ici le sujet suppos savoir du ct du
psychanalyste. Quoi ce dernier peut-il penser devant ce qui choit
d'tre du psychanalysant, quand celui-ci tant venu de ce sujet en
savoir un bout, n'a plus envie du tout d'en lever l'option ?
A quoi ressemble cette jonction o le psychanalysant semble le
doubler d'un renversement logique qui se dirait lui en attribuer
l'articulation : Qu'il sache comme tant de lui ce que je ne savais
pas de l'tre du savoir, et qui a maintenant pour effet que ce que je
ne savais pas est de lui effac ?
C'est lui faire la part belle de ce savoir peut-tre imminent, au
plus aigu, que ce que la destitution subjective en cette chute masque
la restitution o vient l'tre du dsir, de se rejoindre, ne s'y nouer
que d'un seul bord, l'tre du savoir.
Ainsi Thomas la fin de sa vie : sicut palea, de son uvre il le dit :
du fumier.
De ce que le psychanalyste a laiss obtenir au psychanalysant du
sujet suppos savoir, c'est lui que revient d'y perdre Yar/c^ia.
Formule qui ne nous semble pas indigne de venir la place de
celle de la liquidation - terme combien futile ! - du transfert, dont
le bnfice principal est, malgr l'apparence, de renvoyer toujours au
patient prtendu, en dernier ressort, la faute.
Dans ce dtour qui le ravale, ce dont l'analyste est le gond, c'est
de l'assurance que prend le dsir dans le fantasme, et dont alors il
s'avre que la prise n'est rien que celle d'un dstre.
585
ANNEXES
Mais n'est-ce pas l qu'est offert au psychanalysant ce tour de plus
dans le doublage qui nous permet d'y engendrer le dsir du psycha-
nalyste ?
Retenons pourtant, avant de franchir ce passage, cette alternance
dont notre discours se syncope de faire ainsi l'un l'autre s'cranter.
O toucher mieux la non-intersubjectivit? Et combien il est
impossible qu'un tmoignage juste soit port par celui qui franchit
cette passe, sur celui qui la constitue - entendons qu'il l'est cette
passe, de ce que son moment reste son essence mme, mme si,
aprs, a lui passera.
C'est pourquoi ceux qui a a pass au point d'en tre bats, me
paraissent conjoindre l'impropre l'impossible en ce tmoignage
ventuel - et ma proposition va-t-eUe tre que ce soit plutt devant
quelqu'un qui soit encore dans le moment originel, que s'prouve
qu'est bien advenu le dsir du psychanalyste.
Qui pourrait mieux que ce psychanalysant dans la passe, y
authentifier la qualit d'une certaine position dpressive? Nous
n'ventons l rien. On ne peut s'en donner les airs, si on n'y est
pas.
C'est le moment mme de savoir si dans la destitution du sujet, le
dsir advient qui permette d'occuper la place du dstre, justement
de vouloir oprer nouveau ce qu'implique de sparation (avec
l'ambigut du se parre que nous y incluons pour y prendre ici son
accent) l'oyaA+ia.
Disons ici, sans dvelopper, qu'un tel accs implique la barre mise
sur l'Autre, que Ycqak^a en est le signifiant, que c'est de l'Autre
que choit le (a) comme en l'Autre s'ouvre la bance du (- <p) et que
c'est pourquoi, qui peut articuler ce S(A) celui-l n'a nul stage
faire, ni dans les Bien-Ncessaires ni parmi les Suffisances pour tre
digne de la Batitude des Grands Ineptes de la technique rgnante.
Pour la raison que celui-l comme S(A) s'enracine dans ce qui
s'oppose le plus radicalement tout ce quoi il faut et il suffit d'tre
reconnu pour tre : l'honorabilit par exemple.
Le passage qu'il a accompli se traduit ici autrement. Ni il n'y faut,
ni il n'y suffit qu'on le croie franchi pour qu'il le soit. C'est la vraie
porte de la ngation constituante de la signification d'infamie.
Connotation qu'il faudrait bien restaurer dans la psychanalyse.
Dtendons-nous. Appliquons S() AE. a fait : E. Reste l'Ecole
586
ANNEXES
ou l'preuve, peut-tre. a peut indiquer qu'un psychanalyste doit
toujours pouvoir choisir entre l'analyse et les psychanalystes.
Je prtends dsigner dans la seule psychanalyse en intension l'ini-
tiative possible d'un nouveau mode d'accession du psychanalyste
une garantie collective.
Ce n'est pas dire que de considrer la psychanalyse en extension -
soit les intrts, la recherche, l'idologie qu'elle cumule - ne soit pas
ncessaire la critique des Socits telles qu'elles supportent cette
garantie hors de chez nous, l'orientation donner une cole
nouvelle.
Je ne pare aujourd'hui qu' une construction d'organes pour un
fonctionnement immdiat.
Ceci ne me dispense peut-tre pas d'indiquer au moins, pralable
d'une critique au niveau de l'extension, trois repre^ produire
comme essentiels. D'autant plus significatifs qu' s'imposer par leur
grosseur, ils se rpartissent dans les trois registres du symbolique, de
l'imaginaire et du rel.
L'attachement spcifi de l'analyse aux coordonnes de la famille,
est un fait qui est estimer sur plusieurs plans. Il est extrmement
remarquable dans le contexte social.
Il semble li un mode d'interrogation de la sexualit qui risque
fort de manquer une conversion de la fonction sexuelle qui s'opre
sous nos yeux.
La participation du savoir analytique ce mythe privilgi qu'est
l'dipe, privilgi pour la fonction qu'il tient dans l'analyse, privil-
gi aussi d'tre selon le mot de Kroeber, le seul mythe de cration
moderne, est le premier de ces repres.
Observons son rle dans l'conomie de la pense analytique et
pinglons-le de ceci qu' l'en retirer, toute la pense normative de la
psychanalyse se trouve quivaloir en sa structure au dlire de Schreber.
Qu'on pense Entmannung, aux mes rdimes, voire au psychana-
lyste comme cadavre lpreux.
Ceci laisse la place un sminaire sur le Nom-du-Pre dont je
maintiens qu'il n'est pas de hasard que je n'aie pu le faire.
La fonction de l'identification dans la thorie - sa prvalence - ,
comme l'aberrance d'y rduire la terminaison de l'analyse, est lie
la constitution donne par Freud aux Socits et pose la question
de la limite qu'il a entendu donner par l son message.
587
ANNEXES
Elle doit tre tudie en fonction de ce qu'est dans l'Eglise et
dans l'Arme, prises ici pour modles, le sujet suppos savoir.
Cette structure est incontestablement une dfense contre la mise
en question de l'dipe : le Pre idal, c'est--dire le Pre mort,
conditionne les limites o restera dsormais le procs analytique.
Il fige la pratique dans une finalit dsormais impossible articuler
et qui obscurcit au principe ce qui est obtenir de la psychanalyse
didactique.
La mise en marge de la dialectique dipienne qui en rsulte, va
toujours plus s'accentuant dans la thorie et dans la pratique.
Or, cette exclusion a une coordonne dans le rel, laisse dans
une ombre profonde.
C'est l'avnement, corrlatif de l'universalisation du sujet pro-
cdant de la science, du phnomne fondamental, dont le camp de
concentration a montr l'ruption.
Qui ne voit que le nazisme n'a eu ici que la valeur d'un ractif
prcurseur.
La monte d'un monde organis sur toutes les formes de sgrga-
tion, voil quoi la psychanalyse s'est montre plus sensible encore,
en ne laissant pas un de ses membres reconnus aux camps d'exter-
mination.
Or c'est l le ressort de la sgrgation particulire o elle se
soutient elle-mme, en tant que l'IPA se prsente dans cette extra-
territorialit scientifique que nous avons accentue, et qui en fait
bien autre chose que les associations analogues en titre d'autres pro-
fessions.
A proprement parler, une assurance prise de trouver un accueil,
une solidarit, contre la menace des camps s'tendant l'un de ses
secteurs.
L'analyse se trouve ainsi protger ses tenants - d'une rduction
des devoirs impliqus dans le dsir de l'analyste.
Nous tenons ici marquer l'horizon complexe, au sens propre du
terme, sans lequel on ne saurait faire la situation de la psychanalyse.
La solidarit des trois fonctions majeures que nous venons de tra-
cer, trouve son point de concours dans l'existence des Juifs. Ce qui
n'est pas pour tonner quand on sait l'importance de leur prsence
dans tout son mouvement.
Il est impossible de s'acquitter de la sgrgation constitutive de
588
ANNEXES
cette ethnie avec les considrations de Marx, celles de Sartre encore
bien moins. C'est pourquoi, pourquoi spcialement la religion des
Juifs doit tre mise en question dans notre sein.
Je m'en tiendrai ces indications.
Nul remde attendre, tant que ces problmes n'auront pas t
ouverts, la stimulation narcissique o le psychanalyste ne peut vi-
ter de se prcipiter dans le contexte des Socits prsent.
Nul autre remde que de rompre la routine qui est actuellement
le constituant prvalent de la pratique du psychanalyste.
Routine apprcie, gote comme telle, j'en ai recueilli de la
bouche des intresss eux-mmes aux USA l'tonnante, formelle,
expresse dclaration.
Elle constitue un des attraits de principe du recrutement.
Notre pauvre Ecole peut tre le dpart d'une rnovation de l'ex-
prience.
Telle qu'elle se propose, elle se propose comme telle.
Nous proposons d'y dfinir actuellement :
1. Le jury d'accueil, comme :
a) Choisi par le Directoire annuel dans son extension variable.
b) Charg d'accueillir selon les principes du travail qu'ils se propo-
sent, les membres de l'cole, sans limitation de leurs titres ou prove-
nance. Les psychanalystes (AP) ce niveau, n'y ont aucune prfrence.
2. le jury d'agrment :
a) Compos de sept membres : trois analystes de l'Ecole (AE) et
trois psychanalysants pris dans une liste prsente par les analystes de
l'cole (AE). Il est clair qu'en rpondant, ces psychanalystes choisi-
ront dans leur propre clientle, des sujets dans la passe de devenir
psychanalystes - s'y adjoignant le directeur de l'cole.
Ces analystes de l'cole (AE), comme ces psychanalysants seront
choisis par tirage au sort sur chacune des listes.
Un psychanalysant se prsente-t-il, quel qu'il soit, qui postule le
titre d'analyste de l'cole, c'est aux trois psychanalysants qu'il aura
faire, charge pour ceux-ci d'en rendre compte devant le collge au
complet du jury d'agrment (prsentation d'un rapport).
59
ANNEXES
b) Ledit jury d'agrment se trouvera de ce fait en devoir de
contribuer aux critres de l'achvement de la psychanalyse didac-
tique.
c) Son renouvellement par le mme procd du sort, se fera tous
les six mois, jusqu' ce que des rsultats suffisants pour tre publiables,
permettent sa refonte ventuelle ou sa reconduction.
3. L'analyste membre de l'cole prsente qui lui convient la
candidature prcdente. Si son candidat est adjoint aux analystes de
l'cole, il y est admis lui-mme du mme fait.
L'analyste membre de l'cole est une personne qui de son initia-
tive runit ces deux qualits (la seconde implique son passage devant
le jury d'accueil).
Il est choisi pour la qualification qui soude ces deux qualits,
sans avoir poser de candidature ce titre, par le jury d'agrment au
complet qui en prend l'initiative sur le critre de ses travaux et de
son style de pratique.
Un analyste praticien, non qualifi d'AME, passera par ce stage au
cas o un de ses psychanalysants est admis au rang d'AE.
On appliquera ce fonctionnement sur notre graphe pour en faire
apparatre le sens.
Il suffit d'y substituer :
- AE. S( ) ;
- psychanalysants du jury d'agrment (S 0 D) ;
- AMES( A) ;
- psychanalysants tout-venant A.
Le sens des flches y indiquera ds lors la circulation des quali-
fications.
Un peu d'attention suffira montrer quelle rupture - non sup-
pression - de hirarchie en rsulte. Et l'exprience dmontrera ce
que l'on peut en attendre.
La proposition des nouveaux appareils fera l'objet d'une runion
plnire des AE - aux fins d'tre homologue pour prsentation
gnrale.
590
ANNEXES
Un groupe sera charg d'une bibliographie concernant les ques-
tions de formation - aux fins d'tablir une anatomie de la Socit
du type IPA sur ces problmes.
2
Au moment de mettre sous presse, je parcours le numro de L'Arc
qui vient de paratre sur Freud.
Ce numro illustre ce quoi la formule de la revue prsente doit
permettre d'chapper.
A savoir l'ordre d'inflation littraire auquel mon enseignement
s'est oppos jusqu' une crise, dont le succs se saisit mieux voir o
saute le verrou.
Pour la contorsion de la psychanalyse sur son propre nud, qui
fut plus haut ma formule, comment ne pas regretter que la meilleure
biographe de Freud en donne l'exemple, en ne trouvant ici saisir
dans mon retour Freud que le trop , par o il viterait la psy-
chanalyse elle-mme tout simplement.
Que Mme Marthe Robert vienne donc suppler ceux qui se
drobent ce que je dis cette anne de l'acte psychanalytique, pour
mesurer si je rduis la psychanalyse des faons de dire .
Son article ira aux Archives de toute personne un peu au fait des
choses.
Il est convenu que je signerai tout ce qui ici est ma part, donc :
J.L.
591
ANNEXES
3
LIMINAIRE
En manire d'excuse
l'cole
Le numro 2/3 de Scilicet parat en retard : c'est de mon fait.
Une part de ce que je lui destinais, je l'ai transcrite en deux
prfaces, dans un calcul de ce que les lieux en fussent juste assez
dplacs pour faire mesure ce qu'il fallait remettre sa place.
Ainsi passa l'chance de Nol 69.
Le reste concernait trop ce qui m'tait arriv de l'ENS dont on se
souvient peut-tre, tandis que de la mascarade laquelle j'avais
contribu, et des deux mains : dans Le Monde et dans Les Lettres fran-
aises, abattre le jeu ne s'imposait pas.
Dire les ficelles en cette farce et t un dfi de s'appuyer sur leur
dni qui suffit pour qu'on sache, et dfi sans mrite puisqu' ce jeu
j'avais laiss courir.
Il et fallu que plus m'importassent ceux qui plus ne me suppor-
taient. Outre que nulle s'en avrait la suite.
Ce pli de ddain ne se soutient que d'une occasion o son parti
pris fut assez critique pour d'autres, de ce que j'eusse d'eux la
charge, pour que le reproche qu'ils ne m'en font pas, me rende dis-
trait F affront.
La facture de ces choses, je la laisserai l'historien, sans me croire
oblig m'en faire l'annaliste.
Pour mon action, elle se jugera du terme dont j'assigne le dis-
cours analytique, me tenir ce que je fais tel.
C'est la mesure du point d'acte qu'il atteint dans le symbolique,
que se dmontre le rel.
On le comprendra lire en partie I les actes du congrs tenu par
l'cole en 1969 l'htel Luttia.
592
ANNEXES
Congrs o aboutit, fraye du mois de mai dont on parle, quoique
l'ayant bien prcd, ma proposition dite du 9 octobre 1967.
Viennent, partie II, les rponses dont m'a surpris un enquteur
de la radio belge, M. Georgin.
Surprise que je ne relve pas seulement de m'y tre laiss prendre
(ce dont je les introduis), mais d'y maintenant trouver l'effet d'une
audience sans incarnation.
Pourquoi de ce que s'avre qu'elles soient sparables, se refuser au
piquant d'y faire preuve l'incomprhensible quelqu'un de
normalement constitu ?
Si cela veut dire chapper la rgie du discours universitaire, on
ne l'vite pas se faire auteur. Mais me tromp-je ressentir dans la
radiophonie une toute l'action qui s'en dispenserait?
Car je mets en place ici ce que je ne savais pas - je mets les
guillemets pour ceux qui savent ce qui a tourn autour de ces mots
de ma doctrine - , ce que je ne savais pas de ma part dans l'ac-
tuelle rvolution.
Dont je suis, mais pas l'auteur.
Des articles suivent dont le groupement en trois parties est
reconnatre.
Non signs, selon ce que cette revue a inaugur, ceci bien plus
encore rappeler : d'avant mai.
D'une dlibration tranchant d'une voie, elle sans problme, sur
l'indication du dclin de l'auteur.
Ce qui, je le prcise une fois de plus, n'exige pas l'anonymat, mais
la non-identification.
A ce que se prouve la formation, pas l'auteur.
D'o les membres de l'cole ont intrt, semble-t-il, sauter le pas,
puisque, tant que cette formation ne s'est pas prouve, ils ne sont
membres que d'une cole qui n'a rien d'autre pour elle que d'exister :
alors qu'ils ont de moi ceci leur porte contre l'vangile de l'poque,
qu'exister ce n'est pas grand-chose et qu'en tout cas a ne prouve
rien.
Ce qui confirme que rien ne fasse preuve contre une existence
quelconque. Il n'y a preuve que du pour.
Si pressant donc que soit cet intrt des membres, il ne rend pas
593
ANNEXES
vain l'appoint que, pour tmoigner de sa formation, l'Ecole peut
recevoir de non-membres.
Il y en a bien quatre ici dont les noms ( leur gr dans ce cas) se
trouveront, puisque ce numro double clt l'anne, la fin du volume.
Si ce qui vient dans ce numro reste connexe mon discours, ce
n'est pas qu'il n'y en ait d'autres qui dans l'Ecole soient formateurs.
Ils seront bienvenus, je le promets, se produire.
Pour le dehors, on trouvera dans mes rponses radiophoniques
articuls assez les discours non analytiques que j'ai dfinis cette
anne d'une consistance dont rend raison celui que j'instaure de
l'analyse, pour que quiconque puisse estimer ce qu'il doit la for-
mation de l'Ecole, qu'on entende l : ce qu'il doit lui apporter,
mme n'y tre pas inscrit.
Que les contribuants trangers doivent se maintenir dans le futur,
c'est l'occasion de mettre en relief ce qui appert de ce qu'hors de
notre Ecole, il n'y a que des associations d'analystes.
Or c'est un fait qu'il en rsulte un type de publication par quoi la
psychanalyse ne semble prouve qu' compte d'auteur.
A qui ne saute aux yeux que ce qui s'y est produit jusqu' prsent
de travaux, n'est vou qu' diffuser, j'allais crire : diffamer le nom
du signataire.
Ici je m'interroge si c'est seulement d'avoir tard, que ce nu-
mro manque la revue critique de ce qui rsulte de cela comme
travail.
De l'ouvrage de Serge Leclaire (pour nous en tenir au meilleur)
qui trouve ici son compte rendu - mais aussi bien lui-mme a su se
faire attendre des avertis -, au dernier de Maud Mannoni qui trouve
renouveler les abords du psychiatre et va nous attendre, combien
d'autres eussent fait matire une critique qui st s'y galer?
Nous en fallait-il un modle ?
C'est ce qu'on mesurera au parti qu'a tir Michle Montrelay,
analyste de l'cole (nouvelle formule), d'un ouvrage obtenu d'une
tout autre formation.
Qu'on y apprcie ce qui d'original se dispense propos .
A propos de l'ouvrage dont cette critique fait le mrite (en le
numro de juillet de la revue Critique).
594
ANNEXES
Ce n'est pas biais indigne faire preuve du dgel qu'un travail
spcifi de notre formation apporte en le problme de la sexualit
fminine : rest bloqu depuis que Jones en eut fait pice Freud.
La plainte que je ressasse qu'on me dtourne plus souvent qu'on
ne me devance, est ici dsarme.
Non sans que m'en revienne l'cho nostalgique de ce qu'un cer-
tain congrs d'Amsterdam pour quoi j'avais propos ce sujet, y ait
prfr de prendre le vent d'un fcheux retour au bercail.
Il fallait encore du temps pour que ce rel que j'ai promu ds mes
prmisses au rang de catgorie (et dont les badauds me dcriaient de
ne pas le voir venir), je rendisse clair qu'il ne se livre qu' l'acte qui
force le fantasme dont s'assoit la ralit. Scilicet l'acte psychanalytique
en reste loin, quoique hors de lui, ce soit impossible : le rel quoi !
Interdit aux tricheurs.
Un cho : mon discours de clture au congrs tenu par l'Ecole
en avril de cette anne 1970, marque en dernire partie comment se
formulait son travail avant un changement majeur, dont je remets
renonciation l'an qui vient.
Je dclare concurremment laisser la charge de ce qui s'appelle
rdaction ceux-l dont la liste qui termine ce numro, dit qu'ils
contriburent, membres ou non-membres de l'Ecole, Scilicet, pre-
mire anne.
Jacques Lacan,
directeur de VEFP.
Septembre 1970
595
ANNEXES
4
Ont contribu la premire anne de Scilicet :
[suit une liste de vingt et un noms propres].
Ils se font ainsi la tte, soit premier pas, mais thse aussi, de ce
qu'une publication pisodique doit l'Ecole.
Comme firent ceux de Bourbaki pour leur publication monu-
mentale.
C'est qu' choses telles (et toutes proportions gardes), on ne
contribue pas en son nom,
sauf leur faire de ce qu'on l'efface, vhicule.
Dans mon cas, c'est malgr :
J.L.
13X70
Index des noms cits
Abdouchli,Thmouraz, 295,304.
Abel,410.
Abraham, 58,337.
Abraham, Karl, 42,492.
Adam, 438.
Agathon,251,582.
Agostino de Dacie, 535.
Akhnaton, 429.
Aime (cas), 215,571.
Alain, 176,206.
Alcibiade, 251,252,436,582,584.
Alexander, Franz, 128,129.
Alien, Pierre, 295.
Allais, Alphonse, 206,210.
Amaterasu, 505.
Ampre, Andr-Marie, 424.
Antigone, 468.
Anzieu, Didier, 151,158-160,164.
Apollinaire, Guillaume, 191.
Apollon, 158,433.
Aphrodite, 346.
Aristophane, 17,527.
Aristote, 150,177,248,379,405,430,
459,465,469,473,512,523,538,
539,550,566,569.
Arrow,K.J.,295.
Artaud, Antonin, 349.
Augustin (saint), 37.39.181,489.
Auzias, Jean-Marie, 338,339.
Bachofen, 57.
Balint, Michal, 253,487.
Bnziger (Dr), 164.
Barrault, Jean-Louis, 193.
Barthes, Roland, 19,20,497.
Beckett, Samuel, 11.
Beeckman. Isaac. 437.
Bentham,Jeremy, 145.
Bergson, Henri, 57,58,138,154,389.
Berkeley, George, 338.
Beveridge, lord William Henry, 116.
Bion,Wilfried, 107-110,113,114.
Boileau, Nicolas, 544.
Bonaparte, 424.
Borges, Jorge-Luis, 288.
Bourbaki, Nicolas, 286,596.
Boutonier, Juliette, 162,163.
Bouvet, Maurice, 348.
Brentano, Franz, 428.
Bhler, Charlotte, 41.
Can, 124.
Camoens, Luis de, 144.
Canrobert, 286,291.
Cantor, Georg, 249, 336, 452, 477,
492,494,547.
Capgras, Joseph, 66.
Carroll, Lewis, 250,268.
Cnac. Michel. 124.
Czanne, Paul. 183.
Charbonnier. Georges, 221.
Chariemagne, 300.
Charles I
er
, 495.
Chateaubriand, Franois Ren de, 424.
597
INDEX DES NOMS CITS
Chomsky, Noam, 492.
Cicron, 483.
Condorcet, 295.
Conn, 25.
Cooper, David, 362.
Copernic, Nicolas, 421,429,430.
Corneille, Pierre, 60.
Courtenay, Baudouin de, 406.
Dali, Salvador, 215.
Dante, 363,476,487,526,527.
Daumzon, Georges, 449.
David, 139.
Delayjean, 169.
Dmocrite, 494.
De Quincey,Thomas, 127.
Desargues, Grard, 471.
Descartes, Ren, 158, 159, 247, 302,
324,357,376,437,579.
Deutsch, Hlne, 463,464.
Dolto, Franoise, 158.
Dora (cas), 144.
Dor, Gustave, 118.
Dostoevski, Fedor Mikhalovitch, 12.
Doyle (major), 118.
Duquenne, Paul, 213.
Durantschek, Olga, 153.
Duras, Marguerite, 191-197.
Durer, Albrecht, 159.
Durkheim, Emile, 26,27.
Eckhart (Matre), 337.
Einstein, Albert, 330,331.
EUmann, Richard, 568.
Empdocle, 480.
Erikson, Erik, 169.
Ernout, Alfred, 11.
Eschyle, 152.
Euckde, 452.
Eudme, 523.
Eudoxe, 430.
Eurydice, 283.
Ey, Henri, 361,395.
Fauconnet, P., 26.
Faust, 135.
Febvre, Lucien, 196.
Fechner, GustavTheodor, 167.
Fernel, Jean, 454.
Ficin, Marsile, 430.
Fhess, Wilhelm, 15, 169, 253, 274,
325,524,578,580.
Foucault, Michel, 349.
Frazer, James George, 48.
Frege, Gotdob, 200,458,547.
Freud,Anna,129,130,577.
Freud, Sigmund, 12,14,15,29,33,35,
40, 42, 45, 47, 48, 52, 69, 71, 73-
77, 103, 105, 128, 130, 137, 138,
140, 141,143-145, 154-157,159,
162-164, 166-172, 174, 183, 187,
188, 192,195,199, 202, 204-206,
209, 210, 213-215, 219, 221, 222,
224, 229, 237, 239, 240, 244, 249,
250, 253, 256, 257, 274, 275, 277,
280, 285-287, 289, 290, 294, 299,
309,311,313,317,318,323,325-
327, 329, 330, 332-339, 341, 343,
346, 349, 353-357, 363-365, 369,
370, 378, 380-382, 391, 398, 401,
403, 405-407, 410, 413, 417-421,
424, 428, 429, 432, 433, 435, 438,
439, 444, 452, 454, 457, 460, 462-
464, 467, 475, 476, 480, 483, 489,
491, 492, 494, 511, 514-516, 519,
521-524, 527-532, 543-545, 548,
549, 553, 555, 556, 558, 561, 562,
565, 568, 570-573, 578, 579, 581,
582,587,591,595.
Fnsch, Karl von, 523.
598
INDEX DES NOMS CITS
Galile, 421,422,431,522.
Gall, Franz Joseph, 462.
Gauss, Cari Friedrich, 538.
Georgin, Robert, 403,593.
Gilson, Etienne, 473.
Glover, Edward, 216.
Gdel,Kurt,200.
Goebbels, Joseph Paul, 353.
Gracian, Baltasar, 519.
Granoff,Wiadimir, 162.
Graves, Robert, 563.
Griaule, Marcel, 164.
Guattari, Flix, 304.
Guillaume d'Occam, 331.
Halle, Morris, 166.
Hamlet, 568.
Hans (cas du petit -), 390,491,528.
Hargreaves (colonel), 104.
Hardey, Ralph Wyndon Lyon, 148.
Hartmann, Heinz, 206.
Hegel, G.W.F., 36,138,146,159,204,
247, 248,300, 314, 331, 345,412,
421,439,453,462,475,579.
Heidegger, Martin, 160,364,554.
Helmholtz, Hermann von, 253.
Hsiode, 139.
Hesnard,Angelo, 121,122.
Hider,Adolf,353,416.
Hlderlin, Friedrich, 466.
Homme aux loups (cas de F-), 18,
154,530.
Homme aux rats (cas de T-), 210,
327,382,491.
Horney, Karen, 463,464.
Husserl, Edmund, 203.
Huxley, Aldous, 106.
Isaac, 337.
Jacob, 337,347.
Jakobson, Roman, 128,166,313,402,
405,406,415,419,489,490.
Janet, Pierre, 75,202,525.
Jaques, Brigitte, 561.
Jaspers, Karl, 141.
Jones, Ernst, 174,257,463,464,595.
Joyce, James, 11, 337, 504, 565-570,
573.
Jung, Cari Gustav, 11, 439, 492, 516,
549.
Jupiter, 139,527.
Kant, Emmanuel, 164,346,389,423,
424,431,472,480,535-537,543.
Kaumiann, Pierre, 209,210,303.
Kepler, Johannes, 422,431.
Klein, Flix, 202,324-326,471.
Klein, Melanie, 52,117,128.
Kojve, Alexandre, 331,453,497.
Koyr, Alexandre, 422,429-431.
Kris, Ernst, 174,330.
Kroeber, Alfred Louis, 256,587.
Kronecker, Leopold, 337.
La Fontaine, Jean de, 545.
Lagache, Daniel, 142,146.
La Houssaye, Amelot de, 519.
Lambert, Johann Heinrich, 423.
Laplanche, Jean, 393.
Lavater, Johann Kaspar, 462.
Leclaire, Serge, 162,393,594.
Leenhardt, Maurice, 152.
Legrand du Saulle, 68.
Leibniz, Gottfried Wilhelm, 204,342,
547.
Le Lionnais, Franois, 85,92.
Lnine, 424.
Lvi-Strauss, Claude, 128, 152, 251,
346,411,412,433,542.
599
INDEX DES NOMS CITS
Levine, Maurice, 130.
Lewin,Kurt, 107.
Luther, Martin, 535.
Lycurgue, 300.
Macalpine, Ida, 213,216,217.
Malinowski, Bronislaw, 26,56.
Mannoni, Maud, 361,370,594.
Mannoni, Octave, 207,209,253.
Marat, 160.
Marguerite d'Angoulme, 196.
Marivaux, 339.
Marr,208.
Marx, Karl, 208, 237, 424, 434, 435,
438,439,494,506,518,555,589.
Maxwell, James Clerk, 423.
Meillet, Antoine, 11.
Merleau-Ponty, Maurice, 175-184,
188,203.
Miller, Jacques-Alain, 503,506,509.
Milner, Jean-Claude, 314.
Mbius, August Ferdinand, 270,418,
469, 470, 471, 473, 474, 476, 482,
483,486.
Mose, 337,429.
Montherlant, Henry de, 542.
Montrelay, Michle, 594.
Moreno, Jacob Levy, 118.
Murray, Henry Alexander, 113.
Napolon, 416,418.
Narcisse, 42.
Nemo, Philippe, 297,299.
Newton, Isaac, 357, 422, 423, 431,
522,536.
Nicomaque, 523.
No,523.
Oppenheimer, Julius Robert, 252.
Oury, Jean, 363.
Ovide, 466.
Papin (cas des surs -), 68.
Parmnide, 514.
Pascal, Biaise, 161,337,364,550.
Paulhan, Jean, 273,389.
Pecci-Blunt, 365.
Penrose, 104.
Perelman, Chaim, 400.
Perrotti, 164.
Piaget,Jean, 127,199.
Piron, Henri, 389.
Piprot d'Alleaumes, 123.
Platon, 329, 345, 405, 481, 525, 527,
547.
Poe, Edgar Allan, 12,13,387.
Poincar, Henri, 494.
Politzer, Georges, 396,397.
Promthe,414.
Proudhon, Pierre Joseph, 60.
Ptolme, 430.
Pulhems, 104.
Queneau, Raymond, 85,331.
Rabelais, Franois, 12,146, 148,152,
453.
Racine, Jean, 545.
Rank, Otto, 274.
Raven, 104.
Rees (brigadier gnral), 102, 104,
106,116.
Reik,Theodor,353.
Renan, Ernest, 537.
Reverchon-Jouve, Blanche, 274.
Richemont, 66.
Rickmann,107,lll.
Rifflet-Lemaire, Anika, 393.
600
INDEX DES NOMS CITS
Rivers, William Halse, 25,26.
Robert, Marthe, 591.
Rodger(Dr),114.
Roubleff, Irne, 304.
Russell, Bertrand, 453,492.
Sade (marquis de), 180,389,480.
Salisbury (marquis de), 117.
Salmon, Thomas W., 104.
Sartre, Jean-Paul, 179,180, 203, 204,
247,345,389,579,589.
Saussure, Ferdinand de, 15,127,128,
166,400,403, 406,410,415,489,
515.
Schreber (cas du prsident ), 157,
213-217, 256, 337, 399, 460, 466,
494,587.
Sellin,Ernst,429.
Srieux, Paul, 66.
Shakespeare, William, 250,288,453.
Shand,25.
Signorelli, Luca, 397.
Socrate, 251,302,405,411,426,436,
437,492,548,558,569,582.
Sophocle, 12.
Spearman, Charles, 104,113.
Spinoza, Baruch, 335,526.
Staline, 208.
Sutherland(Dr),114.
Swedenborg, Emanuel, 480,536.
Swift, Jonathan, 347.
Taine, Hippolyte, 424.
Tarde, Gabriel de, 124.
Thomas d*Aquin (saint), 11,254,311,
473,525,585.
Tirsias,466,468.
Tocqueville, Alexis de, 160,424.
Tosquelles, 298.
Tostain, Ren, 304.
Turquet(Dr),105,lll.
UexkuUJakob von, 18,512,550.
Ulysse, 414.
Verdi, Giuseppe, 569.
Voltaire, 174.
Vygotsky, 199.
Wedekind, Frank, 561,562,563.
Wilson (colonel), 118.
Winnicott, Donald Woods, 275, 368,
379.
Wittgenstein, Ludwig Josef, 160.
Wittkaver(Dr),114.
WolfF, Christian, baron von, 423.
Repres bibliographiques
dans l'ordre chronologique
Les complexes familiaux dans la formation de l'individu
L'dition donne de ce texte en 1984 chez Navarin diteur s'ouvrait sur la
note suivante signe J.-A. M. : Ce texte a t crit par Jacques Lacan pour
le tome VIII de Y Encyclopdie franaise, consacr "la vie mentale" et paru en
1938 ; il occupe dans sa seconde partie, "Circonstances et objets de l'activit
psychique", la section A : "La famille", titre sous lequel il est ordinairement
dsign.J'ai restitu pour cette dition le titre donn par Lacan;j'ai restitu
de mme la continuit du texte, rompue par la mise en page de Y Encyclo-
pdie (intertitres, caractres de corps diffrents). Ce texte n'a pas t inclus
dans les crits l'initiative de l'diteur, en raison de sa longueur.
Le nombre treize et la forme logique de la suspicion
Contribution aux Cahiers d'art, 1945-1946, p.383-393.
La psychiatrie anglaise et la guerre
Paru dans Uvolution psychiatrique, vol. I, 1947, p.293-312 et 313-318, et
dans La Querelle des diagnostics, Navarin diteur, 1986.
Prmisses tout dveloppement possible de la criminologie
Il s'agit du rsum, rdig par J. Lacan, de ses rponses au cours de la discus-
sion de son rapport Introduction thorique aux fonctions de la psychana-
lyse en criminologie , crits, d. du Seuil, 1966, p. 125-150. Ce rsum a t
publi dans le mme numro de la Revue franaise de psychanalyse, t. IV, nl,
janvier-mars 1951,p.84-88.
603
REPRES BIBLIOGRAPHIQUES
Intervention au I
er
Congrs mondial de psychiatrie
Paru en 1952 dans les actes du Congrs de 1950, t.V : Psychothrapie-Psycha-
nalyse/Mdecine psychosomatique, Hermann, coll. Actualits scientifiques et
industrielles , 1172, p.103-107.
Discours de Rome
Rdaction du discours prononc l'occasion de la prsentation du rapport
Fonction et champ de la parole et du langage en psychanalyse {crits,
d. du Seuil, 1966, p.237-322) au I
er
Congres de la Socit franaise de psy-
chanalyse, tenu Rome les 26 et 27 septembre 1953. Paru dans la revue La
Psychanalyse, PUF, vol. 1,1956, p.202-211 et 241-255.
La psychanalyse vraie, et la fausse
Texte rdig pour un congrs tenu Barcelone en septembre 1958; rest
indit en franais jusqu' sa publication dans la revue L'Ane, n 51, juillet-
septembre 1992,p.24-27.
Maurice Merleau-Ponty
Contribution au numro d'hommage publi par Les Temps modernes aprs le
dcs du philosophe, n184/185, octobre 1961,p.245-254.
Acte de fondation
Le texte, d'abord diffus sans titre sous forme ronotype en juin 1964, a t
imprim pour la premire fois dans Y Annuaire 1965 de l'cole freudienne
de Paris, accompagn de la Note adjointe et du Prambule . La note
date de 1971 et le Prambule ont t publis dans Y Annuaire 1977 de l'-
cole freudienne de Paris.
Les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse
Extrait de Y Annuaire 1965 de l'cole pratique des hautes tudes, p. 249-251 ;
publi comme prire d'insrer du Sminaire XL
604
REPRES BIBLIOGRAPHIQUES
Hommage fait Marguerite Duras du ravissement de Loi VStein
Paru dans les Cahiers Renaud-Barrault, n5, dcembre 1965, p.3-10 et 15.
Rponses des tudiants en philosophie
Paru dans les Cahiers pour l'analyse, bulletin du Cercle d'pistmologie de
l'ENS, n3,1966, p.5-13, sous le titre, donn par la rdaction, Rponses
des tudiants en philosophie sur l'objet de la psychanalyse . Une note de
la rdaction prcisait : Les questions ici reproduites ont t adresses au
Dr Lacan par un groupe d'tudiants de la Facult des Lettres de Paris.
Le texte en a t rdig par M. G. Contesse. Nous remercions celui-ci
d'avoir accept que nous le reprenions.
Problmes cruciaux pour la psychanalyse
Annuaire 1966 de l'cole pratique des hautes tudes, p.270-273.
Prsentation des Mmoires d'un nvropathe
Cahiers pour Vanalyse, n5, 1966, p.69-72. Texte rdig pour introduire la
premire traduction franaise du texte du prsident Schreber, paraissant en
feuilleton dans la revue avant d'tre publie dans la collection Champ freu-
dien (traduction de Paul Duquenne), aux d. du Seuil. Paru sous le titre
Prsentation , donn par la rdaction.
Petit discours l'ORTF
Publi dans le premier numro de Recherches, n3/4, p.5-9, avec l'autorisa-
tion de l'ORTF. Le texte tait prcd d'une note de la rdaction : Cet
entretien a t diffus le 2 dcembre 1966 dans le cadre des Matines de
France-Culture, au cours de l'mission de Georges Charbonnier "Sciences
et techniques", l'occasion de la parution des Ecrits de Jacques Lacan, aux
ditions du Seuil. Nous remercions le Dr Lacan ainsi que Georges Char-
bonnier de nous en avoir aimablement autoris la publication dans
Recherches.
605
REPRES BIBLIOGRAPHIQUES
L'objet de la psychanalyse
Annuaire 1967 de l'cole pratique des hautes tudes, p.211-212.
Proposition du 9 octobre 1967 sur le psychanalyste de Vcole
Paru dans SciliceU nl, d. du Seuil, 1968, p.14-30.
Discours V cole freudienne de Paris
Paru dans Scilicet, n2/3, d. du Seuil, 1970, p.9-29.
La mprise du sujet suppos savoir
La psychanalyse. Raison d'un chec
De la psychanalyse dans ses rapports avec la ralit
Parus dans Scilicet, nl, d. du Seuil, 1968, p.31-41, 42-50 et 51-59. Une
note finale de l'auteur apportait les prcisions suivantes :
Ces textes n'ont pas t lus, le nombre et la diversit s'y opposant des assis-
tances (en majorit d'tudiants) dont je fus honor. Ils se distinguent donc
de ce que j'ai effectivement prononc, dont enregistrement reste.
Deux autres rencontres ont eu heu, que je n'avais pas prpares. L'une
le 16, Pise, sige de l'cole normale suprieure d'Italie, que je dois l'ami-
ti de Jean Roudaut;j'y ai procd par une maeutique quoi mes audi-
teurs se sont montrs propices, dialogue enregistr aussi.
Le 18, l'Institut psychanalytique de Milan fut le cadre de l'autre, o je n'ai
pas mnag une audience avertie.
Je remercie son directeur, le professeur Fornari, de me l'avoir fournie nom-
breuse pour un dbat du meilleur ton. Le professeur Musatti y tait prsent.
Les services des Affaires culturelles dont j'tais l'hte sont au-dessus de tout
loge : que MM.Vallet et Dufour, entre tous ceux qui je suis reconnaissant,
en reoivent ici l'hommage.
Allocution sur les psychoses de l'enfant
Paru sous le titre Discours de clture des Journes sur les psychoses de
l'enfant , dans Recherches, numro spcial Enfance aline , dcembre
606
REPRES BIBLIOGRAPHIQUES
1968, II, p.143-152 ; repris dans Enfance aline, UGE, coll. 10/18 , 1972,
puis, sous le mme titre, aux ditions Denol dans la collection L'espace
analytique , en 1984. Le texte transcrit avait t corrig par l'auteur.
Introduction de Scilicet au titre de la revue de l'cole freudienne de Paris
Paru dans Scilicet, nl,d. du Seuil, 1968, p.3-13.
La logique du fantasme
Annuaire 1969 de l'cole pratique des hautes tudes, p.189-194.
Adresse Vcole
Paru sous le titre Adresse du jury d'accueil l'assemble avant son vote (le
25 janvier 1969) dans Scilicet, n2/3, d. du Seuil, 1970, p.49-51.
L'acte psychanalytique
Annuaire 1968-1969 de l'cole pratique des hautes tudes, p.213-220.
Note sur l'enfant
Ce texte, remis Mme Jenny Aubry sous la forme de deux feuilles manus-
crites, a t publi pour la premire fois par cette dernire dans son livre
Enfance abandonne paru aux ditions Scarabe et compagnie en 1983, et
repris dans Omicar?, n37,1986, sous le titre Deux notes sur l'enfant . Un
examen plus attentif a permis de conclure qu'il s'agissait d'un texte d'un
seul tenant.
Prface l'dition des crits en livre de poche
Rdig pour crits I, d. du Seuil, coll. Points Essais , 1970, p.7-12. Paru
galement dans crits II, texte intgral, coll. Points , d. du Seuil, 1999,
p.364-369.
607
REPRES BIBLIOGRAPHIQUES
Prface une thse
Paru sous le titre Prface en tte du livre d'Anika Riffiet-Lemairejaque*
Lacan, Bruxelles, Charles Dessart, 1970, p.9-20. L'ouvrage a t repris sous le
mme titre, chez Pierre Mardaga diteur, Bruxelles, 1977, avec la prface
(p. 5-16).
Allocution sur Venseignement
Paru dans Scilicet, n2/3, d. du Seuil, 1970, p.391-399.
Radiophonie
Paru dans Scilicet, n2/3, d. du Seuil, 1970, p.55-99. Lacan avait accept de
rpondre, pour la radio belge, aux questions de M. Robert Georgin.
Lituraterre
crit pour le numro consacr au thme Littrature et psychanalyse de la
revue Littrature, Larousse, n3, octobre 1971, p.3-10; publi en ouverture
du numro.
Avis au lecteur japonais
Paru en franais dans la Lettre mensuelle, publie par l'cole de la Cause freu-
dienne, n3,1981, p.2-3.
Ltourdit
Paru dans Scilicet, n4, d. du Seuil, 1973, p.5-52.
Note italienne
Ce texte laiss indit par J. Lacan a t publi dans Ornicar?, n25, 1982,
p.7-10, prcd d'une note prcisant que les personnes concernes ne
donnrent pas suite aux suggestions exprimes ici .
608
REPRES BIBLIOGRAPHIQUES
Postface au Sminaire XI
Publi la fin du premier volume paru du Sminaire de Jacques Lacan, livre XI :
Les Quatre Concepts fondamentaux de la psychanalyse, d. du Seuil, 1973.
Tlvision
Ce texte a t publi en volume dans la collection Champ freudien , d.
du Seuil, 1974.
...ou pire
Paru dans Sdlket, n5, d. du Seuil, 1975, p.5-10.
Introduction Vdition allemande d'un premier volume des crits
Paru dans Seilicet, n5, d. du Seuil, 1975, p.11-17 ; le titre original prcisait
entre parenthses le nom de l'diteur : Walter Verlag. L'dition allemande
d'un premier volume des crits est parue en 1973 aux ditions Walter
Verlag, sous le titre Schriften I.
Prface L'veil du printemps
crit pour le spectacle mont par Brigitte Jaques au thtre Rcamier dans
le cadre du Festival d'automne 1974 ; paru dans le programme ; repris en
prface de l'dition de la pice de Wedekind dans une traduction de
Franois Regnault, Gallimard, 1974, p.9-12.
Peut-tre Vincennes...
Constituait l'ouverture du nl d'Ormotr?, bulletin priodique du Champ
freudien , janvier 1975, p.3-5; le texte indiquait sous le titre donn par la
rdaction : Proposition de Lacan .
609
REPRES BIBLIOGRAPHIQUES
Joyce le Symptme
Paru en 1979 dans le recueil Joyce & Paris, 1902... 1920-1940... 1975,
codition, par les d. du CNRS et les Publications de l'Universit Lille-3,
des actes du V
e
Symposium international James Joyce, tenu Paris du 16 au
20 juin 1975, p.13-17. Paru galement dans Joyce avec Lacan chez Navarin
diteur dans la coll. Bibliothque des analytica , 1987, p.31-37.
Prface Vdition en langue anglaise du Sminaire, livre XI
Paru dans Omicar?, n12/13,1977, p.124-126. Udition en langue anglaise
du Sminaire, Livre XI est parue en 1977 sous le titre The four fundamental
concepts of psychoanalysis chez Hogarth Press (The Random House Group
Ltd),puis en 1979 aux ditions Penguin. Sous le mme titre, l'diteur am-
ricain Norton a galement publi ce Sminaire en 1978.
Lettre de dissolution
Cette lettre, adresse sous forme ronotype aux membres de l'cole freu-
dienne de Paris, a t lue au sminaire du 8 janvier 1980; elle a t impri-
me dans l
1
Annuaire 1982 de l'cole de la Cause freudienne.
Table
I
Prologue 7
Lituraterre 11
II
Les complexes familiaux dans la formation de l'individu 23
Le nombre treize et la forme logique de la suspicion 85
La psychiatrie anglaise et la guerre 101
Prmisses tout dveloppement possible de la criminologie 121
Intervention au I
er
Congrs mondial de psychiatrie 127
III
Discours de Rome 133
La psychanalyse vraie, et la fausse 165
Maurice Merleau-Ponty 175
IV
Les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse 187
Hommage fait Marguerite Duras, du ravissement de Loi V. Stein . 191
Problmes cruciaux pour la psychanalyse 199
Rponses des tudiants en philosophie 203
Prsentation des Mmoires d'un nvropathe 213
L'objet de la psychanalyse 219
Petit discours l'ORTF 221
V
Acte de fondation 229
Proposition du 9 octobre 1967 sur le psychanalyste de l ' col e. . . . 243
Discours l'cole freudienne de Paris 261
Introduction de Scilicet au titre de la revue de l'EFP 283
Adresse l'cole 293
Allocution sur l'enseignement 297
Note italienne 307
Peut-tre Vmcennes 313
Lettre de dissolution 317
VI
La logique du fantasme 323
La mprise du sujet suppos savoir 329
La psychanalyse. Raison d'un chec 341
De la psychanalyse dans ses rapports avec la ralit 351
Allocution sur les psychoses de l'enfant 361
Note sur l'enfant 373
L'acte psychanalytique 375
VII
Prface l'dition des crits en livre de poche 387
Prface une thse 393
Radiophonie 403
L'tourdit 449
Avis au lecteur japonais 497
VIII
Postface au Sminaire XI 503
Tlvision 509
... ou pire 547
Introduction l'dition aUemande d'un premier volume des crits . 553
Prface L'Eveil du printemps 561
Joyce le Symptme 565
Prface l'dition anglaise du Sminaire XL 571
Annexes 575
Index des noms cits 597
Repres bibliographiques dans l'ordre chronologique 603
Jacques Lacan
au Champ freudien
L'UVRE CRIT
crits
De la psychose paranoaque dans ses rapports avec la personnalit
suivi de Premiers crits sur la paranoa
Tlvision
LE SMINAIRE DE JACQUES LACAN
texte tabli par Jacques-Alain Miller
Uvre L - Les crits techniques de Freud
Livre IL - Le Moi dans la thorie de Freud
et dans la technique de la psychanalyse
Livre III. - Les Psychoses
Livre IV- La Relation d'objet
Livre V- Les Formations de l'inconscient
Livre VIL - L'thique de la psychanalyse
Livre VIII. - Le Transfert
Livre X. - L'Angoisse
Livre XI. - Les Quatre Concepts fondamentaux de la psychanalyse
Livre XVI. - D'un Autre l'autre
Livre XVIL - L'Envers de la psychanalyse
Livre XX. - Encore
Livre XXIII. - Le Sinthome
PARADOXES DE LACAN
srie prsente par Jacques-Alain Miller
Le Triomphe de la religion
prcd de Discours aux catholiques
Des Noms-du-Pre
Mon enseignement
Le Mythe individuel du nvros
ou Posie et vrit dans la nvrose
RALISATION : PAO DITIONS DU SEUIL
MPRESSION : NORMANDIE ROTO IMPRESSION S.A.S. LONRAI (FRANCI
DPT LGAL : AVRIL 2001. N 48647-4 (07-0898)
Autres
crits
PAS--LIRE.
Dfinition lacanienne de rcrit. Quelque
chose comme Chien mchant, ou Dfense
d'entrer. Voire: Lasciate ogni speranza.
Disons que c'est un dfi, fait pour tenter le dsir.
Lacan rsumait d'une phrase la leon des crits:
l'inconscient relve du logique pur, autrement dit
du signifiant. Les Autres crits enseignent de la
jouissance qu'elle aussi relve du signifiant, mais
son joint avec le vivant; qu'elle se produit de
manipulations non pas gntiques mais langa-
gires, affectant le vivant qui parle, celui que la
langue traumatise.
Il s'ensuit: que la jouissance, cynique comme
telle, ne condescend au dsir que par la voie
de l'amour; qu'elle fait obstacle toute program-
mation du rapport sexuel; que, fminine, elle
rpugne l'universel et s'accorde l'infini; que,
phallique, elle est hors-corps; et autres tho-
rmes jusqu'alors inous dans la psychanalyse.
On n'en trouvera pas le rpondant dans
le gnome, dont le dcryptage pourtant fait
promesse, de noces nouvelles du signifiant
et du vivant. On pressent l'avnement du self-
made-man. Nous l'appellerons: LOM du xxr sicle.
Ce recueil pourrait tre son viatique.
A le dchiffrer, on saura mieux y faire avec les
symptmes inconnus de demain.
Il l l i l l l
Le champ freudien Seuil
www.scuil.com
ISBN 978.2.02.048647.7 / Imprim en France 4.01-4 34
Vous aimerez peut-être aussi
- Misrahi Le Corps Et Lesprit Dans La Philosophie de SpinozaDocument148 pagesMisrahi Le Corps Et Lesprit Dans La Philosophie de Spinozamancol100% (1)
- Buytendijk - L'Homme Et L'animalDocument192 pagesBuytendijk - L'Homme Et L'animalmancolPas encore d'évaluation
- Buytendijk - L'Homme Et L'animalDocument192 pagesBuytendijk - L'Homme Et L'animalmancolPas encore d'évaluation
- Le Mythe Individuel Du NevroseDocument33 pagesLe Mythe Individuel Du Nevrosemancol100% (2)
- Bonaparte - Le Cas de Mme Lefebvre - Revue Francaise de PsychanalyseDocument213 pagesBonaparte - Le Cas de Mme Lefebvre - Revue Francaise de PsychanalysemancolPas encore d'évaluation
- Maine de Biran - Ouvres InéditsDocument604 pagesMaine de Biran - Ouvres InéditsmancolPas encore d'évaluation
- Regnault La Cause Et La Causalité Psychique 8 1Document12 pagesRegnault La Cause Et La Causalité Psychique 8 1mancolPas encore d'évaluation
- Revue Francaise de Psych Analyse No 1Document214 pagesRevue Francaise de Psych Analyse No 1Stefan LunguPas encore d'évaluation
- Cuenot IFBDocument254 pagesCuenot IFBmancolPas encore d'évaluation
- Wittling-Ontogenèse Du Schema Corporel Chez L'hommeDocument25 pagesWittling-Ontogenèse Du Schema Corporel Chez L'hommemancol100% (1)
- Lévi-Strauss Response Á Edmund LeachDocument4 pagesLévi-Strauss Response Á Edmund LeachmancolPas encore d'évaluation