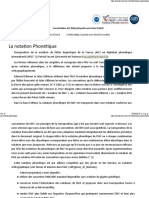Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Jean-Christophe Blum - Le Mépris, Metafilm de Cinefils PDF
Jean-Christophe Blum - Le Mépris, Metafilm de Cinefils PDF
Transféré par
Bruno LaraTitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Jean-Christophe Blum - Le Mépris, Metafilm de Cinefils PDF
Jean-Christophe Blum - Le Mépris, Metafilm de Cinefils PDF
Transféré par
Bruno LaraDroits d'auteur :
Formats disponibles
LE MPRIS, MTAFILM DE CINFILS : JEAN-LUC
GODARD ET LA CONTRAINTE DE LA CITATION
Jean-Christophe Blum, Universit Sorbonne Nouvelle Paris 3
Vous navez rien contre la jeunesse ?
Si ! Moi, jaime bien les vieux.
bout de souffle, Jean-Luc Godard (1959)
Le propre dun moment moderne, et par extension des priodes
charnires o une techn, art ou technique, change de paradigme, cest
datteindre et de porter un point critique une forme aigu de
conscience de soi, de ses effets, et de son inscription dans une
historicit forte. Cest pourquoi lemprunt fait une rcente
monographie du philosophe Marc Cerisuelo1 pour qualifier demble
le clbrissime Mpris de Jean-Luc Godard mrite un bref
claircissement. Dans son livre Hollywood lcran2, Marc Cerisuelo
labore propos notamment du film de Godard la notion de
mtafilm : constituant un genre part entire, il existerait un
corpus de films qui se droulent dans lunivers des plateaux de
production et prennent pour sujet le mtier dartiste 3 de cinma,
mais avec comme point commun lide que les crateurs mis en scne
se trouvent immanquablement confronts la difficult presque
insurmontable dun processus conflictuel par essence ; le genre permet
ainsi souvent aux ralisateurs des mises en abymes virtuoses qui sont
loccasion darts potiques plus ou moins dguiss. uvre ce titre
paradigmatique, Le Mpris, daprs un roman de Moravia 4, est bel
et bien lhistoire de ce monde , pour dtourner le commentaire de
la citation orpheline5 qui clt le gnrique parl du film de Godard :
1
Marc Cerisuelo, Le Mpris, Chatou, ditions de La Transparence,
coll. Cinphilie , 2006.
2
Ibid., p. 18-97 et p. 317-334.
3
Gilles Delavaud, Jean-Pierre Esquenazi, et Marie-Franoise Grange (dir.), Godard
et le mtier dartiste, Paris, LHarmattan, 2003.
4
Alberto Moravia, Il Disprezzo, Milan, Bompiani, 1954.
5
Jean-Luc Godard attribue en ouverture Andr Bazin ( Le cinma, disait Andr
Bazin, substitue notre regard un monde qui saccorde nos dsirs ) une phrase en
fait crite par Michel Mourlet dans son article Sur un art ignor , dans une forme
lgrement diffrente, la page 34 : Puisque le cinma est un regard qui se
Comparatismes -n 1Fvrier 2010
Jean-Christophe Blum
238
en Italie, dans les studios dlabrs de Cinecitt, lcrivain franais
Paul Javal est engag par Jerry Prokosch, un producteur amricain,
pour rcrire le scnario dune adaptation de LOdysse, mise en
scne par un metteur en scne allemand, qui prend les traits et le nom
de Fritz Lang, et lentreprise va trs vite savrer des plus ardues pour
tous les personnages.
Le Mpris serait donc un mtafilm non de cinphile, mais
de cinfils , pour reprendre le mot-valise invent par linfluent
critique Serge Daney. La cinphilie dcrit et identifie ici la gnration
contemporaine du mouvement des cin-clubs et autres cinmathques,
dont la revue des Cahiers du cinma a t le fer de lance et le
principal vivier (de Rohmer Rivette, en passant par Jean Douchet,
Franois Truffaut ou encore Claude Chabrol, et plus tard Bertrand
Tavernier et Pascal Bonitzer). Il sagit dune gnration moderne qui,
contrairement aux classiques pionniers (Chaplin, Griffith, Renoir,
etc.), serait ne avec, par et pour le cinma, et dont la devise aurait pu
tre cette phrase de Truffaut cite par lhistorien Antoine de Baecque,
La vie, ctait lcran 6. Cest donc cette gnration cin-fille, que
Godard, capable en bon rat de cinmathque de voir en une semaine
trois fois un film par bouts de quinze minutes, appartient de plein
droit.
Or, le cinma, malgr son sicle dexistence et sa lourde
hrdit, est encore vu comme un dispositif nouveau, un art jeune, et
une technique moderne par excellence, contemporaine par sa
naissance des grandes avant-gardes modernistes du dbut du
e
XX sicle ; et son ambition peut-tre la plus fondamentale a fait de lui
lincarnation de la machine montrer le monde moderne , pour
reprendre une expression de Jacques Aumont7 (on songe ce que fut
le cinma des premiers temps, celui des frres Lumire, ou encore
celui du projet fou dAlbert Kahn de constituer un atlas visuel anim
qui recenserait lensemble du monde connu avec ses Archives de la
plante) ; et peine plus dun demi-sicle plus tard, en 1963, aprs
tout juste cinq long-mtrages, Jean-Luc Godard merge comme
incarnation du cinma au sens le plus absolu, peru en ce quil a de
plus thorique et de plus rsolument moderne. De fait, nous sommes
en prsence de la convergence rare dun mdium, dun artiste et dun
moment historico-thorique quun film plus que les autres, Le Mpris
(1963), va synthtiser, devenant, la manire des films dAntonioni
en Italie, une manire dtendard des contradictions et des beauts
substitue au ntre pour nous donner un monde accord nos dsirs , ce qui tout
compte fait ne signifie pas exactement la mme chose, Les Cahiers du cinma,
n 98, aot 1959, p. 23-37.
6
Antoine De Baecque et Serge Toubiana, Franois Truffaut [1996], Paris,
Gallimard, rd. augmente, coll. Folio , 2001.
7
Jacques Aumont, Mon trs cher objet , Trafic, n 6, printemps 1993, p. 61-62.
Comparatismes -n 1Fvrier 2010
239
Le Mpris, mtafilm de cinfils :
Jean-Luc Godard et la contrainte de la citation
douloureuses du monde moderne, pris entre un pass crasant et un
futur incertain.
Mais pourquoi une telle cristallisation autour du Mpris ? Il
faut rappeler au pralable que la littrature critique autour du Mpris
est aussi vaste que la renomme du film, phnomne qui saccrot
encore en France du fait que cette uvre a jou un rle sminal, voire
obsessionnel, dans la vocation de nombre des universitaires
prestigieux qui ont fond dans les annes 1970 les tudes
cinmatographiques telles que nous les connaissons (je pense
Jacques Aumont et Michel Marie), fascination qui na cess de
crotre chez leurs disciples (pour ne citer que les thses accomplies par
Marc Cerisuelo ou Nicole Brenez8), ce qui peut sexpliquer par la
fortune critique des crivains-cinastes de la Nouvelle Vague dans
leur berceau intellectuel. Et pourquoi alors une telle fascination pour
ce film plutt quun autre (luvre godardien nest pas avare de chefsduvre, ou de films cultes Passion, Pierrot le fou, bout de
souffle) ? Dabord parce quil est sans doute un des premiers films
destins au grand public stre prsent et avoir t ressenti ds sa
sortie comme un acte thorique ; ensuite, parce quil est avec le
Citizen Kane de Welles (1940), le Sueurs froides dHitchcock
(Vertigo, 1958), un des grands films de la modernit au cinma (nous
reviendrons sur les cas des Italiens Rossellini et Antonioni) dans la
seconde moiti du XXe sicle.
Quelle est donc la modernit qui est reprsente dans et par Le
Mpris au dbut des annes 1960 ? Cest une modernit mlancolique
et paradoxale. Ainsi que la bande-annonce promotionnelle le clame
haut et fort, il sagit du nouveau film traditionnel de Jean-Luc
Godard . Laffirmation a, il est vrai, de quoi choquer par loxymore
quelle brandit en tendard ; elle se comprend cependant plus aisment
si on la replace dans le contexte de lpoque, o Godard est surtout
connu pour son ct provocateur et anti-conventionnel (il serait mme,
sous la plume du critique Michel Ciment de la revue Positif, grande
rivale des Cahiers, le plus moderne de nos modernes 9, et ses films
qui, une fois pass le succs de nouveaut du manifeste bout de
souffle, ont surtout drout le public.
Le film sera donc traditionnel , cest--dire comme les films
les plus courants : laffiche se veut dailleurs rassurante, avec son
budget consquent et sa vedette plantaire Brigitte Bardot. De fait,
8
Nicole Brenez, Autour du Mpris : deux problmes cinmatographiques rapports
linvention figurative et solutions filmiques [thse de doctorat], Lille, ANRT,
1989 ; Marc Cerisuelo, LInstauration du cinma : potique des films et
interprtation (lexemple des mtafilms hollywoodiens) [thse de doctorat], Paris 3,
1998.
9
Michel Ciment, Mon nom est personne (histoire, thorie,...) , Positif, n 544,
juin 2006, p. 2.
Comparatismes -n 1Fvrier 2010
Jean-Christophe Blum
240
pour ceux qui lont vu, le qualificatif qui revient le plus souvent, et
presque instinctivement, est de dire quil sagit l du film peut-tre le
plus classique de son auteur. Classique dans la forme (mais dans une
certaine mesure seulement), en renonant aux ellipses et autres faux
raccords caractristiques du style volontairement improvis qui fait
aux yeux du public la marque de la Nouvelle Vague ; classique dans la
trame (une histoire damour tumultueuse qui finit mal) ; classique
dans le dcor (lItalie romaine, et la cte napolitaine, pleine de ruines
et de lumire). Bref, en soi, rien pour choquer le bourgeois. Mais nous
pourrions faire lhypothse quil y a sans doute plus quun simple
message publicitaire rassurant dans cette formule du nouveau film
traditionnel . Pourquoi ne sagirait-il pas, expos aux yeux de tous,
dissimul derrire une formule anodine, dun vritable principe
directeur du film, et disons-le pour aller vite, de la dfinition de la
modernit selon Godard, la fois nouvelle et traditionnelle,
paradoxale et mlancolique, limage dun metteur en scne qui
prend les traits dun Janus bifrons, la fois vieux sage et enfant
terrible, regardant en mme temps le prsent et le pass ? Comment ne
pas penser, par exemple, dix ans plus tt, au carton mis en exergue
dun autre chef-duvre, japonais cette fois-ci, de Kenji Mizoguchi,
idole de la rdaction des Cahiers (Jean-Luc Godard est-mme
photographi en 1958 recueilli sur sa tombe en train dy brler un
btonnet dencens) ? Cest le gnrique des Contes de la lune vague
aprs la pluie (Ugetsu Monogatari, 1953), qui avertit le spectateur en
ces termes : De lgendes vivant encore dans toutes les mmoires est
tir ce film, tourn dans un style nouveau .
Bref, Le Mpris serait cette chimre, ce que Marc Cerisuelo
dsigne comme la possibilit dun classicisme moderne 10, moins
que ce ne soit linverse Et comment ds lors tenir la vritable
gageure dtre la fois nouveau et traditionnel ? Voil un problme
quil convient darticuler en deux temps, en montrant dabord
combien le projet de Godard est tributaire, ds les premires tapes de
sa gense, dun contexte obsd par la notion de modernit (et
comment Jean-Luc Godard tente demble de la subvertir), puis dans
un second temps comment les choix du cinaste aboutissent ce que
lon pourrait appeler la contrainte de la citation, travers la
radicalisation dune posture prsente ds les premiers films du
cinaste, et qui dessine la possibilit dun cinma encore venir, si
lon pense aux futures Histoire(s) du cinma, son projet vido
dmesur des annes 1990.
ce titre, le projet du Mpris semblait donc immdiatement
un projet singulier, puisquil sagit dun objet dj en soi intertextuel
et en quelque sorte, intermdial, savoir ladaptation dun roman
10
Marc Cerisuelo, Le Mpris, op. cit., p. 24.
Comparatismes -n 1Fvrier 2010
241
Le Mpris, mtafilm de cinfils :
Jean-Luc Godard et la contrainte de la citation
succs de lauteur italien Alberto Moravia, publi en 1954, et dont
Godard, grand lecteur, aurait pris connaissance ds 1955. Il nest pas
de mon propos de faire ltude de ce qui a t modifi par Godard11 ;
toutefois, il est intressant de noter que si le cinaste jette un regard
bien condescendant sur le livre, cela ne lempche pas de formuler
dj trs clairement ce qui motive un tel choix, en croire la note
dintention publie dans les Cahiers du cinma ds 1963 :
Le Mpris, cest aussi lhistoire dun malentendu entre
un homme et une femme. Je crois que le malentendu est un
phnomne moderne []. Le roman de Moravia est un vulgaire
et joli roman de gare, plein de sentiments classiques et dsuets,
en dpit de la modernit des situations. Mais cest avec ce genre
de roman que lon tourne souvent de beaux films12.
Il faut videmment souligner la dualit du projet, et ses enjeux,
noncs tels quels par le cinaste, la runion de couples violemment
antithtiques, linstar de lalliance vulgaire et joli , et au-del, de
celui qui unit le classique et la modernit . Par ailleurs, aussi
mprisant puisse-t-il paratre, le propos nest peut-tre pas si diffrent,
dans le fond, de ce que dit Alfred Hitchcock dans son livre
dentretiens avec Truffaut (dont llaboration est contemporaine du
film), qui prtend que les chefs-duvre littraires font rarement de
grands films, et que des uvres plus mdiocres laissent parfois plus de
marge dinventivit au cinaste lors du processus dadaptation13.
11
Pour plus de prcisions, je renvoie au chapitre que Michel Marie consacre ce
point dans sa synthse Le Mpris. Jean-Luc Godard : tude critique, Paris, Nathan,
1990.
12
Entretien de Godard avec Yvonne Baby paru dans Le Monde du
15 dcembre 1963, cit par Alain Bergala dans Godard au travail : les annes 1960,
Paris, ditions des Cahiers du cinma, 2006, p. 146. Cest moi qui souligne.
13
Truffaut remarque en effet chez Hitchcock une rpugnance adapter les chefsduvre de la littrature. Il y a un trs grand nombre dadaptations dans [son] uvre,
mais il sagit le plus souvent dune littrature strictement rcrative, de romans
populaires [remanis] jusqu ce que cela devienne des films dHitchcock .
Hitchcock rebondit en ces termes : Quand lide de base me convient, je ladopte,
joublie compltement le livre et je fabrique du cinma. [] Ce que je ne
comprends pas, cest que lon sempare rellement dune uvre, dun bon roman
que lauteur a mis trois ou quatre ans crire et qui est toute sa vie. On tripote cela,
on sentoure dartisans et de techniciens de qualit [] alors que lauteur se dissout
dans larrire-plan. On ne pense plus lui , avant de conclure que pour cette raison,
par respect et commodit, il nadapterait jamais Crime et Chtiment, de la mme
manire quil choisira plutt chez John Buchan Les Trente-neuf Marches, un
roman moins important que son grand livre Le Manteau vert, voir Franois
Truffaut, Hitchcock/Truffaut, Paris, Gallimard, 1983, p. 56-57 et p. 76. ce titre, il
est en outre plus que frappant de voir les deux cinastes reprendre le mme exemple
que Godard face Jean Collet ds 1963 : Par exemple, le cinaste qui voudrait ne
faire que des adaptations. Mettons celui qui voudrait consacrer sa vie mettre
lcran Balzac, ou Stendhal, ou Dostoevski peut tre assur quil ne fera peu prs
Comparatismes -n 1Fvrier 2010
Jean-Christophe Blum
242
Mais Alain Bergala fait remarquer quel point le choix du
roman de Moravia a t dict par lide mme de moderne 14. Les
documents de travail publis dans Les Cahiers du cinma lors de la
sortie du film creusent toujours le mme sillon ; ainsi, dans une note
de production, Godard crit ses acteurs pour les aider trouver leurs
personnages : Quand jy rflchis bien, [] Le Mpris mapparat
comme lhistoire de naufrags de la modernit [] 15 ; ou encore :
On pourrait dire aussi, pour tenter dexpliquer Paul, que cest un
personnage de Marienbad qui veut jouer le rle dun personnage de
Rio Bravo 16.
Aprs la confrontation au modernisme agressif de Resnais17 et
du classicisme des studios hollywoodiens et de leur cinma de genre
plus largement accept par le public, en dehors de toute proccupation
auteuriste, Godard persiste dans lexploration des attelages
improbables qui travaillent les esprits de lpoque. Ainsi, avec
toujours le got de la provocation potache qui le caractrise, le
cinaste conclut la note dintention du Mpris par ces mots, non sans
duret : En somme, ce quil sagit de faire cest de russir un film
dAntonioni, cest--dire de le tourner comme un film de Hawks ou
dHitchcock 18.
Cest quen hitchcocko-hawksien de stricte obdience,
Godard gote assez peu la modernit selon Antonioni (la fameuse
incommunicabilit, le refus de la trame narrative et des conventions
communes du rcit, un certain got de la contemplation du monde, et
autres poncifs), peut-tre trop dpourvue de la tension et de la
scheresse propres aux styles des Amricains cits. En effet, pour les
critiques-cinastes issus de lquipe des Cahiers du cinma, lide
mme de la modernit cinmatographique ne fait pas consensus. Pour
reprendre le bilan propos par Jacques Aumont dans son dernier
ouvrage intitul Moderne ? (et sous-titr Comment le cinma est
devenu le plus singulier des arts)19, trois points de vue seraient
possibles : le premier, incarn par Maurice Schrer, alias ric
rien , Jean-Luc Godard, Paris, ditions Seghers, coll. Cinma daujourdhui ,
1963, p. 98.
14
Le mot moderne est celui qui revient le plus dans les dclarations du cinaste
propos du roman de Moravia , Alain Bergala, Godard au travail, op. cit., p. 146.
15
Godard, Les Cahiers du cinma, n 146, aot 1963, p. 31.
16
Godard, Scnario du Mpris. Ouverture , dans Alain Bergala (dir.), Jean-Luc
Godard par Jean-Luc Godard, Paris, ditions de ltoile-Cahiers du cinma, 1985,
p. 243.
17
On peut effectivement constater en lisant les Cahiers du cinma des annes 1959
1961 combien Hiroshima mon amour et LAnne dernire Marienbad ont
boulevers et stimul les rdacteurs de la Nouvelle Vague, qui consacrent ces deux
films plusieurs dossiers spciaux.
18
Marc Cerisuelo, Le Mpris, op. cit., p. 19.
19
Jacques Aumont, Moderne ? Comment le cinma est devenu le plus singulier des
arts, Paris, ditions des Cahiers du cinma, 2007.
Comparatismes -n 1Fvrier 2010
243
Le Mpris, mtafilm de cinfils :
Jean-Luc Godard et la contrainte de la citation
Rohmer, pour qui le cinma est un art trop jeune pour avoir seulement
dj pu atteindre son ge et sa forme classique, et ds lors, il serait
prmatur de songer mme lide de modernit20 ; le deuxime par
la figure dAndr Bazin, lan et matre penser, fervent dfenseur de
Renoir et surtout de Welles, qui dfend lide que le cinma connat
alors une priode charnire, o commencerait se faire jour lide de
modernit, fonde notamment sur la technique du plan-squence21 ;
enfin, en suivant les positions de Jacques Rivette, on peut penser que
la modernit a bel et bien clat : on la trouve en Italie et elle a pour
nom Roberto Rossellini, avec un art fond sur des valeurs et des
techniques (notamment le recours la forme documentaire) totalement
nouvelles22.
Dans cette typologie o Antonioni fait figure de parent pauvre,
o les positions paraissent plus arbitrairement tranches quelles ne le
sont rellement, du fait du manque de recul historique et dun got
certain pour la polmique qui anime le dbat critique en France, JeanLuc Godard parat se situer quelque part entre la deuxime et la
troisime faction, mme sil semble dj apte incarner lui seul une
des voies possibles de la modernit. Welles (la modernit virtuose et
manifeste, consciente de son histoire passe et de son projet prsent,
qui est exprimental et rflexif) et Rossellini (la modernit plus
discrte, moins ostentatoire, moins vidente en un sens, simplement
rfugie dans le contemporain) sont ainsi deux de ses points de
rfrences majeurs et constants au cours de sa carrire, et ds le dbut
de celle-ci.
Ces deux figures rvres sont prsentes en contrepoint plus ou
moins discret tout au long du Mpris, que ce soit par un dessin dune
salle dopra recadre ostensiblement au-dessus de lpaule du
scnariste (allusion crypte un plan de Citizen Kane o Kane fait
construire un thtre pour la pitre cantatrice Suzan, sa deuxime
femme) ou par une affiche dans une salle de cinma romaine, dont on
ne voit quun coin laissant pourtant lire Viaggio, premier mot du titre
dun film fameux de Roberto Rossellini. Mais, une fois de plus, on ne
se trouve pas ici devant une simple concidence heureuse : Voyage en
Italie constitue une autre clbre histoire de couple mal assorti
(George Sanders et Ingrid Bergman, alors pouse de Rossellini),
correspondant une autre relation tourmente entre un cinaste et sa
muse transpose lcran (la perruque noire de Bardot renvoyant
explicitement Anna Karina, la premire femme de Jean-Luc
Godard). Le faisceau gagne encore en puissance quand on constate
quavec Viaggio in Italia, Godard est confront une source ou un
modle dont Le Mpris construit une sorte de remake peine
20
Ibid., p. 38-39.
Ibid., p. 42-47.
22
Ibid., p. 48-55.
21
Comparatismes -n 1Fvrier 2010
Jean-Christophe Blum
244
masqu23, ce que souligne nettement le dmarrage dun travelling
plutt ostentatoire, travelling qui comme le soulignait Rivette dans la
critique de Kapo (Gillo Pontecorvo) en 1962 est affaire de
morale 24. Le mouvement de la camra en effet, plongeant vers
lavant et fondant littralement sur les personnages, les isole peu peu
dans lombre au premier plan et rvle du mme coup, sur larrireplan clair dans lentre du cinma, le titre de laffiche (Viaggio in
Italia), qui tait demeur moiti cach jusque-l. Laffiche soudain
rvle fonctionne alors, par effet de citation et via lintertexte quelle
convoque, comme une explicitation lumineuse et en rseau de la
psychologie des personnages, comme une glose complice du cinaste
lintention du spectateur diligent et comme un programme que se
fixe ambitieusement lartiste.
On constate cependant que la modernit du projet godardien,
bien que rfrentielle et (se) rclamant donc (d)un hritage, est
constamment affiche dans son irrductible singularit, parce quelle
se donne aussi voir dans sa nature radicalement composite et
paradoxale. Or, au milieu de ce programme rsolument moderne par
ses mises en abyme rptes de manire quasi-fractale, le cinaste
donne un tour dcrou supplmentaire. Ses personnages modernes
sont des naufrags ; de mme, si on est en Italie, cest de la Grce
quil est sans cesse question. En film aristotlicien 25, Le Mpris
23
Dans son livre consacr la gense dtaille des premiers films de Godard, Alain
Bergala dveloppe les points de contacts nombreux entre les deux films, depuis
lide du couple de naufrags jusqu limportance du dcor italien : Lide du
dcor comme troisime terme, aussi important que les personnages, vient plus du
film de Rossellini que du roman de Moravia. La traverse de la ville morte de
Cinecitt rime avec celle de Pompi. Les plans sur les statues antiques [] dans le
film suppos de Fritz Lang avec lHercule du Muse de Naples chez Rossellini ,
Alain Bergala, Godard au travail, op. cit., p. 146.
24
Autre chose : on a beaucoup cit, gauche et droite, et le plus souvent assez
sottement, une phrase de Moulet : la morale est affaire de travellings (ou la
version de Godard : les travellings sont affaire de morale) ; on a voulu y voir le
comble du formalisme alors quon en pourrait plutt critiquer lexcs terroriste,
pour reprendre la terminologie paulhanienne. [] [L]homme qui dcide [] de
faire un travelling-avant pour recadrer le cadavre [dune dporte] en contre-plonge
[] na droit quau plus profond mpris. On nous les casse depuis quelques mois
avec les faux problmes de la forme et du fond [] ; ce qui compte, cest le ton, ou
laccent, la nuance comme on voudra lappeler cest--dire le point de vue dun
homme, lauteur, mal ncessaire, et lattitude que prend cet homme par rapport ce
quil filme, et donc par rapport au monde et toutes choses [] , Jacques Rivette,
De labjection , Les Cahiers du cinma, n 120, juin 1961, p. 54. Comment ds
lors ne pas mettre ces propos en rapport avec la note dintention de Godard : Alors
que lodysse dUlysse tait un phnomne physique, jai tourn une odysse
morale : le regard de la camra sur des personnages la recherche dHomre
remplaant celui des dieux sur Ulysse et ses compagnons , Les Cahiers du cinma,
n 146, aot 1963, p. 31. Cest moi qui souligne.
25
Ibid..
Comparatismes -n 1Fvrier 2010
245
Le Mpris, mtafilm de cinfils :
Jean-Luc Godard et la contrainte de la citation
dploie plus quun simple drame amoureux (lhrone se tuant dans un
accident de voiture la fin du film) ; plus quun mtafilm , cest
une tragdie archaque dans les rgles de lart (comment retrouver
Homre), o interviennent les dieux, les mythes et la fatalit. Et si
fatalit il y a, cest quelle met la modernit sous le signe de la
mlancolie, de la nostalgie dun impossible retour au classique (ou du
moins dun hritage bien lourd porter), et de la rfrence oblige, de la
citation vcue certes comme un hommage aux matres, mais aussi
comme une contrainte, et comme un regret de navoir pas (ou de
navoir plus ?) mieux dire. Cest la tragdie du cin-fils confront
ses cin-pairs/pres.
la volont des modernes, Godard ajoute deux lments
supplmentaires et comme il se doit contradictoires. Il sagit dabord
de la nostalgie de limpossible retour au cinma classique, incarne
entre autres par les nombreuses statues qui jalonnent le film, et par la
remarque de Paul pour qui [i]l faut revenir au cinma de Griffith et
de Chaplin, lpoque des Artistes Associs que linterprte
Francesca traduit par un euphmisme : He wants to make different
pictures. Ce dsir de revenir lenfance dun art magnifi par une
histoire du cinma entirement glorieuse (la geste poignante de
lUnited Artists, lanecdote largement apocryphe rappele dans le
film par Paul, soucieux de contrer larrogance de Jerry du dpart
immdiat de Lang pour Hollywood lorsque Goebbels lui propose de
diriger le cinma allemand) fait rtrospectivement apparatre cette
enfance de lart comme un mythe 26. Dautre part, ce qui ressort
ensuite de cette tragdie, cest lidentit profondment romantique, au
sens strict, du monde moderne tel que le peroit Jean-Luc Godard.
Fritz Lang attribue dailleurs volontiers ce qualificatif au chef de fil de
la Nouvelle Vague dans lpisode de la collection documentaire
tlvisuelle Cinastes de notre temps , intitul Le Dinosaure et le
Bb. Jean-Luc Godard va jusqu radicaliser le motif potique du
drame dtre n trop tard dans un monde trop vieux en en faisant la
tragdie de lartiste n trop tard dans un monde dcidment dcadent,
en ces termes dsesprs qui forment laphorisme godardien, formul
ultrieurement : On croyait quon venait aprs alors que tout tait
fini 27.
Le tragique du film repose en ceci : toute filiation parat alors
impossible, alors mme que les cinastes de la modernit ne peuvent
plus trouver dhistoires ou dimages nouvelles, et que la prsence du
divin, la grce, ont quitt le monde de lhomme, comme le rappelle le
personnage de Lang lors de la projection des rushes de son Odysse.
26
Michel Marie, Un monde qui saccorde nos dsirs , dans Philippe Dubois
(dir.), La Revue belge du cinma, n 16, t 1986, p. 24-36.
27
Cit par Marc Crisuelo, Le Mpris, op. cit., p. 14.
Comparatismes -n 1Fvrier 2010
Jean-Christophe Blum
246
Ce moment de la projection est crucial, au sens o tous les
enjeux du film-cadre viennent sy croiser, sy prcipiter. Il sy dit
beaucoup de choses, sur la posie, sur la volont de pouvoir, sur le
mtier de cinaste mais lessentiel (la flure ou le bouleversement
induits par lexprience spectatorielle que viennent de subir les
personnages et qui va installer entre les deux amants les germes du
mpris) semble chapper au discours, et va se matrialiser
digtiquement en sortant du cinma , pour reprendre le titre de
Roland Barthes28. Avant le dpart des personnages pour le tournage en
extrieurs de LOdysse sur lle de Capri, les enjeux du Mpris se
concrtisent justement deux reprises la sortie du cinma, sance
diurne dans une salle de projection des studios de Cinecitt pour le
premier cas, sance nocturne dauditions dactrices en ville dans le
second. chaque fois, un affrontement se joue et des lignes de
fractures nettes sinstallent, rparties selon des couples antagonistes
combins lenvi avec de multiples croisements internes (suivant un
schma de type AA/BB), quil sagisse de lhomme et la femme, de
lartiste et du producteur, du Nouveau monde et de lancien, des
jeunes et des vieux, etc. Au centre de ces confrontations, installant
sans retour possible un avant et un aprs, on trouve irrmdiablement
limpact dun spectacle, avec dune part la force brute dun work in
progress (les rushes lgiaques de lpope filme par Lang) et de
lautre le trouble dun simulacre qui instaure un thtre dombre
(laudition en play back)29. Les deux scnes se rsolvent enfin par le
recours au mme artifice visuel, cest--dire la prsence daffiches
dans le dcor, qui signent la citation ou lemprunt.
Sans revenir outre mesure sur le cas de laffiche de Voyage en
Italie lors de la sance nocturne Rome, il convient de sattarder sur
lespace plus complexe mis en place au dbut du film, dans la scne
diurne Cinecitt. On le constate demble, ce moment plus quaucun
autre (dans un film qui nen manque pourtant pas de semblables) est
satur par le travail de la rfrence, sous toutes ses formes. Si dans la
28
Roland Barthes, En sortant du cinma , Communications, Paris, n 23, 1975 ;
repris dans Essais critiques IV. Le Bruissement de la langue, Paris, Le Seuil, 1984,
p. 383-387.
29
Ce second dispositif sera repris quasi tel quel par lamricain David Lynch prs de
quarante ans plus tard en 2001 dans cette autre jalon du mtafilm quest
Mulholland Dr., ddoubl en ouverture du film (la scne de jitterburg avec les
ombres portes des corps dansants aux couleurs criardes) et en son centre (laudition
de la Camilla Rhodes phantasme, en habits des annes 1960 et playback de
chansons damour pop de lpoque, Sixteen Reasons 1960 et Ive Told every
Little Star 1961). La scne de laudition chez Lynch parat mme unir les deux
dispositifs prsents chez Godard, savoir lcran de projection et la scne de
spectacle, puisque comme Cinecitt, la prsence de la camra est souligne de
manire agressive laide ici dun lent travelling-arrire, et que le principe de la
chanson en postsynchronisation est repris, jusque dans son cadrage frontal et le
sentiment dtranget quelle procure, au dcoupage du Mpris.
Comparatismes -n 1Fvrier 2010
247
Le Mpris, mtafilm de cinfils :
Jean-Luc Godard et la contrainte de la citation
salle de projection le pome dHlderlin que rcite Lang saccorde
avec un certain bonheur la citation attribue Louis Lumire et
ironiquement mise en exergue sous lcran de projection (Il cinema
un invenzione senza avvenire), il en va autrement ds que lon sort :
en effet, dans ce second espace o le drame va se nouer aprs le
mystre de la projection, cest cette fois la combinaison dune srie
daffiches, de personnes et de titres mentionns dans le dialogue qui
viennent dmentir ce que lespace de la salle laissait prsager. Le
metteur en scne sort de lespace obscur de visionnage pour entrer
dans la lumire, accompagn par la musique du film-cadre dont il est
le personnage. On a pu dire ce propos, avec Michel Marie, que Lang
devenait en cet instant prcis la politique des auteurs incarne, ce que
Maxime Scheinfegel reformule en ces termes : Demble Fritz Lang
apporte au film une mmoire dj constitue du cinma []. Limage
lui confre la mission dincarner la figure godardienne de la mmoire
du cinma classique , faisant du cinaste allemand, pilier la fois du
cinma muet europen et du systme hollywoodien du parlant, tous
deux leur apoge, un lieu commun de la mmoire du cinma 30.
Les dialogues sur ce point donnent de prcieuses indications, et
tmoignent dune conception plus subtile quil y parat au premier
abord. Ainsi, Paul prsente Lang Camille sous son visage
amricain : Tu sais, cest lui qui a fait le western avec Marlne
Dietrich quon a vu vendredi soir 31, quoi le cinaste rpond
aussitt Jaime mieux M . Lajout de Camille ( Le Maudit ? On la
vu lautre jour la tlvision32. Moi, jai beaucoup aim. ) ne sert pas
uniquement toffer le dialogue : il montre malicieusement que la
dactylo de vingt-sept ans est plus cultive quelle nen a lair, et plus
encore quelle a bon got ( Moi, jai beaucoup aim ),
contrairement son mari qui galvaude son talent de dramaturge dans
de mdiocres pplums ou polars, et semble prfrer la priode
hollywoodienne du matre, sans doute par tropisme amricain (quon
se rappelle le feutre port en toutes circonstances, pour faire comme
Dean Martin dans Some Came Running 33. Mais Paul nabdique pas
puisque, pendant que sa femme observe aux murs les affiches qui les
entourent, il en profite pour affirmer en apart au cinaste sa
30
Maxime Scheinfeigel, Le dmiurge cinaste : Lang par Godard , dans Nicole
Brenez (dir.), Admiranda, Cahiers danalyse du film et de limage, n 5, Figuration
dfiguration : propositions, 1990, p. 71. Cest moi qui souligne.
31
Il sagit bien videmment de LAnge des maudits (Rancho Notorious, RKO,
1952), le dernier des trois westerns tourns par Lang en Amrique.
32
On trouve ici une des premires apparitions dune vieille rengaine godardienne
(dans les films comme dans les entretiens), qui oppose la tlvision au cinma, la
premire mprisant ncessairement le second, puisquelle force le tlspectateur
baisser les yeux sur les films l o le cinma impose son spectateur recroquevill
dans un fauteuil inclin dlever physiquement le regard vers lcran.
33
Comme un torrent, Vincente Minnelli, MGM, 1958.
Comparatismes -n 1Fvrier 2010
Jean-Christophe Blum
248
prfrence personnelle : Dans Rancho Notorious, quand Mel Ferrer
appuie sur la bascule, cest merveilleux . Cet hommage clair mais
discret permet peut-tre au personnage de Paul, que Piccoli a jou
explicitement comme un alter ego de Jean-Luc Godard, de rparer une
injustice des critiques franais lgard de Lang sur ce film prcis :
Jacques Lourcelles mentionne en effet dans son dictionnaire combien
LAnge des maudits passa compltement inaperu sa sortie 34.
Ce bref dialogue en partie recouvert par le moteur de lAlpha
Romo rouge du producteur prend dautant plus de poids quil se
droule pour ainsi dire sous les yeux de quatre affiches de cinma qui
tapissent les murs extrieurs des studios. Il sagit de Hatari de Howard
Hawks (1962), Vivre sa vie, sous son titre italien Questa la mia vita
de Jean-Luc Godard (1962), Vanina Vanini de Roberto Rossellini
(1961), et Psycho dAlfred Hitchcock (1960) : le corpus na rien de
surprenant si on le considre comme un manifeste visuel de la
politique des auteurs et de la Nouvelle Vague, qui prend la forme de
traces dj en train de disparatre, tant les affiches sont abmes par les
lments, et donnent la scne un indniable aspect de collage. Ce
sont l autant dlments, que Godard met en place prcocement dans
son uvre, pour certains ds bout de souffle, et qui se trouvent ici
pour la premire fois sous un aspect vritablement systmatis. Cette
approche aboutira par la suite, comme en une rplique, la forme
grotesque et inspire de Pierrot le fou, puis aux collages dstructurs
du Godard tardif, qui mettent en place une forte dialectique entre
lcrit et limage (dialectique laquelle sajoutera de manire plus
affirme llment sonore, dans la priode vido). Comme le
constatent Lang et Javal, lhomme du plateau et lhomme du script,
lhomme de limage et lhomme de lcrit, chacun plaidant pour sa
chapelle, ce nest pas la mme chose quand cest film que quand
cest crit 35.
Les personnages godardiens sont pris dans une double
contrainte de limage : limage cinmatographique doit faire du
nouveau en citant danciennes images dont elle est bon gr mal gr
lhritire (par exemple, les statues antiques filmes par Lang dans les
rushes de LOdysse) ; elle est aussi tenue par le texte qui lui donne
34
Mme Les Cahiers du cinma, pourtant attentifs la carrire amricaine de
Lang, ne lui consacrrent pas la moindre critique. , voir Jacques Lourcelles,
Dictionnaire du cinma. Les films, Paris, Robert Laffont, coll. Bouquins , 1992,
p. 54.
35
Naturally, because in the script, it is written; and on the screen, it is pictures.
Motion pictures, its called, fait remarquer Lang au producteur Jerry, furieux de ne
pas reconnatre lcran le scnario quil a lu (Its in the script, but its not what
you have on that screen!). pousant le point de vue du spectateur, Paul rsume
depuis le hors-champ de limage le dbat en traduisant : Ah ! Il dit que ce nest pas
la mme chose quand cest film que quand cest crit . On reconnat bien l, dans
sa fausse navet, la force du laconisme godardien.
Comparatismes -n 1Fvrier 2010
249
Le Mpris, mtafilm de cinfils :
Jean-Luc Godard et la contrainte de la citation
naissance36 sans pouvoir citer lcrit directement, sauf recourir des
artifices (la rcitation intgre au dialogue, des inscriptions dans le
dcor, etc.) toujours ressentis comme tels par le spectateur courant. En
effet, toute la difficult est l : le texte de (ou du) cinma est en soi
pratiquement incitable 37 ou introuvable comme dirait
Raymond Bellour, puisque le droulement de la pellicule et le
dispositif de la projection nous contraignent passer par llaboration
dune description forcment faite de mmoire partir dun certain
moment. Jacques Aumont, dans un article rest clbre renchrit, en
donnant un tour dcrou supplmentaire, soit une nouvelle contrainte
prendre en compte : Le film nest pas citable par le langage, mais il
faut aller plus loin, et dire que, pour pouvoir engrener sur le film,
cest le langage qui doit dune faon ou dune autre arriver, se faire
filmique, se mettre sur le mme plan que le film 38. Il y a l une
tragdie inhrente la nature du cinma, et qui ne saurait se rsoudre
que par le recours, comme Godard, un langage mis sur le mme plan
que le film, devenu filmique, en un mot, un film lui-mme,
entreprise dont Le Mpris, la fois adaptation littraire et
mtafilm , serait sans conteste une des illustrations possibles. De
fait, la pratique de la citation y apparat comme un passage oblig, et
un dfi impossible relever, mais sans cesse renouvel, ce qui achve
de nouer la tragdie. Tout est dj fini ; on ne peut que rpter ce qui a
dj t fait, mais sans jamais pouvoir revenir au classicisme, ni y
ajouter des lments (comme le producteur Jerry qui veut, plein de
fatuit, faire crire de nouvelles scnes pour LOdysse , ce en quoi
il retrouve de manire inattendue lantique art des rhapsodes).
la question de Jean Collet (auteur de la premire
monographie jamais consacre Jean-Luc Godard) qui demande en
1963 au cinaste, juste aprs la sortie de son film, si Le Mpris na pas
t pour le jeune cinaste quil est encore loccasion de faire le point
sur la question des influences, rfrences et citations qui sont sa
marque de fabrique, Godard rpond comme son habitude avec une
grande circonspection, et un rien de goguenardise :
Je crois que cest pareil pour tout le monde : les
influences sont fragmentaires et momentanes. On nest pas
influenc par Orson Welles, mais par un plan spcial dOrson
36
La question est si pressante pour un cinaste quen 1984, Godard filme a
posteriori un appendice autonome son uvre Passion (qui voque les affres dun
metteur en scne de cinma qui cherche reproduire lcran les uvres les plus
clbres de la grande peinture dHistoire), intitul Scnario du film Passion. Il y
pose la question de la prminence (ou prexistence) de limage sur le texte pour un
artiste qui concevrait son travail avec une approche strictement visuelle.
37
Raymond Bellour, Le texte introuvable , LAnalyse du film, Paris, ditions
Albatros, coll. A Cinma , 1979, p. 35-41.
38
Jacques Aumont, Mon trs cher objet , art. cit., p. 68.
Comparatismes -n 1Fvrier 2010
Jean-Christophe Blum
250
Welles quon a envie de refaire. Et personne nest influenc par
Eisenstein, personne na jamais fait de films comme lui. Je crois
que cest un faux problme, absolument faux. Quand on vous
demande quels sont les gens qui vous ont influenc, il ny a
personne. Si, peut-tre mon pre, sans que je le sache. Cest
aussi vrai pour les peintres. On peut trouver des tableaux de
Van Gogh qui ressemblent aux impressionnistes. Mais ils
taient dix mille peindre de cette manire. Et je pense quil
ny a aucune influence. On reprend des choses prcises, des
effets prcis, des phrases prcises39.
Si Jean Collet ne pouvait videmment pas imaginer quelle
intensit cette marque de fabrique serait porte, devenant presque
lunique sujet de toute luvre du Godard des annes 1990, le systme
rfrentiel du film, malgr ses difficults, nous donne pourtant
quelques clefs intressantes, en particulier pour ce qui est du recours
Hlderlin par la voix de la rcitation de Fritz Lang dans Le Mpris.
Philippe Lacoue-Labarthe fait ainsi du pote allemand
sans doute le premier saffronter avec une telle
lucidit la disparition de toute rgle, de tout modle, de toute
codification en matire dart ; rflchir par consquent, dans
tourtes ses implications, la crise gnrale de limitatio []. En
ce sens, il incarne, dans son tragique mme, la contradiction
moderne par excellence : limpossible anticipation (limpossible
modlisation) de luvre40.
Comment ne pas voir-l un programme esthtique qui
saccorderait aux dsirs et aux contraintes de Godard cinaste ? Le
critique Serge Daney justifie cette dimension paradoxale que tous les
commentateurs ont releve dans le cinma de Godard, et qui en fait en
propre un moderne :
partir de lancien, Godard a invent (voire bricol)
les formes actuelles de notre perception des images et des sons.
[] Comme beaucoup dinventeurs de formes, il va de lavant
reculons, avec apprhension, le regard tourn vers ce dont il
sest loign. Il est moins lhomme qui ouvre des portes que
celui dans les yeux duquel un paysage jadis familier et
naturel se modifie avec le recul. Rong par une inquitante
tranget, gagn par le mystre des choses quand on sent quon
ne sait plus les faire. Tel est le paradoxe de Godard. Pris entre
39
Jean Collet, Jean-Luc Godard, op. cit., p. 92.
Philippe Lacoue-Labarthe, dans lintroduction aux Hymnes, lgies et autres
pomes de Hlderlin, suivi de Parataxe par Theodor Wiesengrund Adorno, Paris,
Flammarion, coll. GF , 1983, cit dans Marc Cerisuelo, Jean-Luc Godard, Paris,
Lherminier/ditions des Quatre-Vents, 1988, p. 92.
40
Comparatismes -n 1Fvrier 2010
251
Le Mpris, mtafilm de cinfils :
Jean-Luc Godard et la contrainte de la citation
un pass rcent et un avenir proche [], crucifi entre ce quil
ne sait plus faire et ce quil ne sait pas encore faire, vou au
prsent. On a si facilement parl de Godard enfant terrible ,
avant-gardiste , destructeur , rvolutionnaire quon
na pas vu que, ds le dbut, il respecte la rgle du jeu
(contrairement Truffaut). Ce qui linquite, cest labsence de
rgle41.
La terrifiante absence de rgle que souligne Daney, cette
libert qui ptrifie le crateur quand il en dispose absolument, le
renvoyant limage de statues de marbre antiques qui ponctue Le
Mpris, Godard aurait en somme trouv le moyen de la contourner, en
rigeant un got en systme, en se donnant pour contrainte la seule
pratique qui le renvoie ncessairement linfini de sa mmoire
artistique, la seule qui puisse tre la fois la rgle et le jeu, cest-dire la citation. Et puisque Jean-Luc Godard, on la vu, nest jamais le
dernier commenter son travail au moyen des aphorismes quil
affectionne, laissons-lui une fois de plus le mot de la fin. En effet, ds
1962 dans les colonnes de Cahiers du cinma, il revendiquait
crnement sa marque de fabrique, pour se peindre rsolument en
cinaste en recherche permanente du changement et du prsent :
Ce got de la citation, pourquoi nous le reprocher ? Les
gens, dans la vie, citent ce qui leur plat. Nous avons donc le
droit de citer ce qui nous plat. Je montre donc des gens qui font
des citations : seulement, ce quils citent, je marrange pour que
a me plaise aussi moi. [] Pourquoi se gner ? Si vous avez
envie de dire une chose, il ny a quune solution : le dire42
propos qui dans son vidence mme trouve son cho la
sortie de son film, le cinaste crivant dans une dernire fulgurance :
Film simple et sans mystre, film aristotlicien, dbarrass des
apparences, Le Mpris prouve en 149 plans que dans le cinma
comme dans la vie, il ny a rien de secret, rien lucider, il ny a qu
vivre et filmer 43.
41
Serge Daney, Le paradoxe de Godard , dans Philippe Dubois (dir.), La Revue
belge du cinma, op. cit., p. 7.
42
Godard, Les Cahiers du cinma, n 138, Nouvelle Vague, dcembre 1962, p. 2039.
43
Godard, Les Cahiers du cinma, n 146, aot 1963, p. 31.
Comparatismes -n 1Fvrier 2010
Jean-Christophe Blum
252
Illustrations
De la parole limage par le geste : dans son propre rle, Lang lance
la projection, sous le regard de son producteur Jerry (Jack Palance) et
de son scnariste Paul (Michel Piccoli, au chapeau)
Include me out!
Entre Questa la mia vita/Vivre sa vie (France) et Psycho/Psychose
(tats-Unis), Vannina Vanini (Italie) et M le maudit (Allemagne)
Vrit dun couple et vrit dun film, la rvlation de Viaggio in
Italia par un travelling
Comparatismes -n 1Fvrier 2010
253
Jean-Christophe BLUM Le Mpris, mtafilm de cinfils : JeanLuc Godard et la contrainte de la citation
partir de limportance prise par Le Mpris de Jean-Luc Godard dans
la constitution comme discipline des tudes cinmatographiques, il
sagit de retracer le rle jou par ce film dans la dfinition de la
modernit lcran : en plein moment moderniste (Rossellini,
Antonioni), lapoge dune Nouvelle Vague dj institutionnalise,
cest une modernit mlancolique et paradoxale que se confronte le
cinaste. Son mtafilm (Crisuelo) se veut un art potique qui
prsente un mdium singulier et fuyant condamn la pratique de la
citation des anciens pour se mieux se perptuer, en dpit de son
invention relativement rcente. Ltude sappuie en particulier sur
lanalyse de la squence de la projection des rushes de LOdysse
Cinecitt.
Modernity in Godards Contempt: Born to Quote
Taking as a starting point the status achieved by Jean-Luc Godards
Contempt in the establishment of film studies as an academic field, the
paper retraces back the ways in which this film first defined modernity
on the screen. In the midst of Rosselinis and Antonionis modernist
moment, while the New Wave movement is being questioned, the
filmmaker confronts a melancholic and paradoxical modernity. His
mtafilm (Crisuelo) aims for an ars poetica seen as a unique and
ungraspable medium, condemned to the quotation of the Ancients in
order to perpetuate itself, in spite of its relatively recent invention. As
such, this essay focuses on the analysis of the sequence of the
Odysseys dailies projection in Cinecitt.
Viaggio a Cinecitazione: Il Disprezzo di Jean-Luc Godard e lOdissea
della modernit
Prendendo a spunto limportanza costitutiva de Il Disprezzo di JeanLuc Godard per gli studi sul cinema, larticolo si propone di
ripercorrere il ruolo assunto da questo film nel definire la modernit
cinematografica: in pieno modernismo (Rossellini, Antonioni),
allapogeo di una Nouvelle Vague gi istituzionalizzata, il cineasta si
confronta con una modernit malinconica e paradossale. Il suo
mtafilm (Marc Crisuelo) vuol proporre unarte poetica, che
presenta un medium particolare e sfuggente, condannato alla pratica
della citazione per meglio perpetuarsi, nonostante la relativa novit
della sua invenzione. Pi in particolare, il saggio si fonda sullanalisi
della sequenza della proiezione dei rushes dellOdissea a Cinecitt.
Comparatismes -n 1Fvrier 2010
Vous aimerez peut-être aussi
- Ma Sexualité 6 - 9 Ans - Jocelyne Robert. Livre PDFDocument22 pagesMa Sexualité 6 - 9 Ans - Jocelyne Robert. Livre PDFJade Cousineau100% (1)
- Seydou BadianDocument22 pagesSeydou BadianAlexis Yogo100% (3)
- Ameno Giordano Partition Fiche PDFDocument1 pageAmeno Giordano Partition Fiche PDFWilliam Dante Javier HuamanPas encore d'évaluation
- Article Pao OK PDFDocument1 pageArticle Pao OK PDFOrnaMomPas encore d'évaluation
- Modiano Livret de Famille Récit IncertainDocument18 pagesModiano Livret de Famille Récit IncertainFabianna PellegrinoPas encore d'évaluation
- Harrent. Les Écoles D'antioche: Essai Sur Le Savoir Et L'enseignement en Orient Au IVe Siècle (Après J.-C.) - 1898.Document300 pagesHarrent. Les Écoles D'antioche: Essai Sur Le Savoir Et L'enseignement en Orient Au IVe Siècle (Après J.-C.) - 1898.Patrologia Latina, Graeca et OrientalisPas encore d'évaluation
- J'ai SoifDocument4 pagesJ'ai Soiffrancis3ndourPas encore d'évaluation
- Guiorgui Léonidzé. Chanson de La Première Neige.Document7 pagesGuiorgui Léonidzé. Chanson de La Première Neige.Giorgi Leon KavtarażePas encore d'évaluation
- Civilisation Francaise Analyse PDFDocument10 pagesCivilisation Francaise Analyse PDFAnirudhPas encore d'évaluation
- Traducción Le Surréalisme en Plein Soleil - MagritteDocument29 pagesTraducción Le Surréalisme en Plein Soleil - MagritteMara AndrésPas encore d'évaluation
- Photo Saint-Germain-des-Prés - Dossier de PresseDocument34 pagesPhoto Saint-Germain-des-Prés - Dossier de PresseJason WhittakerPas encore d'évaluation
- La Façade, de Logement Collective Cas de Boussouf Et Daksi-ConstantineDocument197 pagesLa Façade, de Logement Collective Cas de Boussouf Et Daksi-ConstantineKHELIFA100% (2)
- L'aksak - Simha AromDocument43 pagesL'aksak - Simha AromFilipe MaltaPas encore d'évaluation
- La Notation PhonetiqueDocument34 pagesLa Notation PhonetiqueHector OrozcoPas encore d'évaluation
- 305 Survole de L Histoire de L EgliseDocument3 pages305 Survole de L Histoire de L EgliseRobert Bokouaye100% (5)
- Stage Argu Opp ConcessionDocument2 pagesStage Argu Opp ConcessionSpika75Pas encore d'évaluation
- Gala Croisette Club AlbaneDocument2 pagesGala Croisette Club AlbaneBenjamin HOURSPas encore d'évaluation
- Brassens Definitivo PDFDocument1 167 pagesBrassens Definitivo PDFAntonio Enique TorrejonPas encore d'évaluation
- Stained Glass Histories PDFDocument290 pagesStained Glass Histories PDFjessvelazquez100% (1)
- Grand Palais 2016Document48 pagesGrand Palais 2016librairiechretien8174100% (1)
- Nexus N°124 Septembre Octobre 2019Document116 pagesNexus N°124 Septembre Octobre 2019Chri Cha75% (4)
- La Chanson de RolandDocument359 pagesLa Chanson de RolandH_Wotan100% (1)
- La La Land: Mia & Sebastian's ThemeDocument2 pagesLa La Land: Mia & Sebastian's ThemeМаксимТерещукPas encore d'évaluation
- From Russia With Love - Tango From Scent of A WomanDocument5 pagesFrom Russia With Love - Tango From Scent of A WomanPaul SmithPas encore d'évaluation
- Te Adorno Rennes 2Document6 pagesTe Adorno Rennes 2Anonymous BssSe5Pas encore d'évaluation
- Poème!Document2 pagesPoème!Eliana GonzálezPas encore d'évaluation
- Batterie - Le Sub Kick MaisonDocument2 pagesBatterie - Le Sub Kick MaisonWaskaiPas encore d'évaluation