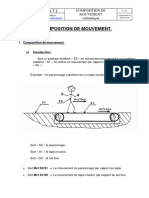Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Maxi Fiches de Construction Mécanique Et de Dessin Industriel en 44 Fiches
Maxi Fiches de Construction Mécanique Et de Dessin Industriel en 44 Fiches
Transféré par
Yahia Chouaki100%(7)100% ont trouvé ce document utile (7 votes)
2K vues188 pagesCopyright
© © All Rights Reserved
Formats disponibles
PDF ou lisez en ligne sur Scribd
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
© All Rights Reserved
Formats disponibles
Téléchargez comme PDF ou lisez en ligne sur Scribd
100%(7)100% ont trouvé ce document utile (7 votes)
2K vues188 pagesMaxi Fiches de Construction Mécanique Et de Dessin Industriel en 44 Fiches
Maxi Fiches de Construction Mécanique Et de Dessin Industriel en 44 Fiches
Transféré par
Yahia ChouakiDroits d'auteur :
© All Rights Reserved
Formats disponibles
Téléchargez comme PDF ou lisez en ligne sur Scribd
Vous êtes sur la page 1sur 188
INVIZ 3CI
FicHEeES
a
mecanique et
dessin industriel
En 44 fiches
Pascal Lussiez
DUNOD
Copyright © 2012 Dunod.
Illustrations (intérieur et couverture) : Raphaélle BaLAzoT
le, pidogrme qui Sgue icone dem pion, proroqent ne
imide ose exclon. Son chet et bows bruce det otto ie hes et do
lene ie cer ur Jo meoce que reer, pe quel pss mime peur
représete pour Havent doer Tes ours do créer des cones
partculérement dans le domaine [BANGER] wells et de les fore dir cor
de Féin echnique et univers: recemen’ et excurd ui mencée
tote, le dévlopperers massif do Nous rappelons done que toute
phobcopl reproducien, poriele oy tobe,
{2 Code eprops inlee GF prowl publaion et
tuole du 1 juilet 1992 intordt |LEPAMIPLKE| ifercte sons. ulrisaion de
cn eft expressément la photoco: (TUE LELIVRE) Toveur, de son édieur ov du
pie @ usoge collec sans ot: Centre frongaisd exaltation do
Sotion des ayant dct. Or, cate pratique droit de copie (CFC, 20, ue des
Sst généralisée dons les @ablisements Gronds-Augustins, 75006 Pai)
© Dunod, Paris, 2012
ISBN 978-2-10-056964-9
le Code de la propridté inellechelle rfoutorisan!, aux termes de Fartcle
1.1225, 2° et 3° o), d'une part, que les « copies ov reproductions stctement
Jervées & I usoge privé du copiste et non destinges & une uiilisation collective »
, d'oute part, que les ancyses et les coures citations dans un but exemple et
illustration, « toute représenttion ou reproduction inégrale ou portale foite
sans le consentoment de Vavleur ov de ses ayants droit ov ayant cause est
lice » (an. L. 1224)
Cette eprésentoton ou reproduction, por quelque procédé que ce soit, consive
rait done une conteforon soncionnée por les aries L. 3352 et suivants du
Code de la propriété intllectvele,
Copyright © 2012 Dunod.
1 Vocabulaire technique
2 Perspectives
1, Définition
2. Domaine d'utilisation
3. Types de perspective
4, La perspective cavaligre
5, La perspective isométrique
6. Construction d’une ellipse
3 Le dessin technique
1. Définition
2. Les différents types de dessin
3. Présentation des dessins
4. Principales régles et convention
4 Les coupes
1. Définition
2. Le principe de réalisation d'une coupe
3. Les différents types de coupe
4. Les régles de représentation
5, Le repérage des coupes
6. Les hachures
5 Filetage et taraudage
1. Filetage
2, Taraudage
3. Assemblage fileté
6 Les sections
1. Définition
2. Les différents types de section
Méthode
7 Les liaisons complates
1. Définition
2. Aspect fonctionnel
3. Familles de solutions constructives
Cann eee
eee
i
12
14
14
4
15
16
7
7
18
18,
19
20
21
2
a
Table des matiéres
8 Les liaisons completes démontables
1, Définition
2. Analyse fonctionnelle
3. Principe de construction
4. Familles de solution
5. Surfaces de contact plan
6. Surface de contact cylindrique
7. Surface de contact conique
8. Surface de contact un degré de liberté
9. Surface de contact hélicoidale
10. Clipsage
9 Les liaisons complétes non démontables
1. Définition
2, Familles de solution
10 Assemblage démontable « Arbre—Moyeu »
Définition
‘Type de solution
Les arréts axiaux par obstacle
Les arréts radiaux par obstacle
Les arréts axiaux et radiaux par obstacle
Peep
11 Composant filetés
Vis de fixation
.. Vis d’assemblage
Vis de pression
}. Ecrou
Dispositifs de freinage des vis et des écrous
. Goujon
Boulon
AeePe
ae
12 Guidages en rotation — Généralité
1. Fonction a assurer
2, Indicateurs de qualité
3. Familles de solutions
13 Guidages en rotation par roulement
1. Composition générale d’un roulement
2. Familles de roulement
3. Type de montage
4, Immobilisation radiale
vi
27
27
7
27
29
30
30
32
32
33
33
34
34
34
37
37
37
38
39
40
42
42
42
4
45
47
49
50
50
50
53
53
53
55
56
Table des matiéres
5, Immobilisation axiale
6. Lubrification
7. Etanchéité
8. Durée de vie
14 Les guidages en rotation par bague de frottement
1, Familles de solutions
Les bagues de frottement en matériaux métalliques
Les bagues de frottement en thermoplastique
Les bagues métal-polymére (ou composite)
Sélection d'une bague de frottement
yeep
15° Guidages en translation
Fonction & assurer
. Indicateurs de qualité
Architecture d’un guidage en translation
|. Familles de solutions
Guidage en translation par contact direct
. Guidage en translation par interposition d’élément antifriction
Guidage en translation par interposition d’ékéments roulants
. Guidage en translation avec interposition d'un film ¢’huile
SA ar eee
16 Etanchéité
1, Mise en évidence du probleme
2, Fuites entre milieux
3. Principaux critéres de choix
4. Typologie de la fonction étancher
17 Etanchéité statique
1, Familles de solution
2. Etanchéité statique directe
3. Etanchéité statique indirecte
18 Etanchéité dynamique de rotation
1. Direct
2. Par interposition de joint
3. Par passage étroit
19 Etanchéité dynamique de translation
1. Btanchéité directe
2. Par interposition de joint
vil
56
37
37
59
60
60
60
62
02
62
64
64
64
64
66
67
68
68
09
70
70
70
7
7
72
nR
R
B
75
ei}
16
7
79
80,
80
Table des matiéres
20 Transmission de puissance
1, La chaine cinématique
2. Les fonctions principales d'une transmission de puissance
3, La puissance mécanique
4, Familles de solutions
21 Engrenage Roue et vis sans fin
1, Représentation
2. Caractéristiques géométriques
3. Caractéristiques mécaniques
22 Engrenage concourant
1. Différent type d’engrenage concourant
2. Représentation
3. Caractéristiques géométriques
4. Caractéristiques mécaniques
23 Engrenage paralléle
Principe de fonetionnement
Diffférent type engrenage parallele
Représentation
Caractéristiques géométriques
Caractéristiques mécaniques
peeps
24 Poulie — Courroie
1, Type de courroie
2. Disposition des arbres
3. Dispositif de tension
4. Représentation schématique
5. Caractéristiques gométriques
6. Caractéristiques mécaniques
25 Réducteur
1, Familles de solutions
2, Réducteur a trains épicycloidaux
26 = Roues et chaines
1. Constitution d’une chaine
2. Type de chaine de transmission de mouvement
3. Représentation schématique
4. Caractéristiques géométriques
5. Caractéristiques mécaniques
vill
83
83
84
84
85
87
87
88
89
93
93
94
94
95,
98
99
100
101
102
107
107
108
108
109
109
110
111
i
113
116
116
7
7
118
118
Table des matiéres
27 Mécanisme a came
Définition
Principe de fonctionnement
Possibilité de transformation
Structure du mécanisme
. Classification
6. Relations cinématique
yeep
28 Systeme vis-écrou
Définition
. Principe de fonctionnement
‘Type architecture
|. Relation géométrique
Relation cinématique
. Relation entre le couple et l'effort axe
. Rendement
8. Solutions constructives
yeep
ae
29 Pignon - crémaillére
1, Définition
2. Principe de fonctionnement
3. Représentation
4. Caractéristiques géométriques
5. Caractéristiques mécaniques
30 Systeme bielle-manivelle-excentrique
Définition
. Principe de fonctionnement
Exemple d’application
|. Schéma cinématique
Relation cinématique
. Les systémes bielle-manivelle di
les excentriques
Aa ee
31. Les matériaux
1. Typologie générale des matériaux
2. Les principales propriétés des matériaux
3. Critéres de choix des matériaux
32 Les aciers
1, Familles d’acier
2. Les aciers non alliés
120
120
120
120
120
121
122
123
123
123
125
126
127
127
128
128
129
129
129
129
130
130
133
133
133
133
133
133
135
135,
136
136
138
141
143
143
143
Table des matiéres
3. Les acier faiblement alliés
4. Aciers fortement alliés
5. Principales caractéristiques
33 Les fontes
1. Les fontes
2. Familles de fontes
3. Désignation normalisée
4. Les fontes non alliées
5. Principales propr
és
34 Le cuivre et ses alliages
1. Le cuivre
2. Principaux alliages de cuivre
3. Les laitons
4, Les bronzes
5, Principales caractéristiques
35 aluminium et ses alliages
1, Désignation des produits corroyés
2. Désignation des produits de fonderie
3. Principales caractéristiques
36 Les matiéres plastiques
1, Familles de plastique
Les thermoplastiques
Les thermodurcissables
Elastoméres
Principales caractéristiques
Marque d'identification pour le recyclage
azeey
37 Conception assistée par ordinateur (CAO)
1, Du besoin & sa matérialisation
2. Modeleurs volumiques
3. Maquette numérique : un référentiel unique
4. Notions principales sur les modeleurs volumiques
38 CAO: Comment réaliser une piéce en 3D 7?
1. Les principales étapes de construction d'une piéce
2, Réaliser une esquis
3. Générer un volume
144
145
146
147
147
147
148
148
149
150
150
150
150
151
151
152
152
153
154
155
155
156
156
156
157
157
158
158
158
158
159
160
160,
161
162
Table des matiéres
39 CAO: Comment créer de la matiére ?
1, Création d'une esquisse
2. Création de matiére par extrusion
3. Création de matiere par révolution
40 CAO : Comment enlever de la matiére ?
1. Enlevement de matiere par extrusion
2, Enlévement de matiére par révolution
41 CAO: Comment réaliser un assemblage de piéces ?
1. Un assemblage
2, Les contraintes d'assemblage
3. Les principales étapes d’assemblage
42 CAO — Comment réaliser une mise en plan ?
Créer une mise en plan
Réaliser la mise en plan
Compléter le cartouche
Insérer une nomenclature
Insérer une vue en coupe (ou section)
yeepe
43 CAO — Fonctions complémentaires
1. Chanfrein
2. Congé et arrondi
3. Pergage
4. Représentation normalisée d'un trou taraudé dans une mise en plan
44 CAO —Répéti
1. Symétrie
2. Répétition lineaire
3. Répétition circulaire
ns de fonctions
163
163
164
165
166
166
167
168
168
168
169
171
171
172
172
172
173
174
174
174
175
175
177
177
178
178
a a . .
Mots-clés
Formes techniques
Les pices mécaniques sont de formes des plus diverses, malgré leur multiplicité, il est possi
de distinguer un ensemble de forme géométrique de base qui constitue le vocabulaire technique
du mécanicien.
Ce vocabulaire usuel résulte des fonctions techniques que doivent réaliser les pitces et par
conséquent des procédés d’obtention utilisés pour réaliser ces formes.
On peut citer par exemple pour le moulage : les arrondis, les congés... ou pour lusinage :
les chanfreins, les alésages..
La liste suivante n’est pas exhaustive. Elle constitue simplement un minimum et pourra senri-
chir du vocabulaire propre A chaque métier ou filigre de la mécanique.
Arrondi Rainure en queue d’aronde Rainure en vé
Bossage ¢
Rainure droite Trou oblong
Tenon f :
Chanfrein Reinure en té
© 2012 Dunod.
Copyright
Fiche 1 + Vocabulaire technique
Congé
Filetage Taraudage
Epaulement,
Méplat
Chanfrein
Collet
Alésage.
Epaulement
intérieur Chantrein
intérieur ou
Chambrage flare
ght © 2012 Dunod.
Copy’
= :
Mots-clés
Perspective, cavaliére, isométrique.
Le croquis & main levée utilise généralement la représentation en perspective. C’est Poutil de
communication le plus performant et rapide entre Pexpression dune idée et sa représentation. I
permet d'expliquer et de comprendre rapidement les formes, la g¢ométrie, la construction d’un
mécanisme ou d'une piece.
1. DEFINITION
Les perspectives sont des techniques de représentation dont le but est de représenter un objet
(schéma, pigce, mécanisme...) A trois dimensions sur une surface (un plan, ou une feuille).
2. DOMAINE D'UTILISATION
On utilisera la représentation en perspective chaque fois que Yon cherche a se faire com-
prendre rapidement sur aspect général d’un objet. Cet objet peut étre un schéma, une pice,
un mécanisme, une machine, ete
Lobjectif est de pouvoir se représenter Vobjet en volume & partir d'une représenta
(dessin sur une feuille par exemple).
Elle offre la possibilité de voir simultanément trois faces de Pobjet en une seule vue.
ion plane
Exemples d'utilisation
Les exemples sont multiples. On retrouve souvent les perspectives pour illustrer ou visualiser un objet
dans des catalogues, dans les dessins de définition comme vue complémentaire, dans les notices de
montages ou de maintenance.
Capteur:
‘mos
& 3
u
A
y
Vue éclatée d’une webcam Schéma cinématique
Fiche 2 + Perspectives
Croquis d'une piéce en perspective
3. TYPES DE PERSPECTIVE
Tlexiste de nombreux types de représentation en perspective, les plus utilisés sont la perspective
cavalitre et isométrique.
i
Perspective cavaliere Perspective isométrique
4, LA PERSPECTIVE CAVALIERE
a) Definition
dj La représentation en perspective cavaligre est la projection oblique d’un objet sur un plan. La
face principale est paralléle au plan de projection,
La perspective cavalitre donne une représentation peu réaliste de Tobjet (déformation
importante).
PB Cube projete
Direction oblique
de la projection Cube
Fiche 2 « Perspectives
b) Regles
+ La perspective cavalidre est normalisée.
* La face principale de objet est représentée en vraie grandeur et sans déformation. Les
autres faces sont déformées.
* Les fuyantes sont 2 45°, Suivant la position de cet angle, plusieurs points de vue sont
possibles.
© On choisira lorientation donnant le plus d'informations sur les formes de la pigce.
* Sur les autres faces, les éléments (droites, cercles, etc.) sont représentés en demi-grandeurs.
d
) Méthode
La perspective cavaliére est simple et facile a dessiner. Elle est tres utilisée pour des croquis,
rapides sur une feuille quadrillée a petits carreaux.
Tout en respectant ses propres régles, une perspective cavalitre se dessine en utilisant la méme
démarche que pour une perspective isométrique présentée ci-apres.
® Attention a représenter votre contour aux bonnes dimensions par rapport au plan choisi.
5. LA PERSPECTIVE ISOMETRIQUE
a) Definition
La perspective isométrique est une technique de représentation du volume d'un objet sur une
surface pour laquelle les trois directions de représentation ont la méme importance.
La représentation en perspective isométrique est la projection orthogonale d'un objet sur un
plan.
La perspective isométrique donne une représentation assez réaliste de Fobjet.
Fiche 2 + Perspectives
b) Regles
+ La perspective isométrique est normalisée.
* Les axes isométriques sont orientés les uns aux autres 4 120° et les dimensions sont multi-
pliées par un coefficient k = 0,82.
® Dans le cas d’un croquis rapide & main levée on peut prendre un coefficient k = 1.
c) Méthode générale de construction
La méthode de représentation d'une perspective est a rapprocher de la méthode de construe-
tion d’un volume par création ou enlévement de matiére avec la fonction extrusion d'un logiciel
deC.AO.
utilisation d’une grille « isométrique » permet de donner rapidement les directions des fuyantes.
eS ©
a Dessinez en trait fin de construction, un parallélépi-
pede aux dimensions maximales de l'objet (hors tout). | Sur une face du volume, représentez votre esquisse.
@C €
A\'aide des fuyantes, représentez le volume. Effacez ensuite les traits de construction.
Copyright © 2012 Dunod.
Fiche 2 « Perspectives
Pour les autres volumes, procédez de la méme fagon que précédemment.
Remarque
Les logiciels possedent généralement une commande de visualisation en perspective.
6. CONSTRUCTION D‘UNE ELLIPSE
Une ellipse représente un cercle déformé par la perspective.
a) Pour les ellipses de petite dimension
Tracez les axes dans le plan. KS
Tracez le losange circonscrit représentant le carré cir- Ke oe
conscrit au cerce. SS
Tracez les arcs en respectant la tangence au point din-
tersection des axes et du losange.
b) Pour les ellipses de grande dimension
Pour les ellipses de grande dimension, il peut étre nécessaire d'avoir des points intermédiaires
entre les arcs tangents.
La méthode de construction ci-dessous permet d’obtenir 8 points supplémentaires au milieu des
demi-cétés du losange.
Copyright © 2012 Dunod.
= 5 s
Mots-clés
Dessin industriel, schéma, croquis, dessin de définition, dessin d’ensemble, cartouche, nomenclature
1. DEFINITION
Le dessin technique est un outil graphique de conception et de communication. II permet de
représenter l'idée d'un objet ou d'un produit sur un plan, en vue de sa réalisation,
Le dessin technique utilise des régles normalisées. C'est un langage universel et de spécialiste.
2. LES DIFFERENTS TYPES DE DESSIN
Dessin d’ensemble
Dessin de finition
(Dessin technique)
a) Le schéma
Le schéma permet généralement, avec des symboles normalisés, de représenter d'une maniére
simplifiée un systéme technique.
Il permet de communiquer d'un point de vue fonetionnel, structurel, relationnel ou technolo-
gique des données ou des informations.
Exemples
‘Schéma cinématique, électrique, pneumatique, hydraulique...
Goulotte —X
de jetée
Verin de
commande —+|
de la trappe
ri
wal. sn
Schéma cinématique d'un mécanisme d’ouverture de trappe Schéma pneumatique
Trappe en
position ouverte
Fiche 3 « Le dessin technique
b) Le croquis
Le croquis est la représentation d’un objet aux dimensions approximatives et au traeé som-
maire. Il permet d'avoir une vision globale de Vobjet.
Bogut Remaglide
a bajne.
Croquis d'une solution technologique Croquis d'une pice en perspective
©) Ledessin
> Le dessin de l'ensemble
Le dessin d’ensemble représente l'ensemble des pieces constituant objet technique. Il permet
de connaitre son organisation, son principe de fonctionnement, ses principales formes et
dimensions,
VISSEUSE
AUTOMATIQUE
Solitenaciele
Dessin d'ensemble
> Le dessin de définition
Le dessin de définition représente une seule piéce suivant plusieurs vues avec sa cotation.
Sa lecture permet de connaitre exactement sa forme, sa matitre, ses dimensions et spécitica-
tions géométriques, et ses états de surface.
10
Copyright © 2012 Dunod.
Fiche 3 Le dessin technique
est non seulement un moyen d’échanger des informations entre le concepteur et le fabricant,
mais aussi un contrat. II est Punique référence lors de la réception des pices fabriquées.
Dessin de definition
3. PRESENTATION DES DESSINS
a) Les formats normalisés }
Les dessins sont représentés sur un support
papier de dimensions normalisées dont le rapport AS
longueur sur largeur est de ¥2. A2
Le format le plus connu, est celui de la feuille de A3
papier ;le format Ad,
On obtient les dimensions des autres formats en
multipliant par 2 la plus petite dimension.
a At
Le format A3 est obtenu (420 x 297 mm) en multi-
pliant par 2 la plus petite longueur du format Ad
(210x2 = 420 mm).
b) La notion d’échelle
Léchelle d’un plan indique la valeur du rapport entre les dimensions dessinées et les dimen-
sions réelles d’une pice ou d'un mécanisme.
Exemples
imension,
Dimer
Echelle=
"
Fiche 3 « Le dessin technique
) Le cartouche
Le cartouche est la carte didentité
du document. II renseigne sur :
* le nom de Fobjet (titre) ;
* le nom de Fentreprise ; A4
* le nom du dessinateur ;
* la référence de la piéce ou du
mécanisme :
* Tindice de mise a jour :
* échelle :
« le format de original ;
* et le symbole de disposition des
vues Position du cartouche
Son emplacement est invariable
Rep | Wo Designation Pe
Tate oa
Dessiné MECANISME 03]
ae 02)
ae 01
x Entreprise Dupont 20]
Exemple de cartouche
d) La nomenclature
A3
La nomenclature est une liste complete c’éléments qui constitue Fobjet ou le mécanisme. Pour
assurer la liaison avec le dessin d'ensemble, chaque élément y est repéré.
(OF | 2 [Rowement abies 607 RST ISO TS RES
Cheips xt O35
Pose N40 10-162 35x90
Chesp ON ATH -38x175
FA
3 Nomenclature
4. PRINCIPALES REGLES ET CONVENTION
cg
Bindermapreics
Les régles et conventions utilisées en dessin technique sont normalisées. Aujourd’hui, le dessin
technique est réalisé avec un outil informatique qui nous libre de ses contraintes,
2
Fiche 3 Le dessin technique
Nous présenterons ci-aprés, ce qui nous semble lessenticl.
a) Vue et projection orthogonale
Une vue est la projection orthogonale d’un objet sur un plan.
Plusieurs vues sont nécessaires pour définir complétement un objet. Elles sont disposées sui-
vant la méthode européenne de projection (figure ci-dessous).
Suivant les formes et la complexité de la pice, on ne représentera sur un dessin de définition
que le nombre de vues nécessaires A sa compréhension.
(o
2
Cette disposition est indiquée dans le cartouche par le symbole ISO
(ci-contre), traduisant par exemple, le fait que la vue de gauche est & ra -
droite de la vue de face,
b) Les types de traits
La norme définit principalement 4 types de trait en fonction de leur utilisation.
Trait Nom Utilisation
Continu fort Arétes et contours vus
oo a Interrompu fin Arétes et contours caches
Mixte fin ‘Axes et plans de symétrie
Continu fin Lignes de cotes, hachures
D/autres régles et conventions comme les coupes et sections ow la représentation des filetages et
taraudages seront abordées dans d'autres fiches de cet ouvrage.
1B
Copyright © 2012 Dunod.
Mots-clés
Coupe, demi-coupe
1. DEFINITION
Une coupe représente la section et la partie de objet en arriére du plan de coupe (ou plan sécant).
Elle est utilisée pour montrer les formes intérieures et les épaisseurs de mativre. D’une manitre
générale, elle permet d’améliorer la lisibilité et donc de faciliter la lecture et la compréhension
des dessins de pieces, en remplagant des contours cachés représentés en trait interrompu.
®
2. LE PRINCIPE DE REALISATION D'UNE COUPE
1. Choisir un plan de coupe
2. Couper virtuellement (par la pensée)
la pice suivant ce plan.
Plan
‘de coupe
‘Sens
‘observation
3. Enlever la partie de la pice avant le plan
de coupe.
4, Dessiner la partie de la piece en arriére
du plan de coupe comme une vue
normale.
Plan de
projection
5. Hachurer les parties de matiére coupées.
—_——— 4
Copyright © 2012 Dunod.
—_——— 5
Fiche 4 « Les coupes
3. LES DIFFERENTS TYPES DE COUPE
On peut classer les coupes en deux grandes familles :
tielles, Elles utilisent le méme principe de réalisation,
jes coupes completes et les coupes par-
Coupe simple
Coupe brisée (o plan parallale
‘Aplan sécant
Demi-coupe
Coupe locale
Une coupe simple
est une coupe complite
avec un plan de coupe
(ou plan sécant) paralléle
au plan de projection.
La coupe brisée a plan pa-
ralléle permet de montrer
les parties creuses situées
dans des plans différents.
Elle est construite a partir
de plans de coupe classique
paralléles entre eux.
Elle évite ainsi plusieurs
‘coupes normales.
Les traces des plans
de coupe sont renforcées 8
chaque changement
de direction,
Copyright © 2012 Dunod.
Fiche 4 © Les coupes
Le plan de coupe est consti-
‘tué de deux plans sécants.
On obtient la vue en coupe
en rabattant un des plans
de coupe dans le prolonge-
ment du second.
Les traces des plans
de coupe sont renforcées a
‘chaque changement
de direction.
Les demi-coupes sont
généralement utilisées
pour des pices
symeétriques ou l'on
souhaite montrer
tune moitié en vue
extérieure et l'autre moitié
en coupe.
Une coupe locale
est une coupe
partiellement représentée,
Elle est utilisée
our représenter un détail
interessant d'une pidce.
4. LES REGLES DE REPRESENTATION
Les piéces suivantes ne sont pas représentées en coupe : les arbres, les clavettes, les boulons, les
vis, les billes, etc.
Les nervures, dont le plan de symétrie de leur grande face est confondu avec le plan séeant
(figures 1 et 2), ne sont pas également représentées en coupe.
16 Se
Copyright © 2012 Dunod.
Fiche 4 « Les coupes
D’une maniére générale, on ne coupe pas les pieces pleines dont la coupe ne donnerait pas une
représentation plus détaillée (figure 3)
Figure 1
Piece nervurée
LE REPERAGE DES COUPES
Le plan de coupe est représenté par un trait mixte fin renforcé aux extrémités, Il est repéré par
deux lettres majuscules,
Des fléches en trait fort, orientées vers la partie 4 conserver, indique le sens d’observation
(comme pour un observateur placé selon la convention européenne de projection).
Chaque vue en coupe est repérée par les deux lettres majuscules précédentes.
AA
6. LES HACHURES
Les hachures symbolisent la zone occupée par la matire dans le plan de coupe. Elles sont
tracées en trait fin continu et inclinées en général de 45 degrés par rapport aux lignes générales
du contour.
Pour les dessins d’ensemble, on associe & chaque nature de matériaux un type de hachures, Pour
une méme pice, les hachures sont identiques,
usage général, tous métaux etalliages légers cuivre matiére plastique ou isolant
métaux et alliages (aluminium...) et ses alliages (électrique), élastoméres
> Regles
@ ekniSscrumenmasar asta pec,
7
“Si
Mots-clés
Filetage, taraudage, vs, filet
. FILETAGE
Un filetage est l'ensemble d'une ou plusieurs rainures hélicoidales a
creusées (filets) le long d’une surface cylindrique.
Un filetage désigne également lopération d'usinage.
Hexiste plusieurs profils de filet ; le filetage métrique ISO a filet trian-
gulaire, le filet trapézoidal, le filet rond, ou encore le filet gaz. Dans
cette fiche, nous nous limiterons au filetage le plus utilisé en visserie
boulonnerie, le filetage métrique ISO a filet triangulaire.
Représentation normalisée
Pour représenter un filetage il n’est pas nécessaire de dessiner les arétes et les surfaces réelles
hélicoidales (méme avec les logiciels de CAO). Ce travail est difficile et inutile. La norme
nous propose une représentation simplifige des filetages, que nous décrirons par les étapes de
réalisation.
A partir d'un cylindre, on creuse une rainure hélicoidale,
Les traits forts représentent les contours extérieurs du
cylindre,
pos Les traits fins représentent le fond de filet du filetage.
La représentation d'un filetage nécessite de connaitre les dimensions suivantes :
* le diametre nominal, noté M pour profil métrique suivi du diamétre extérieur ;
* la longueur de filetage.
Remarque
Le diamétre du fond de filet est normalisé, cependant sur un dessin on pourra le représenter avec un
diametre de l'ordre de 80 % du diametre nominal.
18
Fiche 5 + Filetage et taraudage
2. TARAUDAGE
Un taraudage est un filetage intérieur. Les filets sont usinés dans
un percage.
I permet de recevoir une piece filetée, comme par exemple une vis.
On distingue deux types de trous taraudé
* les trous taraudés débouchant qui traversent la piéce,
* les troustaraudés non débouchant sont appelés « trous borgnes ».
Représentation normalisée
Comme pour le filetage, la norme propose une représen-
tation simplifige du taraudage, que nous décrirons par les
principales étapes de réalisation.
La premiére opération d'usinage est un pergage d'un dia-
metre inférieur au diamétre nominal.
Les traits forts représentent la trace laissée par le pergage.
Avec un outil que on appelle « le taraud », on réalise dans
le percage une rainure hélicoidale (taraudage ou filetage
intérieur) au diametre nominal afin d’y recevoir une pitce
filetée du méme diametre.
Les traits fins représentent le fond de filet du taraudage.
La représentation d’un trou taraudé nécessite de connaitre
suivant les cas, certaines dimensions
* le diamatre de percage :
* la profondeur du pergage ;
* le diamétre nominal du taraudage ;
* la profondeur du taraudage.
20 A le—20_,|
2s who | ito 4 “i
‘Trou taraudé débouchant Trou borgne
Remarque
Dans la pratique sur un dessin, on pourra représenter le percage avec un diamétre de l'ordre de 80 % du
diametre nominal
19
Copyright © 2012 Dunod.
—_——— 20
Fiche 5 « Filetage et taraudage
3. ASSEMBLAGE FILETE
Dans une vue en coupe, la représentation d'un filetage et taraudage suit la régle sur les coupes,
suivant laquelle les pices pleines (arbres, vis...) ne sont pas coupées.
La représentation du filetage recouvrira done la représentation du taraudage.
Copyright © 2012 Dunod.
en o
Mots-clés
Section, section sortie, section rabattue
1. DEFINITION
Une section est la représentation de la partie de Fobjet dans le plan de coupe (ou plan sécant),
Contrairement a la coupe, toutes les parties & arriére du plan de coupe ne sont pas représen-
t6es, Elles sont utilisées pour préciser des formes en évitant de surcharger les vues.
d'observation
Figure 1 Figure 2— Plan de coupe
Prande ane
projection projection
Plan
de coupe
observation d'observation
Figure 3— Coupe Figure 4— Section
2
Fiche 6 « Les sections
+ AA
Figure 5 — Représentation d'une section dans un dessin de définition
2. LES DIFFERENTS TYPES DE SECTION
a) Les sections sorties
Une section sortie est une section représentée A l'extérieure de la vue. Elles sont généralement
dessinées dans la direction du plan de coupe sila place le permet.
Pt feed
/
Section sortie a 8
Figure 6— Sections sortie et rabattue
Section
b) Les sections rabattues
Une section rabattue est une section représentée en superposition dans le plan de la vue
(figure 6). La désignation du plan de coupe peut étre omise.
Pour clarifier le dessin de définition et lorsque c'est possible, il est préférable de représenter une
section sortie.
3. METHODE
Les sections sont des variantes simplifiées des vues en coupe. Pour les représenter, on utilise le
méme principe et les mémes régles de représentation que pour les coupes.
22
Copyright © 2012 Dunod.
Mots-clés
Liaison complete, liaison encastrement.
1. DEFINITION
Une liaison compléte est un assemblage d'un couple de pices liées complétement, c’est-a-dire
sans aucun mouvement relatif entre les deux pices.
Cet assemblage de pieces immobiles les unes par rapport aux autres est modélisé en mécanique
(sous certaines hypotheses) par une liaison « encastrement » représentée par le symbole ci-des-
sous (figure 2).
Place 1
Corton
de soudure Pisce2 —-~Plece t
a [a
freee Figure 2— symbole cinématique
Figure 1 — Liaison complete permanente (soudage) d'une liaison encastrement
2. ASPECT FONCTIONNEL
Une liaison complete entre deux pigces doit répondre aux exigences suivantes :
* positioner une piéce par rapport & autre de fagon stable :
* permettre la transmission des efforts :
* résister au milieu environnant
A partir des fonctions techniques précédentes, on peut dresser une liste des principaux critéres
de choix, comme :
* la précision de la mise en position
* les actions mécaniques transmissibles par la liaison :
* la durée de vie ;
+ Tencombrement ;
+ Festhétique :
* le cofit ; ete.
Ces critéres d’appréciation seront inscrits dans le cahier des charges fonctionnelles de la liaison.
3. FAMILLES DE SOLUTIONS CONSTRUCTIVES
a) Liaison compléte démontable et permanente
On peut classer les solutions constructives en fonction de la possibilité pour assemblage, d’étre
démonté, Nous distinguons deux familles de solution.
* Les liaisons completes démontables que Von peut désolidariser sans détérioration ;
* Les liaisons completes permanentes qui ne peuvent pas étre désaccouplées sans destruc-
tion des pieces.
23
Fiche 7 « Les liaisons completes
Poulle Clavetta Arbre
Figure 3— Liaison complete démontable entre Figure 4— Liaison compléte permanente
une poulie et un arbre par rivetage
b) Classement des liaisons complétes démontables
On peut classer les solutions constructives d'une liaison compléte démontable a partir de la
nature et de importance de chaque contact dans la mise en position relative des pitces et cela
indépendamment des composants d’assemblages (figure 9)
Pour réaliser une liaison compléte, il est nécessaire de supprimer les 6 degrés de liberté entre
les deux pices afin de garantir la mise en position relative.
yy y By: y
Transiation 44 Y Rotation AY
suivant 7 1 autour de J Bx:
Translation Rotation _
Te: suivant YB autour de x
Translation Ee Rotation it
suivant 2, Xx autour de Z x
Zz
S translations + ‘Srrotations
6 degrés de liberté
Figure 5 — Les 6 degrés de liberté
A partir des contraintes du cahier des charges fonctionnelles (C.d.C.F) et de V'exigence mini-
male de coit, les 6 degrés de liberté seront supprimés soit :
* par obstacle en associant des surfaces de contact a la surface prépondérante avec ou sans
composants standards (clavette, goupille...) ;
* par adhérence, en utilisant des composants filetés (vis, écrou...) afin de maintenir réelle-
ment le contact entre les pieces.
24
Fiche 7 * Les liaisons completes
©) Exemples
1 2 Surecoplne 3 4
préoondteante
1 3 2
y
Zz z %X Surface plane
prépondérate
Figure 6 Figure 7
Pigoe 1
Surface plane
pprépondérante
Piece 2
Figure 8
Dans les exemples ci-dessus (figures 6 et 7), on a réalisé une liaison complete démontable entre
la pice (I) et (2) ;cest-A-dire que les deux pices sont solidaires l'une de Pautre sans aucune
possibilité de mouvement relatif.
Dans ces deux exemples, la surface prépondérante est une surface plane (la mise en position est
partielle). II faut done supprimer les trois mouvements relatifs de translation (Tx), (Tz) et de rota-
tion (Ry) pour rendre les pieces solidaires.
Les deux assemblages utilisent pour cela deux principes différents : les obstacles et ladhérence.
Pour assemblage de la figure 6, un premier pion de positionnement (4) supprime par obstacle les
8 translations (Tx) et (Tz), tandis que le deuxime pion supprime le dernier mouvement de rotation (Ry).
Pour la figure 7, les mouvements relatifs ont été supprimés par adhérence au niveau de la sur-
face plane, par laction de serrage entre les deux pieces exereées par la vis (3).
A partir d'une méme surface de contact prépondérante, on supprimera les différents mouve-
ments relatifs soit par obstacle soit adhérence en fonction du cahier des charges fonctionnelles.
‘On remarquera que la liaison complete de la figure 6 a une mise en position d'une plus
® grande précision que la solution constructive de la figure 7, par utilisation des deux pions
de positionnement. Elle permet également de transmettre des efforts plus importants.
Remarque
Pour facilter la réalisation ou pour éviter la déformation génante dune pice sous I'action d'une charge,
les contacts seront souvent surabondants.
25
Copyright © 2012 Dunod.
Fiche 7 « Les liaisons completes
colage
Surface plane “s
Pees) Soudage™ brasage
Surface eyindrique
Rivetage = rivure
Surface conique ‘Autres
Autres surtaces
Figure 9 — Familles de solution
26
Copyright © 2012 Dunod.
Mots-clés
Liaison complete, liaison encastrement, liaison statique
1. DEFINITION
En construction mécanique, on appelle « liaison complete non démontable », un assemblage de
pices ne permettant pas de les désolidariser sans destruction.
2. ANALYSE FONCTIONNELLE
La réalisation d'une liaison complete nécessite la décomposition fonctionnelle suivante :
Reéaliser la mise en position
des 2 piéces
Maintenir en position
les 2 piéces
Transmettre
les actions mécaniques
hay
L Ete...
3. PRINCIPE DE CONSTRUCTION
Lanalyse de la liaison complete entre Varbre (1) et a poulie (2)
suppose un contact maintenu entre les surfaces afin de permettre
identifier les mobilités supprimées par chaque contact et indépen-
damment des éléments de serrage.
Cette démarche d’analyse peut étre utilisée pour toutes les liaisons
completes démontables.
Figure 1
27
Copyright © 2012 Dunod.
—_——— 28
Fiche 8 * Les liaisons complétes démontables
La mise en position est assurée principalement par une surface de contact eylindre (S1) sur
cylindre (S2) entre Parbre (1) et V'alésage de la poulie (2).
Ce contact cylindrique prépondérant permet de supprimer deux rotations et deux translations
(Tableau 1).
= }
Cylindre (51) / eylindre (52) Pe | Ry Fe | Fr
Résultat global fx | Ry” Ae | ay
Tableau 1 — Mobilités supprimées
R
R
association d’un épaulement sur arbre (1) permet de supprimer par obstacle le mouvement
de translation Tz grice au contact plan ($3) sur plan ($4).
Gylindre (S1) / cylindre (S2) fe | fy | Re | mw | Hy) RB
Plan (S3)/plan ($4) Rx | ry | Re | & | Wy |
Résultat global Re Ry RR eye
Tableau 2— Mobilités supprimées
Linsertion d'une clavette (3) permet de supprimer par obstacle le mouvement de rotation Rz,
grdce au contact plan (85) sur plan ($6).
$6
Fiche 8 « Les liaisons complates démontables
La mise en position de la poulie (2) et de Varbre (1) est assurée
principalement par une surface cylindrique et association de
deux contacts plan sur plan. L’ensemble de ces contacts permet
de supprimer toutes les mobilités de Passemblage (Tableau 2).
Le maintien en position est assuré par une rondelle plate (4) et
une vis 4 téte hexagonale (5) (cf. figure 1)
Mise en position globale
Contact Rotation Translation
Gylindre (51) eylindre (52) Re | fy | ke | & | | kb
Plan (53)/plan (54) Rx ory | Re | ok | oy |e
Plan (57)/plan (56) Rx | ry | Re | &« | y |
Résultat global Pe ay | Re te | ay | te
Tableau 3— Mobilités supprimées
4. FAMILLES DE SOLUTION
Les solutions constructives pour réaliser une liaison compléte démontable dépendent de la
nature et de importance des surfaces de contact utilisé dans la mise en position des pices
indépendamment des éléments utilisés pour le maintien position (éléments de serrage).
On regroupe généralement les solutions constructives & partir de leurs surfaces de contact
principal.
Remarque
Les liaisons complétement démontables possédent souvent des surfaces surabondantes afin de limiter
la déformation dela piece
Il nest pas possible de présenter ici toutes les solutions constructives pour réaliser une liaison
complete, nous présenterons simplement dans cette fiche les plus courantes.
29
Fiche 8 « Les liaisons complétes démontables
5. SURFACES DE CONTACT PLAN
La mise en position entre la piéce (1) et la pice (3) est réalisée par
tune surface plane prépondérante. Les mouvements de translation
(1s), (Tz) et de rotation (Ry) sont supprimés par adhérence.
Lavis (2) assure le maintien en position des deux pieces.
Lamise en position entre la pigce (1) et la pice (2) est réalisée par
tune surface plane prépondérante. Les mouverments de translation
(1), (Tz) et de rotation (Ry) sont supprimés par obstacle grace aux
deux pions de positionnement (4).
Les vis (3) assurent le maintien en position des deux pieces.
Lamise en position entre la piéce (1) et la piece (2) est réalisée par
tune surface plane prépondérante. Les mouvements de translation
(Jy), (Tz) sont supprimés par obstacle grace au contact cylindre
sur cylindre (centrage court). Le mouvement de rotation (Rx) est
supprimé par adhérence.
Lavis (3) assure le maintien en position des deux pices.
La mise en position entre la piece (1) et la piece (2) est réalisée par
une surface cylindrique prépondérante. Le mouvement de translation
(Tx) est supprimé par obstacle gréce aux contacts plan sur plan (&pau-
lement). Le mouvement de rotation (Rx) est lui supprimé par obstacle
Vous aimerez peut-être aussi
- Boumaza Imane Et Belal SafiaDocument84 pagesBoumaza Imane Et Belal SafiaYahia ChouakiPas encore d'évaluation
- Fiches Lecture Son Ce1 IpotâmeDocument26 pagesFiches Lecture Son Ce1 IpotâmeYahia ChouakiPas encore d'évaluation
- 11 PuissanceDocument10 pages11 PuissanceYahia ChouakiPas encore d'évaluation
- Chapitre 2Document21 pagesChapitre 2Yahia ChouakiPas encore d'évaluation
- 02 Energie Puissance Cours-BaseDocument6 pages02 Energie Puissance Cours-BaseYahia ChouakiPas encore d'évaluation
- Stockage FroidDocument17 pagesStockage FroidYahia ChouakiPas encore d'évaluation
- Conservation de Pommes BrochureDocument19 pagesConservation de Pommes BrochureYahia ChouakiPas encore d'évaluation
- Composition de MouvementDocument9 pagesComposition de MouvementYahia ChouakiPas encore d'évaluation
- AscenseurDocument4 pagesAscenseurYahia ChouakiPas encore d'évaluation
- Guide Du Dessinateur IndustrielDocument338 pagesGuide Du Dessinateur IndustrielYahia ChouakiPas encore d'évaluation