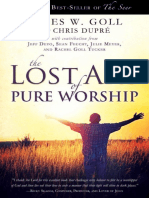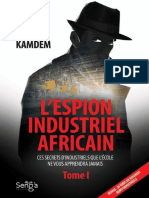Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
1 Presentation Didache
1 Presentation Didache
Transféré par
Religieux ReniseCopyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
1 Presentation Didache
1 Presentation Didache
Transféré par
Religieux ReniseDroits d'auteur :
Formats disponibles
LA DIDACHE - 1 -
De Saint-Marc jusqu'à Tertullien
TOME VII
LA NOUVELLE EGLISE
DIDACHE / L’EGLISE / EXEGESE / LE PROPHETRE
_______________
1992
Jean-Marie GEORGEOT - " De Saint-Marc jusqu'à Tertullien " ( 1978 à 2004 )
LA DIDACHE - 2 -
Jean-Marie GEORGEOT - " De Saint-Marc jusqu'à Tertullien " ( 1978 à 2004 )
LA DIDACHE - 3 -
D I D A C H E
_______________
Page :
Didaché I
Le texte 5
Didaché II
Le chemin 35
Didaché III
Chapitre XV des Actes des Apôtres 59
Didaché IIII
Les trois prières 81
Didaché V
La circoncision 101
Didaché VI
En lisant Josué 121
Didaché I à VI
(N o t e s) 129
_______________
Jean-Marie GEORGEOT - " De Saint-Marc jusqu'à Tertullien " ( 1978 à 2004 )
LA DIDACHE - 4 -
Jean-Marie GEORGEOT - " De Saint-Marc jusqu'à Tertullien " ( 1978 à 2004 )
LA DIDACHE - 5 -
DIDACHE I
L E T E X T E
_______________
Page :
Présentation 5
Convention 5
LE TITRE 6
PREMIERE PARTIE
Chapitre I 6
Chapitre II 8
Chapitres III et IV (le texte / les purifications) 9
Chapitre V 10
Chapitre VI 11
DEUXIEME PARTIE
Chapitre VII (le baptême) 12
Chapitre VII-1 à 3 (l'eau du baptême) 14
Chapitre VII-4 (le jeûne) 16
Chapitre VIII (les hypocrites / le jeûne / le "Notre Père") 16
Chapitre IX (la prière = 'l'eucharistie' le texte / les chiens) 19
Chapitre X (la prière = l'action de grâce') 23
Chapitre XI (le péché contre l'Esprit) 23
TROISIEME PARTIE
Depuis XI-9 jusqu'à la fin 27
QUATRIEME PARTIE
Datation de la Didachè 28
Diverses données 29
_______________
Jean-Marie GEORGEOT - " De Saint-Marc jusqu'à Tertullien " ( 1978 à 2004 )
LA DIDACHE - 6 -
PRESENTATION
_______________
Voici un chapitre écrit pour servir d'apport permettant au lecteur d'avoir
certaines informations sur nos diverses règles de conduite, prières et rites.
Le texte est celui des Sources chrétiennes (248 - 1978).
A seule fin de préparer le lecteur à l'entendement de la présente partie, qu'il
sache déjà que notre conclusion situera le livre de la Didachè comme un écrit
judéo-chrétien datant des années immédiatement après celle durant laquelle fut
écrit le texte de Saint Marc et précédant largement celles qui virent la rédaction
des Actes des Apôtres et des évangiles de Saint Matthieu et de Saint Luc.
_______________
CONVENTION
_______________
Dans ce qui suit, les citations des textes de la Didachè seront présentées par la
lettre 'D.' suivie des références en chapitre et verset conformément à l'édition
des Sources chrétiennes (248).
Les citations de l'évangile de Saint Marc sont présentées comme habituel avec
leurs références en chapitre et verset.
_______________
Jean-Marie GEORGEOT - " De Saint-Marc jusqu'à Tertullien " ( 1978 à 2004 )
LA DIDACHE - 7 -
LE TITRE
DOCTRINE = D I D A C H E
des douze apôtres
DOCTRINE du Seigneur (enseignée) aux nations
par les douze apôtres .
_______________
PREMIERE PARTIE
Chapitres (I - 1 à 6)
D.I-1 Il y a deux voies : l'une de la vie et l'autre de la mort...
D.I-2 Voici donc la voie de la vie : Tu aimeras d'abord Dieu qui
t'a fait (g : agapeseis ton Theon ton poiesanta se), puis ton prochain comme
toi-même (deuteron ton plesion sou ôs seauton) et tout ce que tu ne veux pas
qu'il t'arrive, toi non plus ne le fais pas à autrui (kai su allô me poiei).
Analyse : Immédiatement je lis la puissance des verbes faire et arriver; puis,
ce texte me renvoie au Temple, là-où Jésus se trouve avec un scribe :
Mc XII-30 "Tu aimeras Seigneur ton Dieu" (agapeseis Kurion ton Theon
sou) = il y a, de plus, en Saint Marc, le mot Kurion, comme si le texte de la
Didachè éprouvait une certaine difficulté à aller au-delà de la pure traditionnelle
pensée sémitique. Cependant :
Mc XII-31 "Tu aimeras ton prochain comme toi-même" (agapeseis ton
plesion sou ôs seauton), ce qui est le même texte que dans la Didachè.
Analyse : Il n'y a donc pas, en Saint Marc, l'explication avec le mot faire
comme dans la Didachè. Cette dernière formulation est très sémitique et se
trouve dans un certain nombre de commentaires juifs : apprendre par cœur les
cinq livres de la Tora revient à n'apprendre que le seul commandement de ne pas
faire au prochain ce qu'on ne veut pas qu'il vous fasse à vous-même.
Jean-Marie GEORGEOT - " De Saint-Marc jusqu'à Tertullien " ( 1978 à 2004 )
LA DIDACHE - 8 -
D.I-3 Voici l'enseignement de ces paroles : Bénissez ceux qui
vous maudissent, priez pour vos ennemis et jeûnez pour ceux qui vous
persécutent. Quel mérite y a-t-il, en effet, d'aimer ceux qui vous aiment ?
Les païens eux-mêmes n'en font-ils pas autant ? Vous ! Aimez ceux qui vous
haïssent et vous n'aurez pas d'ennemis.
Analyse : Le lecteur se reportera au lexique (agapaô = aimer = analyse I-2).
Saint Marc et la Didachè n'ont pas écrit textuellement : aimez vos ennemis,
comme l'ont fait Mt (V-44) et Lc (VI-27). Saint Marc dit d'aimer son prochain et
la Didachè commente : priez pour vos ennemis. Si vous savez aimer, vous
n'aurez pas d'ennemi. Le texte, lu de façon méticuleuse, fait apparaître les écarts.
La Didachè est, ici, conforme à ce qui fut écrit en Saint Marc et elle ne va pas
plus loin. Elle ne reprend pas ce qui est en Mt ni en Lc. Je vois ainsi un indice :
l'indice n'est pas la certitude, il est prémisse d'une hypothèse.
Les païens eux-mêmes n'en font-ils pas autant ? : avec le verbe faire
(poiousin). La Didachè établit ainsi un réseau avec ce verbe, en unissant le Dieu
faiseur de toi (= ton Créateur), avec toi qui dois faire seulement ce que tu veux
qu'il te soit fait, et avec les païens qui font d'ailleurs ainsi. Le texte ouvre aux
païens (qui font) le Dieu (faiseur) des juifs (qui doivent faire). Que le lecteur
réalise ! Il y a, ici, un texte très sémitique, de même inspiration que le texte de
Saint Marc.
Notre lecture nous maintient dans une littérature que nous connaissons bien.
D. I-4 Abstiens-toi des désirs charnels et corporels. Si quelqu'un
te donne une gifle sur la joue droite, tends lui aussi l'autre et tu seras
parfait. Si quelqu'un te requiert pour un mille, fais-en deux avec lui. Si
quelqu'un t'enlève ton manteau, donne-lui aussi la tunique. Si quelqu'un te
prend ton bien, ne le réclame pas, car tu ne le peux pas.
D. I-5 Car le Père veut qu'on fasse partager à tous ses propres
dons...
Analyse : Rien de ceci ne semble se trouver dans Saint Marc et la situation
sociale ainsi préconisée rappelle aussitôt le début des Actes des apôtres :
"Et tous ceux qui avaient foi étaient ensemble et avaient tout en commun;
ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et en partageaient le prix entre tous
selon qu'on en avait besoin." (Ac II-44 et 45).
Jean-Marie GEORGEOT - " De Saint-Marc jusqu'à Tertullien " ( 1978 à 2004 )
LA DIDACHE - 9 -
D. I-6 Mais il a été dit aussi à ce sujet : 'Que ton aumône
transpire dans tes mains jusqu'à ce que tu saches à qui tu donnes'. ('Si tu
fais le bien, sache à qui tu le fais et tu recevras grâce pour tes bienfaits' = Siracide
XII-1).
Cependant, je suis dans l'obligation de citer :
Mc X-28 "Pierre commença à lui dire : 'Voici, nous avons tout laissé et nous
t'avons suivi'."
Pierre, à cet instant, sait rappeler le fait à Jésus, mais il ne réclame pas.
Et, avec un sourire, je me rends compte : Si quelqu'un te requiert pour un
mille, fais-en deux avec lui. Je puis en attester, depuis le chemin "le-long-de la
mer de Galilée" (Mc I-16) jusque "sur le chemin" (Mc X-52) à la sortie de Jéricho,
il y eut une multitude de mille et nous l'avons suivi... Quant aux gifles (g :
rapisma = D. I-4), c'est le même mot qu'en Mc (XIV-65).
CHAPITRE (II - 1 à 7)
Ce chapitre présente divers commandements sous la forme NE-PAS + verbe
d'action, très conformes à ce qui est exposé au livre du Lévitique (chapitre XIX).
J'ai noté particulièrement :
D. II-3 ... tu ne porteras-pas-de-faux-témoignage (g : ou pseudo-
martureseis) correspondant à "me pseudomartureses" de Mc (X-19). Les
négations dans la Didachè sont sous la forme ou suivies du verbe actif alors que,
en Saint Marc, il y a : me + verbe actif. La Didachè écrit donc identiquement (au
texte de Saint Matthieu... c. à d. :) au texte de la Septante (Voir Lectio divina par
séquence au chapitre Honore ton père et ta mère (Mc VII-9 et 10) et y lire avec
attention le texte du Décalogue).
Je pense que l'on peut voir ici l'attestation que la Didachè fut écrite par un
judéo-chrétien encore très marqué par sa connaissance du texte (grec) de la Bible
juive. Cette référence ne peut pas se faire dans le texte de Saint Marc, c. à d. : le
texte de la Didachè ne provient pas mot pour mot de l'écrit de Saint Marc.
D. II-6 Tu ne seras ni cupide, ni rapace, ni hypocrite, ni méchant,
ni orgueilleux...
Le mot hypocrite n'a ici que le sens très communément mêlé avec les autres
mots qui l'entourent. Il prendra un sens plus spécifique en D. VIII-1 et 2.
Jean-Marie GEORGEOT - " De Saint-Marc jusqu'à Tertullien " ( 1978 à 2004 )
LA DIDACHE - 10 -
Enfin, j'ai noté quelques touches positives fondues dans cette foule de
prestations négatives :
D. II-5 Ton discours ne sera pas mensonger mais plein d'expé-
rience.
D. II-7 Tu ne haïras personne, mais tu reprendras les uns, tu
prieras pour les autres; d'autres encore, tu les aimeras plus que ton âme.
CHAPITRES III ET IV
1.- Le texte recommence, semblablement au chapitre II qui précède, une suite de
prescriptions négatives mais avec me ou mede + verbe actif. J'ai noté :
D. III-4 Ne t'adonne pas... aux purifications (car cela engendre
l'idolâtrie). Il n'y a aucun commandement positif; l'ensemble des préceptes est
expliqué : cela engendre... ou : cela conduit à...
D. III-7 à 9 Puis viennent des directives positives : Sois doux...
sois patient, miséricordieux... (honnête dans tout ton travail)...
D.III-10 Tu accueilleras, comme des bienfaits, les événements qui
se produisent en sachant que rien n'arrive sans Dieu.
Cette dernière lexie se trouve résumée peu après quelques phrases qui sont
venues pour t'entraîner dans la compagnie des saints :
D. IV-4 Tu ne t'inquiéteras pas de savoir ce qu'il adviendra ou
non.
Ces deux dernières citations présentent comme directive de conduite d'être
toujours disponible, c. à d. plein de foi et de confiance. C'était aussi une
conclusion importante tirée du texte de Saint Marc... et c'est la forme la plus
parfaite de l'Alliance par l'Amour (= avec Dieu-d'Amour).
Le chapitre IV se poursuit par la présentation du don des biens : Si tu
possèdes quelque chose... tu le donneras pour le rachat de tes péchés.. tu
donneras sans murmurer... tu ne commanderas pas (aux tiens) avec
aigreur... (et) vous, les serviteurs, vous serez soumis à vos maîtres... tu
haïras toute impiété... tu confesseras tes fautes... avec la conclusion :
D. IV-14 ... Telle est la voie de la vie.
Jean-Marie GEORGEOT - " De Saint-Marc jusqu'à Tertullien " ( 1978 à 2004 )
LA DIDACHE - 11 -
2.- Sur : Les purifications
D. III-4 Mon enfant, ne t'adonne ni à ... ni à ... ni à l'astrologie, ni
aux purifications... (teknon mou me ginou ... mede ... mede perikathairôn ...).
Je me souviens, ici, du Messie "transfiguré en-présence-de" Pierre, Jacques et
Jean, lui dont les "vêtements arrivèrent resplendissants tout-à-fait blancs" (Mc
IX-2 et 3). J'ai dit comment le blanc est la couleur de l'état purifié (= le Grand
Prêtre dans le Temple à yom kippour, avec ses vêtements (blancs) et le cordon
d'or resplendissant de blanc lorsque arrive le pardon de Dieu).
Dans le texte de Saint Marc, aussitôt après cette manifestation messianique du
blanc sur "une montagne élevée", il y a le regroupement des Douze au pied de la
montagne avec une foule nombreuse, des scribes autour de l'homme et de son
fils malade. Depuis combien de temps ce "petit-enfant" est-il malade ? Le père
répond : depuis son enfance et nulle purification n'a pu aboutir puisque
"souvent aussi (l'esprit-impur) l'a jeté dans le feu et dans l'eau..." (Mc IX-22)
Le texte de la Didachè énonce : tu ne t'adonneras pas à ces (sortes de)
purifications.
CHAPITRE V
D. V-1 Voici maintenant la voie de la mort...
Le passage de l'un à l'autre chapitre est l'indicateur du plan suivi par l'auteur :
les deux voies sont traitées dans deux 'parties' du livre. La deuxième partie parle
de la voie de la mort et se trouve amenée à reprendre la liste des "desseins pires"
(cfr : Mc VII-21). L'énoncé fait en Saint Marc contient douze mots. Dans la
Didachè, il y en a vingt-deux (= le nombre des lettres de l'alphabet hébreu !) et
seulement sept de Mc s'y retrouvent. Cependant pour 'poneriai = méchancetés'
(n° 6), on le trouve peu après dans la Didachè sous la forme de poneron.
Finalement, il manque quatre mots :
n° 8 aselgeia impudence
n° 9 ophtalmos poneros œil méchant
n° 10 blasphemia blasphème
n° 12 aphrosune infamie.
Jean-Marie GEORGEOT - " De Saint-Marc jusqu'à Tertullien " ( 1978 à 2004 )
LA DIDACHE - 12 -
J'ai vu, dans cette partie de la Didachè, deux phrases qui se renvoient l'une à
l'autre et indiquent, de ce fait, que le même auteur les a bien écrites toutes deux :
D. II-2 ... tu ne tueras pas l'enfant par avortement et tu ne le
feras-pas-mourir après la naissance...
D. V-2 ... meurtriers d'enfants, ils font-avorter l'oeuvre de Dieu...
CHAPITRE VI
En quelques lignes se termine ce chapitre des deux voies, d'abord par deux
lexies : ... ne te détourne (pas) de cette voie de la doctrine... (et :) tu seras
parfait, sinon réalise ce que tu peux faire.
Puis vient la ligne suivante, qui paraît comme si elle était ajoutée :
D. VI-3 Pour les aliments, prends avec toi ce que tu pourras, mais
abstiens-toi résolument des viandes offertes aux idoles, car c'est un culte de
dieux morts°. (g : Theôn nekrôn).
Cette dernière expression me fait obligation de rappeler :
Mc XII-27 A Jérusalem, dans le Temple, Jésus leur déclara : Dieu "n'est
pas Dieu de morts°, mais de vivants ! Vous vous égarez beaucoup !" (g : ouk estin
Theos nekrôn).
Il y a dans cette phrase sur beaucoup s'égarer comme un soupir de tristesse
de te voir ne prendre que 'ce que tu pourras' ou aussi de ne 'réaliser (que) ce que
tu peux faire'. C'est la même réflexion, le même jugement. L'expression "dieu de
morts°" égale-t-elle ces 'dieux morts' au sens où elle aurait été d'un usage
courant pour désigner les dieux des cultes païens ?
Il n'y a peut-être pas là des indices suffisants pour établir une parenté directe
entre la Didachè et Saint Marc. De toutes façons, l'ensemble établit solidement
l'isochronisme des textes, mais la structure trouvée dans le texte de Saint Marc
est d'une autre complexité et cohérence que le simple ordonnancement des
phrases de la Didachè.
Jean-Marie GEORGEOT - " De Saint-Marc jusqu'à Tertullien " ( 1978 à 2004 )
LA DIDACHE - 13 -
La liste des vingt-deux mots vient un peu comme une simple énonciation sans
avoir pour but d'évoquer directement la liste des six pluriels, puis des six
singuliers de Mc (VII-21 et 22).
L'ordre suivi par le texte dans la Didachè est de nature compositionnelle et a
pour raison d'être facilement mémorisable. Il n'y a pas le développement de
fondements théologiques ou moraux. Rien ne semble s'opposer dans ce qui y est
présenté à ce que l'on puisse donner à ce texte une origine juive ou judéo-
chrétienne. Certaines phrases sont peut-être adressées plus spécifiquement à des
gens proches du paganisme, mais ne serait-ce pas pour simplement mettre en
garde les juifs contre des comportements païens glissant vers l'immoralité ? La
religion juive n'est pas une religion conquérante et elle ne se veut jamais vouée à
la conversion des hommes des nations (= les non-fils d'Israël).
Le livre des Deux voies est un traité de morale. Il ne dit pas encore qui fut
Dieu-Incarné, ni même s'il est venu. Pourtant, j'ai trouvé de nombreux points
communs entre ce texte et celui de Saint Marc. Pas assez pour établir autre chose
qu'une hypothèse encore bien floue, assez cependant pour m'obliger à poser / au
moins / un point d'interrogation : ?
Cependant je note une chose : l'auteur de la Didachè est un homme d'origine
sémitique et d'une culture identique à celle de celui-là (ceux-là ?) qui écrivit
(écrivirent ?) le texte selon Saint Marc.
DEUXIEME PARTIE
CHAPITRE VII : LE BAPTEME
Voici la deuxième partie de la Didachè. Elle va décrire des rites nouveaux :
D. VII-1 à 3 le baptême
D. VII-4 et VIII-3 le jeûne
D. VIII-2 la prière (= Notre Père)
D. IX-1 à 5 l'eucharistie
D. X-1 à 7 l'action de grâce.
Cette deuxième partie du texte est donc un livre rituel pour cette nouvelle
église : l'Eglise du Christ.
Jean-Marie GEORGEOT - " De Saint-Marc jusqu'à Tertullien " ( 1978 à 2004 )
LA DIDACHE - 14 -
Ceci ressort notamment des citations suivantes :
D. VII-1 ... vers le nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit
Issu de Mc I-10 et 11 : il y a la Trinité de Dieu.
D. VIII-2 Notre Père qui au ciel...
Cfr : Mc XI-25 : le Dieu-Unique.
D. IX-1 Pour l'eucharistie, eucharistez ainsi...
(g : peri de tes eucharistias autôs eucharistesate) : C'est le mot-clé arrivé
deux fois en Saint Marc.
Pour la coupe : D. IX-2 et Mc XIV-23,
pour le pain : D. IX-3 et Mc VIII-6.
D. IX-2 et 3 ... par Jésus ton serviteur...
Cfr : Mc - X-45.
D. IX-4 ... par Jésus-le-Messie... (dia Iesou Christou)
Cfr : Mc I-1.
D. X-6 Hosanna au Dieu (= l'Elohim ?) de David !
Cfr : Mc XI-10 (Mc = "ôsanna"... D. = tô Theô David).
Ces extraits du texte apparaissent à la deuxième partie de la Didachè et lui
donnent la puissance et la gloire d'un livre nouveau. Ils se référent tous
directement au texte de Saint Marc = la deuxième partie de la Didachè est un
livre dogmatique.
(A partir de D. XI-1 commence la troisième partie.)
Jean-Marie GEORGEOT - " De Saint-Marc jusqu'à Tertullien " ( 1978 à 2004 )
LA DIDACHE - 15 -
CHAPITRE (VII - 1 à 3)
D. VII-1 Pour le baptême, baptisez de cette manière : après avoir
dit auparavant tout ce qui précède (= après avoir rappelé à celui que vous
allez baptiser tout ce qui précède dans le présent texte : c. à d. après lui avoir dit
comment doit être fréquentée et vécue la voie de la vie) baptisez vers le Nom
du Père et du Fils et du Saint-Esprit dans de l'eau courante.
Analyse : Car Jésus "fut baptisé vers le Jourdain" (Mc I-9) de la façon dont
"tout le pays (de) Judée et tous les habitants-de-Jérusalem étaient baptisés... dans
le fleuve Jourdain" (Mc I-5).
Le fleuve est l'eau courante qui apporte la vie car elle est mouvement. La
première partie va d'ailleurs faire sans cesse référence à l'eau :
mer de Galilée immobilité disponibilité
fleuve Jourdain mobilité l'action.
Mc I-10 et 11 "Et aussitôt en montant hors de l'eau (Jésus) vit les cieux se
déchirer et l'Esprit comme une colombe... Et une voix (arriva) hors des cieux : 'Toi, tu es
mon Fils, le Bien-Aimé...'."
Mc XIV-36 A Gethsémani : "il disait : Abba ! ô° Père...".
Ainsi le texte de Saint Marc est le premier texte écrit fixant la Trinité : Esprit,
Fils et Père (= la voix qui dit : "Mon Fils !").
Le texte de D. VII-1 est semblablement le premier texte écrit fixant la formule
rituelle : baptisez vers le Nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit.
D. VII-2 Si tu n'as pas d'eau courante, baptise dans une autre eau
et, si tu ne peux pas dans de l'eau froide, dans de l'eau chaude.
Analyse : Se reporter au chapitre Des rites de purification, dans la Lectio
divina pour la séquence (VII-1 à 5). La règle de pureté s'y trouve évoquée : les
juifs doivent se purifier pour les actes importants de la vie, c’est dire qu'ils
doivent faire une immersion rituelle dans une piscine appelée miqveh.
Jean-Marie GEORGEOT - " De Saint-Marc jusqu'à Tertullien " ( 1978 à 2004 )
LA DIDACHE - 16 -
Le texte D. VII-2 donne pour consigne, au cas où l'on ne pourrait être baptisé
dans l'eau courante (c. à d. un cours d'eau, comme le fleuve Jourdain), de
s'immerger dans de l'eau froide (= un lac, comme la mer de Galilée, grande
réserve d'eau immobile) ou, sinon, dans de l'eau chaude (= l'eau du miqveh,
cuve-piscine installée dans la maison avec de l'eau à une température
sensiblement constante, mais plus chaude que celle du-dehors. Se rappeler la
séquence Sur une cruche d'eau (Lectio divina pour le verset XIV-13).)
D. VII-3 Si tu manques de l'une et de l'autre (c. à d. si tu n'es pas à
proximité d'un cours d'eau, d'un lac ou si ta maison ne possède pas de miqveh-
piscine), verse trois fois de l'eau vers la tête (eis ten kephalen) vers le Nom du
Père et du Fils et du Saint-Esprit (eis onoma patros...).
Analyse : Je n'ai pas besoin d'expliciter trois fois puisque le texte explique
aussitôt : Père + Fils + Esprit, et ceci signifie : la Trinité. Mais j'ai pensé à :
Mc XIV-3 "Une femme, en ayant un flacon-d'albâtre d'un parfum de nard
authentique, versa sur sa tête" (autou tes kephales) avec aussitôt : "elle a pris-
d'avance de parfumer mon corps vers l'embaumement" (Mc XIV-8). Le lecteur
remarquera que verser sur la tête a la même valeur que verser sur lui quant à la
tête, c. à d. revient à la même valeur que d'immerger tout le corps. Le geste sur
la tête purifie (= parfume) le corps qui arrive pour une vie nouvelle. C'est
pourquoi la liturgie du baptême retient de verser vers la tête lorsqu'il ne peut y
avoir suffisamment d'eau disponible pour l'immersion.
Le lecteur notera l'évolution du rituel. Alors que l'eau du miqveh doit toujours
être pure et ne peut être ré-approvisionnée que par le seul moyen d'une eau
coulant naturellement (c. à d. : offerte par la main de Dieu), le baptême peut,
dans les cas extrêmes, être donné avec de l'eau puisée avec un seau ou tout autre
récipient. Le rite juif de l'eau rituellement pure évolue vers le rite d'une
(quelconque) eau pour le baptême des hommes des nations (= juifs et païens,
tous les hommes). Il est facile d'en comprendre la raison en posant l'hypothèse
que le texte de la Didachè est destiné à l'enseignement aussi des nations (voir le
titre). En effet, pour des païens, il ne peut y avoir que de l'eau courante
(= fleuve) ou immobile (= lac ou mer). Les païens ne connaissent pas les
piscines (juives) de purification (h: miqveh), celles-ci n'existant que dans des
maisons juives. Il est donc nécessaire d'instituer un règlement nouveau pour
l'eau du baptême.
Jean-Marie GEORGEOT - " De Saint-Marc jusqu'à Tertullien " ( 1978 à 2004 )
LA DIDACHE - 17 -
Ainsi le baptême des judéo-chrétiens se démarque-t-il de celui donné par Jean-
le-Baptiste ou des autres baptêmes juifs pouvant exister au temps des premières
années de l'ère chrétienne.
CHAPITRE (VII - 4)
D. VII-4 Que celui qui baptise, le baptisé et d'autres personnes qui
le peuvent jeûnent avant le baptême, mais ordonne au baptisé de jeûner un
jour ou deux auparavant.
Analyse : Le texte est : pro de tou baptismatos pronesteusatô o baptizôn... et
ceci m'a rappelé :
Mc I-4 g : egeneto Ioannes o baptizôn... = "arriva Jean celui-qui-baptise".
Or, ce Jean est un homme qui jeûne durant les temps où il baptise, puisque :
Mc I-6 "... (il) mangeait des sauterelles et du miel sauvage".
Voir également, ci-dessous, le chapitre D. VIII : sur le jeûne.
CHAPITRE VIII
1.- Sur : les hypocrites
D. VIII-1 Que vos jeûnes n'aient pas lieu en même temps que ceux
des hypocrites (g : meta tôn upokritôn). Ils jeûnent en effet le deuxième et le
cinquième jour de la semaine; vous donc jeûnez le quatrième jour et le jour
de la Préparation.
D. VIII-2 Ne priez pas non plus (g : mede pros-euchesthe) comme les
hypocrites (g : ôs oi upokritai), mais comme le Seigneur vous l'a ordonné
dans son évangile...
Mc VII-6 "Isaïe a bien prophétisé au sujet de vous, les hypocrites, comme (il)-est-
écrit : 'Ce peuple-là m'honore des lèvres, or leur cœur est éloigné (loin) de moi'."
Jean-Marie GEORGEOT - " De Saint-Marc jusqu'à Tertullien " ( 1978 à 2004 )
LA DIDACHE - 18 -
Analyse : Discours et argutie, fallacieux raisonnements et fausse-vérité !
(Voir, dans le lexique, le mot hypocrites) : les hypocrites ont une conduite "non-
pas" comme le Seigneur.
Mc XII-15 Voici que viennent "auprès de lui quelques-uns des pharisiens et des
hérodiens" (XII-13) pour lui poser la question de l'impôt à César. Jésus, "sachant
leur hypocrisie", leur répond...
Les hypocrites sont tous ceux-là, juifs de Jérusalem qui, face au Messie
refusent de voir et d'entendre et ont un comportement contraire à toute (vraie) foi
(= vraie, car la Vérité est Unique).
2.- Sur : le jeûne
Mc II-20 "Or viendront des jours quand l'époux sera arraché d'eux. Et alors ils
jeûneront en ce jour-là."
Le jour au cours duquel le Messie fut arraché à la vie fut celui dont le texte
nous a dit : "Et, comme déjà le soir était arrivé, puisque (c') était la Préparation, c'est à
dire : l'avant-sabbat..." (Mc XV-42). Depuis ce jour, les disciples de Jésus jeûnent
le jour de la semaine qui est le jour de la Préparation (D. VIII-1).
Mc II-18 "Et on dit à Jésus : 'En-raison-de-quoi... les disciples des pharisiens (= les
hypocrites, voir ci-dessus) jeûnent-ils ? Or les disciples, les tiens, ne jeûnent pas !'."
La Didachè rappelle que les pharisiens jeûnaient le deuxième et le cinquième
jour de la semaine. Si "le (jour) un des sabbats"... est le lendemain du sabbat
("comme le soleil se-levait" = Mc XVI-2), les jours de jeûne des pharisiens sont le
lundi (= 2) et le jeudi (= 5). La Didachè instaure une règle nouvelle pour ceux
qui reconnaissent le Messie : le mercredi (= 4) et le vendredi (= la ·Préparation).
Ainsi est instituée la règle nouvelle annoncée par le texte de Mc (II-18 à 22).
Analyse : La présente analyse est de la plus haute importance car elle présente
une corrélation directe entre les deux textes, celui de la Didachè et celui de Saint
Marc. La nouvelle liturgie du jeûne est écrite ici pour la première fois et le texte
de la Didachè suggère l'origine de cette institution du jeûne comme se référant à
des données écrites dans le texte de Saint Marc.
Jean-Marie GEORGEOT - " De Saint-Marc jusqu'à Tertullien " ( 1978 à 2004 )
LA DIDACHE - 19 -
Il est à remarquer que le texte de la Didachè n'impose pas de pratiquer le jeûne
régulièrement chaque semaine ni deux jours toutes les semaines. Il est écrit :
Que vos jeûnes n'aient pas lieu... ce qui semble indiquer : lorsque vous
jeûnerez, ne le faites pas le lundi ou le jeudi comme font les autres, mais le
mercredi et le vendredi : ce sont pour vous deux jours de tristesse car on LUI a
fait(1) autant-qu'on a voulu, selon ce qui est écrit à propos de lui (cfr : Mc IX-13).
Relire ce qui, ci-dessus, est relatif à D. VII-4.
3.- Sur : le "Notre Père"
D. VIII-2 La fin de ce verset expose l'intégralité de la prière du "Notre
Père" : Ne priez pas non plus comme les hypocrites, mais comme le Seigneur
vous l'a ordonné dans son évangile (= c. à d. : priez non pas du bout des lèvres,
mais avec tout votre cœur, ou encore : de toute votre intelligence(2), ainsi que
l'a dit le prophète Isaïe). Priez de cette manière :
Notre Père qui dans le ciel...
............
Car c'est à LUI que sont
la Puissance et la Gloire
dans les siècles.
D. VIII-3 Priez de cette manière trois fois le jour.
Analyse : En ce qui concerne le fait de prier trois fois le jour, le lecteur se
reportera à Lectio divina par verset, aux lieux du texte dans lesquels Jésus prie
(I-35 / VI-46 / IX-29 /...). Il y vérifiera que les juifs priaient trois fois le jour (g :
tris tes emeras), mais aussi une fois la nuit (entre le crépuscule et l'aube du
lendemain).
La Didachè dit de prier trois fois; ce n'est pas quatre, mais cela est durant le
jour. Nouvelle règle pour les judéo-chrétiens qui vont, ainsi, se démarquer du
judaïsme traditionnel ? Je dois noter cependant que, après l'an 70, il n'y eut plus
les trois sacrifices pratiqués quotidiennement dans le Temple. Les juifs, alors en
diaspora, les remplaceront par trois prières échelonnées le long de la journée.
Jean-Marie GEORGEOT - " De Saint-Marc jusqu'à Tertullien " ( 1978 à 2004 )
LA DIDACHE - 20 -
Je pense que, chronologiquement, on peut ordonner diverses informations
comme suit :
au temps de Jésus, on prie trois fois durant la journée et une fois entre le
crépuscule et l'aube,
dans le Temple, il y a trois sacrifices dans le cours de la journée,
pour la Didachè, les judéo-chrétiens, ne sacrifiant pas dans le Temple,
doivent prier de cette manière trois fois le jour,
après l'an 70, Le Temple étant détruit, les juifs orthodoxes hors de
Jérusalem (nouvelle diaspora) décident de prier également trois fois le jour en
mémoire des sacrifices offerts dans le Temple, comme l'ont fait les juifs
depuis la déportation ordonnée par Nabuchodonosor.
Pour ce qui concerne le "Notre Père", j'ai reporté le texte et l'analyse dans le
chapitre Les trois prières (voir infra) et ce, pour des raisons de similitude dans
les énonciations.
CHAPITRE IX
1.- Les textes
D. IX-1 Pour l'eucharistie, rendez-grâce de cette manière
(peri de tes eucharistias autôs eucharistesate).
D. IX-2 D'abord pour la coupe : Nous te rendons grâce notre Père
(Pater emôn).
D. IX-3 Puis pour le pain rompu : Nous te rendons grâce notre
Père
(Pater emôn).
D. IX-4 Car c'est à toi que sont la Gloire et la Puissance
par Jésus Christ, dans les siècles.
D. IX-5 Que personne ne mange ni ne boive de votre eucharistie,
sauf ceux (qui sont) baptisés vers le Nom du Seigneur (eis onoma Kuriou) car
à ce sujet(3) le Seigneur (g : o Kurios) a parlé :
'Ne donnez pas ce qui est saint aux chiens'.
Jean-Marie GEORGEOT - " De Saint-Marc jusqu'à Tertullien " ( 1978 à 2004 )
LA DIDACHE - 21 -
2.- Une affaire de 'chiens'
Lorsqu'un texte interroge son lecteur, celui-ci doit d'abord reprendre le texte
d'origine (ici : le texte grec). Il y a :
D. IX-5 gar peri toutou eireken o Kurios :
'me dôte to agion tois kusi'.
Ce texte fait obligation de venir à :
Mt VII-6 'me dôte to agion tois kusin'.
qui est une parole du Seigneur, venant dans l'évangile de Mt parmi des
nombreuses paroles rassemblées pêle-mêle dans un même chapitre. Je note
aussitôt :
1. le mot chiens(4) est au pluriel,
2. il y a kusiN (Mt) et kusi (D.),
3. la Didachè précise que le Seigneur a parlé, alors que je n'ai pas
rencontré cette parole dans le texte de Saint Marc. Il me faut donc étudier pour
chercher une explication.
Ma première recherche doit, conformément à mes acquis, se tourner vers le
texte de la Tora. Qu'en est-il des chiens ?
Dans la Tora, il y a trois emplois de ce même mot grec 'g : kuôn = chien' :
1.- Exode XI-7 'Contre tous les fils d'Israël, pas un chien ne pointera sa
langue, ni contre les hommes, ni contre les bêtes, afin que vous sachiez que YHVH
distingue entre l'Egypte et Israël.'
Ainsi, le chien représente la méchanceté (ou : la pourriture) de l'Egypte à
l'encontre du peuple d'Israël. Le mot grec est : kuôn.
2.- Exode XXII-30 'Vous serez pour moi des hommes de sainteté : vous ne
mangerez pas de la chair d'une bête mise en pièces dans la campagne; vous la jetterez au
chien.'
Le chien représente, ici encore, la bête tout au plus capable de manger (= un
mot théologiquement important) la chair d'une bête trouvée dans la campagne
(ou : la pourriture). Le mot grec est : kuni.
3.- Deutéronome XXIII-18 et 19
'Il n'y aura pas de prostituée sacrée (h : qadeshah) parmi les filles d'Israël et il
n'y aura pas de prostitué sacré (h : qadesh) parmi les fils d'Israël.
Tu ne laisseras pas entrer dans la maison de YHVH, pour un vœu quelconque, le
cadeau d'une pute ni le salaire d'un chien car tous deux sont une abomination pour
YHVH-ton-Elohim.' Le mot grec est : kunos.
Jean-Marie GEORGEOT - " De Saint-Marc jusqu'à Tertullien " ( 1978 à 2004 )
LA DIDACHE - 22 -
Il y a lieu de noter aussitôt le balancement des expressions prenant en charge
tour à tour la femme et l'homme :
qadeshah la prostituée-sacrée / la pute + le cadeau;
qadesh le prostitué -sacré / le chien + le salaire.
Ceci m'a incité à revenir dans le texte de Saint Matthieu, car :
Mt VII-6 "Ne donnez pas aux chiens ce qui est saint
et ne jetez pas vos perles devant les cochons..."
avec :
qodasha les perles
Q-D-Sh (ce qui est) saint.
Le texte de Saint Matthieu exprime, en formulation sémitique, la similitude
entre cochons et chiens (tous deux au pluriel) et ces animaux sont : la pourriture.
Le lecteur se rappellera le pluriel des porcs dans la séquence du gérasénien.
Ensuite : (en Mt), la parole de Jésus vise à présenter une deuxième relation de
proximité (sémitique) avec les deux mots : perles et saint.
Ainsi, le chien devient le mâle-prostitué-sacré et il est associé (en Mt) à la
femme-prostituée-sacrée; tous deux viennent témoigner des mœurs emplies de
pourriture des religions païennes (cfr : les régions de Tyr : encore un pluriel !) et
attestent de la relation d'exclusion entre "les chiens" et "manger ce qui est
SAINT".
Une question demeure : il y a un écart d'une lettre entre les formules grecques
de la Didachè et Saint Matthieu. Peut-il y avoir, en cela notamment, quelque
explication pouvant confirmer (ou : infirmer ?) l'hypothèse que Saint Matthieu
aurait emprunté sa parole au texte (considéré, dans cette hypothèse, comme pré-
existant) de la Didachè ? Mais un fait nouveau intervient : notre connaissance
des chiens s'est accrue et nous permet de lire, d'une manière neuve, la séquence
Mc (VII-24 à 30) relative à la femme grecque et syrophénicienne de race. Cette
femme habite les régions de Tyr et pourquoi ne pourrions-nous (au moins pour
un instant) la considérer comme étant une prostituée-sacrée ayant une (certaine)
perception de la notion de chien? Je te laisse, ô lecteur, le soin de re-garder
"dessous la table".
Puis, ami, tu considéreras comment le récit vient avec cette femme syro-
phénicienne dans un espace de temps fort réduit avant la deuxième
multiplication des pains (Mc VIII-1 à 9). Il n'y a que douze phrases (= douze fois
'kai') à franchir entre les deux, juste le temps de recevoir l'entendre et le parler
correctement grâce à la guérison du sourd et bègue.
Jean-Marie GEORGEOT - " De Saint-Marc jusqu'à Tertullien " ( 1978 à 2004 )
LA DIDACHE - 23 -
Alors, j'entends Jésus-le-Messie parler à la femme-grecque-syrophénicienne.
IL aurait pu lui dire : 'il n'est pas bon de donner du pain à un chien', et il aurait
(presque) repris le texte de l'Ecriture. Or elle, grecque et syrophénicienne, n'est
pas de culture sémitique. Elle a, autour d'elle, les dieux païens : nombreuses
pièces(5) divines (= le morcellement des dieux ou encore : le pluriel) et peut-être
est-elle de cette sorte de femmes... (prostituées = le jeu de leur identité offerte à
un pluriel d'hommes)... puisque, à coup sûr, elle n'est pas une fille d'Israël (cfr :
Dt XXIII-18) ?
Aussi Jésus lui parle un langage qu'elle peut comprendre et il dit : pain, il n'est
pas beau (= l'expression que souvent on dit aux petits-enfants), enfants et petits-
chiens. Il dit aussi : jeter, mais il ne lui parle pas de donner ce qui est saint à
un chien, ce qui serait un langage inconnu et incompréhensible pour la femme.
Celle-ci a bien entendu, car Jésus lui a parlé comme à une femme bonne
ménagère(6) chez elle (= celle qui consacre précieusement son identité à sa
maison et à son ménage).
La femme répond en dépassant les mots, mais dans le même langage : petits-
chiens, petits-enfants, manger (et balayer les) miettes (qui tombent) dessous la
table. La femme montre qu'elle a entendu juste et qu'elle parle correctement des
choses de son ménage. Et c'est pour ce motif que le texte de Saint Marc utilise le
pluriel pour des chiens devenant toujours les petits-chiens quand ils sont à jouer
avec les petits-enfants.
La Tora est LE texte inspiré du Dieu-Unique des juifs. Or elle ne considère
que LE chien (au singulier). La femme, confrontée à la multiplicité de ses dieux
païens, avait besoin, pour comprendre, qu'il lui soit parlé des petits-chiens (au
pluriel).
3.- Prière pour l'eucharistie
De même que pour le "Notre Père", j'ai reporté le texte et l'analyse de cette
deuxième prière dans le chapitre sur Les trois prières.
Jean-Marie GEORGEOT - " De Saint-Marc jusqu'à Tertullien " ( 1978 à 2004 )
LA DIDACHE - 24 -
CHAPITRE X
D. X-1 Après vous être rassasiés, rendez-grâce de cette manière...
D. X-2 à 6 (C'est le texte de la prière : voir ci-dessous dans le chapitre
sur Les trois prières.)
D. X-7 Laissez les prophètes rendre-grâce autant-qu'ils
voudront.
Analyse : Pour comprendre ce dernier verset, j'ai regardé le verbe 'g : thelô =
vouloir', puis j'ai lu :
Mc III-35 "Qui fera la volonté de Dieu (g : thelema tou Theou), celui-ci est pour moi
frère et sœur et mère."
Et j'ai entendu Boan-Ergès dire à Jésus :
Mc X-35 "Maître, nous voulons (g : disdaskale, thelomen...)..."
Et encore :
Mc XIV-7 "Et, quand vous le voudrez (g : kai otan thelete), vous pourrez leur faire
(du) bien.".
Donc : si certains sont prophètes (= des hommes avec honneur, cfr : Mc VI-4...
et aussi : des hommes° justes et saints, cfr : Mc VI-20 et XI-32), qu'ils rendent-
grâce comme ils "voudront", avec la liberté, pour eux, d'user du verbe vouloir
dans le sens retenu par celui-là (ceux-là) qui écrivit (écrivirent) le texte de Saint
Marc.
CHAPITRE XI
1.- Versets 1 ET 2
D. XI-1 Si quelqu'un vient pour vous enseigner tout ce qui a été
dit précédemment, accueillez-le.
C'est, en forme de miroir, la formule de l'envoi en mission :
Mc VI-7 et 10 et 30 "Et il commença à les envoyer deux (par) deux... Là-où vous
entrerez vers une maison, demeurez-là... Et ils (reviennent rendre compte à Jésus et ils)
lui annoncèrent... autant-qu'ils avaient enseigné."
Jean-Marie GEORGEOT - " De Saint-Marc jusqu'à Tertullien " ( 1978 à 2004 )
LA DIDACHE - 25 -
D. XI-2 Mais si l'enseignant lui-même se met à enseigner un autre
enseignement (o didaskôn ... didaske ... didachen) pour détruire, ne l'entendez
pas(7) ... (me autou akousete). (Et c'est encore la formule en miroir de :
Mc VI-11 "Si pas-même ils ne vous entendent ..." (mede akousôsin umôn).)
... Si c'est au contraire pour accroître la justice et la connaissance
du Seigneur (gnôsis Kuriou), accueillez-le comme le Seigneur. (dexasthe auton
ôs Kurion). ((Et je retouve ce même verbe grec :
Mc VI-11 "... si un lieu ne vous accueillait pas..." (me dexetai umas).
Ici encore le texte de la Didachè semble écrit en corrélation étroite avec le
texte de Saint Marc, ce qui dépasse le simple hasard.))
2.- Versets 3 à 6
D. XI-3 Pour les apôtres et les prophètes, selon le précepte de
l'évangile, agissez de cette manière :
D. XI-4 Que tout apôtre qui vient chez vous soit accueilli comme
le Seigneur,
D. XI-5 mais il ne demeurera qu'un seul jour et, si besoin est, le
jour suivant. S'il demeure trois jours, c'est un faux-prophète.
(g : pseudo-prophetes).
D. XI-6 A son départ, que l'apôtre ne reçoive rien en dehors du
pain pour l'étape. S'il demande de l'argent, c'est un faux-prophète.
2.1 Le mot 'apôtre'
Mc VI-7 "Et il commença à les envoyer deux (par) deux" (apostellein duo duo).
Mc VI-30 "Et les apôtres (o apostoloi) s'assemblent auprès de Jésus..."
2.2 Les consignes
Mc VI-8 "Qu'ils ne lèvent rien vers (le) chemin sinon un bâton seulement, pas de
pain... pas de monnaie-de-bronze."
Mc VI-10 "La-où vous entrerez, vers une maison, demeurez-là jusqu'à-ce-que vous-
sortiez de-là."
Jean-Marie GEORGEOT - " De Saint-Marc jusqu'à Tertullien " ( 1978 à 2004 )
LA DIDACHE - 26 -
3.- Verset 7
3.1 Sur : l'Esprit
D. XI-7 Par ailleurs, vous n'éprouverez aucun prophète qui parle
sous l'inspiration de l'Esprit et vous ne le jugerez pas non plus...
Mc I-24 L'homme en esprit-impur s'écrie en disant : "Quoi (entre) nous et toi,
Jésus nazarénien ? Es-tu venu nous perdre ? Je sais qui tu es toi : le Saint de-le Dieu."
Analyse : Car Jésus, montant hors de l'eau du fleuve Jourdain, avait vu
"l'Esprit comme une colombe descendre-et-rester-vers lui" (I-10).
Jésus parlait sous l'inspiration de l'Esprit "car il était en les enseignant comme
ayant autorité" (I-22). L'homme (en esprit-impur) étant (entré) dans leur
synagogue afin de l'éprouver et disant : "Es-tu venu nous perdre ?", il prononçait
à l'encontre de Jésus un jugement.
3.2 Sur le péché contre l'Esprit-Saint
D. XI-7 ... car tout péché sera effacé, mais ce péché-là ne le sera
pas.
Analyse : Dans le texte de Saint Marc, à la suite de la séquence dans la
synagogue avec l'homme à l'esprit-impur, il y a presque aussitôt l'entrée en scène
des scribes qui lancent le défi du paralytique glissé par le toit.
Il y a aussi les paroles qu'ils disent en leur cœur et ils prononcent à l'encontre
de Jésus un jugement : "... il blasphème ! Qui peut effacer des péchés sinon
Unique le Dieu ?" (II-7). Le texte reste bien dans le sens exposé par le
commencement du verset D. XI-7.
Puis, presque aussitôt, il y a : "Tout sera effacé aux fils des hommes... or, qui
blasphèmera vers l'Esprit-Saint, il n'y a pas de pardon vers le siècle-à-venir mais
il est coupable d'une faute éternelle" (Mc III-28 et 29).
Cette condamnation est reprise dans le verset D. XI-7 avec les mêmes mots
grecs.
Jean-Marie GEORGEOT - " De Saint-Marc jusqu'à Tertullien " ( 1978 à 2004 )
LA DIDACHE - 27 -
4.- Verset 8
D. XI-8 Tout homme qui parle sous l'inspiration de l'Esprit n'est
prophète en effet que s'il a les façons de vivre du Seigneur. On reconnaîtra
donc à leurs façons de vivre le faux-prophète et le prophète (o pseudo-
prophetes kai o prophetes).
Analyse : J'ai consacré l'un de mes chapitres (voir : UN = prophète ?) à
l'étude de la notion de prophète dans le texte de Saint Marc. Je ne savais pas,
alors que je l'écrivais, combien il deviendrait le commentaire le plus complet
pour ce verset de la Didachè. L'ensemble du texte de Saint Marc peut être
considéré comme étant le témoignage rendu au Seigneur (= Kurios) venu vivre
en homme pour s'offrir comme modèle à tout homme. Il fut pleinement Dieu et
il fut pleinement homme. Les grands-prêtres, les anciens, les scribes et bien
d'autres encore n'ont vu en lui qu'un faux-prophète et ont toujours été saisis-de-
stupeur devant ses paroles et ses actes.
Les mots prophète et faux-prophète sont à prendre au sens qu'ils ont dans la
Tora (donc aussi dans le texte de Saint Marc).
TROISIEME PARTIE
DEPUIS XI - 9 JUSQUE LA FIN
D. XI-9 Je néglige ce verset car il a des présentations divergentes.
D. XI-10 Et tout prophète, qui enseigne la vérité sans mettre en
pratique ce qu'il enseigne, est un faux-prophète.
D. XI-11 En revanche, tout prophète éprouvé, vrai, qui agit en vue
du mystère de l'église dans le monde mais qui n'enseigne pas de faire tout ce
qu'il fait lui-même, ne sera pas jugé chez vous car c'est avec Dieu qu'il a son
jugement. C'est en effet de cette manière qu'agirent également les anciens
prophètes.
Jean-Marie GEORGEOT - " De Saint-Marc jusqu'à Tertullien " ( 1978 à 2004 )
LA DIDACHE - 28 -
D. XI-12 Mais quiconque vous dit, sous l'inspiration de l'Esprit :
donne-moi de l'argent ou quelque autre chose, vous ne l'écouterez pas. En
revanche, s'il vous sollicite pour d'autres qui sont dans le besoin, que
personne ne le juge.
Analyse : Le texte de D. XI-10 à 12 est un développement des deux versets D. XI-7
et 8 qui précèdent. Il montre l'importance mise par celui qui écrivit la Didachè
dans la prise en compte de tout prophète au temps de Jésus, avec cette attention
extrême que l'on doit porter sur : sur son enseignement de la vérité et son agir.
Pour celui qui connaît le texte de Saint Marc, il n'y a là rien de nouveau, sinon
la prise en charge de :
Mc XIII-22 ...car se réveilleront... de faux-prophètes... pour provoquer
l'égarement.
La référence au prophète a d'ailleurs été bien fixée par :
Mc VII-6 "Isaïe a bien prophétisé...".
Le verset D. XI-12 revient sur la question de l'argent qui a déjà fait l'objet d'un
commandement en D. XI-6 : ...s'il demande de l'argent, c'est un faux-
prophète.
Ceci m'oblige à rappeler :
Mc XII-38 et 40 Et... il disait : « Re-gardez aux scribes... qui dévorent les maisons
des veuves ! ».
Finalement, ces versets D. XI-10 à 12 sont de simples commentaires de ce qui a
été écrit auparavant. Puis-je les considérer comme étant d'une rédaction
postérieure et venant en forme d'introduction aux chapitres XII à XVI de la
Didachè ?
Ceux-ci, je ne les commenterai pas. Lors de ma lecture, j'ai cru rencontrer, en
pénétrant en eux, comme une nappe de brouillard plus ou moins épais, dont
parfois émerge la grisaille d'une forme (= un mot isolé reconnu au passage
lorsqu'il existe aussi dans le texte de Saint Marc).
Jean-Marie GEORGEOT - " De Saint-Marc jusqu'à Tertullien " ( 1978 à 2004 )
LA DIDACHE - 29 -
L'entrée dans cette zone grisâtre se fait par :
D. XII-1 Que toute personne qui vient au Nom du Seigneur soit
accueillie... (g : dexthetô)... et c'est le verbe de D. XI-1, comme de Mc VI-11. Cela
ne me suffit pas, car le passage venant à ce moment présente une suite de
consignes valables pour un groupe (= une paroisse, une église) déjà organisé
(ou : en cours d'organisation). Si celui qui vient... (agit de telle façon que...),
c'est un trafiquant du Christ : gardez-vous des gens de cette espèce (D. XII-2
et 5). Ce n'est pas là une lexie issue du texte de Saint Marc. C'est, par contre, une
indication donnée dans un but particulièrement précis : c'est l'article d'une Règle
de vie.
Ainsi en est-il pour :
D. XIV-1 Le jour dominical du Seigneur (= donc : le dimanche),
rassemblez-vous pour rompre le pain...
QUATRIEME PARTIE
DATATION DE LA DIDACHE
Arrivés à ce point, pour notre connaissance de la Didachè, nous nous devons
de regarder les données actuelles relativement à l'origine de ce texte :
‘En fait, la critique patristique préfigure à cet égard les conclusions
de la critique moderne. Sans contester l'ancienneté de la Didachè, elle refuse
l'attribution de l'ouvrage au collège apostolique et elle nous fournit de cette
manière des indications précieuses sur les origines du texte. Comme
l'enseignement des Deux voies... la Didachè est issue des premières générations
chrétiennes...
L'auteur de la Didachè appartient vraisemblablement à cette hiérarchie
itinérante de la primitive église qui a tant contribué à la diffusion de l'évangile et
de l'apostolat missionnaire.’
(Introduction à la Didachè)
(Sources chrétiennes 248 - page 127)
Jean-Marie GEORGEOT - " De Saint-Marc jusqu'à Tertullien " ( 1978 à 2004 )
LA DIDACHE - 30 -
DIVERSES DONNEES
1.- En 1873 on découvre à Constantinople un manuscrit transféré en 1887 à
Jérusalem et connu depuis sous la référence Hierosolymitanus 54. Ce manuscrit
est signé et daté du 11 juin 1056 et il reproduit divers livres antiques, dont la
Doctrine des douze apôtres. Il semblerait, à ce jour, que les textes contenus dans
ce manuscrit remontent au IV° ou V° siècle, c. à d. à un temps où la tradition de
l'Eglise prit l'orientation de refuser ces livres dans le canon biblique. Il
semblerait aussi que, à l'origine, il y ait eu séparément un livre sur les Deux
voies et un deuxième livre sur (le reste de) la Didachè.
2.- Le papyrus Oxyrhynchus 1782 est constitué de deux feuillets d'environ 6cm x
5cm de la fin du IV° siècle (donc de même date sensiblement que les Constitu-
tions apostoliques avec lesquelles il présente quelques points communs),
confirmant l'autorité du Hierosolymitanus.
3.- Un document de la charnière IV°/V° siècle offre une version copte de la
Didachè sur un fragment de papyrus. Il fut découvert en 1923. D'origine
incertaine, peut-être Oxyrhynchus en Haute-Egypte, le document ne comporte
que des extraits de la Didachè.
4.- Dans les Constitutions apostoliques, composées aux environs de 385, le texte
(en certains endroits avec des commentaires) de la Didachè est donné. Les
documents qui nous l'ont transmis datent des VI° à XIII° siècles environ et
semblent provenir de divers rameaux de traditions.
5.- Dans les Canons ecclésiastiques des saints apôtres (recension éthiopienne),
un texte (assez libre) de la Didachè a été joint, mais on ne sait pas à quelle
époque. Cependant, ceci n'a pu avoir lieu qu'après le IV° siècle, date de l'origine
de la recension éthiopienne.
6.- Cette énumération montre combien l'origine des textes est difficile à établir.
En conclusion, il semble logique d'admettre que le texte existe
au IV° siècle et qu'il semble, à cette date, être déjà considéré
comme très ancien.
Jean-Marie GEORGEOT - " De Saint-Marc jusqu'à Tertullien " ( 1978 à 2004 )
LA DIDACHE - 31 -
D' AUTRES DONNEES
1.- En Haute-Egypte, près du village de Khenoboskion, une jarre de terre est
trouvée en l'année 1945. Dans un des textes de cette ancienne littérature
chrétiennes (manuscrit X), on lit diverses paroles prononcées par Jésus, dont
j'extrais les deux suivantes :
1.1 Ne donnez pas ce qui est saint aux chiens pour qu'ils ne le
jettent point sur le fumier et ne jetez pas les perles aux porcs de peur qu'ils
ne le fassent... (perte de texte).
(Voir D. IX-5).
1.2 Qui a blasphémé contre le Père, on lui pardonnera. Et qui a
blasphémé contre le Fils, on lui pardonnera. Mais celui qui a blasphémé
contre l'Esprit-Saint, on ne lui pardonnera point : ni sur terre, ni dans le
ciel.
(Voir D. XI-7).
2.- Dans les contrées voisines du Tigre, on découvrit en 1909 un manuscrit
syriaque. Sa datation est impossible mais semblerait (selon certains) permettre
de le situer à la charnière des I°/II° siècles. On donna à ces textes le titre de Odes
de Salomon. J'en extrais les citations suivantes :
n° 11 J'ai couru sur le chemin, dans sa paix,
sur le chemin de la vérité...
n° 15 J'ai abandonné le chemin de l'erreur,
je suis allé vers lui...
n° 17 Il a élevé mon esprit
jusqu'à la hauteur de Sa vérité.
A partir de ce point,
il m'a fixé le chemin de ses pas,
... je suis allé vers...
n° 21 J'ai dépouillé l'obscurité
et revêtu la lumière...
Sa lumière m'a exalté,
j'ai marché en Sa présence.
n° 33 Je vous sauverai de la perdition.
Je vous instruirai dans les chemins de la vérité.
Jean-Marie GEORGEOT - " De Saint-Marc jusqu'à Tertullien " ( 1978 à 2004 )
LA DIDACHE - 32 -
n° 38 J'ai monté la lumière de la vérité
comme un char.
La vérité m'a conduit et m'a porté...
Elle marche à mes côtés,
sur elle, je me repose.
Elle m'empêche de m'égarer parce qu'elle
était et demeure toujours la vérité.
Point de danger pour moi,
car la vérité est à mes côtés.
Jamais je ne m'égarerai...
Or, la vérité marcha dans le chemin droit.
n° 39 Le Seigneur a marché et traversé à pied.
Ses traces sont demeurées fermes dans l'eau
et elles ne sont pas effacées...
Mais les traces de Notre Seigneur Christ sont fermes,
elles ne sont ni effacées ni supprimées.
Le chemin est frayé pour qui passe après lui,
pour ceux qui font le chemin de sa foi
et adorent Son Nom.
Ainsi ai-je lu et entendu chanter en moi ce cantique nouveau des Odes de
Salomon :
n° 41 chant nouveau du Seigneur
de ceux qui l'aiment.
L'auteur a-t-il voulu écrire, pour le nouvel ensemble de textes qui devenait la
deuxième partie de la Bible (= le N.T.), un nouveau Cantique des Cantiques,
amour clamé par ce poète mystique ? J'ai entendu la musique des mots, en suc-
cession de vers, par rangées de trois ou quatre lexies, harmonies ordonnées sur le
chemin, la vérité, la mort et la vie, l'obscurité et la lumière.
Mon esprit n'ose plus ('intellecter') les textes, car il exulte dans son amour.
Mon visage exulte dans la joie. En lui ma crainte devient confiance et mon
incohérence se fond en sa perfection. 'Mes lèvres émettent pour lui une louange
et ma langue est douce de ses cantiques' (cfr : n° 40). Ainsi je lis l'apothéose de
ce chemin et je me sens vivre en un temps venu bien après que le texte de Saint
Marc puis celui de la Didachè m'ont d'abord proposé de le suivre "sur le
chemin" (Mc X-50), puis ont voulu m'enseigner comment : il y a deux chemins
(D. I-1). Il m'a fallu marcher sur le chemin de la vérité, chanté par l'auteur des
Odes de Salomon, afin que je mesure l'écart entre ce chemin mystique et le dur
chemin qui depuis la mer de Galilée alla jusqu'à Jérusalem.
Jean-Marie GEORGEOT - " De Saint-Marc jusqu'à Tertullien " ( 1978 à 2004 )
LA DIDACHE - 33 -
RETOUR A LA DIDACHE
Voici que tu sens, lecteur, qu'il me faut t'avouer : retourne au début, là où la
première partie de la Didachè commence par son verset (I-1). Je t'ai donné le
texte sous la forme suivante :
'Il y a deux voies :
l'une de la vie et l'autre de la mort.
Voici donc la voie de la vie...'.
Le texte est en réalité :
O D O I duo eisi :
il y a deux CHEMINS :
mia tes zôes kai mia tou thanatou /..
l'un de la vie et l'autre de la mort
(et j'ose te rappeler que, dans le texte de Saint Marc, il y a : thanatos = la mort
pour l'homme ou la bête, celle qui aboutit au cadavre, alors que nekros est la
mort° pour celui qui a-foi, celle qui laisse un corps).
../ diaphora de polle metaxu tôn duo ODÔN.
mais la différence est grande entre les deux chemins
e men oun ODOS tes zôes estin ...
voici donc le chemin de la vie ...
Tu connais, ami lecteur, la force et la puissance du mot 'g : odos = chemin'
dans le texte de Saint Marc. Si, jusqu'à ce présent moment où tu lis la présente
phrase, j'avais tenu à conserver le mot voie pour la traduction dans la Didachè du
mot grec odos, cela était dû à ce que j'avais rencontré dans mes recherches de
nombreuses études fondées sur les Deux "voies".
Jean-Marie GEORGEOT - " De Saint-Marc jusqu'à Tertullien " ( 1978 à 2004 )
LA DIDACHE - 34 -
Notamment :
'L'enseignement des deux voies est attesté par des traditions nombreuses et
variées dans l'Eglise ancienne... les différentes recensions des Deux voies qui
nous sont parvenues ont plusieurs antécédents dans la pensée judaïque : ... d'une
part le texte de Qumram (en particulier le Manuel de discipline)... d'autre part la
tradition sapientiale du judaïsme palestinien et des communautés juives de la
diaspora...'
(Introduction à la Didachè)
(Sources chrétiennes - 248)
Il me faut, à présent, étudier :
LE CHEMIN.
_______________
Jean-Marie GEORGEOT - " De Saint-Marc jusqu'à Tertullien " ( 1978 à 2004 )
LA DIDACHE - 35 -
DIDACHE II
LE CHEMIN
_______________
Structure générale
Sur : 'ten odon Kuriou'
Sur : 'odon poiein'
Sur : 'eis odon'
Sur : 'para ten odon'
Finale
La Présence de Dieu
Les Lois du texte :
L'infaillibilité
L'invariabilité
Le dogme
Sur le chemin
Dans la Didachè
Conclusion sur la Didachè
Tora = Chemin
_______________
Jean-Marie GEORGEOT - " De Saint-Marc jusqu'à Tertullien " ( 1978 à 2004 )
LA DIDACHE - 36 -
STRUCTURE GENERALE
1.- Dans le texte de Saint Marc, la suite des emplois de 'g : odos = chemin' est
la suivante :
I-2 + I-3 ten odon avec sou, puis Kuriou
II-23 odon poiein 'faire un chemin'
IV-4 + IV-15 para ten odon
VI-8 EIS ODON
VIII-3 + VIII-27 en te odô
IX-33 + IX-34 en te odô
X-17 EIS ODON + il s'en-allait (n° 1)
X-32 en te odô
X-46 para ten odon + il s'en-allait (n°2)
X-52 en te odô
-------------
XI-8 EIS TEN ODON
XII-14 ten odon + tou Theou
(XIII-1) .............................. + il s'en-allait (n°3)
2.- L'ordonnancement du tableau attire l'attention sur :
ten odon deux au commencement + un à la fin = une triade
para ten odon d'abord deux, puis un = une triade
eis odon = une triade
en te odô = deux triades / odon poiein = un - unique.
Il y a peu de chances pour que ceci soit dû au seul hasard.
Jean-Marie GEORGEOT - " De Saint-Marc jusqu'à Tertullien " ( 1978 à 2004 )
LA DIDACHE - 37 -
Il semble donc y avoir une obligation de lire avec beaucoup d'attention
puisque cette seule première remarque permet de :
voir : une-unique double triade / trois triades / un-unique
entendre : odon quatre fois puis : = eis odon
odô quatre fois puis : = eis odon
odô / odon / odô puis : = eis ten odon
ainsi que :
ten odon ten odon
(les deux premiers emplois) (les deux derniers emplois).
La perception d'une structure telle que celle-ci n'apporte rien de théologique et
n'a, en propre, aucune réalité (sinon : poétique ?) tant qu'elle n'est pas cause de
production de sens par le texte. Il ne saurait donc être question, pour l'exégète,
d'arrêter sa lecture du texte à ce simple résultat.
3.- Souvent, dans la phase de recherche de matériaux pour l'analyse, je compte le
nombre de mots, d'emplois, ... Ici, je suis arrivé immédiatement au résultat
suivant :
ten odon sou + Kuriou + Theou = 3
para ten odon = 2 + 1 = 3
en te odô = 2 + 2 + 1 + 1 = 6 = 3 + 3
eis odon = 3
odon poieiô = 1
Je ne puis plus accepter, maintenant, que ce soit un simple hasard car il y a là
une volonté du texte d'alerter le lecteur. Mon interprétation (c. à d., à ce point de
ma lecture : mon hypothèse) est que chaque sous-ensemble (construit sur le
chiffre trois) entraîne l'obligation de l'existence d'un sens théologique précis.
Si, en étudiant successivement, chacun des sous-ensembles, j'aboutis à
'comprendre' de nouvelles choses dans ce texte de Saint Marc, cela
signifiera que mon hypothèse est vérifiée, ou encore : ce sera
L A P R E U V E de l'Inspiration du Message-Divin de
Jésus-le-Messie = une Preuve de la Présence de Dieu.
Jean-Marie GEORGEOT - " De Saint-Marc jusqu'à Tertullien " ( 1978 à 2004 )
LA DIDACHE - 38 -
SUR : "TEN ODON KURIOU"
Mc I-2 et 3 Se reporter à Lectio divina par verset : la contemplation des
deux textes placés côte à côte, Saint Marc et Malachie, met en évidence l'écart
dans la mise en œuvre du mot odon :
Malachie ... odon pro prosôpou mou
chemin devant la-face de-moi
Saint Marc ... ten odon sou
le chemin de-Toi.
En Mc, le chemin est celui du Seigneur et il y a une union entre odon et sou.
Mais, si je remonte en amont, dans un espace de quelques mots, je constate :
I-2 idou apostellô ton aggelon mou pro prosôpou sou
os kataskeuasei ten odon sou
I-3 ... etoimasate ten odon Kuriou
eutheias poieite tas tribous autou.
A moins d'être aveugle et de ne-pas voir, et à moins d'être sourd et de ne-pas
entendre, il n'est pas possible d'ignorer la présentation des quatre finales :
visage ... en chemin ... sentiers
sou ... sou / Kuriou ... a u t o u.
J'ai dit le sens donné par la substitution sacralisant le mot autou lorsqu'il est
venu remplacer Dieu dans le texte original du prophète Isaïe. Je vois, ici,
beaucoup plus car le chemin vient deux fois au cœur des quatre mots et odon
s'est choisi comme présentateur à la fois sou et Kuriou.
Dans les textes inspirés, lorsqu'une entrée s'offre au texte avec puissance, il
faut re-garder la finale qui, souvent pour des raisons de renvoi/rappel/symétrie,
ou par obligation de relation structurelle, doit offrir une singularité.
Les deux premiers emplois de odon sont venus nous remplir du désir de
contempler le visage du Seigneur. Le dernier emploi du mot odos est :
Jean-Marie GEORGEOT - " De Saint-Marc jusqu'à Tertullien " ( 1978 à 2004 )
LA DIDACHE - 39 -
Mc XII-14 "ten odon tou Theou...". La tristesse et l'abattement
s'emparent de mon âme. J'attendais dans sa gloire le Seigneur = Kuriou, et il a
fallu que "quelques-uns des pharisiens et des hérodiens" (XII-13) viennent
m'imposer "tou Theou", c'est à dire ce Dieu que le texte avait pris soin d'effacer
de la citation du prophète Isaïe en (I-3) pour le remplacer par autou.
Moi, j'avais entendu "tas tribous autou" et j'avais vite compris les raisons des
sentiers : Dieu allait venir, comme il aime venir cheminer sur ses sentiers de
notre terre d'hommes. Et Dieu serait autou : le Dieu-Incarné, vivant comme
homme parmi les hommes. Je savais qu'aux détours des sentiers je le rencontre-
rais. Moi aussi j'aime cheminer sur les lèvres du fleuve pour entendre l'eau vive
me parler de la vie qu'elle porte vers l'aval. Or cette eau, lorsqu'elle est le
Jourdain, va à la mer asphaltitement morte. Ainsi ce texte, où Dieu est si présent
puisque j'ai longuement marché à ses côtés, aboutit à quelques-uns des
pharisiens et des hérodiens, et ceux-ci nient le Dieu-Incarné et refusent le
Messie, car ils disent : "Maître ! Nous savons ... que tu enseignes ten odon tou
Theou !" (XII-14) alors que moi j'ai marché sur le chemin de autou.
Comprends-tu, lecteur, ma très grande détresse d'avoir parcouru si longuement
ce chemin pour aboutir à une impasse ? L'impasse est un chemin fermé, sans
suite, sans prolongement, inutile, barré par un mur, une grille ou quelque bloc
d'immeubles construits en travers. Ici l'impasse du texte est réelle : jamais plus le
mot odos ne reviendra. Il n'y aura plus... il n'y a déjà plus de 'chemin = g :
odos'.
L'enseignement = Pourtant, au fond de cette impasse, par-dessus le mur ou les
grilles qui la ferment, il y a un rayon d'une sourde lumière. Dans le texte de
Saint Marc, j'ai lu :
Mc XII-14 Didaskale ! ... tu enseignes (didaskeis) le chemin de Dieu en vérité =
ep aletheias ten odon tou Theou didaskeis.
Pourquoi, aujourd'hui, suis-je acculé au fond de cette impasse construite par
des pharisiens avec des hérodiens pour stopper le chemin de autou ? Souviens-
toi, lecteur ! Il y a peu nous étions entrés dans l'étude d'un livre qui a pour nom :
Didachè ce qui, traduit, est : la Doctrine, donc l'enseignement, ou encore une
Didascalie. Jeux de mots ou mots en prophétie que les pharisiens et hérodiens
n'ont pu s'empêcher de prononcer en Mc (XII-14) ?
Jean-Marie GEORGEOT - " De Saint-Marc jusqu'à Tertullien " ( 1978 à 2004 )
LA DIDACHE - 40 -
Eux n'ont peut-être jamais su; mais toi, mon ami à mes côtés, tu as lu comment
cette Didachè est Doctrine du chemin, puisqu'elle l'a posé dans son tout premier
mot : 'ODOI duo eisi : il y a deux chemins' (D. I-1).
Nous, nous avons constaté qu'il y a bien ces deux chemins. Il y a ten odon
Kuriou, le chemin de la vie aux côtés de Dieu-homme, et il y a, pour eux,
pharisiens et hérodiens, ce lieu où l'on marche "selon la tradition des anciens"
(Mc VII-5) car, quand on respecte scrupuleusement la tradition, on recopie
fidèlement les textes d'Isaïe le prophète et on écrit : "ten odon tou Theou" !
(Isaïe XL-3)
SUR : "ODON POIEIN"
La deuxième forme sous laquelle se manifeste le chemin dans le texte de Mc
est celle en association avec le verbe faire, mais elle présente une apparition
remarquable, car on a successivement et dans l'ordre de leur manifestation dans
le texte :
I-2 ten odon = le chemin doit être préparé
g : kata-skeuazô seul emploi
I-3 ten odon = le chemin doit être apprêté
g : hetoimazô premier emploi
Ce verbe sera utilisé, en tout, cinq fois et il obéit aux lois du texte :
à deux X-40 la dualité à droite ou à gauche.
à trois XIV-12 l'aboutissement à Jérusalem,
afin de manger la Pâque.
à quatre XIV-15 la plénitude dans la chambre-haute,
avec la totalité des Douze.
à cinq XIV-16 l'identité ils apprêtèrent la Pâque car voici le
jour où l'on "immolait la Pâque" (XIV-12). L'expression est spécifique de la
culture juive et donne au mot Pâque le sens concret de : agneau, l'objet du
sacrifice. A ce cinquième et dernier emploi de hetoimazô, Jésus reçoit l'identité
pour sa Passion : IL est l'agneau. Le verbe hetoimazô satisfait aux lois du texte
d'une façon si magnifique qu'il n'a pu que, lui-même, être apprêté spécialement
pour l'arrivée à son premier emploi au verset (I-3). Ceci aussi est une loi de
l'exégèse dans le texte de Saint Marc.
Jean-Marie GEORGEOT - " De Saint-Marc jusqu'à Tertullien " ( 1978 à 2004 )
LA DIDACHE - 41 -
Et voici la troisième arrivée du mot odos :
II-23 odon poiein = alors que Jésus passe à-travers les champs-de-
blé, "ses disciples commencèrent à faire un chemin en égrenant des épis".
L'expression 'g : odon poieiô = faire un chemin' est UNIQUE en N.T. et, de
plus, on voit que le verbe 'g : tillô = égrener' a, ici, son seul emploi de tout le
texte.
Bien entendu, les pharisiens ne peuvent s'empêcher d'intervenir à un moment
du récit aussi nettement préparé(8). Au fait : D'où viennent ces pharisiens ?
Leur apparition dans le récit a eu lieu en :
II-16 "les scribes" (des pharisiens)
II-18 (on apprend que les pharisiens sont en train de jeûner).
Ces deux entrées du mot pharisien à l'intérieur de l'évangile ont donc lieu en
forme d'un dire à leur sujet, mais personne ne les a vus présents physiquement.
Ils viennent pour la première fois en (II-24) par une parole entendue de tous
(= le style direct). Cette parole est à cause du chemin, mais a son fondement sur
le verbe faire :
II-24 "Et les pharisiens lui disaient : 'Pourquoi (tes disciples) font-ils le
jour-du-sabbat ce qui n'est pas permis ?".
Lors de l'analyse (qui précède le présent texte) sur ten odon Kuriou, j'ai décelé
la gravité de ce qui est dit au verset (XII-14). Ce sera alors la dernière présence
dans le texte des pharisiens et ils parleront pour la dernière fois. Ils n'utiliseront
pas le verbe faire et n'oseront pas dire à Jésus : 'tu as fait... ce qui n'est pas
permis'. Mais leur parole montrera qu'ils n'ont pas changé dans leur structure de
pensée, car ils diront "le chemin" puis, par un détour hypocrite, poseront une
question sur "est-il permis de... ?" (XII-14).
Entre (II-24) et (XII-14), malgré tous les événements nouveaux arrivés, les
pharisiens restent immobiles dans leurs croyances.
Alors, à cause de l'impôt à César,
ils sortent du texte,
car ils veulent demeurer sur LE CHEMIN de leur tradition.
Jean-Marie GEORGEOT - " De Saint-Marc jusqu'à Tertullien " ( 1978 à 2004 )
LA DIDACHE - 42 -
SUR : "EIS ODON"
Il y a trois emplois : VI-8 / X-17 et XI-8. Si tu te reportes, dans le lexique, à
l'analyse du mot 'vers', tu y remarqueras combien frêles étaient alors nos
analyses :
1.- (Voir vers, chapitre II = synthèses).
Le mot chemin avec eis est mentionné pour ses deux seuls emplois (en
première partie), alors que (presque) tous les autres mots retenus subissent une
règle en forme de trinité d'emplois. Ainsi, dans la réalité, si l'on englobe la
deuxième partie, il y a bien trois fois 'eis' avec odon.
2.- (Voir deux pages plus loin - paragraphe 2.- Chemin).
La relation entre (VI-8) et (X-17) : celui qui passe est un rabbi, peut-être
différent des usuels rabbis, car il n'a "pas de monnaie-de-bronze pour la
ceinture" (VI-8). Nous savons combien est acéré le regard des pharisiens et des
hérodiens eux qui, comme ceux de la synagogue, sont sans cesse à l'épier (cfr
: III-2). Ils sont à l'affût et, lorsqu'ils seront en présence de lui dans le Temple de
Jérusalem, ils se rappelleront comment il entra dans la Ville. Il avait dit : "un
bâton, pas de pain, pas de besace... et ne pas revêtir deux tuniques" (VI-8), ce qui
était l'ordre de ne pas employer le pluriel des vêtements. Or, en (XI-8), Il était
'eis odon = sur le chemin' et tous "étalèrent leurs vêtements" : un pluriel de
tuniques ! Alors les pharisiens et hérodiens, dans le Temple, lui parlent et ils lui
disent : " ... le chemin de Dieu = ton odon tou Theou". Ils lui disent : tu
enseignes le chemin qui va à Jérusalem, vers le Temple, c'est le Chemin de Dieu.
En vérité (g : ep alethias) tu sais bien enseigner quoique tous t'aient offert leurs
vêtements, car tu avais dit de ne pas revêtir deux tuniques. Or, bien entendu,
"nous savons que tu es vrai" (XII-14) et que tu n'as pas enfilé tous ces vêtements.
Mais, pourquoi n'as-tu pas maudit ce pluriel de vêtements que "beaucoup
étalèrent sur le chemin = eis ten odon" ?
Le mot odon frappe alors leurs oreilles et leur fait souvenir : 'cet homme' est
celui-là même qui disait de ne jamais prendre "de monnaie-de-bronze pour la
ceinture ... (lorsque l'on va) eis odon = sur le chemin" (VI-8). Alors, ils lui posent
la question de l'argent : faut-il payer (c. à d. : paye-tu ?) l'impôt à César ?
(Ou encore : as-tu dans ta ceinture la monnaie nécessaire pour payer ?)
Jean-Marie GEORGEOT - " De Saint-Marc jusqu'à Tertullien " ( 1978 à 2004 )
LA DIDACHE - 43 -
A leur étonnement, IL leur répond : "... donnez-moi un denier afin que je le
voie" (XII-15).
(Ou encore : Non ! Je n'ai rien dans ma ceinture !)
Ainsi ai-je pu lire le mot eis venu en (XI-8) avec tant de vêtements, en
contradiction apparente du eis de (VI-8), relié à celui de (X-17). La préposition eis
est la Présence glorieuse de Dieu et elle est venue pour l'entrée à Jérusalem, la
ville de David, au-milieu des acclamations de ceux qui précédaient et de ceux
qui suivaient. Cette joie si fortement criée (cfr : XI-9) n'aboutira qu'à l'impasse du
chemin, barricade construite en (XII-14) par quelques-uns des pharisiens et des
hérodiens, au moyen d'un mot à forte teneur théologique :
"... odon tou THEOU".
Plus tard, "au lieu Golgotha", nous entendrons semblablement des grands-
prêtres et des scribes user du même procédé en disant des mots à forte teneur
théologique :
"... le Messie... le Roi d'Israël... descendre... maintenant...".
Mais ils n'oseront plus parler de 'ten odon tou Theou' !
3.- (Voir vers : chapitre III - analyse verset par verset).
Voici que, relisant mon analyse dans le lexique, je suis alerté par une
construction. J'ai écrit : '... ainsi eis a noté la transfiguration (= la transformation)
du chemin par l'apport des quatre eis de (XI-1 et 2)'. S'agirait-il d'une nouvelle
règle de la structure du texte ou bien est-ce un-unique hasard ?
Le lecteur voit aussitôt la réponse :
I-2 et I-3 ten odon ) total = 4
IV-4 et IV-15 ten odon )
VI-8 EIS odon
VIII-3 et VIII-27 en te odô ) total = 4
IX-33 et IX-34 en te odô )
X-17 EIS odon
-------------
XI-1 eis Jérusalem + eis Beth (Phagée + Anie) ) total = 4
XI-2 eis village + eis l'ânon )
XI-8 EIS ten odon
Jean-Marie GEORGEOT - " De Saint-Marc jusqu'à Tertullien " ( 1978 à 2004 )
LA DIDACHE - 44 -
Tout se passe comme si le texte transférait, pour la deuxième partie de
l'évangile, la puissance allégorique de 'odos = chemin' vers 'eis = EL = Dieu'.
En première partie, nous le suivions sur le chemin. A Jérusalem, la Présence
est d'une autre forme et nous n'aurons plus à marcher. En structurant ainsi son
verset (XI-8), le texte associe pour la dernière fois la Puissance de EIS avec la
Fidélité "de ce chemin = ten odon" que nous avons suivi depuis les temps du
commencement, "le long de la mer de Galilée".
Malheureusement, bientôt, quelques pharisiens et hérodiens vont venir tout
bouleverser d'une manière hypocrite avec "ten odon tou Theou" ! Pour eux, les
pharisiens, les hérodiens... et les autres, c'est "tou Theou" qui va créer l'impasse
et barrer "ten odon"(9).
ENCORE SUR : "EIS ODON"
Au sujet des emplois du mot chemin, j'ai remarqué le détail suivant :
n°1 : X-17 comme il s'en-allait + eis odon
n°2 : X-46 comme il s'en-allait + apo (et) Jéricho.
Mais, peu après, arrive : "para ten odon". Cela m'alerte et je dois prêter
attention à cette forme caractéristique du verbe 's'en-aller = g : ek-poreuomai'.
Le lexique m'informe qu'il y a un troisième emploi semblable :
n°3 : XII-1 comme il s'en-allait + hors du Temple
ek tou Ierou.
Je suis surpris par l'inattendu de cette préposition 'g : ek = hors de', car il y a
ainsi une répétition à cause du verbe lui aussi construit avec le préfixe ek :
"EK poreuomenou autou EK tou Ierou".
Notant avec précision les trois textes, je constate :
n°1 : odon avec EIS
n°2 : odon avec PARA mais aussi : APO
b°3 : (absence de odon) et encore : EK.
J'ai relu le texte grec du verset (XIII-1) avec beaucoup d'attention : "g : kai
ekporeuomenOU autOU ek tOU ierOU = et lui s'en-allant hors du Temple, l'un
de ses disciples lui dit : 'Maître ! Vois de quelle-taille (ces) pierres ! Et de
quelle-taille (ces) bâtiments !".
Jean-Marie GEORGEOT - " De Saint-Marc jusqu'à Tertullien " ( 1978 à 2004 )
LA DIDACHE - 45 -
Et je comprends : le Messie (Dieu-Incarné) est à Jérusalem (la ville de David :
sa ville), dans le Temple. Il y a rencontré tous les siens, ceux du Temple :
grands-prêtres, scribes, anciens (XI-27), pharisiens, hérodiens (XII-13),
sadducéens (XII-18), et finalement LE plus scribe des scribes (XII-28). A chaque
fois le dialogue n'a pu être établi. Alors "l'un de ses disciples" (XIII-1), c'est à
dire l'un des Douze, lui parle de l'orgueil des pierres et des bâtiments car Jésus
s'en-allait... mais sans la présence de 'eis' et sans le mot 'chemin' : Jésus ne suit
plus le "chemin = odon".
Ainsi ai-je lu l'absence du mot 'chemin' et le redoublement de 'ek' :
ce sont là deux annonces de l'imminence de la Passion.
SUR : "PARA TEN ODON"
A ce jour, chaque fois que j'ai interrogé le texte de Saint Marc, celui-ci a
répondu. Pourtant, voici que j'hésite, car j'ai beau regarder les trois emplois, je
ne vois guère de lien. Il y a :
IV-4 (du grain) tomba le long du chemin
IV-15 (les mots de la Parole sont) semés le long du chemin
X-46 (Bar-Timée était-) assis le long du chemin.
Je pourrais évoquer Bar-Timée, car avec les données du texte, il est facile
d'écrire un récit : Jéricho (la ville des palmiers, ses sources, son climat) un
aveugle (la peau tannée par le soleil), le nom de Timée (Platon ou vérité lue à
l'envers(10) ?), être-assis (ceux qui sont assis : les scribes, Lévi, une foule, le
gérasénien, Jésus, puis enfin un jeune-homme en blanc) ... Je te laisserai, ami, le
soin de lire avec toutes ces données. Moi, j'ai prié ou encore : j'ai écouté le texte
prier en moi et j'ai vu une chose remarquable : la préposition para se fait suivre
d'un accusatif pour chacun de ces trois emplois avec odon. Or, dans le texte de
l'évangile, il y a seulement QUATRE autres emplois de même nature et tous
quatre sont avec la mer : "para ten thalassan".
I-16 Jésus chemine le long de la mer l'appel des quatre
II-13 Jésus sort le long de la mer l'appel de Lévi
IV-1 Jésus enseigne le long de la mer foule très nombreuse
V-21 Jésus EST le long de la mer deux femmes.
Jean-Marie GEORGEOT - " De Saint-Marc jusqu'à Tertullien " ( 1978 à 2004 )
LA DIDACHE - 46 -
Tu pourras relire tout le reste de l'évangile, il n'y a aucun autre emploi de
'para + accusatif'. Alors, j'ai contemplé, car voici la structure des emplois :
I-16 (la mer) l'appel des QUATRE
et il y aura quatre fois : 'para ten thalassan'
II-13 (la mer) l'appel de Lévi
IV-1 (la mer) (l'appel d') une foule très nombreuse :
toute la foule était auprès de la mer,
car Jésus était-assis en mer. La foule suit.
IV-4 (le chemin) le semeur marche le long du chemin
IV-15 (le chemin) la Parole semée le long du chemin
V-21 (la mer) Jésus (EST) le long de la mer :
c'est le temps de l'Alliance(11) :
la fille au sang + la fille de Jaïre = g : thugater
X-46 (le chemin) Bar-Timée était-assis le long du chemin :
il va se sentir 'appelé'.
As-tu remarqué que, en regroupant la mer et le chemin, cela fait en tout sept
emplois ? Dieu en a fait le serment(12), il vient vivre la vie de l'homme parmi
les hommes : tout homme peut le rencontrer :
le long de la mer ou le long du chemin.
SUR : "EN TE ODÔ"
1.- Voici les six derniers emplois du mot 'g : odos = chemin'. Lecteur : il existe
des chemins de diverses configurations et ceux des pays de plaine sont plus
simples et plus faciles que ceux de la montagne. Tout à l'heure, au dernier des
six emplois, au-delà de Jéricho, nous allons marcher en pays de montagne. J'ose
t'en avertir, car tu peux retourner en arrière pour rester au chaud pays de la ville
des palmiers, à quelques lieues du Jourdain.
Mais, si tu veux m'accompagner, alors suis-moi avec attention car le chemin
va changer : tu risques d'être saisi-de-stupeur... à mon exégèse.
Jean-Marie GEORGEOT - " De Saint-Marc jusqu'à Tertullien " ( 1978 à 2004 )
LA DIDACHE - 47 -
2.- Il nous reste donc à examiner comment vient, par six fois, l'expression "en te
odô". Voici que je te propose de regarder, chaque fois, quel est le verbe
important en ce chemin. Tu verras dans le texte :
VIII-3 'g : ek-luô = défaillir' seul emploi
VIII-27 'g : ep-erotaô = interroger' cinquième emploi
IX-33 'g : dia-logizomai = réfléchir' cinquième emploi
IX-34 'g : dia-legomai = disputer' seul emploi.
Arrêtons-nous ici, car il y a une structure remarquable. Or tu sais que le
cinquième emploi est toujours relatif à l'identité. Alors, écoute bien :
VIII-27 Jésus interroge ses disciples :
"QUI les hommes disent-ils moi être ?"
IX-33 Jésus les interroge encore :
"(A-)quoi réfléchissiez-vous en chemin ?".
La question sur le fonctionnement intellectuel de chacun est la question sur sa
propre identité. Or, par ces deux questions posées en (VIII-27) et (IX-33), Jésus
interroge sur l'identité que les apôtres perçoivent de lui-même, puis d'eux-
mêmes. Bien plus : notre structure révèle que les deux questions posées l'une et
l'autre semblablement en style direct, sont complémentaires. Lui dire qui je le
sais être et lui dire à quoi moi-je réfléchis, revient à lui confier le secret de ma
pensée, de mon intelligence, de mon âme, car c'est LUI dire en quoi moi-je sens
vivre en moi le mot image que j'ai entendu en Genèse (I-27) : 'Elohim créa donc
l'homme à son image, à l'image d'Elohim, il le créa.'
3.- La structure circulaire de ces quatre premiers emplois de en te odô m'oblige à
réfléchir d'une même manière sur les deux derniers :
X-32 "Or ils étaient en chemin en montant vers Jérusalem"
en te odô + monter + eis Ierosoluma.
X-52 "Et (Bar-Timée) le suivait sur le chemin"
suivre + en te odô + eis Ierosoluma,
car ici je note les premiers mots du verset suivant : "Et lorsqu'ils s'approchent de
Jérusalem".
Jean-Marie GEORGEOT - " De Saint-Marc jusqu'à Tertullien " ( 1978 à 2004 )
LA DIDACHE - 48 -
Tu vois déjà le jeu entre ces deux versets et j'ai à peine besoin de te souffler la
méthode exégétique à utiliser. Ces deux versets forment un ensemble séparé des
quatre premiers vus précédemment. Tu trouveras dans le lexique :
X-32 'g : anabainô = monter' septième emploi
X-52 'g : akoloutheô = suivre' douzième emploi.
3.1 "En montant vers Jérusalem"
C'est un serment (= la signification du rang d'ordre sept) que Dieu a fait :
il faut que Dieu-Messie aille vers la Ville. D'ailleurs, afin de compléter et de
confirmer, le texte ajoute : "Et Jésus était à les précéder". Le texte n'a pas écrit :
'et il était...'; la Présence du NOM est l'affirmation du vouloir (= le serment) de
Dieu. Jésus est le Messie et le Messie doit aller vers Jérusalem. D'où le septième
emploi pour le verbe monter.
3.2 "... il le suivait sur le chemin"
Ici, le rang du verbe est douze, ce qui oblige à penser au groupe des
Douze apôtres. Bar-Timée vient d'être guéri et il a levé-le-regard à nouveau. Il
voit de la façon dont il voyait jadis. Lui, qui est le peuple d'Israël, vient de
retrouver son intégrité physique et il 'fixe-le-regard distinctement' (cfr : VIII-25)
sur Jésus-le-Messie. Alors il le suivait sur le chemin et ce douzième emploi me
dit : comme le groupe des Douze, voici que tout l'ensemble d'Israël suit son
Messie.
La phrase suivante ajoute le but de la marche et confirme qu'eux tous 'voient-
bien' (cfr : VIII-25) le but de cette montée : "EIS + Jérusalem" (XI-1).
4.- Ainsi se termine mon exégèse du mot chemin. Je t'avais averti : le chemin est
rocailleux et tu doutes peut-être encore de l'orthodoxie de la méthode suivie...
surtout pour les deux dernières lexies ? Alors, re-garde (à) la présentation du
troisième emploi, celui de 'odon poiein' : c'était aussi une analyse étrange qui
permit de préparer (I-2), puis d'apprêter (I-3) avant de faire (II-23)... et ce sont,
dans l'ordre de leur arrivée dans le texte, les trois premiers verbes que le récit a
choisis pour traiter du chemin.
Jean-Marie GEORGEOT - " De Saint-Marc jusqu'à Tertullien " ( 1978 à 2004 )
LA DIDACHE - 49 -
FINALE
Encore une remarque que je puis formuler en reprenant les mots prononcés par
ces pharisiens et hérodiens qui ont su imposer leur idéologie de tradition. Ils ont
dit :
XII-14 "Nous savons... que tu enseignes LE CHEMIN..."
As-tu remarqué que, jamais, tout le long de ce texte, le mot chemin n'a été
employé au pluriel ? Il aura fallu que ces pharisiens et hérodiens, étant-venus, lui
disent : "ten odon tou Theou", pour que nous prenions conscience que ce
chemin-là n'est pas :
I-3 "ten odon KURIOU".
D'autres, bien avant nous, ont connu, lu, étudié, médité ce Message-Divin.
Alors, eux aussi, ont écrit et pour préparer et apprêter le lecteur, ils ont mis en
tête de leur écrit, et pour premiers mots :
ODOI DUO EISI
Des chemins ? Il y en a D E U X !
(Didaché I-1)
Jean-Marie GEORGEOT - " De Saint-Marc jusqu'à Tertullien " ( 1978 à 2004 )
LA DIDACHE - 50 -
LA PRESENCE DE DIEU :
AMI !
Tu reliras l'alinéa final
référencé 3
du paragraphe :
"STRUCTURE GENERALE"
(a u b a s d e l a p a g e 3 7) .
Jean-Marie GEORGEOT - " De Saint-Marc jusqu'à Tertullien " ( 1978 à 2004 )
LA DIDACHE - 51 -
LES LOIS DU TEXTE
TROIS LOIS DU TEXTE émergent de l'ensemble des résultats fournis par
l'exégèse :
1.- L' INFAILLIBILITE
Si le texte contenait un seul point d'incohérence, le texte tout entier
pourrait être remis en cause.
Les textes de Saint Matthieu et de Saint Luc n'ont pas cette 'infaillibilité'. Les
écarts qu'ils présentent par rapport au texte initial (= le premier des évangiles,
celui de Saint Marc), peuvent toujours être expliqués lorsque l'on admet que :
a) pour Saint Matthieu :
Son auteur a connu le texte de Saint Marc et a disposé d'un exemplaire
écrit. Il sait que Mc est écrit à Jérusalem, par un juif; (nous supposerons, à l'ici
de notre travail, qu')il ne sait pas pourquoi Mc est écrit de cette façon et (qu')il
n'a pas connaissance parfaite des us et habitudes des gens de Jérusalem (= juifs).
b) pour Saint Luc :
Son auteur a disposé du texte intégral de Mc et il sait que ce texte est
authentique. Comme pour Mt, (nous supposerons ici que) Lc ne sait pas pour-
quoi Mc est écrit de cette façon et (qu')il n'a pas connaissance des lois du texte.
Mais Lc a reçu le témoignage direct (par des témoins sûrs) au sujet des
événements de la vie de Jésus. Cependant Lc ne paraît pas connaître le nom de
l'auteur du texte de Saint Marc (ou plutôt : Lc ne laisse transparaître à aucun
moment qu'il puisse avoir connaissance de ce nom).
Jean-Marie GEORGEOT - " De Saint-Marc jusqu'à Tertullien " ( 1978 à 2004 )
LA DIDACHE - 52 -
2.- L' INVARIABILITE
Si une seule lettre ou un seul mot du texte de Saint Marc pouvait être
lu indifféremment sous deux formes distinctes, cela remettrait en cause
systématiquement l'authenticité du reste du texte.
Ceci ne veut pas dire qu'il ne puisse exister divers manuscrits présentant des
différences. Lorsqu'il fut écrit, le texte de Saint Marc fut, dès son origine,
immuable. Les (rares) déviations (dans la transmission) ne portent que sur
quelques très rares lexies ou sur quelques mots. On peut affirmer qu'une
application stricte des lois du texte permet de déceler le caractère hypothétique
(= très douteux) dans certains cas.
Exemple :
Au verset (III-14), la péricope "(qu'il nomma aussi 'apôtres')" ne signifie
pas que Jésus ait dit aux Douze qu'il en faisait des apôtres au moment précis du
choix (III-14 : "Et il fit Douze"); mais le texte commente en annonçant que, plus
tard, au retour de mission, ces douze hommes pourront être dits "apôtres"
puisque, ayant été envoyés en (VI-7), ils reviennent en (VI-30) après avoir fait et
enseigné.
L'analyse du mot "apôtre" et de son contenu théologique permet de retenir
l'hypothèse que la lexie "(qu'il nomma aussi 'apôtres')" est d'une autre nature
d'authenticité que le reste du texte.
Jean-Marie GEORGEOT - " De Saint-Marc jusqu'à Tertullien " ( 1978 à 2004 )
LA DIDACHE - 53 -
3.- LE DOGME
C'est à dire : la stricte VERITE des paroles que le texte relate en style
direct comme étant prononcées par Jésus.
Ces paroles sont totalement et rigoureusement exactes et, partant, non
discutables, pas même dans le plus petit iota. Ceci n'est pas à retenir pour les
discours ou paroles présentées par le récit en style indirect, qui contiennent le
témoignage (= elles sont l'interprétation, la vision et l'entendement) de celui qui
a écrit.
Exemple :
A Gethsémani, le 'texte' a vu Jésus tomber "sur la terre" et l'a entendu
'prier' (= mais, que signifie prier pour le Messie ? sinon, au moins, le fait d'être
face-à-face avec lui-même, Dieu-Eternel ? ... Et que veut dire face-à-face avec
SOI ?). Le 'texte' en déduit un comportement de Jésus et écrit qu' il "priait afin
que, s'il est possible, l'heure passe° (loin) de lui." (XIV-35). Ceci est le
témoignage de celui qui a vu et entendu; il écrit ce qu'il a compris de
l'événement, à l'instant précis où Jésus tombe "sur la terre" et offre à la vue de
Pierre, de Jacques et de Jean, qu' il "priait".
La Vérité était autre puisque Jésus "disait : 'Abba ! - père - TOUT (est)
POSSIBLE POUR TOI...'.". Jésus sait ce que pensent et comprennent les trois
apôtres et il (rectifie) le texte de (XIV-35) : la parole de Jésus est dogmatique.
Les textes de Saint Matthieu et de Saint Luc ont une présentation
différente qui montre l'écart sur "l'infaillibilité" dont il est fait mention ci-dessus
au paragraphe 1.
Jean-Marie GEORGEOT - " De Saint-Marc jusqu'à Tertullien " ( 1978 à 2004 )
LA DIDACHE - 54 -
SUR LE CHEMIN
Tu vois aussitôt, si tu acceptes la vérité des trois lois ci-dessus, en quoi
l'ordonnancement du mot chemin dans le texte de Saint Marc est la PREUVE.
Pourtant, tu doutes encore, je le sens. Alors laisse-toi conduire à relire la
Didachè et à noter quels sont les emplois de ce même mot 'g : odos = chemin'
(venu dans Saint Marc se manifester dans la plénitude de sa Transcendance).
DANS LA DIDACHE
Il suffit de noter avec patience et attention. Mais, comme le livre des Deux
voies (= les deux chemins) n'occupe que les chapitres I à VI, nous limiterons
notre recherche à cette zone.
1.- Le mot 'chemin'
D. I-1 odoi duo eisi... ... tôn duo odôn
Il y a deux chemins... la différence est grande entre ces deux chemins.
D. I-2 E men oun odos tes zôes ...
Voici donc le chemin de la vie.
D. IV-14 Aute estin e odos tes zôes
Tel est le chemin de la vie.
D. V-1 E de tou thanatou odos estin aute...
Voici maintenant le chemin de la mort...
D. VI-1 ... apo tautes tes odou tes didaches...
Veille à ce que personne ne te détourne de ce chemin de la doctrine...
Et ceci peut se résumer :
odoi / odôn / odos tes zôes /
odos tes zôes /
tou thanatou odos / odou.
Jean-Marie GEORGEOT - " De Saint-Marc jusqu'à Tertullien " ( 1978 à 2004 )
LA DIDACHE - 55 -
Il y a donc six emplois pour lesquels je ne vois ni ne comprends aucune
'structure' (= succession organisée) possible. Pour six présences du mot, il y a
quatre formes différentes, dont en plus le singulier et le pluriel.
A la charnière des versets D. IV-14 / D. V-1, il y a un procédé de composition
stylistique fort courant :
aute aute
estin estin
e odos e... odos
ce qui est un simple retournement avec une inclusion : 'tou thanatou' en laquelle
je puis, tout au plus, voir la mise en évidence du mot 'thanatou = la mort : la
crevaison comme pour une bête' (cfr : le sens dans Saint Marc), en opposition
à la vie, puisqu'il y a
odos tes zôes . tou thanatou odos.
2.- Un mot insolite
D. I-5 Ouai tô lambanonti
Ouai à celui qui prend (ce qu'on lui donne s'il n'en a pas besoin).
(Voir dans le lexique le mot ouai). C'est un mot de la culture sémitique, fort
courant, il est vrai, dans le N.T.
3.- Le mot 'fils'
D. III-1 teknon mou ... ((= mon fils))
D. III-2 me ginou... odegei gar e... pros ton
D. III-3 teknon mou me ginou... odegei gar e... pros TEN
D. III-4 teknon mou me ginou... odegei eis ten...
D. III-5 teknon mou me ginou... odegei to... eis ten
D. III-6 teknon mou me ginou... odegei eis ten...
D. IV-1 teknon mou...
D. V-2 teknôn... tekna (= enfants)
J'ai tenu à citer car, ici, il ne m'apparaît aucune volonté de structure, alors que
si cela avait été dans Saint Marc j'aurais eu obligatoirement quelque structure
remarquable mise en évidence. Les cinq parallélismes sont avec quatre
formulations différentes et ne dépassent pas la simple coexistence de teknon mou
me ginou + odegei. Pourtant le verbe odegei contient en lui la notion
fondamentale dans tout ce livre, puisqu'il pourrait être traduit par cheminer
(= conduire).
Jean-Marie GEORGEOT - " De Saint-Marc jusqu'à Tertullien " ( 1978 à 2004 )
LA DIDACHE - 56 -
CONCLUSION SUR LA DIDACHE
Ami ! Ce qui a été lu et découvert dans le texte de Saint Marc au sujet du
'chemin' n'a pas de similitude dans la Didachè, alors que cette dernière se veut
la Doctrine des deux chemins.
Bien évidemment, la conclusion est que l'auteur n'est pas le même. De plus, on
peut affirmer (malgré le titre annonçant qu'il s'agit d'un livre de Doctrine des
DOUZE APOTRES) que l'auteur du livre de Saint Marc n'a pas collaboré
directement à la rédaction de la Didachè, sinon des traces seraient visibles.
Certaines idées de la Didachè se trouvent en conformité avec le texte de Saint
Marc et certains mots sont employés avec le même sens; cela, tout lecteur
attentif peut le voir avec facilité. Mais il n'y a pas ce que je puis appeler le coup
de patte du Maître trahissant sa présence aux côtés de celui qui rédigea. Dans
une peinture = un rayon de lumière, la forme d'un coup de pinceau. Dans l'œuvre
musicale = la résolution d'une sensible, le contrepoint d'un sujet en réponse. Ici,
dans la Didachè, je n'ai rien vu ni décelé à l'analyse.
C'est alors que je me suis souvenu d'un certain chapitre des Actes des apôtres.
(Voir le chapitre, au-delà de ce qui suit ici immédiatement).
TORA = CHEMIN
Un temps assez long après avoir écrit l'ensemble des chapitres sur la Didachè,
je suis revenu ici, en ce lieu de mon texte, afin d'expliciter la notion de chemin.
Voici que désormais je sais que l'évangile de Saint Marc est le sixième
chapitre du livre de Moïse, ou encore : le sixième livre de la Tora.
1.- Le mot TORA signifie : la Loi et il vient d'un verbe dont le sens est : étudier
ou encore : cheminer. L'étude est la production du sens de la Loi; elle est aussi
le chemin de la vie, ce qui confère au mot Tora autant le sens de Loi que celui
de chemin.
Jean-Marie GEORGEOT - " De Saint-Marc jusqu'à Tertullien " ( 1978 à 2004 )
LA DIDACHE - 57 -
2.- La TORA (livre hébreu) comporte cinq livres. Le premier est au
commencement du chemin, mise en route, point de départ. Le second a pour
nom Exode, étymologiquement : la route. Il dit la fin de l'errance d'Israël avec
(au milieu du livre) le don de la Loi. La Tora devient la Tradition écrite :
Mc VII-5 En raison de quoi tes disciples ne marchent-ils pas
selon la tradition des anciens ?
3.- Au Sinaï, l'Eternel donne la Loi à Moïse : Il l'a gravée de Son doigt sur la
pierre, signe inaltérable de validité. Lorsque Moïse vient (= descend) vers son
peuple, il le trouve adorant un veau d'or : les hébreux, ayant ressenti le besoin
d'un dieu, ont fabriqué une idole, c'est à dire un signe voulu par eux pour la fin
de leur errance. Moïse refuse, d'où la destruction du veau et les tables cassées
(car les tables, comme le veau, pourraient être prises comme le signe de la fin de
l'errance... or la Terre promise est encore fort lointaine !). Dieu donne donc
l'ordre de graver le même texte sur une nouvelle table et les hébreux, dans leur
attente, ne fabriquent plus de nouvelle idole en forme de veau d'or, car ils ont
compris qu'il va leur falloir encore marcher.
Le veau d'or était l'affirmation qu'ils voulaient se référer à un dieu. Moïse leur
transmet la Loi nouvelle qui est la référence à Dieu-Unique.
4.- Les hébreux recommencent à marcher, mais désormais ils doivent marcher
dans la Tradition écrite qui est la LOI du Décalogue : c'est le seul document
auquel ils puissent se référer, puisqu'ils sont encore dans un désert (un pas-de-
lieu, avec pas-de-référence, car pas-d'environnement).
Le peuple élu, protégé et guidé par Dieu, vit dans l'Alliance (c'est à dire le
respect de la règle du contrat), ce qui a pour sens : vivre les préceptes reçus par
l'entremise de Moïse. Leur vie consiste à marcher (= cheminer), ce qui est
étudier (afin de donner de plus en plus de sens à) l'écrit reçu au Sinaï.
L'étymologie du mot TORA est :
ETUDIER = donner du sens = marcher = CHEMINER .
Jean-Marie GEORGEOT - " De Saint-Marc jusqu'à Tertullien " ( 1978 à 2004 )
LA DIDACHE - 58 -
Aux deux extrêmes, il y a :
ETUDIER CHEMINER
ce qui, dans le livre de Saint Marc, est écrit s'en-aller-VERS :
Mc XVI-15 "Et (Jésus) leur dit : ' (Vous)-en-allant-VERS...".
5.- Beaucoup plus tard, alors que je marchais vers Damas, j'ai vu Saul tomber
sur le chemin et y trouver sa vérité car Jésus le priva pendant trois jours de
toute possibilité de voir. Ceux qui l'accompagnaient furent obligés de le guider.
Son éblouissement sur le chemin de Damas est interruption, brisure, cassure du
chemin (= la cassure de ce qu'il avait construit en lui-même pour être sa propre
loi).
Ananie, à Damas, refit le geste de Jésus à Beth-Saïde :
Mc VIII-25 "...il imposa les mains sur ses yeux.
Et il voyait-bien,
et (sa vue) fut restituée.
Et il fixait-le-regard distinctement (sur) tout°."
Ac IX-20 'Et aussitôt il proclama, dans les synagogues,
que Jésus est le Fils de Dieu !'
La cassure sur le chemin de Damas devient alors le signe du commencement
d'un nouveau temps : les écrits de Saul (ou encore :) les Epîtres de Paul.
6.- Ainsi ai-je lu le chemin, livre de la Tora allant-vers son sixième chapitre :
évangile de Saint Marc. Puis, la chute sur un chemin(13), commencement d'un
temps pour une écriture nouvelle : les Epîtres de Saint Paul.
_______________
Jean-Marie GEORGEOT - " De Saint-Marc jusqu'à Tertullien " ( 1978 à 2004 )
LA DIDACHE - 59 -
DIDACHE III
CHAPITRE XV
d e s
ACTES DES APOTRES
_______________
Le texte
Analyse
La première épître : texte
La première épître : analyse
Ceux qui décident
L' écrit
Quatre envoyés
La Pénicie et la Samarie
Lectio divina
Annexe : Les raisons de ma lection divina
_________________________
Jean-Marie GEORGEOT - " De Saint-Marc jusqu'à Tertullien " ( 1978 à 2004 )
LA DIDACHE - 60 -
LE TEXTE
1.- Des gens descendus de Judée enseignaient aux frères : si vous n'avez pas été
circoncis selon l'usage mosaïque, vous ne pouvez pas être sauvés.
2.- Paul et Barnabé s'insurgèrent, eurent avec eux une discussion assez vive et
on décida que Paul et Barnabé et quelques autres des leurs monteraient à
Jérusalem auprès des apôtres et des anciens, à propos de cette question.
3.- Quand l'église leur eut fait cortège, ils parcoururent donc la Phénicie et la
Samarie en racontant...
4.- Arrivés à Jérusalem, ils furent reçus par l'église, les apôtres et les anciens et
racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux.
5.- Mais quelques-uns de la secte des pharisiens qui avaient la foi s'élevèrent
pour dire : il faut les circoncire et leur ordonner de garder la Loi de Moïse.
6.- Les apôtres et les anciens se rassemblèrent pour examiner l'affaire.
7 à 11.- Pierre se leva et dit...
12.- Et toute la multitude se tut. Ils écoutaient Barnabé et Paul raconter...
13.- Et quand eux aussi se turent, JACQUES répondit : Frères ! Ecoutez-moi !
14 à 18.- (Discours de Jacques :) Syméon a raconté... je rebâtirai l'abri de David.
19.- C'est pourquoi je juge qu'il n'y a pas à inquiéter ceux des nations qui se
retournent vers Dieu.
20.- IL N'Y A QU'A LEUR ECRIRE : Qu'ils s'abstiennent des souillures des
idoles, de la prostitution, des viandes étouffées et du sang,
21.- car depuis les générations anciennes Moïse (le dit dans son texte) puisqu'on
le lit à chaque sabbat dans les synagogues.
Jean-Marie GEORGEOT - " De Saint-Marc jusqu'à Tertullien " ( 1978 à 2004 )
LA DIDACHE - 61 -
22.- Alors, les apôtres et les anciens avec toute l'église (renvoient Paul et
Barnabé et les font accompagner de Jude et de Silas.)
23 à 28.- (Le texte de l'écrit qu'ils emporteront avec eux).
ANALYSE
(1).- Des gens descendus de Judée :
Nous voici à un temps de recommencement car, au début de l'évangile de
Saint Marc, j'ai noté que "s'en-allait auprès de lui tout le pays (de) Judée".
(Mc I-5)
En ce début du chapitre XV des Actes, ces gens descendus de Judée sont-ils
des juifs convertis à l'enseignement de Jésus ou de simples juifs curieux
d'entendre la doctrine nouvelle ? Ils enseignaient aux frères : donc il ne semble
pas qu'ils se soient ralliés ouvertement et ils font référence à l'usage mosaïque...
ce qui n'est pas la LOI, mais ce qui est la Tradition.
(1).- ...l'usage mosaïque... :
L'expression vient intentionnellement car, il y a peu de temps, nous avons
entendu des faux-témoins dire au sujet d'Etienne : Nous lui avons entendu dire
que Jésus... changeait les usages que Moïse nous a transmis.
(Actes VI-14)
Peu après, Etienne fut lapidé jusqu'à la mort alors que, à côté, un jeune-homme
appelé Saul regardait. L'enjeu de cette expression : la mort pour Paul !
(2).- Paul et Barnabé :
Quelle est leur pensée et leur foi, au sujet de cette question de la
circoncision ? Ils s'insurgèrent et eurent avec eux (= ceux descendus de la
Judée) une discussion assez vive.
Paul et Barnabé racontent partout le nouveau message. Ils arrivent d'Antioche
où ils étaient il y a quelques instants (XIV-26) et ils y racontèrent tout ce que
Dieu avait fait avec eux (XIV-27, qui va se retrouver écrit identiquement en XV-
4). Leur message est le récit des événements récents au sujet de Jésus.
Jean-Marie GEORGEOT - " De Saint-Marc jusqu'à Tertullien " ( 1978 à 2004 )
LA DIDACHE - 62 -
Alors j'ai relu, en mon esprit, tout l'évangile de Saint Marc et je n'y ai trouvé
aucun mot traitant de la circoncision. Plus grave même, j'ai vu le verbe couper
(g : koptô) être l'instrument du scandale pour la main, pour le pied; et aussi le
rituel païen des incisions (g : koptô) pour le gérasénien. L'Alliance, en hébreu, se
dit le tranchage, la coupure. L'arrivée du mot alliance dans le texte (Mc XIV-24)
est tellement singulière qu’aucun mot autre de même parenté en grec ne peut
être trouvé. La vue du Messie, qui est la vie de Celui qu'ils devraient voir
comme le plus juif de tous les juifs est décrite sans qu'il soit fait mention de la
circoncision.
Aussitôt, entraîné par ce questionnement, j'ai cherché le mot sang et j'ai vu
que, dans le texte de Saint Marc, personne ne fait mémoire de l'interdiction de
manger du sang. Pourtant, il y a eu un passage traitant des impuretés et des
nourritures, avec cette parole de Jésus :
Mc VII-18 "Ne réalisez-vous pas que tout ce qui (vient)-du-dehors en
pénétrant dans l'homme ne peut le souiller ?"
Et le sang ? Tous ont entendu, tous ceux-là de la foule (VIII-14) et pas un seul
de ces pharisiens qui rôdent à l'entour (VII-1-3-5-...) n'a osé poser la question. Or,
aujourd'hui, lorsque j'évoque ce verset (VII-18) lors de mes discussions avec mon
rabbin, celui-ci réagit avec passion et vivacité et il n'admet le texte qu'avec une
adjonction mentale : dès que vous avez fait don aux prêtres des prémices d'un
produit, vous pouvez en user librement... ainsi en est-il de toute nourriture.
Bref, rien n'est dit en Saint Marc de la circoncision... ni du sang. Paul et
Barnabé racontent tout ce que Dieu avait fait pour eux ou encore leur
perception de Dieu. Comme ceci n'est pas de l'ordre de l'usage mosaïque, ils ne
font pas de référence à la circoncision.
(3).- ... la Phénicie et la Samarie... :
Lire ces deux noms de lieux géographiques est pour moi une cause
d'étonnement car, dans l'évangile de Saint Marc, aucun des deux n'est cité.
Il me faut donc regarder si, quelque part dans le texte des Actes, j'en trouve
une évocation.
Jean-Marie GEORGEOT - " De Saint-Marc jusqu'à Tertullien " ( 1978 à 2004 )
LA DIDACHE - 63 -
La PHENICIE (absente du texte de Mc) vient ici :
'Ceux donc qui avaient été dispersés depuis l'affliction survenue à propos
d'Etienne passèrent jusqu'en Phénicie...'
(Actes XI-19)
Donc au moins quelques-uns des apôtres et des anciens y sont allés.
'Et, trouvant un navire en partance pour la Phénicie, nous y sommes
montés ... et nous sommes descendus à Tyr.'
(Actes XXI-2 et 3)
Ce dernier texte me rappelle ce qui est dit des régions de Tyr (cfr : Mc III-8 /
VII-24 et 31) et j'ai noté combien le pays est païen.
Revenant alors à la première citation, je vois qu'elle vient aussitôt après que
Pierre eut parlé longuement, car
'Pierre monta à Jérusalem. Ceux de la circoncision le prirent à partie.'
(Actes XI-2)
Pierre répond à la question posée, son témoignage attestant des paroles de
Dieu :
'J'ai entendu une voix me dire... j'ai dit : '... jamais rien d'impur n'est entré
dans ma bouche... Est-ce que je pouvais empêcher Dieu ?'
(Actes XI-2 à 17)
Voici que le texte des Actes me fait prendre conscience : ceux-là qui passèrent
jusqu'en Phénicie parlèrent et racontèrent; le texte a cette précision :
'... ne disant la parole à personne d'autre qu'aux juifs.'
(Actes XI-19)
La prédication touche uniquement ceux qui adorent le Dieu-Unique (des juifs);
mais il n'est rien dit de la matière enseignée, sauf qu'ils leur annonçaient le
Seigneur Jésus. Donc rien sur la circoncision, les viandes étouffées, le sang, les
idoles. Et rien sur les rites (locaux) de ceux qui adorent les dieux (païens).
La SAMARIE (absente du texte de Mc) vient ici :
(Jésus, ressuscité, est avec les apôtres et leur annonce la venue d'un jour
où ils deviendront SES 'témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie
et jusqu'au bout de la terre'. (Actes I-8)
Jean-Marie GEORGEOT - " De Saint-Marc jusqu'à Tertullien " ( 1978 à 2004 )
LA DIDACHE - 64 -
Il est beaucoup question de la Samarie. Philippe y prêche et...
'... les apôtres, à Jérusalem, entendirent que la Samarie avait accueilli la
Parole de Dieu et ils leur envoyèrent Pierre et Jean'.
(Actes VIII-1 à 25)
Le résultat :
'L'Eglise avait donc la paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie.'
(Actes IX-31)
Ainsi Paul et Barnabé agissent en profonde union avec ceux de Jérusalem,
lorsqu'ils parcourent la Phénicie et la Samarie. Ils causaient une grande joie à
tous les frères : ce qui me montre combien la proclamation de Paul et Barnabé
est conforme à l'enseignement de Pierre (la Phénicie), puis de Pierre et Jean (la
Samarie).
(4).- A Jérusalem, ils furent reçus par l'église :
Le mot église désigne la réunion des disciples car, lors de leur départ pour
cette mission, on a vu l'église leur faire cortège.
(5).- Mais quelques-uns de la secte des pharisiens qui avaient la foi :
Le texte apporte une précision : qui avaient la foi et, ici, cette expression
ne peut que désigner des juifs (= pharisiens... ?) convertis. Le mot pharisien me
rappelle le temps de l'évangile durant lequel les pharisiens formaient un groupe
d'hommes attachés à l'enseignement oral et à la Tradition (orale). Ici, ils vont
changer de comportement car ils citent la LOI de Moïse, c'est à dire un écrit et
cette loi écrite impose : il faut les circoncire.
(Relisant ceci un peu plus tard, je voudrais tempérer car : la Loi de Moïse
repose d'abord, et principalement, sur l'écrit; mais les juifs ont ajouté une partie
nouvelle qui est la tradition orale et à laquelle ils donnent aussi pour origine
l'enseignement 'oral' donné par Moïse aux hébreux.)
Les gens descendus de Judée avaient enseigné, beaucoup plus simplement,
que 'celui qui aura-foi et sera circoncis sera sauvé', ceci étant une formulation
conforme à l'esprit du texte des Actes (XV-1) et semblable à la forme du texte
de Mc (XVI-16). On sent que ces gens-là étaient prêts à ajouter :
Mc XVI-16 "Or celui qui n'aura-pas-foi° sera condamné".
Jean-Marie GEORGEOT - " De Saint-Marc jusqu'à Tertullien " ( 1978 à 2004 )
LA DIDACHE - 65 -
Ces gens-là sont des auditeurs de Barnabé et Paul. Les pharisiens, quant à eux,
sont à l'écoute de l'Eglise de Jérusalem et ils ne sont pas descendus de Judée; ils
n'ont pas été chercher, ailleurs, une parole nouvelle : étant de Jérusalem, ils sont
restés à Jérusalem, ont prêté une oreille attentive, sont devenus sympathisants
mais en restant fidèles à la LOI (de Moïse), c'est à dire à l'ECRIT de Moïse.
Ceux de Jérusalem ont conscience de la puissance du LIVRE, garant de leur
orthodoxie, alors que ceux descendus de Judée vont vers des usages évoluant
selon les traditions.
(6).- Les apôtres et les anciens :
... et non pas l'église, car la question est d'une telle importance que seuls
vont délibérer ceux qui ont connu Jésus. Ceci est conforme à la parole de Pierre
lorsqu'il fut délibéré sur le choix de celui qui occuperait la place rendue vacante
par la trahison de Judas. Pierre leur avait dit :
'Il faut donc que parmi les hommes qui ont été avec nous tout le temps que
le Seigneur Jésus allait et venait parmi nous... quelqu'un soit, avec nous, témoin
de sa résurrection.'
(Actes I-21 et 22)
Ceux qui vont délibérer sur la circoncision ont tous été témoins de la
résurrection de Jésus.
(7).- Pierre se leva et leur dit... :
Geste habituel de Pierre, comme en Actes (I-15). Pourquoi Pierre ? Sans
doute en mémoire de tout le vécu auparavant. D'ailleurs la question se posait à
tous les présents puisque Pierre se justifie immédiatement :
'Vous savez que, dès les jours anciens (= voir l'Evangile) Dieu m'a choisi
parmi vous pour que les nations entendent de ma bouche la parole de
l'Evangile et qu'elles aient foi.'
Ensuite, Pierre fait une proposition :
'Pourquoi mettez-vous Dieu à l'épreuve en imposant sur la nuque (=
évocation de Moïse à la nuque raide) des disciples un joug que ni nos pères ni
nous n'avons pu porter ?'
Doit-on en déduire que la loi de Moïse n'est plus appliquée ? Et, si tel est le
sens, en vertu de quel pouvoir Pierre parle-il, car en disant : nous il s'est exprimé
en solidarité avec ceux qui n'ont pas pu porter ? S'agirait-il d'un nouvel usage ?
Jean-Marie GEORGEOT - " De Saint-Marc jusqu'à Tertullien " ( 1978 à 2004 )
LA DIDACHE - 66 -
(12).- Ils écoutaient Barnabé et Paul :
Ceux-ci apportent leur témoignage sur leurs succès en prédication. Il faut
noter que Barnabé passe, ici, avant Paul, sans doute parce qu'il était depuis plus
longtemps un compagnon des apôtres ? Ou : parce que c'est lui, Barnabé, qui a
amené Paul ?
Et aussi : peut-être est-ce lui qui, ici, expose le mieux la situation ?
(13).- Jacques répondit :
Et son discours va être un peu plus long que celui de Pierre. Jacques est le
chef de l'Eglise (de Jérusalem) et il se doit de parler avec autorité. Il terminera en
faisant référence à Moïse (un nom que Pierre n'a pas prononcé), c'est à dire à la
Tora : '...car depuis les générations anciennes, Moïse a dans chaque ville ses
prêcheurs puisqu' ON LE LIT :
CHAQUE SABBAT DANS LES SYNAGOGUES'.
Ceci est vrai : la liturgie judaïque impose chaque sabbat au moins une lecture
d'un passage de la Tora, (de façon telle que la totalité de la lecture de la Tora soit
accomplie sur le cycle de l'année).
(19).- C'est pourquoi je juge... :
Voici l'argument final, non discutable car hiérarchique. Celui qui est chef
de l'Eglise (de Jérusalem, donc du monde) va parler et rendre son verdict. La
parole est risquée, d'une audace infinie, terrible, mais elle est la référence et ce
sera, pour les temps à venir, la garantie de l'orthodoxie. La parole-dogme est le
'pincipe' de la cohésion (= de l'Unité) de l'Eglise. Jacques va juger ou encore :
prononcer une définition pour la conduite et tous devront s'y conformer.
(20).- IL N' Y A QU' A LEUR ECRIRE :
La parole passe par le support de l'Ecriture. Bien entendu, l'Eglise de
Jérusalem va entendre Paul et Barnabé porteurs d'un message. Bien entendu,
Jude et Silas les accompagneront et ainsi sera réalisée la plénitude ((= car ils
sont quatre !)) des deux couples d'hommes : deux sortant de Jérusalem et deux
rentrant dans leur pays de départ. Cela fait penser à Jésus (= Dieu-Incarné)
choisissant lui-même Simon et André, avec Jacques et Jean. Les Quatre vont
diffuser la première de toutes les épîtres.
Jean-Marie GEORGEOT - " De Saint-Marc jusqu'à Tertullien " ( 1978 à 2004 )
LA DIDACHE - 67 -
LA PREMIERE EPITRE : TEXTE
(Actes XV-23 à 29) :
Les apôtres et les anciens, vos frères,
à ceux des frères
d'Antioche, de Syrie et de Cilicie
qui viennent des nations :
Salut !
Ayant appris que quelques-un des nôtres vous ont troublés par des paroles et
ont, sans mandat de notre part, bouleversé vos âmes, nous avons cru bon, à
l'unanimité, de vous envoyer des hommes de choix avec nos chers Barnabé et
Paul, ces hommes qui ont livré leur vie à cause du NOM de Notre Seigneur
Jésus-Christ. Nous avons donc envoyé Jude et Silas qui, de vive voix vous
annonceront la même chose.
L'Esprit-Saint et nous-mêmes, en effet, avons cru bon de ne pas vous imposer
aucune charge en plus du strict nécessaire :
s'abstenir des idolothytes, du sang, des viandes étouffées, de la prostitution,
de quoi vous ferez bien de vous garder.
Portez-vous bien !
LA PREMIERE EPITRE : ANALYSE
les apôtres et les anciens :
C'est à dire : l'Eglise (cfr : XV-4).
qui viennent des nations :
Ou encore : à ceux de la diaspora et des peuples étrangers.
quelques-uns des nôtres :
Donc : des gens de même milieu (culturel) que celui auquel nous
appartenons, ou encore : des juifs.
sans mandat de notre part :
L'expression confirme (a contrario) le mandat que l'Eglise a donné à
Barnabé et Paul d'aller leur porter la parole nouvelle.
Jean-Marie GEORGEOT - " De Saint-Marc jusqu'à Tertullien " ( 1978 à 2004 )
LA DIDACHE - 68 -
Le lecteur reviendra vers l'arrière du texte et y verra comment Barnabé
présente Saul (= Paul) aux apôtres et comment celui-ci agissait de lui-même (IX-
27 à 31). L'envoi en mission de Barnabé et Paul a eu lieu un peu plus tard (XI-30)
et la mission consistait, avant tout, à porter des secours (financiers) aux frères en
Judée.
Il était nécessaire de revenir sur cette histoire, car cela pose une question : Paul
n'a-t-il pas dépassé certaines limites dans son enseignement auprès d'eux,
puisque dès (IX-27 à 31) il avait déjà fait preuve d'une certaine indépendance ?
Cela va obliger à préciser dans la phrase qui suit et à bien resituer la mission de
Barnabé et Paul.
à l'unanimité :
Donc par un choix engageant chacun des Douze apôtres. Pour mon
lecteur, qui sent la relation étroite entre l'auteur de l'Evangile selon Saint Marc et
certain(s) apôtre(s), il y a là un signe qu'il conservera précieusement dans on
cœur (= intelligence), car ceci a une signification profonde particulièrement
envers Saint Paul.
de vive voix :
Il convient de répondre à ceux-là, sur le même registre qu'ils utilisèrent
pour contester (cfr : discussion assez vive en Actes XV-2).
s'abstenir :
Noter le léger glissement depuis la décision dite par Jacques jusqu'à l'écrit
final :
oral = souillures idoles prostitution viandes étouffées sang
écrit = idolothytes sang viandes étouffées prostitution.
(idolothytes = sacrifices offerts aux idoles - viandes sacrificielles).
Or, la question initiale était : La circoncision ?
Il n'en est pas question dans la réponse.
Jean-Marie GEORGEOT - " De Saint-Marc jusqu'à Tertullien " ( 1978 à 2004 )
LA DIDACHE - 69 -
CEUX QUI DECIDENT
Ceux qui se rassemblèrent pour examiner l'affaire (Actes XV-6) furent les
apôtres et les anciens. Ceux qui décident sont les apôtres et les anciens avec
toute l'Eglise (Actes XV-22). Il y a, là encore, un léger glissement pour la prise
de décision.
Cependant, je lis le verset 22 : les anciens et les apôtres approuvent la décision
de Jacques et mandatent Jude et Silas. Ils le font officiellement et toute l' Eglise
est tenue au courant des diverses raisons d'agir ainsi.
Pourtant, j'ai remarqué comment les apôtres sont toujours mentionnés avant
les anciens dans le récit proprement dit (versets 4-6 et 22) ainsi que dès le
commencement du texte de l'épître. Il y a là une preuve que les Douze (=
puisque Matthias...) sont considérés comme le collège suprême, car ils tiennent
leur (pouvoir) d'une nomination faite par Jésus et par lui seul. Les anciens, ceux-
là qui furent à son côté depuis plus ou moins longtemps dès la Galilée ou
simplement à Jérusalem, dans le Temple, viennent après les apôtres.
L'ancienneté ici n'a plus le même rôle que jadis, lorsque le récit répertoriait des
grands-prêtres, des scribes et des anciens. Mais, peut-être, parmi les anciens (des
Actes) y a-t-il des anciens du temps d'avant la Passion, sortis de leur tradition et
venus se joindre à ses disciples ? Que pensent-ils, eux tous, (= eux tous qui sont
circoncis) de la circoncision selon l'usage mosaïque (1) ?
L' ECRIT
Tous vont se taire : 'Et la multitude se tut' (12). Le récit ne laisse entendre
que le son de deux voix : Barnabé et Paul, deux voix pour une contemplation :
les signes et les prodiges que Dieu avait faits (12).
Alors, comme pour une étrange métamorphose, un silence s'établit : 'Et quand
eux aussi se turent...' (13), et c'est la voix pure et unique :
'Jacques répondit' (13).
Vivant intensément l'instant afin d'écouter les bruits du texte, je vois resplendir
le sens des paroles conclusives de Jacques :
'Il n'y a qu'à leur écrire...' (20)
car l'écrit est silence, mais en forme de long message proclamé vers le fond des
âges à venir. L'écrit demeure, immuable. Il peut être déchiré, effacé, taché. Il ne
peut être modifié et il continue toujours à dire ce qu'il contient.
Jean-Marie GEORGEOT - " De Saint-Marc jusqu'à Tertullien " ( 1978 à 2004 )
LA DIDACHE - 70 -
J'ai relu l'écrit tel il est translaté dans les Actes :
'Les apôtres et les anciens, vos frères, à ceux d'Antioche...' (23).
Le commencement est en style solennel et annonce un message officiel; je
n'ose encore écrire : bulle, encyclique, mandement, ... Le texte est écrit afin que
nul lecteur ne puisse, plus tard, mettre en doute le message. Il y a au début :
Salut ! et à la fin : Portez-vous bien !, ce qui marque les limites. Entre les
deux, on trouve la nomination de deux légats : Jude et Silas, accompagnant nos
chers Barnabé et Paul, ce qui confirme leur envoi initial. Puis il y a le
commandement nouveau :
'aucune charge en plus du strict nécessaire; s'abstenir...'
et c'est la fin du message.
QUATRE ENVOYES
As-tu remarqué, ô ami, qu'ils sont quatre, ou encore : deux couples ?
Barnabé + Paul Jude + Silas.
Cela ne devrait pas te laisser indifférent, car tu te souviens des deux couples de
frères qu'il appela à le suivre, un jour, le long de la mer de Galilée.
Faut-il toujours être quatre lorsqu'il y a un message ultra-important à
transmettre ? N'est-ce pas UN SIGNE voulu par l' auteur(14) des Actes des
apôtres pour obliger son lecteur à revenir longuement sur ce qui est la première
de toutes les Epîtres ? Car, enfin, quoi de nouveau cette dernière nous apporte-t-
elle ?
Ami, réfléchis bien : as-tu, dans cet écrit, la réponse à la question initialement
posée ?
Mais alors, la question était-elle bien celle de la circoncision ? N'était-elle pas
autre ? ... Par exemple : la nécessité d'un écrit qui soit comme un nouveau livre
du Lévitique ?
Jean-Marie GEORGEOT - " De Saint-Marc jusqu'à Tertullien " ( 1978 à 2004 )
LA DIDACHE - 71 -
LA PHENICIE ET LA SAMARIE
Je te propose, ami, de laisser pendant quelque temps tous ceux-là de l'Eglise de
Jérusalem et d'aller visiter, par nous-mêmes, les territoires de la Phénicie et de la
Samarie, car ce sont là des régions insolites.
Paul et Barnabé ont tenu à parcourir ce pays et nous avons cru comprendre
que, avant eux déjà, Pierre seul, puis Pierre et Jean y avaient été envoyés en
mission. Y aurait-il la motivation pour les deux de passer par ces terres afin d'y
mesurer l'efficacité des prédications faites ? Je ne puis admettre que les uns
d'Antioche surveillent ainsi les uns de Jérusalem. Alors, serait-ce afin de nous
faire admettre que Pierre et Jean (= un couple d'apôtres) ne pouvaient pas être
envoyés pour la mission qui (finalement) fut confiée à Jude et à Silas ? Je ne
l'accepte toujours pas.
Aussi, toi et moi, marchons sur le chemin afin de parcourir la Phénicie et la
Samarie et, nous en-allant-vers ce pays, réfléchissons à ce qui fit (le verbe g :
poieô) que le Livre de Moïse arriva (g : ginomai).
Mon rabbin, toujours présent à mes côtés lorsqu'il s'agit de l'histoire d'Israël,
expliqua longuement comment le texte que je croyais unique existe en réalité
par une dualité de textes et sous une trinité de formes. Excuse-moi, lecteur, du
long développement qui va suivre, mais tu ne peux plus ignorer certaines
données qui touchent à la forme du texte de la Tora.
Il existe trois textes différents du Livre de Moïse. Pour nous, deux sont très
usuels : le texte hébreu (écrit en caractères hébreux, tels nous sommes habitués
à les voir) et le texte de la Septante (écrit en grec).
Entre ces deux textes, il y a certaines différences dues à des difficultés de
traduction, donc de compréhension, c'est à dire d'interprétation du texte original
hébreu.
Or il y a, en plus, un troisième texte : le Pentateuque SAMARITAIN. Celui-
ci se distingue de la Tora (à partir d'ici, je désignerai par le mot Tora le texte
habituel des juifs, écrit en hébreu carré) par de très nombreuses variantes
(plusieurs milliers) consistant soit en des graphies singulières, des mots
nouveaux, des modifications de l'ordre des mots ou même des récits souvent
allongés.
Jean-Marie GEORGEOT - " De Saint-Marc jusqu'à Tertullien " ( 1978 à 2004 )
LA DIDACHE - 72 -
Une différence très caractéristique vient au Décalogue pour le dixième
commandement qui, chez les samaritains, désigne le mont Garizim comme lieu
unique pour le culte.
Ici, j'arrêtai mon rabbin pour lui rappeler comment, dans le texte de Saint
Marc, ce même dixième commandement n'est pas conforme au texte habituel
(Voir Jésus dit le Décalogue : verset Mc X-19) et ceci est pour moi un nouveau signe
engageant à poursuivre le chemin.
Mon rabbin continua donc : Beaucoup de nos savants, dit-il, croient que le
Pentateuque samaritain a été adopté par la communauté sectaire de Sichem vers
128 avant J.-C., lorsque Jean Hyrcan détruisit le Temple du mont Garizim. Il
fallut alors un texte de la LOI qui puisse servir de ralliement et les samaritains
agirent comme feront, plus tard, les pharisiens lors de la destruction du Temple
de Jérusalem : ils décidèrent d'aménager le texte(15).
Le rabbin ajouta : D'autres de nos savants soutinrent que le Pentateuque
samaritain est beaucoup plus antique et pourrait avoir été écrit dès le quatrième
siècle avant J.-C., peut-être pas dans sa forme aussi explosive, mais déjà avec
des différences notables par rapport à la Tora. C'est ce dernier texte qui a servi
de base pour la rédaction/transcription dite de la Septante, non sans que des
discussions assez vives aient eu lieu pour choisir, au départ, le texte devant être
le texte de référence : Pentateuque samaritain ou Tora ?
Quoiqu'il en soit, l'origine(16) du Pentateuque samaritain le situe comme plus
ancien que la Tora en certaines de ses parties et, pour le reste, comme très
conforme à la Tora.
Or, nous marchions toujours. Alors que nous venions de traverser une
bourgade appelée Rama(17) et que nous arrivions en pleine Samarie, mon
rabbin nous présenta les samaritains : Ce sont des gens qui veillent scrupuleuse-
ment à conserver les rites anciens. Ils vivent les fêtes juives comme les hébreux
vécurent l'événement, et leur calendrier diffère de celui, plus récent, en usage
dans le Temple de Jérusalem. La fête de Pâque, toujours d'un mardi soir à un
mercredi soir, est l'occasion pour eux d'immoler un agneau selon les
prescriptions (que tu trouveras dans divers chapitres de ma Lectio divina par
séquence traitant de la Pâque).
Jean-Marie GEORGEOT - " De Saint-Marc jusqu'à Tertullien " ( 1978 à 2004 )
LA DIDACHE - 73 -
Ces gens parlent l'araméen(18), mais aussi un hébreu prononcé d'une façon
très antique :
Genèse I-1 'Barachet bara Elouwwem it achammem wit ares'
Ils écrivent l'hébreu avec des caractères plus anciens que ceux, pour nous
usuels, utilisés à Jérusalem (et issus de Babylone), l'écriture samaritaine datant
d'avant l'exil hors de la Palestine.
Ils observent très strictement le sabbat : ni feu, donc pas d'aliment chaud, ni
surtout aucun recours à une personne étrangère pour 'faire' quelque service.
Quant à leurs enfants, avant qu'ils aient atteint leur neuvième jour, ils reçoivent
LA CIRCONCISION... et tous attendent le Messie, à qui ils ont donné un Nom
: le RAEB, Messie devant venir comme un nouveau Moïse apporter, à la fin des
temps, la paix et la joie universelles.
Comme nous arrivions au sommet du mont Garizim, mon rabbin conclut :
Ainsi, il y a trois formes pour le Livre de Moïse :
la Tora qui, révisée à Yavne vers les années 90 (ap. J.-C.),
sera connue selon le texte massorétique,
la Septante version alexandrine de la Tora et en différant par quelques
'interprétations',
le Pentateuque samaritain version (alors) usuelle en Phénicie et en Samarie
et connue jusqu'à Jérusalem.
Les gens descendus de Judée(19) utilisaient le texte ci-dessus nommé Tora,
collationné peut-être au V° siècle av. J.-C., au retour de l'exil, à partir de textes
dont l'origine pourrait s'étendre jusqu'au IX° siècle av. J.-C..
La Phénicie et la Samarie utilisaient(20) le texte du Pentateuque samaritain.
Paul et Barnabé utilisent, à Antioche, la Septante, car cette version est en
langue grecque, mais ils sont confrontés au texte de la Tora par l'enseignement
donné par ces gens descendus de Judée.
Ainsi, marchant sur le chemin de la Samarie, avec mon rabbin, nous
réfléchissions pour savoir : des trois textes :
"qui est le plus grand ?"
(cfr : Mc IX-34)
Jean-Marie GEORGEOT - " De Saint-Marc jusqu'à Tertullien " ( 1978 à 2004 )
LA DIDACHE - 74 -
LECTIO DIVINA
Est accompli le moment où le chapitre XV des Actes se manifeste sous une
nouvelle forme. Paul et Barnabé, naguère, avaient été envoyés en mission. Il me
faut revenir un instant sur ces textes ;
(A cause de la grande famine :)
'Les disciples (= Antioche) établirent donc qu'on enverrait, chacun
selon ses moyens, un secours aux frères qui habitaient en Judée; ce qu'ils
firent en l'envoyant aux anciens (= de Jérusalem) par les mains de Barnabé et
de Saul.'
(Actes XI-29 et 30)
(Le texte raconte les malheurs de Jérusalem : assassinat de Jacques, le frère de
Jean et arrestation de Pierre. Un ange libère Pierre... et met à mort Hérode.)
(Actes XII-1 à 24)
'Barnabé et Saul, une fois leur service accompli, s'en revinrent de
Jérusalem en prenant avec eux JEAN surnommé MARC.'
(Actes XII-25)
Je lis ces textes : Barnabé et Saul sont envoyés en mission pour apporter des
secours à Jérusalem. Ils y apprennent tout ce que Dieu a fait pour sauver Pierre
et faire périr Hérode. Après ces événements, ils rentrent à Antioche, mais ils se
font accompagner par Marc, c'est à dire par celui qui a écrit LE LIVRE de tout
ce que Dieu a fait au sujet de Jésus. Et voici que, peu après, une contestation
s'élève. Des judéens enseignaient aux frères sur la circoncision et les usages
mosaïques. Leur enseignement est fait à partir de (leur) Tora, le livre saint de
Jérusalem. Paul et Barnabé, étant juifs dans la diaspora, enseignent à partir de la
Septante. Ils ont pris Marc avec eux : où en était son Livre ?
Afin d'étudier la question en profondeur, ils partent par la Phénicie et la
Samarie, deux pays où on lit une Tora plus antique, connue sous le nom de
Pentateuque samaritain. Ils y racontent le retournement des nations; ils
causaient une grande joie à tous les frères. Donc leur enseignement (le livre de
Marc ?) y fut bien reçu et il n'est en rien contredit par l'écrit du Pentateuque
samaritain. Alors, ils arrivent à Jérusalem.
Jean-Marie GEORGEOT - " De Saint-Marc jusqu'à Tertullien " ( 1978 à 2004 )
LA DIDACHE - 75 -
Je ne recommencerai pas, ami, la lecture du 'Concile'. Allons directement à la
conclusion. Jacques a compris : 'IL N'Y a QU' A LEUR ECRIRE', car
Jacques pense que, désormais, il y a un urgent besoin d'un livre explicitant les
lois de la morale des chrétiens. La question n'est plus d'avoir avec les juifs
orthodoxes (= les judéens) des discussions assez vives, pour discuter (=
comme les rabbins ?) des différentes permissivités de la LOI. Jacques sait que
les juifs (orthodoxes) ont leur Tora. Les disciples de Jésus ont leur (nouvelle)
'Tora' (= le Livre de Marc). Il est urgent maintenant d'écrire le livre de la
doctrine chrétienne.
Mais, auparavant, il y a le problème posé par le mouvement provocateur des
gens de Judée. Pour répondre à ceux-ci, Jacques rédige avec les apôtres et les
anciens et avec toute l'Eglise la première épître que Paul et Barnabé, Jude et
Silas porteront à Antioche. Et aussitôt après...
...et peu après(21), ceux de Jérusalem, les apôtres et les anciens ne vont-
ils pas (faire) écrire le livre que nous connaissons sous le titre de :
DIDACHE ton dôdeka apostolôn =
La doctrine des Douze apôtres ?
Il est temps , MAINTENANT , pour nous ,
de prier les Trois prières de la DIDACHE .
_______________
Jean-Marie GEORGEOT - " De Saint-Marc jusqu'à Tertullien " ( 1978 à 2004 )
LA DIDACHE - 76 -
ANNEXE
LES RAISONS DE MA LECTIO DIVINA
_______________
Cette lectio divina m'a été inspirée par le passage de la Didachè terminant le
Livre des Deux voies (= des deux chemins), juste avant le commencement de la
section suivante devant traiter du baptême, du jeûne, puis de l'eucharistie. Voici
le texte de la Didachè :
(A la fin des commentaires sur le 'chemin de la mort = g : thanatou odos', il y a
cette conclusion :)
'Puissiez-vous, mes enfants, être à l'écart de tout cela.
(D. V-2)
Veille à ce que personne ne te détourne de ce chemin (g : apo tautes tes
odou) de la Doctrine (g : tes didaches), car celui-là t'enseigne en-dehors de
Dieu.
Si tu peux porter tout entier le joug du Seigneur, tu seras parfait. Sinon :
fais ce que tu peux faire.
Pour les aliments : prends sur toi ce que tu pourras, mais abstiens-toi
résolument des viandes offertes aux idoles (g : apo de tou eidôlothutou lian
proseche), car c'est un culte des dieux de morts°(22) (Theôn nekrôn)...
(D. VI-1 à 3)
(Puis, aussitôt et sans aucune transition :) Pour le baptême, baptisez de cette
manière...
(D. VII-1)
Jean-Marie GEORGEOT - " De Saint-Marc jusqu'à Tertullien " ( 1978 à 2004 )
LA DIDACHE - 77 -
Il y a donc, dans les régions de la finale du chapitre VI, un texte qui voudrait
presque s'excuser d'avoir peu traité de la grave question : 'pour les aliments,
comment se comporter pour les idolothytes, pour le sang et pour les viandes
étouffées' ? La Didachè dit cependant, très nettement, le commandement sur les
idolothytes.
J'ai relu, depuis son commencement, ce livre des Deux chemins en y cherchant
des traces de sang ou quelque morceau de viande étouffée : je n'ai rien trouvé !
Alors, priant ces textes, j'ai entendu en moi résonner certains passages de ces
textes. Ce sont plus que de simples indices, et leur harmonisation concorde avec
l'exégèse aboutissant à situer chronologiquement dans l'ordre de leur rédaction :
l'évangile de Saint Marc (premier écrit)
l'épître de Jérusalem (l'Ecrit du premier concile)
la Didachè (la Doctrine de la morale chrétienne).
Voici quelques raisons pour motiver mon exégèse (= ma lectio divina) :
1.- Le Concile de Jérusalem a décrété par un écrit qu'il faut
s'abstenir des idolothytes, du sang, des viandes étouffées.
Il n'y a donc pas besoin d'un commentaire supplémentaire sur le commande-
ment diffusé, car le Concile est net et précis, puisqu'il est écrit : s'abstenir. C'est
pourquoi la Didachè ne commentera pas.
2.- Au sujet de la prostitution, le Concile de Jérusalem a donné le même
commandement : s'abstenir, mais : que recouvre exactement ce mot de
prostitution ? La Didachè a donc pris en charge ce mot par les diverses
précisions suivantes :
'Abstiens-toi des désirs charnels et corporels...'
(D. I-4)
'Tu ne commettras pas d'adultère et
tu éviteras la pédérastie, la fornication...'
(D. II-2)
Jean-Marie GEORGEOT - " De Saint-Marc jusqu'à Tertullien " ( 1978 à 2004 )
LA DIDACHE - 78 -
'Evite les propos obscènes et les regards indiscrets,
car cela engendre l'adultère.'
(D. III-3)
'Voici maintenant le chemin de la mort :
adultères, convoitises, fornications...
actes d'idolâtrie, de magie, de sorcellerie...'
(D. V-1)
3.- Le mot 'g : eidolothutos = idolothytes, viandes immolées aux idoles'
n'existe pas dans le texte de Saint Marc (ni dans les trois autres évangiles) et il
vient pour la première fois (chronologiquement, dans le N.T.) par l'écrit du
Concile de Jérusalem (Actes XV-29) tel que donné précédemment. Il revient une
ultime fois dans les Actes et il est intéressant de noter en quelles circonstances.
Paul et ceux qui l'accompagnent ont fait un voyage missionnaire à Rhodes,
Patara, Tyr, Ptolemaïs et Césarée chez l'évangélisateur Philippe. Alors Agabus,
un prophète descendu de Judée, annonce que, selon l'Esprit-Saint, Paul doit
aller à Jérusalem. Ses compagnons exhortent Paul à ne pas monter à Jérusalem.
Arrivés à Jérusalem, ils sont accueillis avec joie par les frères et, le
lendemain, ils vont chez Jacques où sont tous les anciens. Paul leur raconta en
détail ce que... Dieu avait fait... Ils dirent à Paul : ... il y a parmi les juifs des
dizaines de milliers de croyants... zélés pour la Loi. On leur a dit que tu
enseignes à tous les juifs des nations à se détacher de Moïse, que tu leur dis de
na pas circoncire leurs enfants et de ne pas se conformer aux usages...
Alors, comme quatre hommes doivent aller bientôt se purifier publiquement,
que Paul aille avec eux pour montrer à tous que lui aussi il marche en gardant la
Loi. Puis ils ajoutent : 'Quant aux croyants des nations, c'est nous qui leur avons
écrit de :
se tenir en garde contre
les idolothytes, le sang, la viande étouffée et la prostitution.
(J'ai mis en lettres italiques grasses, dans ce long passage, les mots du chapitre
XV revenus au chapitre XXI-10 à 25).
Jean-Marie GEORGEOT - " De Saint-Marc jusqu'à Tertullien " ( 1978 à 2004 )
LA DIDACHE - 79 -
Les anciens ont ainsi rappelé à Paul le texte de l'épître et rien n'a été changé
dans la formulation du commandement qu'ils avaient mis par écrit. Le
commandement est donc bien rédigé, et la Didachè n'a pas besoin de le
développer ni de le commenter.
4.- Le Concile de Jérusalem n'a rien publié sur la question de la circoncision et
la Didachè n'a pas le moindre mot au sujet de ce rite. (Paul utilisera ce vocable
plus d'une quarantaine de fois dans ses Epîtres). C'est donc une question laissée
en suspens dans les Actes... et dans la Didachè.
5.- En outre, j'ai noté:
'Tu mettras tous tes biens en commun, avec ton frère et tu ne diras
pas qu'ils te sont propres, car si vous êtes solidaires dans l'immortalité, vous
devez l'être à plus forte raison dans les choses périssables.'
(D. IV-8)
Je me suis rappelé avoir lu, dans le premier écrit :
"Pierre commença à lui dire : 'Voici :
nous, nous avons tout laissé et nous t'avons suivi'."
(Mc X-28)
Et cela m'a toujours terrifié : audace ou défi, ou peut-être inconscience ? Car :
qui va subvenir à leurs besoins ? Et j'ai été rassuré, par :
'Et ils étaient assidus à l'enseignement des apôtres et à s'associer pour
rompre le pain et prier... Et tous ceux qui avaient-foi étaient ensemble et
avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et en
partageaient le prix entre tous selon qu'on en avait besoin.'
(Actes II-42 à 45)
"Or Jésus, ayant fixé-son-regard sur lui, l'AIMA et IL lui dit° : '...
Pars ! Autant-que tu as : vends (-le) et donne (-le) ((aux)) pauvres'."
(Mc X-21)
Il était nécessaire que la Didachè, en une phrase courte mais très concise (D.
IV-8) explique la commune concordance entre les textes de Saint Marc et les
événements relatés dans les Actes.
Jean-Marie GEORGEOT - " De Saint-Marc jusqu'à Tertullien " ( 1978 à 2004 )
LA DIDACHE - 80 -
*
*
*
*
***********
*
*
*
*
Jean-Marie GEORGEOT - " De Saint-Marc jusqu'à Tertullien " ( 1978 à 2004 )
LA DIDACHE - 81 -
DIDACHE IV
LES TROIS PRIERES
_______________
Présentation
Prière n° 1 : "Notre Père"
Lectio divina
Pardonne-nous 'comme' nous pardonnons
Sur le mot 'ôs'
Prière n° 2 : pour l'eucharistie
Prière n° 3 : après la communion
Deux textes grecs
Lectio divina
En finale
_______________
Jean-Marie GEORGEOT - " De Saint-Marc jusqu'à Tertullien " ( 1978 à 2004 )
LA DIDACHE - 82 -
PRESENTATION
Pour résumer ce que nous venons de constater au sujet du livre de la Didachè,
notons :
C'est un écrit judéo-chrétien et son auteur a eu connaissance du récit (tel
qu'il résulte) du Livre de Saint Marc.
Il a été écrit quelques années après l'évangile de Saint Marc pour donner à
tous les chrétiens (ceux issus du judaïsme ou ceux venant du paganisme) :
la Doctrine de la morale chrétienne,
les Rituels nouveaux
les Prières pour les assemblées.
Les prières sont au nombre de trois et elles apparaissent pour la première fois
dans un écrit. Elles sont :
le "Notre Père"
la prière eucharistique
l' action de grâce après le repas eucharistique.
Il s'agit là de textes qui nous sont proposés depuis ces temps ayant suivi la
Passion, la Mort et la Résurrection de Jésus-le-Messie, textes charnières issus du
judaïsme, offerts aux nations et priés à Jérusalem et en diaspora.
------------->
Jean-Marie GEORGEOT - " De Saint-Marc jusqu'à Tertullien " ( 1978 à 2004 )
LA DIDACHE - 83 -
PRIERE I
Le "Notre Père"
(D. VIII-2)
Priez de cette manière ...
NOTRE PERE qui dans le ciel = les cieux(1)
soit sanctifié ton NOM(2)
vienne ton Règne(3)
soit faite ta Volonté
semblablement au ciel
et sur terre(4)
Notre pain(5) quotidien donne-nous
et pardonne-nous notre offense
que(6) et nous pardonnons à nos offensants
et garde(7) - nous
de céder(8) en tentation
mais délivre-nous du mal
car EN TOI sont
la PUISSANCE et la GLOIRE (9)
DANS LES SIECLES .
Jean-Marie GEORGEOT - " De Saint-Marc jusqu'à Tertullien " ( 1978 à 2004 )
LA DIDACHE - 84 -
LECTIO DIVINA
1.- dans les cieux
En réalité, le texte de la Didachè est :
'g : en tô ouranô = dans le ciel',
mais j'ose écrire directement le pluriel. En effet, le texte de Saint Marc a donné
"qui dans les cieux" avec le pluriel. Pour un lecteur prenant contact avec cet
évangile mais ne lui consacrant pas un travail d'exégèse méticuleux nécessitant
un temps fort long, l'impression ressentie à une lecture assez rapide conduit à
écrire 'dans le ciel' avec le singulier, car ce qui reste à l'immédiat dans la
mémoire est : "le Seigneur... fut emporté°° vers le ciel" (Mc XVI-19). Le texte
est aussitôt visualisé et le lecteur localise ainsi "le Seigneur ((Jésus))". Or, ceci
situe également Dieu dans le ciel puisque Jésus est "-assis à droite de Dieu"
(XVI-19).
Il est ainsi très logique de penser que celui qui mit par écrit le "Notre Père"
pour la première fois usa du singulier. Lorsque l'analyse théologique arrive de
façon plus élaborée, alors le texte de (Mc XI-25) impose sa rigueur et il oblige au
pluriel car les cieux est un NOM pour l'Eternel.
Je vois donc dans l'usage du singulier un indice pour lire : le rédacteur de la
Didachè a écrit en un temps où le texte de Saint Marc n'est pas encore largement
diffusé (= n'a pas été longuement prié et beaucoup médité) et ceci fait que les
dates de l'écriture de l'un et l'autre livres sont fort proches. Plus tard, lorsque
l'usage du livre se développera, il sera vite compris que le mot ciel/cieux dépend
d'une volonté théologique de celui (ceux) qui a (ont) écrit le livre. Cette lecture
théologique du mot ciel est celle qui est exposée dans le lexique.
2.- ton NOM
J'apprécie beaucoup une intervention de mon rabbin au sujet de cette
lexie. Il m'a expliqué comment, dans les cieux, les anges sanctifient (= chantent
avec louanges) sans cesse le NOM.
J'ai aussitôt eu la vision :
dans les cieux : la sanctification du Nom
sur terre: la venue du Règne.
Et ma prière s'amplifie par les cieux + la terre qui est : la Création.
Jean-Marie GEORGEOT - " De Saint-Marc jusqu'à Tertullien " ( 1978 à 2004 )
LA DIDACHE - 85 -
3.- ton REGNE
Je lis ce mot comme portant au coeur de lui-même un nom pour Dieu.
Ainsi, depuis le commencement, j'ai par trois fois prononcé un mot qui est le
NOM :
DIEU CIEUX REGNE
(voir lexique)
car je me rappelle que Règne = Royauté = Royaume sont une TRINITE de
mots pour l' UNIQUE Basileia.
Je lirai donc la suite de la prière en m'inclinant chaque fois devant les autres
noms à venir : Volonté Puissance Gloire.
4.- et sur terre
Le texte français conserve ainsi l'ordre des mots du grec : d'abord ciel,
puis terre.
Le singulier pour le ciel doit être respecté car, suivant l'usage de ce mot en
Saint Marc, le singulier localise par rapport à terre. L'emploi est donc conforme
à Mc (XVI-19) : "fut emporté°° vers le ciel". Il ne s'agit plus, ici, de la Création
(qui, elle, obligerait à écrire 'les cieux et la terre = ha-shamaim (pluriel) ve ha-
erets (singulier)'. Il s'agit, ici, de la 'volonté' et la comparaison (ôs =
semblablement) imposa la localisation géographique. Donc : "au ciel et sur
terre", et non pas 'sur la terre comme au ciel' qui pourrait être lu en glissement
du défini (la terre) vers l'indéfini (au ciel).
5.- notre pain
Le livre de Saint Marc et la Didachè sont deux écrits sensiblement de
même date (à quelques années près) et ils ont été l'un et l'autre rédigés par des
juifs ayant foi en Jésus (judéo-chrétiens). Je puis donc comprendre le mot pain
comme porteur de son sens sémitique : la nourriture = "notre nourriture
quotidienne donne-nous aujourd'hui".
6.- : que
Il y a, ici, un passage difficile et mon double point est, pour le lecteur,
semblable à un panneau en travers du chemin : attention au virage dangereux !
Les textes sont les suivants :
-------------->
Jean-Marie GEORGEOT - " De Saint-Marc jusqu'à Tertullien " ( 1978 à 2004 )
LA DIDACHE - 86 -
D. VIII-2
kai aphes emin ten opheilen emôn
ô s
kai emeis aphiemen tois opheiletais emôn.
Mc XI-25
aphiete ei ti echete kata tinos
i n a
kai o Pater umôn o en tois ouranois
aphe umin ta paraptômata umôn.
Je constate une parenté entre les deux textes :
D. kai aphes emin t.. emôn
Mc kai aphe umin t.. umôn
Cette similitude et ce parallélisme ont fait brûler en moi, comme pour fondre
deux métaux AFIN QU' un seul alliage, par les deux mots grecs :
I N A / Ô S .
Si tu veux, ô lecteur, regarder dans le fond du creuset qui m'a servi en Lectio
divina par séquence pour lire Afin qu'aussi (votre Père), au verset (XI-25), tu y
verras briller la Présence en deux points qui sont profond silence pour entendre,
en écho, la voix de ta conscience. Toi aussi as-tu bien pardonné, car Dieu dans
son infinie bonté, LUI : te pardonne !
7.- garde
Textuellement : 'g : me = ne-pas'.
Le texte est :
NE-PAS nous aller/tomber/succomber
garde - nous de céder en tentation.
Jean-Marie GEORGEOT - " De Saint-Marc jusqu'à Tertullien " ( 1978 à 2004 )
LA DIDACHE - 87 -
8.- céder
Ce mot français a pour étymologie : 'latin : cedere = aller/s'en-aller'. La
traduction donne :
"que NE-PAS glisser (pour nous) vers la tentation !"
ou encore :
"garde-nous de céder en tentation".
9.- la PUISSANCE et la GLOIRE
Le texte grec est identique à celui que nous retrouverons en D. (X-5) ci-
dessous. Il n'y a pas : 'à toi le Règne, la Puissance et la Gloire'. J'ai longue-ment
prié à ce sujet et j'ai remarqué :
d'abord : dans les trois 'prières' données par la Didachè, il n'y a en jeu que la
Puissance et la Gloire, mais pas le Règne(23).
ensuite : dans le 'Notre Père', le Règne intervient dès la troisième ligne avec
un désir pour sa venue; donc, le Règne n'est pas là.
puis : il y a souvent, dans l'esprit des hommes, comme un penchant vers
ce qui est en forme trinitaire. Cela correspond au rythme de la 'vie' :
naissance = le commencement
vie = le milieu
mort = la fin.
Alors, j'ai vu briller trois lampes de feu entre les cieux et la terre :
le Règne car, depuis toujours, IL règna sur TOUT qui fut tohu-bohu et
qui devint lumière, cieux et terre, luminaires pour le temps et vie pour tous.
la Puissance car, depuis toujours, IL est DIEU-PANTO-KRATOR. Par six
puissances, il créa en un même instant de six jours TOUT pour l'homme. La
septième puissance ne fit rien : il s'étend pour le serment de la liberté laissée à
l'homme de prendre ou de refuser, même de continuer ou de vouloir achever...
la Gloire car, depuis toujours, IL devait DEVENIR homme. En
créant l'homme, ne s'obligeait-il pas à faire arriver Son Incarnation ? La
GLOIRE de Dieu est qu' il soit lui-même (= Dieu) le Messie (= Dieu-Incarné)
AFIN DE vivre parmi les hommes (Homme).
Jean-Marie GEORGEOT - " De Saint-Marc jusqu'à Tertullien " ( 1978 à 2004 )
LA DIDACHE - 88 -
Pour un homme (= toi, moi... et tous), la structure trinitaire porte toujours en
elle les trois valeurs du temps et il est facile de se laisser fondre dans :
naissance commencement Règne
homme = vie milieu Puissance = Dieu ?
mort fin(alité) Gloire
Lecteur ! Il te faut, ici, reprendre tout ce que j'ai dit sur la Dualité. Les uns
disent : Père et Fils. Moi, je prie(24) la Puissance (Dieu qui créa) et la Gloire
(Dieu, qui vit en homme)
Ainsi, pour moi, Dieu est "la Puissance et la Gloire",
mais il n'est pas 'le règne'.
PARDONNE - NOUS c o m m e NOUS PARDONNONS
Plus je progresse dans la lecture théologique de l'évangile de Saint Marc,
moins je comprends ce mot : comme ! Tout ce que j'apprends au sujet de Jésus-
le-Messie, tout ce que j'entends par SES paroles, tout ce que je vois par ses
gestes-de-puissance, tout m'oblige à croire en lui et en son message.
Or, JAMAIS je ne l'ai entendu dire, ni ne l'ai vu faire, en échange ou comme par
contrat. Et même pas ce jour-là avec "les grands-prêtres et les scribes et les
anciens" (Mc XI-27), alors qu'eux l'interrogeaient : "Par quelle autorité... Qui t'a
donné cette autorité...?". Jésus leur dit : "Je vous interrogerai... Répondez-moi
aussi E T je vous dirai..." (XI-29). Il s'agit là d'une argumentation arrivée dans
le dialogue AFIN DE les mettre face à leur conscience; l'enjeu n'est pas la guérison
d'un infirme quelconque, ni une transaction sur quelque rite hérité des anciens.
Même ceux-ci, Jésus les respecte; la femme a pu dire : "Si je touche du moins
ses vêtements...", elle a touché et elle fut guérie (V-29) ; et là où il pénétrait, on
amenait des mal-portants AFIN QU'ils touchent la frange de son vêtement, ils
touchaient et ils étaient guéris (VI-56). Or, il n'a JAMAIS été écrit que Jésus ait fait
(= le verbe poieô) AFIN DE...
Jean-Marie GEORGEOT - " De Saint-Marc jusqu'à Tertullien " ( 1978 à 2004 )
LA DIDACHE - 89 -
Alors, que voudrait signifier ce texte du 'Notre Père' : Pardonne-nous nos
offenses COMME nous pardonnons (aux autres) ? Dans la Lectio divina par
séquence (L.D.S.) pour le verset (XI-25), j'ai donné une formulation du 'Notre
Père' avec :
...et pardonne-nous nos offenses :
et nous pardonnons à ceux qui...
Je me suis refusé à prier avec le mot comme, car je n'ai pas compris. Au
paragraphe 6 de la lectio divina ci-dessus, immédiatement précédant le présent
texte, j'ai donné les textes grecs de D. VIII-2 et de Mc XI-25. Ils peuvent
schématiquement être posés :
D. VIII-2 aphes ... emôn + ÔS KAI
Mc XI-25 INA KAI + aphe ... umôn
Lecteur ! Ensemble nous allons méditer sur le mot grec ôs venu se manifester
dans la Didachè alors qu'un jeu de miroir nous fait voir ina en Saint Marc.
Mais avant de me suivre sur le chemin rocailleux de ôs il te faut relire avec
attention mon étude sur ina dans le chapitre AFIN QU'aussi (votre Père), en
L.D.S. au verset (XI-25). Tu y verras ma traduction avec ce double-point qui est
le profond silence pour l'examen de conscience.
SUR LE MOT : Ô S
Dans le texte de Saint Marc, ce mot vient deux fois et, selon ce qui est
habituel, une seule fois pour chacune des parties.
Mc IX-21 (un esprit sans-parole et sourd) Combien de temps est-il que cette-
chose-là lui arrive ?
-------------
Mc XIV-72 (et un coq convoqua) Et Pierre se-ressouvint du fait que Jésus lui
avait dit°...
Jean-Marie GEORGEOT - " De Saint-Marc jusqu'à Tertullien " ( 1978 à 2004 )
LA DIDACHE - 90 -
Ces deux textes présentent, en grec, un point remarquable :
Mc IX-21 ôs touto gegonen autô ...
-------------
Mc XIV-72 ôs eipen autô ...
Dans mon analyse du 'Notre Père' au paragraphe 6 (ci-dessus dans ce même
chapitre), j'ai fait le rapprochement entre D. VIII-2 et Mc XI-25, pour amener face-
à-face :
ÔS KAI et INA KAI
Or, il y a une inversion puisque, en D. la phrase précédant 'ôs kai' est celle-là
qui, semblable, vient en Saint Marc après 'ina kai'. Je vois là, à cause du
renversement des lexies, une marque de la pensée.
Dans la Didachè, celui qui écrit est un judéo-chrétien, très imprégné de sa
culture sémitique et de la pensée juive. Intellectuellement, il est encore dans
l' Ancienne Alliance et, pour lui, Dieu ne pardonnera QUE SI lui, le juif,
pardonne à son prochain (même si ce prochain n'implore pas le pardon... même
les autres jours que yom kippour, jour du Grand Pardon avec
l'OBLIGATION(25) pour tout juif de pardonner à celui qui a imploré son
pardon. Etant judéo-chrétien, il croit en Jésus-le-Messie, donc en un
enseignement nouveau (cfr : Mc I-22) qui a autorité. Pour autant, il lui est difficile
de changer de culture et lui, fils d'Israël, il pense viscéralement comme les fils
d'Israël, même s'il a la volonté d'admettre le devoir de pardonner toujours.
En Saint Marc, la lexie (XI-25) avec ina kai est une parole dite par Jésus, ou
encore : dite par le Messie. La Parole est vraie dogmatiquement (= non
discutable).
Je vois alors une relation très étroite entre ces pièces des deux textes : Didachè
et Saint Marc. Le sens profond et véritable DOIT être (= est obligatoirement)
conforme à la Parole de Jésus. C'est, pour moi, un article de foi. L'inversion
montre que le judéo-chrétien n'a pas fait tout le chemin nécessaire depuis sa foi
de fils d'Israël jusqu'à la vraie foi en Christ, et qu'il lui reste encore un espace à
franchir AFIN DE inverser sa formulation pour l'identifier à la Parole du Messie.
Mais, alors, ne sera-t-il pas amené à abandonner 'ô s' pour revenir à 'i n a' ?
Jean-Marie GEORGEOT - " De Saint-Marc jusqu'à Tertullien " ( 1978 à 2004 )
LA DIDACHE - 91 -
Lecteur ! Vois, désormais, combien la prière du 'Notre Père' est riche de
confiance et d'amour. Elle t'amène à dire TA confiance en l'AMOUR de Dieu. Et
c'est pour cela que tu dois, toujours, effacer (c'est à dire : pardonner) et oublier
même la cause de ton geste de pardon, donc ne plus avoir mémoire... que tu as
pardonné. Ton geste de pardon n'a de réelle valeur que s'il est fait par l'AMOUR
que tu portes à tout homme, ton prochain. Cet homme-là étant à l'image de Dieu,
si tu l'aimes, c'est Dieu que tu aimes à travers lui.
Si je suis resté si longtemps sur ce verset du 'Notre Père', c'est pour deux
raisons :
d'abord le 'Notre Père' peut être prié par un chrétien, par un judéo-
chrétien, ou par un juif (orthodoxe).
ensuite l'enjeu véritable est celui de l'expression 'en mémoire de...'
car, pour moi, l'homme doit vivre dans le mouvement (Genèse I-1 = ha-
shamaim) AFIN DE (grec : ina = avec l'aide de Dieu) toujours être disponible pour
DEVENIR (Exode III-14).
Rappelle-toi, lecteur ! Au buisson ardent, l'Eternel dit sa devise :
'Eheye asher eheye !'
dans laquelle je me suis senti forcé de traduire le mot du milieu par :
'... QUE ...' :
JE ME FERAI JE ME FERAI
Q
DEVENIR DEVENIR
U
pour / avec / par par / avec / pour
E
T O I T O I
Ce même mot '... QUE...' est celui par moi placé au cœur (= le centre, mais
aussi l'intelligence, l'esprit, l'âme) de la prière du 'Notre Père' :
... et pardonne - nous
QUE
et nous pardonnons...
Jean-Marie GEORGEOT - " De Saint-Marc jusqu'à Tertullien " ( 1978 à 2004 )
LA DIDACHE - 92 -
P R I E R E II
Pour l' EUCHARISTIE
(D. IX-1 à 4)
D'abord pour la coupe
Nous te rendons grâce, Notre Père,
pour la sainte vigne de DAVID ton serviteur,
que tu nous révélas par JESUS, ton serviteur,
A TOI LA GLOIRE DANS LES SIECLES !
Puis, pour le pain rompu
Nous te rendons grâce, Notre Père
pour la vie et la connaissance
que tu nous révélas par JESUS, ton serviteur,
A TOI LA GLOIRE DANS LES SIECLES !
Comme ce pain rompu
disséminé sur les montagnes
rassemblé pour être UN,
de même soit
rassemblée ton église
depuis les extrémités de la terre
VERS ton ROYAUME
car EN TOI sont
la GLOIRE et la PUISSANCE
par JESUS - CHRIST .
Jean-Marie GEORGEOT - " De Saint-Marc jusqu'à Tertullien " ( 1978 à 2004 )
LA DIDACHE - 93 -
P R I E R E III
Après la Communion
(D. X-1 à 6)
Nous te rendons grâce, Père Saint,
pour ton Saint NOM
que tu as fait habiter en nos coeurs
et pour la connaissance et la foi et l'immortalité
que tu nous révélas par JESUS, ton serviteur,
A TOI LA GLOIRE DANS LES SIECLES !
TOI, le MAITRE, Créateur-de-TOUT
Tu créas TOUT à cause de ton NOM,
la nourriture et la boisson
tu les donnas aux hommes,
en jouissance AFIN QU'ils te rendent-grâce.
A nous, tu nous a fait grâce spirituellement
de nourriture et de boisson et de vie éternelle
par JESUS, ton serviteur.
Pour TOUT nous te rendons-grâce,
en ta PUISSANCE.
A TOI LA GLOIRE DANS LES SIECLES !
Souviens-Toi, Seigneur, de ton église pour la délivrer de tout mal
et accueille-la dans ton cœur
et rassemble-la depuis les quatre vents
VERS ton Royaume que Tu lui préparas,
car EN TOI sont
la PUISSANCE et la GLOIRE
DANS LES SIECLES ;
Jean-Marie GEORGEOT - " De Saint-Marc jusqu'à Tertullien " ( 1978 à 2004 )
LA DIDACHE - 94 -
(fin de la PRIERE III)
Que la grâce vienne et que le monde passe !
OSANNA au DIEU - DAVID !
Si quelqu'un est saint : qu'il ARRIVE !
S'il ne l'est pas : qu'il se convertisse !
MARANATA ! AMEN !
*
*
*
*********
*
*
*
Jean-Marie GEORGEOT - " De Saint-Marc jusqu'à Tertullien " ( 1978 à 2004 )
LA DIDACHE - 95 -
DEUX TEXTES GRECS
J'ai tenu à présenter, ici, deux textes grecs. Ce sont des matériaux bruts offerts
à mon lecteur pour sa lectio divina :
1.- Sur 'les quatre vents'
D. X-5 kai sunaxon auten apo tôn tessarôn anemôn ...
Mc XIII-27 kai epi-sunaxei ... ek tôn tessarôn anemôn ...
2.- Sur la doxologie finale
D. VIII-2 (le 'Notre Père')
oti sou estin e Dunamis kai e Doxa
------------------------ eis tous aiônas
D. IX-4 (pour l'eucharistie)
oti sou estin e Doxa kai e Dunamis
(dia Iesou Christou) eis tous aiônas
D. X-5 (après la communion)
oti sou estin e Dunamis kai e Doxa
------------------------ eis tous aiônas
(rappel :)
Mc XIII-26 meta Dunameôs polles kai Doxes
ANALYSE = CONVENTION
Dans tout ce qui va suivre et afin de simplifier la présentation, je donne la
référence suivante définissant chacune des trois prières :
I = le 'Notre Père'
II = la prière eucharistique
III = l'action de grâce.
Jean-Marie GEORGEOT - " De Saint-Marc jusqu'à Tertullien " ( 1978 à 2004 )
LA DIDACHE - 96 -
LECTIO DIVINA
1.- La Didachè nous a transmis ces trois prières en lesquelles toi, lecteur
chrétien d'aujourd'hui, tu retrouves les prières de l'eucharistie. La tradition
(= l'écrit) nous dit qu'elles datent de la première église, celle des Douze apôtres,
celle de Jérusalem (le centre du monde juif) et celle de tous les rayons éclairant
les nations (les missions vers ceux de la diaspora).
2.- J'ai beaucoup entendu, en lisant et priant ces trois textes; et d'abord : le 'Notre
Père' est dogme. La première des prières est la seule des trois que mon rabbin
(= juif orthodoxe) et moi-même pouvons prier ensemble.
3.- Les deux autres prières font référence à Jésus : "par Jésus, ton serviteur",
deux fois, aux mêmes lieux et places dans l'un et l'autre textes, comme en
introduction vers le cri de la foi :
"... à Toi la GLOIRE dans les siècles."
J'ai dit, ailleurs, en quoi la Gloire de Dieu est SON INCARNATION, et
comment elle apporte un NOM à l'Eternel (Béni soit-IL !) car ce nom est
"Jésus". Seul, ce qui vit sur terre peut posséder un nom (cfr : Genèse II-20 et
Genèse III-20). Celui dont son peuple n'osait pas prononcer le nom s'est révélé
comme homme : "Et arriva en ces jours-là que Jésus vint..." (Mc I-9).
4.- Les prières II et III ont même structure :
Prière II Prière III
A.1. nous te rendons grâce
Notre Père Père Saint
par Jésus ton serviteur
A Toi la Gloire dans les siècles
A.2. Notre Père Maître Pantacrator
par Jésus ton serviteur
A Toi la Gloire dans les siècles
B. ton église rassemblée vers ton Royaume
car En Toi sont
Gloire et Puissance Puissance et Gloire
dans les siècles.
Jean-Marie GEORGEOT - " De Saint-Marc jusqu'à Tertullien " ( 1978 à 2004 )
LA DIDACHE - 97 -
5.- J'ai vu dans la prière du 'Notre Père' un texte venant au travers du message de
Saint Marc et formulant une prière juive de jadis; elle est d'une structure très
ancienne, mais actualisée à la suite de la venue du Messie. On peut la lire selon
l'ossature suivante :
A.1. (Dieu) Père des cieux / NOM / Règne / Volonté
ciel + terre = la Création
A.2. (l'homme) pain / offenses / tentation / le mal
B. (le cri de foi) la Puissance et la Gloire
Dieu-Créateur + Dieu-Incarné.
6.- Alors je puis reprendre les deux autres prières selon ce schéma du 'Notre
Père' :
II / A.1. (Dieu) Jésus, fils de David / Israël / la vigne
II / A.2. (l'homme) la vie et la connaissance révélées
II / B. (le cri de foi) la Gloire en premier : Incarnation
III/ A.1. (Dieu) connaissance / foi / immortalité
III/ A.2. (l'homme) nourriture et boisson (2 fois)
III/ B. (le cri de foi) Puissance et Gloire.
Ces deux derniers mots sont ordonnés :
d'abord = la Création Puissance
puis = l'Incarnation Gloire,
cet ordre des mots respectant le temps de l'humanité car :
au Commencement = Genèse : Dieu créa...
à la Cène = Jésus (Messie = Dieu-Incarné) dit : "mon corps".
... et c'est pourquoi, dans la prière II, l'ordre des mots est inversé, car à
l'eucharistie, LE CORPS est présent réellement et Sa Présence prime sur
toute la Création à l'entour.
Jean-Marie GEORGEOT - " De Saint-Marc jusqu'à Tertullien " ( 1978 à 2004 )
LA DIDACHE - 98 -
7.- Ami lecteur, mon compagnon, je veux, pour la suite, te laisser seul face à ces
trois prières AFIN QUE (= avec l'aide de Dieu) tu puisses les prier. Permets-moi,
cependant, de te suggérer quelques constats au sujet de ces textes :
PRIERE I PRIERE II PRIERE III
Puissance et gloire Gloire et Puissance Puissance et Gloire
Jésus-Christ
ton Règne vers ton Royaume vers ton Royaume
e Basileia sou eis ten sen Basileian eis ten sen Basileian
David David
Jésus (deux fois) Jésus (deux fois)
PUISSANCE GLOIRE = PUISSANCE
Jésus-Christ
A.1 habiter... Jésus
A.2 Tu créas ta Puissance
dans les cieux sur les montagnes
au ciel depuis les extrémités depuis les
sur terre de la terre quatre vents
notre pain la sainte vigne nourriture et
quotidien ce pain rompu boisson (deux fois)
la vie et
la connaissance la connaissance
la foi
l'immortalité
Jean-Marie GEORGEOT - " De Saint-Marc jusqu'à Tertullien " ( 1978 à 2004 )
LA DIDACHE - 99 -
EN FINALE
Lecteur !
Je t'interrogerai une-unique parole :
Réponds-moi en disant comment tu pries maintenant,
la doxologie du 'Notre Père' =
... la PUISSANCE et la GLOIRE !
Jean-Marie GEORGEOT - " De Saint-Marc jusqu'à Tertullien " ( 1978 à 2004 )
LA DIDACHE - 100 -
* * * *
Jean-Marie GEORGEOT - " De Saint-Marc jusqu'à Tertullien " ( 1978 à 2004 )
LA DIDACHE - 101 -
DIDACHE V
LA CIRCONCISION
_______________
La question
Les données
Le sens de la circoncision
La déportation
Le retour
Chapitre XV des Actes des apôtres
Annexe I Avec des pharisiens
Annexe II A partir d'Abraham
Annexe III Peu après, Paul avec Timothée...
Annexe IV Simeon
_______________
LA QUESTION
Ceux 'descendus de Judée' disaient : 'Si vous n'avez pas été circoncis selon
l'usage mosaïque, vous ne pouvez pas être sauvés' (Ac XV-1). Ceux (restés) à
Jérusalem s'élevèrent pour dire : 'Il faut les circoncire et leur ordonner de garder
la loi de Moïse' (Ac XV-5). Lecteur ! Je dois, ici, interpeller en toi l'exégète. Le
mot fondamental de l'une et de l'autre de ces deux phrases est-il circoncire ? Car
il est un autre mot commun à l'une et à l'autre et, autour de ce mot, il y a comme
une nuée de brouillard cachant un fondement : '... l'usage mosaïque... la loi de
Moïse...'. Ceci fait entendre la question : la circoncision doit-elle être tranchée à
cause d'un usage ou par obéissance à une loi... ou parce que Moïse ?
Jean-Marie GEORGEOT - " De Saint-Marc jusqu'à Tertullien " ( 1978 à 2004 )
LA DIDACHE - 102 -
LES DONNEES
L'exégète doit toujours revenir aux données du texte. Or je me suis rappelé que
l'obligation de circoncire constitue un article du contrat de cette Alliance passée
par l'Eternel avec Abram. Les textes sont :
Genèse XVII-1 à 9 'YHVH apparut à Abram et lui dit :
'JE suis EL-Shaddaï ! Marche en ma présence et sois parfait !
JE vais mettre mon alliance entre MOI et toi :
JE te multiplierai...
Ton nom sera ABRAHAM...
JE te ferai fructifier...
JE ferai de toi des nations...
J' établirai mon Alliance entre MOI et toi...
JE te donnerai...'.'
Genèse XVII-10 et 11 'Voici MON Alliance que vous garderez entre MOI et
vous, et ta race après toi : tout mâle d'entre vous sera circoncis. Vous serez
circoncis quant à la chair...'
(Et le texte s'amplifie en jouant autour du verbe circoncire jusqu'à la
conclusion :)
Genèse XVII-13 'Ainsi mon Alliance dans votre chair deviendra
Alliance perpétuelle.'
(Comme pour toute loi, l'arrêté d'application suit aussitôt :)
Genèse XVII-14 'L'incirconcis (le mâle qui n'aura pas été circoncis
quant à la chair) sera retranché d'entre ses parents... (car il) a rompu mon
Alliance.'
Ami ! As-tu vraiment bien lu ces textes ? Peut-être ne t'ai-je pas présenté tout
ce qu'ils disent ? Alors, relis encore :
Genèse XII-1 'YHVH dit à Abram : 'Pars de ton pays, de ta patrie,
de la maison de ton père' vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une
grande nation...'.'
Jean-Marie GEORGEOT - " De Saint-Marc jusqu'à Tertullien " ( 1978 à 2004 )
LA DIDACHE - 103 -
Genèse XVII-3 à 10 'Elohim parla en disant :
... MON Alliance... père d'une multitude de nations
... ne-plus Abram... mais : Abraham (verset 5)
... (car :) père d'une multitude de nations
... JE ferai de toi des nations (verset 6)
... MON Alliance... ta race après toi (verset 7)
... Alliance perpétuelle... ta race après toi (verset 7)
... JE te donnerai... ta race après toi (verset 8)
JE serai Dieu pour... ta race après toi (verset 8)
... MON Alliance... ta race après toi (verset 9)
... MON Alliance... ta race après toi' (verset 10).
Ainsi se manifestent des lois du texte que nous connaissons bien :
a) père d'une multitude de nations
non-plus Abram, mais : AbraHAm
père d'une multitude de nations
b) ta race après toi :
à trois aboutir 'Je te donnerai'
à quatre plénitude 'Je serai ton Dieu'
à cinq l'identité (Je te donnerai le nom d'Abraham)
à six l'alliance 'Mon Alliance'
c) le contrat d'Alliance :
à trois aboutir 'à l'âge de huit jours sera circoncis...'
(= troisième emploi de ce mot)
à quatre plénitude le peuple élu : il faudra circoncire...
(= quatrième emploi)
LE SENS DE LA CIRCONCISION
Ainsi il fallait lire ces textes pour connaître l'origine et la raison de la
circoncision. Dieu donne un ordre à un homme nommé Abram. Il lui dit : 'Pars !'
vers l'inconnu en quittant 'ton pays, ta patrie, la maison de ton père' et Dieu lui
dit : je t'aiderai, toi et 'ta race après toi' et le signe matériel qu'un autre homme
est aussi de ta race sera le signe de la circoncision. Toute femme qui connaîtra
un homme saura s'il est de ta race et lorsque 'dans ta maison' il naîtra un mâle, la
femme saura témoigner qu'il est fils de ta race.
Jean-Marie GEORGEOT - " De Saint-Marc jusqu'à Tertullien " ( 1978 à 2004 )
LA DIDACHE - 104 -
Avant l'âge de huit jours, afin qu'il n'y ait point substitution (car, pendant ces
huit jours, à chaque instant la mère veille sur l'enfant, minute par minute), ce
mâle sera circoncis et ainsi marqué dans sa chair du sceau de ta race, et ce sera
pour lui la certitude (= le certificat du contrat) de l'Alliance et, pour vous, le
signe-témoignage qu'il est un des vôtres.
Plus tard, ta race aboutira à devenir la multitude des nations lorsqu'elle leur
fera connaître la Puissance et la Gloire de Dieu. Cela arrivera dans le siècle-à-
venir, lorsque l'Eternel en décidera. Jusqu'à ce moment, tout fils d'Israël sera
circoncis et il aura-en-héritage (cfr : Mc X-17) tout ce qui relève du patrimoine
d'Israël.
LA DEPORTATION
L'histoire aurait pu s'écouler sans trop de heurts, avec un certain calme et dans
le respect de la tradition. Dieu avait dit de circoncire et tous faisaient comme
Dieu avait ordonné.
Et il arriva que Nabuchodonosor vint et, avec lui, arriva la déportation des
gens de Jérusalem vers Babylone. Dieu fit se-lever le prophète Jérémie et 'voici
les termes de la lettre que Jérémie le prophète envoya de Jérusalem à ceux qui
restaient des vieillards de la déportation, aux prêtres, aux prophètes, à tout le
peuple que Nabuchodonosor avait déportés de Jérusalem vers Babel... :
'Bâtissez des maisons et habitez-y
plantez des jardins et mangez leurs fruits
prenez des femmes engendrez fils et filles
prenez des femmes pour vos fils
.......... ..........
multipliez-vous ne diminuez-pas !
recherchez la paix pour la ville où JE vous ai déportés
et intercédez pour elle auprès de YHVH
.......... ..........
Car MOI, JE sais les pensées que JE pense à votre sujet
pensées de salut et non de malheur
pour vous donner un avenir, une espérance'.
(Jérémie XXIX-1 à 11)
Jean-Marie GEORGEOT - " De Saint-Marc jusqu'à Tertullien " ( 1978 à 2004 )
LA DIDACHE - 105 -
Tous ceux de Jérusalem viennent de vivre "l'abomination de la désolation" (Mc
XIII-14) et Nabuchodonosor rasa Jérusalem et déporta 'Jechoniah, roi de Juda,
ainsi que les princes de Juda, les forgerons et les serruriers'
(Jérémie XXIV-1)
Le prophète écrit aux juifs déportés qu'ils doivent vivre selon leurs habitudes
et continuer leur vie là où ils ont été transférés. Qu'ils se regroupent en villes et
villages et en communautés, qu'ils cultivent les champs et qu'ils œuvrent pour la
paix de leurs nouveaux lieux de résidence. Surtout, qu'ils gardent leurs pratiques
religieuses ‘car ainsi a parlé YHVH :
« Vous m'invoquerez, puis vous irez.
Vous me prierez, et je vous écouterai.
Vous me chercherez et vous me trouverez. ».’
(Jérémie XXIX-12 et 13).
Avec la promesse dite par YHVH :
« JE vous rassemblerai d'entre toutes les nations ... puis JE vous ramènerai à
l'endroit d'où JE vous ai déportés. »
(Jérémie XXIX-14°).
Dieu leur a promis : les rassembler d'entre toutes les nations. IL réunira ceux
de ta race et tous seront assurés que nul ennemi ou nul païen n'aura réussi à se
mêler à eux, nul de tous ces peuples d'Assyrie ou d'Orient. Car eux, les juifs, ils
ont toujours le signe de la circoncision pour garantir leur appartenance à ta
race.
LE RETOUR
Jérusalem avait été détruite et le Temple rasé. Les juifs vont revenir et
reconstruire le Temple. Le signe de leur identité sera le garant de la continuité
dans la tradition et la vie d'Israël restera celle du peuple de l'Alliance. Nul
étranger, nul païen ne s'est glissé parmi eux. Dans ces brassages de peuples et
des transferts de populations, il est un groupe qui, seul, est assuré de son
homogénéité et de son origine : ceux-là qui adorent Dieu-Unique et qui sont
circoncis.
Jean-Marie GEORGEOT - " De Saint-Marc jusqu'à Tertullien " ( 1978 à 2004 )
LA DIDACHE - 106 -
La circoncision est l'attestation proclamée à tous les hommes que Dieu-Unique
des juifs est le Dieu de l'Alliance, le Dieu qui créa l'homme, puis s'est choisi
Abraham auquel il se montra sous le nom de EL-Shaddaï. Par un retournement
admirable, la circoncision devient le véritable signe du "Dieu de vivants" (cfr :
Mc XII-27), car il est "lui : Dieu d'Abraham..." (même référence).
La circoncision touche à l'engendrement et à la multiplication (= 'Ne diminuez
pas !'). Etant le signe de l'Alliance, elle est d'abord le signe de la vie, anti-signe
de la mort, de l'idole, de tout le paganisme (babylonien).
CHAPITRE XV DES ACTES DES APOTRES
Lecteur, tu connais la suite du récit : des événements en suite chaotique de
paix, de guerres, de révoltes. Le Messie et, après Lui : les douze avec Jérusalem.
Mais un grand changement est arrivé par Jésus : l'expression 'ta race' a été
transformée en 'les nations'. Il n'y a plus besoin du signe de la chair pour
distinguer 'd'entre toutes les nations' ceux qui ont le droit-de-l'héritage sur
l'Alliance, car l'Alliance est pour tous : Message du Messie.
Pour les fils d'Abraham, la circoncision est leur sceau de l'Alliance et ceux de
Jérusalem peuvent dire, dans la vérité de leur foi : 'Il faut les circoncire et leur
ordonner de garder la Loi de Moïse' (Ac XV-5) car, pour ces gens 'de la secte des
pharisiens', ils pensent à tous ceux-là, d'abord les juifs mais aussi les
sympathisants (= les prosélytes qui sont admis à suivre le rituel et à manger la
Pâque). Cette circoncision est la garantie contractuelle que l'Eternel les aidera et
les protégera : "si je touche au moins ses vêtements... on le suppliait afin qu'ils
touchent la frange de son vêtement...". Et cette Alliance fonctionnera toujours
car l'Eternel n'a qu'une Parole : et la femme est guérie, et ils étaient sauvés.
Or, si on analyse leur question sur le fond, la circoncision n'a aucun sens pour
les fils des hommes car elle ne confère aucune identité nouvelle. Elle
garantissait que les (juifs) circoncis étaient bien des juifs, descendants
d'Abraham. La circoncision ne fera jamais qu'un homme devienne fils
d'Abraham (= fils d'Israël par le sang) si Abraham n'est pas de ses ancêtres (=
de 'ses parents' = Genèse XVII-14).
Jean-Marie GEORGEOT - " De Saint-Marc jusqu'à Tertullien " ( 1978 à 2004 )
LA DIDACHE - 107 -
Au chapitre XV des Actes, tous posent la question sur la circoncision en
référence à Moïse :
... l'usage mosaïque... la Loi de Moïse...
Personne n'a interrogé sur la race d'Abraham. Alors 'Pierre se leva et leur dit : ...
Dieu m'a choisi... pour que les nations entendent'. (Ac XV-7). Puis 'Barnabé et
Paul racontent tous les signes... que Dieu avait faits par eux parmi les nations'
(Ac XV-12).
Alors Jacques évoque Syméon : il disait 'comment Dieu a, d'abord, visité les
nations' (Ac XV-14). Puis le récit des Actes s'accélère par les paroles de Jacques
et celui-ci donne la conclusion :
'Il n'y a pas à inquiéter CEUX DES NATIONS...
Il n'y a qu'à leur écrire...'
(Actes XV-19 et 20)
Jacques ne dira rien, ô Israël !, de ceux de ta race ! et la première épître écrite
par l'Eglise de Jérusalem ne mentionnera pas les circoncisions, simples
passeports des fils d'Abraham, pour leur multiples diasporas.
_______________
Jean-Marie GEORGEOT - " De Saint-Marc jusqu'à Tertullien " ( 1978 à 2004 )
LA DIDACHE - 108 -
ANNEXE I
AVEC DES PHARISIENS
_______________
Alors que, avec mon rabbin, nous marchions(27) à travers le territoire de la
Samarie, l'un de nous s'étonna du texte des Actes : Paul et Barnabé, ayant
parcouru la Phénicie et la Samarie, s'en vinrent à Jérusalem et voici que
'quelques-uns de la secte des pharisiens', qui avaient la foi, s'élevèrent pour
dire : 'Il faut les circoncire... la Loi de Moïse !'
(Actes XV-5)
Ayant relu ce texte, il posa la question : Pourquoi des pharisiens, et pas des
anciens ou des scribes ?
Mon rabbin s'arrêta en disant : les juifs répartissaient les pharisiens en sept
classes : (1) celui aimant Dieu par amour et (2) celui aimant par peur; (3) celui
qui clame à tous pourquoi il doit faire; (4) celui qui a la démarche trop humble
et (5) celui qui évite de regarder devant lui de peur de voir des choses impures
(celui-ci se heurte la tête contre les murs); (6) celui qui marche la tête courbée
vers le sol avec ostentation; enfin (7) le pharisien qui agit contre Sichem.
Est-ce parce que nous étions proches du mont Garizim ? Le nom de SICHEM
nous alerta car la ville était proche, juste entre les monts Ebal et Garizim, au
centre de la Samarie, très près de l'endroit où nous venions de nous arrêter.
Alors mon rabbin rappela ce qui arriva à Dinah, la fille que Jacob eut avec
Léa. (Voir Genèse au chapitre XXXIV). Il dit : le nom : SICHEM est celui d'une
ville, mais aussi d'un homme, le fils de Hamor-le-hévéen, prince de son pays.
Sichem, le fils, rencontra un jour Dinah, la désira, coucha avec elle et la viola.
Etait-elle consentante ? L'histoire ne dit rien...
Jean-Marie GEORGEOT - " De Saint-Marc jusqu'à Tertullien " ( 1978 à 2004 )
LA DIDACHE - 109 -
...mais étant donné que le viol avait eu lieu dans la campagne (hors de la
ville), la législation juive jugeait que la fille ne peut pas appeler à l'aide,
personne ne pouvant l'entendre pour lui porter secours. La jeune fille n'y perd
donc jamais son honneur, puisqu'il est impossible d'affirmer qu'elle pût être
consentante(28). En tout (mal), tout honneur : Sichem la séduira(29) ensuite et
voudra l'épouser.
Les fils de Jacob, donc frères de Dinah, vont négocier avec Sichem et avec son
père Hamor, ceux-ci ayant présenté la demande officielle pour le mariage. Les
fils de Jacob répondent : 'Nous ne pouvons pas donner notre sœur à un homme
qui est incirconcis, car ce serait un opprobre pour nous... (Nous serons donc
d'accord pour ce mariage) si vous devenez comme nous en faisant circoncire
tout mâle d'entre vous. Alors nous vous donnerons nos filles et nous prendrons
vos filles pour nous, nous habiterons avec vous et nous deviendrons un seul
peuple'.
Hamor et Sichem vinrent à la porte de leur ville, parlèrent à leur peuple et
racontèrent la proposition de la circoncision. Ils commentèrent : nous aurons
leurs filles, ils auront les nôtres. En plus : 'leur troupeau et ce qu'ils possèdent,
ainsi que tout leur bétail, tout cela ne sera-t-il pas à nous ? Donnons-leur
seulement notre consentement et qu'ils habitent avec nous.'
Alors tous ceux de la ville qui allèrent vers les fils de Jacob se firent
circoncire car ils y voyaient un grand avantage : les filles, les troupeaux et les
biens des fils de Jacob.
'Il advint, au troisième jour, quand ils étaient souffrants (= la plaie vive de la
circoncision n'est pas encore cicatrisée), que deux des fils de Jacob : Siméon et
Levi, frères de Dinah, prirent leur épée... et tuèrent tous les mâles (= tous les
circoncis).' Ainsi moururent Sichem et son père Hamor... Alors les fils de Jacob
'entrèrent par-dessus les victimes et pillèrent la ville'. Ils prirent les femmes, tout
le bétail petit et gros et toutes les richesses.
L'histoire se passa 'à SALEM(30), ville de Sichem, qui est au pays de Canaan'.
Avec un grand sourire, mon rabbin se tourna vers moi et ajouta : comprends-
tu maintenant pourquoi Paul et Barnabé passèrent par la Samarie avant d'arriver
à Jérusalem, où ils rencontrèrent des pharisiens (= ceux qui agissent comme
Sichem) et pourquoi ceux-ci parlèrent de la circoncision ?
Jean-Marie GEORGEOT - " De Saint-Marc jusqu'à Tertullien " ( 1978 à 2004 )
LA DIDACHE - 110 -
Paul et Barnabé voulaient pouvoir témoigner de ce qui s'était réellement passé
au sujet de la circoncision lorsqu'elle est faite (avec mauvaise intention) pour des
gens qui ne sont pas fils d'Abraham : non pas la circoncision de l'Alliance, mais
une circoncision pour les filles, le troupeau et les biens des israélites.
Or le plus curieux est que, à Jérusalem, lorsque la question sera discutée avec
les apôtres et les anciens, ils vont entendre Jacques évoquer le témoignage de
Siméon au sujet du Dieu du peuple juif.
Mon rabbin ajouta :
'... et SIMEON n'est pas SIMON(31) '.
Et je lui répondis :
'...Siméon a raconté comment Dieu a d'abord visité les nations pour y
prendre un peuple à son NOM' (Ac XV-14). Jacob, en visitant la terre de Canaan,
y rencontre le peuple de Sichem. Il y eut l'affaire de la circoncision, puis le
massacre des habitants de Salem. Deux des frères de Dinah furent les meneurs :
Siméon que tu viens, ô rabbin, d'évoquer et aussi LEVI. Ce dernier eut, parmi
ses descendants, un Lévi que nous retrouverons comme dépositaire du calendrier
ancien des gens de Samarie. Un autre Lévi apparaîtra dans le texte de Saint
Marc, assis à son bureau, travaillant dans ses livres.
Ainsi, ce soir-là, avec mon rabbin, suspendant notre marche à travers le
territoire de la Samarie, nous avons retrouvé Siméon et Lévi , deux hommes fils
de Jacob qui, partis du livre de la Genèse, vont traverser la Bible pour aller vers
les textes de Saint Marc et des Actes.
Tout cela :
A cause de quelques PHARISIENS,
de ceux-là qui agissent comme SICHEM.
_______________
Jean-Marie GEORGEOT - " De Saint-Marc jusqu'à Tertullien " ( 1978 à 2004 )
LA DIDACHE - 111 -
ANNEXE II
A PARTIR D' ABRAHAM
_______________
Dans son Dialogue avec le juif Tryphon, Justin demande à son adversaire : 'Un
chrétien peut-il, maintenant, observer toutes les institutions de Moïse ?'
La réponse de Tryphon est :
'Non !
On ne peut pas immoler ailleurs qu'à Jérusalem l'agneau de la Pâque;
on ne peut offrir les boucs ordonnés pour le temps du jeûne,
ni aucune absolument de toutes les autres offrandes'.
Justin pose alors la question :
'Qu'y a-t-il donc que l'on puisse observer ?'
Tryphon répond :
'Ce sont :
le sabbat,
la circoncision,
l'observation des mois,
les purifications
lorsqu'on a touché quelqu'un des objets défendus par Moïse ...'.
Et Justin :
'... Vous savez bien que jusqu'à Moïse, aucun juste du tout n'a observé
ni n'a reçu l'ordre d'observer la moindre des choses sur lesquelles nous
discutons, sauf la CIRCONCISION qui a commencé à partir d'Abraham.'
(Référence : XLVI-2 à 4)
Jean-Marie GEORGEOT - " De Saint-Marc jusqu'à Tertullien " ( 1978 à 2004 )
LA DIDACHE - 112 -
Cette citation resplendit d'un éclat nouveau lorsque l'on sait que Justin était
samaritain, car j'ai lu :
'Je ne me soucie absolument de rien que de dire la vérité : je dirai sans
redouter personne... Je ne me suis pas davantage soucié de qui que ce soit de
ma race, c'est à dire des samaritains quand je me suis adressé par écrit à
César...'.
(Référence : CXX-6)
En effet, Justin serait né à Sichem (aux alentours de l'année 100) et il s'est
converti au christianisme après avoir fréquenté(32) un philosophe stoïcien, puis
un autre appelé péripatéticien mais qui n'avait rien de philosophe, puis un
pythagoricien qui le renvoya, puis les platoniciens et enfin un vieillard lui
parlant des prophètes mais sachant conclure : 'Avant tout : prie ! ... car personne
ne peut voir ni comprendre si Dieu et son Christ ne lui donnent de comprendre.'
(Référence : VII-3)
_______________
Jean-Marie GEORGEOT - " De Saint-Marc jusqu'à Tertullien " ( 1978 à 2004 )
LA DIDACHE - 113 -
ANNEXE III
PEU APRES , PAUL AVEC TIMOTHEE . . .
_______________
En Actes (XVI-1 à 5), donc aussitôt après le chapitre XV, il y a un récit au sujet
de Timothée. Cet homme était le 'fils d'une juive'. Donc il doit, selon les
préceptes religieux, être considéré comme juif. Or son père était grec, c'est à dire
non-juif.
Afin de bien 'situer' Timothée, Paul 'le prit et le circoncit'. Ainsi Timothée
doit-il être regardé, désormais, comme étant juif et ce, par tout le monde, donc
aussi par 'les juifs du lieu'.
Cet acte rituel des juifs ne met pas Paul en contradiction avec les décisions
récentes (= au chapitre XV qui précède) de l'Eglise de Jérusalem, puisque 'dans
les villes où ils passaient, (Paul et les siens) leur livraient, pour qu'ils les
gardent, les décisions prises par les apôtres et les anciens à Jérusalem'.
_______________
Jean-Marie GEORGEOT - " De Saint-Marc jusqu'à Tertullien " ( 1978 à 2004 )
LA DIDACHE - 114 -
ANNEXE IV
SIMEON
_______________
Lorsqu'il a lu mon texte, il fut étonné et il a protesté : Jamais, dit-il, votre
Siméon de la Genèse n'a pu raconter (Ac XV-14) quelque chose puisque dans le
texte (= Genèse XXXIV) nous entendons à peine sa voix, et encore il dit seule-
ment :
'Est-ce qu'on traite notre sœur comme une putain ?'
(Genèse XXXIV-31)
Je lui ai répondu : Siméon (Ac XV-14) ne peut pas être Pierre car il est écrit :
'Siméon a raconté comment Dieu a d'abord visité les nations pour y prendre un
peuple à son nom'. Or Pierre vient de dire : 'Vous savez que, dès les jours
anciens, Dieu m'a choisi parmi vous pour que les nations entendent de ma
bouche la parole de l'évangile et qu'elles aient foi' (Ac XV-7). Dans la parole de
Pierre il n'y a pas visiter les nations ni UN PEUPLE pour SON nom, mais il y a
'ME choisir' et 'LES NATIONS entendent MES paroles', ce qui est
foncièrement différent.
Et puis, voici les textes...
LES TEXTES
1.- Actes XV-14
'Sumeôn exegesato katôs prôton o Theos epeskepsato labein ex
ethnôn laon tô onomati autou.'
'Siméon a raconté comment Dieu a d'abord visité les nations pour y
prendre un peuple à son nom.
(Aucune variante n'est signalée pour ce verset).
Jean-Marie GEORGEOT - " De Saint-Marc jusqu'à Tertullien " ( 1978 à 2004 )
LA DIDACHE - 115 -
2.- Eusèbe : Hist. Eccl.
III-11 ... Sumeôn ton tou Klôpa...
'Siméon, fils de Cléophas, qui est mentionné dans le livre de
l'évangile fut (jugé) digne de cette église (= Jérusalem). Il était, dit-on, cousin du
Sauveur. Hégésippe raconte en effet que Clopas était le frère de Joseph.'
III-32/1 à 3 (Siméon, fils de Clopas et deuxième évêque de Jérusalem,
subit le supplice de la croix et meurt martyr sous le règne de Trajan, vers les
années 105 à 107).
IV-22/4 'Après que Jacques le Juste eut rendu son témoignage comme le
Seigneur et pour la même doctrine, le fils de son oncle, Siméon, fils de Clopas,
fut établi évêque : tous le préférèrent comme deuxième (évêque) parce qu'il était
cousin du Seigneur.'
(Hégésippe : cité par Eusèbe de Césarée)
3.- Constitutions apostoliques VII-46-1 et 2
'Quant aux évêques que nous avons ordonnés au cours de notre vie,
nous vous informons qu'il s'agit de ceux-ci :
Ierosolumôn men Iakôbos o tou Kuriou adelphos / ou theleutesantos
deuteros Sumeôn o tou Klôpa / met on tritos Ioudas Iakôbou.
A Jérusalem : Jacques, le frère du Seigneur. / A sa mort, le second :
Siméon le (fils) de Clopas. / Après lui, le troisième : Judas (fils de) Jacques.'
(Variantes du texte : Kleôpa et aussi : Klôpa).
Il est à noter que Eusèbe écrit, de son côté : 'un juif du nom de Justus reçut à
Jérusalem le siège de l'épiscopat' et succéda à Siméon (Hist. Eccl. III-35). Mais,
n'y a-t-il pas eu une certaine confusion car Justus fut le nom de celui qui était en
lice aux côtés de Matthias pour occuper la place laissée vacante par Judas
Iskarioth le traître ?
4.- Jn XIX-25
"Près de la Croix se tenaient :
e meter autou la mère de Lui
kai e adelphe tes metros autou, et la sœur de la mère de Lui
Maria e tou Klôpa celle de Clopas,
kai Maria e Magdalene et Marie-Madeleine."
5.- Lc XXIV-10
(Revenant du tombeau vide et annonçant aux Onze, il y a :)
"e Magdalene Maria kai Iôanna kai Maria e (tou) Iakôbou = Marie-
Madeleine et Jeanne et Marie celle (de) Jacques".
(Une variante dans l'ordre des mots : Madeleine / Marie)
Jean-Marie GEORGEOT - " De Saint-Marc jusqu'à Tertullien " ( 1978 à 2004 )
LA DIDACHE - 116 -
6.- Mc XV-40
"Or étaient aussi des femmes qui considéraient de loin (la croix et
Jésus mort) parmi lesquelles :
kai Maria e Magdalene et Marie-Madeleine
kai Maria e Iakôbou et Marie, mère de Jacques
tou mikrou kai Iôsetos meter le petit et de Joset,
kai Salôme et Salomé."
(Variantes : Mariam-Madeleine et Maria-Madeleine)
7.- Mc XVI-1
"Et, comme le sabbat était arrivé-à-terme,
Maria e Magdalene Marie-Madeleine
kai Maria e Iakôbou et Marie la (mère de) Jacques
kai Salome et Salomé..."
(Aucune variante)
8.- Lc XXIV-18
"Le même jour, voilà que deux... se rendaient à un bourg appelé
Emmaüs ...
Apokriteis de eis onomati Kleopas eipen pros auton...
L'un du nom de Cléopas ayant répondu dit à LUI..."
(Variantes : eîs ex autôn = l'un hors d'eux / et / onomati / onoma).
Dans les textes cités ci-dessus et pour ce qui concerne le N.T., les variantes
sont indiquées par référence à l'édition grecque Nestle-Aland de 1981.
TROIS FEMMES
Par les résultats de toutes mes études et analyses, je sais que le texte de Saint
Marc et celui de Saint Luc sont entièrement vrais. Donc, à la Croix, il y a trois
femmes :
Marie-Madeleine ;
Marie, la mère de Jacques le frère du Seigneur, celui qui sera le premier
évêque de Jérusalem,
Salomé qui, chez Lc n'est pas mentionnée. Mais, puisque chez Lc il y a
'Jeanne', je sais que cette dernière est à proximité immédiate et a tout vu.
Jean-Marie GEORGEOT - " De Saint-Marc jusqu'à Tertullien " ( 1978 à 2004 )
LA DIDACHE - 117 -
VERS EMMAUS
Par Lc, j'ai appris que l'un des deux qui s'en-vont-vers Emmaüs s'appelle
Kleopas, lui que les Constitutions apostoliques (écrites, semble-t-il, aux
alentours de l'année 385) assimilent à Klopas. Le nom n'est pas tellement
courant dans la Bible et il se pourrait fort que le pèlerin d'Emmaüs de Saint Luc
soit le (père de celui) qui deviendra le second évêque de Jérusalem, successeur
de Jacques.
UN TEXTE EN FORME DE MIDRASH
Le texte du chapitre XV des Actes des apôtres peut être lu suivant
l'ordonnancement suivant :
XV-1 à 12 Un récit depuis l'enseignement prêché dans la région
d'Antioche jusqu'à la grande réunion de l'Eglise du Christ, à Jérusalem.
XV-13 Un changement radical : Jacques va parler !
XV-14 Le retournement arrive par deux mots inattendus : Siméon =
d'où vient-il ? Qu'a-t-il fait ? / et : / 'd'abord' = 'Dieu a d'abord visité les
nations', qui est comme une réponse à ce qui fut écrit en (XV-4).
Si on lit le mot d'abord comme étant l'invitation à retourner vers le texte qui
est d'abord dans l'Ecriture, (le premier chapitre de la Tora, c'est à dire le livre de
la Genèse), on y rencontre Dieu et les nations, puis le choix de son peuple et
enfin Siméon.
XV-14 à 18 La parole de Jacques est en forme d'un dire midrashique sur
l'histoire d'Israël.
XV-19 et 20 Nouveau retournement du texte. Jacques suspend sa lecture
en forme de midrash et il dit sa décision : 'Je juge' (XV-19) et aussitôt il l'engage
par la rigidité de l'écrit : 'Il n'y a qu'à leur écrire' (XV-20).
Ainsi, le texte du chapitre XV se présente en trois parties :
XV-1 à 12 la question Qu'en est-il de la circoncision ?
XV-13 à 18 le midrash Il n'y a qu'à écouter ce que fit Siméon.
XV-19 à fin la réponse (on ne dit rien sur la circoncision)
Alors, me référant au dire midrashique de Jacques, j'ai voulu, moi aussi, faire
que ma lecture soit une...
Jean-Marie GEORGEOT - " De Saint-Marc jusqu'à Tertullien " ( 1978 à 2004 )
LA DIDACHE - 118 -
... LECTURE EN FORME DE MIDRASH
Si je retiens la citation des Constitutions apostoliques (ou du moins : si je
prends acte de l'écrit tel il nous est parvenu, reflétant certainement une volonté
de son auteur), je note que les trois premiers évêques de l'Eglise (c'est à dire :
celle de Jérusalem) ont pour noms :
JACQUES SIMEON JUDAS
et j'ose faire aussitôt un rapprochement avec la situation de Genèse (XXXIV-5 à
31) au pays de Sichem, là où les hébreux ont pour personnalités éminentes :
JACOB SIMEON LEVI .
Bien évidemment l'ensemble des deux égalités :
Jacques = Jacob Siméon = Siméon
entraîne l'obligation de regarder attentivement la situation réciproque entre Levi
(Genèse = le prêtre) et Judas (Jérusalem = ...?...).
La lectio divina, qui est lecture et analyses et ruminations du texte au plus
profond de son lecteur, rejoint ici la lecture midrashique et je me suis plu à
imaginer que Dieu fit arriver successivement son Esprit sur les trois premiers
évêques judéo-chrétiens qu'il fit ordonner (C. A.VII-46/1) par les Douze. Le
premier fut fondateur et porte le nom de Jacob, lequel fut Israël, c'est à dire le
Nom de son peuple. Le deuxième fut le successeur de Jacob. Jadis il était son
fils, Siméon, par lequel fut révélée la vraie richesse de la circoncision avec, pour
conséquence, un pays (Salem) avec une montagne (Garizim) et une tombe sacrée
(les douze patriarches). Voici que Siméon est là encore, homme venu avec le
même nom pour être le deuxième évêque pour un pays (Ieru-Salem) avec une
montagne (Moriya) et une tombe sacrée (le Saint Sépulcre). Or lui, il fut le
troisième à subir le martyr et cette trinité :
JESUS JACQUES SIMEON
fut, en aboutissement, le fondement de l'Eglise. Ces trois furent descendants de
David puisque tous trois étaient parents, donc avaient des ancêtres communs.
Le troisième fut Levi qui n'eut aucune terre, père de la longue lignée de
prêtres. Je ne sais si, en réalité, le troisième évêque se nommait Judas (= un
judéen d'alors, un juif nouveau pour Jérusalem) ou s'il se nomma Juste en qui
ma lecture midrashique voit ce Justus qui avait pour noms (Actes I-23) en plus :
Joseph (comme le conseiller de pharaon, celui par qui tout arriva, nouvelle
union des monothéistes en pays étranger, l'Egypte) et Barsabbas (qui unit le 'fils'
araméen 'Bar' au mot 'Père' créé à Gethsémani : 'Abba'). Le troisième évêque fut
celui par lequel l'Eglise prit définitivement forme et fonction à Jérusalem.
Jean-Marie GEORGEOT - " De Saint-Marc jusqu'à Tertullien " ( 1978 à 2004 )
LA DIDACHE - 119 -
ET SIMEON ?
Alors, à celui qui, étant étonné, avait protesté à cause de 'mon' Siméon de la
Genèse, j'ai dit :
En lecture midrashique, rien ne peut s'opposer à ce que, en Actes (XV-14),
celui qui parle soit Siméon le (fils) de Klopas, le fils de celui-là qui, s'en-allant
vers Emmaüs avec un autre des disciples de Jésus, rencontra un homme, juif
également, qui "allait-vers la (même) campagne" (Mc XVI-12). Les deux lui
"dirent les (choses) au sujet de Jésus le nazarénien" (Lc XXIV-19) et lui "leur
interpréta dans toutes les Ecritures les (choses) au sujet de lui-même... en
commençant (du Livre) de Moïse et (des livres) de tous les prophètes"
(Lc XXIV-27)
Et je lui ai relu le texte des Actes ;
'Siméon a raconté comment Dieu a d'abord visité les nations
pour y prendre un peuple à Son nom',
car Siméon était participant de la mémoire d'Israël, lui l'enfant de Jacob, lui qui
osa sauver l'honneur de la circoncision en tuant les impurs-violeurs de l'honneur
de Dinah. La nation visitée était celle de Hamor, le hévéen, prince du pays de
Sichem et Son peuple est celui des fils de Jacob (Genèse XXXIV-2 puis 7). Israël
va dire à ses fils :
'Vous m'avez porté malheur en me rendant odieux à l'habitant du pays.'
(Genèse XXXIV-30)
Plus tard, beaucoup plus tard, le Messie viendra et ira à la Ville, la Sainte-
Salem (= Ieru-Salem), où il sera crucifié par les habitants du pays. Ceux-ci sont
"tout le pays (de) Judée et tous les habitants-de-Jérusalem" (Mc I-5). Le Messie
fut crucifié par eux tous "les grands-prêtres et les scribes et les anciens avec une
foule et, avec eux, l'un des Douze : Judas" (cfr : Mc XIV-43).
La maison de David était ainsi tombée et, au troisième jour, elle s'est relevée.
'Et ceci est en harmonie avec les paroles des prophètes, selon qu'il est écrit :
après cela je reviendrai et je rebâtirai l'abri de David qui était tombé; je rebâtirai
ses ruines et le redresserai afin que le reste des hommes cherche le Seigneur,
toutes ces nations sur lesquelles mon Nom a été invoqué, dit le Seigneur qui fait
ces choses connues depuis les âges'.
(Actes XV-15 à 18)
Jean-Marie GEORGEOT - " De Saint-Marc jusqu'à Tertullien " ( 1978 à 2004 )
LA DIDACHE - 120 -
Mon compagnon entendit car, avec son très large sourire, il reprit après moi
cette dernière parole : 'Oui, me dit-il, au sujet de Siméon, le texte pouvait bien
écrire qu'il revenait afin de 'rebâtir l'abri de David qui était tombé' car Jacques,
puis Siméon, allaient subir le martyr, eux qui, comme le Seigneur Jésus, étaient
descendants de David.
Mais, avez-vous bien perçu cet 'abri de David = g : ten skenen David' ?
(Actes XV-16) ?
Le mot grec est celui-là que Pierre prophétisa à la Transfiguration :
"g : kai poiesômen treis skenas = faisons aussi trois abris".'
(Mc IX-5)
Trois : comme ces trois-là, à Jérusalem, qui allaient être crucifiés l'un après
l'autre, eux trois étant descendants de David !
Alors j'ai eu une grande vision et j'ai vu l'ange de la justice se lever. Il dit :
Jadis, aux temps du livre de la Genèse, à Sichem en Samarie, Siméon a tué par
un véritable meurtre car il est écrit que Siméon et Lévi 'prirent chacun son épée
(et) entrèrent dans la ville en pleine sécurité et tuèrent tous les mâles...'
(Genèse XXXIV-25)
L'ange de la justice se tenait devant Dieu et disait encore : Ces meurtres furent
fondateurs du royaume du Nord, la Samarie avec Salem, le mont Garizim, la
tombe des douze patriarches, et ce fut l'ancrage d'Israël dans un sol qu'il s'acquit
par les meurtres de Hamor, de Sichem et de tous les mâles.
Bientôt par le Messie l'ancrage de Dieu sera en tous les hommes de toutes les
nations, au-delà de Salem-la-Sainte, du mont Sion, du Sépulcre du Messie. Peut-
être faudra-t-il, en ce jour, effacer cette tache du sang meurtrier répandu à
Sichem ? ... Dieu rappela Siméon AFIN QU'il soit troisième à être crucifié, à périr
par un meurtre ultime-sacrifice(33) pour l'alliance nouvelle offerte par Dieu à
toutes les nations.
Car ceux qui tuèrent Hamor et Sichem, (Jacques et Siméon), étaient des
meurtriers(34) : ils ont agi en pleine sécurité.
Jean-Marie GEORGEOT - " De Saint-Marc jusqu'à Tertullien " ( 1978 à 2004 )
LA DIDACHE - 121 -
DIDACHE VI
EN LISANT JOSUE
_______________
Le chapitre XV des Actes
Josué
Jérusalem
Sichem
Les lévites
Le Pentateuque
Conclusion-questionnement
_______________
Jean-Marie GEORGEOT - " De Saint-Marc jusqu'à Tertullien " ( 1978 à 2004 )
LA DIDACHE - 122 -
LE CHAPITRE XV DES ACTES
J'ai relu une nouvelle fois ce chapitre en notant, verset par verset, des noms ou
des mots remarquables :
1. descendre de Judée mosaïque
2. Paul et Barnabé monter à Jérusalem
(deux fois)
3. parcourir la Samarie
RETOURNEMENT des nations
4. arriver à Jérusalem
5. pharisiens : ceux de Moïse
Sichem
6. ---
7 Pierre pour les nations
8. --- 9. --- 10. --- 11. ---
12. Barnabé et Paul parmi les nations
13. Jacques
14. Syméon
visiter les nations
15. (les prophètes)
16. David
17. toutes ces nations
18.
19. ceux des nations :
RETOURNEMENT
20. ECRIRE
21. Moïse
22. Paul et Barnabé...
Il est des positions remarquables dans cette énumération : Judée et Jérusalem
encadrent mosaïque, de même que Jérusalem et Sichem encadrent Moïse. Or
celui-ci quitta la terre d'Egypte (qui ne lui appartenait pas) pour aller vers la terre
promise (qui appartiendra, mais plus tard, aux hébreux). J'ai dit plus haut
comment j'ai vu le Livre de Jérusalem et le Livre de Samarie, Tora et
Pentateuque samaritain, l'un et l'autre étant le statut, la règle, la LOI de Moïse.
Aussi ai-je relu le Livre de Josué pour y noter comment fut décidé, et pour
quelle tribu, le statut de chacune de ces deux villes : Jérusalem et Sichem.
Jean-Marie GEORGEOT - " De Saint-Marc jusqu'à Tertullien " ( 1978 à 2004 )
LA DIDACHE - 123 -
JOSUE
Josue XIII-1 à 7
'Quand Josué fut vieux, avancé en âge, YHVH lui dit :
'Tu es devenu vieux, avancé en âge, et il te reste encore un très
grand pays à conquérir. Voici le pays qui reste : tous les districts de... Et
maintenant (= c'est le mot de l'Alliance !) partage ce pays en héritage aux neuf
tribus et à la demi-tribu de Manassé.'.'
JERUSALEM
Josue XIV-1 à 8
'Le lot qui échut à la tribu des fils de Juda... Ces frontières à l'Orient, c'est
la mer de sel jusqu'à l'embouchure du Jourdain... La frontière montait à la vallée
de Ben-Hinnom au midi du flanc du jébuséen (c'est Jérusalem).'
(Cette vallée est encore appelée Gey-Hinnom = Géhenne et elle borde l'ancienne
Jérusalem.)
Josue XIV-63
'Quant aux jébuséens qui habitaient Jérusalem, les fils de Juda ne purent
les déposséder et le jébuséen habita à Jérusalem à côté des fils de Juda jusqu'à ce
jour.'
Josue XVIII-11 à 28
'Le sort tomba sur la tribu des fils de Benjamin... Ils eurent pour frontière
du côté du nord le Jourdain; mais la frontière montait au flanc de Jéricho... elle
descendait dans la vallée de Hinnom au flanc du jébuséen au midi... Ils eurent
comme villes : Jéricho, Ha-Aï, Gabaon (= se rappeler la violence déployée par
YHVH pour libérer ces villes de leurs habitants et les donner aux hébreux) et le
jébuséen (c'est Jérusalem).'
Jean-Marie GEORGEOT - " De Saint-Marc jusqu'à Tertullien " ( 1978 à 2004 )
LA DIDACHE - 124 -
SICHEM
Josue XX-1 à 7
'YHVH parla à Josué en disant :
'Parle aux fils d'Israël en disant : Donnez-nous les villes de refuge...
pour que s'y réfugie le meurtrier qui aurait tué une personne par mégarde sans le
savoir... (les anciens de ces villes) le recueilleront... lui donneront un endroit où
il habitera avec eux... Que si le vengeur du sang le poursuit, ils ne livreront pas
le meurtrier à sa main...'
On a consacré donc en deçà du Jourdain Quadès en Galilée... Sichem dans la
montagne de Juda.'
Noter qu'il n'y a que trois noms, donc que le nombre des provinces choisies est
de trois : Galilée, Samarie et Judée. Comme la Galilée est la province du
nord, je vois dans ces trois villes-refuge pour celui qui aurait par mégarde fait
couler le sang d'un homme, comme les trois lieux du chapitre XV des Actes. Ce
sont les repères fondamentaux du voyage de Paul et Barnabé : la Galilée
(= partant d'Antioche, ils sont obligés de la traverser), la Samarie (= le détour
durant le voyage) et la Judée (= l'arrivée à Jérusalem).
Ainsi Paul et Barnabé, enquêtant sur la circoncision (= la coupure, donc le
sang) ont balisé leur trajectoire par les trois villes-refuges du sang versé.
LES LEVITES
La tribu de Levi(31) ne reçut aucune terre :
Josue XIII-14
'A la seule tribu de Lévi on ne donna pas d'héritage : les sacrifices par le
feu à YHVH, c'est un héritage selon ce qu'il lui a dit.'
Josue XIII-33
'... mais à la tribu de Lévi, Moïse ne donna pas d'héritage : YHVH, Dieu
d'Israël, c'est Lui leur héritage selon ce qu'Il leur a dit.'
Jean-Marie GEORGEOT - " De Saint-Marc jusqu'à Tertullien " ( 1978 à 2004 )
LA DIDACHE - 125 -
Car YHVH avait dit à Aaron :
Nombres XVIII-20 et 21
'Tu n'auras pas d'héritage dans leur pays et il n'y aura pas de part pour toi
au-milieu d'eux : c'est moi qui suis ta part et ton héritage au-milieu des fils
d'Israël. Mais aux fils de Lévi, voici que je donne pour héritage toute dîme en
Israël en échange du service qu'ils font, à savoir le service de la Tente du
Témoignage.'
Cependant :
Josue XIV-4
'... on ne donnait pas de part aux lévites dans le pays, sinon des villes pour
y habiter, avec leurs banlieues pour leurs troupeaux et leurs possessions.'
Josue XXI-1 et 2
'Les chefs des maisons paternelles des lévites s'avancèrent... en disant :
YHVH a commandé par l'organe de Moïse de nous donner des
villes pour y habiter, ainsi que leurs banlieues pour notre bétail.'
(Alors, ils leur donnèrent des villes mais, d'abord, les trois villes-refuges :)
Josue XXI-11 de la tribu des fils de Juda Hébron
Josue XXI-21 de la tribu d'Ephraïm Sichem
Josue XXI-32 de la tribu de Nephtali Quadès
Josue XXI-42 'Ces villes comprenaient chacune
la ville et ses banlieues autour d'elle.'
LE PENTATEUQUE
Josue XXIV
'Josué rassembla à Sichem toutes les tribus d'Israël et convoqua les
anciens d'Israël, ses chefs, ses juges, ses scribes. Ils se présentèrent devant
l'Elohim.' (Josué leur dit le récit de l'Alliance depuis que) 'YHVH, Dieu d'Israël'
(l'eut passée avec Abraham : Isaac, Jacob, l'Egypte, Moïse et Aaron, la mer de
jonc...)
Jean-Marie GEORGEOT - " De Saint-Marc jusqu'à Tertullien " ( 1978 à 2004 )
LA DIDACHE - 126 -
'Et maintenant, craignez YHVH. Servez-le en sincérité et en vérité.'
(Le peuple répond :)
'Nous servirons YHVH !'
(Et voici le passage qui m'a frappé fortement :)
'Josué conclut donc en ce jour-là une alliance avec le peuple : il lui imposa
un statut et une règle à Sichem. Puis JOSUE ECRIVIT ces paroles dans le
LIVRE de la Loi d'Elohim. (Il prit alors une pierre et la dressa :) elle servira de
témoin contre vous pour que vous ne puissiez renier votre Dieu.'
(Alors, Josué mourut.)
Ainsi, c'est à Sichem, au cœur de la Samarie, que fut écrit ce premier livre
contenant le statut et la règle pour les douze tribus d'Israël.
CONCLUSION - QUESTIONNEMENT
Bientôt je vais clore ce 'livre' traitant de la Didachè. Le livre de la Doctrine du
Seigneur (enseignée) aux nations par les douze apôtres est, en réalité, un
opuscule très court : il ne comporte que quatre-vingt-dix-neuf versets, chaque
verset étant constitué, bien souvent, d'une seule phrase. Ce serait un livre qui
comporterait très peu de pages s'il était imprimé texte à nu et sans aucune note.
Aussi vais-je re-garder aux longs commentaires vers lesquels il m'a entraîné,
m'obligeant à parcourir (cfr : Ac XV-3) d'autres écrits :
d'abord, bien évidemment :
la Tora
l'évangile selon Saint Marc
puis, en passant :
les Constitutions apostoliques
les Odes de Salomon
enfin, surtout :
les Actes des apôtres (ch. XV)
le livre de la Genèse (ch XVII et XXXIV)
le livre de Josué.
Jean-Marie GEORGEOT - " De Saint-Marc jusqu'à Tertullien " ( 1978 à 2004 )
LA DIDACHE - 127 -
Entre les textes canoniques de la Bible apparaissent des liens qui sont la
marque de l'Esprit-Saint. L'histoire de la relation entre Dieu et l'homme est
l'Histoire de l'Alliance, et l'étude des textes amène à leur faire exprimer toujours
plus de sens en confirmation puis enrichissement du récit vers la cohérence
totale de l'HISTOIRE de l'Alliance.
L'évangile selon Saint Marc vient en continuation de la Tora. Après lui, il y a
les Actes des apôtres dont l'auteur est Saint Luc. J'ai cru, pendant longtemps,
que l'auteur était tout au plus médecin païen converti en l'ami de Saint Paul. A
l'occasion de la mort d'Etienne, j'avais pris conscience que le texte des Actes
était très riche de données judéo-chrétiennes, c'est à dire : de données
sémitiques lues au travers des événements durant la vie et la mort-résurrection
du Christ.
J'aurais pu admettre que les premiers chapitres des Actes eussent été rédigés
par quelque apôtre, ou ancien, ou disciple, pour être offerts à la copie du
médecin païen. Or voici que le chapitre XV des Actes me permet une lecture
en profondeur des temps de la conception de la Tora, d'un temps d'avant (Jéru)-
Salem, alors que les fils d'Israël auraient voulu se fixer à la ville de Salem.
Les sangs versés à flots, non par assassinat, mais pour sauver la liberté et
l'honneur des douze frères (et de leur sœur Dinah), ces sangs versés vont faire
que Sichem sera Nom d'une ville-refuge du sang versé, alors que Salem ne
pourra être la ville sainte où ériger un Temple au Dieu-Unique sur un champ
acheté.
La cohésion des frères nécessitera, pour être maintenue, un ECRIT : statut
et règle de la Loi de Moïse.
Lorsque, plus tard, les juifs de Sichem seront déportés, leur cohésion sera
brisée, car nul prophète ne se lèvera pour leur enseigner de garder leur
Pentateuque avec eux, dans les camps de la déportation.
Cent cinquante ans plus tard encore, face à une même situation pour ceux de la
Sainte-Salem, ceux de Judée iront vers la déportation mais en gardant leur
Tora, ils sauveront leur unité (= leur existence de peuple, les deux mots sont
synonymes).
Jean-Marie GEORGEOT - " De Saint-Marc jusqu'à Tertullien " ( 1978 à 2004 )
LA DIDACHE - 128 -
Lisant de cette façon la puissance de l'ECRIT, j'ai lu dans le chapitre XV des
Actes la première Epître des apôtres et j'ai pensé la Didachè comme étant la
première Constitution apostolique.
Or, tout ce long cheminement de ma réflexion n'a pu être suivi que grâce à un
auteur : cet homme dont on m'avait dit qu'il fut médecin païen...
Au fait :
Q U I est Saint LUC,
auteur des Actes des apôtres ?
*Y*H*V*H*
Jean-Marie GEORGEOT - " De Saint-Marc jusqu'à Tertullien " ( 1978 à 2004 )
LA DIDACHE - 129 -
DIDACHE I à VI
LES NOTES
_______________
Jean-Marie GEORGEOT - " De Saint-Marc jusqu'à Tertullien " ( 1978 à 2004 )
LA DIDACHE - 130 -
* * * *
Jean-Marie GEORGEOT - " De Saint-Marc jusqu'à Tertullien " ( 1978 à 2004 )
LA DIDACHE - 131 -
N O T E S
_______________
n° intitulé Page : n° intitulé Page :
1 on LUI a fait 19 19 gens descendus 73
2 intelligence 19 20 utilisaient 73
3 à ce sujet 20 21 et peu après 75
4 chiens 21 22 dieux de morts° 76
5 pièces 23 23 'le Règne' 87
6 bonne ménagère 23 24 je prie 88
7 ne l'entendez pas 25 25 OBLIGATION 90
8 'préparé' 41 26 au rituel ---
9 barrer "ten odon" 44 27 nous marchions 108
10 lue à l'envers 45 28 consentante 109
11 l'Alliance 46 29 la séduira 109
12 le serment 46 30 SALEM 109
13 chemin 58 31 SIMON 110
14 un signe voulu 70 32 fréquenté 112
15 aménager le texte 72 33 sacrifice 120
16 l'origine 72 34 meurtriers 120
17 Rama 72 35 Lévi 124
18 l'araméen 73
_______________
Jean-Marie GEORGEOT - " De Saint-Marc jusqu'à Tertullien " ( 1978 à 2004 )
LA DIDACHE - 132 -
** ** **
Jean-Marie GEORGEOT - " De Saint-Marc jusqu'à Tertullien " ( 1978 à 2004 )
LA DIDACHE - 133 -
Note 1 : on lui a fait : Page : 19
Se reporter le chapitre Le calendrier dans le Tome VIII.
Note 2 : intelligence : Page : 19
Car, en culture sémitique, les mots de cœur et intelligence sont
synonymes.
Note 3 : à ce sujet : Page : 20
Le texte des Constitutions apostoliques (Sources chrétiennes n° 336)
reprend, en son chapitre VII, le texte de la Didachè. Le passage correspondant à
la prière pour l'eucharistie se trouve référencé C.A. VII-25-5 à 7 :
'Qu'aucun non-initié n'en mange, mais seulement ceux qui ont été
baptisés en la mort du Seigneur. Si un non-initié se dissimule et communie, il
mangera le jugement éternel parce que, n'ayant pas la foi au Christ, il aura
communié à ce qui lui est interdit, pour son châtiment.
Si quelqu'un communie par ignorance, instruisez-le sommairement au plus
vite pour l'initier, afin qu'il ne s'en aille pas avec mépris.'
Une note dans S.C. précise : ces prescriptions ne proviennent pas de la
Didachè. (Donc la parole de Jésus à propos des chiens n'est plus rapportée).
Note 4 : chiens : Page : 21
Ce mot grec se conjugue :
au singulier : nominatif : kuôn / vocatif : kuon / génitif : kunos /
datif : kuni / accusatif : kuna
au pluriel : datif : kusi.
Je note cependant que, dans le texte grec de l'évangile de Saint Matthieu publié
par F. Vigouroux (Paris 1908), il y a kusi et non pas kusin, mais ainsi les chiens
restent toujours dans leur pluriel.
Note 5 : pièces : Page : 23
Cfr : Exode XXII-30 - Voir ci-dessus.
Jean-Marie GEORGEOT - " De Saint-Marc jusqu'à Tertullien " ( 1978 à 2004 )
LA DIDACHE - 134 -
Note 6 : bonne ménagère : Page : 23
Ce qui veut dire : à cette femme prostituée, qui offre son anonymat à tous
les hommes (un pluriel), Jésus parle comme à une bonne ménagère et s'adresse à
elle comme à toute femme vivant son identité dans sa maison (le singulier).
Note 7 : ne l' entendez pas ainsi : Page : 25
C'est à dire : ne l'écoutez pas !
Note 8 : 'préparé' : Page : 41
Le lecteur prendra conscience de la circularité que nous venons, ensemble,
d'exposer :
I-2 kata-skeuazô seul emploi
I-3 hetoimazô premier (de cinq) emploi
II-23 tillô seul emploi.
Mais, en plus, il y a :
II-23 odon poiein : unique en N.T.
Et ceci signifie que c'est le signe à prendre en compte pour l'exégèse :
l'important, dans cette circularité, n'est pas le centre, mais là où est le signe.
Note 9 : barrer "ten odon" = Page : 44
Dieu va stopper le chemin de la vie, pour 'cet homme'. Pour eux, c'est
Dieu qui va faire (le verbe poieô) satisfaction à tous ceux de la foule d'Israël
(cfr : XV-15) qui "le condamnèrent étant coupable de mort.
(Cfr : XIV-64 = g : thanatos)
Note 10 : lue à l' envers : Page : 45
En hébreu, le mot 'vérité' se dit emet. En lisant les consonnes du mot
Timée, on obtient = aleph + mem + tov, ce qui est le mot emet = ' M T !
Ou encore : le nom de cet aveugle, lorsqu'il est lu écrit en grec (c'est à dire : de
gauche à droite) est Timée. Si on laisse les lettres à la même place et qu'on
veuille le lire selon l'habitude des hébreux (de droite à gauche), on lit emet !
Jean-Marie GEORGEOT - " De Saint-Marc jusqu'à Tertullien " ( 1978 à 2004 )
LA DIDACHE - 135 -
Note 11 : l' Alliance : Page : 46
Ceci est en conformité avec la loi du texte car, au sixième rang, il y a
toujours l'Alliance. Puis-je oser voir, ici, un sourire du texte venu confirmer
l'exégèse sur les deux filles ?
Note 12 : le serment : Page : 46
J'ai dit ailleurs comment j'ai vu en Bar-Timée la figure allégorique de tout
le peuple d'Israël. Il est celui-là de (X-22) dont le regard s'est assombri car il était
ayant de (trop) nombreux rites. Alors la lecture du texte, apportant pour la
septième fois 'para + accusatif' en offrande au fils de Timée, est la certitude
que Dieu va tenir son serment d'aider le peuple d'Israël et de le rétablir dans sa
pleine force : Bar-Timé va pouvoir lever-le-regard à nouveau.
Note 13 : chemin : Page : 58
Cfr : 'Ici, il n'y a plus de chemin,
parce qu'il n'y a PLUS DE LOI pour le juste.'
(Jean de la Croix)
Note 14 : UN SIGNE voulu par l' auteur : Page : 70
Peut-être vaudrait-il mieux écrire : voulu par le récit, car il n'est pas
démontré que le signe des Quatre ait été interprété pleinement par Saint Luc.
Les événements ont fait qu'il y a eu 2 + 2 = 4 légats. Cela est un signe envoyé
par l'Esprit-Saint afin que le lecteur se souvienne. Un jour le Seigneur appela à
le suivre 2 + 2 = 4 pêcheurs de la mer de Galilée; en conclusion de cet appel, il
y eut UN écrit : l'évangile selon Saint Marc.
Ici, les légats sont envoyés en mission et ils sont porteurs d' UN écrit : la
première épître de l'Eglise de Jérusalem. Ainsi l'Esprit amène son lecteur à lire le
signe écrit dans le récit des Actes.
Mais alors : l'auteur des Actes des apôtres ne serait-il pas l'Esprit-Saint, par
delà celui que nous nommons Saint Luc ? Alors : mon texte reste pleinement
valable.
Jean-Marie GEORGEOT - " De Saint-Marc jusqu'à Tertullien " ( 1978 à 2004 )
LA DIDACHE - 136 -
Note 15 : aménager le texte : Page : 72
Ne pas lire, dans cette expression, un sens porteur de mensonges ou de
remaniements hérétiques. Lorsqu'on lit un texte en voulant le vivre uniquement
en référence aux événements modernes, donc en abolissant le facteur temps, on
aboutit à une théologie de circonstance, c'est à dire ne présentant aucune
certitude d'orthodoxie.
Note 16 : l' origine : Page : 72
Vers 740/722 avant J.-C., l'Assyrie détruit Samarie, capitale du royaume
du Nord, celui des dix tribus. Les habitants sont déportés. Il ne reste plus que le
royaume du Sud, celui des deux tribus, mais ses rois détournent leur peuple de
l'Alliance avec Dieu.
Vers 640, Josias devient roi et s'efforce de ramener le peuple vers une relation
plus intime avec Dieu. Il propose une réforme à la suite de la découverte d'un
manuscrit deutéronomique apporté à Jérusalem par des réfugiés israélites
venant de Samarie.
En 587, le royaume du Sud (= Juda) est détruit. Le Temple est brûlé et le culte
supprimé : '... le chef des gardes du corps entra à Jérusalem; il brûla la Maison
de YHVH et la maison du roi, ainsi que toutes les maisons de Jérusalem... Quant
au reste de la population... le chef des gardes du corps les envoya en exil, mais il
laissa, du bas peuple du pays, ceux qui pouvaient être vignerons et cultivateurs.'
(II Rois XXV-8 à 12)
Il faudra attendre l'an 538 pour que Cyrus, roi des perses, se déclare chargé
(par YHVH) de rebâtir le Temple de Jérusalem et il lance à travers son royaume
la proclamation suivante destinée aux israélites :
'Quiconque d'entre vous est de tout son peuple, que son Dieu soit avec lui,
qu'il monte à Jérusalem... et qu'il construise la Maison de YHVH.'
(Esdras I-3)
'Et le roi Cyrus fit sortir les ustensiles de la Maison de YHVH que
Nabuchodonosor avait enlevés de Jérusalem.'
(Esdras I-7)
Jean-Marie GEORGEOT - " De Saint-Marc jusqu'à Tertullien " ( 1978 à 2004 )
LA DIDACHE - 137 -
Qu' est devenu le Livre de Moïse ?
'Après ces événements, (on verra revenir à Jérusalem) Esdras, le prêtre-
scribe, scribe des paroles ordonnées par YHVH et de ses lois au sujet d'Israël.'
(Esdras VII-11)
Ainsi : Esdras reçut l'ordre de l'Eternel de ré-écrire, sous SA dictée,
le LIVRE de MOISE .
Note 17 : Rama : Page : 72
En hébreu : ha-ramatah, dont on a dit depuis qu'elle fut la ville d'origine
d'un homme° bon et juste du nom de Joseph.
Note 18 : l' araméen : Page : 73
Même encore aujourd'hui, deux mille ans après ces événements, ils ont
conservé leurs usages. A chaque fête de Pâque, ils vont camper sous des tentes
sur le mont Garizim. Au soir, ils tuent les agneaux et les font rôtir avec des
herbes amères, et eux seuls en mangent car ils veillent à ce qu'aucun non-juif (=
non-samaritain) ne vienne profaner l'offrande.
Note 19 : gens descendus de Judée : Page : 73
Il me faut ici attirer l'attention sur la formulation de cette expression et,
pour cela, je dois très rapidement donner en schéma l'histoire d'Israël.
Après que David eut pu rassembler les douze tribus en un royaume unique et
après qu'il leur eut donné pour capitale la ville de Jérusalem (= la Sainte-Salem
ou encore : Ieru-Salem), son fils Salomon fit rayonner la puissance d'Israël. C'est
alors l'euphorie économique : commerce extérieur maritime, alliances avec de
nombreux peuples, exploitations minières dans le désert. Salomon construit pour
lui-même un palais et pour Dieu il érige le Temple. La splendeur du Temple
s'étend sur la royauté. Pour ce peuple : un roi-unique et UN Dieu-Unique.
Jean-Marie GEORGEOT - " De Saint-Marc jusqu'à Tertullien " ( 1978 à 2004 )
LA DIDACHE - 138 -
Salomon avait engagé d'énormes dépenses gagées par l'avancée économique. Il
fallait ensuite rembourser les dettes, d'où en forme d'intérêts : des réactions, des
récriminations, des révoltes et le schisme.
D'abord, pour les dix tribus, le ralliement de Jéroboam dans le royaume du
Nord = la Samarie. Leur texte : le Pentateuque (samaritain). Le roi assyrien
Sargon : en 722 av. J.-C., la ruine avec la déportation. Fin du royaume,
disparition des dix tribus, survivance locale de quelques groupes attachés à la
terre.
Ensuite, pour deux tribus, des rois pris parmi les descendants de David et de
Salomon règnent sur le royaume du Sud. Le culte dans le Temple de Jérusalem.
Leur texte : la Tora. Nabuchodonosor : en 586 av. J.-C., la ruine avec la
déportation. Survivance locale des juifs agriculteurs. Une innovation : la
tradition mosaïque est respectée dans la diaspora.
Lorsque le retour au pays leur est permis, les juifs déportés parfois choisissent
de revenir, souvent vont s'établir ailleurs ou encore restent dans leur pays d'exil.
Il y a désormais deux sortes de juifs : ceux de la diaspora et ceux revenus en
Judée. Pour ceux du Temple de Jérusalem, la stratégie à suivre est évidente :
reconstruire le Temple et y reprendre le culte des holocaustes, et - grâce à Esdras
- pouvoir disposer à nouveau du texte de la Tora avec sa Tradition.
Les gens descendus de Judée sont des judéens, ce qui se dit
'h : yehoudim = (juifs)',
mais ce ne sont
ni des alliés des juifs de Samarie,
ni des collègues des juifs de la diaspora.
Il y a, désormais, trois sortes de juifs,
comme il y a trois expressions de la Tora.
Note 20 : utilisaient : Page : 73
Une remarque très importante : ceux de Judée ont la Bible (= la Tora +
les prophètes + la Sagesse), mais ceux de Samarie ne reconnaissent comme livre
canonique que le seul livre du Pentateuque (samaritain) et ils n'admettent pas les
livres des prophètes ni les livres de la Sagesse. Pour eux, la Bible est
uniquement le (= leur) livre de Moïse.
Jean-Marie GEORGEOT - " De Saint-Marc jusqu'à Tertullien " ( 1978 à 2004 )
LA DIDACHE - 139 -
Note 21 : et peu après : Page : 75
Voir Annexe ci-dessous.
Note 22 : dieux de morts° : Page : 76
Cfr : "IL n'est pas dieu de morts° (g : Theos nekrôn), mais (Dieu) de
vivants".
(Mc XII-27)
Note 23 : 'le Règne' : Page : 87
La doxologie "car en Toi sont le Règne et la Puissance et la Gloire dans
les siècles" apparaît dans les Constitutions apostoliques (VII-24-1). Le texte
pourrait être daté des environs de l'année 385 (Voir S.C. 320 page 60).
Note 24 : je prie : Page : 88
Mais, si je prie le 'Notre Père' après la Consécration, j'entends en moi
l'inversion par le texte :
"En Toi la GLOIRE et la PUISSANCE"
tel que le texte de la Didachè le donne dans la Prière pour l'eucharistie, car :
la GLOIRE de Dieu est son INCARNATION .
Note 25 : OBLIGATION : Page : 90
Le jour de la fête du pardon (yom kippour), le Grand Prêtre est
entièrement vêtu de blanc pour entrer dans le Saint des Saints, lieu le plus sacré
du Temple, afin d'y implorer le pardon de l'Eternel (Béni soit-Il !) pour toutes les
fautes du peuple d'Israël.
Quand le Grand Prêtre implore le pardon, Dieu pardonne.
Et si ton prochain implore le pardon, tu pardonnes !
C'est là une relation de similitude. Si le Grand Prêtre n'implorait pas, Dieu ne
pardonnerait pas. Si la démarche du Grand Prêtre était faite faussement par
rapport au rituel(26) (voir note ci-dessous), Dieu ne pardonnerait pas.
Semblablement, si le prochain que tu as offensé n'implorait pas ton pardon, tu
ne serais pas obligé de lui pardonner et toute ta vie tu serais libre de le maudire.
Jean-Marie GEORGEOT - " De Saint-Marc jusqu'à Tertullien " ( 1978 à 2004 )
LA DIDACHE - 140 -
Note 26 : au rituel : Page : 139
Exemple : le Grand Prêtre doit (= c'est une obligation) être marié, sinon
ses actes religieux seraient nuls. A cause de l'importance de la fête de yom
kippour, il est donc nécessaire que, au moment précis où le Grand Prêtre entre
dans le Saint des Saints, il ait une épouse.
Pour éviter la nullité qui s'en suivrait en cas de mort subite, à cet instant précis,
de la femme du Grand Prêtre, celui-ci devait obligatoirement être lié, outre son
mariage légitime, par un mariage blanc (donc : avec une vierge).
Note 27 : nous marchions : Page : 108
Voir l'étude sur la Didachè dans le paragraphe consacré au Chapitre XV
des Actes, le passage intitulé : la Phénicie et la Samarie.
Note 28 : consentante : Page : 109
Pour une fille qui était violée dans une ville, la loi juive la décrétait
coupable si elle n'avait pas appelé car, dans une ville, il y a toujours quelqu'un
pour entendre et accourir.
Note 29 : la séduira = Page : 109
En tout bien tout honneur, pour la fille, puisqu'elle n'est pas coupable.
Note 30 : SALEM : Page : 109
Je vois dans ce nom une remarquable occurrence, car SALEM est la
première ville sainte des hébreux. Jacob y 'acheta la parcelle de champ où il
avait tendu sa tente, de la main des fils de Hamor, près de Sichem, pour cent
pécunes (= cent agneaux, monnaie ayant son équivalence en têtes de bétail). Il y
érigea un autel et l'appela EL-Dieu d'Israël.'
(Genèse XXXIII-19 et 20)
La ville de Salem, en Samarie, est la première ville (chronologiquement)
sainte car c'est le premier lieu où les israélites (= les fils d'Israël) achètent un
champ pour y ériger un autel.
Jean-Marie GEORGEOT - " De Saint-Marc jusqu'à Tertullien " ( 1978 à 2004 )
LA DIDACHE - 141 -
L'affaire de la circoncision suivie du massacre ne permettra pas que Salem
devienne la ville sainte d'Israël et il y aura, plus tard, un autre champ (= l'aire
d'Arauna) acheté par David pour y ériger un autel au Dieu d'Israël. La ville de
David s'appellera encore Salem, mais avec le qualificatif mis en avant : Ieru -
Salem = Sainte - Ville. Le lecteur se rappellera alors que le 'TEMPLE' se dit
'IERON'. Ieru-Salem devient la ville du Temple et ceci arriva lorsque Salomon,
le fils de David, construisit en pierres la Maison de YHVH.
Déjà Jacob avait voulu construire une ville sainte autour d'un champ qu'il
avait acheté pour y mettre un autel...
Note 31 : SIMON : Page : 110
C'est à dire : il n'est pas Pierre ! D'ailleurs le lecteur pourra vérifier que
jamais, dans les Actes des apôtres, le nom de Simon n'est employé seul et qu'il y
a toujours 'Simon surnommé Pierre' (Actes X-6 / X-19 / X-32 et XI-13).
Voir Annexe IV : Siméon.
Note 32 : fréquenté : Page : 112
Peut-être ne s'agit-il, ici, que d'un procédé littéraire utilisé par Justin dans
son écrit. Ni le Dialogue avec Tryphon, ni les deux Apologies (à Hadrien et aux
romains) ne permettent de déterminer pourquoi Justin est chrétien.
Note 33 : sacrifice : Page : 120
'Le supplice et la mort de Siméon furent 'semblables à la Passion du
Sauveur'.
(Eusèbe : Hist. Eccl. III-32/3)
Note 34 : meurtriers : Page : 120
Sur les deux tables de pierre données à Moïse au Sinaï, Dieu grava de son
doigt :
'... Tu ne feras pas de meurtre...'
et ce n'est pas la même chose que :
'tu ne tueras pas'.
Jean-Marie GEORGEOT - " De Saint-Marc jusqu'à Tertullien " ( 1978 à 2004 )
LA DIDACHE - 142 -
Ce que Dieu interdit, c'est le meurtre, c'est à dire l'acte d'attenter à la vie du
prochain, acte exécuté en pleine sécurité sans que le prochain puisse se
défendre. Dieu interdit l'assassinat !
Siméon avait agi en assassin, pour donner une terre à Israël. Voici que Dieu
visitera toutes les nations, bien au-delà de son peuple élu. La suppression de la
référence terre-promise passe par la condamnation de l'assassin de jadis :
Siméon reviendra (l'emploi de ce mot, dans mon texte, est licite car il s'agit
d'une lecture midrashique) et sera crucifié. Alors la ville (= Jérusalem) sera
détruite, le lieu du culte (= le Temple) sera rasé et le tombeau restera
éternellement vide.
Note 35 : Lévi : Page : 124
Rencontrant dans ces textes le nom de Lévi, lequel joue un rôle
déterminant dans le chapitre XXXIV de la Genèse, lors de l'affaire du viol de
Dinah, je prends note.
Voir, au sujet de Lévi, une proposition de synthèse de tous ces événements
dans le chapitre sur Le calendrier.
Y H Sh V H
Jean-Marie GEORGEOT - " De Saint-Marc jusqu'à Tertullien " ( 1978 à 2004 )
Vous aimerez peut-être aussi
- Anthropocentrisme - WikipédiaDocument9 pagesAnthropocentrisme - WikipédiaEric MvogPas encore d'évaluation
- Lien 243 PDFDocument8 pagesLien 243 PDFfrancis3ndourPas encore d'évaluation
- Gnaanou Goudi Laylatoul KhadrDocument6 pagesGnaanou Goudi Laylatoul KhadrCheikhouna NdiayePas encore d'évaluation
- Depliant Neuvaine Misericorde DivineDocument2 pagesDepliant Neuvaine Misericorde Divinekomi jeannot N'TSOUKPOEPas encore d'évaluation
- Henri Ghéon - Le Miroir de JésusDocument11 pagesHenri Ghéon - Le Miroir de JésusxibmabPas encore d'évaluation
- 1tim 3.8 13 MessageDocument7 pages1tim 3.8 13 MessageJean Emmanuel LouisPas encore d'évaluation
- Mustang Compact Excavator Me2503 Me3003 Me3503 Me3703 Service Manual 918149aDocument23 pagesMustang Compact Excavator Me2503 Me3003 Me3503 Me3703 Service Manual 918149akellydecker180191brz100% (131)
- Jésus Mon Dieu Je T'adoreDocument2 pagesJésus Mon Dieu Je T'adoreGloire KadiatPas encore d'évaluation
- Moukhadimaat: Cheikh Ahmadou Bamba Composa Ce Poème À La Gloire Du Prophète Mouhammad (PSL)Document15 pagesMoukhadimaat: Cheikh Ahmadou Bamba Composa Ce Poème À La Gloire Du Prophète Mouhammad (PSL)Mame Cheikh Ibra RekPas encore d'évaluation
- 1930 - L'Algérie Jusqu'à La Pénétration SaharienneDocument50 pages1930 - L'Algérie Jusqu'à La Pénétration SaharienneMarc MorellPas encore d'évaluation
- Comment Batir Un Jeune DiscipleDocument43 pagesComment Batir Un Jeune DiscipleRachetée Par ChristPas encore d'évaluation
- Les Mysteres Du Rosaire A Saint Joseph 1Document4 pagesLes Mysteres Du Rosaire A Saint Joseph 1osvaldoPas encore d'évaluation
- L'art Perdu de L'adoration Pure (James W. Goll Chris Dupre Etc.)Document139 pagesL'art Perdu de L'adoration Pure (James W. Goll Chris Dupre Etc.)Firinzelle NGOUELE100% (1)
- Seins Et SaintsDocument33 pagesSeins Et SaintsesthermartinPas encore d'évaluation
- L'HUMILITEDocument4 pagesL'HUMILITEOlivier KangoPas encore d'évaluation
- Le Second Livre Des Sonnets Pour Hc3a9lc3a8ne 1578Document51 pagesLe Second Livre Des Sonnets Pour Hc3a9lc3a8ne 1578Emmanuel FingilaPas encore d'évaluation
- Portes de Decembre 2022Document16 pagesPortes de Decembre 2022nourou jimahPas encore d'évaluation
- FR JailandPrisonMinistryDocument151 pagesFR JailandPrisonMinistryJohann MaksPas encore d'évaluation
- Dao Assurance Maladie Et Global Dommage 2018 Reseau de Soins Edition Du 19 Fevrier 2018Document14 pagesDao Assurance Maladie Et Global Dommage 2018 Reseau de Soins Edition Du 19 Fevrier 2018Kra N'GUESSANPas encore d'évaluation
- Les 8 Dates Incontournables Du Calendrier ÉsotériqueDocument1 pageLes 8 Dates Incontournables Du Calendrier ÉsotériqueEricka Wideline Jean NoelPas encore d'évaluation
- Dossier Documentaire VeniseDocument8 pagesDossier Documentaire VeniseMilana RatelPas encore d'évaluation
- Croissance 1Document43 pagesCroissance 1Neil MvePas encore d'évaluation
- Sade, La Volonté de Destruction de Soi Et La Frénésie Sadique in La Littérature Et Le Mal, George BatailleDocument2 pagesSade, La Volonté de Destruction de Soi Et La Frénésie Sadique in La Littérature Et Le Mal, George BatailleSimon Le Roux GödelPas encore d'évaluation
- De La Violence Contre Soi À L'amour de Soi-MêmeDocument4 pagesDe La Violence Contre Soi À L'amour de Soi-MêmeGabriel ManzukulaPas encore d'évaluation
- Le Sacrement de Mariage FormulaireDocument2 pagesLe Sacrement de Mariage Formulairekevin kuefePas encore d'évaluation
- ChronokidDocument5 pagesChronokidArribardPas encore d'évaluation
- Cours Nietzsche AntéchristDocument8 pagesCours Nietzsche AntéchristLouise LebrunPas encore d'évaluation
- La Foi Cachée Des Pères FondateursDocument42 pagesLa Foi Cachée Des Pères Fondateurskouadio yao ArmandPas encore d'évaluation
- L'Espion Industriel Africain - @CahiersJaunesDocument241 pagesL'Espion Industriel Africain - @CahiersJaunesmoussaking991100% (1)
- Dim 7 Avril 2024Document3 pagesDim 7 Avril 2024Nelly OssangaPas encore d'évaluation