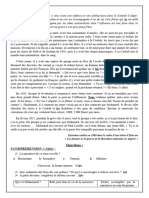Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Lehmann1 39
Lehmann1 39
Transféré par
Meriem Brik0 évaluation0% ont trouvé ce document utile (0 vote)
10 vues39 pagesTitre original
Lehmann1-39 (1)
Copyright
© © All Rights Reserved
Formats disponibles
PDF ou lisez en ligne sur Scribd
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
© All Rights Reserved
Formats disponibles
Téléchargez comme PDF ou lisez en ligne sur Scribd
0 évaluation0% ont trouvé ce document utile (0 vote)
10 vues39 pagesLehmann1 39
Lehmann1 39
Transféré par
Meriem BrikDroits d'auteur :
© All Rights Reserved
Formats disponibles
Téléchargez comme PDF ou lisez en ligne sur Scribd
Vous êtes sur la page 1sur 39
spect:
en
langue
etrangere
Les programmes
en question
OlLGt-23 _|
x FLLE.
He won
SR iene
= rt
Collection F
raitre
Titres parus ou @ pa
+ Sérle F) References
wh
dans un domaine
age
Des points de vue sent oe
procs deb dita tage les kamu ot
soe nune cuatgupe ernnanere (Zaeate)
yon lamgne etre
1 écharnges scolaires €
nicest
- Ensei
= Enseraner & comniene
— Competence transeuttut
padre (Moirand)
on Exrnipe (Baumgratz)
= Le fruencas termes seconde (09)
= Laanane ot littvertare (dae)
= Les eortts dans Fapprentissaue (Péty-Woodley)
+ Série F / Autoformation
Des moyens pour Yautofarmer ¢t des idées dactivités pour |
= Manuel diautoformation (Bertocckini, Costanzo)
cjous of activités communicatives dans ta clase de langue Wels)
~ Entrées en littérature (Goldenstein)
— Une grammaire des tertes et (les diatogues (Moirand)
= Prowmicer tes mots du francais (Wiokand)
= La vidlén on classe de langue (Conpte}
= Lectures interactives en langue étrangére (Cicurel)
~ Evuluer les appreutissages (Lussier)
ja classe.
et aussi...
Les numéros spéciaux « Recherches et application» de la revue Le francais
dans te monde.
= Leviqnes
Acquisition et utilisation dune langue étrungere
= Publics spécifiques et communication spécialisée
= Vers le pluvitinguisme ?
~ Enseignements /apprentissages précoces des langues
~ Les aute-apprentissuaes
— Des formations en langue étrangére
= Des pratiques le Vécrit
Rétmpressions de la collection Le francais dans le monde | B.E.L.C.
~ Evercices systématiques de prononciation francaise (B.EL.C JLéon)
~deu, langage et créativité (BEL.C.|Caré, Debyser)
ISBN 2.01.020646.0
© Hacheu 74
Tons di ae yo 79, boulevard Saint-Germain — F 75006 PARIS
ition. de reproduction et adaptation réserves pour tous pays.
AVA
LU
1. Pe
de li
Ll.
1.2.
128
1.2:
1.2.
1,3.
13.
1.3.
13.
14.
14.
14.
Cor
21
ne
lz)
ruts
SOMMAIRE
AVANT-PROPOS,
LLETAT DE LA QUE
1, Pour une approche culturelle
de Ia communication 4; jalinée ...
LL. Nécexsitén et difficulués d'une intégration
didactique
1.2. Lex differences de comportement
dans la vie professionnell
1.2.1. Le monde des affaires et le
internationales
1.2.2. « Culture d'entreprise
1.2.3, Incide
1.3, Universalité ou spécificité de la science
1.3.1. Traditions philosophiques et traditions
scientifiques
1.3.2. Matrices scienti
1.3.3. La culture scientifique et lechniqui
1.4. Représentations de l'apprentissage
et de la langue cible..
Représentations de la langue ci
4 Représentations de |'apprentissage
Conclusion
2. Des publics d’une extréme diversité ....
exemples, quelques parametres .
des cas .
2. Les paramétres explicatifs principaux .
2.2. Quelques descriptions récentes des publics
25. Des eas particuliers
2.3.1. Les migrants.
.3.2. Dex publics en Afrique dite francophon
2.3.3. Des publics spécifiques sans objectifs spécifiques ?
En résumé ,
‘Sommaire
ids des Tet
" gociales et instit
3.1. Quelques effets de
sur la repo
ques. Econom!
3.2. Didacticiens e
3.2.6. Decideurs et publ
3.3.1. La postérité du «
41)
4.3. Le « frangais fonctionnel » ...
5.1. La spécific
ELL eae
réalités économiques,
utionnelles
demande sociale «
= didactique 3
nse mie, developpement
Rape et Les TAUER oer
Evolutions technologiques et
necignement des langues = .
1 décideurs, une relation complexe
la ~
ics
3.3. - Et pourtant elle tourne » .
frangais instrumental »
en Amérique latine ....
3.3.2. Frangais du tourisme et frangais des affaires
4. Un probleme didactique ancien
4.1. La langue étrangere comme véhicule...
4.1.1. Le frangais pour le développement
- Quelques antécédents
dans le traitement pédagogique
4.2, Les « langues de spéciali
42.1. Les langues de spécialité et leur réseau.
4.2.2. Une lexicographie spécialisée .
4.23. Un dispositif méthodologique .
4.24, Bilan et premiers éléments pour une critique .
4.3.1. Une construction « en creux »
4.3.2. Un corps de doctrines mé
5 5 my
4.3.3. Disparités muethaloiogieuse oe
4.3.4, Des modéles a minima .
C :
3.5. Vers une critique du frangais fonctionnel
Pécificites,
fin prématurée
spécifiques aujourd'hui
fonctionnel ..
scours diversificateur
de priorité au frangais fonctionnel
3.24, Un nouveau changement de politique
3.2.5. Hypotheses sur une
pprentissage
1. CO
" vies UNE REPONSE DIDACTIQUE 113
Besoins langagiers et besoins d’a
114
115
115
116
118
5.2. Incertity
B21 Mises |
5.22 Points
5.3. En finir
5.4. La part
BA.l Facte
542 Toure
5.5. Quiente
Centr
5.6. Idenufl
En conclus
6. Des pre
langagier
6.1. Des de
6.1.1. Lor
6.1.2. Lor
6.2, Des u
62.1. Fon
con
6.22. Le
6.3. De la
6.3.1. Le:
de
6.3.2. Mu
Bilan : le
en
bir a RON
rey. 9o0F
Sommaire [ 5
5.2. Incertitudes théoriques et de mise en ceuvre
5.2.1, Mises en garde oubliées
5.2.2. Points de vue critiques .
5.3. En finir avec une approche de type systémique ? ... 123
BA. La part des situations cibles.
119
Facteur langue et facteur temps 129
Toute leur place mais rien que leur place . 130
5.5. Quentendre par - besoins d’apprentissage »? .......131
5.5.1. Centration sur l'apprenant et l'apprentissage ..... 131
5. Besoins dépendants et besoins non-dépendants .. 133
5.5.3. Composantes des besoins d'apprentissage :
5.6. Identification des besoins et politique de l'offr
En conclusion
6. Des programmes axés sur les contenus
langagiers : syllabus et curriculums .
6.1, Des démarches aux curriculums
6.1.1. organisation d’ensemble
6.1.2. Vorganisation du contenu
6.2. Des unités de langue aux unités de communication
6.2.1. Fondements linguistiques des approches
communicatives ..
6.2.2. Le choix des unités de description
6.3. De la linéarité dans les systemes ..
6.3.1. Le systéme d’apprentissage du Conseil
de PEUrope «.sscescecnsnnn :
6.3.2. Munby et le « communicative syllabus design » ...
Bilan : les situations cibles en question ? les systemes
en miettes ? ..
7. Un autre regard sur l’élaboration
des programmes .. 168
7.1. Centrer l'enseignement/apprentissage sur
autre chose que le contenu langagier ? 169
7.1.1. Construction systématique ou non
La notion problématique de « centration
Centration sur l'apprenant ..
Centration sur l'apprentissage
7.2. Voies alternatives . :
7.2.1. Prabhu et le syllabus procédural -
72.2. Le curriculum multidimensionnel canadien ..
7.2.3. Liapproche intégrée de Byram...
N de-linéarisée
Une approche situationnelle nite
13. ames er pe generat AS
7.3.2. Des outils pour un systeme :
8. La place de la composante linguistique
&.1. Une place différente.
2. ... mais une place diversifi
8.2.1. Glottopolitique et analyse des contextes
linguistiques.
8.2.2. Débusquer des compét
de communication spécifiques ? ...
8.2.3. L’analyse linguistique au coeur
de la démarche didactique ... ae :
8.2.4. La visée culturelle dans I'analyse linguistique .....
Bilan...
BIBLIOGRAPHEE ...
“~_ 2 224
L
en 3
fessio
une
sant y
a son
aut
comy
de qu
nom
T
ques
imp
voir
den
ciree
q
leur
pre¢
disp
ces |
1
pro
per
etre
de f
deu
qui
des
lire
ma
enc
lat
dai
's dits spécifiques
(en somme les publics scienti ques, techniques et pro-
fessionnels) nest pas une question trés neuve. Mais c'est
une question quelque peu empoisonnée, au point qu'on ne
sait pas trop comment la nommer : que certains emploient
& son propos le terme de « langues de spécialite », alors que
autres parlent de «langues pour non spécialistes (A
comprendre comme «non spécialistes des langues »), voila
de quoi alimenter la perplexité de chacun,
Quoi quill en soit ces publics existent, et un certain
nombre de constats semblent s'imposer a tout observateur.
Tout d’abord, leur « traitement » n'est pas limité a des
questions pédagogiques : i] y_a la notamment des
implications politiques, institutionnelles, économiques,
Voire idéologiques, certes présentes des qu'il est question
denseignement des langues, mais qui connaissent en la
circonstance un poids tout particulier.
Diautre part, ces publies se caractérisent a la fois par
leur trés grande diversité, par le fait quills ont des bescins
Precis en matiére de capacités langagieres visées, et quills
disposent de peu de temps pour atteindre les objectifs que
ces besoins permettent de définir. .
Mais aussi que les cours de langue qui leur sont
Proposés ne les satisfont guére, parce qu'ils ne leur
Permettent que rarement de bien communiquer en langue
étrangére dans les situations qui motivent leur demande
de formation, A cela, on peut, en Premiere analyse, trouver
deux explications. Soit que l'on ait négligé leurs objectifs et
gu’on leur enseigne, par exemple, la langue usuelle pour
des échanges oraux en face & face alors quiils ont besoin de
lire des ouvrages d’anthropologie en francais. C'est
malheureusement la situation la plus fréquente, Soit
encore que l'on ait tenu compte de leurs objectifs, mais que
la méthodologie utilisée ne soit pas de nature & permettre
datteindre ces objectifs de maniére satisfaisante.
Les méthodologies actuellement en usage n'ont en effet
Connu que des suecés relatifs ; elles n’ont pas donné tous les
résultats que l'on en escomptait, de sorte qu'il est
certainement nécessaire de remettre louvrage sur le
metier. La démarche suivie a cette fin pourrait se résumer
en quatre points :
re
i
Avant-Propor
¢ reposent, toutes. sur une vision
, one ce parce quelles négligent une dime: oe
etroite du Pron est Ia dimension, culturelle. Entre up
essen ethiopien et un ingénieur frangais ayant 4
ingenieur
Que savons-n
cest-a-dire pri
professionnels.
en langue etrar
du frangais ¢ Pe
Peu, dans |
culturelle de
totalement né,
fondamentale
communtcatior
cultures diverse
didactique lin
permet pas del
Beaucoup.
didacticiens d
assez bonne co
leur diversité
problemes did
On sait a
étrangeres &
dans des consi
économique, si
Il ya en
réponses ont |
Elles ont lew’
maintes fois s
nop
<0)
un
Ia
tow
qui
qui
ot
Hui
des,
jes
ide
‘ils
Ie
ble
ics
ise
os
de
au
les
nit,
en
es
it,
de
le
1e
it,
a
et
es
L'état
de la question
Que savons-nous & propos des publies dits spécifiques,
Cest-a-dire principalement scientifiques, techniques et
professionnels, ainsi que de ta communication spécialisée
en langue étrangere, qui les pousse & vouloir apprendre
du francais ? Peu et beaucoup 4 la fois.
Peu, dans la mesure oit, jusqu'ici, la dimension
culturelle de la question s'est trouvée @ peu pres
totalement négligée. C'est pourtant la une donnée
fondamentale ; il y a des obstacles culturels @ la
communication entre spécialistes appartenant a des
cultures diverses, qui sont premiers et qu'une intervention
didactique limitée aux seuls aspects linguistiques ne
permet pas de lever,
Beaucoup, parce que la question intéresse les
didacticiens depuis longtemps. On dispose done d'une
assez bonne connaissance des publics concernés, méme si
leur diversité extréme ne va pas sans poser de délicats
problémes d’identification et de classement.
On sait aussi que U'enseignement des langues
étrangéeres @ ces publics est trés étroitement imbriqué
dans des considérations d'ordre politique, institutionnel et
éconamique, sinon idéologique.
Il y a enfin un passé méthodologique : diverses
réponses ont été proposées aux problémes quiils posent.
Elles ont leurs cohérences, mais leurs limites ont été
maintes fois soulignées.
Pour une approche
culturelle de la
communication
spécialisée
[..] Vacquisition d'une autre langue [.../ ne constitue que l'un
des facteurs de communication et de coupération avec dos
= étrangers ». Carilyade« létrange »dansle concept d'étranger
Crest-d-dire non seulement quelqu'un quiest d'uneautre nation
mais aussi, comme le dit le Larousse, quelqu'un gui
« appartient pas la chose dont on parle »... gui peut agur de
facon. contraire a l'usage, a V'ordre, au bon sens » !Travuiller.
communiquer, créer avec Wautres implique done que d'autres
conditions soient réunies que la seule possession d'une langue
commune. {...] La premiere condition consiste @ faire l'effort de
connaitre et de comprendre, a minima, les fondements et les
déterminants dela culturede autre. ...|C’est doncun veritable
travail de reconnaissanceet de décodage qu il s agit de conduire
pour sentir ce qui détermine les raisons d'étre et de se comporier
dans les échanges lechniques, commerciaux ou relationnels.
Cari faudra sans cesse y réintégrer des relations, peut-étre tres
différentes, aux hommes et aux femmes, au temps, a Uargent, @
las face», a Vautorité, d'autres « logiques de Vhonneur »{..]
Ces réflexions de P. Caspar!, tout a fait inconcevables il
¥.a seulement quelques dix ans, illustrent excellemment la
polnde frtation des mentalités concernant la part de A
ie mee ni culturetle dang Yapprentissage des langues
is iste Surmonter l'ethnocentrisme, inhérent a tout
Maan” iat le pousse a faire comme si tout se mesurait
fentrme nace g@obPes comportements? Un eth
dentales, tout parsente, a88TavE dans les sociétés ort
moos oe at iculiérement dans celles ou, a Vimage de
siécles, comme tect: oeun semble considérer, depuis des
t simpl tres
pprennent ut simplement nature] que les a!
__citent sa langue et simpregnent de sa culture.
1. Préface 3
ace & P. Carre, o, :
ditions organs erie “apprentisuage des langues cranse™*
Pour une approck
1.1. Néc
d@une ir
EE Sa;
Au-dela de I’
principe selon I
a la communiee
concrete de ce
évidemm
savoir hvresque
de cette dernie
lesquels out
mutatis mutane
Deux constats
sensibles progr
par la didacti
domaine de la c
D'une part
dinventaire de
emprunte a |
universitaires
+ langue étrang
enseignements
Vobjectif - pas
sement a fourn:
est question ici
la société franga
Drautre par
seul contexte |
francaise» 2
observer : il ;
multipliées I
sociologique et
dans les manu
quincaillenie de
longtemps tenu
2. Dans lecadre de
universitaire
3.Voir. parm: les F
international ‘coll
Hachette ‘coll. F
et decrire les faits
ELD
Liétat de |
Pour une approche oulturelle de Ia communication wlectatce, M1 1
= 1.1. Nécessités et difficultés
dune intégration didactique
=
Au-dela de l'acceptation des différences, c’est-a-dire ici du
Principe selon lequel des différences existent et font obstacle
& la communication, se pose la question de la connaissance
coneréte de celles-ci ; une premitre étape consisterait
évidemment a fournir aux enseignants, plutét qu'une
connaissance directe qui est sans doute moins affaire de
savoir livresque sur une société donnée que de fréquentation
Vun de cette derniére, les outils d'analyse des faits de culture,
des lesquels outils présentent en outre l’avantage de pouvoir,
ger, mutatis mutandis, s'appliquer a la diversité des contextes.
‘on ; Deux constats permettent de penser que, sur ce point, de
gut sensibles progrés ont été réalisés depuis moins de dix ans
par la didactique ; restera A étendre ces avancées au
Her; domaine de la communication spécialisée.
gue D'une part et pour ne prendre d’abord, sous réserve
dinventaire de ce qui peut se passer ailleurs, qu'un exemple
emprunté & la situation francaise, les programmes
universitaires de formation au francais (que l'on nomme
« langue étrangére ») comportent® aujourd’hui en France des
enseignements dits d’« anthropologie culturelle » dont
Yobjectif — pas toujours respecté il est vrai — consiste préci-
sément 4 fournir les outils de « lecture » des sociétés dont il
est question ici ; pas seulement, cela est a noter, la lecture de
la société frangaise, mais celle des sociétés en général.
Diautre part, remarque qui la ne ‘applique pas qu'au
seul contexte frangais, l'enseignement de la « civilisation
frangaise » a fait l'objet d’évolutions que chacun peut
ues. observer: il y a quelques années déja que se sont
multipliées les publications’ prénant une approche
out sociologique et ethnologique qui, dans les faits (cest-a- dire
rait dans les manuels et dans les cours), vient supplanter la
quincaillerie de cartes postales et de stéréotypes qui a bien
no- cartes post
oie longtemps tenu lieu d’enseignement de la civilisation.
. de
des 2. Dans lecadre de la maitrise, donc au programme dela quatriéme année
res universitaire,
8.Voir, parmi les plus notables, L, Porcher (coord.), La civilisation CLE
international (coll. DLE), 1985 ;G. Zarate, Enseigner unecultureétrangere,
Hachette (coll. F), 1986 ; Etudes de linguistique apptiquées 69, « Observer
res, et décrire les faits culturele - (coordonné par G. Zarate), 1988.
ER ce RCT TT TT EE LOTT TELS TEE FES i
tion
état de la ques ie de la communicati.
vey une approche culture nication spéci
Pour use apres
aradoxes de Venseignement
Lun des grands Pi blics tits opetifien 2
ation spécialisee aux publics dits speécifiques — o
communicate eessaire dinsister sur le fan aaa 1.2, Les
et ia du paradoxe essentiel ~ tient a cect: du, .
eu ce gonvaine et peut verifier, intuitivement gy de com
ate choc So yage quelaue peu. des differences de dans la
comportement existant entre divers peuples ; il est des lors
fisé den conclure que des gens qui. par exemple, ont des =———
alimentaires différents', ne peuvent que manifester Toute ink
mouiférences de comportement dans leurs activités
desteasionnelles. Ces differences, chacun est encore pret a i tigeaiaisipiies
tel groupe soci
en convenir, ne peuvent pas ne pas introduire des plus grand q
cn aplreations voire des perturbations dans les contacts ~et vane on pe
done dans la communication professionnelle — entre natifs Tentreprise et
de sociétés diverses. ‘étrange) eI
Pourtant, d'un autre oité, telle est la force de Vhabitude marsaut Longe
pédagogique que la composante culturelle n'est a peu pres so echitivable
jamais prise en compte dans la construction des
programmes d'apprentissage de la communication problentters
mener a bie
spécialisée, meme lorsque son importance est reconnue, culurelle sit
voire proclamée, et que le traitement qui en est fait se chez les app
réclame des principes que l'on vient d’évoquer. De ce point qooulturatian,
de vue encore, le «traitement pédagogique » des publics de
r le pédagog penser que
spécifiques ne présente pas de spécificités telles qu'il soit en pour Jenseig
Tien justifié de lui appliquer d'autres regles que celles qui tient pour be
valent pour l'apprentissage des langues étrangeres en Tunivers. scte
général : nécessité, ici comme ailleurs, d'une part des littéraires, Le
savoirs — et plus encore des outils de savoir ~ concernant haut ne peut
les réalités culturelles en contact, d’autre part des doute avisé
instruments didactiques permettant lintégration de coux-ci enseignants ¢
£ jh immes d'apprentissage. C’est donc dire que Svagissant
ie eae ~ sinon méme plus encore qu’ailleurs - 18 sionnels come
comprendie ace, la composante culturelle ne saurait les frontieres
langagiére, vague fe une juxtaposition a la composante en particulier
son integrate corse sur le sommet du gateav. et ave sculture de
apprentissage ze ne et entigre au sein du programme comportemen
que le moyen de rece, ‘sente un impératif en méme te™P> conception de
Mais tenton lution du paradoxe exposé plus haut.
ntons aes
cerner les caractene apart de quelques exemples. d& 1.2.1.Ler
Ik e res de in i iturel
dans le cas des publics pecihgue, la dimension cul et les relz
_ Peut-étre
‘Vorterenplete, ideal, dans le
inal de
SPAS Pour ne pas parlas dee ence importantes dans la chronologe ee componene
sont ke parler deleur ‘
'e8 Allemands, Anglais, Ey pompgution chezco prahes oi
'rangai
Liétat de la questi,
Pour une approche culturelle de la communication wiecialices Ml 13
1.2. Les différences
de comportement
dans la vie professionnelle
a a a es,
Toute information concernant les comportements
professionnels ayant cours dans tel pays, telle profession,
tel groupe social, telle entreprise, revét un intérét d’autant
plus grand que le « monde du travail », comme on dit
parfois en pensant a celui de lusine, du commerce, de
Yentreprise en général, est le plus souvent parfaitement
étranger & lenseignant, y compris dans son propre pays,
surtout lenseignant littéraire. I} en ignore les regles et les
codes, ce monde est pour lui un mystére quasiment
indéchiffrable. On voit d'ailleurs bien la la dimension du
probleme : lenseignant de francais spécialisé devra d'abord
mener & bien une acculturation personnelle (intra-
culturelle si l'on veut) avant d’étre en mesure de favoriser
chez les apprenants avec qui il travaillera une autre
acculturation, inter-culturelle celle-l4. On est souvent tenté
de penser que le peu de gout manifesté par les enseignants
pour lenseignement du francais aux publics spécifiques
tient pour beaucoup & leur crainte face aux mystéres que
Tunivers scientifique et technique étale a leurs yeux de
littéraires. La délicate acculturation dont on a parlé plus
haut ne peut que renforeer les réticences ; il serait sans
doute avisé de multiplier les outils de formation des
enseignants destinés a la favoriser.
Svagissant des différences de comportements profes-
sionnels comme de bien d'autres spécificités de type culturel,
les frontigres ne sont en effet pas seulement celles des pays !
en particulier, ce qu'il est convenu de nommer aujourd’hui la
«culture d'entreprise » fait partie de ces savoirs sur les
comportements dans le travail susceptibles d'intéresser la
conception de programmes d’enseignement des langues.
1.2.1. Le monde des affaires
et les relations internationales
Peut-étre est-on 1a en train d’évoquer un inatteignable
idéal, dans la mesure oi les études interculturelles sur les
comportements dans le travail ne sont pas légion. S'ajoute
Jétat de la question .
14 Wl Pour une approche culturelle de la communication pei
a cela quétant généralement destinées aux Drofessionn ;
eux-méemes, ces études risquent de sembler aunnels
« parlantes » a ceux qui n'ont jamais penetré ,
professionnel decrit. Qu’enfin, lorsqu’elles sont réajisr oe
des auteurs peu soucieux de sociologie ou danthropoigne
sociale, elles adoptent souvent un point de vie pay
aneedotique, celui méme que Yon récuse aujourdhu, qr?
Tenseignement de la civilisation. Is
De ces travaux on donnera maintenant un Premier
ensemble d'exemples, qui justement présentent tp
particularité davoir été fournis par des anthropoliunies,
non des moindres, puisqu’ll s’'agit de Edward 'T. Hall o
Mildred Reed Hall. On se souvient de la sorte de revelation
que représenta, il y a plus de vingt ans, la publication de
La dimension cachée : ainsi, a lire Hall, les étres
communiquaient non seulement par le langage dit nature)
Gncarné dans des langues), mais aussi par leurs
comportements, postures ou attitudes corporelles,
organisés en autant de signes et de messages
interprétables par autrui. Déja l'auteur se livrait a des
comparaisons interculturelles dans le cadre de l'activite
professionnelle, et ce qu'il disait de l’agencement des
bureaux, du sens a attribuer a une porte ouverte ou
fermée, différents aux Etats-Unis et en France - outre que
cela est passé au rang des quasi lieux communs - laissait
déja imaginer Youvrage que Yon voudrait évoquer ici: un
Guide du comportement dans les affaires internationales
(Allemagne, Etats-Unis, France).
Des corpus de traits de comportement
Comme l'indique son titre, Fouvrage est destiné aux
< Managers » des trois pays cités afin de les aider & 8
comprendre et & travailler ensemble. I] décrit dont
auc essivement quelques-uns des traits de comportement
a eatear & pu observer chez les uns et les autres. C ,
Touvrave nee Pas la contribution la plus novatrice ¢°
toujour ga autant que ces traits ne sont évidemment P
Salen, eeeilcues des comportements de travail. ™
que bon nae setvables dans la vie « de tous les jours.
“nm nombre dentre eux pourront sembler banals @
et
t
Hall ct M. Ror ns
internationale, aie Hall, Guide de comportement dans les afl
Pour la traduction france Unis, France), Editions du Seul
Pour une appro
nen connus d
sans doute ps
les al ds
dexceilente q
pas de detail!
Te cas any Et
simplement
remplace Ce
type —et Len
en elle-mem
de comporten
et dincompr
independame
donner lieu li
capacite «hn
langue de Vat
Par exemple
Une cause
contraisma
toujours d
engagemen
scat
fepre
fieterranc
econopnigt
sual de tre
stipulante
prowt
En matin
imprudent
donnees |
Lassistan
pensable®
6.Op cat. pp-22
objective "Mest
se
1c
it.
ci
je
3
ot
Liétat de la i
Pour une approche culturelle de In communicator neuen”
bien connus du lecteur, notamment europeen. On ne sera
sans doute pas bouleverse dapprendre. par exemple. que
les allemands sont tres attaches a ce que les produits soient
dexeellente qualite, durent longtemps et ne connaissent
pas de defiillances de fonctionnement, ce qui ne serait pas
le caw aux Etats-Unis : lorsque ga ne marche plus (ou tout
simplement lorsque ¢a ne marche Pas) on jette et on
remplace, Cependant, Taccumulation d'informations de ce
type ~ et il en est de beaucoup plus inattendues constitue
en elle-méme un «corpus» exemplaire, chaque difference
de comportement representant une potentiahte de blocage
et d’ prehension dans les échanges professionnels,
independamment des verbalisations auxquelles pourrait
donner lieu la situation, cest-a-dire indépendamment de la
capacite « linguistique » de chacun a s'exprimer dans la
langue de l'autre.
Par exemple :
Une cause importante de friction et de conflits dans le monde
des affaires internationales est la conception differente de
engagement. Cette conception, contre toute attente, differe
d'un pays a Vautre. Ce qui, dans un pays, est considéré comme
un engagement contraignant peut trés bien étre vu différemment
dans un autre pays.
WU nous semble qu’en France seul engagement scrit est
contraignant, Il est done préférable pour des étrangers de
toujours demander confirmation éerite d'un entretien. Un
engagement verbal, pris en face & face ou au cours d'une
conversation téléphonique, est souvent remis en question. En
1982, le président Reagan, convaincu d avoir Naecord de Franvois
Mitterrand, annonce que les Alliés ont décidé d'une politique
économique commune enversl'URSS, Un dementi des Frangais
suit de tres pres, avee une déclaration du président francais
stipulanten derniére minute que la France ne s associera pasau
projet,
En matiére de bilans, en France comme ailleurs, il serait aussi
imprudent de prendre pour argent comptant les assurances
données verbalement ou les états financiers produits
Lassistance d'un bangquier ou d'un expert financier est indis-
pensable.®
6. Op. cit., pp. 229-230. Portrait peu Mlatteurou réalité anthropologiquement
objective ?C'est, ilest vrai, & un homme politique frangais en vue (mais qui
se trouve ne pas étre celui dont parle Fall.) que Ton préte, A tort ow a
Faison, des propos selon lesquels « les promesses n'engagent que ceux & qui
on les a faites »,
état de Ie questiotcurelle de 1a communication spéciatisg,
16 Bf Pour une #P! sae
rincipes explicatifs
odes ef des Prine Pet La référe!
cet ensemble d'informations cest s
Des méth:
s encore que nf ‘ Stapies
Maia Lines la methodologic proposes par Hall qui aden
ae tention; elle compte au nombre des outils Taide de ne
ace’ tibles d'aider enseignants et concepteurs de Tinverse, {
a ieeriels. pedagogiques A organiser le recueil de communi:
roa nation necensaire. ON en presentera ici trois la part de
information Temnier («interfaces » culturelles) porte sur a pa
exemptions dont Tétude meriterait d'étre privilegice. Les Sombre da
deux suivants ont également a voir avec Vorganisation de locuteur:
Heescherche dinformation ; ils nous invitent A centrer cette contexte:
recherche sur des modes de fonctionnement tres generaux, ajustemen
sortes de matrices comportementales relatives la maniere e tes int
dont chaque culture se situe vis-a-vis de l'environnement: oe : as
en particulier vis-a-vis du contexte et vis-a-vis de - is an
Yorganisation du temps. Dans l'un et Vautre cas on giniexte |
retrouve d'ailleurs certaines conceptions déja exposces et fees a
conceptualisées dans des ouvrages antérieurs de acy
-
a sous-estin
details qu
Etudier les « interfaces » culturelles pptairens
Citons, tout d’abord, une maniére d’orienter
Vinvestigation qui est définie par référence a la notion
technologique d’« interface »; les auteurs nous invitent a
concentrer investigation sur les comportements a l‘oeuvre La réfé
“Tinve S Sa référ
dans les situations de contact, ce qui est sans doute plus
économique et plus efficace que de s'intéresser indifle- wits
reament a toutes sortes d’aspects des comportements de point de’
chaque groupe culturel pris isolément. civilisatio
: saaidh h
. En somme, que se passe-t-il lorsque des individus renidenl
popanvenant A des sociétés humaines diferentes s* ace aue
Frratenctt Pour accomplir une téehe commune ? Dans oes
cvauons de contact, quelles différences de comportements Dans |
Nécessiteront quelles é . utilise |
part ? Fi, traduit a: procédures d'ajustement de leur ee
. uit dans la terminologie de louvrage : decom
Chaque culture, recoit
iriwber acnebih hadue groupe social, chaque activité a parfait
cules ce ont se ep mse en phase ave da —
8. Le terme
comperndn
Toa faire refer
te La dimension ca tur-meme
gultare, Bdions du Soa eee stée, on lira avee profit Au-dela dela Finterprota
iittuns du Seuil (col ‘coll. Points), 1984. Le langage stlenceun, 9. Op. est. j
Seuil, 198 1. Points), 1984 re ons a2
4. tous trots pour la truduetiey ea dior ta vite, Editio”
liege Lé
Pour une approche culturelle de la communication auestion 17
La référence au contexte comme variable
“st, S'agissant de l'environnement
qui dichotomie entre cultures ot la aeataneaae onctionne
ils l'aide de nombreuses réferences au contexte et cultures ne
de inverse, il est trs peu fait référence au contexte dans la
de communication’. Dans le premier cas (ou « haut contexte)
nie: la part des implicites sera importante alors que, dans le
ur second (+ bas contexte»), on sera porté fournir un grand
is nombre de détails. Les situations de communication entre
de locuteurs respectivement «haut contexte» et « bas
tte contexte » seront done rendues difficiles par linégal
1X, ajustement de la quantité d'information requise par les uns
re et les autres, mais ces difficultés de communication risquent
it fort de se doubler de complications relationnelles : le sujet
de «bas contexte » trouvera que son interlocuteur « haut
a contexte » ne fait rien pour lui faciliter la tache, voire « fait
ae de obstruction » en ne lui fournissant pas le minimum des
dé informations dont il estime avoir besoin ; a l'inverse, le
second soupconnera pour sa part son interlocuteur de le
sous-estimer radicalement en lui infligeant une foule de
détails que lui-méme considére en toute bonne foi comme
parfaitement superflus. Dans un cas aussi bien que dans
autre, on risque d’atteindre rapidement les limites de
er Yoffense, si n'intervient pas le mécanisme d'ajustement des
on interfaces dont il a été question plus haut.
a
= La référence au temps comme variable
f- Une autre caractéristique importante et de grande
de valeur explicative est celle du rapport au temps. De ce
point de vue, on pourra distinguer des individus — et des
civilisations — « monochroniques » et des individus « poly-
chroniques ». Les uns ne font qu'une chose a la fois,
us 3 t
se attendant d’avoir achevé une téche pour en entreprendre
os une nouvelle :
ts Dans les cultures « monochroniques », le temps est percu et
ur utilisé d'une maniére irés linéaire. Il est une route condutsant
du passé au futur. C’est un temps que Yon peut découper,
décomposer en segments de plus en plus fins. Chaque segment
vit recoit une affectation précise, il est réservé & un projet
es parfaitement déterminé.
i ilest a
8. Le terme « référence » pourra sembler quelque peu ambigu + il est
comprendre comme référence implicite et non pas explicite ; eo ce Tors.
faire référence au contexte cest s¢ fier a linterlocuteur pour qu'il en fase
la Tui-méme autant, en allant y puiser les informations nécessaires
z Tinterprétation de messages lacaniques.
du 9. Op.cit., p. 42.
E
Pa ne ee
18
tion sean ace -
sree de In UES rete de la communieAtON sPécialingg
Pour une #P!
t de front plusieurs activités et ne
, menen ‘
Les autres err enient, a sinterrompre momenta.
voient aucun Wer les taches les unes dans les autres
4 enchass
ment et 3 ¢ nc} .
ne aifferences Ans la conception et la gestion du
Ces 4 cecentent elles-aul si, des obstacles & la
temps es ‘on professionnelle, et ouvrage en fournit un
comin mn pr :
‘exemple tout & fait éclairant : ;
mericaine dune grande entreprise américaine est
La filiale mexicnirt Tin. La direction generale vient & Mexico
dirigee oe i. de Fannee suivante. La reunion se
fefinir les objecti :
ner inte epromraminie etabli par la direction ameéricaine,
Qui a tout prevu, sauf de laisser ¢ la direction mexicaine la
possibilte de sexprimer sur certains problémes locaux. dont
‘pourrait bien
‘dependre la. survie de Ventreprise. Malgré ses
‘efforts, la direction mexicaine ne parvient pas a obtenir
Thrseription de son projet @ Vordre du jour. [...]
Bien sir, on peut décréter quiil sagit la, tout simplement, dun
mausais management. Mais la faute est amplifiée par la
Tatance entre deux cultures, [ure monochronique (USA) et
Tautre polychronique (un pays d'Ameérique latine).
Agrégats
On notera enfin que Edward T. Hall et Mildred Reed
Hall établissent une relation méthodologique entre
Yensemble de ces données. Outre le role des interfaces dans
a régulation des différences interculturelles, ces dernieres
sapprehendent par le truchement d'agrégats de concepts
tels que ceux que Ton a pris ici en exemples, Crest ainsi que
be svileations «haut contexte » seront en méme temps
ab race », alors que les civilisations « bas contexte»
secaracteriseront, par une gestion = monochrone + du
que les diverses nae cue tout n’est pas aussi tranche et
Peuvent se répartir t ces — et les diverses cultures ~
extremes. Det att Je long d'un axe borné par les devx
deux entre g ntvidus ou groupes sociaux situés a ces
difhecieremes Seraient. évidemm. les
cultés & communi yment ceux pour qu!
seraient les plus ttipptone et @ travailler en commun
mise en place dearnPoreantes, ceux pour qui le travail de
pourrait done bien étre a. serait le plus nécessaire +
as ; ‘tue la lans ces contextes d'apprentiss@e®
éterminante, Part du culturel s'avérerait la plus
10. Op. cit. pp. 45-46
Pour une a
1.2.2.
Mais
frontiere:
ethniqu
des diffe
puisque
affaire d
mainten:
rechereh
travail et
Le trav
La ch
des trav
comme |
comme u
Ja notion
Taspect |
rement |
expressic
sources |
ethnologi
bien rep
ce qui n’s
la secone
premiére
Mais
notion de
peu la n
doive étr
Telle «
consis!
11, Joreme
au Ministe
fournis sur
aux ethno
ociolingui
place
13. Ph
eollogn
Polytechnic
laRecherch
comme bea
dinigeants |
clalinge
et ne
enta-
tres,
on du
ala
nit un
ine est
Mexico
tion se
caine.
aine la
x, dont
gré ses
obtenir
ut, d'un
par la
ISA) et
nsi que
temps
texte »
e» du
nché et
une approche culturelie de la comm:
L’état de la question
1unieation speci
1.2.2. « Culture d’entreprise ».!
Mais on s'accordera sans peine a considé
frontiéres des Etats, pas plus que les Thaler der ont
ethniques ou linguistiques, ne suffisent a tracer la cate
des differences et des difficultes & communiquer, Et
puisque la communication spécialisée est avant tout une
affaire de communication dang le travail, on complétera
maintenant ce qui précede en faisant référence a des
recherches consacrées & la connaissance des lieux de
travail et des mentalités qui s’y fagonnent.
Le travail comme objet d’analyse
La chose est désormais possible par la notable évolution
des travaux en sociologie et en ethnologie qui, les uns
comme les autres considérent aujourd'hui lentreprise
comme un objet d’étude, aboutissant ainsi a se pencher sur
la notion de « culture dentreprise » (pour n’évoquer ici que
Vaspect de ces recherches qui concerne plus particulié-
rement notre propos). Que cache, ou que révéle, cette
expression aujourd'hui trés a la mode? Emanant de deux
sources distinctes — « managers » d'un cété, chercheurs
ethnologues et sociologues de l'autre!” ~ elle pourrait donc
bien représenter l'embléme de deux croisades différentes,
ce qui n’exclut évidemment ni qu’elles se combattent ni que
la seconde armée vienne a l'occasion préter main forte a la
premiere.
Mais avant d’évoquer ces deux sources distinctes de la
notion de culture dentreprise, tentons de préciser quelque
peu la notion, sans que pour autant la citation qui suit!3
doive étre considérée comme une véritable definition :
Telte quelle est aujourd'hui comprise, Ja culture dentreprise
consiste en principes plus ou moins clairement exprimés, en
LL. deremercie vivementFrangois Faraut, Consciller régional alethnologie
au Ministore de ta culture, pour les éclairages quil ra obligeamment
fournis sur cette question. ;
1 Nui éduite ici, comme dans ce qui suit, de manitre
2 commana E20 esiemen errr fue malas
‘cthnologues. Psychologues sociaux, économistes. historiens.
fociolinguistes ot ‘ethnographes de la communication y ont égalemen
place.
19. Ph-J. Bernard, « Culture, structures et innovation. Questions 4°
colloque -, Introduction a Culture, structures et innate Te
Polytechnique, 29-30 octobre 1990, sous le haut patronage du VT
laRecherchoet deta Technologie. Multigraphie. p.4 Cecolloave rte
‘comme beaucoup d'autres sur la question, des chercheurs et:
dirigeants d'entreprises.
Letat de 18 auc cciarelle de 1a communication spécialisée
Poor une SPP Pour ane 9
lissement de la vocation, regles
conduite AU mit, Ooportement iT anh en pocse de les fon
condute. Orr ‘clleest faite devaleursidenogugties morales indusin
ceruationsdonnees Ee conceptions de base. crovances de prod
Br professionnellés. AT ing buen percues qui constituent |
fondamensales plus ou mo! le Aujou
forconscient ~ de la fire Yentrepns
politique.
WI je marché pertinente
Enjeux de la recherche et enjeux de i rché quelque |
y} 5 managers » que Yon peut classer comme = bons sz
ji “ete ie inean qu supurdnal Tamelioraion des foulent «
Ht ormances passe par 1a responsabilisation des agents de remembre
\ performyeaux ; quen somme le taylorisme & fait son temps done lob
4 et quiune entreprise qui tourne rond est bien moins celle oi renouvela
t prédomine le sentiment d'une hiérarchie toute militaire vers les
b| que celle ob se celui d'une appartenance forte a industriel
j are communauté tendue vers un méme but. De ce cété, objet de
| Vexpression « culture d'entreprise » représente donc prudence
Vétiquette d'une tentative yisant @ associer d'une part Hi ex8 |
veutfeation industrielle des techniques de production, Ventre
introduction d'innovations technologiques, modification comme
ieveomitante des modes dorganisation impliquant. la pendai
disparition plus ov moins prononcée de modéles ouvrtel
Gtroitement hiérarchiques et pyramidaux, et d’autre part ont ete
un changement dans les modes de relations au travail, aux hires
personnes, et plus généralement & Tentreprise ; ceci étant pebii
bien entendu supposé favoriser cela. En ce sens, parvenir & socvste
ce que se forge une forte culture d’entreprise est done. pour en une
certains + managers » modernistes, un moyen parmi soumi:
autres daméliorer les performances de l'entreprise Et intoue
Cest de ce cété que la formule est aujourd'hui trés en vogue: Diaspe
an tte cté Ia communauté scientfiaus des i,
cen ences humaines. Et en premier lieu les fecal
ologues, pour qui Ventreprise et son univers ne atic thne
a étroi
Teprésentaient guére, avant la fin des années soixante- tem
un objet de recherche : ss On rs
BG si les pr
(objet scientifique de recherche n’était pas Ventreprise e” $7 sont pas
‘mais bien plutot le
daprés-guerre,
structurants du
destin de la grande sociste industridle
Qui se jouait profondément dans les effets
travail industriel en constante progress) 14.Rse
dans les u :
Comprendre teks -mémes alimentées par Lexode rural At, Se
srevesei lemilitantiamery digestion, sociale de travail, Pressende
Conflictuels de le vin ondical, les phénomenesrelationnetse 15. Pour
Jeutxde comnocncecie dams les organisations, la complexité Lencrepe
‘du changement teen eldedéciston leseffetssociauz inate 16,» Desa
Vinformatique Bait he liés @ Pautomation et aux debuts avee Moni¢
~~ tlait !objectifde ces sociologues. Isyeh®’
a —
k
winllede Liétat di
pour une approche culturello de Ia communication stueation n
slew de
Wee ter fondementy dew rapports meiaus de ta grand
inch industrwlloonvalescvntededeusprucrrvset tinge fete sete
riaien de prxtuction la source meme de iatructures
rent le
see lens socraur
Aujourd hui, accompagnant ?) la» rehabilitation ~ de
Yentreprise dans: le medias, lopinion publique et la sphere
politiques In sociologie’ francine Terige en. ean
. pertinente »!*. Isemble en aller de meme pour Fethmekage
quelque pew en peine de terrain (le temps nest pine ee
mime +bons sauvages » quand Guayaquis et Trobriandais
des roulent en Mitsubishi), mais surtout en chantier de
tx de remembrement ¢pistémologique (ce n'est pas le terrain,
cmps, done l'objet de la recherche, qui définit une Science),
te od renouvelant sa légitimite en se tournant de plus en plus
aire vers les sociétes dites développées, les socicies
rte A industrielles, vers Ventreprise elle-méme, pour en faire an
cate, objet de recherche ; avec autant que possible quelque
dene prudence, comme le souligne Gérard Althabe'® -
part Ul est dabord nécessaire de désacraliser (dans nos esprits)
tion, Ventreprise, la considérer comme un terrain dinvestigauion
ation comme les autres, un terrain banal en quelque sorte. En effi
rt la pendant des décades on a fait du travail industriel et des
ales ouvriers les porteurs de lhistorivité ; depuis 1980 les positions
part ont été inversées et les entreprencurs se sont transformes en
aur Aéros de la construction de la modernité :Ventreprise est ainsi
Préseniée comme le lieu ott se fabrique le destin du monde, la
cane caverne oi se dissimule le secret de Vengendrement de notre
nr a société. Ce fuisant, toute approche del'entreprise est transformée
pour en une rencontre avee le sacré, ce qui entre autres entraine la
armi soumission & une logique d'un fonctionnement présenté comme
. Et intouchable. Nous devons nous libérer de cet enchantement.
gue. Du point de vue des chercheurs en sciences humaines, il
des y aurait en somme des cultures d'entreprise comme il y a
Tes des cultures nationales ; on a déja vu, avec E.T. Hall - et on
oe le on verra plus encore avec d'autres travaux — ce qui lie
étroitement ces deux types de culture.
On remarquera néanmoins que, d'une source a l'autre,
si les projets sont différents, les discours eux-mémes ne
sont pas nécessairement antagonistes ; que l'on en juge —
1 faire de société
| R. Sainsauliew, « re ise, une affaire
Intoduetenrg ie, = Chanaer Tentrenrite mf i Seealon ti
dela Fondation Nationale des Sciences Politiques, 1990, pp. 13-14.
15. Pour paraphraser le titre d'un colloque et d'un ouvrage collectif :
Lentreprise, categorie pertinente de la sociotogie , PUL, 1987.
16. « Désacraliser rentreprise : un terrain ethnologique banal ., Entretien
sient 'vee Monique Selim, Journal des anthropologues 43-44, juin 1991, pp. 17- |
Liétat de Ja dupe culturelle de Ia communication spécialings
Pour une
3 doute — au seul titre de Touvra,
trop hativernent sans nul Gore J core @ travers les prose
dirigé par R. Sainsa »
Se de ethnologue dans Ventreprise,
vancrage specifique ve
Lepoint dance ed tape. ‘saffirme en effet de la consideree
meme leclou su! Wari ee, production, financement, technologie
df abord pasa en alable) comme une communauté de travail
ete. mats comme rT jsee culturellement dans un projet, une
(non homme de son environnement (publics, partenaires
axtitude 18 Ps ¢e mmunaute signifie immediatement pour
concurrency tle fnalité de [intervention est déchape dla
dualite dirigeant-agent, si souvent source de pusillanimité ou de
duatite oie ralheureuse du cherckeur sociologue. Car pour
Tethnotogue, le discours identitaire, constitutif en cuvre ~
explicitement ou implicitement, dans l'ouverture ou U'injonction,
sclérosé ou vivant ~ travaille Yensemble de la communauté qui
elle-méme le forge.
Sans aucunement entrer dans le débat théorique!?
concernant la légitimité et la valeur respectives des
diverses écoles en présence, on se contentera d'indiquer que
le meme R. Sainsaulieu> y recense «la sociologie du
travail d'inspiration marxiste », «la psychologie ... inspirée
de Vécole rogérienne de Béthel (Etats-Unis), du Tavistock
Institute de Londres et ensuite de Vécole socio-technique
scandinave », «la sociologie des organisations d’inspiration
wéberienne et américaine, et reprise en France autour de
M. Crozier », enfin « une sociologie des identités collectives
et des cultures professionnelles puis organisationnelles »
Des comparaisons interculturelles
On fera ici surtout référence a la derniére de ces
tendances, dans la Mesure ou elle est, plus que les autres,
Porteuse de la notion de culture d'entreprise, mais aussi
parce qu’ égal de Touvrage de E.T. Hall et M. Reed Hall
de Phin cité plus haut", une des publications récentes
ilippe d'Iribarne s’attache A des comparaisons
17. Voir la note 14,p, 21
18. Ph. De ;
communication gu coin rePrise et Vethnologue. Tours et détour®
is 7, 1 et 2 juin ogee identité culturelle et entreprise, Univers!
992, Actes a paraitre
19. Lequel de
bat est assez abondamment illustré par certaines 45
réferences bibli
1 "
Diblegraphics des ogee fOurmiesici-méme, et plus encore PAI
4
20. R. Sainsauli,
walieu, dis .
P.Voir ia note Bp 14. OY OP cits BP. 20-21,
intel
mais
les
ense
Uni:
expl
etla
ses
gene
disp
pote
apps
luis
Une
entr
alr
a Vo
mod
Aone
que
siatt
étab
qui
inco
bien
null
que
oun
ques
tradi
23.0
muniests 1 question
une approche culturelle de la communication 8pécialing, 1 23
e
pour
¥ ionales, non plus cette fois d. biveut
internatio : f lans la négociati
mais dans la gestion des entreprises, dans ce quit nO
les «maniéres spécifiques de gérer oy de travailier
ensemble -?
Ces comparaisons, menées sur trois Pays, France, Etats.
Unis et Pays-Bas, permettent de dégazen des trina
explicatifs des comportements au travail respectifs, Taccent
étant particuligrement mis sur les relations hiérarchiques
et la conception que Yon se fait, dans chacun de ces pays, de
ses devoirs vis-a-vis des téches a accomplir et. plus
géneralement, de l’entreprise a laquelle on appartient. On
dispose la de quelques excellents exemples des déficits
potentiels de communication entre professionnels
appartenant a des cultures différentes, le tout méritant que
lui soient consacrées quelques lignes.
Une logique de ’honneur
Pour ce qui est tout d’abord du comportement dans les
entreprises frangaises, le principe explicatif proposé par
dTribarne est celui d’une « logique de l’honneur » —
catégorie empruntée 4 Montesquieu, et qui donne son titre
4 Touvrage — tempérée par ce qu'il nomme un « devoir de
modération ».
On pourrait dire, en reprenant les categories de Montesquieu
[nh que lon se trouve dans une logique de Uhonneur (qui insiste
sur les devoirs, fixés par la coutume, par lesquels le groupe
auquel on appartient se distingue), plus que par une logique de
la vertu (qui incite a respecter les lois quis ‘appliquent @ tous).
Ce qui fonde cette logique serait done avant tout Vidée
que chacun se fait de ses devoirs et de l’honneur qui
Sattache a les accomplir. Dés lors l'interprétation prend le
Pas sur le réglement, Yesprit sur la lettre, la tradition
établie sur le texte écrit. On touche sans doute alors a ce
qui rend les comportements des francais & peu prés
pcompréhensibles 4 quiconque ne se convainc pas quill y a
bien la une logique, que l'addition des sens de Vhonneur et
‘U devoir, fussent-ils hautement subjectifs, n’équivaut
Rullement a celle des purs intéréts individuels. En somme
ue cette logique parvient a une certaine efficacité ; mieux
ou moins bien que d’autres, telle n'est pas véritablement la
Westion,
=
2B. Airibane, La logique de Vhonneur. Gestion des entreprises et
Fy sitions rationales, Editions du Seuil. 1989.
23. Op. cit. p28,
jon
tata de ta quest e
eon approche saiturelle de Ia communication spéciat
en 7 es les, cette
eaten were renpectucise des req cele mnie de
fasren neo eran tots hollandas) We Para pas ming
se
pour ce qui est des conséquences
J angusiere au travail, nombreux sont
les effets de nature & scandaliver Vobservateur ou
Vinterlocuteur etranger. Par exemple, et sans doute
particulierement revoltante pour un anglo-saxon, la
arlicrltare manifestée a Pegard de la chose écrite (ce sur
quoi les observations de d {ribarne divergent sensiblement
Qu es des Hall) en méme temps que la fréquence et la
facilité avec laquelle une regle non-écrite peut se trouver
subrepticement modifiée. Ou encore la male vigueur de
certains affrontements, verbaux dont la force (qui n’est pas
seulement illocutoire”*) ne pourrait que Se transformer,
ailleurs qu’en France, en haines inextinguibles. Si tel n'est
s le cas est quiintervient le devoir de modération dont
seule la transgression est de nature & créer l'irréparable.
Gn ee dit alors qu'il est bien frangais ce principe selon
Jequel il faut savoir « jusqu’od ne pas aller trop loin»:
Si lee « accrochages »font partie des rapports normaux (et sion
est tres loin du caractére « lisse » des relations néerlandaises),
Tlanont menés avec un grand sens des limites @ ne pas dépasser,
gous peine de basculer dans quelque chose de grave que tous
veulent éviter. Ils constituent une sorte de rituel ou les
protagonistes s'investissent de fagon & la fois notable et limitée
(ala maniére desaffrontements rituels des tribus primitives, ot
Fagressivité manifestée par les adversairesest largement verbate
et symbolique cepgndant que les dommages quills s‘infligent
reatent modestes).”°
implement,
concernant H'acuiv!
Une logique de la vertu
Pour ce qui est maintenant des Etats-Unis, Philippe
dTribarne impute les comportements en entreprise quila
pu observer non pas la logique de Yhonneur mais a celle
de la vertu (toujours en référence aux catégories de
Montesquiew). Cette logique se caractérise par l'acceptation
et le respect, du moins dans Fidéal, de regles fixées 10"
24, Ibidem, p. 27.
25. On se souvienten effet que, dans | i i oo
eae JL. Austin (Qu
fig at fire, aiionn Freee ae ee action Fans
parlant are Te 8 intention de produire un effet sur Vinten ae
28 Ph alt aue la perlocution s attache & Veffet produit.
5. ribarne (1989), Op. cit., pp. 31-32.
Pour une af
commun
dabord ¢
expheites
explicites
comme
transgres
sanction
relation
veritable
d'Inbarn
un cadre
Sevier
evalu
de dir
certat
lesque
points
batsse
quon
Pars
= autres
figuraier
était inj
tirer arg
Dans
transpai
interper
supériet
du cont
répond
régulati
si les pr
s’accom
Ja bonn
corresp
person
américz
fondem
nous rd
qu’a cot
sont le
compéti
27. Ibide
Siti;
ve
poor unc approche culturelle deta communica!
question
Pécialinee 25
mun accord. Un tel mode de fonctio,
obord que les régles en question solent Se eee
explicites ; inversement, seules les régies admises cane
Gpliites, Cest-a-dire celles qui ont bien wes comme
comme telles, ont a étre respectées ; et seule ia
transgression de ces régles mémes peut étre légitimem -
sanctionnée. I] est donc assez évident que dens les
rations de travail, le poids des mots ne se imeem [e
véritablement a la méme balance qu’en France, Philippe
diribarne en fournit lexemple suivant, mettant aux rises
un cadre francais et son subordonné américain?? PS
deviens de faire une évaluation d'un ingén Weur aqui jai fait une
évaluation corrosive, un bon décapage. Un de mes points a été
de dire a cet ingénieur que je reconnaissais qu'il avait fait un
certain nombre cle progres, Mats il y avait diautres points sur
lesquels il n'avait pas travaille et qu me paraissaient ¢tre des
points fondamentaux, en consequence dv quer sa note avart
baissé. Sa réponse a été :« Out, je comprends bun, ca fait un an
qu’on travaille ensemble, vous m'avez change mes objectifs. «
Par sa réaction l'ingénieur manifestait que, pour lui, les
«autres points sur lesquels i] n’avait pas travaillé» ne
figuraient pas au contrat initial, et qu’en consequence il
était injuste (et certainement pas vertueux du tout) d'en
tirer argument pour le sanctionner.
Dans une telle logique de contrat, on voit done que la
transparence est également censée caractériser les relations
interpersonnelles : chacun est responsable devant son
supérieur — comme devant un client — de la bonne exécution
du contrat; chacun travaille « pour» son supérieur et
répond des actes de ses subordonnés directs. Mais une
regulation interpersonnelle harmonieuse n'est possible que
siles procédures, aussi objectives et objectivées soient-elles,
saccompagnent de moeurs « vertueuses », visant a Téquité, &
la bonne foi et a Yhonnéteté des decisions, toutes attitudes
correspondant a ce qu’en anglo-américain l'on nomme
sfaimess ». On voit d'ailleurs aussi, avec cette notion de
sfairness » ou des principes tels que celui de légalité des
Personnes, @ quel point les valeurs de lentreprise
américaine sont celles de la société américaine dans ses
fondements historiques : une société de « marchands pieux *,
Nous rappelle d'Iribarne apres Tocqueville. C'est bien dire
8 cote de « pieux - il y a» marchands » ... que les affaires
font les affaires et qu'il n'y aurait pas de regles a la
“ompétition si la competition n’était pas de regle.
ee
Dn,
Pour
jque du consensus a
on mais Had representent le troisiéme et dernier
Les ys"
"| sition aux affrontements codifies de
eer ‘ Par opt ricaine et aux rapports de force de
Tentrepre francaise, lentreprise néerlandaise se
Ventre ee ait principalement par la recherche du
on a seul moyen de régulation possible dés lors que
consensus Sires tres étroitement réglementées propres au
systeme américain D1 les incessantes pressions in| formelles
caractérisant l'entreprisé frangaise ne sont ici de mise,
Mais rapporter l'idée de consensus a celle d'unanimité
représenterait un total contresens, alors que c'est
justement le ferme attachement de chacun a ses idées, et
donc une forme tres marquée dindividualisme, qui le rend
nécessaire ; et ce parait d’ailleurs étre la le paradoxe
essentiel de Ventreprise néerlandaise pour lobservateur
étranger. La recherche de consensus
ne désigne pas aux Pays-Bas une contrainte rigide exercée par
le groupe sur des individus soumis, mais un processus par
lequel les convictions des uns et des autres tendent a s‘ajuster et
@ converger.’
De sorte qu'il n'y a guére de décision possible sans
discussion préalable, et que cette derniére ne peut jouer
son réle de régulation dans les relations entre personnes
que du fait de l’attachement de chacun aux données
factuelles et a Vobjectivité.
1.2.3. Incidences
Au terme de cette réflexion concern: :
ant quelques aspects
qarele Los finietioments dans lactivité professionnelle,
t ement souhaitable d’insi certains
enseignements d'ordre général. ‘nsisier sure
Comparaisons internationales
et variantes nationales
Afin de ne pas alourdi éja e
dag brie pas alourdir une présentation déja lone
peer pent culturelles dans la pratique de l’activité
fe, il a semblé opportun de ne souligner Y°
28. Ibidem. p91)
>= Ome ahem
PReE Say!
pour une approche culturelle de Ip Comment a
lets nication’ 14Estion
PEcialinge 27
les aspects les plus évidents
ee let ilegiant Vevocation de travies Tone ere ants en
4 comparaisons internationales. Cech menstTe® & des
dle qulune commodite. exposition et ne geet ‘ePendon
aie eroire, que I i = les cultures dentreprige - aisser
di isolable qua travers des comparaisons de pays serait
comme on Va dit, la culture d'entreprige a pays. Si,
. rn tu est 2 .
me arme mise au service de la productivite ame une
rs - . cette
lea n'intéresse pas que les entreprises installées pape
tg0, marchés internationaux, En la matiere dene les
ae différenciations peuvent s'observer i ies cates
nite parmi |
. a © es entrepris
dlun seul et méme pays. Ce qui est dailleurs dane le eres
des choses ; quel rapport y a-t-il en effet entre la vie d'une
immense multinationale et celle d'une entreprise de cn
personnes? Outre la taille, vont pesor toutes sortes at
parametres : lhistoire (entreprise familiale ou non.
ancienneté du métier et de la société); le statut (prive ou
nationalisé) ; les relations A environnement. professionnel
par (type de clients et de fournisseurs) ct au milieu (metropole,
par petite ville ou campagne) ; le degré de syndicalisation et le
eret type de légitimité que s'est forgée la direction ; le « méticr »
lui-méme (confection, batiment, électronique, ...) et ses
éventuelles traditions (formes de compagnonnage), le
ane niveau de formation requis et les filitres de formation
er dominantes au sein de l’entreprise ; les modes de
nes production (artisanal ou fortement automatisé, fractionné
ae ou globalisé, « taylorisé » ou « responsabilise »), ete.
Il est sans doute superflu de multiplier les exemples
montrant que la culture @entreprise se forme dans
Ventreprise elle-méme, avant dire fayonnée par ~ et
éventuellement pour — le marché international Sat
fréquemment dans la presse francaise que les conllits
i 0 SNCF ou la
sociaux affectant des entreprises telles que la $
“ eae 7 s
“lle RATP#* ne tiendraient pas plus 2 des, revendications
1ing concernant les conditions de travail ou de rén
ja nature des metiers ou
qu'a de profondes divergences sur la at ee
la conception de l'entreprise et
fonctionnement”.
gue —— shemins defer Brancareet Rete
yité 2 Rexpectivement Sorieté Nationale des hem goug enteepnses
ue Monon dex Transports Paristens (2Ut0bis CO eenational
q Aut meson doneque marginaloment concern eo
80 On pourra lire R. Sainsnulien, Lidentite i Nationaledes
Bel OrRansetion, Troisieme edition. Presses
lenees Palitiques, 1988
rae ee i emecenee il
ie ly Fondation
internationales suffiront a une
sibilisation ssi@re, pour peu que leur caractere de
generalité ne prove pas trop ala production de nouveaux
stereotypes culturels (le frangais « braillard » en casquette
bleue, a cété de celui au béret et a la baguette de pain).
Mais une appréciation plus fine des. principales différences
francaises sera sans doute nécessaire a Yétranger venant
travailler dans (ow avec) des entreprises frangaises
déterminées.
Les comparaisons i}
Donner des exemples
ou donner en exemple ?
La seconde remarque est une mise en garde : elle porte
sur le fait - amplement souligné par d'Iribarne ~ qu'il
serait tentant mais abusif et totalement naif de se faire de
tel ou tel des processus sociaux de régulation a loeuvre
dans tel pays aussi bien que dans telle entreprise une
représentation idyllique.
Référer aux valeurs historiques de la société américaine
comme explication des comportements américains,
notamment en empruntant a Montesquieu et a Tocqueville
les termes de « vertu » et de « vertueux », n'est en quoi que
ce soit suggérer que cette société-la est plus vertueuse que
les autres. De méme la recherche du consensus basée sur
Yobjectivité comme caractéristique des comportements ne
fait pas de l’entreprise néerlandaise le paradis des
travailleurs. Méme si la polysémie de certains termes
(«exemple » et « modéle » en font partie) se préte a toutes
les facilités et 4 tous les glissements, il ne viendrait
évidemment & l'idée de personne de prendre pour exemple
A suivre ce qui n’est qu’exemple proposé a l’observation. pas
plus que comme modéle a imiter ce qui n’est que modeéle de
comportement.
Simplement, dans chacun des cas évoqués, on pergoit
assez bien que les procédures de régulation, plus ou moins
formalisées, plus ou moins conflictuelles, sont en quelque
sorte ajustées a des faisceaux de valeurs et a des faisceaux
de comportements spécifiques de chacune des cultures qui
en méme temps les engendrent. En somme la forte
congruence des cultures nationales et des cultures
dentreprise se trouve confirmée par les difficultés que [on
observe a Vexportation de ces procédures dans d'autres
cultures que celles qui les ont produites.
—SO-—enonoasnwemanenecnns ik...
sve armchair de wont ngoaion |
Cultures d’entreprise
et comportements langagiers
logique de Vhonneur, fixation des termes de l’échange en
vue de la passation du contrat de travail, recherche enfin
du consensus par la mise a plat des données factuelles de la
situation — cest a travers la verbalisation que s‘opere la
régulation de l’activité collective de travail. I ya du lieu
commun, et done aussi quelque vérité sans doute, dans la
distinction entre professions a forte verbalisation
(enseignants, avocats, journalistes, ...) et professions a
faible verbalisation (les professions dites manuelles). Mais
on apercoit assez bien maintenant de quel intérét peuvent
étre les travaux améliorant notre connaissance des
comportements langagiers dans le travail, quel qu'il soit.
On quitte alors les terres de la sociologie et de l’ethnologie,
entre autres disciplines, pour évoquer des recherches
relevant cette fois des sciences du langage, en particulier
de ce que l'on peut recouvrir du terme suffisamment
général de linguistique sociale. Evoquer seulement, car il
sera nécessaire de reprendre ce point lorsque (dans le
chapitre 8) le moment sera venu d’examiner la place des
réalités proprement langagiéres — et done du réle des
sciences du langage — dans Ja construction d'un appareil »
didactique susceptible de fournir une réponse a la demande
de formation des publics spécifiques. Bien que ces travaux
ne soient généralement pas congus dans une ee
comparatiste (interculturelle), leurs ancrages, Can’ ©&
linguistique sociale, dans l’ethnolinguistique ou dang
Yethnographie de la’ communication, les predisposent en
effet A contribuer a cette connaissance de I'- étrange »
parlait Pierre Caspar.
état de la question .
go Wl tours ee oche culture de Ie communication spécialinty
1.3. Universalité ou
spécificité de la science ?
—— EEE
Reste que cet « étrange » ne tient sans doute pas qu'aux
comportements des individus appartenant @ des cultures
Gifferentes, mais aussi bien aux produits rencontrés de ces
cultures, notamment a ce qu’il est aujourd’hui convenu de
hommer, avec le sociologue Pierre Bourdieu, les = biens
symboliques » : les productions immatérielles de la pensée,
Or si la reconnaissance des spécificités ethniques ou
nationales d'un folklore, d'une littérature. d'une tradition
musicale ou plastique ne pose aucun probleme majeur. il
ne semble pas en aller de meme de la production
A caractére scientifique ou technologique. Tei Vethno-
centrisme se nourrit du sentiment commun d'une supposee
objectivité de la science ~ d'autant plus objective dailleurs
quelle serait plus - dure -, ou plus « exacte », pour
employer des expressions en elles-memes bien révélatrices
du monolithisme des représentations communes de la
pensée scientifique — et donc d'un internationalisme poussé
et unificateur, mais aussi de l'idée que la marche vers le
progres (et qu’y a-t-il de plus emblématique du progrés que
la science et la technologie ?) s'accommoderait mal dun
ordre dispersé.
1.3.1. Traditions philosophiques
et traditions scientifiques
Dire que J'intensification des échanges d’informations
conduit tout droit a cette unification est, par la-meme.
admettre que tout n'est pas si uniforme que l'on veut
parfois le croire dans la pensée scientifique. Et si les
travaux semblent aujourd'hui se multiplier qui tendent au
contraire & mettre a jour ce quill y a de spécifique dans
les modes de pensée scientifique propres a differentes
sociétés, il y a beau temps déja que Robert Jaulin’
Tbpelait (avec la complicité de Bernard Jaulin) existence
‘une mathématique arabe, d'autant plus vite rangee @U
mag:
comme
consi
L'état de la questi
Pour une approche culturelle de la communication erscial ice
magasin des curiosités historiques que ses fondements
cosmogoniques avaient permis de lui attribuer l'en-
combrant statut d'ancétre gloricux mais pré-scientifique.
. Cet exemple des matheématiques est en fait doublement
instructif. D'abord parce que cette science est réputée la
plu «dure » de toutes, au point que ~ vieux débat, vieille
mystification — Yon ait parfois pu tenter de faire croire
quelle etait exempte d'idéologie. Ensuite parce que la mise
en evidence par R. Jaulin des implications cosmogoniques
de la mathématique arabe reléve d'une maniére
dapprehender la science en relation étroite avec les modes
de pensée dominants d'une société, quiils s‘expriment a
travers les manifestations du sens commun ou par le
truchement des écoles philosophiques. Le raisonnement est
alors sensiblement de meme nature que celui de
Ph. d'Iribarne s'agissant de la relation entre les compor-
tements dans lentreprise et les valeurs de la société. On
pense également, dans le domaine de la production
architecturale cette fois, qui est donc dordre technique
autant qu’esthetique, @ la démonstration faite par Erwin
Panofsky*? de la relation entre la naissance de la pensée
scolastique et le passage de l’architecture romane a
Yarchitecture gothique dans la construction des cathé-
drales : les savoirs savants et philosophiques ainsi que leur
diffusion (qui, jusqu’a la Renaissance, sont 'exclusivité des
clercs, religieux et théologiens) produiraient ce que
Panofsky nomme une « force créatrice d’habitudes » yenant
fagonner toutes les sphéres de la pensée et de la création,
y compris technique.
A Yoccasion d'une publication antérieure consacrée aux
publics spécifiques®’, qui se voulait une sorte d’état des
lieux, il avait semblé nécessaire de marquer d’autant plus
fortement la place de la dimension culturelle quelle
apparaissait comme le grand absent des eanstrodiigns
méthodologiques antérieures a destination de ces publics.
Cest ainsi que, traitant de cet aspect culturel de la pensée
et de l'expression scientifiques, Dominique oe
montrait, en évoquant quatre exemples empruntés a
32. E. Panofsky, Architecture gothique et pensée scolastique, Editions de
Se Es. Fanos
31
On
*Pheigy
istoire mondiale de la physique, que cette «.
Oeiauail pas et ne se « disait » pas de la men tithe me
Allemagne, en Grande-Bretagne, en France oy a ire
rapportait ces différences & histoire général de peers, ‘a
et a ses évolutions particuliéres dans leg divers pate
d'autres termes, il soulignait * Pays. By
Vimportance décisive des cadres culturels et linguist
les manieres de penser, de réfléchir, d'innover dans (tt
scientifique, Vimportance décisive des cadres»,
linguistiques dans lesquels sont éduqués et vine,
de science, cadres qui modélent, souvent & leur in.
structures mentales. [...] la science, ou pluty pa
scientifique, n’est pas le déploiement d'une raison until
qui ne ferait que dire un vrai désincarné, ej qui ee
linéairement, mais [...] Vactivilé scientifique est eahotinn
toujours particulier, ..]elle est a jamais imbriquee deni
cadres propres qui la voient s'épansuir.[..] eontratrements
qu'une rhétorique facile dit parfois, la Nature ne parle pas ai,
nia rien a dire, et ce soné les hommes qui s'expriment et neu,
racontent ce qw’ils tiennent pour sa voix. Et ces hommes parien,
dans une langue, et avec tout ce que celle-ci véhicule de propre
1.3.2. Matrices scientifiques
Outre des différenciations culturelles proprement
nationales, D. Pestre évoque, seulement en passant, an
caractére de l’évolution générale des sciences qui peut 4
occasion venir renforcer le sentiment d'étrangeté
qu’éprouverait un scientifique étranger introduit, par le
biais de l’apprentissage du francais, aux réalilés
scientifiques frangaises : le fait que cette évolution sit
«cahotique ». On peut sans doute voir la une référence Ux
théses aujourd’hui largement répandues de Th. Kuhe a
pour qui une nouvelle théorie scientifique ne vient pa ae
construire par opposition a une théorie antérieure tout hed.
marquant comme progrés de la vérité par rapport efor
mais bien plutét dans un acte de rupture, a occasion e 02
Période de crise dans la discipline, par la mise en plece int d2
qu'il nomme une nouvelle « matrice » scientifique, te” 2, cet
Se substituer purement et simplement a une ave le
émiettement rendrait sans doute plus malais¢ en euvre
mberage des différences de pratiques scientifiques ions en
8 divers pays, des lors que histoire de leurs Tel™
Pour une
serait 1
que les
fruit d’
subirai
poids ¢
enjeux
particu
étrang
Au
specifi
dautr
discipl
difficu
affecte
que le
ensem
pourre
serait
politic
Bi
cultur
publi
public
scient
qu'il s
pratic
spécif
dont
Yusag
seron
4 etat de la question
Pour une approche culturelle de la communication wiicialicee 33
serait moins lisible puisque non linéaire, Ceci d’autant plus
que les évolutions ainsi observées ne seraient pas que le
fruit d'une recherche sans cesse inaboutie de la vérité mais
subiraient aussi, toujours selon Kuhn, et d'autres avec lui, le
poids de surdéterminations extra-scientifiques telles que les
enjeux de Pouvoir au sein de la discipline, toutes choses
particuliérement délicates a déméler pour un observateur
étranger.
Au bout du compte, aux difficultés culturelles dues aux
spécificités des comportements viennent donc s'en ajouter
dautres, lies cette fois aux modes d’organisation des
disciplines ainsi qu’é leurs modes dexposition. Ces dernieres
difficultés ne sont pas moins redoutables, puisqu’elles
affectent aussi bien la forme des publications spécialisées
que la forme de l'enseignement des sciences dans leur
ensemble. En d'autres termes, la forme de la discipline
pourrait étre la méme, que la maniére de Tenseigner n’en
serait pas pour autant analogue a tout coup. C’est ainsi que
pour l'enseignement des sciences économiques par exemple,
s'agissant d'une méme théorie, l'accent sera mis avec
insistance sur ses aspects mathématiques (économétriques)
dans tel pays, alors que dans tel autre la tradition
universitaire portera a les négliger pour privilégier plutét
les attendus philosophiques ou les incidences socio-
politiques.
Bien évidemment, ces divers types de difficultés
culturelles se rencontreront diversement dosées selon les
publics d'apprenants ; polairement, selon quiil s'agit de
publics apprenant le francais afin d'aceéder a des contenus
Scientifiques qui (ne) se trouvent formulés (qu'en frangais,
qu'il sagisse la d’étudiants (ou d’éleves) aussi bien que de
Praticiens de la discipline, pour qui primera le repérage des
spécificités épistémologiques et discursives ; ou de publics
dont lobjectif est d'exercer une profession impliquant
Tusage du francais, pour qui les aspects comportementaux
seront d'une plus grande importance.
1.3.3. La culture scientifique et technique
Nous n’avons, dans ce qui précéde, évoqué que la face
traditionnelle, noble pourrait-on dire, de la science : celle
qui concerne «les scientifiques », professionnels,
enseignants, étudiants. De ce point de vue, on peut parler
@une culture scientifique, comme on a parlé plus haut
dune culture d'entreprise, cest-a-dire de l'ensemble des
tion ‘
Listat de aoe ulturelle de Ia communication epéciati.,
une a
gf 34 8 Pour a
avail, des modes d'organisation
comportement be ie des références que se donnent = inven
methodes def tés scientifiques nationales. Un do bs da +
diverses communautes dant comota ssier lev
nue La recherche, rendan comp une enquéte diffu:
dela 1 Tinitiative de la Commission des communautes objec
menée & it s]ques années, donnait, bien que ce ne autre
europeennes iL 8 tei Yenquéte, cagisuaies disco
fit pas la lobjectif premier de l'enquéte, une instructive es
illustration des points communs aussi bien que des acer
differences observables en Europe”. ’
Mais une autre manifestation de la science parait occuper
aujourd'hui une place grandissante, que l'on nomme
également « culture scientifique et technique ». Lidee est 1.4
évidemment que dans un monde ow sciences et technologies
tiennent le réle que ’on voit, y compris dans l'environnement de
quotidien, la culture — entendue dans son acception la plus
restreinte : celle qui fait dire qu’un individu est cultive parce et.
qu'il sait beaucoup de choses et en parle avec aisance - ne —
saurait se limiter aux arts, a l'histoire et & la philosophic. La
culture scientifique et technique est alors la science pour ceux Di
qui ne sont pas les scientifiques dont on parlait plus haut, ow autre
qui sont des scientifiques d’autres disciplines : celle des de la
ment
musées (La Villette & Paris), de la grande presse, de la téle-
vision, destinée au « vulgus » si Pon veut, puisque le vehicule par:
de sa diffusion porte l'affreux nom de « vulgarisation ». cnet
st
La question de la culture scientifique, et de la presence Geis
ou non de la composante scientifique et technique dans le plus ¢
rita culturel de chacun, peut se poser en termes
exercice de la citoyenneté, comme le fait Bernard Caste? *
Mille fois formulée, la question de la capacité du citayen 4 1.4.1
e F
dan an 8e8 pouvoirs dans une démocratic bute sur son lifi¢ it
meee des connaissanc et dane duns une lark "
Choiare tt connaissances scientifiquen ~ tui pormettant 1,
tren connaissance de cause, eee
. exsen
Main ait sien .
TEurope a r agit aujourd'hui de devenir citoyen™ a
était Bake gitavens du monde, xi lu culture acielilit
ernard Defranee nt, Me suRKerent Georges Chit
Poitife, le deren ttedelte dew sesvoira ot des sen” ae wa
beloppement de Vattitude critique a eit
sur les fi,
on
alités des recherche scientifique ©
y des Dannie
L'état de la questio:
Pour une approche culturelle de la communication spcialiaée
inventions techniques »8, alors la diffusion de la littérature
de vulgarisation scientifique aurait tout a gagner d’une
diffusion internationale, L'enseignement du frangais sur
objectifs spécifiques et néanmoins culturels tient la une
autre perspective et un autre public qui, pas plus que les
discours de vulgarisation ne se confondent avec les discours
scientifiques*?, ne se confond pas avec les publics
scientifiques professionnels.
1.4. Représentations
de l’apprentissage
et de la langue cible
rs
Dans la publication de 1990 citée plus haut*9, deux
autres traits avaient été considérés comme partic prenante
de la culture de l’apprenant. Il est nécessaire de les
mentionner ici car eux non plus n’avaient pas fait Vobjet
par le passé d’une attention suffisante dans des
constructions méthodologiques qui se voulaient et se
disaient «centrées sur l’apprenant ». Chacune meériterait
de beaucoup plus amples développements, encore que les
littératures didactiques et sociolinguistiques ne manquent
plus en la matiére.
1.4.1. Représentations de la langue cible
Il s’agit en premier lieu de l'image que se fait
Yapprenant de la langue qu'il va apprendre. Ceci recouvre
essentiellement deux aspects distincts, qui tous deux vont
peser sur la motivation des apprenants et leur attitude vis-
a-vis de la langue étrangére.
38. G. Chappaz et B. Defrance, « Un enjeu politique », Introduction au
Dossier « La culture scientifique et technique », Cahters pédagogiques 261,
rs ering
35
ea
Liétat de Ia question,
36 Pour une 4PPFOC!
Représentations sociolinguistiques
‘abord la nature institutionnelle (sociolo,
koe et politique) des relations exi stant ent
Telangue source d'une part, la langue cible dautre
et d'autres langues éventuellement en Presence, Si |e,
langues sont en guerre, selon la formule bien connye de
Lonteslean Calvet'!, c'est que sur un territoire donne les
relations de complémentarité sont aussi des relations de
concurrence, que certaines sont dominantes et d'autres
dominées, que la possession des unes n'est pas égale 4 la
possession des autres*?. De sorte que les attitudes des
apprenants vis-a-vis du francais sont fortement
conditionnées par cet état de choses : pour ne proposer
qu'un exemple, la concurrence entre le catalan et le
castillan n'est pas sans influencer les conditions de
Tenseignement du francais en Catalogne, comme le
montrent H. Boyer, R. Benda et C. Mestreit*, On verra
au chapitre suivant que ces différenciations socio-
linguistiques, dont on a dit qu’elles modelaient les
représentations — donc la motivation ~ des apprenants.
interviennent également dans la catégorisation des
Principaux types de publics,
Représentations métalinguistiques
ee atic ont été mises en évidence par de
langues. Elles ort Portant sur J’acquisition des
les espérances p aw non plus sur la valeur symbolique ét
langue étrange: Pratiques placées dans acquisition d'une
igere mais sur les mécanismes psychologiques
et cogniti sage
que ton - epee Sequisition. Sont alors en jeu limage
fyoleme de la langue ame gd cette langue rapporté at
interacti ngue source, ainsi la gestion des
interactions langage isi que la gesti
le ; Tes avec des locuteurs de la langv?
Bien
que les ..
Cvnstruction: emulations varient, il est admis au !
Mertion dans un netissances en langue etrangir® Pt
reutt de communication - quels que
ao
I.Calvet,
1987 LaRUerre dey jn, ro vol
he culturelle de la communication *Pécial;
inde
Pour
Cu
Partas
ici lee
comm
plus s
srente
maitr
perfect
a lay
extrem
alerter
Franci
La
stru
enst
enji
a0
niod
semi
mod
effic
dau
sun
du{
conf
soient les vecteurs et les circonstances (oral us écrit, facea face
ou diffeéré, etc.) -requiert et la fabrication de régles de mise en
mots et la Bestion de representations. Linterlangue est
constituée, en un point donné du proces d'exploration de la
langue cible, de Vensemble des fonctionnements attestés dang
la parole de l'apprenant et des représentations qui l'animent
et qui affleurent par divers biais.44
1.4.2. Représentations de lapprentissage
, ll s'agit 1A encore d’une variable dordre a la fois — cest-
a-dire distinctement ET indissociablement — individuelle et
culturelle, en tant qu’elle est propre a des sociétés.
Apprentissage et société
Culturelle, car on sait bien que toutes les sociétés ne
partagent pas la méme conception de ce quest apprendre :
ici P’école coranique a institué la répétition et le « par coeur »
comme le moyen le plus élevé d’acquisition des savoirs Jes
plus sacrés ; 1a l’apprentissage de la danse balinaise ne
s'entend que comme imitation a Vinfini des gestes d’un
maitre guidant et bridant de ses mains, jusqu’a la
perfection, les gestes de I’éléve enfant, tout en ne recourant
a la verbalisation que trés exceptionnellement. Cas
extrémes sans doute de distance culturelle, mais qui nous
alertent sur les risques encourus a l'occasion de ce que
Francis Debyser nommait des « transfert de didactique »#®
La didactique des langues a tour & tour proposé une approche
structuraliste pour la description et l’enseignemeni des langues,
ensuite un modéle plus abstrait de compétence linguistique,
enfin depuis quelques années un modéle pragmatique ou
« communicatif » dit fonctionnel-notionnel, Dou sont venus ces
modéles et d’ow vient le dernier sur lequel un certain accord
semble se faire actuellement ? L'accent tres fortement mis surun
modéle logico-sémantique de communication rationnelle et
efficace correspond-il vraiment 4 la représentation que se font
Wautres cultures dela hiérarchie des fonctions du langage ? Et
s'il n’y correspond pas quia raisonet quia tort (indépendamment
du principe d’autorité qui donne toujours raison au dernier
conférencier venu de Paris) ?
MM Wy Wd ear tects sch ie eek res eS Mis as Tan ahs Ss Ge ec eek
Vous aimerez peut-être aussi
- 100 Jeux Pour Aider Son Enfant en Difficult 233 DapprentissageDocument229 pages100 Jeux Pour Aider Son Enfant en Difficult 233 DapprentissageMeriem Brik100% (4)
- Valerie Perrin Changer L 39 Eau Des FleursDocument510 pagesValerie Perrin Changer L 39 Eau Des FleursMeriem Brik100% (2)
- Sujet 3as (Témoignage Fatma Baichi) .Docx Version 1Document3 pagesSujet 3as (Témoignage Fatma Baichi) .Docx Version 1Meriem BrikPas encore d'évaluation
- Dormir Plus de 9 H Par Nuit Augmenterait Le Risque DDocument1 pageDormir Plus de 9 H Par Nuit Augmenterait Le Risque DMeriem BrikPas encore d'évaluation
- Influence MarketingDocument2 pagesInfluence MarketingMeriem BrikPas encore d'évaluation
- Comp Ecr EldjorfDocument6 pagesComp Ecr EldjorfMeriem BrikPas encore d'évaluation
- Le Structuralisme Jean PiagetDocument67 pagesLe Structuralisme Jean PiagetMeriem BrikPas encore d'évaluation
- Lecture Ce1 Gafi NATHANDocument83 pagesLecture Ce1 Gafi NATHANMeriem BrikPas encore d'évaluation
- GargantuaDocument26 pagesGargantuaMeriem BrikPas encore d'évaluation
- Youpizootie 33Document16 pagesYoupizootie 33Meriem BrikPas encore d'évaluation
- Marie-Antoinette - Sophie de MullenheimDocument148 pagesMarie-Antoinette - Sophie de MullenheimMeriem BrikPas encore d'évaluation