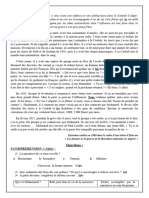Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Le Structuralisme Jean Piaget
Le Structuralisme Jean Piaget
Transféré par
Meriem Brik0 évaluation0% ont trouvé ce document utile (0 vote)
41 vues67 pagesTitre original
Le Structuralisme Jean Piaget,
Copyright
© © All Rights Reserved
Formats disponibles
PDF ou lisez en ligne sur Scribd
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
© All Rights Reserved
Formats disponibles
Téléchargez comme PDF ou lisez en ligne sur Scribd
0 évaluation0% ont trouvé ce document utile (0 vote)
41 vues67 pagesLe Structuralisme Jean Piaget
Le Structuralisme Jean Piaget
Transféré par
Meriem BrikDroits d'auteur :
© All Rights Reserved
Formats disponibles
Téléchargez comme PDF ou lisez en ligne sur Scribd
Vous êtes sur la page 1sur 67
PRESSES UNIVERSITA 3S
DE FRANCE
SAIS-JE 7 a»
ONNAISSANCES ACTUELLES
Ne 1311
LE POINT DES
LA PROVIDENCE - AMIENS
LE
STRUCTURALISME
par
Jean PIAGET
Profuseur dle Fueuiti dow Sefeneee dt Qantoe
cimgurians éprcon
PRESSES UNIVERSITAIRES DE FRANCE
108, Bounevarp Sami-Genmaiw, Pans
19
Cuarirae Premier
INTRODUCTION
ET POSITION DES PROBLEMES
» : 1, Definitions. — On a souvent dit qu’il est diffi-
ft cile de caractériser Ie structuralisme, parse quill
a revétu des formes trop multiples pour présenter
un dénominateur commun et que les o structures »
inyequées ont aequis des significations de plus
en plus différentes. A comparer lea divers sens
qu’a pris le structuralisme dans les sciences contem=
poraines et dans les uussions conrantes, hélas
de plus en plus 4 la mode, il semble cependant
possible de s'essayer 4 une aynthise, mais ala condi-
tion expreese de distinguer les deux problémes
toujours lite en fait, queique indépendantes en droit,
de Vidéal positif que recouvre la notion de structure
dans les conquétes ou les espoirs des diverses
variétés de etracturalisme, et des intentions cri-
ques qui ont accompagné la naigsance et Ie déve-
ea
loppement de chacune d’elles en opposition avec
les tendances régnantes dans lea différentes eat.
ciplines,
Ase livrer 4 cette dissociation, on doit alors
reconnaitre qu'il existe bien un idéal commun
s Mintelligibilité qu’attcignent ou que recherchent
tous lea 2 strueturalistes », tandis que leura inten-
tions critiques sont infiniment variables : pour
6 LE STRUCTURALISME
Jes ung, comme en mathématiques, le stroctoralisme
Woppose an compartimentnge des chapitres hété-
rogenes en retrouvant Tunité griice 4 des isomor-
phismes ; pour d'autres, comme en des générations
snecessives de lingnistes, le structuralisme s'est eur-
tout distaneé des recherches diachroniques portant
sur des phénoménes isolés pour trouver des systéimes
ensemble en fonction de la synehronie ; en pay
chologie le structuralisme a davantage combattu
Jes tendances « ator
réduire les totalités 4 des associations ent
réalables : dans les discussions courantes on voit
le structuralisme s'en prendre a Whisto ne, al
fonctionnalisme «1 fois mime a toutes les formes
de recoura an sujet humain en gi
Tl est done évident que si lon cherche a définir
Je structuralisme en opposition avec d'autres atti-
tudes et on insistant sur celles qu'il a pu combattre,
on ne tronvera que diversité et contradictions, liées
fi toutes les péripéties de histoire dea sciences
du des idécs, Par contre, @ so centrer sur les carac-
thres positifs de Vidie de structure, on trouve au
moins deux aspects communs 4 tous les structu«
ralismes ; d'une part, un idéal ou des espoirs d’
telligibilité intrinstque, fondés sur le postulat qu’ane
structure se suffit 4 elle-méme et ne requiert pas,
pour étre saisie, le recours 4 toutes sortes d’éléments
étrangers & sa nature ; d'autre part, des réalisations,
dans Ia mesure of Pon est parvenu 4 atteindre
etivement certaines structures et of lear uti
jon met em évidence quelques caractires ginéraux
et apparemment nécessaires qu'elles présentent
malgré leurs variétés.
En premitre approximation, une stracture
un systéme de transformations, qui comporte dus.
leis on tant que systéme (par opposition aux pro-
tiques » qui cherchaicnt &
ments
INTRODUCTION BT POSITION DES PROBLEMES 7
prittés des Géments) et qui se conserve ou s*enrichit
par le jeu méme de ses transformations, sans que
telles-ci aboutissent en dehors de ses frontiéres
ou fasee appel i des éléments extérieurs. En un
mat, une structure comprond ainsi lee trois carac-
thres de totalité, de transformations et d’autoréglage,
En seconde approximation, mais il peut s'
dune phase bien ultéricure aussi bien que succédant
fnunédiatement & Ja découverte de la structure,
galle-ci doit powyoir donner liew & ume formalisation,
Seulement il faut bien comprendre que cette forenali-
cation est Vmuvre du théoricien, tandia que la
structure est indép ante de lui, et que cette
formalization peut se traduire immédiatement en
équations logico-mathématiques ou passer par Vin-
termédiaire d'un modtle eybernétique, Il existe
done différents paliers possibles de formalisation
dependant des décisions du théoricien, tandis que
do mode d’existence de la structure qu'il découyre
est G aes en chaque domaine particulier de
recherches.
La notion de transformation nous permet d'abord
de délimiter le probléme, car sil fallait cnglober
dans Vidée de structure tows les formalismes en tous
Jes sens du terme, le structuralisme reeouvrirait en
fait toutes les théories philosophiques non stricte-
ment empiristes qui ont recoura a d
fides essences, de Platon 4 Husserl en
tout par Kant, et méme certaines vari
Pirisme comme le « positivisme logiqus
appel a des formes syntactiques et mines
pour expliquer la lopique. Or, au sens défini a F'inse
tant, Ie logique elle-méme ne comporte pay toujours
de = structures « en tant que structures d’ensemble
et de transformations : elle est resté
ples aspects tributaire d'un atoms
LE STRUCTURALISME
tant et le structuralisme logique n'en cat qu’a ses
debuts,
Neus nous limiterons done, en ee petit ouvrage,
aux stracturalismes propres aux différentes sciences,
oe qi est aja ane entreprise: assex risquée, ainsi
er, ad quelques mauvementa phi-
ia i des degrés divers par lea
gud des sciences humaines, Mais il
convient dabord de commenter quelque peu la défi-
nition proposée et de faire comprendre pourquoi une
notion en apparence aussi abstr: qo'un systéme
de transformation refermé sur lui-méme peut faire
uaitre en tous les domaines de si grands cepoirs.
2. La totalité, — Le coractére de totalité propre
aux structures va do soi, car la seulo opposition
sur laquelle toms les structuralistes sont d'accord
(au sens des intentions eritiques dont il a été question
sous 1) est oclle des structures et des agrégats, ow
composts & partir d'éléments indépendants du tot.
Une structure est oertes formée d'éliments, mais
ceuxeci sont subordonnés & des lois caractérisant
le wystéene ct cea Lois de composi-
tiom me se re 14 4 des associations comula-
tives, mais conférent au tout en tant que tel des
propriétés d'ensemble distinetes de celles des élé-
ments. Par exemple, les nombres entiera n’existent
pas igolément et on ne lea a pas découverts dans un
ordre quelconque pour les réunir ensuite en un tout:
ils nese manifestent qu’en fonction de la suite
mime des nombres et celle-ci présente des pro-
priétés structurales de a groupes », © corps *, 4 ans
neaux a, etc., bien distinctes de celles de chaque
nombre, qui pour sa part peut étre pair ou impai
premier ou divisible par m > I, ete.
Mais ce caractére de totalité souléve en fait bien
INTRODUCTION ET POSITION DES PROBLEMES 9
dee problimes, dont nous retiendro les deux
principaux relatifs l'un sa nature, Fautre a son
mode de formation ou de préformation.
Tl serait faux de croire qu’en tous Irs domaines les attitudes
Spiatimologiques se réduisent a ane alternative: ou lareeennais-
aance des totalités avec lours ructurales eu aan compoai~
tion atomistique i partir d’ékments, Quill Pagisse de truce
Urea perceptivea ou Gestalt, da totalitéa ee
sociales on sociétés entiéres), ct, om constate a
Présuppasitinns arsaciationnistes pour la perception ou ineli-
tor La sncialogie, ete, 02.8 oppoas, dans l'histoire
ax sortes do conceptions, dont la asconde saule
pamit conforee i Pegprit du atructuraliame contemporain.
La premifre consiate 4 an contenter dinverser Ia démarche
ait naturelle aux esprita voulant procédor du
imple am complexe et & poser sons plus les totulités dis |e
départ selon une sorte du dmurgence» considérie comme une
foi de Ja nature. Quand Auguste Comte voulait expliquer
Vhorme par Phumsnité et son plus l'humanité par homme,
quand hein considérait le tout secinl comme émergeant
tie [a réunion des individias carme les malécules de celle dea
ntomes, ou quand les Gestaltistes croyaient disceroer dana
les perceptions primaires une tot
aux offeta de champ en électromagnétiame, da avaient certes
Ip mérite de nous rappeler qu'un tout ast autre chose qu'une
simple comune d’éliments préalable, mais, en cunsidirant
lo tout conime antérieur wux éléments ou contemparain de
leur contact, ils »pliftaivnt la tiehe au risque de mancquee
les problimes centraus de la navuro dea [nis do compos
sition,
‘Or, par-dela les schémas d’association atomi
tique et ceux des totalités émergentes, il existe
une troisiéme position, qui est celle des structura-
lismes opératoires : c'est celle qui adopte das Ie
départ une attitude relationnelle, selon laquelle ce
qui compte n'est ni l’élément ni un tout s*imposant
comme tel cans que l'ou puisse préciser comment,
mais les relations entre les éléments, autrement dit
les procédés ou processus de composition (selon
qaen parle d'opérations intentionnelles ou do
LE STRUCTURALISME
réalités objectives), le tout n'étant quo la résultante
de ces relations ou compositions dont les lois sont
celles du systame.
Mais alors surgit um sccond problime, bien plus
grave, qui est en vérité le probléme central de tout
structoralisme : les totalites par composition sont-
elles compostes de tout temps, mais comment on
par qui, ou ont-elles été d'abord (ct sont-elles
toujours ?) on yoie de composition ? Autrement
les structures comportent-ellea une formation om
ne connaissent-elles qu'une préformation plus ou
moins éterncllo ? Entre les genéses sams structure
que euppoze l'association atomistique et auxquelles
nous a habitués Vempirisme, et les totalités ou
formes sans gentse qui risquent ainsi sans cesse
de rejoindre Ie terrain transcendantal des essences,
des idées platoniciennes ou des formes a priori,
Je structuralisme est appelé ou a choisir, ou A trouver
des solutions de dépassements, Or, evest maturelle-
ment sur ce point que lex opinions divergent le
plus, jusqu’a celles sclon lesquellea le probléme de
Ja structure et de la genése ne saurait se poser, la
t intemporelle par nature (comme si
pas li un choix et précigément dans le
sens de la préformation).
En fait ce probléme, que soulive déja la notion
méme de totalité, s¢ précise dés que l'on prend an
séricux la seconde caractéristique des « structures 1,
au sens contemporain du terme, et qui est d'étre
mn syetime de « transformations » et non pas une
« forme x statique queleonque.
8. Tes transformations. — Si le propre des tota-
lités structurées tient A leurs lois de composition,
elles sont donc structurantes par mature et cost
cette constante dualité ou plus précieément bipo-
INTRODUCTION EY POSITION DES PROTEAMES 11
Tarité de propriétés d'étre toujours et simultanément:
structurantes et structurées qui explique en premier
licu le suecés do cette notion qui, comme celle de
Pc ordre oc not {cus particulier, d'nilleurs,
des structures mathématicy elles), assure son
intelligibilité par son excrcice méme. Or, une ac
vité strocturante ne peut consister qu’en un syetime
de transformation
Cette condition limitative peut J
wante si l'on se réftre aux débats a:
tructuralisme Jingu
ailleurs que de
Jes lois d’oppe
ou aux premitres formes du structuralisme psycho-
logique, puisqu°une Gestalt caractérise des formes
perceptives en général statiques. Or, non seulement
il faut juger d'un courant Widées 2 sa veetion ot
non paz exclasivement 4 ses origines, mais encore,
dts ces débuts linguistiques et paychologiques, on
voit poindre les idées de transformations. Le systtme
synchronique de la langue nest pas immobile +
il refoule ou accepte les innovations em fonction
des besoins déterminéa par les oppositions ow Li
sons du systime, et sane que l'on ait assisté d’emblée
fla naissance de « grammaires transformationnelles x
au sens de Chomsky, la conception saussurienne
d'un équilibre en quelque sorte dynamique s‘est
prolongte rapidement en la stylistique de Bally,
qui porte deja sur des transformations en un sens
restreint de variations individuelles. Quant aux
Gestalts psychologiques, leurs inventeurs ont parlé
dis Ie départ de lois d’ « organisation », qui trans-
forment Ie donné sensoricl et les conceptions pro-
babilistes que Ton pout s'on faire aujourd'hui
aceentuent cet aspect traneformateur de Ia per
meption.
‘aitre sunpre-
ssuriens du
no (Saussure me parlait
a, eb pour earactéris
1 LE STRUCTURALT:
réalités objectives), le tout n’étant que la résultante
de ces relations ou compositions dont les lois sont
celles du systime.
Mais alars surg fe un second probléme, bien plus
grave, qui est en vérité Ie probléme central de tout
structuralisme : les totalités par composition sont-
elles compostes de tout temps, mais comment ou
par qui, ou ont-clles été d’abord (et sont-elles
toujours ?) en voie de composition ? Autrement dit,
les structores comportent-elles une formation ou
annaizsent-elles qu'une préformation plus ou
s éternelle ? Entre les genéses sans structure
m
que suppose Passeciation atomiatique ot auxquelles
nous a hi 4 Vermpirisme, et les totalité: ou
formes sans ge
de rejoindre le terrain transcendamtal des ces,
des idées platoniciennes ou des formes @ privri,
Je etructuralisme cat appelé ou ai choisir, ou a trouver
des solutions de dépassements, Or, o"ost naturelle-
ment sur ce point que les opinions divergent le
plus, jusqu’d celles eclon lesquelles Je probleme de
la structure et de la genése mo eaurait se poser, la
T tre étant intemporelle par nature (comme si
ce wétait pas 1A an choix et précisément dans le
sens de la préformation).
En fait ce probléme, que souléve déja la notion
méme de totalité, we précise dis que Pon pread au
sérieux la seconds enractéristique des « structures x,
au sens contemporain du terme, ai est détre
un systtme deo transformations o et non pas une
a forme » statique leonque.
anu
3. Les transformations, — §i Io propre des totn-
lités structurées tient & leurs lois de composition,
done structurantes par nature et c'cet
mstante dualité ou plus précisément bipo-
T POSITION DES PROBLEMES
INTRODUCTION
larité de propriétés d"étre toujours et simultanément
SITUCtUrAntes et etructurées qui explique en premier
lieu le succés de cette motion qui, comme celle de
Pe ordre » chez Cournot (cas particulier, d’ailleurs,
des structures mathématiques actuelles), assure aon
intelligibilité par som exercice mame, Or, une acti
vité stracturante ne pent consister qu’en un ayatérn
de transformations.
ition limitative peut paraitre surpre-
mante si Von se référe aux débute sauseuriens du
strocturalisme linguistique (Smuseure ne parlait
Wailleurs que de « systéme 2, et pour caractériser
les lois d'opposition et d'équilibre synchroniques)
ou aux premiéres formes du structuralisme psycho-
logique, puisqu’une Gestalt caractérise des formes
perceptives en général statiques. Or, non seulement
il faut juger d'un courant didées a sa vection et
non pas exclusivement & ses origines, mais encore,
dis cea déburs linguistiques et psychologiques, on
voit poindre le: esde transformations. Le systtne
synchronique de la langue nest pas immobile :
il refoule ou accepte les innovations en fonction
des hesoins déterminés par les oppositions ou liai-
sons da eyetime, ot sans que l'on ait assisté d’embléc
A Ja maissance deo grammaires transformationnelles »
au sens de Chomsky, la conception sauseuricnne
dun équilibre en quelque sorte dynamique s'est
prolongée rapidement en la stylistique de Bally,
qui porte déja sur des transformations on un sens
restreint de variations individuelles. Quant aux
Gestalis psychologiques, leurs inventeurs ont parlé
dés le départ de lois d’ o organisation s, qui trans-
forment le donné sensoriel et les conceptions pro
habilistes que Ten peut s’en faire aujourd'hui
accentuent cet aspect transformateur de Ta per-
ception.
1a fe STRUCTURALISME
En fait, toutes les structures connoe
pes » mathématiques les plus élément
qui réglent les parentés, ctc., cont des «ystimes de
transformations, mais celles-ci peuvent étre soit
intemporelles (car 1 + 1 « fomt » mmédiatement 2,
ot 3c sucebde > & 2 cans intervalle de durée}, soit
temporelles (car se marier prend du temps), ot si
elles ne compertaient pas de telles transformations,
elles se confond: it avee des formes statiques
quelconques ct perdraient tout intérét explicatif.
Mais alors se pose inévitablement la question de
la source de ces transformations, done de leura
relations avec une + fdrmation a tout court. Certes,
il faut distinguer en une structure ses éléments, qui
sont soumis 4 de telles transformations, et les lois
mes qui iglent celles-ci : de telles lois peuvent
4 aisément étre congues comme imorualles ot
1 des structuralismes non etrictement for-
mels (au sena des sciences de la formalisation) on
trouve d'exeellents esprits peu enclins & Ia psycho-
genése pour sauter d'un seal bond de In sti
dez régles de la transformation @ leur innéite :
c'est Is cas, par exemple, de Noam Chomsky, 4
ai les grammaires génératrices paraissent requérir
Foxigence de lois syntactiques innées, comme si la
stabilité ne pouvail pas “expliquer par des processus
contraignants d'équilibration et comme si le renvet
4 la biologie que suppose Vhypothise dune inndéité
ne soulewait pas des problimes de formation tout
ausel complex » psychogents
Mais Pespoir implicite de tous les structuralismes
antihisteriques ou antigénétiques est d’asseoir em
initive les structures sur des fondements intem-
porels tels que ceux des systimes logico-mathémat
ques (et Vinnéisme de Chomsky s'accompagn
eet égard dune réduction de ses syntaxes @ une
INTRODUCTION ET POSITION DES PROBLEMES 13
structure formelle de « monotde »), Seulement si
Ton veut ce livrer 4 une théorie générale des struc-
tures, ee ne peat étre alors que conforme aux exi-
gences d'une épistémologie interdisciplinaire, i nest
guire presets sauf a sexiler d'emblée dans l'em-
ee jes transcendent mes, dene pas se deman-
er, en présence dun systime de transformations
intemporelles comme un a groupe » ou comme
réseau de I’ : ensemble des parties », comment on
fes obtient. On peut toujours alors procéder par
décrets comme les axiomatiques, mais, du point
de vue épistémologique, c'est 1d une forme éégante
de vol, qui consiste 4 exploiter le travail antérienr
Wune classe laborieuse de constructeurs au lien de
construire soi-méme les matériaux de départ. L'awtre
méthode, ¢pistémologiquement mains exposée aux
aliénations cognitives, est celle de la généalogie
des structures qu‘impose la distinction introduite
par Goedel entre la plus ou mains grande « force »
onc faiblesse » des stroctures (voir le chap. II) :
en ce cas, un probléme central ne peut plus étre
évité, qui est celui, non pas encore de l'histoire
ni de la payehogentse, mais tout au moins de la
construction dea structures et des relations indi:
sociables entre Ie structuralisme et le constructi
visme, Ce sera done 1a l'un, parmi d'autres, de nay
thimes.
4. Mantoréglage. — Le troisiime caractére fon-
damental des stractures est de se régler ellea-mémes,
cet autoréglage entrainant leur conservation et
une certaine fermeture. A commencer par ces deux
résultantes, elles cignifient que les transformations
inhérentes @ une structure ne conduisent pus en
dehors de ses frontitres, mais n’engendrent que des
éliments appartenant toujours a la etracture ot
lt LE STRUCTURALISME
INTRODUCTION ET POSITION DES PROBLEMES 15
conservant aes lois. Cost ainsi qu'en additionnant
ou soustrayant lon a ou de Pautre deux nombres
entiers ahsolament queleonques on obtient toujours
encore des nombres entiers, ot qui vérifient les lois
du ¢ groupe additif o de ces nombres, C'est en ce
sens que la structure ce referme eur clle-méme, mais
cette fermeture ne signifie en rien que la structure
considérée ne peut pas entrer & titre de sous-strac-
ture dans une structure plus large, Seulement cette
modification des frontiéres générales n’abolit pas
Jes premiéres : il n’y a pas annexion, mais confedé-
ration et les lois de la sous-structure ne sont pas
altérges mais conservées, de telle sorte que le chan-
gement intervenu est un enrichissement.
Ces caractéres de conservation avee stabilité
des frontiéres malgré la construction indéfimie de
nouveaux éléments supposent done un autoréglage
des structures, et cette propriété essontielle reniorce
sans aucun doute importance de la notion et
les espoirs qu'elle suscite en tous les domaines,
car lorsqu’on parvient @ réduire un certain champ
de connaissances & une structure autorégulatrice,
on a Vimpression dentrer en posseecion du moteur
intime du systime, Cet autoréglage e'effectue d’ail-
leurs selon des procédés ou des processus divers,
ce qui introduit la considération d'un ordre de
complexité croiccante et raméne par consiquent
aux questions de construction et en définitive de
formation.
Aw sommet de Péchelle (mais s terme il peut
y avoir divergences et les una parleront de la base
Wune pyramide 14 of nous voyons un + semmet 0},
Vautoréglage proctde par optrations bien réglées,
ces rhzles n’étant autres que Jes lois de totalité
de In structure considérée. On pourrait dire alors
que c'est jouer sur les mote que de parler d’auteré-
a
glage, puisque on pense on bien aux lois de In
re et il va de soi qu’elles Ia réglent, ou bien
1 logicien qui opare, et il
an de soi que, il est en état normal, il
ees actes, Seulement si ses opérations
wont bien réglées, et si les lois de In structure sont
des lois de transformation, done de caractére opé-
ratoire, il reste 4 ec demander ce quest une opéra-
tion dans Ia perspective maactael » Or, du point
de vue eybemétique (done dela scionce du réglage)
celle cst une régulation « parfaite » : cela signifie
qu'elle ne se borne pas 4 corriger les erreurs, au vu
du résultat dee actes, mais qu'elle en constitue
ume précorrection grace 4 dea moyens internes
de controle tels que la réversibilité (par exemple
--n—n = 0), source du principe de contradiction
Gi + n—n #0 alors x & nj.
TVautre part, existe Fimmense catégoric des etruc=
tures non stricterent logiques ou mathématiques,
west-a-dire dont les transformations se déroulent
temps : linguistiques, secielogiques, paycho-
ete. et il va alors de soi que leur réglage
it suppose en ce cas des régulations, au sens
eybernétique du terme, fondées non pas sur des
opérations strictes, cest-d-dire ontitrement réver-
bles {par inversion ou réciprocités), mais sur un
jeu danticipations et de rétreactiona /fiedbacks),
dont Je domaine d'application couvre la vie entire
(dés les régulations physiologiques et Uhoméostasic
du_génome on du « pool génétique « : voir § 10),
Enfin, les régulations au aens habituel du terme
semblent bien procéder de mécanismes atrocturagx
encore plus simples, auxqaels il est impossible de
refuser lo droit d"acoés au domaine des ¢ structures »
en général : ce sont les mécanismes de rythmes,
que l'on retrouve a toutes les échelles biologiques
1 LE STRUCTURALISME:
et humaines (1). Or le rythme assure son autorégu-
lation parles moyens les plus élémentaires fondés sur
les symétrice ot “les répEtitions.
Rythmes, régulations et opérations, telles sont
done les trois procédures cssenticlles de lautoré
ging ge ou de Vautoconservation des structures ;
bre 4 chacun d’y voir les étapes dela construction
« réelle o de ces steoctures, ou de renverecr l'ordre
en mettant 4 la base les mécanismes opératoircs
sous une forme intemporelle et quasi platoniciennc,
en en tiramt tout le reste. Mais il convient encore,
du moins au point de yue de la construction des
structures nouvelles, de distinguer deux paliers
de régulations. Les unes demeurent internes 4 la
structure déja construite om presque ache ec
constituent ainsi son autorégulation aboutissant,
dans les étate d’équilibre, d son outoréglage, Les
autres interviennent dans la constraction de nou-
velles structures englobant la ou les précédentes
et les in mt sous la forme de sous-structures
au sein de structures plas vastes.
st anime fend depuls quelues tutes toute une Sse
cialis avec sea techniques mathimatiques comme ex}
a, 8 fA la sclonce des rythmes ct pérlodicites bi
Rigues (eyitines clreadiens, ovtsti-dire d'enviro 24 heures,
font extrnordinulrement eniraux, ote).
Coarmng I
LES STRUCTURES
MATHEMATIQUES ET LOGIQUES
5, La notion de groupe. — Il est impossible de
se livrer i un exposé critique du structuraliame
sans débuter par examen des structures mathéma-
tiques, ct cela pour des raisons non seulement
logiques, mais encore tenant di Mhistoire méme des
idecs, Si les influences formatrices qui ont pu inter-
venir aux débuts du structuralisme linguistique
et psyehologique n'ont pas été de nature mathé-
matiqne (de Saussure s'est inspiré de la seience
économique en sa doctrine sur léquilibre synchro-
nique, et les Gestaltistes de la physique), le maitre
actuel de Fanthropologie sociale ot culturelle,
Lévi-Strauss, a par contre tiré directement sea
modéles structuranx de Valgtbre générale,
D'autre part, si l'on accepte la définition des
structures présentée sous 1, il semble incontestable
que la plus ancicnne structure connue et étadiée
comme telle a été celle de « groupe x, découverte
par Galois ct qui a peu 4 pea conquis les mathé-
matiques du xix" eitele, Un groupe eat un ensemble
Wcléments (par exemple les nombres entiers positits
et mégatifs) réunis par une opération de compesition
(par exemple l'additinn) telle que, appliqués a dea
Gléments de Fensemble, elle Jfedonne un élément
do Vensemble ; il existe un élément neutre (dana
18 LE STRUCTURALISME
Vexemple ehoisi, le xéro}, tcl que composé avec un
autre il ne le modifie pas (ici n + 0 — 04+ n—n),
et il existe surtout une opération inverse (dans le
s particulier la soustraction), telle que, composte
avec l'opération directe, elle donne élément neutre
(hn n= —n + n= 0); enfin les compositions
sont associatives (ici [n+ m] + l= n-+ [m+ I).
Fondement de Palgtbre, la structure de groupe
west révélée étre d'une généralité et d'une févondité
extraordinaires. On la retrouve dans presque tous
les domaines des mathématiques et en logique;
elle a acquis une importance fondamentale en phy-
sique et ilest probable quill en sera on jour de méme
en bidlogie. 1 importe done de chercher 4 compren-
dre les raisons de ee sucets, car, pourant étre consi-
déré comrnie un prototype des « structures » et en des
domaines of tout ce que l'on avance doit étre démon-
tré, Ie groupe fournit les plus solides raisons d’espé-
rer en Vavenir du structuralisme lersqu'il revét
des formes précises,
La premiére de ces raisons est la forme logico-
ématique d’abstraction, dont procéde le groupe
et qui explique la généralité de ses utilisations.
Lorsqu'une propriété est découverte par abstrac-
tion 4 partir des objets eox-mémes, elle nows ren-
seigne certes sur ces objets, mais plus la propriété
est générale plus elle ristque d’étre pauvre et peu
utilisable pares que s"appliquant & tout. Le propre
au contraire de Vabstraction réfléchissante earac-
‘térise la penaée logieo-mathématique est d'etre tinée
non pas dea objets, mais des actions que l'on peat
exercer sur eux ct essenticlloment des coordinations
lea plus générales de ces actions, telles que de
réunir, ordonner, mettre en farce ete.
Or, ef sont précistment ces coordinations générales
que l'on retrowye dans le groupe, et avant tout
STRUCTURES MATHEMATIQUES ET LOGIQUES 19
a) la possibilite d'un retour au point de départ
{opération inverse du groupe) et &) la possibilité
d'atteindre un méme but par des chemins différents
et sans que ce point d’arnivée soit modifié par liti-
néraire parcouru (associativité du groupe). Quant
Ala nature des compositions (réunions, etc.}, elle
peut étre indépendante de ordre (groupes commu-
tatife) ow porter sur un ordre nécessaire.
Cela étant, la structure de groupe est par conaé-
quent un instrument de eohérence, qui comparte
Ha propre lo aur son réglage interne ou auto-
régulation, Il met, en offet, en uv aon
exercice mime trois des prineipes fondamentaux
da rat ame: celui de nonevontr: oa qi
est incarné dans la réversih des transformations,
celui de Videntité, qui est assurée par la permanence
de élément neutre, et enfin ce principe, eur lequel
on insiste moins mais qui cst tomt aussi essentiel,
selon Jequel le point d’arrivée demeure indépendant
do chemin parcouru. Par exemple l'ensemble des
déplacoments dans Pespace forme un groupe (puis:
que deux déplacements successifs sont encore un
léplacement, puisqu’un déplacement peut étre
annulé parle déplacement inverse ou oretours, etc.) +
or Vassociativité du groupe des déplacements qui
correspond 2 ln conduite des « détours + est & cet
ard fondamentale pour la cohérence de Vespace,
les points darrivée étaient constamment
modifiés par les chemins parcourus il n’y aurait
plus espace mais un flux perpétucl comparable
an fleuve d’Heéraclite,
Le groupe est ensuite un instrament essentiel
de transformations mais de transformations ration:
nelles qui ne modifient pas tout & Ia fois ct dont
chacune est solidaire d'un invariant : c'est ainsi
que le déplacement d'un solide dans l'espace usuel
Jaisse inchangées sea dimensions, que la repartition
dun tout en fractions Inisse invariante la comme
totale, etc. A clle ecule la structure de groupe
saffit 4 dénoncer le caractére artificiel de lanti-
thise eur laquelle E, Meyerson fondait son épisté-
mologie, et selon laquelle toute modification était
irrationnelle, lidentité seule caractérisant la raison.
En tant que combinaieon indistociable de In transformation
ot de ls conservation, le groupe ost alors surtout an instrument
incomparable do constructivité, non seulement puisqu'll eat
uo systime de transformations, muis encore ot surtout pares
que cellesci peuvent @re en quelque sorte dostes par la
différencintion d'un groupe on bea eoweproupes et par les
sages posaillea d'un dé ooux-ei aux autres. C'est ainsi
io groupe dea déplacemienta laisse invariants, en plus dew
dimensions de la figure déplacée (donc dos distances), ace
angles, acs paralléles, nes draites, etc. On peut slurs faire varier
les dimensions, mais en conaervant tour le reste, ot on obtient
un groups plus gi dont le groupe des déplacements
levient un pous-groupe : cleat celal dos similitudes, permettant
dagrandis unefiguee asns en modifier la forme, On peut ensuite
nvodifiee Tee anglee, mais en conservant [ee paralléles ot lew
deaites, ete. ; on obtient ainai un groupe encore plus général,
dont celui des similitudes devient an aoue-groupe : ost colai
de Ia géométsle « affinn n qui itervient, par exemple, en
tranaformant un Torange em un autre, On comtinueca en modi-
fant lea paralléles tout en conarrvunt lea draites : on aboutit
slora an groupe « projectif » (perspectives, ete.) dont les
précédlents deviennent des sous-grogpes emboités, Entin on
pent ne plus conserver les droltes elleeantmes, et considérer
dea figures en quelque sorte dlastiques dont seulos sont muin-
torued let eorreapomdasens biunivoquer et bivontinuss cates
Joura points, et eo sera 1h le groupe le plus général on groupe
desc homéomorphies » propre a la topolugic. Ainsi les diffe.
Tentga géométries, qui pardissaient conetituer le modéle de
descriptions stutiques, purement figueatives et réparties en
chapitres disjaints, ne forment plua, en utilisant la etructure de
graupo, qu'uno vaste construction dont Ine truasfurmations
permettent, par lembottement des sous-growpea, de passer
Wune sousatracture it une autre (sans parler de la mé
péndrale que l'on peut uppuyer aur la topalagie pour en titer
fea métriques particuliéess, noo ¢nelidieanes ow euclidienue
ef revenir parle au groupe dea déplacements). Cheat ce chan-
STRUCTURES MATHEMATIOUES ET LOGIQUES 21
gement radical (une géométrie figurative en on systine total
de transformations que F, Klein a pm exposer en son famoux
« Programme d'Erlungen » et eet Wi um precniar exemple
do ce que, grfice i la structure de groupe, on peut appeler
une victoire positive du: atructuraliame,
6, Les structures méres. — Mais ce n'cat encore
qqu'une victoire partielle et le propre de ce que l'on
a puappeler lécole structuraliste en mathématiques.
eest-i-dire celle des Bourbali, a été de cherel
a suhordonner les mathématiques entitres a lid
ide structure.
Les mathématiques clussiques étaient formées
Wun ensemble de chapitres hétérogines, algtlre,
des nombres, analyse, géométrie, caleul des
éa, etc., portant chacun sur un domaine
sur des objets ou « dtres » définis pur leurs
Propriétés intrinséques. Le fait que la structure
de groupe ait pu s'appliquer anx éléments les plus
divers ct non pas seulement aux opérations algé-
briques a alors poussé les Bourbaki a généraliser
Ja recherche des structores selon un principe ana-
logue abstraction. Si l'on appelle « éléments »
dos objets déja abstraits tels que des nombres, des
déplacements, des projections, ete. {et l'on voit
qu'il y a déja dea ceaiet Wopérations aussi bien
que des opérations en elles-mémes), le groupe n'est
a5 caractérici par In nature de ccs éléments, mais
les dépasse par une nouvelle abstraction de degrs
supérieur qui consiste 4 dégager certaines trans:
formations communes auxquelles on peut soumettre
wWimporte quelles sortes d'éléments. De mime, la
tode des Bourbaki a consisté, par un procédé
de nis isomorphismes, & dégager les structures
leg plus générales auxquelles peuvent ¢ soumettre
des éléments mathématiques de toutes yariétés,
quel que soit le domaine auquel on les emprunte,
2 LE STRUCTURALISHE
ement totalement abstraction
et en faisant enti
de leur nature purticulidre.
Le point de départ d*une telle entreprise a donc
consisté en une sorte d'induction, puisque ni le
nombre ni la forme des structures fondamentales
recherchies n'ont été déduites a priori, Cette mé-
thade a conduit 4 la découverte de trois « structures
mires 0, ¢'est-a-dire sources de toutes les autres, mais
jugécs irréductibles entre elles (ee nombre de trois
Tésultant done d*une ans Tégressive et mon pas
une construction aprionque). Ty a d'abord lex
« structures algébriques », dont le prototype est Te
roupe mais avec tous les dérivés tivés de hui
t anmeanx s, © corps 0, ete,). Elles sont caractérisées
par la présonce d'opérations directes et inverses,
au aang d'une réveraihilité par négation (si T est
Topération et T-* son inverse, alors T 1. T = 0),
On peut distinguer ensuite les « structures dordre »,
qui portent sur les relations et dont le prototype
est le a réseau » om « treillia » (lattice), ¢'est-i-dire
une structure d'une généralité comparable & celle
du groupe, mais qui a été étudiée plus récemment
(par Dedekind, Hirkhoff, ete. ). Le résean unit ses
éléments au moyen des relations x succéde » on
« préctde 1, deux éléments comportant toujours
une plas petite « horae supérieure » (Ie plus proche
des suecesseurs ou supremum) ct une plus grande
« borne inféricure x {le plus élevé des prédéces-
seurs ou infimum), Tl cee comme le groupe
&oun nombre considérah e ens (par exemple
iT « ensemble des parties © d'un ensemble ou
« simplexe » (1), ow & un groupe ct ses sous-
(2) Un easomble 2 ftant fermé de nm ps Fensomile de,
parties (1) ett celal que T'on obtient en privant oes parties 1 A 1,
Ha 2, otc, ¥ compris Ventemible vide ot Mensemble Blais
P(E} a dede 2" dements,
STRUCTURES MATHEMATIQUES ET LOGIGUES 28
groupes, cte.). Sa forme générale de réversibilivé
n'est plus linversion, mais la réciprocité ; « 4.8
précéde A+ B » transformé en « A+ B sucetde
# A.B » par permutation des (-+) et des (.) ainsi
que des relations « préctde s et « succéde s, Hnfin les
troisikmes structures mires sont de nature topolo-
fondées sur les notions de voisinage, de
ité et de limite.
res fondamentalee étant distinguées
‘actérisées, les autres s'ensuivent par deux
provessus : ou par combingison en soumettant
un ensemble d’éléments a deux structures 4 la foi
{exemple 1a topologie algébrique) ou par differe
ciation, c'est-d-dire en imposant dea axiames limi-
tatifs qui définissent des sous-structures (exemple
les groupes géométriques dérivant & titre de sous:
mpes successivement emboités du groupe dee
oméomorphies topologiques en introdmisant la
conservation des droites, puis des paralléles, p
des angles, ete. : Voir § 5). On pent aussi passer
de structures fortes 4 des « strartures plus faibles »,
par exemple un semi-groupe qui cet associatif
mais qui n’a pas d’éléments neutre ni d'inverse
(les nombres naturels = 0).
Pour relier les uns aux autres ces différents
aspects et pour aider a précizer ce que pourrait
Gtre une signification générale des struct’ i
est intéressant de sc demander si les fondements
de cette « architecture des mathématique
est des Bourbaki) présentent un caractire urel x
OU Te peuvent ge situer que aur le terrain formel
des axiomatiques, Nous prendrons ici le terme de
enaturel » au sens of Pou a pu parler de x mombres
naturels» pour désigner les entivrs positifs qui ont été
constroits avant que lea mathématiques ne les wti-
lisent, et construits au moyen d’opérations tintes
STRUCTURES MATHEMATIQUES ET LOGIQUES 25
44 LE STRUCTURALISME
de Paction quotidicune, telles que la correspondance
hiunivoque utilisée par les saciétés primitives dans
Téchange un contre un ou par lenfant qui joue,
des m res avant que Cantor s'en soit servi
peur constituer le premier cardinal transfini
Or il ext frappant de constater quo lea pramiéres opérations
dont se serve Menfant en san développement, et qui dérivent
directement des courdinations générales dn sea uctions sur len
ehjets, peuvent précisdment ov répartir om trois grandes
catigeric, eulon ‘que lour niversibilité pructde par inversion
winites des structures algéhriques (dana in ena piurti-
structures de classifications et ds nombres) ou par
réciprocité comme dans Jes structures d’ordre (dans Je cna
particulier = eériations, corremondances sériales, ete.) om «que,
ca de se fonder sur lea resteriblances et différem
prockdent par dos lois de voisinagge, de con
es, co qui constitue des structures tepolog
s (qui sont, au point de vue psychogénstique,
jeuzes aux structures métriques ot projectives, contraize-
ment au déroulement historique des ctométries, mnuis comfor-
mément & ordre de filiation théarique |),
Ces faite acrblent dane indiquer que les structures notres des
Rourbaki corespandent, sous ung forme maturellement tris
fimentaire, sinon rudimentaize, et fort loignée de tn pénd-
qolité ot de Lx formulisatina possible qu'elles revétent sur Je
plan théorique, a des coordiaations mécessnires au fonction
nement de toute intelligenos dés les stades aacex primitifa de
sn for Tl ne serait pas difficile, en effet, de montrer
que les premiires opérations dont il vient d question
procédent, en fait, des coordinations scnsori-motrices elles-
mémes, dont les actions instramentales, chee le bébé de l'bomme
comme ches le chimpunsi, comportent assurément déji des
«structures {vair lo chap.
ae de Tron
is avant de dégager ce que cos constatations
jsnifient du point de vue logique, rappelons que
le structuralisme des Bourbaki est en voie de trans-
formation sous Vinfluenee d'un courant qu'il est
utile de signaler, car il fait bien apercevoir le mode
de découverte, sinon de formation, dea structures
nouvelles. Tl s‘agit de linvention des « catégorics »
(Mac Lane, Eilenberg, stc.), c'est-i-dire d'une classe
éléments y compris les fonctions qu'lls compar:
tent, done accompagnée de morphismes. En effet,
en son acception actuelle une fonction est I’ « appli-
sation x d'un cnsemble sur un autre ou sur Iui-méme
et conduit ainsi a la construction d'isomorphismes
ou de « morphismes » sous toutes leurs formes.
Crest assex dire que, en insistant sur les fonctions,
les catégories sont axées non plus sur les structures
mires, maiz sur les procédés mimes de mise en
relation qui ont permis de les dégager, ce qui revient
considérer la nouvelle structure comme tirte,
on pas des « étres » auxquels ont abouti les opéra-
tions précédentes, mais de ces opérations mémex
en fant que processus formateurs.
Ce nest done pas sans raison que §. Pay
dang les catégories un effort pour saisir les ap
du mathématicien plus que de «lao mathéma
Cest ld un nouvel exemple de cette abstraction
réfléchissante qui tire sa substance non pas des ob-
jets mais des actions exercées sur eux (méme quand
Tea objets antéricurs étaient deja le produit d'une
tells abstraction), ct ces faits sont présicux quant
fila nature et au mode de constraction des structures,
1, Les strmctures | » — La logique parait
au premier abord constituer le terrain privilégié
des structures, puisqu’elle porte sur les formes de
Ja connaissance et non pas sur ses contenus, Bien
ie lorsque Von souléve le problime (mal vu des
logiciens) de la logique naturelle au sens (indiqué
3 5) des « nombres naturels o, om aperooit vite
que les contenus manipulés par les formes logiques
ont encore des formes, orientées dans la direction
de celles qui eont logicisables, ces formes dea cont
nus comprenant des contenus moins élaborés, mais
qui ont & nouveau des formes, et ainsi de suite,
26 LE STRU.
chaque élément étant um contenu pour celui qui
lui est supérieur et une forme pour l’inférieur.
Mais si cet embhoitement des formes et cette
relativité des formes et des contenus sont haute-
ment instructifs pour la théerie du structur:
ils nintéressent pas la lopicpoe, ai
quant au probléme deg frontiére:
tion (voir § 8). La logique symbolique ow mathéma-
tique (la seule qui compte aujourd'hui) s'installe en
un point queleonque de tette marche arcendante,
mais avec Vintention systématique d’en faire on
commencement absolu, ct cette intention est rai-
sonnable puisqu'elle ext réalisable aréce a la mé-
thodé axiomatique. Tl suffit, en effet, de choisir
comme point de départ un certain nombre de
notions considérées comme indéfinissables, en ce
sens que ce sont elles qui serviront 4 définir lea
autres, et de propositions considérées comme indé-
motitrables (relativement au systéme choisi, car
leur choix est libre) et qui serviront a Ia démons-
tration. Il faut seulement que ces notions premiéres
et ces axiomes soient suffisants, itibles entre
eux ef réduits au minimum, o’est-a-dire non redon-
dants. I] suffit ensuite de se donner des régles
de censtruction, sous la forme d'une prooédure
opératoire, ct In formalisation constitue alors un
systéme qui se suffit i lui-méme, sang a des
intuitions extéricures, et dont le point de départ
est cn on sens absolu, Il reste bien entendu le pro-
blame des frontitres supérieures de la formalisati
et la question épistémologique de savoir ce que
recouvrent les indéfinissables et les indémontrables,
mais, du point de voe formel of se place le logieten, i]
ya bien 14 Vexemple sans doute unique Uune anto=
nomie radicale dans Ie sena d‘un réglaze porement,
interne, cea e autorégulation parfuite,
de la formalisa-
adire d
F
I
n
STRUCTURES MAL
ATIQUES ET LOGIQUES 21
On pourrait done soutenir, aun point de vue Glargi,
a chaque systéme de logique (et ils sont innom-
wables} constitue une structure puisqu'il comporte
les aia earactires de totalité, de transformations
et Wauloréglage. Seulement, d'une part, il s‘agit
de © structures o élaborées ad hoc et, qu'on le dise
ou non, la tendanee intime du structuralisme est
Watteindre des structures o naturelles o, ee concept
Un peu Aquiveque vt souvent mal famé recouvrant,
soit Vidée d'un cnracinement profond dans la nature
humaine (avec un risque de retour a lapriorisme),
soit au contraire Vidée d'une existence absolue
indépendante en un sens de la nature humaine,
qui doit simplement s'y adapter {oc second eens
courant le risqae d’un retour aux essences trans.
cendantales).
Tantre part, et ceci est plus grave, un systéme
de logi hien une totalité fermée quant
4 lensemble dea théortmes quill démontre, mais ce
relative, car fe systim.
reste ouvert par le haut quant aux théo fumes qu'il
: pas (notamment le ‘idabl
cause des limites de la formalisation) et ouver
Io bas, car les notions ct axiomes de départ recou-
yrent un monde d'éléments impl
Gest de ce dernier probléme que s'est surtout
ocenpé ce que l'on peut appeler le structuralisme
en logique, son intention explicite étant de recher-
cher ce qu'il peut y avoir sous les opérations de
départ, codifiées par les axiomes. Et ce que l'on a
trouvé est bien alors um ensemble de structures
authentiques, non seulement comparables aux
grandes stroctures qu'utilisent les mathématiciens
Simposent intuitivement indépendamment
ur formalisation, mais encore identiques 4
certaines d’entre elles et rentrant alors dans ce
28 LE STRUCTURALISME
que Pon appelle aujourd’hui Valgebre générale ot
qui est une théoric dee structures,
H ect on particulier frappamt qué Iu logique de Toole, Mun
dea grands fondoteurs de 1a logique symbolique du x1x* sidele,
constitue une algihre dite algebre d fe. Cotte algébre,
qai couyre Ja logique des classes ot celle des propositions
sous s2 forme classique, correspond nar ailleurs 4 dee arithmé-
tique module 2, e'gst-i-dire dont les seules valears sont et 1,
Or, do cette algéhea on peut titer une stracture dea résequ®
(voir § 6) en ajoutant aux propriété: communes i tana les
réseuux celles d'dtze distributive, de contenir un élément
masinum et un minimam et surtout d'étee complimentée
(chaque terme compartant ainsi som inwerss ou mépation) 2
on pariera alors d'une réseau de Boulom.
Dante part, les deux opérations booléennes de La dis
jonction exclusive (ou p on q, mals pas les deux) ot d'équive-
lies (pret yu ai aches lotrel pertie et aay ex teers
de constituer un groups, et chacun da ces deux geoapes peut
Bre trunsiormé on uh anneau exmmntatt (I) On voit and
qu'on retrouve cn Iogique les deux principales structures
qui sont courantes en mathématicques
‘Mais om peut dégager en outrs un groupe plus général, &
titre de cas particulier du groupe de quaternalite de Klein,
Soit tine apfration telle que Fimplication p > q ; si nous
invorsons {I¥) on aura pig (co qui aio dome Timplcaion),
Si nous en permotons Ina teres, ou simplement que nou
conservons sa forme mais entre propoitions nies (p = @),
on aura sa réciproque R suit y > p. Si, dansla forme normale
de pq (soit p.g¥B.g¥ p.9) nous peemutons les (v) et
I nous obtenons In enrrélative C do p= q, soit pig.
Zafty ol/sona labiuni pf mayq ldctoamcte ertaaral a! eralehie
mation identique f. Oe, on ade fagan commutative: VR — C:
NE=R; CR = Net NRO= I
Hy a done Ji um groupe do quatre transformations
dont [es opirations de In logique hivalente des propositions
(qu’olles soicat binwires, terauires, ete,) fournissent aucant
Wexemples quien pent farmer de quaternes aves Ina éliment=
de sone ensemble de purtica (2); pour certains de cos quan-
(2) ote JB. Gaye Howtos po ATTy La ef conmatsraren
Boars KET ef Ole}, Eth oiclie fe fa Pbdic (ved, XXIE,
(2) Ce INAG que nows avons décrit en 1048 (Traitd de
denne Leu 4 an commentaire de Mare Bannir (Les
Temps mogernes, now. 1860, n° 246, Problimes du structurelisme,
Hf), q2al pout doanes Hew A un mulentencuy xt Hoe senile Fc
STRUCTURES MATHEMATIQUES ET LOGIQUES 29
feraes on a J—R ct N=C on F=C ct N= R, mais
Daturellement jamais I= 1
Au total, il est done clair qu’il existe en logique
les « structures » au sens plein et d'autant ai
‘intéressantes, pour la théorie du structuralisme,
‘que l'on peut suivre leur paychogentse dans le
développement de la pensée naturelle, Ty a done
1 un probléme sur lequel il conviendra de revenir,
4. Les limites vieariantes de la formalisntion, —
Mais la réflexion sur les structures logiques présente
Hn autre intérét pour le structuralisme en général,
qui est de montrer en quoi les « structures 2 ne se
Confondent pas avec leur formalisation et en quoi
elles proctdent bien ainsi d’une réalité x naturelle »
_¢n un sens que nous nous efforcerons de préciser
"peu a peu.
En 1931, Kurt Goedel a fait une découverte
dont Ie retentissement a été cousidérable parce
_ qwen définitive elle mottait en cause les opinions
| Tégnantes tendant a une réduction intégrale des
mathématiques a la logique et de celleri a Ia
pure formalisation; et parce qu’elle imposait &
celle-ci des frontiéres, sans doute mobiles ow viea-
Tiantes, mais toujours existantes en un moment
donné de la construction. Il a, en effet, démontré
"qu'une théorie sufficamment riche et consistante,
comme par exemple Varithmétique élémentaire,
fe pout pas parvenir par ses propres moyens, ou
| par des moyens plus ¢ faibles » (dans le tas pare
AB, on peat nditure tes trols auteus
13) changer 3 ou Xp changer tos
fae des réelpenelts
Gliments non pas Ios
ple AD, Ale, , tabs tre a6 combinaisons de sat
shsemahie de frarticnt ibinaisans pours prapusstions,
Aud peycbalogique itll qa'aw oven fate
Eescenen, taneis que: tes jpsea ie groupes fi ¢ Géments
| ®ynqués par Barbut sont nocessibles des 7-8 ae
A,
LE STRUCTURALISME
ticulier la logique des Principia mathematica de
Whitehead et Russell), 4 démontrer sa propre non-
contradiction ; en sen tenant & seuls instro=
ments elle aboutit, en effet, A des propositions
indécidables et ne parvient done pas dla saturation.
Par contre, on a trouvé ensuite que ces démons-
‘trations, irréalisables au sein de la théorie dedépart,
deviennent possibles en employant des moyens plus
« forts o: e’est ce qu’a obtenu Gentzen pour larith-
métique (lémentaire en aeipan sur larithmé-
tique transfinie de Cantor. Mais celle-ci 4 son tour
ne suffit pas 4 achever son propre systime et pour
y parvenir il faudra recourir 4 des theories de type
euptrienr.
6 premicr intérét de telles constatationa est
qu'elles inteoduisent Ja notion de Ia plus ou moins
grande foree ou faiblesse des structures, en un do-
maine délimité of elles sont comparables. La hit-
rarchie ainsi introduite suggére alors aussitét une
idée de construction, de mémo qu'en biologie la
hiérarchie des caractires a suggéré Vévolution ;
I semble, en effet, raisonnable qu'une structure
faible utilise des moyens plus élémentaires et qu’a
la force croissante correspondent des instruments
dont I'élaboration est plus complexe.
‘Or, cette idée de construction nest pas une
le vue de lesprit. Le second enseignement
fondamental des découverte; de Goedel est, en
effet, de Pimposer de fagon tris directe, puisque,
pour achever une théorie dans le sens de la démons-
tration de sa mon-contradiction, il ne suffit plus
Panalyser sea présuppositions mais il devient néces-
saire de constraire la suivante! On pouvait jus
que-li considérer les théorices comme formant une
belle pyramide reposant eur une base se suffisamt
4 elle-méme, V'étage inférieur étant Ie plus solide
STRUCTURES MATHEMATIQUES ET LOCIQUES #1
puisque formé
truments Irs plas simples.
devient signe de faiblesse et
que pour consolider un étage il faille construire
suivant, la consistamce de la pyramide est en
réalité suspendue & son eommet ct ad um sommet
par lui-méme inachevé et devant étre élevé sans
eesse : Vimage de la pyramide demande alors 4
$tre renversée ct plus précisément remplacte par
‘celle d'une spirale 4 tours de plus en plus larges en
fonction de la montée,
jEu fait, Pidée de la structure comme systime
dé transformations devient ainsi solidaire d'un
constructiviame de la formation continue. Or, la
‘raizon de cet état de chosea apparait en définitive
assez simple et de portée assex trale. On a tiné
des résultats de Goedel des eonsidérations impor-
tantes sur les limites de la formalisation et l'on e pu
if tenee, en plus des puliers formels, de
_ palliers distinets de connaissances semt-formelles et
semi-intuitives ou approchées a des degrés divers
qui attendent, pour ainsi dire, la venue de leur
_ tour de formalisation, Les frontiéres de la formali-
sation sont done mobiles ou vicariantes, et non pas
fermécs une fois pour toutes comme une muraille
Mmarquant les limites d’un empire. J. Ladritre a
proposé linterprétation ingénieuse selon laquel
{ nous ne pouvons pas survoler d'un seul coup
toutes les opérations possibles de la pensée » (1), ce
i est une premitre approximation « » Ais
Pune part le nombre des opérations possibles de
Hotre pensée n'est pus fixé une fois pour toutes et
pourrait bien s'accroitre, ct, d'autre part, motre
gapacité de suryol ec modific tellement avec le déve-
— doppement mental qu'on peut aussi espérer létendre.
(1) Dialeetiea, RIV, 1960, ps SRL,
a2 LE STRUCTURALISME
Par contre, si l'on se référe a la relativité des formes
et des contenus rappelée au début du § 7, les limites
de la formalisation tiendraient plus simplement au
fait qu'il n’existe pas de forme en soi ni de contenu
en soi, tout élément (des actions senserimotrices
aux opérations, ou de celles-ci aux théories, etc.)
jouant simultanément le role de forme par rapport
aux contenus qu'il subsume et du contenu par
apport aux formes supérieures : l'arithmétique
@émentaire est une forme, 4 n’en pas douter, mais
qui devient un contenu dans Varithmétique trans-
finie (4 titre de « puissance du dénombrable x). Le
ultat en est que, 4 chaque niveau, la formali-
sation possible d'un contenu donné demeure limitée
par la nature de ce contenu. La formalisation de
Jao logique naturelle © ne mine pas loin, bien que
celle-cl soit une forme par rapport aux actions
concrétes ; celle des mathématiques intuitives méne
beaucoup plus loin, bien qu'il les faille amender
pour pouvoir les traiter formellement, ete.
‘Or, ei l'on retrouve des formes 4 tous les étages
du comportement humain, jusqu'aux schémes sen-
sori-moteurs et @ leurs cas particuliers les schémes
perceptifs, ete., faut-il en conclure que tout eat
9 structure o et terminer la notre exposé ? En un
eut-Gtre, mais en ce sens eeuloment que tout
est structurable. Mais la structure en tant que sye=
time autoréguluteur de transformations me sc
confond pas avee une forme queleongue + un tas
da cailloux présente pour nous ume forme (ear il
existe, selon la théorie de la Gestalt, de « mauvaises »
comme de a bonnes formes a § 11}, mais il ne peut
devenir une » structure » que si lon s’en donne une
théorie raffinée faisant intervenir le syatime total
de aes mouvements « virtucls ». Ceci nous conduit
a la physique.
i
Caarimee TID
LES STRUCTURES PHYSIQUES
EY BIOLOGIQUES
9, Structures physiques et causalité. — Le structs,
Talisme étant Vattitude théorique qui a renowvel
et continue d'inspirer les seiences de Phomme en
leurs mouvements avant-garde, il était indispen-
sable de commencer par examiner ce qu'il signific
en mathématiques ¢t en logique, mais on pent se
demander pourquoi aussi en physique ? Pour cette
raison qu'on ne sait pas a priort si les structures
Tennent a Thomme, a la nature ou aux denx et que
fa jonction des deux est 4 chercher sur Is terrain
de Ae licution humaine des phénoménes physiques,
Liidéal scientifique du physicien a consisté long.
temps A mesurer des phénoménes, 4 établir des lois
quantitatives et 4 interpréter ces lois en recourant
fi des motions telles que Paccélération, la masse,
Je travail, l'énergie, ete., définies les unes en fonetion
dee autres de maniére 4 préserver certains principes
de conservation expri
autant qu’on peut parler de stroctures en ee stade
classique de la physique, ce sont done surtout celles
des grandes théories, an sein desqmuelles lee relations
Sajustent en un systime relationnel, comme chez
Newton avee Vinertic, Végalité do P'sction et de la
réaction ct la force comme produit doe la masse et
a. hese 2
34 LE STRUCTURALISME
de l'accélération ; ow chez Maxwell avec la récipro-
cité des processus électriques et magnotiques, Mais
depuis I’ébranlement de law physique des principes »,
Fextension de la recherche aux niveaux extrémes,
supérieurs ot inférieurs, de l'échelle des phénoménes,
et depuis des renversements de perspectives aussi
imprévas que Ja subordination de la mécanique &
Pélectromagnétisme, on assiste A une valorization
progressive de l'idée de etructure : la théorie de la
mesure devenant le point délicat de la physique
contemporaine, on en vient @ chercher la stracture
avant la mesure et 4 concevoir la structure comme
un ensemble d’étate et de transformations poseibles
au sein desquels Ie syetime réel étudié vient prendre
ea place déterminée, mais du méme coup interprétés
on expliquér en fonction de ensemble des possibles.
Le problime prineipal que souléve alors pour le
structuralisme cette évolution de la physique est
celui de la mature de la causelité et plus précisément
celui des rapports entre les structures lngico-mathé-
ues utilisées dans l'explication causale des lois
et les structures supposées du récl. Si, avec le
positivisme, on interpriéte lea mathématiques comme
un simple langage, la question nexiste assurément
plus et la seience se réduit elle-méme 4 une pure
description, Mais sitét que l'on reconmait lexistence
de structures logiques ou mathématiques en tant
que systimes de transformations, le problime ee
pose d'établir si ce sont ces transformations for-
molles qui seules rendent compte des modifications
et conservations réelles obaervécs dans les faite ; ei,
au contraire, les premitres ne constituent qu'un
reflet intériorisé en notre esprit des mécaniames
inhérents 4 la causalité physique objective et indé-
pendante de nous; ou enfin =‘il existe entre ces
structures extéricures ct celles de nos opérations un
/ secon
STRUCTURES PHYSIQUES ET BIOLOGIQUES 35
lien permanent mais sana identité, ct um lien que
Yon trouverait a l'wuvre, incarné concrétement en
des domaines mitoyens tels que, par exemple, ceux
des stractures biologiques ou de nos actions sensori=
matrices,
Pour fixer les idées, doux des grandes doctrines de la causa-
fité, au début de co sidcle, so sunt orientées vers Lea deux
smiéres de ces trois sulutions; 1b. Meyerson an coneovant
iu causalité comme apeioriqua parce qua ae réduisant 4 Widen
"tification du divers ct L, Brunschvicg en définissant la enusalité
par la formule« il y a un universi (an sens de In relativité),
isle In difficulté évidento du premier de cen deux systémes
st de m’espliquer que lea conservations et de roléguer lea
_ transformations, qui sant poortant esscnticlles & In causalité,
dans le domaine de I irrutionnel », Quant au second, i a
Pour conséquence d'intégrer les structures opératoires dans la
et de considérer arithmétique comme une discipline
ormithimatique» (analers tout ca que l'on a pa dire
de V'idiéslisme brunschvirgien !). Maia il reste & soumettre cette
bypathies i une vérification paychobiologique.
Pour en revenir 4 la physique, une premiére
évidence est que la déduction logico-mathématique
dun ensemble de lois ne suffit pas a leur explication,
_ tant que cette déduction demeure formelle : l'expli-
cation suppose en plus des étres ono objets » situés
sous les phénoménes et des actions effectives de ces
Stres Jes uns sur les autres, Mais le fait frappant est
“que ces actions ressemblent en bien dea eas a des
upérations et que o’rst précisément dans la mesure
ott il x 4 correspondance emtre les premitres et les
lea que nous avons impression de « compren-
dre s. Mais comprendre ou expliquer ne se borne
oullement alors 4 appliquer nos opérations au réel
et A constater que celui-ei s¢ « laisse faire » : une
Simple application demeure intérieure au niveau
des lois. Pour le dépasser et atteindre les causes, il
- faut plus ; il est nécessaire d'attribuer ces opérations
aux objets comme tely et de les concevoir comme
a LE STRUCTURALISME
constituant en eux-mémes des opérateurs (1), C'est
alors, at alora geulement, que Yon peut parler de
a structure » causale, cette structure étant le sye-
thme odjectif dea opérateura en leurs interactions
effectives.
Dun tel point de vue laceord permanent des
alités yaiques ct des instruments mathéma-
és pour les décrire ext déja assex extra-
car cea instruments ont bien souvent
préexisté 4leur utilisation ct lorsqu‘ils sont construits
4 Veccasion d'un fait nouveau ils ne sont pas tirés
de ce fait physique, mais élaborés déductivement
jusqu’a imitation. Or, cet accord n'est pas simple
ment, comme le croit le tivisme, celui d'un lan-
gage avec les objets désignés (ear ce n'est pas
Phabitude des langages de vaconter d'avance. les
événements qu‘ils décrivent), mais celui des opé-
rations humaines avee celles des objets-opérateurs,
done une harmonie entre cet opératenr particulier
(ou ¢e fabricant d’opérations maultiples) qu’eat
Vhomme en son corps ct em son esprit, et ces opé-
rateurs innombrables que sont les objets physiques
a toutes Tes échelles : il y a done li, ou lien la
reuve éclatante de cette harmonic préétablie entre
s monades a volets clos dont révait Leibniz, ou
bien, si les monades n’étaient par hasard pas fermées
mais overtes, le plus bel exemple dee adaptations
biologiques connues {c’est-d-dire 4 la fois physico-
chimiques et cognitives).
Mais si cela est déja vrai des opérations en général,
cela reste vrai des plus notables des « structures »
opératoires. Qn sait assex, par exemple, que les
structures de groupe (voir & 5) sont dan emploi
(1) Notion esurnnte em mlerophysique ot es pramcdeurs obser
aoa spall completes nr es aperatvirs Inietih ovendaalas sade
Sra a Rat ne aay a pea TTInN ec voroos ten secant
STRUCTURES PHYSIQUES ET BIOLOGIQUES #4
tris général en physique, de échelle microphysique
pean’ Ja mécanique céleste relativiste. Or, cot
emploi eat d'un grand intérét quant aux rapports
entre les structures opératoires du sujet et celles
des opérateurs extériours et objectifs, On peut dis-
oe trois cas a ect égard. Hy a d’abord celui
oi le groupe peut avoir une valeur heuristique pour
le physicien, tout on ne représentant que des trans-
formations irréalisables physiquement, tel le groupe
de quaternalité POT ot P est la parité (transfor-
jmation d'une configuration en sa symétrie en
iniroir), Cla charge (transformation d'une particule
*n som antiparticule) et T Vinyersion du sens du
temps ! Il y a ensuite le cas oft les transformations,
aims constituer des processus physiques indépen-
dants du physicien, résultent d’actions matérielles
de Lesrensoentetnl manipulant les facteurs, ou
encore de coordinations entre dea lectures possibles
piseanele de mesure par des observatcurs en
différentea situations. L'une des rénlisations du
peaks de Lorentz correspond & ¢e second type,
lorequ'il intervient des changements de référentiel
qui coordonnent les points de vue de dewx obser
vateurs ayant des vitesses différentes, Les transfor-
mations du groupe sont alora des opérationa du
sujet, mais physiquement réalisables en certains cas,
ge que montre la ceconde réalisation de ce groupe,
lorsqu’il s‘ugit de transformations réelles opérées
par un méme sujet sur Ie systime étudié, Ceci
conduit au troisitme cas ot les transformations du
groupe sont physiquement réslisées indépendam-
ment des manipulations de Vexpérimentatenr, on
encore physiquement significativee mais a I'état
a virtuel » ou potenticl,
Ce troisiéme cas, le plus intéressant, ext celui de
la composition des forces (le parallélogramme) lors-
38 LE STRUCTURALISME
que les forces se composent d'cllee-mémes, Kt il eet
4 rappeler que pour deux forces ayant une més
tante J, i suffit d'imverser le sens de cette résul-
fante pour que cette troisiéme force R’ égale et
de sena opposé ad A tienne les deux premiéres en
équilibre. I] faut alors évequer aussi ladmirable
explication des états déquilibre par la compensa-
tion de tous les ¢ travaux virtuels » compatibles
avec Ice liaisons du systime, ce qui, joint aux
principes de la composition des forges, constitue
une vaste « structure » explicative fondée sur celle
de groupe,
Max Planck, dont on ait’asces le fle qu‘il a joud on erkant
a physique quantique, mais dont on sait aucsl quill ne seat
pas entidremest adapts wa courant d'idbes qu'il a déclenchtea,
& soutenu que, & efth de la eausnlité efficiente, lea phéno-
mines physiques abéieent d'une maniére aussi totale an
principe d'action minimum : or, co principe, selon lui, relive
dune « couse finals qui, a Minverse, fait du futur, ou plas
précisiment d'une tind erminge, co dent proctde to ddéroule-
ment des processus qui y canduisent » (1). Mais, avant de
Rirceiaae: ine tran (deus le susan lemghicenee nike aaa
fle b nous par Je chemin optique ie plus court malré toutes
les réfractions snbiea en traversant les couches del'atmosphere)
Je pouvoir de 0 comporters comme des étres donde dé raiaona
(ibid p. 129), en plus de Ia qualité Wopératenrs que nons
leur attrilwons ddjii, dl reste 4 ae demandor equament es déser-
mine an co cas Tintégealy de Fermat quia une valear mini
par rapport & tous bea chemins voisina, Or. ici i nouveau
comme dans Is cos des travaux virtuels, c'est on situant Je
réel dana les transformations possibles que lon trouve lexpli-
cation par une compensation de peache en proche eatre toutes
les variations possibles on voldinage da teafet xécl,
Co File dea transformations possihles net enfin évident dans
To cas des explications probabilistes ¢ expliquer le second prin-
eipo de Ia thermodynamique por In croissones de la proba
th (etort-hedire de Pentzopic}, c'est A nowraan, bien qu'il
s'agisso cette fois d'une icréversibilité comtraire aux compo-
(0) ME. Brasee, Eimage de monde dons ta papsigue moderne,
7. 1863, 180.
_ STRUCTURES PHYSIQUES ET BIGLOGIQUES 329
4itions d'un groupe, déterminer une stracture en compasant
Venstmble des possibles pour en déduire le téel (pnisque
la probabilité eat le rapport dos ons favornbles & ces cus
% pasaibles 0),
Au total, il existe done des « structures » phy-
siques indépendantes de nous, mais qui correspon-
dent 4 nes structures opérateires, y compris en ca
caractire qui aurait pu paraitre spécial aux activités
de Vesprit, de porter aur le possible ot de cituer le
réel dans lo eysttme des virtuels. Cette parenté dos
Mructures causales et opératoires, assez compréhen-
sible dans lea cas oi Vexplication tient encore &
des modéles construits en partie artificiellement ou
dans les situations spécinles 4 la microphysique of
Te déroulement des processus est indissociable de
Vaction de l'expérimentateur {d’ot les propos un
peu désabusés Eddington qui estime trop naturel
alors de retrouver sans cesse des formes deo grom
pes»), pore par contre un probléme lorsque des
Tecoupernents multiples montrent Vobjectivité de
Ja structure extérieure & nous. L'explication la plua
simple consiste cn ce cas ad se rappeler que c'est
Wabord dans action propre que nows découvrons
Ia cansalité, non pas dans Vaction d'un « moi » aw
fens métaphysique de Maine de Biran, mais dans
Pastion sensori-motrice ct insteumentale oi le jeune
enfant déja découvre la transmission du mouvement:
et Ie réle des poussées et des résistances. Or, Paction
eet également lan source des opérations, non pas
qu'elle les contienne d'avance, pas plus qu'elle
m6 contient toute la causalité, mais paree que ses
soordinations générales comportent certaines struc-
tures élémentaires suffisent & servir de point de
départ aux abstractions rafléchivsantes ct aux
Constructions ultérieures. Mais eeti conduit aux
structures biologiques.
ww EE STRUCTURALISME
10, Les structures organiques, — Lorganisme vie
want est tout dla fois un systéme physico-chimique
pare lea autres ot la source des activités du sujet.
Si une structure est bien, comme nous l'avons admis
(§ 1), um systéme total de transformations auto-
rigulatrices, Vorganisme est done le prototype des
structures et ai lon conmnaissait la sienne aver pré-
nous fournirait Ia elef du structuralisme
par sa double nature objet physique complexe
ect de moteur du comportement. Mais mous n’en
sommes pas li; un structuralisme biologique au-
thentique n'est méme qu’en voie de formation
aprés des si¢cles de réductionnisme simplificateur
ou de Vitalisme plus verbal qqu’explicatif.
Les cesais do réduction du vital au plysico-
chimique sont deja a eux seuls instructifs pour Te
structuralieme, comme tous les problimes de réduc-
tion, mais avee une acuité particulitee cn co cas
d'importance majeure, Le principe en a été que,
connaissant dans le monde inorganique les phéno-
mines 4, 8, C, ete., il doit sutfire pour comprendre
Vorganisme d*en composer la somme ou Ie produit :
Woh ane longue série de doctrines dites « méen-
nistea x et dont les plus faichewx exemples sont bea
animaux-machines de Descartes et cet aveu impli-
cite de défaite quest le schéma, encore en honneur
en hier dea milienx, d'une évolotion par variations
fortuites et sélection aprés coup. On a ainsi simple-
ment onblié deux faits capitaux, L’wn est que la
physique ne procéde pay par addition d°informa-
tions cumulatives, mais que les découvertes nou-
velles M, NV, ste, comdui
pias refonte des connaissances 4, B,C, ete, : or,
reste les inconnues de Vavenir X, ¥, ete. L’autre
est que, en physique méme, les essais de réduel
du complexe au simple, comme de Méle
ing
mentale dans le domaine des Gestalts on structures
STRUCTURES PHYSIQUES ET BIOLOGIQUES 41
tisme au mécanisme, aboutissent & des synthises
eh Vinféricur est enrichi par le supérieur et on
Tassimilation réciproque qui en résulte met en
évidence I'existence de « structures x d’ensemble
On aux compositions additives on iden-
‘On peut done attendre enns inquiétude
Jes réduetions du vital au physico-chimique, ear
elles ne © réduiront » rien mais transformeront a
deur avantage les deux termes du rapport.
A ces ezsais de réductions, simplificateurs et
antistructuralistes, le vitalisme a constamment
opposé les idées de totalité, de finalité interne ou
externe, etc., mais ¢e ne sont pas li dee structures,
fant que l'on ne précise pas les modalités causales
et opératoires des transformations en jeu dans le
systéme, De méme la doctrine de Fu émergence »
défendue par Lloyd Morgan et d'autres se borne a
constater l'existence de totalités de divers nivenux,
mais dire qu’elles © émergent » 4 un moment donné
ne consiste qua signaler qu'il y a li des problimes,
Dautre part, Ie vit. amis laccent sur
Vorganisme comme sujet, ou souree du sujet, en
oppasition avec le mécaniame de Vohjet, il s'est
toujours contents d'une représentation du sujet
inspirée par les introspections du sens commun ou,
avee Dricech, do la métaphysique des « formes o
aristotéliciennes.
Tl est intéressant de signaler a cet égard que le
premior caeni de structuralisme explicite en biclogie,
I «© organicisme » de L. von Bertalanify, a été
ré par les travaux de ln psychologic expéri-
pereeptives et motriccs, Mais si Vouvre de oo
théortcien de la biologie est d'un incontestable
intérét par son éffort de fonder une « théorie péné=
tale des systémes e, co sont surtout les progrés
Vous aimerez peut-être aussi
- 100 Jeux Pour Aider Son Enfant en Difficult 233 DapprentissageDocument229 pages100 Jeux Pour Aider Son Enfant en Difficult 233 DapprentissageMeriem Brik100% (4)
- Valerie Perrin Changer L 39 Eau Des FleursDocument510 pagesValerie Perrin Changer L 39 Eau Des FleursMeriem Brik100% (2)
- Sujet 3as (Témoignage Fatma Baichi) .Docx Version 1Document3 pagesSujet 3as (Témoignage Fatma Baichi) .Docx Version 1Meriem BrikPas encore d'évaluation
- Dormir Plus de 9 H Par Nuit Augmenterait Le Risque DDocument1 pageDormir Plus de 9 H Par Nuit Augmenterait Le Risque DMeriem BrikPas encore d'évaluation
- Influence MarketingDocument2 pagesInfluence MarketingMeriem BrikPas encore d'évaluation
- Comp Ecr EldjorfDocument6 pagesComp Ecr EldjorfMeriem BrikPas encore d'évaluation
- Lehmann1 39Document39 pagesLehmann1 39Meriem BrikPas encore d'évaluation
- Lecture Ce1 Gafi NATHANDocument83 pagesLecture Ce1 Gafi NATHANMeriem BrikPas encore d'évaluation
- GargantuaDocument26 pagesGargantuaMeriem BrikPas encore d'évaluation
- Youpizootie 33Document16 pagesYoupizootie 33Meriem BrikPas encore d'évaluation
- Marie-Antoinette - Sophie de MullenheimDocument148 pagesMarie-Antoinette - Sophie de MullenheimMeriem BrikPas encore d'évaluation