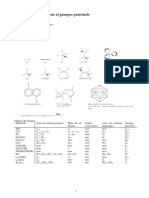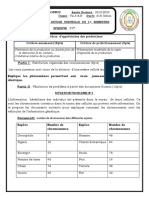Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Vidal de La Blache
Vidal de La Blache
Transféré par
maximus77afxCopyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Vidal de La Blache
Vidal de La Blache
Transféré par
maximus77afxDroits d'auteur :
Formats disponibles
4-
,-^irr
y^
>^i#
-.
.^s
fisi
^^
L
m^^
.^t^
%-H>^*
V'Ug
w^^^m
J
If
^^
N,. i
^>^'
>'*i^ite-
-^l'^'
-^
:i;^M-
^
*C%i
4^-
'^
^
F.
*i*4-..
/?/V*i''
i4
^.-* Sif;
^^^ssasta^
;f,"
^^'
-^
^
j^-^^-.
^ *\.
.j^
.^:^^-:^^-'-'^ ^-
;
^
^-^^
V
Digitized by the Internet Archive
in 2012 with funding from
University of Toronto
http://archive.org/details/principesdegograOOvida
PRINCIPES
DE
GOGRAPHIE HUMAINE
LIBRAIRIE ARMAND COLIN
VIDAL DE LA BLACHE
La France de l'Est {Lorraine-Alsace). Un volume in-S raisin, avec
3
cartes hors texte etun Index alphabtique, broch.
Le Bassin de la Sarre: Clauses dit, Trait de Versailles. Etude historique
et conomique (avec la collaboration de M. L. GALLOIS). Un volume in-8o
raisin, 2 cartes dans le texte et 2 cartes hors texte, broch.
Atlas gnral, historique et gographique : 420 cartes et cartons
en couleur; index alphabtique de
49.500
noms. (Nouvelle Edition conforme
aux Traits de Paix). Un volume in-folio, reli toile.
^
P^'VIDAL DE LA BLACHE
Membre de l'Institut.
PRINCIPES
DE
GOGRAPHIE HUMAINE
publis d'aprs les manuscrits de l'Auteur
par
Emmanuel de Martonne
Avec 2 cartes en noir et 4 cartes en couleur hors texte
l^S'S
')
ck
LIBRAIRIE ARMAND COLIN
103, Boulevard Saint-Michel, PARIS
1922
Tous droits de reproduction, de traduction et d'adaptation rservs pour tous pays.
81
Copyright 1921
by Max Leclerc and H. Bourrelier, proprietors of Librairie Armand Colin
AVERTISSEMENT
P. Vidal de La Blache, mort subitement le 5 avril 1918, en
pleine vigueur intellectuelle, n'a malheureusement pu mettre
la dernire main l'ouvrage que nous prsentons au public.
On a pens cependant qu'il et t vraiment dommage d'envier
aux gographes le bnfice des efforts qu'il avait faits pendant
de longues annes pour clairer et prciser les principes de la
gographie humaine.
Le plan d'ensemble du livre nous tait connu par des
conversations avec l'auteur et par une note remise, ds 1905,
l'diteur Max Leclerc. Les pages manuscrites que nous avons
trouves n'en reprsentaient pas la ralisation complte. La
premire partie, consacre la rpartition des hommes, tait
la plus acheve. Un certain nombre de chapitres en avaient
mme t publis dans les Annales de Gographie
^.
La deuxime
et la troisime parties, restes entirement manuscrites, n'of-
fraient, en dehors de deux ou trois chapitres dfinitivement
rdigs, que des dossiers considrables de notes et de brouillons.
Pour tirer parti de ces dossiers, il a fallu procder un travail
1. La rpartition des hommes sur le globe (premier article), A. d. G., xxvi, 1917,
p. 81-93, forme le Chapitre I : Vue d'ensemble.
La rpartition des hommes sur le
globe (second article). Ibidem, p. 241-254, forme le Chapitre II : Formation de
densit.
Les grandes agglomrations humaines (premier article), Afrique et Asie,
Ibidem,
p. 401-422, forme le Chapitre III : Les grandes agglomrations humaines,
Afrique et Asie.
Les grandes agglomrations humaines (deuxime article) , Europe,
Remarques Gnrales, A. d. G., xxvii, 1918, p. 92-101, forme le Chapitre IV :
L'agglomration europenne.
Les grandes agglomrations humaines (troisime
article) : Rgions mditerranennes. Ibidem, p. 174-187, forme le Chapitre V : R-
gions mditerranennes.
VI AVERTISSEMENT
de patience, rapprochant les fragments qui semblaient destins
se suivre, liminant les pages qui faisaient double emploi,
combinant souvent plusieurs rdactions diffrentes sur le
mme sujet repris plusieurs annes d'intervalle, utilisant
comme guide des indications sommaires sur l'enchanement
des ides jetes au verso ou au coin d'une page. On s'est
rigoureusement interdit tout raccord, qui et risqu de dtonner
avec le style si personnel de l'auteur
;
on s'est born choisir
entre des variantes souvent enchevtres d'une faon dconcer-
tante, et corriger les imperfections videntes que l'auteur
et effaces en recopiant son manuscrit. Au cours de ce travail
dhcat, nous avons t soutenu par le plaisir de voir se dgager
souvent, de la page manuscrite la plus difficile dbrouiller, les
ides les plus originales et les plus fcondes. Si nous ne nous
faisons pas illusion, la plupart des chapitres se prsentent
comme un tout homogne. Bien peu sont videmment incom-
plets.
Un chapitre, au moins, manque, dans la premire partie,
sur l'Agglomration amricaine. Dans la troisime, l'auteur
aurait certainement trait longuement des villes. Nous n'avons
pu dgager sur ce sujet que quelques pages, sorte d'introduc-
tion ou de sommaire. Ces pages ont t donnes comme
fragments, la fin de l'ouvrage, avec divers dveloppements
dont il a t impossible, malgr toutes les recherches, de
trouver la place dans les chapitres peu prs complets.
De mme qu'on s'est interdit tout raccord dans le texte,
on a renonc raliser ou achever les figures, assez nom-
breuses, dont l'auteur n'avait fait qu'indiquer l'ide, ou
commencer la prparation. L'illustration est certainement plus
pauvre que ne l'aurait sans doute voulue Vidal de La Blache.
Du moins avons-nous pu reproduire les quatre grands
planisphres qu'il avait lui-mme tudis dans les derniers
dtails.
En somme, rien d'essentiel ne manque. On reconnat l'uvre
du Matre, riche de vie et de pense.
Ce qui nous a paru le plus nouveau dans ces pages, compares
aux plus rputes qui aient t publies sur l'Anthropogo-
PRINCIPES DE GOGRAPHIE HUMAINE vu
graphie, ou Gographie humaine, c'est moins Ttonnante rudi-
tion, la multitude des exemples emprunts aux pays les plus
varis, que la manire dont le point de vue historique pntre,
domine, inspire l'examen, le classement, l'explication de tous
les faits. Je ne crois pas que personne ait montr au mme degr
la proccupation d'envisager les phnomnes de Gographie
humaine actuels, comme des stades dans une longue volution.
Vidal de La Blache les voit la fois dans le pass et dans le futur.
Et son regard va jusqu'au pass le plus lointain. Ce n'est pas
seulement l'histoire proprement dite qu'il a constamment
recours ;
il remonte jusqu' la prhistoire
;
il se penche atten-
tivement sur ces peuples primitifs qui sont comme des tmoins
de temps rvolus depuis longtemps pour nous ;
et, dans leur
civihsation qui nous semble rudimentaire, il voit tout ce qu'il
y
a de progrs par rapport aux premiers ges de l'humanit.
L'homme lui-mme ne cesse pas d'tre considr commx le terme
d'une volution de certaines espces vivantes, dgag, au prix
d'efforts prolongs, de sa gangue d'animalit. La manire
d'expliquer, de commenter les phnomnes les plus ordinaires
qui forment la trame de notre vie : habitation et cohabitation,
moyens de nourriture, de transport, d'change, donne l'im-
pression d'un esprit qui a russi se placer, en quelque sorte, en
dehors de l'humanit, pour juger et apprcier ses uvres.
Ces proccupations historiques leves n'empchent pas le
point de vue gographique de dominer l'tude de toutes les
questions. C'est toujours la localisation de types, la constata-
tion de rapports locaux qu'aboutissent les analyses.
Les gographes aussi bien que les historiens et les socio-
logues liront et reUront avec profit ces pages, o Vidal de
La Blache a mis le plus pur de sa pense, fruit de toute une
vie d'tudes et de mditations, qui se concentraient de plus
en plus sur la gographie humaine.
Emmanuel de Martonne.
Octobre 192L
PRINCIPES
DE
GOGRAPHIE HUMAINE
INTRODUCTION
Vidal-Lablache, Gographie humaine.
INTRODUCTION
SENS ET OBJET DE LA GOGRAPHIE HUMAINE
I.
EXAMEN CRITIQUE
DE LA CONCEPTION DE GOGRAPHIE HUMAINE
La gographie humaine est une des branches qui ont rcemment
pouss sur le vieux tronc de la gographie. S'il ne s'agissait que d'une
pithte, rien ne serait moins nouveau. L'lment humain fait essen-
tiellement partie de toute gographie
;
l'homme s'intresse surtout
son semblable, et, ds qu'a commenc l're des prgrinations et
des voyages, c'est le spectacle des diversits sociales associ la diver-
sit des lieux qui a piqu son attention. Ce qu'Ulysse a retenu de ses
voyages, c'est la connaissance des cits et des murs de beaucoup
d'hommes . Pour la plupart des auteurs anciens auxquels la gogra-
phie fait remonter ses titres d'origine, l'ide de contre est insparable
de celle de ses habitants
;
l'exotisme ne se traduit pas moins par les
moyens de nourriture et l'aspect physique des hommes, que par les
montagnes, les dserts, les fleuves qui forment leur entourage.
La gographie humaine ne s'oppose donc pas une gographie
d'o l'lment humain serait exclu
;
il n'en a exist de telle que dans
l'esprit de quelques spcialistes exclusifs. Mais elle apporte une con-
ception nouvelle des rapports entre la terre et l'homme, conception
suggre par une connaissance plus synthtique des lois physiques
qui rgissent notre sphre et des relations entre les tres vivants qui
la peuplent.
4 INTRODUCTION
C'est l'expression d'un dveloppement d'ides et non le rsultat
direct et pour ainsi dire matriel de l'extension des dcouvertes et
des connaissances gographiques.
Il semblerait que la grande lumire qui se projeta au xvi sicle
sur l'ensemble de la terre et pu donner lieu une vritable gographie
humaine. Tel ne fut pas le cas. Les murs des habitants tiennent
assurment une grande place dans les rcits et les compilations que
nous a lgus cette poque. Mais quand ce n'est pas le merveilleux,
c'est l'anecdote qui
y
domine. Dans ces divers types de socits qui
dfilent sous nos yeux, aucun principe de classification gographique
ne se fait jour. Ceux qui, d'aprs ces donnes, essayaient de retracer
des tableaux ou des miroirs du monde, ne se montrent en rien sup-
rieurs Strabon. Lorsque, en 1650, Bernard Varenius crit sa Go-
graphie gnrale, l'uvre la plus remarquable qui ait paru avant
Ritter, il emploie propos des phnomnes humains qui doivent
figurer dans les descriptions de contres, des expressions montrant
une condescendance presque ddaigneuse. Ainsi deux sicles de dcou-
vertes avaient accumul des notions sur les peuples les plus divers,
sans qu'il s'en dgaget, pour un esprit proccup de classification
scientifique, r^en de satisfaisant et de net I
Cependant la pense scientifique avait t de longue date attire
par les influences du monde physique et leur action sur les socits
humaines. Ce serait faire injure une ligne de penseurs qui va des
premiers philosophes grecs Thucydide, Aristote, Hippocrate et
Eratosthne, que de ne pas tenir compte des vues ingnieuses, par-
fois profondes, qui sont semes dans leurs crits. Comment le spectacle
vari et grandissant du monde extrieur n'et-il pas veill, par un
juste retour sur la marche des socits humaines, un cho dans ces
coles philosophiques nes sur les rivages d'Ionie ? Il s'tait trouv l
des penseurs qui, comme Heraclite, vritable prdcesseur de Bacon,
jugrent que l'homme, plutt que de river la recherche de la vrit
la contemplation de son microcosme , aurait grande raison d'tendre
son horizon et de demander des lumires au monde plus grand
dont il fait partie
^.
Ils commencrent par chercher dans le milieu physique l'explica-
tion de ce qui les frappait dans le temprament des habitants. Puis,
mesure que les observations sur la marche des vnements et des
socits s'accumulrent dans le temps et dans l'espace, on comprit
mieux quelle part il convenait d'y assigner aux causes gographiques.
1. Bacon, De augmentis scientiarum, t. I,
43.
SENS ET OBJET DE LA GOGRAPHIE HUMAINE 5
Les considrations de Thucydide sur la Grce archaque, de Strabon
sur la position de l'Italie, procdent des mmes exigences d'esprit
que certains chapitres de VEsprit des lois ou de VHistoire de la civi-
lisation en Angleterre de Thomas Buckle.
Ritter s'inspire aussi de ces ides dans son Erdkunde, mais il le
fait davantage en gographe. Si, par un reste de prvention historique,
il assigne un rle spcial chaque grande individualit continentale,
du moins l'interprtation de la nature reste pour lui le pivot. Au
contraire, pour la plupart des historiens et des sociologues, la gogra-
phie n'intervient qu' titre consultatif. On part de l'homme pour
revenir par un dtour l'homme. On se reprsente la terre comme
la scne o se droule l'activit de l'homme , sans rflchir que cette
scne elle-mme est vivante. Le problme consiste doser les influences
subies par l'homme, faire la part d'un certain genre de dterminisme
s'exerant travers les vnements de l'histoire. Questions assur-
ment graves et intressantes, mais qui pour tre rsolues exigent une
connaissance la fois gnrale et plus approfondie du monde terrestre
qu'il n'tait possible de l'obtenir jusqu' ces derniers temps.
II.
LE PRINCIPE DE L'UNIT TERRESTRE
ET LA NOTION DE MILIEU
L'ide qui plane sur tous les progrs de la gographie est celle de,
l'unit terrestre. La conception de la terre comme un tout dont lesj
parties sont coordonnes, o les phnomnes s'enchanent et obissent!
des lois gnrales dont drivent les cas particuliers, avait, ds l'an-
tiquit, fait son entre dans la science par l'astronomie. Suivant
l'expression de Ptolme, la gographie est la science sublime qui
lit dans le ciel l'image de la terre . Mais la conception de l'unit ter-
restre resta longtemps confine dans le domaine mathmatique.
Elle n'a pris corps dans les autres parties de la gographie que de nos
jours, et surtout par la connaissance de la circulation atmosphrique
qui prside aux lois du climat. De plus en plus, on s'est lev la
notion de faits gnraux lis l'organisme terrestre. C'est avec raison
que Fr. Ratzel insiste sur cette conception dont il fait la pierre d'angle
de son Anthropogographie
^.
Les faits de gographie humaine se rat-
tachent un ensemble terrestre et ne sont expUcables que par
lui.f
Ils sont en rapport avec le miUeu que cre, dans chaque partie de la
terre, la combinaison des conditions physiques.
1
il
1. Fr. Ratzel, Anthropogographie, 2
partie, Introduction, Die Hologische
Erdansicht, Stuttgart, 1891.
6 INTRODUCTION
Cette notion de milieu, c'est surtout la gographie botanique qui
a contribu la mettre en lumire, lumire qui se projette sur toute
la gographie des tres vivants. Alexandre de Humboldt avait signal,
avec sa prescience accoutume, l'importance de la physionomie de la
vgtation dans la caractristique d'un paysage, et, lorsqu'en 1836
H. Berghaus publia, sous son inspiration, la premire dition de son
Atlas physique
^ le climat et la vgtation
y
taient mis nettement
en rapport. Cet aperu fcond ouvrait la voie une nouvelle srie de
recherches. Il ne s'agissait plus en effet d'un classement suivant les
espces, mais d'une vue embrassant tout l'ensemble du peuplement
vgtal dans une contre, de faon noter les caractres par lesquels
s'exprime l'influence des conditions ambiantes : sol, temprature,
humidit.
La physionomie de la vgtation est bien le signalement le plus
expressif d'une contre, comme son absence en est un des traits qui
nous tonne. Lorsque nous cherchons voquer un paysage enfoui
dans nos souvenirs, ce n'est pas une plante en particulier, un palmier,
un olivier, dont l'image se dresse dans notre mmoire
;
c'est l'ensemble
des vgtaux divers qui revtent le sol, en soulignent les ondulations
et les contours, lui impriment par leur silhouette, leurs couleurs, leur
espacement ou leurs masses, un caractre commun d'individualit.
La steppe, la savane, la silve, le paysage de parc, la fort-clairire, la
fort-galerie, sont les expressions collectives qui rsument pour nous
cet ensemble. Il ne s'agit pas d'une simple impression pittoresque,
mais d'une physionomie due aux fonctions mmes des plantes et aux
ncessits physiologiques de leur existence.
C'est ce que les observations et les recherches exprimentales de
la gographie botanique, surtout depuis qu'elles se sont tendues
aux rgions tropicales et tempres, toutes les ingalits d'altitudes,
ont dmontr par l'analyse et la comparaison. La concurrence des
plantes entre elles est si active qu'il n*y a que les mieux adaptes
au milieu ambiant qui parviennent s'y maintenir. Encore n'est-ce
jamais qu' l'tat d'quilibre instable. Cette adaptation s'exprime de
diverses manires, la taille, les dimensions et la position des feuilles,
le revtement pileux, les fibres des tissus, le dveloppement des ra-
cines, etc. Non seulement chaque plante pourvoit de son mieux
l'accomplissement de ses fonctions vitales
;
mais il se forme entre
vgtaux diffrents des associations telles que l'une profite du voisi-
nage de l'autre. Quelles que soient les varits d'espces qui cohabitent,
1.
3e
dition refondue en 1892.
SENS ET OBJET DE LA GOGRAPHIE HUMAINE
7
quelles que soient mme les diffrences extrieures des procds
d'adaptation dont elles usent, il
y
a dans toute cette population vg-
tale un signalement commun, auquel ne se trompe pas un il exerc.
Telle est la leon d'cologie, que nous devons aux recherches de la
gographie botanique : cologie, c'est--dire, suivant les termes
mmes de celui qui a invent ce nom
^
la science qui tudie les mu-
tuelles relations de tous les organismes vivant dans un seul et mme
lieu, leur adaptation au milieu qui les environne . Car il est vident
que ces relations n'embrassent pas seulement les plantes. Sans doute,
les animaux dous de locomotion, et l'homme avec son intelligence,
sont mieux arms que la plante pour ragir contre les milieux ambiants.
Mais, si l'on rflchit tout ce qu'implique ce mot de milieu ou d'en-
vironnement suivant l'expression anglaise, tous les fils insouponns
dont est tisse la trame qui nous enlace, quel organisme vivant pour-
rait s'y soustraire ?
En somme, ce qui se dgage nettement de ces recherches, c'est
une ide essentiellement gographique : celle d'un milieu composite,
dou d'une puissance capable de grouper et de maintenir ensemble
des tres htrognes en cohabitation et corrlation rciproque.
Cette notion parat tre la loi mme qui rgit la gographie des tres
vivants. Chaque contre reprsente un domaine o se sont artificielle-
ment runis des tres disparates qui s'y sont adapts une vie com-
mune. Si l'on considre les lments zoologiques qui entrent dans
la composition d'une faune rgionale, on constate qu'elle est des plus
htrognes ;
elle se compose de reprsentants des espces les plus
diverses, que des circonstances, toujours difficiles prciser, mais
lies la concurrence vitale, ont amens dans cette contre. Pourtant
ils s'y sont accommods
;
et, si les relations qu'ils entretiennent entre
eux sont plus ou moins hostiles, elles sont telles cependant que leurs
existences semblent solidaires. Les les mmes, pourvu qu'elles aient
quelque tendue, ne font pas exception cette diversit. Nous recueil-
lons chez les naturalistes zoo-gographes, des expressions telles que
communaut de vie , ou bien association faunistique . Formules
significatives, qui montrent que dans son peuplement animal comme
dans son peuplement vgtal, toute tendue de surface participant
des conditions analogues de relief, de position et de climat, est un
milieu composite concentrant des associations formes d'lments
divers, indignes, transfuges, envahisseurs, survivants de priodes
1. HiECKEL, Histoire de la cration des tres organiss, traduction franaise,
Paris, Reinwald, 1884, page 551.
8 INTRODUCTION
antrieures, mais unies par les liens d'une adaptation commune.
De quelle application ces donnes sont-elles susceptibles quant la
gographie humaine ? C'est ce que nous allons rechercher.
III.
L'HOMME ET LE MILIEU
Mais avant d'aller plus loin, une question se rencontre laquelle
il faut brivement rpondre. La gographie botanique s'appuie dj
sur un nombre imposant d'observations et de recherches
;
la go-
graphie zoologique, quoique bien moins avance, compte de fructueuses
explorations son actif : quelles sont les donnes dont dispose la
gographie humaine ? D'o lui viennent-elles ? Sont-elles assez nom-
breuses pour autoriser les conclusions que nous avons dj laiss
entrevoir ?
Dans l'tude des rapports de la terre et de l'homme, la perspective
a t change
;
plus de recul a t obtenu.
On n'envisageait gure auparavant que la priode historique,
c'est--dire le dernier acte du drame humain, un temps trs court par
rapport la prsence et l'action de l'homme sur la terre. L'investi-
gation prhistorique nous a montr l'homme rpandu depuis un temps
immmorial dans les parties les plus diverses du globe, arm du feu,
taillant des instruments
;
et, si rudimentaires que paraissent ses indus-
tries, on ne saurait considrer comme ngligeables les modifications
qu'a pu subir, de leur fait, la physionomie de la terre. Le chasseur
palolithique, les premiers cultivateurs nolithiques ont ouvert des
brches et cr aussi des associations dans le monde des animaux
et des plantes. Ils ont opr sur des points divers, indpendamment
les uns des autres, comme le prouvent les diversits restes en usage
dans les procds de production du feu. L'homme a influ, plus ancien-
nement et plus universellement qu'on ne pensait, sur le monde vivant.
De ce que l'espce humaine s'est rpandue ainsi de bonne heure sur
les rgions les plus diverses, il rsulte qu'elle a eu se soumettre
des cas d'adaptations multiples. Chaque groupe a rencontr dans le
milieu spcial o il devait assurer sa vie, des auxiliaires ainsi que des
obstacles : les procds auxquels il a eu recours envers eux repr-
sentent autant de solutions locales du problme de l'existence. Or,
jusqu'au moment o, l'intrieur des continents s'tant ouvert, des
explorations scientifiques en ont systmatiquement observ les popu-
lations, un pais rideau nous drobait ces dveloppements varis
d'humanits. Les influences de milieu ne se rvlaient nous qu'
travers une masse de contingences historiques qui les voile.
SENS ET OBJET DE LA GOGRAPHIE HUMAINE 9
La vision directe de formes d'existence en troit rapport avec le
milieu, telle est la chose nouvelle que nous devons l'observation
systmatique de familles plus isoles, plus arrires de l'espce humaine.
Les services que nous signalions tout l'heure comme ayant t
rendus la gographie botanique par l'analyse des flores extra-euro-
pennes, sont prcisment ceux dont la gographie humaine est rede-
vable la connaissance des peuples rests voisins de la nature, aux
Naturvlker. Quelque part qu'on fasse aux changes, il est impossible
d'y mconnatre un caractre marqu d'autonomie, d' endmisme.
Il nous fait comprendre comment certains hommes placs en certaines
conditions dtermines de miheux, agissant d'aprs leur propre inspi-
ration, s'y sont pris pour organiser leur existence. N'est-ce pas, aprs
tout, sur ces bases que se sont leves les civilisations qui ne sont
que des accumulations d'expriences ? En grandissant, en se compli-
quant, elles n'ont pas entirement rompu avec ces origines.
Plusieurs de ces formes primitives d'existence sont prissables
;
plusieurs sont teintes ou en voie d'extinction : soit. Mais elles nous
laissent, comme tmoins ou comme reUques, les produits de leur indus-
trie locale, armes, instruments, vtements, etc., tous les objets dans
lesquels se matrialise, pour ainsi dire, leur affinit avec la nature
ambiante. On a eu raison de les recueillir, d'en former des muses
spciaux o ils sont groups et gographiquement coordonns. Un
objet isol dit peu de chose
;
mais des collections de mme provenance
nous permettent de discerner une empreinte commune, et donnent,
vive et directe, la sensation du milieu. Aussi des muses ethnogra-
phiques tels que celui qu'a fond BerUn l'infatigable ardeur de
Bastian, ou ceux de Leipzig ou d'autres villes, sont-ils de vritables
archives o l'homme peut s'tudier lui-mme, non point in abstracto,
mais sur des ralits.
Autre progrs : nous sommes mieux instruits sur la rpartition de
notre espce, nous savons mieux dans quelle proportion numrique
l'homme occupe les diverses parties de la terre. Je n'affirmerais pas
qu'on possde un inventaire exact de l'humanit, et que le chiffre de
1.700 millions reprsente positivement celui de nos semblables
;
mais
ce qui est certain, c'est que grce des sondages pratiqus un peu
partout dans l'ocan humain, des recensements rpts, des esti-
mations plausibles, on dispose de chiffres dj assez prcis pour per-
mettre d'tablir des rapports.
Dans la mobilit qui prside aux rapports de tous les tres vivants,
l'tat numrique et territorial de chaque espce est une notion scien-
tifique de haute valeur. Elle jette un jour sur l'volution du phno-
10 INTRODUCTION
mne. La population humaine est un phnomne en marche ; c'est le
fait mis pleinement en vidence, lorsque, par-dessus les statistiques
particulires des tats, on considre l'ensemble de sa distribution
sur le globe. Il
y
a des parties qu'elle occupe en force, o elle semble
avoir utilis, mme outre mesure, toutes les possibilits d'espace.
11
y
en a d'autres o, sans que des raisons de sol et de climat justifient,
cette anomalie, elle est reste faible, clairseme. Comment expliquer
ces ingaUts, sinon par des courants d'immigration ayant pris nais-
sance en des temps antrieurs l'histoire et dont la gographie seule
peut nous aider trouver la trace ? Et naturellement aujourd'hui ces
contrs ngliges deviennent des foyers d'appel pour les mouvements
qui agitent l'humanit actuelle.
Un des rapports les plus suggestifs est celui qui existe entre le
nombre d'habitants et une certaine portion de surface
;
autrement dit
la densit de population. Si l'on met en regard des statistiques dtail-
les de population avec des cartes galement dtailles, comme en
possdent aujourd'hui presque tous les principaux pays du monde,
il est possible, par un travail d'analyse, de discerner des correspondances
entre les rassemblements humains et les conditions physiques. On
touche ainsi l'un des problmes essentiels que soulve l'occupation
de la terre. Car l'existence d'un groupement de population dense,
d'une cohabitation nombreuse d'tres humains dans un minimum
d'espace, garantissant la collectivit des moyens assurs de vivre,
est, si l'on
y
rflchit, une conqute qui n'a pu tre ralise qu' la
faveur de rares et prcieuses circonstances
Aujourd'hui les facilits du commerce nous masquent les difficults
qu'ont rencontres, pour former sur place des groupes compacts, les
hommes d'autrefois. Cependant, la plupart des groupements actuels
sont des formations qui remontent haut dans le pass ;
leur tude
analytique permet d'en comprendre la gense. En ralit la population
d'une contre se dcompose, comme l'a bien montr Levasseur
\
en un certain nombre de noyaux, entours d'auroles d'intensit
dcroissante. Elle se groupe suivant des points ou des lignes d'attrac-
tion. Les hommes ne se sont pas rpandus la faon d'une tache
d'huile, ils se sont primitivement assembls la faon des coraux.
Une sorte de cristallisation a agglomr sur certains points des bancs
de populations humaines. Ces populations
y
ont, par leur intelligence,
accru les ressources naturelles et la valeur des lieux, de telle sorte que
1. E. Levasseur, La rpartition de la race humaine (Bulletin intern. de statis-
tique, XVIII,
2e
livr., p. 56).
SENS ET OBJET DE LA GOGRAPHIE HUMAINE 11
d'autres sont venues pour participer, de gr ou de force, aux bnfices
de ce patrimoine, et des couches successives se sont accumules sur
les terrains d'lection.
Nous possdons aujourd'hui des donnes anthropologiques sur
quelques-unes des contres o se sont ainsi superposes des alluvions
humaines. L'Europe centrale, le bassin mditerranen, l'Inde anglaise
S
nous prsentent, titres divers, des exemplaires d'aprs lesquels
il est possible de se rendre compte de la composition des peuplements
humains. La complexit de ces peuplements est, d'une faon gnrale,
ce qui nous frappe. Lorsqu'on essaie de distinguer, d'aprs les indices
anthropologiques rputs les plus persistants, les lments qui entrent
dans la population non seulement d'une grande contre, mais d'une
circonscription rgionale de moindre tendue, on constate qu' peu
d'exceptions prs c'est l'absence d'homognit qui est la rgle. L'an-
thropologie distingue en France des lments trs anciens, remontant
aux temps prhistoriques, ct d'lments venus ultrieurement,
souvent d'une rgion, d'un dpartement mme. Il
y
a dans cette diver-
sit des degrs qu'expliquent suffisamment la nature et la position
des contres
;
mais, dans l'tat actuel de l'volution du peuplement
humain, bien rare sont les parties qui semblent avoir entirement
chapp aux flots d'invasions qui ont circul la surface de la terre :
quelques archipels lointains, quelques cantons montagneux, tout au
plus. Mme dans la rgion des silves africaines, les Ngres de haute;
taille et les Pygmes teint plus clair coexistent en rapports rci-
proques. On peut ds prsent considrer comme acquise, contraire-
ment aux habitudes du langage courant qui les confond sans cesse,
la distinction fondamentale du peuplement et de la race. Sous les
conformits de langue, de religion et de nationalit, persistent et ne
laissent pas de travailler les diffrences spcifiques implantes en nous
par un long atavisme. 'r^
Cependant ces groupes htrognes se combinent dans une organi-
sation sociale qui fait de la population d'une contre, envisage dans
son ensemble, un corps. Il arrive parfois que chacun des lments qui
entrent dans cette composition s'est cantonn dans un genre de vie
particuUer : les uns chasseurs, les autres agriculteurs, les autres pas-
teurs
;
on les voit, en ce cas, cooprer, unis les uns aux autres par
une sohdarit de besoins. Le plus souvent, l'exception de quelques
molcules obstinment rfractaires tels que gypsies, gitanes, tziganes.
1. Le peuple de l'Inde d'aprs la srie des recensements (Annales de Gographie,
XV, 1906, p. 353-375 et 419-442).
12 INTRODUCTION
etc.
dans nos socits d'Europe, l'influence souveraine du milieu
a tout ralli des occupations et des murs analogues. Des signes
matriels traduisent ces analogies. Telle est la force assouplissante
qui prvaut sur les diffrences originelles et les combine dans une
adaptation commune. Les associations humaines, de mme que les
associations vgtales et animales, se composent d'lments divers
soumis l'influence du milieu. On ne sait quels vents les ont runis,
ni d'o, ni quelle poque
;
mais ils coexistent dans une contre qui,
1
peu peu, les a marqus de son empreinte. Il
y
a des socits de longue
\
date incorpores au milieu, mais il
y
en a d'autres en formation, qui
;
vont se recrutant et se modifiant de jour en jour. Sur celles-ci, malgr
Itout, les conditions ambiantes exercent leur pression et on les voit en
Australie, au Cap, ou en Amrique, s'imprgner aussi des lieux o se
droulent leurs destines. Les Boers ne ralisent-ils pas un des plus
remarquables types d'adaptation ?
IV.
L'HOMME FACTEUR GOGRAPHIQUE
Par-dessus le localisme dont s'inspiraient les conceptions ant-
rieures, des rapports gnraux entre la terre et l'homme se font jour.
La rpartition des hommes a t guide dans sa marche par le rappro-
chement et la convergence des masses terrestres. Les solitudes oca-
niques ont divis des coumnes longtemps ignorantes les unes des
autres. Sur l'tendue des continents les groupes qui ont essaim
et
l, ont rencontr entre eux des obstacles physiques qu'ils n'ont sur-
monts qu' la longue : montagnes, forts, marcages, contres sans
eau, etc. La civilisation se rsume dans la lutte contre ces obstacles.
Les peuples qui en sont sortis vainqueurs ont pu mettre en commun
les produits d'une exprience collective, acquise en divers milieux.
D'autres communauts ont perdu, par un long isolement, la facult
d'initiative qui avait mis en uvre leurs premiers progrs
;
incapables
de s'lever par leurs propres forces au-dessus d'un certain stade,
elles font songer ces socits animales qui semblent avoir puis
la somme de progrs dont elles taient susceptibles. Aujourd'hui
toutes les parties de la terre entrent en rapport
;
l'isolement est une
anomalie qui semble un dfi, et ce n'est plus entre contres contigus
et voisines, mais entre contres lointaines qu'est le contact.
Les causes physiques dont les gographes s'taient prcdemment
attachs montrer la valeur, ne sont pas pour cela ngligeables
;
il
importe toujours de marquer l'influence du relief, du climat, de la
position continentale ou insulaire sur les socits humaines
;
mais nous
SENS ET OBJET DE LA GOGRAPHIE HUMAINE 13
devons envisager leurs effets conjointement sur l'homme et sur l'en-
semble du monde vivant.
C'est ainsi que nous pouvons le mieux apprcier le rle qu'il convient
d'attribuer l'homme comme facteur gographique. Actif et passif,
il est la fois les deux. Car, suivant le mot bien connu, natura non nisi 1
{
parendo vincitur .
Un minent gographe russe, M. Woekof, a fait remarquer que les
objets soumis la puissance de l'homme sont surtout ce qu'il appelle
les corps meubles
^.
Il
y
a en effet sur la partie de l'corce terrestre
qui est directement soumise l'action mcanique des eaux courantes,
des geles, des vents, des plantes par leurs racines, des animaux par
les transports de molcules et le pitinement, un rsidu de dsagr-
gation sans cesse renouvel, disponible, susceptible de se modifier
et d'accueillir des formes diverses. Dans les parties les plus ingrates
du Sahara les dunes sont le dernier asile de la vgtation et de la vie.
L'action de l'homme trouve plus de facilits s'exercer dans les
contres o ces matriaux meubles sont rpartis avec abondance
que dans celles o une carapace calcaire, une crote latritique par
exemple ont endurci et strilis la surface.
Mais il faut ajouter que la terre elle-mme, suivant l'expression
de Berthelot, est quelque chose de vivant. Sous l'influence de la lumire
et d'nergies dont le mcanisme nous chappe, les plantes absorbent
et dcomposent les corps chimiques
;
les bactries fixent dans certains
vgtaux l'azote de l'atmosphre. La vie, transforme en passant
d'organismes en organismes, circule travers une foule d'tres : les
uns laborent la substance dont se nourrissent les autres
;
quelques-
uns transportent les germes de maladies qui peuvent dtruire d'autres
espces. Ce n'est pas seulement la faveur des agents inorganiques
que se produit l'action transformatrice de l'homme
;
il ne se contente
pas de mettre profit, avec sa charrue, les matriaux de dcomposi-
tion du sous-sol
;
d'utiliser les chutes d'eau, la force de pesanteur
accrue par les ingalits du relief
;
il collabore avec toutes ces nergies
vivantes qui se groupent et s'associent suivant les conditions de
milieu. Il entre dans le jeu de la nature.
Ce jeu n'est pas exempt de pripties. Il faut remarquer que, dans
beaucoup de parties de la terre, sinon dans la totalit, les conditions
de milieu dtermines par le climat n'ont pas la fixit que semblent
leur attribuer les moyennes enregistres par nos cartes. Le climat est
1. De l'influence de l'honune sur la terre (Annales de Gographie, tome X, 1901,
p. 98).
14
INTRODUCTION
une rsultante qui oscille autour d'une moyenne, plutt qu'il ne s'y
tient. Les donnes beaucoup trop imparfaites encore que nous poss-
dons, ont toutefois mis en lumire le fait que ces oscillations semblent
avoir un caractre priodique, c'est--dire qu'elles persistent plusieurs
annes tantt dans un sens, tantt dans un autre. Des sries pluvieuses
alternent avec des sries sches
; et si ces variations n'apportent pas
grand trouble dans les contrs abondamment arroses, il n'en est pas
de mme dans celles qui ne reoivent que le minimum ncessaire.
On comprend la porte de cette observation, car l'intervention de
l'homme peut consolider le moment positif, asseoir sur un tat tempo-
raire un tat fixe, fixe du moins jusqu' nouvel ordre.
Prenons un exemple : du Nord de l'Afrique au centre de l'Asie, les
observateurs sont frapps de spectacles de dsolation qui contrastent
avec les vestiges de culture et les ruines qui attestent une ancienne
prosprit. Celle-ci reposait sur le fragile chafaudage de travaux
d'irrigation, grce auxquels l'homme russissait tendre aux priodes
sches le bnfice des priodes humides. Que la fonction bienfaisante
soit interrompue quelque temps, tous les ennemis que combattait
l'irrigation prendront le dessus. Surtout, chose plus grave, l'adaptation
aura pris un autre cours. D'autres habitudes auront prvalu chez
les hommes
;
leur existence sera lie d'autres moyens, d'autres
tres exigeant d'autres disponibilits d'espace. La fort n'a pas de
plus grand ennemi que le pasteur
;
les digues et les canaux ont un
adversaire acharn dans le Bdouin dont elles gnent les prgrina-
tions.
L'action de l'homme tire sa principale puissance des auxiliaires
qu'elle mobilise dans le monde vivant : plantes de culture, animaux
domestiques
;
car il met ainsi en branle des forces contenues, qui
trouvent grce lui le champ libre, et qui agissent. La plupart des
associations vgtales formes par la culture se composent d'lments
primitivement disperss. C'taient des plantes niches sur des pentes
exposes au soleil, ou sur les bords des fleuves, qu'avait relgues
sur certains points la concurrence d'espces groupes en plus grandes
masses et constitues en plus gros bataillons. Du cantonnement pro-
pice o elles s'taient retranches, ces plantes, que la reconnaissance
des hommes devait un jour bnir, guettaient le moment o des cir-
constances nouvelles leur livreraient plus d'espace. L'homme, en les
adoptant dans sa clientle, leur a rendu ce service, il les a dlies.
Du mme coup, il a fray la route un cortge de vgtaux ou d'ani-
maux non convis
;
il a substitu des associations nouvelles celles
qui avaient avant lui pris possession de l'espace.
SENS ET OBJET DE LA GEOGRAPHIE HUMAINE 15
Jamais, sans l'homme, les plantes de culture qui couvrent aujour-
d'hui une partie de la terre, n'auraient conquis sur les associations
rivales l'espace qu'elles occupent. Faut-il donc penser que, si la main
de l'homme se retirait, les associations aux dpens desquelles elles
se sont tendues, reprendraient leurs droits ? Rien de moins certain.
Une nouvelle conomie naturelle peut avoir eu le temps de se substi-
tuer l'ancienne. La fort tropicale en disparaissant a fait place la
brousse ;
et ce changement, en modifiant les conditions de lumire,
a limin en partie les tres qu'elle abritait, notamment les glossines
redoutables qui en cartaient d'autres espces. Ailleurs c'est le sous-
bois qui, sous forme de maquis ou de garrigues, a succd la fort :
d'autres enchanements se sont produits, transformant aussi bien le
milieu vivant que les conditions conomiques. On entrevoit qu'un
champ nouveau, presque illimit, s'ouvre aux observations, peut-tre
l'exprimentation. En tudiant l'action de l'homme sur la terre,
et les stigmates qu'a dj imprimes sa surface une occupation tant
de fois sculaire, la gographie humaine poursuit un double objet.
Elle n'a pas seulement dresser le bilan des destructions qui, avec
ou sans la participation de l'homme, ont si singulirement rduit
depuis les temps pliocnes le nombre des grandes espces animales.
Elle trouve aussi, dans une connaissance plus intime des relations
qui unissent l'ensemble du monde vivant, le moyen de scruter les
transformations actuellement en cours et celle qu'il est permis de
prvoir. A cet gard, l'action prsente et future de l'homme, matre
dsormais des distances, arm de tout ce que la science met son ser-
vice, dpasse de beaucoup l'action que nos lointains aeux ont pu
exercer. Flicitons-nous-en, car l'entreprise de colonisation laquelle
notre poque a attach sa gloire, serait un leurre si la nature imposait
des cadres rigides au lieu d'ouvrir cette marge aux uvres de trans-
formation ou de restauration qui sont au pouvoir de l'homme.
PREMIRE PARTIE
LA RPARTITION DES HOMMES
SUR LE GLOBE
Vidal-Lablache, Gographie humaine.
PREMIRE PARTIE
LA RPARTITION DES HOMMES SUR LE GLOBE
CHAPITRE I
VUE D'ENSEMBLE
I.
INGALITS ET ANOMALIES
Pour apprcier les rapports de la terre et de l'homme, la premire
question qui se pose est celle-ci : comment l'espce humaine est-elle
rpartie sur la surface terrestre ? ou, pour serrer de plus prs, dans
quelles proportions numriques en occupe-t-elle les diffrentes con-
tres ? Il est prsumer, en effet, bien que le critrium ne soit pas
infaillible, que l'homme, rare ou nombreux, en groupes denses ou
clairsems, imprime au sol une marque plus ou moins durable, que son
rle est plus actif ou plus passif, qu'il s'exerce en tout cas d'une faon
diffrente.
Le gographe ne peut se contenter des chiffres que fournissent
les statistiques officielles. Il faut bien qu'il
y
joigne les donnes que
peuvent lui fournir des sources diverses, puisqu'il s'agit de dter-
miner, par la comparaison des espaces disponibles et des effectifs,
jusqu' quel degr est accomplie actuellement l'occupation humaine
de la terre. Toutes les parties de la surface terrestre doivent entrer
en ligne de compte
; ce qui, malgr l'insuffisance de certains rensei-
gnements, n'a rien aujourd'hui de chimrique. L'ensemble seul a une
pleine signification, prcisment par les diffrences, les contrastes et
anomalies qu'il dcouvre. Ces anomahes ne laissent pas d'tre sug-
gestives. L'aire de rpartition d'une espce, qu'il s'agisse de l'homme
ou de toute autre espce vivante, n'est pas moins instructive par les
20 LA RPARTITION DES HOMMES SUR LE GLOBE
lacunes et les discontinuits qu'elle rvle, que par les tendues qu'elle
couvre.
On estime que la population de la terre, en 1913, s'lve environ
1.631.517.000 habitants
^.
D'o il rsulterait, pour l'ensemble de la
terre, une densit moyenne de 11 habitants par kilomtre carr :
chiffre qu'on peut traiter de pure abstraction, car, entre le maximum
atteint par les civilisations avances et le minimum ralis par les
socits rudimentaires, il ne correspond aucune tape qui semble
durable dans les contres en voie de peuplement. Or, comment cette
population est-elle rpartie ? Les deux tiers des habitants de la terre
sont concentrs dans un espace qui n'est que le septime de sa super-
ficie
^.
L'Europe, l'Inde, la Chine propre et l'archipel du Japon ab-
sorbent eux seuls plus d'un milliard d'habitants. C'est dans ce groupe
de territoires, isols les uns des autres, rests longtemps sans rapports
directs, que se sont rassembls tous les gros bataillons. Un autre groupe,
il est vrai, s'avance depuis un sicle pas de gant : on compte, en 1910,
plus de 101 millions d'habitants aux tats-Unis. Ce chiffre, toutefois,
n'gale pas encore le quart de la population de l'Europe, superficie
peu prs gale.
Bien plus fortement s'accusent les diffrences, si on les calcule
entre contres situes au Nord et contres situes au Sud de l'qua-
teur. La zone tempre est loin d'atteindre sans doute dans l'hmis-
phre austral la mme tendue que dans le ntre
;
mais si l'on com-
pare la population du Sud du Brsil, des tats de la Plata, du Chili,
du Cap, de l'Australie et de la Nouvelle-Zlande celle qui occupe des
rgions correspondantes et ni plus ni moins favorises dans notre
hmisphre, la disproportion, malgr les accroissements rcents qui
modifient peu peu la balance, reste encore extrmement marque.
Il faut valuer 15 millions environ de kilomtres carrs, une fois et
demie l'Europe, l'tendue des contres tempres de l'hmisphre
austral
;
et ce n'est gure, tout compte fait, qu'au chiffre de 26
27 millions qu'on peut en estimer la population actuelle.
Un certain rapprochement tend sans doute s'oprer entre ces
chiffres ;
mais combien grande est encore la distance conqurir, si
tant est qu'elle doive tre conquise ! On peut dire que, avant l'essor
inou de l'migration europenne au xix^ sicle, phnomne qui repr-
1. Otto Hubner's geographisch-statistische Tabellen, 62. Ausg., Frankfurt-a-M.,
1913.
2 Europe, 448 millions d'habitants ;
Inde (sans la Birmanie et les dpendances
extrieures), 302 millions
;
Chine propre, 326 millions
; Japon (sans les dpendances),
52 millions.
VUE D'ENSEMBLE 21
sente un point tournant dans l'volution du peuplement humain, la
rpartition de notre espce sur le globe ne diffrait gure de ce que l'on
observe aujourd'hui, par exemple, Madagascar, o plus du tiers
de la population s'accumule sur un espace qui n'est que le vingtime
de l'le.
De telles ingalits sont-elles justifies par les conditions natu-
relles ? La multiplication de l'espce humaine rencontre de graves
obstacles, en partie insurmontables, soit dans une surabondance de
vie vgtale et microbienne, touffant l'activit de l'homme, comme
c'est le cas dans les silves quatoriales
;
soit dans une pnurie qui,
par insuffisance d'eau ou de chaleur, anmie en quelque sorte toutes
les sources d'existence. Au contraire, la clmence du climat, l'abon-
dance spontane des moyens de nourriture sont des circonstances
propices. On a essay, la suite de Candolle, de dresser le bilan des
plantes nourricires d'aprs l'origine : si parmi les rgions les plus
favorises on compte le domaine mditerranen et l'Inde, le Soudan
pourrait
y
figurer au mme titre, et l'on ne voit pas que sa contribu-
tion ait jamais t bien forte au peuplement du globe. Un critrium plus
sr serait dans les facilits d'acclimatation qu'offrent certains climats.
Celui, par exemple, o une priode pluvieuse et chaude de quatre
cinq mois succde des hivers de temprature et d'humidit mod-
res, permet la vgtation d'accomplir par an deux cycles et l'homme
de pratiquer deux rcoltes. Les Europens s'merveillent du chan-
gement vue qui, de mai juin, transforme les campagnes du Sud
du Japon. Aux joies bruyantes de la moisson succde en un clin d'il
l'activit silencieuse des nouveaux germes qu'on vient de dposer
dans le sol. Ce rgime, qui est celui de l'Asie des moussons, a srement
stimul la fcondit humaine
;
mais l'a-t-il fait partout ?
Un autre type de climat favorable, quoique moins libral en somme,
est celui qui mnage la vgtation, aprs une interruption hiver-
nale, une priode d'au moins six mois de temprature dpassant
10 degrs, avec des pluies suffisantes. Le cycle est assez long pour
ouvrir l'acclimatation une marge considrable ;
il est peu de crales
qui n'y trouvent place, et avec elles nombre d'arbres fruitiers et de
lgumineuses. Cette heureuse varit, par les compensations qu'elle
offre et les garanties contre ce danger de famine qui fut le cauchemar
des anciennes socits humaines, est assurment une des circonstances
les plus propices qu'ait pu rencontrer leur dveloppement.
Aucune de ces causes ne peut tre nglige
; aucune ne peut suffire.
Tout ce qui touche l'homme est frapp de contingence. De toutes
22 LA RPARTITION DES HOMMES SUR LE GLOBE
parts, ct de domaines propices o l'homme a multipli, on peut
en signaler de semblables dont les effets ont t faibles ou nuls : ct
du Bengale surpeupl, l'Assam et mme la Birmanie faiblement
occups
; ct du Tonkin, le Laos. Et qu'tait, avant le dernier sicle,
cette valle du Mississipi dont le climat, avec ses pluies de printemps
et de commencement d't, est, au dire de A. W. Greely ^
une des
principales bases sur lesquelles repose la prosprit de la grande
Rpublique ? Un terrain de chasse qui, devenu terrain agricole, ne
peut opposer l'Europe qu'une densit infrieure 20 habitants
par kilomtre carr.
La mme impression d'ingalit et d'anomalie nous frappe, si nous
tournons notre attention vers ces marches-frontires de la terre habite
que l'homme n'occupe qu' son corps dfendant, sans doute sous la
pression des populations voisines. Notre race a pouss des avant-
postes dans les hautes altitudes, dans les dserts, dans les rgions
polaires. Il
y
a, dans cette extension de l'homme en dpit du froid,
de la scheresse, de la rarfaction de l'air, un dfi qui est bien une des
affirmations les plus remarquables de son hgmonie sur la nature.
Dans ces domaines qui semblaient pour lui frapps d'interdit, l'homme
s'est avanc
;
mais pas partout du mme pas. La force d'impulsion
qui a pouss l'humanit hors de ses Umites naturelles, s'est exerce
ingalement suivant les rgions.
C'est dans l'hmisphre boral de l'ancien continent que les rgions
dsertiques ont le plus d'tendue
;
elles sont pourtant relativement
moins dpourvues de population que les parties arides de l'Amrique
et de l'Australie. L'homme a russi s'y accrocher tout ce qui
pouvait lui donner quelque prise. Les explorations qui de nos jours
ont pntr au plus profond des continents nous permettent de cir-
conscrire peu prs les parties o l'homme ne parat qu' la dro-
be et en fugitif. L'Arabie a le Dahna
;
l'Iran, ses Khvir et ses
Karakoum
;
le Turkestan, son Taklamakan ;
le Tibet, ses lugubres
plateaux que l'on traverse des semaines entires sans rencontrer
un tre humain. Le Sahara oriental, dans le dsert de Libye, qui a
pourtant ses oasis, et le Sahara occidental, dans le Tanesrouft, sont des
dserts au sens absolu. Mais, en dehors de ces parties tout fait dsh-
rites, nous remarquons que, dans ces rgions arides d'Afrique et
d'Asie, pour peu que s'offre un espace moins inhospitaher, une popu-
lation s'en est empare. Ds qu'un peu d'eau apparat ou se laisse
1. Type Tennessee
; type Missouri. (A. W. Greely, Rainfall Types
of
ihe United
States, dans National Geog. Mag., V, 1893, p. 46.)
VUE D'ENSEMBLE 23
souponner, l'homme, guettant ces points d'lection, a creus des
puits, pratiqu des canalisations qu'il a prolonges parfois par un
effort sans cesse renaissant, obstin devant l'aggravation des svrits
du climat avoir tout de mme le dernier mot. Il lutte comme agri-
culteur ;
il lutte aussi comme pasteur, rdant de pturages en ptu-
rages, mesure qu'ils s'puisent, ce qui ne tarde gure. On a dit de
ces tribus touareg que, si peu nombreuses qu'elles soient, elles sont
encore en excs par rapport aux ressources de la contre
^.
Si donc il
y
a des contres o l'on s'tonne de trouver trop peu d'hommes, il
y
en a d'autres o l'on peut s'tonner bon droit d'en rencontrer trop.
Les hautes altitudes sont l'quivalent des dserts. A 5.000 m., la pres-
sion de la colonne d'air a dj diminu de moiti, les sources de cha-
leur vitale s'appauvrissent dans l'oxygne rarfi
;
et cependant, ds
400 ou 500 m. au-dessous de cette altitude, au Tibet, commencent
se montrer quelques bourgades en pierre et des rudiments de culture.
Presque aussi haut, sur les plateaux du Prou et de la Bolivie, se
hasardent quelques tablissements miniers et quelques lopins de terre.
C'est dans les climats secs, exempts des brouillards intenses et de
l'humidit quatoriale, que l'habitat permanent atteint ses plus
grandes altitudes : il s'panouit entre 3.000 et 2.000 m. sur les plateaux
tropicaux de la rgion sche, au Mexique comme en Abyssinie et dans
l'Ymen. Point de diffrence en cela entre l'ancien et le nouveau
monde
; ces hauts plateaux furent mme le sjour de prdilection
des civilisations amricaines. Mais, dans les montagnes de la zone
tempre, les choses ont pris un cours diffrent. La zone des pturages,
qui surmonte celle des forts, est frquente dans le Pamir, l'Ala,
les Tian-chan, par les ptres kirghiz des hauteurs dpassant 4.000 m.
Moins levs, quoique dpassant parfois 3.000 m., sont les
y
allas, do-
maines o s'est implante la vie pastorale des Kourdes et des Turco-
mans. Enfin le mot Alpes tait dj connu des anciens comme syno-
nyme de hauteurs et de pturages. Cette annexion rgulire des hautes
altitudes la vie conomique n'avait jusqu' nos jours rien d'quiva-
lent dans les Parcs des Montagnes Rocheuses, les Paramos des Andes,
sans qu'aucune raison de climat ni mme de faune justifit ces diff-
rences. Sans doute la prsence de l'homme n'y est que temporaire
;
mais c'est prcisment l'envergure de ses migrations et de l'espace
qu'elles englobent, que se mesure, dans ces rgions en marge, la force
d'expansion de l'humanit.
1. F. FouREAU, Documents scientifiques de la Mission saharienne (Mission Fou-
reau-Lamy), t. II, Paris, 1905, p. 840.
24 LA RPARTITION DES HOMMES SUR LE GLOBE
La plus sensible ingalit, en somme pourtant, est celle qui se rvle
entre le Nord et le Sud, entre l'hmisphre continental et l'hmisphre
ocanique, Vardoge et la notoge de certains zoologues. C'est un
fait remarquable que l'existence d'une chane de populations adaptes,
sur presque toute l'tendue du front que les terres opposent au ple
boral : de la pninsule des Tchouktches la Laponie, du Groenland
l'Alaska. Numriquement faibles, elles rachtent cette infriorit
par l'amplitude de leurs mouvements. On a trouv des traces d'ta-
blissements temporaires jusqu'au del de 80^ de latitude dans le Groen-
land. L'habitat ne saurait avoir, dans ces parages, de limites fixes.
Un perptuel va-et-vient
y
est la loi d'existence des animaux et des
hommes. Il
y
a un flux et un reflux dans cette mare humaine qui bat
les abords inhospitaliers du ple septentrional. Nulle trace de cette
nergie d'expansion, de cette force de conqute, ne se montre dans les
extrmits mridionales que projettent les continents en face du
ple oppos. Le climat n'et pas t plus dfavorable
; tout au con-
traire. Les tapes intermdiaires n'eussent pas manqu entre la Terre
de Feu et les terres antarctiques
;
la distance de 700 800 kilom. qui
les spare n'et pas t au del des moyens de navigateurs tels que les
Eskimaux. Et pourtant, il n'a pas t trouv trace humaine dans
l'intrieur des fiords relativement abrits de la Terre de Graham,
la latitude de l'Islande. L'effort a langui faute d'espace ; et l'infrio-
rit relative que l'on constate chez les mammifres de l'hmisphre
austral semble s'tre tendue aux hommes.
Il rsulte de ce qui prcde que la rpartition des hommes ne s'expli-
que pas par la valeur des contres. Celui qui, jetant un regard de
connaisseur sur les climats et les sols, essayerait d'en dduire le degr
d'occupation humaine, s'exposerait des mcomptes. Le calcul d'un
fermier supputant les probabilits de rcoltes d'aprs les qualits
de ses champs, n'est pas de mise pour le gographe. Une foule d'ano-
malies nous avertissent que la rpartition actuelle de l'espce humaine
est un fait provisoire, issu de causes complexes, toujours en mouvement.
Actuellement, nous constatons, dans un coup d'il d'ensemble, un
chiffre approximatif reprsentant le total des hommes trs ingale-
ment rpartis sur la surface terrestre. Cet tat n'est qu'un point, et
nullement un point d'quilibre, dans une volution dont nous ne pou-
vons encore saisir que trs imparfaitement les allures. Parmi les
causes dont il drive, il
y
en a qui persistent, d'autres qui s'teignent,
d'autres qui entrent en jeu. Le rsultat actuel est essentiellement
mobile et provisoire
;
nanmoins, c'est un rsultat, ayant comme tel
la valeur d'un point de perspective, d'o il est possible d'observer
VUE D'ENSEMBLE
25
rtrospectivement la marche des phnomnes, et peut-tre de hasarder
quelques prvisions.
Sur ce point, toutefois, une grande rserve s'impose. On a exprim,
au xviii^ sicle, l'opinion que la terre pourrait tout au plus nourrir
trois milliards d'habitants. Il suffirait ce compte que la population
actuelle doublt, comme elle a fait en Europe au xix sicle, pour que
le plein ft dpass. Tmoins du peuplement actif de nombre de
contres nouvelles, nous sommes tents aujourd'hui de nous croire
en marche vers des totaux bien suprieurs. Nous pourrions peut-tre
nous tromper aussi, et exagrer les chances futures de population,
comme nos devanciers taient enclins les rduire. Rien ne dit qu'il
y
ait, entre rgions analogues, une densit normale atteinte par les unes,
vers laquelle les autres s'acheminent. Il
y
a trente ou quarante ans,
une des contres les plus fertiles du monde, celle des Prairie States,
au centre des tats-Unis, s'est leve presque d'un bond 16 ou
17 miUions d'mes
;
ce chiffre ne reprsente en somme qu'une densit
de 15 20 habitants par kilomtre carr, bien infrieure celle des
contres agricoles d'Europe
; et il ne semble pas, d'aprs les derniers
recensements, qu'il
y
ait tendance le dpasser
^.
La civilisation contemporaine met en mouvement, ct de causes
qui favorisent l'accroissement de la population, d'autres causes qui
tendraient plutt la rduire. Si ce sont surtout les premires qui ont
agi pendant le xix sicle, il se pourrait que les autres prissent le dessus
au cours des gnrations suivantes.
II.
LE POINT DE DPART
On pourrait penser que les irrgularits que prsente la rparti-
tion de l'espce humaine sont dues un tat d'volution peu avance.
L'homme tant nouveau-venu dans certaines parties de la terre, on
s'exphquerait que ces rgions n'eussent pas encore le nombre d'habi-
tants que mriteraient leurs ressources. Elles n'auraient commenc
que tard tre atteintes par la mare montante du flot humain. Mais
cette vue n'est pas confirme par les faits
;
car il semble que, presque
sur tous les points de la terre, l'homme est un hte dj trs ancien.
Les recherches qui ont t pousses de nos jours dans les parties
les plus diverses de la surface terrestre ont mis jour, soit sous forme
de squelettes, soit sous forme d'objets travaills, des traces presque
universelles de l'antique prsence de l'homme. Des enqutes syst-
1. On observe mme une lgre diminution dans l'tat d'Iowa de 1900 1910.
26 LA RPARTITION DES HOMMES SUR LE GLOBE
matiques dans l'Amrique du Nord ont conclu la diffusion gnrale
de l'homme quaternaire sur ce continent. Ni dans l'Amrique du Sud,
ni au Cap, ni en Australie, c'est--dire dans les parties de la terre qu'on
pourrait croire arrires, les antiques vestiges humains ne font dfaut.
C'est un fait acquis que ds les ges dits palolithiques, tandis que les
glaciers qui avaient envahi une partie des continents n'avaient pas
encore accompli leur retrait dfinitif, l'humanit avait dj ralis
un progrs qui constitue, dans la classe suprieure des tres vivants,
une vritable singularit gographique : elle avait tendu son aire
d'habitat dans des proportions telles qu'elle quivalait presque
l'ubiquit. Ce privilge de quasi-ubiquit, elle l'avait communiqu
dj, ou devait le communiquer dans la suite, aux animaux entrs
dans sa clientle, notamment au chien, son prcoce acolyte.
Cette vaste et prcoce diffusion , suivant l'expression de Darwin
\
suppose l'exercice d'une mentalit suprieure
;
elle prouve qu'il tait
de longue date arm des dons intellectuels et sociaux qui pouvaient
assurer son succs dans la lutte pour l'existence. Ds lors et pas plus
tt commence l'uvre dont nous avons nous occuper ici, l'uvre
gographique de l'homme. Les routes de la gographie se dtachent
ce moment de celles de l'anthropologie. Par quelle suite d'acquisitions
et de perfectionnements, mls de pertes certains gards, l'organisme
humain tait-il entr en possession de ces prcieux avantages ? A l'an-
thropologie de le rechercher. Nous ne pouvons ici que jeter un regard
furtif sur ces questions d'origine. Ce n'est pas le dbut, mais l'aboutisse-
ment d'une longue volution antrieure qui correspond au moment
o l'homme s'est rpandu sur la terre.
A une poque o ni le climat, ni la configuration des terres et des
mers ne correspondaient exactement l'tat actuel, il se prsente
nous comme un tre constitu de longue date en ses traits fondamen-
taux, en possession d'une quantit de traits communs qui excdent
de beaucoup la somme des diffrences. Si intressant qu'il soit de
constater chez l'Australien ou le Ngrito un moindre dveloppement
de la colonne vertbrale, une gracilit plus grande des membres inf-
rieurs servant de support au tronc, ces diffrences sont peu de chose
en comparaison de la chane de ressemblances physiques et morales
qui unit entre eux les membres du genre humain et en fait un tout.
Je ne puis parler qu'en passant de l'enqute ethnographique qui,
de nos jours, s'est tendue aux peuples les plus divers. Sous les variantes
1. Ch. Darwin, Descendance de l'homme, chap. vu, p. 197 (trad. fr. de M. E. Bar-
bier, Paris, 1874).
VUE D'ENSEMBLE
27
des milieux ambiants, une impression d'unit domine. Comment
expliquer qu' travers ces diffrences on ait tant d'occasions de cons-
tater entre contres trs loignes des similitudes et des convergences ?
Sur les principaux incidents de l'existence, et particulirement sur
la mort, la maladie, la survivance des mes, des ides qu'on peut
regarder comme le triste et universel partage de l'humanit ont engen-
dr des rites, des superstitions, des reprsentations figures, masques
ou statuettes, tout un matriel ethnographique analogue. Il
y
a un
fond primitif commun, sur lequel l'homme se rencontre peu prs
partout semblable lui-mme. Conformment aux mmes ides
il a dress, align, chafaud des blocs ou simplement amoncel des
pierres pour abriter des spultures. Suivant les mmes arrangements
il a construit en Suisse et en Nouvelle-Guine des cases lacustres sur
pilotis. On peut se demander si ces analogies ne s'expliquent pas par
des emprunts rciproques, car les relations, mme grande distance,
n'ont jamais manqu absolument. Les emprunts deviennent toutefois
fort invraisemblables entre contres arides spares par la zone qa-
toriale, ou entre contres tropicales spares par des ocans. Combien
n'a-t-il pas fallu de sicles, en Europe mme, pour que l'usage du fer,
connu sur les bords de la Mditerrane, se rpandt en Scandinavie ?
L'hypothse d'emprunts, quand elle ne s'appuie que sur ces analogies
mmes, est gratuite. Il faut se rappeler que nos conceptions et nos
habitudes se sont accumules sur un tuf plus ancien et plus profond
qu'on n'imagine.
Cette diffusion gnrale de l'espce humaine s'effectua par des voies
que nous n'avons pas le moyen de retracer. Soit qu'il
y
ait eu un
centre unique de dispersion, soit qu'on admette une pluralit qui,
en tout cas, ne put tre qu'assez restreinte, il faut que l'humanit ait
trouv devant elle de vastes espaces continus pour se rpandre. Un
morcellement insulaire et t incompatible avec les dplacements
que suppose cette extension. C'est comme tre terrien, par les moyens
de locomotion appropris son organisme, qu'il put franchir des dis-
tances qui nous tonneraient si nous ne savions pas de quoi sont
capables les peuples primitifs. La mer n'entra que plus tard au service
des migrations humaines. Il est significatif que les tribus vivant
proximit de la mer ou mme dans des archipels, comme ces Ngritos
pars sur les ctes mridionales de l'Asie, soient restes trangres
toute vie maritime. L'usage de la navigation est un progrs tardive-
ment acquis, qui resta longtemps l'apanage d'un petit nombre, et
qu'on ne saurait compter au rang de ces inventions primordiales qui
htrent universellement la diffusion de l'humanit.
28 LA RPARTITION DES HOMMES SUR LE GLOBE
Quand les Europens ont tendu leurs dcouvertes et leurs obser-
vations sur l'ensemble du globe, ils ont trouv beaucoup de tribus
qui ignoraient l'usage de la voile, d'autres qui ne pratiquaient pas la
poterie, un plus grand nombre auxquelles les mtaux taient inconnus
;
mais la possession du feu faisait partie du patrimoine commun. Des
trouvailles d'objets calcins accompagnent les plus anciennes traces
de l'homme. La diffrence des procds en usage pour obtenir le feu,
par frottement, par percussion, ou autres moyens plus particuliers,
indique que l'invention dut s'accomplir d'une faon indpendante
en diffrents points de la terre. Il n'est pas interdit de penser que ce
fut dans une des rgions tropicales intervalles de saison sche que
l'invention fit fortune. Lorsqu'on nous conte comment les indignes
de l'Afrique tropicale recueillent, sur une couche d'herbes sches
particulirement inflammables, la poudre incandescente qu'ils ont
fait jaillir en frottant une pice de bois tendre avec une pice de bois
pointue, il semble qu'on assiste une des expriences dcisives qui
donnrent lieu la conservation et au transport de la flamme une fois
obtenue. Le climat qui met porte l'un de l'autre le tapis dessch
de la brousse et le bois dur, c'est--dire le combustible et l'allumette,
reprsente le miheu le plus favorable la marche de cette invention.
C'est l sans doute que vcurent les Promthes inconnus qui par-
vinrent les premiers s'approprier cette force incalculable que recelait
un jaillissement d'tincelle.
L'extension presque universelle d'une trs ancienne humanit
s'explique par la possession de cette arme. Le feu n'tait pas seule-
ment un instrument d'attaque et de dfense contre la faune rivale,
laquelle elle avait disputer son existence ; il lui fournit la possibilit
de s'clairer, de cuire ses aliments. L'homme put ainsi s'accommoder
peu prs de tous les climats, disposer d'un plus grand nombre de
moyens de nourriture. Il fut plus libre de se mouvoir travers la
cration vivante.
Ce ne fut, il est vrai, qu'une couche trs mince et discontinue que
la population qui se rpandit ainsi sur la surface de la terre. La com-
paraison des peuples actuels dont les genres de vie se rapprochent de
ceux que pratiquaient ces primitifs, peut donner quelque ide de la
densit moyenne qu'ils pouvaient atteindre. Exceptons comme ngli-
geable la minime somme d'habitants relgus au del du cercle polaire
ou dans les dserts intertropicaux : il
y
a, aux abords de
60^^
lat. N.,
une srie de peuples de civilisation relativement fixe, auxquels la
chasse et la pche, accompagnes chez quelques-uns d'un peu d'le-
vage et d'agriculture, fournissent le principal de leur subsistance.
VUE D'ENSEMBLE 29
Tchouktches,
Toungouses, Iakoutes, Samoydes, Lapons, etc., cir-
culent ainsi travers cet ensemble de forts, steppes et toundras
qui composent dans l'Asie septentrionale un paysage peu diffrent
de celui o nos palolithiques de l'Europe centrale chassaient le renne.
Un nomadisme rgl d'aprs les migrations des animaux, ainsi que la
ncessit de ne se mouvoir que par petits groupes : telles sont les condi-
tions actuelles, analogues celles qu'on entrevoit dans le lointain
pass. Elles sont favorables une large diffusion en espace, comme le
prouve l'extension des Eskimaux, et elles s'accordent ainsi avec les
faits que constate l'archologie prhistorique. C'est donc une leon
d'archasme que nous donne cet tat social. Lorsqu'on a essay d'va-
luer en chiffres la population de ces peuples
^
qui garnissent sur une
tendue immense la ceinture borale des continents, les calculs les
plus probables ne sont pas arrivs un total de 500.000 habitants :
ce n'est pas mme 1 par kilomtre carr
;
ils ne composeraient pas,
eux tous, la population d'une seule de nos grandes villes de deuxime
ordre I De vastes espaces n'ont pu tre occups autrement pendant la
priode, dcisive dj pour l'avenir, de la cration vivante, o l'homme,
arm du feu, entra, nouveau champion, dans l'arne.
Ce n'est pas que, ds cette poque, il ne se soit form sur certains
points de premires bauches de condensations humaines. La pche,
plus que la chasse,
y
donna lieu. Parmi les amas de rebuts de cuisine
(kfkkenmddingen) trouvs sur les ctes de Danemark, o des dbris
d'oiseaux et de btes sauvages se mlent des amoncellements d'artes
de poissons et d'caills de mollusques, il
y
en a qui n'ont pas moins
de 400 pieds de long, 120 de large, et jusqu' 8 pieds de haut
2.
Ils
datent d'une poque o l'homme n'avait d'autres instruments que des
os ou des silex taills, ni d'autre animal domestique que le chien.
L'abondance du menu, autant que les dimensions des amas, montrent
que des groupes relativement nombreux ont vcu l. La mer, au
contact des ctes ou des bancs qui favorisent l'accomplissement des
fonctions vitales, est une grande pourvoyeuse de nourriture. Des
tmoins ont dcrit, sur les ctes mridionales du Chili, les scnes qui
se droulent mare basse, quand non seulement hommes et femmes,
mais chiens, porcs et, avec de grands cris, oiseaux de mer accourent
vers la provende laisse par le flot, vers la table que quotidiennement
la nature tient ouverte tous ces commensaux.
La vie de pche ctire suppose un certain degr de sdentarit
1. Vo" notamment les calculs de Kurt Hassert (Petermanns Mitt, XXXVII,
1891, p. 152 ; carte, pi. 11).
2. Muse National de Copenhague.
30 LA RPARTITION DES HOMMES SUR LE GLOBE
qui s'accommode d'une densit suprieure. C'est elle qui, ds les
temps trs anciens, a ramass sur les ctes du Japon une population
de professionnels, vivant de poissons crus, dont le nombre, encore
aujourd'hui, gale le vingtime de la population totale de l'Empire du
Soleil-Levant. Peut-tre a-t-elle contribu aussi condenser les popu-
lations de la Chine mridionale. Sur les ctes de la Colombie Britan-
nique, les ethnologistes amricains ont remarqu que les tribus Nutkas,
Thlinkits, Hadas, qui se livraient la pche, avaient une densit trs
suprieure celle des Algonquins vivant de chasse dans l'intrieur
des continents
^.
On saisit dans ces faits le premier anneau de chanes qui ne se sont
pas rompues ;
on peroit des consquences significatives de diffrences
sociales dj applicables ces anciens ges.
N'exagrons pas cependant. Une contre que son isolement conserve
archaque, l'Islande, peut servir de terme de comparaison. Dresse
au milieu de l'Ocan comme un pilier d'appel pour les tres vivants de
l'air et des eaux, elle mnage aux poissons l'abri de ses fiords, aux
oiseaux de mer les anfractuosits de ses falaises, tous des refuges
o ils viennent frayer et nicher
;
et dans ce pullulement de vie animale
ne manquait pas encore il
y
a un demi-sicle le grand pingouin,rAZca
impenniSy un des animaux aujourd'hui disparus dont les restes entrent
dans la composition des kjokkenmddingen. La population humaine
n'a pas manqu d'affluer aussi ce rendez-vous, particuUrement
sur la cte de l'Ouest, baigne par les courants chauds. Les contin-
gents, si clairsems dans l'intrieur, s'y renforcent. Mais combien se
monte au total la densit de l'troite bande littorale ? A 9 habitants
environ par kilomtre carr. C'est sans doute, par analogie, le maximum
qu'on puisse envisager pour les poques primitives.
Que sur de vastes espaces, parcourus par des poignes d'hommes,
certaines places favorises en aient retenu ensemble un plus grand
nombre : il faut donc l'admettre. Mais ce maximum ancien de densit ne
reprsenterait qu'un minimum dans les conditions actuelles
;
c'est le
plus que puissent atteindre les libres dons de la nature.
Il
y
a lieu de se demander si cette espce humaine aux rangs si
clairsems a pu exercer dj une influence sensible sur la physionomie
de la terre. Serf des conditions naturelles, l'homme tait-il en mesure
de les modifier ? Il ne faudrait peut-tre pas se hter de conclure
par la ngative. Les usages du feu sont multiples
;
rien ne prouve
1. J. W. PowELL, Seventh Annual Report
of
the Bureau
of
Ethnology, 1885-86,
Washington, 1891, p. 30 et suiv.
VUE D'ENSEMBLE 31
qu'il se soit born allumer des foyers fugitifs, comme ceux qui noir-
cissent pour quelques jours le sol, l o a stationn un campement
de nomades. L'ide de mnager des espaces dcouverts est ne, comme
la domestication du chien, d'un besoin de scurit et de vigilance,
qui semble avoir prsid ds les premiers temps aux moindres tablisse-
ments humains. A dfaut d'instruments capables de venir bout des
arbres, le feu offrait le moyen d'extirper la vgtation parasite, de
dgager le sol environnant, d'carter les possibilits d'embuscades
et de surprises.
L'humidit du climat ne protge la fort que lorsqu'elle n'est pas
interrompue priodiquement par le retour de longs mois de scheresse.
Les incendies de brousse qui avaient frapp le navigateur Hannon
le long des ctes du Sngal, se pratiquent encore en grand jusque
dans les parties les plus intrieures de l'Afrique. La cendre de certaines
plantes fournit le sel, condiment essentiel de nourriture
;
l'herbe crot
plus fine et plus savoureuse, plus recherche par les antilopes, la
suite des incendies qui ont amend le sol. Et si le chasseur tire parti
de ces avantages, il n'est pas dit qu'ils aient pass inaperus pour ceux
de ses compagnons ou de ses compagnes qui pratiquaient dj la cueil-
lette de certaines graines alimentaires. L'usage de semer des grains
sur brlis, pour en tirer successivement deux ou trois rcoltes, est
une des formes les plus universellement rpandues de culture pri-
mitive. Elle s'associe naturellement la vie de chasse
;
comme on
le voit encore chez les tribus Gonds, Bhils ou autres, qui hantent
les plateaux herbeux de l'Inde centrale.
Beaucoup de parties de la terre ont chapp sans doute toute
modification sensible pendant ces priodes, puisqu'il en reste encore
aujourd'hui que l'action de l'homme n'a pas atteintes. Mais il n'en fut
pas de mme partout. Le paysage naturel fut entam l'endroit le
plus sensible. La rduction de l'tendue forestire au Nord et au Sud
de la zone quatoriale est un fait qui frappe les observateurs sp-
ciaux. L'existence de nombreux reprsentants du sous-bois dans des
espaces aujourd'hui dcouverts, la transformation de lianes qui,
d'ariennes, sont devenues quasi souterraines pour s'adapter de nou-
velles conditions d'existence, semblent indiquer qu'une partie du
domaine immense occup par la savane a t taill aux dpens de la
fort. Si l'on voit celle-ci, ds qu'on s'loigne de quelques degrs de
l'quateur, se rfugier, pourchasse des plateaux et des croupes,
dans les ravins et valles, le climat seul n'est pas responsable de cette
limination. Beaucoup de vestiges de l'ge de pierre, par exemple
dans le Fouta-Djalon et le Soudan occidental, nous avertissent qu'il
32 LA RPARTITION DES HOMMES SUR LE GLOBE
faut beaucoup tenir compte de l'homme. C'est dans ces rgions que
s'est droul le premier acte de cette lutte aveuglment sans merci
que l'homme a engage et qu'il poursuit encore contre l'arbre.
Son action s'exerait cet gard, de compUcit avec la puissante
faune d'herbivores que l'poque miocne avait rpandue dans le
monde. Runies par bandes normes, telles que les ont dcrites avec
stupfaction certains observateurs, dans l'Afrique centrale, les anti-
lopes sont, certains moments de l'anne, une arme dvorante,
dont les jarrets nerveux tendent au loin les ravages. D'immenses
quantits de nourriture herbace ont d alimenter les besoins de ces
troupeaux d'hmiones, onagres, chevaux, lphants sauvages, ainsi
que de ces bisons qui, avant 1870, s'taient multiplis par plusieurs
dizaines de millions dans les Prairies des tats-Unis. L'herbe renat
la pluie suivante, mais les jeunes pousses d'arbres sont dtruites.
Dans la concurrence toujours allume entre l'herbe et l'arbre, l'action
de ces armes d'herbivores, dont nous ne voyons plus aujourd'hui que
des effectifs rduits, pesa certainement d'un grand poids. L'homme,
plus tard, eut les combattre pour dfendre contre eux ses cultures
;
mais l'origine il avait trouv en elles des auxiliaires pour l'aider
se faire place nette.
CHAPITRE II
FORMATION DE DENSIT
I.
GROUPES ET SURFACES DE GROUPEMENTS
Depuis l'poque lointaine o l'espce humaine se rpandit sur les
continents, elle a peu gagn en diffusion. Les progrs accomplis sous
ce rapport dans la priode qui nous est connue se rduisent peu de
choses : quelques les au centre de l'Atlantique et surtout dans l'ocan
Indien et les mers australes. Que les Mascareignes, 150 lieues seule-
ment de Madagascar, fussent restes un asile o vivait en paix, avant
l'arrive rcente de l'homme et du chien, le dronte (Dudo ineptus),
cela ne laisse pas de surprendre. Le flot humain a fini par atteindre
ces rogatons terrestres
;
mais ces maigres annexions se borne peu
prs le bilan des conqutes rcentes de Vcoumne. En revanche,
la population a gagn prodigieusement, quoique ingalement, en
densit. Elle s'est moins accrue en tendue qu'elle ne s'est localise
en profondeur.
Il faut s'unir pour collaborer, en vertu des ncessits primordiales
de la division du travail
;
et d'autre part des difficults s'opposent la
coexistence de forces nombreuses runies. Tel fut le dilemme qui s'est
pos aux socits les plus rudimentaires, aussi bien qu'il se pose aux
civilisations les plus avances. Il n'y a pas d'hiatus entre les deux,
mais seulement des diffrences de degrs. Quelle que soit l'impor-
tance des groupes dont il fait partie, l'homme n'agit et ne vaut go-
graphiquement que par groupes. C'est par groupes qu'il agit la sur-
face de la terre
;
et mme dans les contres o la population semble
former un ensemble des plus cohrents, elle se rsoudrait, si l'on regar-
dait de prs, en une multitude de groupes ou de cellules vivant, comme
celles du corps, d'une vie commune.
Groupes molculaires.
Ces groupes sont en dpendance mani-
feste de la nature des contres. Comme les plantes se rabougrissent
Vidal-Lablache, Gographie humaine. 3
34 LA RPARTITION DES HOMMES SUR LE GLOBE
dfaut de chaleur ou d'humidit, ainsi se racornissent en pareilles
conditions les groupes humains. Une douzaine de huttes, chez les
Eskimaux, pass pour une grande agglomration
;
et au del de 75
de latitude, le maximum est de deux ou trois. Un rassemblement de
14 yourtes est un village qui fait figure dans la province d'Anadyr
^.
La scheresse au Sahara, dans le Kalahari, en Australie, produit le
mme effet que le climat polaire. Foureau note chez les Touareg le
fractionnement infmi par petits groupes des habitants ^.
Dans l'Ar,
les groupes se rduisent 3 ou 4 tentes
^.
Les krals des Hottentots
runissent parfois plus de 100 individus
;
on en compte peine une
douzaine dans les campements de Bochimans ou d'Australiens.
Ailleurs, dans la silve quatoriale africaine, dans la montana ou les
bosques du versant oriental des Andes, l'importance des tablissements
humains est en proportion inverse de la luxuriance vgtale. Ce qu'on
rencontre au Congo, entre l'quateur et le
6^
degr de latitude Nord
ou Sud, ce sont des villages d'une trentaine de cases ;
on nous parle
de villages n'en ayant que 8 ou 10
^.
Ces chiffres ne seraient sans
doute gure dpasss dans l'intrieur de Borno ou de Sumatra. Mais
la diffrence entre les contres dont le climat pche par exubrance
et celles o il pche par anmie, se montre dans la rapidit avec laquelle
les groupes grossissent ds que cesse l'oppression de la fort
;
une
recrudescence subite dans le nombre et l'importance des villages se
produit sur la lisire de la silve
^.
Tandis que la fort elle-mme accrot
sa population au voisinage de la savane, celle-ci se couvre de villages
dont les habitants se chiffrent par centaines, atteignent parfois le
millier
^.
Groupes nomadisants.
Ces groupes, quelque genre de vie qu'ils
appartiennent, sont en rapport dtermin avec une certaine portion
d'espace. Ni la raison ni l'exprience n'admettent de peuple sans
racines, c'est--dire sans un domaine o s'exerce son activit, qui
assure et maintient son existence. Pas de groupe, mme au plus bas
1. A. SiLNiTZKY, La province d'Anadyr (Sibrie orientale) et son administration
(Rev. se.,
4^ sr., XI, 1 et 8 avril 1899, p. 391-402, 426-433).
2. F. Foureau, Documents scientifiques de la Mission saharienne (Mission Fou-
reau-Lamy), t. II, Paris, 1905, p. 840.
3.
Missions au Sahara, par E.-F. Gautier et R. Chudeau, t. II, Sahara soudanais
par R. Chudeau, Paris, 1909, p. 64 et suiv.
4. D' Herr, Mission Clozel dans le Nord du Congo franais (1894-1895) (Annales
de
Gographie, V, 1895-1896, p. 316).
5. Cap^ d'Ollone, Mission Hostains-d'Ollone, 1898-1900. De la Cte d'Ivoire au
Soudan et la Guine, Paris, 1901, p. 305. L'auteur note la densit tonnante
des
populations de la fort prs de la lisire .
6. J.
Bertrand, Le Congo Belge, Bruxelles, 1909, p. 86.
FORMATION DE DENSIT 35
degr de
l'chelle sociale, qui n'ait et ne revendique prement son
territoire. On dit que les plus humbles peuplades australiennes avaient
l'habitude de dterminer par des pierres ou certaines marques connues
les espaces dont la contenance pouvait pourvoir leurs besoins de
chasse, de cueillette, de provisions d'eau et de bois. L'tendue sup-
plant l'insuffisance, ce sont en gnral les groupes les plus indi-
gents qui rclament le plus d'espace.
Mais une trs faible densit de population n'exclut nullement un
certain degr de richesse et de puissance. Les tribus pastorales de
l'Asie et du Sahara ont leurs pturages attitrs qu'elles frquentent
successivement dans leurs parcours priodiques. Ces pturages ont
leur nom
;
ce sont, la diffrence des vagues tendues de bled, des
contres pourvues d'un tat civil. Il est possible que des mois se passent
sans que ces domaines soient visits par leurs possesseurs
;
il faut
que l'herbe ait eu le temps de pousser en l'absence de l'homme. Ces
surfaces que ses pieds foulent si rarement n'en sont pas moins un
domaine, une dpendance du groupe. Quelques-uns de ces groupes,
surtout au cur des dserts, ne sont que d'humbles et insignifiantes
collectivits. Mais tel n'est pas toujours le cas. Certaines tribus du
Sahara oriental ont des ramifications depuis l'Egypte jusqu'au centre
de l'Afrique. Les Larba, dans leurs migrations priodiques entre le
Mzab et les marchs de Boghar et de Teniet-el-Had
\ embrassent un
parcours d'environ 500 km. C'est aussi une longue tape que celle qui
mne les 6.500 Kirghiz des valles du Ferghana vers les hauts plateaux
de l'Ala. De tels exodes supposent un certain degr d'organisation
territoriale. Le sort de cette richesse ambulante qui se chiffre par des
centaines de mille moutons ou chvres, sans compter nes, chevaux
et chameaux, ne saurait tre livr au hasard. Il implique des dispo-
sitions relatives aux passages, aux ravitaillements en eau, aux tapes,
tout ce qu'exige la jouissance rgulire d'un vaste domaine pastoral.
Le cercle ne peut tre dtermin avec une entire rigueur
; une cer-
taine marge est ncessaire, car il faut compter avec les caprices des
saisons, suppler au besoin l'absence de vgtation aux endroits
prvus. Paissant tour tour les herbes des dayas ou redirs, celles
qu'humecte le lit des oued, les touffes aromatiques des steppes, les
gnrations aussi vite puises que parues des plantes annuelles, se
rabattant au besoin sur les jachres des champs limitrophes, ces
troupes dvorantes ont besoin de larges disponibilits d'espace. Rare-
1. Augustin Bernard et N. Lacroix, L'volution du nomadisme en Algrie,
Alger et Paris, 1906, p. 89 ;
voir aussi p. 68.
36 LA RPARTITION DES HOMMES SUR LE GLOBE
ment mme elles peuvent runir tous leurs membres
;
il faut se sparer
pour vivre
;
Abraham et Loth vont patre leurs troupeaux vers les
points opposs de l'horizon. Ce n'est qu'en des occasions solennelles,
joyeusement accueillies, que la tribu peut se donner elle-mme le
spectacle de sa magnificence et dployer, comme Isral devant Balaam,
toute la multitude de ses tentes. Ainsi est exclue du domaine o pr-
vaut la vie pastorale toute occupation intensive du sol
; ou du moins
la part qui est faite celle-ci ne peut s'accrotre sans grave dommage
pour le pasteur
^.
Rapports des groupes entre eux.
La silve tropicale, la savane
herbeuse, la steppe pastorale se traduisent, sous le rapport de la den-
sit d'habitants, par des groupes dissemblables, disposant d'une part
trs ingale d'espace. Toutefois, comme ils font partie d'un ensemble
terrestre qu'anime en son entier la prsence de l'homme, des rac-
tions s'changent entre eux. Par l'effet des transactions qui s'ta-
blissent ou des mouvements qui se rpercutent entre les populations
humaines, des renflements de densit tendent se former sur les
lignes o des genres de vie diffrente entrent en contact. Nous avons
signal plus haut l'accroissement qui correspond, en Afrique, la
zone de contigut entre la silve et la savane. On peut observer le
mme phnomne sur la marge indcise qui s'interpose, dans l'ancien
continent, entre le domaine de la vie pastorale et le domaine agricole
:
aussi bien sur les confins sahariens du Tell et du Soudan que sur les
lisires des steppes de l'Asie occidentale. Des marchs, parfois des
villes 2, surgissent sur ces points de rencontre, ou plutt de soudure,
car c'est un lien de solidarit qui unit ces diverses familles de groupes.
Si l'on se demande, en effet, comment ont pu se former et durer ces
grandes organisations pastorales qui gravitent depuis le Sahara jus-
qu'en Mongolie, on constate que leur existence est en rapport avec
les marchs agricoles qui leur permettent d'changer leurs produits.
L'parpillement d'un ct et la concentration de l'autre apparaissent
comme deux faits connexes.
L'exploitation pastorale, qui, de nos jours, a pris possession de
grandes surfaces en Australie et en Amrique, confirme, en les syst-
matisant, ces rapports. Dans les contres voues la vie pastorale,
1. J'ai indiqu ailleurs comment l'extension des domaines de la vie pastorale
n'est pas ncessairement conditionne par des causes physiques, mais peut tre
aussi bien le rsultat d'empitement. (Les genres de vie dans la gographie humaine,
dans Annales de Gographie, XX^1911, p. 298.)
2. Noter, par exemple, le rcent dveloppement de Merv, avec ses deux marchs
hebdomadaires. (Karl Futterer, Durch Asien, /, Geographische Charakter-Bilder,
Berlin, 1901, p. 6.)
FORMATION DE DENSIT 37
telles que le Grand-Bassin de l'Amrique du Nord, le Sud des Pampas
de l'Argentine, la partie occidentale de la Nouvelle-Galles du Sud, les
contrastes atteignent leur maximum entre l'exigut de main-d'uvre
humaine et l'abondance de capital pastoral. La disproportion est infi-
niment plus forte que dans l'ancien monde entre le nombre du btail
et celui des hommes. On peut estimer 5 ou 6 moutons par homme
le chiffre que possdent les puissantes tribus pastorales dont nous
avons parl. Au contraire, en Australie, on cite des troupeaux de
50.000 80.000 moutons qui n'exigent qu'un personnel de 15 20 per-
sonnes. Dans la Rpublique Argentine, des estancias dtiennent
elles seules des troupeaux de 160.000 moutons. Autre exemple :
l'tat de Wyoming, aux tats-Unis, possdait, en 1900, plus de
5 millions de moutons et n'a pas 150.000 habitants
^.
C'est donc sur de
grands espaces la rduction au minimum de l'lment humain
;
mais
cela, prcisment parce qu'il existe ailleurs des centres de commerce,
de puissants foyers de consommation, des ports, des villes immenses,
o ces manufactures de laine et de viande ont leurs dbouchs. Ces
contrastes font partie de l'conomie gnrale.
L'accumulation sur place.
Voulant caractriser des peuples qui
vgtent dans un tat de civilisation rudimentaire sans un espoir de
progrs, Virgile s'exprime en disant qu'ils ne savaient ni faire masse
de leurs produits ni en pratiquer l'pargne ^.
On ne saurait mieux
mettre le doigt sur le principe d'o sort un accroissement de densit
dans les groupes humains. Seule, la vie sdentaire, directement ou
indirectement, donne consistance l'occupation du sol. Or l'agricul-
ture est le seul rgime qui ait l'origine permis de cohabiter sur un
point fixe et d'y concentrer le ncessaire pour l'existence. Toutefois
n'est pas agriculteur celui qui, aprs avoir brl l'herbe, jette quelques
poignes de grains et s'loigne
;
mais celui qui amasse et fait des
rserves. Le pasteur, dans les rgions arides, essaie de faire subsister
sans provisions assembles d'avance, la fortune des saisons, le plus
d'animaux possible. Les peuples chasseurs de l'Amrique du Nord
n'ignoraient pas la culture
; mais, dit Powell, il tait de pratique
presque universelle de dissiper de grandes quantits de nourriture
dans une constante succession de ftes, dont l'observation supersti-
tieuse ne tardait pas dissiper les approvisionnements
;
et l'abon-
1. TWELFTH GeNSUS OF THE UnITED StATES TAKEN IN THE YEAR 1900,... Stotis-
tical Atlas, prepared under the supervision
of Henry Gannett, Washington, 1903,
carte, pi. 148.
2. Nec componere opes norant, nec parcere parto. (Enide, chant 8, v. 317.)
38 LA RPARTITION DES HOMMES SUR LE GLOBE
dance faisait bientt place au dnment et mme la famine
^
.
L'agriculteur ne tombe pas dans ces mprises
;
la prvoyance et
mme l'avarice lui sont passes dans le sang. Il cumule le patrimoine
des gnrations passes et suivantes. Le premier pas fut l'acclimatation
de plantes et la domestication d'animaux
; l'ensilotage ou la mise
en grange fut le second.
Noyaux de densit et lacunes intermdiaires.
Les cultures souda-
naises occupent un grand espace en Afrique. Mais il
y
a une infirmit
inhrente cette agriculture qui ne pratique pas la fumure du sol
et ne connat pas la charrue. Elle n'utilise que les parties o le sol
meuble permet une simple houe d'y enfouir la semence
; l'aridit
des grs ou des granits la rebute. Elle est capable nanmoins, dans
les conditions favorables du sol, de donner lieu une densit consid-
rable d'habitants. Yunker et Emin-pacha dcrivent l'envi les files
de cases qui se succdent l'une prs de l'autre pendant prs d'une
heure , dans l'Ouganda, Hans Meyer parle dans les mmes termes
des cultures qui s'talent o s'chelonnent en terrasses sur les croupes
du Rouanda, par 1.600 m. d'altitude. A des altitudes bien moindres,
sur le moyen Chari, A. Chevalier signale tel pays qui n'est qu'un
vaste champ verger . Il
y
a, dans le Soudan Nigrien, dit Lucien Marc,
des contres o l'on peut marcher deux jours sans perdre un seul
instant les cases de vue 2.
E. Salesses estime 40 habitants par kilo-
mtre carr la population de certains districts du Fouta-Djalon.
Seulement, ces foyers de densit sont sporadiques
;
ils sont spars
par des intervalles vides.
Incapable de subvenir l'puisement du sol, chaque groupe se
sent bientt l'troit dans l'espace qu'il exploite. Sur un sol qui nous
est pourtant dpeint comme fertile, on nous apprend qu'un village a
besoin de disposer d'une priphrie triple de celle qu'il cultive effec-
tivement
^.
Une sorte de roulement entretient de vastes rserves de
terrains buissonneux ct des cultures. Malgr tout, il arrive un
moment o le pays surpeupl se voit oblig de rejeter une partie de
sa population. Qu'arrive-t-il alors ? Ce n'est pas proximit, mais
au del des obstacles naturels qui circonscrivent son domaine, bien
distance, qu'il met ce rejeton
*.
1. J. W. PowELL, Sevenih Annual Report
of
the Bureau
of
Ethnology, 1885-6,
Washington, 1891, p, 33 et suiv.
2. Lucien Marc, Le Pays Mossi, Paris, 1909, p. 115,
3. Auguste Chevalier, Mission Chari-Lac Tchad, 1902-1904, L'Afrique Centrale
Franaise, Rcit du voyage de la mission, Paris, 1907 (couverture : 1908), p. 250.
4. Dans la fertile valle du Niger, chaque village cultive autour de lui une ban-
FORMATION DE DENSIT 39
Les marches travers des espaces vides, les journes passes sans
voir ni cases, ni visages d'hommes, morne refrain de l'exploration
africaine, s'expliquent ainsi. Les guerres et la traite ont contribu
certes largir ces lacunes : nulle part le Homo homini lupus ne s'ap-
plique mieux. Mais si le groupe social est rest isol, molculaire,
incapable de concerter sa dfense, il
y
a surtout au fond de cela un
mode imparfait d'agriculture. Des scnes d'apparences contradictoire
dfilent ainsi sous les yeux, et nos jugements sur les chiffres totaux
de population s'en ressentent.
Le peuplement de la terre s'est opr par taches, dont les auroles
dans les pays les plus civiliss finissent par se rejoindre
;
encore pas
toujours. Richthofen, dans son journal de voyage en Chine, note entre
provinces voisines et trs civilises, comme le Hou-p et le Ho-nan,
des traces de sparations anciennes et fondamentales
^.
Entre les
chambres et chambrettes dont, suivant son expression, se compose
la Chine, les cloisons, en quelque sorte, sont des marches-frontires,
montagneuses ou accidentes, dont les habitants vivant en clans, par
petits hameaux, pratiquent d'autres modes d'existence que ceux de
la plaine. Les deux peuplements, quoique contigus, ne se fondent pas.
La solution de continuit reste apparente.
L'Inde, dit Sumner Maine, est plutt un assemblage de fragments
qu'une ancienne socit complte en elle-mme . Effectivement, sans
parler des enclaves demi sauvages qui confinent soit au Bengale,
soit au pays des Mahrattes, le village hindou, type de la civilisation
du Nord, est organis pour se sufilre comme si rien n'existait autour
de lui. Constitu en unit agricole, avec son personnel attitr de fonc-
tionnaires et d'artisans, il forme un microcosme. Les analyses des der-
niers recensements indiquent que la plupart des existences restent
enfermes dans ce cadre, sauf pour contracter mariage dans le village
voisin. Ce n'est pas entre villages, mais entre le rgime de commu-
nauts de villages et celui de tribus que s'interpose l'isolement, tant il
est vrai que c'est par l'intermdiaire de causes sociales que s'exerce
l'influence des conditions gographiques !
Groupements de dates diverses en Europe,
Le spectacle qu'offre
aujourd'hui le peuplement, dans la majeure partie de l'Europe, est
lieue dont le rayon peut atteindre 1.500 ou 1.800 m. Lorsque le nombre d'habitants
vient augmenter, ce village n'augmente pas le nombre de ses maisons. Il lance
2 ou 3 kilom. une colonie qui fonde un petit village du mme nom que le pre-
mier. (Commt TouTE, Du Dahom au Sahara..., Paris, 1899, p. 122.)
1. Ferdinand von Richthofen's Tagebiicher aus China. Ausgewlht u. hrsg. v.
E. TiESSEN, I, Berlin, 1907, p. 437.
40 LA RPARTITION DES HOMMES SUR LE GLOBE
tellement composite qu'il faudrait souvent des cartes trs grande
chelle pour distinguer les soudures qui ont fmi par rapprocher en
une apparence de continuit les diffrents groupes. Toutefois, mme
sur des cartes mdiocre chelle, les bords de la Mditerrane montrent
de singulires lacunes. A quelques kilomtres de distance la popula-
tion tombe d'un haut degr de densit un degr de rarfaction qui
touche au dsert. Les campos confinent en Espagne aux huertas
;
les
garrigues, la coustire du Languedoc
;
les plans du Var, aux bassins
de Grasse et de Cannes
;
la Murgia quasi dserte, au littoral populeux
des Fouilles. Dans le Ploponse, les petites plaines d'Argos, d'Achae,
d'lide, de Messnie et de Laconie, qui ne reprsentent qu'un 20 de
la surface, contiennent un quart des habitants. La vie urbaine et la vie
de clans sont deux plantes qui ont trouv autour de la Mditerrane
un sol favorable
;
elles subsistent encore cte cte. Cette coexis-
tence a contribu crer, puis maintenir entre les divers groupes
lmentaires une cohsion qui fait fcheusement dfaut dans les parties
du littoral, comme le Rif, l'Albanie, les Syrtes, o le commerce et la
vie urbaine n'ont pu, jusqu' prsent, pousser de fortes racines.
La grande industrie a boulevers depuis un sicle les conditions
du peuplement dans l'Europe centrale et occidentale. Ce peuplement
s'offrait dj comme un palimpseste sur lequel dix sicles d'histoire
avaient inscrit bien des ratures. Marais asschs, forts dfriches
n'avaient pas cess d'ajouter des touches nouvelles au fond primitif.
Des formes diverses d'tablissements correspondent ces diversits
d'origine
; si bien qu'un coup d'il tant soit peu exerc ne confondra
pas les pays aux vieux villages et ceux o une colonisation ultrieure
a dissmin les fermes en hameaux travers les brandes et les essarts.
Puis l'industrie est venue et a fait sortir du sol une ligne nouvelle
d'tablissements humains.
Cependant le noyau primitif du peuplement se laisse encore dis-
cerner. On peut affirmer, preuves en mains, que les hommes, ici comme
ailleurs, se sont obstins longtemps s'accumuler sur certains lieux,
presque l'exclusion des autres. Quels lieux ? Ce n'tait pas invaria-
blement les plus fertiles, mais les plus faciles travailler : les plateaux
calcaires en Souabe, Bourgogne, Berry, Poitou, etc.
;
les terrains
meubles et friables o la fort n'avait pu qu'imparfaitement s'im-
planter dans ses retours offensifs aprs les priodes glaciaires, et qui
forment une sorte de bande depuis le Sud de la Russie jusqu'au Nord
de la France. Telles furent les clairires, les espaces ars et dcou-
verts, les sites attractifs o se rencontrrent les premiers rassemble-
ments europens, o ils commencrent prendre cohsion et force.
FORMATION DE DENSIT 41
D'intressantes reconstitutions cartographiques, au moyen des trou-
vailles prhistoriques et des documents cadastraux, ont t tentes
pour le Wurtemberg
^
;
on
y
voit les tablissements des poques
romaine et alamannique se superposer exactement, sur les surfaces
non forestires, ceux de l'poque nolithique et du premier ge du
fer. Ce n'est qu'ultrieurement que de nouveaux groupes viennent
s'interposer entre eux. Il n'est pas douteux que les choses se soient
passes de mme en France. Lorsque M. JuUian nous dpeint le terri-
toire d'un peuple gaulois comme un vaste espace renfermant au centre
des terres cultives, protg ses frontires par des obstacles continus,
forts ou marcages, etc. 2, c'est le signalement exact d'une de ces
units fondamentales qu'il nous donne. Nous avons essay nous-
mme de retracer d'aprs ces principes, pour la France et l'Europe
centrale, une carte de l'occupation historique du sol
^.
II.
MOUVEMENTS DE PEUPLES ET MIGRATIONS
Densit par refoulement.
On ne saurait trop faire part, dans la
la fluctuation des phnomnes humains, aux troubles dus aux chocs
des peuples, aux invasions rptes, un tat chronique de guerre.
Certaines contres sont plus exposes que d'autres ces mouvements
dvastateurs : ainsi la zone des steppes qui s'tend de la Mongolie au
Turkestan, ou de l'Arabie au Maghreb. L'histoire
y
enregistre une
srie d'invasions, depuis celles que mentionne Hrodote jusqu' celles
qu'ont finalement contenues les Russes, ou depuis les Arabes jusqu'aux
Almoravides et Hilaliens. La pousse des Massai" dans l'Afrique orien-
tale, celle des Cafres dans l'Afrique australe se sont rpercutes au
loin et ont jonch de dbris de peuples une partie de ce continent.
L'Amrique du Nord n'a pas chapp ces perturbations : ne vit-on
pas, au xviii^ sicle, une tribu obscure, dite des Pieds-noirs, sortie du
bord des Montagnes Rocheuses, s'tendre tout coup, grce la pos-
session du cheval, travers les Prairies de l'Ouest ? En dehors mme
de ces arnes ouvertes, espaces prdestins aux mouvements de vaste
envergure, l'absence de scurit, dans notre Europe, a longtemps
frapp d'interdiction des voies naturelles qui semblaient faites pour
1. Robert Gradmann, Die landlichen Siedlungsformen Wiirttembergs (Peter-
manns MitL, LVI-i,
1910, p. 183-186, 246-249
; 3 cartes 1 /l.OOO.OOO, pi. 31 ;
6 r-
ductions de plans cadastraux ^ 1 /5.000, pi. 40).
2. Camille Jullian, Histoire de la Gaule, II, La Gaule indpendante, Paris,
1908, p. 16.
3. Tableau de la Gographie de la France (Histoire de France d'ERNEST Lavisse,
tome I, Paris, 1903, p. 55-57).
-
Cette planche figure la fin de l'dition de 1908 :
La France, Tableau gographique.
42 LA RPARTITION DES HOMMES SUR LE GLOBE
attirer les hommes. Pendant des sicles, les plateaux de Podolie et de
Galicie, si populeux aujourd'hui
\
virent dboucher, le long du sentier
noir, les tribus qui priodiquement, comme des nues de sauterelles,
s'chappaient des steppes. Les chteaux ou vieux burgs qui dominent
les valles du Rhin et du Rhne furent les refuges des populations
de la plaine contre le droit du poing (Faustrecht). Hier encore,
notre voyageur Crevaux nous apprenait qu'en Amazonie, pour fuir
les dprdations dont le grand fleuve est le vhicule, les tribus indi-
gnes s'en cartaient vers les valles moins accessibles
^,
Ces faits ont eu sur la rpartition des populations humaines des
consquences qui ont souvent survcu aux causes qui les avaient pro-
duites. Ils ont eu pour rsultat de refouler les populations dans des
contres abrites, qui ont pris de ce chef un accroissement anormal.
Les montagnes de la Grande-Kabylie, les oasis du Mzab et peut-tre
celles du Touat et du Tafilelt, doivent des accidents historiques de
cette espce l'excs de population qui s'y trouve. Les articulations
pninsulaires de la Grce, et surtout les les adjacentes, ont t con-
gestionnes la suite des conqutes turques. A l'invasion ottomane est
imputable aussi le refoulement qui a pouss au cur de la rgion
forestire longtemps dlaisse au Sud de la Save, dans la Choumadia,
les populations qui s'taient dveloppes sur les plateaux dcouverts
du centre de la pninsule
^.
L'histoire de notre Algrie, de l'Ukraine, de la Ciscaucasie, nous
montre combien tardive, aprs ces priodes d'invasions et d'inscurit,
a t parfois la revendication de ces contres dignes d'un meilleur
sort. Ces plaines ouvertes avaient cd en partie leur population aux
montagnes, qui souvent l'ont garde. Aux exemples dj cits on peut
ajouter le Caucase, citadelle de peuples dont la diversit tonnait
les anciens, les Alpes transilvaines o s'est reforme la nationalit
roumaine, les Balkans o s'est reconstitu, pendant la domination
turque, le peuple bulgare. Ces montagnes doivent aux refoulements
une densit qu'elles n'auraient pas atteinte spontanment, par leurs
ressources propres.
Densit par concentration.
Tel n'est pas cependant le cours nor-
mal des faits, tel du moins que nous pouvons l'entrevoir. Les hommes
ont commenc par se porter sur certains sites d'lection que la facilit
de culture avait dsigns leur choix et que peu peu l'accumulation
1. La Podolie a plus de 80 habitants par kilomtre carr
;
la Galicie, plus de 90.
2. D' J. Crevaux, Exploration des fleuves Yary, Parou, Ia et Yapura... (Bull,
Soc. Gog.,
7e
sr., III, 1882, p. 696).
3. I. CviJic, La pninsule balkanique, gographie humaine, Paris, 1918.
FORMATION DE DENSIT 43
du
patrimoine signalait leurs convoitises. Ils
y
ont form groupe,
enracin leurs tablissements, s'y sont concentrs, tandis que les
alentours restaient ngligs ou vides. Il faut s'imaginer ces dveloppe-
ments primitifs de population comme susceptibles d'atteindre une
densit relativement forte, quoique borns dans l'espace, enferms
dans des cadres que leurs moyens ne leur permettaient gure d'agran-
dir. Divers indices dans les contres les plus diffrentes permettent
de se rendre compte de ce mode sporadique de peuplement intensif
;
et c'est un des rsultats les plus curieux des connaissances rcemment
acquises sur l'intrieur de l'Afrique, que de nous le montrer sur le vif
et encore l'uvre.
Ce qui oppose aujourd'hui l'expansion sur place des groupes
agricoles soudanais des obstacles qu'ils ne sont pas parvenus sur-
monter, c'est, avons-nous vu, l'imperfection de l'outillage et l'absence
de science agricole. La fort, le marcage furent, en Europe, aussi
des forces hostiles auxquelles il tait difficile et paraissait mme
chimrique de se mesurer. Elles cernaient les groupes dans des espaces
restreints. Il a fallu, pour briser ces cadres, un concours de circons-
tances et d'efforts dont la srie, entrevue seulement par chappes,
est l'histoire des conqutes du sol.
La collaboration d'entreprises collectives et mthodiques, l'inven-
tion de meilleurs instruments, l'introduction de plantes s'accommo-
dant de sols plus pauvres, et par-dessus tout la substitution de la
science aux procds empiriques, ont peu prs ralis en Europe la
solidarit des divers modes d'exploitation qui unit la contre en un
tout. Mais nous voyons encore, en d'autres grandes contres de civi-
Usation et de peuplement, telles que la Chine et le Japon, les cultures
concentres dans les plaines ou sur les terrasses infrieures, et les
montagnes frustres de tout emploi pastoral. L'tendue des terres
cultives n'atteindrait mme, au Japon, que 15
p.
100 de la superficie
totale
^.
Tous ces faits, actuels ou historiques, permettent d'envisager
le surpeuplement comme la consquence prcoce de cet instinct ou de
cette ncessit qui porta les hommes se rassembler et former groupe
sur certaines places, pour
y
poursuivre obstinment les mmes routines.
Surpeuplement et migration.
Le surpeuplement, en ces condi-
tions, ne peut trouver d'issue que l'migration. La Chine, qui est
1. L'Agriculture au Japon (Erposition Universelle de Paris 1900, Paris, Maurice
de Brunof),
p. 20.
Voir aussi la brochure publie, pour la mme Exposition,
par la Direction des Forts au Ministre de l'Agriculture et du Commerce
DE l'Empire du Japon : Description des zones forestires du Japon, prpare par le
D' s. Honda.
44 LA RPARTITION DES HOMMES SUR LE GLOBE
sans doute aujourd'hui le pays d'ancienne civilisation o subsistent
davantage les irrgularits primitives, est le thtre d'une foule de ces
migration anonymes, obscures, dont le total finit par changer la face
du monde. Les voyageurs qui en ont parcouru l'intrieur ont t sou-
vent tmoins du spectacle suivant. Ils rencontrent sur leur route des
familles entires se dplaant d'une contre une autre. Une famine,
une pidmie, ou simplement la difficult de vivre les a forces aban-
donner leurs foyers. L'un d'eux nous dpeint ces familles de cultiva-
teurs, d'aspect dcent, qui campent sur les bords des chemins, empor-
tant avec elles la nourriture pour le voyage ^.
Ainsi il ne s'agit pas
d'un proltariat vagabond, mais de groupes forms, cohrents, dont
femmes, enfants et vieillards font partie, la recherche d'un terrain
propice pour
y
planter leurs pnates et continuer leurs habitudes
traditionnelles. C'est ce qu'il
y
a de plus rsistant dans la socit chi-
noise, la famille, qui se transplante dans son intgrit pour faire souche
ailleurs, et qui, grce sa cohsion,
y
russira. N'est-ce pas en raccourci
l'image du mcanisme par lequel s'oprent les phnomnes de peuple-
ment ? C'est par essaims la manire des abeilles, plutt que par
agglutination la manire des coraux, que les hommes se multiplient.
Le surplus de population ne cherche pas se dverser sur les espaces
vacants qui existent dans le voisinage immdiat : qu'y ferait-il s'il n'y
peut vivre suivant ses habitudes et ses moyens ? On franchit au besoin
de grandes distances, en qute d'un milieu analogue celui qu'on est
contraint de quitter.
C'est ce systme, que les Chinois ont su lever la hauteur d'une
colonisation mthodique, qui les a guids travers les compartiments
de leur domaine. Une carte des agrandissements successifs de la Chine,
telle par exemple que l'a esquisse Richthofen dans son grand ouvrage,
montre moins une extension progressive, comme le ferait une carte
historique de France, qu'une srie de colonisations pousses en avant-
postes. Des bassins spars les uns des autres ont t successivement
acquis la civilisation suprieure qu'avaient su former les fils de Han.
Comme des vases communicants, si l'quilibre vient tre rompu,
ces bassins le rtablissent d'eux-mmes. Lorsque, au xvii^ sicle,
le riche Pays des Quatre-Fleuves , le Sseu-tch'ouan, eut t ruin
par les incursions tibtaines, des groupes d'immigrants afflu-
rent pour combler les vides, apportant si fidlement avec eux leurs
dieux lares et leurs traditions domestiques que leurs descendants
1. Die wissenschaftUchen Ergebnisse der Reise des Grafen Bla Szchenyi in
Osi-Asien, 1877-1880, I, Wien, 1893, p. 223.
FORMATION DE DENSIT
45
savent
encore dire de quelle province taient venus leurs anctres.
Lorsque, en 1861, les Anglais, pntrant de plus en plus dans les
profondeurs
de leur empire indien, entreprirent l'organisation des
Provinces
Centrales, ils constatrent non sans surprise combien rcente
tait
l'occupation agricole de ces contres
^.
Elle remonte aux progrs
que fit, vers la fm du xvi^ sicle, sous l'empereur Akbar, la puissance
mongole dans les valles de la Nerbudda et de la Tapti. Ces contres
taient restes un terrain de chasse des Gonds. Mais le sol
y
est form
de ces couches noires de regur, dit cotton soil, qui depuis longtemps
tait fructueusement cultiv dans le Goudjerat et autour du golfe de
Cambaye. De la population presse sur la cte occidentale partirent
des groupes qui graduellement installrent le travail agricole dans ces
terres de grand avenir. L'infiltration se poursuit encore
;
elle fait tache
autour d'elle. Elle gagne peu peu, dit-on, les chefs de clans, jaloux de
se relever leurs propres yeux par un vernis superficiel d'hindouisme.
Quand la ruche est trop pleine, des essaims s'en chappent. C'est
l'histoire de tous les temps. Ce n'est pas par hasard que les livres o
sont consigns les plus vieux souvenirs de l'humanit, le Vendidad-
Sad, la Bible, les documents chinois, les chroniques mexicaines,
sont pleins de rcits de migrations. Il n'est gure de peuple chez lequel
ne survive la rminiscence obscure d'un tat d'inquitude, de Trieh,
suivant l'expression de K. Ritter, qui le forait migrer de place en
place jusqu'au moment de trouver ce sjour dfinitif, sans cesse
promis par la voix divine, sans cesse cart par des malfices. Ce sont
toujours des domaines limits, la taille de ceux qu'ils pouvaient
connatre, qui sont le terme poursuivi d'tapes en tapes : pour les
Hbreux la terre de Chanaan, pour les Iraniens *les jardins successifs
de Soughd (Sogdiane), Mourv (Margiane ou Merv), Bakhdi (Bactriane).
Non moins accidente est l'odysse des Nahuatlacas pour atteindre
enfin la terre des joncs et des glaeuls , les bords du lac o se fonda
Tenochtitlan, la ville de Mexico
^.
La vieille Italie pratiquait sur ses populations dj trop presses
dans l'Apennin ces amputations qui en dtachaient la fleur de jeu-
nesse (ver sacrum), pour l'envoyer chercher fortune. L'histoire pri-
mitive de l'Europe celtique et germanique se rsume en une srie de
1. Capt. James Forsyth, The Highlands
of
Central India, London, 1871, p. 45.
Voir : P. Vidal de la BlaChe, Le peuple de l'Inde, d'aprs la srie des recensements
(Annales de Gographie, XV, 1906, p. 368).
2. D. Gharnay, Manuscrit Ramirez. Histoire de l'origine des Indiens qui habitent
la Nouvelle-Espagne, selon leurs traditions (Recueil de voyages... publis sous la
direction de Ch. Schefer et Henri Cordier, XIX, Paris, E. Leroux,
1903), p. 13
et suiv., 25 et suiv.
46 LA RPARTITION DES HOMMES SUR LE GLOBE
migrations, contre lesquelles la puissance romaine et le plus tard carlo-
vingienne s'efforcrent, souvent en vain, de ragir. Les Helvtes
qu'attire la renomme des plaines de Saintonge, les Suves qui cherchent
se substituer aux Squanes dans ce que Csar appelle la meilleure
partie de leur domaine, sont des groupes en mal d'espace, en qute
de territoires, faute de savoir tirer parti du leur. C'est par centaines
de mille que les paysans russes de la terre noire se prcipitaient en
Sibrie, si le Gouvernement russe n'et oppos une digue l'irruption
trop brusque du flot.
Sens gnral de l'volution du peuplement.
Ce n'est pas la
faon d'une nappe d'huile envahissant rgulirement la surface terrestre
que l'humanit en a pris possession solide et durable. Des intervalles
vides ont persist longtemps, persistent encore en partie, maintenir
la sparation des groupes. Ceux-ci obissent une loi de ncessit
en se sparant, en s'cartant les uns des autres.
De divers cts, par amas irrguliers, comme des points d'ossifi-
cation, de petits centres de densit ont apparu de bonne heure. Com-
binant leurs aptitudes, transmettant un patrimoine d'expriences, ils
furent d'humbles ateliers de civilisation. Quelques-uns de ces groupes,
profitant de conditions favorables, ont pu servir de laboratoires
la formation de races destines plus tard s'tendre et jouer leur
rle dans le monde.
Il est arriv cependant que, dans des contres situes l'cart,
l'isolement a t rig en systme. Les bnficiaires du sol se sont
efforcs de maintenir autour d'eux la sparation par des moyens arti-
ficiels
;
car l'ide de frontire est aussi enracine que celle de guerre.
Ainsi les silvatiques africains sment d'embches les abords de leurs
villages ;
les clans montagnards, tels que Tcherkesses, Kourdes, Kafirs,
se sont retranchs dans les parties les moins accessibles
;
les Tibtains
eux-mmes ont relgu dans les valles les plus cartes leurs sanc-
tuaires nationaux.
Aujourd'hui, ces centres d'isolement font l'effet d'exceptions. Les
destines de l'humanit eussent t frappes de paralysie si ces condi-
tions primitives avaient prvalu. L'isolement exposait ces socits
s'atrophier, rester perptuellement asservies aux habitudes con-
tractes sous l'impression du milieu o s'tait rvl pour eux le secret
d'une existence meilleure. Ces communauts humaines auraient fini
par ressembler ces socits animales que nous voyons figes dans
leur organisation, rptant les mmes oprations, vivant sur le progrs
jadis ralis une fois pour toutes.
FORMATION DE DENSIT
47
Mais un ferment travaillait ces socits lmentaires, les poussait
crotre et se rpandre au dehors. Leurs rejetons se trouvaient
ainsi, dans le vaste monde, en face de conditions dont la nouveaut
pouvait rebuter les uns, mais qui ouvrait aux plus suprieurement
dous des sources de rajeunissement et d'expansion. Renan a bien
dcrit la transformation qui s'opra chez les Beni-Isral quand ils
entrrent en contact avec la terre de Chanaan
^.
Cette histoire s'est
souvent rpte dans la suite. Une ventilation salutaire, dans la plus
grande partie des contres, a fcond les rapports des hommes.
1. E. Renan, Histoire du peuple d'Isral, I, Paris, 1887.
CHAPITRE III
LES GRANDES AGGLOMRATIONS HUMAINES
AFRIQUE ET ASIE
Ds les temps les plus reculs, certains points de la terre ont vu
s'paissir les rangs humains. Croissez et multipliez est un des plus
antiques prceptes qu'ait couts l'humanit. L'ide de multitudes
semblables, suivant l'expression biblique, aux grains de sable des
rivages de la mer hante de bonne heure les imaginations. La forma-
tion de densit s'est ralise d'abord sporadiquement, la faveur de
circonstances toutes locales. Les dcouvertes d'instruments de l'ge
de pierre ont fourni d'intressantes indications sur ces centres primitifs
de rassemblement. Mais la plupart de ces tentatives n'ont pas de suite
;
elles se heurtent longtemps la difficult de vivre nombreux sur de
petits espaces.
Parmi ces groupes prcoces, les uns ont cd une force centri-
fuge, ils se sont dtachs de leur noyau, comme les satellites d'une
plante. Mais la longue d'autres se sont rapprochs et, s'il est permis
de poursuivre la comparaison, condenss en nbuleuses. Ces agglo-
mrations se sont formes indpendamment, assez loin les unes des
autres. Leur fortune a t diffrente, les unes n'ayant cess de s'ac-
crotre, tandis que d'autres,
mais ceci a t l'exception,
ont
dclin ou ne sont que l'ombre d'elles-mmes. Une lente laboration
les avait prpares, car aux poques lointaines o l'Egypte et la Chalde
apparaissent dans l'histoire, elles comptent dj des traditions et
des souvenirs qui leur communiquent une aurole de haute antiquit.
Les Grecs avaient t frapps de ces grandes socits du Nil et de
l'Euphrate
;
ils ne le furent pas moins, lorsqu'aprs Alexandre ils
apprirent connatre l'Inde du Pendjab et de la valle du Gange.
La Chine, rvle plus tard, tonna par ses multitudes les contempo-
rains de Marco Polo. D'autres agglomrations sont venues, dans la
suite des temps, s'ajouter celles dont furent tmoins ces anciens
ges
;
mais dans ces formations ultrieures intervient une telle com-
Vidal-Lablache, Gographie humaine. 4
50 LA RPARTITION DES HOMMES SUR LE GLOBE
plexit de facteurs que les causes gographiques bien que toujours
effectives, s'y laissent moins directement discerner que dans ces pre-
mires manifestations de force collective, d'o l'humanit commena
rayonner sur la terre.
Leur rpartition semble en rapport avec une zone comprise environ
entre le tropique du Nord et le 40^ degr de latitude. Le climat est
assez chaud pour que nombre de plantes puissent accomplir trs
rapidement leur cycle de maturit et mettre profit l'intervalle entre
les bienfaits priodiques des pluies ou des crues fluviales. L'eau douce,
sous forme de sources, de lacs, de nappe phratique ou de courant,
est la collaboratrice indispensable de ces climats tropicaux ou subtro-
picaux. Les grands fleuves surtout, issus des hauts massifs asiatiques,
et nourris de pluies priodiques, agissent la fois par leurs eaux impr-
gnes de substances solubles et par leurs dpts d'alluvions. On serait
tent de croire que les plus grands rassemblements humains ont d,
ds l'origine, correspondre la section terminale o le courant satur
achve de rejeter sa charge de matriaux. N'est-ce pas, en effet,
dans quelques-uns des grands deltas qui s'chelonnent depuis le Nil
jusqu'au Yang-tseu-kiang que se pressent aujourd'hui les plus fortes
densits d'habitants ? La Basse-Egypte, le Bengale sont actuellement
les parties les plus populeuses de l'Egypte et de l'Inde. Aux embou-
chures du Yang-tseu, l'le Tsong-ming et la pninsule Ha-men attei-
gnent la proportion hypertrophique, l'une de L475, l'autre de 700 habi-
tants par kilomtre carr
^.
Ce serait pourtant une illusion. En ralit,
l'homme n'a pris pied que tard, et dj arm par l'exprience, sur ces
terres amphibies. Ces marcages, o la pente fait dfaut, que l'inonda-
tion menace, n'ont t humaniss qu'au prix de grands efforts. Tous
ne l'ont pas t ;
car, mme sur cette frange littorale de l'Asie des
moussons, ct de deltas surpeupls d'autres attendent encore les
multitudes qui pourraient
y
vivre.
Ce qui est vrai, c'est que ces grands fleuves reprsentent, suivant
les conditions diverses de leur rgime, de leur pente, de la composition
de leurs eaux, de l'origine de leurs troubles, autant de types divers
d'nergies naturelles. Instinctivement, l'homme s'est senti attir
sur leurs bords par l'aflux de cette riche vie animale et vgtale que
dpeignent les peintures des anciens ges pharaoniques. Que la fer-
tilit se concentre ainsi sur les rives du fleuve ou qu'efle s'panouisse
1. P. H. Havret, Note sur le bas Yang-ts-kiang (Annales de Gographie, III,
1893-1894, p.
102-104, 1 fig. carte).
Dans le delta du Tonkin, la densit est tou-
iours de 200 300 hab. au moins par kilomtre carr et atteint jusqu' 500 ou 600
dans le Bas-Delta. (E. Chassigneux, L'irrigation dans le delta du Tonkin, dans
Rev. de Gographie (N. Sr.), VI, 1912, p. 57.)
LES GRANDES AGGLOMRATIONS : AFRIQUE ET ASIE 51
aux alentours, c'est une table ouverte vers laquelle se prcipitent
tous les tres. Mais de longues suites d'efforts combins sont nces-
saires pour arriver discipliner ces grandes masses d'eau, pour
y
rallier des foules humaines, et cela n'a t ralis que dans quelques
parties de la terre.
I.
EGYPTE
L'homme a pullul de bonne heure sur l'alluvion friable, riche
en substances chimiques, que le Nil, assagi dans des biefs successifs,
apporte des volcans d'Abyssinie et dpose dans la longue valle qui
s'ouvre partir d'Assouan. L se droule, comme un long serpent,
la terre noire (Kmi) entre les sables fauves. Les trouvailles prhisto-
riques donnent les indices d'une densit prcoce
^.
La population de
fellahs qui a fourni le levier de la civilisation gyptienne et qui compte
encore aujourd'hui pour 62
p.
100 de la population totale, est un
type original d'humanit, singulirement fidle lui-mme travers
les ges, fermement implant dans son domaine, essentiellement
prolifique. Elle commena par s'panouir librement sur ce sol fcond,
par se complaire ses prodigalits
^
;
se rassemblant peu peu par
petits groupes d'agriculteurs, rpartis par nouts ou nomes semblables
aux nahiehs d'aujourd'hui. Rien n'y ressemble la vie concentre
et prcautionneuse des oasis. Bien tort, on assimile parfois l'Egypte
une longue oasis : nom spcialement invent par les gyptiens
pour les diffrencier de leur propre contre. Le fellah se disperse libre-
ment, il a vite fait de transporter en cas de besoin son habitation rudi-
mentaire d'un point un autre de la bande alluviale qui est son seul
et vritable domicile
^.
La nature du sol fit de l'organisation collective une ncessit.
Elle est telle que la salinit ne tarde pas imprgner l'eau devenue
stagnante. L'obligation d'assurer au flot de crue un prompt coule-
ment, aprs en avoir prlev le tribut, ne s'imposait donc pas moins
1. J. DE Morgan, Recherches sur les origines de VEgypte. IL Ethnographie pr-
historique..., Paris, 1897, p. 67.
2. Les gyptiens avaient commenc par manger sans discernement tous les
fruits que le pays produit. (G. Maspero, Histoire ancienne des peuples de l'Orient
classique, I, Paris, 1895, p. 64.)
3. Pour la plupart aussi facilement construits que dmolis, les petits villages,
hameaux, fermes, peuvent quelquefois changer d'emplacement : la population se
transporte alors sur un point proximit qui prsente de meilleures conditions de
rsidence, et les anciennes demeures sont abandonnes. Ce fait explique le nombre
considrable de locaux vides dont le recensement a d tenir compte. (Ministre
DE l'Intrieur, Recensement gnral de l'Egypte, 3 mai 1882, Rapport, 5
section,
Le Caire, 1884, p. xii.)
52 LA RPARTITION DES HOMMES SUR LE GLOBE
que celle de la capter au passage. La tentation de confisquer l'eau
s'effaa devant la ncessit de la restituer aussitt aprs en avoir
fait usage. C'est cette conception que rpondit le systme de bassins
chelonns paralllement au Nil et s'coulant les uns vers les autres :
sorte d'appareil moul au fleuve, qui eut pour effet de doubler l'tendue
que sa crue peut atteindre et l'espace ouvert la population.
L'accroissement de densit n'excluait pas un appel croissant de
main-d'uvre. On le voit, sous les Pharaons, s'exercer sur les popu-
lations voisines de Palestine et de Syrie, surtout sur ces populations
de Nubie dont le flot ininterrompu ne cesse, comme en vertu d'une
loi naturelle, de s'couler vers l'Egypte
^.
Cet afflux, nanmoins, n'a
pas sensiblement altr; le fond indigne : preuve de la fcondit
persistante qu'il a su opposer toutes les vicissitudes. Mais le domaine
qu'il occupe est trop restreint et les conditions d'amnagement trop
artificielles pour que la densit de la population n'ait pas considra-
blement vari depuis l'antiquit classique. L comme ailleurs, les suites
des conqutes arabe et turque diminurent sensiblement le capital
humain. Au moment de l'expdition franaise d'Egypte, la popu-
lation n'tait estime qu' 2.460.200 habitants
;
vingt-trois ans aprs,
Mehemet-Ali l'valuait 2.536.400. Un demi-sicle aprs commence
la srie des recensements, comportant une marge de plus en plus
restreinte d'incertitude. Ils rvlent un progrs aussi rapide que pro-
digieux :
1846. . . . . . 4.476.440
1882. . . . . . 6.831.131
1897. . . . . . 9.734.405
1907. . . . . . 11.287.359
1917. . . . . . 12.566.000
Ainsi la race indigne, agricole et sdentaire,
car auprs d'elle
le nombre d'trangers ou de Bdouins nomades est insignifiant,
a
fait preuve depuis trois quarts de sicle d'une tonnante lasticit.
Il faut noter en premire ligne que cet accroissement correspond une
extension notable de l'aire cultivable, le systme d'irrigation perma-
nente par canaux, au moyen de grands barrages et d'appareils lva-
toires, ayant t gnrahs surtout dans le Fayoum et la Basse-Egypte
La superficie cultivable, value, il
y
a vingt-cinq ans, un peu plus
de 23.000 kilomtres carrs, dpasserait aujourd'hui 3L000. En outre,
les cultures industrielles, au premier rang desquelles le coton, entranent
de plus grandes exigences de main-d'uvre. Dans les parties qu'at-
1. Les circonscriptions situes au Sud d'Assouan forment la rgion commun-
ment appele Nubie, qui est le pays d'origine des Barbarins. (Ibid., p. xxvii.)
LES GRANDES AGGLOMRATIONS : AFRIQUE ET ASIE 53
teint rirrigation permanente, les rcoltes d'hiver, d't et d'automne
se succdent sans interruption. Ainsi s'explique le bond rapide qui a
doubl en moins d'un demi-sicle la population de cette vieille terre
d'Egypte : exemple non pas unique, mais particulirement saisissant
de la rpercussion directe qu'exerce sur les phnomnes de population
tout progrs conomique.
IL
GHALDE
L'Egypte s'est maintenue comme foyer de population humaine,
tandis que d'autres foyers ont dpri et, comme la Chalde, attendent
une hypothtique rsurrection. Ce n'est pas qu' l'origine les sources
de dveloppement aient manqu. C'est aussi le sol de couleur sombre,
mais plus jaune et plus imprgn de calcaire que celui du Nil, al Sawod,
qu'apportent le Tigre et l'Euphrate, qui servit de noyau la primi-
tive Chalde
^.
L'Euphrate, dont le flot de printemps charrie cette
alluvion, subit, dans les grands marcages que l'ancienne puissance de
Babylone parvint, pour un temps, assainir, une premire dcanta-
tion. C'est ce qui permit, en attendant les grands travaux de canalisa-
tion que devait accomplir la monarchie babylonienne, aux plus anciens
habitants de se grouper dj en nombre, de former de petits royaumes,
de btir ces villes dont les noms, depuis longtemps teints, retentissent
dans les plus vieilles lgendes bibliques.
Il est douteux cependant que les ressources de la contre aient
jamais suscit une densit de population telle qu'on peut la supposer
ds lors en Egypte. Les conditions de crue taient moins rgulires
;
leur amnagement, plus incertain et plus prcaire. Les dynasties
babyloniennes semblent incessamment proccupes d'augmenter par
des transplantations de peuples la somme de main-d'uvre qu'exigent
les grands travaux et l'entretien de cette civilisation urbaine. Volon-
tairement ou non, les trangers affluent. La population prsente un
aspect cosmopolite qui frappe les observateurs et qu'ont plusieurs
fois exprim les Grecs
^.
A travers tant de sicles, le fil de continuit s'est rompu. On voit
encore, aux approches de Bassora, les lambeaux de ces palmeraies
qui faisaient, le long de l'Euphrate, l'admiration des Romains au
1. Voir : Sir William Willcocks, Mesopotamia : Past, Prsent, and Future
(Geog. Journ., XXXV,
1910, p. 1-18, 4 pi. phot. et carte).
2. ll'ku ic);f,6o dtvOpw-irwv dXXoevwv, dit Brose au iii^ sicle avant notre re.
nd|jL[xiy.xov oy'ko^, avait dit Eschyle.
54 LA RPARTITION DES HOMMES SUR LE GLOBE
ive
sicle de notre re
^.
Mais, peuples et cultures semblent aujour-
d'hui rduits en poussire. Le corps de population qui constitue l'os-
sature rsistante de l'Egypte n'existe plus ici. O le trouver, parmi
ces groupes htrognes, vaguement valus un miUion d'hommes,
composs de Bdouihs nomades et d'agriculteurs ensemenant la
vole quelques fonds humides ? La reconstitution de ces antiques
populations de l'lam, de la Chalde, d'Assur qui multiplirent jadis
sur les bords du Karoun, de l'Euphrate et du Tigre, ne serait probable-
ment pas au-dessus des forces d'un grand tat moderne. Mais ce serait
une uvre de longue haleine. Et si, reprenant pied d' uvre le travail
sculaire de l'ancienne Chalde que les six derniers sicles d'anarchie
ont russi anantir, on essayait de vivifier nouveau le territoire
qu'elle embrassait, ce territoire, en fm de compte, ne dpasserait pas,
comme on l'a montr, 20.000 25.000 kilomtres carrs
^,
Prcieuse
conqute assurment, mais pour laquelle les prvisions les plus opti-
mistes restent bien en de des chiffres d'hommes que peuvent aligner
l'Inde, la Chine ou l'Europe.
Situs dans la zone sche qui traverse l'Asie occidentale, spars
par de grands intervalles dserts, ces lieux de concentration, de mme
que ceux du Ferghana et de Samarkand, sous les massifs neigeux de
l'Asie centrale, ne sont que des taches de densit sur un fond presque
vide
^.
L'Egypte seule, grce sa position entre l'Afrique et l'Asie,
la Mditerrane et la mer Rouge, est un carrefour d'espce humaine.
Elle prsente en petit le spectacle d'une de ces collectivits persistantes
qui fixent pour longtemps sur certains points le pivot des relations
des hommes.
HT.
ASIE CENTRALE
Ce n'est jamais en les considrant isolment, dans leurs avantages
propres, qu'on se rendra compte de grandes agglomrations occupant
de vastes tendues terrestres. Ces avantages peuvent rester nuls, s'ils
ne sont vivifis par un apport d'nergies et d'intelligences qui se com-
munique de contres d'autres. Il
y
a donc considrer les Uaisons qui
1. Ammien Marcellin (XXIV, 3, 12),
tmoin de l'expdition de Julien, dcrit
vivement ces forts de palmiers, instar ingentium nemorum .
2. Voir la discussion de Hermann Wagner : Die Uberschtzung der Anbauflche
Babyloniens (Nachrichten K. Ges. Wiss. Gttingen, Phil.-hist. Klasse, 1902, Heft
2,
p.
224-298, 1 pi.).
3. La densit, dans l'ensemble des districts agricoles du Ferghana, ne dpasse-
rait gure 30 habitants au kilomtre carr. Mais, dit A. Woeikof, le Ferghana
est le pays des contrastes. On
y
trouve des oasis population fort dense : peine
a-t-on dpass les murs en lss des jardins d'un grand village, qu'on aperoit les
jardins du village suivant. (Le Turkestan russe, Paris, 1914, p. 139.)
LES GRANDES AGGLOMRATIONS : AFRIQUE ET ASIE 55
existent entre l'ensemble continental et les rgions o sont venues
s'accumuler les alluvions humaines. C'tait une des ides chres
Karl Ritter que certaines contres avaient exerc une sorte de vertu
ducatrice sur les peuples : cela n'est vrai qu'autant que l'on observe
par quels chemins ces peuples
y
sont parvenus, c'est--dire par quelle
initiation progressive ils sont passs. La connexit de contres se pro-
longeant sur de grandes distances, capables d'ouvrir des perspectives
aux groupes qui s'y chelonnent, est, sous ce rapport, un fait de pre-
mire importance. Elle fournit des occasions de contact, sans ncessaire-
ment donner lieu des chocs.
L'attention est attire par l vers la priphrie extrieure des
hautes chanes de plissements qui sillonnent le continent asiatique.
Sur une frange plus ou moins troite qui les borde, se droule une
srie de contres dont quelques-unes sont trs anciennement spcia-
lises comme contres historiques. Ainsi le long des chanes de l'Ar-
mnie et de l'Iran, se succdent les noms d'Osrone, d'Assyrie, d'lam.
Autour du nud o se croisent les chanes de l'Asie centrale, se d-
roulent d'une part la Bactriane et la Sogdiane, de l'autre la Srique
;
et enfin, au Sud des Himalayas, le Pays des Cinq-Fleuves, l'antique
Pantschanada, aujourd'hui Pendjab. Terres de culture, en mme
temps que voies de relations et de commerce, elles ont servi de che-
minement aux hommes. Les voies historiques par lesquelles la Chine
communiquait avec l'Asie centrale longeaient, l'une au Nord, l'autre
au Sud du bassin du Tarim, les grandes chanes des Tian-chan et
des Kouen-lun. Tandis que, dans les repUs des chanes et dans l'int-
rieur des bassins qu'elles abritent, les obstacles aux libres communi-
cations s'accumulent, elles trouvent au contraire des directions traces
d'avance sur les terrasses qui se sont tales au pied des montagnes.
Les points o les rivires s'chappent des dfils montagneux ont
toujours t des sites de choix pour les tablissements humains.
L'eau est d'un maniement plus facile qu'ailleurs : on peut, grce aux
cnes de djections, driver des saignes en tous sens, et la pente
reste encore assez forte pour tendre au loin le rseau des rigoles.
Les Espagnols du Mexique, habitus ces pratiques lmentaires
d'irrigation, dsignaient sous le nom de bocca del agua les issues par
lesquelles les rivires sortent des Montagnes Rocheuses : dj avant
eux les Indiens Pueblos avaient su en tirer parti. Si mme le tribut
vers par les neiges et les glaciers est trs abondant, il arrive qu'en
aval l'eau souterraine afflue. Sous les sables qui succdent aux amon-
cellements de blocs et de graviers dont le fleuve s'est dcharg d'abord,
elle s'infiltre pour reparatre en sources, en fontanili, ou tre facile-
56 LA RPARTITION DES HOMMES SUR LE GLOBE
ment atteinte par des puits. En tout cas, l'emploi agricole des eaux
n'exige qu'un amnagement simple, et nullement hors de la porte
de ces indignes qui, suivant le mot d'un des meilleurs connaisseurs
de l'Asie centrale, savent fort bien utiliser les moindres ruisseaux,
mais sont incapables d'excuter des travaux d'irrigation importants
^
.
Le sol n'est pas moins propice que l'eau. Compos de terrains de
transport, il reste imprgn, sous le climat sec des rgions subtro-
picales, des substances que l'action des vents ou le ruissellement
des eaux
y
ont accumules. Soustrait au lavage puisant des pluies
tropicales, il tient en rserve une foule de rsidus solubles, d'lments
tels que chaux, potasse, magnsie, et par l une fertilit intrinsque
prte surgir. Chaque anne les hommes voyaient se renouveler
le mme miracle : une pousse subite de' vgtation, une floraison
merveilleuse jailUssant, au premier contact des pluies de printemps,
de terrains qui, auparavant, prsentaient toutes les apparences de
mort. Et ces lgions de plantes annuelles remplissaient en quelques
mois leurs promesses de grains ! Cette leon ne fut pas perdue pour les
hommes. Nulle rvlation, si ce n'est celle du feu, ne fit sur eux une
impression plus forte. Sans parler des mythes qu'elle engendra, elle
leur apprit surprendre et pier l'arrive de l'eau du ciel, adapter
leurs cultures en consquence. Il
y
eut, ct des oasis d'irrigation,
des cultures de terrains non irrigus. On appelle hangar, dans le Pend-
jab, les plateaux intermdiaires entre les valles irrigues ou khadar :
c'est, semble-t-il, le mme mot que bagara, par lequel les agriculteurs
iraniens de l'Asie centrale
^
dsignent les terres qu'ils ensemencent
dans l'espoir de l'humidit hivernale et printanire
;
terres qui, gn-
talement, sont contigus aux oasis irrigues. Ainsi les deux principaux
modes de culture se pntrent. Le bl, l'orge, le mil sont la fois des
plantes d'irrigation et de terrains secs. Il n'y a point entre l'oasis et
le dsert, entre le limon sombre et le sable fauve, cette limite inflexible
qui semble enfermer dans un tau le cultivateur des Ksour. Des
conditions varies et extensibles s'offrent l'tablissement des hommes :
pentes de lss arroses irrgulirement par les pluies, rivires grossies
par les neiges, et tous les suintements que, dans les hautes altitudes,
ont prpars les neiges et les glaciers. Sur ces bandes longitudinales
que dessine l'allure du relief, l'agriculture ne s'interrompt que pour
recommencer ensuite d'aprs un type semblable. L'usage de la charrue
et des mmes crales est pratiqu d'un bout l'autre.
1. Commission Impriale de Russie a l'Exposition Universelle de 1900,
La Russie Extra-Europenne et Polaire..., par P. de Semenof, Paris, 1900, p. 143.
2. P. DE Semenof, ouvr. cit.
LES GRANDES AGGLOMRATIONS : AFRIQUE ET ASIE 57
Depuis plus de vingt sicles, des incursions de hordes nomades
ont dchir en Asie le rideau de cultures, refoul vers les montagnes
les races qui en avaient fertilis les abords et auxquelles nous devons
une grande partie des plantes qui composent notre patrimoine. L'agri-
culteur tenace n'a pas lch prise. Partout o il
y
a de l'eau et la bonne
terre, on trouve le Sarte , dit un proverbe iranien
^.
Le paysan persan
s'est blotti, pour laisser passer l'orage, entre les murs de terre de son
bourg. Sur les plateaux de Kermelis et d'Erbil, d'actifs villages se
pressent autour des innombrables tumuli, vestiges des anciennes popu-
lations assyriennes. Telle est la puissance de certains faits naturels
qu'elle se manifeste partout par les mmes effets. C'est le long du ver-
sant oriental des Montagnes Rocheuses que cheminrent les migra-
tions indignes vers le Mexique. C'est l'aide des oasis chelonnes
au pied des Andes que les Incas du Prou propagrent leur civili-
sation vers le Sud, jusqu'au ChiU
2.
Mais il ne s'est pas trouv en Am-
rique, au bout de ces voies de transmission, une Chine ou une valle
du Gange.
IV.
CHINE
Le peuple qui a multipli dans les plaines alluviales du Houang-ho
et du Yang-tseu, et dont le nom s'associe, pour nous, une ide de
pullulement dans l'tendue, les Chinois, rattachent leur origine aux
pays de l'Ouest. Jamais, d'ailleurs, leurs relations n'ont t rompues
avec l'Asie centrale, d'o ils tiraient le jade, les chevaux, o ils ta-
blirent longtemps leurs marchs de soie. La priphrie septentrionale
du massif central asiatique avait pour issue naturelle, vers l'Est, la
zone d'coulement o l'rosion ravive entrane les eaux intrieures
la mer. Les bassins intrieurs, les anciennes cuvettes lacustres
subissent ds lors une transformation : dessales par l'afflux conti-
nuel des eaux courantes, renouveles par l'apport continuel d'allu-
vions, elles entrent en liaison les unes avec les autres : liaisons encore
imparfaites, il est vrai
;
car le Houang-ho et ses affluents passent par
des alternances de bassins et de gorges. Nanmoins cela sufft pour
introduire plus de continuit entre les groupes, plus de libert dans
leurs relations rciproques. Le contact de ces rgions fut dcisif pour
ce peuple d'agriculteurs. Un sursaut de fcondit se produit chaque
fois que des groupes dj arrivs certain degr de civilisation, mais
1. Ajouter celui-ci non moins caractristique : Si un Sarte s'enrichit, il btit
une maison. (A. Woeikof, ouvr. cit, p. 130.)
2. Voir
'.
IsAAH BowMAN, The Rgional Population Groups
of
Atacama (Scoitish
Geog. Mag., XXVI, 1910, p. 1-9, 57-67, 1 fig.).
58 LA RPARTITION DES HOMMES SUR LE GLOBE
dans des conditions relatives de pauvret et de rudesse, trouvent
occasion de pratiquer dans un milieu plus riche, dans une ambiance
plus large, les qualits auxquelles ils avaient d leurs progrs. Les
Bni-Isral ne tardrent pas multiplier quand ils quittrent les
steppes de l'Aram pour les terres plus fertiles de Chanaan. L'hellnisme
acquit une force nouvelle de multiplication sur ces terres d'Asie
Mineure et de Sicile, auprs desquelles la Grce continentale semblait
avoir la pauvret pour compagne
^
. Ainsi arriva-t-il aux Germains,
quand, sortis de leurs ingrats domaines du Nord, ils commencrent
s'panouir dans les pays rhnans. C'est ce qu'avaient prouv les
tribus chinoises lorsque, une poque qu'il est difficile de dtermi-
miner, elles descendirent des oasis orientales de l'Asie intrieure
pour se rpandre dans la valle du Ve-ho, le grand affluent du fleuve
Jaune.
Parmi les provinces historiques de la Chine, le Kan-sou et le Chen-si
marquent le chemin suivi. Elles sont en liaison naturelle. Dans la pre-
mire, le dsert est encore pressant et partout visible ; les villes qui
s'chelonnent sporadiquement depuis Sou-tcheou jusqu'au fleuve Jaune
ont encore le caractre d'oasis. Mais, ds l'entre du Chen-si, la conti-
nuit des cultures est dsormais assure
;
elle se prolonge en se trans-
formant. Les cultivateurs d'oasis apportrent jadis dans ces plaines
de lss des arts agricoles nouveaux avec lesquels ils taient dj fami-
liariss, l'irrigation des champs au moyen des eaux drives des mon-
tagnes. Mais en revanche, en face de nouveaux problmes, ils apprirent
eux-mmes amplifier leurs mthodes et leurs efforts pour s'attaquer
de plus grandes forces naturelles.
Un lien de filiation reste manifeste, toutefois, avec les cultures nes
sur les pentes de l'Asie centrale. Mme habilet distribuer en rseau
artificiel les rivires pourvues de pente, combiner les cultures de
plateaux avec celles des valles. Cette civilisation agricole, avant de
s'panouir dans les vastes plaines deltaques, semble regret s'carter
des chanes
;
elle en suit le pied, en borde fidlement la frange dans
le Tche-li et le Chan-toung
;
ou bien eUe se prlasse dans des bassins
de dimensions encore restreintes : celui de Ta-yan-fou, dans le Chan-si,
un des berceaux de la civilisation chinoise, n'a qu'une tendue de
5.000 kilomtres carrs
; celui de Si-ngan-fou, sur le Ve-ho, un des
plus anciens centres populeux, n'en a gure plus du double. Mais grce
un rgime de pluies plus favorables bien qu'alatoire encore dans ces
provinces du Nord, la terre jaune manifeste pleinement sa puissance
1. IlevTi auvxpocpo (HRODOTE, VII, 102).
LES GRANDES AGGLOMRATIONS : AFRIQUE ET ASIE 59
de fcondit. Elle devient le talisman auquel est attache l'existence
de ce peuple.
La conqute des grandes tendues n'a pas procd en Chine par
grandes enjambes, comme elle put le faire de nos jours aux tats-
Unis ;
mais pas pas, minutieusement, suivant le gnie menu et les
habitudes ataviques de la race. Une progression graduelle est sensible
dans le sens o, de plus en plus, les horizons s'ouvrent, les montagnes
s'cartent, et que suit le cours des eaux. Un ciel moins avare de pluies,
un sol o la terre jaune s'miette et se disperse en alluvions, accueille
dans le Ho-nan, province mdiatrice entre les deux rgions de la
Chine, Cathay et Manzi, les immigrants venus de l'Ouest ou du Nord.
Par del la chane transversale qui spare les bassins du Houang-ho
et du Yang-tseu, l'atmosphre d'ardent soleil baigne par les pluies
de moussons permet, malgr la disparition du lss, un plus riche
assortiment de produits. Dans cette ambiance nouvelle, l'organisa-
tion acquise ne prit pas : les cadres taient forms, il sufft de les
largir. Tout ce qui caractrise, en effet, une conscience collective
plus large se rattache ce groupement de provinces, Chen-si, Ho-nan,
Chan-toung, o s'ouvrirent les vastes perspectives : l est le sjour des
premires dynasties, le site des plus anciennes capitales
\
la patrie
des sages et des philosophes. Au del encore, la contre intermdiaire
o se fondent les contrastes du Nord et du Sud, la province de Ho-nan,
au Sud du Houang-ho, a reu de la phrasologie chinoise la qualifica-
tion de Fleur du Milieu . La population qui, dans le Nord, s'agglo-
mre en villages, se dissmine ici en innombrables hameaux
;
image
d'panouissement et de confiance, parfois mal place, car l'irrgularit
des saisons suspend toujours la menace de famine.
Mais dans la rgion o se confondent les alluvions des deux grands
fleuves, la lutte contre la nature soulve plus de diffcults. Ce n'tait
jadis qu'un ddale de marais et de lagunes, entre lesquels vagabondaient
des rivires fortes crues
; l'accs en est encore assez difficile pour
avoir arrt en 1856 la marche des Tapings vers le Nord. De temps
en temps le monstre sort de sa cage : le Houang-ho, changeant
brusquement de lit, prcipite un flot trouble travers les campagnes
^.
La lutte contre de tels ennemis rclame force de bras
;
il n'y a pour de
telles contres qu'une alternative, sauvagerie ou surpeuplement.
1. Si-ngan-fou (Ghen-si), Lo-yang (Ho-nan) ; celle-ci vers le iii^ sicle avant
notre re, quand commencent les premiers travaux de canalisation entre les deux
grands systmes fluviaux.
2. En 1850, le Houang-ho, abandonnant son ancienne embouchure, s'en creuse
une nouvelle par 4 degrs plus au Nord.
0 LA REPARTITION DES HOMMES SUR LE GLOBE
La religion et l'tat surent
y
pourvoir. L're des grands travaux
collectifs s'ouvrit en Chine en 486 avant notre re, par le creusement
d'un premier tronon du Grand-Canal, quatre ou cinq sicles environ
avant qu'elle ne comment au Japon
^.
C'est le moment o une vue
d'ensemble, exigeant du peuple de travailleurs, se substitua aux entre-
prises particulires et locales. La question de population qui, chez
cette race de petits cultivateurs, tait dj une affaire de famille,
devint aussi affaire d'tat. Dj, en Chine comme dans l'Inde, la
ncessit conomique transforme en rgle religieuse avait donn
lieu un culte de famille. Pour la morale chinloise comme pour la
doctrine brahmanique, le mariage et la procration d'une descendance
nombreuse sont le devoir sacr qui assure aux anctres l'accomplisse-
ment des rites domestiques. Il s'y joignit en Chine un intrt politique.
L'empereur, chef de la grande famille, pratiquait des recensements
plusieurs sicles, dit-on, dj avant notre re
;
il
y
avait des primes
la population, des amendes sur le clibat. Si parfois l'augmentation
paraissait insuffisante, la complaisance de la statistique ne se faisait
pas faute d'enfler les chiffres. Mais les ralits suivaient. Le mot
effrayant revient sous la plume des Europens la vue du nombre
d'enfants dans les foules chinoises
^.
Partout o se concentre l'acti-
vit chinoise, travaux de rizires, halage de bateaux, banlieues sans fin,
tumulte dans les rues, on a l'impression que le rservoir humain coule
pleins bords.
On ne sait pas au juste quelle est actuellement la population totale
de la Chine propre : le chiffre en a t probablement exagr dans des
estimations prcdentes s'inspirant trop d'analogies europennes
^.
Cette population est loin de former une trame continue. Entre ces
bassins o elle s'est concentre et o elle a multipli plaisir, s'inter-
posent comme des marches-frontires qu'elle n'a pas entames, por-
tant son effort exclusif sur le pied des montagnes, les plaines canalises,
les bassins intrieurs o se pratiquent les cultures traditionnelles.
Le bassin intrieur que dessine la province dite des Quatre-fleuves
(Sseu-tch'ouan), o se rassemblent les eaux de quelques-unes des
plus hautes montagnes du monde, passe bon droit pour une des
1. Le P. Dominique Gandar, Le Canal Imprial... (Varits sinologiques, n
4)
Chang-hai, 1894.
G*^ de Yanagisawa, Histoire critique des travaux statistiques
au Japon depuis l'Antiquit jusqu' la Restauration impriale (Bull. Institut int.
de StaU, XIX, livr. 3, La Haye,
(1912), p.
245-307).
2. Par exemple : Ferdinand von Richthofen's Tagebiicher aus China. Ausge-
whlt u. hrsg. v. E. Tiessen, I, Berlin, 1907, p. 55, 564.
3. Le chiffre de 302.110.000 habitants (pour les 18 provinces), indiqu par un
recensement de 1910, semble se rapprocher de la vrit. (The Statesman's Year-
Book 1917, p. 763.)
LES GRANDES AGGLOMRATIONS : AFRIQUE ET ASIE 61
merveilles d'irrigation o triomphe l'agriculture chinoise
^
;
la popu-
lation
y
atteint, dans la plaine centrale de Tch'eng-tou, une densit
qu'on peut valuer entre 300 et 350 habitants par kilomtre carr,
mais elle est peu prs concentre dans cette partie de la province.
Si l'on value approximativement 45 milUons la population totale
du Sseu-tch'ouan, il convient d'ajouter que les deux tiers au moins
se trouvent dans la partie centrale
^.
Le reste, c'est--dire les flancs levs des montagnes, les parties
chappant par leur altitude ou par leur loignement aux procds
de fcondation que ncessite la proximit immdiate de centres habits,
est rest le domaine des populations antrieures, continuant
y
pra-
tiquer une culture plus ou moins primitive. Ds que cesse la rgion
de lss, o le sol est capable de produire sans engrais de riches mois-
sons, et qu' sa place, au Sud du Ho-nan, se droulent ces terres
incessamment laves par les pluies dont il faut sans relche reconsti-
tuer la fertilit, une marge plus grande est abandonne ces popula^
tions qui, sous diffrents noms
^
reprsentent les couches antrieures,
sinon la couche primitive, sur lesquelles se sont tendues, comme une
alluvion nouvelle, les races plus avances en civilisation. Historique-
ment, cela s'exprime par une colonisation procdant d'abord de
rOuest l'Est, puis du Nord au Sud. Elle s'panouit en atteignant
les grands bassins intrieurs qui relient le Yang-tseu et ses magni-
fiques affluents. Lorsque, par l'accroissement mthodique de ses res-
sources et sous l'impulsion de ses vieilles dynasties, elle parvient
disposer d'une technique et d'une main-d'uvre suffisantes pour
affronter les grands travaux de canalisation et d'endiguement, son
domaine s'agrandit d'une conqute o cette multitude prolifique
va dmesurment pulluler. Mais, dans le dveloppement organique
de la civilisation chinoise, ces plaines deltaques font l'effet d'une
excroissance norme qui s'est greffe sur le tronc principal. L n'est
1. Voir : Archibald Little, The Far East, Oxford, 1915, chap. vi,
p. 78 et suiv.
;
Chambre de Commerce de Lyon, La mission lyonnaise d'exploration commerciale
en Chine, 1895-1897, Lyon, 1898, premire partie, livre II, p. 125
;
p. 175, note 2
;
Dans les parties accidentes, le cours d'eau a t supprim
; la surface du sol
est transforme en une srie de gradins, et l'eau s'coule de l'un l'autre.
2. La mission lyonnaise,
p. 232, 256.
De mme, dans le Chan-toung, Richthofen
note l'extraordinaire ingalit de la rpartition des habitants. (China, Ed. Il,
Berlin, 1882, p. 256.)
3. La, dans les montagnes du Chan-toung oriental
;
~
Lolos, Miao, Mantz
dans le Sseu-tch'ouan. La i^opulation qui vit sur le fleuve de Canton serait un
reste des habitants primitifs.
Sur les tribus aborignes entre Fou-kien, Kiang-
si et Tcho-kiang, voir : The Book
of
Ser Marco Polo... Translaied... by Colonel
Sir Henry Yule, Third dition, revised... by Henri Cordier, II, London, 1903,
p. 228, note 3.
On entrevoit dans toute la Chine un substratum ethnique sur
lequel s'est dpose l'alluvion chinoise.
62 LA RPARTITION DES HOMMES SUR LE GLOBE
point l'axe de la Chine. Le chemin de fer central de Pkin Han-k'eou
correspond mieux que la rgion littorale aux directions qu'a suivies
ce peuple. Quand enfm les bassins et les plaines alluviales se rtr-
cissent et font place aux rgions montagneuses et entrecoupes des
provinces du Sud, le flot se divise et va s'afaiblissant
^.
Il s'infiltre
nanmoins par les valles, par les embouchures des fleuves. Et c'est
ainsi qu'il s'insinue profondment, mais progressivement modifi,
dnatur par un mtissage continuel, dans l'Indochine, l'Indonsie,
le monde malais
; tapes d'o il serait prt dborder, en dpit des
barrires qu'on lui oppose, sur tout le pourtour du Pacifique.
V.
INDE
L'tude des grandes agglomrations humaines qu'encadrent d'une
part l'Hindou-koutch et les montagnes de l'Assam, de l'autre les Hima-
layas et le cap Comorin, montre les analogies profondes des grands
phnomnes humains
^.
A l'origine des mouvements qui ont dvers
sur l'Inde, comme sur la Chine, des flots nouveaux de populations,
agit une cause gographique : le passage de l'Asie sche l'Asie humide,
de la rgion des oasis celle des pluies de moussons. La transition
est naturelle entre les valles que fertilisent les eaux du Naryn, du
Zarafchan, de l'Oxus et le Pays des Cinq-fleuves, le Pendjab, vestibule
historique, et sans doute aussi prhistorique, des invasions et immi-
grations de peuples.
Les tribus aryennes, que l'acheminement le long des montagnes
guida vers la grande plaine indo-gangtique,
y
trouvrent aussi vers
l'Est, comme les tribus chinoises affluant du Kan-sou et de l'Asie cen-
trale, l'attrait d'un enrichissement progressif de nature. Au del du
seuil de Sirhind, les pluies de moussons se prononcent et se rgula-
risent
;
le sol sablonneux s'imprgne de rserves d'eau une faible
profondeur, la surface du Doah, ou Msopotamie entre la Djoumna et
1. On a souvent constat la rapidit avec laquelle s'est reconstitue la popula-
tion sur les bords du Yang-tseu, aprs l'insurrection des Tapings (1852-1864), qui
avait cot la vie des millions d'hommes. Cependant il n'en est pas ainsi dans les
provinces montagneuses du Sud. Le Koue-tcheou n'a pas rpar encore aprs un
demi-sicle, malgr les immigrants venus du Sseu-tch'ouan, les vides laisss par
la grande rvolte. (De Mecquenem, Le Koue-Tchou. Essai sur le commerce ext-
rieur de la province, dans Bull, de Gog. hisL et descriptive^ XXIV, anne 1909,
p. 384-395.)
2. Le peuple de l'Inde, d'aprs la srie des recensements (Annales de GographiSy
XV, 1906, p. 353-375, 419-442, 8 fig., cartes et diagr.).
D'aprs le recensement
de 1911, la population de l'Inde (provinces britanniques et tats indignes compris,
mais dfalcation faite de la Birmanie et du Bloutchistan) est d'environ 302 millions
d'habitants (environ 280 millions en 1901).
LES GRANDES AGGLOMRATIONS : AFRIQUE ET ASIE 63
le Gange, est perce d'innombrables puits. Le peuple des palmiers,
figuiers,
lauriers, s'enrichit de nouvelles recrues
;
les cultures de riz,
bananiers, canne sucre, viennent s'ajouter celles des saisons sches.
Comme en Chine, une sorte de conscration religieuse s'attacha la
contre o des populations laborieuses et pauvres s'taient vues
initier une vie plus large. Chose remarquable, en effet, ce n'est pas
le Bengale, o pourtant les facults nourricires sont leur comble,
qui marqua ainsi dans les traditions reconnaissantes de ce peuple
;
c'est la haute valle du Gange jusqu' la ville sacre de Bnars,
qui dans le sanscritisme brahmanique est la contre bnie, le Pays du
Milieu, Madhia desa ! Jusque-l se conserve peu prs dans sa puret
le type de communaut villageoise que les Aryens avaient apport
avec eux, comme une organisation traditionnelle dont la discipline
rglemente voque les rgions sches d'o ils venaient.
Mais plus on avance vers les rgions de pluies abondantes, soit
vers l'Est dans le Bengale, soit vers le Sud vers Cochin et Travancore,
plus les groupements se dissminent et se multiplient
;
le village
ferm fait place une poussire de hameaux entre lesquels il est sou-
vent difficile de tracer une sparation. Mme changement en Chine.
Lorsqu'on a franchi vers le Sud les provinces de Ho-nan et de Chan-
toung, le changement de nature se traduit par une dispersion caractris-
tique des habitations. D'innombrables petites fermes, toutes sem-
blables, groupes par douzaines de maisons en terre avec quelques
arbres : rarement on voit un plus grand village
^
: ainsi se prsente
la physionomie des campagnes qu'arrose le Han, dans la province de
Hou-p. Et dans la plaine de Tch'eng-tou (province de Sseu-tch'ouan),
les membres de la Mission lyonnaise s'tonnent de cette route qui
pendant 80 kilom. environ n'est, pour ainsi dire, qu'une seule rue
borde de maisons
^
. L'espce humaine s'panouit plus librement
sur un sol plus riche en promesses : toutefois les bases de l'tat social
ne diffrent qu'en apparence. Le village ferm tait une expansion
de la famille
;
le hameau, c'est la famille elle-mme unissant ses forces
en une petite communaut agricole
^.
1. RiCHTHOFEN, TagebchT, I, p. 437.
Voir aussi : Die wissenschafiliche
Ergebnisse der Reise des Grafen Bla Szchenyi in Ost-Asien (1877-1880), I, Wien,
1893, p. 113.
2. Chambre de Commerce de Lyon, La mission lyonnaise, Premire partie,
livre II, chapitre i^', p. 125.
3. Telle est l'image que prsentent en raccourci les rituelles iconographiques chi-
noises, et que dcrivent sur le vif plusieurs voyageurs. Richthofen, par exemple,
dans ses notes sur la province de Tcho-kiang, crit : C'est une des plus jolies scnes
de famille qu'on puisse voir, que le grand-pre avec sa nombreuse descendance,
en train de surveiller la cueillette et les prparations diverses des feuilles de th.
64 LA RPARTITION DES HOMMES SUR LE GLOBE
Ainsi se composent d'une multitude de petits groupes, cellules
vivantes, ces agglomrations dont la masse nous tonne. La trame est
forme d'une entrecroisement innombrable de fils tnus, mais qui n'en
sont pas moins solides et rsistants. Les alignements d'habitations
qui se succdent dans le Nord de la Chine sont combins de faon
runir en un groupe les familles qui se rattachent les unes aux autres
par une communaut de descendance et de rites. Dans le village-type
de l'Inde septentrionale, les liens de famille constituent une telle
chane entre les habitants que, par suite des prescriptions et prohi-
bitions qui rglent le mariage, les unions dans le village mme sont
rendues presque impossibles
^.
On cherche femme dans le village
voisin.
Sur ces ensembles, toutefois, plane un air de ressemblance. Une
civilisation commune les pntre, capable de gagner de proche en
proche, et doue, dans l'Inde non moins qu'en Chine, d'une force
remarquable de propagation. On est en prsence d'une de ces impo-
santes crations humaines qu'une longue histoire a faonnes. D'un
nombre d'hommes d'origines diverses, rassembls poques succes-
sives dans certains domaines privilgis, elle a fait un bloc. Il a fallu
pour cela un apport plusieurs fois renouvel d'activits, un patrimoine
grossissant d'acquisitions. Une force de rapprochement et de concen-
tration s'est dgage, capable de maintenir dans un rapport de collec-
tivit d'immenses multitudes humaines : non toutefois sans que, dans
les interstices de ces grands corps, il n'y ait place pour des groupes
rfractaires, rests fidles leur tat primitif
2.
Il en tait ainsi dans
ces grandes monarchies qu'autrefois ont vues l'Egypte, la Perse,
et par l ces civilisations contemporaines de l'Inde et de la Chine
restent empreintes d'un trait d'archasme.
Plus on tudiera la composition de ces agglomrations, mieux on
verra qu'elles sont le rsultat d'une sdimentation prolonge, et dans
les alluvions qui ont contribu les former, on reconnat les apports
successifs guids par des voies naturelles. Aux peuples plus avancs
o chacun a son rle dsign. Les meilleurs jardins de th sont ici des hauteurs
de 500 800 mtres... (Tagebcher, II, Berlin, 1907, p. 35.)
1. Le peuple de l'Inde... (Annales de Gographie, XV, 1906, p. 373).
A ces
liens s'ajoutent dans l'Inde ceux que noue le systme des castes. Il est, crivions-
nous, plus malais l'Hindou qu' tout autre homme de se dtacher de son groupe
social. Les prescriptions de caste sont telles que, ds qu'il s'en loigne, les difficults
se multiplient pour lui
'chaque acte de la vie. Il en rsulte que plus des neuf
diximes des habitants sont recenss aux lieux mmes de leur naissance.
2. Entre les grands foyers de population de l'Inde, ceux du Nord et du Sud,
on trouve (vers les sources de la Nerbudda), les Baigas, petits hommes vivant de
chasse et arms de flches empoisonnes. Non loin de l les tribus des Bhils et des
Gonds n'ont pas un tat de beaucoup suprieur.
LES GRANDES AGGLOMRATIONS : AFRIQUE ET ASIE 65
dont la vague est venue en dernier lieu, il a appartenu d'imprimer
sur ces contres le sceau d'institutions sociales et politiques, qui,
dsormais, les dsigne et les classe dans le monde. Leur rle a con-
sist surtout mettre, par l'ascendant de leur civilisation, plus de
cohsion entre les groupes prexistants, assembler en une construc-
tion des matriaux pars. Ils se sont superposs des couches ant-
rieures.
Nous ne pouvons encore que souponner les mlanges dont se
compose l'agglomration chinoise. Au Japon on distingue au moins
trois ou quatre types fondamentalement diffrents. Quant l'Inde,
les recherches poursuivies depuis trente ans par l'Ethnographie Survey
nous font entrevoir combien d'lments divers entrent dans cet en-
semble de 300 minions d'hommes. Pour ne parler que de la plaine
indo-gangtique, que de variantes et quelle insondable diversit de
races sont recouvertes sous ces tiquettes sommaires et provisoires :
indo-aryen, aryo-dravidien, mongolo-dravidien ! Ds qu'on entre
dans l'analyse des caractres ethniques, on souponne de bien autres
diversits que celles des langues, et l'on commence distinguer sur
quels fondements et de combien de matriaux s'difient ces blocs
humains si bien ciments qu'ils semblent dsormais toute preuve.
Toutefois, leur force d'accroissement n'est pas illimite, pas plus
que la sve d'inventions qui les a anims dans le principe. La sve
semble tarie et l'accroissement semble aujourd'hui arriv un point quasi
stationnaire. Rien du moins, pas plus dans l'Inde qu'en Chine, ne peut
tre compar aux progrs qu'a accomplis, dans le cours du xix sicle,
la population de l'Europe. La population de la Chine, d'aprs un
juge bien plac pour en parler, le ministre amricain W. W. Rockhill
^,
ne se serait que trs lentement accrue pendant le sicle dernier. L,
comme dans l'Inde, l'abondante natalit est tenue en chec par une
mortalit presque aussi forte. Considre par petites priodes, la
population peut accuser parfois un accroissement notable
; mais
il faut, pour en bien juger, prendre du recul. C'est l'ternelle histoire
des vaches grasses. Vienne ensuite la priode contraire : un cortge
de flaux, famine, pidmies, dfiant l'effort mme de l'Administra-
tion britannique, ne tarde pas, comme en vertu d'une priodicit,
s'abattre
;
et du coup disparaissent tous les tres faibles que la misre,
le dfaut d'hygine, la vie prcaire, avaient prdisposs leurs coups.
1. The 1910 Census
of
the population
of
China, Toung Pao ou Archives concernant
l'histoire, les langues, la gographie et l'ethnographie de l'Asie orientale, XIII,
1912, p.
117-125 (voir aussi : BuL American Geog. Soc, XLIV, 1912, p. 668-673).
Vidal-Lablache, Gographie humaine. 5
66 LA RPARTITION DES HOMMES SUR LE GLOBE
VI.
ARCHIPELS ASIATIQUES.
JAPON
Le continent asiatique tait, par sa configuration taille grands
traits, par l'tendue des rapports qu'il ouvre, seul apte fournir
de telles agglomrations le domaine qui leur convient. Mais l'ombre
de ce continent, se droule un monde insulaire que les moussons
mettent en continuels rapports avec lui. Sumatra, Java, Borno n'en
ont t dtachs qu' une poque postrieure au dveloppement
d'une puissante animalit parmi laquelle figurent les plus anciens
spcimens connus d'espce humaine
^,
A la faveur des articulations
innombrables qui dcoupent ces archipels dont Marco Polo bloui
estimait les les par milliers, s'est forme ce qu'on appelle la race
malaise : groupe plutt que race, n du mlange et de la fermentation
de la vie maritime. Par l'une de ses extrmits il se lie aux Dravidiens
du Dcan et par l'autre aux races de la Core et de la Chine.
Dans cette immense diffusion, les lments les plus htrognes,
les degrs les plus ingaux d'tat social coexistent. Entre les ctes et
l'intrieur s'accusent de profondes diffrences : de trs anciens afflux
d'immigrants, Tamouls de l'Inde ou Chinois du Fou-kian, ont rpandu
sur le littoral des contingents sans cesse accrus d'hommes et de civi-
lisations, tandis que, dans les valles et sur les pentes des montagnes,
vgtaient des tribus demi-civilises comme les Bataks de Sumatra
ou les Dayaks de Borno 2, et que de vritables primitifs parvenaient
maintenir leur survivance dans l'intrieur des forts tropicales.
La
concentration de la population s'est ralise dans quelques parties
seulement de ce domaine insulaire : Java o, ds les temps anciens,
les Hindous apportrent leurs cultures de riz, les lments d'une civi-
lisation suprieure et qu'ils prdisposrent ainsi profiter merveilleu-
sement de la scurit et des avantages de l'administration euro-
penne
^
;
enfin dans les Philippines, o la valle centrale et la rgion
deltaque du Sud de Luon montrent une densit en voie rapide
d'accroissement
*.
1. On connat la sensationnelle dcouverte du D' Eugne Dubois, en 1891, sur
la rive gauche de la rivire Bengavan (centre de Java).
Borno possde une faune
remarquablement riche de mammifres (175 espces connues).
2. Les villages (kampongs) des Bataks montrent un haut degr d'organisation
(maisons de chefs, magasins de riz, ateliers de forgerons).
Les Dayaks ont aussi
un tat de civilisation assez avanc. Mais chez tous ces peuples de l'intrieur la
population est stationnaire ou diminue.
3. Depuis le premier recensement quinquennal (1875), la population de Java-
Madoura est passe de 18 millions 36.
4. La population dite civilise des Philippines a doubl de 1845 1903. (F. Mau-
RETTE, Les Philippines d'aprs le recensement de 1903, dans Annales de Gographie
y
XVI, 1907 p. 257.)
LES GRANDES AGGLOMRATIONS : AFRIQUE ET ASIE 67
Les trois principales les de l'archipel japonais, Kiou-siou, Sikok
et Hondo, reprsentent aujourd'hui une agglomration humaine
suprieure en nombre total celle des Iles Britanniques, l'extrmit
oppose de l'ancien continent
^.
Les traces de l'homme sont trs
anciennes dans cet archipel, de mme que sur tout le pourtour sud-
oriental du continent asiatique. L'ide que l'on peut se faire de la
dmographie de ce Japon primitif est celle d'une population laquelle
les abondantes pcheries de son littoral maritime valurent de bonne
heure une densit relativement forte. On sait quel point le poisson
entre aujourd'hui comme nourriture principale dans l'alimentation
japonaise
^.
Un vingtime de la population actuelle se livre encore la
pche. Dans aucune contre, a-t-on pu dire, la mer n'a pris une plus
grande part au dveloppement matriel et moral d'un peuple. Nul
doute qu'une formation prcoce de densit n'ait t atteinte de ce
chef sur les ctes japonaises.
Ce littoral dcoup, baign par les courants, n'est pas sans analogie
avec la cte de sounds et de fiords qui s'tend, sur l'autre bord du
Pacifique, entre le Puget Sound et l'Alaska. L aussi, de riches pche-
ries, la rencontre des courants, ont amass de bonne heure une
population relativement nombreuse. Mais, pour que le Japon ne
demeurt point au stade o se sont arrtes ces tribus Nutkas, Thlin-
kit, etc., du Nord-Ouest amricain, d'autres causes sont entres en
jeu. Le contact de l'Asie tait autrement fcond que celui de l'Am-
rique prcolombienne. La proximit d'un grand continent populeux
et civilis est historiquement sensible aux environs du vn^ sicle
avant notre re. C'est dans l'le la plus mridionale, Kiou-siou, la
plus rapproche de la Core et de la Chine, que commence le travail
d'organisation qui donne son estampille la socit en formation.
De l, elle rayonne et multiplie. Elle gagne successivement les deux
grandes les avec lesquelles la mettent en rapports les innombrables
indentations de la mer intrieure. L'le de Hondo tait encore, dans
l'intrieur, occupe par un peuple qui est rest pour les Japonais
l'image mme de la barbarie, les Anos
^.
Tandis qu'ils sont impitoyable-
ment pourchasss vers le Nord, les dynasties impriales se font, au
1. Population du Japon (Kiou-siou, Sikok, Hondo, Yso) en 1915 : 55 millions
d'habitants, prs de 200 habitants au kilomtre carr, si l'on fait abstraction de
Yso.
2 Voir : Hugh M. Smith, The Fisheries
of
Japan (National Geog. Mag., XV,
1904, p. 362-364).
3. La grande plaine de Tokio tait encore occupe, au premier sicle de notre
re, par ces hommes aux traits frustes, l'abondante pilosit, d'aspect trange
pour les Japonais. Mais ds le quatrime sicle les habitants de Yso commencent
tre soumis l'influence de l'Empire,
68 LA RPARTITION DES HOMMES SUR LE GLOBE
contraire, un devoir d'accueillir et de rpartir parmi leurs sujets les
immigrants qui viennent de Chine et de Core
^.
Ceux-ci apportent,
en effet, des arts nouveaux, soit pour l'industrie, soit pour l'agriculture
et l'amnagement des rizires. Ce flot prcieux d'immigrants est ali-
ment par les flaux qui frappent priodiquement les populations du
continent voisin : famines, rvoltes, guerres civiles et trangres.
Le lgendaire pays de Zipango joue cet gard le rle de refuge et
renforce ainsi maintes reprises son peuplement. Telle a t souvent
la destine des les aux poques troubles qui bouleversent les popu-
lations des (continents
;
tel fut, en Europe, le rle des les Ioniennes
au temps des invasions turques.
Si l'on met hors de compte la croissance urbaine, due surtout
l'apparition rcente de la grande industrie, l'intense peuplement
japonais est strictement attach l'amnagement des rizires et aux
cultures dlicates (th) auxquelles les pentes infrieures des collines
prtent leur abri. Un amnagement minutieux et parcellaire du sol,
dans des compartiments exigus qu'encadrent les montagnes, l'irriga-
tion assure par les pluies de moussons, l'engrais fourni par les dbris
de poissons ou par les herbes dont on dpouille la montagne, telles
sont les bases d'une conomie rurale aussi intensive que restreinte.
Pas ou peu d'levage
;
pas d'exploitation des montagnes. L'homme
n'a song demander aux versants que couvre une mosaque fleurie
de plantes herbaces (hara), qu'un engrais enfouir dans le sol,
peut-tre aussi un plaisir esthtique, un principe d'art. Ce n'est pas
sans surprise qu'on constate que dans les trois grandes les o s'est
constitue la civilisation japonaise et dont la population atteint une
densit comparable celle de l'Angleterre et de l'Italie du Nord, la
superficie cultive n'atteint gure que le septime du sol
^.
Mais
c'est une culture de jardiniers, obtenant par an deux rcoltes et mme
trois dans le Sud-Ouest. Le Japonais, en sa qualit d'imitateur, se
montre encore plus spcialiste que le Chinois dans le choix des espaces
qu'il met en valeur.
La densit s'abaisse progressivement, au Japon, vers le 40 degr
de latitude (Nord de Hondo) et tombe dans l'le d'Yso moins de
20 habitants par kilomtre carr. Mme chute brusque sur le conti-
nent, lorsque au del des plaines de Pkin et du littoral on dpasse
1. Des immigrations chinoises et corennes sont signales ds 219 avant l're
chrtienne. Elles se multiplient dans les sicles suivants. (G' de Yanagisawa, mm.
cit.)
2. Terres cultives : 15 p. 100 de la superficie totale. (D' S. Honda, L'agriculture
au Japon, Paris, Exposition Universelle de 1900, p. 20.)
LES GRANDES AGGLOMRATIONS : AFRIQUE ET ASIE 69
le
40^ degr. Depuis trois sicles que les plaines du Leao, au pied des
montagnes de Mandchourie, ont t entames par la colonisation
chinoise, ses progrs n'ont gure dpass encore la province de Mouk-
den. Celle-ci n'a mme qu'une densit infrieure celle de la mon-
tagneuse Core ^, et au del, dans la province de Girin, par 45^
de lati-
tude, c'est un chiffre tout fait insignifiant que tombe la proportion
relative d'habitants. Ainsi les grands rassemblements humains cessent
en Asie peu prs vers la latitude o ils se renforcent en Europe.
Est-ce la nature seule qu'il convient d'incriminer ? Sans doute la
rudesse du climat continental, qui dj dans le Sud de la Mandchourie
ne permet que des bls de printemps, doit entrer en ligne de compte
;
mais une culture perfectionne et trouv un vaste champ dans ces
paysages de parc, mlanges de prairies et de bouquets d'arbres, qui
caractrisent la Province de l'Amour et qui reprsentent probablement
la physionomie vgtale primitive de notre Europe.
VIL
CONCLUSION
En ralit, cette limite asiatique des grandes agglomrations hu-
maines est celle d'une forme de civilisation. Le Chinois comme le
Japonais ont pouss le plus loin qu'il leur tait possible avec leurs
procds traditionnels, la culture minutieuse dont ils avaient con-
tract l'habitude. Chez toutes les socits agricoles qui ont essaim
dans la zone terrestre que nous venons de considrer, des confins de
la Libye ceux de la Mandchourie, c'est le maniement de l'eau fournie
par les pluies et les fleuves, la pratique de l'irrigation de plus en plus
tendue, qui ont t les grands facteurs de dveloppement numrique.
Restreint dans les oasis, limit une frange bordire le long des mon-
tagnes de l'Asie centrale, ce mode de culture a trouv dans les plaines
du Gange et de la Chine des domaines souhait pour s'panouir.
Ainsi de puissants foyers d'appel se sont forms pour les hommes.
Leur rayonnement s'est tendu sur toute la priphrie insulaire de
l'Asie orientale.
Le cadre spcial dans lequel ont grandi ces socits est gographi-
quement diffrent de celui qui dlimite les populeuses socits d'Eu-
rope. La pntration rciproque que favorisent les communications
modernes pourra la longue attnuer ces diffrences
; il est probable
nanmoins qu'elles subsisteront dans les traits principaux de la dmo-
graphie. Des agglomrations principalement fondes sur l'industrie
1. Core : 80 habitants par kilomtre carr.
70 LA RPARTITION DES HOMMES SUR LE GLOBE
et la vie urbaine prsentent sous bien des rapports d'autres modes
d'existence, d'autres phnomnes que celles qui se sont tablies sur
une collaboration agricole d'une multitude d'tres humains groups
par familles ou par villages.
On ne saurait mconnatre dans celles-ci un caractre d'archasme
qui nous report aux premiers efforts qu'a d faire l'espce humaine
pour se constituer en force et en nombre. La surabondance de produits
obtenus par un ingnieux amnagement de l'eau dans des climats
interrompant peine la vgtation de l'anne, eut un effet merveil-
leux pour permettre la coexistence sur des points restreints de forts
groupes numriques. L'adaptation de l'eau des cultures rgulires,
foisonnant sur place et se succdant prompts intervalles, contribua
concentrer les hommes, de mme que, primitivement, l'usage du
feu avait facilit leur dispersion dans presque toutes les parties de la
terre. L'une et l'autre de ces inventions primordiales se retrouvent
dans la rpartition actuelle de notre espce. C'est parce que, ds les
anciens ges, des groupes se sont rpandus sporadiquement travers
les tendues continentales, que nous rencontrons l'heure actuelle
tant de diversits et d'ingalits, autrement inexplicables, dans leur
degr de culture. Et c'est parce que l'irrigation, aprs avoir appris
aux hommes se serrer sur des points dtermins, leur a fourni, en
certaines contres, un thme de perfectionnements s'engendrant
les uns les autres, que nous voyons des agglomrations qui n'ont
pas attendu pour grandir les facilits qu'offrent les transports modernes.
Ces impulsions initiales ont donn le branle et orient le dvelop-
pement gographique de l'humanit. On peut, au reste, constater ce
fait, qu' chacune des tapes de ce dveloppement correspond une
appropriation nouvelle de ressources ou d'nergies naturelles. C'est
par des efforts d'invention que l'homme d'aujourd'hui comme de
jadis parvient se faire une place de plus en plus considrable sur
la terre.
CHAPITRE IV
<
L'AGGLOMRATION EUROPENNE
I.
LES LIMITES
Parmi les quatre groupes d'agglomration humaine,
Inde, Chine,
Europe, tats-Unis,
le groupe europen est aujourd'hui le principal
Dans la rpartition de l'espce humaine sur le globe, il reprsente un
foyer dont l'action se rpercute partout
;
comme puissance numrique
et conomique, il est le bloc prpondrant qui met son poids dans la
balance.
Cette supriorit numrique est de date rcente. Il est probable
qu'au commencement du xix^ sicle la population de l'Europe n'at-
teignait pas le chiffre dj atteint par l'Inde et la Chine : elle s'levait,
d'aprs les calculs les plus plausibles, 175 millions environ
^.
Si
l'on considre qu'avant les vides, pour le moment incalculables, causs
par la guerre, elle tait value, en 1914, 448 millions, il en rsulte
un accroissement d'environ 150
p.
100 dans une priode dpassant
peine un sicle. La densit moyenne, qui tait peu prs de 19
p.
100
en 1800, tait arrive dpasser, dans ces dernires annes, le chiffre
de 45
p.
100. Il est vrai qu'une moyenne s'tendant indistinctement
l'Europe entire perd beaucoup de sa valeur. Un trait plus signifi-
catif de cette statistique rtrospective est que, vers 1815, aucune
grande rgion sur le continent europen n'avait une densit compa-
rable celle du Royaume lombard-vnitien, soit 90 habitants par
kilomtre carr : la richesse agricole, le legs historique de grands
travaux publics expliquaient cette supriorit. Cette contre a nota-
blement accru sa population dans le cours du dernier sicle ;
mais,
sans parler de la Grande-Bretagne, la Belgique, la Province rhnane,
1. E. Levasseur, Statistique de la superficie et de la population des contres de
la terre. 1" partie : Europe (Bull Institut Intern. de Stat, I, livr. 3-4, 1886, p.
110
et suiv.).
72 LA RPARTITION DES HOMMES SUR LE GLOBE
la Saxe montrent aujourd'hui une densit suprieure la sienne.
La rpartition a donc vari aussi bien que l'effectif total. Des dpla-
cements de densit ont eu lieu. On est en prsence d'un fait en marche,
provoquant des chocs en retour qui se transmettent d'une contre
l'autre. Car c'est, depuis un demi-sicle environ, dans l'Europe
orientale, en Russie notamment ^, que l'accroissement de la popula-
tion procde l'allure la plus acclre. Sans doute, des obstacles de
climat s'opposent ce que l'Europe, dans sa totalit, soit entrane
dans ce mouvement : nanmoins l'organisme europen est tel aujour-
d'hui que les nerfs moteurs agissent avec force jusqu'aux extrmits
des membres.
Le cadre dans lequel se circonscrit, actuellement du moins, l'agglo-
mration europenne, pourrait tre approximativement trac, au Nord,
par le
60^ de latitude. Au del de cette ligne, le long de laquelle s'che-
lonne, en avant-postes, une range de grandes villes 2, s'tend une
vaste rgion (2.500.000 kilomtres carrs environ) o la densit de
population ne dpasse gure au total 3 hab. par kmq
^.
Cependant,
baigne au Nord par une mer qui reste gnralement libre, cette
rgion, depuis dix sicles au moins, est entre dans le cercle d'attrac-
tion des contres voisines. Ce sont d'abord les pcheries qui ont attir
les hommes
;
puis, dans la suite des sicles, le commerce des bois et
des fourrures, aujourd'hui les mines et l'nergie hydrauUque. L'exploi-
tation de ces ressources nouvelles a imprim un accroissement sen-
sible, depuis un demi-sicle, la population de ces confins de l'cou-
mne . Comme dans tous les pays de colonisation, les villes maritimes
en ont surtout profit : les deux tiers de la population norvgienne
sont sur les ctes, et l'on remarque, en Scandinavie comme en Fin-
lande, une proportion relativement forte de population urbaine
*.
Mais les ressources nourricires sont trop indigentes pour laisser
beaucoup de marge l'accroissement
;
l'migration, qui s'y dveloppe
au moins aussi vite que la natalit, et mme, l'occasion, des famines
se chargent d'y mettre un terme.
1. D'aprs E. Levasseur, l'accroissement de population de la Russie d'Europe,
entre 1830 et 1908, aurait t de 186 p. 100
;
plus que double de celui de la Grande-
Bretagne dans la mme priode. (La rpartition de la race humaine sur le globe
terrestre, dans Bull. Institut Intern. de Stat., XVIII, livr. 2, 1909, p. 48-63.)
2. Bergen, 77.000 hab. ;
Kristiania, 242.000 hab. ;
Stockholm, 386.000 hab.
; Hel-
singfors, 161.000 hab. ; Petrograd, 2.133.000 hab.
3. Norvge septentrionale ;
Sude septentrionale (Norrland)
;
Finlande
septentrionale ;
Gouvernements d'Arkhangel'sk, Olonets, Vologda.
4. En Finlande, sur une population totale de 3 millions environ, 429.000 habi-
tent des villes de plus de 20.000 mes. (Socit de Gographie de Finlande,
Atlas de Finlande, 1910.)
La proportion est encore plus forte en Norvge.
L'AGGLOMRATION EUROPENNE
73
A l'Est, la ligne de dmarcation qui circonscrit l'agglomration
europenne a un caractre historique autant au moins que gogra-
phique. Elle touche la steppe saline, mais sans borner la rgion
fertile de la terre noire. On peut la considrer comme la ligne provi-
soire autour de laquelle oscille le pendule, entre le domaine des socits
assises et celui des groupes plus ou moins instables. Elle est jalonne,
comme la limite septentrionale, par une srie de villes rapidement
grandissantes, entre lesquelles la Volga sert de lien
^.
Au del, dans
les gouvernements d'Oufa, Orenbourg, Astrakhan', sur une superficie
au moins gale celle de la France, la densit de la population ne d-
passe gure en moyenne une douzaine d'habitants par kilomtre carr.
Entre cette rgion faiblement peuple et les contres d'accroissement
rapide et continu qui se prolongent jusqu' la rive occidentale du
grand fleuve, le contraste actuel exprime la lisire vers laquelle expire
la civilisation europenne. Dans ses tapes successives, c'est par une
range de villes qu'elle a procd, qu'elle a fait front contre la bar-
barie
;
et ce sont des fleuves qui ont servi d'appui ces fondations
urbaines. Tour tour le Rhin et le Danube, puis, lorsque l'uvre
romaine fut reprise par les Carolingiens et le Saint-Empire germanique,
l'Elbe, la Saale et l'Elster, plus tard encore l'Oder, la Vistule et le
Dniepr ont vu sur leurs bords s'tabUr, en rapports les unes avec les
autres, des ranges de villes : portes d'entre et de sortie entre deux
mondes, la fois centres de propagande religieuse, places d'armes,
lieux de foires et de commerce. Mersebourg, puis Leipzig
;
Magde-
bourg et Hambourg
;
Breslau et Dantzig
;
Riga et Kiev, tracent des
lignes successives. Elles anticipent, dans le dveloppement de l'Eu-
rope, sur le rle futur des villes commerantes qui, de Nijn-Novgorod
Astrakhan', centralisent autour de la Volga les relations de l'Europe
orientale et des steppes.
La ville a son rle part dans la formation du peuplement. C'est
un organe politique, un nud de rapports. Elle est l'expression d'autres
phnomnes que le village, c'est pourquoi elle peut exister indpen-
damment de lui. L'Amrique et l'Australie apportent de rcents
exemples de grandes villes suivant leurs destines sans le cortge de
moindres tablissements qui les accompagne en Europe. Elles servent
de points de ravitaillement d'o la population s'lance de nouvelles
conqutes.
1. Kazan', 194.000 hab.
;
Samara, 144.000 hab.
;
Saratov, 235.000 hab.
;
Tsarist-
syn, 100.000 hab.
; Astrakhan', 162.000 hab.
74 LA RPARTITION DES HOMMES SUR LE GLOBE
II.
POINT DE DPART ET CONDITIONS D'EXTENSION
Il reste donc que plus des deux tiers de l'Europe constituent, au
point de vue de la population, un groupe peu prs compact de den-
sit leve. On distingue bien encore dans cet ensemble des parties
faiblement peuples, mais elles sont entames de toutes parts, et de
plus en plus rduites la retraite que leur laissent les hautes mon-
tagnes, les forts ou les surfaces marcageuses. Les interstices dimi-
nuent entre les rangs presss qui les assigent. En somme, il n'y a pas
entre les mailles de ce tissu d'intervalles vides, comparables ceux qui
sparent l'Inde de la Chine
;
ou, dans l'Inde mme, le Pendjab du Pays
des Mahrattes, le Bengale du Carnatic.
Les agglomrations asiatiques sont nes et ont grandi sous l'in-
fluence d'une cause principale, le climat des moussons. Des centres
de densit sporadiques se sont rapprochs et ont form masse, grce
une collaboration de pluies, de soleil et de fleuves, surexcitant
presque sans rpit la force productive du sol. Les phnomnes humains
se laissent malaisment circonscrire en des limites prcises
;
on cons-
tate toutefois que c'est approximativement entre 10
et
40^
de lati-
tude Nord que se localisent ces foyers humains. L'agglomration
europenne, au contraire, ne touche que par ses extrmits mridio-
nales cette zone terrestre. L'uvre qui a abouti runir en Europe
prs du quart de la population du globe, s'est gnralement accom-
plie dans des conditions de climat et de latitude dont les exigences
dpassent de beaucoup celles des contres tropicales ou subtropi-
cales. Elle reprsente par l quelque chose d'original dans l'histoire
du peuplement du globe. Elle se distingue ainsi, non seulement des
agglomrations antiques qui ont eu pour sige l'Asie orientale et
l'Egypte, mais mme de celles qui sont en voie de formation dans les
contres d'Amrique
;
bien que, vrai dire, celles-ci n'tant encore
qu' leur premier stade, il soit difficile de se prononcer sur leur future
extension.
Le phnomne qui a accumul dans cette pninsule de l'ancien
monde la masse principale d'humanit, prsente une volution plus
complexe que celles que nous avons dj cherch retracer. Le fait
initial cependant parat tre, ici comme ailleurs, l'abondance de res-
sources vgtales propres la nourriture de l'homme. L'Europe, sous
ce rapport, surtout dans les parties de son territoire que n'ont pas
atteintes les liminations des priodes glaciaires, n'est pas moins
richement dote que les rgions qui semblent, au dire des botanistes,
avoir le plus contribu enrichir le patrimoine de ressources aUmen-
L'AGGLOMRATION EUROPENNE 75
taires : l'Inde, le Soudan, ou la Chine
^.
Quelques-unes des crales
les plus utiles, froment et orge, nombre de lgumes, tels que fves,
pois, lentilles, apparaissent sur les bords europens de la Mditer-
rane, soit comme indignes, soit comme des emprunts trs anciens
des contres limitrophes. L'acclimatation des vgtaux qui se con-
centrent autour du domaine mditerranen, trouva dans le commerce
de bonne heure allum sur ses bords un vhicule naturel
;
ajoutons
que, au centre mme de cette mer, la fconde Sicile semblait prdes-
tine servir d'organe de transmission. Parmi les ressources nourri-
cires dont s'enrichit progressivement l'Europe, la Mditerrane a
fourni la plus grande part, mais non la seule. La diversit des plantes
alimentaires dont Pline l'Ancien fait mention comme en usage chez
les peuples sub- ou trans-alpins, est trs remarquable, confirme d'ail-
leurs par les trouvailles prhistoriques. Nous vitons de mentionner
les ressources que l'alimentation pouvait tirer de la chasse ou de
l'levage, puisqu'il ne s'agit que de genres de vie favorables la forma-
tion d'un peuplement dense.
Par la facilit de l'existence, avec les avantages et les inconv-
nients qu'elle entrane, les parties de l'Europe situes au Sud de
40
se rapprochent de celles qui ont favoris en Asie l'panouissement de
l'espce humaine. C'est en pensant elles que Mirabeau a pu parler
de contres o les efforts des pires gouvernements ne russiraient
pas empcher la population de s'accrotre . En ralit, elle ne s'est
pas toujours accrue dans le royaume de Naples et dans l'Espagne
mridionale, et elle a subi bien des rgressions temporaires
;
mais
on doit reconnatre qu'elle a toujours montr, dans les circonstances
propices, tendance s'accumuler. Ce n'est gure que dans les grandes
villes du Sud de l'Italie et de l'Espagne que se rencontre ce proltariat
vivant de peu dont se surchargent les agglomrations de l'Inde ou
du Sud de la Chine 2, ou mme l'hexapoie qui garnit le pied des mon-
tagnes, dans le Turkestan oriental. Sans doute, dfaut d'autres
besoins, celui de la nourriture quotidienne s'impose
; mais cette ques-
tion mme perd de son acuit et devient, suivant les saisons, tout
fait aise rsoudre. A Murcie, crivait de Laborde ^,
on ne saurait
1. Alphonse de Candolle, Origine des plantes cultives, Paris,
4^
d., 1896.
Voir, dans la Geographische Zeitschrift (t. V, 1899), un essai de classement des
plantes utiles suivant leur provenance, par F. Hck. Les pays de la Mditerrane,
conclut-il, paraissent au nombre des plus richement pourvus
(p. 400).
2. Il
y
a vingt ans, la nourriture d'un tisseur de Tch'eng-tou, dans la populeuse
province du Sseu-tchouan, reprsentait par jour environ 18 centimes et demi de
notre monnaie. (Chambre de Commerce de Lyon, La Mission lyonnaise d'explo-
ration commerciale en Chine, 1895-1897, Lyon, 1898,
2^
partie, p. 269.)
3. Al. de Laborde, Itinraire de l'Espagne, Paris, 1828, p. 112.
76 LA RPARTITION DES HOMMES SUR LE GLOBE
trouver une servante pendant l't
; et beaucoup de celles qui sont
places quittent leurs conditions l'entre de la belle saison. Alors
elles se procurent aisment de la salade, quelques fruits, des melons,
surtout du piment
;
ces denres suffisent leur nourriture. On peut
rapprocher ce tmoignage de ceux qui nous viennent des oasis du
Turkestan, situes environ aux mmes latitudes, au sujet de ces popu-
lations qui conservent Kachgar, Yarkand et Khotan, les vieilles
traditions d'agriculture iranienne. Pendant les mois d't, dit Seme-
nof ^, les fruits et les melons suffisent remplacer la charit publique.
L aussi, cette manne priodique est une prime l'oisivet et au
farniente. La nature se charge, moyennant le minimum d'efforts,
et pour ainsi dire au rabais, de pourvoir aux ncessits qui grvent,
sous d'autres latitudes, les socits humaines.
Cependant les contres europennes o l'homme peut s'affranchir
de la continuit de l'elort, sont l'exception. A peine a-t-on dpass
d'une centaine de kilomtres les rives de la Mditerrane que les exi-
gences de climat se multiplient. Elles s'imposent dj aux populations
circum-alpines, balkaniques et danubiennes : combien plus encore
celles qu'on entrevoit ds les premires lueurs de l'histoire, grou-
pes le long des terres fertiles qui suivent environ le 50^ de latitude,
et se prolongent, par l'archipel danois, jusqu'au Sud de la Sude !
En face de ces longs hivers, de ces brumes, de ces intempries incom-
patibles avec la vie en plein air, chre au Napolitain de nos jours
comme son anctre de Pompi, l'abri, le vtement, le chauffage,
l'clairage viennent singulirement compliquer le problme de l'exis-
tence. Ce fut une ncessit naturelle qui substitua aux draperies flot-
tantes les vtements serrs au corps, la saie, les braies gauloises
;
qui
ajuste au sommet de l'habitat un toit lev, et fortement inclin pour
permettre le ruissellement des pluies. Cet habitat, surtout, prend une
importance plus grande dans la vie quotidienne ; ce n'est plus l'ins-
tallation sommaire o l'on s'accommode aprs journe passe sur les
places publiques, mais le sjour o se pratiquent les travaux d'hiver,
o s'entretiennent les industries domestiques, le home, la maison avec
toutes les ides et les sentiments qu'elle veille. Crotre et multiplier de-
vient, dans ces conditions, un prcepte qui suppose l'effort, et au succs
duquel concourent des facteurs de temps, d'ingniosit, de persvrance.
1. Commission Impriale de Russie a l'Exposition Universelle de 1900,
La Russie Extra-Europenne et Polaire, par P. de Semenof, Paris, 1900, p. 161.
E. Huntington, The Puise
of
Asia..., Boston and New York, 1907, p. 151.
F. Grenard, Le Turkestan et le Tibet... (J.-L. Dutreuil de Rhins, Mission scien-
tifique dans la Haute Asie, 1890-1895, Deuxime partie, Paris, 1898, p. 165.)
L'AGGLOMRATION EUROPENNE 77
Au del du
40
de latitude, l'homme doit compter avec des nces-
sits d'habitat, de vtement
outre la nourriture qu'on peut com-
parer ces poids supplmentaires dont on charge dans les courses
certains concurrents. Plusieurs sociologues, depuis Le Play, se sont
attachs analyser les budgets d'ouvriers ruraux ou urbains en diff-
rentes contres d'Europe
^.
Parmi les exemples qu'ils apportent,
je choisis de prfrence ceux qui concernent les rgions o s'est le
plus manifest de nos jours l'accroissement de la population. En
Belgique, en Saxe, en Westphalie (Solingen), ShefTield, la rparti-
tion des dpenses s'tablit peu prs sur les bases suivantes : 60
65
p.
100 pour la nourriture, 15 20
p.
100 pour le vtement, 12
p.
100
pour le logement, 5 p.
100 pour le chauffage et l'clairage. D'aprs
des valuations plus rcentes, dont le Danemark, pays trs prospre,
a t l'objet, les dpenses de nourriture ne reprsentent plus gure
pour chaque famille que la moiti de la totalit des dpenses, la propor-
tion restant peu prs la mme pour le reste
^.
Le mme observateur
fait cette remarque gnrale que plus le budget est petit, plus est
grande la proportion des dpenses de nourriture.
On peut tendre la porte de cette observation. Quand le tisserand
de Tch'eng-tou a prlev sur son maigre salaire la somme ncessaire
son cuelle de riz, il est fort prvoir que le superflu, s'il en reste,
passe la maison de jeu. Dans l'Inde, lorsque la hausse du coton,
provoque par la guerre de Scession amricaine, eut rpandu l'argent
chez les cultivateurs du Dharvar, les bnfices, dit-on, enrichirent
surtout le bijoutier de village. Ne sait-on pas enfin combien, mme
dans nos contres mridionales d'Europe, le got de la parure, du jeu
(loterie) prime tout autre emploi des bnfices alatoires dont ventuelle-
ment on dispose ? Il existe donc des climats o, aprs satisfaction
donne aux besoins de nourriture, l'homme moyen, qui reprsente
en somme le principal lment numrique de la population, peut peu
prs impunment se livrer ses fantaisies. Tout autre est la conception
sociale qui rsulte, dans nos climats, de ce que Montesquieu appelle
le ncessaire physique . Les devoirs grandissent avec les ncessits,
liminent ou du moins rabaissent un niveau trs infrieur cet lment
de parasitisme qui fait pulluler, dans des climats moins exigeants,
la mendicit et le vagabondage. Le mendiant n'y est plus un tre
1. F. Le Play, Les ouvriers europens, 2 dition, Paris, 1877, t. III.
Ducp-
TiAUX, Budgets conomiques des classes ouvrires en Belgique, Bruxelles, 1855.
Pour une priode plus moderne, Ernst Engel, Die Lebenskosien belgischer Arbeiter-
Familien... (Bull. Institut Intern. de Stat., IX, livr 1, 1895, p.
1-124. -
M. Rubin,
Consommation de familles d'ouvriers danois (ibid., XIII, livr. 3, 1903, p. 21-79).
2. M. RuBiN, art. cit,
p. 32, 64.
78 LA RPARTITION DES HOMMES SUR LE GLOBE
aim de Dieu
^.
Une considration imprieuse s'attache l'extrieur
du logement et de la personne, ce qui constitue le confort et ce
qu'exprime bien la formule anglaise, standard
of life.
Cependant, pour subvenir non seulement ces exigences, mais
en outre aux obligations qu'impose la vie moderne, impts, hygine,
ducation, dlassements, etc., l'effort est ncessaire. Il faut crer plus
de ressources pour tenir tte plus de devoirs. Nos contres d'Eu-
rope centrale ou septentrionale en offraient-elles les moyens ? Elles ne
paraissaient pas de prime-abord disposes par la nature pour entretenir
des multitudes pareilles celles des bords du fleuve Bleu ou du Gange.
Si pourtant elles les galent ou dpassent, c'est parce qu'elles ont su
tirer des ressources naturelles plus que n'ont fait les socits asiatiques.
Aux produits du sol elles ont ajout ceux du sous-sol
;
avec les res-
sources de l'agriculture elles ont combin celles de l'levage. Elles ont
appel enfin la science leurs secours. La formation de l'agglomration
europenne apparat ainsi comme une uvre d'intelligence et de
mthode presque autant que de nature.
III.
ROLE DES RELATIONS COMMERCIALES
Ce progrs n'a pas t le privilge d'une race. Non qu'il faille rvo-
quer en doute les qualits suprieures dont l'homme a fait preuve en
Europe pour mettre en valeur avec plus d'intensit qu'ailleurs les
ressources que recelait le milieu. Mais il ne faut pas oubher, quand il
est question de l'Europe, la correspondance naturelle qui en unit
toutes les parties. Par son efTilement progressif en forme de pnin-
sule, son exigut relative, par les facilits de passages qui attnuent
l'obstacle des chanes ou des massifs qui la sillonnent, par les voies
naturelles qu'ouvrent ses fleuves, les peuples trs divers, trs htro-
gnes que les circonstances
y
ont groups, ne tardent jamais long-
temps entrer en communications rciproques. Le localisme, cause
de stagnation, ne tient pas longtemps
;
de telle sorte que le progrs
accompli par les uns n'est pas perdu pour les autres. Le nombre de
contres qui chappent au mouvement gnral se rduit d'ge en ge,
et soit plus lentement, soit plus vite, chacun prend le pas dans l'avance
conomique.
Tout ce que nous savons du pass de l'Europe tend montrer quel
rle ont jou, dans la marche de sa civiUsation, l'imitation et l'exemple
2.
1. F. Grf.nabd, ouvr. cit, p. 165.
2. Feu WoEiKOF tait trs frapp de la puissance de l'exemple. Dans une lettre in-
dite que j*ai sous les yeux, il crivait : D'aprs ce que je sais, le passage du nomade
L'AGGLOMRATION EUROPENNE
79
Le grand panouissement de population et de richesse que, dans
les cinq sicles qui prcdent l're chrtienne, les tiquettes de Hallstatt,
puis de La Tne, signalent au Nord des Alpes et dans le Nord-Est
de la Gaule, concide avec l'aflluence croissante de relations mditerra-
nennes
1.
L'imitation des monnaies macdoniennes, des objets
trusques, la formation d'un art mixte de style romain provincial
que rvlent les trouvailles sur les bords du Rhin et du Danube ^^
sont les indices d'une transformation conomique qui a pntr l'tat
social.
On peut conclure du tmoignage de Strabon
^
qu'un accroissement
de population fut, en Gaule, un des premiers rsultats de la paix ro-
maine, bien que ces fertiles contres d'Occident ne dussent pas chapper
la longue la disette d'hommes *, au dpeuplement, dirions-nous,
qui atteignait dj la Grce et les contres ayant, comme elles, sup-
port le faix d'un long effort de civilisation. L'impulsion qu'avait
prouve l'Europe centrale, celle du Nord la ressentit son tour,
lorsque, vers le v^ sicle de l're chrtienne, la navigation et l'agricul-
ture eurent leur disposition un outillage plus perfectionn que celui
des anciens ges de bronze
^.
Le Nord Scandinave devint alors le foyer
de cette fermentation de peuples qui avait secou, quatre ou cinq cents
ans auparavant, le monde celtique.
Il faut avoir les yeux sur ces causes gnrales pour se rendre compte
du fait qui est proprement le sujet de notre tude : la formation en
Europe du principal groupe humain qui existe actuellement sur le
globe. C'est le rsultat d'une uvre de longue haleine, qui a procd,
non d'un mouvement continu, mais par saccades
;
qui a t traverse
par des catastrophes, qui a connu des priodes de rgression, mais
dont pourtant on peut marquer les tapes, et qui, finalement, se tota-
l'agriculteur n'a lieu que sous l'influence et l'exemple de voisins agricoles. Ainsi
les Magyars, guerriers nomades, sont devenus agriculteurs l'exemple des Slaves
et des Allemands leurs voisins.
1. J. DCHELETTE, Monud d'archologe prhistorique..., t. II,
2^
et
3^
parties,
Paris, 1913-1914, p. 629, 650, 914, etc.
2. Voir : J. J. A. Worsa^e, La colonisation de la Russie et du Nord Scandinave
et leur plus ancien tat de civilisation... (Mm. Soc. R. des Antiquaires du Nord,
Nouv. Sr., 1872-77, p. 73-198).
3. Strabon, IV, 1, 2
;
id., 4, 3 (o revient le mot TioXuavOpwTria).
4. Le manque d'enfants et en dfinitive la disette d'hommes s'empara, de nos
jours, de la Grce entire , dit Polybe (XXXVII, 4).
Plutarque s'exprime
peu prs dans les mmes termes
5. J. J. A. WoRSA^ (mmoire cit, et La civilisation danoise l'poque des Vikings,
dans Mm. Soc. R. des Antiquaires du Nord, Nouv. Sr., 1878-1883, p. 91-130^
note l'accroissement de la population pendant la deuxime priode de l'ge du fer
(450-700 aprs J.-C).
Voir : G. Engelhardt, Influence de l'industrie et de la
civilisation classiques sur celles du Nord dans l'antiquit (ibid., 1872-1877, p. 258
et suiv.).
80 LA RPARTITION DES HOMMES SUR LE GLOBE
lise par un progrs de beaucoup suprieur aux prvisions de la plupart
des penseurs du xviii^ sicle
^.
Par additions successives, dont approxi-
mativement on peut estimer les dates, le domaine d'occupation
intensive s'est agrandi. Dans cette srie de conqutes, les principales
batailles ont t gagnes sur les forts, qu'on a dfriches ; sur les
marais, qu'on a desschs
;
sur les montagnes, qu'on a adaptes
l'conomie pastorale
;
sur les alluvions, qu'on a arraches la mer.
Enfin, il
y
a un sicle et demi, l'aurore de la grande industrie s'est
leve dans une contre de la Grande-Bretagne, o se concentraient le
fer et la houille. Parmi les artisans de l'uvre qui s'labora alors
autour de Birmingham, de Manchester, de Sheffeld et de Newcastle,
plus d'un promoteur est sorti de ce miheu social que nous cherchions,
dans les pages qui prcdent, caractriser d'aprs les budgets d'ou-
vriers. L'exemple de l'Angleterre a gagn le continent. Les ncessits
de la grande industrie se sont traduites par un accroissement en pro-
portions inoues des forces de transport, de sorte que le mouvement
commercial n'a pas cess et ne cesse pas de s'tendre.
Qu'une priode sans exemple d'inventions mcaniques ait donn
l'essor un accroissement sans prcdents de population, c'est un
fait de nature jeter quelque lueur sur le genre de causes qui ont la
prpondrance dans l'volution du peuplement humain. Il corres-
pond l'veil d'initiatives, une plus grande somme d'nergie et
d'intelligence appliques l'exploitation des ressources naturelles.
La cration de richesses nouvelles rclame et appelle son secours
un plus grand nombre de forces humaines
;
un accroissement en rsulte.
Mais le flot s'aplanit en s'tendant. Il arrive tt ou tard que cette
cration engendre aussi de nouveaux besoins, qu'elle introduit des
habitudes qui peu peu produisent leur tour leurs effets sur la
marche du peuplement. Des rpercussions diverses, mme en sens
contraire, peuvent natre suivant les temps et les lieux. Le progrs
porte en lui-mme ses correctifs. Devant ces faits gros de consquences,
il faut s'attendre ce que le phnomne dmographique, en se drou-
lant dans son ampleur, se montre sous des faces trs diverses.
1. On suppose, crivait Adam Smith, qu'il ne faut pas moins de 500 ans pour
doubler le nombre des habitants de la Grande-Bretagne et de la plupart des autres
pays de l'Europe. (Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations,
livre I, chap. viii.)
CHAPITRE V
RGIONS MDITERRANENNES
Lorsque les hommes commencrent entrer en rapport par del
la barrire montagneuse qui borde la Mditerrane, le Sud repr-
senta pour l'ultramontain le pays des fruits, de mme que, par une
gnralisation semblable, l'Europe centrale apparut au mditerranen
comme le pays des forts. Cette distinction reposait assurment sur
un fondement naturel ; mais du moins cette image tait dj une
transformation obtenue par un travail humain sculaire. Nous avons
caractris ainsi le genre de vie qui a prvalu sur les bords de la Mdi-
terrane : Ce n'est pas le champ, mais le jardin qui devint ici le pivot
de la vie sdentaire ^.
Il convient d'ajouter que le jardin, ou pour
mieux dire, la culture de plantation a t, dans ces contres, le prin-
cipe de la concentration des habitants. Elle en fut et elle en est reste
le principal facteur, si du moins l'on fait abstraction des villes.
I.
LES POINTS FAIBLES
La nature physique, dans la rgion mditerranenne, se prte
indiffremment des genres de vie dont l'influence sur la popula-
tion est trs diverse : la culture des crales telles que l'orge ou le
bl, celle des arbustes, primitivement vigne, figuier, olivier, et l'le-
vage pastoral, surtout de la chvre et du mouton. Ce classement
repose sur une distinction trs ancienne : elle figure dans Cicron
comme vieille formule de droit
2.
Entre la terre de semences
et la
terre de plantations
^
la distinction chez les anciens est courante
;
on se demande seulement si l'arboriculture n'est pas une branche de
1. Les genres de vie dans la gographie humaine (Annales de Gographie, XX,
1911, p. 205).
2. Ager, arvus, arbustus, pascuus. (De Republica, 5, 2.)
3. r?, airpiuo; et yr^ Trecpoxeuaivr,. (Xnopiion, Hellniques,
3, 2, 10).
Id. dans
les conomiques.
Vidal-Lablache, Gographie humaine. 6
82 LA RPARTITION DES HOMMES SUR LE GLOBE
l'art agricole. Quant la vie pastorale, elle implique non seulement
diffrence, mais opposition. Elle est le principe d'un antagonisme qui
a frapp les observateurs depuis Thucydide jusqu' Strabon, et qui
persiste encore, sous une forme attnue, de nos jours.
En effet, dans le cadre qu'embrassent les plis des chanes ibriques
et provenales, de l'Apennin, des Alpes dinariques et du Pinde, la
plaine et la montagne s'enchevtrent : celle-ci, neigeuse en hiver,
mais offrant en t de frais pturages
;
l'autre, hospitalire en hiver,
aprs le renouveau qui suit les pluies d'automne, mais subissant du
fait des scheresses d't une interruption de vgtation qui peut
durer jusqu' deux mois. Le btail, aisment mobile, qui est, dans la
rgion mditerranenne, la forme caractristique de richesse (pecunia),
trouve ainsi alternativement dans la plaine et la montagne ce qui lui
convient. Un rgime pastoral est issu de cette solidarit
;
il est possible
d'en concevoir le dveloppement. A proximit d'abord, puis, mesure
que se formaient des collectivits pastorales assez fortes pour assurer
leurs migrations, des distances considrables ^, les troupeaux, sui-
vant l'ordre des saisons, ont pass des hauteurs la plaine et vice versa.
C'est ainsi que, des Alpes dinariques au littoral dalmate, du Pinde
aux plaines de la Thessalie, des Abruzzes la Campagne romaine
et au Tavogliere de Pouille, enfin des montagnes du Lon et de Teruel
aux plaines de l'Andalousie, s'tablit le rgime de la transhumance.
La montagne, en dversant priodiquement sur la plaine ses pasteurs
et ses troupeaux,
y
gnait toute poursuite de travail agricole. Ce
travail, dans les plaines o les consquences du rgime ont t pousses
l'extrme, finit par se rduire deux courtes apparitions de tra-
vailleurs, l'une en octobre pour les semences, l'autre en juin pour les
rcoltes. Ainsi s'explique que, dans les plaines assujetties un tel
rgime, n'ait pu se nouer ce contrat qui, par un rapport quotidien
de soins assidus, unit le cultivateur la terre. La petite proprit
n'a pu s'enraciner avec la tnacit ncessaire, pour peu que des priodes
de guerre et de troubles se soient prolonges
;
elle a t emporte par
la tourmente et a fait place ce rgime de latifundia qui pse encore
en Espagne et en Italie sur quelques-uns des domaines o des popu-
lations ont prospr jadis, o elles pourraient encore vivre l'aise.
Il
y
a l, dans l'tat actuel, une des causes restrictives de la den-
1. L'industrie pastorale, en Espagne, classait les troupeaux en sdentaires
(estantes)i ne sortant pas de la rgion (riveriegos), enfin transhumantes ceux
qui vont d'une extrmit l'autre du royaume. (J. Goury du'Roslan, Essai sur
Ihistoirt conomique de l'Espagne, Paris, Guillaumin,
[1888], in-8, [vi] -j-
355
p.)
Voir : Andr Fribourg, La transhumance en Espagne (Annales de Gographie, XIX,
1910, p.
231-244, 3 fig., cartes
;
cartes 1 /5.000.000, pi. 14 A, B).
RGIONS MDITERRANENNES 83
site de population autour de la Mditerrane. Elle atteint les plaines,
trs sensiblement dans le Sud de l'Europe, et plus encore dans l'Afrique
du Nord o la colonisation franaise ragit non sans succs. Cette
complication de faits physiques et historiques se traduit dans la densit
de population par des points faibles et ce qu'on pourrait appeler une
srie d'anomalies ngatives
^.
II.
ROLE DES CULTURES ARBUSTIVES
Il en est autrement des domaines o s'est implante la culture
arbustive ; l se sont forms de bonne heure, ont grossi successive-
. ment, se sont conservs comme en rserve pendant les temps de crises,
f les rangs pais d'une population qui ne se lasse pas de prter de nou-
I
velles recrues la vie urbaine limitrophe ou mme l'migration
\
d'outre-mer.
Les observateurs qu'attiraient ds l'antiquit classique les pro-
blmes de civilisation, ont parfaitement not que ce type de culture
n'tait pas une cration lmentaire et spontane, mais l'expression
d'un progrs, d'un degr de vie suprieure. Comme tous les progrs
de ce genre, c'tait une uvre de collaboration, se transmettant par
voie de contact et d'imitation suivant que le permettait l'analogie des
climats. L'origine et le centre de propagation de ce genre de vie peuvent
tre cherchs sans hsitation dans la partie du domaine mditerra-
nen confinant aux grandes socits antiques de l'Euphrate et du
Nil. Le vhicule en fut l 'intercourse maritime, que les dcouvertes
prhistoriques en Crte et dans l'archipel gen nous montrent comme
un des faits les plus anciens et des plus dcisifs de la gographie des
civilisations. Les trouvailles de vases crtois ou gens jusque dans la
Haute-Egypte, et rciproquement celles d'objets gyptiens en Crte,
ouvrent de larges horizons qui se prolongent jusqu'aux premires
dynasties pharaoniques, peut-tre au del. A l'poque o l'le de
Santorin n'avait pas encore vu sa partie centrale s'effondrer dans une
convulsion volcanique, c'est--dire il
y
a quarante sicles au bas mot,
ses habitants entretenaient un commerce de poteries avec le dehors
;
ils cultivaient l'olivier, l'orge, divers lgumes
2.
H est possible de dis-
1. Grce. Nome de Phtiotide : 24 hab. par kmq. ; nome de Larissa : 25 hab.
Moyenne du royaume : 41 hab.
Italie. Province de Foggia : 70 hab. par kmq.
Moyenne du royaume : 126 hab.
Espagne. Province de Huelva : 31 hab. par
kmq.
;
province de Gordoue : 36 hab.
;
province de Sville : 42 hab. Moyenne du
royaume : 40 hab.
2. F. FouQU, Santorin et ses ruptions, Paris, Masson, 1879, chap. m : Construc-
tions anthistoriques . C'est dans ces constructions enfouies sous d'paisses
84 LA RPARTITION DES HOMMES SUR LE GLOBE
cerner, travers ces rapports primitifs, le germe qui, suivant des
circonstances diverses de temps et de lieux, s'est panoui, grossissant
autour de la Mditerrane les rangs de la population. Comme tout
progrs destin exciter dans l'humanit un surcrot de force collec-
tive, il s'accomplit au contact de socits ingales, mais travaillant
sur un fonds commun.
Les bords europens de la Mditerrane souffrent de scheresses
saisonnires ;
mais, la diffrence des rgions franchement arides, le
tribut d'humidit vers par l'hiver, le printemps et l'automne sufft
pour entretenir dans le sous-sol,
l'exception des pays karstiques,
des rserves persistantes d'humidit. Ce sont elles que l'arbre ou
l'arbuste puise par la longueur de ses racines. Il faut tenir grand
compte du sous-sol dans la culture mditerranenne
^.
Si l'irrigation
joue un rle qu'on ne saurait exagrer, elle n'est point cependant la
dispensatrice absolue de population et de richesse dans les rgions
subdsertiques. Cette nuance de climat nous explique pourquoi une
culture de terres sches a constamment coexist, dans le Sud de l'Eu-
rope, avec une culture d'irrigation
^.
Celle-ci exigeait une somme de
travaux collectifs et d'organisation qui n'a pu tre atteinte qu' la
longue ;
d'autre part, les surfaces prouves par un mauvais coule-
ment des eaux rclamaient de coteux travaux de desschement
^.
Au contraire, la culture arbustive a pu de prime-abord se propager et
s'tendre sur les terrai)is o, la surface tant sche, le sous-sol restait
suffisamment humect. Remarquons, en effet, que les plantes de ce
genre qui, par l'anciennet de leur culture, semblent avoir de bonne
heure acquis la prpondrance : la vigne, le figuier, l'olivier, auxquels
on peut ajouter l'amandier, sont de celles qui ne ncessitent pas
l'irrigation. Je suis port, par tous ces indices, considrer les contres
surface sche et sous-sol humide comme le plus ancien type mdi-
terranen de culture et de population denses.
Il en est une qui, par sa position et sa nature, convient cette
couches de cendres que les 'fouilles opres par la mission franaise ont mis jour
les diffrents objets auxquels nous faisons allusion.
1. Ce qu'on appelle, aux tats-Unis, le Dnj farming semble renouvel des m-
thodes de l'agriculture punique.
2. Secanos et riegos, sur la cte d'Espagne ;
Aspres, Regatiu ou Rivieral, dans le
Roussillon.
3. La lgende et l'histoire mentionnent en Grce des uvres ou des tentatives
de desschement. Il n'est pas douteux, cependant, qu'elles aient suivi de loin les
travaux d'irrigation. Les plus anciens desschements connus, dans le Roussillon,
ne remontent pas au del du xii^ sicle. (J.-A. Brutails, tude sur la condition
des populations rurales du Roussillon au Moyen Age, Paris, Impr. Nationale, 1891.).
N'a-t-il pas fallu prs de sept sicles, partir du xi^, pour mener fin le dessche-
ment de la Valle di Chiana ?
RGIONS MDITERRANENNES 85
dfinition : c'est la plaine calcaire qui, l'extrmit Sud-Est de la
pninsule italique, s'avance comme un pont la rencontre de l'Orient.
Elle fait partie de la rgion que les Grecs ont trs anciennement connue
sous le nom d'Iapygie et que les Romains dsignaient par celui d'Apulie,
qui se perptua sous la forme plurielle significative : le Puglie. Dans
cet ensemble, la bande littorale qui s'tend de Barletta jusqu' Bari
et mme au del jusqu' Brindisi et Lecce se distingue ds l'antiquit,
vu l'norme quantit de vases qui en sont originaires, comme un foyer
de population
^.
Malgr le cours diffrent qu'a pris l'histoire, la contre
reste encore une terre bnie dont la mauvaise administration sculaire
n'a pas russi paralyser les avantages. Entre une double srie paral-
lle de villes, l'une sur la cte, l'autre 10 kilomtres dans l'intrieur,
s'encadre la campagne sche et lumineuse o, sous l'ombrage tamis
des oliviers, figuiers, pchers, etc., s'tend et gagne de plus en plus le
vignoble, sans atteindre toutefois la prdominance exclusive que lui
abandonne, sur un sol galement sec, son mule moins favorise, la
Coustire du Bas-Languedoc.
III.
LES RIVIRES
Le commerce maritime et la colonisation grco-phnicienne ont
propag, jusqu' l'extrmit des limites qu'elles pouvaient atteindre,
ces cultures minemment lucratives. Sans l'veil de vie gnrale
dont nous avons signal les prcoces indices, on comprendrait mal
comment ce genre de vie suprieure a rayonn de rivage en rivage,
donnant lieu diverses combinaisons. Certaines ctes, par leur exposi-
tion et leur pente, se droulent comme des espaliers dont l'homme
^
n'a eu qu' tailler les gradins. Et, d'autre part, elles mnagent, l'abri?!
du mistral et des vents du Nord, de petites plages sablonneuses
porte les unes des autres, communiquant aisment grce la cl-\
\
mence des vents et l'uniformit du rgime, favorables ainsi une vie
de cabotage et de pche. lelle est, par excellence, la zone de Ligurie,
que la nomenclature populaire a distingue par le nom caractristique
de Rivire : Rivire du Ponant, de Gnes San-Remo
;
Rivire du
Levant, de Gnes la Spezia
^.
La montagne
y
serre de prs la cte,
1. La densit moyenne de la province de Bari (175 hab. au kmq.) et de celle de
Lecce (120 hab.) n'exprime qu'incompltement celle des deux bandes populeuses :
1 Barletta, Bari, Lecce
;
2
Andria, Bitonto, Putignano, etc., qui confinent la
bande presque dserte des Murgie.
2. Densit en 1914 : province de Gnes, 273 hab. au kmq.
;
province de Porto-
Maurizio, 127 hab.
D'aprs une carte de la densit de population de la province
de Gnes, en 1881, la zone de plus de 200 hab. au kmq. se prolonge avec conti-
nuit le long de la mer depuis Sestri Ponente jusqu' Sestri Levante. Elle s'avance
86 LA RPARTITION DES HOMMES SUR LE GLOBE
l'enveloppe pour ainsi dire. On voit sur les pentes tournes vers la
mer blanchir entre les plantations et les bois d'oliviers le bourg prin-
cipal que des sentiers en gradins, quotidiennement escalads par des
nes, relient la plage. Entre deux promontoires qui l'enserrent,
se profile en arc de cercle, comme une corde demi tendue , dit
Reclus, l'anse o les bateaux peuvent tre tirs sur le sable. Bourg
et marine se correspondent, se voient mutuellement, se compltent,
parfois sous le mme nom. Ce dualisme est l'image de la combinaison
d'o est n un genre de vie essentiellement propice la collaboration
familiale, car il unit les occupations de la mer celles d'une culture
exigeant plus de soins que d'elorts musculaires. Tel est, sans parler
des causes survenues au cours des temps, l'attrait qui a pouss les
hommes se presser sur cette frange de cabotage et de pche
^.
Peut-
tre est-ce en Syrie, sur cette partie du littoral qui s'tend du Sud de
Tripoli jusqu'au mont Carmel, qu'il faudrait en chercher le prototype.
L se droula jadis, de Byblos Tyr, toute la srie des villes phni-
ciennes, ppinires de colonies qui ont essaim sur tous les rivages.
Les villes ont subi le sort qui frappe les crations historiques ;
mais, le
long des petites rades qui se succdent, s'chelonnent de nombreux
villages, indice et ultime relique, pour ainsi dire, de la population dense
qui s'est presse sur cette cte
^.
De cette rencontre de conditions, verger et marine, est ne une
combinaison propre la vie de la Mditerrane, qui concentre la popu-
lation et la vie sur certaines parties du littoral, tandis que d'autres
sont inhospitalires.
Ce type de Rivire se rpte ailleurs le long de la Mditerrane en
proportions plus ou moins rduites. Parmi les organisations auxquelles
il a donn lieu, celle de Catalogne est une des plus remarquables. Une
ppinire de bourgs associs des marines s'est forme au Nord-Est
et au Sud-Ouest de Barcelone : l'une (Costa de Levante), jusqu'au
cap de Creus
;
l'autre (Costa de Ponente), jusqu' Tarragone
^.
Quelque
en pointe jusqu' une vingtaine de kilomtres au Nord de Gnes. En gnral,
la zone de plus de 100 hab. ne s'carte gure plus de 5 kilomtres de la mer.
(Bull. Institut Intern. de Stat., III, livr. 2, 1888, p. 159-165.)
1. Par exemple : cte septentrionale du golfe de Salerne (Amalfi) ; cte int-
rieure de la Magnsie (Volo). Sur le versant oriental du promontoire appel Cap
Corse, l'abri des vents d'Ouest, se droule pendant 35 kilomtres une succession
de bourgs et de marines, dont la population dpasse 75 hab. au kmq., plus de deux
fois la moyenne de l'le.
2. Sur la frange littorale qui se droule de Tripoli Sada, la densit de la popu-
lation peut tre value entre 50 et 1 00 hab. au kmq.
3. Dans l'organisation patriarcale de l'ancienne marine de Catalogne, plusieurs
propritaires s'associaient pour l'armement et les oprations d'un bateau. (Ricart
GiRALT, Nuestra marina mercante, Barcelona, 1887). Toute cette partie de la cte
RGIONS MDITERRANENNES 87
changement
qu'apporte la vie moderne avec l'industrie, les villes et
l'envahissement
cosmopolite, ces genres de vie subsistent, non comme
survivance, mais comme expression d'harmonies naturelles qui ont
favoris la multiplication des hommes.
IV.
ZONES D'ALTITUDE
C'est un fait persistant, dans notre rgion mditerranenne, que la
densit de population se localise dans la zone des cultures de planta-
tions. Au-dessus de 800 mtres, les tablissements humains deviennent
rares, sauf aux extrmits mridionales de ce domaine. Encore mme
les villages chelonns sur les pentes mridionales de la Sierra Nevada
ne dpassent-ils pas en gnral la limite des oliviers (1.200 m.) ^, et
s'il se trouve et l, en Sicile, des bourgs populeux comme les bourgs
jumeaux de Calascibetta (878 m.), et de Castrogiovanni, l'antique
Henna (997 m.), la tranche principale de la population de l'le est-elle
circonscrite entre 300 et 800 mtres
2.
Cette zone populeuse par excel-
lence se subdivise elle-mme suivant les divers lments dont elle se
compose et dont elle s'est graduellement enrichie
^.
Ces limites respec-
tives se dessinent par des lignes d'tablissements. C'est ainsi que la
tranche infrieure, o prosprent les cultures d'agrumes, se termine
sur les flancs orientaux et mridionaux de l'Etna par une range
populeuse que semble rgir la courbe de niveau de 300 mtres : niveau
de sources o s'alimentent les irrigations. Sur les collines argileuses
miocnes qui bordent l'arc extrieur de l'Apennin, de Bologne Ter-
moli, une bande de population concentre comme dans le Sud de
l'Italie, mais librement dissmine, suit fidlement la rpartition de
l'olivier entre 200 et 600 mtres environ. La vigne et l'olivier se font
mutuellement cortge
;
la vigne, cependant, est attire par les causes
conomiques actuelles vers la plaine. C'est par la chtaigneraie, du
moins quand la nature du terrain s'y prte, que ce mode de culture.
est couverte de villages, fermes, maisons de campagne... avec faubourgs de pcheurs
sur la plage. > (Instructions Nautiques, n 968, 1913, p. 186.) De mme, en petit,
la cte d'Argels-sur-Mer et Collioure, l'entre du golfe du Lion, o la densit
dpasse 100 hab. par kmq.
1. O. Quelle, Beitrge zur Kenntnis der spanischen Sierra Nevada (Zeitschr.
Ges. Erdk. Berlin,
1908, p
424 et suiv.).
2. O. Marinelli, La distribuzione allimetrica dlia popolazione in Sicilia. (Riv.
Geog. liai., I, 1893, n
2, p. 117.)
En Corse, sur 62 cantons, plus de la moiti
(36)
sont situs un niveau suprieur 400 m.
; une dizaine seulement sont plus
de 800 m. Il semble donc que ce soit entre 400 et 800 m. que se concentre le gros
de la population de l'le.
3. Le mrier, avec l'industrie de la soie, au moyen ge en Espagne et chez nous
plus tard, vient prendre rang parmi ces cultures.
88 LA RPARTITION DES HOMMES SUR LE GLOBE
de gradins en gradins, fait preuve de la plus grande force expansive.
Avec elle monte aussi la zone des populations denses. Elle ne commence
que vers 400 mtres, et plus haut seulement, vers 600 ou 700 mtres,
elle devient dominante. Une ligne d'tablissements humains corres-
pond souvent la limite o l'olivier, avec les cultures qui l'accom-
pagnent, cde la place au chtaignier
i.
Grce cet arbre nourricier,
le flot d'une population dense a pu atteindre ses extrmes limites
sur les flancs de l'Apennin, des Alpes mridionales et des Cvennes
2.
Ces hauteurs, elle les dlaisse aujourd'hui, rebute par le travail minu-
tieux et pnible qu'exigent les terrassements en gradins, difice ma-
onn qu'il fallait sans cesse rparer et entretenir. Ce travail de Sisyphe
n'est plus la porte ni du got des habitants
;
aussi la partie sup-
rieure de ces anciennes terrasses cultives prsente-t-elle souvent l'as-
pect d'une pierraille croulante, abandonne la vaine pture. Une sorte
de flux et de reflux en sens vertical rgit les mouvements de la popula-
tion. Ce que jadis elle cherchait en hauteur, c'tait la scurit, souvent
la salubrit ;
aujourd'hui, l'attraction contraire prvaut
^.
V.
ROLE DES MONTAGNES
Les montagnes bordires de la Mditerrane atteignent rarement
3.000 mtres, mais un grand nombre culminent entre 1.500 mtres et
2.000 mtres, c'est--dire dans la zone o les prcipitations ont leur
valeur maximum. Celles-ci appartenant surtout la saison froide
amassent des neiges en mme temps qu'elles produisent des pluies.
Ainsi se nourrissent les rivires, se gonflent de fortes sources, s'entre-
tiennent de prcieuses rserves pour les scheresses d't. En gnral,
il manque ces montagnes une tendue de zones suprieures o pt
se former, comme dans nos Alpes, une fconde conomie pastorale.
C'est comme chteaux d'eaux et leur pied qu'elles sont productrices
d'agglomrations humaines. Depuis le mont Olympe de Thessalie
jusqu' la Sierra Nevada de la Cordiflre btique apparat nettement
ce rle de la montagne.
Les chanes fragmentaires qui se dressent sur le pourtour effondr
de l'ancienne gide, seraient une rgion d'exemples classiques.
1. Trs nettement en Corse, par exemple Evisa (716 m.). En Vivarais, vers
400 m. 500 m., la chtaigneraie surmonte le mrier et la vigne.
2. La Castagniccia de Corse, qui embrasse, entre 600 m. et 700 m. d'altitude, la
valle d'Orezza et qui correspond peu prs au canton de Piedicroce, a une den-
sit de population de 90 au kmq.
3. C'est ce qu'on observe notamment entre la Cerdagne et le Roussillon. M' Sorre
(Les Pyrnes mditerranennes, Paris, 1913, p. 410) cite un proverbe cerdan :
Baixar sempre, moiintar no
toujours descendre, ne jamais remonter .
RGIONS MDITERRANENNES 89
A leur pied, grce elles, ont exist de trs anciennes agglomrations
humaines. L'antique Lydie, la Bithynie, la Thrace, la Macdoine sont
des contres historiques dont les racines plongent dans la prhistoire.
Au pied de l'Olympe de Bithynie, sur sa terrasse ravine par les tor-
rents. Brousse, toute ruisselante d'eaux vives, est un site dont les
hommes ont de tout temps recherch la fcondit puissante
^.
Ce n'est pas, du moins dans le principe, sur les bords marcageux
de l'Hermos, du Caystre, du Mandre, que se sont installs les ta-
blissements humains ; les appellations filiales dont les hommes ont
ailleurs qualifi leurs fleuves, Gange, Nil, Volga, Rhin, devraient
s'appliquer ici aux montagnes : c'est au pied du Sipyle, du Tmole, du
Messogis, aux endroits mmes o jaillissent les sources, o courent les
ruisseaux noyant les fleurs et les feuillages, les taillis et les futaies,
dans la continuelle vapeur d'un bain nourricier
^.
Sous les noms
hellniss de Magnsie, Philadelphie, etc., dfigurs ou remplacs
leur tour par des vocables turcs, se dguisent des sites bien plus anciens.
A mesure que la puissance politique s'y est forme et que s'y sont dve-
loppes des relations commerciales, des villes, capitales politiques, sont
nes soit sur les ctes, soit sur les promontoires formant acropoles.
Car ces valles mnent au fond de l'Asie. Sardes, dans celle de l'Hermos,
fut la tte de route conduisant Suse. Mais, avant ces priodes, tant
de fois troubles et qui ont entass tant de ruines, c'est dans la fcon-
dit naturelle, l'abondance exubrante de ce qui est ncessaire la vie
que rside le secret de l'attrait qui a rassembl ici les hommes. Par ces
couloirs, l'cran des montagnes, se glisse la vgtation mditerra-
nenne : ce sont des forts d'arbres fruitiers, o noyers et mriers se
mlent au figuier, l'olivier et la vigne.
Un rapport troit, confirm par l'ethnographie, unit ici l'Europe et
l'Asie. L'Olympe thes&alien se laisse entrevoir aussi comme un centre
de formation de peuples. La chane du Karatas, qui le prolonge au
Nord, domine de 1.800 L900 mtres environ
^
la Kampania, la plaine
o fut Pella, capitale de Philippe de Macdoine, l'mathie des anciens,
l'extrmit de laquelle Salonique naquit de Tlierma, le lieu de sources
chaudes. De nombreux tumuli ne montrent qu'un village l'emplace-
1 Brousse, au pied de l'Olympe de Bithynie (2.250 m.). De mme. Afioun Kara
Hissar, sur la plateau intrieur de l'Asie Mineure, 1.000 m. d'altitude, au pied
d'un roc andsitique de 1.220 m.
; Magnsie, 50 m., au pied du Sipyle (1.800 m.)
;
Adin, 65 m. au pied du Messogis (1.050 m.)
; Alachehr, 190 m., au pied du
Tmole (2.050 m.).
2. G. Radet, La Lydie et le monde grec au temps des Mermnades^ Paris, Thorin,
1892, p. 14. Le mme auteur, note
(p. 38) le nombre prodigieux de ruines d'acro-
poles, d'enceintes fortifies, qui bordent les routes de la pninsule .
3. Vodena est 311 m., Niausta 331 m., Verria 188 m.
90 LA RPARTITION DES HOMMES SUR LE GLOBE
ment de Pella, et la plaine a l'air aujourd'hui d'une ncropole. Mais le
surgissement ou la dcharge des eaux au dbouch des montagnes
avait dsign quelques-uns de ces sites invariables que ne dlaissent
plus, aprs les avoir adopts, les tablissements humains. Tous les
voyageurs, depuis Cousinry
i,
se sont plu dcrire Vodena, la ville
des eaux, qui dguise sous son nom slave l'desse macdonienne, l'^Egae
plus ancienne encore. De ses terrasses de travertin s'croulent en cas-
cades, puis se multiplient en ruisseaux, cumant ou poudroyant
travers de magnifiques vergers, des masses d'eau venues de l'int-
rieur. Vodena est le dbouch du bassin de Monastir, l'ancienne Pla-
gonie
;
mais, le long de la mme chane, se succdent d'autres sites
humains, Niausta 2, puis Verria (Berrhoea des anciens Grecs, Karaferia
des Turcs). Celles-ci, d'aprs J. Cvijic, ne marquent pas des points de
passages, elles doivent tout aux avantages locaux. Ces villes, tant de
fois assaillies ou dvastes, persistent en vertu des lois naturelles qui
rgissent les tablissements humains. L'eau est pour elles un gage de
vie imprissable
;
elles pourraient elles trois, dit un Anglais, ali-
menter de leur nergie hydraulique toutes les manufactures de Man-
chester
^.
En attendant que ce pronostic se ralise, elles ont perdu,
au-dessus d'elles, la florissante couronne de villages que dtruisit, au
temps de l'insurrection grecque, Ali-pacha de Janina, et dans la plaine
qui s'tend leurs pieds rgne peu prs la solitude
*.
La montagne est donc non seulement vocatrice mais conserva-
trice de population. Le fertile bassin que traverse la Strouma avant
de parvenir la mer, et, plus l'Est, celui de Drama qu'une barrire
de 500 mtres de haut spare de son port de Kavala, ont contract
leur population sur les flancs des montagnes. Celles-ci, contreforts
avancs du Rhodope (Boz-dagh), dominent de L800 mtres environ
des plaines basses, dont le centre est en partie lacustre. Le long de la
voie romaine (via Egnatia), la ville fonde par Philippe n'est plus
1. Sur le devant du plateau jaillissent vingt cascades... qui se runissent dans
la valle... Dans la ville, la rivire est divise, pour le service public, en un grand
nombre de canaux
; et, au sortir des usines, ces ruisseaux vont former les cascades
de la pente mridionale. Au dehors de la ville, du ct de l'Est, commence une
prairie trs tendue, entoure de jardins, de platanes, de saules, d'ormeaux, etc..
(E.-M. Cousinry, Voyage dans la Macdoine^ Paris, Impr. Royale, 1831, t. I,
p. 78-79.)
2. Elle a d tre habite depuis les anciens temps cause de ses belles eaux
et de ses beaux \dgnobles. Il parat que ce canton fut anciennement habit par les
Bryges. (Cousinry, ouvr. cit,
p. 71.)
Ce peuple des Bryges tait, semble-t-il,
apparent aux Phrygiens.
3. D'aprs J. Cvuic, Grundlinien der Gographie und Gologie von Mazedonien
und Alt-Serbien. I. Teil (Petermanns MiiL, Ergzbd. XXXIV, Ergzh. n 162, Gotha,
1908, p. 353).
4. Id., ibid., p. 355.
RGIONS MDITERRANENNES
91
qu'un village en ruine
;
mais, l'issue des eaux ruisselantes, Drama
conserve un peu d'activit. L, comme Srs, un reste de vie urbaine,
colle la montagne, comme un germe endormi, est le signe d'une
puissance latente qui ne demande qu' s'panouir encore, quand vien-
dra son heure
^.
Elle sonnera quand la petite proprit libre aura rem-
plac le systme des tchifliks ou latilundia qu'y avait implant la domi-
nation turque.
L'Italie, quoique l'histoire ne l'ait gure pargne, a mieux conserv
ses centres de population. Parmi les bassins successifs que relie l'Arno,
celui de Lucques mrite particulirement l'attention. Il n'est pas
comme celui o Florence a succd Pistoia, au dbouch d'un des
passages principaux de l'Apennin. Il doit sa fertilit aux eaux venues
des Alpes Apuanes (cime culminante, L946 m.). Le tribut que lui apporte
le Serchio
y
rencontre, comme l'Arno lui-mme, l'obstacle du mont
Pisan (918 m.), qui l'empche de voir Pise. Le drainage a d se combiner
avec l'irrigation pour discipliner et rpartir l'afflux surabondant
des eaux bienfaisantes. Tandis que l'olivier garnit les premires pentes,
remplac par le chtaignier au-dessus de 560 mtres, la plaine s'tend
comme une marqueterie de petits champs rectangulaires o serpente
la vigne entre mriers et rables, dont le rideau, renforc par des peu-
pliers et des saules, abrite un foisonnement de crales et de lgumes :
le tout nourrit une des plus fortes agglomrations de l'Italie
^.
La
fonction bienfaisante de l'eau s'y accomplit dans sa plnitude. Les
cultures de plaines s'y combinent avec celles des versants. La gamme
de produits, eu gard la latitude, est complte
; s'il
y
manque les
agrumes qui n'apparaissent gure que vers 40^ de latitude, en revanche,
dans le Sud de l'Italie, la chtaigne n'entre plus gure dans l'alimen-
tation. Le cadre rempli dborde au dehors. Ce coin de Toscane mrite
de servir de type.
La Campanie ne se rsume pas dans Naples et sa banlieue, ni dans
les vignobles qui cernent le Vsuve : le trait gographique essentiel
est l'arc de cercle intrieur que dessinent les chanes calcaires brus-
quement interrompues au bord de la plaine. A leur pied se pressent
les populations et les villes, depuis Capoue, au dbouch du Volturne,
par Caserta, Maddaloni, Nola, Sarno, Nocera, jusqu' l'peron calcaire
qui spare ce groupe naturel de celui de Salerne.
1. Srs est 50 m. d'altitude, h porte du Perim-dagh (1.820 m.), Drama est
105 m., au pied du Boz-dagh (1.854 m.). Au-dessous de la ville [Drama], s'chap-
pent de toutes parts des eaux dont les habitants tirent bon parti pour la teinture
et la tannerie. (Gousinry, ouvr, cit, II, p. G.)
2. Province de Lucques, 242 hab. au kmq. (Italie, 126). De l partent de nom-
breux migrants temporaires pour la Corse.
92 LA RPARTITION DES HOMMES SUR LE GLOBE
Le Vulture fait natre comme une oasis dans les solitudes de la
Basilicate. Plus de 500 habitants par kmq. se pressent sur le flanc
occidental de l'Aspromonte. L'Etna ramasse autour de ses flancs, au
niveau des sources, une des plus extraordinaires fourmilires du
monde : 359 hab. au kmq. sur le pourtour entier, jusqu' 600 hab.
sur la partie Est et Sud. De mme, dans le Ploponse, Kalamata,
hritire de Messne, groupe au pied du Taygte (2.400 m.) une popu-
lation double de celle du royaume
^.
Le Canigou (2.785 m.) dispense la Vega de Prades, puis au Rivieral
de la plame roussillonnaise, une richesse d'eau qui depuis le x^ sicle,
fm des luttes dvastatrices entre Francs et Arabes,
y
a entretenu
une densit croissante de population. Le Genil, chapp de la Sierra
Nevada (Cerro de Mulhacen, 3.481 m.) est le crateur d'un groupe
humain que l'antiquit avait connu sous le nom d'Iliberris, remplac
depuis par celui de Grenade. Dans cette partie mridionale de la rgion
mditerranenne, le niveau suprieur des cultures de plantations
s'lve de plus en plus. Les agrumes remontent jusqu' 700 mtres
dans le bassin de Grenade.
Si l'on cherche quelle est en moyenne, autour de la Mditerrane,
la zone d'altitude o se plat l'habitat humain, il faudrait la dterminer
environ entre 200 et 400 mtres. Elle chappe aux exhalaisons qui
rendent souvent la plaine dangereuse et elle admet la plupart des
cultures qui font la richesse du domaine climatique mditerranen.
C'est ce niveau que, autour de la Campagne romaine, se droule la
ligne des Castelli romani, que se nichent les vieux oppida qui bordent,
sur les monts des Volsques, la frange dserte des Marais Pontins, que
d'anciennes villes dominent les abords passablement dserts de l'an-
tique trurie. C'est dans cette zone d'altitude que les plis de l'Apennin
embrassent dans leurs sinuosits un grand nombre de bassins, qui
forment autant d'units dmographiques. Les rivires qui les relient
entre eux ont peiiie se frayer une issue, et il a fallu plus d'une fois
que le travail des hommes aidt l'vacuation des eaux. L'Arno,
le Tibre, comme l'Aterno et la Pescara sur le versant adriatique,
traversent une succession de bassins : celui d'Arezzo
(272 m.), ceux de
Foligno, de Rieti, d'Aquila, de Sulmona
^.
La vie
y
est saine et forte.
Vasari attribuait l'air vif d'Arezzo quelque chose du gnie de Michel-
1. Densit de la Messhie, 76 hab. au kmq. Moyenne de la Grce, 41 hab.
2. Bassin de Foligno, 310 kmq., 240m. ; bassin de Rieti, 88 kmq., 400 m.
;
bassin
d'Aquila, 100 kmq., 700 m.
;
bassin de Sulmona, 107 kmq., 400 m.
;
bassin du lac
Fucin, 842 kmq., 655 m.
Remarquer l'exigut de ces conques, dont la popula-
tion dborde priodiquement.
Voir : Maurice Besnier, La conque de Sulmona
(Annales de Gographie, XIII, 1904, p.
348-360
;
phot., pi. 11).
RGIONS MDITERRANENNES
93
Ange. Autour de Foligno, d'Assise, de Rieti, de Sulmona, se dressent
les plus hautes chanes de l'Apennin calcaire, aussi sches sur les
flancs que ruisselantes de sources la base : Vettore, 2.477 m.
; Gran
Sasso, 2.914 m. ;
Velino, 2.487 m.
;
Majella, 2.795 m. Le jardin en est
le premier plan ; la montagne grise en forme le fond. Les oppida,
vieilles enceintes fortifies, se nichent sur les perons dans les parties
non cultivables. La vie urbaine n'y est pas chez elle, mais une vie
cantonale assez puissante, que la main de Rome a groupe en faisceau,
prpare d'ailleurs par des affinits de langue. Dans la puret et la
vivacit de l'air se conserve et se reforme un matriel humain qui a
fourni autrefois cette mme Rome le meilleur contingent de ses
lgions, et aujourd'hui la main-d'uvre qu'elle recrute pour l'exploi-
tation de la Campagna
^.
Ce va-et-vient cre un rythme caractristique de la vie mditerra-
nenne.
VI.
INFLUENCES ARABES
La physionomie de la Mditerrane a chang au cours des temps, le
peuplement suit la mme marche. Une touche nouvelle vient foncer
le tableau de la densit, quand, aprs la dpopulation qui avait accom-
pagn la dcadence de l'Empire romain, la domination arabe russit
s'tablir dans le Sud de l'Italie et en Espagne. Elle apportait avec
elle de nouvelles cultures, le coton, la canne sucre, le riz, les agrumes,
issues des rgions tropicales et servies par une science plus avance
de l'irrigation. La Mditerrane, dans sa moiti mridionale, offrait un
domaine souhait. Elle a des hivers plus doux, suivis, il est vrai, de
scheresses plus longues
;
mais si pour l'irrigation on dispose de quan-
tits suffisantes, il est possible d'y reproduire la merveille des rgions
tropicales, c'est--dire de faire succder sans interruption, sur des
espaces restreints, des cultures d'espces varies ;
de crer enfin de
puissants appels d'hommes. L'uvre des Arabes, qui a survcu
leur domination, a, comme jadis celle des Phniciens, contribu
mridionaliser la Mditerrane. Dans ces contres qui, dans leur tat
primitif, faisaient aux Orientaux l'effet d'une terre de forts et de
pturages, elle a achev de mettre au premier plan le verger, le jardin
dont la vie pullulante est due l'art dlicat que Persans et Arabes
avaient pouss la perfection. Sans doute, l'organisation de l'eau
1. Ce type de conques tages n'est pas particulier l'Italie. On le retrouve chez
nous : Gonflent de Prades (Prades, 345 m.) et Cerdagne une altitude suprieure
;
en Espagne
;
conque d'Urgel ; Lorca (350 m.) et Murcie
;
Vega de Grenade (700 m.)
et Carapo regadio de Jan, etc.
94 LA RPARTITION DES HOMMES SUR LE GLOBE
n'avait pas attendu les Arabes pour tre une proccupation habi-
tuelle des peuples mditerranens
;
Platon ne fait-il pas allusion de
belles et antiques lois qui avaient pour objet cette question vitale
^
?
Des traces de trs anciens traits et de conventions entre peuples
ont t conserves en Grce ;
il n'est pas douteux que, en Roussillon,
une organisation existt l'poque visigothique
^.
On ne saurait,
toutefois, refuser aux Arabes le mrite d'avoir serr de plus prs que
leurs devanciers le problme de l'irrigation. La Sicile leur offrit en
premier lieu un champ merveilleux d'exprience. Elle provoqua un
afflux de population. La prosprit du Val Mazzara au x^ sicle
y
runissait une population qui sans doute n'avait pas alors d'gale
en Europe
; ce foyer de prosprit et de travail attirait des immigrants
de la Ligurie et du Nord de l'Italie
; la Conca d'Oro de Palerme avait
une population qu'on peut juger non infrieure celle d'aujourd'hui
^.
Nous devons savoir particulirement gr cette organisation, puisque
c'est d'elle que procdent aujourd'hui ces minutieux travailleurs
maltais qui, avec les Mahonais, viennent changer en jardins les ban-
lieues de nos villes algriennes.
Les vegas et huertas d'Espagne s'organisrent la sicilienne
*.
Ont-
elles diminu d'tendue ? Peut-tre sur certains points. Elles s'che-
lonnent, comme on sait, sur la cte orientale et mridionale depuis
Valence jusqu' Malaga, et quelque distance vers l'intrieur depuis
Lorca jusqu' Grenade. Il faut profiter des gorges par lesquelles les
rivires, dbouchant des montagnes proximit du littoral, disposent
encore d'une pente sensible pour en matriser l'coulement. M' Jean
Brunhes a donn de leur organisation une analyse prcise et docu-
mente, laquelle je dois renvoyer le lecteur ^ Rappelons seulement
que plus de 300.000 habitants se pressent sur l'espace d'un millier de
kilomtres carrs qu'on embrasse du haut de la tour de la cathdrale
de Valence. Les bourgs ramasss qu'on observait aux approches vers
Tarragone et Sagonte se dispersent en une multitude de barracas,
1. Lois, VIII, p. 844 a : xwv xwv Tcipi -^ebipyolii TiaXaiol xal xXoi vofjLoi.
2. Brutails, ouvr. cit,
p. 5 et suiv.
3. M. Amari (Storia dei Musulmani di Sicilia, II, Firenze, 1858, p. 435) value
d'aprs les noms d'origine arabe et berbre les nouveaux nuds de population
forms par les colons de cette nationalit l'poque musulmane
;
il en compte 328,
dont 209 dans le Val Mazzara.
Sur les migrants ligures et lombards aux xi et
xiie sicles, voir t. III, 1868, p. 222 et suiv.
4. Amari (ouvr. cit, II, p. 447) mentionne le Livre d'agriculture, crit vers le
dbut du XII
sicle par Ibn el-Awan de Sville (trad. fr., Paris, 1864-1867) ;
il nous
apprend que le mode recommand de plantations d'herbes potagres, oignons,
melons, etc., tait dit la sicilienne.
5. Jean Brunhes, tude de gographie humaine, L'irrigation, ses conditions go-
graphiques, ses modes et son organisation dans la Pninsule ibrique et dans l'Afrique
du Nord, Paris, 1902.
RGIONS MDITERRANENNES 95
toutes de type uniforme. Luzerne, haricots, arachides mme, se suc-
cdent sans interruption. L'oranger
y
gle parfois, mais rarement.
Le tribunal de aguas, tous les jeudis matin, rgle la rpartition des
eaux entre la multitude des petits propritaires, pratiquant, avec
l'appoint d'engrais chimiques, une culture intensive. C'est un type
d'agglomration humaine dont les rgions industrielles de l'Europe
centrale offrent seules l'quivalent.
CHAPITRE VI
CONCLUSIONS : RSULTATS ET CONTINGENCES
L'occupation humaine du globe est entre, vers le dernier tiers
du xix^ sicle, dans une phase nouvelle, trop complique pour qu'on
puisse en aborder d'emble l'examen. Prs de quatre sicles s'taient
couls depuis la dcouverte de l'Amrique : c'tait peine si l'Eu-
rope, dans cet intervalle, avait russi lui envoyer neuf ou dix mil-
lions de ses enfants, peu prs autant que les seuls tats-Unis reoivent
de nos jours en deux dcades. A ce compte, les prairies de l'Amrique
du Nord, les pampas de l'Argentine risquaient de rester longtemps
encore dans le mme tat qu'au temps de Colomb. Ce n'est pas d'un
mot qu'on peut donner la formule de tels changements.
Mais nous pouvons dj constater d'aprs ce qui prcde, combien
la densit de la population est lie aux questions de genres de vie.
Ce n'est pas assez de dire d'une faon gnrale que chaque genre de vie
a ses exigences d'espace, plus grandes pour le chasseur ou pour le
pasteur que pour l'agriculteur
;
bien que la question se pose encore
actuellement en ces termes, et aussi pressante que jamais, dans l'Ouest
amricain comme en Australie et sur les confins du Tell et du Sahara.
En ralit, toute spcialit et toute nuance de genres de vie, tout
progrs, tout changement dans les rapports conomiques de contres,
a son retentissement sur la population. C'est comme marachers et
horticulteurs que les Maltais ou les Mahonais sortent de leurs les
pour aller peupler les banlieues urbaines de l'Algrie. La pratique
de l'levage sur des plateaux unis que les chars peuvent sillonner
fit essaimer les Boers. Cultivateurs particulirement experts dfricher
la fort, les Franco-Canadiens ont pu leur aise multiplier sur place
autour du Saint-Laurent. En revanche, il a suffi d'une succession de
mauvaises rcoltes, le flau se greffant sur une mauvaise constitution
de la proprit, pour que l'Irlande perdt en vingt ans la moiti envi-
ron de sa population. De ce mlange et de cet entrecroisement per-
Vidal-Lablache, Gographie humaine. 7
98 LA RPARTITION DES HOMMES SUR LE GLOBE
ptuel des faits sociaux et des faits gographiques rsultent bien plus
de complexits et de vicissitudes qu'on n'en imagine d'ordinaire.
On risque fort de se tromper quand on fonde ses pronostics sur l'tat
actuel. Sa prolongation dpend des phnomnes auxquels il est li.
D'autre part, il
y
a assez d'exemples montrant la mme race proli-
fique ou strile suivant les temps et les lieux, pour ter beaucoup
de fondement l'importance qu'on s'est plu souvent attribuer aux
causes ethniques. C'est surtout propos de la population qu'on peut
dire que les causes gographiques n'agissent sur l'homme que par
l'intermdiaire des faits sociaux. D'o les oscillations que l'histoire
permet d'entrevoir dans le pass et de prvoir pour l'avenir, de brusques
pousses succdant des temps d'arrt, suivant une allure en somme
assez dconcertante.
Le surpeuplement, initial et pour ainsi dire congnital l'espce
humaine, rentre essentiellement dans ce double caractre conomique
et gographique : conomique, puisqu'il a le plus souvent pour cause
l'insuffisance tirer parti du sol et l'emploi de mthodes agricoles trop
extensives
;
gographique par les formes qu'il revt et les effets qu'il
engendre suivant les milieux o il se produit. Il est naturel que moins
l'espace est tendu, plus tt le point de saturation soit atteint.
C'est pourquoi l'on voit des les, des articulations littorales, d'troites
bandes bornes par les montagnes, charges d'une population surabon-
dante, se dfaire par l'migration de ce surplus. Quelques-unes ont d
cela un rle qui a eu son importance dans la civilisation. C'est par
la Phnicie, la Hellade, les les de la mer Ege et de la mer Ionienne
que la Mditerrane est devenue ce qu'elle reste dans l'histoire gn-
rale, un lieu de concentration et de syncrtisme de peuples. On peut
attribuer de mme un rle prpondrant, dans la colonisation de l'Ar-
chipel japonais, aux deux les mridionales qu'une mer intrieure,
plus dcoupe que la Mditerrane, relie l'le principale : c'est dans
Kiou-Siou et Sikok et sur les rivages qui leur font face que se pressent
les plus denses populations de l'Empire.
Mais des domaines ainsi restreints seraient impuissants donner
aux socits humaines la consistance qui les assure contre les chances
de destruction. Le bassin de la Mditerrane, image encore imparfaite
de ce qu'il fut, malgr les efforts de restauration qui
y
ramnent la
vie, n'est-il pas un exemple de la fragilit de ces civilisations, aux-
quelles manque la large base territoriale ? Aussi la formation des
grandes agglomrations que nous avons essay de dcrire et dont la
force numrique est de taille supporter tous les tributs que les flaux,
guerres, pidmies ou famines, peuvent
y
prlever, constitue nos
CONCLUSIONS: RESULTATS ET CONTINGENCES 99
yeux le principal levier d'action que l'humanit ait russi combiner.
Ces pais bataillons peuvent sans s'appauvrir suffire une expansion
qmi s'tend autour d'eux comme une aurole. Le flot de la colonisation
chinoise, aprs s'tre avanc du Nord vers le Sud, rparant au besoin
ses pertes, recouvrant ses conqutes perdues, finit, dans les provinces
montagneuses du Sud, par se diviser, se ramifier en filets de plus en
plus amincis. Mais tant il s'en faut que sa force d'expansion soit
teinte, que dans l'Indochine et la Malaisie l'lment chinois est le
fermant le plus actif des socits qu'il pntre. L'Inde, de son ct,
fournit des travailleurs l'Assam et la Birmanie
;
sa colonisation
rayonne sur l'Afrique orientale. De ces deux grands groupes sortira
peut-tre le supplment de bras et d'intelligences humaines dont le
manque se fait encore si fcheusement sentir dans la plupart des
contres tropicales.
L'Europe fut aussi un foyer de colonisation pour elle-mme, avant
de le devenir pour le nouveau monde. Les contres dj populeuses de
Flandre et des Nerlandes fournissent pendant le moyen ge des colons,
non seulement au pays du Brandebourg qui en tire son nom de Fl-
ming, mais aux marches orientales de l'Allemagne. La Russie plus
tard puisa son tour dans l'Europe centrale des contingents de colons
pour reconstituer son Ukraine, sa frontire des steppes.
Les agglomrations ont servi leur manire la cause du progrs
;
car rien de nouveau ne se cre sans que l'volution souhaite ait sa
porte de suffisantes disponibilits d'hommes. On puisa dans ces multi-
tudes pour la construction des grands travaux publics qui furent l'or-
gueil de certaines dynasties chinoises
;
pour ces barrages hydrauliques
et ces tanks innombrables qu'on admire dans le Sud de l'Inde. Et, ce
qui nous touche de plus prs, la moderne volution industrielle de
l'Europe eut la chance de trouver dans la prsence de populations
assez denses la main-d'uvre et le personnel dont elle avait besoin.
Dans les rgions leves et pauvres de Saxe, de Silsie, de la Fort-
Noire, des Vosges, du Lyonnais taient installes des populations
nombreuses pour lesquelles l'industrie tait un appoint, avant de
devenir une vocation. Les manufactures qui se fondrent dans le
centre et l'ouest de l'Angleterre la fin du xviiie sicle, recrutrent
leur personnel dans la classe de petits agriculteurs que ruinait alors
une crise conomique. C'est ainsi que, aujourd'hui, le Japon peuple
ses rcentes usines avec la surabondante population de sa campagne.
Mais les causes en apparence les plus durables peuvent avoir fait
leur temps. Il se peut que dans l'arsenal mouvant des causes cono-
miques d'autres prennent leur place. L'augmentation croissante des
100 LA REPARTITION DES HOMMES SUR LE GLOBE
besoins, la multiplicit des services de notre civilisation moderne-
requirent sans cesse un plus grand concours de forces humaines.
Mais les facilits de transport permettent aujourd'hui la main-
d'uvre d'afluer, sans se fixer, mme de grandes distances. Qui
peut dire d'ailleurs que force reste synonyme de nombre? Avec les-
progrs du machinisme l'intelligence supple au nombre. Qu'advien-
dra-t-il enfin si d'autres sources de pouvoir se substituent celles qui-
exigent un appareil encombrant ?
Ainsi l'examen des faits, comme il arrive souvent, pose plus de-
questions qu'il n'en rsout.
DEUXIME PARTIE
LES FORMES DE CIVILISATION
DEUXIME PARTIE
LES FORMES DE GIVILISA.TION
CHAPITRE I
LES GROUPEMENTS ET LES MILIEUX
I.
LA FORCE DU MILIEU
A mesure que les rangs de la population humaine se sont paissis,
de nouveaux rapports ont t nous avec le sol. Des groupes en nombre
croissant ont senti la ncessit de se localiser, de prendre racine dans
une contre plus ou moins dtermine. Volontaire peut-tre et spon-
tane chez les uns, cette concentration a t pour d'autres un effet de
force majeure, rsultant de pousses qui les ont refouls dans des
rgions moins hospitalires. Il est difficile d'admettre que ce soit en
vertu d'un libre choix que des socits humaines aient accommod
leur existence au climat du Sahara ou celui des rgions circumpo-
laires, au point d'en paratre aujourd'hui insparables. Progressive-
ment donc, et par une suite d'vnements dont l'histoire ne montre
que les rpercussions ultimes, un tassement s'est opr entre les
milliers, puis les millions d'hommes qui avaient s'arranger de l'es-
pace que les eaux, les dserts glacs ou arides laissaient libre. L'occu-
pation s'est faite plus intensive. Les habitants ont d se mettre en
complte harmonie avec l'entourage et s'imprgner du milieu.
Sous ce nom de milieu, cher l'cole de Taine, sous celui d'environ-
ment, d'emploi frquent en Angleterre, ou mme sous celui d'cologie,
que Haeckel a introduit dans la langue des naturalistes,
termes qui
au fond reviennent la mme ide,
c'est toujours la mme proccu-
pation qui s'impose l'esprit, mesure que se dcouvre davantage
104 LES FORMES DE CIVILISATION
l'intime solidarit qui unit les choses et les tres. L'homme fait partie
de cette chane
; et dans ses relations avec ce qui l'environne, il est
la fois actif et passif, sans qu'il soit facile de dterminer en la plu-
part des cas jusqu' quel point il est soit l'un, soit l'autre. Il a t
dit des choses pntrantes et justes sur les influences de position,
de climat, sur le poids dont pse le monde inorganique
;
et l'on est
loin assurment d'avoir puis la matire. Si l'homme, trop dsarm
devant le climat et les forces inanimes, est plus l'aise vis--vis du
monde vivant, encore faut-il compter que les tres auxquels il a affaire,
ayant subi comme lui les influences du climat ambiant, les lui ren-
voient rpercutes, accrues et multiplies de toutes parts. Ce n'est
pas entre des individus que son activit s'exerce, mais entre des asso-
ciations collectives, qui n'ont pas moins de droits, les uns et les autres,
tre regards comme autant d'expressions du milieu. Ainsi cette
notion de milieu, qui se rsumait jadis en une formule trop simple,
ne cesse de se compliquer par les progrs de notre connaissance du
monde vivant
;
mais cette complication mme permet de la serrer
de plus prs.
Au point de vue gographique, le fait de cohabitation, c'est--dire
l'usage en commun d'un certain espace, est le fondement de tout.
Dans les cadres rgionaux o se sont accommods des groupes humains,
ils se sont trouvs en prsence d'autres tres, animaux et plantes,
galement groups et vivant en rapports rciproques. Les causes qui
ont prsid ces rassemblements sont diverses
;
elles tiennent au
moins autant au hasard qu' des affinits spcifiques. Les vicissitudes
de climat ont affect, troubl de diverses faons la rpartition des
plantes
;
les pripties de la concurrence vitale ont modifi en tous
sens la distribution des tres
; et pour les hommes en particulier
la dispute de l'espace n'a pas cess de produire des effets perturbateurs.
C'est par colonies, par essaims, plutt que par le jeu rgulier d'expan-
sions naturelles, que se sont forms la plupart des rassemblements
vivants. Parmi les tres qui les composent, beaucoup ont apport
dans l'espace qui les tient runis des qualits ou des habitudes contrac-
tes ailleurs.
Mais dfaut d'affinit originelle, le lien gographique qui les
relie est assez fort pour les maintenir en cohsion et pour former
un faisceau de tous ces tres, en vertu du besoin qu'ils ont de s'ap-
puyer les uns sur les autres. Il ne tient qu' nous de voir l'uvre
cet effort d'accommodation un espace donn : une fente de rocher,
pour peu qu'il s'y soit nich un peu de poussire, se tapisse de quelques
imousses auprs desquelles adviennent, au hasard des germes qu'a
LES GROUPEMENTS ET LES MILIEUX 105
apports le vent, des plantes diverses
; et autour de ces vgtaux, un
monde bruissant d'insectes ne tarde pas afluer. Telle est, en raccourci,
l'image
symbolique des groupements auxquels on assiste.
Cette interdpendance de tous les cohabitants d'un mme espace,
de tous les commensaux d'une mme table, ennemis ou auxiliaires,
chasseurs ou gibiers, tient aux conditions dans lesquelles fonctionne
leur organisme, et relve ainsi du climat. L'tude de la physiologie des
tres vivants autres que l'homme nous fait pntrer dans le secret de
ces rapports. Il est vrai qu'elle ne date gure que d'hier. C'est surtout
parmi les reprsentants minuscules du monde animal, insectes ou rats,
auxquels semble dvolu le redoutable rle d'agents de transmission,
qu'il
y
a des connexits et des relations saisir. Les diffrentes espces
de glossines, messagres de iripanosomeSy laboratoires vivants dans
lesquels mrissent les germes pathognes qui infestent de vastes
contres en Afrique et ailleurs, commencent nous tre connues
dans leurs exigences d'habitat, dans le fonctionnement mme de leurs
scrtions; et nous pouvons discerner que les unes et les autres, comme
les formations vgtales auxquelles elles sont associes, sont, divers
degrs, fonction de la temprature et de l'humidit ambiante
^.
Nous
n'avons pas affaire des flaux vaguement diffus
;
mais des tres
localiss, et, jusque dans leurs migrations priodiques, assujettis des
conditions strictement dtermines de climat.
Chaque collectivit vivante, dans les cadres tracs par les climats,
obit ses propres besoins, poursuit ses buts ; et ces activits multiples
s'entrecroisent avec la ntre. L'homme intervient en associ autant
qu'en matre. A la suite des plantes et des animaux qu'il introduit,
beaucoup d'autres se glissent sans sa permission et travaillent pour
d'autres buts. Lui-mme sert son insu des fins qu'il ne souponnait
gure. Il vous est arriv, marchant sur des chaumes, de faire lever des
nues d'insectes : vous verriez, en vous retournant, que des oiseaux
pient vos pas
;
vous leur servez de rabatteur.
Le sentiment obscur et inquitant de cette force enveloppante qui
se dgage autour de nous du milieu physique et du milieu vivant, fut
jadis une hantise de l'imagination humaine, comme l'attestent, sous
toutes les latitudes, tant de mythologies, de pratiques superstitieuses,
de dictons et lgendes. On dirait aujourd'hui que ce sentiment
s'efface, ou que du moins, par la foule d'objets exotiques qui entrent
dans notre vie quotidienne, il a perdu toute forme concrte. L'homme
1. Voir E. RouBAUD, Les mouches tstss en Afrique occidentale franaise (Annales
de Gographie, XXII, 1913, p. 427-450).
106 LES FORMES DE CIVILISATION
de nos jours n'a d'yeux que pour se contempler dans l'exercice de sa
puissance. Bien des choses pourtant devraient nous avertir des effets
toujours actifs sur nous-mmes de ces influences collectives. Jamais
plus d'occasions n'ont t offertes d'assister la transplantation
de groupes humains dans des milieux diffrents. La colonisation,
l'immigration nous mettent en prsence de pays, non pas neufs comme
on dit tort, mais autrement organiss sous l'influence d'autres
conditions physiques. Ce n'est qu'au prix d'une appropriation plus
ou moins lente et difficile que les nouveaux venus parviennent s'y
installer; quand ce passage est accompli, que d'autres habitudes ont
t contractes et qu'un commencement d'hrdit les a dj cimentes,
nous nous trouvons en face de types humains nouveaux. Les rejetons
dtachs du vieux tronc ont mu dans ces atmosphres diffrentes.
On cite souvent l'exemple du yankee de la Nouvelle-Angleterre ;
mais
il
y
a, dans l'intrieur des Appalaches, d'autres groupes, plus isols,
moins connus, qui ont galement dvi, mais dans d'autres sens, du
type originel. Les Boers sont l'exemple le plus frappant de ce que peut
devenir, en deux sicles, un groupe qui a chang l'atmosphre de la
Hollande pour l'air sec des plateaux africains. Et dans les hautes
valles du Brsil mridional, l'cart des villes, de nouveaux types
de population sont en train de se former. Les vieilles considrations
qui nous ont t transmises d'ge en ge sur la puissance des milieux
accrue de la complicit des habitudes, ne sont nullement des valeurs
ngligeables dans l'tat des civilisations prsentes.
II.
L'ADAPTATION AU MILIEU
CHEZ LES PLANTES ET LES ANIMAUX
Cette puissance des milieux fait que les tres vivants cherchent
s'y adapter par les moyens dont ils disposent. Notre plante est condi-
tionne de telle sorte que l'existence de ses habitants doit se plier
d'incessantes vicissitudes de climat. L'imagination d'un Wells se
plairait sans doute dcrire ce que serait l'existence des habitants
d'une plante dont l'axe serait inclin de faon chapper aux varia-
tions diurnes et saisonales. Pour nous, les paroxysmes de temprature
ou de scheresse, les brusques vagues de chaud et de froid sont une
source continuelle d'preuves ; si bien mme qu'un changement de
vent, un coup de sirocco, de khamsin, ou, comme on ditenSardaigne,
de Levante maladetto, suffit pour produire une secousse, jeter le trouble
passager dans notre organisme.
Un eft'ort sans cesse renouvel serait ncessaire pour faire face
LES GROUPEMENTS ET LES MILIEUX 107
ces vicissitudes, si l'adaptation et l'accoutumance n'intervenaient
pas pour en amortir les chocs. L adaptation quivaut une conomie
d'efforts qui, une fois ralise, assure chaque tre, moins de frais,
l'accomplissement paisible et rgulier de ses fonctions. Si elle manque,
l'organisme s'inquite
;
il fait de sx)n mieux pour
y
tendre. Des exp-
riences ont montr que des plantes transportes de la plaine la
montagne taient capables en trs peu d'annes de modifier leurs or-
ganes extrieurs pour les mettre en rapport avec leur nouvel habitat.
Cette improvisation, quel qu'en soit l'intrt, ne saurait passer pour
une adaptation dfinitive
;
il faut sans doute une longue hrdit pour
assurer la transmission rgulire de caractres acquis pour la circons-
tance. Mais ce qu'elle met bien en lumire, c'est l'extrme sensibilit
des organismes toute variation du milieu ambiant. Un changement
d'altitude a pour effet immdiat de faire jouer un ressort dont le mca-
nisme, assez mystrieux, affecte les organes de communication et
d'change avec le monde extrieur.
Rive au soi, astreinte vivre et se nourrir sur place, la plante
n'a que des moyens limits de rsistance. Ils n'en sont que plus carac-
tristiques. C'est sur les tissus, le feuillage, la taille, le dveloppe-
ment respectif des organes extrieurs et souterrains que porte l'adap-
tation. Contraction des feuilles, pilosit, enduit coriace, formation
d'organes de rserve, ici le pelotonnement des branches, ailleurs leur
talement en parasols, reprsentent autant de formes diverses de
protection contre la scheresse, l'pret du froid, les assauts des vents,
les morsures de l'air ambiant. Ces procds ne sont pas sans ren-
contrer des analogies dans le rgne animal : il suffit de rappeler entre
mille exemples, le pachm ou duvet de la chvre de Cachenur, l'paisse
toison du yack, la fourrure dont se revt le tigre en Mandchourie
et qui devient comme la livre commune des animaux des rgions
arctiques.
Mais, l'animal disposant par la locomotion d'un avantage qui lui
permet de s'manciper, d'chapper une treinte rigoureuse du milieu,
c'est principalement sur les organes de locomotion qu'a port son
effort. Comme par l'effet d'un stimulant spcial, toute la force de ce
que nous appelons l'instinct animal a agi dans ce sens. Si l'on se borne
aux grandes espces animales qui partagent avec l'homme le sjour
de la terre ferme, c'est comme coureurs ou grimpeurs que se diffren-
cient les htes des rgions dont le dualisme s'oppose dans toute la
nature, espaces dcouverts et forts. L'adaptation n'clate pas moins
avec le relief et le sol. A la vigueur lastique de leurs croupes les
quids doivent de franchir vivement de grandes distances ;
sa
108 LES FORMES DE CIVILISATION
<;arrure arcboute sur des piliers espacs le yack doit son impertur-
bable aplomb. De leurs durs sabots terminant des jarrets nerveux,
Je moufllon, le chamois assurent de roc en roc leurs exploits d'acrobates
;
tandis que le chameau tale son pied large et mou sur le sable
;
que
l'lphant ramasse en avant le poids de son corps pour frayer sa piste
il travers la vgtation des mares spongieuses.
De quelle application ces exemples sont-ils l'homme ? Il est
vident d'abord que, par ses organes de respiration, de nutrition, de
scrtion, il reste, comme les animaux, imbib des influences du
milieu ambiant. L'exprimentation mdicale n'est-elle pas prcisment
fonde sur ces analogies physiologiques ? Mais on peut remarquer
en outre que, si dans sa raction contre les exigences du milieu les
procds dfensis peuvent certains gards diffrer, le principe mme
dont cette dfense s'inspire chez les hommes ressemble celui que
nous observons chez les animaux. Il s'agit, pour les uns comme pour
les autres, de cultiver un avantage spcial, de consolider la supriorit
qui leur est propre. Le recours que les uns ont cherch dans ce qui les
distingue, la locomotion, l'homme le cherche dans ce qui le distingue
aussi, son cerveau. Il a tendu son eflort vers ce qui crait son profit
une nouveaut, vers ce qui avait l'attrait d'une invention
;
et il a
trouv dans cet efort le mme plaisir que celui que les animaux les
mieux arms pour la course ou pour l'attaque prouvent exercer
leur agilit ou leur force. Libre de disposer de bras pour saisir et de
doigts pour modeler la matire, il a cr l'instrument. A la diffrence
des lys qui ne filent pas , il pourvoit lui-mme la protection de son
-corps. Quant la vitesse, c'est l'animal, puis aux nergies accu-
mules dans la matire qu'il l'emprunte. Il
y
a comme un principe
immanent de progrs dans ces conflits qui naissent des ncessits du
milieu.
m.
L'ADAPTATION DE L'HOMME AU MILIEU
Dans les conceptions simplistes des anciens, chaque principale
zone terrestre correspondait une race spciale
;
et lorsque par hasard
certains faits contraires la thorie survenaient, on cherchait des
explications plus ou moins vraisemblables. C'est ainsi que, dans leurs
relations avec le Nord, les Romains ayant eu connaissance, un jour,
d'hommes teint fonc, les savants d'alors se htrent de supposer
que des Indiens avaient t jets dans ces rgions par un naufrage
*.
1. Anecdote rapporte par Cornlius Nepos, cit par Pomponius jMela (111,45).
LES GROUPEMENTS ET LES MILIEUX 109^
L'exprience a fait justice de ces ides ; mais il n'en reste pas
moins que, de toutes parts, s'offrent des cas d'adaptation physiolo-
gique des plus remarquables. La forte pigmentation de la peau, l'acti-
vit des glandes de scrtion dont elle est pourvue, constituent pour
les Ngres un avantage sur les autres races qui se trouvent aussi dans
les rgions tropicales
;
l'active vaporation qui se produit la surface
des tissus, et le refroidissement qui en est la suite, maintiennent
l'quilibre entre la chaleur du corps et celle de l'extrieur. L'Indien
de l'Amazonie est loin d'tre aussi bien arm contre son climat.
Si nous passons des rgions humides et chaudes celles o les con-
trastes de temprature sont plus prcipits, o la scheresse de l'air
est susceptible d'atteindre les plus hauts degrs, d'autres traits d'adap-
tation nous frappent. Ce climat sec resserre les tissus de la peau,,
prcipite la circulation du sang. Le sang, plus pauvre en eau, agit
vivement sur le systme nerveux et en excite la fonction. Associe
des variations brusques, heure par heure, de temprature, au rapide
renouvellement des lments de l'air, cette scheresse est un tonique
et un stimulant. Hippocrate l'avait dit, en pensant aux Mditerranens.
L'observation s'applique mieux encore aux populations sahariennes
ou steppiques par rapport aux Ngres du Soudan. Partout o se pro-^
duit ce contact, de l'Atlantique l'Ocan indien, depuis les Maures
du Sngal jusqu'aux Massai" des rgions nilotiques, on voit comme
un fait naturel, fond sur la supriorit intellectuelle, la domination:
ou la prpotence des races vivant sous l'atmosphre dsertique.
Mais, d'autre part, l'altitude intervient comme principe perturba-
teur engendrant d'autres consquences. Des populations relativement
nombreuses sont tablies, 2.000 mtres et plus, sur les plateaux qui,
dans les contres les plus loignes du globe, en Abyssinie comme dans-
les Andes, occupent une partie des rgions tropicales. Elles s'y sont
acclimates de longue date et forment comme des lots distincts.
La scheresse de l'air, par l'obstacle qu'elle oppose aux fermentations-
de la vie microbienne,
y
garantit cette remarquable salubrit dont
l'attrait rassembla sans doute les hommes l'abri de la maladie des
terres basses. Issus de races assurment bien diverses, ils semblent
nanmoins avoir contract sous l'influence ambiante un caractre
commun qui s'est enracin : l'antipathie pour l'efort. L'gale douceur
des tempratures et la facilit du climat n'en sont probablement pas
la seule cause. Comme la tension atmosphrique diminue sensiblement
dans ces hautes altitudes, la combinaison de l'oxygne de l'air avec les;
globules du sang s'opre plus lentement dans les poumons : l'apathie,
la rpugnance toute prolongation d'effort musculaire ou autre,
110 LES FORMES DE CIVILISATION
seraient, d'aprs des observations dignes de foi, la consquence de ce
ralentissement du mcanisme essentiel qui, par le sang, agit sur la vie
nerveuse. Que de phrases on a rptes sur l'air d'atonie et de tristesse
qu'exprime la physionomie de ces indignes d'Amrique ! Le fait est
rel
;
et je me rappelle avoir t frapp, au Mexique, de l'absence
de mouvement et de gat, mme chez les enfants, dans les groupes qui
se formaient pour les repas autour des gares. Cela ne serait-il pas un
simple effet d'hrdit physiologique ?
On recueillerait sans doute beaucoup d'autres exemples d'accords
semblables, entrs dans le temprament et ciments par l'hrdit,
si l'on possdait une connaissance plus complte des peuplades per-
dues dans l'intrieur des continents. Lorsque Nachtigal pntra dans
le Tibesti, un des coins alors les plus inaccessibles du Sahara, l'aspect
des habitants lui rappela ces thiopiens troglodytes dont l'adresse
courir et sauter tait proverbiale du temps d'Hrodote
^
: peuple
de chvres vivant dans un pays de rochers. Leur corps maigre et bien
proportionn, aux attaches fines, exprime la prompte obissance des
muscles aux nerfs moteurs. Au contraire, dans la rgion du Haut-Nil,
Schv/einfurth nous dcrit des tribus que leurs longues jambes tiques
et leurs attitudes d'chassiers en sentinelle au bord de l'eau, ne singu-
larisent pas moins comme peuple de marcages. Ainsi, comme il arrive
dans l'animalit, c'est dans les organes de locomotion qu'apparaissent
surtout les diffrences entre ces primitifs.
On com^prend qu'une adaptation extrmement rigoureuse de cer-
tains miheux rende ceux qu'elle a ainsi faonns rfractaires des
milieux diffrents. Darwin remarque que, plus un groupe humain est
bas dans l'chelle des civilisations, plus il est incapable d'acclimatation.
L'observation est d'une grande porte, mais elle n'exclut nullement
pareille incapacit chez des peuples avancs en civilisation. L'Abyssin
se tient l'cart des marcages qui bordent sa citadelle naturelle,
comme le Chibcha ou le Quitchua des Andes vite l'humidit forestire
de la Montana, et comme le Hova de l'Imrina laisse aux Sakalaves
le sjour des plaines. Rciproquement le Chinois et l'Annamite, peuples
de plaines, rpugnent aux sjours montagneux dont les Lolos, les
Mois et autres tribus ont su parfaitement s'accommoder. La zone
marcageuse qui, sous le nom de Tra, borde au Sud-Est les Himalayas,
n'est point absolument inhabite
;
cependant c'est une rgion o ne
se hasarde gure l'Hindou et qui forme, entre la montagne et la plaine,
une des limites ethniques les plus marques qui existent.
1. IV, 183.
LES GROUPEMENTS ET LES MILIEUX 111
Le rle de l'altitude est dcisif dans ces exemples
; c'est elle qui
dessine des zones de sgrgation rigoureuse, qui trace des adaptations
irrductibles. On ne saurait s'attendre des limitations aussi nettes
suivant de simples diffrences de latitude. Cependant l'exemple des
Ngres est encore ici instructif. Ceux de l'Ouest de l'Afrique ont
eu le fcheux privilge de servir de champ d'exprience. Un acci-
dent de l'histoire, qui est aussi un paradoxe gographique,
sans
parler d'un acte de lse-humanit,
les a transplants aux tats-
Unis, bien au del de leur domaine d'origine. Introduits dans les plan-
tations depuis plusieurs sicles, ils s'y trouvent aujourd'hui en contact
avec une civilisation qui, par l'attrait de ses salaires, les pousse au
dehors et leur ouvre un large champ.
Le sjour des tats du Sud ne leur a pas t dfavorable, puisque,
dans le demi-sicle qui vient de s'couler, leur nombre a doubl
^.
Voici pourtant l'volution que permet de souponner l'analyse des
derniers recensements : elle consiste en un double phnomne
;
tandis
que le contingent ngre augmente dans quelques grandes villes du
Nord, Philadelphie, New York, Chicago, il ne cesse de diminuer dans
les tats ruraux, Maryland, Virginie, Kentucky, Tennessee, qui forment
la zone marginale et extrme de son domaine. Un phnomne de con-
traction se devine, qui rarfie peu peu l'lment ngre au del du 35^
de latitude environ, et le condense au contraire dans la rgion en de,
soit entre la Caroline du Sud et la Louisiane. L'aurole se resserre
en s'paisissant. L'influence du climat, malgr le contrepoids d'at-
tractions conomiques, ramne insensiblement l'expansion ngre vers
les contres humides et chaudes qui en circonscrivent les limites natu-
relles.
On serait entran par ces faits vers les questions de prdispositions
et d'immunits pathologiques
;
chapitre curieux, mais encore peu
explor d'une science qui n'est pas de notre domaine.
IV.
FORMATION DES GROUPES ETHNIQUES COMPLEXES
Nous sommes donc en prsence de groupes qui semblent chez eux,
dans leur milieu naturel
;
quelques-uns mme ont cristallis sur place
;
d'autres, arrachs leur milieu, tendent s'en rapprocher. Que faut-il
penser ? Est-ce un cantonnement rgional, vou l'endmisme,
qu'aboutit la notion du milieu ? Tel n'est point assurment le spectacle
que prsentent les ralits actuelles.
1. 1860 : 4. 441. 810
;
-
1910 : 9. 827. 763.
112 LES FORMES DE CIVILISATION
Rien n'est ce point tranch
;
ni dans la nature humaine dont la
plasticit gale les ressources, ni dans la nature physique qui admet
dans son jeu tant de diversits et de nuances. Les contrastes ramasss,
opposant brusquement les climats, sont relativement rares : c'est par
transitions graduelles que les zones s'attnuent et se transforment.
N'est-ce pas par addition de touches de plus en plus marques, mais
ventuellement interrompues par des retours de physionomies qu'on
croyait disparues, que se droulent, suivant les climats, silves, savanes,
steppes, prairies et forts ? Conditions propices au mlange des hommes.
A mesure que les groupes tendaient conqurir et occuper plus
d'espace, rien dans la nature ne s'opposait srieusement la formation
de groupes intermdiaires servant de traits d'union entre les distinc-
tions fondamentales de races. Comme dans les peintures pharaoniques
o voisinent cte cte les figures claires, rougetres, jusqu'au noir
le plus pur, l'image de l'humanit dut apparatre de plus en plus
composite.
L'analogie des climats fournit le fil conducteur. Elle favorise l'in-
filtration, guide l'accoutumance. Les brusques transports de groupes
d'un certain milieu un milieu tout diffrent ont t rarement cou-
ronns de succs
;
ils ont t parfois pays de dsastres, comme l'at-
testent les tentatives avortes dont abonde, presque jusqu' nos jours,
l'histoire de la colonisation moderne.
Si l'Afrique du Nord est le champ o ne cessent de se croiser Smites,
Berbres et Ngres, c'est en raison des affinits qu'elle offre respecti-
vement au Ngre par ses oasis, aux autres par les similitudes de prio-
dicit saisonale, la correspondance des cycles de vgtation, l'usage
des mmes animaux domestiques. On a souvent constat par quelles
transitions presque insensibles on passe des Fellahs gyptiens aux
Barbarins de Nubie, de l aux Bedjas et aux thiopiens de l'Afrique
orientale. Il
y
a plus : entre ceux-ci et les Maures de l'Afrique occiden-
tale, l'ethnographie signale de singulires ressemblances
; comme si
aux deux extrmits du continent les mmes causes avaient produit
les mmes effets, et que, de ces mlanges hamitiques ou smitiques
avec une proportion de sang ngre, fussent rsults des groupes trs
analogues. De bons observateurs ont dcrit le processus de ce mtis-
sage : c'est d'abord, chez le Berbre ou l'Arabe, la coloration de la
peau qui se fonce
; les autres caractres, nez droit, lvres minces,
cheveux lisses, persistent plus longtemps ^,
et sans doute aussi la
1. Nachtigal, Sahara und Siidan, II, p. 436 ;
Auguste Chevalier, L'Afrique
centrale franaise, Paris, 1908, p. 389.
LES GROUPEMENTS ET LES MILIEUX
113
supriorit crbrale. On a l'impression d'un phnomne en marche,
en voie d'expansion.
L'Inde reprsente, dans son immensit, une des rgions dont le
climat est le plus homogne
;
entre le Pendjab et Ceylan, sur 26 degrs
de latitude, la temprature moyenne de l'anne n'accuse pas mme
deux degrs de dilrence
;
il est vrai que les quantits de pluie sont
trs ingales. Ce vaste espace servit d'arne une race qui tient le
milieu entre les tribus aryennes venues par le Nord-Ouest et les N-
grodes dont on discerne les restes dans l'Extrme-Sud. Sous le nom de
Dravidiens, se range toute une srie de types connexes, dont on peut
suivre la gradation, depuis le sauvage des monts de Travancore jus-
qu'au Tamoul civilis des plaines, depuis le Sautai noir et trapu du
Chota Nagpour jusqu'au Brahmane olivtre et lanc de la plaine du
Gange
;
race, d'ailleurs, solide et fortement enracine. C'est dans ce
fond, rest original malgr les mlanges, que puise l'migration actuelle
vers l'Assam et vers la Birmanie
;
de l, sans doute, vinrent jadis les
Khmers du Cambodge. Les multiples croisements, invitables dans une
si vaste contre, ont eu pour elet de rendre la race mallable, apte
absorber un grand nombre d'lments.
Plus souple encore est peut-tre la combinaison ethnique qu'on
dsigne sous le nom de race malaise. Elle a trouv son expansion dans
le monde d'archipels et de dtroits qui s'tend l'Est du continent
asiatique, comme sous son ombre. Entre le rservoir humain de l'Inde,
le groupe mlansien trs mlang lui-mme, et les races mongolodes,
s'interpose un ensemble de types, qui participe plus ou moins des
uns et des autres. Il se charge au Sud-Est, au voisinage mlansien,
d'lments plus foncs
;
tandis qu'aux Philippines, et dj mme aux
Clbes, se montrent des individus qu'on prendrait pour des Japonais.
Aucun hiatus, dans cette zone de moussons, n'interrompt la chane
des races.
Le docteur Hamy insistait frquemment dans ses leons sur l'ex-
trme difficult d'une dlimitation scientifique entre Jaunes et Blancs .
La formation d'un peuple sibrien fournira, un jour, le commentaire
de cette remarque. Celle du peuple russe la confirme indirectement en
une certaine mesure. Entre la Volga et la Baltique, dans une zone
qui ne s'carte gure du 55^ de latitude, et que caractrise l'alternance
de clairires sols meubles et de forts feuilles caduques, qui pr-
sente par consquent la mme combinaison de matriaux de construc-
tion et de terroirs agricoles, Slaves et Finnois ne cessent de s'entre-
pntrer et graduellement se confondent. Tour tour les Mordves,
Tchrmisses, et autres tribus finnoises s'incorporent au peuple des
Vidal-Lablache, Gographie humaine. 8
114 LES FORMES DE CIVILISATION
Grands-Russes, dans une individualit qui ne s'affirme que davantage
en se renforant de nouvelles recrues.
Je n'ajouterai cette suite d'exemples que celui des bords euro-
pens de la Mditerrane. Par une rare fortune, les lueurs de l'histoire
y
plongent assez loin dans le pass pour permettre de saisir une longue
srie chronologique. Elle montre une continuit de rapports, qui est
l'expression non mconnaissable d'influences naturelles. On assiste
depuis trois mille ans un afflux sans cesse rpt de peuples venus
du Nord : tour tour Doriens et Hellnes, Rhtes et trusques, Celtes
et Gaulois, Germains, Slaves, Normands s'y crent des tablissements.
Ces nouveaux venus ont plus ou moins pay leur tribut aux ts dvo-
rants, la malaria, tout ce qui se mle de perfidement dangereux
l'attrait du climat mditerranen. Mais aprs des liminations, ces
contingents se sont absorbs dans la masse, non sans l'enrichir de nou-
veaux germes. Et aujourd'hui ces mmes Mditerranens s'implantent
en Californie, au Chili, dans l'Argentine, guids par l'analogie des
climats,
y
transportant leur individualit intacte.
Sur tous ces phnomnes, vivant et agissant sous nos yeux en diverses
parties de la terre, plane l'influence souveraine des milieux. Nous la
voyons s'exercer de proche en proche, en des cadres naturellement
appropris. Mais on saisit aussi dans ces exemples l'importance de ce
qu'on peut appeler le facteur social. Cet instinct de rapprochement
qui pousse les hommes s'assimiler les uns aux autres est fait de mobiles
divers : il
y
a chez les uns le dsir d'une organisation sociale fonde
sur la hirarchie et particulirement sur l'esclavage
;
chez les autres,
l'ambition et le besoin de s'agrger un tat social jug suprieur.
En tout cas, l'imitation, le prestige du nouveau, l'veil d'une foule de
suggestions nes du contact et du voisinage d'autres groupes, tra-
vaillent crer une mentalit diffrente de celle qui s'labore dans
l'isolement de certains milieux. Les incompatibilits ethniques, les
diffrences irrductibles ne rsistent pas cette ambiance, imprieuse
dans son ampleur, qui les enveloppe. Elles se fondent, comme au
creuset, pour donner des produits nouveaux. Telle est donc l'impression
double et quelque peu contradictoire que laisse l'examen comparatif
des faits de groupement. Tandis que certains milieux nous montrent
des groupes retranchs et comme parqus dans une jalouse autonomie,
d'autres, au contraire, impriment aux socits qui s'y forment un
cachet de syncrtisme, qui est et sera sans doute de plus en plus la
marque de l'humanit future.
LES GROUPEMENTS ET LES MILIEUX
115
V.
RAGES ET GENRES DE VIE
On est amen penser que les ensembles de caractres physiques
et moraux qui spcifient les divers groupements, sont chose trs com-
plexe, dans laquelle entrent des lments qui appartiennent un pass
prim. Je ne parle pas seulement du problme anthropologique, celui
des principales varits de races humaines dont les origines se perdent
dans un pass si lointain qu'elles chappent entirement la gogra-
phie humaine. Mais dans les ges qui se rapprochent davantage du
ntre, il est possible d'entrevoir des conditions susceptibles d'engendrer
des effets qui, aujourd'hui, ont cess de se produire. Lorsque l'humanit
tait rpartie par groupes rares, dissmins, troitement borns dans
leurs contacts, combien plus stricte tait la concentration des traits
de race ! La rudesse des exigences quotidiennes de la vie, ne laissant
subsister que les plus rigoureusement adapts, tendait liminer les
diffrences dans l'intrieur des groupes. Comme les sauvages actuels,
les hommes de ce temps se pliaient difficilement aux changements
de toute sorte, et vivaient entre eux : les caractres somatologiques
qui constituent ce qu'on appelle proprement parler une race, pou-
vaient acqurir, la faveur de cet isolement relatif, une contexture
solide assurant leur perptuit. D'autres indices nous avertissent
que nous ne pouvons pas tout fait juger de ces anciens temps d'aprs
les ntres. Il s'est produit dans ce pass, qui pourtant se coordonne
encore directement avec notre prsent, certains faits qu'il parat
difficile, sinon impossible, de reproduire dans les conditions actuelles.
Ne semble-t-il pas, par exemple, que la domestication d'animaux,
accomplie ds l'aurore des principales civilisations, soit aujourd'hui
un art en quelque sorte prim, devenu incompatible avec les rapports
actuels de l'animalit et des hommes ? Une dfiance incurable s'est
glisse, a sans doute rompu une intimit primitive. Il faut donc qu'
bien des gards, lorsque nous essayons de comprendre les ralits trs
complexes qui s'offrent notre analyse, nous tenions compte de
conditions maintenant abolies, mais dont les effets persistent travers
les transformations des temps.
Ce qui, au contraire, prvaut avec les progrs des civilisations, ce ^,
qui se dveloppe, ce sont des modes de groupements sociaux origi- \
nairement sortis de la collaboration de la nature et des hommes, mais
\
de plus en plus mancips de l'influence directe des milieux. L'homme
s'est cr des genres de vie. A l'aide de matriaux et d'lments pris
dans la nature ambiante, il a russi, non d'un seul coup, mais par une
116 LES FORMES DE CIVILISATION
transmission hrditaire de procds et d'inventions, constituer
quelque chose de mthodique qui assure son existence, et qui lui
fait un milieu son usage. Chasseur, pcheur, agriculteur, il est cela
grce une combinaison d'instruments qui sont son uvre person-
nelle, sa conqute, ce qu'il ajoute de son chef la cration. Mme dans
des genres de vie qui ne dpassent pas un degr assez humble de civi-
lisation, la part d'invention est assez sensible pour attester la fcondit
de cette initiative.
Et par l s'introduit entre les groupements un nouveau principe
de diffrenciation. Car le genre de vie, par la nourriture et les habitudes
qu'il implique, est, son tour, une cause qui modifie et ptrit l'tre
humain. L'Eskimau, pcheur de phoques, gav d'huile, et, par ce
rgime, capitonnant contre le froid les couches adipeuses de son pi-
derme, ne ressemble gure au chasseur toungouse et iakoute, pas plus
qu'au pasteur lapon, ses congnres des rgions arctiques. Bien que
soumis les uns et les autres aux mmes climats, le Bdouin se distingue
physiquement du Fellah, le Sarte du Kirghiz
;
et jusque dans l'uni-
formit de la zone quatoriale, les tribus de pagayeurs voues la
navigation de l'Oubangui ou du Congo, Sangas, Bayandzi, etc., dif-
frent par le dveloppement de leur thorax aussi bien que par leur
mentalit, de celles que leurs habitudes casanires claquemurent dans
leurs villages agricoles.
Cependant, quoi qu'on puisse attendre des genres de vie, il
y
a autre
chose. Certains traits de races, venus de loin, distincts de ceux que
peuvent expliquer les conditions actuelles, surnagent, persistent avec
une singulire tnacit. Malgr les mlanges qui, ds prsent, font
qu'un groupe homogne de quelque tendue est une extrme raret,
mme dans l'intrieur de l'Afrique, certains caractres de races dposs
en nous par une incommensurable hrdit, remontent comme des
vagues de fond. L'nergie accumule qu'ils portent en eux se ramasse
en des personnalits qui tranchent en bien ou en mal sur les autres
;
ou, plus souvent mme, les forces diverses que nous portons en nous
s'y livrent bataille.
Dans certains groupes, la vertu de la race est plus vivace qu'en
d'autres
;
elle les marque d'un trait saillant qui les distingue, qui
est pour eux une force. D'autant plus remarquable est cette persis-
tance des traits de race, que bien des causes conspirent pour les amor-
tir, pour les noyer dans des groupements htrognes : langues, reli-
gions, formations politiques, villes. Les groupes linguistiques englobent
tant d'lments disparates ! Les tats sont uvres de l'histoire, avec
ses hasards. Pour des religions telles que l'islam, il n'existe que des
LES GROUPEMENTS ET LES MILIEUX 117
croyants. La grande ville est un rouleau de nivellement. Malgr tout,
pourtant, le germe ethnique, quand on le croit mort, a des rveils.
Les mlanges ne parviennent pas entirement le dtruire. Ce que des
sicles lointains ont dpos en nous, rclame ainsi contre une tendance
l'uniformit par la moyenne, qui, si elle devait prvaloir, serait en
fm de compte, un assez triste aboutissement du progi's des relations
humaines.
CHAPITRE II
LES INSTRUMENTS ET LE MATRIEL
I.
INTRT DE L'TUDE DES MUSES ETHNOGRAPHIQUES
Il tait bon d'envisager d'abord, dans un coup d'il d'ensemble,
ce complexe qui constitue la population d'une contre : les diffrents
lments qui entrent dans la composition des groupes
;
tout ce qu'ont
assembl les circonstances et tout ce que tient runi la force des milieux.
Il
y
a peu de groupes homognes, si mme il en existe, au point de
vue de la race. Mais, sous l'influence des divers milieux, l'activit et
l'industrie humaines se sont orientes en sens diffrent
;
des suggestions
locales ont agi, et, pour raliser les intentions qui se sont fait jour,!
des instruments ont t imagins. Bref, un travail s'est fait qui repr-
sente autant d'essais indpendants de rsoudre en communaut
le problme de l'existence sous la pression des influences gographiques.
Ces influences se dessinent avec le relief des choses concrtes, lors-
qu'on examine un de ces muses ethnographiques comme il en existe
dans certaines villes d'Europe ou des tats-Unis, o l'on a eu soin de
coordonner d'une faon systmatique, et en nombre suffisant, les spci-
mens d'objets et d'instruments en usage chez les diffrents peuples. Les
savants qui ont prsid ces collections en ont cherch de prfrence
les lments dans les socits oft>ant le plus de chances d'origi-
nalit, par leur isolement, leur autonomie, et souvent dans les civilisa-
tions les plus menaces de prir. Cette juxtaposition prte compa-
raisons instructives. A ct des matriels relativement riches qu'offrent
les civilisations de la Mlansie ou du Centre-Africain, il en est de
chtifs et de rudimentaires, et qui sont tels, non par le hasard des trou-
vailles, mais par l'indigence des milieux. Quelques coquilles tranchantes,
quelques pointes de flche ou amulettes en os : voil tout ce qui repr-
sente les insulaires Andamans dans ce muse des civilisations
;
quelques
engins de pche, avec une peau de phoque pour vtement, rsument
peu prs l'outillage des Fugiens, tandis qu' l'autre extrmit du
120 LES FORMES DE CIVILISATION
mme continent, les Eskimaux ont su tirer d'une nature plus ingrate
encore un matriel infiniment plus riche. Parfois, certains spcimens
appartiennent dj au pass, ils voquent un tat de civilisation
dcapite, qui a dj perdu en partie, avec sa raison d'tre, ce qui
faisait son orgueil et son luxe : ainsi disparaissent les peaux de bisons
sur lesquelles les Sioux bariolaient leurs textes hiroglyphiques, les
manteaux de plumes dont s'ornaient les grands chefs polynsiens,
les boucliers en peaux de bules qui figuraient dans l'attirail guerrier
des riverains des grands lacs africains, les belles haches en serpentine
ou en nphrite qu'on fabriquait en Nouvelle-Caldonie et en Nouvelle-
Zlande. Elles vont rejoindre dans le pass ces grandes pirogues
becs richement sculpts que virent les Cook, les Bougainville, les
Dumont d'Urville, et dont ils nous ont laiss des dessins, tmoignages
d'industries en train de s'teindre et de civilisations condamnes,
dont quelques-unes n'auront bientt plus que les vitrines de muses
pour dernier asile !
Quelles qu'elles soient cependant, humbles ou riches, ces collections
voquent des socits qui ont vcu, volu, qui ont subi l'action des
temps comme celle des lieux. Jusqu'en Nouvelle-Caldonie des indices
attestent une civilisation qui fut jadis moins rudimentaire.
Ce n'est pas, en efi'et, sur l'impression superficielle d'exotisme
qui rsulte de la runion d'objets rassembls de toutes parts, qu'il faut
s'arrter. Lorsqu'une ide mthodique a prsid leur classement, on
ne tarde pas percevoir qu'un rapport intime unit les objets de mme
provenance. Isols, ils ne frappent que par un air de bizarrerie
;
groups,
ils dclent une empreinte commune. Peu peu, par la comparaison
et l'analyse, l'impression gographique se prcise. De mme que
l'aspect du feuillage et des organes vgtaux d'une plante, que celui
de la fourrure et des organes de locomotion d'un animal permettent
un botaniste ou un zoologue de discerner sous quelles influences
gnrales de climat et de relief ces tres pratiquent leur existence,
il est possible au gographe de discerner, d'aprs le matriel soumis
son examen, dans quelles conditions de milieu il a t form. Est-ce
une rgion de silves tropicales, de steppes, ou de bois rsineux qu'ap-
partiennent ces types d'habitations, d'armes et d'ustensiles ? Pour
quel genre de proie ou de moyens de subsistance, ces instruments
ont-ils t combins ? La matire et la forme de ces appareils de chasse,
de capture, de dfense, de travail, de dpt, de transport, dnoncent
une provenance et une approximation se rapportant certains genres
de vie, forms eux-mmes sous l'influence de conditions physiques et
biologiques qu'il est possible de dterminer. En ce sens une leon de
LES INSTRUMENTS ET LE MATRIEL
12t
gographie comparative se dgage des tmoignages des socits les
plus humbles. Et quant aux socits volues dont le matriel infini-
ment accru ne saurait se circonscrire dans les vitrines d'un muse,
il s'y conserve, du moins provisoirement, assez de vestiges locaux
d'usages et de costumes, pour que les spcimens en soient instructifs.
L'mancipation du milieu local n'est jamais aussi absolue que nos
yeux de citadins nous le feraient croire.
II.
L'EMPREINTE DE LA SILVE QUATORIALE
Parmi les grandes zones de climat et de vgtation, aucune n'est
marque d'un cachet d'cologie plus frappant que celle des forts tro-
picales humides, approximativement circonscrites entre 10 degrs au
Nord et au Sud de l'Equateur. Nous avons dit quelles causes
y
conspirent
maintenir l'isolement des groupes humains. On aurait tort cepen-
dant de conclure qu'il ne s'y est pas dvelopp de civilisations int-
ressantes. La majest du monde vgtal n'a pas t une magnificence
perdue pour les uvres des hommes. Les fts lancs grand dia-
mtre, piliers sur lesquels s'tagent les galeries forestires, fournirent
aux constructions les matriaux de gros uvre, les pices de charpente.
Les bois durs et compacts se prtrent au travail de moulures et d'or-
nement. Diverses espces d'arbres, figuiers ou autres, mirent au service
des hommes une corce flexible, propre se dcouper en bandes et
acqurir par macration la solidit d'un tissu. Dans l'innombrable
famille de palmiers qui peuplent cette zone, depuis VElls guineensis^
africain, la Mauritia flexuosa du Brsil, jusqu'au cocotier polynsien,
l'homme mit profit pour ses instruments ou ses difices les fibres
qui soutiennent les feuilles et les filaments tenaces dont s'entortillent
les troncs. Le mode d'adaptation des pices htrognes qui entrent
dans la composition d'un instrument ou d'une arme, d'une case ou
d'un bateau, a t souvent une pierre d'achoppement pour les industries
primitives. Des chevilles en os ou en mtal ou mme des enduits de
poix ou de goudron ont pourvu ailleurs ces ncessits. Des filaments
vgtaux remplissent ici le mme office. Ce fut avec eux qu'on lia le
manche de bois et la hache de jade, le bois et la corde de l'arc, qu'on
parvint ajuster les pices de charpente, assujettir hermtiquement
les bandes d'corce formant paroi le long des cases, maintenir dans
le bateau les poutres assembles et leur superposer un appareil
moteur. Les peuples mmes qui connaissent l'usage du fer n'en conti-
nurent pas moins user des fibres ou du rachis de leurs palmiers
comme moyen de liaison et de soudure. Rien dans cette prodigieuse
122 LES FORMES DE CIVILISATION
pousse vgtale ne demeura inaperu. Ces palmiers, ces pandanes,
ces musaces ont de longues et larges feuilles que l'atmosphre gorge
d'humidit, mais qui doivent nanmoins la ncessit de rsister
une vaporation puissante une extraordinaire consistance de tissu :
ces frondaisons s'offrirent d'elles-mmes pour former par leur assem-
blage des nattes souples et rsistantes, des rcipients toute preuve,
et pour mnager aux habitations un revtement de tuiles vgtales
non moins impermable que celui dont nous sommes redevables la
tuile ou l'ardoise.
L'homme a entam profondment ce monde vgtal grandiose.
Il en a disjoint les lments pour les matriser. Ce n'est pas dans la
masse forestire reste intacte, mais en bordure, dans les parties limi-
trophes qui en ont t dtaches, qu'on peut le mieux observer ses
effets sur les civilisations humaines. Les botanistes ont not sur plu-
sieurs points les traces incontestables des dfrichements qui en ont
restreint l'tendue. Telle est d'ailleurs la puissance de la vgtation
que des gramines arbustives, des roseaux gants se htent de
prendre les places que la destruction de la silve laisse pour un court
instant vides
;
et c'est ainsi que le bambou, annexe et succdan de ce
genre de forts, est arriv occuper une aire dont l'tendue immense
contribue expliquer la diversit d'emplois auquel il donne lieu.
Il s'associe de la sorte aux matriaux dont l'homme a pu faire usage
;
il fournit son appoint dans ce somptueux arsenal d'nergies vgtales,
sous lequel a succomb l'activit des silvatiques eux-mmes, mais qui
a puissamment servi les riverains de la silve.
La vgtation tropicale a non seulement servi, mais maintes fois
inspir les uvres des hommes. Ce sont des difices vivants que ces
tages superposs des galeries forestires, depuis le sous-bois ras-de-
sol et les arbres mi-hauteur, jusqu'aux cimes suprmes que surmonte
et enveloppe la toiture arienne de feuillage. Si l'architecture des cases
n'en est qu'une reproduction bien mdiocre, elle n'en dcle pas moins
quelque lointaine rminiscence. Les entrelacements de lianes qui
permettent certains htes de la fort de circuler sans toucher terre,
devinrent entre les mains des hommes ces ponts vgtaux qu'on trouve
en usage depuis l'Afrique occidentale jusqu' la Mlansie
;
les indi-
gnes d'Amazonie en prirent modle pour les hamacs, qui semblent
avoir leur origine chez eux. Les gros fruits sphriques du Lagenaria
et du cocotier, comme ailleurs les ufs d'autruche, communiqurent
aux coupes ou calebasses tailles dans leurs flancs, une configuration
ronde ou ovale. Un autre type de rcipient fut fourni par le cylindre
creux qui existe entre chaque nud du bambou, et dont la capacit
LES INSTRUMENTS ET LE MATRIEL 123
peut aller jusqu' deux litres. La nature vivante a cela de caractris-
tique, qu'elle suggre la forme en mme temps qu'elle fournit les
matriaux.
D
y
a un air de famille entre les uvres matrielles issues de ces
civilisations tropicales. Les analogies de climat et de nature vivante
l'expliquent suffisamment, sans qu'il soit ncessaire de supposer
des rapports et des emprunts, bien invraisemblables, quand il s'agit
de contres spares par des tendues ocaniques telles que l'Atlan-
tique ou l'Ocan Indien. De l'Ouest-Africain au Congo, puis de la
Mlansie aux Philippines, enfin en Amazonie, le type de case rectan-
gulaire pignon domine. L'abondance et les proportions de bois durs,
capables de fournir des piliers d'angles et des solives transversales,
ont permis de donner ces constructions des dimensions considrables,
abritant de nombreux htes, se prtant servir de lieux de rassemble-
ment et de danse
;
on trouve jusque chez les tribus les plus recules
de Nouvelle-Guine ces types de maisons communes. Partout, dans ces
rgions, le sol est stagnant et hvmide, rceptacle de reptiles et d'en-
nemis de toute sorte : partout aussi ou peu s'en faut, l'habitat est
maintenu par des piliers ou pilotis distance du sol
;
non seulement
sur les bords des fleuves ou des lacs du Venezuela, mais jusque sur
les collines o se logent de prfrence les populations de Mlansie,
ou dans les rgions leves que les Tagals des Philippines choisissent
pour leurs hameaux. Il faut enfin qu'un revtement pais et sans
dfaut protge l'habitation contre l'assaut des pluies : de l ces toits
forte inclinaison o, grce au raphia, au bananier, au ranevala, au
cocotier, une multitude d'essences galement souples et rsistantes,
un habile entrecroisem^ent des tiges ou des feuilles compose une supra-
structure impermable qui enveloppe la case presque tout entire.
Tantt s'cartant assez des parois vgtales qui constituent le mur
pour laisser la place d'une vrandah, tantt s'articulant de faon
emboter l'une dans l'autre deux toitures superposes, ce pitto-
resque couronnement de la construction lui imprime une physionomie
caractristique, qui a d frapper l'im^agination des hommes, inspirer
autour d'elle un veil de got artistique, car elle n'a pas t sans rap-
port avec l'architecture chinoise et japonaise.
L'analogie des matriaux s'exprime plus d'une fois dans l'analogie
des instruments. De ces bois durs et fortement colors, dont la consis-
tance conserve les artes vives et les moulures dlicates graves par la
main de l'ouvrier, les Mlansiens, les Africains du Congo et du Daho-
mey, les Amricains de l'Amazonie ont tir ces siges sculpts, ces
escabeaux ou tabourets sur lesquels s'est exerce, parfois jusqu'au
124 LES FORMES DE CIVILISATION
dlire, leur verve dcorative. La massue, qui en d'autres contres
est reste une arme grossire et fruste, s'est raffine, ausssi bien en
Polynsie qu'en Guyane, par une lgance et une varit de formes qui
lui ont donn la valeur d'un ornement et d'un insigne de domination.
Enfin, il a suffi d'vider le diamtre de certains troncs, pour obtenir
ces tambours normes qu'on trouve, depuis l'Ouest-Africain jusqu'
la Mlansie, servant de signaux et d'appels, remplissant l'office qui
revient ailleurs aux cornes et conques marines.
Les lanires d'corce fournies par diffrentes essences de Ficus,
par VArtocarpus en Indonsie, le mrier papier en Ocanie, ont donn
lieu, grce des prparations de macration et de battage, ces tissus
dont l'industrie polynsienne nous fournit de riches chantillons,
mais qu' un degr plus humble on retrouve en usage presque universel
tout le long de la zone subquatoriale, de la Polynsie l'Indonsie,
de r Quelle jusqu' l'Ornoque.
Non moins caractristiques sont les applications auxquelles se
sont prts les longs tuyaux de gramines arborescentes : dans les
silves de l'Amazone, comme dans celles de Borno, de Sumatra et de
la presqu'le Malaise, ils ont t convertis en cette arme de jet, Blow-
gun (Blasrohr) que nous appelons sarbacane, et d'o partent, mus
par le souffie, le projectile ou la flche empoisonne. Engin essentielle-
ment appropri la fort paisse, o l'arc et la sagaie ne seraient pas
d'un bon usage, il s'y est spcialis tel point qu'aujourd'hui son aire
d'extension a dcru en mme temps que celle de la fort mme. Mais,
comme les tissus d'corce et beaucoup d'autres inventions caractris-
tiques dont l'emploi va se rtrcissant, il atteste le parti que ces
embryons de civilisation ont su tirer du monde vgtal au milieu
duquel ils voluaient. En l'absence mme de rapports directs, de
singulires convergences sont l pour attester une marche commune
dans les procds d'emprunts tirs de la nature ambiante.
L'usage mme des mtaux a stimul l'industrie indigne sans la
transformer. Il est remarquable de constater surtout dans le centre
et l'Ouest africain, combien la technique du mtal s'y inspire de formes
drives du rgime vgtal. On dirait que le fer ne s'est substitu
au bois qu'en l'imitant. Il
y
a parmi ces couteaux de jet, ces serpes,
ces instruments de sacrifice qui sont originaires de la rgion entre
rOuell et le Cassai', une varit de formes qui rappelle celle qui s'exhale
des innombrables essences runies et concentres dans la fort tropi-
cale. Les uns se profilent symtriquement le long d'un axe semblable
la nervure mdiane d'une feuille de bananier; d'autres se terminent
en lancols comme une tige de palmier; d'autres s'incurvent, et, dans
LES INSTRUMENTS ET LE MATRIEL 125
leur concavit, projettent des dents ou lamelles semblables aux stipules
qui se dtachent de la gane d'une feuille.
III.
CENTRES DE DVELOPPEMENT ORIGINAUX
Naturellement, une connaissance plus com.plte du monde tropical
a mis en relief, se dtachant sur ce fonds commun, une varit inat-
tendue de dveloppements originaux. L'intrieur africain, par exemple,
a cess de nous apparatre comme un morne ensemble d'uniforme bar-
barie. Sur les bords du Cassai*, du Congo, de l'Ouell, les observations
de voyageurs scientifiques ont dress devant nous des types relative-
ment avancs de civilisations : ainsi chez les Bakoubas, les Batks,
les Mongbouttous, chez d'autres encore.
On a souvent remarqu, depuis Livingstone, la diffrence de nature
l'Est et l'Ouest des grands lacs africains. Entre les Masa et les
peuples du Congo les instruments, les armes, les vtements s'opposent
comme la steppe la silve, la faune de grands coureurs la faune
arboricole, le pasteur au cultivateur.
Les Malais.
C'est dans le monde insulaire et pninsulaire de Malai-
sie et de Mlansie, au Sud du continent asiatique et comme son
ombre, que de nouveau la vgtation tropicale se dploie dans sa splen-
deur. Elle s'accompagne, dans les grandes les voisines du vaste conti-
nent, comme Sumatra et Borno, d'une richesse inaccoutume en espces
de mammifres. La richesse et l'originalit du matriel ethnographique
sont en harmonie avec cette nature vivante. Les Bataks de l'intrieur
de Sumatra, les Semangs et Sakas de la presqu'le malaise, les Dayaks
et Keniahs de Borno, ont constitu, chacun dans son genre, des types
d'armes, vtements, instruments, figures aussi archaques maintenant
par rapport la civilisation malaise que le paraissent au milieu de
nous celles du ptre castillan ou du Palikare. Au bord des golfes ou
des fleuves, au penchant des collines, entre les forts qui couvrent
l'intrieur peine connu de ce petit continent qu'on appelle la Nou-
velle-Guine (plus de 800.000 kilomtres carrs), des Ngres dolicho-
cphales paisse toison chevelue ont, sans le secours des mtaux,
fabriqu des massues, des arcs, des tambours comme les Ngres d'Afri-
que, des masques ftichistes comme ceux du Dahomey, des tabourets
artistement sculpts pour appuyer la tte, comme on en use au Japon,
des pirogues balanciers et plateformes comme il en fourmille entre
les les du Pacifique.
Ces surfaces terrestres vont s'miettant, se dispersant en une pous-
126 LES FORMES DE CIVILISATION
sire d'les dont les marins se racontaient, du temps de Marco Polo,
qu'il
y
en avait 12.700, toutes habites sans compter celles qu'on ne
sait pas . Mais si l'appauvrissement de la nature vgtale
y
corres-
pond au rtrcissement des surfaces, les analogies gnrales subsistent.
Il n'y a pas d'hiatus vritable entre le monde malais et le monde poly-
nsien ; une connexit s'y laisse apercevoir, beaucoup plus nette qu'entre
l'Est et l'Ouest de l'Afrique quatoriale. Il faut ici certainement tenir
grand compte des relations d'changes et d'emprunts qui se sont
produites sur les voies d'une colonisation embrassant presque toute
l'tendue du Pacifique. Toutefois c'est encore la nature ambiante qui
fournit le fil conducteur.
Les Polynsiens.
Dans l'inventaire tropical des continents, les
seuls animaux mis contribution sont les oiseaux, surtout au Brsil
et en Guyane, ou les htes puissants des marais ou savanes, lphants
en Afrique, buffles en Asie. La faune marine n'apparat que et l sous
les formes minuscules de perles ou monnaies d'change. Elle prend,
au contraire, de plus en plus d'importance en Indonsie, en Mlansie,
pour devenir enfin prpondrante dans les archipels du Pacifique.
Dj Borno, en Nouvelle-Guine, et jusque dans les montagnes
de la Birmanie et de l'Assam, on voit les longs boucliers de bois se
garnir et se rehausser de coquilles, Borno des cuirasses d'corce se
blinder d'caills de poissons, en Nouvelle-Guine les masques fan-
tastiques se recouvrir d'une plaque en carapace de tortue.
Ainsi s'annoncent les approches d'une rgion maritime qui se dis-
tingue entre toutes les autres par la varit et la magnificence de sa
faune. C'est entre l'Ocan indien et la partie tropicale du Grand Ocan
que le domaine des tortues gantes, des hutres perlires, se rencontre
avec celui de la Cyprea moneta, premier spcimen de cette monnaie
de coquillage qui eut une si extraordinaire dispersion, du Nautilus,
et surtout de la merveille des merveilles, le Tridacna gigas, dont les
coquilles bivalves, larges souvent d'un mtre et semblables un bni-
tier, se drapent des plus vives couleurs. Cette rgion indo-pacifique,
par ses constructions de coraux qui mnagent l'abri et la nourriture,
entre leurs rcifs et dans leurs lagunes, des lgions de poissons, est,
sa manire, un puissant foyer de vie. L'empreinte de cette anima-
lit maritime s'est communique l'industrie humaine. Privs de
mtaux, ces Ocaniens ont utilis la duret et les dimensions du Tri-
dacna gigas, qu'ils trouvaient implant sur les rcifs de polypiers,
pour en fabriquer des ornements et des armes. Par un frottement
obstin au moyen d'une pierre enchsse dans une tige de bambou.
LES INSTRUMENTS ET LE MATERIEL 127
ils en vidaient le centre, ou ils en taillaient les artes. Des disques,
des bracelets, des instruments ayant le tranchant de la hache sont
sortis de ce patient travail. De plus, les grands rdeurs des mers
tropicales, squales, cachalots, ont contribu par leurs dents et leurs
artes hrisser les massues, lances et harpons, et renforcer d'ac-
cessoires aussi meurtriers que pittoresques l'arsenal sur lequel est
fonde l'existence de ces insulaires.
Une note fortement caractrise d'endmisme prvaut la faveur
du morcellement insulaire. Le matriel ethnographique, comme le
genre de vie, varient d'archipels en archipels. A ct de spcimens
perfectionns d'art nautique, on constate l'ignorance de la navigation.
C'est ainsi que l'archipel des les Matty, si voisin de la Nouvelle-
Guine, s'en distingue par l'absence de tout matriel naval. Les formes
de massues, quoique empruntes aux mmes matires, se diversifient
d'le en le. L'attirail et l'accoutrement guerrier se spcialisent. L'in-
sulaire des Salomon, avec son disque d'caill plaqu sur le front, son
arc en bois de cocotier et son bouclier de filaments vgtaux, repr-
sente un des types les plus originaux. Plus trange et plus formidable
est le guerrier des les Gilbert, arm d'une m.assue que hrissent des
dents de squales, et protg par une cuirasse de filaments de cocotiers
garnie de chevelures humaines, dont il s'enveloppe hermtiquement,
malgr le climat, et qui voque je ne sais quelle figure de samoura
ou de chevalier du moyen ge gare dans ces mers polynsiennes !
Parmi cette diversit de civilisations insulaires, s'talait enfin, aux
temps o ces socits taient encore intactes, l'aristocratique chef
maori, avec le casse-tte en serpentine ou en os de baleine suspendu
au poignet, et le manteau en Phormium tenax dans lequel se drapait
son importance. Dans cette lointaine Nouvelle-Zlande, terme extrme
vers le Sud des colonisations polynsiennes, comme dans l'archipel
des Hava, vers le Nord, ces civilisations insulaires avaient jet un
certain clat. L, comme Tonga, Samoa, Tahiti, se pratiquait la
construction de ces grandes pirogues qui firent l'admiration des Cook
et des Dumont d'Urville. Quand on songe que les artisans qui avaient
su accoupler ensemble de grandes pirogues, longues parfois de 30 mtres,
assez troitement relies pour manuvrer ensemble, n'avaient eu
pour accomplir cette difficile besogne d'autres matriaux, en dehors
du bois, que des filaments vgtaux et des gommes, ni d'autres ins-
truments que la coquille ou la pierre, cette admiration ne peut que
redoubler.
128 LES FORMES DE CIVILISATION
IV. LE MONDE DES SAVANES DCOUVERTES
Plus on s'loigne vers les Tropiques, plus la vgtation cesse d'tre
souveraine matresse. A la savane boise succde la savane herbeuse,
celle-ci la steppe. Avec l'amoindrissement de la vgtation dimi-
nuent les emprunts dont elle est l'objet. Mais la substitution d'une
faune de steppe la faune de fort donne lieu des combinaisons
nouvelles. C'est le rgne animal qui devient le guide de l'industrie
humaine. Par troupeaux, par hordes innombrables, antilopes, gazelles,
autruches, bisons, ovids, animaux coureurs adapts par leur pelage
ou leurs plumes de plus grandes diversits de milieux et de plus
grandes intempries de climat, s'offrent comme matires vivantes.
Le cuir dcoup en lanires, tendu en boucliers, assoupli en vtements
ou rcipients, remplit l'ofTice dvolu dans la zone tropicale humide
aux lianes, filaments, cylindres de bambou, corce vgtale. Le dve-
loppement de la vie pastorale en Afrique dans l'un et l'autre hmisphre
a accentu cette empreinte commune. Pasteurs et guerriers, les Mas-
sai et Gallas au Nord de l'Equateur, les Cafres et Zoulous au Sud,
s'accordent pour emprunter aux dpouilles d'animaux leur quipe-
ment et leurs ustensiles. Mais le got de chacun ou les circonstances
locales introduisent des variantes. Le bouclier oblong en peau de buf
prend chez les Zoulous, ces Spartiates de l'Afrique, des proportions
en rapport avec leur haute taille. Le guerrier matbl s'entoure d'une
ceinture o pendent des peaux de btes. Plus pacifique, le pasteur
hrro a consacr un soin particulier l'outillage transportable
qu'exige son genre de vie
;
il oppose un ample manteau de peau, le
karof, aux brusques variations de temprature. Chez les peuplades
guerrires de l'Est africain, l'difice de la chevelure ressemble une
crinire lonine que rehausse un encadrement de plumes d'autruche : et
la figure ainsi affuble des guerriers massai ou du Kavirondo ressuscite
nos yeux ces chasseurs berbres que reprsentent, au Nord du Sahara,
les gravures rupestres de la priode noUthique, ou les Libyens que nous
montrent les monuments gyptiens de la dix-neuvime dynastie.
Si infrieure que soit la faune des steppes du nouveau monde elle
ne fit pas dfaut l'industrie humaine : Dans l'Amrique du Sud le
guanaco fournit aux Tehuelchs de Patagonie le cuir ncessaire pour le
maniement de la bola, et, aprs l'introduction du cheval, pour le har-
nachement de leurs montures. Les Sioux dans l'Amrique du Nord
dressrent leurs tentes avec des peaux de bison, ou en firent la trame
de ces toffes sur lesquelles des figures peintes retraaient des signes
gnalogiques ou parlaient un langage symbolique.
LES INSTRUMENTS ET LE MATRIEL 129
Beaucoup de ces choses appartiennent au pass : une note d'ar-
chasme se mle ainsi la note d'exotisme. Nos yeux en Europe sont
accoutums associer ces diffrences tranches de costumes et d'affu-
blements des rgions exceptionnellement restes l'cart, vivant
de leur vie propre. Il s'en trouve encore de telles, bien que plus rares
chaque jour, dans nos montagnes d'Europe, autour de la Mditerrane,
et sporadiquement dans les Alpes et les Carpathes. Le ptre castillan,
le Palikare, le berger valaque, le Tirolien, l'Uzule des Tatras, sont des
exemplaires peu prs intacts de ces survivances dj partiellement
en pril de mort. Quelques pices de costume, le plus souvent, demeurent
les seuls indices des exigences locales des milieux. Aujourd'hui, comme
de temps immmorial, le Touareg, cavalier voil du dsert, protge
par le litham son visage et ses yeux contre la fine poussire qui flotte
dans l'air. Contre les ingalits du soir et du matin, du soleil et de
l'ombre, la chlamyde velue en peau de mouton, la mastruca sarde, le
capuchon du burnous protgent les paules et compltent l'image
toujours vivante de types connus, que figurent les terres-cuites antiques.
Sous diffrentes formes, avec ou sans broderies, on peut observer,
de l'Espagne l'Iran, l'existence d'une pice de vtement, la gutre
de feutre ou de cuir, rendue indispensable par les taillis et broussailles
qui encombrent le sol en l'absence de vritables forts.
V. SURVIVANCES ET DVELOPPEMENTS AUTONOMES
DANS LES ZONES TEMPRES ET FROIDES
L'empreinte locale est tenace. Elle subsiste dans nos contres
civilises sous les formes multiples des objets de premire ncessit
que continue fabriquer l'industrie domestique : les jarres, les vases
et poteries en Espagne, comme en Berbrie et en Egypte, s'y repro-
duisent tels encore qu'ils sortirent des mains des premiers potiers
qui pratiqurent l'art de faonner la matire argileuse. L'habilet
plier le bois aux formes et aux usages les plus varis trouva, dans
les forts feuilles caduques de l'Europe centrale et orientale, matire
s'exercer en sens diffrent : nous verrons le parti que l'art de la cons-
truction et celui du transport surent tirer de ces bois rsistants et
flexibles
;
mais, si l'on veut encore aujourd'hui se faire une ide de la
familiarit avec laquelle en usrent nos pres, on n'a qu' considrer
ce qui reste de leur mobilier dans quelques campagnes recules ; ou
mieux encore qu' voir combien d'applications les emploie l'industrie
domestique dans les gouvernements forestiers de Russie d'Europe.
Le bois, pour bien des choses,
y
tient lieu de mtal
;
le moujik est
Vidal-Lablache, Gographie humaine. 9
130 LES FORMES DE CIVILISATION
charpentier comme le fellah est potier. Les deltas du Tonkin et de
la Guyane amazonienne ne sont gure infrieurs cet gard au delta
du Nil.
L'isolement, la spcialisation des genres de vie sont, pour quelque
temps encore, des garanties de conservation. Dans les steppes de l'Asie
centrale, le matriel des pasteurs kirghiz, tentes de feutre, lanires
de cuir, cordes de laine, tapis et vtements, ustensiles, est entirement
emprunt au btail qui constitue la richesse
;
et il garde, malgr l'in-
vasion du coton et des importations trangres, ce caractre local qui,
chez nos montagnards, nous frappe comme un archasme.
Il existe, le long des fiords et des fleuves poissonneux qui sillonnent
dans le Nord-Ouest de l'Amrique la bande en partie vierge des forts
de la Colombie britannique, un groupe de tribus dites Nutkas qui
forment un chapitre curieux et unique d'ethnographie amricaine. L
se conserve un ensemble encore peu prs complet de civilisation
matrielle portant un haut degr l'empreinte d'un milieu spcial. Le
bois domine dans les constructions et les ustensiles. Dans ces maisons
de planches, que prcdent des piliers sculpts reprsentant des figures
totmiques, la poterie est inconnue, et c'est dans des vases de bois
qu'au moyen de pierres brlantes on procde la cuisson des aliments.
Cependant pour trouver des socits gardant plus strictement encore
l'empreinte locale, il faut pousser jusqu' ces peuples que la configu-
ration de l'hmisphre boral relgue autour des mers arctiques,
au del de la ceinture forestire qui entoure le Nord de l'ancien et du
nouveau monde. Il est vrai que ce qu'on appelle par antiphrase la civi-
lisation les assige, sous forme d'alcool, et les dcime. Ceux, toutefois,
qui, comme les Samoydes, ont pu s'accommoder du sjour de la
toundra, des steppes de l'Extrme-Nord, chappent plus que les chas-
seurs de fourrures au pril qui les guette. Ils trouvent dans l'levage
du renne et dans l'existence du bouleau-nain, seul arbrisseau qui se
hasarde jusqu'en ces parages, la matire des vtements dont ils se
couvrent, des peaux ou des corces dont ils revtent leurs tentes d't,
des rcipients dont ils font usage.
Plus spcialis dans un autre genre de milieu arctique est l'ensemble
des tribus Innuit ou Eskimaux, qui ont su se crer une patrie depuis
le nord de l'Alaska jusqu'au Groenland. L, ce n'est pas l'levage du
renne, ni la pche dans les fiords qui subviennent l'existence : mais
les grands mammifres marins, qu'il faut, l't, poursuivre au large,
ou, pendant l'hiver, surprendre dans les trous de glace o ils viennent
respirer. Pour subvenir au vtement, la nourriture, l'abri, l'ar-
mement, au transport, rien que les peaux, les dfenses ou les os, l'huile
LES INSTRUMENTS ET LE MATRIEL 131
de ces animaux ;
la neige pour
y
pratiquer des demeures hivernales
;
<et ce que les courants marins peuvent rejeter de bois flotts sur les
rivages 1 Ce que l'Eskimau est parvenu raliser avec ces moyens est
extraordinaire. Nul autre que ce spcialiste des rgions polaires am-
ricaines n'a pu s'accommoder de ce milieu : cet isolement a protg
son originalit. C'est avec un mlange de bois et de peaux de morses
ou de phoques qu'il fabrique ses embarcations, avec les dents ou d-
lenses de ces animaux qu'il arme ses harpons ;
il n'est pas jusqu' l'arc
dont jadis le bois tait remplac par un assemblage d'os articuls*
Dans l'excution technique et le fini artistique des objets varis
qu'exigeait leur genre de vie, les Eskimaux, dit Ratzel, ont ralis
de grandes choses )>. Ce qu'il
y
a chez eux de plus remarquable, aprs
le vtement qui est l'arme contre le climat, ce sont les instruments
4e locomotion : le traneau, que des attelages de chiens font glisser sur
la neige ou le tapis de mousse, et surtout le cayak, la longue et mince
barque couverte de cuir, dans l'orifice duquel s'introduit le pcheur
t qui est comme le prolongement de sa personne.
CONCLUSION
LES CIVILISATIONS STROTYPES
L'intrt qu'excitent de nos jours ces exemplaires de civilisations
autonomes se justifie. On
y
voit comment, spontanment, indpen-
damment les uns des autres, sur des points trs divers, ont pu s'orga-
niser des genres de vie. Forc de tirer parti des ressources fournies
par le milieu, ne pouvant faire dpendre sa vie de l'apport faible et
alatoire du commerce, l'homme a concentr son ingniosit sur un
nombre parfois trs restreint de matriaux, et a su les plier une
extraordinaire multiplicit de services. Tel a t le rle du bambou
ou du cocotier sous les tropiques, du dattier ou de l'agave dans les
contres arides, du bouleau dans les rgions subarctiques, du renne
dans le Nord de l'ancien monde, du phoque ou du morse dans le Nord
du nouveau
;
de telle sorte qu'on pourrait, l'exemple de certains
gographes botanistes, attribuer telle ou telle de ces espces vivantes
la valeur d'un type et en faire le signalement de certains domaines
de civilisation.
Mais, si intressantes que paraissent ces civilisations, par cela
mme qu'elles sont attaches des milieux spciaux, elles sont frap-
pes d'infirmit. Il leur manque le don de se communiquer et de se
rpandre. Toutefois, si leur dpendance envers le milieu local est une
infriorit, elle ne fait que mieux clater en certains cas la puissance
132 LES FORMES DE CIVILISATION
et la varit d'inventions dont l'homme est capable. Car il s'en faut
que ces civilisations autonomes, que nous sommes tents de traiter
de rudimentaires et primitives, soient toutes au mme niveau et se
montrent sur le mme plan. Le temps n'est plus o le Centre africain
nous apparaissait sous l'aspect d'une morne uniformit barbare
Il
y
a, ou il
y
a eu parmi ces socits des degrs divers
;
quelques-unes,
comme ces Mongbouttous qu'a dcrits Schweinfrth, taient parvenus
un assez haut degr d'volution, par comparaison avec d'autres
groupes. Entre les Eskimaux de l'Extrme-Nord de l'Amrique et
les Fugiens de l'Extrme-Sud, l'ingalit est un abme : tous ces peuples
pourtant ont eu se dbattre, livrs leurs propres ressources, contre
une nature plus ou moins inhospitalire. Le succs a t ingal comme
l'effort.
On remarque toutefois, travers la varit des matriaux fournis
par la nature, une ressemblance dans les procds d'adaptation mis
en uvre. Les instruments que l'homme a fabriqus pour l'attaque
ou la dfense, pour le transport, ou comme rcipients, ne s'cartent
pas sensiblement de certaines formes gnrales. Que ce soient la pierre.
For, la coquille ou le bois qui entrent dans leur composition, la hache,
la massue, l'arc, prsentent le mme ensemble. La pirogue creuse
dans un tronc, le canot d'corce, le cayak revtu de peaux, le grement
des voiles de nattes, de lin et de cuir comme chez les anciens Celtes,
diffrent plus par les matriaux que par les formes. Ce qui s'exprime
ainsi, c'est l'intention qui prside l'adaptation de la matire, c'est
l'lment inventif par lequel l'homme
y
imprime sa marque. Il
y
a
dans l'esprit humain assez d'unit pour qu'elle se manifeste par des-
effets peu prs semblables.
CHAPITRE III
IiES MOYENS DE NOURRITURE
Parmi les rapports qui rattachent l'homme un certain milieu,
i'un des plus tenaces est celui qui apparat en tudiant les moyens de
nourriture
;
le vtement, l'armement sont beaucoup plus sujets se
modifier sous Tinfluence du commerce que le rgime alimentaire par
lequel, empiriquement, suivant les climats o ils vivent, les diffrents
groupes subviennent aux ncessits de l'organisme. Il existe cet
effet une remarquable diversit de combinaisons : Bdouin ou Fellah
riverains de la Mditerrane, Europen du Centre ou du Nord, Chinois,
Japonais ou Eskimau, chacun a ralis, avec les lments fournis
par le milieu, accrus de ce qu'il a pu
y
joindre, un type de subsistance
qui est entr dsormais dans le temprament, s'est fortifi par les
habitudes. De tous les caractres par lesquels les hommes se distinguent
et se signalent entre eux, c'est celui qui frappe le plus les observateurs
primitifs, comme le prouvent ces noms d'ichthyophages, lotophages,
galadophages, que nous a lgus la nomenclature des anciens, les indi-
cations ethnographiques d'Hrodote sur les peuples de Scythie, ou la
mention d'anthropophages libralement rpandue sur les cartes du
xvi sicle. Encore aujourd'hui, dans notre Europe mme, on voit
persister, en domaines peu prs impntrables, les consommateurs
d'huile et de beurre, de pain de froment et de pain de seigle, malgr
les nivellements qu'oprent, en cela comme en toutes choses, les pro-
grs de la vie urbaine.
Ce n'est pas le cas de traiter ici la rpartition gographique des
moyens de nourriture en gnral
;
notre intention est de montrer
comment persistent sous cette forme certaines influences de milieu.
C'est donc dans les rgions o ces influences sont le plus battues en
brche, c'est--dire dans les rgions extra-tropicales, que nous pren-
drons nos exemples. Aussi bien, la division est naturelle, c'est celle
qui spare le domaine de la banane de celui o la vigne et le bl mrissent
134 LES FORMES DE CIVILISATION
convenablement leurs fruits, en de de 30 d'un ct ou de Tautre
de l'Equateur.
I.
TYPE MDITERRANEN
Le premier exemple qui s'offre est celui du bassin mditerranen
Il reprsente un type de climat bien marqu, dont les deux termes
principaux sont des ts secs et des hivers doux, raccords par des
saisons de transition plus ou moins humides. Puis, nulle part nous
ne pouvons suivre aussi loin dans le pass les traces d'habitudes
stables et de civilisations fixes. Dans les plus anciennes tombes
d'Egypte on trouve le bl, l'orge, la fve
;
sur les plus anciennes pein-
tures figurent le figuier, la vigne, l'oignon : c'est--dire l'ensemble
peu prs complet des plantes nourricires dont subsiste aujourd'hui
le fellah. Cela reprsente dj une longue laboration culturae, une
combinaison qui a group des plantes qui jadis croissaient et l
en des habitats plus ou moins distincts, qui les a fait passer de l'tat
de sauvageons celui de plantes perfectionnes, adoucies, assouplies
en varits diverses. L'Egypte a pu s'enrichir de cultures industrielles,
accueillir de nouvelles plantes venues surtout de Babylonie ou du
Soudan ; le menu de l'indigne n'a gure chang. C'est un vgtarien,,
en qui s'oppose le contraste, si nettement accus dans les pomes home
riques, avec le pasteur nourri de fromage de brebis ou^^de chvre et de
la chair de ses agneaux. Parmi les crales qui sont le fondement de
son rgime, l'orge a t longtemps la favorite
;
seme en novembre et
rcolte en mars ou avril, elle mrit plus tt que le bl et, chose pr-
cieuse dans ces terres d'irrigation, laisse plus longtemps la place libre
pour d'autres cultures. Mais l, comme tout autour de la Mditerrane,
le bl n'a pas tard la supplanter. Immdiatement sem aprs les
pluies d'automne, il profite du bref ralentissement caus par l'hiver
pour pousser dans le sol des radicelles profondes, s'y imprgne d'azote
et d'autres substances que plus tard la tige, en s'levant, transformera
au contact de l'air, jusqu'au jour o la turgescence favorise par les
dernires pluies de printemps aboutira, sous la chaude et sche influence
de Tt mditerranen, la formation de l'pi. Le cycle de la plante
se moule exactement sur celui des saisons
;
chaque tape de crois-
sance correspond un optimum de conditions propices. Ce bl dur des
pays mditerranens doit l'abondance du gluten ses qualits mi-
nemment nutritives, et demeure ainsi dans ces rgions l'aliment par
excellence : manger du pain, chez les Grecs modernes, est synanyme
de manger.
LES MOYENS DE NOURRITURE 135
Toute
l'antiquit classique distingue comme principaux mtiers de
la terre le labourage et la plantation, celui qui produit l'orge sacre
ou le bl, et l'habile jardinier qui, par la greffe ou la taille, perfec^
tionne les produits d'arbres ou arbustes dont les profondes racines
bravent la scheresse estivale.
L'art de Triptolme a pour complment, dans les ides anciennes,
celui que les habiles horticulteurs phniciens ont traditionnellement
transmis leurs successeurs actuels de Sfax ou de Kerkennah. Pour
comprendre l'importance alimentaire de ces cultures d'arbres, il faut
les associer celles qui se multiplient leur ombre : aux tapis d'orge,
fves ou bl, garnissant, sous le mince feuillage de l'olivier, les gradins
en terrasses ;
ces vignes courant en festons le long des branches de
frne en Kabylie, d'ormeaux ou d'rables en Italie; ce luxuriant
jardinage o prosprent sous les figuiers, pchers, ou autres arbres
fruit, les piments, salades, courges, melons et pastques, dont se
compose la table ouverte o se complat le Mditerranen. Il
y
trouve,
dans les brlants ts, ce qu'il faut pour tancher sa soif ou pour
stimuler son apptit engourdi.
Parmi ces arbres il en est un que la Bible nomme le roi de tous
;
et peut-tre ce titre dcern l'olivier surprendrait ceux qui n'ont pu
vrifier de visu le rle qu'il joue dans l'alimentation des peuples ber-
bres. L'huile d'olive dans l'Afrique du Nord et les rgions adjacentes
du Sud de la Mditerrane, est un objet de consommation bien plus que
d'exportation. L'arbre producteur, trs anciennement perfectionn
par la culture, et si bien adapt au climat mditerranen qu'aprs
plusieurs sicles de dure il persiste se renouveler, se propager par
rejetons, accumule lentement dans son fruit les substances grasses,
riches en carbone. Il ne s'coule pas moins de six mois entre l'poque
de la floraison, qui a lieu en avril, et celle de la maturation qui com-
mence en novembre. C'est la faveur de cette longue laboration que
se concentrent dans le fruit les sucs que, par ses longues racines, par
son feuillage prenne, l'olivier emprunte l'air et au sol. Il en rsulte
un produit de matires grasses, qui peut la rigueur tenir lieu de viande,
et qui la remplace en effet presque entirement dans l'alimentation
ordinaire du Berbre. Qui a vu la galette de froment frotte d'huile
consomme quotidiennement chez nos indignes d'Algrie, a pris sur
le fait un de ces types de rgime alimentaire depuis longtemps fixs,
qui se transmettent de sicle en sicle. Aux jours de fte sont rservs
le mouton, l'agneau pascal , et ces distributions de viande par tte
d'habitant mle, sont pratiques encore en pays berbre.
136 LES FORMES DE CIVILISATION
II. TYPE AMRICAIN. LE MAS
Comme l'arbre de Minerve, le mas, dans les climats chauds, mais
pluies de printemps prolonges dans la premire partie de l't, est
aussi un de ces vgtaux nourriciers que la reconnaissance des hommes
honore d'un culte. Quand les pluies d't ncessaires la prosprit
de la plante se font attendre, on voit encore les Indiens Pueblos qui
habitent dans le Colorado le pied des Montagnes Rocheuses, invoquer
par des processions, dont les participants balancent dans chaque main
un pi de mas, l'arrive du phnomne bienfaisant. De mme que le
bl s'associe notre civilisation classique, de mme le mas est ins-
parable du dveloppement de la civilisation amricaine. Quand les
Europens arrivrent en Amrique, ils trouvrent cette plante cultive
aussi bien sur les bords du Massachusets, que sur les plateaux du
Mexique et du Prou. Des grains ont t dcouverts plus tard dans
les mounds ou tumuli de la valle du Mississipi. Elle avait dj donn
lieu de nombreuses varits, assouplies des climats assez divers,
bien que ne dpassant gure au Nord le
45<^
de latitude. Aussi le mas,
pour les Amricains d'aujourd'hui comme pour ceux de jadis, est-il
le corn, la graine par excellence, comme le bl pour le Mditerranen.
Sur les hauts plateaux du Prou, il formait, avec la pomme de terre
et le quinoa, la base de la nourriture. Il s'associait au Mexique avec
des lgumineuses, telles que le frijol ou haricot noir, et il
y
trouve
ct de lui l'quivalent du vin de palmier dans le pulque, liqueur fer-
mente obtenue par incisions de la hampe florale du maguey ou agave,
une de ces plantes tout usage qui fournissent la fois boisson, nour-
riture et vtement.
Le mas a cess depuis longtemps d'tre une culture exclusivement
amricaine
;
mais c'est encore aux tats-Unis que se trouve le centre
de la production, environ 90
^
/o
de la rcolte mondiale
;
et l'on sait
quelle est, par l'levage de porcs auquel elle donne lieu, l'importance
qu'il occupe dans l'conomie rurale de la grande Rpublique.
Le mas est donc, au mme titre que le bl, le riz, la vigne, le th,
pour ne citer que les principales plantes qu'a adoptes l'alimenta-
tion humaine,
un de ces objets de transmission qui ont servi de
vhicules la civilisation gnrale. C'est en Amrique, peut-tre chez
les Chibchas de Colomme, que sa culture a pris naissance
;
et de l
elle s'est rpandue dans l'Europe mridionale, en Afrique et jusque
dans le Nord de la Chine. Comme ceux aui recueillirent le bl parmi
les touffes de crales sauvages des valles de l'Asie occidentale, ou
LES MOYENS DE NOURRITURE
137
ceux qui prirent l'initiative de cultiver le riz dans les flaques aban-
donnes par les crues priodiques de fleuves de l'Asie des moussons,
la reconnaissance doit aller ces indignes d'Amrique qui surent
choisir, prserver et diversifier par la culture une plante que ses graines
lourdes et peu transportables eussent probablement expose une
prompte disparition. Ce n'est pas un mdiocre legs de ces civilisations
dites primitives, que le don de cette culture nourricire qui a pris,
partout o elle s'est tablie, une remarquable signification sociale.
La rapidit de sa croissance contribua peut-tre entretenir chez les
indignes des habitudes peu fixes. Mais elle aida la colonisation de
l'Amrique
;
car, facile cultiver la main et sans charrue, prompt
porter des graines qui l'tat laiteux, au bout de sept huit semaines,
sont dj comestibles, le mas fut, sous forme de graines, de farine,
ou de grains grills, le viatique des explorateurs et des pionniers, ainsi
que plus tard la providence du petit fermier auquel, par sa croissance
rapide, il paya les frais de premier tablissement. Introduit dans notre
Europe, il laissa place entre ses tiges espaces des cultures subsi-
diaires de courges, haricots, tomates, tournesols, et facilita presque
partout, depuis l'Aquitaine jusqu' la Brianza lombarde et l'Oltnie
valaque, l'existence du petit propritaire vivant de son propre travail
sur sa terre. Infrieur au bl en gluten, mais riche en carbonates
hydrats propres l'engraissement et en glucose, la farine de mas entra
sous des noms divers (tortillay polenta, mamaliga) dans l'alimentation
quotidienne des classes rurales d'une partie de l'Europe mridionale.
III. TYPE EUROPEN CENTRAL
Fondamental en Amrique, le mas, en Europe, n'a fait que s'ajouter
une table dj richement servie. Depuis longtemps, s'affirme la
distinction entre les consommateurs mridionaux d'huile et de pur
froment, et les populations qui leur sont contigus au nord du domaine
mditerranen.
Qu'il
y
et dans cette moyenne Europe celtique et
danubienne,
qui s'tend au nord du
45 degr de latitude, une varit
de moyens de nourriture fonde sur certaines pratiques d'conomie
rurale, c'est ce que l'archologie, dfaut de l'histoire, laisse appa-
ratre. On entrevoit, ds les vi et v sicles avant Jsus-Christ, aux
lueurs des civilisations de la Tne et de Hallstatt, aux dbris des sta-
tions
lacustres, une srie de domaines nourriciers, formant il est vrai
plutt des provinces autonomes qu'un ensemble, mais participant
l'envi aux faveurs d'un climat ensoleill, qui laisse largement la
vgtation six mois au moins de temprature et de pluies propices.
138 LES FORMES DE CIVILISATION
Le sol s'y partageait naturellement entre espaces dcouverts dont les
arbres ne sont pas exclus, et forts o dominent les arbres feuilles
caduques. C'est dans ce cadre que se sont fixs les groupements et les
habitudes des populations rurales.
Les tmoignages anciens, ceux de Polybe, Strabon, Pline, d'Hro-
dote mme sont unanimes sur l'abondance nourricire et le nombre
des populations
;
ce n'est pas d'hier que la multitude des peuples
tablis au cur de l'Europe est un objet d'tonnement et un peu de
crainte pour les Mditerranens. Mais en mme temps des diffrences
se manifestent avec les contres de civilisation plus ancienne. On dis-
cerne un tat conomique moins unifi, plus imprgn de localisme
que celui des riverains de la Mditerrane. Chacun de ces peuples,
Gaulois, Germains, Illyriens, Daces, Thraces, Sarmates, a ses habi-
tudes propres d'alimentation et de boisson : diverses sortes de mils,
surtout chez les Slaves et dans l'Est de l'Europe, le seigle ou l'peautre
chez les Germains, le mil et le seigle ct du bl chez les Lacustres
de l'Europe centrale
;
comme boissons drives, ici la cervoise, la bire
de froment, l'hydromel, peut-tre dj la tsuica valaque, liqueur de
prunes. Certaines cultures spciales, comme l'peautre, ont encore
conserv un reste d'existence dans quelques cantons de Suisse alle-
mande ou de Souabe ;
mais quoique le bl et la vigne, avec leur
escorte d'arbres fruitiers originaires d'Orient, aient presque entire-
ment prvalu, les habitudes nourricires contractes dans cette partie
centrale de l'Europe, aprs avoir t jadis modifies dans une certaine
mesure par la conqute de Rome, ne cdent que lentement de nos
jours celles que propage autour d'elle la vie urbaine.
Les conditions de climat et de sol qui ont favoris ce remarquable
dveloppement se trouvent runies en Europe entre 45 et 55 environ
de latitude : de l'Aquitaine au Nord de l'Angleterre, de la Lombardie
au Sud de la Scandinavie, de la pninsule balkanique la rgion de
Moscou. Plus au Sud une fcheuse restriction est oppose par la sche-
resse des ts et la pnurie de terre vgtale
;
plus au Nord c'est la
frquence des geles et la brivet de la saison chaude, qui abrgent
et compromettent les cultures. Mais dans l'intervalle un assez vaste
domaine s'ouvre des possibilits que l'homme a largement mises
profit.
Le mot de paysage de parc qu'on applique parfois la physio-
nomie de cette partie de l'Europe rpond plutt un tat primitif
qu' une ralit prsent
;
car entre les cultures et les arbres dont nos
exigences alimentaires ont fait lection, un classement s'est tabli,
des groupements plus ou moins systmatiques ont remplac le libre
LES MOYENS DE NOURRITURE 139^
enchevtrement
des espces. La fort, quand elle n'a pas disparu,
s'est retranche sur de certains sols, de certains niveaux
;
et tandis que les cultures de crales revendiquaient des champs ou
espaces libres, c'est suivant des dispositions spciales que se sont ordon-
nes les nombreuses espces d'arbres que l'homme a admis concourir
son alimentation. La plupart se sont rallis porte des groupements
humains, comme des favoris qu'on aime voir : c'est ainsi que, sui-
vant les terrains et les lieux, le chtaignier, le noyer, pour ne citer que
les plus rpandus, sont les compagnons fidles des maisons rurales
ou des villages. Plus d'ailleurs on s'avance vers le Nord, plus il convient
de tenir compte de l'orientation, des ncessits de l'obliquit crois-
sante des rayons solaires : aussi voit-on s'tager sur les pentes favo-
rises tantt ces chtaigneraies en gradins qui couvraient les flancs
du Vivarais, tantt les pruniers qui, de l'Aquitaine la pninsule
balkanique, parsment les flancs des collines le mieux abrites. A ct
des champs qui s'talent, ces arbres et lgumes cultivs en jardins,
rassembls en vergers ou courtils autour des habitations, reprsentent
une des deux faces, et non la' moindre, de la physionomie nourricire
que l'homme, aidant la nature, a imprime ces contres. Si la chtaigne
ne joue plus aujourd'hui dans l'alimentation humaine le mme rle
que lorsqu'elle supplait en hiver l'insuffisance des provisions de
crales, on voit encore, la densit de populations qui correspond
la chtaigneraie, la preuve de l'attraction qu'elle a exerce sur les
hommes.[Le'noyer, outre son fruit, fournit son huile la consommation
journalire. La rcolte du prunier offre en Serbie et dans l'Oltnie
valaque'l'image de joie qui s'associe nos vendanges.
On pourrait s'tonner, puisque la fort s'oppose aux cultures, de
l'importance qui lui est accorde dans les proccupations des hommes
d'autrefois, de la frquente rptition, dans les chartes ou contrats
ruraux, de clauses qui la concernent. De toutes les raisons qu'on
pourrait allguer ce propos, besoin de combustible, de matriaux
ou simplement de chasse, la principale est sans contredit son utilit
pour l'levage. Il n'est pas rare qu'on aperoive, dans des espaces
aujourd'hui compltement dboiss, un chne isol que le hasard,
quelque superstition peut-tre, ont prserv. Ce patriarche est le plus
souvent le dernier tmoin qui subsiste de ce bois ou de ces boqueteaux,
qu'ont maintenant remplacs les cultures, mais qui jadis tenaient
prs d'elle leur rle. Quand on feuillette, dit un forestier allemand,
Gradmann, les collections de chartes du haut moyen ge, on ne trouve
presque jamais le nom du bois, sans que celui du porc n'y soit men-
tionn. Mme chose chez nous, o la glande est si frquemment
149 LES FORMES DE CIVILISATION
l'objet de transactions et clauses spciales. Les nombreuses varits
de chnes feuilles caduques, et subsidiairement les arbres fagnes
comme le htre, sans parler du chtaignier, taient regards comme
nourriciers, comme indispensables lments d'conomie rurale, par
opposition aux espces qui n'ont pour elles que leur beaut esthtique
ou leur rle trop mconnu d'agents naturels. Une ide d'utilit pratique
et quotidienne s'y attachait.
.,
Avant que l'introduction du mas, et plus tard celle des cultures
industrielles eussent facilit et tendu encore l'levage du porc, cet
animal prolifique fut une des ressources qui assuraient l'existence
humaine : cela n'a pas chang. Il grouille dans les rues des villages,
il cohabite avec le paysan, son engraissement est un objet de tendres
proccupations, son sacrifice fait date dans le calendrier rural. Avec
sa chair et ses reliefs de toutes sortes, dment manipuls et conservs,
se compose pour l'anne le menu presque exclusif d'alimentation
carne. Et les choses ne se passent pas autrement que lorsque les jam-
bons de Gaule faisaient figure auprs de la gastronomie romaine, ou
que les textes anciens nous parlaient d'innombrables troupeaux de
porcs vagabondant dans la Pannonie glandifre .
IV.
TYPE EUROPEN SEPTENTRIONAL
Tout ce faisceau de cultures nourricires se dnoue mesure que le
chne fait place aux essences aciculaires, la terre-noire aux sols pauvres
en humus, et que la vgtation des plantes annuelles cesse de disposer
de Quatre ou cinq mois de hautes tempratures : le porc dsormais fait
dfaut l'levage, le mas et le bl d'hiver aux crales; avec eux dis-
paraissent nombre d'arbres fruitiers, et surtout le cortge de lgumi-
neuses varies, fves, lentilles, haricots, pois, qui contribuent pour une
si forte part l'alimentation des peuples d'Europe : invasion venue
du Sud qui expire vers Moscou.
Il semblerait donc qu'au Nord du 55^ de latitude, l'conomie rurale
n'et qu' enregistrer un appauvrissement successif. Mais c'est alors
qu'au Nord-Ouest, et jusqu'assez avant dans le Nord, les avantages du
climat ocanique entrent en jeu. Certains vgtaux tels que le chou,
les raves ou navets racines charnues, probablement indignes dans
l'Europe occidentale, ont tenu de bonne heure leur place dans le rgime
alimentaire des peuples celtes et germaniques. Avec le seigle, crale
rustique, et l'orge, qui entre toutes les crales se contente du cycle
le plus court, ces plantes ont pourvoir la nourriture vgtale des
hommes, en attendant les ressources subsidiaires qui sont venues
LES MOYENS DE NOURRITURE 141
s'y ajouter par la suite. Ce sont ces graines qui, avec l'avoine, ont con-
tribu fixer, trs loin vers le Nord, des populations agricoles. Les
trouvailles archologiques en donnent la preuve. On discerne distinc-
tement ces spcimens d'ancienne agriculture dans l'empreinte qu'ils
ont laisse sur la pte encore molle de poteries qui ne datent pas de
moins que de l'poque nolithique.
Ces vents d'Ouest qui, par la Manche, la Mer du Nord et la Baltique,
prolongent jusqu'au Nord du lac Ladoga les influences ocaniques,
compensent la faiblesse de l'insolation et la brivet des ts par une
douceur relative de temprature qui restreint les risques de geles,
et qui surtout engendre une humidit favorable l'herbe. Dans la
rapide croissance des prs, le dveloppement des parties tendres des
ajoncs et autres plantes de l'Ouest, la vache laitire de proportions
modestes trouve des conditions aussi propices que le porc dans les
pays graines, que le mouton dans la zone mi-pastorale et mi-agricole
qui borde les contres arides. Cette facilit trouver sa subsistance
en a fait une proprit accessible aux plus pauvres, comme la chvre
en d'autres pays. Par l a commenc de se gnraliser en Europe l'usage
alimentaire du lait, auquel les grands peuples agriculteurs de l'Extrme-
Orient sont obstinment rests rfractaires. Une crale longtemps
ddaigne par les peuples du Midi, l'avoine, a d aux mmes circons-
tances de climat sa fortune. Sans avoir une maturit aussi rapide que
l'orge, elle dispose nanmoins jusque dans l'intrieur de la Scandinavie
d'une dure suffisante entre les geles de printemps et d'automne.
C'est elle qui, dans la zone des herbages, devient de plus en plus la
crale favorite
;
soit qu'elle fournisse l'homme une nourriture
combine avec le laitage, le porridge cher aux cossais
;
soit qu'elle
serve l'engraissement du btail bovin, hte naturel de cette zone de
cultures. Enfin, ce type de genres de vie, dj constitu dans le Nord-
Ouest de l'Europe, s'est enrichi d'un auxiliaire inattendu avec une
plante venue du Prou, la pomme de terre. Moins borne dans ses
exigences que l'avoine, ayant aussi des prfrences pour un rgime
doux et pluvieux, elle a fourni un appoint de premier ordre aux besoins
nouveaux ns de la civilisation contemporaine.
Il fallait en effet une srie d'acquisitions supplmentaires pour
assurer l'existence de populations dont les rangs n'ont cess de s'paissir
depuis un sicle et demi environ. L o l'insuffisance des chaleurs
d't s'opposait au rendement des crales, comme en Irlande ou dans
les Grass Couniies d'Angleterre, l galement o les tourbires et mar-
cages laisss par les anciens glaciers durent tre coloniss comme en
Scandinavie et dans le Nord de l'Allemagne, de nouveaux groupes
142 LES FORMES DE CIVILISATION
d'habitants se sont forms et ont grossi. Nulle part, en ces deux der-
niers sicles, l'Europe n'a vu un plus rapide accroissement de popula-
tion. Il a concid, comme effet et cause, avec le dveloppement de la
grande industrie et des agglomrations urbaines. C'est justement au
seuil de cette zone, entre 50 et 55 de latitude, que s'chelonnent
les principaux bassins houillers o l'emploi de la force mcanique de
la vapeur a localis les principaux foyers industriels du monde. Une
norme demande de moyens de nourriture a t le rsultat de cette
rvolution dmographique. Non seulement les produits du monde
entier ont t attirs vers les ports d'approvisionnement, mais une
impulsion extraordinaire a t donne sur place aux cultures que favo-
risait le climat et que rclamaient les exigences des habitants. Par
exemple, la pomme de terre servit au xviii sicle la colonisation
d'une partie de la Prusse
;
elle rend possible aujourd'hui l'existence
de petits groupes de cultivateurs au seuil des rgions arctiques.
On peut donc suivre de nos jours une volution qui se propage dans
l'Europe septentrionale, et de l se communique d'autres contres
en vertu de certaines analogies de conditions gnrales. Ce fut jadis
la faveur des changements conomiques qui suivirent la conqute
romaine, que le bl, la vigne et d'autres cultures du Sud acquirent
une expansion nouvelle qui les porta jusqu' leurs extrmes limites
au Nord. Le christianisme, son tour, contribua les reculer
; la vigne
gagna encore vers le Nord un terrain qu'elle n'a pu conserver, et ce
n'est qu' la fm du xii^ sicle que la culture du bl atteignit la Norvge.
De mme, nous assistons aujourd'hui l'extension d'un type de nourri-
ture qui a des origines lointaines, mais dont le dveloppement est
rcent. Dans ce rgime, la pomme de terre, comme les cultures pro-
pices l'levage, la viande de buf et les produits de fabrication
laitire jouent un rle capital. Les statistiques attestent ce mouvement.
En Finlande, tandis que, dans ces dernires annes, une sensible dimi-
nution s'est manifeste dans les vieilles cultures d'orge et de seigle,
on constate l'augmentation notable de la pomme de terre et de l'avoine.
Danemark, Sude mridionale, Finlande, Nerlande deviennent pro-
ducteurs et exportateurs de plus en plus actifs de beurre et fromage,
comme la Sibrie occidentale, le Canada et peut-tre demain le Sud
du Chili. Car la consommation de ces produits s'accrot sans cesse,
non seulement dans les contres o ils constituent une culture naturelle,
mais partout o va se multipliant et s'accroissant la vie urbaine
;
la production du lait et le dveloppement des villes apparaissent
comme deux faits synchroniques et connexes. Des causes gogra-
phiques et sociales se combinent ainsi dans un rsultat commun.
LES MOYENS DE NOURRITURE 143
V.
TYPES ASIATIQUES
Le Riz.
L'Asie des moussons, de l'Inde orientale la Chine, a
aussi cr ses types d'alimentation. A la faveur des pluies d't, de
l'impulsion puissante qu'elles impriment la vgtation, se dve-
loppe tout un groupe de plantes nourricires, capables de parcourir
en quelques mois leur cycle et de parvenir simultanment maturit.
C'est dans ce groupe que le peuplement humain, si prcoce dans cette
partie du globe, a trouv les lments de systmes rguliers de subsis-
tance. Il
y
a parmi elles une crale particulirement dsigne par
la clrit de sa croissance et par sa valeur nutritive sans gale sur un
espace restreint : recueilli peut-tre l'tat sauvage dans les cavits
lacustres (jhils) que laissent aprs elles les crues priodiques des
grands fleuves de l'Inde, le riz est devenu la plante de culture par
excellence. C'est d'elle que s'est empare l'industrie humaine, pour
en multiplier un degr incroyable les varits, pour en tirer, par une
srie d'oprations rclamant un emploi minutieux de main-d'uvre,
le bnfice de plusieurs rcoltes annuelles. L'amnagement des eaux
dans les cadres disposs pour les recevoir, le degr d'immersion de la
plante, la transplantation et le repiquage la main de chaque brin,
sans parler des manipulations qui suivent la moisson (grenage, dcor-
ticage, etc.), exigent des hommes tout le concours d'attentions, de soins,
d'expriences lentement amasses, de collaboration familiale ou
sociale, dont ils sont capables.
Ce n'est donc pas assez de dire que le riz est pour des centaines de
millions d'hommes la base de nourriture
;
c'est aussi, dans les rgions
o cette culture s'est implante comme prpondrante, un symbole
de civilisation. Le contraste est frappant, sous ce rapport, entre les
peuples hindous, malais et chinois, chez lesquels s'est implant le
travail mthodique, et les peuples tropicaux mlansiens ou papous,
auxquels la moelle farineuse du palmier-sago ou l'arbre pain four-
nissent, moins de frais, une nourriture lmentaire qui leur suffit.
Type chinois,
Quelle que soit la contre o la culture du riz ait
pris naissance, elle a conquis, dans la direction trace par les mous-
sons asiatiques, une zone si tendue que le tribut qu'elle fournit
l'alimentation s'accrot d'une grande varit de supplments suivant
les contres. Il s'associe dans l'Inde du Nord diverses espces de mils
aux noms trs anciens (jowarU bajri, ragi) et certaines crales
ou lgumineuses fournies, grce la douceur de l'hiver, par la rcolte
144 LES FORMES DE CIVILISATION
du printemps qui prcde les premires semailles de riz. Le poisson
d'eau douce, dans les deltas, les basses valles, les terres successive-
ment noyes et dcouvertes, s'ajoute comme moyen de nourriture,
le mme compartiment devenant tour tour vivier et rizire. Comme
ailleurs le faucon a t utilis pour la chasse, l'ingnieux Chinois a su,
par des procds appropris, utiliser les services du cormoran pour la
pche. Le canard, volatile naturel de ces rgions amphibies, lui fournit,
avec le porc, le seul supplment de nourriture carne qui s'ajoute
son ordinaire
;
car il ignore l'levage et il laisse aux montagnards
et aux barbares des steppes la nourriture lacte. La mer est, pour les
populations des provinces maritimes du Sud, Canton et Fo kien, une
grande pourvoyeuse de ces produits divers qui sont pour nous la prin-
cipale originalit de la cuisine chinoise. Mais le Chinois est loin d'tre
au mme degr que le Japonais un ichthyophage. C'est son sol
fcond et minutieusement amend qu'il emprunte le principal de sa
subsistance. Aussi excellent maracher que mdiocre arboriculteur,
il use avec avidit des vgtaux, cleris, navets ou chalotes qu'obtient
son travail la bche. Mais toutefois, dans ce climat qui ne tarde pas
en s'avanant au Nord, avoir ses rigueurs, le besoin d'une nourriture
plus substantielle que le riz se fait sentir
; le riz, d'ailleurs, cesse au
Nord du
32 degr de latitude, d'tre la culture principale. Le suppl-
ment ncessaire est emprunt diverses espces de doliques ou hari-
cots auxquels se prte merveilleusement le Nord de la Chine et qui, de
temps immmorial, sont entrs dans l'alimentation populaire. Le soja
mrite, entre autres plantes dj signales au mme titre, la reconnais-
sance de l'humanit. Sa graine joint ses qualits nutritives des pro-
prits olagineuses qui permettent d'en tirer des prparations ana-
logues l'huile et au beurre, et d'en composer un fromage vgtt
(teou-fou) qui fournit un aliment transportable et qui est, parmi ces.
populations si denses, une ressource particulirement apprcie du
bas peuple.
Type japonais.
Parmi les emprunts que le Japon a faits la
Chine, le riz et le th sont peut-tre ceux qui ont le plus pntr dans
les habitudes, affect le fond mme de la civilisation. Leur introduc-
tion parat relativement rcente. C'est vers le commencement de l're
chrtienne que furent entrepris, sous l'impulsion d'un empereur nova-
teur, les travaux d'irrigation et les amnagements ncessaires la
diffusion de la culture du riz. Quant la culture et l'usage du th,
ils paraissent contemporains de l'introduction du bouddhisme entre
le ix^etle xii sicles. C'est comme signes de civilisation suprieure^
LES MOYENS DE NOURRITURE
145
et dans le cortge des acquisitions successives qui en grossirent le
patrimoine, que le riz et le th vinrent s'adjoindre aux habitudes
traditionnelles. Le climat, du moins jusque vers la partie septentrio-
nale de la grande le Hondo, imbib de pluie, baign de soleil, rali-
sait les conditions idales, et plus encore le soin mticuleux, la vigi-
lance attentive et l'amour que le Japonais consacre toutes les choses
du sol. Ce raffinement de civilisation a donc gagn de proche en proche
;
il a t adopt dans ce monde japonais plus compltement sans doute
que ne le seront jamais les moyens de nourriture qu'on essaie d'im-
porter aujourd'hui d'Europe ou d'Amrique. Malgr tout cependant,
il garde le caractre d'une chose de luxe. Le riz, du moins dans le Nord,
est un aliment rserv aux riches ou aux malades. Le th, par le cr-
monial qui accompagne son usage, par l'aspect artistique des rcipients
qui lui sont consacrs, est un de ces lments qui font partie de l'tiquette
protocolaire par laquelle se distingue le Japonais de bon ton. Mais,
sous ces produits d'adoption, subsistent les habitudes d'alimentation
populaire, trs anciennement enracines. Les forts, qui jadis for-
maient limites entre les principauts ou cantons, fournissaient un
abondant gibier, et laissaient entre elles des clairires, o des cultures
de mils et de lgumes subvenaient l'alimentation locale. C'est surtout
sur place, et part dans chacun des compartiments naturels qui
divisent la contre, que s'obtenaient les moyens de nourriture. Toute-
fois une ressource gnrale provenait des rivages poissonneux qui
bordent les mers japonaises. Les espces foisonnent au contact des
courants qui s'y rencontrent : harengs par multitudes immenses,
sardines, maquereaux, sans oublier les squales qui figurent en masses
dans l'alimentation japonaise. Il n'y a pas d'autre exemple d'un
grand peuple tirant de la mer le principal de sa nourriture. Ses pche-
ries sont aujourd'hui parmi les plus importantes du monde
; on peut
prsumer qu'elles furent la raison de la densit prcoce des habitants
de cet archipel. On valuait rcemment 2.310.000 le nombre de per-
sonnes vivant directement ou indirectement de la pche ctire.
La forme troite et allonge de cet archipel entrecoup rend partout
ais le transport du poisson frais
;
c'est ainsi qu'il n'est point de ville
ou village l'intrieur o ces produits de la mer ne se consomment
quotidiennement, sous toutes les formes, cuits ou mme crus, assai-
sonns en ce cas et dcoups en tranches
;
poissons ou mme requins
remplissent le rle des animaux de boucherie sur nos marchs !
On peut inculquer ces peuples nos industries
;
mais persuader
Chinois et Japonais de se nourrir l'europenne est peut-tre au-
dessus des forces du commerce. Il
y
a des habitudes rfractaires,
ViDAL-LliBLACHE, Gographie humaine. 10
146 LES FORMES DE CIVILISATION
congnitales au climat, enracines dans les tempraments, contre
lesquelles le temps ne peut rien. Tandis que l'exploitation pastorale
de nos Alpes a dvelopp dans l'air pur et sain des hautes rgions
rlevage et les habitudes alimentaires qui en drivent, le Chinois,^
cart des montagnes par les miasmes et les fivres qu'y engendre
le climat des moussons* s'est acharn tirer des plaines et des pentes
de collines les lments de sa nourriture. Tandis que les ts secs
de l'Asie occidentale, concentrant la saveur du fruit, ont incit les
habitants perfectionner les cultures d'arbres fruitiers, cet art dlicat
est rest tranger aux peuples d'Extrme-Orient
;
et le Japonais lui-
mme, cet artiste en jardins, ce peintre de branches fleuries, ne s'y
est point essay. Au lieu du grain de raisin, graduellement gonfl,
puis lentement labor par nos beaux automnes, c'est la feuille de
l'arbre th, dont les gnrations se succdant de cueillette en cueil-
lette travers la saison des pluies, fournissent l'arme d'un breuvage
devenu, l'gal du vin et du caf, un de ces stimulants dont l'homme
se fait un besoin et qu'il propage par le commerce.
VI.
PROPAGATION DES TYPES DE CULTURE
La civilisation s'est empare de ces cultures favorites
; elle en a
tendu au del de toutes prvisions le domaine primitif. Elle a su
tirer de la plante originelle une foule de varits adaptes divers
genres de climats
;
de sorte qu'il est arriv souvent que son importance
est plus grande dans les contres o elle a t acclimate que dans son
pays d'origine. Ce n'est pas aujourd'hui dans les rgions o la culture
du froment a pris naissance qu'elle est la plus productive
;
les mois^
sons des pays mditerranens ne sont pas comparer avec celles que
produisent les plaines centrales de l'Europe. C'est dans les prairies
du Centre-Ouest des tats-Unis, et non plus sur les plateaux tropi-
caux que le mas grossit le plus largement ses pis. On peut dire de
mme que ce n'est pas dans les basses contres deltaques que s'est
dvelopp l'art d'amnager les eaux en vue du maximum de produc-
tion des rizires/ Il
y
a en Chine une rgion reste cet gard classique.
Au dbouch 'des montagnes qui encadrent au Nord la plaine de
Tcheng-tou dans la province des Quatre-Rivires (Sz-tchouan)^
subsiste un temple que la reconnaissance des peuples a lev l'ing-
nieur qui a su pratiquer et codifier l'art de matriser et manier les puis-
santes masses d'eau du Min. Un systme de barrages et d'appareils
dmontables, accommod aux crues priodiques, adapt aux pentes^
assez puissant et assez souple la fois pour diviser l'eau en rigoles.
LES MOYENS DE NOURRITURE 147
et la distribuer en gradins : telle est l'uvre minutieuse qui, probable-
ment accomplie vers le m sicle avant notre re, transforma de
vastes grves de sables et de cailloux en une des plus fertiles et des
plus populeuses plaines du monde. Les rizires de la plaine de Tcheng-
tou-fou passent pour produire, surface gale, une fois et demie la
quantit de graines obtenue dans les autres provinces
^,
La culture du th, elle aussi, est fille du milieu chinois. Cette plante
qui, dans les hautes valles de l'Assam d'o elle est originaire, prsente
le feuillage luxuriant et les proportions d'un arbre, n'a acquis qu'en
diminuant la hauteur de son ft, en rtrcissant la surface de ses
feuilles, l'arme dlicat qui rend clbres jusque dans le Nord de la
Chine les jardins de th du Yunnan. C'est de l, et sous forme arbustive,
que cette culture s'est propage l'Est et au Nord, finalement jus-
qu'au Japon. L'art du cultivateur a consist raliser, dans un milieu
nouveau, les meilleures conditions de croissance : par le drainage, les
amendements, le sarclage, la taille pratique au moment propice,
c'est--dire un peu avant l'arrive des pluies et l'lan de la sve,
il a su transformer et affiner la sauvagerie du produit naturel. De mme
que la vigne, en passant des forts de la Colchide aux contres sches
de la Mditerrane, la plante sud-tropicale du Manipour n'a pris que
dans les rgions tempres de la Chine les proportions et les qualits
qui la distinguent.
Le rle de ces plantes d'lection, devenues pour des millions d'hommes
une base de nourriture ou un besoin physiologique, a maintes fois
attir l'attention des gographes. Le th, le caf ont fourni Karl
Ritter le sujet d'importants chapitres de VErdkunde. A l'intrt
des conditions sociales lies leur culture, s'ajoute celui du vaste
commerce dont elles font l'objet. Ces plantes ont une histoire qui se
mle celle des hommes. Ce sont des plantes de civilisation. Dans
l'extension qu'elles ont acquise s'exprime l'influence de l'homme
sur l'conomie de la vie terrestre. Chaque espce aspire d'elle-mme
s'tendre hors de son centre d'origine
;
mais son expansion, quand
elle ne s'appuie que sur ses propres moyens, rencontre bientt des
limites. Ces limites reculent au contraire par l'intervention de l'homme.
Sans doute, le th, la vigne, le mas, le bl, etc., restent assujettis
des conditions immuables dans leur gnralit et le plus souvent)
incompatibles
;
mais, pour leur culture comme pour la plupart des
phnomnes auxquels prend part l'intelligence de l'homme, une marge
1. Archibald Little, The Far-East,
p.
81 sq. et La Mission lyonnaise en Chine
(Lyon,
1898), t. I,
p. 175 sq.
148 LES FORMES DE CIVILISATION
assez ample se dessine entre une aire minima et une aire maxima
d'expansion. Ce qu'il
y
a de ressources et de varits dans le fond
mystrieux des forces cratrices, se dgage, se consolide et s'amplifie
par les soins vigilants de l'homme : la nature agit sous sa conduite.
Chose non moins remarquable : l'art qui a t ncessaire pour adapter
la plante utile un milieu nouveau, s'emploie aussi la perfectionner.
Il arrive ainsi que ce n'est pas toujours dans son lieu d'origine, mais
dans son lieu de transplantation qu'elle obtient Voptimum voulu
et recherch par l'homme. La plante elle-mme s'imprgne du traite-
ment dont elle est l'objet. L'homme cisle et ptrit la matire brute
;
il communique la pierre et aux mtaux les formes plastiques qui lui
conviennent ;
mais l'gard des espces vivantes, surtout quand il
s'agit de ces plantes annuelles plus sensibles et plus soumises son
attention vigilante, il fait plus. Chaque moment de leur volution
lui offre prise. Pntrant, pour ainsi dire, dans l'intimit de leur tre,
s'identifiant en elles, il parvient modifier dans une certaine mesure
les oprations successives de leur cycle d'existence.
CHAPITRE IV
LES MATRIAUX DE CONSTRUCTION
L'homme a fait son nid, ds qu'il a senti la ncessit de se fixer,
avec les matriaux qu'il avait sous la main. Il a subi l'influence de
ces matriaux. C'est surtout ce sujet qu'il est vrai de dire que la
matire dicte la forme. Des raisons de climat et de sol ont dtermin,
suivant les contres, l'emploi prpondrant du bois, de la terre ou de
la pierre. Mais, leur tour, ces matriaux guident la main de l'homme.
Ayant chacun leurs exigences et pour ainsi dire leur gnie, ils impriment
aux tablissements humains leurs particularits de formes, de dimen-
sions, de rsistance. D'o rsultent des types gnraux qui entrent
dans le signalement caractristique des contres.
Le bois, partout o il s'offrait en abondance, fut et reste le matriel
prfr pour les maisons et les difices. Ne fournissait-il pas spontan-
ment les poutres et des lments essentiels de charpente ? Leur agence-
ment et leur superposition taient indiqus par la matire mme
;
ils s'expriment dans les piliers qui supportent l'difice, les angles en
saillie qui en dessinent les cts, les toits qui en rehaussent et accen-
tuent le sommet, les auvents ou galeries qui en garnissent les bords.
L'architecture tropicale, si l'on peut donner ce nom aux constructions
rectangulaires qui se rpartissent de l'Afrique centrale la Malaisie,
s'harmonise ainsi avec la vgtation et le paysage. Plus tard un style
artistique se dgagea de ces lments, grce la civilisation sino-
japonaise. L'architecte dans ces rgions est un charpentier, un adapta-
teur et un sculpteur de pices de bois, plutt qu'un robuste manieur
de blocs de pierres. Le [Japon surtout, si riche en conifres, cdres-
hinoki et cryptomrias, qui doivent leur contenu rsineux une consis-
tance incorruptible, partage avec la Grce, bien qu'en un genre tout
oppos, le privilge du plus saisissant exemple d'harmonie entre
l'difice et le milieu qui l'encadre. Parmi les arbres verts qui l'envi-
ronnent, le temple japonais shinto est, dans son antique simplicit,
150 LES FORMES DE CIVILISATION
une construction en bois de cdre aussi harmonique avec ce qui l'en-
toure que le promontoire rocheux de Sunium avec les colonnes qui
lui ont valu son nom. La maison japonaise ordinaire ressemble une
cage de bois lgrement pose sur le sol ;
la sobrit du mobilier rpond
celle de l'difice.
I.
LA TERRE DANS LA ZONE ARIDE
Mais le climat de la grande zone sche qui se prolonge en diagonale
du Soudan l'Inde n'est pas propice au bois. Il envie l'homme le
plus commode et le plus familier des matriaux dont il ait gnralis
l'emploi. L'abtardissement graduel de la vgtation arborescente
ne tarde pas, ds qu'on s'loigne d'une douzaine de degrs de l'quateur,
se rendre sensible. La paillote cylindrique foisonne, rgne bientt
sans partage. La vgtation buissonneuse, prcieuse il est vrai pour la
dfense, fournit aux pasteurs ou chasseurs d'esclaves les branchages
pineux et les inextricables fourrs dont se hrissent les enceintes
circulaires des Zribas, comme aujourd'hui les haies de cactus de notre
Algrie. Mais elles se prtent mal la construction. L'arbre n'y est
plus reprsent que par des sujets rabougris et rachitiques, capables
tout au plus de mettre au service du constructeur des perches plus ou
moins tordues, parfaitement impuissantes supporter le poids d'un
grand difice.
A dfaut du bois, un autre genre de matriaux s'offre souhait
dans la zone sche. La terre argileuse, ptrissable, susceptible d'ab-
sorber dans sa pte des ingrdients qui la consolident, sche au soleil
ou cuite au feu, est la matire de maniement facile qui se prte de
multiples usages. Sous les doigts du potier, elle a commenc par re-
produire certaines formes de rcipients vgtaux, couffins, calebasses,
que la nature cessait de fournir. On peut remarquer que la poterie,
devenue un art quasi-universel en Guyane comme au Prou, en Chine
comme en Grce, n'a t nglige que dans quelques les d'Ocanie
o la vgtation elle-mme se chargeait d'y pourvoir. Dans la construc-
tion, le rgne de la terre s*est gnralis sous forme de brique : unie au
fer, celle-ci tend aujourd'hui supplanter toute autre matire
;
elle
rpond au besoin tout moderne d'improviser, de faire vite, qu'il
s'agisse de simili-palais ou d'usines. Mais si l'on remonte aux origines,
on doit reconnatre que ce n'est pas dans les contres o elle svit
aujourd'hui, qu'est ne l'architecture de briques
;
mais dans les rgions
sches de l'ancien monde. Les grands palais chaldens et assyriens,
et mme ceux qui leur ont succd dans l'Asie occidentale et l'Iran
LES MATRIAUX DE CONSTRUCTION
151
jusqu' l'poque d'Alexandre, taient des constructions presque enti-
rement composes d'argile. C'est dans les rgions de scheresse per-
mettant l'emploi de briques crues qu'elle a maintenu sa prpondrance.
Elle rgne encore sous cette forme primitive et presque dpourvue
d'apprts depuis le Maroc jusqu' la Perse, en dpit des pluies d'hiver
qui parfois risquent de liqufier ces murs de terre. Au mobilier de ces
maisons, la terre ne fournit pas seulement les vases contenir et
rafrachir les liquides, mais des objets pour lesquels son emploi semble
paradoxal : il
y
a dans l'Iran comme en Nubie des meubles en argile,
<ies coffres en terre sche. L'homme de ces contres est terrien au sens
le plus absolu du mot : terrien par l'habitat, soit qu'il difie sur le
sol, soit qu'il s'y niche.
C'est en Afrique qu'on peut le mieux suivre, avec l'appauvrissement
graduel de la vgtation, l'emploi de plus en plus exclusif de la terre
pour les constructions. Chez les Chillouks du Haut-Nil le toit seul
et l'enceinte sont en paille, la case cylindrique est en terre. On signale
dj dans l 'arrire-pays du Togo, d'amples ouvrages de fortifications,
dont les tours en terre battue, relies par des courtines de mme
matire, n'ont que leur toit conique fait de feuilles ou de paille. Plus
loin, vers 14 de latitude, la ville soudanaise de Zinder a une enceinte
en terre, enfermant dans ses rues tortueuses des maisons en touba,
ou briques sches au soleil. Enfin dans le Soudan saharien, l'emploi
de la terre et du pis l'emporte dcidment : remparts, maisons, gre-
niers, tatas, ou forteresses en sont construits
; de sorte que la gnrali-
sation de ce mode de btir marche de pair avec la scheresse. C'est
lui qui est presque exclusivement employ dans les oasis sahariennes.
Dans le Maroc mridional, la matire de construction est la tabia,
variante de la mme matire, c'est--dire une terre grasse foule et
mlange avec de la paille hache et de petites pierres. La substitution
de la terrasse ou de la coupole surbaisse au toit et l'emploi exclusif
de la terre sont deux faits caractristiques qui se tiennent. Avec le toit
sur lequel glisse la pluie, disparat l'chafaudage de matire vgtale
qui lui servait de support.
Nulle matire ne se prte plus aisment fournir l'homme des
moyens lmentaires d'tablissement, nulle n'a t plus tt utilise
dans les contres o le climat se prtait son emploi. On n'avait,
suivant les cas, qu' creuser pour obtenir des parois toutes faites,
ou se baisser pour en recueillir les lments. Les sables durcis et
'Ciments par les infiltrations, le sol alluvial et compact de l'Egypte
t de la Msopotamie, les terres argileuses des plateaux armniens,
de l'Iran, et mme dans l'Europe et l'Asie centrale jusqu'au Nord de
152 LES FORMES DE CIVILISATION
la Chine, les vastes nappes de ces sols steppiens, imprgns de concr-
tions calcaires connues sous le nom de lss, ont t ainsi, sous une
forme ou une autre, utiliss par les tablissements humains.
En Espagne, l'habitat dans la terre est pratiqu Guadix, province
de Grenade. Chez les Matmata du Sud tunisien, l'habitat se compose
d'une cour rectangulaire taille dans le sable et flanque de rduits.
Ailleurs, c'est dans les parois pic qu'est pratique l'excavation.
Tout le monde connat, depuis Richthofen, ces villages nichs comme
des alvoles sur les parois perpendiculaires de lss dans les provinces
du Nord de la Chine. Tout un rseau de sentiers taills dans la terre
relient ces habitations. D'autres fois, le village se tapit assez profon-
dment pour qu'on ne le devine qu' la cime des arbres qui le signalent.
Si au contraire la construction se dresse sur le sol, elle s'improvise
peu de frais
; et il est facile d'en lever une autre, s'il
y
a lieu, la
place de la prcdente. Il serait vain d'essayer de tirer parti des mottes
de boue qui ont dj servi et ne se prtent plus aucun usage. La maison
est donc abandonne aussi facilement qu'elle est construite
;
elle n'a
gure plus de permanence que la tente du pasteur. Mais elle persiste
peu prs la mme place
;
car elle est retenue par les occupations
agricoles. Tous les recensements faits en ces dernires annes en Egypte,
s'accordent pour accuser, en mme temps qu'un fourmillement de
cases parses, la multitude extraordinaire des cases abandonnes.
Elles subsistent, dlaisses, sans qu'on ait pris la peine d'en utiliser
les matriaux, jusqu' ce que le tassement des dbris les ait rendues
informes et mconnaissables. Cette facilit de remplacement est un
fait de climat qui n'a pas t sans influence sociale aux premiers temps
de l'occupation humaine en ces contres alluviales. Le sol
y
fournissait
alors un moyen aussi facile qu'conomique de multiplier ces demeures
sur place, de s'y mnager des sjours temporaires suivant les saisons
et les crues du fleuve, de substituer une installation saine la place
contamine par un trop long sjour : autant de raisons qui ont d
contribuer favoriser en ces lieux la formation de groupes si denses.
N'oublions pas que l'implantation durable d'une forte densit de
population est une uvre de longue haleine, qui suppose le concours
de bien des causes diverses. Une de ces causes a t, sans nul doute,
l'emploi gnral d'un matriel que le soleil se charge de cuire et que
la scheresse du climat permet d'utiliser presque sans apprt.
La terre, la brique crue ont t des matriaux conomiques que
rhomme a largement utiliss, mme hors des climats qui en favorisent
l'emploi. En Moravie et en Alsace mme, aux temps prhistoriques,
LES MATRIAUX DE CONSTRUCTION 153
comme de nos jours en Bulgarie danubienne ou en Dobroudja, le lss
a servi d'habitat. On est moins surpris de constater l'emploi combin
du pis et du roseau dans les palissades construites par les Chinois
en Asie centrale. Mais il manque ce mode de construction ce qui
donne essentiellement aux tablissements humains leur signification
gographique : la dure. Des villages et mme des villes, dans les con-
tres sches de Chalde, de Susiane, du Sestan et de l'Asie centrale,
ont emprunt exclusivement l'argile et aux briques crues leurs mat-
riaux : des amoncellements informes avec des dbris de poteries en
sont les seuls indices. Le nom arabe de Tell, si rpandu en Babylonie,
signale dans ces plaines alluviales des monticules qui ne sont autre
chose que des restes d'tablissements humains. Les boulements de
ces murs, qui s'effritent faute de pierres en garantissant les saillies,
forment l'obstacle contre lequel les innombrables particules sableuses
qu'entranent les vents arides se dposent. Elles s'amoncellent bientt
en telles quantits que le tout finit par se confondre en une masse qui
prend naturellement la forme d'une accumulation de matires meubles.
L'uvre de l'homme a cd ; la nature a repris possession du sol.
Des cadavres anonymes de villes dormaient ainsi sous un linceul de
poussire, quand Xnophon parcourait avec les Dix-Mille les plaines
de Msopotamie.
Notons en passant que cet tat de dgradation n'est pas lui-mme
une preuve certaine d'anciennet recule
;
car les agents physiques
conspirent sous ce climat avec l'inconsistance des matriaux pour
anantir promptement toute forme vive et accentue. Il ne faut pas
non plus se laisser illusionner par le nombre de ces tmoins qui peuplent
aujourd'hui, dans les plaines de Chalde ou du Sstan par exemple,
les espaces presque rduits l'tat de solitude. Sans nier les effets
d'une dcadence qu'expliquent suffisamment les causes historiques,
les tablissements ont pu, suivant les hasards de guerres ou d'obstruc-
tions de canaux, dprir et se reformer en successions si rapides que les
calculs de populations qu'on fonderait sur leur existence simultane
seraient trs probablement entachs d'erreurs.
Quand ce n'est pas par miettement, c'est par boulement que
prissent les difices de terre. L'eau est leur principal artisan de des-
truction. Les murs des villages persans tombent en liqufaction sous
les pluies d'hiver. Trop rapprochs des fleuves inondation, Garonne,
Loire, Rhne, Rhin, les murs en pis et cailloux s'croulent : la pierre
seule a permis le contact des fleuves. Plus incorruptible que le bois
et moins expose aux incendies, plus apte que la brique fixer les formes
et fournir des supports, la pierre garantit toute la dure compatible
154 LES FORMES DE CIVILISATION
avec les uvres de Thomme. Si l'on compare les pays de la pierre,
soit autour de la Mditerrane, soit sur les plateaux d'Amrique,
soit dans l'Inde du Nord, ceux o la terre et la brique ont rgn en
matresses, on est frapp d'un singulier contraste : les pyramides de
la quatrime dynastie se dressent presque aussi intactes que lorsque
les blocs en furent extraits des carrires du Mokattan
;
on cherche en
vain en Chalde les traces de nombreuses villes mentionnes par les
textes
;
on a de la peine situer en Mongolie la place de Karakoroum.
De rares tmoins des pistes qui
y
sillonnaient l'Asie centrale subsistent
sous forme de tours de pierre dont parlait Ptolme
; et c'est tout au
plus si quelques palissades de roseaux et de boue rvlent
et l
l'archologue et au gographe les vestiges de ces voies commerciales
ou militaires qu'avait russi tablir d'un bout l'autre du continent
la domination chinoise. Voyez au contraire le rseau des voies romaines
presque entier sur le sol o il s'est incrust. Ne serait-il pas impossible
de se faire une ide exacte des vieilles civilisations amricaines si l'on
n'avait que le tmoignage des mounds ou tumuli en terre qui sont
dissmins dans la valle du Mississipi ? Une mesure de ces civilisations
nous est fournie au contraire par les vastes constructions pyramidales
et les difices gradins qui frapprent d'tonnement les Espagnols
chez les Mayas du Yucatan (Palenqui) ou chez les Quitchuas du Prou
(Tyahuanaco prs du lac Titicaca), ou encore par les vestiges de la
route pave qui, la faon des voies romaines, reliait Cuzco Quito
sur les plateaux du Prou. La prsence et l'usage de la pierre calcaire
ou volcanique ont permis ces peuples. Mayas, Aymaras, Quitchuas,
etc., d'imprimer sur le sol une trace indlbile qui a empch leur nom
de prir.
II.
LA PIERRE DANS LA RGION MDITERRANENNE
L'clat de certains matriaux minraux a fascin le regard et tent
e travail de l'homme. Il s*est attaqu aux matires les plus dures,
ft-ce mme avec les instruments les plus imparfaits, pour peu que
leur poli et leur brillant eussent le don de sduire ses yeux. Le silex
n'a pas t seulement pour les hommes des anciens ges une arme
taille pour les besoins de la cause, mais une matire, dont l'industrie
palolitliique, en Sude par exemple, a su tirer des formes ciseles de
haches et de poignards, qui passent pour des merveilles d'excution.
Le jade dans le Turkestan oriental, l'agathe, le jaspe, la serpentine
et le cristal de roche au Japon et en Chine, le diamant dans l'Inde,
l'obsidienne au Mexique et au Prou, ont t patiemment travaills
LES MATRIAUX DE CONSTRUCTION
t55
t sculpts avec amour. Les trsors portatifs des anciens Japonais
(magatama) taient de vritables crins de ces pierres tailles. Le
granit et le porphyre des sarcophages pharaoniques gardent, aprs
quatre mille ans, leurs moulures intactes et un poli qui est une caresse
pour l'il. Le basalte a fourni au plus vieil art chalden, ainsi qu'
celui de l'Egypte, une indestructible matire de statues. Les uvres
d'art ont t des manifestations de luxe, et des voies de commerce
ont t traces pour s'en procurer la matire. Par l peut-tre l'homme
a t conduit la recherche des mtaux : l'or en ppites tincelantes
ne fut-il pas le premier mtal exploit ?
Mais, pour le gographe, la signification de la pierre consiste surtout
dans l'emploi qu'en font les constructions humaines. Le granit qui
s'caille sous le pic ou le marteau, le schiste qui se dcoupe en dalles
trouvent leur emploi, mais la pierre de construction par excellence
est celle qui se laisse tailler par le ciseau, dcouper en pans rguliers,
appareiller, et qui se prte ainsi aux diverses combinaisons de formes
qu'imagine et cre l'art de l'architecte. Les calcaires et, un moindre
titre, les grs, ont pu ainsi fournir des thmes varis de dveloppements
artistiques. Un rapport s'tablit entre la roche et les monuments.
Les calcaires du Yucatan sont insparables des constructions mayas,
de mme que les grs qui bordent au Sud la valle du Gange voquent
l'image des villes monumentales qui se succdent de Delhi Bnars
;
comme les grs vosgiens celle des cathdrales et des chteaux de la
valle rhnane. C'est dans les grs que sont entailles les nombreuses
gravures rupestres du Sahara algrien, o se montrent les anciennes
aptitudes artistiques de la "race berbre
;
le grs a conserv aux di-
fices de Ptra l'tonnante intgrit de leurs moulures et de leurs orne
ments. Les villages fortifis des Pueblos, dans le Colorado et le Nouveau-
Mexique, sont gnralement construits en grs extraits du lieu mme.
Si immdiat est ce rapport entre la roche et l'difice que plus d'une
fois, de mme qu'aux Baux en Provence, rocs et maisons se confondent
dans une blancheur aveuglante.
Nulle part l'architecture de la pierre n'a dispos d'un plus beau
domaine et n'en a mieux tir parti qu'autour de la Mditerrane.
Tandis qu'au Nord, les chanes de plissements tauro-dinariques courent
en bordure du bassin oriental, les plateaux de Palestine et d'Arabie
ptre, de Lybie et de Cyrnaque lui font face au Sud. A l'Apennin
succdent bientt les chanes et plateaux de Provence, tandis que les
montagnes des Balares se continuent au Sud de l'Espagne jusqu'
l'Atlas. Ainsi l'encadrement est presque complet. Partout, si ce n'est
lorsque les alluvions deltaques ont amass des couches puissantes
156 LES FORMES DE CIVILISATION
d*humus, la roche affleure, peine saupoudre de terre rouge
; la pierre
blanche, sans cesse renaissante et renouvele par la base, couvre de ses
clats la surface. Elle a l'air de crotre la faon de l'herbe. Cette roche,
gnralement aise travailler dans les carrires ou latomies, a la
proprit de durcir ensuite l'air libre, de conserver indfiniment sous
le ciseau de l'ouvrier, dans les moulures des angles ou la cannelure des
colonnes, toute la vivacit de ses artes. Lorsque au voisinage des
massifs archens, en Attique et dans les Cyclades, Carrare et dans les
Pyrnes, le mtamorphisme a agi sur la roche, elle acquiert une texture
cristalline et marmorenne. Le calcaire d'ailleurs se prte la fabrica-
tion du ciment ;
si bien que plus d'un prcieux dbris d'difice antique
a trouv dans le four chaux l'humble consommation de sa destine.
L'clat du soleil et la patine du temps revt ces marbres grecs ou ita-
liens ou les travertins d'eau douce de la Campagne romaine d'une chaude
coloration, qui ajoute ainsi l'effet du climat celui du sol.
Il faut aussi faire la part d'autres matriaux rocheux qu'a largement
mis contribution le travail de l'homme
;
et notamment de ceux qu'a
fournis, sous forme de laves, de dalles, de pperin, le volcanisme actif
de la Mditerrane. Ce qui toutefois domine et a imprim sa physio-
nomie indlbile au paysage mditerranen, c'est la pierre calcaire,
que bien rarement la vgtation couvre d'un tapis assez pais pour
l'empcher de paratre nu.
Il ne manque pas autour de la Mditerrane de bois durs et rsis-
tants, capables de fournir de bons matriaux de construction. Dans les
difices gyptiens, comme dans les burgs d'poque mycnienne ou dans
les plus anciens temples grecs, le bois est employ comme soutien
pour maintenir les murs. Que mme la construction exclusive en bois
ait t jadis pratique pour certains difices, c'est ce que semblent
bien indiquer certains monuments spulcraux de l'Asie Mineure
;
le
classique temple grec colonnes et frontons n'est pas sans en offrir
des rminiscences. Mais la pierre a supplant le bois.
L'emploi de cette pierre a pris, autour de la Mditerrane, tant de
formes familires, elle rpond de si multiples besoins de dfense,
d'abri, de conservation, qu'elle s'associe minutieusement aux occupa-
tions et aux habitudes. Elle fournit les matriaux des murs en gradins
qui retiennent et amassent la terre sur les pentes ; et ainsi s'est gn-
ralis, en mme temps que les plantations d'arbres fruitiers, l'usage
des cultures en terrasses qui sculptent, pour ainsi dire, jusqu' 500 ou
600 mtres les flancs des montagnes. Assembler les blocs, en superposer
les assises, en ajuster les angles rentrants et saillants de faon former
des murs pais et rsistants, est un art essentiellement mditerranen.
LES MATRIAUX DE CONSTRUCTION 157
dont on peut observer encore Tyrinthe et Norba les vnrables
origines. L'appareillage de la pierre
y
va de pair avec les cultures
tages d'arbres fruitiers et de jardinage. Aux cltures pineuses des
rgions subtropicales se substituent au Maroc des enceintes de pierre
(dechenas), englobant les silos bord cylindrique et panses largies,
qui sont entaills mme dans le sous-sol. Rservoirs grains ou citernes
cimentes sont des amnagements pratiqus aussi bien en Syrie et en
Palestine que dans l'Afrique du Nord, et dans les temps bibliques
comme de nos jours. La roche, soit par les cavits pratiques dans
ses flancs, soit par les matriaux extraits de ses carrires, ou mme
pars la surface du sol, s'est prte aussi familirement aux usages
de la vie domestique, s'y est assouplie de mille manires, comme c'est
le cas pour le bois et les matires vgtales dans les rgions forestires
voisines de l'Equateur ou du cercle polaire.
On est amen par l considrer la rgion mditerranenne comme
la patrie de l'art de la pierre d'o, aprs avoir enfant sur place des
types varis, il a rayonn en dehors. L'acropole hellnique, Voppidum
italiote, le hordj arabe, la casbah berbre ont un air de famille
; elles
procdent des mmes matriaux, affectent sur les cimes rocheuses les
mmes positions dominantes. On voit sur les ctes de Ligurie ou de
Provence leurs murs croulants poss en nids d'aigles pour surveiller
au loin l'horizon. Les constructions de type mycnien, qui faisaient
l'effet d'antiquits aux Grecs des temps classiques, ne sont pas sans
analogie avec ces enceintes fortifies d'autrefois que l'on dsigne du
nom de nouraghes en Sardaigne mridionale, de talayots dans les
Balares
;
elles rpondaient sans doute aux mmes besoins de dfense.
Toute la vie antique de la Mditerrane a trouv son expression dans
la pierre. La vieille Apulie, comme le pays de Chanaan, en portent
encore l'empreinte. Des constructions cyHndriques, s 'amincissant
vers le haut en une srie superpose de gradins, dsignes sous le nom
de trullU parsment les Murgie de la terre de Bari et d'Otrante. Elles
se reproduisent sous forme plus lmentaire et plus primitive dans les
constructions de hasard leves sur les flancs de l'Apennin central,
sur le Karst dalmate et jusque sur les ctes du Sud de la France.
Parmi tous ces pays, l'Italie est jamais marque de l'effigie de la
grandeur romaine. Dans un ordre plus humble, ne reste-t-elle pas le
foyer d'mission d'o les mtiers de la pierre et du marbre se rpan-
dirent dans toute l'Europe ?
Nous n'avons pas ici analyser les formes riches et diverses qu'a su,
de ces linaments primitifs, dgager l'art de l'architecte : de ces mat-
riaux assembls, il a difi pyramides et pylnes, colonnes et portiques.
158 LES FORMES DE CIVILISATION
cintres et coupoles, toute cette floraison merveilleuse qu'ont exprime
tour tour Tart gyptien, l'art hellnique, celui de Rome et de Byzance.
Ce n'est pas une leon d'art que nous cherchons dans les monuments
ou les ruines qu'il a laisss sur le sol, mais un exemple de ce que peut
la dure sur les tablissements humains, et par eux sur l'histoire.
Thucydide, dans un passage souvent cit, remarque que si Athnes
et Sparte tombaient en ruines, celui qui ignorerait leur histoire serait
tent, la vue des monuments couvrant le sol, de s'exagrer l'impor-
tance de l'une et de rabattre celle de l'autre. Ce qu'il dit d'Athnes
serait encore plus vrai de Syracuse, construite sur des rochers cal-
caires, percs par les clbres Latomies, qui lui prtent une grandeur
presque sans exemple. Sur ces mamelons rocheux qui se succdent
de VAchradina aux Epipol, la petite le qui fut le berceau de la
cit, le regard embrasse un dveloppement successif dont les tapes
sont jamais graves dans la pierre. Ce genre de pass ne se laisse pas
abolir.
L'abondance et la beaut des matriaux ont favoris sur ces terres
classiques une closion de monuments telle que, mme l'tat de
ruines, elles reprsentent un des enchanements les plus continus
que permette la brivet de l'histoire humaine. La colline des Jbu-
sens devenue Jrusalem, l'Acropole de Ccrops devenue Athnes,
la Roma quadrata du Palatin, sont les noyaux de dveloppements
qui, travers bien des vicissitudes, ont persist aux lieux mmes.
Le cycle par lequel, sur un emplacement donn, la primitive enceinte
mure, le vieil oppidum ont t transforms en une ville qui, elle-
mme, a pu s'panouir en un foyer de civilisation, en une uvre d'art
avec ses temples, ses portiques, ses thtres taills dans le roc, est la
leon qui sort du sol mme. Tout cela prend la forme et l'indestructi-
bilit de la pierre. L'avantage d'hygine et de beaut que, dans nos
climats de l'Europe centrale ou des tats-Unis, la ville moderne
cherche se mnager par des parcs intercals entre les btisses, des
morceaux de forts enchsss parmi ses rues, la cit de pierre et de
marbre des bords de la Mditerrane le demande l'ombre frache
de ses portiques, aux dalles de marbre de ses difices ouverts l'air
libre. Elle aime, comme ses hritires d'aujourd'hui, les sites domi-
nants que vient rafrachir certaines heures la brise de la mer voisine,
les hauteurs que n'atteignent pas les miasmes, les cimes battues par
les vents sals.
Lorsque la vie puissante qui a palpit entre ces difices de pierre
vient diminuer ou s'teindre, les ruines permettent encore d'en
saisir l'ensemble. Le mot par lequel les anciens auteurs croyaient
LES MATRIAUX DE CONSTRUCTION 159^
exprimer le comble de Tanantissement : etiam perere ruinse, n'a
pas de sens ici. La force vivace de cette civilisation mditerranenne
tient en partie cette continuit qui en matrialise l'histoire, qui
en perptue les traditions par le commentaire perptuel des monu-
ments et des ruines. La plupart des villes mditerranennes qu'a
connues l'antiquit se sont enracines au point de continuer leur
existence : les unes sans interruption comme Marseille, d'autres avec
des clipses. Du moins, quand leurs destines historiques ont t rem-
plies, une sorte de vie latente a survcu sur place la vie panouie.
L'attachement au site persiste grce aux matriaux assembls, et
leurs dpens. Salone dtruite revit dans Spalato. Des villages se nichent
dans les ruines d'Antioche ou d'phse. Les catastrophes historiques
qui ruinent les villes ne russissent pas extirper des lieux o elles
avaient pris racine les germes d'tablissements humains. Ceux-ci
persistent sous des formes plus modestes, taille rduite, comme il
arrive aux arbrisseaux du sous-bois de succder la fort dtruite.
Cette association de l'ide de dure avec la construction de pierre
est profondment ancre dans l'esprit humain. On voit en Asie Mineure
dans les contres calcaires de Carie et de Lycie beaucoup de monu-
ments funraires d'poque hellnique, sur lesquels on lit ces mots :
oUo^ aubvio.
L'expression de maison ternelle applique la
tombe se justifie par la dure qu'elle emprunte au roc dans lequel
elle est taille, ou la pierre avec laquelle elle est construite. Dans
les monuments spulcraux d'Egypte ou de Mauritanie, l'orgueilleuse
revendication d'ternit cherche s'affirmer par la mise en uvre
colossale de blocs dont l'accumulation dfie le temps. Ds que l'homme
a prtendu communiquer son existence ou sa mmoire un surcrot
de dure, tendre sa personnalit au del des bornes que sa courte
vie lui refuse, c'est la pierre qu'il a eu recours.
III.
LE BOIS ET LA PIERRE
DANS L'EUROPE CENTRALE ET OCCIDENTALE
C'est de l'archologie
que de parler, d'aprs Strabon, des maisons
cylindriques que les Gaulois construisaient en poutres et en claies
d'osier et qu'ils recouvraient
d'un toit de chaume. Mme tablis au
Sud des Alpes ils
y
avaient transport les habitudes contractes dans
les rgions forestires de l'Europe centrale.
Le bois remplaait pour bien des choses la poterie et la cramique
mditerranennes
;
les Gaulois cisalpins opposrent leurs futailles en
chne hautes comme des maisons aux jares et amphores de leurs
100 LES FORMES DE CIVILISATION
voisins d'Italie
;
de mme qu'aujourd'hui les bahuts et les armoires
de chne de nos campagnards excitent la surprise de maints trangers.
Le rgne du bois comme matriel de construction a t plus gnral
et a persist plus longtemps dans l'Europe centrale que dans la rgion
mditerranenne. Les maisons gauloises que dpeint Strabon res-
semblent aux huttes cylindriques que figurent, sous la torche des
lgionnaires, les reliefs de la colonne Trajane. Les Daces ne connais-
saient pas d'autres masures. Quant aux Germains, dit Tacite, ignorant
le ciment et la brique, ils usent d'assemblages informes de matires,
materia ad omnia utuntur informi . Il n'est pas interdit de deviner,
sous le vague de ces expressions, l'enfance d'un art de construction
qui tait destin prendre de plus en plus d'importance. Ces grossiers
btisseurs avaient recours cet assemblage de torchis et de bois,
qui s'est perptu en se perfectionnant et se diversifiant, notamment
dans une grande partie de la France du Nord et de l'Allemagne.
Le bois usit comme charpente, avant de l'tre comme ornement,
servit maintenir, contre les intempries de climats moins tolrants
que ceux des rgions sches, les fragiles parois de lss ou de limon
que fournissait le sol. Une combinaison originale est ne de l'union
de ces deux matires diffrentes, l'une doue de rsistance au feu,
l'autre servant garantir contre les pluies la solidit de l'ensemble.
L'lgante et riche Normandie, la Picardie voisine, ont tir de bons
effets de ces combinaisons : sur un soubassement emprunt aux silex
de la craie, les poutres entrecroises tracent sur l'assise en pis des
dessins gomtriques. Ce type de construction, tel que les Allemands
le dsignent sous le nom de Fachwerk, a engendr ailleurs de nom-
breuses variantes qu'on peut suivre travers les maisons rurales ou
villageoises d'Alsace, de Souabe et de Franconie, Toute une Europe
plus forestire jadis qu'aujourd'hui revit et se dpeint dans ce dvelop-
pement pittoresque d'un art de construction dont les informes dbuts
ne pouvaient qu'exciter le ddain des Mditerranens, habitus ds
lors aux difices de pierre et de marbre.
Parmi les applications multiples auxquelles les essences varies
de nos arbres feuilles caduques ont donn lieu,
mobilier, usten-
siles agricoles, charronnerie, vannerie, etc.,
il faut donc compter
au premier rang leur rle comme pices de charpentes dans les cons-
tructions. Ce n'est pas seulement la maison de paysan qu'a consolide
une armature de chne
; lorsque l'art de nos contres, dans la France
du Nord, se haussa jusqu' ces difices de pierre dpassant par leurs
dimensions le temple grec et la basilique romaine, d'immenses char-
pentes de chne ou de chtaignier fournirent une partie de l'ossature
LES MATRIAUX DE CONSTRUCTION 161
intrieure des cathdrales ou des halles qui se dressrent de Chartres
Ypres. Des forts aussi bien que des carrires de pierres ont pass
dans ces constructions.
Ce serait forcer la vrit que de chercher dans la physionomie actuelle
de l'Europe, des classements rgionaux fonds sur les matriaux de
construction. On peut opposer la rigueur, comme le fait Solovief,
en se bornant aux traits gnraux si distincts encore en Russie, une
Europe du bois qui est celle du Nord une Europe de la pierre qui serait
celle de l'Ouest et du Sud.
Dans cette Europe de l'Ouest, les diversits du sol ont, ds l'origine,
introduit dans les matriaux et par suite dans les modes de construc-
tion, des diversits que le temps n'a fait qu'accrotre. Les mouve-
ments de peuples sont intervenus pour transplanter d'autres habitudes
;
car l'homme se transporte volontiers avec sa coquille ; il cherche par-
tout accommoder sa demeure suivant ses occupations et ses propres
gots. L'Anglo-Saxon, comme l'Espagnol, ont transport en Amrique
chacun ses modes favoris de construction et ses dispositions familires
d'habitat. On distingue parfois cte cte des diversits voulues.
C'est ainsi que, dans l'Europe centrale, on a pu, avec un peu d'arbi-
traire, classer les types de construction rurale d'aprs les tribus d'occu-
pants germaniques, qui s'y taillrent, entre les Slaves et les peuples
de civilisation romane, leur domaine propre.
On s'exposerait de frquentes erreurs en faisant de la nature du
sol la rgle exclusive des types de construction. Cela mme est moins
vrai que jamais aujourd'hui, par suite des facilits de transports
et de fabrication industrielle. Si de toutes parts, dans les campagnes
comme dans les villes, la brique et le fer, fabriqus en masse et bon
compte, tendent remplacer tous les autres matriaux, c'est le rgne
universel des grandes puissances de l'heure, la houille et la mtallurgie,
qui se trahit par ces signes. La part qui reste nanmoins aux diversits
et individualits rgionales ne sera jamais entirement abolie. Il
y
a,
mme dans cette Europe si transforme, des domaines o prvalent,
en vertu des lois du sol, l'usage de la terre, ou celui de la pierre, ou
celui du bois, sortes de provinces naturelles qui maintiennent peu
prs leurs limites.
Le chalet est un type troitement uni aux Alpes. Combine avec
les larges dalles de schiste qui lui servent de soubassement, empruntant
au bois les poutres de sa charpente, les lamelles imbriques de son toit,
cette construction caractristique rgne depuis la Savoie jusqu'
l'Autriche. Sous d'autres formes, la maison de bois prvaut en Bosnie
et en Serbie mme jusqu'aux environs du mont Kopaonik. La rgion
Vidal-Lablache, Gographie humaine. 11
162 LES FORMES DE CIVILISATION
des grands bois de chnes qui borde au Sud le cours de la Save, est
reste en majeure partie fidle aux matriaux offerts par le sol. L'le-
vage et les pratiques de constructions s'unissent, pour ainsi dire, dans
un mme commentaire gographique.
Les contrastes sont visibles et persistent plus qu'on n'est port
le croire entre les rgions o la pierre abonde et celles o elle manque.
Le temps est pass, il est vrai, o, dans les sables et tourbires de la
plaine germanique, des chausses de bois, pontes longi, tenaient lieu
de routes. Mais ces matriaux de fortune, pis ou terre mlange
de paille hache, terre et cailloux rouls en couches alternantes,
limon avec soubassement de silex, lss et entrecroisements de poutres,
reprsentent des combinaisons varies pour suppler la pierre de
taille. Ainsi, la Beauce, terre de limon, s'obstine conserver ses mai-
sons en pis toit de chaume. En Champagne, le temps n'est pas
loin o les masures en pis, assujetties tant bien que mal par des
solives de bois, disparaissant presque sous la couverture de chaume,
rgnaient l o luisent aujourd'hui les maisons de briques aux toits
de tuiles.
L'architecture a consacr ces diffrences. De grands monuments
sur lesquels plane un souffle d'art singularisent aujourd'hui les contres
du limon et de la brique. Le pays toulousain s'oppose au pays borde-
lais, de mme qu'aux marbres de l'Ardenne, aux pierres de l'Ile-de-
France et de la Normandie, s'oppose l'argile de Londres et des Flandres.
De beaux difices de briques se dressent Albi et Toulouse. L'archi-
tecte s'est efforc en ces lieux de raliser l'aspect monumental, et,
par le seul moyen des ressources qui s'offraient sur place, d'lever en
quelque sorte la brique la dignit de la pierre. Mais celle-ci a l'avan-
tage de la plasticit et de la vie. La beaut de la matire s'unit la
perfection de l'art dans ces difices dont Caen s'enorgueillit et qui
semblent sortis d'un seul jet de ces carrires normandes dont les blocs
servirent btir les cathdrales d'outre-mer.
Naturellement, c'est moins dans les difices d'art, capables d'at-
tirer de loin les matriaux de provenances diverses, que dans les
btisses ordinaires que se grave l'empreinte du milieu. La France
doit passer, parmi les contres de l'Europe transalpine, pour la plus
favorise sous le rapport des matriaux de constructions. La remar-
quable extension des roches calcaires d'ge crtac ou jurassique
imprime aux constructions qu'elles ont attires sur leurs emplacements
des marques trs caractristiques. Les cavits creuses de main d'homme
qui entaillent les escarpements de craie tuffeau le long des valles
tourangelles de la Loire, de l'Indre et du Cher, dsignent, quand
LES MATRIAUX DE CONSTRUCTION 163
elles ne subsistent pas elles-mmes comme habitat, le noyau primitif
d'o se sont dtaches les blanches maisons qui s'alignent le long de
leurs parois. Les assises de calcaire qui ont fourni Paris la belle
pierre que le temps recouvre d'une fine et grise patine, soulignent
la range de beaux villages chelonns du confluent de l'Oisel'Isle-
Adam, ou encore ceux qui se suivent le long des dcoupures qui
cislent au Nord, entre Soissons, Noyon, Coucy et Laon, les plateaux
de l'Ile-de-France. L'air monumental rpandu sur les contres se
reflte en mille dtails, miroite dans les plus humbles constructions
;
il tient la qualit de la pierre extraite sur place. L aussi, ct des
creuttes et carrires que l'homme ne s'est pas toujours dcid aban-
donner, maisons pignons taills en gradins, poternes et croises
sculptes, larges et beaux escaliers, montrent la familiarit prcoce
des habitants avec une matire qui se prtait docilement au model.
Plus foncs de ton, les calcaires du bassin de Lorraine et de Bourgogne
communiquent aux villages serrs qui pressent leurs maisons au pied
des ctes, une tonalit plus sombre, laquelle les dalles de mme nature
dont l'imbrication forme le toit, ajoutent une note d'austrit. La
maison jurassienne largit ses flancs, amplifie ses faades sur les pla-
teaux que percent de toutes parts les blanches clisses des roches.
La maison en pierre est, dans ce cas, comme une chose incorpore
au sol mme
;
elle fait partie de cet ensemble d'indices par lesquels
se caractrise une physionomie de contre.
La marche qu'a suivie en Europe la civilisation, des bords de la
Mditerrane aux confins des rgions forestires du Nord, est jalonne
par des constructions de pierre. C'est un mlange de pierre et de
ciment qui a permis au rseau de voies romaines de traverser les sicles,
et sous les noms de estrades ou estres, chemins ferrs, perrs, voie
de la Preuse, etc., Hochstrasse ou autres vocables non moins signi-
ficatifs, de servir de guide, longtemps de modle, la circulation
moderne.
A travers l'Aquitaine, du Quercy au Poitou, la bande de belle pierre
calcaire se signale par l'abondance d'anciens sites fortifis, oppida
gaulois, chteaux-forts, enceintes mures, etc., qui s'chelonnent
depuis les sites fameux d'Uxellodunum et de Cahors, jusqu' La
Rochefoucauld et Angoulme, et de l vers Lusignan et Poitiers, for-
mant comme une ligne d'architecture militaire et fodale. A travers la
Bourgogne et la Lorraine la bande septentrionale de la grande boucle
calcaire trace une srie analogue de sites fortifis auxquels s'accrocha
de bonne heure une cristallisation d'tablissements humains : depuis
Rena jusqu' Alise-Sainte-Reine, de vieux sites fortifis la jalonnent
164 LES FORMES DE CIVILISATION
en Bourgogne
;
elle signale, de La Marche Vaudmont, les confins
guerriers de Lorraine. L, plus tard, et pour les mmes causes, naquit
cette floraison d'architecture dont Cluny fut le foyer, et dont l'glise
de Vzelay, sur la colline calcaire en vedette auprs du Morvan,
demeure le principal tmoin. L'Angleterre chelonne la plupart de
ses plus anciennes villes fortifies (Chester) ou de ses passages flu-
viaux (Oxford) le long des collines calcaires qui enserrent le bassin
de Londres, ou des hauteurs qui, par Lincoln et York, s'avancent
au Nord jusqu'au cap Flamborough. Ces lignes de constructions ont
mis en saillie l'ossature politique des contres. A travers la Souabe
et la Franconie un trait analogue est fourni en Allemagne par la zone
qui va de Ble Bamberg : ce n'est point par hasard que, sur les pro-
montoires ou contreforts qui la hrissent, on rencontre les sites de
chteaux-forts que les noms de Habsbourg, Hohenstaufen, Hohen-
zollern ont rendu clbres. Au Nord-Ouest du Harz les coteaux cal-
caires du voisinage de Hildesheim s'associent la cit dont l'architec-
ture et les monuments reprsentent ce qu'il
y
a de plus ancien et de
plus remarquable dans l'Allemagne du Nord.
Les conqutes de la pierre sur le bois ont march de pair avec les
progrs de la civilisation. Les xii^ et xiii^ sicles, qui virent renatre
l'ordre et la scurit en Europe, furent aussi les poques du triomphe
de la pierre. C'est alors que se dressent les cathdrales, que, sur la
Seine Paris, sur la Tamise Londres, et ailleurs, des ponts de pierre
remplacent les ponts de bois primitifs. A Avignon, Pont-Saint-Esprit,
sur le Rhne les confrries de pontifes sont l'uvre. Dj sous
Charles le Chauve les fortifications de Pont-de-l'Arche avaient barr
le fleuve aux incursions normandes. Les ponts de pierre ont stabilis
les passages, endigu les invasions, fix la gographie politique,
de mme que ces tours et ces murailles qui, dans les vieilles estampes,
dessinent invariablement les figures de villes. Pendant longtemps
au contraire l'Orient et le Nord restent l'cart. Dans la Russie boise
qui s'tend au Nord du 55^ de latitude ou dans la Finlande, comme
gnralement en Sibrie encore de nos jours, il n'y eut gure que des
villes de bois, que l'incendie pouvait dvorer tel point que les habi-
tants fussent tents d'abandonner le site. Des villes comme Bolga
sur la Volga, Julin ou Vineta sur la Baltique, Biska en Sude, ont
disparu sans laisser de traces. Rien de tel n'tait possible dans cette
Europe qui, de bonne heure, d'Oxford Prague, inscrivit sur le sol
ses monuments de pierre, s'incorpora d'un trait dfinitif au sol.
LES MATRIAUX DE CONSTRUCTION 165
IV.
LE BOIS DANS L'EUROPE SEPTENTRIONALE
Un des changements les plus notables dans la nature vgtale est
celui qui fait graduellement succder vers le Nord les forts de coni-
fres aux essences varies qui rgnent dans les moins hautes latitudes.
Peu peu, les arbres qui avaient t pour les hommes de prcieux
auxiliaires, le chne, qui et mrit dans la zone tempre froide de
succder l'olivier comme roi des arbres, et, avec lui, le frne, si pr-
cieux encore pour la charronnerie et l'outillage agricole, l'if, que sa
flexibilit rsistante rendait apte tant de services, si bien que son
domaine semble avoir t rduit depuis les temps prhistoriques par
une exploitation sans mesure, disparaissent, comme avaient dj
disparu le buis, le chtaignier, le noyer. Ce cortge vari fait place
l'uniformit des pins, picas et mlzes, htes des forts presque
dpourvues de sous-bois. Parmi elles, se glissent pourtant la faveur
des clairires et des valles fluviales quelques espces feuillues : peu-
plier, aune, sorbier, le bouleau surtout qui, vivace et rsistant, tend
son aire de la Sibrie la Scandinavie, du Canada l'Alaska, tout le
long des surfaces continentales qui bordent le ple arctique. La nature
s'appauvrit
;
l'installation de l'homme devient plus lente et plus difTi-
cile
;
les arbres fruitiers cessent d'accompagner les habitations. C'est
environ entre 55 et
60<*
en Europe, vers 50 en Amrique, que se pro-
nonce le changement.
Cependant cette nature, si appauvrie qu'elle soit, n'est pas strile.
Des ressources nouvelles se substituent celles qui font dfaut. Dans
ces forts de conifres, les troncs gorgs de rsine livrent aux cons-
tructions des matriaux incorruptibles. La souplesse du bouleau,
son corce lgre et lastique se prtent des usages presque aussi
varis que ceux du bambou dans d'autres latitudes. Le caisson de bois
qui glisse et trane sur la mousse entre les arbres clairsems, le canot
que l'on transporte par-dessus les seuils dprims d'un bief de rivire
un autre, sont des applications originales qu'en a tires l'ingnio-
sit humaine. C'est surtout dans les instruments de transport que se
manifeste d'abord cette originalit : chose naturelle en des contres
o les dplacements saisonnaux ont t et restent encore en partie
une condition d'existence. Le reste suivra avec les progrs de la civi-
lisation. Mais les notions runies sur l'ethnographie des peuples pri-
mitifs, tribus finnoises du Nord de la Russie, indignes de l'Amrique
septentrionale, montrent suffisamment dj qu'en dpit de difficults
que ces contres opposaient l'homme, l'occupation
y
fut assez ancienne
166 LES FORMES DE CIVILISATION
et invtre pour avoir cr, l comme ailleurs, un matriel spcial
de civilisation en harmonie avec la nature ambiante.
La civilisation moderne, sous sa forme la plus envahissante, celle
de l'industrie, assige cette zone avec une intensit dont elle est loin
jusqu' prsent d'avoir donn les mmes preuves dans la zone tro-
picale. Bien peu des produits vgtaux que produit la nature fores-
tire quatoriale ont t encore utiliss par nos grandes socits mo-
dernes
; au contraire, les ressources forestires du Nord sont depuis
longtemps entres dans la circulation gnrale. Ce n'est plus aux
besoins seuls des habitants, mais la consommation grandissante de
notre industrie qu'ils subviennent. En mme temps, les ressources
du sol sont exploites. Les mines l'taient dans les temps anciens par
les Tchoudes du Nord de la Sibrie
;
le fer l'est aujourd'hui dans les
parties les plus septentrionales de la Scandinavie. De plus en plus,
entrent en jeu les immenses rserves de forces que reclent les masses
d'eau accumules dans ces contres
;
aussi voyons-nous avec tonne-
ment s'ajouter aux cits historiques de Moscou, Ptrograde, Stockholm,
de nouvelles crations et poindre de nouvelles ppinires urbaines en
Finlande, en Scandinavie, en Colombie britannique, l o jadis vg-
taient avec peine des embryons d'agglomrations humaines.
La physionomie des villes et mme des contres se transforme rapi-
dement sous l'influence de la brique et du granit. Toutefois, les condi-
tions intrinsques n'ont pas dit leur dernier mot. Sous ces climats
rigoureux o l'hiver se prolonge pendant 7 ou 8 mois, la ncessit de
retenir la chaleur assure aux constructions en poutres, malgr les
dangers d'incendie, une prfrence justifie. La plupart des villes
russes du Nord ont renonc leurs palissades et enceintes de bois.
Cependant, beaucoup de quartiers restent fidles aux anciens mat-
riaux, mme Moscou. C'est surtout le cas pour les habitations rurales.
En Norvge, sous le ciel mouill et lumineux par claircies, un des
lments qui piquent une note claire dans le paysage, c'est la maison
dont les parois peintes en rouge brillent au soleil. Si vous entrez,
de ces parois luisantes, de ces planches bien unies, s'exhale une odeur
rsineuse. Le village du Nord de la Russie tourne vers la large rue
qui constitue son axe, les pignons ouvrags et orns de vives couleurs
de ses maisons de bois. Uizba russe a supplant, en effet, avec le pro-
grs de la culture et du bien-tre, la rudimentaire et fruste kuta fin-
noise, dont les toits bas de branchages et de terre sourdent encore
et l dans les coins carts de la rgion marcageuse. Le plancher
de bois a remplac dans l'izba russe le sol de terre
;
les fentres et les
ouvertures ont donn passage la fume et la lumire ; des bancs
LES MATRIAUX DE CONSTRUCTION 167
le long des murs et des cloisons de planches divisent la demeure en
plusieurs compartiments. Avec les chambranles dcoups et peints
qui encadrent les fentres, la girouette en forme d'oiseau qui surmonte
le toit, la maison s'gaie et prend un air pittoresque. Elle parat bien
ce qu'elle est rellement, une cration inspire des lieux
;
on sent que,
sur elle, s'est exerce avec prdilection l'adresse et la fantaisie du cons-
tructeur. L'art que le moujik a appliqu se construire, avec les mat-
riaux qu'il avait sa porte, une demeure confortable ses besoins
et ses gots, est le mme qui fait que sous sa main, sans autre instru-
ment que la hache, le bois prend les formes les plus diverses, se prte
aux usages les plus multiples. Le moujik est n charpentier par le
besoin, l'habitude hrditaire, en vertu des conditions de la nature
ambiante, mre de ces nombreuses industries domestiques restes
chez lui encore si vivaces. On ne se figure pas tous les objets qu'il
peut fabriquer avec du bois et dans lesquels il n'entre pas un atome
de fer , dit avec une nuance de regret un mtallurgiste. C'est dans
l'izba russe, la maison finlandaise en Scandinavie telle que l'ont faite
plusieurs gnrations de paysans, avec leurs coffres en corce de bou-
leaux, leurs tagres images et leurs principes de dcoration pitto-
resque, que se manifeste l'expression la plus directe d'un genre de
civilisation autonome, ne au sein d'une nature ingrate. La maison
n'est-elle pas en tout pays l'un des signes fidles de la mentalit de
celui qui l'habite ?
CHAPITRE V
liES TABLISSEMENTS HUMAINS
Les tablissements humains ajoutent une expression au pays. La
premire apparition d'un hameau, aprs une course de hautes mon-
tagnes, est une joie. Cette impression respire dans Richthofen, quand
il note jour par jour les spectacles de voyage qui le frappent,fdans
Barth, quand il passe du Sahara au Soudan. Une ville, un village, des
maisons, sont un lment descriptif
;
soit que l'on considre leur forme
et leurs matriaux, leur adaptation un genre de vie, rural ou urbain,
agricole ou herbager, ils jettent un jour sur les rapports de l'homme et
du sol. Il
y
a donc une grande varit d'tablissements '^humains
;
mais il importe d'en embrasser l'ensemble pour faire chaque l-
ment la part qui lui convient. Le site est le premier considrer, celui
du moins o l'on saisit le plus aisment, semble-t-il, les influences go-
graphiques.
I.
LES SITES
tablissements temporaires et tablissements permanents.
Cer-
tains tablissements se prsentent comme des crations phmres.
Les Germains de l'poque romaine avaient des villages, mais, comme
pour les indignes de l'Amrique du Nord, c'tait des domiciles dont
on s'cartait frquemment pour la chasse ou les besoins de nourriture
et de vtement, et qu'on abandonnait parfois pour en former d'autres.
L'emplacement des villages ngres du Soudan est sujet changer si
le sol s'puise, s'il devient malsain
; il est la merci d'une pidmie.
La fixit des tablissements est en proportion du patrimoine amass
sur place, des amhorations ralises, des relations formes. Entre le
village africain qu'un accident dplace, et nos villages d'Europe dont
nous pouvons suivre l'existence depuis des milliers d'annes, il
y
a
toute la distance qui spare les civilisations rudimentaires d'une civi-
170 LES FORMES DE CIVILISATION
lisation avance, comme entre la petite ville d'autrefois et les immenses
cits que notre poque voit grandir.
Si nous laissons de ct ces tablissements phmres des peuples
primitifs, nous devons aussi mettre de ct les refuges et les abris
de circonstance. Dans un tat d'inscurit chronique, les tablisse-
ments humains s'cartent des sites qu'ils devraient normalement
occuper. Au lieu de se placer l o s'offrent les ressources naturelles
et o l'espace n'est pas misrablement restreint, ils se nichent sur des
points peu accessibles, sur des amoncellements de blocs comme ceux
qu'on nous dpeint dans certaines contres de l'Afrique, sur des som-
mets rocheux comme les vieux oppida des bords de la Mditerrane
ou nos chteaux-forts du moyen-ge, dans des lots ou sur des caps
comme les fondations que jadis le Melkart ou l'Astart phniciennes
semrent autour de la Mditerrane. Mais ces sites ne sont pas durables,
ils sont abandonns ds que les circonstances deviennent plus propices
et ne subsistent qu' l'tat de ruines. Les conditions naturelles prennent
alors le dessus ;
sous le chteau-fort abandonn, un village ou une
ville se forment et grandissent. Quand, dit Thucydide, on commena
tre rassur contre les pirateries, les villes se rapprochrent de la
mer. Et d'autre part la piraterie faisant place au commerce, les lots
sur lesquels avaient t dposs par les pirates eux-mmes un germe
de villes, entrrent en contact avec la terre ferme et s'y rattachrent
mme artificiellement. Tyr, Syracuse, Alexandrie ont ainsi bris leurs
coquilles. Mais alors, partir du moment o l'tablissement a trouv
ou conquis les conditions favorables sa vitalit, il peut faire preuve
d'une singulire persistance durer, mme travers les rvolutions
de l'histoire.
En fondant sur certains points favorables des tablissements sur
lesquels des gnrations successives concentrent les produits de leur
activit, l'homme implante un levier pour agir aux alentours, parfois
au loin. Ces tablissements font figure gographique, non seulement
par eux-mmes, mais par les modifications qu'ils produisent autour
d'eux. Sans parler des influences lointaines presque incalculables
qu'exercent les grandes cits de nos jours, une ville, mme mdiocre,
cre sa banlieue et transforme ainsi ses alentours. Une village groupe
et associe les cultures suivant les commodits de l'exploitation. Mme
les hameaux, les fermes ou maisons isoles, avec leur ouches, leurs
courtils, leurs vergers, leurs masures, oprent une sparation de
formes qui s'enchevtrent l'tat de nature, un classement des champs,
prairies, vergers ou bois dont nos yeux ont pris l'habitude. L'aspect
de contre pleinement civilise, avec sa continuit de cultures, ses
LES ETABLISSEMENTS HUMAINS 171
tendues o se manifeste une rgle introduite par l'homme, est un
rsultat artificiel qui tient la quantit, au voisinage et la dure des
tablissements qu'il a pu fonder. L'absence ou la raret d'tablisse-
ments permanents se traduisent par une composition tout autre du
paysage, d'autres associations vgtales, des interruptions ou des
vides suivant la nature des lieux, l'apparition sporadique de sols
ingrats que rien n'a amends. Ce dernier trait a t not par tous les
observateurs dans l'Afrique tropicale.
Complexit dans les pays de vieille civilisation.
Cependant,
ds qu'il s'agit de passer l'analyse, de distinguer les diffrents types
d'tablissements dans leurs rapports avec les conditions naturelles
et les genres de vie, c'est dans les contres de vieille civilisation que
la complexit des faits rend l'observation le plus difficile.
L'aspect de nos campagnes, en France par exemple ou dans l'Eu-
rope centrale, est un tableau singulirement composite, o les retouches
et les disparates ne manquent pas. On
y
voit se ctoyer des formes qui
sont l'expression de diversits sociales et parfois mme de diversits
ethniques. L'usine a pris place prs de la maison rurale, le chteau
prs de la ferme. Pourquoi ici la maison flamande, l le village alsa-
cien font-ils brusquement place aux fermes wallonnes ou aux villages
lorrains ? Diverses influences se croisent, parmi lesquelles les tradi-
tions ethniques ne sont pas mconnaissables. On sent avec quelle
circonspection doit procder l'analyse et de combien de nuances il
faut tenir compte. Mais cette complication porte en soi son enseigne-
ment.
Les tablissements humains sur le sol historique de notre Europe
ont, plus profondment et plus gnralement qu'ailleurs, remani
les conditions naturelles. Quelques jalons nous permettent de remonter
dans leur histoire. Nulle part elle ne s'offre plus varie et plus riche.
Des bords de la Mditerrane l'Europe centrale, jusqu'au Nord
Scandinave et la plaine russe, on suit une srie chronologique, comme
une vague envahissante dans les rgions les plus diverses de sol et de
climat. Tour tour, les hauteurs qui encadrent le bassin mditerranen
ont t amnages en gradins
; les plaines qui entourent les Alpes
ont t draines
;
les Alpes elles-mmes ont t, jusque dans leurs
hautes rgions, livres l'exploitation pastorale. Aprs que les forts
feuilles caduques de l'Europe centrale eurent t claircies, on s'est
attaqu aux marcages des contres qu'avait prouves l'action gla-
ciaire
;
enfin, les forts de conifres des terrains graveleux de la Russie
du Nord ont t leur tour atteintes par le progrs des tablissements
'
172 LES FORMES DE CIVILISATION
humains. A chacune de ces conqutes sur les pentes, sur les forts,
les marcages, a correspondu l'invention de procds souvent syst-
matiques de culture, de modes particuliers d'conomie rurale.
Sans doute, il
y
a des contres dont la civilisation ne le cde pas en
anciennet celle de l'Europe
;
mais elle le cde en varits. En Chine,
comme au Japon, et mme dans l'Inde, il n'y a pas eu d'attaque mtho-
dique de nouveaux domaines de culture
;
on s'est content de tirer
le meilleur parti de celui qui, de temps immmorial avait t fix
;
les tablissements humains sont rests plus spcialement confins
dans certaines zones : la montagne et la plaine
y
sont comme deux
lments spars ;
ni le Chinois, ni l'Annamite, ni l'Hindou, ne pro-
pagent leurs tablissements dans les montagnes, domaine malsain,
hostile de socits primitives. La montagne a jou surtout un rle
passif
;
elle s'est dpouille au profit de la plaine
; elle n'a pas particip
aux transformations qu'entrane le cours mobile d'une vitalit en veil,
ce perptuel devenir qui affecte aussi roccupation humaine. En ce
sens l'Europe est la plus humanise de toutes les parties du monde.
Nulle autre n'offre une matire aussi riche et hirarchise d'exemples.
L'Amrique a install son systme d'tablissements sur d'autres bases.
Elle a brl les tapes. Sans doute, le village existe aux tats-Unis
dans les parties de colonisation ancienne. Mais les moyens actuels
de circulation, les crations d'entrepts approvisionns de toute
espce de marchandises, l'usage de transformer les produits agricoles
en valeurs de banque, tent la formation des villages une partie
de sa raison d'tre. C'est la ville, et mme la trs grande ville que
tendent les groupements. C'est la ville qui rgit les relations entre
ruraux.
Existence de types.
Dans cette complexit des pays de vieille
civilisation, ne peut-on dcouvrir des types susceptibles de classifica-
tion ?
Remarquons d'abord que les formes d'tablissements, quelles qu'elles
soient, ne se reprsentent pas isolment. Si l'on met part quelques
exploitations minires situes en pleine fort ou au cur des mon-
tagnes, c'est par essaims, par familles en quelque sorte que certains
types se rpartissent la surface. Si c'est le rgime d'habitat dissmin
qui prvaut, les maisons, fermes ou hameaux ne se comptent pas par
quelques units, mais par centaines
;
c'est comme une poussire
d'habitation qui couvre le sol. Si c'est au contraire le type de villages
agglomrs qui domine, ils se distribuent dej^^lle faon que, pour peu
qu'on embrasse un horizon de quelque tendue, on aperoit toujours
LES TABLISSEMENTS HUMAINS 173
plusieurs clochers la fois : nombre de proverbes, chez nous, ont not
le fait. Les villes mmes ont tendance se multiplier et se presser
sur certains points, comme si elles s'attiraient les unes les autres.
Ainsi, abstraction faite des formes qui peuvent venir la traverse,
on discerne aisment que les mmes types sont tirs, dans les rgions
qu'ils occupent, un trs grand nombre d'exemplaires. Il est par l
permis de dire que le site gouverne en partie l'habitat, que parmi les
signes qui concourent caractriser une contre, marquer un pays
d'une empreinte propre, cet indice n'est pas ngligeable. Celui qui,
en France, quitte le pays de Caux pour celui de Bray, la Brie pour la
Beauce, celle-ci pour le Perche, recueille ce sentiment sur le vif. Richt-
hofen ne l'exprime pas avec moins de nettet, quand il dcrit les diff-
rences qui le frappent entre les provinces de Chine : diffrences autant
dans le mode de groupement que dans la forme des maisons.
Rien de plus naturel, si l'on
y
rflchit. L'analogie des conditions
de sol, d'hydrographie, de climat, fait qu'un type d'tablissement,
une fois implant dans une contre,
y
devient dominant, par la nces-
sit qui pousse les cohabitants s'adapter les uns aux autres. C'est
un phnomne d'accommodation rciproque. Les relations quotidiennes
et multiples qui naissent entre habitants d'une mme contre ne per-
mettaient gure, autrefois surtout, de se dpartir des types de groupe-
ment et d'habitat qui correspondent au genre de vie dominant. Dans
les pays de grande culture de crales, la simultanit des travaux,
l'usage des mmes pistes imposaient un mme mode de groupement
pour arriver en temps utile aux parcelles travailler
;
le paiement
s'y faisant en nature, la maison du salari aussi bien que celle du fer-
mier ou propritaire, devait tre amnage en vue de ce qu'elle devait
contenir. Dans les rgions o, au contraire, le sol se morcelait en ter-
rains enclos, tour tour champs et ptures, les petits pays, comme
les dsignent les habitants, il fallait bien que chaque ferme s'isolt
pour subvenir aux ncessits de cet miettement des cultures, qu'elle
se rattacht au lacis de petits sentiers qui couvrent le pays pour s'y
nicher en place utile. C'est surtout dans les pays d'irrigation que la
rgle d'adaptation rciproque se manifeste. Tout
y
est tellement subor-
donn l'lment qui distribue la vie, qu'il ne peut
y
avoir d'autre
mode de groupement, d'autre disposition d'habitat que celle qu'exige
la jouissance en commun soit des eaux courantes, soit des nappes
d'eau. Rien de plus uniforme en effet que les baracas qui peuplent la
huerta de Valence ou que les innombrables petites cases qui s'grnent
dans la haute Egypte, ou que les villages qui encadrent les compar-
timents rizire du Tonkin.
174 LES FORMES DE CIVILISATION
L'observation montre donc qu'il existe des sries. Ce sont elles qu'il
faut reconnatre et tudier et non l'exception. Elles seules ont une
valeur gographique.
Influence des routes.
La plupart des auteurs qui se sont occups
des tablissements humains se sont attachs mettre en lumire le
rle des voies de communication. C'est qu'ils songeaient surtout aux
villes. Les routes, c'est--dire le commerce et la politique, ont fait
les villes
;
il en est autrement des tablissements plus humbles qui
ont procd de mille manires diffrentes l'exploitation du sol.
Meitzen l'a prouv pour les anciennes communauts villageoises de
l'Europe centrale. Nous le voyons autour de nous. Les petits hameaux"
qui se multiplient dans le Sud du Massif central, les fermes voisines
mais isoles du bassin de Rennes, les maisons rurales des rgions de
bocage ne se rattachent au rseau routier que par des sentiers que la
boue rend impraticables. Dans la Brie, la rpartition de ces fermes,
qui sont pourtant de grands centres d'exploitation rurale, montre une
disposition tout fait indpendante des routes : c'est par un lacis de
pistes qu'elles communiquent. En Limagne, la petite culture laisse
peine de place quelques sentiers herbeux. En Beauce, de grandes
routes, mais pas de sentiers.
Cela ne veut pas dire que les routes soient incapables de faire natre
des villages. La nomenclature topographique en fait foi. On voit
actuellement, dans les pays de population dissmine, Flandre, valle
de la Loire, les maisons s'aligner docilement l'appel des routes,
former des rues et donner ainsi un aspect semi-urbain certaines cam-
pagnes. Mais que de pays (Morvan, Vende, Sidobre) o la route ne
fait natre aucun tablissement.
La vie rurale se contente d'une viabilit rudimentaire, soumise
toutes les difficults des saisons, adapte aux pitons ou aux btes
de somme. Dans l'Est de la France et les plaines agricoles de l'Alle-
magne, comme en Angleterre, on entrevoit le vestige d'un type d'or-
ganisation aussi ancien que l'assolement triennal, o l'indpendance
des routes est manifeste. Autour d'un noyau o se groupent les maisons
rurales se droulent en longues bandes parallles des champs soumis
des rgles d'assolement communes, de sorte que semailles, travaux,
rcolte, mise en pture s'y succdent dans le mme ordre et s'accom-
plissent en mme temps. A l'origine les rues du village s'y prolongeaient
sous forme d'troites bandes gazonnes ou laisses en friche pour la
commodit des oprations agricoles. Ce systme autonome de com-
munications, bien que moins manifeste aujourd'hui, est de cration
LES TABLISSEMENTS HUMAINS 175
villageoise ;
il se sufft. Des routes ont pu tre surajoutes en vertu des
besoins extrieurs, mais l'unit sociale, la cellule organise pour
subsister de sa vie propre avait dj de cette manire pourvu sa
propre viabilit.
Isol des routes, l'tablissement rural doit avoir sous la main les
ressources indispensables sa vie.
Dans les rgions arides ou dsertiques, la nature restreint l'habitat
une zone troite dont il ne peut s'carter. La proximit de l'eau est
la rgle inflexible
;
pas d'tablissement qui s'en carte, qui ne tienne de
l'oasis. Mais les rgions tempres laissent plus de marge
;
l'homme
y
peut choisir les sites suivant diffrentes combinaisons. Le besoin de
quelque varit dans l'alimentation, l'eau pour de multiples usages,
les terrains ncessaires l'entretien d'animaux domestiques, le com-
bustible et les matriaux de construction, la salubrit du sol, voil
un rsum des exigences de l'homme pour sa demeure.
Le problme a t rsolu de faon concentrer le mieux possible la
runion des choses ncessaires
;
c'est ce qui explique la fixit des
tablissements humains dans nos rgions de vieille civilisation. Le
principe de combinaison est systmatiquement appliqu dans l'orga-
nisation des anciens villages d'Angleterre
;
on
y
distingue autour de
l'agglomration :
1
les champs de culture
;
2^
les prairies (meadow
grounds)
;
3^
les ptures.
Lignes de contact.
Un relief dont les lignes s'harmonisent et o
l'inclinaison des pentes ne dpasse pas les degrs qui rend les trans-
ports et les relations difficiles, mais qui joint l'avantage d'orienta-
tions diffrentes celui qui rsulte d'une composition varie du sol
;
telles sont, entre autres, les conditions qui attirent et fixent les tablis-
sements ruraux. Nos coteaux de France, surtout dans le bassin pari-
sien, abondent en pareils sites. L'rosion s'y est exerce assez pour que
des boulis aient enrichi en mme temps qu'amorti les pentes, sans
compromettre la stabilit du sol. Les couches du sous-sol, n'ayant pas
t dranges par des dislocations, se droulent en assises rgulires :
aux sables et aux matriaux friables, se superposent en successions
ordonnes des zones d'ingale consistance, calcaires ou marnes,
entre lesquelles affleurent des sources. A cette coordination, il a t
possible d'adapter un classement de prairies, de cultures, de vergers,
de taillis, bois ou garennes, dans lequel les besoins de la communaut
trouvent porte ce qui leur sufft. L'il embrasse aisment cette
superposition rgulire et unit le village et le clocher dans l'image qu'il
en retient. Sur les flancs des coteaux calcaires couronns de bois que
176 LES FORMES DE CIVILISATION
l'rosion a isols dans le Noyonnais, o aux environs de Saint-Gobain
et Laon, des champs s'talent jusqu'au contact des boulis avec les
fonds argileux : les tablissements, dociles ces dispositions linaires,
forment ceinture autour de chaque massif. Les collines de craie tendre
du Snonais doivent l'rosion un profil vas et sensiblement concave
dont les champs dessinent en long ruban la sinuosit. Sur les coteaux
plus raides du calcaire jurassique, en Bourgogne ou en Lorraine, se
succdent, de la base au sommet, les prs, les champs, les vergers, les
forts, soulignant les diffrences si lgres qu'elles soient de sol, de climat
et d'hydrographie, qui se concentrent sur une centaine de mtres
d'altitude. Ce rapprochement en raccourci de zones diverses fournit
aux tablissements un cadre propice ;
il est combin en raison du va-
et-vient qui relie les diverses parties de l'exploitation rurale. Le choix
de la position reprsente la meilleure possibilit de combinaisons
utiles.
Chaque modification du relief offre ainsi de nouvelles chances favo-
rables aux tablissements. Il se produit aux inflexions de pente, aux
intersections de plans diversement inclins, une tendance visible au
rapprochement et mme la concentration des lieux habits. On peut
vrifier en divers pays cette loi naturelle, mme en ceux o la disette
d'eau ne relgue pas, comme en certains plateaux calcaires, les villages
aux affleurements latraux de sources ou au voisinage de rivires.
Les plateaux de travertins et de meulires de la Brie, o l'eau est
partout et l'intrieur desquels prvaut le systme de grandes fermes,
se couronnent sur leur priphrie de villages placs en corniche, pen-
chs d'un ct sur des vergers, adosss, de l'autre, des champs.
D'autres exemples nous viennent du Midi et de l'Ouest. Dans la
plaine du P, en Emilie, en Lombardie et Pimont, le pays fourmille
de maisons rurales, distantes la plupart peine de 500 mtres. Rien
ne distingue particulirement les alentours de ces grosses btisses :
ni arbres, ni jardins, peine quelques lopins de potagers minuscules.
Elles sont indistinctement confondues dans l'immense jardin dont le
travail des habitants a revtu la plaine entire, avec ces cultures
qu'un rideau d'arbres entrelacs de festons de vignes protge contre
les rayons du soleil. Mais avec les collines du Montferrat reparaissent
les villages, couronnant les cimes de leurs clochers et de leurs vieilles
tours.
Dans le Lauraguais languedocien, l'impermabilit du sol a favo-
ris la dispersion par bordes
;
mais sur la tranche que ces plateaux de
molasse opposent aux valles, se succdent des bourgs ou villages,
trs anciens pour la plupart, signals au loin par des ranges de moulins
LES TABLISSEMENTS HUMAINS 177
vent. C'est un spectacle analogue qui frappe le voyageur qui suit la
Loire entre Chalonnes et Ancenis et qui voit sur la rive gauche, de
Saint-Florent Lire, les rampes du pays des Mauges se hrisser
de clochers et de moulins faible distance les uns des autres : der-
rire cette faade villageoise qui fait illusion, on ne dcouvre, si on
la franchit, que de larges croupes parsemes de fermes dans un fouillis
d'arbres.
Une recrudescence de centres habits signale le bord des plateaux
de lss en Alsace, entre Strasbourg et Saverne, comme en Autriche
le bord des plateaux que longe la Morava au Nord de Vienne
;
la vigne
et les vergers ajoutent leur appoint aux cultures de crales. C'est que,
dans ce cas comme dans les prcdents, un talus adouci, form de glis-
sements et d'boulis, facilite la liaison entre les sections de pentes.
Cette disposition familire a pris racine dans les habitudes. Il semble
bien qu'avec le besoin instinctif des combinaisons, ce type ait flott
devant les yeux de nos paysans de France, lorsqu'ils transplantrent
en Amrique ce plant exotique, le village agricole ; sur les terrasses
au bord du Saint-Laurent, leurs maisons s'alignent, voisines sans tre
contigus, droulant en bandes rectangulaires leurs vergers de pom-
miers, leurs champs d'avoine, leurs prairies entoures de barrires
de bois, entre la fort d'en haut et la berge du fleuve.
On peut considrer comme une loi gnrale la prdilection des ta-
blissements humains pour les lignes de contact de couches gologiques
diffrentes. Celui des calcaires oolithiques surmontant les marnes du
has, si frquent en Bourgogne et en Lorraine, a t un des plus fconds
en tablissements prcoces. Le site fameux d'Alise-Sainte-Reine
mriterait de servir de type. L'ocne parisien a fourni, soit entre le
calcaire et les sables, soit entre les gypses et les marnes vertes, l'occa-
sion de villages s'tageant flanc de coteaux, le long de la Seine, de la
Marne et de l'Oise. Les coules de basalte qui, en Auvergne, surmontent
les coteaux d'argile, ont form leur extrmit une lisire de villages,
dont le type est Royat.
Les tablissements affectent de prfrence soit le palier suprieur,
ainsi que nous l'avons vu, soit le palier infrieur. Les ctes calcaires
de Meuse ne manquent pas de bourgs situs au sommet, mais c'est
surtout leur base qui est garnie de riches et florissants villages se succ-
dant de prs, tous orients vers l'Est. Mme disposition dans les bourgs
du vignoble bourguignon.
Villages en srie.
Le nombre et le rapprochement des tablisse-
ments qui se pressent sur ces lignes de contact sont le commentaire
Vidal-Lablache, Gographie humaine. 12
178 LES FORMES DE CIVILISATION
vivant de la force d'attraction qui les tient unis. Rien de plus frappant
que ces ranges de villages qui, en de certains endroits, semblent tre
ns du mme besoin, puisant la mme sve. Un coup d'il les embrasse
se succdant sur le mme plan, en lignes presque ininterrompues, soit
autour des coteaux de Noyon et de Saint-Gobain, soit le long des berges
calcaires qui descendent vers l'Oise. Au pied des ctes de Meuse, entre
Neufchteau et Vaucouleurs, les villages s'alignent aussi, unis ensemble
par un lien de ressemblance, parfois de filiation : Domrmy de Greux,
disait Jeanne d'Arc en parlant de son village natal, qu'elle ne sparait
pas du village an et voisin.
Il
y
a l de vritables lignes de cristallisation. Les tablissements
humains ont obi strictement l'attraction de certaines conditions
propices
;
ils s'y sont propags comme ces coraux dont les construc-
tions ne s'cartent pas de certaines zones. Ils se prtent, par ce voisi-
nage, un mutuel appui et
y
trouvaient, dans les temps troubls, des
garanties de scurit. Les exemples ne manquent pas hors de France,
en Allemagne notamment, aux pieds des plates-formes calcaires de
Souabe, le long de l'Odenwald, suivant la Bergstrasse et ailleurs. Une
grande partie de nos populations a vcu ainsi de ces rapports de vil-
lages formant comme des familles sociales.
Types montagnards.
Dans les montagnes, les lignes de cristalli-
sation sont plus rares. C'est le type dissmin qui prvaut et qui per-
siste. Dans les Alpes franco-pimontaises, on rencontre des groupes
de hameaux plutt que des villages. Cependant quelques lignes d'ha-
bitat se laissent particulirement distinguer. Elles correspondent aux
zones de vgtations qui se succdent en altitude. Sur les flancs de ce
qu'on appelle dans les Vosges des collines, les habitations s'alignent
sur une zone de cultures, qui, surmontant de 100 150 mtres les prai-
ries d'en bas, s'lve au-dessus des brouillards sur les versants o
s'attardent les rayons du soleil. Le bas de la zone de la chtaigneraie,
au-dessus des vignes, dans les monts du Vivarais et une partie des
Cvennes, trace une ligne sensible de peuplement. Il en est de mme
dans le Tessin. En Corse, c'est au contact de la zone de l'olivier et de
celle du chtaignier qu'est la ligne de prdilection. Dans les montagnes
du Cantal, les gros villages sont 800 ou 900 mtres, au-dessus des
cultures, prs des forts et des pturages. Le Jura est jalonn d'ta-
blissements, respectivement situs la limite suprieure du vignoble
et des vergers, puis la limite des cultures de crales. Il
y
a conci-
dence entre les lignes d'habitat et certaines courbes de niveau : celle
de 800 mtres dans les Alpes franaises se signale par des formes varies
LES TABLISSEMENTS HUMAINS 179
d'tablissements ;
c'est la limite entre la zone plutt agricole et la zone
de plus en plus pastorale.
Mais d'autres causes interviennent : nergie de l'rosion, contraste
entre l'humidit des valles et la luminosit sche des hauteurs, orien-
tation, ventilation, pour multiplier les sites d'tablissements. Dans la
zone des cultures, les hameaux ou villages cherchent les versants
ensoleills, les paulements, les terrasses niveaux successifs qu'at-
teint plus rarement le brouillard, les moraines, les cnes de djection
tals aux dbouchs des valles secondaires. Mais le genre de vie
pastorale qui s'est :dvelopp dans les Alpes, repose sur une combi-
naison intime entre les prairies fauchaison des rgions basses et les
pturages des hauteurs, les montagnes . Les tablissements perma-
nents tendent se placer vers l'extrmit suprieure des valles,
pour tre porte des pturages et non loin des bois, et sont prcds
vers les hauteurs par une mare montante de chalets, casere ou habita-
tions temporaires, tantt espacs quelque cent mtrs de distance,
tantt pelotonns en petits groupes, tantt en bois, tantt mariant
le bois et la pierre.
En somme, tout ce qui sme la varit la surface, tout ce qui en-
gendre les facilits d'assemblage et de combinaison se reflte dans la
rpartition de l'habitat. Dans les montagnes, ce sont les talus morai-
niques, les cnes d'boulis qui servent de siges prfrs des hameau5c
ou des villages. Le long des ctes lagunaires, l'apparition de lignes
de dunes suscite sur leurs versants un surcrot d'habitations. Dans les
plaines que sillonnent nos fleuves, les terrasses qui correspondent
d'anciennes berges se couronnent volontiers de maisons ou de vil-
lages. Les monticules isols dans les rgions noyes des marschen ou
polders de la Basse-Allemagne furent jadis les premiers sites d'ta-
blissements. Les cordons pierreux appels osar en Finlande, servent,
entre les dpressions argileuses, de points d'attraction. Dans le Sahara,
les massifs montagneux (Ar, Hoggar), condensateurs de nues, sont
les seuls sites qui se prtent l'habitat permanent.
On voit donc qu' des degrs divers, mais sous tous les climats, tout
accident de relief introduit un lment nouveau qui, par l'orientation,
la sensibilit aux influences mtorologiques, le changement de nature
du sol, fournit l'homme l'occasion, toujours cherche, de concentrer
sa porte la nourriture, l'abri, la demeure stable et d'acqurir par ce
moyen des avantages transmissibles dont se grossit son patrimoine.
Ce ne sont pas les considrations de prudence qui prvalent. Dans
les montagnes, les sites d'habitat affectent ou non les terrains
180 LES FORMES DE CIVILISATION
meubles, placages, cnes de djections, endroits exposs auxboulis.
Le voisinage des volcans a attir, jamais cart. Dans les rgions sis-
miques, les terrains meubles et friables, les plus exposs, sont ceux
qui ont rassembl les habitants.
II.
L'HABITAT AGGLOMR.
FERMES ET VILLAGES
Deux types, rentrant dans la mme famille, correspondent au genre
de vie agricole des plaines ouvertes de l'Europe centrale et occiden-
tale : l'un est le village, l'autre la ferme ou le /zo/, bien distincts par leur
ampleur et la rgularit de leur disposition gnrale de la borde langue-
docienne ou du mas provenal. L'affinit entre ces deux types d'ta-
blissement rural tient l'affinit des genres de vie auxquels ils se
rapportent. Elle est gntique, elle se montre l'origine. Le vicus
s'est group autour de la villa, comme on a vu de nos jours le village
bulgare se former autour du tchiflik turc
^.
La ferme.
La ferme est un tout par l'outillage, les granges, les
animaux, le personnel ouvrier qu'elle hberge. Par sa rgularit, ses
dimensions, elle s'associe la physionomie des grandes plaines agri-
coles. Elle en est un lment ordinaire. Le plus souvent au Nord de la
Loire, elle affecte la forme d'une enceinte carre ou rectangulaire
s 'ouvrant par la grange, enserrant une cour, une habitation et des cu-
ries
;
c'est probablement le type qui se rapproche le plus de l'ancienne
villa gallo-romaine
^.
Elle n'est pas un type particulier aux pays picards
et wallons
;
on la retrouve, quoique avec de moindres dimensions, sur
les plaines de lss de l'Autriche entre Linz et Vienne. N'est-ce pas
l'tablissement adapt par excellence l'outillage considrable et
au personnel nombreux qu'exigent les grandes cultures de crales ?
Les proccupations d'arboriculture et d'levage se font sentir
dans la ferme-masure caractristique du pays de Caux. Elle se distribue
en btiments spars, mais tous compris dans l'enceinte rectangulaire
o des ptures complantes de pommiers sont encloses d'un foss
couronn de htres, tache sombre qui se dtache intervalle presque
rgulier dans la brume estompe du plateau. Sur les confins de l'Artois,
de mme qu'en Danemark et ailleurs, elle se compose de trois bti-
ments perpendiculaires, enserrant une cour avec un entourage d'arbres
et de vergers.
Nous n'insistons pas sur l'analyse des dtails
; ce qu'il importe de
1. JiRECEK, Das Furstentum Bulgarien, iii-4, Vienne, 1891.
2. Muse du Cinquantenaire de Bruxelles, fouilles de la Socit Archologique
de Namur Sauvenire, plan des substructions d'une ferme du ii^ sicle de J.-C.
LES ETABLISSEMENTS HUMAINS 181
noter, c'est la fixit des types, leur multiplication et la fidlit avec
laquelle ils se rptent sur une certaine tendue, attestant l'exacte
adaptation un genre de vie.
La ferme se montre tantt dans l'intervalle des villages, tantt
coexistant avec eux. C'est ainsi que, dans nos plaines des environs de
Paris, on voit l'entre ou la priphrie du village, une de ces cons-
tructions que la longueur de ses murailles nues, la large et haute porte
qui s'ouvre sur la cour intrieure, avec la mare et quelques grands
arbres aux abords, distinguent des maisons qui lui succdent. Cepen-
dant c'est suivant les pays, tantt, la ferme, tantt le village agglomr
qui domine, sans qu'il soit toujours facile de dgager les raisons de
ces diffrences. Assurment la prsence de l'eau la surface
y
contribue.
C'est la raison pour laquelle la ferme domine sur les meulires imper-
mables de Brie, et est frquente, comme dans le pays de Caux,sur
les limons qui se prtent la formation des mares
;
tandis qu'elle est
subordonne et mme rare sur les craies permables de Picardie, de
Champagne ou sur les plateaux du Muschelkalk lorrain. Mais il
y
aurait sans doute d'autres lments chercher dans le domaine de
l'histoire et dans le domaine de l'ethnographie, si l'on avait traiter
cette question.
Le village.
Le village des grandes plaines agricoles, tel qu'il
existe en France, dans l'Europe centrale, dans les plaines du Bas-
Danube, et dans la Petite-Russie, est une des expressions mthodiques
d'un genre de vie. Son pullulement sur les espaces naturellement
dcouverts ou faciles dfricher se lit sur la carte et frappe la vue
sur le terrain. Dans nos campagnes du Santerre, de l'Artois, du Cam-
brsis, etc., dans le Kochersberg entre Saverne et Strasbourg, dans le
Hellweg entre Unna et Soest, dans la Borde de Magdebourg l'Ouest
de l'Elbe, les villages se distribuent, semblables entre eux, comme sur
un chiquier, faible distance les uns des autres. La rgularit de leur
rpartition est moins apparente en Champagne, o ils se serrent le
long des rivires, sur le plateau lorrain o ils affectionnent les dpres-
sions, dans le Soissonnais o ils sont au bord des plateaux calcaires.
En dpit de diffrences qu'expliquent le climat ou des causes historiques,
ces tablissements ont entre eux un lien d'origine
; la sve est puise
aux mmes sources. Leur formation s'est faite par groupes ^ Ce sont
comme des colonies de plantes sociales. L'onomastique rvle souvent
1. Les tablissements dsinence en ville avaient, en Normandie, remplac
les villages dtruits par les invasions des Vikings (v. Joret, Des caractres et de
Vextension du patois normand, Paris, 1883).
182 LES FORMES DE CIVILISATION
cette filiation : tel village, sans doute plus ancien, est reprsent par
son diminutif, peu de distance
^.
Ces types d'tablissement tirent leur force de leur adaptation aux
caractres de sol et de climat propres une partie de l'Europe.
Ces plaines unies sur lesquelles la charrue peut prolonger ses sil-
lons rachtent leur uniformit par l'avantage de se prter de nom-
breuses combinaisons agricoles. Les cultures peuvent s'y pratiquer
en grand, par les mmes procds, avec les mmes instruments, aux
mmes poques : semences, sarclages, rcoltes pouvant s'y faire simul-
tanment. Il
y
a l un principe d'entente, l'avantage consiste en une
conomie de frais et en commodits rciproques. Ces conditions ont
fait natre un systme combin de culture, une pratique rgle des
assolements. Ds une poque ancienne, l'assolement triennal
y
a
trouv son domaine, on en a des preuves ds le ix^ sicle
2.
On a pu
ainsi associer d'un commun accord les cultures de crales ou lgu-
mineuses avec les jachres et les ptures. Mais cette organisation n'est
compatible qu'avec un mode d'habitat o tout l'espace rserv aux
maisons se concentre, o toutes les parcelles sont accessibles et d'o
rayonnent en longues bandes les pices de terre alloties tour de rle.
Le village agglomr autour duquel se coordonnent les cultures, vers
lequel convergent les sentiers ou pistes herbeuses, persiste en vertu de
son organisation intrinsque indpendamment de toute cause extrieure.
A proximit des maisons se centralisent les choses ncessaires la
communaut : les puits creuss frais communs, organe essentiel
des villages de plateaux permables, les tangs et les rservoirs des
rgions sous-sol impermable
;
puis les vergers, les enclos de prs,
les bouquets d'arbres. Dans nos plaines de l'Artois, ce qu'on appelle
le plant est une partie essentielle du village. Compos de potagers,
d vergers de pommiers, de petits prs enclos de fils de fer, il forme
aux maisons qu'il abrite et au clocher qui seul parfois merge, une
ceinture verdoyante en t. Rien de plus vari que ces plants, sorte
d'abrg de vie rurale. Au del rgne l'uniformit, s'tendent les
champs et, jadis surtout, les jachres utilises par les troupeaux. Le
village centralise l'exploitation.
Modifications du paysage.
Ainsi par le principe de combinaisons,
l'ordonnance aussi bien que la composition des paysages ont t
1. Sur 1 /4 de feuille de la carte d'tat-major (Amiens S.-E.), nous trouvons :
Achiet-le-Grand et Achiet-le-Petit, Chuignes et Chuignolles, Ailly et Alliel, Lucheux
et Luchuel.
2. Flach dans Foville, Enqute sur l'habitation, t. II, p. 41.
LES TABLISSEMENTS HUMAINS
183
modifies. L'homme a ralli autour de ses habitations un ensemble
composite d'arbres et de plantes, tandis qu' distance de la priphrie
habite, il disposait l'espace pour ses cultures. Dans l'Europe occi-
dentale et centrale, c'est surtout aux dpens de l'arbre que s'est fait
le changement, tandis que dans l'Europe orientale c'est surtout aux
dpens de la steppe.
Toutes les observations de la gographie botanique semblent indi-
quer que, dans l'Ouest et le Centre de l'Europe, une grande partie de la
surface tait le domaine des arbres feuilles caduques formant des
forts, continues ou coupes de clairires comme une sorte de parc.
Il est naturel de retrouver dans le paysage actuel certains vestiges
de l'tat ancien, comme on retrouve dans les traits de l'adulte des
rminiscences des traits enfantins.
A vrai dire cependant il
y
a des parties o l'arbre, s'il a exist,
a t peu prs limin. Les croupes crayeuses qui s'tendent entre
les valles de l'Aube, de la Suize et de la Marne en Champagne, ou
bien entre l'Ancre et la Somme en Picardie, ne montrent que des
espaces dnuds, o,
et l, quelque moulin ou quelque arbre isol
servent de point de repre. La Beauce elle-mme, sans les alles qui
bordent ses grandes routes, ne connatrait d'arbres que sur la lisire
qui assombrit sa priphrie. Mais le plus souvent, du moins dans notre
France du Nord, un quilibre s'est tabli entre les anciens et les nou-
veaux occupants vgtaux du sol. Si les masses forestires ont, en
grande partie, dsert les plateaux limoneux, elles ont trouv asile
sur les surfaces qui mettent jour l'argile silex, sur les sables qui
dans une partie du bassin parisien tantt surmontent les calcaires
et tantt leur sont sous-jacents (Hurepoix) (fort de Villers-Cotterets),
sur les graviers d'alluvions anciennes qu'enserrent les mandres
fluviatiles de la Seine. L'afleurement des argiles silex les droule
en franges le long des valles (Caux). L'rosion leur a mnag des asiles
o elles se sont retranches, et d'o elles dbordent encore partielle-
ment sous forme de boqueteaux, de garennes, de buissons : ainsi entre
le Vexin et le pays de Caux, ou dans le Hurepoix entre Paris et la
Beauce, ou en Picardie, sur les confins du Ponthieu, de l'Artois, entre
Valenciennes et Mons, sur les confins du Hainaut, des lambeaux de
bois, o le chne et le htre sont fortement reprsents,
semblent
encore protester par leur allure vigoureuse contre les dmembrements
dont ils ont t victimes. Ailleurs, leur ancienne continuit n'est pas
encore compltement masque : c'est ainsi qu'autour du plateau de
grande culture de la Pvle une ceinture peine interrompue de bois
se dessine. Leurs lambeaux se rapprochent dans l'Arrouaise, aux con-
184 LES FORMES DE CIVILISATION
fins du Vermandois et de l'Artois. On peut mme citer des plaines de
grande culture o l'impression de fort est encore omniprsente :
la Brie, ancien Saltus, se distingue par un foisonnement de grands
arbres dans l'intervalle des cultures. Lorsque la couverture limoneuse,
plus paisse sur la convexit du plateau, s'amincit sur les bords, les
bois reprennent le dessus
;
c'est ce qui arrive dans le pays de Caux
notamment. Une bande de forts, de taillis ou de landes s'interpose
entre le peuplement surtout industriel des valles et le peuplement
surtout agricole des plateaux. C'est distance des bords, sur le dos
intact ou peine mamelonn, au sommet de larges ondulations que se
multiplient les fermes ou les gros villages et encore lorsque l'intervalle
entre deux valles est rduit, que les villages sont comme pinces entre
deux bandes de forts.
Que la fort ait t chez elle, dans la plupart de ces plaines, qu'elle
n'ait cd qu' regret et qu' demi aux empitements, c'est ce que
montrent, notamment sur le plateau calcaire lorrain, la force et la com-
position quasi intacte du sous-bois qu'elle abrite. Les lambeaux de
bois de chnes et de charmes, dont les formes rgulirement gom-
triques piquent
et l de taches sombres la surface des chaumes,
conservent, quoiqu' l'tat de rserve, un air de sant affirmant la robus-
tesse qu'ils tiennent du climat et du sol.
Influence du climat continental.
L'arbre semble au contraire un
intrus dans la puszta hongroise, sur les plateaux de Podolie et de Petite-
Russie, o les moissons de crales, souvent bordes de tournesols,
ont remplac le tapis onduleux de Stipa pennaia. Les cultures s'y
tendent sur de grands espaces o l'arbre ne prend pied que sous la
tutelle de l'homme. Les versants abrits et les pentes
y
sont, avec plus
de nettet que dans nos climats ocaniques, les asiles o se retrempe
la fort. Le climat qui avait favoris l'extension des steppes se pro-
longe dans la priode actuelle, si attnu qu'il soit, par des influences
hostiles l'arbre : tels ces vents glacs du Nord-Est qui amnent au
printemps des geles tardives, succdant brusquement des soleils
dj chauds. Les plateaux, inhospitaliers aux arbres, le sont galement
aux hommes. Sous l'influence du climat excessif de l'Europe orientale,
la mme proccupation s'impose qu'en montagne : le besoin de procurer
aux tablissements l'abri ncessaire pour les commodits de l'existence
et pour les cultures dlicates dont l'homme doit s'entourer. Les fertiles
plateaux de Podolie offrent souvent le spectacle de cultures s'tendant
perte de vue, sans qu'on aperoive de viflage
;
ceux-ci sont nichs
sur les flancs ou la naissance de valles secondaires, moins que ce
LES TABLISSEMENTS HUMAINS 185
soit l'intrieur des profonds mandres burins par le Dniester, la
Strypa ou le Sereth. Plus significative encore est la rpartition des
villages dans la rgion russe de la terre noire. Ils se posent exclusive-
ment soit la naissance des ravins latraux, soit sur les terrasses qui
bordent les fleuves. Et si les cours d'eau sont insuffisants, des barrages
artificiels, organes aussi indispensables ces villages que les tanks
aux villes du Sud de l'Inde, pourvoient, par la formation d'tangs
permanents, aux usages rituels et domestiques.
Ainsi se groupe par gros villages la population de la rgion de
la terre noire. Les maisons ne s'y dispersent pas au hasard
; elles se
subordonnent un alignement : une large voie unique forme l'axe
du village. Avec la partie rserve l'habitat, les btiments d'exploi-
tation dessinent un carr qui est la cour. Lorsque, s'avanant vers le
Nord, on arrive au
53^ degr de latitude environ, aux approches de la
rgion forestire mieux pourvue d'eau, on voit peu peu les villages
s'parpiller, s'carter des rivires, et former, avec les champs dfri-
chs qui les entourent, des oasis de plus en plus petites dans des forts
immenses. C'est entre 55 et 50 de latitude que s'accuse la transition,
sensible plutt dans le mode de construction que dans la forme des
villages. La maison de bois remplace la maison de pierre, le toit de bois
le toit de chaume, mais la disposition gnrale ne change pas. Le type
de village compos d'une large rue reste commun la rgion moscovite
et celle de la terre noire
;
la rgularit du plan persiste comme signe
extrieur de l'organisation villageoise
Conclusion.
Ne pouvons-nous pas tirer dj de ces observations les
gnralits qu'elles impliquent ?
Partout nous voyons que les surfaces tendues o prvaut une rela-
tive uniformit de relief et une certaine homognit de sol, ont donn
lieu des villages agglomrs ou des tablissements qui lui ressemblent
par le personnel nombreux qui s'y trouve. Il en a t ainsi non seule-
ment en Europe, mais en Chine. Ce sont, dit Richthofen, en parlant
des villages des pays de lss, des associations de familles unies par
une communaut de descendance ou du moins de rites, dont la coh-
sion est maintenue par la ncessit d'entente dans la conduite des
mmes cultures
^.
A la Chine on pourrait ajouter la plaine indo-gang-
tique, non compris le delta du Bengale, o s'est dvelopp et fix un
des types les plus complets de communaut de village.
Tous ces tablissements, sous des formes varies qu'expliquent les
Chinoy II, p. 680.
186 LES FORMES DE CIVILISATION
diffrences de climat ou des degrs d'tat social, sont l'expression du
mme besoin de centraliser sur quelque point l'exploitation du sol.
Une coopration rglant les dates des actes de la vie agricole, fixant
certains procds d'exploitation, s'impose comme avantageuse tous.
La ncessit de s'unir pour l'amnagement des eaux, la construction
de puits, l'entretien de certains travaux, l'accommodation d'un milieu
favorable aux cultures, resserre la cohabitation. Le village est un
organisme bien dfini, distinct, ayant sa vie propre et une personnalit
qui s'exprime dans le paysage. La concentration de l'habitat s'y
associe avec la multiplicit des parcelles, celles-ci ne pouvant trouver
que dans le village l'intermdiaire commun auquel aboutissent toutes
les pistes.
Ainsi constitu, le village est apte fournir un march et donner
lieu des industries rurales, de mme que maintenant dans la Petite-
Russie, dans la plaine allemande ou de la France du Nord, la culture
industrielle a joint l'usine la ferme.
III.
L'HABITAT DISPERS
Les tablissements humains n'ont pas rencontr partout les mmes
sollicitations de groupement. La diffusion des eaux, la diversit des
orientations, le morcellement des sols, fournissent spontanment sur
divers points la somme des conditions ncessaires une existence
fixe. Les groupements lmentaires, tels que ceux que peuvent former
les membres d'une famille, peine assists de quelques voisins, suf-
fisent. Aucune condition n'impose les diverses servitudes qu'implique
une communaut villageoise. L'habitat se disperse.
Cet habitat dispers se prsente en France sous des formes diverses,
mais avec un caractre rgional assez nettement marqu pour qu'on
puisse, en traits gnraux, lui assigner des limites. Tantt c'est la
petite ferme isole, presque ensevelie dans les arbres, relie par des
sentiers couverts et fangeux d'autres fermes distantes de quelques
centaines de mtres, cas frquent en Bretagne et dans l'Ouest de la
France. Ailleurs, dans le Cotentin, s'observe frquemment l'accouple-
ment de deux ou trois fermes. Des hameaux assez serrs, groupant
ensemble une douzaine de feux, forment un mode de peuplement
assez ordinaire dans plusieurs parties du Massif Central. Des groupes
de maisons spares constituent ce que, dans le Pays Basque, on appelle
un quartier.
Maisons isoles ou hameaux, ce sont des agrgats minuscules, inca-
pables d'exercer autour d'eux une attraction semblable celle qui
LES TABLISSEMENTS HUMAINS 187
coordonne les cultures autour des villages agglomrs des grandes
plaines. La physionomie de paysage qui rsulte de ces formes d'ta-
blissements reflte en ses traits gnraux un tout autre mode d'exploi-
tation du sol, un autre genre de vie, une disposition bien diffrente
de celle que nous avons observe dans les villages agglomrs.
C'est le particularisme substitu la centralisation. Tout parle ici
de sparation, tout marque le cantonnement part
;
des haies d'arbres
dessinent partout leurs zigzags, raient les collines, et leurs cimes muti-
les, prsentant d'tranges silhouettes, divisent jalousement les enclos
et les champs. Les mmes cultures se droulent rarement sur de grands
espaces. C'est par lopins varis qu'elles s'encadrent entre les haies.
Des landes s'entremlent avec les cultures Parfois le mme enclos
sert tour tour la culture et au pturage. Au lieu d'espaces unis,
rarement interrompus par des chemins, partout des sentiers creux,
fosss et leves de terre garnies de .buissons et d'arbres. Ce morcelle-
ment de dtail laisse rarement place des vues d'ensemble
;
et, quand
un point dominant s'offre par hasard, c'est un pays fourr qu'on
dcouvre, o il est difficile de distinguer entre des croupes et des ondu-
lations qui se ressemblent, entre des sentiers qui divaguent. Une impres-
sion d'isolement se dgage de cet ensemble
; et l'tranger se sent mal
l'aise devant ce ddale qui lui semble inhospitalier et hostile. Dans
ce systme d'tablissements, les centres de vie se rduisent des lieux
de rendez-vous priodique, march, glise, chapelle, pangyrie.
On est en face d'un tat arrir. Que ce genre de vie ait de profondes
racines, qu'il tienne au sol autant qu' des habitudes, c'est ce que
montre sa persistance, sa gnralit dans les contres auxquelles il
s'est adapt
; ainsi que les rapports, peut-tre indissolubles, qu'il
a nous avec les institutions, les conceptions sociales de certaines races.
Les cadres de la vie sociale, aussi bien que l'aspect du pays, sou-
lignent la diffrence entre les rgions de villages agglomrs et celles
o l'isolement, tout au plus interrompu de certains jours, est la rgle.
L'opposition entre ces deux types d'tablissements n'est naturelle-
ment point particulire la France, quoiqu'elle ne se prsente pas
partout avec un caractre aussi tranch. Elle a t signale particu-
lirement en Souabe ^, tandis que l'habitat agglomr rgne sur les
plaines calcaires du Moyen-Neckar et sur les plateaux de la Rauhe-Alp,
le systme d'habitat dissmin (Eindhof) trouve un domaine trs
distinct et trs net dans la rgion morainique qui s'tend au Nord du
1. Gradmann, Die landlichen Siedelungen Wurttembergs, Pet. Mitt., 1910, I,
p. 184-186.
188 LES FORMES DE CIVILISATION
lac de Constance et de l'Allgu. Les mmes causes physiques que celles
qui ont t signales plus haut semblent bien ici entrer aussi en jeu :
le morcellement du relief, la richesse en sources, la prsence diffuse
des eaux ont laiss se multiplier les petites units indpendantes,
autour desquelles se pratique l'exploitation du sol. Et ce mode d'exploi-
tation se traduit par le mlange et les enchevtrements de champs
et ptures, o se reflte un genre de vie rest mi-agricole et mi-pastoral.
Nulle part en Europe ce type d'tablissements morcel ne se montre
sur une plus grande chelle et avec un caractre plus marqu d'ar-
chasme que dans la pninsule des Balkans. L'habitat dispers et
l'habitat agglomr, le type hameau et le type village
y
semblent
bien correspondre des diffrences gographiques. En Serbie, comme en
Bulgarie, ce sont les parties accidentes et montagneuses, pentes ou
versants l'exclusion des plaines et valles, qui paraissent le domaine
naturel de la dispersion
^.
Plutt que la ferme isole, on rencontre
l des maisons associes par groupes d'une douzaine de feux ou mme
davantage, dont les occupants sont ordinairement relis par des liens
de famille. L'habitat est calqu ainsi sur l'tat social. Sur les confins
de la vieille Serbie et de la Bulgarie, entre Koumanovo et Kustendil
notamment, Cvijic a cherch tracer la limite, toujours incertaine
en ces matires, qui sparerait les villages agglomrs des groupements
de hameaux
2.
Ces hameaux, dsigns sous le nom de Kolib en Bul-
garie,
y
paraissent aussi le type dominant des collines et des mon-
tagnes
^, ils en constituent le mode de peuplement caractristique,
en antinomie marque avec les villages de plaines. Mme contraste
en Valachie : le Catun, ou groupements par hameaux de 3, 4 ou 5 mai-
sons ou plus, est le type des collines et des avant-monts, comme le vil-
lage est le type des plaines. Partout de l'eau, dans chaque repli
du sol un ruisselet, une source ;
la fort, si ravage qu'elle ait t, est
encore prochaine, offrant les bois ncessaires la construction de la
maison et l'entretien du feu en hiver*. Mme opposition encore au
Nord des Carpathes entre le peuplement par hameaux des collines et
les gros villages des plaines de Galicie et Podolie.
Il
y
a trop de complexit dans les races et trop de fluctuations d'ordre
conomique pour que cette dlimitation base gographique ne
1. C'est de ces peuples que Constantin Porphyrognte crivait : Ils ne peuvent
souffrir que deux cabanes soient l'une prs de l'autre.
2. J. Cvijic, Grundlinien der Gographie und Gologie von Mazedonien und
Altserbien (Pet. Geogr. Miiieilungen, Erg nzungsheft, n 162, 1908), p. 125.
3. Les Kolibariy dit Jirecek, taient primitivement plutt des bergers qui,
subsidiairement, pratiquaient une faible agriculture (Bulgarien, p. 149).
4. Em. de Martonne, La Valachie, Paris, 1902, p. 249.
LES TABLISSEMENTS HUMALNS 189
puisse tre entame. Des causes diverses interviennent pour en
modifier les linaments, la prdominance de la vie agricole sur la vie
pastorale peut s'accentuer ;
la dmarcation continuera cependant de
subsister. Dans cette pninsule balkanique que tant d'accidents histo-
riques ont traverse et qui a t livre un tel enchevtrement de
races, elle rpond des conditions naturelles
;
elle demeure un tmoi-
gnage vivant de l'anciennet de genres de vie spontanment issus du
milieu.
IV.
TYPES DE RGIONS SUBTROPICALES ET SUBARCTIQUES
Soit qu'on s'avance dans la direction des ples, soit qu'on aille
dans la direction de l'Equateur, les zones propices aux tablissements
humains se rduisent progressivement : ici par la surabondance d'eau,
l par la scheresse ou par d'autres causes.
Rgions subarctiques.
Dans le Nord de la Russie d'Europe, c'est
aux abords de la rgion forestire, sur les confins de la fort d'arbres
feuillus et de la fort de conifres, par 58 de latitude environ, que des
diffrences tranches, inconnues nos rgions tempres, se dessinent
entre les parties humanises et les parties rebelles aux tablissements.
Dans la rgion de la haute Volga, domaine des Finnois Tchrmisse
peine entam par la colonisation russe, le contraste s'accuse entre
le haut-pays dont le sol friable couvert d'une couche de terre noire
a permis de pratiquer des clairires agricoles, et le bas-pays o la fort
de pins et de sapins, encore dominante, n'est interrompue que par des
lacs et des marcages. Le village s'est constitu, florissant, entour de
vergers et de massifs de tilleuls, bouleaux et aulnes dans le haut-pays.
Il n'existe dans le bas-pays qu' l'tat rudimentaire, et ne montre
pas de traces de vgtation autour des constructions
^.
L'eau sta-
gnante, avec les miasmes et les geles qu'elle engendre, est visiblement
l'lment hostile.
Dans les provinces de la Baltique, comme en gnral en Scandinavie,
l'parpillement des fermes est le rgime qui apparat, ds qu' la conti-
nuit des plaines se substitue le morcellement propre aux contres
qu'ont envahies les glaciers.
Au Nord du 60^, la Finlande sl t le sige d'une colonisation plus
active. C'est l peut-tre que l'homme a fait le plus d'efforts pour
approprier ses besoins une contre peu hospitalire. Rabote la
1. J. Smirnov (trad. par P. Boyer), Les populations finnoises du bassin de la
Volga et de la Kama, p. 81 sqq.
190 LES FORMES DE CIVILISATION
fois par les glaciers et jonche de leurs dpts, la surface en est sans
cesse morcele en une foule de petits territoires par une alternance
de petites collines rocheuses, de terrains de gravier, de lacs et de champs
d'argile ^.
Ce morcellement, l comme dans les rgions o nous l'avons
vu dj prvaloir pour d'autres causes, a produit son effet
ordinaire : hostile la formation de villages, et favorable aux hameaux
et fermes isols (torp). Une sorte de besoin centrifuge a mme port
les pionniers de la colonisation dans le plateau infrieur s'tablir
autant que possible l'cart les uns des autres, comme ils l'ont fait
plus tard en Amrique dans le Far-West, seul moyen de combiner
librement des ressources parses que la pche et la chasse permet-
taient de joindre une agriculture trs restreinte. Peu peu, il est
vrai, par les progrs du drainage et de l'assainissement du sol, une
marge plus grande s'est ouverte aux tablissements des hommes.
Dans l'Est du plateau lacustre, la coutume s'tablit alors de btir
et l sur les collines de graviers et de sables, mdiocrement fertiles
mais moins exposes aux geles que les terrains argileux ou les tour-
bires du fond des valles
2.
Des groupes sporadiques d'tablissements
ont pris naissance ;
mais ils ne forment de vritables ensembles que le
long des fleuves
^.
Entre les solitudes sur lesquelles psent la stagnation
des eaux et des marcages, l'immobilit des forts de conifres et de
bouleaux, o l'agriculture ne dispose que des misrables ressources
de l'cobuage, la circulation des cours d'eau reprsente le mouvement
et la vie
;
c'est en effet le long des fleuves qu'ont afflu les tablisse-
ments humains. Une frange d'tablissements suit fidlement les cours
d'eau, surtout dans la partie orientale o l'volution du rseau fluvial
est plus avance ; ils s'grnent, plutt qu'ils ne se concentrent sur
leurs rives. Par une analogie remarquable avec nos pays de montagnes,
on
y
remarque que chaque valle fluviale forme une rgion part
*.
Ainsi la rpartition des tablissements est en rapport avec les forces
physiques qui travafllent substituer un rseau fluvial coordonn aux
labyrinthes lacustres et marcageux, hritage des anciens glaciers
quaternaires.
La Chine.
L'homognit du sol dans le Nord de la Chine est pro-
pice aux agglomrations : les unes ne dpassent pas les proportions
de hameaux, les autres sont de gros villages agglomrs. Dans la valle
1. Atlas de Finlande : carte n 2 ; texte, p. 20 (Sederholm).
2. Atlas de Finlande : carte n 12
;
texte, p. 20.
3. Atlas de Finlande : carte n^ 26. Population dans les communes rurales rparties
par villages (chaque point correspond 10 habitants).
4. Atlas de Finlande : carte n" 14
;
texte, p. 43.
LES TABLISSEMENTS HUMAINS 191
du Ve-ho ce sont plutt les hameaux runissant dans une enceinte de
terre un certain nombre de maisonnes en forme de cubes que de
grands villages ferms. Le village se montre plus perfectionn dans
la province de Chan-toung, comme partie intgrante de cette vieille
civilisation qui s'y est conserve mieux qu'ailleurs.
Avec ses temples orns de grands arbres, avec les portraits orns de
moulures et d'inscriptions en pierres sculptes, il ralise parfois ce
type classique que se complaisent reprsenter les anciennes peintures
chinoises.
Lorsqu'on s'avance vers le Sud, du Ho-nan vers le Hou-p, ou du
Chan-toung dans le Kiang-sou entre les deux grands fleuves, surtout
dans le Hou-nan et le Tch-Kiang au Sud de Yang-tseu, et dans la
riche province de l'Ouest, le Sz-tchouan, l'effet des changements
de climat et de sol se fait sentir sur le rgime de l'habitat rural. Plus
de lss pour amortir les ingalits du sol et rpandre une teinte uni-
forme sur toutes choses. La tendance l'parpillement des maisons
s'accuse de plus en plus, se conformant de plus prs l'usage d'asso-
ciation familiale. Tantt l'habitat suit jusqu'au sommet des pentes
les jardins de th qui s'chelonnent, tantt il lit domicile sur les ter-
rains relativement trop levs pour qu'il soit possible d'y faire parvenir
en t l'eau ncessaire la culture du riz
;
il se superpose aux rgions
tages comme le village mditerranen se superpose au verger
^.
Ces petits groupes de maisons juxtaposes expriment la cohabitation
familiale au sens tendu qu'elle a chez ce peuple : avec ses ramifica-
tions, sa nombreuse descendance cimente en troite association
par les croyances et les rites, et retenant ainsi autour des ascendants
des groupes de 30, 40, 50 personnes et plus
2.
Les travaux de saisons
auxquelles la culture du riz, la cueillette du th donnent lieu, doivent
cette coopration familiale un caractre patriarcal, auquel la maison
ou le groupe sert de cadre. Cela reprsente quelque chose de plus
expressif que nos hameaux, une incarnation plus exacte des principes
sur lesquels est fonde la civiUsation chinoise.
Nulle part ce mode de rpartition ne s'panouit plus librement que
dans le bassin rouge , la grande rgion irrigue du Sz-tchouan,
un grand jardin regorgeant d'hommes . Les cultures d'arbres s'y
mlent aux cultures de crales et de lgumineuses, riz, orge, bl,
fves, chanvre, colza, etc., qui se pressent troitement
;
des massifs
d'orangers, de mriers, de rsineux, de bambous, signalent les groupes
1. V. Fig. dans E. Tiessen, China, p. 339, ferme au-dessus de terrasses irrigues
de la haute valle de Han.
2. RicHTHOFEN, China, I, p. 405^
192 LES FORMES DE CIVILISATION
d'habitation
;
et dans cette Chine o le dboisement a partout marqu
ses stigmates, o il ne reste l'arbre partout pourchass que quelques
refuges, autour des temples, ou de ces tombeaux de familles qui
abondent dans la province essentiellement chinoise de Ho-nan, les
haies de bambou, peupliers, mriers qui encadrent ces fermes du Sz-
tchouan, donnent
et l la rminiscence de la fort disparue.
Mais quelle que soit la forme de l'habitat rural, fermes, hameaux
ou villages, la zone en est restreinte en Chine, comme les modes d'exploi-
tation qu'on
y
pratique. Des valles et des plaines qui sont ses lieux
de prdilection, elle gagne pniblement l'aide de terrassements tout
ce qu'elle peut conqurir sur les collines
;
mais l'absence d'levage
met une restriction ses empitements. De l ces contrastes qui
prtent illusion. A la multitude de hameaux ou villages qui se pressent
dans les valles irrigues ou prs des embouchures fluviales o l'adou-
cissement de la pente et le jeu rgulier des mares facilitent l'amna-
gement des eaux, succdent parfois de grands espaces inutiliss.
Nous avons not que des intervalles existent dans les rgions arides
ou semi-arides des bords de la Mditerrane
;
mais l'explication ici
ne vaut pas, puisque c'est prcisment dans les rgions arroses de la
Chine centrale et mridionale que s'intercalent des espaces o l'habitat
se rarfie, ne se montre que sous ses formes les plus rudimentaires.
Un fait social, tenant des habitudes agricoles invtres, concen-
trant toute l'ingniosit et tout l'efort sur les cultures qui dfraient
les besoins de nourriture, de vtement et d'clairage auxquelles s'est
accoutume la socit chinoise
;
telle est et restera, du moins jusqu'
nouvel ordre, la cause de cette rpartition singulirement exclusive,
qui ne rpond rien d'impratif dans les conditions physiques. Bien
plutt elle exprime un stade ancien, fix dans une perfection prcoce
et auquel un isolement sculaire a servi de prservatif.
A ce point de vue nous ne sortons gure de Chine en passant au
Tonkin. Le delta
y
fourmille de villages analogues entre eux, trs voi-
sins et se reproduisant des centaines d'exemplaires, comme un type
de colonisation. Le site en est circonscrit par les casiers naturels
forms par les bourrelets des fleuves
^.
Entre les digues leves contre
les inondations, de petits compartiments s'inscrivent o l'eau s'accu-
mule avec les pluies d't dans des arroyos, des mares, des tangs
en partie artificiels. C'est l que l'Annamite du delta a constitu son
village
;
avec ses maisons en pis, ses tangs, ses mares, ses jardinets
1. Ghassigneux, L'irrigation dans le delta du Tonkin (Revue de Gographie,
t. VI, p. 44, fasc. I).
LES TABLISSEMENTS HUMAINS 193
de lgumes et la lisire de bambous, interrompue de portes, qui lui
sert d'abri ou de dfense, il forme un tout. L'autonomie de ce petit
monde est garantie par la runion de tous les organes de culture, de
dfense, de rserve et d'assurance contre la scheresse. Ce cadre n'est
qu'en partie artificiel. Ces cuvettes o l'on recueille l'eau des pluies
sont, comme les johls du Bengale, drives des flaques que, chaque t,
les pluies et les inondations laissent aprs elles. Il a suffi d'en consolider
les contours, d'en rgulariser le rgime pour pratiquer un amnagement
minutieux, tout fait proportionn aux forces de main-d'uvre,
aux procds et aux instruments de culture dont disposent ces petites
communauts. L'unit sociale sur laquelle est fonde la socit anna-
mite trouve dans ce cadre une expression adquate
;
c'est elle qui
rduit en menue monnaie la richesse apporte en lingot par les fleuves.
L'Inde.
Abstraction faite des vastes plateaux du Centre o
persistent les modes les plus rudimentaires d'tablissements, l'Inde
est par excellence un pays de villages. Dans cette immense agglom-
ration d'hommes les cits ne prennent que 2
^/o
de la population
;
et l'habitat rural se prsente surtout sous forme de villages. La diss-
mination par hameaux ou par cases ne prvaut que dans le Bas-Bengale,
o de toutes parts, les groupes s'parpillent entre des haies de bambous,
et sur la lisire troite de Malabar et de Travancore, rgions o l'abon-
dance des pluies et la prsence universelle des eaux permettent et
favorisent l'parpillement.
Le village se montre au contraire trs agglomr dans le Pendjab,
si populeux, si complet, avec son organisation et ses corps de mtiers,
si bien circonscrit par des murailles de terre, qu'il ressemble un cam-
pement de tribu. Entre les croupes herbeuses o l'levage, les mar-
chs, les foires entretiennent le mouvement (bas-pays ou Khadar),
le captage des crues dans les valles au moyen de drivations lmen-
taires, le forage des puits au voisinage des monts, tiennent la popula-
tion concentre. Le rapprochement des genres de vie diffrents et
hostiles se marque dans le mode de groupement. L'habitat se dlie
davantage, devient plus libre, dans la grande plaine de la Djumna
et du Gange jusqu' Allahabad et Bnars. Non loin des frontires
menaces et des marches d'invasions, le village a laiss se relcher
la rigueur de l'ancienne organisation en communaut
; les collectivits
qu'il groupe sont moindres numriquement. Elles sont aussi plus voi-
sines
;
l'intervalle qui les spare n'atteint pas en moyenne 2 kilomtres
^.
1. Census
of
India, 1891, p. 53.
Vidal-Lablache, Gographie humaine. 13
194 LES FORMES DE CIVILISATION
Le voisinage de la nappe d'eau souterraine que les puits atteignent
une faible profondeur, a permis ces communauts de se multiplier
uniformment sur toute la surface meuble et lgre que circonscrivent
au Nord le Tera, au Sud les falaises de grs de l'Inde centrale. On
compte par centaines de mille les puits soit en maonnerie, soit tem-
poraires qui, perant de toutes parts le sol du Doab (Msopotamie gan-
gtique),
y
sont l'uvre anonyme et ancienne des cultivateurs du sol.
Ils se sont groups
;
et sans doute ce mode d'habitat dans la haute et
moyenne valle du Gange est moins dict par la nature que par le
dsir de rester concentrs, de conserver les liens entre des races diverses
traditionnelles. C'est un type de colonisation, comme dans le delta
du Tonkin. Les groupes, quoique rapprochs, vivent renferms sur
eux-mmes, dans les cadres traditionnels qui contiennent, soit en agri-
culteurs, soit en artisans, tout ce que peuvent rclamer les besoins
et mme les ambitions de luxe, et qui, une fois complets, s'ouvrent
difficilement de nouveaux-venus. Nulle part les recensements n'ont
relev un plus grand nombre d'habitants vivant l'endroit mme dont
ils sont originaires
^.
Tout au plus des mariages entretiennent-ils
quelque change de population entre villages voisins. Si d'une part
la facilit de culture sur un sol homogne et ami a favoris la propaga-
tion d'un mme type de villages, c'est la ncessit de se prcautionner
contre les insuffisances et les irrgularits des pluies qui en a maintenu
la cohsion.
Le rapport entre l'irrigation et le type de villages ne se montre
pas moins dans les rgions intrieures du Dcan, o il est ncessaire
aussi de constituer des rserves pour parer aux insuffisances de pluie.
Le substratum archen des roches ne permet pas d'y multiplier les
forages de puits comme dans les sols meubles des plaines indo-gang-
tiques ;
mais il suffit de quelques barrages dans les larges ondulations
de ces surfaces de pnplaine pour former des tanks ou rservoirs
artificiels. On a compt de ces bassins jusqu' 43.000 rien que dans les
14 districts dpendant de Madras, tous d'origine indigne. II n'est
pas de village qui ne possde cet organe essentiel, qui est la fois son
uvre et sa raison d'tre.
Ainsi, dans l'uvre anonyme qui a prcd dans le Sud comme dans
le Nord de l'Inde les grands travaux qu'ont accomplis des dynasties
hi^oriques, on retrouve, prcdant les grands canaux du Sind et du
Gange, les digues monumentales du Cavery et des fleuves du Carnatie,
le travail prliminaire d'installations et d'amnagements modestes,
1. Census, 1901
LES TABLISSEMENTS HUMAINS 195
conus et excuts la mesure de villages ou groupes restreints, et
qui n'avaient pas d'autre prtention que de nourrir des communauts
de 200 1.000 personnes
^.
Leur adaptation aux conditions de sol et
de climat a fait que, soit dans les contres de Mysore et de Carnatic,
soit dans la plaine gangtique, le type une fois form s'est rpt,
presque sans variantes, des millions d'exemplaires. Il s'est propag
autant que le permettaient les conditions du sol,
V.
CONCLUSION
Si incomplet que soit cet aperu comparatif, il suggre quelques
remarques. Il
y
a quelque chose d'essentiellement gographique dans
la rpartition de ces formes diverses d'habitat rural que nous avons
rencontres en Europe autour de la Mditerrane, en Chine, au Tonkin,
dans rinde, et que nous pourrions sans doute rencontrer ailleurs.
Ces exemples montrent que la rpartition s'organise rgionalement.
Ce n'est pas le hasard qui a implant ici le type de villages agglomrs,
l celui de hameaux disperss, ailleurs celui de petites maisons ou cases
semes comme une poussire. Cependant, il serait chimrique de pr-
tendre tablir des classifications gnrales en rapport avec les circons-
tances gographiques. Certaines conditions seulement de sol et de
climat sont compatibles avec le mode dissmin, dispers, ou agglo-
mr ;
d'autres
y
sont rfractaires. Le groupement dispers convient
aux rgions o, par suite du morcellement du relief, du sol et de l'hy-
drographie, la terre arable est elle-mme morcele. Le village agglo-
mr est chez lui, au contraire, dans les contres o cette surface
arable est continue, d'un seul tenant, permettant une exploitation
uniforme. Sous l'empire de ncessits communes se sont formes des
associations collectives. Le creusement et l'entretien de puits, d'tangs
et de mares, la ncessit de construire des murailles, contribue res-
serrer et agglomrer l'habitat.
Il serait vain de ngliger l'influence de la question de scurit et de
dfense. Au contact de la steppe et des domaines d'autres genres de vie,
tout prend un aspect de forteresse : le village lui-mme, aux confins
du Sahara, de l'Arabie, du Turkestan, de la Mongolie, devient une
prison et un refuge. Par contre, l o la scurit, longtemps absente,
commence renatre, nous assistons un mouvement de dispersion.
L'habitat se dlie en quelque sorte. Du vieux village fortifi, d'aspect
mfiant, de plus en plus dsert sur sa montagne, se dtachent, comme
1. V. table de la population des villages, Census, 1891, p. 49.
196 LES FORMES DE CIVILISATION
une bande d'coliers mancips, des groupes de maisons s'parpillant
leur guise.
Mais, dans le groupement de l'habitat rural, la considration de
dfense, de refuge, n'est pas la principale. Le site exprime une combi-
naison d'influences physiques, o la pente, le niveau d'eau jouent
leur rle, avec une association de cultures artificiellement assembles.
Ces combinaisons se coordonnent diffremment, suivant que le noyau
est un village, un hameau, une ou deux fermes isoles
;
mais elles
existent du fait de l'homme. Elles modifient profondment le paysage,
et sont par l un des objets essentiels de la gographie humaine. De
grandes diffrences sociales sont nes de diffrences d'habitat. Le village
ralise un type de communaut dpassant le cadre de la famille et du
clan. Les vieilles organisations villageoises ont leur rle dans nos
anciennes socits d'Europe, sans parler mme de celui qu'elles con-
servent en Russie. Si elles l'ont perdu, cela tient l'importance crois-
sante des villes, au dveloppement des communications et de la vie
commerciale qui ont fait natre de toutes parts des germes nouveaux.
Les industries villageoises ont en grande partie pri dans nos contres
;
l'industrie moderne tend se distribuer d'aprs des lois nouvelles.
Mais il
y
a de vastes contres o le village est rest et reste encore
l'organisme essentiel : l'Inde, l'Indochine et une grande partie au
moins de la Chine. Le village continue raliser dans l'Inde ce qui
partout ailleurs est le privilge des villes : division du travail, satis-
faction des besoins, mme du superflu. C'est un petit monde ferm
et dont la prise est si forte qu'il touffe tout autre sentiment de com-
munaut, qu'il bouche l'horizon. Nous Annamites, crit le mandarin
Tran Than Binh, cause de la grande varit des institutions commu-
nales, nous nous croyons en Chine ou en Amrique aussitt sortis
de notre village
^.
Le village ainsi, dans ces contres orientales, absorbe une plus forte
part de vie sociale, au dtriment des formes plus vastes d'organisa-
tion, ville ou tat. L'antithse est forte vis--vis de l'Europe
;
elle
apparat plus forte encore si l'on songe aux tats-Unis d'Amrique.
Mais tout cela est matire qui participe la vie, s'assouplit et s'adapte
aux circonstances. L'inscurit, l'tat de piraterie et de guerre modi-
fient plus ou moins temporairement l'habitat. Aucun tat ne saurait
tre considr comme dfinitif et immuable. Le lien qui tenait autour
de la Mditerrane les habitations troitement groupes sur les hau-
teurs s'est relch. Les types de groupements voluent comme toutes
1. H. RussiER et H. Brenier, L'Indo-Chine franaise, p. 136.
LES TABLISSEMENTS HUMAINS
197
choses. Il sera d'un grand intrt de suivre cette volution, non seule-
ment dans les contres mditerranennes, o elle est actuellement
trs sensible, dans les contres de colonisation rcente, l'Amrique
et les rgions tempres de l'hmisphre austral, o elle est ses dbuts
;
mais encore dans les contres tropicales, et dans ces contres d'Orient
et d'Extrme-Orient o la population semble fige en des moules
trs anciens. Ils ont dur dans l'isolement
;
mais ils ne rsisteront
peut-tre pas aux chemins de fer, la grande industrie, aux innova-
tions qui rsultent du contact avec le commerce mondial.
CHAPITRE VI
L'VOLUTION DES CIVILISATIONS
I.
TENDANCE NATURELLE AU PERFECTIONNEMENT
Observez dans une vitrine de muse l'attirail de vtements, armes
et parures du monde mlansien
;
aux coquilles, cailles de tortues,
dents, artes, bois et fibres vgtales, vous reconnaissez l'empreinte
du milieu littoral et quatorial ; dans les ornements brsiliens, vous
retrouvez les plumes des oiseaux bariols des forts
;
dans ceux des
pasteurs cafres les peaux de rhinocros, les lanires d'hippopotames
;
vous devinez autant d'adaptations des genres de vie inspirs direc-
tement du milieu ambiant. Ce milieu a t peu modifi, sauf les incen-
dies, les dfrichements temporaires
; le monde vgtal et animal
reste l'tat de nature
;
et d'autre part, presque rien n'a t emprunt
au dehors. Jetez ensuite un regard autour de vous
;
voyez ces contres
de haute civilisation, o nos champs, prairies, forts mmes sont en
partie des uvres artificielles, o nos compagnons, animaux et vg-
taux, sont exclusivement ceux que nous avons choisis, o les produits,
les instruments, le matriel sont plus ou moins cosmopolites. D'un
ct des civilisations franchement autonomes : de l'autre des civilisa-
tions o le miUeu ne se distingue qu' travers les complications d'l-
ments htrognes. Il semble qu'il
y
ait un abme entre ces rudiments
de culture, expression de milieux locaux, et ces rsultats de progrs
accumuls dont vivent nos civilisations suprieures. Les uns sont si
exactement calqus sur les lieux o ils se trouvent, qu'on ne peut
ni les transporter ni les imaginer ailleurs
;
les autres sont dous de la
facult de se communiquer et de se rpandre.
Cependant, chacun de ces types de civilisations procde de dvelop-
pements qui ont mmes racines. C'est dans le milieu ambiant que par-
tout les groupes d'hommes ont commenc chercher les moyens de
pourvoir aux besoins de leur existence. La plupart ont fait preuve
200 LES FORMES DE CIVILISATION
dans cette recherche de qualits d'ingniosit et d'invention qui
montrent dans la nature humaine plus d'galit originelle que nos
prjugs de civiliss ne l'admettent : l'homme ne s'est pas content
d'user de l'abri des arbres, des roches, pour se mettre en sret, de
cueillir l'aventure les racines ou graines spontanment sorties du
sol, de chasser la manire des btes de proie
; il a tir du palmier,
du bambou, des dpouilles d'animaux marins ou terrestres, de la
pierre et de l'argile, du cuivre et du fer, un monde d'objets qu'il a
frapps de son empreinte, crs son intention. Ce que plus tard
il a obtenu en appliquant la navigation les nergies naturelles de l'air
et de l'eau, plus tard encore, en utilisant la force d'expansion des gaz,
les sources de chaleur et de lumire amasses par les anciens ges
dans les entrailles du sol, rcemment enfin les nergies plus myst-
rieuses de l'lectricit, l'homme des civilisations primitives l'a com-
menc en appliquant ces fins les animaux et plantes que rencontrait
sa vue, le sol qu'il foulait ses pieds. Par l il tait condamn ren-
contrer des conditions plus ou moins favorables. Dans l'espace mesur
dont il disposait, les auxiliaires pouvaient tre rares, et l'on sait qu'en
certaines contres comme l'Ocanie, l'indigence de la nature native
paralysa ces dveloppements. Toutefois, mme l, l'instrument qui
supple ce qui manque l'homme en force et vitesse, apparat par-
tout comme un germe d'o, si rudimentaire qu'il soit, peut sortir,
les conditions tant favorables, une longue suite de progrs, comme un
acte d'initiative, une force de volont.
La nature fournit l'homme des matriaux qui ont leurs exigences
propres, leurs facilits spciales, leurs incapacits aussi, qui se prtent
certaines applications plutt qu' d'autres
;
en cela elle est suggestive,
parfois restrictive. Toutefois, la nature n'agit que comme conseillre.
En crant des instruments, l'homme a poursuivi une intention ;
en
s'appliquant de plus en plus perfectionner ses armes, ses ustensiles
de chasse, de pche ou de culture, les demeures o il pouvait mettre
en sret sa personne et ses biens, son outillage domestique ou ses
ornements de luxe, il a t guid par un dsir d'appropriation plus
prcise un but dtermin. Dans les diffrentes conditions de milieux
o il se trouvait plac, ayant tout d'abord assurer son existence,
il a concentr tout ce qu'il
y
avait en lui d'adresse et d'ingniosit
sur ce but. Les rsultats qu'il a atteints, si infrieurs qu'ils puissent
nous paratre, tmoignent de qualits qui ne diffrent de celles qui
trouvent leur emploi dans nos civilisations modernes, que par la moindre
somme d'expriences accumules. Il
y
a certes des ingalits, des
degrs divers dans l'invention
; mais partout l'tude du matriel ethno-
L'VOLUTION DES CIVILISATIONS 201
graphique dnote de l'ingniosit, mme dans un cercle restreint d'ides
et de besoins.
Les instruments que l'homme met en uvre au service de sa concep-
tion de l'existence, drivent d'intentions et d'eforts coordonns en
vue d'un genre de vie. Par l ils forment un ensemble, ils s'enchanent
et montrent entre eux une sorte de filiation. Une application en appelle
une autre. Le chasseur, pour perfectionner ses armes de jet, boumerang,
sagaye ou javelot, sarbacane, arc et flche, introduit des modifications :
il recourbe ou allonge son arc suivant l'envergure qu'il doit obtenir
;
il protge d'un bracelet le bras que peut endommager le contre-coup
de la corde ;
il garnit la flche de plumes qui rgularisent son lan,
il en amortit la pointe quand il craint d'endommager le plumage de
l'oiseau qu'il veut atteindre. Il s'arme d'un bouclier qui rsiste l'at-
taque. Le bouclier, lger et maniable devant les armes de jet, s'est
allong et alourdi en s'alliant la pique et la lance pour permettre
de s'arc-bouter contre l'assaut de l'ennemi ou de la bte fauve. Si le
Ngre africain de la zone tropicale pratique la mtallurgie du fer,
il ralise dans les formes de couteaux, leurs contournements et cise-
lures, leurs barbelures, une varit qui vise autant de diversits d'em-
plois.
Le matriel que le Kirghiz a cr l'usage de sa vie de dplace-
ments priodiques, la forme de sa tente, de ses vtements, ralisent
un ensemble o tout se tient, comme la personnification d'un genre
de vie. De mme, le matriel qu'a cr l'Eskimau pour subvenir aux
besoins de la pche, de la navigation sur mer, des rapides trajets
sur la glace ou sur le sol de la toundra, traneaux et attelages, kayaks
et harpons, vtements, huttes, reprsente un tout dont les diverses
pices sont coordonnes.
Est-ce seulement le stimulant de l'utilit pratique qui prside
ces combinaisons ? On
y
reconnatra un lment qui entre dans toute
uvre imprgne de patience et d'attention minutieuse, quelque chose
d'analogue ce qui soutient l'artiste dans sa lutte contre la matire,
dans son effort pour lui communiquer l'impression qui est en lui-
mme. La poterie n'est pas moins significative cet gard que la
mtallurgie primitive. Le doigt du potier indigne, en Guyane aussi
bien qu'au Prou, depuis la Chine mridionale jusqu' l'extrmit
occidentale de la Berbrie, ptrit la matire au gr de ses fantaisies
et de ses besoins. Le fini de certains instruments fabriqus, par exemple
chez les Eskimaux, avec de simples artes ou os de poissons, ou chez
certains Polynsiens avec des coquilles d'une remarquable duret,
chez les Maoris de la Nouvelle-Zlande avec les bois durs dont ils
202 LES FORMES DE CIVILISATION
cerclaient les membrures de leurs embarcations, dnote une patience qui
n'est autre chose que l'amour de l'artiste pour son uvre.
En Ocanie, comme dans le Japon primitif, en Chine ou au Mexique,
le travail humain s'est acharn sur certaines pierres dures, jade,
obsidienne, serpentine, dont l'clat l'avait sduit et en a tir une
multiplicit de figurines ou d'objets, tout un matriel de luxe qui
est transmis et survit en partie dans les civilisations raffines. L'tonne-
ment que nous prouvons devant la perfection que les prhistoriques
du Nord de l'Europe surent donner aux instruments de pierre polie
;
celui qui nous frappe devant ces images rupestres, o les artistes
des grottes de l'Espagne et du Sud-Ouest de la France reproduisaient
avec talent les animaux qu'ils rencontraient dans leurs chasses, nous
rvlent chez ces lointains anctres l'artiste qui est en nous.
Ainsi, travers les matriaux que la nature lui fournissait, parfois
en dpit de leur rbellion ou de leur insuffisance, l'homme a pour-
suivi des intentions, ralis de l'art. Obissant ses impulsions et
ses gots propres, il a humanis son usage la nature ambiante. Nous
voyons des degrs divers une srie de dveloppements originaux.
Le matriel, si appauvri qu'il nous soit offert aujourd'hui, des civilisa-
tions autonomes qui se sont formes, dans les milieux diffrents que
nous a rvls la connaissance de la terre, reprsente, non un dbut,
mais toute une srie d'eforts accomplis sur place. Ces civilisations
rudimentaires, qui nous reportent aux priodes archaques de nos propres
civilisations, sont dj pourtant elles-mmes un aboutissement, un
rsultat de progrs dans lesquels se sont visiblement exercs l'initiative,
la volont, le sens artistique.
II.
STAGNATION ET ISOLEMENT
Il est alors assez surprenant de constater que beaucoup de ces civi-
lisations se sont arrtes en route, que la srie des progrs s'est inter-
rompue, et que, en bien des endroits, la sve d'inventions semble
s'tre tarie. Les mmes procds de culture se rptent sans modifi-
cations au Soudan (bien que de nouvelles plantes venues d'Amrique
s'y soient introduites). La mme charrue qu'il
y
a plusieurs milliers
d'annes est en usage sur les bords de la Mditerrane, chez les Ber-
bres. Les types d'habitations, cases cylindriques en pis et en paille,
cases rectangulaires toits inclins et piliers de soutien, se rptent
satit, suivant les zones, dans le Centre et l'Ouest africain. Le for-
geron ngre travaille avec son appareil portatif comme le faisaient ses
lointains anctres. Les couffins du Fellah gyptien, les jarres du pays
L'VOLUTION DES CIVILISATIONS 203
castillan restent fidles des types depuis longtemps fixs et dsormais
invariables que reprsentent les monuments figurs.
Mme dans ces contres de civilisation avance, le cercle des genres
de vie s'est ferm. Les richesses minrales dont la Chine abonde n'ont
pas fait du Chinois un mineur. Cet ingnieux cultivateur ne s'est
adonn ni l'horticulture, ni l'levage. Les mmes errements per-
sistent sans changement sensible. De telle sorte qu'aprs avoir not
les indices d'une volution capable d'atteindre une perfection relative,
nous notons une certaine impuissance, soit pousser plus loin, soit
aborder des directions diffrentes. La srie d'efforts par lesquels,
chasseur ou pcheur, agriculteur ou pasteur, l'homme a assur son
existence, semble avoir aiguill son intelligence dans un sens dont elle
ne dvie plus. Un moment arrive o ces efforts s'arrtent. Si rien ne
vient de nouveau solliciter l'activit, elle s'endort sur les rsultats
acquis. Une priode de stagnation succde des priodes de progrs
ainsi qu'il est advenu en Chine et ailleurs.
L'homme est sollicit vers l'inaction par une pente naturelle. Une
tentation de torpeur le guette. On a vu des naufrags que le hasard
avait runis dans l'archipel de Tristan da Cunha, s'y habituer une
vie de lenteur et d'indolence, au point qu'au bout d'une gnration
ou deux, ils taient incapables d'en affronter une autre. Il faut donc
qu'une force trangre intervienne. Si nous en croyons le pote l'ac-
tivit humaine ne peut que trop aisment s'endormir. Elle ne tarde
pas se complaire dans un tat complet de repos. C'est pourquoi
je tiens lui donner ce compagnon qui aiguillonne et agit et qui,
tant le diable, doit crer.
^
Diable ou non, ce principe d'inquitude et de mcontentement,
capable d'action cratrice, existe dans les replis de l'me humaine,
mais il n'agit qu' son heure, suivant le temps et les hommes. Pour
qu'il s'veille il faut que l'ide du mieux se prsente sous forme con-
crte, qu'on entrevoie ailleurs une ralisation capable de faire envie.
L'isolement, l'absence d'impressions du dehors semblent donc le pre-
mier obstacle qui s'oppose cette conception du progrs. Effective-
ment, les socits humaines que les conditions gographiques ont
tenu l'cart, soit dans les les, soit dans les replis des montagnes, soit
dans les dserts, soit dans les clairires des forts, paraissent frappes
d'immobilit et de stagnation. C'est en Islande, chez les Touareg,
dans le Kafiristan, que l'archasme offre aujourd'hui ses meilleurs
types.
1 Des Menschen Tatigkeit , Faust, scne 1.
204 LES FORMES DE CIVILISATION
Mais il
y
a aussi un autre isolement, celui que l'homme se forge
lui-mme par ses crations, par tout ce qu'il chafaude sur ses
uvres. A ces inventions, dans lesquelles l'homme a mis une part de
lui-mme, ces genres de vie qui absorbent toute son activit, il mle
ses sentiments, ses prjugs, toutes ses conceptions de la vie sociale.
Il
y
ajoute une conscration religieuse que leur prtent le culte de
ses anctres, le respect d'un pass qui s'enveloppe de mystre. Il finit
ainsi par tisser autour de lui une toile paisse qui l'enlace et le paralyse.
La vie tout entire du Ngre de Guine est emptre de rites et de
superstitions qu'il serait aussi dangereux d'enfreindre que celle du
tabou polynsien. Le paysan traditionnel chez nous, comme le culti-
vateur hindou, cambodgien ou chinois, sont des personnages scrupu
leux, fervents observateurs de pratiques telles que l'essentiel ne s'y
distingue plus du parasite. Chaque opration se complique de rgles
d'observance entre lesquelles l'initiative n'a plus de jeu pour s'exercer.
Le genre de vie, entr ce point dans les habitudes, devient un milieu
born dans lequel se meut l'intelligence. Le nouveau parat l'ennemi
;
on voit sous ces influences des organismes sociaux se cristalliser et,
faute de renouvellement, des uvres combines pour le bien commun
devenir des conservatoires de routine.
On a dit avec raison que la base de la socit chinoise est la famille.
Une hirarchie rigoureuse en relie les membres, unis par le culte com-
mun des anctres. Il est incontestable que cette force du lien familial
a puissamment aid cette socit grossir les rangs de sa population,
faire prvaloir une discipline commune, et qu'elle a t une source
de vertus sociales. Mais n'a-t-elle pas entrav le progrs ? Ce qui con-
vient une socit patriarcale ne convient pas une socit moderne.
On est port se demander si ce patronage du chef de famille ne res-
treint pas l'esprit d'initiative, s'il ne s'oppose pas au dveloppement
de l'individu ? L'individualisme, briseur de routines, n'a gure sa
place dans un cadre qui, depuis la naissance, s'ajuste tous les actes
de l'existence, et ne lche mme pas aprs la mort.
Comme on l'a souvent remarqu, le dveloppement outr des insti-
tutions communales rtrcit l'horizon et produit, mme au sein de
populations trs denses, un isolement factice. La communaut de
villages, telle qu'elle est pratique dans l'Inde du Nord, le mir (ou
commune) russe, l'organisation ancienne des villages groups dans une
partie de l'Europe occidentale, sont comme des conservatoires per-
sistants de mtiers spciaux, de procds agricoles, de types d'assole-
ments dont, une fois fixs, on ne pouvait gure s'carter.
Ces organisations supposent une entente fonde sur des expriences
L'VOLUTION DES CIVILISATIONS 205
sculaires et rsumant de longs efforts d'initiative, mais elles indiquent
aussi que, se reposant sur les rsultats acquis, l'intelligence a cess
d'en poursuivre d'autres ; et, par l, ce qui tait mouvement s'est
fig ;
ce qui tait initiative est devenu habitude
;
ce qui tait volont
est tomb dans le domaine de l'inconscient. C'est ainsi que, parmi les
socits animales, certains groupes ont su s'lever une organisation
suprieure. Pour que la fourmi reste attache sa fourmilire, l'abeille
sa ruche, il a fallu d'incalculables progrs antrieurs, mais les progrs
se sont arrts ou sont devenus peu prs insensibles. Il ne reste des
inventions passes qu'une impulsion qui se communique automatique-
ment aux gnrations successives.
III.
LES CONTACTS
Il peut se faire que le contact d'autres civilisations glisse sans
entamer profondment ces organismes endurcis. Des emprunts peuvent
se produire, mais ils restent superficiels entre socits peu prpares
ragir l'une sur l'autre. Lorsque le continent noir entra, par l'inter-
mdiaire des Espagnols et des Portugais, en contact avec l'Amrique,
un grand nombre de plantes comestibles s'introduisirent dans l'agri-
culture africaine. Le manioc, le mas, l'arachide, l'ananas, et peut-tre
l'igname et la patate, ont t apports vers le xv^ sicle sur le conti-
nent noir
1
, en un mot, la plupart des plantes qui servent aujourd'hui
de base l'alimentation. Cet accueil montre une certaine aptitude
au progrs. Voit-on cependant que les procds de cette agriculture
tropicale africaine aient t sensiblement modifis, que la charrue
ait remplac la houe, que les moyens d'amendement et de renouvelle-
ment du sol se soient substitus aux habitudes traditionnelles ? En
aucune faon. Les pratiques agricoles lies au genre dvie ont persist,
avec les organismes sociaux auxquels elles taient adaptes et qui
taient ns avec elles. La vie de village, dans un cercle de culture
born, est reste le trait dominant de civilisation. L'addition de quelques
plantes n'y a rien chang. L'horizon de ces petites communauts,
isoles entre elles et livres par l aux entreprises conqurantes du
dehors, est rest aussi restreint que prcdemment. Aucune vie urbaine
solide, en dehors de la priphrie saharienne, n'a pris racine sur ce
sol, non qu'il ft rebelle la civilisation, mais au contraire parce qu'une
civilisation exclusive s'y tait fait place.
1. A. Chevalier, t. I, fasc. I, Historique de l'agriculture en Afrique occidentale
franaise.
206 LES FORMES DE CIVILISATION
L'introduction du cheval dans les plaines de l'Amrique du Nord,
par les Europens, fut une sorte de crise dans la vie des indignes.
Certaines tribus plus promptes utiliser ce moyen de guerre, durent
la mobilit qu'il leur procura, une supriorit d'attaque et une exten-
si on subite de puissance
;
on vit par exemple dans le Nord-Ouest
celle des Pieds-noirSy primitivement cantonne entre la Saskatchewan
et la Peace River, lorsque, vers le commencement du xviii sicle,
elle fut entre en possession du cheval, tendre subitement jusqu'au
Yellowstone et aux Montagnes Rocheuses le cercle de ses entreprises
aux dpens de ses voisines. Le nomadisme plus ou moins marqu,
qui tait inhrent la vie de chasse, reut certainement de cet auxi-
liaire venu d'Europe, un renfort et un surcrot d'expansion. Mais,
ce phnomne phmre se borne l'effet produit. La vie indigne,
en possession d'un moyen nouveau de persister dans son tre et domi-
ner ses voisins, aurait continu durer sur ses bases traditionnelles,
si la colonisation europenne n'y avait mis ordre.
Dans les cas cits, les genres de vie forms sur place font preuve
d'assez de rsistance pour adapter leurs propres besoins les innova-
tions que des circonstances trangres leur volont leur apportent.
Ils trouvent en eux-mmes de quoi se dfendre, et, dans leurs emprunts
mmes, de quoi se fortifier dans leur tre. Ils ne se modifient pas.
La substitution du cheval la locomotion pdestre, pas plus que celle
des armes feu l'arc ou la sagaie, ne changent rien d'essentiel
aux habitudes contractes de longue date, en rapport avec le milieu
local. Le choc direct de deux civilisations trs ingales ne produit
que des mouvements de surface. Mais, sous la pression des ncessits,
il n'y a pas de rsistances qui tiennent. Les exemples ne manquent
pas de transformations essentielles qui ont modifi, soit sous la pres-
sion du dehors, soit par le dveloppement de causes conomiques,
des socits solidement constitues, dj coules dans un certain
moule. Nous pouvons en juger en voyant de nos jours, sous l'influence
du march universel, le dveloppement de la vie industrielle et urbaine
aux dpens de la vie agricole et rurale, et en constatant qu'il en rsulte
des changements non seulement dans les modes d'exploitation, mais
dans les rapports sociaux, la natalit, les liens de famille, l'alimenta-
tion, etc. Nous sommes frapps, mus, souvent inquiets de ces faits
mais le pass en a connu d'analogues.
Du commerce, de la scurit sur mer, de la colonisation, naquit
autour de la Mditerrane une forme sociale qui atteignit sa plus haute
expression dans la cit. Ce fut une rvolution que celle qui substitua
la cit la bourgade, le culte de la patrie aux sanctuaires de famille.
L'VOLUTION DES CIVILISATIONS 207
un lien public aux liens de clientle
;
rvolution intellectuelle autant
que matrielle. Le costume changea
;
il se fit plus simple
; on cessa de
circuler en armes. L'me du citoyen s'harmonisa avec l'aspect de la cit.
labore, agrandie par Rome, la notion de cit devint une forme de
civilisation capable de se communiquer et de se transmettre des
groupes de plus en plus nombreux. Le rseau des voies romaines en
fut le vhicule. Du bassin mditerranen elle gagna une grande partie
de l'Europe centrale. Avec la conqute marcha le commerce
; l'usage
du vin et du froment se gnralisrent
;
des marchs s'ouvrirent
;
des cultures se propagrent. Cependant, dans cette Europe se dressait
en face du monde romain un type de civilisation bien moins avanc,
assez diffrent pour que son originalit ait frapp l'esprit observateur
de Tacite. Il
y
eut entre ces deux mondes non pas seulement conflit,
mais infiltration. Des sicles pnibles et douloureux s'coulrent avant
qu'une fusion s'accomplt. Elle se ralisa grce une forme religieuse,
sortie elle-mme du creuset mditerranen, issue du mlange d'hommes
et d'ides qui s'y tait accompli
;
le christianisme servit de trait d'union
entre les deux mondes qui semblaient s'exclure, romain et germanique.
Ce qu'avait fait Rome, Charlemagne le fit son tour : il fut fondateur
de villes.
Ces changements, d'ailleurs si dcisifs qu'ils aient t dans l'his-
toire des civilisations, sont loin d'avoir limin les formes sociales
antrieures. Il faut toujours tenir compte des varits et des survi-
vances dans l'tude des socits humaines comme des socits vgtales
ou animales. Mme autour de la Mditerrane, il s'en faut qu'ait dis-
paru la vie de clans avec les habitudes de circulation en armes, de sites
fortifis, de vendettas
;
l'Albanie actuelle est une remarquable survi-
vance, et non la seule, de cet archasme. Mais ces immdiates influences
de milieux locaux sont devenues des exceptions. D'autres germes
ont fructifi ct d'eux, d'autres formes de vie se sont fait jour, ont
exerc leur attraction. La civilisation a vu s'enrichir presque l'infmi
le fond sur lequel elle travailla.
IV.
CONTACTS PAR INVASION ET OPPOSITION DE GENRES DE VIE
L'Europe occidentale montre un dveloppement peu prs continu.
Il n'en a pas t de mme en Afrique du Nord et en Asie, au seuil de la
zone des dserts et des steppes. Depuis le Maroc jusqu' l'Inde, depuis
la Russie jusqu' l'Arabie, les socits n'ont pas cess d'tre en rap-
port
;
mais le contact a t le plus souvent hostile par l'opposition
des genres de vie. De grands empires se sont levs, depuis celui des
208 LES FORMES DE CIVILISATION
Perses jusqu' celui des Arabes et des Mongols. L'islam a tendu son
vaste domaine. Mais aucun de ces empires n'a dispos de la srie des
temps au mme degr que la Chine ou que Rome, continue par le
christianisme. Les invasions arabes, turques, mongoles, ont interrompu
le lien dans l'Afrique du Nord et en Espagne, en Asie Mineure, en
Perse, dans le Nord de l'Inde, aussi bien que sur les bords du Dnieper
et de la Volga
;
elles ont t un hiatus dans le dveloppement normal
des socits
;
elles ont amen une dviation, d'incessantes ncessits
de recommencement. Si ces migrations, dont nous entretient dj
Hrodote, et qui, surtout du iv^ au x^ sicle de J.-C, s'coulent sans
arrt de l'Alta l'Asie occidentale, ont cess en grand depuis
un sicle ou deux ;
elles se poursuivent en petit entre tribus, entre
clans et villages voisins : de Kurdes Armniens, d'Albanais Slaves,
de Bdouins Fellahs.
Cependant, travers ces vicissitudes, on observe la persistance
peine marque d'anciennes civilisations : l'Egypte, sous ses travestisse-
ments successifs, garde dans sa race sa physionomie de sphinx. Le
Persan vit de ses souvenirs et de ses potes. L'Asie Mineure, le Nord
de la Perse, le Turkestan, ont t turquifis , mais comme les murs
hellniques apparaissent Athnes sous le crpissage turc qui s'caille,
il n'est pas impossible de dcouvrir le fond de civilisations anciennes
qu'ont laiss en Asie Mineure les Thraces, Phrygiens, Hittites, Ara-
mens, comme en Armnie et Iran, tous ces vieux peuples fondateurs
de sanctuaires et de monuments. Les vieilles religions naturalistes de
Syrie se sont miettes en sectes diverses.
Ce que les invasions ont impos
et l, c'est la langue, vtement
extrieur. Encore mme, pour suffire aux exigences d'une vie plus
complique que celle des steppes, les dialectes turcs, tartares qui ont
remplac dans le Nord de l'Iran, et des deux cts du Pamir, les dia-
lectes iraniens, ont-ils d faire de larges emprunts au persan et
l'arabe. Quant la langue du camp, VUrdu, forme autour des souve-
rains mongols de Delhi, elle n'est autre que la langue hindoustani
imprgne de vocabulaire persan.
L'islam, malgr ses cadres simples et rigides, n'a pas chapp
la loi : il s'est transform suivant les milieux o il s'enracinait : mara-
boutique en Berbrie, chiite en Perse, altr dans l'Inde au contact
de l'hindouisme. Il a volu suivant les milieux.
Le rsultat a t un fractionnement de religions en sectes, de natio-
nalits compactes en poussires de nationalits. Armniens, Parsis,
Juifs, Syriens sont des dbris de peuples, dont l'axe s'est dplac.
Le commerce, l'industrie sont devenus leur monopole, comme autre-
L'VOLUTION DES CIVILISATIONS 209
fois celui du Phnicien et des Grecs autour des vieilles civilisations
d'Egypte et d'Assyrie. Ce sont des essaims qui vivent et pullulent en
marge de grandes socits et rendent le service d'entretenir, entre des
corps tendant l'inertie, un reste de circulation.
Contre ce fractionnement ragit l'poque prsente. D'hier seulement
la balance penche de nouveau. L'Afrique du Nord, l'Asie centrale,
l'Inde et l'Egypte sont entres dans le cercle des grandes dominations.
La Turquie et la Perse sentent le cercle se refermer autour d'elles.
V.
CONTACTS PAR LE DVELOPPEMENT DU COMMERCE MARITIME
Sur un autre point la vie se rallume. Le monde occidental n'avait
eu que de rares et lointaines chappes sur les grandes civilisations de
l'Extrme-Orient : le contact devient aujourd'hui plus intime et c'est
une des plus intressantes expriences humaines qui s'accomplit.
L'Inde, depuis 1860 avec Lord Dalhousie, a t sillonne de chemins
de fer sous le contrle d'une domination trangre. Dans ces dernires
annes, le rail a pntr en Chine. Depuis la date fatidique du 8 juil-
let 1853 o l'escadre du Commodore Perry parut Yedo, le Japon
s'est ouvert, d'abord demi, puis largement
;
il a inaugur son premier
chemin de fer en 1872
; aujourd'hui ses usines, sa science et jusqu'
son costume sont europens. Nul n'est parti plus tard et n'a march
plus vite. Cette mtamorphose dconcerte et, cependant, il semble
que, cette fois encore, ce peuple n'ait fait qu'obir une loi parti-
culire de son dveloppement, que cette dernire mue soit une rp-
tition de celle qui mit jadis le vieux Japon l'cole de la Core et de la
Chine. Lorsqu'au vi^ sicle de notre re, le boudhisme pntra au
Japon, il accomplit une rvolution semblable celle que, dans notre
Occident, le christianisme apporta au monde barbare. Sous ces em-
prunts, le Japon a jalousement conserv son originalit de peuple
insulaire dans son cadre de montagnes et de dcoupures littorales,
ses plerinages aux sanctuaires ombrags sous les cryptomerias,
le got de sa riante nature fleurie et de l'art religieux qui l'interprte.
Est-ce de ses avatars antrieurs qu'il a acquis sa singulire aptitude
s'approprier la science europenne, s'assimiler ce qui lui a paru
essentiel dans les civilisations extrieures
; nous serions fort embar-
rass de dire s'il faut en faire honneur des qualits de race, sa com-
position ethnique, sa position gographique
; notons seulement que
le prsent ne dment pas le pass.
Le cas insulaire du Japonais offre un frappant contraste avec l'atti-
tude des civilisations continentales qui se sont enracines, poussant
Vidal-Lablache, Gographie humaine. 14
210 LES FORMES DE CIVILISATION
des rejetons autour d'elles : celle de Chine ou de l'Inde. Le commerce
de l'Europe et celui des tats-Unis font l'envi le sige du Chinois :
ils n'ont encore russi qu'imparfaitement introduire en lui de nou-
veaux besoins. S'ils
y
parviennent pour quelques articles, c'est la
condition de se plier ses gots et ses coutumes. Habitue rpandre
sa civilisation autour d'elle, se considrer comme le centre du monde,
la Chine se rsigne mal au rle de disciple. Elle se retranche dans sa
mentalit orgueilleuse. Aux ides subversives de l'Europe ou de l'Am-
rique, leurs articles exotiques, elle oppose sa morale, sa philosophie,
ses traditions littraires, ses habitudes domestiques, sa conception
du luxe et du bien-tre. Aux comptiteurs jaloux lui offrant qui ses
cotonnades et ses machines, qui son ptrole, qui ses allumettes, elle a
longtemps oppos un flegme ddaigneux. Elle cde cependant et com-
mence prendre quelques marchandises. Le Chinois, disent nos
Lyonnais, devient un intressant personnage conomique . Une
priode de fermentation a commenc dont il est impossible de prvoir
les tapes. Mais, de la Chine comme du Japon, on peut dire la mme
chose : l'imitation de l'tranger ne vient que du dsir de se passer de
lui, un sentiment de xnophobie en est le principe.
Au contact de ses matres britanniques, l'Inde a certainement vo-
lu
;
mais dans quel sens ? Tout ce que les Anglais ont tent pour
modifier par ce qu'ils croyaient avantageux la constitution sociale
du pays, pour crer, par exemple au Bengale, une aristocratie ter-
rienne en favorisant les zemindari au dtriment des ryotts
(1793),
a chou ou tourn mal : ils ont russi au contraire en s'appuyant
sur les organismes traditionnels, en dveloppant le rgime municipal,
en respectant les souverainets indignes. Les castes n'ont en rien
cd de la prise qu'elles exercent. Tout l'difice social est rest peu
prs intact. L'ducation, la presse, les universits, la diffusion de la
langue anglaise ont affect la mentalit indigne, mais dans un sens
autre qu'il n'tait prvu. Des mdecins, des chirurgiens habiles ont
pu se former parmi les indignes
;
l'axe de la pense n'a pas t dplac.
Jamais l'attention des lettrs hindous ne s'est plus porte vers les
anciens livres sacrs que depuis que la science europenne les a tou-
chs du bout de son aile. Et quant au peuple, on a remarqu qu'un
des principaux rsultats des facilits donnes aux voies de com-
munication, a t d'augmenter l'affluence de plerins vers les vieux
sanctuaires. Ainsi la branche tordue par le vent reprend sa direction
premire.
Une consquence, et celle-ci capitale, de la domination britan-
nique, se dgage ds prsent : c'est la conscience d'une certaine
L'VOLUTION DES CIVILISATIONS 211
unit de
civilisation entre membres disparates qui s'ignoraient dans
l'Inde d'hier.
VI.
CARACTRE GOGRAPHIQUE DU PROGRS
Lorsque Pascal parle de la suite des hommes comme d'un seul
homme qui subsiste toujours et qui apprend continuellement, il
exprime une vue philosophique de l'esprit, que confirme l'tat actuel
de la civilisation. Mais cela n'implique nullement que le progrs marche
du mme pas rgulier et uniforme. Le cours de l'histoire abonde
l-dessus en dmentis. Encore aujourd'hui, nous voyons dans la
moiti environ de la terre des socits qui n'ont rien appris depuis
des milliers d'annes, fixes, comme un cran d'arrt, sur une somme
de progrs qui, une fois atteints, n'ont pas t dpasss. Ces progrs
avaient permis ces socits locales de vivre et subsister sur place
;
elles n'ont pas t plus loin.
Il
y
a, cependant, des parties de la terre o, travers bien des
vicissitudes, les progrs n'ont t que rarement arrts, o, non sans
accident, le flambeau a pass de main en main. A quoi tient ce privi-
lge et pourquoi ces diffrences ? Il
y
a dans ces faits une rpartition
laquelle les causes purement gographiques ne sauraient tre tran-
gres.
Est-ce hasard si les terres concentres dans l'hmisphre boral
de l'ancien monde, entre la Mditerrane et les mers de Chine, ont vu
se produire la plupart des grands vnements qui ont guid les civiU-
sations ?
On est frapp de l'envergure qu'y prennent les faits sociaux, reli-
gieux ou politiques, qui servent de points de repre dans la marche
du progrs. L, par exemple, s'est opre la diffusion de mmes familles
de langues, expressions de mmes habitudes d'esprit, aryennes depuis
l'Inde jusqu' la Germanie, smitiques de l'Arabie au Maghreb.
L aussi s'est faite la diffusion de formes religieuses bases morales
et philosophiques. Deux des principales religions entre lesquelles se
partage l'humanit, le christianisme et l'islam,
y
ont trouv non
seulement leur berceau, mais leur aire de propagation. Et s'il est dou-
teux qu'il
y
ait, au sens o l'entendit Oscar Peschel, une zone de
fondateurs de religion
i,
il est permis d'admettre qu'il
y
a des par-
ties de la terre o les formes religieuses ont dispos de facilits sp-
ciales d'expansion. Le bouddhisme lui-mme, n dans l'Inde, n'a-t-il
1. O. Peschel, Volkerkunde, etc..
212 LES FORMES DE CIVILISATION
pas chemin travers l'Asie centrale au moyen des routes de com-
merce qui avaient dj rvl l'Occident la contre appele Srique ?
Mmes remarques sur les genres de vie. La plupart des procds
de la vie agricole, mthodes d'irrigation, cultures d'arbres fruitiers,
usage de la charrue, se sont largement rpandus dans les contres
qu'embrasse cet ensemble. La vie pastorale, toujours si dveloppe
dans cette zone, implique un nomadisme qui la fait, il est vrai, gn-
ralement considrer comme un genre de vie infrieur. En ralit,
ce type, tel qu'il s'est organis en Asie et dans le Nord de l'Afrique,
de l'Alta l'Atlas, aux confins des steppes, avec points d'appui et
relations d'change dans les oasis ou dans les rgions limitrophes
de culture, reprsente une forme relativement leve de civilisation.
Il entretient, par les caravanes et les bazars, des rapports tendus
;
il favorise, aux points de contact, la formation de marchs et de
villes
;
il dfraie enfin le luxe patriarcal de la tente. De grands faits
historiques, ayant fortement brass les hommes, ont pris naissance
dans ce milieu. On a vu les familles et les tribus se combiner en conf-
drations, s'agglomrer en hordes qu'ont signales des clairs de puis-
sance quasi mondiale. Le cas de l'Empire mongol, qui fit au xiii^ sicle
trembler l'Europe, ne fut pas un phnomne isol et sans racines.
VII.
LES NOYAUX
Il
y
a des contres o la chane du progrs a t rompue (Europe
orientale, Asie occidentale), o elle ne s'est renoue que plus tard
ou imparfaitement. Il
y
en a d'autres o les progrs n'ont jamais t
tout fait interrompus, qui n'ont pas prouv ces hiatus funestes.
Les formations politiques s'y sont succd en rapport les unes avec
les autres (Europe occidentale et centrale, Egypte mme, etc.).
En somme, les faits gnraux, dans l'histoire des socits humaines,
ne se produisent jamais d'emble. Il faut pralablement triompher
des obstacles accumuls autour de chaque groupe par les distances,
la nature des lieux, les hostilits rciproques. Un dveloppement
embryonnaire prcde le plein panouissement de l'tre. Il faut donc
remonter un peu plus haut dans la chane des faits.
Le christianisme romain s'inscrit dans les cadres de l'Empire d'Oc-
cident, comme le christianisme grec dans celui de l'Empire d'Orient.
C'est aux dpens de cet Empire et de ceux des Perses et des Sassanides
que l'islam a constitu son domaine. Mais ces diffrents Empires
s'taient forms eux-mmes d'lments antrieurs, avaient absorb
en eux ceux d'Egypte, de Chalde, de Macdoine. Continuant remon-
L'VOLUTION DES CIVILISATIONS 213
ter l'chelle du pass, ces grandes formes d'organisations politiques
se dcomposent en plus petites contres, en une multitude de foyers
distincts dous de vie propre. La puissance pharaonique s'lve sur la
multitude de nomes clos sur les bords fertiliss du Nil. De petites
royauts, dont quelques noms seuls nous sont parvenus, entrent dans
la charpente des Empires du Tigre et Euphrate. Un essaim de cits
analogues celles qui s'taient formes Athnes, Corinthe, Milet,
se rpandent le long de la Mditerrane, en face des colonies issues
de Sidon, Tyr et Carthage. La puissance de l'trurie se fond dans celle
de Rome
; et la conqute romaine, son tour, absorbe la civilisation
de type Hallstatt pralablement forme au Nord des Alpes.
Ainsi ces phnomnes dont l'ampleur nous tonne, n'ont fait que
rsumer des dveloppements antrieurs. Ce que l'on distingue l'ori-
gine, c'est la multiplicit de foyers distincts, l'action de socits
de dimensions moindres, microcosmes, agissant chacun dans leur
sphre. Ce sont elles qui ont servi de noyaux aux organisations plus
vastes qui ont hrit de leur travail. Elles s'taient formes elles-
mmes, la faveur des circonstances rgionales, dans des conditions
particulires de milieux. Les alluvions fluviales du Nil et de l'Eu-
phrate, les articulations du littoral mditerranen, les voies d'abou-
tissement de l'arrire-pays continental, par le Rhne, le Danube,
le Nord de la Mer Noire ou la Syrie : tels avaient t, dans ce coin
du monde, sommairement rsums, les avantages qui avaient concouru
entretenir la vie entre ces socits de formation distincte et originale.
Du rapprochement et du mlange de ces divers lments se sont
forms des empires, des religions, des tats, sur lesquels a pass,
avec plus ou moins de rigueur, le rouleau de l'histoire, avec ses chutes
et ses retours, ses actions et ractions, ses flaux et ses bienfaits :
toutes les contingences en un mot qu'entrane le jeu des causes hu-
maines. Mais travers ces contingents filtrent les influences gogra-
phiques.
Une rpercussion rciproque n'a cess presque aucun moment
d'agir entre les socits qui ont couru leurs destines diverses dans
l'espace que circonscrivent l'Europe, l'Asie occidentale et l'Afrique
du Nord. EHes ont engendr des rapports qui annoncent ceux que,
dans notre monde contemporain, a cr l'extension des voies de com-
merce. L'agrandissement des horizons a t progressif. Les voies ro-
maines et la navigation maritime permirent un dveloppement urbain
dont Rome et Alexandrie sont les types. Rome eut son grenier en
Egypte, comme notre Europe urbaine et industrielle a le sien par del
les mers. Une balance s'opra entre les pays nourriciers et les pays
214 LES FORMES DE CIVILISATION
consommateurs. On peut ainsi, dans le spectacle conomique du monde
romain, apercevoir dj, entre l'Italie, la Gaule et la province d'Afrique,
quelques-uns des rapports qui ont leur plein dveloppement sur une
chelle infiniment plus vaste, dans le monde contemporain.
Cette prcocit singulire tient des causes gographiques : non
pas des causes simples, mais un ensemble trs complexe dont la
force s'est rvle grce une continuit de relations. Ni les grands
fleuves riches d'alluvions, ni la vivante Mditerrane, ni les riches
plaines du Danube et de la Russie mridionale, ne suffisent par elles-
mmes expliquer la persistance, sous des formes diverses, de civilisa-
tions progressives. Mais la rpartition des terres et des mers, l'interca-
lation des plaines et des montagnes, le rapprochement des pays de
steppes et des pays de forts ralisent dans cette partie du globe un
agencement tel que les causes gographiques ont pu mieux qu'ailleurs
combiner leurs effets. Il
y
a eu comme une srie d'initiations rci-
proques. Ce phnomne historique ne s'est produit que l
;
car les
civilisations amricaines sont restes confines sur les plateaux, et la
civilisation chinoise, si remarquable tant d'gards, est reste presque
exclusivement attache aux plaines. La civilisation dont l'Europe
moderne est l'hritire finale, s'est nourrie l'origine d'une foule
de foyers distincts, a absorb la substance d'un grand nombre de
milieux locaux. C'est de ces antcdents, de cette longue laboration
sculaire, que des rapports mutuels ont maintenue active, qu'elle a
tir sa richesse et sa fcondit. La convergence des formes de confi-
guration et de relief, le rapprochement des rgions dcouvertes et
des rgions boises, ont mnag un concours de rapports et d'nergies
gograpliiques qu'aucune autre rgion du globe n'a connu au mme
degr.
TROISIME
PARTIE
LA CIRCULATION
TROISIME PARTIE
LA CIRCULATION
CHAPITRE I
LES MOYENS DE TRANSPORT
I.
L'HOMME
Dans toutes les contres o il s'est trouv, l'homme s'est ingni
ds l'origine rsoudre le problme du transport et de la circulation.
Il s'est servi d'abord pour cela des moyens que lui offrait son propre
corps. Une premire cause de diversits fut l'adaptation de ce corps
aux instruments qui furent invents pour lui servir d'auxiliaires.
Tantt c'est un coussinet qui, assujettissant le fardeau sur la tte,
donne la dmarche des femmes une allure de cariatide, tantt c'est
un bton sur lequel s'appuie le portefaix dont les paules plient sous
le poids. Le coolie, dans les contres o crot le souple bambou, fixe
sur ses paules une longue tige aux extrmits de laquelle deux charges
se font quilibre. Le Mexicain de l'Anahuac s'avance le front inclin,
la faon du buf, sous l'treinte des courroies qui retiennent par
derrire son fardeau. Le hammal turc ou notre vigneron conservent
l'attitude que leur impose la hotte. On sait que le geste humain aux
prises avec le fardeau a fourni aux arts plastiques des thmes in-
puisables, qui sont le meilleur commentaire de ces originales diversits.
Le transport par hommes, le plus tenace comme le plus archaque
de tous les modes de transport, est la base de toute tude gnrale
sur cette question. Dans les contres des Andes, o il a longtemps
rgn, peu prs sans partage, il semble que l'exercice de la course
218 LA CIRCULATION
ait agi sur le temprament. L'appareil respiratoire des indignes leur
permet de gravir sans tre incommods des pentes qui mettraient un
Europen hors d'haleine
^.
On connat le rle considrable et anti-
social que joue ce genre de corves dans les parties de l'Afrique cen-
trale o existent des insectes pernicieux pour nos animaux de trans-
port. Le portage humain est parvenu se maintenir presque exclusive-
ment dans les contres, mme trs civilises, mais o l'extrme den-
sit de la population ravale ce point la main-d'uvre humaine,
qu'elle rend tout autre recours superflu. C'est le cas, parat-il, dans la
province chinoise du Sz-tchouan
2.
L'homme n'a pas dploy une moindre fertilit d'inventions pour
franchir les obstacles que pour allger les fardeaux. Avant de se hasar-
der sur mer, il rencontrait l'obstacle des eaux intrieures. Les pirogues
tailles dans un tronc de chne qu'on a exhumes de nos tourbires,
les barques en cuir calfates de roseaux qu'Hrodote dcrit sur le
haut Euphrate, montrent comment il sut utiliser les matriaux locaux.
Depuis l'Euphrate jusqu'au Hoang-ho, on emploie encore aujourd'hui
des peaux de buf gonfles pour passer les rivires. Le nouveau monde,
sous ce rapport, ne le cdait pas l'ancien : tmoin les lgers canots
transportables que les Indiens de l'Amrique du Nord savaient fabri-
quer avec des corces de bouleau. Rares sont les peuples l'actif
desquels on ne puisse citer d'invention originale. Les Pampens
et les Chiquitiens, dit d'Orbigny
^ n'ont jamais pens s'aider d'un
moyen quelconque pour passer les rivires. Mais les Guaranis et les
Moxens avaient de vastes pirogues... Les Araucaniens n'eurent sur
la cte que d'informes radeaux composs de troncs d'arbres
;
mais,
au sommet des Andes o le bois manquait absolument, les Aymaras
inventrent des bateaux forms de joncs solidement lis ensemble
;
sur les ctes sches d'Atacama, ils imaginrent de confectionner avec
des peaux de phoques deux immenses outres remplies d'air et atta-
ches ensemble.
On pourrait citer beaucoup d'autres exemples de ces procds,
dont les spcimens font aujourd'hui l'orgueil des muses ethnogra-
phiques. Ils nous montrent une multiple closion d'inventions locales
fortement marques l'empreinte du milieu. C'est tantt la flore,
tantt la faune, qui a t mise contribution. Les lianes souples et
robustes de la vgtation tropicale ont fourni pour le passage des
rivires d'autres expdients que ceux qu'avaient imagins les pasteurs
1. A. Grandidier, Voyage dans l'Amrique du Sud, p. 5.
2. La Mission lyonnaise en Chine, Lyon, 1898, p. 120.
3. A. d'Orbigny, Voyage dans l'Amrique mridionale, tome IV, p.
102.
LES MOYENS DE TRANSPORT 219
des steppes. Il n'est gure en somme de contres du globe o l'homme
n'ait trouv quelque matire premire utiliser
;
c'est plutt, en cer-
tains cas, l'effort d'esprit, l'initiative, que la matire qui a fait dfaut
.
Ce qu'on peut dire, c'est que les matriaux locaux qu'il parvint
adapter au transport, taient souvent de si imparfaits pis aller, qu'il
ne s'y serait pas obstin, pour peu que des emprunts au dehors eussent
t possibles. Tel est surtout l'enseignement qui rsulte de ces produits
primitifs de l'industrie humaine.
Le stade qu'ils reprsentent est celui des premiers et inutiles efforts
contre l'isolement qui enveloppait ces groupes locaux, qui emp-
chait les inventions de se transmettre et de se communiquer de l'un
l'autre.
Traner le fardeau plutt que le porter est une ide qui, par elle-
mme, n'implique pas une grande supriorit intellectuelle, puisque
la fourmi, le scarabe et d'autres animaux pouvaient en fournir le
modle l'homme. Mais elle fut chez lui un principe fcond d'inven-
tions mcaniques. L'usage d'interposer entre le sol et le fardeau qu'il
s'agit de mouvoir un corps cylindrique donna lieu, chez les Assyriens,
aux traneaux rouleau, que reprsentent leurs monuments. Mais
entre le rouleau primitif et les roues, soit pleines, soit vides, sur
l'essieu desquelles est pos le char, il
y
a la distance d'un trait de
gnie. O, quand se produisit-il ? On est embarrass de le dire, malgr
la lgende chinoise qui attribue ce haut fait un empereur rgnant
il
y
a plus de quarante sicles. Mais il est permis du moins d'liminer
certaines rgions de la liste de celles qui peuvent prtendre cette
invention. La rondelle taille dans un tronc d'arbre, qui fut le type
primitif de la roue ^, exigeait des arbres d'essence dure et de grand
diamtre. Ce ne sont point des matriaux qui abondent dans les
contres o les palmiers et les arbres bois tendre ou spongieux com-
posent surtout la vgtation. L'invention voque naturellement l'ide
du chne et des arbres rsistants qui peuplent les contres froides ou
tempres.
On peut allguer, d'ailleurs, que la vritable patrie d'une invention
est le milieu dans lequel elle se fconde et diversifie ses applications.
Tels furent il
y
a un sicle les pays miniers, pour le rail et la traction
vapeur. Dans les temps prhistoriques auxquels il faut remonter
pour l'origine du chariot roues, il n'y a que certaines rgions qui se
soient montres capables d'en gnraliser l'emploi et d'en multiplier
les applications : ce sont celles qui joignaient l'avantage d'une
1. Forestier, La roue, lude palo-technologique, 1 broch., Paris-Nancy, 1900,
220 LA CIRCULATION
vgtation propice celui d'un relief facile et de plaines unies sur une
grande tendue. A la rigueur la roue, mise en mouvement par la force
humaine, comme dans la brouette, peut s'accommoder d'un sol ingal et
raboteux. Mais dans le cas de traction animale, les conditions de sol
et de relief prennent une importance matresse. Or l'usage des cha-
riots a de beaucoup prcd la construction des routes, les indices
ne manquent pas, ds la haute antiquit, de l'attelage animal soit la
charrue, soit au char. La Chine, aussi bien que la Chalde, l'ont connu.
Le char de guerre figure dans les plus vieilles annales des peuples
de la Mditerrane. Il a pntr relativement tard en Egypte
; mais on
peut peu prs fixer l'poque o, dans sa marche progressive, il s'y
est introduit, du moins comme butin ou machine de guerre
; et ce fut
vers la XVIII^ dynastie, soit vers 1800 ans avant notre re.
Nous rencontrons donc une question sur laquelle il faut pralable-
ment s'expliquer.
Les applications de la roue se sont dveloppes en raison de l'em-
ploi de la traction animale : nous avons chercher quels taient les
animaux que l'homme avait su plier ses besoins de circulation et de
transport.
II.
LA TRACTION ANIMALE
On s'imagine parfois le centre de l'Asie comme une sorte de contre
privilgie d'o se serait chapp jadis, ainsi que d'une arche de No,
un lot complet d'animaux utiles. Il
y
eut en ralit, outre l'Asie cen-
trale, bien d'autres contres o l'homme s'est avis de se mnager
des auxiliaires : le Tibet, l'Inde, le Soudan, la rgion berbre-hispa-
nique, l'Europe centrale, les Andes. La varit des tempraments
spciaux forms en des milieux trs divers fut une circonstance utile
;
elle rpondit la varit des obstacles que l'homme avait surmonter.
Les animaux le plus anciennement domestiqus ne le furent pas en
vue du transport : le chien, le mouton, la chvre, animaux que, malgr
certains services occasionnels, on ne peut ranger dans cette catgorie,
prcdrent sans doute le buf, le cheval, l'ne, le chameau, etc.
Le buf fut peut-tre le premier animal de trait. C'est en cette qualit
qu'il apparat dans les traditions chaldennes, chinoises, comme dans
les mythologies germaniques. L'emploi des bovids comme porteurs
ne put jamais tre que restreint, comme il l'est encore. Mais l'effort
dont est capable ce front vigoureux, exerc rompre les taillis et
carter les obstacles, est le plus fort levier qui puisse, en s'associant
la roue, dplacer de lourdes charges. Rien, mme aujourd'hui, ne
LES MOYENS DE TRANSPORT 221
remplace la vache dans nos sentiers de montagnes, le buffle dans les
rizires et les marcages, le buf dans nos plaines betteraves. Nous
serions ports, toutefois, rabaisser les tats de service de cet auxi-
liaire dans l'histoire des dplacements humains et du commerce,
si de nos jours les migrations des Boers n'en avaient pas encore fourni
un exemple. Au xiii^ sicle, le buf tait l'animal le plus commun-
ment employ au roulage, dans le transit commercial qui s'oprait
entre la mer d'Azof et la Volga
;
c'est ce que nous dit la relation de
l'envoy de saint Louis, le moine Rubrouck.
Il a t nanmoins relgu au second rang, pour la circulation gn-
rale, par des animaux que d'autres milieux avaient prpars ce ser-
vice. C'est dans les rgions dcouvertes, o une vgtation clairseme
impose aux troupeaux en qute de nourriture l'habitude de franchir
de grandes distances, que le cheval et le chameau avaient contract
les qualits dont la domestication s'empara. Parmi les quids aux
jarrets nerveux, au dur sabot, aux puissants naseaux adapts aux
courses rapides, deux races domestiques se distinguent de bonne
heure : le cheval turcoman au front bomb, et le cheval iranien de
Mdie au front plat
^.
Mais rien n'empche de croire qu'il
y
ait eu
d'autres centres de domestication, par exemple dans l'Europe centrale
o des races de chevaux taient trs rpandues, l'tat de gibier,
ds les temps palolithiques. Les Celtes, antrieurs aux Germains
dans l'Europe centrale, avaient une supriorit que constate Tacite
dans cet levage. Les Grecs le reurent des peuples phrygiens ou
thraces, comme auparavant les Chaldens l'avaient emprunt aux
Mdes.
Nul doute que son ardeur et ses allures guerrires n'aient beaucoup
contribu son adoption par l'homme
;
mais, mme en cet emploi,
c'est dj associ au char que le montrent les guerres assyriennes
ou achennes. Animal et vhicule avaient donc t introduits ensemble.
Ce qui concourt prouver son introduction rcente dans le Sud de
l'Asie, c'est qu'au temps de Strabon il n'tait pas usit en Arabie
^
;
il ne s'y rpandit que dans les sicles qui prcdrent Mahomet. On
sait quelles qualits il devait
y
contracter
;
et ceci nous donne une
premire preuve de la souplesse d'adaptation dont il est capable,
grce de nombreuses varits de races, et qui lui a permis de peupler
1. Pitrement, Les chevaux dans les temps historiques et prhistoriques, Paris,
1883.
2. Strabon, XVI, 4, 2 ;
id., XVI, 4, 26. On sait qu'en revanche la mme poque
c'tait le cheval et non le chameau qui servait aux traverses sahariennes, moins
nombreuses d'ailleurs qu'elles ne le devinrent aprs l'Islam.
222 LA CIRCULATION
l'immense domaine qui s'tend du renne l'lphant, des Yakoutes
l'Asie et l'Afrique tropicales, sans parler de sa multiplication rcente
et phnomnale dans les Amriques !
Prjewalski a signal les chameaux l'tat sauvage entre le Tarim
et le Koukou-nor. C'est de l'Asie centrale que semble, en eiet, origi-
naire l'espce, dite bactriane, deux bosses : bte de somme, plus que
de trait
;
peu capable de vitesse, car elle ne fait gure plus de quatre
kilomtres l'heure
;
mais par sa sobrit, son instinct ^, son adresse
trouver lui-mme sa nourriture aux abords des campements, animal
trs propre soutenir des mois entiers de trajets
^
et jouer le rle de
navire au long cours des rgions arides. Ce n'est pas un guerrier
; ses
habitudes flegmatiques ne sauraient tre dranges sans dommage
;
et les expditions dans lesquelles on l'a, de nos jours, engag, soit
dans le Turkestan, soit dans l'Ar, ont t pour ces malheureux ani-
maux de vritables hcatombes. Pour la vitesse toutefois une slec-
tion habile semble avoir obtenu, ds l'antiquit, la varit prcieuse
du chameau de course, dromadaire ou mhari. C'est sans doute aux
Nabatens qu'en revient le mrite. Ces gens pres au gain, dit Strabon,
taient les caravaniers professionnels du transit antique entre la Baby-
lonie et l'Egypte. Leur monopole tenait la possession d'un stock
perfectionn d'animaux de charge. Sous le climat sec et salubre du
Nedjed le dressage leur permit d'obtenir des animaux plus rapides,
supportant mieux la soif
^.
Ils crrent ainsi un produit de concurrence.
Ce ne fut pas un mdiocre avantage pour les antiques socits qui
fleurirent entre la Mditerrane et le Sud-Ouest de l'Asie, que de
pouvoir concentrer leur profit les produits des deux faunes diff-
rentes. Si le cheval et le chameau leur vinrent du Nord, l'ne leur vint
du Sud. L'ne est un africain, issu, non comme on l'a cru, en le confon-
dant avec l'hmione, des steppes de Msopotamie, mais de la zone
dcouverte plantes rigides qui spare le Sahara du Soudan
*.
Il s'est
rpandu vers le Nord par deux voies diffrentes : d'un ct par les
pays de l'Atlas anciennement unis l'Espagne
;
de l'autre, par la
valle du Nil. C'est dans la Haute-Egypte qu'il fut domestiqu ds
1. Son instinct le guide travers les pistes que le sable recouvre (Bonin,
Voyage de Pkin au Turkestan Russe, La Gographie, 1901, p. 120).
2. Il peut faire en 30 jours la traverse du Gobi. (Mission Duireuil de Rhins
;
Grenard, t. II, p. 199.
FuTTERER, Geogrophische Skizze der Wliste Gobi,
Pet. Mitt. Erg. hejt n 139, p. 130.)
3. Le dromadaire peut rester 5 6 jours sans boire. Il parcourt en 6 jours les
600 kilomtres de Hal Bassora.
4. Fr. Lenormand, Sur l'antiquit de Vne et du cheval comme animaux domes-
tiques en Egypte et en Syrie, Comptes rendu de l'Acadmie des Sciences, LXIX,
1869, p.
1256-1258. -
Observations de Milne-Edwards, p. 1269.
LES MOYENS DE TRANSPORT 223
les temps les plus anciens, car les monuments le montrent, ds les
premires dynasties, aussi multipli qu'aujourd'hui. Il
y
tait l'objet
d'une demande incessante laquelle pourvoyaient les convois venus
par eau de Nubie. Tels taient les services auxquels ses qualits le
prparaient pour les pays de petites cultures, de relief morcel, de
transactions locales qui abondent sur le pourtour de la Mditerrane,
qu'il s'y propagea rapidement et qu'il finit par
y
devenir le compagnon
familier, le soutien social de la classe des petites gens.
Mais, comme ne tardrent pas le remarquer les spcialistes, sa
propagation vers le Nord est limite. Il ne supporte pas, disaient les
Grecs, les froids de la Scythie. Tandis que de nos jours il est d'usage
commun dans le Turkestan oriental, il manque au Nord des Tian-
chan
^.
C'est ce qui suggra l'ide de recourir au produit artificiel
n de l'accouplement de l'ne et de la jument. Le mulet parat, dans les
sculptures assyriennes, bt et harnach comme de nos jours. De bonne
heure, il donna lieu des centres de production et de march : c'tait
l'Armnie et la Cappadoce aux temps homriques, comme aujourd'hui
c'est le Poitou pour l'Espagne, le Yunnan pour le Tibet, les tats
argentins de Jujuy et de Salta pour la Bolivie. Quels furent les centres
primitifs de production o s'approvisionna la Chine ? Tout ce que nous
pouvons dire, c'est que l'usage du mulet fut trs anciennement pra-
tiqu dans la Chine du Nord. Dans ce cas, comme dans bien d'autres
analogues, on ne saurait tre trop frapp de ce fait significatif que,
spare tant d'gards de nous par le reste de ses habitudes mat-
rielles et intellectuelles, la Chine du Nord s'en rapproche au contraire
singulirement par une trs ancienne analogie de moyens de transport.
Et cette communaut s'arrte la Chine du Nord
;
elle ne va pas jus-
qu'au Japon.
Auprs de ceux que nous venons d'numrer, les autres auxiliaires
que l'homme s'est associs pour le transport, n'ont qu'une importance
locale. L'lphant, dans sa carrure superbe, est un luxe de rajah ou
une machine de guerre, plutt qu'un serviteur domestique. Le solide
quilibre du yak, cal sur ses jambes courtes, le rend indispensable
dans les escalades du Tibet oriental
;
mais il ne s'accommode que des
hautes altitudes. Le renne excelle plus que tout autre se dptrer
en t, dans les bourbiers de la toundra
;
mais il fuit nos tempratures
d't et la douceur des climats ocaniques. Le lama fut l'unique bte
de somme des anciennes civilisations amricaines, mais sa rsistance
est limite, et il ne fait gure que trois ou quatre lieues par jour.
1. Mission Dutreuil de Rhins (Grenard), t. II, p. 199.
224 LA CIRCULATION
En somme il rsulte de ce qui prcde que, sans qu'il puisse tre
question de foyer commun, il
y
a eu pourtant une rgion o l'emploi
de la force animale au transport et la traction trouva des conditions
particulirement propices, et fut de bonne heure, par imitation
ou mulation, pouss trs loin : c'est la rgion semi-pastorale et semi-
agricole qui traverse en diagonale la partie tempre de l'ancien
continent. L'adaptation de certains animaux suprieurement appro-
pris cet usage entrane celle d'animaux mme mdiocrement dous
;
tandis qu'au contraire en Amrique o, malgr une vidente inf-
riorit, certaines ressources auraient t disponibles, ni le bison, ni
le caribou ne furent domestiqus.
III.
LES VHICULES
Les obstacles sont trs ingalement rpartis la surface des terres.
Certaines rgions se prsentent comme particulirement rebelles :
telles sont les chanes plisses de l'Eurasie ou des Cordillres amri-
caines
;
tels encore, les marcages des contres tropicales pluies
priodiques
;
telles surtout les silves quatoriales d'Afrique ou d'Am-
rique. Mais d'autres parties de surfaces continentales offrent des faci-
lits naturelles la circulation. Ce sont principalement les contres
o, l'accumulation l'emportant sur l'rosion, la surface est couverte
d'un manteau de terres qui aplanit les accidents du relief. Ces condi-
tions se rencontrent dans des parties assez diverses de la zone tempre :
pampas ou prairies amricaines, hauts plateaux de l'Afrique du Nord,
plaines de limon ou de lss de l'Europe occidentale et centrale, terres
noires de Russie. Nulle part elles n'embrassent des tendues plus consi-
drables, d'un seul tenant, que dans la rgion sans coulement vers
la mer qui va del Volga la Chine du Nord. L par excellence se d-
roulent les domaines de parcours et de migration o, comme les troupes
d'animaux errant dans les steppes, comme les grands vols d'oiseaux
s'abattant sur les points d'eau, les hommes ont appris de bonne heure
se dplacer par grandes masses.
Il ne faut pas entendre que de telles contres soient comme une
arne ouverte la circulation. A dfaut de montagnes, qui d'ailleurs
s'interposent
et l, les eaux, les sables crent des obstacles. L'hiver
avec ses neiges et ses pluies dans l'Iran et le Turkestan, le printemps
et l'automne avec leurs boues et leurs fondrires dans la Russie et
la Sibrie mridionales, arrtent ou suspendent la circulation. Mais il
n'en reste pas moins que, pendant une bonne partie de l'anne, la
nature fait peu prs seule les frais des routes. Les longs couloirs
LES MOYENS DE TRANSPORT 225
qui sillonnent l'Iran soit entre l'Armnie et l'Inde, soit entre l'Armnie
et le Turkestan, sont dpeints par les explorateurs comme des avenues
toutes prtes pour des routes carrossables ou des chemins de fer
i.
Les
mmes remarques s'appliquent aux zones plus troites, mais plus
longues encore, qui travers l'Asie centrale relient le Turkestan au
Gobi et aux marches chinoises de l'Ouest
^.
L'avantage que ces contres et leurs pareilles offrent la circula-
tion, consiste non seulement dans un minimum d'obstacles, mais encore
et surtout dans la continuit des mmes moyens de transport. Ce que
ralise notre civilisation moderne, l'uniformit du rail travers des
sections normes de la circonfrence terrestre, se prsentait dj
comme une possibilit demi esquisse dans ces rgions. Il tait loi-
sible, grce l'emploi d'animaux tels que le chameau et le cheval,
d'y franchir rgulirement, sans avoir recourir d'autres moyens,
de trs longues distances. Une fois que l'attirail des tentes ou kibt-
kas tait assujetti sur le dos des chameaux, une fois que le cheval
tait sell ou mieux encore, attel au chariot, rien n'empchait de se
dplacer, sous l'impulsion des diverses circonstances qui peuvent
induire les hommes changer de place, en plus grandes masses et sur
une chelle plus considrable qu'en aucune autre partie de la terre.
Nous revenons ainsi aux considrations prsentes plus haut sur
l'origine et la provenance des antiques moyens de circulation et de
transport. Les applications pratiques auxquelles ils ont donn lieu,
les perfectionnements suggrs par un usage intensif et frquent, se
sont produits dans les rgions que prdisposaient des avantages de
relief et de sol. Pour la Chine du Nord, nous savons que les chariots
quatre chevaux taient usits au moins huit sicles avant notre re.
Les documents abondent surtout pour les contres habites par les
peuples que les textes classiques appelaient Scythes ou Celtes. Si les
Romains construisirent les routes, ce sont les Celtes qui avaient fabri-
qu les vhicules perfectionns qui s'y installrent : par exemple la
rheda lgre et rapide oppose au lourd plaustrum italiote
^.
De nom-
breux chantillons de nos muses archologiques attestent, dans le
1. De Koum Kirman, pendant plus de 1.000 kilomtres, le terrain n'offre
aucune difficult (Stahl, Reisen in Nord und central Persien, Pet. Mitt., Erg'dnz.
heft n 118, p. 39). La mission de Sir Fred. Goldsmith rend le mme tmoignage
sur le trajet encore plus long d'Ispahan Bampur (Eastern Persia, An account
of
the fourney of
the Persian boundary conunission, London, 1875).
Sur les hauts
plateaux d'Algrie on n'a eu qu' poser les rails de chemins de fer.
2. Partout, dit Grenard, o il n'y a pas de grandes accumulations de sable,
la nature ouvre de larges routes plates, unies, meilleures que les voies artificielles
de la Chine. Ouvr. cit, p. 200.
3. GoTz, Die Verkehrswege im Dienste des Welthandels, Stuttgart, 1888, p. 304,
p. 335.
Vidal-Lablache, Gographie humaine. 15
226 LA CIRCULATION
Nord de la Gaule, la pratique de recouvrir de feuilles mtalliques les
diverses parties de la roue. Les spcimens recueillis montrent une
grande varit de types. Plus massives dans les spultures de Bour-
gogne, les roues se montrent trs hautes, trs minces et pourtant trs
solides sous leur armature de fer, dans les trouvailles faites Reims,
au seuil des vastes plaines qui, de la Champagne et la Belgique, s'ten-
dent vers l'Europe centrale
^.
On peut voir dans les chars qui circu-
laient ainsi dans ces plaines, bien avant l're chrtienne, l'anctre
lgitime du lger buggy, vhicule par excellence des prairies amri-
caines. La roue, d'ailleurs, avait reu dans les plaines du Nord de la
Gaule des applications au matriel agricole, tout fait trangres au
monde romain
^.
Ce n'est pas seulement par la vitesse, mais par la capacit, le ton-
nage suivant l'expression moderne, que se distinguaient les moyens
de transport, dans les rgions que nous avons signales. Une des cir-
constances qui frapprent les Romains dans leur rencontre avec les
Cimbres, fut le volume et la contenance de leurs chariots, dont la
juxtaposition formait une enceinte pour l'arme entire et dans les-
quels toute la famille et tout l'avoir trouvaient place
^.
Les mmes
influences gographiques perptuent les mmes effets. C'est ainsi qu'au
xiii^ sicle Rubrouck s'tonne la vue de l'normit des chariots cou-
verts dont se servent les Tartares pour leurs caravanes travers les
steppes de la Russie. Et nous prouvons des impressions analogues en
voyant de nos jours les modes de roulage usits dans les pampas de
l'Argentine, ou sur les plateaux de l'Afrique du Sud ;
massifs vhicules
auxquels sont attels par douzaines des chevaux en Amrique, des
bufs chez les Boers.
La gographie signale donc de vastes contres o la circulation peut
se pratiquer sur une grande chelle en l'absence de routes construites.
On s'explique ainsi que celles o se trouvaient de puissants animaux
susceptibles d'tre plies au transport, aient acquis une importance
prcoce dans les relations humaines. Aussi la domestication du cheval,
qui eut lieu vers la fm de la priode nolithique, est-elle un fait qu'il
est lgitime de mettre en rapport, comme principe initial, avec une
srie de faits archologiques et historiques. C'est ce qu'il nous reste
montrer, en nous bornant quelques indications principales.
Une chose souvent signale par les spcialistes en archologie pr-
1. s. Reinach, Catalogue du muse de Saint- Germain, p. 164, etc.
2. Exemples : la charrue roues, la moissonneuse roues (Pline, Hist. Naf.,
Ed. Sillig, XVIII, 18, 48
;
XVIII, 30, 72
; Varron, de Re rustica).
3. Plutarque, Vie de Marius, ch. xix.
LES MOYENS DE TRANSPORT 227
historique, c'est que l'introduction successive de diffrents mtaux
travaills dans l'Europe occidentale en dehors de la Mditerrane,
l'or et le bronze d'abord, puis le fer et l'argent, dut concider avec
l'arrive de peuples nouveaux. On constate en effet qu'elle correspond
l'apparition de rites et usages auparavant inusits ; on allgue qu'il
serait difficile d'expliquer autrement le remarquable degr de perfec-
tion que prsente ds le dbut ce genre de fabrication industrielle
^.
L'ide de grands mouvements de peuples est insparable de celle des
changements de civilisation qui se substituent ds lors la stagnation
primitive. A quelles directions obirent ces courants humains ? Sans
doute des directions multiples
;
on distingue des voies continentales
de l'Est l'Ouest, du Nord au Sud ;
mais il
y
en eut d'autres. Ce qui
clate surtout, c'est qu'aux caractres essentiellement locaux qui
distinguent les restes de civilisation antrieure, aux horizons borns
qu'ils dclent, a succd ds lors dans une partie d'Europe et d'Asie
une fluctuation inconnue. Des analogies de civilisation se dessinent
par larges tranes suivant les analogies de relief et de sol. Elles sont
jalonnes, entre la Russie mridionale et la Hongrie, par les Kour-
ganes ou tumuli si riches en trouvailles nolithiques
;
elles se pour-
suivent mme au del de l'Oural vers le Nord de l'Asie. Lorsque Pallas
accomplit, entre 1768 et 1770, le premier voyage d'exploration scien-
tifique qui et t tent dans la rgion entre l'Oural et l'Alta, ce fut
pour lui un inpuisable sujet de rflexions et de surprise que les traces
d'exploitation mtallurgique commune qui s'offraient lui et qu'il ne
cessa de rencontrer que vers l'Inissy
^.
Il notait les anciens vestiges
de mines qui servaient alors de repres aux prospecteurs russes, les
objets de cuivre et d'or et l'identit du matriel funraire recel dans
ces amoncellements de pierres, qui lui rappelaient les tombes de gants
qu'il avait connues dans sa patrie, l'Allemagne du Nord.
Que les communications aient t directes ou non, intermittentes
ou continues, elles s'tablirent ds lors dfinitivement, de concert
avec l'usage de plus en plus tendu des mtaux, le long de la zone de
circulation qui unit le centre de l'Europe avec le centre de l'Asie. Ce fut
le signal de grands changements sociaux. On peut les deviner travers
les ges, d'aprs la prsence d'objets de provenance lointaine en nombre
croissant, d'aprs les indices d'emprunts rciproques et d'imitations du
dehors, qui aboutissent enfin des mlanges d'lments de civilisation,
1. Engelhard, Guide du muse des antiquits du Nord Copenhague
;
S. Rei-
NACH, Catalogue du muse de Saint- Germain.
2. Voyages de Pallas (trad. franaise, 1788), tome I, p. 384
;
tome II,
p. 193,
p. 420.
228 LA CIRCULATION
crent des besoins nouveaux, stimulent l'esprit inventif. Avec la facult
de franchir de vastes espaces, un principe nouveau de fermentation
tait entr dans les socits humaines.
Il serait exagr de parler pour ces poques lointaines de voies de
commerce. Mais l'origine de quelques-unes des voies que retracent
ultrieurement les documents historiques, remonte ces dplacements
que l'archologie laisse souponner. Les relations des colonies grecques
du Pont-Euxin avec l'intrieur de l'Asie plongeaient, d'aprs ce que
nous apprend Hrodote, jusque dans les profondeurs de la rgion
mtallurgique de ce continent
^.
La porte dite du jade sur les confins
occidentaux de la Chine donnait accs, entre autres choses, un pr-
cieux objet de luxe, presque universellement recherch l'poque
nolithique, dont la provenance principale est dans les montagnes
du Kouen-lun
^.
Plus tard la route de la soie mit profit les plateaux
du Nord de l'Iran et les couloirs qui s'allongent au Sud des Tian-chan.
Ce sont les guerres et les rvolutions politiques qui empchrent le
transit de la Syrie l'Asie centrale de survivre au sicle des Antonins.
Ces relations continentales, quand elles taient interrompues, cher-
chaient se rtablir ds que les vnements le permettaient. La
constitution de l'Empire mongol au xiii^ sicle permit d'organiser
en quelques annes un trafic direct entre la mer Noire et la Chine du
Nord.
Toutefois le principal objet que transportrent ces voies naturelles,
fut l'homme. Par individus ou petits groupes, l'homme a pu circuler
peu prs partout sur le globe
;
mais par grandes masses, cela n'est
possible que l o il dispose de puissants moyens de transport. Cette
mobilit fut favorise par la constitution de grandes communauts
pastorales dans les steppes. Les stocks d'animaux qui se formrent
ainsi et la ncessit de dplacements priodiques pour les nourrir,
facilitrent les dplacements dfinitifs. Le plus rcent exemple de
ces migrations en masse fut donn en 1720 par les Kirghiz lorsque,
chasss de Dzoungarie par d'autres tribus, ils vinrent s'tablir entre
la Caspienne et l'Oural. Ce fut le dernier cas d'une srie d'invasions
qui, par les Turcs, Mongols, Magyars, Bulgares, Huns remontent
aux Cimmriens d'Hrodote : apparitions priodiques qui, avec leurs
chevaux et leurs chariots, sortaient du monde des steppes comme de
leur milieu naturel. Par leur formation rapide et les trajectoires dter-
mines auxquelles ils semblaient obir, ces phnomnes ressemblaient
1. HRODOTE, IV, 23.
2. RiCHTHOFEN, China, t. I, p. 36.
LES MOYENS DE TRANSPORT 229
aux phnomnes mtorologiques dont la science dtermine le foyer
et suit le parcours.
Mais en dehors des steppes les plaines dcouvertes qui s'tendent
entre la mer Noire et la mer du Nord, furent aussi pendant longtemps
le thtre de mouvements de peuples. Les noms de Scythes, Celtes,
Cimbres et Teutons, Goths, Germains et Slaves, rappellent une srie
de fluctuations qui n'a pris fin que par la constitution des tats mo-
dernes. On entrevoit, aux origines des temps historiques, un flot de
peuples qui ne cesse de couler de l'Europe centrale vers les pninsules
mditerranennes
^.
Une des principales consquences de cet avan-
tage dont disposaient, au point de vue de la circulation, certains
domaines continentaux, fut d'assurer aux peuples qui en taient
issus une part capitale dans la composition ethnographique des rgions
limitrophes. Celtes et Germains, Turcs et mme Mongols se sont
superposs et mlangs, comme envahisseurs ou conqurants, des
races prexistantes.
Cette supriorit des rgions continentales n'tait que relative.
Elle cessa lorsque la mer devint la voie de circulation par excellence.
Les rgions intrieures sans communications faciles avec la mer, tom-
brent alors dans un tat d'infriorit dont toutes ne se sont pas
encore releves. La circulation, qui fut d'abord surtout continentale,
devint par la suite surtout priphrique.
1. Thucydide, I, 12, pour la Grce.
Pline, Hist. Nat^ III,
14, pour l'Italie.
CHAPITRE II
LA ROUTE
I.
FIXATION DES ROUTES
Le navire glisse sur l'eau, le flot fendu se reforme et le sillage s'ef-
face ;
la terre conserve plus fidlement la trace des chemins que de
bonne heure ont fouls les hommes. La route s'imprime sur le sol
;
elle sme des germes de vie : maisons, hameaux, villages, villes. Mme
ce qui semblerait au premier abord des pistes de hasard, traces au
gr des chasseurs et des bergers, grave son empreinte. Les drailles
raient les flancs des Cvennes. A travers les dunes sahariennes, les
couloirs (gassi) sont polis par le pitinement des caravanes. Des pistes
entretenues par les pieds des voyageurs se croisent dans la boucle du
Niger
;
sur la latrite de Madagascar, les sentiers frays dans la fort
par les porteurs se conservent des annes entires. Dans les dfils
boiss de la Colombie britannique, les sentiers de chasseurs mtis
ou indignes ont servi aux prospecteurs d'or, et parfois mme ont
guid les ingnieurs dans les tracs de chemins de fer. Ces minces rubans,
dont la rptition des pas humains effleure la surface, prtendent
dj la permanence, revendiquent une personnalit.
Ce sont surtout les obstacles qui, par l'effort qu'ils exigent, contri-
buent fixer la route, la ramener dans un sillon dfini. La diffusion
des pistes se concentre leur rencontre. Fleuves, marais, montagnes
imposent un point d'arrt, l'assistance d'auxiliaires prsents sur place,
l'organisation de nouveaux moyens de transports. Les hautes mon-
tagnes ne se prtent que sur certains points dtermins au passage.
Aussi voyons-nous, d'un bout l'autre de l'ancien monde, certaines
valles ou certains cols se dsigner de bonne heure l'attention,
comme des voies frquentes par les marchands, guerriers ou plerins,
consacres parfois par quelques traces d'uvres commmoratives
ou par quelques survivances de vieux cultes. Les chanes de plissements
rcents qui siflonnent l'Eurasie dans le sens des paraUles, Alpes, Taurus,
232 LA CIRCULATION
Himalaya, etc., ne sont accessibles que par certains couloirs, des portes
comme disent les gographes anciens, par lesquelles on n'a cess de
transiter depuis que des relations se sont formes entre les hommes,
et qui donnent la puissance qui les matrise. Des restes prhistoriques
jalonnent les directions anciennement suivies vers le Petit-Saint-
Bernard et le mont Genvre, domaines du roi Cottius. Le vieux royaume
de Cilicie tenait les cls de la Syrie, ces troits dfils de Gulak (portes
de Cilicie) garnis de stles sculptes et de rocs gravs, tmoignage
d'antiques expditions militaires avant celles de Cyrus le Jeune et
d'Alexandre. Les inscriptions rupestres de Bhistoun, entre la Chal-
de et la Mdie, racontent la gloire des Achmnides, comme, entre
l'Iran et l'Inde, les colosses taills de Bamian qui bordent les dfils
de Caboul, celle de conqurants inconnus. Dans le ddale obscur
des migrations humaines, ces passages servent de points de repre.
Nous suivons travers le Pinde, par le col de Metzovo qui relie l'pire
la Thessalie, la piste des migrations hellniques d'autrefois, slaves
ou valaques plus tard
;
comme travers les Alpes, au Brenner, la
marche des tribus gauloises et germaniques. La valle de Ferganah
et les dfils du Trek expliquent la rpartition des Iraniens sur l'un
et l'autre versant des chanes de l'Asie centrale. C'est par les passes du
Caboul qu'a coul depuis un millier d'annes un flot musulman dans
les plaines de l'Inde du Nord. La voie qui, par Batang et Ta-tsien-lou,
traverse les escarpements parallles du Fleuve Bleu, du Mkong et du
Salouen, n'est souvent qu'un sentier grimpant ou en corniche au-
dessus d'abmes
; ce n'est pas moins le lien historique qui rattache
la Chine au Tibet, la grande civilisation orientale aux sanctuaires
bouddhistes. L'Amrique, malgr ses Dividing Ranges et ses Elue
Mountains, ses passages clbres de Laramie et de la Cumbre, n'a
opposer que des souvenirs d'hier ces tmoignages parlants de l'his-
toire humaine.
L'existence de quelques points fixes est un principe de dure.
Sans doute, il ne manque pas d'exemples de voies qui ont t dlaisses
aprs avoir t quelque temps suivies par les hommes. Les voies de
caravanes dans le Sahara ont chang plusieurs fois
;
la route du Nil
la mer Rouge, organise par les Ptolmes, n'tait hier qu'un sou-
venir archologique
;
celle qui suivait le Sud du Tarim a pri avec les
villes qu'elle reliait. Cependant, les hommes ont intrt suivre les
pistes ou les voies frayes par leurs devanciers. Ce sont des lignes
d'attraction, le long desquelles se nouent d'autres rapports et o
chaque partie agit aussi pour son compte. Dans l'intervalle, entre les
points de dpart et d'arrive, les ncessits de ravitaillement ou de
LA ROUTE 233
transbordement fixent des tapes jalonnant la route et participant
la vie qu'elle entretient. Si aucune cause ne vient interrompre le
cours de ces rapports, les tablissements ns au contact des routes
en tirent renfort et dure.
II.
CHEMINS MULETIERS ET ROUTES DE CHARS
La nature du relief dcide des modes de transport : btes de somme
ou roulage. Le chariot ne trouve plus d'emploi dans les contres
accidentes
;
c'est surtout dos de mulets que s'oprent les transports.
Le mulet (que les sculptures assyriennes reprsentent charg et har-
nach) est une des plus remarquables applications de la force et de
l'adresse animales l'industrie des transports. Ce produit btard,
plus vigoureux que l'ne, plus sr que le cheval, est rest en posses-
sion de services que ni le chameau au pied mou, ni le yack trop spcialis
en hauts lieux, ni le lama cinq fois plus faible que lui, ne pouvaient
rendre aussi bien. Tandis que, dans les textes anciens, il parat comme
animal de trait, attel au char de grands personnages, il s'est depuis
spcialis comme porteur de fardeaux, presque comme grimpeur.
Dans les parties escarpes et raboteuses o la voie, ncessairement
rtrcie, exige l'effort constant et attentif, ses services s'imposent.
Il combine la souplesse des reins avec l'appui d'un sabot vigoureux,
mis par le ferrement l'preuve des asprits et des chocs. L'espace
ncessaire pour un mulet charg peut se rduire 1 m. 25
;
le double
pour que deux mulets puissent se croiser.
C'est ces conditions qu'est adapt le chemin muletier, ou, comme
disent fort bien les Espagnols, camino de herradura. Il est devenu
ainsi un type de communication essentiellement appropri certaines
contres. C'est l'quivalent de la callis romaine localis dans les parties
les plus diverses du globe. Sans lui, nombre de contres seraient
prives de communications. Les pninsules du Sud de l'Europe, les
pays de l'Atlas, le Pont, l'Armnie, les confins occidentaux de la Chine,
enfin l'Amrique espagnole et portugaise, sont par excellence ses
domaines. Les caves ou chemins creux de nos rgions bocagres
se souviennent de files de mulets qui les animaient. Les Alpes, au centre
de l'Europe, avant d'tre sillonnes par des voies internationales,
possdaient leur systme propre, leur rseau muletier. Il existe tou-
jours et s'est surtout dvelopp entre 800 et L800 mtres, c'est--dire
dans la zone o confinent les cultures et les pturages, sur la combi-
naison desquels est fonde l'conomie alpestre. C'est le systme de
communications qui rpond aux besoins des habitants. Il relie les
234 LA CIRCULATION
valles que sparent des dues ou cluses
; ou, au moyen de cols et de
montes (monts, la monta dans les Alpes de Savoie ou de Dauphin),
les pturages qui pendent sur les deux versants. Ce rseau monta-
gnard se tient le plus possible sur les hauteurs, o est sa raison d'tre.
On chemine sans quitter les croupes, dans le Pinde hellnique. Ce
rseau reste part et, mme dans les Alpes, souvent imparfaitement
reli aux routes, dont on voit, au loin, le ruban blanchir au fond des
valles surcreuses, que des escarpements brusques sparent de ce
monde des plateaux et des croupes suprieures.
L'emploi du chariot, le roulage, a, comme le chemin muletier, son
domaine gographique. C'est dans l'intrieur des grands continents,
en Asie comme en Amrique ou dans l'Afrique australe qu'il a pris
son dveloppement. Il
y
a l des espaces considrables o il a pu tre
pratiqu grce l'aplanissement naturel du sol. La route de chars
a trouv des conditions propices dans ces rgions o l'accumulation,
l'emportant sur l'rosion, tale des surfaces niveles et dcouvertes
que les ravinements n'ont que faiblement entames et o la raret
des pluies laisse le sol assez rsistant pour supporter le poids d'un cha-
riot. Les dunes et les sables mouvants sont, en revanche, les obstacles
surmonter dans l'intervalle des montagnes qui enserrent souvent
ces bassins intrieurs. De pareilles surfaces ouvrent de larges routes
naturelles, certainement meilleures que les voies artificielles mal entre-
tenues. Ce que les Arabes d'Algrie appellent outa dsigne ces espaces
ouverts. On peut rapprocher, au point de vue de la circulation, les
plateaux de steppes entre le Tell et le Sahara algrien, la plaine entre
Pendjab et Delhi, et celle du Nord de la Syrie, les karrous de l'Afrique
australe, les pampas de l'Amrique du Sud, etc. Entre la Scythie
et la Tartarie, dans les plaines qui s'tendent de la mer Noire la Volga,
le chariot est depuis longtemps la rgle. C'est dans la Chine et le Tur-
kestan que s'organisa en grand un systme de roulage. Comme le
chariot scythe ou tartare ^, VArba mongole, le Tch-tseu chinois,
chargs de six cents kilogrammes et trans par quatre chevaux sont
les vhicules appropris ce genre de route.
Cependant, ces routes que l'homme n'a pas faites, sont l'objet d'une
organisation qui en rgularise le parcours. Elles sont jalonnes de points
de repre, munies de stations. Elles prennent ainsi une personnalit
1. V. Relation des voyages de Guillaume de Rubruk, dition Fr. Michel. (Publi-
cations de la Soc. de Gogr., Paris 1839), p. 24 et suiv.
La description des
chariots des Tartares ou Mongols et de leur mode de campement fait songer aux
prgrinations accomplies par les Boers dans leurs tracts travers l'Afrique
australe.
LA ROUTE
235
qui en assure la persistance. L'on a pu relever, de distance en distance,
les jalons qui marquaient la direction d'une de ces voies, aujourd'hui
abandonne, qu'avaient organise les empereurs chinois de la dynastie
des Hans dans les premiers sicles de l're chrtienne : des piliers de
pierres, placs intervalles rguliers, et des vestiges de claies de
roseaux contre l'envahissement des sables
^.
Ce n'est pas autrement
encore aujourd'hui, par une voie jalonne aussi et munie de stations
amnages, que circulent les fonctionnaires chinois se rendant du Kan-
sou la Kachgarie
^.
Ces moyens imparfaits ont plus ou moins servi malgr tout fixer
la circulation terrestre. Les points d'eau, les oasis remplissaient dans
les rgions arides l'office de stations intermdiaires, les dunes et les
sables tant l'obstacle qu'il fallait viter ou franchir au plus court.
La route jalonne, marque de tourelles
^
se relayant moins de 10 km.
est le type perfectionn de ce mode lmentaire. Elle se contente
d'effleurer le sol
;
mais la facilit avec laquelle elle peut se prolonger
pendant de longues distances, l'absence d'entretien dont elle s'accom-
mode, contribuent expliquer certains phnomnes de circulation
qui nous tonnent dans l'histoire du grand continent asiatique. La
facilit avec laquelle des tribus ou des peuples se transportent depuis
la Dzoungarie jusqu' la Caspienne, l'improvisation au temps de l'em-
pire mongol d'un systme de communications rgulires d'un bout
l'autre de l'Asie, tout cela montre quelle grande part il faut faire
la viabilit naturelle.
Le nouveau monde offre des exemples analogues. Le sol uni des
Prairies qui s'tendent entre 36^ et 35 de latitude, des Montagnes
Rocheuses au bas Missouri, sur lequel, en 1881, ont t poss les rails
du chemin de fer de Saint-Louis Santa-F, servait une piste qui,
sous le nom de Santa-Fe TraiU tait suivie par une file de charrettes
lourdement charges, entre les colonies espagnoles du Nouveau-
Mexique et les premiers tablissements fonds dans les tats de l'Ouest.
La Carrela espagnole, trane par des bufs,
y
avait trouv un champ
propre. Ces grands convois mettaient sept huit semaines entre les
Montagnes Rocheuses et le Mississipi, mais dj des transports impor-
tants pouvaient s'effectuer sur des distances de plus de 2.000 kilo-
mtres.
1. BoNiN (Ch. E.), Voyage de Pkin au Turkestan russe par la Mongolie^ le Koukou-
Nor, le Lob-Nor et la Dzoungarie (La Gographie, 1901, I, p. 172).
2. Grandes routes de Lan-tcheou, Ngansi, Tourfan^ Kachgar, Khotan et Keria
(Grenard, t. II, p. 200).
3. Ai6tvo<;
TcJpYo; de l'itinraire de Marcus Titianus dans Ptolme.
236 LA CIRCULATION
Ainsi s'imprime, dans ces modes rudimentaires de circulation et de
transport, la marque imprieuse des milieux physiques et dj se montre
la supriorit de certains domaines pour la transmission de produits
et les mouvements d'hommes et de choses. Une diffrenciation des
contres se dessine, assez grande pour influer sur le commerce, les.
relations et mme sur les formations politiques.
m.
LA ROUTE CONSTRUITE. LES VOIES ROMAINES
Il faut arriver toutefois la route construite, la chausse empierre
telle que l'ont excute les Romains, pour raliser un progrs dcisif
dans l'volution des moyens de transports. D'autres peuples, il est
vrai, les Chinois, les Incas mmes, ont construit des routes paves
;
mais aux Romains appartient la combinaison de ces routes en un sys-
tme, en un rseau, dont les parties se soutiennent. S'incorporant
la gographie, attirant lui les relations, ce rseau a contribu
fixer les destines des contres. C'est l'application la politique
d'une ide primitivement commerciale. La voie romaine est une uvre
d'ingnieur et de topographe. Cet assemblage de mortier, pierre et
bton, ptri chaux et sable, est le prototype de nos routes modernes :
il donne aux transports la rgularit et la permanence, introduit
un trait distinct dans la physionomie du paysage. La voie romaine,
Hochstrasse, dans les pays germaniques, mme aujourd'hui en partie
dlaisse par la circulation, garde sa physionomie, on serait tent de
dire, sa fiert d'allure. Pour viter les rivires, elle suit de prfrence
les croupes que n'ont pas entames les valles divergentes
;
et, sur ces
dos de terrains, cette bande de 8 10 mtres de large prolonge inflexi-
blement pendant des dizaines de kilomtres sa ligne droite. Usant des
matriaux fournis par le sol, du bois comme de la pierre, elle couvre
de dalles polygonales volcaniques les voies Appienne ou Latine, tandis
qu'en Gaule ou en Germanie elle chafaude sur d'normes pilotis
le pont qui traverse le Rhin Mayence, ou difie au besoin, travers
les marais de la Frise ou les fagnes de l'Ardenne, ces chausses en bois
(pontes longi), dont les madriers se montrent encore demi enfoncs
dans les tourbires. Mme hors de service, son empreinte demeure
sur le sol : un bout de chausse herbeuse pargn par la charrue entre-
les hritages qu'eUe spare, nous avertit de son existence. Dlabre,
nglige, elle suflit encore aux relations, dfaut de mieux
; et c'est
par ce qui reste de la Via Egnatia que l'on chemine travers l'Albanie
mridionale.
Elle obit un plan systmatique. De Rome vers le Sud, VAppia
LA ROUTE 237
ne s'arrte qu' Brindisi
; la Flaminia, de tronons en tronons, ne se
termine qu' Rimini, sur l'Adriatique. A travers la Narbonnaise,
VAurlia se continue, aprs Arles, par la Domina^ pour joindre l'Es-
pagne et l'Italie. De Lyon, trois voies gagnent l'Ocan vers la Sain-
tonge, l'embouchure de la Seine et celle du Rhin. La voie de Bavai
Cologne relie et cimente en un tout le Nord de la Gaule, prparant
la province ecclsiastique de Reims et la future Picardie. De Londres
Chester, les deux mers opposes sont mises en rapports. La voie
romaine est surtout une uvre d'imprialisme, un instrument de domi-
nation qui serre en ses griffes tout un faisceau de contres diverses
et lointaines. Elle est reste en bien des contres associe l'histoire
intime et vivante, car c'est par elle qu'ont chemin, avec les mar-
chandises, les plerins ou les armes, tous les bruits du monde, les
ides, les lgendes. Aussi le populaire n'a pas manqu de lui assigner
un nom, il l'a personnifie, et il a choisi pour cela dans son vocabu-
laire ce qu'il trouvait de plus illustre : Csar, Trajan, Brunehaut,
Charlemagne, etc.
Bourgs et villages s'chelonnent sur son parcours, comme le prouve
la nomenclature gographique chez nous et ailleurs : Estre, Caussade,
Septime, Soulosse, Saverne, Taverny, etc. Des villes comme Reims,
Strasbourg, Milan, Augsbourg, grandissent comme nuds de routes.
D'autres se sont formes aux croisements de la navigation et des routes :
Lyon, Metz, Cologne, Paris et Londres. L'influence politique et com-
merciale de la route s'exprime topographiquement et se perptue
jusque dans le plan des villes. Salonique est traverse de part en part
par la Yia Egnatia, qui constitue sa rue principale. Les voies du Nord
et du Sud, sous les noms de rues Saint-Jacques et Saint-Denis, sont
le petit axe de l'ellipse que dessine Paris. A Londres, Holborn Street
et Oxford Street marquent les tracs que suivait, partir du pont
romain, la voie romaine de Douvres Chester.
Ligne d'attraction tant que la scurit et la police
y
rgnent, la
route se change, dans le cas contraire, en ligne rpulsive, voie de guerre
dont s'cartent les habitants. Il
y
eut un temps, dit Thucydide, o
les villes, cause de la piraterie, n'osaient s'tablir au contact de la
mer
;
elles se tenaient en vue, mais quelque distance. La mme chose
a eu lieu le long des routes que l'anarchie et le malheur des temps
livraient aux invasions et au brigandage. C'est pourquoi, le long de la
valle du Rhne ou de la voie Domitienne, on voit, sur les hauteurs
voisines, se dresser tant de bourgs fortifis, de villes ou villages
enceintes mures comme les Kasbah de l'Afrique du Nord, murailles
aujourd'hui ventres et croulantes, ruelles dsertes o tout porte
238 LA CIRCULATION
des vestiges d'abandon, mais qui racontent les misres et les
prils des temps jadis. Elles ne se sont pas d'ailleurs assez car-
tes de la route, pour n'y pouvoir revenir ds que les circonstances
redeviennent propices. Mais, en certains pays, la mfiance subsiste
;
et les vieux bourgs restent farouchement distance, regardant de
loin le va-et-vient du commerce.
L'influence de la voie romaine a survcu la domination dont
elle tait l'instrument. Ce n'est pas en vain qu'elle avait servi d'or-
gane de communication entre les contres loignes. C'est le rseau des
voies romaines qui lit de l'Italie un tout
;
comme c'est lui qui, dans
la Gaule, prpara la configuration de la France. Les contres
mmes qui ne restrent pas fidles aux liens crs par la conqute
suivirent, dans leur dveloppement ultrieur, l'impulsion due
l'organisme vital dont elles avaient t dotes par Rome. La fron-
tire linguistique entre le franais et les langues germaniques, en Suisse
et en Belgique, a un rapport vident avec la direction des princi-
pales voies romaines : celle de Martigny Avenches et de Bavai
Aix-la-Chapelle. Le latin se substitua au grec, dans la pninsule des
Balkans, le long des voies de l'Adriatique au Danube.
La protection des routes reliant la Loire la Seine et celle-ci
l'Escaut fut longtemps la principale affaire de la royaut captienne,
son principal levier d'action sur le domaine royal et en dehors. La
possession de l'Angleterre s'est dispute, entre Saxons et Danois,
le long de la ligne de villes et colonies chelonnes sur la voie romaine
de Douvres Chester, devenue le Watling Street.
IV.
ROUTES MODERNES ET CHEMINS DE FER
Ce n'est gure que dans la priode moderne et jusqu' la veille des
chemins de fer, que l'uvre systmatique des routes recommena
se gnraliser. Le rseau de routes royales dont Colbert, et plus
tard le corps des Ponts et Chausses dotrent la France, fut l'expres-
sion de l'tat centralisateur, dont la force tait tout entire tendue
de la capitale aux frontires. Les voies carrossables que Napolon
pratiqua au mont Genvre, au mont Cenis, au Simplon, en reliant plus
intimement l'Italie au corps de l'Europe, ouvrirent le champ des
rapports nouveaux.
La route est l'instrument qu'emploie ses dbuts la colonisation
europenne. En Algrie, la barrire qui obstrue l'accs de l'intrieur
fut ouverte grands frais par ces routes pittoresques et monumentales
que les gorges de Chabet-el-Akra ou de la Chiffa ont rendues clbres.
LA ROUTE 239
Avant que l'heure des chemins de fer et sonn pour l'Inde, une route
avait t entreprise
(1851),
pour relier de part en part la plaine de
3.000 kilomtres qui se droule depuis les passes de l'Afghanistan jus-
qu'au golfe du Bengale : la voie de Pechawer Calcutta, le Great
Trunk Road fut comme la voie Appienne du nouvel empire des Indes,
uvre d'imprialisme, mais uvre populaire aussi, car elle facilita
la circulation de cette fourmilire hindoue que des motifs de commerce,
de religion ou de vagabondage entretiennent en mouvement perp-
tuel. Avant le transsibrien, la Russie avait trac travers la Sibrie
la route des chercheurs d'or et des dports. De 1811 1833, le gou-
vernement fdral des tats-Unis construisit une route transversale.
National Road, qui, entre le Maryland et l'Ohio, franchit les Alleghanys,
mais s'arrta dans l'Indiana sans pousser jusqu' Saint-Louis qui tait
son but primitif.
Ces prcdents doivent entrer en ligne de compte pour apprcier
la grande rvolution gographique laquelle les chemins de fer ont
donn le branle.
Le rseau des routes a t le canevas sur lequel s'est inscrit en
Europe celui des chemins de fer. Accru chez nous par l'impulsion
donne aux chemins vicinaux, le roulage sur route a drain la circu-
lation vers les chemins de fer. Il n'est nulle part plus actif que dans
les rgions industrielles : dans celle de Lille, par exemple, ct d'un
rseau ferr particulirement serr, la route a trouv dans de nouveaux
moyens de transport (automobiles, tramways lectriques, etc.) un
renouveau d'activit. Les chemins muletiers continuent d'ailleurs
sillonner les montagnes et les contres cartes
; les pistes suivre
dans les steppes des directions marques vers d'anciens marchs.
Ainsi, dans les pays de vieille civilisation, l'appareil de circulation
qu'avait form le temps subsiste et coexiste avec la forme nouvelle.
De l nat une diffrence des plus sensibles avec les rgions que n'a
pas dj sillonnes une circulation plusieurs fois sculaire. Les routes
bordes d'arbres font partie de la physionomie de nos vieilles contres
d'Europe. Des villages de distance en distance, marquant d'anciennes
tapes, s'animent sur leurs parcours
;
parfois, proximit veillent de
vieux bourgs aujourd'hui un peu languissants et solitaires, poursui-
vant leur existence aux points mmes o les anciennes ncessits
de la circulation les avaient fixs. La place de ces marchs ou de ces
petits centres administratifs tait commande par la possibilit d'y
parvenir en quelques heures, d'en revenir le mme jour. Leur rpar-
tition obissait une sorte de rythme en rapport avec le dplacement
du train ordinaire de la vie. Cet ensemble manque dans les pays neufs.
240 LA CIRCULATION
Ce sont des traits, entre beaucoup d'autres, que le regard est dcon-
cert de ne pas trouver dans les contres o le chemin de fer, proies
sine maire creata, est seul agent et seul matre.
La route carrossable avait dj fait ses preuves avant le chemin de
fer. Elle avait contribu supprimer en partie l'obstacle des Alpes,
ouvert l'Algrie, franchi les Appalaches, ralis des rseaux de plu-
sieurs milliers de kilomtres. En ces progrs s'exprimait le besoin de
communications plus libres, plus tendues, qui travaillait partout la
civilisation moderne. Ce que la route tentait, le chemin de fer allait
l'accomplir. Le besoin allait, sinon crer, du moins perfectionner l'or-
gane. Il est vrai que le nouveau mode de transport avait encore
surmonter de plus grands obstacles. Les poids normes qu'il s'agit
de transporter ne s'accommodent pas des pentes fortes
;
quand ce
n'est pas par des tranches, des tunnels ou des viaducs que l'obstacle
est surmont, c'est au moyen de courbes longeant le flanc des valles,
graduant l'ascension des versants. Mais encore la prudence exige-t-elle,
surtout sur les lignes de grand transport, que ces courbes ne dpassent
pas un rayon assez restreint. A ces difficults que l'art des ingnieurs
a d vaincre chez nous grands frais, s'ajoutent, s'il s'agit de rgions
tropicales, celle des fleuves crues priodiques, sur lesquels il est dif-
ficile d'assurer aux ponts des fondements solides. Cela cre des inga-
lits entre les rgions
;
et l'on s'explique qu'il
y
ait ainsi une avance
prise par certaines contres, celles qui offraient aux exigences nouvelles
de ce mode de circulation les surfaces les plus favorables. La conti-
nuit de vastes plaines permettant de conserver des directions recti-
lignes, la consistance du sol permettant de garantir la solidit des
dblais contre les glissements, l'aplanissement gnral des surfaces,
devinrent des circonstances dcisives. La supriorit du bassin pari-
sien et de nos plaines du Nord sur les rgions accidentes du Massif
Central, sur le morcellement territorial de la Bretagne se dessina
avec plus de force. Il s'coula des annes avant que le Massif Central
ft travers de part en part
;
la compagnie dite du Grand Central
ne put venir bout de sa tche et dut abandonner aux compagnies
voisines (Orlans et P.-L.-M.) les concessions obtenues.
Dans l'Europe continentale, l'avantage des communications faciles
qui avait favoris le dveloppement des ligues hansatiques et les
rapports entre le Rhin et l'Elbe (Hellweg), revint plus que jamais
la zone qui traverse l'Allemagne du Nord au pied des dernires
collines.
Une zone de surfaces niveles se prolonge en Russie surtout entre
les
50
et 55 de latitude. Combien, au contraire, les rugueuses pnin-
LA ROUTE 241
suies de l'Europe mridionale taient moins avantageusement dispo-
ses ! Leurs chanes de plissement et l'activit de l'rosion qu'elles
engendrent,
y
multiplient les obstacles. L'Italie a d lutter force
de bras et d'argent contre les glissements du terrain qui rendaient
si difficile et si dispendieuse la construction, indispensable son unit,
de chemins de fer travers les Apennins de Toscane. C'est qu'en effet,
mesure que se sont droules les consquences du chemin de fer,
la diffrence s'est accentue entre les contres qui en taient pourvues
et celles qui ne l'taient pas, et a cr pour ces dernires une telle
infriorit qu' tout prix il a fallu la combattre. L'obstacle physique
a cess d'tre irrductible. L'avantage politique et commercial est
assez grand pour que les capitaux s'y mesurent. L'enjeu a grandi
en proportion des bnfices. C'est ainsi que nos montagnes et dserts
ont t franchis par le rail. Les perfectionnements mcaniques ont
march de pair. On ne recule pas devant des pentes juges jadis ina-
bordables, jusqu' 20 25 millim. par mtre
;
la traction lectrique
ouvre de nouvelles perspectives. Ainsi dans l'volution des communi-
cations, l'obstacle matriel n'est plus que relatif. Il cde la ncessit
de relier les grands marchs producteurs, de perfectionner l'outillage
conomique d'un tat. Est-ce dire que les obstacles physiques soient
supprims ? Nullement. Il est mme significatif que ces perces de
montagnes par de longs tunnels nous ont mis aux prises avec un danger
que ne connaissaient pas les routes d'autrefois, celui de l'irruption
des eaux intrieures.
Quelques changements qu'aient apports les chemins de fer, ils
s'ajoutent au pass plus qu'ils ne le remplacent. Il faut tenir grand
compte de ce qu'avaient pralablement accompli les routes, des
consquences qu'elles avaient produites et qui persistent travers les
faits conomiques de l'ge actuel. Par exemple l'industrie moderne
s'est greffe trs souvent sur les relations cres par les routes. Si beau-
coup de nos villes industrielles ont su conserver leur vitalit malgr
les vicissitudes auxquelles leurs genres de travail ont t en butte,
elles le doivent leur position sur des routes trs anciennement fr-
quentes par le commerce. Lyon, Milan, Zurich, Nuremberg, Leipzig
ont t l'origine des lieux de rencontres de foires, de marchs, la
convergence des routes. Une des plus actives zones industrielles du
Nord de l'Allemagne est celle qui se trouve le long du Hellweg, voie
de commerce qui unissait le Rhin la sortie du Massif Schisteux
au coude que l'Elbe dcrit vers l'Ouest. La Black Counfry elle-mme,
en Angleterre, comptait depuis longtemps des marchs qui s'taient
forms au passage de la route de Londres vers la mer d'Irlande...
Vidal-Lablache, Gographie humaine. 16
242 LA CIRCULATION
Ainsi avait t amass le terreau fertile sur lequel devaient fruc-
tifier les dveloppements futurs. Car ce n'est pas seulement la prsence
du combustible et du minerai, de la matire brute qui fait les foyers
d'industrie : il faut compter l'lment psychologique qui tient aux
habitudes, la familiarit avec le dehors, aux perspectives de relations
lointaines, enfin au crdit, au sens des affaires. Tout cela, ce sont des
germes qui se dposent le long de ces vieilles routes.
L est une des diffrences essentielles entre l'Europe et l'Amrique.
CHAPITRE III
LES CHEMINS DE FER
I.
ORIGINE DES CHEMINS DE FER
Les deux lments qui constituent le chemin de fer, le rail et la
locomotive, ont une commune patrie d'origine. C'est sur les lieux o
il a fallu aviser au transport de matires lourdes qu'on a commenc
se servir de rails. Le charrois sur rails fonctionnait sous terre, dans les
mines de la Grande-Bretagne, avant qu'on ne vt se prolonger le ruban
de voies ferres la surface. L'emploi de la force motrice de la vapeur,
d'abord pour lever l'eau, puis pour actionner les mtiers mcaniques
tait rpandu la fm du xviii^ sicle dans les districts industriels et
miniers de l'Angleterre et du Pays de Galles. La substitution de la
locomotive la machine fixe, la combinaison de la locomotive et du
rail, telles qu'elles furent ralises pour la premire fois par Stephenson,
aprs un premier essai entre Stockton et Darlington, en 1830 entre
Manchester et Liverpool, sont des vnements en troite connexion
avec les lieux o ils ont pris naissance. Par un enchanement de pro-
cds et de dcouvertes qui se succdaient depuis plus d'un sicle
dans les rgions minires et mtallurgiques du Centre et de l'Est
de l'Angleterre, l'invention dcisive avait t prpare et comme
fixe d'avance. Elle est insparable des faits prcurseurs dans lesquels
perce nettement, sous l'impulsion de la nature, le gnie mcanique de
la race.
Ce furent notamment :
1
la grande extraction de la houille, cons-
quence de son application la fonte des minerais
;
2
la substitution
de la houille au bois et de la vapeur la force hydraulique
;
3
l'essor
que prend l'exploitation du fer, par suite de sa substitution sur une
grande chelle au bois dans les constructions. Ainsi, les principaux
lments de l'industrie moderne taient dj entrs en activit ;
et
s'annonait l'importance qu'allaient prendre les rgions dotes de fer
244 LA CIRCULATION
et de houille. C'est dans ces laboratoires naturels des mines du Midland,
du Lancashire, du Northumberland, de la Basse-cosse, qu'on peut
saluer l'avnement du machinisme. Dans l'espace de quelques annes,
des voies ferres ne tardrent pas tre tablies entre Liverpool et
Manchester, Manchester et Leeds, Leeds et Bradford, Derby et
Newcastle
; et les mailles du rseau n'ont plus cess de se resserrer
dans cette rgion. Il
y
a, entre le chemin de fer et les grandes forces
de l'industrie moderne, un rapport rciproque de cause et d'effet,
qui se marque ds l'origine. L fut sign leur acte de naissance.
Ce rapport se marque aussi sur les continents europens, de mme
qu'aux tats-Unis. Les premiers chemins de fer
y
apparaissent dans
des rgions industrielles dj en travail, auxquelles ils apportent un
surcrot de vitalit, telle, en France, la zone Lyon-Saint-tienne et la
Haute-Alsace, en Belgique la rgion de Lige, en Allemagne celle de
Dresde, Leipzig, Magdebourg ; de mme, au del de l'Atlantique,
des rapports se nouent entre New York et la Pensylvanie. Ds le dbut,
la puissance nouvelle apparat dans tout son jour. Son dveloppement
continuera s'alimenter surtout dans les contres qui disposent de
matires d'change en assez grand nombre pour organiser conomique-
ment le trafic, particulirement dans les rgions de houille : Grande-
Bretagne, Belgique, Westphalie, tats-Unis du Nord-Est. Dans la
Pensylvanie orientale, six ou sept compagnies, les Coal Roads vivent
du transport de l'anthracite. A peine le rail commenait-il prendre
possession de la Chine, que dj le Chan-si, pays du fer et de la houille,
prend la tte du mouvement. Le chemin de fer rpond partout l'appel
de cette forme d'industrie essentiellement moderne qui met en mou-
vement d'normes masses minrales.
IL
DVELOPPEMENT DES CHEMINS DE FER
Les chemins de fer obissent une loi de multiplication qui rappelle
l'accroissement de vitesse d la pesanteur. Lentement d'abord,
puis de plus en plus rapidement, ils tendent leurs ramifications sur
la surface du globe. La longueur des lignes qui, en 1840, n'tait encore
que de 7.679 kilomtres, et qui, mme en 1870, trente ans aprs, n'at-
teignait que 206.000 kilomtres, s'levait 790.000 kilomtres en 1900,
et peut tre value en 1911 1.300.000 kilomtres, soit plus de vingt-
cinq fois la circonfrence du globe. Encore ce rsultat ne donne qu'une
imparfaite ide de la puissance de mouvement qui est imprim aux
choses et aux hommes
;
car la plupart des lignes sont amnages
aujourd'hui pour supporter de bien plus puissantes machines et mettre
LES CHEMINS DE FER 245
en mouvement des trains dix fois plus lourds que dans la priode de
dbut. Vitesse et puissance ont au moins quadrupl.
Cependant, le rseau est encore loin d'envelopper toute la partie
terrestre du globe
; de grandes surfaces lui chappent dans l'intrieur
de l'Asie, de l'Afrique et de l'Amrique du Sud
;
tandis que, sur cer-
tains points, les battements du pouls s'acclrent jusqu' la fivre,
beaucoup de contres restent l'cart, sinon inertes, du moins obsti-
nment fidles aux modes archaques de transport ns du milieu go-
graphique. Ce contraste tait bien moins marqu autrefois. L'tat
actuel des communications fait apparatre en lumire crue les effets
de l'isolement
;
ou du moins, l'isolement ne semblait pas jadis une
anomalie, une sorte d'infraction aux conditions gnrales
; ce sont les
progrs du commerce au service d'une industrie exigeante de matires
premires, avide de dbouchs, qui ont largi l'cart, creus presque
un abme entre les contres englobes dans le rseau mondial et celles
qui lui chappent. Il se cre ainsi des diffrences rgionales profondes.
Nous n'avons pas exposer les rsultats sociaux des chemins de fer :
leur importance est estime telle dsormais que, depuis un quart de
sicle, 10 ou 20.000 kilomtres viennent s'ajouter chaque anne aux
rseaux ferrs du globe. La porte gographique des chemins de fer
n'a t que plus lentement aperue. Nous avons quelque peine aujour-
d'hui comprendre que, pendant une premire priode, ils aient t
envisags surtout comme un moyen de transport local. Ce fut pour-
tant le cas, non seulement en Europe, mais aux tats-Unis. De mme
qu'en France, en Allemagne, on procde par lignes isoles entre deux
villes voisines (Paris-Saint-Germain, Lyon-Saint-tienne, Thann-
Mulhouse, Furth-Nremberg, Brunswick-Wolfenbttel, Halle-Magde-
bourg, Dresde-Leipzig, Petrograd-Tsarko-Selo)
; les premires lignes
construites aux tats-Unis ne rpondent aucun plan gnral
; de
grandes difficults s'opposent au raccord d'un tat l'autre. L'uvre
est sporadique, diffuse suivant les besoins locaux. Les ides vacillent
encore sur la porte gographique du nouveau mode de transport.
On n'aperoit pas les conditions vritables dans lesquelles il lui est
possible d'exercer pleinement son action. Tant qu'il n'embrasse que de
courtes distances, le ruban de fer ne fait qu'ajouter un lment de
plus aux nombreux moyens de communication dont disposent dj
nos vieilles contres d'Europe. Le surcrot de clrit dans un rayon
restreint n'introduit pas dans l'conomie des relations prexistantes
un changement radical. Les conditions de vie locale peuvent persister,
telles qu'elles ont t fixes depuis des sicles par les routes et les tapes
;
bourgs, villes ou marchs rpondant aux distances moyennes franchis-
246 LA CIRCULATION
sables dans une journe, telles qu'elles se sont imprimes sur le sol
et dans les habitudes. Les intrts qui sont lis cet ancien tat cons-
pirent pour en conserver le bnfice, russissent tenir en chec le
chemin de fer, tant qu'il n'intervient que comme agent local de trans-
port. Ne voyons-nous pas les diligences rsister plus d'une fois, pour
de faibles parcours, la concurrence de la voie ferre ? Lorsqu'on nous
raconte que, en France, l'poque de l'tablissement des chemins de
fer, certaines villes dclinrent de propos dlibr l'avantage d'en
tre pourvues, cette manire de voir nous tonne. Elle s'explique pour-
tant, sans se justifier, par des raisons assez naturelles une poque
o on pouvait encore mettre en balance les avantages qu'il apporte
et les perturbations conomiques qui en sont la suite.
Le chemin de fer ne parvient racheter avec usure les frais d'outil-
lage et d'tablissement qu'il exige que par la longueur des trajets et
l'tendue des distances qu'il embrasse. Les dpenses tant loin d'aug-
menter en proportion des longueurs kilomtriques, il en rsulte que
l'conomie de frais s'accentue avec les distances. Elle s'ajoute aux
avantages de rgularit, de capacit et de vitesse. En sorte que, plus
le chemin de fer tend son envergure, plus il entre pleinement dans la
ralit de son rle. Peu de personnes taient en tat de voir vers 1835
les consquences que l'exprience devait mettre en lumire. Ce fut en
France le mrite de l'cole saint-simonienne d'avoir eu le pressenti-
ment de ces vrits, d'avoir entrevu que l'uvre future des chemins
de fer s'inscrivait dans un vaste plan de communications mondiales,
parmi lesquelles le percement de l'isthme de Suez.
Ces premires hsitations se traduisent dans le fait qu'en 1840 la
longueur des voies ferres sur toute la surface du globe n'tait encore
que de 7.679 kilomtres : et sur ce chiffre, la part de la France tait
peine de 500, celle des tats-Unis s'levait dj 5,000. Les tats-
Unis offraient un spectacle instructif
;
l'ide de rseau
y
avait pris
corps, et reu un commencement de ralisation. Malgr les entraves
du particularisme d'tat, partout, dans ce pays neuf, fermentait le
dsir de mettre en rapport les centres de production intrieurs et ceux
d'activit maritime. La grande uvre du canal ri, mettant New-
York en communication avec les lacs, avait t acheve
(1825) ; et cet
exemple avait suscit la construction d'autres canaux en Pensylvanie
et ailleurs ;
tandis que sur l'Ohio et le Mississipi, de nombreux services
de bateaux servaient au transport du coton et au va-et-vient de ce
peuple voyageur. Mais pour combien de temps l'impatience amri-
caine s'accommoderait-elle de ces lenteurs ? Un mot tait dans toutes
les bouches : railroad
;
il tait l'objet d'un de ces engouements qui se
LES CHEMINS DE FER
247
rpandent de temps en temps comme une trane de poudre en Am-
rique. Par la supriorit de vitesse, de capacit, de rgularit, il conve-
nait plus que la navigation intrieure aux besoins et aux instincts qui
sont au fond de l'me yankee.
L'impulsion, naturellement, partait des grandes villes maritimes,
points o se concentraient dj le commerce, le travail manufacturier,
les capitaux : Boston, New York, Philadelphie, Baltimore, furent les
capitales nourricires d'entreprises concurrentes. A la rigueur la navi-
gation fluviale ou le cabotage maritime pouvaient provisoirement
suffire pourvoir de coton les manufactures du Nord : quelques lignes
furent amorces dans cette direction
;
mais une dviation singulire
se produisit dans les courants de circulation. Elle prit dcidment
la direction de l'Ouest. Au del des Appalaches, la colonisation s'tait
empare des fertiles territoires de l'Ohio
;
les mines de houille s'exploi-
taient Pittsburg
;
Cincinnati tait devenu un march d'levage
;
on entrait enfin de jour en jour plus en contact avec cette prodigieuse
avenue navigable de 2.000 kilomtres qu'ouvrent les lacs et que
bordent, au Sud et l'Ouest, de vastes espaces fertiles. L'lan ne s'ar-
rta plus
;
c'est de l'Est l'Ouest plutt que du Nord au Sud qu'agit
l'attraction. Le branle tait donn en cette direction ds 1835
;
et au
bout de quelques annes peine, on pouvait voir Boston reli par voie
ferre au Saint-Laurent, New York aux lacs Ontario et Eri, Phila-
delphie Pittsburg, Baltimore l'Ohio.
Ainsi se manifestait dj le rapport troit entre le chemin de fer
et la colonisation. La marche de l'un se rglait sur celle de l'autre
;
un pacte se nouait entre ces deux puissances du monde moderne.
S'il s'tait trouv alors un prophte capable de prvoir les millions
d'immigrants que l'Europe devait jeter vers l'Amrique, il aurait pu
du mme coup prvoir les milliers de kilomtres qui s'ajouteraient
ces rudiments de rseaux ferrs. Ds 1854, travers une confusion
de lignes entreprises et multiplies sans plan gnral, les princi-
pales Trunk Lines se dessinaient dans le sens des parallles. Ayant
franchi les principaux obstacles, elles voyaient se drouler devant elles
les perspectives des prairies
;
et au del se laissait entrevoir le Far-
West, l'illimit dans les espoirs comme dans les espaces I
III. L'IDE NATIONALE ET STRATGIQUE
Nos vieux pays d'Europe eurent lutter contre d'autres difficults.
Ce n'est pas en vain que plusieurs sicles d'histoire avaient travaill
fixer la figure des tats et le site des villes. Les chemins de fer eurent
248 LA CIRCULATION
s'adapter aux rseaux prexistants de communications, des rap-
ports ciments par le temps, des organismes politiques qui avaient
se dfendre contre leurs voisins, des individualits nationales
tailles sur un autre patron et une mesure diffrente qu'en Amrique.
Chaque tat aborda la construction des chemins de fer suivant ses
besoins et ses moyens. L'Angleterre insulaire, plus avance que le
continent dans la voie de l'industrie et plus familire avec la puis-
sance du crdit, s'engagea rsolument
;
et dj Birmingham et Liver-
pool ralisaient la liaison entre son principal foyer d'industrie et son
principal foyer commercial. L'tat belge se hta de mettre Malines
et sa capitale en relation avec Anvers, sa place de guerre. En Alle-
magne, l'ide d'unit nationale que, avec une remarquable prescience,.
Frdric List, aprs Gthe, avait dmle dans l'avnement des che-
mins de fer, reut un commencement d'application par la jonction
des principales villes de la grande plaine du Nord, Berlin avec Stet-
tin
(1843) ;
avec Hambourg, Breslau, Magdebourg
(1846) ;
avec Dresde
et Cologne (1848);
bientt suivie de la jonction avec le Sud par Nurem-
berg et Augsbourg. Et ds 1842, nos orateurs pouvaient dnoncer
avec inquitude les voies de convergence qui aboutissaient Cologne,
Mayence, Mannheim, et concentraient les forces militaires de la Conf-
dration germanique.
La Russie eut pour premier soin d'unir directement ses deux capi-
tales, et, de 1843 1851, excuta sa ligne de Ptersbourg Moscou :
plus tard seulement elle devait entreprendre la lutte contre son prin-
cipal ennemi, la distance. L'ide stratgique de conservation, de dfense,
s'imposa comme une ncessit primordiale dans la plupart de nos pays
d'Europe.
C'est l'instinct de chaque tre de pourvoir avant tout sa conser-
vation personnelle : les tats n'y ont pas manqu. Quand on lit les
dlibrations de nos assembles, en 1842, propos de la constitution
de nos principales lignes ^, on est frapp de la place qu'y tiennent les
proccupations stratgiques. La Russie, aprs l'preuve de la guerre
de Crime, s'empressa de rparer l'insuffisance de son rseau vers les
points reconnus vulnrables. Plus prouve encore aprs la guerre
de 1870 qui avait mutil notre territoire, la France a d reconstituer,
en vue de sa nouvelle frontire, son systme de circulation, adapter
et relier de nouveau ses lignes de chemins de fer, ses canaux
;
et,
comme dans une chair qui a saign les fibres tendent se rejoindre,
elle a essay ainsi de cicatriser sa blessure. C'est pour disposer plus
1. A. Picard, Les Chemins de fer franais, Paris, 1884, I, p. 263.
LES CHEMINS DE FER 249
facilement de ses forces militaires et les porter d'un bout l'autre de
son territoire, que la Turquie a entrepris les lignes qui, de Salonique
Constantinople, de Scutari Bagdad, de Damas La Mecque,
tendent relier les membres loigns de ce corps puissant et lourd.
Quand la Chine, si dfiante et rfractaire, s'est dcide la locomo-
tive, elle a eu soin de tracer comme ligne fondamentale de son rseau
la voie qui unit les deux parties toujours divergentes et htrognes
de cet Empire, le Nord et le Sud, Pkin et Hankeou, et comme on
disait au moyen ge Cathay et Manzi.
Nous croyons, disait en 1837 Dufaure ^, que les principales lignes
de communication destines unir le Nord au Midi, l'Est l'Ouest,
et Paris toutes les extrmits du royaume, ne sont pas seulement
d'un intrt commercial, mais surtout d'intrt national. Telle fut
en effet la conception qui, en 1842, prsida au plan d'ensemble qui,
malgr les modifications apportes par le temps, rgit encore la phy-
sionomie de notre rseau.
Sept lignes rayonnent de Paris vers l'Angleterre, la Belgique,
l'Allemagne, l'Espagne Bayonne, l'Ocan Nantes, la Mditerrane
Marseille, auxquelles s'ajoutaient (titre premier de la loi du 11 juin
1842) une ligne de Bordeaux Marseille et une autre de Lyon Mul-
house. L'ide matresse est celle de l'unit nationale. C'est sur ce tronc
que l'arbre a dvelopp ses branches. Ce fut d'abord, comme presque
partout, par des concessions partielles, des tronons de lignes que
procda l'excution de ce plan. Mais l'exprience ne tarda pas mon-
trer qu'en matire de chemin de fer c'est par la combinaison et l'ten-
due qu'un rseau peut acqurir la vitalit suffisante. Si en 1851 la
longueur des lignes exploites en France n'tait encore que de
3.625 kilomtres, tandis que sept ans aprs elle avait plus que doubl
et que vingt ans aprs elle avait presque sextupl 2, c'est que la fusion
des multiples compagnies du dbut en six compagnies principales
avait fourni la large base territoriale ncessaire l'excution et
l'extension du rseau. Pour soulever, et comme le disait en 1875
un orateur, mettre en mouvement ces millions de tonnes qui dor-
maient depuis des sicles ^, il fallait un levier suffisant pour que,
le surplus d'un ct compensant le dficit provisoire de l'autre, toutes
les parties du territoire pussent subir l'impulsion, participer au mou-
vement de vie et que, de proche en proche, le tressaillement de la vie
1. A. Picard, ouvrage cit, I, p. 57.
2. Chemins de fer franais, fin 1851 ; 3.625 kilomtres en exploitation
;
fin 1858 :
8.769 kilomtres
;
fin 1870 : 17.924 kilomtres.
3. CZANNE, cit par A. Picard, III, p. 182.
250 LA CIRCULATION
rveillant les eaux dormantes les entrant dans les nouveaux courants
de civilisation.
C'tait un progrs : cependant la conception du rle des chemins
de fer ne s'est dgage que peu peu, par la puissance accumule
et combine des elets. On mit longtemps dcouvrir en Europe que
c'tait plus encore dans le mouvement imprim aux choses, dans le
transport des marchandises plus que dans celui des voyageurs, que
consistait la rvolution profonde apporte par les chemins de fer.
Cette ide n'apparat gure dans les discussions auxquelles ils don-
nrent lieu dans nos assembles. On considre la puissance de cet
instrument pour mobiliser les hommes, on ne prvoit pas quel
point il mobilisera les choses. Pendant longtemps, le trafic des mar-
chandises fut, en France, infrieur celui des voyageurs
;
il n'attei-
gnait mme, en 1855, qu'un demi-miUion de tonnes
^.
L'insuffisance
et l'exigut des gares et installations qui datent de cette poque
nous paraissent drisoires.
IV.
EXTENSION RCENTE DU RSEAU FERR
Le maniement rgulier et peu de frais de masses normes de pro-
duits et de matires premires a t rendu possible par la navigation
vapeur. L'accroissement gnral du tonnage devint une ncessit
laquelle durent s'adapter tous les moyens de transports. Une combi-
naison dut s'organiser qui fora les chemins de fer agrandir leurs
installations et augmenter la puissance de leurs machines
;
fleuves
et canaux approfondir leurs chenaux, largir leurs cluses
;
ports
s'amplifier dans des proportions qu'on n'avait pu prvoir. Cette
coopration des moyens de transport a march de pair avec l'allonge-
ment des parcours. Elle a suscit, au cours de son volution, une telle
foule de forces vives qu'elle a d sans cesse faire face par de nouveaux
perfectionnements de nouveaux besoins. En grande partie, la fonc-
tion a cr l'organe. Vires acquirit eundo n'est nulle part plus appli-
cable qu'en matire de chemin de fer.
Lorsqu'on compare la priode si lente des dbuts l'acclration
qui va se prcipitant dans les quatre ou cinq dernires dcades, on sent
qu'une force nouvelle agit en eux qui prend sa source dans des rap-
ports plus tendus d'un caractre mondial. On aurait pu croire en 1875
que la plupart des tats d'Europe avaient achev leurs rseaux, sauf
1. CoLSON, statistique des transports, p. 104. En 1905, le trafic atteignait
17.500.000 tonnes.
LES CHEMINS DE FER 251
l'Italie et la Russie, dj pourtant fort avances
;
nanmoins, de 1875
1910, la longueur des lignes a presque tripl
^.
Une loi comparable
celle qui rgle la chute des corps prside cet accroissement. De 30.000
dans la dcade qui suit 1840, il monte 69.000
(1860),
puis 101.000
(1870),
162.000
(1880),
245.000 (1890). Lgre diminution de 1890
1900, mais le progrs reprend de plus belle de 1900 1910. En mme
temps on commence les rseaux asiatiques et africains : en 1854, celui
de l'Inde qui compte aujourd'hui 50.000 kilomtres
;
en 1881, le trans-
caspien
;
en 1891, le transsibrien, lments essentiels du rseau de la
Russie d'Asie qui ne compte pas moins de 17.000 kilomtres aujour-
d'hui ;
tandis que le rseau algrien est concd en 1860 et qu' l'autre
extrmit de l'Afrique se constitue le rseau du Cap
;
sans parler des
voies qui s'ouvrent en Australie et en Amrique du Sud.
La longueur des chemins de fer du monde qui en 1870 tait value
206.000 kilomtres, dpasse aujourd'hui un million de kilomtres.
L'envergure des rapports ne cesse de crotre avec les longueurs kilo-
mtriques. C'est dans les transports directs grande distance que le
chemin de fer ralise sa supriorit et exerce le maximum de son
action gographique. Aussi peut-on dire que sa tche n'est jamais
finie et qu'un besoin inhrent de croissance le travaille. Mme dans
les contres d'Europe qui semblent arrives un tat de saturation,
des additions et des raccordements s'imposent pour satisfaire de
nouvelles ncessits conomiques.
La France cherche retenir les courants de circulation qui lui
chappent, relier plus directement ses principaux foyers de produc-
tion industrielle, et surtout ses ports que le plan centralis de son rseau
primitif laissait trop l'cart.
La densit du rseau ferr atteint son maximum dans l'Europe
occidentale et les tats-Unis du Nord-Est Atlantique. En Belgique,
dans le Nord de la France et dans la zone mridionale de la plaine
allemande, il n'y a pas de point qui soit 16 kilomtres d'une ligne de
chemin de fer. Arriv ce point, il semble que le dveloppement doive
s'arrter. Mais la traction lectrique ouvre de nouvelles possibilits,
utilises surtout dans les rgions industrielles. Tout un nouveau rseau
se greffe sur le principal : chemins de fer locaux et tramways subur-
bains sont comme la menue monnaie qui facilite les transactions.
En Angleterre, en Belgique, dans la plaine subhercynienne allemande,
dans la France du Nord, la Lombardie, comme dans le Massachusets,
1. Longueur des chemins de fer en Europe en 1875 : 141.700 kilomtres
;
en 1908 :
341.100 kilomtres (Colson, Statistique des transports).
252 LA CIRCULATION
il
y
a peu de points o les hommes aient faire 2 kilomtres de marche
pour atteindre une voie ferre.
Les pays o il semble que la saturation soit atteinte restent encore
l'exception. En dehors de l'Inde et de Java, il ne s'est form de vri-
tables rseaux complets que dans la zone tempre. Aucune raison ne
s'oppose cependant ce que les chemins de fer tendent leurs ramifica-
tions jusqu'au travers des rgions polaires et quatoriales.
Dj se projettent des lignes de pntration partant de la cte sur
toute la priphrie des continents tropicaux : au Brsil, dans l'Afrique
orientale, dans l'Australie occidentale. Le rail pntre dans la zone
arctique Narvik, Dawson City, Arkhangel. Ainsi des jalons sont poss
pour la formation d'un rseau mondial.
Le rseau europen se relie par le transsibrien celui qui s'bauche
au Nord de la Chine. Celui des tats-Unis pntre dans le Mexique
par deux grandes artres. Entre le rseau indien et le rseau russe
en Asie, comme en Afrique entre les lignes d'Algrie, d'Egypte et du
Cap, dans l'Amrique du Sud entre la Bolivie et l'Argentine, il
y
a
solution de continuit. Mais le com)3lement de ces lacunes n'est qu'une
question de temps.
L'tat actuel des communications fait apparatre en lumire crue
les effets de l'isolement. Cet tat, jadis accept comme un fait naturel,
choque aujourd'hui comme un anachronisme. Les matres de l'Inde
voient dans les chemins de fer le moyen le plus efficace pour combattre
le flau qui dcime priodiquement leurs millions de sujets : la famine.
Mais surtout nos industries intensives, dans leur apptit de dbouchs
et de matires premires, souffrent impatiemment que des contres
se drobent. Leur isolement fait l'effet d'une infraction qui ne peut
durer.
Pour toutes ces raisons, l'extension du rseau des voies ferres n'est
pas prs de s'arrter. 10 20.000 kilomtres s'y sont ajouts annuelle-
ment dans le dernier quart du sicle. Ce mouvement continuera et peut
nous rserver encore bien des surprises.
V.
COURANTS INTERNATIONAUX DE L'ANCIEN MONDE
Une des consquences les plus importantes du dveloppement du
rseau mondial est l'tablissement de contacts tendant la formation
d'une sorte d'conomie internationale.
Des sicles d'histoire avaient lev des barrires entre les peuples
d'Europe, dress des frontires douanires, organis chaque tat de
faon se suffire soi-mme. Ces habitudes traditionnelles sont bat-
LES CHEMINS DE FER 253
tues en brche. Ce ne sont plus seulement les diverses parties d'un
mme tat qu'il s'agit de mettre en rapports plus intenses, mais les
contres qui, par leurs produits, s'entr'aident et se compltent, quels
qu'en soient la situation gographique et le statut politique. Entre le
Nord-Amrique et le Sud-Est de l'Europe se cre ainsi une chane
de relations fonde sur les besoins de nourriture. Il s'en forme d'autres
suivant les besoins de l'industrie en minerais ou combustible. Des
lignes internationales dessinent travers l'Europe de grandes diago-
nales qui continuent les lignes de navigation et se combinent en une
sorte de systme europen. Par Constantinople, ce rseau se prolonge
en Asie Mineure. Par Moscou et Samara, il s'enfonce en Sibrie et se
relie au rseau chinois. L'Eurasie communique d'une extrmit
l'autre, de l'Atlantique au Pacifique.
Des combinaisons de tarifs favorisent certains courants. Dans la
concurrence des voies maritimes de l'Ocan et de la Mditerrane,
les chemins de fer dcident. La Suisse occidentale est dispute entre
Anvers et Marseille. Le puissant systme des chemins de fer allemands
parvient, l'aide de tarifs spciaux, refouler devant lui, en Roumanie
et dans le Sud-Est de la Suisse, le commerce mditerranen, en mme
temps qu'il se lie avec l'Italie par les perces alpestres. Nos compa-
gnies du Nord, de l'Est et du P.-L.-M. ont des tarifs destins attirer
le transit. Le P.-L.-M. les abaisse en faveur des expditions au del
de Suez.
Il s'est form et se dveloppe en Europe une politique internatio-
nale des chemins de fer, dont l'ide essentielle est la pousse vers l'Est,
comme en Amrique c'est la pousse vers l'Ouest.
VI. LE RAIL ET LA MISE EN VALEUR DE L'AMRIQUE
Nul exemple n'est plus propre mettre en lumire la prodigieuse
puissance des chemins de fer que celui des tats-Unis. Le problme
du transport, transportation suivant l'expression comprhensible
qu'on rencontre dans la littrature amricaine, n'a nulle part t
abord et rsolu avec plus de hardiesse. Avant les chemins de fer,
l'attention s'tait dj porte sur les canaux, les voies navigables,
les routes longue distance mme. Mais seul le rail devait permettre
de raliser les possibilits en quelque sorte illimites du nouveau
monde.
D'immenses espaces, peu prs vides, s'ouvraient au del de la
barrire des Appalaches
; peine quelques embryons de population
Manche avaient commenc se former sur les bords de l'Ohio. De 1821
254 LA CIRCULATION
1915, environ 29.000.000 d'Europens ont franchi l'Atlantique
pour se transporter dans ces pays neufs. Ce fleuve humain qui, depuis
trois quarts de sicle, ne cesse de couler, tantt acclrant, tantt
ralentissant son cours, se nourrit de sources de plus en plus loignes.
Il roule tour tour, comme le Nil rouge succdant au Nil vert dans
l'inondation priodique, des lments diffrents, d'abord irlandais,
puis allemands et Scandinaves, enfin italiens, slaves, orientaux de la
Mditerrane. Mais chaque anne c'est encore 400.000 ou 500.000 tres
humains que les paquebots d'Europe amnent aux ports des tats-
Unis. Depuis dix ans ce flot puissant envahit aussi le Canada : l'immi-
gration, faible auparavant, s'y tient annuellement aujourd'hui aux
environs de 200.000
i.
Cette masse humaine jete par les paquebots d'Europe sur le conti-
nent amricain, ne s'y est pas rpandue au hasard
;
elle ne s'est pas
miette ainsi que jadis faisaient nos trappeurs franco-canadiens
comme une poussire dans ces vastes espaces : si elle s'est canalise
en quelques courants principaux suivant une marche rgulire, de telle
sorte que le centre de gravit de la population n'a pas cess de se dpla-
cer dans le sens de l'Est l'Ouest,
c'est grce aux chemins de fer.
Ils ont servi de vhicule la colonisation. Plus on s'cartait des ctes
pour s'avancer vers l'intrieur au del de toute route trace 2, plus la
locomotive exerait une action exclusive, devenait autocrate. Elle
donnait au sol qu'elle traversait, ou dont elle s'approchait, la seule
valeur qui pt le faire apprcier en ces pays neufs, celle d'un capital
producteur d'objets de commerce. Le mirage qui attire vers ces contres
nouvelles un flot humain sans cesse renouvel, n'est plus celui des
mines de mtaux prcieux, mais celui des produits et salaires auxquels
donne lieu une vie commerciale intense. Il ne s'agit plus de vivre chi-
chement d'une terre avare, de consumer son nergie dans un labeur
ingrat, mais, aprs avoir emprunt une terre presque vierge un
produit facile, de le transformer aussitt en une richesse circulante :
la moisson aussitt change en chque. Cette richesse ne peut natre
qu'au contact du rail. Celui-ci vivifie ce qu'il touche. Dans les parties
encore inoccupes de l'Ouest, la concession d'une bande de terres
publiques de 32 kilomtres droite et gauche de la ligne, joue le
rle d'une subvention pour la construction des principales voies-
matresses qui traversent d'un ocan l'autre les tats-Unis et le
1. De 1901 1910 le Canada a reu environ un million d'Europens, sans compter
les immigrants des tats-Unis. Les tats-Unis eux-mmes ont reu dans la mme
priode environ 7 millions, l'Argentine peu prs 1.200.000.
2. La National road ne dpassait pas l'Indiana.
LES CHEMINS DE FER 255
Dominion
^.
Les compagnies ont t ainsi investies d'un capital
de spculation qui, quels qu'aient pu tre les abus, les a intresses
mnager par l'application de tarifs modiques le transport longue
distance des produits qui pouvaient alimenter leur trafic.
Que ce soit aux tats-Unis, au Canada, dans l'Argentine, ou en
Australie, ces produits ne pouvaient tre que ceux que rclamait
la vieille Europe, pour la nourriture de ses habitants, pour la consom-
mation de ses industries.
C'tait le bl, le mas, la laine, produits de contres tempres
;
le coton, produit subtropical. Le dveloppement de la navigation
maritime, la rgularit et la clrit des traverses, avaient si bien
aplani les frets entre les principaux ports des deux cts de l'Atlan-
tique, qu'au chemin de fer seul appartenait le pouvoir de faire pen-
cher la balance dans la concurrence des prix. C'est ce qu'a ralis
l'esprit commercial des Amricains. Ils se sont attaqus corps corps
et systmatiquement la distance. Leur force tient ce qu'ils sont
arrivs pratiquer sur les parcours gnraux, mais non locaux, des
voies ferres, les frets les moins levs qu'il
y
ait au monde : leur moyenne
s'est abaisse de prs d'un tiers entre 1870 et 1900.
Ce rsultat n'est pas un simple effet naturel de la concurrence
;
il a t acquis par une suite d'efforts, il date de la priode de fusion
et d'amalgamation
^.
Le mrite en revient l'organisation des courants
de trafics, qui ont concentr le plus conomiquement possible, entre
points de production et points d'embarquement, la plus grande masse
possible de marchandises. Il suppose des combinaisons et des calculs
sans cesse l'preuve des circonstances
; c'est un chafaudage repo-
sant sur des bases qu'il faut sans cesse surveiller. L'organisation
reste assez fluide pour que les courants ne puissent pas se figer. Par
l'ampleur qu'embrasse ce systme de voies ferres, dsignes sous le
nom des potentats des finances qui les dirigent ^, il constitue une
puissance qui tire sa justification de l'normit des produits qu'elle
s'est montre capable de soustraire la loi de la pesanteur.
1. Union et Central Pac, (10 mai 1889).
-
Santa-F (1881).
-
Great Northern
(1883).
South Pac. (1883).
-
Pacific Canadian (1886), etc.
2. La priode de fusion commence vers 1890 et concide avec une grande reprise
d'efforts industriels et de colonisation, dans le Nord-Ouest d'abord et ensuite dans
le Sud. Elle a russi grouper les lignes concurrentes en faisceaux soumis une
direction unique et a abouti la constitution de vritables rseaux se touchant
et se pntrant.
3. Systme Vanderbilt : Boston, Minnesota, Dacota, Missouri, Pensylvanie,
Baltimore, Ohio.
Systme Hill-Morgan : les deux transcontinentaux du Nord.
Systme Harriman : transcontinentaux du Centre et du Sud.
Systme Gould :
Texas et Sud-Ouest, etc.
256 LA CIRCULATION
L'histoire des guerres de chemins de fer, suivie de contrats (pooling),
reste un des chapitres les plus curieux de l'histoire conomique. Mais,
dans cette srie de vicissitudes, il
y
a d'autres forces en jeu que celles
de calcul et de spculation. Il
y
a l'entre en lice de contres nouvelles,
la rapide mise en valeur et en circulation de tout ce que le continent
amricain, au Nord comme au Sud et l'Ouest, dans les Prairies
comme dans la Pampa argentine, au Canada comme dans les Mon-
tagnes Rocheuses, possdait de ressources latentes prtes sortir
de terre. La rgion des Prairies tait comme une rserve mnage
pour l'humanit grandissante. Lorsque, dans la seconde moiti du
xix^ sicle, la colonisation s'y est dveloppe, elle est devenue un grenier
du monde : les dix Prairies States, sur une superficie triple de la France,
ont, depuis 1850, quintupl leur population
;
c'est surtout dans la
priode de 1860 1880 que l'agriculture en a pris possession jusqu'
l'extrme limite des rgions arides. Elle s'est spcialise et la culture
du mas s'est concentre dans les cinq Corn Surplus States (Illinois,
lowa, Kansas, Nebraska, Missouri) qui fournissent eux seuls plus
de la moiti de la production mondiale. Comme au nord du 42^ degr
les geles tardives nuisent au mas, c'est le bl qui rgne dans le Minne-
sota, la valle de la rivire Rouge, comme plus haut dans le Manitoba
canadien d'o l'Angleterre tire 80 millions d'hectolitres. Ces sols
unis, faciles travailler, ont l'avantage de produire des grains de qua-
lit uniforme, qui peuvent tre confondus en masse dans les transports
et les transactions. La moisson peine finie se change en chques pour
les propritaires.
Quand la rcolte de mas manque ou menace de manquer dans les
cinq tats, c'est un afflux de prs de trois cent mille porcs au del
de la moyenne ordinaire, qui encombrent tout coup le march de
Kansas City. A ct des gares s'talent les parcs bestiaux pour les
btes cornes, se dresse l'lvateur pour les grains, auxiliaires
ncessaires au rassemblement en grande masse des objets transports
par le chemin de fer. C'est ainsi que, par quantits colossales, grains,
bl, viande, peaux sont transports par les Orangers Roads, en wsigons
appropris, des prix trs bas, sur plus de 2.000 kilomtres, jusqu'aux
ports d'embarquement pour l'Europe.
VII.
CHEMINS DE FER ET DENSIT DE LA POPULATION
L'tendue dans la continuit des conditions physiques, tel est en
Amrique l'avantage gographique que les chemins de fer ont mis en
valeur. La structure grands traits de ce continent s'y prtait. C'est
LES CHEMINS DE FER 257
au fond une nouvelle manifestation des causes qui avaient dj fait
leurs preuves dans l'expansion des socits humaines. De temps imm-
morial, en Asie, la plaine de l'Hindoustan, les grands plateaux de lss
de la Chine avaient montr ce que vaut l'tendue dans des conditions
semblables comme facteur numrique, comme force de multiplication
et d'accumulation. Il en et t de mme dans la rgion russe de la
terre noire si les cataclysmes des invasions n'en avaient retard le
dveloppement. Cette fois, c'tait avec le machinisme que l'homme
entrait en possession du sol. Par les chemins de fer, steamers, tl-
graphes, lvateurs, charrues vapeur, usines, machines d'extraction,
tout ce que la force mcanique peut ajouter la force manuelle,
tout ce que la capacit de transporter peut ajouter la capacit de
produire, tout ce que la rapidit d'informations stimule d'initiatives,
a concouru la mise en valeur de ces vastes territoires. Grce la
machine, le maximum de production peut tre atteint avec le mini-
mum de main-d'uvre. Aussi voit-on la population rurale dans les
Prairie States
y
qui comptent dj plus de quarante ans de colonisation,
rester notablement infrieure aux chiffres qu'avaient atteints, dans l'an-
cien continent, les grandes contres agricoles. La densit de la popu-
lation dans riowa ne dpasse gure encore 16 habitants par kilomtre
carr, moyenne qu'altre seule la prsence de grandes villes comme
Chicago dans l' Illinois, Saint-Louis dans le Missouri. Aussi la lon-
gueur du rseau ferr apparat-elle trs forte par rapport la popu-
lation. On compterait environ 40 kilomtres de chemins de fer par
16 habitants.
Les conditions sont peu prs les mmes dans le Canada, dans l'Ar-
gentine et l'Afrique australe anglaise. La quantit de matires dispo-
nibles pour le transport est, dans ces pays neufs, en proportion inverse
du nombre des consommateurs sur place. Le rle des chemins de fer
consiste surtout fournir aux producteurs les moyens d'oprer sur
de grandes masses, par la puissance des moyens de transport qu'il met
leur service.
Si, dans les grands foyers d'industrie, la concentration d'tres hu-
mains par millions ou centaines de mille est en rapport direct avec les
chemins de fer, ce sont aussi les chemins de fer qui permettent la for-
mation en Australie, dans la Nouvelle-Zlande, dans la Rpublique
Argentine, de ces immenses troupeaux de btail qui subsistent, pour
fournir quelques marchs du monde laines, peaux, cornes, viandes, etc.
Le rassemblement de troupeaux de moutons de 60.000 ttes, 200.000 et
enfin, cas plus rare, de 500.000 ttes, au gouvernement desquels suffisent
quelques hommes cheval, n'est gure un fait moins extraordinaire
Vidal-Lablache, Gographie humaine. 17
258 LA CIRCULATION
que les villes de 500.000 ou un million d'hommes. En tout cas, ce sont
des faits du mme ordre, des hypertrophies nes, en mme temps,
de causes semblables. De telles agglomrations de btail, comme, dans
les Prairie States, l'accumulation des grains dans les lvateurs cons-
truits pour des milliers de tonnes, correspondent aux agglomrations
humaines auxquelles elles sont destines. Ici Vemporium, la grande
ville, l le runn, Vestancia, la fazenda. C'est la grandeur du dbouch
qui sollicite la puissance de la production. Grce la rpercussion que
les transports rguliers par masses entretiennent, une force norme se
dgage et trouve, de part et d'autre, son emploi. Les produits se
concentrent et s'accumulent en vertu de la loi conomique qui pro-
portionne le prix de transport la quantit transportable. Et c'est
ici que le phnomne prend forme gographique.
VIII.
GRANDES LIGNES MARITIMES ET GRANDES LIGNES
CONTINENTALES
La dernire phase de l'histoire des communications est caractrise
par l'intense collaboration du rail et de la navigation vapeur. La
soudure des courants continentaux aux courants maritimes tend se
faire de plus en plus en un nombre limit de points d'lection qui
prennent le caractre d'emporia mondiaux. Les points d'expdition
s'organisent pour embrasser le plus d'espace possible dans leur cercle
d'approvisionnement ; les points d'arrive, pour desservir le march
le plus large avec la fonction de relation la plus tendue.
Les deux principaux groupes de ports se regardent entre 27 et
40
de latitude sur la cte des tats-Unis, entre 40^ et 54 sur celle d'Eu-
rope.
L'emporium moderne, qu'il s'appelle New York ou Londres, Boston
ou Hambourg, ressemble au port d'autrefois tel que le peignait Joseph
Vernet, comme un paquebot ressemble une balancelle. Ces villes
normes, produit caractristique de notre sicle, sont les organes
crs par les besoins nouveaux du commerce. L se centralisent les
renseignements, se forment les entrepts, se nouent les relations.
Quelque chose de colossal et de dmesur s'associe ces crations : ton-
nage de navires, dimensions des bassins, agglomration de chantiers
et d'usines; l'industrie cherche profiter des avantages qu'offre le
transport par mer des matires lourdes. La supriorit de l'outillage
prvalant sur la distance, l'emporium moderne peut attirer des mar-
chandises qui sembleraient destines des ports plus rapprochs
de leur point d'origine. Li aux courants continentaux et aux rives
LES CHEMINS DE FER 259
maritimes, le grand port peut avoir la puissance de les dtourner.
Son rle le plus vident reste cependant la conscration et l'exploi-
tation des relations tablies entre les lignes de la circulation mondiale
travers les continents et les ocans.
Dans l'histoire conomique du dernier sicle, on rappellera toujours
une concidence frappante, celle de l'ouverture, six mois d'intervalle,
du premier transcontinental qui ait travers l'Amrique du Nord et
du canal de Suez. UUnion Central Pacific (10
mai 1869) fut le signe
avant-coureur d'une srie de constructions qui relirent l'Atlantique-
Nord au Pacifique-Nord. Douze ans aprs, cinq autres lignes traver-
saient le continent amricain ;
le Far-West conduisait vers l'Extrme-
Orient. D'autres ttes de lignes, combinant leurs services de paquebots
avec leurs voies ferres, s'ajoutrent San-Francisco, avec l'avantage
d'une traverse plus courte : Seattle et Tacoma dans le Puget Sound,
Vancouver l'extrmit de la bande de 6.000 kilomtres qui recueille
Halifax le voyageur venu de Liverpool pour le mener en 5 jours au
bord du Pacifique, et 10 jours aprs au Japon. Le commerce va gran-
dissant entre l'Amrique du Nord et le Japon et la Chine
;
dans la
Chine dboise, les bois de Colombie britannique, les grains du Mani-
toba, le ptrole de Californie sont l'objet d'une demande, La mme
ingalit de population existe entre les deux bords du Pacifique qu'entre
ceux de l'Atlantique. Toutefois, avec ces peuples d'Extrme-Orient,
il existe trop de diffrences originelles pour qu'une adaptation des
marchs soit aussi aise qu'entre l'Amrique et l'Europe. L'ingnio-
sit commerciale des Amricains du Nord travaille la raliser. Elle
s'tudie accommoder l'offre la demande, flatter mme le Chinois
et le Japonais comme consommateurs, tout en le repoussant comme
immigrant.
Par un autre chemin, l'Extrme-Orient s'est rattach au commerce
mondial. Lorsqu'en novembre 1869 les premiers navires passrent de
la Mditerrane dans la mer Rouge, ralisant une des plus anciennes
ides saint-simoniennes, des gographes aussi comptents qu'Oscar
Peschel taient loin d'apprcier sa valeur la future importance com-
merciale de cette route. Il ne semblait pas que cette voie maritime se
faufilant de dtroits en dtroits entre les masses continentales, fran-
chissant Gibraltar, Malte, Suez, Aden, Singapore une srie de portes
aises fermer, pt disputer la suprmatie commerciale la grande voie
maritime du Cap.
On ne pouvait encore se rendre compte des changements que la
rapidit et la ponctualit des services maritimes, l'accroissement du
tonnage, l'ouverture d'arrire-pays devaient apporter dans les rapports
260 LA CIRCULATION
des contres. Ce qui s'change le long de cette voie tortueuse qui
touche aux plus anciennes contres civilises, qui pousse ses embran-
chements vers l'Afrique orientale et l'Australie, ce sont des objets
manufacturs d'Europe contre des produits naturels de l'Asie. Ces
produits diffrent de ceux que recherchait le commerce ancien (pices,
or et encens, etc.), qui s'accommodaient des retards de longues tra-
verses, qui pouvaient impunment affronter de longues journes de
navigation sous les Tropiques. Ce sont des produits que rclament
instamment, dates fixes et en quantits considrables, les besoins
alimentaires et industriels des multitudes d'Europe. L'Amrique,
sans doute,
y
pourvoit, mais il serait imprudent, pour assurer la satis-
faction de besoins de premire ncessit, de rester la merci d'un ou
deux centres de production. La rcolte de bl peut manquer en Am-
rique
;
celle du coton peut tre insuffisante
; des pizooties et des
scheresses peuvent oprer des rafles sur le stock d'animaux laine
et peaux que consomme l'Europe. Et d'ailleurs les pays neufs ne
voient-ils pas, leur tour, augmenter leur population et se dvelopper
leurs industries, diminuant d'autant leurs disponibilits ?
C'est sur ces conditions, en partie imprvues, que sont fonds les
progrs de la grande voie maritime de l'ancien monde. On a vu succes-
sivement entrer en ligne de compte, dans le tonnage d'environ 15 mil-
lions de tonnes qui sillonne le canal de Suez, le coton de l'Inde occiden-
tale, les bls du Pendjab, les riz de l'Indochine, le th de la Chine du
Sud. Et mesure que se prolongent vers le Nord les rseaux ferrs,
interviennent les fves olagineuses (soya) de Mandchourie, bientt
peut-tre le bl de la Mandchourie du Nord, les bois de Sibrie,
La part prpondrante de l'Inde dans le commerce du canal de Suez
tient l'avance que lui donne son rseau de chemins de fer, commenc
ds 1856. C'est assurment un phnomne curieux et au premier abord
paradoxal que de voir une contre aussi charge de population devenir
nourricire d'autrui. L'Inde dispose en moyenne d'environ 20 millions
d'hectolitres de bl pour l'Europe; ses rcoltes de bl et de coton sont
attendues, escomptes chaque anne
;
cette exportation fournit
Kurratchi et Bombay son principal lment. Et nanmoins si les
famines n'ont pas disparu, leur frquence et leurs effets ont t en
partie conjurs. L'organisation des transports, appuye sur un rseau
considrable de chemins de fer (plus de 50.000 km.), a rgularis la
circulation intrieure en mme temps qu'elle rattachait l'arrire-pays
aux ports maritimes. Ce que le machinisme, supplant la pnurie
de bras humains, a pu accomplir en Amrique, l'a t, dans cette vieille
terre, la faveur des habitudes traditionnelles de ses populations
LES CHEMINS DE FER 261
rurales. Il
y
a une vertu singulire d'lasticit dans ces anciennes
civilisations fondes sur ce qui change le moins, la fcondit du sol,
les forces rparatives de la terre. Que l'Inde sillonne de chemins de fer,
et mise 20 jours de l'Europe, fasse un commerce de plus de 5 milliards
de francs, dont les deux tiers avec l'Europe
;
que l'Egypte ait vu
depuis 1882 1897 augmenter sa population de 6.814.000 9.734.000 et
11.287.000 en 1907 avec un commerce dpassant 1.300 millions,
de tels rsultats, joints ceux que nous fournissent d'Algrie et la
Tunisie, montrent une facult de rnovation qui justifie les efforts
et les espoirs dont ils sont l'objet.
Il est vrai que ces contres sont passes sous des dominations euro-
pennes : la Chine, qui entre peine dans la priode d'expriences,
y
apporte une civilisation autonome, peu prs intacte, avec une somme
d'habitudes, d'intrts, de prjugs, dont l'adaptation un systme
de l'tranger ne peut s'accomplir sans rsistance. Toutefois, la cause
des chemins de fer l aussi est gagne
;
et l'on peut attendre d'eux
un contact plus intime entre les deux plus considrables foyers de
population du monde.
IX.
CONCLUSION
Ainsi agit, djouant ou dpassant les prvisions, une puissance
gographique dont rien ne permettait de mesurer les effets. De tous
ces systmes de communication se forme un rseau qu'on peut qualifier
de mondial. Il embrasse, en effet, sinon la totalit du globe, du moins
une tendue assez grande pour que rien peu prs n'chappe son
treinte. Sa puissance est faite d'accumulation de ses effets. C'est le
rsultat total de combinaisons multiples, accomplies dans des milieux
diffrents, par le rail, la navigation maritime ou intrieure : aux tats-
Unis, la navigation des Grands-Lacs avec les chemins de fer qui en
recueillent et en prolongent le trafic
;
en Angleterre, un dveloppement
extraordinaire de la marine marchande, disposant d'un fret que com-
plte la houille
;
aux Pays-Bas et en Allemagne, une batellerie fluviale
de fort tonnage pntrant jusqu'au cur du continent, et des chemins
de fer combinant leurs trafics avec le Sud-Est de l'Europe
;
en Afrique,
l'utilisation des grands fleuves, Nil, Niger, Congo, Zambze, relis,
soit la mer, soit entre leurs biefs navigables par des voies ferres;
enfin, l'attaque de l'Asie centrale, tandis que, par le canal de Suez,
s'accomplissait la jonction de deux domaines auparavant distincts du
commerce maritime. Ce qu'il faut voir dans la varit des obstacles
vaincus, c'est le dsir de raliser des adaptations telles que tout ce
262 LA CIRCULATION
qui grve le transport des denres soit rduit au minimum, que la cir-
culation soit le moins possible soumise des transbordements et des
frais accessoires.
Entre les chemins de fer transcontinentaux et la navigation mari-
time, il semble qu'il s'tablisse un partage d'attributions, peut-tre
aussi un partage gographique. La concentration des continents de
l'hmisphre boral entre
60 et 30 de latitude donne lieu une
extension zonale de voies ferres traversant d'un bord l'autre l'Am-
rique du Nord ou l'Eurasie. Le mme ruban d'acier s'allonge sur plus
de 5.000 km. entre New York et San-Francisco, de 6.000 entre Halifax
et Vancouver, de 10.000 entre le Havre et Vladivostok. En cinq ou
six jours on traverse le continent amricain
;
en quatorze jours on
peut franchir aujourd'hui la distance de Paris Pkin. Tout ce qui
exige rapidit, voyageurs, correspondance, trouve ainsi dans ces
voies transcontinentales un avantage que les voies maritimes ne peuvent
atteindre.
Les routes de l'Ocan restent par excellence celles de l'hmisphre
austral. De l'Amrique du Sud au cap de Bonne-Esprance, de l en
Australie et en Nouvelle-Zlande, la mer est la voie ncessaire. Pousss
par les grands frais de l'Ouest, les grands voiliers franchissent en
24 jours, sans voir terre, la distance entre le Cap et Wellington. L'Ocan
Pacifique, dj travers en diagonale entre Vancouver et Auckland,
l'est depuis peu de Panama Sydney. Des points presque impercep-
tibles et ignors dans les vastes tendues ocaniques (Imangareva
par exemple) seront peut-tre demain des tapes mondiales.
Loin d'tre rellement en concurrence, les voies maritimes et
continentales se prtent, dans l'ensemble, un concours qui dcuple
la puissance des effets qu'elles exercent sur la vie conomique. Par
l'effet de cette pntration intime des contres, de ce contact universel
auxquels bien peu chappent encore, il
y
a partout du fret ramasser,
des transactions raliser, des besoins satisfaire. Et c'est^ ainsi
qu'un ferment nouveau s'introduit et travaille toutes les parties du
globe.
CHAPITRE IV
LA MER
I.
ORIGINE DE LA NAVIGATION MARITIME
L'homme, par son corps, ses organes, son appareil respiratoire,
est un tre terrien, attach la partie solide de la terre. Ce serait
peu cependant qu'un domaine rduit au quart de la surface du globe
pour justifier le mot de gographie humaine. Si les terres seules offrent
l'homme la possibilit d'imprimer sa trace, d'enraciner ses uvres,
les mers ont t, par une srie de conqutes o resplendit la lumire
du gnie humain, ouvertes une circulation sans limites. Depuis l'in-
vention de la voile jusqu' celle de la boussole et du sextant, depuis
les premires observations astronomiques jusqu'au calcul des tables
de dclinaisons, on suit un enchanement de dcouvertes associes
la navigation maritime. L'instinct du chasseur, l'exprience du
montagnard s'acquirent et se transmettent individuellement, tandis
que dans le domaine des mers o, sur d'normes distances, aucun
point de repre ne frappe les sens, ce n'est que par la science que
l'homme est parvenu trouver des routes diminuant la part du danger.
La familiarit avec la mer n'a pourtant t longtemps que le pri-
vilge de groupes restreints. On ne peut parler d'une attraction gn-
rale que la mer ait exerce sur les populations humaines
;
certaines
ctes seulement se sont montres attractives : celles par exemple
o, chaque jour, le reflux de la mare laissait dcouvert une pro-
vende facile de faune comestible (Terre de Feu), celles o l'homme
trouvait un abri contre les exhalaisons malsaines des forts marca-
geuses comme dans le Nord-Ouest de l'Europe, ou qu'une bordure
d'les protge contre la houle du large (Skiorgard Scandinave), celles
aussi que le rapprochement de bancs sous-marins rendait propices
la pche (Tunisie orientale, mer du Nord), ou bien les parties resser-
res frquentes poques fixes par des lgions de poissons migra-
264 LA CIRCULATION
teurs (Mditerrane). Toutes ces causes, et d'autres sans doute, ont
puissamment contribu mettre quelques fractions de l'humanit
en contact quotidien avec cet lment qui, par lui-mme, est plutt
objet de crainte. Car, si certaines populations ont t attires par la
mer, d'autres, comme les Perses, s'en sont systmatiquement cartes
et ont traduit leur aversion pour cet lment hostile dans leurs croyances.
De toutes les attractions, la plus puissante pour l'humanit primi-
tive a probablement t celle exerce par la pche. Actuellement
encore, la pche maritime nourrit des millions d'hommes, depuis le
Japon jusqu' la Norvge. Les ressources nourricires de la mer ont
t l'amorce par laquelle le terrien qu'est l'homme a t attir vers
cet lment tranger auquel il s'est habitu, dont il est devenu l'hte
et pour ainsi dire le commensal.
Un autre point de vue s'est rvl ds que le commerce s'est dve-
lopp. C'est l'avantage offert par les surfaces illimites des mers pour
le transport lointain et frais rduits des produits du sol ou de l'in-
dustrie. Sans doute, la richesse ne peut se dvelopper que sur terre,
c'est parce qu'il
y
a des Babylone et des Egypte qu'il
y
a des Phnicie
;
mais c'est la mer qui apporte des mtaux d'Hesprie et des Cassit-
rides jusqu' ces lointaines socits orientales. Ses prils n'taient
rien ct des obstacles que prsentaient les voies de terre. Celles-ci
ont eu beau acqurir avec le temps scurit et rgularit, on voit
encore aujourd'hui les bls de Russie, les houilles anglaises, les bois
du Nord, jusqu'aux vins d'Algrie, prfrer les routes maritimes
cause de la modicit du fret. Une fois la marchandise confie aux
flancs du vaisseau, peu importe quelques centaines de kilomtres de
plus ou de moins.
II.
LA NAVIGATION A VOILE
L'emploi de la force mcanique de l'air pour vaincre la rsistance
de l'eau, c'est--dire la voile, contenait le germe immense de tous les
progrs futurs. On ne peut pas dire de cette invention qu'elle ait eu
un caractre d'universalit, comme par exemple celle du feu : bien des
peuples, qui vivaient en contact avec la mer, ne l'ont point connue,
ou ne l'ont connue que tard. Mais ceux qui, indpendamment d'ail-
leurs les uns des autres, en ont inaugur l'emploi, elle a confr une
prcoce supriorit. Elle les a spciahss. En crant un genre de vie
capable de tendre tous leurs efforts, elle a forg des peuples. Elle a
combin ensemble des lments probablement trs diffrents de popu-
lation,
Cariens et Phniciens, Malais et Mlansiens, peut-tre Celtes
LA MER 265
et Germains, de faon leur imprimer par la communaut des occu-
pations, des caractres qui donnent l'illusion d'une race.
Quelle que ft la matire fournie par le milieu local, que l'on ust,
pour capter et utiliser la force du vent, de nattes de palmiers ou de
bambous comme les Malais, de toile de lin comme les Phniciens
et Hellnes, de toile de coton comme les Carabes, de cuir comme les
Vntes et les anciens Celtes, c'tait l'opposition d'une force natu-
relle une autre force naturelle, une conqute sur la nature, une co-
nomie de main-d'uvre et d'effort musculaire. Ces peuples acquirent
sur les autres la supriorit que donne une plus grande indpendance
des entraves terrestres. On sait quel avantage procura sur les conti-
nents certains peuples la possession du cheval ; sur mer aussi le
navire voile fut un moyen d'hgmonie, car la piraterie en profita
au moins autant que le commerce.
Les priples et autres documents de l'antiquit classique laissent
entrevoir quel degr de connaissance dtaille et minutieuse des
ctes la navigation parvint de bonne heure dans la Mditerrane et
les mers immdiatement voisines. Une riche nomenclature o n'est
omis aucun accident ni anfractuosit du littoral s'applique la cte
et l'anime d'une vie pittoresque. Des dictons se rptent entre marins
sur les passages redouts. Des sanctuaires, des lgendes avec noms
de fondateurs de villes font comme une broderie au littoral de la mer
intrieure. La navigation est imprgne de ces souvenirs. Minutieuse-
ment attentive la cte, elle ne s'en carte qu' regret et le moins pos-
sible. Il faut cependant se hasarder en pleine mer pour^atteindre l'Es-
pagne et l'extrmit occidentale de la Mditerrane : ce fut longtemps
le secret des Phniciens, et des Phocens aprs eux, inventeurs de navires
plus longs et tenant mieux la mer.
Cependant, considrant les faits dans leur gnralit, il n'apparat
pas qu'il
y
ait une sparation entre une priode de navigation ctire
et une priode ultrieure de navigation au large. Tout dpendit de la
nature physique et du rgime des vents. Dans la Mditerrane mme,
les vents tsiens qui soufflent rgulirement, de mai octobre, du
Nord au Sud, unirent de bonne heure le monde hellnique l'Egypte,
firent du bassin oriental un tout que connat dj Homre. Des rap-
ports s'tablirent mme sur de plus grandes distances entre l'Arabie
du Sud et Madagascar
i,
entre l'Afrique orientale et la cte de Malabar.
L'attraction des rivages opposs s'exera d'autant mieux que l'inqui-
tude du retour n'existait pas
;
il tait garanti par l'alternance des
1. Grandidier, Origine des Malgaches.
266 LA CIRCULATION
moussons. Entre la cte de la Chine au Sud de Formose et la cte
d'Annam, l'alternance de la mousson hivernale du Nord et de la mous-
son estivale du Sud a cr des rapports : le nom de mer de Chine
les exprime. La violence souvent dangereuse de ces vents cesse au del
de la digue insulaire forme par les Philippines, Palaouan et Borno :
ce fut un autre domaine que dsigna le nom de mer de Clbes et de
Jolo. Mais des domaines rgis par des vents connus, et o l'on
tait sr de pouvoir revenir, succdaient des espaces que des dangers,
grossis volontiers par l'imagination, semblaient interdire : tel tait,
au Sud de la rgion frquente par la navigation arabe, le courant
redout de Mozambique qui portait vers le Sud avec violence.
Un monde nouveau commenait l. Les documents anciens montrent
que la navigation, s'avanant de Carthage ou de Gads le long de la
cte d'Afrique la faveur des alizs du Nord-Est, ne dpassait pas
Sierra Leone. L s'arrtait l'ocan Atlantique des pays de l'Atlas,
au del rgnaient d'autres vents, vents irrguliers que rencontrent
les navires voiles sur les ctes de Guine
;
les frquentes tornades
y
rendent encore aujourd'hui la navigation difficile : il faut 45 jours
un voilier pour se rendre Lagos, tandis qu'il n'en met que 42 pour
atteindre Rio-de-Janeiro
^.
Cette sparation resta la limite du monde
connu des anciens.
Il est remarquer que le domaine des navigations norvgiennes qui,
entre le viii^ et le xi^ sicle, embrassa l'immense espace maritime
compris entre les Hbrides et l'Islande jusqu'au Groenland et mme
au Labrador, n'empita pas au Sud sur la zone dangereuse du Gulf-
Stream. Ces navigateurs si hardis semblent s'tre astreints suivre
des routes assez septentrionales pour viter la lisire du courant
qui, par
40^^
de latitude environ, charrie des bourrasques et qui, dans les
mois d'hiver, est la zone la plus temptueuse qu'il
y
ait sur le globe.
On estime 42 jours la dure moyenne d'un trajet direct voile d'Eu-
rope en Amrique, et, encore aujourd'hui, les navires partis de Scan-
dinavie continuent tenir le plus possible au Nord jusqu' Terre-
Neuve
2.
L'ide d'une mer septentrionale comprenant l'espace entre
le Groenland, l'Islande, la Scandinavie et l'Ecosse, s'exprime maintes
fois au xvi sicle dans les revendications dano-norvgiennes.
1. G. ScHOTT, Die Verkehrswege der Transozeanischen Segelschiffart in der
Gegenwari (Zeitschr. der Gesellschaft fur
Erdkunde zu Berlin, t. XXX, p.
247 et 279).
2. G ScHOTT, Ibidem, p. 273.
LA MER 267
III.
DOMAINES DE NAVIGATION
Ainsi, par la familiarit croissante avec la mer, s'esquissaient des
limites naturelles, en mme temps que se dessinaient des domaines.
On vit des provinces se tailler dans un empire dont on ne connaissait
pas encore l'tendue. Ces domaines ne sont pas toujours dfinis, sch-
matiss, suivant l'expression de Strabon, par la configuration des
ctes ;
leurs limites sont plutt celles que trace le rgime des vents
et des courants. C'est la navigation qui fournit le principe des dlimi-
tations
;
les Instructions nautiques en sont le commentaire.
L'autonomie de ces domaines maritimes a t en partie consacre
par des noms. Ils sont imprgns d'une terminologie spciale. Nous
avons parl de celle de la Mditerrane : la nomenclature est arabe
ou hindoue dans l'Ocan indien, essentiellement Scandinave dans les
mers du Nord de l'Europe. Cette dernire surtout apparat comme le
produit d'une observation exerce discerner toutes les diversits
de formes dans les accidents du littoral : le
fiord
dsigne une chan-
crure troite et longue
;
le vik reprsente une anse arrondie. Tandis
que les mots ner et skaji s'appliquent des promontoires levs,
peut-tre plus allongs d'aprs le second
;
eyrr est une lande plate
et sablonneuse. Pour les baies de dimensions petites, on emploie les
dsinences vaag, vo, kil, etc.
;
pour les les, ey ou ; une chane d'cueils
forme un ski'rgard
^.
Telle est la signature indlbile que les Norv-
giens ont appose aux mers par eux parcourues.
Les noms subsistent, tandis que disparaissent peu peu les varits
spciales de navires qui s'y taient adapts. Le dhow arabe, la grande
jonque chinoise qui portait, au temps de Marco Polo et d'Oderic de
Pordenone, jusqu' 700 hommes, la pirogue plateforme, les doubles
pirogues balancier des Polynsiens, qui excitrent l'admiration des
Cook et des Dumont d'Urville, ont rejoint ou rejoindront bientt dans
les chantillons de nos muses de marine la Kogge de la Hanse ou le
dragon des Vikings. Cependant ces spcimens archaques ont eu leur
extension, leur part de dcouvertes. De grands espaces maritimes ont
t parcourus par eux.
Il advint naturellement que, dans certains domaines, la navigation
aiguillonne par la concurrence fit preuve d'esprit plus progressif.
Ce fut particulirement l'avantage des marines mditerranennes :
la substitution de la grande voile latine triangulaire l'ancienne voile
1. Egilson, Lexicon poelicum antiquse lingu sepienirionalis, Copenhague, 1860.
MBius, AUn'rdisches Glossar, Leipzig, 1866.
268 LA CIRCULATION
quadrangulaire ralisa un notable progrs. Ce fut un progrs non
moins dcisif quand les Gnois l'eurent remplace leur tour par
une voilure plus mobile et plus maniable, grce laquelle ils purent
s'aventurer en plein ocan, comme les portulans nous les montrent
inscrivant le nom de saint Georges, ds le xiv^ sicle, sur l'archipel
des Aores.
Chaque domaine de navigation eut donc ainsi son volution distincte,
ses dveloppements indpendants, son outillage et son personnel.
Le grand progrs consista franchir ces limites, souder entre eux
ces domaines. Lorsque, par le voyage qui couronna une srie mtho-
dique d'efforts, Vasco de Gama parvint Mlinde sur la cte orientale
d'Afrique, il trouva des pilotes qui connaissaient la route de Calicut
et des Indes ;
et les Indes elles-mmes taient le vestibule d'un autre
domaine frquent, celui des mers sino-malaises. L'essor des dcou-
vertes maritimes au xvi^ sicle ne s'expliquerait gure sans ces pr-
liminaires : ce fut un trait de lumire subit, quand l'union se fit entre
ces domaines diffrents, quand l'aliz du Nord-Est, dj pratiqu
jusqu'aux Canaries, eut port Colomb jusqu' la mer des Carabes,
et quand, d'autre part, eut t vaincu l'obstacle du cap des Temptes.
Mais on peut aussi se rendre compte des profondes ingalits que l'iso-
lement engendre entre les modes de civilisation, quels qu'ils soient,
s'ils se dveloppent indpendamment les uns des autres.
L'esprit d'invention n'avait certes pas fait dfaut dans ces tenta-
tives nautiques exprimentes sur plusieurs points diffrents du globe.
Mais il s'tait arrt ici plutt qu'ailleurs
;
de sorte que, plus progres-
sive, la navigation europenne avait acquis une telle supriorit qu'elle
ne rencontra, dans l' Ocan Indien et ailleurs, que des rivages dont elle
eut aisment raison.
Ce ne fut donc que peu peu que la figure de la mer apparut dans
sa plnitude. Mais, ds le xvi^ sicle, l'unit du monde des mers for-
mant un systme se substitue, dans l'esprit des hommes, la conception
fragmentaire qui faisait de chaque domaine de navigation un monde
part, au del duquel on ne se hasardait gure.
La mer devint le trait d'union par excellence. Elle seule tait capable
d'tablir des communications rgulires et permanentes entre les
diffrentes coumnes distribues la surface des terres. Il faut se
rappeler combien fut tenace la division en Grecs et Barbares, Juifs
et Gentils, Chinois et autres hommes, pour mesurer le changement
de perspective. L'humanit put s'observer maintenant elle-mme,
dans les traits gnraux qui lui sont communs, et dans les diffrences
profondes que cre un long atavisme. Ce ne fut pas la philanthropie
LA MER 269
qui prit le dessus dans cette rencontre
; et cependant que de contrastes
s'offrent la rflexion dans cette extraordinaire histoire. Tout ce qui,
en bien et en mal, caractrise la nature humaine se fit jour au contact
entre ces socits difi'rentes, ingales, spares par des volutions
sculaires. Le proslytisme religieux prit tche de ramener une foi
commune les infidles involontaires et dploya parfois pour cela un
hrosme admirable, tandis que d'autre part les plus impitoyables
procds d'extermination svissaient.
De plus en plus sduite la vue de domaines admirablement dis-
poss pour devenir des patries enviables, des terres vierges o se
rajeunirait le tronc transplant de nos vieilles races, l'Europe com-
mena se rpandre au dehors, sur les Amriques, puis sur l'Australie
et sur l'Afrique du Sud ; des peuples nouveaux se multiplirent et
cet exode toujours croissant eut d'incalculables consquences. En
revanche, la traite dpeupla en partie l'Afrique noire pour prter
aux plantations du nouveau monde les bras qui manquaient. En partie
aussi disparurent les peuples qui avaient fond autour des grands
lacs, le long des Montagnes Rocheuses ou sur les plateaux intertropi-
caux d'Amrique, des confdrations, des Empires, des embryons
d'tats. Jamais en somme branlement plus gnral n'avait retenti
dans les rapports des hommes. L'volution qui commena alors n'a
pas dit son dernier mot
;
c'est elle que nous voyons se poursuivre
et s'amplifier aujourd'hui, avec la force d'tendue que lui prtent les
moyens modernes de circulation.
IV.
L'IDE D'HGMONIE PAR L'OCAN
Avec la fusion des domaines maritimes en un ensemble illimit de
mers et d'ocans, de nouvelles perspectives politiques apparaissaient
ds l'aurore des temps modernes. Les rves d'hgmonie mondiale,
dont la ralisation s'tait toujours heurte l'exigut des continents
et aux limites imposes par leurs configurations gographiques, ne
semblent plus une chimre. L'Empire des mers parat vraiment
pouvoir tre conquis par un peuple. Un contemporain de Cromwell,
Sir James Harrington, avait trouv le mot qui convenait la chose :
Oceana
^.
On avait dj vu des thalassocraties s'difier et disparatre. Elles
avaient gnralement pour point d'appui des ctes se faisant face,
des chapelets d'les formant archipels. Les empires phniciens, ath-
1. J. A. Froude, Oceana or Engand and her colonies, Londres, 1886.
270 LA CIRCULATION
niens, carthaginois de l'antiquit, celui de Venise au moyen ge, celui
de riman de Mascate dans la premire moiti du xix^ sicle repr-
sentent ce type archaque de domination maritime. Ces chafaudages
provisoires manquaient de bases.
L'ide qu'une domination quelconque put s'tablir au large, sur
les libres espaces ocaniques, ne s'tait pas prsente au droit romain,
ou plutt il l'avait par avance exclue : La mer, disait-il, est une chose
commune comme l'air et l'eau de pluie ^.
Il n'en fut plus de mme
quand, en 1494, les Espagnols et les Portugais s'accordrent dans la
prtention de se partager la domination des mers d'aprs un mridien.
A mesure que, sortant des Mditerranes, des mers bordires ou conti-
nentales qui foisonnent dans l'hmisphre Nord, on avait franchi les
grands Finisterres par lesquels se terminent les continents, doubl
le cap de Bonne-Esprance, le cap Horn, sillonn les mers australes,
et qu'on s'tait lanc travers les tendues du Pacifique, on avait
constat l'affaiblissement, puis la disparition des perturbations exer-
ces par les terres sur les mers. Non seulement on avait vu s'ouvrir
des routes sans fm
;
mais les contrastes saisonnaux, encore si marqus
dans les latitudes moyennes de l'Atlantique Nord, s'taient amortis.
Le monde des mers se montrait empreint d'une teinte superficielle
d'uniformit qu'on ne souponnait pas. Tout particularisme s'att-
nuait. Tout ce qui dans les mers dpendantes des continents ncessitait
un outillage particulier, des habitudes de nautique spciale, s'effaait
dans l'galit remarquable de conditions physiques.
Dans l'mulation qui s'alluma de s'approprier les contres riches
de trsors rels et imaginaires, et de s'en faire un gage incomparable
de puissance, ces conditions offraient ceux qui sortiraient victo-
rieux de la lice, des possibilits d'expansion auparavant inconnues.
Des ambitions nouvelles se firent jour. L'ide d'hgmonie, ferment
toujours actif dans les crations de la gomtrie politique, s'amplifia
la taille des ocans. Les dominations, puissantes par l'tendue,
que l'histoire avait connues sur les continents, avaient d pniblement
lutter contre les difficults de communications, la varit d'obstacles
physiques, les diversits d'adaptation rendues ncessaires par des
contrastes de climat. Elles n'avaient russi qu'avec peine les surmonter
et s'taient puises dans cet effort. Leur puissance d'expansion
avait trouv sa pierre d'achoppement dans les diffrences physiques
que multiplient les combinaisons du relief, du climat, de la vgta-
tion, et qui, en s'accumulant, finissent par constituer le plus grave
1. Instituies de Justinien, II, i.
LA MER 271
obstacle. L'empire circummditerranen de Rome, malgr le puissant
rseau des voies qu'il avait cres, avait chou d'un ct contre les
dserts, de l'autre contre les forts et les marcages. Celui des Arabes
n'avait pu prendre pied dans les plaines agricoles du continent euro-
pen. L'immense empire des steppes fond par Gengis-Khan avait
trouv sa limite dans les forts du Nord de l'Asie et du centre de
l'Europe...
Pendant une longue priode, les dominations se pourchassrent
pied pied, car il semblait qu'il n'y et le long des mers qu'un nombre
limit de places prendre : les les des pices, les contres plantations,
mtaux prcieux. Les Hollandais, du cap de Bonne-Esprance aux
les de la Sonde, se taillrent un empire aux dpens du Portugal,
tandis que, par les Antilles et la Guyane, ils amoraient une domina-
tion des Indes occidentales ; et c'est avec l'appoint des dpouilles de la
Hollande et de la France que la Grande-Bretagne difia son tour sa
thalassocratie. A l'Empire britannique tait rserv de raliser le pre-
mier type de puissance mondiale. Gibraltar, Malte, Aden, Singapoor,
lui livrent les cls des compartiments maritimes qui se succdent le
long des masses continentales. Il embrasse, dans une immense envergure,
l'Inde, l'Afrique orientale et l'Australie autour de l'Ocan Indien
;
l'Australie, la Nouvelle-Zlande et le Canada, d'un bord l'autre du
Pacifique. Sillonne par une marine marchande gale toutes les
autres runies, la mer est le ruban qui relie ses possessions. Il a fallu
la Russie le grand effort du transsibrien pour tablir, entre ses
territoires, une communication qui reste malgr tout bien plus impar-
faite. Qu'il se soit form Londres un entrept universel o, longtemps,
dut s'approvisionner l'industrie des autres nations, c'est une leon
qui montre pour la premire fois quelle puissance de transport la mer
pouvait mettre la disposition de l'homme.
V.
RACTIONS CONTINENTALES
Le commerce maritime n'avait d'abord qu'efeur les ctes. Mais
au del du rivage o s'taient levs des comptoirs, o s'taient fonds
des ports, l'intrieur a t sollicit de s'ouvrir. Il existe des voies
naturelles aboutissant la mer, facilitant la pntration des conti-
nents : ce sont les estuaires fluviaux par lesquels la navigation peut
s'avancer plus de cent kilomtres, ou les fleuves assez puissants
pour tre jusque dans l'intrieur le prolongement de la mer. A dfaut
de voies navigables, il
y
a des points de moindre rsistance par les-
quels la circulation pntrait dj vers l'intrieur.
272 LA CIRCULATION
La terre et la mer apprirent ainsi se pntrer. Entre ces deux
mondes qui se touchent, le contact se changea en rapprochement
plus intime. Par les ctes, une nouvelle vie s'insinue, qui anime et
soulve les continents, car elle agrandit l'aire sur laquelle peut agir
la puissance de transport conomique qui est le grand avantage des
voies maritimes, et elle fournit la navigation, avec une abondance
croissante, le fret dont elle a besoin. Autrefois il n'y avait que les ports
qui participassent aux larges perspectives d'outre-mer. Marseille,
Amsterdam, Hambourg vivaient en quelque sorte de leur vie propre.
Aujourd'hui c'est de l'intrieur que partent les ordres, que sont exp-
dies les masses de produits, matires premires ou objets d'alimenta-
tion, dont la mer est la grande dispensatrice
; et, parmi les ports qui
s'en disputent le fret, la slection s'tablit, moins d'aprs les avantages
nautiques qui leur sont propres, que d'aprs les facilits respectives
de leurs relations avec l'intrieur. On peut donc dire que, par une rvo-
lution longuement prpare mais devenue surtout manifeste de nos
jours, les rapports entre les terres et les mers ont t modifis. Certains
avantages auxquels jadis la gographie attachait un grand prix, tels
que les dcoupures multiples, les articulations de dtail du littoral,
^ont pass au second plan, tandis que les considrations de position
prenaient le dessus. Mais en somme l'influence de la mer s'est gnra-
lise
;
elle a largement empit sur les continents. C'est, sur de plus
amples espaces, par de plus grandes masses, entre continents et ocans,
que l'change des marchandises et des hommes s'opre dsormais.
Ces changes que la gographie physique constate entre les climats,
la gographie humaine les ralise entre les produits. Cet tat nouveau
qui est le rsultat du progrs des communications, de l'industrie, de
l'veil de l'activit, a son retentissement son tour, comme i est
naturel, dans la carte politique. Tant de nouvelles forces sont entres
en jeu, que l'tablissement d'une hgmonie unique a cess de rpondre
aux possibilits et peut-tre aux conceptions les plus ambitieuses.
D'autres Empires coloniaux se sont fonds ou se prparent aux cts
de celui qui reste le plus grand de tous.
Dans ces formations politiques grande envergure, les positions
maritimes, telles que les les, les caps, etc., ont leur rle marqu,
comme le prouve le rle que joue Dakar dans nos possessions, et
celui qui semble assur Tahiti et Mangareva aprs le percement de
Panama, ou l'importance des Hawa pour les tats-Unis, sur la route du
Pacifique. Ce sont des jalons, des tapes, des lieux d'atterrissement
de cbles, des dpts de charbon ou de vivres, points de relche, ne
vivant que d'une vie d'emprunt. La vie vient de l'intrieur des conti-
LA MER
273
nents. Partout se fait sentir, plus pressante, la raction de l'intrieur
sur les ctes. C'est un symbole significatif. La zone priphrique s'tend
;
l'aurole maritime gagne l'arrire-pays. La combinaison de l'Hudson,
des Grands-Lacs avec les Prairies, a dcid l'avenir des tats-Unis.
Delhi vient de remplacer Calcutta comme capitale des Indes
; ce qui
avait dbut comme comptoir est devenu un Empire, les valles du
Gange et de l' Indus ont ciment le lien entre la cte et un intrieur
qui va s'largissant. C'est ainsi que, par le Fleuve Rouge, l'attraction
du Tonkin commence se faire sentir jusqu'au Yunnan et gagne le
Sz-tchouan. La Chine, le Japon, sont entrans dans l'orbite des rela-
tions ocaniques. Sur les bords de l'Atlantique, la grande masse de
l'Afrique occidentale, de l'embouchure du Sngal celle du Niger,
penche de plus en plus vers la mer, mesure que les voies de pn-
tration convergentes soutirent le trafic de l'intrieur. Un Congo a
pris place parmi les tats. Une Amazonie commence se dessiner.
Ce mouvement a pour rsultat naturel d'accumuler, de concentrer
la vie aux points de jonction. On pourrait qualifier d'hypertrophie,
si elle tait durable, la disproportion qui existe entre la population
de certains grands entrepts maritimes et des contres auxquelles ils
appartiennent. Sydney compte plus de la moiti de la population de la
Nouvelle-Galles du Sud ;
Melbourne prs de la moiti de celle de Vic-
toria
;
Buenos Ayres renferme elle seule prs du cinquime de l'im-
mense Rpublique Argentine
Il
y
a une connexion entre tous ces faits. La zone de contact entre
les deux surfaces ingales qui se partagent le globe, s'est largie dans
les deux sens ; de plus grands espaces terrestres sont en rapport avec
de plus grands espaces maritimes. Le mouvement et la vie se sont
acclrs en consquence. Une attraction plus forte, capable d'enlever
plus d'hommes la glbe laquelle ils taient attachs, capable d'at-
teindre de plus grandes distances des moissons entires, de mettre
en mouvement des masses plus considrables de produits, opre entre
les diffrentes contres de la terre un brassage qui et auparavant t
impossible.
Cela est l'uvre accomplie de nos jours par la navigation maritime
;
nous laissons au lecteur le soin d'en tirer les consquences sociales et
conomiques. Elles ne sont pas ddaigner
;
et cependant, la
rflexion, toute l'uvre humaine parat imparfaite, effleurant peine
la surface des choses.
Quand on considre le peu d'espace que couvrent les routes suivies
par nos navires par rapport l'immensit des ocans, quand surtout
on songe ce que nos instruments nous laissent souponner de la phy-
Vidal-Lablache, Gographie humaine. 18
274 LA CIRCULATION
siologie et de la morphologie de ce corps immense, de ses abmes, des
mouvements de fonds qui s'y produisent, des changes qui s'y oprent,
de la vie qui, sur toute l'tendue de cette masse, se droule sous des
formes et des apparences insouponnes, lgions mouvantes, plankton
flottant, tres rampant dans les abmes,
on reste confondu du peu
que reprsente en ralit cet effort humain, si notables qu'en soient
les rsultats gographiques. L'on aperoit avec une sorte de stupeur
combien d'activits et d'nergies nous chappent dans l'ensemble
de ce monde o notre petitesse s'imagine jouer un si grand rle. C'est
surtout par l'intermdiaire des tres vivants que l'activit de l'homme
trouve partout moyen de s'exercer. Or quoi se trouve-t-on parvenu ?
Nous avons pu exterminer quelques espces d'amphibies qui frquen-
taient les confins septentrionaux du Pacifique, pourchasser les baleines
des parages qu'elles frquentaient, mais ces destructions se borne
notre atteinte, et nous ne savons mme pas quelles lois obissent
les migrations de poissans qui font l'objet ordinaire de nos pcheries.
Nous ne connaissons pas leur biologie. Presque tout nous chappe
au-dessous de la mince couverture o notre prsence laisse un fugitif
sillon. Presque tout, mme dans ce qui touche les occupations et
les industries les plus anciennes de la mer, devient aussitt mystre en
dehors de ce que peroit la vue. Nous n'avons qu'une seule arme pour
pntrer dans ce monde ferm : c'est l'esprit, arm de science,,
capable d'invention, stimul aujourd'hui par la conscience plus nette
de tout ce qui se recle d'nergies autour de nous. Dans le monde des
mers, comme dans celui de l'air, les conqutes de l'esprit et les appli-
cations pratiques auxquelles elles ont donn lieu sont les plus hauts
signes de la grandeur de l'homme.
C'est par elles qu'il devient vraiment citoyen du monde. Et les chan-
gements oprs par la science sont les plus rapides : l'utopie d'hier
est la ralit de demain.
FRAGMENTS
FORMATION DE RACES
De ce que les traces primitives de l'homme se rencontrent dans
presque toutes les parties de la terre, nous devons conclure son
ubiquit mais non son universalit. Le peuplement ne pouvait
qu'tre intermittent, puisqu'il tait nomadique
;
et il faut aussi se le
reprsenter comme sporadique, c'est--dire avec des lacunes, des
intervalles habituellement vides. Les rgions arctiques ou les marches
frontires du dsert nous offrent une image fidle de cet tat. Dans
ces rgions de chasse et de pche, c'est par petites auroles parses
que se manifeste la prsence de l'homme. Il
y
a des terrains de chasse
plus favorables suivant les saisons ;
il
y
a des sites privilgis de pche-
rie : ce sont ces lieux que l'homme apprit sans doute bientt connatre,
qu'il prit l'habitude de frquenter plus assidment, o il commena
peut-tre improviser quelques grossiers abris, tracer quelques
signes de reconnaissance ou de ralliement, premires bauches des
tablissements que ses arrire-descendants devaient
y
implanter
dans la suite. Peut-tre prit-il l'habitude de signaler par quelques
points de repre les directions les plus commodes pour s'y rendre
au moment voulu. Mais, entre ces linaments rudimentaires de rendez
-
vous priodiques, ces sillages peine plus durables que celui d'un
navire, il faut se reprsenter de grands espaces habituellement vides,
de larges zones d'isolement.
L'isolement est la condition ncessaire de ce que nous appelons des
races. S'il ne cre pas la diffrenciation, on peut affirmer du moins
qu'il contribue la maintenir. C'est seulement avec son concours
que des caractres physiques spcialiss ont pu se constituer, se trans-
mettre et durer travers les mlanges ultrieurs. Or l'humanit primi-
tive, autant que nous pouvons l'entrevoir, apparat sous forme de
races distinctes pourvues de caractres permanents et durables, homo-
gnes sur de grandes tendues.
278 FRAGMENTS
Nous entendons par races des divisions fondes sur des caractres
somatiques, affectant soit la morphologie, soit la physiologie du corps
humain. Aujourd'hui les races physiques se manifestent rarement
dans leur intgrit
;
gographiquement, on ne saisit plus gure que des
groupes profondment mlangs. Il est certain cependant que la cou-
leur de la peau, l'indice cphalique, l'indice nasal, orbito-nasal, la
forme des cheveux, la taille, fournissent des tmoignages persistants
de caractres physiques qui se sont diffrencis, fixs et transmis
d'ge en ge, persistant l'tat plus ou moins pur travers tous les
mlanges. Aucune exprience n'autorise penser que le ngre, le
jaune, le blanc puissent, mme la longue, perdre, en vivant dans un
autre milieu que leur habitat d'origine, leurs caractres typiques.
La formation de ces races doit tre considre comme remontant
aux priodes les plus recules de l'histoire de l'humanit et a d tre
dtermine par des conditions dont nous pouvons difficilement nous
faire ide. Le peuplement humain n'a pas procd la faon d'une
nappe d'huile envahissant rgulirement le domaine terrestre. S'il est
parti d'un centre, d'ailleurs impossible dterminer actuellement,
il n'a pas rayonn galement vers la priphrie. Dans l'impossibilit
o nous sommes de retracer les phases de cette volution, nous ne
pouvons que constater une chose, c'est que, actuellement, la population
humaine est distribue par groupes : entre un petit nombre de foyers
d'accumulation, il
y
a des vides ou du moins des contres beaucoup
moins peuples. Les causes qui ont prsid la formation de ces
groupes ont favoris la cration d'individualits. Quelques-unes sont
demeures faibles, d'autres ont grandi au point d'embrasser de grandes
collectivits. Il est impossible de concevoir, sans l'action mille fois
sculaire de causes sparatrices, les divisions que prsente encore
l'humanit actuelle.
Les conditions naturelles qui ont suspendu ou gn l'expansion des
groupes humains subsistent encore et agissent dans une certaine
mesure : les mers d'abord
;
sur la surface des terres : les marais, les forts,
les montagnes. En outre, il
y
a des contres mieux doues que d'autres
pour fournir aux besoins de l'homme une satisfaction aise et abon-
dante
; la distribution des plantes et des animaux utiles a d exercer
une influence dcisive sur la formation des groupes humains.
Toutes ces conditions ont certainement vari depuis le moment
o se sont formes les races actuelles. Comment expliquer autrement
les contradictions et les obscurits de leur rpartition gographique ?
L'une de celles qui, au Sud de l'Asie a t l'objet d'observations,
est celle des Ngritos. Nettement diffrents par leurs caractres anthro-
FORMATION DE RAGES 279
pologiques, par leur petite taille, leurs cheveux crpus, leur indice
cphalique brachycphale, des races qui les entourent, ils ont t
reconnus par groupes sporadiques, spars par de grandes distances
ocaniques, dans les Philippines, la pninsule malaise, les Andaman,
sans qu'on soit encore en tat de dterminer leurs limites l'Ouest
et au Nord. Rien dans cette race n'est propre faire souponner
quelque trace des aptitudes nautiques ncessaires pour expliquer
cette rpartition. Quelle combinaison d'vnements serait capable
d'expliquer l'existence insulaire dans un rayon de plus de 3.300 kilo-
mtres de groupes passifs trangers toute vie maritime
;
ne connaissant
d'autre outillage que l'arc de forme particulire dont ils se servent
pour la chasse ?
Les recherches comparatives accomplies sur les races du Sud-Ouest
de l'Europe et du Nord de l'Afrique semblent tmoigner aussi en
faveur de changements des conditions gographiques. De bons obser-
vateurs distinguent parmi les Berbres un certain nombre de types
reprsentant des races diffrentes, et, parmi eux, il s'en trouve, tel
que le type brun dolichocphale leptorrhinien, qui ressemblent aux
Italiens du Sud, aux Siciliens et aux Corses
;
d'autres (brachycphales)
qui rappellent de prs certains habitants de notre Massif central
^.
C'est peut-tre dans les montagnes du centre de la Tunisie que se
retrouvent les reprsentants actuels les plus authentiques de la race
dolicocphale face large que nous ont fait connatre les fouilles des
grottes de la Vzre. On peut allguer, qui plus est, que les relations
de contigut continentale ont d persister assez longtemps pour
accompagner certains dveloppements de civilisation. La preuve
en serait dans les ressemblances qu'offrent en Europe et dans l'Afrique
du Nord les produits de l'industrie palolithique
2.
Ainsi l'hypothse de changements considrables dans la configura-
tion des continents semble indispensable pour expliquer la formation
des races ngres. Un tat sans doute moins ancien, mais assez loign
nanmoins de l'tat actuel, semble avoir prsid la formation des
races dont nous constatons aujourd'hui l'analogie dans le Sud de l'Eu-
rope et le Nord de l'Afrique. On pourrait ajouter que, parmi les hypo-
thses sur la formation de la race dolichocphale blonde, dite nor-
dique, la plus naturelle semble celle qui rattache son origine aux
rgions laisses libres dans le Nord de l'Europe par le recul des glaciers
quaternaires. Une preuve de cette origine relativement rcente peut
1. R. CoLLiGNON, Etude sur l'ethnographie de la Tunisie, Bulletin de Gogra-
phie historique et descriptive, 1886, p. 203 p. 286.
2. M. Boule, Les Grottes de Grimaldi, L'Anthropologie, t. XVII, 1906, p. 283.
280 FRAGMENTS
tre tire du caractre de puret qu'elle conserve encore dans certaines
parties de la Scandinavie, comme aussi de la force d'expansion dont
elle a fait preuve dans tous les temps historiques.
Une explosion de prolificit dans des conditions d'isolement doit
tre envisage comme l'origine de races nouvelles. Ces circonstances
peuvent-elles tre encore ralises ? On pourrait citer comme exemple
les Allemands dans les campagnes intrieures du Sud du Brsil, passs
de 20.000 200.000 en deux gnrations
^
;
les Boers dans l'Afrique
du Sud
2.
Mais il ne semble pas que l'isolement ait t assez prolong
dans ces cas pour raliser quelque chose de comparable ce qui a d
se produire maintes fois jadis.
On a cru remarquer le changement que quelques gnrations auraient
russi accomplir sous l'influence du climat des tats-Unis du Nord-
Est dans le temprament de l'Anglo-Saxon devenu le Yankee.
Si rels que soient de pareils changements, ils sont contenus en
d'troites limites, ils ne sont pas capables d'affecter les caractres
primordiaux des races. La rsistance des types est un des faits que les
progrs des tudes anthropologiques ont mis en lumire. Il
y
a des carac-
tres constants ct d'autres qui peuvent varier. Si nous ne sommes
pas en mesure de dire sur quoi se fonde cette distinction, sa ralit
ne peut faire l'ombre d'un doute. Les modifications qu'on observe
dans les races sont dues aux mlanges qui s'oprent entre elles plutt
qu'aux conditions immdiates de climat et de sol influant sur l'orga-
nisme. Nous voyons Lapons et Scandinaves, Slaves et Samoydes,
Malais et Mlansiens, Anos et Japonais coexister aux mmes lati-
tudes, et d'autre part les rgions quatoriales fournir domicile des
races aussi diffrentes que les Ngres d'Afrique et que les Indiens de
l'Amrique du Sud.
Le problme de la formation et de la consolidation de quelques types
gnraux dans lesquels s'absorbe et se rsume une grande quantit
de sous-races ne reoit donc que bien peu d'claircissement, pour ne
pas dire aucun, de l'examen des conditions prsentes. La distinction
des races remonte en ralit une poque o le mode de peuplement
diffrait profondment de celui d'aujourd'hui. Il faut le regarder
comme un legs du pass.
Il n'en existe pas moins des adaptations, rendant, pour des rai-
sons encore obscures, certaines races inaptes sortir de certains milieux
et donnant aux races enracines dans un milieu dtermin la possibilit
1. P. Denis, Le Brsil au XX^ sicle, Paris, 1909, p. 237.
2. V. Dehrain, Le Cap de Bonne-Esprance au XVI11^ sicle, p. 235.
FORMATION DE RACES 281
d'assimiler ou d'liminer les lments trangers qui
y
sont introduits.
De ce dernier cas, un exemple frappant est fourni par ce qui est arriv
sur les plateaux tropicaux d'Amrique.
Il est certain que le type caractristique du Yankee, au long et
maigre cou, la chevelure plate et lisse, offre des traits trangers
la mtropole, peut-tre en rapport avec des diffrences d'tat hydro-
mtrique. On ne voit pas cependant que nos races franaises de l'Ouest
transplantes au Canada aient subi les mmes transformations. Elles
sont, aprs deux cents ans, restes fidles elles-mmes.
Plus incontestables sont les effets de l'altitude. Au-dessus de
2.000 mtres, vivent en Abyssinie et surtout en Amrique un certain
nombre de populations plus civilises que leur entourage des terres
chaudes et basses. La salubrit de ces hauteurs
y
est favorable
l'homme ; les chirurgiens de l'expdition anglaise d'Abyssinie ont
constat la cicatrisation rapide des blessures. Mais la diminution de la
tension atmosphrique nuit la combinaison de l'oxygne de Tair
avec les globules du sang, d'o l'impossibilit d'efforts musculaires
ou crbraux prolongs. On a souvent not chez les Aztques l'absence
de gat et de mouvement, mme chez les enfants, l'apathie et l'atonie
des physionomies.
Certaines races se distinguent d'autres toutes voisines par une force
de rsistance certaines maladies, de vritables immunits patholo-
giques. Par l'effet de ces dispositions, il arrive que le classement des
races se prsente sous l'aspect d'une opposition tranche, d'une incom-
patibilit entre rgions contigus. La malaria carte le Chinois et
l'Annamite des montagnes o vivent les Lolos, Mois et autres peuples
montagnards. Le iera est une sparation tranche entre l'Hindou
aryanis de la plaine et les peuples mongolodes des pentes hyma-
layennes. Les terres chaudes (Germsir) du golfe Persique n'abritent
que des ngres et des mtis l'exclusion des Perses. Le Hova de Mada-
gascar laisse aux Sakalaves le sjour des plaines, comme le Chibcha
ou le Quitchua des plateaux andins a toujours vit l'humidit fores-
tire de la montana
; et comme l'Abyssin vite les terres tour tour
marcageuses et crevasses qui bordent sa citadelle naturelle.
Une adaptation rigoureusement exclusive continue maintenir ces
barrires, mais ces faits correspondent un tat encore peu avanc
des relations gnrales. Les conditions normales dont on pourrait
citer des exemples nombreux, sont celles de types humains vivant
cte cte, s'accommodant des mmes milieux : Bdouins et Fellahs,
Nomades et Ksouriens, Scandinaves et Lapons, Iraniens et Kirghiz,
Fouib et Mandingues, Bantous et Ngrilles.
282 FRAGMENTS
Il faut observer toutefois que, lorsqu'on voit des groupes voisins
rester ce point distincts, c'est que le lien social est rest lche et qu'il
ne s'est point dvelopp encore une force de civilisation capable de
runir et de fondre les contrastes. Dans ces conditions, les particula-
rits de temprament sur lesquelles se greffent les habitudes prennent
le dessus. Il peut arriver mme que des causes artificielles de spara-
tion telles que l'Islam en a cres par rapport au Christianisme tendent
perptuer les divisions. A tout prendre cependant elles sont l'indice
d'un tat social relativement peu avanc, dans lequel le localisme n'est
pas encore aux prises avec les forces conomiques gnrales qui en-
tranent sans cesse un nombre croissant de contres dans leur orbite.
Les contrastes ramasss sur un troit espace, capables d'engendrer
des incompatibilits d'habitats entre races voisines sont en somme des
exceptions. Ne voyons-nous pas, par teintes graduelles, par additions
de touches successives, les zones de climat passer de l'un l'autre ?
Steppes, savanes, forts-clairires, marquent la transition entre la silve
et le dsert. Le domaine de l'olivier et celui des arbres feuilles caduques
s'enchevtrent; entre celui-ci et les forts de conifres du Nord, l'appa-
rition de sols favorables mnage la transition. Cette gamme se retrouve
dans les races humaines. Entre les races caractres assez tranchs
pour qu'elles conservent leur domaine presque exclusif comme le
ngre et Vhomo caucasiens, les intermdiaires abondent
; et ce n'est
pas seulement entre jaunes et blancs qu'on peut noter, avec le D"" Hamy,
l'extrme difficult d'une dlimitation scientifique .
L'Afrique du Nord est le champ o ne cessent de se croiser Smites,
Berbres et Ngres soudaniens. Comme dans les anciennes peintures
des temps pharaoniques, le clair, le basan, le rougetre, jusqu'au
noir voisinent dans l'intervalle qui spare la Mditerrane du Soudan.
On passe, presque insensiblement, des types gyptiens ceux de
Nubie ; et ceux-ci forment le pont vers les Bedjas de l'Afrique orien-
tale ou vers les Ngres du Haut-Nil. L'esclavage, la guerre, l'Islam
ont donn lieu des mtissages dont Nachtigal note les degrs entre
Arabes et gens du Bornou. Le sang ngre coule dans les veines des
Dynastes marocains. Les Touareg n'ont pas entirement rsist son
infiltration. Entre le Sngal et le Maroc, les peuples qu'on appelle
Maures, Berbres croiss de sang ngre, offrent une singulire ressem-
blance avec les thiopiens orientaux
;
si bien qu'il semble qu'aux deux
extrmits de l'Afrique, les mmes causes ont produit les mmes effets
et que, du mlange des deux races chamitiques, Nubiens ou
gyp-
tiens, Berbres proprement dits, avec une certaine proportion de sang
ngre, sont rsults des groupes mixtes trs analogues, dont nous
FORMATION DE RAGES 283
trouvons l'expression la plus complte en Abyssinie d'une part, dans
le Nord du Sngal de l'autre
^
.
Quelque chose de semblable se prsente dans ce groupe de 50 mil-
lions de Dravidiens qui, dans l'Inde, s'interpose entre les races ngres
qui semblent avoir t au Sud les premiers occupants, et les blancs
ultrieurement venus par le Nord-Ouest. Leur type, suivant de bons
observateurs, par certains caractres rappelle le ngre et par d'autres
le blanc ^.
On note une gradation rgulire entre Dravidiens civi-
liss de la plaine et sauvages Ngrodes de la montagne . Quelle que
soit la part du mlange, il
y
a l une vritable race reconnaissable
quelques traits essentiels remarquablement uniformes et distincts
^.
Cette race est chez elle dans l'Inde
;
elle s'y est forme et cimente,
et, mieux assouplie qu'aucune autre aux conditions du climat, c'est
elle qui fournit les migrants la Birmanie, les travailleurs des plan-
tations de th de l'Assam.
Entre les races mongoles et le groupe puissant des Mlansiens,
si mlang lui-mme, une race, grande par sa diffusion, multiple par
ses varits, s'interpose galement, celle des Malais. De Sumatra
aux Philippines, sans parler de ses colonies lointaines, c'est par excel-
lence celle des archipels et des ctes, adonne surtout la pche, la
piraterie et au commerce maritime. Un type malais, reconnaissable
et distinct, s'est constitu l'aide d'lments divers qu'il absorbe
;
on voit en gnral, sous l'influence du voisinage mlansien, la peau
se foncer davantage de l'Ouest vers l'Est. Une autre transition s'ob-
serve du Sud au Nord : aux Philippines et dj mme Clbes, on
remarque des individus qu'on pourrait prendre pour des Japonais.
Conclusion.
Les origines des principales diversits de races nous
chappent
;
elles se perdent dans un pass trop lointain. Mais, malgr la
rserve que l'imperfection des observations nous impose, bien des
faits nous avertissent que la matire humaine conserve sa plasticit
et que, incessamment ptrie parles influences du milieu, elle est capable
de se prter des combinaisons et des formes nouvelles. Le travail
de formation des races est toujours l'uvre. La sve des combinaisons
ethniques n'est pas tarie. Dans le creuset de la nature, des forces
multiples travaillent
;
et, de ces nergies, nul ne reoit plus vivement
1. GoLLiGNON et Deniker, Les Maures du Sngal. L'Anthropologie, VII, 1896,
p. 266.
2. L. Lapique, Comptes rendus des sances de la Socit de Biologie, t. LIX, p. 231
(1905).
3. Census
of
India,
1901, p. 500 sq.
284 FRAGMENTS
le contre-coup que l'tre intelligent qui sait les employer ses fins,
en utiliser les suggestions,
y
modeler ses habitudes et ses genres de
vie. Ce n'est pas seulement par ses intempries, mais par sa tonalit
gnrale qu'agit le climat
;
et le climat n'est pas le seul facteur : le sol,
le relief, les formes qui engendrent les surfaces et les contacts de
terres et d'eau, voil l'ensemble qui agit sur les hommes.
Les peuples s'adaptent, ou pour mieux dire s'assouplissent leurs
habitats successifs. Sur ces mlanges qui forment trait d'union entre
des races loignes et diverses, l'influence du milieu garde le dernier
mot. A la suite des slections qu'elle opre, un rsidu subsiste, qui se
montre capable de rsistance et de dure.
L'Asie centrale, autant qu'elle se rvle aux recherches, est, avec
ses Uzbeks, ses Tadgiks, ses Dunganes, un champ de mlange entre
races. L'extrme Nord du vieux continent, comme le constate Nor-
denskiold, a subi le contre-coup de ces mlanges. En Europe comme
en Asie, la zone entrecoupe de clairires et de forts, qui s'tend entre
50 et b5^ de latitude voit se succder Mongols, Turcs, Finnois et
Slaves. Les Mongols buriates, les Morves et Tchrmisses finnois del
Haute-Volga subissent une russification continue. Ce phnomne n'est
pas diffrent de celui que l'histoire nous fait pressentir vers l'Ouest
au contact des Germains et des Slaves. Toutes ces transformations
ethniques se poursuivent le long d'une zone offrant les mmes condi-
tions la vie agricole.
Quand, par faveur rare, les lueurs de l'histoire permettent de plonger
un peu plus loin dans le pass, comme dans le monde mditerranen,
que discernons-nous ? Les tmoignages d'arrives successives du
centre ou du Nord de l'Europe. Sous les noms de Gtes, Thraces,
Bithyniens, etc., des peuples descendent ainsi des Carpathes au Bos-
phore et de l en Asie Mineure. Le xi^ sicle avant notre re vit l'bran-
lement rpercut du Nord au Sud, d'un bout l'autre de la Grce,
par les invasions doriennes
;
en Italie, nous dit Pline l'Ancien, les
trusques poussrent les Ombriens, avant d'tre eux-mmes pousss
par les Gaulois . Ceux-ci apparaissent au iii^ sicle sur les bords du
golfe du Lion, puis en Espagne. De tout cela, la nature, par voie com-
bine d'liminations et d'adaptations, a fait un ensemble qui subsiste,
incorpor au milieu. Les nouveaux arrivants ont plus ou moins pay
leur tribut aux ts dvorants, aux longues scheresses, aux exhalai-
sons malsaines et aux fermentations putrides
;
mais il s'est form de ces
lments diffrents et successifs un compos ethnique, qui, sans avoir
le caractre de races homognes, prsente des traits communs.
II
LA DIFFUSION DES INVENTIONS
(Instruments et animaux domestiques)
Il
y
a dans l'ensemble des zones tempres une rgion qui se dis-
tingue comme particulirement propre la diffusion des inventions, c'est
la grande rgion continentale qui s'tend travers l'ancien monde
dans l'hmisphre nord. Les outils ou instruments et tout ce qui
constitue les manifestations extrieures d'une civilisation
y
sont en
usage sur de grandes surfaces
; la domestication des animaux s'tend
paralllement l'usage des outils
; les modes d'existence, nourriture,
vtement, habitat prsentent les mmes analogies. On est en prsence
de faits de grande envergure, embrassant des aires considrables,
et cela bien avant les moyens de communications des temps modernes.
Ils sont en tat pour ainsi dire de ventilation perptuelle.
C'est entre 25 et 60 de latitude Nord que cette rgion peut tre
circonscrite. La plupart des inventions sur lesquelles a vcu une grande
partie de l'humanit s'y ralisent.
La charrue.
Prenons pour exemple un instrument dont l'aire
de diffusion s'tend travers l'ancien monde depuis la Mauritanie
jusqu'en Chine, la charrue. Au Sud de l'Ar, dans le Soudan, elle fait
place la culture la houe, l'outil des populations agricoles du centre
africain.
Cette limite exprime un rapport naturel : tandis que le domaine de
la culture la bche est celui des rgions o peu d'espace sufft pour
fournir beaucoup de nourriture, o les arbres, les racines sont les
principaux produits, la charrue n'a pu prendre naissance que dans
les rgions o l'herbe l'emporte sur l'arbre, o il existe des espaces
dcouverts assez tendus dans leur continuit pour permettre de mul-
tiplier les graines.
286 FRAGMENTS
Par quelles sries de suggestions, d'eforts et de perfectionnements
le bton pointu qui sert enfoncer la semence dans le sol s'est-il
transform en la branche noueuse arme d'un soc qui fut la charrue,
nous l'ignorerons toujours, de mme que nous ne pouvons fixer le
moment o le joug a t adapt cet instrument et des animaux attels
ce joug. Nous voyons le buf usit comme animal de trait en Chalde
et nous savons quels rites traditionnels se rapportent en Chine au
labour.
Maintenant encore, dans les spcimens les plus simples, comme la
charrue berbre, les lments essentiels sont combins : le soc et le
coutre de fer s'adaptent la flche et un double emmanchement,
dont l'un sert l'homme pour diriger l'instrument et l'autre sert de
timon pour l'attelage. Ce type est all de bonne heure se compliquant
suivant les contres
;
et, sans qu'il soit ncessaire d'voquer nos char-
rues perfectionnes et tracteurs mcaniques, dj, au
i^r
sicle de notre
re, Varron, Pline et les agronomes latins dcrivaient avec surprise,
dans les plaines du Nord de la Gaule, la charrue roues.
La roue.
L'invention de la roue ne fut pas moins dcisive. Nous
ignorons comment et quelle poque l'ide de traner un fardeau
support par des rouleaux cylindriques a pris naissance
; mais cette
forme ingnieuse, quoique trs primitive, de tranage, coexiste, d'aprs
les monuments assyriens, avec la roue, le char de guerre, l'attelage
du cheval. Il a donc fallu que cette donne primitive fit place l'ide
de la roue, soit pleine comme on la voit encore en Bosnie et au Pays
Basque, soit vide comme dj la montrent les reprsentations
antiques. Entre les roues disposes symtriquement, s'interpose un
essieu soutenant la caisse qui reprsente le char. Mais, partir du
moment o ce type essentiel est cr, que de modifications et d'adap-
tations diverses viennent s'y greler !...
Voil des exemples doublement significatifs. D'abord ils ont une
valeur de localisation. Puis ils nous montrent des inventions qui, de
quelque point initial, se sont rpandues, communiques, perfection-
nes. Rien de pareil ne nous a frapp dans les civilisations closes
l'ombre des silves tropicales. Nous discernons ainsi que, sur des espaces
tendus, l'esprit inventif a travaill sur un thme commun
;
que,
sans s'en carter, il a russi l'adapter aux conditions diverses de
relief et de sol. Et par l se glisse encore un lment gographique.
Ce que l'on peut saisir travers ces inventions, dfaut de dates et
de noms qui ne sont que lgendes, ce sont les conditions naturelles
qui ont pli, dans un sens ou un autre, des inventions, legs de temps
LA DIFFUSION DES INVENTIONS 287
immmorial mais rest vivant et perfectible. Ce qui apparat distinc-
tement, c'est une suite d'applications diverses portant sur un type
dtermin, une activit coordonne de progrs qui ne parat gure
dans le matriel plus uniforme et plus fig de la plupart des socits
tropicales.
Les transports par animaux de trait.
Le moment o le transport
par animaux se substitue au transport par hommes, est dcisif dans
l'volution des socits.
La charrue, le charriot supposent l'emploi de la force animale.
Il n'y a aucune raison de croire,
tout au contraire,
que l'appro-
priation de certains animaux nos besoins de culture et de transport
ait t l'uvre d'une seule et mme contre particulire. Tout indique
que la domestication de ces animaux herbivores dociles et sociables
sur lesquels est fonde l'conomie rurale ou pastorale, s'est opre
en des points assez diffrents. On devine toutefois que certaines con-
tres ont t particulirement propices. O pouvait mieux se nouer
cette familiarit, aide de curiosit rciproque, qui a rapproch de
l'homme les hordes dans lesquelles il a choisi ses auxiliaires, qu'au
seuil mme des steppes, l o, par les cultures d'irrigation, l'homme
avait russi concentrer des ressources, crer autour de lui l'abon-
dance ? L'Egypte, la Chalde, les jardins ou paradis de l'Asie
occidentale jourent pour les animaux le mme rle que pour les plantes.
L'homme sut
y
composer un monde vivant son usage. L'acclima-
tation de plantes utiles
y
fut systmatiquement poursuivie depuis
une haute antiquit : J'ai fait, dit l'Ecclsiaste, des jardins et des
clos o j'ai mis toutes sortes d'arbres. )> L furent, pour cette raison,
les rendez-vous d'animaux divers, les points d'attraction qui grou-
prent animaux et plantes. Nos regards sont ainsi ramens sur ces
parties de la terre, fertiles, mais encadres de scheresses, qui eurent
le privilge, ainsi que nous avons dit, de raliser pour la premire fois
le phnomne de densit du peuplement humain. Ce n'est gure ail-
leurs que put se combiner ce fcond mnage, dont l'absence, en certaines
parties de la terre, a pes lourdement sur la civilisation.
Cette rgion comprend tout l'espace qui s'tend entre le Soudan
et l'Asie centrale, de la Nubie la Mongolie, de l'Iran et de l'Inde sep-
tentrionale l'Asie Mineure. Ainsi les antiques socits qui fleu-
rissent en Egypte et dans l'Asie occidentale durent leur situation le
grand avantage de pouvoir concentrer leur profit les produits de
deux faunes diffrentes. Du Nord leur vinrent le cheval et le chameau
;
l'ne au contraire se rpandit par le Sud.
III
GENRES DE VIE ET DOMAINES DE CIVILISATION
Il se forme, la longue, des domaines de civilisation absorbant
les milieux locaux, des milieux de civilisation imposant une tenue
gnrale qui s'imprime dans beaucoup d'usages de la vie. L'Islam,
l'Hindouisme, la Chine reprsentent des types de civilisation sup-
rieure dont l'imitation s'tend bien au del des limites des rgions
naturelles. L'Europen joue le mme rle, le Yankee tend le prendre
en Amrique. Comme l'extrieur est toujours ce qui est le plus facile
saisir, ce n'est qu'en emprunts superficiels que consistent ces imi-
tations. Les chefs des peuplades Gonds, Bhils et autres sauvages de
l'Inde centrale, adoptent, pour s'imposer leurs congnres, le cos-
tume et l'extrieur des Radjpoutes
;
au Soudan, ct de peuplades
bien sommairement vtues, des personnages draps dans de longues
bandes de coton cousues ensemble, chausss de babouches en cuir
jaune ou rouge, se distinguent comme affilis l'Islam, comme parti-
cipant des avantages d'une civilisation suprieure.
L'appt de jouissances nouvelles, l'illusion de se renouveler soi-
mme en participant, ne ft-ce que par des signes extrieurs, un
tat social plus lev, exerce sur les groupes, comme sur les individus
un infaillible effet d'attraction. C'est un phnomne semblable
celui qui entrane l'exode vers les villes. Il
y
a souvent maladresse
et gaucherie dans ces efforts pour s'assimiler des voisins plus civi-
liss, pour s'approprier le fruit d'uvres d'autrui cres en dehors de
sa sphre propre. N'importe : une forme de civilisation capable de
rayonner autour d'elle devient une source de forces qui agissent par
elles-mmes, indpendamment des conditions immdiates de milieu.
Mais pour cela une condition essentielle est la connaissance rciproque
qu'engendre la facilit des rapports, la frquence des communications,
l'absence d'isolement. C'est parce que, comme on l'a vu, ces rapports
GENRES DE VIE ET DOMAINES DE CIVILISATION 289
taient mieux prpars dans la zone qui traverse l'ancien monde en
diagonale au Nord du Tropique, que nous
y
rencontrons des formes
prcoces de civilisation tailles plus grands traits qu'ailleurs
; do-
maines souhait pour les grands Empires, les grandes religions qui
s'y succdent. Un long travail de syncrtisme a abouti composer
ces rassemblements sociaux que rsument les mots d'Islam, Europe
chrtienne. Hindouisme, Chine, centres d'influences dans lesquels
beaucoup de centres moindres coexistent, mais qui gardent leur phy-
sionomie d'ensemble.
Le Chinois, en dpit des diffrences provinciales, reste identique
lui-mme sur les confins de la Sibrie et Singapour. L'outillage,
les moyens de nourriture, les remdes et l'art de gurir, les formes de
luxe, en sont le symbole matriel. La Chine se compose essentielle-
ment de deux contres diffrentes, le Nord et le Sud, Cathay et Manzi.
C'est dans la Chine centrale que s'est nourrie cette civilisation. Cepen-
dant, il
y
a pour le Chinois une manire peu prs commune de se
nourrir, se loger, se vtir, de soigner ses maladies. Ses procds de
culture ne varient pas sur de grands espaces, tandis qu'il reste r-
fractaire ceux de ses voisins, Mongols ou autres. Le chanvre jadis,
la soie pour les classes riches, le coton forment la trame de ses vte-
ments
; la laine, que pourtant rclamerait le climat du Nord de la
Chine, n'y figure pas. Comme dans les socits trs hirarchises et
en partie archaques, le costume se complique et s'embellit dans les
classes riches. Au lieu de la jaquette courte avec pantalon et sandales
qui suffit aux proltaires, le bourgeois cossu, le mandarin s'enveloppent
d'une sorte de robe de chambre tombant trs bas, dont la prestance
est rehausse par des broderies, des passementeries, des insignes en
jade ou en cristal : en cela consiste le signe extrieur, signe envi de
la supriorit sociale. A ct de la pratique traditionnelle de cultures
dlicates comme celle du th, minutieuses comme celle du riz, des
manipulations compliques comme celles de la soie, il
y
a des indus-
tries trs anciennes et raffines comme celle des porcelaines, des
laques, du jade, de la nphrite, du bronze, qui faisaient l'objet d'un
commerce tendu il
y
a deux mille ans. Le th, transport sous forme
de briques, est devenu indispensable aux peuples de la haute Asie.
La porcelaine figure parmi les plus anciens objets de trafic des mers
de Chine et de l'Ocan Indien
; des spcimens de l'ancien cladon
chinois ne sont pas rares aux Philippines. Ce sont les marques par
lesquelles s'affirme le prestige d'une civilisation et l'attraction qu'elle
exerce autour d'elle.
L'Islam, dans le domaine qu'il s'arrogea aux dpens des civilisa-
Vidal-Lablache, Gographie humaine. 19
290 FRAGMENTS
tions des bords de la Mditerrane et de l'Asie occidentale, recueillit
l'hritage d'industries, de raffinements de culture, miettes tombes
de la table du monde antique. Les pratiques d'irrigation avaient
fleuri en Chalde et en Egypte
;
l'art des briques mailles avait cr
des merveilles en Perse
;
la coupole byzantine avait fond ses assises
;
des industries d'art avaient pouss des racines. Dans la partie occi-
dentale de son domaine, l'antique renomme des maroquins^ des cuirs
de Cordoue, tait peut-tre en rapport avec la trs antique domestica-
tion de la chvre chez les peuples ibriques. Depuis longtemps on
savait, dans ces contres, travailler les peaux, les tanner, les assouplir
et les teindre au moyen de substances vgtales diverses, dont les
bazars d'Afrique ou d'Orient continuent offrir des chantillons.
Le bazar, le caravansrail sont, presque autant que la mosque et le
minaret d'o des milliers de voix, depuis le Maghreb jusqu'au Turkes-
tan, appellent les croyants la prire, les organes de cette forme de
civilisation, une des plus prenantes qui existent. Elle s'appuie sur des
centres religieux : la Mecque, Mdine, Mesched, Samarkand, Fez,
Le Caire, Kerbla, o le sentiment de la communaut se retremp.
Aux approches de Bokhara, un de ces centres urbains dont la renom-
me lointaine attire plerins ou marchands, de longues files d'auberges,
restaurants, annoncent et prcdent la ville. On a souvent dit avec
quelle rapidit les nouvelles, les bruits vrais ou faux circulent d'un
bout l'autre du monde islamique. Il se dgage de tout cela une force
d'opinion, qui ouvre aux croyants non seulement les perspectives
d'une autre vie, mais qui, dans celle-ci mme, le relve ses propres
yeux, et en fait un tre suprieur pour les populations du Soudan et
mme de l'Inde. Vtement, construction, matriel et mobilier, com-
posent le signalement extrieur de cette civilisation musulmane
;
ils se maintiennent avec une singulire persistance. Le Bosniaque
islamis tend se distinguer par son costume
; et ce fut sans doute
un contre-sens que de substituer au turban et au caftan le fez et la
redingote trique de la rforme mahmoudienne...
IV
LA VILLE
Il
y
a des contres d'tablissements sdentaires o la ville ne s'est
pas implante. Le type de village est de beaucoup dominant dans les
grands centres de peuplement rural de l'Inde et de l'Extrme-Orient
;
encore plus dans des contres de moindre civilisation comme le Soudan
et l'Afrique centrale, car on ne saurait donner le nom de ville ces
agglomrations fortuites que la puissance d'un chef improvise et qui
restent ensuite l'tat de termitire abandonne. C'est au contraire
le type de ville qui prvaut absolument dans les rgions de colonisa-
tion rcente, en Amrique et en Australie. Il se combine, en Europe,
avec le peuplement rural, quoique ingalement dans l'Est et l'Ouest,
dans le Nord, le Centre et le Midi.
Nous saisissons qu'il
y
a entre ces deux types d'tablissements
des diffrences spcifiques, plus que de simples diffrences de degr
dans la concentration du peuplement. Ce n'est pas une simple question
de nombre ou d'tendue. La ville, dans le sens plein du mot, est une
organisation sociale de plus grande envergure
;
elle rpond un stade
de civilisation que certaines rgions n'ont pas atteint, qu'elles n'at-
teindront peut-tre jamais d'elles-mmes.
L'origine des villes, si loin qu'il faille remonter, est un fait essentielle-
ment historique. L'aurole mythique dont s'enveloppe leur gense
(rituel, hros ponyme) n'est que l'expression de l'admiration que ce
phnomne a excit parmi les hommes. Crations du commerce et de
la politique, elles accompagnent les premiers dveloppements de
grandes civilisations : Babylone, Memphis, Suze.
La substitution du rgime urbain un rgime villageois et cantonal
fut, sur les bords de la Mditerrane, le chef-d'uvre de la Grce
et de Rome. Les observateurs contemporains de ce phnomne,
Thucydide, Polybe, Strabon, ne s'y tromprent pas. Ils signalent la
TzXi,
la cit antique comme le symbole et l'expression d'une civi-
lisation suprieure. En regard, et par contraste, ils nous montrent
292 FRAGMENTS
des peuples qui, de tout temps, vivent en bourgades ou petits villages.
xa)(jLY\86v )VT;
; et ce signalement se rapporte nettement
d'autres riverains de la Mditerrane, qui, comme en Albanie, en Ber-
brie et dans certaines parties de l'Italie mridionale persistent dans
^et tat quasi primitif.
Ce qui se passa dans l'antiquit classique s'est renouvel plusieurs
fois dans la suite des temps. La Germanie, a remarqu Tacite, ne con-
naissait pas la ville. Il
y
a eu plusieurs reprises, d'abord sous Charle-
magne en Germanie, plus tard dans les pays slaves, dans l'Inde au
moment des conqutes musulmanes, dans le nouveau monde l'ar-
rive des Europens, des priodes de fondations de villes. Les lments
de la cit existaient, mais attendaient pour se combiner une impul-
sion venant du dehors
;
il fallait qu'un soule de vie plus gnral ait
atteint la contre, pour que des habitudes sociales invtres, cimentes
par l'isolement, cdent des habitudes nouvelles.
Quand on tudie dans le pass la gense des villes, on trouve que ce
qui a fait clore le germe, ce qui en a assur le dveloppement, c'est
gnralement la prsence d'un obstacle. Aux dbouchs des montagnes,
aux passages des fleuves, au seuil des dserts, au contact des ctes,
partout o il faut s'arrter, aviser de nouveaux moyens de transport,
il
y
a chance pour qu'une ville se forme.
On connat des tribus riveraines de la mer, dans l'Ouest de l'Afrique
et dans le Sud de l'Asie, qui sont demeures inertes devant cette immen-
sit ;
mais ds que la navigation existe, elle cherche des points fixes :
lots ctiers, caps des bords de la Mditerrane, viks ou golfes des
mers du Nord ;
l s'amorcent les villes. Quand la mare pntre dans
l'embouchure des fleuves, la ville nat au point o la batellerie devient
impuissante.
Sur les bords des montagnes qui ont longtemps arrt les hommes,
se rangent les villes, aux points o les produits, les moyens de transport,
la circulation de la plaine doivent s'accommoder des conditions
nouvelles. De Milan Zurich, de Vienne Lyon, une ceinture de villes
ntoure les Alpes. Tirnovo au Nord des Balkans s'oppose Kasanlik,
comme Vladicaucase Tiflis. Aux dbouchs des passes de Kaboul
se multiplient les marchs du Pendjab.
On trouve aussi des sries de villes s'chelonnant en bordure des
dserts. Les deux rives du Sahara, comme celles de l'Asie centrale,
ont leurs ports. La caravane
y
trouve, aprs les preuves de dures
traverses, des lieux de dtente et de scurit, les caravansrails o
se recrutent convoyeurs et chameaux, d'o rayonnent les transactions,
LA VILLE 293
O se rencontrent les hommes et circulent les nouvelles. Figuig, Tom-
bouctou, Merv, Bokhara et l'hexapole du Turkestan chinois, Maan,
Petra ont jou ce rle.
Enfin l'obstacle des fleuves a servi aussi de pierre d'achoppement.
On ne compte plus les villes qui doivent leur origine un gu, un
passage facilit par des les, parfois un portage (volok), les dunum
et les briva celtiques, les jurt germaniques, etc.
Le rle des routes, trop exclusivement envisag par certains
^,
ne doit pas, en tout cas, tre nglig. Lorsque les voies romaines
eurent assur des communications directes de grandes distances,
leur trac fixa son tour des centres urbains. De Plaisance Bologne
le long de la voie milienne, on voit s'chelonner les villes. Sur la grande
diagonale qui, du Danube la Propontide, de Singidunum Byzance,
traversait la Pninsule Balkanique, les seules villes sont encore celle s
qui ont t implantes par Rome : Nassus (Nich), Sardica (Sofia), etc.
Le phnomne de villages s'levant la dignit de villes se produit
par le jeu des causes conomiques dans les contres o le type urbain
tend prdominer. Les principales rgions industrielles de l'Europe
se sont rvles des ppinires de villes. Autour de Manchester, comme
de Lille, ou en Saxe comme dans la Westphalie rhnane, c'est le mme
pullulement. D'autre part nous voyons d'anciens bourgs, des villes
mme dprir
;
des moyens administratifs
y
soutiennent une existence
factice, quand ce n'est pas assez de l'usage, de l'ancienne viabilit,
pour protger des formes vieillies contre les circonstances qui cons-
pirent contre elles. L'anachronisme qui laisse Roubaix au rang de
chef-lieu de canton n'est pas plus anormal que celui qui attribue de
simples marchs ruraux le titre de sous-prfecture.
Si l'on veut voir la vie urbaine, livre elle-mme, agir dans toute
sa force, c'est plutt aux tats-Unis qu'il faut regarder. La ncessit
de matriser la distance, de combiner de vastes espaces en un domaine
conomique s'y impose
; la ville, seul organisme correspondant ces
besoins, met partout sa marque. Tout groupement nouveau, si modeste
soit-il, dbute comme un centre urbain. Dj l'tat embryonnaire
il possde ou tend se donner les organes qui font la ville : htels,
banque, grands magasins (gnerai store). La chance viendra qui fera
le reste
;
l'optimisme amricain
y
compte. En tout cas, si la ville choue,
elle disparatra sans faire place un village.
1. Kohl(J. K.), Der Verkehr und die Ansiedlungen der Menschen inihrer Ablin-
gigkeit von der Gestaltung der Erdoberfl'che, Dresde et Leipzig, 1841.
294 FRAGMENTS
Tout autres ont t les dbuts et les conditions d'accroissement de
nos villes europennes. Le temps a collabor leur formation
;
il a
ajout, pice pice, les parties dont se compose leur grandeur. L'an-
tiquit nous avait montr dans l'ensemble urbain de Syracuse (Achra-
dina- Tych-pipolis), de Corinthe, d'Athnes (Acropole, ville basse
et longs murs), d'phse (le temple et le port), des exemples d'agr-
gats successifs. Ainsi dans nos villes modernes.
Le noyau reste plus ou moins distinct : Paris, la Cit
;
Londres,
le quartier de la Tour
; Vienne, le quartier de Saint-tienne
;
Rome,
le Palatin. Autour de ce noyau se sont agglutins des lments nou-
veaux : souvent le bourg ct de la ville (bourg du Vatican Rome),
la basse ville au pied de la haute (Bruxelles), de puissantes abbayes
comme Saint-Germain-des-Prs Paris, Westminster Londres.
Puis des rues ont reli les parties (strand)
; des faubourgs se sont
allongs en forme de polypes dans des directions diffrentes. Le sys-
tme des rues garde, malgr tant de remaniements, la trace des quar-
tiers combins en un tout, tortueux dans les parties anciennes, plus
rgulier dans les parties modernes : Vienne le Ring enveloppe un
lacis de ruelles bordes de cafs et de magasins luxueux, Berlin
l'ancienne ville de la Spre se distingue aussi nettement de la Frie-
drichstadt. Parfois mme une ou plusieurs rues principales, corres-
pondant d'anciennes routes matresses, subsistent comme l'axe le
long duquel a grandi la ville. Nos rues Saint-Jacques sur la rive gauche,
Saint-Denis sur la rive droite, retracent le parcours de voies romaines,
qui, du Nord au Sud, franchissaient le fleuve divis en les
;
comme la
rue Saint-Honor, celle qui gagnait l'Oise et le Vexin. A Londres,
on suit par Holborn et Oxford Street la direction fondamentale de la
clbre voie historique (Watling Street), qui, du gu de la Tamise,
gagnait vers Deva (Chester) la cte occidentale. A Salonique, la voie
Egnatia forme, de part en part, la rue principale de la ville.
L'unit urbaine est plus ou moins parfaite. Dans certaines villes,
plus avances dans leur dveloppement, comme Londres, Paris,
la forme d'agrgat tend disparatre. Les sicles qui ont concouru
la formation harmonieuse de Paris se laissent encore discerner,
comme les anneaux concentriques marquant l'accroissement annuel
se dessinent sur le tronc coup d'un grand arbre. Mais les individua-
lits moindres se sont fondues dans une individualit suprieure.
Ce type plus volu est propre l'Europe occidentale. Moscou n'a pas
digr son Kremlin. Les parties se montrent plutt juxtaposes que
fondues dans les grandes cits d'Asie : ville tartare et ville chinoise
Pkin
;
ville chinoise et concessions europennes Changha et Can-
LA VILLE 295
ton ;
ville marchande et cit impriale Tokio
;
ville russe et ville
iranienne Samarkand.
Il appartenait l'Amrique de crer un nouveau type de cit.
Washington, Philadelphie, Buenos Ayres sont sorties toutes faites
d'un plan prconu. Pour peu que la ville remonte ces poques
que la juvnilit amricaine traite de mdivales, c'est--dire au
xvii^ sicle, on
y
retrouve encore avec intrt, bien qu' demi efface
et comme engloutie dans les constructions modernes, la ville primitive :
Boston, la pninsule mamelonne qu'une mince langue de terre,
suivie aujourd'hui par Washington Street, rattachait au continent
;
New York, l'extrmit mridionale de l'le de Manhattan, au Sud
de Wall Street. Mais, de nos jours, la ville surgit trop vite, toute faite,
suivant un plan partout identique. Ces blocs quadrangulaires de mai-
sons coups par des avenues ou rues trolleys, n'ont plus rien de local
ni d'historique, qu'ils s'lvent sur les bords de l'Atlantique ou du
Pacifique, sur les confins du Mexique ou du Canada. C'est une civilisa-
tion singulirement exclusive qui leur imprime une face commune.
Il
y
eut quelque chose de pareil dans ces villes portiques, thermes
et colonnades que les Romains implantrent indistinctement dans
toutes les parties de leur Empire. Mais en Amrique la ville se dve-
loppe dans des proportions auparavant inconnues. Saint-Louis dis-
perse ses diffrents quartiers sur une dizaine de milles de distance.
Chicago embrasse un espace plus grand que le dpartement de la
Seine. La ville amricaine a son appareil de circulation permettant
de spcialiser les quartiers, de sparer la ville des affaires de la ville
du home, d'interposer entre elles d'immenses parcs, d'avoir sa cam-
pagne l'intrieur. La locomotive, crivait il
y
a dj un demi-sicle
Anthony Trollope, est ici comme un animal domestique. Que dirait-il
aujourd'hui ? Essaimant autour d'elle, tendant indfiniment ses
quartiers suburbains, la ville est la plus parfaite expression de l'Amri-
canisme...
INDEX ET TABLES
INDEX ALPHABTIQUE
DES AUTEURS CITS
Amari (M.), 94.
Ammien Marcellin, 54.
B
Bastian, 9.
Berghaus (H.), 6.
Bernard (Augustin), 35.
Brose, 53.
Berthelot, 13.
Bertrand (J.), 34.
Besnier (Maurice), 92.
Bonin, 222, 235.
Bougainville, 120.
Boule (M.), 279.
Bowman (Isaiah), 57=
Brenier (H.), 196.
Brunhes (Jean), 94.
Brutails (G.-A.), 84, 94.
Buckle (Thomas), 5.
CandoUe (Alphonse de), 21,
75.
Csar, 46.
Czanne, 249.
Charnay (D.), 45.
Chassigneux (E.), 50, 192.
Chevalier (Auguste), 38,
112.
Chudeau (Ren), 34.
Collignon (R.), 279, 283.
Colson, 250, 251.
Cook, 120, 127, 267.
Gordier (Henri), 45, 61.
Cousinry, 90, 91.
Crevaux(D^ J.), 42.
Gvijic (J.), 42, 90, 188.
Darwin, 26, 110.
Dchelette (J.), 79.
Dehrain (V.), 280.
Deniker, 283.
Denis (P.), 280.
Ducptiaux, 77.
Dubois
(Dr
Eugne), 66.
Dufaure, 249.
Dumont d'Urville, 120, 127,
267.
E
Egilson, 267.
El-Awan (Ibn), 94.
Emin-pacha, 38.
Engel (Ernst), 77.
Engelhardt (C), 79, 227.
Eratosthne, 4.
Eschyle, 53.
Flach, 182.
Forestier, 219.
Forsyth (cap. E. James),
45.
Foureau (F.), 23, 34.
Foville (de), 182.
Fribourg (Andr), 82.
Futterer (Karl), 36, 222.
Gandar (le P. Dominique),
60.
Gannett (Henry), 37.
Gautier (E.-F.), 34.
Goury du Roslan, 82.
Gotz, 225.
Gradmann, 187.
Grandidier (A.), 218, 265.
Grely (A.-W.), 22.
Grenard (F.), 76, 78, 222,
223. 225, 235.
H
Haeckel, 7, 103.
Hamy
(DO, 113, 282.
Hannon, 31.
Hassert (Kurt), 29.
Havret (P.-H.), 50.
Heraclite, 4.
Hrodote, 41, 58, 133, 138,
218, 228.
Herr
(Dr), 34.
Hck (F.), 75.
Humbold (Alexandre de), 6.
Huntington (E.), 76.
300 INDEX ALPHABTIQUE DES AUTEURS CITS
Jirecek, 180, 188.
Joret (V.), 181.
Jullian (Camille), 41.
K
Kohi (J.-K.), 293.
Laborde (Al. de), 75.
Lacroix (N.), 35.
Lapique (L.), 283.
Lenormand (Fr.), 222.
Le Play (F.), 77.
Levasseur (E.), 10, 71, 72.
Little (Archibald), 61, 147.
M
Marc (Lucien), 38.
Marco Polo, 49, 61, 66, 267.
Marinelli (O.), 87.
Martonne (Em. de), 188.
Maspero (G.), 51.
Maurette (F.), 66.
Mecquenem (de), 62.
Meitzen, 174.
Meyer (Hans), 38.
Milne-Edwards, 222.
Mission lyonnaise en Chine,
61, 63, 75, 147, 218.
Mbius, 267.
Morgan (J. de), 51.
N
Nachtigal, 110, 112.
Ollonne (capitaine d'), 34.
Orbigny (A. d'), 218.
Pallas, 227.
Peschel (Oscar), 211.
Picard (Alfred), 248, 249.
Pitrement, 221.
Platon, 94.
Pline, 138, 226, 229.
Plutarque, 79, 226.
Polybe, 79, 138, 291.
Pomponius Mla, 108.
Powell (J.-W.), 30, 37,
38.
Prjewalski, 222.
Ptolme, 5, 154, 235.
Quelle (O.), 87.
Reinach (Salomon), 226,
227.
Renan (Ernest), 47.
Ricart Giralt, 86.
Richthofen (Ferdinand von)
39, 44, 60, 61, 63, 152,
185, 191, 228.
Ritter (K.), 5, 45, 55, 147.
Rockhill (W.-W.), 65.
Radet (G.), 89.
Ratzel (Fr.), 5.
Roubaud, 105.
Rubin (M.), 77.
Rubrouck, 226.
Russier (H.), 196.
Salesse (E.), 38.
Schefer (Ch.), 45.
Schott (G.), 266.
Schweinfurth, 110, 132.
Sederholm, 190.
Semenof (F. de), 56, 76.
Silnitzky (A.), 34.
Smirnov (J.), 189.
Smith (Adam), 80.
Smith (Hugh M.), 67.
Sorre, 88.
Stahl, 225.
Stephenson, 243.
Strabon,
4, 5, 79, 138, 160,
221, 222, 291.
Sumner Maine, 39.
Szchenyi (Bla), 44, 63.
Tacite, 160, 292.
Thucydide, 4, 5, 158, 170,
229, 291.
Tiessen (E.), 39, 60, 191.
Toute (commandant), 39.
Trollope (Anthony), 295.
Varenius (Bernard), 4.
Varron, 226.
Virgile, 37.
W
Wagner (Hermann), 54.
Willcocks (William), 53.
Woeikof, 13, 54, 57, 78.
Worsaae (J.-J.-A.), 79.
Xnophon, 81, 153.
Yanagisawa
(C^e
de), 60,
68.
Yule (Henry), 61.
Yunker, 38.
INDEX ALPHABTIQUE
DES NOMS GOGRAPHIQUES ET TECHNIQUES
Les noms gographiques sont en caractres gras (Abyssinie, Ile-de-France) ;
les termes
techniques, les noms dplantes et d'animaux, etc., sont en caractres italiques {altitude,
bouleau, chien).
Abyssin, habitat, milieu, 110.
Abyssinie, l'habitat et l'altitude, 23.
-
Adaptation des populations au milieu,
109.
Influence de l'altitude sur la
race, 281. *
Achae la plaine et son peuplement,
40.
Afrique, le peuplement, 22.
Les incen-
dies de brousse, 31.
Exemple de
peuplement sporadique intensif, 43.
L'ide de frontire chez les Silvatiques
africains, 46.
Dveloppement de la
vie pastorale, 128.
Afrique australe, les invasions des Cafres,
41.
Afrique centrale, les antilopes, 32.
L'habitat, les cultures dans l'Afrique
centrale franaise, 38.
Le portage
humain, son influence, 218.
Afrique du Nord, oscillations dans le
peuplement, 14.
Influence du
milieu sur le croisement des races, 112.
Affinits des races du Sud-Ouest
de l'Europe et du Nord de l'Afrique,
279.
Champ de croisement de races,
282.
Afrique orientale, les invasions des
Massa, 41.
Rayonnement de la
colonisation hindoue, 99.
Rapports
avec la cte de Malabar grce la
voile, 265.
Agave, fournit boisson, nourriture et
vtement aux Mexicains, 136.
Agriculture, seul rgime qui ait t
l'origine de l'habitat sdentaire, 37.
La prvoyance de l'agriculteur, 38.
Mode imparfait en Afrique, 39.
Son dveloppement dans le bassin
mditerranen, 134.
Anos, sauvages dans l'intrieur de l'le
Hondo, 67.
Ar, influence de la scheresse sur le
groupement de la population, 34.
Site d'habitat permanent, 179.
Ala, l'habitat et l'altitude, 23.
Migra-
tions des Kirghiz, 35.
Alaska, analogies entre son littoral et
celui des les japonaises, 67.
Albanie, absence de commerce et de vie
urbaine, 40.
Exemple remarquable
de la survivance des clans, 207.
Alca impennis, voir Pingouin.
Alexandrie, expansion vers la mer, 170.
Algonquins, densit de population, 30.
Alise- Sainte- Reine, type d'tablissement
humain sur une ligne de contact de
couches gologiques diffrentes, 177.
Allemagne, l'tablissement humain ind-
pendant de la route, 174.
Les
marschen ou polders, premiers sites
d'tabUssements humains en Basse-
Allemagne, 179.
Allemands, leur prolificit dans le Sud
du Brsil, 280.
Allgu, l'habitat dissmin, 188.
302 INDEX DES NOMS GOGRAPHIQUES ET TECHNIQUES
Almoravides, leurs invasions, 41.
Alpes, hauteurs et pturages, 23.
Le chalet, type de construction alpestre
de la Savoie l'Autriche, 161.
Groupes de hameaux dans les Alpes
franco-pimontaises, 178.
Etablis-
sements humains, 179.
Leur rseau
muletier, 233-234.
Alpes transilvaines, peuplement. L s'est
reforme la nationalit roumaine, 42.
Alsace, le lss a servi d'habitat, 152-
153.
Les centres habits au bord
des plateaux de lss, 177.
Altitude, point o se plat l'habitat
humain autour de la Mditerrane, 92.
AmazoDie, peuplement vitant le grand
fleuve, 42.
Les lianes modles des
hamacs, 122.
La case rectangu-
laire, 123.
Analogie des matriaux
employs par les indignes avec ceux
du Congo et du Dahomey, 123.
La sarbacane, 124.
Amrique, son systme d'tablissements
diffre de celui de l'Europe, 172.
Les chemins de fer, instrument com-
mercial, 256.
Cratrice d'un nouveau
type de cit, 295.
Amrique du Nord, l'homme quaternaire,
26.
Le Grand Bassin, 37.
Les
chasseurs, 37.
Migrations des Pieds-
Noirs, 41.
Les canots d'corce
des Indiens, 218.
L'Union Central
Pacific et le canal de Suez, 259.
Amour (province de 1'), reprsente pro-
bablement la physionomie vgtale
primitive de l'Europe, 69.
Anadyr (province d'), tablissements
eskimaux, 34.
Andamans, traces dans les muses ethno-
graphiques, 119.
Andes, les Paramos, 23.
Faible peuple-
ment de la montana, 34.
La civili-
sation des Incas suit les .oasis, 57.
Influence du climat des hauteurs,
109.
Le transport par hommes
;
influence sur la race, 217-218.
Ane (1'), son origine africaine, 222.
Animal de trait, le buf est probable-
ment le premier, 220.
Annamite, habitat, milieu, 110.
Spar des peuples montagnards par
la malaria, 281.
Anthropogographie, voir Gographie hu-
maine.
Anthropologie, donnes recueillies, 11.
Antilopes, leur grande quantit en Afrique
centrale, 22.
Apennin, Altitude-limite des tablisse-
ments humains, 87.
Appalaches, type humain, 106.
Apulie, le Puglie, ancienne lapygie,
plaine calcaire l'extrmit de la
pninsule italique, 85.
L'architecture
de la pierre, 157.
Aquila (bassin d'), densit de population,
92.
Aquitaine, la pierre calcaire employe
dans les constructions, 163.
Arabe (domination), influence sur le
peuplement, 93.
Arabie, peuplement, 22.
Influence des
guerres et des invasions sur le peuple-
ment, 41.
Arboriculture, distinction avec l'agricul-
ture au point de vue du peuplement,
81-82.
Archipel gen, rle de la culture arbus-
tive dans le peuplement, 83.
Architecture de la pierre, son domaine le
plus beau : le littoral mditerranen,
155.
Arciocje, continuit de l'expansion
humaine, 24.
Argentine, les pampas et la vie pasto-
rale, 37.
Les estancias et leurs trou-
peaux, 37.
Chariots des pampas,
226.
Rapport de la longueur des
chemins de fer avec la densit des trou-
peaux, 257.
Argos, la plaine, son peuplement, 40.
Armnie, peuplement, 55.
L'argile,
matire construire, 151.
Armes de jet, perfectionnes par le chas-
seur selon son genre de vie, 201.
Arno (bassins de 1'), le bassin de Lucques,
91.
Artocarpus, son corce employe fabri-
quer des tissus par les Polynsiens,
124.
Artois, la ferme, 180.
Le village, 181.
-
Le plant, 182.
-
Les arbres, 183.
Asie, le peuplement, 22.
Les Ngritos
et la mer, 27.
Les tribus pastorales,
35.
Asie centrale, oscillations dans le peu-
plement, 14.
Densit de population,
54-57.
A donn naissance une
partie seulement des animaux utiles
l'homme, 220.
Zones toutes prtes
recevoir routes et chemins de fer,
225.
Asie occidentale, les steppes, 36.
Densit de population, 54.
L'argile,
matire peu prs unique employe
dans la construction des palais,
150-
151.
Asie septentrionale, forts, steppes et
toundras, 29.
Assam, peuplement, 22. Le th, 147.
Assur, densit de population, 54.
Association faunistique, formule du peu-
plement animal, 7.
INDEX DES NOMS GOGRAPHIQUES ET TECHNIQUES 303
Assolement triennal, son influence sur
rtablissement humain dans l'Est de
la France, en Allemagne et en Angle-
terre, 174.
Les plaines, son domaine
particulier, 182.
Le village agglo-
mr, 182.
Assouan, l'influence du Nil sur le peu-
plement de l'Egypte partir d'As-
souan, 51.
Assyrie, voie de cheminement des peu-
ples, 55.
L'argile, matire peu
prs unique employe dans la cons-
truction des palais, 150-151.
Les
traneaux rouleau des Assyriens,
219.
Astrakhan (gouvernement d'), faible
densit de population, 73.
Astrakhan, son rle commercial
;
popu-
lation, 73.
Athnes, sa splendeur, 158.
Australie, socit humaine en formation,
12, 18.
-
Population, 20, 22.
-
Vestiges humains, 26.
Influence de
la scheresse sur le peuplement, 34.
Vie pastorale, 36, 37.
Rapport
de la longueur des chemins de fer et
de la densit des troupeaux, 257.
Australiens, leur complexion, 26.
Comment ils dlimitent leurs territoires
de parcours, 35.
Autriche, le chalet type de construction
alpestre, 161.
La ferme du lss,
180.
Auvergne, tablissements humains sur la
ligne de contact du basalte et de
l'argile, 177.
Avoine, contribue fixer des populations
agricoles vers le Nord, 141.
Sa rus-
ticit, 141.
Accroissement de sa
production en Finlande, 142.
Aztques, caractres moraux et physiques
de la race d'aprs l'altitude, 281.
B
Babylonie, Tell : restes d'tablissements
humains, 153.
Bactriane, les migrations des Iraniens,
45.
Voie de cheminement des peu-
ples, 55.
Bagara, terres ensemences par les Ira-
niens de l'Asie centrale, 56.
Balkans, peuplement. L s'est reforme
la nationalit bulgare pendant la
domination turque, 42.
Le hameau,
le village
y
correspondent des diff-
rences gographiques, 188.
Bangar, plateau du Pendjab, 56.
Barbarin, habitat, milieu, 112.
Bari (province de), densit de population,
85.
Les Murgie, 157.
Basalte, les tablissements humains au
contact du basalte et de l'argile,
177.
Basilicate, peuplement, 92.
Basque (Pays), le quartier, type d'habitat,
180.
Bassin mditerranen, exemplaire du
peuplement humain, 11. Altitude
optimum du peuplement, 92.
Types
de climat
;
civilisations fixes, 134.
L'orge, le bl, 134.
Bassin du Tarim, voie historique de
communication de la Chine avec l'Asie
centrale, 55.
Bassin parisien, sites des tablissements
ruraux, 175.
Bassora, restes des palmeraies antiques,
53.
Bataks, peuplent en partie l'intrieur
de Sumatra, 66. Civilisation ar-
chaque, 125.
Baux de Provence, rapports des difices
et de la roche environnante, 155.
Beauce, moyens de communications, 174
Les arbres, 183.
Bedjas, habitat, milieu, 112.
Bdouin (le), ses prgrinations
;
son
action contre les digues et les canaux,
14.
Bhistoun, inscriptions rupestres, 232.
Belgique, progrs de la densit de sa
population, 71.
Les budgets d'ou-
vriers, 77. Les roues ferres, 226.
Etablissement des chemins de fer,
248.
Densit du rseau ferr,
251.
Bnars, solidit de ses monuments, 155.
Bengale, peuplement, 22, 39.
Densit
de la population, 50.
Ses facults
nourricires immenses, 63.
Dissmi-
nation de l'habitat rural dans le Bas-
Bengale, 193.
Beni-Isral, effets de leur entre dans la
terre de Chanaan, 47.
Ils s'y multi-
plient, 58,
Berbres, rle de l'olivier dans leur ali-
mentation, 135.
Plusieurs races, 279.
Bergen, population, 72.
Bergstrasse, villages en srie, 178.
Berlin, son muse ethnographique fond
par Bastian, 9.
Berry, le peuplement, 40.
Beurre et fromage, Sude, Finlande,
Nerlande, Danemark devenus produc-
teurs et exportateurs, 142.
Bhils, leurs procds agricoles, 31.
Birmanie, faible peuplement, 22.
Bisons, leur grande quantit dans les
prairies des Etats-Unis, 32.
304 INDEX DES NOMS GOGRAPHIQUES ET TECHNIQUES
Bl, son rle dans le rgime de l'indigne
gyptien ;
conditions de sa culture dans
le bassin mditerranen, 134.
Bled (le), n'a pas d'tat civil gogra-
phique, 35.
Bocage, les maisons rurales et les moyens
de communications, 174.
Bocca del agua, nom donn par les Espa-
gnols du Mexique aux issues par les-
quelles les rivires sortent des Monta-
gnes Rocheuses, 55.
Bochimans, groupement de la population
dans leurs campements, 34.
Boers, type remarquable d'adaptation,
12, 106.
Causes de leurs migrations,
97.
Leurs chariots attels de bufs,
226. - Leur prolificit, 280.
Buf, fut probablement le premier
animal de trait, 220.
Boghar, ses marchs. Migrations prio-
diques des Larba, 35.
Bois, utilis d'abord comme charpente,
160.
Bola, arme des Tehuelchs, 128.
Bolivie, l'habitat et l'altitude, 23.
Borde, ferme languedocienne, 180.
Borde de Madgebourg, ses villages 181.
Borno, densit de la population, 34.
Son insularit relativement rcente,
66.
Les Dayaks. La population
primitive, 66.
La sarbacane, 121.
Dayaks et Keniahs, 125, 126.
Bosnie, la maison de bois, 161.
Bosques des Andes, peuplement en pro-
portion inverse de la luxuriance
vgtale, 34.
Bouleau, ses emplois varis, 165.
Bourgogne, le peuplement, 40.
Zone de
calcaires employs dans la construc-
tion, 163-164.
Sites des tablisse-
ments ruraux, 176.
Brandebourg, son peuplement par les
Flamands, 99.
Brandes, leur peuplement, 40.
Brsil, population, 20.
Types humains
en formation, 106.
Prolificit des
Allemands dans les campagnes int-
rieures du Sud, 280.
Breslau, population, 73.
Bretagne, la ferme isole, type d'habitat,
186.
Brie, les fermes et les moyens de commu-
nications, 174.
La ferme
y
domine,
181.
Les arbres, 184.
Brique, son rle dans la construction,
son origine, 150-151.
Brousse, centre de peuplement, 89.
Brousse (la), a remplac la fort tropicale,
15.
Lieu probable de l'invention
du feu, 28.
Incendies de brousse,
31.
Budgets d'ouvriers, leurs bases en diff-
rents pays, 77.
Bulgares, leur nationalit reforme dans
les Balkans pendant la domination
turque, 42.
Bulgarie, le lss sert d'habitat, 153.
Types d'habitat
; les Kolib, 188.
Burnous, vtement protecteur, 129.
Caboul, colosses taills de Bamian,
232.
Cafres, leurs invasions, 41.
Civilisa-
tion, 128.
Calcaire, fournit Paris sa belle pierre,
163.
Cambaye (golfe de), le regur est mis de
bonne heure en culture autour du
golfe, 45.
Cambrsis, le village, 181.
Camino de herradura, voir chemin mule-
tier.
Campanie, caractres gographiques
;
population, 91.
Campos, leur peuplement, 40.
Canal de Suez, son ouverture concide
avec celle du premier transcontinental
amricain ; influence de l'un et de
l'autre, 259.
Part de l'Extrme-
Orient dans son tonnage, 260.
Dveloppement de la population et
du commerce de l'Egypte, 261.
Canard, nourriture carne des Chinois,
144.
Canlgou, influence de ses sources sur
le peuplement de son voisinage, 92.
Cannes (Bassin de), son peuplement,
40.
Cantal, situation des gros villages,
178.
Cap (le), socit humaine en formation,
12.
Population, 20.
Vestiges
humains, 26.
Caps, leur rle dans les formations poli-
tiques grande envergure, 272.
Carabes, navigation voile, 265.
Carrela, son emploi sur les routes natu-
relles des prairies amricaines, 235.
Case rectangulaire, sa rpartition go-
graphique, 123.
Castagniccia de Corse, densit de popu-
lation, 88.
Castelli romani, peuplement, 92.
Catun, hameau valaque, 188.
Caucase, peuplement, 42.
Caux (Pays de), la ferme-masure, 180,
181.
Masses forestires, 183, 184,
Caves, anciens chemins muletiers, 233.
Cayak, barque des Eskimaux, 131.
INDEX DES NOMS GOGRAPHIQUES ET TECHNIQUES 305
Clbes, la race, 113.
Celtes, constructeurs de vhicules per-
fectionns, 225.
Navigateurs voile,
265.
Cvennes, la chtaigneraie et le peuple-
ment, 88.
Chalde, haute antiquit de ses tradi-
tions, 49.
Son peuplement, dcrois-
sance de celui-ci, 53-54.
L'argile
matire peu prs unique employe
dans la construction des palais, 150-
151.
Fragilit de cette matire, 153.
Difficult qui en rsulte dans la
recherche des anciennes villes chal-
dennes, 154.
A connu la traction
animale avant la route, 220.
Chalet, type de la construction alpestre,
161.
Chameaux, qualits, domestication, 221.
Pays et origine de l'espce bac-
triane
; slection du dromadaire ou
mhari, 222.
Champagne, constructions en pis, 162.
Les fermes, leur raret, 181.
Les
villages, leur rpartition, 181.
Absence d'arbres, 183.
Anciennet
des roues ferres, 226.
Chanaan, terme des migrations des
Hbreux, 45.
Influence de la terre
sur les Beni-Isral
; sur leur mul-
tiplication, 58.
Chan-toung, la civilisation agricole
y
suit
le pied des montagnes, 58.
L'habi-
tat
;
le village, 191.
Chari moyen, l'habitat, les cultures,
38
Chariot, ses formes et leurs applications
diverses, 225-226.
Son domaine
gographique, 234.
Charpente, utilisation du bois, 160.
Chasseurs (peuples), leur vie en Amrique
d'aprs Powell, 35-36.
Perfectionnent
leurs armes de jet, 201.
Chtaigne, a longtemps suppl l'in-
suffisance des crales, en Europe,
139.
Chtaigneraie, son importance, son rle
dans le peuplement en Corse, 88 ; dans
les Gvennes, 88 ; dans le Vivarais,
178
;
en Europe en gnral, 139.
Chemins de fer, extension progressive,
244.
Porte gographique, 245.
Longueur des voies ferres en 1840,
246.
Rapport troit avec la colo-
nisation, 247.
Difficults en Europe
pour leur tablissement, 247-248.
Densit du rseau ferr, 251.
Vhicule de la colonisation, 254.
Abaissement des frets, 255.
Chemins de fer locaux,
dveloppement,
251-252.
Vidal-Lablache,
Gographie humaine.
Chemins ferrs, anciennes voies romaines,
163.
Chemin muletier, camino de herradura
;
adaptation l'emploi du mulet, 233.
Chne, son importance en Europe, 139-
140.
Chen-si, voie de pntration des Chinois,
58.
Anciennet de son peuplement,
59.
Cheval, instrument de peuplement, 41.
Son introduction modifie le genre
de vie des hommes, 206.
Qualits
;
domestication, 221.
Chibchas, habitat ;
milieu, 110.
Culture
du mas, 136.
Evite l'humidit de
la montana, 281.
Chien, premier animal domestique de
l'homme, 29, 31.
Chili, population, 20.
La mer pour-
voyeuse de la nourriture des popula-
tions et des animaux domestiques,
29.
Chlllouks, emploi de l'argile dans leurs
constructions, 151.
Chine, densit de sa population, 20
Diversit entre le peuplement de pro-
vinces voisines, 39.
Absence de
solidarit entre les habitants des
diverses rgions, ses causes, 43.
Variations de densit du peuplement,
43-44.
L'migration ; ses causes,
44.
Antiquit et densit de sa popu-
lation, 49.
Densit de sa population
compare celle de l'ancienne Chalde,
54.
Ses voies historiques de commu-
nication avec l'Asie centrale, 55.
Le peuplement, 57-62. Dispersion
de la population au Sud du Ho-nan
et du Chan-toung, 63.
Mdiocre
accroissement de la population au
xix sicle, 65.
Les immigrants
chinois reus avec faveur au Japon,
68.
La densit de population diminue
progressivement partir du
40" degr
de latitude, 68-69.
Riz, haricots,
canard, bases de nourriture, 143-144.
Le teou-fou, aliment transportable,
144.
Continuit des mthodes de
culture, 172.
L'habitat conditionn
par le sol, 185, 190.
Les agglom-
rations dans le Nord, 190-191.
L'habitat rural, particulirement dans
le Centre et le Midi, 192.
Stagnation
et isolement de la civilisation, 203.
Diffrence entre cette civilisation et
celle du Japon, 210.
A connu
l'attelage animal avant la route, 220.
Usage ancien du mulet dans la
Chine du Nord, 223.
Les chariots
quatre chevaux
; les routes dans la
Chine du Nord, 225.
20
306 INDEX DES NOMS GOGRAPHIQUES ET TECHNIQUES
Chine mridionale, la pche ctire con-
tribue condenser les populations,
30.
Chine propre (population totale de la),
vraisemblablement 302.110.000 mes,
60.
Chinois^ leur cohsion dans l'migration
44.
Marche de leur colonisation, 58.
Cultivateurs par irrigation, 69.
Peuple de plaine, 110.
Rsistance
la pntration conomique euro-
penne, 210.
Ecarts des montagnes
par la malaria, 281.
Unit du type,
289.
Chlamyde, vtement protecteur, 129.
Chou, son rle dans le rgime alimentaire
des peuples, 140.
Choumadia (la), peuplement, 42.
Cimbres, leurs chariots, 226.
Cit (la), expression la plus haute d'une
forme sociale, 206-207.
Clans, leur maintien autour de la Mdi-
terrane, 207.
Climat, son influence, 13-14.
Coal Roads, ns aux Etats-Unis des nces-
sits du transport de l'anthracite,
244.
Cochin, peuplement par hameaux, 63.
Cocotier polynsien, son utilisation, 121.
Collines des Vosges, tablissements hu-
mains, 178.
Colombie Britannique, les tribus qui se
livrent la pche ont une densit de
population suprieure, 30.
Les
Nutkas, 130.
Colonisation chinoise, ses mouvements
;
son influence, 99.
Colonisation hindoue, son rayonnement
sur l'Afrique orientale, 99.
Colorado (Indiens du\ 136.
Conca d'Oro, influence arabe sur le peu-
plement, 94.
Condensations humaines, la pche plus
que la chasse
y
donne lieu, 29.
Conditions gographiques, leurs change-
ments influent sur la formation des
races, 278-283.
Congo, densit de la population, 34.
Analogie des matriaux employs par
les indignes et ceux de l'Amazonie,
123.
Constance (lac de), l'habitat dissmin,
188.
Cordoue, densit de population, 83.
Core, les Corens migrants reus avec
faveur au Japon, 68.
Densit de
population, 69.
Corn Surplus States aux Etats-Unis,
pays de surproduction de mas, 256.
Corse, zone optimum des tablissements
humains, 178.
Costa de Levante, de Barcelone au cap
de Creus, 86.
Costa de Ponente, de Barcelone Tarra-
gone, 86.
Cotentin, fermes accouples, type d'ha-
bitat, 186.
Ctes de Meuse, les tablissements
humains, 177.
Cotton soil, voir Regur.
Coustire (la), le peuplement, 40.
Crte, influence des cultures arbustives
sur le peuplement, 83.
Culte de famille, ncessit conomique
transforme en rgle religieuse par les
Chinois, 60.
Culture de plantation, son influence dans
les rgions mditerranennes sur la
concentration des habitants, 81.
Culture de terres sches, sa coexistence
constante avec la culture d'irrigation,
dans le Sud de l'Europe, 84.
Cultures arbustives, leur rle, 83.
Cultures en terrasses, sur le littoral mdi-
terranen, 156.
Cyprea moneta, monnaie de coquillage,
126.
Daces, leurs maisons de bois, 160.
Dahna, dsert, 22.
Dahomey, exploration Toute, 39.
Analogie des ustensiles en bois avec
ceux de l'Amazonie, 123.
Dakar, son rle dans nos possessions,
272.
Danemarl^, les kjbkkenmddingen, 29.
Les budgets d'ouvriers, 77.
Pays
devenu producteur et exportateur de
beurre et de fromage, 142.
La ferme,
180.
Dantzig, population, 73.
Danube, les villes, 73.
Dayakis, peuplent en partie l'intrieur
de Borno, 66.
Civilisation archaque,
125.
Dayas, leurs herbages, 35.
Dcan, l'habitat conditionn par l'irri-
gation, 194.
Decherras, enceintes de pierre du Maroc,
157.
Dellii, solidit de ses monuments, 155.
Densit de la population, dl nition, 10.
Sa diminution en Europe au-dessus
du
60e
degr de latitude Nord, 72.
Sa faiblesse dans les gouvernements
d'Oufa, Orenbourg, Astrakhan, 73.
Ses progrs successifs en Europe,
73.
Dhow, bateau arabe, 267.
INDEX DES NOMS GOGRAPHIQUES ET TECHNIQUES 307
Djumra (plaine de la), l'habitat espac,
193.
Dniepr, la population urbaine, 73.
Doab, une Msopotamie entre la Djoum-
ra et le Gange, 62-63. Les puits
;
l'habitat, 194.
Dobroudja, le lss sert d'habitat, 153.
Domestication des animaux, son impor-
tance ds l'aurore des civilisations
;
progrs prims, 115.
Domestication du chien, son intrt pour
l'homme, 31.
Domrmy, type de villages en srie,
178.
Drama (bassin de), son peuplement au
flanc des montagnes, 90.
Drama, activit de la ville, 91.
Dravidiens, types connexes
;
varits
;
migrations, 113.
Race intermdiaire
entre les ngres et les blancs, 283
Dromadaire, slectionn par les Naba-
tens, 222.
Dronte (Dudo ineptus), oiseau vivant aux
les Mascareignes avant le peuplement
humain, 33.
Dry farming, renouvel de l'agriculture
punique, 84.
Dudo ineptus, voir Dronte.
Egypte, haute antiquit de ses traditions,
49.
Basse-Egypte, la plus peuple,
50.
Conditions du peuplement, 51-53.
Rle des irrigations dans la Basse-
Egypte, 52 ; de la culture arbustive
dans la Haute-Egypte, 53.
Civi-
lisations fixes, 134.
Indignes vg-
tariens, 134.
Matriaux de construc-
tion, 151.
Les Pyramides, leur
dure, 154.
Grenier de l'Empire
romain, 213.
Le char de guerre,
220.
L'ne domestiqu d'abord
dans la Haute-Egypte, 222.
Accrois-
sement rcent de la population et du
commerce, 261.
Einodhof, systme d'habitat dissmin,
187.
Elis guineensis, utilisation, 121.
lam, densit de population, 54.
Voie de cheminement des peuples,
55.
Elbe, lieu de villes, 73.
Elphant, animal de transport de luxe
dans l'Inde, 223.
lide, la plaine et son peuplement,
40.
Elster, la population urbaine, 73.
Emilie, grosses fermes, 176.
Empire britannique, ralise le premier
type de thalassocratie mondiale, 271.
Empire mongol, favorise le trafic de la
mer Noire la Chine du Nord, 228.
Endmisme, application la gographie
humaine, 9.
Energie hydraulique, attire comme les
mines la population, 72.
Environment, milieu en anglais, 103.
Epeautre, sa culture subsiste dans la
Suisse allemande et la Souabe, 138.
Erbil, plateau habit par les paysans
persans, 57.
ri (canal), achev en 1825, 246.
Espagne, campos et huertas, 40. R-
gime alimentaire dans le Sud, 75.
Densit de population, 83.
Espagnols, leurs pratiques d'irrigation
au Mexique, 55.
Eskimaux, bons navigateurs, 24.
Leur diffusion, 29, 34.
La race, 116.
Ustensiles, 120.
Civilisation,
130-131.
Plus avancs que les
Fugiens, 132.
Leur matriel con-
ditionn par leur genre de vie, 201.
Essarts, leur peuplement, 40.
Estancias, leurs grands troupeaux, 37.
Estrades, anciennes voies romaines, 163.
Estres, anciennes voies romaines, 163.
Etablissements humains, ont remani les
conditions naturelles en Europe, 171.
tats-Unis, leur population compare
celle de l'Europe, 20.
La valle du
Mississipi, 22.
Les Prairies States,
25.
La puissance de la faune her-
bivore dans la rgion des Prairies,
32.
L'Etat de Wyoming et ses trou-
peaux, 37.
Les villages, les entre-
pts, les villes, 172.
Rapports de
cause effet entre la grande industrie
et les chemins de fer ;
les Coal Roads,
244.
Dbut des chemins de fer,
245.
Leur extension, 246.
Leur
puissance, 253-254.
Force de la
vie urbaine, 293.
thiopiens, affinits avec les fellahs
gyptiens et les Maures, 112.
Etna, zone des agrumes, 87.
Enorme
densit de population, 92.
Euphrate, ses alluvions en Chalde, 53.
Barques en cuir, 218.
Europe, influence du milieu, 12.
Den-
sit de la population, 20.
L'usage
tardif du fer en Scandinavie, 27.
Conditions du peuplement primitif,
40-41.
Comment ont t surmonts
les obstacles, forts, marcages, 43.
Population compare celle de l'Inde
et de la Chine au commencement du
XIX
e
sicle, 71.
Densit de popu-
lation, 71,78.
Influence de sa forme
308 INDEX DES NOMS GOGRAPHIQUES ET TECHNIQUES
pninsulaire, 78.
Foyer de colonisa-
tion 99.
Le paysage de parc, 138.
Marche du peuplement, 171.
Rapports entre la grande industrie
moderne et les chemins de fer, 244.
Dbuts des chemins de fer, 245-247
;
leur dveloppement, 250-251.
Im-
portance du commerce avec l'Inde,
261.
Analogies des races du Sud-
Ouest de l'Europe et du Nord de
l'Afrique, 279.
Les rgions indus-
trielles ppinires de villes, 293.
Croissance graduelle des villes, 294.
Europe centrale, exemplaire du peuple-
ment humain, 11.
Influence de la
grande industrie sur le peuplement,
40
;
ses conditions primitives, 41.
Europe occidentale, influence de la
grande industrie sur le peuplement,
40.
Europe primitive, les migrations des
Celtes et des Germains constituent son
histoire, 45-46.
Exploitation mtallurgique, traces entre
l'Oural et l'Alta, 227.
Fachwerk, nom allemand du pis, 160.
Far-West, relations avec l'Extrme-
Orient, 259.
Faune d'herbivores, poque miocne,
32.
Faune rgionale, ses lments htro-
gnes, 7.
Faustrecht, inscurit influant sur le peu-
plement, 42.
Fayoum, irrigations, 52.
Fellahs, analogies avec Nubiens et Ethio-
piens, 112.
Ferghana, migrations des Kirghiz, 35.
Densit de population, 54.
Ferme (la), type de l'exploitation rurale
agricole, 180.
Fermes accouples
;
fermes isoles, 188, 190.
Ferme isole, type d'habitat, 186.
Feu (le), son origine
; son rle dans
l'expansion de l'espce humaine, 28
;
dans le dboisement, 30-31-
Finlande, importance de la population
urbaine, 72.
Changements agricoles
rcents, 142.
Villes construites en
bois, 164,
Les bsar, sites d'tablis-
sements humains, 179.
Type de
peuplement : les torp, 189-190.
Finnois Tchrmisses, voir Tchrmisses.
Flandre, rayonnement de son migration,
99.
La route fait natre l'habitation,
174.
Foggia, densit de population, 83.
Foligno (bassin de), densit de popula-
tion, 92.
Fort (la), dtruite ou transforme par
le pasteur, 14.
Forts de conifres, source de matriaux
de construction incorruptibles, 165.
Fort-Noire, peuplement, 99.
Fort tropicale, remplace par la brousse,
15.
Son influence sur les civilisa-
tions, 121.
Fou-kian (Chinois du), leurs migrations
dans les archipels asiatiques, 66.
Fouta-Djalon, vestiges de l'ge de pierre,
31. Densit de la population, 38.
France, le peuplement
;
occupation his-
torique du sol, 41.
Diversit et
richesse des matriaux de construc-
tion, 162-163.
-
Dans l'Est, l'tablis-
sement humain est indpendant de la
route, 174.
Chemins de fer
;
recons-
titution dans l'Est, aprs 1870, 248.
Chemins de fer en 1851, en 1858 et
en 1875, 249.
Dveloppement des
rseaux ferrs
;
densit dans le Nord,
251.
Franconie les constructions dans la zone
calcaire, 164.
Frets entre ports atlantiques, 255.
Frijol, haricot noir du Mexique, 136.
Frontire linguistique, son rapport avec
la direction des principales voies
romaines, 238.
Fugiens, traces dans les muses ethno-
graphiques, 119.
Trs infrieurs
aux Eskimaux, 132.
Galicie, route d'invasion, 42.
Gallas, civilisation, 128.
Galles (Pays de), la force motrice
vapeur, 243.
Gange (valle du), antiquit de sa popu-
lation, 49.
Densit de celle-ci, 49.
La communaut villageoise conser-
ve dans la haute valle jusqu'
Bnars. La tradition religieuse, 63.
Les grs, matriaux de construction
des villes monumentales, 155.
L'ha-
bitat espac, 193.
Garrigues (les), ont remplac la fort, 15.
Le peuplement, 40.
Gaule, l'accroissement de population
rsultat de la paix romaine, 79.
Gnes (province de), densit de popula-
tion, 85.
Gense des villes, la prsence d'un obs-
tacle cause leur naissance, 292.
Gnois, perfectionnent la voilure des
navires, 268.
INDEX DES NOMS GOGRAPHIQUES ET TECHNIQUES 309
Genre de vie, conditionne les instruments
employs par l'homme, 201.
Gographie botanique, a mis en lumire
la notion du Milieu, 6. Nous lui
devons la leon d'cologie, 7.
S'appuie sur un nombre imposant
d'observations et de recherches, 8, 9.
Gographie humaine, l'uvre de Vidal
de La Blache, vu.
L'uvre de Fr.
Ratzel, 5.
Germains, leurs procds et leurs mat-
riaux de construction, 160. Leurs
villages l'poque romaine, 169.
Germanie, priodes de fondations de
villes, 292.
Germsir, terres chaudes du golfe Per-
sique, 281-
Gilbert (les), civilisation, 127.
Girin, faible densit de la population,
69.
Gitanes, lment rfractaire la fusion
des races, 11.
Glande, son importance en Europe, 139-
140.
Glossines (les), disparaissent avec la
fort, 15.
Rsultats de leur tude,
105.
Gonds (les), leurs procds agricoles, 31.
Leurs terrains de chasse de la
Nerbudda et de la Tapti transforms
en terrains de culture vers la fin du
XVI sicle, 45.
Goudjerat, le regur
y
est mis de bonne
heure en culture, 45.
Graham (Terre de), voir Terre de Graham.
Grand-Bassin (le), la vie pastorale, 37.
Grand-Canal, le creusement de son pre-
mier tronon en 486 avant notre re,
60.
Grande-Bretagne, progrs de la densit de
sa population, 71. Influence de la
grande industrie du fer et de la houille
sur le peuplement, 80.
Petits agri-
culteurs devenus artisans, 99. Ses
villes construites le long des collines
calcaires, 164. L'tablissement hu-
main indpendant de la route, 174.
Le charroi sur rail dans les mines
antrieur aux chemins de fer de sur-
face, 243. Etablissement des che-
mins de fer, 248.
Grande industrie, son influence sur le
peuplement, 80.
Grands-Russes, leur mlange avec les
Mordves et les Tchrmisses, 113-
114.
Grasse (bassin de), le peuplement, 40.
Gravures rupestres, entailles dans le
grs du Sahara algrien, 155.
Grai Trunck Road, voie Appienne des
Indes, 239.
Grce, le peuplement, 5.
Causes du
surpeuplement, 42.
Densit de
population, 83.
Grenade, le Genil, cause de son peuple-
ment, 92.
Les vegas et les huertas^
94.
Groenland, peuplement, 24,
Guadix, l'habitat dans la terre, 152.
Guanaco, son cuir utilis par les Tehuel-
chs, 128.
Gulak (dfils de), portes de Cilicie,
tmoins d'antiques expditions mili-=
taires, 232.
Gulf Stream, limite au Sud de la naviga-
tion norvgienne voile, 266.
Gypsies, lment rfractaire la fusion
des races, 11.
Habitat, ses ncessits varient suivant les
climats, 76.
Hadas, densit de population, 30.
Ha-men (pninsule), densit hypertro-
phique de la population, 50.
Hainaut, ses bois, 183.
Hallstatt (civilisation de) 137-138.
Absorbe par la conqute romaine, 213.
Hambourg, population, 73.
Hameaux, le Massif central, 174, 186.
La Finlande, 189.
La Chine du
Nord, 190-191. - Le Bas-Bengale, 193.
Hans, organisrent le jalonnement des
routes, 235.
Hara, vgtation herbace au Japon, 68.
Hawa (les), civilisation
; les pirogues,
127.
Hellweg, voie de commerce reliant le
Rhin l'Elbe, 240-241.
Helsingfors, population, 72.
Helvtes, leurs migrations vers la Sain-
tonge, 46.
Hrros, civilisation, 128.
Hilaliens, leurs invasions, 41.
Hindou, le tra le spare des peuples
mongolodes, 281.
Hochstrasse. anciennes voies romaines
dans les pays germaniques, 163.
Mme en partie dlaisses conservent
leur physionomie, 236.
Hof, ferme de l'Europe centrale, 180.
Hoggar, site d'habitat permanent, 179.
Homme (1'), l'homme et le Milieu, 8.
Facteur gographique, 12.
Ses rap-
ports avec la terre
; ingalits et ano-
malies, 19.
Homme quaternaire (/'), sa diffusion dans
l'Amrique du Nord, 26.
Ho-nan, diffrence de peuplement avec
le Hou-p, 39.
Accueille les immi-
310 INDEX DES NOMS GOGRAPHIQUES ET TECHNIQUES
grants venant de l'Ouest ou du Nord,
59.
Anciennet de son peuplement
dissmin en hameaux, 59.
Hondo, densit de population, 67.
Les Anos, 67.
La densit de popu-
lation s'abaisse progressivement au
Nord de l'le, 68.
-
Culture du riz et
du th, 145.
Horticulteurs, les indignes de Sfax et de
Kerkennah hritiers des Phniciens,
135.
Hottentots, groupement en hameaux
(Krals), 34.
Houang-bo, peuplement de ses plaines
alluviales, 57.
Son rgime, 57.
Hou-nan, influence du climat et du sol
sur l'habitat rural, 191.
Hou-p, diffrence de peuplement avec
le Ho-nan, 39.
Hovas, vitent les plaines, 110.
Huelva, densit de population, 83.
Huerts, le peuplement, 40, 94.
Hurepolx, ses bois, 183.
Hydraulique, voir Energie hydraulique.
Iakoutes, peuplade nomade de chasseurs,
29.
Diffrence avec les Eskimaux,
116.
Ile-de-France, ses constructions en pierre
calcaire, 163.
Ues, leur rle dans les formations poli-
tiques grande envergure, 272.
Immigration (courants d'), leur impor-
tance, 10.
Amrique, 254.
Incas, leur pntration vers le Sud, 57.
Incendies de brousse, leur importance,
leur intrt, 31.
Inde, population,
20-21. ^ Plantes nour-
ricires, 21.
Diversit de peuple-
ment, 38.
Occupation agricole
rcente des Provinces centrales, 45.
*
Antiquit des populations du Pend-
jab et de la valle du Gange, 49.
Densit de sa population compare
celle de l'ancienne Chalde, 54.
Le
peuplement,
62-65.
Recensement de
1911, 62.
Le village-type de l'Inde
septentrionale, 64.
Emigrations
dans les archipels asiatiques, 66 ;
en
Birmanie et en Afrique, 99.
Vari-
ts de races, 113.
Cultures limites
aux plaines, 172.
Pays de villages,
193.
Le village, organisme essen-
tiel de l'habitat, 196.
Dvelop-
pement des chemins de fer, 209.
Persistance de la civilisation hindoue,
210.
Le Great Trunck Road, 239.
Part prpondrante de l'Inde dans
le tonnage du canal de Suez, 260.
Son commerce avec l'Europe, 261.
Les sauvages
y
adoptent l'extrieur
des Radjpoutes, 288.
Inde centrale, procds agricoles, 31.
Indiens de l'Amazonie, dfaut d'adapta-
tion au milieu, 109.
Indiens de l'Amrique du Nord, leurs
canots d'corce, 218.
Indiens Pueblos, leur pratique des irri-
gations, 55.
Le mais, 136.
Innuit, voir Eskimaux.
Invasions, leur influence sur la condition
des socits, 208.
La dernire est
celle des Kirghiz, en 1720, 229.
Iran, peuplement, 22, 55.
L'argile,
matire peu prs unique employe
dans la construction des palais, 150-
151.
Meubles en argile, 151.
Ses
couloirs tout prts recevoir routes et
chemins de fer, 224-225.
Iraniens, leurs migrations, 45.
Irlande, causes de dpeuplement, 97.
Irrigation, importance au point de vue
du peuplement, 14.
Islam, s'est appropri les civilisations
antrieures des pays qu'il a envahis,
289-290.
Islande, se trouve la mme latitude
que la terre de Graham, 24.
Milieu
et peuplement, 30.
Italie, peuplement, 5.
Migrations de
ses populations, 45.
Rgime ali-
mentaire dans le Sud, 75.
Densit
de population, 83.
Izba russe, construction en bois, remplace
la kuta finnoise, 166.
Type auto-
nome, 167.
Japon, densit de sa population, 20.
Rgime des cultures dans le Sud,
21.
La pche ctire et le peuple-
ment 30.
Extension rcente des cul-
tures, 43.
Diversit des races, 65.
Le peuplement, 66-69.
Densit
de la population en 1915, 67.
Les immigrants venant de Chine ou de
Core reus favorablement au Japon,
67.
L'amnagement des rizires. La
culture du th, 68.
Superficie cul-
tive, 68.
La densit de population
s'abaisse progressivement vers le
40e
degr de latitude, 68.
Agricul-
teurs devenus artisans, 99.
Culture
du riz et du th, signe de civilisation
suprieure, 144-145.
L'architecture,
l'art du bois, 149.
Pas d'extension
des surfaces cultives, 172.
La
civilisation, 209.
INDEX DES NOMS GOGRAPHIQUES ET TECHNIQUES 311
Japonais, amour du sol, 145.
Type
unique d'un grand peuple tirant sa
principale nourriture d3 la mer, 145.
Java, son insularit relativement rcente,
66.
Influence de la civilisation
hindoue, 66.
Jura, les tablissements humains, 178
K
Kabylie (Grande), exemple de densit
par refoulement, 42.
Kafirs, clan montagnard, 46.
Kalahari (dsert de), 34.
Kalamata, densit de population, 92.
Kampania (la), domine par le Karatas,
89.
Kan-sou, voie de pntration des Chinois,
58.
Karakoroum, difficult pour situer son
emplacement, 154.
Karakoum, population, 22.
Karof, vtement des Hrros, 128.
Karrous, routes naturelles en Afrique
australe, 234.
Kavirondo, coifure, 128.
Kmi, terre noire en Egypte, attire les
populations, 51.
Keniahs, civilisation archaque, 125.
Kerkennah, les horticulteurs, 135.
Kermelis, plateau habit par les paysans
persans, 57.
Khadar, valles irrigues du Pendjab, 56.
L'habitat concentr, 193.
Khvir, dsert de l'Iran, 22.
Khmers, viennent de tribus dravidiennes,
113.
Kiev, population, 73.
Kiou-siou, densit de population, 67.
Lieu d'origine de la civilisation
japonaise, 67.
Point de dpart du
peuplement de l'archipel, 98.
Kirghiz, leur vie pastorale 4.000 m.,
23.
Leurs migrations, 35.
Leur
matriel, 130.
Ce matriel condi-
tionn par leur genre de vie, 201.
Leur migration de 1720, 228.
Kfkkenmddingen, amas de rebuts de
cuisine, 29.
On
y
trouve des dbris
de VAlca impennis, 30.
Kochersberg, le village, 181.
Kogge, navire de la Hanse, 267.
Kolib, hameaux bulgares, 188.
Kouei-tcheou, sa population n'est pas
encore revenue la densit qu'elle
avait avant la rvolte des Tapings, 62.
Kouen-lun, long par une voie historique,
55.
Kourganes, tumuli de la Russie mridio-
nale et de la Hongrie, 227.
Krals, hameaux des Hottentots, 34.
Kristiania, population, 72.
Kurdes, les yailas, 23. Clan monta-
gnard, 46.
Lac Fucin (bassin du), densit de popu-
lation, 92.
Laconie, la plaine et son peuplement,
40.
Lacustres (Cases), en Suisse et Nouvelle-
Guine, 27.
Lama, bte de somme des anciennes civi-
lisations amricaines, 223.
Languedoc, garrigues et coustire, 40.
Laos, peuplement, 22.
Laponie, peuplement, 24.
Lapons, chasseurs et pcheurs nomades,
29.
Diffrent des Eskimaux, 116.
Larba, leurs migrations priodiques, 35.
Larissa, densit de population, 83.
Lauraguals, les tablissements humains,
176.
Leao (plaines du), colonisation chinoise,
69.
Libye, le dsert absolu, 22.
Ligurie, rivire du Ponant
; rivire du
Levant, 85.
Limagne, la petite culture et les moyens
de communications, 174.
Litham, voile du Touareg, 129.
Lss, emploi dans la construction
;
l'habitat, 152-153.
La ferme autri-
chienne, 180.
Loire (valle de la), la route fait natre
l'habitation, 174.
Les tablissements
ruraux entre Chalonnes et Ancenis,
Saint-Florent et Lire, 176-177.
Lolos, peuple montagnard, 110.
Lombardie, grosses fermes, 176.
Londres, quartier de la Tour, noyau de
la ville, 294.
Watling Street, la voie
historique, 294.
Lorraine, son calcaire employ dans la
construction, 163.
Sites des tablis-
sements ruraux, 176.
Raret des
fermes sur le Muschelkalk, 181.
Lucques (bassin de), fertilit
;
population,
91.
Lyonnais, peuplement, 99.
M
Madagascar, rpartition de la population,
21.
Rapports avec l'Arabie du Sud
grce la voile, 265.
Le Hova laisse
aux Sakalaves le sjour des plaines,
281.
312 INDEX DES NOMS GOGRAPHIQUES ET TECHNIQUES
Magdebourg, population, 73.
Les vil-
lages dans la Borde, 181.
Maghreb (le), influence des guerres et
des invasions sur le peuplement,
41.
Magnsie^ les pcheries, 86.
Mahonais, migrations en Algrie, 97.
Mahrattes (pays des), demi sauvage, 39.
Mas, son importance dans la nourriture
et la civilisation des Amricains
;
son
culte, 136-137.
Sa culture a pris
probablement naissance chez les Chib-
chas, 136.
Maison finlandaise, expression d'une
civilisation autonome, 167.
Maisons communes, en Nouvelle-Guine,
123.
Maisons gauloises, construites en bois,
160.
Malabar, dissmination de l'habitat rural,
193.
Rapports avec l'Afrique orien-
tale grce la voile, 265.
Malaga, les vegas et les huerlas, 94.
Malais, dveloppement
;
civilisation, 125.
Navigation voile, 265.
For-
mation de la race, 283.
Maltais, migrations en Algrie,
94,
97.
Mangareva, son rle depuis le percement
du canal de Panama, 272.
Maori, civilisation, 127.
Maquis (le), a remplac la fort, 15.
Marchs agricoles, aliments par les
nomades, 36.
Maroc mridional, la tabia d'argile,
matire de construction, 151.
Marschen, premiers sites d'tablissements
humains en Basse-Allemagne, 179.
Mas, ferme provenale, 180.
Massa, leurs invasions, 52.
Peuple de
steppe, 109. - Coiffure, 128.
Mascareignes (les), le dronte avant l'ar-
rive de l'homme et du chien, 33.
Massif central, les hameaux et les moyens
de communications, 174.
Type
d'habitat, 186.
Massue, 124.
Mastruca, vtement protecteur, 129-
Matbls, leurs ceintures, 128.
Matmata, leur habitat, 152.
Matty (les), civilisation infrieure, 127.
Mauges (les), les tablissements ruraux,
177.
Maures, peuple de steppe, 109.
Res-
semblances avec les Ethiopiens, 112.
Mauriiia flexuosa, utilisation, 121.
Mayas,
amplitude de leurs constructions,
154.
Les matriaux calcaires,
155.
Mditerrane, navigation voile
; les
vents, 265,
Mditerranens, formation de la race
;
son expansion en Amrique, 114.
Mditerranen (bassin), plantes nourri-
cires et peuplement, 21.
L'usage
du fer
y
est connu de bonne heure,
27.
Diversit dans la densit du
peuplement
;
vie urbaine et vie des
clans, 40.
Causes de peuplement,
98.
Mditerranen (littoral), diversit dans
la rpartition du peuplement, 40.
Les crales et les lgumes dans la
partie europenne, 75.
Formation
de la race dans la partie europenne
;
l'afflux des peuples venus du Nord,
114.
L'architecture de la pierre,
155-159.
Les cultures en terrasses,
156.
Les oppida, 170.
La cit,
causes de sa naissance, 206.
Le
rgime urbain substitu au rgime vil-
lageois, 291.
Mhari, voir Dromadaire.
Mlansie, la case rectangulaire, 123.
Massue, tambours, 124.
Civilisation
malaise, 125.
Mlansiens, leur race diffrente des
Mongols et des Malais, 283.
Mer (la), elle devient tardivement un
moyen de migrations humaines, 27.
Premire pourvoyeuse de nourriture
pour l'homme, 29.
Mers australes, faible diffusion de la
population dans les les, 33.
Mersebourg, population, 73.
Merv, son dveloppement d ses deux
marchs hebdomadaires, 36.
Les
migrations des Iraniens, 45.
Msopotamie, matriaux de construction,
151.
Messnie, la plaine et son peuplement,
40.
Densit de population, 92.
Meubles en argile, leur emploi dans l'Iran
et en Nubie, 151.
Mexico, sa fondation par les Nahuat-
lacas, 45.
Mexique, l'habitat et l'altitude, 23.
Les irrigations pratiques par les Espa-
gnols, 55.
Migrations venues des
Montagnes Rocheuses, 57.
Influence
physiologique du climat, 110.
Le
mas et le frijol, 136.
Le pulque,
136.
Migrations des peuples, rcits les con-
cernant, leurs causes, 45.
L'histoire
primxitive de l'Europe celtique et ger-
manique se rsume en une srie de
migrations, 45-46.
Milieu (le), son rapport avec la gogra-
phie humaine, 5.
La gographie
botanique l'a mis en lumire, 6.
L'homme et le milieu, 8.
Influence
INDEX DES NOMS GOGRAPHIQUES ET TECHNIQUES 313
du milieu en Europe, 12.
Synonyme
d'environment, 103.
MineSy leur influence sur la densit des
populations en Europe, 72.
Mississipi, climat, peuplement, 22.
Missouri, le type Missouri, 22.
Mois, peuple montagnard, 110.
Mokattan, ses carrires ont fourni les
blocs ayant servi construire les
pyramides d'Egypte, 154.
Monastir (bassin de), Vodena en est le
dbouch, 90.
Mongolie, le nomadisme, 36.
Influence
des guerres et des invasions sur le
peuplement, 41.
Montagne et plaine, constituent deux
lments spars en Chine, au Japon
et dans l'Inde, 172.
Montagnes Rocheuses, les parcs, 23.
Les bocca del agua, 55.
Leur versant
oriental, voie de migration vers le
Mexique, 57.
Le mas, 136.
Montana, le peuplement en proportion
inverse de la vgtation, 34.
Morava, les centres habits au bord des
plateaux de lss, 177.
Moravie, le lss a servi d'habitat, 152-153,
Mordves, contribuent la formation du
peuple russe, 113-114.
Morvan, l'habitation trangre la route,
174.
Moscou, certains quartiers restent fidles
aux matriaux en bois, 166.
Mounds, tumuli en terre de la valle du
Mississipi, 154.
Moussons, leur influence sur le peuple-
ment de l'Inde et de la Chine, 62.
Favorisent les relations entre le con-
tinent et le monde insulaire asiatiques,
66. Garantissent le retour des
navires voile, 265-266.
Moyen-Neckar, l'habitat agglomr, 187.
Mulet, substitu l'ne dans les rgions
froides
;
est employ de bonne heure
dans la Chine du Nord, 223. Le
chemin muletier, 233.
Murgia (la), le peuplement, 40.
Mrier papier, employ fabriquer des
tissus par les Polynsiens, 124.
Muschelkalk lorrain, raret des fermes,
181.
Muses ethnographiques, leur importance
au point de vue scientifique, 3.
Intrt de leur tude, 119.
Mzab, causes de son peuplement, 42.
Migrations pnodiques des Larba, 35.
N
Nabatens, ont slectionn le dromadaire
ou mhari, 222.
Nahiehs, groupes agricoles actuels en
Egypte, 51.
Nahuatlacas, leurs migrations jusqu' la
fondation de Mexico, 45.
National Road, construit par les Etats-
Unis entre le Maryland et l'Ohio,
239.
Naturvolker, peuples rests voisins de la
nature, 9.
Nautilus, utilisation par les indignes,
126.
Nerlandes, rayonnement de leur mi-
gration, 99.
Pays devenus produc-
teurs et exportateurs de beurre et de
fromage, 142.
Ngres, coexistent avec les Pygmes, 11.
Adaptation au miheu, 109, 111.
Villages des ngres du Soudan, 169.
Ngrltos, complexion, 26.
Demeurent
trangers la vie maritime, 27.
Rpartition supposant de grands chan-
gements gographiques, 278-279.
Nerbudda (valle de la), occupation agri-
cole rcente, 45.
Niausta, (Macdoine), ville ancienne, 90.
Niger (valle du^, villages essaimant,
38-39.
Nijni-Novgorod, rle commercial
;
popu-
lation, 73.
Nil, densit de la population de son delta,
50.
Ses alluvions causent cette den-
sit, 51.
Les bassins d'irrigation, 52.
Nil (Haut-), influence du milieu sur
l'homme, 110.
Nomadisme, rgl sur les migrations des
animaux, 29.
Territoires de par-
cours, 34.
Son volution, 35.
La
vie pastorale, 36, 37, 212.
Nomenclature maritime, indicatrice de
l'autonomie des domaines maritimes
des divers peuples
; Arabes, Hindous,
Scandinaves, 267.
Nomes, groupes agricoles anciens en
Egypte, 51.
Nord Scandinave, peuplement, 79.
Norvge, les deux tiers de la population
tablis sur les ctes, 72.
Les cons-
tructions en bois, 166.
Norvgiens, leur navigation voile
limite au Sud par le Gulf Stream^
266.
Notoge, expansion humaine diffrente
de \ Arcioge, 24.
Nouits, groupes agricoles anciens en
Egypte, 51.
Nouraghes, enceintes fortifies de la
Sardaigne mridionale, 157.
Nouvelle-Caldonie, traces dans les mu-
ses ethnographiques, 120.
Nouvelle-Galles du Sud, la vie pastorale
37.
314 INDEX DES NOMS GOGRAPHIQUES ET TECHNIQUES
Nouvelle-Guine, constructions lacustres,
27.
La case rectangulaire, 123.
Civilisation, 125, 126.
Nouvelle-Zlande, traces dans les muses
ethnographiques, 120.
Civilisation,
127.
Longueur des chemins de fer
et densit des troupeaux, 257.
Noyer, sa culture en Europe, 139.
Noyonnais, sites des tablissements hu-
mains, 176. Villages en srie, 178.
Nubie, immigration en Egypte sous les
Pharaons, 52.
Meubles en argile, 151.
Nutkas, tribu de pcheurs plus dense
que celle des Algonquins chasseurs,
30.
Usage exclusif du bois, 130.
Ocan Atlantique, peuplement rcent
de quelques les, 33.
Ocan Indien, diffusion de la population
dans les les, 33.
Oder, lieu de villes, 73.
(Ecologie, dfinition, intrt, 7, 103, 121.
coumnes, spares parles ocans, 12.
Agrandissements rcents, 33.
Olivier, son importance dans l'alimenta-
tion des Berbres, 135.
Olympe de Bithynie, ses pieds, Brousse
centre de peuplement, 89.
Olympe de Thessalie. rle dans le peu-
plement, 88.
Centre de formation
de peuples, 89.
Oppida, leurs emplacements sur le lit-
toral de la Mditerrane, 170.
Orenbourg (gouvernement d'), faible
densit de population, 73.
Orge, premire base de la nourriture de
l'indigne gyptien, 134.
Son rle
dans l'alimentation humaine, 140.
Contribue fixer des populations agri-
coles vers le Nord, 141.
Osar, sites d'tablissements humains en
Finlande, 179.
Oscillafions de climat, influence sur le
peuplement, 14.
Osrone, voie de cheminement des peu-
ples, 55.
Otrante (Terre d'), les Murgie, 157.
Oued, lieu de pturage, 35.
Ouest Africain, la case rectangulaire,
123. Massue, tambours, 124.
Oufa (gouvernement d'), faible densit
de population, 73.
Ouganda, l'habitat, 38.
Outa, routes naturelles, 234.
Pacifique, analogies entre le littoral
japonais et la cte de l'Alaska, 67.
Pagayeurs de la zone quatoriale, diff-
rences avec les tribus agricoles, 116.
Palais assyriens et chaldens, construits
peu prs exclusivement en argile,
150-151.
Palolithique (priode), l'uvre du chas-
seur palolithique, 8.
Les progrs
du peuplement, 26.
En Europe,
paysages analogues ceux de l'Asie
septentrionale actuelle, 29.
Palerme, la Conca d'Oro, 94.
Palestine, migration en Egypte sous les
Pharaons, 52.
Pamir, pturages levs, 23.
Pampas, la vie pastorale en Argentine,
37.
Modes de roulage, 226.
Routes
naturelles, 234.
Pantschanada, ancien nom du Pendjab, 55.
Parc (paysage de), aspect vgtal pri-
mitif de l'Europe, 138.
Paris, la cit, noyau de la ville, 294.
Harmonie de la formation de la ville,
294.
Pays des Quatre-Fleuves (le), le Sseu-
tch'ouan ruin au xvii^ sicle et
repeupl par l'immigration, 44-45.
Pcheries, valent de bonne heure, au
Japon, une densit relativement forte,
67.
Leur influence sur cette densit
des deux cts du Pacifique, 67.
Leur influence primitive sur la densit
des populations en Europe, 72.
Les pcheries japonaises sont parmi les
plus importantes du monde, 145.
Ploponse, ses plaines et leur peuple-
ment, 40.
Pendjab, antiquit de sa population, 49.
Densit de celle-ci, 49.
Voie de
cheminement des peuples, 55.
Les
bangar et les khadar, 56.
Vestibule
des invasions et immigrations de
peuples, 62.
L'agglomration de
l'habitat rural, 193.
Prou, tablissements humains 4.500 m.,
23.
Migrations des Incas vers le
Chih, 57.
Le mas, la pomme de
terre, le quinoa, 136.
Les Quit-
chuas, 110, 154.
Perrs, anciennes voies romaines, 163.
Persan (paysan), s'est maintenu sur les
plateaux de Kermelis et d'Erbil, 57.
Perses, ne vivent pas dans les terres
chaudes du golfe Persique, 281.
Petite- Russie, absence d'arbres, 184.
Les villages, 184.
Ptra, intgrit des ornements de ses
difices taills dans le grs, 155.
Ptrograd, population, 72.
Peuple russe, sa formation,
113-114.
Pvle (la), pays de grande culture,
183.
INDEX DES NOMS GOGRAPHIQUES ET TECHNIQUES 315
Phniciens, la navigation voile
;
leurs
secrets de navigation, 265.
Philippines, densit de population, 66.
La race, 113.
La case rectangulaire
des Tagals, 123.
Phocens, la navigation voile
;
leurs
secrets de navigation, 265.
Phtiotide, densit de population, 83.
Picardie, la ferme, 180, 181.
Locali-
sation des bois, 183.
Pieds-noirs, leur extension, grce l'em-
ploi du cheval, 41.
Cet emploi
modifie leur genre de vie, 206.
Pimont, les maisons rurales, 176.
Pingouin, entre dans la composition des
kjkkenmddingen, 30.
Pirogues balanciers et plateforme
des ngres de la Nouvelle-Guine, 125.
Pis, employ dans la construction des
difices
; son alliance avec le bois, 160.
Le fachwerk des Allemands, 160.
Les masures de Champagne, 162.
Plaine centrale de Tch'eng-tou, densit
de la population, 61.
Plaine indo-gangtique, attire les tribus
aryennes et chinoises, 62.
Diversit
des races, 62.
L'habitat conditionn
par le sol, 185.
Plant, partie essentielle du village art-
sien, 182.
Plata (la), population, 20.
Plausirum, lourd vhicule italiote, 225.
Podolie, les invasions, l'inscurit, 42.
Paysage, cultures, position des vil-
lages, 184.
Poitou, le peuplement, 40.
Polders, premiers sites d'tablissements
humains en Basse-Allemagne, 179.
Polynsiens, traces dans les muses
ethnographiques, 120. Civilisation,
126-127.
Pomme de terre, l'une des bases de la
nourriture des Pruviens, 136.
Importe du Prou en Europe, 141.
A servi la colonisation d'une partie
de la Prusse, 142.
Accroissement de
sa production en Finlande, 142.
-Pontes longi, chausses de bois de la
plaine germanique, 162. Frise.
Ardenne, 236.
Ponthieu, lambeaux de forts, 183.
Ponts de pierre, marquent un progrs de
la civilisation, 164.
Pooling, contrats de chemins de fer
aux Etats-Unis, 256.
Population de l'Europe, densit relative
;
densit moyenne, 71.
Population de la terre, sa densit, 20.
Population urbaine, forte proportion en
Scandinavie et en Finlande, 72.
Porcs, les chnes
;
la glande, 139-140.
Elevage favoris par la culture du
mas et les cultures industrielles,
140.
Portes de Cllicie, les dfils de Gulak,
232.
Porto-Maurizio (province de), densit de
population, 85.
Poterie (la), ignore par quelques tri-
bus, 28.
N'est pas lie l'architec-
ture en brique, 150.
Varit des
produits, 201.
Pouilles (littoral des), le peuplement,
40.
Prades, densit de population, 92.
Prairies, routes naturelles en Amrique,
235.
Dveloppement agricole, che-
mins de fer, 256.
Prairies States, accroissement de popu-
lation, 25.
Influence des chemins
de fer, 256.
La machinerie cono-
mise la main d'uvre, 257.
Lon-
gueur du rseau ferr par rapport
la densit de population, 257.
Les
chemins de fer et l'agglomration du
btail, 258.
Prhistorique (Investigation), ses rsultats,
8.
Presqu'le malaise, les Semangs et les
Sakas, 125.
Prs, favorisent la propagation de la
vache laitire dans l'Ouest de l'Eu-
rope, 141.
Provinces Baltiques, l'habitat dissmin,
189.
Provinces Centrales (Inde anglaise), l'oc-
cupation agricole en est rcente,
45.
Province rhnane, progrs de la densit
de sa population, 71.
Prunier, sa culture en Europe, 139.
Prusse, la pomme de terre a servi en
coloniser une partie au xviii sicle,
142.
Pueblos, villages fortifis construits en
grs, 155.
Puget Sound, analogie entre son littoral
et celui des les japonaises, 67.
Pulque, liqueur fermente extraite de
l'agave, au Mexique, 136.
Puszta hongroise, absence d'arbres, 184.
Pygmes, coexistent avec les ngres dans
les silves africaines, 11.
Pyramides, leur conservation, triomphe
de la pierre, 154.
Quartier, type d'habitat au Pays basque,
186.
316 INDEX DES NOMS GOGRAPHIQUES ET TECHNIQUES
Quinoa, l'une des bases de la nourriture
des Pruviens, 136.
Qultchuas, vitent la fort humide,
110, 281.
Amplitude de leurs cons-
tructions, 154.
Race malaise, origines et affinits, 66.
Expansion, 113.
Races, leur formation, 277-284.
In-
fluence des changements des conditions
gographiques, 279.
Origine de la
race nordique, 279-280.
Rauhe-Alp, l'habitat agglomr, 187.
Recensements, pratiqus en Chine par les
empereurs plusieurs sicles avant notre
re, 60.
Redirs, voir Daijas.
Refuge, rle dans les premiers tablis-
sements humains, 170.
Regatiu, Roussillon, 84.
Rgime urbain, chef-d'uvre de la Grce,
et de Rome, 291.
Rgion indo-paciique, civilisation, 126.
Rgion mditerranenne, la culture de
plantation
; son influence sur la con-
centration des habitants, 81.
Alti-
tude optimum du peuplement, 87.
L'architecture de la pierre, 155-159.
Les cultures en terrasses, 156-157.
La cit, causes de sa naissance, 206.
La vie des clans, 207.
Rgions industrielles, activit du roulage,
239.
Ppinires de villes en Europe,
293.
Regur, le cotton soil terrain agricole
dans l'Inde, 45.
Renne, localis dans les pays froids, 223.
Rennes (Bassin de), pays de fermes
isoles, 174.
Rseau ferr, densit, 251.
Rapport
la densit de population aux Etats-
Unis, 257.
Rheda, voiture lgre construite par les
Celtes, 225.
Rhin, les invasions, 42. Les villes,
73.
Rhne, les invasions, 42.
Riegos, Espagne, 84.
Rieti (bassin de), densit de population,
92.
Rif (le), absence de commerce et de vie
urbaine, 40.
Riga, population, 73.
Rivieral, Roussillon, 84.
Rivire du Levant, de Gnes la Spezia,
85.
Rivire du Ponant, de Gnes San Remo,
85.
Riz, plante d'alimentation de l'Asie des
moussons, 143.
Sa culture au
Japon, signe de civilisation suprieure,
144-145.
Rizires, les Japonais sont attachs
leur amnagement, 68.
Les rizires
chinoises du Sz-tchouan
; la plaine
de Tcheng-tou-fou, 146-147.
Rocheuses (Montagnes), les Pieds-noirs,
41.
Romains, constructeurs de routes, 225,
236-238.
Rome, rapports avec l'Egypte, 213.
Le Palatin, noyau de la ville, 294.
Rouanda (le), les cultures, 38.
Roues, leurs origines
;
leur crateur, 219.
Les roues ferres, 226.
Influence
de leur invention, 286.
Roulage, son domaine gographique, 234.
En France il a drain la circulation
vers les chemins de fer ; son activit
dans les rgions industrielles, 239.
Roumains, leur nationalit reforme dans
les Alpes transilvaines, 42.
Roussillon, poque visigothique, 94.
Routes jalonnes, les tourelles, 235.
Royat, type d'tablissement humain au
contact du basalte et de l'argile, 177.
Royaume lombard-vnitien, densit de
population vers 1815 et depuis, 71.
Russes, les invasions, 41.
Le Gouver-
nement russe s'oppose une immi-
gration trop brusque en Sibrie, 46.
Russie, progrs acclrs de la densit
de sa population depuis 50 ans, 72.
Colons venus de l'Europe centrale,
99.
Formation du peuple russe,
113-114.
En Russie d'Europe, le
bois tient souvent lieu du mtal, 129-
130.
Les villes construites en bois,
164.
L'habitat dans la rgion de la
terre noire, 185.
Chemins de fer,
248.
Russie du Nord, transformation des
villes sous l'influence de la brique et
du granit, 166.
Orientation des
constructions en bois, 166.
Russie du Sud, le peuplement, 40.
Saaie, la population urbaine, 73.
Sahara, la vie rfugie dans les dunes,
13.
Fractionnement du peuplement,
34.
Territoires de parcours, 35.
Marchs aux confins sahariens, 36.
Populations sahariennes, influence du
climat sec, 109.
Sahara algrien, les gravures rupestres,
155.
INDEX DES NOMS GOGRAPHIQUES ET TECHNIQUES 317
Saint-Gobain, villages en srie, 178.
Saint-Laurent (le), villages agricoles sur
les terrasses au bord du fleuve, 177.
Salomon (les), civilisation
;
originalit,
127.
Salone^ revit dans Spalato, 159.
Samara, population, 73.
Samarkand, lot de peuplement, 54.
Samoa (les), les pirogues, 127.
Samoydes, peuplade nomade de chas-
seurs, 29.
Civilisation, 130.
Sania-Fe Trail, route de colonisation
aux Etats-Unis, 235.
Santerre, le village, 181.
Santorin, civilisation ancienne, 83.
Saratov, population, 73.
Sarbacane, employe dans l'Amazonie
comme en Malaisie, 124.
Sardes, tte de la route conduisant
Suse, 89.
Sarte, agriculteur iranien, 57.
Savane (la), taille aux dpens de la
fort, 31.
La savane herbeuse,
36.
Savoie, le chalet, type de construction
alpestre, 161.
Saxe, progrs de la densit de sa popu-
lation, 72.
Budgets d'ouvriers, 77.
Peuplement, 99.
Scandinavie, l'usage du fer tardif, 27.
Importance de la population urbaine,
72.
Peuplement, 79.
La maison
finlandaise, expression d'une civilisa-
tion autonome, 167.
Secanos, Espagne, 84.
Sdentarit, dtermine par la pche
ctire, 29.
Seigle, son rle dans l'alimentation
humaine, 140.
Contribue fixer
des populations agricoles vers le Nord,
141.
Sstan, fragilit des matriaux d'argile
employs pour les constructions, 153.
Semangs, civilisation archaque, 125.
Sngal, les incendies de brousse, 31.
Snonais, sites des tablissements hu-
mains, 176.
Sentiet noir (le), voie d'invasions, 42.
Squanes, la richesse de leurs terres
attire les invasions des Suves, 46.
Serbie, la maison de bois, 161.
Diff-
rents types d'habitat, 188.
Srique, voie de cheminement des peu-
ples, 55.
Sville, densit de population, 83.
Sfax, les horticulteurs, 135.
Sheltield, les budgets d'ouvriers, 77.
Sibrie, elle attire les paysans russes de
la terre noire, 46.
Villes construites
en bois, 164.
Sicile point de transmission des produits
mditerranens, 75.
Altitude opti-
mum des tablissements humains, 87.
Influence arabe sur le peuplement,
94.
Sierra Nevada, limite des tablissements
humains, 87.
Attire le peuple-
ment, 88.
Silok, densit de population, 67.
Silsie, peuplement, 99.
Silve (la), villages sa limite, 34.
Silve tropicale, 36.
Si-ngan-fou, l'un des plus anciens centres
de la Chine, 58.
Sioux, traces dans les muses ethnogra-
phiques, 120.
Civilisation, 128.
Socit chinoise, sa cohsion dans l'mi-
gration, 44.
Sogdlane, les migrations des Iraniens,
45.
Voie de cheminement des peu-
ples, 55.
Soissonnais, les villages, leur rpartition,
181.
Souabe, peuplement prcoce des plateaux
calcaires, 40.
Sites de chteaux-forts
sur leurs bords, 164.
Villages en
srie, 178.
Deux types d'habitat :
agglomr, dissmin, 187-188.
Soudan, plantes nourricires, 21.
Confins sahariens, 36.
Cultures, 38.
Absence de science agricole, 43.
Les villages ngres, 169.
Soudan Nigrien, fort peuplement, 38.
Soudan occidental, vestiges de l'ge de
pierre, 31.
Soudan saharien, emploi de l'argile dans
les constructions, 151.
Sou-tcheou, voie de pntration des Chi-
nois, 58.
Spalato, remplace Salone dtruite, 159.
Sparte, comparaison de Thucydide, 158.
Sseu-tch'ouan, le Pays des Quatre
Fleuves ,
44-45.
Merveille d'irriga-
tion, 60-61. - Population totale, 61.
Les rizires, 146-147.
L'habitat
rural, 191-192.
Le portage humain,
218.
Steppes, influence des guerres et des
invasions sur le peuplement, 41.
Populations steppiques, influence du
climat sec, 109.
Stockholm, population, 72.
Strouma (bassin de la), son peuplement
sur le flanc des montagnes, 90.
Sude, pays devenu producteur et expor-
tateur de beurre et de fromage, 142.
Suves, attirs vers les terres des S-
quanes, 46.
Suisse, constructions lacustres, 27.
Sulmona (bassin de), densit de popula-
tion, 92.
Sumatra, densit de la population, 34.
318 INDEX DES NOMS GOGRAPHIQUES ET TECHNIQUES
Son insularit relativement rcente, 66.
Les Bataks. Les populations primi-
tives, 66.
La sarbacane, 124.
Les Bataks, 125.
Syracuse, expansion vers la terre, 170.
Syrie, migration vers l'Egypte sous les
Pharaons, 52.
Vie littorale, 86.
Syrtes, absence de commerce et de vie
urbaine, 40.
Sz-tch'ouan, voir Sseu-tch'ouan.
Tabia, matire construire au Maroc
mridional
; sa composition, 151.
Tafilelt, causes de son peuplement, 42.
Tagals, leur habitat, la case rectangu-
laire, 123.
Tahiti, les pirogues, 127.
Son rle
depuis le percement du canal de Pa-
nama, 272.
Taipings (rvolte des), a cot la vie
des millions d'hommes, 62.
Ta-yan-fou (Chan-si), un des berceaux
de la civilisation chinoise, 58.
Taklamakan, dsert du Turkestan, 22.
Talayots, enceintes fortifies des Balares,
157.
Tamouls, leurs migrations vers les archi-
pels asiatiques, 66.
Tanesrouft, le dsert absolu, 22.
Tapti (valle de), occupation agricole
tardive, 45.
Tartares, leurs chariots, 220.
Taias, forteresses soudanaises construites
en argile, 151.
Taygte, population de Kalamata, 92.
Tch-Kiang, influence du climat et du
sol sur l'habitat rural, 191.
Tche-li, la civilisation agricole
y
suit le
pied des montagnes, 58.
Tch'eng-tou, densit de population, 61.
Tcheng-tou-fou (plaine de), les rizires,
147.
Tchrmlsses, contribuent la formation
du peuple russe, 113-114.
Leur
habitat, 189.
Tcherkesses, peuple montagnard, 46.
Tchiflik turc, noyau des villages bul-
gares, 180.
Tchouktches, peuplement de la pnin-
sule, 24.
Peuplade nomade de chas-
seurs, 29.
Tehuelchs, la bola, 128.
Tell, lieu de marchs sur les confins
sahariens, 36.
Tell, nom dsignant des restes d'tablis-
sements humains en Babylonie, 153.
Tne (civilisation de la), ses cultures,
137-138.
Teniet-el-Had, march frquent par les
Larba, 35.
Tenochtitlan (Mexico), fonde par les
Nahuatlacas, 45.
Teou-foUy fromage vgtal, aliment des
Chinois, 144.
Tra, limite ethnique, 110.
Spare
l'Hindou aryanis des Mongolodes;
281.
Terre de Feu, aurait d tre le point de
dpart du peuplement des terres an-
tarctiques, 24.
Terre de Graham, inhabite la lati-
tude de l'Islande, 24.
Terre noire, l'habitat, 185.
Terre (population de la), sa densit, 20.
Tessin, les tablissements humains, 178.
Thalassocraties, hgmonies qui se renou-
vellent et se remplacent, 269-271.
Celle de l'Angleterre difie sur celles
de la Hollande et de la France, 271.
Th, sa culture au Japon, 68.
Signe
de civilisation suprieure, 144-145
;
fille du milieu chinois, 147.
Rpond
un besoin physiologique, 147.
ThUnkits, tribu de pcheurs populeuse,
30. De civilisation arrire, 67.
Tian-chan, pturages 4.000 m., 23.
Long par une voie historique, 55.
Tibesti, influence du milieu sur l'habitant,
110.
Tibet, peuplement, 22.
Pturages
4.000 m., 23.
Tibtains sanctuaires, dans les valles
les plus cartes, 46.
Tigre, ses alluvions en Chalde, 53.
Tissus d'corce, tirs par l'industrie
polynsienne de l'Artocarpus et du
mrier papier, 124.
Togo, constructions en argile, 151.
Tonga (les), les pirogues, 127.
Tonldn, peuplement, 22.
Densit de
la population du delta, 51.
Habitat
rural
; les villages, 192.
Touareg, population en excs par rap-
port aux ressources du pays, 23.
Fractionnement des groupements, 34.
Leur vtement, 129.
Touat, causes de son peuplement, 42.
Touba, brique sche au soleil employes
Zinder, 151.
Toundras, rgions de l'Asie septentrionale,
29.
Toungouses, peuplade nomade de chas-
seurs, 29.
La race, 116.
Traneaux rouleau, leur emploi par les
Assyriens, 219.
Transhumance, son influence sur le peu-
plement, 82.
Travancore, peuplement par hameaux, 63.
Dissmination de l'habitat rural, 193.
INDEX DES NOMS GOGRAPHIQUES ET TECHNIQUES 319
Tribus aryennes, leur acheminement le
long des montagnes, 62.
Tribus pastorales, Asie, Sahara, 35.
Tridacna gigas, utilisation par les indi-
gnes, 126-127.
Tristan da Cunha (archipel), des naufra-
gs s'y sont habitus l'inaction, 203.
Tropicale (zone), rduction de l'tendue
forestire au Nord et au Sud, 31.
Trulli, constructions en pierre, 157.
Trunk Unes, se dessinent ds 1854, 247.
Tsaristsyn, population, 73.
Tsong-ming (le), densit hypertrophique
de la population, 50.
Turcomans, leurs hauts pturages, 23.
Turkestan, ses dserts, 22.
Influence
des guerres et des invasions sur le
peuplement, 41.
Turquie, chemins de fer, 249.
Tyahuanaco, les Quitchuas, 154.
Tyr, foyer de colonisation, 86.
Expan-
sion vers la terre, 170.
Tziganes, lment rfractaire la fusion
des races, 11.
U
Ukraine, repeuplement aprs les inva-
sions, 42.
U ion. Central Pacific, premier transcon-
tinal amricain, 259.
Unit terrestre (Y), cette ide domine tous
les progrs de la gographie, 5.
Vache laitire, sa propagation dans
l'Ouest, grce aux prairies, 141.
Valachie, le catun, 188.
Valence, les vegas et les huertas, 94.
Densit de population de la rgion, 94.
Val Mazzara, influence arabe sur le
peuplement, 94.
Var, les plans, 40.
Vegas, peuplement, 94.
Vgtation (la), signalement le plus ex-
pressif d'une contre, 6.
Vgtation tropicale, inspiratrice d'uvres
humaines, 122.
Ve-ho (valle du), le dveloppement de
la population chinoise, 58.
L'habi-
tat ;
les hameaux, 191.
Vende, l'habitation trangre la route,
174.
Vntes, navigation voile, 265.
Venezuela, la case rectangulaire, 123.
Verria, centre de peuplement, 90.
Vtements, formes et complications va-
rient suivant les ncessits, 76.
Vexin, lambeaux de forts, 183.
Via Appia, voie de communication de
Rome Brindisi, 236-237.
Via Aurlia, voie de communication
travers la Narbonnaise, 237.
Via Domitia, voie de communication
entre l'Italie et l'Espagne, 237.
Via Egnatia, sert encore de voie de com-
munication en Albanie mridionale,
236. Traverse Salonique, 237.
Via Flaminia, voie de communication de
Rome l'Adriatique, 237.
Vienne, quartier Saint-Etienne, noyau
de la ville, 294.
-
Le Ring, 294.
Vie pastorale, son nomadisme, 36, 37,
212.
Son extension en Australie et
en Amrique, 36, 37.
Son dvelop-
pement en Afrique, 128.
Vie sdentaire, elle donne consistance
l'occupation du sol, 37.
Villa, forme primitive du groupement
rural, 180.
Villages agglomrs, mode d'habitat n
de l'assolement triennal, 182.
La
Chine du Nord, 190-191.
Le Tonkin,
192.
-
L'Inde, 193, 196.
Ville (la), son rle spcial dans la forma-
tion du peuplement, 73.
Villers-Cotterets (fort de), massif fores-
tier sur les sables, 183.
Vistule, lieu de villes, 73.
Vivarais, tablissements humains dans la
zone de la chtaigneraie, 178.
Vodena, la ville des eaux, 90.
Voie de la Preuse, ancienne voie ro-
maine, 163,
Voies romaines, leur solidit
;
guident la
circulation moderne, 163.
Voile (la), l'usage en est ignor par cer-
taines tribus, 28.
Moyen d'hg-
monie, 265.
Perfectionne par les
Gnois, 268.
Volga, lieu de villes, limite de l'agglom-
ration europenne, 73.
Vosges, peuplement, 99.
Les collines,
178.
Vulture, son influence sur le peuplement,
92.
W
Wallonie, la ferme, 180.
Westphalie, les budgets d'ouvriers
Solingen, 77.
Wurtemberg, tudes de Gradmann sur
l'histoire du peuplement, 41.
Wyoming, la vie pastorale, 37.
320 INDEX DES NOMS GOGRAPHIQUES ET TECHNIQUES
Yalas (les), domaines pastoraux des
Kurdes, 23.
Yak, animal de transport dans les hautes
altitudes, 223.
Yang-tseu-kiang, densit de la population
de son delta, 50.
Peuplement de
ses plaines alluviales, 57.
La coloni-
sation dans les grands bassins int-
rieurs, 61.
Yankee, type humain, 106.
Influence
du climat des Etats-Unis, 280.
-
Diffrence de type avec le Canadien
franais, 281.
Son rle civilisateur
en Amrique, 288.
Ymen, peuplement entre 2.000 et
3.000 m., 23.
Yso, faible densit de la population, 68.
Yucatan, les constructions des Mayas,
154. Le calcaire, 155.
Yunnan, le th, 147.
Zlande (Nouvelle), densit de la popu-
lation, 20.
Zribas, leurs enceintes de branchages
pineux, 150.
Zinder, emploi de l'argile dans les cons-
tructions, 151.
Zipango, nom lgendaire de la Chine, 68.
Zoulous, civilisation, 128.
TABLE DES PLANCHES
HORS TEXTE.
Planche I.
Grandes cultures de crales 144-145
II.
Priphrie urbaine des rgions arides.... 292-293
III.
Rpartition de la population A la fin du volume
IV.
Les milieux. Dveloppements autonomes de
civilisation. Milieux biologiques. Matriaux
emprunts au rgne vgtal Id.
V.
Id. Milieux biologiques. Matriaux emprun-
ts au rgne animal Id.
VI.
Id. Matriaux et dveloppement des for-
mes de constructions Id.
Vidal-Lablache, Gographie humaine. 21
TABLE DES MATIRES
Avertissement, par M. Emm. de Martonne v
Introduction : Sens et objet de la Gographie humaine 3
I.
Examen critique de la conception de
gographie humaine 3
II.
Le principe de l'unit terrestre et la
notion de milieu 5
III.
L'homme et le milieu 8
IV.
L'homme facteur gographique 12
PREMIRE PARTIE
LA REPARTITION DES HOMMES SUR LE GLOBE
Chapitre I.
Vue d'ensemble 19
I.
Ingalits et anomalies 19
II.
Le point de dpart 25
Chapitre II.
Formation de densit 33
I.
Groupes et surfaces de groupements
(Groupes molculaires.
Groupes
nomadisants.
Rapports des groupes
entre eux.
L'accumulation sur place.
Noyaux de densit et lacunes inter-
mdiaires. Groupements de dates
diverses en Europe) 33
II.
Mouvements de peuples et migrations
(Densit par refoulement.
Densit par
concentration.
Surpeuplement et
migration.
Sens gnral de l'volu-
tion du peuplement) 41
324
Chapitre III.
Chapitre IV.
Chapitre V.
Chapitre VI.
TABLE DES MATIRES
Les grandes agglomrations humaines :
Afrique et Asie 49
I.
Egypte 51
I.
Chalde 53
III.
Asie centrale 54
IV.
Chine 57
V.
Inde 62
VI.
Archipels asiatiques.
Japon 66
VII.
Conclusion 69
L'agglomration europenne 71
I.
Les limites 71
II.
Point de dpart et conditions d'eX"
tension 74
III.
Rle des relations commerciales, ... 78
Rgions mditerranennes 81
I.
Les points faibles 81
IL
Rle des cultures arbustives 83
III.
Les Rivires 85
IV.
Zones d'altitude 87
V.
Rle des montagnes 88
VL
Influences arabes 93
Conclusions : Rsultats et contingences 97
DEUXIME PARTIE
LES FORMES DE CIVILISATION
Chapitre I.
Les groupements et les milieux 103
I.
La force du milieu 103
II.
L'adaptation au milieu chez les plantes
et les animaux 106
III.
L'adaptation de l'homme au milieu 108
IV.
Formation des groupes ethniques
complexes 111
V.
Races et genres de vie 115
Chapitre II.
Les instruments et le matriel 119
I.
Intrt de l'tude des muses ethno-
graphiques 119
II.
L'empreinte de la silve quatoriale..
.
121
III.
Centres de dveloppement originaux
(Les Malais.
Les Polynsiens) 125
IV.
Le monde des savanes dcouvertes. . -128
TABLE DES MATIRES 325
V.
Survivances et dveloppements auto-
nomes dans les zones tempres
et froides 129
VI.
Conclusion : Les civilisations stro-
types 131
Chapitre III.
Les moyens de nourriture 133
I.
Type mditerranen 134
II.
Type amricain, le mas 136
III.
Type europen central 137
IV.
Type europen septentrional 140
V.
Types asiatiques (Le riz.
-^
Type
chinois.
Type japonais) 113
VI.
Propagation des types de culture.. 146
Chapitre IV.
Les matriaux de construction 149
I.
La terre dans la zone aride 150
II.
La pierre dans la rgion mditer-
ranenne 154
III.
Le bois et la pierre dans V Europe
centrale et occidentale 159
IV.
Le bois dans V Europe septentrionale 165
Chapitre V.
Les tablissements humains 169
I.
Les sites (tablissements temporai-
res et tablissements permanents.
Complexit dans les pays de
vieille civilisation.
Existence
de types.
Influence des routes.
Lignes de contact.
Villages
en srie.
Types montagnards). 169
II.
L'habitat agglomr.
Fermes et
villages (La Ferme.
Le Village.
-
Modifications du paysage.
Influence du climat continental.
Conclusion) 180
III.
L'habitat dispers 186
IV.
Types de rgions subtropicales et
subarctiques (Rgions subarcti-
ques.
La Chine.
L'Inde). 189
V.
Conclusion 195
Cpiapitre VI.
L'volution des Civilisations 199
I.
Tendance naturelle au perfection-
nement 199
II.
Stagnation et isolement 202
III.
Les contacts 205
IV.
Contacts par invasion et opposition
de genres de vie 207
326 TABLE DES MATIRES
V.
Contacts par le dveloppement du
commerce maritime
209
VI.
Caractre gographique du progrs.
.
211
VII.
Les noyaux
212
TROISIME PARTIE
LA CIRCULATION
Chapitre I.
Les moyens de transport
217
I.
L'homme
217
II.
La traction animale 220
III.
Les vhicules 224
Chapitre II.
La route 231
I.
Fixation des routes 231
II.
Chemins muletiers et routes de chars.
.
233
III.
La route construite. Les voies romai-
nes 236
IV.
Routes modernes et chemins de
fer. . 238
Chapitre III.
Les Chemins de fer 243
I.
Origine des chemins de fer 243
IL
Dveloppement des chemins de
fer.. . 244
III.
L'ide nationale et stratgique.. .
.
247
IV.
Extension rcente du rseau ferr.
.
. 250
V.
Courants internationaux de l'ancien
monde 252
VI.
Le rail et la mise en valeur de
l'Amrique 253
VII.
Chemins de fer et densit de la popu-
lation 256
VIII.
Grandes lignes maritimes et grandes
lignes continentales 258
IX.
Conclusion 261
Chapitre IV.
La Mer 263
I.
Origine de la navigation maritime.
.
263
II.
La navigation voile 264
m.
Domaines de navigation 267
IV.
L'ide d'hgmonie par l'ocan. . .
.
269
V.
Ractions continentales 271
TABLE DES MATIRES 327
FRAGMENTS
I.
Formation de races
277
II.
La diffusion des inventions
285
La Charrue
285
La roue
286
Les animaux de trait
^ 287
III.
Genres de vie et domaines de civilisation
288
IV.
La Ville 291
Index alphabtique des auteurs cits
299
Index alphabtique des matires
301
Table des planches hors texte
321
ABBEVILLE. IMPRIMERIE F. PAILLART.
RPARTITION DE LA POPULATION
VIDAL- LABLACHE .Gographie humaine.- PI.
Echelle: 1:100.000.000
I I P/us de JOO habitants par fC(f.
L J p/us de 50 habitants par /Cif
I I p/us c/e /O habitants par /C
I I p/us de / habitant par /C(f
I I moins de f habitant par /C^
Librairie Armand Colii
fntp ^Honmctjf , -^i^^^i^
LES MILIEUX
DEVELOPPEMENTS AUTONOMES DE CIVILISATION
Echelle: 1:100000.000
VIDAL- LABLACHL, Gographie humaine. PI. IV Librairie Armand Colli
Provenance presque
exclusivemenb vgtale
Provenance mixte
MILIEUX BIOLOGIQUES
Matriaux emprunts au rgne vgtal
I I
Cocotier, pandane, liane , raphia
a [ [
Coton, gommier, palmier- doum , datOt
b Y
1 Bambou, teck , rotang ^p/anies oleagmcL
[ 1 Cacte , agave, maguey , henne(juen .
'uphorbe, /agenaria
, broussonetia papyrifera
prdominance j
de certaines essences d
[ j Rosesu, papyrus ,ambatch , baobab .peupffer et bois /ger , saxsou/,a/fa
.
e
I
1 Cdre , thuya, genvrier, ohvier chne veri
,
pin d'A/ep , sapin de Cepha/ome
f
I I
Chne , chtaignier , buis, noyer. Frne . auine , iF, sap/n b/anc .
g I I
Boufeau , mize, pica
fmp Aferrtryor^^ . J^*^^^^
LES MILIEUX
DVELOPPEMENTS AUTONOMES DE CIVILISATION
Echelle: 1:100.000.000
VIDAL- LABLACHE, Gographie humaine .PI .V Librairie Armand Colin
MILIEUX BIOLOGIQUES
Matriaux emprunts au rgne animal
I
I
Peaux, os, dents .graisses et huiles
| |
Henn, carjbou . ba/eine,ph:iifue, morse
I I Fourrures
, duvets |.
.." .] Martre-zibe/ine, renardpo/^ii-e ,eider.
il I '-sines
,
poils, peaux V~- ] Mouton /a/ne, chvre, bcf, chameau
II I Toisons, duvets
|^p
Cbtfre duvet (Pec/,m>,yak, /a.na ,a/paca,v/gogne
Dl Cocons, Fils, produits de scrtion
| |
l/er soie (Bomtj-x mon > , insscte cireccorcus^.nens.s).
^ "cau>
, plumes , ufs , cornes
| |
Anti/ope, bufi-zbu, autruche. rha, kangourou , bison en mriguefjusjiien/a?S'
Plumes d'oiseaux tropicaux 1 1 Ara, perruche, condor . O/se^uJt deparad/s , co/ibn .
" Ecailles, perles, coi^uilles, os, artes
| |
Tridacna gigas , tortue, navti7e,s^ua/es
/mp jHonrvc^ , JUn*t
.
LES MILIEUX
DEVELOPPEMENTS AUTONOMES DE CIVILISATION
Echelle: 1:100.000.000
VIDAL- LABLACHE.Gographie humaine _ PI. VI Librairie Armand Colin
MATRIAUX ET DVELOPPEMENT
DES FORMES DE CONSTRUCTIONS
1 Architecture tropicale (bois et Feuilles)
| | Cases gnrahment rectanguhres, surpihds , lo/ts e/evs . (Compirerle rMe </ire/oppement diiMt dinslin/iiieclure chinoise etjaponaise)
.
11_D0IS pineux et paille de brousse
| | Cases gnralement cy/indni/ues; toits hmisphriques enve/opfiarttldirice'.'i^'iinii) _nceinles pineuses (Snhsarabe!)
.
in Emploi de la terre et de la brique
| | Maisons enpis(Aiob,>)ou en bngues crues . Habilationscreusesdans /e/ssKZ'nxmiv.mvi) .KoursanesettumuU.-Briifue mail/e.Talilellesetcy/indres chaldensMrt/r
IV Architecture de la pierre
| | Dolmens ViUages defalaisiers yhmm<\^iA^i\^ .'imi^y Grottes spuhrahs.yotes encorbel/ement(rrul/,.mur3ghei,liij,ot,' Oppida . ^ Pyramides
" ^
I I Maisons en pierres de taille . _ Voies et aqueducs _ /architectures classique et mdivale . Architectures orientale et amricaine
.
V Usage mixte de la pierre, de la terre et du bois
| |
Huttes asiatiques . Maisons en pis et bois avec soubassementdepleme (Europe centrale),// </ ^//sxlNormaudieRcardie).
VI _ Emploi du pin et des rsineux
| |
Uba russe ; blockhaus Scandinave; chaletalpin balcons ouvrays
.
Anciens dveloppements de la cramique fhtene, porcelaine, rcipletts en terre (jur-f^smphor^s eu Sartpruvien ,yuyanais,l<abyle,iialogrec,sinojaponais, etc
lW?S*:.
^:r-
/'S
^^
'^-^%t: , ^_- %A
.%
mr^
m.\
^i^^^^^$%
Vidal de I.a Blache, Paul
Marie
Joseph
Principes
de gographie
humaine
*"
^
PLEASE DO MOT REMOVE
CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET
UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY
#
^
>> ^r^^ \^r
vrk
^;^.
m-:
arm-
*a/,:r.
--T-.-^^
^
il
^
'
^
i?".
'
^i*^
r.-^
V. irf:
-#^:
V.*tL
m.r^.
im
Vous aimerez peut-être aussi
- Eric C09 5. Synthèse Acétate de LinalyleDocument3 pagesEric C09 5. Synthèse Acétate de Linalylebahijmalak4Pas encore d'évaluation
- 8 Le Système HLA 2017Document38 pages8 Le Système HLA 2017Dr BENOUADFELPas encore d'évaluation
- Connaissance Et Maitrise Des Pertes Dans Les Rã©seaux Dâ Eau PotableDocument99 pagesConnaissance Et Maitrise Des Pertes Dans Les Rã©seaux Dâ Eau Potableomaspowercraft100% (1)
- 4 - Ictère FébrileDocument50 pages4 - Ictère FébrileSara SouPas encore d'évaluation
- Pfe DoumDocument88 pagesPfe DoumDoumbiaPas encore d'évaluation
- Lyphochek Assayed Chemistry Control Levels 1 and 2: CuivreDocument1 pageLyphochek Assayed Chemistry Control Levels 1 and 2: CuivreAnouar NouiouiPas encore d'évaluation
- Les Reseaux XDSLDocument33 pagesLes Reseaux XDSLAhm DHPas encore d'évaluation
- Baadi RandaDocument66 pagesBaadi Randamohammed9997Pas encore d'évaluation
- Recueil Des Textes Hygiene PubliqueDocument93 pagesRecueil Des Textes Hygiene PubliqueMaman Ibrahim75% (4)
- AIMF 2cor 1 - 2011 PDFDocument4 pagesAIMF 2cor 1 - 2011 PDFleilalargate_3780929Pas encore d'évaluation
- L'étendue Du Pardon de AllahDocument19 pagesL'étendue Du Pardon de AllahHamza AssermouhPas encore d'évaluation
- Visa Pour Le PCEM1 BiologieDocument242 pagesVisa Pour Le PCEM1 Biologiegoldenlady8886% (7)
- 1 Du 1S Classe Tle ADocument2 pages1 Du 1S Classe Tle ACEG1 DASSA-ZOUMEPas encore d'évaluation
- Moteur Asynchrone TriphaséDocument11 pagesMoteur Asynchrone Triphasémhenaoui100% (1)
- Controle02 RattrapageDocument2 pagesControle02 Rattrapage2021synpaPas encore d'évaluation
- Chapitre 1 - Les Séparations Solide-LiquideDocument5 pagesChapitre 1 - Les Séparations Solide-LiquideBeatrice Florin100% (1)
- CEN TS 14972 - 2017 - Brouillard D'eauDocument72 pagesCEN TS 14972 - 2017 - Brouillard D'eaumescalito1234Pas encore d'évaluation
- Techniques de Forage Et DiagraphieDocument18 pagesTechniques de Forage Et Diagraphiefethi aissa ouissi100% (1)
- S7.10.3 La Teneur en EauDocument2 pagesS7.10.3 La Teneur en EauAss wadePas encore d'évaluation
- Correction Exercice 4 Rendement Dune Eolienne CompressDocument3 pagesCorrection Exercice 4 Rendement Dune Eolienne Compressnajoua beggarPas encore d'évaluation
- Intégration Par La Méthode de Simpson - Cours PythonDocument7 pagesIntégration Par La Méthode de Simpson - Cours PythonDino Princy RatsimbazafyPas encore d'évaluation
- TD PDE - Série 2-L3 EEAI - 20-21Document3 pagesTD PDE - Série 2-L3 EEAI - 20-21kouakoukouassielyse76Pas encore d'évaluation
- ET500 ListDocument7 pagesET500 ListKunal SinghalPas encore d'évaluation
- Minerais Fer Djebel-AniniDocument17 pagesMinerais Fer Djebel-AniniBoubaker BenaissaPas encore d'évaluation
- Dal ReseauDocument2 pagesDal ReseauManel KarimPas encore d'évaluation
- MDS Séance1 BDocument21 pagesMDS Séance1 BAmine ElrhazalPas encore d'évaluation
- Chapitre 12. Applications Affines. - TSEDocument68 pagesChapitre 12. Applications Affines. - TSEYacouba CamaraPas encore d'évaluation
- 04 UsipaDocument18 pages04 UsipakanikaPas encore d'évaluation
- Programme de Cours CM2 PDFDocument6 pagesProgramme de Cours CM2 PDFKone AhmedPas encore d'évaluation
- Le Code de L Environnement-2022Document69 pagesLe Code de L Environnement-2022FabricePas encore d'évaluation