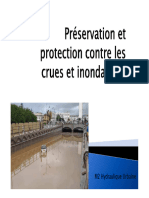Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Dossier Enquete Publique PDF
Dossier Enquete Publique PDF
Transféré par
momoth5Titre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Dossier Enquete Publique PDF
Dossier Enquete Publique PDF
Transféré par
momoth5Droits d'auteur :
Formats disponibles
PROLONGEMENT DU CONTOURNEMENT DALBERT ENTRE LA RD4929 ET LA RD938 Avril 2012 Version 2
2
Dossier Loi sur lEau | Conseil gnral de la Somme
H:\HNEW\PRODUCTION\ETUDES\L1195-80_CG80_Contournement d'Albert_Enviro\L1195_Etude\L1195_DLE\L1195_DLE_Pieces ecrites\L1195_DLE_2.doc
Informations relatives au document
Historique des modifications
Contrle final du Matre dOuvrage
Date
Nom Mme LEPRETRE / M. DURIX
Signature
Version
principale
Date Rdig par Contrle
interne/externe
Modifications
0 10-09-2011 B. COURBOT
P. GOUHIER,
chef de projet
et chef
dagence
Dossier loi sur leau
1 04-11-2011 B. COURBOT
P. GOUHIER,
chef de projet
et chef
dagence
Modification des
calculs hydrauliques
2 05-04-2012 B. COURBOT
P. GOUHIER,
chef de projet
et chef
dagence
Modifications suite
aux remarques de
la DDTM de la
Somme
PROLONGEMENT DU CONTOURNEMENT DALBERT ENTRE LA RD4929 ET LA RD938 Avril 2012 Version 2
3
Dossier Loi sur lEau | Conseil gnral de la Somme
H:\HNEW\PRODUCTION\ETUDES\L1195-80_CG80_Contournement d'Albert_Enviro\L1195_Etude\L1195_DLE\L1195_DLE_Pieces ecrites\L1195_DLE_2.doc
Sommaire
Partie 1. PREAMBULE ................................................................................................................ 5
1.1 Objet de la demande .................................................................................................... 5
1.2 Rappel du cadre juridique ............................................................................................ 5
1.3 Composition du dossier.................................................................................................. 5
Partie 2. Identification du demandeur................................................................................. 6
Partie 3. Emplacement sur lequel linstallation, louvrage et les travaux ou activits
doivent tre raliss ..................................................................................................................... 7
3.1 Situation gographique ................................................................................................. 7
3.2 Voies de communication .............................................................................................. 9
3.2.1 Rseau viaire............................................................................................................. 9
3.2.2 Trafic et dplacements ........................................................................................ 10
Partie 4. Nature, Consistance, Volume et Objet de louvrage, Rubriques de la
nomenclature ............................................................................................................................. 11
4.1 Objet du projet .............................................................................................................. 11
4.2 Cadre rglementaire ................................................................................................... 12
4.3 Reportage photographique ....................................................................................... 12
4.4 Bassins versants naturels ............................................................................................... 13
4.5 Etude hydraulique ........................................................................................................ 15
4.5.1 Hypothses ............................................................................................................. 15
4.5.2 Rtablissement des bassins versants naturels ................................................... 17
4.5.3 Assainissement de la plateforme routire ......................................................... 20
Partie 5. Notice dincidence sur leau et les milieux aquatiques .................................. 29
5.1 Analyse de ltat initial des milieux aquatiques....................................................... 29
5.1.1 Localisation gographique et topographique ................................................ 29
5.1.2 Contexte climatique............................................................................................. 29
5.1.3 Relief/Topographie ............................................................................................... 30
5.1.4 Gologie................................................................................................................. 31
5.1.5 Hydrogologie ....................................................................................................... 33
5.1.6 Eaux superficielles ................................................................................................. 35
5.1.7 Les documents de gestion .................................................................................. 38
5.1.8 Risques majeurs naturels ....................................................................................... 42
5.1.9 Milieu naturel .......................................................................................................... 44
5.1.10 Occupation du sol ................................................................................................. 47
5.1.11 Synthse des enjeux et biovaluation sommaire ............................................. 48
5.1.12 Evaluation des incidences du projet sur le site NATURA 2000 Site
chiroptres de la valle de la Bar ......................................................................................... 49
5.2 Incidences directes et indirectes, temporaires et permanentes, du projet sur la
ressource en eau, le milieu naturel et mesures compensatoires ..................................... 51
5.2.1 Impacts sur la morphologie et les conditions dcoulements ....................... 51
5.2.2 Impacts sur la qualit des eaux ........................................................................... 52
5.2.3 Impacts sur les milieux naturels ............................................................................ 57
5.2.4 Impacts temporaires ............................................................................................. 58
5.2.5 Impacts exceptionnels .......................................................................................... 59
5.2.6 Compatibilit avec les outils de gestion des eaux .......................................... 61
Partie 6. Moyens de surveillance et dintervention .......................................................... 64
6.1 Modalits de gestion des pollutions accidentelles .................................................. 65
6.2 Surveillance et entretien ............................................................................................... 65
Partie 7. Annexes .................................................................................................................... 67
Annexe 1 : comptages automatiques du 08 au 14 fvrier 2011...................................... 68
Annexe 2 : Calcul des gabarits hydrauliques des ouvrages rtablissant les eaux des
bassins versants naturels intercepts .................................................................................... 69
Annexe n3 : Calcul des dbits gnrs par la plateforme projet ................................. 71
Annexe n4 : Calculs des ouvrages de collecte ................................................................ 72
des eaux de ruissellement de la plateforme ...................................................................... 72
Annexe n5 : Calcul du bassin de stockage ....................................................................... 79
Annexe n6 : Calcul du bassin dinfiltration ........................................................................ 79
Annexe n7 : Extrait de ltude gotechnique ................................................................... 80
PROLONGEMENT DU CONTOURNEMENT DALBERT ENTRE LA RD4929 ET LA RD938 Avril 2012 Version 2
4
Dossier Loi sur lEau | Conseil gnral de la Somme
H:\HNEW\PRODUCTION\ETUDES\L1195-80_CG80_Contournement d'Albert_Enviro\L1195_Etude\L1195_DLE\L1195_DLE_Pieces ecrites\L1195_DLE_2.doc
Sommaire cartographique
Carte 1 : Plan de situation .......................................................................................................... 7
Carte 2 : Infrastructures .............................................................................................................. 9
Carte 3 : Carte de bassins versants ........................................................................................ 12
Carte 4 : Sous-bassins versants naturels intercepts ............................................................ 14
Carte 5 : Identifications des surfaces de BVN interceptes ............................................... 17
Carte 6 : Relief ............................................................................................................................ 30
Carte 7 : Gologie .................................................................................................................... 31
Carte 8 : Hydrographie ............................................................................................................. 37
Carte 9 : Risques majeurs naturels .......................................................................................... 43
Carte 10 : Milieu naturel ........................................................................................................... 45
Carte 11 : Occupation du sol .................................................................................................. 47
PROLONGEMENT DU CONTOURNEMENT DALBERT ENTRE LA RD4929 ET LA RD938 Avril 2012 Version 2
5
Dossier Loi sur lEau | Conseil gnral de la Somme
H:\HNEW\PRODUCTION\ETUDES\L1195-80_CG80_Contournement d'Albert_Enviro\L1195_Etude\L1195_DLE\L1195_DLE_Pieces ecrites\L1195_DLE_2.doc
Partie 1. PREAMBULE
1.1 OBJET DE LA DEMANDE
Le prsent dossier dautorisation ralis au titre des articles L.214-1 et suivants du Code
de lEnvironnement est destin fournir des lments dapprciation des incidences
sur les milieux aquatiques et les usages associs, du contournement dAlbert entre la
RD4929 et la RD938 dans le dpartement de la Somme.
Il dfinit galement les mesures correctrices et/ou compensatoires envisages pour
limiter l'impact du projet sur les milieux aquatiques.
1.2 RAPPEL DU CADRE JURIDIQUE
Cette procdure instaure par les articles L.214-1 et suivants et les articles R.214-1 et
suivants du Code de lEnvironnement, vise tous travaux, ouvrages, installations ou
activits ds lors quils concernent directement les milieux aquatiques.
1.3 COMPOSITION DU DOSSIER
Les articles R.214-6 et R.214-32 du Code de lEnvironnement stipulent que le dossier doit
comprendre les pices suivantes :
- identification du demandeur,
- Emplacement des ouvrages,
- Rubrique(s) de la nomenclature dans laquelle les travaux doivent tre rangs,
- Les incidences de lopration sur la ressource en eau, le milieu aquatique,
lcoulement, le niveau et la qualit des eaux,
- Les moyens de surveillance et dintervention,
- Les lments graphiques utiles la comprhension du dossier.
PROLONGEMENT DU CONTOURNEMENT DALBERT ENTRE LA RD4929 ET LA RD938 Avril 2012 Version 2
6
Dossier Loi sur lEau | Conseil gnral de la Somme
H:\HNEW\PRODUCTION\ETUDES\L1195-80_CG80_Contournement d'Albert_Enviro\L1195_Etude\L1195_DLE\L1195_DLE_Pieces ecrites\L1195_DLE_2.doc
Partie 2. IDENTIFICATION DU DEMANDEUR
La prsente demande dautorisation est effectue par :
Conseil Gnral de la Somme
Direction de la Modernisation des Infrastructures
85, avenue Roger Dumoulin
PB 32615
80080 AMIENS Cedex 1
PROLONGEMENT DU CONTOURNEMENT DALBERT ENTRE LA RD4929 ET LA RD938 Avril 2012 Version 2
7
Dossier Loi sur lEau | Conseil gnral de la Somme
H:\HNEW\PRODUCTION\ETUDES\L1195-80_CG80_Contournement d'Albert_Enviro\L1195_Etude\L1195_DLE\L1195_DLE_Pieces ecrites\L1195_DLE_2.doc
Partie 3. EMPLACEMENT SUR LEQUEL LINSTALLATION,
LOUVRAGE ET LES TRAVAUX OU ACTIVITS DOIVENT TRE
RALISS
3.1 SITUATION GOGRAPHIQUE
Le projet se situe dans la Somme sur le territoire de la commune dAlbert, chef-lieu du
canton dAlbert.
Lemprise du projet de contournement dAlbert est de 56 000 m (plateforme projet,
ouvrages dassainissement).
Carte 1 : Plan de situation
PROLONGEMENT DU CONTOURNEMENT DALBERT ENTRE LA RD4929 ET LA RD938 Avril 2012 Version 2
8
Dossier Loi sur lEau | Conseil gnral de la Somme
H:\HNEW\PRODUCTION\ETUDES\L1195-80_CG80_Contournement d'Albert_Enviro\L1195_Etude\L1195_DLE\L1195_DLE_Pieces ecrites\L1195_DLE_2.doc
PROLONGEMENT DU CONTOURNEMENT DALBERT ENTRE LA RD4929 ET LA RD938 Avril 2012 Version 2
9
Dossier Loi sur lEau | Conseil gnral de la Somme
H:\HNEW\PRODUCTION\ETUDES\L1195-80_CG80_Contournement d'Albert_Enviro\L1195_Etude\L1195_DLE\L1195_DLE_Pieces ecrites\L1195_DLE_2.doc
3.2 VOIES DE COMMUNICATION
3.2.1 Rseau viaire
La ville dAlbert, est la 3
me
ville par sa population du dpartement. Elle est
actuellement traverse par la RD938 qui est connecte lautoroute A1 ct est et la
commune de Doullens ct ouest.
La commune dAlbert est un nud routier avec 8 routes dpartementales se croisant :
RD938, assurant notamment la liaison entre le Nord-Ouest du dpartement de la
Somme jusquaux changeurs autoroutiers de lautoroute A1 ; une majorit
dautomobiliste sur la RD938 est qui sont obligs de traverser la ville dAlbert pour
rejoindre lchangeur au niveau de Clery-sur-Somme ; La deuxime fonction de
cet axe est la desserte des zones industrielles situes sur Albert et en priphrie.
Hormis le trafic engendr par les zones dAlbert que sont Henry Potez et Andr
Lin, la RD938 donne un accs direct la zone de Bouzincourt. Cette zone
fonctionne essentiellement avec lindustrie arospatiale de Maulte puisquelle
accueille des entreprises sous-traitantes de la socit Airbus. Les liaisons entre la
zone de Bouzincourt et la zone de Maulte sont donc frquentes,
RD20, hauteur de Bouzincourt participe aussi cette fonction de liaison pour
les usagers qui souhaite accder lchangeur de lautoroute A1 au niveau de
Bapaume,
RD4929 assure la dviation Doullens pour les poids lourds et sert de passage dans
la ville pour la direction Lille-Valencienne-Cambrai,
RD329 : cette route permet de relier les petites communes situes au Sud-Est
dAlbert,
RD42 cette route permet de relier les petites communes situes au Sud-Ouest
dAlbert,
RD91, RD50 assurent des liaisons plus locales : Millencourt.
Carte 2 : Infrastructures
PROLONGEMENT DU CONTOURNEMENT DALBERT ENTRE LA RD4929 ET LA RD938 Avril 2012 Version 2
10
Dossier Loi sur lEau | Conseil gnral de la Somme
H:\HNEW\PRODUCTION\ETUDES\L1195-80_CG80_Contournement d'Albert_Enviro\L1195_Etude\L1195_DLE\L1195_DLE_Pieces ecrites\L1195_DLE_2.doc
3.2.2 Trafic et dplacements
Source : Etude de trafic sur la commune dAlbert ralise par Iris Conseil pour le CG80
en janvier 2011, Donnes de trafic du Conseil gnral de la Somme octobre 2008
Une campagne de comptages automatiques sest droule du 08 au lundi 14 fvrier
2011 (comptages en annexe). Elle a permis de mettre en vidence les phnomnes
suivants :
Les axes desservant la ville dAlbert par le nord prsentent des valeurs de trafics
plus levs que le reste du rseau local,
Les RD4929, RD938 et RD50 restent les axes principaux pour la charge de trafic
Poids Lourds avec respectivement 375 PL/jour, 310 PL/jour et 141 PL/jour,
Malgr linterdiction de circulation aux PL dans certaines artres dAlbert, des
charges de trafic importantes y ont t releves.
PROLONGEMENT DU CONTOURNEMENT DALBERT ENTRE LA RD4929 ET LA RD938 Avril 2012 Version 2
11
Dossier Loi sur lEau | Conseil gnral de la Somme
H:\HNEW\PRODUCTION\ETUDES\L1195-80_CG80_Contournement d'Albert_Enviro\L1195_Etude\L1195_DLE\L1195_DLE_Pieces ecrites\L1195_DLE_2.doc
Partie 4. NATURE, CONSISTANCE, VOLUME ET OBJET DE
LOUVRAGE, RUBRIQUES DE LA NOMENCLATURE
4.1 OBJET DU PROJET
Le projet du conseil gnral consiste en la cration dune voirie de contournement
louest du bourg dAlbert.
Dune longueur de 1 300 m, cette route configure en 2x1 voies reliera les RD4929 et
938. A chaque extrmit du projet ainsi quau croisement du projet avec la RD91, un
carrefour giratoire sera implant. Les voies de raccordement aux RD seront reprofiles
sur quelques dizaines de mtres.
PROLONGEMENT DU CONTOURNEMENT DALBERT ENTRE LA RD4929 ET LA RD938 Avril 2012 Version 2
12
Dossier Loi sur lEau | Conseil gnral de la Somme
H:\HNEW\PRODUCTION\ETUDES\L1195-80_CG80_Contournement d'Albert_Enviro\L1195_Etude\L1195_DLE\L1195_DLE_Pieces ecrites\L1195_DLE_2.doc
4.2 CADRE RGLEMENTAIRE
Les articles R.214-1 R.214-5 du Code de lenvironnement prsentent la nomenclature
des oprations soumises dclaration ou autorisation au titre des articles L.214 et
suivants du code de lenvironnement (codification de la loi sur leau ). Celle-ci
comprend une srie de rubriques et indique pour chacune, les paramtres et seuils
prendre en compte pour dfinir le rgime dont relve le projet.
Ainsi, daprs sa nature et ses caractristiques, le projet est concern par les rubriques
suivantes :
N de la
rubrique
Intitul de la rubrique Installations, ouvrages,
travaux et activits
concerns
Rgime
2.1.5.0
Rejet deaux pluviales dans les eaux
douces superficielles ou sur le sol ou
dans le sous-sol, la surface totale du
projet, augmente de la surface
correspondant la partie du bassin
naturel dont les coulements sont
intercepts par le projet tant
suprieure ou gale 20 ha.
Surface projet = 2,1 ha
Surface BVN intercepts =
232 ha
Surface totale = 234,1 ha
Autorisation
3.2.3.0
Plans d'eau, permanents ou non :
1 Dont la superficie est suprieure ou
gale 3 ha (A) ;
2 Dont la superficie est suprieure 0,1
ha mais infrieure 3 ha (D).
Surface bassin de stockage =
0,1 ha
Surface bassin dinfiltration =
0,33 ha
Surface totale plans deau =
0,43 ha
Dclaration
2.2.4.0
Installations ou activits l'origine d'un
effluent correspondant un apport au
milieu aquatique de plus de 1 t / jour de
sels dissous.
Apport de sels dissous = 0,48
t/jour
Sans objet
Le dossier est donc soumis la procdure dAutorisation au titre des articles L.214-1
L.214-6 du Code de l'Environnement.
4.3 REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE
Les visites de terrain ont t ralises les 19 janvier, 08 fvrier et 28 fvrier 2011.
La zone dtude se situe sur le territoire communal dAlbert, dans le dpartement de la
Somme.
La zone sur laquelle sera ralis le projet est actuellement occupe en quasi-totalit
par des parcelles agricoles.
La zone dtude prend place dans le bassin versant de lancre, affluant de la Somme.
Mthodologie de dcoupage des sous-bassins versants naturels
Dans un premier temps, les sous-bassins versants et talweg ont t dtermins de
manire thorique laide des courbes de niveau de la carte IGN.
Les visites terrain ont ensuite permis daffiner ce dcoupage et de mettre en vidence
le fonctionnement hydraulique en place dans le bassin versant naturel.
Les observations de terrain ont montr quil ny a pas vraiment de politique bien
dfinie concernant les coulements et la continuit hydraulique au sein du bassin est
aujourdhui discontinue.
Ce constat stablit sur la base des diffrents amnagements disparates recenss dans
le bassin versant naturel. Lorsquun talweg intercepte une voirie, celui-ci est soit rtablit
par le biais dune buse bton (dont les diamtres sont souvent surdimensionns), soit
infiltrs par le biais dun foss longitudinale ou dun bassin dinfiltration, soit non rtablis.
Une fois la fonction de chaque amnagement dfinit, le dcoupage des sous-bassins
versants naturels a pu tre affin (voir carte page suivante).
Description gnral du bassin versant naturel
Le bassin versant naturel majeur stale louest du projet depuis les bourgs de
Laviville, Hnencourt et Bouzincourt.
Ses points hauts sont le mont de Millencourt et le mont dAncre 122 et 121 m. Les
bourgs de Bouzincourt et Millencourt font entirement partie de ce bassin versant
naturel tout comme des tronons importants des RD91, RD938 et RD20.
Aucun cours deau permanent ou temporaire nest recens dans ce bassin versant
naturel.
Carte 3 : Carte de bassins versants
PROLONGEMENT DU CONTOURNEMENT DALBERT ENTRE LA RD4929 ET LA RD938 Avril 2012 Version 2
13
Dossier Loi sur lEau | Conseil gnral de la Somme
H:\HNEW\PRODUCTION\ETUDES\L1195-80_CG80_Contournement d'Albert_Enviro\L1195_Etude\L1195_DLE\L1195_DLE_Pieces ecrites\L1195_DLE_2.doc
4.4 BASSINS VERSANTS NATURELS
Trois bassins versants naturels sont intercepts par le projet au niveau de leur talweg
respectif.
Bassin versant naturel 1 (BVN 1)
Dune surface de 4 hectares, le BVN 1 est
situ au sud-ouest du projet. Entirement
constitu de parcelles cultives, ce bassin
versant naturel ne possde pas de talweg
marqu au niveau du projet.
Vue vers le haut du BVN 1 depuis la RD4929
Bassin versant naturel 2 (BVN 2)
Situ louest du projet, le BVN 2 stale sur
une surface de 221 hectares. Ses deux
points hauts sont le Haut de Rocourt (112
m) et le Champ Renard (107 m). Le talweg
de ce bassin versant naturel est marqu.
Lensemble des surfaces constituant le
BVN 2 sont des parcelles cultives. A noter
que le la RD91 traverse le BVN 2 dest en
ouest.
Vue vers le BVN 2 depuis le Champ Renard
PROLONGEMENT DU CONTOURNEMENT DALBERT ENTRE LA RD4929 ET LA RD938 Avril 2012 Version 2
14
Dossier Loi sur lEau | Conseil gnral de la Somme
H:\HNEW\PRODUCTION\ETUDES\L1195-80_CG80_Contournement d'Albert_Enviro\L1195_Etude\L1195_DLE\L1195_DLE_Pieces ecrites\L1195_DLE_2.doc
Bassin versant naturel 3 (BVN 3)
Vue vers le BVN 3 depuis le chemin de Warloy
Carte 4 : Sous-bassins versants naturels intercepts
Le BVN 3 stale au nord-ouest du
projet. Dune surface de 7
hectares, ce bassin versant naturel
ne reprsente quune petite partie
du bassin versant naturel dont il fait
partie. Ceci sexplique par le fait
que le principal fond de talweg du
bassin versant est intercept juste
en amont du projet par un foss
dinfiltration (voir carte des bassins
versants naturels).
Les eaux de ruissellement du BVN 3
interceptent directement le projet
sans tre au pralable
concentres dans un talweg
marqu.
Entirement constitu de parcelles
cultives, le BVN 3 est dlimit au
nord par le chemin de Warloy.
PROLONGEMENT DU CONTOURNEMENT DALBERT ENTRE LA RD4929 ET LA RD938 Avril 2012 Version 2
15
Dossier Loi sur lEau | Conseil gnral de la Somme
H:\HNEW\PRODUCTION\ETUDES\L1195-80_CG80_Contournement d'Albert_Enviro\L1195_Etude\L1195_DLE\L1195_DLE_Pieces ecrites\L1195_DLE_2.doc
4.5 ETUDE HYDRAULIQUE
Cette tude a t tablie en s'appuyant notamment :
Sur des visites dtailles du terrain et des ouvrages existants,
Sur les dispositions prvues par le Guide Technique pour lAssainissement Routier (GTAR Stra
2006),
Sur les dispositions prvues par le Guide Technique Pollution dOrigine Routire (GTPOR Stra
2007),
Sur les dispositions prvues par le Guide technique des bassins de retenue d'eaux pluviales (STU
Service Technique de l'Urbanisme).
4.5.1 Hypothses
Dans le cadre de ltude hydraulique, le Conseil Gnral a souhait que 2 hypothses
soient tudies en terme de gestion des eaux pluviales.
4.5.1.1 Hypothses n1
Les eaux de ruissellement de la plateforme projet seront spares des eaux de
ruissellement issues des surfaces de BVN intercepts par le projet.
Les cunettes longitudinales rcupreront :
- les eaux de la plateforme projet (chausses, accotements, talus et cunettes),
- les eaux des branches de raccordement (chausses, accotements et talus),
- les eaux des giratoires (chausses, trottoirs, talus et cunettes).
4.5.1.2 Hypothses n2
On considre dans cette solution que les eaux de ruissellement des surfaces de BVN
directement intercepts par le projet sont collectes dans le mme rseau que les
eaux issues de la plateforme projet.
Ceci implique que :
- Les surfaces de BVN rtablis sont moindres (ventuellement les ouvrages de
rtablissements OH1, 2, 3 sont de plus petit diamtre),
- Les cunettes prvues pour rcuprer les eaux de la plateforme sont susceptibles
dtre amnages afin de sassurer quelles seront capables de prendre en
charge le surplus deaux de ruissellement. Le gabarit des bassins dinfiltration
prvus pour la gestion des eaux de ruissellement de la plateforme projet risque
galement dtre augment.
Les cunettes longitudinales rcupreront alors :
- Les eaux de la plateforme projet (chausses, accotements, talus et cunettes),
- Les eaux des branches de raccordement (chausses, accotements et talus),
- Les eaux des giratoires (chausses, trottoirs, talus et cunettes),
- Les eaux de ruissellement des surfaces de BVN directement intercepts.
Le tableau de la page suivante prsente les avantages/inconvnients de chaque
hypothse.
PROLONGEMENT DU CONTOURNEMENT DALBERT ENTRE LA RD4929 ET LA RD938 Avril 2012 Version 2
16
Dossier Loi sur lEau | Conseil gnral de la Somme
H:\HNEW\PRODUCTION\ETUDES\L1195-80_CG80_Contournement d'Albert_Enviro\L1195_Etude\L1195_DLE\L1195_DLE_Pieces ecrites\L1195_DLE_2.doc
Hypothse n1 Hypothse n2
BVN 1
Recueil des eaux
pluviales
Fosss enherbs
Long. = 250 m - Larg. = 1 m
Haut. = 0,5 m
Cot = 2 100
/
Franchissement de la
plateforme
Buse 400
Fosse de diffusion
Cot = 3 000
/
BVN 2
Recueil des eaux
pluviales
Assur par le profil spcifique du
chemin agricole
/
Franchissement de la
plateforme
Cadre
Larg. = 1 m
Haut. = 0,5 m
Cot = 32 000
Cadre
Larg. = 1 m
Haut. = 0,5 m
Cot = 32 000
BVN 3
Recueil des eaux
pluviales
Assur par le profil spcifique du
chemin agricole
/
Franchissement de la
plateforme
Buse : 400
Cot = 7 500
Buse : 400
Cot = 7 500
BVR
Recueil des eaux
pluviales de la
plateforme projet
Du PT461 au PT300 ct ouest
et du PT461 au pT424 ct est :
Cunette enherbe
Du PT461 au PT300 ct ouest
Cunette enherbe
Larg. = 1,5 m - Haut. = 0,4 m
Hypothse n1 Hypothse n2
Larg. = 1,4 m - Haut. = 0,3 m
Du PT424 au PT300 ct est :
Cunette enherbe
Larg. = 1,5 m - Haut. = 0,35 m
Cot = 8 400
Du PT461 au PT300 ct est :
Cunette enherbe
Larg. = 1,5 m - Haut. = 0,35 m
Cot = 10 000
Transfert des eaux
pluviales
Buse 400
Cot = 25 000
Buse 400
Cot = 25 000
Stockage et
infiltration des eaux
pluviales
Bassin de stockage
V = 907 m
3
Bassin dinfiltration
V = 2 035 m
3
Cot = 47 000
Bassin de stockage
V =1 350 m
3
Bassin dinfiltration
V = 2 258 m
3
Cot = 58 000
Avanta
ges et
inconv
nients
Un foss enherb est crer pour rcuprer les eaux de ruissellement du BVN 1 pour
lhypothse n1.
Les ouvrages hydrauliques (buse, cadre) franchissant la plateforme projet sont plus grands
et plus nombreux pour lhypothse n1.
Une partie du linaire de cunettes enherbes longitudinales est de moindre dimension pour
lhypothse n1.
Le volume des bassins de stockage et dinfiltration est moindre pour lhypothse n1.
Lhypothse n1 est moins couteuse que lhypothse n2 (- 7 500 )
PROLONGEMENT DU CONTOURNEMENT DALBERT ENTRE LA RD4929 ET LA RD938 Avril 2012 Version 2
17
Dossier Loi sur lEau | Conseil gnral de la Somme
H:\HNEW\PRODUCTION\ETUDES\L1195-80_CG80_Contournement d'Albert_Enviro\L1195_Etude\L1195_DLE\L1195_DLE_Pieces ecrites\L1195_DLE_2.doc
Aprs comparaison des 2 hypothses, le choix du CG80 sest port sur lhypothse n1.
Cette hypothse est la solution la plus adapte une gestion raisonne des eaux
pluviales.
La sparation des eaux de ruissellement des BVN et des eaux de ruissellement issues de
la plateforme projet, permet de maintenir le rseau de talwegs existants impactant au
minimum les coulements naturels existants.
Ce principe permet galement doptimiser la taille des bassins de dcantation et
dinfiltration (et par consquent les terrassements) en traitant uniquement les eaux
pollues (pollution accidentelle et chronique) de la plateforme routire.
4.5.2 Rtablissement des bassins versants naturels
4.5.2.1 Amnagements proposs
Le parti retenu vise rtablir lensemble des eaux de ruissellement des BVN 1, 2 et 3
sous le projet de contournement. Les coulements issus des BVN seront rcolts le long
du chemin agricole implant en parallle du projet ct ouest.
Les surfaces de BVN dont les coulements sont directement intercepts par le projet
ont t identifies et sont prsentes sur la carte de la page suivante. Ces donnes
surfaciques vont permettre de calculer le profil du chemin agricole ncessaire pour
acheminer les eaux de ruissellement aux ouvrages hydrauliques implants aux points
bas des BVN.
Ces ouvrages hydrauliques dnomms OH 1, 2 et 3 seront de type buse et cadre. Ils
permettront aux eaux de ruissellement des BVN de franchir la plateforme projet.
En aval, les eaux de ruissellement des BVN 2 et 3 se diffuseront dans les terrains
agricoles ou chemineront dans le talweg naturel. Les eaux issues du BVN 1 seront
infiltres dans une fosse de diffusion implante au pied de la plateforme projet.
Dans le cadre du projet, les coulements naturels seront rtablis pour la pluie de
frquence centennale conformment ce qui prcise le Guide Technique
Assainissement Routier du Stra (octobre 2006).
Carte 5 : Identifications des surfaces de BVN interceptes
PROLONGEMENT DU CONTOURNEMENT DALBERT ENTRE LA RD4929 ET LA RD938 Avril 2012 Version 2
18
Dossier Loi sur lEau | Conseil gnral de la Somme
H:\HNEW\PRODUCTION\ETUDES\L1195-80_CG80_Contournement d'Albert_Enviro\L1195_Etude\L1195_DLE\L1195_DLE_Pieces ecrites\L1195_DLE_2.doc
4.5.2.2 Dimensionnements
Les dbits de ruissellement retenus pour le dimensionnement des ouvrages de collecte
et de rtention des talwegs intercepts sont dtermins pour une pluie de priode de
retour centennale (Q100).
Les mthodes de calcul des dbits dapport des bassins versants sont multiples et
fonction de la surface des bassins versants :
Bassins versants Surface Mthode
Petit bassin 1 km2 > S Rationnelle
Bassin moyen 1 km2 < S < 10 km2 Mixte
Bassin de grande superficie S > 10 km2 CRUPEDIX
Mthode dite rationnelle
La mthode utilise pour le calcul des dbits des sous bassins versants dont les surfaces
tant infrieures 1 km est la mthode dite rationnelle.
La formule est la suivante :
Q10 = 2,78 x C x i x A
Q100 = 2x Q10
avec Q : Le dbit en litre/seconde,
C : Le coefficient de ruissellement,
I : Lintensit de la pluie dcennale en millimtre/heure,
A : La surface des bassins versants en hectare.
Q10 correspond une pluie de frquence dcennale et Q100 une pluie de frquence
centennale.
Lintensit i est obtenue par la formule de Montana : i = a . t(-b)
a et b sont des coefficients rgionaux qui varient selon la dure de laverse.
La pluviomtrie qui sera retenue dans le cadre de cette tude est celle de la station
pluviomtrique dAbbeville sur une priode de 1993 2003.
Coefficient de
Montana
Pour une occurrence
dcennale
a b
6min 30min 252 0,469
30 min 360
min
687 0,792
Le temps de concentration est :
t = L/ (60 x V)
avec L : Le plus long parcours de leau en mtre,
V : La vitesse moyenne dcoulement en mtre/seconde. Il sagit des donnes fournies
dans le Guide de lassainissement en fonction du type de terrain.
PROLONGEMENT DU CONTOURNEMENT DALBERT ENTRE LA RD4929 ET LA RD938 Avril 2012 Version 2
19
Dossier Loi sur lEau | Conseil gnral de la Somme
H:\HNEW\PRODUCTION\ETUDES\L1195-80_CG80_Contournement d'Albert_Enviro\L1195_Etude\L1195_DLE\L1195_DLE_Pieces ecrites\L1195_DLE_2.doc
Mthode dite Crupdix
Q10 = (P/80) x R x S 0,8
avec : P : la pluie journalire de frquence dcennale (gal 50 mm)
R : le coefficient rgional (gal 1 dans la rgion)
S : la surface du bassin versant.
Mthode mixte
Q10 = Q10R + Q10C
avec : Q10R : le dbit dcennal obtenu avec la mthode rationnelle
Q10C : le dbit dcennal obtenu avec la mthode Crupdix
et sont des coefficients variant linairement avec la surface du bassin versant tel
que : + = 1 et avec = 1 pour S =1 Km et = 0 pour S =10 Km.
Les rsultats suivants prsentent le dbit gnr par le ruissellement des eaux de pluie
sur les bassins versants naturels.
Les ouvrages sont calculs partir de la mthode de Manning Strickler qui permet
notamment de dfinir le dbit capable de louvrage.
Ce dernier doit donc tre suprieur au dbit de projet pour permettre le
rtablissement de ce dernier.
Le tableau prsent en page suivante rcapitule les gabarits hydrauliques des
ouvrages qui pourront tre mis en place dans le cadre du projet.
Les feuilles de calculs sont prsentes en annexe.
PROLONGEMENT DU CONTOURNEMENT DALBERT ENTRE LA RD4929 ET LA RD938 Avril 2012 Version 2
20
Dossier Loi sur lEau | Conseil gnral de la Somme
H:\HNEW\PRODUCTION\ETUDES\L1195-80_CG80_Contournement d'Albert_Enviro\L1195_Etude\L1195_DLE\L1195_DLE_Pieces ecrites\L1195_DLE_2.doc
CARACTRIS
TIQUES DU
BVN A
GERER
Ouvrage
crer
Caractristiques
(Gabarit
hydraulique
minimum)
pente
haute
ur de
rempl
issage
Vitesse Observations
BVN Q 100
en m/s
En m Pour Q100
en m/s
1
0,28
Foss
enherb
(F 1)
Long. = 250 m
Larg. = 1 m
Haut. = 0,5 m
5 % 0,29 1,63
Le foss mnera les eaux pluviales
depuis la limite nord de BVN (entre
les BVN 1 et 2) jusqu louvrage
hydraulique (OH 1).
0,28
Buse
(OH 1)
400 5 % 0,22 4,16
LOH 1 rtablira lensemble des eaux
de ruissellement du BVN 1 sous la
plateforme projet.
2
0,13
Profilag
e du
chemin
agricole
Long. = 150 m
Larg. = 4,5 m
Haut. = 0,15 m
6 % 0,14 0,40
La cunette cre par le profil
particulier du chemin agricole mnera
les eaux pluviales depuis la limite sud
de BVN (entre les BVN 1 et 2) jusqu
louvrage hydraulique (OH 2).
2,38
Buse
(OH 2)
Cadre
Larg. = 1 m
Haut. = 0,5 m
2 % 0,62 4,74
LOH 2 rtablira lensemble des eaux
de ruissellement du BVN 2 sous la
plateforme projet.
3
0,23
Profilag
e du
chemin
agricole
Long. = 360 m
Larg. = 4,5 m
Haut. = 0,20 m
3 % 0,20 0,46
La cunette cre par le profil
particulier du chemin agricole mnera
les eaux pluviales depuis la limite sud
de BVN (entre les BVN 2 et 3) jusqu
louvrage hydraulique (OH 3).
0,45
Buse
(OH 3)
400 4 % 0,37 3,68
LOH 3 rtablira lensemble des eaux
de ruissellement du BVN 3 sous la
plateforme projet.
4.5.3 Assainissement de la plateforme routire
La lecture du profil en long du projet de contournement laisse apparatre quun seul
bassin versant routier sera cr. En effet, toutes les eaux de ruissellement de la
plateforme projet descendront depuis le giratoire avec la RD938 en direction du
giratoire avec la RD4929 (nord/sud).
Lensemble des eaux de la plateforme seront achemines vers un bassin de stockage
et un bassin dinfiltration implants au droit des PT300 313.
Ces principes dassainissement (bassin de stockage + bassin dinfiltration) sont
identiques ceux de la portion existante du contournement dAlbert.
Suivant les recommandations du CG80, les ouvrages seront dimensionns afin de
prendre en charge une pluie doccurrence dcennale.
Les profils en travers type prsents ci-dessous localisent les dispositifs de rcuprations
des eaux pluviales de la chausse suivant que le projet se situe en remblai (4 pour 1)
ou en dblai (3 pour 1). Le profil en long joint au dossier permet de situer les tronons
en remblai et les tronons en dblai.
Les dblais maximum nexcdent pas 2,58 m de hauteur (PT404).
Le choix dune faible pente pour les talus en dblai (3 pour 1) ainsi que
lensemencement des talus par des plantes mellifres permet de minimiser les
phnomnes drosion qui pourraient sy produire.
La rutilisation des terres sera conditionne par leurs caractristiques mcaniques
dcrites dans ltude gotechnique du CETE de 2009 ainsi que par de nouvelles
analyses prvues immdiatement avant les travaux de terrassement. Ces mesures de
prcaution permettent dviter au maximum lapparition de phnomnes drosion
et de ruissellement.
PROLONGEMENT DU CONTOURNEMENT DALBERT ENTRE LA RD4929 ET LA RD938 Avril 2012 Version 2
21
Dossier Loi sur lEau | Conseil gnral de la Somme
H:\HNEW\PRODUCTION\ETUDES\L1195-80_CG80_Contournement d'Albert_Enviro\L1195_Etude\L1195_DLE\L1195_DLE_Pieces ecrites\L1195_DLE_2.doc
PROLONGEMENT DU CONTOURNEMENT DALBERT ENTRE LA RD4929 ET LA RD938 Avril 2012 Version 2
22
Dossier Loi sur lEau | Conseil gnral de la Somme
H:\HNEW\PRODUCTION\ETUDES\L1195-80_CG80_Contournement d'Albert_Enviro\L1195_Etude\L1195_DLE\L1195_DLE_Pieces ecrites\L1195_DLE_2.doc
PROLONGEMENT DU CONTOURNEMENT DALBERT ENTRE LA RD4929 ET LA RD938 Avril 2012 Version 2
23
Dossier Loi sur lEau | Conseil gnral de la Somme
H:\HNEW\PRODUCTION\ETUDES\L1195-80_CG80_Contournement d'Albert_Enviro\L1195_Etude\L1195_DLE\L1195_DLE_Pieces ecrites\L1195_DLE_2.doc
4.5.3.1 Calculs du dbit de la plateforme
Mthodologie
Le dbit maximum de ruissellement pour une averse de frquence donne est obtenu
par la formule rationnelle :
Q10 = 2,78 x C x i x A
avec Q : Le dbit en litre/seconde,
C : Le coefficient de ruissellement,
i : Lintensit de la pluie dcennale en millimtre/heure,
A : La surface des bassins versants en hectare.
Lintensit i est obtenue par la formule de Montana : i = a x t(-b)
a et b sont des coefficients rgionaux qui varient selon la dure de laverse.
La pluviomtrie qui sera retenue dans le cadre de cette tude est celle de la station
pluviomtrique dAbbeville sur une priode de 1993 2003.
Coefficient de
Montana
Pour une occurrence dcennale
a b
6min 30min 252 0,469
30 min 360 min 687 0,792
Le temps de concentration est :
V x 60
L
t =
avec L : Le plus long parcours de leau en mtre,
V : La vitesse moyenne dcoulement en mtre/seconde
- lintensit de la pluie est : i = a x t-b
- le temps de concentration est : t = L / 60 x V
Le coefficient dapport moyen est obtenu par la relation suivante :
S1 x C1 + S2 x C2
C =
S1 + S2
avec C1, le coefficient de ruissellement en fonction de la nature du sol.
Soit C1 = 0,2 (espaces verts : talus, cunette)
Et C2 = 1 (surfaces impermabilises : voiries, trottoirs, accotement stabilis)
La couche de roulement de la voirie projete est de type BBM (Bton Bitumineux
Mince), la structure de la voirie est impermable.
PROLONGEMENT DU CONTOURNEMENT DALBERT ENTRE LA RD4929 ET LA RD938 Avril 2012 Version 2
24
Dossier Loi sur lEau | Conseil gnral de la Somme
H:\HNEW\PRODUCTION\ETUDES\L1195-80_CG80_Contournement d'Albert_Enviro\L1195_Etude\L1195_DLE\L1195_DLE_Pieces ecrites\L1195_DLE_2.doc
Rsultats
Les caractristiques du bassin versant routier ainsi que les dbits gnrs par le
ruissellement sur la chausse sont les suivants :
Surface de la
plate-forme
en m
Surface
active (Sa)
en m2
Q de la
plateforme
en l/s
BVR 32 809 22 980 113
Les calculs sont dtaills en annexe.
4.5.3.2 Dimensionnement des ouvrages de collecte
Mthodologie
La mthode de calcul est une mthode empirique dite du temps dquilibre ou
mthode rationnelle.
Le temps dquilibre est le temps ncessaire pour obtenir la sortie du rseau un dbit
constant partir dun dbit dentre constant (la pluie).
La mthode se dcompose en quatre tapes :
Dtermination de lintensit de la pluie en fonction de la dure de celle-ci (cette
dure correspond au temps dquilibre au point de calcul et varie donc le long
de la rivire),
Dtermination du dbit vacuer en un point du rseau, en tenant compte du
temps dquilibre ce point (ajustement couple vitesse dbit capable),
Dtermination du dbit maximum admissible (dbit capable) par louvrage ce
mme point.
Le dbit capable est le dbit maximum admissible par un ouvrage lorsquil est rempli
pleine section.
Il est calcul partir de la formule de MANNING-STRICKLER :
Q = K x R 2/3 x S x p
avec : Q = Dbit en m3 / s
K = Coefficient de rugosit donn dans les tableaux ou par le fabriquant des
ouvrages.
S = Section mouille, cest--dire la section contenant leau vacuer.
R = Rayon hydraulique en m.
Cest le rapport S/P entre la section mouille et le primtre mouill.
p = La pente de louvrage exprime en valeur dcimale (mtre par mtre)
Par exemple : 0.005 = 0,5%
Pour les ouvrages qui sont proposs, le seul paramtre qui fait varier la capacit des
ouvrages est la pente. Les simulations sur le dbit capable des ouvrages seront
effectues avec la pente la plus faible du profil en long.
PROLONGEMENT DU CONTOURNEMENT DALBERT ENTRE LA RD4929 ET LA RD938 Avril 2012 Version 2
25
Dossier Loi sur lEau | Conseil gnral de la Somme
H:\HNEW\PRODUCTION\ETUDES\L1195-80_CG80_Contournement d'Albert_Enviro\L1195_Etude\L1195_DLE\L1195_DLE_Pieces ecrites\L1195_DLE_2.doc
Le tableau ci-aprs prsente les ouvrages ncessaires la collecte des eaux et leur
localisation.
Rsultats
Localisation
Ouvrage de
collecte
BVR
Du PT461 au PT300
ct ouest
Et du PT461 au
PT424
Cunette enherbe
1,4 m x 0,3 m
-
canalisation 400
Du PT424 au PT300
Ct est
Cunette enherbe
1,5 m x 0,35 m
-
canalisation 400
Remarques :
Les dbits de ruissellement gnrs par la plateforme peuvent tre pris en
charge par des canalisations 300. Le choix sest port sur des canalisations
400 pour assurer un confort dentretien en phase dexploitation.
Les eaux de ruissellement des talus des giratoires de raccordement ct RD938
et 4929 sinfiltreront naturellement dans les cunettes de pied de talus. Ces eaux
ne seront pas rediriges vers les bassins de stockage et dinfiltration afin
doptimiser le dimensionnement des ouvrages de collecte et dinfiltration.
Ces eaux de ruissellement ne seront pas en contact avec celles des giratoires
(rcoltes par des bordures et diriges vers les bassins de stockage et
dinfiltration) empchant ainsi toute pollution chronique ou accidentelle.
4.5.3.3 Dimensionnement du bassin de stockage
Principes
Les eaux de la plateforme seront intgralement tamponnes par le bassin de
stockage. Ce bassin permettra de rguler larrive des eaux au bassin dinfiltration ainsi
que de traiter une partie des pollutions par dcantation.
Le dimensionnement de ce bassin est effectu pour une pluie de rfrence 10 ans.
Mthodologie
La mthodologie utilise est celle dite des pluies. Cette mthode est base sur
lutilisation des courbes intensit-dure .
La courbe des volumes entrants est construite partir de la loi pluviomtrique de la
station dAbbeville.
Le dbit de fuite tant constant, le problme se prsente graphiquement comme suit :
2 l/s/ha
PROLONGEMENT DU CONTOURNEMENT DALBERT ENTRE LA RD4929 ET LA RD938 Avril 2012 Version 2
26
Dossier Loi sur lEau | Conseil gnral de la Somme
H:\HNEW\PRODUCTION\ETUDES\L1195-80_CG80_Contournement d'Albert_Enviro\L1195_Etude\L1195_DLE\L1195_DLE_Pieces ecrites\L1195_DLE_2.doc
La diffrence dordonne maximum Dn obtenue au temps t reprsente le volume
donner au bassin pour la pluie critique. Des pluies plus longues ou plus courtes
conduiraient des volumes infrieurs.
Les paramtres suivants sont utiliss :
- La surface active draine par le bassin de retenue. Cette surface est
pondre par un coefficient dapport (Ca) ou de ruissellement qui
caractrise le rendement global de la pluie,
- Le dbit de fuite du bassin de retenue.
Rsultats
Surface de la
plateforme
en m
Surface active
(Sa)
en m2
Volume utile
en m
3
32 809 22 980 759
La mise en place dun orifice en calibr en sortie de ce bassin de stockage et de
dcantation permettra de rguler les eaux dcantes en direction du bassin
dinfiltration.
Le temps moyen de vidange du bassin de rtention sera de 32 heures.
4.5.3.4 Dimensionnement du bassin dinfiltration
Principes
Les eaux rgules et dcantes seront ensuite achemines dans un bassin dinfiltration
implant au droit du projet.
Le dimensionnement de cet ouvrage dinfiltration est effectu pour une pluie de
rfrence 10 ans.
Mthodologie
Dtermination du dbit dabsorption du sol
Il sagit de dterminer en premier la capacit des ouvrages vacuer les eaux
pluviales.
En matire dhydraulique des sols, les mthodes simples de calcul sont bases
essentiellement sur la loi de DARCY :
Qf = p x Si
avec : Qf = Dbit en l/s
Si = Surface dinfiltration en m
p = Coefficient de permabilit en m/s
1,0 x 10-5 m/s pour le BVR 1 et 4,1 x 10-7 m/s pour le BVR 2
On obtient donc les dbits dabsorption suivants :
Surface dinfiltration (Si)
en m
Coefficient de
permabilit (p)
en m/s
Dbit de fuite
(Qf)
en l/s
2 000 4,1 x 10-7 0,82
PROLONGEMENT DU CONTOURNEMENT DALBERT ENTRE LA RD4929 ET LA RD938 Avril 2012 Version 2
27
Dossier Loi sur lEau | Conseil gnral de la Somme
H:\HNEW\PRODUCTION\ETUDES\L1195-80_CG80_Contournement d'Albert_Enviro\L1195_Etude\L1195_DLE\L1195_DLE_Pieces ecrites\L1195_DLE_2.doc
Calcul du dbit spcifique
Le calcul des dbits spcifiques Qs permettra dinterprter les hauteurs spcifiques de
stockage (Ha) dans le graphique des hauteurs de pluie.
Qs = 360/(Sa/10000) x Qf
avec : Qs = Dbit spcifique en mm/h
Sa = Surface active en m
Qf = Dbit de fuite ou dbit dabsorption en m3/s
Le dbit spcifique de louvrage est prsent ci-dessous :
Surface active
en m (Sa)
Dbit
dabsorption
en m/s (Qf)
Dbit
spcifique
en mm/h (Qf)
22 980 0,82 x 10-3 0,13
Un extrait de ltude gotechnique prsentant les coefficients de permabilit
mesurs sur le site est disponible en annexe.
Lecture de la hauteur spcifique de stockage
La mthodologie utilise est celle dite des pluies. Cette mthode est base sur
lutilisation des courbes intensit-dure .
La courbe des volumes entrants est construite partir de la loi pluviomtrique de la
station dAbbeville, la plus proche du site.
A partir du dbit de fuite constant, on repre sur le graphique les hauteurs de pluie
selon la priode retour donnes (10 ans). Ceci permet de connatre la hauteur
spcifique de stockage. Elle est de 87,00 mm pour le bassin dinfiltration.
Calcul du volume utile
Il sagit maintenant de dfinir le volume minimum ncessaire du bassin dinfiltration.
V = Ha x Sa / 1000
avec : V = Dbit spcifique en mm/h
Ha = Hauteur spcifique de stockage
Sa = Surface active en m
Surface active
(Sa)
en m
Hauteur
spcifique de
stockage (Ha)
en mm
Volume utile
du bassin (V)
en m
3
22 980 87,00 1 999
PROLONGEMENT DU CONTOURNEMENT DALBERT ENTRE LA RD4929 ET LA RD938 Avril 2012 Version 2
28
Dossier Loi sur lEau | Conseil gnral de la Somme
H:\HNEW\PRODUCTION\ETUDES\L1195-80_CG80_Contournement d'Albert_Enviro\L1195_Etude\L1195_DLE\L1195_DLE_Pieces ecrites\L1195_DLE_2.doc
Le projet sera donc dot dun bassin dinfiltration dune capacit de 1 999 m
3
. Celui-ci
sera implant au niveau du PT301 lest du projet afin dviter quil soit submerg lors
dune pluie doccurrence suprieure celle prvue au dimensionnement des
ouvrages de rtablissement des bassins versants naturels.
Ce bassin restera en partie en eau 10 jours (temps de vidange) en raison de la faible
permabilit du sol. Ce parti damnagement transformera le bassin en mare avec
plantations de diverses essences adaptes au milieu aquatique (voir traitement
paysager ci-dessous).
Afin de prendre en charge une ventuelle succession de pluies doccurrence
dcennale, le volume du bassin a t lgrement surdimensionn (20%).
Un traitement paysager particulier sera mis en uvre au niveau du bassin dinfiltration.
Les pentes des talus seront faibles (3 pour 1) et des plantes aquatiques de fond de
bassin et de berges de type Typha latifolia, Iris pseudacorus occuperont lespace.
Lillustration ci-contre montre lamnagement paysager particulier prvu au niveau
des bassins de gestion des eaux pluviales.
Un plan de principes dassainissement ainsi que le profil en long du projet de
contournement sont joints au dossier.
PROLONGEMENT DU CONTOURNEMENT DALBERT ENTRE LA RD4929 ET LA RD938 Avril 2012 Version 2
29
Dossier Loi sur lEau | Conseil gnral de la Somme
H:\HNEW\PRODUCTION\ETUDES\L1195-80_CG80_Contournement d'Albert_Enviro\L1195_Etude\L1195_DLE\L1195_DLE_Pieces ecrites\L1195_DLE_2.doc
Partie 5. NOTICE DINCIDENCE SUR LEAU ET LES MILIEUX
AQUATIQUES
5.1 ANALYSE DE LTAT INITIAL DES MILIEUX AQUATIQUES
5.1.1 Localisation gographique et topographique
Le projet sinscrit au niveau de parcelles agricoles, et stend sur le linaire compris
entre la RD4929 et le RD938, soit lquivalent de 1,5 km en amnagement sur place. Le
projet comprend galement la cration de trois giratoires et lamnagement de zones
servant au stockage des rcoltes de betteraves.
5.1.2 Contexte climatique
Source : Mto France
Le secteur dtude appartient une rgion soumise un climat ocanique, humide et
tempr.
5.1.2.1 Tempratures
Le climat du dpartement de la Somme est de type tempr ocanique avec des
hivers assez doux, et des ts ne pas trop chauds.
Au centre du dpartement, le plateau picard (rgion d'Amiens) est une rgion de
transition entre la plaine ctire au climat dominante fortement maritime avec l'Est
de la Somme au climat semi-ocanique ponctu de nuances continentales.
La Somme bnficie d'un climat humide en particulier dans sa partie Ouest au
voisinage de la mer. Vers l'Est les pluies diminuent jusqu' des valeurs voisines de
600 mm.
La temprature annuelle moyenne est de 10,9 C et la pluviomtrie annuelle moyenne
est de 662,2 mm.
Le mois le plus froid est le mois de janvier avec une temprature moyenne de 4,3 C et
un minimum absolu de -13,5 C (1996).
Le mois le plus chaud est le mois daot avec une temprature moyenne de 18,8 C et
un maximum absolu de 38,1 C (2003).
PROLONGEMENT DU CONTOURNEMENT DALBERT ENTRE LA RD4929 ET LA RD938 Avril 2012 Version 2
30
Dossier Loi sur lEau | Conseil gnral de la Somme
H:\HNEW\PRODUCTION\ETUDES\L1195-80_CG80_Contournement d'Albert_Enviro\L1195_Etude\L1195_DLE\L1195_DLE_Pieces ecrites\L1195_DLE_2.doc
5.1.2.2 Prcipitations
Les prcipitations sont rparties sur toute lanne avec un maximum pour le mois de
dcembre (74,6 mm) et un minimum pour le mois de mai (44,8 mm).
5.1.2.3 Vents
Les vents dominants sont de direction Sud/Ouest.
Figure 1 : Diagramme ombrothermique - Station d'Amiens Glisy (Source : Mto France)
La zone dtude sinscrit au sein dun territoire soumis climat ocanique, humide et
tempr.
5.1.3 Relief/Topographie
Sources : Carte ING Scan25
La commune dAlbert est traverse du Nord au Sud par la rivire de lAncre. Ainsi le
relief est peu accentu sur la commune dAlbert. Laltitude varie de 42 m vers le lieu-
dit les Carabes 121 m en priphrie dAlbert.
Le secteur se distingue par une topographie lgrement marque, montrant une
pente quasiment constante du Sud de la Zone, vers le Nord.
Carte 6 : Relief
PROLONGEMENT DU CONTOURNEMENT DALBERT ENTRE LA RD4929 ET LA RD938 Avril 2012 Version 2
31
Dossier Loi sur lEau | Conseil gnral de la Somme
H:\HNEW\PRODUCTION\ETUDES\L1195-80_CG80_Contournement d'Albert_Enviro\L1195_Etude\L1195_DLE\L1195_DLE_Pieces ecrites\L1195_DLE_2.doc
5.1.4 Gologie
Source : BRGM, InfoTerre, SDAGE Artois-Picardie, Direction Rgionale de
lEnvironnement et de lAmnagement et du logement de Picardie, Etude
gotechnique du CETE ralise en 2009
Les informations suivantes sont issues de la carte gologique n47 (Albert).
La zone dtude est localise sur le plateau Picard et se situe dans le Nord-Ouest du
Bassin Parisien. Le substratum est constitu par la craie blanche dont les assises
stendent sur Turonien terminal jusquau Campanien. Sur les plateaux, une couverture
paisse dune dizaine de mtres est constitue la base par des limons argileux silex
et au sommet par des limons loessodes des plateaux. Sur les pentes raides, la craie est
apparente ou recouverte dune couche mince de colluvions rcentes descendant
des plateaux ou par des limons de pentes.
Les principales formations gologiques rencontres sur la zone dtude sont :
5.1.4.1 Formation secondaire
Les formations secondaires sont reprsentes par
le Turonien terminal, le Coniacien, le Santonien et
le Campanien.
Le Turonien terminal est constitu d'une craie
blanche nombreux silex noirs d'une paisseur
d'au moins une quinzaine de mtres. Le
Coniacien, le Santonien et le Campanien sont
reprsents par des craies blanches, moins riches
en silex.
5.1.4.2 Les formations superficielles
Les formations superficielles sont les suivantes :
- Limons des plateaux : c'est une formation loessique de 5 10 mtres d'paisseur qui
couronne le sommet des plateaux ;
- Colluvions et limons des valles sches : ces formations sont constitues d'un
mlange de limons, de terre crayeuse et de fragments de craie qu'on trouve
principalement soit en placage sur les pentes crayeuses soit dans les fonds concaves
des valles sches.
Carte 7 : Gologie
PROLONGEMENT DU CONTOURNEMENT DALBERT ENTRE LA RD4929 ET LA RD938 Avril 2012 Version 2
32
Dossier Loi sur lEau | Conseil gnral de la Somme
H:\HNEW\PRODUCTION\ETUDES\L1195-80_CG80_Contournement d'Albert_Enviro\L1195_Etude\L1195_DLE\L1195_DLE_Pieces ecrites\L1195_DLE_2.doc
PROLONGEMENT DU CONTOURNEMENT DALBERT ENTRE LA RD4929 ET LA RD938 Avril 2012 Version 2
33
Dossier Loi sur lEau | Conseil gnral de la Somme
H:\HNEW\PRODUCTION\ETUDES\L1195-80_CG80_Contournement d'Albert_Enviro\L1195_Etude\L1195_DLE\L1195_DLE_Pieces ecrites\L1195_DLE_2.doc
La zone dtude sinscrit pour partie sur des formations colluviales, or cette formation
est susceptible de camoufler des nappes deau sous-jacentes. La campagne de
sondages de sols aux endroits prvus pour les amnagements na pas mis en vidence
de nappe aquifre.
5.1.5 Hydrogologie
5.1.5.1 Contexte hydrogologique de la zone tudie
La nappe de la craie turonienne constitue le principal rservoir d'un aquifre libre
dbit important. Elle alimente la nappe alluviale de l'Ancre situe l'Est du trac
tudi. Aucune nappe aquifre n'a t mise en vidence lors de la campagne de
sondages ralise par le CETE Nord Picardie en juin 2009.
Plusieurs nappes se rencontrent autour dAlbert : les nappes profondes du Bathonien,
du Lusitanien et de l'Albien non utilises pour l'eau potable, la nappe libre de la craie
et enfin les nappes alluviales.
La nappe de la craie, limite en profondeur par les dives turoniennes ou les craies
marneuses de mme ge, fournit les meilleurs dbits en dehors des plateaux, l o les
fissures ont t largies par dissolution, les dbits pouvant varier de 10 200 m
3
/h.
L'coulement de la nappe est de type libre filets parallles. La surface pizomtrique
pouse la morphologie en l'attnuant. La zone basse de la nappe correspond la
valle de la Somme, vers laquelle descendent les eaux du plateau du Santerre et
celles de la partie septentrionale de la feuille, les sens d'coulement tant estouest
le long de la valle de la Somme et respectivement sudnord et nordsud. Sur la
bordure du Santerre, les points hauts se tiennent vers 60-70 m, sur la bordure nord ; ils
montent au-dessus de 110 m prs de Longueval, tandis que les points bas le long de la
Somme descendent d'Est en Ouest de plus de 40 m moins de 30 m (relevs de 1962).
La nappe de la craie au niveau de lemplacement prvu pour le bassin dinfiltration
est situe plus de 20 m de profondeur (tude gotechnique du CETE). Les formations
gotechniques de limons sableux, Silts, Limons crayeux, Craie limoneuse sparent la
couche de Craie de la surface.
La vulnrabilit de la nappe au niveau du bassin dinfiltration sera trs faible.
5.1.5.2 Qualit
Dans le SDAGE Artois-Picardie, les eaux souterraines de la zone dtude correspondent
aux masses deau souterraine de la Craie de la moyenne valle de la Somme et la
craie de la valle de la Somme aval.
Zone dtude
PROLONGEMENT DU CONTOURNEMENT DALBERT ENTRE LA RD4929 ET LA RD938 Avril 2012 Version 2
34
Dossier Loi sur lEau | Conseil gnral de la Somme
H:\HNEW\PRODUCTION\ETUDES\L1195-80_CG80_Contournement d'Albert_Enviro\L1195_Etude\L1195_DLE\L1195_DLE_Pieces ecrites\L1195_DLE_2.doc
Tableau 1 : Objectifs de qualit de la masse d'eau (Source : SDAGE Artois-Picardie)
Nom de
la masse
deau
Code de
la masse
deau
Objectif de qualit
chimique
Objectif quantitatif Objectif global
Type Date Type Date Type Date
Craie de
la
moyenne
valle de
la
Somme
1012
1012 Bon tat 2027 Bon tat 2015 Bon tat 2027
Le report en 2027 pour latteinte dun bon tat chimique pour la masse deau est d
aux paramtres nitrates et pesticides.
5.1.5.3 Les zones vulnrables aux nitrates
Les zones vulnrables aux nitrates dcoulent de lapplication de la directive nitrates
qui concerne la prvention et la rduction des nitrates dorigine agricole. Cette
directive de 1991 oblige chaque tat membre dlimiter des zones vulnrables o
les eaux sont pollues ou susceptibles de ltre par les nitrates dorigine agricole. Elles
sont dfinies sur la base des rsultats de campagnes de surveillance de la teneur en
nitrates des eaux douces superficielles et souterraines. Des programmes dactions
rglementaires doivent tre appliqus dans les zones vulnrables aux nitrates et un
code de bonnes pratiques est mis en uvre hors zones vulnrables.
La commune dAlbert est classe par arrt du 20 dcembre 2002 en tant que zone
vulnrable la pollution aux nitrates dorigine agricole.
5.1.5.4 Usages
Source : Agence Rgionale de Sant du Centre, Infoterre (BRGM : Bureau de
Recherches Gologiques et Minires)
Il nexiste pas de captage deau destine la consommation humaine ou primtres
de protection concerns sur la zone de votre tude. Seule la prsence dun ancien
captage AEP (ref : 00472X0049/PC) de la ville dAlbert est rfrence mais celui-ci
nest plus en activit depuis plusieurs annes.
La zone dtude comprend de nombreux forages et puits rpartis sur lensemble de la
commune dAlbert.
Figure 2 : Puits et Forages prsents sur la commune d'Albert (Source : Infoterre)
Parmi lensemble de ces points deau, il existe 27 ouvrages exploits majoritairement
pour lusage personnel et industriel.
PROLONGEMENT DU CONTOURNEMENT DALBERT ENTRE LA RD4929 ET LA RD938 Avril 2012 Version 2
35
Dossier Loi sur lEau | Conseil gnral de la Somme
H:\HNEW\PRODUCTION\ETUDES\L1195-80_CG80_Contournement d'Albert_Enviro\L1195_Etude\L1195_DLE\L1195_DLE_Pieces ecrites\L1195_DLE_2.doc
5.1.6 Eaux superficielles
Source : Banque Hydro, Agence de leau Artois-Picardie, SAGE Somme aval et cours
deau ctiers, Plan Dpartemental pour la Protection du milieu aquatique et la
Gestion des ressources piscicoles de la Somme
5.1.6.1 Le rseau hydrographique de la zone dtude
Le rseau hydrographique est compos dun cours deau :
LAncre, traverse Albert du Nord vers le Sud ;
LAncre
Long de 38 km, cest un affluent de la Somme
en rive droite. Elle prend sa source sur la
commune de Miraumont dans le canton
d'Albert.
Elle s'coule vers le sud-ouest, dans une valle
assez large et humide, avant de se jeter dans
la Somme la sortie d'Aubigny pour son bras
principal, un peu en aval de Corbie,
l'altitude 28 mtres.
Elle passe par Albert avec une chute d'eau de
7 mtres de haut, ct du jardin public (66m
57m).
Elle est classe 1re catgorie piscicole.
Figure 3 : Profil en long de lAncre (source : PDPG de la Somme)
5.1.6.2 Lhydrologie
Il existe quune seule station de mesures sur lAncre localise sur Bonnay allant de 2001
2011.
Les rsultats de cette station sont les suivants :
PROLONGEMENT DU CONTOURNEMENT DALBERT ENTRE LA RD4929 ET LA RD938 Avril 2012 Version 2
36
Dossier Loi sur lEau | Conseil gnral de la Somme
H:\HNEW\PRODUCTION\ETUDES\L1195-80_CG80_Contournement d'Albert_Enviro\L1195_Etude\L1195_DLE\L1195_DLE_Pieces ecrites\L1195_DLE_2.doc
Tableau 2 : Moyennes interannuelles caractristiques de lAncre Bonnay estims entre 2002 et 2011
(Source : Banque Hydro)
Sep Oct Nov Dec Jan Fev Mar Avr Mai Jui Jui Aou
Moy
Total
Moy.
en m
3
/s
1.69 1.66 1.75 1.90 2.22 2.49 2.76 2.77 2.52 2.16 1.86 1.65 2.12
LAncre (PDPG80)
Surface du bassin versant en km 236
Etiage QMNA5 en m
3
/s : 1,59 m
3
/s
Q class (frquence 20 ans): 1,2 m
3
/s
Moyenne annuelle Annuel: 2,65 m
3
/s
Q class (frquence 50 ans) : 1,77 m
3
/s
Maximum connu en m
3
/s le 20 mars 2002 6,7
Ainsi, lAncre a un fonctionnement de type pluvial, caractris par des hautes eaux en
hiver et des basses eaux en t. Le dbit maximum est atteint en avril avec une
moyenne de 2,77 m
3
/s. La valeur de dbit caractristique dune crue dcennale est
de 0,75 m
3
/s.
5.1.6.3 La qualit des eaux superficielles
LAncre
Qualit physico-chimique
LAncre a fait l'objet de deux stations qualit installes sur son cours : l'une Albert et
l'autre Bonnay. Sa valle a t utilise pour la construction de la ligne ferroviaire
Amiens-Arras sur la voie ferre "ex grandes-lignes" Paris-Lille.
La qualit physico-chimique de lAncre est alterne de passable bonne notamment
pour les paramtres nitrates et pesticides.
Qualit biologique
LIndice Biologique Global Normalis ou IBGN permet dvaluer la qualit
hydrobiologique dun site aquatique, par lintermdiaire de la composition des
peuplements dinvertbrs benthiques vivant sur divers habitats (couple
support/vitesse). LIBGN est sensible aux variations de la composition physico-chimique
de leau et plus particulirement aux fluctuations de la pollution organique et
chimique, mais aussi de la nature des substrats (travaux en rivire ou recalibrage) et
des vnements climatiques (orages, crues subites). La mthode permet, dans les
conditions naturelles de stabilit hydraulique et dans les limites de sa sensibilit,
dvaluer lincidence dune perturbation sur le milieu rcepteur.
Une note indicielle, comprise entre 0 et 20, dtermine la qualit globale du milieu
aquatique.
L'Indice Biologique Diatomes ou IBD a t conu pour une application l'ensemble
des cours d'eau, l'exception des zones estuariennes, condition de respecter
scrupuleusement la norme.
Dans ces conditions, l'indice permet:
D'valuer la qualit biologique d'une station,
De suivre l'volution temporelle de la qualit biologique de l'eau,
D'en suivre l'volution spatiale,
PROLONGEMENT DU CONTOURNEMENT DALBERT ENTRE LA RD4929 ET LA RD938 Avril 2012 Version 2
37
Dossier Loi sur lEau | Conseil gnral de la Somme
H:\HNEW\PRODUCTION\ETUDES\L1195-80_CG80_Contournement d'Albert_Enviro\L1195_Etude\L1195_DLE\L1195_DLE_Pieces ecrites\L1195_DLE_2.doc
D'valuer les consquences d'une perturbation sur le milieu (sensibilit la
pollution organique, saline ou eutrophisation).
La qualit biologique de lAncre est globalement passable avec quelques points de
bonne qualit.
Tableau 3 : Donnes sur la qualit biologique de lAncre entre 2004-2007 (Source : DREAL Picardie)
2007 2006 2005 2004
IBGN IBD IBGN IBD IBGN IBD IBGN IBD
Station
Bonnay
9 13,2 10 11,2 12 11,7 14 11,9
LAncre Bonnay est une station dclasse dun niveau de qualit bonne en 2004
passable en 2007 (perte de 2 units indicielles IBGN en 2005, de 2 units en 2006
et 1 unit en 2007).
11.9 11.7 11.2 13.2
La qualit passable de leau domine nettement dans les rsultats de lIBD.
Sur lAncre o sont pratiqus conjointement lIBGN et lIBD, on ne trouve pas de
corrlation entre les rsultats des deux indices, sur lensemble des donnes.
Objectifs de qualit
Les objectifs de qualit fixs pour la masse deau LAncre sont les suivants.
Tableau 4 : Objectifs de qualit (Source : SDAGE Artois-Picardie)
Masse
deau
Code de la
masse
deau
Objectif dtat
cologique
Objectif dtat
chimique
Objectif dtat
global
Objectif Date Objectif Date Objectif Date
LAncre AR04 Bon tat 2015 Bon tat 2027 Bon tat 2027
Rservoirs biologiques
Les rservoirs biologiques dfinis par le SDAGE sont ncessaires au maintien ou
latteinte du bon tat cologique des cours deau. Cest un tronon de cours deau
ou une annexe hydraulique qui va jouer le rle de ppinire, de fournisseur despces
susceptibles de coloniser une zone naturellement ou artificiellement appauvrie.
LAncre nest pas classe comme rservoir biologique dans le SDAGE Artois-Picardie.
Carte 8 : Hydrographie
PROLONGEMENT DU CONTOURNEMENT DALBERT ENTRE LA RD4929 ET LA RD938 Avril 2012 Version 2
38
Dossier Loi sur lEau | Conseil gnral de la Somme
H:\HNEW\PRODUCTION\ETUDES\L1195-80_CG80_Contournement d'Albert_Enviro\L1195_Etude\L1195_DLE\L1195_DLE_Pieces ecrites\L1195_DLE_2.doc
5.1.7 Les documents de gestion
5.1.7.1 Directive Cadre sur lEau
La directive 2000/60/CE du Parlement europen et du Conseil du 23 octobre 2000, dite
directive-cadre, tablit un cadre pour une politique communautaire dans le domaine
de leau, elle fixe quatre grands objectifs aux Etats membres :
Larrt de toute dtrioration de la ressource en eau ;
Latteinte du bon tat quantitatif des eaux superficielles, souterraines et ctires
pour 2015 ;
La rduction massive des rejets de substances dangereuses et la suppression des
rejets de substances dangereuses prioritaires ;
Le respect des objectifs rglementaires lis aux zones protges , cest--dire
soumises une rglementation communautaire.
La loi de transposition de la directive en droit franais a t promulgue le 21 avril
2004. Pour les eaux souterraines, lobjectif de bon tat lchance 2015 intgre deux
objectifs :
atteindre le bon tat quantitatif (quilibre entre prlvement et rechargement
de la nappe) ;
atteindre le bon tat chimique, relatif aux normes de qualit environnementale
en
vigueur.
Pour les eaux de surface, lobjectif de bon tat lchance 2015 intgre deux
objectifs :
atteindre un bon tat cologique, associant ltat biologique et hydro
morphologique des milieux aquatiques ;
atteindre le bon tat chimique, relatif aux normes de qualit environnementale
en vigueur.
PROLONGEMENT DU CONTOURNEMENT DALBERT ENTRE LA RD4929 ET LA RD938 Avril 2012 Version 2
39
Dossier Loi sur lEau | Conseil gnral de la Somme
H:\HNEW\PRODUCTION\ETUDES\L1195-80_CG80_Contournement d'Albert_Enviro\L1195_Etude\L1195_DLE\L1195_DLE_Pieces ecrites\L1195_DLE_2.doc
5.1.7.2 Schma Directeur dAmnagement et de Gestion des Eaux du bassin
Artois-Picardie
Approuv par arrt prfectoral du 16 octobre 2009, le Schma Directeur
dAmnagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) est un document de planification
qui fixe, pour une priode de 6 ans, les orientations fondamentales dune gestion
quilibre et durable de la ressource en eau et les objectifs de qualit et de quantit
des eaux (art. L212-1 du Code de lEnvironnement) atteindre.
Il a pour objectif de se mettre en conformit avec la Directive Cadre europenne sur
lEau (DCE) du 23 octobre 2000.
Ce document reprsente le plan de gestion des eaux du district hydrographique ;
ce titre, et en accord avec la Directive cadre sur lEau (DCE), il fixe des objectifs
environnementaux atteindre pour chaque masse deau du bassin (cours deau, plan
deau, eaux souterraines, eaux ctires et eaux de transition).
Primtre du SDAGE Artois-Picardie
Les grandes orientations du SDAGE
Les orientations fondamentales du SDAGE pour une gestion quilibre de la ressource
en eau rpondent aux 4 enjeux identifis lissue de ltat des lieux du bassin Artois-
Picardie :
Enjeu 1 : La gestion qualitative des milieux aquatiques
Enjeu 2 : La gestion quantitative des milieux aquatiques
Enjeu 3 : La gestion et la protection des milieux aquatiques
Enjeu 4 : Le traitement des pollutions historiques
Le nouveau SDAGE est organis autour de 8 dfis, permettant de rpondre aux 4
principaux enjeux noncs ci-dessus :
Diminuer les pollutions ponctuelles des milieux par les polluants classiques,
Diminuer les pollutions diffuses des milieux aquatiques,
Rduire les pollutions des milieux aquatiques par les substances dangereuses,
Rduire les pollutions microbiologiques des milieux,
Protger les captages d'eau pour l'alimentation en eau potable actuelle et
future,
Protger et restaurer les milieux aquatiques humides,
Grer la raret de la ressource en eau,
Limiter et prvenir le risque d'inondation.
Le SDAGE propose galement deux grandes orientations transversales qui contribuent
relever ces 8 dfis :
Acqurir et partager les connaissances,
Dvelopper la gouvernance et lanalyse conomique.
Zone dtude
PROLONGEMENT DU CONTOURNEMENT DALBERT ENTRE LA RD4929 ET LA RD938 Avril 2012 Version 2
40
Dossier Loi sur lEau | Conseil gnral de la Somme
H:\HNEW\PRODUCTION\ETUDES\L1195-80_CG80_Contournement d'Albert_Enviro\L1195_Etude\L1195_DLE\L1195_DLE_Pieces ecrites\L1195_DLE_2.doc
Objectifs
Lobjectif atteindre est de maintenir les masses deau en bon tat, voire en trs bon
tat, ou datteindre un bon tat. On distingue les masses deau naturelles, des masses
deau fortement modifies (MEFM) et artificielles (MEA).
Pour les masses deau naturelles, cet objectif prend en compte :
Lobjectif de bon tat chimique,
Lobjectif de bon tat cologique,
Pour les MEFM et MEA, cet objectif comprend :
Lobjectif de bon tat chimique (identique celui des masses deau naturelles) ;
Lobjectif de bon potentiel cologique.
Lobjectif pour une masse deau est, par dfinition, latteinte en 2015 du bon tat ou
du bon potentiel. Plus prcisment :
Pour les masses deau en trs bon tat, bon tat ou bon potentiel actuellement,
lobjectif est de le rester (non dgradation),
Pour les masses deau susceptibles de ne pas atteindre le bon tat ou le bon potentiel
en 2015, des reports dchance sur des objectifs moins stricts sont nanmoins
possibles.
Zone dtude
PROLONGEMENT DU CONTOURNEMENT DALBERT ENTRE LA RD4929 ET LA RD938 Avril 2012 Version 2
41
Dossier Loi sur lEau | Conseil gnral de la Somme
H:\HNEW\PRODUCTION\ETUDES\L1195-80_CG80_Contournement d'Albert_Enviro\L1195_Etude\L1195_DLE\L1195_DLE_Pieces ecrites\L1195_DLE_2.doc
5.1.7.3 Schma dAmnagement et de Gestion des Eaux
Il existe un Schma dAmnagement et de Gestion des Eaux (SAGE) en cours
dinstruction sur la zone dtude : le SAGE Somme Aval et cours deau ctiers.
Ces enjeux du territoire Somme aval et cours deau ctiers sont :
enjeux qualitatifs de la ressource dus aux diffrentes activits : industrie,
agriculture, assainissement
enjeux lis la gestion quantitative de la ressource avec les problmes de
scheresse sur certains secteurs et donc de restriction dusage,
enjeux de sant publique prsents sur le bassin avec les problmes
bactriologiques touchant lactivit conchylicole ainsi que la contamination du
milieu aquatique par les PCB,
enjeux de scurit avec les inondations de la Somme ainsi que les problmes de
ruissellement et de mouvements de terrains,
Zone dtude
Zone dtude
PROLONGEMENT DU CONTOURNEMENT DALBERT ENTRE LA RD4929 ET LA RD938 Avril 2012 Version 2
42
Dossier Loi sur lEau | Conseil gnral de la Somme
H:\HNEW\PRODUCTION\ETUDES\L1195-80_CG80_Contournement d'Albert_Enviro\L1195_Etude\L1195_DLE\L1195_DLE_Pieces ecrites\L1195_DLE_2.doc
enjeux conomiques pour les activits lies leau telles que lindustrie,
lagriculture, la pche, la chasse, le tourisme, les sports nautiques et les loisirs.
Le projet de contournement dAlbert ne devra pas aller lencontre des objectifs du
SAGE Somme aval et cours deau ctiers notamment en remettant en cause la
qualit piscicole des cours deau ou en augmentant le risque dinondation.
5.1.8 Risques majeurs naturels
Source : Site Internet de Primnet,
La commune dAlbert est soumise aux risques naturels suivants :
Inondation par remonte de nappes naturelles,
Inondation par ruissellement et coule de boue,
Inondation par une crue (dbordement de cours deau).
5.1.8.1 Inondation
Les risques dinondations se situent aux abords des cours deau : lAncre.
Actuellement, les risques d'origine hydrologique sont approchs :
soit au travers des plans de prvention des risques naturels inondation (PPRI),
soit lorsque ces derniers nont pas t labors sur un territoire communal au
travers du schma Technique de Protection contre les Crues (STPC).
Le PPRI, tabli par l'tat, dfinit des zones d'interdiction et des zones de prescription ou
constructibles sous rserve. Il peut imposer d'agir sur l'existant pour rduire la
vulnrabilit des biens. La loi rglemente l'installation d'ouvrages susceptibles de
provoquer une gne l'coulement des eaux en priode d'inondation.
Un PPRI doit tre annex dans les documents durbanisme des communes aprs
approbation, leur permettant ainsi de refuser ou d'accepter sous certaines conditions
un permis de construire dans des zones inondables.
L'objectif est double : le contrle du dveloppement en zone inondable jusqu'au
niveau de la crue de rfrence et la prservation des champs d'expansion des crues.
Le PPR peut galement prescrire ou recommander des dispositions constructives (mise
en place de systmes rduisant la pntration de l'eau, mise hors d'eau des
quipements sensibles) ou des dispositions concernant l'usage du sol (amarrage des
citernes ou stockage des flottants). Ces mesures simples, si elles sont appliques,
permettent de rduire considrablement les dommages causs par les crues.
Les communes concernes par le risque dinondation ou des PPRI sont raliss ou en
cours dlaboration sont :
Sur la zone dtude :
Le PPR I Valle de la Somme et ses affluents approuv le 01/12/04.
118 communes de la valle de la Somme et ses affluents sont concernes.
Zone dtude
PROLONGEMENT DU CONTOURNEMENT DALBERT ENTRE LA RD4929 ET LA RD938 Avril 2012 Version 2
43
Dossier Loi sur lEau | Conseil gnral de la Somme
H:\HNEW\PRODUCTION\ETUDES\L1195-80_CG80_Contournement d'Albert_Enviro\L1195_Etude\L1195_DLE\L1195_DLE_Pieces ecrites\L1195_DLE_2.doc
La zone couverte correspond aux communes qui ont t dclare en tat de
catastrophe naturelle en 2001. Les principales villes sont comprises : Pronne, Corbie,
Albert, Amiens et Abbeville.
Le projet de contournement dAlbert est situ en dehors des zones dala dfinies par
le PPRi. Le projet devra nanmoins sattacher ne pas acclrer les coulements afin
de respecter les objectifs dfinis par le SDAGE.
Carte 9 : Risques majeurs naturels
PROLONGEMENT DU CONTOURNEMENT DALBERT ENTRE LA RD4929 ET LA RD938 Avril 2012 Version 2
44
Dossier Loi sur lEau | Conseil gnral de la Somme
H:\HNEW\PRODUCTION\ETUDES\L1195-80_CG80_Contournement d'Albert_Enviro\L1195_Etude\L1195_DLE\L1195_DLE_Pieces ecrites\L1195_DLE_2.doc
5.1.9 Milieu naturel
Source : biovaluation faune flore ralise par LE CERE- dcembre 2010
5.1.9.1 Contexte naturel local et environnant
Les zones de protection cologique sont des zones prsentant un caractre
rglementaire ou non pour leurs enjeux cologiques, faunistiques ou floristiques telles
que les zones Natura 2000, les Parcs Naturels, les rserves, les espaces naturels
sensibles
Les espaces remarquables recenss dans un primtre de 10 km autour de la zone
dtude sont reprsents dans le tableau suivant :
Tableau 5 : Espaces remarquables localiss dans un rayon de 10 km autour du site dtude
PROLONGEMENT DU CONTOURNEMENT DALBERT ENTRE LA RD4929 ET LA RD938 Avril 2012 Version 2
45
Dossier Loi sur lEau | Conseil gnral de la Somme
H:\HNEW\PRODUCTION\ETUDES\L1195-80_CG80_Contournement d'Albert_Enviro\L1195_Etude\L1195_DLE\L1195_DLE_Pieces ecrites\L1195_DLE_2.doc
Carte 10 : Milieu naturel
PROLONGEMENT DU CONTOURNEMENT DALBERT ENTRE LA RD4929 ET LA RD938 Avril 2012 Version 2
46
Dossier Loi sur lEau | Conseil gnral de la Somme
H:\HNEW\PRODUCTION\ETUDES\L1195-80_CG80_Contournement d'Albert_Enviro\L1195_Etude\L1195_DLE\L1195_DLE_Pieces ecrites\L1195_DLE_2.doc
5.1.9.2 Zones Naturelles dIntrt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF)
Les ZNIEFF ou Zones d'Intrt cologique Faunistique et Floristique reprsentent le
rsultat d'un inventaire scientifique. Leur valeur en jurisprudence est atteste.
On distingue deux types de ZNIEFF :
De type II
La ZNIEFF de type II runit des milieux naturels formant un ou plusieurs ensembles*
possdant une cohsion leve et entretenant de fortes relations entre eux. Elle se
distingue de la moyenne du territoire rgional environnant par son contenu patrimonial
plus riche et son degr d'artificialisation plus faible.
Chaque ensemble constitutif de la zone est un assemblage d'units cologiques,
homognes dans leur structure ou leur fonctionnement.
Les ZNIEFF de type II sont donc des ensembles gographiques gnralement
importants, incluant souvent plusieurs ZNIEFF de type I, et qui dsignent un ensemble
naturel tendu dont les quilibres gnraux doivent tre prservs. Cette notion
d'quilibre n'exclut donc pas qu'une zone de type II fasse l'objet de certains
amnagements sous rserve du respect des cosystmes gnraux.
De type I
La ZNIEFF de type I est un territoire correspondant une ou plusieurs units cologiques
homognes*. Elle abrite au moins une espce ou un habitat caractristique
remarquable ou rare, justifiant d'une valeur patrimoniale plus leve que celle du
milieu environnant.
Par unit cologique homogne, on entend un espace possdant une combinaison
constante de caractres physiques et une structure cohrente, abritant des groupes
d'espces vgtales ou animales caractristiques (souvent protges).
Les ZNIEFF de type I sont donc des sites particuliers gnralement de taille rduite,
infrieure aux ZNIEFF de type II. Ils correspondent a priori un trs fort enjeu de
prservation voire de valorisation de milieux naturels.
La zone dtude nintercepte aucune ZNIEFF et se trouve moins de 2 km au Sud-
Ouest de :
la ZNIEFF de type I Valle de lAncre entre Beaumont Hamel et Aveluy et cours
suprieur de lAncre .
La zone dtude est incluse dans un site dintrt ponctuel pour lequel aucune fiche
descriptive nexiste pour lheure sur le site internet de la DREAL Picardie.
ZNIEFF de type I Valle de lAncre entre Beaumont Hamel et Aveluy et cours
suprieur de lAncre N220 013 968
Il sagit dun territoire qui couvre les moyennes et hautes valle de lAncre. Chacune
de ces parties prsentes des caractristiques spcifiques.
Les roselires, les prairies humides, les mares et le lit mineur de l'Ancre, entre Miraumont
et Beaumont-Hamel, sont les milieux les plus prcieux de la zone. Ils accueillent
plusieurs espces remarquables pour la Picardie. La pente leve de l'Ancre, sur ce
tronon, permet des conditions assez favorables la reproduction et au
dveloppement de la faune salmonicole. Les substrats (cailloux et pierres) offrent
quelques zones de frayres intressantes pour la Truite fario (Salmo trutta fario). Il s'agit
du seul secteur de ce cour d'eau qui puisse accueillir la fraie des salmonids.
5.1.9.3 Rseau Natura 2000
Il a pour objectif de contribuer prserver la diversit biologique sur lensemble du
territoire de lUnion europenne en assurant le maintien ou le rtablissement dans un
tat de conservation favorable des habitats naturels et des habitats despces de la
flore et de la faune sauvages dintrt communautaire et il est compos de sites
naturels dsigns spcialement par chacun des 27 pays de lUnion en application de
deux directives europennes :
la directive 79/409/CEE du 2 avril 1979 concernant la conservation des Oiseaux
sauvages ( directive Oiseaux ) qui dsigne des Zones de Protection Spciales (ZPS)
qui permet de conserver sur le long terme 181 espces et sous-espces d'oiseaux
sauvages menaces et qui ncessitent donc une attention particulire de l'Union
Europenne ;
la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des Habitats
naturels ainsi que de la Faune et de la Flore sauvages ( directive Habitats ) qui
dsigne des Zones Spciales de Conservation (ZSC) ou les Sites dIntrts
Communautaires SIC qui sont les futures ZSC. Cette directive rpertorie plus de
200 types d'habitats naturels, 200 espces animales et 500 espces vgtales
prsentant un intrt communautaire et ncessitant une protection.
Dans les 10 km au Sud de la commune dAlbert, on recense :
La ZSC Moyenne Valle de la Somme ,
La ZPS Etang et marais du bassin de la Somme .
PROLONGEMENT DU CONTOURNEMENT DALBERT ENTRE LA RD4929 ET LA RD938 Avril 2012 Version 2
47
Dossier Loi sur lEau | Conseil gnral de la Somme
H:\HNEW\PRODUCTION\ETUDES\L1195-80_CG80_Contournement d'Albert_Enviro\L1195_Etude\L1195_DLE\L1195_DLE_Pieces ecrites\L1195_DLE_2.doc
5.1.9.4 Zones humides
Les zones humides sont caractrises par leur grande diversit et leur richesse, elles
jouent un rle fondamental pour la gestion quantitative de leau, le maintien de la
qualit des eaux et la prservation de la diversit biologique.
Les zones humides ont t dfinies par la loi sur leau du 3 janvier 1992 puis par des
textes rcents (arrts du 24-06-2008 et du 01-10-2009, circulaire du 18-01-2010)
La zone dtude ne comprend pas de parcelle identifie comme dominante
humide suivant les donnes de la DREAL Picardie.
Localisation des zones dominante humide (DREAL Picardie)
5.1.10 Occupation du sol
La base de donnes Corine Land Cover (2006) permet dapprhender loccupation
du sol sur la zone dtude.
Le territoire de la zone dtude est domin par des surfaces agricoles. On distingue un
cordon de prairie au Sud et au Nord de la Commune appartenant la valle de
lAncre.
Au centre se concentrent le secteur urbain du bourg dAlbert.
Carte 11 : Occupation du sol
Zone dtude
PROLONGEMENT DU CONTOURNEMENT DALBERT ENTRE LA RD4929 ET LA RD938 Avril 2012 Version 2
48
Dossier Loi sur lEau | Conseil gnral de la Somme
H:\HNEW\PRODUCTION\ETUDES\L1195-80_CG80_Contournement d'Albert_Enviro\L1195_Etude\L1195_DLE\L1195_DLE_Pieces ecrites\L1195_DLE_2.doc
5.1.11 Synthse des enjeux et biovaluation sommaire
Les enjeux sur la zone dtude sont essentiellement lis la prsence, dans un premier
temps, des cours deau et notamment de lAncre au niveau du bourg et de sa partie
aval, celle-ci tant incluse dans le Site dIntrt Ponctuel.
5.1.11.1 Biovaluation sommaire
Compte tenu du diagnostic ralis, les types doccupation du sol sont classs par
rapport leur sensibilit au projet de dviation. Cette hirarchisation seffectue selon
diffrents critres :
les zonages rglements ;
la potentialit daccueil despces animales et vgtales dintrt patrimonial ;
la biodiversit spcifique potentielle et corridor cologique ;
la vulnrabilit par rapport au projet.
La carte de biovaluation (cf. Carte de biovaluation sommaire) tient compte de ces
critres et se base sur cinq niveaux de sensibilit :
Le tableau ci-dessous explicite les critres de biovaluation retenus :
Habitat naturel
et semi-naturel
Protection
potentielle des
espces et des
habitats
Biodiversit
spcifique
potentielle et
corridor
cologique
Vulnrabilit
Sensibilit
au projet
Tout habitat en
zone Natura
2000
oui Eleve Forte Faible
Cours deau oui Eleve Forte Moyenne
Plan deau et
mare
oui Moyenne Forte Trs faible
Boisements oui Moyenne Forte Moyenne
Prairies oui Moyenne Moyenne Moyenne
Cultures et
vergers
non Trs faible Trs faible Trs faible
Zones urbanises non Trs faible Faible Trs faible
Le projet se situe dans un contexte de plaine agricole en lisire de la ville. Les cultures
sont les habitats les plus reprsents. Le nombre de milieux total identifi est faible (7
au total) et ces derniers sont fortement influencs par les activits humaines (culture
intensive). Les cultures qui la composent sont considres comme peu sensibles face
au projet de dviation.
Lhydrographie surfacique (cours deau, mares, fosss et tangs) est value
sensibilit moyenne en raison de la prsence de talwegs secs qui concentre les
coulements.
Les boisements sont nots sensibilit moyenne ; ceux-ci peuvent accueillir des
espces protges de la faune notamment (flore et insecte remarquables ).
En dehors du primtre Natura 2000, les prairies ne sont pas susceptibles daccueillir
des espces patrimoniales ; elles sont donc values sensibilit moyenne.
Les principales contraintes vis--vis du milieu naturel retenir pour la ralisation du
contournement dAlbert concernent le boisement au sud de la RD4929.
Enfin, il conviendra de prvoir des amnagements spcifiques qui permettront de
retrouver un intrt cologique (bandes de vgtation, spontane aux abords des
parcelles cultives, plantation, le plus en amont possible, d'habitats de substitution
(haies).
PROLONGEMENT DU CONTOURNEMENT DALBERT ENTRE LA RD4929 ET LA RD938 Avril 2012 Version 2
49
Dossier Loi sur lEau | Conseil gnral de la Somme
H:\HNEW\PRODUCTION\ETUDES\L1195-80_CG80_Contournement d'Albert_Enviro\L1195_Etude\L1195_DLE\L1195_DLE_Pieces ecrites\L1195_DLE_2.doc
5.1.12 Evaluation des incidences du projet sur le site NATURA 2000
Site chiroptres de la valle de la Bar
Les sites ligibles au rseau Natura 2000 les plus proches du projet sont :
- la Zone Spciale de Conservation Moyenne Valle de la Somme qui se
trouve 8,0 km au Sud du projet,
- la Zone de Protection Spciale Etang et marais du bassin de la Somme qui
se trouve 8,5 km au Sud du projet.
Description de la ZSC Moyenne Valle de la Somme :
Source : INPN
Ce long tronon de la valle de la Somme comporte la zone des mandres d'axe
gnral Est/Ouest entre Corbie et Pronne. L'ensemble de la valle, au rle vident de
corridor fluviatile, est une entit de forte cohsion et solidarit cologique des milieux,
lie aux quilibres trophiques, hydriques, biologiques, aux flux climatiques et
migratoires.
La Somme, dans cette partie, dveloppe un exemple typique de large valle en U
faible pente.
L'expression du systme tourbeux alcalin est marqu par des affinits continentales
sensibles, croissantes d'ailleurs en remontant la valle, par un vieillissement gnralis
avec acclration de la dynamique arbustive et prforestire, par une dgradation
de la qualit des eaux circulantes de la Somme, par un envasement gnralis.
Associs au fond humide de la valle et en troite dpendance des conditions
msoclimatiques humides cres, les versants offrent par le jeu des concavits et des
convexits des mandres, un formidable et original ensemble diversifi d'boulis,
pelouses, ourlets et fourrs calcicoles d'affinits submontagnardes, opposant les
versants froids aux versants bien exposs o se mlent les caractres thermophiles et
submontagnards. Xrosre des versants et hygrosre tourbeuse donnent ce secteur
de la Somme, une configuration paysagre et coenotique de haute originalit et
troitement dpendante des conditions gomorphologiques et climatiques catnales.
Les intrts spcifiques sont nombreux et levs, surtout floristiques :
plantes suprieures avec 21 espces protges
nombreuses plantes rares et menaces
diversit du cortge des tourbires alcalines et des pelouses calcaires
diversit gntique des populations pelousaires
prsence d'une espce de la directive : Sisymbrium supinum
Bryophytes remarquables, notamment le groupe des sphaignes
Richesse en orchides
Les intrts faunistiques sont :
ornithologiques : avifaune paludicole nicheuse (rapaces, anatids, passereaux
notamment fauvettes, Blongios nain), plusieurs oiseaux menacs au niveau
national
entomologiques : plusieurs insectes menacs dont un papillon de la directive
(Lycaena dispar)
herptologiques avec d'importantes populations de Vipre pliade.
Description de la ZPS Etang et marais du bassin de la Somme :
Source : INPN
Ces portions de la valle de la Somme entre Abbeville et Pargny comportent une zone
de mandres entre Clry-sur-Somme et Corbie et un profil plus linaire entre Corbie et
Abbeville ainsi qu' l'amont de Clry-sur-Somme. Le systme de biefs formant les
tangs de la Haute Somme constitue un rgime des eaux particulier, o la Somme
occupe la totalit de son lit majeur. Les hortillonnages d'Amiens constituent un
exemple de marais apprivois intgrant les aspects historiques, culturels et culturaux
(marachage) un vaste rseau d'habitats aquatiques. L'ensemble du site, au rle
vident de corridor fluviatile migratoire, est une entit de forte cohsion et solidarit
cologique des milieux aquatiques et terrestres.
L'expression du systme tourbeux alcalin est marque par un vieillissement gnralis
avec acclration de la dynamique arbustive et prforestire, par une dgradation
de la qualit des eaux, par un envasement gnralis.
Qualit et importance :
Ce site constitue un ensemble exceptionnel avec de nombreux intrts spcifiques,
notamment ornithologiques : avifaune paludicole nicheuse (populations importantes
de Blongios nain, Busard des roseaux, passereaux tels que la Gorgebleue miroir,... ),
et plusieurs autres espces d'oiseaux menacs au niveau national (Sarcelle d'hiver,
Canard souchet...).
Outre les lieux favorables la nidification, le rle des milieux aquatiques comme sites
de halte migratoire est fondamental pour les oiseaux d'eau.
PROLONGEMENT DU CONTOURNEMENT DALBERT ENTRE LA RD4929 ET LA RD938 Avril 2012 Version 2
50
Dossier Loi sur lEau | Conseil gnral de la Somme
H:\HNEW\PRODUCTION\ETUDES\L1195-80_CG80_Contournement d'Albert_Enviro\L1195_Etude\L1195_DLE\L1195_DLE_Pieces ecrites\L1195_DLE_2.doc
Vulnrabilit :
Actuellement la valle de la Somme ne fonctionne plus comme un systme
exportateur : avec la rgression ou la disparition des pratiques de fauche, pturage,
trpage, tourbage, l'exportation de matire est le plus souvent insuffisante pour
maintenir un tat trophique correct du systme. Il en rsulte des phnomnes
d'atterrissement et de minralisation de la tourbe, de vieillissement des roselires,
cariaies, moliniaies au profit des mgaphorbiaies et fourrs hygrophiles. Ces processus
ont t acclrs par la pollution du cours de la Somme et par l'envasement. Les
vastes surfaces de roselires inondes qui dominaient de nombreux secteurs il y a 50
ans ont t considrablement rduites, de mme que les herbiers aquatiques de
qualit et les prairies humides ptures.
Par ailleurs, les inondations de 2001 ont dpos des limons qui ont notamment altr
l'tat de conservation des roselires et des habitats tourbeux et acclr l'envasement
de nombreux tangs.
Enfin, phnomne plus rcent, la prolifration de la Jussie, dans un premier temps dans
les tangs de la Haute Somme et plus rcemment l'aval d'Amiens, est une menace
importante qui pse sur les milieux aquatiques.
Lvaluation des incidences du projet sur la ZSC et la ZPS :
Le projet est situ au Nord de la ZSC Moyenne Valle de la Somme et de la ZPS
Etang et marais du bassin de la Somme respectivement 8 000 m et 8 500 m en
distance directe.
Les 2 sites NATURA 2000 correspondent tous les 2 des secteurs de la valle de la
Somme. Lvaluation des incidences du projet sur ces 2 sites se fera donc
conjointement.
Si on analyse une vue arienne de lespace consquent qui spare le site du projet et
la valle de la Somme (sites NATURA 2000), on peut prtendre que les 2 entits sont
dconnectes du fait de la prsence :
dobstacles visuels du fait du relief marqu : la valle de lAncre et la valle de
la Somme sont spares par une frange du plateau Picard,
de nombreuses activits humaines :
- le maillage que constituent les voies de communication aux abords
dAlbert. On recense notamment la prsence des RD929, RD52, RD120,
RD42, RD1,
- la voie ferre Albert/Corbie qui vient galement couper lespace
sparant les 2 sites,
- laroport dAlbert-Picardie proximit des 2 zones,
- les villages de Dernancourt, Morlancourt, Ville-sur-Ancre et Treux.
La seule connexion qui existe entre le site du projet et la valle de la Somme est
dordre hydraulique. Les 2 entits font parties du mme bassin versant et le projet est
situ en amont des sites NATURA 2000.
Etant donn linterdistance des 2 sites et les dispositions du projet en matire de
gestion des eaux pluviales (sur les plans qualitatif et quantitatif), on peut conclure que
le projet hydraulique naura pas dincidences sur les objectifs de conservation des sites
NATURA 2000.
Que ce soit en matire dimpacts visuels, sonores ou olfactifs, linterdistance, le relief
ainsi que les lments anthropiques que sont les routes dpartementales, voie ferre,
laroport et les villages aux abords du projet laisse penser que le projet naura pas
dimpact sur les objectifs de conservation des sites NATURA 2000.
PROLONGEMENT DU CONTOURNEMENT DALBERT ENTRE LA RD4929 ET LA RD938 Avril 2012 Version 2
51
Dossier Loi sur lEau | Conseil gnral de la Somme
H:\HNEW\PRODUCTION\ETUDES\L1195-80_CG80_Contournement d'Albert_Enviro\L1195_Etude\L1195_DLE\L1195_DLE_Pieces ecrites\L1195_DLE_2.doc
5.2 INCIDENCES DIRECTES ET INDIRECTES, TEMPORAIRES ET PERMANENTES, DU
PROJET SUR LA RESSOURCE EN EAU, LE MILIEU NATUREL ET MESURES
COMPENSATOIRES
Lanalyse des incidences du projet sur lenvironnement distingue successivement :
les effets temporaires et permanents induits par la priode de chantier,
les effets permanents directs et indirects lis limplantation physique du projet
(effets structurels) et lexploitation des amnagements (effets fonctionnels).
Les mesures rductrices et compensatoires que le matre douvrage sengage
mettre en uvre sont dtailles la suite de la description des incidences.
Les impacts sont apprcis en fonction des modifications prvisibles de l'tat initial, sur
la base des lments connus au stade de l'Avant-Projet.
5.2.1 Impacts sur la morphologie et les conditions dcoulements
5.2.1.1 Eaux souterraines
Le projet prsente des tronons en remblai (hauteur max = 1,88 m) et des tronons en
dblai (hauteur max = 2,58 m).
La ralisation de remblais ou de dblais importants peut entraner des perturbations de
lcoulement des nappes souterraines :
La mise en place dune voirie en remblai peut occasionner des tassements de
terrain qui entranent des perturbations des coulements deaux souterraines,
Les dblais peuvent crer des rabattements localiss des nappes souterraines
situes faible profondeur.
La cration du contournement dAlbert se fera en majorit sur des terrains ddis la
culture et au pturage.
Le projet ne concerne pas des zones o les eaux souterraines sont protger en
priorit et nest pas situ proximit de champs captants.
Le projet consiste en un amnagement de surface (voirie, giratoire et
damnagement paysager).
La ralisation de remblais notamment au franchissement des fonds de talweg sera
dune hauteur maximum denviron 1,9 mtre.
Le coefficient de stabilit calcul lors de ltude gotechnique pour les formations
pdologiques prsentes (limons sableux) est nettement suprieur la valeur moyenne
confirmant ainsi la stabilit de louvrage projet.
Les remblais et dblais qui seront crs dans le cadre du projet nauront pas dimpact
sur les coulements des nappes souterraines.
PROLONGEMENT DU CONTOURNEMENT DALBERT ENTRE LA RD4929 ET LA RD938 Avril 2012 Version 2
52
Dossier Loi sur lEau | Conseil gnral de la Somme
H:\HNEW\PRODUCTION\ETUDES\L1195-80_CG80_Contournement d'Albert_Enviro\L1195_Etude\L1195_DLE\L1195_DLE_Pieces ecrites\L1195_DLE_2.doc
5.2.1.2 Eaux superficielles
Le trac du projet de contournement coupe plusieurs sous-bassins versants et stoppe
le cheminement des coulements naturels des eaux (ruissellement concentr et diffus).
Le Conseil Gnral de la Somme souhaite mettre en place un systme de gestion de
lassainissement qui spare les eaux de ruissellement des bassins versants naturels
intercepts des eaux de ruissellement de la plateforme projet.
Le ruissellement diffus des surfaces interceptes est collect par la cunette forme par
le profilage particulier du chemin agricole longeant le projet et est ensuite dirig dans
le fond de talweg.
Les coulements du ruissellement concentrs sont rtablis par lintermdiaire
douvrages de rtablissement des talwegs naturels.
Une fosse de diffusion implante laval du projet permettra linfiltration des eaux de
ruissellement du BVN n1.
Les ouvrages hydrauliques de rtablissement des talwegs permettent le passage des
dbits gnrs par les bassins versants amont lors des prcipitations doccurrence
centennale.
Le projet de Contournement dAlbert prsente un impact possible sur les conditions
dcoulement par limpermabilisation de surfaces qui conduit laugmentation du
volume et du dbit des eaux de ruissellement par rapport aux ruissellements gnrs
sur les terrains naturels,
La modification du coefficient de ruissellement des surfaces concernes entrane
lvacuation de dbits importants.
Les eaux de ruissellement de la chausse seront recueillies par des dispositifs
longitudinaux de collecte (cunettes enherbes, bordures et canalisations).
Les tronons en dblais seront dots dune faible pente (3 pour 1) et disposeront dun
ensemencement mellifre permettant de minimiser les phnomnes drosion quy
pourraient sy produire.
Le rseau de collecte dirigera les eaux de voirie vers le bassin de stockage puis le
bassin dinfiltration.
Suivant les recommandations du CG80, lensemble de ces quipements sont
dimensionns pour la collecte, le stockage et linfiltration des eaux de ruissellement
dune pluie doccurrence dcennale.
Le tamponnement, linfiltration compensent les impacts de limpermabilisation des
surfaces en conservant les dbits gnrs par les terrains naturels.
Enfin, le projet na que trs peu dincidence quantitative en raison de la faible
superficie impermabilise du projet. En effet, la superficie du projet au regard de
celle du bassin versant hydrographique est minime.
5.2.2 Impacts sur la qualit des eaux
5.2.2.1 Eaux superficielles
On identifie quatre types de pollutions gnres par la route :
la pollution pendant les travaux,
la pollution accidentelle,
la pollution saisonnire,
la pollution chronique.
La gestion de la pollution due aux travaux est prsente dans le paragraphe des
impacts temporaires.
La gestion de la pollution accidentelle est prsente dans le paragraphe des impacts
en cas dvnements exceptionnels.
Pollution saisonnire
La pollution saisonnire est en relation avec les vnements saisonniers lis lentretien
de la route et des couvertures vgtales des bas-cts.
Il sagit essentiellement de deux grands types de pollution :
PROLONGEMENT DU CONTOURNEMENT DALBERT ENTRE LA RD4929 ET LA RD938 Avril 2012 Version 2
53
Dossier Loi sur lEau | Conseil gnral de la Somme
H:\HNEW\PRODUCTION\ETUDES\L1195-80_CG80_Contournement d'Albert_Enviro\L1195_Etude\L1195_DLE\L1195_DLE_Pieces ecrites\L1195_DLE_2.doc
Les salages hivernaux : la composition des substances de salage peut
amener des concentrations leves de composs indsirables,
Lentretien des couvertures vgtales des bas-cts : lentretien des
couvertures vgtales des bas-cts se fait par fauchage ou par
dbroussaillage mais aussi par lutilisation de produits chimiques dont les plus
courants sont les dsherbants-dbroussaillants et les limitateurs de croissance.
Le nombre moyen dinterventions de salages est de 10 par saison hivernale, avec un
apport de sel de lordre de 30 g/m de chausse.
Les bandes circulantes de la voirie auront une surface totale de 1,6 ha.
En appliquant lapport de salage de 30 g/m cette surface, on obtient 0,48 t de sel
par intervention sur la totalit du projet.
Pour lutter contre la pollution saisonnire, les actions mener seront diriges sur les
composantes suivantes :
- Le personnel, par la prise de conscience des mcanismes mis en jeu lors du
traitement rapport avec les phnomnes traiter,
- Les matriels de salage et de dneigement asservis et prcis rgulirement
entretenus,
- Les dosages appliqus qui doivent tre adapts,
-Les produits : les quantits et la nature des fondants utiliss doivent tre optimises en
les ajustant aux types de phnomnes mtorologiques routiers rencontrs. Les
produits utiliss sont le sel et la saumure. La prfrence sera aussi donne aux salages
prventifs et prcuratifs.
Pour les produits phytosanitaires, il faut prioriser lutilisation dherbicides homologu
pour lemploi et le milieu auquel il est destin, suspendre les traitements durant les
pluies et les priodes de scheresse ou de gel.
Lemploi des produits chimiques et autres produits phytosanitaires ncessite quelques
prcautions : chaque type de produit correspond des dosages, mthodes et
matriels dpandage adapts.
Pour limiter les phnomnes de dispersion de ces produits, il conviendra de respecter
les recommandations des fabricants. Il est recommand de ne pas utiliser ces produits
en cas de pluie ou de priode de scheresse marque.
Lentretien par fauchage et/ou le dbroussaillage sera privilgi dans lentretien des
couvertures vgtales des bas-cts.
Pollution chronique
La pollution chronique est gnre par le lessivage des chausses lors des vnements
pluvieux.
Elle est en relation directe avec le trafic par :
Lusure de la chausse,
Les dpts de graisse et dhuile,
Lusure des pneumatiques,
Les rsidus de combustion.
Ces lments sont accumuls par le temps sec et entrans par le flot des eaux de
pluie sur la plate-forme. Du point de vue qualitatif, cette pollution est caractrise par
des paramtres spcifiques :
Matires en suspension (MES),
Prsence dhydrocarbures,
Prsence de mtaux lourds.
Lvaluation de la pollution chronique est faite selon les indications fournies par le Setra
(Note dinformation n75).
A partir dexprimentations installes sur des autoroutes interurbaines, le Setra a
dtermin que la charge polluante annuelle prendre en compte pour une section
courante dpend de sa surface impermabilise et du trafic.
PROLONGEMENT DU CONTOURNEMENT DALBERT ENTRE LA RD4929 ET LA RD938 Avril 2012 Version 2
54
Dossier Loi sur lEau | Conseil gnral de la Somme
H:\HNEW\PRODUCTION\ETUDES\L1195-80_CG80_Contournement d'Albert_Enviro\L1195_Etude\L1195_DLE\L1195_DLE_Pieces ecrites\L1195_DLE_2.doc
Ces formules de calcul de pollution dfinies pour les sections courantes donnent :
Charge annuelle : Ca = Cu x (T/1 000) x S
avec Ca : charge annuelle (kg)
T : trafic global (v/j)
S : surface impermabilise (ha)
Cu : charge unitaire annuelle (kg/ha)
Fraction maximale : Fr = 2,3 x h
avec h : hauteur de prcipitation
Les charges unitaires annuelles pour un site ouvert sont :
MES : 40 kg/ha
DCO : 40 kg/ha
Zn : 0,4 kg/ha
Cu : 0,02 kg/ha
Cd : 0,002 kg/ha
Hc totaux : 0,6 kg/ha
Hap : 0,00008 kg/ha
Les concentrations sont calcules pour un trafic journalier de 1 440 vhicules (trafic
moyen journalier lhorizon 2035 donne issue de ltude de Trafic de 2011).
Les rsultats des calculs de charges polluantes sont prsents en annexe.
Les eaux de ruissellement de la plate-forme routire sont recueillies par les ouvrages de
collecte longitudinaux (cunettes enherbes, bordures et canalisations) et transfres
dans le bassin de stockage et de tamponnement.
Les dpollutions observes avant le rejet des eaux sont lis :
la dcantation dans le bassin de stockage,
laction auto-purative des noues enherbes.
Les rendements puratoires du systme dassainissement sont :
Paramtres Dcantation
Vs=1 m/h *
(%)
Matires en
suspension
85
Demande chimique
en oxygne
75
Zinc 80
Cuivre 80
Cadmium 80
Hydrocarbures
totaux
65
Hydrocarbures
aromatiques
polycycliques
65
PROLONGEMENT DU CONTOURNEMENT DALBERT ENTRE LA RD4929 ET LA RD938 Avril 2012 Version 2
55
Dossier Loi sur lEau | Conseil gnral de la Somme
H:\HNEW\PRODUCTION\ETUDES\L1195-80_CG80_Contournement d'Albert_Enviro\L1195_Etude\L1195_DLE\L1195_DLE_Pieces ecrites\L1195_DLE_2.doc
Compte tenu des temps de sjour important (>15h) les particules dont la vitesse de
chute est suprieure 1 m/h seront dcantes.
La rsultante en terme de rendement de la combinaison de plusieurs systmes
dassainissement est donne par la formule :
R = 1 [(1 r1) x (1 r2)]
avec R la rsultante
r1 et r2 les rendements puratoires
Les concentrations obtenues aprs dpollution sont compares aux objectifs de
concentration pour une eau de qualit 1 et pour le bon tat chimique (Directive
cadre sur leau).
Les concentrations obtenues sur la totalit du projet sont prsentes dans le tableau
suivant :
Paramtres Concentration en sortie
(Projet total)
Objectif de
qualit 1
Bon tat
chimique
(DCE)
moyenne
annuelle
(mg/l)
en priode
de pointe
(mg/l)
(mg/l)
(mg/l)
Matires en
suspension
1,957 2,981 <70 25-50
Demande
chimique en
oxygne
3,262 4,968 <25 20-30
Zinc 0,009 0,013 <0,5
Cuivre 0,001 0,001 <0,05
Cadmium 0,000 0,000 <0,001 0.005
Hydrocarbures
totaux
0,068 0,104 <1
Hydrocarbures
aromatiques
polycycliques
0,000 0,000 sans objet
Les rsultats obtenus sont conformes lobjectif de qualit 1 et au bon tat chimique
(DCE) pour le projet dans sa totalit en moyenne annuelle et en priode de pointe.
PROLONGEMENT DU CONTOURNEMENT DALBERT ENTRE LA RD4929 ET LA RD938 Avril 2012 Version 2
56
Dossier Loi sur lEau | Conseil gnral de la Somme
H:\HNEW\PRODUCTION\ETUDES\L1195-80_CG80_Contournement d'Albert_Enviro\L1195_Etude\L1195_DLE\L1195_DLE_Pieces ecrites\L1195_DLE_2.doc
La lutte contre la pollution chronique va sarticuler autour du rseau dassainissement
et des quipements qui lui sont associs.
Le rseau dassainissement de la voirie comprend :
- des ouvrages longitudinaux de collecte des eaux de voirie (cunettes enherbes,
bordures et canalisations),
- un bassin de stockage et de dpollution avec volume mort pour permettre la
dcantation,
- un bassin dinfiltration.
Le bassin de stockage sera quip dune vanne by-pass permettant le confinement
des pollutions (cf. paragraphe impacts exceptionnels).
Une surverse sera amnage pour permettre lvacuation des eaux de ruissellement
issues dune prcipitation dintensit suprieure la prcipitation dcennale (cf.
paragraphe impacts exceptionnels).
Les rejets seront conformes lobjectif de qualit 1 et au bon tat chimique (DCE).
La sparation des eaux de voirie et des eaux de bassin versant naturel vitera la
dilution de la pollution avant traitement et permettra dviter les risques de surverse
des polluants lors des vnements pluvieux exceptionnels.
5.2.2.2 Eaux souterraines
Les eaux de ruissellement de la chausse charges en lments polluants divers
peuvent tre par le biais de la pollution des eaux superficielles et/ou par infiltration,
lorigine dune contamination des eaux souterraines.
Il est important de souligner que le trac du projet de contournement ne concerne
pas de zone o les eaux souterraines sont protger en priorit et nest pas situ
proximit de champs captants irremplaables.
Le projet est susceptible dentraner la pollution des eaux souterraines de plusieurs
faons :
- infiltration dune pollution survenant durant les travaux,
- infiltration dune pollution accidentelle,
- infiltration des eaux de voirie avant leur passage dans les ouvrages de dpollution,
- infiltration des eaux de voirie dpollues aprs rejet.
Les effets des pollutions accidentelles ou dues aux travaux sont prsents dans les
paragraphes Impacts exceptionnels et Impacts temporaires .
Infiltration avant traitement
Les eaux de voirie charges en pollution routire scoulent vers louvrage de
dpollution (bassin de stockage) par lintermdiaire du rseau de collecte.
Linfiltration des eaux non pures au niveau des ouvrages de collecte est susceptible
de causer une pollution des nappes souterraines.
Les ouvrages de collecte ont un pouvoir auto-purateur qui sera mis en place
notamment au travers des noues vgtalises.
Un sol complexe, suffisamment pais, permet en effet :
la filtration : processus physique de rtention des particules qui dpend de la
granulomtrie et de l'homognit du sol.
l'absorption et les changes d'ions : les deux processus physico-chimiques rversibles
sont essentiellement dvelopps par les argiles, les oxydes, les hydroxydes et les
matriaux amorphes. Ils permettent la rtention de molcules non charges, soit
organiques (hydrocarbures, pesticides, etc.. .), soit minrales (mtaux lourds oxyds).
les processus biologiques : dans les couches superficielles du sol, la flore bactrienne,
fongique, algale et la faune peuvent intervenir pour dgrader la pollution.
Associ ces mcanismes auto-purateurs, la vgtalisation des noues permettra aux
macrophytes dabsorber les matires minrales et le chevelu racinaire facilitera
linfiltration de leau et sera le sige dune forte activit microbienne.
Lefficacit de ces mcanismes auto-purateurs dpend de la pente des noues
enherbes. Dans lensemble, leur profil indique des pentes infrieures 1% ce qui laisse
envisager un rle de dcantation efficace.
PROLONGEMENT DU CONTOURNEMENT DALBERT ENTRE LA RD4929 ET LA RD938 Avril 2012 Version 2
57
Dossier Loi sur lEau | Conseil gnral de la Somme
H:\HNEW\PRODUCTION\ETUDES\L1195-80_CG80_Contournement d'Albert_Enviro\L1195_Etude\L1195_DLE\L1195_DLE_Pieces ecrites\L1195_DLE_2.doc
Infiltration aprs traitement
Aprs leur dpollution dans le bassin de stockage, les eaux pures sont transfres au
bassin dinfiltration.
Ces eaux peuvent alors sinfiltrer pour rejoindre les eaux de la nappe sous-jacente.
La vulnrabilit des nappes souterraines est estime de niveau moyen sur la majorit
du projet.
Par consquent, linfiltration deaux partiellement pures peut entraner la pollution
des nappes souterraines.
Les calculs de dpollution effectus dans le paragraphe 5.2.3.1. montrent que les
concentrations des rejets moyens de la totalit du projet sont conformes aux objectifs
de qualit des eaux de surface.
De plus la pollution rsiduelle sera limine par la dpollution supplmentaire qui peut
sobserver au sein des formations pdologiques en place.
Par consquent, linfiltration des eaux de ruissellement de la plate-forme routire aprs
dpollution nengendrera pas de pollution des nappes deaux souterraines.
5.2.3 Impacts sur les milieux naturels
5.2.3.1 ZNIEFF
La ZNIEFF de type 1 Valle de lAncre entre Beaumont Hamel et Aveluy et cours
suprieur de lAncre est la plus proche du projet (environ 2 km).
Lintrt cologique de ces ZNIEFF est li la prsence deau et de milieux aquatiques
associs.
Un projet tel que le contournement dAlbert peut avoir deux types dimpacts sur cette
zone :
la destruction dune partie des zones naturelles par lamnagement de
surfaces,
la pollution des milieux avals par des rejets non traits.
Le projet, relativement loign de la ZNIEFF de type 1 Valle de lAncre entre
Beaumont Hamel et Aveluy et cours suprieur de lAncre , nengendrera aucune
destruction de zones naturelles au sein de la ZNIEFF.
Les paragraphes prcdents ont montr que les eaux de voirie gnres par le projet
seront dpollues par les ouvrages dassainissement qui seront mis en place.
Les eaux rejetes auront une qualit conforme lobjectif de qualit 1 et au bon tat
chimique de la directive cadre sur leau. Les rejets deaux du projet ne creront pas
de pollution laval.
Enfin, la ZNIEFF de type 1 concerne est situe en amont du projet.
5.2.3.2 Faune aquatique
Les impacts sur la faune aquatique sont induits par deux phnomnes :
- la destruction ou dgradation des milieux et limplantation du projet,
- la pollution des eaux.
Ces impacts peuvent tre diverses. Leffet immdiat le plus marquant est celui de la
mortalit de la faune piscicole. Cette mortalit est due une asphyxie du poisson
rsultant de la consommation doxygne lie la dcomposition de la matire
organique carbonate ou azote.
Cette diminution provoque aussi des effets sur le dveloppement et la reproduction
des poissons.
La persistance et laccumulation dun grand nombre de polluants, notamment les
mtaux lourds, dans la chane alimentaire correspond aux effets diffrs du projet sur
la faune aquatique.
Aucun cours deau permanent nest prsent dans lenvironnement immdiat du
projet. Aucun rejet ne se fait directement dans un cours deau.
Aucun enjeu sur les activits piscicoles nest craindre sur la zone dtude.
PROLONGEMENT DU CONTOURNEMENT DALBERT ENTRE LA RD4929 ET LA RD938 Avril 2012 Version 2
58
Dossier Loi sur lEau | Conseil gnral de la Somme
H:\HNEW\PRODUCTION\ETUDES\L1195-80_CG80_Contournement d'Albert_Enviro\L1195_Etude\L1195_DLE\L1195_DLE_Pieces ecrites\L1195_DLE_2.doc
5.2.3.3 Flore aquatique
Comme la faune aquatique, la flore aquatique subit les effets nfastes des deux
phnomnes suivants :
- la destruction ou dgradation des milieux et limplantation du projet,
- la pollution des eaux.
Aucun cours deau permanent nest prsent dans lenvironnement immdiat du
projet. Aucun rejet ne se fait directement dans un cours deau.
Le projet comprend la vgtalisation des talus et des bassins de stockage et
dinfiltration en fin damnagement. On peut donc envisager un impact positif sur la
distribution gnrale des espces.
5.2.4 Impacts temporaires
Les impacts temporaires sont lis la phase de ralisation du projet. Ceux-ci sont
limits dans le temps la priode correspondant aux travaux.
Le suivi strict des rgles de scurit et de bonnes pratiques qui seront dictes dans le
cahier des charges des entreprises permet de compenser ou dliminer en quasi-
totalit les impacts temporaires.
La pollution durant les travaux a pour principale origine lrosion lie aux
dfrichements et aux terrassements, lutilisation de produits bitumineux entrant dans la
composition des corps de chausse, lutilisation de sous-produits et dchets de
terrassement et les engins de travaux publics.
Les vnements pluvieux peuvent tre lorigine de lexportation dimportants
volumes de matires en suspension vers le rseau hydrographique et affecter la
qualit et plus particulirement la valeur biologique du substrat. Les risques sont
relativement alatoires et difficiles quantifier. Cependant, il est assez facile de sen
prmunir moyennant quelques prcautions lmentaires qui seront imposes aux
entreprises charges de la construction.
Pendant la phase dexcution des travaux, quand les dispositifs de protection ne
seront pas encore en place, une attention particulire sera porte aux pollutions
possibles.
Les prcautions prendre lors des diffrentes phases du chantier sont les suivantes :
- Le lavage et la vidange des engins seront interdits si les aires de stationnement des
matriels de chantier sont situes dans la zone dtude,
- Installation de chantier : des dispositions devront tre prises, notamment sur les aires
destines lentretien des engins ou sur les zones de stockage des carburants ou des
divers liants utiliss (liants hydraulique ou hydrocarbon).
Des mesures simples permettront dviter des pollutions accidentelles :
- Mise en place de bacs de rtention pour le stockage des produits inflammables,
- Enlvement des emballages usagers,
- Cration de fosss tanches autour des installations pour contenir les dversements
accidentels,
- Installation de WC chimique.
Nettoyage des emprises
Les terrains concerns par le projet ne prsentent pas de zones particulirement
sensibles lrosion.
Aucune perturbation de lcoulement des eaux de ruissellement nest craindre.
Terrassements et chausses
Le rseau de collecte des eaux de ruissellement de la plate-forme routire sera ralis
aprs le terrassement du remblai.
Les traitements aux liants hydrauliques (chaux, ciment) des matriaux de terrassement
pourront tre envisags sans contraintes particulires vis--vis des eaux souterraines.
Seules, les prcautions dusage par rapport lenvironnement urbain et agricole sont
prendre en compte, notamment par forts vents.
PROLONGEMENT DU CONTOURNEMENT DALBERT ENTRE LA RD4929 ET LA RD938 Avril 2012 Version 2
59
Dossier Loi sur lEau | Conseil gnral de la Somme
H:\HNEW\PRODUCTION\ETUDES\L1195-80_CG80_Contournement d'Albert_Enviro\L1195_Etude\L1195_DLE\L1195_DLE_Pieces ecrites\L1195_DLE_2.doc
Les dversements accidentels de produits polluants (liants hydrocarbons) pourront
tre maintenus par le rseau de collecte dj ralis.
Toutes ces prescriptions figureront dans le Cahier des Clause Techniques Particulires
(CCTP) qui sera remis lentreprise titulaire des travaux. Le Schma Organisationnel du
Plan dAssurance Qualit (SOPAQ) pourra comporter une rubrique pollution .
5.2.5 Impacts exceptionnels
Les vnements exceptionnels susceptibles dintervenir au niveau du projet sont
majoritairement de deux types :
- accident de la circulation,
- prcipitation exceptionnelle.
5.2.5.1 Pollution accidentelle
Ce type de pollution rsulte dun dversement ventuel des produits dangereux lors
dun accident de la circulation.
Les hydrocarbures reprsentent prs de 50% des produits dangereux.
Le trafic de ces matires est rglement en trois catgories :
Produits modifiant le pH de leau (acides et bases),
Produits de faible toxicit mais rendant leau impropre la consommation,
Produit de toxicit aigu.
Un des objectifs du projet de contournement dAlbert est lamlioration de la scurit
routire. Par consquent, les risques de pollution accidentelle doivent diminuer avec la
ralisation de lamnagement.
Lorsque se produit un accident, des prcautions doivent tre prises, dune part pour la
scurit des personnes et dautre part, pour limiter lextension de la pollution dans le
milieu naturel.
Lutter contre une telle pollution fait appel une chane dinterventions dont
lefficacit dpend entre autres des informations existantes comme :
- Le plan du rseau dassainissement de laxe routier,
- La liste des laboratoires agrs,
- La carte de vulnrabilit des nappes souterraines,
- La liste des captages et pompages deau, etc.
Toutes ces informations permettent de dfinir des procdures suivre dans le cadre
dun schma oprationnel au niveau local (communal et intercommunal).
Un schma dalerte devra tre mis en place avec le concours de lensemble des
services concerns avant la mise en service de la nouvelle liaison (Pompiers,
Gendarmerie, Conseil Gnral de la Somme, Mairies). Le contenu de ce plan est
expos en paragraphe Modalits de gestion des pollutions accidentelles .
Le principe dun schma dalerte est :
- Information rapide lors des accidents,
- Identification du polluant,
- Prise de mesure de confinement (fermeture des vannes, obstruction des points de
rejets, utilisation de matriaux absorbants),
- Pompage des polluants,
- Remise en tat de louvrage dassainissement.
Dans tous les cas de pollution accidentelle, on procdera par une identification
analytique du polluant sur le site o il se sera rpandu.
Des mesures de confinement terre seront prises afin de tarir la source de pollution,
dempcher ou de restreindre la propagation dans le milieu aquatique.
Lassainissement prvu dans ce projet permettra ainsi de collecter les eaux pollues
accidentellement, de les stocker localement et de les traiter.
Les polluants dverss sur la chausse lors dun accident de circulation seront en effet
rcuprs par le rseau de collecte et achemins dans le bassin de stockage. Les
PROLONGEMENT DU CONTOURNEMENT DALBERT ENTRE LA RD4929 ET LA RD938 Avril 2012 Version 2
60
Dossier Loi sur lEau | Conseil gnral de la Somme
H:\HNEW\PRODUCTION\ETUDES\L1195-80_CG80_Contournement d'Albert_Enviro\L1195_Etude\L1195_DLE\L1195_DLE_Pieces ecrites\L1195_DLE_2.doc
polluants pourront tre confins dans le bassin par fermeture de la vanne de rejet
avant pompage et remise en tat.
En cas de dysfonctionnement de la vanne ou de dversement par surverse, le
passage des eaux dans une cloison siphode avant rejet apporte une scurit
supplmentaire.
La fermeture de la vanne de by-pass aprs la collecte de la pollution accidentelle
permet de rejeter le dbit gnr par une prcipitation sans passage par le bassin de
tamponnement.
Elle permet ainsi de ne pas diluer la pollution et de sassurer que celle-ci ne sera pas
rejete par surverse.
PROLONGEMENT DU CONTOURNEMENT DALBERT ENTRE LA RD4929 ET LA RD938 Avril 2012 Version 2
61
Dossier Loi sur lEau | Conseil gnral de la Somme
H:\HNEW\PRODUCTION\ETUDES\L1195-80_CG80_Contournement d'Albert_Enviro\L1195_Etude\L1195_DLE\L1195_DLE_Pieces ecrites\L1195_DLE_2.doc
5.2.5.2 Prcipitation exceptionnelle
Les prcipitations exceptionnelles engendrent des consquences au niveau des
volumes deaux de ruissellement de voiries grer par le rseau dassainissement et
au niveau des dbits de bassins versants naturels rtablir sous le projet.
Conformment aux prconisations du CG80, le rseau dassainissement est
dimensionn pour grer les prcipitations doccurrence dcennale.
Dans le cadre dune prcipitation dintensit de dimensionnement ou dintensit
infrieure :
Les eaux de ruissellement de voirie sont collectes par les ouvrages longitudinaux et
diriges vers le bassin de stockage.
Ce bassin permet le tamponnement dune prcipitation de dimensionnement
transfre ensuite au bassin dinfiltration aprs passage dans une cloison siphode.
Dans le cadre dune prcipitation dintensit suprieure la prcipitation de
dimensionnement :
Les eaux de ruissellement sont collectes par les ouvrages longitudinaux et diriges
vers le bassin de stockage (dans la limite des capacits maximales de louvrage).
Dans un premier temps, le bassin tampon se remplit en rejetant un dbit rgul vers le
bassin dinfiltration.
Lorsque le bassin est plein, les eaux supplmentaires sont rejetes par surverse dans le
fond de talweg existant sans passage par la cloison siphode. Le rejet dbit rgul
continue fonctionner.
En fin de prcipitation, le dbit darrive des eaux de ruissellement diminue et la
surverse cesse de fonctionner. Le rejet en dbit rgul continue fonctionner jusqu
la vidange totale du bassin de stockage.
Par consquent, lors dune prcipitation dintensit suprieure la prcipitation
dcennale, le dbit de rejet des eaux de ruissellement dans le milieu naturel nest plus
rgul.
La dpollution des eaux nest pas totale compte tenu du rejet dune partie des eaux
pluviales par surverse des bassins. Cette dpollution incomplte aura peu dimpact sur
la qualit des eaux rejetes compte tenu de limportante dilution des polluants. En
effet, les tudes montrent que la concentration en polluants est maximale lors des
prcipitations doccurrence annuelle.
Lors dvnements pluvieux exceptionnels, les dbits importants gnrs par le
ruissellement sur les bassins versants naturels scoulent dans les talwegs
habituellement secs.
Ces coulements doivent tre rtablis sous le projet sans aggravation de la situation
aval.
Les ouvrages hydrauliques de rtablissement mis en place sous le projet sont
dimensionns pour le passage des dbits centennaux.
De plus, la fosse de diffusion prvue au niveau du BVN n1 sera vrifie et cures
rgulirement afin de sassurer de son bon fonctionnement.
5.2.6 Compatibilit avec les outils de gestion des eaux
5.2.6.1 Compatibilit avec le SDAGE
Le secteur dtude sinscrit dans le SDAGE du bassin Artois-Picardie. Ce document a
t adopt par le comit de bassin le 30 novembre 2009. Il est un outil de
lamnagement du territoire qui vise obtenir les conditions dune meilleure conomie
de la ressource en eau et le respect des milieux aquatiques, tout en assurant un
dveloppement conomique et humain en vue de la recherche dun dveloppement
durable.
Le tableau suivant prsente la conformit du projet avec les orientations et dispositions
dfinies dans le cadre de ce document.
PROLONGEMENT DU CONTOURNEMENT DALBERT ENTRE LA RD4929 ET LA RD938 Avril 2012 Version 2
62
Dossier Loi sur lEau | Conseil gnral de la Somme
H:\HNEW\PRODUCTION\ETUDES\L1195-80_CG80_Contournement d'Albert_Enviro\L1195_Etude\L1195_DLE\L1195_DLE_Pieces ecrites\L1195_DLE_2.doc
Orientation Disposition Remarques /
mesures du projet
Compatibilit
4.1 La
gestion
qualitative
des milieux
aquatiques
Orientation 1
Continuer la rduction
des apports de matires
polluantes classiques
dans les milieux.
Dpollution des eaux de
ruissellement de voirie. Les
eaux infiltres respecteront
lobjectif de qualit de
niveau 1 et le bon tat
chimique (DCE).
Diminution des risques de
pollutions accidentelles par
le respect de la procdure
de gestion des pollutions
accidentelles (plan
dalerte).
Compatible
Orientation 4
Adopter une gestion des
sols et de lespace
agricole permettant de
limiter les risques de
ruissellement, drosion,
et de transfert des
polluants.
Les gestionnaires des voies
de communication
(contournement dAlbert et
chemin agricole longeant le
contournement) veilleront
restaurer et entretenir les
cunettes enherbes.
Compatible
Orientation 7
Assurer la protection des
aires dalimentation des
captages
Projet situ en dehors dune
aire dalimentation de
captage.
Nanmoins, dpollution des
eaux de ruissellement de
voirie et rejet de qualit de
niveau 1 et bon tat
chimique (DCE).
Compatible
Orientation Disposition Remarques /
mesures du projet
Compatibilit
4.2 La
gestion
quantitative
des milieux
aquatiques
Orientation 13
Limiter le ruissellement en
zones urbaines et en
zones rurales pour
rduire les risques
dinondation
Les eaux de ruissellement
de la plateforme routire
seront infiltres tout comme
les eaux de ruissellement du
BVN n1 veillant ainsi ne
pas aggraver les risques
dinondations laval.
Lintgration paysagre du
bassin dinfiltration sera
ralise.
Compatible
4.3 La
gestion et la
protection
des milieux
aquatiques
Orientation 24
Assurer la continuit
cologique et une
bonne gestion piscicole
LAncre fait partie des cours
deau prsentant un enjeu
Poissons migrateurs ou
continuit cologique sur
le long terme.
Le projet naura pas
dimpact sur lAncre que ce
soit en terme de qualit et
de quantit
Compatible
Orientation 25
Stopper la disparition, la
dgradation des zones
humides et prserver,
maintenir et protger
leur fonctionnalit
Aucune zone dominante
humide na t recense
sur le trac du projet de
contournement
Compatible
4.4 Le
traitement
des pollutions
historiques
- - Sans Objet
PROLONGEMENT DU CONTOURNEMENT DALBERT ENTRE LA RD4929 ET LA RD938 Avril 2012 Version 2
63
Dossier Loi sur lEau | Conseil gnral de la Somme
H:\HNEW\PRODUCTION\ETUDES\L1195-80_CG80_Contournement d'Albert_Enviro\L1195_Etude\L1195_DLE\L1195_DLE_Pieces ecrites\L1195_DLE_2.doc
Orientation Disposition Remarques /
mesures du projet
Compatibilit
4.5 Des
politiques
publiques
plus
innovantes
pour grer
collectiveme
nt un bien
commun
- - Sans Objet
5.2.6.2 Compatibilit avec le SAGE
Le projet est implant lintrieur du primtre du SAGE Somme Aval et cours deau
ctiers.
Ce SAGE tant en cours dinstruction, aucune contrainte ne sapplique au projet.
Nanmoins, le projet prend en compte par anticipation les principaux enjeux dfinis
dans le cadre de ce SAGE.
Les principaux enjeux dfinis dans le cadre de llaboration du SAGE Somme Aval et
cours deau ctiers sont :
enjeux qualitatifs de la ressource dus aux diffrentes activits : industrie,
agriculture, assainissement,
enjeux lis la gestion quantitative de la ressource avec les problmes de
scheresse sur certains secteurs et donc de restriction dusage,
enjeux de sant publique prsents sur le bassin avec les problmes
bactriologiques touchant lactivit conchylicole ainsi que la contamination du
milieu aquatique par les PCB,
enjeux de scurit avec les inondations de la Somme ainsi que les problmes de
ruissellement et de mouvements de terrains,
enjeux conomiques pour les activits lies leau telles que lindustrie,
lagriculture, la pche, la chasse, le tourisme, les sports nautiques et les loisirs.
PROLONGEMENT DU CONTOURNEMENT DALBERT ENTRE LA RD4929 ET LA RD938 Avril 2012 Version 2
64
Dossier Loi sur lEau | Conseil gnral de la Somme
H:\HNEW\PRODUCTION\ETUDES\L1195-80_CG80_Contournement d'Albert_Enviro\L1195_Etude\L1195_DLE\L1195_DLE_Pieces ecrites\L1195_DLE_2.doc
Partie 6. MOYENS DE SURVEILLANCE ET DINTERVENTION
PROLONGEMENT DU CONTOURNEMENT DALBERT ENTRE LA RD4929 ET LA RD938 Avril 2012 Version 2
65
Dossier Loi sur lEau | Conseil gnral de la Somme
H:\HNEW\PRODUCTION\ETUDES\L1195-80_CG80_Contournement d'Albert_Enviro\L1195_Etude\L1195_DLE\L1195_DLE_Pieces ecrites\L1195_DLE_2.doc
6.1 MODALITS DE GESTION DES POLLUTIONS ACCIDENTELLES
La gestion des pollutions accidentelles susceptibles de survenir lors dun accident de la
circulation passe par la mise en place dun schma dalerte.
Ce schma dalerte sera dfini en concertation avec les services concerns par le
nouveau trac (Pompiers, Gendarmerie, Conseil Gnral, DDE, Mairies).
Le principe dun schma dalerte est :
Information rapide lors des accidents,
Identification du polluant,
Prise de mesures de confinement (fermeture des vannes, obstruction des points
de rejets, utilisation de matriaux absorbants),
Pompage des polluants,
Remise en tat de louvrage dassainissement.
Lors dun dversement accidentel sur la chausse, les polluants liquides seront recueillis
par le rseau dassainissement constitu de cunettes enherbes, de bordures,
bouches dengouffrement et canalisations PVC.
Si le volume de produits polluants est trop important et que ceux-ci nont pas pu tre
stopps par la mise en place de matriaux absorbants, les polluants sont dirigs par le
rseau dassainissement vers le bassin de retenue.
La vanne de sortie du bassin de retenue peut tre ferme pour assurer le stockage des
polluants avant pompage et envoi en centre de dpollution.
Le bassin de retenue et les ouvrages de collecte devront ensuite tre remis en tat :
vrification de ltanchit, nettoyage des produits contamins, dcapage des terres
contamines dans les noues enherbes
Dans le cas o le dversement accidentel se produit durant une prcipitation, la
vanne by-pass mise en place en entre de bassin permet de rejeter les eaux de
ruissellement de la voirie directement (talweg sec du BVN n1) aprs la rcupration
de la totalit de la pollution et des eaux de ruissellement pollues.
Cette mesure permet dviter une dilution importante de la pollution dans le bassin de
stockage qui nuit lefficacit de la gestion de la dpollution : risque de surverse,
dpollution moins efficace,
6.2 SURVEILLANCE ET ENTRETIEN
Un calendrier des interventions dentretien suivies de rparations et de surveillance
sera fix pour les diffrentes oprations.
Lentretien par curage sera effectu tous les deux ans.
Toutefois, si les visites dinspection mettent en vidence un envasement prmatur des
ouvrages, les frquences de curage seront augmentes.
Les oprations de curage seront effectues par une entreprise spcialise avec toutes
les prcautions ncessaires pour maintenir ltanchit des ouvrages.
Les produits de curage et de faucardage devront ressuyer sur une aire tanche
prvue cet effet. Ils seront ensuite analyss par un laboratoire agr pour connatre
leur destination finale.
Les rsultats de ces analyses ainsi que la destination de ces produits seront
communiqus au service charg de la police des eaux.
Le contrle et lentretien des pices mcaniques (vannes notamment) seront raliss
au moins une fois lan. Les pices usages seront remplaces.
Pour viter les envasements et le blocage des vannes et ouvrages de rgulation
hydraulique, on devra assurer leur manuvre rgulire.
Les flottants et objets encombrants saccumulant devant les grilles et les seuils de
surverse, les orifices et autres singularits seront dgags.
La vanne by-pass doit tre maintenue en tat de fonctionnement (manuvre
rgulire) afin de pouvoir tre utilise de faon rapide et efficace en cas de pollution
accidentelle.
Des prlvements deau en amont et en aval du point de rejet dans le milieu naturel
seront effectus afin de pouvoir raliser des analyses pour dterminer linfluence des
eaux de rejet du produit sur la qualit des eaux.
Linspection des ouvrages sera mensuelle et les analyses seront excutes au moins
deux fois par an. Elles concerneront les paramtres tudis dans le prsent dossier :
MES, DCO, Hydrocarbures, Zinc, Cuivre, Cadmium.
PROLONGEMENT DU CONTOURNEMENT DALBERT ENTRE LA RD4929 ET LA RD938 Avril 2012 Version 2
66
Dossier Loi sur lEau | Conseil gnral de la Somme
H:\HNEW\PRODUCTION\ETUDES\L1195-80_CG80_Contournement d'Albert_Enviro\L1195_Etude\L1195_DLE\L1195_DLE_Pieces ecrites\L1195_DLE_2.doc
Les rsultats de ces analyses seront aussi communiqus au service charg de la police
des eaux.
On procdera galement une visite des ouvrages aprs chaque pisode pluvieux
important.
Les diverses oprations dentretien et de contrle sont la charge du Matre
douvrage.
PROLONGEMENT DU CONTOURNEMENT DALBERT ENTRE LA RD4929 ET LA RD938 Avril 2012 Version 2
67
Dossier Loi sur lEau | Conseil gnral de la Somme
H:\HNEW\PRODUCTION\ETUDES\L1195-80_CG80_Contournement d'Albert_Enviro\L1195_Etude\L1195_DLE\L1195_DLE_Pieces ecrites\L1195_DLE_2.doc
Partie 7. ANNEXES
PROLONGEMENT DU CONTOURNEMENT DALBERT ENTRE LA RD4929 ET LA RD938 Avril 2012 Version 2
68
Dossier Loi sur lEau | Conseil gnral de la Somme
H:\HNEW\PRODUCTION\ETUDES\L1195-80_CG80_Contournement d'Albert_Enviro\L1195_Etude\L1195_DLE\L1195_DLE_Pieces ecrites\L1195_DLE_2.doc
ANNEXE 1 : COMPTAGES AUTOMATIQUES DU 08 AU 14 FVRIER 2011
Poste Localisation TMJO TV TMJO PL %Poids Lourds
1
RD929
Sens vers Albert 2793 144 5,2%
Sens vers Bapaume 2984 144 4,8%
2
RD938
Sens vers Albert 2353 167 7,1%
Sens vers RD929 2126 76 3,6%
3
RD329
Sens vers Albert 2382 58 2,4%
Sens vers RD929 2583 140 5,4%
4
RD42
Sens vers RD929 1297 15 1,2%
Sens vers Albert 1021 26 2,5%
5 RD52
Sens vers Dermancourt 639 20 3,1%
Sens vers Albert 625 18 2,9%
6
RD929
Sens vers Albert 2158 139 6,4%
Sens vers Amiens 2021 235 11,6%
7
RD91
Sens vers Albert 538 18 3,3%
Sens vers Millencourt 536 23 4,3%
8
RD938
Sens vers Bouzincourt 2224 163 7,3%
Sens vers Albert 2173 148 6,8%
9
RD50
Sens vers Aveluy 1723 65 3,8%
Sens vers Albert 1729 76 4,4%
TMJO : Trafic Moyen Journalier Ouvr
TV : Tous Vhicules
PL : Poids Lourds
PROLONGEMENT DU CONTOURNEMENT DALBERT ENTRE LA RD4929 ET LA RD938 Avril 2012 Version 2
69
Dossier Loi sur lEau | Conseil gnral de la Somme
H:\HNEW\PRODUCTION\ETUDES\L1195-80_CG80_Contournement d'Albert_Enviro\L1195_Etude\L1195_DLE\L1195_DLE_Pieces ecrites\L1195_DLE_2.doc
ANNEXE 2 : CALCUL DES GABARITS HYDRAULIQUES DES OUVRAGES
RTABLISSANT LES EAUX DES BASSINS VERSANTS NATURELS INTERCEPTS
PROLONGEMENT DU CONTOURNEMENT DALBERT ENTRE LA RD4929 ET LA RD938 Avril 2012 Version 2
70
Dossier Loi sur lEau | Conseil gnral de la Somme
H:\HNEW\PRODUCTION\ETUDES\L1195-80_CG80_Contournement d'Albert_Enviro\L1195_Etude\L1195_DLE\L1195_DLE_Pieces ecrites\L1195_DLE_2.doc
PROLONGEMENT DU CONTOURNEMENT DALBERT ENTRE LA RD4929 ET LA RD938 Avril 2012 Version 2
71
Dossier Loi sur lEau | Conseil gnral de la Somme
H:\HNEW\PRODUCTION\ETUDES\L1195-80_CG80_Contournement d'Albert_Enviro\L1195_Etude\L1195_DLE\L1195_DLE_Pieces ecrites\L1195_DLE_2.doc
ANNEXE N3 : CALCUL DES DBITS GNRS PAR LA PLATEFORME PROJET
PROLONGEMENT DU CONTOURNEMENT DALBERT ENTRE LA RD4929 ET LA RD938 Avril 2012 Version 2
72
Dossier Loi sur lEau | Conseil gnral de la Somme
H:\HNEW\PRODUCTION\ETUDES\L1195-80_CG80_Contournement d'Albert_Enviro\L1195_Etude\L1195_DLE\L1195_DLE_Pieces ecrites\L1195_DLE_2.doc
ANNEXE N4 : CALCULS DES OUVRAGES DE COLLECTE
DES EAUX DE RUISSELLEMENT DE LA PLATEFORME
PROLONGEMENT DU CONTOURNEMENT DALBERT ENTRE LA RD4929 ET LA RD938 Avril 2012 Version 2
73
Dossier Loi sur lEau | Conseil gnral de la Somme
H:\HNEW\PRODUCTION\ETUDES\L1195-80_CG80_Contournement d'Albert_Enviro\L1195_Etude\L1195_DLE\L1195_DLE_Pieces ecrites\L1195_DLE_2.doc
PROLONGEMENT DU CONTOURNEMENT DALBERT ENTRE LA RD4929 ET LA RD938 Avril 2012 Version 2
74
Dossier Loi sur lEau | Conseil gnral de la Somme
H:\HNEW\PRODUCTION\ETUDES\L1195-80_CG80_Contournement d'Albert_Enviro\L1195_Etude\L1195_DLE\L1195_DLE_Pieces ecrites\L1195_DLE_2.doc
PROLONGEMENT DU CONTOURNEMENT DALBERT ENTRE LA RD4929 ET LA RD938 Avril 2012 Version 2
75
Dossier Loi sur lEau | Conseil gnral de la Somme
H:\HNEW\PRODUCTION\ETUDES\L1195-80_CG80_Contournement d'Albert_Enviro\L1195_Etude\L1195_DLE\L1195_DLE_Pieces ecrites\L1195_DLE_2.doc
PROLONGEMENT DU CONTOURNEMENT DALBERT ENTRE LA RD4929 ET LA RD938 Avril 2012 Version 2
76
Dossier Loi sur lEau | Conseil gnral de la Somme
H:\HNEW\PRODUCTION\ETUDES\L1195-80_CG80_Contournement d'Albert_Enviro\L1195_Etude\L1195_DLE\L1195_DLE_Pieces ecrites\L1195_DLE_2.doc
PROLONGEMENT DU CONTOURNEMENT DALBERT ENTRE LA RD4929 ET LA RD938 Avril 2012 Version 2
77
Dossier Loi sur lEau | Conseil gnral de la Somme
H:\HNEW\PRODUCTION\ETUDES\L1195-80_CG80_Contournement d'Albert_Enviro\L1195_Etude\L1195_DLE\L1195_DLE_Pieces ecrites\L1195_DLE_2.doc
PROLONGEMENT DU CONTOURNEMENT DALBERT ENTRE LA RD4929 ET LA RD938 Avril 2012 Version 2
78
Dossier Loi sur lEau | Conseil gnral de la Somme
H:\HNEW\PRODUCTION\ETUDES\L1195-80_CG80_Contournement d'Albert_Enviro\L1195_Etude\L1195_DLE\L1195_DLE_Pieces ecrites\L1195_DLE_2.doc
PROLONGEMENT DU CONTOURNEMENT DALBERT ENTRE LA RD4929 ET LA RD938 Avril 2012 Version 2
79
Dossier Loi sur lEau | Conseil gnral de la Somme
H:\HNEW\PRODUCTION\ETUDES\L1195-80_CG80_Contournement d'Albert_Enviro\L1195_Etude\L1195_DLE\L1195_DLE_Pieces ecrites\L1195_DLE_2.doc
ANNEXE N5 : CALCUL DU BASSIN DE STOCKAGE
ANNEXE N6 : CALCUL DU BASSIN DINFILTRATION
PROLONGEMENT DU CONTOURNEMENT DALBERT ENTRE LA RD4929 ET LA RD938 Avril 2012 Version 2
80
Dossier Loi sur lEau | Conseil gnral de la Somme
H:\HNEW\PRODUCTION\ETUDES\L1195-80_CG80_Contournement d'Albert_Enviro\L1195_Etude\L1195_DLE\L1195_DLE_Pieces ecrites\L1195_DLE_2.doc
ANNEXE N7 : EXTRAIT DE LTUDE GOTECHNIQUE
Vous aimerez peut-être aussi
- Mini Projet HydrologieDocument34 pagesMini Projet HydrologieNabil FtPas encore d'évaluation
- Unit Des Eaux de Surface Et Des Eaux Souterraines Principe Fondamental de La Mise en Valeur Des Ressources HydrologiquesDocument10 pagesUnit Des Eaux de Surface Et Des Eaux Souterraines Principe Fondamental de La Mise en Valeur Des Ressources HydrologiquesGhislainPas encore d'évaluation
- Ressources en Eau SouterraineDocument21 pagesRessources en Eau SouterraineHadjali LeiticiaPas encore d'évaluation
- Hydrologie Generale Sceance 1Document14 pagesHydrologie Generale Sceance 1douma eyaPas encore d'évaluation
- Monographie de La Region de Dakhla - Oued Eddahab FR - 0Document61 pagesMonographie de La Region de Dakhla - Oued Eddahab FR - 0samira habibiPas encore d'évaluation
- Prévenir Les Inondations PDFDocument36 pagesPrévenir Les Inondations PDFLamineJojoPas encore d'évaluation
- Note Hydraulique 2 Mauguio v3Document10 pagesNote Hydraulique 2 Mauguio v3Amine AlichePas encore d'évaluation
- 1 - Rappels Fondamentaux Sur L Hydrologie de BaseDocument51 pages1 - Rappels Fondamentaux Sur L Hydrologie de BaseMohamed Ilias HamaniPas encore d'évaluation
- Hydrologue Memoire Master Recherche Salif KoneDocument100 pagesHydrologue Memoire Master Recherche Salif KoneKone SalifPas encore d'évaluation
- Les Bassins Hydrauliques Du MarocDocument17 pagesLes Bassins Hydrauliques Du Maroctassili17Pas encore d'évaluation
- Délivré Par: Université Paul Valéry - Montpellier 3Document163 pagesDélivré Par: Université Paul Valéry - Montpellier 3hajar daoudiPas encore d'évaluation
- Allocation Optimale de L'eau Dans Le Bassin Versant Du Fleuve SénégalDocument84 pagesAllocation Optimale de L'eau Dans Le Bassin Versant Du Fleuve SénégalNacera BenslimanePas encore d'évaluation
- PFNL AfriquecentraleDocument103 pagesPFNL AfriquecentraleITOBA DinaPas encore d'évaluation
- A663-Conference Q100 Lez Rapport 28-09-2007 Cle05edbaDocument185 pagesA663-Conference Q100 Lez Rapport 28-09-2007 Cle05edbaJalal KePas encore d'évaluation
- Debat AbhtDocument25 pagesDebat AbhtNeverbacktohimPas encore d'évaluation
- République Algérienne Démocratique et Populaire ﻲﻤﻠﻌﻟا ﺚﺤﺒﻟاو ﻲﻟﺎﻌﻟا ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا ةرازو ﺪﯾﺎﻘﻠﺑ ﺮﻜﺑ ﻮﺑأ ﺔﻌﻣﺎﺟ - نﺎﺴﻤﻠﺗDocument101 pagesRépublique Algérienne Démocratique et Populaire ﻲﻤﻠﻌﻟا ﺚﺤﺒﻟاو ﻲﻟﺎﻌﻟا ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا ةرازو ﺪﯾﺎﻘﻠﺑ ﺮﻜﺑ ﻮﺑأ ﺔﻌﻣﺎﺟ - نﺎﺴﻤﻠﺗMaissa OuisPas encore d'évaluation
- Cahier Des RecommandationsDocument37 pagesCahier Des RecommandationsrymouachPas encore d'évaluation
- Recherche BahonDocument16 pagesRecherche BahonIng AndrePas encore d'évaluation
- Cours Hydrologie Générale - CH 02Document15 pagesCours Hydrologie Générale - CH 02abdelhamidPas encore d'évaluation
- EauDocument151 pagesEauL'IndépendantPas encore d'évaluation
- Amaane 2Document12 pagesAmaane 2HAMZA KASSIMIPas encore d'évaluation
- Cours HydraulogieDocument44 pagesCours Hydraulogieanouar100% (2)
- Livre Des Résumés-Atelier Sensibilisation 2018Document20 pagesLivre Des Résumés-Atelier Sensibilisation 2018CAKPOPas encore d'évaluation
- Crue Décennale - Bassin Inférieur À 200 KM - Afrique OccidentaleDocument48 pagesCrue Décennale - Bassin Inférieur À 200 KM - Afrique Occidentalegueyetapha77Pas encore d'évaluation
- Global MapperDocument26 pagesGlobal MapperOmar Kettani100% (1)
- Tres Imporatnat Pour Le GradexDocument30 pagesTres Imporatnat Pour Le GradexAbd Facin100% (2)
- Guide Gestion Eaux Pluviales PDFDocument386 pagesGuide Gestion Eaux Pluviales PDFAbdellatifPas encore d'évaluation
- Kouedjou Ref1 Ajira030521Document10 pagesKouedjou Ref1 Ajira030521ghaiethPas encore d'évaluation
- TFEDocument44 pagesTFEAchref ZakiPas encore d'évaluation
- Cours Sur Le Bassin VersantDocument16 pagesCours Sur Le Bassin Versantbaba abou100% (1)