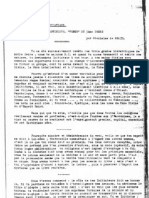Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Origine Des Formes Alphabétiques Anciennes Et Modernes: Rapports Entre Celles-Ci Et Les Hiéroglyphes Égyptiens Et Les Clés Chinoises
Origine Des Formes Alphabétiques Anciennes Et Modernes: Rapports Entre Celles-Ci Et Les Hiéroglyphes Égyptiens Et Les Clés Chinoises
Transféré par
Spartakus FreeMann0 évaluation0% ont trouvé ce document utile (0 vote)
264 vues25 pagesTitre original
Origine des formes alphabétiques anciennes et modernes : rapports entre celles-ci et les hiéroglyphes égyptiens et les clés chinoises
Copyright
© Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Formats disponibles
PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Formats disponibles
Téléchargez comme PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
0 évaluation0% ont trouvé ce document utile (0 vote)
264 vues25 pagesOrigine Des Formes Alphabétiques Anciennes Et Modernes: Rapports Entre Celles-Ci Et Les Hiéroglyphes Égyptiens Et Les Clés Chinoises
Origine Des Formes Alphabétiques Anciennes Et Modernes: Rapports Entre Celles-Ci Et Les Hiéroglyphes Égyptiens Et Les Clés Chinoises
Transféré par
Spartakus FreeMannDroits d'auteur :
Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Formats disponibles
Téléchargez comme PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
Vous êtes sur la page 1sur 25
QUATRIEME SEANCE.
(VENDRED! 21 sEPTEMBRE 1688).
Présidenee de M. le docteur C. Buovssais,
La parole est M. Moreau ve Dammantin sur cette question :
Quelle a été Vorigine des formes alphabétiques anciennes et mo-
dernes ? Quels rapports existent entre ces formes et celles des hic-
roglyphes égyptiens et des clés chinoises?
Mesdames et Messieurs, dit M. Moreau de Dammartin, les
orateurs qui nous ont précédé, quoique savants de profession,
se sont présentés & vous comme des malades ayant besoin de
ménagement; ils ont cru devoir solliciter toute votre indul-
gence. Nous quine sommes ni orateur ni savant de profession
que devons-nous faire? Protester contre une telle manie; oui,
Messieurs, dans la persuasion ou nous sommes, que, du choc
des opinions jaillit la vérité, nous osons réclamer toute la sé-
vérité de votre jugement.
Vous n’en doutez point, Messieurs, les questions sur les-
quelles nous avons lhonneur d’appeler votre attention ne sont
point du nombre de celles sur lesquelles il soit facile d'impro-
viser un travail. Le nétre, que nous regrettons d’étre forcé de
resserrer, est le résultat de plusieurs années de recherches;
cest Texposition sommaire de vingt-deux tableaux compa-
ratifs d'alphabets anciens et modernes; exposition dans la-
quelle l'origine de chacun de ces caractéres est clairement in-
diquée.
Vous y trouverez, Messieurs, que ces caractéres, sans en
excepter les clés chinoises et les hiéroglyphes égyptiens, ont
été puisés 4 une source commune, c’est-a-dire qu’ils sont'tous
dus & l'astronomie.
Nous dirons en d’autres termes que les éléments dont se
composent les alphabets employés a la représentation de la pa-
role doivent leurs formes & Fexpression linéaire de certains
groupes d’étoiles pris dans la sphére des constellations arabes ;
et que ces groupes, que les peuples ont circonscrits d'une infi-
nité de maniéres au moyen de lignes, permettent d'expliquer
Pinnombrable quantité de formes dont ces caractéres ont été
revétus.
Nous pensons que les nombreuses données contenues dans
ces explications jetteront quelque jour sur la source des tradi-
tions astronomiques, sur ce qu'il y a de mystérieux dans le
monde ancien et dans les monuments des temps primitifs.
Il n’est pas besoin de remonter & lorigine des sociétés pour
expliquer celle des alphabets; il suffit de poser en principe
qu’une nation (Egyptienne trés probablement ), voisine du tro-
pique (si fon en juge par Tes constelfations australes qui de-
vaient raser l’horison du peuple inventeur ), et dés longtemps
adonnée & linspection des astres, remarqua dans la sphére
étoilée certains groupes d’étoiles successivement parcourus par
des astres mobiles , espéce de voie & laquelle on donna Ie nom
de Zodiaque, & cause dés animaux symboliques dont eHe fut
peuplée, pour marquer la division duodécimale naturellement
indiquée par le cours de la lune eu égard a celui du soleil.
Chacune de ces divisions, subdivisée par tiers, donna lieu
aux trente-six décans, ou 4 trente-six méridiens principaux,
dont on détermina la place au moyen de quelque étoile fixe par
laquelle ils passaient; méridiens qu’on ne put rappeler 4 la
mémoire que par la circonscription exacte des groupes d’é-
toiles propres & les désigner; de méme que, pour donner un
nom chacun de ces groupes, on dut les comparer a quelque ob-
jet physique d'un rapport plus ou moins sensible. On eut donc
ainsi trente-six constellations extra-zodiacales, dont vingt-
deux affectées 4 ’hémisphére supérieur, et quatorze a Vhémis-
phére inférieur. De ces premiers, douze furent employés (chez
les Chinois, par exemple ) désigner les douze heures du jour,
ou les stations journaliéres du soleil ; les dix autres, & désigner
les dix jours compris entre chacun des méridiens. Dans la
suite, ces symboles servirent & représenter une série de chif-
fres quelconque, car Je calcul précéda l’écriture et lui fraya la
voie.
Nous n’inférerons point de la, Messieurs, que les lettres hé-
braiques ou d'autres soient des chiffres transformés en signes
phonétiques , mais bien que leurs types, étant une collection
de génies symboliques célestes, attachés successivement aux
divisions de Ia sphére, ont dd, selon lcur rang, représenter
une valeur numérique. C'est ainsi que les dix premiéres let-
tres ont servi, plus tard encore, de type & l'arithmétique dénaire
des Arabes.
Comme chacun de ces vingt-deux symboles célestes avait,
dans la langue parlée, un nom commengant par une intona-
tion plus ou moins différente, il put devenir le caractére repré-
sentatif de cette intonation; cest ainsi, du moins, que parait
sétre formée |’écriture alphabétique.
La nature de la langue chinoise fit prendre 4 son écriture
une autre direction ; ainsi, la sphére étoilée une fois peuplée
détres symboliques, qui avaient dans la langue parlée un nom
monosyllabique; image méme de cet étre, ou souvent encore
une copie du groupe d’étoiles dont il était l’équivalent, servit
& la représentation et de cet étre et de ce monosyllabe. Aussi
verrons-nous que ces vingt-deux groupes d’étoiles, placés sur
Jes vingt-deux premiers méridiens d’une sphére céleste , par-
tir du vingtiéme degré du Capricorne, et remontant ensuite
vers le Sagittaire , etc., ont prété leurs formes, non-seulement
aux vingt-deux caractéres des divers alphabets orientaux, et
aux nombreux signes phonétiques égyptiens qui leur corres-
pondent, mais encore 4 vingt-deux caractéres chinois , images
des deux cycles (celui des jours et celui des heures ) qui leur
correspondent également. Ceci nous met sur la voie de Fori-
gine des signes qui entrent dans la composition complémen-
taire des clés chinoises, des alphabets des autres nations, et
méme de ceux qui sont encore inconnus ou indéchiffrés.
Parcourons rapidement la liste comparative des groupes cé-
lestes, classés d’aprés le systéme chinois, répondant exacte-
ment a la classification hébraique :
1° Le tseu(2059) (1), premier caractére du cycle chinois, ré-
pond au aleph des Hebreux, 4 l’alpha des Grecs; il doit comme
eux ses formes variées a la constellation de la Grue, voisine
du Poisson austral , de la sphére orientale ;
2° Le tcheou chinois (13), le beth hébreu et le B latin, em-
pruntent les leurs a la téte du Bélier des Signes, paranatellon
au Capricorne.
3° Le yn chinois (2146), le ghimel hébreu et le G latin, a
la constellation de la grande Ourse;
4° Le mao chinois (1030 ), le daleth hébreu et Je D latin, aa
Triangle boréal ;
5° Le chin chinois (10987), le hé des Hébreux et le éw
grec, 4 ’Autel austral et au Sagittaire;
6° Le ssé chinois (2396), le vau hébreu et le F latin, a la
queue du Scorpion des Signes ;
7° Le ouchinois (gg9), le zain hébreu et le Z latin, au penta-
gone du Cocher celeste ;
(1) Ges chiffres indiquent et indiqueront dans tout le cours de ce mémoire
ceux sous lesquels on trouve chaque caractére dans le dictionnaire Chinois-
Francais de Basile de Glemona, publié par M. de Guignes.
8° Le hoey chinois (4059), le het hébreu et le he grec, a un
groupe voisin de PAutel austral ;
9° Le chin chinois (6172), le thet hébreu et th grec, su
groupe du Reene sous Cassiopée et au Cercle poleire arctique;
10° Le yeou chinois (11277), le iod hébreu et le I Jatin, au
quadrilatére de la petite Ourse et aux étoiles voisines du Péle;
11° Le qu chinois (3172), le caph hébreu et le K latin, a la
Chaise de Cassiopée;
12° Le hay chinois (81), Ie lamed hébreu et le L latin, & la
constellation du Loup du Centaure;
13° Le kia chinois (6172), le men hébreu et le M tatin, ala
constellation du Bouvier;
14° Le Y chinois (50), le noun hébreu et le N latin, au lien
austrai des Poissons et d’un groupe voisin ;
15° Le ping chinois (18), le samech hébreu et le ch grec, au
groupe intérieur du carré de Pégase;
16° Le ting chinois (2), le ain hébreu et le O Jatin, & la téte
du grand Chien, ou 4 Sirius, et aux étoiles voisines;
17° Le meou (3170) chinois, le phe des hébreux, le pi grec
et le P latin, a la constellation du Corbeau ;
18° Le ki chinois (2394), le tzad hébreu et le ts grec, au col
de I’Hydre céleste coupé par ’équateur ;
19° Le keng chinois (2512), le quoph hébreu et le Q latin, &
lacoupe des constellations;
20° Lesin chinois (1096), le resch hébreu et le R latin, & la
téte de I’'Hydre;
21° Le gin chinois (1760), le sin hébreu et leS latin, au
Liévre d'Orion.
aa° Le kouey chinois (6479), le tau des hébreux, derniers
caractéres des collections chinoises et hébraiques, empruntent
enfin les leurs 4 la constellation dela Lyre et du Vautour.
Ces explications, qui s’appliquent également aux hi¢rogly-
phes phonétiques correspondant aux lettres hébraiques, grec-
ques, ou latines, confirment pleinement les interprétations de
M. Champollion le jeune, si digne des regrets des savants.
Vous comprendrez, Messieurs, l’importance des inductions
que l’on peut tirer de nos principes touchant lorigine des clés
chinoises, des lettres hébraiques, des hiéroglyphes phonétiqnes
et figuratifs égyptiens, etc. Ces inductions ne se bornent pas
aux symboles précités; elles s’étendent aux traditions antiques,
aux monuments mvstiques, allégoriques, etc., de divers peuples
anciens. Elle se rattachent a lorigine fabuleuse de quelques
personnages qui figurent dans les temps antchistoriques de la
Chine et dans la mythologie des Egyptiens et des Grecs.
Nous citerons Ja mosaique de Palestrine, monument dans
lequel nous avons vu deux tableaux, l'un, supérieur, image de
la sphére des constellations; l'autre, inférieur, espéce d’alma-
nach symbolique de l’année civile;
Le monument curieux 4 plus d’un titre, gravé sur un rocher
de Taunston dans l’Amérique septentrionale, et dans lequel
nous avons reconnu un théme astronomique ou un hémisphére
céleste supérieur, et le tracé linéaire de plusieurs constellations
de la sphére orientale ;
La pierre babylonienne, du cabinet des médailles, dans la-
quelle nous avons reconou un zodiaque oriental accompagné
de quelques paranatellons ;
Le bas-relief, dit de l’apothéose d’Homére , espéce d'élage-
bale ou pierre du soleil, offrant les douze mois personnifiés
dans Apollon, les neuf Muses, Jupiter et Janus, et plus bas
la célébration des Cronies, ou fétes du temps révolu ;
La premiére planche de histoire du Mexique par figures,
dans laquelle nous avons reconnu un hémisphére supérieur et
les dix constellations @ formes humaines de la sphére arabe;
personnages considérés la comme princes fondateurs de l’em-
pire mexicain, et ayant tous des noms qui s’expliquent facile-
ment par la langue grecque, ou plutdt par les noms de ses
génies mythologiques.
Létade que nous avons faite du jeu des tarots égyptiens
nous ayant conduit 4 découvrir l’analogie qui existe entre ses
vingt-deux atouts ou cartes figurées, et les vingt-deux carac-
téres alphabétiques orientaux tirés de la sphére céleste orien-
tale et rangés dans le méme ordre, nous avons di: joindre a
chacun de nos tableaux l’explication d’une de ces cartes.
Cycle chinois des heures ou des douze chin (10987), servant a la
description des douze premieres lettres des alphabets orien-
taux.
Premier Tableau. (Aleph hébreu.) La lettre A, premier ca~
ractére des alphabets anciens et modernes, répond au tseu chi-
nois (2059), premier caractére du cycle des heures. Ces diffé-
rents caractéres doivent leurs formes diverses & des uracts de
lignes circonscrivant les étoiles dont se compose la constellation
de la Grue, voisine du Poisson austral de la sphére orientale.
En général, inspection de nos tableaux comparatifs fera
mieux comprendre qu’une longue explication les changements
de formes qu’ont subis les caractéres a diverses époques et chez
les différents peuples (1).
On verra dans le pretnier de ces tableaux que le tseu chinois,
prononcé si au Japon, et signifiant filiation, fils , enfant, nour-
risson, a pu, dans ses formes antiques, répondre au hiéroglyphe
égyptien ci, enfant; on verra comment cet enfant, assis sur le
lotus au zodiaque circulaire de Dendra, y est le symbole du
soleil naissant ; comment loie, animal au long col comme la
grue, a pu devenir le hiéroglyphe homophone de ce dernier ;
comment l’ibis, également au long col, a pu préter ses formes
au aleph hiéroglyphique , et comment enfin les autres formes
ont pu en étre déduites.
Une forme complexe du tseu chinois (2063 bis, Klaproth )
offre la clé tchouen des fleuves, torrents (2380). Le vase du
Verseau, formé de trois étoiles et d’ou s’échappe un fleuve ,
explique lorigine de cette clé, source elle-méme des aleph
égyptiens, persépolitaias, thibétains, arméniens, illyriens, etc.
La clé tseu, simple ou complexe, mais recouverte de la clé
mian des combles, fondements, etc. (2065, 2076), signifie
caractére , lettre, produire; i| était bien naturel que le carac-
tére initial d'une collection de signes phonétiques se chargeat
de ces valeurs; c’est toujours par les noms des premiers élé-
ments de ces collections qu’elles ont été désignées.
(1) Les tableaux circulent dans l’assembkéc.
Les diverses difections données a l’écriture ont dénaturé
une partie des lettres. Cette diversité, dont on n’a pu jus-
qu’ici donner de bonnes raisons, s’explique par la manitre
dont on a lu les signes célestes, soit & mesure qu’ils se levaient
a Vhorison ou les uns au-dessus des autres, a la maniére des
Chinois, soit dans le sens que le soleil les parcourt, ou de
droite 4 gauche, soit en les lisant sur un planisphére ou de
gauche a droite, soit enfin en boustrophédon, ou comme les
beeufs labourent, ce que l’on doit entendre des Ourses célestes
qui semblent labourer autour du péle , Pune a droite et Vautre
& gauche.
La valeur attribuée au aleph hébreu , boeuf, voie, institution,
parait indiquer que l’alphabet fut composé a I’époque ot le
Taureau était équinoxial , cest-a-dire il y a environ 4,400 ans.
Ce taureau est celui qui servait de monture au dieu soleil
invincible ou au Mithra des Perses, et trés probablement au
Lao-tseu des Chinois, le Roo-si des Japonais.
La mére de Lao-tseu , errante comme Danaé, congut son fils
par l’influence d’une grande étoile ; il naquit sous un prunier,
dont il porta d’abord le nom dy (4086), et auquel on ajouta le
mot eulh, oreille (8337), a cause, dit-on, de la grandeur déme-
surée de ses oreilles. Mais le nom de Persée vient du Persea
(prunitera arbor), et Jes ailes dont on orne sa téte équivalent
a des oreilles, Lao-tseu est comme Persée, armé d'un harpé
ou sabre recourbé a deux tranchants, Il est comme Mithra et
Persée , sur un boeuf aérien , symbole du taureau céleste.
La premiére carte du tarot qui répond & la premiére lettre
hébraique offre l'image d'un escamoteur faisant des opérations
magiques a l'aide de la baguette des Mages ou baste, d’oii vient
le nom de bateleur. Ce bateleur offre une des formes revétues
par Persée , et les hords énormes de son chapeau sont dus aux
étoiles qui ont fourni et les ailes du Persée grec et les oreilles
du Lao-tseu chinois. La baste est motivée par le groupe qui
surmonte Je triangle boréal , et dont la direction indique sur le
méridien l’étoile de la ceinture de Persée, dont on a fait la
muscade a escamoter, mise dans la main gauche du bateleur.
Cette baste, dans les hiéroglyphes, représente Vidée oueri,
beri, alné, premier, chef, commandant. Elle a paru étre une
bourse 4 M. Champollion.
Deuzxizme Tableau. (Beth.) Les beth alphabétiques et ie
tcheou chinois (13), symbole de la deuxiéme heure, prennent
leurs formes des étoiles de la téte du Bélier des signes; ils ont
donc pour but de désigner Je méridien qui sépare le Bélier des
Poissons, lequel méridien , passant par la jambe du bootés, a
Aonné lieu a tirer des étoiles de cette jambe plusieurs beth hié»
roglyphiques.
Il est a remarquer que de la constellation du Bélier on ob-
tient Ja figure parfaite d’un bélier accroupi. Cette forme n'a
point échappé aux anciens; le bélier de la pierre de Taunston
en Amérique offre une contexture & peu prés semblable, ce
qui n'empéche point sa partie supérieure de présenter la forme
exacte d’un tcheou chinois antique. :
Remarquez encore , Messicurs , que les Egyptiens ont repré-
senté la consonnance B par un bélier parfait , ou par une téte
de béllier, ou par des cassolettes dont la forme singuliere est
due aux étoiles de la téte du Bélier céleste.
La deuxiéme carte du tarot représente une femme ayant la
téte am milieu d’un voile carré, et tenant un livre. Ne serait-ce
point Androméde, dont Vhistuire est liée a celle de Perse? et
Yétoile de la téte d’Androméde faisant partie du quadrilatére
de Pégase ne motiverait-elle pas le voile?
Trotsieme Tableau. (Ghimel.) La grande Ourse explique les
ghimel alphabétiques et la clé chinoise tao (740) des épées ,
glaives, couteaux, etc.
Le yn dans ses formes complexes fait allusion aux deux Our-
ses séparées par une fléche symbolique, image du colure qui
les divise, et explique la valeur épée donnée au tao. C’est cette
épée qu’on voit en main de l’animal typhonien remplagant la
grande Ourse au zodiaque circulaire de Dendra.
Dans la distribution des lettres sur les méridiens de la sphere
céleste, celui qui est attribué au ghimel passe par les pieds de
devant de la grande Ourse; aussi les étoiles dont ils sont for-
més ont-elles fourni les patéres higroglyphiques, images du
ghimel.
Les Hébreux traduisent ghimel par chameau, mais cet ani-
mal, cause de sa conformité avec le zébu, boeuf asiatique, te-
nant lieu, sous le nom de yabous, de la grande Ourse dans lz
mosaique de Palestrine , a puy étre employé concurremment.
C’est ainsi que le Bootés, gardien des Ourses, est quelquefois
surnommé le Chamelier.
Quatriéme Tableau. (Daleth.) Le daleth alphabétique et le
mao chinois (1030), symboles de la quatriéme heure , doivent
leurs formes au triangle boréal placé en téte du Beélier céleste.
Ce triangle, qui dans le planisphére égyptien de Kircher est in-
titulé porta Deorum (parceque la s’opére le passage des astres
de V’hémisphére inférieur 4 "hémisphére supérieur), explique
la valeur attribuée au daleth hébreu, janua, porta, fores ; et au
mao chinois , portes ouvertes.
Le mao explique les daleth doubles de certains alphabets ;
son dédoublement a fourni la clé tsie (1026) , retrancher , di-
viser, valeur qui s’explique par la position du triangle, eu
égard au point initial des signes.
Cingquiéme Tableau. (Hé.) Le chin ch:nois (10987), image
de la cinquitme heure, est un caractére complexe qui tire ses
formes de l’Autel austral, voisin de l’arc du Sagittaire , lequel
a fourni le hé des Orientaux et la clé chinoise kong (2614) des
arcs dont les formes anciennes offrent un are parfait, et dont
une variante prononcée yn (2616) est donnée comme équiva-
lent du chin ou de la cinquiéme heure. Le*cing arabe, pris
comme les hé de l'are du Sagittaire, se confond avec les formes
antiques du kong chinois.
Sixiéme Tableau. (Yau.) Le tau, sixitme lettre hébraique,
et le ss¢ chinois (2396), symbole de la sixigme heure , doivent
leurs formes aux étoiles de la queue du Scorpion, dont la dis-
position en ligne courbe confirme la valeur crochet, attribuée
au vau des Hébreux. Ce groupe explique tous les vau alphabé-
tiques et hiéroglyphiques, etc.
Septieme Tableau. (Zain.) Le ou chinois (999), symbole de
ja septiéme heure, et le zain, septidme lettre hébraique , pren-
nent leurs formes des étoiles principales du Cocher céleste, et
désignent le méridien qui passe par l’étoile dle l’extrémité de la
corne du Taureau des signes, laquelle fait partie du pentagone
du Cocher.
La position de ce groupe, qui tient le milieu du ciel, expli-
qve les diverses valeurs attribuées aux caractéres qui y ont
puisé leurs formes : ainsi le ou chinois est rendu par midi,
milieu du jour.
La constellation du Cocher, dans laquelle on place tous les
personnages mythologiques qu'on suppose avoir été les inven-
teurs des chars ou les conducteurs du char du soleil, est aussi
celle qui a servi de type au char de l’Osiris triomphant repré-
senté sur la septitme carte du tarot. Nous attribuons & la
méme constellation les hiéroglyphes symboliques hebai, tra-
druits par congrégation, panégyrie, dont la partie inférieure
offre le vase neb, traduit par curios, seigneur, hiéroglyphe
devant ainsi ses formes aux trois étoiles inférieures du penta-
gone du Cocher. Nous lui attribuons encore les coffres de la
représ entation, ou corbeilles mystérieuses, dans lesquelles on
plagait l’enfant et le serpent symboliques confi¢s a la garde des
filles d’Erechtée, c’est-a-dire aux Hyades, filles du cocher
Erichton. Neus pouvons encore citer la tour de Danaée, la
tour ou Maison- Dieu , représentée sur la seiziéme carte du ta-
rot, ou l’on voit une tour qui répond 4 la corbeille de la re-
présentation, une couronue inclinée qui répond au couvercle
de la corbeille, et un rameau d’or rappelant le serpent qui s’en
échappe. Au pied de la tour on voit les Gémeaux, dont la chute
rappéle celle de Phacton, une des formes du Cocher, cane-
vas sur lequel a été brodée l'histoire d’Hippolyte fils de Thésée,
et celle du prince égyptien Rampsinit ou Ramsés, dont le tré-
sor, renfermé dans une tour, est dérobé par les fils de l’archi-
tecte qui I’a batie, lesquels, au rapport d’Hérodote, volent le
prince et se précipitent du haut de la tour. Nous citerons en-
core Phistoire plus singuliére rapportée par Vigénére, lequel ,
traitant de divers alphabets, s’exprime ainsi. « Il n’y a guére
dapparence d’avoir attribué un alphabet a Virgile Ie philo-
sophe, dont il se raconte des fables trop ridicules , comme
davoir été laissé suspendu dans une corbeille a mi-¢iage d'une
tour fort haute, par une dame a qui il voulait faire l'amour; mais,
pour s’en venger, il fit éteindre par son art tout le feu qui était
dans Rome, sans qu’il fit possible d’en rallumer sion ne Vallait
chercher és parties secrétes de cette moqueuse, et encore le mal
était de ne pouvoir le communiquer l'un a Vautre, parceque
soudain il s'amortissait ; avec semblables réveries pour entrete-
nir les vieilles et les petits enfants. » Le méme auteur s’étonne
de ce que certains caractéres alphabétiques ont pu étre nom-
més géomantiques, la géomantie étant, dit-il, « la projection
de quelques points guidés par la constellation qui régne, les-
quels points sont réduits ensuite en des lignes accommodées 2
des figures dont on tire les prédictions selon l'art. » Ce passage
curieux, véritable définition de l’origine des lettres , confirme
trop notre théorie pour que nous nous soyons dispensé de le
rapporter.
La constellation du Cocher exptique le hi¢roglyphe figuratif
image des combats, offrant deux bras armés, lun d'un bou-
clier et l'autre d’un glaive, rappelant la valeur du zain hebreu,
trait, armes, glaive; le groupe de la main droite explique le
pedum hiéroglyphique, la houlette des bergers, le baton pas-
toral des Grecs, la crosse des évéques , etc. Nous y trouvons
Yorigine du tsy (3), ou chiffre sept des Chinois, de la clef yang
des chévres (8183). Mais le Cocher porte une chévre et ses
chevreaux. Il est surnommé Haiok, Eega, Aix, la chévre, et
Hiksos, le pasteur de chévres, nom porté par la dynastie des
rois pasteurs égyptiens. Il est le méme que Je dieu Pan, pro-
tecteur des jardins et des troupeaux. Il est le méme encore que
Je fabuleux empereur Fou-Hy, fondateur de la Chine, oi 'on
suppose qu’il régna cent quarante ans, et & qui on aitribue
Vinvention du zodiaque, de l'alphabet, du calendrier, la con-
naissance de l’agriculture, de la vertu des plantes, de la mu-
sique, etc. On Jui attribue aussi les koua, ou les buit sym-
boles, comme on attribue au Thot égyptien les huit lettres
divines.
Les formes qu’on attribue 4 Fou-Hy sont celles du Cocher
véleste, des cornes, une téte de boeuf, des pieds terminés en
serpents, etc. Si le Cocher est lié au quadrilatére de Pégase,
orienté comme les quatre parties du monde, Fou-Hy voit sur
Ie dos d’un dragon-cheval les traces dont il forme les koua,
orientés également, et c'est ce quon appelle le 4o-tou, ou la
table sortie du fleuve , du lac profond, image de I’Hypocréne.
Une derniére preuve de l'identité du Cocher céleste comme
type de Fou-Hy, c'est l’image de ce dernier, dont les formes,
singuliérement caractérisées, s’expliquent par un simple tracé
de la constellation, ot se retrouvent sa figure écrasée, sa barbe
triangulaire , les protubérances de son crane, ete.
Huitieme Tableau. (Het.) Le het, ou aspiration forte, tire
ses formes d’un groupe de huit étoiles situces entre l’Autel et le
Triangle austral. Le oey chinois (4061), symbole de la huititme
heure, et qui offre les idées d’arbre fleuri ou d’arbre a fruit,
peut étre comparé au triple rameau dont le tableau supérieur
de la mosaique de Palestrine offre une image fort curicuse,
image dont le groupe du het et le Triangle austral sont le type
essentiellement mystique. Cet arbre porte pour fruit un cyno-
eéphale, embléme du soleil naissant : aussi en Chine le carac-
tére lieou (4188), composé de la clef mo, des arbres et du mao,
image du Triangle boréal employé ici par analagie avec le Trian-
gle austral, est-il traduit par salix (saule); cest aussi le nom
dune constellation australe de la sphére chinoise, qu’on dit
étre de huit étoiles, et qui ne peut étre ainsi qu’une désigua-
tion de notre groupe du het.
La huitiéme carte du tarot est Thémis ou la Justice, qui, a
Vimitation de la Vierge cdleste, mére du soleil, tient une ba-
lance.
La neuviéme carte est |'Hermile ou le Sage, qui, la lanterne
en main, cherche un homme en plein midi.
A-t-on examiné jusqu’a quel point on peut ajouter foi 4 ce
que la tradition raconte de Diogéne le cynique? Ne serait-it
que la personnification d'un génie céleste? Le neuviéme décan
égyptien, au zodiaque circulaire de Dendra, offre ]'Autel aus-
Vous aimerez peut-être aussi
- Rituel de Leglise Gnostique ChaoteDocument65 pagesRituel de Leglise Gnostique ChaoteMichel Mangin100% (4)
- Alphabet CelesteDocument22 pagesAlphabet CelesteSpartakus FreeMann92% (13)
- Grand ExorcismeDocument12 pagesGrand ExorcismeSpartakus FreeMann92% (12)
- L'Esclave Magique Par S. de GuaitaDocument39 pagesL'Esclave Magique Par S. de GuaitaEzoOccult80% (5)
- Discours MarconsiDocument32 pagesDiscours MarconsiJCTCHIOUFOU100% (1)
- Tritheme Alphabet Enn'agrammatonDocument14 pagesTritheme Alphabet Enn'agrammatonSpartakus FreeMann100% (1)
- Les Carrés Magiques Dans La Talismanie D'agrippaDocument19 pagesLes Carrés Magiques Dans La Talismanie D'agrippaSpartakus FreeMann90% (10)
- Ordination Grand Elu Zorobabel CompletDocument17 pagesOrdination Grand Elu Zorobabel CompletSpartakus FreeMann100% (9)
- Ordination Reau+CroixDocument25 pagesOrdination Reau+CroixSpartakus FreeMann100% (8)
- Amphitheatre de La SagesseDocument62 pagesAmphitheatre de La SagesseSpartakus FreeMann100% (1)
- Della Porta de Distillation de Distillationibus 1609Document100 pagesDella Porta de Distillation de Distillationibus 1609JanWillPas encore d'évaluation
- Lexi Que KelDocument174 pagesLexi Que KelSpartakus FreeMannPas encore d'évaluation
- Serpent Fabre D OlivetDocument3 pagesSerpent Fabre D OlivetSpartakus FreeMannPas encore d'évaluation
- Occult Is Me - Kabbale - Le Livre Des NomsDocument7 pagesOccult Is Me - Kabbale - Le Livre Des Nomsmoisejerry100% (2)
- Profession de Foi GnostiqueDocument4 pagesProfession de Foi GnostiqueSpartakus FreeMannPas encore d'évaluation
- Guematria Temourah Et Notariqon Par Spartakus FreeMannDocument9 pagesGuematria Temourah Et Notariqon Par Spartakus FreeMannSpartakus FreeMann100% (1)
- Les Illumines Avignon Par BricaudDocument68 pagesLes Illumines Avignon Par BricaudSpartakus FreeMann75% (4)
- Une Mise Au Point Concernant L'eglise Gnostique ChaoteDocument9 pagesUne Mise Au Point Concernant L'eglise Gnostique ChaoteSpartakus FreeMann100% (1)
- Liber PrimusDocument16 pagesLiber PrimusMario FilhoPas encore d'évaluation
- Les Esprits Supérieurs - Noms-De-Dieu Chapitre 2Document7 pagesLes Esprits Supérieurs - Noms-De-Dieu Chapitre 2Spartakus FreeMann100% (1)
- Dante Par PeladanDocument55 pagesDante Par PeladanEric LizeulPas encore d'évaluation
- L Enfant HermaphroditeDocument40 pagesL Enfant HermaphroditeEzoOccultPas encore d'évaluation
- Leo Taxil Diana VaughanDocument22 pagesLeo Taxil Diana VaughanSpartakus FreeMann100% (1)
- Le Sanctuaire de Memphis Ou HermèsDocument277 pagesLe Sanctuaire de Memphis Ou HermèsSpartakus FreeMann75% (4)
- Discours Initiatique Martiniste Par S. de GuaitaDocument3 pagesDiscours Initiatique Martiniste Par S. de GuaitaEzoOccultPas encore d'évaluation
- Bonnerot Jean-Pierre - Satan, Lucifer, Le Prince de Ce MondeDocument49 pagesBonnerot Jean-Pierre - Satan, Lucifer, Le Prince de Ce MondeRabo Magagi AboubacarPas encore d'évaluation
- (Alchimie) Nicolas Flamel - Le Sommaire PhilosophiqueDocument8 pages(Alchimie) Nicolas Flamel - Le Sommaire PhilosophiquemeauPas encore d'évaluation
- Noms de Dieu Chapitre 1Document12 pagesNoms de Dieu Chapitre 1Spartakus FreeMann100% (3)
- Fond de La Boite de Pandore La Figure Du Baphomet ChretienDocument16 pagesFond de La Boite de Pandore La Figure Du Baphomet ChretienMario FilhoPas encore d'évaluation
- Dialogue Entre La NatureDocument52 pagesDialogue Entre La NatureEzoOccultPas encore d'évaluation