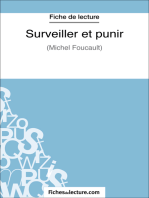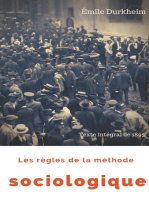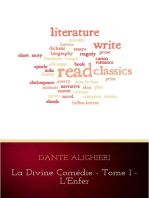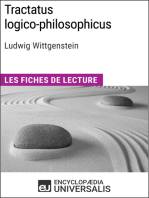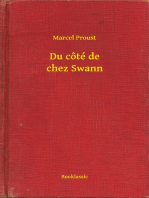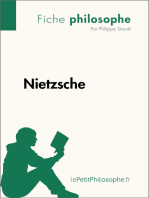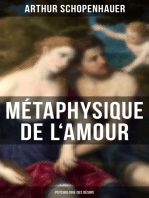Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Foucault - Histoire de La Sexualité I
Foucault - Histoire de La Sexualité I
Transféré par
Virginia RubioTitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Foucault - Histoire de La Sexualité I
Foucault - Histoire de La Sexualité I
Transféré par
Virginia RubioDroits d'auteur :
Formats disponibles
Michel Foucault
Histoire
de la sexualit
1
La volont
de savoir
Gallimard
titions Galimar, 1976.
1
Nous autres, victoriens
Longtemps nous auri ons support, et nous subi
rions auj ourd' hui encore, un rgime victorien.
L'impriale bgueule fgurerait au blason de notre
sexuali t, retenue, muette, hypocrite.
Au dbut du XVII
e
sicle encore, une certaine
franchise avait cours, di t on. Les pratiques ne
cherchai ent gure l e secret ; l es mots se disaient
sans rti cence excessive, et les choses sans trop de
dguisement ; on avait, avec l'illicite, une familia
rit tolrante. Les codes du grossier, de l ' obscne,
de l'indcent taient bien lches, si on les compare
ceux du XIX
e
sicl e. Des gestes directs, des dis
cours sans honte, des transgressions vi sibles.
des anatomies montres et facilement mles, des
enfants dlurs rdant sans gne ni scandale
parmi l es rires des adultes : les corps ( ( fai saient
la roue l,
A ce plei n jour, un rapi de crpuscule alrait fait
suite, jusqu' aux nui ts monotones de la bourgeoi
sie victorienne. La sexualit est alors soigneuse
ment renferme. El le emmnage. La famille conju
gale l a confsque. Et l ' absorbe tout entire dans le
10 La volont de savoir
srieux de la fonction de reproduire. Autour du
sexe, on se tait. Le couple, lgitime et procrateur,
fait la loi . Il s' impose comme modle, fait valoir
la norme, dtient l a vrit, garde l e droit de par
ler en se rservant le principe du secret. Dans
l'espace social, comme au cur de chaque mai
son, un seul li eu de sexualit reconnue, mais
utilitaire et fcond : la chambre des parents.
Le reste n' a pl us qu' s' estomper; l a convenance
des attitudes esquive les corps, la dcence des
mots blanchit les discours. Et le strile, s'il
vient insister et trop se montrer, vire l' anor
mal : il en recevra le statut et devra en payer
les sanctions.
Ce qui n' est pa. s ordonn la gnration ou
transfgur par elle n
'
a pl us ni feu ni loi. Ni verbe
non plus. A l a foi s chass, dni et rduit au
silence. Non seulement a n' existe pas, mais a
ne doit pas exi ster et on l e fera disparatre ds la
moindre manifestation - actes ou paroles. Les
enfants, par exemple, on sait bien qu' ils n' ont pas
de sexe : raison de le leur interdire, raison pour
dfendre qu'ils en parlent, raison pour se fermer
les yeux et se boucher les oreilles partout o ils
viendraient en faire montre, raison pour imposer
un silence gnral et appliqu. Tel serait le propre
de la rpression, et ce qui la distingue des inter
dits que maintient la simple loi pnale : elle fonc
tionne bien comme condamnation disparatre,
mais aussi comme injonction de silence, afrma
tion d' inexistence, et constat, par consquent,
que de tout cela il n'y a rien dire, ni voir,
ni savoir. Ainsi, dans sa logique boiteuse,
Nous autres, victoriens 1 1
irait l'hypocrisie de nos socits bourgeoises.
Force cependant quelques concessions. S'il
faut vraiment faire place aux sexualits illgi
times, qu'elles aillent faire leur tapage alleurs :
l o on peut les rinscrire sinon dans les circuits
de la production, du moins' dans ceux du proft.
La maison close et la mai son de sant seront ces
lieux de tolrance : l a prostitue, le client et le
souteneur, le psychiatre et son hystrique ces
autres vctoriens)) dirat Stephen Marcus
semblent avoir subrepticement fait passer le plai
sir qui ne se dit pas dans l 'ordre des choses qui
se comptent ; les mots, l es gestes, autoriss alors
en sourdine, s'y changent au prix fort. L seule
ment le sexe sauvage aurait droit des formes
de rel, mais bien insulari ses, et des types de
di scours clandesti ns, circonscrits, cods. Partout
ailleurs le puritani sme moderne aurait impos
son triple dcret d'interdiction, d'inexi stence et
de muti sme.
De ces deux l ongs sicl es o l'histoire de l a
sexualit devrait se lire d' abord comme l a chro
nique d'une rpression croi ssante, serions nous
afranchi s? Si peu, nous dit-on encore. Par Freud,
peut tre. Mais avec quelle circonspection, quelle
prudence mdical e, quelle garantie scientifque
d'innocuit, et combien de prcauti ons pour tout
maintenir, sans crainte de W dbordement dans
l'esps.ce le pl us sr et l e plus di scret, entre divan
et discours : encore l chuchotement proftable
sur un lit. Et pourrait il en tre autrement? On
nous explique que, si la rpression a bien t,
depuis l'ge classique, le mode fondamental de
12
La volont de savoir
liaison entre pouvoir, savoir et sexualit, on ne
peut s' en afranchir qu' un pri x considrable : il
n'y faudrait pas moins qu' une transgression des
l oi s, une l eve des interdits, une irruption de l a
parole, une restitution du plai sir dans l e rel, et
toute une nouvelle conomie dans les mcani smes
du pouvoir ; car l e moindre clat de vrit est sous
condition politique. De tel s efets, on ne peut
donc les attendre d'une simpl e prati que mdi
cale, ni d'un di scours thori que, ft-il rigoureux.
Ainsi dnonce t-on le conformisme de Freup, les
fonctions de normali sation de l a psychanalyse,
tant de timidit sous l es grands emportements de
Reich, et tous l es efets d'intgration assurs par
l a !l science )) du sexe ou l es prati ques, peine
louches, de la sexologie.
Ce di scours sur l a moderne rpression du sexe
tient bien. Sans doute parce qu' il est facile tenir.
Une grave caution hi storique et politique l e pro
tge ; en fai sant natre l'ge de la rpression au
XVII
e
sicle, aprs des centaines d' annes de plein
air et de libre expressi on, on l ' amne coincider
avec le dveloppement du capitali sme : il ferait
corps avec l' ordre bourgeoi s . La petite chronique
du sexe et de ses brimades se transpose aussitt
dans l a crmonieuse histoire des modes de pro
duction; sa futilit s'vanouit. Un principe d' expli
cation se dessine du fait mme : si le sexe est
rprim avec tant de rigueur, c' est qu'il est incom
patible avec une mi se au travail gnrale et inten
sive ; l' poque o on exploite systmatiquement
l a force de travail, pouvait on tolrer qu' elle aille
s' gailler dans les plai sirs, sauf dans ceux, rduits
Nous autres, victoriens 1 3
au minimum, qui lui permettent de se reproduire?
Le sexe et ses efets ne sont peut-tre pas faciles
dchifrer; ainsi resitue, l eur rpression, en
revanche, s' analyse ai sment. Et l a cause du sexe
- de sa libert, mai s aussi de l a connaissance
qu
on en prend et du droit qu' on a d' en parler
se trouve en toute lgitimit rattache l'honneur
d' une cause politique : le sexe, lui aussi , s'inscrit
dans l' avenir. Un esprit souponneux se demande
rait peut tre si tant de prcauti ons pour donner
l' histoire du sexe un parrainage aussi consi d
rabl e ne portent pas encore la trace des vieil les
pudeurs : comme s' il ne fall ait pas moins que ces
corrlati ons valorisantes pour que ce discours
pui sse tre tenu ou reu.
Mai s i l y a peut tre une autre raison qui rend
pour nous si gratifant de formuler en termes de
rpression les rapports du sexe et du pouvoir: ce
qu' on pourrait appeler le bnfce du locuteur. Si
le sexe est rprim, c' est dire vou l a prohi
bition, l'inexi stence et au mutisme, l e seul fait
d' en parler, et de parler de sa rpression, a comme
une allure de transgression dlibre. Qui tient ce
langage se met jusqu' un certai n point hors pou
voir ; il bouscule la loi ; il antici pe, tant soit peu, l a
libert future. De l cette solennit avec laquelle
aujourd' hui , on parle du sexe. Les premiers dmo
graphes et les psychiatres du XIX
e
sicl e, quand ils
avaient l' voquer, estimaient qu'ils devaient se
faire pardonner de retenir l ' attention de l eurs
lecteurs sur des suj ets si bas et tellement futiles.
Nous, depui s des di zaines d' annes, nous n' en
parlons gure sans prendre un peu l a pose :
14 La volont de savoir
conscience de braver l ' ordre tabli , ton de voix
qui montre qu'on se sait subversif, ardeur
conjurer le prsent et appeler un avenir dont on
pense bi en contribuer hter le jour. Quelque
chose de l a rvolte, de l a libert promise, de l' ge
prochain d' une autre loi passe aisment dans ce
di scours sur l ' oppression du sexe. Certaines des
vieilles fonctions traditionnelles de la prophtie
s ' y trouvent ractives. A demain le bon sexe.
C'est parce qu' on afrme cette rpression qu' on
peut encore faire coexi ster, discrtement, ce que
la peur du ridicule ou l' amertume de l 'histoire
empche l a plupart d' entre nous de rapprocher :
la rvolution et le bonheur; ou la rvolution et un
corps autre, plus neuf, plus beau; ou encore la
rvolution et le plaisir. Parler contre les pouvoirs,
dire l a vrit et promettre la jouissance ; li er l'un
l ' autre l' illumination, l' afranchissement et des
volupts multiplies ; tenir un discours o se
joignent l' ardeur du savoir, la volont de changer
la loi et le jardin espr des dlices - voil qui
soutient sans doute chez nous l ' acharnement
parler du sexe en termes de rpression; voil qui
explique peut-tre aussi la valeur marchande
qu'on attribue non seulement tout ce qui s'en
dit, mai s au simple fait de prter une oreill e ceux
qui veulent en lever les efets. Nous sommes , aprs
tout, la seule civili sati on o des prposs reoivent
rtribution pour couter chacun faire confdence
de son sexe : comme si l' envie d' en parler et l'in
trt qu'on en espre avaient dbord largement
les possibilits de l 'coute, certains mme ont mis
leurs oreill es en locati on.
Nous autres, victoriens 15
Mai s pl us que cette incidence conomique, me
parat essenti elle l ' existence notre poque d' un
di scours o l e sexe, l a rvl ation de l a vrit, l e
renversement de la loi du mondeq l'annonce d'un
autre jour et l a promesse d' une certaine flicit
sont lis ensemble. C' est le sexe aujourd'hui qui
sert de support cette vieille forme, si familire
et si importante en Occident, de la prdication
Un grand prche sexuel - qui a eu ses thologiens
subtils et ses voix populaires - a parcouru nos
socits depuis quelques dizai nes d' annes; il
a fusti g l'ordre ancien, dnonc les hypocri sies,
chant le droit de l 'immdi at et du rel ; il a fait
rver d' une autre cit. Songeons aux Francis
cains. Et demandons"nous comment il a pu se
faire que le lyri sme, que la religiosit qui avaient
accompagn longtemps le projet rvolutionnaire
se soient, dans les socits industri ell es et occi
dentales, reports, pour une bonne part au moins,
sur le sexe.
L' ide du sexe rprim n'est donc pas seulement
afaire de thori e. L' afrmation d'une sexualit
qui n'aurait jamais t assujettie avec pl us de
rigueur qu' l' ge de l'hypocrite bourgeoisie
afaire et comptabl e se trouve couple avec l' em
phase d'un discours destin dire la vrit sur le
sexe, modifer son conomie dans le rel, sub
vertir la loi qui l e rgit, changer son avenir.
L' nonc de l ' oppression et la forme de la prdi
cation renvoient l'une l ' autre ; rciproquement
ils se renforcent. Dire que le sexe n' est pas
rprim ou pl utt dire que du sexe au pouvoir le
rapport n'est pas de rpressi on risque de n' tre
16 La volont de savoir
qu'un paradoxe strile. Ce ne serait pas seulement
heurter une thse bien accepte. Ce serait aller
l' encontre de toute l ' conomi e, de tous les int
rts P discursifs qui la sous-tendent.
C' est en ce point que je voudrais situer la srie
d' analyses hi stori ques dont ce livI-ci est l a foi s
l'introduction et comme l e premier survol: rep
rage de quelques points historiquement signi fca
ti fs et esquisses de certai ns problmes thori ques.
Il s' agit en somme d'interroger le cas d' une
socit qui depui s pl us d'un sicle se fustige
bruyamment de son hypocrisie, parle avec pro
lixit de son propre silence, s' acharne dtailler
ce qu' elle ne dit pas, dnonce les pouvoirs qu' el l e
exerce et promet de se librer des lois qui l ' ont fai t
fonctionner. Je voudrai s faire le tour non seule
ment de ces discours, mais de la volont qui l es
porte et de l 'intention stratgique qui les soutient.
La question que je voudrai s poser n' est pas :
pourquoi sommes nous rprims, mais pourquoi
disons-nous, avec tant de passion, tant de ran
cur contre notre pass le plus proche, contre
notre prsent et contre nous-mmes, que nous
sommes rprims? Par quel le spiral e en sommes
nous arrivs afrmer que le sexe est ni, mon
trer ostensiblement que nous le cachons , dire
que nous le tai sons -, et ceci en le formul ant en
mots explicites, en cherchant le faire voi r dans
sa ralit l a pl us nue, en l ' afrmant dans l a posi
tivit de son pouvoir et de ses efets? I l est lgi
time coup sr de se demander pourquoi pendant
si longtemps on a associ l e sexe et le pch
encore faudrai t-il voir comment s' est fai te cette
Nous autres, victoriens 17
associati on et se garder de dire gl obalement et
htivement que le sexe tait !l condamn - mais
il faudrait se demander aussi pourquoi nous nous
culpabili sons si fort aujourd' hui d' en avoir fait
autrefois un pch? Par quels chemins en sommes
nous venus tre P en faute )) l ' gard de notre
sexe? Et tre une civili sation assez singulire
pour se dire qu' el l e a elle-mme pendant long
temps et encore aujourd' hui P pch ))
sexe, par abus de pouvoir? Comment s' est fait ce
dplacement qui , tout en prtendant nous afran
chir de l a nature pcheresse du sexe, nous accable
d' une grande faute hi storique qui aurait consi st
justement imaginer cette nature fautive et tirer
de cette croyance de dsastreux efets?
On me dira que s'il y a tant de gens aujourd'hui
pour afrmer cette rpression, c' est parce qu' elle
est histori quement vidente. Et que s'ils en
parlent avec une telle abondance et depuis si
longtemps, c' est que cette rpressi on est profon
dment ancre, qu' elle a des racines et des raisons
solides, qu' elle pse sur l e sexe de manire si
ri goureuse que ce n' est point une seule dnoncia
tion qui pourra nous en afranchi r; l e travail ne
peut tre que l ong. D' autant plus long sans doute
que le propre du pouvoir - et singulirement d'un
pouvoir comme celui qui foncti onne dans notre
socit - c' est d' tre rpressif et de rprimer avec
une particulire attention les nergi es inuti l es,
l 'intensit des plaisirs et les conduites irrgu
lires. Il faut donc s' attendre que l es efets de
librati on l' gard de ce pouvoir rpressif soient
lents se manifester; l' entrepri se de parler du
18 La volont de savoir
sexe librement et re l' accepter dans sa ralit est
si trangre au droit fl de toute une hi stoire main
tenant mi llnaire, elle est en outre si hostile aux
mcanismes intri nsques du pouvoir, qu'elle ne
peut manquer de pitiner longtemps avant de
russir dans sa tche.
Or, par rapport ce que j' appellerai s cette
t f hypothse rpressi ve on peut lever troi s
doutes considrabl es. Premier doute : l a rpres
sion du sexe est elle bien une vidence hi storique?
Ce qui se rvle un tout premier regard - et qui
autorise par consquent poser une hypothse
de dpart - est ce bien l ' accentuation ou peut
tre l' instauration depui s le XVII
e
sicle d' un
rgime de rpression sur l e sexe? Question pro
prement hi stori que. Deuxime doute : l a mca
nique du pouvoir, et en parti culier celle qui est
mi se en jeu dans une socit comme la ntre, est
elle bien pour l ' essentiel de l' ordre de la rpres
sion? L'interdit, la censure, l a dngation sont ils
bien les formes selon l esquelles le pouvoir s' exerce
d' une faon gnrale, peut tre, dans toute so
cit, et coup sr dans la ntre? Question
hi storico thorique. Enfn troi sime doute : le
discours criti que qui s' adresse l a rpression
vient il croiser pour lui barrer la route un mca
nisme de pouvoir qui avait foncti onn jusque l
sans contestation ou bien ne fait il pas parti e du
mme rseau hi stori que que ce qu'il dnonce (et
sans doute travestit) en l'appelant t f
rpression ),?
y a t il bien une rupture hi storique entre l 'ge de
la rpression et l'analyse criti que de la rpres
sion? Questi on hi storico politique. En introdui-
Nous autres, victoriens 19
sant ces trois doutes, il ne s' agit pas seulement de
fai re des contre hypothses, symtri ques et
inverses des premires ; il ne s' agit pas de dire :
la sexualit, loin d' avoir t rprime dans les
socits capitalistes et bourgeoises, a bnfci au
contrare d'un rgime de libert constante ; il ne
s'agit pas de dire: le pouvoir, dans des socits
comme les ntres, est plus tolrant que rpressif
et la criti que qu'on fai t de la rpression peut bien
se donner des airs de rupture, e
l
le fai t partie d'un
processus beaucoup plus ancien qu'elle et selon le
sens dans lequel on lira ce processus, elle appa
ratra comme un nouvel pisode dans l' attnua
tion des interdits ou comme une forme plus ruse
ou plus discrte du pouvoir.
Les doutes que je voudrai s opposer l' hypo
thse rpressive ont pour but moins de montrer
qu'elle est fausse que de la replacer dans une
conomie gnrale des di scours sur le sexe
l' intrieur des socits moderne s depui s l e
XVIe sicl e. Pourquoi a t-on parl de l a sexualit,
qu' en a-t-on dit? Quels taient les efets de pou
voir induits par ce qu'on en disait? Quels liens
entre ces discours, ces efets de pouvoir et les
plaisirs qui se trouvaient investi s par eux? Quel
savoi r se formait partir de l? Bref, il s' agit de
dterminer, dans son fonctionnement et dans ses
raisons d'tre, le rgime de pouvoir-savoir-plaisir
qui soutient chez nous le discours sur la sexualit
humaine. De l le fait que le point essentiel (en
premire instance du moins) n' est pas tellement de
savoir si au sexe on dit oui ou non, si on formule
des interdits ou des permissions, si on arme son
20 La volont de savoir
importance ou si on nie ses efets, si on chtie ou
non les mots dont on se sert pour l e dsigner ; mai s
de
p
rendre en considrati on le fait qu'on en parle,
ceux qui en parlent, l es lieux et points de vue d' o
on en parle, l es insti tuti ons qui i ncitent en par
ler, qui emmagasinent et difusent ce qu' on en dit,
bref, le fait gl obal, l a W mise en dis
cours ) , du sexe. De l aussi l e fai t que le point
important sera de savoir sous quelles formes,
travers quels canaux, en se glissant le long de
quel s di scours le pouvoi r parvient jusqu' aux
conduites les plus tnues et les plus individuelles,
quels chemins l ui permettent d' atteindre l es
formes rares ou pei ne perceptibles du dsir,
comment il pntre et contrle le plaisir quo
tidien - tout ceci avec des efets qui peuvent
tre de refus, de barrage, de di squalifcati on,
mais aussi d' i ncitati on, d'intensifcation, bref
les P techni ques polymorphes du pouvoir ,) . De
l enfn l e fai t que le poi nt important ne sera
pas de dterminer si ces productions discursives
et ces efets de pouvoir conduisent formuler l a
vrit du s, exe, ou des mensonges au contraire
destins l ' occulter, mais de dgager l a W volont
de savoir )) qui leur sert la foi s de support et
d'instrument.
I l faut bien s' entendre ; je ne prtends pas que le
sexe n' a pas t prohib ou barr ou masqu ou
mconnu depuis l'ge classi que ; je n' afrme
mme pas qu'i l l ' a t de ce moment moins qu' au
paravant. Je ne dis pas que l 'interdit du sexe est
un leurre ; mais que c' est un leurre d' en faire l ' l
ment fondamental et constituant partir duquel
Nous autres, victoriens 21
on pourrait crire l'histoire de ce qui a t dit
propos du sexe partir de l'poque moderne.
Tous ces lments ngatifs - dfenses, refus, cen
sures, dngations - que l'hypothse rpressive
regroupe en un grand mcanisme central destin
dire non, ne sont sans doute que des pices qui
ont un rle local et tactique jouer dans une mise
en di scours, dans une technique de pouvoir, dans
une volont de savoir qui sont loin de se rduire
eux.
En somme, je voudrais dtacher l' analyse des
privilges qu' on accorde d'ordinaire l' conomie
de raret et aux principes de rarfaction, pour
chercher au contraire l es instances de production
discursiv (qui bi en sr mnagent aussi des
silences) , de production de pouvoir (qui ont par
foi s pour fonction d' i nterdire) , des productions de
savoir (lesquelles font souvent circuler des erreurs
ou des mconnaissances systmatiques)";
drais faire l'histoire de ces instances et de leurs
transformations. Or un tout premier survol,
fai t de ce point de vue, semble indiquer que depuis
la fn du XVIe sicle, la P mise en discours )) du
sexe, loin de subir un processus de restriction, a
au contraire t soumise un mcanisme d' incita
tion croi ssante ; que les techniques de pouvoir qui
s'exercent sur le sexe n'ont pas obi un principe
de slection rigoureuse mais au contraire de di s
smination et d' implantation des sexualits poly
morphes et que la volont de savoir ne s' est pas
arrte devant un tabou ne pas lever, mais
qu'elle s' est acharne - travers bien des erreurs
sans doute - constituer une science de la sexua
22 La volont de savoir
lit. Ce sont ce s mouvements que j e voudrai s, pas
sant en quel que sorte derrire l ' hypothse rpres
sive et les faits d' interdiction ou d' exclusion
qu' elle invoque, faire apparatre mai ntenant de
faon schmati que, partir de quel ques faits
hi stori ques, ayant val eur de marques.
Il
L 'hypothse rpressive
1
L'INCITATION AUX DISCOURS
XVII
e
sicle : ce serait le dbut d' un ge de
rpression, propre aux socits qu'on appelle
bourgeoi ses, et dont nous ne seri ons peut tre pas
encore tout fait afranchis. Nommer le sexe
serait, de ce moment, devenu pl us difcile et plus
coteux. Comme si , pour le matriser dans le rel,
il avait fallu d' abord le rduire au niveau du lan
gage, contrler sa libre circulation dans l e dis
cours, le chasser des choses dites et teindre l es
mots qui le rendent trop sensiblement prsent. Et
ces interdits mmes auraient peur, dirait-on, de
le nommer. Sans mme avoir l e dire, l a pudeur
moderne obtiendrait qu' on n' en parle pas, par le
seul jeu de prohibitions qui renvoient les unes
aux autres : des muti smes qui, force de se taire,
imposent le silence. Censure.
Or, prendre ces troi s derniers sicl es dans
leurs transformati ons continues, l es choses appa
raissent bien difrentes : autour, et propos du
sexe, une vritable expl osion di scursive. Il faut
s' entendre. Il se peut bien qu'il y ai t eu une pu
ration - et fort rigoureuse du vocaulaire
26 La volont de savoir
autori s. Il se peut bi en qu'on ait codif toute
une rhtorique de l ' al l usion et de la mtaphore.
De nouvel les rgl es de dcence, sans aucun doute,
ont fltr les mots : police des noncs. Contrl e
des nonciati ons aussi : on a dfni de faon beau
coup pl us stri cte o et quand i l n' tait pas pos
sible d' en parler ; dans quelle situation, entre
quels locuteurs, et l ' i ntri eur de quels rapports
sociaux; on a tabli ainsi des rgions sinon de
silence absolu, du moins de tact et de discrtion :
entre parents et enfants par exemple, ou duca
teurs, et lves, matres et domestiques . Il y a eu
l , c' est presque certain
,
toute une conomie res
trictive. Elle s' i ntgre cette politique de l a langue
et de l a p arole - spontane pour une part, concer
te pour une autre qui a accompagn l es redis
tributi ons social es de l ' ge classique.
En revanche, au niveau des discours et de leurs
domai nes, l e phnomne est presque inverse. Sur
l e sexe, l es discours des discours spci fques,
difrents l a foi s par l eur forme et leur objet -
n'ont pas cess de prolifrer : une fermentation
discursive qui s' est acclre depui s le XVIII
e
sicle.
Je ne pense pas tellement ici l a multiplication
probable des di scours ! illicites P des discours
d' infraction qui, crment, nomment Je sexe par
i nsulte ou dri si on des nouvelles pudeurs ; le res
serrement des rgles de convenance a amen vrai
semblablement, comme contre efet, une valori sa
ti on et une intensifcation de l a parole indcente.
Mai s l ' essentiel, c' est l a multiplication des dis
cours sur l e sexe, dans le champ d' exercice du
pouvoir lui mme : inci tation institutionnelle
L 'hyothse rpressive 27
en parler, et en parler de plus en plus; obstina
ton des instaces du pouvoir en entendre parler
et le faire paler lui mme sur le mode de l ' arti
cul ation expli cite et du dtail i ndfniment cumul.
Soit l' volution de la pastorale catholique et du
sacrement de pnitence aprs l e Concil e de Trente.
On voile peu peu l a nudit des questions que for
mulaient l es manuels de confession du Moyen
Age, et hon nombre de celles qui avaient cours au
XVII
e
sicle eQcore. On vite d'entrer dans ce
dtail que certansq comme Sanchez ou Ta
hurini, ont longtemps cru indispensable pour que
la confession soit complte : position respective
des partenai res, attitudes pri ses, gestes, attou
chements, moment exact du pl aisir -tout un par
cours pointil leux de l' acte sexuel dans son op
ration mme. La discrtion est recommande,
avec de plus en plus d'insistance. Il faut quant
aux pchs contre l a puret l a plus grande
rserve : c Cette matire ressemble la poix qui
tant manie de telle faon que ce puisse tre,
encore mme que ce serait pour la jeter loin de
soi, tache nanmoins et souille toujours 1. )) Et
pl us tard Alphonse de Liguori prescrira de dbu
ter quitte ventuellement s' y tenir, surtout
avec les enfants par des questions W dtour
nes et un peu vagues 2 " .
Mai s l a langue peut bi en se chtier. L' exten
sion de l ' aveu, et de l ' aveu de l a chair, ne cesse
de crotre. Parce que l a Contre Rforme s' em-
1. P. Segneri, L'Instruction du pnitent, traduction, 1695, p. 301.
2. A. de Liguori, Pratique des confesseurs (trad. franaise, 1854),
p. 140.
28
La volont de savoir
ploie dans tous les pays catholiques acclrer
le rythme de la confession annuelle. Parce qu'elle
essaie d'imposer des rgles mticuleuses d' exa
men de soi-mme. Mai s surtout parce qu' elle
accorde de plus en plus d'importance dans la pni
tence et aux dpens, peut tre, de certains
autres pchs - toutes les insinuations de l a
chair : penses, dsirs, imaginations volup
tueuses; dlectations, mouvements conjoints de
l ' me et du corps, tout cel a dsormais doit entrer,
et en dtai l, dans le jeu de la confession et de la
di rection. Le sexe, selon l a nouvelle pastorale,
ne doit plus tre nomm sans prudence; mais ses
aspects, ses corrlations, ses efets doivent tre
suivi s jusque dans leurs rameaux les plus fns :
une ombre dans une rveri e, une image trop len
tement chasse, une complicit mal conjure entre
l a mcanique du corps et l a complaisance de l ' es
prit : tout doit tre dit. Une double Yolutin tend
faire de la chair la racine de tous les pchs,
et en dpl acer le moment le plus important de
l ' acte lui-mme vers le trouble, si difcile per
cevoir et formuler, du dsi r ; car c' est un mal
qui atteint l' homme entier, et sous l es formes les
plus secrtes : ( . Examinez donc, diligemment,
toutes les facults de votre me, l a mmoire, l' en
tendement, l a volont. Examinez aussi avec exac
titude tous vos sens, ... Exami nez encore toutes
vos penses, toutes vos paroles, et toutes vos
actions. Examinez mme jusqu' vos songes,
savoir si , tant veills vous ne leur avez pas
donn votre consentement . . . Enfn n' estimez pas
que dans cette matire si chatouilleuse et si pril-
L 'hypothse rpressive 29
leuse, i l Y ait quelque chose de petit et de lger 1. 1)
Un discours oblig et attentif doit donc suivre,
selon tous ses dtours, l a ligne de jonction du
corps et de l ' me : il fait apparatre, sous la sur
face des pchs, l a nervure ininterrompue de la
chai r. Sous l e couvert d'un langage qu' on prend
soin d' purer de manire qu'il n'y soit plus nomm
directement, le sexe est pris en charge, et comme
traqu, par un discours qui prtend ne lui laisser
ni obscurit ni rpit.
C' est peut tre l pour la premire fois que
s'impose sous la forme d'une contrainte gnral e,
cette inonction si parti culire l ' Occi dent
moderne. Je ne parle pas de l ' obligation d' avouer
les infractions aux lois du sexe, comme l' exi
geat la pnitence traditi onnelle; mais de la tche,
quasi infnie, de dire, de se dire soi-mme et de
dire un autre, aussi souvent que possible, tout
ce qui peut concerner le jeu des plaisirs, sen
sations et penses innombrables qui, travers
l'me et le corps, ont quelque afnit avec le sexe.
Ce proj et d' une l mise en discours I du sexe, il
s'tait form, il y a bi enlongtemps, dans une tra
dition asctique et monastique. Le XVII
e
sicle
en a fai t une rgle pour tous. On dira qu' en fait,
elle ne pouvait gure s' appliquer qu' une toute
petite l ite ; la masse des fdles qui n' allaient
confesse qu' de rares reprises dans l'anne
chappai t des prescripti ons si complexes. Mai s
l'important sans doute, c' est que cette obligation
ait t fxe au moi ns comme point idal , pour tout
1. P. Segneri, loc. cit., pp. 301 302.
30
La volont de savoir
bon chrtien. Un impratif est pos : non pas seu
lement confesser l es actes contraires l a loi, mai s
chercher faire de son dsir, de tout son dsir,
discours. Rien, s'il est possible, ne doit chapper
cette formulation, quand bien mme l es mots
qu' elle emploie ont tre soigneusement neutra
liss. La pastorale chrtienne a inscrit comme
devoir fondamental la tche de faire passer tout
ce qui a trait au sexe au moulin sans fn de la
parole 1. L'interdit de certains mots, la dcence
des expressions, toutes les censures du vocabu
laire pourraient bien n' tre que des dispositifs
seconds par rapport ce grand assujettissement :
des manires de l e rendre moralement acceptable
et techniquement utile.
On pourrait tracer une ligne qui irait droit de
la pastorale du XVII
e
sicle ce qui en fut la pro
jection dans l a littrature, et dans l a littrature
W scandaleuse )). Tout dire, rptent les direc
teurs : W non seulement les actes consomms mai s
les attouchements sensuels, tous les regards
impurs, tous l es propos obscnes . . . , toutes les
penses consenti es 2 )+ Sade relance l'injonction
dans des termes qui semblent retranscrits des
traits de directi on spirituelle : Il faut vos
rcits les dtails l es pl us grands et les plus ten
dus; nous ne pouvons juger ce que la passion que
vous contez a de relatif aux murs et aux carac
1. La pastorale rforme, quoique d' une faon plus discrte, a
pos aussi des rgles de mise en discours du sexe. Ceci sera dve
lopp dans le volume suivant, L Chair et le corps.
2. A. de Liguori, Prceptes sur le siime commandement (trad.
1835), p. 5.
L 'hypothse rpressive 31
tres de l' homme, qu' autant que vous ne dguisez
aucune circonstance ; l es moindres circonstances
servent d' ailleurs infniment ce que nous atten
dons de vos rcits P+ Et la fn du 77 sicle
l'auteur anonyme de My secret Lie s' est encore
soumis la mme prescription; il fut sans doute,
en apparence au moins, une sorte de libertin tra
ditionnel ; mais cette vie qu'il avait consacre
presque entirement l' activit sexuelle, il a eu
l'ide de la doubler du rcit le plus mticuleux de
chacun de ses pisodes. Il s' en excuse parfois en
faisant valoir son souci d' duquer les jeunes gens,
lui qui a fait imprimer, quel ques exemplaires
seulement, ces onze volumes consacrs aux
moindres aventures, pl aisirs et sensations de son
sexe ; il vaut mieux l e croire quand i l l aisse passer
dans son texte l a voix du pur impratif : Je
raconte l es faits, comme ils se sont produits,
autant que je puisse me les rappeler; c' est tout ce
que je puis faire; une vie secrte ne doit prsen
ter aucune omission; il n'y a rien dont on doive
avoir honte . . . , on ne peut jamais trop connatre la
nature humaine 2. Le solitaire de la Vie secrte a
dit souvent, pour justifer qu ' il les dcrive, que ses
plus tranges pratiques taient partages certai
nement par des milliers d' hommes sur la surface
de l a terre. Mais l a plus trange de ces pratiques,
qui tait de les raconter toutes, et en dtail, et
au jour le jour, le princi pe en avait t dpos
dans le cur de l'homme moderne depuis deux
1. O.-A. de Sade, Les 120 Journes de Sodome, d. Pauvert, l,
pp. 139-140.
2. An.,My secret Lie, rdite par Grove Press, 1964.
32 La volont de savoir
bons sicles. Plutt que de voir en cet homme
singulier l' vad courageux d' un victorianisme
qui l' astrei gnait au silence, je serais tent de
penser qu' une poque o dominaient des
consignes d' ailleurs fort prolixes de di scrtion
et de pudeur, il fut le reprsentant le plus direct
et d'une certaine manire le plus nafd' une i njonc
tion plurisculaire parler du sexe. L' accident
historique, ce serai ent plutt les pudeurs du
puritani sme, victorien I; elles seraient en tout
cas une pripti e, un rafnement, un retournement
tactique dans le grand processus de mise en dis
cours du sexe.
Mi eux que sa souveraine, cet Angl ai s sans iden
tit peut servir de fgure centrale l 'histoire d' une
sexualit moderne qui se forme dj pour une
bonne part avec l a pastorale chrtienne. Sans
doute, J' oppos de cell e-ci , il s' agissait pour lui
de maorer les sensations qu'il prouvait par le
dtail de ce qu'il en disait; comme Sade, il cri
vait, au sens fort de l ' expression, pour son seul
plaisir I; il mlait soigneusement la rdaction et
l a relecture de son texte des scnes roti ques
dont el l es tai ent l a fois la rptiti on, l e pro
longement et le stimulant. Mai s aprs tout, l a pas
torale chrti enne, elle aussi, cherchait produire
des efets spcifques sur le dsir, par l e seul fait
de le mettre, i ntgralement et avec applicati on,
en di scours : efets de matrise et de dtachement
.mns doute, mai s aussi efet de reconversi on spi
rituel l e, de retournement vers Dieu, efet phy
sique de bi enheureuse douleur sentir dans son
corps l es morsures de la tentation et l ' amour qui
L'hyothse rpressive 33
lui rsi ste. L' essentiel est bien l. Que l'homIe
occidental ait t depuis trois sicles attach
cette tche de tout dire sur son sexe ; que depuis
l'ge classi que i l y ait eu une maj oration cons
tante et une valorisation toujours plus grande du
di scours sur l e sexe ; et qu'on ait attendu de ce dis
cours, soigneusement analyti que, des efets mul
tiples de dplacement, d' intensifcation, de rorien
tation, de modi fcation sur le dsir l ui"mme. On a
non seulement largi le domaine de ce qu' on pou
vait dire du sexe et astrei nt les hommes l ' tendre
toujours ; mais surtout on a branch sur le sexe le
discours, selon un dispositif complexe et efets
varis, qui ne peut s' puiser dans le seul rapport
une loi d' interdiction. Censure sur le sexe? On a
plutt mi s en place un appareillage produire sur
le sexe des di scours, toujours davantage de dis
cours, susceptibles de fonctionner et de prendre
efet dans son conomie mme.
Cette technique peut tre serait reste lie au
destin de la spiritualit chrtienne ou l ' co
nomie des plaisirs individuel s, si elle n' avait t
appuye et relance par d' autres mcanismes.
Essentiellement un (( intrt public )) . Non pas une
curiosit ou une sensibilit collectives ; non pas une
mentalit nouvelle. Mai s des mcani smes de pou
voir au fonctionnement desquel s le di scours sur
le sexe - pour des raisons sur lesquelles il fau
dra revenir - est devenu essentiel . Nat vers le
XVIII
e
sicle une incitati on politique, conomi que,
techni que= parler du sexe. Et non pas tellement
sous l a forme d'une thorie gnral e de la sexua
lit, mais sous forme d' analyse, de comptabilit,
34 La volont de savoir
de classifcation et de spci fcation, sous forme de
recherches quantitati ves ou causales . Prendre le
sexe l l en compte P tenir sur lui un discours qui
ne soit pas uniquement de moral e, mai s de ratio
nal it, ce fut l une ncessit assez nouvelle pour
qu' au dbut ell e s' tonne d' elle-mme et se cherche
des excuses . Comment un di scours de raison pour
rait-il parler de a? l Rarement l es phil osophes
ont port un regard assur sur ces objets pl acs
entre l e dgot et le ridicul e, o il fallait la fois
viter l ' hypocri si e et l e scandale l l Et prs d' un
sicle plus tard, l a mdecine dont on aurait pu
attendre qu' elle soi t moi ns surpri se de ce qu el le
avait formul er trbuche encore au moment de
parler : P L' ombre qui enveloppe ces faits, l a honte
et l e dgot qu' i l s i nspi rent, en ont de tout temps
loi gn
'
l e regard des observateurs . . . J ' ai l ong
temps hsit faire entrer dans cette tude le
tableau repoussant 2 P L' essenti el n' est pas dans
tous ces scrupules, dans le l moralisme )) qu' ils
trahi ssent, ou l 'hypocrisi e dont on peut l es soup
onner. Mai s dans l a ncessit reconnue qu il faut
l es surmonter. Du sexe, on doi t parler, on doi t
parler publiquement et d' une manire qui ne soit
pas ordonne au partage du licite ou de l ' i lli cite,
mme si le locuteur en maintient pour lui la di s
tinction ( c'est le montrer que servent ces dcla
rations sol ennel l es et limi nai res); on doi t en parler
comme d'une chose qu' on n' a pas simplement
condamner ou tolrer, mais grer, i nsrer
1. Condorcet. cit par J. L. Flandrin. Familles, 1976.
2. A Tardieu. tude mdico lgale sur les attentats au mur.,
1857. p. 114.
L'hyothse rpressive 35
dans des systmes d' utilit, rgler pour le plus
grand
b
ien de tous, faire fonctionner selon un
optimum. Le sexe, a ne se juge pas seulement,
a s
'
administre. Il relve de la puissance pu
b
lique ;
il appelle des procdures de gestion; il doit tre
pris en charge par des discours analytiques. Le
sexe, au XVIII
e
sicle, devient afare de W police P+
Mas au sens plein et fort qu'on donnait alors ce
mot - non pas rpression du dsordre, mais
majoration ordonne des forces collectives et
individuelles : M Afermir et augmenter par la
sagesse de ses rglements l a puissance intrieure
de l'
tat, et comme cette puissance consiste non
seulement dans la Rpublique en gnral, et
dans chacun des membres qui la composent,
mais encore dans les facults et les talents de
tous ceux qui lui appartiennent, il s' ensuit que
l a police doit s'occuper entirement de ces
moyens et les faire servir au bonheur publi c.
Or, elle ne peut obtenir ce but qu'au moyen de
l a connaissance qu' elle a de ces difrents
avantages 1. Police du sexe : c' est- dire non
pas rigueur d'une prohibition mais ncessit
de rgler le sexe par des discours utiles et
publics.
Quelques exemples seulement. Une des grandes
nouveauts dans les techniques de pouvoir, au
XVIII
e
sicle, ce fut l ' apparition, comme problme
conomique et politi que, de l a population : la
population richesse, l a population main-d' uvre
ou capacit de travail, la population en qui-
1. J. VOO Justi, lments gnrau de police, trad. 1769, p. 20.
36 La volont de savoir
libre entre sa croi ssance propre et les res
sources dont elle dispose. Les gouvernements
s' aperoivent qu'ils n'ont pas afaire simplement
des sujets, ni mme un W peuple , mai s une
P popul ation ", avec ses phnomnes spcifques,
et ses vari ables propres : natalit, morbidit,
dure de vi e, fcondit, tat de sant, frquence
des mal adi es, forme d' alimentation et d'haitat.
Toutes ces vaiabl es sont au point de croi sement
des mouvements propres l a vie et des efets pa
ticuli ers aux i nstitutions : P Les
tats ne se
peuplent poi nt suivant l a progression naturelle
de la propagati on, mai s en rai son de leur indus
tri e, de leurs productions, et des difrentes insti
tutions . . . Les hommes se multi plient comme les
productions du sol et proporti on dl avantages
et des ressources qu' ils trouvent dans leurs tra
vaux 1. ll Au cur de ce problme conomique et
politique de la popul ation, le sexe : il faut analy
ser le taux de natalit, l' ge du mari age, les nai s
sances lgitimes et illgitimes, l a prcocit et la
frquence des rapports sexuels, l a manire de les
rendre fconds ou striles, l ' efet du clibat ou des
interdits, l' incidence des prati ques contracep
tives - de ces fameux ! funestes secrets dont les
dmographes, l a veille de la Rvoluti on, savent
qu'ils sont dj familiers la capagne. Certes,
i l y avait bi en longtemps qu' on afrmat qu'un
pays devait tre peupl s' il voulait tre riche et
puissant. Mai s c' est l a premire fois qu' au moins
1. C.-j. Herbert, Essai sur la police ynrale des yrains (1753),
pp. 320 321.
L 'hyothse rpressive 37
d'une manire constante, une socit afrme que
son avenir et sa fortune sont l i s non seulement
au nombre et la vertu des citoyens, non seule
ment aux rgl es de leurs mari ages et l' organi sa
ti on des familles, mais la manire dont chacun
fait usage de son sexe. On passe de l a dsolation
rituelle sur la dbauche sans fruit des riches, des
clibataires et des liberti ns, un discours o l a
conduite sexuelle de la population est prise la
fois pour objet d'analyse et cible d'intervention;
on va des thses massivement populationnistes
de l' poque mercantili ste des tentatives de
rgulation plus fnes et mieux calcules qui oscil
leront selon les objectifs et les urgences dans
une direction nataliste ou antinatali ste. A travers
l'conomie politique de la population se forme
toute une grille d' observations sur le sexe. Nat
l'analyse des conduites sexuelles, de leurs dter
minations et de leurs efets, la limite du biolo
gique et de l' conomique. Appaai ssent aussi ces
campagnes systmatiques qui , au-del des moyens
traditi onnel s - exhortati ons moral es et rel i
gieuses, mesures fscales - essaient de faire du
comportement sexuel des couples, une conduite
conomique et politique concerte. Les raci smes
du XIX
e
et du xxe sicle y trouveront certains de
leurs points d' ancrage. Que l'
tat sache ce qu'il
en est du sexe des citoyens et de l'usage qu'il s en
font, mai s que chacun, aussi, soit capable de
contrler l'usage qu' il en fat. Entre l'
tat et
l'individu, le sexe est devenu un enjeu, et un enjeu
public ; toute une trame de discours, de savoirs,
d' analyses et d' injonctions l' ont investi .
38
La volont de savoir
Il en est de mme pour le sexe des enfants. On
dit souvent que l 'ge classique l' a soumi s une
occultation dont il ne s' est gure dgag avant
l es Trois Essais ou les bnfques angoi sses du
petit Hans. Il est vrai qu' une ancienne P libert
de langage a pu disparatre entre enfants et
adultes, ou lves et matres. Aucun pdagogue
du XVII
e
sicle n' aurait publiquement, comme
rasme dans ses Dialogues, conseill son disciple
sur le choix d' une bonne prostitue. Et les rires
bruyants qui avaient accompagn si l ongtemps,
et, semble t-il , dans toutes l es classes sociales, l a
sexualit prcoce des enfants, peu peu se sont
teints. Mai s ce n' est pas pour autant une pure et
simple mise au silence. C' est plutt un nouveau
rgime des discours. On n' en dit pas moins, au
contraire. Mai s on le dit autrement ; ce sont
d' autres gens qui le disent, partir d' autres points
de vue et pour obtenir d' autres efets. Le mutisme
lui mme, les choses qu' on se refuse dire ou
qu' on interdit de nommer, la di scrtion qu on
requi ert entre certai ns locuteurs, sont moins la
limite absol ue du discours, l' autre ct dont il
serait spar par une frontire rigoureuse, que des
lments qui fonctionnent ct des choses dites,
avec elles et par rapport elles dans des stratgies
d'ensemble. Il n' y a pas faire de partage binaire
entre ce qu' on dit et ce qu'on ne dit pas ; il faudrait
essayer de dterminer les difrentes manires de
ne pas les dire, comment se di stribuent ceux qui
peuvent et ceux qui ne peuvent pas en parler,
quel type de di scours est autoris ou quelle
forme de discrti on est requise pour les uns et les
L 'hypothse rpressive 39
autres. Il n'y a pas un, mai s des silences et il s
font partie intgrante des stratgi es qui sous
tendent et traversent l es di scours .
Soi ent l es collges d' ensei gnement du XVIII
e
si
cl e . Globalement, on peut avoir l ' impression que
du sexe on n'y parle pratiquement pas. Mai s il
suft de jeter un coup d' i l sur l es di spositifs
architecturaux, sur l es rgl ements de discipl i ne
et toute l ' organisati on i ntrieure : i l ne cesse pas
d'y tre questi on du sexe. Les constructeurs y ont
pens, et xpli citement. Les organi sateurs l e
prennent en compte de faon permanente. Tous
l es dtenteurs d' une part d' autorit sont pl acs
dans un tat d' alerte perptuel le, que l es amna
gements, l es prcautions pri ses, l e jeu des puni
ti ons et des responsabi lits relancent sans rpit.
L' espace de la cl asse, la forme des tabl es, l ' am
nagement des cours de rcrati on, la di stribution
des dortoirs (avec ou sans cloi sons,
a
vec ou sans
ri deaux), l es rglements prvus pour l a surveil
lance du coucher et du sommeil , tout cel a renvoie,
de l a manire l a pl us prol i xe, l a sexualit des
enfants e Ce qu' on pourrai t appel er l e di scours
interne de l ' i nstituti on - cel ui qu' el l e se ti ent
1 . Rglement de police pour les lces ( 1 809) , art. 67 . Il Y aura
toujours, pendant les heures de classe et dtude. un matre d' tude
survei l l ant l ' extri eur,
p
our empcher l es l ves sorti s pour des
besoi ns. de s'arrter et de se runi r.
68. Aprs la pri re du soi r, l es l ves seront recondui ts au dortoi r
o l es matres l es feront aussi tt coucher.
69. Les matres ne se coucheront qu' aprs s' tre assurs que
chaque l ve tst dans son l i t.
70. Les l i ts seront spars par des Cl oi sonb de deux mtres de
hauteur. Les dortoi rs seront cl ai rs pendant l a nui t. B
40 La volont de savoir
elle mme et qui circule parmi ceux qui la font
fonctionner - est pour une part importante arti
cul sur le constat que cette sexualit exi ste,
prcoce, active,
p
ermanente. Mai s il y a plus :
le sexe du collgien est devenu au cours du
XVIII
e
sicl e - et d' une manire pl us particulire
que celui des adolescents en gnral - un pro
blme public. Les mdeci ns s'adressent aux direc
teurs d' tablissements et aux professeurs, mais
donnent aussi leurs avi s aux familles ; les pda
g
ogues font des projets qu'ils soumettent aux
autorits ; les matres se tournent vers les lves,
leur font des recommandati ons et rdigent pour
eux des livres d' exhortation, d'exemples moraux
ou mdicaux. Autour du collgien et de son sexe
prolifre toute une littrature de prceptes, d' avi s,
d' observations, de consei l s mdicaux, de cas
cliniques, de schmas de rforme, de plans pour
des institutions i dales. Avec Basedow et le mou
vement W philanthropique allemand, cette mise en
discours du sexe adol escent a pris une ampleur
consi drable. Saltzmann avait mme organi s
une col e exprimentale, dont l e caractre parti
culier tait un contrle et une ducation du sexe
si bien rfchi s que l'universel pch de jeunesse
devait ne s'y pratiquer jamai s. Et dans toutes ces
mesures pri ses, l' enfant ne devait pas tre seule
ment l ' objet muet et inconscient de soins concerts
entre eux par les seuls adultes ; on lui imposait
un certain discours rai sonnable, limit, cano
nique et vrai sur le sexe - une sorte d'orthopdie
di scursive. La grande te, organise au Philan
thropinum au moi s de mai 1 7 76, peut servir de
L 'hyothse rpressive 4 1
vignette. Ce fut dans l a forme mle de l ' examen,
des jeux foraux, de l a distributi on des prix et du
conseil de rvi sion, la premire communion solen
nelle du sexe adol escent et du di scours raison
nable. Pour montrer l e succs de l' ducation
sexuelle qu'on donnait aux lves, Basedow avait
convi ce que l' Allemagne pouvait compter de
notable (Goethe avait t un des rares dcliner
l'invitation) . Devant l e public rassembl , un des
professeurs, Wolke, pose aux lves des ques
tions choisies sur les mystres du sexe, de l a nai s
sance, de la procration : il leur fait commenter
des gravures qui reprsentent une femme enceinte,
un couple, un berceau. Les rponses sont clai
res, sans honte ni gne. Aucun rire malsant ne
vient l es troubler - sauf justement du ct d' un
public adulte plus enfantin que les enfants eux
mmes, et que Wolke, svrement, rprimande.
On applaudit fnalement ces garons joufus qui,
devant les grands, tressent d'un savoir adroit les
guirlandes du di scours et du sexe 1.
Il serait inexact de dire que l ' i nstitution pda
gogique a impos massivement le silence au sexe
des enfants et des adolescents. Elle a au contraire,
depuis le XVIII
e
sicl e, dmultipli son suj et les
formes du discours ; elle a tabli pour lui des points
d'implantation difrents ; elle a cod les contenus
et qualif les locuteurs. Parler du sexe des en
fants, en faire parler les ducateurs, l es mde-
1. J. Schummel, Friens Reise nach Dessau ( 1 776) , cit par
A. Pinl oche
, L Rorme de l'ducation en Allemagne au XVIIe sicle
( 1 889), pp. 1 25- 1 29.
4 2 La volont de savoir
cins, l es admini strateurs et l es parents, ou l eur en
parler, faire parler les enfants eux mmes, et l es
enserrer dans une trame de di scours qui tantt
s' adressent eux, tantt parl ent d' eux, tantt
leur imposent des connai ssances canoniques, tan
tt forment partir d' eux un savoir qui l eur
chappe, - tout cela permet de l ier une intensi f
cation des pouvoi rs et une multipli cati on du di s
cours . Le sexe des enfants et des adolescents est
devenu, epuis l e XVIII
e
sicl e, un enjeu important
autour duquel d' innombrables dispositifs institu
tionnel s et stratgies di scursives ont t amna
gs. Il se peut bien qu' on ait retir aux adultes
et aux enfants eux-mmes une certaine manire
d' en parler ; et qu' on l ' ait di squali fe comme
directe, crue, grossire. Mai s ce n' tait l que l a
contrepartie, et peut-tre la condition pour que
fonctionnent d' autres discours, multipl es, entre
croi ss, subtilement hirarchiss, et tous for
tem
ent articuls autour d'un fai sceau de relations
de pouvoir.
On pourrait citer bien d' autres foyers qui,
partir du XVIII
e
sicle ou du XIXe sicle, sont entrs
en activit pour susciter l es di scours sur le
sexe. La mdecine d' abord, par l 'intermdiaire
des ff maladies de nerfs 1) ; la psychiatri e ensui te,
quand elle se met chercher du ct de l' ! excs " ,
pui s de l' onanisme, puis de l ' insatisfacti on, puis
des W fraudes l a procration " l'tiologi e des
maladi es mental es, mai s surtout quand elle s' an
nexe comme de son domaine propre l ' ensemble
des perversions sexuelles ; la justice pnal e aussi
qui l ongtemps avait eu afai re l a sexual i t sur-
L 'hypothse rpressive 4 3
tout sous l a forme de crimes V normes ll et contre
nature, mais qui , vers l e mi l i eu du XIX
e
sicl e,
s' ouvre l ajuri dicti on menue des petits attentats,
des outrage s mi neurs, des perversi ons sans i m
portance enfn tous ces contrl es soci aux qui se
dvel oppent l a fn du si cl e pass, et qui fltrent
la sexualit des coupl es, des parents et des
enfants, des adol escents dangereux et en danger
entreprenant de protger, de sparer, de pr
veni r, signal ant partout des pri l s, veillant des
attenti ons, appel ant des di agnostics, entassant
des rapports, organi sant des thrapeuti ques ;
autour du sexe, i l s irradient l es discours, intensi
fant l a conscience d' un danger incessant qui
rel ance son tour l ' i ncitati on en parl er.
Un jour de 1 86 7 , un ouvrier agricol e, du vi llage
de Lapcourt, un peu simpl e d' esprit, empl oy
sel on l es saisons chez l es uns ou l es autres, nourri
ici et l par un peu de charit et pour le pire tra
vail , log dans les granges ou l es curi es, est
dnonc : au bord d' un champ, i l avait, d' une
petite fl l e, obtenu quel ques caresses, comme i l
l ' avait dj fait, comme i l l ' avait vu faire, comme
le fai saient autour de l ui l es gami ns du village ;
c' est qu' la l i si re du bois, ou dans le foss de l a
route qui mne Saint- Nicol as, on jouait fami
l i rement au jeu qu' on appelait du l ait caill lI ,
JI est donc si gnal par l es parents au maire du
vil l age, dnonc par l e maire aux gendarmes,
condui t par l es gendarmes au juge, inculp par
lui et soumi s un premier mdeci n, pui s deux
autres experts qui, aprs avoir rdi g l eur rap-
44 La volont de savoir
port, le publient 1 . L'important de cette hi stoire?
C' est son caractre minuscule ; c' est que ce quoti
dien de la sexuali t villageoise, ces infmes dlec
tations buissonnires aient pu devenir, partir
d' un certain moment, objet non seulement d' une
i ntolrance collective, mais d' une action judi
ciaire, d' une intervention mdicale, d' un examen
cli nique attentif, et de toute une laboration
thorique. L'important, c' est que de ce person
nage, jusque-l partie intgrante de la vie
paysanne, on ait entrepri s de mesurer la bote
crnienne, d' tudier l' ossature de la face, d' ins
pecter l' anatomi e pour y relever les signes pos
sibles de' dgnrescence ; qu' on l'ait fait parler ;
qu' on l' ait interrog sur ses penses, penchants,
habitudes, sensati ons, jugements. Et qu' on at
dcid fnalement, le tenant quitte de tout dlit,
d'en faire un pur obj et de mdecine et de savoir
- objet enfouir, jusqu'au bout de sa vie,
l'hpital de Marville, mais
faire connatre
aussi au monde savant par une analyse dtalle.
On peut parier qu' l a mme poque, l'instituteur
de Lapcourt apprenai t aux petits villageois ch
tier leur langage et ne plus paler de toutes ces
choses voix haute. Mai s c'tait l sans doute
une des conditions pour que les institutions de
savoir et de pouvoir pui ssent recouvrir ce petit
thtre de tous les jours de leur discours solen
nel. Sur ces gestes sans ge, sur ces plasirs
peine furtifs qu' changeaient les simples d' esprit
avec les enfants veills, voil que notre socit
1. H. Bonnet ct J. Bulard, R
ap
ort mdico-Iga1 8ur l'tat mental
d Ch. -J. Jouy, 4 javier 1 868.
L 'hyothse rpressive 45
et elle fut sans doute l a premire dans l'his
toire - a investi tout un appareil discourir,
analyser et connatre.
Entre l 'Anglais libertin, qui s' acharnait crire
pour lui mme les singularits de sa vie secrte,
et son contemporai n, ce niai s de village qui
donnait quelques sous aux fllettes pour des
compl aisances que l ui refusaient les pl us grandes,
il y . a sans aucun doute quelque l i en profond :
d' un extrme l ' autre, le sexe est, de toute
faon, devenu quelque chose dire, et dire
exhaustivement selon des dispositifs discursifs
qui sont divers mai s qui sont tous leur manire
contraignants. Confdence subtile ou interroga
toire autoritaire, le sexe, rafn ou rustique,
doit tre dit. Une grande injonction polymorphe
soumet aussi bien l ' anonyme angl ais que le pauvre
paysan lorrai n, dont l ' hstoire a voulu qu'il s' ap
pelt Jouy.
Depui s le XVIII
e
sicle, l e sexe n' a pas cess de
provoquer une sorte d' rthisme discursif gnra
lis. Et ces discours sur le sexe ne se sont pas mul
tiplis hors du pouvoir ou contre lui ; mas l mme
o il s' exerait et comme moyen de son exerci ce;
partout ont t amnages des incitations par-
1er, partout des dispositifs entendre et enre
gistrer, partout des procdures pour observer,
interroger et formuler. On le dbusque et on le
contraint une existence discursive. De l'impra
tif singulier qui impose chacun de faire de sa
sexualit un di scours permanent, jusqu'aux m
canismes multiples qui, dans l ' ordre de l'cono
mie, de l a pdagogie, de la mdecine, de lajustice,
46 La volont de savoir
i ncitent, extraient, anagent, institutionnali sent
l e discours du sexe, c' est une immense prolixit
que notre civilisation a requise et organise. Peut
tre aucun autre type de socit n' a jamais accu
mul, et dans une hi stoire rel ativement si courte,
une telle quantit de discours sur le sexe. De lui,
i l se pourrait bien que nous parlions plus que de
toute autre chose ; nous nous acharnons cette
tche; nous nous convainquons par un trange
scrupule que nous n' en disons jamais assez, que
nous sommes trop timi des et peureux, que nous
nous cachons l ' aveuglante vidence par inertie
et par soumi ssi on, et que l ' essentiel nous chap
p
e
toujours, qu'il faut encore partir sa recherche.
Sur le sexe, l a plus intarissable, l a pl us impa
tiente des socits, il se pourrait que ce soit l a
ntre.
Mais ce premier survol le montre : il s'agit
moins d' un discours sur le sexe que d' une multi
plicit de discours produits par toute une srie
d' appareill ages fonctionnant dans des institu
tions difrentes . Le Moyen Age avait organis
autour du thme de la chair et de l a pratique de
l a pni tence un discours assez fortement uni
taire. Au cours des. sicles rcents, cette relative
unit a t dcompose, disperse, dmultiplie
en une explosion de di scursivits di stinctes, qui
ont pris forme dans la dmographie, l a biologie,
la mdecine, l a psychiatrie, l a psychologi e, la mo
ral e, l a pdagogi e, l a criti que politique. Mieux :
le lien solide qui attachait l ' une l ' autre la tho
logie morale de l a concupi scence et l' obligation de
l 'aveu ( l e discours thori que sur l e sexe et sa for-
L 'h
y
pothse rpressive 47
mulation en premire personne), ce lien a t sinon
rompu, du moins dtendu et diversif : entre
l'objectivation du sexe dans des discours ration
nel s, et le mouvement par lequel chacun est mis
la tche de raconter son propre sexe, il s' est pro
duit depuis le XVIII
e
sicle, toute une srie de ten
sions, de confits, d' eforts d' ajustement, de ten
tatives de retranscription. Ce n'est donc pas
simplement en termes d' extension continue qu'il
faut parler de cette croissance discursive ; on doit
y voir plutt une dispersion des foyers d' o- se
tiennent ces discours, une diversifcation de leurs
formes et le dploiement complexe du rseau qui
les relie. Plutt que le souci uniforme de cacher le
sexe, plutt qu' une pudibonderie gnrale du
langage, ce qui marque nos trois derniers sicl es,
c'est l a varit, c'est l a large dispersion des
appareils qu' on a invents pour en parler, pour
en faire parler, pour obtenir qu' i l parle de l ui
mme, pour couter, enregistrer, transcrire et
redi stribuer ce qui s'en dit. Autour du sexe, toute
une trame de mises en discours varies, spci
fques et coercitives : une censure massive,
depuis les dcences verbales imposes par l ' ge
classique? Il s' agit plutt d' une incitation rgle
et polymorphe aux discours.
On objectera sans doute que si, pour parler du
sexe, il a fallu tant de stimulations et tant de
mcani smes contrai gnants, c' est bi en que rgnait,
de faon globale, un certain interdit fondamen
tal ; seules des ncessits prci ses - urgences
conomi ques, utilits politiques - ont pu lever
cet interdit et ouvrir au discours sur le sexe
48 La volont de savoir
quelques accs, mais toujours l imits et soigneu
sement cods; tant parler du sexe, amnager tant
de disposi tifs insistants pour en faire parler, mai s
sous des conditi ons strictes, cel a ne prouve-t-il
qu'il est sous secret et qu' on cherche surtout
l'y maintenir encore? Mai s il faudrai t interroger
justement ce thme si frquent que le sexe est
hors discours et que seul e la leve d'un obstacle,
la rupture d'un secret peut ouvrir le chemin qui
mne jusqu' lui . Ce thme ne fait-il pas partie de
l' injonction par laquelle on suscite le discours?
N' est-ce pas pour inciter en parler, et toujours
recommencer en parler, qu' on l e fai t miroiter,
la limite extrieure de tout discours actuel,
comme le secret qu'il est indispensable de dbus
quer une chose ausivement rduite au mu
tisme, et qu'il est la foi s difcile et ncessaire,
dangereux et prcieux de dire? Il ne faut pas
oublier que l a pastorale chrtienne, en fai sant du
sexe ce qui , par excellence, devait tre avou, l' a
toujours prsent comme l'inquitante nigme :
non pas ce qui se montre obstinment, mais ce
qui se cache partout, l'insidieuse prsence la
quelle on risque de rester sourd tant elle parle
d'une voix basse et souvent dguise. Le secret
du sexe n'est sans doute pas la ralit fonda
mentale par rapport laquelle se situent toutes
les incitati ons en parler - soit qu'elles essaient
de le briser, soit que de faon obscure elles le
recondui sent par la manire mme dont elles
parlent. Il s' agit plutt d'un thme qui fait partie
de la mcanique mme de ces incitations : une
manire de donner forme l' exigence d' en parler,
L 'hyothse rpressive 49
une fable indispensable l'conomie indfni
ment prolifrante du di scours sur le sexe. Ce qui
est propre aux socits modernes, ce n'est pas
qu'elles aient vou le sexe rester dans l' ombre,
c' est qu'elles se soient voues en parler tou
joursa en le fai sant valoir comme le secret.
2
L ' I MP L ANTATI O N P E RV E RS E
Objection possible : cette prolifration des
di scours, on aurait tort d' y voir un simple phno
mne quantitatif, quel que chose comme une pure
croi ssance, comme si tait indifrent ce qu' on y
dit, comme si le fai t qu' on en parle tait en soi
pl us important que l es formes d'impratifs qu' on
lui i mpose en en parlant. Car cette mise en di s
cours du sexe n' est elle pas ordonne l a tche
de chasser de la ralit les formes de sexua
lit qui ne sont pas soumises l'conomie stricte
de l a reproducti on : dire non aux activits inf
condes, bannir l es pl aisirs d' ct, rduire ou
exclure l es prati ques qui n' ont pas pour fn l a
gnration? A travers tant de discours, on a
multipli l es condamnati ons judiciaires des petites
perversions ; on a annex l' irrgularit sexuelle
la maladie mentale ; de l ' enfance la vieill esse, on
a dfni une norme du dveloppement sexuel et
caractri s avec soi n toutes l es dviances pos
sibl es ; on a organis des contrles pdagogi ques
et des cures mdical es ; autour des moindres fan
tai si es, l es morali stes, mai s aussi et surtout l es
L 'hypothse rpressive 5 1
mdeci ns ont rameut tout l e vocabulaire empha
tique de l' abomination : n' est-ce pas autant de
moyens mi s en uvre pour rsorber, au proft
d'une sexualit gnitalement centre, tant de
plaisirs sans fruit? Toute cette attention bavarde
dont nous fai sons tapage autour de la sexualit,
depuis deux ou troi s sicles, n' est-elle pas ordon
ne un souci lmentaire : assurer le peuplement,
reproduire la force du travail, reconduire la forme
des rapports sociaux; bref amnager une sexua
l i t conomi quement uti l e et pol i tiquement
conservatrice?
Je ne sai s pas encore si tel est fnalement l ' ob
jectif. Mai s ce n' est poi nt par rduction en tout
cas qu' on a cherch l ' atteindre. Le XIX
e
sicle et
le ntre ont t plutt l' ge de l a multiplication :
une dispersion des sexualits, un renforcement de
leurs formes di sparates, une impl antation mul
tiple des ! perversions . Notre poque a t ini
tiatrice d' htrognits sexuelles.
Jusqu' l a fn du XVIII
e
sicle, trois grands codes
explicites en dehors des rgularits coutumi res
et des contraintes d' opinion rgi ssaient les pra
tiques sexuell es : droit canonique, pastorale chr
tienne et loi civil e. Ils fxaient, chacun leur
manire, l e partage du licite et de l 'illicite. Or ils
taient tous centrs sur l es relations matrimo
niales : le devoir conjugal , l a capacit le rem
plir, l a manire dont on l ' observait, les exigences
et l es vi olences dont on l ' accompagnait, l es
caresses i nuti l es ou indues auxquell es il servait
de prtexte, sa fcondit ou l a manire dont on
s'y prenait pour le rendre stri l e, l es moments
52 La volont de savoir
o on le demandait (priodes dagereuses de la
grossesse et de l'allaitement, temps dfendu du
carme ou des astinences), sa frquence et
sa raret * c'tat cela surtout qui tait satur
de prescriptions. Le sexe des conjoints tait
obsd de rgles et de recommandations. La rela
tion de mariage tat le foyer le plus intense des
contraintes ; c'tait d'elle qu'on parlait surtout;
plus
que toute aute, elle avait s' avouer das l e
dtal. Elle tait sous surveillance majeure : tait
elle en dfaut, elle avait se montrer et se
dmontrer devant tmoin. Le W reste demeurait
beaucoup plus confus : qu'on songe l'incertitude
du statut de l a sodomie , ou l'indifrence
devant la sexualit des enfants.
En outre ces difrents codes ne faisaent pas
de partage net entre les infractions aux rgles des
alliances et les dviations par rapport la gni
talit. Rompre les lois du mariage ou chercher des
plaisirs tranges valait de toute faon condana
tion. Dans la liste des pchs graves, spars
seulement par leur importance, fguraient le
stupre (relations hors maiage), l'adultre, le
rapt, l'inceste spirituel ou charnel, mai s aussi la
sodomie, ou l a M caresse rciproque. Quant aux
tribunaux, ils pouvaient condamner aussi bien
l'homosexualit que l'infdlit, le mariage sas
le consentement des parents ou la bestialit. Dans
l'ordre civil comme dans l'ordre religieux, ce qui
tait pris en compte, c'tait un illgalisme d'en
semble. Sans doute la M contre-nature y tait
elle marque d'une abomination particulire.
Mai s elle n' tait perue que comme une forme
L 'hyothse rpressive 53
extrme du P contre l a loi I ; elle enfreignait, elle
aussi , des dcrets - des dcrets aussi sacrs que
ceux du mari age et qui avaient t tabli s pour
rgir l'ordre des choses et le plan des tres. Les
prohibitions portant sur le sexe taent fonda
mentalement de nature juridique. La W nature I
sur laquelle il arivait qu' on les appui e tai t
encore une sorte de droit. Longtemps les herma
phrodites furent des criminels, ou des rejetons
du crime, puisque l eur disposition anatomique,
leur tre mme embrouillait la loi qui di stinguat
les sexes et prescrivait leur conjoncti on.
A ce systme centr sur l ' alliance lgitime,
l'explosion discursive du XVIII
e
et du XX
e
sicle a
fat subir deux modifcations. D' aord un mou
vement centrifuge par rapport la monogamie
htrosexuelle. Bi en sr, l e champ des pratiques et
des pl asirs continue lui tre rfr comme sa
rgle interne. Mai s on en parle de moins en moins,
en tout cas avec une sobrit croi ssante. On
renonce l a traquer dans ses secrets ; on ne lui
demande pl us de se formuler au jour le jour. Le
couple lgi time, avec sa sexualit rgulire, a
droit plus de di scrti on. I l tend fonctionner
comme une norme, plus rigoureuse peut-tre, mai s
plus silenci euse. En revanche ce qu' on i nterroge,
c'est la sexualit des enfants, c' est celle des fous et
des criminel s ; c'est le plaisir de ceux qui n' aiment
pas l ' autre sexe ; ce sont les rveri es, les obses
sions, les petites manies ou les grades rages. A
toutes ces fgures, peine aperues autrefoi s, de
s'avancer maintenant pour prendre l a parole et
faire l ' aveu difcile de ce qu' elles sont. On ne les
54
La volont de savoir
condamne, sans doute, pas moins. Mais on l es
coute ; et s' i l arrive qu' on interroge nouveau
la sexualit rgulire, c' est, par un mouvement
de refux, partir de ces sexualits priphriques.
De l l 'extracti on, dans le champ de la sexua
lit, d' une dimensi on spci fque de l a W contre
nature Par rapport aux autres formes condam
nes (et qui le sont de moins en moi ns), comme
l' adultre ou le rapt, elles prennent leur autono
mie : pouser une proche parente ou pratiquer l a
sodomi e, sduire une religieuse ou exercer le
sadisme, tromper sa femme ou violer des cadavres
deviennent des choses essenti el lement difrentes.
Le domaine couvert par le sixime commande
ment commence se dissocier. Se dfait aussi,
dans l ' ordre civil , l a catgorie confuse de l a
tt dbauche ll qui avait t pendant plus d' un
sicle une des rai sons l es pl us frquentes du ren
fermement administratif De ses dbris surgi ssent
d' une part l es infractions l a lgislation (ou la
morale) du mariage et de la famille, et de l ' autre
les atteintes l a rgul arit d' un fonctionnement
naturel ( attei ntes que l a loi, d' ailleurs, peut bien
sanctionner) . On a peut-tre l, parmi d' autres,
une rai son de ce prestige de Don Juan que trois
sicles n' ont pas tei nt. Sous l e grand infracteur
des rgl es de l ' alliance - voleur de femmes,
sducteur des vierges, honte des familles et insulte
aux maris et aux pres - perce un autre person
nage : celui qui est travers, en dpit de lui-mme,
par l a sombre fol i e du sexe. Sous le liberti n, le
pervers. I l rompt dlibrment l a loi, mai s en
mme temps quel que chose comme une nature
L'hypothse rpressive 55
droute l ' emporte loin de toute nature ; sa mort,
c' est le moment o l e retour surnaturel de l' of
fense et de la vindicte croi se la fuite dans la
contrenature. Les deux grands systmes de
rgles que l' Occi dent tour tour a conus pour
rgir le sexe - la l oi de l ' al l i ance et l' ordre des
dsirs -, l ' exi stence de Don Juan, surgie l eur
frontire commune, l es renverse tous deux. Lais
sons l es psychanalystes s'iterroger pour savoir
s'il tait homosexuel, narci ssique ou impuissant.
Non sans l enteur et quivoque, l oi s naturell es
de l a matrimonialit et rgl es immanentes de l a
sexualit commencent s'inscrire sur deux
registres di sti ncts. Un monde de la perversion se
dessi ne, qui est scant par rapport celui de l ' i n
fracti on l gal e ou morale, mai s n' en est pas sim
plement une varit. Tout un petit peuple nat,
difrent, mal gr quelques cousinages, des anci ens
liberti ns. De l a fn du XVIII
e
sicle jusqu' au ntre,
i l s courent dans l es intersti ces de la socit, pour
suivis mai s pas toujours par l es l oi s, enferms
souvent mai s pas toujours dans l es prisons,
malades peut-tre, mai s scandaleuses, dange
reuses victimes, proi es d un mal trange qui porte
aussi le nom de vice et parfoi s de dlit. Enfants
trop veills , fllettes prcoces, collgi ens ambi
gus, domestiques et ducateurs douteux, mari s
cruels ou maniaques, collectionneurs solitaires ,
promeneurs aux impulsions tranges : i l s hantent
l es conseils de di scipli ne, les maisons de redresse
ment, l es colonies pnitenti aires, l es tribunaux et
l es asiles ; i l s portent chez l es mdeci ns leur infa
mie et leur maladi e chez l es juges. C' est l'innom-
56 La volont de savoir
brable famille des pervers qui voisinent avec les
dlinq
uants et s' apparentent aux fous. Ils ont
port successivement au cours du sicle la marque
de l a folie morale )) , de la nvrose gnitale )) ,
de l '
W
aberration du sens gnsique ), de la dg
nrescence )) , ou du dsquilibre psychique .
Que signife l ' apparition de toutes ces sexua
lits priphriques? Le fait qu'elles puissent appa
ratre en plein jour est-il signe que la rgle se
desserre? Ou le fait qu'on y porte tant d' attention
prouve-t-il un rgime plus svre et le souci de
prendre sur elles un exact contrle? En termes de
rpression, les choses sont ambigus. Indulgence
si on songe que l a svrit des codes propos des
dlits sexuels s' est considrablement attnue au
XIX
e
sicle ; et que l ajustice souvent s' est dessaisie
elle-mme au proft de la mdecine. Mai s ruse
supplmentaire de la svrit si on pense toutes
les instances de contrle et tous les mcanismes
de surveillance mis en place par la pdagogie ou
la thrapeutique. Il se peut bien que l'interven
tion de l' gli se dans la sexualit conjugale et son
refus des fraudes I l a procration aient perdu
depuis
200 ans beaucoup de leur insistance. Mai s
l a mdecine, ell e, est entre en force dans les plai
sirs du couple : ell e a invent toute une pathologie
organique, fonctionnelle ou mentale, qui natrait
des p
ratiques sexuelles incompltes I ; elle a
class avec soin toutes les formes de plaisirs
annexes ; elle les a intgrs au W dveloppement P
et aux M perturbations ) de l' instinct; elle en a
entrepris la gestion.
L'important n' est peut-tre pas dans le niveau
L 'hyothse rpressive 57
de l'indulgence ou l a quantit de rpression; mais
dans l a forme de pouvoir qui s'exerce. S' agit il ,
quand on nomme, comme pour l a faire lever,
toute cette vgtation de sexualits disparates, de
l es exclure du rel ? Il semble bi en que la fonc
tion du pouvoir qui s'exerce l ne soit pas celle
de l'interdit. Et qu'il se soit agi de quatre opra
tions bien difrentes de l a simple prohibition.
1. Soient l es vieilles prohibitions d' alliances
consanguines ( aussi nombreuses, aussi complexes
qu'elles soient) ou l a condanation de l' adultre,
avec son invitable frquence ; soient d' autre part
les contrles rcents par lesquel s on a investi
depuis le XIX
e
sicle la sexualit des enfants et
pourchass leurs P habitudes solitaires . Il est
vident qu' i l ne s' agit pas du mme mcanisme de
pouvoir. Non seulement parce qu'il s' agit ici de
mdecine, et l de loi ; ici de dressage, l de pna
lit; mai s aus si parce que la tactique mise en
uvre n' est pas la mme. En apparence, il s' agit
bien dans les deux cas d' une tche d'limination
toujours voue l'chec et contrainte toujours de
recommencer. Mais l 'interdit des incestes vise
son objectif par une diminution asymptotique de
ce qu'il condamne ; le contrle de la sexualit
enfantine le vi se par une difusion simultane de
son propre pouvoir et de l'objet sur lequel il
l'exerce. Il procde selon une double croissance
prolonge l' infni . Les pdagogues et les mde
cins ont bien combattu l' onanisme des enfants
comme une pidmie qu' on voudrait teindre. En
fait, tout au long de cette campagne sculaire, qui
a mobilis le monde adulte autour du sexe des
58 La volont de savoir
enfants, il s' est agi de prendre appui sur ces plai
sirs tnus, de les constituer comme secrets (c'est
-dire de l es contraindre se cacher pour se per
mettre de l es dcouvrir) , d' en remonter le f, de l es
suivre des origines aux efets, de traquer tout ce
qui pourrait l es induire ou seulement l e per
mettre ; partout o i l s risquaient de se manifester,
on a i nstall des dispositifs de surveillance, tabli
des piges pour contraindre aux aveux, impos
des discours, intari ssables et correctifs ; on a alert
les parents et les ducateurs, on a sem chez eux le
soupon que tous les enfants taient coupables, et
la peur d' tre eux mmes coupables s'ils ne les
souponnaient pas assez ; on les a tenus en veil
devant ce danger rcurrent; on leur a prescrit leur
conduite et recod leur pdagogie ; sur l ' espace
familial, on a ancr les pri ses de tout un rgime
mdico-sexuel. Le (( vice de l ' enfant, ce n' est pas
tellement un ennemi qu' un support ; on peut bien le
dsigner comme le mal supprimer ; l 'chec nces
saire, l'extrme acharnement une tche assez
vaine font souponner qu'on lui demande de per
sister, de prolifrer aux limites du vi sible et de
l'invi sible, plutt que de disparatre pour tou
jours. Tout au long de cet appui, le pouvoir
avance, multiplie ses relai s et ses efets, cepen
dant que sa cible s' tend, se subdivise et se rami
fe, s'enfonant dans le rel du mme pas que lui .
I l s' agit en apparence d' un di spositif de barrage ;
en fait, on a amnag, tout autour de l ' enfant, des
li
g
nes de pntration indfni e.
2. Cette chasse nouvelle aux sexualits pri
phriques entrane une incorporation des perer-
L'h
y
pothse rpressive 59
sions et une spcication nouvele des individus.
La sodomie - celle des anciens droits civil ou
canonique - tait un type d' actes interdits ; leur
auteur n' en tait que l e sujet j uridique. L'homo
sexuel du XIX
e
sicle est devenu un personnage :
un pass, une histoire et une enfance, un carac
tre, une forme de vie ; une morphologie aussi ,
avec une anatomi e indiscrte et peut tre une phy
siologie mystrieuse. Rien de ce qu' il est au total
n'chappe sa sexualit. Partout en lui, elle est
prsente : sous j acente toutes ses conduites
parce qu'elle en est l e principe insidieux et indf
niment actif; inscrite sans pudeur sur son visage
et sur son corps parce qu' el l e est un secret qui se
trahit toujours- Elle lui est consubstantielle, moins
comme un pch d'habi tude que comme une nature
singuli re. Il ne faut pas oublier que la catgo
rie psychologi que, psychi atri que, mdicale de
l' homosexualit s' est constitue du jour o on l ' a
caractrise - l e fameux article de Westphal en
1 870, sur les ! l sensati ons sexuel l es contraires ))
peut valoir comme date de nai ssance 1 - moi ns
par un type de rel ations sexuel l es que par une cer
taine qualit de l a sensibilit sexuelle, une cer
tai ne manire d' i ntervertir en soi-mme le mas
culin et l e fminin. L' homosexualit est apparue
comme une des fgures de la sexualit lorsqu'elle
a t rabattue de la prati que de l a sodomie sur
une sorte d' androgynie i ntrieure, un hermaphro
disme de l ' me. Le sodomite tait un relapsq
l ' homosexuel est mai ntenant une espce.
1. WestphaJ , A rch i v fr Neuro[o9ie, 1870.
60
La volont de savoir
Comme sont e spces tous ces petits pervers que
les psychi atres du XX
e
sicle entomologisent en
leur donnant d' tranges noms de baptme : i l y a
les exhibitionnistes de Lasgue, l es ftichi stes de
Binet, l es zoophiles et zoorastes de Kraft-Ebing,
les auto monosexualistes de Rohleder; i l y aura
les mixoscopophil es, les gyncomastes, les pres
byophil es, les inverti s sexoesthtiques et les
femmes dyspareunistes. Ces beaux noms d'hr
sies renvoient une nature qui s'oubli erait assez
pour chapper l a loi, mai s se souviendrait assez
d'elle-mme pour continuer produire encore des
espces, mme l o il n'y a plus d' ordre. La mca
nique du pouvoir qui pourchasse tout ce dispa
rate ne prtend l e supprimer qu' en lui donnant
une rali t analytique, visible et permanente :
elle l' enfonce dans les corps, elle le glisse sous les
conduites, elle en fait un principe de classement
et d' intelligibilit, elle le constitue comme rai son
d' tre et ordre naturel du dsordre. Exclusion de
ces mille sexualits aberrantes? Non pas, mais
spcifcation, solidifcati on rgionale de chacune
d' elles. Il s' agit, en les di ssminant, de les par
semer dans le rel et de l es incorporer l'indi
vidu.
3. Plus que l es vieux interdits, cette forme de
pouvoi r demande pour s'exercer des prsences
constantes, attentives, curieuses aussi ; elle sup
pose des proximits ; elle procde par examens
et observations insi stantes ; elle requiert un
change de di scours, travers des questios qui
extorquent des aveux, et des confdences qui
dbordent les i nterrogati ons. Elle implique une
L'hypothse rpressive 6 1
approche physi que et un j eu d e sens ati ons
intenses. De cela, l a mdicalisation de l' insolite
sexuel est la fois l' efet et l'instrument. Enga
ges dans le corps, devenues caractre profond
des indivi dus, les bizarreries du sexe rel vent
d' une technologie de la sant et du pathologique.
Et inversement ds l ors qu' elle est chose mdical e
ou mdicali sabl e, c' est comme lsion, dysfonc
tionnement ou symptme qu'il faut aller la sur
prendre dans le fond de l' organisme ou sur la sur
face de l a peau ou parmi tous les signes du
comportement. Le pouvoir qui, ansi, prend en
charge la sexualit, se met en devoir de frler
les corps ; il les caresse des yeux; i l en intensife
des rgi ons ; il lectri se des surfaces ; i l dramatise
des moments troubles. Il prend bras-le-corps le
corps sexuel . Accroi ssement des efcacits sans
doute et extension du domaine contrl. Mai s
aussi sensualisation du pouvoir et bnfce de
plasir. Ce qui produit un double efet : une impul
sion est donne au pouvoir par son exercice mme ;
un moi rcompense le contrle qui surveille et le
porte plus loin; l'intensit de l' aveu relance la
curi osit du questionnaire ; l e plaisir dcouvert
refue vers le pouvoir qui l e cerne. Mais tant de
questions pressantes singularisent, chez celui
qui doit rpondre, les pl aisirs qu'il prouve ; le
regard les fxe, l' attention les isole et les anime.
Le pouvoir fonctionne comme un mcanisme d' ap
pel, i l attire, i l extrat ces trangets sur lesquelles
il veille. Le plasir difuse sur le pouvoir qui le
traque ; l e pouvoir ancre le plai sir qu'il vient de
dbusquer. L'examen mdical, l'investigation psy-
6 2
La volont de savoir
chiatrique, le rapport pdagogi que, l es contrl es
famili aux peuvent bien avoir pour objectif gl obal
et apparent de dire non toutes les sexualits
errantes ou i mproductives ; de fait ils fonctionnent
comme de s mcani smes doubl e impul si on :
plai sir et pouvoir. Pl ai sir d' exercer un pouvoi r
qui questionne, surveill e, guette, pie, fouill e,
palpe, met au jour ; et de l ' autre ct, plai si r qui
s' all ume d' avoir chapper ce pouvoir, l e
fuir, le tromper ou l e travesti r. Pouvoir qui
se lai sse envahi r par le plai sir qu' i l pourchasse ;
et en face de lui , pouvoir s' afrmant dans le plai si r
de se montrer, de scandaliser, ou de rsister. Cap
tation et sduction ; afrontement et renforcement
rciproque : les parents et l es enfants, l ' adulte
et l' adol escent, l ' ducateur et les lves, les mde
cins et les malades, l e psychi atre avec son hyst
rique et ses pervers n' ont pas cess de jouer ce
j eu depui s le XIX
e
sicle. Ces appel s, ces esquives,
ces i ncitations circulaires ont amnag autour des
sexes et des corps, non pas des frontires ne pas
franchir, mai s les spirales perptuelles du pou
voir et du pl ai sir.
4. De l ces dispositis de saturation sexuelle si
caractri stiques de l ' espace et des r tes soci aux
du XIX
e
sicle. On dit souvent que la socit
moderne a tent de rduire l a sexualit au coupl e
au couple htrosexuel et autant que possi bl e
lgitime. On pourrait dire aussi bi en qu'il a si non
invent, du moins soigneusement amnag et fait
prolifrer les groupes lments multipl es et
sexualit circulante : une di stribution de poi nts
de pouvoir, hirarchi ss ou afronts ; des pl aisirs
L 'hypothse rpressive 63
poursuivi s )) - c'est'-dire l a fois dsirs et
pourchasss ; des sexualits parcel l aires tolres
ou encourages; des proximits qui se donnent
comme procds de surveillance, et qui fonc
tionnent comme des mcanismes d'intensifcation;
des contacts inducteurs. Ainsi en est-il de l a
famille, ou plutt de la maisonne, avec parents,
enfants et dans certai ns cas domestiques. La
famille du XIX
e
sicle est-elle bien une cellule
monogamique et conjugale? Peut-tre dans une
certaine mesure. Mais elle est aussi un rseau de
plaisirs-pouvoirs articuls selon des points mul
tipl es et avec des relations transformabl es. La
sparation des adultes et des enfants, l a pol arit
tablie entre la chambre des parents et celle des
enfants (elle est devenue canonique au cours du
sicle quand on a entrepris de construire des loge
ments populaires), la sgrgation relative des
garons et des flles, l es consignes strictes de
soins donner aux nourrissons (allaitement ma
ternel , hygine), l' attenti on veille sur la sexua
lit infantil e, les dangers supposs de l a mastur
bati on, l'importance accorde la pubert, l es
mthodes de surveillance suggres aux parents,
les exhortations, les secrets et l es peurs, l a pr
sence, la foi s valori se et redoute, des domes
tiques, tout cela fait de la famille, mme ramene
ses plus petites dimensions, un rseau complexe,
satur de sexualits multipl es, fragmentaires et
mobiles. Les rduire la relation conjugale, quitte
projeter celle-ci, sous forme de dsir i nterdit,
sur l es enfants, ne peut rendre compte de ce dis
positif qui est, par rapport ces sexualits, moins
64 La volont de savoir
p
rincipe d' inhibition que mcanisme incitateur et
multipli cateur. Les instituti ons scolaires ou psy
chi atri ques, avec leur population nombreuse, leur
hi rarchi e, leurs anagements spati aux, leur
systme de surveillance, constituent, ct
de la famille, une autre faon de di stribuer l e
jeu des pouvoirs et des plaisirs ; mai s el l es des
sinent, el l es aussi . des rgi ons de haute satu
ration sexuelle, avec des espaces ou des rites pri
vilgis comme la salle de classe, le dortoir, la
vi site ou l a consultation. Les formes d'une sexua
lit non conjugal e, non htrosexuelle, non mono
game y sont appeles et i nstalles.
La socit P bourgeoise du XIX
e
sicle, l a ntre
encore sans doute, est une socit de l a perversion
clatante et clate. Et ceci non point sur le mode
de l 'hypocri si e, car rien n' a t plus manifeste et
prolixe, plus manifestement pris en charge par l es
di scours et l es i nstituti ons . Non poi nt parce que,
pour avoir voulu dresser contre l a sexualit un
barrage trop rigoureux ou trop gnral , elle
aurait malgr elle donn lieu tout un bourgeon
nement pervers et une longue pathologie de
l' instinct sexuel . Il s' agit plutt du type de pou
voir qu' el l e a fai t foncti onner sur l e corps et sur
le sexe. Ce pouvoir justement n'a ni la forme de la
loi ni les efets de l'i nterdit. Il procde au contraire
par dmultiplication des sexualits singulires. Il
ne fxe pas de frontires l a sexualit ; i l en pro
longe l es formes diverses, en les poursuivant selon
des li gnes de pntration indfnie. Il ne l'exclut
pas, il l' inclut dans le corps comme mode de sp
cifcation des i ndivi dus. Il ne cherche pas l ' es-
L 'hypothse rpressive 65
quiver; i l attirp ses varits par des spirales o
plai sir et pouvoir se renforcent ; il n' tablit pas
de barrage ; il amnage des lieux de saturation
maxi mal e. Il produit et fxe l e disparate sexuel .
La socit moderne est perverse, non point en
dpit de son puritanisme ou comme par le contre
coup de son hypocri sie ; elle est perverse relle
ment et directement.
Rellement. Les sexualits multipl es - celles
qui apparai ssent avec les ges (sexualits du
nourri sson ou de l ' enfant) , celles qui se fxent
dans des gots ou des pratiques (sexualit de l 'in
verti , du grontophile, du fti chi ste . . . ), celles qui
investi ssent de faon difuse des relati ons (sexua
lit du rapport mdecin-malade, pdagogue
lve, psychiatre fou), celles qui hantent les
espaces (sexualit du foyer, de l' cole, de la pri
son) - toutes forment le corrlat de procdures
prci ses de pouvoir. Il ne faut pas imaginer que
toutes ces choses jusque l tolres ont attir
l' attention et reu une qualifcation pjorative,
lorsqu' on a voulu donner un rle rgulateur au
seul type de sexualit susceptible de reproduire
la force de travail et la forme de la famille. Ces
comportements polymorphes ont t rellement
extraits du corps des hommes et de leurs plaisirs;
ou plutt i l s ont t solidifs en eux; i l s ont t,
par de multipl es dispositi fs de pouvoir appels,
mis au jour, isols, intensi fs, incorpors. La
croissance des perversions n' est pas un thme
morali sateur qui aurait obsd les esprits scrupu
leux des vi ctoriens. C' est l e produit rel de l 'inter
frence d'un type de pouvoir sur l es corps et leurs
66
La volont de savoir
plaisirs. Il se peut que l' Occident n'ait pas t
capale d'inventer des plaisirs nouveaux, et sans
doute n' a-t-il pas dcouvert de vices indits. Mais
il a dfni de nouvelle s rgles au jeu des pouvoirs
et des plai sirs : l e visage fg des perversions s'y
est dessin.
Directement. Cette implantation des perversions
multipl es n' est pas une moquerie de la sexualit
se vengeant d' un pouvoir qui lui imposerat une
loi rpressive l'eKcs. Il ne s'agit pas non plus
de formes paradoxal es de plaisir se retourant
vers le pouvoir pour l'investir sous la forme d'un
pl ai sir subi r Pa L'implantation des perver
sions e st un efet instrument : c' est par l'isole
ment, l 'intensifcation et la consolidation des
sexualits priphriques que les relations du pou
voir au sexe et au plaisir se ramifent, se mul
tiplient, apentent le corps et pntrent les
conduites. Et sur cette avance des pouvoirs, se
fxent des sexualits dissmines, pingles
un ge, un lieu, un got, un type de pra
tiques. Prolifration des sexualits par l'exten
sion du pouvoir ; majoration du pouvoir auquel
chacune de ces sexualits rgionales donne une
surface dintervention : cet enchanement, depui s
le XIXe sicle surtout, est assur et relay par les
innombrables profts conomiques qui grce
l'intermdiaire de l a mdecine, de la psychiatrie,
de la prosti tutiona de la pornographie, se sont
branchs l a foi s sur cette dmultiplication ana
lytique du plaisir et cette majoration du pouvoir
qui le contrle. Pl ai sir et pouvoir ne s' annulent
pas ; ils ne se retournent pas l'un contre l' autre;
L 'hypothse rpressive 67
i l s s e poursuivent, s e chevauchent e t s e relancent.
I l s s' enchanent selon des mcanismes complexes
et positifs d' excitation et d'incitation.
Il faut donc sans doute abandonner lhypothse
que les socits industri elles modernes ont inau
gur sur l e sexe un ge de rpession accrue. Non
seulement on assi ste une explosion visible des
sexualits hrtiques. Mai s surtout et c' est l
l e point important un dispositif fort difent de
la loi, mme s'il s'appuie localement sur des pro
cdures d' interdiction, assure, par un rseau de
mcani smes qui s'enchanent, la prolifration de
plaisirs spcifques et l a multipli cation de sexu8
lits di sparates. Aucune socit n'aurait t plus
pudibonde, dit-on, jamai s les instances de pouvoir
n' auraient mis plus de soin feindre d' i gnorer ce
qu'elles interdisaient, comme si elles ne voulaient
avoir avec lui aucun point commun. C' est l'inverse
qui apparat, au moins un survol gnral :
jamai s davantage de centres de pouvoirs ; jamai s
pl us d' attention manifeste et prolixe ; j amai s plus
de contacts et de liens circulai res ; jamais plus de
foyers o s' all ument, pour se di ssminer plus loin,
l'intensit des plai sirs et l' obstinati on des pou
vOirs.
I I I
Scientia sexualis
Je suppose qu' on m' accorde les deux premiers
points ; j'imagine qu' on accepte de dire que le dis
cours sur l e sexe, depuis trois sicl es maintenant,
a t multipli plutt que rarf ; et que s'il a
port avec lui des interdits et des prohibitions, il
a d'une faon plus fondamentale assur l a soli
difcation et l 'implantation de tout un disparate
sexuel. Il n' en demeure pas moins que tout cela
semble n' avoir jou essentiellement qu'un rle
de dfense. A tant en parler, le dcouvrir dmul
tipli, cloisonn et spcif l justement o on l' a
insr, on ne chercherait au fond qu' masquer le
sexe : discours cran, dispersion vitement. Jus
qu' Freud au moins, l e discours sur le sexe - le
di scours des s avants et des thoriciens - n' aurait
gure cess d' occulter ce dont il parlait. On pour
rait prendre toutes ces choses dites, prcautions
mticuleuses et aalyses dtalles pour autant
de procdures destines esquiver l' insuppor
table, la trop prilleuse vrit du sexe. Et le seul
fait qu'on ait prtendu en parler du point de
vue purif et neutre d'une science est en lui-
Je suppose qu' on m' accorde les deux premiers
points ; j'imagine qu' on accepte de dire que l e dis
cours sur le sexe, depuis trois sicl es maintenant,
a t multipli plutt que rarf ; et que s'il a
port avec lui des i nterdits et des prohibitions, il
a d'une faon plus fondamentale assur la soli
difcation et l'implantation de tout un disparate
sexuel. Il n'en demeure pas moins que tout cela
semble n' avoir jou essentiellement qu' un rle
de dfense. A tant en parler, le dcouvrir dmul
tipli, cloi sonn et spcif l justement o on l ' a
insr, on ne chercherait au fond qu masquer l e
sexe : discours cran, dispersion vitement. Jus
qu' Freud au moi ns, le discours sur le sexe - l e
discours des savants et des thoriciens n' aurat
gure cess d' occulter ce dont il parlait. On pour
rait prendre toutes ces choses dites, prcautions
mticuleuses et analyses dtailles pour autant
de procdures destines esquiver l'insuppor
table, la trop prilleuse vrit du sexe. Et le seul
fait qu' on ait prtendu en parler du point de
vue purif et neutre d' une science est en lui-
7 2 La volont de savoIr
mme signifcatif. C' tait en efet une science
faite d' esquives pui sque dans l' i ncapacit ou le
refus de parler du sexe l ui-mme, elle s' est rf
re surtout ses aberrati ons, perversions, bizar
reries excepti onnelles, annul ati ons pathol ogiques,
exasprations morbides. C' tait galement une
science subordnnne pour l ' essentiel aux imp
ratifs d' une morale dont elle a, sous les espces
de la norme mdi cal e, ritr l es partages . Sous
prtexte de dire vrai , partout elle al lumait des
peurs ; elle prtai t aux moindres osci llati ons de
la sexualit une dynastie imaginaire de maux
destins se rpercuter sur des gnrati ons ; elle
a afrm dangereuses pour l a socit tout entire
les habitudes furtives des timi des et les petites
manies les plus solitaires ; au bout des pl aisi rs
insolites, elle n' a plac rien moi ns que la mort :
celle des indivi dus, celle des gnrations, celle de
l' espce.
Elle s' est lie ainsi une prati que mdicale
insistante et indi scrte, volubile procl amer ses
dgots, prompte courir au secours de la loi et
de l' opinion, pl us servile l ' gard des pui ssances
d' ordre que docile l' gard des exigences du
vrai . Involontairement nave dans l es cas l es
meilleurs, et dans l es pl us frquents, vol ontaire
ment mensongre, complice de ce qu' elle dnon
ait, hautaine et frl euse, el le a instaur toute
une poli ssonneri e du morbi de, caractri stique du
XIXe sicle fni ssant ; des mdeci ns comme Garnier,
Pouillet, Ladoucette en ont t, en France, les
scri bes s ans gloire, et Rollinat le chantre. Mai s,
au-del de ces plaisirs troubl es, elle revendi-
Scientia sexualis 7 3
quait d' autres pouvoirs; elle se posait e n instance
souveraine des impratifs d' hygine, ramassant
les vieilles peurs du mal vnrien avec les thmes
nouveaux de l' asepsi e, les grands mythes vo
luti onnistes avec les institutions rcentes de la
sant publique ; elle prtendait assurer l a vigueur
physi que et la propret' moral e du corps soci al ;
elle promettait d' liminer les titulaires de tares,
l es dgnrs et les popul ations abtardies. Au
nom d' une urgence biologique et hi storique, elle
justifait les racismes d'
E
tat, alors imminents.
Elle les fondait en l! vrit P .
Quand on compare ces discours sur l a sexualit
humaine, ce qu' tait la mme poque l a phy
siologie de la reproduction animale ou vgtal e,
le dcal age surprend. Leur faibl e teneur, je ne di
s
mme pas en sci enti fcit, mais en rationalit l
mentaire, les met part dans l' hi stoire des
connai ssances. Ils forment une zone trangement
brouille. Le sexe, tout au long du XIXe sicle,
semble s' inscrire sur deux regi stres de savoir
bien di stincts : une biologie de la reproduction,
qui s' est dveloppe continment selon une nor
mativit scientifque gnrale et une mdecine du
sexe obi ssant de tout autres rgles de forma
tion. De l' une l' autre, aucun change rel,
aucune structurati on rciproque; l a premire n' a
gure jou, par rapport l ' autre, que le rle d' une
lointai ne garantie, et bien fctive : une caution
globale sous le couvert de l aquelle les obstacles
moraux, l es options conomiques ou politiques,
l es peurs traditionnelles pouvaient se rcrire
dans un vocabulaire de consonance scientifque.
74
La volont de savoir
Tout se passerait comme si une rsi stance
fondamentale s'opposait ce que soit tenu sur le
sexe humain, ses corrlations et ses efets, un dis
cours de forme rationnelle. Une telle dnivellation
serat bien le signe qu'il s' agissait en ce genre de
di scours, non point de dire la vrit, mais d' emp
cher seulement qu' elle s' y produi se. Sous la dif
rence entre la physiologie de la reproduction et la
mdecine de la sexualit, il faudrait voir autre
chose et plus qu' un progrs scientifque ingal ou
une dnivellation dans les formes de la rationalit;
l 'une relverait de cette immense volont de savoir
qui a support l'institution du discours scienti
fque en Occident ; tadis que l' autre relverait
d'une volont obstine de non-savoir.
C' est indniale : le discours savant qui fut tenu
sur l e sexe au Xl
e
sicle a t travers de crdu
ls sans ge, mais aussi d' aveuglements syst
matiques : refus de voir et d'entendre ; mai s - et,
c' est l sans doute le point essentiel - refus qui
portat sur cela mme qu'on faisat apparatre,
ou dont on sollicitait imprieusement la formula
tion. Car, il ne peut y avoir de mconnai ssance
que sur le fond d'un rapport fondamental la
vrit. L' esquiver, lui barrer l' accs, la masquer :
autant de tactiques locales, qui viennent comme en
surimpression, et par un dtour de dernire ins
tance, donner une forme paradoxale une ptition
essentielle de savoir. Ne pas vouloir reconnatre,
c' est encore une priptie de la volont de vrit.
Que la Salptrire de Charcot serve ici d'exemple :
c'tat un immense appareil d'observation, avec
ses examens, ses interrogatoires, ses expriences,
Scientia sexualis 7 5
mais c'tait aussi une machinerie d'incitation,
avec ses prsentati ons publiques, son thtre des
cri ses rituelles soigneusement prpares l 'ther
ou au nitrate d'ayl, son jeu de dialogues, de pal
pations, de mains qu' on impose, de postures que
les mdecins, d' un geste ou d'une parole, suscitent
ou efacent, avec la hirarchie du personnel qui
pie, organise, provoque, note, rapporte, et qui
accumule une immense pyraide d' observations
et de dossiers. Or, c'est sur fond de cette incitation
permanente au discours et la vrit, que
viennent jouer les mcanismes propres de la
mconnai ssance : ansi le geste de Charcot inter
rompant une consultation publique o il commen
ait tre trop manifestement question de a . ;
ainsi plus frquemment, l' efacement progressif,
au fl des dossiers de ce qui, en fait de sexe, avat
t dit et montr par les malades, mai s aussi vu,
appel, sollicit par les mdecins eux-mmes, et
que les observations publies lident presque
entirement 1. L'important, das cette histoire,
n'est pas qu'on se soit bouch les yeux ou les
oreilles ni qu'on se soit tromp; c'est d' abord
1. Cf. par exempl e, Bourneville, Iconograhie de la Saltrire,
pp. 1 10 et suiv. Les documents indits sur les leons de Chacot,
qu' on peut encore trouver l a Salptrire, sont sur ce point encore
pl us explicites que les textes publis. Ls jeux de l'incitation et de
l 'lision s'y l i sent for cl airement. Une note manuscrite rapporte l a
sance du 25 novembre 1877. L sujet prsente une contracture
hystrique; Charcot suspend une cri se en plaant les mains d' abord
pui s l' extrmit d' un bton sur les ovai res. Il retire le bton, la crise
reprend, qu'i l fait acclrer pa des inhalations de nitrate d'ayl. La
mal ade alors rclae le bton-sexe dans des mots qui, eux, ne
comportent aucune mtaphore On fat dispaate G. dont l
e
dlire continue .
76 La volont de savoir
qu' on ait construi t autour du sexe et propos de
lui un immense appareil produire, quitte l a
masquer au dernier moment, la vrit. L'impor
tant, c' est que le sexe n' ait pas t seulement
afaire de sensation et de pl ai sir, de loi ou d' inter
dicti on, mai s aussi de vrai et de faux, que la vrit
du sexe soi t devenue chose essentiell, utile ou
d angereuse, prcieuse ou redoutabl e, bref, que le
sexe ait t constitu comme un enjeu de vrit.
A reprer donc, non pas le seuil d' une rati onalit
nouvelle dont Freud - ou un autre - marquerait
la dcouverte, mais la formation progressive (et
l es transformati ons aussi ) de ce P jeu de l a vrit
et du sexe l que le XIX
e
sicle nous a lgu, et dont
rien ne prouve, mme si nous l ' avons modif, que
nous en sommes afranchi s. Mconnai ssances,
drobades, esquives n' ont t possibles, et n' ont
pris leurs efets que sur fond de cette trange
entrepri se : dire la vrit du sexe. Entreprise qui
ne date pas du XIXe sicle, m
me si alors le projet
d' une ! science lui a prt une forme singulire.
Elle est le socle de tous les discours aberrants,
nafs et russ, o l e savoir du sexe semble s' tre
si longtemps gar.
Il Y a hi storiquement deux grandes procdures
pour produire l a vrit du sexe.
D' un ct, l es socits - et elles ont t nom
breuses : l a Chine, le Japon, l' Inde, Rome, l es
socits arabo-musul manes - qui se sont dotes
Scientia sexualis 7 7
d'une ars erotica. Dans l' art rotique, la vrit
est extraite du plaisir lui-mme, pri s comme pra
tique et recueilli comme exprience ; ce n' est pas
par rapport une loi absolue du permis et du
dfendu, ce n' est point par rfrence un critre
d' utilit, que le plaisir est pris en compte; mai s,
d' abord et avant tout par rapport lui-mme, i l
y est connatre comme plaisir, donc selon son
intensit, sa qualit spcifque, sa dure, ses rver
brations dans le corps et l ' me. Mieux : ce savoir
doit tre revers, mesure, dans la pratique
sexuelle elle-mme, pour la travailler comme de
l'intrieur et amplifer ses efets. Ainsi, se consti
tue un savoir qui doit demeurer secret, non point
cause d'un soupon d'infamie qui marquerait
son objet, mais par la ncessit de le tenir dans la
plus grade rserve, puisque, selon la tradition,
il perdrait tre divulgu son efcace et sa vertu.
Le rapport au matre dtenteur des secrets est
donc fondamental ; seul, celui-ci peut le trans
mettre sur le mode sotrique et au terme d' une
initiation o il guide, avec un savoir et une sv
rit sans faille, le cheminement du disciple. De cet
art magistral , les efets, bien plus gnreux que ne
l e laisserait. supposer la scheresse de ses recettes,
doivent transfgurer celui sur qui il fait tom
ber ses privilges : matri se absolue du corps,
jouissance unique, oubli du temps et des limites,
lixir de longue vie, exil de la mort et de ses
menaces.
Notre civili sation, en premire approche du
moins, n' a pas dars erotica. En revanche, el l e est
la seule, sans doute, pratiquer une scientia
78 La volont de savoir
sexualis. Ou plutt, avoir dvelopp au cours
des sicles
pour dire l a vrit du sexe, des pro
cdures qui s'ordonnent pour l ' essentiel une
forme ' de pouvoir-savoir rigoureusement oppose
l' art des initiati ons et au secret magi stral : il
s' agit de l ' aveu.
Depui s l e Moyen Age au moins, les socits
occidentales ont plac l' aveu parmi les rituels
maeurs dont on attend l a production de vrit :
rglementation du sacrement de pnitence par le
Concile de Latran, en 1 2 1 5, dveloppement des
techniques de confessi on qui s'en est suivi, recul
dans la justi ce crimi nelle des procdures accusa
toires, di sparition des preuves de culpabilit
( serments, duel s, jugements de Dieu) et dvelop
pement des mthodes d' interrogation et d' enqute,
part de plus en plus grande prise par l'administra
tion royal e dans la poursuite des infractions et
ceci aux dpens des procds de transaction
prive, mise en place des tribunaux d' Inquisition,
tout cela a contribu donner l ' aveu un rle
central dans l' ordre des pouvoirs civils et reli
gi eux. L'voluti on du mot aveu )) et de la fonction
juridique qu' il a dsi gne est en elle-mme carac
tri stique : de 1' aveu )) , garantie de statut, d'iden
tit et de valeur accorde quelqu'un p
a
un
autre, on est pass l' ! aveu )) , reconnai ssance par
quelqu' un de ses propres actions ou penses. L'in
dividu s'est longtemps authentif par la rfrence
des autres et la mani festation de son lien autrui
( famille, allgeance, protecti on) ; puis on l ' a
authentif par le di scours de vrit qu' il tait
capable ou oblig de tenir sur lui mme. L'aveu
Scientia sexualis 7 9
d e l a vrit s' est inscrit au cur des procdures
d' individuali sation par le pouvoir.
En tout cas, ct des rituels de l'preuve,
ct des cauti ons donnes par l' autorit de l a
tradition, ct des tmoignages, mais aussi des
procds savants d' observati on et de dmonstra:
tion, l' aveu est devenu, en Occident, une des tech
niques les plus hautement valorises pour pro
duire le vrai . Nous sommes devenus, depuis l ors,
une socit singulirement avouante. L'aveu a dif
fus loin ses efets : dans la justice, dans l a mde
cine, dans l a pdagogie, dans les rapports fami
liaux, dans les relations amoureuses, dans l ' ordre
l e plus quotidien, et dans les rites les pl us solen
nels ; on avoue ses crimes, on avoue ses pchs. on
avoue ses penses et ses dsirs, on avoue son
pass et ses rves, on avoue son enfance; on avoue
ses maladi es et ses misres ; on s'emploie avec
la plus grande exactitude dire ce qu'il y a de
plus difcile dire ; on avoue en public et en priv,
ses parents, ses ducateurs, son mdecin,
ceux qu' on aime; on se fai t soi-mme, dans l e
plaisir et l a peine, des aveux impossibles tout
autre, et dont on fait des livres. On avoue ou
on est forc d' avouer. Quand i l n' est pas spon
tan, ou impos par quelque impratif intrieur,
l ' aveu est extorqu ; on l e dbusque dans l ' me
ou on l ' arrache au corps. Depuis le Moyen Age,
l a torture l ' accompagne comme une ombre, et l e
soutient quand i l se drobe : noirs jumeaux 1 .
1 . Le droit grec avait dj coupl l a torture et l' aveu, au moi ns
pour l es escl aves. Le droit romai n imprial avai t l argi la pratique.
Ces questions seront reprises dans l e Pouvoir de la vrit.
80 La volont de savoir
Comme la tendresse la plus dsarme, les plus
sangl ants des pouvoirs ont besoin de confession.
L ' homme, en Occident, est devenu une bte d' aveu.
De l sans doute une mtamorphose dans la
littrature : d'un plai sir de raconter et d' en
tendre, qui tait centr sur le rcit hroque ou
merveilleux des !l preuves P de bravoure ou de
sai ntet, on est pass une littrature ordonne
l a tche infnie de faire lever du fond de soi
mme, entre les mots, une vrit que la forme
mme de l ' aveu fait miroiter comme l'inacces
sible . De l aus si, cette autre manire de philoso
pher : chercher le rapport fondamental au vrai,
non pas simplement en soi-mme dans quelque
savoir oubli, ou dans une certaine trace origi
naire mais dans l' examen de soi-mme qui
dlivre, travers tant d' impressions fugitives, les
certitudes fondamentales de la conscience. L'obli
gation de l'aveu nous est maintenant renvoye
partir de tant de points difrents, elle nous est
dsormai s si profondment incorpore que nous
ne la percevons plus comme l' efet d' un pouvoir
qui nous contraint ; il nous semble au contraire
que la vrit, au plus secret de nous-mme, ne
!! demande P qu' se faire jour; que si elle n'y
accde pas, c' est qu'une contrainte la retient,
que la violence d'un pouvoir pse sur elle, et
qu' elle ne pourra s' articuler enfn qu' au prix
d' une sorte de libration. L'aveu afranchit, le
pouvoir rduit au silence ; la vrit n' appartient
pas l ' ordre du pouvoir, mais elle est dans une
parent originaire avec la libert : autant de
thmes traditionnels dans la philosophi e, qu' une
Scientia sexualis 8 1
hi stoire politique de la vrit )) devrait retourner
en montrant que la vrit n' est pas libre par
nature, ni l ' erreur serve, mai s que sa production
est tout entire traverse des rapports de pouvoir.
L' aveu en est un exempl e.
Il faut tre soi-mme bien pig par cette ruse
interne de l ' aveu, pour prter l a censure,
l'interdiction de dire et de penser, un rle fonda
mental ; il faut se faire une reprsentation bien
inverse du pouvoir pour croire que nous parlent
de libert toutes ces voix qui , depuis tant de
temps, dans notre civili sation, ressassent la for
midabl e injonction d' avoir dire ce qu' on est, ce
qu' on a fait, ce dont on se souvient et ce qu' on a
oubli, ce qu' on cache et ce qui se cache, ce
quoi on ne pense pas et ce qu' on pense ne pas
penser. Immense ouvrage auquel l ' Occident a
pli des gnrations pour produire pendant
que d' autres formes de travail assuraient l ' ac
cumulati on du capital l ' assujettissement des
hommes ; je veux dire leur constitution comme
P sujets q aux deux sens du mot. Qu' on s' imagine
combien dut paratre exorbitant, au dbut du
XIII
e
sicle, l' ordre donn tous l es chrtiens
d' avoir s' agenouiller une fois l ' an au moins
pour avouer, sans en omettre une seule, chacune
de leurs fautes . Et, qu'on songe, sept sicles plus
tard, ce parti san obscur venu rej oindre, au fond
de la montagne, la rsi stance serbe ; ses chefs lui
demandent d' crire sa vie ; et quand i l apporte ces
quel ques pauvres feuill es, grifonnes dans l a
nuit, on ne l es regarde pas, on l ui di t seulement :
Recommence, et di s l a vrit. P Les fameux
82 La volont de savoir
interdits de J Jngage auxquels on prte tant de
poids devraient-ils faire oublier ce joug mill
naire de l' aveu?
Or, depui s l a pnitence chrtienne jusqu' au
jourd'hui, l e sexe fut matire privilgie de
confessi on. Ce qu' on cache, dit-on. Et si c' tait au
contraire ce que, d' une faon toute particulire,
on avoue? Si l' obligation de le cBcher n' tait
qu' un autre aspect du devoir de l ' avouer (le celer
d' autant mieux et avec d' autant plus de soin que
l' aveu en est pl us important, exige un rituel pl us
strict et promet des efets pl us dcisifs) ? Si l e
sexe tait, dans notre socit, une chelle de
plusieurs sicles maintenant, ce qui est plac
sous le rgime sans dfaillance de l ' aveu? La mise
en discours du sexe dont on parl ait pl us haut, la
dissminati on et le renforcement du disparate
sexuel sont peut-tre deux pices d' un mme di s
positif; ell es s'y articulent grce l ' lment cen
tral d' un aveu qui contraint l'nonciation vri
dique de la singularit sexuelle aussi extrme
qu' elle soit. En Grce, la vrit et le sexe se
liaient dans l a forme de l a pagogi e, par la
transmi ssion, corps corps, d' un savoir prcieux;
le sexe servait de support aux initiations de la
connai ssance. Pour nous, c' est dans l' aveu que se
lient la vrit et le sexe, par l' expression obl i ga
toire et exhaustive d'un secret indivi duel . Mai s,
cette foi s, c' est l a vrit qui sert de support au
sexe et ses manifestations.
Or, l ' aveu est un rituel de di scours o l e sujet qui
parle concide avec le sujet de l' nonc ; c' est
aussi un rituel qui se dpl oi e dans un rapport de
Scientia sexualis 83
pouvoir, car on n' avoue pas sans la prsence au
moins virtuelle d' un partenaire qui n' est pas sim
plement l'interlocuteur, mai s l' instace qui re
quiert l'aveu, l'impose, l ' apprcie et intervient
pour juger, punira pardonner, consoler, rconci
lier; un rituel o la vrit s' authentife de l ' obs
tacle et des rsistances qu' elle a eu lever pour
se formuler; un rituel enfn o la seule non
ci ation, indpendamment de ses consquences
externes, produit, chez qui l' articule, des modif
cations intrinsques : elle l' innocente, elle le
rachte, elle l e purife, elle le dcharge de ses
fautes, elle le libre, elle lui promet le saut. Pen
dant des sicles, la vrit du sexe a t prise, au
moins pour l ' essentiel, dans cette forme discur
sive. Et, non point dans celle de l ' enseignement
(l'ducation sexuelle se limitera aux principes
gnraux et aux rgles de prudence) ; non point
dans celle de l' initi ation (reste pour l' essentiel
une pratique muette, que l ' acte de dniaiser ou
de dforer rend seulement risible ou violente).
C' est une forme, on le voi t bi en, qui est au plus
loin de celle qui rgit (( l ' art rotique - Par la
structure de pouvoir qui lui est immanente, le
discours de l 'aveu ne saurait venir d' en haut,
comme dans l'ars erotica, et par la volont souve
rai ne du matre, mai s d' en bas, comme une parole
requi se, oblige, faisant sauter par quelque
contrai nte imprieuse les sceaux de l a retenue
ou de l' oubli. Ce qu' il suppose de secret n' est pas
l i au prix lev de ce qu'il a dire et au petit
nombre de ceux qui mritent d' en bnfcier; mais
son obscure famili arit et sa bassesse gn-
84 La volont de savoir
raIe. Sa vrit n'est pas garantie par l' autorit
hautaine du magi stre ni par la tradition qu'il
transmet, mais par le lien, l ' appartenance essen
tielle dans le di scours entre celui qui parle et ce
dont il parle. En revanche, l'instance de domina
tion n'est pas du ct de clui qui parle (car c' est
lui qui est contraint) mais du ct de celui qui
coute et se tai t; non pas du ct de celui qui sait
et fait rponse, mais du ct de celui qui interroge
et n' est pas cens savoir. Et ce discours de vrit
enfn prend efet, non pas dans celui qui le reoit,
mai s dans celui auquel on l ' arrache. Nous sommes
au plus loin, avec ces vrits avoues, des initia
ti ons savantes au plaisir, avec leur technique et
leur mystique. Nous appartenons, en revanche,
une socit qui a ordonn, non dans la trans
mission du secret, mai s autour de la l ente monte
de l a confdence, l e difcile savoir du sexe .
L' aveu a t, et demeure encore aujourd'hui, l a
matrice gnrale qui rgit l a production du dis
cours vrai sur le sexe. Il a t toutefois consid
rablement transform. Longtemps, i l tait rest
solidement encastr dans la pratique de l a pni
tence. Mais, peu peu, depuis l e protestantisme,
l a Contre-Rforme, la pdagogie du XVIII
e
sicle
et la mdecine du XIX
e
, il a perdu s localisation
rituelle et exclusive ; il a difus ; on l'a utili s
dans toute une srie de rapports : enfants et
parents, lves et pdagogues, malades et psy-
Scientia sexualis 85
chiatres, dlinquants et experts. Les motivations
et les efets qu' on en attend se sont di versifs, de
mme que les formes qu' il prend : interrogatoires ,
consultations, rcits autobi ographi ques, lettres ;
ils sont consigns, transcrits, runis en dos
siers, publi s et comments. Mai s surtout l ' aveu
s'ouvre, sinon d' autres domaines, au moins
de nouvelles manires de les parcourir. Il ne
s' agit plus seulement de dire ce qui a t fat
l ' acte sexuel et comment ; mai s de restituer
en lui et autour de l ui , les penses qui l 'ont dou
bl , les obsessions qui l ' accompagnent, les images,
l es dsi rs, l es modulations et la qualit du pl ai
sir qui l ' habitent. Pour la premire foi s sans
doute une soci t s' est penche pour solliciter et
entendre la confdence mme des plai sirs i ndivi
duels.
Di ssmination, donc, des procdures d' aveu,
locali sation multiple de leur contrainte, extension
de leur domaine : il s'est constitu peu peu une
grande archive des pl aisirs du sexe. Cette archive
s' est longtemps eface mesure qu' elle se Cons
tituait. Elle passait sans traces ( ainsi le voulait
l a confession chrti enne), jusqu' ce que l a mde
cine, la psychi atrie, la pdagogie aussi , aient
commenc l a soli difer : Campe, Salzmann,
pui s surtout Kaan, Kraft-Ebing, Tardieu, Molle,
Havelock Elli s, ont runi avec soin toute cette
lyrique pauvre du di sparate sexuel. Ainsi les
soci t s occi dental es ont commenc teni r
le egi stre i ndfni de l eurs pl ai sirs. Elles en ont
tabli l ' herbier, instaur la classifcation ; elles
ont dcrit les dfciences quoti diennes comme
86 La volont de savoir
les bizareri es ou les exasprati ons. Moment
important : il est facile de rire des psychiatres
du XIX
e
sicle, qui s' excusaient avec emphase
des horreurs auxquelles ils allaent devoir don
ner la parole, en voquant les W attentats aux
murs ou les W aerrations des sens gn
si ques Je serais prt plutt saluer leur s
rieux : ils avaient le sens de l'vnement. C' tait
le moment o les plaisirs l es pl us singuliers
taient appel s tenir sur eux-mmes un discours
de vrit qui avait s' articuler non plus sur celui
qui parle du pch et du salut, de l a mort et de
l ' ternit, mais sur celui qui parle du corps et de
l a vie - sur le discours de l a science. Il y avait
de quoi faire trembler les mots ; se constituait
alors cette chose improbal e : une science aveu,
une science qui prenai t appui sur les rituels de
l ' aveu et sur ses contenus, une science qui suppo
sait cette extorsion multiple et insistante, et se
donnait pour objet l'inavouable avou. Scandale,
bien sr, rpulsion en tout cas du discours scienti
fque, si hautement institutionnali s au XIX
e
sicle,
quand il dut prendre en charge tout ce discours
d' en bas. Paradoxe thorique aussi et de m
thode : les longues discussions sur la possibilit
de constituer une science du sujet, l a validit de
l'introspecti on, l'vidence du vcu, ou l a pr
sence soi de l a conscience, rpondaient sans
doute ce problme qui tat inhrent au fonc
tionnement des discours de vrit dans notre
socit : peut-on articuler la production de l a
vrit selon l e vieux modle juridico religieux de
l ' aveu, et l' extorsion de l a confdenc selon l a
Scientia sexualis 87
rgle du di scours scientifque? Lassons dire ceux
qui croient que la vrit du sexe a t lide plus
rigoureusement que jamais au XIX
e
sicl e, pa un
redoutable mcanisme de barrage et un dfcit
central du discours. Dfcit, non pas, mai s sur
charge, reduplication, plutt trop que pas assez
de di scours, en tout cas interfrence entre deux
modalits de pro,uction du vrai : les procdures
d' aveu et la di scursivit scientifque.
Et, au lieu de faire le compte des erreurs, des
naivets, des morali smes qui ont peupl au
XIX
e
sicle les di scours de vrit sur l e sexe, il
vaudrait mieux reprer les procds par lesquels
cette volont de savoir relative au sexe, qui carac
tri se l ' Occident moderne, a fait fonctionner l es
rituel s de l ' aveu dans l es schmas de l a rgularit
scienti fque : comment est on parvenu consti
tuer cette immense et traditi onnelle extorsion
d' aveu sexuel dans des formes scienti fques?
1. Par une codication clinique du P faire
parler : combiner la confession avec l ' examen,
le rcit de soi mme avec le dploiement d' un
ensemble de signes et de symptmes dchifrables ;
l'interrogatoire, le questionnaire serr, l ' hypnose
avec le rappel des souvenirs, l es associations
libres : autant de moyens pour rinscrire l a pro
cdure d' aveu dans un champ d' observations
scientifquement acceptabl es.
2. Par le postulat d'une causalit gnrale et
diuse : devoir tout dire, pouvoir interroger sur
tout, trouvera sajusti fcati on dans le principe que
88
La volont de savoir
l e sexe est dot d' un pouvoir causal inpui sable et
polymorphe. L' vnement le pl us discret dans la
con
d
uite sexuelle accident ou dviati on, dfcit
ou excs - est suppos capabl e d' entraner l es
consquences l es pl us varies tout au long de
"exi stence ; i l n' est gure de maladie ou de troubl e
physique auquel l e XX
e
sicl e n' ait imagin une
p
art au moins d' tiologie sexuell e. Des mauvai ses
habitudes des enfants aux phti si es des adultes,
aux apoplexies des vieillards, aux maladi es ner
veuses et aux dgnrescences de la race, l a
mdecine d' al ors a ti ss tout un rseau de causa
lit sexuelle. Il peut bien nous paratre fantas
ti que. Le principe du sexe P cause de tout et de
n'importe quoi )) est l ' envers thorique d' une exi
gence technique : faire fonctionner dans une pra
ti que de type scientifque l es procdures d' un aveu
qui devait tre l a foi s total , mticuleux et cons
tant. Les dangers illimits que porte avec lui l e
sexe justifent le caractre exhaustif de l ' i nquisi
tion laquel le on le soumet.
3. Par le princie d'une latence intrinsque la
sexualit : s' i l faut arracher la vrit du sexe par
la technique de l ' aveu, ce n'est pas simplement
parce qu' elle est difcile dire, ou frappe par les
interdits de la dcence. Mai s, parce que l e fonc
tionnement du sexe est obscur ; parce qu' il est de
sa nature d' chapper et que son nergie comme
ses mcani smes se drobent ; parce que son pou
voir causal est en partie clandestin. En l 'i ntgrant
un projet de di scours scientifque, l e XIX
e
sicle a
dpl ac l ' aveu ; il tend ne pl us porter seulement
Scientia sexualis 89
sur ce que l e sujet voudrait bien cacher; mai s,
sur ce qui lui est cach lui mme, ne pouvant
venir la lumire que peti t petit -et par le tra
vail d' un aveu auquel , chacun de leur ct, parti
cipent l' interrogateur et l'interrog . Le principe
d' une latence essentielle l a sexualit permet
d' arti cul er sur une prati que sci enti fque l a
contrainte d' un aveu difcile. I l faut bien l ' arra
cher, et de force, puisque a se cache.
4. Par la mthode de l 'interprtation : s'il faut
avouer, ce n' est pas seulement parce que celui
auquel on avoue aurait le pouvoir de pardonner,
de consoler et de diriger. C'est que l e travail
de la vrit produire, si on veut scientifque
ment le valider, doit passer par cette relation.
Elle ne rside pas dans le seul sujet qui, en
avouant, la porterait toute faite l a lumire.
Elle se constitue en partie double : prsente, mai s
incomplte, aveugle elle mme chez celui qui
parle, elle ne peut s' achever que chez celui qui la
recueill e. A lui de dire l a vrit de cette vrit
obscure : il faut doubler la rvlation de l ' aveu
par le dchifrement de ce qu'il dit. Celui qui
coute ne sera pas simpl ement le matre du par
don, le juge qui condamne ou tient quitte ; il sera le
matre de la
v
rit. Sa fonction est hermneutique.
Pa rapport l' aveu, son pouvoir n' est pas seule
ment de l' exiger, avant qu'il soit fait, ou de
dcider, aprs qu'il a t profr ; il est de cons
tituer, travers lui et en le dcryptant, un dis
cours de vrit. En fai sant de l' aveu, non pl us une
preuve, mais un signe, et de l a sexualit quelque
90 La volont de savoir
chose interprter, le XlX
e
sicle s' est donn l a
possibilit de faire fonctionner les procdures
d' aveu dans l a formation rgulire d' un discours
scientifque.
5. Par la mdicalisation des efets de l 'aveu :
l' obtention de l ' aveu et ses efets sont recods
dans la forme d' oprati ons thrapeutiques. Ce
qui veut di re d' abord que le domaine du sexe ne
sera plus plac seulement sur l e regi stre de l a
faute et du pch, de l ' excs ou de l a transgres
sion, mai s s ous le rgime (qui n' en est d' ailleurs
que la transposition) du normal et du patholo
gique ; on dfnit pour la premire foi s une mor
bidit propre au sexuel ; le sexe apparat comme
un chap de haute fragilit pathologique : sur
face de rpercussion pour les autres maladi es,
mai s aussi foyer d' une nosographi e propre, celle
de l'instinct, des penchants, des images, du pla
sir, de la conduite. Cela veut dire aussi que l' aveu
prendra son sens et sa ncessit parmi les inter
venti ons mdi cal es : exi g par l e mdeci n,
ncessaire pour l e di agnosti c et efcace, par
lui mme, dans la cure. Le vrai , s' il est dit
temps, qui il faut, et par celui qui en est l a
foi s le dtenteur et le responsable, gurit.
Prenons des repres historiques larges : notre
socit, en rompant avec les traditions de l'ars
erotica, s' est donn une scientia sexualis. Plus
prcisment, elle a poursuivi l a tche de produire
des discours vrais sur le sexe, et ceci en ajustant,
non S(S ma, l' ancienne procdure de l' aveu sur
Scientia sexualis 9 1
les rgles du discours scientifque. La scientia
sexualis, dveloppe partir du XIX
e
sicle, garde
paadoxalement pour noyau le rite singulier de la
confession obligatoire et exhaustive, qui fut dans
l'Occident chrtien la premire technique pour
produire la vrit du sexe. Ce rite, depuis le XVI
e
,
s'tat peu peu dtach du sacrement de pni
tence, et par l'intermdiare de la conduction des
es et de la direction de conscience - ars artium
- il a migr vers la pdagogie, vers les rapports
des adultes et des enfants, vers les relations fami
liales, vers la mdecine et la psychiatrie. En tout
cas, depuis cent cinquante ans bientt, un dispo
sitif complexe est en place pour produire sur le
sexe des discours vras : un dispositif qui enjambe
lagement l'histoire puisqu'il branche la vieille
injonction de l'aveu sur les mthodes de l' coute
clinique. Et c'est au travers de ce dispositif qu'a
pu apparatre comme vrit du sexe et de ses pla
sirs quelque chose comme la M sexuait a
La sexuait : corrlatif de cette pratque dis
cursive lentement dveloppe qu'est la scientia
sexualise De cette sexuait, les caractres fon
daentaux ne traduisent pas une reprsentation
plus ou moins brouille par l'idologie, 0,. une
mconnassance induite par les interdits; ils
correspondent aux exigences fonctionnelles du
discours qui doit produire sa vrit. Au point de
croisement d'une technique d'aveu et d' une dis
cursivit scientifque, l o il a fallu trouver entre
elles quelques grands mcani smes. d' ajustement
(technique d'coute, postulat de causalit, prin
cipe de latence, rgle de l'interprtation, imp-
92
La volont de savoir
rati f de mdicalisati on), l a sexualit s' est dfnie
comme tant par : un domaine pn
trable des processus pathologiques, et appel ant
donc des interventi ons de thra
p
eutiques ou de
normali sati on ; un champ de signifcations
dchifrer ; un lieu de processus cachs par des
mcanismes spcifques ; un foyer de relati ons
causalendfnies , une parole obscure qu'il faut
la fois dbusquer et couter. C' est conomie
des discours, j e veux dire l eur technologie i ntrin
sque, les ncessits de leur fonctionnement, l es
tacti ques qu' ils mettent en uvre, les efets de
pouvoir qui l es sous tendent et qu' ils vhiculent
c' est cela et non point un systme de reprsen
tations qui dtermine l es caractres fondamen
taux de ce qu' i l s disent. L' hi stoire de l a sexua
lit - c' est -dire de ce qui a fonctionn au
XIX
e
sicle comme domaine de vrit spcifque -
doit se faire d' abord du point de vue d' une histoire
des di scours.
Avanons l ' hypothse gnrale du travail. La
socit qui se dveloppe au XVIII
e
sicle - qu' on
appellera comme on voudra bourgeoi se, capita
liste ou industrielle - n' a pas oppos au sexe un
refus fondamental de le reconnatre. Elle a au
contraire mi s en uvre tout un appareil pour
produire sur lui des di scours vrai s. Non seule
ment, elle a beaucoup parl de l ui et contraint
chacun en parl er ; mais elle a entrepris d' en
formuler la vrit rgle. Comme si el l e suspectait
en lui un secret capital . Comme si elle avait besoin
de cette production de vrit . Comme s'il lui tait
es sentiel que l e sexe soit i nscrit, non seulement
Scientia sexualis 9 3
dans une conomie du plaisir, mais dans un
rgime ordonn de s avoir. Ainsi, il est devenu peu
peu l' objet du grand soupon; l e sens gnral et
inquitant qui traverse malgr nous nos conduites
et nos exi stences; le point de fragilit par o nous
viennent l es menaces du mal ; l e fragment de nuit
que chacun de nous porte en soi. Signifcation
gnral e, secret universel, cause omniprsente,
peur qui ne cesse pas. Si bien que dans cette ques
ti on P du sexe ( aux deux sens, d' interrogatoire et
de problmati sation ; d' exigence d' aveu et d'int
gration un champ de rati onalit), deux proces
sus se dveloppent, renvoyant toujours de l' un
l ' autre : nous lui demandons de dire l a vrit (mai s
nous nous rservons, pui squ' i l est l e secret et qu' il
s' chappe lui-mme, de dire nous mmes l a
vrit enfn cl aire, enfn dchifre de sa vrit) ;
et nous lui demandons de nous dire notre vrit,
ou plutt, nous lui demandons de dire la vrit
profondment enfouie de cette vrit de nous
mmes que nous croyons possder en conscience
immdiate. Nous lui disons sa vrit, en dchif
frant ce qu'il nous en dit ; il nous dit la ntre en
librant ce qui s' en drobe. C' est de ce jeu que
s' est constitu, lentement depuis plusieurs sicl es,
un savoir du sujet ; savoir, non pas tellement de
sa forme, mais de ce qui l e scinde ; de ce qui l e
dtermine peut tre, mai s surtout le fait chapper
lui mme. Cela a pu paratre imprvu, mais ne
doit gure tonner quand on songe l a longue
histoire de l a confession chrtienne et judiciaire,
aux dpl acements et transformati ons de cette
forme de savoir pouvoir, si capitale en Occident,
94
La volont de savoir
qu'est l' aveu : selon des cercles de plus en plus
serrs, l e projet d'une science du sujet s' est mis
graviter autour de la question du sexe. La cau
salit dans le sujet, l 'inconscient du sujet, la
vrit du suj
et
dans l ' autre qui sat, le savoir .en
lui de ce qu' i
l
ne sait pas lui mme, tout cela a
trouv se dployer dans le discours du sexe.
Non point, cependant, en raison de quelque pro
prit naturelle inhrente au sexe lui-mme, mais
en fonction des tactiques de pouvoir qui sont
immanentes ce discours .
Scientia sexualis contre ars erotica, sans doute.
Mas il faut noter que l'ars erotica n'a tout de
mme pas disparu de la civilisation occidentale;
ni mme qu'elle n' a pas toujours t absente du
mouvement par lequel on a cherch produire
la science du sexuel. Il y a eu, dans la confession
chrtienne, mais surtout dans la direction et
l'exaen de conscience, dans l a recherche de
l'union spirituelle et de l' amour de Dieu, toute
une srie de procds qui s' apparentent un art
rotique : gui dage par le matre le long d' un
chemin d' initiation, intensifcation des expriences
et jusque dans leurs composantes physiques,
majoration des efets par le discours qui les
accompagne ; les phnomnes de possession et
d'extase, qui ont eu une telle frquence dans le
catholicisme de l a Contre-Rforme, ont sans doute
t les efets incontrls qui ont dbord la tech-
Scientia sexualis 9 5
nique rotique immanente cette science subtile
de la chair. Et, il faut se demander si, depuis le
XI
e
sicle, l a scientia sexualis - sous le fard de
son positivisme dcent - ne fonctionne pas, au
moins par certaines de ses dimensions, comme une
ars erotica. Peut tre cette production de vrit,
aussi intimide qu' elle soit par le modle scien
tifque, a t-elle multipli, intensif et mme aussi
cr ses plaisirs i ntri nsques. On dit souvent que
nous n' avons pas t capables d' imaginer des plai
sirs nouveaux. Nous avons au moins invent un
plasir autre : plai sir la vrit du plasir, plaisir
la savoir, l'exposer, la dcouvrir, se fas
ciner d la voir, la dire, captiver et capturer
les autres par elle, la confer dans le secret, l a
dbusquer par la ruse ; pl aisir spcifque au dis
cours vrai sur le plaisir. Ce n' est pas dans l' idal,
promi s par la mdecine, d' une sexualit saine,
ni dans la rverie humaniste d' une sexualit
complte et panouie, ni surtout dans le lyri sme
de l' orgasme et les bons sentiments de la bio
nergie qu'il faudrait chercher les lments les
plus importants d' un art rotique li notre sa
voir sur la sexualit (il ne s' agit l que de son uti
lisation normali satrice) ; mais dans cette multipli
cation et intensifcation des plai sirs lis la pro
duction de la vrit sur l e sexe. Les livres savants,
crits et lus, les consultati ons et les examens, l' an
goisse rpondre aux questions et les dlices se
sentir i nterprt, tant de rcits fats soi et aux
autres, tant de curi osit, de si nombreuses conf
dences dont le devoir de vrit soutient, non sans
trembler un peu, le scandale, le foisonnement de
96
La volont de savoir
fantaisi es secrtes qu' on paye si cher le droit de
chuchoter qui sait l es entendre, d' un mot le
formidable ! plai sir l' analyse )) (au sens le plus
large de ce dernier mot) que l ' Occi dent depuis
plusieurs sicles a foment savamment, tout cela
forme comme les fragments errants d'un art ro
tique que vhiculent, en sourdine, l ' aveu et la
science du sexe. Faut il croire que notre scientia
sexualis n' est qu' une forme singulirement sub
tile d'ars erotica? et qu' elle est, de cette tradi
tion apparemment perdue, l a version occidentale
et quintessencie? Ou faut il supposer que tous ces
plaisirs ne sont que les sous produits d' une
science sexuelle, un bnfce qui en soutient l es
innombrabl es eforts?
En tout cas, l' hypothse d' un pouvoir de rpres
sion que notre socit exercerait sur l e sexe et
pour des rai sons d' conomie, parat bien exigu,
s'il faut rendre compte de toute cette srie de
renforcements et d' intensifcati ons qu' un premier
parcours fait apparatre : prolifration de dis
cours, et de discours soigneusement i nscrits dans
des exi gences de pouvoir ; solidifcation du di spa
rate sexuel et constitution de di spositifs suscep
tibles non seulement de l' i soler, mai s de l ' appeler,
de le susciter, de l e constituer en foyers d' atten
tion, de discours et de plaisirs ; production exige
d' aveux et instauration partir de l d' un systme
de savoir lgitime et d' une conomie de plaisirs
multipl es. Beaucoup plus que d'un mcanisme n
gatif d' exclusion ou de rejet, il s' agit de l ' allumage
d' un rseau subtil de discours, de savoi rs, de plai
si rs, de pouvoirs ; il s' agit, non d' un mouvement
Scientia sexualis 9 7
qui s' obstinerait repousser l e sexe sauvage dans
quelque rgi on obscure et i naccessible ; mai s au
contraire, de processus qui le di ssmi nent l a
surface de s chose s et des corps , qui l ' excitent, l e
mani festent e t l e font parl er, l implantent dans l e
rel e t l ui enjoi gnent de dire l a vrit : tout un
scinti l lement vi si bl e du sexuel que renvoient l a
multiplicit des di scours, l ' obstination des pou
voirs et les jeux du savoir avec le plaisir.
Husion que tout cela? Impression htive der
rire laquelle un regard pl us soigneux retrouve
rait bi en l a grande mcani que connue de l a
rpressi on? Au del de ces quel ques phospho
rescences , ne faut-il pas retrouver la l oi sombre
qui toujours dit non? Rpondra - ou devrait
rpondre l' enqute histori que. Enqute sur la
mani re dont s' est form depui s troi s bons sicl es
l e savoi r du sexe ; s ur la manire dont se sont
multipl i s l es discours qui l' ont pri s pour objet,
et sur l es rai sons pour l esquel les nous en sommes
venus prter un prix presque fabuleux l a
vrit qu' i l s pensaient produi re. Peut tre ces
analyses hi storiques fni ront elles par di ssiper ce
que semble suggrer ce premi er parcours. Mai s le
postulat de dpart que je voudrai s tenir le pl us
longtemps possible, c' est que ces di spositifs de
pouvoir et de savoir, de vrit et de plaisirs, ces
di spositifs, si difrents de l a rpression, ne sont
pas forcment secondaires et drivs ; et, que l a
rpressi on n' est pas de toute faon fondamentale
et gagnante. Il s' agit donc de prendre ces dispo
sitifs au srieux, et d' inverser l a di rection de
l'analyse : plutt que d' une rpression gnrale-
98 La volont de savoir
ment admi se. et d' une i gnorance mesure ce
que nous supposons savoir, il faut partir de ces
mcanismes positifs, producteurs de savoir, mul
ti
p
licateurs de di scours, i nducteurs de pl aisir, et
gnrateurs de pouvoir, l es suivre dans leurs
condi ti ons d' apparition et e fonctionnement et
chercher comment se di stri buent par rapport
eux l es faits d' interdiction ou d' occultation qui
l eur sont lis. Il s' agit en somme de dfnir l es
stratgies de pouvoir qui sont immanentes cette
volont de savoi r. Sur le cas prci s de la sexualit,
constituer l' conomi e pol itique )) d' une volont
de savoir.
I V
Le dispositi de sexualit
Ce dont il s ' agit dans cette sene d' tudes?
Transcrire en hi stoire la fabl e des Bijou indis
crets.
Au nombre de ses emblmes, notre socit porte
celui du sexe qui parl e. Du sexe qu' on surprend,
qu' on interroge et qui, contraint et volubile l a
foi s, rpond i ntari ssablement. Un certain mca
ni sme, assez ferique pour se rendre l ui-mme
invisible, l'a un jour captur. Il lui fai t dire dans
un jeu o l e plaisir se mle l' involontaire, et le
consentement l ' i nqui si tion, l a vrit de soi et
des autres . Nous vivons tous, depuis bien des
annes, au . royaume du prince Mangogul : en
proi e une immense curi osi t pour le sexe, obsti
ns le questionner, i nsati ables l ' entendre et
en entendre parler, prompts inventer tous l es
anneaux magi ques qui pourraient forcer sa dis
crti on. Comme s' il tait essentiel que nous puis
si ons tirer de ce petit fragment de nous-mmes,
non seulement du pl ai sir, mais du savoir et tout
un jeu subtil qui passe de l'un l ' autre : savoir
du pl aisi r, plai sir savoir le plaisir, pl ai sir-
1 02
La volont de savoir
savoi r; et comme si ce fantasque animal que nous
logeons avait de son ct une oreille assez
curieuse, des yeux assez attentifs, une langue et
un espi t as sez bi en faits , pour en savoi r fort
l ong, et tre tout fai t capabl e de l e di re, ds
qu' on l e sol li cite avec un peu d' adresse. Entre
chacun de nous et notre sexe, l ' Occident a tendu
une incessante demande de vrit : nous de l ui
arracher l a sienne, pui squ' elle lui chappe ; lui
de nous dire l a ntre, pui sque c' est lui qui l a
dtient dans l ' ombre. Cach, l e sexe? Drob par
de nouvelles pudeurs, maintenu sous le boi sseau
par l es exi gences mornes qe la socit bourgeoi se?
I ncandescent au contraire. I l a t plac, voi e:
pl usieurs centaines d' annes, au centre d' une
formi dable ptition de savoir. Ptition doubl e,
car nous sommes astreints savoir ce qu' il en est
de l ui, tandis qu' il est soLponn, lui, de savoir
ce qu' il en est de nous.
La question de ce que nous sommes, une cer
tai ne pente nous a conduits, en quelques sicl es,
la poser au sexe. Et, non pas tellement au sexe
nature (l ment du systme du vivant, objet pour
une bi ol ogie) , mais au sexe histoire, ou sexe
signifcati on, au sexe di scours. Nous nous sommes
pl acs nous mmes sous l e si gne du sexe, mai s
d' une Logi
q
ue du sexe, plutt que d' une Physi
q
ue.
I l ne faut pas s' y tromper : sous la grande srie
des oppositi ons binaires (corps-me, chair-esprit,
insti nct rai son, pulsions conscience) qui sem
bl aient renvoyer le sexe une pure mcari que
s ans raison, l ' Occident est parvenu non pas seule
ment, nn pas tellement annexer l e sexe un
Le dispositi de sexualit 1 03
champ de rationalit, ce qui n' aurait sans doute
rien de bien remarquabl e, tant nous sommes habi
tus depui s les Grecs de telles W conqutes ,
mai s nous faire passer presque tout entier
- nous, notre corps , notre e, notre indivi dua
lit, notre histoire - sous le signe d une logique
de la concupiscence et du dsir. Ds qu' il s' agit
de savoir qui ns sommes, c' est elle qui nous sert
dsormais de clef universelle. De
p
ui s plusieurs
dcennies, l s gnticiens ne conoivent pl us la
vie comme une or
g
ani sation dote en outre de
l' trwge capacit de se reproduire ; i ls voient
dans le mcanisme de reproduction cel a mme qui
introdui t la dimension du biologique : matrice
non seulement des vivants, mai s de l a vie. Or,
voici des sicl es, d' une faon sans doute bien peu
! scientifque Pa les innombrables thoriciens et
praticiens de la chair avai ent dj fait de l' homme
l' enfant d' un sexe imprieux et intelligible. Le
sexe, raison de tout.
Il n' y a pas poser l a question : pourquoi le
sexe est il donc si secret? quelle est cette force
qui si lon
g
temps l' a rduit au sil ence et vient
peine de se relcher, nous permettant peut tre
de le questionner, mai s toujours partir et au
travers de sa rpression? En fait, cette question,
si souvent rpte notre poqueq n' est que la
forme rcente d'une afrmation considrable et
dune
p
rescripti on scul aire : l bas, est la
vrit ; allez l 'y surprendre. Acheronta movebo :
vieille dcisione
1 04 La volont de savoir
Vous
q
ui tes sages et pleins d'une haute et
p
rofonde
[science
Vous qui concevez et savez
Comment, o
et quand tout s 'unit
. . . Vous, grands sages, dites-moi ce qu 'il en est
Dcouvrez-moi ce qu 'il advint de moi
Dcouvrez*moi o
, Loment et qund
Pourquoi semblable chose m'est arrive I ?
I l coni ent donc de demander avant toutes
choses : quelle est cette injonction? Pourquoi
cette grande chasse l a vrit du sexe, l a vrit
dans le sexe?
Dans l e rcit de Diderot, le bon gni e Cucufa
dcouvre au fond de sa poche parmi quelques
mi sres - grai ns bni ts, peti tes pagodes de
pl omb et drages moisi es - l a minuscule bague
d argent dont l e chaton retourn fait parler l es
sexes qu' on rencontre. I l l a donne au sultan
curieux. A nous de savoir quel anneau merveil
l eux confre cheZ nous une pareille pui ssance, au
doi gt de quel matre il a t pl ac ; quel jeu de
pouvoir i l permet ou suppose, et comment chacun
de nous a pu devenir par rapport son propre
sexe et par rapport cel ui des autres une sorte
de sultan attentif et imprudent. Cette bague
magique, ce bijou si indiscret l orsqu' i l s' agit de
faire parl er l es autres - mai s si peu di sert sur son
propre mcanisme, c' est lui qu' i l convi ent de
rendre son tour loquace ; c' est de l ui qu' i l faut
parler. Il faut faire l hi stoi re de cette volont de
1 . G. - A. Brger, ci t
p
ar Scho
p
enhauer. Mtaphysique de
l 'amour.
Le dispositi de sexualit 105
vrit, de cette ptiti on de savoir qui depuis tant
de sicles maintenant fait miroiter le sexe : l' his
toire d' une obstination et d' un acharnement. Que
demandons nous au sexe, au-del de ses pl aisirs
possibles, pour que nous nous enttions ainsi?
Quelle est cette patience ou cette avidit l e cons
tituer comme le secret, l a cause omnipotente, le
sens cach, la peur sans rpit? Et pourquoi la
tche de dcouvrir cette difcile vrit s' est elle
retourne fnalement en une invitation lever les
interdits et dnouer des entraves? Le travail
tait il donc si ardu qu' il fallait l'enchanter de
cette promesse? ou ce savoir tait il devenu d'un
tel prix politique. conomique, thique - qu'il
a fallu, pour y assujettir chacun, l'assurer non
sans paradoxe qu'il y trouverait son afranchis
sement?
Soit, pour situer les recherches venir, quelques
propositions gnrales concernant l' enjeu, la
mthode, le domaine parcourir et les priodisa
tions qu' on peut provisoirement admettre.
1
E N J E U
Pourquoi ces recherches? Je me rends bien
compte qu' une i ncerti tude a travers l es esqui sses
traces plus haut ; el l e ri sque fort de condamner
l es enqutes pl us dtai l l es que j' ai projetes . J ' ai
rpt cent foi s que l ' hi stoi re des derniers si cl es
dans ies socits occidentales ne montrait gure
le jeu d' un pouvoi r essenti ellement rpressi f. J ' ai
ordonn mon propos l a mi se hors jeu de cette
notion en feignant d' i gnorer qu' une criti que tait
mene par aill eurs et d' une faon sans doute bien
plus radi cale : une cri ti que qui s' est efectue au
niveau de la thorie du dsir. Que le sexe ne soit
pas P rprim )) , ce n' est pas en efet une asser
tion bien neuve. Il y a bon temps que des psycha
nalystes l ' ont di t. I l s ont rcus l a petite machine
rie simple qu'on imagi ne vol ontiers lorsqu' on
parle de rpressi on ; l ' i de d' une nergie rebelle
qu' i l faudrait jugul er l eur a paru i nadquate pour
dchi frer l a mani re dont pouvoi r et dsi r s' ar
ticul ent ; i l s l es supposent l i s sur un mode pl us
compl exe et pl us originaire que ce jeu entre une
nergie s auvage, naturel l e et vi vante, montant
1 08 La volont de savoir
sans cesse d' en bas et un ordre d' en haut cher
chant lui faire obstacle ; i l n' y aurait pas ima
giner que le dsir est rprim, pour la bonne rai
son que c' est l a loi qui est constitutive du dsir et
du manque qui l' instaure. Le rapport de pouvoir
serait dj l o est le dsir : illusion donc, de le
dnoncer dans une rpression qui s' exercerait
aprs coup; mai s vanit aussi de partir la qute
d' un dsi r hors pouvoir.
Or, d' une manire obstinment confuse, j' ai
parl, comme sil s' agi ssait de notions quiva
lentes, tantt de l a rpression, tantt de la loi,
de l'interdit ou de la censure. J' ai mconnu - en
ttement ou ngligence tout ce qui peut distin
guer leurs implications thoriques ou pratiques.
Et je conois bien qu'on soit en droit de me
dire : en vous rfrant sans cesse des tech
nologies positives de pouvoir, vous essayez
de gagner au meilleur compte . sur les deux
tableaux; vous confondez vos adversaires sous
la fgure de celui qui est le plus faible, et, dis
cutant l a seule rpression, vous voulez ausi
vement faire croire que vous vous tes dbarrass
du problme de la loi ; et pourtant vous gardez
du principe du pouvoir loi la consquence pra
tique essentiell e, savoir qu' on n'chappe pas au
pouvoir, qu'il est toujours dj l et qu' il constitue
cela mme qu' on tente de lui opposer. De l' ide
d' un pouvoir rpression, vous avez retenu l' l
ment thorique le plus fragile, et pour le critiquer;
de l' i de du pouvoir loi, vous avez retenu, mais
pour le conserver votre propre usage, l a cons
quence politi que l a plus strilisante.
Le dispositi de sexualit 1 09
L' enjeu des enqutes qui vont suivre, c' est
d' avancer moi ns vers une thorie )) que vers une
P analytique ) ) du pouvoi r : je veux dire vers l a
dfni ti on du domaine spci fque que forment l es
relati ons de pouvoir et l a dtermination des i ns
truments qui permettent de l ' anal yser. Or i l me
semble que cette analyti que ne peut se constituer
qu' la condi tion de faire place nette et de s' af
franchi r d' une certaine reprsentati on du pouvoir,
celle que j' appellerais on verra tout l ' heure
pourquoi P juridi co-di scursive )) . C' est cette
concepti on qui commande aussi bien la thmatique
de l a rpres si on que l a thorie de la loi constitu
tive du dsi r. En d' autres termes, ce qui di sti ngue
l ' une de l' autre l ' analyse qui se fait en termes de
rpres si on des i nsti ncts et cel l e qui se fait en
termes de l oi du dsi r, c' est coup sr l a manire
de concevoi r l a nature et l a dynami que des pul
si ons ; ce n' est pas la mani re de concevoir le pou
voir. L'une et l ' autre ont recours une reprsenta
ti on commune du pouvoi r qui , selon l ' usage qu' on
en fai t et l a positi on qu' on lui reconnat l ' gard
du dsi r, mne deux consquences opposes :
soit la promesse d' une V l i bration )) si le pouvoi r
n' a sur l e dsir qu' une pri se extri eure, s oit, s' il
est constitutif du dsi r l ui-mme, l ' afrmati on :
vous tes toujours dj pi gs. N'i magi nons pas,
du reste, que cette reprsentati on soi t propre
ceux qui posent l e problme des rapports du pou
voir au sexe. El l e est en fait beaucoup plus gn
ral e ; on la retrouve frquemment dans les analyses
poli ti ques du pouvoi r, et el l e s' enracine sans
doute l oi n dans l ' hi stoi re de l ' Occident.
1 1 0
La volont de savoir
Voi ci quel ques-uns de ses traits principaux
La relation ngative. Entre pouvoir et sexe,
i l n'tabl it jamai s de rapport que sur l e mode
ngtif . rejet, exclusi on, refus , barr
a
ge, ou
encore occultati on ou masque. Le pouvoir ne
ll peut )) ri en sur l e sexe et l es plai si rs, sauf
l eur dire non ; s' i l produit, ce sont des absences
ou des l acunes ; il l i de des lments, il i ntrodui t
des di scontinuits, il spare ce qui est joint, il
marque des fronti res. Ses efets prennent l a forme
gnrale de la limite et du manque.
L'instance de la rgle. Le pouvoir serait
essentiel l ement ce qui, au sexe, dicte sa loi . Ce qui
veut dire d' abord que le sexe se trouve pl ac par
lui sous un rgi me binaire : licite et illi cite, permi s
et dfendu. Ce qui veut dire ensuite que l e pouvoi r
prescrit au sexe un \ ! ordre qui foncti onne en
mme temps comme forme d' i ntelligibilit : l e
sexe se dchifre partir de son rapport l a l oi .
Ce qui veut di re enfn que l e pouvoir agi t en pro
nonant l a rgl e : l a prise du pouvoi r sur l e sexe
se ferait par l e l angage ou pl utt par un acte de
di scours crant, du fait mme qu' i l s' arti cul e, un
tat de droit. I l parIe, et c' est l a rgle. La forme
pure du pouvoir, on l a trouverait dans la foncti on
du lgisl ateur; et son mode d' action serait par
rapport au sexe de type juridico-discursif.
- Le ccle de l 'interdit : tu n' approcheras pas,
tu ne toucheras pas, t u ne consommeras pas , t u
n' prouveras pas de pl ai si r, t u ne parl eras pas,
t u n' apparatras pas ; l a limite t u n' exi steras
pas, sauf dans l ' ombre et le secret. Sur le sexe,
le pouvoir ne ferai t jouer qu' une loi de pro hi-
Le dispositi de sexualit I I I
biti on. Son obj ectif : que l e sexe renonce
lui-mme . Son instrument : la menace d' un
chtiment qui n' est autre que sa suppressi on.
Renonce toi -mme sous pei ne d' tre suppri m ;
n' apparai s pas si tu ne veux pas disparatre. Ton
exi stence ne sera mai ntenue qu' au prix de ton
annulati on. Le pouvoir ne contrint l e sexe que
par un interdit qui j oue de l ' alternative entre
deux i nexi stences .
- La l09ique de la censure. Cette interdiction
est suppose prendre trois formes ; afrmer que
a n' est pas permi s, empcher que a soit dit,
nier que a existe. Formes apparemment difcil es
conci l i er. Mai s c' est l qu' on imagi ne une sorte
de l ogi que en chane qui serait caractri stique des
mcani smes de censure : el l e lie l ' i nexistant,
l 'illicite et l ' i n formulable de faon que chacun soit
la foi s principe et efet de l ' autre : de ce qui est
interdit, on ne doit pas parl er j usqu' ce qu'il soit
annul dans le rel ; ce qui est i nexi stant n' a
droit aucune manifestati on, mme dans l' ordre
de l a parol e qui nonce son i nexi stence ; et ce qu' on
doit taire se trouve banni du rel comme ce qui est
i nterdi t par excel l ence. La l ogique du pouvoir sur
l e sexe serait la l ogique paradoxale d' une loi qui
pourrait s' noncer comme injonction d' inexis
tence, de non-manifestati on et de mutisme.
- L'unit du dis
p
ositi Le pouvoir sur le sexe
s' exercerait de l a mme faon tous l es niveaux.
Du haut en bas, dans ses dcisions gl obal es comme
dans ses interventi ons capiHaires, quel s que soient
les appareils ou les i nstituti ons sur l esquel s il s' ap
puie, il agirait de faon uniforme et mas sive ; il
1 1 2 La volont de. savoir
fonctionnerait sel on l es rouages si mpl es et ind
fniment reproduits de la loi, de l ' interdit et de l a
censure : de l'
tat la famille, du prince au pre,
du tri bunal l a menue monnaie de punitions quo
tidiennes, des i nstances de l a domination social e
aux structures constitutives du sujet l ui-mme, on
trouverait, des chelles seulement diffrentes,
une forme gnrale de pouvoir. Cette forme, c' est
l e droi t, avec l e jeu du licite et de l' illicite, de la
transgression et du chtiment. Qu' on lui prte la
forme du prince qui formul e le droi t, du pre qui
interdi t, du censeur qui fait taire, ou du matre
qui dit la loi, de toute faon on schmatise le
pouvoir sous une forme juridique ; et on dfnit ses
efets comme obissance. En face d' un pouvoir
qui est loi, le sujet qui est constitu comme sujet
- qui est assujetti " est celui qui obit. A
l'homognit formelle du pouvoir tout au l ong de
ces instances, correspondrait chez celui qu' il
contraint qu' il s' agisse du sujet en face du
monarque, du citoyen en face de l '
tat, de l ' enfant
en face des parents, du di sciple en face du matre
- la forme gnrale de soumi ssion. Pouvoir
lgi slateur d' un ct et sujet obissant de l' autre.
Sous l e thme gnral que le pouvoi r rprime
le sexe, comme sous l'ide de la loi consti tutive
du dsir, on retrouve la mme mcanique suppo
se du pouvoir. Elle est dfnie d' une manire
trangement limitative. D' abord parce que ce
serait un pouvoir pauvre dans ses ressources, co
nome de ses procds, monotone dans les tactiques
qu'il utili se, i ncapabl e d'invention et comme
condamn se rpter toujours lui mme. Ensuite
Le dispositi de sexualit 1 1 3
parce que c' e!t un pouvoir qui n' aurait gure que
l a pui ssance du (( non ) hors d' tat de ri en pro
dui re, apte seulement poser des l imites, i l serait
essentiellement anti-nergie ; tel serait l e para
doxe de son efcace : ne rien pouvoi r, sinon faire
que ce qu' i l soumet ne pui sse rien son tour, si non
ce qu' i l l ui l ai sse fai re. Enfn parce que c' est un
pouvoir dont le modle serait essentiellement juri
di que, centr sur le seul nonc de l a loi et l e seul
fonctionnement de l ' interdit. Tous les modes de
dominati on, de soumi ssi on, d' assujetti ssement se
ramnerai ent fnalement l' efet d' obi ssance.
Pourquoi accepte-t-on si ai sment cette concep
ti on j uri di que du pouvoi r? Et par l l ' lision de
tout ce qui pourrait en fai re l' efcacit productive,
l a richesse stratgique, la posi tivit ? Dans une
socit comme la ntre o les appareils du pouvoir
sont si nombreux, ses rituels si visibles et ses
instruments fnalement si srs, dans cette socit
qui fut, sans doute, plus i nventive que toute autre
en mcani smes de pouvoir subti l s et dl i s, pour
quoi cette tendance ne l e reconnatre que sous l a
forme ngative et dcharne de l 'interdit? Pour
quoi rabattre les di spositifs de l a domination sur
l a seule procdure de l a loi d' i nterdicti on?
Rai son gnrale et tacti que qui semble aller de
soi : c' est la conditi on de masquer une part
importante de lui-mme que le pouvoir est tol
rable. Sa russite est en proporti on de ce qu' il
parvient cacher de ses mcani smes. Le pouvoir
serait-il accept s' i l tait entirement cynique?
Le secret n' est pas pour lui de l ' ordre de l ' abus ;
il est indi spensable son fonctionnement. Et non
1 1 4
La volont de savoir
pas seulement parce qu'il l ' impose ceux qu' il
soumet, mais peut-tre parce qu' i l est ceux-ci
tout aussi indi spensabl e : l ' accepterai ent-i l s, s' ils
n'y voyaient une si mpl e limite pose l eur dsir,
lai ssant valoir une part intacte mme si elle
est rduite - de li bert? Le pouvoir, comme pure
limite trace la libert, c' est, dans notre socit
au moins, la forme gnrale de son acceptabilit.
Il y a peut-tre cela une rai son hi stori que.
Les grandes i nstituti ons de pouvoi r qui se sont
dveloppes au Moyen Age la monarchie, l'
tat
avec ses appareils - ont pris essor sur fond d' une
multiplicit de pouvoirs pralabl es, et jusqu'
un certain point contre eux : pouvoirs denses,
enchevtrs, confictuels, pouvoirs l i s l a domi
nation directe ou indirecte sur la terre, la
possession des armes, au servage, aux liens de
suzerainet et de vassalit. Si elles ont pu s'im
planter, si elles ont su, en bnfciant de toute
une srie d' alliances tacti ques, se faire accepter,
c' est qu' elles se sont prsentes comme i nstances
de rgulation, d' arbitrage, de dlimitati on, comme
une manire d' introduire entre ces pouvoirs un
ordre, de fxer un principe pour les mitiger et les
di stribuer selon des fronti res et une hi rarchie
tablie. Ces grandes formes de pouvoir ont fonc
tionn, en face des puissances multiples et afron
tes, au-dessus de tous ces droits htrognes
comme principe du droit, avec le triple caractre
de se constituer comme ensemble unitaire, d' i den
tifer sa volont la loi et de s' exercer travers
des mcani smes d'interdicti on et de sanction. Sa
formule pa et justitia marque, en cette fonction
Le dispositi de sexualit 1 1 5
laquel le elle prtendait, l a paix comme prohi
bi tion des guerres fodal es ou prives et l aj ustice
comme manire de suspendre le rglement priv
des litiges . Sans doute s' agi ssait-il dans ce dve
loppement des grandes institutions monarchi ques
de bi en autre chose que d' un pur et simple di fce
juridique. Mai s tel fut l e l angage du pouvoir,
telle fut l a reprsentati on qu' il a donne de lui
mme et dont toute l a thori e du droit publ ic
btie au Moyen Age ou rebtie partir du droi t
romain a port tmoi gnage . Le droi t n' a pas t
simplement une arme habi l ement manie par l es
monarque s ; i l a t pour l e systme monarchi que
son mode de manifestati on et l a forme de son
acceptabilit. Depui s le Moyen Age, dans l es
socits occidental es, l ' exercice du pouvoir se
formule toujours dans le droit.
Une tradition qui remonte au XVII
e
ou au
XIX
e
sicl e nous a habitus pl acer le pouvoir
monarchi que absol u du ct du non-droit : l ' arbi
traire, les abus, le capri ce, l e bon vouloir, les pri
vilges et les exceptions , l a continuati on tradi ti on
nelle des tats de fait. Mai s c' est oublier ce trait
hi stori que fondamental que les monarchies occi
dental es se sont di fes comme des systmes de
droit, se sont rfchi es travers des thori es
du droi t et ont fait fonctionner l eurs mcani smes
de pouvoir dans l a forme du droi t. Le vi eux
reproche que Boul ai nvi l l i ers fai sai t l a monar
chie franai se qu' el le s' est servie du droit et des
j uri stes pour abol i r l es droi ts et abai sser l ' aris
tocratie est sans doute fond en gros. A travers
le dvel oppement de la monarchie et de ses insti-
1 1 6 La . volont de savoir
tutions s' est instaure cette dimension dujuridico
politique; elle n' est certainement pas adquate
la manire dont le pouvoir s' est exerc et
s'exerce ; mais el l e est l e code selon lequel il se
prsente. et prescrit l ui-mme qu' on l e pense.
L ' hi stoire de l a monarchie et l e recouvrement
des faits et procdures de pouvoir par le di scours
juridico-pol i ti que ont t de pair.
Or, malgr les eforts qui ont t faits pour
dgager le j uri dique de l' i nstituti on monarchique
et pour librer l e politi que du juridique, l a
reprsentation du pouvoir est reste pri se dans
ce systme . Soi ent deux exemples . La cri
tique de l ' instituti on monarchi que en France au
XVIII
e
sicle ne s' est pas faite contre le systme
juridico-monarchi que, mai s au nom d' un systme
juridique pur, rigoureux, dans lequel pourraient
se couler sans excs ni irrgul arits tous l es m
canismes de pouvoi r, contre une monarchie qui,
malgr ses afrmati ons, dbordai t sans cesse l e
droi t et se pl aait elle-mme au-dess1s des loi s.
La criti que politique s' est alors servie de toute l a
rfexion juridi que qui avait accompagn l e
dveloppement de l a monarchi e, pour condamner
cel le-ci ; mai s elle n'a pas mis en question l e prin
cipe que l e droit doi t tre l a forme mme du pou
voir et que l e pouvoir devait toujours s' exercer
dans la forme du droit. Un autre type de cri
ti que des instituti ons politi ques est apparu au
XIX
e
sicl e ; criti que beaucoup pl us radi cale puis
qu'il s' agi ssai t de motrer non pas seulement
que l e pouvoir rel chappait aux rgles du
droit, mai s que l e systme du droit lui-mme
Le dispositi de sexualit 1 1 7
n' tait qu'une manire d' exercer la violence, de
l ' annexer au proft de certai ns, et de faire fonc
tionner, sous l ' apparence de l a loi gnral e, l es
di ssymtries et l es injustices d'une domination.
Mai s cette critique du droit se fait encore sur
fond du postulat que l e pouvoir doit par essence,
et idalement, s' exercer selon un droit fondamen
tal.
Au fond, malgr les difrences d' poques et
d' objectifs , la reprsentation du pouvoir est
reste hante par l a monarchie. Dans l a pense
et l' analyse politique, on n' a toujours pas coup
l a tte du roi. De l l ' importance qui est encore
donne dans l a thorie du pouvoir au problme
du droit et de la violence, de la loi et de l 'illga
lit, de la volont et de la libert, et surtout de
l '
tat et de la souverainet (mme si cell e-ci est
interroge non pl us dans l a personne du souve
rain mai s dans un tre collecti f. Penser le pou
voir partir de ces problmes, c'est les penser
partir d'une forme hi storique bien parti culire
nos socits : la monarchie juridique. Bien par
ticul ire et malgr tout transitoire. Car si beau
coup de ses formes ont subsist et subsi stent
encore, des mcanismes de pouvoir trs nouveaux
l' ont peu peu pntre, qui sont probablement
irrductibl es l a reprsentation du droit. On l e
verra pl us l oi n, ces mcanismes de pouvoir sont
pour une part au moins ceux qui ont pris en
charge, partir du XVIII
e
sicle, la vie des hommes,
l es hommes comme corps vivants. Et s' il est vrai
que le juridique a pu servir reprsenter de
faon sans doute non exhaustive, un pouvoir
1 1 8 La volont de savoir
essentiellement centr sur l e prl vement et l a
mort, i l est a
b
sol ument htrogne aux nouveaux
procds de pouvoi r qui foncti onnent non pas au
droit mais l a techni que, non pas l a l oi mais
l a normal i sati on, non pas au chtiment mai s au
contrl e, et qui s' exercent des ni veaux et dans
des formes qui dbordent l '
tat et ses apparei l s.
Nous sommes entrs, depui s des sicl es mai nte
nant, dans un type de socit o l e juridi que peut
d
e moins en moins coder l e pouvoir ou l ui servir
de systme de reprsentati on. Notre l i gne de
pente nous l oi gne de pl us en pl us d' un rgne du
droit qui commenait dj recul er dans l e pass
l ' poque o l a Rvol uti on franaise et avec ell e
l ' ge
d
es constituti ons et des codes sembl ai ent l e
promettre pour un avenir proche.
C'est cette reprsentati on juri
d
i que qui est
encore l ' uvre dans l es analyses contempo
raines sur les rapports du pouvoi r au sexe . Or l e
problme, ce n' est pas de savoi r si le dsir est
bien tranger au pouvoir, s' il est antri eur la
l oi comme on l'imagine souvent ou si ce n' est
poi nt l a l oi au contraire qui l e constitue. L n' est
pas l e poi nt. Que le dsir soit ceci ou cel a, de
toute faon on continue l e concevoir par rap
port u
n
pouvoir qui est toujours juri di que et
di scursi f un pouvoi r qui trouve son poi nt cen
tral dans l ' nonciation de l a l oi . On demeure atta
ch une certaine image du pouvoir-loi , du pou
voir souverainet que l es thorici ens du droi t et
l ' i nstitution monarchi que ont dessi ne. Et c' est
de cette i mage qu' i l faut s' afranchir, c' est--dire
du privil ge thorique de l a loi et de l a souverai-
Le dispositi de sexualit 1 1 9
net, si on veut faire une analyse du pouvoir dans
l e jeu concret et hi storique de ses procds. I l
faut btir une analytique du pouvoir qui ne pren
dra pl us le droit pour modle et pour code.
Cette hi stoire de l a sexualit, ou plutt cette
srie d' tudes concernant l es rapports hi stori ques
du pouvoir et du discours sur l e sexe, je reconnai s
volontiers que le projet en est circulaire, en ce
sens qu' i l s' agit de deux tentatives qui renvoient
rune l ' autre. Essayons de nous dfaire d' une
reprsentation juridique et ngative du pouvoir,
renonons le penser en termes de loi, d'interdit,
de libert, et de souverainet : comment ds lors
analyser ce qui s' est pass, dans l'histoire
rcente, propos de cette chose, en apparence
une des plus interdites de notre vie et de notre
corps, le sexe? Comment, si ce n'est sur le mode
de la prohibition et du barrage, l e pouvoir a-t-il
accs lui ? Par quels mcanismes, ou tactiques,
ou dispositifs? Mai s admettons en retour qu' un
examen un peu soigneux montre que dans les
socits modernes l e pouvoir n' a pas, de fait, rgi
la sexual it sur le mode de la loi et de la souverai
net ; supposons que l ' analyse historique ait rvl
la prsence d'une vritabl e P technologie )) du
sexe, beaucoup plus complexe et surtout beau
coup pl us positive que le seul efet d' une ! d
fense )) ; ds lors, cet exemple qu'on ne peut
manquer de considrer comme privilgi, puisque
l , mieux que partout ailleurs, l e pouvoir semblai t
fonctionner comme interdit ne contraint-il pas
se donner, propos du pouvoir, des princi pes
d' analyse qui ne relvent pas du systme du droit
1 20 La volont de savoir
et de l a forme de l a loi ? Donc, il s' agit la foi s, en
s e donnant une autre thorie du pouvoira de for
mer une autre gri lle de dchi frement histori que ;
et, e n re
g
ardant d' un pe u prs tout un matriau
hi stori que, d' avancer peu peu vers une autre
concepti on du pouvoi r. Penser la foi s l e sexe
sans l a loi , et l e pouvoi r sans le roi -
2
M T HODE
Donc : analyser la formation d' un certain type
de savoir sur le sexe, en termes non de rpression
ou de loi, mai s de pouvoir. Mai s ce mot de pou
voir )) ri sque d' induire plusieurs malentendus.
Mal entendus concernant son identit, sa forme,
son unit. Par pouvoir, j e ne veux pas dire l e
Pouvoir P a comme ensemble d'institutions et d' ap
pareils qui garanti ssent la sujtion des citoyens
dans un
tat donn. Par pouvoir, je n' entends pas
non pl us un mode d' assujettissement, qui par
opposition la vi olence, aurait l a forme de l a
rgle. Enfn, je n' entends pas un systme gn
ral de domi nation exerce par un lment ou
un groupe sur un autre, et dont les efets, par
drivations successives, traverseraient le corps
social tout entier. L' analyse, en termes de pou
voir, ne doi t pas postuler, comme donnes ini
ti al es, l a souverai net de l '
tat, l a forme de
la loi ou l ' unit globale d' une domination; cell es
ci n' en sOIt pl utt que l es formes terminal es. Par
pouvoir, \ il me semble qu' il faut comprendre
d' abord l a mul tiplicit des rapports de frc qui
1 2 2 La volont de savoir
sont immanents au domaine o i ls s'exercent, et
sont constitutifs de leur organisation; le jeu qui
par voie de luttes et d' afrontements incessants
les transforme, les renforce, les inverse ; l es
appuis que ces rapports de force trouvent les
uns dans l es autres, de manire former chane
ou systme, ou, au contraire, les dcalages,
les contradi cti ons qui les isolent les uns des
autres ; l es stratgi es enfn dans l esquel les ils
prennent efet, et dont le dessin gnral ou la
cristalli sation institutionnelle prennent corps
dans l es appareils tati ques, dans la formu- ,
lation de la l oi , dans l es hgmonies
La condition de possibilit du pouvoir, en
cas le point de vue qui permet de rendre intel
li gible son exercice, jusqu' en ses efets l es plus
priphriques l a et qui permet aussi d' uti
l i ser ses mcanismes comme grille d' intelligibi
lit du champ social , i l ne faut pas la chercher
dans l' exi stence premire d'un point central,
dans un foyer unique de souverainet d' o rayon
neraient des formes drives et descendantes ;
c' est l e socle mouvant des rapports de force qui
induisent sans cesse, par l eur ingalit, des tats
de pouvoir, mai s toujours locaux et instables.
Omniprsence du pouvoir : non point parce qu'il
aurait le privilge de tout regrouper sous son
invincible unit, mai s parce qu' il se produit
chaque instant, en tout point, ou plutt dans
toute relation d' un point un autre. Le pouvoir
est partout ; ce n' est pas qu' il englobe tout, c' est
qu'il vient de partout. Et le pouvoir dans ce
qu' il a de permanent, de rptitif, d' inerte, d' auto-
Le dispositi de sexualit 1 2 3
reproducteur, n' est que l ' efet d' ensemble, qui se
dessine partir de toutes ces mobilits, l ' en
chanement qui prend appui sur chacune d' elles
et cherche en retour les fxer. I l faut sans doute
tre nominaliste : le pouvoir, ce n' est pas une insti
tuti on, et ce n' est pas une structure, ce n' est pas
une certaine pui ssance dont certains seraient
dots : c' est le nom qu' on prte une situation
stratgique complexe dans une socit donne.
Faut-il al ors retourner la formule et dire que
l a politique, c' est l a guerre poursuivie par
d' autres moyens? Peut-tre, si on veut toujours
maintenir un cart entre guerre et politi que,
devrai t-on avancer pl utt que cette multiplicit
des rapports de force peut tre code en partie
et j amais totalement soit dans la forme de
la !! guerre ll q soit dans la forme de la t! poli
tique I ; ce seraient l deux stratgi es difrentes
(mai s promptes basculer l'une dans l ' autre)
pour intgrer ces rapports de force dsquili
brs, htrognes, instabl es, tendus.
En suivant cette l i gne, on pourrait avancer un
certain nombre de propositi ons :
q
le pouvoir n' est pas quel que chose qui
s' acquiert, s' arrache ou se partage, quel que
chose qu' on garde ou qu' on l aisse chapper ;
le pouvoir s' exerce partir de points innom
brables, et dans l e jeu de relations ingali
taires et mobil es;
que l es rel ations de pouvoir ne sont pas en posi
tion d'extri orit l ' gard d' autres types de
rapports (processus conomi ques, rapports
de connaissance, relati ons sexuelles) , mai s
1 24
La volont de savoir
qu' elles leur sont immanentes ; elles sont les
efets immdiats des partages, ingalits et
dsquilibres qui s' y produi sent, et elles
sont rciproquement les conditions internes
de ces difrenciations ; l es relations de pou
voir ne sont pas en de super
structure, avec un simple rle de prohib
i
tion
ou de reconduction; elles ont, l o elles
jouent, un rle di rect
e
ment producteur ;
- que le pouvoir vient d' en bas ; ' est--dire qu'il
n' y a pas, au principe des , relati ons de pou
voir, et comme matrice gnrale, une opposi
tion binaire et globale entre les dominateurs
et les domins, cette dual
it
se rpercutant
de haut en bas, et sur des groupes de lus en
plus restreints jusque dans les profondeurs
du corps social. I l faut plutt supposer que
l es rapports de force multiples qui se forment
et jouent dans les appareils de producti on,
l es familles, les groupes restreints, les i nsti
tutions, servent de support de l arges e'ts
de clivage qui parcourent l' ensemble du
corps social . Ceux-ci forment alors une ligne
de force gnrale qui traverse les afront
ments locaux, et les relie ; bien sr, en retour,
ils procdent sur eux des redi stributions ,
des ali gnements, des homognisations,
des amnagements de srie, des mises en
convergence. Les grandes dominations sont
l es efets hgmoniques que soutient conti
nment l' intensit de tous ces afrontements ;
- que les relations de pouvoir sont l a foi s intn
tionnelles et non subjectives. Si, de fait, elles
Le dispositi de sexualit 1 2 5
sont intelli gibles, ce n' est pas parce qu'elles
seraient l ' efet, en terme de causalit, d' une
instance autre, qui l es (( expliquerait mai s,
c' est qu' elles sont, de part en part, traverses
par un calcul : pas de pouvoir qui s' exerce
sans une srie de vises et ,d" objectifs. Mais
cela ne veut pas dire qu' il rsulte du choix
ou de l a dcision d' un sujet individuel ; ne
cherchons pas l ' tat-major qui prsi de sa
rati onalit ; ' ni l a caste qui gouverne, ni les
groupes qui contrlent les appareils de l '
tat,
ni ceux qui prennent les dcisions cono
miques les plus importantes ne grent l ' en
semble du rseau de pouvoir qui fonctionne
dans une socit (et la fait fonctionner) ;
l a rati onalit du pouvoir, c' est
celle de
tactiques souvent fort explicites au niveau
limit o elles s'inscrivent cynisme local du
pouvoir qui, s' enchanant l es unes aux
autresq s' appelant et se propageant, trou
vant ailleurs leur appui et leur conditi on,
dessinent fnalement des dispositifs d' en"
semble : l, la logi que est encore parfaite
ment claire, les vises dchifrabl es, et pour
tant, il arrive qu' i l n'y ait plus personne
pour les avoir conues et bi en peu pour les
formuler : caractre impli cite des grandes
stratgies anonymes, presque muettes, qui
coordonnent des tacti ques l oquaces dopt les
! ! inventeurs P ou l es responsables sont sou
vent sans hypocri si e ;
que l o il y a pouvoi r, il y a rsistance et que
pourtant, ou plutt par l mme, celle-ci n' est
1 26
La volont de savoir
jamai s en position d' extriorit par rapport
au pouvoir. Faut il dire qu' on est ncessai
rement dans )) le pouvoir, qu' on ne lui
chappe )) pas, qu' il n' y a pas, par rap
port lui, d' extrieur absolu, parce qu' on
serait immanquablement soumis l a loi?
Ou que, l' hi stoire tant l a ruse de l a rai
son, le pouvoir, lui, serait la ruse de l' his
toire -, celui qui toujours gagne? Ce serait
mconnatre l e caractre strictement rel a
tionnel des rapports de pouvoir. Il s ne peuvent
exi ster'' qu'en fonction d' une multiplicit de
points de rsistance : ceux ci jouent, dans
les rel ations de pouvoir, l e rle d' adversaire,
de cibl e, d' appui, de saillie pour une pri se.
Ces points de rsistance sont prsents prtout
dans l e rseau de pouvoir. I l n'y a .onc pas
i par rapport au pouvoir un l i eu du grand
Refus - me de l a rvolte, foyer de toutes
l es rbellions, loi pure d rvolutionnaire.
Mai s des rsistances qui
sont des cas d' es
pces : possibles, ncessaires, improbabl es,
spontanes, sauvages, solitaires, concertes,
r amp ant e s , vi ol ent e s , i rrc onci l i abl e s ,
promptes l a transaction, intresses, ou
sacrifcielles; par dfnition, elles ne peuvent
exister que dans l e champ stratgique des
relations de pouvoir. Mai s cela ne veut pas
dire qu' ells n' en sont que le contrecoup,
la marque en creux, formant par rapport
l ' essentiell e domination un envers fnalement
toujours passif, vou l' indfnie dfaite. Les
rsistances ne relvent pas de quelques prin-
Le dispositi de sexualit 1 2 7
cipes htrognes ; mai s elles n e sont pas pour
autant leurre ou promesse ncessairement
due. Ell es sont l' autre terme, dans les
relati ons de pouvoir; ell es s'y inscrivent
comme l' irrductible vis--vi s . Elles sont
donc, elles 8tSSi , distribues de faon irr
gulire : les points, les nuds, les foyers de
rsi stance sont di ssmins avec plus ou moi ns
de densit dans le temps et l ' espace, dressant
parfoi s des groupes ou des indivi dus de
manire dfniti ve, allumant certai ns points
du corps, certains moments de l a vie, cer
tai ns types de comportement. Des grandes
ruptures radical es, des partages binaires
et massifs ? Parfoi s. Mai s on a afaire le pl us
souvent des points de rsi stance mobiles
et transitoires, introdui sant dans une soci t
des clivages qui se dpl acent, bri sant des
units et suscitant ds regroupements, sil
lonnant les i ndividus eux-mmes, les dcou
pant et les remodelant, traant en eux, dans
l eur corps et dans leur me , des rgions
i rrductibles. Tout comme le r seau des rel a
tions de pouvoir fnit par former un pai s
ti ssu qui traverse le,s apparei l s et l es insti
tuti ons, sans se local i ser exactement er eux,
de mme l ' essaimage des points de rsis
tance traverse l es stratifcati ons soci al es et
les units individuell es. Et, c' est sans doute
le codage stratgique
o
e ces points de rsis
tance qui rend possi ble une rvolution, un
peu comme l'
tat repose sur l' intgration
instituti onnelle des rapports de pouvoir.
1 28
La volont de savoir
C' est dans ce champ des rapports de force
qu' i l faut tenter d' analyser les mcani smes de
pouvoi r. Ainsi , on chappera ce systme Sou
verai n- Loi qui a si l ongtemps fasci n l a pense
politi que. Et, s'il est vrai que Machi avel fut un
des rares et c' tait l sans doute l e scandale
de
on l cyni sme ll - penser le pouvoi r du
Prirce en termes de rapports de force, peut
tre faut-il fai re un pas de pl us , se passer du per
sonnage du Pri nce, et dchi frer l es mcani smes
de pouvoi r parti r d' une stratgi e i mmanente aux
rapports de force.
Pour en reveni r au sexe et aux di scours de
vri t qui l ' ont pri s en charge, 1 a questi on
rsoudre ne doi t donc pas tre : tant donn
tel l e structure tati que, comment et pourquoi
f!
l e Il pouvoi r a-t-il besln d' instituer un savoi r
du sexe? Ce ne sera pas non pl us : quel l e domi
nati on d' ensemble a servi l e soi n apport, depui s
l e XVIII
e
si cl e, produi re sur l e sexe des di scours
vrai s? Ni non pl us " : quel l e loi a prsi d l a foi s
l a rgul arit du comportement sexuel et l a
conformi t de ce qu' on en di sai t? Mai s : dans tel
type de di scours sur le sexe, dans telle forme
d' extorsi on de vrit qui apparat hi stori quement
et dans des l i eux dtermi ns ( autour du corps de
l ' enfant, propos du sexe de la femme, l ' occasi on
des prati ques de restricti ons des nai ssances , etc . )
quell es sont l es relati ons de pouvoi r, l es pl us
i mmdi ates, l es pl us l ocales , qui sont l ' uvre ?
Comment rendent-el l es possi bl es ces sortes de
Le dispositi de sexualit 12 9
di scolu' s, et inversement comment ces discours
leur servent-ils de support? Comment le jeu de
ces relations de pouvoir se trouve-t-il modif
par leur exercice mme renforcement de cer
tains termes, afaiblissement d' autres, efets de
rsistance, contre-investi ssements, de sorte qu' il
n' y a pas eu, donn une foi s pour toutes, un
type d' assujetti ssement stabl e? Comment ces rela
ti ons de pouvoir se lient-elles l es unes aux autres
selon l a logique d' une stratgie globale qui prend
rtrospectivement l ' al l ure d' une politi que uni
taire et volontari ste du sexe? En gros : plutt
que de rapporter la forme unique du grand
Pouvoir, toutes l es violences i nfnitsimales qui
s ' exercent sur le sexe, tous les regards troubles
qu' on porte sur lui et tous les caches dont on
en oblitre la .connai ssance possiblea il s' agit
d' immerger la production foi sonnante des dis
cours sur le sexe dans le champ des relations de
pouvoir multiples et mobil es.
Ce qui condui t poser- titre pralable, quatre
rgles. Mai s ce ne sont point des impratifs de
mthode; tout au pl us des prescriptions de pru
dence.
1 . Rgle d'immanence
Ne pas consi drer qu' i l y a un certain domaine
de la sexualit qui relve en droit d' une connais
sance scientifque, dsintres se et libr
e
, mais
sur lequel les exi gences conomi ques ou ido
logi ques du pouvoir ont fait jouer des mca"
1 30 La volont de savoir
ni smes de prohibiti on. Si la sexualit s' est consti
tue comme domaine connatre, c' est partir
de relati ons de pouvoir qui l' ont institue comme
objet possi bl e ; et en retour si le pouvoir a pu la
prendre pour cibl e, c' est parce que des techniques
de s avoi r, des procdures de discours ont t
c apables de l' investi r. Entre techniques de savoir
et stratgi es de pouvoi r, nulle extriorit, mme
si el les ont leur rl e spcifque et qu' elles s' arti
culent l ' une sur l ' autre, partir de l eur dif
rence. On partira donc de ce qu' on pourrait appe
ler les !! foyers locaux l de pouvoir-savoir :
par exempl e, les rapports qui se nouent entre
pnitent et confesseur, ou fdle et di recteur : l
et sous l
e
signe de l a \ chair l matri ser, dif
rentes formes de discours - examen de soi-mme,
interrogatoi res, aveux, interprtati ons, entre
ti ens - vhi culent dans une sorte d' alles et
venues incessantes des formes d' assujettissement
e. t es schmas de connaissance. De mme, le
corps de l' enfant survei l l , entour dans son ber
ceau, son l i t ou sa chambre par toute une ronde
de parents, de nourrices, de domestiques, de
pdagogues, de mdeci ns, tous attentifs aux
moi ndres manifestati ons de son sexe, a constitu,
surtout partir du XVIII
e
sicle, un autre ! foyer
l ocal l de pouvoir-savoir.
2 . Rgles des variations continues
Ne pas chercher qui a l e pouvoir dans l ' ordre
de la sexualit (les hommes, les adultes, les
Le dispositi de sexualit 1 31
parents, l es mdecins) et qui en est priv (les
femmes, les adolescents, les enfants, les ma
lades . . . ) ; ni qui a le droit de savoir, et qui est
maintenu de force dans l'ignorance. Mas cher
cher plutt le schma des modifcations que les
rapports de force impliquent pa leur jeu mme.
Les di stributions de pouvoir Pq les ' appropria
tions de savoir ne reprsentent jamais que des
coupes i nstantanes, sur des processus soit de
renforcement cumul de l'lment l e plus fort,
soit d'inversion du rapport, soit de croissance
simultane des deux, termes. Les relati ons de
pouvoir-savoi r ne sont pas des formes donnes de
rpartition, ce sont des matri ces de transfor
mations )) . L' ensemble " constitu au X
e
sicle,
par le pre, la mre, l' ducateur, l e mdecin
autour de l ' enfant et de son sexe, a t travers
de modifcations incessantes, de dplacements
continus dont un des rsultats les plus specta
culaires a t un trange renversement : alors
que la sexualit de l' enfant avait t au dpart
problmatise dans un rapport qui s'tablissait
directement du mdecin aux parents (sous la
forme de
c
onsei l s, d' avis le surveiller, de me
naces pour l' avenir) , c' est fnalement dans le
rapport du psychiatre l ' enfant que la sexualit
des adultes eux-mmes s' est trouve mise en
question.
3. Rgle du double conditionnement
Aucun foyer local )i , aucun ! schma de trans
formati on )) ne pourrait fonctionner si , par une
1 32 La volont de savoir
sene d' enchanements successifs, il ne s' i nscri
vait en fn de compte dans une stratgie d' en
sembl e. Et inversement, aucune stratgie ne
pourrait assurer des efets globaux si el l e ne
prenait appui sur des relati ons prci ses et tnues
qui lui servent non pas d' appl i cation et de cons
quence, mai s de support et de point d' ancrage.
Des unes aux autres, pas de discontinuit comme
s' il s' agi ssai t de deux ni veaux di frents ( l ' un
microscopi que et l ' autre macroscopique) ; mai s
pas non pl us d' homognit (comme si l ' un n' tait
que la projection grossi e ou la mini aturisation
de l ' autre) ; i l faut plutt penser au doubl e condi
ti onnement d' une stratgie par l a spcifcit des
tacti ques possi bl es, et des tactiques par l ' enve
loppe stratgi que qui les fai t foncti onner. Ainsi le
pre dans la famille n'est pas le ! reprsentant
du souverain ou de l '
tat ; et ceux-ci ne sont point
l es projecti ons du pre une autre chel l e. La
famille ne reproduit pas l a socit ; et cell e-ci
en retour ne l ' imite pas. Mai s le di spositif fami
lial, dans ce qu' i l avait justement d'i nsul aire et
d'htromorphe aux autres mcani smes de pou
voir, a pu servir de support aux grandes ma
nuvres pour le contrle malthusien de l a nata
lit, pour l es incitati ons populationnistes, pour
l a mdicali sation du sexe et la psychiatri sation
de ses formes non gnital es.
4. Rgle de la polalence tactique des discours
Ce qui se dit sur le sexe ne doit pas tre analys
comme l a simpl e surface de projecti on de ces
Le dispositi de sexualit 1 33
mcani smes de pouvoi r. C' est bi en dans le
discours que pouvoir et savoir viennent s' ar
ti culer. Et pour cette raison mme, il faut conce
voir le di scours comme une srie de segments
discontinus, dont la fonction tactique n' est ni
uniforme ni stabl e. Plus prcisment, il ne faut
pas imaginer un monde du di scours partag
entre le discours reu et le di scours exclu ou entre
le di scours dominant et celui qui est domin;
mai s comme' une multi plicit d' lments discur
sifs qui peuvent jouer dans des stratgi es di
verses. C' est cette di stribution qu' il faut restituer,
avec ce qu'elle comporte de choses dites et de
choses caches, d' nonciations requises et inter
dite s ; avec ' ce qu'elle suppose de variantes et
d' efets di frents selon celui qui parl e, sa posi
tion de pouvoir, le contexte institutionnel o il
se trouve plac; avec ce qu' elle comporte aussi
de dplacements et de rutilisations de formules
identiques pour des objectifs opposs. Les dis
cours, pas plus que les silences, ne sont une fois
pour toutes soumis au pouvoir ou dresss contre
lui . Il faut admettre un jeu complexe et instabl e
o l e discours peut tre la foi s instrument et
efet de pouvoir, mais aussi obstacle, bute, point
de rsistance et dpart pour une stratgie oppo
se. Le discours vhicule et produit du pouvoir;
il le renforce mais aussi le mine, l ' expose, le rend
fragile et permet de le barrer. De mme le silence
et l e secret abritent le pouvoir, ancrent ses inter
dits ; mais ils desserrent aussi ses prises et m
nagent des tolrances plus ou moins obscures.
Qu' on songe par exemple l 'hi stoire de ce qui
1 34 La volont de savoir
fut par excel l ence W l e Il grand pch contre na
ture. L' extrme di scrti on des textes sur l a s odo
mi e cette catgorie si confuse " la rti cence
presque gnral e en parler a permis l on
g
temps
un foncti onnement doubl e : d' une part une
extrme svrit ( pei ne du feu appl i qLe e ncore
au XVIII
e
si cl e, sans qu aucune protestati on im
portante ait pu tre formule a'ant l e mi l i eu du
sicl e) et d' autre part une tolrance assurment
trs l arge (qu' on ddui t i ndirectement de l a raret
des condamnations judi ci aires, et qu' on aperoi t
pl us di rectement travers certai ns tmoi gnages
sur l es socits d' l: ommes qui pouvaient exi ster
l ' arme ou dans les Cours ) . Or, l ' appariti on
au XIX
e
si cl e, dans l a psychi atrie, l a juri spru
dence, la li ttrature aussi , de toute une srie de
di scours sur les espces et sous"espces d' homo
sexualit, d' inversi on, de pdrasti e, d' herma
phrodi sme psychi que Il , a permis coup sr une
trs forte avance des contrl es soci aux dans
cette rgi on de perversi t Il ; mai s el l e a permi s
aussi la constituti on d' un di scours en retour Il :
l' homosexual i t s' est mi se parl er d el l e"mme.
revendi quer s a l
g
iti mi t ou s a natural it
Il
et souvent dan s le vocabul ai re, avec l es catgo
rie s par l esquel l es el l e tait mdi cal ement di s
qualife . I l n' y a pas d' un ct l e di scours du
pouvoir et en face, un autre qui s' oppose l ui -
Les di scours sont des l ments ou des bl ocs tac
tiques dans l e champ des rapports de force ; il
peut y en avoi r de di frents et mme de contra
di ctoires l ' i ntri eur d' une mme stratgi e ; i l s
peuvent au contraire ci rculer sans changer de
Le dispositi de sexualit 1 35
forme entre des stratgi es opposes. Aux discours
sur le sexe, i l n' y a pas demander avant tout
de quelle thorie implicite i ls drivent, ou quels
partages moraux ils reconduisent, ou quelle i do
logie - dominante ou domine ils reprsentent;
mai s il faut les interroger aux deux niveaux de
leur productivit tactique (quel s efets rci
proques de pouvoir et de savoir ils assurent) et
de leur intgrati on stratgique (quelle cononc
ture et quel rapport de force rend leur utilisation
ncessa
i
re en tel ou en tel pi sode des afronte
ments divers qui se produi sent) .
Il s' agit en somme de s' orienter vers une
conception du pouvoir qui, au privilge de la loi,
substitu
e
le point de vue de l' obj ectif, au privilge
de l' interdit l e point de vue de l' efcacit tac
tique, au privilge de la souverainet, l ' ana
lyse d' un champ multiple et mobil e de rapports
de force o se produisent des efets globaux,
mais jamais totalement stables, de domination.
Le modl e stratgique, plutt que le modle du
droit. Et cela, non point par choix spculatif ou
prfrence thorique ; mais parce qu' en efet,
c' est un des traits fondaentaux des socits
occidentales que les rapports de force qui long
temps avaient trouv dans l a guerre, dans toutes
l es formes de guerre, leur expression principale
se sont petit petit investi s dans l' ordre du pou
voir politi qe.
3
DOMA I N E
Il ne faut pas dcrire l a sexualit comme une
pousse rtive, trangre par nature et indocile
par ncessi t un pouvoir qui, de son ct,
s' pui se la soumettre et souvent choue la
matri ser entirement. Elle apparat plutt comme
un point de passage particulirement dense pour
les rel ations de pouvoir : entre hommes et femmes,
entre jeunes et vieux, entre parents et progniture,
entre ducateurs et lves, entre prtres et lacs,
entre une administration et une population. Dans
l es relati ons de pouvoir, l a sexualit n' est pas
l ' lment le pl us sourd, mai s un de ceux, plutt,
qui est dot de l a pl us grande instrumentalit : uti
li sabl e pour le pl us grand nombre de manuvres,
et pouvant servir de poi nt d' appui, de charnire
aux stratgies les plus vari es.
I l n'y a pas une stratgie unique, globale,
valant pour toute l a soci t et portant de faon
uniforme sur toutes les manifestations du sexe :
l ' i de, par exempl e, qu' on a souvent cherch,
travers di frents moyens, rduire tout le
sexe sa foncti on reproductrice, sa forme
Le dispositi de sexualit 1 37
htrosexuel l e et adul te, et sa l gitimit matri
moni al e, ne rend pas compte, sans doute, des
multipl es objecti fs vi ss, des multipl es moyens
mi s en uvre dans l e s pol i ti ques sexuel l es
qui ont concern l es deux sexes, l es difrents
ges, l es di verses cl asses soci al es .
En premi re approche, i l semble qu' on pui sse
di sti nguer, partir du XVIII
e
si cle, quatre grands
ensembl es statgi ques , qui dvel oppent propos
du sexe des di s positifs spci fques de savoir et de
pouvoir. Il s ne sont pas ns tout d' une pice ce
moment l ; mai s i l s ont pri s al ors une cohrence,
ils ont atteint dans l ' ordre du pouvoir une efca
cit , dans l ' ordre du savoi r une producti vit qui
permettent de l es dcrire dans leur rel ative auto
nomI e.
Hystrisation du corps de lafemme : triple pro
cessus par l equel l e corps de l a femme a t ana
lys quali f et di squal i f comme corps int
gral ement satur de sexualit ; par l equel ce corps
a t intgr, s ous l ' efet d' une pathologie qui l ui
serait intrinsque, au champ des prati ques mdi
cales ; par l equel enfn il a t mi s en communi ca
tion organique avec l e corps social (dont i l doi t
assurer l a fcondi t rgl e) , l ' espace fami l i al
(dont il doit tre un l ment substanti el et fonc
tionnel) et l a vie des enfants (qu' i l produit et qu' i l
doi t garanti r, par une responsabi lit bi ol ogi co
moral e qui dure tout au l ong de l ' ducati on) : l a
Mre, ave
c
son i mage en ngatif qui est l a ! ! femme
nerveuse = constitue la forme l a plus visible de
cette hystri sati on. ,
Pdagogisation du sexe de l 'enant : doubl e
1 38 La volont de savoir
afrmation que presque tous l es enfants se livrent
ou sont suscepti bl es de se livrer une activit
sexuel l e ; et que cette activit sexuelle tant i ndue,
la foi s naturelle )) et \ contre nature l elle
porte en el l e des dangers physi ques et moraux,
collectifs et i ndividuel s ; l es enfants sont dfni s
comme des tres se7uel s l imi naires )' , en de
du sexe et dj en l ui , sur une dangereuse l igne de
partage ; l es parents, l es familles, l es ducateurs,
l es mdeci ns, l es psychologues plus tard doivent
prendre en charge, de faon continue, ce germe
sexuel prci eux et prilleux, dangereux et en
danger; cette pdagogisation se montre surtout
dans la guerre contre l' onanisme qui a dur en
Occident pendant prs de deux sicl es.
Socialisation des conduites procratrices : so
ciali sati on conomique par le biais de toutes les
incitations ou freins apports , par des mesures
soci al es
)) ou fscales , l a fcondit des couples ;
soci al i sation poli tique par l a responsabili sation
des couples l' gard du corps social tout entier
(qu' il faut limiter ou au contraire renforcer) ,
socialisation mdical e, par la valeur pathogne,
pour l' individu et l ' espce, prte aux pratiques
d' un contrle des nai ssances.
Enfn psychiatrisation du plaisir perers : l ' ins
tinct sexuel a t isol comme instinct bi ologique
et psychique autonome ; on a fai t l' analyse cli
ni que de toutes l es formes d' anomal i es dont i l
peut tre atteint ; on l ui a prt un rle de norma
lisation et de pathol ogi sation sur l a conduite tout
entire ; enfn on a cherch pour ces anomalies
une technologi e correcti ve.
Le dispositi de sexualit 1 39
Dans la proccupation du sexe, qui monte tout
au long du XIX
e
si cl e, quatre fgures se dessinent,
objets pri vi l gis de savoir, cibl es et points d' an
crage pour l es entrepri ses du savoir : l a femme
hystri que, l ' enfant masturbateur, le couple mal
thusien, l' adulte pervers, chacune tant le corr
latif d' une de ces stratgies qui , chacune sa
manire, a travers et utili s l e sexe des enfants,
des femmes et des hommes.
Dans ces stratgies, de quoi s' agit il ? D' une
l utte contre la sexualit? Ou d' un efort pour
en prendre le contrl e? D' une tentative pour
mieux la rgir et masquer ce qu' el l e peut avoir
d'i ndi scret, de voyant, d' i ndoci le? Une faon
de formul er sur elle cette part de savoir qui
serait tout juste acceptable ou utile? En fait,
i l s' agit pl utt de l a production mme de la
sexualit. Celle-ci , il ne faut pas la concevoir
comme une sorte donne de nature que le pouvoir
essaierait de mater, ou comme un domaine obscur
que l e savoir tenterait, peu peu, de dvoiler.
C' est le nom qu' on peut donner un dispositif
hi stori que : non pas ralit d' en dessous sur
laquelle on exercerait des pri ses difciles, mais
grand rseau de surface o l a stimulation des
corps, l' intensifcation des pl aisirs, l' incitation
au disco\rs, la formation des connaissances, le
renforcement des contrles et des rsistances,
s ' encha nent l es uns avec l e s autres, sel on
qu
l ques grandes stratgies de s avoir et de pou
VOIr.
1 40 La volont de savoir
On peut admettre sans doute que l es relati ons
de sexe ont donn lieu, dans toute socit, un
dispositi d'alliance : systme de mariage, de fxa
tion et de dveloppement des parents, de trans
mi ssion des noms et des biens. Ce di spositif d' al
liance, avec l es mcani smes de contrainte qui
l' assurent, avec le savoi r souvent complexe qu'il
appelle, a perdu de son importance, mesure que
les processus conomi ques et que l es structures
politiques ne pouvaient plus trouver en lui un ins
trument adquat ou un support sufsant. Les
socits occidentales modernes ont invent et
mi s en pl ace,. surtout partir du XVIII
e
sicle,
un nouveau di spositi f qui se superpose l ui , et
sans lui donner cong, a contri bu en rduire
l' importance. C' est l e dispositi de sexualit :
comme le di spositif d' alli ance, il se branche sur
les partenaires sexuels ; mai s selon un tout autre
mode. On pourrait les opposer terme terme. Le
di spositif d' alli ance se charpente autour d' un
systme de rgl es dfni ssant le permi s et le
dfendu, le prescrit . et l ' i llicite ; l e di spositif de
sexualit foncti onne d' aprs des techniques mo
biles, polymorphes et conjoncturelles de pou
voi r. Le di spositif d' alli ance a, parmi ses objec
tifs pri ncipaux, de reproduire le jeu des relati ons
et de mainteni r l a loi qui l es rgit ; l e di spo
sitif de sexualit engendre en revanche une
extensi on permanente des domaines et des formes
de contrle. Pour le premi er, ce qui est perti
nent, c' est le lien entre des partenaires au sta
tut dfni ; pour le second, ce sont les sensa
ti ons du corps , l a qualit des pl ai si rs, la nature
Le dispositi de sexualit 1 4 1
des impressions aus si tnues ou imperceptibles
qu' elles soi ent. Enfn si l e di spositif d' alli ance est
fortement articul sur l ' conomi e cause du rl e
qu'il peut jouer dans l a transmi ssion ou la cir
culation des ri chesses, le di spositif de sexualit
est li l ' conomie par des relais nombreux et
subtil s, mai s dont le principal est le corps
corps qui produit et qui consomme. D' un mot, l e
di spositif d' al l i ance est ordonn sans doute
une homostasie du corps social qu'il a pour
foncti on de maintenir; de l son l i en privilgi
avec l e droit ; de l aus si l e fai t que le temps fort
pour lui, c' est l a ! reproducti on l Le dispositif
de sexualit a pour rai son d' tre non de se repro
duire, mai s de prolifrer, d' innover, d' annexer,
d'i nventer, de pntrer les corps de faon de plus
en pl us dtaille et de contrler l e s populations
de manire de plus en pl us global e. Il faut donc
admettre troi s ou quatre thses contrai res
celle que suppose le thme d' une sexualit rpri
me par les formes modernes de l a socit : la
sexualit est lie des dispositifs rcents de
pouvoi r ; elle a t en expansi on croi ssante depuis
le XVII
e
si cle ; l ' agencement qui l ' a soutenue
depui s l ors n' est pas ordonn l a reproduction ;
il a t li ds l ' ori gi ne une intensifcati on
du corps - sa valorisation comme objet de
savoi r et comme l ment dans l es rapports de
pOUVOI r.
Dire
'
que le di spositif de sexualit s' est subs
titu au di spositif d' al l i ance ne serait pas exact.
On peut i magi ner qu' un jour peut-tre il l ' aura
rempl ac. Mai s de fait, aujourd' hui , s'il tend l e
1 42 La volont de savoir
recouvrir, il ne l ' a pas efac ni rendu i nutile.
Hi storiquement d' ai lleurs, c' est autour et par
tir du dispositif d' al l i ance que celui de sexualit
s' est mis en place. La prati que de la pnitence
pui s de l ' examen de conscience et de l a direction
spirituelle en a t le noyau formateur : or, on l ' a
vu , ce qui fut d' abord en jeu au tribunal de l a
pnitence, c' tait l e sexe en tant que support
de relati ons ; l a question pose tait celle du
commerce permi s ou dfendu ( adultre, rapport
hors mari age, rel ation avec une personne inter
dite par le sang ou le statut, caractre l gitime
ou non de l ' acte de conjoncti on) ; puis peu peu
avec l a nouvelle pastorale - et son application
dans les sminaires, les collges et les couvents
on est pass d'une problmati que de l a relation
une problmati que de la P chair ), c' est--dire
du corps, de la sensati on, de l a nature du pl ai sir,
des mouvements les plus secrets de l a concupis
cence, des formes subtil es de l a dlectation et du
consentement. La W sexualit ) tait en train de
natre, de natre d' une techni que de pouvoir qui
avait t l ' origine centre sur l ' alliance. Depui s,
elle n' a pas cess de fonctionner par rapport
un systme d' alli ance et en prenant appui sur lui .
La cell ul e familial e, telle qu' elle a t valorise
au cours du XVIII
e
sicle, a permis que sur ses
deux dimensions principales l ' axe mari-femme
et l ' axe parents-enfants se dveloppent les
lments principaux du di spositif de sexualit
(le corps fmini n, la prcocit i nfanti l e, la rgul a-
1. Cf. supra, p. 5 1.
Le dispositi de sexualit 1 43
ti on des naissances et, dans une moindre mesure
sans doute, la spcifcation des pervers) . Il ne
faut pas comprendre l a famille sous sa forme
contemporaine comme une structure social e,
conomique et politi que d' alliance qui exclut l a
sexualit ou du moi ns la bride, l ' attnue autant
qu'U est possibl e et n' en retient que les foncti ons
util es. El l e a pour rle au contraire de l' ancrer
et d' en constituer le support permanent. Elle
assure la production d' une sexualit qui n' est
pas homogne aux privilges de l ' alliance, tout
en permettant que l es systmes de l ' alliance soient
traverss de toute une nouvelle tacti que de pou
voi r qu'i l s i gnoraient jusque-l. La famille est
l ' changeur de l a sexualit et de l ' alliance : elle
transporte la loi et l a dimension du juridique dans
le di spositif de sexualit ; et el l e transporte l' co
nomie du pl ai sir et l' intensit des sensations dans
l e rgime de l' all i ance.
Cet pinglage du di spositif d' alliance et du
dispositif de sexualit dans la forme de la fa
mille permet de comprendre un certain nombre
de faits : que la famille soit devenue depuis l e
XVIII
e
sicle un li eu obl i gatoire d' afects, de senti
ments, d' amour; que la sexualit ait pour po
int
privi lgi d' cl osi on l a famille ; que pour cette
rai son elle nai sse P incestueuse P. Il se peut bien
que dans l es socits o prdominent l es dispo
sitifs d' alli ance l ' i nterdi ction de l'inceste soit une
rgle fonctionnellement indispensabl e. Mai s dans
une socit comme la ntre, o la famille est le
foyer le pl
u
s actif de l a sexualit, et o ce sont
sans doute les exi gences de celle-ci qui main-
1 44 La volont de savoir
tiennent et prolongent son existence, l ' inceste,
pour de tout autres rai sons et sur un tout autre
mode, occupe une place centrale ; i l y est sans
cesse soll i cit et refus, objet de hanti se et d' ap
pel , secret redout et joint indispensable. Il
apparat comme ce qui est hautement i nterdi t
dans l a famille pour autant qu' elle joue comme
di spositif d' alli ance ; mai s i l est aussi ce qui est
continment requi s pour que l a fami l l e soi t bi en
un foyer d' incitation permanente de l a sexua
lit . Si pendant pl us d' un sicle l ' Occi dent s' est
si fort i ntress l' interdiction de l' i nceste, si
d' un accord peu prs commun on y a vu un
uni versel soci al et un des points de passage obli g
la clture, c' est que peut-tre on trouvai t l un
moyen de se dfendre, non poi nt contre un dsir
incestueux, mais contre l' extension et les impli
cati ons de ce di spositif de sexualit qu' on avait
mis en pl ace mai s dont l' inconvni ent, parmi
bien des bnfces, tait d' i gnorer les lois et les
formes juri di ques de l ' alliance. Afrmer que toute
socit, quel l e qu' elle soi t, et par consquent
l a ntre, est soumise cette rgle des rgl es,
g
aranti ssai t que ce di spositif de sexualit dont
on commenai t mani pul er les efets tranges
- et parmi eux l ' i ntensi fcation afective de l ' es
pace fami l i al ne pourrait pas chapper au
grand et vi eux systme de l ' alliance. Ainsi l e
droi t, mme dans l a nouvelle mcani que de pou
voir, serait sauf. Car tel est le paradoxe de cette
socit qui a i nvent depui s l e XVIII
e
si cle tant de
technol ogi es de pouvoir trangres au droit :
elle en redoute l es efets et les prolifrati ons et
Le dis
p
ositi de sexualit 1 4 5
elle essaie de les iecoder dans les formes du droit.
Si on admet que le seuil de toute culture c' est
l' inceste interdit, alors la sexualit se trouve
depui s le fond des temps pl ace sous l e signe de
la l oi et du droi t. L'ethnologie, en rlaborant
sans ceCse depui s si longtemps, l a thorie tranS
culturelle de l' interdiction de l'inceste, a bien
mrit de tout le di spositif moderne de sexualit
et des di scours thoriques qu' il produit.
Ce
q
ui s' est pass depui s le XVII
e
sicle peut se
dchifrer ansi : le dispositi f de sexualit,
q
ui
s' tait dvelopp d' abord dans l es marges des
institutions familiales (dans l a direction de cons
ci ence, dans la pdagogie) , va se recentrer peu
peu sur la fami l l e : ce qu'il pouvait comporter
d'tranger, d' irrducti ble, de prilleux peut-tre
pour l e di spositif d' alliance la conscience de ce
danger se mani feste dans les criti ques si sou
vent adresses l' indi scrtion des directeurs, et
dans tout l e dbat, un peu plus tardifa sur l ' du
cation prive ou publi
q
ue, institutionnelle ou
famil iale des enfants 1 est repri s en compte par
la famille une famille rorgani se, resserre
sans doute, i ntensi f e coup sr par rapport aux
anciennes foncti ons qu' elle exerait dans le dispo
sitif d' alli ance. Les parents, l es conjoints de
viennent dans la famille les princi paux agents
d'un di sposi ti f de sexualit qui l' extrieur
s appui e sur l es mdeci ns, les pdagoguesa plus
1 . Le Tartufe de Mol ire et Le Prcepteur de Lenz, pl us d' un
sicl t de di stance. re
p
rsent ent tous deux l 'interfrence du di spositif
de sexu al it sur l e di sposi t i f de rami l l e. dans le cas de l a direction
spi ri tuel l e pour Le Tartufe et de l ' ducation pour Le Prcepteur.
1 4 6 La volont de savoir
tard le s psychiatres, et qui l' intri eur vient
doubler et bientt W psychologiser ou W psychi a
tri ser le s rapports d' alliance. Apparai ssent
alors ces personnages nouveaux : la femme ner
veuse, l' pouse fri gi de, l a mre indifrente ou
assi ge d' obsessi ons meurtri res, le mari impuis
sant, sadique, pervers, la flle hystri que ou neu
rasthnique, l' enfant prcoce et dj pui s, l e
jeune homosexuel qui refuse le mariage ou
nglige sa femme. Ce sont les fgures mi xtes de
l'alliance dvoye et de la sexualit anormale ;
ils portent le troubl e de celle-ci dans l ' ordre de
la premire ; et ils sont l ' occasion pour l e systme
de l ' alliance de faire valoir ses droits dans l ' ordre
de la sexualit. Une demande incessante nat
alors de la famille : demande pour qu' on l ' aide
rsoudre ces jeux malheureux de la sexualit
et de l ' alliance ; et, pi ge par ce di spositif de
sexualit qui l ' avait investie de l' extri eur, qui
avait contribu l a sol idifer sous sa forme
moderne, elle lance vers les mdecins, les pda
gogues , les psychi atres, les prtres aussi et l es
pasteurs, vers tous l es P experts possi bl es, l a
l ongue plainte de sa soufrance sexuell e. Tout se
passe comme si el le dcouvrait soudain l e redou
table secret de ce qu' on l ui avait i ncul qu et
qu' on ne cessai t de l ui suggrer : ell e, arche
fondamentale de l ' al l i ance, tait le germe de
toutes les infortunes du sexe. Et la voi l , depuis
le mili eu du XIX
e
si cl e au moins, traquant en soi
l es moindres traces de sexualit, s' arrachant
elle-mme l es aveux l es plus difciles, sollicitant
l' coute de tous ceux qui peuvent en savoi r long,
Le dispositi de sexualit 1 47
et s'ouvrant de part en part l'infni examen.
La famille, c'est le cristal dans le dispositif de
sexualit : elle semble difuser une sexualit
qu'en fait elle rfchit et difracte. Par sa pn
trabilite et par ce jeu de renvois vers l 'extrieur,
elle est pour ce dispositif un des lments tac
tiques les plus prcieux.
Mais cela n'a pas t sans tension ni problme.
L encore Charcot constitue sans doute une fgure
centrale. Il fut pendant des annes le plus notable
de ceux auxquels les familles, encombres de
cette sexualit qui les saturait, demandaient
arbitrage et soins . Et lui qui recevait, du monde
entier, des parents conduisant leurs enfants, des
poux leurs femmes, des femmes leurs mari s,
avait pour premier soi n et il en a souvent donn
le conseil ses lves - de sparer le W malade
de sa faille, et pour mieux l' observer de n' cou
ter celle-ci que le moins possible 1 . Il cherchait
dtacher le domaine de la sexualit du systme
de l' alliance, pour le traiter directement par une
prati que mdicale dont la technicit et l' auto
nomie taient garanties par le modle neurolo
gique. La mdecine reprenait ainsi pour son
1. Charot, Leons du Mardi. 7 janvier 1 888 Pour bien traiter
une jeune flle hystri que, il ne faut pas la l aisser avec son pre et sa
mre, il faut la placer dans une maison de sant. . . Savez-vous
combien de temps les jeunes flles bien l eves pleurent leurs mres,
lorsqu'elles les quittent? . . . Prenons l a moyenne Ii vous voulez ; c'est
une demi-heure, ce n'est pas beaucoup. "
2 1 fvri er 1 888 - Dans le cas d' hystrie des jeunes garons, ce
qu'il faut faire, c'est l es sparer de leurs mres. Tant qu'ils sont avec
leurs mres, il n'y a rien faire . . . Quelquefois le pre est aussi
insupportable que la mre ; le mieux est donc de les supprimer tous
l es deux .
1 4 8 La volont de savoir
propre compte et sel on l es rgl es d' un savoir
spcifque, une sexualit dont elle avait elle
mme incit les familles se proccuper comme
d' une tche essentielle et d' un danger majeur.
Et Charcot, pl usieurs repri ses, note avec quel l e
difcul t le s famil l es ( ( cdai ent )) au mdeci n l e
pati ent qu' elles tai ent venues pourtant l ui appor
ter, comment elles faisai ent le sige des mai sons
de sant o l e sujet tait tenu l' cart et de
quel l es interfrences ell es toublaient sans cesse
l e travai l du mdecin. El l es n' avaient pourtant
pas s' i nquiter : c' tai t pour leur rendre des
indivi dus sexuel l ement intgrabl es au systme de
l a fami ll e que l e thrapeute intervenai t ; et cette
interventi on, tout en mani pul ant l e corps sexuel,
ne l ' autori sai t pas se formuler en di scours
explicite. De ces (( causes gni tal es )) , il ne faut pas
p
arler : tel l e fut, prononce mi-voix, l a phrase
que l a pl us fameuse oreille de notre poque
surprit, un jour de 1 8 86, de l a bouche de Charcot.
Dans cet espace de jeu, la psychanalyse est
venue se l oger, mais en modifant considrable
ment l e rgime des i nquitudes et des rassu
rances . Ell e devait bien au dbut susciter mfance
et hostili t pui sque, poussant la limite l a leon
de Charcot, el l e entreprenait de parcourir la
sexualit des i ndi vi dus hors du contrle fami
l i al ; elle mettait au jour cette sexualit elle-mme
s ans la recouvrir par l e modle neurologique ;
mi eux encore elle mettait en question l es rel ati ons
familiales dans l ' analyse qu' elle en fai sait. Mai s
voi l que l a psychanalyse, qui semblait dans ses
modalits techni ques pl acer l ' aveu de l a sexualit
Le dispositi de sexualit 1 4 9
hors de la souverainet familial e, retrouvait au
cur mme de cette sexualit, comme principe de
s a formati on et chifre de son intelligibilit, l a l oi
de l ' alli ance, les jeux ml s de l' pousaille et de l a
parent, l' i nceste. La garanti e que l , au fond de
l a sexualit de chacun, on allait retrouver le rap
port parents-enfants, permettait, au moment o
tout sembl ait i ndi quer le processus inverse, de
maintenir l' pinglage du di spositif de sexualit
sur le systme de l ' alli ance. Il n' y avait pas de
ri sque que la sexualit apparai sse, par nature,
trangre la loi : ell e ne se constituait que par
celle-ci . Parents, ne craignez pas de conduire
vos enfants l' analyse : elle leur apprendra que,
de toute faon, c' est vous qu' i ls aiment. Enfants,
ne vous pl ai gnez pas trop de n' tre pas orphe
lins et de retrouver toujours au fond de vous
mme votre Mre-Objet ou l e signe souverain du
Pre : c' est par eux que vous accdez au dsir.
De l, aprs tant de rticences, l'immense consom
mati on d' analyse dans les socits o l e di sposi
tif d' alliance et le systme de la famille avaient
besoin de renforcement. Car c' est l un des points
fondamentaux dans toute cette hi stoire du dis
positif de sexualit : avec l a technol ogie de la
chair )) dans le Chri sti ani sme classique, il a
pris naissance en s' appuyant sur l es systmes
d' alliance et les rgles qui le rgi ssent; mai s
aujourd' hui, il joue un rle inverse ; c' est lui qui
tend soutenir le vieux di spositif d' alliance. De
la direction de conscience l a psychanalyse, les
dispositifs d' alliance et de sexualit, tournant
l'un pa rapport l ' autre selon un lent processus
1 50 La volont de savoir
qui a maintenant pl us de trois sicles, ont inver
s l eur position; dans la pastorale chrtienne,
la loi de l' al li ance codait cette chair qu'on tait
en train de dcouvrir et elle lui imposait d'entre
de jeu une armature encore juridique ; avec la
psychanalyse, c' est l a sexualit qui donne corps
et vie aux rgles de l ' alli ance en les saturant de
dsir.
Le domaine qu'il s' agit d' analyser dans les
difrentes tudes qui vont suivre le prsent
volume, c' est donc ce dispositif de sexualit : sa
formation partir de la chair chrtienne; son
dveloppement travers les quatre grandes stra
tgies qui se sont dployes au XIX
e
sicle : sexua
li sation de l ' enfant, hystrisation de la femme,
spcifcati on des pervers, rgul ation des popu
lations : toutes stratgies qui passent par une
famille dont il faut bi en voir qu' elle a t, non pas
puissance d' interdiction, mai s facteur capital de
sexualisation.
Le premier moment correspondrait la nces
sit de constituer une V force de travail (donc
pas de P dpense inutile, par d' nergie gaspille,
toutes les forces rabattues sur le seul travail) et
d' assurer sa reproduction (conj ugalit, fabrica
ton rgle d' enfants) . Le second moment corres
pondrait cette poque du SpitkapitaLismus o
l' exploitation du travail saari n' exige pas les
mmes contraintes violentes et physiques qu' au
XIX
e
sicle et o la politi que du corps ne requiert
plus l'li sion du sexe ou sa limitation au seul rle
reproducteur; elle passe plutt par sa canalisation
multiple dans les circuits contrls de l'conomie :
Le dispositi de sexualit 1 5 1
une d subl i mati on sur-rpressive, comme on dit.
Or, si l a pol i ti que du sexe ne met pas en uvre
pour l ' es sentiel l a loi de l ' interdit, mai s tout un
appareil techni que, s i l s' agit plutt de l a produc
tion de la P sexualit ll que de l a rpressi on du
sexe, i l faut abandonner une tel l e scansion, dca
ler l ' analyse par rapport au problme de la force
de traail et abandonner sans doute l' nerg
ti sme di fus qui souti ent le thme d' une sexualit
rprime pour des rai sons conomi ques.
4
P RI O D I S AT I O N
L'hi stoire de l a sexualit, si on veut l a centrer
sur les mcanismes de rpressi on, suppose deux
ruptures . L' une au cours du XVII
e
sicle : nai s
sance des grandes prohibitions, valori sati on de
l a seul e sexual i t adul te et matri moniale, imp
rati fs de dcence, esqui ve obligatoire du corp s,
mi se au silence et pudeurs impratives du l an
gage ; l ' autre, au xx
e
sicle ; moi ns rupture
d' ail leurs qu' i nfexi on de la courbe : c' est l e mo
ment o l es mcani smes de la rpression auraient
commenc se desserrer ; on serait pass d' in
terdits sexuel s pressants une tolrance relative
l ' gard des rel ati ons prnuptiales ou extra
matrimoni al es ; la di squalifcation des pervers lI
se serait attnue, l eur condamnation par la l oi
en parti e eface ; on aurait pour une bonne part
lev les tabous qui pesaient sur la sexualit des
enfants.
I l faut essayer d sui vre l a chronologi e de ces
procds : l es inventi ons, l es mutati ons i nstru
mental es, l es rmanences. Mai s il y a aussi le
cal endrier de leur utili sation, l a chronol ogi e de
Le dispositi de sexualit 1 53
leur difusion et des efets ( d' assujetti ssement ou
de rsistance) qu' i l s indui sent. Ces datati ons
multipl es ne coincident sans doute pas avec l e
grand cycle rpressi f qu'on situe d' ordinaire
entre le XVII
e
et l e Xxe sicl e.
1 . La chronologi e des techni ques ell es-mmes
remonte loin. Il faut chercher leur point de for
mati on dans l es prati que s pnitenti el l es du
christi ani sme mdi val ou plutt dans la double
srie constitue par l ' aveu obligatoire, exhaustif
et pri odi que impos tous les fdles par le
Conile de Latran, et par l es mthodes de l ' asc
ti sme, de l'exercice spirituel et du mystici sme
dvel oppes avec une i ntensi t parti cul i re
depui s le XIV
e
sicle. La Rforme d' abord, le
cathol i ci sme tridentin ensuite marquent une
mutati on importante et une sci ssion dans ce
qu' on pourrait appel er l a ! technologie tradi
ti onnel l e de la chair l - Sci ssion dont la profon
deur ne doit pas tre mconnue cela n'exclut
pas cependant un certain paralllisme dans les
mthodes catholiques et protestantes de l' exa
men de consci ence et de la direction pastorale :
ici et l se fxent, avec des subtilits diverses, des
procds d' analyse et de mi se en di scours de la
concupi scence P Techni que riche, rafne, qui
se dvel oppe depuis l e XVI
e
sicle travers de
l ongues l aborati ons thori ques et qui se f ge
l a fn du XVIII
e
si cl e dans des formul es qui
peuvent symbol i ser le ri gorisme mi tig d'Al
phonse de Liguori d' une part et l a pdagogie wes
leyenne de l'autre.
Or, en cette mme fn du XVIII
e
si cl e, et pour
1 54
La volont de savoir
des rai sons qu'il faudra dterminer, naissait une
technologie du sexe toute nouvelle ; nouvelle, car
sans tre rellement indpendante de la thma
tique du pch, elle chappait pour l ' essentiel
l 'institution eccl siasti que. Par l ' intermdiaire
de la pdagogi e, de la mdecine et de l ' conomie,
elle fai sait du sexe non seulement une afaire
laque, mai s une afaire d'
tat ; mieux, une afaire
o le corps social tout entier, et presque chacun
de ses indi vi dus, tait appel se mettre en sur
veillance. Nouvelle aussi , car elle se dveloppai t
selon troi s aes : celui de l a pdagogie avec,
comme ohjectif, la sexualit spcifque de l'en
fant, celui de la mdecine avec, comme objectif,
la physi ol ogie sexuelle propre aux femmes, celui
de l a dmographie enfn, l ' objectif tant la rgu
lation spontane ou concerte des nai ssances. Le
pch de jeunesse !l = l es maladies de nerfs
et l es fraudes l a procration Il (comme on
appellera plus tard ces W funestes secrets )
marquent ainsi les trois domaines privilgi s de
cette technologie nouvell e. Sans doute pour cha
cun de ces points, elle reprend, non sans l es
simplifer, des mthodes dj formes par l e chris
tianisme : la sexualit des enfants tait dj pro
hlmati se dans l a pdagogie spirituelle du chris
tianisme (il n' est pas indifrent que l e premier
trait consacr au pch de Mollities ait t crit
au xve sicle par Gerson, ducateur et mystique;
et que l e recuei l de l 'Onania rdig par Oekker
au XVIIIe sicl e reprenne mot mot des exempl es
tabl i s par l a pastorale anglicane) ; l a mdecine
des nerfs et des vapeurs, au XVIII
e
sicle, reprend
Le dispositi de sexualit 1 5 5
son tour le domaine d' analyse repr dj au
moment o l es phnomnes de la possessi on
avai ent ouvert une cri se grave dans l es prati ques
si ! i ndi scrtes )) de l a directi on de conscience et
de l' examen spirituel (l a mal adi e nerveuse n' est
certai nement pas l a vrit de l a possession ; mai s
l a mdecine de l' hystrie n' est pas s ans rapport
avec l ' ancienne direction des W obsdes Il ) ; et l es
campagnes propo
'
s de la natalit dpl acent,
sous une autre forme et un autre niveau, l e
contrle des rapports conjugaux dont la pni
tence chrti enne avait poursuivi avec tnt d' obs
tination l' examen. Visi ble continuit, mai s qui
n' empche pas une transformation capitale : la
technologie du sexe va, pour l ' essentiel, s' or
donner partir de ce moment-l l ' i nstituti on
mdi cal e, l ' exigence de normalit, et, plutt
qu' la question de la mort et du chtiment ter
nel , au problme de la vie et de l a maladie. La
c{ chair )) est rabattue sur l ' organisme.
Cette mutation se situe au tournant du XVIII
e
et
du XIX
e
si cle ; elle a ouvert la voie bien d' autres
transformati ons, qui en drivent. L' une d' abord a
dtach la mdecine du sexe de la mdecine gn
rale du corps ; elle a isol un ! i nstinct )) sexuel,
susceptible, mme s ans altrati on organique, de
prsenter des anomali es constitutives, des dvia
ti ons acqui ses, des i nfrmits ou des processus
pathologiques . La Ps
y
chopath ia sexualis de Hei n
ri ch Kaan, en 1 846, peut servir d' indicateur : de
ces annes datent l a relative autonomi saion du
sexe par rapport au corps, l ' apparition cor
rlative d' une mdeci ne, d' une l orthopdie )) ,
1 5 6 La volont de savoir
qui lui serai ent spcifques, l ' ouverture en un
mot de ce grand domaine mdi co-psycholo
gi que des perversi ons l q qui al l ai t prendre l a
relve des vi ei l l es catgories moral es de l a d
bauche ou de l ' excs . A l a mme poque, l ' ana
lyse de l ' hrdit pl aait l e sexe ( l es rel ati ons
sexuelle s, l es maladi es vnriennes, l es alli ances
matrimoni al es, l es perversions) en position de
l responsabil i t bi ol ogi que l par rapport l ' es
pce : non seulement le sexe pouvai t tre afect
de ses propre s maladi es, mai s il pouvait, si on
ne le contrlait pas, soi t transmettre des mal a
di es, soi t en crer pour l es gnrati ons futures :
il apparai ssai t ai nsi au pri nci pe de tout un capi tal
pathologi que de l ' espce. D' o le projet mdi cal
mais aussi politique d' organi ser une gestion ta
tique des mari ages, des nai ssances et des survi es ;
l e sexe et s a fcondi t doi vent tre admi nistrs . La
mdecine des perversions et l es programmes de
l ' eugnisme ont t, dans l a technol ogi e du sexe,
les deux grandes innovati ons de la seconde moiti
du XIX
e
sicle.
I nnovati on s qui s ' art i cul ai ent faci l ement ,
car la thorie de l a l eur
permettait de renvoyer perptuellement de l ' une
l ' autre ; el l e expl i quai t comment une hr
dit lourde de maladi es diverses organiques,
fonctionnelles ou psychiques, peu importe pro
dui sait en fn de compte un pervers sexuel (cher
chez dans l a gnal ogi e d' un exhi bi tionni ste ou
d' un homosexuel : vous y trouverez un anctre
hmiplgique , un parent phti si que, ou un oncle
atteint de dmence sni l e) ; mais elle expl i quat
Le dispositi de sexualit 1 5 7
comment une perversion sexuelle induisait aussi
un puisement de la descendance rachiti sme
des enfants, strilit des gnrati ons futures.
L' ensemble perversion-hrdit-dgnrescence a
constitu le noyau solide des nouvell es technolo
gi es du sexe. Et qu' on n'imagine pas qu' il
s' agi ssait l seulement d' une thorie mdicale
scientifquement i nsufsante et abusivement mora
lisatrice. Sa surface de di spersion a t large et
son implantation profonde. La psychiatri e, mas
l a jurisprudence, l a mdecine l gale, l es instances
du contrle social, la surveillance des enfants
dangereux ou en danger ont foncti onn longtemps
la dgnrescence l! = au systme hrdit
perversion. Toute une pratique sociale, dont le
racisme d'
tat fut la forme l a foi s exaspre et
cohrente, a donn cette technol ogie du sexe
une puissance redoutable et des efets lointains.
Et la position singulire de la psychanalyse se
comprendrait mal, la fn du XIX
e
sicle, si on ne
voyait la rupture qu' elle a opr par rapport au
grand systme de l a dgnrescence : elle a repris
le projet d' une technologie mdicale propre
l' i nstinct sexuel ; mais elle a cherch l' afran
chir de ses corrlati ons avec l ' hrdit, et donc
avec tous les raci smes et tous l es eugnismes. On
peut bi en maintenant revenir sur ce qu' il pouvait
y avoir de volont normali satrice chez Freud ; on
peut bien aus si dnoncer l e rle jou depuis des
annes par l' institution psychanalytique ; dans
cette grande famille des technologi es du sexe qui
remonte si loi n dans l' hi stoire de l' Occident
chrtien, et parmi cell es qui ont entrepris, au
1 58 La volont de savoir
XIX
e
sicl e, la mdicalisation du sexe, elle fut,
jusqu' aux anes 1 940, celle qui s' est oppose,
rigoureusement, aux efets politiques et institu
tonnel s du systme perversi on-hrdit-dgn
rescence.
On le voit : la gnalogie de toutes ces tech
niques, avec leurs mutati ons, leurs dpl acements,
leurs continuits, leurs ruptures, ne concide pas
avec l'
h
ypot
h
se d' une grande phase rpressive
i naugure au cours de l ' ge classique, et en voie
de se clore l entement au cours du xx
e
si cle. Il y a
eu plutt une inventivit perptuel l e, un foisonne
ment constant des mthodes et des procds, avec
deux moments particulirement fconds dans cette
histoire prolifrante : vers le milieu du XVI
e
sicle,
le dveloppement des procdures de direction et
d'examen de conscience ; au dbut du XIX
e
sicl e,
l' appariti on des technologies mdical es du sexe.
2. Mai s ce ne serait l encore qu' une datation
des techni ques elles-mmes . Autre a t l' histoire
de leur difusion et de leur point d' application. Si
on crit l ' hi stoire de l a sexualit en termes de
rpressi on, et qu' on rfre cette rpressi on l' uti
lisation de la force de travail , i l faut bien supposer
que l es contrles sexuels ont t d' autant plus
intenses et plus soi gneux qu' i l s s' adres saient aux
classes pauvres ; on doit imaginer qu' i l s ont suivi
les lignes de l a pl us grande domination et de
l' expl oitati on la pl us systmatique : l'homme
adulte, jeune, ne possdant que sa force pour
vivre, aurait d tre la cible premire d' un assu
jetti ssement desti n dplacer l es nergi es dispo
nibl es du plai si r inutile vers l e travail obligatoire.
Le dispositi de sexualit 1 59
Or il ne semble pas que les choses se soient pas
ses ainsi . Au contraire, les techni ques les plus
rigoureuses se sont formes et surtout elles ont
t appliques d' abord, avec le plus d'intensit,
dans les classes conomiquement privilgies
et politiqemet diri geantes . La direction des
consciences, l' examen de soi-mme, toute l a
longue l aboration des pchs de l a chair, l a
dtecti on scrupul euse de la concupiscence - au
tant de procds subtils qui ne pouvaient gure
tre accessibles qu' des groupes restreints. La
mthode pnitentielle d'Alphonse de Liguori, les
rgles proposes par Wesley aux mthodistes,
leur ont assur une sorte de difusion plus l arge,
c' est vrai ; mai s ce fut au prix d' une simplifcation
considrabl e. On pourrait en dire autant de l a
famille comme instance de contrle et point de
saturati on sexuelle : c' est dans l a famille W bour
geoise )) ou P ari stocrati que )) que fut problma
tise d' abord l a sexualit des enfants ou des ado
lescents ; en elle que fut mdicali se la sexualit
fminine ; elle qui fut alerte d' abord sur l a patho
logie possible du sexe, l ' urgence de le surveil
ler et la ncessit d' inventer une technologie
rationnelle de correction. C' est elle qui fut d' abord
le lieu de la psychi atri sation du sexe. La premire,
elle est entre en rthisme sexuel, se donnant des
peurs, inventant des recettes , appelant au secours
des techniques savantes, s uscitant, pour se les
rpter elle-mme, d' innombrabl es discours. La
bourgeoisie a commenc par considrer que c'tat
son propre sexe qui tait chose importante, fra
gile trsor, secret indi spensable connatre. Le
1 60 La volont de savoir
p
ersonnage qui a t d' abord investi par le dis
positif de sexualit, un des premiers avoir t
W sexuali s , il ne faut pas oublier que ce fut l a
femme oisive .) , aux limites du (( monde o elle
devait touours fgurer comme valeur, et de la
famille o on lui assi gnai t un lot nouveau d' obli
gations conjugal es et parental es : ainsi est appa
rue la femme (( nerveuse )) , l a femme atteinte de
W vapeurs )) ; l l 'hystri sation de l a femme a
trouv son point d' ancrage. Quant l ' adolescent
gaspillant dans des plaisirs secrets sa future
substance, l ' enfant onaniste qui a tant proccup
les mdecins et l es ducateurs depuis la fn du
XVIII
e
sicle jusqu' la fn du XIX
e
sicle, ce n'tait
pas l' enfant du peuple, le futur ouvrier auquel il
aurait fallu enseigner les di sciplines du corps ;
c'tait le collgien, l ' enfant entour de domes
tiques, de prcepteurs et de gouvernantes, et qui
ri squait de compromettre moins une force phy
sique que des capacits intellectuelles, un devoir
moral et l ' obligation de conserver sa famille et
sa classe une descendance saine.
En face de cela, l es couches populaires ont long
temps chapp au dispositif de (( sexualit .
Certes, elles taient soumises, sel on des modali
ts particulires, au dispositif des P alliances
:
valorisation du mariage lgitime et de l a f
condit, exclusion des uni ons consanguines, pres
criptions d' endogamie sociale et local e. I l est peu
probabl e en revanche que l a technologie chr
tienne de la chai r ait jamai s eu pour elle une
grande importance. Quant aux mcanismes de
sexuali s ation, ils l es ont pntrs lentement, et
Le dispositi de sexualit 1 6 1
sans doute en trois tapes successives. D' abord
propos des problmes de la natalit, lorsqu'il fut
dcouvert, la fn du xvme sicle, que l'art de
tromper la nature n'tait pas le privilge des cita
dins et des dbauchs, mais qu'il tat connu et
pratiqu pa ceux qui , tout proches de la nature
elle-mme, auraient d plus que tous les autres y
rpugner. Ensuite lorsque l'organisation de la
famille W canonique " a paru, autour des annes
1 830, un instrument de contrle politique et de
rgulation conomique indispensable l' assujet
tissement du proltaiat urban :
g
rade cam
pagne pour la W moralisation des classes pauvres o
nfn lorsque se dveloppa la fn du XlXe sicle le
contrle judiciaire et mdica des perversions, au
nom d'une protection
g
nrale de l a socit et de
la race. On peut dire qu' alors le dispositif de
sexualit Pq labor sous ses formes les plus
complexes, les plus intenses pour et par les classes
privilgies, s'est difus dans le corps social tout
entier. Mais il n'a pas pris partout les mmes
formes et il n'a pas utilis partout les mmes ins
truments (les rles respectifs de l'instance mdi
cale et de l'instance judiciaire n'ont pas t les
mmes ici et l; ni la manire mme dont la mde
cine de la sexualit a fonctionn) .
Ces rappels de chronologie qu'il s'agi sse
de l'invention des techniques ou du calendrier de
leur difusion - ont leur importance. Il s rendent
1 62
La volont de savoir
fort douteus e l ' i de d' un cycle rpressif, ayant
un commenc
e
ment et une fn, dessinant au moins
une courbe avec ses points d' i nfexion : il n' y a
vrai sembl ablement pas eu un ge de l a restriction
sexuelle ; et ils font douter aussi de l ' homog
nit du processus tous l es niveaux de la
socit et dans toutes les classes : il n' y a pas eu
une politique sexuelle unitaire. Mais surtout il s
rendent problmati que l e sens du processus et
se s raisons d'tre : ce n' est point, semble-t-il ,
comme principe de li mi tati on du pl aisir des autres
que le dispositif de sexualit a t ms en pl ace
par ce qu' il tait de traditi on d' appeler l es
" cl asses dirigeantes )) . I l apparat plutt qu' ell es
l' ont d' abord essay sur elles-mmes. Nouvel
avatar de cet asctisme bourgeoi s tant de fois
dcrit propos de la Rforme, de l a nouvelle
thique du travail et de l ' essor du capitali sme? Il
semble justement qu' il ne s' agi sse pas l d' un
asctisme, en tout cas d' un renoncement au plai sir
ou d' une disqualifcation de l a chair ; mais au
contraire d' une intensifcati on du corps, d' une
probl mati sation de la sant et de ses conditions
de fonctionnement ; il s' agit de nouvelles tech
ni ques pour maximaliser l a vie. Pl utt que d'une
rpression sur l e sexe des classes exploiter, i l
fut d' abord question du corps, de la vi gueur= de
l a longvit,
de la progniture, et de l a descen
dance des cl asses qui domi naient )) . C' est l
que fut tabl i , en premire instance, l e dispositif
de sexualit, comme di stribution nouvelle des
pl ai si rs, des di scours, des vrits et des pouvoi rs.
lJ faut y souponner l ' autoafrmation d' une
Le dis
p
ositi de sexualit 1 6 3
cl asse, plutt que l ' asservissement d' une autre :
une dfense, une protection, un renforcement, une
exaltation, qui furent par la suite - au prix de
difrentes transformati ons - tendus aux autres
comme moyen de contrle conomique et de suj
tion politique. Dans cet investissement de son
propre sexe par une technologi e de pouvoir et de
savoir qu' elle-mme inventait, la bourgeoisie
fai sait valoir l e haut prix pol itique de son cor
p
s,
de ses sensations, de ses plaisi rs, de sa sant, de
s a survie. Dans toutes ces procdures, n' i sol ons
pas ce qu'il peut y avoir de restrictions, de pu
deurs, d' esquives ou de silence, pour les rfrer
quelque interdit constitutif, ou refoulement, ou
instinct de mort. C' est un agencement politique
de la vie qui s' est constitu, non dans un asservis
sement d' autrui, mais dans une afrmation de soi.
Et loin que l a classe qui devenait hgmonique
au XVIIIe sicle ait cru devoir amputer son corps
d' un sexe inutile, dpensier et d angereux ds lors
qu' il n' tait pas vou l a seule reproducti on, on
peut dire au contraire qu' elle s'est donn un corps
soigner, protger, cultiver, prserver de
tous l es dangers et de tous l es contacts, i soler
des autres pour qu' il garde sa valeur difren
tielle ; et cela en se d onnant, entre autres moyens,
une technologie du sexe.
Le sexe n' est pas cette parti e du corps que la
bourgeoi sie a d di squalifer ou annul er pour
mettre au travail ceux qu'elle dominait. Il est
cet l ment d' elle-mme qui l ' a, plus que tout
autre, i nqui te, proccupe. qui a sollicit et
obtenu ses soins et qu' elle a cultiv avec un
1 64
La volont de savoir
mlange de frayeur, de curiosit, de dlectation
et de fvre. Elle lui a identif ou du moins sou
mis son corps, en lui prtant sur celui-ci un pou
voir mystrieux et indfni ; elle y a accroch sa
vie et sa mort en le rendant responsable de sa
sant future ; elle a investi en lui son avenir en
suppo sant qu' il avait des efets inluctables sur
sa descendance ; elle lui a subordonn son me
en prtendant que c' est lui qui en constituait
l'lment le plus secret et le plus dterminant.
N'imaginons pas la bourgeoisie se chtrant sym
boliquement pour mieux refuser aux autres le
droit d' avoir un sexe et d'en user leur gr. I l
faut plutt l a voir s' employer, parti r du milieu
du XVIII
e
sicle, se donner une sexualit et se
constituer partir d'elle un corps spcifque, un
corps P de classe avec une sant, une hygiie,
une descendance, une race : autosexuali sation de
son corps, incarnation du sexe dans son corps
propre, endogamie du sexe et du corps. Il y avait
sans doute cela plusieurs raisons.
Et d' abord une transpm,i . > :m, sous d'autres
formes, des procds utiliss par la noblesse pour
marquer et maintenir sa distinction d
e
caste ; car
l' ari stocratie nobiliaire avait, elle aussi, afrm la
spcifcit de son corps; mais c'tait sous l a forme
du sany. c' est--dire de l' anciennet des ascen
dances et de la valeur des alliances ; la bourgeoi
sie pour se donner un corps a regard l 'inverse
du ct de sa descendance et de l a sant de son
organi sme. Le sang de l a bourgeoisie, ce fut
son sexe. Et ce n' est pas l un jeu sur les mots ;
beaucoup des thmes propres aux manires de
Le dispositi de sexualit 1 6 5
caste de la noblesse s e retrouvent dans la bour
geoisie du XIX
e
sicle, mai s sous les espces de
prceptes biologi ques, mdicaux, ou eugniques ;
le souci gnalogi que est devenu proccupation
de l' hrdit ; dans les mariages , on a pri s en
compte non seulement des impratifs cono
miques et des rgles d' homognit sociale, non
seulement les promesses de l ' hritage mai s les
menaces de l ' hrdit ; l es failles portaient et
cachaient une sorte de bl ason invers et sombre
dont les quartiers infamants taient les maadies
ou les tares de la parentle l a paralysie gn
rale de l ' aeul, l a neurasthnie de la mre, la
phtisie de la cadette, les tantes hystriques ou
rotomanes, les cousins aux murs mauvai ses.
Mai s dans ce souci du corps sexuel , il y avait
plus que la transpositi on bourgeoise des thmes
de la noblesse des fns d' afrmation de soi
mme. Il s' agi ssait aussi d'un autre projet : celui
d' une expansion indfnie de la force, de la
vigueur, de la sant, de l a vie. La valorisation du
corps est bien lier avec l e processus de crois
sance et d' tabli ssement de l ' hgmonie bour
geoise : non point cependant cause de l a valeur
marchande prise par la force de travail, mais
cause de ce que pouvait reprsenter politique
ment, conomiquement, historiquement aussi
pour l e prsent et pour l ' avenir de l a bourgeoi
sie, la W culture P de son propre corps. Sa domi
nation en dpendait pour une part ; ce n' tait pas
seulement une afaire d' conomie ou d' idologie,
c'tait aussi une afai re W physique - En portent
tmoignage les ouvrages publis en si grand
1 66 La volont de savoir
nombre la fn du AN
sicle sur l ' hygi ne du
corps , l' art de l a l ongvi t, les mthodes pour
faire des enfants en bonne sant et les garder en
vi e l e pl us l ongtemps pos si bl e, l es procds pour
aml i orer l a descendance humaine ; i l s attestent
ai nsi la corrlation de ce souci du corps et du
sexe avec un racisme ll - Mai s celui-ci est fort
difrent de cel ui qui tait mani fest par la
nobl esse et qui tait ordonn des fns essentiel
lement conservatri ces. Il s' agit d' un raci sme
dynamique, d' un raci sme de l ' expansi on, mme
si on ne le trouve encore qu' l ' tat embryonnaire
et qu'il at d attendre la seconde moiti du
XIX
e
sicle pour porter l es fruits que nous avol
gots.
Que me pardonnent ceux pour qui bourgeoi si e
signi fe l i si on du corps et refoulement de l a
sexualit, ceux pour qui lutte de classe i mpl i que
combat pour l ever ce refoul ement. La phi l o
sophi e spontanie l de l a bourgeoisie n' est peut
tre pas aussi i dali ste ni castratri ce qu' on l e di t;
un de ses premiers soins en tout cas a t de se
donner un corps et une sexualit de s' assurer l a
force. l a prennit, l a prol i fration scul aire de ce
corps par l' organi sation d' un di spositif de sexua:
lit. Et ce processus tait li au mouvement par
lequel el l e afrmait sa di frence et son hgmoni e.
I l faut sans doute admettre qu' une des formes
primordiales de l a conscience de clas se, c' est
l' armati on du corps ; du moins, ce fut le cas
pour l a bourgeoi si e au cours du XVlll
e
sicle ; elle
a converti le sang bleu des nobl es en un orga
ni sme bi en portant et en une sexualit sai ne ; on
Le dispositi de sexualit 1 6 7
comprend pourquoi elle a mis s i longtemps et
oppos tant de rti cences reconnatre un corps
et un sexe aux autres classes celles juste
ment qu'elle exploitait. Les conditi ons de vie qui
taent fai tes au proltariat, surtout dans l a pre
mire moiti du XIX
e
sicle, montrent qu' on tait
loin de prendre en souci son corps et son sexe 1 :
peu importait que ces gens-l vivent ou meurent,
de toute faon a se reproduisait tout seul.
Pour que le proltariat soit dot d' un corps et
d'une sexualit, pour que sa sant, son sexe et
sa reproduction fassent problme, i l a fallu des
confits (en particulier propos de l ' espace ur
bain : cohaitati on, proximit, contaminati on,
pidmies, comme le cholra de 1 832 , ou encore
prostitution et maladi es vnriennes) ; il a fallu
des urgences conomi ques (dveloppement de
l' industrie lourde avec l a ncessit d'une main
d' uvre stable et comptente, obligation de
contrler l es fux de popul ation et de parvenir
des rgulations dmographiques) ; il a fallu enfn
l a mise en place de toute une technologie de
contrle qui permettait de maintenir sous sur
veillance ce corps et cette sexualit qu' enfn on
leur reconnai ssai t (l' cole, l a politique de l ' habi
tat, l' hygine publi que, l es instituti ons de secours
et d' assurance, l a mdicalisation gnrale des
populations, bref tout un appareil admini stra
tif et technique a permi s d' importer sans danger
l e dispositif de sexualit dans la classe exploite ;
1 . Cf. K. Marx, Le Ca
p
ital, LI , chap. X. 2, Le capital afam de
surra vail .
1 68 La volont de savoir
il ne risquait plus de jouer un rle d' afrmation
de classe en face de la bourgeoisie ; il restait l 'ins
trument de son hgmoni e). De l sans doute les
rticences du proltariat accepter ce di spositif;
de l sa tendance dire que toute cette sexualit
est afare de bourgeoisie et ne le concerne pas.
Certai ns croi ent pouvoir dnoncer la foi s
deux hypocrisies symtriques : celle, dominante,
de la bourgeoisie qui nierait sa propre sexualit
et celle, induite, du proltari at qui rejette son
tour la sienne par acceptation de l' i dologie d' en
face. C' est mal comprendre le processus par lequel
la bourgeoisie au contraire s' est dote, dans une
afrmation politique arrogante, d' une sexualit
bavarde que le proltari at a refus longtemps
d' accepter ds l ors qu' elle lui tait impose par l a
suite des fns d' assujettissement. S'il est vrai que
la sexualit )' , c' est l' ensemble des efets produits
dans les corps, les comportements, les rapports
sociaux par un certain dispositif relevant d'une
technologie politique complexe, il faut reconnatre
que ce dispositif ne joue pas de faon symtrique
ici et l, qu'il n' y produit donc pas l es mmes
efets. Il faut donc revenir des formulations
depuis longtemps dcries ; il faut dire qu' il y a
une sexualit bourgeoise, qu'il y a des sexualits
de classe. Ou plutt que l a sexualit est origi
nairement, historiquement bourgeoise et qu'elle
induit, dans ses dplacements successifs et ses
transpositi ons, des efets de classe spcifques.
Le dispositi de sexualit 1 69
Un mot encore. On a donc eu, au cours du
XIX
e
sicle, une gnralisati on du dispositif de
sexualit, partir d'un foyer hgmonique. A l a
limite, quoique sur un mode et avec des instru
ments difrents, le corps soci al tout entier a t
dot d'un W corps Universalit de l a
sexuali t? C' est l qu' on voi t s' introduire un
nouvel l ment difrenciateur. Un peu comme l a
bourgeoisie avait, l a fn du xvm
e
sicl e, oppos
au sang valeureux des nobl es son propre corps
et sa sexualit prci euse, elle va, l a fn du
XlX
e
si cle, chercher redfnir la spcifcit de
la sienne en face de celle des autres, reprendre
difrentiellement sa propre sexualit, tracer
une ligne de partage qui singularise et protge
son corps. Cette ligne ne sera plus celle qui i ns
taure la sexualit, mais une ligne qui au contraire
la barre ; c' est l ' i nterdit qui fera l a difrence, ou
du moi ns l a mani re dont i l s' exerce et l a ri gueur
avec laquelle il est impos. La thorie de l a
rpressi on, qui va peu peu recouvrir tout le
dispositif de sexualit et lui donner l e sens d' un
interdit gnrali s, a l son point d'origine. El l e
est hi storiquement l i e l a difusion du dispo
sitif de sexualit. D' un ct el le va justifer son
extension autoritaire et contraignante, en posant
le principe que toute sexualit doit tre soumi se
la l oi , mieux, qu' elle n' est sexualit que par
l'efet de la loi : non seulement il faut soumettre
1 70 La volont de savoir
votre sexualit l a loi, mai s vous n' aurez une
sexualit que de vous assujettir l a loi. Mai s
d' un autre ct l a thorie de l a rpression va
compenser cette di fusion gnrale du di spositif
de sexualit par l ' analyse du jeu difrenti el des
i nterdits selon l es classes social es. Du di scours
qui l a fn du XVIII
e
sicle di sait : W Il y a en nous
un lment de prix qu' il faut redouter et mnager,
auquel i l faut apporter tous nos soins , si nous
nous ne voulons pas qu' il engendre des maux
infnis P on est pass un di scours qui dit :
Notre sexualit, la difrence de celle des
autres, est soumise un rgime de rpressi on si
i ntense que l dsormai s est le danger ; non seu
lement le sexe est un secret redoutabl e, comme
n' ont cess de le dire aux gnrati ons prcdentes
les di recteurs de conscience, les morali stes, l es
pda
gogues et les mdecins, non seul ement il
faut l e dbusquer dans sa vrit, mai s s' il prte
avec lui tant de dangers, c' est que nous l ' avons
trop l ongtemps scrupule, sens trop aigu du
pch, hypocri si e, comme on voudra rduit au
silence. )) Dsormai s l a difrenciati on sociale
s' afrmera non pas par l a qualit ( sexuelle P
du corps, mai s par l ' intensit de sa rpression.
La psychanalyse vient s' i nsrer en ce point :
la foi s thorie de l ' appartenance essenti el l e de
la loi et du dsir et technique pour lever les efets
de l'interdit l o sa ri gueur le rend pathogne.
Dans son mergence histori que, l a psychanalyse
ne peut se di ssocier de la gnralisati on du di s
positif de sexual it et des mcani smes secon
daires de di frenciati on qui s'y sont produits. Le
Le dispositi de sexualit 1 7 1
problme de l ' i nceste est de ce point de vue
encore signifcatif. D' une part, on l a vu, sa
prohibition est pose comme principe absolu
ment universel qui permet de penser la foi s le
systme d' al l i ance et le rgime de l a sexualit ;
cette interdicti on, sous une forme ou sous une
autre, vaut donc pour toute socit et pour tout
indivi du. Mai s dans la pratique, l a psychanalyse
se donne pour tche de lever, chez ceux qui sont
en position d' avoir recours ell e, l es efets de
refoulement qu'elle peut induire ; elle leur permet
d' articuler en discours leur dsir incestueux. Or
la mme poque= sorgani sait une chasse sys
tmatique aux pratiques i ncestueuses, telles
qu'ell es existaient dans les campagnes ou dans
certains milieux urbains auxquels l a psychana
lyse n' avait pas accs : un quadrillage adminis
tratif et judiciaire serr a t anag alors pour
y mettre un terme ; toute une politique de pro
tection de l' enfance ou de mise en tutelle des
mineurs en danger avait, en partie, pour
objectif leur retrait hors des familles qu' on sus
pectait par faute de place, proximit douteuse,
habitude de dbauche, primitivit sauvage ou
dgnrescence - de pratiquer l 'inceste. Alors que
le dispositif de sexualit avait depuis l e XVIII
e
sicle
intensif les rapports afectifs, l es proximits
corporelles entre parents et enfants, alors qu'il
y avait eu une perptuelle incitati on l'inceste
dans l a famille bourgeoi se, le rgime de sexua
lit appliqu aux classes populaires implique au
contraire l' exclusion des pratiques de l' inceste
ou du moins leur dpl acement sous une autre
1 72
La volont de savoir
forme . A l' poque o l ' inceste est pourchass
comme conduite d' un ct, de l 'autre, la psycha
nalyse s' emploie le mettre au jour comme dsir
et lever pour ceux qui en soufrent la rigueur
qui le refoule. Il ne faut pas oublier que la dcou
verte de l' dipe a t contemporane de l 'organi
sation juridi que de la dchance paternelle (en
France par l es lois de 1 889 et 1 898) . Au moment
o Freud dcouvrat quel tait l e dsir de Dora,
et lui permettait de se formuler, on s' armait
pour dnouer, dans d' autres couches sociales,
toute ces proximits blabl es ; le pre, d' un
ct, tat rig en objet d' amour oblig ; mai s
ailleurs, s'il tait amant, il tait dchu par la loi.
Ainsi la psychanalyse, comme pratique thra
peutique rserve, jouait par rapport d' autres
procdures un rl e difrenci ateur, dans un dis
positif de sexualit maintenant gnralis. Ceux
qui avaient perdu l e privilge excl usi f d' avoir
souci de leur sexualit ont dsormai s le privi
lge d' prouver plus que d' autres ce qui l'in
terdit et de possder la mthode qui permet de
l ever le refoulement.
L ' hi stoire du di spositif de sexualit, tel
qu'il s' est dvelopp depuis l' ge classique,
peut valoir comme archologie de l a psycha
nalyse. On l ' a vu en efet : elle joue dans ce dispo
sitif plusieurs rles simultans : elle est mca
nisme d'pinglage de la sexualit sur le systme
d' alliance ; elle s' tablit en position adverse par
rapport la thorie de l a dgnrescence ; elle
fonctionne comme lment difrenciateur dans la
technologie gnrale du sexe. Autour d' elle la
Le dispositi de sexualit 1 73
grande exi gence de l ' aveu qui s' tait forme
depui s si longtemps prend le sens nouveau d' une
i njoncti on l ever l e refoul ement. La tche de la
vrit se trouve l ie mai ntenant la mise en ques
tion de l ' i nterdit.
Or cela mme ouvrait l a possibilit d' un dpla
cement tacti que considrabl e : rinterprter tout
le di sposi tif de sexualit en termes de rpression
gnral i s e ; rattacher cette rpression des
mcani smes gnraux de domi nati on et d' exploi
tati on ; l i er l es uns aux autres l es processus qui
permettent de s' afranchir des unes et des autres.
Ainsi s' est forme entre l es deux guerres mon
di al es et autour de Reich l a critique hi storico
politi que de la rpression sexuelle. La valeur
de cette critique et ses efets dans l a ralit ont
t consi drabl es. Mais la possibilit mme de
son succs tait lie au fai t qu' elle se dployait
toujours dans le dispositif de sexualit, et non
pas hors de lui ou contre lui. Le fait que tant de
choses aient pu changer dans le comportement
sexuel des socits occidental es sans qu' ait t
rali se aucune des promesses ou condi tions
politi ques que Reich y attachait suft prouver
que toute cette rvolution P du sexe, toute cette
lutte anti-rpre ssive )) ne reprsentait rien de
plus, mais rien de moins et c' tait dj fort
important qu'un dplacement et un retourne
ment tactiques dans le grand di spositif de sexua
lit. Mai s on comprend aussi pourquoi on ne pou
vait demander cette critique d' tre l a grille pour
une histoire de ce mme dispositi f. Ni le principe
d'un mouvement pour le dmanteler.
v
Droit de mort et pouvoir sur la vie
Longtemps, un des privilges caractristiques
du pouvoi r souverain avait t le droit de vie et
de mort. Sans doute drivait-il formellement de
l a vieille
p
atria
p
otes tas qui donnait au pre de
famille romain l e droit de ! disposer " de l a vie
de ses enfants comme de celle des esclaves ; il la
l eur avait P donne )) , il pouvait la leur retirer Le
droit de vie et de mort tel qu' il se formule chez
les thori ciens classi ques en est une forme dj
considrablement attnue. Du souverain ses
sujets, on ne conoit pl us qu' il s' exerce dans
l ' absolu et inconditi onnellement, mai s dans l es
seuls cas o l e souverain se trouve expos dans
son exi stence mme : une sorte de droi t de r
pl i que. Est-il menac par des ennemis extri eurs,
qui veulent le renverser ou contester ses droi ts?
Il peut al ors lgitimement faire la guerre, et
demander ses sujets de prendre part l a dfense
de l
tat ; sans se proposer directement l eur
mort )) , i l l ui est l i cite d' exposer leur vie )) : en ce
sens, i l exerce sur eux un droi t !! indirect )) de vi e et
1 7 8
La volont de savoir
de mort 1 . Mais si c'est l' un d' eux qui se dresse
conte lui et enfreint ses lois, alors il peut exercer
sur sa vie un pouvoir direct : titre de chtiment,
il le tuera. Ainsi entendu, le droit de vie et de mort
n' est plus un privilge absolu : il est conditionn
par la dfense du souverain, et sa survie propre.
Faut-il le concevoir avec Hobbes comme l a trans
position au prince du droit que chacun poss
derait l 'tat de nature de dfendre sa vie au
prix de la mort des autres? Ou faut-il y voir un
droit spcifque qui apparat avec la formation
de cet tre juridique nouveau qu'est le souve
rain 2 ? De toute faon le droit de ve et de
mort, sous cette forme moderne, relative et limi
te, comme sous sa forme ancienne et absolue,
est un droit dissymtrique. Le souverain n'y
exerce son droit sur la vie qu'en faisant jouer
son droit de tuer, ou en le retenant ; il ne marque
son pouvoir sur la vie que par l a mort qu'il est en
mesure d' exiger. Le droit qui se formule comme
de vie et de est en fait le droit de faire
mourir ou de laisser vivre. Aprs tout, il se sym
bolisait par le glaive. Et peut-tre faut-il rappor
ter cette forme juridique un type historique
de socit o le pouvoir s' exerait essentielle
ment comme i nstance de prlvement, mca-
lisme de soustraction, droit de s' approprier
1. S. Pufendorf, Le Droit de la nature (trad. de 1734) , p. 445.
2. De mme qu' un corps compos peut avoir des qualits qui ne se
trouvent dans aucun des corps simples du mlange dont i l es t form,
de mme un corps moral peut avoir, en vertu de l' union mme des
personnes dont i l est compos, certai ns droits dont aucun des pati
culiers n' tait formel lement revtu et qu' il n' appartient qu' aux
conducteurs d'exercer. P Pufendorf, Loc. cit. , p. 452.
Droit de mort et pouvoir sur la vie 1 7 9
une part des richesses, extorsion de produits,
de biens, de services, de travail et de sang,
impose aux sujets . Le pouvoir y tat avant tout
droit de pri se : sur les choses, le temps, les corps
et fnalement la vie ; il culminat dans le privilge
de s' en emparer pour l a supprimer.
Or, l' Occident a connu depuis l ' ge classi que
une trs profonde transformation de ces mca
nismes du pouvoir. Le W prlvement tend
n'en plus tre l a forme majeure, mai s une pice
seulement parmi d' autres qui ont des fonctions
d' incitation, de renforcement, de contrle, de
survei llance, de majoration e t d'organi sation des
forces qu' il soumet : un pouvoir destin pro
duire des forces, l es faire crotre et l es ordon
ner plutt que vou les barrer, les faire plier
ou les dtruire. Le droit de mort tendra ds
lors se dplacer ou du moins prendre appui
sur l es exi gences d' un pouvoir qui gre la vie
et s' ordonner ce qu' elles rclament. Cette
mort, qui se fondait sur le droit du souve
rain de se dfendre ou de demander qu' on l e
dfende, va apparatre comme l e simple envers
du droit pour le corps social d' assurer sa vie, de
l a maintenir ou de l a dvelopper. Jamais l es
guerres n' ont t pl us sanglantes pourtant que
depuis le XlXe sicle et, mme toutes propor
ti ons gardes, jamais les rgimes n'avaient
jusque-l prati qu sur leurs propres populati ons
de pareils holocaustes. Mais ce formidable pou
voir de mort - et c' est peut-tre ce qui lui donne
une part de sa force et du cyni sme avec lequel i l
a repouss si loin ses propres limites se donne
1 80
La volont de savoir
maintenant comme le complmentaire d' un pou
voir qui s' exerce positivement sur l a vie, qui
e
ntreprend de la grer, de l a majorer, de l a mul
tiplier, d' exercer sur elle des contrles prci s et
des rgulations d' ensemble. Les guerres ne se font
p
l us au nom du souverain qu'il faut dfendre;
elles se font au nom de l'exi stence de tous ; on
dresse des populati ons entires s' entre-tuer
rciproquement au nom de la ncessit pour
elles de vivre. Les massacres sont devenus vitaux.
C' est comme gestionnaire de l a vi e et de l a sur
vie, des corps et de la race que tant de rgimes
ont pu mener tant de guerres, en faisant tuer
tant d' hommes. Et par un retournement qui
permet de boucler l e cercle, plus l a technologie
des guerres les a fait virer la destruction
exhaustive, plus en efet la dcision qui les ouvre
et celle qui vient les clore s'ordonnent l a question
nue de la survi e. La situation atomique est aujour
d' hui au point d' abouti ssement de ce processus :
le pouvoir d'exposer une population une mort
gnrale est l'envers du pouvoir de garantir
une autre son mai ntien dans l ' existence. Le
principe : pouvoir tuer pour pouvoir vivre, qui
soutenait la tactique des combats, est devenu
principe de stratgie entre
tats ; mai s l ' exi stence
en question n' est pl us celle, j uridique, de la sou
verainet, c' est celle, biologique, d' une popula
ti on. Si le gnocide est bien le rve des pouvoirs
modernes, ce n'est pas par un retour auj ourd'hui
du vieux droit de tuer; c'est parce que le pouvoir se
situe et s' exerce au niveau de l a vie, de l ' espce, de
la race et des phnomnes massifs de popul ation.
Droit de mort et pouvoir sur la vie 1 8 1
J'aurai s pu prendre, un autre niveauq
lexemple de la peine de mort. Elle a t long
temps avec la guerre l' autre forme du droit de
glaive; elle constituait la rponse du souverain
qui attaquait sa volont, sa l oi , sa personne.
Ceux qui meurent sur l' chafaud sont devenus
de plus en plus rares, l' inverse de ceux qui
meurent dans les guerres . Mai s c'est pour l es
mmes raisons que ceux-ci sont devenus plus
nombreux et ceux-l plus rares. Ds lors que le
pouvoir s' est donn pour fonction de grer l a vieq
ce n' est pas la naissance de sentiments humani
tares, c' est l a rai son d' tre du pouvoir et la
logique de son exercice qui ont rendu de plus en
plus difcile l ' application de la peine de mort.
Comment un pouvoir peut"il exercer dans la mi se
mort ses pl us hautes prrogatives, si son rle
majeur est d assurer, de soutenir, de renforcer,
de multiplier l a vi e et de la mettre en ordre?
Pour un tel pouvoir l ' excution capitale est l a
foi s la limite, l e scandale et l a contradiction. De
l le fait qu'on n' a pu la maintenir qu' en invo
quant moins l'normit du crime lui-mme que l a
monstruosit du crimi nel, son incorrigibilit,
et la sauvegarde de la socit. On tue lgitime
ment ceux qui sont pour les autres une sorte de
danger biologi que
On pourrait dire qu' au vieux droit de faire
mourir ou de laisser vivre s' est substitu un
pouvoir de
fa
ire vivre ou de rejeter dans l a
mort. Cest peut"tre ainsi que s' explique cette
disqualifcation de l a mort que marque l a dsu
tude rcente des rituels qui l ' accompagnaient.
1 8 2 La volont de savoir
Le soin qu'on met esquiver la mort est moins
li une angoisse nouvelle qui l a rendrait insup
portable pour nos socits qu' au fait que l es
procdures de pouvoir n' ont pas cess de s' en
dtourner. Avec le passage d' un monde l ' autre,
la mort tait la relve d' une souverainet ter
restre par une autre, singulirement plus puis
sante ; l e faste qui l' entourait relevait de la cr
monie politique. C' est sur l a vie maintenat et
tout au long de son droulement que le pouvoir
tablit ses prises ; l a mort en est la limite, l e
moment qui l ui chappe ; elle devient l e point
le plus secret de l' existence, le plus priv .
I l ne faut pas s' tonner que l e suicide crime
autrefois puisqu'il tait une manire d' usurper
sur l e droit de mort que l e souverai n, celui d'ici
bas ou celui de l ' au-del, avait seul l e droit
d' exercer s oit devenu au cours du XIX
e
sicle
une des premires conduites entrer dans le
champ de l ' analyse sociologique ; i l fai sait appa
ratre aux frontires et dans les interstices du
pouvoir qui s' exerce sur l a vie, l e droit individuel
et priv de mourir. Cette obstination mourir,
si trange et pourtant si rgulire, si constante
dans ses manifestations, si peu explicable par
consquent par des particularits ou accidents
individuels, fut un des premiers tonnements
d' une socit o le pouvoir politique venait de se
donner pour tche de grer la vie.
Concrtement, ce pouvoir sur la vie s' est dve
lopp depuis l e XVII
e
sicle sous deux formes
principales ; elles ne sont pas antithtiques ; elles
constituent plutt deux ples de dveloppement
Droit de mort et pouvoir sur la vie 1 8 3
relis par tout un faisceau intermdiaire de rela
tions. L'un des pl es, le premier, semble-t-il ,
s' tre form, a t centr sur le corps comme
machine : son dressage, l a majoration de ses
aptitude s, l' extorsion de ses forces, l a croi ssance
paral l l e de son utilit et de sa docilit, son
intgration des systmes de contrle efcaces
et conomiques, tout cela a t assur par des
procdures de pouvoir qui caractri sent l es dis
cilines : anatomo-politique du corps humain.
Le second, qui s' est form un peu plus tard, vers
le milieu du XVIII
e
sicle, est centr sur le corps
espce, sur le corps travers par l a mcani que
du vivant et servant de support aux processus
biologi ques : la prolifration, les naissances et
la mortalit, le niveau de sant, la dure de vie, l a
longvit avec toutes les conditions qui peuvent
les faire varier; leur prise en charge s' opre par
toute une srie d' interventi ons et de contrles
rgulateurs : une bio-politique de la population.
Les di scipl ines du corps et l es rgulati ons de la
populati on constituent les deux pl es autour
desquels s' est dploye l' organi sation du pou
voir sur l a vi e. La mise en pl ace au cours de
l' ge classique de cette grande technologie
double face - anatomique et biologique, in di vi
duali sante et spcifante, tourne vers les perfor
mances du corps et regardant vers les processus
de la vie - caractri se un pouvoir dont la pl us
haute fonction dsormai s n' est peut-tre pl us de
tuer mai s d'investir l a vie de part en part.
La vieille puissance de la mort o se symboli
sait le pouvoir souverain est maintenant recou-
1 84 La volont de savoir
verte soigneusement par l ' admi ni strati on des
corps et l a gesti on calculatrice de l a vi e. Dvelop
pement rapi de au cours de l ' ge cl assi que des
di sci pli nes di verses - col es, col lges, casernes,
ateliers ; appariti on aussi , dans l e champ des
prati ques poli tiques et des observations cono"
mi ques, des probl mes de natalit, de l ongvit,
de sant publ i que, d' habi tat, de migration ; expl o
si on, donc, de techni ques di verses et nombreuses
pour obtenir l ' assujetti ssement des corps et l e
contrle des popul ati ons . S' ouvre ai nsi l ' re d' un
( ( bi o-pouvoi r )) . Les deux directions dans l esquel l es
il se dvel oppe apparai ssent e ncore au XVIII
e
si cl e
nettement spares . Du ct de la di sci pl i ne, ce
sont des i nstituti ons comme l ' arme ou l ' cole ;
ce sont des rfexions sur l a tacti que= sur l ' ap
prenti ssage, sur l ' ducati on, sur l ' ordre des
soci ts ; el l es vont des anal yses proprement
militaires du Marchal de Saxe aux rves poli
tiques de Guibert ou de Servan. Du ct des rgu
lati ons de popul ation, c' est l a dmographi e, c' est
l ' estimati on du rapport entre ressources et habi
tants, c' est l a mi se en tabl eau des ri chesses et de
l eur circulati on, des vi es et de l eur dure pro
babl e : c' es t Ques nay, Moheau, Ss smi l ch .
La phi l osophi e des \ I dol ogues )) comme thorie
de l ' i de, du signe, de la gense i ndividuelle des
sensati ons mai s aussi de l a compositi on sociale
des i ntrts, l ' I dol ogi e comme doctri ne de l ' ap
prenti ssage mai s aussi du contrat et de la forma
tion rgl e du corps soci al consti tue sans doute l e
di scours abstrait dans l equel on a
c
herch coor
donner ces deux techni ques de pouvoir pour en
Droit de mort et pouvoir sur la vie 1 85
fare l a thorie gnrale. En fait, leur articulation
ne se fera pas au niveau d'un di scours spculatif
mais dans la forme d' agencements concrets qui
constitueront l a grande technol ogie du pouvoir
au XIX
e
sicle : le dispositi f de sexualit sera l'un
d' entre eux, et l ' un des plus importants.
Ce bio-pouvoir a t, n' en pas douter, un
lment i ndispensable au dveloppement du capi
talisme ; cel ui-ci n'a pu tre assur qu' au prix de
l' insertion contrle des corps dans l ' appareil
de production et moyennant un ajustement des
phnomnes de population aux processus cono
miques. Mai s il a exig davantage ; il lui a fallu
la croi ssance des uns et des autres, leur renfor
cement en mme temps que leur utilisabilit et
leur docilit ; i l lui a fallu des mthodes de pou
voir susceptibles de majorer les forces, les apti
tudes, la vie en gnral sans pour autant l es
rendre plus difciles assujetti r; si le dvelop
pement des grands appareils d'
tat, comme ins
titutions de pouvoir, a assur le maintien des
rapports de producti on, l es rudiments d' ana
tomo- et de bi o-politi que, invents au XVII
e
sicle
comme techniques de pouvoir prsentes tous l es
niveaux du corps social et uti l i ses par des insti
tutions trs diverses (la fami l l e comme l ' arme,
l ' cole ou l a police, la mdecine individuelle ou
l' admi ni stration des collectivits) , ont agi au
niveau des processus conomiques, de l eur drou
lement, des forces qui y sont l ' uvre et les sou
tiennent ; il s ont opr aussi comme facteurs de
sgrgation et de hirarchisation sociale, agi s
sant sur les forces respectives des uns et des
1 86 La volont de savoir
autres, garanti ssant des rapports de domination
et des efets d' hgmonie ; l' ajustement de l'ac
cumulation des hommes sur celle du capital, l' ar
ticulation de la croi ssance des groupes humains
sur l' expansion des forces productives et la r
partition di frentielle du proft, ont t; pour une
part, rendus possibl es par l ' exercice du bio
pouvoir sous ses formes et avec ses procds mul
tipl es. L'investissement du corps vivant, sa valori
sation et la gestion distributive de ses forces ont
t ce moment-l indispensables.
On sait combien de foi s a t pose la question
du rle qu'a pu avoir, dans la toute premire for
mation du capitali sme, une morae asctique ;
mai s ce qui s' est pass au XVIII
e
sicle dans cer
tai ns pays d' Occident, et qui a t li par le
dveloppement du capitalisme, est un phnomne
autre et peut-tre d' une plus grande ampleur que
cette nouvelle moral e, qui semblait disqualifer
le corps ; ce ne fut rien de moins que l' entre de
la vie dans l' histoire - je veux dire l 'entre des
phnomnes propres l a vie de l' espce humaine
dans l' ordre du savoir et du pouvoir -, dans le
champ des techniques politiques. Il ne s' agit pas
de prtendre qu' ce moment-l s'est produit l e
premier contact de la vi e et de l' hi stoire. Au
contare, l a pression du biologique sur l 'histo
rique tai t reste, pendant des mi l l naires,
extrmement forte ; l ' pi dmi e et l a fami ne
constituaient l es deux grandes formes drama
tiques de ce rapport qui demeurat ainsi plBc
sous le signe de la mort; par un processus circu
lare, l e dveloppement conomique et principale-
Droit de mort et pouvoir sur la vie 1 87
ment agricole du XVIII
e
sicl e, l ' augmentation d e la
productivit et des ressources encore plus rapi de
que la croi ssance dmographique qu' elle favo
risait, ont permi s que se desserrent un peu ces
menaces profondes : l ' re des grands ravages de
l a faim et de la peste sauf quelques rsur
gences est close avant la Rvolution franaise ;
l a mort commence ne plus harceler directe
ment la vie. Mai s en mme temps le dveloppe
ment des connaissances concernant la vie en
gnral, l' alioration des techniques agricoles,
les observations et les mesures visant la vi e et la
survie des hommes, contribuaient ce desserre
ment : une relative matrise sur la vie cartait
quelques-unes des imminences de la mort. Dans
l' espace de jeu ainsi acquis, l ' organisant et l'lar
gi ssant, des procds de pouvoir et de sa,oir
prennent en compte l es processus de la vie et
entreprennent de les contrler et de les modifer.
L 'homme occidental apprend peu peu ce que
c'est que d'tre une espce vivante dans un
monde vivant, d' avoir un corps, des conditions
d' existence, des probabilits de vie, une sant
individuelle et collective, des forces qu'on peut
modifer et un espace o on peut l es rpartir de
faon optimale. Pour la premire foi s sans doute
dans l'hi stoire, le biologique se rflchit dans
l e politique ; l e fait de vivre n' est plus ce soubas
sement inaccessible qui n'merge que de temps
en temps, dans le hasard de la mort et sa fatalit ;
il passe pour une part dans le champ de contrle
du savoir et d' intervention du pouvoir. Celui-ci
n' aura pl us afaire seulement des sujets de
1 88 La volont de savoir
droit sur l esquel s l a prise ultime est l a mort,
mai s des tres vivants, et la prise qu' il pourra
exercer sur eux devra se placer au niveau de la
vi e elle-mme ; c' est l a prise en charge de l a vie,
plus que la menace du meurtre, qui donne au
pouvoir son accs jusqu' au corps. Si on peut
appeler bio-hi stoire P l es pressi ons par lesquelles
les mouvements de la vie et les processus de l' hi s
toire interfrent l es uns avec les autres, il faudrait
parl er de bio-politi que I pour dsigner ce qui fait
entrer l a vie et ses mcanismes dans le domaine
des calculs explicites et fait du pouvoir-savoir un
agent de transformati on de la vie humai ne ; ce
n'est point que l a vie ait t exhaustivement int
gre des techni ques qui la dominent et la grent;
sans cesse el l e l eur chappe. Hors du " monde
occidental , la famine existe, une chelle plus
importante que j amai s ; et l es ri sques biologiques
enc ourus par l ' espce sont peut-tre plus grands,
pl us graves en tout cas, qu' avant l a nai ssance de
l a microbi ologi e. Mai s ce qu' OD pourrait appe
ler le seuil de modernit biologique )) d' une
socit se situe au moment o l ' espce entre
comme enjeu dans ses propres stratgies poli
tiques. L' homme, pendant des millnaires, est rest
ce qu' il tait pour Ari stote : un animal vivant
et de plus capable d' une exi stence politIque;
l' homme moderne es t un animal dans l a poli
ti que duquel sa vie d' tre vivant est en ques
tion.
Cette transformati on a eu des consquences
considrabl es. Inutile d' insi ster ici sur l a rup
ture qui s' est alors produite dans le rgime du
Droit de mort et pouvoir sur la vie 1 89
discours scientifque et sur la manire dont l a
double problmatique de la vie et de l' homme est
venue traverser et redi stribuer l'ordre de l ' pis
tm classique. Si la question de l'homme a t
pose - dans sa spcifcit de vivant et dans sa
spcifcit par rapport aux vivants - la rai son
en est chercher dans le nouveau mode de rap
port de l'histoire et de la vie : dans cette posi
tion double de la vie qui la met la foi s l ' ext
rieur de l'histoire comme son entour biologique
et l'intrieur de l' historicit humaine, pntre
par ses techniques de savoir et de pouvoir. Inu
tile d'insister non plus sur la prolifration des
technologies politiques, qui partir de l vont
investir le corps , la sant, les faons de se nour
rir et de se loger, l es conditions de vie, l' espace
tout entier de l ' existence.
Une autre consquence de ce dveloppement
du bio-pouvoir, c' est l'importance croi ssante
prise par le jeu de la norme aux dpens du sys
tme juridique de la loi. La loi ne peut pas ne pas
tre arme, et son arme, par excellence, c' est l a
mort; ceux qui la transgressent, elle rpond,
au moins titre d' ultime recours, par cette
menace absolue. La loi se rfre toujours au
glaive. Mais un pouvoir qui a pour tche de
prendre la vie en charge aura besoin de mca
nismes continus, rgulateurs et correctifs. Il ne
s' agit plus de faire jouer la mort dans le champ
de la souverainet, mais de distribuer le vivant
dans un domai ne de valeur et d'utilit. Un tel pou
voir a qualifer, mesurer, apprcier, hirar
chiser, plutt qu' se manifester dans son clat
1 90
La volont de savoir
meurtri er ; il n' a pas tracer l a l i gne qui spare,
des sujets obi ssants, l es ennemi s du souverain ;
il opre des di stributions autour de la norme. Je
ne veux pas di re que l a l oi s' eface ou que l es
i nstitutions de justice tendent di sparatre ;
mai s que la l oi fonctionne toujours davantage
comme une norme, et que l ' i nstitution judiciaire
s ' intgre de plus en plus un continuum d' appa
reils (mdicaLx, administratifs, etc. ) dont l es
fonctions sont surtout rgulatrices. Une socit
normali satrice est l ' efet historique d' une techno
logi e de p
ouvoir centre sur l a vi e. Par rapport
aux socits que nous avons connues j usqu' au
XVIII
e
si cl e, nous sommes entrs dans une phase de
rgressi on du juridique ; l es Constitutions crites
dans le monde entier depui s l a Rvolution fran
ai se, l es Codes rdigs et remanis , toute une
activit lgisl ative permanente et bruyante ne
doi vent pas faire i l l usi on : ce sont l l es formes
qui rendent acceptable un pouvoir essentiellement
normali sateur.
Et contre ce pouvoir encore nouveau au
XIX
e
sicl e, l es forces qui rsistent ont pris
appui sur cel a mme qu' il investit c' est--dire
sur l a vie et l ' homme en tant qu' i l est vivant.
Depui s le sicle pass, l es grandes l uttes qui
mettent en questi on l e systme gnral de pou
voir ne se font plus au nom d' un retour aux an
ciens droi ts, ou en foncti on du rve millnaire
d' un cycle des temps et d'un ge d' or. On n' attend
pl us l ' empereur des pauvres, ni l e royaume des
derniers j ours, ni mme seulement l e rtabli sse
ment des j usti ces qu' on imagine ancestrales ; ce
Droit de mort et pouvoir sur la vie 1 9 1
qUi est revendiqu et sert d' objecti f, c' est la
Vi e, entendue comme besoi ns fondamentaux,
essence concrte de l ' homme, accomplissement
de ses vi rtualits, plni tude du possibl e. Peu
importe s' i l s' agit ou non d' utopie ; on a l un
processus trs rel de l utte ; l a vie comme objet
poli ti que a t en quelque sorte prise au mot et
retourne contre l e systme qui entreprenait
de l a contler- C' est l a vie beaucoup pl us
que le droi t qui est devenue al ors l 'enjeu des
luttes poli tiques, mme si celles-ci se formulent
travers des afrmati ons de droit. Le (( droit
l a vie, au corps, la sant, au bonheur,
la satisfaction des besoins, le ( droit l! = par-del
toutes l es oppressions ou ( ( alinati ons = retrou
ver ce qu' on est et tout ce qu' on peut tre, ce
(( droit ) 1 si incomprhensi bl e pour l e systme juri
di que classique, a t la rpli que politi que
toutes ces procdures nouvelles de pouvoir qui,
elles non plus, ne relvent pas du droit tradition
nel de la souverainet .
Sur ce fond, peut se comprendre l' importance
prise par le sexe comme enjeu politique. C' est
qu' i l est la charnire des deux axes le l ong des
quel s s' est dveloppe toute l a technologie poli
ti que de l a vie. D' un ct i l relve des di sciplines
du corps : dressage, intensi fcation et di stributi on
des forces , ajustement et conomie des nergi es.
De l ' autre, il relve de l a rgulation des popula-
1 92 La volont de savoir
tions, par tous les efets globaux qu'il induit. Il
s'insre simultanment sur les deux registres ;
il donne lieu des surveillances infnitsimales,
des contrles de tous les instants, des amna
gements spati aux d' une extrme mticulosit,
des examens mdicaux ou psychologiques ind
fni s , tout un miCro-pouvoir sur le corps ; mas
il donne lieu aussi des mesures massives, des
estimati ons stati stiques, des interventions qui
vi sent le corps social tout entier ou des groupes
pris dans leur ensembl e. Le sexe est accs
la foi s la vie du corps et l a vie de l' espce.
On se sert de lui comme matrice des disciplines
et comme principe des rgulati ons. C' est pour
quoi, au XIX
e
sicl e, la sexualit est poursui
vie jusque dans le pl us petit dtail des existences ;
elle est traque dans les conduites, pourchasse
dans les rves ; on la suspecte sous les moindres
folies, on la poursuit j usque dans les premires
annes de l' enfance ; elle devient l e chifre de l'in
divi dualit, la foi s ce qui permet de l' analyser
et ce qui rend possible de la dresser. Mai s on la
voi t aussi deveni r thme d' oprati ons poli
tiques, d' i nterventions conomi ques (par des
incitati ons ou des freins l a procration), de
campagnes i dologiques de moraisation ou de
responsabilisation : on l a fai t valoir comme
l'indice de force d' une socit, rvlant aussi
bien son nergie politi que que sa vigueur bio
logique. D'un ple l ' autre de cette techno
logie du sexe, s' chelonne toute une srie de
tacti ques di verses qui combi nent selon des
proportions varies l'objectif de l a di scipline du
Droit de mort et pouvoir sur la vie 1 9 3
corps e t celui de l a rgul ation des populati ons.
De l l'importance des quatre grandes lignes
d' attaque le long desquell es s' est avance de
puis deux sicl es la politi que du sexe. Chacune a
t une manire de composer les techniques dis
ci pl i naires avec l es procds rgulateurs. Les
deux premires ont pri s appui sur des exigences
de rgul ati on sur toute une thmatique de l 'es
pce, de la descendance, de l a sant collective
pour obtenir des efets au niveau de l a discipline ;
la sexualisation de l ' enfant s' est faite dans l a
forme d' une campagne pour la sant de l a race
(la sexualit prcoce a t prsente depuis le
XVIII
e
sicle jusqu' la fn du XIX
e
la foi s comme
une menace pidmique qui risque de compro
mettre non seul ement la sant future des adultes,
mais l ' avenir de la socit et de l ' espce tout
entire) ; l'hystri sation des femmes, qui a appel
une mdicali sation minuti euse de l eur corps et
de leur sexe, s' est faite au nom de la responsa
bilit qu' elles auraient l' gard de la sant de
leurs enfants, de l a solidit de l' institution fai
liale et du salut de la socit. C' est le rapport
inverse qui a jou propos du contrle des nas
sances et de la psychiatrisation des perversi ons :
l l' intervention tait de nature rgulatrice, mas
elle devait prendre appui sur l'exigence de dis
ciplines et de dressages indivi duel s. D' une faon
gnral e, l ajonction du W corps et de la popu
lation Pa le sexe devient une cible centrale pour un
pouvoir qui s' organise autour de la gestion de l a
vie plutt que de l a menace de l a mort.
Le sang est rest longtemps un lment impor-
1 94 La volont de savoir
tant dans l es mcani smes du pouvoir, dans ses
manifestati ons et dans ses rituel s. Pour une
socit o sont prpondrants les systmes d' a
liace, l a forme politique du souverain, la dif
renci ation en ordres et en castes, la valeur des
lignages, pour une socit o la faine, les pi
dmi es, les vi ol ences rendent la mort imminente,
le sang constitue une des valeurs essentielles ;
son prix tient l a fois son rle instrumental
(pouvoir verser le sang) , son fonctionnement
dans l' ordre des si gnes ( avoir un certain sang,
tre du mme sang, accepter de risquer son sag),
sa prcarit aussi (facile rpandre, sujet se
tarir, trop prompt se mler, vite susceptible de
se corrompre) . Socit de sang j' allai s dire
de W sanguinit ) : honneur de l a guerre et peur
des famines , triomphe de la mort, souveran au
glaive, bourreaux et supplices , l e pouvoir parle
travers l e sang; celui-ci est une ralit /onc
tion sybolique. Nous sommes, nous, dans une
socit du W sexe ou plutt W sexualit : les
mcani smes du pouvoir s' adressent au corps,
la vie, ce qui la fait prolifrer, ce qui renforce
l' espce, sa vigueur, sa capcit de dominer, ou
son aptitude tre utili se. Sant, progniture,
race, avenir de l' espce, vitalit du corps social,
le pouvoir parle de l a sexualit et l a sexualit;
celle-ci n' est pas marque ou symbole, elle est
objet et cible. Et ce qui fait son importance, c' est
moi ns sa raret ou sa prcarit que son insis
tance, sa prsence insidi euse, l e fai t qu' elle est
partout la foi s allume et redoute. Le pouvoir
l a dessi ne, l a suscite et s' en sert comme le sens
Droit de mort et pouvoir sur la vie 195
prolifrant qu'il faut toujours reprendre sous
contrle pour qu'il n'chappe point; elle est un
efet valeur de sens. Je ne veux pas dire quune
substi tution du sexe au sang rsume elle seule
les transformations qui marquent le seuil de
notre modernit. Ce n' est pas l ' me de deux civi
lisations ou le principe organisateur de deux
formes cul turel l es que je tente d' exprimer ;
je cherche l es raisons pour lesquelles la sexua
lit, loin d'avoir t rprime dans la socit
contemporaine, y est au contraire en perma
nence suscite. Ce sont les nouvelles procdures
de pouvoir labores pendant l' ge classique et
mises en uvre au XIX
e
sicle qui ont fait passer
nos socits d' une sybolique du san
g
une ana
ltique de la sexualit. On le voit, s'il y a quelque
chose qui est du ct de l a loi, de l a mort, de la
transgression, du symbolique et de la souverai
net, c'est le sang; la sexualit, elle, est du ct
de la norme, du savoir, de la vie, du sens, des
di sciplines et des rgulations.
Sade et l es premiers eugnistes sont contem
porains de ce passage de l a W sanguinit la
sexualit " . Mai s al ors que les premiers rves
de perfectionnement de l ' espce font basculer
tout le problme du sang dans une gestion fort
contraignante du sexe (art de dterminer l es bons
mariages. de provoquer les fcondits souhaites,
d' assurer la sant et l a longvit des enfants).
alors que l a nouvelle ide de race tend efacer
les particul arits ari stocrati ques du sang pour
ne retenir que les efets contrlables du sexe.
Sade reporte l ' analyse exhaustive du sexe dans
1 96 La volont de savoir
les mcanismes exasprs de l' ancien pouvoir de
souverainet et sous les vieux prestiges entire
ment maintenus du sang; celui-ci court tout au
long du plai sir sang du supplice et du pouvoir
absolu, sang de l a caste qu' on respecte en soi et
qu'on fai t couler pourtant dans les rituel s majeurs
du parricide et de l 'inceste, sang du peuple qu' on
rpand merci pui sque celui qui coul e dans ses
veines n' est mme pas digne d' tre nomm. Le
sexe chez Sade est sans norme, sans rgle intrin
sque qui pourrait se formuler partir de sa
propre nature ; mais il est soumis la loi illimite
d'un pouvoir qui lui-mme ne connat que la
sienne propre ; s'il lui arrive de s'imposer par jeu
l'ordre des progressions soigneusement discipli
nes en journes successives, cet exercice le
conduit n' tre plus que le point pur d'une souve
rainet unique et nue : droit illimit de la mons
truosit toute-puissante. Le sang a rsorb l e
sexe.
En fait, l ' analytique de l a sexualit et l a sym
bolique du sang ont beau relever en leur principe
de deux rgimes de pouvoir bien distincts, ils ne
se sont pas succd (pas plus que ces pouvoirs
eux-mmes) sans chevauchements, interactions
ou chos. De difrentes manires, l a proccupa
tion du sang et de la loi a hant depuis prs de
deux sicles l a gestion de la sexualit. Deux de
ces interfrences sont remarquables, l ' une cause
de son importance hi storique, l ' autre cause des
probl mes thoriques qu' el le pose. Il est arriv,
ds l a seconde moiti du XIX
e
sicle, que la thma
tique du sang ait t appele vivi fer et sou-
Drit de mort et
p
ouvoir sur la vie 1 97
tenir de toute une pai sseur hi stori que le type
de pouvoir politique qui s' exerce travers l es
disposi tifs de sexualit . Le raci sme se forme en
c poi nt (le racisme sous sa forme moderne, ta
tque, biologisante) : toute une poli ti que du peu
plement, de la famil l e, du mari age- de l ' ducation,
de l a hirarchisation social e, de l a propri tq
et une longue srie d' interventi lns permanentes
au niveau du corps , des condui tes, de l a sant, de
l a vie quotidienne ont reu alors leur couleur et
leur justi fcation du souci mythi que de protger
la puret du sang et de fai re triompher la race.
Le nazi sme a sans doute t la combi nai son
la plus naive et l a pl us ruse et ceci parce
que cela des fantasmes du sang avec les pa
roxysme s d' un pouvoir di scipl inai re. Une mi se
en ordre eugni que de l a socit, avec ce qu' el l e
pouvait comporter d' extensi on et d' intensi fca
tion des micro-pouvoirs, sous le couvert d' une
tati sation illimite, s' accompagnait de l ' exal ta
tion onirique d' un sang supri eur cel l e-ci impl i
quait l a foi s le gnocide systmati que des
autres et l e ri sque de s' exposer soi-mme un
sacri fce total . Et l ' histoire a voul u que l a pol i
tique hi tlrienne du sexe soi t re ste une prati que
drisoire tandis que le mythe du sang se transfor"
mai t, lui , dans le plus grand massacre dont l e s
homme s pour l' instant pui ssent se souveni r.
A l ' extrme oppos, on peut sui vre, depui s cette
mme fn du XI XC sicle, l' efort thori que pour
ri nscri re l a thmatique de l a sexual i t dans l e
systme de la loi , de l ' ordre symbol i que et de l a
souverainet. C' est l ' honneur pol i ti que de l a psy-
1 98
La volont de savoir
chanalyse ou du moins de ce qu' i l a pu y avoir
de plus cohrent en elle d' avoir suspect (et
ceci ds sa nai
s
sance, c' est--dire ds sa l i gne
de rupture avec l a neuro-psychiatri e de l a dg
nrescence) ce qu' i l pouvait y avoir d' irrparable
ment prolifrant dans ces mcani smes de pouvoir
qui prtendaient contrler et grer l e quotidien
de la sexualit : de l l' efort freudien (par rac
tion sans doute la grande monte du racisme
qui lui tait conteporain) pour donner comme
principe l a sexualit l a loi l a loi de l ' al
liance, de la consangui nit interdite, du Pre
Souverain, bref pour convoquer autour du dsir
tout l' ancien ordre du pouvoir. A cela la psycha
nalyse doit d' avoir t quel ques exceptions
prs et pour l' essentiel en opposition thorique
et pratique avec le fascisme. Mai s cette position
de la psychanalyse a t lie une conjoncture
historique prci se. Et rien ne saurait empcher
que penser l ' ordre du sexuel selon l' instance de
l a loi, de la mort, du sang et de l a souverainet
quelles que soient l es rfrences Sade et
Bataille, quel s que soient les gages de subver
sion qu' on leur demande ne soit en fn de
compte une rtro-version P hi stori que. I l faut
penser le di sposi ti f de sexualit parti r des tech
niques de pouvoir qui lui sont contemporaines .
On me dira : c' est donner dans un hi stori
cisme pl us hti f que radi cal ; c' est esquiver
Droit de mort et pouvoir sur la vie 1 99
au proft de phnomnes, vai ales peut-tre,
mai s fragil es, secondaires et somme toute
superfciel s, l'existence biologiquement solide
des fonctions sexuell es ; c' est parler de la sexua
lit comme si le sexe n' existait pas. Et on serait
en droit de m' objecter : Vous prtendez ana
lyser par le menu l es processus par lesquels ont
t sexuali ss le corps des femmes, la vie des
enfants, les rapports familiaux et tout un l arge
rseau de relations sociales. Vous voulez dcrire
cette grande monte du souci sexuel depuis le
XVII
e
si cle et l' acharnement croissant que nous
avons mis souponner le sexe partout. Admet
tons ; et supposons en efet que les mcanismes
de pouvoir ont t plus employs susciter et
irriter " l a sexualit qu' l a rprimer. Mas
vous voi l rest bien proche de ce dont vous pen
sez, sans doute, vous tre dmarqu ; au fond
vous montrez des phnomnes de difusion, d' a
crage, de fxation de l a sexualit, vous essayez
de faire voir ce qu' on pourrat appeler l ' organi
sati on de zones rognes " dans le corps socia;
il se pourrait bien que vous n' ayez fat que trans
poser l ' chelle de processus difus des mca
nismes que la psychanalyse a reprs avec pr
cision au niveau de l ' indivi du. Mas vous lidez
ce partir de quoi cette sexual i sation a pu se
faire et que la psychanalyse, ell e, ne mconnat
pas savoir le sexe. Avant Freud, on cherchait
localiser la sexuali t au pl us serr : dans le
sexe, dans ses fonctions de reproducti on, dans
ses localisations anatomiques immdiates; on se
raattait sur un minimum biologi que organe,
200
La volont de savoir
i nsti nct, fnal i t. Vous tes, vous, en posI tI On
symtri que et i nverse : il ne reste pour vous que
des efets sans support, des rami fcati ons prives
de raci ne, une sexual i t sa
n
s sexe. Castration,
l encore. ))
En ce poi nt, i l faut di sti nguer deux questi ons.
D' un ct : l ' anal yse de l a sexualit comme ! dis
posi ti f pol i tique )) impl i que-t-elle ncessairement
l ' li si on du corps, de l' anatomi e, du bi ol ogi que,
du foncti onnel ? A cette premire question, je crois
qu ' on peut rpondre non. En tout cas, l e but de
la prsente recherche est bien de montrer com
ment de s di sposi ti fs de pouvoir s' arti cul ent direc
tement sur l e corps sur des corps, des fonctions,
des proce ssus physiologi ques, des sensati ons, des
pl ai si rs ; l oi n que l e corps ai t tre gomm, il
s' agit de l e faire apparatre dans une analyse
o le bi ol ogi que et l ' hi storique ne se feraient
pas suite, comme dans l ' volutionnisme des
anci ens sociologues, mais se lieraient selon une
complexit croi s sant mesure que se dve
loppent l es technol ogi es modernes de pouvoir
qui prennent l a vi e pour cibl e. Non pas donc
f l
hi stoire des mentalits )) qui ne ti endrait compte
des corps que par l a manire dont on l es a per
s ou dont on leur a donn sens et val eur ; mais
hi stoire des corps l! et de la mani re dont on a
investi ce qu' i l y a de pl us matri el , de pl us vivant
en eux.
Autre questi on, di stincte de l a premire : cette
matrialit l aquel l e on se rfre n' est-elle donc
pas cel l e du sexe, et n' y a-t-il pas paradoxe
vouloi r faire une hi stoire de l a sexualit au
Droit de mort et pouvoir sur la vie 201
niveau des corps, sans qu' i l y soit questi on, le
moins du monde, du sexe? Aprs tout, le pouvoir
qui s' exerce travers la sexualit ne s' adresse
t-il pas, spci fquement, cet lment du rel
qu' est l e ! sexe " le sexe en gnral ? Que la
sexualit ne soit pas par rapport au pouvoir un
domai ne extrieur auquel il s' imposerait, qu' elle
soit au contraire efet et i nstrument de ses agen
cements, passe encore. Mai s l e sexe, lui, n' est-il
pas, par rapport au pouvoir, l' P autre Pa tandis
qu'il est pour la sexualit l e foyer autour duquel
ell e distri bue ses efets? Or, justement, c' est cette
i de du sexe qu' on ne peut pas recevoir sans exa
men. l Le sexe " est-il , dans l a ralit, le point
d' ancrage qui supporte les manifestati ons de l! l a
sexualit I , ou bi en une i de complexe, hi stori
quement forme l' i ntrieur du dispositif de
sexualit? On pourrait montrer, en tout cas,
comment cette ide !! du sexe s' est forme
travers l es difrentes stratgi es de pouvoir et
quel rle dfni elle y a jou.
Tout au long des grandes li gnes au long des
quel les s' est dvelopp le dispositif de sexualit
depui s le XIXe sicle, on voit s' l aborer cette ide
qu'il existe autre chose que des corps, des or
ganes, des l ocali sations somati ques, des fonctions,
des systmes anatomo-physiologiques, des sensa
tions, des pl aisirs ; quel que chose d' autre et de
pl us, quel que chose qui a ses proprits intrin
sques et ses lois propres : l e sexe - Ainsi , dans
l e processus d'hystri sati on de l a femme, l e
t! sexe " a t dfni de trois faons : comme ce qui
appartient en commun l' homme et la femme ;
202 La volont de savoir
ou comme ce qui appartient aussi par excellence
l' homme et fait donc dfaut la femme ; mai s
encore comme ce qui constitue lui seul le corps
de la femme, l 'ordonnant tout entier aux fonctions
de reproduction et l e perturbant sans cesse par
les efets de cette mme fonction; l' hystrie est
interprte, dans cette stratgie, comme le jeu du
sexe en tant qu' il est l ' W un et l ' autre l q tout
et partie, principe et manque. Dans la sexuali
sation de l' enfance, l'ide s' l abore d'un sexe
qui est prsent (du fait de l ' anatomie) et absent
(du point de vue de l a physiologie), prsent ga
lement si on considre son activit et dfcient si
on se rfre sa fnalit reproductrice ; ou encore
actuel dans ses manifestations mai s cach dans
ses efets qui n' apparatront dans leur gravit
pathologique que pl us tard; et chez l ' adulte, si
le sexe de l ' enfant est encore prsent, c' est sous
la forme d' une causalit secrte qui tend annu
ler le sexe de l' adulte (ce fut un des dogmes de la
mdecine du XVIII
e
et du XIX
e
sicle de supposer
que la prcocit du sexe entrane par la suite la
strilit, l'impui ssance, l a frigidit, l'incapacit
d'prouver du plai sir, l ' anesthsie des sens) ; en
sexualisant l' enfance on a constitu l'ide d' un
sexe marqu par le jeu essentiel de l a prsence
et de l'absence, du cach et du manifeste ; l a mas
turbation avec les efets qu' on lui prte rvle
rait de faon privilgie ce jeu de l a prsence et
de l ' absence, du manifeste et du cach . Dans la
psychiatri sation des perversions, l e sexe t
rapport des fonctions biologiques et un
appareil anatomo-physiologi que qui lui donne
Droit de mort et pouvoir sur la vie 203
son (( sens , c' est--dire s a fnalit ; mais i l est
aussi rfr un instinct qui, travers son
propre dveloppement et selon les objets auxquels
il peut s' attacher, rend possi ble l'apparition des
conduites perverses, et intelli
g
ible leur gense ;
ainsi le sexe f se dfnit par un entrelace
ment de fonction et d'instinct, de fnalit et de
si
g
nifcation; et sous cette forme, il se mani
feste, mieux que partout ailleurs, dans l a per
version-modle, dans ce ftichisme qui, depuis
1 8 7 7 au moins, a servi de fl directeur l ' analyse
de toutes les autres dviations, car on y lisait
clairement la fxation de l'instinct un objet sur
le mode de l' adhrence historique et de l'inad
quation biologique. Enfn dans la sociali sation
des conduites procratrices, le sexe est dcrit
comme pris entre une loi de ralit (dont les
ncessits conomiques sont l a forme immdiate
et la plus abrupte) et une conomie de plaisir qui
tente toujours de la contourner quand elle ne la
mconnat pas; la plus clbre des fraudes q
l e P cotus interruptus , reprsente l e point o
l'instance du rel contraint mettre un terme
au plaisir et o le plaisir trouve encore se
faire jour malgr l'conomie prescrite par le
rel. On le voit; c'est le dispositif de sexualit
qui , dans ses difrentes stratgies, met en place
cette ide P du sexe ; et sous les quatre grandes
formes de l'hystrie, de l'onani sme, du ftichisme
et du cot interrompu, elle le fait apparatre
comme soumis au jeu du tout et de la partie, du
principe et du manque, de l'absence et de la pr
sence, de l' excs et de la dfcience, de l a foncion
204
La volont de savoir
et de l ' instinct, de l a fnalit et du sens, du rel et
du pl aisir. Ainsi s' est forme peu peu l ' arma
ture d' une thorie gnrale du sexe.
Or cette thori e, ainsi engendre, a exerc dans
le di spositif de sexualit un certain nombre de
fonctions qui l ' ont rendue indispensabl e. Trois
surtout ont t importantes. D' abord la notion de
sexe l a permis de regrouper selon une unit
artifcielle des lments anatomiques, des fonc
tions biologiques, des conduites, des sensations,
des plaisirs et ell e a permi s de faire fonctionner
cette unit fctive comme principe causal , sens
omniprsent, secret dcouvrir partout : l e sexe
a donc pu fonctionner comme signifant unique
et comme signif universel. De plus en se donnant
unitairement comme anatomie et comme manque,
comme fonction et comme latence, comme instinct
et comme sens, il a pu marquer l a ligne de contact
entre un savoir de la sexualit humaine et les
sciences biologi ques de l a reproduction; ainsi le
premier, sans rien emprunter rellement aux
secondes sauf quel ques analogies incertai nes et
quelques concepts transplants a reu par pri
vilge de voi si nage une garantie de quasi-scien
tfcit ; mais par ce mme voisinage certains des
contenus de la biologie et de l a physiologie ont pu
servir de principe de normalit pour la sexualit
humai ne. Enfn, la notion de sexe a assur un
retournement essentiel ; elle a permis d' inverser
l a reprsentation des rapports du pouvoir la
sexualit et de faire apparatre celle-ci non point
dans sa relation essentielle et positive au pouvoir,
mas comme acre das une instance spcifque
Droit de mort et pouvoir sur la vie 205
et irrductible que l e pouvoir cherche comme il
peut assujettir ; ainsi l 'ide du sexe ! permet
d' esquiver ce qui fait le !! pouvoir " du pouvoir;
elle permet de ne le penser que comme loi et i nter
dit. Le sexe, cette instance qui nous parat nous
dominer et ce secret qui nous semble sous-jacent
tout ce que nous sommes, ce point qui nous
fascine par le pouvoir qu'il manifeste et par le
sens qu' il cache, auquel nous demandons de rv
ler ce que nous sommes et de nous librer ce qui
nous dfnit, le sexe n' est sans doute qu' un point
idal rendu ncessaire par le dispositif de sexua
lit et par son fonctionnement. I l ne faut pas ima
giner une instance autonome du sexe qui produi
rai t secondairement les efets multiples de la
sexualit tout au long de sa s urface de contact
avec le pouvoir. Le sexe est au contraire l' lment
le pl us spculatif, le pl us idal, l e pl us intrieur
aussi dans un dispositif de sexualit que le pouvoir
organise dan s ses pri ses sur les corps, leur mat
rialit, leurs forces, leurs nergi es, leurs sensa
tions, leurs plai sirs.
On pourrait ajouter que ! le sexe " exerce une
autre foncti on encore qui traverse les premires
et l es souti ent. Rle pl us prati que cette fois que
thorique. C' est par le sexe en efet, point imagi
naire fx par le dispositif de sexualit, que cha
cun doit passer pour avoir accs sa propre intel
ligibilit (pui squ' il est la fois l ' lment cach et
le principe producteur de sens) , la totalit de
son corps (puisqu' il en est une partie relle et
menace et qu' i l en constitue symboliquement le
tout), son identit (puisqu'il joint la force
206 La volont de savoir
d' une pul sion l a singularit d' une histoire) . Par
un renvers ement qui a sans doute commenc de
faon subreptice depui s longtemps et l 'poque
dj de la pastorale chrtienne de la chair - nous
en sommes arrivs maintenant demander notre
intelligi bi lit ce qui fut, pendant tant de sicles,
consi dr comme fol i e, la plnitude de notre corps
ce qui en fut longtemps le stigmate et comme l a
blessure, notre i dentit ce qu' on percevait
comme obscure pousse sans nom. De l l'im
portance que nous l ui prtons, la crainte rvren
cieuse dont nous l' entourons, le soin que nous
mettons le connatre. De l le fait qu il soit
devenu, l' chelle des sicl es, plus important que
notre me, plus important presque que notre vie;
et de l que toutes l es nigmes du monde nous
paraissent si lgres compares ce secret, en
chacun de nous minuscule, mai s dont l a densit
le rend plus grave que tout autre. Le pacte faus
tien dont le dispositif de sexualit a inscrit en
nous la tentation est dsormai s celui-ci : chan
ger la vie tout entire contre le sexe lui-mme,
contre l a vrit et l a souverainet du sexe. Le
sexe vaut bien la mort. C' est en ce sens, mais on
le voit strictement hi storique, que le sexe aujour
d'hui est bien travers par l'instinct de mort.
Quand l'Occident, il y a bien longtemps, eut
dcouvert l ' amour, il lui a accord assez de prix
pour rendre la mort acceptable; cest le sexe
auourd' hui qui prtend cette quivalenceq la
plus haute de toutes . Et tandis que le dispositif
de sexuali t permet aux techniques de pouvoir
d'investir la vie, le point fctif du sexe, qu'il a
Droit de mort et pouvoir sur la vie 207
lui-mme marqu, exerce assez de fascination
sur chacun pour qu' on accepte d'y entendre
gronder la mort.
En crant cet lment imaginaire qu' est (( le
sexe le dispositif de sexualit a suscit un de
ses principes i nternes de foncti onnement les pl us
essentiels : le dsir du sexe - dsir de l ' avoir,
dsir d'y accder, de le dcouvrir, de le librer,
de l articuler en discours, de le formuler en vrit.
Il a constitu (( le sexe l ui-mme comme dsi
rabl e. Et c' est cette dsirabilit du sexe qui fxe
chacun de nous l ' injonction de le connatre, d' en
mettre au jour l a loi et l e pouvoir ; c' est cette dsi
rabilit qui nous fait croire que nous afrmons
contre tout pouvoir les droits de notre sexe, alors
qu' elle nous attache en fait au dispositif de sexua
lit qui a fai t monter du fond de nous"mme
comme un mirage o nous croyons nous re
connatre, le noir clat du sexe.
W Tout est sexe, disai t Kate, dans Le Serpent
plumes, tout est sexe. Comme le sexe peut tre
beau quand l ' homme le garde pui ssant et sacr
et qu' il emplit l e monde. Il est comme le soleil qui
vous inonde, vous pntre de sa lumi re. ll
Donc, ne pas rfrer l' instance du sexe une
hi stoire de l a sexualit ; mais montrer comment
P le sexe " est sous l a dpendance histori que de
la sexualit. Ne pas placer le sexe du ct du rel,
et l a sexualit du ct des ides confuses et des
illusi ons ; la sexualit est une fgure histori que
trs rell e, et c' est el l e qui a suscit comme l
ment spculatif, ncessaire son fonctionnement,
la notion du sexe. Ne pas croire qu' en di sant oui
208
La volont de savoir
au sexe, on di t non au pouvoir ; on suit au
contraire le fl du di spositif gnral de sexualit.
C'est de l i nstance du sexe qu' il faut s' afranchir
si, par un retournement tactique des divers mca
nismes de l a sexualit, on veut faire valoir contre
les prises du pouvoir, les corps, les plaisirs, l es
savoirs, dans leur multiplicit et leur possibilit
de rsi stance- Contre le di spositif de sexualit, le
point d' appui de la contre-attaque ne doit pas tre
le sexe"dsir, mai s l es corps et l es pl aisirs .
I l Y a eu tant d' acti on dans l e p as s ,
di sait D. H. Lawrence, particuli rement d' action
sexuelle, une si monotone et lassante rptition
sans nul dveloppement parallle dans la pense
et l a comprhension- A prsent, notre afaire est
de comprendre l a sexualit. Aujourd' hui, l a
comprhension pleinement consciente de l' insti nct
sexuel importe pl us que l ' acte sexuel . "
Peut-tre un jour s' tonnera"t-on- On corpren
dra mal qu' une civilisati on si oue par ailleurs
dvelopper d' immenses appareil s de production
et de destruction ait trouv le temps et l ' infnie
patience de s' interroger avec autant d anxit
sur ce qu' il en est du sexe ; on sourira peuttre en
se rappel ant que ces hommes que nous aons t
croyaient qu' il y a de ce ct-l une vrit au
moins aussi prcieuse que celle qu' i l s avaient dj
demande l a terre, aux toiles et aux formes
pures de l eur pense ; on sera surpris de l' achar-
Droit de mort et pouvoir sur la vie 209
nement que nous avons mi s feindre d' arracher
sa nuit une sexualit que tout nos discours,
nos habitudes, nos i nstituti ons, nos rglements,
nos savoirs produisait en pl eine lumire et re
lanait avec fracas. Et on se demandera pourquoi
nous avons tant voulu lever l a loi du silence sur
ce qui tai t l a plus bruyante de nos proccupa
tions. Le bruit, rtrospectivement, pourra pa
ratre dmesur, mai s pl us trange encore notre
enttement n'y dchifrer que refus de parl er et
consigne de se taire. On s' interrogera sur ce qui
a pu nous rendre si prsomptueux; on cherchera
pourquoi nous nous sommes attribu le mrite
d' avoir, l es premi ers, accord au sexe, contre
toute une morale mi l l naire, l ' importance que
nous di sons tre la sienne et comment nous avons
pu nous glorifer de nous tre afranchis enfn au
xx
e
sicle d' un temps de l ongue et dure rpression
celui d'un ascti sme chrti en prolong, infchi,
avari cieusement et vtilleusement utilis par les
impratifs de l' conomie bourgeoi se. Et l o nous
voyons aujourd' hui l ' hi stoire d'une censure difci
lement leve, on reconnatra plutt la longue mon
te travers les sicles d'un di spositif compl exe
pour faire parler du sexe, pour y attacher notre
attention et notre souci, pour nous faire croire
la souverainet de sa loi alors que nous sommes
travaill s en fait par les mcani smes de pouvoir
de l a sexualit.
On se moquera du reproche de pansexual I sme
qui fut un moment object Freud et l a psycha
nalyse. Mai s ceux qui paratront aveugles seront
peut-tre moins ceux qui l ' ont formul que ceux
2 1 0
La volont de savoir
qui l ' ont cart d' un revers de main, comme s' i l
tradui sait seulement les frayeurs d' une vieille
pudi bonderi e. Car les premiers, aprs tout, ont
t seul ement s urpri s par un processus qui avait
commenc depuis bien longtemps et dont ils
n' avaient pas vu qu' i l les entourait dj de toutes
parts ; il s avai ent attri bu au seul mauvai s gnie
de Freud ce qui avait t prpar de longue main;
ils s' taient tromps de date quant la mi se en
place, dans notre socit, d' un dispositif gnral
de sexual it Mai s l es seconds, eux, ont fait
erreur sur la nature du processus ; ils ont cru que
Freud restituai t enfn au sexe, par un retournement
soudai n, l a part qui lui tait due et qui lui avait
t si longtemps conteste ; ils n' ont pas vu que le
bon gnie de Freud l ' avait plac en un des poi nts
dcisifs marqus depuis le XVIII
e
sicle par les
stratgies de savoir et de pouvoir ; et qu' il rel an
ait ainsi avec une efcacit admirable, di gne
des plus grands spirituels et directeurs de
l' poque classique, l' injonction sculaire d' avoir
connatre le sexe et le mettre en discours. On
voque souvent les i nnombrables procds par les
quels le chri stianisme ancien nous aurait fait d
tester le corps ; mais songeons un peu toutes ces
ruses par l esquell es, depuis plusieurs sicles , on
nous a fait aimer le sexe, par lesquelles on nous a
rendu dsirable de le connatr, et prci eux tout
ce qui s' en di t ; par lesquelles aussi on nous a
incits dployer toutes nos habilets pour le
surprendre, et attachs au devoir d' en extraire
la vrit ; par lesquelles on nous a culpabili ss
de l'avoir si longtemps mconnu. Ce sont elles
Droit e mort et pouvoir sur la vie 2 1 1
qui mriteraient, aujourd' hui, d' tonner. Et nous
devons songer qu' un jour, peut-tre, dans une
autre conomie des corps et des plaisirs, on ne
comprendra plus bien comment les ruses de la
sexualit, et du pouvoir qui en soutient le di spo
sitf, sont parvenues nous soumettre cette
austre monarchi e du sexe, au point de nous
vouer la tche indfnie de forcer son secret et
d'extorquer cette ombre l es aveux l es plus
vraI S.
Ironie de ce di spositif : il nous fai t croire qu' il
y va de notre W libration .
1. Nous autres, victoriens 7
II. L'hypothse rpressive 23
1. L'incitation aux discours 25
2. L'implantation perverse 50
III. Scientia sexualis 69
IV. Le dispositif de sexualit 99
1. Enjeu 1 07
2. Mthode 121
3. Domaine 136
4. Priodisation 1 52'
V. Droit de mort et pouvoiI sur la vie 1 75
Vous aimerez peut-être aussi
- Histoire de La Folie À L'age Classique M FoucaultDocument295 pagesHistoire de La Folie À L'age Classique M Foucaultigoramelo100% (8)
- J.P Sartre - L'être Et Le NéantDocument684 pagesJ.P Sartre - L'être Et Le Néantlasolitudenue94% (52)
- L'existentialisme est un humanisme de Jean-Paul Sartre (Analyse approfondie): Approfondissez votre lecture de cette œuvre avec notre profil littéraire (résumé, fiche de lecture et axes de lecture)D'EverandL'existentialisme est un humanisme de Jean-Paul Sartre (Analyse approfondie): Approfondissez votre lecture de cette œuvre avec notre profil littéraire (résumé, fiche de lecture et axes de lecture)Pas encore d'évaluation
- Georges Bataille - L'Amour D'un Être MortelDocument21 pagesGeorges Bataille - L'Amour D'un Être Mortelyeatshsu100% (2)
- Essai sur le don: Forme et raison de l'échange dans les sociétés archaïquesD'EverandEssai sur le don: Forme et raison de l'échange dans les sociétés archaïquesPas encore d'évaluation
- Sartre - Verite Et ExistenceDocument145 pagesSartre - Verite Et Existencescrazed100% (1)
- Fondements de la métaphysique des moeurs de Kant - Le règne des fins (Commentaire): Comprendre la philosophie avec lePetitPhilosophe.frD'EverandFondements de la métaphysique des moeurs de Kant - Le règne des fins (Commentaire): Comprendre la philosophie avec lePetitPhilosophe.frPas encore d'évaluation
- La Crise des sciences européennes et la phénoménologie transcendantale d'Edmund Husserl: Les Fiches de lecture d'UniversalisD'EverandLa Crise des sciences européennes et la phénoménologie transcendantale d'Edmund Husserl: Les Fiches de lecture d'UniversalisPas encore d'évaluation
- Aristote (Fiche philosophe): Comprendre la philosophie avec lePetitPhilosophe.frD'EverandAristote (Fiche philosophe): Comprendre la philosophie avec lePetitPhilosophe.frPas encore d'évaluation
- Être et Temps de Martin Heidegger: Les Fiches de lecture d'UniversalisD'EverandÊtre et Temps de Martin Heidegger: Les Fiches de lecture d'UniversalisPas encore d'évaluation
- Éthique de Spinoza - L'origine et la nature des sentiments (Commentaire): Comprendre la philosophie avec lePetitPhilosophe.frD'EverandÉthique de Spinoza - L'origine et la nature des sentiments (Commentaire): Comprendre la philosophie avec lePetitPhilosophe.frPas encore d'évaluation
- Merleau-Ponty - Phénoménologie de La PerceptionDocument278 pagesMerleau-Ponty - Phénoménologie de La PerceptionVinícius dos Santos100% (1)
- Michel Foucault-Qu'est-ce Que La Critique - Suivi de La Culture de Soi-Vrin (2015) PDFDocument195 pagesMichel Foucault-Qu'est-ce Que La Critique - Suivi de La Culture de Soi-Vrin (2015) PDFRobert Pilsner100% (1)
- Être et Temps de Heidegger - Nécessité, structure et primauté de la question de l'être (Commentaire): Comprendre la philosophie avec lePetitPhilosophe.frD'EverandÊtre et Temps de Heidegger - Nécessité, structure et primauté de la question de l'être (Commentaire): Comprendre la philosophie avec lePetitPhilosophe.frPas encore d'évaluation
- Comment rédiger une dissertation? (Fiche de cours): Méthodologie lycée - Réussir le bac de françaisD'EverandComment rédiger une dissertation? (Fiche de cours): Méthodologie lycée - Réussir le bac de françaisÉvaluation : 3.5 sur 5 étoiles3.5/5 (2)
- Le désir (Fiche notion): LePetitPhilosophe.fr - Comprendre la philosophieD'EverandLe désir (Fiche notion): LePetitPhilosophe.fr - Comprendre la philosophieÉvaluation : 5 sur 5 étoiles5/5 (1)
- Levinas - Autrement Qu'être Ou Au-Delà L'essenceDocument286 pagesLevinas - Autrement Qu'être Ou Au-Delà L'essencenorega000100% (10)
- Les règles de la méthode sociologique (texte intégral de 1895): Le plaidoyer d'Émile Durkheim pour imposer la sociologie comme une science nouvelleD'EverandLes règles de la méthode sociologique (texte intégral de 1895): Le plaidoyer d'Émile Durkheim pour imposer la sociologie comme une science nouvellePas encore d'évaluation
- Tractatus logico-philosophicus de Wittgenstein - Le statut de la philosophie (Commentaire): Comprendre la philosophie avec lePetitPhilosophe.frD'EverandTractatus logico-philosophicus de Wittgenstein - Le statut de la philosophie (Commentaire): Comprendre la philosophie avec lePetitPhilosophe.frPas encore d'évaluation
- Dictionnaire de la Sociologie: Les Dictionnaires d'UniversalisD'EverandDictionnaire de la Sociologie: Les Dictionnaires d'UniversalisPas encore d'évaluation
- FOUCAULT, Dits Et Écrits 1954-1988. IV 1980-1988 PDFDocument900 pagesFOUCAULT, Dits Et Écrits 1954-1988. IV 1980-1988 PDFunlecteur100% (6)
- Jean-Paul Sartre - Critique de La Raison DialectiqueDocument381 pagesJean-Paul Sartre - Critique de La Raison DialectiqueVinícius dos Santos100% (8)
- La crise de l'esprit, la politique de l'esprit, le bilan de l'intelligenceD'EverandLa crise de l'esprit, la politique de l'esprit, le bilan de l'intelligencePas encore d'évaluation
- Hegel (Fiche philosophe): Comprendre la philosophie avec lePetitPhilosophe.frD'EverandHegel (Fiche philosophe): Comprendre la philosophie avec lePetitPhilosophe.frÉvaluation : 1 sur 5 étoiles1/5 (1)
- Le Léviathan de Hobbes - Des causes de la génération et de la définition d'une République (Commentaire): Comprendre la philosophie avec lePetitPhilosophe.frD'EverandLe Léviathan de Hobbes - Des causes de la génération et de la définition d'une République (Commentaire): Comprendre la philosophie avec lePetitPhilosophe.frPas encore d'évaluation
- Kierkegaard (Fiche philosophe): Comprendre la philosophie avec lePetitPhilosophe.frD'EverandKierkegaard (Fiche philosophe): Comprendre la philosophie avec lePetitPhilosophe.frPas encore d'évaluation
- Idees Directrices Pour Une PhenomenologieDocument602 pagesIdees Directrices Pour Une PhenomenologieLaura Hunter96% (24)
- Malaise dans la civilisation: Essai de métaphysique sur le devenir des culturesD'EverandMalaise dans la civilisation: Essai de métaphysique sur le devenir des culturesPas encore d'évaluation
- Husserl (Fiche philosophe): Comprendre la philosophie avec lePetitPhilosophe.frD'EverandHusserl (Fiche philosophe): Comprendre la philosophie avec lePetitPhilosophe.frPas encore d'évaluation
- Dictionnaire de la Philosophie politique: Les Dictionnaires d'UniversalisD'EverandDictionnaire de la Philosophie politique: Les Dictionnaires d'UniversalisPas encore d'évaluation
- Histoire de la philosophie: Une édition complète de l'Histoire de la philosophie des origines à nos joursD'EverandHistoire de la philosophie: Une édition complète de l'Histoire de la philosophie des origines à nos joursÉvaluation : 5 sur 5 étoiles5/5 (1)
- Foucault Dits Et Ecrits II 19701975Document852 pagesFoucault Dits Et Ecrits II 19701975Collectif Les EntropiquesPas encore d'évaluation
- Le Monde comme volonté et comme représentation: Tome ID'EverandLe Monde comme volonté et comme représentation: Tome IPas encore d'évaluation
- L'Interprétation des rêves de Sigmund Freud: Les Fiches de lecture d'UniversalisD'EverandL'Interprétation des rêves de Sigmund Freud: Les Fiches de lecture d'UniversalisPas encore d'évaluation
- Les Anormaux Michel FoucaultDocument230 pagesLes Anormaux Michel FoucaultÉric Zuliani100% (7)
- Le Gai Savoir de Friedrich Nietzsche: Les Fiches de lecture d'UniversalisD'EverandLe Gai Savoir de Friedrich Nietzsche: Les Fiches de lecture d'UniversalisPas encore d'évaluation
- Du contrat social ou Principes du droit politique: Un traité de philosophie politique de Jean-Jacques Rousseau (texte intégral)D'EverandDu contrat social ou Principes du droit politique: Un traité de philosophie politique de Jean-Jacques Rousseau (texte intégral)Évaluation : 3.5 sur 5 étoiles3.5/5 (510)
- Tractatus logico-philosophicus de Ludwig Wittgenstein: Les Fiches de lecture d'UniversalisD'EverandTractatus logico-philosophicus de Ludwig Wittgenstein: Les Fiches de lecture d'UniversalisPas encore d'évaluation
- Le Système Des Objets - Jean BaudrillardDocument288 pagesLe Système Des Objets - Jean BaudrillardMeriam Ben Amor63% (8)
- Nietzsche (Fiche philosophe): Comprendre la philosophie avec lePetitPhilosophe.frD'EverandNietzsche (Fiche philosophe): Comprendre la philosophie avec lePetitPhilosophe.frPas encore d'évaluation
- La volonté de Puissance: Essai d'une transmutation de toutes les valeurs (Études et Fragments)D'EverandLa volonté de Puissance: Essai d'une transmutation de toutes les valeurs (Études et Fragments)Pas encore d'évaluation
- Phénoménologie de l'esprit de Hegel: Les Fiches de lecture d'UniversalisD'EverandPhénoménologie de l'esprit de Hegel: Les Fiches de lecture d'UniversalisÉvaluation : 1 sur 5 étoiles1/5 (1)
- La culture générale expliquée: Les clés pour comprendreD'EverandLa culture générale expliquée: Les clés pour comprendrePas encore d'évaluation
- Pensees-Rebelles Foucault, Derrida, Deleuze PDFDocument186 pagesPensees-Rebelles Foucault, Derrida, Deleuze PDFRicardo Passepartout100% (2)