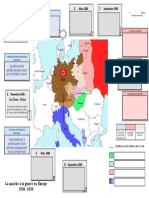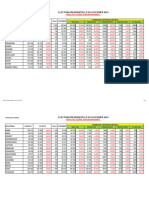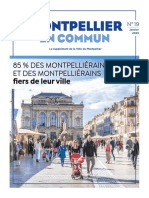Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Fiche N°62 - Le Travail en Réseau
Fiche N°62 - Le Travail en Réseau
Transféré par
Mars76Titre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Fiche N°62 - Le Travail en Réseau
Fiche N°62 - Le Travail en Réseau
Transféré par
Mars76Droits d'auteur :
Formats disponibles
FAVI 62ème FICHE Avril 98
POURQUOI CLIENT POLITIQUE ENGAGEMENT OUTILS ADHESION RESULTATS
AMOUR
DE MAITRISE
?
OPERATEUR OPERATEUR
CLIENT
EXTERNE DE MESURE
Q
LEADERS LEADERS
CADRES CADRES
$
INTERNE DE PROGRES
DIRECTION FOURNISSEURS
LE TRAVAIL EN RESEAU
Expert FAVI : Tous les acteurs FAVI (inconsciemment)
"UN Français vaut TROIS Japonais !" dit-on, car notre culture individualiste nous est un avantage dans le
domaine de la créativité.
Mais "TROIS Japonais valent DIX Français !" car leur culture collectiviste les arme mieux pour le travail en
groupe.
Par contre "TROIS Américains valent NEUF Japonais", car eux ne travaillent pas en groupe mais en réseau, au
sein duquel chacun garde sa valeur individuelle.
Et pour reprendre un des principes d’Einstein : "La somme d’éléments positifs est souvent supérieure à leur
somme arithmétique, car s’y ajoutent les interactions positives entre ces éléments".
Donc : "TROIS Américains, en réseau, valent DIX ou ONZE Japonais, et VINGT Français"
Cette différence de comportement résulte sans aucun doute de nos systèmes éducatifs :
- En France on demande aux enfants d’être bons en tout, c’est la moyenne du tout qui compte, d’où la
production de pseudo élites qui prétendent se suffire à eux-mêmes, (le Major de Polytechnique n’a besoin
de personne !).
- Aux Etats-Unis, on incite chaque élève à être le meilleur en une chose, et peu importe la chose; le sport,
l’expression théâtrale, ou la poterie sont au même niveau que la physique ou les math ! Ce faisant,
l’individu meilleur en quelque chose sait pertinemment qu’il a besoin du meilleur d’autres, pour régler un
problème donné, et pour ce faire constituera un réseau.
La matrice sur les leviers de motivation (fiche N° 59 ) met en évidence que :
Le travail individuel concerne d’avantage l’entreprise qualitative,
Le travail en groupe, l’entreprise productive,
Le travail en réseau, l’entreprise écoutante, réactive au monde qui l’entoure.
D’où l’importance de la compréhension de la différence entre groupe et réseau !
UN GROUPE :
- est constitué par une autorité supérieure,
- a souvent pour liant les affinités entre les membres,
- a un nombre de membres fixes,
- travaille de façon collective,
- dans une même unité de temps,
- dans une même unité de lieu,
- peut subsister après la résolution d’un problème, si le groupe s’entend bien, il cherchera un autre problème
à résoudre.
UN RESEAU :
- se constitue spontanément,
- ne s’instaure pas, il se tolère, et pour le tolérer, il faut se situer sur le terrain de sa propre ignorance,
- a pour seul ciment la résolution d’un problème,
- est à géométrie variable, le nombre de ses membres évolue en fonction du degré d’avancement de l’étude,
- chacun travaille isolément dans son domaine de compétence,
- sans unité de temps (pas tous en même temps),
- sans unité de lieu, chacun chez soi (d’où l’intérêt du NET)
- le réseau se désagrège spontanément après résolution du problème.
Comment favoriser l’émergence de réseaux ?
Sans doute :
en déstructurant,
en ménageant des espaces de liberté pour chacun,
en supprimant les frontières formelles entre les fonctions,
en acceptant des chevauchements ou des flous entre les fonctions,
en favorisant et en promouvant les notions d’expertise des uns et des autres,
en laissant à chacun la liberté de faire évoluer sa fonction,
en tolérant un certain illogisme de fonctionnement,
en faisant passer l’expertise avant les considérations hiérarchiques,
en acceptant de ne plus maîtriser toute l’information,
en accordant systématiquement la primauté au résultat sur la logique d’activité et de fonctionnement,
en veillant à ce que les réseaux ne se pérennisent pas pour devenir des groupes,
On cite le cas de standardistes de CNN qui, ayant eu une information exploitable, et faute de trouver un reporter
disponible, ont embarqué le preneur de son disponible, le cameraman disponible (création d’un réseau), sont allés
faire le reportage, l’ont présenté à l’antenne, puis ont naturellement repris leur poste de standardiste (dissolution
du réseau)!
On note aussi le cas du lieutenant auquel, pour une mission donnée, l'armée américaine consciente de sa
spécialité, attribue le rang et le grade de commandant et lui donne pouvoir de constituer une équipe.
La mission accomplie, l'équipe se désagrège et le lieutenant redevient lieutenant.
62ème fiche
Vous aimerez peut-être aussi
- Modele Statuts SarlDocument14 pagesModele Statuts SarlAymen Gmar100% (1)
- Penser L Architecture Et La VilleDocument254 pagesPenser L Architecture Et La VilleHassan EL MANKOUCHPas encore d'évaluation
- Argumentation M4Document4 pagesArgumentation M4Sapinette Le Phương HòaPas encore d'évaluation
- 2020 MP-PC Rapport Ecrit Francais (Xeulcr)Document7 pages2020 MP-PC Rapport Ecrit Francais (Xeulcr)Youssef SaidiPas encore d'évaluation
- Mugunga VFDocument1 pageMugunga VFInfos Actualite.cdPas encore d'évaluation
- LegaultDocument30 pagesLegaultgefregmail.comPas encore d'évaluation
- Cours HistoireDocument9 pagesCours HistoirepetitPas encore d'évaluation
- Goebbels: JournalDocument22 pagesGoebbels: JournalfrancaisfranceoPas encore d'évaluation
- Compte Rendu de La Reunion SN Cad Mali de Janvier 2023Document3 pagesCompte Rendu de La Reunion SN Cad Mali de Janvier 2023Gaoussou BerthéPas encore d'évaluation
- Leçon 1 Activité 1 RéponsesDocument1 pageLeçon 1 Activité 1 RéponsesdaizysecoursPas encore d'évaluation
- F 2021060Document32 pagesF 2021060Kada Ben youcefPas encore d'évaluation
- TN Adresse Pepiniere Sent ReprisesDocument4 pagesTN Adresse Pepiniere Sent ReprisesFedi AbdenbiPas encore d'évaluation
- 31 Rubriques ZarifianDocument16 pages31 Rubriques ZarifianWahib LahnitiPas encore d'évaluation
- L'Organisation Adminitrative MarocaineDocument3 pagesL'Organisation Adminitrative Marocainehakima hajjajPas encore d'évaluation
- Jeromine Nicolai Supports Videos Pour Enseigner en Lycee Premieres 2020-04!27!15!39!16 508Document2 pagesJeromine Nicolai Supports Videos Pour Enseigner en Lycee Premieres 2020-04!27!15!39!16 508rdmzpmhn9wPas encore d'évaluation
- De La XénophobieDocument2 pagesDe La Xénophobiefranck lagahi100% (1)
- Bulletin Sango Ya Bomoko #6Document8 pagesBulletin Sango Ya Bomoko #6Infos Actualite.cdPas encore d'évaluation
- La Marche À La Guerre 36-39, VEDocument1 pageLa Marche À La Guerre 36-39, VEGizemPas encore d'évaluation
- Terres Promises - de Pétain À de Gaulle - La Trajectoire Tourmentée Du Diplomate Jacques Truelle - Éditions de La SorbonneDocument20 pagesTerres Promises - de Pétain À de Gaulle - La Trajectoire Tourmentée Du Diplomate Jacques Truelle - Éditions de La SorbonnetikkunPas encore d'évaluation
- SLT Mialison DVLPPMTDocument3 pagesSLT Mialison DVLPPMTmialison ravaliteraPas encore d'évaluation
- Fiche de Revision Sur Les Regimes Totalitaires Des Annees 1930-2Document2 pagesFiche de Revision Sur Les Regimes Totalitaires Des Annees 1930-2rita rifaiPas encore d'évaluation
- Le Tribalisme EstDocument2 pagesLe Tribalisme Estmerveille BokendaPas encore d'évaluation
- Resultat FinalDocument3 pagesResultat Finalvthdd2nsktPas encore d'évaluation
- Districts de Côte D'ivoire - WikipédiaDocument4 pagesDistricts de Côte D'ivoire - WikipédiaHady SANOGOPas encore d'évaluation
- De Gaulle Et La FR LibreDocument2 pagesDe Gaulle Et La FR LibreAlae (217) EL HAMDAOUIPas encore d'évaluation
- Magazine Janvier 2023Document20 pagesMagazine Janvier 2023slo furyPas encore d'évaluation
- La CorruptionDocument11 pagesLa CorruptionAnonymous ZmRV6WqPas encore d'évaluation
- His Le Modele Britannique Version Élèves Et Ses InfluencesDocument34 pagesHis Le Modele Britannique Version Élèves Et Ses InfluencesDaphné PhilippPas encore d'évaluation
- Jan 02Document1 pageJan 02Imane EddohaPas encore d'évaluation
- L'Effondrement de L'Affaire Pegasus: Jonathan Scott, Expert en CybercriminalitéDocument36 pagesL'Effondrement de L'Affaire Pegasus: Jonathan Scott, Expert en CybercriminalitémhmhatimPas encore d'évaluation