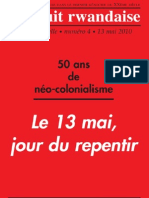Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
L'attentat Contre Juvénal Habyarimana
Transféré par
La Nuit rwandaiseTitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
L'attentat Contre Juvénal Habyarimana
Transféré par
La Nuit rwandaiseDroits d'auteur :
Formats disponibles
Michel Sitbon
À propos de l’attentat
contre Juvénal
habyarimana
Ce ne fut pas une mince surprise que d’apprendre, grâce aux arti-
cles de la journaliste belge Colette Braeckman, dès le mois de juin
1994, que les auteurs de l’attentat où avait disparu les présidents du
Rwanda et du Burundi pourraient avoir été des soldats français.
Ainsi, non seulement la France avait appuyé le régime ethniste avant
le génocide, non seulement l’armée génocidaire était une créature
française, mais, de plus, l’attentat qui déclencha le génocide aurait
été mis en œuvre par les services français.
Dès cet instant, la responsabilité totale de Mitterrand dans le génocide
des Tutsi devenait “hypothèse forte”. Depuis dix ans, l’auscultation atten-
tive des mécanismes du crime a dramatiquement confirmé l’étendue de la
responsabilité française. Mais dès ce jour-là, les éléments apportés par
Colette Braeckman suffisaient pour tirer toutes les conséquences. Si cela
avait pu en arriver là – au point où des soldats français se chargent directe-
ment de la pulvérisation de l’avion d’Habyarimana –, la France n’avait pas
seulement « accompagné » l’exécution du génocide, mais bien plutôt assuré
sa « direction opérationnelle » – et, dans un tel cas, on en savait assez sur le
régime présidentiel pour comprendre que seul François Mitterrand était en
position de prendre de telles décisions.
On était jusque-là face à un mystère. On voyait bien que l’attentat avait
servi de feu vert à l’exécution du génocide planifié, mais il semblait diffici-
lement concevable que le Hutu Power, patronné par Agathe Habyarimana,
ait commencé par abattre son époux Juvénal, qui avait toujours couvé ce
LA NuiT RwANDAiSe N°3 1
parti sous son aile présidentielle. Lorsqu’on craignait que survienne le
génocide annoncé, on imaginait d’ordinaire que le maître d’œuvre d’un tel
programme serait Juvénal Habyarimana lui-même.
Qui donc avait pu commettre cet attentat ? Dans les heures qui suivirent
la nouvelle de l’assassinat du Président, à Kigali, les radicaux hutu procla-
maient à qui voulait l’entendre que c’était « un coup des Belges ». La
Belgique était spécialement mal vue du Hutu Power du fait de son engage-
ment dans les troupes de l’ONu, la Minuar – l’ancien colonisateur assu-
rant l’essentiel de ce contingent. La présence de ces troupes était considé-
rée comme un vrai problème par ceux qui projetaient le génocide. elles
seraient au mieux des témoins gênants, au pire un obstacle pour les massa-
cres massifs envisagés.
Rétrospectivement, cette accusation, lancée immédiatement après la
chute de l’avion d’Habyarimana, apparaît comme un simple élément de la
propagande antibelge déjà engagée depuis quelque temps. il s’agissait de
faire monter la pression contre les troupes belges afin de rendre la situation
suffisamment intenable pour que Bruxelles soit contraint de décider leur
retrait. Le lendemain, en massacrant dix soldats belges, les hommes de la
garde présidentielle, sous la houlette du colonel Bagosora, finiront par
obtenir ce retrait quasi indispensable au déploiement du programme géno-
cidaire : celui-ci allait pouvoir s’exécuter à huis-clos.
Les Belges étaient surtout les seuls suspects, hormis le Hutu Power et ses
alliés français, qu’on puisse présenter à la population de Kigali avec un
minimum de vraisemblance : tout le monde savait alors que le FPR n’avait
d’aucune façon les moyens d’un tel acte sur un terrain totalement contrôlé
par ses adversaires. Les hommes de la Minuar, par contre, circulaient assez
librement, en particulier dans le secteur de l’aéroport où ils étaient basés,
pour pouvoir figurer dans la liste des suspects. Des soldats belges auraient
fait cela pour le compte du FPR : d’un point de vue pratique, c’était la
seule solution pour imputer l’attentat à l’adversaire. Cela supposait
d’abord une forte complicité entre la Belgique et le FPR. Or rien n’atteste
d’une telle chose dont on ne trouve pas l’ombre d’un indice dans aucun
recoin du dossier. Mais dans l’esprit paranoïaque des propagandistes du
génocide, comme la Belgique s’était engagée dans le corps expéditionnaire
de l’ONu dans l’espoir de l’empêcher, elle était « objectivement » com-
plice des « tutsis » – et donc l’alliée du FPR. Cela suffisait pour prétendre
qu’une telle alliance ait pu pousser les Belges à prêter leur concours pour
tuer le président bien aimé. et comme des soldats belges étaient station-
nés à l’aéroport…
2 LA NuiT RwANDAiSe N°3 • MiCHeL SiTBON, À propos de L’attentat...
en fait, Bagosora était obligé de dénoncer les Belges, non seulement
pour déchaîner la foule contre eux et affaiblir la Minuar, mais simplement
pour ne pas avouer à la face de tous… qu’il était l’auteur du crime. Tout le
monde à Kigali pouvait comprendre que, mis à part les Français et les
hommes de Bagosora, seuls des soldats belges de la Minuar auraient eu une
chance de placer une batterie de missiles dans le secteur de l’aéroport. Si ce
n’était « un coup des Belges », ce ne pouvait être qu’« un coup des Hutu ».
il fallait, au contraire, pour la mécanique du génocide, en 1994 – comme
pour la négation de ses responsabilités en 2004 ou aujourd’hui –, que cet
attentat soit compris comme « un coup des Tutsi ».
Ainsi le génocide pouvait commencer. Pour « venger » le Président.
Ce qu’on appelle « l’hypothèse belge » n’est, de fait, plus soutenue
sérieusement par personne. Que reste-t-il comme possibilités ? Qui aurait
pu commettre un tel attentat ? Ce qu’on sait, c’est que l’avion fut abattu
d’un tir de plusieurs missiles consécutifs, une opération relativement
sophistiquée pour laquelle il fallait quelques compétences. Le coup « dou-
blé », expliquent les experts militaires, est indispensable lorsqu’il s’agit
d’abattre un avion muni de dispositifs de protection1. Le premier missile
peut être évité, mais le deuxième, s’il est envoyé presque simultanément,
atteint sa cible quasi immanquablement. Cette technique du double tir
permet de conclure qu’en tout cas cet attentat n’a pu être l’œuvre que de
« professionnels ».
D’après les diverses thèses en présence, seul le FPR, avec l’aide des États-
unis, ou le Hutu Power, avec l’aide de la France, auraient eu les moyens
d’une telle opération. Les missiles employés, d’origine soviétique, étaient
entre les mains des deux éventuels commanditaires, récupérés à l’occasion
de la guerre du Golfe sur les stocks de l’armée irakienne. Si les deux hypo-
thèses sont fortement contradictoires, tout le monde s’accorderait au
moins sur cette question de la provenance des missiles.
Les débris de ceux-ci sont entre les mains de l’armée française depuis le
premier jour. Y apparaîtraient des numéros de série. Ces numéros seraient
partiellement effacés – ont expliqué les autorités militaires aux députés de
la Mission Quilès, après quatre ans d’un silence pour le moins étonnant.
L’effacement partiel des numéros laisserait la place au doute : nous ne dis-
poserions pas de cette preuve formelle.
Ce n’est pas ce que dit Filip Reyntjens, un chercheur belge pourtant
généralement hostile au FPR. Selon ses informations, les missiles seraient
d’origine française – et il en donne, lui, les numéros complets2. Le profes-
MiCHeL SiTBON, À propos de L’attentat... • LA NuiT RwANDAiSe N°3 3
seur Reyntjens précise qu’il tient cette information de diverses sources
concordantes : les services secrets belges, les services anglais, et des milieux
hutu en exil, dont il est très proche. Cette information aurait, de plus, été
recoupée par Patrick de Saint-exupéry, du Figaro. C’est beaucoup.
Filip Reyntjens évoquait également que, selon ses sources, les missiles
auraient transité par la Belgique. On aura confirmation de ceci, et des
détails éventuellement éclairants, dans la révélation, toujours par Colette
Braeckman, des déclarations de Christian Tavernier, le « Bob Dénard belge
», employé à l’époque par Mobutu. Les services de renseignements belges,
le SGR, recoupant Tavernier, proposaient alors l’explication suivante :
« … l’attentat aurait été un coup monté par le président Mobutu, et les
missiles, achetés en France, auraient été acheminés en camion sur
Ostende puis envoyés par vol cargo (probablement par la compagnie
Scibe) vers Kinshasa puis Goma. Au Kivu, les missiles auraient été
réceptionnés par la Division spéciale présidentielle et mis en place à
Kigali début avril. » « Selon l’un des informateurs du SGR, les missiles
venaient de France ; ils ont été stockés à l’ambassade du Zaïre à
Bruxelles et, accompagnés par le fils du président Mobutu, ils sont
partis en avion d’Ostende. »
Braeckman tente alors une explication des raisons pour lesquelles le dic-
tateur zaïrois aurait « monté » un tel « coup » : « on sait que le chef de l’État zaï-
rois, qui résistait à la démocratisation des institutions de son pays, craignait l’exem-
ple des élections démocratiques qui avaient eu lieu au Burundi en 1993 et désap-
prouvait les accords d’arusha au rwanda ». Comme Quesnot, comme
Huchon, comme Védrine, et tutti quanti. Comme Bagosora. Comme
Mitterrand.
Les précédentes indications données par Colette Braeckman, dès juin
1994, provenaient d’un message parvenu, à Bruxelles, à la rédaction de son
journal « vers la mi-juin », déposé par un coursier. L’auteur de ce message se
présentait comme « chef de milice », à Kigali. Selon ce document, les missiles
auraient été tirés contre l’avion présidentiel par deux soldats français du
DAMi (Détachement d’assistance militaire à l’instruction). un document
« bouleversant dans sa forme », dit Braeckman3 :
« Il s’agissait d’une lettre manuscrite, datée du 29 mai… Une méchante feuille
de papier quadrillée, pliée huit fois et dissimulée dans une enveloppe de for-
tune, qui n’était qu’un papier maladroitement collé. »
On y lisait :
« L’avion du président Habyarimana a été abattu par deux militaires français
du dami au service de la Cdr dans le but de déclencher le carnage… Il n’y
4 LA NuiT RwANDAiSe N°3 • MiCHeL SiTBON, À propos de L’attentat...
a que très peu de Cdr au courant de ce complot, quatre personnes plus les
deux Français, personne de la famille du président, quatre chefs Cdr dont
moi… »
expliquant le mécanisme que nous examinions plus haut sur lequel se
serait fondée l’accusation en vogue contre des Belges, le document précise :
« Les Français ont mis des uniformes belges pour quitter l’endroit et être vus de loin
par deux soldats de la garde nationale. » il se trouve que ce dernier détail se
recoupe avec une sombre histoire d’uniformes militaires belges chapardés
dans un hôtel de Kigali peu de temps auparavant. Le fait que l’auteur de ce
message utilise ici l’ancienne dénomination de la garde présidentielle,
remarque Braeckman, atteste au moins de ce qu’il serait rwandais. Ce sera
un des éléments qui, à l’analyse, lui permettront de conclure à la vraisem-
blable authenticité du document.
« Je ne donnerai pas le nom des rwandais, mais l’un des Français s’appelle, je
crois, Étienne et est jeune. »
Quinze ans plus tard, cette information éventuellement capitale, bien
que rapportée de tous côtés – y compris dans les travaux de la Mission par-
lementaire –, n’aura même pas fait l’objet d’une interpellation formelle des
autorités militaires. et celles-ci n’ont toujours pas daigné répondre…
« Le message se concluait de manière dramatique, relate Braeckman : “Moi,
j’ai le bras droit arraché et je vais sans doute mourir faute de soins.” » et, comme
pour mieux authentifier son témoignage, l’auteur prenait la peine, pour ter-
miner de préciser ses motivations : « C’est pour deux vrais amis belges que j’ai
décidé de dire la vérité. » À l’heure de mourir, pendant que le génocide se
déchaînait autour de lui, ce qui le chagrinait, c’était la campagne haineuse
et diffamatoire qui s’était abattue contre « les Belges », dont il savait, lui,
qu’elle était diffamatoire, puisque ce n’était pas des Belges, mais des
Français qui avaient tué Habyarimana. « suivaient le nom, la date et le titre de
l’auteur de cette étrange missive : “chef de milice à Kigali”. »
La mission d’information parlementaire aura repris sans s’émouvoir
cette information concernant en particulier ce soldat du Dami, « Étienne »,
identifié nominalement, présent en effet au Rwanda à partir de février, puis
au Burundi en mai, pour « des actions de sécurités rapprochées que la France
aurait initié au profit des autorités burundaises », précise le rapport parlemen-
taire4. Les députés ne semblent donc pas avoir eu la tentation d’en savoir
plus, ne demandant même pas les états de service de ce soldat dont ils don-
nent le nom – et cherchent encore moins à l’entendre. Pas plus que Paul
Barril, d’ailleurs, présent « sur une colline du rwanda », comme il l’explique
MiCHeL SiTBON, À propos de L’attentat... • LA NuiT RwANDAiSe N°3 5
gracieusement lui-même dans son livre de mémoires, Guerres secrètes de l’Ély-
sée. Le fameux gendarme aurait néanmoins été vu à Bujumbura ce jour-là,
selon Braeckman – qui précise que ceci n’est pas forcément contradictoire
si on considère que la colline de Masaka est à une cinquantaine de kilomè-
tres de la frontière burundaise.
Quant à « Étienne », les parlementaires n’auront fait que confirmer ce
que Braeckman avait déjà pu savoir « de sources privées ». Outre son nom,
dont elle donnait les initiales, la journaliste pouvait ajouter qu’il s’agissait
d’« un spécialiste du tir au mortier », « qui faisait partie du dami » donc, « por-
tant le grade de sergent ». « Instructeur de tir qui avait travaillé au rwanda », il
« avait quitté Kigali avec l’opération noroît en décembre 1993 ». Colette
Braeckman pouvait déjà préciser, ce que le rapport parlementaire redira à
sa suite, qu’« il était discrètement revenu en mars 1994 et depuis l’été, il se retrouve
au Burundi ».
On avait compris jusque-là qu’en application des accords d’Arusha, et
des décisions de l’ONu qui avaient présidé à la création de la Minuar, le
contingent militaire français avait quitté le Rwanda en décembre 1993,
date à laquelle les troupes de l’opération Noroît, présentes depuis 1990,
s’étaient effectivement retirées, laissant la place aux hommes de Dallaire.
il restait en fait, officiellement, au Rwanda une vingtaine d’assistants
militaires français – des « AMT » – ainsi que c’est aujourd’hui reconnu sans
être pour autant expliqué. en plus de quoi, il faudrait compter également
des « Dami », dont la mission n’était pas officielle, semble-t-il, puisque offi-
ciellement il n’y avait là donc que les 25 coopérants militaires, attaché de
défense compris. Mais il faut croire que la présence « officieuse » de ces
DAMi est considérée comme normale, n’ayant pas non plus fait l’objet
d’observation parlementaire…
Les témoignages faisant état de la présence de ces soldats d’élite à Kigali,
dès le mois de février, précisent que, lorsqu’on les interrogeait sur leur pré-
sence au Rwanda après que la France eut décidé de retirer ses forces, ils
disaient être là en vacances, à titre privé… Les parlementaires admettent
que ces « vacances » correspondent à une mission officieuse, et ne s’en for-
malisent pas plus que ça, comme si, dans un tel contexte, la notion d’une
présence clandestine de militaires français ne posait aucun problème.
Les compétences de cet Étienne, « instructeur de tir » du DAMi, portent
donc en particulier sur les questions balistiques. en d’autres termes, il est
probable qu’il savait comment exécuter le tir sophistiqué qui abattit l’avion
du président Habyarimana.
6 LA NuiT RwANDAiSe N°3 • MiCHeL SiTBON, À propos de L’attentat...
Quant à la piste française, on dispose d’une autre source très bien infor-
mée. il s’agit de Gérard Prunier, un des meilleurs connnaisseurs de la
région – envoyé par le ministère de la Défense au Rwanda pour négocier
avec le FPR avant l’opération Turquoise. Comme Reyntjens, celui-ci prend
la précaution de déclarer d’emblée qu’à son avis, la thèse d’une responsabi-
lité française serait la moins vraisemblable. Mais, exactement comme le pro-
fesseur belge, Prunier expose un ensemble de faits qui démontre l’inverse.
Son exposé devient particulièrement précieux lorsqu’il révèle que le capi-
taine Barril « connaissait les personnes capables de recruter des mercenaires blancs
expérimentés pour un Hit Contract sur le président Habyarimana »5. Cette phrase,
dont tous les mots ne peuvent qu’être rigoureusement pesés sous la plume
d’un conseiller officiel de la République, sonne comme une accusation de
la plus extrême gravité.
Le rapport de la Mission parlementaire reprend cette citation in extenso,
et pointe de diverses manières vers l’ex-gendarme de Mitterrand, mais ne
parviendra pas néanmoins à l’interroger. Barril, présent donc « sur une col-
line du rwanda » le jour de l’attentat, selon ses propres dires6, n’a pas
répondu à ce jour. et on attend aussi toujours son alibi.
Le capitaine Barril travaille depuis longtemps dans le privé. Des « merce-
naires », nous explique-t-on, sont susceptibles d’être engagés par l’une ou
l’autre des parties, indépendamment de leur nationalité. Ce n’est malheu-
reusement pas tout à fait comme ça que ça se passe. Les mercenaires
employés par la Françafrique particulièrement, sont l’exacte réplique de ce
qu’on connaissait sous le nom de « corsaires »7 en d’autres temps : des
hommes qui agissent pour le compte d’un État, avec un statut qui ne
trompe personne mais qui permet – relativement – de dégager la responsa-
bilité directe de celui-ci quant à leurs actes.
L’ambiguïté de l’intervention « privée » de Barril auprès d’Habyarimana
était si forte, qu’« un des plus hauts officiers français », « empêtré dans le men-
songe », confiait à Patrick de Saint-exupéry qu’en 1993 il aurait posé la ques-
tion – « qu’il veut de confiance » –, au Président de la République, « en tête-à-
tête » : « L’ancien capitaine Barril est-il officiellement ou officieusement chargé
d’une mission ? » « paul Barril n’est mandaté par personne », aurait répondu
Mitterrand8.
L’anecdote est surtout savoureuse parce qu’elle met en lumière le fait que
même « un des plus hauts officiers français » puisse en être réduit à demander
au Président ce que fait réellement un ancien capitaine de gendarmerie,
devenu par le génie du « domaine réservé » présidentiel un de ces « cor-
saires de la République ».
MiCHeL SiTBON, À propos de L’attentat... • LA NuiT RwANDAiSe N°3 7
Dans le cas de l’attentat contre le président Habyarimana, examinons un
instant cette hypothèse : des soldats français, instructeurs de tir ou anciens
gendarmes, en « vacances » ou en mission, auraient accepté un contrat
« privé » pour assassiner un chef d’État allié de leur pays... Supposons qu’ils
aient pu engager une telle action sans l’accord de leurs supérieurs hiérar-
chiques. Peut-on alors sérieusement imaginer qu’ils n’aient pas fait l’objet
d’une enquête – et de sanctions ?
De plus, si l’on admet que ces hommes ont été engagés par le Hutu Power
pour l’aider à accomplir son coup d’État, est-il imaginable un instant que les
relations entre la France et le régime issu de ce coup d’État contre l’allié de
l’Élysée se soient poursuivies sans l’ombre d’un désaccord apparent ?
Rappelons que c’est après l’attentat que, dans les locaux de l’ambassade
de France, en présence de l’ambassadeur Marlaud, s’est constitué le gouver-
nement intérimaire qui aura la responsabilité du génocide, sous l’impul-
sion du colonel Bagosora. À noter aussi la probable présence du lieutenant-
colonel Maurin, reconnu comme « chef d’état-major de fait » de l’armée
rwandaise, dont on sait qu’il avait installé son QG à l’ambassade dès le 6
avril.
Précisons : alors que le chef de l’État rwandais venait d’être abattu dans
ces conditions, après que le Premier ministre, Agathe uwilingiyimana, eut
été liquidée à son tour par les hommes de la garde présidentielle, ainsi que
les dix casques bleus belges qui tentaient d’assurer sa protection, l’ambassa-
deur de France accueillait les responsables de ces meurtres pour apporter
sa bénédiction à leur coup d’État. L’assassinat du Premier ministre était le
deuxième acte d’une prise du pouvoir dont le premier acte avait été l’atten-
tat contre l’avion de Juvénal Habyarimana.
A-t-on vraiment besoin de preuves supplémentaires ?
Mais peut-être sommes-nous allés un peu vite. examinons maintenant
l’autre hypothèse : et si le FPR avait organisé cet attentat ? La première
objection à cette hypothèse est d’ordre politique : Habyarimana revenait
d’Arusha, où il avait enfin conclu la mise en place du nouveau gouverne-
ment d’union nationale avec le FPR. Pour tous les observateurs de la poli-
tique rwandaise, il s’agissait d’une considérable victoire pour ce parti. On
comprend mal pourquoi ce même parti aurait choisi de liquider l’homme
avec lequel il venait de conclure un accord lui donnant satisfaction – au
risque de réduire cet accord à néant.
8 LA NuiT RwANDAiSe N°3 • MiCHeL SiTBON, À propos de L’attentat...
À cet argument, on répond qu’il y aurait eu au FPR des « extrémistes »
qui souhaitaient conquérir le pouvoir sans partage, et pour lesquels cet
accord aurait été insuffisant. il est facile d’objecter que cette hypothèse ne
correspond pas du tout à ce qu’on sait du FPR : il s’agit d’un parti et d’une
armée extrêmement disciplinés. Par ailleurs, ce scénario implique que ces «
extrémistes » auraient parié sur le génocide des Tutsi, dont tout le monde
savait qu’une déstabilisation de l’État rwandais lui aurait donné le feu vert.
Dans l’esprit de ceux qui avancent cette hypothèse, le FPR dans son entier
est un parti « extrémiste ». Croient-ils néanmoins sincèrement qu’aussi extré-
miste soit-il, ce parti, ou une tendance de ce parti, aurait pu tranquillement
se résoudre à la liquidation en masse des Tutsi du Rwanda – leurs familles ?
Ainsi, non seulement les « Khmers noirs » auraient voulu exterminer les
Hutu – 80 % de la population –, mais pour ce faire ils en seraient passés
par l’acceptation de l’extermination des Tutsi… Je crains que les tenants de
cette thèse ne voient même pas à quel point elle est « amusante ».
Depuis que le professeur Reyntjens a donné, devant la Mission d’infor-
mation parlementaire, de nombreux détails quant à la provenance et aux
numéros d’immatriculation des missiles, et quant à leur parcours à partir
des arsenaux français, on a soudainement assisté au réveil d’une autre piste.
C’est Bernard Debré qui a fait, le premier, quelques déclarations fracas-
santes dans la presse. Puis Alain Juppé, Édouard Balladur et François
Léotard ont repris la même thèse devant la Mission parlementaire. Bernard
Debré est venu confirmer ses propos devant celle-ci. Ces fameux missiles
seraient, en fait, d’origine américaine. Des hommes du FPR auraient été
entraînés à leur maniement aux États-unis, à Phœnix, Arizona, explique
François Léotard, ministre de la Défense à l’époque des faits, c’est-à-dire
lorsqu’il aurait fallu procéder à une enquête sérieuse.
On ne peut que s’étonner de la légèreté avec laquelle une accusation de
cette gravité est proférée par des hommes politiques français – dont deux
anciens Premiers ministres. et pour cause : il s’agit, bien évidemment,
d’un leurre. Ou bien, il faudrait imaginer que la CiA s’amuse à dégommer
un chef d’État allié de la France, comme ça… en pleine zone d’influence
française ! un tel acte de terrorisme international aurait fait s’effondrer
plusieurs années de patiente politique française et provoqué rien de moins
qu’un génocide, et on en parlerait avec cette désinvolture, le sourire aux
lèvres, quatre ans plus tard. Ce serait en quelque sorte un détail sans
importance…
MiCHeL SiTBON, À propos de L’attentat... • LA NuiT RwANDAiSe N°3 9
On pourrait s’étonner aussi qu’aucune question n’ait été posée aux auto-
rités américaines … et on s’étonnera surtout de voir comment des minis-
tres, ou chefs de gouvernements, peuvent se sentir autorisés à dire n’im-
porte quoi dans une telle affaire, tout comme il est difficile de concevoir
que le Parlement ait pu ne pas engager plus loin ses accusations, après avoir
rassemblé un dossier si objectivement explosif quant à cette responsabilité
française prétendument contestée. Quant au caractère fantaisiste de cette
« hypothèse américaine », les rapporteurs iront jusqu’à souligner qu’elle avait
été avancée « sans davantage de précautions », « comme en témoignent les audi-
tions de MM. Bernard debré, ancien Ministre de la Coopération, ou François
Léotard, ancien Ministre de la défense ».
il est ainsi admis que des responsables politiques puissent se moquer de
tous, ouvertement en quelque sorte, sauf que leur fraude n’aura été dési-
gnée comme telle qu’en quelques mots, à la deux centième page d’un rap-
port que peu de monde aura lu en détail. il faut croire que dans ce pays, il
suffit d’une pirouette de ce genre pour se dédouaner, même quand les faits
examinés sont de la plus extrême gravité.
Faut-il souligner qu’à elle seule, cette mascarade devant la Mission d’in-
formation parlementaire permet de conclure à la responsabilité française ?
Sinon, pourquoi des ministres se seraient-ils exposés au ridicule en avan-
çant une telle incongruité ? La seule explication plausible d’un tel compor-
tement, c’est bien qu’ils avaient besoin de faire diversion, exactement
comme Paul Barril, Stephen Smith, Jean-Louis Bruguière ou Pierre Péan.
Nous sommes ici dans un ordre de considérations psychologiques et poli-
tiques. il reste à examiner les éléments matériels dont on dispose. Les mis-
siles ont été tirés de la colline de Masaka, près de l’aéroport de Kigali. La
colline de Masaka était dans la zone contrôlée par la garde présidentielle.
Théoneste Bagosora avait la haute main sur cette garde.
Tout au long de la journée divers témoins avaient vu des militaires rwan-
dais prendre position au bord des routes du secteur – présence qui rend
d’autant plus improbable l’infiltration d’un commando FPR suggérée par
Smith depuis dix ans sans tenir compte de ce genre de détails… Deux per-
sonnes avaient même croisé « deux jeeps de l’armée rwandaise », « accompagnées
d’un camion », en train de « prendre position », « à 200 mètres » du point d’où
partiront les missiles. Ces témoins rapportaient que les hommes – noirs –
qu’ils ont vu alors portaient l’uniforme de l’armée rwandaise, mais le béret
curieusement penché à gauche, « à la française » – alors que les belges le por-
tent à droite, « et ont transmis cette coutume au rwandais » précisait Colette
Braeckman.
10 LA NuiT RwANDAiSe N°3 • MiCHeL SiTBON, À propos de L’attentat...
Aussi posait-elle une question : « ces militaires d’allure “africaine” et même
“rwandaise” n’étaient-ils pas en réalité des antillais ou des Guadeloupéens que l’on
avait déjà vu opérer précédemment dans les rangs gouvernementaux ou que des gens
avaient surpris dans les taxis de Kigali, incapable de comprendre le chauffeur alors
qu’ils portaient l’uniforme de l’armée nationale ? » Car, comme Patrick de Saint-
exupéry l’aura aussi constaté, il arrivait que des militaires français, noirs ou
blancs – ceux-ci se noircissant, au besoin, le visage –, portent l’uniforme
des FAR …
Quoi qu’il en soit, ces témoignages semblent établir que ces hommes
étaient là en toute quiétude, sans craindre le passage d’une patrouille des
hommes de Bagosora dont la principale caserne n’était pas loin, ni les sol-
dats français, également là chez eux.
On essaye de semer le trouble dans le débat avec des « informations »
selon lesquelles ces batteries de missiles sont « très légères », faciles à trans-
porter, laissant donc entendre par-là qu’un commando du FPR aurait pu
s’infiltrer entre les lignes ennemies et faire le coup. On a vu les gros tubes
dont il s’agit, et ils ne sont pas si petits. il a même été contesté, en Belgique,
qu’ils aient pu transiter par le garage de l’ambassade du Zaïre à Bruxelles en
raison de leur dimension…
Resterait à expliquer pourquoi la réaction des paras du camp de
Kanombé fut, après avoir laissé filer le commando, de procéder, le soir
même de l’attentat, à l’élimination des trois mille habitants – hutu – de la
colline de Masaka. Supprimant les éventuels témoins.
On ne donne pas d’explication non plus pour cette batterie aperçue
dans la journée, dans un secteur où patrouillait la Garde présidentielle.
D’un côté, il y a des faits, plus que des indications, auxquels il n’est pas
répondu. De l’autre, il y a une hypothèse, totalement inconsistante avec la
nature des faits connus. C’est peu.
il faudrait aussi qu’on nous explique pourquoi, alors que l’armée fran-
çaise entretenait avec l’armée rwandaise d’excellentes relations qui lui per-
mettaient de circuler tout à fait librement à Kigali et dans ses environs, en
particulier dans la zone de l’aéroport et, plus précisément, à l’emplacement
où les débris de l’avion sont tombés, alors que les soldats français ont effec-
tivement ratissé le terrain, comme en témoigne le commandant de Saint-
Quentin9, pourquoi donc, après avoir perdu dans de telles circonstances un
allié, un « ami » de François Mitterrand, on n’aura procédé à aucune
enquête pour éclaircir ce point toujours controversé des circonstances de la
MiCHeL SiTBON, À propos de L’attentat... • LA NuiT RwANDAiSe N°3 11
mort de cet « ami » – et de ses pilotes français ? il aura ainsi fallu attendre
quatre ans pour qu’une instruction soit ouverte à Paris par le juge
Bruguière, à partir d’éléments dont on a pu voir qu’ils peuvent être carré-
ment fantaisistes, et dont le seul objet sérieux sera de fournir les gesticula-
tions nécessaires pour détourner l’attention des véritables responsabilités.
« plus qu’une simple indication, le comportement des autorités françaises est presque
un aveu », remarquait Jean-Paul Gouteux10.
Les indications d’une responsabilité française sont trop nombreuses
pour pouvoir être écartées.
Dans l’état des informations dont nous, citoyens, disposons, il n’y a pas
deux solutions : seul François Mitterrand était en position d’ordonner l’at-
tentat contre le président Habyarimana. On pourrait presque dire « heureu-
sement » car, si tel n’était pas le cas, cela laisserait supposer que des « ser-
vices » publics, comme la DGSe, ou privés, comme ceux du capitaine Paul
Barril, auraient assez de liberté pour agir en contradiction avec la politique
de la France.
Rassurons-nous : François Mitterrand n’était certainement pas homme à
laisser passer de tels écarts sans y réagir. Or l’Élysée sera d’une discrétion
remarquable dans ce dossier. Les hommes du DAMi, bien que dénoncés
nommément et publiquement, ne seront jamais inquiétés, pas plus que
Paul Barril.
Toutes les hypothèses étant épuisées, et les manœuvres pour en inventer
d’autres ayant d’ores et déjà sombré dans le ridicule, il faut bien se rendre
à l’évidence. Ainsi qu’on l’a déjà vu à l’occasion de l’attentat contre le
Rainbow warrior11, Mitterrand avait un certain goût pour les actions
secrètes, même lorsqu’elles étaient parfaitement inutiles. L’affaire des
irlandais de Vincennes, dans laquelle Paul Barril s’était déjà illustré, est
comme la caricature de cette tendance lourde de celui qui a présidé aux des-
tinées de la France pendant deux septennats.
On aura même pu dire du président socialiste que, dans sa « jeunesse
française », en 1937, il aurait… participé à poser des bombes de la Cagoule
contre des bâtiments du patronat !12 Ce qui est sûr, c’est qu’il était si proche
de ceux qui ont été accusés de cet attentat qu’il rendra visite en prison à
l’un – Bouvyer –, et sera, bien longtemps après, en ami fidèle, à l’enterre-
ment de l’autre – Méténier. Quoiqu’il en soit, soulignons la logique para-
doxale de cet attentat où les terroristes d’extrême-droite attaquaient symbo-
liquement leur propre camp, faisant sauter le siège des organisations patro-
12 LA NuiT RwANDAiSe N°3 • MiCHeL SiTBON, À propos de L’attentat...
nales dont ils tiraient leurs subsides. ils espéraient ainsi accréditer l’idée
d’une menace communiste, afin d’entraîner l’armée dans un coup d’État
contre le gouvernement de Front populaire – comme en espagne. Notons
que cette logique n’est pas pas sans rapport avec celle mise en œuvre dans
l’attentat rwandais.
Multi-récidiviste de ce genre de coups tordus, Mitterrand s’était même
fait prendre la main dans le sac lors de l’affaire dite de l’Observatoire. il
aurait alors estimé utile, pour son « plan de carrière », de se faire (genti-
ment) tirer dessus dans un jardin public désert13. Le politicien centriste de
la iVème République espérait ainsi promouvoir sa figure de leader de la
gauche dans la nouvelle république gaullienne – objectif qu’il atteindra
d’ailleurs aux élections présidentielles suivantes de 1965. On aurait pour-
tant pu croire que sa réputation ne s’en remettrait pas – l’homme qu’il avait
recruté pour cette mascarade témoignant, dès le lendemain, du montage…
Dans le cas de l’attentat contre Juvénal Habyarimana, on peut dire qu’au
moins, pour une fois, cette action pouvait avoir un sens. Mais un sens
redoutable.
Peut-être faut-il chercher un ressort particulier dans la situation de coha-
bitation institutionnelle de Mitterrand avec ceux qui étaient à la fois ses
adversaires en politique et ses partenaires en Françafrique ? Le vieux prési-
dent avait déjà pu expérimenter, avant 1988, cette figure paradoxale dans un
régime quasi monarchique comme la Vème République, où sans avoir à
céder la place à la tête de l’État, il est dessaisi de la « réalité du pouvoir », le
gouvernement du pays, lorsque l’opposition parlementaire devient majori-
taire. Lui restent néanmoins de belles prérogatives : le « domaine réservé »,
en théorie la politique étrangère. La réalité de ce « domaine réservé » pour-
rait se réduire à une question de préséance dans les rencontres internatio-
nales, tant il est évident que les gouvernements étrangers ne peuvent traiter
réellement qu’avec ceux qui détiennent le pouvoir exécutif. Le leader de la
gauche en avait fait l’humiliante expérience une première fois, en 1986.
Lorsqu’en 1993 cette configuration inconfortable se représenta,
Mitterrand aurait achevé sa carrière en gentil patriarche dépourvu de pou-
voirs s’il n’avait été aussi chef des armées. La guerre du Rwanda l’investis-
sait, au moins là, de la plénitude de ses pouvoirs. D’une manière générale
cette fonction de chef militaire lui garantissait la direction effective de cette
part du « domaine réservé » où l’armée est essentielle : l’Afrique. On pou-
vait dire « Mitterrand l’africain » : là, sa couronne n’était pas contestée.
Cela n’empêchait pas le gouvernement de gouverner, et, par exemple,
MiCHeL SiTBON, À propos de L’attentat... • LA NuiT RwANDAiSe N°3 13
Édouard Balladur de prendre une décision de première importance pour le
« pré-carré » africain en dévaluant considérablement le franc CFA, en 1993.
On voyait bien que le chef d’État n’avait plus de pouvoirs réels que dans la
mesure où il dirigeait l’action des armées, comme au Rwanda.
S’il voulait conserver la direction de la politique africaine, il lui fallait
s’imposer aux autres comme un chef légitime. Dans la dynamique d’un
combat, la position la plus extrême est souvent la plus respectée. Autant la
France ne devait pas donner l’impression de faiblir face à ses « amis » dicta-
teurs africains, autant François Mitterrand devait-il, pour se faire respecter
par ses partenaires de cohabitation, se manifester comme le meilleur chef
possible de la politique impériale en Afrique. Seul le maximalisme pouvait
faire l’unanimité. À l’inverse, souscrire aux accords d’Arusha aurait été une
trahison de la logique du système néo-colonial.
Mais pourquoi François Mitterrand aurait-il ordonné l’assassinat de son
allié – et « ami » – Juvénal Habyarimana ?
une explication s’impose, en toute logique :
L’assassinat d’Habyarimana était nécessaire pour camoufler l’aide fran-
çaise au génocide. en éliminant dès le premier acte celui qui était officiel-
lement l’allié de la France, Mitterrand se couvrait. Si Habyarimana avait
présidé à l’extermination des Tutsi et de l’opposition, son allié français
aurait été directement et manifestement impliqué dans cette politique. un
programme tel que ce crime monumental demandait un minimum de tra-
vestissement. en procédant au remodelage du gouvernement de l’État
rwandais, on introduisait juste assez de trouble pour que la responsabilité
française ne soit pas mécaniquement écrasante.
Objection : pourquoi, alors, avoir reconnu le gouvernement intérimaire
responsable du génocide ? Cette reconnaissance aussi était voyante. Oui,
mais beaucoup moins. Si c’est bien évidemment plus qu’un indice de la
complicité effective de la France, ce n’était pas une preuve du même degré :
la mort d’Habyarimana, le coup d’État, la guerre civile rendaient la situa-
tion confuse à souhait.
Pour procéder au génocide, il fallait, par exemple, de toute façon, se
débarrasser du Premier ministre Agathe uwilingiyimana et de nombre de
responsables de l’appareil d’État qui s’opposeraient à coup sûr à un tel
programme.
Si Habyarimana avait procédé lui-même à un tel coup d’État avant d’exé-
cuter le génocide, sa responsabilité aurait été excessivement voyante. À lui,
14 LA NuiT RwANDAiSe N°3 • MiCHeL SiTBON, À propos de L’attentat...
il aurait été impossible de prétendre qu’il ne contrôlait pas la situation,
comme le laisseront entendre ses successeurs pour se dédouaner.
Mais, plus encore, il aurait été impossible pour l’Élysée d’échapper à la
critique. La réponse de Bruno Delaye – « on n’arrive pas à joindre [les respon-
sables du génocide] au téléphone » – aurait été simplement inconcevable. Ce
flou était la ligne de défense minimum dont Mitterrand avait besoin dans
cette affaire. il n’y a rien de tel, lorsqu’on mène une politique secrète, que
de donner l’impression qu’on est éventuellement en train de jouer un jeu
adverse au sien. Puisqu’il avait fallu tuer Habyarimana, l’ami de Mitterrand,
pour procéder au génocide, n’était-ce pas le signe que ce génocide était
contraire à la politique de l’Élysée ?
De même, le recours aux machettes comme moyen d’extermination per-
mettait de prétendre que les « massacres interethniques », ainsi qu’on eut
l’audace de qualifier le génocide, étaient des mouvements populaires spon-
tanés. Puisque les moyens étaient à la portée de tous, bien malin qui réus-
sirait à démontrer qu’on y était pour quelque chose. imaginons un instant
que le génocide ait été opéré à coups d’armes lourdes. Automatiquement,
tous les regards se seraient portés vers l’armée contrôlant ces armes – et vers
ses fournisseurs.
il est à noter, toutefois, que le nombre de machettes disponibles au
Rwanda en ce début d’avril 1994 était sans commune mesure avec les
besoins de la vie agricole. Comme on l’a vu, il y eut des achats massifs de
machettes, en Chine notamment, quelques mois avant le génocide. De
même, un approvisionnement soudain de 30 000 grenades à fragmentation
a largement servi lorsqu’on procéda à la liquidation de Tutsi à l’intérieur
des écoles ou des églises où ils s’étaient réfugiés : ces « abris » seront les
chambres à gaz du Rwanda. en fait, on arrive à reconstituer aujourd’hui que
les deux tiers des victimes seront ainsi assassinées, dès le premier mois, par
l’armée directement donc, les bâtiments servant de « refuges » ayant été le
plus souvent pulvérisés à l’aide d’un armement professionnel. Les machettes
auront ainsi la double fonction de « mouiller » d’une part la population, et
de camoufler d’autre part les véritables instruments du crime.
Ainsi l’attentat, comme le recours aux machettes, procèdent d’une
logique dont la raison essentielle repose dans ce qu’on appelle le négation-
nisme – ainsi qu’on appelle la stratégie constante de la défense pour tous
ces crimes imprescriptibles. Où l’on voit qu’il y a de multiples couches de
négation, avant d’en arriver à la négation totale. Au premier niveau, on
parle de « massacres inter-ethniques », on exhibe les machettes.
MiCHeL SiTBON, À propos de L’attentat... • LA NuiT RwANDAiSe N°3 15
Simultanément, il faut camoufler l’armée, principal exécutant du crime.
Plus encore, bien sûr, c’est l’armée française qu’il fallait rendre invisible.
Mais de manière générale, c’est le processus de décision, la « hiérarchie
parallèle » qui commandera l’ensemble de la manœuvre, qui devait complè-
tement disparaître du tableau.
À cette fin, le lien indéniable entre l’attentat et le début des massacres
génocidaires doit absolument être gommé. il est admis par tous que cet
attentat fut le détonateur du génocide, qui s’enclenchera aussitôt, pour «
venger » le Président. C’est pourquoi la recherche des commanditaires de
cette opération prend un relief dramatique.
« Quelles qu’aient été leurs intentions, leur responsabilité ne porte pas seulement
sur l’attentat et la mort des passagers de l’avion présidentiel rwandais, mais aussi
sur le génocide lui-même », écrivions-nous en 1998.
Bien sûr, l’hypothèse, reprise abondamment depuis, suivant laquelle l’at-
tentat serait imputable au FPR, n’impliquerait nullement que celui-ci
puisse avoir la « responsabilité » « du génocide lui-même »… Nous n’envisagions
même pas cette hypothèse, par manque d’imagination peut-être. Mais s’il
s’avérait, contre toute vraisemblance, que l’attentat soit l’œuvre du FPR,
comment cela pourrait-il permettre de faire porter la responsabilité du
génocide aux seuls qui l’aient réellement combattu ? C’est aller un peu vite
en besogne. C’est pourtant le syllogisme sur lequel s’appuie désormais la
défense du groupe génocidaire, après avoir été avancé par la presse, réper-
cutant la thèse instruite par le juge Bruguière.
Ainsi maître Jean Degli, un des avocats vedettes de la défense des auteurs
du génocide poursuivis devant le Tribunal d’Arusha. Écoutons le14 :
« il faut insister sur le fait que l’attentat du 6 avril 1994 contre l’avion
du Président Habyarimana a été considéré dès le début des événe-
ments comme étant un élément fondamental dans le drame rwandais,
dans les massacres qui ont eu lieu au Rwanda en 1994. (…) C’est le
signe d’envoi en quelque sorte. »
L’avocat togolais précisait sa pensée :
« …dans la hiérarchie des choses, cet élément fait partie des séquences
de la planification du génocide, de la planification des massacres au
Rwanda. »
et il expliquait :
« Le “génocide” est un terme juridique qui nécessite d’être démontré
notamment dans sa planification (…) Pour que les gens soient
16 LA NuiT RwANDAiSe N°3 • MiCHeL SiTBON, À propos de L’attentat...
condamnés pour génocide, il faut démontrer l’élément “planification”
qui est un élément, la conspiration est un élément fondamental dans
le constat du génocide. »
Or, précisait-il, « …il y a actuellement [en 2003] des enquêtes qui sont
conduites par le juge français Bruguière », enquête « conduite à la fois pour l’État
français mais également pour le tpIr… ». il ne cachait pas non plus combien
il partageait le point de vue du juge Bruguière, tel qu’on le trouve exposé
dans le livre de Charles Onana15 – dont le micro-colloque, à l’occasion
duquel ces propos étaient exprimés, servait de lancement. Point de vue éga-
lement partagé par Pierre Péan, devenu entre-temps colporteur-en-chef des
élucubrations du juge « anti-terroriste » parisien. Péan qui devait intervenir,
après maître Degli, au même colloque, tout comme Charles Onana, le jour-
naliste camerounais qui aura fait une spécialité de propager cette thèse, et
qui parlait, lui, en ouverture des débats ce jour-là.
À ce qu’on comprend, l’hypothèse qui est avancée là repose sur la publi-
cation dans un journal canadien d’un article faisant état d’un rapport
enfoui d’un enquêteur de l’ONu. Celui-ci s’appuyait sur les propos de
transfuges du FPR accusant Kagamé d’être le commanditaire de l’attentat.
Pierre Péan, avec Christophe Nick, avait d’abord présenté ce « scoop » dans
Le vrai papier journal, de Karl Zéro, en 2000. Comme on a vu, Stephen
Smith le reprendra, quatre ans plus tard, en 2004, dans Le Monde, sans plus
de soucis ni pour la cohérence, ni pour sa crédibilité, semble-t-il. Ces jour-
nalistes auront fait comme si le juge Bruguière avait réussi à donner consis-
tance à ce qui, non seulement contredit l’ensemble des faits tels qu’ils sont
connus, mais n’était a priori basé que sur un document rapportant des
témoignages non vérifiés.
ironiquement, le grand mérite de l’instruction Bruguière aura été de
démontrer… combien sa thèse manque de fondements. Ce qui est apparu
lorsque ces « témoins » se sont successivement rétractés, dénonçant même
les conditions dans lesquelles leurs témoignages avaient été recueillis par le
juge – ouvrant la voie à l’accusation de forfaiture16.
S’il semble que l’on doive à la vacuité de son dossier le fait que le juge
Bruguière ait longtemps remis la publication de ses résultats, il est bien pro-
bable qu’on doive aussi à cette faiblesse des excentricités telle l’invention
d’une nouvelle « boîte noire » qui aura fait diversion pendant deux mois, de
mars à juin 2004. Au hasard, les deux mois entourant la commémoration
du dixième anniversaire. Cette « boîte » ne sera apparue soudainement
dans les colonnes du journal du soir que pour escamoter le vrai débat sur
la responsabilité française, dont ce dixième anniversaire était l’occasion.
MiCHeL SiTBON, À propos de L’attentat... • LA NuiT RwANDAiSe N°3 17
Dix ans après les faits, à l’heure où ceux-ci avaient été suffisamment
explorés, six ans après le rapport Quilès, et plus encore après les travaux de
Jean-Paul Gouteux, on pouvait espérer que se produise en France une
minute de vérité. De tous côtés montait cette revendication. Apparaissait
pour l’occasion, une nouvelle génération de citoyens, qui avaient dix ans à
l’époque, et qui, étant arrivés en âge de lire Gouteux, interrogaient leurs
aînés. Ainsi, pour la petite histoire, c’est sur l’insistance de jeunes adhé-
rents que l’association Survie prendra l’initiative de lancer la Commission
d’enquête citoyenne.
Celle-ci, à elle seule, constitue un événement considérable que les fantai-
sies de Smith sur la « boîte noire », et le désintérêt relatif d’une presse tou-
jours très sage, n’auront pas réussi à étouffer complètement. La dramatique
défaillance des institutions pour prendre en compte les responsabilités des
hommes qui ont commis le crime rwandais aura ouvert un espace extraor-
dinaire, où s’impose la nécessité d’un libre examen par les citoyens de ce
que l’État ne veut pas voir. un nouvel espace démocratique.
C’est la première fois, à notre connaissance, que ce principe à valeur
constitutionnelle apparaît aussi clairement. il s’inspire du précédent, en
1967, du Tribunal Russel, où l’on avait vu une tripotée de prix Nobel du
monde entier constituer, au niveau international, en réaction à la guerre du
Vietnam, une commission dont la méthode consistait déjà à instruire les
faits aussi rigoureusement que possible – et à en tirer les conclusions qui
s’imposent. La nécessité d’une telle « cour internationale » était apparue
alors dans un monde divisé en deux par la guerre froide, où le crime impé-
rial pouvait s’éterniser, au Vietnam, sans que personne ne puisse le pren-
dre en compte, le droit de véto, que se réservent au Conseil de sécurité de
l’ONu les États les plus puissants, empêchant rigoureusement toute
condamnation par la communauté internationale.
Dès le départ, à l’initiative du philosophe anglais Bertrand Russel, alors
âgé de 94 ans, le Tribunal qui portera son nom se plaçait dans la continuité
du seul précédent historique comparable, celui de Nuremberg. Dans son
discours inaugural, Jean-Paul Sartre entreprenait d’abord la critique de ce
précédent historique. Si les juges de Nuremberg avaient ouvert « la voie à
une véritable juridiction permettant de dénoncer et condamner les délits de guerre où
qu’ils se soient produits », « à peine le dernier coupable allemand jugé, le tribunal
s’évanouit dans les airs, et personne n’en a plus jamais entendu parler », remar-
quait Sartre. Comme on sait, on avait pu critiquer ces jugements comme
justice de vainqueurs, ce qui en limitait la légitimité.
« Cette légitimité pourtant, il n’eût pas été difficile de la fonder. Il eut suffi que
l’organisme créé pour juger les nazis ait survécu à cet office particulier », et que
18 LA NuiT RwANDAiSe N°3 • MiCHeL SiTBON, À propos de L’attentat...
l’ONu naissante consolide cette institution en « Tribunal permanent »,
suggérait le philosophe. « ainsi les dispositions hâtives et incomplètes prises par
les alliés en 1945, puis abandonnées, ont créé une véritable lacune dans la vie inter-
nationale. Un organisme fait cruellement défaut (…) laissant un vide qu’il faut com-
bler et que personne ne comble. »
Ce « tribunal permanent » aura finalement vu le jour, sous le nom « cour
pénale internationale », après que l’ONu ait eu besoin de créer, en 1994,
deux juridictions ad hoc sur le modèle ici critiqué de Nuremberg, l’une
pour la Yougoslavie, l’autre pour le Rwanda. Ce dernier Tribunal, qui siège
à Arusha, ayant totalement exclu du champ de ses poursuites les responsa-
bles français, laissait béant l’espace d’une intervention citoyenne pour exa-
miner ces responsabilités, la France n’étant pas plus menacée d’avoir à
répondre de ses actes que les États-unis des bombardements terrifiants
qu’ils faisaient subir au peuple vietnamien en 1967. Sartre soulignait aussi
ce fait :
« Nous avons parfaitement conscience de n’avoir été mandatés par
personne, mais si nous avons pris l’initiative de nous réunir, c’est
parce que nous savions que personne ne pouvait nous mandater. » (…)
« Certes notre Tribunal n’est pas une institution. Mais il ne se substi-
tue à aucun pouvoir institué : il est issu au contraire d’un vide et d’un
appel. » (…) C’est « sa parfaite impuissance et son universalité » qui
donne sa légitimité à un tel tribunal. « Ne représentant ni gouverne-
ment ni parti, nous ne pouvons recevoir d’ordre : nous examinerons
les faits “en notre âme et conscience”, comme on dit ou, si l’on pré-
fère, en toute liberté d’esprit. »
Sans le savoir, par le hasard historique de deux drames universels, le long
martyr des vietnamiens et le génocide des Tutsi du Rwanda, s’esquisse ce
qui pourrait bien être l’apparition d’un nouveau droit : le droit des peuples
à examiner par eux-mêmes les agissements de leurs États. C’est d’ailleurs,
ainsi que les juristes en conviennent parfois, l’un des plus énormes para-
doxes du droit que l’action de l’État, le plus puissant des acteurs, ne soit
jamais examinée que par lui-même. un paradoxe que le droit administratif
français pousse à ses extrêmes limites en osant postuler son caractère par-
tial, au service de l’État, contradictoirement à l’idée même de justice.
On aura d’ailleurs remarqué, depuis qu’il existe une cour européenne,
combien les justiciables confrontés à l’État en France, n’attendent bien sou-
vent de secours plus que de cette cour dont l’accès est singulièrement
réduit, par le coût et par la durée des procédures qui imposent d’épuiser les
recours du droit national avant de s’adresser à elle. Son encombrement,
MiCHeL SiTBON, À propos de L’attentat... • LA NuiT RwANDAiSe N°3 19
comme celui des cours administratives en général, provoque banalement
des délais de plus de dix ans avant qu’une cause puisse être sérieusement
entendue. Le justiciable victime d’un abus de l’État devra non seulement
disposer de réels moyens pour régler les honoraires plus élevés que la
moyenne des juristes spécialisés, auxquels on est obligé de recourir. il lui
faudra, de plus, beaucoup d’obstination et, de préférence, une longue vie,
ou la « chance » d’avoir engagé assez jeune un tel litige…
il demeure ainsi une multitude de fautes administratives qui échappent
à l’examen. Ce que suggère le droit esquissé par le Tribunal Russel et par la
commission d’enquête citoyenne constituée dix ans après le génocide des
Tutsi, c’est qu’en de telles situations, lorsqu’une action critiquable de l’État
échappe à toute critique du fait de cette défaillance structurelle des institu-
tions à s’auto-examiner, alors s’ouvre un nouvel espace pour le droit, qui
s’appellerait ici une « justice citoyenne », qui se distingue radicalement par
ses méthodes de ce qu’on appelle « justice populaire », dont il est évident
qu’il s’agit d’un espace de non-droit. Au contraire de cette dernière qui se
munit d’abord du pouvoir d’exécuter ses sentences, la justice « citoyenne »
est impuissante.
« Il nous est impossible de rendre les sentences exécutoires », reconnaissait
Bertrand Russel, dès son discours du 13 novembre 1966, à la première réu-
nion, préparatoire, du « tribunal international des crimes de guerre » qu’il met-
tait sur pied. « Je crois que ces limitations sont en réalité des vertus. »
Sartre développera cette idée quelques mois plus tard, dans son discours
d’ouverture des travaux effectifs du Tribunal, à Stockolm, le 2 mai 1967 :
« Nous sommes impuissants : c’est la garantie de notre indépen-
dance. » (…) « Ce qui est sûr, en tout cas, c’est que notre impuissance,
même si nous sommes convaincus par les preuves apportées, nous
interdit de porter sentence. Que pourrait signifier en effet, une
condamnation, fût-ce la plus légère, si nous n’avons pas les moyens de
la faire exécuter ? Nous nous bornerons donc, le cas échéant, à décla-
rer : tel ou tel acte tombe en effet sous le coup de la juridiction de
Nuremberg ; il est donc, d’après elle, crime de guerre et, si la loi était
appliquée, il serait passible de telle ou telle sanction. »
Mutatis mutandis, la commission d’enquête citoyenne sur l’intervention
française au Rwanda était à la fois dépourvue de l’autorité des grands phi-
losophes et confrontée à un problème juridique d’une nature plus drama-
tique encore : non seulement le crime de génocide est le plus grand, unique
par son caractère imprescriptible, et correspond plus précisément encore
20 LA NuiT RwANDAiSe N°3 • MiCHeL SiTBON, À propos de L’attentat...
aux qualifications de Nuremberg, mais la guerre du Vietnam était un
conflit inter-étatique. Le Tribunal Russel recevra les encouragements des
autorités du Nord-Vietnam, y compris de Ho Chi Min, et même celle du
roi du Cambodge, Norodom Sihanouk. Le peuple vietnamien s’adossait de
plus à la solidarité socialiste, aussi bien de la Chine voisine que de l’uRSS,
de l’Allemagne de l’est ou de la Tchécoslovaquie. La dénonciation de l’in-
tervention américaine au Vietnam s’inscrivait dans un monde bi-polaire,
où le général de Gaulle avait normalement refusé qu’un tel tribunal siège à
Paris17, ce pourquoi les prix Nobels en seront réduits à se réfugier dans leur
« patrie adoptive », la Suède, pays « neutre ».
Comme on aura déjà eu l’occasion de le souligner, c’est dans le monde
« unifié » postérieur à la chute du mur de Berlin que le génocide d’avril 94
a pris place : dans un monde où il y a d’autant moins de garde-fous que les
peuples ne peuvent plus espérer s’appuyer sur une puissance contre l’autre.
Plus encore qu’à Stockolm, trente-sept ans plus tôt, passage Dubail, c’est «
en toute liberté d’esprit » que les membres de la « commission d’enquête citoyenne
pour la vérité sur l’implication française dans le génocide des tutsi » auront eu à
examiner la responsabilité de leur État. Plus encore que la responsabilité
américaine dans la guerre du Vietnam, la responsabilité française dans le
génocide des Tutsi du Rwanda est un crime qui échappe à toute possibilité
de dénonciation par quelque puissance de ce monde.
C’est alors qu’apparaît la possibilité d’un authentique « droit citoyen »,
fondée sur le droit inexpugnable de tout citoyen à apprécier par lui-même
quelque fait politique que ce soit – puisque le domaine du politique est bien
le domaine de tous. et c’est bien parce qu’il est question ici de quelque
chose qui pourrait bien devenir un véritable droit, que les « commissaires »
du passage Dubail ne se seront pas institués en Tribunal : l’affaire est bien
trop grave pour mimer quelque attitude que ce soit, et ainsi que Sartre le
comprenait déjà lorsqu’il définissait les principes de l’intervention, égale-
ment « citoyenne », du Tribunal Russel, il ne s’agit pas là, en fait, de juger,
mais d’instruire. et pour autant que les méthodes du droit soient respectées
dans leur essence de garantie d’équité, tout individu, et a fortiori tout groupe
d’individus, a totale légitimité pour instruire quelque fait politique que ce
soit, puisque, encore une fois, il s’agit de faits publics – et d’intérêt public.
La commission citoyenne qui aura siégé du 22 au 27 mars 2004, dans le
sous-sol d’un immeuble associatif d’une ruelle d’un Paris ouvrier presque
disparu, à l’abri même d’une excessive pression journalistique, aura été un
modèle de sobriété, sans pour autant perdre conscience de son importance.
MiCHeL SiTBON, À propos de L’attentat... • LA NuiT RwANDAiSe N°3 21
Quoiqu’on veuille, d’ores et déjà, ses conclusions « provisoires » constituent
l’acte d’accusation le plus dramatique que des citoyens auront jamais
énoncé à la face d’un État. Tout y est, simple reflet de ce que, maintenant,
on sait tout – ou presque ce pourquoi certaines de ces conclusions conser-
vent la forme interrogative, appelant à des travaux complémentaires. N’a
été résumé là que le « réquisitoire introductif », en quelque sorte d’une
enquête qu’il faut bien sûr approfondir, et d’un procès qu’il reste à ouvrir.
On pourra remarquer au passage que s’ouvre également un nouveau
champ dans la critique politique lorsque, au-delà de la dénonciation des
acteurs institutionnels, la commission consacre une partie de ses conclu-
sions à l’examen des responsabilités médiatiques. Nous insistions sur cette
dimension du problème dès le premier numéro de Maintenant, en janvier
1995. La dénonciation de la presse n’aura certainement pas aidé au succès
de cette publication qui sombra dans un silence aussi remarquable que
celui qui avait salué son apparition, après une année d’existence au long de
laquelle la politique de la France, au Rwanda et ailleurs, y aura été dénon-
cée avec constance.
Après cette expérience avortée d’un média qui ne respecterait pas
l’omerta, Mehdi Ba, qui avait assuré la rédaction en chef de Maintenant,
publiait, en 1997, Un génocide français, dont la critique des médias consti-
tuait la trame. Jean-Paul Gouteux traitera également l’aspect « médiatique »
du problème dans son premier livre, Un génocide secret d’État, paru aux Édi-
tions sociales à la même époque. Gouteux faisait état des mémoires de
Claude Silberzhan, ancien patron de la DGSe, dans lesquelles celui-ci évo-
quait ses bonnes relations avec le directeur du Monde de l’époque, Jean-
Marie Colombani. L’idée que de telles relations aient pu expliquer l’ab-
sence d’esprit critique de ce journal vis-à-vis de la politique mise en œuvre
au Rwanda, semble avoir ému Colombani : Le Monde demandait aussitôt
devant les tribunaux une réparation de 500 000 francs.
Les Éditions sociales ne bénéficiaient plus de « l’or de Moscou » depuis
longtemps… Si celles-ci ont disparu depuis, ce n’est toutefois heureusement
pas du fait de l’exorbitante demande des avocats du Monde, celle-ci ayant
été rejetée, en première instance et en appel. Se voyant contesté sur un
point de sa démonstration, Jean-Paul Gouteux s’attela à analyser en détail
le travail de ce qu’il appellait le « quotidien de référence », tout au long de
la crise rwandaise. L’ouvrage qui en résulta, Le Monde, un contre-pouvoir ?, est
sous-titré sans ambiguïté « désinformation et manipulation dans le génocide
rwandais ».
22 LA NuiT RwANDAiSe N°3 • MiCHeL SiTBON, À propos de L’attentat...
Jean-Marie Colombani choisira alors de poursuivre encore l’éditeur et
l’auteur, de même qu’il engagera une procédure en cassation contre le ver-
dict de cour d’Appel l’ayant débouté face aux Éditions sociales . il aurait été
particulièrement scandalisé par la présentation du nouveau livre, où l’on
disait que les faits dénoncés là pourraient s’assimiler à de la « complicité de
génocide ». Gouteux et l’esprit frappeur seront condamnés, y compris en
appel, pour avoir exercé un droit de critique que d’autres tribunaux avaient
explicitement reconnu lorsque la même affaire leur avait été soumise avec
l’ouvrage précédent de Gouteux.
Cette monographie où l’auteur prend soin de décrire méticuleusement
le phénomène qu’il avait dénoncé sommairement dans son premier
ouvrage, n’en est pas moins un exemple de ce qu’on a appelé la « médiacri-
tique ». Déjà de nombreux travaux (universitaires) se sont inspirés directe-
ment de la méthode exposée dans ce petit livre qui ouvre le champ d’une
« critique des médias », dont il faut simplement s’étonner qu’elle n’ait pas
été plus développée auparavant, tant l’évidence de son utilité est frappante.
Cette nécessité, vitale pour une pensée politique, de critiquer les sources
de toute information, du point de ce que l’on peut savoir des faits relative-
ment à ce que l’on peut comprendre des intentions de ceux qui les rappor-
tent, n’est apparue, curieusement, au moment de la première guerre du
Golfe, qu’après la fin du bloc socialiste. Cela donne une idée de la profon-
deurs des « alignements » de cette époque récente, et du fait que l’on consi-
dérait alors en somme normale la mauvaise foi des médias – comme c’est
d’usage en toute situation de guerre. Ceci serait une indication de ce
qu’après la guerre, on espérerait plus d’objectivité de la part des journa-
listes. Ou plutôt, de ce qu’il devient manifeste alors que les mensonges sont
dirigés contre les lecteurs-citoyens, pour falsifier leur capacité de décision.
La première manifestation de cette méthode, critique du traitement de l’in-
formation pendant cette guerre dont personne ne voulait sauf la presse,
apparaîtra dans attention médias ! de Michel Collon, publié en 1992 chez
ePO.
Comme on le voyait déjà dans le livre de Mehdi Ba, la critique métho-
dique des médias est un redoutable scalpel pour disséquer la politique de
l’État. C’est un instrument d’une précision diabolique, lorsqu’on voit que,
quoi qu’il fasse, si l’on prend la peine de soupeser ce qu’il dit et ce qu’il ne
dit pas, dès qu’on entreprend l’effort de déchiffrer ce qu’il veut manifeste-
ment faire entendre et ce qu’il veut tout aussi manifestement qu’on n’en-
tende pas, le journal dit tout…
MiCHeL SiTBON, À propos de L’attentat... • LA NuiT RwANDAiSe N°3 23
Ce paradoxe savoureux atteint son paroxysme dans l’affaire rwandaise,
où l’on peut également prendre la mesure de l’effet catastrophique d’un
traitement particulièrement peu critique de l’action de l’État.
Plus encore, on voit, à l’expérience de ce dossier, combien l’action média-
tique constitue une part essentielle de l’entreprise gouvernementale. Au
Rwanda même, les « médias du génocide » auront été identifiés très tôt par
Jean-Pierre Chrétien et Marcel Kabanda, comme une articulation principale
de l’extermination des Tutsi. Dans cet ouvrage, désormais classique, n’étaient
examinés que les médias rwandais, avec leur spécificité d’armes de guerre.
D’une autre nature bien sûr que le travail de deuxième degré auquel se consa-
cre d’ordinaire la « médiacritique » de la presse en France ou ailleurs.
Mais le caractère de cette dénonciation n’est pas beaucoup moins drama-
tique lorsque les historiens soulignent, par exemple, comment les auteurs
du génocide eux-mêmes étaient accrochés à leur radio pour écouter, sur
RFi, les commentaires de Jean Hélène, dont le travail de correspondant à
Nairobi pour cette radio comme pour Le Monde sera l’objet d’une part
importante de la critique de Gouteux, après avoir été dénoncé aussi bien
par Jean-Pierre Chrétien que par Mehdi Ba ou d’autres. C’est même dou-
loureux d’imaginer qu’il aurait suffi d’un peu plus de pertinence alors, et
de simplement décrire les faits tels qu’on les voyait à Kigali dès les premiers
jours, pour rendre impossible l’exécution du programme génocidaire dans
sa folle dimension.
C’est exactement ce que Jean Carbonare voulait signifier à Bruno
Masure, présentateur du journal télévisé, lorsqu’il fut invité pour rendre
compte des résultats de son enquête18, en 1993, qui annonçait le génocide
à venir un an plus tard. il est d’ailleurs indispensable, pour prendre la
mesure du drame rwandais, de réentendre les mots de celui qui incarnera
alors la conscience qui manquait à tous. Dès cet instant, assis devant les
caméras derrière lesquelles il savait que le pays le regardait, Carbonare aura
compris que sa protestation fugace serait probablement vaine, mais il aura
mesuré en même temps qu’il pouvait suffire qu’un média fasse son travail
pour que l’engrenage du génocide s’effondre comme un château de cartes :
« Vous aussi vous pouvez quelque chose, Monsieur Masure », disait-il, la voix bri-
sée, comme désespéré que cette évidence ne puisse être entendue. Pour la
première fois peut-être, le « quatrième pouvoir » était directement inter-
pellé, là-même où il officie – pendant l’office pourrait-on dire. Pendant que
se nouait le drame.
De même il est évident que si l’un ou l’autre des trois médias qui consti-
tuent l’arc consensuel du pouvoir en France, Le Monde, Le Figaro ou
24 LA NuiT RwANDAiSe N°3 • MiCHeL SiTBON, À propos de L’attentat...
Libération, si l’un ou l’autre de ces journaux avait engagé, quotidiennement,
un travail de dénonciation de la politique française au Rwanda, on voit mal
comment François Mitterrand aurait pu la poursuivre, ainsi qu’on en aura
déjà fait la remarque.
La médiacritique est une méthode dont l’un des intérêts est que le phé-
nomène évolutif qu’elle prend pour sujet n’en finit pas d’apporter de nou-
veaux éléments. La critique des médias pendant – ou avant – le génocide,
se prolonge de celle des mêmes médias après l’événement.
Le travail de Jean Hélène ou de Jacques isnard, que Gouteux passait au
crible dans son livre, aura été même éclipsé par celui de Stephen Smith dix
ans plus tard dans les colonnes du journal du soir. Smith s’était déjà distin-
gué depuis longtemps dans Libération. On aurait d’ailleurs pu reprocher à
Gouteux, en focalisant sur le « quotidien de référence » du fait des respon-
sabilités que ceci implique, d’avoir fait l’impasse sur le travail de Smith à
Libération, particulièrement important dans le traitement médiatique du
génocide.
Que Le Monde ait entretenu une lecture ethniste de la crise rwandaise
était surtout critiquable parce que celle-ci l’entraînait à ne pas dénoncer la
politique criminelle dont il partageait, au moins, les prémisses. Cette sym-
pathie pour l’ethnisme lui faisait oublier de décrire l’activité du parti eth-
niste, bien réelle et même spectaculaire, au delà du raisonnable. « C’est
l’analyse de tous les événements en terme de lutte raciale qui est scandaleusement
imposée aux lecteurs », dit Morel. Mais c’est surtout pour ses omissions que
ce journal était scandaleux. Cette position atteindra son comble lorsqu’on
y donnera la parole au chef des milices de Kigali, en plein génocide, pour
le laisser… démentir qu’il y ait un génocide ! Jean Hélène oubliait alors de
préciser que l’homme qu’il interviewait était un des animateurs de l’entre-
prise criminelle qu’il niait. un tel travestissement ne posait aucun pro-
blème à ce journal puisqu’à cette date il en était toujours à parler de « mas-
sacres inter-ethniques »…
On n’aura pas eu l’occasion de tomber aussi bas à Libération ou au
Figaro : mais le silence n’y sera pas moins pesant pendant la durée du géno-
cide, à l’exception du fameux Libé du 18 mai, où l’on doit à Alain Frilet un
dossier constituant un acte d’accusation complet – qui permet de mesurer
combien on savait tout ou presque dès ce moment-là.
Mais c’est à partir de l’opération Turquoise que Smith, à l’époque dans
Libération donc, entreprendra la tâche à laquelle il s’est consacré ensuite
MiCHeL SiTBON, À propos de L’attentat... • LA NuiT RwANDAiSe N°3 25
dans les colonnes du Monde, de défense active des intérêts du camp génoci-
daire. On s’étonne de l’évolution du travail de ce journaliste, précédem-
ment critique, dans Libération, de la politique ethniste mise en œuvre – au
contraire de ce qu’on voyait au Monde au même moment. Ce n’est qu’après
le génocide qu’il sera devenu l’avocat de cette politique criminelle.
exactement comme un avocat ne peut se charger d’un dossier qu’après le
crime. Dès le départ, il focalisera sur l’aspect le plus « explosif », l’attentat –
explosif surtout, comme on a vu, parce que si cet attentat est attribuable
aux services français, et à une décision de François Mitterrand, ceci
implique une responsabilité française totale quant au génocide.
On comprend qu’il ait pu sembler utile de désamorcer une telle suspi-
cion. Cette dénonciation imposait un contre-feu.
Le premier à réagir sera le capitaine Barril, si “voyant” qu’on n’osait alors
imaginer qu’il ait pu tremper lui-même dans une affaire aussi délicate. Là
où Colette Braeckman donnait une indication sérieuse sur l’éventuelle res-
ponsabilité française qui, normalement, aurait demandé à être vérifiée ou
contredite, Paul Barril se contentait d’exhiber au journal télévisé une «
boîte noire » – déjà.
La boîte noire… C’est d’ordinaire un élément d’enquête, possiblement
utile pour éclairer les circonstances de la chute d’un avion, en particulier
lorsque sa cause est inconnue… Les deux missiles lancés sur l’avion
d’Habyarimana auront fait assez de bruit, au propre comme au figuré, pour
qu’au moins un point ne fasse pas mystère : on sait comment on s’y est pris
pour faire tomber l’avion. Reste à savoir qui. Malgré l’infinie capacité de
crédulité du public, nombreux auront été les lecteurs du Monde étonnés de
l’importance que Smith aura voulu donner à la recherche de cette « boîte
noire » dix ans après. Comment pouvait-il prétendre y découvrir des indica-
tions sur l’identité des tueurs ?
Comme on sait, la première boîte noire de Barril avait le défaut d’être
noire, et de n’être certainement pas l’enregistreur de vol que l’ex-gendarme
du Président se vantait d’avoir récupéré au péril de sa vie. C’est à cette occa-
sion qu’on pouvait apprendre que ces boîtes dites noires sont en fait fluo-
rescentes, afin d’être plus faciles à retrouver dans les décombres d’une catas-
trophe. il semblerait que Barril ignorait ce détail en présentant au public
une « boîte noire » noire…
Ce sketch était d’autant plus ridicule que les lieux du crime étaient tota-
lement sous le contrôle de la garde présidentielle – et des soldats français
26 LA NuiT RwANDAiSe N°3 • MiCHeL SiTBON, À propos de L’attentat...
qui seuls pouvaient y accéder, ainsi que le commandant de Saint-Quentin
en a rendu compte. Le jour de l’attentat et pendant les jours qui suivront,
seuls le colonel Bagosora, et donc le lieutenant-colonel Maurin19, auront eu
le pouvoir d’engager une enquête à partir de l’examen des restes de l’avion
et des armes qui avaient permis de l’atteindre.
un caporal de l’armée génocidaire, interviewé par Monique Mas, sur
RFi, « aura trouvé étonnant que, sitôt l’avion tombé, “les Gp et les Français se sont
précipités à Kanombe au lieu d’aller voir ce qui se passait à Masaka” ». en effet…
Saint-Quentin en témoigne lui-même : il s’est précipité vers les débris de
l’avion, mais ne semble pas s’être préoccupé une seconde de savoir d’où
étaient partis les tirs – ni lui, ni personne dans le camp de Kanombé, à 500
mètres du lieu-dit “la Ferme” où les exécuteurs de ce que Prunier a appelé
le « contrat » sur Habyarimana ont dû pouvoir tranquillement plier bagages
une fois leur besogne faite.
« Masaka était une position gouvernementale », rappelle l’ancien caporal des
FAR à Monique Mas. « dans une cour de Masaka, il y avait un camp d’entraî-
nement interhahamwe. Il y avait aussi une position française bien connue. »
L’hypothèse d’une infiltration du FPR ne sera échafaudée que bien plus
tard, dans la presse française, après les révélations de Braeckman comme on
a vu. À ce moment-là les hommes de Bagosora feront mine de croire à « un
coup des Belges ». Mais ils s’en prendront alors à n’importe quel Belge, et
n’auront donc même pas essayé d’attraper sur le fait ces fameux belges que
personne n’ose même plus évoquer depuis, tant il est évident que ces voci-
férations anti-belges de la garde présidentielle proposaient une version
purement fantaisiste de ce qui avait pu se passer. Faut-il souligner que seul
l’assassin a intérêt à faire courir la foule derrière des assassins imaginaires ?
Saint-Quentin raconte comment il s’est démené pour extraire les corps
de la carcasse de l’avion tombée ironiquement dans le jardin du Président.
S’il avait alors le moindre souci de faire mine d’enquêter, après avoir laissé
filer les assassins, qu’aurait-il eu d’autre à faire que de chercher, au passage,
la « boîte noire » ? D’ailleurs, c’est ce qu’il aura probablement fait, puisque
Dallaire témoigne avoir reçu à son bureau, quelques jours après, ce qui sem-
blait bien pouvoir être l’enregistreur de vol de l’avion – fluorescent donc –
et qu’il a aussitôt transmis à New York, à l’ONu, où cela aura tant pas-
sionné les foules qu’on ne se souvenait même plus l’avoir reçue lorsque, dix
ans plus tard, Smith pointera dans cette direction.
Au sujet de cette « boîte noire », on dispose de la note 19 de Jean-Claude
Lefort – publiée dans La nuit rwandaise n°2 – qui fait état d’une lettre du
MiCHeL SiTBON, À propos de L’attentat... • LA NuiT RwANDAiSe N°3 27
général Rannou à la Mission parlementaire, le 15 juin1998, confirmant « offi-
ciellement », « la présence des deux “boîtes noires” habituelles », « un enregistreur des
conversations de l’équipage », et « un enregistreur des paramètres de bord ». « Je
constate que quelqu’un a pensé qu’il était préférable de les faire disparaître », souli-
gnait Lefort avant de conclure, impitoyable : « Ce qui réduit le champ des suspects
à ceux qui eurent accès à la zone du crash dans les heures qui ont suivi l’attentat. »
Alors pourquoi Barril avait-il inventé une boîte noire – même pas fluo-
rescente ? Le procédé semble tellement grossier qu’on se sera trompé d’in-
terprétation, à l’époque, en l’attribuant à la balourdise du bonhomme.
C’est la répétition du même scénario dix ans plus tard, sous la forme infi-
niment plus sophistiquée d’un feuilleton entretenu pendant deux mois
dans le « quotidien de référence » qui nous met la puce à l’oreille. Comme
Barril dix ans plus tôt, Smith s’est sérieusement ridiculisé lorsqu’il s’est
avéré que la boîte trouvée sur ses indications était carrément fausse, pas
moins fausse que la précédente20. Après un suspens dramatique, à la
recherche de la fameuse boîte dans les placards de l’Onu, Smith ne se don-
nera même pas la peine d’informer ses lecteurs de la déconvenue. C’est à
Corine Lesnes, correspondante aux États-unis, que l’on doit l’information
sous un titre suggérant, à l’inverse des résultats de l’expertise de ladite
boîte, que ces investigations « renforcent encore le mystère »…
Pourquoi aura-t-il été tenté à répétition d’attirer l’attention du public sur
une « boîte noire » fantaisiste, au risque de se discréditer et donc d’affaiblir
la thèse qu’on veut promouvoir ?
eh bien, simplement parce qu’elle est noire. Parce qu’elle est noire, et
parce qu’elle est boîte. elle symbolise la vérité inatteignable, le puits de la
connaissance, sur lequel on se penche en vain pour percer sa nuit pro-
fonde. C’est poétique ? Non, cela s’appelle un archétype jungien, de ces
symboles qui recouvrent des mythes inscrits dans la structure même de la
langue, et qu’il suffit d’évoquer pour renvoyer à des significations extrême-
ment structurées dans nos inconscients.
Dès le départ, la propagande moderne s’intéressa aux expériences de
Pavlov, tentant d’en appliquer la méthode à la manipulation des masses.
Les concepts de Jung seront parmi les ingrédients les plus employés par la
propagande politique des partis totalitaires dès l’entre-deux guerres21. On
aurait ainsi une indication de ce que les manipulateurs d’aujourd’hui n’ont
pas renoncé à ces vieilles recettes.
Qu’il soit évident que le contenu des dialogues entre la tour de
contrôle et le pilote de l’avion n’ait pu d’aucune façon nous informer sur
28 LA NuiT RwANDAiSe N°3 • MiCHeL SiTBON, À propos de L’attentat...
l’identité des tueurs n’aura pas gêné Smith qui prétendait y chercher des
preuves de l’action d’un commando du FPR. exactement comme Barril
dix ans auparavant.
L’intention de ceux qui posent à répétition de prétendues boîtes noires
au milieu des débats est en fait transparente : il ne s’agit là que de signifier
qu’il y a un mystère. Dès lors que l’idée du mystère est installée dans l’es-
prit du public, n’importe quel scénario est plausible. il y a dix ans, la diver-
sion opérée par Barril en présentant sa fausse boîte noire à la télé avait suf-
fisamment semé de trouble dans le dossier, même si le tuyau devait aussi-
tôt s’avérer percé, pour que Smith puisse faire paraître ses élucubrations
dans Libération sans même tenir compte des informations publiées par
Braeckman dans Le soir. La journaliste belge avait pourtant simplement
donné la clef du mystère, bonne ou mauvaise. Dès lors on aurait dû passer
dans une deuxième phase de l’enquête : il y aurait eu, par exemple, à véri-
fier si les éléments du témoignage crédible qu’elle rapportait correspon-
daient à la réalité.
Quinze ans après, cette information originelle due à Colette Braeckman
prend figure comique quand on voit que le fameux Étienne, soldat français
nommément dénoncé pour être l’un des deux exécutants du « contrat », n’a
toujours pas été interrogé, et n’aura même pas eu besoin ne serait-ce que de
fournir un alibi. La Mission d’information parlementaire a travaillé imper-
turbablement pendant six mois sans qu’un seul député n’ait l’idée de
s’étonner de l’absence de réponse de l’armée face à cette accusation d’une
extrême gravité reprise pourtant par l’ensemble des critiques, et dont on
sait que les députés avaient connaissance.
On n’en était plus à spéculer.
et c’était bien le problème. Pour se protéger de cette avancée spectacu-
laire de l’enquête, les auteurs du crime devaient au contraire rouvrir d’ur-
gence l’espace de la spéculation. La boîte noire de Barril ne servait qu’à ça.
et, sur la base du trouble qu’elle avait suffi à susciter, Smith pouvait échaf-
fauder une « deuxième version » à laquelle l’État s’accroche depuis, comme
un naufragé à sa planche.
Dix ans plus tard, le problème changeait d’échelle, lorsque la mise en
accusation de la France accédait au degré de ce que nous appelons la res-
ponsabilité totale. C’est alors qu’on découvrait « l’inconcevable » – que l’ar-
mée française ait pu directement participer au génocide. Ce que permet-
taient de comprendre les témoignages recueillis par Cécile Grenier,
Georges Kapler, ou Monique Mas, auprès des rescapés et des anciens mili-
MiCHeL SiTBON, À propos de L’attentat... • LA NuiT RwANDAiSe N°3 29
taires ou miliciens rwandais, confirmés par les déclarations du général
Dallaire, le patron de la Minuar, au micro de Daniel Mermet. Des
Français ? « Il y en avait plein », « tout le long » du génocide… « Bien sûr »…22
Tout aussi important le fait que l’on dispose simultanément, grâce à
Gabriel Périés et Patrick de Saint-exupéry, de l’explication complète du
mécanisme politico-militaire du génocide – ce qu’on a appelé sa « méthodo-
logie »23. La théorie de la guerre révolutionnaire, avec ses « hiérarchies paral-
lèles » et son COS achève d’établir la forme de la responsabilité française.
Rappelons que le « Commandement des opérations spéciales », institué
en 1992, permet au président de la République de passer ses instructions
directement aux unités d’élite de l’armée, avec l’aide du chef d’état-major
des armées, en court-circuitant l’ensemble de la hiérarchie militaire. À
noter, de surcroît, que les opérations sous « COS » sont classées ultra-
secrètes. Ce dispositif aura provoqué le fait que certaines unités puissent
être considérées comme faisant partie du « COS ». On parle de « garde pré-
torienne » au service du Président.
Pour ce qui est de la « guerre révolutionnaire », on découvre à son étude
qu’il s’agit en fait de l’organisation, au sein de l’armée, d’une activité clan-
destine, avec sa propre « hiérarchie », dite « parallèle », et ses objectifs par-
ticuliers, éventuellement très différents de la politique déclarée, tout aussi
« secrets » que peuvent l’être les actions de « COS ». il n’est pas interdit de
voir le « COS » comme une forme de « légalisation » de la guerre révolu-
tionnaire : au sommet « hiérarchie parallèle » et hiérarchie officielle se
confondent.
Ces informations circonscrivent assez rigoureusement le champ de la res-
ponsabilité française pour qu’on sorte à ce sujet aussi de toute spéculation.
Là où Braeckman avait permis d’avancer sur la question de l’attentat,
l’ensemble de ces apports du dixième anniversaire permettaient de se faire
une idée beaucoup plus claire de l’implication française dans le génocide
lui-même. Dix ans après les faits, alors que la plaidoirie en défense de
Mitterrand élaborée par Paul Quilès avait fini par faire long feu et alors que
de tous côtés montait l’évidence de cette terrible responsabilité dont per-
sonne n’a encore eu sérieusement à répondre, il était absolument néces-
saire de réintroduire le doute dans l’esprit du public.
Manifestement à court d’arguments, les défenseurs du camp génocidaire
n’auront ainsi rien trouvé d’autre pour résister à l’examen du nouvel état
du dossier que le même symbole auxquels ils avaient recouru il y a dix ans
pour esquiver l’accusation sur l’attentat. La boîte noire, dès lors, devient
30 LA NuiT RwANDAiSe N°3 • MiCHeL SiTBON, À propos de L’attentat...
l’image de la négation. Dans l’inconscient, elle exprime ce qu’on souhaite
enfouir, ce qu’on ne veut pas savoir.
Si ce subterfuge n’aura pas permis d’avancer d’un pouce dans l’enquête
elle-même, il aura au moins satisfait, pendant deux mois – les deux mois
névralgiques de la commémoration du dixième anniversaire –, le désir que
les choses ne soient pas comme elles sont – un désir qui est, peu ou prou,
enfoui dans le cœur de tous. S’appuyant sur ce socle, plus pragmatique-
ment, la comédie de la boîte noire aura fait diversion, et permis d’escamo-
ter ce que disaient les rescapés ou le général Dallaire. Quant au niveau stric-
tement politique, grâce à ce pseudo-point d’interrogation, écho des gesticu-
lations de Bruguière, la diplomatie française, armée de l’indignation feinte
du Monde, pouvait se permettre de tourner le dos à ses responsabilités, et ce
jusqu’au cœur de la cérémonie de commémoration, à Kigali.
Le Monde aura alors fait tout ce qu’il pouvait pour faire passer le message
de fond, suivant lequel ces prétendues informations du juge Bruguière,
enrobées dans la boîte noire de Smith, pourraient induire la conclusion
ahurissante que la charge de la responsabilité du génocide revienne au FPR.
Puisque le FPR aurait pu commettre l’attentat, il aurait… voulu le géno-
cide… et s’il l’a voulu, osent poursuivre imperturbablement ces sophistes,
n’en a-t-il pas la responsabilité principale ?
L’avocat togolais, Jean Degli, partait exactement des mêmes prémisses
pour induire une conclusion un peu plus audacieuse, à laquelle Le Monde
n’aura pas osé entraîner ses lecteurs. il a l’avantage de plus de cohérence,
car il ne cache pas, lui, qu’il ne pense pas fondée la qualification même de
génocide. Bien sûr, le FPR n’a pas commis le génocide des Tutsi du Rwanda
poursuivi devant le Tribunal d’Arusha, puisqu’à ses yeux un tel génocide
n’a pas eu lieu et qu’il n’y a eu que des « massacres inter-ethniques », comme
dans les articles de Jean Hélène de 1994. La responsabilité principale de tels
phénomènes incontrôlables se reporterait dès lors sur le déclencheur.
Après, c’est la guerre, et l’avocat peut conclure que, dans ce cas… :
« …il y a également à poursuivre ceux qui ont commis ce qu’on
appelle les crimes de grande gravité et qui ont massacré les autres
populations du Rwanda, et notamment les Hutu et les Twa. Donc les
membres du FPR sont aussi des justiciables de ce Tribunal, en tout cas
ceux d’entre eux qui ont pu s’impliquer dans les massacres de popula-
tion. »
Nirvana de la défense : Nuremberg où comparaîtraient des généraux
russes, américains et anglais…
MiCHeL SiTBON, À propos de L’attentat... • LA NuiT RwANDAiSe N°3 31
L’attentat, cette folle prise de risque pour laquelle il n’aura fallu rien de
moins que l’incomparable sang-froid de François Mitterrand, se retourne
en divine surprise : puisque l’opération est « stérile »24, elle laisse forcément
la place à suffisamment de doutes pour prétendre en faire porter la respon-
sabilité à autrui.
il aura fallu néanmoins attendre des années, que l’attentat se rattache
bien au génocide, dans l’esprit du public comme chez l’ensemble des cher-
cheurs, pour que soit osée la monstruosité conceptuelle d’en déduire que,
du coup, le FPR serait le responsable du génocide. et pourquoi pas son
auteur, tant qu’on y est ? C’est d’ailleurs bien la conclusion que tirent les
défenseurs des génocidaires, lorsqu’ils se réunissent en colloque négation-
niste à la Sorbonne, par exemple. D’ailleurs, précisent-ils, toujours imper-
turbablement logiques, on a mal compris : ce sont des Hutu qui ont été
tués, deux ou trois millions, plutôt que des Tutsi, 50 000 tout au plus, la
plupart tués par le FPR d’ailleurs…
Ainsi la boucle est bouclée. La farce négationniste commence bien dans
les contorsions hypothétiques autour de l’attentat, dont les auteurs sont
réduits à inventer des boîtes noires pour faire diversion.
il n’a encore été répondu à aucune des questions souvent formulées, ici
ou ailleurs. Au résultat de ces diversions à coups de symboles absurdes et
de rapports bidons, la responsabilité personnelle de François Mitterrand
dans cet attentat aura été encore moins abordée que celle de sa responsabi-
lité dans la conduite de la politique du génocide.
C’est l’« hypothèse forte », que rien de sérieux n’a contredit à ce jour,
d’une responsabilité du parti génocidaire y compris dans l’attentat qui per-
met de qualifier celui-ci de déclencheur. Au sens où ce fut effectivement le
coup de feu qui donna le départ de l’exécution du génocide. Lequel était
planifié de longue date, ce dont atteste non seulement la redoutable effica-
cité de sa mise en œuvre, mais de nombreuses sources antérieures, ainsi que
l’ensemble des études approfondies réalisées depuis. Pour que « la machine
à tuer »25 puisse donner son plein rendement, il lui fallait un détonateur, un
événement qui lui donne son élan.
Si François Mitterrand a choisi – parmi les divers événements détona-
teurs que pouvaient lui proposer les techniciens de la « guerre révolution-
naire » –, celui qui supposait la mort d’Habyarimana dont il se disait l’ami
depuis tant d’années, c’est d’abord parce qu’il s’agissait de son ami. Ainsi,
il se fabriquait son alibi personnel.
ensuite, comme on l’a vu, une telle manœuvre, déstabilisant l’État rwan-
dais, permettait d’instaurer le trouble nécessaire au déploiement d’un
crime sans responsabilités apparentes.
32 LA NuiT RwANDAiSe N°3 • MiCHeL SiTBON, À propos de L’attentat...
Mais, surtout, la possibilité d’abattre Habyarimana en plein ciel ouvrait
la voie à un débat sans fin – celui précisément dans lequel nous sommes
engagés aujourd’hui. On ne sait pas ce qui se passe au ciel… pas plus qu’au
fond d’une « boîte noire » imaginaire. il suffisait que les auteurs des tirs ne
soient pas pris sur le fait. Dès lors, « stérile », cette opération donnait, par
avance, du grain à moudre pour tous ceux qui voudraient bien se porter au
secours de l’armée française, ainsi qu’on a pu voir Smith, Onana ou Péan
– et Barril, et Bruguière.
il n’est pas exclu que le choix de cet élément soit intervenu assez tôt, et
explique le cadeau fastueux que la France avait tenu à faire à son « ami »,
sous la forme de cet avion des usines Dassault, destiné au chef d’un État en
guerre, où l’on aurait oublié de prévoir l’option de protection contre les tirs
de missiles – et éventuellement la traditionnelle « boîte noire », ouvrant la
voie à la tentation d’y substituer, à répétition, des boîtes fantaisistes. Qui
tombe du ciel, laisse du champ au mystère, ouvrant la possibilité d’une opé-
ration « stérile ».
Reprenons les choses à l’envers : Bagosora dit « je vais préparer l’apoca-
lypse » en août 1993, dès les accords d’Arusha. Le génocide aura lieu en
avril, huit mois plus tard, en utilisant comme prétexte une réaction de
colère à l’assassinat d’Habyarimana. Cet élément sera, mieux qu’un pré-
texte, le camouflage de l’entreprise génocidaire en « déchaînements sponta-
nés », même si, dans la pratique, les organisateurs ont dû recourir à de tous
autres arguments, pour imposer les massacres, de préfecture en préfecture.
L’attentat est partie intégrante du génocide, et c’est en ce sens que la res-
ponsabilité française y est dramatique : en plus de tout, Mitterrand aura
appuyé sur le détonateur – et ajouté à son palmarès le meurtre de deux
chefs d’État. On était loin de pouvoir l’imaginer au départ.
Ainsi François Mitterrand aurait… décidé du déclenchement du géno-
cide ! On tourne autour du pot, depuis quinze ans maintenant, pour savoir
quelle serait la part respective de la responsabilité française et des responsa-
bilités locales dans le génocide des Tutsi. On répète à l’envi que ce ne sont
tout de même pas les soldats français qui tenaient les machettes. Mais on a
vu combien les machettes auront pu servir d’alibi là où l’usage d’armes de
guerre aura assuré l’essentiel de la mortalité. On sait aussi comment l’ar-
mée a encadré de bout en bout le « déchaînement populaire » des porteurs
de machettes. On a pu vérifier également que la direction effective de cette
armée était entre les mains d’un officier français, le lieutenant-colonel
Maurin – et que celui-ci était encore au Rwanda en avril 1994. Les témoi-
MiCHeL SiTBON, À propos de L’attentat... • LA NuiT RwANDAiSe N°3 33
gnages se sont multipliés pour faire état de la présence de militaires français
« tout le long » du génocide. On sait par ailleurs qu’au-delà de cet encadre-
ment rapproché, le financement de l’armée génocidaire reposait intégrale-
ment sur l’aide française.
empruntons à Bruno Boudiguet cette image parlante : le PNB du
Rwanda est comparable à celui d’une ville comme Quimper. Que
“pesaient” Habyarimana ou Bagosora face à Mitterrand ? Pas lourd. et qui
donc pouvait prendre les décisions, les décisions ultimes ? Qui était le
patron ?
Cette responsabilité essentielle quant à la direction du génocide lui-
même, a été finalement identifiée dans les conclusions de la Commission
d’enquête citoyenne :
« S’agissant de la hiérarchie des responsabilités, la Commission
constate :
– 6.1 en tout ce qui précède, que des enquêtes complémentaires doi-
vent continuer à vérifier, la responsabilité de l’ancien Président de la
République François Mitterrand, chef des Armées, apparaît la plus
grande. »
On découvre – en écoutant les témoignages des rescapés – que François
Mitterrand pouvait regarder les images du génocide, prises de satellite – et
recommander qu’on ne laisse pas les cadavres flotter, ce qui est du plus
mauvais effet. À moins que l’on ne doive cette initiative à l’un ou l’autre de
ses assistants, du fond de leurs bureaux élyséens – ou, plus vraisemblable-
ment, à l’état-major de l’amiral Lanxade. On comprend aussi que
Mitterrand et ses collaborateurs ne manquaient pas de téléphones « sécuri-
sés » pour communiquer quotidiennement avec Marlaud ou avec Maurin.
il y aura même un téléphone, « sécurisé » aussi, apporté délicatement par
Jean-Christophe Ruffin et Gérard Prunier, afin de mettre directement en
contact Paris avec le QG de Kagamé, pour négocier Turquoise – et, semble-
t-il, la restitution d’une trentaine de soldats français, ainsi qu’on put l’ap-
prendre en marge de l’audition de Ruffin devant la CeC. [Voir à ce sujet l’ar-
ticle de Jacques Morel sur « Butaré, le 1er juillet »]
Colette Braeckman expliquait, dès 1994, qu’elle s’était décidée à publier
le témoignage incriminant des soldats français dans l’attentat, après en
avoir mûrement soupesé l’opportunité. elle avait à prendre en compte,
entre autres, les informations « selon lesquelles deux groupes de trois à cinq “spé-
cialistes” français se trouvaient toujours bloqués dans les camps de l’armée gouver-
nementale et de la gendarmerie encerclée par le Fpr ». La journaliste belge crai-
34 LA NuiT RwANDAiSe N°3 • MiCHeL SiTBON, À propos de L’attentat...
gnait alors une « intervention imminente » française pour sauver ces hommes,
dans le contexte de laquelle son informateur aurait été en danger.
Ces soldats, mis à la une de la presse mondiale, auraient pu, à eux seuls,
faire s’écrouler le mythe du retrait français fin 1993 et – de même que si le
génocide avait pris place sous la direction d’Habyarimana – cela aurait lar-
gement suffi à mettre en cause dès le départ la responsabilité personnelle
de François Mitterrand, celle de la France et de son armée, dans l’extermi-
nation des Tutsi du Rwanda.
Si, quinze ans plus tard, ces responsabilités ne devraient plus pouvoir
laisser de doute pour tout esprit impartial, le temps aura aussi apporté un
apaisement pour tous ceux que ces évidences survoltent, avec la conscience
du caractère imprescriptible de ce crime. L’urgence n’en demeure pas
moins de soigner la République des maladies qu’elle cultive depuis son ori-
gine et dont le caractère chronique n’enlève rien à la virulence.
Notes
1. Selon Dassault, fournisseur de l’avion, cette « option » permettant d’esquiver un tir « sim-
ple » aurait été omise sur le modèle livré au président rwandais – ainsi que la « boîte noire
», comme on aura l’occasion de voir plus loin.
2. Dans Rwanda : trois jours qui ont fait basculer l’histoire, de Filip Reyntjens, Cahiers africains
n° 16, page 45, L’Harmattan, 1995. Reproduits également dans les annexes du rapport de
la Mission parlementaire à qui Reyntjens les aura fourni.
3. Dans rwanda, histoire d’un génocide, Fayard, 2004.
4. ironique, mais non moins vraisemblable : après avoir participé à l’assassinat du président
burundais à Kigali, ce militaire d’élite aurait été chargé de la protection de son successeur…
excellente couverture… Le métier de chef d’État pouvait effectivement sembler à hauts
risques au Burundi, et mériter une telle « protection » : l’antérieur Président, Melchior
Ndadaye, « au profit » duquel les « actions de sécurité rapprochées » étaient censées être assu-
rées par… Paul Barril, était mort en 1993, moins d’un an auparavant.
5. Dans Rwanda : le génocide, paru aux éditions Dagorno en 1998.
6. Dans son livre Guerres secrètes à l’Élysée, Albin Michel, 1996.
7. Le plus célèbre de ces mercenaires d’Afrique, Bob Denard, a publié ses mémoires sous le
titre Corsaire de la République. « Ce n’est pas l’appât du gain ni le goût de la notoriété ou du sang
qui ont dicté mon action, mais le désir de servir mon pays », déclare-t-il en préambule. « La France
m’a soutenu ou du moins m’a-t-elle toujours laissé faire. » Foccart confirmait, en déclarant, au procès
de Bob denard, avoir toujours été au courant de ses activités, le qualifiant de « patriote qui a servi son
pays ».
8. Voir L’inavouable, page 256.
9. Le commandant Grégoire de Saint-Quentin apparaît dans ce récit anecdotiquement, sur-
tout parce qu’il est intervenu le premier pour examiner les décombres de l’attentat, et
MiCHeL SiTBON, À propos de L’attentat... • LA NuiT RwANDAiSe N°3 35
extraire les cadavres de la carcasse de l’avion. il était ainsi parmi les militaires demeurés au
Rwanda après le retrait de Noroît, toujours présent ce 6 avril 1994 donc. On ne sait pas
grand chose de plus sur lui, sinon qu’il publie de temps à autres dans la Revue de la défense
nationale dont, en 1997, un article intitulé retour à la guerre révolutionnaire ? ou, en 1998,
Mercenariat et mutations stratégiques, et, en 1999, pourquoi les forces spéciales ? Ainsi, les mili-
taires encore présents au Rwanda à l’heure du génocide n’étaient pas de simples soldats,
mais, comme on voit, de redoutables théoriciens de la guerre révolutionnaire…
10. Dans un Génocide secret d’État.
11. Ce bateau des écologistes de Greenpeace fut plastiqué, en 1985, en Nouvelle Zélande,
pour qu’un essai nucléaire français en préparation à Mururoa ne soit pas encombré de leur
présence. il y eut un mort, un photographe présent sur le bateau au moment de son plasti-
cage par une équipe de nageurs de la DGSe. Ces derniers seront même capturés, et le minis-
tre de la défense, Charles Hernu, servira alors de fusible à Mitterrand.
12. Voir Pierre Péan : Un certain docteur Martin, Une jeunesse française.
13. en dépit de ce fiasco, Mitterrand aurait-il inspiré De Gaulle auquel le même genre de
mésaventure opportune bénéficiera fantastiquement quelques temps plus tard – au Petit
Clamart ? Rappelons qu’au départ De Gaulle n’avait pas osé instituer l’élection du Président
au suffrage universel. C’est grâce à l’émotion suscitée par cet attentat qu’il pourra faire adop-
ter, par Référendum, cet « ajout » dans la Constitution de la Vème République, instituant
la monarchie républicaine dont la France est encore affligée.
14. À l’occasion d’un colloque, à Paris, le 4 avril 2003, dans une salle louée aux Champs
Élysées, véritable répétition du colloque qui se tiendra un an plus tard à la Sorbonne [voir
notre article, « le 6 avril 1994 », dans LNR2]. Jean Degli a dû démissioner de sa charge d’avo-
cat commis d’office par le Tribunal, accusé d’un détournement de 300 000 dollars. il aurait
simplement fait désigner comme assistante une femme qui n’aurait eu pour diplôme d’avo-
cate qu’une fausse attestation obtenue par maître Degli auprès du barreau de… Paris. On
apprend au passage que les honoraires perçus par les avocats de la défense – et même par
leurs assistants – peuvent être relativement fastueux – et pris en charge par le budget du tri-
bunal. un autre avocat avait dû précédemment démissioner lorsqu’on s’était aperçu qu’il
surfacturait de façon à reverser 2 500 dollars par mois à son client…
15. Les secrets du génocide rwandais, enquête sur les mystères d’un président. Premier livre de
Charles Onana, publié chez Duboiris en 2002.
16. Cf. l’article « Forfaiture », publié dans le n°2 de La lettre de la nuit rwandaise.
17. On voit là d’ailleurs typiquement les limites de la mythologie gaullienne sur le monde
« multipolaire » dont sa politique se prétendait l’expression.
18. Avec la FiDH et Human Rigts watch.
19. Faut-il souligner l’importance du lieutenant-colonel Jean-Jacques Maurin dans l’ensem-
ble des opérations ? Au Rwanda depuis 1992, il a, peu de temps après son arrivée, remplacé
son supérieur hiérarchique, le lieutenant-colonel Chollet. il aura dès lors, officiellement, la
fonction de conseiller à la fois du Président Habyarimana et du Chef d’état-major de l’ar-
mée rwandaise, le colonel Serubuga « qu’il suivait dans tous ses déplacements », selon ses pro-
pres déclarations à la mission parlementaire.
20. S’il s’agissait de la même boîte livrée à Dallaire, il faut conclure que cette boîte aussi
aurait été fausse… Ce qui aurait au moins le mérite de coller avec les déclarations du fabri-
quant, Dassault, qui disait que cet avion n’en avait pas été équipé. Apporter une fausse boîte
à la Minuar aurait été dans ce cas une façon pour les assassins de couper court à toute
enquête : la seule pièce à conviction éventuellement utile dans une telle circonstance n’étant
plus à rechercher. Quant à Dassault peut-être témoignait-il de façon absurde de l’inexistence
36 LA NuiT RwANDAiSe N°3 • MiCHeL SiTBON, À propos de L’attentat...
des boîtes reconnues par Rannou, pour dissuader de les chercher ?
21. Serge Tchakotine dressera alors un inventaire assez large de ces méthodes dont il recom-
mandait l’application dans Le viol des foules par la propagande politique, réédité ces dernières
années en poche par Gallimard. Tchakotine avait essayé de convaincre la social-démocratie
allemande de recourir à cet arsenal pour résister à l’ascension d’Hitler, suggérant que celle-
ci ne pouvait être empêchée que si l’on employait les mêmes armes que l’adversaire. il trou-
vera de l’écho en France, en particulier dans l’extrême-gauche pivertiste de la SFiO.
22. Voir, dans le numéro 2 de La nuit rwandaise, notre article intitulé « Le 6 avril 2004 »
23. « L’invention des races rwandaises et de leur affrontement est celle des missionnaires. Le permis de
tuer a été donné de fait par l’eglise », précise Morel. « de plus elle a fourni les locaux pour l’abat-
tage », ajoute-t-il. À ne pas oublier bien sûr, à l’heure où l’on examine la monstruosité du
déploiement de la guerre révolutionnaire. L’eglise aussi y est pour quelque chose. et pas
qu’un peu. Si l’on doit au colonel Marlières l’inspiration d’appliquer la « guerre révolution-
naire » au Rwanda dès 1954, il ne faut pas sous-estimer pour autant l’importance décisive de
Mgr Perraudin, qui pilotera le régime raciste hutu pendant plus de trente ans.
24. Selon les termes d’un militaire, déconseillant à Patrick de Saint-exupéry de chercher
dans cette voie. une opération est dite « stérile » lorsqu’elle ne laisse aucune trace – aucune
pièce à conviction, bref, aucune façon de remonter aux commanditaires. Voir L’inavouable,
éditions des Arènes. il semblerait qu’une des choses qui garantisse cette « stérilité » soit, en
cette matière comme en toute autre, la qualité de l’omerta qui fait que jamais aucun mili-
taire ne parle. et même comme ça, on parle toujours trop : ainsi, en faisant valoir la « stéri-
lité » de l’opération, ce militaire ne se rendait peut-être pas compte du fait que son propos
constituait un aveu…
25. Ainsi que Colette Braeckman l’a appelée, dans son Histoire d’un génocide, parue chez
Fayard en 1994, quelques mois après l’événement. Cette « machine à tuer » a été depuis
méticuleusement décrite par Alison Des Forges et les enquêteurs d’Human Rights watch,
dans leur rapport monumental, aucun témoin ne doit survivre, publié chez Khartala.
Vous aimerez peut-être aussi
- La Nuit Rwandaise N°4Document498 pagesLa Nuit Rwandaise N°4La Nuit rwandaisePas encore d'évaluation
- LNR8 Francois Graner - L'attentat Du 6 Avril 1994Document48 pagesLNR8 Francois Graner - L'attentat Du 6 Avril 1994Izuba.infoPas encore d'évaluation
- La Nuitrwandaise 2Document417 pagesLa Nuitrwandaise 2La Nuit rwandaise100% (1)
- Gouteux ColombaniDocument8 pagesGouteux Colombanisl.aswad8331Pas encore d'évaluation
- Rapport D'enquete Sur Les Causes, Les Circonstances Et Les Responsabilites de L'attentat Du 06/04/1994 Contre L'avion Presidentiel Rwandais Falcon 50 #9XR-NNDocument186 pagesRapport D'enquete Sur Les Causes, Les Circonstances Et Les Responsabilites de L'attentat Du 06/04/1994 Contre L'avion Presidentiel Rwandais Falcon 50 #9XR-NNKagatamaPas encore d'évaluation
- Rapport RDC s603 2009Document294 pagesRapport RDC s603 2009La Nuit rwandaisePas encore d'évaluation
- Cécile Grenier - CarnetsDocument54 pagesCécile Grenier - CarnetsLa Nuit rwandaisePas encore d'évaluation
- Le Regard de Ryszard Kapuscinski Sur L Cycle 20074Document15 pagesLe Regard de Ryszard Kapuscinski Sur L Cycle 20074Mahad AbdiPas encore d'évaluation
- Cécile Grenier - CarnetsDocument54 pagesCécile Grenier - CarnetsLa Nuit rwandaisePas encore d'évaluation
- Catalogue IzubaDocument24 pagesCatalogue IzubaIzuba.infoPas encore d'évaluation
- La France Au Cœur Du Génocide Des TutsiDocument2 pagesLa France Au Cœur Du Génocide Des TutsiIzuba.infoPas encore d'évaluation